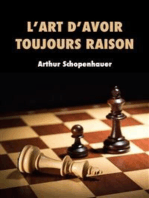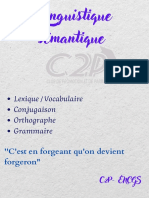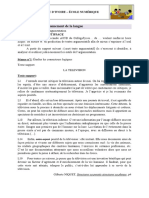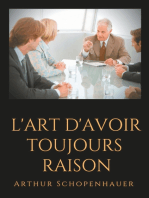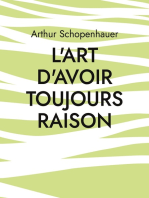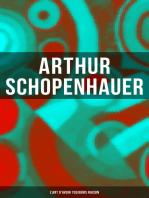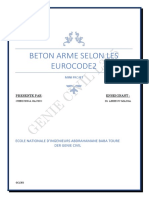Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Révision Générale Le Requisitoire
Révision Générale Le Requisitoire
Transféré par
ducray.acmTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Révision Générale Le Requisitoire
Révision Générale Le Requisitoire
Transféré par
ducray.acmDroits d'auteur :
Formats disponibles
Révision générale : le réquisitoire.
Définition :Discours ou texte qui accuse qqn ou qqch en donnant le détail de ses fautes
ou imperfections.
Type de texte : Argumentatif.
Genre : un réquisitoire.
Visée communicative : dénoncer pour convaincre.
La thèse : la thèse est le point de vue défendu par l’auteur ou l’autrice tout au long d’un
texte argumentatif. Il s’agit de sa prise de position par rapport à un sujet controversé,
un débat de société qui ne fait pas l’unanimité. C’est le point de vue duquel l’auteur ou
l’autrice cherche à convaincre son ou sa destinataire.
Une thèse explicite est clairement énoncée dans le texte. On la repère facilement, sans
avoir besoin de faire des inférences ou de recourir à la déduction, puisqu’elle est inscrite
mot pour mot dans le texte.
Une thèse implicite est sous-entendue. Elle n’est pas directement mentionnée dans le
texte, mais le lecteur ou la lectrice peut la comprendre par déduction.
Les arguments : les arguments sont les raisons qui sont énoncées pour appuyer la thèse
d’un texte argumentatif. C’est ce que l’auteur ou l’autrice utilise pour convaincre son ou
sa destinataire d’adhérer à son point de vue.
Pour dégager les arguments d’un texte argumentatif, il est possible de se poser la
question suivante : Pourquoi l’auteur ou l’autrice pense-t-il ou pense-t-elle que…
[thèse] ?.
L’antonymie :
Les mots antonymes sont des mots qui appartiennent à la même classe, mais dont la
signification est opposée.
Il y a plusieurs manières de former les antonymes.
1. Certains sont des mots complètement différents (petit/grand,
monter/descendre).
2. D’autres sont formés par dérivation, avec l’ajout
d’un préfixe (ordre/désordre, réel/irréel, adroit/maladroit).
3. Il est aussi possible de former des antonymes en alternant
des préfixes ou
des suffixes (hypothermie/hyperthermie, émigrer/immigrer,
anglophile/anglophobe).
Des antonymes employés dans la même phrase créent des effets stylistiques. Ils peuvent
participer aux figures de style d’opposition.
L’expression de l’opposition
Exprimer une opposition, c’est évoquer un fait dont la réalisation est contraire à un
autre fait.
La langue ne manque pas d’outils qui permettent d’exprimer l’opposition, des outils
particulièrement utiles à connaître pour produire une argumentation.
1. Exprimer l’opposition à l’aide d’une proposition subordonnée conjonctive
• L’opposition peut être exprimée par une proposition subordonnée conjonctive, qui
précède, coupe ou suit la proposition dont elle dépend.
Cette proposition subordonnée est le plus souvent introduite par les locutions
conjonctives bien que ou quoique, suivies du subjonctif.
Ex. : Bien que personne n’avoue y croire vraiment, tout le monde tient compte des
superstitions.
• La subordonnée d’opposition peut également être introduite par :
Alors que, quand, tandis que, qui ajoutent une nuance temporelle et qui nécessitent
l’emploi de l’indicatif ; ex. : Alors que rien ne le justifie vraiment, on évite de passer sous
une échelle ;
Si et même si, qui nécessitent l’emploi de l’indicatif ; ex. : Si le chiffre 13 porte malheur
aux yeux de certains, il est gage de bonheur pour d’autres ;
Quand (bien) même qui appartient au registre de langue soutenu et qui nécessite
l’emploi du conditionnel ; ex. : Quand bien même vous croiseriez un chat noir, il ne vous
arriverait pas malheur pour autant ;
Tout… que, suivi de l’indicatif, et si (pour, quelque)… que, suivi du subjonctif, qui
encadrent un nom ou un adjectif et qui appartiennent au registre soutenu ; ex. : Tout
vaillant qu’il est, Hector craint les vampires.
• Il convient de ne pas employer la locution conjonctive malgré que, jugée incorrecte.
2. Utiliser d’autres procédés
D’autres constructions permettent l’expression de l’opposition.
a) Les compléments circonstanciels d’opposition dans la phrase simple
Une circonstance d’opposition peut aussi être :
Un nom ou un groupe nominal introduit par les prépositions ou les locutions
prépositives malgré, au lieu de, en dépit de, etc. ; ex. : Malgré la peur qu’elle inspire,
l’araignée du soir apporterait de l’espoir ;
Un infinitif ou un groupe infinitif introduit par les prépositions ou les locutions
prépositives sans, au lieu de, loin de, etc. ; ex. : Loin d’être un danger, l’araignée du soir
offrirait un espoir ;
Un gérondif ou un groupe gérondif (renforcés parfois par les adverbes tout ou même) ;
ex. : Même en gardant sur soi un trèfle à quatre feuilles, on n’est pas sûr d’avoir de la
chance.
b) Autres constructions
• Pour exprimer explicitement l’opposition, on peut utiliser :
Deux propositions indépendantes coordonnées par et, mais, or, cependant, néanmoins,
pourtant, toutefois, etc. ; ex. : Il vaut mieux ne pas se marier en août, dit-on ; pourtant
de nombreux couples choisissent le mois de Marie pour convoler en justes noces ;
Une proposition subordonnée relative introduite par un pronom relatif indéfini (qui que,
quoi que, où que) ; ex. : Certaines personnes fatalistes sont persuadées que, quoi que
l’on fasse, il est impossible de conjurer le mauvais sort.
L’expression du but
Le but est le résultat, l’objectif que l’on cherche à atteindre. Son expression se fait par
l’intermédiaire d’un complément circonstanciel de but.
Le complément circonstanciel de but est un complément qui nous renseigne sur la
finalité, le but dans lequel une action est menée. Il répond à la question dans quel but ?
Ce complément peut être une proposition infinitive :
Exemple : Je joue pour gagner.
Ce complément peut être une proposition subordonnée :
La proposition subordonnée, complément circonstanciel de but, est appelée proposition
subordonnée circonstancielle finale. Elle est introduite par des locutions comme – afin
que -, - pour que -, - de peur que -, - de crainte que -. Le verbe est conjugué au mode
subjonctif.
Exemple : Elle parle fort afin que tout le monde entende.
Les modalisateurs : vocabulaire valorisant ou dévalorisant
Le modalisateur permet ainsi de marquer le jugement, le doute, l’admiration ou la
révolte, etc.
Les modalisateurs peuvent être :
Des indices d’opinion, de jugement (verbes, adverbes) ;
Des marques affectives (termes impliquant une émotion ou un sentiment) ;
Des termes évaluatifs (vocabulaire valorisant/dévalorisant, comparatif/superlatif, etc.) ;
Un modalisateur est un mot qui traduit l’appréciation du locuteur sur son propre
énoncé. Les modalisateurs sont les mots qui traduisent la marque du jugement du
locuteur.
Le modalisateur permet ainsi de marquer le jugement, le doute, l’admiration ou la
révolte, etc.
Les modalisateurs peuvent être :
Des indices d’opinion, de jugement (verbes, adverbes) ;
Des marques affectives (termes impliquant une émotion ou un sentiment) ;
Des termes évaluatifs (vocabulaire valorisant/dévalorisant, comparatif/superlatif, etc.) ;
Le temps choisi.
1. Le vocabulaire valorisant ou mélioratif
Pour exprimer un jugement positif sur un être ou une chose, on choisit :
Des verbes d’appréciation qui sous-entendent un jugement positif ;
Exemples : aimer, adorer, admirer, contempler, préférer, choisir, etc.
Des adverbes marquant un jugement de valeur positif ;
Exemples : bien, délicieusement, magnifiquement, parfaitement, superbement, etc.
Des noms valorisants pour désigner un être ou une chose (choisis dans la liste des
synonymes) ;
Exemples : « Une demeure » est plus valorisant que « une cabane ».
Des adjectifs mélioratifs donnant une impression positive ;
Exemples : « Des couleurs éblouissantes » est plus valorisant que « des couleurs criardes.
»
Des préfixes et suffixes ayant une valeur méliorative.
Exemples : extraordinaire, célébrissime, archiconnue.
2. Le vocabulaire dévalorisant ou péjoratif
Pour exprimer un jugement négatif sur un être ou une chose, on choisit :
Des verbes d’appréciation qui sous-entendent un jugement péjoratif ;
Exemples :
Détester, haïr, redouter, craindre
Des adverbes marquant un jugement de valeur négatif ;
Exemples :
Mal, malencontreusement, malheureusement, affreusement
Des noms dévalorisants pour désigner un être ou une chose ;
Exemple :
« Une masure » est dévalorisant par rapport à « une maison »
Des adjectifs péjoratifs donnant une impression négative ;
Exemple :
« Des remarques dérisoires » est dévalorisant par rapport à « d’infimes remarques. »
Des préfixes et suffixes ayant une valeur péjorative.
Exemples :
Jaunâtre, fadasse, noiraud, vieillot, etc.
Vous aimerez peut-être aussi
- Ebook Mercedes Ron A Contre Sens T4 ConfianceDocument210 pagesEbook Mercedes Ron A Contre Sens T4 ConfianceSaotraniaina Rakotoarimanana100% (1)
- L’Art d’avoir toujours raison: Premium EbookD'EverandL’Art d’avoir toujours raison: Premium EbookÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (2)
- Législation Et Organisation Publicitaire Au MarocDocument29 pagesLégislation Et Organisation Publicitaire Au MarocEl Fadil Harrouni67% (3)
- EXPRIMER ET NUANCER SON OPINION CoursDocument4 pagesEXPRIMER ET NUANCER SON OPINION Coursradouan kaddouriPas encore d'évaluation
- C1 II S Assertion EmphaseDocument6 pagesC1 II S Assertion EmphaseAlexandru BordeaPas encore d'évaluation
- Cours D2Document7 pagesCours D2Hadji KalonjiPas encore d'évaluation
- ArgumentationDocument54 pagesArgumentationMes FarPas encore d'évaluation
- Le Texte ArgumentatifDocument13 pagesLe Texte Argumentatifcarinebechara1785Pas encore d'évaluation
- Récap LinguistqueDocument43 pagesRécap Linguistquesirox 1Pas encore d'évaluation
- Texte ArgumentatifDocument2 pagesTexte ArgumentatiffionashapellPas encore d'évaluation
- Cours ArgumentationDocument3 pagesCours Argumentationybqq528dgpPas encore d'évaluation
- L'ArgumentationDocument10 pagesL'Argumentationpeinture09100% (1)
- Texte ArgumentatifDocument4 pagesTexte ArgumentatifHidour AhmedPas encore d'évaluation
- Les Formes de Largumentation1Document2 pagesLes Formes de Largumentation1Ndamba PrincePas encore d'évaluation
- Déchiffrer Un Texte Argumentatif - Boîte À OutilsDocument2 pagesDéchiffrer Un Texte Argumentatif - Boîte À OutilsJohn SmartsonPas encore d'évaluation
- Synthèse Prod 3 OkDocument3 pagesSynthèse Prod 3 OktheomainilPas encore d'évaluation
- Fiche Règles Gram À Savoir en 3PM Temps DéterminantDocument6 pagesFiche Règles Gram À Savoir en 3PM Temps DéterminantMaelys DaultPas encore d'évaluation
- HLP - Procédés Rhétoriques de La PersuasionDocument2 pagesHLP - Procédés Rhétoriques de La PersuasionCelinePas encore d'évaluation
- Ob - b2bc29 - Seance 2 Les Connecteurs ArgumentatifDocument6 pagesOb - b2bc29 - Seance 2 Les Connecteurs Argumentatifhouda111456Pas encore d'évaluation
- La Négation CoursDocument5 pagesLa Négation Coursmathisg92Pas encore d'évaluation
- Dzexams Docs 5ap 904179Document6 pagesDzexams Docs 5ap 904179malikabouzida1998Pas encore d'évaluation
- Devoir de Mise À Niveau Première LangueDocument13 pagesDevoir de Mise À Niveau Première LanguemoisechoualaPas encore d'évaluation
- ArgumenterDocument4 pagesArgumenterMarc Bellagamba100% (1)
- Activités de Remédiation 2AS MélodieDocument12 pagesActivités de Remédiation 2AS Mélodienarrymene95Pas encore d'évaluation
- Présentation Simple Et Basique Vert GouttesDocument17 pagesPrésentation Simple Et Basique Vert Gouttesaissamaroc90Pas encore d'évaluation
- Le Texte ArgumentatifDocument10 pagesLe Texte ArgumentatifCezar-George Badale0% (1)
- Cours Du Francais L - ArgumentationDocument56 pagesCours Du Francais L - ArgumentationLinda ToumiPas encore d'évaluation
- Enonciation CoursDocument2 pagesEnonciation CoursMostafa AmriPas encore d'évaluation
- Le Ne ExplètifDocument8 pagesLe Ne ExplètifcuriosidadesPas encore d'évaluation
- Types Et Formes de PhrasesDocument3 pagesTypes Et Formes de PhrasesTobenna AstleyPas encore d'évaluation
- Texte Argumentatif Cours Français 3 Cpi 2020-2021Document8 pagesTexte Argumentatif Cours Français 3 Cpi 2020-2021Ken Kun100% (4)
- FRancesDocument7 pagesFRancesErnesto BecaPas encore d'évaluation
- Argumentation 3e CoursDocument3 pagesArgumentation 3e Courscarinebechara1785Pas encore d'évaluation
- Construire Une ArgumentationDocument4 pagesConstruire Une ArgumentationCăliman DenisPas encore d'évaluation
- Le Texte Argumentatif-2 - Correction)Document11 pagesLe Texte Argumentatif-2 - Correction)carinebecharaPas encore d'évaluation
- Cours FrançaisDocument11 pagesCours FrançaisLoic SikamPas encore d'évaluation
- LexiqueDocument5 pagesLexiquemallekini NazihaPas encore d'évaluation
- La PhraseDocument6 pagesLa PhrasemedPas encore d'évaluation
- Adj. (Suite)Document2 pagesAdj. (Suite)hamzaabderh12Pas encore d'évaluation
- Revision Generale 2017Document4 pagesRevision Generale 2017Reine De SabaPas encore d'évaluation
- Texte Argumentatif PresentationDocument5 pagesTexte Argumentatif PresentationMouad ChoummaPas encore d'évaluation
- Phrase ÉtendueDocument19 pagesPhrase Étenduebarka bouchra100% (1)
- Coup D'oeil Francais CafopDocument42 pagesCoup D'oeil Francais CafopK LandryPas encore d'évaluation
- 0le Texte ArgumentatifDocument6 pages0le Texte ArgumentatifDiana PanteaPas encore d'évaluation
- La Révision FinaleDocument11 pagesLa Révision FinaleCherad Nada100% (2)
- 6 L'adjectif Et Le Pronom IndéfiniDocument8 pages6 L'adjectif Et Le Pronom IndéfiniAlexandru HorneaPas encore d'évaluation
- Le Champ Sémantique Et Les Différents SensDocument6 pagesLe Champ Sémantique Et Les Différents Sensnada benPas encore d'évaluation
- 4e Langue Les Adjectifs Et Les AdverbesDocument3 pages4e Langue Les Adjectifs Et Les Adverbesben.boughaziPas encore d'évaluation
- CM Stylistique de La ProseDocument10 pagesCM Stylistique de La ProseGuillaume BASTIENPas encore d'évaluation
- ACTIVITE: Perfectionnement de La Langue: Seconde Francais Côte D'Ivoire - École NumériqueDocument7 pagesACTIVITE: Perfectionnement de La Langue: Seconde Francais Côte D'Ivoire - École NumériqueAboubacar KamagatePas encore d'évaluation
- Glossaire Terminologique de Grammaire Linguistique PDFDocument7 pagesGlossaire Terminologique de Grammaire Linguistique PDFJSPas encore d'évaluation
- Techniques D'expression FrançaiseDocument12 pagesTechniques D'expression Françaisecare upPas encore d'évaluation
- Caracteristiques Du Texte ArgumentatifDocument1 pageCaracteristiques Du Texte ArgumentatifSalim SaliimPas encore d'évaluation
- Figures de Rhã©torique - Niveau 1Document3 pagesFigures de Rhã©torique - Niveau 1leaPas encore d'évaluation
- Ecrit Argumentatif Corrige ApplicationsDocument6 pagesEcrit Argumentatif Corrige ApplicationsdvdmanguilPas encore d'évaluation
- Gram MaireDocument19 pagesGram MaireGhizlane DaifPas encore d'évaluation
- L'Art d'avoir toujours raison: un essai de dialectique éristiqueD'EverandL'Art d'avoir toujours raison: un essai de dialectique éristiqueÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (2)
- L'Art d'avoir toujours raison: une oeuvre du philosophe allemand Arthur Schopenhauer qui traite de l'art de la controverseD'EverandL'Art d'avoir toujours raison: une oeuvre du philosophe allemand Arthur Schopenhauer qui traite de l'art de la controversePas encore d'évaluation
- Arthur Schopenhauer: L'Art d'avoir toujours raison: La dialectique éristiqueD'EverandArthur Schopenhauer: L'Art d'avoir toujours raison: La dialectique éristiqueÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (195)
- Le Participe passé dans tous ses états: Petit traité de l'Accord du Participe passé avec être et avoirD'EverandLe Participe passé dans tous ses états: Petit traité de l'Accord du Participe passé avec être et avoirPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Etude VRD Du LotissementDocument177 pagesRapport de Stage Etude VRD Du LotissementKHELOUFI MEROUANEPas encore d'évaluation
- Hydrogeologie Notions CoursiupgsiDocument26 pagesHydrogeologie Notions CoursiupgsiomaroutPas encore d'évaluation
- Cheickna SackoDocument27 pagesCheickna SackoCheicknaPas encore d'évaluation
- Le Changement Par La Voie PacifiqueDocument32 pagesLe Changement Par La Voie Pacifiqueelmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- Guideetu2019 20Document171 pagesGuideetu2019 20Hyacinthe KossiPas encore d'évaluation
- Book OaaDocument2 pagesBook OaaEYOLPas encore d'évaluation
- Agua Salada - PartesDocument6 pagesAgua Salada - PartesSergio Andrade GuevaraPas encore d'évaluation
- Ms GC Kies+ChikhDocument182 pagesMs GC Kies+Chikhyasminezenasni08Pas encore d'évaluation
- Formation Excel Niveau 2Document2 pagesFormation Excel Niveau 2dossougoin100% (1)
- Livret PhonetiqueDocument15 pagesLivret PhonetiquedrevetphPas encore d'évaluation
- Observations Sur Lemploi de Ladobe Du PiDocument23 pagesObservations Sur Lemploi de Ladobe Du Piarepsm.maisonartsPas encore d'évaluation
- Règlement TOMBOLA Tchin Lait 2021Document5 pagesRèglement TOMBOLA Tchin Lait 2021fun momentsPas encore d'évaluation
- 10.implémentation Des Services de Fichier Et D'impressionDocument20 pages10.implémentation Des Services de Fichier Et D'impressionsalma ezzPas encore d'évaluation
- A IX-A Floares Planificare UnitatiDocument11 pagesA IX-A Floares Planificare UnitatiDana Floares100% (1)
- Seul Avec Dieu - Rédécouvrir La Puissance Et La Passion de La Prière - John MacArthurDocument137 pagesSeul Avec Dieu - Rédécouvrir La Puissance Et La Passion de La Prière - John MacArthurNic Iwandza50% (2)
- Dar Al Islam 8Document114 pagesDar Al Islam 8jesusPas encore d'évaluation
- Guide r2d2 AltayaDocument24 pagesGuide r2d2 AltayaFranck JeannePas encore d'évaluation
- PDFDocument5 pagesPDFSidoine Aka100% (1)
- Communique GbagboDocument1 pageCommunique GbagboLa Nouvelle TribunePas encore d'évaluation
- Anti-Hbc Ii: SystemDocument6 pagesAnti-Hbc Ii: SystemDaouf AlamiPas encore d'évaluation
- Relation Soignant SoigneDocument36 pagesRelation Soignant Soigneۥٰۥٰۥٰ ۥٰۥٰۥٰPas encore d'évaluation
- Première Chapitre CcgatDocument12 pagesPremière Chapitre CcgatIsmail JeuPas encore d'évaluation
- Guide Des Ressources HumainesDocument9 pagesGuide Des Ressources HumainesAdel BelakhdarPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - La Conduite D'une Action VenteDocument24 pagesChapitre 3 - La Conduite D'une Action VenteChayma RouebhiaPas encore d'évaluation
- Warhammer Chroniques Livre 1Document25 pagesWarhammer Chroniques Livre 1Pillonel ChristophePas encore d'évaluation
- Tdee 104 PDFDocument109 pagesTdee 104 PDFSlim JendoubiPas encore d'évaluation
- At TaqwaDocument22 pagesAt Taqwanabsthetoons100% (1)
- Dossier de Presse Résidence D'artisteDocument7 pagesDossier de Presse Résidence D'artisteDani RectoPas encore d'évaluation