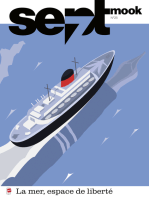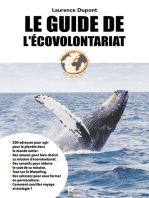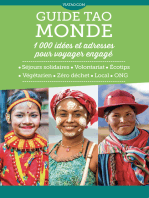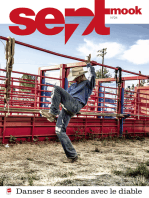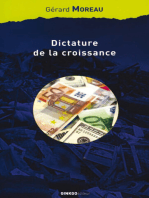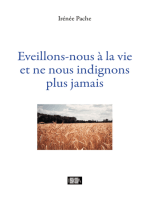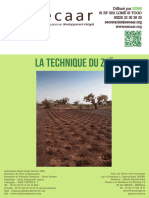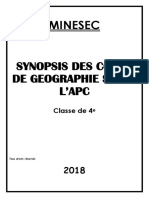Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
SUJET Voyage Tourisme Et Environnement
SUJET Voyage Tourisme Et Environnement
Transféré par
charifa.hassani08Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
SUJET Voyage Tourisme Et Environnement
SUJET Voyage Tourisme Et Environnement
Transféré par
charifa.hassani08Droits d'auteur :
Formats disponibles
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
TOUTES SPÉCIALITÉS
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
Durée : 4 heures
Aucun matériel autorisé
IINVITATION AU VOYAGE…
PREMIÈRE PARTIE : SYNTHÈSE (/ 40 POINTS)
Vous rédigerez une synthèse objective, concise et ordonnée des documents suivants :
DOCUMENT 1 : Camille Guittonneau, « Homo Touristicus : le tourisme détruit-il
l’environnement ? », Easynomics, 15juillet 2020
DOCUMENT 2 : Steve Hagimont : « Les vacances peuvent-elles être « durables » ? », Le
Monde, 4 juillet 2022
DOCUMENT 3 : Clément Guillou, « À Punta Cana, le tourisme pèse sur les ressources », Le
Monde, 27 juillet 2022
DOCUMENT 4 : Marina Fabre, infographie réalisée pour le site Novethic.fr à partir des
données de l’ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), 24 juin
2021
DEUXIEME PARTIE : ÉCRITURE PERSONNELLE (/20 POINTS)
Selon vous, le tourisme est-il un mode de voyage écologiquement responsable ?
Vous répondrez à cette question d’une façon argumentée en vous appuyant sur les
documents du corpus, vous lectures et vos connaissances personnelles.
Aurélien Pigeat – Lycée Jules Siegfried 1
DOCUMENT 1
Le tourisme dégrade-t-il l’environnement ? « En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont
polluer toutes les plages, et, par leur unique présence, abîmer tous les paysages », chantait Renaud
à propos des Français dans Hexagone. D’ailleurs, à la fin des années 2010, aller bronzer en
Espagne ou en Grèce coûtait souvent moins cher que de le faire en France. Jusqu’à l’été 2020. Cet
5 été-là, on est resté en France. Beaucoup de frontières étaient fermées, et puis, de toute manière,
peu d’avions volaient. Et puis il fallait relancer l’économie locale, fortement dépendante du
tourisme. On a alors découvert des lieux qui n’apparaissaient pas encore sur Instagram et
redécouvert une façon de voyager que beaucoup avaient oubliée. Car le tourisme, à l’ère du
numérique, alimente la pollution.
Transport : des émissions de CO2 toujours plus importantes à cause de
l’effet rebond
10 Tout voyage commence par un déplacement. Et lorsqu’il s’agit d’effectuer un voyage durant
des congés relativement courts, la solution la plus pragmatique est de prendre l’avion. Le problème
de pollution liée à l’aviation civile (2,6% des émissions de CO2, sans parler d’autres impacts en
haute altitude) est évident et déjà bien connu. Les entreprises du secteur de l’aéronautique
planchent d’ailleurs déjà sur des solutions d’alimentation moins polluantes, comme l’hydrogène,
15 depuis plusieurs années déjà. Et bien que l’industrie aéronautique soit consommatrice de
ressources, son maintien, dans une forme moins polluante, est tout à fait souhaitable. Car il ne faut
surtout pas s’interdire de voyager. En effet, l’enrichissement intellectuel procuré par le voyage ne
peut que contribuer à l’élévation humaine. D’ailleurs, les Humanistes puis les Lumières invitaient
au voyage.
20 La baisse du coût du voyage est très positive dans la mesure où elle le rend accessible à des
personnes qui n’en avaient pas les moyens. Les rapporteurs du think tank The Shift Project
établissent que « sur les 5 dernières années, le trafic mondial […] a augmenté en moyenne de 6,8%
par an, soit un doublement tous les 10 ans ». Mais la baisse du coût du voyage contribue-t-elle
réellement à la démocratisation de ce dernier ? D’après le Secours populaire, un enfant français
25 sur trois ne part pas en vacances pendant l’été. Il semble donc que la baisse des coûts ne profite
pas à tous. Le voyage étant moins cher, un public déjà en mesure de voyager peut le faire plus
souvent qu’avant tout en dépensant le même montant. On appelle ce phénomène l’effet rebond.
Les économies réalisées dans un domaine alimentent la consommation.
Le voyageur devient un consommateur. Pendant les Trente Glorieuses, le philosophe Guy
30 Debord qualifiait déjà le tourisme de produit de consommation. Il expliquait que « la circulation
humaine » était « considérée comme une consommation ». Les opérateurs de voyage ont d’ailleurs
trouvé un nouveau segment de marché : celui des voyageurs qui culpabilisent d’avoir un bilan
carbone important. Aujourd’hui, en un clic, le voyageur-consommateur peut payer un organisme
spécialisé pour planter des arbres, et, ainsi, alléger en même temps que son portefeuille ses
35 remords d’avoir parcouru des milliers de kilomètres en avion. Mais outre le fait que l’arbre mettra
des années à absorber le CO2 émis (et finira par le réémettre dans l’atmosphère après sa mort), un
tel système encourage le voyageur à consommer de nouveau. Ainsi, de par sa consommation, il
pollue toujours plus. On tombe, une fois de plus, dans l’effet rebond.
Aurélien Pigeat – Lycée Jules Siegfried 2
Logement : les géants du numérique transforment les paysages
Au lieu de se rendre à l’hôtel, le voyageur peut aujourd’hui louer une chambre chez un
40 particulier via la plateforme AirBnB. A ses débuts, l’entreprise permettait à ses utilisateurs de
louer les pièces vacantes de leurs logements à d’autres particuliers. L’entreprise a repris
l’expression « bed and breakfast » (BnB) utilisée dans l’hôtellerie et y a appliqué le préfixe
« Air ». « AirB » comme « airbed », matelas gonflable. Peu à peu, avec la complicité de la
plateforme et outrepassant parfois les lois locales, ce sont des appartements entiers qui se sont
45 retrouvé dédiés à la location. Ce sont autant de logements en moins sur le marché. Outre la hausse
des loyers qui résulte de la raréfaction des biens, on peut déplorer que les habitants et les
entreprises sont forcés de s’éloigner de plus en plus du centre-ville.
Prenons l’exemple de Paris : les fermetures de petites classes intra-muros et les travaux du
Grand-Paris reflètent l’exode des familles vers la banlieue. Or, augmenter la population en
50 banlieue, c’est risquer la bétonisation des écrins de verdure et l’étalement urbain toujours plus
destructeur de terres agricoles. Alors que la demande de résilience, notamment alimentaire, est
croissante, il convient de s’interroger sur la fuite des populations en périphérie et ses
conséquences.
Ces derniers mois, l’économiste Gaël Giraud a insisté à plusieurs reprises sur l’importance de
55 conserver des villes très denses, que ce soit pour limiter l’étalement urbain, limiter les migrations
pendulaires ou encore réaliser des économies d’énergie dans le bâti. L’urbaniste Jean Haëntjens
pointe AirBnB comme un symptôme de l’uberisation des villes. Pour satisfaire le consommateur,
il s’agit de créer une ville « à la demande ». Pour cela, on transforme des paysages urbains,
notamment pour répondre aux codes du marketing d’influence. Dans Ceci n’est pas une tulipe, le
60 critique d’art Yves Michaud dénonce le coût pour le contribuable d’une œuvre monumentale de
Jeff Koons : Bouquet of Tulips. Cette dernière, présentée comme un cadeau à la ville de Paris en
hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, a été installée aux abords des Champs
Elysées, entraînant des coûts de consolidation des sols à la charge de la Mairie de Paris. Pour Anne
Hidalgo, maire de la capitale, un tel « cadeau » contribue au prestige de la ville. Mais cette œuvre
65 contribue surtout à l’accumulation de spotsinstagramables dans la capitale. Car de la même
manière qu’ils poussent à la consommation, les réseaux sociaux, Instagram en tête, provoquent
l’envie de voyager. Ils sont responsables d’un tourisme spectacle : voyager toujours plus, se mettre
en scène.
Séjour : instagramisation du tourisme et consommation
En 2019, j’ai été témoin d’une scène qui m’a chagrinée. Ce jour-là, j’ai déjeuné dans un
70 restaurant très prisé de Pigalle. Un des rares restaurants de Paris où l’on peut encore déguster de
la bonne cuisine traditionnelle française à moindres frais. Alors que je savoure mon os à moelle,
je remarque mes voisins : un couple de jeunes voyageurs asiatiques de mon âge environ. Ils ont
fait un long voyage pour découvrir Paris. Je me réjouis pour eux. Dans cette brasserie, ils
découvrent des plats que l’on mangeait chez nos arrière-grands-parents. Ils immortalisent leurs
75 plats typiquement français avec leurs téléphones dernier cri. Ils ne rangeront pas leurs téléphones.
Au contraire, chacun passera son repas en tête à tête avec son propre cellulaire, l’écran à une
vingtaine de centimètres du visage, à faire défiler les photographies des assiettes d’inconnus sur
Instagram. Parfois, lorsque le serveur dépose un nouveau plat sur la table, ils lèvent le nez pour
capturer leur nouvelle assiette, la filtrer et la poster immédiatement sur leur réseau social préféré.
80 Ils font ainsi profiter leurs abonnés de ce très bon moment passé en amoureux, hashtag “parigram”.
Puis ils se replongent dans le monde édulcoré d’Instagram. Ainsi, nos tourtereaux n’auront pas
profité de leur repas. Ils n’en garderont pas de souvenir, sinon quelques clichés passés sous un
Aurélien Pigeat – Lycée Jules Siegfried 3
filtre. Pas beaucoup plus que leurs abonnés, en somme. Les réseaux sociaux tels qu’Instagram
incitent au tourisme spectacle. Il ne s’agit pas tant de voyager pour profiter que pour se montrer.
85 Créer du contenu et cocher des cases. Or, pour créer du contenu, il faut voyager encore et toujours
plus. Nous en revenons à la pollution causée par le trafic, notamment aérien, ainsi que par
l’étalement urbain ou encore l’accès d’un large public à des endroits fragiles.
En outre, le stockage des clichés sur les réseaux sociaux est lui-même polluant. En effet, une
photographie carrée sur Instagram mesure 1080×1080 pixels, soit environ 1,2.10 6 pixels. Pour un
90 codage en 48 bits, chaque pixel pèse 6 octets. Notre photo pèse donc environ 7.10 6 octets soit 7
Mo. D’après The Shift Project, le stockage d’un octet dans un data center coûte environ 7,2.10 -8
Wh. Le stockage d’une seule photo dans un data center nécessite une énergie de 0,5 Wh environ.
C’est autant d’énergie qu’il faut produire pour alimenter le centre. Si le centre est alimenté par des
sources d’énergie carbonées, le seul stockage de notre photo émet donc du CO 2. La même photo
95 du même monument en milliers d’exemplaires a donc un bilan carbone potentiellement important.
À l’heure où nous mettons cet article en ligne, Instagram dénombre 6,3 millions de publications
sous le hashtag « eiffeltower ». Pour stocker ces 6,3 millions de photos, ce sont plus de 3 MWh
qui sont nécessaires. Or, peu de pays bénéficient d’une électricité faiblement carbonée. Alors
qu’elles sont émettrices de CO2, les mêmes photographies prises depuis le Trocadéro, la rue de
100 l’Université ou l’avenue de Camoëns se juxtaposent. Car il faut ajouter son cliché à l’édifice. Dans
une société du spectacle, il faut rester sous les projecteurs. Quitte à imiter son voisin et rendre le
monde toujours plus uniforme.
« Homo touristicus » achète des expériences formatées et reproduit les clichés de centaines
d’influenceurs avant lui. Déjà au XIXème siècle, le philosophe Ralph Waldo Emerson dénonçait
105 les « attractions chimériques de voyages exotiques ». Il ne voyait aucun intérêt au voyage de
divertissement. Le consumérisme moderne pousse le vice encore plus loin : il ne s’agit plus
seulement de divertissement mais d’uniformisation des expériences touristiques. La journaliste
Rinny Gremaud a pu observer la « mallification », la « starbuckisation » et la « disneyification »
du monde lors d’un périple à travers les centres commerciaux les plus monumentaux de la planète.
110 Le constat est alarmant : toutes ces expériences se ressemblent. D’ailleurs, tout est fait pour
épargner aux voyageurs-consommateurs les affres de l’acclimatation. Ainsi, de l’entrée dans
l’avion jusqu’à l’intérieur des malls, le voyageur-consommateur respire l’air conditionné et
retrouve, partout, les mêmes enseignes, afin qu’il ne perde pas ses repères. L’homme n’est plus
un voyageur qui se confronte à l’inconnu, mais un consommateur qui dépense son argent.
115 Ainsi, parce qu’il favorise les émissions liées au transport, le stockage dans les data centers
ou encore l’étalement urbain, le tourisme à l’ère du numérique est particulièrement néfaste pour
l’environnement. En 2010, lors d’une conférence donnée devant les élèves du lycée Louis-le-
Grand, le philosophe Michel Serres invitait le public adolescent à détourner le regard de l’écran
et à admirer le paysage à travers le hublot lorsqu’il prendrait l’avion. C’est peut-être là la meilleure
120 façon de ne pas s’enfermer dans un écran comme nos deux jeunes touristes. C’est une façon de
commencer à nous imprégner de notre nouvel environnement. De voyager, en somme. Traiter le
voyageur en consommateur, c’est dégrader l’environnement. Traiter le voyageur en
consommateur, c’est surtout le priver de ce qui fait l’intérêt du voyage. Et si la crise du coronavirus
était l’opportunité pour nous, consommateurs, d’exiger un voyage authentique ?
125
Camille Guittonneau, « Homo Touristicus : le tourisme détruit-il l’environnement ? », Easynomics, 15juillet
2020
Aurélien Pigeat – Lycée Jules Siegfried 4
DOCUMENT 2
L’historien Steve Hagimont analyse, dans une tribune au « Monde », les relations
entre la massification du tourisme et les transformations de l’environnement.
La saison estivale débute et, avec elle, l’espoir de renouer avec les records de fréquentation
touristique de 2019. Représentant alors près de 8 % du PIB français et environ 10 % du PIB
mondial, le tourisme s’est imposé comme un secteur majeur de l’économie contemporaine. En
réponse aux enjeux écologiques présents, à tous les échelons, des entreprises aux organisations
5 internationales en passant par les collectivités et les Etats, les relances post-Covid-19 défendent
un tourisme « durable » dans lequel la croissance des flux internationaux et des revenus serait
découplée d’une empreinte écologique qui, elle, se réduirait.
Tout en précisant que le tourisme est responsable de 11 % des émissions de gaz à effet de
serre en France, le plan de relance du secteur annoncé par le premier ministre en novembre
10 2021 envisage tout de même de consolider la place du pays en tant que première destination
touristique mondiale et de gagner la première place au chapitre des recettes. La « quête
d’authenticité, de proximité » offrirait l’opportunité de « proposer un tourisme durable [qui]
devient un avantage comparatif décisif », « pour ramener vers nous encore davantage de
touristes du monde entier ».
15 L’idée qu’un tourisme bien pensé permettrait de valoriser la préservation de
l’environnement n’est pas si nouvelle. On la retrouve explicitement depuis les années 1960, au
moins. Pour répondre aux inquiétudes liées aux effets environnementaux de la croissance et à
l’urbanisation d’une société perdant ses liens avec la « nature », l’Etat a alors favorisé des
équipements qui devaient attirer et concentrer les touristes tout en évitant l’étalement : les
20 stations nouvelles des côtes languedocienne et aquitaine ou celles consacrées au ski dans les
Alpes. En même temps est engagée la politique des parcs nationaux, pensés pour concilier la
protection de derniers espaces de nature authentique et le développement économique, grâce
au tourisme, dans des régions en déprise. Le tourisme offrant de rémunérer la protection.
Des recherches, à l’exemple de celles de Guillaume Blanc, ont montré la manière dont des
25 logiques proches, appliquées dans les espaces coloniaux et postcoloniaux, ont justifié
l’expulsion des populations vivant dans les zones protégées, offertes à la consommation de
voyageurs issus des classes moyennes supérieures mondiales, dont les modes de vie sont
pourtant à l’origine de la dégradation accélérée de l’environnement terrestre. Le cercle
vertueux de la protection et de la croissance s’est transformé en cercle vicieux de dépossession
30 et de violence, pour un gain écologique finalement difficile à évaluer.
Valorisation et protection de la nature par le tourisme vont en fait dans bien des politiques
et programmes depuis des décennies désormais, en dépit de l’empreinte écologique de
l’activité. L’histoire permet en effet de documenter les transformations successives des milieux
pour les monétiser, sur un marché fortement concurrentiel, dès le XVIIIe siècle. Chemins,
35 routes, urbanisations, jetées, chemins de fer, remontées mécaniques, artificialisation de terres
agricoles, prélèvements divers sur la faune, la flore et les forêts, exposition accrue aux risques
montrent les effets qu’a eus l’admiration de la nature sur les écosystèmes.
Aurélien Pigeat – Lycée Jules Siegfried 5
Mutation radicale
À mesure que les marchés touristiques ont crû, les emprises ont, elles aussi,
systématiquement crû. Cela n’échappe d’ailleurs pas aux contemporains tel Elisée Reclus, qui,
40 en 1880, s’inquiète de la multiplication des hôtels et chemins de fer en montagne, ou les
fondateurs de la Ligue de protection des oiseaux, qui, en 1912, mettent en réserve les Sept-Iles
pour protéger les macareux des chasses touristiques. Si les contestations des équipements
touristiques restent longtemps sporadiques, la fin des années 1960 (avec la lutte pour défendre
le parc national de la Vanoise contre les stations de ski voisines) et 1970 voient se multiplier
45 les oppositions à des projets directement ou indirectement touristiques, des hôtels en sites non
bâtis aux aéroports.
À la dénonciation des effets sur les paysages, la faune et la flore se sont ajoutées, depuis
les années 1990, les inquiétudes liées aux émissions de gaz à effet de serre. Car la croissance
du tourisme est structurellement liée à celle de transports émetteurs en CO2. Après les chemins
50 de fer à vapeur, les automobiles et avions ont révolutionné la manière de penser l’aménagement
du territoire autour de routes, de parkings et d’aéroports, concernant y compris les formes
« vertes » du tourisme (tourisme rural, en réserves naturelles). Cette croissance est aussi passée
par l’artificialisation des sols, également alimentée par le développement des résidences
secondaires depuis les années 1960 en France.
55 Le tourisme est en même temps vital dans nombre de territoires où il s’est imposé, parfois
depuis plus de deux siècles, comme sans rival pour créer des emplois et maintenir la population
sur place. Tandis que les sciences sociales pointent l’enjeu de justice avec lequel devrait
composer la transformation du tourisme, l’histoire montre l’importance qu’ont eue certaines
de ses formes dans l’attention portée aux êtres et aux choses. Le tourisme est, possiblement,
60 une voie d’ouverture à la beauté et à la diversité du monde, y compris proche.
Mais le découplage que sa croissance continue imposerait repose sur des ruptures
technologiques dans les mobilités qui ne semblent guère réalistes dans le temps qui reste pour
contenir le dérèglement climatique et l’érosion du vivant. Comme la plupart des secteurs, le
tourisme devrait connaître une mutation radicale, qui sera anticipée et réfléchie ou brutalement
65 subie en raison des différents chocs, climatiques, énergétiques, sanitaires et géopolitiques, qui
viendront assurément.
Steve Hagimont : « Les vacances peuvent-elles être « durables » ? », Le Monde, 4 juillet
2022
Aurélien Pigeat – Lycée Jules Siegfried 6
DOCUMENT 3
En République dominicaine, la multiplication des infrastructures aggrave l’érosion des
côtes et la pénurie d’eau
Depuis la terrasse du club house surplombant piscine et plage immaculée, Jake Kheel passe en
revue les angoisses du moment : les sargasses, ces algues brunes des eaux caribéennes que les groupes
hôteliers tentent d’arrêter au large ; l’eau qui manque en République dominicaine et finira par limiter
la croissance touristique ; les décharges sauvages et les tonnes de déchets quotidiens, que les pouvoirs
5 publics s’avèrent incapables de collecter ; et cet océan « qui [l]’empêche de dormir la nuit » , car le
réchauffement et la pollution des eaux apportent sans relâche de nouveaux défis.
Jake Kheel dirige la Fondation Grupo Puntacana, du nom de l’empire touristique que fonda son
grand-père. Il a peu de raisons de se plaindre, mais quelques-unes de s’inquiéter. Punta Cana, jadis
une jungle inhabitée à la pointe est de la République dominicaine, est devenue un emblème mondial
10 du tourisme de masse et des dégâts environnementaux que provoque son développement anarchique.
Cet Américain élégant, diplômé en gestion environnementale, est décrit comme l’un des esprits
responsables du tourisme dominicain. En corrigeant les excès du siècle passé, il veut aussi préserver
l’avenir du groupe familial. Mais son environnement immédiat résume les contradictions de la
mission. L’accès à l’eau, par exemple. « C’est le principal problème, en raison du manque
15 d’infrastructures de traitement et d’investissements de la part du gouvernement », déplore Jake Kheel.
Derrière lui, un golf entretenu par arrosage automatique continu, où deux amies travaillent leur
gestuelle sur des greens impeccables. La consommation d’eau des hôtels du groupe s’élève à
17 000 mètres cubes par jour – dont 10 000 sont des eaux retraitées.
En République dominicaine, la disponibilité d’eau douce a baissé de 35% entre 1992 et 2014. Si
20 l’agriculture capte les quatre cinquièmes de la manne restante, le tourisme a pris sa part dans la
dégradation de cette ressource : pollution engendrée par les déchets de l’activité touristique,
déforestation et, désormais, intrusion d’eau salée causée par le pompage d’eau douce des hôtels en
bord de mer. Plusieurs régions souffrent déjà d’une pénurie d’eau, dont la frontière avec Haïti, zone
la plus sèche et pauvre du pays. Précisément celle où le gouvernement projette le plus important
25 développement touristique depuis la naissance de Punta Cana, dans un écosystème qui, de l’avis des
spécialistes, supportera difficilement l’arrivée de dizaines de milliers de visiteurs.
Manque de volonté politique
« Là-bas, à Pedernales, il n’y a ni eau ni rivières. Pour développer une zone touristique, ce peut
être un problème », souligne Max Puig, ancien ministre de l’environnement et vice-président exécutif
du Conseil national pour le changement climatique (CNCC). « À Punta Cana, la pénurie d’eau passe
30 inaperçue, car tout est vert ! Mais nous avons là un très grave problème d’intrusion saline. On autorise
des hôtels à construire cinq puits, ils en construisent huit. Les sanctions ne suivent pas toujours. »
Le président de la République en personne, Luis Abinader, a été placé à la tête du CNCC. Signe,
souligne M. Puig, de l’importance accordée aux questions environnementales dans le pays. La prise
de conscience est réelle, insiste-t-il, les lois de protection de l’environnement solides, les aires
35 protégées nombreuses, comme les institutions consacrées au sujet. Mais, derrière la façade, « il y a
des problèmes d’application ».
Le Conseil national de l’environnement, créé par une loi en 2000, s’est réuni pour la première
fois… en 2022. Le projet de loi sur l’adaptation au changement climatique, proposé il y a huit ans,
n’a jamais été adopté. Il manque à la fois des moyens et une volonté politique pour faire respecter les
40 lois sur le terrain. L’enquête d’une ONG portoricaine, le Centre de journalisme d’investigation, a
montré l’ampleur des exemptions accordées à l’industrie touristique et des délits environnementaux
tels que la destruction de mangroves et de zones humides, ou la construction à proximité du rivage,
Aurélien Pigeat – Lycée Jules Siegfried 7
n’y ont donné lieu à aucune sanction. « La loi sur l’environnement est violée constamment, soit de
manière sauvage, soit à travers des dérogations pour des permis de construire ou l’extraction de
45 sable », accuse Euren Cuevas, avocat spécialiste du droit de l’environnement. Son association,
l’Institut des avocats pour la protection de l’environnement est l’une des rares suffisamment
organisées pour s’opposer à certains projets. Le gouvernement vient de lui retirer sa maigre subvention
annuelle – 1 000 dollars. « Assumer son opposition est difficile ici, car on vous assèche
économiquement. Mais ce n’est pas comme dans d’autres pays d’Amérique centrale ou d’Amérique
50 du Sud, où l’on vous élimine physiquement », observe Euren Cuevas.
Un mois après qu’il eut tenu ces propos, le ministre de l’environnement Orlando Jorge Mera était
tué, le 6 juin, dans son bureau par un homme d’affaires auquel il avait refusé une autorisation
d’exportation de tonnes de piles usagées. Le ministre s’enorgueillissait d’avoir porté devant la justice
de nombreuses violations de permis environnementaux.
55 Le mode de pensée dominant continue à ménager autant les intérêts touristiques que
l’environnement ; jusqu’au Fonds national pour l’environnement, bras financier du ministère, dont le
directeur de la planification, Camilo Cabreja, soutient que, « compte tenu des ressources financières
que génère le tourisme, il est très important de trouver un cadre dans lequel tourisme et environnement
interagissent de manière positive », Punta Cana ? « Son développement n’a pas porté atteinte à
60 l’environnement. » Les projets de développement d’hôtels de milliers de chambres à Pedernales ? « La
biodiversité est importante là-bas, mais il faut apporter des opportunités économiques à une
population déshéritée. »
Les voix qui dénoncent l’impact du développement anarchique des années 2000 deviennent
toutefois plus audibles. Selon Elia Mariel Martinez, spécialiste de la gestion des côtes dans le pays,
65 « de nombreux promoteurs ont compris que des erreurs avaient été commises. Ils savent que, s’ils ne
font rien pour inverser le cours de la situation, leurs entreprises ne seront plus rentables ».
Perte de revenus
Car les atteintes aux mangroves, dunes et autres zones humides, associées à la montée des eaux
et à l’acidification des océans, produisent un cocktail explosif pour le tourisme. La gestion des algues
brunes est à la charge des hôteliers. Tout comme le maintien des plages de sable blanc, dont la surface
70 diminue à vue d’œil en raison de la dégradation de la barrière de corail et des perturbations apportées
à l’écosystème marin. La destruction des protections naturelles face aux événements violents rend les
réparations plus coûteuses, et leur multiplication induit à la fois des coûts et une perte de revenus –
car la saison des ouragans s’allonge. « La vision d’ensemble est effrayante », admet Jake Kheel.
L’héritier du Grupo Puntacana, dont la fondation travaille à reconstruire la barrière de corail, dit
75 faire preuve de pédagogie à l’endroit des mastodontes hôteliers espagnols qui ont conquis les côtes
dominicaines : « On leur explique que ce que l’on fait n’est pas bon pour la nature, mais aussi pour le
tourisme à moyen terme. Ce n’est pas un délire pour sauver la planète. Et ils l’entendent. »
En 2011, une étude du gouvernement dominicain avait estimé le coût, pour les finances publiques,
de l’adaptation du secteur touristique au changement climatique à seulement 780 millions de dollars
80 (731 millions d’euros) d’ici à 2030. « Au regard de ce que le secteur amasse comme richesses, c’est
tout petit, souligne David Arias Rodriguez, un acteur-clé du combat environnemental en République
dominicaine. Les écosystèmes sont proches de l’effondrement et l’industrie touristique, ici, court à sa
perte. » Et la bonne nouvelle ? « Aujourd’hui, elle le sait. »
Clément Guillou, « À Punta Cana, le tourisme pèse sur les ressources », Le Monde, 27 juillet 2022
Aurélien Pigeat – Lycée Jules Siegfried 8
DOCUMENT 4
Marina Fabre, infographie réalisée pour le site Novethic.fr à partir des données de l’ADEME (Agence De
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), 24 juin 2021.
Aurélien Pigeat – Lycée Jules Siegfried 9
Vous aimerez peut-être aussi
- Delf B2 CorrigeDocument37 pagesDelf B2 CorrigeTudor Ana86% (22)
- Compréhension Oral Document 1Document2 pagesCompréhension Oral Document 1Arunima SethiPas encore d'évaluation
- Sujet E3C Voie Techno N°1Document8 pagesSujet E3C Voie Techno N°1LETUDIANT100% (1)
- Quatre Pistes Pour Réinventer Le TourismeDocument2 pagesQuatre Pistes Pour Réinventer Le TourismeIkhlass LahmidiPas encore d'évaluation
- Compréhension Orale Tourisme de MasseDocument5 pagesCompréhension Orale Tourisme de MasseAmaiaHamaikaPas encore d'évaluation
- L Avion Plaisir Coupable Des ÉcolosDocument2 pagesL Avion Plaisir Coupable Des ÉcolosHeidi ReedPas encore d'évaluation
- Agir Ensemble Pour Un Tourisme DurableDocument64 pagesAgir Ensemble Pour Un Tourisme DurableMouna BelmouddenPas encore d'évaluation
- Le Tourisme Institutionnel Sur Internet (Comment Seduire LesDocument104 pagesLe Tourisme Institutionnel Sur Internet (Comment Seduire Lesmaison_d_hotesPas encore d'évaluation
- 2023 SELON VOUS DOIT On Condamner Le Tourisme de MasseDocument2 pages2023 SELON VOUS DOIT On Condamner Le Tourisme de MasseMoui-Lahcène AzzedinePas encore d'évaluation
- Le Nouveau Marketing TouristiqueDocument141 pagesLe Nouveau Marketing TouristiqueThirodE ClementPas encore d'évaluation
- Brunel (2006) Disneylandiation TourismeDocument7 pagesBrunel (2006) Disneylandiation TourismeVillalta VladyPas encore d'évaluation
- Utilité Économique Et Sociale Du Tourisme Social en Languedoc-RoussillonDocument149 pagesUtilité Économique Et Sociale Du Tourisme Social en Languedoc-RoussillonFélix BangouraPas encore d'évaluation
- CE 06-07-2022 Touristes Go HomeDocument4 pagesCE 06-07-2022 Touristes Go HomeJoy MelloulPas encore d'évaluation
- Master Tourisme Textes 1 Et 2 Theme GrammaticalDocument2 pagesMaster Tourisme Textes 1 Et 2 Theme GrammaticalPhilip SadikalayPas encore d'évaluation
- Chiffres Cles 2020Document124 pagesChiffres Cles 2020fabiooo999Pas encore d'évaluation
- Suite Unité 4 - Édito B2 ÉlèvesDocument5 pagesSuite Unité 4 - Édito B2 ÉlèvesCharles RicordelPas encore d'évaluation
- KPG FR C Epr3 2019B ScriptDocument4 pagesKPG FR C Epr3 2019B ScriptMaraki XonPas encore d'évaluation
- Tourisme Et MondialisationDocument10 pagesTourisme Et MondialisationyoussefbaqiPas encore d'évaluation
- 2020 Leçons Et Corrigés Tourisme 1 PDFDocument9 pages2020 Leçons Et Corrigés Tourisme 1 PDFDema HyariPas encore d'évaluation
- Communication Environnementale 00Document12 pagesCommunication Environnementale 00Alex MbiliziPas encore d'évaluation
- Tef 2021Document31 pagesTef 2021Achraf100% (1)
- Tourisme ExpérientielDocument24 pagesTourisme ExpérientielBlandine BAHINPas encore d'évaluation
- Le Tourisme DurableDocument7 pagesLe Tourisme DurablehafidaPas encore d'évaluation
- Le Tourisme ResponsableDocument14 pagesLe Tourisme ResponsableSaraPas encore d'évaluation
- Ce CompletDocument12 pagesCe Completabdi amirPas encore d'évaluation
- 2017 Hamon Lancelot MémoireDocument283 pages2017 Hamon Lancelot MémoireChaimae ÇhPas encore d'évaluation
- Sujet Espagnol SostenibleDocument3 pagesSujet Espagnol SostenibleJorge SeguraPas encore d'évaluation
- KPG FR C Epr3 2018B ScriptDocument4 pagesKPG FR C Epr3 2018B ScriptKonstantina TalantiPas encore d'évaluation
- NaitUp Livre-Blanc Voyager-AutrementDocument37 pagesNaitUp Livre-Blanc Voyager-AutrementHaroldPas encore d'évaluation
- Tourisme de Masse-ArticleDocument4 pagesTourisme de Masse-ArticleSantiago Medina ElNortePas encore d'évaluation
- Dossier Tourisme ResponsableDocument11 pagesDossier Tourisme ResponsableSan SanPas encore d'évaluation
- Approche Thematique Architecture de Bien EtreDocument26 pagesApproche Thematique Architecture de Bien EtreSara OualiPas encore d'évaluation
- Les Organismes Indépendants de ClassificationDocument18 pagesLes Organismes Indépendants de ClassificationSaint-val LaurincePas encore d'évaluation
- Sujets Mercatique VPT 2008Document25 pagesSujets Mercatique VPT 2008maison_d_hotesPas encore d'évaluation
- Projet de Fin DDocument27 pagesProjet de Fin DValmick IndustriePas encore d'évaluation
- Tourisme Responsable Dernic3a8re VersionDocument48 pagesTourisme Responsable Dernic3a8re VersionOlivePas encore d'évaluation
- L'idiot Du VoyageDocument3 pagesL'idiot Du VoyageClarisse MeunierPas encore d'évaluation
- CP - Lect 2Document2 pagesCP - Lect 2Pramod V BPas encore d'évaluation
- Enseignement Scientifique MathDocument6 pagesEnseignement Scientifique MatherdenPas encore d'évaluation
- B1 Francais Avec Pierre Lecon5 Correction ExerciceDocument7 pagesB1 Francais Avec Pierre Lecon5 Correction ExerciceAnaPas encore d'évaluation
- Tourismophobe Ou Touristophobe C1Document3 pagesTourismophobe Ou Touristophobe C1SusanAbigael OkayaPas encore d'évaluation
- Acronymes Abreviations Glossaire Et BibliographieDocument8 pagesAcronymes Abreviations Glossaire Et BibliographieIsmael RakPas encore d'évaluation
- Influenceurs VoyagesDocument4 pagesInfluenceurs VoyageslafriPas encore d'évaluation
- Dossier Pour Ou Contre Le TourismeDocument7 pagesDossier Pour Ou Contre Le Tourismeoussama khadroufPas encore d'évaluation
- Innovation FR PDFDocument68 pagesInnovation FR PDFYoussef RadefPas encore d'évaluation
- Exposé GéographieDocument11 pagesExposé GéographieMarie Charlotte GjdPas encore d'évaluation
- Réchauffement climatique: Bonnes questions et vraies réponses - Édition mise à jour et augmentée - 2024D'EverandRéchauffement climatique: Bonnes questions et vraies réponses - Édition mise à jour et augmentée - 2024Pas encore d'évaluation
- L'urgence de relocaliser: Pour sortir du libre-échange et du nationalisme économiqueD'EverandL'urgence de relocaliser: Pour sortir du libre-échange et du nationalisme économiquePas encore d'évaluation
- Guide Tao Monde: 1 000 idées et adresses pour voyager engagéD'EverandGuide Tao Monde: 1 000 idées et adresses pour voyager engagéPas encore d'évaluation
- Face au monde d'après: Du COVID à 2030 : s'adapter à ce qui pourrait nous attendreD'EverandFace au monde d'après: Du COVID à 2030 : s'adapter à ce qui pourrait nous attendrePas encore d'évaluation
- Entreprendre et investir pour le monde d'aprèsD'EverandEntreprendre et investir pour le monde d'aprèsÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- L' Écotourisme, entre l’arbre et l’écorce: De la conservation au développement viable des territoiresD'EverandL' Écotourisme, entre l’arbre et l’écorce: De la conservation au développement viable des territoiresPas encore d'évaluation
- Eveillons-nous à la vie et ne nous indignons plus jamaisD'EverandEveillons-nous à la vie et ne nous indignons plus jamaisPas encore d'évaluation
- Les Problèmes Causés Par Le SéismeDocument5 pagesLes Problèmes Causés Par Le SéismeMohamed EL AMRIPas encore d'évaluation
- Séismes - 4ème - Cours - Géologie SVTDocument3 pagesSéismes - 4ème - Cours - Géologie SVTmed100% (2)
- Lecture 9Document69 pagesLecture 9fahodocPas encore d'évaluation
- La Technique Du ZaïDocument7 pagesLa Technique Du Zaïcfice.beninPas encore d'évaluation
- Contribution À L'identification Et À La Caractérisation de La Zone Humide El Hammam Medjana : Cartographie de La Zone D'étudeDocument119 pagesContribution À L'identification Et À La Caractérisation de La Zone Humide El Hammam Medjana : Cartographie de La Zone D'étudeMoone MessPas encore d'évaluation
- Cour Les VolcansDocument14 pagesCour Les VolcansFata MedPas encore d'évaluation
- AtmosphereDocument171 pagesAtmosphereAss SidibePas encore d'évaluation
- KHAMMAR HichemDocument54 pagesKHAMMAR HichemHamaidi AbderrazekPas encore d'évaluation
- Cours de Sol, Vegetation Et Mineralisation 2020 LMDDocument101 pagesCours de Sol, Vegetation Et Mineralisation 2020 LMDhistoriangeleka100% (2)
- CotedIvoire 2012 Country ReportDocument32 pagesCotedIvoire 2012 Country ReportAmeh KouadioPas encore d'évaluation
- Note de Calcul Hydraulique 2017-11-03Document4 pagesNote de Calcul Hydraulique 2017-11-03jaouadi mabroukaPas encore d'évaluation
- Note Cours 2011Document307 pagesNote Cours 2011Badr ChaibiPas encore d'évaluation
- Géographie 4eDocument20 pagesGéographie 4eLucien Zeh Mballa100% (3)
- Actes de Conference DefinitifDocument233 pagesActes de Conference DefinitifSalah Eddine ZianiPas encore d'évaluation
- 03-2011-Les TerrassementsDocument31 pages03-2011-Les TerrassementsRomaric VERDONCKPas encore d'évaluation
- TFC Peter Migha ClassificationDocument54 pagesTFC Peter Migha ClassificationRubenPas encore d'évaluation
- CH 1.2 ParoiDocument16 pagesCH 1.2 ParoiThk AliPas encore d'évaluation
- Cours D'hydrostatistiqueDocument54 pagesCours D'hydrostatistiquengoufabrice20100% (1)
- Ecoregion MadagascarDocument25 pagesEcoregion Madagascardiana vizcaino100% (1)
- BELKAMEL Aissa PDFDocument126 pagesBELKAMEL Aissa PDFYoucef BenferdiPas encore d'évaluation
- Etude OASIS MAROC - ELC - 020911 - DiskStation - Aug-13-0923-2015 - ConflictDocument70 pagesEtude OASIS MAROC - ELC - 020911 - DiskStation - Aug-13-0923-2015 - ConflictHassan ElkhabriPas encore d'évaluation
- These-AJ 2Document235 pagesThese-AJ 2Sitta LedantiPas encore d'évaluation
- Failles Site SudDocument16 pagesFailles Site SudRahma GhanemPas encore d'évaluation
- ProjectionDocument12 pagesProjectionAbderrahim El HamdaouiPas encore d'évaluation
- Cours RéservoirDocument32 pagesCours RéservoirKhadija DhiflaouiPas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document36 pagesChapitre 2Youssef EL GHAIDAPas encore d'évaluation
- Manuel de L'amateur Des Jardins3Document854 pagesManuel de L'amateur Des Jardins3Anonymous e34JgdPqoDPas encore d'évaluation
- Fiche de Cours - Économie AfricaineDocument18 pagesFiche de Cours - Économie AfricaineBANGA PrincePas encore d'évaluation
- 2236-Texte de L'article-4537-1-10-20170912Document8 pages2236-Texte de L'article-4537-1-10-20170912Djalil DjowPas encore d'évaluation
- SA GL SD 1 V1.3FR Annexe S01 GlossaireDocument34 pagesSA GL SD 1 V1.3FR Annexe S01 Glossairemarc-etienne N'DRIPas encore d'évaluation