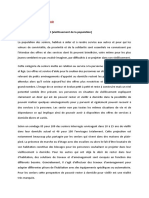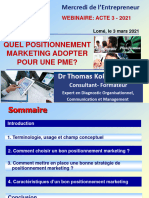Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Séance 4: Fiche de Connaissance: Partie 1: Les Differents Types D'Allocation
Séance 4: Fiche de Connaissance: Partie 1: Les Differents Types D'Allocation
Transféré par
Douniyà IssameTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Séance 4: Fiche de Connaissance: Partie 1: Les Differents Types D'Allocation
Séance 4: Fiche de Connaissance: Partie 1: Les Differents Types D'Allocation
Transféré par
Douniyà IssameDroits d'auteur :
Formats disponibles
Séance 4 : Fiche de connaissance
Mise à jour : mai 2018
PARTIE 1 : LES DIFFERENTS TYPES D’ALLOCATION
• L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est versée mensuellement par la Caisse
d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) (ou la Mutualité sociale agricole pour les
personnes relevant de ce régime) aux personnes retraitées ayant de faibles ressources, âgées de 65
ans ou plus et résidant de manière stable et régulière sur le territoire français.
Le montant annuel de l'Aspa pour une personne seule est au maximum
de 9 638,42 € (soit 803,20 € par mois). Il est calculé en tenant compte de la différence entre la
somme de 9 638,42 € et les ressources du demandeur.
Par exemple, si Monsieur X. perçoit 8 000 € par an, le montant de l'Aspa sera de 9 638,42 € -
8 000 € = 1 638,42 € par an.
Les sommes versées au titre de l'Aspa sont récupérables sur succession, si l'actif net de celle-ci
dépasse 39 000 €.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit que le montant de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées (Aspa) ainsi que les plafonds de ressources pour y avoir accès, seront
augmentés par décret, de 2018 à 2020.
• L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
L’APA est délivrée par le conseil départemental aux personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans,
que celles-ci vivent à domicile ou en institution, et justifiant d’une résidence stable et régulière sur le
territoire français. L’article L. 232-1 du code de l’Action sociale et des familles précise : « Toute
personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du
manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation
personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation,
définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux
personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide
pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance
régulière. »
Le niveau de dépendance des personnes âgées est évalué au moyen d’une grille appelée Autonomie
Gérontologie Groupes Iso-Ressources (AGGIR) comprenant six groupes GIR, détaillés ci-dessous.
Si le GIR est compris entre 1 et 4, l’équipe médico-sociale départementale adresse au demandeur de
l’APA une proposition de plan d’aide.
Les fondamentaux de l’action sociale Page 1 sur 8
Séance 4 : Fiche de connaissance
Mise à jour : mai 2018
En cas de détérioration de l’état de santé, une réévaluation du GIR peut être demandée à tout
moment par la personne âgée.
Gir Degrés de dépendance
Gir 1 • Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement
altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d'intervenants,
• Ou personne en fin de vie
Gir 2 • Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas
totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des
activités de la vie courante,
• Ou personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable de se
déplacer et qui nécessite une surveillance permanente
Gir 3 Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son autonomie locomotrice,
mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'une aide pour les soins corporels
Gir 4 • Personne n'assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut se déplacer
à l'intérieur de son logement, et qui a besoin d'aides pour la toilette et l'habillage,
• Ou personne n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidée pour les
soins corporels et les repas
Gir 5 Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des
repas et le ménage
Gir 6 Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante
Source : https://www.service-public.fr
Si le versement de l’APA n’est soumis à aucune condition de ressources, son montant sera toutefois
modulé en fonction du niveau de celles-ci.
Les fondamentaux de l’action sociale Page 2 sur 8
Séance 4 : Fiche de connaissance
Mise à jour : mai 2018
PARTIE 2 : LES DISPOSITIFS POUR FAVORISER LE MAINTIEN A DOMICILE
Conformément aux souhaits d’une majorité de personnes âgées et comme le prévoit la loi
d’adaptation de la société au vieillissement, de nombreux dispositifs sont proposés pour favoriser le
maintien à domicile.
• Les services de soins infirmiers à domicile
Les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) interviennent au domicile des personnes âgées et
des personnes handicapées sur prescription médicale. Ils sont financés par l’Assurance maladie.
Ces soins, qui doivent pouvoir être dispensés sept jours sur sept, poursuivent plusieurs objectifs :
préserver l’autonomie, éviter l’hospitalisation, faciliter le retour à domicile après une hospitalisation
indispensable ou encore retarder l’entrée en institution.
Les Ssiad font appel à de nombreuses compétences professionnelles : infirmiers, aides-soignants,
pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychologues…
• L’hospitalisation à domicile (HAD)
L’article R6121-4-1 du code de la Santé publique stipule : « Les établissements d'hospitalisation à
domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en
fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et
coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité
et la fréquence des actes. »
L’hospitalisation à domicile n’est pas réservée aux personnes âgées. Elle concerne tous les patients
atteints de pathologies graves. L’HAD, qui nécessite une prescription médicale, est assurée par des
professionnels rattachés à des structures (hospitalière, associative…) bénéficiant d’une autorisation.
Les équipes HAD peuvent intervenir au domicile mais également dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
• Les accueils de jour
Les accueils de jour permettent de rompre l’isolement des personnes âgées tout en leur proposant
différentes activités de nature à prévenir la perte d’autonomie. Elles autorisent par ailleurs l’aidant
d’une personnes âgée à prendre un peu de répit tout en lui offrant la possibilité d’échanger avec
d’autres personnes ou d’autres familles confrontées à une même problématique, la maladie
Les fondamentaux de l’action sociale Page 3 sur 8
Séance 4 : Fiche de connaissance
Mise à jour : mai 2018
d’Alzheimer par exemple. L’accueil de jour peut être proposé par des structures ad hoc ou des
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Le prix de journée dans
ces établissements est fixé par le conseil départemental.
• Les aides à domicile
Les personnes âgées de 65 ans ou plus (60 ans en cas d’inaptitude au travail), exclues du bénéfice de
l’Allocation personnalisée d’autonomie peuvent bénéficier d’une aide à domicile si elles ont des
difficultés pour accomplir les tâches de la vie courante. En fonction des ressources de la personne,
une aide financière peut être versée soit par le département (pour les personnes dont les ressources
sont inférieures à 803,20 € pour une personne seule et à 1 246,97 € pour un couple), soit par sa
caisse de retraite.
• Les aides au logement
- l’aide personnalisée au logement et l’allocation de logement sociale peuvent être versées sous
conditions de ressources par la Caisse d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole.
- Les aides à l’adaptation du logement peuvent être versées sous conditions de ressources par
l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Les caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire
et collectivités locales (région, département, commune) peuvent aussi accorder des aides, des
prêts, voire des subventions. Enfin des crédits d’impôts sont possibles.
• Autres aides
- Les aides extra-légales des communes et conseils départementaux sont des aides financières ou
en nature, attribuées au cas par cas.
- L’Aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH) se traduit par l’élaboration d’un plan
d’aide personnalisé (ménage, aide aux courses, portage de repas, …), détaillé quelques
jours avant la sortie de l’hôpital par une assistante sociale. Cette prestation est mise en œuvre
par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat).
Les fondamentaux de l’action sociale Page 4 sur 8
Séance 4 : Fiche de connaissance
Mise à jour : mai 2018
PARTIE 3 : LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL
Les établissements qui accueillent les personnes âgées peuvent être sanitaires ou médico-sociaux.
• Les établissements sanitaires
- Les services de soins de suite et de réadaptation proposent de la rééducation (afin de
permettre au patient de retrouver ses moyens physiques, cognitifs et psychologiques), de la
réadaptation (pour l’aider à s’adapter à une éventuelle perte de ses capacités), et de la
réinsertion (pour le rendre le plus autonome possible).
- Les unités de soins de longue durée s’adressent quant à elles à des personnes très
dépendantes, dont l’état de santé nécessite une surveillance permanente.
• Les établissements sociaux et médico-sociaux
- Les résidences autonomie : Appelées auparavant « logements-foyers », les résidences
autonomie proposent un hébergement indépendant et des parties communes proposant des
services collectifs (restauration, blanchisserie, etc.). Ces résidences, majoritairement gérées
par des structures publiques ou à but non lucratif, ont une vocation sociale. Le coût du
logement y est modéré. Depuis la loi d’adaptation de la société au vieillissement, elles
peuvent bénéficier d’un « forfait autonomie » qui leur permet de réaliser des actions de
prévention de la perte d’autonomie auprès de leurs résidants.
• Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
Appelés auparavant « maisons de retraite », les Ehpad accueillent des personnes âgées de plus de 60
ans pouvant avoir besoin de soins médicaux et paramédicaux. L’offre comprend l’hébergement, la
restauration, l’animation et le soin. Les Ehpad doivent signer une convention avec le conseil
départemental et l’agence régionale de santé dans laquelle ils s’engagent à respecter des objectifs de
qualité de prise en charge en contrepartie de financements. Les Ehpad font appel à trois sources de
financement : le prix hébergement financé par le résident, le tarif dépendance établir en fonction du
Gir et pris en charge par l’Allocation personnalisée d’autonomie et le tarif soins, pris en charge par
l’Assurance maladie. Les Ehpad peuvent être publics, associatifs ou privés lucratifs.
• L’accueil chez des particuliers
Des particuliers peuvent accueillir chez eux, à titre onéreux, des personnes âgées et/ou handicapées.
Les accueillants familiaux doivent être agréés par le conseil départemental. L’agrément est délivré
pour une durée de cinq ans. Le conseil départemental organise la formation et le contrôle des
accueillants familiaux ainsi que le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Un contrat
d’accueil conforme à un modèle national doit être signé et une copie doit être adressée au conseil
départemental.
Les fondamentaux de l’action sociale Page 5 sur 8
Séance 4 : Fiche de connaissance
Mise à jour : mai 2018
PARTIE 4 : LES NOUVEAUX OUTILS : MAIA, PASA, UHR, EHPAD HORS LES
MURS
MAIA : MAIA est l’acronyme qui désigne « méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et
de soins dans le champ de l’autonomie ».
Comme l’indique la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, cette méthode associe
l’ensemble « des acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en
perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice : l’intégration des services
d’aide et de soins. L’intégration fait l’objet d’une préoccupation internationale depuis les années
1990 et fait partie des politiques publiques en France depuis 2008.
L’intégration va plus loin que la coopération, qui repose seulement sur un principe de coordination.
L’intégration conduit tous les acteurs à coconstruire leurs moyens d’action, leurs outils collaboratifs,
et in fine à partager les actions elles-mêmes et la responsabilité de leur conduite. Cette approche
permet d’apporter une réponse décloisonnée, harmonisée, complète et adaptée aux besoins de la
personne âgée (accueil, information, orientation et mise en place de soins, d’aides ou de
prestations), quelle que soit la structure à laquelle elle s’adresse. »
La MAIA repose sur 3 mécanismes et 3 outils.
Les 3 mécanismes sont :
• La concertation, pour co-construire un projet commun.
• Le guichet intégré pour proposer, partout sur le territoire, une réponse harmonisée et
adaptée aux besoins des usagers.
• La gestion de cas qui est réservée aux personnes âgées dont la situation dite complexe,
nécessite un suivi intensif au long cours. Un gestionnaire de cas est alors identifié qui sera
l’interlocuteur direct de la personne, du médecin traitant, des professionnels intervenant à
domicile.
• Zoom sur Les gestionnaires de cas. Ils doivent suivre un cursus pour obtenir un diplôme
interuniversitaire « gestion de cas » dispensé par les universités de Lille, Paris, Rennes,
Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Martinique et Reims.
Les 3 outils sont :
Le formulaire d’analyse multidimensionnelle (utilisé par les professionnels des guichets intégrés) et
l’outil d’évaluation multidimensionnelle – le ResidentAssessment Instrument-Home Care, outil
commun d’origine américaine validé scientifiquement, et choisi au terme d’une procédure de marché
public.
Le plan de service individualisé (PSI) permettant de planifier l’ensemble des interventions assurées
auprès d'une personne âgée en situation complexe.
Les fondamentaux de l’action sociale Page 6 sur 8
Séance 4 : Fiche de connaissance
Mise à jour : mai 2018
Le système d’informations partageables entre les professionnels du territoire.
Chaque année, chaque agence régionale de santé (ARS) lance un appel à candidatures pour mettre
en place la méthode MAIA sur des territoires infra départementaux. Le « porteur » de projet doit
être un organisme à but non lucratif, en capacité de mobiliser les acteurs locaux, comme les centres
locaux d’information et de coordination (CLIC) par exemple.
La CNSA indique que 352 dispositifs MAIA sont en fonctionnement (décembre 2016). 98% du
territoire français est ainsi couvert. 35 % des dispositifs MAIA sont portés par des conseils
départementaux, 33 % par des acteurs de la coordination (CLIC, réseaux de santé), 12 % par des
établissements de santé.
PASA & UHR : PASA est l’acronyme de « Pôle d’activités et de soins adaptés » ; UHR est l’acronyme
d’unité d’hébergement renforcée. Ces deux dispositifs d’accompagnement spécifiques issus du Plan
Alzheimer 2008-2012 visent à améliorer la prise en charge des troubles psycho-comportementaux
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en institution.
Les PASA proposent notamment des activités thérapeutiques individuelles ou collectives adaptées
qui visent au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles, des fonctions cognitives et
sensorielles ainsi qu’au maintien du lien social de ces personnes.
La mesure 26 de l’axe 1 : « Soigner et accompagner tout au long de la vie et sur l’ensemble du
territoire » du Plan Maladies Neuro-dégénératives (PMND) 2014-2019 prévoit la poursuite du
déploiement des pôles d’accompagnement et de soins adaptés (PASA) et l’inscription de cette offre
au sein des filières de soins et accompagnement « de droit commun ».
Le PMND indique qu’au 31 décembre 2013, « les données disponibles font état de 12 432 places de
PASA installées, soit entre 888 et 1 036 PASA (unités de 12 ou 14 places), ce qui représente un taux
de 50 % de PASA installés par rapport à la cible de 25 000 places initialement prévues et financées. Le
taux de mise en œuvre de ce dispositif (prévision de 70 % de PASA autorisés à fin 2014) apporte la
preuve qu’il correspond bien aux attentes des usagers et des professionnels car il instaure une
dynamique en termes de qualité́ d’accompagnement. Une enquête réalisée auprès des ARS confirme
la nécessité d’atteindre les objectifs quantitatifs initiaux afin de bien mailler le territoire. »
De la même manière, la mesure 27 du Plan prévoit la poursuite et le renforcement du déploiement
des unités d’hébergement renforcé (UHR) en Ehpad et l’inscription là aussi de cette offre au sein des
filières de soins et accompagnement « de droit commun ». L’offre d’UHR s’est là aussi développée.
Selon les chiffres inscrits dans le PMND : « Au 31 décembre 2013, on dénombre 1 135 places
installées (soit entre 81 et 94 UHR selon le nombre de places par unité́) en Ehpad au regard d’une
cible de 1 600 places prévue initialement. Dans le secteur sanitaire, il était prévu d’identifier 3 300
lits d’UHR sanitaires dans les Unités de soins de longue durée (USLD), soit 190 unités avec une
capacité moyenne de 17 lits. Au dernier recensement en 2013, on comptait 54 UHR ouvertes et 50
prévues par les ARS. »
Ehpad hors les murs :
L’Ehpad hors les murs est un dispositif social innovant visant à permettre aux personnes âgées
dépendantes de continuer à vivre chez elles grâce à une prise en charge coordonnée : HAD, Ssiad,
Les fondamentaux de l’action sociale Page 7 sur 8
Séance 4 : Fiche de connaissance
Mise à jour : mai 2018
Ehpad, réseau, portage de repas, etc. L’adaptation du logement fait également l’objet d’attentions
particulières. Ce dispositif peut aussi permettre aux aidants de prendre quelques jours de repos en
toute tranquillité.
Le dispositif est le plus souvent adossé à une structure existante et il est souvent présenté comme un
pôle de services proposant un accueil gradué et complet : accueil de jour, soins, animation... Le pôle
peut aussi associer un ou plusieurs Ehpad susceptibles d'accueillir de manière séquentielle la
personne âgée en cas de problèmes de santé.
Les fondamentaux de l’action sociale Page 8 sur 8
Vous aimerez peut-être aussi
- Note de Stage Premiere EcriteurDocument5 pagesNote de Stage Premiere EcriteurJafarianPas encore d'évaluation
- Epreuve de Maths Com Escom 3 Eval 4Document2 pagesEpreuve de Maths Com Escom 3 Eval 4Sali YusufPas encore d'évaluation
- Bac ST2S 2016 Corrige STSSDocument2 pagesBac ST2S 2016 Corrige STSSLETUDIANT0% (1)
- L3 - Droit Des Régimes Matrimoniaux (Corrigé)Document8 pagesL3 - Droit Des Régimes Matrimoniaux (Corrigé)stefPas encore d'évaluation
- L'Art de La Sûreté - Chapitre 14Document29 pagesL'Art de La Sûreté - Chapitre 14Houcine FCSPas encore d'évaluation
- Guide Aides Financieres 2021 LiNoteDocument43 pagesGuide Aides Financieres 2021 LiNotePierre-André LelièvrePas encore d'évaluation
- Dispositif de Prise en Soins Des Personnes AgeesDocument12 pagesDispositif de Prise en Soins Des Personnes AgeesBenoit RanisePas encore d'évaluation
- Aide Pour Bien Vieillir Chez Soi PapDocument16 pagesAide Pour Bien Vieillir Chez Soi Paplionel laloupePas encore d'évaluation
- AUtonomie Et DépendanceDocument20 pagesAUtonomie Et Dépendanceleger.aureliePas encore d'évaluation
- Les Lois Des Politiques de La VieillesseDocument4 pagesLes Lois Des Politiques de La VieillesselcdseverinePas encore d'évaluation
- Projet Accueil de JourDocument3 pagesProjet Accueil de JourBENJAMINPas encore d'évaluation
- Partie ADocument28 pagesPartie Amarry.giirl2Pas encore d'évaluation
- Les Politiques Mises en ŒuvreDocument3 pagesLes Politiques Mises en ŒuvreZëýn AđŕPas encore d'évaluation
- Essentiel Politique PADocument25 pagesEssentiel Politique PAEmma DEMONTEPas encore d'évaluation
- L'Accompagnement Social en SPDocument60 pagesL'Accompagnement Social en SPmontels.marie.ifsiPas encore d'évaluation
- Dossier Maladies InvalidantesDocument14 pagesDossier Maladies InvalidantesZëýn AđŕPas encore d'évaluation
- 7 - Soins Dentaires À DomicileDocument10 pages7 - Soins Dentaires À DomicileImane ABBASPas encore d'évaluation
- Journée Type en EHPAD AlzheimerDocument1 pageJournée Type en EHPAD Alzheimerleahugbebaert09Pas encore d'évaluation
- 1er CoursDocument5 pages1er Cours7psghtnqydPas encore d'évaluation
- GAAP 1 - Dérogations Pour Placement en EHPADDocument6 pagesGAAP 1 - Dérogations Pour Placement en EHPADFred DernautPas encore d'évaluation
- Mémoire RédacDocument19 pagesMémoire RédacMahira OleginePas encore d'évaluation
- La Dépendance de La Personne ÂgéeDocument39 pagesLa Dépendance de La Personne Âgéeanon-926416100% (5)
- Projet Associatif 2021 2026 1Document10 pagesProjet Associatif 2021 2026 1Natacha YakoubiPas encore d'évaluation
- TD4 Vieissellement, HandicapDocument5 pagesTD4 Vieissellement, HandicaplilianoemiPas encore d'évaluation
- Plaquette CCASDocument14 pagesPlaquette CCASEskel Antoine Grival du ClairventPas encore d'évaluation
- Cerfa 16301 Demande Aides Autonomie Pour Les Personnes Agees A DomicileDocument13 pagesCerfa 16301 Demande Aides Autonomie Pour Les Personnes Agees A Domicilehitogag597Pas encore d'évaluation
- Chapitre 7 - Evaluation Clinique Et Fonctionnelle Du Handicap MoteurDocument25 pagesChapitre 7 - Evaluation Clinique Et Fonctionnelle Du Handicap MoteurrachidPas encore d'évaluation
- Livre Blanc VieillissementDocument21 pagesLivre Blanc Vieillissementmaxime.brogniartPas encore d'évaluation
- 2022 Guide Sans AbriDocument41 pages2022 Guide Sans AbriNathaly ParrasPas encore d'évaluation
- Auxiliaire v4922Document3 pagesAuxiliaire v4922melamel60400Pas encore d'évaluation
- Guide Habitat Sante Mentale 2011 LILLEDocument33 pagesGuide Habitat Sante Mentale 2011 LILLEPère DelaunayPas encore d'évaluation
- ProfessionnalisationDocument8 pagesProfessionnalisationledouaironchanceliviePas encore d'évaluation
- GuideFAS2023 V9Document18 pagesGuideFAS2023 V9Wann PengPas encore d'évaluation
- S3 Fiche 2Document1 pageS3 Fiche 2Douniyà IssamePas encore d'évaluation
- Guide FAS 2019Document20 pagesGuide FAS 2019Kiss JózsefPas encore d'évaluation
- KOR HC Alg Broch Thuiszorg FR 04-08-2021 WEBDocument20 pagesKOR HC Alg Broch Thuiszorg FR 04-08-2021 WEBdodo.medartPas encore d'évaluation
- Liste Des ÉtablissementsDocument7 pagesListe Des Établissementsappo lauPas encore d'évaluation
- Groupe 6Document27 pagesGroupe 6lorentzdaniel258Pas encore d'évaluation
- Liste Des ÉtablissementsDocument7 pagesListe Des Établissementsappo lauPas encore d'évaluation
- Logements Avec Encadrement Pour Personnes Ges - Logements ProtgsDocument3 pagesLogements Avec Encadrement Pour Personnes Ges - Logements Protgsana bananaPas encore d'évaluation
- Dc2 Numero 5-2 Bon A ImprimerDocument8 pagesDc2 Numero 5-2 Bon A Imprimerto biPas encore d'évaluation
- Charte Du Malade France PDFDocument26 pagesCharte Du Malade France PDFVanessa GoudiabyPas encore d'évaluation
- Item 16 - Se?curite? SocialeDocument4 pagesItem 16 - Se?curite? Socialecharles.hosseini-teheraniPas encore d'évaluation
- Brochure Aide Aux Personnes 2022Document9 pagesBrochure Aide Aux Personnes 2022Melissa BaloulPas encore d'évaluation
- 11 Fiche Pratique-Les Centres D-Hebergement D-Urgence Chu - Mai 2021 Cle2b761aDocument1 page11 Fiche Pratique-Les Centres D-Hebergement D-Urgence Chu - Mai 2021 Cle2b761amika lepagePas encore d'évaluation
- FuckDocument1 pageFuckJamesPas encore d'évaluation
- Bien Vivre Chez Soi2Document8 pagesBien Vivre Chez Soi2Maria PagesPas encore d'évaluation
- Qualité de Vie en Ehpad (Volet 4)Document114 pagesQualité de Vie en Ehpad (Volet 4)Sante_SociauxPas encore d'évaluation
- Concours D'Entree A L'Ecole de 2018: SujetDocument34 pagesConcours D'Entree A L'Ecole de 2018: SujetEdou DiscretPas encore d'évaluation
- Les Établissements Du Médico-SocialDocument6 pagesLes Établissements Du Médico-SocialMael BourgaultPas encore d'évaluation
- Qualité de Vie en Ehpad (Volet 3)Document70 pagesQualité de Vie en Ehpad (Volet 3)Sante_SociauxPas encore d'évaluation
- ExposéDocument4 pagesExposéEmeline BarraultPas encore d'évaluation
- Répertoire Structures - Infos - 220906 - 161244Document7 pagesRépertoire Structures - Infos - 220906 - 161244Olivia Byr-HouhouPas encore d'évaluation
- 'Accueil Des Stagiaires Avril 2014Document44 pages'Accueil Des Stagiaires Avril 2014Simona MunteanuPas encore d'évaluation
- ES474BDocument34 pagesES474BGuy Roger Kinimo KOUACOUPas encore d'évaluation
- Fiche Thématique Sur La Prise en Charge Des Personnes HandicapéesDocument6 pagesFiche Thématique Sur La Prise en Charge Des Personnes HandicapéesMohamed LaminePas encore d'évaluation
- Clef de Compréhension Autonomie - DépendanceDocument3 pagesClef de Compréhension Autonomie - Dépendanceabusson7Pas encore d'évaluation
- Examens SociologieDocument2 pagesExamens SociologieAmandine VeysPas encore d'évaluation
- Répit Des AidantsDocument44 pagesRépit Des AidantsFlorence DaoudalPas encore d'évaluation
- Alzheimer Essentiel 4 PagesDocument4 pagesAlzheimer Essentiel 4 PagesImounan FatimaPas encore d'évaluation
- Mission Flash EHPAD de L'assemblée Nationale: Communication RapporteureDocument22 pagesMission Flash EHPAD de L'assemblée Nationale: Communication RapporteureJournal la MarseillaisePas encore d'évaluation
- Maisons Hospitalieres Senart - Dossier de Presse - Novembre 2020Document13 pagesMaisons Hospitalieres Senart - Dossier de Presse - Novembre 2020swann.duchateauPas encore d'évaluation
- LES ORGANISATIONS DE SOINS DE LONGUE DUREE: Points de vue scientifiques et critiques sur les CHSLD et les EHPADD'EverandLES ORGANISATIONS DE SOINS DE LONGUE DUREE: Points de vue scientifiques et critiques sur les CHSLD et les EHPADPas encore d'évaluation
- Methode Abc Activity Based CostingDocument5 pagesMethode Abc Activity Based CostingZakariae MountassirPas encore d'évaluation
- Partitions ListeDocument3 pagesPartitions ListecreachouxPas encore d'évaluation
- Les Cathedrales Pour Les NulsDocument78 pagesLes Cathedrales Pour Les Nulsmirceap99100% (3)
- Audit Fiscal - DéfinitifDocument16 pagesAudit Fiscal - DéfinitifElallaoui AzizaPas encore d'évaluation
- 1 D087397 D 01Document14 pages1 D087397 D 01Haseo Ga-Rei100% (1)
- Catalogue Architecture Et PassionDocument40 pagesCatalogue Architecture Et Passionflo_raaPas encore d'évaluation
- B1 FrenchDocument12 pagesB1 Frenchamali23Pas encore d'évaluation
- Bilan FonctionnelDocument43 pagesBilan FonctionnelSawsen Jerfel100% (3)
- Gestion Des Conflits Au Travail: Réalisé Par: Encadré ParDocument18 pagesGestion Des Conflits Au Travail: Réalisé Par: Encadré ParwassimPas encore d'évaluation
- Sim Et DistrubtionDocument31 pagesSim Et DistrubtionKhalil TrabelssiPas encore d'évaluation
- 7 Anpgf Mde 03 Mars 2021Document68 pages7 Anpgf Mde 03 Mars 2021Komlan AvouletePas encore d'évaluation
- Feuille de Route Acad Mique 010621 Rag 14800Document29 pagesFeuille de Route Acad Mique 010621 Rag 14800Hicham H.Pas encore d'évaluation
- Bouteflika Une Imposture Algerienne MohaDocument224 pagesBouteflika Une Imposture Algerienne Mohaissadbertrand3Pas encore d'évaluation
- GUIDE Les Rois Des Dividendes - BoursogramDocument14 pagesGUIDE Les Rois Des Dividendes - BoursogramHugo JallaisPas encore d'évaluation
- TP8 - Configuring and Modifying Standard IPv4 ACLsDocument11 pagesTP8 - Configuring and Modifying Standard IPv4 ACLsNios GraffPas encore d'évaluation
- GES821 C02M04 Maturité en Gestion de Projet (CMMi)Document28 pagesGES821 C02M04 Maturité en Gestion de Projet (CMMi)mehave5379Pas encore d'évaluation
- Andersen Lescargot Et Le RosierDocument2 pagesAndersen Lescargot Et Le RosierMohamed KHARDANIPas encore d'évaluation
- Calendrier Positiviste (Suivi De) Auguste (... ) Comte Auguste Bpt6k21868fDocument65 pagesCalendrier Positiviste (Suivi De) Auguste (... ) Comte Auguste Bpt6k21868ftommydrogandoPas encore d'évaluation
- Tortue GabonDocument21 pagesTortue GabonalinaceePas encore d'évaluation
- E-Myth, le mythe de l'entrepreneur revisité (French Edition) -- Gerber, Michael E_ -- 2017 -- Alisio -- 9781092928373 -- 6716cea218fdb74e5af8944f9373ec47 -- Anna’s ArchiveDocument269 pagesE-Myth, le mythe de l'entrepreneur revisité (French Edition) -- Gerber, Michael E_ -- 2017 -- Alisio -- 9781092928373 -- 6716cea218fdb74e5af8944f9373ec47 -- Anna’s ArchiveJean COMPAOREPas encore d'évaluation
- GUCPP FR 12012023 X DISI X SDCOM X 2023Document7 pagesGUCPP FR 12012023 X DISI X SDCOM X 2023stephanefodjo86Pas encore d'évaluation
- Programme de Formation Maintenance HospitaliereDocument4 pagesProgramme de Formation Maintenance HospitaliereFassou LamahPas encore d'évaluation
- Al-Simsimah: Glossaire Des Termes Arabes PDFDocument14 pagesAl-Simsimah: Glossaire Des Termes Arabes PDFRoberto TurciPas encore d'évaluation
- Sujet Brevet Francais 2018 Antilles GuyaneDocument10 pagesSujet Brevet Francais 2018 Antilles GuyaneLeya PLANTIERPas encore d'évaluation
- EpigrapheDocument5 pagesEpigrapheMaximilien kimpuanzaPas encore d'évaluation
- 9782850182617Document44 pages9782850182617Daashe mujingaPas encore d'évaluation
- Un Nouveau Système Douanier en Algérie Par Hakim BERDJOUDJDocument3 pagesUn Nouveau Système Douanier en Algérie Par Hakim BERDJOUDJRIHANI MohamedPas encore d'évaluation