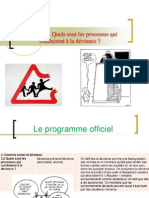Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
De La Division Du Travail Social
De La Division Du Travail Social
Transféré par
Mari NadifCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
De La Division Du Travail Social
De La Division Du Travail Social
Transféré par
Mari NadifDroits d'auteur :
Formats disponibles
mile Durkheim (1893)
DE LA DIVISION DU TRAVAIL SOCIAL
Livre I
Un document produit en version numrique par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales" Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi partir de :
mile Durkheim (1893)
DE LA DIVISION DU TRAVAIL SOCIAL Une dition lectronique ralise partir du livre dmile Durkheim (1893), De la division du travail social. Polices de caractres utilise : Pour le texte: Times, 12 points. Pour les citations : Times 10 points. Pour les notes de bas de page : Times, 10 points. dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2001 pour Macintosh. Mise en page sur papier format LETTRE (US letter), 8.5 x 11) dition complte le 15 fvrier 2002 Chicoutimi, Qubec.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
Table des matires
PRFACE DE LA SECONDE DITION. - Quelques remarques sur les groupements professionnels PRFACE DE LA PREMIRE DITION INTRODUCTION : Le Problme Dveloppement de la division du travail social, gnralit du phnomne. D'o le problme: Faut-il nous abandonner au mouvement ou y rsister, ou question de la valeur morale de la division du travail. Incertitude de la conscience morale sur ce point; solutions contradictoires simultanment donnes. Mthode pour faire cesser cette indcision. tudier la division du travail en elle-mme et pour elle-mme. Plan du livre
LIVRE I :
CHAPITRE I :
LA FONCTION DE LA DIVISION DU TRAVAIL
MTHODE POUR DTERMINER CETTE FONCTION
Sens du mot fonction I. II. La fonction de la division du travail n'est pas de produire la civilisation Cas o la fonction de la division du travail est de susciter des groupes qui, sans elle, n'existeraient pas. D'o l'hypothse qu'elle joue le mme rle dans les socits suprieures, qu'elle est la source principale de leur cohsion Pour vrifier cette hypothse, il faut comparer la solidarit sociale qui a cette source aux autres espces de solidarits et, par suite, les classer. Ncessit d'tudier la solidarit travers le systme des rgles juridiques ; autant il y a de classes de ces dernires, autant il y a de formes de solidarits. Classification des rgles juridiques : rgles sanction rpressive; rgles sanction restitutive SOLIDARIT MCANIQUE OU PAR SIMILITUDES
III.
CHAPITRE II: I.
Le lien de solidarit sociale auquel correspond le droit rpressif est celui dont la rupture constitue le crime. On saura donc ce qu'est ce lien si l'on sait ce qu'est le crime essentiellement. Les caractres essentiels du crime sont ceux qui se retrouvent les mmes partout o il y a crime, quel que soit le type social. Or, les seuls caractres
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
communs tous les crimes qui sont ou qui ont t reconnus comme tels sont les suivants : 1 le crime froisse des sentiments qui se trouvent chez tous les individus normaux de la socit considre ; 2 ces sentiments sont forts ; 30 ils sont dfinis. Le crime est donc l'acte qui froisse des tats forts et dfinis de la conscience collective ; sens exact de cette proposition. - Examen du cas o le dlit est cr ou du moins aggrav par un acte de l'organe gouvernemental. Rduction de ce cas la dfinition prcdente II. Vrification de cette dfinition ; si elle est exacte, elle doit rendre compte de tous les caractres de la peine. Dtermination de ces caractres ; 1 elle est une raction passionnelle, d'intensit gradue; 2 cette raction passionnelle mane de la socit; rfutation de la thorie d'aprs laquelle la vengeance prive aurait t la forme primitive de la peine ; 30 cette raction s'exerce par l'intermdiaire d'un corps constitu Ces caractres peuvent tre dduits de notre dfinition du crime : 1 tout sentiment fort offens dtermine mcaniquement une raction passionnelle ; utilit de cette raction pour le maintien du sentiment. Les sentiments collectifs, tant les plus forts qui soient, dterminent une raction du mme genre, d'autant plus nergique qu'ils sont plus intenses. Explication du caractre quasi religieux de l'expiation ; 2 le caractre collectif de ces sentiments explique le caractre social de cette raction ; pourquoi il est utile qu'elle soit sociale ; 3 l'intensit et surtout la nature dfinie de ces sentiments expliquent la formation de l'organe dtermin par lequel la raction s'exerce Les rgles que sanctionne le droit pnal expriment donc les similitudes sociales les plus essentielles ; par consquent, il correspond la solidarit sociale qui drive des ressemblances et varie comme elle. Nature de cette solidarit. On peut donc mesurer la part qu'elle a dans l'intgration gnrale de la socit d'aprs la fraction du systme complet des rgles juridiques que reprsente le droit pnal LA SOLIDARIT DUE A LA DIVISION DU TRAVAIL OU ORGANIQUE
III.
IV.
CHAPITRE III: 1.
La nature de la sanction restitutive implique : 1 que les rgles correspondantes expriment des tats excentriques de la conscience commune ou qui lui sont trangers ; 2 que les rapports qu'elles dterminent ne lient qu'indirectement l'individu la socit. Ces rapports sont positifs ou ngatifs Rapports ngatifs dont les droits rels sont le type. Ils sont ngatifs parce qu'ils lient la chose la personne, non les personnes entre elles. - Rduction ce type des rapports personnels qui s'tablissent l'occasion de l'exercice des droits rels ou la suite du dlit et du quasi-dlit. - La solidarit qu'expriment les rgles correspondantes, tant ngative, n'a pas d'existence propre, mais n'est qu'un prolongement des formes positives de la solidarit sociale Rapports positifs ou de coopration qui drivent de la division du travail. Sont rgis par un systme dfini de rgles juridiques qu'on peut appeler le droit coopratif ;
II.
III.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
vrification de cette proposition propos des diffrentes parties du droit coopratif. Analogies entre la fonction de ce droit et celle du systme nerveux. IV. Conclusion : Deux sortes de solidarit positive, l'une qui drive des similitudes, l'autre de la division du travail. Solidarit mcanique, solidarit organique. La premire varie en raison inverse, la seconde en raison directe de la personnalit individuelle. A celle-l correspond le droit rpressif, celle-ci le droit coopratif
CHAPITRE IV : AUTRE PREUVE DE CE QUI PRCDE Si le rsultat prcdent est exact, le droit rpressif doit avoir d'autant plus la prpondrance sur le droit coopratif que les similitudes sociales sont plus tendues et la division du travail plus rudimentaire, et inversement. Or, c'est ce qui arrive I. Plus les socits sont primitives, plus il y a de ressemblances entre les individus ; ressemblances physiques ; ressemblances psychiques. L'opinion contraire vient de ce qu'on a confondu les types collectifs (nationaux, provinciaux, etc.) et les types individuels. Les premiers s'effacent, en effet, tandis que les autres se multiplient et deviennent plus prononcs. D'autre part, la division du travail, nulle l'origine, va toujours en se dveloppant Or, l'origine, tout le droit a un caractre rpressif. Le droit des peuples primitifs. Le droit hbreu. Le droit hindou. Dveloppement du droit coopratif Rome, dans les socits chrtiennes. Aujourd'hui, le rapport primitif est renvers. Que la prpondrance primitive du droit rpressif n'est pas due la grossiret des murs. PRPONDRANCE PROGRESSIVE DE ORGANIQUE ET SES CONSQUENCES LA SOLIDARIT
II.
CHAPITRE V : I.
La prpondrance actuelle du droit coopratif sur le droit rpressif dmontre que les liens sociaux qui drivent de la division du travail sont actuellement plus nombreux que ceux qui drivent des similitudes sociales. Comme cette prpondrance est plus marque mesure qu'on se rapproche des types sociaux suprieurs, c'est qu'elle n'est pas accidentelle, mais dpend de la nature de ces types. Non seulement ces liens sont plus nombreux, mais ils sont plus forts. Critre pour mesurer la force relative des liens sociaux. Application de ce critre En mme temps qu'ils sont moins forts, les liens qui drivent des similitudes se relchent mesure que l'volution sociale avance. En effet, la solidarit mcanique dpend de trois conditions : 1 tendue relative de la conscience collective et de la conscience individuelle ; 2 intensit - 3 degr de dtermination des tats qui composent la premire. Or, la premire de ces conditions restant tout au plus constante, les deux autres rgressent. Mthode pour le prouver d'aprs les variations numriques des types criminologiques. Classification de ces derniers Rgression et disparition progressive d'un grand nombre de ces types
II.
III.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
IV.
Ces pertes n'ont pas t compenses par d'autres acquisitions. Thorie contraire de Lombroso ; rfutation. Le nombre des tats forts et dfinis de la conscience commune a donc diminu. Autre preuve. Les tats de la conscience commune, particulirement forts, prennent un caractre religieux ; or, la religion embrasse une portion toujours moindre de la vie sociale. Autre preuve tire de la diminution des proverbes, dictons, etc. La solidarit organique devient donc prpondrante
V.
CHAPITRE VI : PRPONDRANCE PROGRESSIVE DE LA SOLIDARIT ORGANIQUE ET SES CONSQUENCES (suite) I. II. Structures sociales correspondant ces deux sortes de solidarits ; type segmentaire ; sa description ; correspond la solidarit mcanique. Ses formes diverses Type organis ; ses caractres ; correspond la solidarit organique. Antagonisme de ces deux types ; le second ne se dveloppe qu' mesure que le premier s'efface. Toutefois, le type segmentaire ne disparat pas compltement. Formes de plus en plus effaces qu'il prend Analogie entre ce dveloppement des types sociaux et celui des types organiques dans le rgne animal La loi prcdente ne doit pas tre confondue avec la thorie de M. Spencer sur les socits militaires et les socits industrielles. L'absorption originelle de l'individu dans la socit ne vient pas d'une trop forte centralisation militaire, mais plutt de l'absence de toute centralisation. L'organisation centraliste, commencement d'individuation. Consquences de ce qui prcde ; 1 rgle de mthode ; 2 l'gosme n'est pas le point de dpart de l'humanit.
III. IV.
CHAPITRE VII : SOLIDARIT ORGANIQUE ET SOLIDARIT CONTRACTUELLE I. Distinction de la solidarit organique et de la solidarit industrielle de M. Spencer. Celle-ci serait exclusivement contractuelle ; elle serait libre de toute rglementation. Caractre instable d'une telle solidarit. Insuffisance des preuves par illustration donnes par M. Spencer. Ce qui manifeste l'tendue de l'action sociale, c'est l'tendue de l'appareil juridique ; or, elle devient toujours plus grande Il est vrai que les relations contractuelles se dveloppent mais les relations non contractuelles se dveloppent en mme temps. Vrification de ce fait propos des fonctions sociales diffuses: 1 le droit domestique devient plus tendu et plus complexe; or, en principe, il n'est pas contractuel. De plus, la place restreinte qu'y a le contrat priv devient toujours plus petite: mariage, adoption, abdication des droits et des devoirs de famille ; 2 plus le contrat prend de place, plus il est rglement. Cette rglementation implique une action sociale positive. Ncessit de cette rglementation. Discussion des analogies biologiques sur lesquelles s'appuie M. Spencer.
II.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
III.
Vrification du mme fait propos des fonctions crbro-spinales de l'organisme social (fonctions administratives et gouvernementales). Le droit administratif et constitutionnel, qui n'a rien de contractuel, se dveloppe de plus en plus. Discussion des faits sur lesquels M. Spencer appuie l'opinion contraire. Ncessit de ce dveloppement par suite de l'effacement du type segmentaire et des progrs du type organis. Les analogies biologiques contredisent la thorie de M. Spencer Conclusions du premier livre: la vie morale et sociale drive d'une double source ; variations inverses de ces deux courants
IV.
LIVRE II :
CHAPITRE I :
LES CAUSES ET LES CONDITIONS
LES PROGRS DE LA DIVISION DU TRAVAIL ET CEUX DU BONHEUR
D'aprs les conomistes, la division du travail a pour cause le besoin d'accrotre notre bonheur. Cela suppose qu'en fait nous devenons plus heureux. Rien n'est moins certain I. A chaque moment de l'histoire, le bonheur que nous sommes capables de goter est limit. Si la division du travail n'avait pas d'autres causes, elle se serait donc vite arrte, une fois atteinte la limite du bonheur. Cette limite recule, il est vrai, mesure que l'homme se transforme. Mais ces transformations, supposer qu'elles nous rendent plus heureux, ne se sont pas produites en vue de ce rsultat ; car, pendant longtemps, elles sont douloureuses et sans compensation Ont-elles d'ailleurs ce rsultat ? Le bonheur, c'est l'tat de sant ; or, la sant ne s'accrot pas mesure que les espces s'lvent. Comparaison du sauvage et du civilis. Contentement du premier. Multiplication des suicides avec la civilisation ; ce qu'elle prouve. Consquences importantes au point de vue de la mthode en sociologie Le progrs viendrait-il de l'ennui que causent les plaisirs devenus habituels ?Ne pas confondre la varit, qui est un lment essentiel du plaisir, avec la nouveaut, qui est secondaire. Caractre pathologique du besoin de nouveaut quand il est trop vif. LES CAUSES
II.
III.
CHAPITRE II: I.
Les progrs de la division du travail ont pour causes : 1 L'effacement du type segmentaire, c'est--dire l'accroissement de la densit morale de la socit, symbolis par l'accroissement de la densit matrielle ; principales formes de cette dernire ; 2 l'accroissement du volume des socits, pourvu qu'il soit accompagn d'un accroissement de densit Thorie de M. Spencer, d'aprs laquelle l'accroissement de volume n'agirait qu'en multipliant les diffrences individuelles. Rfutation
II.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
III.
L'accroissement de volume et de densit dtermine mcaniquement les progrs de la division du travail en renforant l'intensit de la lutte pour la vie. Comment se forme le besoin de produits plus abondants et de meilleure qualit; c'est un rsultat de la cause qui ncessite la spcialisation, non la cause de cette dernire. La division du travail ne se produit donc qu'au sein des socits constitues. Erreur de ceux qui font de la division du travail et de la coopration le fait fondamental de la vie sociale. Application de cette proposition la division internationale du travail. Cas de mutualisme. LES FACTEURS SECONDAIRES L'INDTERMINATION PROGRESSIVE DE LA CONSCIENCE COMMUNE ET SES CAUSES
IV.
CHAPITRE III:
La division du travail ne peut progresser que si la variabilit individuelle s'accrot, et celle-ci ne s'accrot que si la conscience commune rgresse. La ralit de cette rgression a t tablie. Quelles en sont les causes ? I. Comme le milieu social s'tend, la conscience collective s'loigne de plus en plus des choses concrtes et, par suite, devient plus abstraite. Faits l'appui: transcendance de l'ide de Dieu ; caractre plus rationnel du droit, de la morale, de la civilisation en gnral. Cette indtermination laisse plus de place la variabilit individuelle L'effacement du type segmentaire, en dtachant l'individu de son milieu natal, le soustrait l'action des anciens et diminue ainsi l'autorit de la tradition Par suite de l'effacement du type segmentaire, la socit, enveloppant de moins prs l'individu, peut moins bien contenir les tendances divergentes Pourquoi l'organe social ne peut pas, ce point de vue, jouer le rle de segment
II. III. IV.
CHAPITRE IV : LES FACTEURS SECONDAIRES (suite) L'HRDIT L'hrdit est un obstacle aux progrs de la division du travail, faits qui dmontrent qu'elle devient un facteur moindre de la distribution des fonctions. D'o cela vient-il ? I. L'hrdit perd de son empire parce qu'il se constitue des modes d'activit de plus en plus importants qui ne sont pas hrditairement transmissibles. Preuves: 1 il ne se forme pas de races nouvelles; 2 l'hrdit ne transmet bien que les aptitudes gnrales et simples ; or, les activits deviennent plus complexes en devenant plus spciales. Le legs hrditaire devient aussi un facteur moindre de notre dveloppement, parce qu'il faut y ajouter davantage.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
II.
Le legs hrditaire devient plus indtermin. Preuves : 1 l'instinct rgresse des espces animales infrieures aux espces plus leves, de l'animal l'homme. Il y a donc lieu de croire que la rgression continue dans le rgne humain. C'est ce que prouvent les progrs ininterrompus de l'intelligence, laquelle varie en raison inverse de l'instinct ; 2 non seulement il ne se forme pas de races nouvelles, mais les races anciennes s'effacent ; 3 recherches de M. Galton. Ce qui se transmet rgulirement, c'est le type moyen. Or, le type moyen devient toujours plus indtermin par suite du dveloppement des diffrences individuelles CONSQUENCES DE CE QUI PRCDE
CHAPITRE V : I.
Caractre plus souple de la division du travail social compare la division du travail physiologique. La cause en est que la fonction devient plus indpendante de l'organe. Dans quel sens cette indpendance est une marque de supriorit La thorie mcaniste de la division du travail implique que la civilisation est le produit de causes ncessaires, non un but qui par soi-mme attire l'activit. Mais, tout en tant un effet, elle devient une fin, un idal. De quelle manire. Il n'y a mme pas de raison de supposer que cet idal prenne jamais une forme immuable, que le progrs ait un terme. Discussion de la thorie contraire de M. Spencer L'accroissement du volume et de la densit, en changeant les socits, change aussi les individus. L'homme est plus affranchi de l'organisme, par suite, la vie psychique se dveloppe. Sous l'influence des mmes causes, la personnalit individuelle se dgage de la personnalit collective. Puisque ces transformations dpendent de causes sociales, la psycho-physiologie ne peut expliquer que les formes infrieures de notre vie psychique. C'est la socit qui explique l'individu en grande partie. Importance de cette proposition au point de vue de la mthode
II.
III.
LIVRE III : LES FORMES ANORMALES
CHAPITRE I : LA DIVISION DU TRAVAIL ANOMIQUE
Formes anormales o la division du travail ne produit pas la solidarit. Ncessit de les tudier I. Cas anormaux dans la vie conomique ; crises industrielles plus frquentes mesure que le travail se divise ; antagonisme du travail et du capital. De mme, l'unit de la science se perd mesure que le travail scientifique se spcialise Thorie d'aprs laquelle ces effets seraient inhrents la division du travail. D'aprs Comte, le remde consiste dans un grand dveloppement de l'organe gouvernemental et dans l'institution d'une philosophie des sciences. Impuissance de l'organe gouvernemental rgler les dtails de la vie conomique de la philosophie des sciences assurer l'unit de la science
II.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
10
III.
Si, dans tous les cas, les fonctions ne concourent pas, c'est que leurs rapports ne sont pas rgls ; la division du travail est anomique. Ncessit d'une rglementation. Comment, normalement, elle drive de la division du travail. Qu'elle fait dfaut dans les exemples cits. Cette anomie vient de ce que les organes solidaires ne sont pas en contact suffisant ou suffisamment prolong. Ce contact est l'tat normal. La division du travail, quand elle est normale, n'enferme donc pas l'individu dans une tche, en l'empchant de rien voir au-del.
CHAPITRE II : I.
LA DIVISION DU TRAVAIL CONTRAINTE
La guerre des classes. Elle vient de ce que l'individu n'est pas en harmonie avec sa fonction, parce que celle-ci lui est impose par contrainte. Ce qui constitue la contrainte : c'est toute espce d'ingalit dans les conditions extrieures de la lutte. Il est vrai qu'il West pas de socits o ces ingalits ne se rencontrent. Mais elles diminuent de plus en plus. La substitution de la solidarit organique la solidarit mcanique rend cette diminution ncessaire. Autre raison qui rend ncessaire ce progrs dans la voie de l'galit. La solidarit contractuelle devient un facteur de plus en plus important du consensus social. Or, le contrat ne lie vraiment que si les valeurs changes sont rellement quivalentes, et, pour qu'il en soit ainsi, il faut que les changistes soient placs dans des conditions extrieures gales. Raisons qui rendent ces injustices plus intolrables mesure que la solidarit organique devient prpondrante. En fait, le droit contractuel et la morale contractuelle deviennent toujours plus exigeants ce point de vue. La vraie libert individuelle ne consiste donc pas dans la suppression de toute rglementation, mais est le produit d'une rglementation ; car cette galit n'est pas dans la nature. Cette oeuvre de justice est la tche qui s'impose aux socits suprieures ; elles ne peuvent se maintenir qu' cette condition
II.
CHAPITRE III:
AUTRE FORME ANORMALE
Cas o la division du travail ne produit pas la solidarit parce que l'activit fonctionnelle de chaque travailleur est insuffisante. Comment la solidarit organique s'accrot avec l'activit fonctionnelle dans les organismes - dans la socit. Qu'en fait l'activit fonctionnelle s'accrot en mme temps que la division du travail, si elle est normale. Raison secondaire qui fait que celle-ci produit la solidarit CONCLUSION I. Solution du problme pratique pos au dbut. La rgle qui nous commande de raliser les traits du type collectif a pour fonction d'assurer la cohsion sociale ; d'autre part, elle est morale et ne peut s'acquitter de sa fonction que parce qu'elle a
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
11
un caractre moral. Or, la rgle qui nous commande de nous spcialiser a la mme fonction ; elle a donc galement une valeur morale. Autre manire de dmontrer cette proposition. Conjecture sur le caractre essentiel de la moralit, induite des classifications prcdentes. La morale, c'est l'ensemble des conditions de la solidarit sociale. Que la division du travail prsente ce critre II. Que la division du travail ne diminue pas la personnalit individuelle : 10 Pourquoi serait-il dans la logique de notre nature de se dvelopper en surface plutt qu'en profondeur ? 20 Bien plus, la personnalit individuelle ne progresse que sous l'influence des causes qui dterminent la division du travail. L'idal de la fraternit humaine ne peut se raliser que si la division du travail progresse en mme temps. Elle est donc lie toute notre vie morale III. Mais la division du travail ne donne naissance la solidarit que si elle produit en mme temps un droit et une morale. Erreur des conomistes ce sujet. Caractre de cette morale : plus humaine, moins transcendante. Plus de justice. Considrations sur la crise actuelle de la morale
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
12
[En grec dans le texte] (ARISTOTE, Pol., B, 1, 1261 a, 24.)
Prface de la seconde dition
Quelques remarques sur les groupements professionnels
Retour la table des matires
En rditant cet ouvrage, nous nous sommes interdit d'en modifier l'conomie premire. Un livre a une individualit qu'il doit garder. Il convient de lui laisser la physionomie sous laquelle il s'est fait connatre 1. Mais il est une ide, qui tait reste dans la pnombre lors de la premire dition, et qu'il nous parat utile de dgager et de dterminer davantage, car elle clairera certaines parties du prsent travail et mme de ceux que nous avons publis depuis 2. Il s'agit du rle que les groupements professionnels sont destins remplir dans l'organisation sociale des peuples contemporains. Si, primitivement, nous n'avions touch ce problme que par voie d'allusions, c'est que nous comptions le reprendre et en faire une tude spciale. Comme d'autres occupations sont survenues qui nous ont dtourn de ce projet, et comme nous ne voyons pas quand il nous sera possible d'y donner suite, nous voudrions profiter de cette seconde dition pour montrer comment cette question se rattache au sujet trait dans la suite de l'ouvrage, pour indiquer en quels termes elle se pose, et surtout pour tcher d'carter les raisons qui empchent encore trop d'esprits d'en bien comprendre l'urgence et la porte. Ce sera l'objet de cette nouvelle prface.
1
Nous nous sommes born supprimer dans l'ancienne Introduction une trentaine de pages qui, aujourd'hui, nous ont paru inutiles. Nous nous expliquons, d'ailleurs, sur cette suppression l'endroit mme o elle a t opre. Voir Le suicide, conclusion.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
13
Nous insistons plusieurs reprises, au cours de ce livre, sur l'tat d'anomie juridique et morale o se trouve actuellement la vie conomique. Dans cet ordre de fonctions, en effet, la morale professionnelle n'existe vritablement qu' l'tat rudimentaire. Il y a une morale professionnelle de l'avocat et du magistrat, du soldat et du professeur, du mdecin et du prtre, etc. Mais si l'on essayait de fixer en un langage un peu dfini les ides en cours sur ce que doivent tre les rapports de l'employeur avec l'employ, de l'ouvrier avec le chef d'entreprise, des industriels concurrents les uns avec les autres ou avec le publie, quelles formules indcises on obtiendrait ! Quelques gnralits sans prcision sur la fidlit et le dvouement que les salaris de toutes sortes doivent ceux qui les emploient, sur la modration avec laquelle ces derniers doivent user de leur prpondrance conomique, une certaine rprobation pour toute concurrence trop ouvertement dloyale, pour toute exploitation par trop criante du consommateur, voil peu prs tout ce que contient la conscience morale de ces professions. De plus, la plupart de ces prescriptions sont dnues de tout caractre juridique; elles ne sont sanctionnes que par l'opinion, non par la loi, et l'on sait combien l'opinion se montre indulgente pour la manire dont ces vagues obligations sont remplies. Les actes les plus blmables sont si souvent absous par le succs que la limite entre ce qui est permis et ce qui est prohib, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, n'a plus rien de fixe, mais parat pouvoir tre dplace presque arbitrairement par les individus. Une morale aussi imprcise et aussi inconsistante ne saurait constituer une discipline. Il en rsulte que toute cette sphre de la vie collective est, en grande partie, soustraite l'action modratrice de la rgle. C'est cet tat d'anomie que doivent tre attribus, comme nous le montrerons, les conflits sans cesse renaissants et les dsordres de toutes sortes dont le monde conomique nous donne le triste spectacle. Car, comme rien ne contient les forces en prsence et ne leur assigne de bornes qu'elles soient tenues de respecter, elles tendent se dvelopper sans termes, et viennent se heurter les unes contre les autres pour se refouler et se rduire mutuellement. Sans doute, les plus intenses parviennent bien craser les plus faibles ou se les subordonner. Mais si le vaincu peut se rsigner pour un temps une subordination qu'il est contraint de subir, il ne la consent pas, et, par consquent, elle ne saurait constituer un quilibre stable 1. Des trves imposes par la violence ne sont jamais que provisoires et ne pacifient pas les esprits. Les passions humaines ne s'arrtent que devant une puissance morale qu'elles respectent. Si toute autorit de ce genre fait dfaut, c'est la loi du plus fort qui rgne, et, latent ou aigu, l'tat de guerre est ncessairement chronique. Qu'une telle anarchie soit un phnomne morbide, c'est ce qui est de toute vidence, puisqu'elle va contre le but mme de toute socit, qui est de supprimer ou, tout au moins, de modrer la guerre entre les hommes, en subordonnant la loi physique du plus fort une loi plus haute. En vain, pour justifier cet tat d'irrglemen1
Voir liv. III, chap. 1er, III.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
14
tation, fait-on valoir qu'il favorise l'essor de la libert individuelle. Rien n'est plus faux que cet antagonisme qu'on a trop souvent voulu tablir entre l'autorit de la rgle et la libert de l'individu. Tout au contraire, la libert (nous entendons la libert juste, celle que la socit a le devoir de faire respecter) est elle-mme le produit d'une rglementation. Je ne puis tre libre que dans la mesure o autrui est empch de mettre profit la supriorit physique, conomique ou autre dont il dispose pour asservir ma libert, et seule, la rgle sociale peut mettre obstacle ces abus de pouvoir. On sait maintenant quelle rglementation complique est ncessaire pour assurer aux individus l'indpendance conomique sans laquelle leur libert n'est que nominale. Mais ce qui fait, aujourd'hui en particulier, la gravit exceptionnelle de cet tat, c'est le dveloppement, inconnu jusque-l, qu'ont pris, depuis deux sicles environ, les fonctions conomiques. Tandis qu'elles ne jouaient jadis qu'un rle secondaire, elles sont maintenant au premier rang. Nous sommes loin du temps o elles taient ddaigneusement abandonnes aux classes infrieures. Devant elles, on voit de plus en plus reculer les fonctions militaires, administratives, religieuses. Seules, les fonctions scientifiques sont en tat de leur disputer la place ; et encore la science actuellement n'a-t-elle gure de prestige que dans la mesure o elle peut servir la pratique, c'est--dire en grande partie, aux professions conomiques. C'est pourquoi on a pu, non sans quelque raison, dire de nos socits qu'elles sont ou tendent tre essentiellement industrielles. Une forme d'activit qui a pris une telle place dans l'ensemble de la vie sociale ne peut videmment rester ce point drgle sans qu'il en rsulte les troubles les plus profonds. C'est notamment une source de dmoralisation gnrale. Car, prcisment parce que les fonctions conomiques absorbent aujourd'hui le plus grand nombre des citoyens, il y a une multitude d'individus dont la vie se passe presque tout entire dans le milieu industriel et commercial ; d'o il suit que, comme ce milieu n'est que faiblement empreint de moralit, la plus grande partie de leur existence s'coule en dehors de toute action morale. Or, pour que le sentiment du devoir se fixe fortement en nous, il faut que les circonstances mmes dans lesquelles nous vivons le tiennent perptuellement en veil. Nous ne sommes pas naturellement enclins nous gner et nous contraindre ; si donc nous ne sommes pas invits, chaque instant, exercer sur nous cette contrainte sans laquelle il n'y a pas de morale, comment en prendrions-nous l'habitude ? Si, dans les occupations qui remplissent presque tout notre temps, nous ne suivons d'autre rgle que celle de notre intrt bien entendu, comment prendrions-nous got au dsintressement, l'oubli de soi, au 'sacrifice ? Ainsi l'absence de toute discipline conomique ne peut manquer d'tendre ses effets au-del du monde conomique lui-mme et d'entraner sa suite un abaissement de la moralit publique. Mais, le mal constat, quelle en est la cause et quel en peut tre le remde ?
Dans le corps de l'ouvrage, nous nous sommes surtout attach faire voir que la division du travail n'en saurait tre rendue responsable, comme on l'en a parfois et injustement accuse ; qu'elle ne produit pas ncessairement la dispersion et l'incohrence, mais que les fonctions, quand elles sont suffisamment en contact les unes avec les autres, tendent d'elles-mmes s'quilibrer et se rgler. Mais cette explication est incomplte. Car s'il est vrai que les fonctions sociales cherchent spontanment s'adapter les unes aux autres pourvu qu'elles soient rgulirement en
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
15
rapports, d'un autre ct, ce mode d'adaptation ne devient une rgle de conduite que si un groupe le consacre de son autorit. Une rgle, en effet, n'est pas seulement une manire d'agir habituelle ; c'est, avant tout, une manire d'agir obligatoire, c'est-dire soustraite, en quelque mesure, l'arbitraire individuel. Or, seule une socit constitue jouit de la suprmatie morale et matrielle qui est indispensable pour faire la loi aux individus ; car la seule personnalit morale qui soit au-dessus des personnalits particulires est celle que forme la collectivit. Seule aussi, elle a la continuit et mme la prennit ncessaires pour maintenir la rgle par-del les relations phmres qui l'incarnent journellement. Il y a plus, son rle ne se borne pas simplement riger en prceptes impratifs les rsultats les plus gnraux des contrats particuliers; mais elle intervient d'une manire active et positive dans la formation de toute rgle. D'abord, elle est l'arbitre naturellement dsign pour dpartager les intrts en conflit et pour assigner chacun les bornes qui conviennent. Ensuite, elle est la premire intresse ce que l'ordre et la paix rgnent; si l'anomie est un mal, c'est avant tout parce que la socit en souffre, ne pouvant se passer, pour vivre, de cohsion et de rgularit. Une rglementation morale ou juridique exprime donc essentiellement des besoins sociaux que la socit seule peut connatre ; elle repose sur un tat d'opinion, et toute opinion est chose collective, produit d'une laboration collective. Pour que l'anomie prenne fin, il faut donc qu'il existe ou qu'il se forme un groupe o se puisse constituer le systme de rgles qui fait actuellement dfaut. Ni la socit politique dans son ensemble, ni l'tat ne peuvent videmment s'acquitter de cette fonction ; la vie conomique, parce qu'elle est trs spciale et qu'elle se spcialise chaque jour davantage, chappe leur comptence et leur action 1. L'activit d'une profession ne peut tre rglemente efficacement que par un groupe assez proche de cette profession mme pour en bien connatre le fonctionnement, pour en sentir tous les besoins et pouvoir suivre toutes leurs variations. Le seul qui rponde ces conditions est celui que formeraient tous les agents d'une mme industrie runis et organiss en un mme corps. C'est ce qu'on appelle la corporation ou le groupe professionnel. Or, dans l'ordre conomique, le groupe professionnel n'existe pas plus que la morale professionnelle. Depuis que, non sans raison, le sicle dernier a supprim les anciennes corporations, il n'a gure t fait que des tentatives fragmentaires et incompltes pour les reconstituer sur des bases nouvelles. Sans doute, les individus qui s'adonnent un mme mtier sont en relations les uns avec les autres par le fait de leurs occupations similaires. Leur concurrence mme les met en rapports. Mais ces rapports n'ont rien de rgulier ; ils dpendent du hasard des rencontres et ont, le plus souvent, un caractre tout fait individuel. C'est tel industriel qui se trouve en contact avec tel autre ; ce n'est pas le corps industriel de telle ou telle spcialit qui se runit pour agir en commun. Exceptionnellement, on voit bien tous les membres d'une mme profession s'assembler en congrs pour traiter quelque question d'intrt gnral ; mais ces congrs ne durent jamais qu'un temps ; ils ne survivent pas aux circonstances particulires qui les ont suscits, et, par suite, la vie collective dont ils ont t l'occasion s'teint plus ou moins compltement avec eux. Les seuls groupements qui aient une certaine permanence sont ce qu'on appelle aujourd'hui les syndicats soit de patrons, soit d'ouvriers. Assurment il y a l un commencement d'organisation professionnelle, mais encore bien informe et rudimentaire. Car, d'abord, un syndicat est une association prive, sans autorit lgale,
1
Nous revenons plus loin sur ce point, p. 350 et suiv.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
16
dpourvue, par consquent, de tout pouvoir rglementaire. Le nombre en est thoriquement illimit, mme l'intrieur d'une mme catgorie industrielle ; et comme chacun d'eux est indpendant des autres, s'ils ne se fdrent et ne s'unifient, il n'y a rien en eux qui exprime l'unit de la profession dans son ensemble. Enfin, non seulement les syndicats de patrons et les syndicats d'employs sont distincts les uns des autres, ce qui est lgitime et ncessaire, mais il n'y a pas entre eux de contacts rguliers. Il n'existe pas d'organisation commune qui les rapproche, sans leur faire perdre leur individualit, et o ils puissent laborer en commun une rglementation qui, fixant leurs rapports mutuels, s'impose aux uns et aux autres avec la mme autorit ; par suite, c'est toujours la loi du plus fort qui rsout les conflits, et l'tat de guerre subsiste tout entier. Sauf pour ceux de leurs actes qui relvent de la morale commune, patrons et ouvriers sont, les uns par rapport aux autres, dans la mme situation que deux tats autonomes, mais de force ingale. Ils peuvent, comme le font les peuples par l'intermdiaire de leurs gouvernements, former entre eux des contrats. Mais ces contrats n'expriment que l'tat respectif des forces conomiques en prsence, comme les traits que concluent deux belligrants ne font qu'exprimer l'tat respectif de leurs forces militaires. Ils consacrent un tat de fait; ils ne sauraient en faire un tat de droit. Pour qu'une morale et un droit professionnels puissent s'tablir dans les diffrentes professions conomiques, il faut donc que la corporation, au lieu de rester un agrgat confus et sans unit, devienne, ou plutt redevienne un groupe dfini, organis, en un mot une institution publique. Mais tout projet de ce genre vient se heurter un certain nombre de prjugs qu'il importe de prvenir ou de dissiper.
Et d'abord, la corporation a contre elle son pass historique. Elle passe, en effet, pour tre troitement solidaire de notre ancien rgime politique, et, par consquent, pour ne pouvoir lui survivre. Il semble que rclamer pour l'industrie et le commerce une organisation corporative, ce soit entreprendre de remonter le cours de l'histoire ; or, de telles rgressions sont justement regardes ou comme impossibles ou comme anormales. L'argument porterait si l'on proposait de ressusciter artificiellement la vieille corporation telle qu'elle existait au Moyen Age. Mais ce n'est pas ainsi que la question se pose. Il ne s'agit pas de savoir si l'institution mdivale peut convenir identiquement nos socits contemporaines, mais si les besoins auxquels elle rpondait ne sont pas de tous les temps, quoiqu'elle doive, pour y satisfaire, se transformer suivant les milieux. Or, ce qui ne permet pas de voir dans les corporations une organisation temporaire, bonne seulement pour une poque et une civilisation dtermine, c'est, la fois, leur haute antiquit et la manire dont elles se sont dveloppes dans l'histoire. Si elles dataient uniquement du Moyen Age, on pourrait croire, en effet, que, nes avec un systme politique, elles devaient ncessairement disparatre avec lui. Mais, en ralit, elles ont une bien plus ancienne origine. En gnral, elles apparaissent ds qu'il y a des mtiers, c'est--dire ds que l'industrie cesse d'tre purement agricole. Si elles semblent tre restes inconnues de la Grce, au moins jusqu' l'poque de la conqute romaine, c'est que les mtiers, y tant mpriss, taient exercs presque
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
17
exclusivement par des trangers et se trouvaient par cela mme en dehors de l'organisation lgale de la cit 1. Mais Rome, elles datent au moins des premiers temps de la Rpublique ; une tradition en attribuait mme la cration au roi Numa 2. Il est vrai que, pendant longtemps, elles durent mener une existence assez humble, car les historiens et les monuments n'en parlent que rarement ; aussi ne savons-nous que fort mal comment elles taient organises. Mais, ds l'poque de Cicron, leur nombre tait devenu considrable et elles commenaient jouer un rle. A ce moment, dit Waltzing, toutes les classes de travailleurs semblent possdes du dsir de multiplier les associations professionnelles . Le mouvement ascensionnel continua ensuite, jusqu' atteindre, sous l'Empire, une extension qui n'a peut-tre pas t dpasse depuis, si l'on tient compte des diffrences conomiques 3. Toutes les catgories d'ouvriers, qui taient fort nombreuses, finirent, semble-t-il, par se constituer en collges, et il en fut de mme des gens qui vivaient du commerce. En mme temps, le caractre de ces groupements se modifia; ils finirent par devenir de vritables rouages de l'administration. Ils remplissaient des fonctions officielles; chaque profession tait regarde comme un service publie dont la corporation correspondante avait la charge et la responsabilit, envers l'tat 4. Ce fut la ruine de l'institution. Car cette dpendance vis--vis de l'tat ne tarda pas dgnrer en une servitude intolrable que les empereurs ne purent maintenir que par la contrainte. Toutes sortes de procds furent employs pour empcher les travailleurs de se drober aux lourdes obligations qui rsultaient pour eux de leur profession mme : on alla jusqu' recourir au recrutement et l'enrlement forcs. Un tel systme ne pouvait videmment durer qu'autant que le pouvoir politique tait assez fort pour l'imposer. C'est pourquoi il ne survcut pas la dissolution de l'Empire. D'ailleurs, les guerres civiles et les invasions avaient dtruit le commerce et l'industrie ; les artisans profitrent de ces circonstances pour fuir les villes et se disperser dans les campagnes. Ainsi les premiers sicles de notre re virent se produire un phnomne qui devait se rpter identiquement la fin du XVIIIe : la vie corporative s'teignit presque compltement. C'est peine s'il en subsista quelques traces, en Gaule et en Germanie, dans les villes d'origine romaine. Si donc un thoricien avait, ce moment, pris conscience de la situation, il et vraisemblablement conclu, comme le firent plus tard les conomistes, que les corporations n'avaient pas, ou, du moins, n'avaient plus de raison d'tre, qu'elles avaient disparu sans retour, et il aurait sans doute trait de rtrograde et d'irralisable toute tentative pour les reconstituer. Mais les vnements eussent tt fait de dmentir une telle prophtie. En effet, aprs une clipse d'un temps, les corporations recommencrent une nouvelle existence dans toutes les socits europennes. Elles durent renatre vers le
1
3 4
Voir HERRMANN, Lehrbuch des griechischen Antiquitten, 4te B., 3e d., p. 398. Parfois, l'artisan tait mme, en vertu de sa profession, priv du droit de cit (ibid., p. 392). - Reste savoir si, dfaut d'une organisation lgale et officielle, il n'y en avait pas de clandestine. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait des corporations de commerants (Voir FRANCOTTE, L'industrie dans la Grce antique, t. II, p. 204 et suiv.). PLUTARQUE, Numa, XVII ; PLINE, Hist. nat., XXXIV. Ce n'est sans doute qu'une lgende, mais elle prouve que les Romains voyaient dans leurs corporations une de leurs plus anciennes institutions. tude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, t. I, pp. 56-57. Certains historiens croient que, ds le principe, les corporations furent en rapports avec l'tat. Mais il est bien certain, en tout cas, que leur caractre officiel fut autrement dvelopp sous l'Empire.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
18
XIe et le XIIe sicle. Ds ce moment, dit M. Levasseur, les artisans commencent sentir le besoin de s'unir et forment leurs premires associations 1 . En tout cas, au XIIIe sicle, elles sont de nouveau florissantes, et elles se dveloppent jusqu'au jour o commence Pour elles une nouvelle dcadence. Une institution aussi persistante ne saurait dpendre d'une particularit contingente et accidentelle ; encore bien moins est-il possible d'admettre qu'elle ait t le produit de je ne sais quelle aberration collective. Si depuis les origines de la cit jusqu' l'apoge de l'Empire, depuis l'aube des socits chrtiennes jusqu'aux temps modernes, elles ont t ncessaires, c'est qu'elles rpondent des besoins durables et profonds. Surtout le fait mme qu'aprs avoir disparu une premire fois, elles se sont reconstitues d'elles-mmes et sous une forme nouvelle, te toute valeur l'argument qui prsente leur disparition violente la fin du sicle dernier comme une preuve qu'elles ne sont plus en harmonie avec les nouvelles conditions de l'existence collective. Au reste, le besoin que ressentent aujourd'hui toutes les grandes socits civilises de les rappeler la vie est le symptme le plus sr que cette suppression radicale n'tait pas un remde et que la rforme de Turgot en ncessitait une autre qui ne saurait tre indfiniment ajourne.
II
Mais si toute organisation corporative n'est pas ncessairement un anachronisme historique, est-on fond croire qu'elle soit appele jouer, dans nos socits contemporaines, le rle considrable que nous lui attribuons ? Car si nous la jugeons indispensable, c'est cause, non des services conomiques qu'elle pourrait rendre, mais de l'influence morale qu'elle pourrait avoir. Ce que nous voyons avant tout dans le groupe professionnel, c'est un pouvoir moral capable de contenir les gosmes individuels, d'entretenir dans le cur des travailleurs un plus vif sentiment de leur solidarit commune, d'empcher la loi du plus fort de s'appliquer aussi brutalement aux relations industrielles et commerciales. Or il passe pour tre impropre un tel rle. Parce qu'il est n l'occasion d'intrts temporels, il semble qu'il ne puisse servir qu' des fins utilitaires, et les souvenirs laisss par les corporations de l'ancien rgime ne font que confirmer cette impression. On se les reprsente volontiers dans l'avenir telles qu'elles taient pendant les derniers temps de leur existence, occupes avant tout maintenir ou accrotre leurs privilges et leurs monopoles, et l'on ne voit pas comment des proccupations aussi troitement professionnelles pourraient avoir une action bien favorable sur la moralit du corps ou de ses membres. Mais il faut se garder d'tendre tout le rgime corporatif ce qui a pu tre vrai de certaines corporations et pendant un temps trs court de leur dveloppement. Bien loin qu'il soit atteint d'une sorte d'infirmit morale de par sa constitution mme, c'est surtout un rle moral qu'il a jou pendant la majeure partie de son histoire. C'est ce qui est particulirement vident des corporations romaines. Les corporations d'artisans, dit Waltzing, taient loin d'avoir chez les Romains un caractre professionnel aussi prononc qu'au moyen ge : on ne rencontre chez elles ni rglementation sur les mthodes, ni apprentissage impos, ni monopole ; leur but n'tait pas non plus de runir les fonds ncessaires pour exploiter une industrie 2. Sans doute, l'association leur donnait plus de forces pour sauvegarder au besoin leurs intrts
1 2
Les classes ouvrires en France jusqu' la Rvolution, 1, 194. Op. cit., I, 194.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
19
communs. Mais ce n'tait l qu'un des contrecoups utiles que produisait l'institution ; ce n'en tait pas la raison d'tre, la fonction principale. Avant tout, la corporation tait un collge religieux. Chacune d'elles avait son dieu particulier dont le culte, quand elle en avait les moyens, se clbrait dans un temple spcial. De mme que chaque famille avait son Lar familiaris, chaque cit son Genius publicus, chaque collge avait son dieu tutlaire, Genius collegii. Naturellement, ce culte professionnel n'allait pas sans ftes que l'on clbrait en commun par des sacrifices et des banquets. Toutes sortes de circonstances servaient, d'ailleurs, d'occasion de joyeuses assembles ; de plus, des distributions de vivres ou d'argent avaient souvent lieu aux frais de la communaut. On s'est demand si la corporation avait une caisse de secours, si elle assistait rgulirement ceux de ses membres qui se trouvaient dans le besoin, et les avis sur ce point se sont partags 1. Mais ce qui enlve la discussion une partie de son intrt et de sa porte, c'est que ces banquets communs, plus ou moins priodiques, et les distributions qui les accompagnaient souvent tenaient lieu de secours et faisaient l'office d'une assistance indirecte. De toute manire, les malheureux savaient qu'ils pouvaient compter sur cette subvention dissimule. -Comme corollaire de ce caractre religieux, le collge d'artisans tait, en mme temps, un collge funraire. Unis, comme les Gentiles, dans un mme culte pendant leur vie, les membres de la corporation voulaient, comme eux aussi, dormir ensemble leur dernier sommeil. Toutes les corporations qui taient assez riches avaient un columbarium collectif, o, quand le collge n'avait pas les moyens d'acheter une proprit funraire, il assurait du moins ses membres d'honorables funrailles aux frais de la caisse commune. Un culte commun, des banquets communs, des ftes communes, un cimetire commun, n'est-ce pas, runis ensemble, tous les caractres distinctifs de l'organisation domestique chez les Romains ? Aussi a-t-on pu dire que la corporation romaine tait une grande famille . Aucun mot, dit Waltzing, n'indique mieux la nature des rapports qui unissaient les confrres, et bien des indices prouvent qu'une grande fraternit rgnait dans leur sein 2. La communaut des intrts tenait lieu des liens du sang. Les membres se regardaient si bien comme des frres que, parfois, ils se donnaient ce nom entre eux. L'expression la plus ordinaire tait, il est vrai, celle de sodales; mais ce mot mme exprime une parent spirituelle qui implique une troite fraternit. Le protecteur et la protectrice du collge prenaient souvent le titre de pre et de mre. Une preuve du dvouement que les confrres avaient pour leur collge, ce sont les legs et les donations qu'ils lui font. Ce sont aussi ces monuments funraires o nous lisons : Pius in collegio, il fut pieux envers son collge, comme on disait Pius in suos 3. Cette vie familiale tait mme tellement dveloppe que M. Boissier en fait le but principal de toutes les corporations romaines. Mme dans les corporations ouvrires, dit-il, on s'associait avant tout pour le plaisir de vivre ensemble, pour trouver hors de chez soi des distractions ses fatigues et ses ennuis, pour se faire une intimit moins restreinte que la famille, moins tendue que la cit, et se rendre ainsi la vie plus facile et plus agrable 4. Comme les socits chrtiennes appartiennent un type social trs diffrent de la cit, les corporations du Moyen Age ne ressemblaient pas exactement aux corporations romaines. Mais elles aussi constituaient pour leurs membres des milieux
1 2 3 4
Le plus grand nombre des historiens estime que certains collges tout au moins taient des socits de secours mutuels. Op. cit., I, p. 330. Op. cit., I, p. 331. La religion romaine, II, p. 287-288.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
20
moraux. La corporation, dit M. Levasseur, unissait par des liens troits les gens du mme mtier. Assez souvent, elle s'tablissait dans la paroisse ou dans une chapelle particulire et se mettait sous l'invocation d'un saint qui devenait le patron de toute la communaut... C'tait l qu'on s'assemblait, qu'on assistait en grande crmonie des messes solennelles aprs lesquelles les membres de la confrrie allaient, tous ensemble, terminer leur journe par un joyeux festin. Par ce ct, les corporations du Moyen Age ressemblaient beaucoup celles de l'poque romaine 1. La corporation, d'ailleurs, consacrait souvent une partie des fonds qui alimentaient son budget des oeuvres de bienfaisance. D'autre part, des rgles prcises fixaient, pour chaque mtier, les devoirs respectifs des patrons et des ouvriers, aussi bien que les devoirs des patrons les uns envers les autres 2. Il y a, il est vrai, de ces rglements qui peuvent n'tre pas d'accord avec nos ides actuelles ; mais c'est d'aprs la morale du temps qu'il les faut juger, puisque c'est elle qu'ils expriment. Ce qui est incontestable, c'est qu'ils sont tous inspirs par le souci, non de tels ou tels intrts individuels mais de l'intrt corporatif, bien ou mal compris, il n'importe. Or, la subordination de l'utilit prive l'utilit commune quelle qu'elle soit a toujours un caractre moral, car elle implique ncessairement quelque esprit de sacrifice et d'abngation. D'ailleurs, beaucoup de ces prescriptions procdaient de sentiments moraux qui sont encore les ntres. Le valet tait protg contre les caprices du matre qui ne pouvait le renvoyer volont. Il est vrai que l'obligation tait rciproque ; mais, outre que cette rciprocit est juste par elle-mme, elle se justifie mieux encore par suite des importants privilges dont jouissait alors l'ouvrier. C'est ainsi qu'il tait dfendu aux matres de le frustrer de son droit au travail en se faisant assister par leurs voisins ou mme par leurs femmes. En un mot, dit M. Levasseur, ces rglements sur les apprentis et les ouvriers sont loin d'tre ddaigner pour l'historien et pour l'conomiste. Ils ne sont pas l'uvre d'un sicle barbare. Ils portent le cachet d'un esprit de suite et d'un certain bon sens, qui sont, sans aucun doute, dignes de remarque 3 . Enfin, toute une rglementation tait destine garantir la probit professionnelle. Toutes sortes de prcautions taient prises pour empcher le marchand ou l'artisan de tromper l'acheteur, pour les obliger faire oeuvre bonne et loyale 4 . - Sans doute, un moment arriva o les rgles devinrent inutilement tracassires, o les matres se proccuprent beaucoup plus de sauvegarder leurs privilges que de veiller au bon renom de la profession et l'honntet de ses membres. Mais il n'y a pas d'institution qui, un moment donn, ne dgnre, soit qu'elle ne sache pas changer temps, et s'immobilise, soit qu'elle se dveloppe dans un sens unilatral, en outrant certaines de ses proprits : ce qui la rend malhabile rendre les services mmes dont elle a la charge. Ce peut tre une raison pour chercher la rformer, non pour la dclarer tout jamais inutile et la dtruire. Quoi qu'il en soit de ce point, les faits qui prcdent suffisent prouver que le groupe professionnel n'est nullement incapable d'exercer une action morale. La place si considrable que la religion tenait dans sa vie, tant Rome qu'au Moyen Age, met tout particulirement en vidence la nature vritable de ses fonctions ; car toute communaut religieuse constituait alors un milieu moral, de mme que toute discipline morale tendait forcment prendre une forme religieuse. Et d'ailleurs ce
1 2
3 4
Op. cit., I, pp. 217-218. Op. cit., I, p. 221. - Voir sur le mme caractre moral de la corporation, pour l'Allemagne, GIERKE, Das Deutsche Genossenschaftswesen, I, 384 ; pour l'Angleterre, ASHLEY, Hist. des doctrines conomiques, I, p. 101. Op. cit., p. 238. Op. cit., pp. 240-261.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
21
caractre de l'organisation corporative est d l'action de causes trs gnrales, que l'on peut voir agir dans d'autres circonstances. Du moment que, au sein d'une socit politique, un certain nombre d'individus se trouvent avoir en commun des ides, des intrts, des sentiments, des occupations que le reste de la population ne partage pas avec eux, il est invitable que, sous l'influence de ces similitudes, ils soient attirs les uns vers les autres, qu'ils se recherchent, entrent en relations, s'associent, et qu'ainsi se forme peu peu un groupe restreint, ayant sa physionomie spciale, au sein de la socit gnrale. Mais une fois que le groupe est form, il s'en dgage une vie morale qui porte naturellement la marque des conditions particulires dans lesquelles elle s'est labore. Car il est impossible que des hommes vivent ensemble, soient rgulirement en commerce sans qu'ils prennent le sentiment du tout qu'ils forment par leur union, sans qu'ils s'attachent ce tout, se proccupent de ses intrts et en tiennent compte dans leur conduite. Or, cet attachement quelque chose qui dpasse l'individu, cette subordination des intrts particuliers l'intrt gnral est la source mme de toute activit morale. Que ce sentiment se prcise et se dtermine, qu'en s'appliquant aux circonstances les plus ordinaires et les plus importantes de la vie il se traduise en formules dfinies, et voil un corps de rgles morales en train de se constituer. En mme temps que ce rsultat se produit de lui-mme et par la force des choses, il est utile et le sentiment de son utilit contribue le confirmer. La socit n'est mme pas seule intresse ce que ces groupes spciaux se forment pour rgler l'activit qui se dveloppe en eux et qui, autrement, deviendrait anarchique ; l'individu, de son ct, y trouve une source de joies. Car l'anarchie lui est douloureuse lui-mme. Lui aussi, il souffre des tiraillements et des dsordres qui se produisent toutes les fois que les rapports inter-individuels ne sont soumis aucune influence rgulatrice. Il n'est pas bon pour l'homme de vivre ainsi sur le pied de guerre au milieu de ses compagnons immdiats. Cette sensation d'une hostilit gnrale, la dfiance mutuelle qui en rsulte, la tension qu'elle ncessite sont des tats pnibles quand ils sont chroniques ; si nous aimons la guerre, nous aimons aussi les joies de la paix, et ces dernires ont d'autant plus de prix pour les hommes qu'ils sont plus profondment socialiss, c'est--dire (car les deux mots sont quivalents) plus profondment civiliss. La vie commune est attrayante, en mme temps que coercitive. Sans doute, la contrainte est ncessaire pour amener l'homme se dpasser luimme, surajouter sa nature physique une autre nature ; mais, mesure qu'il apprend goter les charmes de cette existence nouvelle, il en contracte le besoin, et il n'est point d'ordre d'activit o il ne les recherche passionnment. Voil pourquoi, quand des individus qui se trouvent avoir des intrts communs s'associent, ce n'est pas seulement pour dfendre ces intrts, c'est pour s'associer, pour ne plus se sentir perdus au milieu d'adversaires, pour avoir le plaisir de communier, de ne faire qu'un avec plusieurs, c'est--dire, en dfinitive, pour mener ensemble une mme vie morale. La morale domestique ne s'est pas forme autrement. A cause du prestige que la famille garde nos yeux, il nous semble que si elle a t et si elle est toujours une cole de dvouement et d'abngation, le foyer par excellence de la moralit, c'est en vertu de caractres tout particuliers dont elle aurait le privilge et qui ne se retrouveraient ailleurs aucun degr. On se plat croire qu'il y a dans la consanguinit une cause exceptionnellement puissante de rapprochement moral. Mais nous avons eu souvent l'occasion de montrer 1 que la consanguinit n'a nullement l'efficacit extraordinaire qu'on lui attribue. La preuve en est que, dans une multitude de socits, les
1
Voir notamment Anne sociologique, 1, p. 313 et suiv.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
22
non-consanguins se trouvent en nombre au sein de la famille : la parent dite artificielle se contracte alors avec une trs grande facilit, et elle a tous les effets de la parent naturelle. Inversement, il arrive trs souvent que des consanguins trs proches sont, moralement ou juridiquement, des trangers les uns pour les autres : c'est, par exemple, le cas des cognats dans la famille romaine. La famille ne doit donc pas ses vertus l'unit de descendance : c'est tout simplement un groupe d'individus qui se trouvent avoir t rapprochs les uns des autres, au sein de la socit politique, par une communaut plus particulirement troite d'ides, de sentiments et d'intrts. La consanguinit a pu faciliter cette concentration ; car elle a naturellement pour effet d'incliner les consciences les unes vers les autres. Mais bien d'autres facteurs sont intervenus : le voisinage matriel, la solidarit des intrts, le besoin de s'unir pour lutter contre un danger commun, ou simplement pour s'unir, ont t des causes autrement puissantes de rapprochement. Or, elles ne sont pas spciales la famille, mais elles se retrouvent, quoique sous d'autres formes, dans la corporation. Si donc le premier de ces groupes a jou un rle si considrable dans l'histoire morale de l'humanit, pourquoi le second en serait-il incapable ? Sans doute, il y aura toujours entre eux cette diffrence que les membres de la famille mettent en commun la totalit de leur existence, les membres de la corporation leurs seules proccupations professionnelles. La famille est une sorte de socit complte dont l'action s'tend aussi bien sur notre activit conomique que sur notre activit religieuse, politique, scientifique, etc. Tout ce que nous faisons d'un peu important, mme en dehors de la maison, y fait cho et y provoque des ractions appropries. La sphre d'influence de la corporation est, en un sens, plus restreinte. Encore ne faut-il pas perdre de vue la place toujours plus importante que la profession prend dans la vie mesure que le travail se divise davantage ; car le champ de chaque activit individuelle tend de plus en plus se renfermer dans les limites marques par les fonctions dont l'individu est spcialement charg. De plus, si l'action de la famille s'tend tout, elle ne peut tre que trs gnrale ; le dtail lui chappe. Enfin et surtout la famille, en perdant son unit et son indivisibilit d'autrefois, a perdu du mme coup une grande partie de son efficacit. Comme elle se disperse aujourd'hui chaque gnration, l'homme passe une notable partie de son existence loin de toute influence domestique 1. La corporation n'a pas de ces intermittences, elle est continue comme la vie. L'infriorit qu'elle peut prsenter certains gards par rapport la famille n'est donc pas sans compensation. Si nous avons cru devoir rapprocher ainsi la famille et la corporation, ce n'est pas simplement pour tablir entre elles un parallle instructif, mais c'est que ces deux institutions ne sont pas sans quelques rapports de parent. C'est ce que montre notamment l'histoire des corporations romaines. Nous avons vu, en effet, qu'elles se sont formes sur le modle de la socit domestique dont elles ne furent d'abord qu'une forme nouvelle et agrandie. Or, le groupe professionnel ne rappellerait pas ce point le groupe familial s'il n'y avait entre eux quelque lien de filiation. Et en effet, la corporation a t, en un sens, l'hritire de la famille. Tant que l'industrie est exclusivement agricole, elle a dans la famille et dans le village, qui n'est lui-mme qu'une sorte de grande famille, son organe immdiat, et elle n'en a pas besoin d'autre. Comme l'change n'est pas ou est peu dvelopp, la vie de l'agriculteur ne le tire pas hors du cercle familial. L'activit conomique n'ayant pas de contrecoup en dehors de la maison, la famille suffit la rgler et sert ainsi elle-mme de groupe professionnel. Mais il n'en est plus de mme une fois qu'il existe des mtiers. Car pour vivre d'un
1
Nous avons dvelopp celte ide dans Le suicide, p. 433.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
23
mtier il faut des clients, et il faut sortir de la maison pour les trouver ; il faut en sortir aussi pour entrer en rapports avec les concurrents, lutter contre eux, s'entendre avec eux. Au reste, les mtiers supposent plus ou moins directement les villes, et les villes se sont toujours formes et recrutes principalement au moyen d'immigrants, c'est-dire d'individus qui ont quitt leur milieu natal. Une forme nouvelle d'activit tait donc ainsi constitue qui dbordait du vieux cadre familial. Pour qu'elle ne restt pas l'tat inorganis, il fallait qu'elle se crt un cadre nouveau, qui lui ft propre ; autrement dit, il tait ncessaire qu'un groupe secondaire, d'un genre nouveau, se formt. C'est ainsi que la corporation prit naissance : elle se substitua la famille dans l'exercice d'une fonction qui avait d'abord t domestique, mais qui ne pouvait plus garder ce caractre. Une telle origine ne permet pas de lui attribuer cette espce d'amoralit constitutionnelle qu'on lui prte gratuitement. De mme que la famille a t le milieu au sein duquel se sont labors la morale et le droit domestiques, la corporation est le milieu naturel au sein duquel doivent s'laborer la morale et le droit professionnels.
III
Mais, pour dissiper toutes les prventions, pour bien montrer que le systme corporatif n'est pas seulement une institution du pass, il serait ncessaire de faire voir quelles transformations il doit et peut subir pour s'adapter aux socits modernes ; car il est vident qu'il ne peut pas tre aujourd'hui ce qu'il tait au Moyen ge. Pour pouvoir traiter cette question avec mthode, il faudrait avoir tabli au pralable de quelle manire le rgime corporatif a volu dans le pass et quelles sont les causes qui ont dtermin les principales variations qu'il a subies. On pourrait alors prjuger avec quelque certitude ce qu'il est appel devenir, tant donn les conditions dans lesquelles les socits europennes se trouvent actuellement places. Mais, pour cela, des tudes comparatives seraient ncessaires qui ne sont pas faites et que nous ne pouvons faire chemin faisant. Peut-tre, pourtant, n'est-il pas impossible d'apercevoir ds maintenant, mais seulement dans ses lignes les plus gnrales, ce qu'a t ce dveloppement. De ce qui prcde il ressort dj que la corporation ne fut pas Rome ce qu'elle devint plus tard dans les socits chrtiennes. Elle n'en diffre pas seulement par son caractre plus religieux et moins professionnel, mais par la place qu'elle occupait dans la socit. Elle fut, en effet, au moins l'origine, une institution extra-sociale. L'historien qui entreprend de rsoudre en ses lments l'organisation politique des Romains, ne rencontre, au cours de son analyse, aucun fait qui puisse l'avertir de l'existence des corporations. Elles n'entraient pas, en qualit d'units dfinies et reconnues, dans la constitution romaine. Dans aucune des assembles lectorales, dans aucune des runions de l'arme, les artisans ne s'assemblaient par collges : nulle part le groupe professionnel ne prenait part, comme tel, la vie publique, soit en corps, soit par l'intermdiaire de reprsentants rguliers. Tout au plus la question peut-elle se poser propos de trois ou quatre collges que l'on a cru pouvoir identifier avec certaines des centuries constitues par Servius Tullius (tignarii, aerarii, tibicines, cornicines) ;
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
24
encore le fait est-il mal tabli 1. Et quant aux autres corporations, elles taient certainement en dehors de l'organisation officielle du peuple romain 2. Cette situation excentrique, en quelque sorte, s'explique par les conditions mmes dans lesquelles elles s'taient formes. Elles apparaissent au moment o les mtiers commencent se dvelopper. Or, pendant longtemps, les mtiers ne furent qu'une forme accessoire et secondaire de l'activit sociale des Romains. Rome tait essentiellement une socit agricole et guerrire. Comme socit agricole, elle tait divise en gentes et en curies ; l'assemble par centuries refltait plutt l'organisation militaire. Quant aux fonctions industrielles, elles taient trop rudimentaires pour affecter la structure politique de la cit 3. D'ailleurs, jusqu' un moment trs avanc de l'histoire romaine, les mtiers sont rests frapps d'un discrdit moral qui ne leur permettait pas d'occuper une place rgulire dans l'tat. Sans doute, il vint un temps o leur condition sociale s'amliora. Mais la manire dont fut obtenue cette amlioration est elle-mme significative. Pour arriver faire respecter leurs intrts et jouer un rle dans la vie publique, les artisans durent recourir des procds irrguliers et extra-lgaux. Ils ne triomphrent du mpris dont ils taient l'objet qu'au moyen d'intrigues, de complots, d'agitation clandestine 4. C'est l meilleure preuve que, d'elle-mme, la socit romaine ne leur tait pas ouverte. Et si, plus tard, ils finirent par tre intgrs dans l'tat pour devenir des rouages de la machine administrative, cette situation ne fut pas pour eux une conqute glorieuse, mais une pnible dpendance ; s'ils entrrent alors dans l'tat, ce ne fut pas pour y occuper la place laquelle leurs services sociaux pouvaient leur donner droit, mais simplement pour pouvoir tre plus adroitement surveills par le pouvoir gouvernemental. La corporation, dit Levasseur, devint la chane qui les rendit captifs et que la main impriale serra d'autant plus que leur travail tait plus pnible ou plus ncessaire l'tat 5. Tout autre est leur place dans les socits du Moyen ge. D'emble, ds que la corporation apparat, elle se prsente comme le cadre normal de cette partie de la population qui tait appele jouer dans l'tat un rle si considrable : la bourgeoisie ou le tiers-tat. En effet, pendant longtemps, bourgeois et gens de mtier ne font qu'un. La bourgeoisie au XIIIe sicle, dit Levasseur, tait exclusivement compose de gens de mtier. La classe des magistrats et des lgistes commenait peine se former ; les hommes d'tude appartenaient encore au clerg ; le nombre des rentiers tait trs restreint, parce que la proprit territoriale tait alors presque toute aux mains des nobles ; il ne restait aux roturiers que le travail de l'atelier et du comptoir, et c'tait par l'industrie ou par le commerce qu'ils avaient conquis un rang dans le royaume 6. Il en fut de mme en Allemagne.
1
3 4 5 6
Il parat plus vraisemblable que les centuries ainsi dnommes ne contenaient pas tous les charpentiers, tous les forgerons, mais ceux-l seulement qui fabriquaient ou rparaient les armes et les machines de guerre. Denys d'Halicarnasse nous dit formellement que les ouvriers ainsi groups avaient une fonction purement militaire [en grec dans le texte] ; ce n'tait donc pas des collges proprement dits, mais des divisions de l'arme. Tout ce que nous disons sur la situation des corporations laisse entire la question controverse de savoir si l'tat, ds le dbut, est intervenu dans leur formation. Alors mme qu'elles auraient t, ds le principe, sous la dpendance de l'tat (ce qui ne parat pas vraisemblable), il reste qu'elles n'affectaient pas la structure politique. C'est ce qui nous importe. Si l'on descend d'un degr l'volution, leur situation est encore plus excentrique. A Athnes, elles ne sont pas seulement extra-sociales, mais presque extra-lgales. WALTZING, op. cit., I, p. 85 et suiv. Op. cit., I, p. 31. Op. cit., I, p. 191.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
25
Bourgeois et citadin taient des termes synonymes, et, d'un autre ct, nous savons que les villes allemandes se sont formes autour de marchs permanents, ouverts par un seigneur sur un point de son domaine 1. La population qui venait se grouper autour de ces marchs, et qui devint la population urbaine, tait donc presque exclusivement faite d'artisans et de marchands. Aussi les mots de forenses ou de mercatores servaient-ils indiffremment dsigner les habitants des villes, et le jus civile ou droit urbain est trs souvent appel jus fori ou droit du march. L'organisation des mtiers et du commerce semble donc bien avoir t l'organisation primitive de la bourgeoisie europenne. Aussi, quand les villes s'affranchirent de la tutelle seigneuriale, quand la commune se forma, le corps de mtiers, qui avait devanc et prpar ce mouvement, devint la base de la constitution communale. En effet, dans presque toutes les communes, le systme politique et l'lection des magistrats sont fonds sur la division des citoyens en corps de mtiers 2 . Trs souvent on votait par corps de mtiers, et l'on choisissait en mme temps les chefs de la corporation et ceux de la commune. A Amiens, par exemple, les artisans se runissaient tous les ans pour lire les maires de chaque corporation ou bannire ; les maires lus nommaient ensuite douze chevins qui en nommaient douze autres et l'chevinage prsentait son tour aux maires des bannires trois personnes parmi lesquelles ils choisissaient le maire de la commune... Dans quelques cits, le mode d'lection tait encore plus compliqu, mais, dans toutes, l'organisation politique et municipale tait troitement lie l'organisation du travail 3. Inversement, de mme que la commune tait un agrgat de corps de mtiers, le corps de mtiers tait une commune au petit pied, par cela mme qu'il avait t le modle dont l'institution communale tait la forme agrandie et dveloppe. Or, on sait ce qu'a t la commune dans l'histoire de nos socits, dont elle est devenue, avec le temps, la pierre angulaire. Par consquent, puisqu'elle tait une runion de corporations et qu'elle s'est forme sur le type de la corporation,' c'est celle-ci, en dernire analyse, qui a servi de base tout le systme politique qui est issu du mouvement communal. On voit que, chemin faisant, elle a singulirement cr en importance et en dignit. Tandis qu' Rome elle a commenc par tre presque en dehors des cadres normaux, elle a, au contraire, servi de cadre lmentaire nos socits actuelles. C'est une raison nouvelle pour que nous nous refusions y voir une sorte d'institution archaque, destine disparatre de l'histoire. Car si, dans le pass, le rle qu'elle joue est devenu plus vital mesure que le commerce et que l'industrie se dveloppaient, il est tout fait invraisemblable que des progrs conomiques nouveaux puissent avoir pour effet de lui retirer toute raison d'tre. L'hypothse contraire paratrait plus justifie 4.
1 2 3 4
Voir RIETSCHEL, Markt und Stadt in threm rechtlichen Verhltniss, Leipzig, 1897, passim, et tous les travaux de Sohm sur ce point. Op. cit., I, 193. Ibid., I, p. 183. Il est vrai que, quand les mtiers s'organisent en castes, il leur arrive de prendre trs tt une place apparente dans la constitution sociale ; c'est le cas des socits de l'Inde. Mais la caste n'est pas la corporation. C'est essentiellement un groupe familial et religieux, non pas un groupe professionnel. Chacune a son degr de religiosit propre. Et, comme la socit est organise religieusement, cette religiosit, qui dpend de causes diverses, assigne chaque caste un rang dtermin dans l'ensemble du systme social. Mais son rle conomique n'est pour rien dans cette situation officielle (cf. BOUGL, Remarques sur le rgime des castes, Anne sociologique, IV).
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
26
Mais d'autres enseignements se dgagent du rapide tableau qui vient d'tre trac. Tout d'abord, il permet d'entrevoir comment la corporation est tombe provisoirement en discrdit depuis environ deux sicles, et, par suite, ce qu'elle doit devenir pour pouvoir reprendre son rang parmi nos institutions publiques. On vient de voir, en effet, que, sous la forme qu'elle avait au Moyen ge, elle tait troitement lie l'organisation de la commune. Cette solidarit fut sans inconvnients, tant que les mtiers eux-mmes eurent un caractre communal. Tant que, en principe, artisans et marchands eurent plus ou moins exclusivement pour clients les seuls habitants de la ville ou des environs immdiats, c'est--dire tant que le march fut principalement local, le corps de mtiers, avec son organisation municipale, suffit tous les besoins. Mais il n'en fut plus de mme une fois que la grande industrie fut ne ; comme elle n'a rien de spcialement urbain, elle ne pouvait se plier un systme qui n'avait pas t fait pour elle. D'abord, elle n'a pas ncessairement son sige dans une ville ; elle peut mme s'tablir en dehors de toute agglomration, rurale ou urbaine, prexistante ; elle recherche seulement le point du territoire o elle peut le mieux s'alimenter et d'o elle peut rayonner le plus facilement possible. Ensuite, son champ d'action ne se limite aucune rgion dtermine, sa clientle se recrute partout. Une institution, aussi entirement engage dans la commune que l'tait la vieille corporation, ne pouvait donc servir encadrer et rgler une forme d'activit collective qui tait aussi compltement trangre la vie communale. Et en effet, ds que la grande industrie apparut, elle se trouva tout naturellement en dehors du rgime corporatif, et c'est ce qui fit, d'ailleurs, que les corps de mtiers s'efforcrent par tous les moyens d'en empcher les progrs. Cependant, elle ne fut pas pour cela affranchie de toute rglementation : pendant les premiers temps, l'tat joua directement pour elle un rle analogue celui que les corporations jouaient pour le petit commerce et pour les mtiers urbains. En mme temps que le pouvoir royal accordait aux manufactures certains privilges, en retour, il les soumettait son contrle, et c'est ce qu'indique le titre mme de manufactures royales qui leur tait accord. Mais on sait combien l'tat est impropre cette fonction ; cette tutelle directe ne pouvait donc manquer de devenir compressive. Elle fut mme peu prs impossible partir du moment o la grande industrie eut atteint un certain degr de dveloppement et de diversit ; c'est pourquoi les conomistes classiques en rclamrent, et bon droit, la suppression. Mais si la corporation, telle qu'elle existait alors, ne pouvait s'adapter cette forme nouvelle de l'industrie, et si l'tat ne pouvait remplacer l'ancienne discipline corporative, il ne s'ensuivait pas que toute discipline se trouvt dsormais inutile ; il restait seulement que l'ancienne corporation devait se transformer, pour continuer remplir son rle dans les nouvelles conditions de la vie conomique. Malheureusement, elle n'eut pas assez de souplesse pour se rformer temps ; c'est pourquoi elle fut brise. Parce qu'elle ne sut pas s'assimiler la vie nouvelle qui se dgageait, la vie se retira d'elle, et elle devint ainsi ce qu'elle tait la veille de la Rvolution, une sorte de substance morte, de corps tranger qui ne se maintenait plus dans l'organisme social que par une force d'inertie. Il n'est donc pas surprenant qu'un moment soit venu o elle en ait t violemment expulse. Mais la dtruire n'tait pas un moyen de donner satisfaction aux besoins qu'elle n'avait pas su satisfaire. Et c'est ainsi que la question reste encore devant nous, rendue seulement plus aigu par un sicle de ttonnements et d'expriences infructueuses.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
27
Luvre du sociologue n'est pas celle de l'homme d'tat. Nous n'avons donc pas exposer en dtail ce que devrait tre cette rforme. Il nous suffira d'en indiquer les principes gnraux tels qu'ils paraissent ressortir des faits qui prcdent. Ce que dmontre avant tout l'exprience du pass, c'est que les cadres du groupe professionnel doivent toujours tre en rapport avec les cadres de la vie conomique : c'est pour avoir manqu cette condition que le rgime corporatif a disparu. Puisque donc le march, de municipal qu'il tait, est devenu national et international, la corporation doit prendre la mme extension. Au lieu d'tre limite aux seuls artisans d'une ville, elle doit s'agrandir de manire comprendre tous les membres de la profession, disperss sur toute l'tendue du territoire 1; car, en quelque rgion qu'ils se trouvent, qu'ils habitent la ville ou la campagne, ils sont tous solidaires les uns des autres et participent une vie commune. Puisque cette vie commune est, certains gards, indpendante de toute dtermination territoriale, il faut qu'un organe appropri se cre, qui l'exprime et qui en rgularise le fonctionnement. En raison de ses dimensions, un tel organe serait ncessairement en contact et en rapports directs avec l'organe central de la vie collective, car les vnements assez importants pour intresser toute une catgorie d'entreprises industrielles dans un pays ont ncessairement des rpercussions trs gnrales dont l'tat ne peut pas ne pas avoir le sentiment ; ce qui l'amne intervenir. Aussi n'est-ce pas sans fondement que le pouvoir royal tendit instinctivement ne pas laisser en dehors de son action la grande industrie ds qu'elle apparut. Il tait impossible qu'il se dsintresst d'une forme d'activit qui, par sa nature mme, est toujours susceptible d'affecter l'ensemble de la socit. Mais cette action rgulatrice, si elle est ncessaire, ne doit pas dgnrer en une troite subordination, comme il arriva au XVIIe et au XVIIIe sicle. Les deux organes en rapport doivent rester distincts et autonomes : chacun d'eux a ses fonctions dont il peut seul s'acquitter. Si c'est aux assembles gouvernementales qu'il appartient de poser les principes gnraux de la lgislation industrielle, elles sont incapables de les diversifier suivant les diffrentes sortes d'industrie. C'est cette diversification qui constitue la tche propre de la corporation 2. Cette organisation unitaire pour l'ensemble d'un mme pays n'exclut d'ailleurs aucunement la formation d'organes secondaires, comprenant les travailleurs similaires d'une mme rgion ou d'une mme localit, et dont le rle serait de spcialiser encore davantage la rglementation professionnelle suivant les ncessits locales ou rgionales. La vie conomique pourrait ainsi se rgler et se dterminer sans rien perdre de sa diversit.
Nous n'avons pas parler de l'organisation internationale qui, par suite du caractre international du march, se dvelopperait ncessairement par-dessus cette organisation nationale; car, seule, celle-ci peut constituer actuellement une institution juridique. La premire, dans l'tat prsent du droit europen, ne peut rsulter que de libres arrangements conclus entre corporations nationales. Cette spcialisation ne pourrait se faire qu' l'aide d'assembles lues, charges de reprsenter la corporation. Dans l'tat actuel de l'industrie, ces assembles, ainsi que les tribunaux chargs d'appliquer la rglementation professionnelle, devraient videmment comprendre des reprsentants des employs et des reprsentants des employeurs, comme c'est dj le cas dans les tribunaux de prud'hommes ; cela suivant des proportions correspondantes l'importance respective attribue par l'opinion ces deux facteurs de la production. Mais s'il est ncessaire que les uns et les autres se rencontrent dans les conseils directeurs de la corporation, il n'est pas moins indispensable qu' la base de l'organisation corporative ils forment des groupes distincts et indpendants, car leurs intrts sont trop souvent rivaux et antagonistes. Pour qu'ils puissent prendre conscience librement, il faut qu'ils en prennent conscience sparment. Les deux groupements ainsi constitus pourraient ensuite dsigner leurs reprsentants aux assembles communes.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
28
Par cela mme, le rgime corporatif serait protg contre ce penchant l'immobilisme qu'on lui a souvent et justement reproch dans le pass ; car c'est un dfaut qui tenait au caractre troitement communal de la corporation. Tant qu'elle tait limite l'enceinte mme de la ville, il tait invitable qu'elle devnt prisonnire de la tradition, comme la ville elle-mme. Comme, dans un groupe aussi restreint, les conditions de la vie sont peu prs invariables, l'habitude y exerce sur les gens et sur les choses un empire sans contrepoids, et les nouveauts finissent mme par y tre redoutes. Le traditionalisme des corporations n'tait donc qu'un aspect du traditionalisme communal, et il avait les mmes raisons d'tre. Puis, une fois qu'il se fut invtr dans les murs, il survcut aux causes qui lui avaient donn naissance et qui le justifiaient primitivement. C'est pourquoi, quand la concentration matrielle et morale du pays et la grande industrie qui en fut la consquence eurent ouvert les esprits de nouveaux dsirs, veill de nouveaux besoins, introduit dans les gots et dans les modes une mobilit jusqu'alors inconnue, la corporation, obstinment attache ses vieilles coutumes, fut hors d'tat de rpondre ces nouvelles exigences. Mais des corporations nationales, en raison mme de leur dimension et de leur complexit, ne seraient pas exposes ce danger. Trop d'esprits diffrents y seraient en activit pour qu'une uniformit stationnaire pt s'y tablir. Dans un groupe form d'lments nombreux et divers, il se produit sans cesse des rarrangements, qui sont autant de sources de nouveauts 1. L'quilibre d'une telle organisation n'aurait donc rien de rigide, et, par suite, se trouverait naturellement en harmonie avec l'quilibre mobile des besoins et des ides. Il faut, d'ailleurs, se garder de croire que tout le rle de la corporation doive consister tablir des rgles et les appliquer. Sans doute, partout o il se forme un groupe, se forme aussi une discipline morale. Mais l'institution de cette discipline n'est qu'une des nombreuses manires par lesquelles se manifeste toute activit collective. Un groupe n'est pas seulement une autorit morale qui rgente la vie de ses membres, c'est aussi une source de vie sui generis. De lui se dgage une chaleur qui chauffe ou ranime les curs, qui les ouvre la sympathie, qui fait fondre les gosmes. Ainsi, la famille a t dans le pass la lgislatrice d'un droit et d'une morale, dont la svrit est souvent alle jusqu' l'extrme rudesse, en mme temps que le milieu o les hommes ont appris, pour la premire fois, goter les effusions du sentiment. Nous avons vu de mme comment la corporation, tant Rome qu'au Moyen ge, veillait ces mmes besoins et cherchait y satisfaire. Les corporations de l'avenir auront une complexit d'attributions encore plus grande, en raison de leur ampleur accrue. Autour de leurs fonctions proprement professionnelles viendront s'en grouper d'autres qui reviennent actuellement aux communes ou des socits prives. Telles sont les fonctions d'assistance qui, pour tre bien remplies, supposent entre assistants et assists des sentiments de solidarit, une certaine homognit intellectuelle et morale comme en produit aisment la pratique d'une mme profession. Bien des uvres ducatives (enseignements techniques, enseignements d'adultes, etc.) semblent galement devoir trouver dans la corporation leur milieu naturel. Il en est de mme d'une certaine vie esthtique ; car il parat conforme la nature des choses que cette forme noble du jeu et de la rcration se dveloppe cte cte avec la vie srieuse laquelle elle doit servir de contrepoids et de rparation. En fait, on voit ds prsent des syndicats qui sont en mme temps des socits de secours mutuels, d'autres qui fondent des maisons communes o l'on organise des cours, des
1
Voir plus bas, liv. II, chap. III, IV.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
29
concerts, des reprsentations dramatiques. L'activit corporative peut donc s'exercer sous les formes les plus varies. Mme il y a lieu de supposer que la corporation est appele devenir la base ou une des bases essentielles de notre organisation politique. Nous avons vu, en effet, que si elle commence d'abord par tre extrieure au systme social, elle tend s'y engager de plus en plus profondment mesure que la vie conomique se dveloppe. Tout permet donc de prvoir que, le progrs continuant se faire dans le mme sens, elle devra prendre dans la socit une place toujours plus centrale et plus prpondrante. Elle fut jadis la division lmentaire de l'organisation communale. Maintenant que la commune, d'organisme autonome qu'elle tait autrefois, est venue se perdre dans l'tat comme le march municipal dans le march national, n'est-il pas lgitime de penser que la corporation devrait, elle aussi, subir une transformation correspondante et devenir la division lmentaire de l'tat, l'unit politique fondamentale ? La socit, au lieu de rester ce qu'elle est encore aujourd'hui, un agrgat de districts territoriaux juxtaposs, deviendrait un vaste systme de corporations nationales. On demande de divers cts que les collges lectoraux soient forms par professions et non par circonscriptions territoriales, et il est certain que, de cette faon, les assembles politiques exprimeraient plus exactement la diversit des intrts sociaux et leurs rapports ; elles seraient un rsum plus fidle de la vie sociale dans son ensemble. Mais dire que le pays, pour prendre conscience de lui-mme, doit se grouper par professions, n'est-ce pas reconnatre que la profession organise ou la corporation devrait tre l'organe essentiel de la vie publique ? Ainsi serait comble la grave lacune que nous signalons plus loin dans la structure des socits europennes, de la ntre en particulier. On verra, en effet, comment, mesure qu'on avance dans l'histoire, l'organisation qui a pour base des groupements territoriaux (village ou ville, district, province, etc.) va de plus en plus en s'effaant. Sans doute, chacun de nous appartient une commune, un dpartement, mais les liens qui nous y rattachent deviennent tous les jours plus fragiles et plus lches. Ces divisions gographiques sont, pour la plupart, artificielles et n'veillent plus en nous de sentiments profonds. L'esprit provincial a disparu sans retour ; le patriotisme de clocher est devenu un archasme que l'on ne peut pas restaurer volont. Les affaires municipales ou dpartementales ne nous touchent et ne nous passionnent plus gure que dans la mesure o elles concident avec nos affaires professionnelles. Notre activit s'tend bien au-del de ces groupes trop troits pour elle, et, d'autre part, une bonne partie de ce qui s'y passe nous laisse indiffrents. Il s'est produit ainsi comme un affaissement spontan de la vieille structure sociale. Or, il n'est pas possible que cette organisation interne disparaisse sans que rien ne la remplace. Une socit compose d'une poussire infinie d'individus inorganiss, qu'un tat hypertrophi s'efforce d'enserrer et de retenir, constitue une vritable monstruosit sociologique. Car l'activit collective est toujours trop complexe pour pouvoir tre exprime par le seul et unique organe de l'tat ; de plus, l'tat est trop loin des individus, il a avec eux des rapports trop extrieurs et trop intermittents pour qu'il lui soit possible de pntrer bien avant dans les consciences individuelles et de les socialiser intrieurement. C'est pourquoi, l o il est le seul milieu o les hommes se puissent former la pratique de la vie commune, il est invitable qu'ils s'en dprennent, qu'ils se dtachent les uns des autres et que, dans la mme mesure, la socit se dsagrge. Une nation ne peut se maintenir que si, entre l'tat et les particuliers, s'intercale toute une srie de groupes secondaires qui soient assez proches des individus pour les attirer fortement dans leur sphre d'action et les entraner ainsi dans le torrent gnral de la vie sociale. Nous venons de montrer comment les groupes professionnels sont aptes remplir ce rle, et
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
30
que tout mme les y destine. On conoit ds lors combien il importe que, surtout dans l'ordre conomique, ils sortent de cet tat d'inconsistance et d'inorganisation o ils sont rests depuis un sicle, tant donn que les professions de cette sorte absorbent aujourd'hui la majeure partie des forces collectives 1. Peut-tre sera-t-on mieux en tat de s'expliquer maintenant les conclusions auxquelles nous sommes arriv la fin de notre livre sur Le suicide 2. Nous y prsentions dj une forte organisation corporative comme un moyen de remdier au malaise dont les progrs du suicide, joints d'ailleurs bien d'autres symptmes, attestent l'existence. Certains critiques ont trouv que le remde n'tait pas proportionn l'tendue du mal. Mais c'est qu'ils se sont mpris sur la nature vritable de la corporation, sur la place qui lui revient dans l'ensemble de notre vie collective, et sur la grave anomalie qui rsulte de sa disparition. Ils n'y ont vu qu'une association utilitaire, dont tout l'effet serait de mieux amnager les intrts conomiques, alors qu'en ralit elle devrait tre l'lment essentiel de notre structure sociale. L'absence de toute institution corporative cre donc, dans l'organisation d'un peuple comme le ntre, un vide dont il est difficile d'exagrer l'importance. C'est tout un systme d'organes ncessaires au fonctionnement normal de la vie commune qui nous fait dfaut. Un tel vice de constitution n'est videmment pas un mal local, limit une rgion de la socit ; c'est une maladie totius substantiae qui affecte tout l'organisme, et, par consquent, l'entreprise qui aura pour objet d'y mettre un terme ne peut manquer de produire les consquences les plus tendues. C'est la sant gnrale du corps social qui y est intresse. Ce n'est pas dire toutefois que la corporation soit une sorte de panace qui puisse servir tout. La crise dont nous souffrons ne tient pas une seule et unique cause. Pour qu'elle cesse, il ne suffit pas qu'une rglementation quelconque s'tablisse l o elle est ncessaire ; il faut, de plus, qu'elle soit ce qu'elle doit tre, c'est--dire juste. Or, ainsi que nous le dirons plus loin, tant qu'il y aura des riches et des pauvres de naissance, il ne saurait y avoir de contrat juste , ni une juste rpartition des conditions sociales 3. Mais si la rforme corporative ne dispense pas des autres, elle est la condition premire de leur efficacit. Imaginons, en effet, que soit enfin ralise la condition primordiale de la justice idale, supposons que les hommes entrent dans la vie dans un tat de parfaite galit conomique, c'est--dire que la richesse ait entirement cess d'tre hrditaire. Les problmes au milieu desquels nous nous dbattons ne seraient pas rsolus pour cela. En effet, il y aura toujours un appareil conomique et des agents divers qui collaboreront son fonctionnement ; il faudra donc dterminer leurs droits et leurs devoirs, et cela pour chaque forme d'industrie. Il faudra que, dans chaque profession, un corps de rgles se constitue, qui fixe la quantit du travail, la rmunration juste des diffrents fonctionnaires, leur
1
2 3
Nous ne voulons pas dire, d'ailleurs, que les circonscriptions territoriales sont destines disparatre compltement, mais seulement qu'elles passeront au second plan. Les institutions anciennes ne s'vanouissent jamais devant les institutions nouvelles, au point de ne plus laisser de traces d'elles-mmes. Elles persistent, non pas seulement par survivance, mais parce qu'il persiste aussi quelque chose des besoins auxquels elles rpondaient. Le voisinage matriel constituera toujours un lien entre les hommes ; par consquent, l'organisation politique et sociale base territoriale subsistera certainement. Seulement, elle n'aura plus son actuelle prpondrance, prcisment parce que ce lien perd de sa force. Au reste, nous avons montr plus haut que, mme la base de la corporation, on trouvera toujours des divisions gographiques. De plus, entre les diverses corporations d'une mme localit ou d'une mme rgion, il y aura ncessairement des relations spciales de solidarit qui rclameront, de tout temps, une organisation approprie. Le suicide, p. 434 et suiv. Voir plus bas, liv. III, chap. III.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
31
devoir vis--vis les uns des autres et vis--vis de la communaut, etc. On sera donc, non moins qu'actuellement, en prsence d'une table rase. Parce que la richesse ne se transmettra plus d'aprs les mmes principes qu'aujourd'hui, l'tat d'anarchie n'aura pas disparu, car il ne tient pas seulement ce que les choses sont ici plutt que l, dans telles mains plutt que dans telles autres, mais ce que l'activit dont ces choses sont l'occasion ou l'instrument n'est pas rgle ; et elle ne se rglementera pas par enchantement ds que ce sera utile, si les forces ncessaires pour instituer cette rglementation n'ont pas t pralablement suscites et organises. Il y a plus : des difficults nouvelles surgiraient alors, qui resteraient insolubles sans une organisation corporative. Jusqu' prsent, en effet, c'tait la famille qui, soit par l'institution de la proprit collective, soit par l'institution de l'hritage, assurait la continuit de la vie conomique : ou bien elle possdait et exploitait les biens d'une manire indivise, ou bien, partir du moment o le vieux communisme familial fut branl, c'tait elle qui les recevait, reprsente par les parents les plus proches la mort du propritaire 1. Dans le premier cas, il n'y avait mme pas de mutation par dcs et les rapports des choses aux personnes restaient ce qu'ils taient sans mme tre modifis par le renouvellement des gnrations ; dans le second, la mutation se faisait automatiquement, et il n'y avait pas de moment perceptible o les biens restassent vacants, sans mains pour les utiliser. Mais si la socit domestique ne doit plus jouer ce rle il faut bien qu'un autre organe social la remplace dans l'exercice de cette fonction ncessaire. Car il n'y a qu'un moyen pour empcher le fonctionnement des choses d'tre priodiquement suspendu, c'est qu'un groupe, perptuel comme la famille, ou les possde et les exploite lui-mme, ou les reoive chaque dcs pour les remettre, s'il y a lieu, quelque autre dtenteur individuel qui les mette en valeur. Mais nous avons dit et nous redirons combien l'tat est peu fait pour ces tches conomiques, trop spciales pour lui. Il n'y a donc que le groupe professionnel qui puisse s'en acquitter utilement. Il rpond, en effet, aux deux conditions ncessaires : il est intress de trop prs la vie conomique pour n'en pas sentir tous les besoins, en mme temps qu'il a une prennit au moins gale celle de la famille. Mais pour tenir cet office, encore faut-il qu'il existe et qu'il ait mme pris assez de consistance et de maturit pour tre la hauteur du rle nouveau et complexe qui lui incomberait. Si donc le problme de la corporation n'est pas le seul qui s'impose l'attention publique, il n'en est certainement pas qui soit plus urgent : car les autres ne pourront tre abords que quand il sera rsolu. Aucune modification un peu importante ne pourra tre introduite dans l'ordre juridique, si l'on ne commence par crer l'organe ncessaire a l'institution du droit nouveau. C'est pourquoi il est mme vain de s'attarder rechercher, avec trop de prcision, ce que devra tre ce droit ; car, dans l'tat actuel de nos connaissances scientifiques, nous ne pouvons l'anticiper que par de grossires et toujours douteuses approximations. Combien plus il importe de se mettre tout de suite luvre en constituant les forces morales qui, seules, pourront le dterminer en le ralisant!
Il est vrai que, l o le testament existe, le propritaire peut dterminer lui-mme la transmission de ses biens. Mais le testament n'est que la facult de droger la rgle du droit successoral ; c'est cette rgle qui est la norme d'aprs laquelle se font ces transmissions. Ces drogations, d'ailleurs, sont trs gnralement limites et sont toujours l'exception.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
32
Prface de la premire dition
Retour la table des matires
Ce livre est avant tout un effort pour traiter les faits de la vie morale d'aprs la mthode des sciences positives. Mais on a fait de ce mot un emploi qui en dnature le sens et qui n'est pas le ntre. Les moralistes qui dduisent leur doctrine, non d'un principe a priori, mais de quelques propositions empruntes une ou plusieurs sciences positives comme la biologie, la psychologie, la sociologie, qualifient leur morale de scientifique. Telle n'est pas la mthode que nous nous proposons de suivre. Nous ne voulons pas tirer la morale de la science, mais faire la science de la morale, ce qui est bien diffrent. Les faits moraux sont des phnomnes comme les autres ; ils consistent en des rgles d'action qui se reconnaissent certains caractres distinctifs ; il doit donc tre possible de les observer, de les dcrire, de les classer et de chercher les lois qui les expliquent. C'est ce que nous allons faire pour certains d'entre eux. On objectera l'existence de la libert. Mais si vraiment elle implique la ngation de toute loi dtermine, elle est un obstacle insurmontable, non seulement pour les sciences psychologiques et sociales, mais pour toutes les sciences, car, comme les volitions humaines sont toujours lies quelques mouvements extrieurs, elle rend le dterminisme tout aussi inintelligible au-dehors de nous qu'au-dedans. Cependant, nul ne conteste la possibilit des sciences physiques et naturelles. Nous rclamons le mme droit pour notre science 1. Ainsi entendue, cette science n'est en opposition avec aucune espce de philosophie, car elle se place sur un tout autre terrain. Il est possible que la morale ait quelque fin transcendante que l'exprience ne peut atteindre ; c'est affaire au mtaphysicien de s'en occuper. Mais ce qui est avant tout certain, c'est qu'elle se dveloppe
1
On nous a reproch (BEUDANT, Le droit individuel et l'tat, p. 244) d'avoir quelque part qualifi de subtile cette question de la libert.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
33
dans l'histoire et sous l'empire de causes historiques, c'est qu'elle a une fonction dans notre vie temporelle. Si elle est telle ou telle un moment donn, c'est que les conditions dans lesquelles vivent alors les hommes ne permettent pas qu'elle soit autrement, et la preuve en est qu'elle change quand ces conditions changent, et seulement dans ce cas. Il n'est plus aujourd'hui possible de croire que l'volution morale consiste dans le dveloppement d'une mme ide qui, confuse et indcise chez l'homme primitif, s'claire et se prcise peu peu par le progrs spontan des lumires. Si les anciens Romains n'avaient pas la large conception que nous avons aujourd'hui de l'humanit, ce n'est pas par suite d'une erreur due l'troitesse de leur intelligence ; mais c'est que de pareilles ides taient incompatibles avec la nature de la cit romaine. Notre cosmopolitisme ne pouvait pas plus y apparatre qu'une plante ne peut germer sur un sol incapable de la nourrir, et, d'ailleurs, il ne pouvait tre pour elle qu'un principe de mort. Inversement, s'il a fait, depuis, son apparition, ce n'est pas la suite de dcouvertes philosophiques ; ce n'est pas que nos esprits se soient ouverts des vrits qu'ils mconnaissaient ; c'est que des changements se sont produits dans la structure des socits, qui ont rendu ncessaire ce changement dans les murs. La morale se forme donc, se transforme et se maintient pour des raisons d'ordre exprimental ; ce sont ces raisons seules que la science de la morale entreprend de dterminer. Mais de ce que nous nous proposons avant tout d'tudier la ralit, il ne s'ensuit pas que nous renoncions l'amliorer :
L'expression n'avait dans notre bouche rien de ddaigneux. Si nous cartons ce problme, c'est uniquement parce que la solution qu'on en donne, quelle qu'elle soit, ne peut faire obstacle nos recherches.
Nous estimerions que nos recherches ne mritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intrt spculatif. Si nous sparons avec soin les problmes thoriques des problmes pratiques, ce n'est pas pour ngliger ces derniers : c'est, au contraire, pour nous mettre en tat de les mieux rsoudre. C'est pourtant une habitude que de reprocher tous ceux qui entreprennent d'tudier la morale scientifiquement leur impuissance formuler un idal. On dit que leur respect du fait ne leur permet pas de le dpasser ; qu'ils peuvent bien observer ce qui est, mais non pas nous fournir des rgles de conduite pour l'avenir. Nous esprons que ce livre servira du moins branler ce prjuge, car on y verra que la science peut nous aider trouver le sens dans lequel nous devons orienter notre conduite, dterminer l'idal vers lequel nous tendons confusment. Seulement, nous ne nous lverons cet idal qu'aprs avoir observ le rel, et nous l'en dgagerons ; mais est-il possible de procder autrement ? Mme les idalistes les plus intemprants ne peuvent pas suivre une autre mthode, car l'idal ne repose sur rien s'il ne tient pas par ses racines la ralit. Toute la diffrence, c'est qu'ils tudient celle-ci d'une faon trs sommaire, se contentent mme souvent d'riger un mouvement de leur sensibilit, une aspiration un peu vive de leur cur, qui pourtant n'est qu'un fait, en une sorte d'impratif devant lequel ils inclinent leur raison et nous demandent d'incliner la ntre. On objecte que la mthode d'observation manque de rgles pour juger les faits recueillis. Mais cette rgle se dgage des faits eux-mmes, nous aurons l'occasion d'en donner la preuve. Tout d'abord, il y a un tat de sant morale que la science seule peut dterminer avec comptence, et comme il n'est nulle part intgralement ralis,
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
34
c'est dj un idal que de chercher s'en rapprocher. De plus, les conditions de cet tat changent parce que les socits se transforment et les problmes pratiques les plus graves que nous ayons trancher consistent prcisment le dterminer nouveau en fonction des changements qui se sont accomplis dans le milieu. Or, la science, en nous fournissant la loi des variations par lesquelles il a dj pass, nous permet d'anticiper celles qui sont en train de se produire et que rclame le nouvel ordre de choses. Si nous savons dans quel sens volue le droit de proprit mesure que les socits deviennent plus volumineuses et plus denses, et si quelque nouvel accroissement de volume et de densit rend ncessaires de nouvelles modifications, nous pourrons les prvoir, et, les prvoyant, les vouloir par avance. Enfin, en comparant le type normal avec lui-mme, - opration strictement scientifique, - nous pourrons trouver qu'il n'est pas tout entier d'accord avec soi, qu'il contient des contradictions, c'est--dire des imperfections, et chercher les liminer ou les redresser ; voil un nouvel objectif que la science offre la volont. - Mais, dit-on, si la science prvoit, elle ne commande pas. Il est vrai ; elle nous dit seulement ce qui est ncessaire la vie. Mais comment ne pas voir que, supposer que l'homme veuille vivre, une opration trs simple transforme immdiatement les lois qu'elle tablit en rgles impratives de conduite ? Sans doute elle se change alors en art ; mais le passage de l'une l'autre se fait sans solution de continuit. Reste savoir si nous devons vouloir vivre ; mme sur cette question ultime, la science, croyons-nous, n'est pas muette 1. Mais si la science de la morale ne fait pas de nous des spectateurs indiffrents ou rsigns de la ralit, elle nous apprend en mme temps la traiter avec la plus extrme prudence, elle nous communique un esprit sagement conservateur. On a pu, et bon droit, reprocher certaines thories qui se disent scientifiques d'tre subversives et rvolutionnaires ; mais c'est qu'elles ne sont scientifiques que de nom. En effet, elles construisent, mais n'observent pas. Elles voient dans la morale, non un ensemble de faits acquis qu'il faut tudier, mais une sorte de lgislation toujours rvocable que chaque penseur institue nouveau. La morale rellement pratique par les hommes n'est alors considre que comme une collection d'habitudes, de prjugs qui n'ont de valeur que s'ils sont conformes la doctrine ; et comme cette doctrine est drive d'un principe qui n'est pas induit de l'observation des faits moraux, mais emprunt des sciences trangres, il est invitable qu'elle contredise sur plus d'un point l'ordre moral existant. Mais nous sommes moins que personne exposs ce danger, car la morale est pour nous un systme de faits raliss, li au systme total du monde. Or, un fait ne se change pas en un tour de main, mme quand c'est dsirable. D'ailleurs, comme il est solidaire d'autres faits, il ne peut tre modifi sans que ceux-ci soient atteints, et il est souvent bien difficile de calculer par avance le rsultat final de cette srie de rpercussions ; aussi l'esprit le plus audacieux devient-il rserv la perspective de pareils risques. Enfin et surtout, tout fait d'ordre vital, comme sont les faits moraux, - ne peut gnralement pas durer s'il ne sert quelque chose, s'il ne rpond pas quelque besoin ; tant donc que la preuve contraire n'est pas faite, il a droit notre respect. Sans doute, il arrive qu'il n'est pas tout ce qu'il doit tre et que, par consquent, il y ait lieu d'intervenir, nous venons nous-mme de l'tablir. Mais l'intervention est alors limite : elle a pour objet, non de faire de toutes pices une morale ct ou au-dessus de celle qui rgne, mais de corriger celle-ci ou de l'amliorer partiellement.
Nous y touchons un peu plus loin, liv. II, chap. 1er.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
35
Ainsi disparat l'antithse que l'on a souvent tent d'tablir entre la science et la morale, argument redoutable o les mystiques de tous les temps ont voulu faire sombrer la raison humaine. Pour rgler nos rapports avec les hommes, il n'est pas ncessaire de recourir d'autres moyens que ceux qui nous servent rgler nos rapports avec les choses ; la rflexion, mthodiquement employe, suffit dans l'un et dans l'autre cas. Ce qui rconcilie la science et la morale, c'est la science de la morale ; car en mme temps qu'elle nous enseigne respecter la ralit morale, elle nous fournit les moyens de l'amliorer. Nous croyons donc que la lecture de cet ouvrage peut et doit tre aborde sans dfiance et sans arrire-pense. Toutefois, le lecteur doit s'attendre y rencontrer des propositions qui heurteront certaines opinions reues. Comme nous prouvons le besoin de comprendre ou de croire comprendre les raisons de notre conduite, la rflexion s'est applique la morale bien avant que celle-ci ne soit devenue objet de science. Une certaine manire de nous reprsenter et de nous expliquer les principaux faits de la vie morale nous est ainsi devenue habituelle, qui pourtant n'a rien de scientifique ; car elle s'est forme au hasard et sans mthode, elle rsulte d'examens sommaires, superficiels, faits en passant, pour ainsi dire. Si l'on ne s'affranchit pas de ces jugements tout faits, il est vident que l'on ne saurait entrer dans les considrations qui vont suivre : la science, ici comme ailleurs, suppose une entire libert d'esprit. Il faut se dfaire de ces manires de voir et de juger qu'une longue accoutumance a fixes en nous ; il faut se soumettre rigoureusement la discipline du doute mthodique. Ce doute est, d'ailleurs, sans danger ; car il porte, non sur la ralit morale, qui n'est pas en question, mais sur l'explication qu'en donne une rflexion incomptente et mal informe. Nous devons prendre sur nous de n'admettre aucune explication qui ne repose sur des preuves authentiques. On jugera les procds que nous avons employs pour donner nos dmonstrations le plus de rigueur possible. Pour soumettre la science un ordre de faits, il ne suffit pas de les observer avec soin, de les dcrire, de les classer ; mais, ce qui est beaucoup plus difficile, il faut encore, suivant le mot de Descartes, trouver le biais par o ils sont scientifiques, c'est--dire dcouvrir en eux quelque lment objectif qui comporte une dtermination exacte, et, si c'est possible, la mesure. Nous nous sommes efforc de satisfaire cette condition de toute science. On verra, notamment, comment nous avons tudi la solidarit sociale travers le systme des rgles juridiques ; comment, dans la recherche des causes, nous avons cart tout ce qui se prte trop aux jugements personnels et aux apprciations subjectives, afin d'atteindre certains faits de structure sociale assez profonds pour pouvoir tre objets d'entendement, et, par consquent, de science. En mme temps, nous nous sommes fait une loi de renoncer la mthode trop souvent suivie par les sociologues qui, pour prouver leur thse, se contentent de citer sans ordre et au hasard un nombre plus ou moins imposant de faits favorables, sans se soucier des faits contraires, nous nous sommes proccup d'instituer de vritables expriences, c'est-dire des comparaisons mthodiques. Nanmoins, quelques prcautions qu'on prenne, il est bien certain que de tels essais ne peuvent tre encore que trs imparfaits, mais, si dfectueux qu'ils soient, nous pensons qu'il est ncessaire de les tenter. Il n'y a, en effet, qu'un moyen de faire une science, c'est de l'oser, mais avec mthode. Sans doute, il est impossible de l'entreprendre si toute matire premire fait dfaut. Mais, d'autre part, on se leurre d'un vain espoir quand on croit que la meilleure manire d'en prparer l'avnement est d'accumuler d'abord avec patience tous les matriaux qu'elle
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
36
utilisera, car on ne peut savoir quels sont ceux dont elle a besoin que si elle a dj quelque sentiment d'elle-mme et de ses besoins, partant, si elle existe.
Quant la question qui a t l'origine de ce travail, c'est celle des rapports de la personnalit individuelle et de la solidarit sociale. Comment se fait-il que, tout en devenant plus autonome, l'individu dpende plus troitement de la socit ? Comment peut-il tre la fois plus personnel et plus solidaire ? Car il est incontestable que ces deux mouvements, si contradictoires qu'ils paraissent, se poursuivent paralllement. Tel est le problme que nous nous sommes pos. Il nous a paru que ce qui rsolvait cette apparente antinomie, c'est une transformation de la solidarit sociale, due au dveloppement toujours plus considrable de la division du travail. Voil comment nous avons t amen faire de cette dernire l'objet de notre tude 1.
Nous n'avons pas besoin de rappeler que la question de la solidarit sociale a dj t tudie dans la seconde partie du livre de M. MARION sur la Solidarit morale. Mais M. Marion a pris le problme par un autre ct, il s'est surtout attach tablir la ralit du phnomne de la solidarit.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
37
Introduction
Le problme
Retour la table des matires
Quoique la division du travail ne date pas d'hier, c'est seulement la fin du sicle dernier que les socits ont commenc prendre conscience de cette loi, que, jusquel, elles subissaient presque leur insu. Sans doute, ds l'antiquit, plusieurs penseurs en aperurent l'importance 1 ; mais Adam Smith est le premier qui ait essay d'en faire la thorie. C'est d'ailleurs lui qui cra ce mot, que la science sociale prta plus tard la biologie. Aujourd'hui, ce phnomne s'est gnralis un tel point qu'il frappe les yeux de tous. Il n'y a plus d'illusion se faire sur les tendances de notre industrie moderne ; elle se porte de plus en plus aux puissants mcanismes, aux grands groupements de forces et de capitaux, et par consquent l'extrme division du travail. Non seulement dans l'intrieur des fabriques les occupations sont spares et spcialises l'infini, mais chaque manufacture est elle-mme une spcialit qui en suppose d'autres. Adam Smith et Stuart Mill espraient encore que du moins l'agriculture ferait exception la rgle, et ils y voyaient le dernier asile de la petite proprit. Quoique en pareille matire il faille se garder de gnraliser outre mesure, cependant il parat difficile de contester aujourd'hui que les principales branches de l'industrie agricole sont de plus en plus entranes dans le mouvement gnral 2. Enfin, le commerce lui-mme s'ingnie suivre et reflter, avec toutes leurs nuances, l'infinie diversit des entreprises industrielles, et, tandis que cette volution s'accomplit avec une spontanit irrflchie, les conomistes qui en scrutent les causes et en apprcient les rsultats,
1 2
[en grec dans le texte] (thique , Nicomaque, E, 1133 a, 16). Journal des conomistes, novembre 1884, p. 211.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
38
loin de la condamner et de la combattre, en proclament la ncessit. Ils y voient la loi suprieure des socits humaines et la condition du progrs. Mais la division du travail n'est pas spciale au monde conomique ; on en peut observer l'influence croissante dans les rgions les plus diffrentes de la socit. Les fonctions politiques, administratives, judiciaires, se spcialisent de plus en plus. Il en est de mme des fonctions artistiques et scientifiques. Nous sommes loin du temps o la philosophie tait la science unique ; elle s'est fragmente en une multitude de disciplines spciales dont chacune a son objet, sa mthode, son esprit. De demisicle en demi-sicle, les hommes qui ont marqu dans les sciences sont devenus plus spciaux 1. Ayant relever la nature des tudes dont s'taient occups les savants les plus illustres depuis deux sicles, M. de Candolle remarqua qu' l'poque de Leibniz et de Newton il lui aurait fallu crire presque toujours deux ou trois dsignations pour chaque savant ; par exemple, astronome et physicien, ou mathmaticien, astronome et physicien, ou bien n'employer que des termes gnraux comme philosophe ou naturaliste. Encore cela n'aurait pas suffi. Les mathmaticiens et les naturalistes taient quelquefois des rudits ou des potes. Mme la fin du XVIIIe sicle, des dsignations multiples auraient t ncessaires pour indiquer exactement ce que les hommes tels que Wolff, Haller, Charles Bonnet avaient de remarquable dans plusieurs catgories des sciences et des lettres. Au XIXe sicle, cette difficult n'existe plus ou, du moins, elle est trs rare 2. Non seulement le savant ne cultive plus simultanment des sciences diffrentes, mais il n'embrasse mme plus l'ensemble d'une science tout entire. Le cercle de ses recherches se restreint un ordre dtermin de problmes ou mme un problme unique. En mme temps, la fonction scientifique qui, jadis, se cumulait presque toujours avec quelque autre plus lucrative, comme celle de mdecin, de prtre, de magistrat, de militaire, se suffit de plus en plus ellemme. M. de Candolle prvoit mme qu'un jour prochain la profession de savant et celle de professeur, aujourd'hui encore si intimement unies, se dissocieront dfinitivement. Les spculations rcentes de la philosophie biologique ont achev de nous faire voir dans la division du travail un fait d'une gnralit que les conomistes, qui en parlrent pour la premire fois, n'avaient pas pu souponner. On sait, en effet, depuis les travaux de Wolff, de von Baer, de Milne-Edwards, que la loi de la division du travail s'applique aux organismes comme aux socits; on a mme pu dire qu'un organisme occupe une place d'autant plus leve dans l'chelle animale que les fonctions y sont plus spcialises. Cette dcouverte a eu pour effet, la fois, d'tendre dmesurment le champ d'action de la division du travail et d'en rejeter les origines dans un pass infiniment lointain, puisqu'elle devient presque contemporaine de l'avnement de la vie dans le monde. Ce n'est plus seulement une institution sociale qui a sa source dans l'intelligence et dans la volont des hommes ; mais c'est un phnomne de biologie gnrale dont il faut, semble-t-il, aller chercher les conditions dans les proprits essentielles de la matire organise. La division du travail social n'apparat plus que comme une forme particulire de ce processus gnral, et les socits, en se conformant cette loi, semblent cder un courant qui est n bien avant elles et qui entrane dans le mme sens le monde vivant tout entier.
1 2
DE CANDOLLE, Histoire des Sciences et des Savants, 2e d., p. 263. Loc. cit.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
39
Un pareil fait ne peut videmment pas se produire sans affecter profondment notre constitution morale ; car le dveloppement de l'homme se fera dans deux sens tout fait diffrents, suivant que nous nous abandonnerons ce mouvement ou que nous y rsisterons. Mais alors une question pressante se pose : de ces deux directions, laquelle faut-il vouloir ? Notre devoir est-il de chercher devenir un tre achev et complet, un tout qui se suffit soi-mme, ou bien au contraire de n'tre que la partie d'un tout, l'organe d'un organisme ? En un mot, la division du travail, en mme temps qu'elle est une loi de la nature, est-elle aussi une rgle morale de la conduite humaine, et si elle a ce caractre, pour quelles causes et dans quelle mesure ? Il n'est pas ncessaire de dmontrer la gravit de ce problme pratique ; car, quelque jugement qu'on porte sur la division du travail, tout le monde sent bien qu'elle est et qu'elle devient de plus en plus une des bases fondamentales de l'ordre social. Ce problme, la conscience morale des nations se l'est souvent pos, mais d'une manire confuse et sans arriver rien rsoudre. Deux tendances contraires sont en prsence sans qu'aucune d'elles arrive prendre sur l'autre une prpondrance tout fait inconteste. Sans doute, il semble bien que l'opinion penche de plus en plus faire de la division du travail une rgle imprative de conduite, l'imposer comme un devoir. Ceux qui s'y drobent ne sont pas, il est vrai, punis d'une peine prcise, fixe par la loi, mais ils sont blms. Nous avons pass le temps o l'homme parfait nous paraissait tre celui qui, sachant s'intresser tout sans s'attacher exclusivement rien, capable de tout goter et de tout comprendre, trouvait moyen de runir et de condenser en lui ce qu'il y avait de plus exquis dans la civilisation. Aujourd'hui, cette culture gnrale, tant vante jadis, ne nous fait plus l'effet que d'une discipline molle et relche 1. Pour lutter contre la nature, nous avons besoin de facults plus vigoureuses et d'nergies plus productives. Nous voulons que l'activit, au lieu de se disperser sur une large surface, se concentre et gagne en intensit ce qu'elle perd en tendue. Nous nous dfions de ces talents trop mobiles qui, se prtant galement tous les emplois, refusent de choisir un rle spcial et de s'y tenir. Nous prouvons de l'loignement pour ces hommes dont l'unique souci est d'organiser et d'assouplir toutes leurs facults, mais sans en faire aucun usage dfini et sans en sacrifier aucune, comme si chacun d'eux devait se suffire soi-mme et former un monde indpendant. Il nous semble que cet tat de dtachement et d'indtermination a quelque chose d'antisocial. L'honnte homme d'autrefois n'est plus pour nous qu'un dilettante, et nous refusons au dilettantisme toute valeur morale ; nous voyons bien plutt la perfection dans l'homme comptent qui cherche, non tre complet, mais produire, qui a une tche dlimite et qui s'y consacre, qui fait son service, trace son sillon. Se perfectionner, dit M. Secrtant, c'est apprendre son rle, c'est se rendre capable de remplir sa fonction... La mesure de notre perfection ne se trouve plus dans notre complaisance nous-mmes, dans les applaudissements de la foule ou dans le sourire approbateur d'un dilettantisme prcieux, mais dans la somme des services rendus et dans notre capacit d'en rendre encore 2. Aussi l'idal moral, d'un, de simple et d'impersonnel qu'il tait, va-t-il de plus en plus en se diversifiant. Nous ne pensons plus que le devoir exclusif de l'homme soit de raliser en lui les qualits de l'homme en gnral ; mais nous croyons qu'il est non moins tenu d'avoir celles de son emploi.
1
On a parfois interprt ce passage comme s'il impliquait une condamnation absolue de toute espce de culture gnrale. En ralit, comme il ressort du contexte, nous ne parlons ici que de la culture humaniste qui est bien une culture gnrale, mais non la seule qui soit possible. Le principe de la morale, p. 189
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
40
Un fait entre autres rend sensible cet tat de l'opinion, c'est le caractre de plus en plus spcial que prend l'ducation. De plus en plus nous jugeons ncessaire de ne pas soumettre tous nos enfants une culture uniforme, comme s'ils devaient tous mener une mme vie, mais de les former diffremment en vue des fonctions diffrentes qu'ils seront appels remplir. En un mot, par un de ses aspects, l'impratif catgorique de la conscience morale est en train de prendre la forme suivante : Mets-toi en tai de remplir utilement une fonction dtermine. Mais, en regard de ces faits, on en peut citer d'autres qui les contredisent. Si l'opinion publique sanctionne la rgle de la division du travail, ce n'est pas sans une sorte d'inquitude et d'hsitation. Tout en commandant aux hommes de se spcialiser, elle semble toujours craindre qu'ils ne se spcialisent trop. A ct des maximes qui vantent l travail intensif il en est d'autres, non moins rpandues, qui en signalent les dangers. C'est, dit Jean-Baptiste Say, un triste tmoignage se rendre que de n'avoir jamais fait que la dix-huitime partie d'une pingle ; et qu'on ne s'imagine pas que ce soit uniquement l'ouvrier qui toute sa vie conduit une lime et un marteau qui dgnre ainsi de la dignit de sa nature, c'est encore l'homme qui, par tat, exerce les facults les plus dlies de son esprit 1. Ds le commencement du sicle, Lemontey 2, comparant l'existence de l'ouvrier moderne la vie libre et large du sauvage, trouvait le second bien plus favoris que le premier. Tocqueville n'est pas moins svre : A mesure, dit-il, que le principe de la division du travail reoit une application plus complte, l'art fait des progrs, l'artisan rtrograde 3. D'une manire gnrale, la maxime qui nous ordonne de nous spcialiser est, partout, comme nie par la maxime contraire, qui nous commande de raliser tous un mme idal et qui est loin d'avoir perdu toute son autorit. Sans doute, en Principe, ce conflit n'a rien qui doive surprendre. La vie morale, comme celle du corps et de l'esprit, rpond des ncessits diffrentes et mme contradictoires, il est donc naturel qu'elle soit faite, en partie, d'lments antagonistes qui se limitent et se pondrent mutuellement. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a dans un antagonisme aussi accus de quoi troubler la conscience morale des nations. Car encore faut-il qu'elle puisse s'expliquer d'o peut provenir une semblable contradiction. Pour mettre un terme cette indcision, nous ne recourrons pas la mthode ordinaire des moralistes qui, quand ils veulent dcider de la valeur morale d'un prcepte, commencent par poser une formule gnrale de la moralit pour y confronter ensuite la maxime conteste. On sait aujourd'hui ce que valent ces gnralisations sommaires 4. Poses ds le dbut de l'tude, avant toute observation des faits, elles n'ont pas pour objet d'en rendre compte, mais d'noncer le principe abstrait d'une lgislation idale instituer de toutes pices. Elles ne nous donnent donc pas un rsum des caractres essentiels que prsentent rellement les rgles morales dans telle socit ou tel type social dtermin ; mais elles expriment seulement la manire dont le moraliste se reprsente la morale. Sans doute ce titre elles ne laissent pas d'tre instructives ; car elles nous renseignent sur les tendances morales qui sont en train de se faire jour au moment considr. Mais elles ont seulement l'intrt d'un fait, non d'une vue scientifique. Rien n'autorise voir dans les aspirations personnelles
1 2 3 4
Trait d'conomie politique, liv. I, chap. VIII. Raison ou folie, chapitre sur l'influence de la division du travail. La dmocratie en Amrique. Dans la premire dition de ce livre, nous avons longuement dvelopp les raisons qui prouvent, selon nous, la strilit de cette mthode. Nous croyons aujourd'hui pouvoir tre plus bref. Il y a des discussions qu'il ne faut pas prolonger indfiniment.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
41
ressenties par un penseur, si relles qu'elles puissent tre, une expression adquate de la ralit morale. Elles traduisent des besoins qui ne sont jamais que partiels, elles rpondent quelque desideratum particulier et dtermin que la conscience, par une illusion dont elle est coutumire, rige en une fin dernire ou unique. Que de fois mme il arrive qu'elles sont de nature morbide! On ne saurait donc s'y rfrer comme des critres objectifs qui permettent d'apprcier la moralit des pratiques. Il nous faut carter ces dductions qui ne sont gnralement employes que pour faire figure d'argument et justifier, aprs coup, des sentiments prconus et des impressions personnelles. La seule manire d'arriver apprcier objectivement la division du travail est de l'tudier d'abord en elle-mme d'une faon toute spculative, de chercher quoi elle sert et de quoi elle dpend, en un mot, de nous en former une notion aussi adquate que possible. Cela fait, nous serons en mesure de la comparer avec les autres phnomnes moraux et de voir quels rapports elle soutient avec eux. Si nous trouvons qu'elle joue un rle similaire quelque autre pratique dont le caractre moral et normal est indiscut, que, si dans certains cas elle ne remplit pas ce rle, c'est par suite de dviations anormales ; que les causes qui la dterminent sont aussi les conditions dterminantes d'autres rgles morales nous pourrons conclure qu'elle doit tre classe parmi ces dernires. Et ainsi, sans vouloir nous substituer la conscience morale des socits, sans prtendre lgifrer sa place, nous pourrons lui apporter un peu de lumire et diminuer ses perplexits. Notre travail se divisera donc en trois parties principales : Nous chercherons d'abord quelle est la fonction de la division du travail, c'est-dire quel besoin social elle correspond ; Nous dterminerons ensuite les causes et les conditions dont elle dpend ; Enfin, comme elle n'aurait pas t l'objet d'accusations aussi graves si rellement elle ne dviait plus ou moins souvent de l'tat normal, nous chercherons classer les principales formes anormales qu'elle prsente afin d'viter qu'elles soient confondues avec les autres. Cette tude offrira de plus cet intrt, c'est qu'ici, comme en biologie, le pathologique nous aidera mieux comprendre le physiologique. D'ailleurs, si l'on a tant discut sur la valeur morale de la division du travail, c'est beaucoup moins parce qu'on n'est pas d'accord sur la formule gnrale de la moralit, que pour avoir trop nglig les questions de fait que nous allons aborder. On a toujours raisonn comme si elles taient videntes ; comme si, pour connatre la nature, le rle, les causes de la division du travail, il suffisait d'analyser la notion que chacun de nous en a. Une telle mthode ne comporte pas de conclusions scientifiques ; aussi, depuis Adam Smith, la thorie de la division du travail n'a-t-elle fait que bien peu de progrs. Ses continuateurs, dit M. Schmoller 1, avec une pauvret d'ides remarquable, se sont obstinment attachs ses exemples et ses remarques jusqu'au jour o les socialistes largirent le champ de leurs observations et opposrent la division du travail dans les fabriques actuelles celle des ateliers du XVIIIe sicle. Mme par l, la thorie n'a pas t dveloppe d'une faon systmatique et approfondie ; les considrations technologiques ou les observations d'une vrit banale de quelques conomistes ne purent non plus favoriser particulirement le dveloppement
1
La Division du travail tudie au point de vue historique, in Revue d'conomie politique, 1889, p. 567.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
42
de ces ides. Pour savoir ce qu'est objectivement la division du travail, il ne suffit, pas de dvelopper le contenu de l'ide que nous nous en faisons, mais il faut la traiter comme un fait objectif, observer, comparer, et nous verrons que le rsultat de ces observations diffre souvent de celui que nous suggre le sens intime 1.
Depuis 1893, deux ouvrages ont paru ou sont parvenus notre connaissance qui intressent la question traite dans notre livre. C'est d'abord la Sociale Differenzierung de M. SIMMEL (Leipzig, vii-147 p.), o il n'est pas question de la division du travail spcialement, mais du processus d'individuation, d'une manire gnrale. Il y a ensuite le livre de M. BCHER, Die Entstehung der Wolkswirtschaft, rcemment traduit en franais sous le titre d'tudes d'histoire et d'conomie politique (Paris, Alcan, 1901), et dont plusieurs chapitres sont consacrs la division du travail conomique.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
43
LIVRE PREMIER
LA FONCTION DE LA DIVISION DU TRAVAIL
Retour la table des matires
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
44
Chapitre I
Mthode pour dterminer cette fonction
Retour la table des matires
Le mot de fonction est employ de deux manires assez diffrentes. Tantt il dsigne un systme de mouvements vitaux, abstraction faite de leurs consquences, tantt il exprime le rapport de correspondance qui existe entre ces mouvements et quelques besoins de l'organisme. C'est ainsi qu'on parle de la fonction de digestion, de respiration, etc. ; mais on dit aussi que la digestion a pour fonction de prsider l'incorporation dans l'organisme des substances liquides ou solides destines rparer ses pertes ; que la respiration a pour fonction d'introduire dans les tissus de l'animal les gaz ncessaires l'entretien de la vie, etc. C'est dans cette seconde acception que nous entendons le mot. Se demander quelle est la fonction de la division du travail, c'est donc chercher quel besoin elle correspond ; quand nous aurons rsolu cette question, nous pourrons voir si ce besoin est de mme nature que ceux auxquels rpondent d'autres rgles de conduite dont le caractre moral n'est pas discut. Si nous avons choisi ce terme, c'est que tout autre serait inexact ou quivoque. Nous ne pouvons employer celui de but ou d'objet et parler de la fin de la division du travail, parce que ce serait supposer que la division du travail existe en vue des rsultats que nous allons dterminer. Celui de rsultats ou d'effets ne saurait davantage nous satisfaire, parce qu'il n'veille aucune ide de correspondance. Au contraire, le mot de rle ou de fonction a le grand avantage d'impliquer cette ide, mais sans rien prjuger sur la question de savoir comment cette correspondance s'est tablie, si elle rsulte d'une adaptation intentionnelle et prconue ou d'un ajustement aprs coup. Or, ce qui nous importe, c'est de savoir si elle existe et en quoi elle consiste, non si elle a t pressentie par avance ni mme si elle a t sentie ultrieurement.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
45
I
Rien ne parat facile, au premier abord, comme de dterminer le rle de la division du travail. Ses efforts ne sont-ils pas connus de tout le monde ? Parce qu'elle augmente la fois la force productive et l'habilet du travailleur, elle est la condition ncessaire du dveloppement intellectuel et matriel des socits ; elle est la source de la civilisation. D'autre part, comme on prte assez volontiers la civilisation une valeur absolue, on ne songe mme pas chercher une autre fonction la division du travail. Qu'elle ait rellement ce rsultat, c'est ce qu'on ne peut songer discuter. Mais si elle n'en avait pas d'autre et ne servait pas autre chose, on n'aurait aucune raison pour lui attribuer un caractre moral. En effet, les services qu'elle rend ainsi sont presque compltement trangers la vie morale, ou du moins n'ont avec elle que des relations trs indirectes et trs lointaines. Quoiqu'il soit assez d'usage aujourd'hui de rpondre aux diatribes de Rousseau par des dithyrambes en sens inverse, il n'est pas du tout prouv que la civilisation soit une chose morale. Pour trancher la question, on ne peut pas se rfrer des analyses de concepts qui sont ncessairement subjectives ; mais il faudrait connatre un fait qui pt servir mesurer le niveau de la moralit moyenne et observer ensuite comment il varie mesure que la civilisation progresse. Malheureusement, cette unit de mesure nous fait dfaut ; mais nous en possdons une pour l'immoralit collective. Le nombre moyen des suicides, des crimes de toute sorte, peut en effet servir marquer la hauteur de l'immoralit dans une socit donne. Or, si l'on fait l'exprience, elle ne tourne gure l'honneur de la civilisation, car le nombre de ces phnomnes morbides semble s'accrotre mesure que les arts, les sciences et l'industrie progressent 1. Sans doute il y aurait quelque lgret conclure de ce fait que la civilisation est immorale, mais on peut tre tout au moins certain que, si elle a sur la vie morale une influence positive et favorable, celle-ci est assez faible. Si, d'ailleurs, on analyse ce complexus mal dfini qu'on appelle la civilisation, on trouve que les lments dont il est compos sont dpourvus de tout caractre moral. C'est surtout vrai pour l'activit conomique qui accompagne toujours la civilisation. Bien loin qu'elle serve aux progrs de la morale, c'est dans les grands centres industriels que les crimes et les suicides sont le plus nombreux ; en tout cas, il est vident qu'elle ne prsente pas les signes extrieurs auxquels on reconnat les faits moraux. Nous avons remplac les diligences par les chemins de fer, les bateaux voiles par les transatlantiques, les petits ateliers par les manufactures ; tout ce dploiement d'activit est gnralement regard comme utile, mais il n'a rien de moralement obligatoire. L'artisan, le petit industriel qui rsistent ce courant gnral et persvrent obstinment dans leurs modestes entreprises, font tout aussi bien leur
1
Voir Alexander von OETTINGEN, Moralstatistik, Erlangen, 1882, 37 et suiv. - TARDE, Criminalit compare, chap. II (Paris, F. Alcan). - Pour les suicides, voir plus bas, liv. II, chap. I, II.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
46
devoir que le grand manufacturier qui couvre un pays d'usines et runit sous ses ordres toute une arme d'ouvriers. La conscience morale des nations ne s'y trompe pas : elle prfre un peu de justice tous les perfectionnements industriels du monde. Sans doute l'activit industrielle n'est pas sans raison d'tre ; elle rpond des besoins, mais ces besoins ne sont pas moraux. A plus forte raison en est-il ainsi de l'art, qui est absolument rfractaire tout ce qui ressemble une obligation, car il est le domaine de la libert. C'est un luxe et une parure qu'il est peut-tre beau d'avoir, mais que l'on ne peut pas tre tenu d'acqurir: ce qui est superflu ne s'impose pas. Au contraire, la morale c'est le minimum indispensable, le strict ncessaire, le pain quotidien sans lequel les socits ne peuvent pas vivre. L'art rpond au besoin que nous avons de rpandre notre activit sans but, pour le plaisir de la rpandre, tandis que la morale nous astreint suivre une voie dtermine vers un but dfini : qui dit obligation dit du mme coup contrainte. Ainsi, quoiqu'il puisse tre anim par des ides morales ou se trouver ml l'volution des phnomnes moraux proprement dits, l'art n'est pas moral par soi-mme. Peut-tre mme l'observation tablirait-elle que, chez les individus, comme dans les socits, un dveloppement intemprant des facults esthtiques est un grave symptme au point de vue de la moralit. De tous les lments de la civilisation, la science est le seul qui, dans de certaines conditions, prsente un caractre moral. En effet, les socits tendent de plus en plus regarder comme un devoir pour l'individu de dvelopper son intelligence, en s'assimilant les vrits scientifiques qui sont tablies. Il y a, ds prsent, un certain nombre de connaissances que nous devons tous possder. On n'est pas tenu de se jeter dans la grande mle industrielle ; on n'est pas tenu d'tre un artiste ; mais tout le monde est maintenant tenu de ne pas rester ignorant. Cette obligation est mme si fortement ressentie que, dans certaines socits, elle n'est pas seulement sanctionne par l'opinion publique, mais par la loi. Il n'est pas, d'ailleurs, impossible d'entrevoir d'o vient ce privilge spcial la science. C'est que la science n'est autre chose que la conscience porte son plus haut point de clart. Or, pour que les socits puissent vivre dans les conditions d'existence qui leur sont maintenant faites il faut que le champ de la conscience tant individuelle que sociale s'tende et s'claire. En effet, comme les milieux dans lesquels elles vivent deviennent de plus en plus complexes et, par consquent, de plus en plus mobiles, pour durer, il faut qu'elles changent souvent. D'autre part, plus une conscience est obscure, plus elle est rfractaire au changement, parce qu'elle ne voit pas assez vite qu'il est ncessaire de changer ni dans quel sens il faut changer; au contraire, une conscience claire sait prparer par avance la manire de s'y adapter. Voil pourquoi il est ncessaire que l'intelligence guide par la science prenne une part plus grande dans le cours de la vie collective. Seulement, la science que tout le monde est ainsi requis de possder ne mrite gure d'tre appele de ce nom. Ce n'est pas la science, c'en est tout au plus la partie commune et la plus gnrale. Elle se rduit, en effet, un petit nombre de connaissances indispensables qui ne sont exiges de tous que parce qu'elles sont la porte de tous, La science proprement dite dpasse infiniment ce niveau vulgaire. Elle ne comprend pas seulement ce qu'il est honteux d'ignorer, mais tout ce qu'il est possible de savoir. Elle ne suppose pas seulement chez ceux qui la cultivent ces facults moyennes que possdent tous les hommes, mais des dispositions spciales. Par suite, n'tant accessible qu' une lite, elle n'est pas obligatoire ; c'est une chose utile et belle, niais elle n'est pas ce point ncessaire que la socit la rclame imprativement. Il est avantageux d'en tre muni; il n'y a rien d'immoral ne pas l'acqurir,
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
47
C'est un champ d'action qui est ouvert l'initiative de tous, mais o nul n'est contraint d'entrer. On n'est pas plus tenu d'tre un savant que d'tre un artiste. La science est donc, comme l'art et l'industrie, en dehors de la morale 1. Si tant de controverses ont eu lieu sur le caractre moral de la civilisation, c'est que, trop souvent, les moralistes n'ont pas de critre objectif pour distinguer les faits moraux des faits qui ne le sont pas. On a l'habitude de qualifier de moral tout ce qui a quelque noblesse et quelque prix, tout ce qui est l'objet d'aspirations un peu leves, et c'est grce cette extension excessive du mot que l'on a fait rentrer la civilisation dans la morale. Mais il s'en faut que le domaine de l'thique soit aussi indtermin ; il comprend toutes les rgles d'action qui s'imposent imprativement la conduite et auxquelles est attache une sanction, mais ne va pas plus loin. Par consquent, puisqu'il n'y a rien dans la civilisation qui prsente ce critre de la moralit, elle est moralement indiffrente. Si donc la division du travail n'avait pas d'autre rle que de rendre la civilisation possible, elle participerait la mme neutralit morale. C'est parce qu'on n'a gnralement pas vu d'autre fonction la division du travail que les thories qu'on en a proposes sont ce point inconsistantes. En effet, supposer qu'il existe une zone neutre en morale, il est impossible que la division du travail en fasse partie 2. Si elle n'est pas bonne, elle est mauvaise : si elle n'est pas morale, elle est une dchance morale. Si donc elle ne sert pas autre chose, on tombe dans d'insolubles antinomies, car les avantages conomiques qu'elle prsente sont compenss par des inconvnients moraux, et comme il est impossible de soustraire l'une de l'autre ces deux quantits htrognes et incomparables, on ne saurait dire laquelle des deux l'emporte sur l'autre, ni, par consquent, prendre un parti. On invoquera la primaut de la morale pour condamner radicalement la division du travail. Mais, outre que cette ultima ratio est toujours un coup d'tat scientifique, l'vidente ncessit de la spcialisation rend une telle position impossible soutenir. Il y a plus ; si la division du travail ne remplit pas d'autre rle, non seulement elle n'a pas de caractre moral, mais on n'aperoit pas quelle raison d'tre elle peut avoir. Nous verrons, en effet, que, par elle-mme, la civilisation n'a pas de valeur intrinsque et absolue ; ce qui en fait le prix, c'est qu'elle correspond certains besoins. Or, cette proposition sera dmontre plus loin 3, ces besoins sont eux-mmes des consquences de la division du travail. C'est parce que celle-ci ne va pas sans un surcrot de fatigue que l'homme est contraint de rechercher, comme surcrot de rparations, ces biens de la civilisation qui, autrement, seraient pour lui sans intrt. Si donc la division du travail ne rpondait pas d'autres besoins que ceux-l, elle n'aurait d'autre fonction que d'attnuer les effets qu'elle produit elle-mme, que de panser les blessures qu'elle fait. Dans ces conditions, il pourrait tre ncessaire de la subir, mais il n'y aurait aucune raison de la vouloir, puisque les services qu'elle rendrait se rduiraient rparer les pertes qu'elle cause. Tout nous invite donc chercher une autre fonction la division du travail. Quelques faits d'observation courante vont nous mettre sur le chemin de la solution.
1 2 3
Le caractre essentiel du bien compar au vrai est donc d'tre obligatoire. Le vrai, pris en luimme, n'a pas ce caractre (JANET, Morale, p. 139). Car elle est en antagonisme avec une rgle morale. Voir liv. II, chap. 1er et V.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
48
II
Tout le monde sait que nous aimons qui nous ressemble, quiconque pense et sent comme nous. Mais le phnomne contraire ne se rencontre pas moins frquemment. Il arrive trs souvent que nous nous sentons ports vers des personnes qui ne nous ressemblent pas, prcisment parce qu'elles ne nous ressemblent pas. Ces faits sont en apparence si contradictoires que, de tout temps, les moralistes ont hsit sur la vraie nature de l'amiti et l'ont drive tantt de l'une et tantt de l'autre cause. Les Grecs s'taient dj pos la question. L'amiti, dit Aristote, donne lieu bien des discussions. Selon les uns, elle consiste dans une certaine ressemblance et ceux qui se ressemblent s'aiment : de l ce proverbe qui se ressemble s'assemble et le geai cherche le geai, et autres dictons pareils. Mais selon les autres, au contraire, tous ceux qui se ressemblent sont potiers les uns pour les autres. Il y a d'autres explications cherches plus haut et prises de la considration de la nature. Ainsi Euripide dit que la terre dessche est amoureuse de pluie, et que le sombre ciel charg de pluie se prcipite avec une amoureuse fureur sur la terre. Hraclite prtend qu'on n'ajuste que ce qui s'oppose, que la plus belle harmonie nat des diffrences, que la discorde est la loi de tout devenir 1. Ce que prouve cette opposition des doctrines, c'est que l'une et l'autre amiti existent dans la nature. La dissemblance, comme la ressemblance, peut tre une cause d'attrait mutuel. Toutefois, des dissemblances quelconques ne suffisent pas produire cet effet. Nous ne trouvons aucun plaisir rencontrer chez autrui une nature simplement diffrente de la ntre. Les prodigues ne recherchent pas la compagnie des avares, ni les caractres droits et francs celle des hypocrites et des sournois ; les esprits aimables et doux ne se sentent aucun got pour les tempraments durs et malveillants. Il n'y a donc que les diffrences d'un certain genre qui tendent ainsi l'une vers l'autre ; ce sont celles qui, au lieu de s'opposer et de s'exclure, se compltent mutuellement. Il y a, dit M. Bain, un genre de dissemblance qui repousse, un autre qui attire, l'un qui tend amener la rivalit, l'autre conduire l'amiti... Si l'une (des deux personnes) possde une chose que l'autre n'a pas, mais qu'elle dsire, il y a dans ce fait le point de dpart d'un charme positif 2. C'est ainsi que le thoricien l'esprit raisonneur et subtil a souvent une sympathie toute spciale pour les hommes pratiques, au sens droit, aux intuitions rapides ; le timide pour les gens dcids et rsolus, le faible pour le fort, et rciproquement. Si richement dous que nous soyons, il nous manque toujours quelque chose, et les meilleurs d'entre nous ont le sentiment de leur insuffisance. C'est pourquoi nous cherchons chez nos amis les qualits qui nous font dfaut, parce qu'en nous unissant eux nous participons en quelque manire leur nature, et que nous nous sentons alors moins incomplets. Il se forme ainsi de petites associations d'amis o chacun a son rle conforme son caractre, o il y a un vritable change de services. L'un protge, l'autre console ; celui-ci conseille, celui-l excute, et c'est ce partage des fonctions, ou, pour employer l'expression consacre, cette division du travail qui dtermine ces relations d'amiti. Nous sommes ainsi conduits considrer la division du travail sous un nouvel aspect. Dans ce cas, en effet, les services conomiques qu'elle peut rendre sont peu de
1 2
thique Nic., VIII, I, 1155 a, 32. motions et volont, tr. fr., Paris, F. Alcan, p. 135.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
49
chose ct de l'effet moral qu'elle produit, et sa vritable fonction est de crer entre deux ou plusieurs personnes un sentiment de solidarit. De quelque manire que ce rsultat soit obtenu, c'est elle qui suscite ces socits d'amis, et elle les marque de son empreinte.
L'histoire de la socit conjugale nous offre du mme phnomne un exemple plus frappant encore. Sans doute l'attrait sexuel ne se fait jamais sentir qu'entre individus de la mme espce, et l'amour suppose assez gnralement une certaine harmonie de penses et de sentiments. Il n'est pas moins vrai que ce qui donne ce penchant son caractre spcifique et ce qui produit sa particulire nergie, ce n'est pas la ressemblance, mais la dissemblance des natures qu'il unit. C'est parce que l'homme et la femme diffrent l'un de l'autre qu'ils se recherchent avec passion. Toutefois, comme dans le cas prcdent, ce n'est pas un contraste pur et simple qui fait clore ces sentiments rciproques : seules, des diffrences qui se supposent et se compltent peuvent avoir cette vertu. En effet, l'homme et la femme isols l'un de l'autre ne sont que des parties diffrentes d'un mme tout concret qu'ils reforment en s'unissant. En d'autres termes, c'est la division du travail sexuel qui est la source de la solidarit conjugale, et voil pourquoi les psychologues ont trs justement remarqu que la sparation des sexes avait t un vnement capital dans l'volution des sentiments; c'est qu'elle a rendu possible le plus fort peut-tre de tous les penchants dsintresss. Il y a plus. La division du travail sexuel est susceptible de plus ou de moins ; elle peut ou ne porter que sur les organes sexuels et quelques caractres secondaires qui en dpendent, ou bien, au contraire, s'tendre toutes les fonctions organiques et sociales. Or, on peut voir dans l'histoire qu'elle s'est exactement dveloppe dans le mme sens et de la mme manire que la solidarit conjugale. Plus nous remontons dans le pass, plus elle se rduit peu de chose. La femme de ces temps reculs n'tait pas du tout la faible crature qu'elle est devenue avec les progrs de la moralit. Des ossements prhistoriques tmoignent que la diffrence entre la force de l'homme et celle de la femme tait relativement beaucoup plus petite qu'elle n'est aujourd'hui 1. Maintenant encore, dans l'enfance et jusqu' la pubert, le squelette des deux sexes ne diffre pas d'une faon apprciable : les traits en sont surtout fminins. Si l'on admet que le dveloppement de l'individu reproduit en raccourci celui de l'espce, on a le droit de conjecturer que la mme homognit se retrouvait aux dbuts de l'volution humaine, et de voir dans la forme fminine comme une image approche de ce qu'tait originellement ce type unique et commun dont la varit masculine s'est peu peu dtache. Des voyageurs nous rapportent d'ailleurs que, dans un certain nombre de tribus de l'Amrique du Sud, l'homme et la femme prsentent dans la structure et l'aspect gnral une ressemblance qui dpasse ce que l'on voit ailleurs 2. Enfin le Dr Lebon a pu tablir directement et avec une
1 2
TOPINARD, Anthropologie, p. 146. Voir SPENCER, Essais scientifiques, tr. fr., Paris, F. Alcan, p. 300. - WAITZ, dans son Anthropologie der Naturvlker, 1. 76, rapporte beaucoup de faits du mme genre.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
50
prcision mathmatique cette ressemblance originelle des deux sexes pour l'organe minent de la vie physique et psychique, le cerveau. En comparant un grand nombre de crnes, choisis dans des races et dans des socits diffrentes, il est arriv la conclusion suivante : Le volume du crne de l'homme et de la femme, mme quand on compare des sujets d'ge gal, de taille gale et de poids gal, prsente des diffrentes considrables en faveur de l'homme, et cette ingalit va galement en s'accroissant avec la civilisation, en sorte qu'au point de vue de la masse du cerveau et, par suite, de l'intelligence, la femme tend se diffrencier de plus en plus de l'homme. La diffrence qui existe par exemple entre la moyenne des crnes des Parisiens contemporains et celle des Parisiennes est presque double de celle observe entre les crnes masculins et fminins de l'ancienne gypte 1. Un anthropologiste allemand, M. Bischoff, est arriv sur ce point aux mmes rsultats 2. Ces ressemblances anatomiques sont accompagnes de ressemblances fonctionnelles. Dans ces mmes socits, en effet, les fonctions fminines ne se distinguent pas bien nettement des fonctions masculines ; mais les deux sexes mnent peu prs la mme existence. Il y a maintenant encore un trs grand nombre de peuples sauvages o la femme se mle la vie politique. C'est ce que l'on a observ notamment chez les tribus indiennes de l'Amrique, comme les Iroquois, les Natchez 3, Hawa o elle participe de mille manires la vie des hommes 4, la NouvelleZlande, Samoa. De mme on voit trs souvent les femmes accompagner les hommes la guerre, les exciter au combat et mme y prendre une part trs active. A Cuba, au Dahomey, elles sont aussi guerrires que les hommes et se battent ct d'eux 5. Un des attributs aujourd'hui distinctifs de la femme, la douceur, ne parat pas lui avoir appartenu primitivement. Dj dans certaines espces animales la femelle se fait plutt remarquer par le caractre contraire. Or, chez ces mmes peuples le mariage est dans un tat tout fait rudimentaire. Il est mme trs vraisemblable, sinon absolument dmontr, qu'il y a eu une poque dans l'histoire de la famille o il n'y avait pas de mariage ; les rapports sexuels se nouaient et se dnouaient volont sans qu'aucune obligation juridique lit les conjoints. En tout cas, nous connaissons un type familial qui est relativement proche de nous 6 et o le mariage n'est encore qu' l'tat de germe indistinct, c'est la famille maternelle. Les relations de la mre avec ses enfants y sont trs dfinies, mais celles des deux poux sont trs lches. Elles peuvent cesser ds que les parties le veulent, ou bien encore ne se contractent que pour un temps limit 7. La fidlit conjugale n'y est pas encore exige. Le mariage, ou ce qu'on appelle ainsi, consiste uniquement dans des obligations d'tendue restreinte et, le plus souvent, de courte dure, qui lient le mari aux parents de la femme ; il se rduit donc peu de chose. Or, dans une socit donne, l'ensemble de ces rgles juridiques qui constituent le mariage ne fait que symboliser l'tat de la solidarit conjugale. Si celle-ci est trs forte, les liens qui unissent les poux sont nombreux et complexes, et, par consquent, la rglementation matrimoniale qui a pour objet de les dfinir est elle-mme trs dveloppe. Si, au
1 2 3 4 5 6 7
L'homme et les socits, II, 154. Das Gehirngewicht dez Menschen, eine Studie. Bonn, 1880. WAITZ, Anthropologie, III, 101-102. WAITZ, Op. cit., VI, 121. SPENCER, Sociologie, tr. fr., Paris, F. Alcan, III, 391. La famille maternelle a certainement exist chez les Germains. - Voir DARGUN, Mutterrecht und Raubehe im Germanischen Rechte, Breslau, 1883. Voir notamment SMITH, Marriage and Kinship in Eearly Arabia, Cambridge, 1885, p. 67.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
51
contraire, la socit conjugale manque de cohsion, si les rapports de l'homme et de la femme sont instables et intermittents, ils ne peuvent pas prendre une forme bien dtermine, et, par consquent, le mariage se rduit un petit nombre de rgles sans rigueur et sans prcision. L'tat du mariage dans les socits o les deux sexes ne sont que faiblement diffrencis tmoigne donc que la solidarit conjugale y est elle-mme trs faible. Au contraire, mesure qu'on avance vers les temps modernes, on voit le mariage se dvelopper. Le rseau de liens qu'il cre s'tend de plus en plus, les obligations qu'il sanctionne se multiplient, Les conditions dans lesquelles il peut tre conclu, celles auxquelles il peut tre dissous se dlimitent avec une prcision croissante, ainsi que les effets de cette dissolution. Le devoir de fidlit s'organise ; d'abord impos la femme seule, il devient plus tard rciproque. Quand la dot apparat, des rgles trs complexes viennent fixer les droits respectifs de chaque poux sur sa propre fortune et sur celle de l'autre. Il suffit, d'ailleurs, de jeter un coup d'il sur nos Codes pour voir quelle place importante y occupe le mariage. L'union des deux poux a cess d'tre phmre ; ce n'est plus un contact extrieur, passager et partiel, mais une association intime, durable, souvent mme indissoluble de deux existences tout entires. Or, il est certain que, dans le mme temps, le travail sexuel s'est de plus en plus divis. Limit d'abord aux seules fonctions sexuelles, il s'est peu peu tendu bien d'autres. Il y a longtemps que la femme s'est retire de la guerre et des affaires publiques et que sa vie s'est concentre tout entire dans l'intrieur de la famille. Depuis, son rle n'a fait que se spcialiser davantage. Aujourd'hui, chez les peuples cultivs, la femme mne une existence tout fait diffrente de celle de l'homme. On dirait que les deux grandes fonctions de la vie psychique se sont comme dissocies, que l'un des sexes a accapar les fonctions affectives et l'autre les fonctions intellectuelles. A voir, dans certaines classes, les femmes s'occuper d'art et de littrature comme les hommes, on pourrait croire, il est vrai, que les occupations des deux sexes tendent redevenir homognes. Mais, mme dans cette sphre d'action, la femme apporte sa nature propre, et son rle reste trs spcial, trs diffrent de celui de l'homme. De plus, si l'art et les lettres commencent devenir choses fminines, l'autre sexe semble les dlaisser pour se donner plus spcialement la science. Il pourrait donc trs bien se faire que ce retour apparent l'homognit primitive ne ft autre chose que le commencement d'une diffrenciation nouvelle. D'ailleurs, ces diffrences fonctionnelles sont rendues matriellement sensibles par les diffrences morphologiques qu'elles ont dtermines. Non seulement la taille, le poids, les formes gnrales sont trs dissemblables chez l'homme et chez la femme, mais le Dr Lebon a dmontr, nous l'avons vu, qu'avec le progrs de la civilisation le cerveau des deux sexes se diffrencie de plus en plus. Suivant cet observateur, cet cart progressif serait d, la fois, au dveloppement considrable des crnes masculins et un stationnement ou mme une rgression des crnes fminins. Alors, dit-il, que la moyenne des crnes parisiens masculins les range parmi les plus gros crnes connus, la moyenne des crnes parisiens fminins les range parmi les plus petits crnes observs, bien audessous du crne des Chinoises et peine au-dessus du crne des femmes de la Nouvelle-Caldonie 1. Dans tous ces exemples, le plus remarquable effet de la division du travail n'est pas qu'elle augmente le rendement des fonctions divises, mais qu'elle les rend
1
Op. cit., 154.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
52
solidaires. Son rle dans tous ces cas n'est pas simplement d'embellir ou d'amliorer des socits existantes, mais de rendre possibles des socits qui, sans elles, n'existeraient pas. Faites rgresser au-del d'un certain point la division du travail sexuel, et la socit conjugale s'vanouit pour ne laisser subsister que des relations sexuelles minemment phmres ; si mme les sexes ne s'taient pas spars du tout, toute une forme de la vie sociale ne serait pas ne, Il est possible que l'utilit conomique de la division du travail soit pour quelque chose dans ce rsultat, mais, en tout cas, il dpasse infiniment la sphre des intrts purement conomiques ; car il consiste dans l'tablissement d'un ordre social et moral sui generis. Des individus sont lis les uns aux autres qui, sans cela, seraient indpendants ; au lieu de se dvelopper sparment, ils concertent leurs efforts ; ils sont solidaires et d'une solidarit qui n'agit pas seulement dans les courts instants o les services s'changent, mais qui s'tend bien au-del. La solidarit conjugale, par exemple, telle qu'elle existe aujourd'hui chez les peuples les plus cultivs, ne fait-elle pas sentir son action chaque moment et dans tous les dtails de la vie ? D'autre part, ces socits que cre la division du travail ne peuvent manquer d'en porter la marque. Puisqu'elles ont cette origine spciale, elles ne peuvent pas ressembler celles que dtermine l'attrait du semblable pour le semblable ; elles doivent tre constitues d'une autre manire, reposer sur d'autres bases, faire appel d'autres sentiments. Si l'on a souvent fait consister dans le seul change les relations sociales auxquelles donne naissance la division du travail, c'est pour avoir mconnu ce que l'change implique et ce qui en rsulte. Il suppose que deux tres dpendent mutuellement l'un de l'autre, parce qu'ils sont l'un et l'autre incomplets, et il ne fait que traduire au-dehors cette mutuelle dpendance. Il n'est donc que l'expression superficielle d'un tat interne et plus profond. Prcisment parce que cet tat est constant, il suscite tout un mcanisme d'images qui fonctionne avec une continuit que n'a pas l'change. L'image de celui qui nous complte devient en nous-mme insparable de la ntre, non seulement parce qu'elle y est frquemment associe, mais surtout parce qu'elle en est le complment naturel : elle devient donc partie intgrante et permanente de notre conscience, tel point que nous ne pouvons plus nous en passer et que nous recherchons tout ce qui en peut accrotre l'nergie. C'est pourquoi nous aimons la socit de celui qu'elle reprsente, parce que la prsence de l'objet qu'elle exprime, en la faisant passer l'tat de perception actuelle, lui donne plus de relief. Au contraire, nous souffrons de toutes les circonstances qui, comme l'loignement ou la mort, peuvent avoir pour effet d'en empcher le retour ou d'en diminuer la vivacit. Si tourte que soit cette analyse, elle suffit montrer que ce mcanisme n'est pas identique celui qui sert de base aux sentiments de sympathie dont la ressemblance est la source. Sans doute, il ne peut jamais y avoir de solidarit entre autrui et nous que si l'image d'autrui s'unit la ntre. Mais quand l'union rsulte de la ressemblance des deux images, elle consiste dans une agglutination. Les deux reprsentations deviennent solidaires parce que tant indistinctes, totalement ou en partie, elles se confondent et n'en font plus qu'une, et elles ne sont solidaires que dans la mesure o elles se confondent, Au contraire, dans le cas de la division du travail, elles sont en dehors l'une de l'autre, et elles ne sont lies que parce qu'elles sont distinctes. Les sentiments ne sauraient donc tre les mmes dans les deux cas ni les relations sociales qui en drivent. Nous sommes ainsi conduits nous demander si la division du travail ne jouerait pas le mme rle dans des groupes plus tendus, si, dans les socits contemporaines o elle a pris le dveloppement que nous savons, elle n'aurait pas pour fonction
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
53
d'intgrer le corps social, d'en assurer l'unit. Il est trs lgitime de supposer que les faits que nous venons d'observer se reproduisent ici, mais avec plus d'ampleur ; que ces grandes socits politiques ne peuvent, elles aussi, se maintenir en quilibre que grce la spcialisation des tches ; que la division du travail est la source, sinon unique, du moins principale de la solidarit sociale. C'est dj ce point de vue que s'tait plac Comte. De tous les sociologues, notre connaissance, il est le premier qui ait signal dans la division du travail autre chose qu'un phnomne purement conomique. Il y a vu la condition la plus essentielle de la vie sociale , pourvu qu'on la conoive dans toute son tendue rationnelle, c'est--dire qu'on l'applique l'ensemble de toutes nos diverses oprations quelconques, au lieu de la borner, comme il est trop ordinaire, de simples usages matriels . Considre sous cet aspect, dit-il, elle conduit immdiatement regarder non seulement les individus et les classes, mais aussi, beaucoup d'gards, les diffrents peuples comme participant la fois, suivant un mode propre et un degr spcial, exactement dtermin, une oeuvre immense et commune dont l'invitable dveloppement graduel lie d'ailleurs aussi les cooprateurs actuels la srie de leurs prdcesseurs quelconques et mme la srie de leurs divers successeurs. C'est donc la rpartition continue des diffrents travaux humains qui constitue principalement la solidarit sociale et qui devient la cause lmentaire de l'tendue et de la complication croissante de l'organisme social 1. Si cette hypothse tait dmontre, la division du travail jouerait un rle beaucoup plus important que celui qu'on lui attribue d'ordinaire. Elle ne servirait pas seulement doter nos socits d'un luxe, enviable peut-tre, mais superflu ; elle serait une condition de leur existence. C'est par elle, ou du moins c'est surtout par elle, que serait assure leur cohsion ; c'est elle qui dterminerait les traits essentiels de leur constitution. Par cela mme, et quoique nous ne soyons pas encore en tat de rsoudre la question avec rigueur, on peut cependant entrevoir ds maintenant que, si telle est rellement la fonction de la division du travail, elle doit avoir un caractre moral, car les besoins d'ordre, d'harmonie, de solidarit sociale passent gnralement pour tre moraux. Mais, avant d'examiner si cette opinion commune est fonde, il faut vrifier l'hypothse que nous venons d'mettre sur le rle de la division du travail. Voyons si, en effet, dans les socits o nous vivons, c'est d'elle que drive essentiellement la solidarit sociale.
III
Mais comment procder cette vrification ? Nous n'avons pas simplement rechercher si, dans ces sortes de socits, il existe une solidarit sociale qui vient de la division du travail. C'est une vrit vidente, puisque la division du travail y est trs dveloppe et qu'elle produit la solidarit. Mais il faut surtout dterminer dans quelle mesure la solidarit qu'elle produit contri1
Cours de philosophie positive, IV, 425. - On trouve des ides analogues dans SCHAEFFLE, Bau und Leben des socialen Krpers, II, passim, et CLMENT, Science sociale, 1, 235 et suiv.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
54
bue l'intgration gnrale de la socit : car c'est seulement alors que nous saurons jusqu' quel point elle est ncessaire, si elle est un facteur essentiel de la cohsion sociale, ou bien, au contraire, si elle n'en est qu'une condition accessoire et secondaire. Pour rpondre cette question, il faut donc comparer ce lien social aux autres, afin de mesurer la part qui lui revient dans l'effet total, et pour cela il est indispensable de commencer par classer les diffrentes espces de solidarit sociale. Mais la solidarit sociale est un phnomne tout moral qui, par lui-mme, ne se prte pas l'observation exacte ni surtout la mesure. Pour procder tant cette classification qu' cette comparaison, il faut donc substituer au fait interne qui nous chappe un fait extrieur qui le symbolise et tudier le premier travers le second. Ce symbole visible, c'est le droit. En effet, l o la solidarit sociale existe, malgr son caractre immatriel, elle ne reste pas l'tat de pure puissance, mais manifeste sa prsence par des effets sensibles. L o elle est forte, elle incline fortement les hommes les uns vers les autres, les met frquemment en contact, multiplie les occasions qu'ils ont de se trouver en rapports. A parler exactement, au point o nous en sommes arrivs, il est malais de dire si c'est elle qui produit ces phnomnes ou, au contraire, si elle en rsulte ; si les hommes se rapprochent parce qu'elle est nergique, ou bien si elle est nergique parce qu'ils sont rapprochs les uns des autres. Mais il n'est pas ncessaire pour le moment d'lucider la question, et il suffit de constater que ces deux ordres de faits sont lis et varient en mme temps et dans le mme sens. Plus les membres d'une socit sont solidaires, plus ils soutiennent de relations diverses soit les uns avec les autres, soit avec le groupe pris collectivement : car, si leurs rencontres taient rares, ils ne dpendraient les uns des autres que d'une manire intermittente et faible. D'autre part, le nombre de ces relations est ncessairement proportionnel celui des rgles juridiques qui les dterminent. En effet, la vie sociale, partout o elle existe d'une manire durable, tend invitablement prendre une forme dfinie et s'organiser, et le droit n'est autre chose que cette organisation mme dans ce qu'elle a de plus stable et de plus prcis 1. La vie gnrale de la socit ne peut s'tendre sur un point sans que la vie juridique s'y tende en mme temps et dans le mme rapport. Nous pouvons donc tre certains de trouver refltes dans le droit toutes les varits essentielles de la solidarit sociale. On pourrait objecter, il est vrai, que les relations sociales peuvent se fixer sans prendre pour cela une forme juridique. Il en est dont la rglementation ne parvient pas ce degr de consolidation et de prcision ; elles ne restent pas indtermines pour cela, mais, au lieu d'tre rgles par le droit, elles ne le sont que par les murs. Le droit ne rflchit donc qu'une partie de la vie sociale et, par consquent, ne nous fournit que des donnes incompltes pour rsoudre le problme. Il y a plus : il arrive souvent que les murs ne sont pas d'accord avec le droit ; on dit sans cesse qu'elles en temprent les rigueurs, qu'elles en corrigent les excs formalistes, parfois mme qu'elles sont animes d'un tout autre esprit. Ne pourrait-il pas alors se faire qu'elles manifestent d'autres sortes de solidarit sociale que celles qu'exprime le droit positif ? Mais cette opposition ne se produit que dans des circonstances tout fait exceptionnelles. Il faut pour cela que le droit ne corresponde plus l'tat prsent de la socit et que pourtant il se maintienne, sans raison d'tre, par la force de l'habitude. Dans ce cas, en effet, les relations nouvelles qui s'tablissent malgr lui ne laissent pas de s'organiser ; car elles ne peuvent pas durer sans chercher se consolider.
1
Voir plus loin, livre III, chap. 1er.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
55
Seulement, comme elles sont en conflit avec l'ancien droit qui persiste, elles ne dpassent pas le stade des murs et ne parviennent pas entrer dans la vie juridique proprement dite. C'est ainsi que l'antagonisme clate. Mais il ne peut se produire que dans des cas rares et pathologiques, qui ne peuvent mme durer sans danger. Normalement, les murs ne s'opposent pas au droit mais au contraire en sont la base. Il arrive, il est vrai, que sur cette base rien ne s'lve. Il peut y avoir des relations sociales qui ne comportent que cette rglementation diffuse qui vient des murs ; mais c'est qu'elles manquent d'importance et de continuit, sauf, bien entendu, les cas anormaux dont il vient d'tre question. Si donc il peut se faire qu'il y ait des types de solidarit sociale que les murs sont seules manifester, ils sont certainement trs secondaires ; au contraire, le droit reproduit tous ceux qui sont essentiels, et ce sont les seuls que nous ayons besoin de connatre. Ira-t-on plus loin et soutiendra-t-on que la solidarit sociale n'est pas tout entire dans ses manifestations sensibles ; que celles-ci ne l'expriment qu'en partie et imparfaitement; qu'au-del du droit et des murs il y a l'tat interne d'o elle drive, et que, pour la connatre vritablement, il faut l'atteindre en elle-mme et sans intermdiaire ? - Mais nous ne pouvons connatre scientifiquement les causes que par les effets qu'elles produisent, et, pour en mieux dterminer la nature, la science ne fait que choisir parmi ces rsultats ceux qui sont le plus objectifs et qui se prtent le mieux la mesure. Elle tudie la chaleur travers les variations de volume que produisent dans les corps les changements de temprature, l'lectricit travers ses effets physico-chimiques, la force travers le mouvement. Pourquoi la solidarit sociale ferait-elle exception ? Qu'en subsiste-t-il d'ailleurs une fois qu'on l'a dpouille de ses formes sociales ? Ce qui lui donne ses caractres spcifiques, c'est la nature du groupe dont elle assure l'unit, c'est pourquoi elle varie suivant les types sociaux. Elle n'est pas la mme au sein de la famille et dans les socits politiques ; nous ne sommes pas attachs notre patrie de la mme manire que le Romain l'tait la cit ou le Germain sa tribu. Mais puisque ces diffrences tiennent des causes sociales, nous ne pouvons les saisir qu' travers les diffrences que prsentent les effets sociaux de la solidarit. Si donc nous ngligeons ces dernires, toutes ces varits deviennent indiscernables et nous ne pouvons plus apercevoir que ce qui leur est commun toutes, savoir la tendance gnrale la sociabilit, tendance qui est toujours et partout la mme et n'est lie aucun type social en particulier. Mais ce rsidu n'est qu'une abstraction ; car la sociabilit en soi ne se rencontre nulle part. Ce qui existe et vit rellement, ce sont les formes particulires de la solidarit, la solidarit domestique, la solidarit professionnelle, la solidarit nationale, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, etc. Chacune a sa nature propre ; par consquent, ces gnralits ne sauraient en tout cas donner du phnomne qu'une explication bien incomplte, puisqu'elles laissent ncessairement chapper ce qu'il a de concret et de vivant. L'tude de la solidarit relve donc de la sociologie. C'est un fait social que l'on ne peut bien connatre que par l'intermdiaire de ses effets sociaux. Si tant de moralistes et de psychologues ont pu traiter la question sans suivre cette mthode, c'est qu'ils ont tourn la difficult. Ils ont limin du phnomne tout ce qu'il a de plus spcialement social pour n'en retenir que le germe psychologique dont il est le dveloppement. Il est certain, en effet, que la solidarit, tout en tant un fait social au premier chef, dpend de notre organisme individuel. Pour qu'elle puisse exister, il faut que notre constitution physique et psychique la comporte. On peut donc, la rigueur, se contenter de l'tudier sous cet aspect. Mais, dans ce cas, on n'en voit que la partie la
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
56
plus indistincte et la moins spciale ; ce n'est mme pas elle proprement parler, mais plutt ce qui la rend possible. Encore cette tude abstraite ne saurait-elle tre bien fconde en rsultats. Car, tant qu'elle reste l'tat de simple prdisposition de notre nature psychique, la solidarit est quelque chose de trop indfini pour qu'on puisse aisment l'atteindre. C'est une virtualit intangible qui n'offre pas prise l'observation. Pour qu'elle prenne une forme saisissable, il faut que quelques consquences sociales la traduisent au-dehors. De plus, mme dans cet tat d'indtermination, elle dpend de conditions sociales qui l'expliquent et dont, par consquent, elle ne peut tre dtache. C'est pourquoi il est bien rare qu' ces analyses de pure psychologie quelques vues sociologiques ne se trouvent mles. Par exemple, on dit quelques mots de l'influence de l'tat grgaire sur la formation du sentiment social en gnral 1 ; on bien on indique rapidement les principales relations sociales dont la sociabilit dpend de la manire la plus apparente 2. Sans doute, ces considrations complmentaires, introduites sans mthode, titre d'exemples et suivant les hasards de la suggestion, ne sauraient suffire pour lucider beaucoup la nature sociale de la solidarit. Elles dmontrent du moins que le point de vue sociologique s'impose mme aux psychologues. Notre mthode est donc toute trace. Puisque le droit reproduit les formes principales de la solidarit sociale, nous n'avons qu' classer les diffrentes espces de droit pour chercher ensuite quelles sont les diffrentes espces de solidarit sociale qui y correspondent. Il est, ds prsent, probable qu'il en est une qui symbolise cette solidarit spciale dont la division du travail est la cause. Cela fait, pour mesurer la part de cette dernire, il suffira de comparer le nombre des rgles juridiques qui l'expriment au volume total du droit. Pour ce travail, nous ne pouvons nous servir des distinctions usites chez les jurisconsultes. Imagines pour la pratique, elles peuvent tre trs commodes ce point de vue, mais la science ne peut se contenter de ces classifications empiriques et par -peu-prs. La plus rpandue est celle qui divise le droit en droit public et en droit priv ; le premier est cens rgler les rapports de l'individu avec l'tat, le second ceux des individus entre eux. Mais quand on essaie de serrer les ternies de prs, la ligne de dmarcation qui paraissait si nette au premier abord s'efface. Tout droit est priv, en ce sens que c'est toujours et partout des individus qui sont en prsence et qui agissent ; mais surtout tout droit est publie, en ce sens qu'il est une fonction sociale et que tous les individus sont, quoique des titres divers, des fonctionnaires de la socit. Les fonctions maritales, paternelles, etc., ne sont ni dlimites, ni organises d'une autre manire que les fonctions ministrielles et lgislatives, et ce n'est pas sans raison que le droit romain qualifiait la tutelle de munus publicum. Qu'est-ce d'ailleurs que l'tat ? O commence et o finit-il ? On sait combien la question est controverse ; il n'est pas scientifique de faire reposer une classification fondamentale sur une notion aussi obscure et mal analyse. Pour procder mthodiquement, il nous faut trouver quelque caractristique qui, tout en tant essentielle aux phnomnes juridiques, soit susceptible de varier quand ils varient. Or, tout prcepte de droit peut tre dfini : une rgle de conduite sanctionne. D'autre part, il est vident que les sanctions changent suivant la gravit attribue aux prceptes, la place qu'ils tiennent dans la conscience publique, le rle
1 2
BAIN, motions et volont, p. 117 et suiv., Paris, F. Alcan. SPENCER, Principes de psychologie, VIIIe Partie, chap. V, Paris, F. Alcan.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
57
qu'ils jouent dans la socit. Il convient donc de classer les rgles juridiques d'aprs les diffrentes sanctions qui y sont attaches. Il en est de deux sortes. Les unes consistent essentiellement dans une douleur, ou, tout au moins, dans une diminution inflige l'agent ; elles ont pour objet de l'atteindre dans sa fortune, ou dans son honneur, ou dans sa vie, ou clans sa libert, de le priver de quelque chose dont il jouit. On dit qu'elles sont rpressives ; c'est le cas du droit pnal. Il est vrai que celles qui sont attaches aux rgles purement morales ont le mme caractre : seulement elles sont distribues d'une manire diffuse par tout le monde indistinctement, tandis que celles du droit pnal ne sont appliques que par l'intermdiaire d'un organe dfini; elles sont organises. Quant l'autre sorte, elle n'implique pas ncessairement une souffrance de l'agent, mais consiste seulement dans la remise des choses en tal, dans le rtablissement des rapports troubls sous leur forme normale, soit que l'acte incrimin soit ramen de force au type dont il a dvi, soit qu'il soit annul, c'est--dire priv de toute valeur sociale. On doit donc rpartir en deux grandes espces les rgles juridiques, suivant qu'elles ont des sanctions rpressives organises, ou des sanctions seulement restitutives. La premire comprend tout le droit pnal ; la seconde, le droit civil, le droit commercial, le droit des procdures, le droit administratif et constitutionnel, abstraction faite des rgles pnales qui peuvent s'y trouver. Cherchons maintenant quelle sorte de solidarit sociale correspond chacune de ces espces.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
58
Chapitre II
Solidarit mcanique ou par similitudes
I
Retour la table des matires
Le lien de solidarit sociale auquel correspond le droit rpressif est celui dont la rupture constitue le crime ; nous appelons de ce nom tout acte qui, un degr quelconque, dtermine contre son auteur cette raction caractristique qu'on nomme la peine. Chercher quel est ce lien, c'est donc se demander quelle est la cause de la peine, ou, plus clairement, en quoi le crime consiste essentiellement. il y a sans doute des crimes d'espces diffrentes ; mais, entre toutes ces espces, il y a non moins srement quelque chose de commun. Ce qui le prouve, c'est que la raction qu'ils dterminent de la part de la socit, savoir la peine, est, sauf les diffrences de degrs, toujours et partout la mme. L'unit de l'effet rvle l'unit de la cause. Non seulement entre tous les crimes prvus par la lgislation d'une seule et mme socit, mais entre tous ceux qui ont t ou qui sont reconnus et punis dans les diffrents types sociaux, il existe assurment des ressemblances essentielles. Si diffrents que paraissent au premier abord les actes ainsi qualifis, il est impossible qu'ils n'aient pas quelque fond commun. Car ils affectent partout de la mme manire la conscience morale des nations et produisent partout la mme consquence. Ce sont tous des crimes, c'est--dire des actes rprims par des chtiments dfinis. Or, les proprits essentielles d'une chose sont celles que l'on observe partout o cette chose existe et qui n'appartiennent qu' elle. Si donc nous voulons savoir en quoi consiste essentiellement le crime, il faut dgager les traits qui se retrouvent les mmes dans toutes les varits criminologiques des diffrents types sociaux. Il n'en est point qui puissent tre ngliges. Les conceptions juridiques des socits les plus infrieures ne sont pas moins dignes d'intrt que celles des socits les plus leves; elles sont des
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
59
faits non moins instructifs. En faire abstraction serait nous exposer voir l'essence du crime l o elle n'est pas. C'est ainsi que le biologiste aurait donn des phnomnes vitaux une dfinition trs inexacte s'il avait ddaign d'observer les tres monocellulaires ; car, de la seule contemplation des organismes et surtout des organismes suprieurs, il aurait conclu tort que la vie consiste essentiellement dans l'organisation. Le moyen de trouver cet lment permanent et gnral n'est videmment pas de dnombrer les actes qui ont t, en tout temps et en tout lieu, qualifis de crimes, pour observer les caractres qu'ils prsentent. Car si, quoi qu'on en ait dit, il y a des actions qui ont t universellement regardes comme criminelles, elles sont l'infime minorit, et, par consquent, une telle mthode ne pourrait nous donner du phnomne qu'une notion singulirement tronque, puisqu'elle ne s'appliquerait qu' des exceptions 1. Ces variations du droit rpressif prouvent en mme temps que ce caractre constant ne saurait se trouver parmi les proprits intrinsques des actes imposs ou prohibs par les rgles pnales, puisqu'ils prsentent une telle diversit, mais dans les rapports qu'ils soutiennent avec quelque condition qui leur est extrieure. On a cru trouver ce rapport dans une sorte d'antagonisme entre ces actions et les grands intrts sociaux, et on a dit que les rgles pnales nonaient pour chaque type social les conditions fondamentales de la vie collective. Leur autorit viendrait donc de leur ncessit ; d'autre part, comme ces ncessits varient avec les socits, on s'expliquerait ainsi la variabilit du droit rpressif. Mais nous nous sommes dj expliqu sur ce point. Outre qu'une telle thorie fait au calcul et la rflexion une part beaucoup trop grande dans la direction de l'volution sociale, il y a une multitude d'actes qui ont t et sont encore regards comme criminels, sans que, par euxmmes, ils soient nuisibles la socit. En quoi le fait de toucher un objet tabou, un animal ou un homme impur ou consacr, de laisser s'teindre le feu sacr, de manger de certaines viandes, de ne pas immoler sur la tombe des parents le sacrifice traditionnel, de ne pas prononcer exactement la formule rituelle, de ne pas clbrer certaines ftes, etc., a-t-il pu jamais constituer un danger social ? On sait pourtant quelle place occupe dans le droit rpressif d'une foule de peuples la rglementation du rite, de l'tiquette, du crmonial, des pratiques religieuses. Il n'y a qu' ouvrir le Pentateuque pour s'en convaincre, et, comme ces faits se rencontrent normalement dans certaines espces sociales, il est impossible d'y voir de simples anomalies et des cas pathologiques que l'on a le droit de ngliger.
C'est pourtant cette mthode qu'a suivie M. GAROFALO. Sans doute, il semble y renoncer quand il reconnat l'impossibilit de dresser une liste de faits universellement punis (Criminologie, p. 5), ce qui, d'ailleurs, est excessif. Mais il y revient finalement puisque, en somme, le crime naturel est pour lui celui qui froisse les sentiments qui sont partout la base du droit pnal, c'est--dire la partie invariable du sens moral et celle-l seulement. Mais pourquoi le crime qui froisse quelque sentiment particulier certains types sociaux serait-il moins crime crue les autres ? M. Garofalo est ainsi amen refuser le caractre de crime des actes qui ont t universellement reconnus comme criminels dans certaines espces sociales et, par suite, rtrcir artificiellement les cadres de la criminalit. Il en rsulte que sa notion du crime est singulirement incomplte. Elle est aussi bien flottante, car l'auteur ne fait pas entrer dans ses comparaisons tous les types sociaux, mais il en exclut un grand nombre qu'il traite d'anormaux. On peut dire d'un fait social qu'il est anormal par rapport au type de l'espce, mais une espce ne saurait tre anormale. Les deux mots jurent d'tre accoupls. Si intressant que soit l'effort de M. Garofalo pour arriver une notion scientifique du dlit, il n'est pas fait avec une mthode suffisamment exacte et prcise. C'est ce que montre bien cette expression de dlit naturel dont il se sert. Est-ce que tous les dlits ne sont pas naturels ? Il est probable qu'il y a l un retour de la doctrine de Spencer, pour qui la vie sociale n'est vraiment naturelle que dans les socits industrielles. Malheureusement rien n'est plus faux.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
60
Alors mme que l'acte criminel est certainement nuisible la socit, il s'en faut que le degr de nocivit qu'il prsente soit rgulirement en rapport avec l'intensit de la rpression qui le frappe. Dans le droit pnal des peuples les plus civiliss, le meurtre est universellement regard comme le plus grand des crimes. Cependant une crise conomique, un coup de bourse, une faillite mme peuvent dsorganiser beaucoup plus gravement le corps social qu'un homicide isol. Sans doute le meurtre est toujours un mal, mais rien ne prouve que ce soit le plus grand mal. Qu'est-ce qu'un homme de moins dans la socit ? Qu'est-ce qu'une cellule de moins dans l'organisme ? On dit que la scurit gnrale serait menace pour l'avenir si l'acte restait impuni ; mais qu'on mette en regard l'importance de ce danger, si rel qu'il soit, et celle de la peine ; la disproportion est clatante. Enfin, les exemples que nous venons de citer montrent qu'un acte peut tre dsastreux pour une socit sans encourir la moindre rpression. Cette dfinition du crime est donc, de toute manire, inadquate. Dira-t-on, en la modifiant, que les actes criminels sont ceux qui semblent nuisibles la socit qui les rprime ; que les rgles pnales expriment, non pas les conditions qui sont essentielles la vie sociale, mais celles qui paraissent telles au groupe qui les observe ? Mais une telle explication n'explique rien ; car elle ne nous fait pas comprendre pourquoi, dans un si grand nombre de cas, les socits se sont trompes et ont impos des pratiques qui, par elles-mmes, n'taient mme pas utiles. En dfinitive, cette prtendue solution du problme se rduit un vritable truisme ; car, si les socits obligent ainsi chaque individu obir ces rgles, c'est videmment qu'elles estiment, tort ou raison, que cette obissance rgulire et ponctuelle leur est indispensable ; c'est qu'elles y tiennent nergiquement. C'est donc comme si l'on disait que les socits jugent les rgles ncessaires parce qu'elles les jugent ncessaires. Ce qu'il nous faudrait dire, c'est pourquoi elles les jugent ainsi. Si ce sentiment avait sa cause dans la ncessit objective des prescription& pnales ou, du moins, dans leur utilit, ce serait une explication. Mais elle est contredite par les faits ; la question reste tout entire. Cependant cette dernire thorie n'est pas sans quelque fondement ; c'est avec raison qu'elle cherche dans certains tats du sujet les conditions constitutives de la criminalit. En effet, le seul caractre commun tous les crimes, c'est qu'ils consistent - sauf quelques exceptions apparentes qui seront examines plus loin - en des actes universellement rprouvs par les membres de chaque socit. On se demande aujourd'hui si cette rprobation est rationnelle et s'il ne serait pas plus sage de ne voir dans le crime qu'une maladie ou qu'une erreur. Mais nous n'avons pas entrer dans ces discussions ; nous cherchons dterminer ce qui est ou a t, non ce qui doit tre. Or, la ralit du fait que nous venons d'tablir n'est pas contestable ; c'est--dire que le crime froisse des sentiments qui, pour un mme type social, se retrouvent dans toutes les consciences saines. Il n'est pas possible de dterminer autrement la nature de ces sentiments, de les dfinir en fonction de leurs objets particuliers : car ces objets ont infiniment vari et peuvent varier encore 1. Aujourd'hui, ce sont les sentiments altruistes qui prsentent ce caractre de la manire la plus marque ; mais il fut un temps, trs voisin de nous,
1
Nous ne voyons pas quelle raison scientifique M. Garofalo a de dire que les sentiments moraux actuellement acquis la partie civilise de l'humanit constituent une morale non susceptible de perte, mais d'un dveloppement toujours croissant (p. 9). Qu'est-ce qui permet de marquer ainsi une limite aux changements qui se feront dans un sens ou dans l'autre ?
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
61
o les sentiments religieux, domestiques, et mille autres sentiments traditionnels avaient exactement les mmes effets. Maintenant encore, il s'en faut que la sympathie ngative pour autrui soit, comme le veut M. Garofalo, seule produire ce rsultat. Est-ce que, mme en temps de paix, nous n'avons pas pour l'homme qui trahit sa patrie au moins autant d'aversion que pour le voleur et l'escroc ? Est-ce que, dans les pays o le sentiment monarchique est encore vivant, les crimes de lse-majest ne soulvent pas une indignation gnrale ? Est-ce que, dans les pays dmocratiques, les injures adresses au peuple ne dchanent pas les mmes colres ? On ne saurait donc dresser une liste des sentiments dont la violation constitue l'acte criminel; ils ne se distinguent des autres que par ce trait, c'est qu'ils sont communs la grande moyenne des individus de la mme socit. Aussi les rgles qui prohibent ces actes et que sanctionne le droit pnal sont-elles les seules auxquelles le fameux axiome juridique nul n'est cens ignorer la loi s'applique sans fiction. Comme elles sont graves dans toutes les consciences, tout le monde les connat et sent qu'elles sont fondes. C'est du moins vrai de l'tat normal. S'il se rencontre des adultes qui ignorent ces rgles fondamentales ou n'en reconnaissent pas l'autorit, une telle ignorance ou une telle indocilit sont des symptmes irrcuss de perversion pathologique ; ou bien, s'il arrive qu'une disposition pnale se maintienne quelque temps bien qu'elle soit conteste de tout le monde, c'est grce un concours de circonstances exceptionnelles, par consquent anormales, et un tel tat de choses ne peut jamais durer. C'est ce qui explique la manire particulire dont le droit pnal se codifie. Tout droit crit a un double objet : prescrire certaines obligations, dfinir les sanctions qui y sont attaches. Dans le droit civil, et plus gnralement dans toute espce de droit sanctions restitutives, le lgislateur aborde et rsout sparment ces deux problmes. Il dtermine d'abord l'obligation avec toute la prcision possible, et c'est seulement ensuite qu'il dit la manire dont elle doit tre sanctionne. Par exemple, dans le chapitre de notre Code civil qui est consacr aux devoirs respectifs des poux, ces droits et ces obligations sont noncs d'une manire positive ; mais il n'y est pas dit ce qui arrive quand ces devoirs sont viols de part ou d'autre. C'est ailleurs qu'il faut aller chercher cette sanction. Parfois mme elle est totalement sous-entendue. Ainsi l'art. 214 du Code civil ordonne la femme d'habiter avec son mari : on en dduit que le mari peut la forcer rintgrer le domicile conjugal, mais cette sanction n'est, nulle part, formellement indique. Le droit pnal, tout au contraire, n'dicte que des sanctions, mais il ne dit rien des obligations auxquelles elles se rapportent. Il ne commande pas de respecter la vie d'autrui, mais de frapper de mort l'assassin. Il ne dit pas tout d'abord, comme fait le droit civil : Voici le devoir, mais, tout de suite : Voici la peine. Sans doute, si l'action est punie, c'est qu'elle est contraire une rgle obligatoire ; mais cette rgle n'est pas expressment formule. Il ne peut y avoir cela qu'une raison, c'est que la rgle est connue et accepte de tout le monde. Quand un droit coutumier passe l'tat de droit crit et se codifie, c'est que des questions litigieuses rclament une solution plus dfinie ; si la coutume continuait fonctionner silencieusement, sans soulever de discussion ni de difficults, il n'y aurait pas de raison pour qu'elle se transformt. Puisque le droit pnal ne se codifie que pour tablir une chelle gradue de peines, c'est donc que celle-ci seule peut prter au doute. Inversement, si les rgles dont la peine punit la violation n'ont pas besoin de recevoir une expression juridique, c'est qu'elles ne sont l'objet d'aucune contestation, c'est que tout le monde en sent l'autorit 1.
Cf. BINDING, Die Normen und ihre Uebertretung, Leipzig, 1872, I, 6 et suiv.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
62
Il est vrai que, parfois, le Pentateuque n'dicte pas de sanctions, quoique, comme nous le verrons, il ne contienne gure que des dispositions pnales. C'est le cas pour les dix commandements, tels qu'ils se trouvent formuls au chapitre XX de l'Exode et au chapitre V du Deutronome. Mais c'est que le Pentateuque, quoiqu'il ait fait office de Code, n'est pourtant pas un Code proprement dit. Il n'a pas pour objet de runir en un systme unique et de prciser en vue de la pratique des rgles pnales suivies par le peuple hbreu ; c'est mme si peu une codification que les diffrentes parties dont il est compos semblent n'avoir pas t rdiges la mme poque. C'est avant tout un rsum des traditions de toute sorte par lesquelles les Juifs s'expliquaient euxmmes et leur faon la gense du monde, de leur socit et de leurs principales pratiques sociales. Si donc il nonce certains devoirs qui certainement taient sanctionns par des peines, ce n'tait pas qu'ils fussent ignors ou mconnus des Hbreux ni qu'il ft ncessaire de les leur rvler ; au contraire, puisque le livre n'est qu'un tissu de lgendes nationales, on peut tre assur que tout ce qu'il renferme tait crit dans toutes les consciences. Mais c'est qu'il s'agissait essentiellement de reproduire, en les fixant, les croyances populaires sur l'origine de ces prceptes, sur les circonstances historiques dans lesquelles ils taient censs avoir t promulgus, sur les sources de leur autorit ; or, de ce point de vue, la dtermination de la peine devient quelque chose d'accessoire 1. C'est pour la mme raison que le fonctionnement de la justice rpressive tend toujours rester plus ou moins diffus. Dans des types sociaux trs diffrents, elle ne s'exerce pas par l'organe d'un magistrat spcial, mais la socit tout entire y participe dans une mesure plus ou moins large. Dans les socits primitives, o, comme nous le verrons, le droit est tout entier pnal, c'est l'assemble du peuple qui rend la justice. C'est le cas chez les anciens Germains 2. A Rome, tandis que les affaires civiles relevaient du prteur, les affaires criminelles taient juges par le peuple, d'abord par les comices curies et ensuite, partir de la loi des XII Tables, par les comices centuries ; jusqu' la. fin de la Rpublique, et quoique en fait il et dlgu ses pouvoirs des commissions permanentes, il reste en principe le juge suprme pour ces sortes de procs 3. A Athnes, sous la lgislation de Solon, la juridiction criminelle appartenait en partie aux [en grec dans le texte], vaste collge qui, nominalement, comprenait tous les citoyens au-dessus de trente ans 4. Enfin, chez les nations germano-latines, la socit intervient dans l'exercice de ces mmes fonctions, reprsente par le jury. L'tat de diffusion o se trouve ainsi cette partie du pouvoir judiciaire serait inexplicable, si les rgles dont il assure l'observation et, par consquent, les sentiments auxquels ces rgles rpondent n'taient immanents dans toutes les consciences. Il est vrai que, dans d'autres cas, il est dtenu par une classe privilgie ou par des magistrats particuliers. Mais ces faits ne diminuent pas la valeur dmonstrative des prcdents, car, de ce que les sentiments collectifs ne ragissent plus qu' travers certains intermdiaires, il ne suit pas qu'ils aient cess d'tre collectifs pour se localiser dans un nombre restreint de consciences. Mais cette dlgation peut tre due soit la multiplicit plus grande des affaires qui ncessite l'institution de fonctionnaires spciaux, soit la trs grande importance prise par
1
2 3 4
Les seules exceptions vritables cette particularit du droit pnal se produisent quand c'est un acte de l'autorit publique qui cre le dlit. Dans ce cas, le devoir est gnralement dfini indpendamment de la sanction ; on se rendra compte plus loin de la cause de cette exception. TACITE, Germania, chap. XII. Cf. WALTER, Histoire de la procdure civile et du droit criminel chez les Romains, tr. fr., 829 ; REIN, Criminalrecht der Roemer, p. 63. Cf. GILBERT, Handbuch der Griechischen Staatsalterthmer, Leipzig, 1881, I, 138.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
63
certains personnages ou certaines classes et qui en fait les interprtes autoriss des sentiments collectifs.
Cependant, on n'a pas dfini le crime quand on a dit qu'il consiste dans une offense aux sentiments collectifs ; car il en est parmi ces derniers qui peuvent tre offenss sans qu'il y ait crime. Ainsi, l'inceste est l'objet d'une aversion assez gnrale, et cependant c'est une action simplement immorale. Il en est de mme des manquements l'honneur sexuel que commet la femme en dehors de l'tat de mariage, du fait d'aliner totalement sa libert entre les mains d'autrui ou d'accepter d'autrui une telle alination. Les sentiments collectifs auxquels correspond le crime doivent donc se singulariser des autres par quelque proprit distinctive : ils doivent avoir une certaine intensit moyenne. Non seulement ils sont gravs dans toutes les consciences, mais ils y sont fortement gravs. Ce ne sont point des vellits hsitantes et superficielles, mais des motions et des tendances qui sont fortement enracines en nous. Ce qui le prouve, c'est l'extrme lenteur avec laquelle le droit pnal volue. Non seulement il se modifie plus difficilement que les murs, mais il est la partie du droit positif la plus rfractaire au changement. Que l'on observe, par exemple, ce qu'a fait le lgislateur depuis le commencement du sicle dans les diffrentes sphres de la vie juridique ; les innovations dans les matires de droit pnal sont extrmement rares et restreintes, tandis qu'au contraire une multitude de dispositions nouvelles se sont introduites dans le droit civil, le droit commercial, le droit administratif et constitutionnel. Que l'on compare le droit pnal tel que la loi des XII Tables l'a fix Rome avec l'tat o il se trouve l'poque classique ; les changements que l'on constate sont bien peu de chose ct de ceux qu'a subis le droit civil pendant le mme temps. Ds l'poque des XII Tables, dit Mainz, les principaux crimes et dlits sont constitus : Durant dix gnrations, le catalogue des crimes publics ne fut augment que par quelques lois qui punissent le pculat, la brigue et peut-tre le plagium 1. Quant aux dlits privs, on n'en reconnut que deux nouveaux : la rapine (actio bonorum vi raptorum) et le dommage caus injustement (damnun injuria datum). On retrouve le mme fait partout. Dans les socits infrieures, le droit, comme nous le verrons, est presque exclusivement pnal ; aussi est-il trs stationnaire. D'une manire gnrale, le droit religieux est toujours rpressif : il est essentiellement conservateur. Cette fixit du droit pnal tmoigne de la force de rsistance des sentiments collectifs auxquels il correspond. Inversement, la plus grande plasticit des rgles purement morales et la rapidit relative de leur volution dmontrent la moindre nergie des sentiments qui en sont la base ; ou bien ils sont plus rcemment acquis et n'ont pas encore eu le temps de pntrer profondment les consciences, ou bien ils sont en train de perdre racine et remontent du fond la surface. Une dernire addition est encore ncessaire pour que notre dfinition soit exacte. Si, en gnral, les sentiments que protgent des sanctions simplement morales, c'est-dire diffuses, sont moins intenses et moins solidement organiss que ceux que protgent des peines proprement dites, cependant il y a des exceptions. Ainsi, il n'y a aucune raison d'admettre que la pit filiale moyenne ou mme les formes lmentaires de la compassion pour les misres les plus apparentes soient aujourd'hui des sentiments plus superficiels que le respect de la proprit ou de l'autorit publique ;
1
Esquisse historique du droit criminel de l'ancienne Rome, in Nouvelle Revue historique du droit franais et tranger, 1882, pp. 24 et 27.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
64
cependant, le mauvais fils et l'goste mme le plus endurci ne sont pas traits en criminels. Il ne suffit donc pas que les sentiments soient forts, il faut qu'ils soient prcis. En effet, chacun d'eux est relatif une pratique trs dfinie. Cette pratique peut tre simple ou complexe, positive ou ngative, c'est--dire consister dans une action ou une abstention, mais elle est toujours dtermine. Il s'agit de faire ou de ne pas faire ceci ou cela, de ne pas tuer, de ne pas blesser, de prononcer telle formule, d'accomplir tel rite, etc. Au contraire, les sentiments comme l'amour filial ou la charit sont des aspirations vagues vers des objets trs gnraux. Aussi les rgles pnales sont-elles remarquables par leur nettet et leur prcision, tandis que les rgles purement morales ont gnralement quelque chose de flottant. Leur nature indcise fait mme que, trs souvent, il est difficile d'en donner une formule arrte. Nous pouvons bien dire d'une manire trs gnrale qu'on doit travailler, qu'on doit avoir piti d'autrui, etc. ; mais nous ne pouvons fixer de quelle faon ni dans quelle mesure. Il y a place ici par consquent pour des variations et des nuances. Au contraire, parce que les sentiments qu'incarnent les rgles pnales sont dtermins, ils ont une bien plus grande uniformit ; comme ils ne peuvent pas tre entendus de manires diffrentes, ils sont partout les mmes.
Nous sommes maintenant en tat, de conclure. L'ensemble des croyances et des sentiments communs la moyenne des membres d'une mme socit forme un systme dtermin qui a sa vie propre; on peut l'appeler la conscience collective ou commune. Sans doute, elle n'a pas pour substrat un organe unique ; elle est, par dfinition, diffuse dans toute l'tendue de la socit; mais elle n'en a pas moins des caractres spcifiques qui en font une ralit distincte. En effet, elle est indpendante des conditions particulires o les individus se trouvent placs; ils passent, et elle reste. Elle est la mme au Nord et au Midi, dans les grandes villes et dans les petites, dans les diffrentes professions. De mme, elle ne change pas chaque gnration, mais elle relie au contraire les unes aux autres les gnrations successives. Elle est donc tout autre chose que les consciences particulires, quoiqu'elle ne soit ralise que chez les individus. Elle est le type psychique de la socit, type qui a ses proprits, ses conditions d'existence, son mode de dveloppement, tout comme les types individuels, quoique d'une autre manire. A ce titre, elle a donc le droit d'tre dsigne par un mot spcial. Celui que nous avons employ plus haut n'est pas, il est vrai, sans ambigut. Comme les termes de collectif et de social sont souvent pris l'un pour l'autre, on est induit croire que la conscience collective est toute la conscience sociale, c'est--dire s'tend aussi loin que la vie psychique de la socit, alors que, surtout dans les socits suprieures, elle n'en est qu'une partie trs restreinte. Les fonctions judiciaires, gouvernementales, scientifiques, industrielles, en un mot toutes les fonctions spciales sont d'ordre psychique, puisqu'elles consistent en des systmes de reprsentations et d'actions : cependant elles sont videmment en dehors de la conscience commune. Pour viter une confusion 1 qui a t commise, le mieux serait peut-tre de crer une expression technique qui dsignerait spcialement l'ensemble des similitudes sociales. Nanmoins, comme l'emploi d'un mot nouveau,
1
La confusion n'est pas sans danger. Ainsi, on se demande Parfois si la conscience individuelle varie ou non comme la conscience collective; tout dpend du sens qu'on donne au mot. S'il reprsente des similitudes sociales, le rapport de variation est inverse, nous le verrons ; s'il dsigne toute la vie psychique de la socit, le rapport est direct. Il est donc ncessaire de distinguer.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
65
quand il n'est pas absolument ncessaire, n'est pas sans inconvnient, nous garderons l'expression plus usite de conscience collective ou commune, mais en nous rappelant toujours le sens troit dans lequel nous l'employons. Nous pouvons donc, rsumant l'analyse qui prcde, dire qu'un acte est criminel quand il offense les tats forts et dfinis de la conscience collective 1. La lettre de cette proposition n'est gure conteste, mais on lui donne d'ordinaire un sens trs diffrent de celui qu'elle doit avoir. On l'entend comme si elle exprimait non la proprit essentielle du crime, mais une de ses rpercussions. On sait bien qu'il froisse des sentiments trs gnraux et trs nergiques ; mais on croit que cette gnralit et cette nergie viennent de la nature criminelle de l'acte, qui, par consquent, reste tout entier dfinir. On ne conteste pas que tout dlit soit universellement rprouv, mais on prend pour accord que la rprobation dont il est l'objet rsulte de sa dlictuosit. Seulement on est ensuite fort embarrass pour dire en quoi cette dlictuosit consiste. Dans une immoralit particulirement grave ? Je le veux ; mais c'est rpondre la question par la question et mettre un mot la place d'un autre ; car il s'agit prcisment de savoir ce que c'est que l'immoralit, et surtout cette immoralit particulire que la socit rprime au moyen de peines organises et qui constitue la criminalit. Elle ne peut videmment venir que d'un ou plusieurs caractres communs toutes les varits criminologiques ; or le seul qui satisfasse cette condition, c'est cette opposition qu'il y a entre le crime, quel qu'il soit, et certains sentiments collectifs. C'est donc cette opposition qui fait le crime, bien loin qu'elle en drive. En d'autres termes, il ne faut pas dire qu'un acte froisse la conscience commune parce qu'il est criminel, mais qu'il est criminel parce qu'il froisse la conscience commune. Nous ne le rprouvons pas parce qu'il est un crime, mais il est un crime parce que nous le rprouvons. Quant la nature intrinsque de ces sentiments, il est impossible de la spcifier; ils ont les objets les plus divers, et on n'en saurait donner une formule unique. On ne peut dire qu'ils se rapportent ni aux intrts vitaux de la socit, ni un minimum de justice ; toutes ces dfinitions sont inadquates. Mais, par cela seul qu'un sentiment, quelles qu'en soient l'origine et la fin, se retrouve dans toutes les consciences avec un certain degr de force et de prcision, tout acte qui le froisse est un crime. La psychologie contemporaine revient de plus en plus l'ide de Spinoza, d'aprs laquelle les choses sont bonnes parce que nous les aimons, bien loin que nous les aimions parce qu'elles sont bonnes. Ce qui est primitif, c'est la tendance, l'inclination ; le plaisir et la douleur ne sont que des faits drivs. Il en est de mme dans la vie sociale. Un acte est socialement mauvais parce qu'il est repouss par la socit. Mais, dira-t-on, n'y a-t-il pas des sentiments collectifs qui rsultent du plaisir ou de la douleur que la socit prouve au contact de leurs objets ? Sans doute, mais ils n'ont pas tous cette origine. Beaucoup, sinon la plupart, drivent de tout autres causes. Tout ce qui dtermine l'activit prendre une forme dfinie peut donner naissance des habitudes d'o rsultent des tendances qu'il faut dsormais satisfaire. De plus, ce sont ces dernires tendances qui, seules, sont vraiment fondamentales. Les autres n'en sont que des formes spciales et mieux dtermines ; car, pour trouver du charme tel ou tel objet, il faut que la sensibilit collective soit dj constitue de manire pouvoir le goter. Si les sentiments correspondants sont abolis, l'acte le plus funeste la socit pourra tre non seulement tolr, mais honor et propos en exemple. Le plaisir est incapable de crer de toutes pices un penchant ; il peut
1
Nous n'entrons pas dans la question de savoir si la conscience collective est une conscience comme celle de l'individu. Par ce mot, nous dsignons simplement l'ensemble des similitudes sociales, sans prjuger la catgorie par laquelle ce systme de phnomnes doit tre dfini.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
66
seulement attacher ceux qui existent telle ou telle fin particulire, pourvu que celleci soit en rapport avec leur nature initiale.
Cependant, il y a des cas o l'explication prcdente ne parat pas s'expliquer. Il y a des actes qui sont plus svrement rprims qu'ils ne sont fortement rprouvs par l'opinion. Ainsi la coalition des fonctionnaires, l'empitement des autorits judiciaires sur les autorits administratives, des fonctions religieuses sur les fonctions civiles sont l'objet d'une rpression qui n'est pas en rapport avec l'indignation qu'ils soulvent dans les consciences. La soustraction de pices publiques nous laisse assez indiffrents et pourtant est frappe de chtiments assez levs. Il arrive mme que l'acte puni ne froisse directement aucun sentiment collectif ; il n'y a rien en nous qui proteste contre le fait de pcher et de chasser en temps prohib ou de faire passer des voitures trop lourdes sur la voie publique. Cependant, il n'y a aucune raison de sparer compltement ces dlits des autres ; toute distinction radicale 1 serait arbitraire, puisqu'ils prsentent tous, des degrs divers, le mme critre externe. Sans doute, dans aucun de ces exemples, la peine ne parat injuste ; si elle n'est pas repousse par l'opinion publique, celle-ci, abandonne elle-mme, ou ne la rclamerait pas du tout ou se montrerait moins exigeante. C'est donc que, dans tous les cas de ce genre, la dlictuosit ne drive pas, ou ne drive pas tout entire de la vivacit des sentiments collectifs qui sont offenss, mais reconnat une autre cause. Il est certain, en effet, qu'une fois qu'un pouvoir gouvernemental est institu, il a par lui-mme assez de force pour attacher spontanment certaines rgles de conduite une sanction pnale. Il est capable, par son action propre, de crer certains dlits ou d'aggraver la valeur criminologique de certains autres. Aussi tous les actes que nous venons de citer prsentent-ils ce caractre commun qu'ils sont dirigs contre quelqu'un des organes directeurs de la vie sociale. Faut-il donc admettre qu'il y a deux genres de crimes relevant de deux causes diffrentes ? On ne saurait s'arrter une telle hypothse. Quelque nombreuses qu'en soient les varits, le crime est partout le mme essentiellement, puisqu'il dtermine partout le mme effet, savoir la Peine, (lui, si elle peut tre plus ou moins intense, ne change pas pour cela de nature. Or, un mme fait ne peut avoir deux causes, moins que cette dualit ne soit qu'apparente et qu'au fond elles n'en fassent qu'une. Le pouvoir de raction qui est propre ]'tat doit clone tre de mme nature que celui qui est diffus dans la socit. Et en effet d'o viendrait-il ? De la gravit des intrts que gre l'tat et qui demandent tre protgs d'une manire toute particulire ? Mais nous savons que la seule lsion d'intrts mme graves ne suffit pas dterminer la raction pnale ; il faut encore qu'elle soit ressentie d'une certaine faon. D'o vient, d'ailleurs, que le moindre dommage caus l'organe gouvernemental soit puni, alors que des dsordres beaucoup plus redoutables dans d'autres organes sociaux ne sont rpars que civilement ? La plus petite infraction la police de la voirie est frappe d'une amende ; la violation, mme rpte, des contrats, le manque constant de dlicatesse dans les rapports conomiques n'obligent qu' la rpartition du prjudice. Sans doute l'appareil de direction joue un rle minent dans la vie sociale, mais il en est d'autres dont l'intrt ne laisse pas d'tre vital et dont le fonctionnement n'est pourtant pas assur de
1
Il n'y a qu' voir comment M. Garofalo distingue ce qu'il appelle les vrais crimes des autres (p. 45) ; c'est d'aprs une apprciation personnelle qui ne repose sur aucun caractre objectif.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
67
cette manire. Si le cerveau a son importance, l'estomac est un organe qui, lui aussi, est essentiel, et les maladies de l'un sont des menaces pour la vie comme celles de J'autre, Pourquoi ce privilge fait ce qu'on appelle parfois le cerveau social ? La difficult se rsout facilement si l'on remarque que, partout o un pouvoir directeur s'tablit, sa premire et sa principale fonction est de faire respecter les croyances, les traditions, les pratiques collectives, c'est--dire de dfendre la conscience commune contre tous les ennemis du dedans comme du dehors. Il en devient ainsi le symbole, l'expression vivante aux yeux de tous. Aussi la vie qui est en elle se communique-t-elle lui, comme les affinits des ides se communiquent aux mots qui les reprsentent, et voil comment il prend un caractre qui le met hors de pair. Ce n'est plus une fonction sociale plus ou moins importante, c'est le type collectif incarn. Il participe donc l'autorit que ce dernier exerce sur les consciences et c'est de l que lui vient sa force. Seulement, une fois que celle-ci est constitue sans s'affranchir de la source d'o elle dcoule et o elle continue s'alimenter, elle devient pourtant un facteur autonome de la vie sociale, capable de produire spontanment des mouvements propres que ne dtermine aucune impulsion externe, prcisment cause de cette suprmatie qu'elle a conquise. Comme, d'autre part, elle n'est qu'une drivation de la force qui est immanente la conscience commune, elle a ncessairement les mmes proprits et ragit de la mme manire, alors mme que cette dernire ne ragit pas tout fait l'unisson. Elle repousse donc toute force antagoniste comme ferait l'me diffuse de la socit, alors mme que celle-ci ne sent pas cet antagonisme ou ne le sent pas aussi vivement, c'est--dire qu'elle marque comme crimes des actes qui la froissent sans pourtant froisser au mme degr les sentiments collectifs. Mais c'est de ces derniers qu'elle reoit toute l'nergie qui lui permet de crer des crimes et des dlits. Outre qu'elle ne peut venir d'ailleurs et que pourtant elle ne peut pas venir de rien, les faits suivants, qui seront amplement dvelopps dans toute la suite de cet ouvrage, confirment cette explication. L'tendue de l'action que l'organe gouvernemental exerce sur le nombre et sur la qualification des actes criminels dpend de la force qu'il recle. Celle-ci son tour peut tre mesure soit par l'tendue de l'autorit qu'il exerce sur les citoyens, soit par le degr de gravit reconnu aux crimes dirigs contre lui. Or, nous verrons que c'est dans les socits infrieures que cette autorit est le plus grande et cette gravit le plus leve, et, d'autre part, que c'est dans ces mmes types sociaux que la conscience collective a le plus de puissance 1. C'est donc toujours cette dernire qu'il faut revenir ; c'est d'elle que, directement ou indirectement, dcoule toute criminalit. Le crime n'est pas seulement la lsion d'intrts mme graves, c'est une offense contre une autorit en quelque sorte transcendante. Or, exprimentalement, il n'y a pas de force morale suprieure l'individu, sauf la force collective. Il y a, d'ailleurs, une manire de contrler le rsultat auquel nous venons d'arriver. Ce qui caractrise le crime, c'est qu'il dtermine la peine. Si donc notre dfinition du crime est exacte, elle doit rendre compte de tous les caractres de la peine. Nous allons procder cette vrification. Mais auparavant il faut tablir quels sont ces caractres.
D'ailleurs, quand l'amende est toute la peine, comme elle n'est qu'une rparation dont le montant est fixe, l'acte est sur les limites du droit pnal et du droit restitutif.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
68
II
En premier lieu, la peine consiste dans une raction passionnelle. Ce caractre est d'autant plus apparent que les socits sont moins cultives. En effet, les peuples primitifs punissent pour punir, font souffrir le coupable uniquement pour le faire souffrir et sans attendre pour eux-mmes aucun avantage de la souffrance qu'ils lui imposent. Ce qui le prouve, c'est qu'ils ne cherchent ni frapper juste ni frapper utilement, mais seulement frapper. C'est ainsi qu'ils chtient les animaux qui ont commis l'acte rprouv 1 ou mme les tres inanims qui en ont t l'instrument passif 2. Alors que la peine n'est applique qu' des personnes, elle s'tend souvent bien au-del du coupable et s'en va atteindre des innocents, sa femme, ses enfants, ses voisins, etc. 3. C'est que la passion qui est l'me de la peine ne s'arrte qu'une fois puise. Si donc, quand elle a dtruit celui qui l'a le plus immdiatement suscite, il lui reste des forces, elle se rpand plus loin d'une manire toute mcanique. Mme quand elle est assez modre pour ne s'en prendre qu'au coupable, elle fait sentir sa prsence par la tendance qu'elle a dpasser en gravit l'acte contre lequel elle ragit. C'est de l que viennent les raffinements de douleur ajouts au dernier supplice. A Rome encore, le voleur devait non seulement rendre l'objet drob, mais encore payer une amende du double ou du quadruple 4. D'ailleurs, la peine si gnrale du talion n'est-elle pas une satisfaction accorde la passion de la vengeance ? Mais aujourd'hui, dit-on, la peine a chang de nature ; ce n'est plus pour se venger que la socit chtie, c'est pour se dfendre. La douleur qu'elle inflige n'est plus entre ses mains qu'un instrument mthodique de protection. Elle punit, non parce que le chtiment lui offre par lui-mme quelque satisfaction, mais afin que la crainte de la peine paralyse les mauvaises volonts. Ce n'est plus la colre, mais la prvoyance rflchie qui dtermine la rpression. Les observations prcdentes ne pourraient donc pas tre gnralises : elles ne concerneraient que la forme primitive de la peine et ne pourraient pas tre tendues sa forme actuelle. Mais pour qu'on ait le droit de distinguer aussi radicalement ces deux sortes de peines, ce n'est pas assez de constater qu'elles sont employes en vue de fins diffrentes. La nature d'une pratique ne change pas ncessairement parce que les intentions conscientes de ceux qui l'appliquent se modifient. Elle pouvait, en effet, jouer dj le mme rle autrefois, mais sans qu'on s'en apert. Dans ce cas, pourquoi se transformerait-elle par cela seul qu'on se rend mieux compte des effets qu'elle produit? Elle s'adapte aux nouvelles conditions d'existence qui lui sont ainsi faites sans changements essentiels. C'est ce qui arrive pour la peine. En effet, c'est une erreur de croire que la vengeance ne soit qu'une inutile cruaut. Il est bien possible qu'en elle-mme elle consiste dans une raction mcanique et sans
1 2 3 4
Voir Exode, XXI, 28; Lv., XX, 16. Par exemple, le couteau qui a servi perptrer le meurtre. - Voir POST, Bausteine fr eine allgemeine Rechtswissenschaft, 1, pp. 230-231. Voir Exode, XX, 4 et 5; Deutronome, XII, 12-18; THONISSEN, tudes sur l'histoire du droit criminel, 1, 70 et 178 et suiv. WALTER, op. cit., 793.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
69
but, dans un mouvement passionnel et inintelligent, dans un besoin irraisonn de dtruire ; mais, en fait, ce qu'elle tend dtruire tait une menace pour nous. Elle constitue donc en ralit un vritable acte de dfense, quoique instinctif et irrflchi. Nous ne nous vengeons que de ce qui nous a fait du mal, et ce qui nous a fait du mal est toujours un danger. L'instinct de la vengeance n'est en somme que l'instinct de conservation exaspr par le pril. Ainsi il s'en faut que la vengeance ait eu dans l'histoire de l'humanit le rle ngatif et strile qu'on lui attribue. C'est une arme dfensive qui a son prix ; seulement, c'est une arme grossire. Comme elle n'a pas conscience des services qu'elle rend automatiquement, elle ne peut pas se rgler en consquence ; mais elle se rpand un peu au hasard, au gr des causes aveugles qui la poussent et sans que rien ne modre ses emportements. Aujourd'hui, comme nous connaissons davantage le but atteindre, nous savons mieux utiliser les moyens dont nous disposons ; nous nous protgeons avec plus de mthode et, par suite, plus efficacement. Mais, ds le principe, ce rsultat tait obtenu, quoique d'une manire plus imparfaite. Entre la peine d'aujourd'hui et celle d'autrefois il n'y a donc pas un abme, et, par consquent, il n'tait pas ncessaire que la premire devnt autre chose qu'elle-mme pour s'accommoder au rle qu'elle joue dans nos socits civilises. Toute la diffrence vient de ce qu'elle produit ses effets avec une plus grande conscience de ce qu'elle fait. Or, quoique la conscience individuelle ou sociale ne soit pas sans influence sur la ralit qu'elle claire, elle n'a pas le pouvoir d'en changer la nature. La structure interne des phnomnes reste la mme, qu'ils soient conscients ou non. Nous pouvons donc nous attendre ce que les lments essentiels de la peine soient les mmes que jadis. Et en effet, la peine est reste, du moins en partie, une uvre de vengeance. On dit que nous ne faisons pas souffrir le coupable pour le faire souffrir ; il n'en est pas moins vrai que nous trouvons juste qu'il souffre. Peut-tre avons-nous tort ; mais ce n'est pas ce qui est en question. Nous cherchons pour le moment dfinir la peine telle qu'elle est ou a t, non telle qu'elle doit tre, Or, il est certain que cette expression de vindicte publique, qui revient sans cesse dans la langue des tribunaux, n'est pas un vain mot. En supposant que la peine puisse rellement servir nous protger pour l'avenir, nous estimons qu'elle doit tre, avant tout, une expiation du pass. Ce qui le prouve, ce sont les prcautions minutieuses que nous prenons pour la proportionner aussi exactement que possible la gravit du crime ; elles seraient inexplicables si nous ne croyions que le coupable doit souffrir parce qu'il a fait le mal et dans la mme mesure. En effet, cette graduation n'est pas ncessaire si la peine n'est qu'un moyen de dfense. Sans doute, il y aurait danger pour la socit ce que les attentats les plus graves fussent assimils de simples dlits ; mais il ne pourrait y avoir qu'avantage, dans la plupart des cas, ce que les seconds fussent assimils aux premiers. Contre un ennemi, on ne saurait trop prendre de prcautions. Dira-t-on que les auteurs des moindres mfaits ont des natures moins perverses et que, pour neutraliser leurs mauvais instincts, il suffit de peines moins fortes ? Mais si leurs penchants sont moins vicieux, ils ne sont pas pour cela moins intenses. Les voleurs sont aussi fortement enclins au vol que les meurtriers l'homicide ; la rsistance qu'offrent les premiers n'est pas infrieure celle des seconds, et par consquent, pour en triompher, on devrait recourir aux mmes moyens. Si, comme on l'a dit, il s'agissait uniquement de refouler une force nuisible par une force contraire, l'intensit de la seconde devrait tre uniquement mesure d'aprs l'intensit de la premire, sans que la qualit de celle-ci entrt en ligne de compte. L'chelle pnale ne devrait donc comprendre qu'un petit nombre de degrs ; la peine ne devrait varier que suivant que le criminel est plus ou moins endurci, et non suivant la nature de l'acte criminel. Un voleur incorrigible serait trait comme un meurtrier incorrigible. Or, en fait, quand
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
70
mme il serait avr qu'un coupable est dfinitivement incurable, nous nous sentirions encore tenus de ne pas lui appliquer un chtiment excessif. C'est la preuve que nous sommes rests fidles au principe du talion, quoique nous l'entendions dans un sens plus lev qu'autrefois. Nous ne mesurons plus d'une manire aussi matrielle et grossire ni l'tendue de la faute, ni celle du chtiment ; mais nous pensons toujours qu'il doit y avoir une quation entre ces deux termes, que nous ayons ou non avantage tablir cette balance. La peine est donc reste pour nous ce qu'elle tait pour nos pres. C'est encore un acte de vengeance, puisque c'est une expiation. Ce que nous vengeons, ce que le criminel expie, c'est l'outrage fait la morale.
Il y a surtout une peine o ce caractre passionnel est plus manifeste qu'ailleurs ; c'est la honte qui double la plupart des peines, et qui crot avec elles. Le plus souvent, elle ne sert rien. A quoi bon fltrir un homme qui ne doit plus vivre dans la socit de ses semblables et qui a surabondamment prouv par sa conduite que des menaces plus redoutables ne suffisaient pas l'intimider ? La fltrissure se comprend quand il n'y a pas d'autre peine ou comme complment d'une peine matrielle assez faible ; dans le cas contraire, elle fait double emploi. On peut mme dire que la socit ne recourt aux chtiments lgaux que quand les autres sont insuffisants, mais alors pourquoi les maintenir ? Ils sont une sorte de supplice supplmentaire et sans but, ou qui ne peut avoir d'autre cause que le besoin de compenser le mal par le mal. C'est si bien un produit de sentiments instinctifs, irrsistibles, qu'ils s'tendent souvent des innocents ; c'est ainsi que le lieu du crime, les instruments qui y ont servi, les parents du coupable participent parfois l'opprobre dont nous frappons ce dernier. Or, les causes qui dterminent cette rpression diffuse sont aussi celles de la rpression organise qui accompagne la premire. Il suffit, d'ailleurs, de voir dans les tribunaux comment la peine fonctionne, pour reconnatre que le ressort en est tout passionnel,; car c'est des passions que s'adressent et le magistrat qui poursuit et l'avocat qui dfend. Celui-ci cherche exciter de la sympathie pour le coupable, celui-l rveiller les sentiments sociaux qu'a froisss l'acte criminel, et c'est sous l'influence de ces passions contraires que le juge prononce. Ainsi, la nature de la peine n'a pas essentiellement chang. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le besoin de vengeance est mieux dirig aujourd'hui qu'autrefois. L'esprit de prvoyance qui s'est veill ne laisse plus le champ aussi libre l'action aveugle de la passion ; il la contient dans de certaines limites, il s'oppose aux violences absurdes, aux ravages sans raison d'tre. Plus claire, elle se rpand moins au hasard ; on ne la voit plus, pour se satisfaire quand mme, se tourner contre des innocents. Mais elle reste nanmoins l'me de la pnalit. Nous pouvons donc dire que la peine consiste dans une raction passionnelle d'intensit gradue 1.
Mais d'o mane cette raction ? Est-ce de l'individu ou de la socit ?
1
C'est d'ailleurs ce que reconnaissent ceux-l mmes qui trouvent inintelligible l'ide d'expiation; car leur conclusion, c'est crue, pour tre mise en harmonie avec leur doctrine, la conception traditionnelle de la peine devrait tre totalement transforme et rforme de fond en comble. C'est donc qu'elle repose et a toujours repos sur le principe qu'ils combattent (Voir FOUILLE, Science sociale, p. 307 et suiv.).
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
71
Tout le monde sait que c'est la socit qui punit ; mais il pourrait se faire que ce ne ft pas pour son compte. Ce qui met hors de doute le caractre social de la peine, c'est qu'une fois prononce, elle ne peut plus tre leve que par le gouvernement au nom de la socit. Si c'tait une satisfaction accorde aux particuliers, ceux-ci seraient toujours matres d'en faire la remise : on ne conoit pas un privilge impos et auquel le bnficiaire ne peut pas renoncer. Si c'est la socit seule qui dispose de la rpression, c'est qu'elle est atteinte alors mme que les individus le sont aussi, et c'est l'attentat dirig contre elle qui est rprim par la peine. Cependant, on peut citer des cas o l'excution de la peine dpend de la volont des particuliers. A Home, certains mfaits taient punis d'une amende au profit de la partie lse, qui pouvait y renoncer ou en faire l'objet d'une transaction : c'tait le vol non manifeste, la rapine, l'injure, le dommage caus injustement 1. Ces dlits, que l'on appelait privs (delicta privata), s'opposaient aux crimes proprement dits dont la rpression tait poursuivie au nom de la cit. On retrouve la mme distinction en Grce, chez les Hbreux 2. Chez les peuples plus primitifs, la peine semble tre parfois une chose encore plus compltement prive, comme tend le prouver l'usage de la vendetta. Ces socits sont composes d'agrgats lmentaires, de nature quasi familiale, et qui sont commodment dsigns par l'expression de clans. Or, lorsqu'un attentat est commis par un ou plusieurs membres d'un clan contre un autre, c'est ce dernier qui chtie lui-mme l'offense qu'il a subie 3. Ce qui accrot encore, au moins en apparence, l'importance de ces faits au point de vue de la doctrine, c'est qu'on a trs souvent soutenu que la vendetta avait t primitivement la forme unique de la peine : celle-ci aurait donc consist d'abord dans des actes de vengeance prive. Mais alors, si aujourd'hui la socit est arme du droit de punir, ce ne peut tre, semble-t-il, qu'en vertu d'une sorte de dlgation des individus. Elle n'est que leur mandataire. C'est leurs intrts qu'elle gre leur place, probablement parce qu'elle les gre mieux, mais ce n'est pas les siens propres. Dans le principe, ils se vengeaient euxmmes ; maintenant, c'est elle qui les venge ; mais comme le droit pnal ne peut avoir chang de nature par suite de ce simple transfert, il n'aurait donc rien de proprement social. Si la socit parat y jouer un rle prpondrant, ce n'est que comme substitut des individus. Mais si rpandue que soit cette thorie, elle est contraire aux faits les mieux tablis. On ne peut pas citer une seule socit o la vendetta ait t la forme primitive de la peine. Tout au contraire, il est certain que le droit pnal l'origine tait essentiellement religieux. C'est un fait vident pour l'Inde, pour la Jude, puisque le droit qui y tait pratiqu tait cens rvl 4. En gypte, les dix livres d'Herms, qui renfermaient le droit criminel avec toutes les autres lois relatives au gouvernement de l'tat, taient appels sacerdotaux, et lien affirme que, de toute antiquit, les prtres gyptiens exercrent le pouvoir judiciaire 5. Il en tait de mme dans l'ancienne Germanie 6. En Grce, la justice tait considre comme une manation de Jupiter, et
1 2 3 4
5 6
REIN, Op. cit., p. 111. Chez les Hbreux, le vol, la violation de dpt, l'abus de confiance, les coups taient traits comme dlits privs. Voir notamment Morgan, Ancient Society, London, 1870,p. 76. En Jude, les juges n'taient pas des prtres, mais tout juge tait le reprsentant de Dieu, l'homme de Dieu (Deutr., 1, 17 ; Exode, XXII, 28). Dans l'Inde, c'tait le roi qui jugeait, mais cette fonction tait regarde comme essentiellement religieuse (MANOU, VIII, V, 303-311). THONISSEN, tudes sur l'histoire du droit criminel, I, p. 107. ZOEPFL, Deutsche Rechtsgeschichte, p. 909.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
72
le sentiment comme une vengeance du dieu 1. A Rome, les origines religieuses du droit pnal sont rendues manifestes et par de vieilles traditions 2, et par des pratiques archaques qui subsistrent trs tard, et par la terminologie juridique elle-mme 3. Or, la religion est chose essentiellement sociale. Bien loin qu'elle ne poursuive que des fins individuelles, elle exerce sur l'individu une contrainte de tous les instants. Elle l'oblige des pratiques qui le gnent, des sacrifices, petits ou grands, qui lui cotent. Il doit prendre sur ses biens les offrandes qu'il est tenu de prsenter la divinit; il doit prendre sur le temps de son travail ou de ses distractions les moments ncessaires l'accomplissement des rites ; il doit s'imposer toute sorte de privations qui lui sont commandes, renoncer mme la vie si les dieux l'ordonnent. La vie religieuse est toute faite d'abngation et de dsintressement. Si donc le droit criminel est primitivement un droit religieux, on peut tre sr que les intrts qu'il sert sont sociaux. Ce sont leurs propres offenses que les dieux vengent par la peine et non celles des particuliers ; or, les offenses contre les dieux sont des offenses contre la socit. Aussi, dans les socits infrieures, les dlits les plus nombreux sont-ils ceux qui lsent la chose publique : dlits contre la religion, contre les murs, contre l'autorit, etc. Il n'y a qu' voir dans la Bible, dans les lois de Manou, dans les monuments qui nous restent du vieux droit gyptien la place relativement petite qui est faite aux prescriptions protectrices des individus, et, au contraire, le dveloppement luxuriant de la lgislation rpressive sur les diffrentes formes du sacrilge, les manquements aux divers devoirs religieux, aux exigences du crmonial, etc. 4. En mme temps, ces crimes sont les plus svrement punis. Chez les Juifs, les attentats les plus abominables sont les attentats contre la religion 5. Chez les anciens Germains, deux crimes seulement taient punis de mort, au dire de Tacite : c'taient la trahison et la dsertion 6. D'aprs Confucius et Meng-Tseu, l'impit est une plus grande faute que l'assassinat 7. En gypte, le moindre sacrilge est puni de mort 8. A Rome, tout en haut de l'chelle de la criminalit, se trouve le crimen perduellionis 9 Mais alors, qu'est-ce que ces peines prives dont nous rapportions plus haut des exemples ? Elles ont une nature mixte et tiennent la fois de la sanction rpressive et de la sanction restitutive. C'est ainsi que le dlit priv du droit romain reprsente une sorte d'intermdiaire entre le crime proprement dit et la lsion purement civile. Il a des traits de l'un et de l'autre et flotte sur les confins des deux domaines. C'est un dlit en ce sens que la sanction fixe par la loi ne consiste pas simplement remettre les choses en tat ; le dlinquant n'est pas seulement tenu de rparer le dommage qu'il a caus, mais il doit quelque chose en surcrot, une expiation. Cependant, ce n'est pas tout fait un dlit, puisque, si c'est la socit qui prononce la peine, ce n'est pas elle qui est matresse de l'appliquer. C'est un droit qu'elle confre la partie lse qui,
1
2 3 4 5 6 7 8 9
C'est le fils de Saturne, dit Hsiode, qui a donn aux hommes la justice (Travaux et jours, V, 279 et 280, d. Didot). - Quand les mortels se livrent... aux actions vicieuses, Jupiter la longue vue leur inflige un prompt chtiment (ibid., 266, Cf. Iliade, XVI, 384 et suiv.). WALTER, Op. cit., 788. REIN, Op. cit., pp. 27-36. Voir THONISSEN, passim. MUNCK, Palestine, p. 216. Germania, XII. PLATH, Gesetz und Recht im alten China, 1865, 69 et 70. THONISSEN, op. cit., I, 145. WALTER, op. cit., 803.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
73
seule, en dispose librement 1. De mme, la vendetta est videmment un chtiment que la socit reconnat comme lgitime, mais qu'elle laisse aux particuliers le soin d'infliger. Ces faits ne font donc que confirmer ce que nous avons dit sur la nature de la pnalit. Si cette sorte de sanction intermdiaire est, en partie, une chose prive, dans la mme mesure, ce n'est pas une peine. Le caractre pnal en est d'autant moins prononce que le caractre social en est plus effac et inversement. Il s'en faut donc que la vengeance prive soit le prototype de la peine ; ce n'est au contraire qu'une peine imparfaite. Bien loin que les attentats contre les personnes aient t les premiers qui fussent rprims, l'origine ils sont seulement sur le seuil du droit pnal. Ils ne se sont levs sur l'chelle de la criminalit qu' mesure que la socit s'en est plus compltement saisie, et cette opration, que nous n'avons pas dcrire, ne s'est certainement pas rduite un simple transfert. Tout au contraire, l'histoire de cette pnalit n'est qu'une suite continue d'empitements de la socit sur l'individu ou plutt sur les groupes lmentaires qu'elle renferme dans son sein, et le rsultat de ces empitements est de mettre de plus en plus la place du droit des particuliers celui de la socit 2.
Mais les caractres prcdents appartiennent tout aussi bien la rpression diffuse qui suit les actions simplement immorales qu' la rpression lgale. Ce qui distingue cette dernire, c'est, avons-nous dit, qu'elle est organise ; mais en quoi consiste cette organisation ? Quand on songe au droit pnal tel qu'il fonctionne dans nos socits actuelles, on se reprsente un code o des peines trs dfinies sont attaches des crimes galement dfinis. Le juge dispose bien d'une certaine latitude pour appliquer chaque cas particulier ces dispositions gnrales ; mais, dans ses lignes essentielles, la peine est prdtermine pour chaque catgorie d'actes dfectueux. Cette organisation savante n'est cependant pas constitutive de la peine, car il y a bien des socits o celle-ci existe sans tre fixe par avance. Il y a dans la Bible nombre de dfenses qui sont aussi impratives que possible et qui, cependant, ne sont sanctionnes par aucun chtiment expressment formul. Le caractre pnal n'en est pourtant pas douteux ; car, si les textes sont muets sur la peine, en mme temps ils expriment pour l'acte dfendu une telle horreur qu'on ne peut souponner un instant qu'il soit rest impuni 3. Il y a donc tout lieu de croire que ce silence de la loi vient simplement de ce que la rpression n'tait pas dtermine. Et, en effet, bien des rcits du Pentateuque nous apprennent qu'il y avait des actes dont la valeur criminelle tait inconteste, et dont la peine n'tait tablie que par le juge qui l'appliquait. La socit savait bien qu'elle se trouvait en prsence d'un crime ; mais la sanction pnale qui y devait tre attache n'tait pas encore dfinie 4. De plus, mme parmi les peines qui sont nonces par le
1
3 4
Toutefois, ce qui accentue le caractre pnal du dlit priv, c'est qu'il entranait l'infamie, vritable peine publique (Voir REIN, op. cit., 916, et BOUVY, De l'infamie en droit romain, Paris, 1884, 35). En tout cas, il importe de remarquer que la vendetta est chose minemment collective. Ce n'est pas l'individu qui se venge, mais son clan ; plus tard, c'est au clan ou la famille qu'est paye la composition. Deutr., VI, 25. On avait trouv un homme ramassant du bois le jour du sabbat : Ceux qui le trouvrent l'amenrent Mose et Aaron et toute l'assemble, et ils le mirent en prison, car on n'avait pas encore dclar ce qu'on devait lui faire (Nombres, XV, 32-36). -Ailleurs, il s'agit d'un homme
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
74
lgislateur, il en est beaucoup qui ne sont pas spcifies avec prcision. Ainsi nous savons qu'il y avait diffrentes sortes de supplices qui n'taient pas mis sur le mme pied, et pourtant, dans un grand nombre de cas, les textes ne parlent que de la mort d'une manire gnrale, sans dire quel genre de mort devait tre inflig. D'aprs Sumner Maine, il en tait de mme dans la Rome primitive ; les crimina taient poursuivis devant l'assemble du peuple qui fixait souverainement la peine par une loi, en mme temps qu'elle tablissait la ralit du fait incrimin 1. Au reste, mme jusqu'au XVIe sicle, le principe gnral de la pnalit, c'est que l'application en tait laisse l'arbitraire du juge, arbitrio el officio judicis... Seulement, il n'est pas permis au juge d'inventer des peines autres que celles qui sont usites 2 . Un autre effet de ce pouvoir du juge tait de faire entirement dpendre de son apprciation jusqu' la qualification de l'acte criminel, qui, par consquent, tait elle-mme indtermine 3. Ce n'est donc pas dans la rglementation de la peine que consiste l'organisation distinctive de ce genre de rpression. Ce n'est pas davantage dans l'institution d'une procdure criminelle ; les faits que nous venons de citer dmontrent assez qu'elle a fait, pendant longtemps, dfaut. La seule organisation qui se rencontre partout o il y a peine proprement dite se rduit donc l'tablissement d'un tribunal. De quelque manire qu'il soit compos, qu'il comprenne tout le peuple ou seulement une lite, qu'il suive ou non une procdure rgulire tant dans l'instruction de l'affaire que dans l'application de la peine, par cela seul que l'infraction, au lieu d'tre juge par chacun, est soumise l'apprciation d'un corps constitu, par cela seul que la raction collective a pour intermdiaire un organe dfini, elle cesse d'tre diffuse : elle est organise. L'organisation pourra tre plus complte, mais ds ce moment elle existe. La peine consiste donc essentiellement dans une raction passionnelle, d'intensit gradue, que la socit exerce par l'intermdiaire d'un corps constitu sur ceux de ses membres qui ont viol certaines rgles de conduite. Or, la dfinition que nous avons donne du crime rend trs aisment compte de tous ces caractres de la peine.
III
Tout tat fort de la conscience est une source de vie ; c'est un facteur essentiel de notre vitalit gnrale. Par consquent, tout ce qui tend l'affaiblir nous diminue et nous dprime ; il en rsulte une impression de trouble et de malaise analogue celle que nous ressentons quand une fonction importante est suspendue ou ralentie. Il est donc invitable que nous ragissions nergiquement contre la cause qui nous menace
1 2 3
qui avait blasphm le nom de Dieu. Les assistants l'arrtent, mais ne savent pas comme il doit tre trait. Mose lui-mme l'ignore et va consulter l'ternel (Lv., XXIV, 12-16). Ancien droit, p. 353. Du Boys, Histoire du droit criminel des peuples modernes, VI, 11. Du Boys, ibid., 14.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
75
d'une telle diminution, que nous nous efforcions de l'carter, afin de maintenir l'intgralit de notre conscience. Au premier rang des causes qui produisent ce rsultat, il faut mettre la reprsentation d'un tat contraire. Une reprsentation n'est pas, en effet, une simple image de la ralit, une ombre inerte projete en nous par les choses ; mais c'est une force qui soulve autour d'elle tout un tourbillon de phnomnes organiques et psychiques. Non seulement le courant nerveux qui accompagne l'idation rayonne dans les centres corticaux autour du point o il a pris naissance et passe d'un plexus dans l'autre, mais il retentit dans les centres moteurs o il dtermine des mouvements, dans les centres sensoriels o il rveille des images, excite parfois des commencements d'illusions et peut mme affecter jusqu'aux fonctions vgtatives 1 ; ce retentissement est d'autant plus considrable que la reprsentation est elle-mme plus intense, que l'lment motionnel en est plus dvelopp. Ainsi la reprsentation d'un sentiment contraire au ntre agit en nous dans le mme sens et de la mme manire que le sentiment dont elle est le substitut ; c'est comme s'il tait lui-mme entr dans notre conscience. Elle a, en effet, les mmes affinits, quoique moins vives ; elle tend veiller les mmes ides, les mmes mouvements, les mmes motions. Elle oppose donc une rsistance au jeu de notre sentiment personnel, et, par suite, l'affaiblit, en attirant dans une direction contraire toute une partie de notre nergie. C'est comme si une force trangre s'tait introduite en nous de nature dconcerter le libre fonctionnement de notre vie psychique. Voil pourquoi une conviction oppose la ntre ne peut se manifester en notre prsence sans nous troubler ; c'est que, du mme coup, elle pntre en nous, et se trouvant en antagonisme avec tout ce qu'elle y rencontre, y dtermine de vritables dsordres. Sans doute, tant que le conflit n'clate qu'entre des ides abstraites, il n'a rien de bien douloureux, parce qu'il n'a rien de bien profond. La rgion de ces ides est la fois la plus leve et la plus superficielle de la conscience, et les changements qui y surviennent, n'ayant pas de rpercussions tendues, ne nous affectent, que faiblement. Mais quand il s'agit d'une croyance qui nous est chre, nous ne permettons pas et ne pouvons pas permettre qu'on y porte impunment la main. Toute offense dirige contre elle suscite une raction motionnelle, plus ou moins violente, qui se tourne contre l'offenseur. Nous nous emportons, nous nous indignons contre lui, nous lui en voulons, et les sentiments ainsi soulevs ne peuvent pas ne pas se traduire par des actes ; nous le fuyons, nous le tenons distance, nous l'exilons de notre socit, etc. Nous ne prtendons pas sans doute que toute conviction forte soit ncessairement intolrante ; l'observation courante suffit dmontrer le contraire. Mais c'est que des causes extrieures neutralisent alors celles dont nous venons d'analyser les effets. Par exemple, il peut y avoir entre les adversaires une sympathie gnrale qui contienne leur antagonisme et qui l'attnue. Mais il faut que cette sympathie soit plus forte que cet antagonisme, autrement, elle ne lui survit pas. Ou bien les deux partis en prsence renoncent la lutte quand il est avr qu'elle ne peut pas aboutir, et ils se contentent de maintenir leurs situations respectives, ils se tolrent mutuellement, ne pouvant pas s'entredtruire. La tolrance rciproque qui clt parfois les guerres de religion est souvent de cette nature. Dans tous ces cas, si le conflit des sentiments n'engendre pas ses consquences naturelles, ce n'est pas qu'il ne les recle, c'est qu'il est empch de les produire.
Voir MAUDSLEY, Physiologie de l'esprit, tr. fr., p. 270.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
76
D'ailleurs, elles sont utiles en mme temps que ncessaires. Outre qu'elles drivent forcment des causes qui les produisent, elles contribuent les maintenir. Toutes ces motions violentes constituent, en ralit, un appel de forces supplmentaires qui viennent rendre au sentiment attaqu l'nergie que lui soutire la contradiction. On a dit parfois que la colre tait inutile parce qu'elle n'tait qu'une passion destructive, mais c'est ne la voir que par un de ses aspects. En fait, elle consiste dans une surexcitation de forces latentes et disponibles qui viennent aider notre sentiment personnel faire face aux dangers en les renforant. A l'tat de paix, si l'on peut ainsi parler, celui-ci n'est pas suffisamment arm pour la lutte, il risquerait donc de succomber si des rserves passionnelles n'entraient en ligne au moment voulu ; la colre n'est autre chose qu'une mobilisation de ces rserves. Il peut mme se faire que, les secours ainsi voqus dpassant les besoins, la discussion ait pour effet de nous affermir davantage dans nos convictions, bien loin de nous branler. Or, on sait quel degr d'nergie peut prendre une croyance ou un sentiment, par cela seul qu'ils sont ressentis par une mme communaut d'hommes en relation les uns avec les autres ; les causes de ce phnomne sont aujourd'hui bien connues 1. De mme que des tats de conscience contraires s'affaiblissent rciproquement, des tats de conscience identiques, en s'changeant, se renforcent les uns les autres. Tandis que les premiers se soustraient, les seconds s'additionnent. Si quelqu'un exprime devant nous une ide qui tait dj ntre, la reprsentation que nous nous en faisons vient s'ajouter notre propre ide, s'y superpose, se confond avec elle, lui communique ce qu'elle-mme a de vitalit ; de cette fusion sort une ide nouvelle qui absorbe les prcdentes, et qui, par suite, est plus vive que chacune d'elles prise isolment. Voil pourquoi, dans les assembles nombreuses, une motion peut acqurir une telle violence ; c'est que la vivacit avec laquelle elle se produit dans chaque conscience retentit dans toutes les autres. Il n'est mme pas ncessaire que nous prouvions dj par nous-mmes, en vertu de notre seule nature individuelle, un sentiment collectif, pour qu'il prenne chez nous une telle intensit ; car ce que nous y ajoutons est, en somme, bien peu de chose. Il suffit que nous ne soyons pas un terrain trop rfractaire pour que, pntrant du dehors avec la force qu'il tient de ses origines, il s'impose nous. Puisque donc les sentiments qu'offense le crime sont, au sein d'une mme socit, les plus. universellement collectifs qui soient, puisqu'ils sont mme des tats particulirement forts de la conscience commune, il est impossible qu'ils tolrent la contradiction. Surtout si cette contradiction n'est pas purement thorique, si elle s'affirme non seulement par des paroles, mais par des actes, comme elle est alors porte son maximum, nous ne pouvons manquer de nous raidir contre elle avec passion. Une simple remise en tat de l'ordre troubl ne saurait nous suffire ; il nous fait une satisfaction plus violente. La force contre laquelle le crime vient se heurter est trop intense pour ragir avec tant de modration. D'ailleurs, elle ne pourrait le faire sans s'affaiblir, car c'est grce l'intensit de la raction qu'elle se ressaisit et se maintient au mme degr d'nergie. On peut expliquer ainsi un caractre de cette raction que l'on a souvent signal comme irrationnel. Il est certain qu'au fond de la notion d'expiation, il y a l'ide d'une satisfaction accorde quelque puissance, relle ou idale, qui nous est suprieure. Quand nous rclamons la rpression du crime, ce n'est pas nous que nous voulons personnellement venger, mais quelque chose de sacr que nous sentons plus ou moins confusment en dehors et au-dessus de nous. Ce quelque chose, nous le concevons de manires diffrentes suivant les temps et les milieux ; parfois, c'est une simple ide,
1
Voir ESPINAS, Socits animales, passim, Paris, F. Alcan.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
77
comme la morale, le devoir ; le plus souvent, nous nous le reprsentons sous la forme d'un ou de plusieurs tres concrets : les anctres, la divinit. Voil pourquoi le droit pnal non seulement est essentiellement religieux l'origine, mais encore garde toujours une certaine marque de religiosit : c'est que les actes qu'il chtie paraissent tre des attentats contre quelque chose de transcendant, tre ou concept. C'est par cette mme raison que nous nous expliquons nous-mmes comment ils nous paraissent rclamer une sanction suprieure la simple rparation dont nous nous contentons dans l'ordre des intrts purement humains. Assurment, cette reprsentation est illusoire ; c'est bien nous que nous vengeons en un sens, nous que nous satisfaisons, puisque c'est en nous et en nous seuls que se trouvent les sentiments offenss. Mais cette illusion est ncessaire. Comme par suite de leur origine collective, de leur universalit, de leur permanence dans la dure, de leur intensit intrinsque, ces sentiments ont une force exceptionnelle, ils se sparent radicalement du reste de notre conscience dont les tats sont beaucoup plus faibles. Ils nous dominent, ils ont, pour ainsi dire, quelque chose de surhumain, et, en mme temps, ils nous attachent des objets qui sont en dehors de notre vie temporelle. Ils nous apparaissent donc comme l'cho en nous d'une force qui nous est trangre et qui, de plus, est suprieure celle que nous sommes. Nous sommes ainsi ncessits les projeter en dehors de nous, rapporter quelque objet extrieur ce qui les concerne ; on sait aujourd'hui comment se font ces alinations partielles de la personnalit. Ce mirage est tellement invitable que, sous une forme ou sous une autre, il se produira tant qu'il y aura un systme rpressif. Car, pour qu'il en ft autrement, il faudrait qu'il n'y et en nous que des sentiments collectifs d'une intensit mdiocre, et, dans ce cas, il n'y aurait plus de peine. On dira que l'erreur se dissipera d'ellemme ds que les hommes en auront pris conscience ? Mais nous avons beau savoir que le soleil est un globe immense, nous le voyons toujours sous l'aspect d'un disque de quelques pouces. L'entendement peut bien nous apprendre interprter nos sensations ; il ne peut les changer. Du reste, l'erreur n'est que partielle. Puisque ces sentiments sont collectifs, ce n'est pas nous qu'ils reprsentent en nous, mais la socit. Donc, en les vengeant, c'est bien elle et non nous-mmes que nous vengeons, et, d'autre part, elle est quelque chose de suprieur l'individu. C'est donc tort qu'on s'en prend ce caractre quasi religieux de l'expiation pour en faire une sorte de superftation parasite. C'est au contraire un lment intgrant de la peine. Sans doute, il n'en exprime la nature que d'une manire mtaphorique, mais la mtaphore n'est pas sans vrit. D'autre part, on comprend que la raction pnale ne soit pas uniforme dans tous les cas, puisque les motions qui la dterminent ne sont pas toujours les mmes. Elles sont, en effet, plus ou moins vives selon la vivacit du sentiment froiss, et aussi selon la gravit de l'offense subie. Un tat fort ragit plus qu'un tat faible, et deux tats de mme intensit ragissent ingalement suivant qu'ils sont plus ou moins violemment contredits. Ces variations se produisent ncessairement, et de plus elles servent, car il est bon que l'appel de forces soit en rapport avec l'importance du danger. Trop faible, il serait insuffisant ; trop violent, ce serait une perte inutile. Puisque la gravit de l'acte criminel varie en fonction des mmes facteurs, la proportionnalit que l'on observe partout entre le crime et le chtiment s'tablit donc avec une spontanit mcanique, sans qu'il soit ncessaire de faire des supputations savantes pour la calculer. Ce qui fait la graduation des crimes est aussi ce qui fait celle des peines ; les deux chelles ne peuvent, par consquent, pas manquer de se correspondre, et cette correspondance, pour tre ncessaire, ne laisse pas, en mme temps, d'tre utile.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
78
Quant au caractre social de cette raction, il drive de la nature sociale des sentiments offenss. Parce que ceux-ci se retrouvent dans toutes les consciences, l'infraction commise soulve chez tous ceux qui en sont tmoins ou qui en savent l'existence une mme indignation. Tout le monde est atteint, par consquent tout le monde se raidit contre l'attaque. Non seulement la raction est gnrale, mais elle est collective, ce qui n'est pas la mme chose ; elle ne se produit pas isolment chez chacun, mais avec un ensemble et une unit, d'ailleurs variables suivant les cas. En effet, de mme que des sentiments contraires se repoussent, des sentiments semblables s'attirent, et cela d'autant plus fortement qu'ils sont plus intenses. Comme la contradiction est un danger qui les exaspre, elle amplifie leur force attractive. Jamais on prouve autant le besoin de revoir ses compatriotes que quand on est en pays tranger ; jamais le croyant ne se sent aussi fortement port vers ses coreligionnaires qu'aux poques de perscution. Sans doute, nous aimons en tout temps la compagnie de ceux qui pensent et qui sentent comme nous ; mais c'est avec passion, et non plus seulement avec plaisir, que nous la recherchons au sortir de discussions o nos croyances communes ont t vivement combattues. Le crime rapproche donc les consciences honntes et les concentre. Il n'y a qu' voir ce qui se produit, surtout dans une petite ville, quand quelque scandale moral vient d'tre commis. On s'arrte dans la rue, on se visite, on se retrouve aux endroits convenus pour parler de l'vnement et on s'indigne en commun. De toutes ces impressions similaires qui s'changent, de toutes les colres qui s'expriment, se dgage une colre unique, plus ou moins dtermine suivant les cas, qui est celle de tout le monde sans tre celle de personne en particulier. C'est la colre publique. Elle seule, d'ailleurs, peut servir quelque chose. En effet, les sentiments qui sont en jeu tirent toute leur force de ce fait qu'ils sont communs tout le monde, ils sont nergiques parce qu'ils sont incontests. Ce qui fait le respect particulier dont ils sont l'objet, c'est qu'ils sont universellement respects. Or, le crime n'est possible que si ce respect n'est pas vraiment universel ; par consquent, il implique qu'ils ne sont pas absolument collectifs et il entame cette unanimit, source de leur autorit. Si donc, quand il se produit, les consciences qu'il froisse ne s'unissaient pas pour se tmoigner les unes aux autres qu'elles restent en communion, que ce cas particulier est une anomalie, elles ne pourraient pas ne pas tre branles la longue. Mais il faut qu'elles se rconfortent en s'assurant mutuellement qu'elles sont toujours l'unisson ; le seul moyen pour cela est qu'elles ragissent en commun. En un mot, puisque c'est la conscience commune qui est atteinte, il faut aussi que ce soit elle qui rsiste, et, par consquent, que la rsistance soit collective.
Il reste dire pourquoi elle s'organise. On s'expliquera ce dernier caractre si l'on remarque que la rpression organise ne s'oppose pas la rpression diffuse, mais s'en distingue seulement par des diffrences de degrs : la raction y a plus d'unit. Or, l'intensit plus grande et la nature plus dfinie des sentiments que venge la peine proprement dite rendent aisment compte de cette unification plus parfaite. En effet, si l'tat ni est faible ou s'il n'est
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
79
ni que faiblement, il ne peut dterminer qu'une faible concentration des consciences outrages ; tout au contraire, s'il est fort, si l'offense est grave, tout le groupe atteint se contracte en face du danger et se ramasse, pour ainsi dire, sur lui-mme. On ne se contente plus d'changer des impressions quand on en trouve l'occasion, de se rapprocher ici ou l suivant les hasards ou la plus grande commodit des rencontres, mais l'moi qui a gagn de proche en proche pousse violemment les uns vers les autres tous ceux qui se ressemblent et les runit en un mme lieu. Ce resserrement matriel de l'agrgat en rendant plus intime la pntration mutuelle des esprits, rend aussi plus faciles tous les mouvements d'ensemble ; les ractions motionnelles, dont chaque conscience est le thtre, sont donc dans les conditions les plus favorables pour s'unifier. Cependant, si elles taient trop diverses, soit en quantit, soit en qualit, une fusion complte serait impossible entre ces lments partiellement htrognes et irrductibles. Mais nous savons que les sentiments qui les dterminent sont trs dfinis, et par consquent trs uniformes. Elles participent donc de la mme uniformit et, par suite, viennent tout naturellement se perdre les unes dans les autres, se confondre en une rsultante unique qui leur sert de substitut et qui est exerce, non par chacun isolment, mais par le corps social ainsi constitu. Bien des faits tendent prouver que telle fut historiquement la gense de la peine. On sait, en effet, qu' l'origine, c'est l'assemble du peuple tout entier qui faisait fonction de tribunal. Si mme on se reporte aux exemples que nous citions tout l'heure d'aprs le Pentateuque 1, on y verra les choses se passer comme nous venons de les dcrire. Ds que la nouvelle du crime s'est rpandue, le peuple se runit et quoique la peine ne soit pas prdtermine, la raction se fait avec unit. C'tait mme, dans certains cas, le peuple lui-mme qui excutait collectivement la sentence aussitt aprs qu'il l'avait prononce 2. Puis l o l'assemble s'incarna dans la personne d'un chef, celui-ci devint totalement ou en partie l'organe de la raction pnale et l'organisation se poursuivit conformment aux lois gnrales de tout dveloppement organique. C'est donc bien la nature des sentiments collectifs qui rend compte de la peine et, par consquent, du crime. De plus, on voit de nouveau que le pouvoir de raction dont disposent les fonctions gouvernementales, une fois qu'elles ont fait leur apparition, n'est qu'une manation de celui qui est diffus dans la socit, puisqu'il en nat. L'un n'est que le reflet de l'autre ; l'tendue du premier varie comme celle du second. Ajoutons d'ailleurs que l'institution de ce pouvoir sert maintenir la conscience commune elle-mme. Car elle s'affaiblirait si l'organe qui la reprsente ne participait pas au respect qu'elle inspire et l'autorit particulire qu'elle exerce. Or, il n'y peut participer sans que tous les actes qui l'offensent soient refouls et combattus comme ceux qui offensent la conscience collective, et cela, alors mme qu'elle n'en est pas directement affecte.
1 2
Voir plus haut, p. 62, n. 3. Voir THONISSEN, tudes, etc., I, pp. 30 et 232. - Les tmoins du crime jouaient parfois un rle prpondrant dans l'excution.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
80
IV
Ainsi l'analyse de la peine a confirm notre dfinition du crime. Nous avons commenc par tablir inductivement. que celui-ci consistait essentiellement dans un acte contraire aux tats forts et dfinis de la conscience commune ; nous venons de voir que tous les caractres de la peine drivent en effet de cette nature du crime. C'est donc que les rgles qu'elle sanctionne expriment les similitudes sociales les plus essentielles. On voit ainsi quelle espce de solidarit le droit pnal symbolise. Tout le monde sait, en effet, qu'il y a une cohsion sociale dont la cause est dans une certaine conformit de toutes les consciences particulires un type commun qui n'est autre que le type psychique de la socit. Dans ces conditions, en effet, non seulement tous les membres du groupe sont individuellement attirs les uns vers les autres parce qu'ils se ressemblent, mais ils sont attachs aussi ce qui est la condition d'existence de ce type collectif, c'est--dire la socit qu'ils forment par leur runion. Non seulement les citoyens s'aiment et se recherchent entre eux de prfrence aux trangers, mais ils aiment leur patrie. Ils la veulent comme ils se veulent eux-mmes, tiennent ce qu'elle dure et prospre, parce que, sans elle, il y a toute une partie de leur vie psychique dont le fonctionnement serait entrav. Inversement, la socit tient ce qu'ils prsentent tous ces ressemblances fondamentales, parce que c'est une condition de sa cohsion. Il y a en nous deux consciences : l'une ne contient que des tats qui sont personnels chacun de nous et qui nous caractrisent, tandis que les tats que comprend l'autre sont communs toute la socit 1. La premire ne reprsente que notre personnalit individuelle et la constitue ; la seconde reprsente le type collectif et, par consquent, la socit sans laquelle il n'existerait pas. Quand c'est un des lments de cette dernire qui dtermine notre conduite, ce n'est pas en vue de notre intrt personnel que nous agissons, mais nous poursuivons des fins collectives. Or, quoique distinctes, ces deux consciences sont lies l'une l'autre, puisqu'en somme elles n'en font qu'une, n'ayant pour elles deux qu'un seul et mme substrat organique. Elles sont donc solidaires. De l rsulte une solidarit sui generis qui, ne des ressemblances, rattache directement l'individu la socit ; nous pourrons mieux montrer dans le chapitre prochain pourquoi nous proposons de l'appeler mcanique. Cette solidarit ne consiste pas seulement dans un attachement gnral et indtermin de l'individu au groupe, mais rend aussi harmonique le dtail des mouvements. En effet, comme ces mobiles collectifs se retrouvent partout les mmes, ils produisent partout les mmes effets. Par consquent, chaque fois qu'ils entrent en jeu, les volonts se meuvent spontanment et avec ensemble dans le mme sens. C'est cette solidarit qu'exprime le droit rpressif, du moins dans ce qu'elle a de vital. En effet, les actes qu'il prohibe et qualifie de crimes sont de deux sortes : ou bien ils manifestent directement une dissemblance trop violente contre l'agent qui les accomplit et le type collectif, ou bien ils offensent l'organe de la conscience commune. Dans un cas comme dans l'autre, la force qui est choque par le crime qui le refoule est donc la mme ; elle est un produit des similitudes sociales les plus
1
Pour simplifier l'exposition, nous supposons que l'individu n'appartient qu' une socit. En fait, nous faisons partie de plusieurs groupes et il y a en nous plusieurs consciences collectives ; mais cette complication ne change rien au rapport que nous sommes en train d'tablir.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
81
essentielles, et elle a pour effet de maintenir la cohsion sociale, qui rsulte de ces similitudes. C'est cette force que le droit pnal protge contre tout affaiblissement, la fois en exigeant de chacun de nous un minimum de ressemblances sans lesquelles l'individu serait une menace pour l'unit du corps social, et en nous imposant le respect du symbole qui exprime et rsume ces ressemblances en mme temps qu'il les garantit. On s'explique ainsi que des actes aient t si souvent rputs criminels et punis comme tels sans que, par eux-mmes, ils soient malfaisants pour la socit. En effet, tout comme le type individuel, le type collectif s'est form sous l'empire de causes trs diverses et mme de rencontres fortuites. Produit du dveloppement historique, il porte la marque des circonstances de toute sorte que la socit a traverses dans son histoire. Il serait donc miraculeux que tout ce qui s'y trouve ft ajust quelque fin utile ; mais il ne peut pas ne pas s'y tre introduit des lments plus ou moins nombreux qui n'ont aucun rapport avec l'utilit sociale. Parmi les inclinations, les tendances que l'individu a reues de ses anctres ou qu'il s'est formes chemin faisant, beaucoup certainement ou ne servent rien, ou cotent plus qu'elles ne rapportent. Sans doute, elles ne sauraient tre en majorit nuisibles, car l'tre, dans ces conditions, ne pourrait pas vivre ; mais il en est qui se maintiennent sans tre utiles, et celles-l mmes dont les services sont le plus incontestables ont souvent une intensit qui n'est pas en rapport avec leur utilit, parce qu'elle leur vient en partie d'autres causes. Il en est de mme des passions collectives. Tous les actes qui les froissent ne sont donc pas dangereux par eux-mmes ou, du moins, ne sont pas aussi dangereux qu'ils sont rprouvs. Cependant, la rprobation dont ils sont l'objet ne laisse pas d'avoir une raison d'tre; car, quelle que soit l'origine de ces sentiments, une fois qu'ils font partie du type collectif, et surtout s'ils en sont des lments essentiels, tout ce qui contribue les branler branle du mme coup la cohsion sociale et compromet la socit. Il n'tait pas du tout utile qu'ils prissent naissance ; mais une fois qu'ils ont dur, il devient ncessaire qu'ils persistent malgr leur irrationalit. Voil pourquoi il est bon, en gnral, que les actes qui les offensent ne soient pas tolrs. Sans doute, en raisonnant dans l'abstrait, on peut bien dmontrer qu'il n'y a pas de raison pour qu'une socit dfende de manger telle ou telle viande, par soi-mme inoffensive. Mais une fois que l'horreur de cet aliment est devenue partie intgrante de la conscience commune, elle ne peut disparatre sans que le lien social se dtende, et c'est ce que les consciences saines sentent obscurment 1. Il en est de mme de la peine. Quoiqu'elle procde d'une raction toute mcanique, de mouvements passionnels et en grande partie irrflchis, elle ne laisse pas de jouer un rle utile. Seulement, ce rle n'est pas l o on le voit d'ordinaire. Elle ne sert pas ou ne sert que trs secondairement corriger le coupable ou intimider ses imitateurs possibles ; ce double point de vue, son efficacit est justement douteuse et, en tout cas, mdiocre. Sa vraie fonction est de, maintenir intacte la cohsion sociale en maintenant toute sa vitalit la conscience commune. Nie aussi catgoriquement, celle-ci perdrait ncessairement de son nergie si une raction motionnelle de la communaut ne venait compenser cette perte, et il en rsulterait un relchement
1
Cela ne veut pas dire qu'il faille quand mme conserver une rgle pnale parce que, un moment donn, elle a correspondu quelque sentiment collectif. Elle n'a de raison d'tre que si ce dernier est encore vivant et nergique. S'il a disparu ou s'il est affaibli, rien n'est vain et mme rien n'est mauvais comme d'essayer de la maintenir artificiellement et de force. Il peut mme se faire qu'il faille combattre une pratique qui a t commune, mais ne l'est plus et s'oppose l'tablissement de pratiques nouvelles et ncessaires. Mais nous n'avons pas entrer dans cette question de casuistique.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
82
de la solidarit sociale. Il faut donc qu'elle s'affirme avec clat au moment o elle est contredite, et le seul moyen de s'affirmer est d'exprimer l'aversion unanime, que le crime continue inspirer, par un acte authentique qui ne peut consister que dans une douleur inflige l'agent. Ainsi, tout en tant un produit ncessaire des causes qui l'engendrent, cette douleur n'est pas une cruaut gratuite. C'est le signe qui atteste que les sentiments collectifs sont toujours collectifs, que la communion des esprits dans la mme foi reste tout entire, et, par l, elle rpare le mal que le crime a fait la socit. Voil pourquoi on a raison de dire que le criminel doit souffrir en proportion de son crime, pourquoi les thories qui refusent la peine tout caractre expiatoire paraissent tant d'esprits subversives de l'ordre social. C'est qu'en effet ces doctrines ne pourraient tre pratiques que dans une socit o toute conscience commune serait peu prs abolie. Sans cette satisfaction ncessaire, ce qu'on appelle la conscience morale ne pourrait pas tre conserv. On peut donc dire sans paradoxe que le chtiment est surtout destin agir sur les honntes gens ; car, puisqu'il sert gurir les blessures faites aux sentiments collectifs, il ne petit remplir ce rle que l o ces sentiments existent et dans la mesure o ils sont vivants. Sans doute, en prvenant chez les esprits dj branls un affaiblissement nouveau de l'me collective, il peut bien empcher les attentats de se multiplier ; mais ce rsultat, d'ailleurs utile, n'est qu'un contrecoup particulier. En un mot, pour se faire une ide exacte de la peine, il faut rconcilier les deux thories contraires qui en ont t donnes ; celle qui y voit une expiation et celle qui en fait une arme de dfense sociale. Il est certain, en effet, qu'elle a pour fonction de protger la socit, mais c'est parce qu'elle est expiatoire ; et d'autre part, si elle doit tre expiatoire, ce n'est pas que, par suite de je ne sais quelle vertu mystique, la douleur rachte la faute, mais c'est qu'elle ne peut produire son effet socialement utile qu' cette seule condition 1. Il rsulte de ce chapitre qu'il existe une solidarit sociale qui vient de ce qu'un certain nombre d'tats de conscience sont communs tous les membres de la mme socit. C'est elle que le droit rpressif figure matriellement, du moins dans ce qu'elle a d'essentiel. La part qu'elle a dans l'intgration gnrale de la socit dpend videmment de l'tendue plus ou moins grande de la vie sociale qu'embrasse et que rglemente la conscience commune. Plus il y a de relations diverses o cette dernire fait sentir son action, plus aussi elle cre de liens qui attachent l'individu au groupe ; plus, par consquent, la cohsion sociale drive compltement de cette cause et en porte la marque. Mais, d'autre part, le nombre de ces relations est lui-mme proportionnel celui des rgles rpressives ; en dterminant quelle fraction de l'appareil juridique reprsente le droit pnal, nous mesurerons donc du mme coup l'importance relative de cette solidarit. Il est vrai qu'en procdant de cette manire nous ne tiendrons pas compte de certains lments de la conscience collective qui, cause de leur moindre nergie ou de leur indtermination, restent trangers au droit rpressif, tout en contribuant assurer l'harmonie sociale; ce sont ceux qui sont protgs par des peines simplement diffuses. Mais il en est de mme des autres parties du droit. Il n'en est pas qui ne soient compltes par des murs, et comme il n'y a pas de raison de supposer que le rapport entre le droit et les murs ne soit pas le mme dans ces diffrentes sphres, cette limination ne risque pas d'altrer les rsultats de notre comparaison.
En disant que la peine, telle qu'elle est, a une raison d'tre, nous n'entendons pas qu'elle soit parfaite et ne puisse tre amliore. Il est trop vident, au contraire, qu'tant produite par des causes toutes mcaniques en grande partie, elle ne peut tre que trs imparfaitement ajuste son rle. Il ne s'agit que d'une justification en gros.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
83
Chapitre III
La solidarit due la division du travail ou organique
Retour la table des matires
La nature mme de la sanction restitutive suffit montrer que la solidarit sociale laquelle correspond ce droit est d'une tout autre espce. Ce qui distingue cette sanction, c'est qu'elle West pas expiatoire, mais se rduit une simple remise en tat. Une souffrance proportionne son mfait n'est pas inflige celui qui a viol le droit ou qui le mconnat ; il est simplement condamn s'y soumettre. S'il y a dj des faits accomplis, le juge les rtablit tels qu'ils auraient d tre. Il dit le droit, il ne dit pas de peines. Les dommages-intrts n'ont pas de caractre pnal ; c'est seulement un moyen de revenir sur le pass pour le restituer, autant que possible, sous sa forme normale. M. Tarde a cru, il est vrai, retrouver une sorte de pnalit civile dans la condamnation aux dpens, qui sont toujours la charge de la partie qui succombe 1. Mais, pris dans ce sens, le mot n'a plus qu'une valeur mtaphorique. Pour qu'il y et peine, il faudrait tout au moins qu'il y et quelque proportion entre le chtiment et la faute, et pour cela il serait ncessaire que le degr de gravit de cette dernire ft srieusement tabli. Or, en fait, celui qui perd le procs paye les frais quand mme ses intentions seraient pures, quand mme il ne serait coupable que d'ignorance. Les raisons de cette rgle semblent donc tre tout autres : tant donn que la justice n'est pas rendue gratuitement, il parat quitable que les frais en soient supports par celui qui en a t l'occasion. Il est possible, d'ailleurs,
1
TARDE, Criminalit compare, p. 113, Paris, F. Alcan.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
84
que la perspective de ces dpenses arrte le plaideur tmraire, mais cela ne suffit pas en faire une peine. La crainte de la ruine qui suit d'ordinaire la paresse ou la ngligence peut rendre le ngociant actif et appliqu, et pourtant la ruine n'est pas, au sens propre du mot, la sanction pnale de ses fautes. Le manquement ces rgles n'est mme pas puni d'une peine diffuse. Le plaideur qui a perdu son procs n'est pas fltri, son honneur n'est pas entach. Nous pouvons mme imaginer que ces rgles soient autres qu'elles ne sont, sans que cela nous rvolte. L'ide que le meurtre puisse tre tolr nous indigne, mais nous acceptons trs bien que le droit successoral soit modifi, et beaucoup conoivent mme qu'il puisse tre supprim. C'est du moins une question que nous ne refusons pas de discuter. De mme, nous admettons sans peine que le droit des servitudes ou celui des usufruits soit autrement organis, que les obligations du vendeur et de l'acheteur soient dtermines d'une autre manire, que les fonctions administratives soient distribues d'aprs d'autres principes. Comme ces prescriptions ne correspondent en nous aucun sentiment, et comme gnralement nous n'en connaissons pas scientifiquement les raisons d'tre puisque cette science n'est pas faite, elles n'ont pas de racines chez la plupart d'entre nous. Sans doute, il y a des exceptions. Nous ne tolrons pas l'ide qu'un engagement contraire aux murs ou obtenu soit par la violence, soit par la fraude, puisse lier les contractants. Aussi, quand l'opinion publique se trouve en prsence de cas de ce genre, se montre-t-elle moins indiffrente que nous ne disions tout l'heure et aggrave-t-elle par son blme la sanction lgale. C'est que les diffrents domaines de la vie morale ne sont pas radicalement spars les uns des autres ; ils sont, au contraire, continus et, par suite, il y a entre eux des rgions limitrophes o des caractres diffrents se retrouvent la fois. Cependant, la proposition prcdente reste vraie dans la trs grande gnralit des cas. C'est la preuve que les rgles sanction restitutive ou bien ne font pas du tout partie de la conscience collective, ou n'en sont que ... tats faibles. Le droit rpressif correspond ce qui est le cur, le centre de la conscience commune ; les rgles purement morales en sont une partie dj moins centrale ; enfin, le droit restitutif prend naissance dans des rgions trs excentriques pour s'tendre bien au-del. Plus il devient vraiment, luimme, plus il s'en loigne. Ce caractre est d'ailleurs rendu manifeste par la manire dont il fonctionne. Tandis que le droit rpressif tend rester diffus dans la socit, le droit restitutif se cre des organes de plus en plus spciaux : tribunaux consulaires, conseils de prud'hommes, tribunaux administratifs de toute sorte. Mme dans sa partie la plus gnrale, savoir le droit civil, il n'entre en exercice que grce des fonctionnaires particuliers : magistrats, avocats, etc., qui sont devenus aptes ce rle grce une culture toute spciale. Mais, quoique ces rgles soient plus ou moins en dehors de la conscience collective, elles n'intressent pas seulement les particuliers. S'il en tait ainsi, le droit restitutif n'aurait rien de commun avec la solidarit sociale, car les rapports qu'il rgle relieraient les individus les uns aux autres sans les rattacher la socit. Ce seraient de simples vnements de la vie prive, comme sont, par exemple, les relations d'amiti. Mais il s'en faut que la socit soit absente de cette sphre de la vie juridique. Il est vrai que, gnralement, elle n'intervient pas d'elle-mme et de son propre mouvement ; il faut qu'elle soit sollicite par les intresss. Mais, pour tre provoque, son intervention n'en est pas moins le rouage essentiel du mcanisme, puisque c'est elle seule qui le fait fonctionner. C'est elle qui dit le droit par l'organe de ses reprsentants.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
85
On a soutenu cependant que ce rle n'avait rien de proprement social, mais se rduisait celui de conciliateur des intrts privs ; que, par consquent, tout particulier pouvait le remplir, et que si la socit s'en chargeait, c'tait uniquement pour des raisons de commodit. Mais rien n'est plus inexact que de faire de la socit une sorte de tiers-arbitre entre les parties. Quand elle est amene intervenir, ce n'est pas pour mettre d'accord des intrts individuels; elle ne cherche pas quelle peut tre la solution la plus avantageuse pour les adversaires et ne leur propose pas de compromis ; mais elle applique au cas particulier qui lui est soumis les rgles gnrales et traditionnelles du droit. Or, le droit est chose sociale au premier chef, et qui a un tout autre objet que l'intrt des plaideurs. Le juge qui examine une demande de divorce ne se proccupe pas de savoir si cette sparation est vraiment dsirable pour les poux, mais si les causes qui sont invoques rentrent dans l'une des catgories prvues par la loi. Mais, pour bien apprcier l'importance de l'action sociale, il faut l'observer, non pas seulement au moment o la sanction s'applique, o le rapport troubl est rtabli, mais aussi quand il s'institue. Elle est, en effet, ncessaire soit pour fonder, soit pour modifier nombre de relations juridiques que rgit ce droit et que le consentement des intresss ne suffit ni crer ni changer. Telles sont notamment celles qui concernent l'tat des personnes. Quoique le mariage soit un contrat, les poux ne peuvent ni le former, ni le rsilier leur gr. Il en est de mme de tous les autres rapports domestiques, et, plus forte raison, de tous ceux que rglemente le droit administratif. Il est vrai que les obligations proprement contractuelles peuvent se nouer et se dnouer par le seul accord des volonts. Mais il ne faut pas oublier que, si le contrat a le pouvoir de lier, c'est la socit qui le lui communique. Supposez qu'elle ne sanctionne pas les obligations contractes ; celles-ci deviennent de simples promesses qui n'ont plus qu'une autorit morale 1. Tout contrat suppose donc que, derrire les parties qui s'engagent, il y a la socit toute prte intervenir pour faire respecter les engagements qui ont t pris ; aussi ne prte-t-elle cette force obligatoire qu'aux contrats qui ont par eux-mmes une valeur sociale, c'est--dire qui sont conformes aux rgles du droit. Nous verrons mme que, parfois, son intervention est encore plus positive. Elle est donc prsente toutes les relations que dtermine le droit restitutif, mme celles qui paraissent le plus compltement prives, et sa prsence, pour n'tre pas sentie, du moins l'tat normal, n'en est pas moins essentielle 2. Puisque les rgles sanction restitutive sont trangres la conscience commune, les rapports qu'elles dterminent ne sont pas de ceux qui atteignent indistinctement tout le monde ; c'est--dire qu'ils s'tablissent immdiatement, non entre l'individu et la socit, mais entre des parties restreintes et spciales de la socit qu'ils relient entre elles. Mais, d'autre part, puisque celle-ci n'en est pas absente, il faut bien qu'elle y soit plus ou moins directement intresse, qu'elle en sente les contrecoups. Alors, suivant la vivacit avec laquelle elle les ressent, elle intervient de plus ou moins prs et plus ou moins activement, par l'intermdiaire d'organes spciaux chargs de la reprsenter. Ces relations sont donc bien diffrentes de celles que rglemente le droit
1 2
Et encore cette autorit morale vient-elle des murs, c'est--dire de la socit. Nous devons nous en tenir ici ces indications gnrales, communes toutes les formes du droit restitutif. On trouvera plus loin (mme livre, chap. VII) des preuves nombreuses de cette vrit pour la partie de ce droit qui correspond la solidarit que produit la division du travail.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
86
rpressif, car celles-ci rattachent directement et sans intermdiaire la conscience particulire la conscience collective, c'est--dire l'individu la socit. Mais ces rapports peuvent prendre deux formes trs diffrentes : tantt ils sont ngatifs et se rduisent une pure abstention ; tantt ils sont positifs ou de coopration. Aux deux classes de rgles qui dterminent les uns et les autres correspondent deux sortes de solidarit sociale qu'il est ncessaire de distinguer.
II
Le rapport ngatif qui peut servir de type aux autres est celui qui unit la chose la personne. Les choses, en effet, font partie de la socit tout comme les personnes, et y jouent un rle spcifique ; aussi est-il ncessaire que leurs rapports avec l'organisme social soient dtermins. On peut donc dire qu'il y a une solidarit des choses dont la nature est assez spciale pour se traduire au-dehors par des consquences juridiques d'un caractre trs particulier. Les jurisconsultes, en effet, distinguent deux sortes de droits ils donnent aux uns le nom de rels, aux autres celui de personnels. Le droit de proprit, l'hypothque appartiennent la premire espce, le droit de crance la seconde. Ce qui caractrise les droits rels, c'est que, seuls, ils donnent naissance un droit de prfrence et de suite. Dans ce cas, le droit que j'ai sur a chose est exclusif de tout autre qui viendrait s'tablir aprs le mien. Si, par exemple, un bien a t successivement hypothqu deux cranciers, la seconde hypothque ne peut en rien restreindre les droits de la premire. D'autre part, si mon dbiteur aline la chose sur laquelle j'ai un droit d'hypothque, celui-ci n'en est en rien atteint, mais le tiers-acqureur est tenu ou de me payer, ou de perdre ce qu'il a acquis. Or, pour qu'il en soit ainsi, il faut que le lien de droit unisse directement, et sans l'intermdiaire d'aucune autre personne, cette chose dtermine a ma personnalit juridique. Cette situation privilgie est donc la consquence de la solidarit propre aux choses. Au contraire, quand le droit est personnel, la personne qui est oblige envers moi peut, en contractant des obligations nouvelles, me donner des cocranciers dont le droit est gal au mien, et quoique j'aie pour gages tous les biens de mon dbiteur, s'il les aline, ils sortent de mon gage en sortant de son patrimoine. La raison en est qu'il n'y a pas de relation spciale entre ces biens et moi, mais entre la personne de leur propritaire et ma propre personne 1. On voit en quoi consiste cette solidarit relle : elle relie directement les choses aux personnes, mais non pas les personnes entre elles. A la rigueur, on peut exercer un droit rel en se croyant seul au monde, en faisant abstraction des autres hommes. Par consquent, comme c'est seulement par l'intermdiaire des personnes que les choses sont intgres dans la socit, la solidarit qui rsulte de cette intgration est
1
On a dit quelquefois que la qualit de pre, celle de fils, etc., taient l'objet de droits rels (Voir ORTOLAN, Instituts, 1, 660). Mais ces qualits ne sont que des symboles abstraits de droits divers, les uns rels (droit du pre sur la fortune de ses enfants mineurs, par exemple), les autres personnels.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
87
toute ngative. Elle ne fait pas que les volonts se meuvent vers des fins communes, mais seulement que les choses gravitent avec ordre autour des volonts. Parce que les droits rels sont ainsi dlimits, ils n'entrent pas en conflits ; les hostilits sont prvenues, mais il n'y a pas de concours actif, pas de consensus. Supposez un tel accord aussi parfait que possible ; la socit o il rgne - s'il rgne seul - ressemblera une immense constellation o chaque astre se meut dans son orbite sans troubler les mouvements des astres voisins. Une telle solidarit ne fait donc pas des lments qu'elle rapproche un tout capable d'agir avec ensemble ; elle ne contribue en rien l'unit du corps social. D'aprs ce qui prcde, il est facile de dterminer quelle est la partie du droit restitutif laquelle correspond cette solidarit : c'est l'ensemble des droits rels. Or, de la dfinition mme qui en a t donne, il rsulte que le droit de proprit en est le type le plus parfait. En effet, la relation la plus complte qui puisse exister entre une chose et une personne est celle qui met la premire sous l'entire dpendance de la seconde. Seulement, cette relation est elle-mme trs complexe, et les divers lments dont elle est forme peuvent devenir l'objet d'autant de droits rels secondaires, comme l'usufruit, les servitudes, l'usage et l'habitation. On peut donc dire en somme que les droits rels comprennent le droit de proprit sous ses diverses formes (proprit littraire, artistique, industrielle, mobilire, immobilire) et ses diffrentes modalits, telles que les rglemente le second livre de notre Code civil. En dehors de ce livre, notre droit reconnat encore quatre autres droits rels, mais qui ne sont que des auxiliaires et des substituts ventuels de droits personnels : c'est le gage, l'antichrse, le privilge et l'hypothque (art. 2071-2203). Il convient d'y ajouter tout ce qui est relatif au droit successoral, au droit de tester et, par consquent, l'absence, puisqu'elle cre, quand elle est dclare, une sorte de succession provisoire. En effet, l'hritage est une chose ou un ensemble de choses sur lesquelles les hritiers et les lgataires ont un droit rel, que celui-ci soit acquis ipso facto par le dcs du propritaire, ou bien qu'il ne s'ouvre qu' la suite d'un acte judiciaire, comme il arrive pour les hritiers indirects et les lgataires titre particulier. Dans tous ces cas, la relation juridique est directement tablie, non entre une personne et une personne, mais entre une personne et une chose. Il en est de mme de la donation testamentaire, qui n'est que l'exercice du droit rel que le propritaire a sur ses biens, ou du moins sur la portion qui en est disponible.
Mais il y a des rapports de personne personne qui, pour n'tre point rels, sont cependant aussi ngatifs que les prcdents et expriment une solidarit de mme nature. En premier lieu, ce sont ceux qu'occasionne l'exercice des droits rels proprement dits. Il est invitable, en effet, que le fonctionnement de ces derniers mette parfois en prsence les personnes mmes de leurs dtenteurs. Par exemple, lorsqu'une chose vient s'ajouter une autre, le propritaire de celle qui est rpute principale devient du mme coup propritaire de la seconde ; seulement il doit payer l'autre la valeur de la chose qui a t unie (art. 566). Cette obligation est videmment personnelle. De mme, tout propritaire d'un mur mitoyen qui veut le faire lever est tenu de payer au copropritaire l'indemnit de la charge (art. 658). Un lgataire titre particulier est oblig de s'adresser au lgataire universel pour obtenir la dlivrance de la chose lgue, quoiqu'il ait un droit sur celle-ci ds le dcs du testateur (art. 1014). Mais la
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
88
solidarit que ces relations expriment ne diffre pas de celle dont nous venons de parler : elles ne s'tablissent, en effet, que pour rparer ou pour prvenir une lsion. Si le dtenteur de chaque droit rel pouvait toujours l'exercer sans en dpasser jamais les limites, chacun restant chez soi, il n'y aurait lieu aucun commerce juridique. Mais, en fait, il arrive sans cesse que ces diffrents droits sont tellement enchevtrs les uns dans les autres, qu'on ne peut mettre l'un en valeur sans empiter sur ceux qui le limitent. Ici, la chose sur laquelle j'ai un droit se trouve entre les mains d'un autre ; c'est ce qui arrive pour le legs. Ailleurs, je ne puis jouir de mon droit sans nuire celui d'autrui ; c'est le cas pour certaines servitudes. Des relations sont donc ncessaires pour rparer le prjudice, s'il est consomm, ou pour l'empcher ; mais elles n'ont rien de positif. Elles ne font pas concourir les personnes qu'elles mettent en contact ; elles n'impliquent aucune coopration ; mais elles restaurent simplement ou maintiennent, dans les conditions nouvelles qui se sont produites, cette solidarit ngative dont les circonstances sont venues troubler le fonctionnement. Bien loin d'unir, elles n'ont lieu que pour mieux sparer ce qui s'est uni par la force des choses, pour rtablir les limites qui ont t violes et replacer chacun dans sa sphre propre. Elles sont si bien identiques aux rapports de la chose avec la personne que les rdacteurs du Code ne leur ont pas fait une place part, mais en ont trait en mme temps que des droits rels. Enfin, les obligations qui naissent du dlit et du quasi-dlit ont exactement le mme caractre 1. En effet, elles astreignent chacun rparer le dommage qu'il a caus par sa faute aux intrts lgitimes d'autrui. Elles sont donc personnelles, mais la solidarit laquelle elles correspondent est videmment toute ngative, puisqu'elles consistent non a servir, mais ne pas nuire. Le lien dont elles sanctionnent la rupture est tout extrieur. Toute la diffrence qu'il y a entre ces relations et les prcdentes, c'est que, dans un cas, la rupture provient d'une faute, et, dans l'autre, de circonstances dtermines et prvues par la loi. Mais l'ordre troubl est le mme ; il rsulte, non d'un concours, mais d'une pure abstention 2. D'ailleurs, les droits dont la lsion donne naissance ces obligations sont eux-mmes rels ; car je suis propritaire de mon corps, de ma sant, de mon honneur, de ma rputation, au mme titre et de la mme manire que des choses matrielles qui me sont soumises. En rsum, les rgles relatives aux droits rels et aux rapports personnels qui s'tablissent leur occasion forment un systme dfini qui a pour fonction, non de rattacher les unes aux autres les parties diffrentes de la socit, mais, au contraire, de les mettre en dehors les unes des autres, de marquer nettement les barrires qui les sparent. Elles ne correspondent donc pas un lien social Positif ; l'expression mme de solidarit ngative dont nous nous sommes servi n'est pas parfaitement exacte. Ce n'est pas une solidarit vritable, ayant une existence propre et une nature spciale, mais plutt le ct ngatif de toute espce de solidarit. La premire condition pour qu'un tout soit cohrent, c'est que les parties qui le composent ne se heurtent pas en des mouvements discordants. Mais cet accord externe n'en fait pas la cohsion ; au contraire, il la suppose. La solidarit ngative n'est possible que l o il en existe une autre, de nature positive, dont elle est la fois la rsultante et la condition.
1 2
Art. 1382-1386 du Code civil. - On y pourrait joindre les articles sur la rptition de l'ind. Le contractant qui manque ses engagements est, lui aussi, tenu d'indemniser l'autre partie. Mais, dans ce cas, les dommages-intrts servent de sanction un lien positif. Ce n'est pas pour avoir nui que le violateur du contrat paie, mais pour n'avoir pas effectu la prestation promise.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
89
En effet, les droits des individus, tant sur eux-mmes que sur les choses, ne peuvent tre dtermins que grce des compromis et des concessions mutuelles ; car tout ce qui est accord aux uns est ncessairement abandonn par les autres. On a dit parfois que l'on pouvait dduire l'tendue normale du dveloppement de l'individu soit du concept de la personnalit humaine (Kant), soit de la notion de l'organisme individuel (Spencer). C'est possible, quoique la rigueur de ces raisonnements soit trs contestable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, dans la ralit historique, ce n'est pas sur ces considrations abstraites que l'ordre moral s'est fond. En fait, pour que l'homme ait reconnu des droits autrui, non pas seulement en logique, mais sans la pratique de la vie, il a fallu qu'il consentt limiter les siens, et, par consquent, cette limitation mutuelle n'a pu tre faite que dans un esprit d'entente et de concorde. Or, si l'on suppose une multitude d'individus sans liens pralables entre eux, quelle raison aurait pu les pousser ces sacrifices rciproques ? Le besoin de vivre en paix ? Mais la paix par elle-mme n'est pas chose plus dsirable que la guerre. Celle-ci a ses charges et ses avantages. Est-ce qu'il n'y a pas eu des peuples, est-ce qu'il n'y a pas de tout temps des individus dont elle est la passion ? Les instincts auxquels elle rpond ne sont pas moins forts que ceux que la paix satisfait. Sans doute, la fatigue peut bien pour un temps mettre fin aux hostilits, mais cette simple trve ne peut pas tre plus durable que la lassitude temporaire qui la dtermine. Il en est, plus forte raison, de mme des dnouements qui sont dus au seul triomphe de la force ; ils sont aussi Provisoires et prcaires que les traits qui mettent fin aux guerres internationales. Les hommes n'ont besoin de la paix que dans la mesure o ils sont unis dj par quelque lien de sociabilit. Dans ce cas, en effet, les sentiments qui les inclinent les uns vers les autres modrent tout naturellement les emportements de l'gosme, et, d'un autre ct, la socit qui les enveloppe, ne pouvant vivre qu' condition de n'tre pas chaque instant secoue par des conflits, pse sur eux de tout son poids pour les obliger se faire les concessions ncessaires. Il est vrai qu'on voit parfois des socits indpendantes s'entendre pour dterminer l'tendue de leurs droits respectifs sur les choses, c'est--dire de leurs territoires. Mais, justement, l'extrme instabilit de ces relations est la meilleure preuve que la solidarit ngative ne peut pas se suffire elle seule. Si aujourd'hui, entre peuples cultivs, elle semble avoir plus de force, si cette partie du droit international qui rgle ce qu'on pourrait appeler les droits rels des socits europennes a peut-tre plus d'autorit qu'autrefois, c'est que les diffrentes nations de l'Europe sont aussi beaucoup moins indpendantes les unes des autres ; c'est que, par certains cts, elles font toutes partie d'une mme socit, encore incohrente, il est vrai, mais qui prend de plus en plus conscience de soi. Ce qu'on appelle l'quilibre europen est un commencement d'organisation de Cette socit. Il est d'usage de distinguer avec soin la justice de la charit, c'est--dire le simple respect des droits d'autrui de tout acte qui dpasse cette vertu purement ngative. On voit dans ces deux sortes de pratiques comme deux couches indpendantes de la morale : la justice, elle seule, en formerait les assises fondamentales ; la charit en serait le couronnement. La distinction est si radicale que, d'aprs les partisans d'une certaine morale, la justice seule serait ncessaire au bon fonctionnement de la vie sociale ; le dsintressement ne serait gure qu'une vertu prive, qu'il est beau, pour le particulier, de poursuivre, mais dont la socit peut trs bien se passer. Beaucoup mme ne la voient pas sans inquitude intervenir dans la vie publique. On voit par ce qui prcde combien cette conception est peu d'accord avec les faits. En ralit, pour que les hommes se reconnaissent et se garantissent mutuellement des droits, il faut d'abord qu'ils s'aiment, que, pour une raison quelconque, ils tiennent les uns aux autres et une mme socit dont ils fassent partie. La justice est pleine de charit, ou, pour reprendre nos expressions, la solidarit ngative n'est qu'une manation
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
90
d'une autre solidarit de nature positive : c'est la rpercussion dans la sphre des droits rels de sentiments sociaux qui viennent d'une autre source. Elle n'a donc rien de spcifique, mais c'est l'accompagnement ncessaire de toute espce de solidarit. Elle se rencontre forcment partout o les hommes vivent d'une vie commune, que celle-ci rsulte de la division du travail social ou de l'attrait du semblable pour le semblable.
III
Si du droit restitutif on distrait les rgles dont il vient d'tre parl, ce qui reste constitue un systme non moins dfini qui comprend le droit domestique, le droit contractuel, le droit commercial, le droit des procdures, le droit administratif et constitutionnel. Les relations qui y sont rgles y sont d'une tout autre nature que les prcdentes ; elles expriment un concours positif, une coopration qui drive essentiellement de la division du travail. Les questions que rsout le droit domestique peuvent tre ramenes aux deux types suivants : 1 Qui est charg des diffrentes fonctions domestiques ? Qui est poux, qui pre, qui enfant lgitime, qui tuteur, etc. ? 2 Quel est le type normal de ces fonctions et leurs rapports ? C'est la premire de ces questions que rpondent les dispositions qui dterminent les qualits et les conditions requises pour contracter mariage, les formalits ncessaires pour que le mariage soit valable, les conditions de la filiation lgitime, naturelle, adoptive, la manire dont le tuteur doit tre choisi, etc. C'est, au contraire, la seconde question que rsolvent les chapitres sur les droits et les devoirs respectifs des poux, sur l'tat de leurs rapports en cas de divorce, de nullit de mariage, de sparation de corps et de biens, sur la puissance paternelle, sur les effets de l'adoption, sur l'administration du tuteur et ses rapports avec le pupille, sur le rle du conseil de famille vis--vis du premier et du second, sur le rle des parents dans les cas d'interdiction et de conseil judiciaire. Cette partie du droit civil a donc pour objet de dterminer la manire dont se distribuent les diffrentes fonctions familiales et ce qu'elles doivent tre dans leurs mutuelles relations ; c'est dire qu'il exprime la solidarit particulire qui unit entre eux les membres de la famille par suite de la division du travail domestique. Il est vrai qu'on n'est gure habitu envisager la famille sous cet aspect ; on croit le plus souvent que ce qui en fait la cohsion, c'est exclusivement la communaut des sentiments et des croyances. Il y a, en effet, tant de choses communes entre les membres du groupe familial que le caractre spcial des tches qui reviennent chacun d'eux nous chappe facilement ; c'est ce qui faisait dire A. Comte que l'union domestique exclut toute pense de coopration directe et continue un but quelconque 1 . Mais
1
Cours de philosophie positive, IV, p. 419.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
91
l'organisation juridique de la famille, dont nous venons de rappeler sommairement les lignes essentielles, dmontre la ralit de ces diffrences fonctionnelles et leur importance. L'histoire de la famille, partir des origines, n'est mme qu'un mouvement ininterrompu de dissociation au cours duquel ces diverses fonctions, d'abord indivises et confondues les unes dans les autres, se sont peu peu spares, constitues part, rparties entre les diffrents parents suivant leur sexe, leur ge, leurs rapports de dpendance, de manire faire de chacun d'eux un fonctionnaire spcial de la socit domestique 1. Bien loin de n'tre qu'un phnomne accessoire et secondaire, cette division du travail familial domine au contraire tout le dveloppement de la famille. Le rapport de la division du travail avec le droit contractuel n'est pas moins accus. En effet, le contrat est, par excellence, l'expression juridique de la coopration. Il y a, il est vrai, les contrats dits de bienfaisance o l'une seulement des parties est lie. Si je donne autrui quelque chose sans conditions, si je me charge gratuitement d'un dpt ou d'un mandat, il en rsulte pour moi des obligations prcises et dtermines. Pourtant, il n'y a pas de concours proprement dit entre les contractants, puisqu'il n'y a de charges que d'un ct. Cependant, la coopration n'est pas absente du phnomne ; elle est seulement gratuite ou unilatrale. Qu'est-ce, par exemple, que la donation, sinon un change sans obligations rciproques ? Ces sortes de contrats ne sont donc qu'une varit des contrats vraiment coopratifs. D'ailleurs, ils sont trs rares ; car ce n'est qu'exceptionnellement que les actes de bienfaisance relvent de la rglementation lgale. Quant aux autres contrats, qui sont l'immense majorit, les obligations auxquelles ils donnent naissance sont corrlatives ou d'obligations rciproques, ou de prestations dj effectues. L'engagement d'une partie rsulte ou de l'engagement pris par l'autre, ou d'un service dj rendu par cette dernire 2. Or, cette rciprocit n'est possible que l o il y a coopration, et celle-ci, son tour, ne va pas sans la division du travail. Cooprer, en effet, c'est se partager une tche commune. Si cette dernire est divise en tches qualitativement similaires, quoique indispensables les unes aux autres, il y a division du travail simple ou du premier degr. Si elles sont de nature diffrente, il y a division du travail compose, spcialisation proprement dite. Cette dernire forme de la coopration est, d'ailleurs, de beaucoup celle qu'exprime le plus gnralement le contrat. Le seul qui ait une autre signification est le contrat de socit, et peut-tre aussi le contrat de mariage, en tant qu'il dtermine la part contributive des poux aux dpenses du mnage. Encore pour qu'il en soit ainsi, fautil que le contrat de socit mette tous les associs sur le mme niveau, que leurs apports soient identiques, que leurs fonctions soient les mmes, et c'est un cas qui ne se prsente jamais exactement dans les relations matrimoniales, par suite de la division du travail conjugale. En regard de ces rares espces, qu'on mette la multiplicit des contrats qui ont pour objet d'ajuster les unes aux autres des fonctions spciales et diffrentes : contrats entre l'acheteur et le vendeur, contrats d'change, contrats entre entrepreneurs et ouvriers, entre le locataire de la chose et le locateur, entre le prteur et l'emprunteur, entre le dpositaire et le dposant, entre l'htelier et le voyageur, entre le mandataire et le mandant, entre le crancier et la caution du dbiteur, etc.
1 2
Voir quelques dveloppements sur ce point, mme livre, chap. VII. Par exemple, dans le cas du prt intrt.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
92
D'une manire gnrale, le contrat est le symbole de l'change ; aussi M. Spencer a-til pu, non sans justesse, qualifier de contrat physiologique l'change de matriaux qui se fait chaque instant entre les diffrents organes du corps vivant 1. Or, il est clair que l'change suppose toujours quelque division du travail plus ou moins dveloppe. Il est vrai que les contrats que nous venons de citer ont encore un caractre un peu gnral. Mais il ne faut pas oublier que le droit ne figure que les contours gnraux, les grandes lignes des rapports sociaux, celles qui se retrouvent identiquement dans des sphres diffrentes de la vie collective. Aussi chacun de ces types de contrats en suppose-t-il une multitude d'autres, plus particuliers, dont il est comme l'empreinte commune et qu'il rglemente du mme coup, mais o les relations s'tablissent entre des fonctions plus spciales. Donc, malgr la simplicit relative de ce schma, il suffit manifester l'extrme complexit des faits qu'il rsume.
Cette spcialisation des fonctions est, d'ailleurs, plus immdiatement apparente dans le Code de commerce qui rglemente surtout les contrats spciaux au commerce : contrats entre le commissionnaire et le commettant, entre le voiturier et l'expditeur, entre le porteur de la lettre de change et le tireur, entre le propritaire du navire et ses cranciers, entre le premier et le capitaine et les gens de l'quipage, entre le frteur et l'affrteur, entre le prteur et l'emprunteur la grosse, entre l'assureur et l'assur. Pourtant, ici encore, il y a un grand cart entre la gnralit relative des prescriptions juridiques et la diversit des fonctions particulires dont elles rglent les rapports, comme le prouve la place importante faite la coutume dans le droit commercial. Quand le Code de commerce ne rglemente pas de contrats proprement dits, il dtermine ce que doivent tre certaines fonctions spciales, comme celles de l'agent de change, du courtier, du capitaine, du juge commissaire en cas de faillite, afin d'assurer la solidarit de toutes les parties de l'appareil commercial.
Le droit de procdure, - qu'il s'agisse de procdure criminelle, civile ou commerciale, - joue le mme rle dans l'appareil judiciaire. Les sanctions des rgles juridiques de toute sorte ne peuvent tre appliques que grce au concours d'un certain nombre de fonctions, fonctions des magistrats, des dfenseurs, des avous, des jurs, des demandeurs et des dfendeurs, etc. ; la procdure fixe la manire dont elles doivent entrer en jeu et en rapports. Elle dit ce qu'elles doivent tre et quelle est la part de chacune dans la vie gnrale de l'organe. Il nous semble que, dans une classification rationnelle des rgles juridiques, le droit de procdure ne devrait tre considr que comme une varit du droit administratif : nous ne voyons pas quelle diffrence radicale spare l'administration de la justice du reste de l'administration. Quoi qu'il en soit de cette vue, le droit administratif proprement dit rglemente les fonctions mal dfinies que l'on appelle admi-
Bases de la morale volutionniste, p. 124. Paris.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
93
nistratives 1, tout comme le prcdent fait pour les fonctions judiciaires. Il dtermine leur type normal et leurs rapports soit les unes avec les autres, soit avec les fonctions diffuses de la socit ; il faudrait seulement en distraire un certain nombre de rgles qui sont gnralement ranges sous cette rubrique, quoiqu'elles aient un caractre pnal 2. Enfin, le droit constitutionnel fait de mme pour les fonctions gouvernementales. On s'tonnera peut-tre de voir runis dans une mme classe le droit administratif et politique et ce que l'on appelle d'ordinaire le droit priv. Mais d'abord, ce rapprochement s'impose si l'on prend pour base de la classification la nature des sanctions, et il ne nous semble pas qu'il soit possible d'en prendre une autre si l'on veut procder scientifiquement. De plus, pour sparer compltement ces deux sortes de droit, il faudrait admettre qu'il y a vraiment un droit priv, et nous croyons que tout droit est publie, parce que tout droit est social. Toutes les fonctions de la socit sont sociales, comme toutes les fonctions de l'organisme sont organiques. Les fonctions conomiques ont ce caractre comme les autres. D'ailleurs, mme parmi les plus diffuses, il n'en est pas qui ne soient plus ou moins soumises l'action de l'appareil gouvernemental. Il n'y a donc entre elles ce point de vue, que des diffrences de degrs.
En rsum, les rapports que rgle le droit coopratif sanctions restitutives et la solidarit qu'ils expriment rsultent de la division du travail social. On s'explique d'ailleurs que, en gnral, des relations coopratives ne comportent pas d'autres sanctions. En effet, il est dans la nature des tches spciales d'chapper l'action de la conscience collective ; car, pour qu'une chose soit l'objet de sentiments communs, la premire condition est qu'elle soit commune, c'est--dire qu'elle soit prsente toutes les consciences et que toutes se la puissent reprsenter d'un seul et mme point de vue. Sans doute, tant que les fonctions ont une certaine gnralit, tout le monde peut en avoir quelque sentiment : mais plus elles se spcialisent, plus aussi se circonscrit le nombre de ceux qui ont conscience de chacune d'elles ; plus, par consquent, elles dbordent la conscience commune. Les rgles qui les dterminent ne peuvent donc pas avoir cette force suprieure, cette autorit transcendante qui, quand elle est offense, rclame une expiation. C'est bien aussi de l'opinion que leur vient leur autorit, tout comme celle des rgles pnales, mais d'une opinion localise dans des rgions restreintes de la socit. De plus, mme dans les cercles spciaux o elles s'appliquent et o, par consquent, elles sont reprsentes aux esprits, elles ne correspondent pas des sentiments bien vifs, ni mme le plus souvent aucune espce d'tat motionnel. Car, comme elles fixent la manire dont les diffrentes fonctions doivent concourir dans les diverses combinaisons de circonstances qui peuvent se prsenter, les objets auxquels elles se rapportent ne sont pas toujours prsents aux consciences. On n'a pas toujours
1
Nous gardons l'expression couramment employe ; mais elle aurait besoin d'tre dfinie, et nous ne sommes pas en tat de le faire. Il nous parat, en gros, que ces fonctions sont celles qui sont immdiatement places sous l'action des centres gouvernementaux. Mais bien des distinctions seraient ncessaires. Et aussi celles qui concernent les droits rels des personnes morales de l'ordre administratif, car les relations qu'elles dterminent sont ngatives.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
94
administrer une tutelle, une curatelle 1, ni exercer ses droits de crancier ou d'acheteur, etc., ni surtout les exercer dans telle ou telle condition. Or, les tats de conscience ne sont forts que dans la mesure o ils sont permanents. La violation de ces rgles n'atteint donc dans ses parties vives ni l'me commune de la socit, ni mme, au moins en gnral, celle de ces groupes spciaux, et par consquent ne peut dterminer qu'une raction trs modre. Tout ce qu'il nous faut, c'est que les fonctions concourent d'une manire rgulire; si donc cette rgularit est trouble, il nous suffit qu'elle soit rtablie. Ce n'est pas dire, assurment, que le dveloppement de la division du travail ne puisse pas retentir dans le droit pnal. Il y a, nous le savons dj, des fonctions administratives et gouvernementales dont certains rapports sont rgls par le droit rpressif, cause du caractre particulier dont est marqu l'organe de la conscience commune et tout ce qui s'y rapporte. Dans d'autres cas encore, les liens de solidarit qui unissent certaines fonctions sociales peuvent tre tels que de leur rupture rsultent des rpercussions assez gnrales pour susciter une raction pnale. Mais, pour la raison que nous avons dite, ces contrecoups sont exceptionnels. En dfinitive, ce droit joue dans la socit un rle analogue celui du systme nerveux dans l'organisme. Celui-ci, en effet, a pour tche de rgler les diffrentes fonctions du corps, de manire les faire concourir harmoniquement : il exprime ainsi tout naturellement l'tat de concentration auquel est parvenu l'organisme, par suite de la division du travail physiologique. Aussi, aux diffrents chelons de l'chelle animale, peut-on mesurer le degr de cette concentration d'aprs le dveloppement du systme nerveux. C'est dire qu'on peut galement mesurer le degr de concentration auquel est parvenue une socit par suite de la division du travail social, d'aprs le dveloppement du droit coopratif sanctions restitutives. On prvoit tous les services que nous rendra ce critre.
IV
Puisque la solidarit ngative ne produit par elle-mme aucune intgration, et que, d'ailleurs, elle n'a rien de spcifique, nous reconnatrons deux sortes seulement de solidarits positives que distinguent les caractres suivants : 1 La premire relie directement l'individu la socit sans aucun intermdiaire. Dans la seconde, il dpend de la socit, parce qu'il dpend des parties qui la composent. 2 La socit n'est pas vue sous le mme aspect dans les deux cas. Dans le premier, ce que l'on appelle de ce nom, c'est un ensemble plus ou moins organis de croyances et de sentiments communs tous les membres du groupe : c'est le type collectif. Au contraire, la socit dont nous sommes solidaires dans le second cas est un systme de fonctions diffrentes et spciales qu'unissent des rapports dfinis. Ces deux socits n'en font d'ailleurs qu'une. Ce sont deux faces d'une seule et mme ralit, mais qui ne demandent pas moins tre distingues.
1
Voil pourquoi le droit qui rgle les rapports des fonctions domestiques n'est pas pnal, quoique ces fonctions soient assez gnrales.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
95
3 De cette seconde diffrence en dcoule une autre qui va nous servir caractriser et dnommer ces deux sortes de solidarits. La premire ne peut tre forte que dans la mesure o les ides et les tendances communes tous les membres de la socit dpassent en nombre et en intensit celles qui appartiennent personnellement chacun d'eux. Elle est d'autant plus nergique que cet excdent est plus considrable. Or, ce qui fait notre personnalit, c'est ce que chacun de nous a de propre et de caractristique, ce qui le distingue des autres. Cette solidarit ne peut donc s'accrotre qu'en raison inverse de la personnalit. Il y a dans chacune de nos consciences, avons-nous dit, deux consciences : l'une, qui nous est commune avec notre groupe tout entier, qui, par consquent, n'est pas nous-mme, mais la socit vivant et agissant en nous ; l'autre qui ne reprsente au contraire que nous dans ce que nous avons de personnel et de distinct, dans ce qui fait de nous un individu 1. La solidarit qui drive des ressemblances est son maximum quand la conscience collective recouvre exactement notre conscience totale et concide de tous points avec elle : mais, ce moment, notre individualit est nulle. Elle ne peut natre que si la communaut prend moins de place en nous. 11 y a l deux forces contraires, l'une centripte, l'autre centrifuge, qui ne peuvent pas crotre en mme temps. Nous ne pouvons pas nous dvelopper la fois dans deux sens aussi opposs. Si nous avons un vif penchant penser et agir par nous-mme, nous ne pouvons pas tre fortement enclin penser et agir comme les autres. Si l'idal est de se faire une physionomie propre et personnelle, il ne saurait tre de ressembler tout le monde. De plus, au moment o cette solidarit exerce son action, notre personnalit s'vanouit, peut-on dire, par dfinition ; car nous ne sommes plus nous-mme, mais l'tre collectif. Les molcules sociales qui ne seraient cohrentes que de cette seule manire ne pourraient donc se mouvoir avec ensemble que dans la mesure o elles n'ont pas de mouvements propres, comme font les molcules des corps inorganiques. C'est pourquoi nous proposons d'appeler mcanique cette espce de solidarit. Ce mot ne signifie pas qu'elle soit produite par des moyens mcaniques et artificiellement. Nous ne la nommons ainsi que par analogie avec la cohsion qui unit entre eux les lments des corps bruts, par opposition celle qui fait l'unit des corps vivants. Ce qui achve de justifier cette dnomination, c'est que le lien qui unit ainsi l'individu la socit est tout fait analogue celui qui rattache la chose la personne. La conscience individuelle, considre sous cet aspect, est une simple dpendance du type collectif et en suit tous les mouvements, comme l'objet possd suit ceux que lui imprime son propritaire. Dans les socits o cette solidarit est trs dveloppe, l'individu ne s'appartient pas, nous le verrons plus loin ; c'est littralement une chose dont dispose la socit. Aussi, dans ces mmes types sociaux, les droits personnels ne sont-ils pas encore distingus des droits rels. Il en est tout autrement de la solidarit que produit la division du travail. Tandis que la prcdente implique que les individus se ressemblent, celle-ci suppose qu'ils diffrent les uns des autres. La premire n'est possible que dans la mesure o la personnalit individuelle est absorbe dans la personnalit collective ; la seconde n'est possible que si chacun a une sphre d'action qui lui est propre, par consquent une personnalit. Il faut donc que la conscience collective laisse dcouverte une partie de la conscience individuelle, pour que s'y tablissent ces fonctions spciales qu'elle ne
1
Toutefois, ces deux consciences ne sont pas des rgions gographiquement distinctes de nousmme, mais se pntrent de tous cts.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
96
peut pas rglementer ; et plus cette rgion est tendue, plus est forte la cohsion qui rsulte de cette solidarit. En effet, d'une part, chacun dpend d'autant plus troitement de la socit que le travail est plus divis, et, d'autre part, l'activit de chacun est d'autant plus personnelle qu'elle est plus spcialise. Sans doute, si circonscrite qu'elle soit, elle n'est jamais compltement originale ; mme dans l'exercice de notre profession, nous nous conformons des usages, des pratiques qui nous sont communes avec toute notre corporation. Mais, mme dans ce cas, le joug que nous subissons est autrement moins lourd que quand la socit tout entire pse sur nous, et il laisse bien plus de place au libre jeu de notre initiative. Ici donc, l'individualit du tout s'accrot en mme temps que celle des parties ; la socit devient plus capable de se mouvoir avec ensemble, en mme temps que chacun de ses lments a plus de mouvements propres. Cette solidarit ressemble celle que l'on observe chez les animaux suprieurs. Chaque organe, en effet, y a sa physionomie spciale, son autonomie, et pourtant l'unit de l'organisme est d'autant plus grande que cette individuation des parties est plus marque. En raison de cette analogie, nous proposons d'appeler organique la solidarit qui est due la division du travail. En mme temps, ce chapitre et le prcdent nous fournissent les moyens de calculer la part qui revient chacun de ces deux liens sociaux dans le rsultat total et commun qu'ils concourent produire par des voies diffrentes. Nous savons, en effet, sous quelles formes extrieures se symbolisent ces deux sortes de solidarits, c'est-dire quel est le corps de rgles juridiques qui correspond chacune d'elles. Par consquent, pour connatre leur importance respective dans un type social qui est donn, il suffit de comparer l'tendue respective des deux sortes de droits qui les expriment, puisque le droit varie toujours comme les relations sociales qu'il rgle.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
97
Pour prciser les ides, nous dveloppons, dans le tableau suivant, la classification des rgles juridiques qui est renferme implicitement dans ce chapitre et le prcdent :
I. - Rgles sanction rpressive organise (On en trouvera une classification au chapitre suivant) II. - Rgles sanction restitutive dterminant des Droit de proprit sous ses formes diverses (mobilire, immobilire, etc.). Modalits diverses du droit de proprit (servitude, usufruit, etc.). Dtermins par l'exercice normal des droits rels. Dtermins par la violation fautive des droits rels.
De la chose avec la personne. Rapports ngatifs ou d'abstention Des personnes entre elles
Entre les fonctions domestiques. Entre les fonctions conomiques diffuses. Rapports positifs ou de coopration Des fonctions administratives Des fonctions gouvernementales. Rapports contractuels en gnral. Contrats spciaux. Entre elles. Avec les fonctions gouvernementales. Avec les fonctions diffuses de la socit. Entre elles. Avec les fonctions administratives. Avec les fonctions politiques diffuses.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
98
Chapitre IV
Autre preuve de ce qui prcde
Retour la table des matires
Pourtant, cause de l'importance des rsultats qui prcdent, il est bon, avant d'aller plus loin, de les confirmer une dernire lois. Cette nouvelle vrification est d'autant plus utile qu'elle va nous fournir l'occasion d'tablir une loi qui, tout en leur servant de preuve, servira aussi clairer tout ce qui suivra. Si les deux sortes de solidarits que nous venons de distinguer ont bien l'expression juridique que nous avons dite, la prpondrance du droit rpressif sur le droit coopratif doit tre d'autant plus grande que le type collectif est plus prononc et que la division du travail est plus rudimentaire. Inversement, mesure que les types individuels se dveloppent et que les tches se spcialisent, la proportion entre l'tendue de ces deux droits doit tendre se renverser. Or, la ralit de ce rapport peut tre dmontre exprimentalement.
Plus les socits sont primitives, plus il y a de ressemblances entre les individus dont elles sont formes. Dj Hippocrate dans son crit De Aere et Locis, avait dit que les Scythes ont un type ethnique et point de types personnels. Humboldt remarque dans ses Neuspanien 1 que, chez les peuples barbares, on trouve plutt une physionomie propre la horde que des physionomies individuelles, et le fait a t
1
I, p. 116.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
99
confirm par un grand nombre d'observateurs. De mme que les Romains trouvaient entre les vieux Germains de trs grandes ressemblances, les soi-disant sauvages produisent le mme effet l'Europen civilis. A vrai dire, le manque d'exercice peut tre souvent la cause principale qui dtermine le voyageur un tel jugement; ... cependant, cette inexprience ne pourrait que difficilement produire cette consquence si les diffrences auxquelles l'homme civilis est accoutum dans son milieu natal n'taient rellement pas plus importantes que celles qu'il rencontre chez les peuples primitifs. Bien connue et souvent cite est cette parole d'Ulloa, que qui a vu un indigne d'Amrique les a tous vus 1. Au contraire, chez les peuples civiliss, deux individus se distinguent l'un de l'autre au premier coup dil et sans qu'une initiation pralable soit pour cela ncessaire. Le Dr Lebon a pu tablir d'une manire objective cette homognit croissante mesure qu'on remonte vers les origines. Il a compar les crnes appartenant des races et des socits diffrentes, et y a trouv que les diffrences de volume du crne existant entre individus de mme race... sont d'autant plus grandes que la race est plus leve dans l'chelle de la civilisation. Aprs avoir group les volumes des crnes de chaque race par sries progressives, en ayant soin de n'tablir de comparaisons que sur des sries assez nombreuses pour que les termes soient relis d'une faon graduelle, j'ai reconnu, dit-il, que la diffrence de volume entre les crnes masculins adultes les plus grands et les crnes les plus petits est en nombre rond de 200 centimtres cubes chez le gorille, de 280 chez les parias de l'Inde, de 310 chez les Australiens, de 350 chez les anciens gyptiens, de 470 chez les Parisiens du XIIe sicle, de 600 chez les Parisiens modernes, de 700 chez les Allemands 2 . Il y a mme quelques peuplades o ces diffrences sont nulles. Les Andamans et les Todas sont tous semblables. On en peut presque dire autant des Groenlandais. Cinq crnes de Patagons que possde le laboratoire de M. Broca sont identiques 3. Il n'est pas douteux que ces similitudes organiques ne correspondent des similitudes psychiques. Il est certain, dit Waitz, que cette grande ressemblance physique des indignes provient essentiellement de l'absence de toute forte individualit psychique, de l'tat d'infriorit de la culture intellectuelle en gnral. L'homognit des caractres (Gemlhseigenschaflen) au sein d'une peuplade ngre est incontestable. Dans l'gypte suprieure, le marchand d'esclaves ne se renseigne avec prcision que sur le lieu d'origine de l'esclave et non sur son caractre individuel, car une longue exprience lui a appris que les diffrences entre individus de la mme tribu sont insignifiantes ct de celles qui drivent de la race. C'est ainsi que les Nubas et les Gallus passent pour trs fidles, les Abyssins du Nord pour tratres et perfides, la majorit des autres pour de bons esclaves domestiques, mais qui ne sont gure utilisables pour le travail corporel ; ceux de Fertit pour sauvages et prompts la vengeance 4. Aussi l'originalit n'y est-elle pas seulement rare, elle n'y a, pour ainsi dire, pas de place. Tout le monde alors admet et pratique, sans la discuter, la mme religion ; les sectes et les dissidences sont inconnues : elles ne seraient pas tolres. Or, ce moment, la religion comprend tout, s'tend tout. Elle renferme dans un tat de mlange confus, outre les croyances proprement religieuses, la morale, le droit, les principes de l'organisation politique et jusqu' la science, ou du moins ce qui en tient
1 2 3 4
WAITZ, Anthropologie der Naturvlker, 1, pp. 75-76. Les socits, p. 193. TOPINARD, Anthropologie, p. 393. Op. cit., I, p, 77. - Cf. ibid., p. 446.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
100
lieu. Elle rglemente mme les dtails de la vie prive. Par consquent, dire que les consciences religieuses sont alors identiques, - et cette identit est absolue, - c'est dire implicitement que, sauf les sensations qui se rapportent l'organisme et aux tats de l'organisme, toutes les consciences individuelles sont peu prs composes des mmes lments. Encore les impressions sensibles elles-mmes ne doivent-telles pas offrir une grande diversit, cause des ressemblances physiques que prsentent les individus. C'est pourtant une ide encore assez rpandue que la civilisation a, au contraire, pour effet d'accrotre les similitudes sociales. A mesure que les agglomrations humaines s'tendent, dit M. Tarde, la diffusion des ides suivant une progression gomtrique rgulire est plus marque 1. Suivant Hale 2, c'est une erreur d'attribuer aux peuples primitifs une certaine uniformit de caractre, et il donne comme preuve ce fait que la race jaune et la race noire de l'ocan Pacifique, qui habitent cte cte, se distinguent plus fortement l'une de l'autre que deux peuples europens. De mme, est-ce que les diffrences qui sparent le Franais de l'Anglais ou de l'Allemand ne sont pas moindres aujourd'hui qu'autrefois ? Dans presque toutes les socits europennes, le droit, la morale, les murs, mme les institutions politiques fondamentales sont peu prs identiques. On fait galement remarquer qu'au sein d'un mme pays on ne trouve plus aujourd'hui les contrastes qu'on y rencontrait autrefois. La vie sociale ne varie plus ou ne varie plus autant d'une province l'autre ; dans les pays unifis comme la France, elle est peu prs la mme dans toutes les rgions, et ce nivellement est son maximum dans les classes cultives 3. Mais ces faits n'infirment en rien notre proposition. Il est certain que les diffrentes socits tendent se ressembler davantage; mais il n'en est pas de mme des individus qui composent chacune d'elles. Il y a maintenant moins de distance que jadis entre le Franais et l'Anglais en gnral, mais cela n'empche pas les Franais d'aujourd'hui de diffrer entre eux beaucoup plus que les Franais d'autrefois. De mme, il est bien vrai que chaque province tend perdre sa physionomie distinctive ; mais cela n'empche pas chaque individu d'en prendre de plus en plus une qui lui est personnelle. Le Normand est moins diffrent du Gascon, celui-ci du Lorrain et du Provenal : les uns et les autres n'ont plus gure en commun que les traits communs tous les Franais ; mais la diversit que prsentent ces derniers pris ensemble ne laisse pas de s'tre accrue. Car, si les quelques types provinciaux qui existaient autrefois tendent se fondre les uns dans les autres et disparatre, il y a, la place, une multitude autrement considrable de types individuels. Il n'y a plus autant de diffrences qu'il y a de grandes rgions, mais il y en a presque autant qu'il y a d'individus. Inversement, l o chaque province a sa personnalit, il n'en est pas de mme des particuliers. Elles peuvent tre trs htrognes les unes par rapport aux autres, et n'tre formes que d'lments semblables, et c'est ce qui se produit galement dans les socits politiques. De mme, dans le monde biologique, les protozoaires sont ce point distincts les uns des autres qu'il est impossible de les classer en espces 4 ; et cependant, chacun d'eux est compos d'une matire parfaitement homogne.
1 2 3
Lois de l'imitation, p. 19. Ethnography and philology of the Un. States, Philadelphie, 1846, p. 13. C'est ce qui fait dire M. TARDE : Le voyageur qui traverse plusieurs pays d'Europe observe plus de dissemblances entre les gens du peuple rests fidles leurs vieilles coutumes qu'entre les personnes des classes suprieures (op. cit., p. 59). Voir PERRIER, Transformisme, p. 235.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
101
Cette opinion repose donc sur une confusion entre les types individuels et les types collectifs, tant provinciaux que nationaux. Il est incontestable que la civilisation tend niveler les seconds ; mais on en a conclu tort qu'elle a le mme effet sur les premiers, et que l'uniformit devient gnrale. Bien loin que ces deux sortes de types varient l'un comme l'autre, nous verrons que l'effacement des uns est la condition ncessaire l'apparition des autres 1. Or, il n'y a jamais qu'un nombre restreint de types collectifs au sein d'une mme socit, car elle ne peut comprendre qu'un petit nombre de races et de rgions assez diffrentes pour produire de telles dissemblances. Au contraire, les individus sont susceptibles de se diversifier l'infini. La diversit est donc d'autant plus grande que les types individuels sont plus dvelopps. Ce qui prcde s'applique identiquement aux types professionnels. Il y a des raisons de supposer qu'ils perdent de leur ancien relief, que l'abme qui sparait jadis les professions, et surtout certaines d'entre elles, est en train de se combler. Mais ce qui est certain, c'est qu' l'intrieur de chacune d'elles les diffrences se sont accrues. Chacun a davantage sa manire de penser et de faire, subit moins compltement l'opinion commune de la corporation. De plus, si de profession profession les diffrences sont moins tranches, elles sont en tout cas plus nombreuses, car les types professionnels se sont eux-mmes multiplis mesure que le travail se divisait davantage. S'ils ne se distinguent plus les uns des autres que par de simples nuances, du moins ces nuances sont plus varies. La diversit n'a donc pas diminu, mme ce point de vue, quoiqu'elle ne se manifeste plus sous forme de contrastes violents et heurts. Nous pouvons donc tre assurs que, plus on recule dans l'histoire, plus l'homognit est grande ; d'autre part, plus on se rapproche des types sociaux les plus levs, plus la division du travail se dveloppe. Voyons maintenant comment varient, aux divers degrs de l'chelle sociale, les deux formes du droit que nous avons distingues.
II
Autant qu'on peut juger de l'tat du droit dans les socits tout fait infrieures, il parat tre tout entier rpressif. Le sauvage, dit Lubbock, n'est libre nulle part. Dans le monde entier, la vie quotidienne du sauvage est rgle par une quantit de coutumes (aussi imprieuses que des lois) compliques et souvent fort incommodes, de dfenses et de privilges absurdes. De nombreux rglements fort svres, quoiqu'ils ne soient pas crits, compassent tous les actes de leur vie 2. On sait, en effet, avec quelle facilit, chez les peuples primitifs, les manires d'agir se consolident en pratiques traditionnelles, et, d'autre part, combien est grande chez eux la force de la tradition. Les murs des anctres y sont entoures de tant de respect qu'on ne peut y droger sans tre puni.
1 2
Voir plus loin, liv. II, chap. II et III. - Ce que nous y disons peut servir la fois expliquer et confirmer les faits que nous tablissons ici. LUBBOCK, Les origines de la civilisation, p. 440. Paris, F. Alcan. - Cf. SPENCER, Sociologie, p. 435. Paris, F. Alcan.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
102
Mais de telles observations manquent ncessairement de prcision, car rien n'est difficile saisir comme des coutumes aussi flottantes. Pour que notre exprience soit conduite avec mthode, il faut la faire porter autant que possible sur des droits crits. Les quatre derniers livres du Pentateuque, l'Exode, le Lvitique, les Nombres, le Deutronome reprsentent le plus ancien monument de ce genre que nous possdions 1. Sur ces quatre ou cinq mille versets, il n'y en a qu'un nombre relativement infime o soient exprimes des rgles qui puissent, la rigueur, passer pour n'tre pas rpressives. Ils se rapportent aux objets suivants : Droit de proprit: Droit de retrait Jubil Proprit des Lvites (Lvitique, XXV, 14-25, 29-311, et XXVII, 1-34). Droit domestique : Mariage (Dent., XXI, 11-14 ; XXIII, 5 ; XXV, 5-10 ; Lv., XXI, 7, 13, 14) ; - Droit successoral (Nombres, XXVII, 8-11, et XXVI, 8 ; Dent., XXI, 15-17) ; - Esclavage d'indignes et d'trangers (Dent., XV. 12-17 ; Exode, XXI, 2-11 ; Lv., XIX, 20 ; XXV, 39-44 ; XXXVI, 44-54). Prts et salaires (Dent., XV, 7-9 ; XXIII, 19-20 ; XXIV, 6 et 10-13 ; XXV, 15). Quasi-dlits (Exode, XXI, 18-33 et 33-35 ; XXII, 6 et 10-17 2. Organisation des fonctions publiques. Des fonctions des prtres (Nombres, X) ; des Lvites (Nombres, III et IV) ; des Anciens (Deut., XXI, 19; XXII, 15; XXV, 7 ; XXI, 1 ; Lv., IV, 15) ; des juges (Exode, XVIII, 25 ; Deut., 1, 15-17).
Le droit restitutif et surtout le droit coopratif se rduisent donc trs peu de chose. Ce n'est pas tout. Parmi les rgles que nous venons de citer, beaucoup ne sont pas aussi trangres au droit pnal qu'on pourrait le croire au premier abord, car elles sont toutes marques d'un caractre religieux. Elles manent toutes galement de la divinit ; les violer, c'est l'offenser, et de telles offenses sont des fautes qui doivent tre expies. Le livre ne distingue pas entre tels ou tels commandements, mais ils sont tous des paroles divines auxquelles on ne peut dsobir impunment. Si tu ne prends pas garde faire toutes les paroles de cette loi qui sont crites dans ce livre en craignant ce nom glorieux et terrible, l'ternel ton Dieu, alors l'ternel te frappera toi et ta postrit. Le manquement, mme par suite d'erreur, un prcepte quelconque constitue un pch et rclame une expiation. Des menaces de ce genre, dont la nature pnale n'est pas douteuse, sanctionnent mme directement quelques-unes de ces rgles que nous avons attribues au droit restitutif. Aprs avoir dcid que la femme divorce ne pourra plus tre reprise par son mari si, aprs s'tre remarie, elle divorce de nouveau, le texte ajoute : Ce serait une abomination devant l'ternel ; ainsi lu ne chargeras d'aucun pch le pays que l'ternel ton Dieu te donne en hritage. De mme, voici le verset o est rgle la manire dont doivent tre pays les salaires : Tu lui (au mercenaire) donneras le salaire le jour mme qu'il aura travaill, avant
1
Nous n'avons pas nous prononcer sur l'antiquit relle de l'ouvrage - il nous suffit qu'il se rapporte une socit de type trs infrieur - ni sur l'antiquit relative des parties qui le composent, car, au point de vue qui nous occupe, elles prsentent toutes sensiblement le mme caractre. Nous les prenons donc en bloc. Tous ces versets runis (moins ceux qui traitent des fonctions publiques) sont au nombre de 135.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
103
que le soleil se couche, car il est pauvre et c'est quoi son me s'attend, de peur qu'il ne crie contre loi l'ternel et que lu ne pches. Les indemnits auxquelles donnent naissance les quasi-dlits semblent galement prsentes comme de vritables expiations. C'est ainsi qu'on lit dans le Lvitique : On punira aussi de mort celui qui aura frapp de mort quelque personne que ce soit. Celui qui aura frapp une bte mort la rendra ; vie pour vie..,, fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent 1. . La rparation du dommage caus a tout l'air d'tre assimile au chtiment du meurtre et d'tre regarde comme une application de la loi du talion. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de prceptes dont la sanction n'est pas spcialement indique ; mais nous savons dj qu'elle est certainement pnale. La nature des expressions employes suffit le prouver. D'ailleurs, la tradition nous apprend qu'un chtiment corporel tait inflig quiconque violait un prcepte ngatif, quand la loi n'nonait pas formellement de peine 2. En rsum, des degrs divers, tout le droit hbreu, tel que le Pentateuque le fait connatre, est empreint d'un caractre essentiellement rpressif. Celui-ci est plus marqu par endroits, plus latent dans d'autres, mais on le sent partout prsent. Parce que toutes les prescriptions qu'il renferme sont des commandements de Dieu, placs, pour ainsi dire, sous sa garantie directe, elles doivent toutes cette origine un prestige extraordinaire qui les rend sacro-saintes ; aussi, quand elles sont violes, la conscience publique ne se contente-telle pas d'une simple rparation, mais elle exige une expiation qui la venge. Puisque ce qui fait la nature propre du droit pnal, c'est l'autorit extraordinaire des rgles qu'il sanctionne, et que les hommes n'ont jamais connu ni imagin d'autorit plus haute que celle que le croyant attribue son Dieu, un droit qui est cens tre la parole de Dieu lui-mme ne peut manquer d'tre essentiellement rpressif. Nous avons mme pu dire que tout droit pnal est plus ou moins religieux, car ce qui en est l'me, c'est un sentiment de respect pour une force suprieure l'homme individuel, pour une puissance, en quelque sorte, transcendante, sous quelque symbole qu'elle se fasse sentir aux consciences, et ce sentiment est aussi la base de toute religiosit. Voil pourquoi, d'une manire gnrale, la rpression domine tout le droit chez les socits infrieures : c'est que la religion y pntre toute la vie juridique, comme d'ailleurs toute la vie sociale. Aussi ce caractre est-il encore trs marqu dans les lois de Manou. Il n'y a qu' voir la place minente qu'elles attribuent la justice criminelle dans l'ensemble des institutions nationales. Pour aider le roi dans ses fonctions, dit Manou, le Seigneur produisit ds le principe le gnie du chtiment, protecteur de tous les tres, excuteur de la justice, son propre fils, et dont l'essence est toute divine. C'est la crainte du chtiment qui permet toutes les cratures mobiles et immobiles de jouir de ce qui leur est propre, et qui les empche de s'carter de leurs devoirs... Le chtiment gouverne le genre humain, le chtiment le protge ; le chtiment veille pendant que tout dort ; le chtiment est la justice, disent les sages... Toutes les classes se corrompraient, toutes les barrires seraient renverses, l'univers ne serait que confusion si le chtiment ne faisait plus son devoir 3.
1 2 3
XXIV, 17, 18, 20. Voir MUNCK, Palestine, p. 216. - SELDEN, De Sunedriis, pp. 889-903, numre, d'aprs Mamonide, tous les prceptes qui rentrent dans cette catgorie. Lois de Manou, trad. LOISELEUR, VII, v. 14-24.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
104
La loi des XII Tables se rapporte une socit dj beaucoup plus avance 1 et plus rapproche de nous que n'tait le peuple hbreu. Ce qui le prouve, c'est que la socit romaine n'est parvenue au type de la cit qu'aprs avoir pass par celui o la socit juive est reste fixe, et l'avoir dpasse ; nous en aurons la preuve plus loin 2. D'autres faits d'ailleurs tmoignent de ce moindre loignement. D'abord on trouve dans la loi des XII Tables tous les principaux germes de notre droit actuel, tandis qu'il n'y a, pour ainsi dire, rien de commun entre le droit hbraque et le ntre 3. Ensuite la loi des XII Tables est absolument laque. Si, dans la Rome primitive, des lgislateurs comme Numa furent censs recevoir leur inspiration de la divinit, et si, par suite, le droit et la religion taient alors intimement mls, au moment o furent rdiges les XII Tables cette alliance avait certainement cess, car ce monument juridique a t prsent ds l'origine comme une oeuvre tout humaine et qui ne visait que des relations humaines. On n'y trouve que quelques dispositions qui concernent les crmonies religieuses, et encore semblent-elles y avoir t admises en qualit de lois somptuaires. Or, l'tat de dissociation plus ou moins complte o se trouvent l'lment juridique et l'lment religieux est un des meilleurs signes auxquels on peut reconnatre si une socit est plus ou moins dveloppe qu'une autre 4. Aussi le droit criminel n'occupe-t-il plus toute la place. Les rgles qui sont sanctionnes par des peines et celles qui n'ont que des sanctions restitutives sont, cette fois, bien distingues les unes des autres. Le droit restitutif s'est dgag du droit rpressif qui l'absorbait primitivement ; il a maintenant ses caractres propres, sa constitution personnelle, son individualit. Il existe comme espce juridique distincte, munie d'organes spciaux, d'une procdure spciale. Le droit coopratif lui-mme fait son apparition : on trouve dans les XII Tables un droit domestique et un droit contractuel. Toutefois, si le droit pnal a perdu de sa prpondrance primitive, sa part reste grande. Sur les 115 fragments de cette loi que Voigt est parvenu reconstituer, il n'y en a que 66 qui puissent tre attribus au droit restitutif, 49 ont un caractre pnal accentu 5. Par consquent, le droit pnal n'est pas loin de reprsenter la moiti de ce code tel qu'il nous est parvenu ; et pourtant, ce qui nous en reste ne peut nous donner qu'une ide trs incomplte de l'importance qu'avait le droit rpressif au moment o il fut rdig. Car ce sont les parties qui taient consacres ce droit qui ont d se perdre le plus facilement. C'est aux jurisconsultes de l'poque classique que nous devons presque exclusivement les fragments qui nous ont t conservs ; or, ils s'intressaient beaucoup plus aux problmes du droit civil qu'aux questions du droit criminel. Celuici ne se prte gure aux belles controverses qui ont t de tout temps la passion des juristes. Cette indiffrence gnrale dont il tait l'objet a d avoir pour effet de faire
1
2 3 4 5
En disant d'un type social qu'il est plus avanc qu'un autre, nous n'entendons pas que les diffrents types sociaux s'tagent en une mme srie linaire ascendante, plus ou moins leve suivant les moments de l'histoire. Il est au contraire certain que, si le tableau gnalogique des types sociaux pouvait tre compltement dress, il aurait plutt la forme d'un arbre touffu, souche unique, sans doute, mais rameaux divergents. Mais, malgr cette disposition, la distance entre deux types est mesurable ; ils sont plus ou moins hauts. Surtout on a le droit de dire d'un type qu'il est au-dessus d'un autre quand il a commenc par avoir la forme de ce dernier et qu'il l'a dpasse. C'est certainement qu'il appartient une branche ou un rameau plus lev. Voir chap. VI, II. Le droit contractuel, le droit de tester, la tutelle, l'adoption, etc., sont choses inconnues du Pentateuque. Cf. WALTER, Op. Cit., 1 et 2 ; VOIGT, Die XII Tafeln, I, p. 43. Dix (lois somptuaires) ne mentionnent pas expressment de sanction; mais le caractre pnal n'en est pas douteux.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
105
sombrer dans l'oubli une bonne partie de l'ancien droit pnal de Rome. D'ailleurs, mme le texte authentique et complet de la loi des XII Tables ne le contenait certainement pas tout entier. Car elle ne parlait ni des crimes religieux, ni des crimes domestiques, qui taient jugs les uns et les autres par des tribunaux particuliers, ni des attentats contre les murs. Il faut enfin tenir compte de la paresse que le droit pnal met, pour ainsi dire, se codifier. Comme il est grav dans toutes les consciences, on n'prouve pas le besoin de l'crire pour le faire connatre. Pour toutes ces raisons, on a le droit de prsumer que, mme au Ive sicle de Rome, le droit pnal reprsentait encore la majeure partie des rgles juridiques. Cette prpondrance est encore beaucoup plus certaine et beaucoup plus accuse, si on le compare, non pas tout le droit restitutif, mais seulement la partie de ce droit qui correspond la solidarit organique. En effet, ce moment, il n'y a gure que le droit domestique dont l'organisation soit dj assez avance la procdure, pour tre gnante, n'est ni varie ni complexe le droit contractuel commence seulement natre. Le petit nombre des contrats que reconnat l'ancien droit, dit Voigt, contraste de la manire la plus frappante avec la multitude des obligations qui naissent du dlit 1. Quant au droit publie, outre qu'il est encore assez simple, il a en grande partie un caractre pnal, parce qu'il a gard un caractre religieux. A partir de cette poque, le droit rpressif n'a fait que perdre de son importance relative. D'une part, supposer mme qu'il n'ait pas rgress sur un grand nombre de points, que bien des actes qui, l'origine, taient regards comme criminels, n'aient pas cess peu peu d'tre rprims, - et le contraire est certain pour ce qui concerne les dlits religieux, - du moins ne s'est-il pas sensiblement accru ; nous savons que, ds l'poque des XII Tables, les principaux types criminologiques du droit romain sont constitus. Au contraire, le droit contractuel, la procdure, le droit public n'ont fait que prendre de plus en plus d'extension. A mesure qu'on avance, on voit les rares et maigres formules que la loi des XII Tables comprenait sur ces diffrents points se dvelopper et se multiplier jusqu' devenir les systmes volumineux de l'poque classique. Le droit domestique lui-mme se complique et se diversifie mesure qu'au droit civil primitif vient peu peu s'ajouter le droit prtorien. L'histoire des socits chrtiennes nous offre un autre exemple du mme phnomne. Dj Sumner Maine avait conjectur qu'en comparant entre elles les diffrentes lois barbares on trouverait la place du droit pnal d'autant plus grande qu'elles sont plus anciennes 2. Les faits confirment cette prsomption. La loi salique se rapporte une socit moins dveloppe que n'tait la Rome du ive sicle. Car si, comme cette dernire, elle a dj franchi le type social auquel s'est arrt le peuple hbreu, elle en est pourtant moins compltement dgage. Les traces en sont beaucoup plus apparentes, nous le montrerons plus loin. Aussi le droit pnal y avait-il une importance beaucoup plus grande. Sur les 293 articles dont est compos le texte de la loi salique, tel qu'il est dit par Waitz 3, il n'y en a gure que 25 (soit environ 9 %) qui n'aient pas de caractre rpressif ; ce sont ceux qui sont relatifs la constitution de la famille franque 4. Le contrat n'est pas encore affranchi du droit pnal, car le refus d'excuter au jour fix l'engagement contract donne lieu une
1 2 3 4
XII Tafeln, II, p. 448. Ancien droit, p. 347. Sas alte Recht der Salischen Franken, Kiel, 1846. Tit. XLIV, XLV, XLVI, LIX, LX, LXII.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
106
amende. Encore la loi salique ne contient-elle qu'une partie du droit pnal des Francs, puisqu'elle concerne uniquement les crimes et les dlits pour lesquels la composition est permise. Or, il y en avait certainement qui ne pouvaient pas tre rachets. Que l'on songe que la Lex ne contient pas un mot ni sur les crimes contre l'tat, ni sur les crimes militaires, ni sur ceux contre la religion, et la prpondrance du droit rpressif apparatra plus considrable encore 1. Elle est dj moindre dans la loi des Burgundes, qui est plus rcente. Sur 311 articles, nous en avons compt 98, c'est--dire prs d'un tiers, qui ne prsentent aucun caractre pnal. Mais l'accroissement porte uniquement sur le droit domestique, qui s'est compliqu, tant pour ce qui concerne le droit des choses que pour ce qui regarde celui des personnes. Le droit contractuel n'est pas beaucoup plus dvelopp que dans la loi salique. Enfin, la loi des Wisigoths, dont la date est encore plus rcente et qui se rapporte un peuple encore plus cultiv, tmoigne d'un nouveau progrs dans le mme sens. Quoique le droit pnal y prdomine encore, le droit restitutif y a une importance presque gale. On y trouve, en effet, tout un code de procdure (liv. I et II), un droit matrimonial et un droit domestique dj trs dvelopps (liv. III, tit. I et VI ; liv. IV). Enfin, pour la premire fois, tout un livre, le cinquime, est consacr aux transactions. L'absence de codification ne nous permet pas d'observer avec la mme prcision ce double dveloppement dans toute la suite de notre histoire ; mais il est incontestable qu'il s'est poursuivi dans la mme direction. Ds cette poque, en effet, le catalogue juridique des crimes et des dlits est dj trs complet. Au contraire, le droit domestique, le droit contractuel, la procdure, le droit publie se sont dvelopps sans interruption, et c'est ainsi que, finalement, le rapport entre les deux parties du droit que nous comparons s'est trouv renvers.
Le droit rpressif et le droit coopratif varient donc exactement comme le faisait prvoir la thorie qui se trouve ainsi confirme. Il est vrai qu'on a parfois attribu une autre cause cette prdominance du droit pnal dans les socits infrieures ; on l'a explique par la violence habituelle dans les socits qui commencent crire leurs lois. Le lgislateur, dit-on, a divis son oeuvre en proportion de la frquence de certains accidents de la vie barbare 2 . M. Sumner Maine, qui rapporte cette explication, ne la trouve pas complte ; en ralit, elle n'est pas seulement incomplte, elle est fausse. D'abord, elle fait du droit une cration artificielle du lgislateur, puisqu'il aurait t institu pour contredire les murs publiques et ragir contre elles. Or, une telle conception n'est plus aujourd'hui soutenable. Le droit exprime les murs, et s'il ragit contre elles, c'est avec la force qu'il leur a emprunte. L o les actes de violence sont frquents, ils sont tolrs ; leur dlictuosit est en raison inverse de leur frquence. Ainsi, chez les peuples infrieurs, les crimes contre les personnes sont plus ordinaires que dans nos socits civilises; aussi sont-ils au dernier degr de l'chelle pnale. On peut presque dire que les attentats sont d'autant plus svrement punis qu'ils sont plus rares. De plus, ce qui fait l'tat plthorique du droit pnal primitif, ce
1 2
Cf. THONISSEN, Procdure de la loi salique, p. 244. Ancien droit, p. 348.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
107
n'est pas que nos crimes d'aujourd'hui y sont l'objet de dispositions plus tendues, mais c'est qu'il existe une criminalit luxuriante, propre ces socits, et dont leur prtendue violence ne saurait rendre compte : dlits contre la foi religieuse, contre le rite, contre le crmonial, contre les traditions de toute sorte, etc. La vraie raison de ce dveloppement des rgles rpressives, c'est donc qu' ce moment de l'volution la conscience collective est tendue et forte, alors que le travail n'est pas encore divis. Ces principes poss, la conclusion va s'en dgager toute seule.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
108
Chapitre V
Prpondrance progressive de la solidarit organique et ses consquences
I
Retour la table des matires
Il suffit en effet de jeter un coup dil sur nos Codes pour y constater la place trs rduite que le droit rpressif occupe par rapport au droit coopratif. Qu'est-ce que le premier ct de ce vaste systme form par le droit domestique, le droit contractuel, le droit commercial, etc. ? L'ensemble des relations soumises une rglementation pnale ne reprsente donc que la plus petite fraction de la vie gnrale, et, par consquent, les liens qui nous attachent la socit et qui drivent de la communaut des croyances et des sentiments sont beaucoup moins nombreux que ceux qui rsultent de la division du travail. Il est vrai, comme nous en avons dj fait la remarque, que la conscience commune et la solidarit qu'elle produit ne sont pas exprimes tout entires par le droit pnal ; la premire cre d'autres liens que ceux dont il rprime la rupture. Il y a des tats moins forts ou plus vagues de la conscience collective qui font sentir leur action par l'intermdiaire des murs, de l'opinion publique, sans qu'aucune sanction lgale y soit attache, et qui, pourtant, contribuent assurer la cohsion de la socit. Mais le droit coopratif n'exprime pas davantage tous les liens qu'engendre la division du travail ; car il ne nous donne galement de toute cette partie de la vie sociale, qu'une reprsentation schmatique. Dans une multitude de cas, les rapports de mutuelle dpendance qui unissent les fonctions divises ne sont rgls que par des usages, et ces rgles non crites dpassent certainement en nombre celles qui servent de prolongement au droit rpressif, car elles doivent tre aussi diverses que les fonctions
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
109
sociales elles-mmes. Le rapport entre les unes et les autres est donc le mme que celui des deux droits qu'elles compltent, et, par consquent, on peut en faire abstraction sans que le rsultat du calcul soit modifi. Cependant, si nous n'avions constat ce rapport que dans nos socits actuelles et au moment prcis de leur histoire o nous sommes arrivs, on pourrait se demander s'il n'est pas d des causes temporaires et peut-tre pathologiques. Mais nous venons de voir que, plus un type social est rapproch du ntre, plus le droit coopratif devient prdominant ; au contraire, le droit pnal occupe d'autant plus de place qu'on s'loigne de notre organisation actuelle. C'est donc que ce phnomne est li, non a quelque cause accidentelle et plus ou moins morbide, mais la structure de nos socits dans ce qu'elle a de plus essentiel, puisqu'il se dveloppe d'autant plus qu'elle se dtermine davantage. Ainsi la loi que nous avons tablie dans notre prcdent chapitre nous est doublement utile. Outre qu'elle a confirm les principes sur lesquels repose notre conclusion, elle nous permet d'tablir la gnralit de cette dernire. Mais de cette seule comparaison nous ne pouvons pas encore dduire quelle est la part de la solidarit organique dans la cohsion gnrale de la socit. En effet, ce qui fait que l'individu est plus ou moins troitement fix son groupe, ce n'est pas seulement la multiplicit plus ou moins grande des points d'attache, mais aussi l'intensit variable des forces qui l'y tiennent attach. Il pourrait donc se faire que les liens qui rsultent de la division du travail, tout en tant plus nombreux, fussent plus faibles que les autres, et que l'nergie suprieure de ceux-ci compenst leur infriorit numrique. Mais c'est le contraire qui est la vrit. En effet, ce qui mesure la force relative de deux liens sociaux, c'est l'ingale facilit avec laquelle ils se brisent. Le moins rsistant est videmment celui qui se rompt sous la moindre pression. Or, c'est dans les socits infrieures, o la solidarit par ressemblances est seule ou presque seule, que ces ruptures sont le plus frquentes et le plus aises. Au dbut, dit M. Spencer, quoique ce soit pour l'homme une ncessit de s'unir un groupe, il n'est pas oblig de rester uni ce mme groupe. Les Kalmoucks et les Mongols abandonnent leur chef quand 'ils trouvent son autorit oppressive, et passent d'autres. Les Abipones quittent leur chef sans lui en demander la permission et sans qu'il en marque son dplaisir, et ils vont avec leur famille partout o il leur plat 1, Dans l'Afrique du Sud, les Balondas passent sans cesse d'une partie du pays l'autre. Mac Culloch a remarqu les mmes faits chez les Koukis. Chez les Germains, tout homme qui aimait la guerre pouvait se faire soldat sous un chef de son choix. Rien n'tait plus ordinaire et ne semblait plus lgitime. Un homme se levait au milieu d'une assemble ; il annonait qu'il allait faire une expdition en tel lieu, contre tel ennemi ; ceux qui avaient confiance en lui et qui dsiraient du butin l'acclamaient pour chef et le suivaient... Le lien social tait trop faible pour retenir les hommes malgr eux contre les tentations de la vie errante et du gain 2. Waitz dit d'une manire gnrale des socits infrieures que, mme l o un pouvoir directeur est constitu, chaque individu conserve assez d'indpendance pour se sparer en un instant de son chef, et se soulever contre lui, s'il est assez puissant pour cela, sans qu'un tel acte passe pour criminel 3 . Alors mme que le gouvernement est despotique, dit le mme auteur, chacun a toujours la libert de faire
1 2 3
Sociologie, III, p. 381. FUSTEL DE COULANGES, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, Ire Part., p. 352. Anthropologie, etc., 1re Part., pp. 359-360.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
110
scession avec sa famille. La rgle d'aprs laquelle le Romain, fait prisonnier par les ennemis, cessait de faire partie de la cit, ne s'expliquerait-elle pas aussi par la facilit avec laquelle le lien social pouvait alors se rompre Il en est tout autrement mesure que le travail se divise. Les diffrentes parties de l'agrgat, parce qu'elles remplissent des fonctions diffrentes, ne peuvent pas tre facilement spares. Si, dit M. Spencer, on sparait du Middlesex ses alentours, toutes ses oprations s'arrteraient au bout de quelques jours, faute de matriaux. Sparez le district o l'on travaille le coton d'avec Liverpool et les autres centres, et son industrie s'arrtera, puis sa population prira. Sparez les populations houillres des populations voisines qui fondent les mtaux ou fabriquent les draps d'habillement la machine, et aussitt celles-ci mourront socialement, puis elles mourront individuellement. Sans doute, quand une socit civilise subit une division telle qu'une de ses parties demeure prive d'une agence centrale exerant l'autorit, elle ne tarde pas en faire une autre ; mais elle court grand risque de dissolution, et avant que la rorganisation reconstitue une autorit suffisante, elle est expose rester pendant longtemps dans un tat de dsordre et de faiblesse 1. C'est pour cette raison que les annexions violentes, si frquentes autrefois, deviennent de plus en plus des oprations dlicates et d'un succs incertain. C'est qu'aujourd'hui arracher une province un pays, c'est retrancher un ou plusieurs organes d'un organisme. La vie de la rgion annexe est profondment trouble, spare qu'elle est des organes essentiels dont elle dpendait ; or, de telles mutilations et de tels troubles dterminent ncessairement des douleurs durables dont le souvenir ne s'efface pas. Mme pour l'individu isol, ce n'est pas chose aise de changer de nationalit, malgr la similitude plus grande des diffrentes civilisations 2. L'exprience inverse ne serait pas moins dmonstrative. Plus la solidarit est faible, c'est--dire plus la trame sociale est relche, plus aussi il doit tre facile aux lments trangers d'tre incorpors dans les socits. Or, chez les peuples infrieurs, la naturalisation est l'opration la plus simple du monde. Chez les Indiens de l'Amrique du Nord, tout membre du clan a le droit d'y introduire de nouveaux membres par vole d'adoption. Les captifs pris la guerre ou sont mis mort, ou sont adopts dans le clan. Les femmes et les enfants faits prisonniers sont rgulirement l'objet de la clmence. L'adoption ne confre pas seulement les droits de la gentilit (droits du clan), mais encore la nationalit de la tribu 3. On sait avec quelle facilit Rome, l'origine, accorda le droit de cit aux gens sans asile et aux peuples qu'elle conquit 4. C'est d'ailleurs par des incorporations de ce genre que se sont accrues les socits primitives. Pour qu'elles fussent aussi pntrables, il fallait qu'elles n'eussent pas de leur unit et de leur personnalit un sentiment trs fort 5. Le phnomne contraire s'observe l o les fonctions sont spcialises. L'tranger, sans doute, peut bien s'introduire provisoirement dans la socit, mais l'opration par laquelle il est assimil, savoir la naturalisation, devient longue et complexe. Elle
1 2 3 4 5
Sociologie, 11, p. 54. On verra de mme, dans le chapitre VII, que le lien qui rattache l'individu sa famille est d'autant plus fort, plus difficile briser, que le travail domestique est plus divis. MORGAN, Ancient Society, p. 80. DENYS d'Halicar., I, 9. - Cf. ACCARIAS, Prcis de droit romain, I, 51. Ce fait n'est pas du tout inconciliable avec cet autre que, dans ces socits, l'tranger est un objet de rpulsion. Il inspire ces sentiments tant qu'il reste tranger. Ce que nous disons, c'est qu'il perd facilement cette qualit d'tranger pour tre nationalis.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
111
n'est plus possible sans un assentiment du groupe, solennellement manifest et subordonn des conditions spciales 1. On s'tonnera peut-tre qu'un lien qui attache l'individu la communaut au point de l'y absorber puisse se rompre ou se nouer avec cette facilit. Mais ce qui fait la rigidit d'un lien social n'est pas ce qui en fait la force de rsistance. De ce que les parties de l'agrgat, quand elles sont unies, ne se meuvent qu'ensemble, il ne suit pas qu'elles soient obliges ou de rester unies, ou de prir. Tout au contraire, comme elles n'ont pas besoin les unes des autres, comme chacun porte en soi tout ce qui fait la vie sociale, il peut aller la transporter ailleurs, d'autant plus aisment que ces scessions se font gnralement par bandes ; car l'individu est alors constitu de telle sorte qu'il ne peut se mouvoir qu'en groupe, mme pour se sparer de son groupe. De son ct, la socit exige bien de chacun de ses membres, tant qu'ils en font partie, l'uniformit des croyances et des pratiques ; mais, comme elle peut perdre un certain nombre de ses sujets sans que l'conomie de sa vie intrieure en soit trouble, parce que le travail social y est peu divis, elle ne s'oppose pas fortement ces diminutions. De mme, l o la solidarit ne drive que des ressemblances, quiconque ne s'carte pas trop du type collectif est, sans rsistance, incorpor dans l'agrgat. Il n'y a pas de raisons pour le repousser, et mme, s'il y a des places vides, il y a des raisons pour l'attirer. Mais, l o la socit forme un systme de parties diffrencies et qui se compltent mutuellement, des lments nouveaux ne peuvent se greffer sur les anciens sans troubler ce concert, sans altrer ces rapports, et, par suite, l'organisme rsiste des intrusions qui ne peuvent pas se produire sans perturbations.
II
Non seulement, d'une manire gnrale, la solidarit mcanique lie moins fortement les hommes que la solidarit organique, mais encore, mesure qu'on avance dans l'volution sociale, elle va de plus en plus en se relchant. En effet, la force des liens sociaux qui ont cette origine varie en fonction des trois conditions suivantes : 1 Le rapport entre le volume de la conscience commune et celui de la conscience individuelle. Ils ont d'autant plus d'nergie que la premire recouvre plus compltement la seconde. 2 L'intensit moyenne des tats de la conscience collective. Le rapport des volumes suppos gal, elle a d'autant plus d'action sur l'individu qu'elle a plus de vitalit. Si, au contraire, elle n'est faite que d'impulsions faibles, elle ne l'entrane que faiblement dans le sens collectif. Il aura donc d'autant plus de facilit pour suivre son sens propre, et la solidarit sera moins forte.
On verra de mme, dans le chapitre VII, que les intrusions d'trangers dans la socit familiale sont d'autant plus faciles que le travail domestique est moins divis.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
112
3 La dtermination plus ou moins grande de ces mmes tats. En effet, plus les croyances et les pratiques sont dfinies, moins elles laissent de place aux divergences individuelles. Ce sont des moules uniformes dans lesquels nous coulons tous uniformment nos ides et nos actions ; le consensus est donc aussi parfait que possible ; toutes les consciences vibrent l'unisson. Inversement, plus les rgles de la conduite et celles de la pense sont gnrales et indtermines, plus la rflexion individuelle doit intervenir pour les appliquer aux cas particuliers. Or, elle ne peut s'veiller sans que les dissidences clatent ; car, comme elle varie d'un homme l'autre en qualit et en quantit, tout ce qu'elle produit a le mme caractre. Les tendances centrifuges vont donc en se multipliant aux dpens de la cohsion sociale et de l'harmonie des mouvements. D'autre part, les tats forts et dfinis de la conscience commune sont des racines du droit pnal. Or, nous allons voir que le nombre de ces dernires est moindre aujourd'hui qu'autrefois, et qu'il diminue progressivement mesure que les socits se rapprochent de notre type actuel. C'est donc que l'intensit moyenne et le degr moyen de dtermination des tats collectifs ont eux-mmes diminu. De ce fait, il est vrai, nous ne pouvons pas conclure que l'tendue totale de la conscience commune se soit rtrcie ; car il peut se faire que la rgion laquelle correspond le droit pnal se soit contracte et que le reste, au contraire, se soit dilat. Il peut y avoir moins d'tats forts et dfinis, et en revanche un plus grand nombre d'autres. Mais cet accroissement, s'il est rel, est tout au plus l'quivalent de celui qui s'est produit dans la conscience individuelle ; car celle-ci s'est, pour le moins, agrandie dans les mmes proportions. S'il y a plus de choses communes tous, il y en a aussi beaucoup plus qui sont personnelles chacun. Il y a mme tout lieu de croire que les dernires ont augment plus que les autres, car les dissemblances entre les hommes sont devenues plus prononces mesure qu'ils se sont cultivs. Nous venons de voir que les activits spciales se sont plus dveloppes que la conscience commune ; il est donc pour le moins probable que, dans chaque conscience particulire, la sphre personnelle s'est beaucoup plus agrandie que l'autre. En tout cas, le rapport entre elles est tout au plus rest le mme ; par consquent, de ce point de vue la solidarit mcanique n'a rien gagn, si tant est qu'elle n'ait rien perdu. Si donc, d'un autre ct, nous tablissons que la conscience collective est devenue plus faible et plus vague, nous pourrons tre assurs qu'il y a un affaiblissement de cette solidarit, puisque, des trois conditions dont dpend sa puissance d'action, deux au moins perdent de leur intensit, la troisime restant sans changement. Pour faire cette dmonstration, il ne nous servirait rien de comparer le nombre des rgles sanction rpressive dans les diffrents types sociaux, car il ne varie pas exactement comme celui des sentiments qu'elles reprsentent. Un mme sentiment peut, en effet, tre froiss de plusieurs manires diffrentes et donner ainsi naissance plusieurs rgles sans se diversifier pour cela. Parce qu'il y a maintenant plus de manires d'acqurir la proprit, il y a aussi plus de manires de voler ; mais le sentiment du respect de la proprit d'autrui ne s'est pas multipli pour autant. Parce que la personnalit individuelle s'est dveloppe et comprend plus d'lments, il y a plus d'attentats possibles contre elle ; mais le sentiment qu'ils offensent est toujours le mme. Il nous faut donc, non pas nombrer les rgles, mais les grouper en classes et en sous-classes, suivant qu'elles se rapportent au mme sentiment ou des sentiments diffrents, ou des varits diffrentes d'un mme sentiment. Nous constituerons ainsi les types criminologiques et leurs varits essentielles, dont le nombre est ncessairement gal celui des tats forts et dfinis de la conscience commune. Plus ceux-ci sont nombreux, plus aussi il doit y avoir d'espces criminelles, et, par
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
113
consquent, les variations des unes refltent exactement celles des autres. Pour fixer les ides, nous avons runi dans le tableau suivant les principaux de ces types et les principales de ces varits qui ont t reconnus dans les diffrentes sortes de socits. Il est bien vident qu'une telle classification ne saurait tre ni trs complte, ni parfaitement rigoureuse ; cependant, pour la conclusion que nous voulons en tirer, elle est d'une trs suffisante exactitude. En effet, elle comprend certainement tous les types criminologiques actuels ; nous risquons seulement d'avoir omis quelques-uns de ceux qui ont disparu. Mais comme nous voulons justement dmontrer que le nombre en a diminu, ces omissions ne seraient qu'un argument de plus l'appui de notre proposition.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
114
Rgles prohibant des actes contraires des sentiments collectifs I AYANT DES OBJETS GNRAUX
Positifs (Imposant la pratique de la religion). Sentiments religieux Relatifs aux croyances touchant le divin. Relatifs au culte. Relatifs aux organes du culte. Sanctuaire. Prtres.
Ngatifs 1
Sentiments nationaux
Positifs (Obligations civiques positives). Ngatifs (Trahison, guerre civile, etc.). Paternels et filiaux. Conjugaux. De parent en gnral. Ngatifs. - Les mmes. Positifs Inceste. Sodomie. Msalliances.
Sentiments domestiques
Unions prohibes Sentiments relatifs aux rapports sexuels Prostitution. Pudeur publique. Pudeur des mineurs.
Sentiments relatifs au travail
Mendicit. Vagabondage. Ivresse 2. Rglementation pnale du travail. Relatifs certains usages professionnels. Relatifs la spulture. Relatifs la nourriture. Relatifs au costume. Relatifs au crmonial. Relatifs des usages de toutes sortes.
Sentiments traditionnels divers
Les sentiments que nous appelons positifs sont ceux qui imposent des actes positifs, comme la pratique de la foi ; les sentiments ngatifs n'imposent que l'abstention. Il n'y a donc entre eux que des diffrences de degrs. Elles sont pourtant importantes, car elles marquent deux moments de leur dveloppement. Il est probable que d'autres mobiles interviennent dans notre rprobation de l'ivresse, notamment le dgot qu'inspire l'tat de dgradation o se trouve naturellement l'homme ivre.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
115
En tant qu'ils sont offenss directement Sentiments relatifs l'organe de la conscience commune
Lse-majest. Complots contre le pouvoir lgitime. Outrages, violences contre l'autorit. - Rbellion. Empitement des particuliers sur les fonctions publiques. Usurpation. - Faux publics. Forfaitures des fonctionnaires et diverses fautes professionnelles. Fraudes au dtriment de l'tat. Dsobissances de toutes sortes (contraventions administratives).
Indirectement 1
II AYANT DES OBJETS INDIVIDUELS
Meurtres, blessures. - Suicide. Sentiments relatifs la personne de l'individu Libert individuelle L'honneur Aux choses de l'individu Physique. Morale (Pression dans l'exercice des droits civiques). Injures, calomnies. Faux tmoignages.
Vols. - Escroquerie, abus de confiance. Fraudes diverses. Faux-monnayage. - Banqueroute. Incendie. Brigandage. - Pillage. Sant publique.
Sentiments relatifs une gnralit d'individus, soit dans leurs personnes, soit dans leurs biens.
Nous rangeons sous cette rubrique les actes qui doivent leur caractre criminel au pouvoir de raction propre l'organe de la conscience commune, du moins en partie. Une sparation exacte entre ces deux sous-classes est d'ailleurs bien difficile faire.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
116
III
Il suffit de jeter un coup d'il sur ce tableau pour reconnatre qu'un grand nombre de types criminologiques se sont progressivement dissous. Aujourd'hui, la rglementation de la vie domestique presque tout entire a perdu tout caractre pnal. Il n'en faut excepter que la prohibition de l'adultre et celle de la bigamie. Encore l'adultre occupe-t-il dans la liste de nos crimes une place tout fait exceptionnelle, puisque le mari a le droit d'exempter de la peine la femme condamne. Quant aux devoirs des autres membres de la famille, ils n'ont plus de sanction rpressive. Il n'en tait pas de mme autrefois. Le dcalogue fait de la pit filiale une obligation sociale. Aussi le fait de frapper ses parents 1 ou de les maudire 2, ou de dsobir au pre 3, tait-il puni de mort. Dans la cit athnienne qui, tout en appartenant au mme type que la cit romaine, en reprsente cependant une varit plus primitive, la lgislation sur ce point avait le mme caractre. Les manquements aux devoirs de famille donnaient ouverture une plainte spciale, la [en grec dans le texte] Ceux qui maltraitaient ou insultaient leurs parents ou leurs ascendants, qui ne leur fournissaient pas les moyens d'existence dont ils avaient besoin, qui ne leur procuraient pas des funrailles en rapport avec la dignit de leurs familles... pouvaient tre poursuivis par la [en grec dans le texte] 4. Les devoirs des parents envers l'orphelin ou l'orpheline taient sanctionns par des actions du mme genre. Cependant, les peines sensiblement moindres qui frappaient ces dlits tmoignent que les sentiments correspondants n'avaient pas Athnes la mme force ou la mme dtermination qu'en Jude 5. A Home enfin, une rgression nouvelle et encore plus accuse se manifeste. Les seules obligations de famille que consacre la loi pnale sont celles qui lient le client au patron et rciproquement 6. Quant aux autres fautes domestiques, elles ne sont plus punies que disciplinairement par le pre de famille. Sans doute, l'autorit dont il dispose lui permet de les rprimer svrement; mais, quand il use ainsi de son pouvoir, ce n'est pas comme fonctionnaire publie, comme magistrat charg de faire respecter dans sa maison la loi gnrale de l'tat, c'est comme particulier qu'il agit 7. Ces sortes d'infractions tendent donc devenir des affaires purement prives dont la
1 2 3 4 5 6
Exode, XXI, 17. - Cf. Deutr., XXVII, 16. Exode, XXI, 15. Ibid., XXI, 18-21. THONISSEN, Droit pnal de la Rpublique athnienne, p. 288. La peine n'tait pas dtermine, mais semble avoir consist dans la dgradation (Voir THONISSEN, op. cit., p. 291). Patronus, si clienti fraudem fecerit, sacer esto, dit la loi des XII Tables. - A l'origine de la cit, le droit pnal tait moins tranger la vie domestique. Une lex regia, que la tradition fait remonter Romulus, maudissait l'enfant qui avait exerc des svices contre ses parents (FESTUS, p. 230, s. v. Plorare). Voir VOIGT, XII Tafeln, II, 273.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
117
socit se dsintresse. C'est ainsi que, peu peu, les sentiments domestiques sont sortis de la partie centrale de la conscience commune 1. Telle a t l'volution des sentiments relatifs aux rapports des sexes. Dans le Pentateuque, les attentats contre les murs occupent une place considrable. Une multitude d'actes sont traits comme des crimes que notre lgislation ne rprime plus : la corruption de la fiance (Deutronome, XXII, 23-27), l'union avec une esclave (Lvitique, XIX, 20-22), la fraude de la jeune fille dflore qui se prsente comme vierge au mariage (Deutronome, XXII, 13-21), la sodomie (Lvitique, XVIII, 22), la bestialit (Exode, XXII, 19), la prostitution (Lvitique, XIX, 29) et plus spcialement la prostitution des filles de prtres (ibid., XXI, 19), l'inceste, et le Lvitique (ch. XVII) ne compte pas moins de dix-sept cas d'inceste. Tous ces crimes sont, de plus, frapps de peines trs svres : pour la plupart, c'est la mort. Ils sont dj moins nombreux dans le droit athnien, qui ne rprime plus que la pdrastie salarie, le proxntisme, le commerce avec une citoyenne honnte en dehors du mariage, enfin l'inceste, quoique nous soyons mal renseigns sur les caractres constitutifs de l'acte incestueux. Les peines taient aussi gnralement moins leves. Dans la cit romaine, la situation est peu prs la mme, quoique toute cette partie de la lgislation y soit plus indtermine : on dirait qu'elle perd de son relief. La pdrastie, dans la cit primitive, dit Rein, sans tre prvue par la loi, tait punie par le peuple, les censeurs ou le pre de famille, de mort, d'amende ou d'infamie 2. Il en tait peu prs de mme du stuprum ou commerce illgitime avec une matrone. Le pre avait le droit de punir sa fille ; le peuple punissait d'une amende ou d'exil le mme crime sur la plainte des diles 3. Il semble bien que la rpression de ces dlits soit en partie dj chose domestique et prive. Enfin, aujourd'hui, ces sentiments n'ont plus d'cho dans le droit pnal que dans deux cas : quand ils sont offenss publiquement ou dans la personne d'un mineur, incapable de se dfendre 4. La classe des rgles pnales que nous avons dsignes sous la rubrique traditions diverses reprsente en ralit une multitude de types criminologiques distincts, correspondant des sentiments collectifs diffrents. Or, ils ont tous, ou presque tous, progressivement disparu. Dans les socits simples, o la tradition est toute-puissante et o presque tout est en commun, les usages les plus purils deviennent par la force de l'habitude des devoirs impratifs. Au Tonkin, il y a une foule de manquements aux convenances qui sont plus svrement rprims que de graves attentats contre la socit 5. En Chine, on punit le mdecin qui n'a pas rgulirement rdig son ordonnance 6. Le Pentateuque est rempli de prescriptions du mme genre. Sans parler d'un trs grand nombre de pratiques semi-religieuses dont l'origine est videmment
1
2 3 4 5 6
On s'tonnera peut-tre que l'on puisse parler d'une rgression des sentiments domestiques Rome, le lieu d'lection de la famille patriarcale. Nous ne pouvons que constater les faits ; ce qui les explique, c'est que la formation de la famille patriarcale a eu pour effet de retirer de la vie publique une foule d'lments, de constituer une sphre d'action prive, une sorte de for intrieur. Une source de variations s'est ainsi ouverte qui n'existait pas jusque-l. Du jour o la vie de famille s'est soustraite l'action sociale pour se renfermer dans la maison, elle a vari de maison en maison, et les sentiments domestiques ont perdu de leur uniformit et de leur dtermination. Criminalrecht der Rmer, p. 865. Ibid., p. 869. Nous ne rangeons sous cette rubrique ni le rapt, ni le viol, o il entre d'autres lments. Ce sont des actes de violence plus que d'impudeur. POST, Bausteine, 1, p. 226. POST, ibid. - Il en tait de mme dans l'ancienne gypte (Voir THONISSEN, tudes sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, 1, 149).
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
118
historique et dont toute la force vient de la tradition, l'alimentation 1, le costume 2, mille dtails de la vie conomique y sont soumis une rglementation trs tendue 3. Il en tait encore de mme, jusqu' un certain point, dans les cits grecques. L'tat, dit M. Fustel de Coulanges, exerait sa tyrannie jusque dans les plus petites choses. A Locres, la loi dfendait aux hommes de boire du vin pur. Il tait ordinaire que le costume ft fix invariablement par les lois de chaque cit ; la lgislation de Sparte rglait la coiffure des femmes, et celle d'Athnes leur interdisait d'emporter en voyage plus de trois robes. A Rhodes, la loi dfendait de se raser la barbe ; Byzance, elle punissait d'une amende celui qui possdait chez soi un rasoir ; Sparte, au contraire, elle exigeait qu'on se rast la moustache 4. Mais le nombre de ces dlits est dj bien moindre; Rome, on n'en cite gure en dehors de quelques prescriptions somptuaires relatives aux femmes. De nos jours, il serait, croyons-nous, malais d'en dcouvrir dans notre droit. Mais la perte de beaucoup la plus importante qu'ait faite le droit pnal est celle qui est due la disparition totale ou presque totale des crimes religieux. Voil donc tout un monde de sentiments qui a cess de compter parmi les tats forts et dfinis de la conscience commune. Sans doute, quand on se contente de comparer notre lgislation sur cette matire avec celle des types sociaux infrieurs pris en bloc, cette rgression parat tellement marque qu'on se prend douter qu'elle soit normale et durable. Mais, quand on suit de prs le dveloppement des faits, on constate que cette limination a t rgulirement progressive. On la voit devenir de plus en plus complte mesure qu'on s'lve d'un type social l'autre, et par consquent il est impossible qu'elle soit due un accident provisoire et fortuit. On ne saurait numrer tous les crimes religieux que le Pentateuque distingue et rprime. L'Hbreu devait obir tous les commandements de la Loi sous la peine du retranchement. Celui qui aura viol la Loi la main leve, sera extermin du milieu de mon peuple 5. A ce titre, il n'tait pas seulement tenu de ne rien faire qui ft dfendu, mais encore de faire tout ce qui tait ordonn, de se faire circoncire soi et les siens, de clbrer le sabbat, les ftes, etc. Nous n'avons pas rappeler combien ces prescriptions sont nombreuses et de quelles peines terribles elles sont sanctionnes. A Athnes, la place de la criminalit religieuse tait encore trs grande; il y avait une accusation spciale, la [en grec dans le texte], destine poursuivre les attentats contre la religion nationale. La sphre en tait certainement trs tendue. Suivant toutes les apparences, le droit attique n'avait pas dfini nettement les crimes et les dlits qui devaient tre qualifis d'[en grec dans le texte], de telle sorte qu'une large place tait laisse l'apprciation du juge 6. Cependant, la liste en tait certainement moins longue que dans le droit hbraque. De plus, ce sont tous ou presque tous des dlits d'action, non d'abstention. Les principaux que l'on cite sont en effet les suivants : la ngation des croyances relatives aux dieux, leur existence, leur rle dans les affaires humaines ; la profanation des ftes, des sacrifices, des jeux, des temples et des autels ; la violation du droit d'asile, les manquements aux devoirs
1 2 3 4 5 6
Deutr., XIV, 3 et suiv. Ibid., XXII, 5, 11, 12 et XIV, 1. Tu ne planteras point ta vigne de diverses sortes de plants (ibid., XXII, 9). - Tu ne laboureras pas avec un ne et un buf accoupls (ibid., 10). Cit antique, p. 266. Nombres, XV, 30. MEIER et SCHOEMANN, Der attische Process, 2e d., Berlin, 1863, p. 367.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
119
envers les morts, l'omission ou l'altration des pratiques rituelles par le prtre, le fait d'initier le vulgaire au secret des mystres, de draciner les oliviers sacrs, la frquentation des temples par les personnes auxquelles l'accs en est interdit 1. Le crime consistait donc, non ne pas clbrer le culte, mais le troubler par des actes positifs ou par des paroles 2. Enfin, il n'est pas prouv que l'introduction de divinits nouvelles et rgulirement besoin d'tre autorise et ft traite d'impit, quoique l'lasticit naturelle de cette accusation et permis parfois de l'intenter dans ce cas 3. Il est vident d'ailleurs que la conscience religieuse devait tre moins intolrante dans la patrie des sophistes et de Socrate que dans une socit thocratique comme tait le peuple hbreu. Pour que la philosophie ait pu y natre et s'y dvelopper, il a fallu que les croyances traditionnelles ne fussent pas assez fortes pour en empcher l'closion. A Rome, elles psent d'un poids moins lourd encore sur les consciences individuelles. M. Fustel de Coulanges a justement insist sur le caractre religieux de la socit romaine ; mais, compar aux peuples antrieurs, l'tat romain tait beaucoup moins pntr de religiosit 4. Les fonctions politiques, spares trs tt des fonctions religieuses, se les subordonnrent. Grce cette prpondrance du principe politique et au caractre politique de la religion romaine, l'tat ne prtait la religion son appui qu'autant que les attentats dirigs contre elle le menaaient indirectement. Les croyances religieuses d'tats trangers ou d'trangers vivant dans l'Empire romain taient tolres, si elles se renfermaient dans leurs limites et ne touchaient pas de trop prs l'tat 5. Mais l'tat intervenait si des citoyens se tournaient vers des divinits trangres, et, par l, nuisaient la religion nationale. Toutefois, ce point tait trait moins comme une question de droit que comme un intrt de haute administration, et l'on intervint contre ces actes, suivant l'exigence des circonstances, par des dits d'avertissement et de prohibition ou par des chtiments allant jusqu' la mort 6. Les procs religieux n'ont certainement pas eu autant d'importance dans la justice criminelle de Rome que dans celle d'Athnes. Nous n'y trouvons aucune institution juridique qui rappelle la [en grec dans le texte], Non seulement les crimes contre la religion sont plus nettement dtermins et sont moins nombreux, mais beaucoup d'entre eux ont baiss d'un ou de plusieurs degrs. Les Romains, en effet, ne les mettaient pas tous sur le mme pied, mais distinguaient les scelera expiabilia des scelera inexpiabilia. Les premiers ne ncessitaient qu'une expiation qui consistait dans un sacrifice offert aux dieux 7. Sans doute, ce sacrifice tait une peine en ce sens que l'tat en pouvait exiger l'accomplissement, parce que la tache dont s'tait souill le coupable contaminait la socit et risquait d'attirer sur elle la colre des dieux. Cependant, c'est une peine d'un tout autre caractre que la mort, la confiscation, l'exil, etc. Or, ces fautes si aisment rmissibles taient de celles que le droit athnien rprimait avec la plus grande svrit. C'taient, en effet :
1 2
3 4 5 6 7
Nous reproduisons cette liste d'aprs MEIER et SCHMANN, Op. cit., p. 368. - Cf. THONISSEN, Op. cit., Chap. II. M. Fustel de Coulanges dit, il est vrai, que d'aprs un texte de POLLUX (VIII, 46), la clbration des ftes tait obligatoire. Mais le texte cit parle d'une profanation positive et non d'une abstention. MEIER et SCHMANN, Op. cit., 369. - Cf. Dictionnaire des Antiquits, art. Asebeia . M. Fustel reconnat lui-mme que ce caractre tait beaucoup plus marqu dans la cit athnienne (La cit, chap. XVIII, dernires lignes). REIN, Op. cit., pp. 887-88. WALTER, Op. cit., 804. MARQUARDT, Rmische Staatsverfassung, 2e d., t. III, p. 185.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
120
1 La profanation de tout locus sacer; 2 La profanation de tout locus religiosus 3 Le divorce en cas de mariage per confarreationem 4 La vente d'un fils issu d'un tel mariage ; 5 L'exposition d'un mort aux rayons du soleil 6 L'accomplissement sans mauvaise intention de l'un quelconque des scelera inexpiabilia. A Athnes, la profanation des temples, le moindre trouble apport aux crmonies religieuses, parfois mme la moindre infraction au rituel 1 taient punis du dernier supplice. A Rome, il n'y avait de vritables peines que contre les attentats qui taient la fois trs graves et intentionnels. Les seuls scelera inexpiabilia taient en effet les suivants : 1 Tout manquement intentionnel au devoir des fonctionnaires de prendre les auspices ou d'accomplir les sacra, ou bien encore leur profanation ; 2 Le fait pour un magistrat d'accomplir une legis actio un jour nfaste, et cela intentionnellement ; 3 La profanation intentionnelle des feriae par des actes interdits en pareil cas ; 4 L'inceste commis par une vestale ou avec une vestale 2. On a souvent reproch au christianisme son intolrance. Cependant, il ralisait ce point de vue un progrs considrable sur les religions antrieures. La conscience religieuse des socits chrtiennes, mme l'poque o la foi est son maximum, ne dtermine de raction pnale que quand on s'insurge contre elle par quelque action d'clat, quand on la nie et qu'on l'attaque en face. Spare de la vie temporelle beaucoup plus compltement qu'elle n'tait mme Rome, elle ne peut plus s'imposer avec la mme autorit et doit se renfermer davantage dans une attitude dfensive. Elle ne rclame plus de rpression pour des infractions de dtail comme celles que nous rappelions tout l'heure, mais seulement quand elle est menace dans quelqu'un de ses principes fondamentaux ; et le nombre n'en est pas trs grand, car la foi, en se spiritualisant, en devenant plus gnrale et plus abstraite, s'est, du mme coup, simplifie. Le sacrilge, dont le blasphme n'est qu'une varit, l'hrsie sous ses diffrentes formes sont dsormais les seuls crimes religieux 3. La liste continue donc diminuer, tmoignant ainsi que les sentiments forts et dfinis deviennent eux-mmes
1 2
Voir des faits l'appui dans THONISSEN, Op. cit., p. 187. D'aprs VOIGT, XII Tafeln, 1, pp. 450-455. - Cf. MARQUARDT, Rmische Alterthmer, VI, 248. - Nous laissons de ct un ou deux scelera qui avaient un caractre laque en mme temps que religieux, et nous ne comptons comme tels que ceux qui sont des offenses directes contre les choses divines. Du Boys, op. cit., VI, p. 62 et suiv. - Encore faut-il remarquer que la svrit contre les crimes religieux a t trs tardive. Au Xe sicle, le sacrilge est encore rachet moyennant une composition de 30 livres d'argent (Du Boys, v, 231). C'est une ordonnance de 1226 qui, pour la premire fois, sanctionne la peine de mort contre les hrtiques. On peut donc croire que le renforcement des peines contre ces crimes est un phnomne anormal, d des circonstances exceptionnelles, et que n'impliquait pas le dveloppement normal du christianisme.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
121
moins nombreux. Comment, d'ailleurs, peut-il en tre autrement ? Tout le monde reconnat que la religion chrtienne est la plus idaliste qui ait jamais exist. C'est donc qu'elle est faite d'articles de foi trs larges et trs gnraux beaucoup plus que de croyances particulires et de pratiques dtermines. Voil comment il se fait que l'veil de la libre pense au sein du christianisme a t relativement prcoce. Ds l'origine, des coles diffrentes se fondent et mme des sectes opposes. A peine les socits chrtiennes commencent-elles s'organiser au moyen ge qu'apparat la scolastique, premier effort mthodique de la libre rflexion, premire source de dissidences. Les droits de la discussion sont reconnus en principe. Il n'est pas ncessaire de dmontrer que le mouvement n'a fait depuis que s'accentuer. C'est ainsi que la criminalit religieuse a fini par sortir compltement ou presque compltement du droit pnal.
IV
Voil donc nombre de varits criminologiques qui ont progressivement disparu et sans compensation, car il ne s'en est pas constitu qui fussent absolument nouvelles. Si nous prohibons la mendicit, Athnes punissait l'oisivet 1. Il n'est pas de socit o les attentats dirigs contre les sentiments nationaux ou contre les institutions nationales aient jamais t tolrs ; la rpression semble mme en avoir t plus svre autrefois et, par consquent, il y a lieu de croire que les sentiments correspondants se sont affaiblis. Le crime de lse-majest, si fertile jadis en applications, tend de plus en plus disparatre. Cependant, on a dit parfois que les crimes contre la personne individuelle n'taient pas reconnus chez les peuples infrieurs, que le vol et le meurtre y taient mme honors. M. Lombroso a essay rcemment de reprendre cette thse. Il a soutenu que le crime, chez le sauvage, n'est pas une exception, mais la rgle gnrale... qu'il n'y est considr par personne comme un crime 2 . Mais, l'appui de cette affirmation, il ne cite que quelques faits rares et quivoques qu'il interprte sans critique. C'est ainsi qu'il en est rduit identifier le vol avec la pratique du communisme ou avec le brigandage international 3. Or, de ce que la proprit est indivise entre tous les membres du groupe, il ne suit pas du tout que le droit au vol soit reconnu ; il ne peut mme y avoir vol que dans la mesure o il y a proprit 4. De mme, de ce qu'une socit ne trouve pas rvoltant le pillage aux dpens des nations voisines, on ne peut pas conclure qu'elle tolre les mmes pratiques dans ses relations intrieures et ne protge pas ses nationaux les uns contre les autres. Or, c'est
1 2 3 4
THONISSEN, op, cit., 363. L'homme criminel, tr. fr., p. 36. Mme chez les peuples civiliss, dit M. Lombroso l'appui de son dire, la proprit prive fut longue s'tablir. p. 36, in fine. Voil ce qu'il ne faut pas oublier pour juger de certaines ides des peuples primitifs sur le vol. L o le communisme est rcent, le lien entre la chose et la personne est encore faible, c'est--dire que le droit de l'individu sur la chose n'est pas aussi fort qu'aujourd'hui, ni, par suite, les attentats contre ce droit aussi graves. Ce n'est pas que le vol soit tolr pour autant ; il n'existe pas dans la mesure o la proprit prive n'existe pas.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
122
l'impunit du brigandage interne qu'il faudrait tablir. Il y a, il est vrai, un texte de Diodore et un autre d'Aulu-Gelle 1 qui pourraient faire croire qu'une telle licence a exist dans l'ancienne gypte. Mais ces textes sont contredits par tout ce que nous savons sur la civilisation gyptienne : Comment admettre, dit trs justement M. Thonissen, la tolrance du vol dans un pays o... les lois prononaient la peine de mort contre celui qui vivait de gains illicites ; o la simple altration d'un poids ou d'une mesure tait punie de la perte des deux mains 2 ? On peut chercher par voie de conjectures 3 reconstituer les faits que les crivains nous ont inexactement rapports, mais l'inexactitude de leur rcit n'est pas douteuse. Quant aux homicides dont parle M. Lombroso, ils sont toujours accomplis dans des circonstances exceptionnelles. Ce sont tantt des faits de guerre, tantt des sacrifices religieux ou le rsultat du pouvoir absolu qu'exerce soit un despote barbare sur ses sujets, soit un pre sur ses enfants. Or, ce qu'il faudrait dmontrer, c'est l'absence de toute rgle qui, en principe, proscrive le meurtre ; parmi ces exemples particulirement extraordinaires, il n'en est pas un qui comporte une telle conclusion. Le fait que, dans des conditions spciales, il est drog cette rgle, ne prouve pas qu'elle n'existe pas. Est-ce que, d'ailleurs, de pareilles exceptions ne se rencontrent pas mme dans nos socits contemporaines ? Est-ce que le gnral qui envoie un rgiment une mort certaine pour sauver le reste de l'arme agit autrement que le prtre qui immole une victime pour apaiser le dieu national ? Est-ce qu'on ne tue pas la guerre ? Est-ce que le mari qui met mort la femme adultre ne jouit pas, dans certains cas, d'une impunit relative, quand elle n'est pas absolue ? La sympathie dont meurtriers et voleurs sont parfois l'objet n'est pas plus dmonstrative. Les individus peuvent admirer le courage de l'homme sans que l'acte soit tolr en principe. Au reste, la conception qui sert de base cette doctrine est contradictoire dans les termes. Elle suppose, en effet, que les peuples primitifs sont destitus de toute moralit. Or, du moment que des hommes forment une socit, si rudimentaire qu'elle soit, il y a ncessairement des rgles qui prsident leurs relations et, par consquent, une morale qui, pour ne pas ressembler la ntre, n'en existe pas moins. D'autre part, s'il est une rgle commune toutes ces morales, c'est certainement celle qui prohibe les attentats contre la personne ; car des hommes qui se ressemblent ne peuvent vivre ensemble sans que chacun prouve pour ses semblables une sympathie qui s'oppose tout acte de nature les faire souffrir 4. Tout ce qu'il y a de vrai dans cette thorie, c'est d'abord que les lois protectrices de la personne laissaient autrefois en dehors de leur action une partie de la population, savoir les enfants et les esclaves. Ensuite, il est lgitime de croire que cette protection est assure maintenant avec un soin plus jaloux, et, par consquent, que les sentiments collectifs qui y correspondent sont devenus plus forts. Mais il n'y a dans ces deux faits rien qui infirme notre conclusion. Si tous les individus qui, un titre quelconque, font partie de la socit, sont aujourd'hui galement protgs, cet adoucissement des murs est d, non l'apparition d'une rgle pnale vraiment nouvelle, mais
1 2 3 4
DIODORE, 1, 39 ; AULU-GELLE, Noctes Attic, XI, 18. THONISSEN, tudes, etc., 1, 168. Les conjectures sont faciles (Voir THONISSEN et TARDE, Criminalit, p. 40). Cette proposition ne contredit pas cette autre, souvent nonce au cours de ce travail, que, ce moment de l'volution, la personnalit individuelle n'existe pas. Celle qui fait alors dfaut, c'est la personnalit psychique et surtout la personnalit psychique suprieure. Mais les individus ont toujours une vie organique distincte, et cela suffit pour donner naissance cette sympathie, quoiqu'elle devienne plus forte quand la personnalit est plus dveloppe.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
123
l'extension d'une rgle ancienne. Ds le principe, il tait dfendu d'attenter la vie des membres du groupe ; mais cette qualit tait refuse aux enfants et aux esclaves. Maintenant que nous ne faisons plus ces distinctions, des actes sont devenus punissables qui n'taient pas criminels. Mais c'est simplement parce qu'il y a plus de personnes dans la socit, et non parce qu'il y a plus de sentiments collectifs. Ce n'est pas eux qui se sont multiplis, mais l'objet auquel il se rapportent. Si pourtant il y a lieu d'admettre que le respect de la socit pour l'individu est devenu plus fort, il ne s'ensuit pas que la rgion centrale de la conscience commune se soit tendue. Il n'y est pas entr d'lments nouveaux, puisque de tout temps ce sentiment a exist et de tout temps a eu assez d'nergie pour ne pas tolrer qu'on le froisst. Le seul changement qui se soit produit, c'est qu'un lment ancien est devenu plus intense. Mais ce simple renforcement ne saurait compenser les pertes multiples et graves que nous avons constates. Ainsi, dans l'ensemble, la conscience commune compte de moins en moins de sentiments forts et dtermins ; c'est donc que l'intensit moyenne et le degr moyen de dtermination des tats collectifs vont toujours en diminuant, comme nous l'avions annonc. Mme l'accroissement trs restreint que nous venons d'observer ne fait que confirmer ce rsultat. Il est, en effet, trs remarquable que les seuls sentiments collectifs qui soient devenus plus intenses sont ceux qui ont pour objet, non des choses sociales, mais l'individu. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que la personnalit individuelle soit devenue un lment beaucoup plus important de la vie de la socit, et pour qu'elle ait pu acqurir cette importance, il ne suffit pas que la conscience personnelle de chacun se soit accrue en valeur absolue, mais encore qu'elle se soit accrue plus que la conscience commune. Il faut qu'elle se soit mancipe du joug de cette dernire, et, par consquent, que celle-ci ait perdu de l'empire et de l'action dterminante qu'elle exerait dans le principe. En effet, si le rapport entre ces deux termes tait rest le mme, si l'une et l'autre s'taient dveloppes en volume et en vitalit dans les mmes proportions, les sentiments collectifs qui se rapportent l'individu seraient, eux aussi, rests les mmes ; surtout ils ne seraient pas les seuls avoir grandi. Car ils dpendent uniquement de la valeur sociale du facteur individuel, et celle-ci, son tour, est dtermine, non par le dveloppement absolu de ce facteur, mais par l'tendue relative de la part qui lui revient dans l'ensemble des phnomnes sociaux.
On pourrait vrifier encore cette proposition en procdant d'aprs une mthode que nous ne ferons qu'indiquer brivement. Nous ne possdons pas actuellement de notion scientifique de ce que c'est que la religion ; pour l'obtenir, en effet, il faudrait avoir trait le problme par cette mme mthode comparative que nous avons applique la question du crime, et c'est une tentative qui n'a pas encore t faite. On a dit souvent que la religion tait, chaque moment de l'histoire, l'ensemble des croyances et des sentiments de toute sorte relatifs aux rapports de l'homme avec un tre ou des tres dont il regarde la nature comme suprieure la sienne. Mais une telle dfinition est manifestement inadquate. En
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
124
effet, il y a une multitude de rgles, soit de conduite, soit de pense, qui sont certainement religieuses et qui, pourtant, s'appliquent des rapports d'une tout autre sorte. La religion dfend au Juif de manger de certaines viandes, lui ordonne de s'habiller d'une manire dtermine ; elle impose telle ou telle opinion sur la nature de l'homme et des choses, sur les origines du monde ; elle rgle bien souvent les relations juridiques, morales, conomiques. Sa sphre d'action s'tend donc bien audel du commerce de l'homme avec le divin. On assure d'ailleurs qu'il existe au moins une religion sans dieu 1 ; il suffirait que ce seul fait ft bien tabli pour qu'on n'et plus le droit de dfinir la religion en fonction de l'ide de Dieu. Enfin, si l'autorit extraordinaire que le croyant prte la divinit peut rendre compte du prestige particulier de tout ce qui est religieux, il reste expliquer comment les hommes ont t conduits attribuer une telle autorit un tre qui, de l'aveu de tout le monde, est, dans bien des cas, sinon toujours, un produit de leur imagination. Rien ne vient de rien ; il faut donc que cette force qu'il a lui vienne de quelque part, et, par consquent, cette formule ne nous fait pas connatre l'essence du phnomne. Mais, cet lment cart, le seul caractre, semble-t-il, que prsentent galement toutes les ides comme tous les sentiments religieux, c'est qu'ils sont communs un certain nombre d'individus vivant ensemble, et qu'en outre ils ont une intensit moyenne assez leve. C'est, en effet, un fait constant que, quand une conviction un peu forte est partage par une mme communaut d'hommes, elle prend invitablement un caractre religieux ; elle inspire aux consciences le mme respect rvrentiel que les croyances proprement religieuses. Il est donc infiniment probable - ce bref expos ne saurait sans doute constituer une dmonstration rigoureuse - que la religion correspond une rgion galement trs centrale de la conscience commune. Il resterait, il est vrai, circonscrire cette rgion, la distinguer de celle qui correspond au droit pnal et avec laquelle, d'ailleurs, elle se confond souvent en totalit ou en partie. Ce sont des questions tudier, mais dont la solution n'intresse pas directement la conjecture trs vraisemblable que nous venons de faire. Or, s'il est une vrit que l'histoire a mise hors de doute, c'est que la religion embrasse une portion de plus en plus petite de la vie sociale. A l'origine, elle s'tend tout ; tout ce qui est social est religieux ; les deux mots sont synonymes. Puis, peu peu, les fonctions politiques, conomiques, scientifiques s'affranchissent de la fonction religieuse, se constituent part et prennent un caractre temporel de plus en plus accus. Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui tait d'abord prsent toutes les relations humaines, s'en retire progressivement; il abandonne le monde aux hommes et leurs disputes. Du moins, s'il continue le dominer, c'est de haut et de loin, et l'action qu'il exerce, devenant plus gnrale et plus indtermine, laisse plus de place au libre jeu des forces humaines. L'individu se sent donc, il est rellement moins agi ; il devient davantage une source d'activit spontane. En un mot, non seulement le domaine de la religion ne s'accrot pas en mme temps que celui de la vie temporelle et dans la mme mesure, mais il va de plus en plus en se rtrcissant. Cette rgression n'a pas commenc tel ou tel moment de l'histoire ; mais on peut en suivre les phases depuis les origines de l'volution sociale. Elle est donc lie aux conditions fondamentales du dveloppement des socits, et elle tmoigne ainsi qu'il y a un nombre toujours moindre de croyances et de sentiments collectifs qui sont et assez collectifs et assez forts pour prendre un caractre religieux. C'est dire que l'intensit moyenne de la conscience commune va elle-mme en s'affaiblissant.
Le Bouddhisme (voir article sur le Bouddhisme dans l'Encyclopdie des sciences religieuses).
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
125
Cette dmonstration a sur la prcdente un avantage : elle permet d'tablir que la mme loi de rgression s'applique l'lment reprsentatif de la conscience commune, tout comme l'lment affectif. A travers le droit pnal, nous ne pouvons atteindre que des phnomnes de sensibilit, tandis que la religion comprend, outre des sentiments, des ides et des doctrines. La diminution du nombre des proverbes, des adages, des dictons, etc., mesure que les socits se dveloppent, est une autre preuve que les reprsentations collectives vont, elles aussi, en s'indterminant. Chez les peuples primitifs, en effet, les formules de ce genre sont trs nombreuses. La plupart des races de l'ouest de l'Afrique, dit Ellis, possdent une abondante collection de proverbes, il y en a un au moins pour chaque circonstance de la vie, particularit qui leur est commune avec la plupart des peuples qui ont fait peu de progrs dans la civilisation 1. Les socits plus avances ne sont un peu fcondes ce point de vue que pendant les premiers temps de leur existence. Plus tard, non seulement il ne se produit pas de nouveaux proverbes, mais les anciens s'oblitrent peu peu, perdent leur acception propre pour finir mme par n'tre plus entendus du tout. Ce qui montre bien que c'est surtout dans les socits infrieures qu'ils trouvent leur terrain de prdilection, c'est qu'aujourd'hui ils ne parviennent se maintenir que dans les classes les moins leves 2. Or, un proverbe est l'expression condense d'une ide ou d'un sentiment collectifs, relatifs une catgorie dtermine d'objets. Il est mme impossible qu'il y ait des croyances ou des sentiments de cette nature sans qu'ils se fixent sous cette forme. Comme toute pense tend vers une expression qui lui soit adquate, si elle est commune un certain nombre d'individus, elle finit ncessairement par se renfermer dans une formule qui leur est galement commune. Toute fonction qui dure se fait un organe a son image. C'est donc tort que, pour expliquer la dcadence des proverbes, on a invoqu notre got raliste et notre humeur scientifique. Nous n'apportons pas dans le langage de la conversation un tel souci de la prcision ni un tel ddain des images ; tout au contraire, nous trouvons beaucoup de saveur aux vieux proverbes qui nous sont conservs. D'ailleurs, l'image n'est pas un lment inhrent du proverbe ; c'est un des moyens, mais non pas le seul, par lequel se condense la pense collective. Seulement, ces formules brves finissent par devenir trop troites pour contenir la diversit des sentiments individuels. Leur unit n'est plus en rapport avec les divergences qui se sont produites. Aussi ne parviennent-elles se maintenir qu'en prenant une signification plus gnrale, pour disparatre peu peu. L'organe s'atrophie parce que la fonction ne s'exerce plus, c'est-dire parce qu'il y a moins de reprsentations collectives assez dfinies pour s'enfermer dans une forme dtermine. Ainsi tout concourt prouver que l'volution de la conscience commune se fait dans le sens que nous avons indiqu. Trs vraisemblablement, elle progresse moins que les consciences individuelles ; en tout cas, elle devient plus faible et plus vague dans son ensemble. Le type collectif perd de son relief, les formes en sont plus abstraites et plus indcises. Sans doute, si cette dcadence tait, comme on est souvent port le croire, un produit original de notre civilisation la plus rcente et un vnement unique dans l'histoire des socits, on pourrait se demander si elle sera durable ; mais, en ralit, elle se poursuit d'une manire ininterrompue depuis les
1 2
The Ewe-Speaking Peoples of the Slave Coast, Londres, 1890, p. 258. Wilhelm BORCHARDT, Die Sprichwoertlichen Redensarten, Leipzig, 1888, XII. - Cf. voir Wyss, Die Sprichwoeerter bei den Rmischen Komikern, Zurich, 1889.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
126
temps les plus lointains. C'est ce que nous nous sommes attach dmontrer. L'individualisme, la libre pense ne datent ni de nos jours, ni de 1789, ni de la rforme, ni de la scolastique, ni de la chute du Polythisme grco-latin ou des thocraties orientales. C'est un phnomne qui ne commence nulle part, mais qui se dveloppe, sans s'arrter, tout le long de l'histoire. Assurment, ce dveloppement n'est pas rectiligne. Les socits nouvelles qui remplacent les types sociaux teints ne commencent jamais leur carrire au point prcis o ceux-ci ont cess la leur. Comment serait-ce possible ? Ce que l'enfant continue, ce n'est pas la vieillesse ou l'ge mr de ses parents, mais leur propre enfance. Si donc on veut se rendre compte du chemin parcouru, il faut ne considrer les socits successives qu' la mme poque de leur vie. Il faut, par exemple, comparer les socits chrtiennes du Moyen ge avec la Home primitive, celle-ci avec la cit grecque des origines, etc. On constate alors que ce progrs, ou, si l'on veut, cette rgression s'est accomplie, pour ainsi dire, sans solution de continuit. Il y a donc l une loi inluctable contre laquelle il serait absurde de s'insurger. Ce n'est pas dire, d'ailleurs, que la conscience commune soit menace de disparatre totalement. Seulement, elle consiste de plus en plus en des manires de penser et de sentir trs gnrales et trs indtermines, qui laissent la place libre une multitude croissante de dissidences individuelles. Il y a bien un endroit o elle s'est affermie et prcise, c'est celui par o elle regarde l'individu. A mesure que toutes les autres croyances et toutes les autres pratiques prennent un caractre de moins en moins religieux, l'individu devient l'objet d'une sorte de religion. Nous avons pour la dignit de la personne un culte qui, comme tout culte fort, a dj ses superstitions. C'est donc bien, si l'on veut, une foi commune ; mais, d'abord, elle n'est possible que par la ruine des autres, et par consquent ne saurait produire les mmes effets que cette multitude de croyances teintes. Il n'y a pas compensation. De plus, si elle est commune en tant qu'elle est partage par la communaut, elle est individuelle par son objet. Si elle tourne toutes les volonts vers une mme fin, cette fin n'est pas sociale. Elle a donc une situation tout fait exceptionnelle dans la conscience collective. C'est bien de la socit qu'elle tire tout ce qu'elle a de force, mais ce n'est pas la socit qu'elle nous attache : c'est nous-mmes. Par consquent, elle ne constitue pas un lien social vritable. C'est pourquoi on a pu justement reprocher aux thoriciens, qui ont fait de ce sentiment la base exclusive de leur doctrine morale, de dissoudre la socit. Nous pouvons donc conclure en disant que tous les liens sociaux qui rsultent de la similitude se dtendent progressivement. A elle seule, cette loi suffit dj montrer toute la grandeur du rle de la division du travail. En effet, puisque la solidarit mcanique va en s'affaiblissant, il faut ou que la vie proprement sociale diminue, ou qu'une autre solidarit vienne peu peu se substituer celle qui s'en va. Il faut choisir. En vain on soutient que la conscience collective s'tend et se fortifie en mme temps que celle des individus. Nous venons de prouver que ces deux termes varient en sens inverse l'un de l'autre. Cependant, le progrs social ne consiste pas en une dissolution continue ; tout au contraire, plus on s'avance, plus les socits ont un profond sentiment d'elles-mmes et de leur unit. Il faut donc bien qu'il y ait quelque autre lien social qui produise ce rsultat ; or, il ne peut pas y en avoir d'autre que celui qui drive de la division du travail. Si, de plus, on se rappelle que, mme l o elle est le plus rsistante, la solidarit mcanique ne lie pas les hommes avec la mme force que la division du travail, que, d'ailleurs, elle laisse en dehors de son action la majeure partie des phnomnes sociaux actuels, il deviendra plus vident encore que la solidarit sociale tend
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
127
devenir exclusivement organique. C'est la division du travail qui, de plus en plus, remplit le rle que remplissait autrefois la conscience commune ; c'est principalement elle qui fait tenir ensemble les agrgats sociaux des types suprieurs. Voil une fonction de la division du travail autrement importante que celle que lui reconnaissent d'ordinaire les conomistes.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
128
Chapitre VI
Prpondrance progressive de la solidarit organique et ses consquences (suite)
I
Retour la table des matires
C'est donc une loi de l'histoire que la solidarit mcanique, qui d'abord est seule ou peu prs, perde progressivement du terrain, et que la solidarit organique devienne peu peu prpondrante. Mais quand la manire dont les hommes sont solidaires se modifie, la structure des socits ne peut pas ne pas changer. La forme d'un corps se transforme ncessairement quand les affinits molculaires ne sont plus les mmes. Par consquent, si la proposition prcdente est exacte, il doit y avoir deux types sociaux qui correspondent ces deux sortes de solidarits. Si l'on essaye de constituer par la pense le type idal d'une socit dont la cohsion rsulterait exclusivement des ressemblances, on devra la concevoir comme une masse absolument homogne dont les parties ne se distingueraient pas les unes des autres, et par consquent ne seraient pas arranges entre elles, qui, en un mot, serait dpourvue et de toute forme dfinie et de toute organisation. Ce serait le vrai protoplasme social, le germe d'o seraient sortis tous les types sociaux. Nous proposons d'appeler horde l'agrgat ainsi caractris.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
129
Il est vrai que l'on n'a pas encore-, d'une manire tout fait authentique, observ de socits qui rpondissent de tous points ce signalement. Cependant, ce qui fait qu'on a le droit d'en postuler l'existence, c'est que les socits infrieures, celles par consquent qui sont le plus rapproches de ce stade primitif, sont formes par une simple rptition d'agrgats de ce genre. On trouve un modle presque parfaitement pur de cette organisation sociale chez les Indiens de l'Amrique du Nord. Chaque tribu iroquoise, par exemple, est forme d'un certain nombre de socits partielles (la plus volumineuse en comprend huit) qui prsentent tous les caractres que nous venons d'indiquer. Les adultes des deux sexes y sont les gaux les uns des autres. Les sachems et les chefs qui sont la tte de chacun de ces groupes, et dont le conseil administre les affaires communes de la tribu, ne jouissent d'aucune supriorit. La parent elle-mme n'est pas organise ; car on ne peut donner ce nom la distribution de la masse par couches de gnrations. A l'poque tardive o l'on observa ces peuples, il y avait bien quelques obligations spciales qui unissaient l'enfant ses parents maternels ; mais ses relations se rduisaient encore peu de chose et ne se distinguaient pas sensiblement de celles qu'il soutenait avec les autres membres de la socit. En principe, tous les individus du mme ge taient parents les uns des autres au mme degr 1. Dans d'autres cas, nous nous rapprochons mme davantage de la horde ; MM. Fison et Howitt dcrivent des tribus australiennes qui ne comprennent que deux de ces divisions 2. Nous donnons le nom de clan la horde qui a cess d'tre indpendante pour devenir l'lment d'un groupe plus tendu, et celui de socits segmentaires base de clans aux peuples qui sont constitus par une association de clans. Nous disons de ces socits qu'elles sont segmentaires, pour indiquer qu'elles sont formes par la rptition d'agrgats semblables entre eux, analogues aux anneaux de l'annel, et de cet agrgat lmentaire qu'il est un clan, parce que ce mot en exprime bien la nature mixte, la fois familiale et politique. C'est une famille, en ce sens que tous les membres qui la composent se considrent comme parents les uns des autres, et qu'en fait ils sont, pour la plupart, consanguins. Les affinits qu'engendre la communaut du sang sont principalement celles qui les tiennent unis. De plus, ils soutiennent les uns avec les autres des relations que l'on peut qualifier de domestiques, puisqu'on les retrouve ailleurs dans des socits dont le caractre familial n'est pas contest : je veux parler de la vindicte collective, de la responsabilit collective, et, ds que la proprit individuelle commence faire son apparition, de l'hrdit mutuelle. Mais, d'un autre ct, ce n'est pas une famille au sens propre du mot ; car, pour en faire partie, il n'est pas ncessaire d'avoir avec les autres membres du clan des rapports de consanguinit dfinis. Il suffit de prsenter un critre externe qui consiste gnralement dans le fait de porter un mme nom. Quoique ce signe soit cens dnoter une commune origine, un pareil tat civil constitue en ralit une preuve trs peu dmonstrative et trs facile imiter. Aussi le clan compte-t-il beaucoup d'trangers, c'est ce qui lui permet d'atteindre des dimensions que n'a jamais une famille proprement dite : il comprend trs souvent plusieurs milliers de personnes. D'ailleurs, c'est l'unit politique fondamentale les chefs de clans sont les seules autorits sociales 3.
1 2 3
MORGAN, Ancient Society, pp. 62-122. Kamilaroi and Kurnai. - Cet tat a, d'ailleurs, t celui par lequel ont pass l'origine les socits d'Indiens de l'Amrique (Voir MORGAN, op. cit.). Si, l'tat de puret, nous le croyons du moins, le clan forme une famille indivise, confuse, plus tard des familles particulires, distinctes les unes des autres, apparaissent sur le fond primitivement homogne. Mais cette apparition n'altre pas les traits essentiels de l'organisation
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
130
On pourrait donc aussi qualifier cette organisation de politico-familiale. Non seulement le clan a pour base la consanguinit, mais les diffrents clans d'un mme peuple se considrent trs souvent comme parents les uns des autres. Chez les Iroquois, ils se traitent, suivant les cas, de frres ou de cousins 1. Chez les Hbreux, qui prsentent, nous le verrons, les traits les plus caractristiques de la mme organisation sociale, l'anctre de chacun des clans qui composent la tribu est cens descendre du fondateur de cette dernire, qui est lui-mme regard comme un des fils du pre de la race. Mais cette dnomination a sur la prcdente l'inconvnient de ne pas mettre en relief ce qui fait la structure propre de ces socits. Mais, de quelque manire qu'on la dnomme, cette organisation, tout comme celle de la horde, dont elle n'est qu'un prolongement, ne comporte videmment pas d'autre solidarit que celle qui drive des similitudes, puisque la socit est forme de segments similaires et que ceux-ci, leur tour, ne renferment que des lments homognes. Sans doute, chaque clan a une physionomie propre, et par consquent se distingue des autres ; mais aussi la solidarit est d'autant plus faible qu'ils sont plus htrognes, et inversement. Pour que l'organisation segmentaire soit possible, il faut la fois que les segments se ressemblent, sans quoi ils ne seraient pas unis, et qu'ils diffrent, sans quoi ils se perdraient les uns dans les autres et s'effaceraient. Suivant les socits, ces deux ncessits contraires sont satisfaites dans des proportions diffrentes ; mais le type social reste le mme. Cette fois, nous sommes sortis du domaine de la prhistoire et des conjectures. Non seulement ce type social n'a rien d'hypothtique, mais il est presque le plus rpandu parmi les socits infrieures ; et on sait qu'elles sont les plus nombreuses. Nous avons dj vu qu'il tait gnral en Amrique et en Australie. Post le signale comme trs frquent chez les Ngres de l'Afrique 2 ; les Hbreux s'y sont attards, et les Kabyles ne l'ont pas dpass 3. Aussi Waitz, voulant caractriser d'une manire gnrale la structure de ces peuples, qu'il appelle des Naturvlker, en donne-t-il la peinture suivante o l'on retrouvera les lignes gnrales de l'organisation que nous venons de dcrire : En rgle gnrale, les familles vivent les unes ct des autres dans une grande indpendance et se dveloppent peu peu, de manire former de petites socits (lisez des clans) 4 qui n'ont pas de constitution dfinie tant que les luttes intrieures ou un danger extrieur, savoir la guerre, n'amnent pas un ou plusieurs hommes se dgager de la masse de la socit et mettre sa tte. Leur influence, qui repose uniquement sur des titres personnels, ne s'tend et ne dure que dans les limites marques par la confiance et la patience des autres. Tout adulte reste en face d'un tel chef dans un tat de parfaite indpendance : C'est pourquoi nous
1 2 3 4
sociale que nous dcrivons ; c'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'y arrter. Le clan reste l'unit politique, et, comme ces familles sont semblables et gales entre elles, la socit reste forme de segments similaires et homognes, quoique, au sein des segments primitifs, commencent se dessiner des segmentations nouvelles, mais du mme genre. MORGAN, Op. cit., p. 90. Afrikanische Jurisprudenz, I. Voir HANOTEAU et LETOURNEUX, La Kabylie et les coutumes kabyles, II, et MASQUERAY, Formation des cits chez les populations sdentaires de l'Algrie, Paris, 1886, chap. V. C'est par erreur que Waitz prsente le clan comme driv de la famille. C'est le contraire qui est la vrit. D'ailleurs, si cette description est importante cause de la comptence de l'auteur, elle manque un peu de prcision.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
131
voyons de tels peuples, sans autre organisation interne, ne tenir ensemble que par l'effet des circonstances extrieures et par suite de l'habitude de la vie commune 1. La disposition des clans l'intrieur de la socit et, par suite, la configuration de celle-ci peuvent, il est vrai, varier. Tantt ils sont simplement juxtaposs de manire former comme une srie linaire : c'est le cas dans beaucoup de tribus indiennes de l'Amrique du Nord 2. Tantt - et c'est la marque d'une organisation plus leve chacun d'eux est embot dans un groupe plus vaste qui, form par la runion de plusieurs clans, a une vie propre et un nom spcial ; chacun de ces groupes, son tour, peut tre embot avec plusieurs autres dans un autre agrgat encore plus tendu, et c'est de cette srie d'embotements successifs que rsulte l'unit de la socit totale. Ainsi, chez les Kabyles, l'unit politique est le clan, fix sous forme de village (djemmaa ou thaddart) ; plusieurs djemmaa forment une tribu (arch'), et plusieurs tribus forment la confdration (thak'ebilt), la plus haute socit politique que connaissent les Kabyles. De mme chez les Hbreux, le clan, c'est ce que les traducteurs appellent assez improprement la famille, vaste socit qui renfermait des milliers de personnes, descendues, d'aprs la tradition, d'un mme anctre 3. Un certain nombre de familles composait la tribu, et la runion des douze tribus formait l'ensemble du peuple hbreu. Ces socits sont si bien le lieu d'lection de la solidarit mcanique que c'est d'elle que drivent leurs principaux caractres physiologiques. Nous savons que la religion y pntre toute la vie sociale, mais c'est parce que la vie sociale y est faite presque exclusivement de croyances et de pratiques communes qui tirent d'une adhsion unanime une intensit toute particulire. Remontant par la seule analyse des textes classiques jusqu' une poque tout fait analogue celle dont nous parlons, M. Fustel de Coulanges a dcouvert que l'organisation primitive des socits tait de nature familiale et que, d'autre part, la constitution de la famille primitive avait la religion pour base. Seulement, il a pris la cause pour l'effet. Aprs avoir pos l'ide religieuse, sans la faire driver de rien, il en a dduit les arrangements sociaux qu'il observait 4, alors qu'au contraire ce sont ces derniers qui expliquent la puissance et la nature de l'ide religieuse. Parce que toutes ces masses sociales taient formes d'lments homognes, c'est--dire parce que le type collectif y tait trs dvelopp et les types individuels rudimentaires, il tait invitable que toute la vie psychique de la socit prt un caractre religieux. C'est aussi de l que vient le communisme, que l'on a si souvent signal chez ces peuples. Le communisme, en effet, est le produit ncessaire de cette cohsion spciale qui absorbe l'individu dans le groupe, la partie dans le tout. La proprit n'est en dfinitive que l'extension de la personne sur les choses. L donc o la personnalit collective est la seule qui existe, la proprit elle-mme ne peut manquer d'tre collective. Elle ne pourra devenir individuelle que quand l'individu, se dgageant de
1 2 3
Anthropologie, I, p. 359. Voir MORGAN, op. cit., p. 153 et suiv. Ainsi la tribu de Ruben, qui comprenait en tout quatre familles, comptait, d'aprs les Nombres (XXVI, 7), plus de quarante-trois mille adultes au-dessus de vingt ans (cf. Nombres, chap. III, 15 et suiv. ; Josu, VII, 14. - Voir MUNCK, Palestine, pp. 116, 125, 191). Nous avons fait l'histoire d'une croyance. Elle s'tablit: la socit humaine se constitue. Elle se modifie : la socit traverse une srie de rvolutions. Elle disparat : la socit change de face (Cit antique, fin).
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
132
la masse, sera devenu, lui aussi, un tre personnel et distinct, non pas seulement en tant qu'organisme, mais en tant que facteur de la vie sociale 1. Ce type peut mme se modifier sans que la nature de la solidarit sociale change pour cela. En effet, les peuples primitifs ne prsentent pas tous cette absence de centralisation que nous venons d'observer ; il en est, au contraire, qui sont soumis un pouvoir absolu. La division du travail y a donc fait son apparition. Cependant, le lien qui, dans ce cas, unit l'individu au chef est identique celui qui, de nos jours, rattache la chose la personne. Les relations du despote barbare avec ses sujets, comme celles du matre avec ses esclaves, du pre de famille romain avec ses descendants, ne se distinguent pas de celles du propritaire avec l'objet qu'il possde. Elles n'ont rien de cette rciprocit que produit la division du travail. On a dit avec raison qu'elles sont unilatrales 2. La solidarit qu'elles expriment reste donc mcanique ; toute la diffrence, c'est qu'elle relie l'individu, non plus directement au groupe, mais celui qui en est l'image. Mais l'unit du tout est, comme auparavant, exclusive de l'individualit des parties. Si cette premire division du travail, quelque importante qu'elle soit par ailleurs, n'a pas pour effet d'assouplir la solidarit sociale comme on pourrait s'y attendre, c'est cause des conditions particulires dans lesquelles elle s'effectue. C'est, en effet, une loi gnrale que l'organe minent de toute socit participe de la nature de l'tre collectif qu'il reprsente. L donc o la socit a ce caractre religieux, et, pour ainsi dire, surhumain, dont nous avons montr la source dans la constitution de la conscience commune, il se transmet ncessairement au chef qui la dirige et qui se trouve ainsi lev bien au-dessus du reste des hommes. L o les individus sont de simples dpendances du type collectif, ils deviennent tout naturellement des dpendances de l'autorit centrale qui l'incarne. De mme encore, le droit de proprit que la communaut exerait sur les choses d'Une manire indivise passe intgralement la personnalit suprieure qui se trouve ainsi constitue. Les services proprement professionnels que rend cette dernire sont donc pour peu de chose dans la puissance extraordinaire dont elle est investie. Si, dans ces sortes de socits, le pouvoir directeur a tant d'autorit, ce n'est pas, comme on l'a dit, parce qu'elles ont plus spcialement besoin d'une direction nergique ; mais cette autorit est tout entire une manation de la conscience commune, et elle est grande, parce que la conscience commune elle-mme est trs dveloppe. Supposez que celle-ci soit plus faible ou seulement qu'elle embrasse une moindre partie de la vie sociale, la ncessit d'une fonction rgulatrice suprme ne sera pas moindre ; cependant, le reste de la
1
M. Spencer a dj dit que l'volution sociale, comme d'ailleurs l'volution universelle, dbutait par un stade de plus ou moins parfaite homognit. Mais cette proposition, telle qu'il l'entend, ne ressemble en rien celle que nous venons de dvelopper. Pour M. Spencer, en effet, une socit qui serait parfaitement homogne ne serait pas vraiment une socit ; car l'homogne est instable par nature et la socit est essentiellement un tout cohrent. Le rle social de l'homognit est tout secondaire ; elle peut frayer la voie une coopration ultrieure (Soc., III, p. 368), mais elle n'est pas une source spcifique de vie sociale. A certains moments, M. Spencer semble ne voir dans les socits que nous venons de dcrire qu'une juxtaposition phmre d'individus indpendants, le zro de la vie sociale (ibid., p. 390). Nous venons de voir, au contraire, qu'elles ont une vie collective trs forte, quoique sui generis, qui se manifeste non par des changes et des contrats, mais par une grande abondance de croyances et de pratiques communes. Ces agrgats sont cohrents, non seulement quoique homognes, mais dans la mesure o ils sont homognes. Non seulement la communaut n'y est pas trop faible, mais on peut dire qu'elle existe seule. De plus, elles ont un type dfini qui drive de leur homognit. On ne peut donc les traiter comme des quantits ngligeables. Voir TARDE, Lois de l'imitation, pp. 402-412.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
133
socit ne sera plus vis--vis de celui qui en sera charg dans le mme tat d'infriorit. Voil pourquoi la solidarit est encore mcanique tant que la division du travail n'est pas plus dveloppe. C'est mme dans ces conditions qu'elle atteint son maximum d'nergie : car l'action de la conscience commune est plus forte quand elle s'exerce, non plus d'une manire diffuse, mais par l'intermdiaire dun organe dfini. Il y a donc une structure sociale de nature dtermine, laquelle correspond la solidarit mcanique. Ce qui la caractrise, c'est qu'elle est un systme de segments homognes et semblables entre eux.
II
Tout autre est la structure des socits o la solidarit organique est prpondrante. Elles sont constitues, non par une rptition de segments similaires et homognes, mais par un systme d'organes diffrents dont chacun a un rle spcial, et qui sont forms eux-mmes de parties diffrencies. En mme temps que les lments sociaux ne sont pas de mme nature, ils ne sont pas disposs de la mme manire. Ils ne sont ni juxtaposs linairement comme les anneaux d'un annel, ni embots les uns dans les autres, mais coordonns et subordonns les uns aux autres autour d'un mme organe central qui exerce sur le reste de l'organisme une action modratrice. Cet organe lui-mme n'a plus le mme caractre que dans le cas prcdent ; car, si les autres dpendent de lui, il en dpend son tour. Sans doute, il a bien encore une situation particulire et, si l'on veut, privilgie ; mais elle est due la nature du rle qu'il remplit et non quelque cause trangre ses fonctions, quelque force qui lui est communique du dehors. Aussi n'a-t-il plus rien que de temporel et d'humain ; entre lui et les autres organes il n'y a plus que des diffrences de degrs. C'est ainsi que, chez l'animal, la prminence du systme nerveux sur les autres systmes se rduit au droit, si l'on peut parler ainsi, de recevoir une nourriture plus choisie et de prendre sa part avant les autres ; mais il a besoin d'eux, comme ils ont besoin de lui. Ce type social repose sur des principes tellement diffrents du prcdent qu'il ne peut se dvelopper que dans la mesure o celui-ci s'est effac. En effet, les individus y sont groups, non plus d'aprs leurs rapports de descendance, mais d'aprs la nature particulire de l'activit sociale laquelle ils se consacrent. Leur milieu naturel et ncessaire n'est plus le milieu natal, mais le milieu professionnel. Ce n'est plus la consanguinit, relle ou fictive, qui marque la place de chacun, mais la fonction qu'il remplit. Sans doute, quand cette organisation nouvelle commence apparatre, elle essaye d'utiliser celle qui existe et de se l'assimiler. La manire dont les fonctions se divisent se calque alors, aussi fidlement que possible, sur la faon dont la socit est dj divise. Les segments, ou du moins des groupes de segments unis par des affinits spciales, deviennent des organes. C'est ainsi que les clans dont l'ensemble forme la tribu des Lvites s'approprient chez le peuple hbreu les fonctions sacerdotales. D'une manire gnrale, les classes et les castes n'ont vraisemblablement ni une autre origine ni une autre nature : elles proviennent du mlange de l'organisation professionnelle naissante avec l'organisation familiale prexistante. Mais cet arran-
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
134
gement mixte ne peut pas durer longtemps, car, entre les deux termes qu'il entreprend de concilier, il y a un antagonisme qui finit ncessairement par clater. Il n'y a qu'une division du travail trs rudimentaire qui puisse s'adapter ces moules rigides, dfinis, et qui ne sont pas faits pour elle. Elle ne peut s'accrotre qu'affranchie de ces cadres qui l'enserrent. Ds qu'elle a dpass un certain degr de dveloppement, il n'y a plus de rapport ni entre le nombre immuable des segments et celui toujours croissant des fonctions qui se spcialisent, ni entre les proprits hrditairement fixes des premiers et les aptitudes nouvelles que les secondes rclament 1. Il faut donc que la matire sociale entre dans des combinaisons entirement nouvelles pour s'organiser sur de tout autres bases. Or, l'ancienne structure, tant qu'elle persiste, s'y oppose ; c'est pourquoi il est ncessaire qu'elle disparaisse. L'histoire de ces deux types montre, en effet, que l'un n'a progress qu' mesure que l'autre rgressait. Chez les Iroquois, la constitution sociale base de clans est l'tat de puret, et il en est de mme des Hbreux, tels que nous les montre le Pentateuque, sauf la lgre altration que nous venons de signaler. Aussi le type organis n'existe-t-il ni chez les uns ni chez les autres, quoiqu'on puisse peut-tre en apercevoir les premiers germes dans la socit juive. Il n'en est plus de mme chez les Francs de la loi salique : il se prsente cette fois avec ses caractres propres, dgags de toute compromission. Nous trouvons en effet chez ce peuple, outre une autorit centrale rgulire et stable, tout un appareil de fonctions administratives, judiciaires ; et, d'autre part, l'existence d'un droit contractuel, encore, il est vrai, trs peu dvelopp, tmoigne que les fonctions conomiques elles-mmes commencent se diviser et s'organiser. Aussi la constitution politicofamiliale est-elle srieusement branle. Sans doute, la dernire molcule sociale, savoir le village, est bien encore un clan transform. Ce qui le prouve, c'est qu'il y a entre les habitants d'un mme village des relations qui sont videmment de nature domestique et qui, en tout cas, sont caractristiques du clan. Tous les membres du village ont les uns sur les autres un droit d'hrdit en l'absence de parents proprement dits 2. Un texte que l'on trouve dans les Capita extravagantia legis salicae (art. 9) nous apprend de mme qu'en cas de meurtre commis dans le village les voisins taient collectivement solidaires. D'autre part, le village est un systme beaucoup plus hermtiquement clos au-dehors et ramass sur lui-mme que ne le serait une simple circonscription territoriale; car nul ne peut s'y tablir sans le consentement unanime, exprs ou tacite, de tous les habitants 3. Mais, sous cette forme, le clan a perdu quelques-uns de ses caractres essentiels : non seulement tout souvenir d'une commune origine a disparu, mais il a dpouill presque compltement toute importance politique. L'unit politique, c'est la centaine. La population, dit Waitz, habite dans les villages, mais elle se rpartit, elle et son domaine, d'aprs les centaines qui, pour toutes les affaires de la guerre et de la paix, forment l'unit qui sert de fondement toutes les relations 4.
1 2
3 4
On en verra les raisons plus bas, liv. II, chap. IV. Voir GLASSON, Le droit de succession dans les lois barbares, p. 19. - Le fait est, il est vrai, contest par M. Fustel de Coulanges, quelque formel que paraisse le texte sur lequel M. Glasson s'appuie. Voir le titre De Migrantibus de la loi salique. Deutsche Verfassungsgeschichte, 2e d., II, p. 317.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
135
A Rome, ce double mouvement de progression et de rgression se poursuit. Le clan romain, c'est la gens, et il est bien certain que la gens tait la base de l'ancienne constitution romaine. Mais, ds la fondation de la Rpublique, elle a presque compltement cess d'tre une institution publique. Ce n'est plus ni une unit territoriale dfinie, comme le village des Francs, ni une unit politique. On ne la retrouve ni dans la configuration du territoire, ni dans la structure des assembles du peuple. Les comitia curiata, o elle jouait un rle social 1, sont remplacs ou par les comitia centuriata, ou par les comitia tributa, qui taient organiss d'aprs de tout autres principes. Ce n'est plus qu'une association prive qui se maintient par la force de l'habitude, mais qui est destine disparatre, parce qu'elle ne correspond plus rien dans la vie des Romains. Mais aussi, ds l'poque de la loi des XII Tables, la division du travail tait beaucoup plus avance Rome que chez les peuples prcdents et la structure organise plus dveloppe : on y trouve dj d'importantes corporations de fonctionnaires (snateurs, chevaliers, collge de pontifes, etc.), des corps de mtiers 2, en mme temps que la notion de l'tat laque se dgage. Ainsi se trouve justifie la hirarchie que nous avons tablie d'aprs d'autres critres, moins mthodiques, entre les types sociaux que nous avons prcdemment compars. Si nous avoirs pu dire que les Hbreux du Pentateuque appartenaient Un type social moins lev que les Francs de la loi salique, et que ceux-ci, leur tour, taient au-dessous des Romains des XII Tables, c'est qu'en rgle gnrale, plus l'organisation segmentaire base de clans est apparente et forte chez un peuple, plus aussi il est d'espce infrieure ; il ne peut, en effet, s'lever plus haut qu'aprs avoir franchi ce premier stade. C'est pour la mme raison que la cit athnienne, tout en appartenant au mme type que la cit romaine, en est cependant une forme plus primitive : c'est que l'organisation politico-familiale y a disparu beaucoup moins vite. Elle y a persist presque jusqu' la veille de la dcadence 3. Mais il s'en faut que le type organis subsiste seul, l'tat de puret, une fois que le clan a disparu. L'organisation base de clans n'est, en effet, qu'une espce d'un genre plus tendu, l'organisation segmentaire. La distribution de la socit en compartiments similaires correspond des ncessits qui persistent, mme dans les socits nouvelles o s'tablit la vie sociale, mais qui produisent leurs effets sous une autre forme. La masse de la population ne se divise plus d'aprs les rapports de consanguinit, rels ou fictifs, mais d'aprs la division du territoire. Les segments ne sont plus des agrgats familiaux, mais des circonscriptions territoriales. C'est d'ailleurs par une volution lente que s'est fait le passage d'un tat l'autre. Quand le souvenir de la commune origine s'est teint, que les relations domestiques qui en drivent, mais lui survivent souvent comme nous avons vu, ont elles-mmes disparu, le clan n'a plus conscience de soi que comme d'un groupe d'individus qui occupent une mme portion du territoire. Il devient le village proprement dit. C'est ainsi que tous les peuples qui ont dpass la phase du clan sont forms de districts territoriaux (marches, communes, etc.), qui comme la gens romaine venait s'engager dans la curie, s'embotent dans d'autres districts de mme nature, mais plus vastes,
1 2 3
Dans ces comices, le vote se faisait par curie, c'est--dire par groupe de gentes. Un texte semble mme dire qu' l'intrieur de chaque curie on votait par gentes (Gell., XV, 27, 4). Voir MARQUARDT, Privat Leben der Rmer, II, p. 4. Jusqu' Clisthne; or, deux sicles aprs, Athnes perdait son indpendance. De plus, mme aprs Clisthne, le clan athnien, le [en grec dans le texte] tout en ayant perdu tout caractre politique, conserva une organisation assez forte (Cf. GILBERT, op. cit., I, pp. 142 et 200).
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
136
appels ici centaine, l cercle ou arrondissement, et qui, leur tour, sont souvent envelopps par d'autres, encore plus tendus (comt, province, dpartements), dont la runion forme la socit 1. L'embotement peut d'ailleurs tre plus ou moins hermtique ; de mme les liens qui unissent entre eux les districts les plus gnraux peuvent tre ou trs troits, comme dans les pays centraliss de l'Europe actuelle, ou plus lches, comme dans les simples confdrations. Mais le principe de la structure est le mme, et c'est pourquoi la solidarit mcanique persiste jusque dans les socits les plus leves. Seulement, de mme qu'elle n'y est plus prpondrante, l'arrangement par segments n'est plus, comme prcdemment, l'ossature unique, ni mme l'ossature essentielle de la socit. D'abord, les divisions territoriales ont ncessairement quelque chose d'artificiel. Les liens qui rsultent de la cohabitation n'ont pas dans le cur de l'homme une source aussi profonde que ceux qui viennent de la consanguinit. Aussi ont-ils une bien moindre force de rsistance. Quand on est n dans un clan, on n'en peut pas plus changer, pour ainsi dire, que de parents. Les mmes raisons ne s'opposent pas ce qu'on change de ville ou de province. Sans doute, la distribution gographique concide gnralement et en gros avec une certaine distribution morale de la population. Chaque province, par exemple, chaque division territoriale a des murs et des coutumes spciales, une vie qui lui est propre. Elle exerce ainsi sur les individus qui sont pntrs de son esprit, une attraction qui tend les maintenir en place, et, au contraire, repousser les autres. Mais, au sein d'un mme pays, ces diffrences ne sauraient tre ni trs nombreuses, ni trs tranches. Les segments sont donc plus ouverts les uns aux autres. Et en effet, ds le moyen ge, aprs la formation des villes, les artisans trangers circulent aussi facilement et aussi loin que les marchandises 2 . L'organisation segmentaire a perdu de son relief. Elle le perd de plus en plus mesure que les socits se dveloppent. C'est, en effet, une loi gnrale que les agrgats partiels qui font partie d'un agrgat plus vaste, voient leur individualit devenir de moins en moins distincte. En mme temps que l'organisation familiale, les religions locales ont disparu sans retour ; seulement, il subsiste des coutumes locales. Peu peu, elles se fondent les unes dans les autres et s'unifient, en mme temps que les dialectes, que les patois viennent se rsoudre en une seule et mme langue nationale, que l'administration rgionale perd de son autonomie. On a vu dans ce fait une simple consquence de la loi d'imitation 3. Il semble cependant que ce soit plutt un nivellement analogue celui qui se produit entre des masses liquides qui sont mises en communication. Les cloisons qui sparent les diverses alvoles de la vie sociale, tant moins paisses, sont plus souvent traverses ; leur permabilit augmente encore parce qu'on les traverse davantage. Par suite, elles perdent de leur consistance, s'affaissent progressivement, et, dans la mme mesure, les milieux se confondent. Or, les diversits locales ne peuvent se maintenir qu'autant que la diversit des milieux subsiste. Les divisions territoriales sont donc de moins en moins fondes dans la nature des choses, et par consquent perdent de leur
1
2 3
Nous ne voulons pas dire que ces districts territoriaux ne soient qu'une reproduction des anciens arrangements familiaux ; ce nouveau mode de groupement rsulte, au contraire, au moins en partie, de causes nouvelles qui troublent l'ancien. La principale de ces causes est la formation des villes, qui deviennent le centre de concentration de la population (Voir plus bas, liv. II, chap. II, I). Mais quelles que soient les origines de cet arrangement, il est segmentaire. SCHMOLLER, La division du travail tudie au Point de vue historique, in Rev. d'con. pol., 1890, p. 145. Voir TARDE, Lois de l'imitation, passim, Paris, F. Alcan.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
137
signification. On peut presque dire qu'un peuple est d'autant plus avanc qu'elles y ont un caractre plus superficiel. D'autre part, en mme temps que l'organisation segmentaire s'efface ainsi d'ellemme, l'organisation professionnelle la recouvre de plus en plus compltement de sa trame. Dans le principe, il est vrai, elle ne s'tablit que dans les limites des segments les plus simples sans s'tendre au-del. Chaque ville, avec ses environs immdiats, forme un groupe l'intrieur duquel le travail est divis, mais qui s'efforce de se suffire soi-mme. La ville, dit M. Schmoller, devient autant que possible le centre ecclsiastique, politique et militaire des villages environnants. Elle aspire dvelopper toutes les industries pour approvisionner la campagne, comme elle cherche concentrer sur son territoire le commerce et les transports 1. En mme temps, l'intrieur de la ville, les habitants sont groups d'aprs leur profession ; chaque corps de mtier est comme une ville qui vit de sa vie propre 2. Cet tat est celui o les cits de l'antiquit sont restes jusqu' une poque relativement tardive, et d'o sont parties les socits chrtiennes. Mais celles-ci ont franchi cette tape de trs bonne heure. Ds le XIVe sicle, la division inter-rgionale du travail se dveloppe : Chaque ville avait l'origine autant de drapiers qu'il lui en fallait. Mais les fabricants de draps gris de Ble succombent, dj avant 1362, sous la concurrence des Alsaciens ; Strasbourg, Francfort et Leipzig, la filature de laine est ruine vers 1500... Le caractre d'universalit industrielle des villes d'autrefois se trouvait irrparablement ananti. Depuis, le mouvement n'a fait que s'tendre. Dans la capitale se concentrent, aujourd'hui plus qu'autrefois, les forces actives du gouvernement central, les arts, la littrature, les grandes oprations de crdit ; dans les grands ports se concentrent plus qu'auparavant toutes les exportations et importations. Des centaines de petites places de commerce, trafiquant en bls et en btail, prosprent et grandissent. Tandis que, autrefois, chaque ville avait des remparts et des fosss, maintenant quelques grandes forteresses se chargent de protger tout le pays. De mme que la capitale, les chefslieux de province croissent par la concentration de l'administration provinciale, par les tablissements provinciaux, les collections et les coles. Les alins ou les malades d'une certaine catgorie, qui taient autrefois disperss, sont recueillis, pour toute la province et tout un dpartement, en un seul endroit. Les diffrentes villes tendent toujours plus vers certaines spcialits, de sorte que nous les distinguons aujourd'hui en villes d'universits, de fonctionnaires, de fabriques, de commerce, d'eaux, de rentiers. En certains points ou en certaines contres, se concentrent les grandes industries : construction de machines, filatures, manufactures de tissage, tanneries, hauts fourneaux, industrie sucrire travaillant pour tout le pays. On y a tabli des coles spciales, la population ouvrire s'y adapte, la construction des machines s'y concentre, tandis que les communications et l'organisation du crdit s'accommodent aux circonstances particulires 3. Sans doute dans une certaine mesure, cette organisation professionnelle s'efforce de s'adapter celle qui existait avant elle, comme elle avait fait primitivement pour l'organisation familiale ; c'est ce qui ressort de la description mme qui prcde. C'est d'ailleurs un fait trs gnral que les institutions nouvelles se coulent tout d'abord dans le moule des institutions anciennes. Les circonscriptions territoriales tendent
1 2 3
Op. cit., p. 144. Voir LEVASSEUR, Les classes ouvrires en France jusqu' la Rvolution, p. 195. SCHMOLLER, La division du travail tudie au point de vue historique, in Rev. d'conom. pol., pp. 145-148.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
138
donc se spcialiser sous la forme de tissus, d'organes ou d'appareils diffrents, tout comme les clans jadis. Mais, tout comme ces derniers, elles sont en ralit incapables de tenir ce rle. En effet, une ville renferme toujours ou des organes ou des parties d'organes diffrents ; et inversement, il n'est gure d'organes qui soient compris tout entiers dans les limites d'un district dtermin, quelle qu'en soit l'tendue. Il les dborde presque toujours. De mme, quoique assez souvent les organes les plus troitement solidaires tendent se rapprocher, cependant, en gnral, leur proximit matrielle ne reflte que trs inexactement l'intimit plus ou moins grande de leurs rapports. Certains sont trs distants qui dpendent directement les uns des autres ; d'autres sont trs voisins dont les relations ne sont que mdiates et lointaines. Le mode de groupement des hommes qui rsulte de la division du travail est donc trs diffrent de celui qui exprime la rpartition de la population dans l'espace. Le milieu professionnel ne concide pas plus avec le milieu territorial qu'avec le milieu familial. C'est un cadre nouveau qui se substitue aux autres ; aussi la substitution n'est-elle possible que dans la mesure o ces derniers sont effacs. Si donc ce type social ne s'observe nulle part l'tat de puret absolue, de mme que, nulle part, la solidarit organique ne se rencontre seule, du moins il se dgage de plus en plus de tout alliage, de mme qu'elle devient de plus en plus prpondrante. Cette prdominance est d'autant plus rapide et d'autant plus complte qu'au moment mme o cette structure s'affirme davantage, l'autre devient plus indistincte. Le segment si dfini que formait le clan est remplac par la circonscription territoriale. A l'origine du moins, celle-ci correspondait, quoique d'une manire vague et seulement approche, la division relle et morale de la population ; mais elle perd peu peu ce caractre pour n'tre plus qu'une combinaison arbitraire et de convention. Or, mesure que ces barrires s'abaissent, elles sont recouvertes par des systmes d'organes de plus en plus dvelopps. Si donc l'volution sociale reste soumise l'action des mmes causes dterminantes, - et on verra plus loin que cette hypothse est la seule concevable, - il est permis de prvoir que ce double mouvement continuera dans le mme sens, et qu'un jour viendra o toute, notre organisation sociale et politique aura une base exclusivement ou presque exclusivement professionnelle. Du reste, les recherches qui vont suivre tabliront 1 que cette organisation professionnelle n'est mme pas aujourd'hui tout ce qu'elle doit tre ; que des causes anormales l'ont empche d'atteindre le degr de dveloppement ds prsent rclam par notre tat social. On peut juger par l de l'importance qu'elle doit prendre dans l'avenir.
III
La mme loi prside au dveloppement biologique. On sait aujourd'hui que les animaux infrieurs sont forms de segments similaires, disposs soit en masses irrgulires, soit en sries linaires ; mme, au plus bas degr de l'chelle, ces lments ne sont pas seulement semblables entre eux, ils sont encore en composition homogne. On leur donne gnralement le nom de colonies. Mais
1
Voir plus bas, mme livre, chap. VII, II et liv. III, chap. 1er.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
139
cette expression, qui, d'ailleurs, n'est pas sans quivoque, ne signifie pas que ces associations ne sont point des organismes individuels ; car toute colonie dont les membres sont en continuit de tissus est, en ralit, un individu 1 . En effet, ce qui caractrise l'individualit d'un agrgat quelconque, c'est l'existence d'oprations effectues en commun par toutes les parties. Or, entre les membres de la colonie, il y a mise en commun des matriaux nutritifs et impossibilit de se mouvoir autrement que par des mouvements d'ensemble, tant que la colonie n'est pas dissoute ; il y a plus ; luf, issu de l'un des segments associs, reproduit, non ce segment, mais la colonie entire dont il faisait partie : Entre les colonies de polypes et les animaux les plus levs, il n'y a, ce point de vue, aucune diffrence 2. Ce qui rend d'ailleurs toute sparation radicale impossible, c'est qu'il n'y a point d'organismes, si centraliss qu'ils soient, qui ne prsentent des degrs divers, la constitution coloniale. On en trouve des traces jusque chez les vertbrs, dans la composition de leur squelette, de leur appareil urognital, etc. ; surtout leur dveloppement embryonnaire donne la preuve certaine qu'ils ne sont autre chose que des colonies modifies 3. Il y a donc dans le monde animal une individualit qui se produit en dehors de toute combinaison d'organes 4 . Or, elle est identique celle des socits que nous avons appeles segmentaires. Non seulement le plan de structure est videmment le mme, mais la solidarit est de mme nature. En effet, comme les parties qui composent une colonie animale sont accoles mcaniquement les unes aux autres, elles ne peuvent agir qu'ensemble, tant du moins qu'elles restent unies. L'activit y est collective. Dans une socit de polypes, comme tous les estomacs communiquent ensemble, un individu ne peut manger sans que les autres mangent ; c'est, dit M. Perrier, le communisme dans toute l'acception du mot 5. Un membre de la colonie, surtout quand elle est flottante, ne peut pas se contracter sans entraner dans son mouvement les polypes auxquels il est uni, et le mouvement se communique de proche en proche 6. Dans un ver, chaque anneau dpend des autres d'une manire rigide, et cela quoiqu'il puisse s'en dtacher sans danger. Mais, de mme que le type segmentaire s'efface mesure qu'on s'avance dans l'volution sociale, le type colonial disparat mesure qu'on s'lve dans l'chelle des organismes. Dj entam chez les annels, quoique encore trs apparent, il devient presque imperceptible chez les mollusques, et enfin l'analyse seule du savant parvient en dcouvrir les vestiges chez les vertbrs. Nous n'avons pas montrer les analogies qu'il y a entre le type qui remplace le prcdent et celui des socits organiques. Dans un cas comme dans l'autre, la structure drive de la division du travail ainsi que la solidarit. Chaque partie de l'animal, devenue un organe, a sa sphre d'action propre o elle se meut avec indpendance sans s'imposer aux autres ; et cependant, un autre point de vue, elles dpendent beaucoup plus troitement les unes des autres que dans une colonie, puisqu'elles ne peuvent pas se sparer sans prir. Enfin, dans l'volution organique tout comme dans l'volution sociale, la division du travail commence par utiliser les cadres de l'organisation segmentaire,
1 2 3 4 5 6
PERRIER, Le transformisme, p. 159. PERRIER, Colonies animales, p. 778. Ibid., liv. Il, chap. V, VI et VII. Ibid., p. 779. Transformisme, p. 167. Colon. anim., p. 771.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
140
mais pour s'en affranchir ensuite et se dvelopper d'une manire autonome. Si, en effet, l'organe n'est parfois qu'un segment transform, c'est cependant l'exception 1. En rsum, nous avions distingu deux sortes de solidarits ; nous venons de reconnatre qu'il existe deux types sociaux qui y correspondent. De mme que les premires se dveloppent en raison inverse l'une de l'autre, des deux types sociaux correspondants l'un rgresse rgulirement mesure que l'autre progresse, et ce dernier est celui qui se dfinit par la division du travail social. Outre qu'il confirme ceux qui prcdent, ce rsultat achve donc de nous montrer toute l'importance de la division du travail. De mme que c'est elle qui, pour la plus grande part, rend cohrentes les socits au sein desquelles nous vivons, c'est elle aussi qui dtermine les traits constitutifs de leur structure, et tout fait prvoir que, dans l'avenir, son rle, ce point de vue, ne fera que grandir.
IV
La loi que nous avons tablie dans les deux derniers chapitres a pu, par un trait, mais par un trait seulement, rappeler celle qui domine la sociologie de M. Spencer. Comme lui, nous avons dit que la place de l'individu dans la socit, de nulle qu'elle tait l'origine, allait en grandissant avec la civilisation. Mais ce fait incontestable s'est prsent nous sous un tout autre aspect qu'au philosophe anglais, si bien que, finalement, nos conclusions s'opposent aux siennes plus qu'elles ne les rptent. Tout d'abord, suivant lui, cette absorption de l'individu dans le groupe serait le rsultat d'une contrainte et d'une organisation artificielle ncessite par l'tat de guerre o vivent d'une manire chronique les socits infrieures. En effet, c'est surtout la guerre que l'union est ncessaire au succs. Un groupe ne peut se dfendre contre un autre groupe ou se l'assujettir qu' condition d'agir avec ensemble. Il faut donc que toutes les forces individuelles soient concentres d'une manire permanente en un faisceau indissoluble. Or, le seul moyen de produire cette concentration de tous les instants est d'instituer une autorit trs forte laquelle les particuliers soient absolument soumis. Il faut que, comme la volont du soldat se trouve suspendue au point qu'il devient en tout l'excuteur de la volont de son officier, de mme la volont des citoyens se trouve diminue par celle du gouvernement 2 . C'est donc un despotisme organis qui annihilerait les individus, et comme cette organisation est essentiellement militaire, c'est par le militarisme que M. Spencer dfinit ces sortes de socits. Nous avons vu, au contraire, que cet effacement de l'individu a pour lieu d'origine un type social que caractrise une absence complte de toute centralisation. C'est un produit de cet tat d'homognit qui distingue les socits primitives. Si l'individu n'est pas distinct du groupe, c'est que la conscience individuelle n'est presque pas distincte de la conscience collective. M. Spencer et d'autres sociologues avec lui semblent avoir interprt ces faits lointains avec des ides toutes modernes. Le sentiment si prononc qu'aujourd'hui chacun de nous a de son individualit leur a fait
1 2
Voir Colon. anim., p. 763 et suiv. Sociol., II, p. 153.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
141
croire que les droits personnels ne pouvaient tre ce point restreints que par une organisation coercitive. Nous y tenons tant qu'il leur a sembl que l'homme ne pouvait en avoir fait l'abandon de son plein gr. En fait, si dans les socits infrieures une si petite place est faite la personnalit individuelle, ce n'est pas que celle-ci ait t comprime ou refoule artificiellement, c'est tout simplement qu' ce moment de l'histoire elle n'existait pas. D'ailleurs, M. Spencer reconnat lui-mme que, parmi ces socits, beaucoup ont une constitution si peu militaire et autoritaire qu'il les qualifie lui-mme de dmocratiques 1 ; seulement, il veut y voir un premier prlude de ces socits de l'avenir qu'il appelle industrielles. Mais, pour cela, il lui faut mconnatre ce fait que, dans ces socits tout comme dans celles qui sont soumises un gouvernement despotique, l'individu n'a pas de sphre d'action qui lui soit propre, ainsi que le prouve l'institution gnrale du communisme ; de mme, les traditions, les prjugs, les usages collectifs de toute sorte, ne psent pas sur lui d'un poids moins lourd que ne ferait une autorit constitue. Aussi ne peut-on les traiter de dmocratiques qu'en dtournant le mot de son sens ordinaire. D'autre part, si elles taient rellement empreintes de l'individualisme prcoce qu'on leur attribue, on aboutirait cette trange conclusion que l'volution sociale s'est essaye, ds le premier pas, produire les types les plus parfaits, puisque nulle force gouvernementale n'existe d'abord que celle de la volont commune exprime par la horde assemble 2 . Le mouvement de l'histoire serait-il donc circulaire et le progrs ne consisterait-il que dans un retour en arrire ? D'une manire gnrale, il est ais de comprendre que les individus ne peuvent tre soumis qu' un despotisme collectif ; car les membres d'une socit ne peuvent tre domins que par une force qui leur soit suprieure, et il n'en est qu'une qui ait cette qualit : c'est celle du groupe. Une personnalit quelconque, si puissante qu'elle soit, ne pourrait rien elle seule contre une socit tout entire ; celle-ci ne peut donc tre asservie malgr elle. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu, la force des gouvernements autoritaires ne leur vient pas d'eux-mmes, mais drive de la constitution mme de la socit. Si, d'ailleurs, l'individualisme tait ce point congnital l'humanit, on ne voit pas comment les peuplades primitives auraient pu si facilement s'assujettir l'autorit despotique d'un chef, partout o cela a t ncessaire. Les ides, les murs, les institutions mmes auraient d s'opposer une transformation aussi radicale. Au contraire, tout s'explique une fois qu'on s'est bien rendu compte de la nature de ces socits ; car alors ce changement n'est plus aussi profond qu'il en a l'air. Les individus, au lieu de se subordonner au groupe, se sont subordonns celui qui le reprsentait, et comme l'autorit collective, quand elle tait diffuse, tait absolue, celle du chef, qui n'est qu'une organisation de la prcdente, prit naturellement le mme caractre. Bien loin qu'on puisse faire dater de l'institution d'un pouvoir despotique l'effacement de l'individu, il faut au contraire y voir le premier pas qui ait t fait dans la voie de l'individualisme. Les chefs sont, en effet, les premires personnalits individuelles qui se soient dgages de la masse sociale. Leur situation exceptionnelle, les mettant hors de pair, leur cre une physionomie distincte et leur confre par suite une individualit. Dominant la socit, ils ne sont plus astreints en suivre tous les mouvements. Sans doute, c'est du groupe qu'ils tirent leur force ; mais une fois que celle-ci est organise, elle devient autonome et les rend capables d'une activit
1 2
Sociol., II, pp. 154-155. Ibid., III, pp. 426-427.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
142
personnelle. Une source d'initiative se trouve donc ouverte, qui n'existait pas jusquel. Il y a dsormais quelqu'un qui peut produire du nouveau et mme, dans une certaine mesure, droger aux usages collectifs. L'quilibre est rompu 1. Si nous avons insist sur ce point, c'est pour tablir deux propositions importantes. En premier lieu, toutes les fois qu'on se trouve en prsence d'un appareil gouvernemental dou d'une grande autorit, il faut aller en chercher la raison, non dans la situation particulire des gouvernants, mais dans la nature des socits qu'ils gouvernent. Il faut observer quelles sont les croyances communes, les sentiments communs qui, en s'incarnant dans une personne ou dans une famille, lui ont communiqu une telle puissance. Quant la supriorit personnelle du chef, elle ne joue dans ce processus qu'un rle secondaire ; elle explique pourquoi la force collective s'est concentre dans telles mains plutt que dans telles autres, non sans intensit. Du moment que cette force, au lieu de rester diffuse, est oblige de se dlguer, ce ne peut tre qu'au profit d'individus qui ont dj tmoign par ailleurs de quelque supriorit ; mais si celle-ci marque le sens dans lequel se dirige le courant, elle ne le cre pas. Si le pre de famille, Rome, jouit d'un pouvoir absolu, ce n'est pas parce qu'il est le plus ancien, ou le plus sage ou le plus expriment, mais c'est que, par suite des circonstances o s'est trouve la famille romaine, il a incarn le vieux communisme familial. Le despotisme, du moins quand il n'est pas un phnomne pathologique et de dcadence, n'est autre chose qu'un communisme transform. En second lieu, on voit par ce qui prcde combien est fausse la thorie qui veut que l'gosme soit le point de dpart de l'humanit, et que l'altruisme, au contraire, soit une conqute rcente. Ce qui fait l'autorit de cette hypothse auprs de certains esprits, c'est qu'elle parat tre une consquence logique des principes du darwinisme. Au nom du dogme de la concurrence vitale et de la slection naturelle, on nous dpeint sous les plus tristes couleurs cette humanit primitive dont la faim et la soif, mal satisfaites d'ailleurs, auraient t les seules passions; ces temps sombres o les hommes n'auraient eu d'autre souci et d'autre occupation que de se disputer les uns aux autres leur misrable nourriture. Pour ragir contre les rveries rtrospectives de la philosophie du XVIIIe sicle, et aussi contre certaines doctrines religieuses, pour dmontrer avec plus d'clat que le paradis perdu n'est pas derrire nous et que notre pass n'a rien que nous devions regretter, on croit devoir l'assombrir et le rabaisser systmatiquement. Rien n'est moins scientifique que ce parti pris en sens contraire. Si les hypothses de Darwin sont utilisables en morale, c'est encore avec plus de rserve et de mesure que dans les autres sciences. Elles font, en effet, abstraction de l'lment essentiel de la vie morale, savoir de l'influence modratrice que la socit exerce sur ses membres et qui tempre et neutralise l'action brutale de la lutte pour la vie et de la slection. Partout o il y a des socits, il y a de l'altruisme, parce qu'il y a de la solidarit. Aussi le trouvons-nous ds le dbut de l'humanit et mme sous une forme vraiment intemprante ; car ces privations que le sauvage s'impose pour obir la tradition religieuse, l'abngation avec laquelle il sacrifie sa vie ds que la socit en
1
On trouve ici une confirmation de la proposition nonce dj plus haut, p. 89, et qui fait de la force gouvernementale une manation de la vie inhrente la conscience collective.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
143
rclame le sacrifice, le penchant irrsistible qui entrane la veuve de l'Inde suivre son mari dans la mort, le Gaulois ne pas survivre son chef de clan, le vieux Celte dbarrasser ses compagnons d'une bouche inutile par une fin volontaire, tout cela n'est-ce pas de l'altruisme ? On traitera ces pratiques de superstitions ? Qu'importe, pourvu qu'elles tmoignent d'une aptitude se donner ? Et d'ailleurs, o commencent et o finissent les superstitions ? On serait bien embarrass de rpondre et de donner du fait une dfinition scientifique. N'est-ce pas aussi une superstition que l'attachement que nous prouvons pour les lieux o nous avons vcu, pour les personnes avec lesquelles nous avons eu des relations durables ? Et pourtant cette puissance de s'attacher n'est-elle pas l'indice d'une saine constitution morale ? A parler rigoureusement, toute la vie de la sensibilit n'est faite que de superstitions, puisqu'elle prcde et domine le jugement plus qu'elle n'en dpend. Scientifiquement, une conduite est goste dans la mesure o elle est dtermine par des sentiments et des reprsentations qui nous sont exclusivement personnels. Si donc nous nous rappelons quel point, dans les socits infrieures, la conscience de l'individu est envahie par la conscience collective, nous serons mme tent de croire qu'elle est tout entire autre chose que soi, qu'elle est tout altruisme, comme dirait Condillac. Cette conclusion, pourtant, serait exagre, car il y a une sphre de la vie psychique qui, quelque dvelopp que soit le type collectif, varie d'un homme l'autre et appartient en propre chacun - c'est celle qui est forme des reprsentations, des sentiments et des tendances qui se rapportent l'organisme et aux tats de l'organisme ; c'est le monde des sensations internes et externes et des mouvements qui y sont directement lis. Cette premire base de toute individualit est inalinable et ne dpend pas de l'tat social. Il ne faut donc pas dire que l'altruisme est n de l'gosme, une pareille drivation ne serait possible que par une cration ex nihilo. Mais, parler rigoureusement, ces deux ressorts de la conduite se sont trouvs prsents ds le dbut dans toutes les consciences humaines, car il ne peut pas y en avoir qui ne refltent, la fois, et des choses qui se rapportent l'individu tout seul et des choses qui ne lui sont pas personnelles. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, chez le sauvage, cette partie infrieure de nousmme reprsente une fraction plus considrable de l'tre total, parce que celui-ci a une moindre tendue, les sphres suprieures de la vie psychique y tant moins dveloppes ; elle a donc plus d'importance relative et, par suite, plus d'empire sur la volont. Mais, d'un autre ct, pour tout ce qui dpasse ce cercle des ncessits physiques, la conscience primitive, suivant une forte expression de M. Espinas, est tout entire hors de soi. Tout au contraire, chez le civilis, l'gosme s'introduit jusqu'au sein des reprsentations suprieures : chacun de nous a ses opinions, ses croyances, ses aspirations propres, et y tient. Il vient mme se mler l'altruisme, car il arrive que nous avons une manire nous d'tre altruiste qui tient notre caractre personnel, la tournure de notre esprit, et dont nous refusons de nous carter. Sans doute, il n'en faut pas conclure que la part de l'gosme est devenue plus grande dans l'ensemble de la vie ; car il faut tenir compte de ce fait que la conscience tout entire s'est tendue. Il n'en est pas moins vrai que l'individualisme s'est dvelopp en valeur absolue en pntrant dans des rgions qui, l'origine, lui taient fermes. Mais cet individualisme, fruit du dveloppement historique, n'est pas davantage celui qu'a dcrit M. Spencer. Les socits qu'il appelle industrielles ne ressemblent pas plus aux socits organises que les socits militaires aux socits segmentaires base familiale. C'est ce que nous verrons dans le prochain chapitre.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
144
Chapitre VII
Solidarit organique et solidarit contractuelle
I
Retour la table des matires
Il est vrai que, dans les socits industrielles de M. Spencer, tout comme dans les socits organises, l'harmonie sociale drive essentiellement de la division du travail 1. Ce qui la caractrise, c'est qu'elle consiste dans une coopration qui se produit automatiquement, par cela seul que chacun poursuit ses intrts propres. Il suffit que chaque individu se consacre une fonction spciale pour se trouver, par la force des choses, solidaire des autres. N'est-ce pas le signe distinctif des socits organises ? Mais si M. Spencer a justement signal quelle tait, dans les socits suprieures, la cause principale de la solidarit sociale, il s'est mpris sur la manire dont cette cause produit son effet, et, par suite, sur la nature de ce dernier. En effet, pour lui, la solidarit industrielle, comme il l'appelle, prsente les deux caractres suivants : Comme elle est spontane, il n'est besoin d'aucun appareil coercitif ni pour la produire ni pour la maintenir. La socit n'a donc pas intervenir pour assurer un concours qui s'tablit tout seul. Chaque homme peut s'entretenir par son travail, changer ses produits contre ceux d'autrui, prter son assistance et recevoir un
1
Sociol., III, p. 332 et suiv.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
145
payement, entrer dans telle ou telle association pour mener une entreprise, petite ou grande, sans obir la direction de la socit dans son ensemble 1. La sphre de l'action sociale irait donc de plus en plus en se rtrcissant, car elle n'aurait plus d'autre objet que d'empcher les individus d'empiter les uns sur les autres et de se nuire rciproquement, c'est--dire qu'elle ne serait plus que ngativement rgulatrice. Dans ces conditions, le seul lien qui reste entre les hommes, c'est l'change absolument libre. Toutes les affaires industrielles... se font par voie d'change libre. Ce rapport devient prdominant dans la socit mesure que l'activit individuelle devient prdominante 2. Or, la forme normale de l'change est le contrat ; c'est pourquoi, mesure qu'avec le dclin du militarisme et l'ascendant de l'industrialisme la puissance comme la porte de l'autorit diminuent et que l'action libre augmente, la relation du contrat devient gnrale ; enfin, dans le type industriel pleinement dvelopp, cette relation devient universelle 3 . Par l, M. Spencer ne veut pas dire que la socit repose jamais sur un contrat implicite ou formel. L'hypothse d'un contrat social est, au contraire, inconciliable avec le principe de la division du travail ; plus on fait grande la part de ce dernier, plus compltement on doit renoncer au postulat de Rousseau. Car pour qu'un tel contrat soit possible, il faut qu' un moment donn toutes les volonts individuelles s'entendent sur les bases communes de l'organisation sociale, et, par consquent, que chaque conscience particulire se pose le problme politique dans toute sa gnralit. Mais, pour cela, il faut que chaque individu sorte de sa sphre spciale, que tous jouent galement le mme rle, celui d'homme d'tat et de constituants. Reprsentezvous l'instant o la socit se contracte : si l'adhsion est unanime, le contenu de toutes les consciences est identique. Donc, dans la mesure o la solidarit sociale provient d'une telle cause, elle n'a aucun rapport avec la division du travail. Surtout rien ne ressemble moins cette solidarit spontane et automatique qui, suivant M. Spencer, distingue les socits industrielles ; car il voit, au contraire, dans cette poursuite consciente des fins sociales, la caractristique des socits militaires 4. Un tel contrat suppose que tous les individus peuvent se reprsenter les conditions gnrales de la vie collective, afin de faire un choix en connaissance de cause. Or, M. Spencer sait bien qu'une telle reprsentation dpasse la science dans son tat actuel et, par consquent, la conscience. Il est tellement convaincu de la vanit de la rflexion quand elle s'applique de telles matires, qu'il veut les soustraire mme celle du lgislateur, bien loin de les soumettre l'opinion commune. Il estime que la vie sociale, comme toute vie en gnral, ne peut s'organiser naturellement que par une adaptation inconsciente et spontane, sous la pression immdiate des besoins et non d'aprs un plan mdit de l'intelligence rflchie. Il ne songe donc pas que les socits suprieures puissent se construire d'aprs un programme solennellement dbattu. Aussi bien la conception du contrat social est-elle aujourd'hui bien difficile dfendre, car elle est sans rapport avec les faits. L'observateur ne la rencontre, pour ainsi dire, pas sur son chemin. Non seulement il n'y a pas de socits qui aient une telle origine, mais il n'en est pas dont la structure prsente la moindre trace d'une organisation contractuelle. Ce n'est donc ni un fait acquis l'histoire, ni une tendance
1 2 3 4
Ibid., III, p. 808. Sociol., II, p. 160. Ibid., III, p. 813. Sociol., II, p. 332 et suiv. - Voir aussi L'individu contre l'tat, passim, Paris, F. Alcan.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
146
qui se dgage du dveloppement historique. Aussi, pour rajeunir cette doctrine et lui redonner quelque crdit, a-t-il fallu qualifier de contrat l'adhsion que chaque individu, une fois adulte, donne la socit o il est n, par cela seul qu'il continue y vivre. Mais alors il faut appeler contractuelle toute dmarche de l'homme qui n'est pas dtermine par la contrainte 1. A ce compte, il n'y a pas de socit, ni dans le prsent ni dans le pass, qui ne soit ou qui n'ait t contractuelle ; car il n'en est pas qui puisse subsister par le seul effet de la compression. Nous en avons dit plus haut la raison. Si l'on a cru parfois que la contrainte avait t plus grande autrefois qu'aujourd'hui, c'est en vertu de cette illusion qui a fait attribuer un rgime coercitif la petite place faite la libert individuelle dans les socits infrieures. En ralit, la vie sociale, partout o elle est normale, est spontane ; et si elle est anormale, elle ne peut pas durer. C'est spontanment que l'individu abdique ; et mme il n'est pas juste de parler d'abdication l o il n'y a rien abdiquer. Si donc on donne au mot cette acception large et quelque peu abusive, il n'y a aucune distinction faire entre les diffrents types sociaux ; et si l'on entend seulement par l le lien juridique trs dfini que dsigne cette expression, on peut assurer qu'aucun lien de ce genre n'a jamais exist entre les individus et la socit. Mais si les socits suprieures ne reposent pas sur un contrat fondamental qui porte sur les principes gnraux de la vie politique, elles auraient ou tendraient avoir pour base unique, suivant M. Spencer, le vaste systme de contrats particuliers qui lient entre eux les individus. Ceux-ci ne dpendraient du groupe que dans la mesure o ils dpendraient les uns des autres, et ils ne dpendraient les uns des autres que dans la mesure marque par les conventions prives et librement conclues. La solidarit sociale ne serait donc autre chose que l'accord spontan des intrts individuels, accord dont les contrats sont l'expression naturelle. Le type des relations sociales serait la relation conomique, dbarrasse de toute rglementation et telle qu'elle rsulte de l'initiative entirement libre des parties. En un mot, la socit ne serait que la mise en rapport d'individus changeant les produits de leur travail, et sans qu'aucune action proprement sociale vienne rgler cet change. Est-ce bien le caractre des socits dont l'unit est produite par la division du travail ? S'il en tait ainsi, on pourrait avec raison douter de leur stabilit. Car si l'intrt rapproche les hommes, ce n'est jamais que pour quelques instants ; il ne peut crer entre eux qu'un lien extrieur. Dans le fait de l'change, les divers agents restent en dehors les uns des autres, et l'opration termine, chacun se retrouve et se reprend tout entier. Les consciences ne sont que superficiellement en contact ; ni elles ne se pntrent, ni elles n'adhrent fortement les unes aux autres. Si mme on regarde au fond des choses, on verra que toute harmonie d'intrts recle un conflit latent ou simplement ajourn. Car, l o l'intrt rgne seul, comme rien ne vient refrner les gosmes en prsence, chaque moi se trouve vis--vis de l'autre sur le pied de guerre et toute trve cet ternel antagonisme ne saurait tre de longue dure. L'intrt est, en effet, ce qu'il y a de moins constant au monde. Aujourd'hui, il m'est utile de m'unir vous ; demain, la mme raison fera de moi votre ennemi. Une telle cause ne peut donc donner naissance qu' des rapprochements passagers et des associations d'un jour. On voit combien il est ncessaire d'examiner si telle est effectivement la nature de la solidarit organique. Nulle part, de l'aveu de M. Spencer, la socit industrielle n'existe l'tat de puret : c'est un type partiellement idal qui se dgage de plus en plus de l'volution,
1
C'est ce que fait M. FOUILLE, qui oppose contrat compression (voir Science sociale, p. 8).
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
147
mais qui n'a pas encore t compltement ralis. Par consquent, pour avoir le droit de lui attribuer les caractres que nous venons de dire, il faudrait tablir mthodiquement que les socits les prsentent d'une manire d'autant plus complte qu'elles sont plus leves, abstraction faite des cas de rgression. On affirme en premier lieu que la sphre de l'activit sociale diminue de plus en plus au profit de celle de l'individu. Mais pour pouvoir dmontrer cette proposition par une exprience vritable, il ne suffit pas, comme fait M. Spencer, de citer quelques cas o l'individu s'est effectivement mancip de l'influence collective ; ces exemples, si nombreux qu'ils puissent tre, ne peuvent servir que d'illustrations et sont, par eux-mmes, dnus de toute force dmonstrative. Car il est trs possible que, sur un point, l'action sociale ait rgress, mais que, sur d'autres, elle se soit tendue, et que, finalement on prenne une transformation pour une disparition. La seule manire de faire la preuve objectivement est, non de citer quelques faits au hasard de la suggestion, mais de suivre dans son histoire, depuis ses origines jusqu'aux temps les plus rcents, l'appareil par lequel s'exerce essentiellement l'action sociale, et de voir si, avec le temps, il a augment ou diminu de volume. Nous savons que c'est le droit. Les obligations que la socit impose ses membres, pour peu qu'elles aient d'importance et de dure, prennent une forme juridique ; par consquent les dimensions relatives de cet appareil permettent de mesurer avec exactitude l'tendue relative de l'action sociale. Or, il est trop vident que, bien foin de diminuer, il va de plus en plus en s'accroissant et en se compliquant. Plus un code est primitif, plus le volume en est petit ; il est, au contraire, d'autant plus considrable qu'il est plus rcent. Sur ce point, le doute n'est pas possible. Sans doute, il n'en rsulte pas que la sphre de l'activit individuelle devienne plus petite. Il ne faut pas oublier, en effet, que s'il y a plus de vie rglemente, il y a aussi plus de vie en gnral. C'est pourtant une preuve suffisante que la discipline sociale ne va pas en se relchant. Une des formes qu'elle affecte tend, il est vrai, rgresser, nous l'avons nous-mme tabli ; mais d'autres, beaucoup plus riches et beaucoup plus complexes, se dveloppent la place. Si le droit rpressif perd du terrain, le droit restitutif, qui n'existait pas du tout l'origine, ne fait que s'accrotre. Si l'intervention sociale n'a plus pour effet d'imposer tout le monde certaines pratiques uniformes, elle consiste davantage dfinir et rgler les rapports spciaux des diffrentes fonctions sociales, et elle n'est pas moindre parce qu'elle est autre. M. Spencer rpondra qu'il n'a pas affirm la diminution de toute espce de contrle, mais seulement du contrle positif. Admettons cette distinction. Qu'il soit positif ou ngatif, ce contrle n'en est pas moins social, et la question principale est de savoir s'il s'est tendu ou contract. Que ce soit pour ordonner ou pour dfendre, pour dire Fais ceci ou Ne fais pas cela, si la socit intervient davantage, on n'a pas le droit de dite que la spontanit individuelle suffit de plus en plus tout. Si les rgles qui dterminent la conduite se multiplient, qu'elles soient impratives ou prohibitives, il n'est pas vrai qu'elle ressortisse de plus en plus compltement l'initiative prive. Mais cette distinction mme est-elle fonde ? Par contrle positif, M. Spencer entend celui qui contraint l'action, tandis que le contrle ngatif contraint seulement l'abstention, Un homme a une terre ; je la cultive pour lui en totalit ou en partie, ou bien je lui impose en tout ou partie le mode de culture qu'il suivra : voil un contrle positif. Au contraire, je ne lui apporte ni aide ni conseils pour sa culture, je l'empche simplement de toucher la rcolte du voisin, de passer par la terre du
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
148
voisin ou d'y dposer ses dblais : voil le contrle ngatif. La diffrence est assez tranche entre se charger de poursuivre la place d'un citoyen tel but qu'il appartient ou se mler des moyens que ce citoyen emploie pour le poursuivre, et d'autre part, l'empcher de gner un autre citoyen qui poursuit le but de son choix 1. Si tel est le sens des termes, il s'en faut que le contrle positif soit en train de disparatre. Nous savons, en effet, que le droit restitutif n, fait que grandir ; or, dans la grande majorit des cas, ou il marque au citoyen le but qu'il doit poursuivre, ou il se mle des moyens que ce citoyen emploie pour atteindre le but de son choix. Il rsout propos de chaque relation juridique les deux questions suivantes : 1 dans quelles conditions et sous quelle forme existe-t-elle normalement ? 2 quelles sont les obligations qu'elle engendre ? La dtermination de la forme et des conditions est essentiellement positive, puisqu'elle astreint l'individu suivre une certaine procdure pour arriver son but. Quant aux obligations, si elles se ramenaient en principe la dfense de ne pas troubler autrui dans l'exercice de ses fonctions, la thse de M. Spencer serait vraie, au moins en partie. Mais elles consistent le plus souvent en des prestations de services, de nature positive. Mais entrons dans le dtail.
II
Il est trs vrai que les relations contractuelles, qui taient rares l'origine ou compltement absentes, se multiplient mesure que le travail social se divise. Mais ce que M. Spencer semble n'avoir pas aperu, c'est que les relations non contractuelles se dveloppent en mme temps. Examinons d'abord cette partie du droit que l'on qualifie improprement de priv et qui, en ralit, rgle les rapports des fonctions sociales diffuses ou, autrement dit, la vie viscrale de l'organisme social. En premier lieu, nous savons que le droit domestique, de simple qu'il tait d'abord, est devenu de plus en plus complexe, c'est--dire que les espces diffrentes de relations juridiques auxquelles donne naissance la vie de famille sont beaucoup plus nombreuses qu'autrefois. Or, d'une part, les obligations qui en rsultent sont de nature minemment positive ; c'est une rciprocit de droits et de devoirs. De l'autre, elles ne sont pas contractuelles, du moins sous leur forme typique. Les conditions dont elles dpendent se rattachent notre statut personnel, qui dpend lui-mme de notre naissance, de nos rapports de consanguinit, par consquent de faits qui sont soustraits notre volont. Cependant, le mariage et l'adoption sont des sources de relations domestiques, et ce sont des contrats. Mais il se trouve justement que, plus on se rapproche des types sociaux les plus levs, plus aussi ces deux oprations juridiques perdent leur caractre proprement contractuel.
1
Essais de morale, p. 194, note.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
149
Non seulement dans les socits infrieures, mais Rome mme, jusqu' la fin de l'Empire, le mariage reste une affaire entirement prive. C'est gnralement une vente, relle chez les peuples primitifs, fictive plus tard, mais qui est valable par le seul consentement des parties dment attest. Ni formes solennelles d'aucune sorte, ni intervention d'une autorit quelconque n'taient alors ncessaires. C'est seulement avec le christianisme que le mariage affecta un autre caractre. De bonne heure, les chrtiens prirent l'habitude de faire bnir leur union par un prtre. Une loi de l'empereur Lon le Philosophe convertit cet usage en loi pour l'Orient ; le concile de Trente en fit autant pour l'Occident. Dsormais, le mariage ne se contracte plus librement, mais par l'intermdiaire d'une puissance publique, savoir l'glise, et le rle de celle-ci n'est pas seulement celui d'un tmoin, mais c'est elle et elle seule qui cre le lien juridique que la volont des particuliers suffisait jusqu'alors tablir. On sait comment, dans la suite, l'autorit civile fut substitue dans cette fonction l'autorit religieuse, et comment, en mme temps, la part de l'intervention sociale et des formalits ncessaires fut tendue 1. L'histoire du contrat d'adoption est plus dmonstrative encore. Nous avons dj vu avec quelle facilit et sur quelle large chelle se pratiquait l'adoption dans les clans indiens de l'Amrique du Nord. Elle pouvait donner naissance toutes les formes de la parent. Si l'adopt tait du mme ge que l'adoptant, ils devenaient frres et surs ; si le premier tait une femme dj mre, elle devenait la mre de celui qui l'adoptait. Chez les Arabes, avant Mahomet, l'adoption servait souvent fonder de vritables familles 2. Il arrivait frquemment plusieurs personnes de s'adopter mutuellement ; elles devenaient alors frres ou surs les unes des autres, et la parent qui les unissait tait aussi forte que s'ils taient descendus d'une commune origine. On trouve le mme genre d'adoption chez les Slaves. Trs souvent, des membres de familles diffrentes se prennent pour frres et surs et forment ce qu'on appelle une confraternit (probatinstvo). Ces socits se contractent librement et sans formalit : l'entente suffit les fonder. Cependant le lien qui unit ces frres lectifs est plus fort mme que celui qui drive de la fraternit naturelle 3. Chez les Germains, l'adoption fut probablement aussi facile et frquente. Des crmonies trs simples suffisaient la constituer 4. Mais dans l'Inde, en Grce, Rome, elle tait dj subordonne des conditions dtermines. Il fallait que l'adoptant et un certain ge, qu'il ne ft pas parent de l'adopt un degr qui ne lui et pas permis d'en tre le pre naturel ; enfin, ce changement de famille devenait une opration juridique trs complexe, qui ncessitait l'intervention du magistrat. En mme temps, le nombre de ceux qui avaient la jouissance du droit d'adoption devenait plus restreint. Seuls, le pre de famille ou le clibataire sui juris pouvaient adopter, et le premier ne le pouvait que s'il n'avait pas d'enfants lgitimes. Dans notre droit actuel, les conditions restrictives se sont encore multiplies. Il faut que l'adopt soit majeur, que l'adoptant ait plus de cinquante ans, qu'il ait trait l'adopt comme son propre enfant pendant longtemps. Encore faut-il ajouter que,
1 2 3 4
Bien entendu, il en est de mme pour la dissolution du lien conjugal. SMITH, Marriage and Kinship in early Arabia, Cambridge, 1885, p. 135. KRAUSS, Sitte und Brauch der Sdslaven, chap. XXXI. VIOLLET, Prcis de l'histoire du droit franais, p. 402.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
150
mme ainsi limite, elle est devenue un vnement trs rare. Avant la rdaction de notre Code, elle tait mme presque compltement tombe en dsutude, et aujourd'hui encore, certains pays, comme la Hollande et le Bas-Canada, ne l'admettent pas du tout. En mme temps qu'elle devenait plus rare, l'adoption perdait de son efficacit. Dans le principe, la parent adoptive tait de tous points semblables la parent naturelle. A Rome, la ressemblance tait encore trs grande ; cependant, il n'y avait plus parfaite identit 1. Au XVIe sicle, elle ne donnait plus droit la succession ab intestat du pre adoptif 2. Notre Code a rtabli ce droit ; mais la parent laquelle donne lieu l'adoption ne s'tend pas au-del de l'adoptant et de l'adopt. On voit combien est insuffisante l'explication traditionnelle qui attribue cet usage de l'adoption chez les socits anciennes au besoin d'assurer la perptuit du culte des anctres. Les peuples qui l'ont pratique de la manire la plus large et la plus libre, comme les Indiens de l'Amrique, les Arabes, les Slaves, ne connaissaient pas ce culte et, au contraire, c'est Rome, Athnes, c'est--dire dans les pays o la religion domestique tait son apoge, que ce droit est pour, la premire fois soumis un contrle et des restrictions. Si donc il a pu servir satisfaire ces besoins, ce n'est pas pour les satisfaire qu'il s'est tabli ; et inversement, s'il tend disparatre, ce n'est pas que nous tenions moins assurer la perptuit de notre nom et de notre race. C'est dans la structure des socits actuelles et dans la place qu'y occupe la famille qu'il faut aller chercher la cause dterminante de ce changement. Une autre preuve de cette vrit, c'est qu'il est devenu encore plus impossible de sortir d'une famille par un acte d'autorit prive que d'y entrer. De mme que le lien de parent ne rsulte pas d'un engagement contractuel, il ne peut pas tre rompu comme un engagement de ce genre. Chez les Iroquois, on voit parfois une partie du clan en sortir pour aller grossir le clan voisin 3. Chez les Slaves, un membre de la Zadruga qui est fatigu de la vie commune peut se sparer du reste de la famille et devenir pour elle juridiquement un tranger, de mme qu'il peut tre exclu par elle 4. Chez les Germains, une crmonie peu complique permettait tout Franc qui en avait le dsir de se dgager compltement de toutes les obligations de la parent 5. A Rome, le fils ne pouvait pas sortir de sa famille par sa seule volont, et ce signe nous reconnaissons un type social plus lev. Mais ce lien que le fils ne pouvait pas rompre pouvait tre bris par le pre ; c'est dans cette opration que consistait l'mancipation. Aujourd'hui, ni le pre ni le fils ne peuvent modifier l'tat naturel des relations domestiques ; elles restent telles que la naissance les dtermine. En rsum, en mme temps que les obligations domestiques deviennent plus nombreuses, elles prennent, comme on dit, un caractre publie. Non seulement, en principe, elles n'ont pas une origine contractuelle, mais le rle qu'y joue le contrat va toujours en diminuant ; au contraire, le contrle social sur la manire dont elles se nouent, se dnouent, se modifient, ne fait qu'augmenter. La raison en est dans l'effacement progressif de l'organisation segmentaire. La famille, en effet, est pendant longtemps un vritable segment social. A l'origine, elle se confond avec le clan si,
1 2 3 4 5
ACCARIAS, Prcis de droit romain, I, p. 240 et suiv. VIOLLET, op. cit., p. 406. MORGAN, Ancient Society, p. 81. KRAUSS, op. cit., p. 113 et suiv. Loi salique, tit. LX.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
151
plus tard, elle s'en distingue, c'est comme la partie du tout elle est le produit d'une segmentation secondaire du clan, identique celle qui a donn naissance au clan luimme, et, quand ce dernier a disparu, elle se maintient encore en cette mme qualit. Or, tout ce qui est segment tend de plus en plus tre rsorb dans la masse sociale. C'est pourquoi la famille est oblige de se transformer. Au lieu de rester une socit autonome au sein de la grande, elle est attire toujours davantage dans le systme des organes sociaux. Elle devient elle-mme un de ces organes, charg de fonctions spciales, et, par suite, tout ce qui se passe en elle est susceptible d'avoir des rpercussions gnrales. C'est ce qui fait que les organes rgulateurs de la socit sont ncessits intervenir, pour exercer sur la manire dont la famille fonctionne une action modratrice ou mme, dans certains cas, positivement excitatrice 1. Mais ce n'est pas seulement en dehors des relations contractuelles, c'est sur le jeu de ces relations elles-mmes que se fait sentir l'action sociale. Car tout n'est pas contractuel dans le contrat. Les seuls engagements qui mritent ce nom sont ceux qui ont t voulus par les individus et qui n'ont pas d'autre origine que cette libre volont. Inversement, toute obligation qui n'a pas t mutuellement consentie n'a rien de contractuel. Or, partout o le contrat existe, il est soumis une rglementation qui est l'uvre de la socit et non celle des particuliers, et qui devient toujours plus volumineuse et plus complique. Il est vrai que les contractants peuvent s'entendre pour droger sur certains points aux dispositions de la loi. Mais, d'abord, leurs droits cet gard ne sont pas illimits. Par exemple, la convention des parties ne peut faire qu'un contrat soit valide qui ne satisfait pas aux conditions de validit exiges par la loi. Sans doute, dans la grande majorit des cas, le contrat n'est plus maintenant astreint des formes dtermines ; encore ne faut-il pas oublier qu'il y a toujours dans nos Codes des contrats solennels. Mais si la loi, en gnral, n'a plus les exigences formalistes d'autrefois, elle assujettit le contrat des obligations d'un autre genre. Elle refuse toute force obligatoire aux engagements contracts par un incapable, ou sans objet, ou dont la cause est illicite, ou faits par une personne qui ne peut pas vendre, ou portant sur une chose qui ne peut tre vendue. Parmi les obligations qu'elle fait dcouler des divers contrats, il en est qui ne peuvent tre changes par aucune stipulation. C'est ainsi que le vendeur ne peut manquer l'obligation de garantir l'acheteur contre toute viction qui rsulte d'un fait qui lui est personnel (art. 1628), ni celle de restituer le prix en cas d'viction, quelle qu'en soit l'origine, pourvu que l'acheteur n'ait pas connu le danger (art. 1629), ni celle d'expliquer clairement ce quoi il s'engage (art. 1602). De mme, dans une certaine mesure tout au moins, il ne peut tre dispens de la garantie des vices cachs (art. 1641 et 1643), surtout s'il les a connus. S'il s'agit d'immeubles, c'est l'acheteur qui a le devoir de ne pas profiter de la situation pour imposer un prix trop sensiblement au-dessous de la valeur relle de la chose (art. 1674), etc. D'autre part, tout ce qui concerne la preuve, la nature des actions auxquelles donne droit le contrat, les dlais dans lesquels elles doivent tre intentes, est absolument soustrait aux transactions individuelles.
1
Par exemple, dans les cas de tutelle, d'interdiction, o l'autorit publique intervient parfois d'office. Le progrs de cette action rgulatrice ne contredit pas la rgression, constate plus haut, des sentiments collectifs qui concernent la famille ; au contraire, le premier phnomne suppose l'autre, car, pour que ces sentiments eussent diminu ou se fussent affaiblis, il a fallu que la famille et cess de se confondre avec la socit et se ft constitu une sphre d'action personnelle, soustraite la conscience commune. Or, cette transformation tait ncessaire pour qu'elle pt devenir ensuite un organe de la socit, car un organe, c'est une partie individualise de la socit.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
152
Dans d'autres cas, l'action sociale ne se manifeste pas seulement par le refus de reconnatre un contrat form en violation de la loi, mais par une intervention positive. Ainsi le juge peut, quels que soient les termes de la convention, accorder dans certaines circonstances un dlai au dbiteur (art. 1184, 1244, 1655, 1900), ou bien obliger l'emprunteur restituer au prteur sa chose avant le terme convenu, si ce dernier en a un pressant besoin (art. 1189). Mais ce qui montre mieux encore que les contrats donnent naissance des obligations qui n'ont pas t contractes, c'est qu'ils obligent non seulement ce qui y est exprim, mais encore toutes les suites que l'quit, l'usage ou la loi donnent l'obligation d'aprs sa nature (art. 1135). En vertu de ce principe, on doit suppler dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimes (art. 1160). Mais alors mme que l'action sociale ne s'exprime pas sous cette forme expresse, elle ne cesse pas d'tre relle. En effet, cette possibilit de droger la loi, qui semble rduire le droit contractuel au rle de substitut ventuel des contrats proprement dits, est, dans la trs grande gnralit des cas, purement thorique. Pour s'en convaincre, il suffit de se reprsenter en quoi il consiste. Sans doute, quand les hommes s'unissent par le contrat, c'est que, par suite de la division du travail, ou simple ou complexe, ils ont besoin les uns des autres. Mais, pour qu'ils cooprent harmoniquement, il ne suffit pas qu'ils entrent en rapport, ni mme qu'ils sentent l'tat de mutuelle dpendance o ils se trouvent. Il faut encore que les conditions de cette coopration soient fixes pour toute la dure de leurs relations. Il faut que les devoirs et les droits de chacun soient dfinis, non seulement en vue de la situation telle qu'elle se prsente au moment o se noue la contrat, mais en prvision des circonstances qui peuvent se produire et la modifier. Autrement, ce serait chaque instant des conflits et des tiraillements nouveaux, Il ne faut pas oublier, en effet, que, si la division du travail rend les intrts solidaires, elle ne les confond pas ; elle les laisse distincts et rivaux. De mme qu' l'intrieur de l'organisme individuel chaque organe est en antagonisme avec les autres, tout en cooprant avec eux, chacun des contractants, tout en ayant besoin de l'autre, cherche obtenir aux moindres frais ce dont il a besoin, c'est--dire acqurir le plus de droits possible, en change des moindres obligations possible. Il est donc ncessaire que le partage des uns et des autres soit prdtermin, et cependant il ne peut se faire d'aprs un plan prconu. Il n'y a rien dans la nature des choses de quoi l'on puisse dduire que les obligations de l'un ou de l'autre doivent aller jusqu' telle limite plutt qu' telle autre. Mais toute dtermination de ce genre ne peut rsulter que d'un compromis ; c'est un moyen terme entre la rivalit des intrts en prsence et leur solidarit. C'est une position d'quilibre qui ne peut se trouver qu'aprs des ttonnements plus ou moins laborieux. Or, il est bien vident que nous ne pouvons ni recommencer ces ttonnements, ni restaurer nouveaux frais cet quilibre toutes les fois que nous nous engageons dans quelque relation contractuelle. Tout nous manque pour cela. Ce n'est pas au moment o les difficults surgissent qu'il faut les rsoudre, et cependant nous ne pouvons ni prvoir la varit des circonstances possibles travers lesquelles se droulera notre contrat, ni fixer par avance, l'aide d'un simple calcul mental, quels seront, dans chaque cas, les droits et les devoirs de chacun, sauf dans les matires dont nous avons une pratique toute particulire. D'ailleurs, les conditions matrielles de la vie s'opposent ce que de telles oprations puissent tre rptes. Car, chaque instant, et souvent l'improviste, nous nous trouvons contracter de ces liens, soit que nous achetions, soit que nous vendions, soit
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
153
que nous voyagions, soit que nous louions des services, soit que nous descendions dans une htellerie, etc. La plupart de nos relations avec autrui sont de nature contractuelle. Si donc il fallait chaque fois instituer nouveau les luttes, les pourparlers ncessaires pour bien tablir toutes les conditions de l'accord dans le prsent et dans l'avenir, nous serions immobiliss. Pour toutes ces raisons, si nous n'tions lis que par les termes de nos contrats, tels qu'ils ont t dbattus, il n'en rsulterait qu'une solidarit prcaire. Mais le droit contractuel est l qui dtermine les consquences juridiques de nos actes que nous n'avons pas dtermines. Il exprime les conditions normales de l'quilibre, telles qu'elles se sont dgages d'elles-mmes et peu peu de la moyenne des cas. Rsum d'expriences nombreuses et varies, ce que nous ne pouvons prvoir individuellement y est prvu, ce que nous ne pouvons rgler y est rglement, et cette rglementation s'impose nous, quoiqu'elle ne soit pas notre oeuvre, mais celle de la socit et de la tradition. Elle nous astreint des obligations que nous n'avons pas contractes, au sens exact du mot, puisque nous ne les avons pas dlibres, ni mme, parfois, connues par avance. Sans doute, l'acte initial est toujours contractuel ; mais il a des suites, mme immdiates, qui dbordent plus ou moins les cadres du contrat. Nous cooprons parce que nous l'avons voulu, mais notre coopration volontaire nous cre des devoirs que nous n'avons pas voulus. De ce point de vue, le droit des contrats apparat sous un tout autre aspect. Ce n'est plus simplement un complment utile des conventions particulires, c'en est la norme fondamentale. S'imposant nous avec l'autorit de l'exprience traditionnelle, il constitue la base de nos rapports contractuels. Nous ne pouvons nous en carter que partiellement et accidentellement. La loi nous confre des droits et nous assujettit des devoirs comme drivant de tel acte de notre volont. Nous pouvons, dans certains cas, faire l'abandon des uns ou nous faire dcharger des autres. Les uns et les autres n'en sont pas moins le type normal des droits et des devoirs que comporte la circonstance, et il faut un acte exprs pour le modifier. Aussi les modifications sontelles relativement rares ; en principe, c'est la rgle qui s'applique ; les innovations sont exceptionnelles. Le droit des contrats exerce donc sur nous une action rgulatrice de la plus haute importance, puisqu'il prdtermine ce que nous devons faire et ce que nous pouvons exiger. C'est une loi qui peut tre change par la seule entente des parties ; mais tant qu'elle n'est pas abroge ou remplace, elle garde toute son autorit, et, d'autre part, nous ne pouvons faire acte de lgislateur que d'une manire trs intermittente. Il n'y a donc qu'une diffrence de degrs entre la loi qui rgle les obligations qu'engendre le contrat et celles qui fixent les autres devoirs des citoyens. Enfin, en dehors de cette pression organise et dfinie qu'exerce le droit, il en est une qui vient des murs. Dans la manire dont nous concluons nos contrats et dont nous les excutons, nous sommes tenus de nous conformer des rgles qui, pour n'tre sanctionnes ni directement ni indirectement par aucun code, n'en sont pas moins impratives. Il y a des obligations professionnelles, purement morales, et qui sont pourtant trs strictes. Elles sont surtout apparentes dans les professions dites librales, et, si elles sont peut-tre moins nombreuses chez les autres, il y a lieu de se demander, comme nous le verrons, si ce n'est pas l'effet d'un tat morbide. Or, si cette action est plus diffuse que la prcdente, elle est tout aussi sociale ; d'autre part, elle est ncessairement d'autant plus tendue que les relations contractuelles sont plus dveloppes, car elle se diversifie comme les contrats.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
154
En rsum donc, le contrat ne se suffit pas soi-mme, mais il n'est possible que grce une rglementation du contrat qui est d'origine sociale. Il l'implique, d'abord parce qu'il a beaucoup moins pour fonction de crer des rgles nouvelles que de diversifier dans les cas particuliers les rgles gnrales prtablies; ensuite, parce qu'il n'a et ne peut avoir le pouvoir de lier que dans de certaines conditions qu'il est ncessaire de dfinir. Si, en principe, la socit lui prte une force obligatoire, c'est qu'en gnral l'accord des volonts particulires suffit assurer, sous les rserves prcdentes, le concours harmonieux des fonctions sociales diffuses. Mais s'il va contre son but, s'il est de nature troubler le jeu rgulier des organes, si, comme on dit, il n'est pas juste, il est ncessaire que, tant dpourvu de toute valeur sociale, il soit aussi destitu de toute autorit. Le rle de la socit ne saurait donc, en aucun cas, se rduire faire excuter passivement les contrats ; il est aussi de dterminer quelles conditions ils sont excutoires et, s'il y a lieu, de les restituer sous leur forme normale. L'entente des parties ne peut rendre juste une clause qui, par elle-mme, ne l'est pas, et il y a des rgles de justice dont la justice sociale doit prvenir la violation, mme si elle a t consentie par les intresss. Une rglementation est ainsi ncessaire, dont l'tendue ne peut tre limite par avance. Le contrat, dit M. Spencer, a pour objet d'assurer au travailleur l'quivalent de la dpense que lui a cause son travail 1. Si tel est vraiment le rle du contrat, il ne pourra jamais le remplir qu' condition d'tre rglement bien plus minutieusement qu'il n'est aujourd'hui ; car ce serait un vrai miracle s'il suffisait produire srement cette quivalence. En fait, c'est tantt le gain qui dpasse la dpense, tantt la dpense qui dpasse le gain, et la disproportion est souvent clatante. Mais, rpond toute une cole, si les gains sont trop bas, la fonction sera dlaisse pour d'autres ; s'ils sont trop levs, elle sera recherche et la concurrence diminuera les profits. On oublie que toute une partie de la population ne peut pas quitter ainsi sa fonction, parce que aucune autre ne lui est accessible. Ceux mmes qui ont davantage la libert de leurs mouvements ne peuvent pas la reprendre en un instant ; de pareilles rvolutions sont toujours longues s'accomplir. En attendant, des contrats injustes, insociaux par dfinition, ont t excuts avec le concours de la socit, et, quand l'quilibre a t rtabli sur un point, il n'y a pas de raison pour qu'il ne se rompe pas sur un autre. Il n'est pas besoin de dmontrer que cette intervention, sous ses diffrentes formes, est de nature minemment positive, puisqu'elle a pour effet de dterminer la manire dont nous devons cooprer. Ce n'est pas elle, il est vrai, qui donne le branle aux fonctions qui concourent ; mais, une fois que le concours est commenc, elle le rgle. Ds que nous avons fait un premier acte de coopration, nous sommes engags et l'action rgulatrice de la socit s'exerce sur nous. Si M. Spencer l'a qualifie de ngative, c'est que, pour lui, le contrat consiste uniquement dans l'change. Mais, mme ce point de vue, l'expression qu'il emploie n'est pas exacte. Sans doute, quand, aprs avoir pris livraison d'un objet ou profit d'un service, je refuse d'en fournir l'quivalent convenu, je prends autrui ce qui lui appartient et on peut dire que la socit, en m'obligeant tenir ma promesse, ne fait que prvenir une lsion, une agression indirecte. Mais, si j'ai simplement promis un service sains en avoir, au pralable, reu la rmunration, je n'en suis pas moins tenu de remplir mon engagement ; cependant, dans ce cas, je ne m'enrichis pas au dtriment d'autrui ; je refuse seulement de lui tre utile. De plus, l'change, nous l'avons vu, n'est pas tout le contrat; mais il y a aussi la bonne harmonie des fonctions qui concourent. Celles-ci ne sont pas seulement en contact pendant le court instant o les choses passent d'une
1
Bases de la morale volutionniste, p. 124 et suiv.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
155
main dans l'autre ; mais des rapports plus tendus en rsultent ncessairement, au cours desquels il importe que leur solidarit ne soit pas trouble. Mme les comparaisons biologiques sur lesquelles M. Spencer appuie volontiers sa thorie du contrat libre en sont bien plutt la rfutation. Il compare, comme nous avons fait, les fonctions conomiques la vie viscrale de l'organisme individuel, et fait remarquer que cette dernire ne dpend pas directement du systme crbrospinal, mais d'un appareil spcial dont les principales branches sont le grand sympathique et le pneumo-gastrique. Mais, si de cette comparaison il est permis d'induire, avec quelque vraisemblance, que les fonctions conomiques ne sont pas de nature tre places sous l'influence immdiate du cerveau social, il ne s'ensuit pas qu'elles puissent tre affranchies de toute influence rgulatrice ; car, si le grand sympathique est, dans une certaine mesure, indpendant du cerveau, il domine les mouvements des viscres tout comme le cerveau fait pour ceux des muscles. Si donc il y a dans la socit un appareil du mme genre, il doit avoir sur les organes qui lui sont soumis une action analogue. Ce qui y correspond, suivant M. Spencer, c'est cet change d'informations qui se fait sans cesse d'une place l'autre sur l'tat de l'offre et de la demande et qui, par suite, arrte ou stimule la production 1. Mais il n'y a rien l qui ressemble une action rgulatrice. Transmettre une nouvelle n'est pas commander des mouvements. Cette fonction est bien celle des nerfs affrents, mais n'a rien de commun avec celle des ganglions nerveux ; or, ce sont ces derniers qui exercent la domination dont nous venons de parler. Interposs sur le trajet des sensations, c'est exclusivement par leur intermdiaire que celles-ci peuvent se rflchir en mouvements. Trs vraisemblablement, si l'tude en tait plus avance, on verrait que leur rle, qu'ils soient centraux ou non, est d'assurer le concours harmonieux des fonctions qu'ils gouvernent, lequel serait tout instant dsorganis s'il devait varier chaque variation des impressions excitatrices. Le grand sympathique social doit donc comprendre, outre un systme de voies de transmission, des organes vraiment rgulateurs qui, chargs de combiner les actes intestinaux comme le ganglion crbral combine les actes externes, aient le pouvoir ou d'arrter les excitations, ou de les amplifier, ou de les modrer suivant les besoins. Cette comparaison induit mme penser que l'action rgulatrice laquelle est actuellement soumise la vie conomique n'est pas ce qu'elle devrait tre normalement. Sans doute, elle n'est pas nulle, nous venons de le montrer. Mais, ou bien elle est diffuse, ou bien elle mane directement de l'tat. On trouvera difficilement dans nos socits contemporaines des centres rgulateurs analogues aux ganglions du grand sympathique. Assurment, si ce doute n'avait d'autre base que ce manque de symtrie entre l'individu et la socit, il ne mriterait pas d'arrter l'attention. Mais il ne faut pas oublier que, jusqu' des temps trs rcents, ces organes intermdiaires existaient : c'taient les corps de mtiers. Nous n'avons pas en discuter ici les avantages ni les inconvnients. D'ailleurs, de pareilles discussions sont difficilement objectives, car nous ne pouvons gure trancher ces questions d'utilit pratique que d'aprs nos sentiments personnels. Mais par cela seul qu'une institution a t ncessaire pendant des sicles des socits, il parat peu vraisemblable que celles-ci se soient brusquement trouves en tat de s'en passer. Sans doute, elles ont chang ; mais il est lgitime de prsumer a priori que les changements par lesquels elles ont pass rclamaient moins une destruction radicale de cette organisation qu'une transformation. En
1
Essais de morale, p. 187.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
156
tout cas, il y a trop peu de temps qu'elles vivent dans ces conditions pour qu'on puisse dcider si cet tat est normal et dfinitif ou simplement accidentel et morbide. Mme les malaises qui se font sentir depuis cette poque dans cette sphre de la vie sociale ne semblent pas prjuger une rponse favorable. Nous trouverons dans la suite de ce travail d'autres faits qui confirment cette prsomption 1.
III
Il y a enfin le droit administratif. Nous appelons ainsi l'ensemble des rgles qui dterminent d'abord les fonctions de l'organe central et leurs rapports, ensuite celles des organes qui sont immdiatement subordonns au prcdent, leurs relations les unes avec les autres, avec les premiers et avec les fonctions diffuses de la socit. Si nous continuons emprunter la biologie un langage qui, pour tre mtaphorique, n'en est pas moins commode, nous dirons qu'elles rglementent la faon dont fonctionne le systme crbro-spinal de l'organisme social. C'est ce systme que, dans la langue courante, on dsigne sous le nom d'tat. Que l'action sociale qui s'exprime sous cette forme soit de nature positive, c'est ce qui n'est pas contest. En effet, elle a pour objet de fixer de quelle manire doivent cooprer ces fonctions spciales. Mme, certains gards, elle impose la coopration ; car ces divers organes ne peuvent tre entretenus qu'au moyen de contributions qui sont exiges imprativement de chaque citoyen. Mais, suivant M. Spencer, cet appareil rgulateur irait en rgressant, mesure que le type industriel se dgage du type militaire, et finalement les fonctions de l'tat seraient destines se rduire la seule administration de la justice. Seulement, les raisons allgues l'appui de cette proposition sont d'une remarquable indigence ; c'est peu prs uniquement d'une courte comparaison entre l'Angleterre et la France, et entre l'Angleterre d'autrefois et celle d'aujourd'hui que M. Spencer croit pouvoir induire cette loi gnrale du dveloppement historique 2. Cependant, les conditions de la preuve ne sont pas autres en sociologie et dans les autres sciences. Prouver une hypothse, ce n'est pas montrer qu'elle rend assez bien compte de quelques faits rappels propos ; c'est constituer des expriences mthodiques. C'est faire voir que les phnomnes entre lesquels on tablit une relation ou concordent universellement, ou bien ne subsistent pas l'un sans l'autre, ou varient dans le mme sens et dans le mme rapport. Mais quelques exemples exposs sans ordre ne constituent pas une dmonstration. Mais, de plus, ces faits pris en eux-mmes ne dmontrent rien en l'espce ; car tout ce qu'ils prouvent, c'est que la place de l'individu devient plus grande et le pouvoir gouvernemental moins absolu. Mais il n'y a aucune contradiction ce que la sphre de l'action individuelle grandisse en mme temps que celle de l'tat, ce que les fonctions qui ne sont pas immdiatement places sous la dpendance de l'appareil rgulateur central se dveloppent en mme temps que ce dernier. D'autre part, un
1 2
Voir liv. III, chap.1er. - V. surtout la prface o nous nous exprimons plus explicitement sur ce point. Sociol., III, pp. 822-834.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
157
pouvoir peut tre la fois absolu et trs simple. Rien n'est moins complexe que le gouvernement despotique d'un chef barbare, les fonctions qu'il remplit sont rudimentaires et peu nombreuses. C'est que l'organe directeur de la vie sociale peut avoir absorb en lui toute cette dernire, pour ainsi dire, sans tre pour cela trs dvelopp, si la vie sociale elle-mme n'est pas trs dveloppe. Il a seulement sur le reste de la socit une suprmatie exceptionnelle, parce que rien n'est en tat de le contenir ni de le neutraliser. Mais il peut trs bien se faire qu'il prenne plus de volume en mme temps que d'autres organes se forment qui lui font contrepoids. Il suffit pour cela que le volume total de l'organisme ait lui-mme augment. Sans doute, l'action qu'il exerce dans ces conditions n'est plus de mme nature ; mais les points sur lesquels elle s'exerce se sont multiplis et, si elle est moins violente, elle ne laisse pas de s'imposer tout aussi formellement. Les faits de dsobissance aux ordres de l'autorit ne sont plus traits comme des sacrilges, ni par consquent rprims avec le mme luxe de svrit ; mais ils ne sont pas davantage tolrs, et ces ordres sont plus nombreux et portent sur des espces plus diffrentes. Or, la question qui se pose est de savoir, non si la puissance coercitive dont dispose cet appareil rgulateur est plus ou moins intense, mais si cet appareil lui-mme est devenu plus ou moins volumineux. Une fois le problme ainsi formul, la solution ne saurait tre douteuse. L'histoire montre en effet que, d'une manire rgulire, le droit administratif est d'autant plus dvelopp que les socits appartiennent un type plus lev ; au contraire, plus nous remontons vers les origines, plus il est rudimentaire. L'tat dont M. Spencer fait un idal est en ralit la forme primitive de l'tat. En effet, les seules fonctions qui lui appartiennent normalement d'aprs le philosophe anglais sont celles de la justice et celles de la guerre, dans la mesure du moins o la guerre est ncessaire. Or, dans les socits infrieures, il n'a effectivement pas d'autre rle. Sans doute, ces fonctions n'y sont pas entendues comme elles le sont actuellement ; elles ne sont pas autres pour cela. Toute cette intervention tyrannique qu'y signale M. Spencer n'est qu'une des manires par lesquelles s'exerce le pouvoir judiciaire. En rprimant les attentats contre la religion, contre l'tiquette, contre les traditions de toute sorte, l'tat remplit le mme office que nos juges d'aujourd'hui, quand ils protgent la vie ou la proprit des individus. Au contraire, ses attributions deviennent de plus en plus nombreuses et varies mesure qu'on se rapproche des types sociaux suprieurs. L'organe mme de la justice, qui est trs simple dans le principe, va de plus en plus en se diffrenciant ; des tribunaux diffrents se forment, des magistratures distinctes se constituent, le rle respectif des uns et des autres se dtermine ainsi que leurs rapports. Une multitude de fonctions qui taient diffuses se concentrent. Le soin de veiller l'ducation de la jeunesse, de protger la sant gnrale, de prsider au fonctionnement de l'assistance publique, d'administrer les voies de transport et de communication, rentre peu peu dans la sphre d'action de l'organe central. Par suite, celui-ci se dveloppe, et, en mme temps, il tend progressivement sur toute la surface du territoire un rseau de plus en plus serr et complexe de ramifications qui se substituent aux organes locaux prexistants ou se les assimilent. Des services de statistique le tiennent au courant de tout ce qui se passe dans les profondeurs de l'organisme. L'appareil des relations internationales, je veux dire la diplomatie, prend lui-mme des proportions toujours plus considrables. A mesure que se forment les institutions qui, comme les grands tablissements de crdits, ont, par leurs dimensions et par la multiplicit des fonctions qui en sont solidaires, un intrt gnral, l'tat exerce sur elles une influence modratrice. Enfin mme l'appareil militaire, dont M. Spencer affirme la rgression, semble au contraire se dvelopper et se centraliser d'une manire ininterrompue.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
158
Cette volution ressort avec tant d'vidence des enseignements de l'histoire qu'il ne nous parat pas ncessaire d'entrer dans plus de dtails pour la dmontrer. Que l'on compare les tribus destitues de toute autorit centrale aux tribus centralises, cellesci la cit, la cit aux socits fodales, les socits fodales aux socits actuelles, et l'on suivra pas pas les principales tapes du dveloppement dont nous venons de retracer la marche gnrale. Il est donc contraire toute mthode de regarder les dimensions actuelles de l'organe gouvernemental comme un fait morbide, d un concours de circonstances accidentelles. Tout nous oblige y voir un phnomne normal, qui tient la structure mme des socits suprieures, puisqu'il progresse d'une manire rgulirement continue, mesure que les socits se rapprochent de ce type. On peut d'ailleurs montrer, au moins en gros, comment il rsulte des progrs mmes de la division du travail et de la transformation qui a pour effet de faire passer les socits du type segmentaire au type organis. Tant que chaque segment a sa vie qui lui est particulire, il forme une petite socit dans la grande et a, par consquent, en propre ses organes rgulateurs, tout comme celle-ci. Mais leur vitalit est ncessairement proportionnelle l'intensit de cette vie locale ; ils ne peuvent donc pas manquer de s'affaiblir quand elle s'affaiblit elle-mme. Or, nous savons que cet affaiblissement se produit avec l'effacement progressif de l'organisation segmentaire. L'organe central, trouvant devant lui moins de rsistance, puisque les forces qui le contenaient ont perdu de leur nergie, se dveloppe et attire lui ces fonctions, semblables celles qu'il exerce, mais qui ne peuvent plus tre retenues par ceux qui les dtenaient jusque-l. Ces organes locaux, au lieu de garder leur individualit et de rester diffus, viennent donc se fondre dans l'appareil central qui, par suite, grossit, et cela d'autant plus que la socit est plus vaste et la fusion plus complte ; c'est dire qu'il est d'autant plus volumineux que les socits sont d'une espce plus leve. Ce phnomne se produit avec une ncessit mcanique, et, d'ailleurs, il est utile, car il correspond au nouvel tat des choses. Dans la mesure o la socit cesse d'tre forme par une rptition de segments similaires, l'appareil rgulateur doit lui-mme cesser d'tre form par une rptition d'organes segmentaires autonomes. Toutefois, nous ne voulons pas dire que, normalement, l'tat absorbe en lui tous les organes rgulateurs de la socit quels qu'ils soient, mais seulement ceux qui sont de mme nature que les siens, c'est--dire qui prsident la vie gnrale. Quant ceux qui rgissent des fonctions spciales, comme les fonctions conomiques, ils sont en dehors de sa sphre d'attraction. Il peut bien se produire entre eux une coalescence du mme genre, mais non entre eux et lui ; ou du moins, s'ils sont soumis l'action des centres suprieurs, ils en restent distincts. Chez les vertbrs, le systme crbrospinal est trs dvelopp, il a une influence sur le grand sympathique, mais il laisse ce dernier une large autonomie. En second lieu, tant que la socit est faite de segments, ce qui se produit dans l'un d'eux a d'autant moins de chances de faire cho dans les autres que l'organisation segmentaire est plus forte. Le systme alvolaire se prte naturellement la localisation des vnements sociaux et de leurs suites. C'est ainsi que, dans une colonie de polypes, un des individus peut tre malade sans que les autres s'en ressentent. Il n'en est plus de mme quand la socit est forme par un systme d'organes. Par suite de leur mutuelle dpendance, ce qui atteint l'un en atteint d'autres, et ainsi tout changement un peu grave prend un intrt gnral.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
159
Cette gnralisation est encore facilite par deux autres circonstances. Plus le travail se divise, moins chaque organe social comprend de parties distinctes. A mesure que la grande industrie se substitue la petite, le nombre des entreprises diffrentes diminue ; chacune a plus d'importance relative, parce qu'elle reprsente une plus grande fraction du tout ; ce qui S'y produit a donc des contrecoups sociaux beaucoup plus tendus. La fermeture d'un petit atelier ne cause que des troubles trs limits, qui cessent d'tre sentis au-del d'un petit cercle ; la faillite d'une grande socit industrielle est, au contraire, une perturbation publique. D'autre part, comme le progrs de la division du travail dtermine une plus grande concentration de la masse sociale, il y a entre les diffrentes parties d'un mme tissu, d'un mme organe ou d'un mme appareil, un contact plus intime qui rend plus faciles les phnomnes de contagion. Le mouvement qui nat sur un point se communique rapidement aux autres ; il n'y a qu' voir avec quelle vitesse, par exemple, une grve se gnralise aujourd'hui dans un mme corps de mtier. Or, un trouble d'une certaine gnralit ne peut se produire sans retentir dans les centres suprieurs. Ceux-ci, tant affects douloureusement, sont ncessits intervenir, et cette intervention est d'autant plus frquente que le type social est plus lev. Mais il faut pour cela qu'ils soient organiss en consquence ; il faut qu'ils tendent dans tous les sens leurs ramifications, de manire tre en relations avec les diffrentes rgions de l'organisme, de manire aussi tenir dans une dpendance plus immdiate certains organes dont le jeu pourrait avoir, l'occasion, des rpercussions exceptionnellement graves. En un mot, leurs fonctions devenant plus nombreuses et plus complexes, il est ncessaire que l'organe qui leur sert de substrat se dveloppe, ainsi que le corps de rgles juridiques qui les dterminent. Au reproche qu'on lui a souvent fait de contredire sa propre doctrine, en admettant que le dveloppement des centres suprieurs se fait en sens inverse dans les socits et dans les organismes, M. Spencer rpond que ces variations diffrentes de l'organe tiennent des variations correspondantes de la fonction. Suivant lui, le rle du systme crbro-spinal serait essentiellement de rgler les rapports de l'individu avec le dehors, de combiner les mouvements soit pour saisir la proie, soit pour chapper l'ennemi 1. Appareil d'attaque et de dfense, il est naturellement trs volumineux chez les organismes les plus levs, o ces relations extrieures sont elles-mmes trs dveloppes. Il en est ainsi des socits militaires, qui vivent en tat d'hostilit chronique avec leurs voisines. Au contraire, chez les peuples industriels, la guerre est l'exception ; les intrts sociaux sont principalement d'ordre intrieur ; l'appareil rgulateur externe, n'ayant plus la mme raison d'tre, rgresse donc ncessairement. Mais cette explication repose sur une double erreur. D'abord, tout organisme, qu'il ait ou non des instincts dprdateurs, vit dans un milieu avec lequel il a des relations d'autant plus nombreuses qu'il est plus complexe. Si donc les rapports d'hostilit diminuent mesure que les socits deviennent plus pacifiques, ils sont remplacs par d'autres. Les peuples industriels ont un commerce mutuel autrement dvelopp que celui que les peuplades infrieures entretiennent les unes avec les autres, si belliqueuses qu'elles soient. Nous parlons, non du commerce qui s'tablit directement d'individus individus, mais de celui qui unit les corps sociaux entre eux. Chaque socit a des intrts gnraux dfendre contre les autres,
Essais de morale, p. 179.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
160
sinon par la voie des armes, du moins au moyen de ngociations, de coalitions, de traits. De plus, il n'est pas vrai que le cerveau ne fasse que prsider aux relations externes. Non seulement il semble bien qu'il peut parfois modifier l'tat des organes par des voies tout internes, mais, alors mme que c'est du dehors qu'il agit, c'est sur le dedans qu'il exerce son action. En effet, mme les viscres les plus intestinaux ne peuvent fonctionner qu' l'aide de matriaux qui viennent du dehors, et comme il dispose souverainement de ces derniers, il a par l sur tout l'organisme une influence de tous les instants. L'estomac, dit-on, n'entre pas en jeu sur son ordre ; mais la prsence des aliments suffit exciter les mouvements pristaltiques. Seulement, si les aliments sont prsents, c'est que le cerveau l'a voulu, et ils y sont dans la quantit qu'il a fixe et de la qualit qu'il a choisie. Ce n'est pas lui qui commande les battements du cur, mais il peut, par un traitement appropri, les retarder ou les acclrer. Il n'y a gure de tissus qui ne subissent quelqu'une des disciplines qu'il impose, et l'empire qu'il exerce ainsi est d'autant plus tendu et d'autant plus profond que l'animal est d'un type plus lev. C'est qu'en effet son vritable rle est de prsider, non pas aux seules relations avec le dehors, mais l'ensemble de la vie : cette fonction est donc d'autant plus complexe que la vie elle-mme est plus riche et plus concentre. Il en est de mme des socits. Ce qui fait que l'organe gouvernemental est plus ou moins considrable, ce n'est pas que les peuples sont plus ou moins pacifiques ; mais il crot mesure que, par suite des progrs de la division du travail, les socits comprennent plus d'organes diffrents plus intimement solidaires les uns des autres.
IV
Les propositions suivantes rsument cette premire partie de notre travail. La vie sociale drive d'une double source, la similitude des consciences et la division du travail social. L'individu est socialis dans le premier cas, parce que, n'ayant pas d'individualit propre, il se confond, ainsi que ses semblables, au sein d'un mme type collectif ; dans le second, parce que, tout en ayant une physionomie et une activit personnelles qui le distinguent des autres, il dpend d'eux dans la mesure mme o il s'en distingue, et par consquent de la socit qui rsulte de leur union. La similitude des consciences donne naissance des rgles juridiques qui, sous la menace de mesures rpressives, imposent tout le monde des croyances et des pratiques uniformes ; plus elle est prononce, plus la vie sociale se confond compltement avec la vie religieuse, plus les institutions conomiques sont voisines du communisme. La division du travail donne naissance des rgles juridiques qui dterminent la nature et les rapports des fonctions divises, mais dont la violation n'entrane que des mesures rparatrices sans caractre expiatoire. Chacun de ces corps de rgles juridiques est d'ailleurs accompagn d'un corps de rgles purement morales. L o le droit pnal est trs volumineux, la morale commune est trs tendue : c'est--dire qu'il y a une multitude de pratiques collectives
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
161
places sous la sauvegarde de l'opinion publique. L o le droit restitutif est trs dvelopp, il y a pour chaque profession une morale professionnelle. A l'intrieur d'un mme groupe de travailleurs, il existe une opinion, diffuse dans toute l'tendue de cet agrgat restreint, et qui, sans tre munie de sanctions lgales, se fait pourtant obir. Il y a des murs et des coutumes communes un mme ordre de fonctionnaires et qu'aucun d'eux ne peut enfreindre sans encourir le blme de la corporation 1. Toutefois, cette morale se distingue de la prcdente par des diffrences analogues celles qui sparent les deux espces correspondantes de droits. Elle est en effet localise dans une rgion limite de la socit ; de plus, le caractre rpressif des sanctions qui y sont attaches est sensiblement moins accentu. Les fautes professionnelles dterminent un mouvement de rprobation beaucoup plus faible que les attentats contre la morale publique. Cependant, les rgles de la morale et du droit professionnels sont impratives comme les autres. Elles obligent l'individu agir en vue de fins qui ne lui sont pas propres, faire des concessions, consentir des compromis, tenir compte d'intrts suprieurs aux siens. Par consquent, mme l o la socit repose le plus compltement sur la division du travail, elle ne se rsout pas en une poussire d'atomes juxtaposs, entre lesquels il ne peut s'tablir que des contacts extrieurs et passagers. Mais les membres en sont unis par des liens qui s'tendent bien au-del des moments si courts o l'change s'accomplit. Chacune des fonctions qu'ils exercent est, d'une manire constante, dpendante des autres et forme avec elles un systme solidaire. Par suite, de la nature de la tche choisie drivent des devoirs permanents. Parce que nous remplissons telle fonction domestique ou sociale, nous sommes pris dans un rseau d'obligations dont nous n'avons pas le droit de nous affranchir. Il est surtout un organe vis--vis duquel notre tat de dpendance va toujours croissant : c'est l'tat. Les points par lesquels nous sommes en contact avec lui se multiplient ainsi que les occasions o il a pour charge de nous rappeler au sentiment de la solidarit commune. Ainsi, l'altruisme n'est pas destin devenir, comme le veut M. Spencer, une sorte d'ornement agrable de notre vie sociale ; mais il en sera toujours la base fondamentale. Comment, en effet, pourrions-nous jamais nous en passer ? Les hommes ne peuvent vivre ensemble sans s'entendre et, par consquent, sans se faire des sacrifices mutuels, sans se lier les uns aux autres d'une manire forte et durable. Toute socit est une socit morale. A certains gards, ce caractre est mme plus prononc dans les socits organises. Parce que l'individu ne se suffit pas, c'est de la socit qu'il reoit tout ce qui lui est ncessaire, comme c'est pour elle qu'il travaille. Ainsi se forme un sentiment trs fort de l'tat de dpendance o il se trouve : il s'habitue s'estimer sa juste valeur, c'est--dire ne se regarder que comme la partie d'un tout, l'organe d'un organisme. De tels sentiments sont de nature inspirer non seulement ces sacrifices journaliers qui assurent le dveloppement rgulier de la vie sociale quotidienne, mais encore, l'occasion, des actes de renoncement complet et d'abngation sans partage. De son ct, la socit apprend regarder les membres qui la composent, non plus comme des choses sur lesquelles elle a des droits, mais comme des cooprateurs dont elle ne peut se passer et vis--vis desquels elle a des devoirs. C'est donc tort qu'on oppose la socit qui drive de la communaut des croyances celle qui a pour base la coopration, en n'accordant qu' la premire un caractre moral, et en ne voyant dans la seconde qu'un groupement conomique. En ralit, la coopration a, elle aussi, sa moralit intrinsque. Il y a seulement lieu de croire,
1
Ce blme, d'ailleurs, comme toute peine morale, se traduit par des mouvements extrieurs (peines disciplinaires, renvoi d'employs, perte des relations, etc.).
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : Livre I
162
comme nous le verrons mieux dans la suite, que, dans nos socits actuelles, cette moralit n'a pas encore tout le dveloppement qui leur serait ds maintenant ncessaire. Mais elle n'est pas de mme nature que l'autre. Celle-ci n'est forte que si l'individu ne l'est pas. Faite de rgles qui sont pratiques par tous indistinctement, elle reoit de cette pratique universelle et uniforme une autorit qui en fait quelque chose de surhumain et qui la soustrait plus ou moins la discussion. L'autre, au contraire, se dveloppe mesure que la personnalit individuelle se fortifie. Si rglemente que soit une fonction, elle laisse toujours une large place l'initiative de chacun. Mme beaucoup des obligations qui sont ainsi sanctionnes ont leur origine dans un choix de la volont. C'est nous qui choisissons notre profession et mme certaines de nos fonctions domestiques. Sans doute, une fois que notre rsolution a cess d'tre intrieure et s'est traduite au-dehors par des consquences sociales, nous sommes lis : des devoirs s'imposent nous que nous n'avons pas expressment voulus. C'est pourtant dans un acte volontaire qu'ils ont pris naissance. Enfin, parce que ces rgles de conduite se rapportent, non aux conditions de la vie commune, mais aux diffrentes formes de l'activit professionnelle, elles ont par cela mme un caractre plus temporel, pour ainsi dire, qui tout en leur laissant leur force obligatoire, les rend plus accessibles l'action des hommes. Il y a donc deux grands courants de la vie sociale, auxquels correspondent deux types de structure non moins diffrents. De ces courants, celui qui a son origine dans les similitudes sociales coule d'abord seul et sans rival. A ce moment, il se confond avec la vie mme de la socit ; puis, peu peu, il se canalise, se rarfie, tandis que le second va toujours en grossissant. De mme, la structure segmentaire est de plus en plus recouverte par l'autre, mais sans jamais disparatre compltement. Nous venons d'tablir la ralit de ce rapport de variation inverse. On en trouvera les causes dans le livre suivant.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
12
LIVRE II
LES CAUSES ET LES CONDITIONS
Retour la table des matires
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
13
Chapitre I
Les progrs de la division du travail et ceux du bonheur
Retour la table des matires
A quelles causes sont dus les progrs de la division du travail ? Sans doute, il ne saurait tre question de trouver une formule unique qui rende compte de toutes les modalits possibles de la division du travail. Une telle formule n'existe pas. Chaque cas particulier dpend de causes particulires qui ne peuvent tre dtermines que par un examen spcial. Le problme que nous nous posons est moins vaste. Si l'on fait abstraction des formes varies que prend la division du travail suivant les conditions de temps et de lieu, il reste ce fait gnral qu'elle se dveloppe rgulirement mesure qu'on avance dans l'histoire. Ce fait dpend certainement de causes galement constantes que nous allons rechercher. Cette cause ne saurait consister dans une reprsentation anticipe des effets que produit la division du travail en contribuant maintenir l'quilibre des socits. C'est un contrecoup trop lointain pour qu'il puisse tre compris de tout le monde ; la plupart des esprits n'en ont aucune conscience. En tout cas, il ne pouvait commencer devenir sensible que quand la division du travail tait dj trs avance. D'aprs la thorie la plus rpandue, elle n'aurait d'autre origine que le dsir qu'a l'homme d'accrotre sans cesse son bonheur. On sait, en effet, que plus le travail se divise, plus le rendement en est lev. Les ressources qu'il met notre disposition sont plus abondantes ; elles sont aussi de meilleure qualit. La science se fait mieux et plus vite ; les oeuvres d'art sont plus nombreuses et plus raffines ; l'industrie produit plus et les produits en sont plus parfaits. Or, l'homme a besoin de toutes ces choses ; il
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
14
semble donc qu'il doive tre d'autant plus heureux qu'il en possde davantage, et, par consquent, qu'il soit naturellement incit les rechercher. Cela pos, on explique aisment la rgularit avec laquelle progresse la division du travail ; il suffit, dit-on, qu'un concours de circonstances, qu'il est facile d'imaginer, ait averti les hommes de quelques-uns de ces avantages, pour qu'ils aient cherch l'tendre toujours plus loin, afin d'en tirer tout le profit possible. Elle progresserait donc sous l'influence de causes exclusivement individuelles et psychologiques. Pour en faire la thorie, il ne serait pas ncessaire d'observer les socits et leur structure : l'instinct le plus simple et le plus fondamental du cur humain suffirait en rendre compte. C'est le besoin du bonheur qui pousserait l'individu se spcialiser de plus en plus. Sans doute, comme toute spcialisation suppose la prsence simultane de plusieurs individus et leur concours, elle n'est pas possible sans une socit. Mais, au lieu d'en tre la cause dterminante, la socit serait seulement le moyen par lequel elle se ralise, la matire ncessaire l'organisation du travail divis. Elle serait mme un effet du phnomne plutt que sa cause. Ne rptet-on pas sans cesse que c'est le besoin de la coopration qui a donn naissance aux socits ? Celles-ci se seraient donc formes pour que le travail pt se diviser, bien loin qu'il se ft divis pour des raisons sociales ? Cette explication est classique en conomie politique. Elle parat d'ailleurs si simple et si vidente qu'elle est admise inconsciemment par une foule de penseurs dont elle altre les conceptions. C'est pourquoi il est ncessaire de l'examiner, tout d'abord.
Rien n'est moins dmontr que le prtendu axiome sur lequel elle repose. On ne peut assigner aucune borne rationnelle la puissance productive du travail. Sans doute, elle dpend de l'tat de la technique, des capitaux, etc. Mais ces obstacles ne sont jamais que provisoires, comme le prouve l'exprience, et chaque gnration recule la limite laquelle s'tait arrte la gnration prcdente. Quand mme elle devrait parvenir un jour un maximum qu'elle ne pourrait plus dpasser, - ce qui est une conjecture toute gratuite, - du moins, il est certain que, ds prsent, elle a derrire elle un champ de dveloppement immense. Si donc, comme on le suppose, le bonheur s'accroissait rgulirement avec elle, il faudrait aussi qu'il pt s'accrotre indfiniment ou que, tout au moins, les accroissements dont il est susceptible fussent proportionns aux prcdents. S'il augmentait mesure que les excitants agrables deviennent plus nombreux et plus intenses, il serait tout naturel que l'homme chercht produire davantage pour jouir encore davantage. Mais, en ralit, notre puissance de bonheur est trs restreinte. En effet, c'est une vrit gnralement reconnue aujourd'hui que le plaisir n'accompagne ni les tats de conscience qui sont trop intenses, ni ceux qui sont trop faibles. Il y a douleur quand l'activit fonctionnelle est insuffisante ; mais une activit
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
15
excessive produit les mmes effets 1. Certains physiologistes croient mme que la douleur est lie une vibration nerveuse trop intense 2. Le plaisir est donc situ entre ces deux extrmes. Cette proposition est, d'ailleurs, un corollaire de la loi de Weber et de Fechner. Si la formule mathmatique que ces exprimentateurs en ont donne est d'une exactitude contestable, il est un point, du moins, qu'ils ont mis hors de doute, c'est que les variations d'intensit par lesquelles peut passer une sensation sont comprises entre deux limites. Si l'excitant est trop faible, il n'est pas senti ; mais s'il dpasse un certain degr, les accroissements qu'il reoit produisent de moins en moins d'effet, jusqu' ce qu'ils cessent compltement d'tre perus. Or, cette loi est vraie galement de cette qualit de la sensation qu'on appelle le plaisir. Elle a mme t formule pour le plaisir et pour la douleur longtemps avant qu'elle ne le ft pour les autres lments de la sensation : Bernoulli l'appliqua tout de suite aux sentiments les plus complexes, et Laplace, l'interprtant dans le mme sens, lui donna la forme d'une relation entre la fortune physique et la fortune morale 3. Le champ des variations que peut parcourir l'intensit d'un mme plaisir est donc limit. Il y a plus. Si les tats de conscience dont l'intensit est modre sont gnralement agrables, ils ne prsentent pas tous des conditions galement favorables la production du plaisir. Aux environs de la limite infrieure, les changements par lesquels passe l'activit agrable sont trop petits en valeur absolue pour dterminer des sentiments de plaisir d'une grande nergie. Inversement, quand elle est rapproche du point d'indiffrence, c'est--dire de son maximum, les grandeurs dont elle s'accrot ont une valeur relative trop faible. Un homme qui a un trs petit capital ne peut pas l'augmenter facilement dans des proportions qui suffisent changer sensiblement sa condition. Voil pourquoi les premires conomies apportent avec elles si peu de joie : c'est qu'elles sont trop petites pour amliorer la situation. Les avantages insignifiants qu'elles procurent ne compensent pas les privations qu'elles ont cotes. De mme, un homme dont la fortune est excessive ne trouve plus de plaisir qu' des bnfices exceptionnels, car il en mesure l'importance ce qu'il possde dj. Il en est tout autrement des fortunes moyennes. Ici, et la grandeur absolue et la grandeur relative des variations sont dans les meilleures conditions pour que le plaisir se produise, car elles sont facilement assez importantes, et pourtant il n'est pas ncessaire qu'elles soient extraordinaires pour tre estimes leur prix. Le point de repre qui sert mesurer leur valeur n'est pas encore assez lev pour qu'il en rsulte une forte dprciation. L'intensit d'un excitant agrable ne peut donc s'accrotre utilement qu'entre des limites encore plus rapproches que nous ne disions tout d'abord, car il ne produit tout son effet que dans l'intervalle qui correspond la partie moyenne de l'activit agrable. En de et au-del, le plaisir existe encore, mais il n'est pas en rapport avec la cause qui le produit, tandis que, dans cette zone tempre, les moindres oscillations sont gotes et apprcies. Rien n'est perdu de l'nergie de l'excitation qui se convertit toute en plaisir 4. Ce que nous venons de dire de l'intensit de chaque irritant pourrait se rpter de leur nombre. Ils cessent d'tre agrables quand ils sont trop ou trop peu nombreux, comme quand ils dpassent ou n'atteignent pas un certain degr de vivacit. Ce n'est
1 2 3 4
SPENCER, Psychologie, 1, 283. - WUNDT, Psychologie physiologique, I, chap. X, 1. RICHET. Voir son article Douleur dans le Dictionnaire encyclopdique des sciences mdicales. LAPLACE, Thorie analytique des probabilits, Paris, 1847, pp. 187, 432. - FECHNER, Psychophysik, 1, 236. Cf. WUNDT, loc. cit.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
16
pas sans raison que J'exprience humaine voit dans l'aurea mediocritas la condition du bonheur. Si donc la division du travail n'avait rellement progress que pour accrotre notre bonheur, il y a longtemps qu'elle serait arrive sa limite extrme, ainsi que la civilisation qui en rsulte, et que l'une et l'autre se seraient arrtes. Car, pour mettre l'homme en tat de mener cette existence modeste qui est la plus favorable au plaisir, il n'tait pas ncessaire d'accumuler indfiniment des excitants de toute sorte. Un dveloppement modr et suffi pour assurer aux individus toute la somme de jouissances dont ils sont capables. L'humanit serait rapidement parvenue un tat stationnaire d'o elle ne serait plus sortie. C'est ce qui est arriv aux animaux : la plupart ne changent plus depuis des sicles, parce qu'ils sont arrivs cet tat d'quilibre.
D'autres considrations conduisent la mme conclusion. On ne peut pas dire d'une manire absolue que tout tat agrable est utile, que le plaisir et l'utilit varient toujours dans le mme sens et le mme rapport. Cependant, un organisme qui, en principe, se plairait des choses qui lui nuisent, ne pourrait videmment pas se maintenir. On peut donc accepter comme une vrit trs gnrale que le plaisir n'est pas li aux tats nuisibles, c'est--dire qu'en gros le bonheur concide avec l'tat de sant. Seuls, les tres atteints de quelque perversion physiologique ou psychologique trouvent de la jouissance dans des tats maladifs. Or, la sant consiste dans une activit moyenne. Elle implique en effet un dveloppement harmonique de toutes les fonctions, et les fonctions ne peuvent se dvelopper harmoniquement qu' condition de se modrer les unes les autres, c'est--dire de se contenir mutuellement en de de certaines limites, au-del desquelles la maladie commence et le plaisir cesse. Quant un accroissement simultan de toutes les facults, il n'est possible pour un tre donn que dans une mesure trs restreinte qui est marque par l'tat congnital de l'individu. On comprend de cette manire ce qui limite le bonheur humain : c'est la constitution mme de l'homme, pris chaque moment de l'histoire. tant donn son temprament, le degr de dveloppement physique et moral auquel il est parvenu, il y a un maximum de bonheur comme un maximum d'activit qu'il ne peut pas dpasser. La proposition n'est gure conteste, tant qu'il ne s'agit que de l'organisme : tout le monde reconnat que les besoins du corps sont limits et que, par suite, le Plaisir physique ne peut pas s'accrotre indfiniment. Mais on a dit que les fonctions spirituelles faisaient exception. Point de douleur pour chtier et rprimer... les lans les plus nergiques du dvouement et de la charit, la recherche passionne et enthousiaste du vrai et du beau. On satisfait sa faim avec une quantit dtermine de nourriture ; on ne satisfait pas sa raison avec une quantit dtermine de savoir 1. C'est oublier que la conscience, comme l'organisme, est un systme de fonctions qui se font quilibre et que, de plus, elle est lie un substrat organique de l'tat duquel elle dpend. On dit que, s'il y a un degr de clart que les yeux ne peuvent pas supporter, il n'y a jamais trop de clart pour la raison. Cependant, trop de science ne
1
RABIER, Leons de philosophie, I, 479.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
17
peut tre acquise que par un dveloppement exagr des centres nerveux suprieurs, qui lui-mme ne peut se produire sans tre accompagn de troubles douloureux. Il y a donc une limite maxima qui ne peut tre dpasse impunment, et comme elle varie avec le cerveau moyen, elle tait particulirement basse au dbut de l'humanit ; par consquent, elle et t vite atteinte. De plus, l'entendement n'est qu'une de nos facults. Elle ne peut donc s'accrotre au-del d'un certain point qu'au dtriment des facults pratiques, en branlant les sentiments, les croyances, les habitudes dont nous vivons, et une telle rupture d'quilibre ne peut aller sans malaise. Les sectateurs de la religion la plus grossire trouvent dans la cosmogonie et la philosophie rudimentaires qui leur sont enseignes un plaisir que nous leur enlverions sans compensation possible, si nous parvenions les pntrer brusquement de nos doctrines scientifiques, quelque incontestable qu'en soit la supriorit. A chaque moment de l'histoire et dans la conscience de chaque individu, il y a pour les ides claires, les opinions rflchies, en un mot pour la science, une place dtermine au-del de laquelle elle ne peut pas s'tendre normalement. Il en est de mme de la moralit. Chaque peuple a sa morale qui est dtermine par les conditions dans lesquelles il vit. On ne peut donc lui en inculquer une autre, si leve qu'elle soit, sans le dsorganiser, et de tels troubles ne peuvent pas ne pas tre douloureusement ressentis par les particuliers. Mais la morale de chaque socit, prise en elle-mme, ne comporte-t-elle pas un dveloppement indfini des vertus qu'elle recommande ? Nullement. Agir moralement, c'est faire son devoir, et tout devoir est fini. Il est limit par les autres devoirs ; on ne peut se donner trop compltement autrui sans s'abandonner soi-mme ; on ne peut dvelopper l'excs sa personnalit sans tomber dans l'gosme. D'autre part, l'ensemble de nos devoirs est lui-mme limit par les autres exigences de notre nature. S'il est ncessaire que certaines formes de la conduite soient soumises cette rglementation imprative qui est caractristique de la moralit, il en est d'autres, au contraire, qui y sont naturellement rfractaires et qui pourtant sont essentielles. La morale ne peut rgenter outre mesure les fonctions industrielles, commerciales, etc., sans les paralyser, et cependant elles sont vitales ; ainsi, considrer la richesse comme immorale n'est pas une erreur moins funeste que de voir dans la richesse le bien par excellence. Il peut donc y avoir des excs de morale, dont la morale, d'ailleurs, est la premire souffrir ; car, comme elle a pour objet immdiat de rgler notre vie temporelle, elle ne peut nous en dtourner sans tarir elle-mme la matire laquelle elle s'applique. Il est vrai que l'activit esthtico-morale, parce qu'elle n'est pas rgle, parat affranchie de tout frein et de toute limitation. Mais, en ralit, elle est troitement circonscrite par l'activit proprement morale ; car elle ne peut dpasser une certaine mesure qu'au dtriment de la moralit. Si nous dpensons trop de nos forces pour le superflu, il n'en reste plus assez pour le ncessaire. Quand on fait trop grande la place de l'imagination en morale, les tches obligatoires sont ncessairement ngliges. Toute discipline mme parat intolrable quand on a trop pris l'habitude d'agir sans autres rgles que celles qu'on se fait soi-mme. Trop d'idalisme et d'lvation morale font souvent que l'homme n'a plus de got remplir ses devoirs quotidiens. On en peut dire autant de toute activit esthtique d'une manire gnrale ; elle n'est saine que si elle est modre. Le besoin de jouer, d'agir sans but et pour le plaisir d'agir, ne peut tre dvelopp au-del d'un certain point sans qu'on se dprenne de la vie srieuse. Une trop grande sensibilit artistique est un phnomne maladif qui ne peut pas se gnraliser sans danger pour la socit. La limite au-del de laquelle l'excs commence est d'ailleurs variable, suivant les peuples ou les milieux sociaux ;
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
18
elle commence d'autant plus tt que la socit est moins avance ou le milieu moins cultiv. Le laboureur, s'il est en harmonie avec ses conditions d'existence, est et doit tre ferm des plaisirs esthtiques qui sont normaux chez le lettr, et il en est de mme du sauvage par rapport au civilis. S'il en est ainsi du luxe de l'esprit, plus forte raison en est-il de mme du luxe matriel. Il y a donc une intensit normale de tous nos besoins, intellectuels, moraux, aussi bien que physiques, qui ne peut tre outrepasse. A chaque moment de l'histoire, notre soif de science, d'art, de bien-tre est dfinie comme nos apptits, et tout ce qui va au-del de cette mesure nous laisse indiffrents ou nous fait souffrir. Voil ce qu'on oublie trop quand on compare le bonheur de nos pres avec le ntre. On raisonne comme si tous nos plaisirs avaient pu tre les leurs ; alors, en songeant tous ces raffinements de la civilisation dont nous jouissons et qu'ils ne connaissaient pas, on se sent enclin plaindre leur sort. On oublie qu'ils n'taient pas aptes les goter. Si donc ils se sont tant tourments pour accrotre la puissance productive du travail, ce n'tait pas pour conqurir des biens qui taient pour eux sans valeur. Pour les apprcier, il leur et fallu d'abord contracter des gots et des habitudes qu'ils n'avaient pas, c'est--dire changer leur nature. C'est en effet ce qu'ils ont fait, comme le montre l'histoire des transformations par lesquelles a pass l'humanit. Pour que le besoin d'un plus grand bonheur pt rendre compte du dveloppement de la division du travail, il faudrait donc qu'il ft aussi la cause des changements qui se sont progressivement accomplis dans la nature humaine, que les hommes se fussent transforms afin de devenir plus heureux. Mais, supposer mme que ces transformations aient eu finalement un tel rsultat, il est impossible qu'elles se soient produites dans ce but, et, par consquent, elles dpendent d'une autre cause. En effet, un changement d'existence, qu'il soit brusque ou prpar, constitue toujours une crise douloureuse, car il fait violence des instincts acquis qui rsistent. Tout le pass nous retient en arrire, alors mme que les plus belles perspectives nous attirent en avant. C'est une opration toujours laborieuse que de draciner des habitudes que le temps a fixes et organises en nous. Il est possible que la vie sdentaire offre plus de chances de bonheur que la vie nomade ; mais quand, depuis des sicles, on n'en a pas men d'autre que cette dernire, on ne s'en dfait pas aisment. Aussi, pour peu que de telles transformations soient profondes, une vie individuelle ne suffit pas les accomplir. Ce n'est pas assez d'une gnration pour dfaire l'uvre des gnrations, pour mettre un homme nouveau la place de l'ancien. Dans l'tat actuel de nos socits, le travail n'est pas seulement utile, il est ncessaire ; tout le monde le sent bien, et voil longtemps dj que cette ncessit est ressentie. Cependant, ils sont encore relativement rares ceux qui trouvent leur plaisir dans un travail rgulier et persistant. Pour la plupart des hommes, c'est encore une servitude insupportable ; l'oisivet des temps primitifs n'a pas perdu pour eux ses anciens attraits. Ces mtamorphoses cotent donc beaucoup pendant trs longtemps sans rien rapporter. Les gnrations qui les inaugurent n'en recueillent pas les fruits, s'il y en a, parce qu'ils viennent trop tardivement. Elles n'en ont que la peine. Par consquent, ce n'est pas l'attente d'un plus grand bonheur qui les entrane dans de telles entreprises. Mais, en fait, est-il vrai que le bonheur de l'individu s'accroisse mesure que l'homme progresse ? Rien n'est plus douteux.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
19
II
Assurment, il y a bien des plaisirs auxquels nous sommes ouverts aujourd'hui et que des natures plus simples ne connaissent pas. Mais, en revanche, nous sommes exposs bien des souffrances qui leur sont pargnes, et il n'est pas sr du tout que la balance se solde notre profit. La pense est, sans doute, une source de joies, et qui peuvent tre trs vives ; mais en mme temps, que de joies elle trouble ! Pour un problme rsolu, que de questions souleves qui restent sans rponse ! Pour un doute clairci, que de mystres aperus qui nous dconcertent ! De mme, si le sauvage ne connat pas les plaisirs que procure une vie trs active, en retour, il est inaccessible l'ennui, ce tourment des esprits cultivs ; il laisse couler doucement sa vie sans prouver perptuellement le besoin d'en remplir les trop courts instants de faits nombreux et presss. N'oublions pas, d'ailleurs, que le travail n'est encore pour la plupart des hommes qu'une peine et qu'un fardeau. On objectera que, chez les peuples civiliss, la vie est plus varie, et que la varit est ncessaire au plaisir. Mais, en mme temps qu'une mobilit plus grande, la civilisation apporte avec elle plus d'uniformit ; car c'est elle qui a impos l'homme le travail monotone et continu. Le sauvage va d'une occupation l'autre, suivant les circonstances et les besoins qui le poussent ; l'homme civilis se donne tout entier une tche, toujours la mme, et qui offre d'autant moins de varit qu'elle est plus restreinte. L'organisation implique ncessairement une absolue rgularit dans les habitudes, car un changement ne peut pas avoir lieu dans la manire dont fonctionne un organe sans que, par contrecoup, tout l'organisme en soit affect. Par ce ct, notre vie offre l'imprvu une moindre part, en mme temps que, par son instabilit plus grande, elle enlve la jouissance une partie de la scurit dont elle a besoin. Il est vrai que notre systme nerveux, devenu plus dlicat, est accessible de faibles excitations qui ne touchaient pas celui de nos pres, parce qu'il tait trop grossier. Mais aussi, bien des irritants qui taient agrables sont devenus trop forts pour nous, et, par consquent, douloureux. Si nous sommes sensibles plus de plaisirs, nous le sommes aussi plus de douleurs. D'autre part, s'il est vrai que, toutes choses gales, la souffrance produit dans l'organisme un retentissement plus profond que la joie 1, qu'un excitant dsagrable nous affecte plus douloureusement qu'un excitant agrable de mme intensit ne nous cause de plaisir, cette plus grande sensibilit pourrait bien tre plus contraire que favorable au bonheur. En fait, les systmes nerveux trs affins vivent dans la douleur et finissent mme par s'y attacher. N'est-il pas trs remarquable que le culte fondamental des religions les plus civilises soit celui de la souffrance humaine ? Sans doute, pour que la vie puisse se maintenir, il faut, aujourd'hui comme autrefois, que dans la moyenne des cas, les plaisirs l'emportent sur les douleurs. Mais il n'est pas certain que cet excdent soit devenu plus considrable. Enfin et surtout, il n'est pas prouv que cet excdent donne jamais la mesure du bonheur. Sans doute, en ces questions obscures et encore mal tudies, on ne peut rien affirmer avec certitude ; cependant, il parat bien que le bonheur est autre chose
1
Voir HARTMANN, Philosophie de l'inconscient, II.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
20
qu'une somme de plaisirs. C'est un tat gnral et constant qui accompagne le jeu rgulier de toutes nos fonctions organiques et psychiques. Ainsi, les activits continues, comme celles de la respiration et de la circulation, ne procurent pas de jouissances positives ; pourtant, c'est d'elles surtout que dpendent notre bonne humeur et notre entrain. Tout plaisir est une sorte de crise ; il nat, dure un moment et meurt ; la vie, au contraire, est continue. Ce qui en fait le charme fondamental doit tre continu comme elle. Le plaisir est local ; c'est une affection limite un point de l'organisme ou de la conscience ; la vie ne rside ni ici ni l, mais elle est partout. Notre attachement pour elle doit donc tenir quelque cause galement gnrale. En un mot, ce qu'exprime le bonheur, c'est, non l'tat momentan de telle fonction particulire, mais la sant de la vie physique et morale dans son ensemble. Comme le plaisir accompagne l'exercice normal des fonctions intermittentes, il est bien un lment du bonheur, et d'autant plus important que ces fonctions ont plus de place dans la vie. Mais il n'est pas le bonheur ; il n'en peut mme faire varier le niveau que dans des proportions restreintes. Car il tient des causes phmres ; le bonheur, des dispositions permanentes. Pour que des accidents locaux puissent affecter profondment cette base fondamentale de notre sensibilit, il faut qu'ils se rptent avec une frquence et une suite exceptionnelles. Le plus souvent, au contraire, c'est le plaisir qui dpend du bonheur : suivant que nous sommes heureux ou malheureux, tout nous rit ou nous attriste. On a eu bien raison de dire que nous portons notre bonheur avec nous-mmes. Mais, s'il en est ainsi, il n'y a plus se demander si le bonheur s'accrot avec la civilisation. Il est l'indice de l'tat de sant. Or, la sant d'une espce n'est pas plus complte parce que cette espce est d'un type suprieur. Un mammifre sain ne se porte pas mieux qu'un protozoaire galement sain. Il en doit donc tre de mme du bonheur. Il ne devient pas plus grand parce que l'activit devient plus riche, mais il est le mme partout o elle est saine. L'tre le plus simple et l'tre le plus complexe gotent un mme bonheur, s'ils ralisent galement leur nature. Le sauvage normal peut tre tout aussi heureux que le civilis normal. Aussi les sauvages sont-ils tout aussi contents de leur sort que nous pouvons l'tre du ntre. Ce parfait contentement est mme un des traits distinctifs de leur caractre. Ils ne dsirent rien de plus que ce qu'ils ont et n'ont aucune envie de changer de condition. L'habitant du Nord, dit Waitz, ne recherche pas le Sud pour amliorer sa position, et l'habitant d'un pays chaud et malsain D'aspire pas davantage le quitter pour un climat plus favorable. Malgr les nombreuses maladies et les maux de toute sorte auxquels est expos l'habitant de Darfour, il aime sa patrie, et non seulement il ne peut pas migrer, mais il lui tarde de rentrer s'il se trouve l'tranger... En rgle gnrale, quelle que soit la misre matrielle dans laquelle vit un peuple, il ne laisse pas de tenir son pays pour le meilleur du monde, son genre de vie pour le plus fcond en plaisirs qu'il y ait, et il se regarde lui-mme comme le premier de tous les peuples. Cette conviction parat rgner gnralement chez les peuples ngres 1. Aussi, dans les pays qui, comme tant de contres de l'Amrique, ont t exploits par les Europens, les indignes croient fermement que les Blancs n'ont quitt leur patrie que pour venir chercher le bonheur en Amrique. On cite bien l'exemple de quelques jeunes sauvages qu'une inquitude maladive poussa hors de chez eux la recherche du bonheur ; mais ce sont des exceptions trs rares.
WAITZ, Anthropologie, I, 346.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
21
Il est vrai que des observateurs nous ont parfois dpeint la vie des socits infrieures sous un tout autre aspect. Mais c'est qu'ils ont pris leurs propres impressions pour celles des indignes. Or, une existence qui nous parat intolrable peut tre douce pour des hommes d'une autre constitution physique et morale. Par exemple, quand, ds l'enfance, on est habitu exposer sa vie a chaque instant et, par consquent, ne la compter pour rien, qu'est-ce que la mort ? Pour nous apitoyer sur le sort des peuples primitifs, il ne suffit donc pas d'tablir que l'hygine y est mal observe, que la police y est mal faite. L'individu seul est comptent pour apprcier son bonheur ; il est heureux s'il se sent heureux. Or, de l'habitant de la Terre de Feu jusqu'au Hottentot, l'homme, l'tat naturel, vit satisfait de lui-mme et de son sort 1 . Combien ce contentement est plus rare en Europe Ces faits expliquent qu'un homme d'exprience ait pu dire Il y a des situations o l'homme qui pense se sent infrieur celui que la nature seule a lev, o il se demande si ses convictions les plus solides valent mieux que les prjugs troits mais doux au cur 2.
Mais voici une preuve plus objective. Le seul fait exprimental qui dmontre que la vie est gnralement bonne, c'est que la trs grande gnralit des hommes la prfre la mort. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que, dans la moyenne des existences, le bonheur l'emporte sur le malheur. Si le rapport tait renvers, on ne comprendrait ni d'o pourrait provenir l'attachement des hommes pour la vie, ni surtout comment il aurait pu se maintenir, froiss chaque instant par les faits. Il est vrai que les pessimistes expliquent la persistance de ce phnomne par les illusions de l'esprance. Suivant eux, si, malgr les dceptions de l'exprience, nous tenons encore la vie, c'est que nous esprons tort que l'avenir rachtera le pass. Mais, en admettant mme que l'esprance suffise expliquer l'amour de la vie, elle ne s'explique pas elle-mme. Elle n'est pas miraculeusement tombe du ciel dans nos curs ; mais elle a d, comme tous les sentiments, se former sous l'action des faits. Si donc les hommes ont appris a esprer, si, sous le coup du malheur, ils ont pris l'habitude de tourner leurs regards vers l'avenir et d'en attendre des compensations leurs souffrances actuelles, c'est qu'ils se sont aperus que ces compensations taient frquentes, que l'organisme humain tait la fois trop souple et trop rsistant pour tre aisment abattu, que les moments o le malheur l'emportait taient exceptionnels et que, gnralement, la balance finissait par se rtablir. Par consquent, quelle que soit la part de l'esprance dans la gense de l'instinct de conservation, celui-ci est un tmoignage probant de la bont relative de la vie. Pour la mme raison, l o il perd soit de son nergie, soit de sa gnralit, on peut tre certain que la vie elle-mme perd de ses attraits, que le mal augmente, soit que les causes de souffrance se multiplient, soit que la force de rsistance des individus diminue. Si donc nous possdions un fait objectif et mesurable qui traduise les variations d'intensit par lesquelles passe ce sentiment suivant les socits, nous pourrions du mme coup mesurer celles du malheur moyen dans ces mmes milieux. Ce fait, c'est le nombre des suicides. De mme que la raret primitive des morts volontaires est la meilleure preuve de la puissance et de l'universalit de cet instinct, le fait qu'ils s'accroissent dmontre qu'il perd du terrain.
1 2
Ibid., 347. Cowper ROSE, Four years in Southern Africa, 1829, p. 173.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
22
Or, le suicide n'apparat gure qu'avec la civilisation. Du moins, le seul qu'on observe dans les socits infrieures l'tat chronique prsente des caractres trs particuliers qui en font un type spcial dont la valeur symptomatique n'est pas la mme. C'est un acte non de dsespoir, mais d'abngation. Si chez les anciens Danois, chez les Celtes, chez les Thraces, le vieillard arriv un ge avanc met fin ses jours, c'est qu'il est de son devoir de dbarrasser ses compagnons d'une bouche inutile ; si la veuve de l'Inde ne survit pas son mari, ni le Gaulois au chef de son clan, si le bouddhiste se fait craser sous les roues du char qui porte son idole, c'est que des prescriptions morales ou religieuses l'y obligent. Dans tous ces cas, l'homme se tue, non parce qu'il juge la vie mauvaise, mais parce que l'idal auquel il est attach exige ce sacrifice. Ces morts volontaires ne sont donc pas plus des suicides, au sens vulgaire du mot, que la mort du soldat ou du mdecin qui s'expose sciemment pour faire son devoir. Au contraire, le vrai suicide, le suicide triste, est l'tat endmique chez les peuples civiliss. Il se distribue mme gographiquement comme la civilisation. Sur les cartes du suicide, on voit que toute la rgion centrale de l'Europe est occupe par une vaste tache sombre qui est comprise entre le 47e et le 57e degr de latitude et entre le 20e et le 40e degr de longitude. Cet espace est le lieu de prdilection du suicide ; suivant l'expression de Morselli, c'est la zone suicidogne de l'Europe. C'est l aussi que se trouvent les pays o l'activit scientifique, artistique, conomique est porte son maximum : l'Allemagne et la France. Au contraire, l'Espagne, le Portugal, la Russie, les peuples slaves du Sud sont relativement indemnes. L'Italie, ne d'hier, est encore quelque peu protge, mais elle perd de son immunit mesure qu'elle progresse. L'Angleterre seule fait exception ; encore sommes-nous mal renseigns sur le degr exact de son aptitude au suicide. A l'intrieur de chaque pays, on constate le mme rapport. Partout le suicide svit plus fortement sur les villes que sur les campagnes. La civilisation se concentre dans les grandes villes ; le suicide fait de mme. On y a mme vu parfois une sorte de maladie contagieuse qui aurait pour foyers d'irradiation les capitales et les villes importantes et qui, de l, se rpandrait sur le reste du pays. Enfin, dans toute l'Europe, la Norvge excepte, le chiffre des suicides augmente rgulirement depuis un sicle 1. D'aprs un calcul, il aurait tripl de 1821 1880 2. La marche de la civilisation ne peut pas tre mesure avec la mme prcision, mais on sait assez combien elle a t rapide pendant ce temps. On pourrait multiplier les preuves. Les classes de la population fournissent au suicide un contingent proportionn leur degr de civilisation. Partout, ce sont les professions librales qui sont le plus frappes et l'agriculture qui est le plus pargne. Il en est de mme des sexes. La femme est moins mle que l'homme au mouvement civilisateur ; elle y participe moins et en retire moins de profit ; elle rappelle davantage certains traits des natures primitives 3 ; aussi se tue-t-elle environ quatre fois moins que l'homme. Mais, objectera-t-on, si la marche ascensionnelle des suicides indique que le malheur progresse sur certains points, ne pourrait-il pas se faire qu'en mme temps le bonheur augmentt sur d'autres ? Dans ce cas, cet accroissement de bnfices suffirait peut-tre compenser les dficits subis ailleurs. C'est ainsi que, dans certaines
1 2 3
Voir les Tables de Morselli. OETTINGEN, Moralstatistik, Erlangen, 1882, p. 742. TARDE, Criminalit compare, 48.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
23
socits, le nombre des pauvres augmente sans que la fortune publique diminue. Elle est seulement concentre en un plus petit nombre de mains. Mais cette hypothse elle-mme n'est gure plus favorable notre civilisation. Car, supposer que de telles compensations existassent, on n'en pourrait rien conclure sinon que le bonheur moyen est rest peu prs stationnaire ; ou bien, s'il avait augment, ce serait seulement de trs petites quantits qui, tant sans rapport avec la grandeur de l'effort qu'a cot le progrs, ne pourraient pas en rendre compte. Mais l'hypothse mme est sans fondement. En effet, quand on dit d'une socit qu'elle est plus ou moins heureuse qu'une autre, c'est du bonheur moyen qu'on entend parler, c'est--dire de celui dont jouit la moyenne des membres de cette socit. Comme ils sont placs dans des conditions d'existence similaires, en tant qu'ils sont soumis l'action d'un mme milieu physique et social, il y a ncessairement une certaine manire d'tre et, par consquent, une certaine manire d'tre heureux qui leur est commune. Si du bonheur des individus on retire tout ce qui est d des causes individuelles ou locales pour ne retenir que le produit des causes gnrales et communes, le rsidu ainsi obtenu constitue prcisment ce que nous appelons le bonheur moyen. C'est donc une grandeur abstraite, mais absolument une et qui ne peut pas varier dans deux sens contraires la fois. Elle peut crotre ou dcrotre, mais il est impossible qu'elle croisse et qu'elle dcroisse simultanment. Elle a la mme unit et la mme ralit que le type moyen de la socit, l'homme moyen de Qutelet ; car elle reprsente le bonheur dont est cens jouir cet tre idal. Par consquent, de mme qu'il ne peut pas devenir au mme moment plus grand et plus petit, plus moral et plus immoral, il ne peut pas davantage devenir en mme temps plus heureux et plus malheureux. Or, les causes dont dpendent les progrs du suicide chez les peuples civiliss ont un caractre certain de gnralit. En effet, il ne se produit pas sur des points isols, dans certaines parties de la socit l'exclusion des autres : on l'observe partout. Selon les rgions, la marche ascendante est plus rapide ou plus lente, mais elle est sans exception. L'agriculture est moins prouve que l'industrie, mais le contingent qu'elle fournit au suicide va toujours croissant. Nous sommes donc en prsence d'un phnomne qui est li non telles ou telles circonstances locales et particulires, mais un tat gnral du milieu social. Cet tat est diversement rfract par les milieux spciaux (provinces, professions, confessions religieuses, etc.) ; - c'est pourquoi son action ne se fait pas sentir partout avec la mme intensit, - mais il ne change pas pour cela de nature. C'est dire que le bonheur dont le dveloppement du suicide atteste la rgression est le bonheur moyen. Ce que prouve la mare montante des morts volontaires, ce n'est pas seulement qu'il y a un plus grand nombre d'individus trop malheureux pour supporter la vie, - ce qui ne prjugerait rien pour les autres qui sont pourtant la majorit, - mais c'est que le bonheur gnral de la socit diminue. Par consquent, puisque ce bonheur ne peut pas augmenter et diminuer en mme temps, il est impossible qu'il augmente, de quelque manire que ce puisse tre, quand les suicides se multiplient ; en d'autres termes, le dficit croissant dont ils rvlent l'existence n'est compens par rien. Les causes dont ils dpendent n'puisent qu'une partie de leur nergie sous forme de suicides ; l'influence qu'elles exercent est bien plus tendue. L o elles ne dterminent pas l'homme se tuer en supprimant totalement le bonheur, du moins elles rduisent dans des proportions variables l'excdent normal des plaisirs
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
24
sur les douleurs. Sans doute, il peut arriver par des combinaisons de circonstances particulires que, dans certains cas, leur action soit neutralise de manire rendre possible mme un accroissement de bonheur ; mais ces variations accidentelles et prives sont sans effet sur le bonheur social. Quel statisticien d'ailleurs hsiterait voir dans les progrs de la mortalit gnrale au sein d'une socit dtermine un symptme certain de l'affaiblissement de la sant publique ? Est-ce dire qu'il faille imputer au progrs lui-mme, et la division du travail qui en est la condition, ces tristes rsultats ? Cette conclusion dcourageante ne dcoule pas ncessairement des faits qui prcdent. Il est, au contraire, trs vraisemblable que ces deux ordres de faits sont simplement concomitants. Mais cette concomitance suffit prouver que le progrs n'accrot pas beaucoup notre bonheur, puisque celui-ci dcrot, et dans des proportions trs graves, au moment mme o la division du travail se dveloppe avec une nergie et une rapidit que l'on n'avait jamais connues. S'il n'y a pas de raison d'admettre qu'elle ait effectivement diminu notre capacit de jouissance, il est plus impossible encore de croire qu'elle l'ait sensiblement augmente. En dfinitive, tout ce que nous venons de dire n'est qu'une application particulire de cette vrit gnrale que le plaisir est, comme la douleur, chose essentiellement relative. Il n'y a pas un bonheur absolu, objectivement dterminable, dont les hommes se rapprochent mesure qu'ils progressent ; mais de mme que, suivant le mot de Pascal, le bonheur de l'homme n'est pas celui de la femme, celui des socits infrieures ne saurait tre le ntre, et rciproquement. Cependant, l'un n'est pas plus grand que l'autre. Car on ne peut en mesurer l'intensit relative que par la force avec laquelle il nous attache la vie en gnral, et notre genre de vie en particulier. Or, les peuples les plus primitifs tiennent tout autant l'existence et leur existence que nous la ntre. Ils y renoncent mme moins facilement 1. Il n'y a donc aucun rapport entre les variations du bonheur et les progrs de la division du travail. Cette proposition est fort importante. Il en rsulte en effet que, pour expliquer les transformations par lesquelles ont pass les socits, il ne faut pas chercher quelle influence elles exercent sur le bonheur des hommes, puisque ce n'est pas cette influence qui les a dtermines. La science sociale doit renoncer rsolument des comparaisons utilitaires dans lesquelles elle s'est trop souvent complue. D'ailleurs, de telles considrations sont ncessairement subjectives, car toutes les fois qu'on compare des plaisirs ou des intrts, comme tout critre objectif fait dfaut, on ne peut pas ne pas jeter dans la balance ses ides et ses prfrences propres, et on donne pour une vrit scientifique ce qui n'est qu'un sentiment personnel. C'est un principe que Comte avait dj trs nettement formul. L'esprit essentiellement relatif, dit-il, dans lequel doivent tre ncessairement conues les notions quelconques de la politique positive, doit d'abord nous faire ici carter comme aussi vaine qu'oiseuse la vague controverse mtaphysique sur l'accroissement du bonheur de l'homme aux divers ges de la civilisation... Puisque le bonheur de chacun exige une suffisante harmonie entre l'ensemble du dveloppement de ses diffrentes facults et le systme local des circonstances quelconques qui dominent sa vie, et puisque, d'une autre part, un tel quilibre tend toujours spontanment un certain degr, il ne saurait y avoir lieu comparer positivement ni par aucun sentiment direct, ni par aucune voie
1
Hormis les cas o l'instinct de conservation est neutralis par des sentiments religieux, patriotiques, etc., sans qu'il soit pour cela plus faible.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
25
rationnelle, quant au bonheur individuel, des situations sociales dont l'entier rapprochement est absolument impossible 1. Mais le dsir de devenir plus heureux est le seul mobile individuel qui et pu rendre compte du progrs ; si on l'carte, il n'en reste pas d'autre. Pour quelle raison l'individu susciterait-il de lui-mme des changements qui lui cotent toujours quelque peine s'il n'en retire pas plus de bonheur ? C'est donc en dehors de lui, c'est--dire dans le milieu qui l'entoure, que se trouvent les causes dterminantes de l'volution sociale. Si les socits changent et s'il change, c'est que ce milieu change. D'autre part, comme le milieu physique est relativement constant, il ne peut pas expliquer cette suite ininterrompue de changements. Par consquent, c'est dans le milieu social qu'il faut aller en chercher les conditions originelles. Ce sont les variations qui s'y produisent qui provoquent celles par lesquelles passent les socits et les individus. Voil une rgle de mthode que nous aurons l'occasion d'appliquer et de confirmer dans la suite.
III
On pourrait se demander cependant si certaines variations que subit le plaisir, par le fait seul qu'il dure, n'ont pas pour effet d'inciter spontanment l'homme varier, et, si par consquent, les progrs de la division du travail ne peuvent pas s'expliquer de cette manire. Voici comment on pourrait concevoir cette explication. Si le plaisir n'est pas le bonheur, c'en est pourtant un lment. Or, il perd de son intensit en se rptant ; si mme il devient trop continu, il disparat compltement. Le temps suffit rompre l'quilibre qui tend s'tablir, et crer de nouvelles conditions d'existence auxquelles l'homme ne peut s'adapter qu'en changeant. A mesure que nous prenons l'habitude d'un certain bonheur, il nous fuit, et nous sommes obligs de nous lancer dans de nouvelles entreprises pour le retrouver. Il nous faut ranimer ce plaisir qui s'teint au moyen d'excitants plus nergiques, c'est--dire multiplier ou rendre plus intenses ceux dont nous disposons. Mais cela n'est possible que si le travail devient plus productif, et par consquent, se divise davantage. Ainsi, chaque progrs ralis dans l'art, dans la science, dans l'industrie, nous obligerait des progrs nouveaux, uniquement pour ne pas perdre les fruits du prcdent. On expliquerait donc encore le dveloppement de la division du travail par un jeu de mobiles tout individuels et sans faire intervenir aucune cause sociale. Sans doute, dirait-on, si nous nous spcialisons, ce n'est pas pour acqurir des plaisirs nouveaux, mais c'est pour rparer, au fur et mesure qu'elle se produit, l'influence corrosive que le temps exerce sur les plaisirs acquis. Mais, si relles que soient ces variations du plaisir, elles ne peuvent pas jouer le rle qu'on leur attribue. En effet, elles se produisent partout o il y a du plaisir, c'est-dire partout o il y a des hommes. Il n'y a pas de socit o cette loi psychologique ne s'applique ; or, il y en a o la division du travail ne progresse pas. Nous avons vu, en effet, qu'un trs grand nombre de peuples primitifs vivent dans un tat stationnaire
1
Cours de philosophie positive, 2e d., IV, 273.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
26
d'o ils ne songent mme pas sortir. Ils n'aspirent rien de nouveau. Cependant leur bonheur est soumis la loi commune. Il en est de mme dans les campagnes chez les peuples civiliss. La division du travail n'y progresse que trs lentement et le got du changement n'y est que trs faiblement ressenti. Enfin, au sein d'une mme socit, la division du travail se dveloppe plus ou moins vite suivant les sicles ; or, l'influence du temps sur les plaisirs est toujours la mme. Ce n'est donc pas elle qui dtermine ce dveloppement. On ne voit pas, en effet, comment elle pourrait avoir un tel rsultat. On ne peut rtablir l'quilibre que le temps dtruit et maintenir le bonheur un niveau constant, sans des efforts qui sont d'autant plus pnibles qu'on se rapproche davantage de la limite suprieure du plaisir ; car, dans la rgion qui avoisine le point maximum, les accroissements qu'il reoit sont de plus en plus infrieurs ceux de l'excitation correspondante. Il faut se donner plus de peine pour le mme prix. Ce qu'on gagne d'un ct, on le perd de l'autre, et l'on n'vite une perte qu'en faisant des dpenses nouvelles. Par consquent, pour que l'opration ft profitable, il faudrait tout au moins que cette perte ft importante et le besoin de la rparer fortement ressenti. Or, en fait, il n'a qu'une trs mdiocre nergie, parce que la simple rptition n'enlve rien d'essentiel au plaisir. Il ne faut pas confondre, en effet, le charme de la varit avec celui de la nouveaut. Le premier est la condition ncessaire du plaisir, puisqu'une jouissance ininterrompue disparat ou se change en douleur. Mais le temps, lui seul, ne supprime pas la varit, il faut que la continuit s'y ajoute. Un tat qui se rpte souvent, mais d'une manire discontinue, peut rester agrable, car si la continuit dtruit le plaisir, c'est ou parce qu'elle le rend inconscient, ou parce que le jeu de toute fonction exige une dpense qui, prolonge sans interruption, puise et devient douloureuse. Si donc l'acte, tout en tant habituel, ne revient qu' des intervalles assez espacs les uns des autres, il continuera tre senti et la dpense faite pourra tre rpare entre-temps. Voil pourquoi un adulte sain prouve toujours le mme plaisir boire, manger, dormir, quoiqu'il dorme, boive et mange tous les jours. Il en est de mme des besoins de l'esprit, qui sont, eux aussi, priodiques comme les fonctions psychiques auxquelles ils correspondent. Les plaisirs que procurent la musique, les beaux-arts, la science se maintiennent intgralement, pourvu qu'ils alternent. Si mme la continuit peut ce que la rptition ne peut pas, elle ne nous inspire pas pour cela un besoin d'excitations nouvelles et imprvues. Car si elle abolit totalement la conscience de l'tat agrable, nous ne pouvons pas nous apercevoir que le plaisir qui y tait attach s'est en mme temps vanoui ; il est, d'ailleurs, remplac par cette sensation gnrale de bien-tre qui accompagne l'exercice rgulier des fonctions normalement continues, et qui n'a pas un moindre prix. Nous ne regrettons donc rien. Qui de nous n'a jamais eu envie de sentir battre son cur ou fonctionner ses poumons ? Si, au contraire, il y a douleur, nous aspirons simplement un tat qui diffre de celui qui nous fatigue. Mais pour faire cesser cette souffrance, il n'est pas ncessaire de nous ingnier. Un objet connu, qui d'ordinaire nous laisse froids, peut mme dans ce cas nous causer un vif plaisir s'il fait contraste avec celui qui nous lasse. Il n'y a donc rien dans la manire dont le temps affecte l'lment fondamental du plaisir, qui puisse nous provoquer un progrs quelconque. Il est vrai qu'il en est autrement de la nouveaut, dont l'attrait n'est pas durable. Mais si elle donne plus de fracheur au plaisir, elle ne le constitue pas. C'en est seulement une qualit secondaire et accessoire, sans laquelle il peut trs bien exister, quoiqu'il risque alors d'tre moins
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
27
savoureux. Quand donc elle s'efface, le vide qui en rsulte n'est pas trs sensible ni le besoin de le combler trs intense. Ce qui en diminue encore l'intensit, c'est qu'il est neutralis par un sentiment contraire qui est beaucoup plus fort et plus fortement enracin en nous ; c'est le besoin de la stabilit dans nos jouissances et de la rgularit dans nos plaisirs. En mme temps que nous aimons changer, nous nous attachons ce que nous aimons et nous ne pouvons pas nous en sparer sans peine. Il est, d'ailleurs, ncessaire qu'il en soit ainsi pour que la vie puisse se maintenir : car si elle n'est pas possible sans changement, si mme elle est d'autant plus flexible qu'elle est plus complexe, cependant elle est avant tout un systme de fonctions stables et rgulires. Il y a, il est vrai, des individus chez qui le besoin du nouveau atteint une intensit exceptionnelle. Rien de ce qui existe ne les satisfait ; ils ont soif de choses impossibles, ils voudraient mettre une autre ralit la place de celle qui leur est impose. Mais ces mcontents incorrigibles sont des malades, et le caractre pathologique de leur cas ne fait que confirmer ce que nous venons de dire. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que ce besoin est de sa nature trs indtermin. Il ne nous attache rien de prcis, puisque c'est un besoin de quelque chose qui n'est pas. Il n'est donc qu' demi constitu, car un besoin complet comprend deux termes : une tension de la volont et un objet certain. Comme l'objet n'est pas donn audehors, il ne peut avoir d'autre ralit que celle que lui prte l'imagination. Ce processus est demi reprsentatif. Il consiste plutt dans des combinaisons d'images, dans une sorte de posie intime que dans un mouvement effectif de la volont. Il ne nous fait pas sortir de nous-mme ; ce n'est gure qu'une agitation interne qui cherche une voie vers le dehors, mais ne l'a pas encore trouve. Nous rvons de sensations nouvelles, mais c'est une aspiration indcise qui se disperse sans prendre corps. Par consquent, l mme o elle est le plus nergique, elle ne peut avoir la force de besoins fermes et dfinis qui, dirigeant toujours la volont dans le mme sens et par des voies toutes frayes, la stimulent d'autant plus imprieusement qu'ils ne laissent de place ni aux ttonnements ni aux dlibrations. En un mot, on ne peut admettre que le progrs ne soit qu'un effet de l'ennui 1. Cette refonte priodique et mme, certains gards, continue de la nature humaine, a t une oeuvre laborieuse qui s'est poursuivie dans la souffrance. Il est impossible que l'humanit se soit impos tant de peine uniquement pour pouvoir varier un peu ses plaisirs et leur garder leur fracheur premire.
C'tait la thorie de Georges Leroy ; nous ne la connaissons que par ce qu'en dit COMTE dans son Cours de philosophie positive, t. IV, p. 449.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
28
Chapitre II
Les causes
I
Retour la table des matires
C'est donc dans certaines variations du milieu social qu'il faut aller chercher la cause qui explique les progrs de la division du travail. Les rsultats du livre prcdent nous permettent d'induire tout de suite en quoi elles consistent. Nous avons vu, en effet, que la structure organise et, par consquent, la division du travail se dveloppent rgulirement mesure que la structure segmentaire s'efface. C'est donc que cet effacement est la cause de ce dveloppement ou que le second est la cause du premier. Cette dernire hypothse est inadmissible, car nous savons que l'arrangement segmentaire est pour la division du travail un obstacle insurmontable qui doit avoir disparu, au moins partiellement, pour qu'elle puisse apparatre. Elle ne peut tre que dans la mesure o il a cess d'tre. Sans doute, une fois qu'elle existe, elle peut contribuer en acclrer la rgression ; mais elle ne se montre qu'aprs qu'il a rgress. L'effet ragit sur la cause, mais ne perd pas pour cela la qualit d'effet ; la raction qu'il exerce est par consquent secondaire. L'accroissement de la division du travail est donc d ce fait que les segments sociaux perdent de leur individualit, que les cloisons qui les sparent deviennent plus permables, en un mot qu'il s'effectue entre eux une coalescence qui rend la matire sociale libre pour entrer dans des combinaisons nouvelles. Mais la disparition de ce type ne peut avoir cette consquence que pour une seule raison. C'est qu'il en rsulte un rapprochement entre des individus qui taient spars ou, tout au moins, un rapprochement plus intime qu'il n'tait ; par suite, des mouvements s'changent entre des parties de la masse sociale qui, jusque-l, ne s'affectaient mutuellement pas. Plus le systme alvolaire s'est dvelopp, plus les relations dans
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
29
lesquelles chacun de nous est engag se renferment dans les limites de l'alvole laquelle nous appartenons. Il y a comme des vides moraux entre les divers segments. Au contraire, ces vides se comblent mesure que ce systme se nivelle. La vie sociale, au lieu de se concentrer en une multitude de petits foyers distincts et semblables, se gnralise. Les rapports sociaux - on dirait plus exactement intra-sociaux deviennent par consquent plus nombreux, puisque de tous cts ils s'tendent audel de leurs limites primitives. La division du travail progresse donc d'autant plus qu'il y a plus d'individus qui sont suffisamment en contact pour pouvoir agir et ragir les uns sur les autres. Si nous convenons d'appeler densit dynamique ou morale ce rapprochement et le commerce actif qui en rsulte, nous pourrons dire que les progrs de la division du travail sont en raison directe de la densit morale ou dynamique de la socit. Mais ce rapprochement moral ne peut produire son effet que si la distance relle entre les individus a elle-mme diminu, de quelque manire que ce soit. L densit morale ne peut donc s'accrotre sans que la densit matrielle s'accroisse en mme temps, et celle-ci peut servir mesurer celle-l. Il est, d'ailleurs, inutile de rechercher laquelle des deux a dtermin l'autre ; il suffit de constater qu'elles sont insparables. La condensation progressive des socits au cours du dveloppement historique se produit de trois manires principales. 1 Tandis que les socits infrieures se rpandent sur des aires immenses relativement au nombre des individus qui les composent, chez les peuples plus avancs, la population va toujours en se concentrant. Opposons, dit M. Spencer, la populosit des rgions habites par des tribus sauvages avec celle des rgions d'une gale tendue en Europe ; ou bien, opposons la densit de la population en Angleterre sous l'Heptarchie avec la densit qu'elle prsente aujourd'hui, et nous reconnatrons que la croissance produite par union de groupes s'accompagne aussi d'une croissance interstitielle 1. Les changements qui se sont successivement effectus dans la vie industrielle des nations dmontrent la gnralit de cette transformation. L'industrie des nomades, chasseurs ou pasteurs, implique en effet l'absence de toute concentration, la dispersion sur une surface aussi grande que possible. L'agriculture, parce qu'elle ncessite une vie sdentaire, suppose dj un certain resserrement des tissus sociaux, mais encore bien incomplet, puisque entre chaque famille il y a des tendues de terre interposes 2. Dans la cit, quoique la condensation y ft plus grande, cependant les maisons n'taient pas contigus, car la mitoyennet n'tait pas connue du droit romain 3. Elle est ne sur notre sol et atteste que la trame sociale y est devenue moins lche 4. D'autre part, depuis leurs origines, les socits europennes ont vu leur densit s'accrotre d'une manire continue, malgr quelques cas de rgression passagre 5.
1 2 3 4
Sociologie, II, 31. Colunt diversi ac discrett, dit Tacite des Germains ; suam quisque domum spatio circumdat (German., XVI). Voir dans ACCARIAS, Prcis, 1, 640, la liste des servitudes urbaines. Cf. FUSTEL, La cit antique, p. 65. En raisonnant ainsi, nous n'entendons pas dire que les progrs de la densit rsultent des changements conomiques. Les deux faits se conditionnent mutuellement, et cela suffit pour que la prsence de l'un atteste celle de l'autre. Voir LEVASSEUR, La population franaise, passim.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
30
2 La formation des villes et leur dveloppement est un autre symptme, plus caractristique encore, du mme phnomne. L'accroissement de la densit moyenne peut tre uniquement d l'augmentation matrielle de la natalit et, par consquent, peut se concilier avec une concentration trs faible, un maintien trs marqu du type segmentaire. Mais les villes rsultent toujours du besoin qui pousse les individus se tenir d'une manire constante en contact aussi intime que possible les uns avec les autres ; elles sont comme autant de points o la masse sociale se contracte plus fortement qu'ailleurs. Elles ne peuvent donc se multiplier et s'tendre que si la densit morale s'lve. Nous verrons du reste qu'elles se recrutent par voie d'immigration, ce qui n'est possible que dans la mesure o la fusion des segments sociaux est avance. Tant que l'organisation sociale est essentiellement segmentaire, la ville n'existe pas. Il n'y en a pas dans les socits infrieures ; on n'en rencontre ni chez les Iroquois, ni chez les anciens Germains 1. Il en fut de mme des populations primitives de l'Italie. Les peuples d'Italie, dit Marquardt, habitaient primitivement non dans des villes, mais en communauts familiales ou villages (pagi), dans lesquels les fermes (vici, [en grec dans le texte]) taient dissmines 2. Mais, au bout d'un temps assez court, la ville y fait son apparition. Athnes, Rome sont ou deviennent des villes, et la mme transformation s'accomplit dans toute l'Italie. Dans nos socits chrtiennes, la ville se montre ds l'origine, car celles qu'avait laisses l'Empire romain ne disparurent pas avec lui. Depuis, elles n'ont fait que s'accrotre et se multiplier. La tendance des campagnes affluer vers les villes, si gnrale dans le monde civilis 3, n'est qu'une suite de ce mouvement ; or, elle ne date pas d'aujourd'hui : ds le XVIIe sicle elle proccupait les hommes d'tat 4. Parce que les socits commencent gnralement par une priode agricole, on a parfois t tent de regarder le dveloppement des centres urbains comme un signe de vieillesse et de dcadence 5. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette phase agricole est d'autant plus courte que les socits sont d'un type plus lev. Tandis qu'en Germanie, chez les Indiens de l'Amrique et chez tous les peuples primitifs, elle dure autant que ces peuples eux-mmes, Rome, Athnes, elle cesse assez tt, et, chez nous, on peut dire qu'elle n'a jamais exist sans mlange. Inversement, la vie urbaine commence plus tt et, par consquent, prend plus d'extension. L'acclration rgulirement plus rapide de ce dveloppement dmontre que, loin de constituer une sorte de phnomne pathologique, il drive de la nature mme des espces sociales suprieures. A supposer doue que ce mouvement ait atteint aujourd'hui des proportions menaantes pour nos socits, qui n'ont peut-tre plus la souplesse suffisante pour s'y adapter, il ne laissera pas de se poursuivre soit par elles, soit aprs elles, et les types sociaux qui se formeront aprs les ntres se distingueront vraisemblablement par une rgression plus rapide et plus complte encore de la civilisation agricole. 3 Enfin, il y a le nombre et la rapidit des voies de communication et de transmission. En supprimant ou en diminuant les vides qui sparent les segments sociaux,
1 2 3 4 5
Voir TACITE, Germ., XVI. - SOHM, Ueber die Entstehung der Stdte. Rmische Alterthmer, IV, 3. Voir sur ce point DUMONT, Dpopulation et civilisation, Paris, 1890, chap. VIII, et OETTINGEN, Moralstatistik, p. 273 et suiv. Voir LEVASSEUR, op. cit., p. 200. Il nous semble que c'est l'opinion de M. TARDE dans ses Lois de l'imitation.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
31
elles accroissent la densit de la socit. D'autre part, il n'est pas ncessaire de dmontrer qu'elles sont d'autant plus nombreuses et plus perfectionnes que les socits sont d'un type plus lev. Puisque ce symbole visible et mesurable reflte les variations de ce que nous avons appel la densit morale 1, nous pouvons le substituer cette dernire dans la formule que nous avons propose. Nous devons, d'ailleurs, rpter ici ce que nous disions plus haut. Si la socit, en se condensant, dtermine le dveloppement de la division du travail, celui-ci, son tour, accrot la condensation de la socit. Mais il n'importe ; car la division du travail reste le fait driv, et, par consquent, les progrs par lesquels elle passe sont dus aux progrs parallles de la densit sociale, quelles que soient les causes de ces derniers. C'est tout ce que nous voulions tablir. Mais ce facteur n'est pas le seul. Si la condensation de la socit produit ce rsultat, c'est qu'elle multiplie les relations intra-sociales. Mais celles-ci seront encore plus nombreuses si, en outre, le chiffre total des membres de la socit devient plus considrable. Si elle comprend plus d'individus en mme temps qu'ils sont plus intimement en contact, l'effet sera ncessairement renforc. Le volume social a donc sur la division du travail la mme influence que la densit. En fait, les socits sont gnralement d'autant plus volumineuses qu'elles sont plus avances et, par consquent, que le travail y est plus divis. Les socits comme les corps vivants, dit M. Spencer, commencent sous forme de germes, naissent de masses extrmement tnues en comparaison de celles auxquelles elles finissent par arriver. De petites hordes errantes, telles que celles des races infrieures, sont sorties les plus grandes socits : c'est une conclusion qu'on ne saurait nier 2. Ce que nous avons dit sur la constitution segmentaire rend cette vrit indiscutable. Nous savons, en effet, que les socits sont formes par un certain nombre de segments d'tendue ingale qui s'enveloppent mutuellement. Or, ces cadres ne sont pas des crations artificielles, surtout dans le principe ; et mme quand ils sont devenus conventionnels, ils imitent et reproduisent autant que possible les formes de l'arrangement naturel qui avait prcd. Ce sont autant de socits anciennes qui se maintiennent sous cette forme. Les plus vastes d'entre ces subdivisions, celles qui comprennent les autres, correspondent au type social infrieur le plus proche ; de mme, parmi les segments dont elles sont leur tour composes, les plus tendus sont des vestiges du type qui vient directement au-dessous du prcdent, et ainsi de suite. On retrouve chez les peuples les plus avancs des traces de l'organisation sociale la plus primitive 3. C'est ainsi que la tribu est forme par un agrgat de hordes ou de clans ; la nation (la nation juive par exemple) et la cit par un agrgat de tribus ; la cit son tour, avec les villages qui lui sont subordonns, entre comme lment dans des socits plus composes, etc. Le volume social ne peut donc manquer de s'accrotre, puisque chaque espce est constitue par une rptition de socits, de l'espce immdiatement antrieure.
1 2 3
Toutefois, il y a des cas particuliers, exceptionnels, o la densit matrielle et la densit morale ne sont peut-tre pas tout fait en rapport. Voir plus bas, chap. III, note finale. Sociologie, II, 23. Le village, qui n'est originellement qu'un clan fix.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
32
Cependant il y a des exceptions. La nation juive, avant la conqute, tait vraisemblablement plus volumineuse que - la cit romaine du Ive sicle ; pourtant elle est d'une espce infrieure. La Chine, la Russie sont beaucoup plus populeuses que les nations les plus civilises de l'Europe. Chez ces mmes peuples, par consquent, la division du travail n'est pas dveloppe en raison du volume social. C'est qu'en effet l'accroissement du volume n'est pas ncessairement une marque de supriorit si la densit ne s'accrot en mme temps et dans le mme rapport. Car une socit peut atteindre de trs grandes dimensions, parce qu'elle comprend un trs grand nombre de segments, quelle que soit la nature de ces derniers ; si donc mme les plus vastes d'entre eux ne reproduisent que des socits d'un type trs infrieur, la structure segmentaire restera trs prononce, et, par suite, l'organisation sociale peu leve. Un agrgat mme immense de clans est au-dessous de la plus petite socit organise, puisque celle-ci a dj parcouru des stades de l'volution en de desquels il est rest. De mme, si le chiffre des units sociales a de l'influence sur la division du travail, ce n'est pas par soi-mme et ncessairement, mais c'est que le nombre des relations sociales augmente gnralement avec celui des individus. Or, pour que ce rsultat soit atteint, ce n'est pas assez que la socit compte beaucoup de sujets, mais il faut encore qu'ils soient assez intimement en contact pour pouvoir agir et ragir les uns sur les autres. Si, au contraire, ils sont spars par des milieux opaques, ils ne peuvent nouer de rapports que rarement et malaisment, et tout se passe comme s'ils taient en petit nombre. Le crot du volume social n'acclre donc pas toujours les progrs de la division du travail, mais seulement quand la masse se contracte en mme temps et dans la mme mesure. Par suite, ce n'est, si l'on veut, qu'un facteur additionnel ; mais quand il se joint au premier, il en amplifie les effets par une action qui lui est propre et, par consquent, demande en tre distingu. Nous pouvons donc formuler la proposition suivante : La division du travail varie en raison directe du volume et de la densit des socits, et si elle progresse d'une manire continue au cours du dveloppement social, c'est que les socits deviennent rgulirement plus denses et trs gnralement plus volumineuses. En tout temps, il est vrai, on a bien compris qu'il y avait une relation entre ces deux ordres de faits ; car, pour que les fonctions se spcialisent davantage, il faut qu'il y ait plus de cooprateurs et qu'ils soient assez rapprochs pour pouvoir cooprer. Mais, d'ordinaire, on ne voit gure dans cet tat des socits que le moyen par lequel la division du travail se dveloppe, et non la cause de ce dveloppement. On fait dpendre ce dernier d'aspirations individuelles vers le bien-tre et le bonheur, qui peuvent se satisfaire d'autant mieux que les socits sont plus tendues et plus condenses. Tout autre est la loi que nous venons d'tablir. Nous disons, non que la croissance et la condensation des socits permettent, mais qu'elles ncessitent une division plus grande du travail. Ce n'est pas un instrument par lequel celle-ci se ralise ; c'en est la cause dterminante 1.
1
Sur ce point encore nous pouvons nous appuyer sur l'autorit de Comte: Je dois seulement, dit-il, indiquer maintenant la condensation progressive de notre espce comme un dernier lment gnral concourant rgler la vitesse effective du mouvement social. On peut donc d'abord aisment reconnatre que cette influence contribue beaucoup, surtout l'origine, dterminer dans l'ensemble du travail humain une division de plus en plus spciale, ncessairement incompatible avec un petit nombre de cooprateurs. En outre, par une proprit plus intime et moins connue, quoique encore plus capitale, une telle condensation stimule directement, d'une manire trs puissante, au dveloppement plus rapide de l'volution sociale, soit en poussant les individus tenter de nouveaux efforts pour s'assurer par des moyens plus raffins une existence qui, autrement, deviendrait plus difficile, soit aussi en obligeant la socit ragir avec une nergie
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
33
Mais comment peut-on se reprsenter la manire dont cette double cause produit son effet ?
II
Suivant M. Spencer, si l'accroissement du volume social a une influence sur les progrs de la division du travail, ce n'est pas qu'il les dtermine ; il ne fait que les acclrer. C'est seulement une condition adjuvante du phnomne. Instable par nature, toute masse homogne devient forcment htrogne, quelles qu'en soient les dimensions ; seulement, elle se diffrencie plus compltement et plus vite quand elle est plus tendue. En effet, comme cette htrognit vient de ce que les diffrentes parties de la masse sont exposes l'action de forces diffrentes, elle est d'autant plus grande qu'il y a plus de parties diversement situes. C'est le cas pour les socits : Quand une communaut, devenant fort populeuse, se rpand sur une grande tendue de pays et s'y tablit, si bien que ses membres vivent et meurent dans leurs districts respectifs, elle maintient ses diverses sections dans des circonstances physiques diffrentes, et alors ces sections ne peuvent plus rester semblables par leurs occupations. Celles qui vivent disperses continuent chasser et cultiver la terre ; celles qui s'tendent sur le bord de la mer s'adonnent des occupations maritimes ; les habitants de quelque endroit choisi, peut-tre pour sa position centrale, comme lieu de runions priodiques, deviennent commerants, et une ville se fonde... Une diffrence dans le sol et dans le climat fait que les habitants des campagnes, dans les diverses rgions du pays, ont des occupations spcialises en partie et se distinguent en ce qu'ils produisent des bufs, ou des moutons, ou du bl 1. En un mot, la varit des milieux dans lesquels sont placs les individus produit chez ces derniers des aptitudes diffrentes qui dterminent leur spcialisation dans des sens divergents, et si cette spcialisation s'accrot avec les dimensions des socits, c'est que ces diffrences externes s'accroissent en mme temps. Il n'est pas douteux que les conditions extrieures dans lesquelles vivent les individus ne les marquent de leur empreinte et que, tant diverses, elles ne les diffrencient. Mais il s'agit de savoir si cette diversit, qui, sans doute, n'est pas sans rapports avec la division du travail, suffit la constituer. Assurment, on s'explique que, suivant les proprits du sol et les conditions du climat, les habitants produisent ici du bl, ailleurs des moutons ou des bufs. Mais les diffrences fonctionnelles ne se rduisent pas toujours, comme dans ces deux exemples, de simples nuances ; elles sont parfois si tranches que les individus entre lesquels le travail est divis forment comme autant d'espces distinctes et mme opposes. On dirait qu'ils conspirent pour s'carter le plus possible les uns des autres. Quelle ressemblance y at-il entre le cerveau qui pense et l'estomac qui digre ? De mme, qu'y a-t-il de commun entre le pote tout entier son rve, le savant tout entier ses recherches,
plus opinitre et mieux concerte pour lutter plus opinitrement contre l'essor plus puissant des divergences particulires. A l'un et l'autre titre, on voit qu'il ne s'agit point ici de l'augmentation absolue du nombre des individus, mais surtout de leur concours plus intense sur un espace donn (Cours, IV, 455). Premiers principes, 381.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
34
l'ouvrier qui passe sa vie tourner des ttes d'pingles, le laboureur qui pousse sa charrue, le marchand derrire son comptoir ? Si grande que soit la varit des conditions extrieures, elle ne prsente nulle part des diffrences qui soient en rapport avec des contrastes aussi fortement accuss, et qui, par consquent, puissent en rendre compte. Alors mme que l'on compare, non plus des fonctions trs loignes l'une de l'autre, mais seulement des embranchements divers d'une mme fonction, il est souvent tout fait impossible d'apercevoir quelles dissemblances extrieures peut tre due leur sparation. Le travail scientifique va de plus en plus en se divisant. Quelles sont les conditions climatriques, gologiques ou mme sociales qui peuvent avoir donn naissance ces talents si diffrents du mathmaticien, du chimiste, du naturaliste, du psychologue, etc. ? Mais, l mme o les circonstances extrieures inclinent le plus fortement les individus se spcialiser dans un sens dfini, elles ne suffisent pas dterminer cette spcialisation. Par sa constitution, la femme est prdispose mener une vie diffrente de l'homme ; cependant, il y a des socits o les occupations des sexes sont sensiblement les mmes. Par son ge, par les relations de sang qu'il soutient avec ses enfants, le pre est tout indiqu pour exercer dans la famille ces fonctions directrices dont l'ensemble constitue le pouvoir paternel. Cependant, dans la famille maternelle, ce n'est pas lui qu'est dvolue cette autorit. Il parat tout naturel que les diffrents membres de la famille aient des attributions, c'est--dire des fonctions diffrentes suivant leur degr de parent ; que le pre et l'oncle, le frre et le cousin n'aient ni les mmes droits, ni les mmes devoirs. Il y a cependant des types familiaux o tous les adultes jouent le mme rle et sont sur le mme pied d'galit, quels que soient leurs rapports de consanguinit. La situation infrieure qu'occupe le prisonnier de guerre au sein d'une tribu victorieuse semble le condamner - si du moins la vie lui est conserve - aux fonctions sociales les plus basses. Nous avons vu pourtant qu'il est souvent assimil aux vainqueurs et devient leur gal. C'est qu'en effet, si ces diffrences rendent possible la division du travail, elles ne la ncessitent pas. De ce qu'elles sont donnes, il ne suit pas forcment qu'elles soient utilises. Elles sont peu de chose, en somme, ct des ressemblances que les hommes continuent prsenter entre eux; ce n'est qu'un germe peine distinct. Pour qu'il en rsulte une spcialisation de l'activit, il faut qu'elles soient dveloppes et organises, et ce dveloppement dpend videmment d'autres causes que la varit des conditions extrieures. Mais, dit M. Spencer, il se fera de lui-mme, parce qu'il suit la ligne de la moindre rsistance et que toutes les forces de la nature se portent invinciblement dans cette direction. Assurment, si les hommes se spcialisent, ce sera dans le sens marqu par ces diffrences naturelles, car c'est de cette manire qu'ils auront le moins de peine et le plus de profit. Mais pourquoi se spcialisent-ils ? Qu'est-ce qui les dtermine pencher ainsi du ct par o ils se distinguent les uns des autres ? M. Spencer explique assez bien de quelle manire se produira l'volution, si elle a lieu ; mais il ne nous dit pas quel est le ressort qui la produit. A vrai dire, pour lui, la question ne se pose mme pas. Il admet en effet que le bonheur s'accrot avec la puissance productive du travail. Toutes les fois donc qu'un moyen nouveau est donn de diviser davantage le travail, il lui parat impossible que nous ne nous en saisissions pas. Mais nous savons que les choses ne se passent pas ainsi. En ralit, ce moyen n'a de valeur pour nous que si nous en avons besoin, et comme l'homme primitif n'a aucun besoin de tous ces produits que l'homme civilis a appris dsirer et qu'une organisation plus complexe du travail a prcisment pour effet de lui fournir, nous ne pouvons comprendre d'o vient la spcialisation croissante des tches que si nous savons comment ces besoins nouveaux se sont constitus.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
35
III
Si le travail se divise davantage mesure que les socits deviennent plus volumineuses et plus denses, ce n'est pas parce que les circonstances extrieures y sont plus varies, c'est que la lutte pour la vie y est plus ardente. Darwin a trs justement observ que la concurrence entre deux organismes est d'autant plus vive qu'ils sont plus analogues. Ayant les mmes besoins et poursuivant les mmes objets, ils se trouvent partout en rivalit. Tant qu'ils ont plus de ressources qu'il ne leur en faut, ils peuvent encore vivre cte cte ; mais si leur nombre vient s'accrotre dans de telles proportions que tous les apptits ne puissent plus tre suffisamment satisfaits, la guerre clate, et elle est d'autant plus violente que cette insuffisance est plus marque, c'est--dire que le nombre des concurrents est plus lev. Il en est tout autre ment si les individus qui coexistent sont d'espces ou de varits diffrentes. Comme ils ne se nourrissent pas de la mme manire et ne mnent pas le mme genre de vie, ils ne se gnent pas mutuellement ; ce qui fait prosprer les uns est sans valeur pour les autres. Les occasions de conflits diminuent donc avec les occasions de rencontre, et cela d'autant plus que ces espces ou varits sont plus distantes les unes des autres. Ainsi, dit Darwin, dans une rgion peu tendue, ouverte l'immigration et o, par consquent, la lutte d'individu individu doit tre trs vive, on remarque toujours une trs grande diversit dans les espces qui l'habitent. J'ai trouv qu'une surface gazonne de trois pieds sur quatre, qui avait t expose pendant de longues annes aux mmes conditions de vie, nourrissait vingt espces de plantes appartenant dix-huit genres et huit ordres, ce qui montre combien ces plantes diffraient les unes des autres 1. Tout le monde, d'ailleurs, a remarqu que, dans un mme champ, ct des crales, il peut pousser un trs grand nombre de mauvaises herbes. Les animaux, eux aussi, se tirent d'autant plus facilement de la lutte qu'ils diffrent davantage. On trouve sur un chne jusqu' deux cents espces d'insectes qui n'ont les unes avec les autres que des relations de bon voisinage. Les uns se nourrissent des fruits de l'arbre, les autres des feuilles, d'autres de l'corce et des racines. Il serait, dit Haeckel, absolument impossible qu'un pareil nombre d'individus vct sur cet arbre, si tous appartenaient la mme espce, si tous, par exemple, vivaient aux dpens de l'corce ou seulement des feuilles 2. De mme encore, l'intrieur de l'organisme, ce qui adoucit la concurrence entre les diffrents tissus c'est qu'ils se nourrissent de substances diffrentes. Les hommes subissent la mme loi. Dans une mme ville, les professions diffrentes peuvent coexister sans tre obliges de se nuire rciproquement, car elles poursuivent des objets diffrents. Le soldat recherche la gloire militaire, le prtre l'autorit morale, l'homme d'tat le pouvoir, l'industriel la richesse, le savant la renomme scientifique ; chacun d'eux peut donc atteindre son but sans empcher les autres d'atteindre le leur. Il en est encore ainsi mme quand les fonctions sont moins loignes les unes des autres. Le mdecin oculiste ne fait pas concurrence celui qui soigne les maladies mentales, ni le cordonnier au chapelier, ni le maon l'bniste,
1 2
Origine des espces, 131. Histoire de la cration naturelle, 240.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
36
ni le physicien au chimiste, etc. Comme ils rendent des services diffrents, ils peuvent les rendre paralllement. Cependant, plus les fonctions se rapprochent. plus il y a entre elles de points de contact, plus, par consquent, elles sont exposes se combattre. Comme, dans ce cas, elles satisfont par des moyens diffrents des besoins semblables, il est invitable qu'elles cherchent plus ou moins empiter les unes sur les autres. Jamais le magistrat ne concourt avec l'industriel ; mais le brasseur et le vigneron, le drapier et le fabricant de soieries, le pote et le musicien s'efforcent souvent de se supplanter mutuellement. Quant ceux qui s'acquittent exactement de la mme fonction, ils ne peuvent prosprer qu'au dtriment les uns des autres. Si donc on se reprsente ces diffrentes fonctions sous la forme d'un faisceau ramifi, issu d'une souche commune, la lutte est son minimum entre les points extrmes, tandis qu'elle augmente rgulirement mesure qu'on se rapproche du centre. Il en est ainsi, non pas seulement l'intrieur de chaque ville, mais dans toute l'tendue de la socit. Les professions similaires situes sur les diffrents points du territoire se font une concurrence d'autant plus vive qu'elles sont plus semblables, pourvu que la difficult des communications et des transports ne restreigne pas le cercle de leur action. Cela pos, il est ais de comprendre que toute condensation de la masse sociale, surtout si elle est accompagne d'un accroissement de la population, dtermine ncessairement des progrs de la division du travail. En effet, reprsentons-nous un centre industriel qui alimente d'un produit spcial une certaine rgion du pays. Le dveloppement qu'il est susceptible d'atteindre est doublement limit, d'abord par l'tendue des besoins qu'il s'agit de satisfaire ou, comme on dit, par l'tendue du march, ensuite par la puissance des moyens de production dont il dispose. Normalement, il ne produit pas plus qu'il ne faut, encore bien moins produit-il plus qu'il ne peut. Mais, s'il lui est impossible de dpasser la limite qui est ainsi marque, il s'efforce de l'atteindre ; car il est dans la nature d'une force de dvelopper toute son nergie tant que rien ne vient l'arrter. Une fois parvenu ce point, il est adapt ses conditions d'existence ; il se trouve dans une position d'quilibre qui ne peut changer si rien ne change. Mais voici qu'une rgion, jusqu'alors indpendante de ce centre, y est relie par une voie de communication qui supprime partiellement la distance. Du mme coup, une des barrires qui arrtaient son essor s'abaisse ou, du moins, recule ; le march s'tend, il y a maintenant plus de besoins satisfaire. Sans doute, si toutes les entreprises particulires qu'il comprend avaient dj ralis le maximum de production qu'elles peuvent atteindre, comme elles ne sauraient s'tendre davantage, les choses resteraient en l'tat. Seulement, une telle condition est tout idale. En ralit, il y a toujours un nombre plus ou moins grand d'entreprises qui ne sont pas arrives leur limite et qui ont, par consquent, de la vitesse pour aller plus loin. Comme un espace vide leur est ouvert, elles cherchent ncessairement s'y rpandre et le remplir. Si elles y rencontrent des entreprises semblables et qui sont en tat de leur rsister, les secondes contiennent les premires, elles se limitent mutuellement et, par suite, leurs rapports mutuels ne sont pas changs. Il y a, sans doute, plus de concurrents ; mais, comme ils se partagent un march plus vaste, la part de chacun des deux camps reste la mme. Mais s'il en est qui prsentent quelque infriorit, elles devront ncessairement cder le terrain qu'elles occupaient jusque-l et o elles ne peuvent plus se maintenir dans les conditions nouvelles o la lutte s'engage. Elles n'ont plus alors d'autre alternative que de disparatre ou de se transformer, et cette transformation doit
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
37
ncessairement aboutir une spcialisation nouvelle. Car si, au lieu de crer immdiatement une spcialit de plus, les plus faibles prfraient adopter une autre profession, mais qui existait dj, il leur faudrait entrer en concurrence avec ceux qui l'ont exerce jusqu'alors. La lutte ne serait donc plus close, mais seulement dplace, et elle produirait sur un autre point ses consquences. Finalement, il faudrait bien qu'il y et quelque part ou une limination ou une nouvelle diffrenciation. Il n'est pas ncessaire d'ajouter que, si la socit compte effectivement plus de membres en mme temps qu'ils sont plus rapprochs les uns des autres, la lutte est encore plus ardente et la spcialisation qui en rsulte plus rapide et plus complte. En d'autres termes, dans la mesure o la constitution sociale est segmentaire, chaque segment a ses organes propres qui sont comme protgs et tenus distance des organes semblables par les cloisons qui sparent les diffrents segments. Mais, mesure que ces cloisons s'effacent, il est invitable que les organes similaires s'atteignent, entrent en lutte et s'efforcent de se substituer les uns aux autres. Or, de quelque manire que se fasse cette substitution, il ne peut manquer d'en rsulter quelque progrs dans la voie de la spcialisation. Car, d'une part, l'organe segmentaire qui triomphe, si l'on peut ainsi parler, ne peut suffire a la tche plus vaste qui lui incombe dsormais que grce une plus grande division du travail, et d'autre part les vaincus ne peuvent se maintenir qu'en se concentrant une partie seulement de la fonction totale qu'ils remplissaient jusqu'alors. Le petit patron devient contrematre, le petit marchand devient employ, etc. Cette part peut d'ailleurs tre plus ou moins considrable suivant que l'infriorit est plus ou moins marque. Il arrive mme que la fonction primitive se dissocie simplement en deux fractions d'gale importance. Au lieu d'entrer ou de rester en concurrence, deux entreprises semblables retrouvent l'quilibre en se partageant leur tche commune ; au lieu de se subordonner l'une l'autre, elles se coordonnent. Mais, dans tous les cas, il y a apparition de spcialits nouvelles. Quoique les exemples qui prcdent soient surtout emprunts la vie conomique, cette explication s'applique toutes les fonctions sociales indistinctement. Le travail scientifique, artistique, etc., ne se divise pas d'une autre manire ni pour d'autres raisons. C'est encore en vertu des mmes causes que, comme nous l'avons vu, l'appareil rgulateur central absorbe en lui les organes rgulateurs locaux et les rduit au rle d'auxiliaires spciaux. De tous ces changements rsulte-t-il un accroissement du bonheur moyen ? On ne voit pas quelle cause il serait d. L'intensit plus grande de la lutte implique de nouveaux et pnibles efforts qui ne sont pas de nature rendre les hommes plus heureux. Tout se passe mcaniquement. Une rupture d'quilibre dans la masse sociale suscite des conflits qui ne peuvent tre rsolus que par une division du travail plus dveloppe : tel est le moteur du progrs. Quant aux circonstances extrieures, aux combinaisons varies de l'hrdit, comme les dclivits du terrain dterminent la direction d'un courant, mais ne le crent pas, elles marquent le sens dans lequel se fait la spcialisation l o elle est ncessaire, mais ne la ncessitent pas. Les diffrences individuelles qu'elles produisent resteraient l'tat de virtualit si, pour faire face des difficults nouvelles, nous n'tions contraints de les mettre en saillie et de les dvelopper. La division du travail est donc un rsultat de la lutte pour la vie : mais elle en est un dnouement adouci. Grce elle, en effet, les rivaux ne sont pas obligs de s'liminer mutuellement, mais peuvent coexister les uns ct des autres. Aussi,
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
38
mesure qu'elle se dveloppe, elle fournit un plus grand nombre d'individus qui, dans des socits plus homognes, seraient condamns disparatre, les moyens de se maintenir et de survivre. Chez beaucoup de peuples infrieurs, tout organisme mal venu devait fatalement prir ; car il n'tait utilisable pour aucune fonction. Parfois, la loi, devanant et consacrant en quelque sorte les rsultats de la slection naturelle, condamnait mort les nouveau-ns infirmes ou faibles, et Aristote lui-mme 1 trouvait cet usage naturel. Il en est tout autrement dans les socits plus avances. Un individu chtif peut trouver dans les cadres complexes de notre organisation sociale une place o il lui est possible de rendre des services. S'il n'est faible que de corps et si son cerveau est sain, il se consacrera aux travaux de cabinet, aux fonctions spculatives. Si c'est son cerveau qui est dbile, il devra, sans doute, renoncer affronter la grande concurrence intellectuelle ; ruais la socit a, dans les alvoles secondaires de sa ruche, des places assez petites qui l'empchent d'tre limin 2 . De mme, chez les peuplades primitives, l'ennemi vaincu est mis mort ; l o les fonctions industrielles sont spares des fonctions militaires, il subsiste ct du vainqueur en qualit d'esclave. Il y a bien quelques circonstances o des fonctions diffrentes entrent en concurrence. Ainsi, dans l'organisme individuel, la suite d'un jene prolong, le systme nerveux se nourrit aux dpens des autres organes, et le mme phnomne se produit si l'activit crbrale prend un dveloppement trop considrable. Il en est de mme dans la socit. En temps de famine ou de crise conomique, les fonctions vitales sont obliges, pour se maintenir, de prendre leurs subsistances aux fonctions moins essentielles. Les industries de luxe priclitent, et les portions de la fortune publique qui servaient les entretenir sont absorbes par les industries d'alimentation ou d'objets de premire ncessit. Ou bien encore il peut arriver qu'un organisme parvienne un degr d'activit anormal, disproportionn aux besoins, et que, pour subvenir aux dpenses causes par ce dveloppement exagr, il lui faille prendre sur la part qui revient aux autres. Par exemple, il y a des socits o il y a trop de fonctionnaires, ou trop de soldats, ou trop d'officiers, ou trop d'intermdiaires, ou trop de prtres, etc. ; les autres professions souffrent de cette hypertrophie. Mais tous ces cas sont pathologiques ; ils sont dus ce que la nutrition de l'organisme ne se fait pas rgulirement ou ce que l'quilibre fonctionnel est rompu.
Mais une objection se prsente l'esprit : Une industrie ne peut vivre que si elle rpond quelque besoin. Une fonction ne peut se spcialiser que si cette spcialisation correspond quelque besoin de la socit. Or, toute spcialisation nouvelle a pour rsultat d'augmenter et d'amliorer la production. Si cet avantage n'est pas la raison d'tre de la division du travail, c'en est la consquence ncessaire. Par consquent, un progrs ne peut s'tablir d'une manire durable que si les individus ressentent rellement le besoin de produits plus abondants ou de meilleure qualit. Tant que l'industrie des transports n'tait pas constitue, chacun se dplaait avec les moyens dont il disposait, et on tait fait cet tat de choses. Pourtant, pour qu'elle ait pu devenir une spcialit, il a fallu que les hommes
1 2
Politique, IV (VII), 16, 1335 b, 20 et suiv. BORDIER, Vie des socits, 45.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
39
cessassent de se contenter de ce qui leur avait suffi jusqu'alors et devinssent plus exigeants. Mais d'o peuvent venir ces exigences nouvelles ? Elles sont un effet de cette mme cause qui dtermine les progrs de la division du travail. Nous venons de voir en effet qu'ils sont dus l'ardeur plus grande de la lutte. Or, une lutte plus violente ne va pas sans un plus grand dploiement de forces et, par consquent, sans de plus grandes fatigues. Mais pour que la vie se maintienne, il faut toujours que la rparation soit proportionne la dpense ; c'est pourquoi les aliments qui, jusqu'alors, suffisaient restaurer l'quilibre organique sont dsormais insuffisants. Il faut une nourriture plus abondante et plus choisie. C'est ainsi que le paysan, dont le travail est moins puisant que celui de l'ouvrier des villes, se soutient tout aussi bien, quoique avec une alimentation plus pauvre. Celui-ci ne peut se contenter d'une nourriture vgtale, et encore, mme dans ces conditions, a-t-il bien du mal compenser le dficit qu'un travail intense et continu creuse chaque jour dans le budget de son organisme 1. D'autre part, c'est surtout le systme nerveux central qui supporte tous ces frais 2 ; car il faut s'ingnier pour trouver des moyens de soutenir la lutte, pour crer des spcialits nouvelles, pour les acclimater, etc. D'une manire gnrale, plus le milieu est sujet au changement, plus la part de l'intelligence dans la vie devient grande ; car elle seule peut retrouver les conditions nouvelles d'un quilibre qui se rompt sans cesse, et le restaurer. La vie crbrale se dveloppe donc en mme temps que la concurrence devient plus vive, et dans la mme mesure. On constate ces progrs parallles non pas seulement chez l'lite, mais dans toutes les classes de la socit. Sur ce point encore, il n'y a qu' comparer l'ouvrier avec l'agriculteur ; c'est un fait connu que le premier est beaucoup plus intelligent, malgr le caractre machinal des tches auxquelles il est souvent consacr. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison que les maladies mentales marchent du mme pas que la civilisation, ni qu'elles svissent dans les villes de prfrence aux campagnes, et dans les grandes villes plus que dans les petites 3. Or, un cerveau plus volumineux et plus dlicat a d'autres exigences qu'un encphale plus grossier. Des peines ou des privations que celui-ci ne sentait mme pas branlent douloureusement celui-l. Pour la mme raison, il faut des excitants moins simples pour affecter agrablement cet organe, une fois qu'il s'est affin, et il en faut davantage, parce qu'il s'est en mme temps dvelopp. Enfin, plus que tous les autres, les besoins proprement intellectuels s'accroissent 4 ; des explications grossires ne peuvent plus satisfaire des esprits plus exercs. On rclame des clarts nouvelles, et la science entretient ces aspirations en mme temps qu'elle les satisfait. Tous ces changements sont donc produits mcaniquement par des causes ncessaires. Si notre intelligence et notre sensibilit se dveloppent et s'aiguisent, c'est que nous les exerons davantage ; et si nous les exerons plus, c'est que nous y sommes contraints par la violence plus grande de la lutte que nous avons soutenir. Voil comment, sans l'avoir voulu, l'humanit se trouve apte recevoir une culture plus intense et plus varie.
1 2 3 4
Voir BORDIER, op. cit., 166 et suiv. FR, Dgnrescence et criminalit, 88. Voir art. Alination mentale , dans le Dictionnaire encyclopdique des sciences mdicales. Ce dveloppement de la vie proprement intellectuelle ou scientifique a encore une autre cause que nous verrons au chapitre suivant.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
40
Cependant, si un autre facteur n'intervenait, cette simple prdisposition ne saurait susciter elle-mme les moyens de se satisfaire, car elle ne constitue qu'une aptitude jouir, et, suivant la remarque de M. Bain, de simples aptitudes jouir ne provoquent pas ncessairement le dsir. Nous pouvons tre constitus de manire prendre du plaisir cultiver la musique, la peinture, la science, et cependant ne pas le dsirer, si on nous en a toujours empchs 1 . Mme quand nous sommes pousss vers un objet par une impulsion hrditaire et trs forte, nous ne pouvons le dsirer qu'aprs tre entrs en rapports avec lui. L'adolescent qui n'a jamais entendu parler des relations sexuelles ni des joies qu'elles procurent, peut bien prouver un malaise vague et indfinissable ; il peut avoir la sensation que quelque chose lui manque, mais il ne sait pas quoi et, par consquent, n'a pas de dsirs sexuels proprement dits ; aussi ces aspirations indtermines peuvent-elles assez facilement dvier de leurs fins naturelles et de leur direction normale. Mais, au moment mme o l'homme est en tat de goter ces jouissances nouvelles et les appelle mme inconsciemment, il les trouve sa porte, parce que la division du travail s'est en mme temps dveloppe et qu'elle les lui fournit. Sans qu'il y ait cela la moindre harmonie prtablie, ces deux ordres de faits se rencontrent, tout simplement parce qu'ils sont des effets d'une mme cause. Voici comme on peut concevoir que se fait cette rencontre. L'attrait de la nouveaut suffirait dj pousser l'homme exprimenter ces plaisirs. Il y est mme d'autant plus naturellement port que la richesse et la complexit plus grandes de ces excitants lui font trouver plus mdiocres ceux dont il s'tait jusqu'alors content. Il peut d'ailleurs s'y adapter mentalement avant d'en avoir fait l'essai ; et comme, en ralit, ils correspondent aux changements qui se sont faits dans sa constitution, il pressent qu'il s'en trouvera bien. L'exprience vient ensuite confirmer ces pressentiments ; les besoins qui sommeillaient s'veillent, se dterminent, prennent conscience d'eux-mmes et s'organisent. Ce n'est pas , dire toutefois que cet ajustement soit, dans tous les cas, aussi parfait ; que chaque produit nouveau, d de nouveaux progrs de la division du travail, corresponde toujours un besoin rel de notre nature, il est, au contraire, vraisemblable qu'assez souvent les besoins se contractent seulement parce qu'on a pris l'habitude de l'objet auquel ils se rapportent. Cet objet n'tait ni ncessaire ni utile ; mais il s'est trouv qu'on en a fait plusieurs fois l'exprience, et on s'y est si bien fait qu'on ne peut plus s'en passer. Les harmonies qui rsultent de causes toutes mcaniques ne peuvent jamais tre qu'imparfaites et approches ; mais elles sont suffisantes pour maintenir l'ordre en gnral. C'est ce qui arrive la division du travail. Les progrs qu'elle fait sont, non pas dans tous les cas, mais gnralement, en harmonie avec les changements qui se font chez l'homme, et c'est ce qui leur permet de durer. Mais, encore une fois, nous ne sommes pas pour cela plus heureux. Sans doute, une fois que ces besoins sont excits, ils ne peuvent rester en souffrance sans qu'il y ait douleur. Mais notre bonheur n'est pas plus grand parce qu'ils sont excits. Le point de repre par rapport auquel nous mesurions l'intensit relative de nos plaisirs est dplac ; il en rsulte un bouleversement de toute la graduation. Mais ce dclassement des plaisirs n'implique pas un accroissement. Parce que le milieu n'est plus le mme, nous avons d changer, et ces changements en ont dtermin d'autres dans notre manire d'tre heureux ; mais qui dit changements ne dit pas ncessairement progrs.
motions et volont, 419.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
41
On voit combien la division du travail nous apparat sous un autre aspect qu'aux conomistes. Pour eux, elle consiste essentiellement produire davantage. Pour nous, cette productivit plus grande est seulement une consquence ncessaire, un contrecoup du phnomne. Si nous nous spcialisons, ce n'est pas pour produire plus, mais c'est pour pouvoir vivre dans les conditions nouvelles d'existence qui nous sont faites.
IV
Un corollaire de tout ce qui prcde, c'est que la division du travail ne peut s'effectuer qu'entre les membres d'une socit dj constitue. En effet, quand la concurrence oppose des individus isols et trangers les uns aux autres, elle ne peut que les sparer davantage. S'ils disposent librement de l'espace, ils se fuiront ; s'ils ne peuvent sortir des limites dtermines, ils se diffrencieront, mais de manire devenir encore plus indpendants les uns des autres. On ne peut citer aucun cas o des relations de pure hostilit se soient, sans l'intervention d'aucun autre facteur, transformes en relations sociales. Aussi, comme entre les individus d'une mme espce animale ou vgtale il n'y a gnralement aucun lien, la guerre qu'ils se font n'a-t-elle d'autre rsultat que de les diversifier, de donner naissance des varits dissemblables et qui s'cartent toujours plus les unes des autres. C'est cette disjonction progressive que Darwin a appele la loi de la divergence des caractres. Or, la division du travail unit en mme temps qu'elle oppose ; elle fait converger les activits qu'elle diffrencie ; elle rapproche ceux qu'elle spare. Puisque la concurrence ne peut pas avoir dtermin ce rapprochement, il faut bien qu'il ait prexist ; il faut que les individus entre lesquels la lutte s'engage soient dj solidaires et le sentent, c'est--dire appartiennent une mme socit. C'est pourquoi l o ce sentiment de solidarit est trop faible pour rsister l'influence dispersive de la concurrence, celle-ci engendre de tout autres effets que la division du travail. Dans les pays o l'existence est trop difficile par suite de l'extrme densit de la population, les habitants, au lieu de se spcialiser, se retirent dfinitivement ou provisoirement de la socit ; ils migrent dans d'autres rgions. Il suffit, d'ailleurs, de se reprsenter ce qu'est la division du travail pour comprendre qu'il n'en peut tre autrement. Elle consiste, en effet, dans le partage de fonctions jusque-l communes. Mais ce partage ne peut tre excut d'aprs un plan prconu ; on ne peut dire par avance o doit se trouver la ligne de dmarcation entre les tches, une fois qu'elles seront spares ; car elle n'est pas marque avec une telle vidence dans la nature des choses, mais dpend, au contraire, d'une multitude de circonstances. Il faut donc que la division se fasse d'elle-mme et progressivement. Par consquent, pour que, dans ces conditions, une fonction puisse se partager en deux fractions exactement complmentaires, comme l'exige la nature de la division du travail, il est indispensable que les deux parties qui se spcialisent soient, pendant tout le temps que dure cette dissociation, en communication constante : il n'y a pas d'autre moyen pour que l'une reoive tout le mouvement que l'autre abandonne et qu'elles s'adaptent l'une l'autre. Or, de mme qu'une colonie animale dont tous les membres sont en continuit de tissu constitue un individu, tout agrgat d'individus, qui sont en contact continu, forme une socit. La division du travail ne peut donc se
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
42
produire qu'au sein d'une socit prexistante. Par l, nous n'entendons pas dire tout simplement que les individus doivent adhrer matriellement les uns aux autres, mais il faut encore qu'il y ait entre eux des liens moraux. D'abord, la continuit matrielle, elle seule, donne naissance des liens de ce genre, pourvu qu'elle soit durable ; mais, de plus, ils sont directement ncessaires. Si les rapports qui commencent s'tablir dans la priode des ttonnements n'taient soumis aucune rgle, si aucun pouvoir ne modrait le conflit des intrts individuels, ce serait un chaos d'o ne pourrait sortir aucun ordre nouveau. On imagine, il est vrai, que tout se passe alors en conventions prives et librement dbattues ; il semble donc que toute action sociale soit absente. Mais on oublie que les contrats ne sont possibles que l o il existe dj une rglementation juridique et, par consquent, une socit. C'est donc tort qu'on a vu parfois dans la division du travail le fait fondamental de toute vie sociale. Le travail ne se partage pas entre individus indpendants et dj diffrencis qui se runissent et s'associent pour mettre en commun leurs diffrentes aptitudes. Car ce serait un miracle que des diffrences, ainsi nes au hasard des circonstances, pussent se raccorder aussi exactement de manire former un tout cohrent. Bien loin qu'elles prcdent la vie collective, elles en drivent. Elles ne peuvent se produire qu'au sein d'une socit et sous la pression de sentiments et de besoins sociaux ; c'est ce qui fait qu'elles sont essentiellement harmoniques. Il y a donc une vie sociale en dehors de toute division du travail, mais que celle-ci suppose. C'est, en effet, ce que nous avons directement tabli en faisant voir qu'il y a des socits dont la cohsion est essentiellement due la communaut des croyances et des sentiments, et que c'est de ces socits que sont sorties celles dont la division du travail assure l'unit. Les conclusions du livre prcdent et celles auxquelles nous venons d'arriver peuvent donc servir se contrler et se confirmer mutuellement. La division du travail physiologique est elle-mme soumise cette loi : elle n'apparat jamais qu'au sein de masses polycellulaires qui sont dj doues d'une certaine cohsion. Pour nombre de thoriciens, c'est une vrit par soi-mme vidente que toute socit consiste essentiellement dans une coopration. Une socit, au sens scientifique du mot, dit M. Spencer, n'existe que lorsqu' la juxtaposition des individus s'ajoute la coopration 1. Nous venons de voir que ce prtendu axiome est le contrepied de la vrit. Il est au contraire vident, comme le dit Auguste Comte, que la coopration, bien loin d'avoir pu produire la socit, en suppose ncessairement le pralable tablissement spontan 2 . Ce qui rapproche les hommes, ce sont des causes mcaniques et des forces impulsives comme l'affinit du sang, l'attachement un mme sol, le culte des anctres, la communaut des habitudes, etc. C'est seulement quand le groupe s'est form sur ces bases que la coopration s'y organise. Encore, la seule qui soit possible dans le principe est-elle tellement intermittente et faible que la vie sociale, si elle n'avait pas d'autre source, serait elle-mme sans force et sans continuit. A plus forte raison, la coopration complexe qui rsulte de la division du travail est-elle un phnomne ultrieur et driv. Elle rsulte de mouvements intestinaux qui se dveloppent au sein de la masse, quand celle-ci est constitue. Il est vrai qu'une fois qu'elle est apparue, elle resserre les liens sociaux et fait de la socit une individualit plus parfaite. Mais cette intgration en suppose une autre qu'elle remplace. Pour que les units sociales puissent se diffrencier, il faut
1 2
Sociologie, III, 331. Cours de philosophie positive, IV, 421.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
43
d'abord qu'elles se soient attires ou groupes en vertu des ressemblances qu'elles prsentent. Ce procd de formation s'observe, non pas seulement aux origines, mais chaque stade de l'volution. Nous savons, en effet, que les socits suprieures rsultent de la runion de socits infrieures du mme type : il faut d'abord que ces dernires soient confondues au sens d'une seule et mme conscience collective pour que le processus de diffrenciation puisse commencer ou recommencer. C'est ainsi que les organismes plus complexes se forment par la rptition d'organismes plus simples, semblables entre eux, qui ne se diffrencient qu'une fois associs. En un mot, l'association et la coopration sont deux faits distincts, et si le second, quand il est dvelopp, ragit sur le premier et le transforme, si les socits humaines deviennent de plus en plus des groupes de cooprateurs, la dualit des deux phnomnes ne s'vanouit pas pour cela. Si cette vrit importante a t mconnue par les utilitaires, c'est une erreur qui tient la manire dont ils conoivent la gense de la socit. Ils supposent l'origine des individus isols et indpendants, qui, par suite, ne peuvent entrer en relation que pour cooprer ; car ils n'ont pas d'autre raison pour franchir l'intervalle vide qui les spare et pour s'associer. Mais cette thorie, si rpandue, postule une vritable cration ex nihilo. Elle consiste, en effet, dduire la socit de l'individu ; or, rien de ce que nous connaissons ne nous autorise croire la possibilit d'une pareille gnration spontane. De l'aveu de M. Spencer, pour que la socit puisse se former dans cette hypothse, il faut que les units primitives passent de l'tat d'indpendance parfaite celui de dpendance mutuelle 1 . Mais qu'est-ce qui peut les avoir dtermines une si complte transformation ? La perspective des avantages qu'offre la vie sociale ? Mais ils sont compenss et au-del par la perte de l'indpendance, car pour des tres qui sont destins par nature une vie libre et solitaire, un pareil sacrifice est le plus intolrable qui soit. Ajoutez cela que, dans les premiers types sociaux, il est aussi absolu que possible, car nulle part l'individu n'est plus compltement absorb dans le groupe. Comment l'homme, s'il tait n individualiste, comme on le suppose, aurait-il pu se rsigner une existence qui froisse aussi violemment son penchant fondamental? Combien l'utilit problmatique de la coopration devait lui paratre ple ct d'une telle dchance 1 D'individualits autonomes, comme celles qu'on imagine, il ne peut donc rien sortir que d'individuel, et par consquent la coopration ellemme, qui est un fait social, soumis des rgles sociales, n'en peut pas natre, C'est ainsi que le psychologue qui commence s'enfermer dans son moi n'en peut plus sortir, pour retrouver le non-moi. La vie collective n'est pas ne de la vie individuelle, mais c'est, au contraire, la seconde qui est ne de la premire. C'est cette condition seulement que l'on peut s'expliquer comment l'individualit personnelle des units sociales a pu se former et grandir sans dsagrger la socit. En effet, comme, dans ce cas, elle s'labore au sein d'un milieu social prexistant, elle en porte ncessairement la marque ; elle se constitue de manire ne pas ruiner cet ordre collectif dont elle est solidaire ; elle y reste adapte, tout en s'en dtachant. Elle n'a rien d'antisocial, parce qu'elle est un produit de la socit. Ce n'est pas la personnalit absolue de la monade, qui se suffit soi-mme et pourrait se passer du reste du monde, mais celle d'un organe ou d'une partie d'organe qui a sa fonction dtermine, mais ne peut, sans courir des chances de mort, se sparer du reste de l'organisme. Dans ces conditions, la coopration devient
1
Sociologie, III, 332.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
44
non seulement possible, mais ncessaire. Les utilitaires renversent donc l'ordre naturel des faits, et rien n'est moins surprenant que cette interversion ; c'est une illustration particulire de cette vrit gnrale que ce qui est premier dans la connaissance est dernier dans la ralit. Prcisment parce que la coopration est le fait le plus rcent, c'est elle qui frappe tout d'abord le regard. Si donc on s'en tient aux apparences, comme fait le sens commun, il est invitable qu'on y voie le fait primaire de la vie morale et sociale. Mais, si elle n'est pas toute la morale, il ne faut pas davantage la mettre en dehors de la morale, comme font certains moralistes. Tout comme les utilitaires, ces idalistes la font consister exclusivement dans un systme de rapports conomiques, d'arrangements privs dont l'gosme est le seul ressort. En ralit, la vie morale circule travers toutes les relations qui la constituent, puisqu'elle ne serait pas possible si des sentiments sociaux, et par consquent moraux, ne prsidaient son laboration. On objectera la division internationale du travail ; il semble vident que, dans ce cas du moins, les individus entre lesquels le travail se partage n'appartiennent pas la mme socit. Mais il faut se rappeler qu'un groupe peut, tout en gardant son individualit, tre envelopp par un autre, plus vaste, et qui- en contient plusieurs du mme genre. On peut affirmer qu'une fonction, conomique ou autre, ne peut se diviser entre deux socits que si celles-ci participent quelques gards une mme vie commune et, par consquent, appartiennent une mme socit. Supposez, en effet, que ces deux consciences collectives ne soient pas, par quelque point, fondues ensemble, on ne voit pas comment les deux agrgats pourraient avoir le contact continu qui est ncessaire ni, par suite, comment l'un d'eux pourrait abandonner au second l'une de ses fonctions. Pour qu'un peuple se laisse pntrer par un autre, il faut qu'il ait cess de s'enfermer dans un patriotisme exclusif et qu'il en ait appris un autre, plus comprhensif. Au reste, on peut directement observer ce rapport des faits dans l'exemple le plus frappant de division internationale du travail que nous offre l'histoire. On peut dire, en effet, qu'elle ne s'est jamais vraiment produite qu'en Europe et de notre temps. Or, c'est la fin du sicle dernier et au commencement de celui-ci qu'a commenc se former une conscience commune des socits europennes. Il y a, dit M. Sorel, un prjug dont il importe de se dfaire. C'est de se reprsenter l'Europe de l'ancien rgime comme une socit d'tats rgulirement constitue, o chacun conformait sa conduite des principes reconnus de tous, o le respect du droit tabli gouvernait les transactions et dictait les traits, o la bonne foi en dirigeait l'excution, o le sentiment de la solidarit des monarchies assurait, avec le maintien de l'ordre public, la dure des engagements contracts par les princes... Une Europe o les droits de chacun rsultent des devoirs de tous tait quelque chose de si tranger aux hommes d'tat de l'ancien rgime qu'il fallut une guerre d'un quart de sicle, la plus formidable qu'on et encore vue, pour leur en imposer la notion et leur en dmontrer la ncessit. La tentative que l'on fit au congrs de Vienne et dans les congrs qui suivirent pour donner l'Europe une organisation lmentaire fut un progrs, et non un retour vers le pass 1. Inversement, tout retour d'un nationalisme troit a toujours pour consquence un dveloppement de l'esprit protectionniste, c'est--dire une tendance des peuples s'isoler, conomiquement et moralement, les uns des autres.
L'Europe et la Rvolution franaise, I, 9 et 10.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
45
Si cependant, dans certains cas, des peuples qui ne tiennent ensemble par aucun lien, qui mme parfois se regardent comme ennemis 1, changent entre eux des produits d'une manire plus ou moins rgulire, il faut ne voir dans ces faits que de simples rapports de mutualisme qui n'ont rien de commun avec la division du travail 2. Car, parce que deux organismes diffrents se trouvent avoir des proprits qui s'ajustent utilement, il lie s'ensuit pas qu'il y ait entre eux un partage de fonctions 3.
Voir KULISCHER, Der Handel auf den primitiven Culturstufen (Ztschr. f. Vlkerpsychologie, X, 1877, p. 378), et SCHRADER, Linguistisch-historische Forschungen zur Handelsgeschichte, Ina, 1886. Il est vrai que le mutualisme se produit gnralement entre individus d'espces diffrentes, mais le phnomne reste identique, alors mme qu'il a lieu entre individus de mme espce (voir sur le mutualisme ESPINAS, Socits animales, et GIRAUD, Les socits chez les animaux). Nous rappelons en terminant que nous avons seulement tudi dans ce chapitre comment il se fait qu'en gnral la division du travail va de plus en plus en progressant, et nous avons dit les causes dterminantes de ce progrs. Mais il peut trs bien se faire que, dans une socit en particulier, une certaine division du travail et, notamment, la division du travail conomique, soit trs dveloppe, quoique le type segmentaire y soit encore assez fortement prononc. Il semble bien que c'est le cas de l'Angleterre. La grande industrie, le grand commerce paraissent y tre aussi dvelopps que sur le continent, quoique le systme alvolaire y soit encore trs marqu, comme le prouvent et l'autonomie de la vie locale et l'autorit qu'y conserve la tradition. (La valeur symptomatique de ce dernier fait sera dtermine dans le chapitre suivant.) C'est qu'en effet la division du travail, tant un phnomne driv et secondaire, comme nous venons de le voir, se passe la surface de la vie sociale, et cela est surtout vrai de la division du travail conomique. Elle est fleur de peau. Or, dans tout organisme, les phnomnes superficiels, par leur situation mme, sont bien plus accessibles l'action des causes extrieures, alors mme que les causes internes dont ils dpendent gnralement ne sont pas modifies. Il suffit ainsi qu'une circonstance quelconque excite chez un peuple un plus vif besoin de bien-tre matriel pour que la division du travail conomique se dveloppe sans que la structure sociale change sensiblement. L'esprit d'imitation, le contact d'une civilisation plus raffine peuvent produire ce rsultat. C'est ainsi que l'entendement, tant la partie culminante et, par consquent, la plus superficielle de la conscience, peut tre assez facilement modifie par des influences externes, comme l'ducation, sans que les assises de la vie psychique soient atteintes. On cre ainsi des intelligences trs suffisantes pour assurer le succs, mais qui sont sans racines profondes. Aussi ce genre de talent ne se transmet-il pas par l'hrdit. Cette comparaison montre qu'il ne faut pas juger de la place qui revient une socit sur l'chelle sociale d'aprs l'tat de sa civilisation, surtout de sa civilisation conomique ; car celle-ci peut n'tre qu'une imitation, une copie et recouvrir une structure sociale d'espce infrieure. Le cas, il est vrai, est exceptionnel ; il se prsente pourtant. C'est seulement dans ces rencontres que la densit matrielle de la socit n'exprime pas exactement l'tat de la densit morale. Le principe que nous avons pos est donc vrai d'une manire trs gnrale, et cela suffit notre dmonstration.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
46
Chapitre III
Les facteurs secondaires
L'indtermination progressive de la conscience commune et ses causes
Retour la table des matires
Nous avons vu dans la premire partie de ce travail que la conscience collective devenait plus faible et plus vague, mesure que la division du travail se dveloppait. C'est mme par suite de cette indtermination progressive que la division du travail devient la source principale de la solidarit. Puisque ces deux phnomnes sont ce point lis, il n'est pas inutile de rechercher les causes de cette rgression. Sans doute, en faisant voir avec quelle rgularit elle se produit, nous avons directement tabli qu'elle dpend certainement de quelques conditions fondamentales de l'volution sociale. Mais cette conclusion du livre prcdent serait plus incontestable encore si nous pouvions trouver quelles sont ces conditions. Cette question est, d'ailleurs, solidaire de celle que nous sommes en train de traiter. Nous venons de montrer que les progrs de la division du travail sont dus la pression plus forte exerce par les units sociales les unes sur les autres et qui les oblige se dvelopper dans des sens de plus en plus divergents. Mais cette pression est chaque instant neutralise par une pression en sens contraire que la conscience commune exerce sur chaque conscience particulire. Tandis que l'une nous pousse nous faire une personnalit distincte, l'autre au contraire nous fait une loi de ressembler tout le monde. Tandis que la premire nous incline suivre la pente de notre nature personnelle, la seconde nous retient et nous empche de dvier du type collectif. En d'autres termes, pour que la division du travail puisse natre et crotre, il ne suffit pas qu'il y ait chez les individus des germes d'aptitudes spciales, ni qu'ils soient incits varier dans le sens de ces aptitudes ; mais il faut encore que les variations individuelles soient possibles. Or, elles ne peuvent se produire quand elles sont en opposition avec quelque tat fort et dfini de la conscience collective ; car
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
47
plus un tat est fort, et plus il rsiste tout ce qui peut l'affaiblir ; plus il est dfini, moins il laisse de place aux changements. On peut donc prvoir que le progrs de la division du travail sera d'autant plus difficile et lent que la conscience commune aura plus de vitalit et de prcision. Inversement, il sera d'autant plus rapide que l'individu pourra plus facilement se mettre en harmonie avec son milieu personnel. Mais, pour cela, il ne suffit pas que ce milieu existe ; il faut encore que chacun soit libre de s'y adapter, c'est--dire soit capable de se mouvoir avec indpendance, alors mme que tout le groupe ne se meut pas en mme temps et dans la mme direction. Or, nous savons que les mouvements propres des particuliers sont d'autant plus rares que la solidarit mcanique est plus dveloppe. Les exemples sont nombreux o l'on peut directement observer cette influence neutralisante de la conscience commune sur la division du travail. Tant que la loi et les murs font de l'inalinabilit et de l'indivision de la proprit immobilire une stricte obligation, les conditions ncessaires l'apparition de la division du travail ne sont pas nes. Chaque famille forme une masse compacte, et toutes se livrent la mme occupation, l'exploitation du patrimoine hrditaire. Chez les Slaves, la Zadruga s'accrot souvent dans de telles proportions que la misre y est grande ; cependant, comme l'esprit domestique est trs fort, on continue gnralement vivre ensemble, au lieu d'aller entreprendre au dehors des professions spciales comme celles de marin et de marchand. Dans d'autres socits, o la division du travail est plus avance, chaque classe a des fonctions dtermines et toujours les mmes qui sont soustraites toute innovation. Ailleurs, il y a des catgories entires de professions dont l'accs est plus ou moins formellement interdit aux citoyens. En Grce 1, Rome 2, l'industrie et le commerce taient des carrires mprises ; chez les Kabyles, certains mtiers comme ceux de boucher, de fabricant de chaussures, etc., sont fltris par l'opinion publique 3. La spcialisation ne peut donc pas se faire dans ces diverses directions. Enfin, mme chez des peuples o la vie conomique a dj atteint un certain dveloppement, comme chez nous au temps des anciennes corporations, les fonctions taient rglementes de telle sorte que la division du travail ne pouvait progresser. L o tout le monde tait oblig de fabriquer de la mme manire, toute variation individuelle tait impossible 4. Le mme phnomne se produit dans la vie reprsentative des socits. La religion, cette forme minente de la conscience commune, absorbe primitivement toutes les fonctions reprsentatives avec les fonctions pratiques. Les premires ne se dissocient des secondes que quand la philosophie apparat. Or, elle n'est possible que quand la religion a perdu un peu de son empire. Cette manire nouvelle de se reprsenter les choses heurte l'opinion collective qui rsiste. On a dit parfois que c'est le libre examen qui fait rgresser les croyances religieuses ; mais il suppose son tour une rgression pralable de ces mmes croyances. Il ne peut se produire que si la foi commune le permet. Le mme antagonisme clate chaque fois qu'une science nouvelle se fonde. Le christianisme lui-mme, quoiqu'il ait fait tout de suite la rflexion individuelle une plus large place qu'aucune autre religion, n'a pu chapper cette loi. Sans doute,
1 2
3 4
BSSCHENSCHTZ, Besitz und Erwerb. D'aprs DENYS d'Halicarnasse (IX, 25), pendant les premiers temps de la Rpublique, aucun Romain ne pouvait se faire marchand ou artisan. - CICRON parle encore de tout travail mercenaire comme d'un mtier dgradant (De off., I, 42). HANOTEAU et LETOURNEUX, La Kabylie, Il, 23. Voir LEVASSEUR, Les classes ouvrires en France jusqu' la Rvolution, passim.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
48
l'opposition fut moins vive tant que les savants bornrent leurs tudes au monde matriel, puisqu'il tait abandonn en principe la dispute des hommes. Encore, comme cet abandon ne fut jamais complet, comme le Dieu chrtien n'est pas entirement tranger aux choses de cette terre, arriva-t-il ncessairement que, sur plus d'un point, les sciences naturelles elles-mmes trouvrent dans la foi un obstacle. Mais c'est surtout quand l'homme devint un objet de science que la rsistance fut nergique. Le croyant, en effet, ne peut pas ne pas rpugner l'ide que l'homme soit tudi comme un tre naturel, analogue aux autres, et les faits moraux comme les faits de la nature ; et l'on sait combien ces sentiments collectifs, sous les formes diffrentes qu'ils ont prises, ont gn le dveloppement de la psychologie et de la sociologie. On n'a donc pas compltement expliqu les progrs de la division du travail, quand on a dmontr qu'ils sont ncessaires par suite des changements survenus dans le milieu social ; mais ils dpendent encore de facteurs secondaires qui peuvent ou en faciliter, ou en gner ou en entraver compltement le cours. Il ne faut pas oublier en effet que la spcialisation n'est pas la seule solution possible la lutte pour la vie : il y a aussi intgration, la colonisation, la rsignation une existence prcaire et plus dispute, enfin l'limination totale des plus faibles par voie de suicide ou autrement. Puisque le rsultat est dans une certaine mesure contingente et que les combattants ne sont pas ncessairement pousss vers l'une de ces issues l'exclusion des autres, ils se portent vers celle qui est le plus leur porte. Sains doute, si rien n'empche la division du travail de se dvelopper, ils se spcialisent. Mais si les circonstances rendent impossible ou trop difficile ce dnouement, il faudra bien recourir quelque autre. Le premier de ces facteurs secondaires consiste dans une indpendance plus grande des individus par rapport au groupe, leur permettant de varier en libert. La division du travail physiologique est soumise la mme condition. Mme rapprochs les uns des autres, dit M. Perrier, les lments anatomiques conservent respectivement toute leur individualit. Quel que soit leur nombre, aussi bien dans les organismes les plus levs que dans les plus humbles, ils se nourrissent, s'accroissent et se reproduisent sans souci de leurs voisins. C'est en cela que consiste la loi d'indpendance des lments anatomiques, devenue si fconde entre les mains des physiologistes. Cette indpendance doit tre considre comme la condition ncessaire au libre exercice d'une facult plus gnrale des plastides, la variabilit sous l'action des circonstances extrieures ou mme de certaines forces immanentes aux protoplasmes. Grce leur aptitude varier et leur indpendance rciproque, les lments ns les uns des autres et primitivement tous semblables entre eux ont pu se modifier dans des sens diffrents, prendre des formes diverses, acqurir des fonctions et des proprits nouvelles 1. Contrairement ce qui se passe dans les organismes, cette indpendance n'est pas dans les socits un fait primitif, puisque l'origine l'individu est absorb dans le groupe. Mais nous avons vu qu'elle apparat ensuite et progresse rgulirement en mme temps que la division du travail, par suite de la rgression de la conscience collective. Il reste chercher comment cette condition utile de la division du travail social se ralise mesure qu'elle est ncessaire. Sans doute, c'est qu'elle dpend ellemme des causes qui ont dtermin les progrs de la spcialisation. Mais comment l'accroissement des socits en volume et en densit peut-il avoir ce rsultat ?
1
Colonies animales, 702.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
49
Dans une petite socit, comme tout le monde est plac sensiblement dans les mmes conditions d'existence, le milieu collectif est essentiellement concret. Il est fait des tres de toute sorte qui remplissent l'horizon social. Les tats de conscience qui le reprsentent ont donc le mme caractre. D'abord, ils se rapportent des objets prcis, comme cet animal, cet arbre, cette plante, cette force naturelle, etc. Puis, comme tout le monde est situ de la mme manire par rapport ces choses, elles affectent de la mme faon toutes les consciences. Toute la tribu, si elle n'est pas trop tendue, jouit ou souffre galement des avantages ou des inconvnients du soleil ou de la pluie, du chaud ou du froid, de tel fleuve, de telle source, etc. Les impressions collectives qui rsultent de la fusion de toutes ces impressions individuelles, sont donc dtermines dans leur forme aussi bien que dans leurs objets-et, par suite, la conscience commune a un caractre dfini. Mais elle change de nature mesure que les socits deviennent plus volumineuses. Parce que ces dernires se rpandent sur une plus vaste surface, elle est elle-mme oblige de s'lever au-dessus de toutes les diversits locales, de dominer davantage l'espace et, par consquent, de devenir plus abstraite. Car il n'y a gure que des choses gnrales qui puissent tre communes tous ces milieux divers. Ce n'est plus tel animal, mais telle espce ; telle source, mais les sources ; telle fort, mais la fort in abstracto. D'autre part, parce que les conditions de la vie ne sont plus partout les mmes, ces objets communs, quels qu'ils soient, ne peuvent plus dterminer partout des sentiments aussi parfaitement identiques. Les rsultantes collectives n'ont donc plus la mme nettet, et cela d'autant plus que les lments composants sont plus dissemblables. Plus il y a de diffrence entre les portraits individuels qui ont servi faire un portrait composite, plus celui-ci est indcis. Il est vrai que les consciences collectives locales peuvent garder leur individualit au sein de la conscience collective gnrale et que, comme elles embrassent de moindres horizons, elles restent plus facilement concrtes. Mais nous savons qu'elles viennent peu peu s'vanouir au sein de la premire, mesure que s'effacent les segments sociaux auxquels elles correspondent. Le fait qui, peut-tre, manifeste le mieux cette tendance croissante de la conscience commune, c'est la transcendance parallle du plus essentiel de ses lments, je veux parler de la notion de la divinit. A l'origine, les dieux ne sont pas distincts de l'univers, ou plutt il n'y a pas de dieux, mais seulement des tres sacrs, sans que le caractre sacr dont ils sont revtus soit rapport quelque entit extrieure, comme sa source. Les animaux ou les vgtaux de l'espce qui sert de totem au clan sont l'objet du culte ; mais ce n'est pas qu'un principe sui generis vienne leur communiquer du dehors leur nature divine. Cette nature leur est intrinsque ; ils sont divins par euxmmes. Mais peu peu, les forces religieuses se dtachent des choses dont elles n'taient d'abord que des attributs, et elles s'hypostasient. Ainsi se forme la notion d'esprits ou de dieux qui, tout en rsidant de prfrence ici ou l, existent cependant en dehors des objets particuliers auxquels ils sont plus spcialement rattachs 1. Par cela mme, ils ont quelque chose de moins concret. Toutefois, qu'ils soient multiples
1
Voir RVILLE, Religions des peuples non civiliss, 1, 67 et suiv. ; II, 230 et suiv.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
50
ou qu'ils aient t ramens une certaine unit, ils sont encore immanents au monde. Spars, en partie, des choses, ils sont toujours dans l'espace. Ils restent donc tout prs de nous, constamment mls notre vie. Le polythisme grco-latin, qui est une forme plus leve et mieux organise de l'animisme, marque un progrs nouveau dans le sens de la transcendance. La rsidence des dieux devient plus nettement distincte de celle des hommes. Retirs sur les hauteurs mystrieuses de l'Olympe ou dans les profondeurs de la terre, ils n'interviennent plus personnellement dans les affaires humaines que d'une manire assez intermittente. Mais c'est seulement avec le christianisme que Dieu sort dfinitivement de l'espace ; son royaume n'est plus de ce monde ; la dissociation entre la nature et le divin est mme si complte qu'elle dgnre en antagonisme. En mme temps, la notion de la divinit devient plus gnrale et plus abstraite, car elle est forme non de sensations, comme dans le principe, mais d'ides. Le Dieu de l'humanit a ncessairement moins de comprhension que ceux de la cit ou du clan. D'ailleurs, en mme temps que la religion, les rgles du droit s'universalisent, ainsi que celles de la morale. Lies d'abord des circonstances locales, des particularits ethniques, climatriques, etc., elles s'en affranchissent peu peu et, du mme coup, deviennent plus gnrales. Ce qui rend sensible cet accroissement de gnralit, c'est le dclin ininterrompu du formalisme. Dans les socits infrieures, la forme mme extrieure de la conduite est prdtermine jusque dans ses dtails. La faon dont l'homme doit se nourrir, se vtir en chaque circonstance, les gestes qu'il doit faire, les formules qu'il doit prononcer sont fixs avec prcision. Au contraire, plus on s'loigne du point de dpart, plus les prescriptions morales et juridiques perdent de leur nettet et de leur prcision. Elles ne rglementent plus que les formes les plus gnrales de la conduite et les rglementent d'une manire trs gnrale, disant ce qui doit tre fait, non comment cela doit tre fait. Or, tout ce qui est dfini s'exprime sous une forme dfinie. Si les sentiments collectifs avaient la mme dtermination qu'autrefois, ils ne s'exprimeraient pas d'une manire moins dtermine. Si les dtails concrets de l'action et de la pense taient aussi uniformes, ils seraient aussi obligatoires. On a souvent remarqu que la civilisation avait tendance devenir plus rationnelle et plus logique ; on voit maintenant quelle en est la cause. Cela seul est rationnel qui est universel. Ce qui droute l'entendement, c'est le particulier et le concret. Nous ne pensons bien que le gnral. Par consquent, plus la conscience commune est proche des choses particulires, plus elle en porte exactement l'empreinte, plus aussi elle est inintelligible. Voil d'o vient l'effet que nous font les civilisations primitives. Ne pouvant les ramener des principes logiques, nous sommes ports n'y voir que des combinaisons bizarres et fortuites d'lments htrognes. En ralit, elles n'ont rien d'artificiel ; seulement, il faut en chercher les causes dterminantes dans des sensations et des mouvements de la sensibilit, non dans des concepts, et s'il en est ainsi, c'est que le milieu social pour lequel elles sont faites n'est pas suffisamment tendu. Au contraire, quand la civilisation se dveloppe sur un champ d'action plus vaste, quand elle s'applique plus de gens et de choses, les ides gnrales apparaissent ncessairement et y deviennent prdominantes. La notion d'homme, par exemple, remplace dans le droit, dans la morale, dans la religion celle du Romain, qui, plus concrte, est plus rfractaire la science. C'est donc l'accroissement de volume des socits et leur condensation plus grande qui expliquent cette grande transformation.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
51
Or, plus la conscience commune devient gnrale, plus elle laisse de place aux variations individuelles. Quand Dieu est loin des choses et des hommes, son action n'est plus de tous les instants et ne s'tend plus tout. Il n'y a plus de fixe que des rgles abstraites qui peuvent tre librement appliques de manires trs diffrentes. Encore n'ont-elles plus ni le mme ascendant ni la mme force de rsistance. En effet, si les pratiques et les formules, quand elles sont prcises, dterminent la pense et les mouvements avec une ncessit analogue celle des rflexes, au contraire, ces principes gnraux ne peuvent passer dans les faits qu'avec le concours de l'intelligence. Or, une fois que la rflexion est veille, il n'est pas facile de la contenir. Quand elle a pris des forces, elle se dveloppe spontanment au-del des limites qu'on lui avait assignes. On commence par mettre quelques articles de foi audessus de la discussion, puis la discussion s'tend jusqu' eux. On veut s'en rendre compte, on leur demande leurs raisons d'tre, et de quelque manire qu'ils subissent cette preuve, ils y laissent une partie de leur force. Car des ides rflchies n'ont jamais la mme puissance contraignante que des instincts ; c'est ainsi que des mouvements qui ont t dlibrs n'ont pas l'instantanit des mouvements involontaires. Parce qu'elle devient plus rationnelle, la conscience collective devient donc moins imprative, et, pour cette raison encore, elle gne moins le libre dveloppement des varits individuelles.
II
Mais cette cause n'est pas celle qui contribue le plus produire ce rsultat. Ce qui fait la force des tats collectifs, ce n'est pas seulement qu'ils sont communs la gnration prsente, mais c'est surtout qu'ils sont, pour la plupart, un legs des gnrations antrieures. La conscience commune ne se constitue en effet que trs lentement et se modifie de mme. Il faut du temps pour qu'une forme de conduite ou une croyance arrive ce degr de gnralit et de cristallisation, du temps aussi pour qu'elle le perde. Elle est donc presque tout entire un produit du pass. Or, ce qui vient du pass est gnralement l'objet d'un respect tout particulier. Une pratique laquelle tout le monde unanimement se conforme a sans doute un grand prestige ; mais si elle est forte en outre de l'assentiment des anctres, on ose encore bien moins y droger. L'autorit de la conscience collective est donc faite en grande partie de l'autorit de la tradition. Nous allons voir que celle-ci diminue ncessairement mesure que le type segmentaire s'efface. En effet, quand il est trs prononc, les segments forment autant de petites socits plus ou moins fermes les unes aux autres. L o ils ont une base familiale, il est aussi difficile d'en changer que de changer de famille, et si, quand ils n'ont plus qu'une base territoriale, les barrires qui les sparent sont moins infranchissables, elles persistent cependant. Au Moyen ge, il tait encore difficile un ouvrier de trouver du travail dans une autre ville que la sienne 1; les douanes intrieures formaient, d'ailleurs, autour de chaque compartiment social une ceinture qui le protgeait contre les infiltrations d'lments trangers. Dans ces conditions, l'individu est retenu
1
LEVASSEUR, op. cit., I, 239.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
52
au sol o il est n et par les liens qui l'y attachent et parce qu'il est repouss d'ailleurs ; la raret des voies de communications et de transmission est une preuve de cette occlusion de chaque segment. Par contrecoup, les causes qui maintiennent l'homme dans son milieu natal le fixent dans son milieu domestique. D'abord, l'origine, les deux se confondent, et si, plus tard, ils se distinguent, on ne peut pas s'loigner beaucoup du second quand on ne peut pas dpasser le premier. La force d'attraction qui rsulte de la consanguinit exerce dans son action avec son maximum d'intensit, puisque chacun reste toute sa vie plac tout prs de la source mme de cette force. C'est, en effet, une loi sans exception que, plus la structure sociale est de nature segmentaire, plus les familles forment de grandes masses compactes, indivises, ramasses sur elles-mmes 1. Au contraire, a mesure que les lignes de dmarcation qui sparent les diffrents segments s'effacent, il est invitable que cet quilibre se rompe. Comme les individus ne sont plus contenus dans leurs lieux d'origine et que ces espaces libres, qui s'ouvrent devant eux, les attirent, ils ne peuvent manquer de s'y rpandre. Les enfants ne restent plus immuablement attachs au pays de leurs parents, mais s'en vont tenter fortune dans toutes les directions. Les populations se mlangent, et c'est ce qui fait que leurs diffrences originelles achvent de se perdre. La statistique ne nous permet malheureusement pas de suivre dans l'histoire la marche de ces migrations intrieures ; mais il est un fait qui suffit tablir leur importance croissante, c'est la formation et le dveloppement des villes. Les villes, en effet, ne se forment pas par une sorte de croissance spontane, mais par immigration. Bien loin qu'elles doivent leur existence et leurs progrs l'excdent normal des naissances sur les dcs, elles prsentent ce point de vue un dficit gnral. C'est donc du dehors qu'elles reoivent les lments dont elles s'accroissent journellement. Selon Dunant 2, le crot annuel de l'ensemble de la population des trente et une grandes villes d'Europe emprunte 784,6 pour mille l'immigration. En France, le recensement de 1881 accusait sur celui de 1876 une augmentation de 766 000 habitants ; le dpartement de la Seine et les quarante-cinq villes ayant plus de 30 000 habitants absorbaient sur le chiffre de l'accroissement quinquennal plus de 661000 habitants, en laissant seulement 105 000 rpartir entre les villes moyennes, les petites villes et les campagnes 3 . Ce n'est pas seulement vers les grandes villes que se portent ces grands mouvements migrateurs, ils rayonnent dans les rgions avoisinantes. M. Bertillon a calcul que, pendant l'anne 1886, tandis que, dans la moyenne de la France, sur 100 habitants, 11,25 seulement taient ns en dehors du dpartement, dans le dpartement de la Seine il y en avait 34,67. Cette proportion des trangers est d'autant plus leve que les villes que compte le dpartement sont plus populeuses. Elle est de 31,47 dans le Rhne, de 26,29 dans les Bouches-du-Rhne, de 26,41 dans la Seine-et-Oise 4, de 19,46 dans le Nord, de 17,62 dans la Gironde 5. Ce phnomne n'est pas particulier aux grandes villes ; il se produit galement, quoique avec une moindre intensit, dans les petites villes, dans les bourgs. Toutes ces agglomrations augmentent constamment aux
2 3 4 5
Le lecteur voit de lui-mme les faits qui vrifient cette loi dont nous ne pouvons donner ici une dmonstration expresse. Elle rsulte de recherches que nous avons faites sur la famille et que nous esprons publier prochainement. Cit par LAYET, Hygine des paysans, dernier chapitre. DUMONT, Dpopulation et civilisation, 175. Ce chiffre lev est un effet du voisinage de Paris. Dictionnaire encyclopdique des sciences mdicales, art. Migration .
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
53
dpens des communes plus petites, d sorte que l'on voit chaque recensement le nombre des villes de chaque catgorie s'augmenter de quelques units 1. Or, la mobilit plus grande des units sociales que supposent ces phnomnes de migration dtermine un affaiblissement de toutes les traditions. En effet, ce qui fait surtout la force de la tradition, c'est le caractre des personnes qui la transmettent et l'inculquent, je veux dire les anciens. Ils en sont l'expression vivante ; eux seuls ont t tmoins de ce que faisaient les anctres. Ils sont l'unique intermdiaire entre le prsent et le pass. D'autre part, ils jouissent, auprs des gnrations qui ont t leves sous leurs yeux et sous leur direction, d'un prestige que rien ne peut remplacer. L'enfant, en effet, a conscience de son infriorit vis--vis des personnes plus ges qui l'entourent, et il sent qu'il dpend d'elles. Le respect rvrentiel qu'il a pour elles se communique naturellement tout ce qui en vient, tout ce qu'elles disent et tout ce qu'elles font. C'est donc l'autorit de l'ge qui fait en grande partie celle de la tradition. Par consquent, tout ce qui peut contribuer prolonger cette influence au-del de l'enfance ne peut que fortifier les croyances et les pratiques traditionnelles. C'est ce qui arrive quand l'homme fait continue vivre dans le milieu o il a t lev, car il reste alors en rapports avec les personnes qui l'ont connu enfant, et soumis leur action. Le sentiment qu'il a pour elles subsiste et, par consquent, produit les mmes effets, c'est--dire contient les vellits d'innovation. Pour qu'il se produise des nouveauts dans la vie sociale, il ne suffit pas que des gnrations nouvelles arrivent la lumire, il faut encore qu'elles ne soient pas trop fortement entranes suivre les errements de leurs devancires. Plus l'influence de ces dernires est profonde, - et elle est d'autant plus profonde qu'elle dure davantage, plus il y a d'obstacles aux changements. Auguste Comte avait raison de dire que si la vie humaine tait dcuple, sans que la proportion respective des ges ft pour cela modifie, il en rsulterait un ralentissement invitable, quoique impossible mesurer, de notre dveloppement social 2 . Mais c'est l'inverse qui se produit si l'homme, au sortir de l'adolescence, est transplant dans un nouveau milieu. Sans doute, il y trouve aussi des hommes plus gs que lui ; mais ce n'est pas ceux dont il a, pendant l'enfance, subi l'action. Le respect qu'il a pour eux est donc moindre et de nature plus conventionnelle, car il ne correspond aucune ralit ni actuelle, ni passe. Il n'en dpend pas et n'en a jamais dpendu ; il ne peut donc les respecter que par analogie. C'est, d'ailleurs, un fait connu que le culte de l'ge va en s'affaiblissant avec la civilisation. Si dvelopp jadis, il se rduit aujourd'hui quelques pratiques de politesse, inspires par une sorte de piti. On plaint les vieillards plus qu'on ne les craint. Les ges sont nivels. Tous les hommes qui sont arrivs la maturit se traitent peu prs en gaux. Par suite de ce nivellement, les murs des anctres perdent de leur ascendant, car elles n'ont plus auprs de l'adulte de reprsentants autoriss. On est plus libre vis--vis d'elles, parce qu'on est plus libre vis--vis de ceux qui les incarnent. La solidarit des temps est moins sensible parce qu'elle n'a plus son expression matrielle dans le contact continu des gnrations successives. Sans doute, les effets de l'ducation premire continuent se faire sentir, mais avec moins de force, parce qu'ils ne sont pas entretenus. Ce moment de la pleine jeunesse est, d'ailleurs, celui o les hommes sont le plus impatients de tout frein et le plus avides de changement. La vie qui circule en eux n'a
1 2
DUMONT, op. cit., 178. Cours de philosophie positive, IV, 451.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
54
pas encore eu le temps de se figer, de prendre dfinitivement des formes dtermines, et elle est trop intense pour se laisser discipliner sans rsistance. Ce besoin se satisfera donc d'autant plus facilement qu'il sera moins contenu du dehors, et il ne peut se satisfaire qu'aux dpens de la tradition. Celle-ci est plus battue en brche au moment mme o elle perd de ses forces. Une fois donn, ce germe de faiblesse ne peut que se dvelopper avec chaque gnration ; car on transmet avec moins d'autorit des principes dont on sent moins l'autorit. Une exprience caractristique dmontre cette influence de l'ge sur la force de la tradition. Prcisment parce que la population des grandes villes se recrute surtout par l'immigration, elle se compose essentiellement de gens qui, une fois adultes, ont quitt leurs foyers et se sont soustraits l'action des anciens. Aussi le nombre des vieillards y est-il trs faible, tandis qu'au contraire celui des hommes dans la force de l'ge y est trs lev. M. Cheysson a dmontr que les courbes de la population chaque groupe d'ge, pour Paris et pour la province, ne se rencontrent qu'aux ges de 15 20 ans et de 50 55 ans. Entre 20 et 50 la courbe parisienne est beaucoup plus leve, au-del elle est plus basse 1. En 1881, on comptait Paris 1 118 individus de 20 25 ans pour 874 dans le reste du pays 2. Pour le dpartement de la Seine tout entier, on trouve sur 1000 habitants 731 de 15 60 ans et 76 seulement au-del de cet ge, tandis que la province a 618 des premiers et 106 des seconds. En Norvge, d'aprs Jacques Bertillon, les rapports sont les suivants sur 1000 habitants :
Villes De 15 30 ans De 30 45 ans De 45 60 ans De 60 et au-dessus 278 205 110 59
Campagnes 239 183 120 87
Ainsi, c'est dans les grandes villes que l'influence modratrice de l'ge est son minimum ; on constate en mme temps que, nulle part, les traditions n'ont moins d'empire sur les esprits. En effet, les grandes villes sont les foyers incontests du progrs ; c'est en elles qu'ides, modes, murs, besoins nouveaux s'laborent pour se rpandre ensuite sur le reste du pays. Quand la socit change, c'est gnralement leur suite et leur imitation. Les humeurs y sont tellement mobiles que tout ce qui vient du pass y est un peu suspect ; au contraire, les nouveauts, quelles qu'elles soient, y jouissent d'un prestige presque gal celui dont jouissaient autrefois les coutumes des anctres. Les esprits y sont naturellement orients vers l'avenir. Aussi la vie s'y transforme-t-elle avec une extraordinaire rapidit : croyances, gots, passions y sont dans une perptuelle volution. Nul terrain n'est plus favorable aux volutions de toute sorte. C'est que la vie collective ne peut avoir de continuit l o les
1 2
La question de la population, in Annales d'hygine, 1884. Annales de la Ville de Paris.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
55
diffrentes couches d'units sociales, appeles se remplacer les unes les autres, sont ce point discontinues. Observant que, pendant la jeunesse des socits et surtout au moment de leur maturit, le respect des traditions est beaucoup plus grand que pendant leur vieillesse, M. Tarde a cru pouvoir prsenter le dclin du traditionalisme comme une phase simplement transitoire, une crise passagre de toute volution sociale. L'homme, dit-il, n'chappe au joug de la coutume que pour y retomber, c'est--dire pour fixer et consolider en y retombant les conqutes dues son mancipation temporaire 1. Cette erreur tient, croyons-nous, la mthode de comparaison suivie par l'auteur et dont nous avons, plusieurs fois dj, signal les inconvnients. Sans doute, si l'on rapproche la fin d'une socit des commencements de celle qui lui succde, on constate un retour du traditionalisme ; seulement, cette phase, par laquelle dbute tout type social, est toujours beaucoup moins violente qu'elle ne l'avait t chez le type immdiatement antrieur. Jamais, chez nous, les murs des anctres n'ont t l'objet du culte superstitieux qui leur tait vou Rome ; jamais il n'y eut Rome une institution analogue la [en grec dans le texte] du droit athnien, s'opposant toute innovation 2 ; mme au temps d'Aristote, c'tait encore en Grce une question de savoir s'il tait bon de changer les lois tablies pour les amliorer, et le philosophe ne se prononce pour l'affirmative qu'avec la plus grande circonspection 3. Enfin, chez les Hbreux, toute dviation de la rgle traditionnelle tait encore plus compltement impossible, puisque c'tait une impit. Or, pour juger de la marche des vnements sociaux, il ne faut pas mettre bout bout les socits qui se succdent, mais ne les comparer qu' la priode correspondante de leur carrire. Si donc il est bien vrai que toute vie sociale tend se fixer et devenir coutumire, la forme qu'elle prend devient toujours moins rsistante, plus accessible aux changements ; en d'autres termes, l'autorit de la coutume diminue d'une manire continue. Il est d'ailleurs impossible qu'il en soit autrement, puisque cet affaiblissement dpend des conditions mmes qui dominent le dveloppement historique. D'autre part, puisque les croyances et les pratiques communes tirent en grande partie leur force de la force de la tradition, il est vident qu'elles sont de moins en moins en tat de gner la libre expansion des variations individuelles.
III
Enfin, mesure que la socit s'tend et se concentre, elle enveloppe de moins prs l'individu et, par consquent, peut moins bien contenir les tendances divergentes qui se font jour. Il suffit pour s'en assurer de comparer les grandes villes aux petites. Chez ces dernires, quiconque cherche s'manciper des usages reus se heurte des rsistances qui sont parfois trs vives. Toute tentative d'indpendance est un objet de scandale public, et la rprobation gnrale qui s'y attache est de nature dcourager
1 2 3
Lois de l'imitation, 271. Voir sur Cette [en grec dans le texte] MEIER et SCHMANN, Der aitische Process. ARIST., Pol., II, 8, 1268 b, 26.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
56
les imitateurs. Au contraire, dans les grandes cits, l'individu est beaucoup plus affranchi du joug collectif ; c'est un fait d'exprience qui ne peut tre contest. C'est que nous dpendons d'autant plus troitement de l'opinion commune qu'elle surveille de plus prs toutes nos dmarches. Quand l'attention de tous est constamment fixe sur ce que fait chacun, le moindre cart est aperu et aussitt rprim ; inversement, chacun a d'autant plus de facilits pour suivre son sens propre qu'il est plus ais d'chapper ce contrle. Or, comme dit un proverbe, on n'est nulle part aussi bien cach que dans une foule. Plus un groupe est tendu et dense, plus l'attention collective, disperse sur une large surface, est incapable de suivre les mouvements de chaque individu ; car elle ne devient pas plus forte alors qu'ils deviennent plus nombreux. Elle porte sur trop de points la fois pour pouvoir se concentrer sur aucun. La surveillance se fait moins bien, parce qu'il y a trop de gens et de choses surveiller. De plus, le grand ressort de l'attention, savoir l'intrt, fait plus ou moins compltement dfaut. Nous ne dsirons connatre les faits et gestes d'une personne que si son image rveille en nous des souvenirs et des motions qui y sont lis, et ce dsir est d'autant plus actif que les tats de conscience ainsi rveills sont plus nombreux et plus forts 1. Si, au contraire, il s'agit de quelqu'un que nous n'apercevons que de loin en loin et en passant, ce qui le concerne, ne dterminant en nous aucun cho, nous laisse froids, et, par consquent, nous ne sommes incits ni nous renseigner sur ce qui lui arrive, ni observer ce qu'il fait. La curiosit collective est donc d'autant plus vive que les relations personnelles entre les individus sont plus continues et plus frquentes ; d'autre part, il est clair qu'elles sont d'autant plus rares et plus courtes que chaque individu est en rapports avec un plus grand nombre d'autres. Voil pourquoi la pression de l'opinion se fait sentir avec moins de force dans les grands centres. C'est que l'attention de chacun est distraite dans trop de directions diffrentes, et que, de plus, on se connat moins. Mme les voisins et les membres d'une mme famille sont moins souvent et moins rgulirement en contact, spars qu'ils sont chaque instant par la masse des affaires et des personnes intercurrentes. Sans doute, si la population est plus nombreuse qu'elle n'est dense, il peut arriver que la vie, disperse sur une plus grande tendue, soit moindre sur chaque point. La grande ville se rsout alors en un certain nombre de petites villes, et, par consquent, les observations prcdentes ne s'appliquent pas exactement 2. Mais partout o la densit de l'agglomration est en rapport avec son volume, les liens personnels sont rares et faibles : on perd plus facilement les autres de vue, mme ceux qui vous entourent de trs prs et, dans la mme mesure, on s'en dsintresse. Comme cette mutuelle indiffrence a pour effet de relcher la surveillance collective, la sphre d'action libre de chaque individu s'tend en fait et, peu peu, le fait devient un droit. Nous savons, en effet, que la conscience commune ne garde sa force qu' la condition de ne pas tolrer les contradictions ; or, par suite de cette diminution du contrle social, des actes se commettent journellement qui la contredisent, sans que pourtant elle ragisse. Si donc il en est qui se rptent avec assez de frquence et d'uniformit, ils finissent par nerver le sentiment collectif qu'ils froissent. Une rgle ne parat plus aussi respectable, quand elle cesse d'tre respecte, et cela impunment ; on ne trouve
1
Il est vrai que, dans une petite ville, l'tranger, l'inconnu n'est pas l'objet d'une moindre surveillance que l'habitant ; mais c'est que l'image qui le reprsente est rendue trs vive par un effet de contraste, parce qu'il est l'exception. Il n'en est pas de mme dans une grande ville, o il est la rgle, tout le monde, pour ainsi dire, tant inconnu. Il y a l une question tudier. Nous croyons avoir remarqu que, dans les villes populeuses, mais peu denses, l'opinion collective garde de sa force.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
57
plus la mme vidence un article de foi qu'on a trop laiss contester. D'autre part, une fois que nous avons us d'une libert, nous en contractons le besoin ; elle nous devient aussi ncessaire et nous parat aussi sacre que les autres. Nous jugeons intolrable un contrle dont nous avons perdu l'habitude. Un droit acquis une plus grande autonomie se fonde. C'est ainsi que les empitements que commet la personnalit individuelle, quand elle est moins fortement contenue du dehors, finissent par recevoir la conscration des murs. Or, si ce fait est plus marqu dans les grandes villes, il ne leur est pas spcial ; il se produit aussi dans les autres, suivant leur importance. Puisque donc l'effacement du type segmentaire entrane un dveloppement toujours plus considrable des centres urbains, voil une premire raison qui fait que ce phnomne doit aller en se gnralisant. Mais de plus, mesure que la densit morale de la socit s'lve elle devient elle-mme semblable une grande cit qui contiendrait dans ses murs le peuple tout entier. En effet, comme la distance matrielle et morale entre les diffrentes rgions tend s'vanouir, elles sont les unes par rapport aux autres dans une situation toujours plus analogue celle des diffrents quartiers d'une mme ville. La cause qui, dans les grandes villes, dtermine un affaiblissement de la conscience commune doit donc produire son effet dans toute l'tendue de la socit. Tant que les divers segments, gardant leur individualit, restent ferms les uns aux autres, chacun d'eux limite troitement l'horizon social des particuliers. Spars du reste de la socit par des barrires plus ou moins difficiles franchir, rien ne nous dtourne de la vie locale, et, par suite, toute notre action s'y concentre. Mais mesure que la fusion des segments devient plus complte, les perspectives s'tendent, et d'autant plus qu'au mme moment la socit elle-mme devient gnralement plus tendue. Ds lors, mme l'habitant de la petite ville vit moins exclusivement de la vie du petit groupe qui l'entoure immdiatement. Il noue avec des localits loignes des relations d'autant plus nombreuses que le mouvement de concentration est plus avanc. Ses voyages plus frquents, les correspondances plus actives qu'il change, les affaires qu'il suit au-dehors, etc., dtournent son regard de ce qui se passe autour de lui. Le centre de sa vie et de ses proccupations ne se trouve plus si compltement au lieu qu'il habite. Il s'intresse donc moins ses voisins, parce qu'ils tiennent une moindre place dans son existence. D'ailleurs, la petite ville a moins de prise sur lui, par cela mme -que sa vie dborde ce cadre exigu, que ses intrts et ses affections s'tendent bien au-del. Pour toutes ces raisons, l'opinion publique locale pse d'un poids moins lourd sur chacun de nous, et comme l'opinion gnrale de la socit n'est pas en tat de remplacer la prcdente, ne pouvant surveiller de prs la conduite de tous les citoyens, la surveillance collective se relche irrmdiablement, la conscience commune perd de son autorit, la variabilit individuelle s'accrot. En un mot, pour que le contrle social soit rigoureux et que la conscience commune se maintienne, il faut que la socit soit divise en compartiments assez petits et qui enveloppent compltement l'individu ; au contraire, l'un et l'autre s'affaiblissent mesure que ces divisions s'effacent 1. Mais, dira-t-on, les crimes et les dlits auxquels sont attaches des peines organises ne laissent jamais indiffrents les organes chargs de les rprimer. Que la
1
A cette cause fondamentale il faut ajouter l'influence contagieuse des grandes villes sur les petites, et des petites sur les campagnes. Mais cette influence n'est que secondaire, et, d'ailleurs, ne prend d'importance que dans la mesure o la densit sociale s'accrot.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
58
ville soit grande ou petite, que la socit soit dense ou non, les magistrats ne laissent pas impunis le criminel ni le dlinquant. Il semblerait donc que l'affaiblissement spcial dont nous venons d'indiquer la cause dt se localiser dans cette partie de la conscience collective qui ne dtermine que des ractions diffuses, sans pouvoir s'tendre au-del. Mais, en ralit, cette localisation est impossible, car ces deux rgions sont si troitement solidaires que l'une ne peut tre atteinte sans que l'autre s'en ressente. Les actes que les murs sont seules rprimer ne sont pas d'une autre nature que ceux que la loi chtie ; ils sont seulement moins graves. Si donc il en est parmi eux qui perdent toute gravit, la graduation correspondante des autres est trouble du mme coup ; ils baissent d'un degr ou de plusieurs et paraissent moins rvoltants. Quand on n'est plus du tout sensible aux petites fautes, on l'est moins aux grandes. Quand on n'attache plus une grande importance la simple ngligence des pratiques religieuses, on ne s'indigne plus autant contre les blasphmes ou les sacrilges. Quand on a pris l'habitude de tolrer complaisamment les unions libres, l'adultre scandalise moins. Quand les sentiments les plus faibles perdent de leur nergie, les sentiments plus forts, mais qui sont de mme espce et ont les mmes objets, ne peuvent garder intgralement la leur. C'est ainsi que, peu peu, l'branlement se communique la conscience commune tout entire.
IV
On s'explique maintenant comment il se fait que la solidarit mcanique soit lie l'existence du type segmentaire, ainsi que nous l'avons tabli dans le livre prcdent. C'est que cette structure spciale permet la socit d'enserrer de plus prs l'individu, - le tient plus fortement attach son milieu domestique et, par consquent, aux traditions, - enfin, en contribuant borner l'horizon social, contribue aussi 1 le rendre concret et dfini. C'est donc des causes toutes mcaniques qui font que la personnalit individuelle est absorbe dans la personnalit collective, et ce sont des causes de mme nature qui font qu'elle s'en dgage. Sans doute, cette mancipation se trouve tre utile ou, tout au moins, elle est utilise. Elle rend possibles les progrs de la division du travail ; plus gnralement, elle donne l'organisme social plus de souplesse et d'lasticit. Mais ce n'est pas parce qu'elle est utile qu'elle se produit. Elle est parce qu'elle ne peut pas ne pas tre. L'exprience des services qu'elle rend ne peut que la consolider une fois qu'elle existe. On peut se demander cependant si, dans les socits organises, l'organe ne joue pas le mme rle que le segment; si l'esprit corporatif et professionnel ne risque pas de remplacer l'esprit de clocher et d'exercer sur les individus la mme pression. Dans ce cas, ils ne gagneraient rien au changement. Le doute est d'autant plus permis que l'esprit de caste a eu certainement cet effet, et que la caste est un organe social. On sait aussi combien l'organisation des corps de mtiers a, pendant longtemps, gn le dveloppement des variations individuelles ; nous en avons cit plus haut des exemples.
1
Ce troisime effet ne rsulte qu'en partie de la nature segmentaire ; la cause principale en est dans l'accroissement du volume social. Resterait savoir pourquoi, en gnral, la densit s'accrot en mme temps que le volume. C'est une question que nous posons.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
59
Il est certain que les socits organises ne sont pas possibles sans un systme dvelopp de rgles qui prdterminent le fonctionnement de chaque organe. A mesure que le travail se divise il se constitue une multitude de morales et de droits professionnels 1. Mais cette rglementation n'en laisse pas moins agrandi le cercle d'action de l'individu. Tout d'abord, l'esprit professionnel ne peut avoir d'influence que sur la vie professionnelle. Au-del de cette sphre, l'individu jouit de la libert plus grande dont nous venons de montrer l'origine. Il est vrai que la caste tend son action plus loin, mais elle n'est pas un organe proprement dit. C'est un segment transform en organe ; elle tient donc de la nature de l'un et de l'autre. En mme temps qu'elle est charge de fonctions spciales, elle constitue une socit distincte au sein de l'agrgat total. Elle est une socit-organe, analogue ces individus-organes que l'on observe dans certains organismes 2. C'est ce qui fait qu'elle enveloppe l'individu d'une manire beaucoup plus exclusive que les corporations ordinaires. En second lieu, comme ces rgles n'ont de racines que dans un petit nombre de consciences, mais laissent indiffrente la socit dans son ensemble, elles ont une moindre autorit par suite de cette moindre universalit. Elles offrent donc une moindre rsistance aux changements. C'est pour cette raison qu'en gnral les fautes proprement professionnelles n'ont pas le mme degr de gravit que les autres. D'autre part, les mmes causes qui, d'une manire gnrale, allgent le joug collectif, produisent leur effet librateur l'intrieur de la corporation comme audehors. A mesure que les organes segmentaires fusionnent, chaque organe social devient plus volumineux, et cela d'autant plus que, en principe, le volume total de la socit s'accrot au mme moment. Les pratiques communes au groupe professionnel deviennent donc plus gnrales et plus abstraites, comme celles qui sont communes toute la socit et, par suite, elles laissent la place plus libre aux divergences particulires. De mme, l'indpendance plus grande dont les gnrations nouvelles jouissent par rapport leurs anes ne peut manquer d'affaiblir le traditionalisme de la profession ; ce qui rend l'individu encore plus libre d'innover. Ainsi, non seulement la rglementation professionnelle, en vertu de sa nature mme, gne moins que toute autre l'essor des varits individuelles, mais de plus, elle le gne de moins en moins.
1 2
Voir plus haut, liv. I, chap. V. Voir PERRIER, Colon. anim., 764.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
60
Chapitre IV
Les facteurs secondaires (suite)
L'hrdit
Retour la table des matires
Dans ce qui prcde, nous avons raisonn comme si la division du travail ne dpendait que de causes sociales. Cependant elle est aussi lie des conditions organico-psychiques. L'individu reoit en naissant des gots et des aptitudes qui le prdisposent certaines fonctions plus qu' d'autres, et ces prdispositions ont certainement une influence sur la manire dont les tches se rpartissent. D'aprs l'opinion la plus commune, il faudrait mme voir dans cette diversit des natures la condition premire de la division du travail, dont la principale raison d'tre serait de classer les individus suivant leurs capacits 1 . Il est donc intressant de dterminer quelle est au juste la part de ce facteur, d'autant plus qu'il constitue un nouvel obstacle la variabilit individuelle et, par consquent, aux progrs de la division du travail. En effet, comme ces vocations natives nous sont transmises par nos ascendants, elles se rfrent, non pas aux conditions dans lesquelles l'individu se trouve actuellement plac, mais celles o vivaient ses aeux. Elles nous enchanent donc notre race, comme la conscience collective nous enchanait notre groupe, et entravent par suite la libert de nos mouvements. Comme cette partie de nous-mme est tourne tout entire vers le pass, et vers un pass qui ne nous est pas personnel, elle nous dtourne de notre sphre d'intrts propres et des changements qui s'y produisent, Plus elle est dveloppe, plus elle nous immobilise, La race et l'individu sont deux forces contraires qui varient en raison inverse l'une de l'autre. En tant que nous ne faisons que reproduire et que continuer nos anctres, nous tendons vivre
1
STUART MILL, conomie politique.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
61
comme ils ont vcu, et nous sommes rfractaires toute nouveaut. Un tre qui recevrait de l'hrdit un legs trop important et trop lourd serait peu prs incapable de tout changement ; c'est le cas des animaux qui ne peuvent progresser qu'avec une grande lenteur. L'obstacle que le progrs rencontre de ce ct est mme plus difficilement surmontable que celui qui vient de la communaut des croyances et des pratiques. Car celles-ci ne sont imposes l'individu que du dehors et par une action morale, tandis que les tendances hrditaires sont congnitales et ont une base anatomique. Ainsi, plus grande est la part de l'hrdit dans la distribution des tches, plus cette distribution est invariable ; plus, par consquent, les progrs de la division du travail sont difficiles, alors mme qu'ils seraient utiles. C'est ce qui arrive dans l'organisme. La fonction de chaque cellule est dtermine par sa naissance. Dans un animal vivant, dit M. Spencer, le progrs de l'organisation implique non seulement que les* units composant chacune des parties diffrencies conservent chacune sa position, mais aussi que leur descendance leur succde dans ces positions. Les cellules hpatiques qui, tout en remplissant leur fonction, grandissent et donnent naissance de nouvelles cellules hpatiques, font place celles-ci quand elles se dissolvent et disparaissent ; les cellules qui en descendent ne se rendent pas aux reins, aux muscles, aux centres nerveux pour s'unir dans l'accomplissement de leurs fonctions 1. Mais aussi les changements qui se produisent dans l'organisation du travail physiologique sont-ils trs rares, trs restreints et trs lents. Or, bien des faits tendent dmontrer que, l'origine, l'hrdit avait sur la rpartition des fonctions sociales une influence trs considrable. Sans doute, chez les peuples tout fait primitifs, elle ne joue ce point de vue aucun rle. Les quelques fonctions qui commencent se spcialiser sont lectives ; mais c'est qu'elles ne sont pas encore constitues. Le chef ou les chefs ne se distinguent gure de la foule qu'ils dirigent ; leur pouvoir est aussi restreint qu'phmre ; tous les membres du groupe sont sur un pied d'galit. Mais aussitt que la division du travail apparat d'une manire caractrise, elle se fixe sous une forme qui se transmet hrditairement ; c'est ainsi que naissent les castes. L'Inde nous offre le plus parfait modle de cette organisation du travail, mais on la retrouve ailleurs. Chez les Juifs, les seules fonctions qui fussent nettement spares des autres, celles du sacerdoce, taient strictement hrditaires. Il en tait de mme Rome pour toutes les fonctions publiques, qui impliquaient les fonctions religieuses, et qui taient le privilge des seuls patriciens. En Assyrie, en Perse, en gypte, la socit se divise de la mme manire. L o les castes tendent disparatre, elles sont remplaces par les classes qui, pour tre moins troitement closes au-dehors, n'en reposent pas moins sur le mme principe. Assurment, cette institution n'est pas une simple consquence du fait des transmissions hrditaires. Bien des causes ont contribu la susciter. Mais elle n'aurait pu ni se gnraliser ce point, ni persister pendant si longtemps, si, en gnral, elle n'avait eu pour effet de mettre chacun la place qui lui convenait. Si le systme des castes avait t contraire aux aspirations individuelles et l'intrt social, aucun artifice n'et pu le maintenir. Si, dans la moyenne des cas, les individus n'taient pas rellement ns pour la fonction que leur assignait la coutume ou la loi, cette classification traditionnelle des citoyens et t vite bouleverse. La preuve,
1
SPENCER, Sociol., III, 349.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
62
c'est que ce bouleversement se produit en effet ds que cette discordance clate. La rigidit des cadres sociaux ne fait donc qu'exprimer la manire immuable dont se distribuaient alors les aptitudes, et cette immutabilit elle-mme ne peut tre due qu' l'action des lois de l'hrdit. Sans doute, l'ducation, parce qu'elle se faisait tout entire dans le sein de la famille et se prolongeait tard pour les raisons que nous avons dites, en renforait l'influence; mais elle n'et pu elle seule produire de tels rsultats. Car elle n'agit utilement et efficacement que si elle s'exerce dans le sens mme de l'hrdit. En un mot, cette dernire n'a pu devenir une institution sociale que l o elle jouait effectivement un rle social. En fait, nous savons que les peuples anciens avaient un sentiment trs vif de ce qu'elle tait. Nous n'en trouvons pas seulement la trace dans les coutumes dont nous venons de parler et dans d'autres similaires, mais il est directement exprim dans plus d'un monument littraire 1. Or, il est impossible qu'une erreur aussi gnrale soit une simple illusion et ne corresponde rien dans la ralit. Tous les peuples, dit M. Ribot, ont une foi, au moins vague, la transmission hrditaire. Il serait mme possible de soutenir que cette foi a t plus vive dans les temps primitifs qu'aux poques civilises. C'est de cette foi naturelle qu'est ne l'hrdit d'institution. Il est certain que des raisons sociales, politiques, ou mme des prjugs ont d contribuer la dvelopper et l'affermir ; mais il serait absurde de croire qu'on l'a invente 2. D'ailleurs, l'hrdit des professions tait trs souvent la rgle, alors mme que la loi ne l'imposait pas. Ainsi la mdecine, chez les Grecs, fut d'abord cultive par un petit nombre de familles. Les asclpiades ou prtres d'Esculape se disaient de la postrit de ce dieu... Hippocrate tait le dix-septime mdecin de sa famille. L'art divinatoire, le don de prophtie, cette haute faveur des dieux, passaient chez les Grecs pour se transmettre le plus souvent de pre en fils 3. En Grce, dit Hermann, l'hrdit de la fonction n'tait prescrite par la loi que dans quelques tats et pour certaines fonctions qui tenaient plus troitement la vie religieuse, comme, Sparte, les cuisiniers et les joueurs de flte ; mais les murs en avaient fait aussi pour les professions des artisans un fait plus gnral qu'on ne croit ordinairement 4. Maintenant encore, dans beaucoup de socits infrieures, les fonctions se distribuent d'aprs la race. Dans un grand nombre de tribus africaines, les forgerons descendent d'une autre race que le reste de la population. Il en tait de mme chez les Juifs au temps de Sal. En Abyssinie, presque tous les artisans sont de race trangre : le maon est Juif, le tanneur et le tisserand sont Mahomtans, l'armurier et l'orfvre Grecs et Coptes. Aux Indes, bien des diffrences de castes qui indiquent des diffrences de mtiers concident encore aujourd'hui avec celles de races. Dans tous les pays de population mixte, les descendants d'une mme famille ont coutume de se vouer certaines professions ; c'est ainsi que, dans l'Allemagne orientale, les pcheurs, pendant des sicles, taient Slaves 5. Ces faits donnent une grande vraisemblance l'opinion de Lucas, d'aprs laquelle l'hrdit des professions est le type primitif, la forme lmentaire de toutes les institutions fondes sur le principe de l'hrdit de la nature morale .
1 2 3 4
RIBOT, L'hrdit, 2e d., p. 360. Ibid., 345. Ibid., 365. - Cf. HERMANN, Griech. Antiq., IV, 353, n. 3. Ibid., 395, n. 2, chap. 1er, 33. - Pour les faits, voir notamment: PLATON, Eutyphr., 11 C; Alcibiade, 121 A; Rp., IV, 421 D ; surtout Protag., 328 A; PLUTARQUE, Apophth. Lacon., 208 B. SCHMOLLER, La division du travail, in Rev. d'con. polit., 1888, p. 590.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
63
Mais aussi on sait combien, dans ces socits, le progrs est lent et difficile. Pendant des sicles, le travail reste organis de la mme manire, sans qu'on songe rien innover. L'hrdit s'offre ici nous avec ses caractres habituels : conservation, stabilit 1. Par consquent, pour que la division du travail ait pu se dvelopper, il a fallu que les hommes parvinssent secouer le joug de l'hrdit, que le progrs brist les castes et les classes. La disparition progressive de ces dernires tend, en effet, prouver la ralit de cette mancipation ; car on ne voit pas comment, si l'hrdit n'avait rien perdu de ses droits sur l'individu, elle aurait pu s'affaiblir comme institution. Si la statistique s'tendait assez loin dans le pass, et surtout si elle tait mieux informe sur ce point, elle nous apprendrait trs vraisemblablement que les cas de professions hrditaires deviennent toujours moins nombreux. Ce qui est certain, c'est que la foi l'hrdit, si intense jadis, est aujourd'hui remplace par une foi presque oppose. Nous tendons croire que l'individu est en majeure partie le fils de ses uvres et mconnatre mme les liens qui le rattachent sa race et l'en font dpendre ; c'est du moins une opinion trs rpandue et dont se plaignent presque les psychologues de l'hrdit. C'est mme un fait assez curieux que l'hrdit ne soit vraiment entre dans la science qu'au moment o elle tait presque compltement sortie de la croyance. Il n'y a pas l, d'ailleurs, de contradiction. Car ce qu'affirme au fond la conscience commune, ce n'est pas que l'hrdit n'existe pas, mais que le poids en est moins lourd, et la science, nous le verrons, n'a rien qui contredise ce sentiment. Mais il importe d'tablir le fait directement, et surtout d'en faire voir les causes.
En premier lieu, l'hrdit perd de son empire au cours de l'volution, parce que, simultanment, des modes nouveaux d'activit se sont constitus qui ne relvent pas de son influence. Une premire preuve de ce stationnement de l'hrdit, c'est l'tat stationnaire des grandes races humaines. Depuis les temps les plus reculs, il ne s'en est pas form de nouvelles : du moins, si, avec M. de Quatrefages 2, on donne ce nom mme aux diffrents types qui sont issus de trois ou quatre grands types fondamentaux, il faut ajouter que plus ils s'loignent de leurs points d'origine, moins ils prsentent les traits constitutifs de la race. En effet, tout le monde est d'accord pour reconnatre que ce qui caractrise cette dernire, c'est l'existence de ressemblances hrditaires ; aussi les anthropologistes prennent-ils pour base de leurs classifications des caractres physiques, parce qu'ils sont les plus hrditaires de tous. Or, plus les types anthropologiques sont circonscrits, plus il devient difficile de les dfinir en fonction de proprits exclusivement organiques, parce que celles-ci ne sont plus ni assez nombreuses ni assez distinctives. Ce sont des ressemblances toutes morales, que l'on tablit l'aide de la linguistique, de l'archologie, du droit compar, qui deviennent prpondrantes ; mais on n'a aucune raison d'admettre qu'elles soient hrditaires.
1 2
RIBOT, op. cit., p. 360. Voir L'espce humaine.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
64
Elles servent distinguer des civilisations plutt que des races. A mesure qu'on avance, les varits humaines qui se forment deviennent donc moins hrditaires ; elles sont de moins en moins des races. L'impuissance progressive de notre espce produire des races nouvelles fait mme le plus vif contraste avec la fcondit contraire des espces animales. Qu'est-ce que cela signifie, sinon que la culture humaine, mesure qu'elle se dveloppe, est de plus en plus rfractaire ce genre de transmission ? Ce que les hommes ont ajout et ajoutent tous les jours ce fond primitif qui s'est fix depuis des sicles dans la structure des races initiales, chappe donc de plus en plus l'action de l'hrdit. Mais s'il en est ainsi du courant gnral de la civilisation, plus forte raison en est-il de mme de chacun des affluents particuliers qui le forment, c'est--dire de chaque activit fonctionnelle et de ses produits. Les faits qui suivent confirment cette induction. C'est une vrit tablie que le degr de simplicit des faits psychiques donne la mesure de leur transmissibilit. En effet, plus les tats sont complexes, plus ils se dcomposent facilement, parce que leur grande complexit les maintient dans un tat d'quilibre instable. Ils ressemblent ces constructions savantes dont l'architecture est si dlicate qu'il suffit de peu de chose pour en troubler gravement l'conomie, la moindre secousse, l'difice branl s'croule mettant nu le terrain qu'il recouvrait. C'est ainsi que, dans les cas de paralysie gnrale, le moi se dissout lentement jusqu' ce qu'il ne reste plus, pour ainsi dire, que la base organique sur laquelle il reposait. D'ordinaire, c'est sous le choc de la maladie que se produisent ces faits de dsorganisation. Mais on conoit que la transmission sminale doit avoir des effets analogues. En effet, dans l'acte de la fcondation, les caractres strictement individuels tendent se neutraliser mutuellement; car, comme ceux qui sont spciaux l'un des parents ne peuvent se transmettre qu'au dtriment de l'autre, il s'tablit entre eux une sorte de lutte d'o il est impossible qu'ils sortent intacts. Mais plus un tat de conscience est complexe, plus il est personnel, plus il porte la marque des circonstances particulires dans lesquelles nous avons vcu, de notre sexe, de notre temprament. Par les parties infrieures et fondamentales de notre tre nous nous ressemblons beaucoup plus que par ces sommets : c'est par ces derniers, au contraire, que nous nous distinguons les uns des autres. Si donc ils ne disparaissent pas compltement dans la transmission hrditaire, du moins ils ne peuvent survivre qu'effacs et affaiblis. Or, les aptitudes sont d'autant plus complexes qu'elles sont plus spciales. C'est, en effet, une erreur de croire que notre activit se simplifie mesure que nos tches se dlimitent. Au contraire, c'est quand elle se disperse sur une multitude d'objets qu'elle est simple, car, comme elle nglige alors ce qu'ils ont de personnel et de distinct pour ne viser que ce qu'ils ont de commun, elle se rduit quelques mouvements trs gnraux qui conviennent dans une foule de circonstances diverses. Mais quand il s'agit de nous adapter des objets particuliers et spciaux, de manire tenir compte de toutes leurs nuances, nous ne pouvons y parvenir qu'en combinant un trs grand nombre d'tats de conscience, diffrencis l'image des choses mmes auxquelles ils se rapportent. Une fois agencs et constitus, ces systmes fonctionnent sans doute avec plus d'aisance et de rapidit, mais ils restent trs complexes. Quel prodigieux assemblage d'ides, d'images, d'habitudes n'observe-t-on pas chez le prote qui compose une page d'imprimerie, chez le mathmaticien qui combine une multitude de thormes pars et en fait jaillir un thorme nouveau ; chez le mdecin qui, un signe imperceptible, reconnat du coup une maladie et en prvoit en mme temps la
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
65
marche ? Comparez la technique si lmentaire de l'ancien philosophe, du sage qui, par la seule force de la pense, entreprend d'expliquer le monde, et celle du savant d'aujourd'hui qui n'arrive rsoudre un problme trs particulier que par une combinaison trs complique d'observations, d'expriences, grce des lectures d'ouvrages crits dans toutes les langues, des correspondances, des discussions, etc., etc. C'est le dilettante qui conserve intacte sa simplicit primitive. La complexit de sa nature n'est qu'apparente. Comme il fait le mtier de s'intresser tout, il semble qu'il ait une multitude de gots et d'aptitudes divers. Pure illusion ! Regardez au fond des choses, et vous verrez que tout se rduit un petit nombre de facults gnrales et simples, mais qui, n'ayant rien perdu de leur indtermination premire, se dprennent avec aisance des objets auxquels elles s'attachent, pour se reporter ensuite sur d'autres. Du dehors, on aperoit une succession ininterrompue d'vnements varis ; mais c'est le mme acteur qui joue tous les rles sous des costumes un peu diffrents. Cette surface o brillent tant de couleurs savamment nuances recouvre un fond d'une dplorable monotonie. Il a assoupli et affin les puissances de son tre, mais il n'a pas su les transformer et les refondre pour en tirer une uvre nouvelle et dfinie ; il n'a rien lev de personnel et de durable sur le terrain que lui a lgu la nature. Par consquent, plus les facults sont spciales, plus elles sont difficilement transmissibles ; ou, si elles parviennent passer d'une gnration l'autre, elles ne peuvent manquer de perdre de leur force et de leur prcision. Elles sont moins irrsistibles et plus mallables ; par suite de leur plus grande indtermination, elles peuvent plus facilement changer sous l'influence des circonstances de famille, de fortune, d'ducation, etc. En un mot, plus les formes de l'activit se spcialisent, plus elles chappent l'action de l'hrdit.
On a cependant cit des cas o des aptitudes professionnelles paraissent tre hrditaires. Des tableaux dresss par M. Galton il semble rsulter qu'il y a eu parfois de vritables dynasties de savants, de potes, de musiciens. M. de Candolle, de son ct, a tabli que les fils de savants se sont souvent occups de science 1 . Mais ces observations n'ont, en l'espce, aucune valeur dmonstrative. Nous ne songeons pas, en effet, soutenir que la transmission d'aptitudes spciales est radicalement impossible ; nous voulons dire seulement qu'en gnral elle n'a pas lieu, parce qu'elle ne peut s'effectuer que par un miracle d'quilibre qui ne saurait se renouveler souvent. Il ne sert donc rien de citer tels ou tels cas particuliers o elle s'est produite ou parat s'tre produite ; mais il faudrait encore voir quelle part ils reprsentent dans l'ensemble des vocations scientifiques. C'est seulement alors que l'on pourrait juger s'ils dmontrent vraiment que l'hrdit a une grande influence sur la faon dont se divisent les fonctions sociales. Or, quoique cette comparaison ne puisse tre faite mthodiquement, un fait, tabli par M. de Candolle, tend prouver combien est restreinte l'action de l'hrdit dans ces carrires. Sur 100 associs trangers de l'Acadmie de Paris, dont M. de Candolle a pu refaire la gnalogie, 14 descendent de ministres protestants, 5 seulement de mdecins, de chirurgiens, de pharmaciens. Sur 48 membres trangers de la Socit royale de Londres en 1829, 8 sont fils de pasteurs, 4 seulement ont pour pres des hommes de l'art. Pourtant, le nombre total de ces derniers, dans les pays hors de France, doit tre bien suprieur celui des ecclsiastiques protestants. En effet, parmi
1
Histoire des sciences et des savants, 2e d., p. 293.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
66
les populations protestantes, considres isolment, les mdecins, chirurgiens, pharmaciens et vtrinaires sont peu prs aussi nombreux que les ecclsiastiques, et quand on ajoute ceux des pays purement catholiques autres que la France, ils constituent un total beaucoup plus considrable que celui des pasteurs et ministres protestants. Les tudes que les hommes de l'art mdical ont faites et les travaux auxquels ils doivent se livrer habituellement pour leur profession sont bien plus dans la sphre des sciences que les tudes et les travaux d'un pasteur. Si le succs dans les sciences tait une affaire uniquement d'hrdit, il y aurait bien plus de fils de mdecins, pharmaciens, etc., sur nos listes que de fils de pasteurs 1 . Encore n'est-il pas du tout certain que ces vocations scientifiques des fils de savants soient rellement dues l'hrdit. Pour avoir le droit de les lui attribuer, il ne suffit pas de constater une similitude de gots entre les parents et les enfants, il faudrait encore que ces derniers eussent manifest leurs aptitudes aprs avoir t levs ds leur premire enfance en dehors de leur famille et dans un milieu tranger toute culture scientifique. Or, en fait, tous les fils de savants sur lesquels a port l'observation ont t levs dans leurs familles, o ils ont naturellement trouv plus de secours intellectuels et d'encouragements que leurs pres n'en avaient reus. Il y a aussi les conseils et l'exemple, le dsir de ressembler son pre, d'utiliser ses livres, ses collections, ses recherches, son laboratoire, qui sont pour un esprit gnreux et avis des stimulants nergiques. Enfin, dans les tablissements o ils achvent leurs tudes, les fils de savants se trouvent en contact avec des esprits cultivs ou propres recevoir une haute culture, et l'action de ce milieu nouveau ne fait que confirmer celle du premier. Sans doute, dans les socits o c'est la rgle que l'enfant suive la profession du pre, une telle rgularit ne peut s'expliquer par un simple concours de circonstances extrieures ; car ce serait un miracle qu'il se produist dans chaque cas avec une aussi parfaite identit. Mais il n'en est pas de mme de ces rencontres isoles et presque exceptionnelles que l'on observe aujourd'hui. Il est vrai que plusieurs des hommes scientifiques anglais auxquels s'est adress M. Galton 2 ont insist sur un got spcial et inn qu'ils auraient ressenti ds leur enfance pour la science qu'ils devaient cultiver plus tard. Mais, comme le fait remarquer M. de Candolle, il est bien difficile de savoir si ces gots viennent de naissance ou des impressions vives de la jeunesse et des influences qui les provoquent et les dirigent. D'ailleurs, ces gots changent, et les seuls importants pour la carrire sont ceux qui persistent. Dans ce cas, l'individu qui se distingue dans une science ou qui continue de la cultiver avec plaisir ne manque jamais de dire que c'est chez lui un got inn. Au contraire, ceux qui ont des gots spciaux dans l'enfance et n'y ont plus pens n'en parlent pas. Que l'on songe la multitude d'enfants qui chassent aux papillons ou font des collections de coquilles, d'insectes, etc., qui ne deviennent pas des naturalistes. Je connais aussi bon nombre d'exemples de savants qui ont eu, tant jeunes, la passion de faire des vers ou des pices de thtre et qui, dans la suite, ont eu des occupations bien diffrentes 3 . Une autre observation du mme auteur montre combien est grande l'action du milieu social sur la gense de ces aptitudes. Si elles taient dues l'hrdit, elles seraient galement hrditaires dans tous les pays ; les savants issus de savants seraient dans la mme proportion chez tous les peuples du mme type. Or, les faits
1 2 3
Op. cit., p. 294. English men of science, 1874, p. 144 et suiv. Op. cit., p. 320.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
67
se sont manifests d'une tout autre manire. En Suisse, il y a eu depuis deux sicles plus de savants groups par famille que de savants isols. En France et en Italie, le nombre des savants qui sont uniques dans leur famille constitue au contraire l'immense majorit. Les lois physiologiques sont cependant les mmes pour tous les hommes. Donc, l'ducation dans chaque famille, l'exemple et les conseils donns doivent avoir exerc une influence plus marque que l'hrdit sur la carrire spciale des jeunes savants. Il est, d'ailleurs, ais de comprendre pourquoi cette influence a t plus forte en Suisse que dans la plupart des pays. Les tudes s'y font jusqu' l'ge de dix-huit ou vingt ans dans chaque ville et dans des conditions telles que les lves vivent chez eux auprs de leurs pres. C'tait surtout vrai dans le sicle dernier et dans la premire moiti du sicle actuel, particulirement Genve et Ble, c'est--dire dans les deux villes qui ont fourni la plus forte proportion de savants unis entre eux par des liens de famille. Ailleurs, notamment en France et en Italie; il a toujours t ordinaire que les jeunes gens fussent levs dans des collges o ils demeurent et se trouvent, par consquent, loigns des influences de famille 1. Il n'y a donc aucune raison d'admettre l'existence de vocations innes et imprieuses pour des objets spciaux 2 ; du moins, s'il y en a, elles ne sont pas la rgle. Comme le remarque galement M. Bain, le fils d'un grand philologue n'hrite pas d'un seul vocable ; le fils d'un grand voyageur peut, l'cole, tre surpass en gographie par le fils d'un mineur 3 . Ce n'est pas dire que l'hrdit soit sans influence, mais ce qu'elle transmet, ce sont des facults trs gnrales et non une aptitude particulire pour telle ou telle science. Ce que l'enfant reoit de ses parents, c'est quelque force d'attention, une certaine dose de persvrance, un jugement sain, de l'imagination, etc. Mais chacune de ces facults peut convenir une foule de spcialits diffrentes et y assurer le succs. Voici un enfant dou d'une assez vive imagination ; il est de bonne heure en relations avec des artistes, il deviendra peintre ou pote ; s'il vit dans un milieu industriel, il deviendra un ingnieur l'esprit inventif ; si le hasard le place dans le monde des affaires, il sera peut-tre un jour un hardi financier. Bien entendu, il apportera partout avec lui sa nature propre, son besoin de crer et d'imaginer sa passion du nouveau ; mais les carrires o il pourra utiliser ses talents et satisfaire son penchant sont trs nombreuses. C'est, d'ailleurs, ce que M. de Candolle a tabli par une observation directe. Il a relev les qualits utiles dans les sciences que son pre tenait de son grand-pre; en voici la liste; volont, esprit d'ordre, jugement sain, une certaine puissance d'attention, loignement pour les abstractions mtaphysiques, indpendance d'opinion. C'est assurment un bel hritage, mais avec lequel on aurait pu devenir galement un administrateur, un homme d'tat, un historien, un conomiste, un grand industriel, un excellent mdecin, ou bien enfin un naturaliste, comme fut M. de Candolle. Il est donc vident que les circonstances eurent une large part dans le choix de sa carrire, et c'est en effet ce que son fils nous apprend 4. Seuls, l'esprit mathmatique et le sentiment musical pourraient bien tre assez souvent des dispositions de naissance, dues un hritage direct des parents. Cette apparente anomalie ne surprendra pas, si l'on se rappelle que ces deux talents se sont dvelopps de trs bonne heure dans l'histoire de l'humanit. La musique est le premier des arts et les mathmatiques la premire des sciences qu'aient cultivs les hommes ; cette double facult doit donc tre plus gnrale et moins complexe qu'on ne le croit, et c'est ce qui en expliquerait la transmissibilit.
1 2 3 4
Op. cit., p. 296. Ibid., p. 299. motions et volont, p. 53. Op. cit., p. 318.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
68
On en peut dire autant d'une autre vocation, celle du crime. Suivant la juste remarque de M. Tarde, les diffrentes varits du crime et du dlit sont des professions, quoique nuisibles ; elles ont mme parfois une technique complexe. L'escroc, le faux monnayeur, le faussaire sont obligs de dployer plus de science et plus d'art dans leur mtier que bien des travailleurs normaux. Or, on a soutenu que non seulement la perversion morale en gnral, mais encore les formes spcifiques de la criminalit taient un produit de l'hrdit ; on a mme cru pouvoir porter plus de 40 % la cote du criminel-n 1 . Si cette proportion tait prouve, il en faudrait conclure que l'hrdit a parfois une grande influence sur la faon dont se rpartissent les professions, mme spciales. Pour la dmontrer, on a essay de deux mthodes diffrentes. On s'est souvent content de citer des cas de familles qui se sont voues tout entires au mal, et cela pendant plusieurs gnrations. Mais, outre que, de cette manire, on ne peut pas dterminer la part relative de l'hrdit dans l'ensemble des vocations criminelles, de telles observations, si nombreuses qu'elles puissent tre, ne constituent pas des expriences dmonstratives. De ce que le fils d'un voleur devient voleur lui-mme, il ne suit pas que son immoralit soit un hritage que lui a lgu son pre ; pour interprter ainsi les faits, il faudrait pouvoir isoler l'action de l'hrdit de celle des circonstances, de l'ducation, etc. Si l'enfant manifestait son aptitude au vol aprs avoir t lev dans une famille parfaitement saine, alors on pourrait bon droit invoquer l'influence de l'hrdit ; mais nous possdons bien peu d'observations de ce genre qui aient t faites mthodiquement. On n'chappe pas l'objection en faisant remarquer que les familles qui sont ainsi entranes au mal sont parfois trs nombreuses. Le nombre ne fait rien l'affaire ; car le milieu domestique, qui est le mme pour toute la famille, quelle qu'en soit l'tendue, suffit expliquer cette criminalit endmique. La mthode suivie par M. Lombroso serait plus concluante si elle donnait les rsultats que s'en promet l'auteur. Au lieu d'numrer un certain nombre de cas particuliers, il constitue anatomiquement et physiologiquement le type du criminel. Comme les Caractres anatomiques et physiologiques, et surtout les premiers, sont congnitaux, c'est--dire dtermins par l'hrdit, il suffira d'tablir la proportion des dlinquants qui prsentent le type ainsi dfini, pour mesurer exactement l'influence de l'hrdit sur cette activit spciale. On a vu que, suivant Lombroso, elle serait considrable. Mais le chiffre cit n'exprime que la frquence relative du type criminel en gnral. Tout ce qu'on en peut conclure par consquent, c'est que la propension au mal en gnral est souvent hrditaire; mais on n'en peut rien dduire relativement aux formes particulires du crime et du dlit. On sait d'ailleurs aujourd'hui que ce prtendu type criminel n'a, en ralit, rien de spcifique. Bien des traits qui le constituent se retrouvent ailleurs. Tout ce qu'on aperoit, c'est qu'il ressemble celui des dgnrs, des neurasthniques 2. Or, si ce fait est une preuve que, parmi les criminels, il y a beaucoup de neurasthniques, il ne s'ensuit pas que la neurasthnie mne toujours et invinciblement au crime. Il y a au moins autant de dgnrs qui sont honntes, quand ils ne sont pas des hommes de talent ou de gnie.
1 2
LOMBROSO, L'homme criminel, 669. Voir FR, Dgnrescence et criminalit.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
69
Si donc les aptitudes sont d'autant moins transmissibles qu'elles sont plus spciales, la part de l'hrdit dans l'organisation du travail social est d'autant plus grande que celui-ci est moins divis. Dans les socits infrieures, o les fonctions sont trs gnrales, elles ne rclament que des aptitudes galement gnrales qui peuvent plus facilement et plus intgralement passer d'une gnration l'autre. Chacun reoit en naissant tout l'essentiel pour soutenir son personnage ; ce qu'il doit acqurir par lui-mme est peu de chose ct de ce qu'il tient de l'hrdit. Au Moyen ge, le noble, pour remplir son devoir, n'avait pas besoin de beaucoup de connaissances ni de pratiques bien compliques, mais surtout de courage, et il le recevait avec le sang. Le lvite et le brahmane, pour s'acquitter de leur emploi, n'avaient pas besoin d'une science bien volumineuse, - nous pouvons en mesurer les dimensions d'aprs celles des livres qui la contenaient; - mais il leur fallait une supriorit native de l'intelligence qui les rendait accessibles des ides et des sentiments auxquels le vulgaire tait ferm. Pour tre un bon mdecin au temps d'Esculape, il n'tait pas ncessaire de recevoir une culture bien tendue ; il suffisait d'avoir un got naturel pour l'observation et pour les choses concrtes, et, comme ce got est assez gnral pour tre aisment transmissible, il tait invitable qu'il se perptut dans certaines familles et que, par suite, la profession mdicale y ft hrditaire. On s'explique trs bien que, dans ces conditions, l'hrdit soit devenue une institution sociale. Sans doute, ce n'est pas ces causes toutes psychologiques qui ont pu susciter l'organisation des castes ; mais, une fois que celle-ci fut ne sous l'empire d'autres causes, elle dura parce qu'elle se trouva tre parfaitement conforme et aux gots des individus et aux intrts de -la socit. Puisque l'aptitude professionnelle tait une qualit de la race plutt que de l'individu, il tait tout naturel qu'il en ft de mme de la fonction. Puisque les fonctions se distribuaient immuablement de la mme manire, il ne pouvait y avoir que des avantages ce que la loi consacrt le principe de cette distribution. Quand l'individu n'a que la moindre part dans la formation de son esprit et de son caractre, il ne saurait en avoir une plus grande dans le choix de sa carrire et, si plus de libert lui tait laisse, gnralement il ne saurait qu'en faire. Si encore une mme capacit gnrale pouvait servir dans des professions diffrentes ! Mais, prcisment parce que le travail est peu spcialis, il n'existe qu'un petit nombre de fonctions spares les unes des autres par des diffrences tranches ; par consquent, on ne peut gure russir que dans l'une d'elles. La marge laisse aux combinaisons individuelles est donc encore restreinte de ce ct. En dfinitive, il en est de l'hrdit des fonctions comme de celle des biens. Dans les socits infrieures, l'hritage transmis par les aeux, et qui consiste le plus souvent en immeubles, reprsente la partie la plus importante du patrimoine de chaque famille particulire ; l'individu, par suite du peu de vitalit qu'ont alors les fonctions conomiques, ne peut pas ajouter grand-chose au fond hrditaire. Aussi n'est-ce pas lui qui possde, mais la famille, tre collectif, compos non seulement de tous les membres de la gnration actuelle, mais de toute la suite des gnrations. C'est pourquoi les biens patrimoniaux sont inalinables ; aucun des reprsentants phmres de l'tre domestique ne peut en disposer, car ils ne sont pas lui. Ils sont la famille, comme la fonction est la case. Alors mme que le droit tempre ses prohibitions premires, une alination du patrimoine est encore considre comme une forfaiture; elle est pour toutes les classes de la population ce qu'une msalliance est pour l'aristocratie. C'est une trahison envers la race, une dfection. Aussi, tout en la tolrant, la loi pendant longtemps y met-elle toute sorte d'obstacles ; c'est de l que vient le droit de retrait.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
70
Il n'en est pas de mme dans les socits plus volumineuses o le travail est plus divis. Comme les fonctions sont plus diversifies, une mme facult peut servir dans des professions diffrentes. Le courage est aussi ncessaire au mineur, l'aronaute, au mdecin, l'ingnieur qu'au soldat. Le got de l'observation peut galement faire d'un homme un romancier, un auteur dramatique, un chimiste, un naturaliste, un sociologue. En un mot, l'orientation de l'individu est prdtermine d'une manire moins ncessaire par l'hrdit. Mais ce qui diminue surtout l'importance relative de cette dernire, c'est que la part des acquts individuels devient plus considrable. Pour mettre en valeur le legs hrditaire, il faut y ajouter beaucoup plus qu'autrefois. En effet, mesure que les fonctions se sont spcialises davantage, des aptitudes simplement gnrales n'ont plus suffi. Il a fallu les soumettre une laboration active, acqurir tout un monde d'ides, de mouvements, d'habitudes, les coordonner, les systmatiser, refondre la nature, lui donner une forme et une figure nouvelles. Que l'on compare - et nous prenons des points de comparaison assez rapprochs l'un de l'autre - l'honnte homme du XVIIe sicle avec son esprit ouvert et peu garni, et le savant moderne, arm de toutes les pratiques, de toutes les connaissances ncessaires la science qu'il cultive ; le noble d'autrefois avec son courage et sa fiert naturels, et l'officier d'aujourd'hui avec sa technique laborieuse et complique ; et l'on jugera de l'importance et de la varit des combinaisons qui se sont peu peu superposes au fonds primitif. Mais parce qu'elles sont trs complexes, ces savantes combinaisons sont fragiles. Elles sont dans un tat d'quilibre instable qui ne saurait rsister une forte secousse. Si encore elles se retrouvaient identiques chez les deux parents, elles pourraient peuttre survivre la crise de la gnration. Mais une telle identit est tout fait exceptionnelle. D'abord, elles sont spciales chaque sexe ; ensuite, mesure que les socits s'tendent et se condensent, les croisements se font sur une plus large surface, en rapprochant des individus de tempraments plus diffrents. Toute cette superbe vgtation d'tats de conscience meurt donc avec nous, et nous n'en transmettons nos descendants qu'un germe indtermin. C'est eux qu'il appartient de le fconder nouveau, et, par consquent, ils peuvent plus aisment, si c'est ncessaire, en modifier le dveloppement. Ils ne sont plus astreints aussi troitement rpter ce qu'ont fait leurs pres. Sans doute, ce serait une erreur de croire que chaque gnration recommence nouveaux frais et intgralement l'uvre des sicles, ce qui rendrait tout progrs impossible. De ce que le pass ne se transmet plus avec le sang, il ne s'ensuit pas qu'il s'anantisse : il reste fix dans les monuments, dans les traditions de toute sorte, dans les habitudes que donne l'ducation. Mais la tradition est un lien beaucoup moins fort que l'hrdit ; elle prdtermine d'une manire sensiblement moins rigoureuse et moins nette la pense et la conduite. Nous avons vu, d'ailleurs, comment elle-mme devenait plus flexible mesure que les socits devenaient plus denses. Un champ plus large se trouve donc ouvert aux variations individuelles, et il s'largit de plus en plus mesure que le travail se divise davantage. En un mot, la civilisation ne peut se fixer dans l'organisme que par les bases les plus gnrales sur lesquelles elle repose. Plus elle s'lve au-dessus, plus, par consquent, elle s'affranchit du corps ; elle devient de moins en moins une chose organique, de plus en plus une chose sociale. Mais alors ce n'est plus par l'intermdiaire du corps qu'elle peut se perptuer, c'est--dire que l'hrdit est de plus en plus incapable d'en assurer la continuit. Elle perd donc de son empire, non qu'elle ait cess d'tre une loi de notre nature, mais parce qu'il nous faut, pour vivre, des armes qu'elle ne peut nous donner. Sans doute, de rien nous ne pouvons rien tirer, et les
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
71
matriaux premiers qu'elle seule nous livre ont une importance capitale ; niais ceux qu'on y ajoute en ont une qui n'est pas moindre. Le patrimoine hrditaire conserve une grande valeur, mais il ne reprsente plus qu'une partie de plus en plus restreinte de la fortune individuelle. Dans ces conditions, on s'explique dj que l'hrdit ait disparu des institutions sociales et que le vulgaire, n'apercevant plus le fond hrditaire sous les additions qui le recouvrent, n'en sente plus autant l'importance.
II
Mais il y a plus ; il y a tout lieu de croire que le contingent hrditaire diminue non seulement en valeur relative, mais en valeur absolue. L'hrdit devient un facteur moindre du dveloppement humain, non seulement parce qu'il y a une multitude toujours plus grande d'acquisitions nouvelles qu'elle ne peut pas transmettre, mais encore parce que celles qu'elle transmet gnent moins les variations individuelles. C'est une conjecture que rendent trs vraisemblable les faits qui suivent. On peut mesurer l'importance du legs hrditaire pour une espce donne d'aprs le nombre et la force des instincts. Or, il est dj trs remarquable que la vie instinctive s'affaiblit mesure qu'on monte dans l'chelle animale. L'instinct, en effet, est une manire d'agir dfinie, ajuste une fin troitement dtermine. Il porte l'individu des actes qui sont invariablement les mmes et qui se reproduisent automatiquement quand les conditions ncessaires sont donnes ; il est fig dans sa forme. Sans doute, on peut l'en faire dvier la rigueur, mais outre que de telles dviations, pour tre stables, rclament un long dveloppement, elles n'ont d'autre effet que de substituer un instinct un autre instinct, un mcanisme spcial un autre de mme nature. Au contraire, plus l'animal appartient une espce leve, plus l'instinct devient facultatif. Ce n'est plus, dit M. Perrier, l'aptitude inconsciente former une combinaison d'actes indtermins, c'est l'aptitude agir diffremment suivant les circonstances 1. Dire que l'influence de l'hrdit est plus gnrale, plus vague, moins imprieuse, c'est dire qu'elle est moindre. Elle n'emprisonne plus l'activit de l'animal dans un rseau rigide, mais lui laisse un jeu plus libre. Comme le dit encore M. Perrier, chez l'animal, en mme temps que l'intelligence s'accrot, les conditions de l'hrdit sont profondment modifies . Quand des animaux on passe l'homme, cette rgression est encore plus marque. L'homme fait tout ce que font les animaux et davantage ; seulement, il le fait en sachant ce qu'il fait et pourquoi il le fait ; cette seule conscience de ses actes semble le dlivrer de tous les instincts qui le pousseraient ncessairement accomplir ces mmes actes 2. Il serait trop long d'numrer tous les mouvements qui, instinctifs chez l'animal, ont cess d'tre hrditaires chez l'homme. L mme o l'instinct survit, il a moins de force, et la volont peut plus facilement s'en rendre matresse.
1 2
Anatomie et physiologie animales, 201. Cf. la prface de l'Intelligence des animaux, de ROMANES, P. XXIII. GUYAU, Morale anglaise, 1re d., 330.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
72
Mais alors, il n'y a aucune raison pour supposer que ce mouvement de recul, qui se poursuit d'une manire ininterrompue des espces animales infrieures aux espces les plus leves, et de celles-ci l'homme, cesse brusquement l'avnement de l'humanit. Est-ce que l'homme, du jour o il est entr dans l'histoire, tait totalement affranchi de l'instinct ? Mais nous en sentons encore le joug aujourd'hui. Est-ce que les causes qui ont dtermin cet affranchissement progressif, dont nous venons de voir la continuit, auraient soudainement perdu leur nergie ? Mais il est vident qu'elles se confondent avec les causes mmes qui dterminent le progrs gnral des espces, et, comme il ne s'arrte pas, elles ne peuvent davantage s'tre arrtes. Une telle hypothse est contraire toutes les analogies. Elle est mme contraire des faits bien tablis. Il est, en effet, dmontr que l'intelligence et l'instinct varient toujours en sens inverse l'un de l'autre. Nous n'avons pas, pour le moment, chercher d'o vient ce rapport ; nous nous contentons d'en affirmer l'existence. Or, depuis les origines, l'intelligence de l'homme n'a pas cess de se dvelopper; l'instinct a donc d suivre la marche inverse. Par consquent, quoiqu'on ne puisse pas tablir cette proposition par une observation positive des faits, on doit croire que l'hrdit a perdu du terrain au cours de l'volution humaine. Un autre fait corrobore le prcdent. Non seulement l'volution n'a pas fait surgir de races nouvelles depuis le commencement de l'histoire, mais encore les races anciennes vont toujours en rgressant. En effet, une race est forme par un certain nombre d'individus qui prsentent, par rapport un mme type hrditaire, une conformit suffisamment grande pour que les variations individuelles puissent tre ngliges. Or, l'importance de ces dernires va toujours en augmentant. Les types individuels prennent toujours plus de relief au dtriment du type gnrique dont les traits constitutifs, disperss de tous cts, confondus avec une multitude d'autres, indfiniment diversifis, ne peuvent plus tre facilement rassembls en un tout qui ait quelque unit. Cette dispersion et cet effacement ont commenc, d'ailleurs, mme chez des peuples trs peu avancs. Par suite de leur isolement, les Esquimaux semblent placs dans des conditions trs favorables au maintien de la puret de leur race. Cependant, les variations de la taille y dpassent les limites individuelles permises... Au passage d'Hotham, un Esquimau ressemblait exactement un Ngre ; au goulet de Spafarret, un Juif (Seeman). Le visage ovale, associ un nez romain, n'est pas rare (King). Leur teint est tantt trs fonc et tantt trs clair 1 . S'il en est ainsi dans des socits aussi restreintes, le mme phnomne doit se reproduire beaucoup plus accus dans nos grandes socits contemporaines. Dans l'Europe centrale, on trouve cte cte toutes les varits possibles de crnes, toutes les formes possibles de visages. Il en est de mme du teint. D'aprs les observations faites par Virchow, sur dix millions d'enfants pris dans diffrentes classes de l'Allemagne, le type blond, qui est caractristique de la race germanique, n'a t observ que de 43 33 fois pour 100 dans le Nord ; de 32 25 fois dans le Centre et de 24 18 dans le Sud 2. On s'explique que, dans ces conditions, qui vont toujours en empirant, l'anthropologiste ne puisse gure constituer de types nettement dfinis.
Les rcentes recherches de M. Galton confirment, en mme temps qu'elles permettent de l'expliquer, cet affaiblissement de l'influence hrditaire 3.
1 2 3
TOPINARD, Anthropologie, 458. WAGNER, Die Kulturzchtung des Menschen, in Kosmos, 1886; Heft, p. 27. Natural Inheritance, London, 1889.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
73
D'aprs cet auteur, dont les observations et les calculs paraissent difficilement rfutables, les seuls caractres qui se transmettent rgulirement et intgralement par l'hrdit dans un groupe social donn sont ceux dont la runion constitue le type moyen. Ainsi, un fils n de parents exceptionnellement grands n'aura pas leur taille, mais se rapprochera davantage de la mdiocrit. Inversement, s'ils sont trop petits, il sera plus grand qu'eux. M. Galton a mme pu mesurer, au moins d'une manire approche, ce rapport de dviation. Si l'on convient d'appeler parent moyen un tre composite qui reprsenterait la moyenne des deux parents rels (les caractres de la femme sont transposs de manire pouvoir tre compars ceux du pre, additionns et diviss ensemble), la dviation du fils, par rapport cet talon fixe, sera les deux tiers de celle du pre 1. M. Galton n'a pas seulement tabli cette loi pour la taille, mais aussi pour la couleur des yeux et les facults artistiques. Il est vrai qu'il n'a fait porter ses observations que sur les dviations quantitatives, et non sur les dviations qualitatives que les individus prsentent par rapport au type moyen. Mais on ne voit pas pourquoi la loi s'appliquerait aux unes et non aux autres. Si la rgle est que l'hrdit ne transmet bien les attributs constitutifs de ce type qu'au degr de dveloppement avec lequel ils s'y trouvent, elle doit aussi ne bien transmettre que les attributs qui s'y trouvent. Ce qui est vrai des grandeurs anormales des caractres normaux doit tre vrai, plus forte raison, des caractres anormaux eux-mmes. Ils doivent, en gnral, ne passer d'une gnration l'autre qu'affaiblis et tendre disparatre. Cette loi s'explique, d'ailleurs, sans peine. En effet, un enfant n'hrite pas seulement de ses parents, mais de tous ses ascendants ; sans doute, l'action des premiers est particulirement forte, parce qu'elle est immdiate, mais celle des gnrations antrieures est susceptible de s'accumuler quand elle s'exerce dans le mme sens, et, grce cette accumulation qui compense les effets de l'loignement, elle peut atteindre un degr d'nergie suffisant pour neutraliser ou attnuer la prcdente. Or, le type moyen d'un groupe naturel est celui qui correspond aux conditions de la vie moyenne, par consquent aux plus ordinaires. Il exprime la manire dont les individus se sont adapts ce qu'on peut appeler le milieu moyen, tant physique que social, c'est--dire au milieu o vit le plus grand nombre. Ces conditions moyennes taient les plus frquentes dans le pass pour la mme raison qui fait qu'elles sont les plus gnrales dans le prsent ; c'est donc celles o se trouvaient placs la majeure partie de nos ascendants. Il est vrai qu'avec le temps elles ont pu changer ; mais elles ne se modifient gnralement qu'avec lenteur. Le type moyen reste donc sensiblement le mme pendant longtemps. Par suite, c'est lui qui se rpte le plus souvent et de la manire la plus uniforme dans la srie des gnrations antrieures, du moins dans celles qui sont assez proches pour faire sentir efficacement leur action. C'est grce cette constance qu'il acquiert une fixit qui en fait le centre de gravit de l'influence hrditaire. Les caractres qui le constituent sont ceux qui ont le plus de rsistance, qui tendent se transmettre avec le plus de force et de prcision ; ceux, au contraire, qui s'en cartent ne survivent que dans un tat d'indtermination d'autant plus grande que l'cart est plus considrable. Voil pourquoi les dviations qui se produisent ne sont jamais que passagres et ne parviennent mme se maintenir pour un temps que d'une manire trs imparfaite.
1
Op. cit., 101.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
74
Toutefois, cette explication mme, d'ailleurs un peu diffrente de celle qu'a propose M. Galton lui-mme, permet de conjecturer que sa loi, pour tre parfaitement exacte, aurait besoin d'tre lgrement rectifie. En effet, le type moyen de nos ascendants ne se confond avec celui de notre gnration que dans la mesure o la vie moyenne n'a pas chang. Or, en fait, des variations se produisent d'une gnration l'autre qui entranent des changements dans la constitution du type moyen. Si les faits recueillis par M. Galton semblent nanmoins confirmer sa loi telle qu'il l'a formule, c'est qu'il ne l'a gure vrifie que pour des caractres physiques qui sont relativement immuables, comme la taille ou la couleur des yeux. Mais si l'on observait d'aprs la mme mthode d'autres proprits, soit organiques, soit psychiques, il est certain qu'on s'apercevrait des effets de l'volution. Par consquent, parler la rigueur, les caractres dont le degr de transmissibilit est maximum ne sont pas ceux dont l'ensemble constitue le type moyen d'une gnration donne, mais ceux que l'on obtiendrait en prenant la moyenne entre les types moyens des gnrations successives. Sans cette rectification, d'ailleurs, on ne saurait s'expliquer comment la moyenne du groupe peut progresser ; car si l'on prend la lettre la proposition de M. Galton, les socits seraient toujours et invinciblement ramenes au mme niveau, puisque le type moyen de deux gnrations, mme loignes l'une de l'autre, serait identique. Or, bien loin que cette identit soit la loi, on voit, au contraire, mme des caractres physiques aussi simples que la taille moyenne ou la couleur moyenne des yeux changer peu peu, quoique trs lentement 1. La vrit, c'est que, s'il se produit dans le milieu des changements qui durent, les modifications organiques et psychiques qui en rsultent finissent par se fixer et s'intgrer dans le type moyen qui volue. Les variations qui s'y produisent chemin faisant ne sauraient donc avoir le mme degr de transmissibilit que les lments qui s'y rptent constamment. Le type moyen rsulte de la superposition des types individuels et exprime ce qu'ils ont le plus en commun. Par consquent, les traits dont il est form sont d'autant plus dfinis qu'ils se rptent plus identiquement chez les diffrents membres du groupe ; car, quand cette identit est complte, ils s'y retrouvent intgralement avec tous leurs caractres et jusque dans leurs nuances. Au contraire, quand ils varient d'un individu l'autre comme les points par o ils concident sont plus rares, ce qui en subsiste dans le type moyen se rduit des linaments d'autant plus gnraux que les diffrences sont plus grandes. Or, nous savons que les dissemblances individuelles vont en se multipliant, c'est--dire que les lments constitutifs du type moyen se diversifient davantage. Ce type lui-mme doit donc comprendre moins de traits dtermins, et cela d'autant plus que la socit est plus diffrencie. L'homme moyen prend une physionomie de moins en moins nette et accuse, un aspect plus schmatique. C'est une abstraction de plus en plus difficile fixer et dlimiter. D'autre part, plus les socits appartiennent une espce leve, plus elles voluent rapidement, puisque la tradition devient plus souple, comme nous l'avons tabli. Le type moyen change donc d'une gnration l'autre. Par consquent, le type doublement compos qui rsulte de la superposition de tous ces types moyens est encore plus abstrait que chacun d'eux et le devient toujours davantage. Puisque donc c'est l'hrdit de ce type qui constitue l'hrdit normale, on voit que, selon le mot de M. Perrier, les conditions de cette dernire se modifient profondment. Sans doute, cela ne veut pas dire qu'elle transmette moins de choses d'une manire absolue ; car si les individus prsentent plus de caractres dissemblables, ils prsentent aussi plus de caractres. Mais ce qu'elle transmet consiste de plus en plus en des prdispositions
1
Voir ARRAT, Rcents travaux sur l'hrdit, in Rev. phil., avril 1890, p. 414.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
75
indtermines, en des faons gnrales de sentir et de penser qui peuvent se spcialiser de mille manires diffrentes. Ce n'est plus comme autrefois des mcanismes complets, exactement agencs en vue de fins spciales, mais des tendances trs vagues qui n'engagent pas dfinitivement l'avenir. L'hritage n'est pas devenu moins riche, mais il n'est plus tout entier en biens liquides. La plupart des valeurs dont il est compos ne sont pas encore ralises, et tout dpend de l'usage qui en sera fait. Cette flexibilit plus grande des caractres hrditaires n'est pas due seulement leur tat d'indtermination, mais l'branlement qu'ils ont reu par suite des changements par lesquels ils ont pass. On sait, en effet, qu'un type est d'autant plus instable qu'il a dj subi plus de dviations. Parfois, dit M. de Quatrefages, les moindres causes transforment rapidement ces organismes devenus pour ainsi dire instables. Le buf suisse, transport en Lombardie, devient un buf lombard en deux gnrations. Deux gnrations suffisent aussi pour que nos abeilles de Bourgogne, petites et brunes, deviennent dans la Bresse grosses et jaunes. Pour toutes ces raisons, l'hrdit laisse toujours plus de champ aux combinaisons nouvelles. Non seulement il y a un nombre croissant de choses sur lesquelles elle n'a pas prise, mais les proprits dont elle assure la continuit deviennent plus plastiques. L'individu est donc moins fortement enchan son pass ; il lui est plus facile de s'adapter aux circonstances nouvelles qui se produisent, et les progrs de la division du travail deviennent ainsi plus aiss et plus rapides 1.
Ce qu'il parat y avoir de plus solide dans les thories de Weismann pourrait servir confirmer ce qui prcde. Sans doute, il n'est pas prouv que, comme le soutient ce savant, les variations individuelles soient radicalement intransmissibles par l'hrdit. Mais il semble bien avoir fortement tabli que le type normalement transmissible est, non le type individuel, mais le type gnrique, qui a pour substrat organique, en quelque sorte, les lments reproducteurs ; et que ce type n'est pas aussi facilement atteint qu'on l'a parfois suppos parles variations individuelles (Voir WEISMANN, Essais sur l'hrdit, trad. fran, Paris, 1892, notamment le troisime Essai, - et BALL, Hrdit et exercice, trad. fran., Paris, 1891). Il en rsulte que plus ce type est indtermin et plastique plus aussi le facteur individuel gagne de terrain. A un autre point de vue encore, ces thories nous intressent. Une des conclusions de notre travail auxquelles nous attachons le plus d'importance est cette ide que les phnomnes sociaux drivent de causes sociales et non de causes psychologiques ; que le type collectif n'est pas la simple gnralisation d'un type individuel, mais qu'au contraire celui-ci est n de celui-l. Dans un autre ordre de faits, Weismann dmontre de mme que la race n'est pas un simple prolongement de l'individu ; que le type spcifique, au point de vue physiologique et anatomique, n'est pas un type individuel qui s'est perptu dans le temps, mais qu'il a son volution propre ; que le second s'est dtach du premier, loin d'en tre la source. Sa doctrine est, comme la ntre, ce qu'il nous semble, une protestation contre les thories simplistes qui rduisent le compos au simple, le tout la partie, la socit ou la race l'individu.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
76
Chapitre V
Consquences de ce qui prcde
I
Retour la table des matires
Ce qui prcde nous permet de mieux comprendre la manire dont la division du travail fonctionne dans la socit. A ce point de vue, la division du travail social se distingue de la division du travail physiologique par un caractre essentiel. Dans l'organisme, chaque cellule a son rle dfini et ne peut en changer. Dans la socit, les tches n'ont jamais t rparties d'une manire aussi immuable. L mme o les cadres de l'organisation sont les plus rigides, l'individu peut se mouvoir, l'intrieur de celui o le sort l'a fix, avec une certaine libert. Dans la Rome primitive, le plbien pouvait librement entreprendre toutes les fonctions qui n'taient pas exclusivement rserves aux patriciens ; dans l'Inde mme, les carrires attribues chaque caste avaient une suffisante gnralit pour laisser la place un certain choix. Dans tout pays, si l'ennemi s'est empar de la capitale, c'est--dire du cerveau mme de la nation, la vie sociale n'est pas suspendue pour cela ; mais, au bout d'un temps relativement court, une autre ville se trouve en tat de remplir cette fonction complexe laquelle, pourtant, rien ne l'avait prpare. A mesure que le travail se divise davantage, cette souplesse et cette libert deviennent plus grandes. On voit le mme individu s'lever des occupations les plus humbles aux plus importantes. Le principe d'aprs lequel tous les emplois sont galement accessibles tous les citoyens ne se serait pas gnralis ce point s'il ne
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
77
recevait des applications constantes. Ce qui est plus frquent encore, c'est qu'un travailleur quitte sa carrire pour la carrire voisine. Alors que l'activit scientifique n'tait pas spcialise, le savant, embrassant peu prs toute la science, ne pouvait gure changer de fonction, car il lui et fallu renoncer la science elle-mme. Aujourd'hui, il arrive souvent qu'il se consacre successivement des sciences diffrentes, qu'il passe de la chimie la biologie, de la physiologie la psychologie, de la psychologie la sociologie. Cette aptitude prendre successivement des formes trs diverses n'est nulle part aussi sensible que dans le monde conomique. Comme rien n'est plus variable que les gots et les besoins auxquels rpondent ces fonctions, il faut que le commerce et l'industrie se tiennent dans un perptuel tat d'quilibre instable, afin de pouvoir se plier tous les changements qui se produisent dans la demande. Tandis qu'autrefois l'immobilit tait l'tat presque naturel du capital, que la loi mme empchait qu'il se mobilist trop aisment, aujourd'hui on peut peine le suivre travers toutes ses transformations, tant est grande la rapidit avec laquelle il s'engage dans une entreprise, s'en retire pour se reposer ailleurs o il ne se fixe que pour quelques instants. Aussi faut-il que les travailleurs se tiennent prts le suivre et, par consquent, servir dans des emplois diffrents. La nature des causes dont dpend la division du travail social explique ce caractre. Si le rle de chaque cellule est fix d'une manire immuable, c'est qu'il lui est impos par sa naissance ; elle est emprisonne dans un systme d'habitudes hrditaires qui lui marquent sa vie et dont elle ne peut se dfaire. Elle ne peut mme les modifier sensiblement, parce qu'elles ont affect trop profondment la substance dont elle est forme. Sa structure prdtermine sa vie. Nous venons de voir qu'il n'en est pas de mme dans la socit. L'individu n'est pas vou par ses origines une carrire spciale ; sa constitution congnitale ne le prdestine pas ncessairement un rle unique en le rendant incapable de tout autre, mais il ne reoit de l'hrdit que des prdispositions trs gnrales, partant trs souples, et qui peuvent prendre des formes diffrentes. Il est vrai qu'il les dtermine lui-mme par l'usage qu'il en fait. Comme il lui faut engager ses facults dans des fonctions particulires et les spcialiser, il est oblig de soumettre une culture plus intensive celles qui sont plus immdiatement requises pour son emploi et laisser les autres s'atrophier en partie. C'est ainsi qu'il ne peut dvelopper au-del d'un certain point son cerveau sans perdre une partie de sa force musculaire ou de sa puissance reproductrice ; qu'il ne peut surexciter ses facults d'analyse et de rflexion sans affaiblir l'nergie de sa volont et la vivacit de ses sentiments, ni prendre l'habitude de l'observation sans perdre celle de la dialectique. De plus, par la force mme des choses, celle de ses facults qu'il intensifie au dtriment des autres est ncessite prendre des formes dfinies, dont elle devient peu peu prisonnire. Elle contracte l'habitude de certaines pratiques, d'un fonctionnement dtermin, qu'il devient d'autant plus difficile de changer qu'il dure depuis plus longtemps. Mais, comme cette spcialisation rsulte d'efforts purement individuels, elle n'a ni la fixit ni la rigidit que, seule, peut produire une longue hrdit. Ces pratiques sont plus souples, parce qu'elles sont d'une plus rcente origine. Comme c'est l'individu qui s'y est engag, il peut s'en dgager, se reprendre pour en contracter de nouvelles. Il peut mme rveiller des facults engourdies par un sommeil prolong, ranimer leur vitalit, les remettre au premier plan, quoique, vrai dire, cette sorte de rsurrection soit dj plus difficile. On est tent, au premier abord, de voir dans ces faits des phnomnes de rgression ou la preuve d'une certaine infriorit, tout au moins l'tat transitoire d'un
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
78
tre inachev en voie de formation. En effet, c'est surtout chez les animaux infrieurs que les diffrentes parties de l'agrgat peuvent aussi facilement changer de fonction et se substituer les unes aux autres. Au contraire, mesure que l'organisation se perfectionne, il leur devient de plus en plus impossible de sortir du rle qui leur est assign. On est ainsi conduit se demander si un jour ne viendra pas o la socit prendra une forme plus arrte, o chaque organe, chaque individu aura une fonction dfinie et n'en changera plus. C'tait, ce qu'il semble, la pense de Comte 1 ; c'est certainement celle de M. Spencer 2. L'induction, pourtant, est prcipite ; car ce phnomne de substitution n'est pas spcial aux tres trs simples, mais on l'observe galement aux degrs les plus levs de la hirarchie, et notamment dans les organes suprieurs des organismes suprieurs. Ainsi, les troubles conscutifs l'ablation de certains domaines de l'corce crbrale disparaissent trs souvent aprs un laps de temps plus ou moins long. Ce phnomne peut seulement tre expliqu par la supposition suivante : d'autres lments remplissent par supplance la fonction des lments supprims. Ce qui implique que les lments supplants sont exercs de nouvelles fonctions... Un lment qui, lors des rapports normaux de conduction, effectue une sensation visuelle, devient, grce un changement de conditions, facteur d'une sensation tactile, d'une sensation musculaire ou de l'innervation motrice. Bien plus, on est presque oblig de supposer que, si le rseau central des filets nerveux a le pouvoir de transmettre des phnomnes de diverses natures un seul et mme lment, cet lment sera en tat de runir dans son intrieur une pluralit de fonctions diffrentes 3 . C'est ainsi encore que les nerfs moteurs peuvent devenir centriptes et que les nerfs sensibles se transforment en centrifuges 4. Enfin, si une nouvelle rpartition de toutes ces fonctions peut s'effectuer quand les conditions de transmission sont modifies, il y a lieu de prsumer, d'aprs M. Wundt, que, mme l'tat normal, il se prsente des oscillations ou variations qui dpendent du dveloppement variable des individus 5 . C'est qu'en effet une spcialisation rigide n'est pas ncessairement une marque de supriorit. Bien loin qu'elle soit bonne en toutes circonstances, il y a souvent intrt ce que l'organe ne soit pas fig dans son rle. Sans doute, une fixit mme trs grande est utile l o le milieu lui-mme est fixe ; c'est le cas, par exemple, des fonctions nutritives dans l'organisme individuel. Elles ne sont pas sujettes de grands changements pour un mme type organique ; par consquent, il n'y a pas d'inconvnient, mais tout intrt, ce qu'elles prennent une forme dfinitivement arrte. Voil pourquoi le polype, dont le tissu interne et le tissu externe se remplacent l'un l'autre avec tant de facilit, est moins bien arm pour la lutte que les animaux plus levs chez qui cette substitution est toujours incomplte et presque impossible. Mais il en est tout autrement quand les circonstances dont dpend l'organe changent souvent : alors, il faut changer soi-mme ou prir. C'est ce qui arrive aux fonctions complexes et qui nous adaptent des milieux complexes. Ces derniers, en effet, cause de leur complexit mme, sont essentiellement instables : il s'y produit sans cesse quelque rupture d'quilibre, quelque nouveaut. Pour y rester adapte, il faut donc que la fonction, elle aussi, soit toujours prte changer, se plier aux situations nouvelles. Or, de tous les milieux qui existent, il n'en est pas de plus complexe que le
1 2 3 4 5
Cours de philosophie positive, VI, 505. Sociol., II, 57. WUNDT, Psychologie physiologique; trad. fran., I, 234. Voir l'exprience de Khne et de Paul Bert, rapporte par WUNDT, ibid., 233. Ibid., I, 239.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
79
milieu social ; il est donc tout naturel que la spcialisation des fonctions sociales ne soit pas dfinitive comme celle des fonctions biologiques, et, puisque cette complexit augmente mesure que le travail se divise davantage, cette lasticit devient toujours plus grande. Sans doute, elle est toujours enferme dans des limites dtermines, mais qui reculent de plus en plus. En dfinitive, ce qu'atteste cette flexibilit relative et toujours croissante, c'est que la fonction devient de plus en plus indpendante de l'organe. En effet, rien n'immobilise une fonction comme d'tre lie une structure trop dfinie ; car, de tous les arrangements, il n'en est pas de plus stable ni qui s'oppose davantage aux changements. Une structure, ce n'est pas seulement une certaine manire d'agir, c'est une manire d'tre qui ncessite une certaine manire d'agir. Elle implique non seulement une certaine faon de vibrer, particulire aux molcules, mais un arrangement de ces dernires qui rend presque impossible tout autre mode de vibrations. Si donc la fonction prend plus de souplesse, c'est qu'elle soutient un rapport moins troit avec la forme de l'organe ; c'est que le lien entre ces deux termes devient plus lche. On observe, en effet, que ce relchement se produit mesure que les socits et leurs fonctions deviennent plus complexes. Dans les socits infrieures, o les tches sont gnrales et simples, les diffrentes classes qui en sont charges se distinguent les unes des autres par des caractres morphologiques ; en d'autres termes, chaque organe se distingue des autres anatomiquement. Comme chaque caste, chaque couche de la population a sa manire de se nourrir, de se vtir, etc., et ces diffrences de rgime entranent des diffrences physiques. Les chefs fidjiens sont de grande taille, bien faits et fortement muscls ; les gens de rang infrieur offrent le spectacle d'une maigreur qui provient d'un travail crasant et d'une alimentation chtive. Aux les Sandwich, les chefs sont grands et vigoureux, et leur extrieur l'emporte tellement sur celui du bas peuple qu'on les dirait de race diffrente. Ellis, confirmant le rcit de Cook, dit que les chefs tahitiens sont, presque sans exception, aussi au-dessus du paysan par la force physique qu'ils le sont par le rang et les richesses. Erskine remarque une diffrence analogue chez les naturels des les Tonga 1. Au contraire, dans les socits suprieures, ces contrastes disparaissent. Bien des faits tendent prouver que les hommes vous aux diffrentes fonctions sociales se distinguent moins qu'autrefois les uns des autres par la forme de leur corps, par leurs traits ou leur tournure. On se pique mme de n'avoir pas l'air de son mtier. Si, suivant le vu de M. Tarde, la statistique et l'anthropomtrie s'appliquaient dterminer avec plus de prcision les caractres constitutifs des divers types professionnels, on constaterait vraisemblablement qu'ils diffrent moins que par le pass, surtout si l'on tient compte de la diffrenciation plus grande des fonctions. Un fait qui confirme cette prsomption, c'est que l'usage des costumes professionnels tombe de plus en plus en dsutude. En effet, quoique les costumes aient assurment servi rendre sensibles des diffrences fonctionnelles, on ne saurait voir dans ce rle leur unique raison d'tre, puisqu'ils disparaissent mesure que les fonctions sociales se diffrencient davantage. Ils doivent donc correspondre des dissemblances d'une autre nature. Si d'ailleurs, avant l'institution de cette pratique, les hommes des diffrentes classes n'avaient dj prsent des diffrences somatiques apparentes, on ne voit pas comment ils auraient eu l'ide de se distinguer de cette manire. Ces marques extrieures d'origine conventionnelle ont d n'tre inventes qu' l'imitation de marques extrieures d'origine naturelle. Le costume ne nous semble
1
SPENCER, Sociol., III, p. 406.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
80
pas tre autre chose que le type professionnel qui, pour se manifester mme travers les vtements, les marque de son empreinte et les diffrencie son image. C'en est comme le prolongement. C'est surtout vident pour ces distinctions qui jouent le mme rle que le costume et viennent certainement des mmes causes, comme l'habitude de porter la barbe coupe de telle ou telle manire, ou de ne pas la porter du tout, ou d'avoir les cheveux ras ou longs, etc. Ce sont des traits mmes du type professionnel qui, aprs s'tre produits et constitus spontanment, se reproduisent par voie d'imitation et artificiellement. La diversit des costumes symbolise donc avant tout des diffrences morphologiques ; par consquent, s'ils disparaissent, c'est que ces diffrences s'effacent. Si les membres des diverses professions n'prouvent plus le besoin de se distinguer les uns des autres par des signes visibles, c'est que cette distinction ne correspond plus rien dans la ralit. Pourtant, les dissemblances fonctionnelles ne font que devenir plus nombreuses et plus prononces; c'est donc que les types morphologiques se nivellent. Cela ne veut certainement pas dire que tous les cerveaux sont indiffremment aptes toutes les fonctions, mais que leur indiffrence fonctionnelle, tout en restant limite, devient plus grande. Or, cet affranchissement de la fonction, loin d'tre une marque d'infriorit, prouve seulement qu'elle devient plus complexe. Car s'il est plus difficile aux lments constitutifs des tissus de s'arranger de manire l'incarner et, par consquent, la retenir et l'emprisonner, c'est parce qu'elle est faite d'agencements trop savants et trop dlicats. On peut mme se demander si, partir d'un certain degr de complexit, elle ne leur chappe pas dfinitivement, si elle ne finit pas par dborder tellement l'organe qu'il est impossible celui-ci de la rsorber compltement. Qu'en fait elle soit indpendante de la forme du substrat, c'est une vrit depuis longtemps tablie par les naturalistes : seulement, quand elle est gnrale et simple, elle ne peut pas rester longtemps dans cet tat de libert, parce que l'organe se l'assimile facilement et, du mme coup, l'enchane. Mais il n'y a pas de raison de supposer que cette puissance d'assimilation soit indfinie. Tout fait prsumer au contraire que, partir d'un certain moment, la disproportion devient toujours plus grande entre la simplicit des arrangements molculaires et la complexit des arrangements fonctionnels. Le lien entre les seconds et les premires va donc en se dtendant. Sans doute, il ne s'ensuit pas que la fonction puisse exister en dehors de tout organe, ni mme qu'il puisse jamais y avoir absence de tout rapport entre ces deux termes ; seulement, le rapport devient moins immdiat. Le progrs aurait donc pour effet de dtacher de plus en plus, sans l'en sparer toutefois, la fonction de l'organe, la vie de la matire, de la spiritualiser par consquent, de la rendre plus souple, plus libre, en la rendant plus complexe. C'est parce que le spiritualisme a le sentiment que tel est le caractre des formes suprieures de l'existence qu'il s'est toujours refus voir dans la vie psychique une simple consquence de la constitution molculaire du cerveau. En fait, nous savons que l'indiffrence fonctionnelle des diffrentes rgions de l'encphale, si elle n'est pas absolue, est pourtant grande. Aussi les fonctions crbrales sont-elles les dernires se prendre sous une forme immuable. Elles sont plus longtemps plastiques que lors autres et gardent d'autant plus leur plasticit qu'elles sont plus complexes ; c'est ainsi que leur volution se prolonge beaucoup plus tard chez le savant que chez l'homme inculte. Si donc les fonctions sociales prsentent ce mme caractre d'une manire encore plus accuse, ce n'est pas par suite d'une exception sans prcdent, mais c'est qu'elles correspondent un stade encore plus lev du dveloppement de la nature.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
81
II
En dterminant la cause principale des progrs de la division du travail, nous avons dtermin du mme coup le facteur essentiel de ce qu'on appelle la civilisation. Elle est elle-mme une consquence ncessaire des changements qui se produisent dans le volume et dans la densit des socits. Si la science, l'art, et l'activit conomique se dveloppent, c'est par suite d'une ncessit qui s'impose aux hommes ; c'est qu'il n'y a pas pour eux d'autre manire de vivre dans les conditions nouvelles o ils sont placs. Du moment que le nombre des individus entre lesquels les relations sociales sont tablies est plus considrable, ils ne peuvent se maintenir que s'ils se spcialisent davantage, travaillent davantage, surexcitent leurs facults ; et de cette stimulation gnrale rsulte invitablement un plus haut degr de culture. De ce point de vue, la civilisation apparat donc, non comme un but qui meut les peuples par l'attrait qu'il exerce sur eux, non comme un bien entrevu et dsir par avance, dont ils cherchent s'assurer par tous les moyens la part la plus large possible, mais comme l'effet d'une cause, comme la rsultante ncessaire d'un tat donn. Ce n'est pas le ple vers lequel s'oriente le dveloppement historique et dont les hommes cherchent se rapprocher pour tre plus heureux ou meilleurs ; car ni le bonheur, ni la moralit ne s'accroissent ncessairement avec l'intensit de la vie. Ils marchent parce qu'il faut marcher, et ce qui dtermine la vitesse de cette marche, c'est la pression plus ou moins forte qu'ils exercent les uns sur les autres, suivant qu'ils sont plus ou moins nombreux. Ce n'est pas dire que la civilisation ne serve rien ; mais ce n'est pas les services qu'elle rend qui la font progresser. Elle se dveloppe parce qu'elle ne peut pas ne pas se dvelopper ; une fois qu'il est effectu, ce dveloppement se trouve tre gnralement utile ou, tout au moins, il est utilis ; il rpond des besoins qui se sont forms en mme temps, parce qu'ils dpendent des mmes causes. Mais c'est un ajustement aprs coup. Encore faut-il ajouter que les bienfaits qu'elle rend ce titre ne sont pas un enrichissement positif, un accroissement de notre capital de bonheur, mais ne font que rparer les pertes qu'elle-mme a causes. C'est parce que cette suractivit de la vie gnrale fatigue et affine notre systme nerveux qu'il se trouve avoir besoin de rparations proportionnes ses dpenses, c'est--dire de satisfactions plus varies et plus complexes. Par l, on voit mieux encore combien il est faux de faire de la civilisation la fonction de la division du travail ; elle n'en est qu'un contrecoup. Elle ne peut en expliquer ni l'existence ni les progrs, puisqu'elle n'a pas par elle-mme de valeur intrinsque et absolue, mais, au contraire, n'a de raison d'tre que dans la mesure o la division du travail elle-mme se trouve tre ncessaire. On ne s'tonnera pas de l'importance qui est ainsi attribue au facteur numrique, si l'on remarque qu'il joue un rle tout aussi capital dans l'histoire des organismes. En effet, ce qui dfinit l'tre vivant, c'est la double proprit qu'il a de se nourrir et de se reproduire, et la reproduction n'est elle-mme qu'une consquence de la nutrition. Par consquent, l'intensit de la vie organique est proportionnelle, toutes choses gales, l'activit de la nutrition, c'est--dire au nombre des lments que l'organisme est susceptible de s'incorporer. Aussi, ce qui a non seulement rendu possible, mais ncessit l'apparition d'organismes complexes, c'est que, dans de certaines conditions,
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
82
les organismes plus simples restent groups ensemble de manire former des agrgats plus volumineux. Comme les parties constitutives de l'animal sont alors plus nombreuses, leurs rapports ne sont plus les mmes, les conditions de la vie sociale sont changes, et ce sont ces changements leur tour qui dterminent et la division du travail, et le polymorphisme, et la concentration des forces vitales et leur plus grande nergie. L'accroissement de la substance organique, voil donc le fait qui domine tout le dveloppement zoologique. Il n'est pas surprenant que le dveloppement social soit soumis la mme loi. D'ailleurs, sans recourir ces raisons d'analogie, il est facile de s'expliquer le rle fondamental de ce facteur. Toute vie sociale est constitue par un systme de faits qui drivent de rapports positifs et durables, tablis entre une pluralit d'individus. Elle est donc d'autant plus intense que les ractions changes entre les units composantes sont elles-mmes plus frquentes et plus nergiques. Or, de quoi dpendent cette frquence et cette nergie ? De la nature des lments en prsence, de leur plus ou moins grande vitalit ? Mais nous verrons dans ce chapitre mme que les individus sont beaucoup plutt un produit de la vie commune qu'ils ne la dterminent. Si de chacun d'eux on retire tout ce qui est d l'action de la socit, le rsidu que l'on obtient, outre qu'il se rduit peu de chose, n'est pas susceptible de prsenter une grande varit. Sans la diversit des conditions sociales dont ils dpendent, les diffrences qui les sparent seraient inexplicables ; ce n'est donc pas dans les ingales aptitudes des hommes qu'il faut aller chercher la cause de l'ingal dveloppement des socits. Sera-ce dans l'ingale dure de ces rapports ? Mais le temps, par lui-mme, ne produit rien ; il est seulement ncessaire pour que les nergies latentes apparaissent au jour. Il ne reste donc d'autre facteur variable que le nombre des individus en rapports et leur proximit matrielle et morale, c'est--dire le volume et la densit de la socit. Plus ils sont nombreux et plus ils exercent de prs leur action les uns sur les autres, plus ils ragissent avec force et rapidit ; plus, par consquent, la vie sociale devient intense. Or, c'est cette intensification qui constitue la civilisation 1. Mais tout en tant un effet de causes ncessaires, la civilisation peut devenir une fin, un objet de dsir, en un mot un idal. En effet, il y a pour une socit, chaque moment de son histoire, une certaine intensit de la vie collective qui est normale, tant donn le nombre et la distribution des units sociales. Assurment, si tout se passe normalement, cet tat se ralisera de soi-mme ; mais prcisment on ne peut se proposer de faire en sorte que les choses se passent normalement. Si la sant est dans la nature, il en est de mme de la maladie. La sant n'est mme, dans les socits comme dans les organismes individuels, qu'un type idal qui n'est nulle part ralis tout entier. Chaque individu sain en a des traits plus ou moins nombreux ; mais nul ne
1
Nous n'avons pas rechercher ici si le fait qui dtermine les progrs de la division du travail et de la civilisation, c'est--dire l'accroissement de la masse et de la densit sociales, s'explique luimme mcaniquement ; s'il est un produit ncessaire de causes efficientes, ou bien un moyen imagin en vue d'un but dsir, d'un plus grand bien entrevu. Nous nous contentons de poser cette loi de la gravitation du monde social, sans remonter plus haut. Cependant, il ne semble pas qu'une explication tlologique s'impose ici plus qu'ailleurs. Les cloisons qui sparent les diffrentes parties de la socit s'effacent de plus en plus par la force des choses, par suite d'une sorte d'usure naturelle, dont l'effet peut d'ailleurs tre renforc par l'action de causes violentes. Les mouvements de la population deviennent ainsi plus nombreux et plus rapides, et des lignes de passage se creusent selon lesquelles ces mouvements s'effectuent : ce sont les voies de communication. Ils sont plus particulirement actifs aux points o plusieurs de ces lignes se croisent : ce sont les villes. Ainsi s'accrot la densit sociale. Quant l'accroissement de volume, il est d des causes de mme genre. Les barrires qui sparent les peuples sont analogues celles qui sparent les divers alvoles d'une mme socit et disparaissent de la mme faon.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
83
les runit tous. C'est donc une fin digne d'tre poursuivie que de chercher rapprocher autant que possible la socit de ce degr de perfection. D'autre part, la voie suivre pour atteindre ce but peut tre raccourcie. Si, au lieu de laisser les causes engendrer leurs effets au hasard et suivant les nergies qui les poussent, la rflexion intervient pour en diriger le cours, elle peut pargner aux hommes bien des essais douloureux. Le dveloppement de l'individu ne reproduit celui de l'espce que d'une manire abrge il ne repasse pas par toutes les phases qu'elle a traverses mais il en est qu'il omet et d'autres qu'il parcourt plus vite, parce que les expriences faites par la race lui permettent d'acclrer les siennes. Or, la rflexion peut produire des rsultats analogues ; car elle est galement une utilisation de l'exprience antrieure, en vue de faciliter l'exprience future. Par rflexion d'ailleurs, il ne faut pas entendre exclusivement une connaissance scientifique du but et des moyens. La sociologie, dans son tat actuel, n'est gure en tat de nous guider efficacement dans la solution de ces problmes pratiques. Mais, en dehors des reprsentations claires au milieu desquelles se meut le savant, il en est d'obscures auxquelles sont lies des tendances. Pour que le besoin stimule la volont, il n'est pas ncessaire qu'il soit clair par la science. Des ttonnements obscurs suffisent pour apprendre aux hommes qu'il leur manque quelque chose, pour veiller des aspirations et faire en mme temps sentir dans quel sens ils doivent tourner leurs efforts. Ainsi, une conception mcaniste de la socit n'exclut pas l'idal, et c'est tort qu'on lui reproche de rduire l'homme n'tre qu'un tmoin inactif de sa propre histoire. Qu'est-ce en effet qu'un idal, sinon une reprsentation anticipe d'un rsultat dsir et dont la ralisation n'est possible que grce cette anticipation mme ? De ce que tout se fait d'aprs des lois, il ne suit pas que nous n'ayons rien faire. On trouvera peut-tre mesquin un tel objectif, parce qu'il ne s'agit en somme que de nous faire vivre en tat de sant. Mais c'est oublier que, pour l'homme cultiv, la sant consiste satisfaire rgulirement les besoins les plus levs tout aussi bien que les autres, car les premiers ne sont pas moins que les seconds enracins dans sa nature. Il est vrai qu'un tel idal est prochain, que les horizons qu'il nous ouvre n'ont rien d'illimit. En aucun cas il ne saurait consister exalter sans mesure les forces de la socit, mais seulement les dvelopper dans la limite marque par l'tat dfini du milieu social. Tout excs est un mal comme toute insuffisance. Mais quel autre idal peut-on se proposer ? Chercher raliser une civilisation suprieure celle que rclame la nature des conditions ambiantes, c'est vouloir dchaner la maladie dans la socit mme dont on fait partie ; car il n'est pas possible de surexciter l'activit collective au-del du degr dtermin par l'tat de l'organisme social, sans en compromettre la sant. En fait, il y a chaque poque un certain raffinement de civilisation dont le caractre maladif est attest par l'inquitude et le malaise qui l'accompagnent toujours. Or, la maladie n'a jamais rien de dsirable. Mais, si l'idal est toujours dfini, il n'est jamais dfinitif. Puisque le progrs est une consquence des changements qui se font dans le milieu social, il n'y a aucune raison de supposer qu'il doive jamais finir. Pour qu'il pt avoir un terme, il faudrait que, un moment donn, le milieu devnt stationnaire. Or, une telle hypothse est contraire aux inductions les plus lgitimes. Tant qu'il y aura des socits distinctes, le nombre des units sociales sera ncessairement variable dans chacune d'elles. A supposer mme que le chiffre des naissances parvienne jamais se maintenir un niveau constant, il y aura toujours d'un pays l'autre des mouvements de population, soit par suite de conqutes violentes, soit par suite d'infiltrations lentes et silencieuses. En effet, il est impossible que les peuples les plus forts ne tendent pas s'incorporer
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
84
les plus faibles, comme les plus denses se dversent chez les moins denses ; c'est une loi mcanique de l'quilibre social non moins ncessaire que celle qui rgit l'quilibre des liquides. Pour qu'il en ft autrement, il faudrait que toutes les socits humaines eussent la mme nergie vitale et la mme densit, ce qui est irreprsentable, ne serait-ce que par suite de la diversit des habitats. Il est vrai que cette source de variations serait tarie si l'humanit tout entire formait une seule et mme socit. Mais outre que nous ignorons si un tel idal est ralisable, pour que le progrs s'arrtt, il faudrait encore qu' l'intrieur de cette socit gigantesque les rapports entre les units sociales fussent eux-mmes soustraits tout changement. Il faudrait qu'ils restassent toujours distribus de la mme manire ; que non seulement l'agrgat total, mais encore chacun des agrgats lmentaires dont il serait form conservt les mmes dimensions. Mais une telle uniformit est impossible, par cela seul que ces groupes partiels n'ont pas tous la mme tendue ni la mme vitalit. La population ne peut pas tre concentre sur tous les points de la mme manire ; or, il est invitable que les plus grands centres, ceux o la vie est le plus intense, exercent sur les autres une attraction proportionne leur importance. Les migrations qui se produisent ainsi ont pour effet de concentrer davantage les units sociales dans certaines rgions, et, par consquent, d'y dterminer des progrs nouveaux qui s'irradient peu peu des foyers o ils sont ns sur le reste du pays. D'autre part, ces changements en entranent d'autres dans les voies de communication, qui en provoquent d'autres leur tour, sans qu'il soit possible de dire o s'arrtent ces rpercussions. En fait, bien loin que les socits, mesure qu'elles se dveloppent, se rapprochent d'un tat stationnaire, elles deviennent au contraire plus mobiles et plus plastiques. Si, nanmoins, M. Spencer a pu admettre que l'volution sociale a une limite qui ne saurait tre dpasse 1, c'est que, suivant lui, le progrs n'a d'autre raison d'tre que d'adapter l'individu au milieu cosmique qui l'entoure. Pour ce philosophe la perfection consiste dans l'accroissement de la vie individuelle c'est--dire dans une correspondance plus complte de l'organisme avec ses conditions physiques. Quant la socit, c'est un des moyens par lesquels s'tablit cette correspondance plutt que le terme d'une correspondance spciale. Parce que l'individu n'est pas seul au monde, mais qu'il est environn de rivaux qui lui disputent ses moyens d'existence, il a tout intrt tablir entre ses semblables et lui des relations telles qu'ils le servent, au lieu de le gner ; ainsi nat la socit, et tout le progrs social consiste amliorer ces rapports, de manire leur faire produire plus compltement l'effet en vue duquel ils sont tablis. Ainsi, malgr les analogies biologiques sur lesquelles il a si longuement insist, M. Spencer ne voit pas dans les socits une ralit proprement dite, qui existe par soi-mme et en vertu de causes spcifiques et ncessaires, qui, par consquent, s'impose l'homme avec sa nature propre et laquelle il est tenu de s'adapter pour vivre, tout aussi bien qu'au milieu physique ; mais c'est un arrangement institu par les individus afin d'tendre la vie individuelle en longueur et en largeur 2. Elle consiste tout entire dans la coopration soit positive, soit ngative, et l'une et l'autre n'ont d'autre objet que d'adapter l'individu son milieu physique. Sans doute, elle est bien en ce sens une condition secondaire de cette adaptation : elle peut, suivant la manire dont elle est organise, rapprocher l'homme ou l'loigner de l'tat d'quilibre parfait, mais elle n'est pas elle-mme un facteur qui contribue dterminer la nature de cet quilibre. D'autre part, comme le milieu cosmique est dou d'une
1 2
Premiers principes, p. 454 et suiv. Bases de la morale volutionniste, p. 11.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
85
constance relative, que les changements y sont infiniment longs et rares, le dveloppement qui a pour objet de nous mettre en harmonie avec lui est ncessairement limit. Il est invitable qu'un moment arrive o il n'y ait plus de relations externes auxquelles ne correspondent des relations internes. Alors le progrs social ne pourra manquer de s'arrter, puisqu'il sera arriv au but o il tendait et qui en tait la raison d'tre : il sera achev. Mais, dans ces conditions, le progrs mme de l'individu devient inexplicable. En effet, pourquoi viserait-il cette correspondance plus parfaite avec le milieu physique ? Pour tre plus heureux ? Nous nous sommes dj expliqu sur ce point. On ne peut mme pas dire d'une correspondance qu'elle est plus complte qu'une autre, par cela seul qu'elle est plus complexe. En effet, on dit d'un organisme qu'il est en quilibre quand il rpond d'une manire approprie, non pas toutes les forces externes, mais seulement celles qui font impression sur lui. S'il en est qui ne l'affectent pas, elles sont pour lui comme si elles n'taient pas et, par suite, il n'a pas s'y adapter. Quelle que soit leur proximit matrielle, elles sont en dehors de son cercle d'adaptation, parce qu'il est en dehors de leur sphre d'action. Si donc le sujet est d'une constitution simple, homogne, il n'y aura qu'un petit nombre de circonstances externes qui soient de nature le solliciter, et, par consquent, il pourra se mettre en mesure de rpondre toutes ces sollicitations, c'est--dire raliser un tat d'quilibre irrprochable, trs peu de frais. Si, au contraire, il est trs complexe, les conditions de l'adaptation seront plus nombreuses et plus compliques, mais l'adaptation elle-mme ne sera pas plus entire pour cela. Parce que beaucoup d'excitants agissent sur nous qui laissaient insensible le systme nerveux trop grossier des hommes d'autrefois, nous sommes tenus, pour nous y ajuster, un dveloppement plus considrable. Mais le produit de ce dveloppement, savoir l'ajustement qui en rsulte, n'est pas plus parfait dans un cas que dans l'autre ; il est seulement diffrent parce que les organismes qui s'ajustent sont eux-mmes diffrents. Le sauvage dont l'piderme ne sent pas fortement les variations de la temprature, y est aussi bien adapt que le civilis qui s'en dfend l'aide de ses vtements. Si donc l'homme ne dpend pas d'un milieu variable, on ne voit pas quelle raison il aurait eue de varier; aussi la socit est-elle, non pas la condition secondaire, mais le facteur dterminant du progrs. Elle est une ralit qui n'est pas plus notre oeuvre que le monde extrieur et laquelle, par consquent, nous devons nous plier pour pouvoir vivre ; et c'est parce qu'elle change que nous devons changer. Pour que le progrs s'arrtt il faudrait donc qu' un moment le milieu social parvnt un tat stationnaire, et nous venons d'tablir qu'une telle hypothse est contraire toutes les prsomptions de la science. Ainsi, non seulement une thorie mcaniste du progrs ne nous prive pas d'idal, mais elle nous permet de croire que nous n'en manquerons jamais. Prcisment parce que l'idal dpend du milieu social qui est essentiellement mobile, il se dplace sains cesse. Il n'y a donc pas lieu de craindre que jamais le terrain ne nous manque, que notre activit arrive au terme de sa carrire et voie l'horizon se fermer devant elle. Mais, quoique nous ne poursuivions jamais que des fins dfinies et limites, il y a et il y aura toujours, entre les points extrmes o nous parvenons et le but o nous tendons, un espace vide ouvert nos efforts.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
86
III
En mme temps que les socits, les individus se transforment par suite des changements qui se produisent dans le nombre des units sociales et leurs rapports. Tout d'abord, ils s'affranchissent de plus en plus du joug de l'organisme. L'animal est plac presque exclusivement sous la dpendance du milieu physique ; sa constitution biologique prdtermine son existence. L'homme, au contraire, dpend de causes sociales. Sans doute, l'animal forme aussi des socits ; mais, comme elles sont trs restreintes, la vie collective y est trs simple ; elle y est en mme temps stationnaire parce que l'quilibre de si petites socits est ncessairement stable. Pour ces deux raisons, elle se fixe facilement dans l'organisme, elle .n'y a pas seulement ses racines, elle s'y incarne tout entire au point de perdre ses caractres propres. Elle fonctionne grce un systme d'instincts, de rflexes qui ne sont pas essentiellement distincts de ceux qui assurent le fonctionnement de la vie organique. Ils prsentent, il est vrai, cette particularit qu'ils adaptent l'individu au milieu social et non au milieu physique, qu'ils ont pour causes des vnements de la vie commune ; cependant, ils ne sont pas d'une autre nature que ceux qui dterminent dans certains cas, sans ducation pralable, les mouvements ncessaires au vol et la marche. Il en est tout autrement chez l'homme, parce que les socits qu'ils forment sont beaucoup plus vastes ; mme les plus petites que l'on connaisse dpassent en tendue la plupart des socits animales. tant plus complexes, elles sont aussi plus changeantes, et ces deux causes runies font que la vie sociale dans l'humanit ne se fige pas sous une forme biologique. L mme o elle est le plus simple, elle garde sa spcificit. Il y a toujours des croyances et des pratiques qui sont communes aux hommes sans tre inscrites dans leurs tissus. Mais ce caractre s'accuse davantage mesure que la matire et que la densit sociales s'accroissent. Plus il y a d'associs et plus ils ragissent les uns sur les autres, plus aussi le produit de ces ractions dborde l'organisme. L'homme se trouve ainsi plac sous l'empire de causes sui generis dont la part relative dans la constitution de la nature humaine devient toujours plus considrable. Il y a plus : l'influence de ce facteur n'augmente pas seulement en valeur relative, mais en valeur absolue. La mme cause qui accrot l'importance du milieu collectif branle le milieu organique, de manire le rendre plus accessible l'action des causes sociales et l'y subordonner. Parce qu'il y a plus d'individus qui vivent ensemble, la vie commune est plus riche et plus varie ; mais, pour que cette varit soit possible, il faut que le type organique soit moins dfini, afin de pouvoir se diversifier. Nous avons vu, en effet, que les tendances et les aptitudes transmises par l'hrdit devenaient toujours plus gnrales et plus indtermines, plus rfractaires, par consquent, se prendre sous forme d'instincts. Il se produit ainsi un phnomne qui est exactement l'inverse de celui que l'on observe aux dbuts de l'volution. Chez les animaux, c'est l'organisme qui s'assimile les faits sociaux et, les dpouillant de leur nature spciale, les transforme en faits biologiques. La vie sociale se matrialise. Dans l'humanit, au contraire, et surtout dans les socits suprieures, ce sont les causes sociales qui se substituent aux causes organiques. C'est l'organisme qui se spiritualise. Par suite de ce changement de dpendance, l'individu se transforme. Comme cette activit qui surexcite l'action spciale des causes sociales ne peut pas se fixer dans
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
87
l'organisme, une vie nouvelle, sui generis elle aussi, se surajoute celle du corps. Plus libre, plus complexe, plus indpendante des organes qui la supportent, les caractres qui la distinguent s'accusent toujours davantage, mesure qu'elle progresse et se consolide. On reconnat cette description les traits essentiels de la vie psychique. Sans doute, il serait exagr de dire que la vie psychique ne commence qu'avec les socits ; mais il est certain qu'elle ne prend de l'extension que quand les socits se dveloppent. Voil pourquoi, comme on l'a souvent remarqu, les progrs de la conscience sont en raison inverse de ceux de l'instinct. Quoi qu'on en ait dit, ce n'est pas la premire qui dissout le second ; l'instinct, produit d'expriences accumules pendant des gnrations, a une trop grande force de rsistance pour s'vanouir par cela seul qu'il devient conscient. La vrit, c'est que la conscience n'envahit que les terrains que l'instinct a cess d'occuper ou bien ceux o il ne peut pas s'tablir. Ce n'est pas elle qui le fait reculer ; elle ne fait que remplir l'espace qu'il laisse libre. D'autre part, s'il rgresse au lieu de s'tendre mesure que s'tend la vie gnrale, la cause en est dans l'importance plus grande du facteur social. Ainsi, la grande diffrence qui spare l'homme de l'animal, savoir le plus grand dveloppement de sa vie psychique, se ramne celle-ci : sa plus grande sociabilit. Pour comprendre pourquoi les fonctions psychiques ont t portes, ds les premiers pas de l'espce humaine, un degr de perfectionnement inconnu des espces animales, il faudrait d'abord savoir comment il se fait que les hommes, au lieu de vivre solitairement ou en petites bandes, se sont mis former des socits plus tendues. Si pour reprendre la dfinition classique, l'homme est un animal raisonnable, c'est qu'il est un animal sociable, ou du moins infiniment plus sociable que les autres animaux 1. Ce n'est pas tout. Tant que les socits n'atteignent 'pas certaines dimensions ni un certain degr de concentration, la seule vie psychique qui soit vraiment dveloppe est celle qui est commune tous les membres du groupe, qui se retrouve identique chez chacun. Mais, mesure que les socits deviennent plus vastes et surtout plus condenses, une vie psychique d'un genre nouveau apparat. Les diversits individuelles, d'abord perdues et confondues dans la masse des similitudes sociales, s'en dgagent, prennent du relief et se multiplient. Une multitude de choses qui restaient en dehors des consciences parce qu'elles n'affectaient pas l'tre collectif, deviennent objets de reprsentations. Tandis que les individus n'agissaient qu'entrans les uns par les autres, sauf les cas o leur conduite tait dtermine par des besoins physiques, chacun d'eux devient une source d'activit spontane. Les personnalits particulires se constituent, prennent conscience d'elles-mmes, et cependant cet accroissement de la vie psychique de l'individu n'affaiblit pas celle de la socit, mais ne fait que la transformer. Elle devient plus libre, plus tendue, et comme, en dfinitive, elle n'a pas d'autres substrats que les consciences individuelles, celles-ci s'tendent, se compliquent et s'assouplissent par contrecoup. Ainsi, la cause qui a suscit les diffrences qui sparent l'homme des animaux est aussi celle qui l'a contraint s'lever au-dessus de lui-mme. La distance toujours plus grande qu'il y a entre le sauvage et le civilis ne vient pas d'une autre source. Si de la sensibilit confuse de l'origine la facult d'idation s'est peu peu dgage, si l'homme a appris former des concepts et formuler des lois, son esprit a embrass des portions de plus en plus tendues de l'espace et du temps, si, non content de retenir le pass, il a de plus en plus empit sur l'avenir, si ses motions et
1
La dfinition de M. de Quatrefages qui fait de l'homme un animal religieux est un cas particulier de la prcdente ; car la religiosit de l'homme est une consquence de son minente sociabilit.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
88
ses tendances, d'abord simples et peu nombreuses, se sont multiplies et diversifies, c'est parce que le milieu social a chang sans interruption. En effet, moins que ces transformations ne soient nes de rien, elles ne peuvent avoir eu pour causes que des transformations correspondantes des milieux ambiants. Or, l'homme ne dpend que de trois sortes de milieux : l'organisme, le monde extrieur, la socit. Si l'on fait abstraction des variations accidentelles dues aux combinaisons de l'hrdit, - et leur rle dans le progrs humain n'est certainement pas trs considrable, - l'organisme ne se modifie pas spontanment; il faut qu'il y soit lui-mme contraint par quelque cause externe. Quant au monde physique, depuis les commencements de l'histoire il reste sensiblement le mme, si du moins on ne tient pas compte des nouveauts qui sont d'origine sociale 1. Par consquent, il n'y a que la socit qui ait assez chang pour pouvoir expliquer les changements parallles de la nature individuelle. Il n'y a donc pas de tmrit affirmer ds maintenant que, quelques progrs que fasse la psycho-physiologie, elle ne pourra jamais reprsenter qu'une fraction de la psychologie, puisque la majeure partie des phnomnes psychiques ne drivent pas de causes organiques. C'est ce qu'ont compris les philosophes spiritualistes, et le grand service qu'ils ont rendu la science a t de combattre toutes les doctrines qui rduisent la vie psychique n'tre qu'une efflorescence de la vie physique. Ils avaient le trs juste sentiment que la premire, dans ses manifestations les plus hautes, est beaucoup trop libre et trop complexe pour n'tre qu'un prolongement de la seconde. Seulement, de ce qu'elle est en partie indpendante de l'organisme, il ne s'ensuit pas qu'elle ne dpende d'aucune cause naturelle et qu'il faille la mettre en dehors de la nature. Mais tous ces faits dont on ne peut trouver l'explication dans la constitution des tissus drivent des proprits du milieu social ; c'est du moins une hypothse qui tire de ce qui prcde une trs grande vraisemblance. Or, le rgne social n'est pas moins naturel que le rgne organique. Par consquent, de ce qu'il y a une vaste rgion de la conscience dont la gense est inintelligible par la seule psycho-physiologie, on ne doit pas conclure qu'elle s'est forme toute seule et qu'elle est, par suite, rfractaire l'investigation scientifique, mais seulement qu'elle relve d'une autre science positive qu'on pourrait appeler la socio-psychologie. Les phnomnes qui en constitueraient la matire sont, en effet, de nature mixte ; ils ont les mmes caractres essentiels que les autres faits psychiques, mais ils proviennent de causes sociales. Il ne faut donc pas, avec M. Spencer, prsenter la vie sociale comme une simple rsultante des natures individuelles, puisque, au contraire, c'est plutt celles-ci qui rsultent de celle-l. Les faits sociaux ne sont pas le simple dveloppement des faits psychiques, mais les seconds ne sont en grande partie que le prolongement des premiers l'intrieur des consciences. Cette proposition est fort importante, car le point de vue contraire expose chaque instant le sociologue prendre la cause pour l'effet, et rciproquement. Par exemple, si, comme il est arriv souvent, on voit dans l'organisation de la famille l'expression logiquement ncessaire de sentiments humains inhrents toute conscience, on renverse l'ordre rel des faits ; tout au contraire, c'est l'organisation sociale des rapports de parent qui a dtermin les sentiments respectifs des parents et des enfants. Ceux-ci eussent t tout autres si la structure sociale avait t diffrente, et la preuve, c'est qu'en effet l'amour paternel est inconnu dans une multitude de socits 2. On pourrait citer bien d'autres exemples de
1 2
Transformations du sol, des cours d'eau, par l'art des agriculteurs, des ingnieurs, etc. C'est le cas des socits o rgne la famille maternelle.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
89
la mme erreur 1. Sans doute, c'est une vrit vidente qu'il n'y a rien dans la vie sociale qui ne soit dans les consciences individuelles ; seulement, presque tout ce qui se trouve dans ces dernires vient de la socit. La majeure partie de nos tats de conscience ne se seraient pas produits chez des tres isols et se seraient produits tout autrement chez des tres groups d'une autre manire. Ils drivent donc, non de la nature psychologique de l'homme en gnral, mais de la faon dont les hommes une fois associs s'affectent mutuellement, suivant qu'ils sont plus ou moins nombreux, plus ou moins rapprochs. Produits de la vie en groupe, c'est la nature du groupe qui seule les peut expliquer. Bien entendu, ils ne seraient pas possibles si les constitutions individuelles ne s'y prtaient ; mais celles-ci en sont seulement les conditions lointaines, non les causes dterminantes. M. Spencer compare quelque part 2 l'uvre du sociologue au calcul du mathmaticien qui, de la forme d'un certain nombre de boulets, dduit la manire dont ils doivent tre combins pour se tenir en quilibre. La comparaison est inexacte et ne s'applique pas aux faits sociaux. Ici, c'est bien plutt la forme du tout qui dtermine celle des parties. La socit ne trouve pas toutes faites dans les consciences les bases sur lesquelles elle repose ; elle se les fait elle-mme 3.
2 3
Pour n'en citer qu'un exemple, c'est le cas de la religion que l'on a explique par des mouvements de la sensibilit individuelle, alors que ces mouvements ne sont que le prolongement chez l'individu des tats sociaux qui donne naissance aux religions. Nous avons donn quelques dveloppements sur ce point dans un article de la Revue philosophique, tudes de science sociale, juin 1886. Cf. Anne sociologique, t. II, pp. 1-28. Introduction la science sociale, chap. 1er. En voil assez, pensons-nous, pour rpondre ceux qui croient prouver que tout est individuel dans la vie sociale, parce que la socit n'est faite que d'individus. Sans doute, elle n'a pas d'autre substrat ; mais parce que les individus forment une socit, des phnomnes nouveaux se produisent qui ont pour cause l'association, et qui, ragissant sur les consciences individuelles, les forment en grande partie. Voil pourquoi, quoique la socit ne soit rien sans les individus, chacun d'eux est beaucoup plus un produit de la socit qu'il n'en est l'auteur.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
90
LIVRE III
LES FORMES ANORMALES
Retour la table des matires
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
91
Chapitre I
La division du travail anomique
Retour la table des matires
Jusqu'ici, nous n'avons tudi la division du travail que comme un phnomne normal; mais, comme tous les faits sociaux et, plus gnralement, comme tous les faits biologiques, elle prsente des formes pathologiques qu'il est ncessaire d'analyser. Si, normalement, la division du travail produit la solidarit sociale, il arrive cependant qu'elle a des rsultats tout diffrents ou mme opposs. Or, il importe de rechercher ce qui la fait ainsi dvier de sa direction naturelle ; car, tant qu'il n'est pas tabli que ces cas sont exceptionnels, la division du travail pourrait tre souponne de les impliquer logiquement. D'ailleurs, l'tude des formes dvies nous permettra de mieux dterminer les conditions d'existence de l'tat normal. Quand nous connatrons les circonstances dans lesquelles la division du travail cesse d'engendrer la solidarit, nous saurons mieux ce qui est ncessaire pour qu'elle ait tout son effet. La pathologie, ici comme ailleurs, est un prcieux auxiliaire de la physiologie. On pourrait tre tent de ranger parmi les formes irrgulires de la division du travail la profession du criminel et les autres professions nuisibles. Elles sont la ngation mme de la solidarit et pourtant elles sont constitues par autant d'activits spciales. Mais, parler exactement, il n'y a pas ici division du travail, mais diffrenciation pure et simple, et les deux termes demandent n'tre pas confondus. C'est ainsi que le cancer, les tubercules accroissent la diversit des tissus organiques sans qu'il soit possible d'y voir une spcialisation nouvelle des fonctions biologiques 1. Dans tous ces cas, il n'y a pas partage d'une fonction commune, mais au sein de l'organisme, soit individuel, soit social, il s'en forme un autre qui cherche vivre aux dpens du premier. Il n'y a mme pas de fonction du tout ; car une manire
1
C'est une distinction que ne fait pas M. Spencer. Il semble que pour lui les deux termes soient synonymes. Cependant la diffrenciation qui dsintgre (cancer, microbe, criminel) est bien diffrente de celle qui concentre les forces vitales (division du travail).
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
92
d'agir ne mrite ce nom que si elle concourt avec d'autres l'entretien de la vie gnrale. Cette question ne rentre donc pas dans le cadre de notre recherche. Nous ramnerons trois types les formes exceptionnelles du phnomne que nous tudions. Ce n'est pas qu'il ne puisse y en avoir d'autres ; mais celles dont nous allons parler sont les plus gnrales et les plus graves.
Un premier cas de ce genre nous est fourni par les crises industrielles ou commerciales, par les faillites qui sont autant de ruptures partielles de la solidarit organique ; elles tmoignent en effet que, sur certains points de l'organisme, certaines fonctions sociales ne sont pas ajustes les unes aux autres. Or, mesure que le travail se divise davantage, ces phnomnes semblent devenir plus frquents, au moins dans certains cas. De 1845 1869 1, les faillites ont augment de 70 %. Cependant, on ne saurait attribuer ce fait l'accroissement de la vie conomique, car les entreprises se sont beaucoup plutt concentres qu'elle ne se sont multiplies. L'antagonisme du travail et du capital est un autre exemple, plus frappant, du mme phnomne. A mesure que les fonctions industrielles se spcialisent davantage, la lutte devient plus vive, bien loin que la solidarit augmente. Au Moyen ge, l'ouvrier vit partout ct de son matre, partageant ses travaux dans la mme boutique, sur le mme tabli 2 . Tous, deux faisaient partie de la mme corporation et menaient la mme existence. L'un et l'autre taient presque gaux ; quiconque avait fait son apprentissage pouvait, du moins dans beaucoup de mtiers, s'tablir s'il avait de quoi 3. Aussi les conflits taient-ils tout fait exceptionnels. A partir du XVe sicle, les choses commencrent changer. Le corps de mtier n'est plus un asile commun ; c'est la possession exclusive des matres qui y dcident seuls de toutes choses... Ds lors, une dmarcation profonde s'tablit entre les matres et les compagnons. Ceux-ci formrent, pour ainsi dire, un ordre part ; ils eurent leurs habitudes, leurs rgles, leurs associations indpendantes 4. Une fois que cette sparation fut effectue, les querelles devinrent nombreuses. Ds que les compagnons croyaient avoir se plaindre, ils se mettaient en grve ou frappaient d'interdit une ville, un patron, et tous taient tenus d'obir au mot d'ordre... La puissance de l'association donnait aux ouvriers le moyen de lutter armes gales contre leurs patrons 5. Cependant les choses taient loin d'en tre venues ds lors au point o nous les voyons prsent. Les compagnons se rebellaient pour obtenir un salaire plus fort ou tel autre changement dans la condition du travail, mais ils ne tenaient pas le patron pour un ennemi perptuel auquel on obit par contrainte. On voulait le faire cder sur un point, et on s'y employait avec nergie, mais la lutte n'tait pas ternelle ; les ateliers ne contenaient pas deux races ennemies : nos doctrines socialistes taient
1 2 3 4 5
Voir BLOCK, Statistique de la France. LEVASSEUR, Les classes ouvrires en France jusqu' la Rvolution, 311, 315. Ibid., I, 496. Ibid. Ibid., I, 504.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
93
inconnues 1 . Enfin, au XVIIe sicle commence la troisime phase de cette histoire des classes ouvrires : l'avnement de la grande industrie. L'ouvrier se spare plus compltement du patron. Il est en quelque sorte enrgiment. Chacun a sa fonction, et le systme de la division du travail fait quelques progrs. Dans la manufacture des Van-Robais, qui occupait 1692 ouvriers, il y avait des ateliers particuliers pour la charronnerie, pour la coutellerie, pour le lavage, pour la teinture, pour l'ourdissage, et les ateliers du tissage comprenaient eux-mmes plusieurs espces d'ouvriers dont le travail tait entirement distinct 2. En mme temps que la spcialisation devient plus grande, les rvoltes deviennent plus frquentes. La moindre cause de mcontentement suffisait pour jeter l'interdit sur une maison, et malheur au compagnon qui n'aurait pas respect l'arrt de la communaut 3. On sait assez que, depuis, la guerre est toujours devenue plus violente. Nous verrons, il est vrai, dans le chapitre suivant que cette tension des rapports sociaux est due en partie ce que les classes ouvrires ne veulent pas vraiment la condition qui leur est faite, mais ne l'acceptent trop souvent que contraintes et forces, n'ayant pas les moyens d'en conqurir d'autres. Cependant, cette contrainte ne saurait elle seule rendre compte du phnomne. En effet, elle ne pse pas moins lourdement sur tous les dshrits de la fortune d'une manire gnrale, et pourtant cet tat d'hostilit permanente est tout fait particulier au monde industriel. Ensuite, l'intrieur de ce monde, elle est la mme pour tous les travailleurs indistinctement. Or, la petite industrie, o le travail est moins divis, donne le spectacle d'une harmonie relative entre le patron et l'ouvrier 4 ; c'est seulement dans la grande industrie que ces dchirements sont l'tat aigu. C'est donc qu'ils dpendent en partie d'une autre cause. On a souvent signal dans l'histoire des sciences une autre illustration du mme phnomne. Jusqu' des temps assez rcents, la science, n'tant pas trs divise, pouvait tre cultive presque tout entire par un seul et mme esprit. Aussi avait-on un sentiment trs vif de son unit. Les vrits particulires qui la composaient n'taient ni si nombreuses, ni si htrognes qu'on ne vt facilement le lien qui les unissait en un seul et mme systme. Les mthodes, tant elles-mmes trs gnrales, diffraient peu les unes des autres, et l'on pouvait apercevoir le tronc commun partir duquel elles divergeaient insensiblement. Mais, mesure que la spcialisation s'est introduite dans le travail scientifique, chaque savant s'est de plus en plus renferm, non seulement dans une science particulire, mais dans un ordre spcial de problmes. Dj A. Comte se plaignait que, de son temps, il y et dans le monde savant bien peu d'intelligences embrassant dans leurs conceptions l'ensemble mme d'une science unique, qui n'est cependant son tour qu'une partie d'un grand tout. La plupart, disait-il, se bornent dj entirement la considration isole d'une section plus ou moins tendue d'une science dtermine, sans s'occuper beaucoup de la relation de ces travaux particuliers avec le systme gnral des connaissances positives 5 . Mais alors la science, morcele en une multitude d'tudes de dtail qui ne se rejoignent pas, ne forme plus un tout solidaire. Ce qui manifeste le mieux peuttre cette absence de concert et d'unit, c'est cette thorie, si rpandue, que chaque
1 2 3 4 5
Hubert VALLEROUX, Les corporations d'arts et de mtiers, p. 49. LEVASSEUR, II, 315. Ibid., 319. Voir CAUWS, Prcis d'conomie politique, II, 39. Cours de philosophie positive, I, 27.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
94
science particulire a une valeur absolue, et que le savant doit se livrer ses recherches spciales sans se proccuper de savoir si elles servent quelque chose et tendent quelque part, Cette division du travail intellectuel, dit M. Schffle, donne de srieuses raisons de craindre que ce retour d'un nouvel Alexandrinisme n'amne une nouvelle fois sa suite la ruine de toute science 1.
II
Ce qui fait la gravit de ces faits, c'est qu'on y a vu quelquefois un effet ncessaire de la division du travail, ds qu'elle a dpass un certain degr de dveloppement. Dans ce cas, dit-on, l'individu, courb sur sa tche, s'isole dans son activit spciale ; il ne sent plus les collaborateurs qui travaillent ct de lui la mme uvre que lui, il n'a mme plus du tout l'ide de cette oeuvre commune. La division du travail ne saurait donc tre pousse trop loin sans devenir une source de dsintgration. Toute dcomposition quelconque, dit Auguste Comte, devant ncessairement tendre dterminer une dispersion correspondante, la rpartition fondamentale des travaux humains ne saurait viter de susciter un degr proportionnel les divergences individuelles, la fois intellectuelles et morales, dont l'influence combine doit exiger dans la mme mesure une discipline permanente, propre prvenir ou contenir sans cesse leur essor discordant. Si d'une part, en effet, la sparation des fonctions sociales permet l'esprit de dtail un heureux dveloppement, impossible de tout autre manire, elle tend spontanment, d'une autre part, touffer l'esprit d'ensemble ou, du moins, l'entraver profondment. Pareillement, sous le point de vue moral, en mme temps que chacun est ainsi plac sous une troite dpendance envers la masse, il en est naturellement dtourn par le propre essor de son activit spciale qui le rappelle constamment son intrt priv dont il n'aperoit que trs vaguement la vraie relation avec l'intrt publie... C'est ainsi que le mme principe qui a seul permis le dveloppement et l'extension de la socit gnrale menace, sous un autre aspect, de la dcomposer en une multitude de corporations incohrentes qui semblent presque ne point appartenir la mme espce 2. M. Espinas s'exprime peu prs dans les mmes termes : Division, dit-il, c'est dispersion 3. La division du travail exercerait donc, en vertu de sa nature mme, une influence dissolvante qui serait surtout sensible l o les fonctions sont trs spcialises. Comte, cependant, ne conclut pas de son principe qu'il faille ramener les socits ce qu'il appelle lui-mme l'ge de la gnralit, c'est--dire cet tat d'indistinction et d'homognit qui fut leur point de dpart. La diversit des fonctions est utile et ncessaire ; mais, comme l'unit, qui n'est pas moins indispensable, n'en sort pas spontanment, le soin de la raliser et de la maintenir devra constituer dans l'organisme social une fonction spciale, reprsente par un organe indpendant. Cet organe, c'est l'tat ou le gouvernement. La destination sociale du gouvernement, dit Comte, me parat surtout consister contenir suffisamment et prvenir autant que possible cette fatale disposition la dispersion fondamentale des ides, des sentiments
1 2 3
Bau und Leben des socialen Krpers, IV, 112. Cours, IV, 429. Socits animales, conclusion, IV.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
95
et des intrts, rsultat invitable du principe mme du dveloppement humain, et qui, si elle pouvait suivre sans obstacle son cours naturel, finirait invitablement par arrter la progression sociale sous tous les rapports importants. Cette conception constitue mes yeux la premire base positive et rationnelle de la thorie lmentaire et abstraite du gouvernement proprement dit, envisag dans sa plus noble et plus entire extension scientifique, c'est--dire comme caractris en gnral par l'universelle raction ncessaire, d'abord spontane et ensuite rgularise, de l'ensemble sur les parties. Il est clair, en effet, que le seul moyen rel d'empcher une telle dispersion consiste riger cette indispensable raction en une nouvelle fonction spciale, susceptible d'intervenir convenablement dans l'accomplissement habituel de toutes les diverses fonctions de l'conomie sociale, pour y rappeler sans cesse la pense de l'ensemble et le sentiment de la solidarit commune 1. Ce que le gouvernement est la socit dans sa totalit, la philosophie doit l'tre aux sciences. Puisque la diversit des sciences tend briser l'unit de la science, il faut charger une science nouvelle de la reconstituer. Puisque les tudes de dtail nous font perdre de vue l'ensemble des connaissances humaines, il faut instituer un systme particulier de recherches pour le retrouver et le mettre en relief. En d'autres termes, il faut faire de l'tude des gnralits scientifiques une grande spcialit de plus. Qu'une classe nouvelle de savants, prpars par une ducation convenable, sans se livrer la culture spciale d'aucune branche particulire de la philosophie naturelle, s'occupe uniquement, en considrant les diverses sciences positives dans leur tat actuel, dterminer exactement l'esprit de chacune d'elles, dcouvrir leurs relations et leur enchanement, rsumer, s'il est possible, tous leurs principes propres en un moindre nombre de principes communs... et la division du travail dans les sciences sera pousse, sans aucun danger, aussi loin que le dveloppement des divers ordres de connaissances l'exigera 2 . Sans doute, nous avons montr nous-mme 3 que l'organe gouvernemental se dveloppe avec la division du travail, non pour y faire contrepoids, mais par une ncessit mcanique. Comme les organes sont troitement solidaires l o les fonctions sont trs partages, ce qui affecte l'un en atteint d'autres, et les vnements sociaux prennent plus facilement un intrt gnral. En mme temps, par suite de l'effacement du type segmentaire, ils se rpandent avec plus de facilit dans toute l'tendue d'un mme tissu ou d'un mme appareil. Pour ces deux sries de raisons, il y en a davantage qui retentissent dans l'organe directeur dont l'activit fonctionnelle, plus souvent exerce, s'accrot ainsi que le volume. Mais sa sphre d'action ne s'tend pas plus loin. Or, sous cette vie gnrale et superficielle, il en est une intestine, un monde d'organes qui, sans tre, tout fait indpendants du premier, fonctionne cependant sans qu'il intervienne, sans mme qu'il en ait conscience, du moins l'tat normal. Ils sont soustraits son action parce qu'il est trop loin d'eux. Ce n'est pas le gouvernement qui peut, chaque instant, rgler les conditions des diffrents marchs conomiques, fixer les prix des choses et des services, proportionner la production aux besoins de la consommation, etc. Tous ces problmes pratiques soulvent des
1 2
Cours de philosophie positive, IV, pp. 430-431. Ce rapprochement entre le gouvernement et la philosophie n'a rien qui doive surprendre ; car, aux yeux de Comte, ces deux institutions sont insparables l'une de l'autre. Le gouvernement, tel qu'il le conoit, n'est possible que si la philosophie positive est dj constitue. Voir plus haut, liv. I, chap. VII, III, pp. 197-205.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
96
multitudes de dtails, tiennent des milliers de circonstances particulires que ceux-l seuls connaissent qui en sont tout prs. A plus forte raison ne peut-il ajuster ces fonctions les unes aux autres et les faire concourir harmoniquement si elles ne concordent pas d'elles-mmes, Si donc la division du travail a les effets dispersifs qu'on lui attribue, ils doivent se dvelopper sans rsistance dans cette rgion de la socit, puisque rien ne s'y trouve qui puisse les contenir. Cependant, ce qui fait l'unit des socits organises, comme de tout organisme, c'est le consensus spontan des parties, c'est cette solidarit interne qui non seulement est tout aussi indispensable que l'action rgulatrice des centres suprieurs, mais qui en est mme la condition ncessaire, car ils ne font que la traduire en un autre langage et, pour ainsi dire, la consacrer. C'est ainsi que le cerveau ne cre pas l'unit de l'organisme, mais l'exprime et la couronne. On parle de la ncessit d'une raction de l'ensemble sur les parties, mais encore faut-il que cet ensemble existe ; c'est--dire que les parties doivent tre dj solidaires les unes des autres, pour que le tout prenne conscience de soi et ragisse ce titre. On devrait donc, voir, mesure que le travail se divise, une sorte de dcomposition progressive se produire, non sur tels ou tels points, mais dans toute l'tendue de la socit, au lieu de la concentration toujours plus forte qu'on y observe en ralit. Mais, dit-on, il n'est pas besoin d'entrer dans ces dtails. Il suffit de rappeler partout o c'est ncessaire l'esprit d'ensemble et le sentiment de la solidarit commune , et cette action, le gouvernement seul a qualit pour l'exercer. Il est vrai, mais elle est beaucoup trop gnrale pour assurer le concours des fonctions sociales, s'il ne se ralise pas de soi-mme. En effet, de quoi s'agit-il ? De faire sentir chaque individu qu'il ne se suffit pas, mais fait partie d'un tout dont il dpend ? Mais une telle reprsentation, abstraite, vague et, d'ailleurs, intermittente comme toutes les reprsentations complexes, ne peut rien contre les impressions vives, concrtes, qu'veille chaque instant chez chacun de nous son activit professionnelle. Si donc celle-ci a les effets qu'on lui prte, si les occupations qui remplissent notre vie quotidienne tendent nous dtacher du groupe social auquel nous appartenons, une telle conception, qui ne s'veille que de loin en loin et n'occupe jamais qu'une petite partie du champ de la conscience, ne pourra pas suffire nous y retenir. Pour que le sentiment de l'tat de dpendance o nous sommes ft efficace, il faudrait qu'il ft, lui aussi, continu, et il ne peut l'tre que s'il est li au jeu mme de chaque fonction spciale. Mais alors la spcialisation n'aurait plus les consquences qu'on l'accuse de produire. Ou bien l'action gouvernementale aura-t-elle pour objet de maintenir entre les professions une certaine uniformit morale, d'empcher que les affections sociales, graduellement concentres entre les individus de mme profession, y deviennent de plus en plus trangres aux autres classes, faute d'une suffisante analogie de murs et de pense 1 ? Mais cette uniformit ne peut pas tre maintenue de force et en dpit de la nature des choses. La diversit fonctionnelle entrane une diversit morale que rien ne saurait prvenir, et il est invitable que l'une s'accroisse en mme temps que l'autre. Nous savons, d'ailleurs, pour quelles raisons ces deux phnomnes se dveloppent paralllement. Les sentiments collectifs deviennent donc de plus en plus impuissants contenir les tendances centrifuges qu'est cense engendrer la division du travail ; car, d'une part, ces tendances augmentent mesure que le travail se divise davantage, et, en mme temps, les sentiments collectifs euxmmes s'affaiblissent.
Cours de philosophie. positive, IV, 42.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
97
Pour la mme raison, la philosophie devient de plus en plus incapable d'assurer l'unit de la science. Tant qu'un mme esprit pouvait cultiver la fois les diffrentes sciences, il tait possible d'acqurir la comptence ncessaire pour en reconstituer l'unit. Mais, mesure qu'elles se spcialisent, ces grandes synthses ne peuvent plus gure tre autre chose que des gnralisations prmatures, car il devient de plus en plus impossible une intelligence humaine d'avoir une connaissance suffisamment exacte de cette multitude innombrable de phnomnes, de lois, d'hypothses qu'elles doivent rsumer. Il serait intressant de se demander, dit justement M. Ribot, ce que la philosophie, comme conception gnrale du monde, pourra tre un jour, quand les sciences particulires, par suite de leur complexit croissante, deviendront inabordables dans le dtail et que les philosophes en seront rduits la connaissance des rsultats les plus gnraux, ncessairement superficielle 1. Sans doute, on a quelque raison de juger excessive cette fiert du savant, qui, enferm dans ses recherches spciales, refuse de reconnatre tout contrle tranger. Pourtant, il est certain que, pour avoir d'une science une ide un peu exacte, il faut l'avoir pratique, et, pour ainsi dire, l'avoir vcue. C'est qu'en effet elle ne tient pas tout entire dans les quelques propositions qu'elle a dfinitivement dmontres. A ct de cette science actuelle et ralise, il en est une autre, concrte et vivante, qui s'ignore en partie et se cherche encore : ct des rsultats acquis, il y a les esprances, les habitudes, les instincts, les besoins, les pressentiments si obscurs qu'on ne peut les exprimer avec des mots, si puissants cependant qu'ils dominent parfois toute la vie du savant. Tout cela, c'est encore de la science : c'en est mme la meilleure et la majeure partie, car les vrits dcouvertes sont en bien petit nombre ct de celles qui restent dcouvrir, et d'autre part, pour possder tout le sens des premires et comprendre tout ce qui s'y trouve condens, il faut avoir vu de prs la vie scientifique tandis qu'elle est encore l'tat libre, c'est--dire avant qu'elle se soit fixe sous forme de propositions dfinies. Autrement, on en aura la lettre, on l'esprit. Chaque science a, pour ainsi dire, une me qui vit dans la conscience des savants. Une partie seulement de cette me prend un corps et des formes sensibles. Les formules qui l'expriment, tant gnrales, sont aisment transmissibles. Mais il n'en est pas de mme dans cette autre partie de la science qu'aucun symbole ne traduit au-dehors. Ici, tout est personnel et doit tre acquis par une exprience personnelle. Pour y avoir part, il faut se mettre l'uvre et se placer devant les faits. Suivant Comte, pour que l'unit de la science ft assure, il suffirait que les mthodes fussent ramenes l'unit 2 ; mais c'est justement les mthodes qu'il est le plus difficile d'unifier. Car, comme elles sont immanentes aux sciences elles-mmes, comme il est impossible de les dgager compltement du corps des vrits tablies pour les codifier part, on ne peut les connatre que si on les a soi-mme pratiques. Or, il est ds maintenant impossible un mme homme de pratiquer un grand nombre de sciences. Ces grandes gnralisations ne peuvent clone reposer que sur une vue assez sommaire des choses. Si, de plus, on songe avec quelle lenteur et quelles patientes prcautions les savants procdent d'ordinaire la dcouverte de leurs vrits mme les plus particulires, on s'explique que ces disciplines improvises n'aient plus sur eux qu'une bien faible autorit. Mais quelle que soit la valeur de ces gnralits philosophiques, la science n'y saurait trouver l'unit dont elle a besoin.
1 2
Psychologie allemande, Introduction, p. XXVII. Op. cit., 1, 45.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
98
Elles expriment bien ce qu'il y a de commun entre les sciences, les lois, les mthodes particulires, mais, ct des ressemblances, il y a les diffrences qui restent intgrer. On dit souvent que le gnral contient en puissance les faits particuliers qu'il rsume ; mais l'expression est inexacte. Il contient seulement ce qu'ils ont de commun. Or, il West pas dans le monde deux phnomnes qui se ressemblent, si simples soient-ils. C'est pourquoi toute proposition gnrale laisse chapper une partie de la matire qu'elle essaie de matriser. Il est impossible de fondre les caractres concrets et les proprits distinctives des choses au sein d'une mme formule impersonnelle et homogne. Seulement, tant que les ressemblances dpassent les diffrences, elles suffisent intgrer les reprsentations ainsi rapproches ; les dissonances de dtail disparaissent au sein de l'harmonie totale. Au contraire, mesure que les diffrences deviennent plus nombreuses, la cohsion devient plus instable et a besoin d'tre consolide par d'autres moyens. Qu'on se reprsente la multiplicit croissante des sciences spciales avec leurs thormes, leurs lois, leurs axiomes, leurs conjectures, leurs procds et leurs mthodes, et on comprendra qu'une formule courte et simple, comme la loi d'volution par exemple, ne peut suffire intgrer une aussi prodigieuse complexit de phnomnes. Quand mme ces vues d'ensemble s'appliqueraient exactement la ralit, la partie qu'elles en expliquent est trop peu de chose ct de ce qu'elles laissent inexpliqu. Ce n'est donc pas par ce moyen qu'on pourra jamais arracher les sciences positives leur isolement. Il y a un trop grand cart entre les recherches de dtail qui les alimentent et de telles synthses. Le lien qui rattache l'un l'autre ces deux ordres de connaissances est trop mince et trop lche, et par consquent, si les sciences particulires ne peuvent prendre conscience de leur mutuelle dpendance qu'au sein d'une philosophie qui les embrasse, le sentiment qu'elles en auront sera toujours trop vague pour tre efficace. La philosophie est comme la conscience collective de la science, et, ici comme ailleurs, le rle de la conscience collective diminue mesure que le travail se divise.
III
Quoique A. Comte ait reconnu que la division du travail est une source de solidarit, il semble n'avoir pas aperu que cette solidarit est sui generis et se substitue peu peu celle qu'engendrent les similitudes sociales. C'est pourquoi, remarquant que celles-ci sont trs effaces l o les fonctions sont trs spcialises, il a vu dans cet effacement un phnomne morbide, une menace pour la cohsion sociale, due l'excs de la spcialisation, et il a expliqu par l les faits d'incoordination qui accompagnent parfois le dveloppement de la division du travail. Mais puisque nous avons tabli que l'affaiblissement de la conscience collective est un phnomne normal, nous ne saurions en faire la cause des phnomnes anormaux que nous sommes en train d'tudier. Si, dans certains cas, la solidarit organique n'est pas tout ce qu'elle doit tre, ce n'est certainement pas parce que la solidarit mcanique a perdu du terrain, mais c'est que toutes les conditions d'existence de la premire ne sont pas ralises.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
99
Nous savons en effet que, partout o on l'observe, on rencontre en mme temps une rglementation suffisamment dveloppe qui dtermine les rapports mutuels des fonctions 1. Pour que la solidarit organique existe, il ne suffit pas qu'il y ait un systme d'organes ncessaires les uns aux autres et qui sentent d'une faon gnrale leur solidarit, mais il faut encore que la manire dont ils doivent concourir, sinon dans toute espce de rencontres, du moins dans les circonstances les plus frquentes, soit prdtermine. Autrement, il faudrait chaque instant de nouvelles luttes pour qu'ils pussent s'quilibrer, car les conditions de cet quilibre ne peuvent tre trouves qu' l'aide de ttonnements au cours desquels chaque partie traite l'autre en adversaire au moins autant qu'en auxiliaire. Ces conflits se renouvelleraient donc sans cesse, et, par consquent, la solidarit ne serait gure que virtuelle, les obligations mutuelles devaient tre tout entires dbattues nouveau dans chaque cas particulier. On dira qu'il y a les contrats. Mais, d'abord, toutes les relations sociales ne sont pas susceptibles de prendre cette forme juridique. Nous savons, d'ailleurs, que le contrat ne se suffit pas lui-mme, mais suppose une rglementation qui s'tend et se complique comme la vie contractuelle elle-mme. De plus, les liens qui ont cette origine sont toujours de courte dure. Le contrat n'est qu'une trve et assez prcaire ; il ne suspend que pour un temps les hostilits. Sans doute, si prcise que soit une rglementation, elle laissera toujours une place libre pour bien des tiraillements. Mais il n'est ni ncessaire, ni mme possible que la vie sociale soit sans luttes. Le rle de la solidarit n'est pas de supprimer la concurrence, mais de la modrer. D'ailleurs l'tat normal, ces rgles se dgagent d'elles-mmes de la division du travail ; elles en sont comme le prolongement. Assurment, si elle ne rapprochait que des individus qui s'unissent pour quelques instants en vue d'changer des services personnels, elle ne pourrait donner naissance aucune action rgulatrice. Mais ce qu'elle met en prsence, ce sont des fonctions, c'est--dire des manires d'agir dfinies, qui se rptent, identiques elles-mmes, dans des circonstances donnes, puisqu'elles tiennent aux conditions gnrales et constantes de la vie sociale. Les rapports qui se nouent entre ces fonctions ne peuvent donc manquer de parvenir au mme degr de fixit et de rgularit. Il y a certaines manires de ragir les unes sur les autres qui, se trouvant plus conformes la nature des choses, se rptent plus souvent et deviennent des habitudes ; puis les habitudes, mesure qu'elles prennent de la force, se transforment en rgles de conduite. Le pass prdtermine l'avenir. Autrement dit, il y a un certain dpart des droits et des devoirs que l'usage tablit et qui finit par devenir obligatoire. La rgle ne cre donc pas l'tat de dpendance mutuelle o sont les organes solidaires, mais ne fait que l'exprimer d'une manire sensible et dfinie, en fonction d'une situation donne. De mme, le systme nerveux, bien loin de dominer l'volution de l'organisme, comme on l'a cru autrefois, en rsulte 2. Les filets nerveux ne sont vraisemblablement que les lignes de passage qu'ont suivies les ondes de mouvements et d'excitations changes entre les divers organes ; ce sont des canaux que la vie s'est creuss elle-mme en coulant toujours dans le mme sens, et les ganglions ne seraient que le lieu d'intersection de plusieurs de ces lignes 3. C'est pour avoir mconnu cet aspect du phnomne que certains moralistes ont accus la division du travail de ne pas produire de solidarit vritable. Ils n'y ont vu que des changes particuliers, combinaisons phmres, sans pass comme sans lendemain, o l'individu est abandonn lui-mme ; ils n'ont pas aperu
1 2 3
Voir liv. I, chap. VII. Voir PERRIER, Colonies animales, p. 746. Voir SPENCER, Principes de biologie, II, 438 et suiv.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
100
ce lent travail de consolidation, ce rseau de liens qui peu peu se tisse de soi-mme et qui fait de la solidarit organique quelque chose de permanent. Or, dans tous les cas que nous avons dcrits plus haut, cette rglementation ou n'existe pas, ou n'est pas en rapport avec le degr de dveloppement de la division du travail. Il n'y a plus aujourd'hui de rgles qui fixent le nombre des entreprises conomiques, et, dans chaque branche d'industrie, la production n'est pas rglemente de manire ce qu'elle reste exactement au niveau de la consommation. Nous ne voulons d'ailleurs tirer de ce fait aucune conclusion pratique ; nous ne soutenons pas qu'une lgislation restrictive soit ncessaire ; nous n'avons pas en peser ici les avantages et les inconvnients. Ce qui est certain, c'est que ce dfaut de rglementation ne permet pas l'harmonie rgulire des fonctions. Les conomistes dmontrent, il est vrai, que cette harmonie se rtablit d'elle-mme, quand il le faut, grce l'lvation ou l'avilissement des prix, qui, suivant les besoins, stimule ou ralentit la production. Mais, en tout cas, elle ne se rtablit ainsi qu'aprs des ruptures d'quilibre et des troubles plus ou moins prolongs. D'autre part, ces troubles sont naturellement d'autant plus frquents que les fonctions sont plus spcialises ; car plus une organisation est complexe, et plus la ncessit d'une rglementation> tendue se fait sentir. Les rapports du capital et du travail sont, jusqu' prsent, rests dans le mme tat d'indtermination juridique. Le contrat de louage de services occupe dans nos Codes une bien petite place, surtout quand on songe la diversit et la complexit des relations qu'il est appel rgler. Au reste, il n'est pas ncessaire d'insister sur une lacune que tous les peuples sentent actuellement et s'efforcent de combler 1. Les rgles de la mthode sont la science ce que les rgles du droit et des murs sont la conduite ; elles dirigent la pense du savant comme les secondes gouvernent les actions des hommes. Or, si chaque science a sa mthode, l'ordre qu'elle ralise est tout interne. Elle coordonne les dmarches des savants qui cultivent une mme science, non leurs relations avec le dehors. Il n'y a gure de disciplines qui concertent les efforts de sciences diffrentes en vue d'une fin commune. C'est surtout vrai des sciences morales et sociales ; car les sciences mathmatiques, physico-chimiques et mme biologiques ne semblent pas tre ce point trangres les unes aux autres. Mais le juriste, le psychologue, l'anthropologiste, l'conomiste, le statisticien, le linguiste, l'historien procdent leurs investigations comme si les divers ordres de faits qu'ils tudient formaient autant de mondes indpendants. Cependant, en ralit, ils se pntrent de toutes parts ; par consquent, il en devrait tre de mme des sciences correspondantes. Voil d'o vient l'anarchie que l'on a signale, non sans exagration d'ailleurs, dans la science en gnral, mais qui est surtout vraie de ces sciences dtermines. Elles offrent, en effet, le spectacle d'un agrgat de parties disjointes qui ne concourent pas entre elles. Si donc elles forment un ensemble sans unit, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas un sentiment suffisant de leurs ressemblances ; c'est qu'elles ne sont pas organises. Ces divers exemples sont donc des varits d'une mme espce ; dans tous ces cas, si la division du travail ne produit pas la solidarit, c'est que les relations des organes ne sont pas rglementes, c'est qu'elles sont dans un tat d'anomie.
Ceci tait crit en 1893. Depuis, la lgislation industrielle a pris dans notre droit une place plus importante. C'est ce qui prouve combien la lacune tait grave, et il s'en faut qu'elle soit comble.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
101
Mais d'o vient cet tat ? Puisqu'un corps de rgles est la forme dfinie que prennent avec le temps les rapports qui s'tablissent spontanment entre les fonctions sociales, on peut dire a priori que l'tat d'anomie est impossible partout o les organes solidaires sont en contact suffisant et suffisamment prolong. En effet, tant contigus, ils sont aisment avertis en chaque circonstance du besoin qu'ils ont les uns des autres et ont par consquent un sentiment vif et continu de leur mutuelle dpendance. Comme pour la mme raison, les changes se font entre eux facilement ; ils se font aussi frquemment tant rguliers ; ils se rgularisent d'eux-mmes et le temps achve peu peu luvre de consolidation. Enfin, parce que les moindres ractions peuvent tre ressenties de part et d'autre, les rgles qui se forment ainsi en portent l'empreinte, c'est--dire qu'elles prvoient et fixent jusque dans le dtail les conditions de l'quilibre. Mais si, au contraire, quelque milieu opaque est interpos, il n'y a plus que les excitations d'une certaine intensit qui puissent se communiquer d'un organe l'autre. Les relations, tant rares, ne se rptent pas assez pour se dterminer ; c'est chaque fois nouvelle de nouveaux ttonnements. Les lignes de passage suivies par les ondes de mouvement ne peuvent pas se creuser parce que ces ondes elles-mmes sont trop intermittentes. Du moins, si quelques rgles parviennent cependant se constituer, elles sont gnrales et vagues ; car, dans ces conditions, il n'y a que les contours les plus gnraux des phnomnes qui puissent se fixer. Il en sera de mme si la contigut, tout en tant suffisante, est trop rcente ou a trop peu dur 1. Trs gnralement, cette condition se trouve ralise par la force des choses. Car une fonction ne peut se partager entre deux ou plusieurs parties d'un organisme que si celles-ci sont plus ou moins contigus. De plus, une fois que le travail est divis, comme elles ont besoin les unes des autres, elles tendent naturellement diminuer la distance qui les spare. C'est pourquoi, mesure qu'on s'lve dans l'chelle animale, on voit les organes se rapprocher et, comme dit M. Spencer, s'introduire dans les interstices les uns des autres. Mais un concours de circonstances exceptionnelles peut faire qu'il en soit autrement. C'est ce qui se produit dans les cas qui nous occupent. Tant que le type segmentaire est fortement marqu, il y a peu prs autant de marchs conomiques que de segments diffrents ; par consquent, chacun d'eux est trs limit. Les producteurs, tant trs prs des consommateurs, peuvent se rendre facilement compte de l'tendue des besoins satisfaire. L'quilibre s'tablit donc sans peine et la production se rgle d'elle-mme. Au contraire, mesure que le type organis se dveloppe, la fusion des divers segments les uns dans les autres entrane celle des marchs en un march unique, qui embrasse peu prs toute la socit. Il s'tend mme au-del et tend devenir universel ; car les frontires qui sparent les peuples s'abaissent en mme temps que celles qui sparaient les segments de chacun d'eux. Il en rsulte que chaque industrie produit pour des consommateurs qui sont disperss sur toute la surface du pays ou mme du monde entier. Le contact n'est donc plus suffisant. Le producteur ne
1
Il y a cependant un cas o l'anomie peut se produire, quoique la contigut soit suffisante. C'est quand la rglementation ncessaire ne peut s'tablir qu'au prix de transformations dont la structure sociale n'est plus capable ; car la plasticit des socits n'est pas indfinie. Quand elle est son terme, les changements mme ncessaires sont impossibles.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
102
peut plus embrasser le march du regard, ni mme par la pense ; il ne peut plus s'en reprsenter les limites, puisqu'il est pour ainsi dire illimit. Par suite, la production manque de frein et de rgle ; elle ne peut que ttonner au hasard, et, au cours de ces ttonnements, il est invitable que la mesure soit dpasse, tantt dans un sens et tantt dans l'autre. De l ces crises qui troublent priodiquement les fonctions conomiques. L'accroissement de ces crises locales et restreintes que sont les faillites est vraisemblablement un effet de cette mme cause. A mesure que le march s'tend, la grande industrie apparat. Or, elle a pour effet de transformer les relations des patrons et des ouvriers. Une plus grande fatigue du systme nerveux jointe l'influence contagieuse des grandes agglomrations accrot les besoins de ces derniers. Le travail la machine remplace celui de l'homme ; le travail la manufacture celui du petit atelier. L'ouvrier est enrgiment, enlev pour toute la journe sa famille ; il vit toujours plus spar de celui qui l'emploie, etc. Ces conditions nouvelles de la vie industrielle rclament naturellement une organisation nouvelle ; mais comme ces transformations se sont accomplies avec une extrme rapidit, les intrts en conflit n'ont pas encore eu le temps de s'quilibrer 1. Enfin, ce qui explique que les sciences morales et sociales sont dans l'tat que nous avons dit, c'est qu'elles ont t les dernires entrer dans le cercle des sciences positives. Ce n'est gure en effet que depuis un sicle que ce nouveau champ de phnomnes s'est ouvert l'investigation scientifique. Les savants s'y sont installs, les uns ici, les autres l, suivant leurs gots naturels. Disperss sur cette vaste surface, ils sont rests jusqu' prsent trop loigns les uns des autres pour sentir tous les liens qui les unissent. Mais, par cela seul qu'ils pousseront leurs recherches toujours plus loin de leurs points de dpart, ils finiront ncessairement par s'atteindre et, par consquent, par prendre conscience de leur solidarit. L'unit de la science se formera ainsi d'elle-mme ; non par l'unit abstraite d'une formule, d'ailleurs trop exigu pour la multitude des choses qu'elle devrait embrasser, mais l'unit vivante d'un tout organique. Pour que la science soit une, il n'est pas ncessaire qu'elle tienne tout entire dans le champ de regard d'une seule et mme conscience, - ce qui d'ailleurs est impossible, - mais il suffit que tous ceux qui la cultivent sentent qu'ils collaborent une mme oeuvre.
Ce qui prcde te tout fondement un des plus graves reproches qu'on ait faits la division du travail. On l'a souvent accuse de diminuer l'individu en le rduisant au rle de machine. Et en effet, s'il ne sait pas o tendent ces oprations qu'on rclame de lui, s'il ne les rattache aucun but, il ne peut plus s'en acquitter que par routine. Tous les jours, il rpte les mmes mouvements avec une rgularit monotone, mais sans s'y intresser ni les comprendre. Ce n'est plus la cellule vivante d'un organisme vivant, qui vibre sans cesse au contact des cellules voisines, qui agit sur elles et rpond son tour leur action, s'tend, se contracte, se plie et se transforme suivant les besoins et les circonstances ; ce n'est plus qu'un rouage inerte, qu'une force extrieure met en branle et qui se meut toujours dans le mme sens et de la mme faon. videmment, de
1
Rappelons toutefois que, comme on le verra au chapitre suivant, cet antagonisme n'est pas d tout entier la rapidit de ces transformations, mais, en bonne partie, l'ingalit encore trop grande des conditions extrieures de la lutte. Sur ce facteur le temps n'a pas d'action.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
103
quelque manire qu'on se reprsente l'idal moral, on ne peut rester indiffrent un pareil avilissement de la nature humaine. Si la morale a pour but le perfectionnement individuel, elle ne peut permettre qu'on ruine ce point l'individu, et si elle a pour fin la socit, elle ne peut laisser se tarir la source mme de la vie sociale ; car le mal ne menace pas seulement les fonctions conomiques, mais toutes les fonctions sociales, si leves soient-elles. Si, dit A. Comte, l'on a souvent justement dplor dans l'ordre matriel l'ouvrier exclusivement occup pendant sa vie entire la fabrication de manches de couteaux ou de ttes d'pingles, la saine philosophie ne doit pas, au fond, faire moins regretter dans l'ordre intellectuel l'emploi exclusif et continu du cerveau humain la rsolution de quelques quations ou au classement de quelques insectes: l'effet moral, en l'un et l'autre cas, est malheureusement fort analogue 1. On a parfois propos comme remde de donner aux travailleurs, ct de leurs connaissances techniques et spciales, une instruction gnrale. Mais, supposer qu'on puisse ainsi racheter quelques-uns des mauvais effets attribus la division du travail, ce n'est pas un moyen de les prvenir. La division du travail ne change pas de nature parce qu'on la fait prcder d'une culture gnrale. Sans doute, il est bon que le travailleur soit en tat de s'intresser aux choses de l'art, de la littrature, etc. ; mais il n'en reste pas moins mauvais qu'il ait t tout le jour trait comme une machine. Qui ne voit, d'ailleurs, que ces deux existences sont trop opposes pour tre conciliables et pouvoir tre menes de front par le mme homme ! Si l'on prend l'habitude des vastes horizons, des vues d'ensemble, des belles gnralits, on ne se laisse plus confiner sans impatience dans les limites troites d'une tche spciale. Un tel remde ne rendrait donc la spcialisation inoffensive qu'en la rendant intolrable et, par consquent, plus ou moins impossible. Ce qui lve la contradiction, c'est que, contrairement ce qu'on a dit, la division du travail ne produit pas ces consquences en vertu d'une ncessit de sa nature, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles et anormales. Pour qu'elle puisse se dvelopper sans avoir sur la conscience humaine une aussi dsastreuse influence, il n'est pas ncessaire de la temprer par son contraire ; il faut et il suffit qu'elle soit elle-mme, que rien ne vienne du dehors la dnaturer. Car, normalement, le jeu de chaque fonction spciale exige que l'individu ne s'y enferme pas troitement, mais se tienne en rapports constants avec les fonctions voisines, prenne conscience de leurs besoins, des changements qui y surviennent, etc. La division du travail suppose que le travailleur, bien loin de rester courb sur sa tche, ne perd pas de vue ses collaborateurs, agit sur eux et reoit leur action. Ce n'est donc pas une machine qui rpte des mouvements dont il n'aperoit pas la direction, mais il sait qu'ils tendent quelque part, vers un but qu'il conoit plus ou moins distinctement. Il sent qu'il sert quelque chose. Pour cela, il n'est pas ncessaire qu'il embrasse de bien vastes portions de l'horizon social, il suffit qu'il en aperoive assez pour comprendre que ses actions ont une fin en dehors d'elles-mmes. Ds lors, si spciale, si uniforme que puisse tre son activit, c'est celle d'un tre intelligent, car elle a un sens, et il le sait. Les conomistes n'auraient pas laiss dans l'ombre ce caractre essentiel de la division du travail et, par suite, ne l'auraient pas expose ce reproche immrit, s'ils ne l'avaient rduite n'tre qu'un moyen d'accrotre le rendement des forces sociales, s'ils avaient vu qu'elle est avant tout une source de solidarit.
Cours, IV, 430.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
104
Chapitre II
La division du travail contrainte
I
Retour la table des matires
Cependant, ce n'est pas assez qu'il y ait des rgles ; car parfois, ce sont ces rgles mmes qui sont la cause du mal. C'est ce qui arrive dans les guerres de classes. L'institution des classes ou des castes constitue une organisation de la division du travail, et c'est une organisation troitement rglemente ; cependant elle est souvent une source de dissensions. Les classes infrieures n'tant pas ou n'tant plus satisfaites du rle qui leur est dvolu par la coutume ou par la loi, aspirent aux fonctions qui leur sont interdites et cherchent en dpossder ceux qui les exercent. De l des guerres intestines qui sont dues la manire dont le travail est distribu. On n'observe rien de semblable dans l'organisme. Sans doute, dans les moments de crise, les diffrents tissus se font la guerre et se nourrissent les uns aux dpens des autres. Mais jamais une cellule ou un organe ne cherche usurper un autre rle que celui qui lui revient. La raison en est que chaque lment anatomique va mcaniquement son but. Sa constitution, sa place dans l'organisme dterminent sa vocation ; sa tche est une consquence de sa nature. Il peut s'en acquitter mal, mais il ne peut pas prendre celle d'un autre, moins que celui-ci n'en fasse l'abandon comme il arrive dans les rares cas de substitution dont nous avons parl. Il n'en est pas de mme dans les socits. Ici, la contingence est plus grande ; il y a une plus large distance entre les dispositions hrditaires de l'individu et la fonction sociale qu'il remplira ; les premires n'entranent pas les secondes avec une ncessit aussi immdiate. Cet espace, ouvert aux ttonnements et la dlibration, l'est aussi au jeu d'une multitude de causes qui peuvent faire dvier la nature individuelle de sa direction normale et crer un tat pathologique. Parce que cette organisation est plus souple,
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
105
elle est aussi plus dlicate et plus accessible au changement. Sans doute, nous ne sommes pas, ds notre naissance, prdestins tel emploi spcial ; nous avons cependant des gots et des aptitudes qui limitent notre choix. S'il n'en est pas tenu compte, s'ils sont sans cesse froisss par nos occupations quotidiennes, nous souffrons et nous cherchons un moyen de mettre un terme nos souffrances. Or, il n'en est pas d'autre que de changer l'ordre tabli et d'en refaire un nouveau. Pour que la division du travail produise la solidarit, il ne suffit donc pas que chacun ait sa tche, il faut encore que cette tche lui convienne. Or, c'est cette condition qui n'est pas ralise dans l'exemple que nous examinons. En effet, si l'institution des classes ou des castes donne parfois naissance des tiraillements douloureux, au lieu de produire la solidarit, c'est que la distribution des fonctions sociales sur laquelle elle repose ne rpond pas, ou plutt ne rpond plus la distribution des talents naturels. Car, quoi qu'on en ait dit 1, ce n'est pas uniquement par esprit d'imitation que les classes infrieures finissent par ambitionner la vie des classes plus leves. Mme, vrai dire, l'imitation ne peut rien expliquer elle seule, car elle suppose autre chose qu'elle-mme. Elle n'est possible qu'entre des tres qui se ressemblent dj et dans la mesure o ils se ressemblent ; elle ne se produit pas entre espces ou varits diffrentes. Il en est de la contagion morale comme de la contagion physique : elle ne se manifeste bien que sur des terrains prdisposs. Pour que des besoins se rpandent d'une classe dans une autre, il faut que les diffrences, qui primitivement sparaient ces classes, aient disparu ou diminu. Il faut que, par un effet des changements qui se sont produits dans la socit, les uns soient devenus aptes des fonctions qui les dpassaient au premier abord, tandis que les autres perdaient de leur supriorit originelle. Quand les plbiens se mirent disputer aux patriciens l'honneur des fonctions religieuses et administratives, ce n'tait pas seulement pour imiter ces derniers, mais c'est qu'ils taient devenus plus intelligents, plus riches, plus nombreux et que leurs gots et leurs ambitions s'taient modifis en consquence. Par suite de ces transformations, l'accord se trouve rompu dans toute une rgion de la socit entre les aptitudes des individus et le genre d'activit qui leur est assign ; la contrainte seule, plus ou moins violente et plus ou moins directe, les lie leurs fonctions ; par consquent, il n'y a de possible qu'une solidarit imparfaite et trouble. Ce rsultat n'est donc pas une consquence ncessaire de la division du travail. Il ne se produit que dans des circonstances toutes particulires, savoir quand elle est l'effet d'une contrainte extrieure. Il en va tout autrement quand elle s'tablit en vertu de spontanits purement internes, sans que rien vienne gner les initiatives des individus. A cette condition, en effet, l'harmonie entre les natures individuelles et les fonctions sociales ne peut manquer de se produire, du moins dans la moyenne des cas. Car, si rien n'entrave ou ne favorise indment les concurrents qui se disputent les tches, il est invitable que ceux-l seuls qui sont les plus aptes chaque genre d'activit y parviennent. La seule cause qui dtermine alors la manire dont le travail se divise est la diversit des capacits. Par la force des choses, le partage se fait donc dans le sens des aptitudes, puisqu'il n'y a pas de raison pour qu'il se fasse autrement. Ainsi se ralise de soi-mme l'harmonie entre la constitution de chaque individu et sa condition. On dira que ce n'est pas toujours assez pour contenter les hommes ; qu'il en est dont les dsirs dpassent toujours les facults. Il est vrai ; mais ce sont des cas exceptionnels et, peut-on dire, morbides. Normalement, l'homme trouve le bonheur accomplir sa nature ; ses besoins sont en rapport avec ses moyens. C'est ainsi que
1
TARDE, Lois de l'imitation.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
106
dans l'organisme chaque organe lie rclame qu'une quantit d'aliments proportionne sa dignit. La division du travail contrainte est donc le second type morbide que nous reconnaissons, Mais il ne faut pas se tromper sur le sens du mot. Ce qui fait la contrainte, ce n'est pas toute espce de rglementation, puisque, au contraire, la division du travail, nous venons de le voir, ne peut pas se passer de rglementation. Alors mme que les fonctions se divisent d'aprs des rgles prtablies, le partage n'est pas ncessairement l'effet d'une contrainte. C'est ce qui a lieu mme sous le rgime des castes, tant qu'il est fond dans la nature de la socit. Cette institution, en effet, n'est pas toujours et partout arbitraire. Mais quand elle fonctionne dans une socit d'une faon rgulire et sans rsistance, c'est qu'elle exprime, au moins en gros, la manire immuable dont se distribuent les aptitudes professionnelles. C'est pourquoi, quoique les tches soient dans une certaine mesure rparties par la loi, chaque organe s'acquitte de la sienne spontanment. La contrainte ne commence que quand la rglementation, ne correspondant plus la nature vraie des choses et, par suite, n'ayant plus de base dans les murs, ne se soutient que par la force. Inversement, on peut donc dire que la division du travail ne produit la solidarit que si elle est spontane et dans la mesure o elle est spontane. Mais par spontanit, il faut entendre l'absence, non pas simplement de toute violence expresse et formelle, mais de tout ce qui peut entraver, mme indirectement, le libre dploiement de la force sociale que chacun porte en soi. Elle suppose, non seulement que les individus ne sont pas relgus par la force dans des fonctions dtermines, mais encore qu'aucun obstacle, de nature quelconque, ne les empche d'occuper dans les cadres sociaux la place qui est en rapport avec leurs facults. En un mot, le travail ne se divise spontanment que si la socit est constitue de manire ce que les ingalits sociales expriment exactement les ingalits naturelles. Or, pour cela, il faut et il suffit que ces dernires ne soient ni rehausses ni dprcies par quelque cause extrieure. La spontanit parfaite n'est donc qu'une consquence et une autre forme de cet autre fait : l'absolue galit dans les conditions extrieures de la lutte. Elle consiste, non dans un tat d'anarchie qui permettrait aux hommes de satisfaire librement toutes leurs tendances bonnes ou mauvaises, mais dans une organisation savante o chaque valeur sociale, n'tant exagre ni dans un sens ni dans l'autre par rien qui lui ft tranger, serait estime a son juste prix. On objectera que, mme dans ces conditions, il y a encore lutte, par suite des vainqueurs et des vaincus, et que ces derniers n'accepteront jamais leur dfaite que contraints. Mais cette contrainte ne ressemble pas l'autre et n'a de commun avec elle que le nom : ce qui constitue la contrainte proprement dite, c'est que la lutte mme est impossible, c'est que l'on n'est mme pas admis combattre. Il est vrai que cette spontanit parfaite ne se rencontre nulle part comme un fait ralis. Il n'y a pas de socit o elle soit sans mlange. Si l'institution des castes correspond la rpartition naturelle des capacits, ce n'est cependant que d'une manire approximative et, en somme, grossire. L'hrdit, en effet, n'agit jamais avec une telle prcision que, mme l o elle rencontre les conditions les plus favorables son influence, les enfants rptent identiquement les parents, Il y a toujours des exceptions la rgle et, par consquent, des cas o l'individu n'est pas en harmonie avec les fonctions qui lui sont attribues. Ces discordances deviennent plus nombreuses mesure que la socit se dveloppe, jusqu'au jour o les cadres, devenus trop troits, se brisent. Quand le rgime des castes a disparu juridiquement, il se survit lui-mme dans les murs, grce la persistance de certains prjugs, une
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
107
certaine faveur s'attache aux uns, une certaine dfaveur aux autres, qui est indpendante de leurs mrites. Enfin, alors mme qu'il ne reste, pour ainsi dire, plus de trace de tous ces vestiges du pass, la transmission hrditaire de la richesse suffit rendre trs ingales les conditions extrieures dans lesquelles la lutte s'engage; car elle constitue au profit de quelques-uns des avantages qui ne correspondent pas ncessairement leur valeur personnelle. Mme aujourd'hui et chez les peuples les plus cultivs, il y a des carrires qui sont ou totalement fermes, ou plus difficiles aux dshrits de la fortune. Il pourrait donc sembler que l'on n'a pas le droit de considrer comme normal un caractre que la division du travail ne prsente jamais l'tat de puret, si l'on ne remarquait d'autre part que plus on s'lve dans l'chelle sociale, plus le type segmentaire disparat sous le type organis, plus aussi ces ingalits tendent se niveler compltement. En effet, le dclin progressif des castes, partir du moment o la division du travail s'est tablie, est une loi de l'histoire ; car, comme elles sont lies l'organisation politico-familiale, elles rgressent ncessairement avec cette organisation. Les prjugs auxquels elles ont donn naissance et qu'elles laissent derrire elles ne leur survivent pas indfiniment, mais s'teignent peu peu. Les emplois publics sont de plus en plus librement ouverts tout le monde, sans condition de fortune. Enfin, mme cette dernire ingalit, qui vient de ce qu'il y a des riches et des pauvres de naissance, sans disparatre compltement, est du moins quelque peu attnue. La socit s'efforce de la rduire autant que possible, en assistant par divers moyens ceux qui se trouvent placs dans une situation trop dsavantageuse, et en les aidant en sortir. Elle tmoigne ainsi qu'elle se sent oblige de faire la place libre tous les mrites et qu'elle reconnat comme injuste une infriorit qui n'est pas personnellement mrite. Mais ce qui manifeste mieux encore cette tendance c'est la croyance, aujourd'hui si rpandue, que l'galit devient toujours plus grande entre les citoyens et qu'il est juste qu'elle devienne plus grande. Un sentiment aussi gnral ne saurait tre une pure illusion, mais doit exprimer, d'une manire confuse, quelque aspect de la ralit. D'autre part, comme les progrs de la division du travail impliquent au contraire une ingalit toujours croissante, l'galit dont la conscience publique affirme ainsi la ncessit ne peut tre que celle dont nous parlons, savoir l'galit dans les conditions extrieures de la lutte. Il est d'ailleurs ais de comprendre ce qui rend ncessaire ce nivellement. Nous venons de voir, en effet, que toute ingalit extrieure compromet la solidarit organique., Ce rsultat n'a rien de bien fcheux pour les socits infrieures, o la solidarit est surtout assure par la communaut des croyances et des sentiments. En effet, quelque tendus qu'y puissent tre les liens qui drivent de la division du travail, comme ce n'est pas eux qui attachent le plus fortement l'individu la socit, la cohsion sociale n'est pas menace pour cela. Le malaise qui rsulte des aspirations contraries ne suffit pas tourner ceux-l mme qui en souffrent contre l'ordre social qui en est la cause, car ils y tiennent, non parce qu'ils y trouvent le champ ncessaire au dveloppement de leur activit professionnelle, mais parce qu'il rsume leurs yeux une multitude de croyances et de pratiques dont ils vivent. Ils y tiennent, parce que toute leur vie intrieure y est lie, parce que toutes leurs convictions le supposent, parce que, servant de base l'ordre moral et religieux, il leur apparat comme sacr. Des froissements privs et de nature temporelle sont videmment trop lgers pour branler des tats de conscience qui gardent d'une telle origine une force exceptionnelle. D'ailleurs, comme la vie professionnelle est peu dveloppe, ces froissements ne sont qu'intermittents. Pour toutes ces raisons, ils sont faiblement ressentis. On s'y
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
108
fait donc sans peine ; on trouve mme ces ingalits, non seulement tolrables, mais naturelles. C'est tout le contraire qui se produit quand la solidarit organique devient prdominante ; car, alors, tout ce qui la relche atteint le lien social dans sa partie vitale. D'abord, comme, dans ces conditions, les activits spciales s'exercent d'une manire peu prs continue, elles ne peuvent tre contraries sans qu'il en rsulte des souffrances de tous les instants. Ensuite, comme la conscience collective s'affaiblit, les tiraillements qui se produisent ainsi ne peuvent plus tre aussi compltement neutraliss. Les sentiments communs n'ont plus la mme force pour retenir quand mme l'individu attach au groupe ; les tendances subversives, n'ayant plus le mme contrepoids, se font jour plus facilement. Perdant de plus en plus le caractre transcendant qui la plaait comme dans une sphre suprieure aux intrts humains, l'organisation sociale n'a plus la mme force de rsistance, en mme temps qu'elle est davantage battue en brche ; oeuvre tout humaine, elle ne peut plus s'opposer aussi bien aux revendications humaines. Au moment mme o le flot devient plus violent, la digue qui le contenait est branle : il se trouve donc tre beaucoup plus dangereux. Voil pourquoi, dans les socits organises, il est indispensable que la division du travail se rapproche de plus en plus de cet idal de spontanit que nous venons de dfinir. Si elles s'efforcent et doivent s'efforcer d'effacer autant que possible les ingalits extrieures, ce n'est pas seulement parce que l'entreprise est belle, mais c'est que leur existence mme est engage dans le problme. Car elles ne peuvent se maintenir que si toutes les parties qui les forment sont solidaires, et la solidarit n'en est possible qu' cette condition. Aussi peut-on prvoir que cette uvre de justice deviendra toujours plus complte, mesure que le type organis se dveloppera. Quelque importants que soient les progrs raliss dans ce sens, ils ne donnent vraisemblablement qu'une faible ide de ceux qui s'accompliront.
II
L'galit dans les conditions extrieures de la lutte n'est pas seulement ncessaire pour attacher chaque individu sa fonction, mais encore pour relier les fonctions les unes aux autres. En effet, les relations contractuelles se dveloppent ncessairement avec la division du travail, puisque celle-ci n'est pas possible sans l'change dont le contrat est la forme juridique. Autrement dit, une des varits importantes de la solidarit organique est ce qu'on pourrait appeler la solidarit contractuelle. Sans doute, il est faux de croire que toutes les relations sociales puissent se ramener au contrat, d'autant plus que le contrat suppose autre chose que lui-mme ; il y a cependant des liens spciaux qui ont leur origine dans la volont des individus. Il y a un consensus d'un certain genre qui s'exprime dans les contrats et qui, dans les espces suprieures, reprsente un facteur important du consensus gnral. Il est donc ncessaire que, dans ces mmes socits, le solidarit contractuelle soit, autant que possible, mise l'abri de tout ce qui peut la troubler, Car si, dans les socits moins avances, elle peut tre instable sans grand inconvnient pour les raisons que nous avons dites, l o elle est une des formes minentes de la solidarit sociale, elle ne peut tre menace sans que l'unit du corps social soit menace du mme coup. Les conflits qui naissent des
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
109
contrats prennent donc plus de gravit mesure que le contrat lui-mme prend plus d'importance clans la vie gnrale. Aussi, tandis qu'il est des socits primitives qui n'interviennent mme pas pour les rsoudre 1, le droit contractuel des peuples civiliss devient toujours plus volumineux ; or, il n'a pas d'autre objet que d'assurer le concours rgulier des fonctions qui entrent en rapports de cette manire. Mais, pour que ce rsultat soit atteint, il ne suffit pas que l'autorit publique veille ce que les engagements contracts soient tenus ; il faut encore que, du moins dans la grande moyenne des cas, ils soient spontanment tenus. Si les contrats n'taient observs que par force ou par peur de la force, la solidarit contractuelle serait singulirement prcaire. Un ordre tout extrieur dissimulerait mai des tiraillements trop gnraux pour pouvoir tre indfiniment contenus. Mais, dit-on, pour que ce danger ne soit pas craindre, il suffit que les contrats soient librement consentis. Il est vrai ; mais la difficult n'est pas pour cela rsolue, car, qu'est-ce qui constitue le libre consentement ? L'acquiescement verbal ou crit n'en est pas une preuve suffisante ; on peut n'acquiescer que forc. Il faut donc que toute contrainte soit absente ; mais o commence la contrainte ? Elle ne consiste pas seulement dans l'emploi direct de la violence ; car la violence indirecte supprime tout aussi bien la libert. Si l'engagement que j'ai arrach en menaant quelqu'un de la mort, est moralement et lgalement nul, comment serait-il valable si, pour l'obtenir, j'ai profit d'une situation dont je n'tais pas la cause, il est vrai, mais qui mettait autrui dans la ncessit de me cder ou de mourir ? Dans une socit donne, chaque objet d'change a, chaque moment, une valeur dtermine que l'on pourrait appeler sa valeur sociale. Elle reprsente la quantit de travail utile qu'il contient ; il faut entendre par l, non le travail intgral qu'il a pu coter, mais la part de cette nergie susceptible de produire des effets sociaux utiles, c'est--dire qui rpondent des besoins normaux. Quoique une telle grandeur ne puisse tre calcule mathmatiquement, elle n'en est pas moins relle. On aperoit mme facilement les principales conditions en fonction desquelles elle varie ; c'est, avant tout, la somme d'efforts ncessaires la production de l'objet, l'intensit des besoins qu'il satisfait, et enfin l'tendue de la satisfaction qu'il y apporte. En fait, d'ailleurs, c'est autour de ce point qu'oscille la valeur moyenne ; elle ne s'en carte que sous l'influence de facteurs anormaux et, dans ce cas, la conscience publique a gnralement un sentiment plus ou moins vif de cet cart. Elle trouve injuste tout change o le prix de l'objet est sans rapport avec la peine qu'il cote et les services qu'il rend. Cette dfinition pose, nous dirons que le contrat n'est pleinement consenti que si les services changs ont une valeur sociale quivalente. Dans ces conditions, en effet, chacun reoit la chose qu'il dsire et livre celle qu'il donne en retour pour ce que l'une et l'autre valent. Cet quilibre des volonts que constate et consacre le contrat se produit donc et se maintient de soi-mme puisqu'il n'est qu'une consquence et une autre forme de l'quilibre mme des choses. Il est vraiment spontan. Il est vrai que nous dsirons parfois recevoir, pour le produit que nous cdons, plus qu'il ne vaut ; nos ambitions sont sans limites et, par consquent, ne se modrent que parce qu'elles se contiennent les unes les autres. Mais cette contrainte, qui nous empche de
1
Voir STRABON, p. 702. De mme dans le Pentateuque on ne trouve pas de rglementation du contrat.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
110
satisfaire sans mesure nos dsirs mme drgls, ne saurait tre confondue avec celle qui nous te les moyens d'obtenir la juste rmunration de notre travail. La premire n'existe pas pour l'homme sain. La seconde seule mrite d'tre appele de ce nom ; seule, elle altre le consentement. Or, elle n'existe pas dans le cas que nous venons de dire. Si, au contraire, les valeurs changes ne se font pas contrepoids, elles n'ont pu s'quilibrer que si quelque force extrieure a t jete dans la balance. Il y a eu lsion d'un ct ou de l'autre ; les volonts n'ont donc pu se mettre d'accord que si l'une d'elles a subi une pression directe ou indirecte, et cette pression constitue une violence. En un mot, pour que la force obligatoire du contrat soit entire, il ne suffit pas qu'il ait t l'objet d'un assentiment exprim ; il faut encore qu'il soit juste, et il n'est pas juste par cela seul qu'il a t verbalement consenti. Un simple tat du sujet ne saurait engendrer lui seul ce pouvoir de lier qui est inhrent aux conventions ; du moins, pour que le consentement ait cette vertu, il faut qu'il repose lui-mme sur un fondement objectif. La condition ncessaire et suffisante pour que cette quivalence soit la rgle des contrats, c'est que les contractants soient placs dans des conditions extrieures gales. En effet, comme l'apprciation des choses ne peut pas tre dtermine a priori, mais se dgage des changes eux-mmes, il faut que les individus qui changent n'aient, pour faire apprcier ce que vaut leur travail, d'autre force que celle qu'ils tirent de leur mrite social. De cette manire, en effet, les valeurs des choses correspondent exactement aux services qu'elles rendent et la peine qu'elles cotent ; car tout autre facteur, capable de les faire varier, est, par hypothse, limin. Sans doute, leur mrite ingal fera toujours aux hommes des situations ingales dans la socit ; mais ces ingalits ne sont extrieures qu'en apparence, car elles ne font que traduire au-dehors des ingalits internes; elles n'ont donc d'autre influence sur la dtermination des valeurs que d'tablir entre ces dernires une graduation parallle la hirarchie des fonctions sociales, Il n'en est plus de mme si quelques-uns reoivent de quelque autre source un supplment d'nergie ; car celle-ci a ncessairement pour effet de dplacer le point d'quilibre, et il est clair que ce dplacement est indpendant de la valeur sociale des choses. Toute supriorit a son contrecoup sur la manire dont les contrats se forment ; si donc elle ne tient pas la personne des individus, leurs services sociaux, elle fausse les conditions morales de l'change. Si une classe de la socit est oblige, pour vivre, de faire accepter tout prix ses services, tandis que l'autre peut s'en passer, grce aux ressources dont elle dispose et qui pourtant ne sont pas ncessairement dues quelque supriorit sociale, la seconde fait injustement la loi la premire. Autrement dit, il ne peut pas y avoir des riches et des pauvres de naissance sans qu'il y ait des contrats injustes. A plus forte raison, en tait-il ainsi quand la condition sociale elle-mme tait hrditaire et que le droit consacrait toute sorte d'ingalits. Seulement, ces injustices lie sont pas fortement senties tant que les relations contractuelles sont peu dveloppes et que la conscience collective est forte. Par suite de la raret des contrats, elles ont moins d'occasions de se produire, et surtout les croyances communes en neutralisent les effets. La socit n'en souffre pas parce qu'elle n'est pas en danger pour cela. Mais, mesure que le travail se divise davantage et que la foi sociale s'affaiblit, elles deviennent plus insupportables, parce que les circonstances qui leur donnent naissance reviennent plus souvent, et aussi parce que les sentiments qu'elles veillent ne peuvent plus tre aussi compltement temprs par des sentiments contraires. C'est ce dont tmoigne l'histoire du droit contractuel, qui tend de plus en plus retirer toute valeur aux conventions o les contractants se sont trouvs dans des situations trop ingales.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
111
A l'origine, tout contrat, conclu dans les formes, a force obligatoire, de quelque manire qu'il ait t obtenu. Le consentement n'en est mme pas le facteur primordial. L'accord des volonts ne suffit pas les lier, et les liens forms ne rsultent pas directement de cet accord. Pour que le contrat existe, il faut et il suffit que certaines crmonies soient accomplies, que certaines paroles soient prononces, et la nature des engagements est dtermine, non par l'intention des parties, mais par les formules employes 1. Le contrat consensuel n'apparat qu' une poque relativement rcente 2. C'est un premier progrs dans la voie de la justice. Mais, pendant longtemps, le consentement, qui suffisait valider les pactes, put tre trs imparfait, c'est--dire extorqu par la force ou par la fraude. Ce fut assez tard que le prteur romain accorda aux victimes de la ruse et de la violence l'action de dolo et l'action quod metus causa 3 ; encore la violence n'existait-elle lgalement que s'il y avait eu menace de mort ou de supplices corporels 4. Notre droit est devenu plus exigeant sur ce point. En mme temps. la lsion, dment tablie, fut admise parmi les causes qui peuvent, dans certains cas, vicier les contrats 5. N'est-ce pas, d'ailleurs, pour cette raison que les peuples civiliss refusent tous de reconnatre le contrat d'usure ? C'est qu'en effet il suppose qu'un des contractants est trop compltement la merci de l'autre. Enfin, la morale commune condamne plus svrement encore toute espce de contrat lonin, o l'une des parties est exploite par l'autre, parce qu'elle est la plus faible et ne reoit pas le juste prix de sa peine. La conscience publique rclame d'une manire toujours plus instante une exacte rciprocit dans les services changs, et, ne reconnaissant qu'une forme obligatoire trs rduite aux conventions qui ne remplissent pas cette condition fondamentale de toute justice, elle se montre beaucoup plus indulgente que la loi pour ceux qui les violent.
C'est aux conomistes que revient le mrite d'avoir les premiers signal le caractre spontan de la vie sociale, d'avoir montr que la contrainte ne peut que la faire dvier de sa direction naturelle et que, normalement, elle rsulte, non d'arrangements extrieurs et imposs, mais d'une libre laboration interne. A ce titre, ils ont rendu un important service la science de la morale ; seulement, ils se sont mpris sur la nature de cette libert. Comme ils y voient un attribut constitutif de l'homme, comme ils la dduisent logiquement du concept de l'individu en soi, elle leur semble tre entire ds l'tat de nature, abstraction faite de toute socit. L'action sociale, d'aprs eux, n'a donc rien y ajouter ; tout ce qu'elle peut et doit faire, c'est d'en rgler le fonctionnement extrieur de manire ce que les liberts concurrentes ne se nuisent pas les unes aux autres. Mais si elle ne se renferme pas strictement dans ces limites, elle empite sur leur domaine lgitime et le diminue.
1 2
3 4 5
Voir le contrat verbis, litteris et re dans le droit romain. Cf. Esmein, tudes sur les contrats dans le trs ancien droit franais, Paris, 1883. Ulpien regarde les contrats consensuels comme tant juris gentium (L. V, 7 pr., et 1, De Pact., II, 14). Or tout le jus gentium est certainement d'origine postrieure au droit civil. Voir VOIGT, Jus gentium. L'action quod metus causa qui est un peu antrieure l'action de dolo est postrieure la dictature de Sylla. On en place la date en 674. Voir L. 3, 1, et L. 7, 1. Diocltien dcida que le contrat pourrait tre rescind si le prix tait infrieur la moiti de la valeur relle. Notre droit n'admet la rescision pour cause de lsion que dans les ventes d'immeubles.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
112
Mais, outre qu'il est faux que toute rglementation soit le produit de la contrainte, il se trouve que la libert elle-mme est le produit d'une rglementation. Loin d'tre une sorte d'antagoniste de l'action sociale, elle en rsulte. Elle est si peu une proprit inhrente de l'tat de nature qu'elle est au contraire une conqute de la socit sur la nature. Naturellement, les hommes sont ingaux en force physique ; ils sont placs dans des conditions extrieures ingalement avantageuses, la vie domestique ellemme, avec l'hrdit des biens qu'elle implique et les ingalits qui en drivent, est, de toutes les formes de la vie sociale, celle qui dpend le plus troitement de causes naturelles, et nous venons de voir que toutes ces ingalits sont la ngation mme de la libert. En dfinitive, ce qui constitue la libert, c'est la subordination des forces extrieures aux forces sociales ; car c'est seulement cette condition que ces dernires peuvent se dvelopper librement. Or, cette subordination est bien plutt le renversement de l'ordre naturel 1. Elle ne peut donc se raliser que progressivement, mesure que l'homme s'lve au-dessus des choses pour leur faire la loi, pour les dpouiller de leur caractre fortuit, absurde, amoral, c'est--dire dans la mesure o il devient un tre social. Car il ne peut chapper la nature qu'en se crant un autre monde d'o il la domine ; ce monde, c'est la socit 2. La tche des socits les plus avances est donc, peut-on dire, une oeuvre de justice. Qu'en fait elles sentent la ncessit de s'orienter dans ce sens, c'est ce que nous avons montr dj et ce que nous prouve l'exprience de chaque jour. De mme que l'idal des socits infrieures tait de crer ou de maintenir une vie commune aussi intense que possible, o l'individu vnt s'absorber, le ntre est de mettre toujours plus d'quit dans nos rapports sociaux, afin d'assurer le libre dploiement de toutes les forces socialement utiles. Cependant, quand on songe que, pendant des sicles, les hommes se sont contents d'une justice beaucoup moins parfaite, on se prend se demander si ces aspirations ne seraient pas dues peut-tre des impatiences sans raisons, si elles ne reprsentent pas une dviation de l'tat normal plutt qu'une anticipation de l'tat normal venir, si, en un mot, le moyen de gurir le mal dont elles rvlent l'existence est de les satisfaire ou de les combattre. Les propositions tablies dans les livres prcdents nous ont permis de rpondre avec prcision cette question qui nous proccupe. Il n'est pas de besoins mieux fonds que ces tendances, car elles sont une consquence ncessaire des changements qui se sont faits dans la structure des socits. Parce que le type segmentaire s'efface et que le type organis se dveloppe, parce que la solidarit organique se substitue peu peu celle qui rsulte des ressemblances, il est indispensable que les conditions extrieures se nivellent. L'harmonie des fonctions et, par suite l'existence, sont ce prix. De mme que les peuples anciens avaient, avant tout, besoin de foi commune pour vivre, nous, nous avons besoin de justice, et on peut tre certain que ce besoin deviendra toujours plus exigeant si, comme tout le fait prvoir, les conditions qui dominent l'volution sociale restent les mmes.
Bien entendu, nous ne voulons pas dire que la socit soit en dehors de la nature, si l'on entend par l l'ensemble des phnomnes soumis la loi de causalit. Par ordre naturel, nous entendons seulement celui qui se produirait dans ce qu'on a appel l'tat de nature, c'est--dire sous l'influence exclusive de causes physiques et organico-psychiques. Voir liv. II, chap. V. - On voit une fois de plus que le contrat libre ne se suffit pas soi-mme, puisqu'il est possible que grce une organisation sociale trs complexe.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
113
Chapitre III
Autre forme anormale
Retour la table des matires
Il nous reste dcrire une dernire forme anormale. Il arrive souvent dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre, que les fonctions sont distribues de telle sorte qu'elles n'offrent pas une matire suffisante l'activit des individus. Qu'il y ait cela une dplorable perte de forces, et c'est ce qui est vident, mais nous n'avons pas nous occuper du ct conomique du phnomne. Ce qui doit nous intresser, c'est un autre fait qui accompagne toujours ce gaspillage, savoir une incoordination plus ou moins grande de ces fonctions. On sait en effet que, dans une administration o chaque employ n'a pas de quoi s'occuper suffisamment les mouvements s'ajustent mal entre eux, les oprations se font sans ensemble, en un mot la solidarit se relche, l'incohrence et le dsordre apparaissent. A la cour du Bas-Empire, les fonctions taient spcialises l'infini, et pourtant il en rsultait une vritable anarchie. Ainsi, voil des cas o la division du travail, pousse trs loin, produit une intgration trs imparfaite. D'o cela vient-il ? On serait tent de rpondre que ce qui manque, c'est un organe rgulateur, une direction. L'explication est peu satisfaisante, car, trs souvent, cet tat maladif est luvre du pouvoir directeur lui-mme. Pour que le mal disparaisse, il ne suffit donc pas qu'il y ait une action rgulatrice, mais qu'elle s'exerce d'une certaine manire. Aussi bien savons-nous de quelle manire elle s'exercera. Le premier soin d'un chef intelligent et expriment sera de supprimer les emplois inutiles, de distribuer le travail de manire ce que chacun soit suffisamment occup, d'augmenter par consquent l'activit fonctionnelle de chaque travailleur, et l'ordre renatra spontanment en mme temps que le travail sera plus conomiquement amnag. Comment cela se fait-il? C'est ce qu'on voit mal au premier abord. Car enfin, si chaque fonctionnaire a une tche bien dtermine, s'il s'en acquitte exactement, il aura
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
114
ncessairement besoin des fonctionnaires voisins, et il ne pourra pas ne pas s'en sentir solidaire. Qu'importe que cette tche soit petite ou grande, pourvu qu'elle soit spciale ? Qu'importe qu'elle absorbe ou non son temps et ses forces ? Il importe beaucoup au contraire. C'est qu'en effet, d'une manire gnrale, la solidarit dpend trs troitement de l'activit fonctionnelle des parties spcialises. Ces deux termes varient l'un comme l'autre. L o les fonctions sont languissantes, elles ont beau tre spciales, elles se coordonnent mal entre elles et sentent incompltement leur mutuelle dpendance. Quelques exemples vont rendre ce fait trs sensible. Chez un homme, la suffocation oppose une rsistance au passage du sang travers les capillaires, et cet obstacle est suivi d'une congestion et d'arrt du cur ; en quelques secondes, il se produit un grand trouble dans tout l'organisme, et au bout d'une minute ou deux les fonctions cessent 1 . La vie tout entire dpend donc trs troitement de la respiration. Mais, chez une grenouille, la respiration peut tre suspendue longtemps sans entraner aucun dsordre, soit que l'aration du sang qui s'effectue travers la peau lui suffise, soit mme qu'elle soit totalement prive d'air respirable et se contente de l'oxygne emmagasin dans ses tissus. Il y a donc une assez grande indpendance et, par consquent, une solidarit imparfaite entre la fonction de respiration de la grenouille et les autres fonctions de l'organisme, puisque celles-ci peuvent subsister sans le secours de celles-l. Ce rsultat est d ce fait que les tissus de la grenouille, ayant une activit fonctionnelle moins grande que ceux de l'homme, ont aussi moins besoin de renouveler leur oxygne et de se dbarrasser de l'acide carbonique produit par leur combustion. De mme, un mammifre a besoin de prendre de la nourriture trs rgulirement ; le rythme de sa respiration, l'tat normal, reste sensiblement le mme ; ses priodes de repos ne sont jamais trs longues ; en d'autres termes, ses fonctions respiratoires, ses fonctions de nutrition, ses fonctions de relation, sont sans cesse ncessaires les unes aux autres et l'organisme tout entier, tel point qu'aucune d'elles ne peut rester longtemps suspendue sans danger pour les autres et pour la vie gnrale. Le serpent, au contraire, ne prend de nourriture qu' de longs intervalles, ses priodes d'activit et d'assoupissement sont trs distantes l'une de l'autre ; sa respiration, trs apparente de certains moments, est parfois presque nulle, c'est--dire que ses fonctions ne sont pas troitement lies, mais peuvent sans inconvnient s'isoler les unes des autres. La raison en est que son activit fonctionnelle est moindre que celle des mammifres. La dpense des tissus tant plus faible, ils ont moins besoin d'oxygne ; l'usure tant moins grande, les rparations sont moins souvent ncessaires, ainsi que les mouvements destins poursuivre une proie et s'en emparer. M. Spencer a d'ailleurs fait remarquer qu'on trouve dans la nature inorganise des exemples du mme phnomne. Voyez, dit-il, une machine trs complique dont les parties ne sont pas bien ajustes ou sont devenues trop lches par l'effet de l'usure ; examinez-la quand elle va s'arrter. Vous observez certaines irrgularits de mouvement prs du moment o elle arrive au repos : quelques parties s'arrtent les premires, se remettent en mouvement par l'effet de la continuation du mouvement des autres, et alors elles deviennent leur tour des causes de renouvellement du mouvement dans les autres parties qui avaient cess de se mouvoir. En d'autres termes, quand les changements rythmiques de la machine sont rapides, les actions et les ractions qu'ils exercent les uns sur les autres sont rgulires et tous les mouvements sont bien intgrs : mais, mesure que la vitesse diminue, des irrgularits se produisent, les mouvements se dsintgrent 2.
1 2
SPENCER, Principes de biologie, II, 131. SPENCER, Principes de biologie, II, 131.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
115
Ce qui fait que tout accroissement de l'activit fonctionnelle dtermine un accroissement de solidarit, c'est que les fonctions d'un organisme ne peuvent devenir plus actives qu' condition de devenir aussi plus continues. Considrez-en une en particulier. Comme elle ne peut rien sans le concours des autres, elle ne peut produire davantage que si les autres aussi produisent plus ; mais le rendement de celles-ci ne peut s'lever, son tour, que si celui de la prcdente s'lve encore une fois par un nouveau contrecoup. Tout surcrot d'activit dans une fonction, impliquant un surcrot correspondant dans les fonctions solidaires, en implique un nouveau dans la premire : ce qui n'est possible que si celle-ci devient plus continue. Bien entendu, d'ailleurs, ces contrecoups ne se produisent pas indfiniment, mais un moment arrive o l'quilibre s'tablit de nouveau. Si les muscles et les nerfs travaillent davantage, il leur faudra une alimentation plus riche, que l'estomac leur fournira, condition de fonctionner plus activement ; mais, pour cela, il faudra qu'il reoive plus de matriaux nutritifs laborer, et ces matriaux ne pourront tre obtenus que par une nouvelle dpense d'nergie nerveuse ou musculaire. Une production industrielle plus grande ncessite l'immobilisation d'une plus grande quantit de capital sous forme de machines ; mais ce capital, son tour, pour pouvoir s'entretenir, rparer ses pertes, c'est--dire payer le prix de son loyer, rclame une production industrielle plus grande. Quand le mouvement qui anime toutes les parties d'une machine est trs rapide, il est ininterrompu parce qu'il passe sans relche des unes aux autres. Elles s'entranent mutuellement, pour ainsi dire. Si, de plus, ce n'est pas seulement une fonction isole mais toutes la fois qui deviennent plus actives, la continuit de chacune d'elles sera encore augmente. Par suite, elles seront plus solidaires. En effet, tant plus continues, elles sont en rapports d'une manire plus suivie et ont plus continuellement besoin les unes des autres. Elles sentent donc mieux leur dpendance. Sous le rgne de la grande industrie, l'entrepreneur est plus dpendant des ouvriers, pourvu qu'ils sachent agir de concert ; car les grves, en arrtant la production, empchent le capital de s'entretenir. Mais l'ouvrier, lui aussi, peut moins facilement chmer, parce que ses besoins se sont accrus avec son travail. Quand, au contraire, l'activit est moindre, les besoins sont plus intermittents, et il en est ainsi des relations qui unissent les fonctions. Elles ne sentent que de temps en temps leur solidarit, qui est plus lche par cela mme. Si donc le travail fourni non seulement n'est pas considrable, mais encore n'est pas suffisant, il est naturel que la solidarit elle-mme, non seulement soit moins parfaite, mais encore fasse plus ou moins compltement dfaut. C'est ce qui arrive dans ces entreprises o les tches sont partages de telle sorte que l'activit de chaque travailleur est abaisse au-dessous de ce qu'elle devrait tre normalement. Les diffrentes fonctions sont alors trop discontinues pour qu'elles puissent s'ajuster exactement les unes aux autres et marcher toujours de concert ; voil d'o vient l'incohrence qu'on y constate. Mais il faut des circonstances exceptionnelles pour que la division du travail se fasse de cette manire. Normalement, elle ne se dveloppe pas sans que l'activit fonctionnelle ne s'accroisse en mme temps et dans la mme mesure. En effet, les mmes causes qui nous obligent nous spcialiser davantage nous obligent aussi travailler davantage. Quand le nombre des concurrents augmente dans l'ensemble de la socit, il augmente aussi dans chaque profession particulire ; la lutte y devient plus vive et, par consquent, il faut plus d'efforts pour la pouvoir soutenir. De plus, la division du travail tend par elle-mme rendre les fonctions plus actives et plus continues. Les conomistes ont, depuis longtemps, dit les raisons de ce phnomne ;
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
116
voici quelles sont les principales : 1 Quand les travaux ne sont pas diviss il faut sans cesse se dranger, passer d'une occupation une autre. La division du travail fait l'conomie de tout ce temps perdu ; suivant l'expression de Karl Marx, elle resserre les pores de la journe. 2 L'activit fonctionnelle augmente avec l'habilet, le talent du travailleur que la division du travail dveloppe ; il y a moins de temps employ aux hsitations et aux ttonnements. Le sociologue amricain Carey a fort bien mis en relief ce caractre de la division du travail : Il ne peut, dit-il, exister de continuit dans les mouvements du colon isol. Dpendant pour ses subsistances de sa puissance d'appropriation et forc de parcourir des surfaces immenses de terrain, il se trouve souvent en danger de mourir, faute de nourriture. Lors mme qu'il russit s'en procurer, il est forc de suspendre ses recherches et de songer effectuer les changements de rsidence indispensables pour transporter la fois ses subsistances, sa misrable habitation et lui-mme. Arriv l, il est forc de devenir tour tour cuisinier, tailleur... Priv du secours de la lumire artificielle, ses nuits sont compltement sans emploi, en mme temps que le pouvoir de faire de ses journes un emploi fructueux dpend compltement des chances de la temprature. Dcouvrant enfin cependant qu'il a un voisin 1, il se fait des changes entre eux ; mais, comme tous deux occupent des parties diffrentes de l'le, ils se trouvent forcs de se rapprocher exactement comme les pierres l'aide desquelles ils broient leur bl... En outre, lorsqu'ils se rencontrent, il se prsente des difficults pour fixer les conditions du commerce, raison de l'irrgularit dans l'approvisionnement des diverses denres dont ils veulent se dessaisir. Le pcheur a eu une chance favorable et a pch une grande quantit de poissons, mais le hasard a permis au chasseur de se procurer du poisson et, en ce moment, il n'a besoin que de fruits, et le pcheur n'en possde pas. La diffrence tant, ainsi que nous le savons, indispensable pour l'association, l'absence de cette condition offrirait ici un obstacle l'association, difficile surmonter. Cependant, avec le temps, la richesse et la population se dveloppent et, avec ce dveloppement, il se manifeste un accroissement dans le mouvement de la socit ; ds lors, le mari change des services contre ceux de sa femme, les parents contre ceux de leurs enfants, et les enfants changent des services rciproques ; l'un fournit le poisson, l'autre la viande, un troisime du bl, tandis qu'un quatrime transforme le laine en drap. A chaque pas, nous constatons un accroissement dans la rapidit du mouvement, en mme temps qu'un accroissement de force de la part de l'homme 2. D'ailleurs, en fait, on peut observer que le travail devient plus continu mesure qu'il se divise davantage. Les animaux, les sauvages travaillent de la manire la plus capricieuse, quand ils sont pousss par la ncessit de satisfaire quelque besoin immdiat. Dans les socits exclusivement agricoles et pastorales, le travail est presque tout entier suspendu pendant la mauvaise saison. A Rome, il tait interrompu par une multitude de ftes ou de jours nfastes 3. Au Moyen ge, les chmages sont encore multiplis 4. Cependant, mesure que l'on avance, le travail devient une occupation permanente, une habitude et mme, si cette habitude est suffisamment
1 2 3 4
Bien entendu ce n'est l qu'une manire d'exposer les choses. Ce n'est pas ainsi qu'elles se sont historiquement passes. L'homme n'a pas dcouvert un beau jour qu'il avait un voisin. Science sociale, trad. fran., I, pp. 229-231. Voir MARQUARDT, Rm. Stattsverwaltung, III, 545 et suiv. Voir LEVASSEUR, Les classes ouvrires en France jusqu' la Rvolution, 1, 474 et 475.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
117
consolide, un besoin. Mais elle n'aurait pu se constituer, et le besoin correspondant n'aurait pu natre, si le travail tait rest irrgulier et intermittent comme autrefois. Nous sommes ainsi conduits reconnatre une nouvelle raison qui fait de la division du travail une source de cohsion sociale. Elle ne rend pas seulement les individus solidaires, comme nous l'avons dit jusqu'ici, parce qu'elle limite l'activit de chacun, mais encore parce qu'elle l'augmente. Elle accrot l'unit de l'organisme, par cela seul qu'elle en accrot la vie; du moins, l'tat normal, elle ne produit pas un de ces effets sans l'autre.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
118
CONCLUSION
I
Retour la table des matires
Nous pouvons maintenant rsoudre le problme pratique que nous nous sommes pos au dbut de ce travail. S'il est une rgle de conduite dont le caractre moral n'est pas contest, c'est celle qui nous ordonne de raliser en nous les traits essentiels du type collectif. C'est chez les peuples infrieurs qu'elle atteint son maximum de rigueur. L, le premier devoir est de ressembler tout le monde, de n'avoir rien de personnel ni en fait de croyances, ni en fait de pratiques. Dans les socits plus avances, les similitudes exiges sont moins nombreuses ; il en est pourtant encore, nous l'avons vu, dont l'absence nous constitue en tat de faute morale. Sans doute, le crime compte moins de catgories diffrentes ; mais, aujourd'hui comme autrefois, si le criminel est l'objet de la rprobation, c'est parce qu'il n'est pas notre semblable. De mme, un degr infrieur, les actes simplement immoraux et prohibs comme tels sont ceux qui tmoignent de dissemblances moins profondes, quoique encore graves. N'est-ce pas, d'ailleurs, cette rgle que la morale commune exprime, quoique dans un langage un peu diffrent, quand elle ordonne l'homme d'tre un homme dans toute l'acception du mot, c'est-dire d'avoir toutes les ides et tous les sentiments qui constituent une conscience humaine ? Sans doute, si l'on prend la formule la lettre, l'homme qu'elle nous prescrit d'tre serait l'homme en gnral et non celui de telle ou telle espre sociale. Mais, en ralit, cette conscience humaine que nous devons raliser intgralement en nous n'est autre chose que la conscience collective du groupe dont nous faisons partie. Car de quoi peut-elle tre compose, sinon des ides et des sentiments auxquels nous sommes le plus attachs ? O irions-nous chercher les traits de notre modle si ce n'est en nous et autour de nous ? Si nous croyons que cet idal collectif est celui de l'humanit tout entire, c'est qu'il est devenu assez abstrait et gnral pour paratre convenir tous les hommes indistinctement. Mais, en fait, chaque peuple se fait de ce
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
119
type soi-disant humain une conception particulire qui tient son temprament personnel. Chacun se le reprsente son image. Mme le moraliste qui croit pouvoir, par la force de la pense, se soustraire l'influence des ides ambiantes, ne saurait y parvenir ; car il en est tout imprgn et, quoi qu'il fasse, c'est elles qu'il retrouve dans la suite de ses dductions. C'est pourquoi chaque nation a son cole de philosophie morale en rapport avec son caractre. D'autre part, nous avons montr que cette rgle avait pour fonction de prvenir tout branlement de la conscience commune et, par consquent, de la solidarit sociale, et qu'elle ne peut s'acquitter de ce rle qu' condition d'avoir un caractre moral. Il est impossible que les offenses aux sentiments collectifs les plus fondamentaux soient tolres sans que la socit se dsintgre ; mais il faut qu'elles soient combattues l'aide de cette raction particulirement nergique qui est attache aux rgles morales. Or, la rgle contraire, qui nous ordonne de nous spcialiser, a exactement la mme fonction. Elle aussi est ncessaire la cohsion des socits, du moins partir d'un certain moment de leur volution. Sans doute, la solidarit qu'elle assure diffre de la prcdente ; mais si elle est autre, elle n'est pas moins indispensable. Les socits suprieures ne peuvent se maintenir en quilibre que si le travail y est divis ; l'attraction du semblable pour le semblable suffit de moins en moins produire cet effet. Si donc le caractre moral de la premire de ces rgles est ncessaire pour qu'elle puisse jouer son rle, cette ncessit n'est pas moindre pour la seconde. Elles correspondent toutes deux au mme besoin social et le satisfont seulement de manires diffrentes, parce que les conditions d'existence des socits diffrent elles-mmes. Par consquent, sans, qu'il soit ncessaire de spculer sur le fondement premier de l'thique, nous pouvons induire la valeur morale de l'une de la valeur morale de l'autre. Si, certains points de vue, il y a entre elles un vritable antagonisme, ce n'est pas qu'elles servent des fins diffrentes ; au contraire, c'est qu'elles mnent au mme but, mais par des voies opposes. Par suite, il n'est pas ncessaire de choisir entre elles une fois pour toutes, ni de condamner l'une au nom de l'autre ; ce qu'il faut, c'est faire chacune, chaque moment de l'histoire, la place qui lui convient.
Peut-tre mme pouvons-nous gnraliser davantage. Les ncessits de notre sujet nous ont, en effet, oblig classer les rgles morales et en passer en revue les principales espces. Nous sommes ainsi mieux en tat qu'au dbut pour apercevoir, ou tout au moins pour conjecturer, non plus seulement le signe extrieur, mais le caractre interne qui leur est commun toutes et qui peut servir les dfinir. Nous les avons rparties en deux genres : les rgles sanction rpressive, soit diffuse, soit organise, et les rgles sanction restitutive. Nous avons vu que les premires expriment les conditions de cette solidarit sui generis qui drive des ressemblances et laquelle nous avons donn le nom de mcanique ; les secondes, celles de la solidarit ngative 1 et de la solidarit organique. Nous pouvons donc dire d'une manire gnrale que la caractristique des rgles morales est qu'elles noncent les conditions fondamentales de la solidarit sociale. Le droit et la morale, c'est l'ensemble des liens qui nous attachent les uns aux autres et la socit, qui font de la masse des individus un agrgat et un cohrent. Est moral, peut-on dire, tout ce
1
Voir liv. I, chap. III, II.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
120
qui est source de solidarit, tout ce qui force l'homme compter avec autrui, rgler ses mouvements sur autre chose que les impulsions de son gosme, et la moralit est d'autant plus solide que ces liens sont plus nombreux et plus forts. On voit combien il est inexact de la dfinir, comme on a fait souvent, par la libert ; elle consiste bien plutt dans un tat de dpendance. Loin qu'elle serve manciper l'individu, le dgager du milieu qui l'enveloppe, elle a, au contraire, pour fonction essentielle d'en faire la partie intgrante d'un tout et, par consquent, de lui enlever quelque chose de la libert de ses mouvements. On rencontre parfois, il est vrai, des mes qui ne sont pas sans noblesse et qui, pourtant, trouvent intolrable l'ide de cette dpendance. Mais c'est qu'elles n'aperoivent pas les sources d'o dcoule leur propre moralit, parce que ces sources sont trop profondes. La conscience est un mauvais juge de ce qui se passe au fond de l'tre, parce qu'elle n'y pntre pas. La socit n'est donc pas, comme on l'a cru souvent, un vnement tranger la morale ou qui n'a sur elle que des rpercussions secondaires ; c'en est, au contraire, la condition ncessaire. Elle n'est pas une simple juxtaposition d'individus qui apportent, en y entrant, une moralit intrinsque ; mais l'homme n'est un tre moral que parce qu'il vit en socit, puisque la moralit consiste tre solidaire d'un groupe et varie comme cette solidarit. Faites vanouir toute vie sociale, et la vie morale s'vanouit du mme coup, n'ayant plus d'objet o se prendre. L'tat de nature des philosophes du XVIIIe sicle, s'il n'est pas immoral, est du moins amoral ; c'est ce que Rousseau reconnaissait lui-mme. D'ailleurs, nous ne revenons pas pour cela la formule qui exprime la morale en fonction de l'intrt social. Sans doute, la socit ne peut exister si les parties n'en sont solidaires ; mais la solidarit n'est qu'une de ses conditions d'existence. Il en est bien d'autres qui ne sont pas moins ncessaires et qui ne sont pas morales. De plus, il peut se faire que, dans ce rseau de liens qui constituent la morale, il y en ait qui ne soient pas utiles par eux-mmes ou qui aient une force sans rapport avec leur degr d'utilit. L'ide d'utile n'entre donc pas comme lment essentiel dans notre dfinition. Quant ce qu'on appelle la morale individuelle, si l'on entend par l un ensemble de devoirs dont l'individu serait la fois le sujet et l'objet, qui ne le relieraient qu' lui-mme et qui, par consquent, subsisteraient alors mme qu'il serait seul, c'est une conception abstraite qui ne correspond rien dans la ralit. La morale, tous ses degrs, ne s'est jamais rencontre que dans l'tat de socit, n'a jamais vari qu'en fonction de conditions sociales. C'est donc sortir des faits et entrer dans le domaine des hypothses gratuites et des imaginations invrifiables que de se demander ce qu'elle pourrait devenir si les socits n'existaient pas. Les devoirs de l'individu envers lui-mme sont, en ralit, des devoirs envers la socit ; ils correspondent certains sentiments collectifs qu'il n'est pas plus permis d'offenser, quand l'offens et l'offenseur sont une seule et mme personne, que quand ils sont deux tres distincts. Aujourd'hui, par exemple, il y a dans toutes les consciences saines un trs vif sentiment de respect pour la dignit humaine, auquel nous sommes tenus de conformer notre conduite tant dans nos relations avec nous-mmes que dans nos rapports avec autrui, et c'est mme l tout l'essentiel de la morale qu'on appelle individuelle. Tout acte qui y contrevient est blm, alors mme que l'agent et le patient du dlit ne font qu'un. Voil pourquoi, suivant la formule kantienne, nous devons respecter la personnalit humaine partout o elle se rencontre, c'est--dire chez nous comme chez nos semblables. C'est que le sentiment dont elle est l'objet n'est pas moins froiss dans un cas que dans l'autre.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
121
Or, non seulement la division du travail prsente le caractre par lequel nous dfinissons la moralit, mais elle tend de plus en plus devenir la condition essentielle de la solidarit sociale. A mesure qu'on avance dans l'volution, les liens qui attachent l'individu sa famille, au sol natal, aux traditions que lui a lgues le pass, aux usages collectifs du groupe se dtendent. Plus mobile, il change plus aisment de milieu, quitte les siens pour aller ailleurs vivre d'une vie plus autonome, se fait davantage lui-mme ses ides et ses sentiments. Sans doute, toute conscience commune ne disparat pas pour cela ; il restera toujours, tout au moins, ce culte de la personne, de la dignit individuelle dont nous venons de parler, et qui, ds aujourd'hui, est l'unique centre de ralliement de tant d'esprits. Mais combien c'est peu de chose surtout quand on songe l'tendue toujours croissante de la vie sociale, et, par rpercussion, des consciences individuelles ! Car, comme elles deviennent plus volumineuses, comme l'intelligence devient plus riche, l'activit plus varie, pour que la moralit reste constante, c'est--dire pour que l'individu reste fix au groupe avec une force simplement gale celle d'autrefois, il faut que les liens qui l'y attachent deviennent plus forts et plus nombreux. Si donc il ne s'en formait pas d'autres que ceux qui drivent des ressemblances, l'effacement du type segmentaire serait accompagn d'un abaissement rgulier de la moralit. L'homme ne serait plus suffisamment retenu ; il ne sentirait plus assez autour de lui et au-dessus de lui cette pression salutaire de la socit, qui modre son gosme et qui fait de lui un tre moral. Voil ce qui fait la valeur morale de la division du travail. C'est que, par elle, l'individu reprend conscience de son tat de dpendance vis--vis de la socit ; c'est d'elle que viennent les forces qui le retiennent et le contiennent. En un mot, puisque la division du travail devient la source minente de la solidarit sociale, elle devient du mme coup la base de l'ordre moral. On peut donc dire la lettre que, dans les socits suprieures, le devoir n'est pas d'tendre notre activit en surface, mais de la concentrer et de la spcialiser. Nous devons borner notre horizon, choisir une tche dfinie et nous y engager tout entiers, au lieu de faire de notre tre une sorte duvre d'art acheve, complte, qui tire toute sa valeur d'elle-mme et non des services qu'elle rend. Enfin, cette spcialisation doit tre pousse d'autant plus loin que la socit est d'une espce plus leve sans qu'il soit possible d'y assigner d'autre limite 1. Sans doute, nous devons aussi travailler raliser en nous le type collectif dans la mesure o il existe. Il y a des sentiments communs, des ides communes, sans lesquels, comme on dit, on n'est pas un homme. La rgle qui nous prescrit de nous spcialiser reste limite par la rgle contraire. Notre conclusion n'est pas qu'il est bon de pousser la spcialisation aussi loin que possible, mais aussi loin qu'il est ncessaire. Quant la part faire entre ces deux ncessits antagonistes, elle se dtermine l'exprience et ne saurait tre calcule a priori. Il nous suffit d'avoir montr que la seconde n'est pas d'une autre nature que la premire, mais qu'elle est elle-mme morale, et que, de plus, ce devoir devient
1
Cependant, il y a peut-tre une autre limite mais dont nous n'avons pas parler, car elle concerne plutt l'hygine individuelle. On pourrait soutenir que, par suite de notre constitution organicopsychique, la division du travail ne peut dpasser une certaine limite sans qu'il en rsulte des dsordres. Sans entrer dans la question, remarquons toutefois que l'extrme spcialisation laquelle sont parvenues les fonctions biologiques ne semble pas favorable cette hypothse. De plus, dans l'ordre mme des fonctions psychiques et sociales est-ce que, la suite du dveloppement historique, la division du travail n'a pas t porte au dernier degr entre l'homme et la femme ? Est-ce que des facults tout entires n'ont pas t perdues par cette dernire et rciproquement ? Pourquoi le mme phnomne ne se produirait-il pas entre individus du mme sexe ? Sans doute, il faut toujours du temps pour que l'organisme s'adapte ces changements ; mais on ne voit pas pourquoi un jour viendrait o cette adaptation deviendrait impossible.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
122
toujours plus important et plus pressant, parce que les qualits gnrales dont il vient d'tre question suffisent de moins en moins socialiser l'individu. Ce n'est donc pas sans raison que le sentiment publie prouve un loignement toujours plus prononc pour le dilettante et mme pour ces hommes qui, trop pris d'une culture exclusivement gnrale, refusent de se laisser prendre tout entiers dans les mailles de l'organisation professionnelle. C'est qu'en effet ils ne tiennent pas assez la socit ou, si l'on veut, la socit ne les tient pas assez, ils lui chappent, et, prcisment parce qu'ils ne la sentent ni avec la vivacit, ni avec la continuit qu'il faudrait, ils n'ont pas conscience de toutes les obligations que leur impose leur condition d'tres sociaux. L'idal gnral auquel ils sont attachs tant, pour les raisons que nous avons dites, formel et flottant, ne peut pas les tirer beaucoup hors d'eux-mmes. On ne tient pas grand-chose quand on n'a pas d'objectif plus dtermin et, par consquent, on ne peut gure s'lever au-dessus d'un gosme plus ou moins raffin. Celui, au contraire, qui s'est donn une tche dfinie est, chaque instant, rappel au sentiment de la solidarit commune par les mille devoirs de la morale professionnelle 1.
II
Mais est-ce que la division du travail, en faisant de chacun de nous un tre incomplet, n'entrane pas une diminution de la personnalit individuelle ? C'est un reproche qu'on lui a souvent adress. Remarquons tout d'abord qu'il est difficile de voir pourquoi il serait plus dans la logique de la nature humaine de se dvelopper en surface qu'en profondeur. Pourquoi une activit plus tendue, mais plus disperse, serait-elle suprieure une activit plus concentre, mais circonscrite ? Pourquoi y aurait-il plus de dignit tre complet et mdiocre, qu' vivre d'une vie plus spciale, mais plus intense, surtout s'il nous est possible de retrouver ce que nous perdons ainsi, Par notre association avec d'autres tres qui possdent ce qui nous manque et qui nous compltent ? On part de ce principe que l'homme doit raliser sa nature d'homme, accomplir son [en grec dans le texte], comme disait Aristote. Mais cette nature ne reste pas constante aux diffrents moments de l'histoire ; elle se modifi avec les socits. Chez les peuples infrieurs, l'acte propre de l'homme est de ressembler ses compagnons, de raliser en lui tous les traits du type collectif que l'on confond alors, plus encore qu'aujourd'hui, avec le type humain. Mais, dans les socits plus avances, sa nature est, en grande partie,
Parmi les consquences pratiques que l'on pourrait dduire de la proposition que nous venons d'tablir, il en est une qui intresse la pdagogie. On raisonne toujours en matire d'ducation comme si la base morale de l'homme tait faite de gnralits. Nous venons de voir qu'il n'en est rien. L'homme est destin remplir une fonction spciale dans l'organisme social et, par consquent, il faut qu'il apprenne par avance jouer son rle d'organe ; car une ducation est ncessaire pour cela, tout aussi bien que pour lui apprendre son rle d'homme, comme on dit. Nous ne voulons pas dire, d'ailleurs, qu'il faille lever l'enfant pour tel ou tel mtier prmaturment, mais il faut lui faire aimer les tches circonscrites et les horizons dfinis. Or, ce got est bien diffrent de celui des choses gnrales et ne peut pas tre veill par les mmes moyens.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
123
d'tre un organe de la socit, et son acte propre, par consquent, est de jouer son rle d'organe. Il y a plus : loin d'tre entame par les progrs de la spcialisation, la personnalit individuelle se dveloppe avec la division du travail. En effet, tre une personne, c'est tre une source autonome d'action. L'homme n'acquiert donc cette qualit que dans la mesure o il y a en lui quelque chose qui est lui, lui seul et qui l'individualise, o il est plus qu'une simple incarnation du type gnrique de sa race et de son groupe. On dira que, en tout tat de came, il est dou de libre arbitre et que cela suffit fonder sa personnalit. Mais, quoi qu'il en soit de cette libert, objet de tant de discussions, ce n'est pas cet attribut mtaphysique, impersonnel, invariable, qui peut servir de base unique la personnalit concrte, empirique et variable des individus. Celle-ci ne saurait tre constitue par le pouvoir tout abstrait de choisir entre deux contraires ; mais encore faut-il que cette facult s'exerce sur des fins et des mobiles qui soient propres l'agent. En d'autres -termes, il faut que les matriaux mmes de sa conscience aient un caractre personnel. Or, nous avons vu dans le second livre de cet ouvrage que ce rsultat se produit progressivement mesure que la division du travail progresse elle-mme. L'effacement du type segmentaire, en mme temps qu'il ncessite une plus grande spcialisation, dgage partiellement la conscience individuelle du milieu organique qui la supporte comme du milieu social qui l'enveloppe et, par suite de cette double mancipation, l'individu devient davantage un facteur indpendant de sa propre conduite. La division du travail contribue elle-mme cet affranchissement ; car les natures individuelles, en se spcialisant, deviennent plus complexes et, par cela mme, sont soustraites en partie l'action collective et aux influences hrditaires qui ne peuvent gure s'exercer que sur les choses simples et gnrales. C'est donc par suite d'une vritable illusion que l'on a pu croire parfois que la personnalit tait plus entire tant que la division du travail n'y avait pas pntr. Sans doute, voir du dehors la diversit d'occupations qu'embrasse alors l'individu, il peut sembler qu'il se dveloppe d'une manire plus libre et plus complte. Mais, en ralit, cette activit qu'il manifeste n'est pas sienne. C'est la socit, c'est la race qui agissent en lui et par lui ; il n'est que l'intermdiaire par lequel elles se ralisent. Sa libert n'est qu'apparente et sa personnalit d'emprunt. Parce que la vie de ces socits est, certains gards, moins rgulire, on s'imagine que les talents originaux peuvent plus aisment s'y faire jour, qu'il est plus facile chacun d'y suivre ses gots propres, qu'une plus large place y est laisse la libre fantaisie. Mais c'est oublier que les sentiments personnels sont alors trs rares. Si les mobiles qui gouvernent la conduite ne reviennent pas avec la mme priodicit qu'aujourd'hui, ils ne laissent pas d'tre collectifs, par consquent impersonnels, et il en est de mme des actions qu'ils inspirent. D'autre part, nous avons montr plus haut comment l'activit devient plus riche et plus intense mesure qu'elle devient plus spciale 1. Ainsi, les progrs de la personnalit individuelle et ceux de la division du travail dpendent d'une seule et mme cause. Il est donc impossible de vouloir les uns sans vouloir les autres. Or, nul ne conteste aujourd'hui le caractre obligatoire de la rgle qui nous ordonne d'tre et d'tre, de plus en plus, une personne.
1
Voir plus haut, p. 255 et suiv. et p. 298.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
124
Une dernire considration va faire voir quel point la division du travail est lie toute notre vie morale.
C'est un rve depuis longtemps caress par les hommes que d'arriver enfin raliser dans les faits l'idal de la fraternit humaine. Les peuples appellent de leurs vux un tat o la guerre ne serait plus la loi des rapports internationaux, o les relations des socits entre elles seraient rgles pacifiquement comme le sont dj celles des individus entre eux, o tous les hommes collaboreraient la mme oeuvre et vivraient de la mme vie. Quoique ces aspirations soient en partie neutralises par celles qui ont pour objet la socit particulire dont nous faisons partie, elles ne laissent pas d'tre trs vives et prennent de plus en plus de force. Or, elles ne peuvent tre satisfaites que si tous les hommes forment une mme socit, soumise aux mmes lois. Car, de mme que les conflits privs ne peuvent tre contenus que par l'action rgulatrice de la socit qui enveloppe les individus, les conflits intersociaux ne peuvent tre contenus que par l'action rgulatrice d'une socit qui comprenne en son sein toutes les autres. La seule puissance qui puisse servir de modrateur l'gosme individuel est celle du groupe ; la seule qui puisse servir de modrateur l'gosme des groupes est celle d'un autre groupe qui les embrasse. A vrai dire, quand on a pos le problme en ces termes, il faut bien reconnatre que cet idal n'est pas la veille de se raliser intgralement ; car il y a trop de diversits intellectuelles et morales entre les diffrents types sociaux qui coexistent sur la terre pour qu'ils puissent fraterniser au sein d'une mme socit. Mais ce qui est possible, c'est que les socits de mme espce s'agrgent ensemble, et c'est bien dans ce sens que parat se diriger notre volution. Dj nous avons vu qu'au dessus des peuples europens tend se former, par un mouvement spontan, une socit europenne qui a, ds prsent, quelque sentiment d'elle-mme et un commencement d'organisation 1. Si la formation d'une socit humaine unique est jamais impossible, ce qui toutefois n'est pas dmontr 2, du moins la formation de socits toujours plus vastes nous rapproche indfiniment du but, Ces faits ne contredisent d'ailleurs en rien la dfinition que nous avons donne de la moralit, car si nous tenons l'humanit et si nous devons y tenir, c'est qu'elle est une socit qui est en train de se raliser de cette manire et dont nous sommes solidaires 3. Or, nous savons que des socits plus vastes ne peuvent se former sans que la division du travail se dveloppe : car non seulement elles ne pourraient se maintenir en quilibre sans une spcialisation plus grande des fonctions, mais encore l'lvation du nombre des concurrents suffirait produire mcaniquement ce rsultat ; et cela, d'autant plus que l'accroissement de volume ne va gnralement pas sans un accroissement de densit. On peut donc formuler la proposition suivante : l'idal de la
1 2
Voir pp. 265-266. Rien ne dit que la diversit intellectuelle et morale des socits doive se maintenir. L'expansion toujours plus grande des socits suprieures d'o rsulte l'absorption ou l'limination des socits moins avances tend, en tout cas, la diminuer. Aussi les devoirs que nous avons envers elle ne priment-ils pas ceux qui nous lient notre patrie. Car celle-ci est la seule socit, actuellement ralise, dont nous fassions partie ; l'autre n'est gure que desideratum dont la ralisation n'est mme pas assure.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
125
fraternit humaine ne peut se raliser que dans la mesure o la division du travail progresse, Il faut choisir : ou renoncer notre rve, si nous nous refusons circonscrire davantage notre activit, ou bien en poursuivre l'accomplissement, mais la condition que nous venons de marquer.
III
Mais si la division du travail produit la solidarit, ce n'est pas seulement parce qu'elle fait de chaque individu un changiste comme disent les conomistes 1; c'est qu'elle cre entre les hommes tout un systme de droits et de devoirs qui les lient les uns aux autres d'une manire durable. De mme que les similitudes sociales donnent naissance un droit et une morale qui les protgent, la division du travail donne naissance des rgles qui assurent le concours pacifique et rgulier des fonctions divises. Si les conomistes ont cru qu'elle engendrait une solidarit suffisante, de quelque manire qu'elle se ft, et si, par suite, ils ont soutenu que les socits humaines pouvaient et devaient se rsoudre en des associations purement conomiques, c'est qu'ils ont cru qu'elle n'affectait que des intrts individuels et temporaires. Par consquent, pour estimer les intrts en conflit et la manire dont ils doivent s'quilibrer, c'est--dire pour dterminer les conditions dans lesquelles l'change doit se faire, les individus seuls sont comptents ; et comme ces intrts sont dans un perptuel devenir, il n'y a place pour aucune rglementation permanente. Mais une telle conception est, de tous points, inadquate aux faits. La division du travail ne met pas en prsence des individus, mais des fonctions sociales. Or, la socit est intresse au jeu de ces dernires : suivant qu'elles concourent rgulirement ou non, elle sera saine ou malade. Son existence en dpend donc, et d'autant plus troitement qu'elles sont plus divises. C'est pourquoi elle ne peut les laisser dans un tat d'indtermination, et d'ailleurs elles se dterminent d'elles-mmes. Ainsi se forment ces rgles dont le nombre s'accrot mesure que le travail se divise et dont l'absence rend la solidarit organique ou impossible ou imparfaite. Mais il ne suffit pas qu'il y ait des rgles, il faut encore qu'elles soient justes et, pour cela, il est ncessaire que les conditions extrieures de la concurrence soient gales. Si, d'autre part, on se rappelle que la conscience collective se rduit de plus en plus au culte de l'individu, on verra que ce qui caractrise la morale des socits organises, compare celle des socits segmentaires, c'est qu'elle a quelque chose de plus humain, partant, de plus rationnel. Elle ne suspend pas notre activit des fins qui ne nous touchent pas directement ; elle ne fait pas de nous les serviteurs de puissances idales et d'une tout autre nature que la ntre, qui suivent leurs voies propres sans se proccuper des intrts des hommes. Elle nous demande seulement d'tre tendres pour nos semblables et d'tre justes, de bien remplir notre tche, de travailler ce que chacun soit appel la fonction qu'il peut le mieux remplir, et reoive le juste prix de ses efforts. Les rgles qui la constituent n'ont pas une force contraignante qui touffe le libre examen ; mais parce qu'elles sont davantage faites pour nous et, dans un certain sens, par nous, nous sommes plus libres vis--vis d'elles. Nous voulons les comprendre, et nous craignons moins de les changer. Il faut se garder, d'ailleurs, de trouver insuffisant un tel idal sous prtexte qu'il est trop
1
Le mot est de M. de MOLINARI, La morale conomique, p. 248.
mile Durkheim (1893), De la division du travail social : livres II et III
126
terrestre et trop notre porte. Un idal n'est pas plus lev parce qu'il est plus transcendant, mais parce qu'il nous mnage de plus vastes perspectives. Ce qui importe, ce n'est pas qu'il plane bien haut au-dessus de nous, au point de nous devenir tranger, mais c'est qu'il ouvre notre activit une assez longue carrire, et il s'en faut que celui-ci soit la veille d'tre ralis. Nous ne sentons que trop combien c'est une oeuvre laborieuse que d'difier cette socit o chaque individu aura la place qu'il mrite, sera rcompens comme il le mrite, o tout le monde, par suite, concourra spontanment au bien de tous et de chacun. De mme, une morale n'est pas au-dessus d'une autre parce qu'elle commande d'une manire plus sche et plus autoritaire, parce qu'elle est plus soustraite la rflexion. Sans doute, il faut qu'elle nous attache autre chose que nous-mmes ; mais il n'est pas ncessaire qu'elle nous enchane jusqu' nous immobiliser. On a dit 1 avec raison que la morale, - et par l il faut entendre non seulement les doctrines, mais les murs, - traversait une crise redoutable. Ce qui prcde peut nous aider comprendre la nature et les causes de cet tat maladif. Des changements profonds se sont produits, et en trs peu de temps, dans la structure de nos socits ; elles se sont affranchies du type segmentaire avec une rapidit et dans des proportions dont on ne trouve pas un autre exemple dans l'histoire. Par suite, la morale qui correspond ce type social a rgress, mais sans que l'autre se dveloppt assez vite pour remplir le terrain que la premire laissait vide dans nos consciences. Notre foi s'est trouble ; la tradition a perdu de son empire ; le jugement individuel s'est mancip du jugement collectif. Mais, d'un autre ct, les fonctions qui se sont dissocies au cours de la tourmente n'ont pas eu le temps de s'ajuster les unes aux autres, la vie nouvelle qui s'est dgage comme tout d'un coup n'a pas pu s'organiser compltement, et surtout ne s'est pas organise de faon satisfaire le besoin de justice qui s'est veill plus ardent dans nos curs. S'il en est ainsi, le remde au mal n'est pas de chercher ressusciter quand mme des traditions et des pratiques qui, ne rpondant plus aux conditions prsentes de l'tat social, ne pourraient vivre que d'une vie artificielle et apparente. Ce qu'il faut, c'est faire cesser cette anomie, c'est trouver les moyens de faire concourir harmoniquement ces organes qui se heurtent encore en des mouvements discordants, c'est introduire dans leurs rapports plus de justice en attnuant de plus en plus ces ingalits extrieures qui sont la source du mal. Notre malaise n'est donc pas, comme on semble parfois le croire, d'ordre intellectuel ; il tient des causes plus profondes. Nous ne souffrons pas parce que nous ne savons plus sur quelle notion thorique appuyer la morale que nous pratiquions jusqu'ici ; mais parce que, dans certaines de ses parties, cette morale est irrmdiablement branle, et que celle qui nous est ncessaire est seulement en train de se former. Notre anxit ne vient pas de ce que la critique des savants a ruin l'explication traditionnelle qu'on nous donnait de nos devoirs et, par consquent, ce n'est pas un nouveau systme philosophique qui pourra jamais la dissiper; mais c'est que, certains de ces devoirs n'tant plus fonds dans la ralit des choses, il en est rsult un relchement qui ne pourra prendre fin qu' mesure qu'une discipline nouvelle s'tablira et se consolidera. En un mot, notre premier devoir actuellement est de nous faire une morale. Une telle oeuvre ne saurait s'improviser dans le silence du cabinet ; elle ne peut s'lever que d'elle-mme, peu peu, sous la pression des causes internes qui la rendent ncessaire. Mais ce quoi la rflexion peut et doit servir, c'est marquer le but qu'il faut atteindre. C'est ce que nous avons essay de faire.
Voir BEAUSSIRE, Les principes de la morale, Introduction.
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Courants PédagogiquesDocument5 pagesLes Courants PédagogiquesMohamed Bendaoud100% (2)
- Le Colonialisme Est Un SystèmeDocument12 pagesLe Colonialisme Est Un Systèmechiswick59Pas encore d'évaluation
- Démocratie Bruno BernardiDocument14 pagesDémocratie Bruno BernardiveraPas encore d'évaluation
- Fiche 1-Liens Sociaux Dans Une Société IndividualisteDocument7 pagesFiche 1-Liens Sociaux Dans Une Société IndividualisteMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Violence Symbolique Gerard MaugerDocument22 pagesViolence Symbolique Gerard MaugerCintiaLucilaMPas encore d'évaluation
- De La Conduite Du Changement Organisationnel À La Co-Construction Du RôleDocument605 pagesDe La Conduite Du Changement Organisationnel À La Co-Construction Du RôleMajdouline FarazdagPas encore d'évaluation
- Lascoumes La Sociologie de L Action PublDocument123 pagesLascoumes La Sociologie de L Action PublAudrey SzymanowiczPas encore d'évaluation
- Sociologie Française PDFDocument21 pagesSociologie Française PDFAnonymous QModKrPas encore d'évaluation
- Lecole de Demain Entre Mooc Et Classe InverseeDocument7 pagesLecole de Demain Entre Mooc Et Classe InverseeLüiz Winthröp HërnandëzPas encore d'évaluation
- INTRODUCTION A LA SOCIOLOGIE (Cours 1er Niveau)Document8 pagesINTRODUCTION A LA SOCIOLOGIE (Cours 1er Niveau)Hamoutni MohamedPas encore d'évaluation
- AcculturationDocument5 pagesAcculturationArno PatyPas encore d'évaluation
- Aide Carnet TerrainDocument5 pagesAide Carnet TerrainClaude SpPas encore d'évaluation
- Le Développement Durable Comme Compromis La Modernisation Écologique de Léconomie À Lère de La Mondialisation by Corinne GendronDocument292 pagesLe Développement Durable Comme Compromis La Modernisation Écologique de Léconomie À Lère de La Mondialisation by Corinne GendronTaro Barké SouleymanePas encore d'évaluation
- L'impact de Covid-19 Sur Les Systèmes ÉducatifsDocument9 pagesL'impact de Covid-19 Sur Les Systèmes ÉducatifsSiham BelhajPas encore d'évaluation
- 1 - La SociologieDocument6 pages1 - La SociologieAmine BenslimanePas encore d'évaluation
- Réseaux Sociaux Et Structures Relationnelles - Emmanuel LazegaDocument185 pagesRéseaux Sociaux Et Structures Relationnelles - Emmanuel LazegaSelim Ben CheikhPas encore d'évaluation
- Eduquer Et Instruire A L'argumentation Les AdoDocument373 pagesEduquer Et Instruire A L'argumentation Les AdoJustin-Gratien Muzigwa Kashema100% (1)
- Ouellet 2011 - Mutations Du Politique Et Capitalisme PDFDocument134 pagesOuellet 2011 - Mutations Du Politique Et Capitalisme PDFames12345Pas encore d'évaluation
- Suzanne Husson: REVETIR LA VIE DES CHIENSDocument10 pagesSuzanne Husson: REVETIR LA VIE DES CHIENSno noPas encore d'évaluation
- Litteratures Sud 9782813000132Document267 pagesLitteratures Sud 9782813000132Ferdinand Tayamaou Egue100% (1)
- Durkheim (1892) de La Division Du Travail Social IDocument162 pagesDurkheim (1892) de La Division Du Travail Social IFederico Lorenc ValcarcePas encore d'évaluation
- Durkheim - de La Div Du Travl Soc IDocument206 pagesDurkheim - de La Div Du Travl Soc IJulio Santos FilhoPas encore d'évaluation
- Fiche 211 - L'Actualité de L'analyse de La Solidarité de DurkheimDocument4 pagesFiche 211 - L'Actualité de L'analyse de La Solidarité de DurkheimMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- S2.1 Les Liens Sociaux Dans Les... - Elève PDFDocument62 pagesS2.1 Les Liens Sociaux Dans Les... - Elève PDFjayseseckPas encore d'évaluation
- Exercices Chapitre 9Document11 pagesExercices Chapitre 9Rija Angelo RakotomanantsoaPas encore d'évaluation
- Thème 211 - Actualité de L'analyse de DurkheimDocument20 pagesThème 211 - Actualité de L'analyse de DurkheimMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Durkheim, Qu'Est-ce Qu'Un Fait SocialDocument4 pagesDurkheim, Qu'Est-ce Qu'Un Fait SocialGros Caca Liquide100% (1)
- Thème 1 - Les Liens SociauxDocument36 pagesThème 1 - Les Liens SociauxMme et Mr Lafon100% (2)
- Thème 211 - Liens Dans Les Sociétés ModernesDocument20 pagesThème 211 - Liens Dans Les Sociétés ModernesMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Emile Durkheim, Les Règles de La Méthode SociologiqueDocument7 pagesEmile Durkheim, Les Règles de La Méthode SociologiqueDuvivierPas encore d'évaluation
- Fiche 1 - Comment Analyser Les Conflits SocaiuxDocument6 pagesFiche 1 - Comment Analyser Les Conflits SocaiuxMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- SFGSDFGSDGDocument148 pagesSFGSDFGSDGasfdsadasdfPas encore d'évaluation
- Fiche 2211 - Conflit Social Pathologie Ou IntégrateurDocument3 pagesFiche 2211 - Conflit Social Pathologie Ou IntégrateurMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Fiche 211 - Les Fondements Des Liens Sociaux Dans Les Sociétés ModernesDocument4 pagesFiche 211 - Les Fondements Des Liens Sociaux Dans Les Sociétés ModernesMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Le Cour de La CriminologieDocument5 pagesLe Cour de La CriminologieNoureddine Abatourab25% (4)
- Lien Social Et Intégration Fiche de Cours - SES SchoolMouvDocument1 pageLien Social Et Intégration Fiche de Cours - SES SchoolMouvKimberley BoulayPas encore d'évaluation
- FDGHFHGDocument149 pagesFDGHFHGasfdsadasdfPas encore d'évaluation
- Cohésion Sociale - 1609082891259 PDFDocument7 pagesCohésion Sociale - 1609082891259 PDFAli MaimounaPas encore d'évaluation
- Thème 211 - Les Liens SociauxDocument37 pagesThème 211 - Les Liens SociauxMme et Mr Lafon100% (1)
- Quels Liens Sociaux Dans Les Sociétés IndividualistesDocument31 pagesQuels Liens Sociaux Dans Les Sociétés IndividualistesMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Durkheim (1899), Deux Lois de L'évolution PénaleDocument27 pagesDurkheim (1899), Deux Lois de L'évolution Pénalejuanmarquez2012Pas encore d'évaluation
- CM - Sociologie de L'organisation Et de L'institutionDocument23 pagesCM - Sociologie de L'organisation Et de L'institutionnassim.barek94Pas encore d'évaluation
- DurheimDocument12 pagesDurheimMichaël Nze MinkoePas encore d'évaluation
- Thème 221 - Comment Analyser Les Conflits SociauxDocument28 pagesThème 221 - Comment Analyser Les Conflits SociauxMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Thème 3.2 - Quels Sont Les Processus Qui Conduisent À La DévianceDocument29 pagesThème 3.2 - Quels Sont Les Processus Qui Conduisent À La DévianceMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Sociologie de La ComDocument5 pagesSociologie de La Comdylanales99Pas encore d'évaluation
- Science PolitiqueDocument21 pagesScience Politiqueanastasiagallouet63Pas encore d'évaluation
- Devoir DurkheimDocument4 pagesDevoir DurkheimMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Introduction À La Sociologie VIIIDocument14 pagesIntroduction À La Sociologie VIIIHürrem KIPIRTIPas encore d'évaluation
- Thème 1 - Comment Analyser Les Conflits SociauxDocument27 pagesThème 1 - Comment Analyser Les Conflits SociauxMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Support 01Document10 pagesSupport 01DohPas encore d'évaluation
- Correctionthème 211 - Actualité de L'analyse de DurkheimDocument27 pagesCorrectionthème 211 - Actualité de L'analyse de DurkheimMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- L'influenceDocument9 pagesL'influenceÀbdêr Rãhmänę WtPas encore d'évaluation
- Thème 2 - Le Conflit Social Pathologie Ou Facteur de Cohésion SocialeDocument22 pagesThème 2 - Le Conflit Social Pathologie Ou Facteur de Cohésion SocialeMme et Mr Lafon100% (1)
- Résumé Pour Examen-Sociologie GénéraleDocument4 pagesRésumé Pour Examen-Sociologie GénéraleUxia RojoPas encore d'évaluation
- TH 7 Deviance 2122Document3 pagesTH 7 Deviance 2122adamovlinaPas encore d'évaluation
- DeviancesDocument30 pagesDeviancesBRAKNESSPas encore d'évaluation
- Sociologie SynthèseDocument2 pagesSociologie SynthèseMaxime PenetPas encore d'évaluation
- Les Principales Définitions en SociologieDocument3 pagesLes Principales Définitions en SociologieANISSA BARADAPas encore d'évaluation
- Q3 Synthese EleveDocument1 pageQ3 Synthese EleveArthur SandrettoPas encore d'évaluation
- Discours Sur Les Sciences Et Les Arts Rousseau Jean-JacquesDocument82 pagesDiscours Sur Les Sciences Et Les Arts Rousseau Jean-JacquesjeanlucboutinPas encore d'évaluation
- Rapport: Séance3Document4 pagesRapport: Séance3Sara RimasPas encore d'évaluation
- Résumé Méthodologie Et Épistémologie de La RechercheDocument20 pagesRésumé Méthodologie Et Épistémologie de La RechercheYassine BoudiPas encore d'évaluation
- Etat Des Evaluations Non Remplies EVAL 1 - TRIM 3Document9 pagesEtat Des Evaluations Non Remplies EVAL 1 - TRIM 3ESSOME ESSOME OLIVIER STEPHANEPas encore d'évaluation
- Linguistique Générale, Langage, Langue, Parole - Définitions, RéflexionsDocument4 pagesLinguistique Générale, Langage, Langue, Parole - Définitions, Réflexionsdemetrios2017100% (1)
- Re SumeDocument8 pagesRe Sumeeln89203Pas encore d'évaluation
- Culture Scientifique Cours de Pascal MarchandDocument7 pagesCulture Scientifique Cours de Pascal Marchandbeebac2009Pas encore d'évaluation
- Feuilletage 992Document16 pagesFeuilletage 992Ricky CharlotPas encore d'évaluation
- Corrigé Série 1 GMDocument5 pagesCorrigé Série 1 GMImad IgrekPas encore d'évaluation
- L'etude Du SonDocument416 pagesL'etude Du SonPatrick NjikePas encore d'évaluation
- Voilà Pourquoi Il Est Interdit Au Noir Africain de Fouiller Dans Son Passé Kamite Partie IDocument3 pagesVoilà Pourquoi Il Est Interdit Au Noir Africain de Fouiller Dans Son Passé Kamite Partie INinsemond RoyPas encore d'évaluation
- N.Iorga Etudes Byzantines II.-Bucarest 1940 PDFDocument432 pagesN.Iorga Etudes Byzantines II.-Bucarest 1940 PDFnusret100% (1)
- TariqDocument6 pagesTariqsingkin2 KaraokéPas encore d'évaluation
- Constat de Vérificatione BALANCE 2011Document4 pagesConstat de Vérificatione BALANCE 2011mebarkiPas encore d'évaluation
- Programme Du SéminaireDocument3 pagesProgramme Du SéminaireDikra DahmanePas encore d'évaluation
- Figura Rapport Annuel 2015-2016 0Document253 pagesFigura Rapport Annuel 2015-2016 0Younes MTLPas encore d'évaluation
- Cours 1 Socio UrbaineDocument7 pagesCours 1 Socio UrbaineAida AmraniPas encore d'évaluation
- Theories Des OrganisationsDocument25 pagesTheories Des OrganisationsStanley Cool Diamond JeudyPas encore d'évaluation
- La Révolution (Tome 8)Document294 pagesLa Révolution (Tome 8)IHS_MAPas encore d'évaluation
- Le - Mythe Dans La Psychologie PrimitiveDocument41 pagesLe - Mythe Dans La Psychologie PrimitivebrandonbenqPas encore d'évaluation
- Gaume - Traité Du Saint-EspritDocument776 pagesGaume - Traité Du Saint-EspritGuineweta100% (1)
- Eugenio Mauri: Goal Directed Requirements Acquisition (KAOS) Knowledge Acquisition in Automated SpecificationDocument19 pagesEugenio Mauri: Goal Directed Requirements Acquisition (KAOS) Knowledge Acquisition in Automated SpecificationEugenioMauriPas encore d'évaluation
- Rfse 006 0175Document9 pagesRfse 006 0175pablo aravenaPas encore d'évaluation
- Cours Mouvement ForceDocument5 pagesCours Mouvement ForceProtoproutePas encore d'évaluation
- Introduction - Anthropologie Tripartite ChrétienneDocument2 pagesIntroduction - Anthropologie Tripartite Chrétiennee2a8dbaePas encore d'évaluation
- Innovation TechnologiqueDocument277 pagesInnovation Technologiquekendy zertPas encore d'évaluation
- Desertion of Science in Senegal and The Question of Gender in The Particular Case of The 12th Grade S1Document18 pagesDesertion of Science in Senegal and The Question of Gender in The Particular Case of The 12th Grade S1International Journal of Recent Innovations in Academic ResearchPas encore d'évaluation
- Reg LementDocument9 pagesReg LementAymen ChtaraPas encore d'évaluation