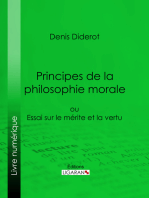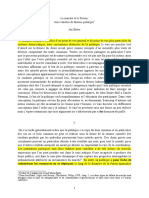Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
ACCARDO La Colère Du Juste
ACCARDO La Colère Du Juste
Transféré par
Elodie Tuaillon-Hibon0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
25 vues44 pagesTitre original
ACCARDO la colère du juste
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
25 vues44 pagesACCARDO La Colère Du Juste
ACCARDO La Colère Du Juste
Transféré par
Elodie Tuaillon-HibonDroits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 44
La colre du juste
Notre colre contre linjustice
est toujours intacte.
Appel des Rsistants,
avril :cc
Par bien des aspects, les textes de Libertad rassembls dans
ce volume peuvent paratre dats, en rapport avec des
vnements et des problmes appartenant une poque
rvolue et ne leur laissant quun intrt purement histo-
rique et documentaire. On peut mme tre assur que
leur rdition passera, aux yeux de nos augures moder-
nistes, supposer quils y prtent attention, pour lexhu-
mation archologique de vestiges poudreux tmoignant
dune vision primitive et compltement prime de la
ralit sociale.
En effet, dans le climat de consensus rpublicain et
deuro-conformisme artificieusement entretenu par les
puissances publiques et prives, dont tous les discours sont
marqus au coin du politiquement correct, dont toutes les
dclarations sont soigneusement dbarrasses de la moindre
asprit conceptuelle et dont toutes les penses sont ren-
dues molles, lisses et finalement interchangeables force
de platitude technocratique, de prudence rhtorique et
dextnuation de la conviction, il nest pas douteux quune
personnalit sexprimant la faon dun Libertad serait
alain accardo
immdiatement taxe par les commentateurs dimpolitesse,
de mauvais got, de brutalit, d extrmisme populiste
et de quelques autres vices rdhibitoires attestant tous son
insigne archasme idologique.
Il faut reconnatre que, tant par leur contenu que par
leur style expressif, les dclarations de Libertad contras-
tent singulirement avec celles que lon peut entendre ou
lire le plus souvent aujourdhui, dans un dbat (ou plutt
un concert) marqu par la volont deuphmiser lextrme
la violence des rapports sociaux et o, lexception de
quelques voix discordantes, nos lites dirigeantes et culti-
ves, rompues au bavardage mdiatique, rivalisent dans
lart de dlayer, destomper, ddulcorer, de ne jamais appe-
ler chat un chat et finalement de beaucoup parler pour
dire tout sur des riens sans rien dire sur le tout. On conoit
que pour un public abreuv ad nauseam de cette bibine
tidasse ruisselant d peu prs toutes les chaires et toutes
les tribunes, depuis celles des ditorialistes de presse jus-
qu celles du Parlement, en passant par celles des prdi-
cateurs religieux ou des experts de service, la prose en
fusion de Libertad fasse leffet dune brlure intense et
probablement insupportable pour certains.
Libertad tait anarchiste mais, nous allons le voir, il nest
pas ncessaire dtre de sa chapelle non seulement pour
comprendre, mais pour partager son sentiment sur nombre
de points. En le lisant, ce qui nous a paru intressant, au-
del de la question, que nous laisserons aux spcialistes, de
savoir quels sont exactement sa place et son poids dans la
tradition anarchiste en particulier et plus largement dans
le mouvement social de son temps, cest quil incarne, avec
ses limites et ses contradictions propres, la faon dun
personnage romanesque balzacien ou flaubertien, un type
social, celui du juste , dont nous voudrions esquisser ici
un portrait. Il nous parat significatif cet gard que, dans
Les Cloches de Ble, Aragon lui ait mnag une apparition :
peu sympathique apparemment aux yeux du communiste,
le personnage, par son relief et sa consistance, sest impos
lattention du romancier.
* *
*
Ce qui frappe dabord chez Libertad, cest quil tient des
propos sans complaisance et parfois pnibles entendre.
Non tant par provocation que parce quil parle de choses
terribles voir. Quelles horreurs hors du commun
dnonce-t-il qui justifient ses outrances verbales ? En
fait, ce qui dclenche les foudres de limprcateur, ce nest
rien que le tableau le plus ordinaire et le plus constant, celui
du monde qui lenvironne quotidiennement et dont cha-
cun peut, comme lui, avoir le spectacle : Les accidents,
la maladie, la misre, avec, pour les entretenir, les haines
entre les pauvres, les haines entre nations. [infra, p. :,]
Quoi, dira-t-on, ce nest que cela ? Mais cest vieux
comme le monde ! Il ny a vritablement l ni sujet nou-
veau ni motif sortir de ses gonds et jeter feu et flammes,
comme il le fait avec dlectation. Sans doute les socits
humaines sont-elles loin dtre parfaites. La ntre ne lest
pas, hlas, et ses dfauts appellent de svres critiques, mais
il en est de pires et on ne saurait honntement mconnatre
ses bons cts et ses agrments. Une attitude moralement
juste et intellectuellement saine ne consiste-t-elle pas sef-
forcer, avec patience et ralisme, den tendre les avantages
et den rduire les inconvnients, au lieu de tout condam-
ner uniformment et de fulminer des anathmes ? Ny a-
t-il pas quelque chose de dmesur et par l dinsens dans
cette fureur sans nuance qui noircit tout et npargne pas
plus les victimes que leurs perscuteurs ?
Cest vrai, la misre et linjustice sont vieilles comme le
monde, mais leur anciennet entrane-t-elle quon doive
en tre moins indign et moins press dy mettre un
terme ? Il sagit l dun vieux dbat, qui peut paratre
dpass certains, et qui pourtant conserve son actualit :
la colre du juste ,
celui qui oppose, en matire de transformation sociale, les
tenants de la rformation progressive et continue de lordre
tabli aux partisans de la rupture franche et radicale avec
celui-ci. Pour les uns, il est prfrable de prendre son
temps, pour grer et amnager lexistant sans hte ni
secousse; pour les autres, on na que trop attendu et, mme
si on ne peut jamais, en toute rigueur, du pass faire table
rase , il est devenu urgent de subvertir et de changer en
profondeur ce qui est. Mais bien avant que cette opposi-
tion fondamentale ne prenne la forme moderne dans
laquelle elle a t exprimente, thorise et institution-
nalise, bien avant que les notions mmes de rvolution
et de rforme ne viennent structurer explicitement la
pense et laction politiques, on peut les voir luvre,
tantt en filigrane et implicitement, tantt sous des
habillages spcifiques (religieux, culturels ou autres), dans
lhistoire de la plupart des socits de classes
1
.
Aussi loin que lon remonte dans lhistoire des luttes
sociales, en face de lattitude dacceptation plus ou moins
rsigne, voire de collaboration plus ou moins enthousiaste,
qui est gnralement celle du plus grand nombre, on voit
se manifester une attitude de refus catgorique et mme de
rbellion dclare contre lordre tabli, qui est gnrale-
ment le fait dune minorit plus ou moins claire intel-
lectuellement et moralement. Nous parlons ici dune
volont de rupture radicale avec les principes mmes de
lorganisation sociale en place et pas seulement dun dsir
de changement limit telles de leurs consquences. Le
dsir de rformes ponctuelles est en effet une chose large-
ment rpandue, mme chez les plus conservateurs. Un peu
alain accardo :c
1. On peut dire cet gard que le couple rforme/rvolution thmatise
dans sa forme moderne lopposition sculaire et irrductible entre deux
rapports au monde socialement conditionns, deux visions existentielles
fondamentales (peut-tre le terme philosophique de Weltanschauung
serait-il plus appropri ici) de la ralit sociale et plus prcisment des struc-
tures de domination qui ont fait et font encore universellement et de faon
prpondrante la substance de cette ralit.
de mcontentement y suffit. Aussi lattitude rformiste
sest-elle manifeste sous une forme ou une autre, y com-
pris de faon violente et explosive (rvoltes, meutes, jac-
queries, etc.), un moment ou un autre, dans toutes les
socits historiques, o elle na cess dtre un des moteurs
du changement social. Mais dun changement qui, en tout
tat de cause, ne remet pas sciemment en question les prin-
cipes de fonctionnement des rapports sociaux existants et
reste encadr, matris ou impuls par les institutions
rgnantes, sans quau bout du compte le pouvoir chappe
aux mains de groupes nantis fermement retranchs dans
leurs privilges. Ce qui explique quaujourdhui encore les
partis de droite et les organisations patronales puissent aussi
rclamer des rformes . En revanche, lorsque le dsir de
changement vise la racine mme des choses et touche aux
principes fondamentaux, on passe un tout autre registre.
Ce nest plus seulement de rforme quil sagit mais de rvo-
lution. Il va de soi que tous ceux qui ont partie lie avec
lordre tabli et ils sont toujours plus nombreux quon
ne pense acceptent la rigueur de lamender mais pas dy
mettre fin. Aussi y a-t-il toujours deux manires de main-
tenir lordre des choses : la mthode conservatrice qui
consiste verrouiller le statu quo et la mthode rformiste
qui consiste concder pour mieux prserver.
Que le rejet radical du monde existant ne soit, gnra-
lement, que le fait dun petit nombre, voil qui est attest
depuis trs longtemps, ne serait-ce qu travers des mythes
fondateurs, comme ceux que nous rapporte lAncien
Testament, o on peut lire, au chapitre de la Gense, que
Sodome et Gomorrhe furent ananties par la colre divine,
faute de pouvoir aligner non pas cinquante justes , ni
trente, ni mme vingt, mais dix seulement de leurs habi-
tants qui nauraient pas sombr eux aussi dans lignomi-
nie et liniquit o se vautraient leurs concitoyens. Bien
sr, mme sil est douteux quon ait jamais t en mesure
de recenser exactement le nombre des justes dans une
population, ce que lon a constamment observ, cest que
la colre du juste ::
leurs effectifs taient et restent infiniment moindres que
ceux des gens qui, des degrs et des titres divers, sac-
commodent passivement de ltat de choses existant, quand
ils ne sen font pas les promoteurs actifs.
Pour viter tout malentendu sur ce point, sans doute
est-il utile de rappeler quil existe diffrentes faons de
refuser la soumission lordre tabli et que toutes les
formes de refus ne sont pas moralement quivalentes. La
seule ici qui nous intresse, cest prcisment celle du
juste , ce terme tant pris dans sa plus large acception,
la fois religieuse et laque, pour dsigner celui ou celle
qui, ses risques et prils, ose sopposer au cours ordinaire des
choses, par fidlit une ide plus haute, intellectuellement
plus exigeante et moralement plus gnreuse, de la justice
donc au nom dun bien commun plus universel et non
pas pour des raisons de convenance personnelle ou pour
servir des intrts partisans.
Lordre tabli a coutume de se dfendre en entretenant
la confusion, en traitant uniformment tous les trublions
comme des ennemis du genre humain et en frappant avec
la mme svrit ceux qui sortent de la lgalit par le haut,
pour la dpasser, et ceux qui en sortent par le bas, parce
quelle les dpasse. Tous des hors-la-loi , des voyous ,
des terroristes ! Spartacus ou Jsus sont crucifis comme
des larrons parmi dautres, Socrate est incarcr et jug
comme un criminel, Che Guevara est traqu et abattu
comme un bandit et les opposants politiques des dicta-
tures sont emprisonns avec la pgre. Un tel amalgame a
une utilit pratique vidente, mais il est dpourvu de toute
justification thorique, mme si dans la ralit empirique
on peut constater quentre les deux types extrmes de la
transgression (par surcrot de sens moral) et de linfraction
(par anesthsie morale) il y a place pour toute une gamme
de comportements dviants et dattitudes interm-
diaires dont il est parfois difficile de dmler dans quelle
mesure ils visent luniversel et dans quelle mesure ils
servent le particulier ou, plus difficile encore, de discerner
alain accardo ::
comment en servant lun ils peuvent atteindre lautre. Mais
il nest pas dans notre propos dexaminer maintenant cet
aspect de la question.
Ce que nous retenons en loccurrence, cest quil existe
une dmarche de contestation et de refus de linjustice du
monde social, dinspiration morale, qui est inhrente les-
sence mme de la vie en socit et continment atteste
au long des sicles, du moins dans les socits structures
par des rapports de domination entre groupes et entre indi-
vidus. Il sagit l dune sorte dinvariant structural, li au
fait que ces dominations sociales, indpendamment mme
de la question de leur lgitimit, ne peuvent stablir et se
maintenir quau prix de terribles dommages et de cruelles
douleurs et quelles conduisent certaines de leurs victimes
sinsurger, dabord pour crier quelles ont mal et que cest
assez de souffrance. Ensuite, il arrive que ce cri, chez cer-
tains, se prolonge en une question : De quel droit nous
fait-on du mal ? Au nom de quoi devons-nous lendurer ?
La porte est alors ouverte la critique sociale. Il y a des
chances en effet quun questionnement de cette nature
dbouche sur le constat que le monde est mal fait et
que la source de tous les maux est inhrente une organi-
sation sociale dfectueuse, des institutions iniques, des
pouvoirs arbitraires, des murs corrompues, etc. Plus exac-
tement, du fait du naturalisme anthropologique propre
aux idologies religieuses et philosophiques qui ont histo-
riquement prvalu dans les socits de classes, on a long-
temps considr que les maux de la socit avaient pour
origine les tares, les vices et autres imperfections, inscrits
dans la nature humaine . Le monde social tait jug
mauvais parce que la socit ntait perue que comme un
agrgat dindividus, et dindividus intrinsquement vicieux
(ou vicis). Le mal tait dans la socit parce quil tait
dabord, par essence (ou naissance), dans les individus. En
consquence, la critique sociale ne sadressait pas ce qui
est spcifiquement social (par exemple les conditions dexis-
tence, la structure de rpartition des capitaux conomiques
la colre du juste :,
et culturels, les modles de pouvoir, etc.) mais elle a com-
menc par tre une critique ad hominem, sadressant cer-
tains, voire tous les membres dune population donne,
pour dnoncer plus ou moins vigoureusement leurs contri-
butions respectives lignominie et liniquit rgnantes
et pour stigmatiser leur mauvaise volont suppose.
Lillustration archtypique de ce genre de critique peut tre
trouve dans la tradition vtro-testamentaire des pro-
phtes dIsral. Il est intressant de constater que, si
maintes reprises les prophtes juifs, comme Ezchiel par
exemple, nont pas craint de dnoncer les fautes et les
crimes commis par les puissants, par les princes et les pas-
teurs du troupeau , dans lensemble il importe de le sou-
ligner , les Esae, Jrmie, Ose, Habacuc et les autres
grandes figures de la ligne prophtique sen prennent
indistinctement tous les membres de la collectivit,
hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, dont
ils stigmatisent et avec quelle implacable violence ver-
bale! les reniements et les indignits partags. Leur rqui-
sitoire ne vise pas seulement les sphres du pouvoir mais
aussi et peut-tre surtout les gens ordinaires et leurs com-
portements de la vie quotidienne, tenus pour galement res-
ponsables de tout ce qui va mal dans la socit et qui
dclenche le courroux divin. Malheur au peuple charg
diniquits, proclame Esae, les petits seront abattus et les
grands seront abaisss.
Cette fonction de critique sociale, quon pourrait appe-
ler fonction prophtique, est loin toutefois dtre lapanage
des prophtes juifs. On la voit sincarner, sous toutes les
latitudes, toutes les poques, dans des individus et des
groupes divers dont le trait commun est de trouver insup-
portable le monde environnant, non pas seulement parce
que celui-ci serait contraire leurs dsirs gostes mais parce
quil ne cesse de profaner, tourner en drision et bafouer
de mille faons, dans la pratique quotidienne, les idaux
les plus sublimes, les principes les plus admirables et les
valeurs les plus sacres, dont on continue hypocritement
alain accardo :
se rclamer pour la parade. Car, au fond, la vocifration
prophtique consiste dabord rappeler ce que chacun sait
et quoi tous acquiescent en principe : une certaine ide
de la dignit humaine et le devoir de la respecter effective-
ment en tout tre et en toutes circonstances, en soi-mme
comme en autrui, conviction do dcoule le cortge des
rgles et obligations que simpose lindividu dcid vivre
moralement et que rsume la formule humaniste selon
laquelle lhomme non seulement ne doit pas tre un loup
pour lhomme mais doit, au contraire, Homo homini res
sacra, tenir son semblable pour sacr.
Malheureusement, comme les rapports sociaux existants
noffrent pas les conditions objectives de ralisation de cette
exigence morale, le juste , qui est conduit assumer la
fonction prophtique, ne peut quentrer en dissidence et
dnoncer le divorce entre les principes affichs et les actes,
dont saccommode lchement limmense majorit de ses
contemporains. La voix du prophte rappelle ces derniers
que si le monde est un abme dinjustices et un ocan de
souffrances, ils y sont tout de mme pour quelque chose,
ne serait-ce que par leur inlassable complaisance, leur pas-
sivit, leur frilosit, leur crainte de sexposer, leur conni-
vence foncire. Chacun sent bien, au fond de soi, que les
reproches du prophte sont justifis. Mais la bonne foi et
linclination lautocritique tant des dispositions peu
cultives, chacun se rassure en accusant le prophte din-
tolrance. Cette accusation, quoique facile et strotype,
ne manque pas dun certain fondement ; toutefois, loin
dtre infamante, elle souligne au contraire ce par quoi le
prophte est un individu hors du commun, au-dessus de
la tartuferie et de la bassesse ambiantes, ce pour quoi il
mriterait dtre glorifi et pris en exemple : il ne tolre
pas, il ne peut plus tolrer lintolrable.
La plupart des gens ne savisent pas que cest grce leur
prtendue vertu de tolrance que la machine sociale
broyer des vies humaines fonctionne continment, avec
autant defficacit. La vritable tolrance est une conqute
la colre du juste :,
difficile de la civilisation et du rationalisme ; et elle est
incompatible avec le mpris de lhumain sous quelque
forme que ce soit. Impliquant le respect des diffrences,
cest une vertu majeure qui concourt la recherche de la
vrit et la prservation de la paix civile, sur toutes les
questions livres larbitraire des seules opinions indivi-
duelles. Malheureusement, la notion est trop souvent
entendue comme une invitation lindiffrence et au refus
du choix. La prtendue tolrance nest plus alors quac-
coutumance et nivellement, relativisme invertbr et inca-
pacit dassumer des responsabilits qui ne sont plus affaire
dopinion fluctuante mais dcoulent des principes fonda-
teurs du pacte social et des valeurs de civilisation aux-
quelles on prtend adhrer. Quand on est en face des
dgts effroyables, matriels et plus encore humains, cau-
ss par la barbarie, le mpris, lavidit, le mensonge et le
dni de justice inscrits dans lordre tabli, dans ses institu-
tions et ses murs, tolrer cest se rendre complice. La seule
excuse que pourraient invoquer les complices, cest leur
inconscience, dautant plus profonde quelle est davantage
favorise par les dominants qui elle profite.
Alors se lvent des prophtes, des justes , des mes qui
ne sont pas encore teintes, des esprits pas encore frapps
de ccit, des curs pas encore blinds et qui crient, pour
eux-mmes et pour tous les autres : Assez, a suffit ! Ils
se rebellent parce quils en ont assez de devoir supporter
linsupportable. Ils sont bout de patience, ils ne peuvent
pas shabituer lhorreur du monde : ils ne peuvent plus
tolrer, composer, pactiser, saccommoder, sarranger, tran-
siger, tre ralistes , reculer pour mieux sauter , faire
la part des choses , faire le dos rond , laisser glisser ,
sen laver les mains , prendre de la hauteur , garder
la mesure , excuter toutes les figures de la dissimulation,
de la trahison et de la veulerie, se taire et vivre comme sils
taient dj morts, en tat de coma spirituel dpass. Ils
ont bu le calice jusqu la lie et leur me a la nause ; elle
dborde de dsenchantement, de tristesse et de dgot. Ils
alain accardo :o
se sentent partags entre une immense compassion et une
intense indignation qui senflamme parfois en fureur
contre eux-mmes et leurs semblables. Ils ont appris voir
les choses comme elles sont, ils regardent dsormais la ra-
lit en face et ils voient sa lpre. la diffrence de leurs
contemporains, ils ne peuvent plus faire semblant ni se
raconter des histoires pour garder bonne conscience, ils ne
dtournent pas les yeux et refusent le divertissement per-
manent auquel ils sont invits de toutes parts. Ils sont ulc-
rs, dfinitivement rvolts, et on ne sait jamais ce qui
domine en eux de la colre ou de la piti.
Bien videmment ils ne sortent pas de terre comme
des champignons . De Weber Bourdieu, la sociologie a
labor les outils ncessaires ltude de leur engendre-
ment. Leur mergence un moment donn, dans une
population donne, est fonction de ltat du champ des
luttes religieuses et politiques, du rapport des forces pour
conserver ou modifier lordre existant, de leurs proprits
positionnelles et de leur trajectoire personnelle. Le fait
quils occupent le plus souvent des positions domines et
appartiennent des groupes mieux pourvus en capital
symbolique quen capital conomique, ayant en cons-
quence, au-del de la morale de leurs intrts, un intrt
certain pour la morale et une disposition protestataire,
nautorise pas invalider leur dmarche et nte rien la
pertinence de leur critique sociale. Quand le consensus le
plus large, celui des intrts gostes, de lavidit de
jouissance, de la vanit, de la lchet et de lhypocrisie, a
rameut au plus bas la multitude des esprits et des curs,
quand lencens slve, mais vers les athltes et les pop
stars, les assoiffs de fric et les rois du crime
1
, alors le
temps des hrtiques et de la rbellion est venu. (Le constat
quils sont gnralement peu nombreux attire lattention
sur des mcanismes sociologiques fondamentaux, ceux de
la colre du juste :;
1. George Steiner, Matres et disciples, Gallimard, 2003, p. 184.
la socialisation et de la conformation des individus, sur
lesquels nous reviendrons un peu plus loin.)
Du coup les gens normaux les tiennent pour des
malades. Certes, le monde tel quil va les rend malades. Les
justes forment une engeance peu la mode, qui souffre
chroniquement dune affection trange, la fois intellec-
tuelle et morale, consistant se vouloir consquents, cest-
-dire prendre au srieux les exigences de leur foi ou de
leur idal et sefforcer dy conformer leurs actes. Ils nont
pas cette capacit de se moquer des principes et dtre illo-
giques, que le scepticisme relativiste, particulirement dans
les priodes de dcadence et danomie, insuffle la plu-
part de leurs contemporains, tous ces habiles prompts
sadapter et trouver des accommodements. Pour un
juste , vivre moralement, cest faire son devoir, quoi quil
en cote, sans ruse ni casuistique. Le devoir snonce
limpratif, pas au conditionnel. On ne le fait pas moi-
ti ni au tiers, on ne le fait pas par intermittence, on ne le
fait pas par procuration, on ne le fait pas de faon facul-
tative, on le fait ou on le nie. Parce quil refuse la demi-
mesure, le juste se voit reprocher davoir perdu toute
mesure ; parce quil excre la tideur, il est accus dtre un
incendiaire ; parce quil rappelle des obligations incon-
tournables, il est dnonc comme liberticide ; parce quil
invoque la puret de lidal originel, sans concession ni
compromission, il est raill comme angliste et nostal-
gique. Bref, au milieu dune socit qui communie au plus
bas, dans la dsinvolture morale et le reniement de ses
engagements, il se retrouve en tat dexcommunication. Au
milieu de ses congnres, il sent quil est devenu un tran-
ger, un barbare, un alien vivant sur une autre plante,
voire un alin mental. Et, par consquent, un gneur.
Do la tentation, si souvent manifeste historiquement,
de faire de ncessit vertu, en loccurrence de faire sces-
sion avec le monde et de se retirer effectivement dune
socit laquelle on nappartient dj plus. Sans doute
limmense arme de ceux qui, de lAntiquit nos jours,
alain accardo :
en Orient comme en Occident, ont adopt les diffrents
modles, religieux ou laques, de la vie extra-mondaine ne
sest-elle pas recrute uniquement parmi les justes en
rupture avec leur socit. Dautres motivations ont pu
entraner ce genre de dmarche sparatiste. Mais il nest pas
douteux que, parmi ces lgions dasctes, dermites, de
moines, de cnobites, de vagabonds ou de marginaux
divers qui ont prfr vivre lcart de leurs contempo-
rains, il y ait eu un grand nombre dhommes et de femmes
pour qui ctait la seule faon concevable de critiquer radi-
calement la socit de leur temps. Des moines bouddhistes
refusant de faire tourner plus longtemps la roue des dsirs,
ou des cyniques comme Diogne, optant pour une vie de
chien, jusquaux disciples dpicure rpudiant lasservisse-
ment aux faux plaisirs, ou aux mules de Franois dAssise
abandonnant tout pour vivre la vie des plus humbles,
autant de refus de donner son adhsion au jeu fallacieux et
corrupteur du monde environnant.
Bien entendu, on vitera de prter anachroniquement
ces insoumis et contempteurs du monde une attitude
politique ou une vision sociologique que la culture de leur
poque rend impensables. Leur dmarche a fondamenta-
lement une vise de salut personnel. Dans cette perspec-
tive, la critique sociale proprement dite ne peut tre
quimplicite et objective, en ce sens que les voies de la vie
spirituelle et de la sagesse sont perues comme rigou-
reusement incompatibles avec lintgration au monde tel
quil est. Il ne sagit pas par consquent de chercher chan-
ger la ralit dun monde temporel irrmdiablement vici
mais de le laisser sa vacuit et son absurdit pour ne
soccuper que de se changer soi-mme par une conversion
de tout son tre. Chacun deux va rptant sa faon :
Mon royaume nest pas de ce monde.
vrai dire, il sagit l dune dmarche extrmement
ambigu, et mme contradictoire, cause de sa double
dimension. En tant quelle est sparation davec le monde
social, elle abandonne celui-ci ses pesanteurs dgradantes.
la colre du juste :,
Mais mme le retrait au dsert pour mener une vie de sty-
lite ou danachorte est encore une faon dexister sociale-
ment, ne serait-ce que par linfluence quon exerce sur des
fidles et les moyens de subsistance quon en tire, et par
lexemple vivant quon propose, qui devient ipso facto une
action pdagogique rformatrice, mme en labsence de
toute intention de rformer. plus forte raison lorsque
cette intention existe, comme on le voit avec vidence dans
le cas dun Franois dAssise, chez qui on trouve conjoin-
tement le rejet radical du monde qui lentoure et la volont
nanmoins dy introduire un nouvel ordre (dans les diverses
acceptions du terme), prcisment en y travaillant faire
reconnatre et institutionnaliser lordre des moines men-
diants qui sest agrg autour de sa personne. Le double
aspect de la scession et de la rformation devint tout fait
vident avec le dveloppement au xvi
e
sicle de lglise
rforme, dont certains membres devaient finalement
pousser la volont de schisme jusqu quitter lEurope pour
tenter de refonder ailleurs une socit nouvelle.
En rsum, on peut donc dire, que, du fait de lincapa-
cit de percevoir la socit comme une ralit spcifique
ne se rduisant pas un ensemble de relations inter-
individuelles, la critique sociale a t pendant des sicles
condamne se cantonner dans la dnonciation des vices
inhrents la nature humaine et ne proposer rien
dautre, en fait de remde tous les maux de la socit, que
le changement des comportements personnels dans le sens
dune ascse du corps et de lesprit et dun dtachement
croissant par rapport aux choses de ce monde.
Il faudrait pouvoir stendre davantage sur cette concep-
tion asctique du changement pour en montrer la part de
bien-fond, qui semble dailleurs connatre aujourdhui un
regain dactualit. dfaut, bornons-nous rappeler quelle
a prvalu jusqu une poque relativement rcente. Plus
prcisment jusqu ce que la philosophie des Lumires et
la Rvolution franaise de :;, imposent lide que, pour
remdier aux maux de la socit, il faut aussi, voire surtout,
alain accardo :c
changer son organisation et donc le pouvoir. Il est cet
gard significatif que cette socit monarchique et curiale,
o les structures de lordre fodal taient depuis longtemps
en voie de dcomposition, ait paru encore intouchable
mme aux esprits les plus indpendants du xvii
e
sicle. On
en trouve une difiante dmonstration, entre autres, dans
le thtre de Molire : celui-ci brosse une peinture peu
flatteuse de certains vices contemporains mais, lorsquil
invente le personnage dAlceste, qui sera sans doute le
porte-parole le plus explicite de sa critique sociale, il nen
fait pas un insurg militant pour une socit nouvelle
mais un misanthrope , cest--dire quelquun qui excre
lessence mme du genre humain. Si Alceste ne peut plus
tolrer les aberrations et les tares du monde qui lentoure,
il continue en imputer les manifestations liniquit de
la nature humaine pour laquelle il professe une immor-
telle haine pour reprendre ses propres termes. Il nima-
gine pas un seul instant quon puisse remdier quelque
chose qui est de lordre de la nature, cest--dire aussi mas-
sif, accablant et imparable quune pidmie de peste ou un
sisme. On sy rsigne ou on sen va. Comme il ne peut
plus sen accommoder, il dcide De chercher sur la terre
un endroit cart / O dtre homme dhonneur on ait la
libert . Ce nest pas quil soit un lche ni quil ait peur ;
mais, ayant pris la mesure du mal, il est convaincu de lina-
nit de tous les efforts pour le combattre ou y remdier.
En consquence, il cherche se mettre non pas tant labri
qu lcart. Il ne veut plus tremper dans la corruption et
limposture gnralises. Conformment la sculaire
dmarche des justes refusant le monde qui les refuse, il
va sexclure lui-mme, prendre ses distances, sortir dun jeu
quil ne supporte plus de jouer. Ctait ce que, prs dun
demi-sicle plus tt, les plerins du Mayflower faisaient
leur faon. Un peu plus dun sicle plus tard, Alceste aurait
eu une autre alternative : non pas le choix entre la com-
promission et la dmission mais entre la soumission et
linsurrection. Encore fallait-il, pour pouvoir crier Aux
la colre du juste ::
armes citoyens ! , laisser aux manufactures le temps de se
dvelopper et la critique rationaliste le temps de
dsacraliser lordre tabli.
* *
*
Libertad, quant lui, tait de ces misanthropes que le
monde social ne cesse dengendrer, mais qui, la diffrence
dAlceste, restent dans la mle et continuent se battre,
vaille que vaille, pour changer la ralit. Entre lpoque
dAlceste et celle de Libertad, plus de deux sicles dhistoire
ont modifi, bien des gards, le rapport des hommes au
monde qui les entourait, en particulier dans les socits
industrialises occidentales, o les aspirations des peuples
la dmocratie staient renforces et o la lutte des classes
battait son plein sous limpulsion dun mouvement ouvrier
dont les organisations politiques et syndicales militaient
ardemment pour une rvolution socialiste. Comme cela
tait sans doute invitable, ce mouvement ouvrier tait,
depuis ses origines au sicle prcdent, travaill en perma-
nence par une dialectique de lidentit et de la diffrence,
de lunion et de la distinction, qui avait pour effet dexa-
cerber les divergences et les clivages de ses diverses com-
posantes. On sait quelles divisions dommageables ces
contradictions ont finalement abouti.
Quoi quil en ft de ces oppositions et tensions au dbut
du xx
e
sicle, lide de la ncessit doprer une rupture dci-
sive, franche, et violente si ncessaire, avec lordre tabli,
cest--dire avec la domination du capital sur le travail, avait
fait son chemin. Les justes de cette poque-l taient
pour beaucoup des rvolutionnaires sociaux qui consid-
raient que la classe ouvrire, classe exploite et opprime
par excellence, tait dsormais lagent historique dun chan-
gement social de grande envergure, et que celui-ci ntait
pas attendre et subir passivement mais organiser de faon
rationnelle et intentionnelle.
alain accardo ::
dire les choses de cette faon, on risque de se can-
tonner dans un registre acadmique dont les possibilits
dexpression restent bien en de de leur objet. En effet,
on ne saurait rendre totalement compte de lentre en
lutte de ceux qui sinsurgent pour plus de justice sans vo-
quer leur capacit de sympathie (ou dempathie) avec la
souffrance dautrui, et singulirement des plus faibles. Qui
na pas prouv personnellement cette douleur profonde
et durable que provoquent chez certains humains non pas
seulement lexprience des injustices et des humiliations
subies mais encore le spectacle de la destruction de leurs
semblables par des conditions dexistence indignes, de leur
crasement impitoyable par les rouages dune organisa-
tion sociale arbitraire, de leur misre, de leur dchance,
de leur dtresse insondable, silencieuse et triste, ne pourra
comprendre tout fait ce que cest qu tre rvolt ni
par consquent ressentir ce qui a fait crier Ezchiel, lever
le poing Spartacus, pleurer Franois dAssise et pouss
tant dautres justes de par le monde refuser leur all-
geance un ordre tabli dont ils auraient pu, comme les
autres, saccommoder tant bien que mal. Cest seulement
sur ce fond de sentiments tacitement partags que le dis-
cours thorique sur lexploitation, les ingalits, loppres-
sion, etc., peut prendre vritablement tout son sens et tout
son impact. Au-del de toute rhtorique, la communica-
tion des consciences suppose que les individus concerns
aient en commun les mmes structures affectives com-
mandant un mme type de rapport au monde existant.
Tout se passe comme si les justes avaient dvelopp la
capacit, hypertrophie chez eux et atrophie chez les
autres, de percevoir clairement et dvaluer exactement les
monstruosits et les abominations inhrentes lorgani-
sation de la socit, cest--dire de les ressentir intens-
ment la fois comme injustifiables sur le plan thorique
et insupportables dans la pratique, sans possibilit de les
euphmiser ni de sy accoutumer si peu que ce soit.
la colre du juste :,
* *
*
Manifestement, Libertad tait de cette famille. Ses ori-
gines, son parcours, ses conditions de vie devaient lavoir
dot de cette hypersensibilit larbitraire de la domina-
tion sociale et au malheur de ses victimes, ce que lon
pourrait appeler l ethos du juste
1
. On lit dans ses textes
lexpression dun dgot incoercible pour le monde.
Parlant des malheureux qui se suicident par familles
entires cause de trop de misre, il devine chez eux on
ne sait quelle nause [qui] monte au cur en face de la
socit [infra, p. :,o]. Nul doute quil ne ressente lui-
mme la lassitude quil leur prte et qui lui fait pro-
noncer cette apostrophe mouvante, digne dun Franois
Villon exprimant sa piti pour les gueux : mes frres
les lasss, mes frres les souffrants [infra, p. :,]
Mais Libertad nest pas homme se laisser accabler par
le spectacle dun monde qui ne peut quinspirer lhorreur
et la compassion quand on lobserve au beffroi de la
misre [infra, p. :,]. Sil y a chez lui quelque chose dun
Snque, une inclination ce taedium vitae [dgot de
la vie] dont parlait le moraliste, il y a davantage encore
dun Tacite, que sa vision pessimiste de lhistoire portait
un odium humani generis [haine du genre humain] ,
la faon dAlceste.
cet gard, on ne saurait tre surpris de constater que,
chez Libertad, la haine du mal social sous toutes ses
formes conduit fustiger avec la mme violence le com-
portement des bourgeois exploiteurs et le comportement
des proltaires exploits dans une veine assez semblable
celle des prophtes juifs qui promettaient le mme chti-
ment aux grands et aux petits, aux riches et aux pauvres,
alain accardo :
1. L ethos est lthique sous sa forme pratique, cest--dire lensemble
des dispositions dun individu ressentir spontanment comme bon ou
mauvais , bien ou mal , les diffrents aspects de son vcu.
tous galement coupables dinfidlit aux commandements
divins. On sait quil sagit l dun des points importants de
doctrine qui opposaient anarchistes et socialistes plus ou
moins scientifiques dans leurs analyses respectives de la
lutte des classes. En schmatisant lextrme, on peut dire
que, pour les socialistes, cause sans doute de linfluence
du point de vue marxiste dans le mouvement ouvrier,
les agents sociaux se classent en fonction dun critre objec-
tif essentiel : la place quils occupent dans les rapports de
production, cest--dire celle de propritaire des moyens
de production et dchange ou bien celle de dtenteur
dune force de travail physique et intellectuelle. En vertu
de la loi de loffre et la demande gouvernant le libre
march du travail, celui-ci est livr pieds et poings lis au
bon vouloir de celui-l qui, press par une impitoyable
concurrence, va lexploiter sans vergogne et sans limite.
Cette opposition irrductible est, selon les socialistes, la
pierre angulaire objective de toute lorganisation sociale. Au
contraire, pour les anarchistes comme Libertad, le critre
de classement est la faon dont les individus se rapportent
personnellement lordre social tabli : ils en sont soit
adversaires et cherchent le dtruire, soit partisans et cher-
chent le prserver, selon la perception que chacun en
prend. De sorte quon peut trouver des bourgeois et des
proltaires dans les deux camps et quil ny a pas de raison
de considrer les uns comme seuls coupables en exonrant
les autres de toute responsabilit. Point de vue scandaleux
aux yeux des socialistes, pour qui cela revient mlanger
les bourreaux et les victimes, et qui sy refusent non pas
seulement en vertu de considrations sentimentales (les cli-
chs romantiques sur le bon peuple vertueux) ou de
stratgie politique sur le terrain des luttes (rassembler les
travailleurs, les mobiliser politiquement), mais aussi parce
que les mcanismes mmes de lexploitation capitaliste sont
censs tablir une ligne de dmarcation bien nette entre
les uns et les autres et quon ne peut se tenir objectivement
des deux cts de la ligne la fois.
la colre du juste :,
En vrit, le point de vue de Libertad ne minimise en
aucune faon ce quil appelle lui-mme latrocit des lois
sociales et conomiques, labsurdit criminelle de la pro-
prit et du salariat [infra, p. :c] ; et il nattnue en rien la
responsabilit des puissants dans tous les maux qui frap-
pent les peuples. Ce nest pas lui qui irait, la faon de tant
de nos journalistes, ranger des problmes sociaux dans la
rubrique des faits divers ou des catastrophes naturelles. Par
exemple, propos de la grande pidmie de cholra de :,c
qui fit dinnombrables victimes, il crivait : Gouvernants
conomiques et politiques, financiers et lgislateurs, vous
avez dchan le cholra sur lhumanit ; ce sont vos lois
mauvaises, cest votre pret au gain, vos dsirs de jouis-
sance jamais calms qui font que des millions dhommes
sont la proie dsigne de lpidmie. [infra, p. c,] Mais,
dans cette circonstance comme en toute autre, il dnonce
conjointement la part de responsabilit qui incombe, selon
lui, aux exploits et opprims eux-mmes. Les reproches
quil leur adresse peuvent se regrouper sous deux princi-
paux chefs daccusation : dune part leur collaboration trop
frquente avec les matres pour assurer la domination de
ces derniers dans tous les domaines ; dautre part et surtout
leur consternante rsignation leur propre malheur :
Exploits conomiques, moutons politiciens, ouvriers et
lecteurs, vous avez dchan le cholra sur lhumanit ;
cest votre acceptation tacite, votre passivit devant lex-
ploitation, votre rsignation devant la souffrance, devant
la misre, votre consentement labjection et la salet qui
font de vous le champ o croasseront bientt les corbeaux
de la mort. [infra, p. c]
Le ressentiment de Libertad contre les victimes consen-
tantes est tel quil en arrive souhaiter que lpidmie fasse
encore plus de morts, quelle continue d avancer vite
travers lEurope corrompue par le luxe et la misre et
quelle vide les palais et les chaumires sous ses attaques
redoutables [infra, p. :c]. Il finit par scrier : Oui, je
voudrais la leon plus cruelle encore. [infra, p. c] Le
alain accardo :o
propos est norme : cette forme de politique du pire ne
peut manquer de choquer une sensibilit humaniste, qui
y trouvera comme un relent de sadisme. On a l une ver-
sion politique de la croyance pdagogique la bonne cor-
rection , selon laquelle plus le fautif expie la faute
commise et moins il est enclin recommencer dans la
logique du : Cest bien fait pour lui, a lui servira de
leon, la prochaine fois il fera attention!
On a compris depuis longtemps que cette croyance (de
nature foncirement religieuse) lefficacit de la punition
corrective est peu fonde, dmentie comme elle lest
constamment par lexprience et par lhistoire. Le redou-
blement des souffrances quendurent les opprims ne
conduit pas ncessairement lclosion dune conscience
rvolutionnaire. Au contraire, laccablement des corps et
des esprits par un excs de misre a souvent un effet, depuis
longtemps observ, dasphyxie et de dmoralisation. Sans
doute Libertad se laisse-t-il emporter par le dpit et lirri-
tation auxquels sont invitablement exposs tous ceux qui
se battent contre loppression sociale lorsquils constatent
quils sont bien mal compris et bien peu suivis par la masse
des opprims. Comment par exemple un militant poli-
tique ou syndical nprouverait-il pas un sentiment de
trahison lorsquil sentend dire par un de ses camarades
particulirement exploits, qui il propose une action
revendicative, voire la simple lecture dun tract : a ne
mintresse pas, je ne fais pas de politique ? Aux yeux de
qui a compris la ncessit de se battre parce quil ny a
dautre voie, pour sortir de la tristesse ouvrire , comme
lcrivait Navel, que la lutte syndicale et politique , ceux
qui refusent de se mobiliser sont coupables de dsertion et
affaiblissent le combat collectif. Quant ceux qui colla-
borent dlibrment avec les dominants, ce sont des tratres
avrs, sans scrupule et sans excuse. On conoit que les
domins les plus investis dans les luttes sociales, et qui y
puisent espoir et dignit, se sentent frustrs et parfois furieux
de ce que leur militantisme courageux et altruiste nveille
la colre du juste :;
autour deux que de faibles chos dans une population trop
souvent atone, qui parat sarranger de tout, y compris de
sa propre humiliation, pourvu quon lui fournisse du pain
et des jeux .
Libertad possdait au plus haut point cette capacit din-
dignation devant linjustice qui est indispensable la
rvolte et qui conduit souvent, sur la lance, reprocher
la victime de faire par son absence de rsistance le jeu de
son bourreau. La rsignation du faible devant la violence
du fort devient dans cette perspective une forme de com-
plicit qui appelle aussi condamnation de la part du
prophte anim dune sainte colre . Libertad semble
commettre en loccurrence lerreur intellectualiste de la
plupart des prophtes qui croient quil suffit de parler vrai
et juste pour tre entendu et qui finissent par se fcher de
ltre si peu. Nous nous poserons un peu plus loin la ques-
tion de savoir si cette colre est bien fonde. Mais sup-
poser quelle le soit, autorise-t-elle le juste svir contre
ceux qui ne le suivent pas et rclamer quils soient frap-
ps sans piti, que ce soit coups de bacilles du cholra ou
avec dautres armes ? Quel terrible paradoxe, pour qui pro-
clame Il nest point de sauveur suprme , que den arri-
ver souhaiter la mort pour ceux-l mmes quon voulait
aider se librer de leurs chanes ! Il advient ainsi que chez
le juste la haine de loppresseur oblitre lamour de
lopprim dautant plus que lopprim nest pas forc-
ment aimable et quil peut loccasion se confondre avec
loppresseur. Sans doute est-il invitable que ceux qui ont
faim et soif de justice aient tendance se transformer en
justiciers implacables, et que, submergs par leur indigna-
tion, lenvie les prenne de se saisir dun fouet pour fustiger
les marchands du temple ou mme dune bombe pour pul-
vriser le temple lui-mme. Dans cette circonstance, avant
de reprocher au juste son inadmissible violence ,
comme font les pharisiens de tout acabit, il convient de
dnoncer et dsarmer dabord la violence inerte et dautant
alain accardo :
plus inhumaine des institutions, laquelle la violence du
juste est la rponse ultime et dsespre.
Mais il importe alors de se souvenir que la volont de
justice ne se confond pas avec la soif de vengeance et que
le droit de remontrance se double dun devoir de com-
prhension. Le juste a le droit, et mme le devoir de se
mettre en colre, condition que sa colre soit juste, cest--
dire quelle ne frappe pas aveuglment. Tenir cette condi-
tion pour ngligeable ou secondaire Qui veut la fin veut
les moyens ; On ne fait pas domelette ; etc. , cest
donner raison celui qui, avec Goethe, prfre linjus-
tice au dsordre ; ou qui, avec Camus, prfre sa mre
la justice . Vieux dilemme qui na cess de crucifier la
rflexion thique dans sa forme traditionnelle.
Fort heureusement, les militants sont gnralement
conduits surmonter leur irritation ou leur dception par
la conscience aigu quils prennent de ce quest rellement
loppression sociale et de ce que sont les effets dltres de
lexploitation sur la subjectivit des individus qui y sont
soumis. Ils savent que les souffrances de toute sorte, la pni-
bilit des conditions dexistence et de travail, lpuisement,
les privations, la mauvaise hygine, linsuffisance dins-
truction, les discriminations, les humiliations, la peur, le
chmage, langoisse, lalcoolisme, la drogue, labsence de
toute perspective, bref, la misre et ses maux sans nombre,
ont des consquences physiques et psychologiques des-
tructrices. Ils comprennent bien par consquent que le
manque de combativit des domins est un effet mme de
la domination, et quon ne peut dcemment en faire grief
des victimes qui sont plus plaindre qu blmer.
Mais il est permis de se demander sil ny a pas, dans cette
absolution de principe, un prjug aussi discutable que
celui de la svrit vindicative. Il est certain que, dans une
optique rationaliste, et a fortiori scientifique, la devise qui
semble simposer est celle que prconisait Spinoza : Ne
pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas har, mais com-
prendre. Admirable maxime. Mais justement, sagissant
la colre du juste :,
de comprendre le fonctionnement des rapports sociaux de
domination, comment convient-il dapprcier le rle jou
par les diffrents protagonistes et singulirement par ceux
qui sont le plus domins ? Sont-ils des victimes ou des
coupables et dans quelle mesure ? Peut-on incriminer la
malfaisance du systme sans prendre en compte toutes les
contributions son fonctionnement ?
* *
*
On touche l un aspect de la lutte des classes assez contra-
dictoire, dont les organisations politiques et syndicales tra-
ditionnelles ont d se dbrouiller en pratique sans jamais
lui donner de rponse thorique entirement cohrente. La
rflexion achoppe en effet sur une sorte daporie quon peut
rsumer ainsi : comment peut-on attendre de travailleurs
exploits et opprims quils comprennent la ncessit de la
lutte et quils se mobilisent, quand on sait ce que sont les
mcanismes objectifs et les effets rels de lexploitation capi-
taliste et de loppression sociale ? Si celles-ci tendent
comme on peut le vrifier partout dshumaniser tou-
jours plus le travailleur, le robotiser, le rduire la
condition dobjet parmi des objets, alors on ne peut ston-
ner de ltat dilotisme dans lequel il est maintenu et on ne
peut videmment lui reprocher en aucune faon sa rsi-
gnation fataliste. Du mme coup, lentreprise de lui faire
prendre conscience de son tat et de le mettre en mouve-
ment, surtout dans une optique rvolutionnaire, devient
une sorte de gageure bien intentionne mais voue
lchec, comme si on voulait convaincre des cailloux de
remonter deux-mmes la pente o ils ont roul. Si donc
on sobstine lappeler au combat, cest quon mise, peu
ou prou, sur lexistence en lui de ressources subjectives qui
lui permettent de relever la tte et de sortir de sa passivit.
Auquel cas, on ne peut plus invoquer les effets de lex-
ploitation comme excuse absolutoire au refus de se battre.
alain accardo ,c
Tout au plus peut-on y voir des circonstances qui attnuent
la responsabilit personnelle sans jamais lannuler. On est
alors en droit de sinterroger sur la part prise par les domi-
ns leur propre asservissement et sur leur part de respon-
sabilit dans la reproduction des rapports de domination,
cest--dire, pour tre plus explicite, sur la nature et le degr
de leur connivence avec lordre tabli.
Dans le mouvement ouvrier, toutes tendances confon-
dues, aujourdhui comme au temps de Libertad, le dis-
cours militant continue dentrelacer les deux thmes, en
accentuant selon les circonstances le rquisitoire ou le plai-
doyer. On peut en trouver une loquente illustration dans
un placard anti-lectoral intitul Le criminel , rdig par
Libertad en :,co. Il y crit tout dun trait : Cest toi le
criminel, peuple, puisque cest toi le souverain. Tu es, il
est vrai, le criminel inconscient et naf. [infra, p. ::] Dans
une mme invocation, aux accents rousseauistes, le peuple
est charg dune infamante responsabilit, pour en tre
immdiatement exonr au motif quil ne sait ce quil fait.
Mais si effectivement quelquun agit mal sans le savoir, sans
le faire exprs, donc sans le vouloir expressment, est-il juste
de le mettre dans le mme sac que ceux qui savent ce quils
font ? Nest-il pas abusif de les traiter tous comme des cri-
minels sans autre forme de procs et de prtendre punir
avec la mme svrit celui qui agit mal par inadvertance
et celui qui agit avec lintention de faire du mal ?
Dun autre ct, reprocher quelquun davoir voulu le
mal quil a fait ne relve-t-il pas du procs dintention ?
Dans la tradition rationaliste, dexcellents esprits, de
Socrate Descartes et Leibniz, ont considr quon ne
peut vouloir dlibrment le mal, que nul nest mchant
volontairement , qu il suffit de bien juger pour bien
faire et quon agit toujours sub specie boni, en croyant
bien faire et en vue dun bien. Il ny aurait pas de mchants
mais seulement des aveugles et des ignorants. Dans une
telle hypothse, on conoit que les patrons, les grands
commis et les grands actionnaires capitalistes, inspirateurs
la colre du juste ,:
ou ralisateurs de politiques conomiques et sociales pro-
grammes, qui rduisent des peuples la misre et au dses-
poir, jettent la rue des milliers de travailleurs, font crever
des enfants de faim ou sentretuer des populations entires,
soient indigns de sentendre traiter de criminels puis-
quils sont, en bons libraux, sincrement convaincus pour
la plupart de vouloir la prosprit gnrale. Un grand tech-
nocrate franais, notoirement connu pour ses convictions
chrtiennes hautement proclames, ne soutenait-il pas, il
y a quelques annes, quil dirigeait la politique du Fonds
montaire international avec le souci de rechercher le bien
public ?! Faudrait-il donc, en bonne justice, tenir tous
ceux qui offensent lhumain pour non responsables du mal
quils provoquent, teindre toute vindicte leur encontre
et finalement leur accorder le pardon de leurs offenses pour
la raison qu ils ne savent pas ce quils font et sont plus
btes que mchants ? Comment les empcher alors de
poursuivre leurs mfaits ?
On voit comment, sen tenir aux termes usuels de la
problmatique morale, on est pris dans un dilemme sans
issue rationnelle. Telles sont les difficults inextricables
auxquelles se heurte la rflexion quand elle reste tribu-
taire doppositions de nature mtaphysique comme celle
du mcanisme objectiviste et du spontanisme subjecti-
viste qui sous-tend laporie signale prcdemment et qui
est inscrite au cur mme de lidologie individualiste
dominante. La soumission au prjug idaliste qui main-
tient une coupure ontologique radicale entre le sujet, tout
intrieur, et la ralit objective, tout extrieure, empche
de comprendre vraiment le fonctionnement tant des rap-
ports sociaux que des individus. Ds lors quon absolu-
tise les contraintes objectives pesant sur lindividu, on
doit conclure son alination totale et dfinitive ; ce serait
proprement miracle den sortir. Si au contraire on abso-
lutise sa libert , comme fait lindividualisme, alors on
doit conclure limpossibilit de toute alination.
alain accardo ,:
Aucun des deux points de vue, objectiviste ou subjecti-
viste, nest vraiment pertinent sauf peut-tre, la limite,
dans des situations de ncessit extrme pour cette rai-
son quaucun des deux postulats philosophiques ne tient
compte des conditions sociales concrtes dmergence et
de dveloppement de la conscience morale individuelle ni
des effets rels des processus de la socialisation. Celle-ci
tend mettre en adquation les structures internes de la
subjectivit personnelle et les structures objectives externes,
de telle sorte que chacun finisse par acqurir, volens nolens,
les dispositions fondamentales sentir, agir et penser en
fonction de sa condition sociale et des positions qui lui
sont assignes dans les diffrents champs sociaux o il est
appel simpliquer. Des concours imprvus de circons-
tances, des vnements contingents et la pluralit des ins-
tances pdagogiques en concurrence (famille, cole, glise,
mtier, groupes lectifs, etc.) peuvent entraner des clivages,
des rats et des brouillages de socialisation, gnra-
teurs de problmes ponctuels dintgration, mais globale-
ment (statistiquement, dirait le sociologue), dans une
formation sociale donne, une poque donne, la socia-
lisation des individus les conduit efficacement sassurer
les proprits physiques, mentales et autres, indispensables
pour saccommoder de leur condition (de classe) et gravi-
ter sur lorbite o les ont placs les verdicts dinstitution,
ce qui est la condition sine qua non de toute vie collective,
en tout ordre social. Cela nest videmment possible que
dans la mesure o les contraintes, dabord exognes, sont
devenues endognes et se sont transformes en obligations
personnellement et spontanment assumes, voire en auto-
matismes et en rflexes tellement incorpors quils nont
mme plus besoin du concours de la rflexion et semblent
tre inns. Ds lors que les contraintes externes se sont
mues en motivations internes, avec toutes les variations
et nuances individuelles quon peut imaginer, peu importe
que ces motivations soient bien fondes ou totalement
mystifies : celui qui les prouve a dsormais le sentiment
la colre du juste ,,
de faire librement ce qui, en ralit, dans la situation objec-
tive o il se trouve, est la seule chose faire , celle pour
laquelle il se sent fait .
1
En dautres termes et pour en revenir au comportement
des exploits en face de leurs exploiteurs, on peut dire quils
sont les uns et les autres fondamentalement faonns par
leur socialisation respective, pour fonctionner ensemble
dans un rapport de domination/soumission, ou mieux
dinterdpendance (pour parler comme Norbert Elias), qui
cesserait dtre fonctionnel et de se reproduire dune gn-
ration lautre si les uns ou les autres cessaient de lprou-
ver comme allant de soi dans son principe et refusaient de
sy plier. Cela se produit dailleurs de temps autre, dans
certaines conditions particulires, mais pas de faon suffi-
samment massive pour enrayer le fonctionnement du
systme. Si quelques poignes de rebelles , de fortes
ttes , de dvoys , de hors-la-loi et d anarchistes
comme disent les dfenseurs de lordre tabli se mon-
trent trop rcalcitrants, les forces de rpression se chargent
de les faire rentrer dans le rang et ractivent, au besoin en
cassant les ttes qui dpassent, la salutaire disposition des
autres domins la patience et lobissance que leur
socialisation a dj inscrite dans leur tre.
Mais si la coercition nest jamais totalement absente des
rapports de domination, aucun ordre social ne sest jamais
maintenu durablement par le seul recours la coercition.
Le pilier de soutnement le plus solide de toute construc-
tion sociale, cest sa lgitimit, cest--dire la reconnaissance
(au double sens dacceptation et de gratitude) explicite ou
implicite dont elle est lobjet, tort ou raison, de la part
du plus grand nombre. Cela est vrai pour la socit capi-
taliste comme pour nimporte quelle autre. Ctait vrai
alain accardo ,
1. Du mme auteur, on retrouvera un large dveloppement de cette
approche ni objectiviste ni subjectiviste de lincorporation de lordre
social dans son Introduction une sociologie critique. Lire Pierre Bourdieu,
Agone, lments , 2006. [nde]
lpoque de Libertad, comme cela reste vrai aujourdhui.
Il ny a donc pas lieu de soffusquer quand on entend par-
ler de cette forme dadquation spontane qui sinstaure
entre les diffrents protagonistes de la vie sociale et les
amne sadapter les uns aux autres, sajuster leur envi-
ronnement et finalement collaborer de multiples faons,
sans mme le vouloir expressment, au maintien et la
reproduction de lordre tabli, alors mme quils ont bien
des raisons de se plaindre de celui-ci. Dans les socits de
classes, il semble que les partisans de la lutte des classes
aient eu une propension, comprhensible mais fcheuse,
surestimer dans leurs analyses les antagonismes et le dis-
sensus pour en faire la dimension majeure de la dynamique
sociale ; et sous-estimer fortement la seconde dimension,
celle de la collaboration des classes et du consensus, qui va
bien au-del de ses manifestations les plus immdiatement
visibles et en particulier bien au-del des intentions
conscientes des agents domins, ces derniers pouvant mme
en arriver dvelopper consciemment une relle hostilit
contre les dominants tout en continuant obir, sans
ncessairement sen rendre compte, la logique de la domi-
nation quils ont intriorise sous forme de dispositions
profondes et de connivence objective.
On a souvent soulign, aprs La Botie, les manifesta-
tions de servitude volontaire chez tous ceux qui se
soumettent un pouvoir despotique. On devrait tre tout
aussi attentif, pour le moins, au fait que la servitude la
plus difficile combattre, parce que la plus dissimule,
cest la servitude involontaire lie une socialisation dont
les effets incorpors se naturalisent et se font oublier
mesure quils sintgrent la personnalit, pour former
un vritable inconscient social, gnrateur de soumission
la fois individuelle et collective
1
. Ce quoublient, ou
la colre du juste ,,
1. Du mme auteur, on lira De notre servitude involontaire (Agone, Contre-
feux , 2001), o il dveloppe une analyse de ce thme en forme de
Lettre mes camarades de gauche . [nde]
ignorent, malheureusement, la plupart des doctrinaires
de linsoumission et du refus dobissance.
* *
*
Plus dun observateur a not la surprenante aptitude des
individus sadapter des conditions dexistence qui sem-
blent a priori proprement insupportables force dtre
inhumaines, comme par exemple la vie dans les bagnes ou
les camps dextermination. Dans ses Souvenirs de la mai-
son des morts, Dostoevski, parlant de son exprience du
bagne sibrien, faisait cette remarque faussement banale
que lhomme est un tre qui shabitue tout . Abso-
lument tout. Les tmoignages sur les camps de la mort,
comme ceux recueillis par Michael Pollak (LExprience
concentrationnaire), ou les terribles rcits de Primo Levi (Si
cest un homme) et de Chalamov (Rcits de la Kolyma), le
confirment
1
. Le mme constat vaut pour lexistence, en
apparence plus normale , que sont obliges de mener
des populations entires de par le monde. Non seulement
il y a toujours des bagnes, mais cest la vie ordinaire elle-
mme, avec ses banlieues ghettoses, ses quartiers de tau-
dis, ses ateliers clandestins, son travail la chane et son
chmage, ses familles dsintgres et son sous-proltariat
clochardis, ses drogues, ses bouges, ses bordels et ses
fillettes prostitues, ses enfants-soldats ou ses dealers, ses
famines et ses pidmies, ses tueries et ses massacres, ses
racismes, ses apartheids et ses chiourmes, cest la vie la plus
quotidienne, sans horizon et sans espoir, qui reste un vaste
bagne pour des millions dtres humains condamns lex-
termination par la misre sans fin, y compris dans des pays
dits dvelopps , comme le ntre, o il faut tre aussi
alain accardo ,o
1. Fedor Dostoevski, Souvenirs de la maison des morts, Folio, 1991; Michael
Pollak, LExprience concentrationnaire. Essai sur le maintien de lidentit sociale,
Metaili, 2000 ; Primo Levi, Si cest un homme, Pocket, 1988 ; Varlam
Chalamov, Rcits de la Kolyma, Verdier, 2002. [nde]
mal informs, ou aussi aveugls de prjugs que la plupart
de nos journalistes, pour redcouvrir avec tonnement, de
loin en loin et comme incidemment, que des centaines de
milliers denfants vivent au-dessous du seuil de pauvret ,
dans notre belle Europe
Et malgr tout, ces populations affreusement dshrites,
ces damns de la Terre arrivent survivre, saccom-
moder de leurs conditions dexistence en les amnageant
diversement, et mme dans bien des cas prouver cet
amor fati dont parlaient les Latins, aimer leur destin
pour les gratifications quils peuvent en retirer, aussi
confondant pour lentendement que cela paraisse. Bien
sr, il y a des ressentiments qui fermentent, des colres qui
couvent, provoques par trop de peines et de frustrations,
et qui par moments explosent. Mais, faute de comprendre
quelles sont les causes profondes et structurelles de leur
mal, les rvolts sont plutt enclins sen prendre, sous
les prtextes les plus divers, dautres dshrits, quon se
charge gnralement de leur dsigner. Les haines entre
pauvres , comme dit Libertad [infra, p. :,], sont dailleurs
un ingrdient universel indispensable au fonctionnement
des rapports de domination.
On ne saurait ignorer ni sous-estimer cet aspect de lop-
pression sociale, observable partout : lun des pires effets de
la misre, cest de transformer ses victimes en bourreaux de
leurs semblables. Comme la soulign Philippe Bourgois
propos du commerce de la drogue East Harlem, ce sont
les victimes elles-mmes qui sont les organisateurs et les
agents les plus efficaces et les plus impitoyables de la vio-
lence et de la terreur. Cest l que rside la dimension la
plus mal comprise et la plus cruciale de loppression.
Partout dans lhistoire et dans le monde, les victimes (pri-
sonniers ou opprims) collaborent aux formes les plus bar-
bares de leur propre torture. Si on refuse de voir et de
reconnatre cette dimension, de peur de contribuer aux
strotypes racistes ou par sensibilit et par respect de la
la colre du juste ,;
rputation dune communaut, on nie lun des principes
les plus fondamentaux de loppression
1
.
Il faut rflchir l-dessus si on veut vraiment comprendre
comment il se fait quun ordre social, souvent oppressif
et mme, comme lordre capitaliste, rpressif jusquau
meurtre institutionnalis et lassassinat de masse ,
conserve sa prennit, en dpit des contradictions et des
crises qui le travaillent et le secouent. Un des facteurs
essentiels, peut-tre le plus dcisif, de cette stabilit doit
tre cherch dans le fait que toute domination sociale,
pour saccomplir totalement, passe par la collaboration tan-
tt volontaire et dlibre, tantt involontaire et inconsciente,
mais toujours ncessaire, des opprims avec leurs oppresseurs.
Il convient de regarder lucidement les choses, sans mani-
chisme et sans crainte du politiquement incorrect : ce
ne sont pas les grands profiteurs en personne qui se char-
gent dassurer quotidiennement le bon fonctionnement
de la machine extorquer la plus-value et maximiser les
profits. Pour accomplir cette besogne, ils ont imprative-
ment besoin de se faire seconder par une arme dauxi-
liaires quils recrutent parmi les domins eux-mmes. Tout
au long et au-del de ces longues chanes de dlgation de
pouvoir, la logique de la domination tend structurer tous
les champs sociaux de faon homologue : dans la socit
de classes, la libido dominandi sinculque ds le jeune ge
et le fin du fin devient pour chacun, avec ou sans mandat
formel, dtre en position de jouer au patron , au
cad , de faire la loi , avec son conjoint, ses enfants,
ses camarades, ses voisins, ses collgues, ses lves, ses
concitoyens ou, dfaut, son chien. Chacun entreprend
de se tailler un fief, si minuscule soit-il, de sadjuger une
seigneurie, si drisoire soit-elle, et de rgenter qui il peut,
comme il peut, pour compenser la domination dont il est
lobjet par ailleurs. Dans un climat gnral de domination,
alain accardo ,
1. Philippe Bourgois, Une nuit dans une shooting gallery , Actes de la
recherche en sciences sociales, septembre 1992, n 94.
les diffrentes formes de domination se font cho et se
servent dalibi les unes aux autres ; et les dominants de
banlieue, de bureau, de boudoir, dalcve ou de cour de
rcration ne sont pas ncessairement les moins froces.
Ce qui nanmoins ne signifie pas que toutes les domina-
tions squivalent, ni quil ny ait jamais que des rapports
de domination entre les agents sociaux.
Si donc on veut tre consquent avec ce que la science
sociale rvle de la socialisation, on doit convenir que tous
les membres dune formation sociale donne sont en
quelque sorte ontologiquement impliqus, des degrs
divers, dans le fonctionnement de ses structures de domi-
nation, et que la logique objective de ce fonctionnement
ne peut saccomplir librement que dans la mesure o
elle est assume subjectivement par les individus : soit sous
des formes explicites (par exemple celle dune idologie
professionnelle et corporatiste) ; soit, le plus souvent, sous
la forme pratique de dispositions et inclinations agir
spontanment dans un certain sens. De sorte quon peut
indiffremment les accuser ou les excuser de faire ce quils
font, suivant quon prfre par prjug idologique, ou
simplement par commodit considrer quils sont
acteurs ou quils sont agis, responsables ou irresponsables.
En fait, ils sont toujours lun et lautre, insparablement
et dans des proportions variables selon quils disposent
plus ou moins largement des moyens (connaissances,
outillage conceptuel, temps libre, revenus, incitations du
milieu, etc.) de dvelopper la dimension explicite, rflexive
et intentionnelle de leur action, et de passer du stade de
la matrise pratique de leur pratique au stade de sa ma-
trise thorique. Reste que, moralement et intellectuelle-
ment, il nest pas indiffrent quun individu agisse de faon
intentionnelle et rflchie, ou quil agisse en se laissant
porter, sans le vouloir expressment, par la logique objec-
tive dun systme quil a intriorise et assimile son insu
mme et quil sert sans avoir le sentiment dy tre asservi.
la colre du juste ,,
Il serait injuste de mesurer la mme aune la part de
responsabilit personnelle dans lun et lautre cas.
La contradiction dont le discours militant est rest pri-
sonnier vient de ce quune philosophie traditionnelle et
essentialiste du sujet a du mal penser, faute dun langage
adquat, le mouvement dialectique rel de la construction
de soi qui permet un individu de se librer, cest--dire
de se dsaliner progressivement et de gagner en autonomie
relative partir des contraintes dabord subies et intrio-
rises pratiquement, puis rflchies, matrises thorique-
ment et utilises de faon critique. Cela implique, bien sr,
un interminable travail sur soi-mme qui ne peut sac-
complir qu condition dtre socialement stimul et
soutenu tout au long de lexistence. Si les militants (rvo-
lutionnaires en particulier) pratiquaient la socioanalyse et
la rflexivit, cest--dire thorisaient davantage leur propre
dmarche avec les outils conceptuels de la sociologie cri-
tique, cela viterait peut-tre certains de tomber dans
lincohrence qui consiste prter aux travailleurs une
volont forcment mauvaise (et donc condamnable)
puisquelle nest pas spontanment subversive ; et
considrer en mme temps que les conditions objectives
dexistence sont de nature empcher toute volont de
rsistance de se faire jour. Libertad semble par endroits sur
le point de surmonter la contradiction mais, comme la
plupart des pourfendeurs de lidologie dominante, il
continuait de penser, certains gards et sans sen rendre
compte, lintrieur de cette idologie quil excrait encore
plus quil nen dmontait les subtils rouages et nen perce-
vait tous les piges. Il ntait videmment pas seul pen-
ser ainsi : le discours militant tait (et reste) imprgn dun
volontarisme sans limite, la manire des couplets de
LInternationale, dont le texte par ailleurs si juste politi-
quement abonde en auto-exhortations significatives :
Foule esclave, debout, debout Sauvons-nous nous-
mmes, Dcrtons le salut commun Soufflons nous-
mmes notre forge Dcrtons la grve aux armes , etc.
alain accardo c
Tous les militants rvolutionnaires savent dexprience que,
sur le terrain des luttes relles, les mobilisations sont autre-
ment plus difficiles quelles ne le paraissent dans la chaleur
vibrante des meetings, et quon ne se bat pas par dcret.
Alors, pour expliquer les lenteurs et les checs, on
invoque linertie du systme , sa puissance crasante et
sa violence impitoyable. Lintroduction du concept de
systme (capitaliste en loccurrence) dans lanalyse due
linfluence exerce ds le xix
e
sicle par la science sociale
naissante (elle-mme influence par les sciences naturelles)
sur la pense politique a certainement marqu un pro-
grs dans la comprhension des rapports sociaux ; et il y
aurait toute raison de sen fliciter si malheureusement ce
concept navait pris trs rapidement, et conserv depuis,
une acception mcaniste rductrice et abusivement homo-
gnisante, selon laquelle le systme, dfini comme
monolithique et exclusif, se rduirait lensemble des
rouages conomiques et politiques imposant de lextrieur
leur froide logique objective. Cest ainsi que toute rflexion
sur le fonctionnement des rapports sociaux et la possibi-
lit de les modifier a t condamne osciller indfiniment
entre le constat objectiviste de lcrasement des travailleurs
par le systme et laffirmation subjectiviste que, pour le
combattre et y mettre fin, il suffit de le dcider. Do le
corollaire, volontariste par excellence, daprs lequel ne pas
se mobiliser cest faire preuve dune insigne mauvaise
volont, qui mriterait punition.
La contradiction que nous signalons apparat avec vi-
dence chez Libertad, par exemple dans la suite du texte
Le criminel , quand, toujours ladresse du peuple
bourreau de lui-mme, il lance : Tu te plains ; mais tu
veux le maintien du systme o tu vgtes. [infra, p. ::]
On peut entendre des propos similaires, aujourdhui
comme hier, dans la bouche dinnombrables militants. La
rflexion continue senfermer dans deux affirmations
exclusives lune de lautre, sans en tre particulirement
incommode vrai dire et sans quon trouve bizarre quun
la colre du juste :
systme objectif tout-puissant laisse subsister chez le tra-
vailleur quil crase une volont miraculeusement intacte
et optimiste qui pourrait, par une sorte de fiat incon-
ditionnel, se dresser contre lui et le mettre en chec. On
en arrive ainsi reprocher au travailleur alin ce que
Libertad reproche au peuple entier Tu ne veux, donc
tu ne peux tre libre [infra, p. ::c] , sans se poser la ques-
tion qui sest pose beaucoup et que Marcuse formulait
en ces termes : Comment des gens qui ont subi une
domination efficace et russie peuvent-ils crer par eux-
mmes les conditions de la libert ? ; cest--dire, com-
ment des conditions sociales dexistence dont on dnonce
par ailleurs linhumanit peuvent-elles permettre cette
volont dmancipation de se former et de sexercer ?
Laffirmation que le travailleur est alin ou, au
contraire, quil est libre , reste une thse mtaphysique
vide tant quelle na pas de contenu sociologique (socio-
conomique, socioculturel, etc.) dment tabli, cest--
dire tant quon na pas examin concrtement comme
le faisait Marx quelle est la situation effective de tels ou
tels travailleurs dans tels ou tels secteurs de la production,
tels ou tels moments historiques ; tant quon na pas
apprci quel niveau et sous quelles formes sest stabilis
(provisoirement) le rapport des forces entre travailleur(s)
et exploiteur(s) capitaliste(s) ou autre(s). Des esclaves peu-
vent diminuer, voire mettre fin leur servitude, non pas
parce quils seraient libres par essence mais parce quils ont
dcouvert que leur soumission fait la force de leur matre
et quils ont entrepris de se battre, ne serait-ce que pour
obtenir un morceau de pain ou une heure de repos sup-
plmentaire. On ne nat pas avec la libert. On la construit
et on la conquiert, sur toutes les adversits et toutes les
pesanteurs. Louvrier de Michelin qui prend sa carte syn-
dicale et qui a le courage de faire grve tmoigne par l
mme quil est parvenu un degr de libration suprieur
celui du cadre industriel ou commercial hautement
diplm qui sengage dans une concurrence outrance
alain accardo :
avec ses collgues pour gagner les faveurs patronales et
faire carrire .
Sans doute la vision du social aurait-elle pu viter ce
genre daporie si lattention porte depuis le xix
e
sicle
ltude dailleurs indispensable des structures objec-
tives, en particulier par le courant marxiste, navait donn
la critique sociale une orientation objectiviste durable,
une sorte de pesant lest structuraliste qui devait abou-
tir (dans les annes :,oc) lviction du sujet de laction
historique. La dcouverte du systme , de ses mca-
nismes et de ses ncessits a quelque peu clips le rle des
individus dans le fonctionnement des structures. Plus
exactement, on a nglig de dvelopper la conception
matrialiste de la subjectivit, dont Marx lui-mme avait
trac les linaments, en tudiant plus fond ce que les
structures objectives produisent sur le plan des structures
de la subjectivit individuelle, ce que Sartre devait appe-
ler plus tard lintriorisation de lextriorit et dont la socio-
logie bourdieusienne a fait ensuite un de ses principaux
objets danalyse. Bref, pour rsumer dune formule ce qui
sest pass, on pourrait dire que ce qui a gravement fait
dfaut au mouvement ouvrier, au-del de lanalyse co-
nomique, cest une thorie des rapports entre habitus et
champ social pour clairer les effets de conditionnement
rciproque entre le systme objectiv lextrieur et le sys-
tme incorpor lintrieur. Faute dclaircir la dialectique
ultra-complexe selon laquelle les hommes font une his-
toire qui les fait, il est presque impossible dviter une
difficult, trs commune, de lanalyse sociologique, le dan-
ger que les intentions objectives, que dgage lanalyse,
napparaissent comme des intentions expresses, des stra-
tgies intentionnelles, des projets explicites comme
lcrivait Bourdieu
1
.
Disons, en manire de conclusion provisoire sur cette
question, que dans la mesure o linjustice sociale est bien
la colre du juste ,
1. Pierre Bourdieu, Esquisse pour une auto-analyse, Raisons dagir, 2004, p. 90.
le produit du fonctionnement objectif dun systme (et
plus exactement dun systme de systmes) que nul ne peut
totalement matriser, ni pratiquement ni thoriquement,
il serait absurde de semporter contre le systme si celui-
ci, loin dtre purement extrieur aux sujets, ne semparait
de chacun deux, corps et me, et nen faisait, des degrs
variables, ses instruments consentants. Et cest assurment
l la plus grande difficult de la lutte rvolutionnaire : pour
lutter contre linjustice, il ne suffit pas de sattaquer au sys-
tme qui sest fait choses ; il faut aussi bien mettre en cause le
systme qui sest fait personnes. Or on ne peut pas sattaquer
aux personnes comme si elles ntaient que des choses, et
mme quand on les reconnat objectivement coupables, on
na pas le droit de les traiter comme des objets.
* *
*
Que dirait Libertad sil pouvait voir ce que la socit capi-
taliste est devenue, lui qui portait un regard tellement
svre dj sur les domins de son poque, ces proltaires
du capitalisme industriel dont les conditions dexistence
accablantes tous gards taient des circonstances pour le
moins attnuantes ? son poque au moins, la lutte des
classes tait une ralit effective dont la notion tait expli-
citement prsente lesprit de bien des travailleurs. On
pouvait en discuter les modalits et les consquences, du
moins constituait-elle une reprsentation du monde et de
lHistoire sur laquelle on pouvait sappuyer la fois pour
comprendre le prsent et pour prparer lavenir. La classe
ouvrire franaise, qui avait commenc au sicle prcdent
secouer ses chanes et qui, selon lapprciation de Marx,
avait port la contestation plus loin que partout ailleurs en
Europe , tait massivement prsente sur le front des luttes
travers ses fractions les plus avances et les plus organi-
ses ; elle faisait mieux que rsister loppression, elle rayon-
nait sur le monde du travail, faisait trembler les classes
alain accardo
possdantes et dirigeantes, fascinait les intellectuels en
dcomposant dans leur esprit les visions traditionnelles de
lHistoire ; et elle semblait pouvoir faire avancer la civilisa-
tion par la promesse dun monde plus juste, pacifique et
tellement imminent que les bourgeoisies capitalistes pani-
ques, pour y faire obstacle, ne reculrent pas devant un
conflit mondial o, avant mme que la Grande Guerre nait
commenc, la haine entre proltaires balaya brutalement
et pour longtemps toute solidarit internationaliste.
Aujourdhui, la classe ouvrire nest plus, chez nous,
que lombre de ce quelle fut et son rve dhgmonie
semble dfinitivement bris. Non pas que, comme cer-
tains le croient, ses effectifs aient diminu avec le passage
de la socit industrielle la socit de services, dinfor-
mation, etc. Cest qualitativement et non quantitative-
ment que le monde ouvrier a perdu son importance. Au
dbut du xx
e
sicle encore, dans une socit industrielle
monstrueusement ingalitaire, qui narrivait mme pas
sauver les apparences dmocratiques de la domination
bourgeoise, o les grandes conqutes sociales restaient
faire, o les populations rurales taient en voie durbani-
sation et de proltarisation acclre, le monde ouvrier
avait un prsent certes encore misrable, mais il pouvait
croire en un avenir radieux : il tait capable de lutter, pas
seulement pour des augmentations de salaire ou une
diminution de la journe de travail mais en mme temps
pour mettre fin la tyrannie du capital et instaurer la fra-
ternit socialiste entre les peuples ; il avait impos sa pr-
sence sur la scne historique, avec ses organisations pour
mener la lutte des classes, ses doctrines, ses objectifs, ses
traditions, ses drapeaux et sa fiert ; sa culture tait origi-
nale et vivante ; bref, dans la pte sociale, la classe ouvrire
entretenait comme un levain rvolutionnaire qui lui valait
la crainte haineuse de tous les possdants et le respect,
voire ladmiration des autres travailleurs.
Pour une foule de raisons sur lesquelles nous ne pouvons
nous tendre ici, le monde ouvrier a cess aujourdhui dtre
la colre du juste ,
considr comme le vecteur dun changement rvolution-
naire. Sa conscience de classe sest progressivement affadie,
brouille et dlite. Le dveloppement massif du chmage
a cr les conditions favorables des politiques de rpres-
sion et de rgression sociale, qui ont elles-mmes entretenu
des tendances rcurrentes un racisme anti-immigr dont
les germes sont toujours prsents, dans les classes populaires
comme ailleurs. Prises dans un vritable cercle vicieux, les
organisations politiques et syndicales les plus reprsen-
tatives de la classe ouvrire ont renforc le processus
dalination en se ralliant, officiellement ou non, la social-
dmocratie et lconomie de march. Le socialisme du
xix
e
sicle (et de la premire moiti du xx
e
sicle), qui
voyait dans le proltariat lmancipateur du genre humain,
lui proposait un destin digne de Promthe ; la modernit
capitaliste ne lui fait plus miroiter que celui dun Babbitt.
vrai dire, la seule rvolution qui intressait le prolta-
riat industriel (et qui continue peut-tre intresser pour
quelque temps encore certaines populations parmi les plus
pauvres de la plante), ctait la rvolution qui aurait
consist retourner les rapports sociaux pour les remettre
sur leurs pieds, en rendant lensemble de la collectivit
lentire matrise de son destin, cest--dire en instaurant
une dmocratie effective, indissociablement politique, co-
nomique et sociale. De cette rvolution-l, aujourdhui, il
nest plus (ou presque plus) question chez nous. Pour le
reste, nous vivons dans une socit rvolutionnaire en
diable, o des millions de personnes, y compris de
gauche , se piquent de faire tous les jours une rvolu-
tion dans un domaine ou un autre. Ces rvolutions
qui entranent parfois des changements rels (par exemple
sur le plan des murs) mais qui le plus souvent se rdui-
sent des artifices de mise en scne affectant la modalit
des pratiques bien plus que leur matrialit restent sym-
boliques et ont en commun dignorer totalement le socle
conomique des rapports sociaux et les intrts de classe.
alain accardo o
Plus on rvolutionne la socit capitaliste daujourdhui,
plus les riches senrichissent et les pauvres sappauvrissent,
plus le Capital senfle et plus le Travail devient prcaire et
dprci. On conoit que ce type de rvolution rituelle soit
vu dun trs bon il par tous les partisans de lordre tabli,
car celui-ci parvient merveille digrer les changements
de cette nature. Mieux mme : quand il ne les rcupre
pas aprs coup, il les organise grand renfort de publicit.
La modification incessante des pratiques, leur obsolescence
acclre, la qute exacerbe de nouveaut , le bou-
gisme , toute cette frnsie mobiliste attise commercia-
lement est devenue un ressort essentiel de la manipulation
des masses et de lautomanipulation. La rvolution
dsormais fait circuler la marchandise et les visages de
Lnine et Che Guevara servent dicnes publicitaires. La
jeunesse elle-mme est offerte joyeusement en sacrifice
au Moloch capitaliste.
Si Libertad trouvait dans le comportement alin du pro-
ltariat de son poque des motifs de colre, quelle serait sa
fureur alors au spectacle de nos classes moyennes enlises
dans les marcages du capitalisme de consommation, de
communication et de spculation? Il aurait apparemment
encore plus de raisons de crier la compromission, la veu-
lerie et la tartuferie. Il est difficile en effet dignorer lim-
portance prise par la collaboration des classes, et lampleur
de la contribution, pas seulement politique, que les classes
moyennes apportent au fonctionnement du systme capi-
taliste. Sans leur adhsion massive, celui-ci seffondrerait
ou, en tout cas, serait oblig, pour atteindre ses fins, de
renoncer sa faade dmocratique et de recourir en per-
manence la violence rpressive. Jamais sans doute autant
qu notre poque, dans les socits dveloppes , un sys-
tme de domination na bnfici dun tel concours des
domins eux-mmes lencadrement de leurs semblables et
leur propre asservissement aux intrts des matres. Pour
la colre du juste ;
prix de leur autosoumission, les membres des classes
moyennes sont invits patienter, encore et toujours,
gnration aprs gnration, en picorant des miettes du
festin o ils rvent de sattabler la faveur dune miracu-
leuse croissance ininterrompue. Le reste nest plus chez
eux que littrature et pieux sentiments.
On peut faire confiance aux bataillons de petits-bourgeois
pour sauver le systme qui fait corps avec eux, qui est
devenu en eux structures de sensibilit et structures de pen-
se. En eux, l esprit du capitalisme sest fait chair et sang
pour engendrer la version petite-bourgeoise de lHomo
oeconomicus capitalisticus, petit possdant possd, roturier
qui rve danoblissement, prtendant dpourvu des
moyens de ses prtentions, engeance malheureuse qui
cherche dsesprment compenser, dans laccroissement
besogneux de son avoir, la dliquescence de ses raisons
dtre. Cratures du systme rendues dpendantes des
opiums quil distille, voues osciller entre engouements
de la mode et accs de dprime, entre foucades gostes et
apitoiements humanitaires, les petits-bourgeois ne cessent
de contribuer recrer le systme en se battant pour repro-
duire (ou amliorer) les positions quils y occupent, dans
dinexpiables luttes catgorielles qui dressent leurs fractions
les unes contre les autres, comme des coqs de combat sous
le regard condescendant de leurs managers grands bour-
geois. Et si on ne peut pas dire, en toute rigueur, quils
savent exactement ce quils font, du moins peut-on dire
que pour la plupart ils ne veulent pas le savoir
1
.
Car nous ne sommes plus lpoque de Libertad, et les
classes moyennes actuelles ne sauraient tre assimiles au
proltariat de la fin du xix
e
sicle. On ne peut plus arguer
que leurs conditions dexistence et de travail sont de nature
annihiler toute capacit de rsistance de leur part. Sans
doute sont-elles soumises en permanence un travail de
alain accardo
1. Du mme auteur, on lira Le Petit-Bourgeois gentilhomme (Labor, Bruxelles,
2003), o il dveloppe une analyse de la moyennisation de la socit . [nde]
conditionnement idologique dune puissance ingale
jusquici et dont on ne saurait minimiser les effets abtis-
sants. Il nen demeure pas moins que le message de sou-
mission lordre tabli passe dautant mieux quil trouve,
pour laccueillir, les structures de personnalit conniventes
et complaisantes caractristiques de lentre-deux o se
meut le petit-bourgeois, tre social hybride cartel entre
le bonheur (actuel ou escompt) de dominer et la douleur
irrmdiable dtre domin.
Nous avons encore ici et l quelques Libertads en acti-
vit dont on ne sait plus trs bien si les manifestations rup-
tives pisodiques sont celles de vieux volcans en voie
dextinction ou si elles sont annonciatrices dexplosions et
de ruptures venir, tant il reste vrai que nos socits dve-
loppes , en tat danomie avance, ne cessent de flotter et
driver dangereusement, telles des plaques tectoniques faus-
sement stabilises, sur le magma plantaire du sous-dve-
loppement et des ingalits. Sans doute nous faudrait-il
aujourdhui beaucoup dautres prophtes lucides, coura-
geux et encolrs, des justes irrconciliables avec linfa-
mie rgnante mais qui auraient assimil les apports de la
science sociale ceux de Marx, Elias, Bourdieu, entre autres
et qui pratiqueraient lautosocioanalyse en mme temps
que lanalyse du monde objectif.
Gardons-nous toutefois dentretenir encore des illusions
dont lhistoire na que trop montr linanit. Quelle que
soit limportance du rle jou dans le changement social
par des individus inspirs, si charismatiques soient-ils, rien
ne peut se faire si leur vision nest pas en consonance avec
les attentes informules dune population suffisamment
nombreuse pour crer un rapport de forces diffrent ds
lors quelle se sera empare de cette vision nouvelle pour
en faire son projet propre. Mais prcisment, o trouver
aujourdhui, dans nos socits europennes, la masse
dhommes et de femmes lucides, dtermins, courageux
et dsintresss, capables de se battre pour autre chose
la colre du juste ,
quun repltrage, pompeusement dguis en moderni-
sation , du vieux systme dexploitation et dalination
auquel limmense majorit prte la main, justifiant ainsi
son appellation usurpe de dmocratie ? Chez les
petits-bourgeois ?
Alain Accardo
Avril 2006
alain accardo ,c
Vous aimerez peut-être aussi
- Dés de La Destinée 18pDocument18 pagesDés de La Destinée 18pharevishnouPas encore d'évaluation
- Charles Perelman Et L. Olbrechts-Tyteca - Traite de L Argumentation, PUF 1958Document370 pagesCharles Perelman Et L. Olbrechts-Tyteca - Traite de L Argumentation, PUF 1958Silvia De Alejandro100% (5)
- L000489 01sDocument40 pagesL000489 01sseglaPas encore d'évaluation
- Émergence de ProbabilitéDocument5 pagesÉmergence de Probabilitéachille7Pas encore d'évaluation
- Notes Sur L'écologie D'aldo Leopold ("Almanach D'un Comté Des Sables")Document1 pageNotes Sur L'écologie D'aldo Leopold ("Almanach D'un Comté Des Sables")the_existentialistPas encore d'évaluation
- Colloque NietzscheDocument1 pageColloque NietzscheEmmanuel SalanskisPas encore d'évaluation
- Principes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuD'EverandPrincipes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuPas encore d'évaluation
- THOMAS. La Verité, Le Juge Et L'historienDocument21 pagesTHOMAS. La Verité, Le Juge Et L'historienGina LeónPas encore d'évaluation
- CULTURE ET TECHNIQUE Dominique BourgDocument14 pagesCULTURE ET TECHNIQUE Dominique BourgIntinionPas encore d'évaluation
- Balibar, Étienne, Quel Universalisme Aujourd'Hui, e Cercle Gramsci, 3 December 1993, LimogesDocument28 pagesBalibar, Étienne, Quel Universalisme Aujourd'Hui, e Cercle Gramsci, 3 December 1993, LimogesbalibarPas encore d'évaluation
- Elster Marché Et ForumDocument25 pagesElster Marché Et ForumErin ZhanPas encore d'évaluation
- Paix PerpetuelleDocument17 pagesPaix PerpetuelleVeronica Stancu100% (1)
- Anarcho CommunismeDocument356 pagesAnarcho CommunismeSwann ProfanePas encore d'évaluation
- Demulier Guerre-Paix PDFDocument15 pagesDemulier Guerre-Paix PDFAristo PatPas encore d'évaluation
- Pelerin de L'absoluDocument135 pagesPelerin de L'absoluDidier CoutanceauPas encore d'évaluation
- Le Droit Comme Forme de Socialisation Georg Simmel Et Le Problème de LégitimitéDocument24 pagesLe Droit Comme Forme de Socialisation Georg Simmel Et Le Problème de LégitimitébloodyblackwingPas encore d'évaluation
- Aurore NietzscheDocument259 pagesAurore NietzschealiodormanoleaPas encore d'évaluation
- Corps Mystique Et Société Politique Chez Eric Voegelin (Gontier)Document21 pagesCorps Mystique Et Société Politique Chez Eric Voegelin (Gontier)dhstyjntPas encore d'évaluation
- Victor Delbos - La Philosophie Pratique de Kant-Alcan (1905)Document818 pagesVictor Delbos - La Philosophie Pratique de Kant-Alcan (1905)Benoit GidePas encore d'évaluation
- Vacarme - Faut-Il Brûler LegendreDocument13 pagesVacarme - Faut-Il Brûler LegendreEmmanuel GleveauPas encore d'évaluation
- Alexander Neumann - Conscience de CasseDocument116 pagesAlexander Neumann - Conscience de CassevfpuzonePas encore d'évaluation
- L'anarchieDocument12 pagesL'anarchieDuncan GnahouaPas encore d'évaluation
- Michel FOUCAULT, L'Herméneutique Du SujetDocument5 pagesMichel FOUCAULT, L'Herméneutique Du SujetSchneider AntoinePas encore d'évaluation
- Crise de La Raison Et Image de La Pensée Chez Deleuze - Villani, ArnaudDocument14 pagesCrise de La Raison Et Image de La Pensée Chez Deleuze - Villani, ArnaudJulius1982Pas encore d'évaluation
- Maurice Hauriou, Réponse A Un Docteur en DroitDocument6 pagesMaurice Hauriou, Réponse A Un Docteur en DroitladalaikaPas encore d'évaluation
- Le Vieillissement Au Féminin Et Au Masculin Chez Simone de Beauvoir Female and Male Aging in Simone de BeauvoirDocument15 pagesLe Vieillissement Au Féminin Et Au Masculin Chez Simone de Beauvoir Female and Male Aging in Simone de BeauvoirLola MontelPas encore d'évaluation
- Pierre Pachet /// Habilitation À Diriger Des RecherchesDocument32 pagesPierre Pachet /// Habilitation À Diriger Des RecherchesPierrePachetPas encore d'évaluation
- Bruno Karsenti: La Transcendance de L'autonomieDocument11 pagesBruno Karsenti: La Transcendance de L'autonomieDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Pourquoi Balibar ?, Par Vincent DescombesDocument15 pagesPourquoi Balibar ?, Par Vincent Descombesk1103634Pas encore d'évaluation
- Pédérastie GrecqueDocument4 pagesPédérastie GrecquearthurchevreulPas encore d'évaluation
- Balibar, Cosmopolitisme Et InternationalismeDocument28 pagesBalibar, Cosmopolitisme Et InternationalismeSpinoza1974Pas encore d'évaluation
- Choresie (Augustin Berque) (CGQ) PDFDocument12 pagesChoresie (Augustin Berque) (CGQ) PDFRodrigo BuenaventuraPas encore d'évaluation
- Description Et Interpretation Chez Clifford GeertzDocument7 pagesDescription Et Interpretation Chez Clifford GeertzdemaistrePas encore d'évaluation
- Qu Est Ce Que L Ethique Des Vertus - Konstantin BuechlerDocument18 pagesQu Est Ce Que L Ethique Des Vertus - Konstantin BuechlerYves GhiotPas encore d'évaluation
- Rapport Préliminaire de La Commission Pour La Vérité Sur La Dette Publique GrecqueDocument64 pagesRapport Préliminaire de La Commission Pour La Vérité Sur La Dette Publique GrecqueCADTM100% (2)
- Socio Dans La CiteDocument283 pagesSocio Dans La Citekhouadi abdelwahidPas encore d'évaluation
- L'essence de La Modernité Selon Heidegger La RepresentationDocument10 pagesL'essence de La Modernité Selon Heidegger La RepresentationJorge CarrilloPas encore d'évaluation
- Lordon10 PDFDocument215 pagesLordon10 PDFOussamaGhajjouPas encore d'évaluation
- L'apologie de La Guerre Dans La Philosophie ContemporaineDocument30 pagesL'apologie de La Guerre Dans La Philosophie ContemporaineMichel Bourot100% (1)
- Feuerbach Lecteur de Fichte PDFDocument18 pagesFeuerbach Lecteur de Fichte PDFgdupres66Pas encore d'évaluation
- La Biographie Historique en France Un Essai DhistDocument17 pagesLa Biographie Historique en France Un Essai DhistAbdelghani BoualiPas encore d'évaluation
- Edith SteinDocument150 pagesEdith SteinRone SantosPas encore d'évaluation
- Querelles Cartésiennes Débat Entre Alquié Et Guéroult Adouli KhouloudDocument7 pagesQuerelles Cartésiennes Débat Entre Alquié Et Guéroult Adouli KhouloudKhouloud Adouli100% (1)
- Réification Et Antagonisme. L'opéraïsme, La Théorie Critique Et Les Apories Du Marxisme Autonome - Frédéric Monferrand Et Vincent ChansonDocument10 pagesRéification Et Antagonisme. L'opéraïsme, La Théorie Critique Et Les Apories Du Marxisme Autonome - Frédéric Monferrand Et Vincent ChansongrootvaderPas encore d'évaluation
- Qu'Est-ce Que Les Lumières - KantDocument5 pagesQu'Est-ce Que Les Lumières - KantTristanPas encore d'évaluation
- Luchelli, J.P. - These Le TransfertDocument310 pagesLuchelli, J.P. - These Le TransfertPatricio Andrés BelloPas encore d'évaluation
- F. Gros Introduction À La Philosophie de Michel Foucault. M.F. Une Philosophie de La VéritéDocument7 pagesF. Gros Introduction À La Philosophie de Michel Foucault. M.F. Une Philosophie de La VéritéNicolasCaballeroPas encore d'évaluation
- Boltanski ChiapelloDocument5 pagesBoltanski ChiapelloMichel FultotPas encore d'évaluation
- Durkheim (1893) de La Division Du Travail Social PDFDocument502 pagesDurkheim (1893) de La Division Du Travail Social PDFVincent ColonnaPas encore d'évaluation
- Levinas Et DerridaDocument6 pagesLevinas Et DerridaAnonymous cfc0YgPas encore d'évaluation
- Philosophie Morale Et PolitiqueDocument5 pagesPhilosophie Morale Et PolitiqueJonas LewisPas encore d'évaluation
- Heidegger Et Le Problème Du Monde de 1927 À 1930.Document109 pagesHeidegger Et Le Problème Du Monde de 1927 À 1930.Frédéric DautremerPas encore d'évaluation
- Kant e Derrida CosmoplitismoDocument14 pagesKant e Derrida CosmoplitismoMaíra MatthesPas encore d'évaluation
- Engel - Michel Foucault, Connaissance, Veritéet EthiqueDocument5 pagesEngel - Michel Foucault, Connaissance, Veritéet EthiqueDmitry DunduaPas encore d'évaluation
- Badiou WittgensteinDocument10 pagesBadiou WittgensteinB RhiePas encore d'évaluation
- Dehors, Chaos Et Matières Intensives Dans La Philosophie de Gilles Deleuze - Mengue, Philippe PDFDocument25 pagesDehors, Chaos Et Matières Intensives Dans La Philosophie de Gilles Deleuze - Mengue, Philippe PDFJulius1982Pas encore d'évaluation
- Histoiredelesthen France PDFDocument332 pagesHistoiredelesthen France PDFFrancisco Caja LópezPas encore d'évaluation
- Sortir de L'économie N°4 - Printemps 2012)Document266 pagesSortir de L'économie N°4 - Printemps 2012)croquignolPas encore d'évaluation
- Comentario A La Barbarie de Michel HenryDocument3 pagesComentario A La Barbarie de Michel HenryLuis FelipePas encore d'évaluation
- La Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Tremblement de Bataille - Philippe Sollers LEIDO (2002)Document4 pagesTremblement de Bataille - Philippe Sollers LEIDO (2002)Diego Luis SanrománPas encore d'évaluation
- Dédoublement Et Unité Dans L'abbé CDocument22 pagesDédoublement Et Unité Dans L'abbé CDiego Luis SanrománPas encore d'évaluation
- Socialisme Fasciste Drieu La (... ) Drieu La Bpt6k1512379pDocument259 pagesSocialisme Fasciste Drieu La (... ) Drieu La Bpt6k1512379pDiego Luis SanrománPas encore d'évaluation
- AnthropologieDocument2 pagesAnthropologieDiego Luis SanrománPas encore d'évaluation
- Théorie de La Contradiction (1975)Document104 pagesThéorie de La Contradiction (1975)Diego Luis SanrománPas encore d'évaluation
- Paul Virilio Cybermonde La Politique Du PireDocument24 pagesPaul Virilio Cybermonde La Politique Du PireDiego Luis SanrománPas encore d'évaluation
- (Ebook FR) Autogestion Et HiérarchieDocument16 pages(Ebook FR) Autogestion Et HiérarchieJean-yves DagonPas encore d'évaluation
- Tableau Figures 2Document3 pagesTableau Figures 2Charaf Adam LaasselPas encore d'évaluation
- Formation Montage PDFDocument8 pagesFormation Montage PDFpopeye974100% (1)
- Memoire Online - L'Externalisation - Un Mythe Ou Une Stratégie Pour Les Entreprises Du Cameroun - L'exemple Des Banques Commerciales - Geraldine FOUALEMDocument86 pagesMemoire Online - L'Externalisation - Un Mythe Ou Une Stratégie Pour Les Entreprises Du Cameroun - L'exemple Des Banques Commerciales - Geraldine FOUALEMarthur_1569100% (1)
- Audit GRHDocument96 pagesAudit GRHSidAli KouPas encore d'évaluation
- Écrits Sans PrixDocument86 pagesÉcrits Sans PrixalfneynellyPas encore d'évaluation
- Corrige SVTDocument92 pagesCorrige SVTMohamedPas encore d'évaluation
- Chapitre 0Document2 pagesChapitre 0Mehdi CherguiPas encore d'évaluation
- Brochure Latham Piscine Acier 2020 FRDocument13 pagesBrochure Latham Piscine Acier 2020 FREmanuel HuardPas encore d'évaluation
- Series ProgrammesDocument4 pagesSeries Programmeshanen100% (1)
- Fiche Pratique Pour Renseigner La Maquette Modèle Economique D'une Startup PDFDocument2 pagesFiche Pratique Pour Renseigner La Maquette Modèle Economique D'une Startup PDFNilo TiquePas encore d'évaluation
- PNL 170503163650Document31 pagesPNL 170503163650IlyassPas encore d'évaluation
- TP MAXSURF StructureDocument7 pagesTP MAXSURF StructurehamzaPas encore d'évaluation
- 8 Foudre 2004Document36 pages8 Foudre 2004Amin Lucho100% (1)
- MCSA12 Formation Mcsa Windows Server 2012 PDFDocument4 pagesMCSA12 Formation Mcsa Windows Server 2012 PDFCertyouFormation0% (1)
- Devoir de MATHS 5eDocument2 pagesDevoir de MATHS 5eLAWSON NICOLASPas encore d'évaluation
- Thèse Loukil Leila PDFDocument224 pagesThèse Loukil Leila PDFMoh Abd BenPas encore d'évaluation
- Olympe de Gouges - LDP - Partie 7 - DissertationDocument85 pagesOlympe de Gouges - LDP - Partie 7 - DissertationsallimabenmalhaPas encore d'évaluation
- Transfert Dans Systemes Fluides Mono Multiphasiques PDFDocument6 pagesTransfert Dans Systemes Fluides Mono Multiphasiques PDFNacera BenslimanePas encore d'évaluation
- AssembleurDocument37 pagesAssembleurzarathoustra1959100% (1)
- TP Flambement Laboratoire MateriauxDocument8 pagesTP Flambement Laboratoire MateriauxRym Lachgar100% (2)
- Informatique PDFDocument32 pagesInformatique PDFabdoul7Pas encore d'évaluation
- Analyse Matlab PDFDocument1 pageAnalyse Matlab PDFMike NkouetchaPas encore d'évaluation
- Emploi Du Temps Filière COMPTABILITE-FINANCE-FISCALITEDocument2 pagesEmploi Du Temps Filière COMPTABILITE-FINANCE-FISCALITESalma NoursPas encore d'évaluation
- Projet Final - C.Colón - CompressedDocument3 pagesProjet Final - C.Colón - CompressedjackPas encore d'évaluation
- Corre L'Intensité Du Courant ÉlectriqueDocument2 pagesCorre L'Intensité Du Courant ÉlectriqueAbđė Ěł ŁğđPas encore d'évaluation
- Optimisation1 Chap3bDocument28 pagesOptimisation1 Chap3bSawssan Hanane100% (1)
- TETES OUVRAGES HYDRAULIQUE TYPE BUSES AUTOCAD - Recherche GoogleDocument2 pagesTETES OUVRAGES HYDRAULIQUE TYPE BUSES AUTOCAD - Recherche GoogleBraised.Mountains-Association AssociationPas encore d'évaluation
- Les Niveaux Fonctionnels Déterminent Les Fonctionnalités Des Services de Domaine Active DirectoryDocument5 pagesLes Niveaux Fonctionnels Déterminent Les Fonctionnalités Des Services de Domaine Active DirectoryHassan JoussanPas encore d'évaluation