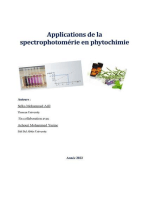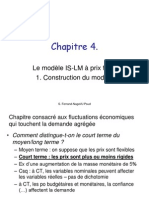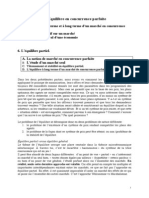Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Transformations Lentes Et Rapides
Transféré par
José Ahanda NguiniCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Transformations Lentes Et Rapides
Transféré par
José Ahanda NguiniDroits d'auteur :
Formats disponibles
CHAPITRE 1 TRANSFORMATIONS LENTES ET RAPIDES
1 Rappels sur les couples oxydantsrducteurs
1. Oxydants et rducteurs
Un rducteur est une espce chimique capable de cder au moins un lectron Demi-quation
2+ 3+ * Fe = Fe + e
Red = Ox + ne
Le rducteur Fe2+ est oxyd en Fe3+. Le rducteur est toujours oxyd. La perte dlectrons correspond une oxydation. Un oxydant est une espce chimique capable de capter au moins un lectron Demi-quation
2+ * Fe + 2 e = Fe
Ox + ne = Red
Loxydant Fe2+ est rduit en Fe. Loxydant est toujours rduit. Le gain dlectrons correspond une rduction.
2. Couple redox
Un mme lment impliqu dans un oxydant et un rducteur dfinit un couple oxydant/rducteur Dans le couple redox, le rducteur est toujours prsent droite de loxydant. Remarque : une mme espce chimique peut tre un rducteur dans un milieu ractionnel et un oxydant dans un autre milieu ractionnel. Il est important dobserver son volution : cest la perte ou le gain dlectrons qui dfinit si lon est en prsence dune oxydation ou dune rduction de lespce chimique.
3. Quelques exemples de couples redox
Couple redox H+(aq)/H2(g) O2(g)/OH(aq) Mn+(aq)/M(s) Fe3+(aq)/Fe2+(aq) I2(g)/I(aq) MnO4(aq)/Mn2+(aq)
2(aq)/Cr3+(aq) Cr2O7 2(aq)/S O 2(aq) S4O6 2 3 H2O2/H2O
Oxydant ion H+(aq) dioxygne
Rducteur dihydrogne ion hydroxyde cation mtallique mtal ion fer(III) ion fer(II) diiode ion iodure ion permanganate ion manganse ion chrome ion bichromate ion ttrathionate eau oxygne ion thiosulfate eau
Demi-quation 2H+(aq) + 2e = H2(g) O2(g) + 2H2O + 4e = 4OH Mn+(aq) + ne = M(s) Fe3+(aq) + e = Fe2+ (aq) I2(g) + 2e = 2I MnO4(aq) + 8H+(aq) + 5e = Mn2+(aq) + 4H2O 2(aq) + 14H+ + 6e = Cr2O7 2Cr3+(aq) + 7H2O 2(aq) + 2e = 2S O 2(aq) S4O6 2 3 H2O2 + 2e + 4H+(aq) = 2H2O
cours
savoir-faire
exercices
corrigs
exemples dapplication
Au laboratoire, le professeur prpare une solution de nitrate dargent dans laquelle il dpose une lame dtain. Au bout dun temps suffisamment long, on observe un lger dpt dargent sur la lame dtain.
1. Quels sont les couples redox qui interviennent dans cette exprience ? 2. crire les demi-quations doxydorduction correspondantes. 3. Quel est loxydant ? Quel est le rducteur ? Prciser la demi-raction correspondant loxydation et celle correspondant la rduction.
1. Indication : dterminer les espces en prsence partir de lnonc et consulter le tableau ci-contre. Les espces qui voluent sont largent et ltain. Ce sont des mtaux. Ag+(aq)/Ag(s) et Sn2+(aq)/Sn(s) 2. Indication : le tableau des couples redox indique la demi-quation pour un mtal M : Mn+(aq) + ne = M(s) Ag+(aq) + e = Ag(s) et Sn2+(aq) + 2e = Sn(s) 3. Indication : les ions argent initialement prsents dans la solution donnent du mtal argent Ag. Lion argent prsent dans le nitrate dargent volue au cours de lexprience puisquon observe un dpt de mtal argent. Lion argent capte des lectrons. Ag+ est donc loxydant. Il est rduit. La demi-quation correspondant cette rduction est donc : Ag+(aq) + e = Ag(s) Ltain passe sous la forme Sn2+. Il donne des lectrons. Il est donc oxyd. Ltain est le rducteur. La demi-quation correspondant cette oxydation est donc : Sn(s) = Sn2+(aq) + 2e
corrig comment
On donne les espces chimiques suivantes : I, Cu2+, Cr3+, O2, Fe3+.
1. Trouver les oxydants. Justifier. 2. Quels sont les rducteurs conjugus de ces oxydants ?
Indication : consulter le tableau des couples redox. Attention, Cr3+ peut tre un oxy2). dant (conjugu de Cr) ou un rducteur (conjugu de Cr2O7
corrig comment
1. Cu2+, O2, Fe3+, Cr3+. 2. Cu2+(aq)/Cu, O2(g)/OH(aq), Fe3+(aq)/Fe, Fe3+(aq)/Fe2+(aq), Cr3+(aq)/Cr.
9
CHAPITRE 1 TRANSFORMATIONS LENTES ET RAPIDES
2 Ractions doxydorduction
1. Dfinition
Une raction doxydorduction met en jeu deux couples redox et donc le transfert dun ou plusieurs lectrons du rducteur de lun des couples loxydant de lautre couple. Cest lassociation des demi-quations doxydorduction correspondant chaque couple redox qui constitue lquation doxydorduction. rducteur 1 oxydant 2 + n2 e n2 rducteur 1 + n1 oxydant 2 = = oxydant 1 + n1 e rducteur 2 n2 oxydant 1 + n2 rducteur 2 n2 n1
n2 Red1 + n1 Ox2 n2 Ox1 + n1 Red2
2. Exemple
Fe Cu2+ + 2e 2 Fe + 3 Cu2+ = = Fe3+ + 3e Cu 2 Fe3+ + 3 Cu 2 3
Les couples redox en prsence sont : Fe3+(aq)/Fe(s) et Cu2+(aq)/Cu(s). chaque couple correspond une demi-quation doxydorduction. Dans lexemple choisi, Cu2+ est loxydant : il est rduit. Fe est le rducteur : il est oxyd.
exemple dapplication
On veut prparer un litre de solution de sulfate de cuivre II. Pour cela, on dissout une masse m1 de 60 g de sulfate de cuivre II hydrat CuSO4, 5H2O dans 1 L deau. La solution obtenue est bleue.
1. Quelle est la concentration molaire dions Cu2+ dans la solution ? 2. On prlve 200 mL de cette solution et on y plonge une lame de zinc. La
solution initialement bleue se dcolore peu peu. a. Pourquoi la solution se dcolore-t-elle ? b. Quels sont les couples doxydorduction en prsence ? crire la demi-quation doxydorduction correspondant chaque couple. c. Dans la solution, quel est loxydant ? Quel est le rducteur ? d. crire lquation de la raction doxydorduction qui seffectue. e. Quelle est la masse m2 de cuivre qui sest dpose lorsque la solution est devenue incolore ? Quelle est alors la masse m3 de zinc qui a disparu ?
10
cours
savoir-faire
exercices
corrigs
1. Indication : la quantit de matire initiale des ions Cu2+ est gale la quantit de matire du sulfate de cuivre hydrat CuSO4, 5 H2O mise en solution. m1 nCuSO4, 5 H2O = = 60 = 0,24 mol M CuSO4, 5 H2O 249 ,6 n 2+ 0, 24 = 0,24 mol.L1 nCu2+ = nCuSO4, 5 H2O = 0,24 mol cCu2+ = Cu = V 1 2. a. Indication : ce sont les ions Cu2+ qui colorent la solution en bleu. Si la solution se dcolore, cest donc que la quantit de matire des ions Cu2+ dans la solution diminue. b. Indication : on sait dj que la quantit dions Cu2+ dans la solution volue. Les ions Cu2+ interviennent donc dans lun des couples redox. Le zinc introduit dans la solution est responsable de la dcoloration : il intervient donc dans lautre couple redox. Les couples redox sont : Cu2+(aq)/Cu(s) et Zn2+(aq)/Zn(s). Cu2+(aq) + 2e = Cu(s) et Zn2+(aq) + 2 e = Zn(s) c. Indication : dans les demi-quations, Cu2+(aq) et Zn2+(aq) sont les oxydants. Mais on sait que la teneur en ions Cu2+(aq) prsents initialement dans la solution diminue. Loxydant est donc Cu2+(aq) et le rducteur Zn(s). d. Conseil : crire les deux demi-ractions dans le sens de la rduction de loxydant et de loxydation du rducteur. Multiplier, si ncessaire, chaque demi-quation par un nombre pour que le nombre dlectrons capts par loxydant soit gal au nombre dlectrons cds par le rducteur. Faire la somme membre membre des deux demiquations. rduction de loxydant Cu2+(aq) + 2 e = Cu(s) Zn(s) = Zn2+(aq) + 2 e oxydation du rducteur Cu2+(aq) + Zn(s)
corrig comment
Cu(s) + Zn2+
e. Conseil : utiliser le tableau dcrivant lvolution du systme chimique et dfinir le ractif limitant (cf. savoir-faire, chap. 4, p. 88). Dans ce cas, le zinc est en excs et le ractif limitant est Cu2+ qui disparat compltement lorsque la raction est termine (solution incolore). nCu2+ = cCu2+. V = 0,24 . 0,2 = 0,048 mol. Quand la raction est termine, tous les ions Cu2+ ont disparu et xf = 0,048 mol. quation tat du systme Avancement (mol) Initial xi = 0 En cours x Final xf = 0,048 Cu2+ + Zn Cu + Zn2+ Quantits de matire (mol) 0,048 en excs 0 0 0,048 x en excs x x 0 en excs 0,048 0,048
La quantit de matire des ions Zn2+ prsents dans la solution la fin de la raction est gale la quantit de matire de zinc qui a disparu au cours de la raction. nZn = nZn2+ m3 = nZn . MZn = 0,048 . 65,4 = 3,139 g.
m2 = nCu . MCu = 0,048 . 63,5 = 3,048 g.
11
CHAPITRE 1 TRANSFORMATIONS LENTES ET RAPIDES
3 Facteurs cintiques : temprature
et concentration des ractifs
1. Influence de la temprature
Dans la trs grande majorit des cas, une lvation de temprature acclre les ractions. Un abaissement de la temprature ralentit une raction. En moyenne, la vitesse est multiplie par un facteur voisin de 2 si la temprature augmente de dix degrs.
2. Influence de la concentration des ractifs
La vitesse dune raction chimique est plus grande si la concentration des ractifs augmente. On ralentit une raction en diluant le milieu ractionnel. La vitesse dune raction chimique est proportionnelle la concentration des ractifs.
exemple dapplication
On dispose de deux solutions A et B. On prlve 10 mL de la solution A et 10 mL de la solution B. Les prlvements sont placs chacun dans une prouvette au bain-marie. un instant t0, on mlange les deux solutions puis on note le temps o apparat une coloration. On ralise cette exprience diffrentes tempratures. Les rsultats obtenus sont donns dans le tableau ci-dessous :
Exprience Temprature (C) Temps coul (s) 1 30 15 2 25 17 3 20 20 4 15 23 5 10 24 6 5 31 a) Reprsenter les variations du temps en fonction de la temprature. b) Que peut-on en dduire ?
On dispose de la solution A de concentration constante et dune solution C
de concentration variable. On prlve 10 mL de solution A et 10 mL de solution C. un instant t0, on mlange les deux solutions puis on note le temps o apparat une coloration. On ralise cette exprience pour diffrentes concentrations de la solution C. Les rsultats obtenus sont donns dans le tableau ci-contre :
12
cours
savoir-faire
exercices
corrigs
Exprience Concentration solution C (mol.L1) Temps coul (s)
1 20 9
2 16 10
3 12 12
4 8 20
5 4 54
6 2 60
a) Reprsenter les variations du temps en fonction de la concentration. b) Que peut-on en dduire ?
Comparer les deux courbes obtenues. Que peut-on en dduire ? a) Conseil : bien placer le temps coul en ordonne et la temprature en abscisse.
b) Le temps coul qui reprsente le temps de raction diminue lorsque la temprature augmente. Llvation de temprature augmente la vitesse de la raction puisquon obtient plus vite la coloration de la solution.
corrig comment
35 30 25 20 15 10 a) Conseil : l encore bien placer le 5 temps coul en ordonne et la concen- 0
tration de la solution C en abscisse. Attention, dans le mlange, la concentration a chang : V prlev 10 [Xi] = [Xi]. = [X] = [Xi]. V total 20 2
a
0 5 10 15 20 25 30 35
Temprature (C)
avec [X] = concentration de lespce inconnue dans le mlange. [Xi] = concentration de lespce inconnue dans la solution C. Concentration Xi solution C (mol.L1) Concentration X mlange (mol.L1) 20 10 16 8 12 6 8 4 4 2 2 1
Temps coul (s)
b) Le temps coul (temps de raction) diminue lorsque la concentration dun ou plusieurs ractifs augmente. Laugmentation de la concentration du ractif augmente la vitesse de raction puisquon obtient plus vite la coloration de la solution.
Indication : une droite indique une proportionnalit. 0 2 4 6 8 10 12 Les courbes a et b sont diffrentes : la temprature et la concentration sont deux facteurs qui agissent sur la vitesse de la raction mais ils nagissent pas de la mme faon.
80 70 60 50 40 30 20 10 0
CHAPITRE 1 TRANSFORMATIONS LENTES ET RAPIDES
4 Interprtation microscopique
de la raction chimique
1. Chocs et collisions
Pour que deux entits chimiques (atomes, molcules, ions) ragissent, il faut quelles entrent en collision et que le choc soit efficace. Le choc est efficace si les entits chimiques sont modifies aprs le choc : les entits chimiques doivent tre en mouvement et donc ltat liquide ou ltat gazeux.
2. Exemple
Observons ce qui se passe lors dun choc efficace. Prenons lexemple de la formation de liodure dhydrogne : H2(g) + I2(g) 2HI(g).
Phase 1 ltat gazeux, les molcules de dihydrogne et de diiode se dplacent. Elles possdent une nergie cintique. Phase 2 Les molcules H2 et I2 se rapprochent. Si elles ont une orientation adquate et : si leur nergie cintique est faible, H2 et I2 se repoussent et se sparent : il y a eu un choc lastique ; si leur nergie cintique est leve, les liaisons covalentes dans H2 et I2 peuvent se rompre et de nouvelles liaisons peuvent se former : il y a un tat transitoire. Au moment du choc, lnergie cintique des molcules se convertit en nergie dactivation Ea. Pour quun choc soit efficace, il faut que la somme des nergies cintiques des molcules H2 et I2 soit au moins gale lnergie dactivation. Phase 3 Ltat transitoire a une dure de vie trs courte (1010 s). On peut alors : soit reformer H2 et I2 et il ny a pas de raction ; soit obtenir 2HI et la raction continue. Phase 4 Les molcules HI se sparent.
Remarque :
E > Ea raction exonergtique E < Ea raction endonergtique
14
cours
savoir-faire
exercices
corrigs
exemples dapplication
Pour faire brler du charbon, il faut dabord le chauffer (avec de lalcool,
du petit bois...). Considrez-vous que cette raction est exonergtique ou endonergtique ? Expliquer. Le E de cette raction est-il suprieur ou infrieur lnergie dactivation ?
corrig comment
Conseil : traduire lnonc en termes de raction chimique. Lquation de la raction de combustion du charbon est de la forme : C + O2 CO2 Pour que la raction ait lieu, il faut que les liaisons OO du dioxygne se cassent et quil se forme dautres liaisons. Il faut donc commencer par apporter de lnergie pour que les liaisons puissent se rompre et quil se forme une entit transitoire. Cette nergie doit tre au moins gale lnergie dactivation Ea. Une fois la raction amorce, elle sautoentretient puisque la combustion du charbon dgage de la chaleur. Cest une raction exonergtique. Le E est donc suprieur Ea (graphique p. 14).
Dessiner, pour une raction endonergtique entre deux entits A et B, une figure analogue la figure ci-dessous.
nergie E
tat transitoire (g)
Ea Ef Ei
Ractifs A+B
nergie libre
E
Produits (AB par exemple) Avancement de la raction
Dans une raction endonergtique, E < Ea. Les phases 1, 2 et 3 restent inchanges. Seule la phase 4 est modifie.
corrig comment
15
CHAPITRE 1 TRANSFORMATIONS LENTES ET RAPIDES
5 Aspects cintiques microscopiques
1. Transformations lentes et rapides
Ractions rapides : certaines ractions sont si rapides quelles donnent limpression dtre instantanes : ractions de neutralisation ; ractions de prcipitation ; certaines ractions doxydorduction. Ractions lentes : ractions doxydorduction. Ractions trs lentes : formation de la rouille, synthse de leau.
2. Frquence des chocs
Le choc entre deux molcules A2 et B2 se produit si d RA2 + RB2. La frquence n des chocs dpend du nombre dentits ractives par unit de volume, de la vitesse de ces entits et donc de la temprature.
RA2 d RB2 A2
n = NA2.NB2.S.VA2 B2 avec : S = (RA2 + RB2)2 section efficace de collision ; NA2 nombre dentits ractives A2 par unit de volume dans lintervalle de temps considr ; NB2 nombre dentits ractives B2 par unit de volume dans lintervalle de temps considr ; VA2 vitesse de lentit A2.
3. Influence des facteurs cintiques
Augmentation de la temprature : plus la temprature des ractifs est leve, plus les entits chimiques se dplacent grande vitesse avec une grande nergie cintique. Les collisions sont frquentes, la probabilit davoir des chocs efficaces augmente et la vitesse de raction augmente. Augmentation de la concentration des ractifs : en augmentant le nombre dentits dans le milieu ractionnel, on augmente la probabilit que les entits se rencontrent et donc le nombre de chocs.
16
cours
savoir-faire
exercices
corrigs
exemples dapplication
Voici trois quations reprsentant des ractions chimiques :
1. Ag+(aq) + Cl(aq) AgCl(s) 2. Cu2+(aq) + Zn(s) Cu(s) + Zn2+(aq) 3. 4Fe(s) + 3O2(g) 2Fe2O3(s) Quelle est la raction qui, 25 C, devrait normalement seffectuer : le plus vite ? le plus lentement ? Peut-on mettre exprimentalement en vidence ces observations ?
corrig comment
Indication : bien noter dans quel milieu les espces voluent. La raction 1 (prcipitation de AgCl[s]) est la raction la plus rapide. La raction 3 (oxydation du fer) est la plus lente. Conseil : certaines ractions ont t vues en TP. Raction 1 : lapparition du prcipit est quasi immdiate. Raction 2 : cest une raction doxydorduction. La solution bleue dions Cu2+ se dcolore lentement. Raction 3 : un morceau de ferraille abandonn lair soxyde trs lentement.
On veut raliser lexprience suivante : A(g) + B(g) C(g) Pour optimiser la vitesse de raction, on fait plusieurs essais en modifiant chaque essai les concentrations initiales des ractifs : cest dans lessai 3 que la vitesse initiale de la raction est la plus grande. Discutez.
Essais Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Concentration A mol.L1 0,2 0,1 0,2 0,1 Concentration B mol.L1 0,2 0,3 0,3 0,4
corrig comment
Indication : considrer la frquence des chocs. La concentration des ractifs est plus leve dans les essais 3 et 4. Or la vitesse est plus grande dans lessai 3 : la probabilit davoir des chocs efficaces est donc plus importante dans lessai 3. La frquence n des chocs dpend du nombre dentits ractives par unit de volume, de la vitesse de ces entits et donc de la temprature : n = NA2.NB2.S.VA2. Pour un volume de 1 L, n dpend notamment du produit des concentrations. Cest dans lessai 3 que ce produit est le plus grand et donc que la frquence des chocs efficaces est la plus leve.
17
Vous aimerez peut-être aussi
- Le Modèle de SollowDocument40 pagesLe Modèle de SollowJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- 17 TRAITS RARES Qui Mènent Au Succès Par SmartsCubeDocument37 pages17 TRAITS RARES Qui Mènent Au Succès Par SmartsCubeJosé Ahanda Nguini100% (4)
- Macro Chap 7 - Le Modèle OA-DADocument41 pagesMacro Chap 7 - Le Modèle OA-DAJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- Le Modèle de RamseyDocument22 pagesLe Modèle de RamseyJosé Ahanda Nguini100% (3)
- ExercicesEtDS Etude Quantitative Chimie BEPDocument2 pagesExercicesEtDS Etude Quantitative Chimie BEPMenasria HakimPas encore d'évaluation
- Série de Révision N°1Document5 pagesSérie de Révision N°1BaccariPas encore d'évaluation
- Cours Cinéique UM6P 20 - 21Document57 pagesCours Cinéique UM6P 20 - 21Hifdi AyaPas encore d'évaluation
- Chimie TD 3 Cinétique Chimique PDFDocument4 pagesChimie TD 3 Cinétique Chimique PDFOussama El BouadiPas encore d'évaluation
- Chap7 BtsDocument16 pagesChap7 BtsImen HammoudaPas encore d'évaluation
- Ch4 Ds Atome Structure Electronique 28Document2 pagesCh4 Ds Atome Structure Electronique 28Molka HamdiPas encore d'évaluation
- Corrigé Type Chimie Des Surfaces Master 1 CHIMIE M S1 2019 2020Document2 pagesCorrigé Type Chimie Des Surfaces Master 1 CHIMIE M S1 2019 2020Zahra l زهرة50% (2)
- TD 1 ThermodynamiqueDocument4 pagesTD 1 Thermodynamiqueyoussef barjiPas encore d'évaluation
- Chap.6 TP12 Titrage PH Metrique D Un Vinaigre Correction PDFDocument2 pagesChap.6 TP12 Titrage PH Metrique D Un Vinaigre Correction PDFYouSsef EchafaiPas encore d'évaluation
- Séance 04 Juin 2020Document29 pagesSéance 04 Juin 2020Hafsa MajentaPas encore d'évaluation
- Chimie-Chapitre1-Mesures Quantite Matiere PDFDocument3 pagesChimie-Chapitre1-Mesures Quantite Matiere PDFRedouane Reda100% (1)
- Acide FormiqueDocument5 pagesAcide FormiquebivaPas encore d'évaluation
- Suivi D Une Transformation Chimique Cours 2 2Document9 pagesSuivi D Une Transformation Chimique Cours 2 2Smove OnerPas encore d'évaluation
- Chapitre VDocument4 pagesChapitre VBelinda Dancheu100% (1)
- Correction Epreuve de Chimie Des Electrolytes 2014 2015Document5 pagesCorrection Epreuve de Chimie Des Electrolytes 2014 2015Imene GhmrPas encore d'évaluation
- ChimieDocument5 pagesChimieEssamiPas encore d'évaluation
- OS Corrige RedoxDocument31 pagesOS Corrige RedoxMahdiNaani100% (2)
- TD Cinetiqueserie n07Document2 pagesTD Cinetiqueserie n07YASSINE AZNAGPas encore d'évaluation
- Chimie SolutionDocument164 pagesChimie SolutionZonta NeoPas encore d'évaluation
- Mecanique Serie 3Document2 pagesMecanique Serie 3maryem sousitaPas encore d'évaluation
- Série 2 Chimie 1 Avec CorrigéDocument11 pagesSérie 2 Chimie 1 Avec CorrigésamiaPas encore d'évaluation
- C Ex23 Cin Ca PDFDocument4 pagesC Ex23 Cin Ca PDFعادل الحمديPas encore d'évaluation
- Equilibre D Un Corps Sous L Action de 2 Forces Exercices Non Corriges 2 PDFDocument3 pagesEquilibre D Un Corps Sous L Action de 2 Forces Exercices Non Corriges 2 PDFSigmandro AndroPas encore d'évaluation
- TPCorrCeFe 4Document2 pagesTPCorrCeFe 4Amelie Pinchon100% (1)
- Tp11 Deshydratation Methylbutan 2 OlDocument3 pagesTp11 Deshydratation Methylbutan 2 Olالغزيزال الحسن EL GHZIZAL HassanePas encore d'évaluation
- SV1 Chimie1Document49 pagesSV1 Chimie1Yassine ElkaPas encore d'évaluation
- Cinétique Chimique App PDFDocument6 pagesCinétique Chimique App PDFAzizElheni100% (1)
- PHY121 TD3 CorrigeDocument0 pagePHY121 TD3 CorrigeKhaDija KhaLdiPas encore d'évaluation
- Electrochimie ChafouDocument12 pagesElectrochimie ChafouSamah SoltanePas encore d'évaluation
- Fonctions Usuelles PDFDocument29 pagesFonctions Usuelles PDFchanezPas encore d'évaluation
- Poly Complet 08 Circuits Linéaires D'ordre 2 en Régime TransitoireDocument13 pagesPoly Complet 08 Circuits Linéaires D'ordre 2 en Régime TransitoireSélène Chausson100% (1)
- Série Dexercices Sur Lélectrode Normale À HydrogèneDocument4 pagesSérie Dexercices Sur Lélectrode Normale À HydrogènechadaPas encore d'évaluation
- TD Chapitre 6 Cinetique MacroscopiqueDocument12 pagesTD Chapitre 6 Cinetique MacroscopiqueNabil holmesPas encore d'évaluation
- Correction Epreuve de Chimie Des Electrolytes 2014 2015 2Document5 pagesCorrection Epreuve de Chimie Des Electrolytes 2014 2015 2Chimiste ChimistePas encore d'évaluation
- La Loi de Conservation de La MasseDocument4 pagesLa Loi de Conservation de La MasseLo MélodyPas encore d'évaluation
- Théorie Cinétique Des GazDocument6 pagesThéorie Cinétique Des GazFabrice ArriaPas encore d'évaluation
- ExtraitDocument8 pagesExtraitStéphane WilliamPas encore d'évaluation
- 4 Exercice Suivi D'une Transformation ChimiqueDocument2 pages4 Exercice Suivi D'une Transformation Chimiquenabil echerrarPas encore d'évaluation
- TP Dosage WinklerDocument5 pagesTP Dosage WinklerYassine RakchoPas encore d'évaluation
- Oxydation Et RéductionDocument2 pagesOxydation Et RéductionFélix Kouassi100% (1)
- Exercice 4 Réactions Destérification Et Dhydrolyse LAHLALI PDFDocument5 pagesExercice 4 Réactions Destérification Et Dhydrolyse LAHLALI PDFBouba KhedherPas encore d'évaluation
- 12 Thermochimie2 Td-EnonceDocument5 pages12 Thermochimie2 Td-Enoncecours importantPas encore d'évaluation
- TRAVAUX DIRIGES N°4 OXYDO - REDUCTION Et DIAGRAME E-pHDocument4 pagesTRAVAUX DIRIGES N°4 OXYDO - REDUCTION Et DIAGRAME E-pHAlex N'zuePas encore d'évaluation
- Enonces Des Exercices de Chimie TheoriqueDocument34 pagesEnonces Des Exercices de Chimie TheoriqueAbdelhakim Bailal0% (1)
- 2nd AC - C6 Equation - Bilan Dune Réaction ChimiqueDocument8 pages2nd AC - C6 Equation - Bilan Dune Réaction ChimiqueDerz ØffĩčïëlPas encore d'évaluation
- S4 BchitouDocument23 pagesS4 BchitouRafikou22Pas encore d'évaluation
- Exercice 2 Solution Tampon Énoncé Et CorrectionDocument2 pagesExercice 2 Solution Tampon Énoncé Et CorrectionJacky KabeyaPas encore d'évaluation
- Exercice (Type Bac) Suivi Temporel D - Une Transformation ChimiqueDocument2 pagesExercice (Type Bac) Suivi Temporel D - Une Transformation ChimiquephytanjaPas encore d'évaluation
- Série5 Liqvap 2022 PC2Document4 pagesSérie5 Liqvap 2022 PC2Aymen GharbiPas encore d'évaluation
- TP Dosage Complexometrie3Document3 pagesTP Dosage Complexometrie3Sellam AnisPas encore d'évaluation
- C3Chim - Transformations - Limitees - Exercices - Sabatier PDFDocument5 pagesC3Chim - Transformations - Limitees - Exercices - Sabatier PDFAzizElheni0% (1)
- Entr OpieDocument2 pagesEntr OpieamelPas encore d'évaluation
- A-TP-1 RedoxDocument7 pagesA-TP-1 RedoxPathmanathanPas encore d'évaluation
- Cours 2 Chimie IndutrielleDocument15 pagesCours 2 Chimie IndutrielleIsmaëlPas encore d'évaluation
- Fiche D Exos PC 3eDocument2 pagesFiche D Exos PC 3ebertin kabore100% (1)
- Applications de la spectrophotomérie en phytochimie: sciencesD'EverandApplications de la spectrophotomérie en phytochimie: sciencesPas encore d'évaluation
- Théorie Des Organisations (Suite)Document44 pagesThéorie Des Organisations (Suite)José Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- S2 - Les Différentes Approches Théoriques de L'entrepriseDocument68 pagesS2 - Les Différentes Approches Théoriques de L'entrepriseJosé Ahanda Nguini100% (1)
- IAE Chap 7 - Monnaie Et Financement de L'économieDocument33 pagesIAE Chap 7 - Monnaie Et Financement de L'économieJosé Ahanda Nguini100% (1)
- IAE Chap 4 - Mercantilistes Et PhysiocratesDocument35 pagesIAE Chap 4 - Mercantilistes Et PhysiocratesJosé Ahanda Nguini100% (1)
- IAE Conseils DissertationDocument2 pagesIAE Conseils DissertationJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- IAE Chap 6 - Des Néoclassiques Aux ContemporainsDocument0 pageIAE Chap 6 - Des Néoclassiques Aux ContemporainsJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- Macro Chap 5 - Le Modèle IS-LM À Prix FixesDocument18 pagesMacro Chap 5 - Le Modèle IS-LM À Prix FixesJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- Diversité Et Complémentarité Des MétabolismesDocument10 pagesDiversité Et Complémentarité Des MétabolismesJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- Des Débuts de La Génétique Aux Enjeux ActuelsDocument8 pagesDes Débuts de La Génétique Aux Enjeux ActuelsJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- Macro Chap 4 - Le Modèle IS-LM À Prix FixesDocument24 pagesMacro Chap 4 - Le Modèle IS-LM À Prix FixesJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- Economie D'échange Et La Boîte D'edgeworthDocument10 pagesEconomie D'échange Et La Boîte D'edgeworthJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- Macro Chap 2 - Les Marchés Des Biens Et ServicesDocument25 pagesMacro Chap 2 - Les Marchés Des Biens Et ServicesJosé Ahanda Nguini0% (1)
- Macro Chap 1 - Variables Clés Et Théories de La MacroDocument9 pagesMacro Chap 1 - Variables Clés Et Théories de La MacroJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- Equilibre en CCPDocument19 pagesEquilibre en CCPJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- Exos2009 FinalDocument121 pagesExos2009 FinalJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- Facteurs de Production Et Progrès TechniqueDocument31 pagesFacteurs de Production Et Progrès TechniqueJosé Ahanda NguiniPas encore d'évaluation