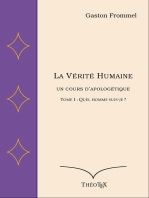Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Bulletin Heideggérien 2-2012
Bulletin Heideggérien 2-2012
Transféré par
sologurenTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bulletin Heideggérien 2-2012
Bulletin Heideggérien 2-2012
Transféré par
sologurenDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
BULLETIN HEIDEGGRIEN (Bhdg)
- Secrtaires : Sylvain CAMILLERI (Universit catholique de Louvain/Universit de Montpellier III) Christophe PERRIN (Universit Paris-Sorbonne) - Comit scientifique : Jeffrey Andrew BARASH (Universit de Picardie Jules Verne) Rudolf BERNET (Katholieke Universiteit Leuven) Steven CROWELL (Rice University) Jean-Franois COURTINE (Universit Paris-Sorbonne) Dan DAHLSTROM (Boston University) Franoise DASTUR (Universit de Nice Sophia-Antipolis) Gnter FIGAL (Albert-Ludwigs-Universitt Freiburg) Jean GRONDIN (Universit de Montral) Theodore KISIEL (Northern Illinois University) Richard POLT (Xavier University) Jean-Luc MARION (Acadmie franaise) Claude ROMANO (Universit Paris-Sorbonne) Hans RUIN (Sdertrn University) Thomas SHEEHAN (Stanford University) Peter TRAWNY (Bergische Universitt Wuppertal) Jean-Marie VAYSSE (Universit de Toulouse-Le Mirail) Helmut VETTER (Universitt Wien) Holger ZABOROWSKI (Catholic University of America) - Comit de rdaction : Diana AURENQUE (Karl-Ruprechts-Universitt Tbingen) Vincent BLOK (Radboud University Nijmegen) Cristian CIOCAN (Universitatea din Bucureti) Franois JARAN (Universitat de Valncia) Julien PIRON (Universit de Lige) Mark SINCLAIR (Manchester Metropolitan University) Christian SOMMER (CNRS, Paris) Sverin YAPO (Universit de Cocody)
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
- Correspondants locaux : Victoria BRIATOVA (- ) Wenjing CAI (University of Copenhagen) Richard COLLEDGE (Australian Catholic University) Tziovanis GEORGAKIS ( ) Takashi IKEDA (University of Tokyo) Francesco PAOLO DE SANCTIS (Universit Ca Foscari Venezia) Marcus SACRINI (Universidade de So Paulo) Young-Hwa SEO (Seoul National University)
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
SOMMAIRE DU BHDG 2
LIMINAIRES............................................................................................................. 4
I. Le sacrifice de ltre. Note sur la pense du sacrifice chez Heidegger , par Joseph COHEN .................................................................................................. 4 II. "Natur Kunst Technick". Chronique des rencontres de Messkirch, 25-29 mai 2011 , par Sylvaine GOURDAIN et Claudia SERBAN .....................44
BIBLIOGRAPHIE POUR LANNE 2011 ....................................................49
1. Textes de Heidegger..........................................................................................49 2. Traductions de textes de Heidegger ................................................................49 3. Collectifs et numros de revues ......................................................................51 4. tudes gnrales ................................................................................................57 5. tudes particulires ...........................................................................................63
RECENSIONS ........................................................................................................85 INSTRUMENTUM ............................................................................................ 123
* Les secrtaires du Bhdg remercient le Centre dtudes phnomnologiques de lUniversit catholique de Louvain (dir. Mme Danielle Lories) et le Centre dhermneutique phnomnologique de lUniversit Paris-Sorbonne (dir. MM. Claude Romano, Jean-Claude Gens et Michael Foessel) daccueillir cette publication sur leur site respectif. ** Il est possible de se procurer des tirs--part du Bhdg en crivant ladresse : bulletin.heideggerien@gmail.com. Nota bene : le numro ISSN de la version imprime diffre de celui de la version lectronique.
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
BULLETIN HEIDEGGRIEN II
Organe international de recension et de diffusion des recherches heideggriennes pour lanne 2011
LIMINAIRES I. LE SACRIFICE DE LTRE Note sur la pense du sacrifice chez Heidegger Depuis quelle Loi lhistoire de la philosophie se sera-t-elle constitue et dploye en tant que vrit ? Cette question provoque un bouleversement de la philosophie par la philosophie. Et ce parce quelle commande son histoire de se soumettre lpreuve la plus radicale : mettre en question cela mme qui laura conditionne. Comme si la philosophie devait, par cette question, se dtacher delle-mme en pntrant en elle-mme afin dy rvler la conditionnalit propre de son dveloppement. Ainsi, cette question ordonne lide directrice de lhistoire de la philosophie de rexaminer, dvaluer, et donc de justifier la prsupposition fondamentale de son orientation en rvlant le lieu foncier depuis lequel se sera affermie son assise, sa base, sa stance. Elle exige donc de lhistoire de la philosophie une confrontation avec elle-mme en examinant la modalit propre de son discours et en requrrant de celui-ci lexplicitation de son coup denvoi . Car lhistoire de la philosophie nen aura jamais fini de dvoiler cela mme qui louvre ce quelle est et de rejouer ce qui la dfinit en sexposant au questionnement du lieu originaire do sveille son vnement. Cest dire quinterminablement la philosophie ne cessera de revenir sur ellemme. Mais que signifie ici revenir ? Ou encore, do peut sentendre la propension propre la philosophie dexprimer ce quelle est en questionnant do elle vient ?
Fond par Sylvain Camilleri & Christophe Perrin. Ont collabor ce Bulletin : Mmes Diana Aurenque, Ccile Bonmariage, Victoria Briatova, Wenjing Cai, Sylvaine Gourdain, Ariane Kiatibian, Virginie Palette et Claudia Serban ; MM. Sylvain Camilleri, Cristian Ciocan, Joseph Cohen, Richard Colledge, Tziovanis Georgakis, Francesco Paolo De Sanctis, Choong-Su Han, Takashi Ikeda, Franois Jaran, Paul Marinescu, Christophe Perrin, Quentin Person, Marcus Sacrini, Young-Hwa Seo, Mark Sinclair, Christian Sommer et Kazunori Watanabe. Que M. Joseph Cohen soit tout particulirement remerci pour la confiance inconditionnelle quil a place en lui. Le symbole signale les publications recenses de lanne.
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Assurment, cette propension originaire constitue et dploie la philosophie en tant que vrit. Depuis Platon, peut-tre mme depuis Parmnide, la philosophie sest reconnue dans lexercice tendu vers la comprhension de ltre en tant que vrit. Cest cependant Aristote 1 qui donnera cette vise sa formulation la plus dcisive en la dterminant dans lhorizon ultime dun questionnement dont la tche sera de penser lessence de ce qui est. Cet horizon fera de la mtaphysique une science distincte et diffrente de toutes les autres sciences. Car celles-ci ne conoivent toujours quune rgion particulire au sein de la totalit de ltant. Elles rflchissent toujours l objet en ce que celui-ci appartient dj lhorizon de ltantit dterminable. Mais la science de ltre en tant qutre ouvre cela mme qui ne saurait se rduire la dtermination. Elle ouvre donc ce qui transcende toute dtermination et dpasse toute gnralit gnrique. Car ltre ne saurait se rduire lhorizon capable de le comprendre en tant qu objet pralablement dtermin. En ce sens, ltre est le transcendantal inobjectivable, indtermin et indterminable. Or cest ici que slabore, proprement dit, le problme de la mtaphysique : est-il possible de circonscrire ce transcendantal en une science qui, par dfinition, doit et se doit de ntre concentre que sur un genre dtermin 2 ? En vrit, cette question ne peut que se rsoudre, se dlier et se relever par une subrogation. La modalit propre de substitution, Aristote lengagera dans la Mtaphysique o seront dabord dtermines les diffrentes acceptions du sens de ltre et o, par consquent, stablira la quadruple dfinition de ltre : ltre en tant quaccident ; ltre comme vrai ; ltre selon les catgories ; ltre en tant que potentialit et activit. Or, et Aristote le prcise dans le Livre de la Mtaphysique, de tous les sens fondamentaux de ltre, ltre au sens le plus magistral revient ltre vrai ou faux 3. Cest dire et telle sera la thse capitale de tout ldifice ontologique aristotlicien : le sens de ltre sexprime en tant quil appartient vridiquement ltant lui-mme, alors que celui qui se trouve dans le faux ne fait que contredire ltant en son tre. Ainsi, la question visant le sens de ltre est restreinte, voire rduite, la possibilit de p enser le
Sur le rapport entre ontologie et vrit chez Aristote, renvoyons aux textes suivants de Martin Heidegger : Die Grundbegriffe der antiken Philosophie, GA 22, pp. 149 sq., ainsi qu Aristoteles, Metaphysik 1-3. Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft, GA 33, pp. 11 sq. Cf. aussi lexcellente et dsormais classique tude de Pierre Aubenque, Le problme de ltre chez Aristote, Paris, PUF, 1962. 2 Aristote, Mtaphysique, Livre , 2, 1003 b 19-20. 3 Aristote, Mtaphysique, Livre , 10. Cf. Martin Heidegger, Aristoteles, Metaphysik, 1-3. Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft, GA 33.
1
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
lieu o ltant est exprim en vrit. Ce qui signifie qu mme la question du sens de ltre sopre un passage o linfinitif verse dans le participe et donc o lentiret du projet dclaircir lessence de ce qui est sentend comme la tche dexprimer le sens par lequel ltant se rvle en tant qutant, ou encore, en lequel ltant dvoile par o il est tant, cest--dire, en et par lequel ltant dcouvre le fond vrai de son dploiement propre. Do la question fondamentale de la mtaphysique : quel est le sens de ltre de ltant et comment tablir le lien vridique entre ltre de ltant et ltant ? Or et il sera revenu Heidegger de le relever snonce, mme cette question fondamentale, un certain glissement o le sens de ltre revient la possibilit de dicter les premiers principes et les premires causes de ltant. la question du sens de ltre, Aristote lui subroge donc une mtaphysique entendue comme science capable dinstituer la base, le soubassement, lassise de ltant. Et cette subrogation, il nous faut la souligner mme le texte dAristote. Il nous faut marquer en quoi elle est inscrite et ne cesse duvrer au cur de la pense dAristote projetant ainsi cela mme que Heidegger aura nomm la constitution onto-thologique de la mtaphysique . Et pour souligner dabord et avant tout ceci : cette subrogation tmoigne dj de la diffrence sournoise, cache, dissimule depuis laquelle lonto-thologie se dploiera, se dveloppera et saccentuera entre la pense de ltre et la question de ltre en tant que fondement de ltant . Car, et il nous faut le rappeler, cette subrogation opre mme la smantique du mot tre qui, nous lavons rappel plus haut, arbore plusieurs sens dfinitionnels. En effet, plusieurs reprises, dans la Mtaphysique, Aristote signalera la polysmie de ltre1. Et mme en privilgiant lousia, il ne cessera de rappeler et de cautionner quil ne sagit l quun des sens possibles de ltre et non pas sa seule et unique, fixe et unilatrale dfinition. Certes, et Heidegger naura pas manqu de le faire remarquer, Aristote ne suivra pas la voie quil avait pourtant trace et fraye. Aprs avoir affirm la polysmie de ltre, il sefforcera dattnuer cette affirmation en marquant le lieu o sera concentre lhomonymie de ltre. Ce lieu nous le savons cest lousia entendu la fois comme essence et substance. Cest dire donc que lousia sera pense dans la conjonction de
Aristote dfinit la polysmie du verbe tre principalement dans le Livre , 7, 1017 a 23 sq. de la Mtaphysique. Notons cependant quil y revient dans le Livre , 2, 1003 a 33, puis galement, dans le Livre , 1, 1028 a 10. Cf. la trs judicieuse lecture de linterprtation que fera Heidegger de la polysmie de ltre propose par Werner Marx dans Heidegger und die Tradition. Eine problemgeschichtliche Einfhrung in die Grundbestimmungen des Seins, Hamburg, Meiner, 1980.
1
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
lessence et de la substance et se signifiera ainsi en tant qu essence substantielle . Do la signification ddouble de lousia avance par Aristote dans le Livre , 2 : essence principielle de ltant et substrat des accidents, ou encore, principe dintelligibilit de tout tant et conditionnalit de lexistence en tant qutant. Lousia devient ainsi l essence-substance de lonto-thologie et, en ce sens, le socle par lequel tous les autres sens de ltre peuvent se dire en vrit. Et donc : lousia est ce quoi toutes les acceptions de ltre sont suspendues tel quAristote sapplique le rappeler toujours dans le Livre de la Mtaphysique. Ainsi, lhistoire de la mtaphysique sera entirement structure par ce glissement subrogatoire premier et originaire dont nous venons de retracer la pente. Plus encore, il appartiendra la mtaphysique de parfaire cette substitution et, partant, daggraver subrepticement, en la refoulant jusqu loubli, la diffrence do pourtant elle se sera dploye du sens de ltre sa comprhension en ousia comme essentialit et substantialit de ltant en totalit. Et ce, en prorogeant une distinction hirarchique entre la mtaphysique gnrale , reine des sciences, premire en dignit et importance et seule lgitime discourir sur ltre, puis les trois autres domaines de savoirs thoriques, nommes mtaphysiques spciales , et o la psychologie, la physique et la thologie se voient attribuer la responsabilit de discourir sur lme, sur le cosmos et sur Dieu. Or, selon Aristote, celles-ci ne sont pas toutes gales. Au sein des mtaphysiques spciales , il faut encore hirarchiser. Cest--dire, reconnatre la supriorit de la thologie dans la hirarchie des mtaphysiques spciales . Car, sil est vrai que nous pouvons, selon Aristote, modifier lordre de cette hirarchie en interchangeant la psychologie et la physique, il demeure interdit de destituer la thologie de sa suprmatie dans lascendance des mtaphysiques spciales . La thologie est science minente et premire en ce quelle discourt sur le genre le plus excellent de ltre, cette nature immobile et spare quest Dieu. Cela ne saurait vouloir dire cependant que la thologie serait antinomique aux autres sciences. En vrit, son excellence est fondatrice et universelle. Elle fonde les autres sciences en tant la seule science dont luniversalit est en elle-mme essentielle. Ainsi, la primaut de la thologie la dfinit la fois comme cette science dont le discours portera sur lessence de ltant suprme, mais aussi, comme essentiellement universelle. Elle explicitera la fois lessence de ltant premier et parfait, mais aussi, et par consquent, aura pour tche de rflchir lessence universelle de la totalit de ses attributs, cest--dire de tout ce qui est, et donc
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
ltant en totalit 1 . Elle sera donc tenue ce qui donnera lieu une ontothologie selon laquelle Dieu donnerait ltre aux tants par la vertu de sa propre essence de signifier la synthse essentielle entre le discours sur ltant suprme et lexpression de ltant en totalit. Onto-thologie , telle sera lappellation que Heidegger attribuera non seulement au mouvement de cette synthse entre thologie et ontologie, mais aussi, et depuis celle-ci, toute la tradition qui aura repris, dvelopp, dploy, labor la singulire tche de penser ltre comme raison dtre , cause ou fondement et o une prima aut ultima ratio ncessairement simposait la pense. Et ce mouvement dont Heidegger nhsitera pas souligner quil stablira et saffermira par bonds discontinus, csures et interruptions se profilera jusqu Hegel, sinon jusqu Nietzsche, dont la force aura t de lui faire subir une ultime transformation en le renversant. Ce mouvement ontothologique signifiera lessence de ltre et ce sera encore Hegel que la tradition aura laiss le soin de lexpliciter se constituant en et pour soimme comme le Vrai quil faut concevoir non pas seulement comme substance mais tout aussi bien comme sujet 2 , et donc comme le Concept mme de la philosophie en ce que ce Concept dsigne la comprhension absolue de ltre en tant que fondement incontest et incontestable de ltant. En ce sens, la thologie ne saurait reprsenter un versant de la mtaphysique ct de lontologie. La thologie se dirait bien plutt comme une dimension intimement lie, voire absolument constitutive, de lontologie. Autrement dit, et en suivant ce dveloppement, il nous faudrait affirmer que lontologie est la thologie tout comme la thologie est lontologie. Or de ce mouvement, il sera revenu Heidegger non pas simplement de le relever en le nommant, mais aussi en le dconstruisant , de lui faire exprimer une autre parole que celle qui sy laissait depuis toujours entendre. Une autre parole o se dirait une vrit qui ne serait plus essentiellement luvre dune activit reprsentative o le fondement serait lunique lieu du vrai. Une autre parole donc qui, sans nier ou dnier le dploiement de lonto-thologie, viendrait et proviendrait de l envoi de ltre , parviendrait de la voix de ltre et surviendrait du don de ltre comme accueil (Herkunft) originaire de la vrit. Plus quun simple renversement du dploiement onto-thologique de la mtaphysique ce dploiement o se dispense la vrit comme justification du fondement il sagira, pour Heidegger, de penser lEreignis, l vnement appropriant et
1 2
Aristote, Mtaphysique, Livre , 1, 1026 a 31. Hegel, Phnomnologie de lesprit, tr. fr. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Aubier, 1994, p. 37.
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
dpropriant o la vrit se pense non plus comme adaequatio, justification, jugement, laboration du fondement, mais bien plutt depuis le lieu o elle se dit en un double mouvement de clement et dclement (A-ltheia), cest--dire doccultation et de ds-ocultation comme mise en prsence ou venir en prsence de la prsence. En ce sens, la prsence (Anwesen) se sera toujours dj rtracte du prsent-subsistant et donc se sera ainsi prserve de son puisement dans lAnwesende. Cest prcisment ce double mouvement de clement et de dclement au cur mme de la prsence et ainsi retir du prsent que Heidegger entendra en soulignant quil sagit dsormais de penser partir du lieu o la vrit se dit en une lgende de ltre (die Sage des Seyns) comme vrit de ltre (Wahrheit des Seyns) . Or, dans le chemin de pense qui va de l ontologie fondamentale de Sein und Zeit la pense de ltre , amorce dans les crits dits de la priode du tournant , et notamment dans les Beitrge zr Philosophie (Vom Ereignis), avant dtre amplement dploye dans le texte de 1956, Zur Seinsfrage et radicalement engage dans celui de 1962, Zeit und Sein, Heidegger reprendra lentiret de la mtaphysique qui se sera constitue en onto-thologie en vue dy veiller, au-del delle, ce que cette tradition voile et dissimule et dont le voilement et la dissimulation constituent prcisment ce quelle est. Et ce, afin de remonter vers une donation autre et plus ancienne que celle du fondement de lontothologie dont nous comprenons quil, ce fondement, se sera affermi et prsentifi dans la dissimulation et loccultation de cette donation immmoriale demeure ainsi impense et toujours venir . Il sagira, par l mme, de penser dune faon encore plus grecque 1, do se dploie, sans sy puiser ou sy rduire, ce qui est grec. Do la complexit de cette autre pense : comment dire cette donation autre ? Comment dire dans le langage cela mme qui ne saurait se traduire, sans se rduire, par le langage ? Comment laisser se dire la vrit de ltre sans irrmdiablement trahir dans ce qui est dit ce qui sy dit ? Cette question, dont la vise commande tout le rapport qui stablira entre la pense de ltre et la tradition onto-thologique de la mtaphysique, Heidegger lui aura accord une importance incontournable en marquant en quoi elle demeure linlassable tche de la pense 2. Elle exige de dtourner
Martin Heidegger, Aus einem Gesprch von der Sprache , in Unterwegs zur Sprache, GA 12, p. 127. Cf. la remarquable tude de Didier Franck, Heidegger et le christianisme. Lexplication silencieuse, Paris, PUF, 2004. 2 Cf. Martin Heidegger, Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens , in Zur Sache des Denkens, GA 14.
1
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
le regard de l o celui-ci sappliquerait conformer ltre partir de ltant et qui, par consquent, chercherait dterminer ltre en le traduisant en fondement de ltant. Ainsi, penser le sens de ltre, souligne Heidegger, demande que soit abandonn la rduction et la traduction de ltre en fond tant que fondement de ltant et, par l, que soit libre une pense authentique de la donation. En effet, Heidegger le souligne :
ltre, le penser en propre, demande de dtourner le regard de ltre, pour autant quil est, comme dans toute mtaphysique, seulement pens partir de ltant, et fond, en vue de ltant, comme fond de ltant. Penser ltre en propre demande que soit abandonn ltre comme fond de ltant, en faveur du donner ; ltre, se-dployer-en-prsence, devient tout autre. En tant que laisser-se-dployer-dans-la-prsence, il a sa place dans la libration hors du retrait ; mais en tant que don de cette libration, il reste retenu dans le donner. Ltre nest pas. De ltre il y a, en tant que libration (hors du retrait) dun dploiement en prsence1.
Quest-ce dire ? Rien de moins que ceci : le donner implique de penser sa propre rtraction l o il se donne et, dans le double mouvement de son retrait et de son don, linstant o se laisse se dployer en prsence ltre. Ainsi Heidegger chemine-t-il vers une pense de la donation pure qui est uniquement et exclusivement approche en tant que don qui ne donne que son don et qui, la fois et simultanment, sy retire et sy soustrait, sy rtracte et sy dissimule ouvrant donc au jeu o ne fait que se donner, ne fait que senvoyer lenvoi de ce qui tre ce qui est. Et cette pense du don, Heidegger lui attribuera le nom particulier en lequel sera gard et sauvegard toute la teneur de sa dtermination propre : le Es gibt . Zeit und Sein dploiera cette accentuation du geste heideggrien. Et ce parce que ce texte marquera lexigence douvrir lhistoire de la mtaphysique non pas simplement limpens de son dveloppement, mais aussi et surtout, en la pliant au-del delle-mme, vers la possibilit de penser la donation se donnant en prsence : la venue en prsence de la prsence. De ce fait, ce texte ne commandera rien de moins que de penser la donation en son irrductibilit propre. Il sagit donc de reprendre le tout de lhistoire de la mtaphysique non seulement en soulignant en quoi et pourquoi ltre y aura t caractris comme prsence (cest--dire, comme temporalit), mais en portant et
1
Martin Heidegger, Zeit und Sein , in GA 14, p. 9-10.
10
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
transportant la pense ailleurs que dans le socle de son histoire questionner la prsence elle-mme en recherchant en elle le l do elle vient et, partant, en la pensant depuis un tout autre vnement : le Es gibt , l il y a 1. Citons encore Heidegger : De ltant, nous disons : il est. Pourtant le regard sur la question "tre" et sur la question "temps", nous restons circonspects. Nous ne disons pas ltre est, le temps est mais : il y a tre, et il y a temps 2. Prcisons dj que Heidegger entend dans le Es gibt le donner . En pensant l il y a du temps et l il y a de ltre , il pense du coup l il y a de cela mme qui donne tre et temps. Ainsi, cest mme le Es gibt entendu comme donation quil faudra penser tre et temps et, en ce sens, la provenance dtre et temps. Le Es gibt est donc la matrice mme de la donation dtre et temps. Ce qui se pense au cur du Es gibt est donc double et ddoubl3. Dabord, le Es gibt Sein exige de penser en quoi et pourquoi la prsence se rtracte de la prsence en se donnant par l mme en prsence. Cest dire quil commande de penser le retrait en ltre de ltre, et donc ltre dj soccultant en lui-mme l o il se donne en prsence. Un double mouvement o, la fois, ltre se retire de la prsence et o dj ltre se retirant de ce dont il se retire, accentuant ainsi sa propre occultation en lui-mme, se donne en tant que destinement do le laisser-se-dployer de la prsence soffre. Or il faut ici remarquer car cela affectera et redfinira tout le rapport que Heidegger entretiendra avec lhistoire de la mtaphysique que le Es gibt Sein constitue le caractre poqual de ltre. Or poque ne saurait ici sentendre comme un moment de lhistoire ou comme un instant dans une continuit chronologique. Pour Heidegger, le Es gibt Sein , en tant quil signe lpoqualit de ltre, est le trait originaire du don de ltre . Il est le se tenir chaque fois auprs de soi de ltre se rtractant en lui-mme et offrant par l mme lclaircie do se donne sa donation propre, cest--dire do souvre ltre en vue de (im Hinblick auf) son historialit propre. Cest ce que Heidegger nomme le destiner (Schicken). Citons le passage en entier :
Ibid., p. 9. Ibid. 3 Renvoyons ici la trs importante tude de Marlne Zarader : Heidegger et les paroles de lorigine, Paris, Vrin, 1990. Et en particulier, la troisime partie : Au-del des Grecs euxmmes , pp. 205-256.
1 2
11
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Le donner qui ne donne que sa donation, mais qui, se donnant ainsi, pourtant se retient et se soustrait, un tel donner, nous le nommons : destiner. Si nous pensons ainsi le donner, alors ltre quIl y a est bien le destin. Destin de cette manire est chacun de ses changements. Lhistorique dans lhistoire de ltre se dtermine partir du caractre destinal dune destination, et non pas partir dun cours de lhistoire entendu dans un sens indtermin1.
Et donc correspondre ltre, se maintenir au plus proche du don de ltre , ne saurait signifier sa saisie spculative absolue. Cest bien plutt laissertre 2 le don se donner en prsence tout en ne saisissant que ce qui sy donne cest dire en dlaissant le don toujours sa libert rtractive propre. Dans ces conditions, ce qui est saisi dans le destiner nest que ce qui y est donn sans jamais que le destiner lui-mme ne se rduise ni ne spuise en ce qui est donn en son don. Ainsi le destiner , en ce quil se destine en dploiement de prsence, garde et sauvegarde la source innommable et inapparente de sa propre donation. Tel se dploie alors le destiner : la fois et simultanment comme une rserve et un versement. Ce qui signifie ceci : le destiner est linstant o ltre laisse tre le dploiement de ltre 3. Do lexigence de penser le destiner comme ladresse lhistoire de son dploiement et la rtraction de cette mme histoire histoire qui naura, ainsi, conserv que les traces, les prsentifications, les apparitions reues dans et par ce destinement . Sensuit la question que Heidegger nhsite pas soulever dans Zeit und Sein : do ltre se destine-t-il ? Depuis quelle source ou ressource se destine ltre en son dploiement en prsence ? Et quest-ce qui accorde le destinement de ltre en son laisser-se-dployer de la prsence ? Nous pourrions ici multiplier les formulations de cette question. Celle-ci vise, en vrit, cela mme qui se destine et donc commande de penser au cur de ce qui donne ltre en prsence. Rappelons le passage de Zeit und Sein :
Mais comment penser le Il qui donne tre ? La remarque introductive, propos du rapprochement de Temps et tre , faisait signe vers le fait que ltre, en tant que ousia, en tant que prsence, tait marqu dans un sens non encore dtermin par une caractristique temporelle, et donc par le
Martin Heidegger, Zeit und Sein , in GA 14, p. 12-13. Ibid., p. 9. 3 Ibid.
1 2
12
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
temps. De l, il ny a quun pas prsumer que le Il, qui donne tre, qui dtermine ltre comme approche-de-ltre et comme laisser-ltre-sedployer-en-prsence, pourrait bien se laisser trouver en ce qui, dans le titre Temps et tre , se nomme Temps 1.
Il sagira ainsi de penser au plus prs du destiner de ltre et dapprocher le Es de Es gibt Sein en louvrant au donner du temps . Or, il ne faudrait point croire que Heidegger cherche ici dceler un quelconque fondement au destiner de ltre. La citation souligne bien quil nous faut penser le temps partir de ce qui se signifie dans Zeit und Sein. Et donc, il nous faut penser le temps tout autrement que ce que nous y aurons entendu dans lhistoire de lonto-thologie. Cest dire, tout autrement que comme un fondement. En ce sens, le temps ne se signifiera nullement comme le fondement du destiner de ltre. Bien plutt, mme le destiner de ltre, il sagira de redoubler la question de la donation et de penser en direction de ce qui donne le temps. Es gibt Zeit revient dire : penser vers cela mme qui donne le temps en y rvlant la matrice propre de sa donation. Ainsi, si Es gibt Sein marque le destiner de ltre et si ce destiner se retient en se laissant dployer, Es gibt Zeit renvoie tout aussi bien le temps cela mme qui le donne. Tout se passe comme si Heidegger asservissait temps et tre au mme procd : penser temps et tre depuis cela mme qui les donne en propre. Cest pourquoi Heidegger crit :
Le propre de ltre nest rien du genre de ltre. Si nous pensons proprement aprs ltre, alors la question elle-mme nous mne dune certaine manire loin de ltre, nous le faisant dlaisser, et nous pensons le destinement qui donne ltre comme donation. Pour autant que nous portions attention cela, nous nous attendons alors ce que le propre, aussi, du temps ne se laisse plus dterminer laide de la caractristique courante du temps tel quil est communment reprsent2.
Souvre ainsi la mditation vers ce qui donne le temps. Pour ce faire, Heidegger, dans Zeit und Sein, revient la caractrisation principale et principielle en laquelle se sera dtermine, tout au long de son histoire, la question de la temporalit : le prsent comme maintenant 3. Or, le retour
Ibid., p. 14. Ibid. 3 Ibid., p. 14-15.
1 2
13
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
ce fil tendu dAristote jusqu Hegel et en lequel la question de la temporalit aura t pose et rsolue partir du maintenant-prsent nest effectue quen vue dy dceler sa provenance. Cest--dire, dy dceler lautre do cette position et cette rsolution se seront affermies et fixes en dterminant lessence traditionnelle du temps en prsent-subsistant . Certes, cette dtermination classique avait dj t amplement dmantele et dconstruite dans les analyses tayes au chapitre VI de la seconde section de Sein und Zeit. Ces analyses soulignaient dabord en quoi la reprsentation traditionnelle du temps comme maintenant-prsent morcelait, fractionnait et dpartageait la temporalit elle-mme en trois moments distincts et irrductibles : prsent, pass, avenir. Puis, elles engageaient repenser la temporalit elle-mme non plus depuis sa reprsentation traditionnelle, mais bien plutt depuis de son unit extatique propre unit extatique en laquelle se dploie le mouvement diffrenciant des trois dimensions temporelles. Dans Zeit und Sein, Heidegger assumera videmment ces analyses antrieures. Cependant, il les reformulera. Car il semploiera souligner en quoi la temporalit doit tre pense l o elle accorde porte et apporte les trois dimensions temporelles dans un jeu de mutuelle tension oeuvrant mme son unit propre. Prsent , pass , avenir sont ainsi recueillis au sein dun incessant jeu de tension o se dploie un accord mutuel la prsence se donnant en tant que tel comme le temps lui-mme. Et donc les trois modes du temps prsent , pass , avenir sont runis en tant que donns dune mme et unique donation : la prsence. Ce qui signifie que le temps est donn dans le jeu de la prsence avec la prsence et en lequel les trois dimensions temporelles du prsent , du pass et de lavenir sont toujours engages en une modalit o chacune se voit rapporte lune en lautre en tant toutes retenues en elles-mmes. Do la phrase de Heidegger, tire dUnterwegs zur Sprache : die Zeit zeitigt , le temps donne temps 1. Le propre du temps ne sera alors que le donner de sa propre procession comme l Ouvert o se maintiennent et se retiennent dans le jeu incessant de leur mutuelle tension les trois dimensions temporelles. Et Heidegger de nommer, dans Zeit und Sein, lextension de cet Ouvert : l espace libre du temps. 2
Martin Heidegger, Das Wesen der Sprache , in Unterwegs zur Sprache, GA 12, p. 201. Martin Heidegger, Zeit und Sein , in GA 14, p. 18-19. Citons le passage en entier : Cette faon de procder nest manifestement pas fonde, si lon admet que lunit qui vient dtre dsigne, lunit de la porrection qui porte et apporte et prcisment elle , il nous faut la nommer : temps. Car le temps nest lui-mme rien de temporel, pas plus quil nest quelque chose dtant. Cest pourquoi il nous demeure interdit de dire que lavenir, lavoir-t et le prsent sont donns "en mme temps". Et cependant, le fait quils se
1 2
14
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Ainsi, cest afin de dcrire le temps dans luvre de son don propre don la fois diffrentiant et unifiant que Heidegger propose de penser la temporalit partir de ce qui nest nullement temporel, et donc depuis une spatialit , cest--dire depuis lespace-du-temps 1 (Zeit-Raum). Or cette espace-dutemps , il ne faudra nullement le signifier spatialement ; lextension de l espace-du-temps nest aucunement spatiale. Elle caractrise, mme le temps, le jeu de sa temporalisation propre en tant que don de son Ouvert au sein duquel le temps lui-mme se recouvre en son unit propre et approprie cest dire se temporalise. La question que Zeit und Sein sefforcera de faire advenir deviendra cependant : do procde le temps se temporalisant, cest--dire, do vient la temporalit en tant qu espace-du-temps unifiant les trois dimensions temporelles et les accordant, les portant et les apportant par l mme, dans lincessance de leur tension enjoue ? Ce qui se marque au sein mme de cette question nest rien de moins quune radicalisation de la temporalit, car seront cherchs et recherchs non seulement la mouvance propre du temps comme accord de temporalisation en sa modalit propre, mais projetant ainsi la temporalit vers le sans-fond de sa provenance le lieu do l espace-dutemps se donne. Et Heidegger daccentuer la ncessit de cette question tout juste aprs avoir rappel que la temporalisation du temps se dploie dans le geste de sa propre donation comme jeu pluridimensonnel saccordant toujours dans le port et dj comme lapport de ses trois dimensions temporelles : Mais do, maintenant, se dtermine lunit des trois dimensions du temps vritable, i.e. lunit des trois modes jouant les uns dans les autres de la porrection qui porte et apporte, chaque fois, une manire propre davancer dans ltre ? 2 . Cest dire : comment penser la provenance de la temporalisation du temps ? Rponse : dans et par une quatrime
portent les uns aux autres leur propre porrection appartient un seul ensemble. Leur unifiante unit ne peut se dterminer qu partir de ce qui leur est propre ; partir de ce quils se portent les uns aux autres. Mais quoi donc se portent-ils les uns aux autres ? Rien dautre queux-mmes et cela veut dire : lavance du dploiement dtre en eux procure. Avec elle sclaircit ce que nous nommons lespace libre du temps [...] "Espace libre du temps" nomme maintenant lOuvert, qui sclaircit dans la porrection qui porte et apporte les uns aux autres lavenir, ltre-pass et le prsent. Seul cet Ouvert et lui seul accorde lespace tel que nous le connaissons habituellement tout son espacement possible. Lclaircissante porrection qui porte et apporte les uns aux autres lavenir, lavoir -t et le prsent est elle-mme pro-spatiale ; seulement ainsi elle peut accorder place lespace, i.e. le donner . 1 Ibid. 2 Ibid., p. 19.
15
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
dimension 1 du temps dans le temps se temporalisant. Ce qui signifie que cette quatrime dimension donne le temps se temporalisant. Plus prcisment, la source donatrice du temps se temporalisant se pense depuis une quatrime dimension . Car cette quatrime dimension donne le temps se temporalisant en ce quelle donne l espace-du-temps o saccordent les trois dimensions temporelles du temps. Cette quatrime dimension, Heidegger la nomme la porrection 2 (Reichen). Porrection signifie ici : le donner de la temporalisation du temps. Dire du temps donc quil se donne depuis une porrection , cest marquer ceci : le donner du temps est toujours, la fois et simultanment, accord de sa tridimensionnalit et, au-del de celle-ci, accord avec soi-mme en soi-mme. Plus radicalement : le temps se temporalisant vient de la porrection comme donation du jeu accordant sa pluridimensionnalit propre. Ainsi, cest dire que le temps se temporalisant vient depuis un autre que son accord. Do la possibilit de comprendre le Es gibt Zeit dans la doublit qui le caractrise : le temps se temporalisant est laccord de soi-mme avec soi-mme dans et par le jeu unifiant de sa tridimensionnalit propre et accord de soi-mme avec soi-mme donn depuis une autre et loigne, quoique toujours en soi-mme, provenance. Et il est important de maintenir cette autre provenance du temps mme la temporalisation du temps. Car en elle et par elle se logeront la fois ce qui demeure empch dans lavoir-t et ce qui dans le survenir demeure rserv 3. Cest pourquoi Heidegger crira de la quatrime dimension quelle est proximit approchante dont la force est de librer et de dployer un lointain . Soyons prcis :
Cest pourquoi cette premire, cette initiale et au sens propre du mot entreprenante porrection o repose lunit du temps vritable nous la nommons : la proximit approchante (Nahheit). Mais elle approche lavenir, lavoir-t, le prsent les uns des autres dans la mesure o elle libre et dploie un lointain. Car elle tient ouvert lavoir-t tandis quelle empche sa venue comme prsent. Cet approchement de la proximit tient ouvert le survenir depuis lavenir en ce que, dans le venir, elle rserve la possibilit du prsent. La proximit approchante a le caractre de lempchement et
Ibid., p. 20. Ibid. 3 Ibid.
1 2
16
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
de la rserve. lavance, elle tient les modes de la porrection davoir-t, davenir et de prsent les uns pour les autres dans leur unit1.
Le destiner (Schicken) marque le Es gibt Sein et la porrection (Reichen) souligne le Es gibt Zeit. Heidegger le rsume dailleurs au milieu de Zeit und Sein :
Le donner dans le Il y a tre sest manifest comme destiner et comme unit dterminante de toutes les destinations (= comme destinement) de parousia, en leurs changements lourds dpoques. Le donner dans le Il y a temps sest manifest comme la porrection claircissante de la rgion quadri-dimensionnelle2.
Ce faisant Heidegger souligne doublement et dans la doublit du Es gibt que penser Es gibt Sein, cest inscrire le don de ltre l o ce qui y est destin en tant quhistoire de ltre est command par une rtraction et une occultation, puis que penser Es gibt Zeit, cest ouvrir le temps une spatialit partir de laquelle se dploie une porrection claircissante comme accord de ses trois dimensions pass, futur et prsent , accord lui-mme donn comme proximit approchante o ce qui y est donn demeure rserv et sauvegard en une autre et lointaine donation. Or cest au cur de cette doublit, entre destiner et porrection que se pensera, pour Heidegger, lIl y a d tre et temps et, partant, que se pensera le donner de ltre et le donner du temps . Cest dire quau cur de cette diffrence, entre destiner et porrection , se travaille toujours le mme : lIl y a de la donation dtre et temps. Do lexigence de renouveler le questionnement en vue de lIl y a et de ce qui, en lui, se donne. LIl y a est donation dtre et temps, donation de leur co-appartenance 3 . Et Heidegger de marquer au sein mme de cette donation quelle est aussi une avance dabsence : Nous gardons cependant en vue : le "Il" nomme en tout cas dans linterprtation qui soffre en premier une avance dabsence 4. Ce mot, une avance dabsence , tient souligner que lIl y a dtre et temps ne se donne point dans le rgime de ltantit. Et ce parce quil faut penser lIl y a uniquement dans le registre de sa propre donation. Ce qui signifie : penser lIl y a comme une avance dans labsence de tout fondement ou fondation, voire de toute structure propositionnelle o se
Ibid. Ibid., p. 22. 3 Renvoyons ici lexcellente, et dsormais classique, tude de Franoise Dastur, Heidegger et la question du temps, Paris, PUF, 1990, pp. 108 sq. 4 Martin Heidegger, Zeit und Sein , in GA 14, p. 23.
1 2
17
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
forment des noncs sujet-prdicat. Ainsi la question de Heidegger : Comment cependant porter autrement au regard le "Il" que nous prononons en disant "Il y a tre", "Il y a temps" ? 1. Et la rponse :
Tout simplement de telle faon que nous pensions cet Il partir du genre de donation qui lui appartient : donation comme rassemblement de la destination, donation comme porrection claircissante. Toutes deux y ont ensemble leur part, dans la mesure o le premier, le rassemblement de la destination, repose en la seconde, la porrection claircissante2.
Cest donc bien le et dtre et temps dont il sera ici question. Soulignons cependant que de penser le et dtre et temps, penser donc la donation de cela mme donnant et tre et temps signifie aussi la citation tout juste rapporte le signale que cette co-appartenance se voit elle-mme travaille par une diffrence. En effet, lIl y a de ltre repose dans lIl y a du temps marquant du mme coup que lIl y a du temps repose en un autre lieu. Do lquivocit au cur de lIl y a : se penser la fois comme la donation de la diffrence dtre et temps et comme la donation mme de leur co-appartenance. Or cette donation de la diffrence co-appartenante porte un nom, cest celui de lEreignis3. Quest-ce que lEreignis ? 4. La question est pose simplement dans Zeit und Sein avant que nintervienne une importante mise en garde. Car, en exigeant que lEreignis se dise en ce quil est, en cherchant donc traduire en termes essentialisant cela mme dont elle senquiert, la forme de cette question trahit et rvoque lEreignis lui-mme. En effet, aprs avoir soigneusement marqu qutre et temps nous sont toujours adresss en tant que questions5, et donc qutre et temps demeurent toujours en question, Heidegger prvient : toute pense de lEreignis devra et se devra de se dire autrement que dans lordre de lnonciation. Ainsi, la question quest-ce que lEreignis ? requerra et sollicitera une autre langue et commandera une tout autre formulation de la question. Car, lEreignis nest pas de ltre, il donne ltre ; il nest pas du temps, il donne le temps. Il donne le et dtre et temps, leur co-appartenance mme et, du coup, prcde toute question senqurant de ce quil est ou peut tre. La
Ibid, p. 24. Ibid. 3 Cf. ibid. sq. 4 Ibid., p. 25. 5 Cf. ibid.
1 2
18
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
question senqurrant de ce quil est doit ainsi tre dtourne de sa vise, dlie de lemprise de sa propre nonciation et de la rsolution que celle -ci engage ncessairement. La question doit donc se faire mditante et renoncer ntre que vise questionnante cherchant se combler en une rponse dterminante. Cest dire quelle doit, cette question, se penser elle-mme jusqu ne plus se traduire en question et par l dlaisser sa forme, dnier son ordonnance, dmanteler sa position en se faisant coute qui garde et sauvegarde la donation de la diffrence co-appartenante dtre et temps :
Les deux, ltre aussi bien que le temps, nous les avons nomms des questions. Le et , entre les deux, laissait leur relation lun lautre dans lindtermin. Maintenant se montre : ce qui se laisse appartenir et convenir lune lautre les deux questions, ce qui non seulement apporte les deux questions leur proprit, mais encore les sauvegarde dans leur coappartenance et les y maintient, le tenant des deux questions, cest lEreignis. Le tenant de la question ne vient pas sajouter aprs coup comme un rapport plaqu sur ltre et le temps. Le tenant de la question fait advenir dabord ltre et le temps leur proprit partir de leur rapport, et la vrit travers lappropriation qui shberge dans le rassemblement de la destination et dans la porrection claircissante. En consquence de quoi le Il qui donne dans le Il y a tre , Il y a temps cet Il satteste comme lEreignis. Cet nonc est juste, et cependant manque du mme coup la vrit, autrement dit il nous voile le tenant de la question ; car sans y prendre garde, nous nous le sommes reprsent comme quelque chose de prsent, alors que nous tentons de penser la prsence comme telle. 1
Nous lavons rappel : lEreignis ne saurait se dire en tre ou en temps. Il nomme le Il du Il y a tre et du Il y a temps. Cest dire, et telle sera la premire diction de lEreignis : il donne la donation en tant que telle de la coappartenance diffrenciante de tre et temps. Il donne la donation o sapproprient tre et temps en leur diffrence. Cependant, prcise Heidegger, cela ne saurait vouloir dire que lEreignis doive se comprendre comme un concept suprme 2 au sein duquel le tout de la pense engage penser la donation dtre et temps, leur co-appartenance diffrenciante en tant que telle, serait compris. LEreignis ne peut se penser en tant que fondement o tre et temps viendraient trouver lassise de leur propre ou le principe o chacun
1 2
Ibid., p. 24-25. Ibid., p. 27.
19
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
viendrait se reposer. Bien plutt, indique Heidegger, au cur de lEreignis lappropriation dtre et temps est donne depuis ce qui ne saurait sy rduire. Cest pourquoi Heidegger insiste dabord sur le fait quil nous faut penser lEreignis non pas en son sens courant d vnement 1, mais bien plutt depuis Eignen, autrement dit depuis cela qui fait advenir soi-mme en sa proprit lclaircie sauvegardante de la porrection et destination 2 . Ainsi, lEreignis donne l claircie sauvegardante o sapproprient en diffrence porrection et destination . Car ce qui sy pense est ladvenir de lappropriation dtre et temps en leur diffrence. Mais de cet advenir , que peut-on en dire ? Heidegger, soucieux de ne pas rduire lEreignis une autre formulation ou appellation parmi celles dj survenues dans lhistoire de lonto-thologie, marque sans dtour quil est penser partir du en tant que et donc comme don de la donation. Ce qui ne saurait signifier autre chose que ceci : lEreignis est penser non pas comme simple renversement en lequel ltre serait un mode de lEreignis, mais bien plutt l o l tre svanouit dans lEreignis 3, l o tre en tant quEreignis traduit le don de lappropriement advenant lui-mme dtre et temps. Ainsi, tout se passe comme si lappropriement dtre et temps se voyait affect, non pas dun affaiblissement de son propre, mais dun certain d-dire o ce qui se donne se fait aussi et la fois retrait. En somme, Heidegger inscrit ici mme, l o tre et temps adviennent dans leur appropriation diffrenciante, la rtraction de cela mme qui la fait advenir. Citons ici le passage :
quau donner en tant que destiner appartient larrt dun suspendre ; en propres termes ceci que dans la porrection davoir-t et dadvenir jouent lempchement du prsent et la rserve du prsent. Ce qui vient dtre nomm : suspension, empchement, rserve, manifeste quelque chose de tel quun se-soustraire, bref : le retrait. Dans la mesure pourtant o les modes dtermins par lui de la donation (destination et porrection) reposent dans le mouvement de faire advenir soi dans sa proprit, il faut que le retrait appartienne au propre de lappropriement4.
En rsulte la radicalit de la pense engage penser lEreignis : il laisse advenir le propre comme appropriation dtre et temps en ncessairement sy
Heidegger le prcise, en effet, plusieurs reprises, par exemple ici : ce qui est nomm par ce mot das Ereignis est tout autre chose quun vnement ibid., p. 26. 2 Ibid., p. 25-26. 3 Ibid., p. 27. 4 Ibid.
1
20
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
retirant. La consquence est en vrit abyssale. Car, au cur de l Ereignis, se dploie ainsi limpossibilit de fixer la pense engage le penser, limpossibilit donc de saisir lEreignis. tre et temps ne sont pas appropris comme sils reposaient en un sol premier. Bien plutt, tre et temps sont donns en leur appropriation depuis cela mme qui demeure toujours libre et abyssalement retir de toute saisie. Nul fondement ou Grund congnital ne saurait ici sceller la libert de cette donation. Elle uvre en tant que telle, cest-dire en donnant l o elle se retire dans l Insondable (Das Unberechenbare) 1. De ce fait, lEreignis ne se prsente jamais. Sa donation est indissociablement rtraction. LEreignis donne donc lappropriation dtre et temps, du destiner et de la porrection, mais la fois, senlve son don propre. Certes, Heidegger le souligne la fois quant au destiner 2 et quant la porrection 3, mais il aura aussi tenu le marquer mme lEreignis en tant que tel. LEreignis est lui-mme retrait en lui-mme 4 . Cest prcisment en ce sens que lEreignis est appropriement, avnement au propre et dpropriement, Enteignis, ce qui nest jamais donn la prsence en se soustrayant de toute saisie possible comme se rtractant de toute nomination en prservant et en sauvegardant en son trfonds ce quil a de plus propre. Ereignis se donne en Enteignis, lappropriement sadvient en dpropriement ; et donc, le don de lappropriement dtre et temps se dproprie de lui-mme en vue de ce qui sy donne :
Dans la mesure maintenant o le rassemblement de la destination repose dans la porrection du temps, et o celle-ci repose avec celui-l dans lEreignis, sannonce dans le faire advenir soi (dans lappropriation) cette proprit singulire que lEreignis soustrait la dclosion sans limite ce quil a de plus propre. Pes partir du faire advenir soi, cela veut dire : il se dproprie, au sens quon a dit, de soi-mme. lEreignis comme tel
Cf. Martin Heidegger, Nachwort zu: "Was ist Metaphysik?", in Wegmarken, GA 9, p. 309. Martin Heidegger, Zeit und Sein , in GA 14, p. 27 : La destination dans le destinement de ltre a t caractrise comme donation, o ce qui destine sarrte et se contient soi mme, et dans cette suspension se retire, se drobe la dclosion . 3 Ibid, p. 27 : Dans le temps vritable et son espace libre pour le temps sest manifeste la porrection de lavoir-t, donc de ce qui nest plus prsent : lempchement portant sur le prsent ; sest manifest dans la porrection du futur, donc du non-encore prsent : la rserve du prsent. Empchement et rserve montrent le mme trait que la suspension : savoir le se-soustraire . 4 Cf. Martin Heidegger, Protokoll zu einem Seminar ber den Vortrag "Zeit und Sein" , in GA 14, p. 266 : LEreignis est le retrait, non seulement en tant que destiner, mais en tant quEreignis .
1 2
21
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
appartient le dpropriement. Par ce dernier lEreignis ne se dlaisse ni ne sabandonne lui-mme, mais au contraire sauvegarde ce qui lui est propre1.
Se marque ainsi, et au cur de la pense de lEreignis, la responsabilit la plus aigu : celle de rpondre de cet irrductible cart entre appropriement et dpropriement la source mme de tout ce qui advient. Et donc de rpondre dun voilement irrductible et illimit mme ce qui se donne. Do lexigence : penser que rien ne repose en soi-mme et que la pense demeure rsolument expose lincessant mouvement dap-propriement (Ereignis) et de dpropriement (Ent-eignis) dans la donation dtre et temps. Cest dire penser lAltheia dans la doublit de son nom : clement et dclement. Souvre ainsi la pense la vrit historiale de ltre , le mouvement perptuellement engag dun clement et dun dclement en lequel ladvenance de ltre se dploie et soffre nous. Il sagit de penser l o la pense est rsolument habite par un insondable secret au cur mme de ce qui lui est donn penser. Or, quen est-il du secret ? Et depuis quel lieu peut-on approcher, apprhender et comprendre un secret ? La question ainsi formule est pernicieuse, voire prjudiciable. Et ce parce quelle risque de perdre ce quelle se donne comme tche de cerner. En posant cette question, quen est-il du secret ? , lon prcipite la pense dans son propre embarras : connatre un secret en le fixant en ce quil est, cest aussi et du mme coup, lanantir, le nier, le dtruire dans et par le geste qui croit justement latteindre. Car le secret ne saurait se rsoudre tre la simple dissimulation de quelque chose, dun mot, dun fait, dun don. Le secret nest pas ce qui se dissimule au savoir. Portons ici le secret son aportisation la plus radicale : plus un secret est prcautionneusement dissimul au savoir, plus il a de chance de ntre pas ou plus du tout un secret, mais simplement une chose connaissable et donc accessible. En somme, au moment mme o le secret devient une exigence de pense, la question qui se tourne vers lui semble interdite. Comment penser ds lors sans rduire le penser au questionner ? En laissant le penser tre expos au secret en tant que secret, et ainsi en laissant le secret socculter en lui-mme telle une occultation soccultant elle-mme ? Mais condition de comprendre ceci : laisser le secret au secret, ce nest pas dire jeter sur lui un silence impntrable. Cest, bien au contraire, lapprocher du Dire, le porter une certaine manifestet un Dire o se manifesterait la veille du secret en tant que secret et o se prserverait ce que
1
Martin Heidegger, Zeit und Sein , in GA 14, p. 27-28.
22
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
le secret garde et protge de sa perte ou de sa rduction dans la simple lucidation prsentifiante du dit Heidegger, en effet, laura prcis, notamment dans son commentaire de lhymne La Germanie de Hlderlin :
le retrait et le voilement savrent tre un mode particulier de manifestet. Le secret nest pas une barrire situe au-del de la vrit, mais il est luimme la plus haute forme de la vrit ; car pour laisser le secret tre vritablement ce quil est sauvergarde de lEtre authentique dans le retrait il faut que le secret soit comme tel manifeste. Un secret qui nest pas connu dans sa puissance de voilement nest pas un secret. Plus la connaissance du voilement se situe haut et plus le dire du voilement en tant que tel est vridique plus sa puissance de retrait demeure intacte1.
Et, en interprtant le mot de Hlderlin, lInnigkeit ou la tendresse mot o se concentre potiquement l unit originale quest linimiti des puissances de ce qui a purement surgi 2 comme vrit de ltre :
Elle est le secret qui est partie prenante en ltre. Ce qui a purement surgi nest jamais inexplicable sous une perspective, en une quelconque strate de ltre ; il reste nigme de part en part. La tendresse na pas la structure dun secret parce que dautres ne peuvent pas la pntrer ; cest en elle-mme quelle dploie ltre comme secret. Il ny a de secret que l o rgne la tendresse. Si toutefois ce secret est nomm et dit comme tel, le voil bien de ce fait manifeste, mais le dvoilement de sa manifestet est prcisment volont de ne pas expliquer, et plus encore : il est entente du secret comme retrait se mettant soi-mme en retrait3.
Il sagit ainsi en pense de reconnatre 4 le secret en tant que secret en le laissant tre ce quil a tre, en le laissant nous dire ce vers quoi il fait signe. Et ce vers quoi il fait signe nest rien dautre que la remmoration 5 dun immmorial toujours impens et dj -venir . Voil ce quil faut faire : reconnatre la diffrence entre la pense mditante et la pense calculante , puis, au sein de cette diffrence, apercevoir lclosion la fois de la modalit mme depuis laquelle se dploie
Martin Heidegger, Hlderlins Hymnen. "Germanien" und "Der Rhein", GA 39, p. 119. Ibid., p. 250. 3 Ibid. 4 Cf. Martin Heidegger, Was heit Denken?, GA 8, p. 117-118. 5 Cf. ibid. p. 145 sq.
1 2
23
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
lhistoire de la mtaphysique et de cela mme que cette histoire aura occult en son dploiement. Cest--dire, apercevoir lindissociabilit ambigu et quasiparadoxale de ces deux dploiements. Cest pourquoi Heidegger distingue, dans Der Satz vom Grund par exemple, l appel (Anspruch) 1 du principe de raison en lequel se constitue la pense calculante cette pense qui approprie ltre pour le penser en tant que fond, fondement, principe, raison de ltant du rappel (Zuspruch) 2 qui veille, par-del l appel du principe de raison , l cho 3 dun immmorial impens, secret et retir o sexprime sournoisement la pr-sance de l claircie pralable toute prsence, linapparent inpuisable et irrductible depuis lequel se dploie la mise-enprsence de la prsence et de la manifestet de ltant. Et nous venons donc de le marquer : souvre ainsi la modalit dune remmoration en laquelle la pense accueille l advenance avant quelle ne soit prise, entreprise et saisie dans les rets de la prsence. Une remmoration dont le geste consiste dabord et avant tout veiller, par del la tradition onto-thologique de la mtaphysique, une pense matinale o la prsence sannonce depuis une provenance irrductible ce qui sy annonce. Ainsi, remmorer ne signifie en rien se lier ou sattacher au pass ou au prsent qui nest plus disponible, mais bien plutt exige de sexposer ladvenance indtermine qui, se retirant toujours de la prsence dtermine, laisse venir en prsence la prsence. Remmorer , cest alors se tenir dans lad-venir de la prsence sans laisser son immmorial se rduire en prsent. Or, il se libre ici un tout autre rapport lhistoire de la mtaphysique. Un rapport o la destruction de la mtaphysique succde l exposition recueillante dune vrit devenue garde et sauvegarde de ce qui appelle lhomme rpondre dun immmorial toujours dj impens et pas encore pensable par la mtaphysique. Mais ce rpondre nest ni un quitisme ni un gnosticisme. Pas davantage ne ne cherche-t-il svader ou sortir de la mtaphysique par une mystique trangre au logos. Car la mtaphysique constitue notre inalinable destin4. Et ce parce que notre destin la mtaphysique nous aura toujours t
Martin Heidegger, Der Satz vom Grund, GA 10, p. 203. Ibid., 3 Martin Heidegger, Nachwort zu: "Was ist Metaphysik?", in GA 9, p. 310 : La pense originelle est lcho de la faveur de ltre, dans laquelle sclaircit et se laisse advenir lunique ralit : ltant est. Cet cho est la rponse humaine la parole silencieuse de ltre . 4 Les phrases de Heidegger abondent pour dire linvitabilit de la mtaphysique, cest -dire linluctable mutation et rduction de ltre (prsence) en sa saisie e n tant-prsent. Citons pour lexemple le passage qui ouvre Zeit und Sein : tre, depuis le matin de la
1 2
24
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
donn comme le dploiement de lavnement de ltre. Reste que ce destin, nous ne laurons reconnu que trop tard, en retard et dans le retard de la
pense europenne-occidentale et jusqu aujourdhui veut dire le mme que Anwesen approche de ltre. Dans ce mot dAnwesen, parousia, parle le prsent. Or le prsent, selon la reprsentation courante, forme avec le pass et le futur ce qui caractrise le temps. tre, en tant quavance-de-ltre, est dtermin par le temps. Quil en soit ainsi suffirait dj pour porter dans la pense un trouble ne plus cesser. Ce trouble crot ds que nous nous attachons penser et repenser dans quelle mesure et en quoi il y a cette dtermination de ltre par le temps Zeit und Sein , in GA 14, p. 6. Nous laurons compris, ltre, depuis le matin de la pense europenne-occidentale , aura t pens comme prsence (Anwesen, parousia) Cest dire aussi, qu mme cette aube de la pense, ltre se sera compris non pas comme subsistance ni comme permanence , mais comme venue en prsence , ce que Heidegger nomme dans Vom Wesen und Begriff der Phusis, irruption-la-prsence (Anwesung) cf. Martin Heidegger, Vom Wesen und Begriff der Phusis. Aristoteles, Physik B, 1, in GA 9, p. 296-297. Or, la naissance de lontologie, et donc le dploiement de la mtaphysique, pour Heidegger, signifiera une invitable mutation, un glissement ou un dvoiement de la prsence en prsent, de la parousia en ousia. Ainsi, cela mme qui aura t prouv en tant que prsence surgissement et irruption, venue et advenance de la prsence se sera signifie et donc fixe en prsent-subsistant, prsentpermanent, constance de ltant-prsent. Mais, et il nous faut le souligner, linterprtation que fera Heidegger de ce premier commencement nest pas simplement de marquer cette rduction de la prsence en prsent comme si lon passait dune pense sachante une pense perdue dans lignorance. En vrit, ce qui ici souvre pour Heidegger cest la possibilit dapercevoir mme la prsence la puissance de sa propre rtraction occultante. En ce sens, souvre la possibilit de penser lhistoire de la mtaphysique comme ce qui se sera constitue en comprenant, en saisissant et en interprtant ltre partir et depuis son retrait, son occultation, son clement : ltre est prsence et lhistoire de la mtaphysique est le retrait de la prsence. En somme, lhistoire de la mtaphysique pense ltre sur le mode de labsence en ayant pens la rtraction de la prsence elle -mme en prsent . Do la requte de Heidegger : affirmer ce qui demeure pleinement impens dans la mtaphysique, la prsence, en lui faisant reconnatre quelle naura t possible en tant que telle que depuis cet impens, quil sagit de remmorer en son sens originaire propre, et donc partir de ce qui le constitue en tant que prsence savoir le temps. Ainsi, lhistoire de cette invitabilit rductrice de ltre en tant que prsence en tant prsent ne s aurait tre comprise comme simplement ngative. Elle doit surtout tre entendue en ce que ltre aura toujours t pens partir de son histoire et, en vrit, demeure indissociable de celle-ci, car cest prcisment partir de celle-ci que souvre pour la pense la vue sur ltre ne spuisant jamais entirement en son histoire la rendant bien plutt possible en sy retirant. Penser ce retrait de la prsence en elle-mme signifie par consquent penser la fois ltre en tant que prsence et le temps de cette prsence. Cest prcisment ce que Heidegger nommera l autre commencement de la pense . Car mme si les penseurs grecs demeurent au plus prs de ltre comme prsence en pensant ltre comme parousia ou comme phusis, Anwesung dans lAnwesen avant ousia ou Anwesende, ils ne pensent pas la prsence elle-mme en son appartenance une temporalit propre. Ainsi, ils y sont mais la manquent aussi comme telle. Ils manquent de la penser en ce qui la lie et lallie une temporalit propre. Telle sera la tche laquelle Heidegger sommera la pense : penser le et dtre et temps : lEreignis dun autre commencement de la pense. Renvoyons ici la trs pntrante tude de Franoise Dastur, Prsence, prsent et vnement chez Heidegger , in Grard Bensussan et Joseph Cohen (ds.), Heidegger. Le danger et la promesse, Paris, Kim, 2006, pp. 111-131.
25
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
question1. Au cur du rapport entre le retard de notre question et notre destin, il nous aura t donn la fois la mmoire de toute lhistoire onto-thologique de la mtaphysique et la possibilit au cur mme de cette mmoire et donc mme la mmoire de son oubli de se remmorer une altrit encore impense en cette histoire. Ainsi, notre rapport lhistoire doit se penser en louvrant la fois elle-mme et lautre delle-mme, disons, elle-mme depuis lautre delle-mme. Cest dire : en louvrant cela mme do elle sera provenue provenance nous commandant de repenser lentiret de la mtaphysique depuis une donation autre, laissant advenir 2 le possible comme possible en le gardant de son puisement dans leffectivit du prsent et en y apercevant la fois son immmorial et son toujours -venir . * mme cette remmoration , o se fait jour la possibilit de revenir depuis ce qui ne saurait se rduire lhistoire onto-thologique de la mtaphysique en se rappelant ladvenance inapparente de sa vrit historiale, se trace une exigence radicale : celle de penser le sacrifice la fois comme lessence de la mtaphysique et comme ce qui demeure encore impens par elle. Avant de pntrer dans le mouvement de cette exigence, il nous faut ds prsent marquer que la thmatique du sacrifice uvre sournoisement dans lcriture de Heidegger. En effet, Heidegger na que trs peu recours au terme de sacrifice (Opfer) . Et au moins pour cette raison vidente : le terme de sacrifice , quil faut entendre avant tout en un sens verbal, faire un sacrifice (sacrum facere), est charg dun sens thologique massif et porte, voire engage, une logique que lon peut videmment qualifier, aprs Hegel, de spculative en laquelle slabore dj la relve (Aufhebung) du fini dans linfini, du profane dans le sacr 3 . Une logique spculative que Heidegger
Martin Heidegger, Zeit und Sein , in GA 14, p. 10-11 : Do prenons nous le droit de caractriser ltre comme prsence, comme Anwesen ? La question vient trop tard. Parce que cette faon de se donner de ltre sest dj dcide depuis trs longtemps, sans notre contribution et, plus encore, sans notre mrite. En consquence de quoi nous sommes lis la caractrisation de ltre comme prsence. Celle-ci tient sa force contraignante du dbut du dvoilement de ltre comme dicible, cest--dire comme pensable. Depuis le dbut de la pense occidentale chez les Grecs, tout dire de l"tre" et du "est" se tient dans la mmoire (Andenken) de la dfinition contraignante pour la pense de ltre comme prsence . 2 Ibid., p. 29-30 : Penser ltre sans ltant, cela veut dire : penser ltre sans gard pour la mtaphysique. Un tel gard rgne encore dans lintention de surmonter la mtaphysique. Cest pourquoi il vaut la peine de renoncer au surmontement et de laisser la mtaphysique elle-mme . 3 Il est vident que les comprhensions du sacrifice chez, dune part, Hegel et, dautre part, Heidegger diffrent radicalement. Or, comme nous le montrerons, cest avec Heidegger
1
26
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
sappliquera tout particulirement vider en cherchant par l mme dployer une toute autre pense de la ngation 1. Et ce afin dentraner la thmatique du sacrifice dans une redfinition radicale marque par une dconstruction intgrale visant dmanteler toutes les modalits ontothologiques des discours traditionnels quant au sacrifice, et en particulier le discours signifi par la logique de lAufhebung hglienne o le sacrifice est compris et saisi en tant quessence rconciliante du Savoir Absolu. Cest ainsi, et mme ce projet de la redfinir entirement, que la thmatique du sacrifice accompagnera de faon dcisive llaboration de l ontologie fondamentale , en particulier dans lanalytique de l tre-pour-la-mort labore dans les chapitres I et II ( 54-60) de la seconde section de Sein und Zeit, puis, quelle ne cessera dhabiter diffremment et autrement la pense de ltre . Et ce parce que Heidegger naura jamais sacrifi la possibilit du sacrifice2. Bien au contraire, il aura toujours tenu librer une pense du sacrifice au-del de sa comprhension onto-thologique. En vrit, cest au fond sans fond de la pense de ltre et au cur mme de la vrit historiale de ltre se rtractant en dployant la venue en prsence de la prsence lieu depuis lequel la manifestet de ce qui est peut avoir lieu que Heidegger aura inscrit lessence ultime du sacrifice. Cest dire quil aura pens lessence ultime du
que se sera dgage, au-del et en-de de lhistoire onto-thologique de la mtaphysique, une autre signification du sacrifice en philosophie. Marquons galement, et ce ds prsent, que Levinas et Derrida sinscriront mme si cette inscription saccompagnera dune relecture de la pense heideggrienne dans le sillage ici trac par Heidegger quant la thmatique du sacrifice et son lien inalinable avec la vrit historiale de ltre . Il nous appartiendra de le montrer dans une autre tude. Quil nous soit permis cependant de renvoyer, quant la modalit et la signification du sacrifice dans la pense de Hegel, notre ouvrage Le sacrifice de Hegel, Paris, Galile, 2007. 1 Il nous faut ici renvoyer aux notes rdiges entre 1938 et 1941 sur la ngativit , dans lesquelles Heidegger prsente et dploie lidalisme spculatif de Hegel en ouvrant, au cur de lAufhebung et de sa systmaticit, une perce au-del de la dialectique de ltre et du nant, et donc rsolument porte non pas vers son accomplissement et sa dtermination dans le Savoir Absolu mais vers le sans-fond (Ab-grund) de la vrit historiale de ltre cf. Martin Heidegger, Hegel. 1. Die Negativitt (1938/39). 2. Erluterung der "Einleitung" zu Hegels "Phnomenologie des Geistes" (1942) , GA 68. 2 Nous souhaitons renvoyer quelques travaux dj publis qui cherchent approcher cette difficile thmatique du sacrifice dans la pense de Heidegger : Emilio Brito, Heidegger et lhymne du sacr, Louvain, Peeters, 1999 ; Franoise Dastur, Phnomnologie de ltre-mortel , in La mort, Paris, PUF, 2007, pp. 103-152 ; Jacques Derrida, Donner la mort, Paris, Galile, 1999 ; Michel Haar, Les limites de ltre-rsolu et le primat dabord latent puis explicite de la temporalit originaire sur la temporalit authentique , in Heidegger et lessence de lhomme, Grenoble, Millon, 1993, pp. 55-92 ; Jan Patoka, La technique selon Husserl et selon Heidegger , tr. fr. dErika Abrams, in Libert et sacrifice. crits politiques, Grenoble, Millon, 1990, et Joseph Cohen, Lappel de Heidegger , in Grard Bensussan et Joseph Cohen (ds.), Heidegger. Le danger et la promesse, Paris, Kim, 2006, pp. 61-77.
27
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
sacrifice mme la vrit historiale de ltre en la situant au cur de lEreignis donnant et adonnant le et dtre et temps. Et ainsi comme la modalit propre de la responsabilit de l homme envers la vrit historiale de ltre . Au-del donc de lanalyse accomplie dans Sein und Zeit, l o souvrait la possibilit du sacrifice pour lautre partir de limpossibilit de se substituer ltre pour la mort de lautre1, Heidegger aura repens lessence ultime du
Poursuivons notre interrogation par cette inflexion sur le rapport entre le Dasein, le Mitsein, l tre-pour-la-mort , la possibilit du sacrifice et ce que Heidegger nommera la communaut . Se tracera au centre de ce rapport la possibilit dune thique originaire qui, comme nous le savons, est voque dans la Brief ber den "Humanismus" : Si donc conformment au sens fondamental du mot ethos, le terme dthique doit indiquer que cette discipline pense le sjour de lhomme, on peut dire que cette pense qui pense la vrit de ltre comme llment originel de lhomme en tant quek -sistant est dj en elle-mme lthique originaire Martin Heidegger, Brief ber den "Humanismus", in GA 9, p. 356. Mais cette thique originaire doit toujours, marque Heidegger quelques lignes plus loin dans le texte, demeurer lcoute de la pense de ltre , et donc nest jamais penser ni comme pratique ni comme thorique . En effet, pour le Heidegger de 1946, si l thique originaire devait pouvoir se dployer ce ne saurait tre partir ou depuis une loi pose et propose dans et par la raison dun sujet autonome. Elle doit se donner lhomme depuis une pense qui pose la question de la vrit de ltre, et par lmme dtermine le sjour essentiel de lhomme partir de ltre et vers lui ibid., p. 357. Or cette pense nest ni thique ni ontologie ibid. Elle uvre avant toute distinction en ce quelle garde et sauvegarde la parole inexprime de ltre ibid., p. 361 , do se dploie une Loi et un faire qui dpasse et dborde toute praxis et dont la puissance est celle dun Dire qui dsormais sera toujours -penser ibid., p. 362. Nous expliciterons en quoi cette Loi et ce faire sont lis et allis, pour Heidegger, ce que nous avons nomm la possibilit ultime du sacrifice. Mais, en ce moment mme, il nous appartient de faire remarquer quavant dvoquer l thique originaire dans le Brief ber den "Humanismus", Heidegger en aura dj ouvert la possibilit ds Sein und Zeit. Marquons le sans dtour : la possibilit de cette thique originaire se serait dabord dploye dans la possibilit propre au Dasein du sacrifice pour lautre possibilit donne partir de linsubstituabilit de son tre pour la mort . Nous le savons, Heidegger ne cesse, dans tre et temps, de le souligner : l tre-pour-la-mort est radicalement insubstituable. Ds lors, il est impossible et impensable de dlivrer ou dpargner lautre du rapport sa mort. Rappelons ici la lettre de Heidegger : Nul ne peut prendre son mourir autrui. Lon peut certes "aller la mort pour un autre", mais cela ne signifie jamais que ceci : se sacrifier pour lautre "dans une affaire dtermine". En revanche, un tel mourir ne peut jamais signifier que sa mort serait alors le moins du monde te lautre. Son mourir, tout Dasein doit ncessairement chaque fois le prendre lui-mme sur soi. La mort, pour autant quelle "soit", est toujours essentiellement mienne, et certes elle signifie une possibilit spcifique dtre o il y va purement et simplement de ltre du Dasein chaque fois propre. Dans le mourir, il apparat que la mort est ontologiquement constitue par la miennet et lexistence Martin Heidegger, Sein und Zeit, GA 2, p. 319. Il faut ici remarquer limportance que Heidegger accorde linsubstituabilit de l tre-pour-lamort . En soulignant limpossibilit de soustraire lautre sa mort et ce mme au moment o lon se sacrifierait pour lautre Heidegger exige de repenser, laune de cette insubstituabilit, l tre-avec lautre. Et par l-mme de repenser le sacrifice pour lautre,
1
28
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
en donnant celui-ci sa possibilit proprement authentique et indpassable. Ainsi, loin de dterminer un rapport de simple solipsisme existential o lautre serait ni ou oubli , Heidegger maintiendra, en vrit, tout le contraire : linsubstituabilit de l tre pour la mort ouvre au cur de la Jemeinigkeit du Dasein la possibilit de son tre-avec lautre dont Heidegger aura toujours tenu souligner quil tait indissociable de lexistentialit mme du Dasein. Heidegger le souligne sans cesse : le mitsein est co-existential au Dasein. Or cest bien dans linsubstituabilit de l tre pour la mort du Dasein et par la rsolution qui sy possibilise signifiant ainsi la miennet propre de chaque Dasein engag dans son pouvoir-tre le plus propre, absolu et indpassable en tant que possibilit extrme de son existence ibid., p. 338 que se trace, la fois et simultanment, un tre-ensemble o, loin de se perdre dans la quotidiennet du On , est privilgie lauthenticit du rapport que chaque Dasein entretient et maintient lenseigne de sa propre mort. Ainsi, pour Heidegger, cest parce que la mort est chaque fois et insubstituablement mienne que l tre-avec authentique est possible et demeure possibilis. Plus en avant, cest au cur de cette insubstituabilit que le Dasein peut entretenir un rapport authentique avec lautre, cest-dire un rapport o il ne msinterprte pas la possibilit indpassable de lautre et o donc il ne travestit point lexistentialit propre de lautre. Heidegger lcrira quelques pages plus loin dans tre et temps : Libre pour les possibilits les plus propres, dtermines partir de la fin, cest--dire comprises comme finies, le Dasein expulse le danger de mconnatre partir de sa comprhension finie de lexistence les possibilits dexist ence dautrui qui le dpassent, ou bien en les msinterprtant, de les rabattre sur les siennes propres afin de se dlivrer ainsi lui-mme de son existence factice la plus propre. Mais la mort, en tant que possibilit absolue, nisole que pour rendre, indpassable quelle est, le Dasein comme tre-avec comprhensif pour le pouvoir-tre des autres ibid., p. 350-351. Ainsi, la libert du Dasein, en ce quelle souvre dans linsubstituabilit de sa propre mort, rserve lautre sa libert. Il lui rserve et lui donne le lieu do peut sexprimer sa libert propre en ne simmisant pas dans le rapport que lautre est appel entretenir et maintenir avec sa mort. Autrement dit, le Dasein laisse tre lautre dans son insubstituable tre-pour-la-mort . Cest ainsi quil faut comprendre la phrase de Heidegger, plus loin dans Sein und Zeit, au 60 : partir du en-vue-de-quoi du pouvoirtre choisi par lui-mme, le Dasein rsolu se rend libre pour son monde. La rsolution soi-mme place pour la premire fois le Dasein dans la possibilit de laisser "tre" les autres dans leur pouvoir-tre le plus propre et douvrir conjointement celui-ci dans la sollicitude qui devance et libre. Le Dasein rsolu peut devenir "conscience" dautrui. Cest de ltre Soi-mme authentique de la rsolution que jaillit pour la premire fois ltre -lun-aveclautre authentique et non pas des ententes quivoques et jalouses ou des fraternisations verbeuses dans le On et dans ce que lon veut entreprendre ibid., p. 395. LEntschlossenheit du Dasein lui fait donc accder la conscience dautrui, cest--dire lui fait devenir non pas lautre, mais comprhension de lexistentialit o se rvle par l mme la possibilit existentiale de lautre et o celle-ci est laisse lautre en son unicit et en sa singularit dtre riv la mort qui est toujours la sienne propre. Ainsi, le Dasein ne saurait se comprendre comme cet tant ferm et repli sur soi-mme, mais bien plutt comme cet tant pour lequel linsubstituabilit du rapport sa mort ouvre aussi ce que la possibilit ultime de lautre se dploie en son propre. Insubstituablement sienne, la mort ouvre donc le Dasein au rapport authentique lautre, cest--dire, la possibilit laisse lautre de se projeter dans son pouvoir-tre le plus propre. Ds lors, pour Heidegger, ce nest quen tant toujours dj engag dans la miennet de son propre tre pour la mort que souvre aussi lauthenticit de l tre-avec-autrui . Or en quoi consiste cet tre-avec-autrui ? Nous lavons dit : en la possibilit de laisser lautre son tre-pour-la-mort . Mais aussi et du coup en la possibilit pour le Dasein de se
29
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
sacrifier pour lautre. En somme, et la limite radicale de cette logique : ce nest que dans limpossibilit de mourir pour lautre, de mourir la place de lautre en se substituant son tre-pour-la-mort que le sacrifice pour lautre devient authentiquement possible. Ce qui signifie quau cur de la Jemeinigkeit et de linsubstituabilit de l tre pour la mort se libre aussi un tre-avec o souvre, par l-mme, la possibilit du sacrifice pour lautre. Ou encore, l tre-avec en ce quil est ancr dans limpossibilit de se substituer l tre pour la mort de lautre et inalinablement fix dans le rapport que chaque Dasein entretient avec sa mort marque aussi la possibilit de se sacrifier pour lautre sans se substituer son rapport la mort. Cest ainsi que peut se constituer une communaut. Or, le mot communaut doit sentendre, selon Heidegger, dans la constitution de lhistorialit propre du Dasein comprise comme destin, et donc comme comme co-destinalit dans l tre-avec . Et Heidegger le souligne : cette communaut, cette co-destinalit de ltre-lun-avec-lautre ne saurait se rduire la composition de parcours individuels ou lassemblement de sujets autonomes. Dans la communaut , l tre-avec est toujours inscrit et dj engag dans le mme monde et dans la rsolution pour des possibilits dtermines et donc les destins sont dentre de jeu dj guids ibid., p. 507. Mais vers quoi les destins sont-ils guids ? Vers louverture une co-destinalit ibid., p. 508 comme libert pour le sacrifice . Citons ici Heidegger : La rsolution comme destin est la libert pour le sacrifice, tel quil peut tre exig par la situation, dune dcision dtermine ibid., 516-517. Cest dire que la communaut est penser dans la possibilit revendique et assume, engage et dploye du libre sacrifice pour lautre. Or, et nous lavons dploy, ce libre sacrifice pour lautre nest possible que dans lexistentialit indpassable de chaque Dasein engag dans linsubstituabilit inaltrable de sa propre mort. Ainsi, cest uniquement depuis la miennet insubstituable de l tre-pour-la-mort que peut se constituer une co-destinalit de singularits rsolument engages dans la possibilit du libre sacrifice pour lautre. En-de de la communaut fonde sur un principe de reconnaissance entre sujets sidentifiant en une comprhension dialogique commune, Heidegger pense le lieu originel dun tre-ensemble se dployant dans et par la diffrence radicale des existants et en laquelle se profile, avant toute communication, une appartenance linsubstituabilit de la mort singulire de chaque existant. Ainsi, chaque existant est li et alli lautre par limpossibilit de mourir pour lui mais o, la fois et simultanment, cette impossibilit ouvre la seule et unique, singulire et exceptionnelle possibilit de se sacrifier pour lui. La communaut est ainsi ancre dans limpossibilit de sidentifier ou de se substituer lun lautre l o se noue une possibilit extrme surgissant de cette radicale diffrence entre existants, possibilit de se sacrifier lun pour lautre. Possibilit aussi de survivre lautre et dtre le tmoin de lautre non pas donc doublier lautre sa mort dans et par le travail intriorisant dun deuil, mais au contraire, de porter en soi lirremplaable, irrapropriable et secrte altrit de lautre. Cest cette communaut manant de limpossibilit de mourir pour lautre au sens de mourir la place de lautre et o se dploie par-l mme la possibilit singulire de se sacrifier pour lautre que Heidegger fera entendre plusieurs annes aprs Sein und Zeit, et notamment dans le sminaire de 1934-1935 quil consacrera La Germanie de Hlderlin : Cette communaut originelle ne nat pas dune entre en relations rcipr oques seule la socit nat ainsi ; mais au contraire la communaut est grce la liaison primordiale de chaque individu avec ce qui, un niveau suprieur, lie et dtermine chaque individu. Quelque chose doit tre manifeste, qui nest ni lindividu lui seul, ni la communaut en tant que telle. Chez les soldats, la camaraderie du front ne provient pas dun besoin de rassembler parce que dautres personnes dont on est loign ont fait dfaut, ni dun accord pralable pour senthousiasmer en commun ; sa plus profonde, son unique raison est que
30
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
sacrifice l o se dploie la responsabilit de la pense fie la vrit historiale de ltre . Cest pourquoi le sacrifice est pens, dans les dernires pages du Nachwort Was ist Metaphysik? 1, comme le don prodigue, soustrait
la proximit de la mort en tant que sacrifice a dabord amen chacun une identique annulation, qui est devenue la source dune appartenance absolue chacun dautres. Cest justement la mort que chaque homme doit mourir pour lui seul et qui isole lextrme chaque individu, cest la mort, et lacceptation du sacrifice quelle exige, qui crent avant tout lespace de la communaut dont jaillit la camaraderie. La camaraderie a -t-elle donc sa source dans langoisse ? Oui et non. Non, si, comme le petit-bourgeois, on entend par angoisse le tremblement perdu dune lchet qui a perdu la tte. Oui, si langoisse est conue comme une proximit mtaphysique de labsolu qui nest accorde qu lautonomie et lacceptation suprmes. Si nous nintgrons pas de force notre Dasein des puissances qui lient et isolent aussi absolument que la mort comme sacrifice librement consenti, cest--dire qui sen prennent aux racines du Dasein de chaque individu, et qui rsistent dune faon aussi profonde et entire dans un savoir authentique, in ny aura jamais de camaraderie : tout au plus une forme particulire de socit Martin Heidegger, Hlderlins Hymnen "Germanien" und "Der Rhein", GA 39, p. 72-73. Sensuit que souvre ici la possibilit de penser une communaut ailleurs et autrement que dans et par llaboration dune reconnaissance dialogique ou contractuelle dindividus. Elle provoque la pense sorienter vers lide dune communaut surgissant dun tout autre vnement lvnement que tous partagent mais qui demeure rsolument et absolument singulier et insubstituable : la mort. Or partir de cette vnementialit propre chaque Dasein, et qui constitue chaque Dasein en sa miennet propre, est donn le lieu do se dploiera une communaut dont la force sera celle de lier les existants qui la forment une possibilit sans justification et injustifiable du sacrifice. Autrement dit, une communaut o les existants se sacrifient non pas pour ce que ltat pourrait reprsenter ou leur offrir (reconnaissance, galit, etc.), ni non plus pour ce quil pourrait difier comme valeur, idologie, politique, mais uniquement pour linsubstituable existence de lautre. Une communaut donc toujours dploye depuis linsubstituabilit et dj allie par le respect vou laltrit impntrable de lautre. En somme, nous pourrions mme aller jusqu dire quil sagit ici de penser une communaut dexistants isols o cet isolement se donne prcisment comme lultime possibilit d tre-avec lautre sans que celle-ci ne soit mdie par ce qui rendrait leur co-appartenance visible, justifiable, reprsentable, rationnellement calculable ou reconnaissable. Nous pourrions mme ultimement suggrer que cette communaut est sans communaut, savoir quelle se pense sans quelle ne se rduise ce qui pourrait la fixer en une signification mdie par lexigence dune justification contractuelle, mais qui, prcisment, dborderait et surpasserait tout lien rationnellement dtermin pour ne se dire que dans une thique hyperbolique de limpossibilit-possibilit du sacrifice pour lautre. Une communaut donc davant la raison commune et travaille dabord par ce qui diffrencie et maintient en diffrence les existants et o cest prcisment en cette diffrenciation que souvre lultime possibilit de se donner lautre sans se substituer lui, sans aussi quil ne soit except de son avenir le plus propre en tant que libert la plus rsolument sienne. 1 Il est remarquable que la traduction franaise du Nachwort Was ist Metaphysik? rende le mot allemand Opfer par offrande et non pas par sacrifice. Certes, le mot Opfer peut bel et bien tre traduit par offrande. Ainsi, il ne saurait y avoir derreur dans lexcellent travail de traduction ralis par Roger Munier. Cependant, il nous semble important de signaler quOpfer peut galement se traduire par sacrifice. Et il nous semble essentiel de le traduire ainsi. Non seulement parce que l offrande prsuppose toujours le sacrifice , mais
31
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
aussi et surtout parce que Heidegger nous lavons dj soulign se sera appliqu penser lessence ultime du sacrifice. Certes, cette essence ultime ne peut tre reconduite une interprtation thologisante dOpfer et se doit de dmanteler celle-ci. Or cest trs certainement par souci de respecter cette d-thologisation heideggrienne du sacrifice que Roger Munier aura choisi de rendre Opfer par offrande plutt que par sacrifice ce dernier terme tant lourd de signification pour la pense religieuse. Cependant, sil nous semble essentiel de traduire Opfer par sacrifice plutt que par offrande, cest dabord parce que jamais Heidegger naura cherch viter les concepts, les mots, les signifiants hr its de la tradition onto-thologique, insistant bien plutt les accueillir en exigeant de ceux-l mmes quils se mettent parler autrement. Puis, parce que sil est vrai quil faut lire une continuit dans luvre de Heidegger, entre Sein und Zeit et lcriture du Nachwort Was ist Metaphysik? par exemple, il nous semble que lemploi du terme sacrifice est autrement plus parlant et rigoureusement plus juste. Pour le comprendre il faut retourner Sein und Zeit. Et plus particulirement au 53 o Heidegger labore le projet existential dun tre authentique pour la mort . Dans ces pages, Heidegger, nous le savons, souligne ceci : la mort en tant que possibilit indpassable est la possibilit la plus propre du Dasein. Il entend ainsi marquer que la mort, loin de simplement se comprendre comme une ventualit qui incombe tout tre humain, interpelle le Dasein la fois dans sa finitude et dans sa singularit louvrant ainsi son pouvoir-tre le plus proprement sien. Car la mort isole le Dasein dans sa finitude et donc le rend singulirement libre pour la possibilit existentiale ultime de son pouvoirtre . Or Heidegger, tout juste aprs avoir marqu avec force le pouvoir-tre le plus propre du Dasein, cet tre-auprs de soi-mme du Dasein dans son tre-pour-la-mort insubstituable crit : Ltre pour elle fait comprendre au Dasein qui le prcde, titre de possibilit extrme de lexistence, la ncessit de se sacrifier ( selbst aufzugeben). Mais le devancement nesquive pas lindpassabilit comme ltre pour la mort inauthentique, mais il se rend libre pour elle. Le devenir-libre devanant pour la mort propre libre de la perte dans les possibilits qui ne se pressent que de manire contingente, et cela en faisant comprendre et choisir pour la premire fois authentiquement les possibilits factices qui sont en de de la possibilit indpassable. Le devancement ouvre lexistence, titre de possibilit extrme, le sacrifice de soi (Selbstaufgabe) et brise ainsi tout raidissement sur lexistence chaque fois atteinte Martin Heidegger, Sein und Zeit, GA 2, p. 350. Par suite, il marque en quoi le devancement propre au Dasein dans son tre pour la mort est cela mme qui lui ouvre laccs une possibilit inattendue et imprvue dans la quotidiennet une possibilit extrme de son existence chaque fois sienne : celle du sacrifice de soi . Or le mot que Heidegger forge dans le passage que nous venons de citer est celui de Selbstaufgabe. Ce mot, nous pouvons galement le traduire ainsi : la tche (Aufgabe) du don (Gabe) de soi (Selbst) . Il souligne la tche propre au Dasein possibilit qui lui est donne dans et par son devenir-libre devanant de se donner soi-mme pour lautre. Non seulement de se donner soi-mme lautre l o il est impossible de prendre lautre son mourir ou de mourir pour lui, mais aussi et peut-tre surtout de remettre son soi lexposition de ltre. Cette tche du don de soi rvle dans son tre pour la mort marque labandon de ltantit et la sortie de la quotidiennet du On vers sa rsolution pour ltre. Heidegger le signalera quelques pages plus loin, toujours dans le 53 : Il est maintenant possible de rsumer ainsi notre caractrisation de ltre pour la mort authentique existentiellement projet : le devancement dvoile au Dasein sa perte dans le On-mme et le transporte devant la possibilit, primairement dpourvue de la protection de la sollicitude proccupe, dtre lui-mme mais lui-mme dans la LIBERT POUR LA MORT passionne, dlie des illusions du On, factice, certaine delle-mme et angoisse ibid., p. 353. Nous lentendons donc :
32
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
lauthentique rsolution pour ltre vient et provient dune libert pour la mort qualifie ici de passionne (leidenschaftlich) . Or Heidegger noffre aucune explication ou interprtation pour le choix du mot leidenschaftlich. Que vient-il signifier ? En quoi la libert pour la mort est-elle une passion ? Et dabord, quest-ce quune passion ? Le mot allemand Leidenschaft, traduit ici par passion, dit un souffrir , un prouver , un endurer . En ce sens, il signifie dabord un tat de passivit, ltat o un individu est affect par opposition aux tats o il serait lui-mme la cause de son propre agir. En ceci, il marque une exposition, et donc une sortie hors de sa position , projetant ainsi lexistant qui en souffre vers une bance, un clivage, une csure ou une diffrence non pas simplement entre soi-mme et une ralit htronomique, mais en lui-mme, entre, pour ainsi dire, soi-mme et soi-mme. Cest donc quil marque un dtournement de lextriorit o lexistant retourne vers son soi-mme et au cur de la coupure inhrente son soi-mme le transportant dj vers lautre de son soi-mme. Or le mot allemand Leidenschaft, comme le mot franais passion, ne sont videmment pas sans voquer lensemble des souffrances du Christ depuis, tel que le rapporte Matthieu, son agonie Gethsmani jusqu sa crucificxion et son ensevelissement (Matthieu, 26.27). La passion christique est signifie par le Christ lui-mme lorsquil dclare tre venu donner sa vie en ranon une multitude (ibid., 20.38) puis, lorsquil offre, lors de la Cne, son corps et son sang en don de soi-mme ses disciples. Ce don de soi-mme marque la conversion de sa crucifixion en fondation dune nouvelle alliance faisant donc de la passion christique le dploiement de lamour de Dieu envoyant son unique berger offrir sa vie pour ses brebis . Ainsi, la passion christique est reconnue comme sagesse et puissance de Dieu tant davance le mouvement dun sacrifice ultime et dune rconciliation absolue. Il est remarquable que Heidegger, dans le cours du semestre dhiver 1920-1921 intitul Einleitung in die Phnomenologie der Religion GA 60 , commente la passion christique. Certes, Heidegger ne sattarde point sur labsoluit de la rsolution rc onciliatrice dans et par la crucifixion du Christ. Bien plutt, concentrant son analyse sur leschatologie paulinienne, Heidegger souligne que la passion christique est la possibilit mme de penser la facticit du Dasein et donc, mme cette facticit, louverture un autre vnement l-venir depuis lequel sinscrit une rupture radicale de la chronologie du temps historique. Le Dasein serait ainsi ouvert un vnement irrductible au rgime de ltantit et ainsi une vnementialit venue de lautre de ltant. Mais si cette ouverture entendue comme passion ne peut, selon Heidegger, spuiser en une rsolution rconciliatrice absolue, elle demeure nanmoins lie un certain sacrifice. En vrit, au cur de cette passion se trace le lien entre le sacrifice et lexposition du Dasein lautre de ltant. Car et cest l que nous pouvons comprendre le terme leidenschaftlich et son entre en scne dans lanalytique existentiale de Sein und Zeit ce que Heidegger entend faire valoir dans le passage que nous avons cit plus haut est la passion du Dasein lui-mme, cest--dire la libert propre de sa facticit en son tre-pour-la-mort lexposant authentiquement lautre de ltant. Ce qui se trace donc en cette passion , en cette libert pour la mort passionne , cest lexposition authentique du Dasein ltre, et par l mme, le sacrifice de ltantit quil opre au nom de lautre de ltant. Do le dplacement hautement significatif et remarquable de lexpression qui marque mme le Dasein son exposition rsolue ltre dplacement quil faut aussi comprendre comme une transformation de lexpression de Sein und Zeit celle qui surgira dans le Nachwort Was ist Metaphysik? : de la libert pour la mort passionne la libert pour le sacrifice Martin Heidegger, Nachwort zu: "Was ist Metaphysik?", in GA 9, p. 309. Heidegger entend ici marquer le passage du Dasein en son tre pour la mort engag dans la tche du don de soi pour
33
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
toute obligation 1. Si penser est lengagement par ltre pour ltre 2 , le sacrifice constitue et signifie lopration mme de cet engagement. Et en effet, Heidegger sappliquera redfinir le laisser-tre , en lequel la pense est rsolument fie la garde de la vrit historiale de ltre , par la singularit dun sacrifice. Plus prcisment, il marquera la rponse de la pense essentielle celle de maintenir, en son ek-sistence , louverture pour ltre en gardant et sauvegardant sa vrit historiale en son adresse rtractive propre par cette unique exigence : celle dune libert du sacrifice 3. Citons le passage en entier :
tre ce quil a tre vers la rsolution de son sacrifice libre pour ltre et pour sa libre revendication par ltre. Or, il ne faudrait pas comprendre dans cette libert pour le sacrifice en tant que passion du Dasein louvrant lautre de ltant une simple abolition de ltant. Bien plutt car, rappelons-le, Heidegger aura toujours tenu lindissociabilit de ltant et de ltre, lexprimant aussi, entre tant dautres textes, dans le Nachwort Was ist Metaphysik? : ltant nest jamais sans ltre ibid., p. 306 faut-il y entendre une sparation davec ltant, ou encore, un dpart de ltantit, et donc une libert toujours dj engage et rsolue dans et pour lautre de ltant. Plus encore, le sacrifice de ltant nest pas un acte concret, mais un acte de pens il ne concerne pas tel ou tel tant, mais ltant en son entier. En ce sens, se remarque encore la proximit entre la libert pour la mort passionne de Sein und Zeit et la libert pour le sacrifice du Nachwort Was ist Metaphysik? . Cette proximit se signifiera ainsi : la libert pour la mort passionne signifie lexposition du Dasein somm daffronter, dans langoisse, lautre de ltant l o cet affrontement lappelle sa libration de lemprise de ltant-prsent en un sacrifice de lentiret de ltant au nom de sa revendication par ltre et en vue de souvrir par-del ltant lcoute de ltre. Cette insistance sur le sacrifice de ltant entendu comme sparation davec ltant et libration de lemprise de ltant-prsent dans lexposition labme de ltre constitue le point central du Nachwort Was ist Metaphysik? . Heidegger et telle est la raison pour laquelle, mieux encore que par offrande , il nous semble plus judicieux et rigoureux de traduire, dans ce texte, Opfer par sacrifice ne cesse de souligner en quoi et pourquoi Opfer est dabord sacrifice de ltant et par l-mme coute rsolue la voix de ltre et exposition lappel de loffrande de ltre. En vrit, cest dans le sacrifice de ltant que se rvle pour le Dasein rsolument revendiqu par ltre loffrande de ltre. videmment il ne saurait y avoir ici dordre chronologique entre sacrifice et offrande. Bien plutt, il nous faut ici penser, selon Heidegger, le sacrifice et loffrande dans la double-mouvance dun sacrifice ouvrant loffrande et dune offrande dissimulant ce que son sacrifice recle. Cest ainsi quil nous appartiendrait peut-tre de proposer un autre mot pour dire ce mouvement, celui de sacrifiance. Ce mot signe de faon singulire le sacrifice entendu comme dpart de ltant ou csure davec ltant et, la fois et simultanment, y inscrit une fidlit, une fiance, envers ce qui, par le sacrifice, se donne, savoir, le don lui-mme, mais qui demeure gard, retenu, sauvegard, retir. Nous laisserons cette proposition, pour linstant, ouverte. 1 Martin Heidegger, Nachwort zu: "Was ist Metaphysik?", in GA 9, p. 309. 2 Martin Heidegger, Brief ber den "Humanismus", in GA 9, p. 313. 3 Martin Heidegger, Nachwort zu: "Was ist Metaphysik?", in GA 9, p. 309.
34
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
La pense dont les penses non seulement ne calculent pas, mais sont absolument dtermines partir de lautre de ltant, je lappelle la pense essentielle. Au lieu de se livrer des calculs sur ltant au moyen de ltant, elle se prodigue dans ltre pour la vrit de ltre. Cette pense rpond la revendication de ltre, quand lhomme remet son essence historique la ralit simple de lunique ncessit qui ne contraint pas, tandis quelle oblige et cre lurgence qui saccomplit dans la libert du sacrifice1.
Or que faut-il entendre au cur de cette libert ? Ceci : la libert du sacrifice est trs prcisment ce qui porte la vrit historiale de ltre la possibilit de son Dire. Car cette libert du sacrifice dsenveloppe ceci : il y a tant ou ltant est donn. Heidegger le souligne la suite du passage tout juste cit du Nachwort Was ist Metaphysik? : Lurgence est que la vrit de ltre soit sauvegarde, quoi quil puisse choir lhomme et tout tant. Le sacrifice est le don prodigue, soustrait toute obligation, parce que slevant de labme de la libert, de lessence de lhomme en vue de la sauvegarde de la vrit de ltre pour ltant 2 . En ce sens donc, mme si le don vient initialement et solennellement de ltre, la pense essentielle ne saurait tre, mme ce don, simplement rceptive ou passive. Elle est voue et dvoue, rpondante et passionne en ce quelle re-donne la vrit historiale de ltre son Dire pour ltant. Ce qui signifie ceci : la pense essentielle est singulirement requise en ce quelle sacrifie ltantit en ouvrant au lieu pr-sant de tout tant-prsent o gt la vrit historiale de ltre ; Dire pr-expressif o ltre se donne en se retirant au dploiement de sa prsentatification en ce qui est . Car et telle est la responsabilit de la pense essentielle , ce envers quoi elle est dj gage et engage, fie et dvoue le sacrifice est le dpart de ltant dans la marche pour la sauvegarde de la faveur de ltre 3. Le sacrifice est donc port sur ltant en ce quil ouvre lau-del de ltantit et, en sy arrachant, sy sparant et sy distanciant, expose la vrit historiale de ltre en sa donation propre. En somme, le sacrifice rend et renvoie Cela , irrductible au prsent, do ce qui est provient : la prsence. Il expose, au-del et en de de ltant-prsent et de lapparition de ltant en prsent-constant et subsistant, non pas le fondement de ltantit, mais lavnement depuis lequel la prsence se dploie en tant que telle. Car le sacrifice marque cela mme qui demeure en advenant et se rtractant, se dcelant et se clant. Non pas quil dsigne la
Ibid. Ibid. nous soulignons. 3 Ibid. p. 311.
1 2
35
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
remonte ou la reconduction du donn au don, comme si nous passions de ltant au fondement de ltant. Bien plutt, le sacrifice fait voir et aperce voir, jusque dans le dploiement mme de ltant, la mouvance inapparente de la prsence, ladvenir de la prsence en prsence. Cest dire rien de moins que ceci : le sacrifice est dploiement de ladresse rtractive de lEreignis et, partant, expose la pense en lengageant la vrit historiale de ltre . Il commande donc la pense de toujours se tenir dans la trace matinale 1 de lEreignis o, en son immmorial advenir sadonne lappropriation et la dpropriation de temps et tre mouvance mme de la venue en prsence de la prsence. Or le sacrifice fait voir la vrit historiale de ltre en donnant accs sa doublit propre cette doublit toujours dj anime par le voilement et le dvoilement, le clement et le dclement que Heidegger interprte dans le double mouvement de la lth et de la-lth. Car le sacrifice demeure la modalit opratoire en et par laquelle cette vrit historiale peut tre repre en son retrait, aperue en son repli, dcele en son clement. Cest pourquoi le sacrifice se dmarque de toute calculabilit et se dtache de toute conomie. Il exige, par-del toute fixit et dtermination dans ltantit, la pense sen remettre la vrit historiale de ltre en sattachant son adresse rtractive o sapproprient et se dproprient temps et tre. Heidegger nomme ce mouvement o le sacrifice ouvre la vrit historiale de ltre : lessence exodique du sacrifice 2. Pourquoi exodique ? Car le sacrifice porte la pense ne plus se fixer dans ltant-dtermin en la poussant sengager elle-mme dans la doublit de la vrit historiale de ltre : sengager donc la fois en son clement et en son dclement. Par suite, Heidegger aura repens le terme de sacrifice en lui donnant la fonction non plus dlever le fini linfini, mais dtre le geste propre de la pense en ce que celle-ci se met lcoute de la vrit historiale de ltre , cest dire en ce quelle se fie rsolument la double modalit opratoire de lEreignis. Car le sacrifice tel lEreignis uvre comme une origine soustraite toujours susceptible doprer selon une doublit elle-mme insacrifiable : il est rtrospectif et prospectif il fait voir tout ce qui en drive et il fait signe vers ce qui nous demeure inconnu et innommable.
Martin Heidegger, Der Weg zur Sprache , in Der Spruch des Anaximander, GA 78, p. 255. Sur la trace dans la pense de Heidegger, renvoyons ici aux trs importantes tudes de Jacques Derrida : Ousia et Gramm. Note sur une note de Sein und Zeit , in Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1971 et De lesprit, Paris, Galile, 1987. 2 Martin Heidegger, Nachwort zu: "Was ist Metaphysik?", in GA 9, p. 311.
1
36
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Cest ainsi que le sacrifice commande la pense (Denken) de se dire en gratitude (Danken) 1. Et il appartiendra lhomme dhonorer cette gratitude en inscrivant en tout donn la marque innommable de sa donation. Lhomme veillera ainsi toujours penser mme le donn cela qui demeure occult en toute donn. Do sa responsabilit : garder le dclement-clement de la vrit historiale de ltre par-del et en tout donn prsent. Cest prcisment ce quentend ici Heidegger en conjuguant la pense , l essence de lhomme , le sacrifice , la gratitude cele et ltre : Dans le sacrifice advient la gratitude cele (der vergobene Dank), qui seule honore la bienveillance en vertu de laquelle ltre sest transmis lessence de lhomme dans la pense, afin que lhomme assume, dans la relation ltre, la garde de ltre 2. Le sacrifice ouvre ainsi la pense la dimension de lIncalculable, de lIndestructible et de lInnommable. Car il confie la pense au Sacr . Et ce non pas parce que le sacrifice porterait ou transporterait la pense dans labsoluit dune rconciliation humaine et divine, comme si en celle -ci tout tait relev et lev dans labsoluit infinie, mais bien plutt parce que le sacrifice consacre toujours la pense un innommable clement. Ce clement signifie que ltre et lhomme se co-appartiennent et demeurent coresponsables lun envers lautre. Cest prcisment ce qui marque limportance du sacrifice chez Heidegger : il dploie l entre-deux de ltre et de lhomme l o cet entre-deux signifie le retour, le revenir, le rappel de lhomme la vrit historiale de ltre . Il inscrit donc la pense dans lEreignis en y veillant la possibilit de Dire ladvenir de son immmorial et l immmorialit de son -venir . Cest ce Dire que Heidegger donnera le nom d histoire de 3 ltre . Or, ce dire repose entirement sur la responsabilit envers le sens de ltre et provient de la singularit insubstituable de l appel de ltre . Mais ce Dire , menant et guidant la pense la fois vers ltre et donc vers elle-mme, Heidegger laura dfini ds Sein und Zeit comme pouvoirour (Hrenknnen) 4. Pourquoi ? Car le pouvoir-our constitue louverture primordiale du Dasein en vue de son pouvoir tre le plus propre. 5 Mais, et il
Cf. par exemple Martin Heidegger, Der Weg zur Sprache , in GA 78, p. 251. Martin Heidegger, Nachwort zu: "Was ist Metaphysik?", in GA 9, p. 310. 3 Il nous faut ici renvoyer la grande tude dAron Kelkel, La lgende de ltre. Langage et posie chez Heidegger, Paris, Vrin, 1980. 4 Martin Heidegger, Sein und Zeit, GA 2, p. 217. 5 Ibid.
1 2
37
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
nous faut ici le rappeler, dans Sein und Zeit, l our primordial nest pas encore dispos par la voix de ltre . Il demeure tendu vers la voix de lami que tout Dasein porte avec soi 1 . Dans le Nachwort Was ist Metaphysik? cependant et sans que la situation ne se renverse ou ne se retourne, mais o elle cherche plutt se prciser cest ltre qui imposera son silence. Or ce silence ne saurait se rduire une simple absence de parole, une perte de la parole, ou une mutit. En vrit, on ne saurait dire de ce silence quil est simplement assimilable tre sans voix . Il prcde la fois la parole et le silence, tout comme il devance laffirmation et la ngation. Cest dire quil vient et provient de l Autre pur 2. Il est exposition laltrit pure de la vrit historiale de ltre et provoque, dans la pense, une bouleversante transformation de lessence du langage. Car face cette altrit pure, la pense est rsolument domicilie dans la demeure de ltre 3 , dont lessence est toujours le langage. En ce sens, le silence dont Heidegger parlera ici nest pas, proprement dit, silencieux. Sa diction en tant que demeure de ltre est toujours dj exile de lalternative entre la parole et le silence en ouvrant Cela o le penseur apprend exister dans ce qui na pas de nom 4. Cest au cur de cette existence dans lexil de la langue, transit par l angoisse seule tonalit o se dvoile lautre de ltant 5 et donc projet dans le sans nom de labme 6 , que peut sentendre 7 la rsonance de la voix silencieuse 8 de ltre rsonance en laquelle sveille et laquelle rpond le Dire du penseur . Heidegger le remarquera la toute fin de du Nachwort Was ist Metaphysik? :
La pense, obissant la voix de ltre, cherche pour celui-ci la parole partir de laquelle la vrit de ltre vient au langage. Cest seulement lorsque le langage de lhomme historique surgit de la parole quil est daplomb. Mais sil se tient daplomb, alors lui fait signe la garantie de la
Ibid. Sur la voix de lami , renvoyons ici la pntrante interprtation de Jacques Derrida dans Politiques de lamiti, Paris, Galile, 1994. Cf. aussi aux lectures suivantes : Jean-Franois Courtine, La voix (trangre) de lami. Appel et/ou dialogue , in Heidegger et la phnomnologie, Paris, Vrin, 1990, pp. 327-353 ; Franois Raffoul, chaque fois mien, Paris, Galile, 2004, p. 230 sq. 2 Martin Heidegger, Nachwort zu: "Was ist Metaphysik?", in GA 9, p. 306. 3 Martin Heidegger, Brief ber den "Humanismus", in GA 9, p. 361. 4 Ibid., p. 319. 5 Martin Heidegger, Nachwort zu: "Was ist Metaphysik?", in GA 9, p. 306. 6 Ibid. 7 Ibid. 8 Ibid.
1
38
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
voix silencieuse de sources caches. La pense de ltre veille sur la parole et dans une telle vigilance remplit sa destination. Cest le souci pour lusage de la langue. Du mutisme longtemps gard et de llucidation patiente du domaine en lui clairci vient le dire du penseur1.
Mais rpondre la voix silencieuse de la vrit historiale de ltre signifie trs prcisment, pour Heidegger, prouver dans le rien la vaste dimension ouverte de ce qui donne tout tant la garantie dtre 2. Cest-dire donc, tre doublement responsable ou responsable doublement, la fois pour la vrit historiale de ltre irrductible ltant et pour ltant qui ne peut se passer de son lien davec ladvenance inapparente de la venue en prsence de la prsence, do il peut apparatre. Doublement responsable et responsable doublement la fois envers ce qui nest pas ltant et envers le lieu o se prolifre, non pas le fond de ltant, mais ladvenir en lequel se donne la venue en prsence de la prsence irrductible ltant-prsent, mais en laquelle celui-ci se dploie. Rpondre dune responsabilit signifie donc, pour Heidegger, tre toujours dj expos ladvenance en laquelle la mise en prsence de la prsence sclaircit dans la modalit de la vrit historiale de ltre , en y voyant aussi le lieu du dploiement de ltant. Heidegger le soutiendra, immdiatement aprs la citation tout juste rapporte :
Cest ltre lui-mme. Sans ltre, dont lessence insondable, mais non dploye encore, nous destine le rien dans langoisse essentiale, tout tant resterait dans la privation dtre. Mais aussi bien, mme cette dernire nest pas, comme abandon de ltre, un nant nul, sil est vrai quil appartient la vrit de ltre que jamais ltre ne se dploie sans ltant, que jamais un tant nest sans ltre3.
Or, et nous venons de le signifier en citant Heidegger, cette responsabilit se pense toujours comme angoisse essentiale 4. Mais elle se pense aussi, et mme le sans-fond de cette angoisse, comme une promesse. Une promesse jaillissant mme la voix silencieuse de la vrit historiale de ltre et en laquelle lhomme est somm de se tenir libre dans lindtermination de
Ibid, p. 311. Ibid., p. 306. 3 Ibid. 4 Ibid.
1 2
39
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
ltre 1 . Cest ainsi que, pour Heidegger, la rponse de cette responsabilit angoisse et promise la libert dans la vrit historiale de ltre est le oui linsistance requrant daccomplir la plus haute revendication, dont seule est atteinte lessence de lhomme 2. Ce oui est acquiescement la fois de la vrit historiale de ltre et de la prolifration de ltant, le maintient mme du mi-lieu o tre et tant sont rapports lun lautre sans jamais se rduire lun en lautre. Telle est lpreuve donc de lhomme car seul de tout tant, lhomme prouve, appel par la voix de ltre, la merveille des merveilles : Que ltant est 3. Souvre ainsi le mouvement dune diffrence toujours diffre et maintenue, diffre dans son maintient dune co-appartenance o tre et tant demeurent irrductiblement htrognes mme le sans-fond de Ce qui demeure 4. Or, Ce qui demeure , et qui est le nant sans-fond de lhabiter de lhomme, dfinit trs prcisment la vrit historiale de ltre en laquelle celui qui y sjourne est engag sans rserve dans la rponse pensive la plus abyssale , angoissante , effroyable , mais qui est aussi la plus urgente . Nous avons dj cit plus haut ce passage, mais il nous faut le rpter : Cette pense rpond la revendication de ltre, quand lhomme remet son essence historique la ralit simple de lunique ncessit qui ne contraint pas, tandis quelle oblige, mais cr lurgence qui saccomplit dans la libert du sacrifice 5. Do la question : quel rapport subsistera-t-il entre la libert du sacrifice et la vrit historiale de ltre ? Cette question entend revenir sur lentiret du rapport entre lhistoire de la mtaphysique et la pense de ltre . Or lhypothse quil nous est permis de dvelopper aprs avoir travers linterprtation du sacrifice que Heidegger avance, notamment dans le Nachwort Was ist Metaphysik? , pourrait se constituer en deux faces et viserait comprendre la doublit mme de la vrit historiale de ltre , cette doublit dont la modalit approprie et dproprie la rtraction de ltre et la mise en prsence de ltant. Voici donc lhypothse : la fois et simultanment, le sacrifice est le mouvement par lequel ne cesse de se constituer lhistoire de la mtaphysique en sa traduction oublieuse de la vrit historiale de ltre dans lordre de ltant-prsent et louverture, par del cette traduction, ce qui ne saurait sy rduire, ce qui toujours se rtracte de sa prsentification en occultant, drobant, dissimulant ladvenir de son advenance
Ibid, p. 307. Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid. 5 Ibid., p. 309.
1 2
40
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
comme source propre de la mise en prsence de la prsence. Le sacrifice est, en ce sens, le nud du rapport entre ltre comme destiner et le temps comme porrection et ouvrirait, dans lhistoire de la mtaphysique et par la csure davec ltant-prsent quil inscrit en elle, cela mme do cette histoire peut se re-penser. Cest dire, en vrit, que le sacrifice oeuvre entre la vrit historiale de ltre et lhistoire de la mtaphysique. Car il uvre mme la vrit historiale de ltre . Ainsi le sacrifice constitue, non pas uniquement louverture la vrit historiale de ltre , mais aussi la modalit en laquelle lEreignis se donne. Et donc, le sacrifice ne saurait se comprendre exclusivement comme une exprience de labandon ou de la suspension de ltant. Il est aussi, pour Heidegger, lEreignis mme en ce que celui-ci est le double mouvement en et par lequel sapproprie et se dproprie le et dtre et temps en vrit historiale . Ainsi, lhistorialit de la vrit de ltre est, en vrit, le sacrifice. Car et cest prcisment ici que Heidegger loin de rduire le sacrifice sa signification onto-thologique aura pens mme ce terme une tout autre possibilit le sacrifice est offrande qui en soffrant se retient aussi, se garde et se sauvegarde. Que retient-il ? Que garde et sauvegarde-t-il ? Non pas soi-mme mais sa provenance. En donnant et se donnant, il retient, garde et sauvegarde do il vient retenant, gardant et sauvegardant, en secret, sa possibilit insacrifiable. En ce sens, le sacrifice demeure intraduisible dans la langue de la mtaphysique. Car il oeuvre depuis la doublit mme du clement et du dclement propre la vrit historiale de ltre . Cela ne saurait signifier que le sacrifice demeure indemne de sa rduction dans la langue de la mtaphysique. En vrit, cest tout le contraire. Le sacrifice est la fois toujours irrductible et dj rduit, toujours intraduisible et dj traduit. Il symbolise ce qui uvre la fois au cur de lhistoire de la mtaphysique et ce qui uvre au-del de son dploiement mme lEreignis donnant le et dtre et temps, partir duquel se donne et se pense la venue en prsence de la prsence. Tout se passe donc comme si lhistoire de la mtaphysique ne cessait de se sacrifier en se prolifrant et, par ce sacrifice mme, ne faisait toujours quouvrir et souvrir ce quelle naura pas encore pens : le sacrifice de ltre. Cette ouverture au sein de lhistoire de la mtaphysique vers une voix au-del du dploiement de son expression propre serait ainsi dgage par le sacrifice, et ceci parce quil est ce geste o cette histoire entendrait lappel de ce qui ne se rduira jamais sa logique et qui pourtant lui donne son lan, lui offre son envoi, lui attribue sa prolifration. Ce qui nest pas sans penser, quant au sacrifice, une logique de la supplmentarit. Et ce parce que si lhistoire de la mtaphysique se signifie toujours dans et par le sacrifice comme traduction de la vrit historiale de 41
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
ltre en tant-prsent, il ouvre par l mme, et au sein de cette histoire, une supplmentarit irrductible au prsent supplmentarit qui nest rien dautre que lcoute de cette voix silencieuse de l appel de ltre . Car ce qui importe ici est ceci : le Dire de la vrit historiale de ltre en tant quil se donne et soffre toujours dans le retrait et dj par le clement de sa donation, est sacrifice. Le sacrifice oeuvre ainsi doublement et inscrirait une doublit au cur de la pense. Il signifie la fois la modalit mme de la mtaphysique, tout en la portant au-del delle-mme, et la geste propre la vrit historiale de ltre , prise et prise dans le jeu incessant de sa clement et de son dclement. Le sacrifice est li et alli au dploiement de lhistoire de la mtaphysique en ce quil lie et allie le clement et le dclement de la vrit historiale de ltre . Et ce, non pas uniquement parce que cette histoire se sera entirement constitue dans la ritration sournoise dune logique o toujours sy symbolise le sacrifice, mais aussi, et en suivant lide centrale quavancera Heidegger quant l envoi de lhistoire de la mtaphysique : parce que le sacrifice y uvre comme ce qui y demeure encore impens et dont limpens est justement le symbole. Ainsi, le sacrifice devient la traduction la plus fidle du syntagme de loubli de la vrit historiale de ltre en histoire de la mtaphysique. Car le sacrifice marque la fois ce que lhistoire de la mtaphysique aura oubli de penser en tant elle-mme cependant toujours constitue par lui. Cest dire donc que le sacrifice signifie la modalit propre la vrit historiale de ltre en ce quil trace le geste en et par lequel celle -ci se donne, par son retrait, en dployant la venue en prsence de la prsence irrductible au prsent de tout ce qui est dtermin en tant que prsent. Cest pourquoi Heidegger situera, dans la confrence de 1950, Das Ding , au croisement entre les Dieux, les Hommes, la Terre et le Ciel, l offrande et le sacrifice . Car le sacrifice y nomme la vrit historiale de ltre en ce quil uvre au rassemblement et au versement de celle-ci. Il verse cela mme qui sy rassemble. coutons Heidegger :
La libation est le breuvage offert aux dieux immortels. Ce versement de la libation comme breuvage est le versement vritable. Dans le verser du breuvage consacr, la cruche versante dploie son tre comme le versement qui offre. Le breuvage consacr est ce que le mot Guss (versement, liquide vers) dsigne proprement : loffrande et le sacrifice. Guss, giessen (verser) rpondent au grec keein, lindo-europen ghu. Le sens est : sacrifier. L o le versement est accompli en mode essentiel, o il est
42
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
suffisamment pens et authentiquement dit, giessen veut dire faire offrande, sacrifier et par consquent faire don1.
Ce quil faut comprendre est ceci : le sacrifice rassemble et garde ce quil rassemble en se faisant versement il garde ce qui sy rassemble en le versant, il sauvegarde son rassemblement en ladonnant. Or ce qui sy rassemble, cest le Quadriparti les Dieux, les Hommes, la Terre et le Ciel. Ce qui sy verse, cest la donation de la co-appartenance mme du Quadriparti. Do notre titre, Le sacrifice de ltre quil faut entendre dans le double sens du gnitif : sacrifice oeuvrant mme ltre et sacrifice par ltre de son uvre mme, rassemblement en venue en prsence de la prsence et versement de ce rassemblement mme. Se signifie alors le double sens du sacrifice, son essence ultime : oprant au cur de ladvenance clante et dcelante de temps et tre comme rassemblement en vrit historiale , adonnant la venue en prsence de la prsence qui toujours se sacrifie elle-mme dans son versement souvrant par l mme en lorbe du prsent.
Nur wer begreift, da der Mensch geschichtlich, sein Wesen grnden mu durch die Grndung des Da-seins, da die Instndigkeit des Ausstehens des Da-seins nicht anderes ist als die Anwohnerschaft im Zeit-Raum jenes Geschehens, das sich als die Flucht der Gtter ereignet, nur wer schaffend die Bestrzung und Beseligung des Ereignisses in die Verhaltenheit als Grundstimmung zurcknimmt, vermag das Wesen des Seins zu ahnen und in solcher Besinnung die Wahrheit fr das knftige Wahre vorzubereiten. Wer dieser Vorbereitung sich opfert, steht im bergang und mu weit vorausgegriffen haben und darf vom Heutigen, so unmittelbar dringlich dies sein mag, kein unmittelbares Verstehen, allenfalls, nur Widerstand erwarten2.
Joseph COHEN (University College Dublin) *
Martin Heidegger, Das Ding , in Vortrge und Aufstze, GA 7, p. 174. Martin Heidegger, Beitrge zur Philosophie (Vom Ereignis), GA 65, p. 51-52 nous soulignons.
1 2
43
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
II. NATUR KUNST TECHNIK Chronique des rencontres de Messkirch, 25-29 mai 2011 Du 25 au 29 mai 2011 sest tenu Messkirch le cinquime colloque du Martin-Heidegger-Forschungsgruppe, organis par Alfred Denker et Holger Zaborowski. Cette rencontre a non seulement eu pour cadre, dans la ville natale du penseur, le Muse et les Archives Heidegger, au cur mme du chteau de Messkirch, mais elle a aussi bnfici de la prsence notable du fils du philosophe, Jrg, de son pouse, ainsi que de leur fille Gertrud ditrice des lettres adresses Elfride par son mari. Cest en effet un point dhonneur que la famille Heidegger met participer chacune des rencontres du MartinHeidegger-Forschungsgruppe, celle-ci ayant cette fois pour thme : Natur Kunst Technik . Un tel intitul avait bien sr lavantage dembrasser tous les moments de la philosophie heideggrienne, et a permis de croiser de multiples perspectives sur des problmatiques essentielles. Alors que, selon Heidegger, la nature comme physis permet, par analogie, de comprendre ltre comme le fait de se dployer en un mouvement douverture, la technique entretient avec elle un rapport de tension constitutif. En effet, la technique moderne, tout en tant, dans son essence oublie comme tchn, un mode de dvoilement de ltre, exprime linstrumentalisation et lexploitation anthropocentriques de la nature par lhomme et reprsente pour Heidegger laboutissement de la mtaphysique occidentale. Par opposition, lart est susceptible dincarner le laisser-tre fondamental par lequel ltre peut advenir en dehors de toute tentative de matrise de la part de lhomme. En cela, lart est compris en son sens originel de tchn, ce qui le rapproche galement du mode de dvoilement propre la physis. Les interventions du colloque ont su rendre compte de ces rapports complexes en les interrogeant sous des angles fort divers, do la varit et la richesse des communications qui ont pu tre, en sances plnires ou en sections parallles, prsentes par plus de soixantedix participants venus dune vingtaine de pays, exgtes consacrs aussi bien que chercheurs dbutants. Cest ensemble que les confrenciers sont arrivs Messkirch, aprs une rencontre la veille au soir Fribourg, dans lambiance chaleureuse de la Martins Bru, et cest aussitt, soit en dbut daprs-midi le 25 mai que les travaux du colloque ont dbut en quatre sections parallles. Ouvrant la premire dentre elles, Holger Zaborowski (Catholic University of America) a prsent la Gelassenheit comme vnement de la libert, suivi par Pol Vandevelde (Marquette University) qui a trait de ltre comme advenir et de la 44
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
posie comme fondation de son histoire, puis par Peter Brokmeier (Leibniz Universitt Hannover) qui a interrog le rapport entre poiesis et politique. Dans les autres sections, les interventions ont port sur des questions varies, ainsi celle de la biopolitique souleve par Shaireen Rasheed (Long Island University), celle du naturalisme aborde par David Storey (Fordham University), ou celle de la reprsentation mathmatique de la nature discute par Gregory Esplin (Purdue University). Revenait alors Theodore Kisiel (Northern Illinois University) de conclure cette premire journe en soulignant lactualit de la description heideggrienne du Gestell, les catastrophes technologiques les plus rcentes laccident nuclaire de Fukushima par exemple ne faisant ses yeux que projeter une chelle plantaire lexprience, rendue clbre par Sein und Zeit, du dysfonctionnement du marteau. Le lendemain, jour du 35ime anniversaire de la mort de Heidegger, la diversit des propos restait de mise, ceux-ci allant de questions fort conceptuelles la temporalit propre la nature et la physis pour Mario Martn Gmez Pedrido (Universidad de Buenos Aires) ou linterdpendance entre libert et monde pour Andreas Beinsteiner (Universitt Innsbruck), jusqu des thmes impact socio-culturel plus net, tels la pdagogie et lducation pour Francine Hultgren (University of Maryland), Debra L. Scardaville, (New Jersey City University) ou Joachim L. Oberst (University of New Mexico), ou encore la mdecine de la reproduction pour Pablo Azcar Pruyas (Universitt Bremen). Avant lheure du djeuner, Istvn M. Fehr (Etvs Lornd Tudomnyegyetem) a tenu le public en apptit en comparant la relation entre art et vrit chez Heidegger et Gadamer, pour indiquer le dpassement que tous deux accomplissent dune esthtique ayant pour centre de gravit la subjectivit en direction dune ontologisation de luvre dart. Cest la question de lesthtique qui a justement anim les interventions tenues laprs-midi par Wayne Froman (George Mason University) et Jeffrey Kinlaw (McMurry University), pendant que Rico Gutschmidt (Technische Universitt Dresden) exposait la transformation de lhomme dans la Sptphilosophie heideggrienne et la dimension religieuse inhrente ce nouveau rapport au monde, et que Jorge Uscatescu Barrn (Albert-Ludwigs-Universitt) reprenait pour les affiner quelques unes des distinctions conceptuelles fondamentales prsupposes par le thme gnral du colloque. Cette deuxime journe de travail sest acheve sur une note plus festive, alliant solennit et motion. Dune part, en prsence des autorits de la ville, les participants ont assist, dans le Muse Heidegger, linaug uration dune station mdia permettant la fois dcouter lenregistrement de 45
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
diffrentes confrences tenues par Heidegger et de visionner bon nombre de photographies reprsentant le penseur, sa famille, ses collgues et ses amis. Dautre part, Jrg Heidegger, son fils an n en 1919 et dont il faut saluer lendurante prsence lors du colloque, a pris la parole pour se livrer un formidable rcit autobiographique, intitul de faon suggestive Die Httenwelt meines Vaters . Avec une relle motion quil na pu que communiquer son public, Jrg Heidegger sest alors remmor, plus de quatre-vingt dix ans, plusieurs pisodes de sa jeunesse, que plusieurs clichs ainsi que la projection dune bande vido quil ralisa en son temps Todtnauberg ont parfaitement illustrs. Le pittoresque de ce court mtrage, dont une scne fait voir Heidegger en train de moudre du caf pour aider son pouse alors quil est encore alit et de redoubler despigles grimaces pour faire rire son fils derrire la camra, sest ncessairement grav dans la mmoire des spectateurs. La troisime journe du colloque sest ouverte le lendemain par une nouvelle matine divise en sections parallles : Gnther Neumann (LMU Mnchen) a propos un examen critique de lopposition heideggrienne entre linfinit du temps naturel et la finitude de la temporalit existentiale. La question directrice de la technique a, quant elle, t explore nouveaux frais, et dans son rapport la comprhension de la nature qui anime lidologie national-socialiste par Julia A. Ireland (Whitman College), et dans une comparaison avec Fink par Virgilio Cesarone (Universit del Salento). Deux communications en franais ont du reste t donnes ce matin-l : celle de Claudia Serban (Universit Paris-Sorbonne), intitule Capacits de lanimal, potentialits de lustensile et possibilits du Dasein , et celle de Christophe Perrin (Universit Paris-Sorbonne/Fondation Thiers) qui, en analysant lesprit de la technique et son malin gnie , a questionn le rle historial de Descartes dans linauguration du rgne du Gestell. Aprs la confrence en sance plnire de Ralf Elm (Pdagogische Hochschule Weingarten), qui a abord le thme de lethos et, avec lui, celui de lhabitation ou du sjour potique de lhomme sur terre, par contraste avec la crise du dracinement ou du manque de patrie, les travaux de laprs-midi lui ont fait cho, ainsi la prsentation de Robert Metcalf (University of Colorado) sur la Bodenstndigkeit, comme celle de Tobias Keiling (Albert-Ludwigs-Universitt Freiburg) qui sest interrog sur le lieu de lart et la place qui revient aux diffrents genres artistiques selon Heidegger et Gadamer. Mais dautres questions ont aussi t souleves : celle du deuil dans lhorizon dune analytique existentiale de ltrepour-la-mort, par Sandrine Cartier-Millon (Universit Pierre Mends France/Freie Universitt Berlin) ; celle du rapport ambigu Schelling, auquel 46
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Heidegger associe la fois le parachvement et le dpassement du rgne de la mtaphysique qui prfigure celui de la technique, par Sylvaine Gourdain (Universit Paris-Sorbonne/Albert-Ludwigs-Universitt Freiburg) ; celle de la remythisation ou religion potique , dont saccompagne la critique de la technique au fur et mesure de limportance croissante que prend la figure de Hlderlin dans la pense de Heidegger, par Christian Sommer (CNRS Paris) ; celle de la place de la corporit au sein du monde technique, par Oliver Bruns (Carl von Ossietzky Universitt Oldenburg), ou dans la pratique artistique, par Robert Clarke (University of Huddersfield) ; et, last but not least, la signification thique du dpassement du danger de la technique au moyen de lart, par Diana Aurenque (Eberhard Karls Universitt Tbingen). La fin de laprs-midi a t son tour fort stimulante. Les auditeurs ont pu apprcier lapproche originale tente par Alfred Denker, co-organisateur du colloque, de luvre de la photographe amricaine Sally Mann ; la reconstitution historique de diffrents modles de la causalit, oscillant entre transitivit et auto-manifestation, propose par Martina Roesner (HumboldtUniversitt zu Berlin), les enjeux cologiques soulevs par Vincent Blok (Radboud University Nijmegen) et lexploration de grandes notions philosophiques comme le mouvement et la transcendance, accomplie par Jeffrey Gower (Villanova University) et Adam Tate (Macquarie University). La confrence plnire du soir sest distingue des autres communications de la journe par son aspect particulirement revigorant, grce au propos dlibrment provocateur de Babette Babich (Fordham University), qui a mis lpreuve, non sans la radicaliser, la critique heideggrienne de la technique en sinspirant de Gnther Anders et en avanant vers lhorizon dun transhumanisme qui dpasse, autrement que ne la fait Heidegger, la constellation conceptuelle de lhumanisme classique. Le jour de la clbration des 750 ans de la ville de Messkirch, les communications de la dernire matine du colloque ont leur tour soulev des questions centrales, comme celle du lieu cosmologique et de la praxis sociale de la technique, par Annette Hilt (Johannes Gutenberg-Universitt Mainz), dun ventuel essentialisme technologique, par Tracy Colony (European College of Liberal Arts), ou encore du quadriparti, par Michael Medzech (Espelkamp). En fin de matine, la confrence plnire de John C. Maraldo (University of North Florida) a apport une tentative originale denvisager quoi pourrait ressembler concrtement une pratique de la Gelassenheit, laide dexemples inspirs, ex oriente lux, de pratiques artisanales qui ne sont pourtant pas instrumentales ou volontaristes proprement parler, comme le modelage dune cruche par 47
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
un potier. La dernire session parallle du colloque a donn loccasion, en dbut daprs-midi, dimaginer, avec Michael Eldred (Cologne), une approche non mtaphysique de la musique qui puise dans la description heideggrienne de lcoute, aux antipodes de lesthtique musicale subjectiviste dAdorno ; ou encore dassister, lors de lintervention de Michael Ruppert (Universitt Erfurt), une rigoureuse analyse du renouvellement de lexprience et de la pense de lespace par Heidegger, loppos de toute mathmatisation technoscientifique et rduction mtrique. Ute Guzzoni (Albert-Ludwigs-Universitt Freiburg) a offert au colloque sa note finale en rassemblant les auditeurs dans lespace de la srnit , titre mme de sa confrence. Aprs de chaleureux remerciements leurs htes, Alfred Denker et Holger Zaborowski, les participants ont pu traverser le parc du Chteau de Messkirch afin de parcourir une dernire fois ensemble le clbre Feldweg le chemin de campagne que Heidegger empruntait souvent afin de mditer, allant jusqu la lisire dun bois o, sous un chne connu comme le chne de Heidegger , un modeste banc en bois porte encore, sous la forme dune inscription, le souvenir de sa prsence. Gageons que seront encore nombreux ceux qui, dans deux ans, arpenteront nouveau ce sentier en pensant Freiheit und Geschichte , thme du prochain colloque. Sylvaine GOURDAIN (Universit Paris-Sorbonne/Albert-Ludwigs-Universitt Freiburg) & Claudia SERBAN (Universit Paris-Sorbonne)
48
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
BIBLIOGRAPHIE POUR LANNE 2011 1. Textes de Heidegger 1.1. HEIDEGGER (Martin), Anfang der abendlndischen Philosophie. Auslegung des Anaximander und Parmenides, GA 35, dit par TRAWNY (Peter), Francfortsur-le-Main, Klostermann, 272 p. 1.2. HEIDEGGER (Martin), Der Deutsche Idealismus (Fichte, Hegel, Schelling) und die philosophische Problemlage der Gegenwart, GA 28, dit par STRUBE (Claudius), Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 368 p. (nouvelle dition) 1.3. HEIDEGGER (Martin), Die Protokolle von Martin Heideggers Seminar zu Schellings "Freiheitsschrift" (1927/28), in HHN (Lore) & JANTZEN (Jrg) (ds.), Heideggers Schelling-Seminar (1927/28), Stuttgart, FrommanHolzboog, 481 p. 1.4. HEIDEGGER (Martin), Die "Seinsfrage" in Sein und Zeit. Das Transzendentale in Sein und Zeit , in EMAD (Parvis), HERRMANN (Friedrich-Wilhelm von), DAVID (Pascal), CORIANDO (Paola-Ludovika), SCHLER (Ingeborg) & SCHALOW (Frank), Heidegger-Studien/HeideggerStudies/tudes heideggriennes, Enowning-Thinking, the Onefold of Hermeneutic Phenomenology, Interpreting Gestalt and History, 27, Berlin, Duncker & Humblot, pp. 9-12 1.5. HEIDEGGER (Martin), Phnomenologie des religisen Lebens, GA 60, dit par JUNG (Matthias), STRUBE (Claudius) & REGEHLY (Thomas), Francfort-surle-Main, Klostermann, 352 p. (nouvelle dition remanie) 1.6. HEIDEGGER (Martin), Seminare: Hegel Schelling, GA 86, dit par TRAWNY (Peter), Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 906 p. 2. Traductions de textes de Heidegger Traductions anglaises 2.1. HEIDEGGER (Martin), Introduction to Philosophy. Thinking and Poetizing, trad. par BRAUNSTEIN (Phillip Jacques), Bloomington, Indiana University Press, Studies in Continental Thought 2.2. HEIDEGGER (Martin), Poverty , trad. par KALARY (Thomas) & SCHALOW (Frank), in SCHALOW (Frank) (d.), Heidegger, Translation and the Task of Thinking. Essays in Honor of Parvis Emad, Dordrecht, Springer, Contributions to Philosophy, pp. 3-10
49
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
2.3. HEIDEGGER (Martin), The Concept of Time, trad. par FARIN (Ingo), Londres/New-York, Continuum, Athlone Contemporary European Thinkers Traductions chinoises 2.4. HEIDEGGER (Martin), Ren, shi yi de an ju : hai de ge er yu yao [ dichterisch wohnet der Mensch ], trad. de ZHANG (Ru-lun) & HAO (yuan-bao), Shanghai, Shanghai yuan dong chu ban she 2.5. HEIDEGGER (Martin), Yan jiang yu lun wen ji [Vortrge und Aufstze], trad. de SUN (Zhou-xing), Shanghai, San lian shu dian 2.6. HEIDEGGER (Martin), Tong yi yu cha yi [Identitt und Differenz], trad. de SUN (Zhou-xing), CHEN (Xiao-wen) & YU (Ming-feng), Pkin, Shang wu yin shu guan 2.7. HEIDEGGER (Martin), Kang de yu xing er shang xue yi nan [Kant und das Problem der Metaphysik], trad. de WANG (Qing-jie), Shanghai, Shang hai yi wen chu ban she Traductions corennes 2.8. HEIDEGGER (Martin), Hoesang [Andenken], trad. de SHIN (Sang Hien), Paju, Nanam 2.9. HEIDEGGER (Martin), Jonggyojeok Salm ui Hyeonsanghak [Phnomenologie des religisen Lebens], trad. de KIM (Jae Chul), Seoul, Numen Traductions franaises 2.10. HEIDEGGER (Martin), Exercices sur Aristote, De anima , trad. de CAMILLERI (Sylvain) & PERRIN (Christophe), in ARRIEN (Sophie-Jan) & CAMILLERI (Sylvain) (ds.), Le jeune Heidegger (1909-1926). Hermneutique, phnomnologie, thologie, Paris, Vrin, Problmes & Controverses, pp. 239-257 2.11. HEIDEGGER (Martin), Le problme du pch chez Luther , trad. et annot. de SOMMER (Christian), in ARRIEN (Sophie-Jan) & CAMILLERI (Sylvain) (ds.), Le jeune Heidegger (1909-1926). Hermneutique, phnomnologie, thologie, Paris, Vrin, Problmes & Controverses, pp. 259-288 2.12. HEIDEGGER (Martin), Parmnide, trad. de PIEL (Thomas), Paris, Gallimard, Bibliothque de Philosophie 2.13. HEIDEGGER (Martin), Le manque de noms salutaires , trad. de SAATDJIAN (Dominique), in SAATDJIAN (Dominique), La ralit rptition, Paris, SPM Lettrage, pp. 95-114
50
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Traductions espagnoles 2.14. HEIDEGGER (Martin), Ejercitacin en el pensamiento filosfico: ejercicios en el semestre de invierno de 1941-1942, trad. de CIRIA (Alberto), Barcelone, Herder 2.15. HEIDEGGER (Martin)/BULTMANN (Rudolf), Correspondencia 1925-1975, trad. de GABAS (Raul), Barcelone, Herder Traductions grecques 2.16. HEIDEGGER (Martin), Phainomenologikes ermineies ston Aristoteli. Diglossi ekdosi, trad. de ILIOPOULOS (Giorgos), Athnes, Pathakes 2.17. HEIDEGGER (Martin), Peri politikis, peri alitheias, peri technikis, trad. de TZORTZOPOULOS (Dimitris), Athnes, Iridanos 2.18. HEIDEGGER (Martin), Nietzsche: I voulisi gya ischy os techni, trad. de ILIOPOULOS (Giorgos), Athnes, Plethron Traductions italiennes 2.19. HEIDEGGER (Martin), Che cos la verit ?, trad. de GTZ (Carlo), Milan, Marinotti 2.20. HEIDEGGER (Martin), Dallesperienza del pensiero (1910-1976), trad. de CURCIO (Nicola), Gnes, Il Nuovo Melangolo 2.21. HEIDEGGER (Martin), La questione della cosa, trad. de VITIELLO (Vincenzo), Milan, Mimesis 2.22. HEIDEGGER (Martin), Oltre lestetica. Scritti sullarte, trad. de MARAFIOTI (Rosa Maria), Messine, Sicania Traduction russe 2.23. HEIDEGGER (Martin), Vremja I bytie, trad. par BIBIHIN (Vladimir), Moscou, Akademitcheskii proekt
3. Collectifs et numros de revues En allemand 3.1. ESPINET (David) (d.), Schreiben Dichten Denken. Zu Heideggers Sprachbegriff, Fribourg, Klostermann ESPINET (David), Einleitung: Das Archiv als arch des Denkens , pp. 9-11 Dichtung und Literatur : AURENQUE (Diana), Literatur, ffentlichkeit und Geheimnis. Die heideggersche Unterscheidung von geschrieben-ausgesprochenem und schweigend-hrendem Wort , pp. 51
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
13-28 ; SOMMER (Christian), "Abendlndische Dichtung und europische Literatur". Zu Heideggers Begriff der Sprache als Urdichtung im Ausgang von Hlderlin , pp. 29-39 Literaturtheorie : YCHLISKI (Arkadiusz), Heidegger und die Kunst des Romans , pp. 41-54 ; MARINO (Stefano), Philosophy and Poetry Philosophy as a Kind of Writing. Some Remarks on Richard Rortys Heidegger Interpretation , pp. 55-68 ; CULBERTSON (Carolyn), Finding Oneself in Language. On the Theme of Entanglement in Heideggers Unterwegs zur Sprache and Barthes Literary Theory , pp. 69-81 ; Heideggers Dichter : BAUR (Patrick), Heidegger und Pindar. Die Huslichkeit der Dichtung , pp. 83-98 ; MIRKOVI (Nikola), sthetischer Zustand als Grundstimmung. Eine Funote zu Heideggers Schiller-Seminar (1936) , pp. 99-112 ; CECCHI (Dario), Oedipus Enigma. Heidegger on Schiller, Arendt on Kant , pp. 113-126 ; GORGONE (Sandro), Entwurzelung und Verwstung. Heidegger und die Dichtung der Heimat , pp. 127-144 ; BARISON (Marcello), Seynsgeschichte und Erdgeschichte. Zwischen Heidegger und Jnger , pp. 145-160 ; NAVIGANTE (Adrin), Stimme des Seyns, Verstummen des Gedichts. Zum Denken der Diskontinuitt bei Heidegger und Celan , pp. 161-176 ; KEILING (Tobias), Ort und Zeit im Meridian. Heidegger in Derridas Celan-Interpretation , pp. 177196 ; DUSSERT (Jean-Baptiste), Chemin faisant. Heidegger et Char , pp. 199-209 Sprachdenken : BERNERT (Sandy), Sein und Sage. Martin Heidegger zwischen Seinsrede und Zuspruch des Seins , pp. 211-226 ; ALTMAN (Megan), Heidegger and Aristotle on Contemplating Contemplation , pp. 227-240 ; SCHLLES (Manuel), Wahrheit und Eros in Heideggers Ereignis-Denken und bei Platon , pp. 241-255 3.2. ESPINET (David) & KEILING (Tobias) (ds.), Heideggers Ursprung des Kunstwerks. Ein kooperativer Kommentar, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, Heidegger Forum Vorwort, pp. 11-18 ; Themen : DE LARA (Francisco), Kunstwerke und Gebrauchsgegenstnde. Ding, Zeug und Werk in ihrer Widerspiegelung , pp. 19-32 ; AURENQUE (Diana), Die Kunst und die Technik. Herstellung, , , pp. 33-45 ; ESPINET (David), Kunst und Natur. Der Streit von Welt und Erde , pp. 46-65 ; KEILING (Tobias), Kunst, Werk, Wahrheit. Heideggers Wahrheitsverstndnis in Der Ursprung des Kunstwerkes , pp. 66-94 ; SCHLLES (Manuel), Die Kunst im Werk. Gestalt Stimmung Ton , pp. 95-109 ; FLATSCHER (Matthias), 52
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Dichtung als Wesen der Kunst? , pp. 110-122 ; CIMINO (Antonio), ESPINET (David), KEILING (Tobias), Kunst und Geschichte , pp. 123138 Philosophische Einflsse : PANTOULIAS (Michai), Heideggers Ontologie des Kunstwerks und die antike Philosophie. Heraklit und Aristoteles , pp. 139-159 ; SCHWENZFEUER (Sebastian), Vom Ende der Kunst. Eine kurze Betrachtung zu Heideggers Kunstwerkaufsatz vor dem Hintergrund des Deutschen Idealismus , pp. 160-172 ; MIRKOVI (Nikola), Heidegger und Hlderlin. Eine Spurensuche in Der Ursprung des Kunstwerkes , pp. 173-185 ; EGEL (Antonia), Das "eigene Mh" der Kunst. Zu den literarischen Quellen in Der Ursprung des Kunstwerkes , pp. 186-199 Wirkungen im Werk Heideggers : MIRKOVI (Nikola), Schnheit, Rausch und Schein. Heideggers Auseinandersetzung mit der sthetik Nietzsches , pp. 200-209 ; HILDEBRANDT (Toni), "Bildnerisches Denken". Martin Heidegger und die bildende Kunst , pp. 210-225 ; WESTERLUND (Fredrik), Heideggers Transformation der Phnomenologie in Der Ursprung des Kunstwerkes , pp. 226-233 ; VEITH (Jerome), Dichten, Denken, Sagen. Wirkungen des Kunstwerkaufsatzes im spteren Sprachdenken Heideggers , pp. 234-240 Philosophische Wirkungsgeschichte : NAVIGANTE (Adrin), Adorno ber Heideggers Ontologie des Kunstwerks , pp. 241-249 ; ALLOA (Emmanuel), Restitutionen. Wiedergaben des Ursprung des Kunstwerkes in der franzsischen Philosophie , pp. 250-265 ; THANING (Morten), Rezeption in der philosophischen Hermeneutik , pp. 266-283. En anglais 3.3. DAHLSTROM (Daniel) (d.), Interpreting Heidegger. New Essays, Cambridge, Cambridge University Press DAHLSTROM (Dan), Introduction , pp. 1-13 ; ZABOROWSKI (Holger), Heideggers Hermeneutics: Toward a New Practice of Understanding , pp. 15-41 ; SHEEHAN (Thomas), Facticity and Ereignis , pp. 42-68 ; CRITCHLEY (Simon), The Null-Basis Being of a Nullity, or Between Two Nothings: Heideggers Uncanniness , pp. 69-78 ; GUIGNON (Charles), Heideggers Concept of Freedom, 1927-1930 , pp. 79-105 ; THOMSON (Iain), Ontotheology , pp. 106-132 ; DAHLSTROM (Dan), Being at the Beginning: Heideggers Interpretation of Heraclitus , pp. 135-155 ; HAYES (Josh Michael), Being-Affected: Heidegger, Aristotle, and the Pathology of Truth , pp. 156-173 ; KAFER (Stephan), Heideggers Interpretation of Kant , pp. 174-196 ; COLONY (Tracy), The Death of God and the 53
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Life of Being: Heideggers Confrontation with Nietzsche , pp. 197-216 ; MITCHELL (Andrew J.), Heideggers Poetics of Relationality , pp. 217232 ; BRAVER (Lee), Analyzing Heidegger: A History of Analytic Reactions to Heidegger , pp. 235-255 ; FROMAN (Wayne J.), Levinas and Heidegger: A Strange Conversation , pp. 256-272 ; DASTUR (Franoise), Derridas Reading of Heidegger , pp. 273-298 3.4. HEMMING (Laurence Paul), AMIRIDIS (Kostas) & COSTAE (Bogdan) (ds.), Movement of Nihilism. Heideggers Thinking after Nietzsche, Londres/New York, Continuum HEMMING (Laurence Paul), Introduction , pp. 1-7 ; COSTEA (Bogdan) & AMIRIDIS (Kostas), The Movement of Nihilism as Self-Assertation , pp. 8-24 ; HEMMING (Laurence Paul), Heideggers "Movement of Nihilism" as Political and Metaphysical Critique , pp. 25-38 ; ROHKRMER (Thomas), Fighting Nihilism through Promoting a New Faith: Heidegger with the Debates of His Times , pp. 39-53 ; DE BEISTEGUI (Miguel), Questioning Politics, or Beyond Power , pp. 54-70 ; BROADBENT (Hal), Living the berfluss. Early Christianity and the Flight of Nausea , pp. 7192 ; HODGE (Joanna), Heidegger on Virtue and Technology: The Movement of Nihilism , pp. 93-109 ; MALPAS (Jeff), Nihilism and the Thinking of Place , pp. 110-127 ; PARSONS (Susana Frank), What Gives Here? Phronesis and die Gtter: A Close Reading of 70-71 of Heideggers Besinnung , pp. 128-143 ; SIEBERS (Johan), "Myth means: the saying word"/"The Lord said that he would dwell in thick darkness" , pp. 144154 ; SINCLAIR (Mark), Comings to Terms with Nihilism: Heidegger on the Freedom in Technology , pp. 155-169 3.5. SCHALOW (Frank) (d.), Heidegger, Translation and the Task of Thinking. Essays in Honor of Parvis Emad, Dordrecht, Springer, Contributions to Phenomenology SCHALOW (Frank), Introduction , pp. 11-46 ; HOPKINS (Burt C.), Deformalization and Phenomenon in Husserl and Heidegger , pp. 4969 ; SENA (Marylou), A Purview of Being: The Ontological Structure of World, Reference (Verweisung) and Indication (Indikation) , pp. 71-94 ; KOVACS (George), Heideggers Experience with Language , pp. 95109 ; KALARY (Thomas), Heideggers Thinking of Difference and the God-question , pp. 111-133 ; CORIANDO (Paola-Ludovika), Substance and Emptiness: Preparatory Steps toward a Translational Dialogue 54
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
between Western and Buddhist Philosophy , pp. 135-143 ; RADLOFF (Bernhard), Preliminary Notes on Divine Images in the Light of BeingHistorical Thinking , pp. 145-171 ; SCHALOW (Frank), A Conversation with Parvis Emad on the Question of Translation in Heidegger , pp. 175-189 ; KOVACS (George), Heideggers Contributions to Philosophy: The Challenge of its Translation , pp. 191-211 ; VON HERRMANN (Friedrich-Wilhelm), Dasein and Da-sein in Being and Time and in Contributions to Philosophy (From Enowning) , pp. 213-224 ; DE GENNARO (Ivo), Husserl and Heidegger on Da-sein: With a Suggestion for Its Interlingual Translation , pp. 225-252 ; IRELAND (Julia A.), Heidegger, Hlderlin, and Eccentric Translation , pp. 253-267 ; NELSON (Eric S.), Responsiveness, Translation: Heideggers Ethics , pp. 269-290 ; SCHALOW (Frank), Attunement and Translation , pp. 291-311 En espagnol 3.6. ROCHA DE LA TORRE (Alfredo) (d.), Heidegger hoy. Estudios y perspectivas, Gramma, Buenos Air/Rio/Barcelone, Filosofa, Argumentos LEYTE (Arturo), Heidegger: una nota (obra) sincrnica , pp. 1318 ; COURTINE (Jean-Franois), Reduccin, construccin, destruccin. De un dilogo entre tres: Natorp, Husserl, Heidegger , pp. 21-41 ; GRONDIN (Jean), Heidegger y el desafo del nominalismo , pp. 43-53 ; ADRIN ESCUDERO (Jess), "El hombre es un viviente que lee el peridico". Heidegger, lector de la retrica aristotlica , pp. 55-77 ; TENGELYI (Lszl), Filosofa y concepcin del mundo: Dilthey, Husserl, Heidegger , pp. 79-94 ; RUBIO (Roberto), Sobre la produccin de imgenes: Heidegger lector de Platn , pp. 95-109 ; AINBINDER (Bernardo), Donacin y posibilidad. Heidegger y la filosofa trascendental , pp. 111-134 ; SLOTERDIJK (Peter), La poltica de Heidegger: aplazar el fin de la historia , pp. 137-166 ; GUTIRREZ (Carlos B.), La pobreza de Heidegger , pp. 167-183 ; WALTON (Roberto), El camino hacia lo inaparente , pp. 185-205 ; MSMELA (Carlos), Heidegger. La intimidad () como contienda () del Ser mismo , pp. 207-231 ; ROCHA DE LA TORRE (Alfredo), Heidegger: Ontologa y olvido del hombre. La interpretacin de Emmanuel Levinas , pp. 233-254 ; VIGO (Alejandro), Tenencia previa y gnesis ontolgica. Observaciones sobre algunas estrategias metdicas en la analtica existenciaria de Sein und Zeit , pp. 257-303 ; RODRGUEZ (Ramn), La manera correcta de entrar en el crculo. La cuestin del 55
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
sentido en Ser y tiempo , pp. 305-326 ; ROSSI (Luis), Ser y tiempo y la fenomenologa de la comunidad y la sociedad , pp. 327-346 ; GAMA (Luis Eduardo), Heidegger y los crculos de la interpretacin , pp. 347364 ; MANCILLA (Mauricio), Entre historicidad y comprensin dialgica: hermenutica filosfica como apropiacin de la tradicin , pp. 365376 ; FLAMARIQUE (Lourdes), Alumbrando la fenomenologa hermenutico-existencial. Heidegger tras los pasos de la teologa , pp. 379-406 ; CONTRERAS (Andrs Francisco), Humanismo y superacin del subjetivismo , pp. 407-429 ; DE LARA (Francisco), La autocancelacin de la filosofa en el joven Heidegger , pp. 431-446 ; CEPEDA (Margarita), Ser y Zen , pp. 447-461 ; RAMOS DOS REIS (Rbson), La hermenutica de la naturaleza viva segn Martin Heidegger , pp. 463-476 En franais 3.7. ARRIEN (Sophie-Jan) & CAMILLERI (Sylvain) (ds.), Le jeune Heidegger (1909-1926). Hermneutique, phnomnologie, thologie, Paris, Vrin CAMILLERI (Sylvain) & ARRIEN (Sophie-Jan), Introduction , pp. 723 ; VIGLIOTTI (Robert), Linfluence de la tradition augustinienne sur le jeune Heidegger , pp. 29-50 ; DEWALQUE (Arnaud), Objectualit et domaine de validit. Sur la premire partie de lHabilitationsschrift , pp. 5174 ; CROWE (Benjamin D.), Heidegger et le no-kantisme de Bade. Critique de la philosophie des valeurs , pp. 75-93 ; ZAHAVI (Dan), Comment examiner la subjectivit ? propos de la rflexion : Natorp et Heidegger , pp. 95-118 ; SCHMIDT (Ina), La vie comme dfi phnomnologique. La pense du jeune Heidegger comme critique de la science rigoureuse , pp. 119-133 ; CAMILLERI (Sylvain), Phnomnologie de la mystique mdivale : les Notes de 1916-1919 , pp. 135-153 ; ARRIEN (Sophie-Jan), Foi et indication formelle , pp. 155-172 ; SOMMER (Christian), (Qui) suis-je ? Quaestio augustinienne et Seinsfrage heideggrienne , pp. 173-184 ; COYNE (Ryan D.), Hermneutique et confession : ce que le jeune Heidegger a trouv chez Augustin , pp. 185-211 ; CIOCAN (Cristian), La gense de problme de la mort avant tre et Temps , pp. 213-217 En plusieurs langues 3.8. EMAD (Parvis), HERRMANN (Friedrich-Wilhelm von), DAVID (Pascal), CORIANDO (Paola-Ludovika), SCHLER (Ingeborg) & SCHALOW (Frank), 56
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Heidegger-Studien/Heidegger-Studies/tudes heideggriennes, Enowning-Thinking, the Onefold of Hermeneutic Phenomenology, Interpreting Gestalt and History, 27, Berlin, Duncker & Humblot Articles : DE GENNARO (Ivo), Minding that "We" Cannot Ever Not Think Beng: Enowning and the Treasure of the Onset , pp. 15-43 ; RICHTER (Ewald), berlegungen zu neu verffentlichten Manuskripten Heideggers ber Metaphysik und moderne Naturwissenschaft , pp. 4574 ; FRANCE-LANORD (Hadrien), Martin Heidegger et la question de lautre: III. tre soi ensemble, IV. Le souci mutuel , pp. 75-99 ; BLOK (Vincent), Establishing the Truth, Heideggers Reflections on Gestalt , pp. 101-118 ; CERCEL (Gabriel), Zur Entstehung einer phnomenologischen Hermeneutik der Geschichte: Heinrich Finke und Martin Heidegger (1911-1933) , pp. 119-136 ; TENGELYI (Lszl), Lide de mtontologie et la vision du monde selon Heidegger , pp. 137-153 ; KOVACS (George), The Impact of Heideggers Beitrge zur Philosophie on Understanding his Lifework , pp. 154-176 ; PLTNER (Gunther), Heideggers Umgang mit Thomas von Aquin , pp. 177-195 Essays in Interpretation : KALARY (Thomas) & SCHALOW (Frank), Attunement, Discourse, and the Onefold of Hermeneutic Phenomenology: Recent Heidegger-Literature and a New Translation of his Work in Critical Perspective , pp. 199-219 ; NEUGEBAUER (Kaus), Lesen, Hren, Streiten ber Kunst: Briefwechsel Heidegger Bauch, Phnomenologie des Hrens, Heidegger und Nationalsozialismus , pp. 221-226 ; SCHLER (Ingeborg), Heidegger und Diels: Editorische Notiz zu Heideggers Vorlesungsmanuskript "Der Spruch des Anaximander". GA 78 , pp. 237-242 Update on the Gesamtausgabe, pp. 243-258 Errata and Omissions in Recent English Translations of the Gesamtausgabe, pp. 259-262
4. tudes gnrales En allemand 4.1. ANGLET (Kurt), Die letzte Stunde. Eine Betrachtung, Regensburg, Echter, 181 p. 4.2. AURENQUE (Diana), Ethosdenken. Auf der Spur einer ethischen Fragestellung in der Philosophie Martin Heideggers, Fribourg, Alber, Alber Thesen, 384 p.
57
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
4.3. DENKER (Alfred), Unterwegs zur Sein und Zeit. Einfhrung in das Leben und Denken von Martin Heidegger, Stuttgart, Klett-Cotta, 240 p. 4.4. FISCHER (Norbert), Die Gottesfrage im Denken Martin Heideggers, Hamburg, Meiner, 239 p. 4.5. FLATSCHER (Matthias), Logos und Lethe. Zur phnomenologischen Sprachauffassung im Sptwerk von Heidegger und Wittgenstein, Fribourg, Alber, Albert Thesen, 300 p. 4.6. GIVSAN (Hassan), Zu Heidegger. Ein Nachtrag zu "Heidegger das Denken der Inhumanitt", Wurtzbourg, Knigshausen & Neumann, 185 p. 4.7. GROSSER (Florian), Revolution Denken. Heidegger und das Politische 1919 bis 1969, Munich, Beck, 567 p. 4.8. HEMPEL (Hans-Peter), Heideggers Holzwege, Wrzburg, Knigshausen & Neumann, 170 p. 4.9. KAZMIERSKI (Sergiuz), Die Anaximanderauslegung Heideggers und der Anfang des Abendlndischen Denkens, Nordhausen, Bautz, Studia Classica & Mediaevalia, 294 p. 4.10. KESSEL (Thomas), Phnomenologie des Lebendigen. Heideggers Kritik an den Leitbegriffen der neuzeitlichen Biologie, Alber, 288 p. 4.11. KOUBA (Petr), Geistige Strung als Phnomen. Perspektiven des heideggerschen Denkens auf dem Gebiet der Psychopathologie, Wurzburg, Knigshausen & Neumann, Orbis Phnomenologicus Studien, 400 p. 4.12. KLUN (Branko), Metaphysikkritik und biblische Erbe, Wien, LIT, Austria: Forschung und Wissenschaft, 152 p. 4.13. LIN (Shing-Shang), Von den modernen zu den postmodernen Zeitvorstellungen. Kant, Heidegger, Virilio, Baudrillard, Essen, Die Blaue Eule, 424 p. 4.14. RIIS (Sren), Zur Neubestimmung der Technik. Eine Auseinandersetzung mit Martin Heidegger, Tbingen, Naar, Basler Studien zur Philosophie, 304 p. 4.15. THONHAUSER (Gerhard), ber das Konzept der Zeitlichkeit bei Sren Kierkegaard mit stndigem Hinblick auf Martin Heidegger, Fribourg, Alber, Alber Thesen, 240 p. 4.16. WITT (Christoph), Der Weg durch das Feld des Denkens. Eine Deutung zu Martin Heideggers "Der Feldweg", Messkirch, Gmeiner, 96 p. En anglais 4.17. ABUSEHLY (Karam), Heidegger and the Question of Literary Interpretation. A Critical Study, Sarrebruck, VDM Verlag Dr. Mller, 128 p. 4.18. ASKEY (Richard) & JENSEN (Farquhar), Of Philosophers and Madmen. A Disclosure of Martin Heidegger, Medard Boss, and Sigmund Freud, 58
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Amsterdam/New York, Rodopi, Contemporary Psychoanalytic Series 12, 146 p. 4.19. BOLT (Barbara), Heidegger Reframed. Interpreting Key Thinkers for the Arts, Londres, I. B. Tauris, Contemporary Thinkers Reframed Series, 208 p. 4.20. BROADBENT (Hal St. John), Heidegger Chauvet Benedict XVI. The Call of the Holy, Londres/New York, T & T Clark International, 272 p. 4.21. CAMPBELL (Timothy C.), Improper Life. Technology and Biopolitics from Heidegger to Agamben, Minneapolis, University of Minnesota Press, 232 p. 4.22. FRIEDMAN (Michael), A Parting of the Ways. Carnap, Cassirer, and Heidegger, New York, Open Court, 182 p. 4.23. GAUTHIER (David), Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, and the Politics of Dwelling, Lanham, Lexington Books, 230 p. 4.24. GLAZIER (Jacob), Heideggers and Bosss Analysis and an Integration with Taoism. A Comparative and Counseling Perspective, Sarrebruck, LAP Lambert, 56 p. 4.25. HEIL (Dominik), Ontological Fundaments for Ethical Management. Heidegger and the Corporate World, Dordrecht, Springer, Issues in Buisness Ethics, 218 p. 4.26. HEMMING (Laurence Paul), Heidegger and Theology, Londres/New York, Continuum, Philosophy and Theology, 176 p. 4.27. LADOPOULOU (Anastasia), The Work of Art as Historical Event. Heideggers Later Philosophy and Aesthetic Theory, Sarrebruck, VDM Dr. Mller, 244 p. 4.28. MILLER (Bernard), Rhetorics Earthly Realm. Heidegger, Sophistry, and the Gorgian Kairos, Anderson, Parlor Press, 396 p. 4.29. OBRIEN (Mahon), Heidegger and Authenticity. From Resoluteness to Releasement, Londres/New York Continuum, 208 p. 4.30. ODONOGHUE (Brendan), A Poetics of Homecoming. Heidegger, Homelessness and the Homecoming Venture, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 350 p. 4.31. PIETRZAK (Witold Konstanty), Myth, Language, and Tradition. A Study of Yeats, Steven, and Eliot in the Context of Heideggers Search for Being, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 330 p. 4.32. SCHULZ (Gregory), Wednesdays Child. From Heidegger to Affective Neuroscience, a Field Theory of Angst, Eugene, Wipf & Stock Publishers, 146 p. 4.33. SIMON (Jules), Art and Responsibility A Phenomenology of the Diverging Paths of Rosenzweig and Heidegger, Londres/New York, Continuum, 304 p.
59
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
4.34. STOLOROW (Robert D.), World, Affectivity, Trauma. Heidegger and PostCartesian Psychoanalysis, New York, Routledge, Psychoanalytic Inquiry Book Series, 132 p. 4.35. THOMSON (Iain D.), Heidegger, Art, and Postmodernity, Cambridge, Cambridge University Press, 264 p. 4.36. TOWNSON (Christopher), Site and Non-Site. Heidegger, Turrell, Smithson, Sarrebruck, VDM Dr. Mller, 268 p. 4.37. VANDEVELDE (Pol), Heidegger and the Romantics. The Literary Invention of Meaning, New-York, Routledege, Routledge Studies in Twentieth Century Philosophy, 256 p. 4.38. VATTIMO (Gianni) & ZABALA (Santiago), Hermeneutic Communism. From Heidegger to Marx, New York, Columbia University Press, Insurrections: Critical Studies in Religion, Politics, and Culture, 264 p. 4.39. VELKLEY (Richard L.), Heidegger, Strauss, and the Premises of Philosophy. On Original Forgetting, Chicago/Londres, University of Chicago Press, 208 p. 4.40. WATTS (Michael), The Philosophy of Heidegger, Durham, Acumen, Continental European Philosophy, 240 p. En chinois 4.41. SUN (Zhou-xing), Yu yan cun zai lun : hai de ge er si xiang yan jiu [Ontologie linguistique. Recherches sur la pense heideggrienne], Pkin, Shang wu yin shu guan 4.42. ZHANG (Wen-chu), Zhui xun zui hou de yi dao qing yan : "cun zai yu shi jian" qian 38 jie de si xiang [Suivre la dernire fume . Les penses des 38 premiers paragraphes de Sein und Zeit], Guangzhou, Guang dong ren min chu ban she En coren 4.43. KANG (Hak-Sun), Jonjae wa Gonggan : Haideggeo Jonjae ui Toporoji wa Sasang ui Heureum [tre et espace. Topologie de ltre de Heidegger et de son courant de pense], Paju, Hangilsa, 560 p. 4.44. GU (Yeon-Sang), Haideggeo ui Jonjae muleum e daehan gang ui [Une lecture de la question heideggrienne de ltre], Seoul, Cheryun, 236 p. 4.45. LEE (Seung-Hoon), Seon kwa Haideggeo [Le zen et Heidegger], Seoul, Hwang geum al Press, 367 p. 4.46. LEE (Suh-Kyu), Haideggeo Cheolhak [La philosophie de Heidegger], Paju, Seogwangsa, 264 p.
60
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
En espagnol 4.47. XOLOCOTZI (ngel), Una crnica de Ser y Tiempo, taca, Benemerita Universidade Autonoma de Puebla, 155 p. En finnois 4.48. KURKI (Janne), Lacanin diskurssiteoria. Lhiluenta Lacanin Seminaarista XVII ja Heideggerin luennosta Was ist das die Philosophie?, Vantaa, Apeiron Kirjat, 265 p. En franais 4.49. AOUN (Mouchir Basile), Heidegger et la pense arabe, Paris, LHarmattan, Pense religieuse et philosophique arabe, 150 p. 4.50. BOTET (Serge), De Nietzsche Heidegger : lcriture spculaire en philosophie, Paris, LHarmattan, Ouverture philosophique, 178 p. 4.51. CABESTAN (Philippe) & DASTUR (Franoise), Daseinsanalyse. Phnomnologie et Psychiatrie, Paris, Vrin, Bibliothque des Philosophies, 220 p. 4.52. DASTUR (Franoise), Heidegger et la pense venir, Paris, Vrin, Problmes & controverses, 252 p. 4.53. FDIER (Franois), Martin Heidegger. Le temps. Le monde, Paris, SPM Lettrage, 302 p. 4.54. GIVSAN (Hassan), Une histoire consternante. Pourquoi des philosophes se laissent corrompre par le cas Heidegger ?, trad. par TRIERWEILER (Denis), Paris, Presses Universitaires de Paris, 250 p. 4.55. LACOSTE (Jean-Yves), tre en danger, Paris, Cerf, Passages, 384 p. 4.56. JEAN (Grgori), Quotidiennet et ontologie. Recherches sur la diffrence phnomnologique, Louvain, Peeters, Bibliothque Philosophique de Louvain, 452 p. 4.57. LANORD (Hadrien-France), Heidegger, Aristote et Platon. Dialogue trois voix, Paris, Cerf, La nuit surveille, 128 p. 4.58. LAPORTE (Roger), La clairire et le refuge. Leons sur Heidegger, livre-DVD dit par LAGARDE (Franois), Montpellier, Hors-oeil ditions, 146 min. 4.59. LINDBERG (Susanna), Entre Heidegger et Hegel. closion et vie de ltre, Paris, LHarmattan, Ouverture philosophique, 196 p. 4.60. RAMELLA (Lorenzo), Lexprrience critique : laventure de la raison dans la philosophie franaise aprs Heidegger, Nice, Ovadia, 168 p.
61
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
En italien 4.61. ANELLI (Alberto), Heidegger e la teologia, Brescia, Morcelliana, 140 p. 4.62. BIGINI (Roberto), Martin Heidegger. Una guida al velamento, Rome, Aracne, 188 p. 4.63. BORDONI (Carlo), Le scarpe di Heidegger. Loggettivit dellarte et lartista come soggetto debole, Chieti, Solfanelli 4.64. CAMERLINGO (Francesco), La questione del senso. Con Heidegger a Wittgenstein sullenigma dellesistenza, Gnes, Il nuovo Melangolo, 164 p. 4.65. DI CANIO (Arcangelo), L"altro pensiero". Heidegger e la filosofia giapponese, Lecce, Pensa Multimedia, 240 p. 4.66. FICARA (Elena), Heidegger e il problema della metafisica, Rome, Casini, 247 p. 4.67. GIOVE (Paolo), Educazione e tempo. La concezione del tempo nella filosofia e nella pedagogia. Da Heidegger e Husserl alleducazione permanente, Massafra, Dellisanti, 96 p. 4.68. GORGONE (Sandro), Nel deserto dellumano. Potenza e Machenschaft nel pensiero di Martin Heidegger, Milan, Mimesis, 212 p. 4.69. HEIDEGGER (Heinrich), Martin Heidegger: mio zio, dit par STAGI (Pierfrancesco), Brescia, Morcelliana, Il pellicano rosso: Nuova serie, 106 p. 4.70. JACOBSON (Marco), Heidegger e Dilthey. Vita, morte et storia, Milan, Mimesis, 274 p. 4.71. LUZI (Patrizia), Intenzionalit e trascendenza. Il pensiero di Husserl e Heidegger, Rome, Carocci, Biblioteca di testi e studi, 174 p. 4.72. PAOLINELLI (Marco), Edith Stein e "luomo non redento" di Martin Heidegger, Milan, ISU Universit Cattolica, 256 p. 4.73. PELINI (Daniele), Lanalogia in Heidegger. Per una reinterpretazione di Sein und Zeit, Rome, Stamen, 261 p. 4.74. PETROSINO (Silvano), Abitare larte. Heidegger, la Bibbia, Rothko, Novara, Interlinea, 128 p. 4.75. ROCCHI (Draga), La silenziosa forza del possibile: note a margine di Essere e Tempo, Rome, Lithos, 210 p. 4.76. TRAVAGLINI (Graziella), Metafisica e metalinguistica in Martin Heidegger. Un confronto con Ferdinant de Saussure, Milan, Unicopoli, 90 p. 4.77. ZACCARIA (Gino), Pensare il nulla. Leopardi, Heidegger, Pavie, Ibis, 251 p. En japonais 4.78. GOT (Yoshiya), Haideg sonzai to jikan [Sein und Zeit de Heidegger], Kyoto, Kyshob, 134 p.
62
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
4.79. IKEDA (Takashi), Haideg sonzai to ki : sonzai to jikan no kaishaku to tenkai [tre et action. Sein und Zeit de Heidegger rexamin], Tokyo, Sbunsha, 253 p. 4.80. KOBAYASHI (Masatsugu), Marutin haideg no tetsugaku to seiji: minzoku ni okeru sonzai no araware [Philosophie et politique chez Martin Heidegger], Tokyo, Fksha, 288 p. 4.81. SHIGERU (Makito), Haideg to shingaku [Heidegger et la thologie], Tokyo, Chisenshokan, 278 p. 4.82. WATANABE (Jir), Haideg II [Heidegger II], Tokyo, Chikumashob, 685 p. 4.83. WATANABE (Jir), Haideg III [Heidegger III], Tokyo, Chikumashob, 634 pages. En russe 4.84. DOUGUIN (Alexandr Gelievitch), Martin Heidegger. Vosmognost` russkoi filosofii, Moscou, Akademitcheskii proekt, Gaudeamus, 500 p.
5. tudes particulires En allemand 5.1. BLOK (Vincent), Der "religise" Charakter von Heideggers philosophischer Methode: relegere, re-eligere, relinquere , Studia Phaenomenologica, 11, pp. 285-307 5.2. BRASSER (Martin), Das Mystische im Konzept der Methode des Philosophierens bei Rosenzweig und Heidegger , Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg, 29, pp. 203-226 5.3. CIMINO (Antonio), Begriff und Vollzug. Performativitt und Indexikalitt als Grundbestimmungen der formalen anzeigenden Begriffsbildung bei Heidegger , Internationales Jahrbuch fr Hermeneutik, 10, pp. 215-239 5.4. CIMINO (Antonio), Subjektivitt und Intersubjektivitt des hermeneutisch-phnomenologischen Diskurses. Zu Heideggers Begriff der Wiederholung , in RMER (Inga) (d.), Subjektivitt und Intersubjektivitt in der Phnomenologie, Wrzburg, Ergon, Studien zur phnomenologie und praktischen Philosophie, pp. 163-174 5.5. CROWELL (Steven), Ma-nehmen: Sinnbildung und Erfahrung bei Heidegger , in GONDEK (Hans-Dieter), KLASS (Tobias Nikolaus) & TENGELYI (Lszl) (ds.), Phnomenologie der Sinnereignisse, Paderborn, Fink, pp. 166-188 63
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.6. DRMAN (Iris), Heideggers unaufgefhrte Tragdie , in GONDEK (Hans-Dieter), KLASS (Tobias Nikolaus) & TENGELYI (Lszl) (ds.), Phnomenologie der Sinnereignisse, Paderborn, Fink, pp. 189-207 5.7. JANSSEN (Paul), Die Sterblichkeit der Irdischen nach Fink und Heidegger in Abhebung gegen Husserls transzendentalen Subjektivismus , in NIELSEN (Cathrin) & SEPP (Hans-Reiner) (ds.), Welt denken. Annherungen an die Kosmologie Eugen Finks, Fribourg, Alber, Phnomenologie: Texte und Kontexte, pp. 134-153 5.8. NIELSEN (Cathrin), Kategorien der Physis. Heidegger und Fink , in NIELSEN (Cathrin) & SEPP (Hans-Reiner) (ds.), Welt denken. Annherungen an die Kosmologie Eugen Finks, Fribourg, Alber, Alber Phnomenologie, pp. 154-183 5.9. RMER (Inga), Vorlaufende Entschlossenheit oder Schuld gegenber der Vergangenheit? berlegungen zu Heidegger und Ricur , in MORAN (Dermot) & SEPP (Hans-Reiner) (ds.), Phenomenology 2010, vol. 4, Traditions, Transitions and Challenges, Bucarest, Zeta Books, pp. 226-251 5.10. SHCHYTTSOVA (Tatiana), Gebrtigkeit ein zweideutiges Existenzial. Zur Aporetik der Heideggerschen Daseinsanalytik , in MORAN (Dermot) & SEPP (Hans-Reiner) (ds.), Phenomenology 2010, vol. 4, Traditions, Transitions and Challenges, Bucarest, Zeta Books, pp. 209-225 5.11. SHCHYTTSOVA (Tatiana), Miteinandersein und Generative Erfahrung. Philosophisch-Anthropologische Implikationen der Fundamentalontologie Heideggers und der Kosmologie Finks , in NIELSEN (Cathrin) & SEPP (Hans-Reiner) (ds.), Welt denken. Annherungen an die Kosmologie Eugen Finks, Fribourg, Alber, Alber Phnomenologie, pp. 293-307 5.12. TERTULIAN (Nicolas), Die Ontologie bei Heidegger und Lukcs , Deutsche Zeitschrift fr Philosophie, 59/2, pp. 175-197 5.13. VETTER (Helmuth), Die nchtliche Seite der Welt. Anmerkungen zu Martin Heidegger und Eugen Fink , in NIELSEN (Cathrin) & SEPP (HansReiner) (ds.), Welt denken. Annherungen an die Kosmologie Eugen Finks, Fribourg, Alber, Alber Phnomenologie, pp. 184-207 5.14. VETTER (Helmuth), Weltbild und Bild bei Heidegger. Eine Vorlufigebestandsaufnahme , in FABRIS (Adriano) & al. (ds.), Bild als Prozess. Neue Perspektiven einer Phnomenologie des Sehens, Wrzburg, Knigshausen & Neumann, pp. 133-150 5.15. WELZ (Claudia), Das Gewissen als Instanz der Selbsterschlieung: Luther, Kierkegaard und Heidegger , Neue Zeitschrift fr Systematische Theologie, 53/3, pp. 265-284 64
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.16. WESCHE (Tilo), Dialektik oder Ontologie: Heidegger , in KLEIN (Richad), KREUZER (Johann) & MLLER-DOOHM (Stefan), AdornoHandbuch, Stuttgart/Weimar, Metzler, pp. 364-373 5.17. WESCHE (Tilo), Welt, Sprache, Kontingenz. Heideggers Begriff der Wahrheit , in RESE (Friederike), ESPINET (David) & STEINMANN (Michael) (ds.), Gegenstndlichkeit und Objektivitt, Tbingen, Mohr Siebeck, pp. 160189 5.18. WINTER (Thomas Arne), Verdeckungsgeschichte. Heideggers phnomenologische Traditionskritik , Studia Phaenomenologica, 11, pp. 99115 En anglais 5.19. ANDERSON (Travis T.), Complicating Heidegger and the Truth of Architecture , Journal of Aesthetics and Art Criticism, 69/1, pp. 69-79 5.20. AWAD (Najeeb G.), Time/History, Self-Disclosure and Anticipation: Pannenberg, Heidegger and the Question of Metaphysics , Sophia, 50/1, pp. 113-133 5.21. AYLESWORTH (Gary E.), Heidegger, Nietzsche, and the Struggle for Europe , in WEBER (Barabara) et al. (ds.), Cultural Politics and Identity. The Public Space of Recognition, Zrch/Berlin, LIT, pp. 39-48 5.22. BACKMANN (Jussi), The Transitional Breakdown of the Word: Heidegger and Stefan Georges Encounter with Language , Gatherings. The Heidegger Circle Annual, 1, pp. 54-73 5.23. BLAKE (Thomas), Staging Heidegger: Corporeal Philosophy, Cognitive Science, and Theater , Analecta Husserliana, 109, pp. 329-338 5.24. BOTHA (Catherine), On the Way Home: Heidegger and Marlene van Niekerks Triomf , Phronimon, 12/1, pp. 19-39 5.25. COURTINE (Jean-Franois), Reduction, Construction, Destruction of a Three-Way Dialogue: Natorp, Husserl and Heidegger , in VANDEVELDE (Pol) & HERMBERG (Kevin) (ds.), Variations on Truth: Approaches in Contemporary Phenomenology, New York, Continuum, Issues in Phenomenology and Hermeneutics, pp. 179-200 5.26. COYNE (Ryan), A Difficult Proximity: The Figure of Augustine in Heideggers Path , Journal of Religion, 91/3, pp. 365-396 5.27. DAHLSTROM (Daniel O.), Thinking of Nothing: Heideggers Criticisms of Hegels Conception of Negativity , in HOULGATE (Stephen) & BAUR (Michael) (ds.), A Companion to Hegel, Oxford, Blackwell, Blackwell Companions to Philosophy, pp. 519-536 65
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.28. DICKS (Henry), The Self-Poetizing Earth: Heidegger, Santiago Theory, and Gaia Theory , Environmental Philosophy, 8/1, pp. 41-61 5.29. DOUD (Robert E.), Philosophy and/as Poetry , Existentia, 21/3-4, pp. 313-413 5.30. EL-BIZRI (Nader), Being at Home Among Things: Heideggers Reflections on Dwelling , Environnment, Space, Place, 3/1, pp. 47-71 5.31. ELLIOT (Brian), Community and Resistance in Heidegger, Nancy and Agamben , Philosophy and Social Criticism, 37/3, pp. 259-271 5.32. EMAD (Parvis), "Thinking" in the Crossing to, and "Poetizing" out of the Other Onset. Preliminary Reflexions on Heideggers Characterizations of Nietzsche and Hlderlin in the Beitrge , Existentia, 21/3-4, pp. 217-240 5.33. EUBANKS (Cecil) & GAUTHIER (David), The Politics of the Homeless Spirit: Heidegger and Levinas on Dwelling and Hospitality , History of Political Thought, 32/1, pp. 125-146 5.34. FAIN (Lucas), Heideggers Cartesian Nihilism , Review of Metaphysics, 64/3, pp. 555-575 5.35. FIGUERAS I BADIA (Marta), How Can We Get a Knowledge of Being: The Relation Between Being and Time in the Young Heidegger , Analecta Husserliana, 108, pp. 111-120 5.36. FREEMAN (Lauren), Reconsidering Relational Autonomy: A Feminist Approach to Selfhood and the Other in the Thinking of Martin Heidegger , Inquiry, 54/4, pp. 361-383 5.37. FRIEDMAN (Maurice), Buber, Heschel, and Heidegger: Two Jewish Existentialists Confront a Great German Existentialist , Journal of Humanistic Psychology, 51/1, pp. 129-134 5.38. GEORGAKIS (Tziovanis), Tradition as Gelotopoesis: An Essay on the Hermeneutics of Laughter in Martin Heidegger , Cosmos and History, 7/2, pp. 179-203 5.39. GILBERT-WALSH (James), Nazism, Philosophy, and Academic Accountability: The Real Controversy Surrounding Emmanuel Fayes Heidegger , Journal of the History of the Behavioral Sciences, 47/1, pp. 88-100 5.40. GINEV (Dimitri), To Existential Spatiality to the Metric Science of Space. An Attempt at Reconstructing an Aspect of the Existential Analytic , Existentia, 21/1-2, pp. 179-298 5.41. GOLDMAN (Avery), Kant, Heidegger, and the Circularity of Transcendantal Inquiry , Epoche, 15/1, pp. 107-120 5.42. HA (Peter), The Conception of the Pre-objective Body in Heidegger and Merleau-Ponty , Cheolhak kwa hyeonsanghak yeongu, 48, pp. 88-114 66
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.43. HAN-PILE (Batrice), Describing Reality or Disclosing Worldhood? Vermeer and Heidegger , in PARRY (Joseph D.) (d.), Art and Phenomenology, Londres/New York, Routledge, pp. 138-161 5.44. HARMAN (Graham), Plastic Surgery for the Monadology: Leibniz via Heidegger , Cultural Studies Review, 17/1, pp. 211-229 5.45. HAWKES (Dave), Heidegger Undisclosed: Is Heidegger and Phenomenology hiding or hidden from Solution Focus? , InterAction, 3/2, pp. 28-41 5.46. HEALY (Maria), Heideggers Contribution to Hermeneutic Phenomenological Research , in THOMSON (Gill), DYKES (Fiona) & DOWNE (Soo) (ds.), Qualitative Research in Midwifery and Childbirth. Phenomenological Approaches, Londres, Routledge, pp. 215-232 5.47. HOLT (Robin) & MUELLER (Franck), Wittgenstein, Heidegger and Drawing Lines in Organization Studies , Organization Studies, 32/1, pp. 6784 5.48. HOPKINS (Burt), Heideggers Hermeneutical Critique of Consciousness Revisited , in VANDEVELDE (Pol) & HERMBERG (Kevin) (ds.), Variations on Truth: Approaches in Contemporary Phenomenology, New York, Continuum, Issues in Phenomenology and Hermeneutics, pp. 79-93 5.49. IKEDA (Takashi), Agency and Mortality: Heideggers Existential Analysis of Death and its Practical Philosophical Background , Bulletin of Death and Life Studies, 7, pp. 138-159 5.50. INWOOD (Michael), Heidegger and the Weltbild , Humana.Mente. Journal of Philosophical Studies, 18, pp. 55-68 5.51. IRETON (Sean), Lines and Crimes of Demarcation: Mathematizing Nature in Heidegger, Pychon and Kehlmann , Comparative Literature, 63/2, pp. 142-160 5.52. IVANOVA (Ivelina), The Phenomenological Ontology of Martin Heidegger as a Foundation for Redefining the Concept of Interpretative Approaches in the Theory of History , Balkan Journal of Philosophy, 2, pp. 183-186 5.53. JONES (Adrian), Historys "So it seems": Heideggerian Phenomenologies and History , Journal of the Philosophy of History, 5/1, pp. 1-35 5.54. KISIEL (Theodore), Heidegger Reads Dilthey on the Enactment of Christian Heilsgeschichte , in Lessing (Hans-Ulrich), Makkreel (Rudolf) & Pozzo (Ricardo) (ds.), Recent Contributions to Diltheys Philosophy of the Human Sciences, Stuttgart/Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, pp. 177-199. 67
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.55. KOCHAN (Jeff), Getting Real with House and Heidegger , Perspective on Science, 19/1, pp. 81-115 5.56. MCDONALD (Iain), "What Is, Is More than It Is": Adorno and Heidegger on the Priority of Possibility , International Journal of Philosophical Studies, 19/1, pp. 31-57 5.57. KLASKOW (Tyler), "Looking" for Intentionality with Heidegger , Symposium, 15/1, pp. 94-109 5.58. KOWALSKY (BORYS), The Imperative of Virtue in the Age of Global Technology and Globalized Mass Culture: A Liberal-Humanist Response to the Heideggerian Challenge , The Bulletin of Science, Technology & Society, 31/1, pp. 28-42 5.59. LOGAR (Tea), Grounding Ethical Norms in Heideggers Mitsein , Balkan Journal of Philosophy, 2, pp. 187-196 5.60. LUCAS (Peter), Heidegger and Authenticity , Ethics and Self-Knowledge, 26/2, pp. 123-142 5.61. MARTINKOVA (Irena), Anthropos as Kinanthropos: Heidegger and Patoka on Human Movement , Sports, Ethics & Philosophy, 5/3, pp. 217230 5.62. MCCARTHY (Vincent), Martin Heidegger: Kierkegaards Influence Hidden and In Full View , in STEWART (Jon) (d.), Kierkegaard and Existentialism, Cornwall, Ashgate, pp. 95-126 5.63. MITCHELL (Andrew J.), Heideggers Later Thinking of Animality: The End of World Poverty , Gatherings. The Heidegger Circle Annual, 1, pp. 74-85 5.64. MULHALL (Stephen), Attunement and Disorientation: the Moods of Philosophy in Heidegger and Sartre , in KENAAN (Hagi) & FERBER (Illit) (ds.), Philosophys Moods. The Affective Grounds of Thinking, Dordrecht, Springer, Contributions to Phenomenology, pp. 123-139 5.65. MURCHADA (Felix O.), The Political Significance of Waiting in Heideggers Philosophy of Action , in HALLSALL (Francis), JANSSEN (Julia) & MURPHY (Sinead) (ds.), Critical Communities and Aesthetic Practices, Dordrecht, Springer, Contributions to Phenomenology, pp. 139-149 5.66. NELSON (Eric S.), The World Picture and its Conflict in Dilthey and Heidegger , Humana.Mente Journal of Philosophical Studies, 18, pp. 19-38 5.67. NITSCHE (Martin), The Topology of Metaphysical Viewpoints in the Light of Heideggers Return to Aristotle , Phainomena, 20/74-75, pp. 87102 5.68. NORRIS (Andrew), Jean-Luc Nancy on the Political after Heidegger and Schmitt , Philosophy and Social Criticism, 37/4, pp. 899-913 68
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.69. OBRIEN (Mahon), The Future of Humanity: Heidegger, Personhood and Technology , Comparative Philosophy, 2/2, pp. 23-49 5.70. ODDE (Dorte), Motivation and Existence. Motivation in Kierkegaard and Heidegger , Existential Analysis, 22/1, pp. 56-59 5.71. OKRENT (Mark), Davidson, Heidegger, and Truth , in MALPAS (Jeff) (d.), Dialogues with Davidson. Acting, Interpreting, Understanding, Cambridge (Mass.)/Londres, MIT Press, pp. 87-112 5.72. OMAHONEY (Paul), Opposing Political Philosophy and Literature: Strausss Critique of Heidegger and the Fate of the Quarrel between Philosophy and Poetry , Theoria, 56/128, pp. 73-96 5.73. ONISHI (Bradley B.), Information, Bodies, and Heidegger , Sophia, 50/1, pp. 101-112 5.74. PALMER (Michael), An Introduction to Martin Heidegger: "RadicalCommitted" Anticosmopolitanism , in TREPANIER (Lee) & HABIB (Khalil M.) (ds.), Cosmopolitanism in the Age of Globalization. Citizens without States, Lexington, The University Press of Kentucky, pp. 161-183 5.75. PREZ (Berta M.), Aesthetics without Autonomy: Heidegger and Adorno , Proceedings of the European Society for Aesthetics, 3, pp. 235-252 5.76. POLT (Richard), Meaning, Excess, and Event , Gatherings. The Heidegger Circle Annual, 1, pp. 26-53 5.77. POWELL (Sally), Discovering the Unhidden: Heideggers Interpretation of Platos Allegory of the Cave and its Implications for Psychotherapy , Existential Analysis, 22/1, pp. 39-49 5.78. REEDY (Patrick) & LEARMONTH (Mark), Death and Organization: Heideggers Thought on Death and Life in Organizations , Organization Studies, 32/1, pp. 117-131 5.79. RIIS (Sren), Towards the Origin of Modern Technology: Reconfiguring Martin Heideggers Thinking , Continental Philosophy Review, 44/1, pp. 103-117 5.80. RUPPO (Anna Pia), Ethics, Practical Philosophy, and the Transformation of the World: The Dialogue between Heidegger and Marcuse , Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, 3/1, pp. 118-129 5.81. RYAN (Sean), Heideggers Nietzsche , in WOODWARD (Ashley), Interpreting Nietzsche. Reception and Influence, New York, Continuum, pp. 5-19 5.82. S CAVALCANTE SCHUBACK (Marcia), Sacrifice and Salvation: Jan Patockas Reading of Heidegger on the Question of Technology , in
69
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
CHVATIK (Jan) (d.), Jan Patoka and the Heritage of Phenomenology, Dordrecht, Springer, pp. 23-38 5.83. SCHWEMMER (Oswald), Event and Form: Two Themes in the DavosDebate between Martin Heidegger and Ernst Cassirer , Synthese, 179/1, pp. 59-73 5.84. SCOTT (Tim), Heidegger among dryads: on the origin of the female work of art , Journal of Organizational Change Management, 24/6, pp. 789-805 5.85. SEPULVEDO (Katherine), The Call: Heidegger and Ethical Conscience , Res Cogitans, 2, pp. 72-79 5.86. SHARKEY (Rodney), Beaufret, Beckett, and Heidegger : The Question(s) of Influence , Samuel Beckett Today Aujourdhui, 22, pp. 409-422 5.87. SHEEHAN (Thomas), Astonishing! Things Make Sense! , Gatherings. The Heidegger Circle Annual, 1, pp. 1-25 5.88. SIKKA (Tina), Technology, Communication, and Society: From Heidegger and Habermas to Feenberg , Review of Communication, 11/2, pp. 93-106 5.89. SMITH (Christopher), Destruktion-Konstruktion: Heidegger, Gadamer, and Ricoeur , in TAYLOR (George H.) & MOOTZ (Francis J.) (ds.), Gadamer & Ricur. Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics, New York, Continuum, pp. 15-41 5.90. STAEHLER (Tanja), Heidegger, Derrida, the Question and the Call , in MORAN (Dermot) & SEPP (Hans-Reiner) (ds.), Phenomenology 2010, vol. 4, Traditions, Transitions and Challenges, Bucarest, Zeta Books, pp. 252-274 5.91. STAFECKA (Mara), Kant and the Beginnings of German Transcendentalism: Heidegger and Mamardashvili , Analecta Husserliana, 108, pp. 261-268 5.92. STOREY (David), The Uses and Abuses of Metaphysical Language in Heidegger, Derrida, and Daoism , Comparative and Continental Philosophy, 3/1, pp. 113-124 5.93. STRHAN (Anna), Religious Language as Poetry: Heideggers Challenge , Heythrop Journal, 52/6, pp. 5.94. SU (Ya-Hui), Lifelong learning as Being: The Heideggerian Perspective , Adult Education Quarterly, 61/1, pp. 57-72 5.95. TCHIR (Trevor), Daimon Appearances and the Heideggerian Influence on Arendts Account of Political Action , in YEATMAN (Anna), HANSEN (Philipp), BARBOUR (Charles) & ZOLKOS (Magdalena) (ds.), Action and Appearance. Ethics and the Politics of Writing in Hannah Arendt, Londres/New York, Continuum, pp. 53-68 70
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.96. TENGELYI (Lszl), Transformations in Heideggers Conception of Truth between 1927 and 1930 , in VANDEVELDE (Pol) & HERMBERG (Kevin) (ds.), Variations on Truth: Approaches in Contemporary Phenomenology, New York, Continuum, Issues in Phenomenology and Hermeneutics, pp. 94-108 5.97. THEODOROU (Panos), Heideggers Search for a Phenomenological Fundamental Ontology in his 1919 WS, vis--vis the Neo-Kantian Philosophy of Values , in COPOERU (Ion), KONTOS (Pavlos), SERRANO DE HARO (Agustn), Phenomenology 2010, vol. 3, The Horizons of Freedom, Bucarest, Zeta Books, pp. 404-431 5.98. THOMPSON (Iain), Transcendance and the Problem of Otherworldy Nihilism: Taylor, Heidegger, Nietzsche , Inquiry-Oslo, 54/2, pp. 140-159 5.99. TURANLI (Aydan), Perspicuous Representation: A Wittgensteinian Interpretation of Martin Heideggers View of Truth , Analecta Husserliana, 110/1, pp. 295-305 5.100. VANDEVELDE (Pol), Heideggers Fluid Ontology in the 1930s: The Platonic Connection , in VANDEVELDE (Pol) & HERMBERG (Kevin) (ds.), Variations on Truth: Approaches in Contemporary Phenomenology, New York, Continuum, Issues in Phenomenology and Hermeneutics, pp. 109-126 5.101. WALSH (David), Voegelin and Heidegger. Apocalypse without Apocalypse , in TREPANIER (Lee) & MCGUIRE (Steven F.) (ds.), Eric Voegelin and the Continental Tradition, Columbia (Miss.), The University of Missouri Press, Eric Voegelin INST Series, pp. 166-191 5.102. WEIDENFELD (Matthew C.), Heideggers Appropriation of Aristotle: Phronesis, Conscience, and Seeing through the One , European Journal of Political Theory, 10/2, pp. 254-276 5.103. WOOD (Jason), Contra Heidegger: A Defense of Platos "Productionist Metaphysics" , Epoche, 15/1, pp. 221-247 5.104. WOOD (Robert E.), Heideggers In-der-Welt-Sein and Hegels Sittlichkeit , Existentia, 21/3-4, pp. 255-274 5.105. WRATHALL (Mark) & LAMBETH (Morganna), Heideggers Last God , Inquiry, 54/2, pp. 160-182 5.106. WUJIN (Yu), Three Reversals in the Development of Metaphysics: Reflections on Heideggers Theory of Metaphysics , Social Sciences in China, 32/2, pp. 5-18 5.107. ZEYTINOGLU (Cem), Appositional (Communication) Ethics: Listening to Heidegger and Levinas in Chorus , Review of Communication, 11/4, pp. 272-285 71
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
En chinois 5.108. BAN (Gao-jie), Hai de ge er zhe xue zhong de "wu jia ke gui" gai nian tan wei [ De la notion dUnheimlichkeit dans la philosophie heideggrienne ], Zhe jiang she hui ke xue, 3, pp. 68-73 5.109. CHEN (Bei-jie), Wu yu zai : lun hai de ge er cun zai lun de fei tong yi xing [ Nant et tre : de la non-identit dans lontologie heideggrienne ], Hang zhou shi fan da xue xue bao (she hui ke xue ban), 1, pp. 81-85 5.110. CHENG (Zhi-min), Hai de ge er de bo la tu zhu yi pi pan [ La critique heideggrienne du platonisme ], Ren wen za zhi, 2, pp. 1-5 5.111. DENG (Zhi-yong), Bo ke yu hai de ge er de xiang si xing [ Des ressemblances entre Burke comme matre de rhtorique et Heidegger comme matre de philosophie ], Tian jing wai guo yu da xue xue bao, 4, pp. 17-22 5.112. DONG (Xue-wen), Zen yang ren shi hai de ge er de cun zai lun si xiang [ Comment comprendre lide heideggrienne dontologie ? ], Shanghai da xue xue bao (she hui ke xue ban), 4, pp. 37-43 5.113. DU (Song-shi), Zuo wei yuan shi shi jian xing de "wei lai" hai de ge er de sheng cun lun shi jian guan ge ming [ Lavenir comme temporalit primordiale la rvolution heideggrienne de la notion existential de temps ], Bei fang lun cong, 2, pp. 144-147 5.114. FANG (Xiang-hong), Hai de ge er de "ben zhen de li shi" shi ben zhen de ma ? hai de ge er zao qi shi jian xian xiang xue yan jiu xian yi [ L"historicit authentique" de Heidegger est-elle authentique ? Quelques doutes quant la premire phnomnologie heideggrienne du temps ], Jiang su she hui ke xue, 2, pp. 45-51 5.115. FENG (Fang) & PANG (Xue-quan), Xin xian xiang xue dui hai de ge er "zai shi cun zai" si xiang de yang qi [ Labandon de lide heideggrienne d"tre-au-monde" dans la no-phnomnologie ], Zhe jiang da xue xue bao, 1, pp. 55-62 5.116. HE (Jiang-xin), Hai de ge er yu xing er shang xue wen ti [ Heidegger et le problme de la mtaphysique ], Gan su she hui ke xue, 3, pp. 32-35 5.117. KE (Xiao-gang), Cong cun zai yu shi jian dao zhe xue lun gao : hai de ge er qian hou qi si xiang guan xi shu jie [ De Sein und Zeit aux Beitrge zur Philosophie : de la relation entre la premire et la dernire pense de Heidegger ], Xian dai zhe xue, 1, pp. 61-66
72
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.118. LEUNG (Ka-wing), Hai de ge er lun dong wu yu shi jie [ Heidegger. propos de lanimal et du monde ], Tong ji da xue xue bao, 1, pp. 15-23 5.119. LI (Jing), Shen me shi zhen li ? hai de ge er he wei te gen si tan de bu tong ying da [ Quest-ce que la vrit ? Diffrentes rponses de Heidegger Wittgenstein ], Shi jie zhe xue, 3, pp. 139-149 5.120. LI (Xia-ling), Hai de ge er de ke xue guan [ Le point de vue de Heidegger sur la science ], Wu han li gong da xue xue bao (she hui ke xue ban), 1, pp. 105-110 5.121. LI (Zhang-yin), Hai de ge er de "yuan-you-yin fa" yin guo xing [ La causalit heideggrienne du "dans lequel et pour lequel" ], Shi jie zhe xue, 4, pp. 80-91 5.122. LI (Zhao-yong), Hai de ge er zhuan xiang shi jiao zhong de cun zai yu shi jian wen ti [ Les problmes de ltre et du temps dans la perspective du Tournant chez Heidegger ], Si chuan da xue xue bao (zhe xue she hui ke xue ban), 6, pp. 32-38 5.123. LIU (Gui-xiang), Lun hai de ge er dui ma ke si "lao dong guan" de pi ping jian ping ma ke si he hai de ge er de xiang tong he xiang yi [ De la critique heideggrienne du "point de vue du travail" de Marx et des identits et des diffrences entre Heidegger et Marx ], Lan zhou da xue xue bao, 3, pp. 153-158 5.124. LU (Yun-cheng), Cun zai yu wu shi lun hai de ge er yu hei ge er de xiang yu he qi yi [ Heidegger et Hegel : identits et diffrences dans leur comprhension de ltre et du nant ), Yun nan da xue xue bao (she hui ke xue ban), 2, pp. 27-34 5.125. LUO (Jiu), Hai de ge er de "hao liang zhi bian" [ "Le dbat de HaoLian" de Heidegger ], Ren wen za zhi, 1, pp. 13-19 5.126. PENG (Li-qun) & ZHAO (Wei), Lue lun hai de ge er de "xing er shang xue zhuan xiang" [ Du "tournant mtaphysique" de Heidegger ], Shanghai da xue xue bao, 4, pp. 44-55 5.127. SHI (Ting-xiong), Hai de ge er dui sheng cun lun zhu huan jie de ci xu tiao zheng ji qi qi shi [ La hirarchie heideggrienne des moments existentiaux et ses consquences ], Zhe xue yan jiu, 3, pp. 69-75 5.128. SHI (Ting-xiong), Cong zhen li li chang de gai bian kan hai de ge er "cun zai" yun si de zhuan huan [ De la transformation heideggrienne de la notion dtre au vu de son ide de la vrit ], Shi jie zhe xue, 1, pp. 122131 5.129. SONG (Ji-jie), Hai de ge er de xian xiang xue guan nian cun zai yu shi jian "dao lun" de zai shen cha [ Lide heideggrienne de la 73
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
phnomnologie nouvel examen de lintroduction de Sein und Zeit ], Jiang su she hui ke xue, 1, pp. 53-61 5.130. WANG (Jun), Fei shi yi de yu yan yu shi yi de yu yan hai de ge er wan qi yu yan pi pan si xiang zai yan jiu [ Langage non potique et langage potique. Compte-rendu du point de vue du vieil Heidegger sur le langage ], Wen yi yan jiu, 9, pp. 68-71 5.131. WU (Zeng-ding), Yi shu zuo pin de ben yuan yu hai de ge er de xian xiang xue ge ming [ Die Ursprung des Kunstwerkes et la revolution phnomnologique de Heidegger ], Wen yi yan jiu, 9, pp. 16-24 5.132. XIE (Ya-zhou), Shi te lao si dui hai de ge er zhe xue de fan si yu hui ying [ La rflexion de Strauss sur et sa rponse la philosophie heideggrienne ], Zhe xue dong tai, 6, pp. 56-61 5.133. YANG (You-wen), Hai de ge er de "yu yan zhuan xiang" ji qi yu yan guan [ Le "tournant linguistique" de Heidegger et son point de vue sur le langage ], in Li lun yue kan, 3, pp. 56-58 5.134. YUAN (Zhao-wen), "Yi qie yi shu ben zhi shang dou shi shi" shi lun hai de ge er shi xue zhi zhuan du [ "Tout art est par essence posie" du tournant heideggrien vers la posie ], Jiang huan lun tan, 1, pp. 72-77 5.135. ZHANG (Fu Hai), Lun hai de ge er shi xue de zhe xue shi ji [ Du principe philosophique de la posie heideggrienne ], Qiu suo, 1, pp. 141142 5.136. ZHANG (Ke), Cong "zhen li zhi ben zhi" dao "bei zhi zhi zhen li" dui hai de ge er lun zhen li de ben zhi yi wen de shu jie yu fan si [ De "lessence de la vrit" la "vrit de lessence" interprtation de et rflexion sur Vom Wesen der Wahrheit ], Dong yue lun cong, 6, pp. 136-141 5.137. ZHANG (Qing-xiong), Shi yu si cong hai de ge er chu fa quan shi zhong wen he de wen shi ge zhong de sheng cun lun yi jing [ Pense et posie une interpretation culturelle croise de la pense existentielle en Chine et en Allemagne partir dune perspective heideggrienne ], Fu dan da xue xue bao, 3, pp. 46-53 5.138. ZHANG (Qiu-cheng), Wei xian dai ren de sheng cun zhi gen dui hai de ge er ke xue ji shu zhi si de jie du [ Enraciner lexistence des hommes modernes interprtation de la pense heideggrienne de la science et de la technique ], Bei fang lun cong, 3, pp. 116-119
74
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
En coren 5.139. CHEONG (Eun-Hae), Bulgyo ui Du Juyo Gaenyeom in Jinyeo wa Yunhoe ui Siganronjeok Haeseok [ Interprtation thortico-temporelle des concepts centraux du bouddhisme, tathata et samsara ], Jonjaeron yeongu, 26, pp. 157-214 5.140. CHOI (Go-Won), "Jonjae" gaenyeom ui Haeseokhak jeok Uimi wa Hakmun jeok Yeokhal [ La signification hermneutique et le rle scientifique du concept dtre ], Jonjaeron yeongu, 26, pp. 281-306 5.141. GU (Yeon-Sang), Haideggeo ui Jonjae Muleum gwa "Itda" ui Geunbon Uimi [ Enqute sur la signification fondamentale d"tre" et question de ltre chez Heidegger ], Jonjaeron yeongu, 26, pp. 245-279 5.142. KANG (Sung Joong), Interraeksyeon Dijain ui Cheolhak jeok Giban eu ro seo ui Hyeonsanghak Yeongu [ tude sur la phnomnologie comme fondation philosophique du design dinteraction centre sur la phnomnologie de Husserl et Heidegger ], HangukDijain Mukhwa Hakhoe, 2, pp. 1-11 5.143. KIM (Dong-Gyu), Yesul Jakpum ui jonjaeron jeok Topos [ Le topos ontologique de loeuvre dart : les points de vue de Dilthey et de Heidegger ], Jonjaeron yeongu, 25, pp. 117-145 5.144. KIM (Jae-Chul), Haideggeo Cheolhak eseo Siljaeseong Munje [ Le problme de la ralit chez M. Heidegger ], Jonjaeron yeongu, 26, pp. 126-155 5.145. KIM (Sang-Rok), Jonjae Hyangyu wa Jonjae Gineung [ Plaisir de ltre et fonction de ltre ], Jonjaeron yeongu, 26, pp. 91-123 5.146. LEE (Jong-Ju), Huseol ui Taja Iron e daehan Haideggeo ui Bipan, Yeonghyang geu ri go Daeeung Jeonryak [ La critique heideggrienne de la thorie husserlienne de lautre, ses rpercussions sur Husserl et les rponses de celui-ci ], Cheolhak kwa hyeonsanghak yeongu, 49, pp. 59-104 5.147. LEE (Kan-Pyo), Haideggeo Sasang ese o ui Yeokseol gwa geu Jonggyocheolhak jeok Hamui [ Le paradoxe dans la pense de Heidegger et son implication philosophico-religieuse ], Jonjaeron yeongu, 25, pp. 269304 5.148. LEE (Sang-Ok), Haideggeo wa Jinri ui Jungguk jeok Bangbeop [ Heidegger et la method chinoise de la vrit ], Dogyo Mukhwa Yeongu, 34, pp. 289-321 5.149. OH (Hee-Cheon), Anaximander ui Geumeon e na ta nan Haideggeo ui Jonjae Ihae [ La comprhension heideggrienne de ltre dans son trait der Spruch des Anaximander ], Jonjaeron yeongu, 26, pp. 57-90
75
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.150. OH (Seung-Sung), Haideeger ui Jeonheo ga gaet neun Cheolhak jeok in Eumi ui Sinhak jeok Suyong [ tude sur le sens thologique du tournant de Heidegger : par-del la thologie centre sur le sujet de la mdiation de Schleiermacher et Tillich ], Shimhak Sasang, 153, pp. 117-160 5.151. PARK (Chan-Kook), Niche wa Haideggeo Sasang ui Bigyo Gochal [ tude comparative de Nietzsche et de Heidegger ], Jonjaeron yeongu, 25, pp. 53-86 5.152. PARK, (Mi-Kyung), Heoldeolrin, Haideggeo, Kicheu ga bon Ihsang eu ro seo ui Geuriseu wa Si ui Gaenyeom [ Lide de la Grce et de la posie chez Friedrich Hlderlin, Martin Heidegger et John Keats ], Oegukmukhak Yeongu, 42, pp. 225-254 5.153. SEO (Young-Hwa), Haideggeo ui Sayu e seo Mu ui Jiwi e dae han Haeseok [ Du statut du nant dans la pense de Heidegger : clairage sur la relation du nant au monde et au soi ], Jonjaeron yeongu, 25, pp. 235-268 5.154. SHIN (Syng-Hwan), Haideggeo wa SeonBulgyo reul tonghan Talgeundae jeok SaYu ui Sido [ tude sur une pense post-moderne dans la philosophie heideggrienne et le bouddhisme zen ], Jonjaeron yeongu, 26, pp. 1-29 5.155. SUH (Dong-Uhn), Nishida wa Haideggeo ui Jinri Gaenyeom [ Le concept de la vrit chez K. Nishida et M. Heidegger ], Cheolhak kwa hyeonsanghak yeongu, 48, pp. 1-28 5.156. SUH (Dong-Uhn), Sai Jonjae (Da-sein) ro seo ui Ingan [ Ltrehomme comme entre-deux (Da-sein) ], Jonjaeron yeongu, 25, pp. 171-202 5.157. SUH (Dong-Uhn), Salm ui jonjaeron in ga Jukeum ui Byeonjeungbeop in ga? [ Lontologie de la vie ou la dialectique de la mort ? ], Jonjaeron yeongu, 26, pp. 215-244 En espagnol 5.158. ADRIN ESCUDERO (Jess), Heidegger y el olvido del cuerpo , Lectora: revista de dones y textualitat, 17, pp. 175-210 5.159. ADRIN ESCUDERO (Jess), Traducir a Heidegger , Investigaciones fenomenolgicas, 8, pp. 93-100 5.160. AURENQUE (Diana), La primaca del lenguaje silente-oyente en la filosofa heideggeriana y su dimensin tica , in EYZAGUIRRE TAFRA (Sylvia) (d.), Actas del II Congreso Internacional de Fenomenologa y Hermenutica, Departamento de Artes y Humanidades, Facultad de Humanidades y Educacin, Universidad Andrs Bello, Santiago du Chili, pp. 221-229
76
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.161. BERTORELLO (Adrian), La virtualidad del sentido y su actualizacin en el discurso descriptivo. Una interpretacin del lugar de la descripcin en el metodo fenomenolgico de Heidegger , Pensamiento, 67/251, pp. 89-102 5.162. CAZZANELLI (Stefano), El neokantismo en el joven Heideger , Revista de Filosofa, 35/1, pp. 21-43 5.163. CASTELLANOS RODRIGUES (Blen), Heidegger y la ecologia profunda , Nomadas, 30/2, pp. 55-62 5.164. CONSTANTE (Alberto), Nada nos garantiza que el mundo tiene un sentido. Reflexin sobre "El Otro comienzo en Heidegger" , La lmpara de Digenes, 20/21, pp 101-114 5.165. FIGUEROA (Gustavo), La biotica actual: las interrogantes de Heidegger , Revista mdica de Chile, 139/10, pp. 1378-1383 5.166. GAMA (Luis Eduardo), Las indicaciones formales y la filosofa como pregunta , in DE LARA (Francisco) (d.), Entre fenomenologia y hermeneutica. Franco Volpi in Memoriam, Santiago de Chile, Plaza y Valds, pp. 43-70 5.167. GRONDIN (Jean), El paso de la hermneutica de Heidegger a la de Gadamer , in DE LARA (Francisco) (d.), Entre fenomenologia y hermeneutica. Franco Volpi in Memoriam, Santiago de Chile, Plaza y Valds, pp. 139-164 5.168. LESERRE (Daniel), Significado y posibilidad: la comprensin ontolgica del lenguaje en ser y tiempo como filosofa del hablar , Revista de Humanidades, 24, pp. 25-51 5.169. MORUJO (Carlos A), Husserl, Heidegger y Freud y el problema de la crisis europea , Investigaciones Fenomenolgicas, 3, pp. 293-320 5.170. PEDRAGOSA (Pau), Habitar, construir, pensar en el mundo tecnolgico , Investigaciones Fenomenolgicas, 3, pp. 361-378 5.171. PENELAS (Frederico), Recepciones pragmatistas de Martin Heidegger , Revisita de Filosofa, 23/1, pp. 109-124 5.172. ROCHA DE LA TORRE (Alfredo), Lenguaje y ser : la superacin de la hermneutica en la fenomenologa heideggeriana , in DE LARA (Francisco) (d.), Entre fenomenologia y hermeneutica. Franco Volpi in Memoriam, Santiago de Chile, Plaza y Valds, pp. 117-138 5.173. RODRGUES (Ramn), La indicacin formal y su uso en Ser y Tempo , in DE LARA (Francisco) (d.), Entre fenomenologia y hermeneutica. Franco Volpi in Memoriam, Santiago de Chile, Plaza y Valds, pp. 71-74 5.174. RUIZ FERNNDEZ (Jos), La crtica de Natorp a Husserl y la asuncin de un uso conceptual fenomenolgico indicativo en las primeras lecciones de Heidegger , in COPOERU (Ion), KONTOS (Pavlos) & SERRANO DE
77
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
HARO (Agustn), Phenomenology 2010, vol. 3, The Horizons of Freedom, Bucarest, Zeta Books, pp. 368-385 5.175. RUIZ FERNNDEZ (Jos), La indicacin formal como renovacin de la fenomenologia. Luces y sombras , Dianoia. Revista de filosofia, 56/66, pp. 31-58 5.176. RUIZ FERNNDEZ (Jos), La bsqueda de un logos para la vida concreta. Entorno a Natorp, Husserl y Heidegger , in RODRGUES (Ramn) (d.), Lenguaje y Categoras en la Hermneutica Filosfica, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 123-156 5.177. SABROVSKY (Eduardo), La crtica de Levinas a Heidegger en Totalidad et Infinito , Ideas y Valores, 60/145, pp. 55-68 5.178. VSQUEZ ROCCA (Adolfo), Sloterdijk, Heidegger et Jean-Luc Nancy : esferas, arqueologa de lo ntimo, morfologa del espacio compartido e historia de la fascinacin de proximidad , Nmadas. Revista Crtica de Ciencias Sociales y Jurdicas, 32/4, pp. 1-39 5.179. VOLPI (Franco), "Ms alto que la realidad est la possibilidad". La aproximacin fenomenolgica a la historia de la filosofa en el joven Heidegger , in DE LARA (Francisco) (d.), Entre fenomenologia y hermeneutica. Franco Volpi in Memoriam, Santiago de Chile, Plaza y Valds, pp. 13-42 5.180. XOLOCOTZI (ngel), La dimensiones de la cosa. Heidegger y el entramado der hermneutica, metafsica y fenomenologa , in DE LARA (Francisco) (d.), Entre fenomenologia y hermeneutica. Franco Volpi in Memoriam, Santiago de Chile, Plaza y Valds, pp. 95-116 En franais 5.181. BALAZUT (Jol), La Critique de la raison pure de Kant comme prfiguration de lontologie heideggrienne , Le Portique, 26, pp. 127-154 5.182. BONNET (Herv), Lopacit ontologique de la transparence chez Heidegger , Appareil, 7, url : http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=1188 5.183. BRUNEAULT (Frdric), quelle condition une thique hermneutique est-elle possible ? Analyse du jeu et de la philosophie pratique chez Gadamer comme propdeutique au Mitsein de Heidegger , Symposium, 15/1, pp. 5-28 5.184. CAMILLERI (Sylvain), Heidegger, lecteur et interprte de Saint Paul , Freiburger Zeitschrift fr Philosophie und Theologie, 58/1, pp. 145-162
78
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.185. CIOCAN (Cristian), Comprendre et sens. La gense ontologique du langage dans lanalytique du Dasein , Revue philosophique de Louvain, 109/3, pp. 527-551 5.186. DASTUR (Franoise), Heidegger et la question de l"essence'' du langage , Alter, 19, pp. 43-56 5.187. DASTUR (Franoise), La critique ricurienne de la conception de la temporalit dans. tre et temps de Heidegger , Archives de philosophie, 74/4, pp. 565-580 5.188. DASTUR (Franoise), La question du monde chez Husserl et Heidegger , in DELANNOY (Franck) & SYS (Jacques), Sens et Cosmos, Arras, Artois Presses Universit, pp. 201-215 5.189. DASTUR (Franoise), Rception et non-rception de Heidegger en France , Revue Germanique Internationale, 13, pp. 35-57 5.190. DECLERCK (Gunnar), Linsoutenable pesanteur de ltre. Pesanteur physique et pesanteur ontologique dans la pense de Heidegger , Revue philosophique de Louvain, 109/3, pp. 489-525 5.191. DE SAINT AUBERT (Emmanuel), Merleau-Ponty face Husserl et Heidegger : illusions et rquilibrages , Revue Germanique Internationale, 13, pp. 59-73 5.192. DEWALQUE (Arnaud), Lautonomie des catgories syntaxiques (Husserl, Heidegger, Pfnder) , in DEWALQUE (Arnaud), LECLERCQ (Bruno) & SERON (Denis) (ds.), La thorie des catgories. Entre logique et ontologie, Lige, PULg, pp. 119-147 5.193. EVARD (Jean-Luc), Martin Heidegger : lUniversit dans tous ses tats , Cahiers dtudes levinassiennes, 10, pp. 33-46 5.194. FRADET (Pierre-Alexandre), Bergson, Heidegger et la question du possible : le renversement dune conception classique , Ithaque, 8, pp. 97117 5.195. GRONDIN (Jean), Gerhard Krger et Heidegger. Pour une autre histoire de la mtaphysique , Archives de Philosophie, 74/1, pp. 109-127 5.196. GUEST (Grard), Pascal et Heidegger. Heidegger lecteur de Pascal , Les tudes Philosophiques, 96/1, pp. 41-60 5.197. NAULT (Franois), Thologie et philosophie. Le jeune Heidegger et la politique dun partage , in GAZIAUX (ric) (d.), Pour une raison de la foi : la thologie, Louvain, Peeters, Cahier de la Revue thologique de Louvain, pp. 123-146 5.198. JOLLIVET (Servanne), Enjeux et limites du retour au monde de la vie chez le jeune Heidegger , Philosophie, 108, pp. 77-90 79
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.199. PERRIN (Christophe), LEinsamkeit comme Grundbegriff. Dune ide fragmente chez Heidegger , PhaenEx, 6/2, pp. 71-108 5.200. POTESTA (Andrea), Lexhibition de labsent : Derrida, Heidegger et lin-origine de luvre dart , in JDEY (Adnen) (d.), Derrida et la question de lart. Dconstructions de lesthtique, Paris, Ccile Dufaut, pp. 297-315 5.201. SCHNELL (Alexander), Au-del de Husserl, Heidegger et MerleauPonty : la phnomnologie de Marc Richir , Revue Germanique Internationale, 13, pp. 95-108 5.202. SCHLER (Ingeborg), Le premier et lautre commencement de la philosophie selon les Apports la philosophie de Martin Heidegger , Phainomena, 20/74-75, pp. 103-123 5.203. SERVEL (Nicolas), Levinas interprte de Sein und Zeit dans "Martin Heidegger et lontologie" , Cahiers dtudes levinassiennes, 10, pp. 201-216 En grec 5.204. GEORGOPOULOS (Nenos), Technologia kai Apeleftherosi : Heidegger kai Egbert Schuurman , Dia-logos, 1, pp. 85-95 5.205. TZORTZOPOULOS (Dimitris), Oikodomein, Oikein, Skeptesthai. I athliotita tis anestiotitas kai to ergo tis skepsis , Filosofein, 3, pp. 146-161 En italien 5.206. ARDOVINO (Adriano), Dal logos al fuoco. Heidegger e leco di Eraclito , Giornale de Metafisica, 33/1-2, pp. 197-226 5.207. BERNET (Rudolf), Lessere come pulsione. Una lettura heideggeriana di Leibniz , in DREON (Roberta), PALTRINIERI (Gian Luigi) & PERISSINOTTO (Luigi) (ds.), Nelle parole del mondo. Scritti in onore di Mario Ruggenini, Milan, Mimesis, pp. 35-51 5.208. DILLKOFER (Stefanie), Heidegger su Klee , Iride, 2, pp. 411-426 5.209. SERAFINI (Luca), Etica heideggeriana ed etia kantiana. Due diverse interpretazioni nel dibattito francese contemporaneo , Filosofia e teologia, 25/2, pp. 367-379 En japonais 5.210. ABE (Masanobu), Haideg no "meta sonzairon" saik : gensonzai no hitsei to monado no ygensei [ La mta-ontologie heideggrienne reconsidre : la Geworfenheit du Dasein et la finitude de la monade ], Ningen Sonzairon, 17, pp. 47-58
80
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.211. AJISAKA (Makoto), Haideg tetsugaku to nachizumu no mondai [ La philosophie de Heidegger et le problme du nazisme ], Kiron21, 12, pp. 123-137 5.212. ARAHATA (Yasuhiro), Gensy to Bunp : haideg to vitogensyutain [ Phnomne et grammaire : Heidegger et Wittgenstein ], Hgaku Kenky, 84/2, pp. 1-24 5.213. ARIMA (Zenichi), Geijustu to sekai : haideg no geijutsu ron he no ichi ksatsu [ Lart et le monde : considrations sur la thorie heideggrienne de lart ], Keiei jh kenky seinan daigaku keiei jh gakubu ronsy, 18/2, pp. 93-106 5.214. FURUSY (Masataka), Keijijy gaku no kongen wo megutte : haideg no puraton kaisyaku no ichi sokumen [ De lorigine de la mtaphysique : un aspect de linterprtation heideggrienne de Platon ], Ris, 686, pp. 125137 5.215. HIROTA (Dennis), Shinran no jikansei oyobi shizen shis no ksatsu: haideg tono hikaku teki kanten kara [ La conception de la temporalit de Shinran et Jinen : notes sur une comparaison avec Heidegger ], Shinsygaku, 123/124, pp. 85-103 5.216. HIROTA (Tomoko), Haideg sonzairon ni okeru "rinrigaku" no ichiduke : "Sonzai to jikan" ni okeru tandokuka no mondai wo cyshin toshite [ Localiser lthique dans lontologie de Heidegger ], Gensygaku nenp, 27, pp. 105-112 5.217. IGARASHI (Sachiko), "Seishin" ni tsuite : derida no haideg [ De lesprit : Derrida et Heidegger ], Tetsugaku shis ronsy, 36, pp. 17-40 5.218. KAMIO (Kazutoshi), haideg ni okeru "mottomo kiken na mon" toshite no kotoba [ Le langage comme "le pril extrme" dans la pense heideggrienne ], Tetsugaku, 62, pp. 205-220 5.219. KIMIJIMA (Yasuaki), Syoki furaiburuku ki no haideg tetsugaku to sono hh : ktei to hitei no gensygaku [ La philosophie de Heidegger et sa mthdologie dans la premire priode fribourgeoise : une phnomnologie de laffirmation et de la ngation ], Gensygaku nenp, 27, pp. 81-88 5.220. KIMURA (Fumito), Haideg tetsugaku wa seimei rinrigaku ni taishite nani wo donoyni shiji suru noka [ Quindique la philosophie de Heidegger de la biothique, et comment ? Le cas de la mdecine rgnrative ], Ryts kagaku daigaku ronsy, 24/1, pp. 9-27
81
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.221. MURAI (Norio), Hancy to cyetsu : haideg ni okeru cyetsuronsei no shik [ Catgorie et transcendance : la pense transcendantale chez Heidegger ], Shis, 1049, pp. 33-57 5.222. NAKA (Yukio), tre ou autrement qutre ? : Sheringu, haideg, marion [ tre ou autrement qutre ? Schelling, Heidegger et Marion ], Aruk, 19, pp. 47-59 5.223. NAKAJIMA (Tru), Ninshiki ron to sonzai ron : kanto to haideg [ pistmologie et ontologie : Kant et Heidegger ], Kokushi kan daigaku kyy ronsy, 69, pp. 17-26 5.224. NAKAMURA (Daisuke), Mondai toshite no idea to itsu naru "ucy": arubru rotoman no haideg kaisyaku [ Lide comme un problme et le cosmos comme le On : linterprtation de Heidegger dA. Lautman ], Vol, 5, pp. 34-43 5.225. TSUKA (Rui), Shisetsu de kurasu syjo tachi no konnan sa : haideg no "seken" wo tegakari to shite [ Les difficults des filles face aux autres dans un orphelinat : un claircissement bas sur "le On" de Heidegger ], Ningen sei shinri gaku kenky, 28/2, pp. 203-213 5.226. SUZUKI (Ydai), Kategor teki cyokkan to a puriori : ronri gaku kenky kara dgu bunseki he [ Lintuition catgoriale et la priori chez Heidegger : des investigations logiques lanalyse de linstrument ], Tetsugaku kagakushi rons, 13, pp. 55-75 5.227. ABATA (Taketo), Tsj gakky ni zaiseki suru "tokubetsu na hairyo wo ysuru kodomo" no sekai segai : haideg ni yoru kodomo no gensonzairon wo michibiki toshite [ Sur un sens de lalination au monde chez les "enfants qui requirent une attention spcifique dans les classes ordinaires" : partir dune perspective heideggrienne danalyse du Dasein ], Manabu to Oshieru no gensygaku kenky, 14, pp. 31-44 5.228. TADA (Keisuke), Haideg no kanto kaisyaku to keijijgaku no nijsei mondai [ Linterprtation heideggrienne de Kant et le problme mtaphysique de la dualit ], Gensygaku nenp, 27, pp. 121-129 5.229. TERAMURA (Akinobu), "Sonzai to jikan" cykai (12) [ Commentaire sur Sein und Zeit ], Kagoshima daigaku hbun gakubu kiy jinbun gakka ronsy, 73, pp. 79-118 5.230. TSUDA (Yoshio), Syoki haideg ni okeru gensy gaku no jiko rikai: gensy gaku no nij teki imi [ Lauto-comprhension par le jeune Heidegger de la phnomnologie : dune double signification de la phnomnologie ], Jchi tetsugaku shi, 23, pp. 1-13
82
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.231. TSUDA (Yoshio), Syoki haideg ni okeru gensy gaku no honshitsu kitei: sono shisaku no michi ni okeru kakushin to kut [ La dfinition de la phnomnologie chez le jeune Heidegger ], Gensygaku nenp, 27, pp. 7380 5.232. WATANABE (Hideyuki), Haideg ni okeru szryoku no kanousei: kanto no cyetsu ron teki eneki ron kaisyaku wo tebiki to shite [ Le potentiel de la thorie de limagination de Heidegger : son interprtation de la dduction transcendantale dans la philosophie de Kant ], Kyto seika daigaku kiy, 38, pp. 179-195 5.233. YAMASHITA (Tetsur), Rogosu to Shinri : Haideg no rogosu ron ni okeru shinri gainen no kitei [ Logos et vrit : la conception de la vrit dans la logique heideggrienne ], Gensygaku nenp, 27, pp. 113-120 5.234. YAMASHITA (Yoshiyuki), Haideg kara dgen he : ditsusei no gainen wo hashi to shite [ De Heidegger Dougen : le lien du concept didentit ], Meisei daigaku kenky kiy jinbun gakubu nihon bunka gakka, 19, pp. 79-99 5.235. YOKITANI (Yasuichi), Geijutsu wo hikkaki dasu : haideg ni yotte thaku, eitoku, tany, kyo, ferumru, raipu wo kanzuru [ Sortir de lart : contempler Touhaku, Eitoku, Tanyuu, Oukyo, Vermeer et Laib avec Heidegger ], Knan daigaku kiy bungaku hen, 161, pp. 193-207 En portugais 5.236. ALBUQUERQUE (Jos Fbio da Silva), As crticas heideggerianas ao status filosfico da conscincia em Husserl diante da problemtica do conhecimento do sculo XIX , Sntese, 38/120, pp. 91-115 5.237. DE RESENDE (Vani Teresinha), A interpretao heideggeriana do platonismo como doutrina da verdade , Poros, 3/5, pp. 1-12 5.238. FERREIRA (Acylene M. Cabral), Amor e liberdade em Heidegger , Kriterion, 52/123, pp. 139-158 5.239. MARQUES (Victor Hugo de Oliveira), A co-pertena entre ser e fundamento em Heidegger , Intuitio, 4/1, pp. 180-193 5.240. MARTINS FILHO (Jos R. F.), Heidegger e a religiao : uma interface , Revista filosofia capital, 6/13, 2011, pp. 41-48 5.241. MISSAGGIA (Juliana), As principais influncias filosficas na formulao das indicaes formais heideggerianas , Argumentos, 3/6, pp. 89-98
83
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
5.242. NOGUEIRA (Roberto Passos), Extenso fenomenolgica dos conceitos de sade e enfermidade em Heidegger , Cincia e sade coletiva, 16/1, pp. 259-266 5.243. PASSOS NOGUEIRA (Roberto), Extenso fenomenolgica dos conceitos de sade e enfermidade em Heidegger , Ciencia e Saude Coletiva, 16/1, pp. 259-266 5.244. PRADO (Germano Nogueira), O comum e o prprio: do elemento de um Marx aps Heidegger , Intuitio, 4/2, pp. 133-147 5.245. ROCHA (Zeferino), A ontologia heideggeriana do cuidado e suas ressonncias clnicas , Sntese, 38/120, pp. 71-90 5.246. SILVA (Antonio Wardison C.) & MOACIR DE AQUINO (Jos), A questao onto-teolgica em Heidegger , Revista de cultura teolgica, 19/75, pp. 11-25 5.247. VON ZUBEN (Newton Aquiles), A fenomenologia como retorno ontologia em Martin Heidegger , Trans/Form/Ao, 34/2, pp. 85-102 5.248. WERLE (Marco Aurlio), Heidegger e a produo tcnica e artstica da natureza , Trans/Form/Ao, 34/2, pp. 95-108 5.249. WU (Roberto), A ontologia da Phronesis: a leitura heideggeriana da tica de Aristteles , Veritas, 56/1, pp. 95-110 En roumain 5.250. CIOCAN (Cristian), Heidegger si stiintele. Cazul biologiei , Revista de Filosofie, 58/5-6, p. 633-648 En russe 5.251. PILJAVSKII (Nestor), Obmanchik i adept odnovremenno. Razmychlyaya o riske s Martinom Heideggerom , Ex libris, url : http://exlibris.ng.ru/tendenc/2011-03-24/4_risk.html
84
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
RECENSIONS
Diana Aurenque, Ethosdenken. Auf der Spur einer ethischen Fragestellung in der Philosophie Martin Heideggers, Fribourg/Munich, Alber, Alber Thesen, 384 p. Dans son ouvrage, issu dune thse soutenue Fribourg-en-Brisgau, Diana Aurenque cherche les traces dune pense de lethos dans la philosophie de Martin Heidegger, revisitant lensemble de son uvre partir de ce motif. Lethos dsigne originairement le sjour (Aufenthalt) humain prs de la vrit de ltre et se distingue ainsi de lthique, qui concerne la morale du point de vue de son fondement. Comme sjourner signifie tre prsent dans un lieu prcis un moment dtermin, lethos est li un engagement (Verbindlichkeit). En accentuant ce caractre dengagement, lA. interprte la pense de lethos comme la qute du sjour adapt ltre humain. Ce sjour tant de nature philosophique, le questionnement de lessence de la philosophie est, ds lors, omniprsent. Le livre est compos de trois parties : la premire intitule Le sjour dans laction , la deuxime Lethos et la vrit de ltre et la dernire Lethos philosophique est-il dpolitis et solitaire ? La philosophie de Heidegger, les autres, et la communaut . La premire partie traite de la priode qui stend de 1919 Sein und Zeit. LA. lucide dabord le rapport troit quentretient lhermneutique de la facticit avec le moment thique, pour prsenter ensuite le dbat de Heidegger avec la philosophie pratique aristotlicienne en prenant comme fils directeurs les concepts de phronesis () et de kairos (). Elle expose enfin la possibilit de lthique dans Sein und Zeit. La deuxime partie examine la pense de lethos dans la priode postrieure lopus magnum, en interrogeant notamment les concepts de nant (Nichtigkeit) et de configuration du monde (Weltbildung) dans le projet heideggrien dune mtaphysique du Dasein. Lauteur thmatise ensuite la conception heideggrienne de la vrit dans son rapport aux notions de sjour et dhabiter (wohnen), pour proposer par la suite une interprtation de la pense de lvnement appropriant (Ereignis) au prisme de lethos, avant dattirer notre attention sur lhabiter potique comme sjour nouveau et originaire de lhomme. Dans la dernire partie de louvrage, lA. confronte la pense de lethos avec la philosophie morale, la philosophie politique et la philosophie sociale. Le concept dtre-avec (Mitsein) est dabord soumis la critique levinassienne. Puis Diana Aurenque montre que le concept heideggrien dethos 85
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
est certes dpolitis, mais quil mnage la possibilit dune sphre publique authentique, car il ne concerne pas seulement lethos de lindividu, mais aussi lethos de la communaut. Avec ce livre, Diana Aurenque publie une tude remarquable par sa systmaticit et son exhaustivit. Le thme de lethos ny est pas prsent comme un thme parmi dautres, mais comme le thme fondamental mme de la pense heideggrienne de ltre. Ainsi sexprime la ncessit de la pense de lethos : lhistoire de ltre nest pas seulement lhistoire de loubli de ltre, mais aussi de loubli de lethos (p. 166). Selon lA., la pense heideggrienne de lethos est dpolitise, car elle comprend le sjour appropri non pas par rapport ltat juste, mais par rapport lhabiter qui advient en correspondance avec ltre. Or, comme cet habiter exemplaire doit faire lobjet dune appropriation, la pense de lethos indique par elle-mme le chemin suivre. Il serait alors intressant dtablir une comparaison entre les conceptions occidentale et extrme-orientale du politique pour repenser le rapport entre la pense de lethos et le politique. En Chine, au Japon et en Core, le politique se traduit laide dun mot qui vient de lancien chinois : . Ce mot est compos de deux pictogrammes. Le premier, , reprsente une empreinte de pas sur un chemin et dsigne le fait de se poser des questions sur le bon chemin suivre. Le deuxime, , figure quant lui une canne et dsigne le fait de battre un animal pour le faire avancer. En runissant ces deux significations, pourrait signifier : amener un tre humain se poser des questions sur le bon chemin prendre , cest--dire : donner une direction approprie un tre humain . Ainsi, si le politique se comprenait dans le sens du vieux mot chinois, la pense de lethos, en tant quelle indique le chemin suivre, pourrait tre qualifie dethos politique. Choong-Su Han traduction de Virginie Palette
Gabriel Cercel, Cartea experienei. Heidegger i hermeneutica vieii [Le livre de lexprience. Heidegger et lhermneutique de la vie], Bucarest, Humanitas, Academica, prface de Gabriel Liiceanu, 2010, 506 p. Louvrage de Gabriel Cercel vient complter de manire avantageuse la collection Academica de la maison ddition Humanitas, connue pour 86
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
publier les traductions roumaines des grands phnomnologues allemands et franais, de remarquables monographies les concernant, mais aussi nombre dtudes originales en ce domaine. Pour citer la prface enthousiaste de Gabriel Liiceanu, remarquons demble que cette parution vient confirmer lavnement dun nouvel ge de la philosophie roumaine redevable la pense de Heidegger (p. 8). En effet, depuis le dbut des annes 2000, on assiste, dans les principaux centres universitaires roumains, un puissant essor de la phnomnologie hermneutique ; celle-ci tant mme envisage par certains comme la voie privilgie du renouveau de la philosophie est-europenne. Mais si louvrage Cercel sinscrit incontestablement dans cette nouvelle vague, il fait entendre une voix singulire par lobjet mme de sa recherche et le traitement quil lui rserve. Remarquons dabord que Le livre de lexprience est, dans sa langue et peut-tre aussi hors delle, la premire reconstitution monographique de lhermneutique de Martin Heidegger dans son ensemble, visant couvrir de manire intgrale sa gense, son dveloppement et sa rception, mais aussi sa structure mthodologique, thmatique et conceptuelle (p. 71). En se donnant cette tche pour le moins ambitieuse, lA. entend rpondre ce qui lui semble tre un besoin croissant de la recherche au fur et mesure que la Gesamtausgabe complte la publication des crits du jeune Heidegger : avoir une vue panoptique sur les aventures de lhermneutique heideggrienne. Pourtant, il ne faudrait pas en dduire que le discours de lA. se laisse enfermer dans la simple analyse historique et gnalogique, aussi pntrante et complte soit-elle. Tmoignant dune parfaite matrise des textessources de son sujet de 1909 jusqu 1927 et mme au-del , dune profonde connaissance du contexte philosophique et thologique de lpoque, et enfin dune trs large prise en compte de la littrature secondaire, ltude de Cercel va jusqu sinterroger de manire fort pertinente sur la signification du tournant hermneutique de la philosophie contemporaine (p. 53). Cest dire si lexamen minutieux de la dynamique interne de lhermneutique heideggrienne, loin dtre une fin en soi, doit permettre de rflchir ses applications possibles dans le domaine des sciences humaines quitte prendre le risque de sloigner des aspirations premires du philosophe allemand. Le second aspect qui vient prciser la particularit de cette approche rside dans le motif interprtatif qui guide les lectures de Heidegger effectue par lA. Celui opre en quelque sorte deux niveaux : celui dune conviction qui cherche sa confirmation travers lanalyse, et celui dune hypothse issue 87
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
dune certaine vision de la dynamique hermneutique de ltre ; partition qui nest pas sans rappeler celle labore et mise en uvre par von Hermann entre Zugangsmethode et Behandlungsart). La conviction voque est que lhermneutique possde une fonction unificatrice pour lensemble de la pense heideggrienne, depuis ses commencements thologiques jusquaux dernires tudes sur la Seynsgeschichte. Cest ainsi quon apprend dans ce qui est srement lun des meilleurs chapitres du livre rejoignant par ailleurs les analyses rcentes de Christian Sommer et Sylvain Camilleri sur les sources thologico-religieuses de la pense heideggrienne que la problmatique hermneutique marque profondment, non seulement le chemin phnomnologique de Heidegger, mais aussi et dabord son bref parcours tho-logique ; lempreinte sur le second ntant pas sans responsabilit dans lempreinte sur le premier. Projet novateur et pourtant tt abandonn dune comprhension interprtative de la pense mdivale aux yeux de Cercel lUrform de lhermneutique heideggrienne , intrt prcoce pour lexgse luthrienne, attention plus gnrale porte la dimension historique du fait religieux : autant daspects lies dans luvre protoheideggrienne qui permettent lA. de parler dune dcennie thologique (p. 117) qui aura durablement marqu la dimension hermneutique du Denkweg. Et cest avec non moins de prcision que Cercel continue dexaminer cette fonction unificatrice de lhermneutique travers quatre autres chapitres couvrant le dveloppement de la pense heideggrienne dans son intgralit. Ces chapitres sintitulent : Lhermneutique de la vie facticielle , Dilthey et le salut de la ralit , Lhermneutique du Dasein comme ontologie fondamentale , et Lhorizon hermneutique de la pense aprs la Kehre et lactualit de lhermneutique heideggrienne ). Quant lhypothse qui commande lapproche des textes heideggriens dploye par Cercel, elle est nonce sous la forme dune distinction entre les dimensions mthodologique et thmatique de lhermneutique, distinction qui reproduirait celle entre le comprendre existential et le comprendre existentiel, mais aussi celle entre lontique et lontologique. Cette dualit structurale entre le pr-hermneutique et linterprtation proprement dite nest en fait quun artifice exgtique qui veut ainsi exposer la circularit originaire, le caractre auto-hermneutique de lexistence. Il est en ce sens exemplaire que, dans le chapitre portant sur Sein und Zeit, la discussion ayant trait aux apories de la diffrence ontologique soit place au beau milieu de lexhibition des multiples significations de lhermneutique : ainsi, comprendre lexigence de diffrencier entre tre et 88
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
tant, tout en admettant la ncessit de les penser ensemble, peut devenir un exercice prliminaire, prparer penser la distinction entre la dimension mthodologique et la dimension thmatique de lhermneutique, tout en sefforant de retrouver leur unit originaire. Il est vident que, malgr la profondeur et ltendu de lanalyse, une telle dmarche sera toujours ouverte des amendements et des dveloppements supplmentaires. Cest ce titre que nous nous permettons de pointer deux absences problmatiques dans le traitement de certains sujets. Par exemple, destruction et temporalit thmes aussi dcisifs pour lhermneutique de la facticit que lhermneutique transcendantale de Sein und Zeit ne reoivent dans le cadre de cette tude quune attention mineure. En esprant quune seconde dition viendra combler ces absences, nous pouvons conclure en citant la belle remarque de Gabriel Liiceanu visant clairer le titre de louvrage de Cercel : en crivant sur lhermneutique de Heidegger, et donc sur la circularit dune pense, lauteur entre lui-mme dans le jeu quil soumet lanalyse. En dautres termes, il fait ainsi un enjeu de son tre propre (p. 9). Paul Marinescu Recension rdige dans le cadre du projet PN-II-RU-PD-2011-3-0206 soutenu par CNCSIS-UEFISCSU
liane Escoubas, Questions heideggriennes. Stimmung, logos, traduction, posie, Paris, Hermann, Le Bel Aujourdhui, 2010, 215 p. Toujours le nouveau doit lancien. Dans le rcent livre dliane Escoubas, la question nest pas de savoir quoi mais combien. Reprenant cinq de ses articles publis durant ces vingt dernires annes, lactuelle professeur mrite de lUniversit Paris XII-Val de Marne ne signe ici quun seul indit. Sensuit un recueil qui a le dfaut de sa qualit essentiellement regrouper des textes diffrents et, qui plus est, loigns dans le temps, il ne peut comporter que moins dunit que chacun deux , comme la qualit de son dfaut principalement reposer sur des crits approuvs et, qui plus est, prouvs par le temps, il ne peut possder moins de valeur que tous runis. Sans doute est-ce pour faire pice ce dfaut et pour faire montre de cette qualit que, dans un bref et bel avant-propos faisant sienne lexergue mme de la Gesamtausgabe : 89
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Wege nicht Werke (p. 7), lA. justifie sa dmarche. Prsentant Heidegger comme essentiellement en mouvement (p. 8) sa pense ntant pas pense mais pensante (p. 7), son uvre ntant pas faite mais se faisant (p. 8) , elle se propose de suivre ses dplacements. Ou plutt : puisquelle ne veut sadonner ni une entreprise de restitution, intgrale et suivie , ni une analyse thmatique slective (p. 7), elle simpose darrter sa marche deux places quil frquente et qui soffrent comme deux topo-limites (p. 8) : la question et lcoute. Sans se mettre la question de lcoute, louable, sa volont de [se] mettre lcoute des questions (p. 9) nen demeure pas moins contestable. De mme que le motif de la question survit Sein und Zeit, prsent quil est, et ostensiblement, dans Die Frage nach dem Ding, Die Frage nach der Kunst et Die Frage nach der Technik , celui de lcoute prexiste largement aux textes des annes 50 sur la parole et la posie (p. 9) quon relise au besoin le 34 de lHauptwerk. Regrettons donc labsence dune vritable problmatisation du rapport de la question et de lcoute, ainsi que labsence dune relle justification du choix des deux questions de la Stimmung et du langage comme objet de linvestigation. Et regrettons-le doublement : primo, parce quliane Escoubas ne se trompe bien sr pas sur la centralit de ces figures qui autorisent une vaste relecture de Heidegger relecture dont, prcisment, la mesure est donne par son expertise , secundo, parce quelle ny revient pas en conclusion conclusion qui, cruellement, manque son ouvrage pour dresser le bilan des six textes dont elle a pourtant habilement organis la mise en continuit. Le premier dentre eux, Parcours de la topologie dans luvre de Heidegger , date de 2008. Y faisant lhypothse de la possibilit dune lecture topologique de Heidegger, cest--dire dune investigation de la "situation" des lments dun ensemble, de leurs positions relatives, de leur disposition, indpendamment de leurs grandeurs et de leurs distances (p. 13), lA. commence par souligner limportance dune "logique du lieu" (p. 15) dans Sein und Zeit, insistant sur le Da- du Dasein et son ouverture, mais observant le silence sur ltre-partout-et-nulle-part quil est sous le rgime du On. Aprs avoir explicit la signification du Tournant en sappuyant sur Max Loreau et sa Gense du phnomne, liane Escoubas enchane alors les prsentations de plusieurs des thmatiques chres au second Heidegger : celles de lhistoire, de lorigine, du site, de lhabitation. Savantes, ses lignes nen sont pas moins elliptiques. moins de connatre le parcours heideggrien, on passe dun lieu lautre sans que ne soit dcrit le chemin qui les relie.
90
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Le deuxime texte ici repris, Analytique de la Stimmung , date lui aussi de 2008. Il interroge le changement de signification de la notion de Stimmung, structure du Dasein en 1927 mais caractristique dune poque en 1937. Sappuyant sur Sein und Zeit o ltant que je suis est dit tre fondamentalement "affection" (p. 43), lA. relit dabord lanalytique existentiale comme une analytique de la Stimmung, cherchant montrer que tous les existentiaux se rapportent celle-ci, qui serait comme leur cl de vote (p. 39). Parcourant les Grundbegriffe der Metaphysik, les Hlderlins Hymnen, lEinfhrung in die Metaphysik comme les deux Nietzsche, elle explore ensuite lespace thmatique [] des Grundstimmungen (p. 51) pour retracer lhistoire de ltre travers leur histoire, Heidegger faisant successivement de langoisse (1927), de la nostalgie (1929), du deuil (1934/1935), de livresse (1936/1937), de la retenue (1937/1938) la, ou plutt, une tonalit fondamentale, jusqu revenir sur ltonnement qui permet la philosophie de commencer et en venir leffroi et la crainte qui servent lautre commencement de la pense. Intitul Ontologie fondamentale et archologie de la psych , le troisime texte date, lui, de 1992, mme si lA. en offre ici une version modifie. Il porte sur les Zollikoner Seminare et interroge leur intrt pour une psychiatrie phnomnologique. liane Escoubas conoit lexplication avec Freud comme le fil directeur permanent (p. 68) des travaux mens par Heidegger avec et chez Mdard Boss. Lanalyse offerte en 1965 de la notion freudienne danalyse fournit dailleurs lindice le plus net de cette Auseinandersetzung, dont les termes [] sont clairs (p. 70). Pour lA., lUnbewusste rpond le Dasein, au Trieb la Sorge, la thorie du moi toute une conception du soi. travers le fondateur de la psychanalyse, le fondateur de la phnomnologie lui-mme serait donc vis car, consciente ou pas, mme combat : la psych-subjectivit soppose au monde, dont elle permet de rendre compte. Or Heidegger, lui, soppose lopposition : Dehors Dedans (p. 76), au point quil semble permis den reprer une autre, soit celle de ldipe freudien et de ldipe dont [il] donne lecture dans la tragdie de Sophocle (p. 80). Charm de la mise en parallle, on ne peut pourtant qutre contrari quelle demeure un effet dannonce. LArchive du logos est le titre du quatrime texte, paru pour la premire fois en 2007. Aprs cette prcision liminaire selon laquelle cest vritablement au sein du questionnement historial que le thme du logos prend toute son importance (p. 87), lA. se donne pour tche de retracer la patiente investigation, par Heidegger, du logos grec et de son dclin (p. 90). partir dune riche tude du cours du semestre dt 1935, sensuivent la 91
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
dmonstration que les affirmations majeures des penseurs initiaux disent le mme tout le moins celle de Parmnide : Le penser et ltre sont la mme chose , et celle dHraclite : Un est tout et lattestation de ce que pense et posie chez les tragiques sont le mme tout le moins dans le premier chur de lAntigone de Sophocle. La conception platonicienne de ltre comme idea, eidos (p. 107) comme le passage du grec au latin (p. 111) peuvent ds lors tre avancs pour rendre compte de limpossibilit pour linitial de demeurer dans son initialit (p. 110), comprenons : de la possibilit, sinon de la ncessit pour le logos de se faire simple discours, et par l mme, pour lontologie, pure thorie des catgories. Version remanie dun article de 1989, Traduction et histoire de la vrit est le cinquime texte de louvrage. Il dveloppe lide que lide de la traduction dveloppe par Heidegger autour de 1935 savre chez lui le nud reliant la pense de la langue et la pense de lhistoire de ltre (p. 117). Faisant valoir que la thmatique particulire de la traduction prend la relve de la thmatique gnrale quest lhermneutique sitt ngocie la Kehre, lA. fait voir o et comment le cours du semestre dhiver 1942/1943 claire le double sens du verbe bersetzen en allemand selon que lon accentue son prfixe ou son radical , ainsi que les trois formes de traduction existantes le transfert, la reformulation et la rinterprtation. Son intention tant de montrer qu une traduction a toujours affaire la vrit (p. 138), simpose aussitt lexemple de la mutation de lessence de la vrit ou altheia en grec partir des deux contraires du terme althes lathon et pseudes , dont la romanit na pas retenu le bon. Ceci acquis, on ne pourra que saluer la force dune tude qui, aujourdhui encore, na pas pris une ride. La parole potique Hlderlin, Rilke, Trakl, George est donc le sixime et dernier texte ici prsent et le seul qui nait pas encore fait lobjet dune publication. Disons-le tout de suite : il est nos yeux excellent, car aussi didactique que technique. liane Escoubas y soutient que lessence de la posie est historiale pour Heidegger, dune historialit qui est le trait fondamental enseign par Hlderlin, ou plutt par sa posie. On y dcouvre en effet que lorigine est cela qui ne saurait se laisser immdiatement reconnatre , en sorte quil faut sen enqurir, la qute de lorigine tant prcisment "histoire" (p. 148). Aveugles ce qui sourd lorigine, il nous faut donc traverser ce qui nous est tranger pour revenir ce qui nous est familier, sinon propre, car inn, ce retour au natal (p. 151) tant toujours un retour non pas vers le pass, mais vers le futur. Do le thme que lA. choisit de souligner parmi tous ceux qui sentrecroisent dans la lecture heideggrienne des 92
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
pomes de Hlderlin (p. 157) : celui de la fte, image paradoxal dun temps qui sinterrompt pour que soit clbr son imperturbable cours. Mais lA. de poursuivre son parcours dans la bibliothque potique heideggrienne. Parce quil pense la nature comme risque, Rilke est pens par Heidegger comme la pensant selon la volont les hommes ne vont et font-ils pas avec le risque en choisissant de lassumer ? Aussi Rilke chante-t-il la scurit que lhomme moderne trouve dans le retournement du "devant" ou de l"en face" en "dedans" : en dedans de la conscience (p. 169). Il est en ce sens le pote de notre poque, celle de laccomplissement de la mtaphysique. Quant Trakl, qui est celui qui permet la pleine saisie du quadriparti, il plat Heidegger pour sa posie sombre, qui dcrit un monde de catastrophe et de fin du monde (p. 187), cependant que George, par son pome Das Wort , met sur la voie du renversement de lessence de la parole la parole de lessence, en tant quil fait sentir pourquoi les mots que nous prononons mais qui toujours nous prcdent font finalement que parler (sprechen) signifie couter (hren). Donnant et non donn[s] , ils tmoignent ainsi du voisinage de posie (Dichten) et pense (Denken) (p. 212). Au terme de ce livre quil faut dsormais lire, tant nous en avons parl, mais dont on et pu souhaiter que, consistant surtout en reprises, il actualise ses rfrences bibliographiques en citant par exemple Heidegger selon les nouvelles traductions franaises ou, mieux, uniformment selon la Gesamtausgabe , un sentiment se dgage : limpatience dune suite, puisquil na pas de fin. Fidle luvre quil commente, lui-mme est un work-in-progress. En songeant au deuxime volet des Questions cartsiennes de Jean-Luc Marion, esprons quaprs ces premires Questions heideggriennes, liane Escoubas ne sinspire plus seulement que dun titre. Christophe Perrin
Jess Adrin Escudero, Heidegger y la genealoga de la pregunta por el ser. Una articulacin temtica y metodolgica de su obra temprana, Barcelone, Herder, 2010, 621 p. Louvrage du Professeur Jess Adrin Escudero, que publie la maison ddition espagnole Herder et dont le titre franais serait Heidegger et la gnalogie de la question de ltre. Une articulation thmatique et mthodologique de son uvre de jeunesse , est le premier en langue espagnole 93
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
prsenter lensemble du corpus heideggrien menant la rdaction de Sein und Zeit. Bien quil existt dj dimportantes tudes sur le jeune Heidegger nous pensons surtout au livre de Ramn Rodrguez, La transformacin hermenutica de la fenomenologa. Una interpretacin de la obra temprana de Heidegger (Madrid, Tecnos, 1997), mais aussi celui dngel Xolocotzi, Fenomenologa de la vida fctica. Heidegger y su camino a Ser y tiempo (Mexico, Plaza y Valdes, 2004) , cet ouvrage de prs de 600 pages assume la tche ambitieuse de prsenter de faon exhaustive non seulement les thmatiques contenues dans les tomes rcemment publis de la Gesamtausgabe, mais aussi de replacer dans leur contexte philosophico-intellectuel toutes les thses dfendues par Heidegger, de telle sorte quelles soient prsentes comme autant de rponses aux problmes soulevs par les nokantiens, la phnomnologie naissante ou encore la philosophie de la vie. Jess Adrin Escudero est lun des meilleurs spcialistes dans le monde hispanophone de cette tranche de luvre de Heidegger. Il a traduit dans sa langue plusieurs textes dimportance de Heidegger dont les Interprtations phnomnologiques dAristote et le trait toujours indit en franais Le concept de temps , a publi plusieurs ouvrages et tudes sur le jeune Heidegger, dont un excellent dictionnaire intitul El lenguaje de Heidegger. Diccionario filosfico 19121927 (Barcelone, Herder, 2009), qui prsente avec rudition les premiers concepts fondamentaux de la pense heideggrienne. Louvrage publi lan pass par Herder est le fruit dune quinzaine dannes de recherches sur ce sujet. Par son extension et sa capacit articuler les thmatiques tant dans leurs aspects philosophiques quhistoriques, il devrait bientt obtenir le statut douvrage de rfrence en espagnol tout le moins quant la gense de luvre matresse de Heidegger, Sein und Zeit. Certes, ce livre nest pas le premier problmatiser lapparition du projet dune ontologie fondamentale dans luvre de Heidegger. Les travaux pionniers du Theodore Kisiel sont sans doute les plus connus et les plus admirs. Avec son livre The Genesis of Heideggers Being & Time (Berkeley, University of California Press, 1993), Kisiel a fait dcouvrir au monde acadmique ce que les ouvrages de Pggeler laissait seulement deviner : que Heidegger tait un grand philosophe bien avant la publication de Sein und Zeit. Litinraire parfaitement chronologique que parcourt luvre de Kisiel a permis de nombreux chercheurs de travailler sur des textes alors indits. Bien que les textes les plus importants pour comprendre lorigine des questions de Sein und Zeit les cours de la priode de Marbourg (1923-1928) fussent publis dans leur majorit entre 1975 et 1979, les premiers cours de Fribourg (1919-1923) ne 94
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
le furent quentre la fin des annes 1980 et 2005. Pour le public francophone, cest louvrage de Jean Greisch, Ontologie et temporalit. Esquisse dune interprtation intgrale de Sein und Zeit (Paris, PUF, 1994) qui introduisit aux grands problmes de lhermneutique de la facticit. Le livre dAdrin Escudero apparat donc quinze ans aprs la premire vague dtudes et, prenant appui sur eux comme sur le corpus heideggrien (1913-1927) maintenant disponible, prsente les grands thmes de luvre du jeune Heidegger. Lauteur possde une parfaite connaissance de tous les dbats engags dans les tudes heideggriennes, tant en allemand quen espagnol, en franais, en anglais ou en italien, et commente tous les problmes dinterprtation qui ont pu surgir au cours des trente dernires annes. Un appendice bibliographique de cent vingt pages est dailleurs publi sur la page web de lditeur Herder (www.herdereditorial.com) afin de complter les quarante pages de bibliographie contenues dans le livre. Nous ne pouvons que souhaiter que ce document lectronique soit actualis chaque anne. Dans lintroduction son livre, lauteur prend ses distances avec deux lignes dinterprtation de luvre du jeune Heidegger , soit celle de Kisiel qui, par souci historique, perd de vue lorientation du chemin de Heidegger, et celle quil associe la personne de Gadamer et qui voit dans luvre de jeunesse une parfaite prparation luvre tardive. Adrin Escudero propose plutt une interprtation gnalogique qui pntre le contenu des problmes philosophiques, de telle sorte que les thmes de luvre napparaissent pas comme des morceaux indpendants mais suivent un fil conducteur qui puisse offrir une vision globale de luvre. Lauteur voque ce sujet des travaux dautres chercheurs hispanophones Ramn Rodrguez, ngel Xolocotzi et Francisco de Lara , mais aussi de chercheurs allemands Hans-Helmuth Gander, Friedrich Wilhelm von Herrmann. Aprs une brillante introduction historique qui replace la gense de Sein und Zeit dans son contexte philosophique, social, politique, artistique, etc., lauteur tente de montrer que la racine cache du problme de ltre remonte aux tout premiers textes de Heidegger et que les germes de la pense de lontologie fondamentale y sont dj prsents. Ainsi, la diffrence ontologique, lhistoricit ou la critique du sujet moderne constituent le cadre dans lequel lauteur aborde les premiers dbats opposant Heidegger aux nokantiens ou son matre Husserl. Or, la vise de louvrage sera justement de montrer comment ces thmes qui apparaissent en filigrane dans les premiers textes se dveloppent et prennent forme lors de la rdaction de Sein und Zeit. 95
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Louvrage dAdrin Escudero est compos de deux axes dont le premier, laxe thmatique, consiste en un parcours des thmes fondamentaux prsents dans les premiers cours et crits de Heidegger. Ainsi, la phnomnologie de la religion, les problmes lis la temporalit, l ontologisation de la philosophie pratique aristotlicienne, le problme de la vrit et, finalement, la dcouverte de Kant sont les thmes abords dans la premire partie de louvrage. Dans tous les cas, lauteur tient compte de lensemble de la littrature sur le sujet et parvient exposer clairement les liens qui existent entre le traitement heideggrien de ces problmes et celui qui avait alors cours dans la philosophie de lpoque. Le deuxime axe, laxe mthodologique, est quant lui consacr aux problmes proprement mthodologiques et cherche montrer les liens qui unissent, puis sparent les phnomnologies de Heidegger et de Husserl. La critique que Heidegger adresse lendroit de son matre quant son attitude thorique ou son anhistoricit permet Adrin Escudero de dresser un portrait complet de ce quest la phnomnologie hermneutique heideggrienne et souligner les points de rencontre fondamentaux entre les deux penseurs, tablissant comme Jean-Franois Courtine et Jean-Luc Marion lavaient fait il y a plusieurs annes un parallle entre la rduction phnomnologique husserlienne et le phnomne de langoisse analys par Heidegger. De par son exhaustivit, tant dans le traitement des thmes que dans sa considration de la littrature secondaire, louvrage dAdrin Escudero constitue une source prcieuse pour quiconque sintresse luvre du jeune Heidegger. Une traduction franaise serait bien entendu souhaitable dans la mesure o, depuis les recherches de Jean Greisch, aucun ouvrage na abord de faon aussi systmatique la priode qui prcde la publication de Sein und Zeit. Franois Jaran
Florian Grosser, Revolution Denken. Heidegger und das Politische 1919 bis 1969, Munich, Beck, 567 p. LA. de cet ouvrage, issu dune thse de doctorat soutenue en 2009 lUniversit de Munich, entend esquisser le profil politique de la philosophie heideggrienne (p. 15) au-del mme de lpisode du Rectorat (1933-1934), dans le but dy situer dventuels risques politiques , comme y invitait 96
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
nagure J. Derrida. Cest ainsi explicitement un concept du politique chez Heidegger que lA. voudrait donner relief, en sappuyant sur un vaste corpus qui stend du cours sur lide de philosophie (1919) jusqu la confrence Die Kunst und der Raum (1969). Le chapitre I prsente, comme cest lusage, ltat de la recherche (p. 24-26, p. 415-419, n. 30). LA. nignore rien des controverses rcentes ou moins rcentes, et plus ou moins frelates Faras, Faye , ni des tudes importantes sur ce thme, quelques exceptions prs. Alors que lA. nhsite pas citer les travaux dun Sloterdijk ou dun iek, les tudes de Kisiel par exemple ne sont curieusement pas cites sauf un article , Bourdieu (Lontologie politique de Martin Heidegger, 1988) est peine voqu, les livres de Radloff (Heidegger and the question of national-socialism, 2007) et de Fritsche (Historical Destiny and National Socialism in Heideggers Being and Time, 1999) napparaissent pas, les deux volumes du Heidegger-Jahrbuch (2009) consacrs Heidegger et le national-socialisme , avec bon nombre de documents indits dont le sminaire de 1933/1934 Hegel. ber den Staat sont galement ignors, de mme ltude de Bambach, Heideggers roots. Nietzsche, national socialism, and the Greeks (2003), etc. ; autant de titres et de travaux connus qui auraient pu sinscrire dans le champ thmatique de lA. Au mme chapitre, les deux notions opratoires cardinales de lA. que sont la notion de pense politique et celle d ambigut (Zweideutigkeit) , sans oublier toute une srie de notions mthodologiques annexes disperses dans louvrage, et de provenance rsolument anglo-amricaine discursive setting, power play, birds eye view, thin definition, trickle-down-effect, master narrative , rsument lapproche gnrale qualifie d hermneutico-analytique . Sous la notion de pense politique , lA. entend rassembler tout ce qui, sur le Denkweg de Heidegger, est susceptible de prsenter des liens politiques , possibles ou rels (p. 32). Le spectre envisag est donc vaste et vari : de lengagement pour la vlkische Bewegung et la mise en parallle des dmocraties occidentales et des systmes totalitaires aprs la guerre la mditation sur le dpassement de la mtaphysique ou sur lorigine de luvre dart Cette pense politique doit tre distingue de la comprhension du politique au sens plus restreint, qui engloberait des rflexions de type mtapolitique sur la constitution, les limites et la possibilit du politique et formerait le noyau ou l picentre de la pense politique de Heidegger. La notion d ambigut est explicitement thmatise par Heidegger dans son cours de 1935 (Einfhrung in die Metaphysik) comme marque indicielle de lesprit (Geist), et, pourrait-on ajouter, de lesprit tragique , accord la 97
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
logique du dvoilement paradoxal de la vrit de ltre . LA. utilise la notion pour caractriser lessentielle et structurelle ambigut des noncs heideggriens (p. 41, p. 275-277, p. 383), ambigut qui, surtout dans le domaine politique ou mtapolitique, serait prendre systmatiquement en considration pour dchiffrer sa pense. Cette caractrisation dailleurs (et le lien entre thorie et praxis quelle tente de saisir) deviendrait peut-tre plus intelligible si on lclairait par le concept dindication formelle (formale Anzeige) que Heidegger labore au dbut des annes 1920, mais qui reste opratoire tout le long de son Denkweg, mais aussi par la logique retorse de son discours double, se dployant en rgime exotrique ou sotrique selon ses destinataires. Reste savoir si ladite caractrisation par la notion dambigut suffit percer les arcanes mtapolitiques de Heidegger et sa philosophie de la rvolution pour en circonscrire les ventuels dangers et risques . Pour reprer ceuxci, lA., toujours dans ce chapitre I, construit le modle dun concept du politique jug dnu de danger (ungefhrlich) , cest--dire pluraliste, en recourant des auteurs aussi divers que Hobbes, Arendt, Rawls ou encore Habermas et Chantal Mouffe, pour dfinir trois conditions du politique qui permettraient a contrario de mesurer le degr de nocivit ou de dangerosit du concept heideggrien du politique (p. 44) en fonction de ses ventuels points dintersection avec le national-socialisme rel (p. 141-150) : la conscience de linscurit (Unsicherheit) ou de linstabilit de toute situation politique, la reconnaissance de limpossibilit dune supervision panoramique de cette situation (Unberschaubarkeit), le souci de ltre en commun (Gemeinschaftlichkeit). Dans le cours de louvrage, on sen doute, lA. entend dmontrer que le concept du politique selon Heidegger ne suffit aucune de ces conditions, tout en dgageant la possibilit dinscrire certains de ses lments antidmocratiques, titre pour ainsi dire prventif, dans le dbat actuel sur la dmocratie (p. 57) nous y reviendrons pour terminer. Les chapitres II, III et IV reconstruisent cette pense politique de Heidegger selon trois moments historiques : 1933-1945 Troisime Reich , 1919-1933 Weimar , 1945-1969 Rpublique fdrale. Passons ici assez rapidement sur lanalyse, au chapitre III, de la prhistoire du premier moment, qui retrace, sur un mode narratif, la gense de certains motifs de la pense politique de Heidegger que lA. entend reprer dans Sein und Zeit : rsolution (Entschlossenheit), authenticit (Eigentlichkeit), historicit (Geschichtlichkeit), tre-avec (Mitsein), etc. Cette dernire notion surtout, soit dit entre parenthses, aurait pu donner lieu une discussion de ses implications politiques ou mtapolitiques, puisquelle procde dune rinterprtation 98
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
phnomnologique de certains passages dcisifs sur lanimal politique et dou de langage dans la Politique dAristote, comme le montre par exemple le cours de Heidegger profess en 1924, paru en 2002. Voyons plus en dtail le chapitre II, cur de louvrage, qui inscrit lengagement de Heidegger, et l ruption (Ausbruch) de sa pense politique (1933-1934), dans un rseau de notions alors minemment surcharges : peuple (Volk), auto-affirmation (Selbstbehauptung), travail (Arbeit), combat (Streit, Kampf), mission (Auftrag), etc. Les analyses sont souvent bien informes, parfois un peu rapides toutefois, comme autant de pitchs en attente de dveloppement. Le Discours de Rectorat nest trait quen survol (p. 67-68), alors quil contient sans doute certains motifs directeurs de lengagement, selon les dires de Heidegger lui-mme ; cest du moins ce qui pourrait apparatre si on clairait cette allocution, fort condense, par les deux cours contemporains de la priode du Rectorat vol. 36/37 et vol. 38 de la Gesamtausgabe , et par dautres textes et documents accessibles dans le vol. 16 ou ailleurs. Peut-tre lanalyse de la rmanence dune forme de platonisme politique dans le Discours, rmanence qui sinscrit par ailleurs dans un contexte germanique particulier, celui du Troisime Humanisme et de lintrt accru, depuis les annes 1910, de Natorp Jaeger, pour le corpus politique de Platon, et-elle alors permis de rendre visible au moins lun des axes structurants de lengagement heideggrien nfaste, troitement li, en 1933/1934, la volont de rformer lUniversit pour en faire la cellule directrice de ltat, cest--dire la volont, in fine donc assez classiquement platonicienne, de fonder le politique sur un mode mtaphysique . Pour la priode de dsengagement qui suit immdiatement le Rectorat, lA. met en avant la notion de Besinnung, laquelle, dveloppe dans les traits sotriques notamment dans les Beitrge de 1936-1938, vol. 65, et dans le trait de 1938/1939 qui porte ce nom, vol. 66 de la Gesamtausgabe , indiquerait, entre autres, une prise de conscience lgard de la ralit du mouvement hitlrien (p. 154, p. 178). On peut abonder dans le sens de lA. lorsquil crit quaprs l chec du Rectorat, Heidegger ne soutient plus gure certains aspects de la politique du parti comme les mesures dalignement, Gleichschaltung, ou la sortie de la SDN, points culminants de cette phmre concordance, selon lA. (p. 385) , mais quil ne se dtourne pas moins du domaine du politique comme tel (p. 180-204 ; p. 385). Car tout porte croire, notamment le cours, qui suit sa dmission, de 1934/1935, que Heidegger repense ce domaine politique partir dun programme no-hlderlinien essentiellement utopique . Cest cet aspect, notre avis fondamental, qui est 99
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
quelque peu nglig, alors mme que lA. insiste sur la place insigne de lart (p. 79-84) en soulignant juste titre la qualit proprement rvolutionnaire (p. 84) que Heidegger accorde luvre dart dans sa confrence De lorigine de luvre dart (1935/1936). Limportance structurante de Hlderlin est certes perue (p. 164-165, p. 193), mais cette perception, ou plutt ce pressentiment, ne conduit pas pour autant lA. jusqu tudier de plus prs la notion du Sacr (das Heilige) , expdie en une ligne dans ce contexte (p. 165 ; p. 331) ; cest cette notion pourtant qui, notre sens, serait susceptible de mettre en perspective larticulation, chez Heidegger, entre le politique et le thologique, au-del de lide dune simple esthtisation du politique (p. 194). Le rapport que Heidegger tablit entre les hymnes tardifs de Hlderlin et le thme de lEreignis est peine voqu (p. 91) ; or, cest sans doute ce rapport quon aurait pu approfondir pour mettre au jour le programme no-hlderlinien dune pense de lEreignis comme mtapolitique. Quoi quil en soit, le commentaire que Rorty, cit par lA. (p. 202), fait du recours Hlderlin parat alors pour le moins inapte saisir ces enjeux : Ascetic priests are often not much fun to be around, and usually are useless if what you are interested in is hapiness . Sil sagit de penser la rvolution chez ou selon Heidegger, comme le suggre le titre de louvrage, cest--dire de souligner lorientation fondamentale-rvolutionnaire (p. 196) et polmique (p. 394) de son concept du politique, il aurait pu tre utile de retracer la doctrine rvolutionnaire du tragique de Hlderlin prcisment, que lauteur qualifie pourtant de rvolutionnaire ultime ( p. 90), et den montrer limpact possible sur Heidegger et sur sa doctrine sotrique de lEreignis et de la Kehre im Ereignis, laquelle sous-tend lide du retournement (Umkehrung) que lauteur invoque (p. 196) quon songe simplement ce qucrit Hlderlin J. G. Ebel, le 10 janvier 1797 : Je crois une rvolution future des conceptions et des manires de voir qui feront rougir de honte tous les reprsentants des conceptions antrieures. Il se peut que lAllemagne y contribue pour une large part . Le chapitre IV entend traquer les effets de l ruption politique sur la pense daprs-guerre, partir des thmes heideggriens typiques que sont lEreignis, la srnit (Gelassenheit), le danger (Gefahr), le dispositif arraisonnant (Gestell), le quadriparti (Geviert) ou la technique , etc. Si pour cette priode des annes 1950 et 1960, lauteur constate, juste titre, laffaiblissement dpolitisant de la thmatique du polemos, omniprsente avant 1945 (p. 335-336), il souligne aussi la survivance dune srie de figures mtapolitiques (p. 337-339) : le refus de reconnatre lautonomie de la sphre 100
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
du politique refus dj stigmatis par Arendt ; lorientation monologique impliquant une Diskursverweigerung ; lide destinale dun ordre prtabli lhistoire de ltre et lopacit argumentative quelle impliquerait ; la tendance une esthtisation de la politique ou une politisation de lart ; enfin, encore et toujours, la thmatique de la rvolution . En dpit de la survivance de ces quelques figures, effectivement prives aprs 1945 de leur possible champ de dploiement, lauteur remarque juste titre quil semble bien malais de prter au dernier Heidegger une conception explicite du politique (p. 339). Le jugement rtrospectif que Heidegger luimme porte sur le national-socialisme aprs 1945 peut paratre ambivalent, du moins lire lentretien du Spiegel de 1966 et la clbre phrase de 1935 maintenue en 1953 dans la publication du cours Einfhrung in die Metaphysik. Or, cette ambivalence nest que lcho dune tension prsente ds 1933, et lA. a le mrite de montrer clairement, si besoin tait, que lon ne saurait facilement parler, dans le cas du penseur de Fribourg, ni d anti-nazisme , ni de cryptonazisme (p. 342), ces deux interprtations tant impuissantes comprendre que ds 1933 le programme rvolutionnaire national-socialiste constitue dune certaine manire un point de rfrence constant, mais souvent ngatif, pour la politique de ltre , les divergences entre les deux nayant eu de cesse de saccentuer depuis l chec du Rectorat . Lun des objectifs de cet ouvrage est alors de dgager certains traits de la politique de ltre tmoignant prcisment de ce conflit, et que lauteur considre comme potentiellement dangereux (p. 343-351) : le quitisme politique de Heidegger, oscillant entre lexhortation l archi-Fhrung et lapolitisme pur et simple ; son discours sacrificiel germanocentr dans limmdiat aprs-guerre ; linadquation des notions issues de la doctrine de lhistoire de ltre (Seinsgeschichte) pour penser le politique, cest--dire ce que que Janicaud avait nagure qualifi d historialisme destinal , la Ver-antwortung lgard du destin de ltre pervertissant, selon lauteur, la Verantwortung au sens thico-politique, impliquant par ailleurs un solide mpris pour les souffrances relles rsorbes et niveles en fonction de ce destin , etc. LA. identifie pour finir certaines ressources susceptibles dtre rutilises ou recycles aujourdhui hors de leur contexte dmergence pour repenser le politique (p. 352-357), par exemple dans le domaine de la pense cologique lutilisation de Heidegger par la deep ecology en est lun des indices , de la philosophie interculturelle dans le sillage du dialogue nou par Heidegger, de faon encore rudimentaire il est vrai, avec certaines formes de taosme et de bouddhisme zen dans les annes 1950 et 1960 , ou dans la 101
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
perspective dune critique de la mondialisation partir du concept de plantaire labor en interprtant Der Arbeiter dans les annes 1930. noter aussi, sous forme de digression, les analyses intressantes que lA. consacre lintgration positive de certains motifs heideggriens dans la pense politique de Marcuse et dArendt (p. 397-405). Si leffort de dgager un concept du politique et den proposer une critique argumente parat louable, il est permis de se demander, pour conclure, si ce concept suffit puiser le Denkweg de Heidegger dont le motif fondamental serait la rvolution et la structure fondamentale, l ambigut . Lambition de prsenter la pense de Heidegger sous lhgmonie dune strate politique matricielle plus ou moins enfouie (p. 43) risque, nous semble-t-il, de favoriser une lecture politisante potentiellement totale de cette pense et, de faon synchrone, den aplatir les concepts directeurs, ds lors privs de leur articulation peut-tre dcisive avec le thologique, en loccurrence, avec la thologie potique de Hlderlin. Le vecteur du thologico-politique, Hlderlin, est certes voqu plus dune fois, nous lavons not, mais lauteur ne semble lui accorder gure quune importance subordonne dans le projet densemble, tant peut-tre trop fix sur les liens avec les agenda setter de lentre-deux guerres (p. 222) que seraient Jnger et Schmitt (p. 205-217, p. 280-292, p. 364377). Or, cette ide mohlrienne, problmatique et date, dune trinit plus ou moins souterraine de la rvolution conservatrice Heidegger, Jnger, Schmitt , oblitre dautres contextes et facteurs non moins importants sinon plus, comme par exemple la Deutsche Bewegung ou linfluence dun certain messianisme gorgien vhicul par Hellingrath, ainsi que du mythologme de l Allemagne secrte dont un Benjamin avait pu remarquer la complmentarit, volontiers dnie par les disciples de George, avec l Allemagne officielle . Ces quelques rserves sur lvitement du problme thologico-politique mises part, il convient plus gnralement de saluer linterrogation nuance de lauteur sur les compatibilits et les incompatibilits entre la pense de la Seinsgeschichte et le national-socialisme ou plutt les national-socialismes , son rejet argument des explications simplistes, ainsi que sa volont de dsolidariser la problmatique Heidegger et le politique de la thmatique, plus restreinte la priode 1933-1945, Heidegger et le national-socialisme . LA. a choisi une voie mdiane entre les deux extrmes que sont la condamnation idologique de luvre et la reprise orthodoxe de certaines positions politiques les plus discutables, jugeant que le meilleur traitement quon puisse infliger ce classique controvers (p. 406) est de considrer sa 102
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
pense comme une provocation et une preuve pour les dfenseurs et les thoriciens de la dmocratie, prsente ou future. cet gard, louvrage contribue la tche circonscrite par Derrida en 1987 : reconnatre les analogies et les possibilits de rupture entre ce qui sappelle le nazisme [] et dautre part une pense heideggrienne aussi multiple et qui restera longtemps provocante, nigmatique, encore lire . Christian Sommer
Muhammad Kamal, From Essence to Being. The Philosophy of Mulla Sadra and Martin Heidegger, Londres, ICAS Press, 2010, 207 p. Comparer deux penseurs de tradition et dpoque trs diffrentes est une entreprise prilleuse. Lhistorien de la pense ne pourra que tiquer, le philosophe se sentir parfois dmuni tant lui manquent les concepts de base de lune ou de lautre des traditions. Nous nous situons plutt du ct de lhistorien de la pense, mais sans raideur excessive : nous pouvons concevoir que dautres lectures soient possibles et, surtout, puissent apporter quelque chose la rflexion. Dautant quici, les deux penses en question, celle de Heidegger et celle du philosophe iranien Mulla Sadra Shirazi (ca. 1572-1640), partagent pour ainsi dire une mme base grecque. Entreprise justifie donc, ou du moins justifiable, mais seulement si elle se situe au niveau des fondements mmes de la pense de chacun, pour montrer les ides communes et les fractures. Ce qui nous intresse dans ce type de mise en parallle est la rflexion sur les questions fondamentales : quelle est la vision de ces deux penseurs sur ce qui est et sur la structure du rel ? Quest-ce que ltre ? Ce qui est est-il pens comme participation une mme ralit ou sagit-il ici dune pense du multiple ? Dans le premier cas, comment penser le multiple ? Quid de lanthropologie, de la place de lhomme, de son rapport ltre ? Cest l sans doute que la rupture de la modernit a le plus de poids comme sur la question du nant. Muhammad Kamal est bien conscient du problme : dans son introduction, et encore dans sa conclusion, il rpte la difficult de son entreprise de mise en perspective (p. 1 et p. 179). Mais rpter quon a conscience de la difficult ne constitue pas un argument. Le centre du propos de lA. va dans le bon sens : prudent, il entend montrer que la base mme de la rflexion de Heidegger et de Sadra est, mutatis mutandis, lopposition la conception du rel de Platon. Mais tout ne peut pas tre compar, en 103
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
particulier ce qui touche la question de lhomme. Mme si lA. prend ses prcautions, il est difficile de suivre lide mme dune comparaison. Lexpos de la pense de Sadra appelle quelques remarques. LA. nous offre lhabituelle explication sur le passage de la prminence de lessence celle de ltre comme acte, dans le dbat sur la question de la prminence de lun ou lautre aspect n de la distinction entre ce que la chose est et le fait quelle est pose par Avicenne (p. 8 sq.). Deux observations. Dabord, plutt que du rapport de prminence, cest la question du jal (instauration, position) qui importe ici. Dans la tradition de pense de Sadra, la question qui permet de comprendre ce quest fondamentalement ce que je vois comme ralit se pose dans les termes suivants : que fait Dieu ou le Premier principe quand il pose ce qui est ? Pose-t-il dabord une essence pour lui donner ensuite ltre ? Pose-t-il dabord lacte dtre mme, acte dtre qui ensuite est dfini comme tant telle ou telle ralit particulire ? Pose-t-il un tout indissociable ? Ces questions somment en mme temps de se prononcer sur la question de savoir si le monde est multiple ou fondamentalement un derrire les apparences des phnomnes. Ensuite, la position de Sadra est ici prsente exclusivement comme un abandon de la philosophie la Suhrawardi appele philosophie ishrq o il y aurait oubli de ltre. Il nous semble cependant quil y a dans la pense de Sadra quelque chose de plus fondamental, et dintrinsquement ishrq, dont la position dans le dbat sur la fondamentalit nest quun indice ou un piphnomne. Limportant nest pas que, pour Suhrawardi, ltre comme concept nest quun objet mental. Certes, il lest : il ny a pas pour lui quelque chose comme ltre qui serait en dehors de ce qui est, cest--dire telle ou telle chose. Ce nest pas de ltre qui se dploie travers les choses qui sont, mais des choses qui sont et partir desquelles notre entendement construit le concept dtre. Daccord. Mais quest-ce qui est pour Suhrawardi ? Nous ne suivons pas ici linterprtation de lA. selon laquelle la mtaphysique de la lumire de Suhrawardi serait une pense essentialiste, qui oublierait et empcherait de toucher le cur mme de ce qui est (cf. en particulier p. 6 et 13). Cette interprtation nest quun prtexte lclairage du projet sadrien en termes heideggriens : en privilgiant nettement lessence sur ltre, Suhrawardi rpte un geste typiquement platonicien dont la consquence est de sceller la vrit au lieu de la dvoiler ; il tombe donc sous le coup de la critique heideggrienne de la philosophie occidentale de Platon Nietzsche (p. 6 et p. 65) ; et il devient possible de caractriser la contribution de Sadra au dbat comme une tentative de basculer vers une nouvelle ontologie base sur la primaut de ltre (p. 6) et non plus sur celle de lessence. Selon nous, la 104
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
mtaphysique ishrq est une comprhension du rel base sur la lumire comme ralit, source du rel, ainsi que de lidentit et de la diversit de ce qui est. Cette pense de la participation pourrait tre rapproche de celle dIbn Arabi et de lcole akbar, centre sur ltre comme acte, mais elle sen distingue radicalement par lattention qui y est porte la ralit des multiples expressions de ltre ici exprim en termes de lumire , et donc au maintien de la multiplicit au sein mme de lidentit et de la participation. L o lcole akbar peut-tre plus quIbn Arabi lui-mme insiste sur lvanescence de ce qui est autre que le Rel, la multiplicit ntant admise que dans les manifestations et non dans ltre lui-mme, la mtaphysique ishrq insiste sur la ralit du multiple. Cest l selon nous le cur mme de la position mtaphysique de Sadra : penser comme Suhrawardi, cest--dire penser le rel la fois comme unit et comme multiple, mais avec le vocabulaire akbar de ltre. Ainsi, Mulla Sadra est fondamentalement un ishraq, par le fait quil veut pouvoir penser ensemble le Rel et les ralits, lunit sous-jacente et la multiplicit relle do lide de gradation ou de modulation de ltre (tashkk), impensable pour un Akbar. Lide que chaque tre individuel possde un mode unique dexistence et est un "degr" de ltre (p. 96-97), et non un degr de manifestation du seul tre qui soit vritablement comme dans la pense akbar, est une ide fondamentalement ishrq. Prsenter la pense de Sadra comme exclusivement anti-ishraq ainsi que le fait ici lA. ne nous semble pas tenable. Par consquent, rendre Suhrawardi et son cole responsables dun oubli de ltre comparable celui que Heidegger impute la mtaphysique occidentale et faire toute proportion garde de Sadra une sorte de prcurseur du penseur allemand ne lest pas davantage. un seul moment , lA. esquisse une Auseinandersetzung digne de ce nom : lorsquil prvoit de pointer deux carts substantiels entre les vues ontologiques de Mulla Sadra et celles de Heidegger (p. 95). La premire quant la question de la diffrence ontologique entre ltre et les tres (pp. 96-101) ; la seconde quant au problme de laccessibilit du sens de ltre (pp. 101-116). Ici et l le rapport au divin signerait une diffrence irrductible entre les deux penseurs. Mais tonnamment, lA. sape lui-mme les fondements de la confrontation avant mme de lentamer : en caricaturant la thse de Karl Lwith selon laquelle lontologie heideggrienne possde une tonalit religieuse crypte mais indniable, il parvient remettre Sadra et Heidegger au mme niveau. Le choix nous est alors offert daccentuer la dimension philosophique de Sadra ou de se rendre lvidence que Heidegger est un thologien dguis. 105
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Pour conclure, en plus dtre par trop rptitif dans ses chapitres, le livre est truff dapproximations dans ses interprtations de lun et lautre penseurs et justifie donc le reproche quon adresse souvent la philosophie compare, savoir quelle en reste la surface des systmes quelle compare. Lexemple flagrant en est la ritration strile car jamais re-problmatise de la thse plutt lgre mais pas totalement inintressante de louvrage selon laquelle Sadra et Heidegger combattent tous deux le platonisme et pour la mme raison sa responsabilit dans loubli de ltre et de sa vrit au profit de lavnement dune certaine forme de nihilisme et envisagent dune mme manire le dpassement de la mtaphysique en dessinant un nouvel horizon de pense et en inaugurant une nouvelle poque dans lhistoire de la philosophie de ltre (p. 13, 19, 65, 73, 76, 77, 123, 180). Heureusement, les chapitres 5 et 6 prennent un peu de hauteur. Ils dtaillent en certaines pages plutt claires comment faire dialoguer Sadra et Heidegger sur la question du nant ainsi que celle de la projection, indiquant cette fois plus fermement que la conception heideggrienne du temps et de ltre-pour-la-mort permet de penser le devenir en termes bien plus concrets que ne lautorise la pense sadrienne. Finalement, ce nest pas chose tonnante dans la mesure o lA. reconnat demi-mot que la philosophie de Sadra ne cesse pas de revendiquer une doctrine de lmanation (p. 95 et p. 135) qui lempche de se dtacher entirement de ce quon appellera un certain real-idalisme noplatonicien. Plus loin, il fallait effectivement relever que la terminologie sadrienne reste prisonnire du contexte de la thologie aristotlo-islamique du XVIe sicle, tandis que Heidegger semploie pour sa part dvelopper un nouveau langage philosophique moins en dette vis--vis de la terminologie scolasticoaristotlicienne (p. 180). Si cet aveu ne condamne pas davance toute comparaison, il fragilise le projet de lA. qui, dans lultime phrase de son livre, confie cette chose trs juste : Des analyses plus rigoureuses sont requises dans le futur pour fonder ce que cette tude se contente de viser (p. 188 nous soulignons). Ccile Bonmariage & Sylvain Camilleri
106
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Susanna Lindberg, Heidegger contre Hegel. Les Irrconciliables, Paris, LHarmattan, Ouverture philosophique, 2010, 222 p. Issu dune thse de doctorat, louvrage se propose d expliquer lexplication (p. 101, p. 105 et p. 130) exemplaire que Heidegger ne cesse de poursuivre avec et contre Hegel. Lenjeu nest pas de monter un dialogue artificiel, comme si la langue, les mots et les problmes des deux penseurs taient les mmes, ou comme si lun pouvait encore rpondre lautre. Lhorizon gnral de louvrage est bien plus large : il sagit de comprendre lexplication philosophique comme condition transcendantale et existentiale de la question de ltre, de lhistoire et du temps lui-mme. Envisageant Hegel et Heidegger non du point de vue extrieur de la comparaison dopinions, mais comme sujets dun conflit (p. 11) propos de ltre, comme acteurs d un dbat historial sur lhistorialit (p. 11), lA. dconstruit mthodiquement la conception classique du dialogue comme identification dune mmet et assume lindiscernabilit de principe de ltre partag par Hegel et Heidegger. En labsence de tout langage commun, et parce quil ny a nul monolinguisme de ltre, nul logos unique surplombant lhistoire, lexplication Widerlegung daprs Hegel, Auseinandersetzung selon le terme choisi par Heidegger pour caractriser sa confrontation avec Hegel nomme la conflictualit propre de ltre (p. 53). Et ce nest que depuis ce conflit sur le nom et le sens de ltre que ce dernier peut justement se montrer et se dire, que sont produits la chose et ses participants, et que peuvent prendre corps deux discours irrconciliables, parce que dune diffrence sans relve (Aufhebung). Lexplication produit ainsi un diffrend philosophique et ouvre par l le Dasein la dimension de lhistoire en tant que ltre se donne penser depuis des sites divers et des positionnements multiples quil sagit de distinguer poqualement. Bref, comme lcrit lA., il sagit, en ne cdant pas sur le conflit des penses, d tudier le temps par la sparation, lhistorialit par la confrontation, et ltre par le dialogue (p. 53). En plus de la grande clart de lexposition, retenons essentiellement trois temps forts dans le parcours propos par louvrage. Premirement, lA. avance le concept de traduction (bersetzung) pour rendre compte la fois de limpossibilit darrter un sens ou un nom de ltre et de la ncessit quil y a, pour le penseur, de saffronter des paroles trangres pour trouver penser. Le logos de la traduction est le logos de lexplication en tant quil assume laporie de la philia philosophique (p. 22) : le penseur se reoit de la parole historiale de lami qui lui fait signe vers ce quil y reste encore penser, mais il revient au penseur de traduire, dinterprter la 107
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
parole reue, de sexpliquer polmiquement avec elle, pour creuser lcart historial et comprendre le site de son originarit propre (Ursprnglichkeit), de son actualit philosophique. Deuximement, dployant les perspectives ouvertes par la poursuite de lexplication philosophique, lA. place le dialogue Hegel-Heidegger sous la modalit du dfi. Si la lecture heideggrienne de Hegel est minemment stratgique (p. 177), si Heidegger oblitre le dynamisme hglien de ltre comme vie, activit et libert, cest certes pour distinguer sa propre pense de la vrit et de la temporalit de ltre, sa propre conception du Dasein, mais cest surtout pour viter daffronter ce qui, dans la pense de Hegel, pourrait lui lancer un dfi. Escamotant ltre hglien comme vie de lesprit au profit de lide ontothologique dune causa sui immobile , Heidegger rvle la finitude comme point aveugle (p. 85) de la philosophie de Hegel ; et ce dernier rpond lattaque en lui lanant en retour le dfi de penser la rencontre de lautre dans un tre-avec authentique (eigentliches Miteinandersein) . LA. cherche ainsi exhumer, depuis la pense hglienne de lacte, une autre pense de la finitude. (p. 149). Contrairement Heidegger, qui comprend lide hglienne comme une substance extratemporelle pour laquelle le temps nest quune alination provisoire, et laction volontaire comme la ralisation dune forme en attente dans la conscience thorique, lA. insiste sur linconscience structurelle de la conscience pratique, qui prcde la conscience thorique de lide et donne sa chance une historialit authentique. (p. 151). Labsolu ne prexiste ni au monde ni lacte philosophique, mais il est tout entier acte et ne peut se saisir que dans une existence temporelle, inquite, dchire et finie. Hegel ne clture ni ne supprime, mais dploie au contraire lhistoire en tant que seule dimension possible du sujet absolu. Cette insistance sur la pure actuosit (p. 167) de lide hglienne permet lA. de rapprocher, de la faon la plus inattendue, la conception tlologique de lhistoire chez Hegel de la pense eschatologique de lEreignis chez Heidegger, en tant que ni lide hglienne ni ltre heideggrien ne sont chose transcendante hors de lhistoire, mais en tant quils sont tous deux seulement ce qui advient historialement, ce par quoi seulement il y a du temps. En retour, il sagit d branler (p. 111), d inquiter (p. 124) ltre-avec heideggrien en confrontant le Dasein de Sein und Zeit la conscience morale (Gewissen) de la Phnomenologie des Geistes. LA. oppose la finitude du Dasein dans ltre-pour-lamort solitaire, la pure adresse qui convoque le Dasein rpondre seul de luimme, au motif hglien du pardon rconciliateur par lequel deux consciences morales se reconnaissent comme la fois absolument diffrentes, et pourtant 108
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
non moins absolument gales. Le dfi lanc par Hegel Heidegger, pour ainsi dire, permet lA. de dnoncer la fois l ontologisation irresponsable (p. 141) dans laquelle versent les analyses heideggriennes, et laporie dans laquelle nous jette lexpos du Mitsein : parce que son analytique de ltre-avec ne permet pas de penser la rencontre de deux Dasein, Heidegger ne peut expliquer lexplication , et celle-ci reste une condition aportique de la pense de ltre (p. 105). Seul lexpos hglien de la conscience morale peut expliquer lexplication , car il comprend lexplication comme reconnaissance de lautre dans la msentente, le diffrend, et non dans la chose commune qui nivelle toute diffrence. Troisimement, aprs avoir brillamment rapproch la pense de lEreignis de la philosophie hglienne de lhistoire et lErinnerung hglien de lAndenken hlderlinien tout en prenant bien soin de souligner les diffrences radicales entre ces motifs, l mme o ils semblaient les plus proches , lA. peut juger rtrospectivement son parcours comme lentreprise dune double "dconstruction" (p. 201) de Hegel par Heidegger et de Heidegger par Hegel, laquelle naura laiss aucun dentre eux indemne. Au fond, il sagissait de comprendre lexplication quasi-incessante de Heidegger avec Hegel, non comme la disqualification dun discours sur ltre au profit dun autre, mais, plus fondamentalement, comme la mise en crise de toute fixation du sens de ltre. Parce que ltre est sans nom propre, retir dans son indicibilit, il nest plus que le conflit sur son sens (p. 202). Et le temps devient temps du conflit sur le sens du temps (p. 203), temps de la pense en acte (p. 204), temps qui spare (p. 98) et instaure du mme coup une communaut transhistorique de grands penseurs qui, sans partager ni lieu ni langue, donne penser la temporalit du temps lui-mme (p. 176). Au terme de ce parcours, le lecteur pourrait tre quelque peu du par la conclusion de louvrage. Si lA. assume le risque et linconfort dun discours qui soit la fois hglien et heideggrien dun discours que Hegel et Heidegger jugeraient donc intenable et insoutenable (p. 9), il nen reste pas moins que lide centrale de louvrage savre relativement troite : Heidegger ne cesse de sexpliquer avec Hegel parce que lindiscernabilit de ltre quils partagent menace de rompre la distance. Prcisons cependant que pour spargner un tel sentiment, il nest que de lire, chez le mme diteur et dans la mme collection, le second volet de la thse de doctorat de lA., contrainte faire paratre deux volumes en lieu et place dun seul et mme travail. Quentin Person 109
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Susanna Lindberg, Entre Heidegger et Hegel. closion et vie de ltre, Paris, LHarmattan, Ouverture philosophique, 194 p. Louvrage, qui composait lorigine une partie de la thse de doctorat de lA., se prsente comme une mditation du mot de Heidegger selon lequel Hegel et lui penseraient le mme ltre , tant bien entendu que le mme nest pas lidentique (selbe, aber nicht gleiche). Aprs avoir rappel sa perspective de lecture, savoir lire Hegel et Heidegger comme les sujets dune explication philosophique mene depuis labsence de tout sens transcendant positif de ltre, lA. nous propose un parcours en trois parties. Une premire partie (pp. 15-51) aborde frontalement la question heideggrienne du sens de ltre. Ltre est sans nom propre, il ne se montre que depuis la conflictualit des penses sur son sens, dans le besoin de traduire les paroles envoyes dune autre exprience de ltre pour trouver encore penser et dans la ncessit de reconnatre, malgr tout, la persistance dun reste non traductible de la chose, qui se refuse mme chaque parole singulire. Il sagit ds lors, pour Heidegger, de faire surgir la question du sens de ltre en sexpliquant polmiquement avec la pense hglienne de ltre. LA. montre que cette explication a lieu dans les lignes mmes de la traduction pensante (p. 19) des paroles dHraclite que propose Heidegger. Heidegger traduit potiquement Hraclite parce quil cherche revenir en de de lpoque hglienne de la mtaphysique, identifie par lui comme tant celle de la substance comme causa sui, de la subjectivit, de la reprsentation, de lontotho-logie, et de la phusis comme production (Entstehung). Cette traduction pensante est donc en ralit une stratgie de contre-traduction (p. 20) de linterprtation hglienne des paroles dHraclite, un effort pour librer "notre" pense de lhglianisme (p. 20), une rfutation mthodique de ltre hglien (p. 24). LA. suit pas pas la mditation heideggrienne de la parole hraclitenne phusis kruptesthai philei , et fait progressivement apparatre le sens propre de chacun de ses mots. Phusis nomme la venue au jour de ltre depuis lui-mme, en toute clart. Kruptesthai renvoie la finitude de ltre, la possibilit de son retrait ou de laveuglement son gard, et nomme ainsi la limite propre de la clart qui conditionne toute vision, la logique selon laquelle ltre ne peut venir au jour que depuis la possibilit de sa propre impossib ilit. Philei est linclination rciproque et rserve de phusis et kruptesthai, ce qui rassemble et lie harmonieusement les lments du monde tout en les maintenant spars, tourns les uns vers les autres et pourtant chacun retir auprs de soi. LA. montre clairement toute la distance que Heidegger prend 110
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
avec la ngativit hglienne en opposant la rconciliation dialectique des opposs, lharmonie fondamentale de la philia qui maintient lcart. Cest contre cette prcipitation de la diffrence dans la synthse dialectique que Heidegger traduit phusis par Aufgehung et non plus Entstehung , polemos par Auseinandersetzung qui rvle lincommensurabilit des termes et maintient leur distance , logos par Versammlung et non Vernunft, qui compose un systme de propositions et fait de ltre un objet pour une subjectivit absolue. Ltre apparat en tant que monde dans le polemos, et il ny a nulle relve (Aufhebung) ni runification possibles des tre spars. Chaque tant-prsent (Anwesende) est prsent aux autres et pourtant tous sont en conflit, incommensurables et incomprhensibles. Le logos chez Heidegger est logos de la dchirure, et sil y a quelque chose comme une dialectique (diapheromenon, Austrag) cest une dialectique dchire (p. 44), une dialectique comme transport qui maintient bant les rapports conflictuels. Dans une deuxime partie (p. 55-82), lA. envisage les principales thses de Heidegger concernant ltre hglien. Heidegger pointe la grandeur cache (p. 68) du systme hglien et sa faillite dans son essence thologique. Le systme de Hegel est, selon Heidegger, sourd la question de lhistorialit de ltre parce quil est systme dune pure prsence- (Anwesenheit) de labsolu : prsence-auprs-de-nous qui conduit la parousie, prsence--soi dun absolu qui se comprend parfaitement, se reprsente et se rflchit sans reste dans un systme conu comme image du Dieu (p. 69). Dans une troisime partie (p. 85-166), lA., lisant Die Wissenschaft der Logik, expose la thorie hglienne de leffectivit de lesprit en guise de "rponse" de Hegel Heidegger (p. 14). Plutt que dappuyer la distinction trop claire entre la pense de ltre et l"ontothologie" (p. 23), lA. cherche faire merger deux penses croises de la finitude, deux efforts semblables pour dpasser la mtaphysique. Lenjeu global de cette troisime partie est donc de nous faire entendre labsolu hglien non comme la relve de toute finitude, mais comme linfinitisation de toute limite ou de toute dterminit qui la rvlerait comme tant inadquate soi, insatisfaisante. Linfini nest, dans ce cadre, ni lautre du fini, ni une dtermination adquate et dfinitive situe audel de toute limite. Linfini est lacte mme de (se) dterminer, le dsir inquiet de dtermination de tout ce qui est l, lacte mme de sprouver dans le fini et de nier aussitt cette ngation premire, forme ou figure particulire, pour (r)affirmer nouveau la libert premire de lacte. Cest depuis ce battement (p. 150), cette ngativit de lacte pur, cette logique de la libert
111
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
que lA. comprend lide absolue ou le sujet absolu hglien comme vivant (p. 152). Cette troisime partie souvre et se referme sur la conception hglienne de la volont qui, loin dtre une mtaphysique de la volont selon laquelle une forme dj acheve du vrai ou du bien nattendrait que sa reproduction effective dans une conscience pratique, montre au contraire une rationalit qui ne peut venir au jour au sein du monde qu mme laction finie dun sujet particulier. Il ny ni forme qui prcde, ni dpendance de lide larbitraire de la volont subjective, mais une co-dtermination ou une collaboration de la contingence et de la ncessit, de labsolu et de laction singulire. Parce que le sujet particulier ne matrise ds labord ni laction ellemme ni le sens de la ralit quil produit, le sens de son action ne peut qutre dpos entre les mains de la communaut qui la reoit. LA. poursuit sa dmonstration en commentant les trois propositions qui ouvrent le premier chapitre de la logique de ltre ( tre, tre pur , Nant, le nant pur , Ltre pur et le nant pur sont donc la mme chose ). Ces trois formules ne sont pas des propositions de la raison (Stze). Elles sont dun autre logos qui laisse venir ltre la pense et au langage tout en les suscitant leur dimension cratrice : nonant ltre et le nant purs tels quils soffrent lui, le savoir dcouvre et nomme Mme leur pure possibilit de diffrenciation (p. 107), le rien entre ltre et son tre (p. 107) qui inaugure une pense de ltre. Cet autre logos (le logos spculatif) nest pas le simple arrangement systmatique des formes et dterminations de la pense. Il est bien plutt linquitude du savoir et de ses significations immdiates, la suspension de la langue et de la reprsentation qui laisse surgir ltre dans sa puret et sa vacuit, comme un mot vid de son vidence et devenant question. Ltre hglien nest ainsi ni fabrication, ni produit dune cause extrieure ; il nomme lacte pur de venir tre depuis le rien, cest--dire depuis limpossibilit dtre pens partir dun tant positif. Lessence nest pas plus lautre de ltre (120), mais elle nomme le faire du savoir pur (p. 122), les actes de rationalit (p. 122) qui font venir au jour la chose en elle-mme depuis elle-mme. La contradiction hglienne ne nomme pas le conflit des reprsentations, mais une crise de la pense (p. 127), cest-dire louverture de la dimension de la prsentation (Darstellung) du concept mme la conflictualit des propositions contradictoires. La constitution de la phnomnalit de ltre, cest la bance du conflit ; et la contradiction ne relve nullement la diffrence mais la produit comme ce qui permet la chose dapparatre (p. 147). LA. peut ainsi prsenter la logique hglienne comme une pense de la finitude, partir de la lutte fondamentale avec la limite 112
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
absolue (p. 108). Parce que la contradiction est lapparatre de la chose, cette dernire ne peut exister que dans le rapport son autre, ce qui nest pas elle. Le vivant se met en forme dans sa confrontation avec tout ce qui le limite, tout ce qui lui est autre. Cette interaction forme et dforme tout la fois la forme que le vivant avait dj et constitue le rel du monde comme une permanente reconfiguration de sens. La Logik, comme la Naturphilosophie, montre donc comment lide surgit du rel en tant que vie des formes finies. Il ny a pas forme mais formation incessante (p. 130), il ny a pas fiction mais un pur fictionnement (p. 130), il ny a jamais identit mais actes dans lesquels lidentit est produite, hergestellt (p. 126). LA. peut alors conclure son ouvrage en cherchant dans lexplication entre Heidegger et Hegel le lieu partir duquel la question de ltre pourrait se prsenter, se re-poser nous. Heidegger et Hegel ont tous les deux voulu dvoiler ltre, en de de toute mtaphysique de la substance, comme mouvement sans fondement dune incessante advenue soi dans lpreuve de la finitude. Il sagissait, pour lun comme pour lautre, de ne surtout pas interrompre la pense, mais de d-penser les positions donnes (p. 11), de maintenir ouvert le conflit, pour saisir ltre linstant de sa mue, mme le mouvement de son changement poqual (p. 173). Dans la double impossibilit principielle didentifier la diffrence et la chose commune des deux conceptions de ltre, il sagissait pour lA. de faire apparatre une certaine mmet comme affinit rciproque (p. 170), comme pur besoin et [la] pure possibilit de penser (p. 171) : cest parce que la chose reste inidentifiable quelle peut soffrir la pense et susciter des logoi incommensurables, cest parce que ltre nest rien de rvlable quil sagit de le dployer obliquement dans lexplication son sujet (p. 172). Ltre simpose au sortir de cette tude comme res publica o la possibilit et la ncessit de la pense ont lieu, tre en mue (p. 9) qui ne stiole ni ne se dissipe mais simpose comme absence, comme fond lmentaire do diffrentes figures et divers noms de ltre peuvent surgir (p. 177). Le parcours de louvrage accompli, permettons-nous deux remarques critiques propos de la lecture propose par lA. de la Science de la logique de Hegel. Signalons tout dabord que lA. utilise de prfrence, bien quen la rfrant au texte original et en se permettant du coup de parfois la modifier, la traduction date et non critique de S. Janklvitch. De faon plus gnrale, regrettons ensuite une lecture diagonale des trois tomes de la somme. Plutt que de faire droit au(x) rythme(s) dialectique(s) propre(s) et la performativit du discours ontologique de la ngativit de Hegel, Susanna Lindberg prfre 113
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
rsumer tel ou tel moment dialectique le commencement, ltre-l, lapparence et la rflexion, lidentit et la diffrence, etc. Une fois encore, cest sans doute parce que la lecture de Hegel doit, pour lA., alimenter soit un dfi, soit une indiscernabilit avec les thses de Heidegger, que les premires propositions de la Logique en sont rduites nexprimer que linquitude de tout savoir positif de ltre, que ltre-l signe tout juste l acceptation du fait quon ne puisse parler du soi que par rapport ce qui est tranger (p. 114) ; lapparence, le fait que ltre est dans sa faon de se montrer (p. 123), etc. Mais la fin justifie les moyens. Quentin Person
Sren Riis, Zur neubestimmung der Technik. Eine Auseinandersetzung mit Martin Heidegger, Tbingen, Francke Verlag, 2011, 304 p. Les multiples monographies (Pggeler, Luckner, Vaysse) consacres la question de la technique dans la pense de Heidegger lors de la dernire dcennie illustrent tout lintrt port par la recherche heideggrienne envers cette thmatique, dont lintitul de la rencontre heideggrienne de Messkirch du printemps 2011, Nature. Culture. Technique , constitue un tmoignage des plus rcents. Sinscrivant pleinement dans cette constellation, ltude dtaille mene par Sren Riis vise expliciter dans quelle mesure Heidegger, sans dvelopper de philosophie systmatique de la technique mais en imprgnant de cette question les divers linaments de sa pense, redtermine de faon ingale la teneur de la question de la technique dans le spectre de la pense contemporaine. Pour ce, le propos de lauteur sorganise en trois moments correspondant chacun laffirmation dune thse forte : le point de dpart est constitu par une explicitation de lessence de la technique moderne chez Heidegger avec lide dune technique moderne qui serait mettre au niveau dune nature vivante et non plus du rsultat dune production humaine laquelle correspondrait, quant elle, la conception antique de la technique. Ltude se poursuit en traitant de la proximit structurelle entre art et technique, selon laquelle la technique moderne peut se prsenter comme un art (p. 14) et elle aboutit dgager une pluralit de gnalogies possibles pour rendre compte de la naissance de la technique moderne (ibid.). Le travail se conoit ainsi dune part comme une tude critique immanente visant distinguer les considrations de Heidegger relatives la technique, selon par exemple que 114
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
cette dernire soit antique ou moderne, et proposant par extension dengager une confrontation densemble avec la pense de Heidegger comme lindique le sous-titre de ltude ; dautre part, ltude vise largir sa porte en proposant de situer la comprhension [heideggrienne] de la technique dans une thorie hermneutique de plus grande ampleur (p. 7), souhaitant ainsi affirmer toute lintensit du lien entre la question de la technique et celle de linterprtation. La revendication dune vritable singularit heideggrienne dans le traitement de la question de la technique grce lintroduction dune conceptualit spcifique (lautonomie du Gestell, lessence de la technique, le danger de luvre dart) dominant pralablement ltude se trouvera par consquent quelque peu nuance par la suite au profit dune rflexion largie mene par lauteur sur le caractre la fois visionnaire et prometteur du positionnement heideggrien au vu des dfis philosophiques contemporains et venir. Lauteur entend en effet confrer un caractre exemplaire la confrontation heideggrienne avec la question de la technique lre moderne, lassimilant un enjeu marquant de lhistoire de la philosophie grce lanalogie, tout fait heureuse, quil dresse avec le traitement platonicien de la question de la sophistique. La dtermination de la technique qui se dploie tout au long de louvrage revt deux caractristiques fondamentales : une immanence luvre dart dune part dans la mesure o, selon le mot de Heidegger, lessence de la technique nest absolument rien de technique et dautre part, un grand danger, consistant empcher lhomme de dvelopper une comprhension de la vrit comme phnomne, en la dvoyant comme correspondance ou vracit, le rendant ds lors prisonnier dune certaine interprtation du monde (p. 14), restreignant ainsi son pouvoir-tre homme. On pourra regretter que ltude nait pu prendre en compte la publication en 2009 chez Klostermann du volume 76 de la Gesamtausgabe intitul Leitgedanken zur Entstehung der Metaphysik, der neuzeitlichen Wissenschaft und der modernen Technik , et notamment de la troisime partie de ce volume prsentant des textes datant de la fin des annes 1940, prcdant la rdaction de la fameuse confrence de 1953, La question de la technique , sollicite dans la premire partie de ltude. Cette dernire aurait peut-tre gagn sur certains points une exhaustivit quantitative, obtenue la lumire de manuscrits nouvellement accessibles. Une telle contingence ditoriale est toutefois indpendante de ses grands mrites, clairant tout autant le Technikphilosoph que celui qui voudrait retrouver circoncis avec discernement et rigueur les cheminements heideggriens. Le travail de lauteur prsente loriginalit et la fracheur de souvent questionner, sans pour autant vouloir 115
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
la mettre en cause, lapproche de Heidegger en touchant lexplicitation de thmatiques essentielles dans sa pense (comme le statut de lessence) et en rpondant lambition difficile de maintenir malgr tout la technique et lart dans le libre jeu de louvert. Ariane Kiatibian
Iain Thomson, Heidegger, Art and Postmodernity, Cambridge, Cambridge University Press, 264 p. Faisant suite Heidegger on Ontotheology: Technology and the Politics of Education (Cambridge University Press, 2005), Heidegger, Art and Postmodernity est le deuxime livre dIain Thomson, Professeur de Philosophie lUniversit du Nouveau-Mexique. En prenant l onto-thologie pour fil conducteur de la dlimitation heideggrienne de lhistoire de la philosophie, son premier ouvrage avait interrog lengagement politique et pdagogique du penseur allemand face la technique moderne. En reprenant cette ide pour guide, ce nouvel opus entend montrer comment la rflexion heideggrienne sur lart cherche y faire face et comment elle permet ainsi dentrevoir la possibilit dune poque vritablement postmoderne. Sans doute sera-t-il difficile aux lecteurs francophones de trouver quelque nouveaut dans laffirmation voulant que lonto-thologie soit un concept-cl chez Heidegger. Selon Thomson pourtant, le concept explique aussi dans son uvre la critique de la technique moderne et indique combien la tentative qui y est faite de frayer un chemin vers une poque postmoderne est plus cohrente et persuasive (p. 33) que lon ne le croit dhabitude. Prsente dans le premier chapitre de son livre, la thse de lA. consiste soutenir que la technique moderne exprime ou est exprime par lontothologie nietzschenne, en vertu de laquelle la volont de puissance constitue lessence et la base de tout tant, alors que le retour ternel du mme constitue son sommet. Cette onto-thologie technique (p. 18) est la dernire forme de ce que Heidegger dcrit sous le titre de constitution onto-thologique de la mtaphysique . Nanmoins, Thomson ne considre pas ncessaire dexaminer de prs lessai de 1957 qui porte ce titre, essai jug difficile mais important (p. 36), tant on sait quil est bien lun des rares textes dans lequel Heidegger aborde lide de manire franche et directe. Ce parti pris risque bien sr de rendre la perspective de lA. simpliste, sinon rductrice, non seulement parce 116
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
quelle fait surtout dpendre la conception heideggrienne de la technique de la bien discutable Auseinandersetzung avec la philosophie de Nietzsche, mais aussi parce quelle obscurcit finalement le sens mme de lide donto-thologie. Thomson la confond avec la distinction des concepts dessence et dexistence (p. 14), puis avec une trange ide de proprits intrinsques (p. 21), cela sans la moindre explication. Voil qui est fort dcevant de la part dun auteur qui pointe souvent les exagrations dautres commentateurs de faon utile et intelligente. Deux chapitres sur la philosophie de lart heideggrienne sensuivent. Le premier examine la critique heideggrienne de lesthtique de faon claire, et mme originale, alors que le deuxime aborde sa conception postmoderne de lart. Ce chapitre tente en fait, sur plus dune vingtaine de pages, dpuiser la controverse quant linterprtation du tableau de Van Gogh dans la version finale de Die Ursprung des Kunstwerkes . Selon Thomson, Heidegger naurait pas simplement projet son interprtation plutt bucolique, puisque le tableau donne une sorte de prsence un rien imprsentable (p. 96). Mais il est bien difficile de voir comment le fait de souligner ce rien sert dfendre lapproche heideggrienne contre ses critiques : si le rien nest rien dautre que le conflit du monde et de la terre, lon comprenait dj trs bien Heidegger ; sil ne lest pas, il faut lA. expliquer comment on procde, dans linterprtation du tableau, de lun lautre. Il est possible de critiquer les dtails des thses de Thomson, mais lon ne saurait nier que ce deuxime livre, comme le premier, fait preuve dune matrise impressionnante du corpus heideggriens et des tudes qui lui sont ddies. Ce nest que dans le quatrime chapitre cependant que lA. justifie sa tentative de restituer lide du postmoderne en philosophie ide qui est particulirement approprie la pense historique heideggrienne et de la rclamer des cultural studies contemporaines. Ce faisant, Thomson offre une lecture intressante de La condition postmoderne de Lyotard et, en mme temps, se montre trs a laise dans la pop philosophy. Le chapitre qui lui est consacr interroge le sens postmoderne des chansons de U2, alors que le cinquime de louvrage analyse The Watchmen, une bande dessine. Dans toutes ses analyses duvres dart, Thomson crit avec loquence, et cest avec perspicacit quil porte une attention particulire des dtails souvent inaperus jusque-l. Les deux derniers chapitres de son livre en reviennent une lecture plus directe de luvre heideggrienne en abordant la structure, dcrite comme fugue , des Beitrge zur Philosophie, comme le rapport quentretiennent les ides de danger et de promesse dans la pense tardive du natif de Messkirch. 117
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Mais ce retour des thmes plus strictement philosophiques en fin douvrage ne saurait cacher le fait que Heidegger, Art, and Postmodernity a la forme dun recueil darticles six des sept chapitres ont dj t publis ailleurs , plus que celle dune monographie parfaitement structure. Mark Sinclair
Timothy Stanley, Protestant Metaphysics after Karl Barth and Martin Heidegger, Londres, SCM Press, Veritas, 2010, 275 p. La littrature secondaire compte relativement peu dtudes tentant une comparaison des penses de Karl Barth et de Martin Heidegger. En fait, aucune monographie navait encore t consacre ce sujet. Pourtant, ces deux figures majeures de la pense du XXe sicle se connaissaient, se citaient et se discutaient mutuellement en certaines occasions ; sans compter que deux points au moins les rapprochent : linscription radicale dans leur poque ou plutt contre celle-ci dune part ; certains de leurs objets de recherche dautre part. Ces deux points sont ceux qui semblent fonder en partie la prsente tude qui, cependant, les problmatise dune manire relativement originale. Son objectif nest pas tant de rapprocher tout prix Heidegger de Barth ou linverse que dclairer les relations existantes, possibles ou impossibles entre leurs penses respectives en pointant des diffrences irrductibles, en particulier dans la faon dont ils se rapportent la tradition. De ce point de vue, Barth nest plus seulement le prcurseur de Heidegger, mais un interlocuteur aussi valable que lui dans la discussion de toutes les problmatiques philosophicothologiques contemporaines, et il nest plus question dinterprter la thologie barthienne selon lhistoire heideggrienne de lonto-thologie, mais de voir comment le thologien et le philosophe articulent la question mtaphysique diffremment, cependant quils labordent tous deux avec des outils et selon des reprsentations issus du protestantisme. Notons demble que la prtention de lauteur nest pas quhistorique. Certes, il sagit dexaminer de prs les textes de Barth et de Heidegger, mais cet examen accompagne une rflexion sur le futur du protestantisme qui, au mme titre que les autres religions et confessions, se transforme progressivement, sous la contrainte des temps, en un objet postmoderne . Nous ne sommes pas totalement convaincu de lintrt dassortir ltude comparativo-gntique de deux auteurs tels que Barth et Heidegger dune tude prospective se plaant demble dans lre 118
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
postmoderne, sans mme avoir expliqu comment nous y sommes entrs. Mais soit. Le problme de ce livre est plutt quil comporte deux grandes parties distinctes la premire sur Heidegger, lautre sur Barth qui ne font pratiquement jamais rfrence lune lautre, en sorte que lon peut remettre en question la ncessit de les runir dans un mme ouvrage. ce titre, lauteur ne remplit donc que trs imparfaitement lobjectif quil se fixe dans sa Prface, savoir clairer un auteur par lautre. Considrons maintenant chaque partie pour elle-mme puisque, au fond, cest ainsi quelles sont penses. Celle sur Heidegger se compose de deux chapitres. Dans le premier, La croix de Heidegger , lauteur introduit la critique heideggrienne de lonto-thologie en suivant essentiellement linterprtation quen ont propose Jacques Derrida et Jean-Luc Marion. Il dveloppe cependant une hypothse de travail intressante selon laquelle, en se penchant sur le rapport entre phnomnologie et thologie en particulier dans la fameuse confrence de Marbourg en 1927 , Heidegger envisage deux projets distincts. Le premier est celui quon connat : sparer ou librer la phnomnologie et lontologie avec elle de la thologie. Le second est celui quon nglige trop souvent : penser une thologie sans ltre dote dune vraie effectivit et donc capable de sauver sa manire. Le second chapitre de la premire partie, La thologie protestante aprs Heidegger , semploie en partie retracer les origines de ce projet dans les premiers cours de Fribourg et de Marbourg. Il comporte, entre autres, un rsum assez clair de linfluence du jeune Luther sur le jeune Heidegger. Lui succdent malheureusement sans transition un aperu des emprunts de Bultmann et Tillich la pense heideggrienne mais laquelle ? puis une lecture sans clats de la Kehre qui sarticulent difficilement ce qui prcde. La toute fin de cette premire partie prpare la seconde en remettant en cause juste titre lide trs rpandue selon laquelle Barth ne pourrait faire lobjet daucune lecture philosophique moins de dformer sa prima intentio. Lauteur prcise raison que si lon prend pour rfrence la philosophie telle que Heidegger la conoit et la pratique et telle quon la conoit et quon la pratique depuis Heidegger , alors la thologie dialectique relve bien dun certain existentialisme philosophique, cependant que celui-ci ne se dveloppe pas partir dune conception parfaitement heideggrienne de lonto-thologie et de son histoire. Cet cart ou cette diffrence fait prcisment lobjet de la seconde partie. Celle-ci est en un sens plus matrise que la premire, plus ferme aussi. Elle traite tout dabord du jeune Barth, celui du Rmerbrief de 1919/1922, et du rle trop souvent minor quont jou Luther et ses matres luthriens dans son 119
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
dveloppement thologico-religieux. Elle explore ensuite la relation du blois saint Anselme travers une relecture plutt novatrice du Proslogion et de ltude que le thologien lui a consacre dans les annes 1930 (Fides quaerens intellectum). Elle se penche galement sur le Barth de la maturit, celui de la Kirchliche Dogmatik, afin de montrer comment il refonde la question ontologique et lontologie elle-mme partir des notions de Parole et de Rvlation de Dieu. Elle examine enfin la christologie barthienne et le problme de lanalogie la lumire de tout ce qui a t dgag auparavant. Lide gnrale est que Barth dveloppe une lecture sans concession de la tradition mtaphysique tout en sauvegardant ce qui, en elle, semble inspir dune intervention de lhistoire du salut dans lhistoire profane. Le nom de Heidegger nest presque jamais invoqu dans cette seconde partie. Il ne retrouve droit de cit que dans la conclusion, o lauteur explique que savoir ce que la confrontation de Heidegger avec lonto-thologie peut apporter la thologie protestante aujourdhui implique de faire retour la tradition vanglique partir de laquelle le philosophe a procd la dconstruction de cette lame de fond qui a soulev et port lhistoire de la pense au moins jusqu la fin du XIXe sicle. Nous nous accordons volontiers avec lauteur sur ce point, mais nous ne sommes pas sr que louvrage quil signe offre les moyens systmatiques de sorienter adquatement dans la problmatique et dentreprendre concrtement la tche gigantesque qui se dessine lhorizon. Sylvain Camilleri
Makito Shigeru, Haideg to shingaku [Heidegger et la thologie], Tokyo, Chisenshokan, 278 p. Ce livre, Heidegger et la thologie, est la premire tude sur Heidegger et la thologie chrtienne au Japon. Selon sa prface, il se compose darticles publis depuis 2001 par lA., quoique tous aient t remanis. Ce livre possde donc une relle unit. Il dsire lucider pour ainsi dire le et qui lie Heidegger la thologie. lucider disons-nous, car llucidation, autrement dit lErrterung, est la recherche ou la localisation du lieu . Or, cest prcisment le lieu du travail collaboratif de la thologie et de la philosophie par lissue dune impasse dans laquelle la thologie chrtienne se trouve aujourdhui qui est ici dtermin, ce site quest la pense heideggrienne ayant rendu possible un nouveau dialogue entre philosophie et thologie. 120
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Prcisons la substance du livre. Celui-ci est divis en deux parties la premire compte huit chapitres, la deuxime deux. La premire partie traite, comme telle, de la relation de Heidegger la thologie. Elle claire son devenir au cours des annes 1920 et clarifie, aprs 1930, des thmes tels que Dieu, le langage, Hlderlin, Schelling ou la vrit. En usant de Heidegger comme dun tremplin, la seconde partie semploie penser la possibilit dune nouvelle philosophie de la religion. La thse de lA. est de placer lide du Dieu cach au cur de la pense heideggrienne. Cherchant ressaisir lide de la vie de la foi dans lglise primitive, une ide laquelle le jeune Heidegger est parvenu en travaillant Luther, Makito Shigeru livre un certain nombre dindices en vue de reparcourir le Denkweg heideggrien. ses yeux, la thologie du Dieu cach montre la dimension transcendante prsente dans lantagonisme entre le Dieu cach dans la rvlation et le Dieu qui apparat comme phnomne. Cette ide est le moteur de la critique heideggrienne du systme mtaphysique, dfini comme ontothologie. Comprenons-le bien, pour lA., le dpassement heideggrien de la mtaphysique est men partir de la tradition thologique du Dieu cach , tradition que vient nourrir le concept du dernier Dieu (letzter Gott) dans les Beitrge zur Philosophie. Prsent comme dcoulant de la destruction du Dieu mtaphysique, le dernier Dieu est tenu par lA. comme le Dieu vivant ou encore comme le Dieu digne de Dieu , le silence de Heidegger sur le dernier Dieu aprs 1940 ntant pas jug signer lathisme de Heidegger, mais plutt signifier la tentative qui est la sienne pour se tenir face Dieu honntement . Makito Shigeru peut alors faire la part belle aux considrations heideggriennes sur la thologie ngative. partir de Hlderlin et de Schelling, lA. met au jour la figure du Dieu comme absence de fondement, un Dieu qui nest plus causa mais Ab-grund. Dans la deuxime partie de son livre, lA. examine la possibilit de construire une philosophie chrtienne lpoque post-mtaphysique , philosophie qui dfinirait de manire forcment philosophique les fondements de la foi . Makito Shigeru soutient que cest une logique du paradoxe qui est mme de fonder une telle philosophie, logique selon laquelle lhomme qui na pas de pch confesser en expie malgr tout, et selon laquelle lhomme sent la grce de Dieu au moment o celui-ci semble labandonner ainsi dans lpreuve. Cette logique nest bien sr pas celle de la mtaphysique, mais une logique de lamour et de lesprit qui permet de dcrire ltat de la foi dans la "faktische Lebenserfahrung" . Dpassant le cadre de la simple analyse de textes, lA. finit par affirmer que la pense 121
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
heideggrienne a servi la philosophie chrtienne la plus rcente plus quon le croit dordinaire, ce qui selon lui ne remet pas en cause lide quavec ou sans le penseur allemand, cette philosophie ne peut tre quun cercle carr. Kazunori Watanabe
122
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
INSTRUMENTUM CONCORDANCE HEIDEGGER par Franois JARAN & Christophe PERRIN Index nominum Antiquit II (De Socrate Plotin, IVe IIIe s. ap. J.-C.)
ANTISTHNE [Antisthenes, Antistheniker, antisthenisch-] 15 369 18 157 19 502-504, 506, 508-511, 514, 551, 569, 570, 581, 582, 648 22 17, 127, 134, 273, 275, 278 33 23 ARISTOTE [Aristoteles, Aristoteliker, Aristotelis, Aristotelismus, aristotelisch-, nacharistotelisch-, vor-Aristoteliker, voraristotelisch-] 1 15, 33, 34, 46, 49-51, 53, 55, 56, 67, 92, 93, 123, 175, 180, 193, 194, 197, 201, 202, 204, 205, 211, 223, 242, 260, 263, 287, 378, 386, 403 2 3-5, 14, 18, 24, 34, 35, 43, 45, 52, 53, 114, 125, 184-186, 211, 227, 264, 275, 282, 284, 290, 298, 299, 324, 452, 527, 531, 556, 564, 566, 570, 571/SZ 2, 3, 10, 14, 18, 25, 26, 32, 33, 39, 40, 93, 138-140, 159, 170, 199, 208, 212-214, 219, 225, 226, 244, 341, 399, 421, 427, 428, 432, 433 3 6-8, 12, 56, 129, 220, 221, 222, 225, 241, 246, 290, 293, 308 5 15, 22, 77, 80-82, 87, 98, 101103, 128, 194, 195, 238, 249, 263,
322-325, 331, 340, 341, 344, 351, 368, 371 6.1 17, 52-54, 61, 62, 78, 80, 151, 193, 247, 248, 358, 406, 446, 450, 460, 463, 500, 530, 536, 538, 540, 541-546 6.2 8, 9, 11, 61-63, 65, 96, 97, 115, 116, 124, 141, 148, 157, 190, 193, 203, 204, 206, 212, 310, 313, 366-369, 371-374, 377, 379-381, 391, 392, 396, 400, 413, 418, 432, 433 7 10, 11, 14, 32, 43, 44, 46, 75, 156, 170, 218, 265, 268 8 47, 75, 78, 81-83, 99, 103-105, 112, 199, 200, 215, 219, 225, 226, 231, 239 9 4, 76, 84, 124, 125, 128, 129, 133, 170, 181, 232, 235, 242, 243, 245, 246-249, 251, 252, 254, 255, 257-262, 264-266, 270-287, 289, 293-295, 299-301, 314, 332, 348, 354, 355, 363, 379, 380, 434, 437, 438, 442 10 19, 23, 92-95, 102, 103, 107, 112, 117, 158, 163 11 11, 15-18, 22, 26, 63, 145, 146 12 53, 88, 192, 232, 233 14 13, 15, 55, 84, 85, 89, 93, 97-99, 147, 148 15 10, 18, 42, 54, 121, 135, 140, 144, 172, 188, 207, 220, 226, 246, 247, 263, 264, 272, 283,
123
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
288-290, 301-304, 318-320, 326, 328-330, 335, 337, 346, 348-350, 352, 370, 377, 378, 384, 428 16 29, 30, 38, 41, 44, 357, 423, 633, 659, 708, 778 17 5-13, 15, 17-22, 24-27, 29, 31, 33-35, 38, 40-43, 48, 51, 52, 111, 118, 119, 121, 131, 132, 138, 153, 155, 156, 162, 164, 168-170, 173, 176, 181, 183, 187, 189, 190, 192, 194, 195, 207, 210, 214, 216, 223, 247, 251, 293, 295-298, 304, 309, 312, 316 18 3-6, 9, 10, 12-17, 19, 21-24, 26, 28-33, 35-37, 39, 41, 43-50, 5255, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 72-77, 79, 80, 82-85, 88, 90-94, 96-98, 101, 103-105, 107-111, 113-124, 126, 128-131, 133-136, 140, 142-146, 152, 153, 155, 156, 158-160, 162-165, 167-172, 174178, 182, 183, 185, 187-202, 204, 205, 207-211, 213-216, 218-220, 223, 225-241, 243-252, 256, 258, 260-262, 264-266, 277-279, 283287, 289-294, 297-299, 301, 302, 304-310, 312-317, 319, 321-325, 327, 328, 333-335, 337-340, 342, 343, 345, 346, 350-352, 366, 368, 369, 375, 376, 379, 381, 385, 386, 388-394, 400, 403 19 2, 10-16, 18, 19, 21-23, 27-35, 37-39, 42, 44, 45, 47, 48, 51-53, 55-68, 70, 72, 73, 77-79, 82, 84-91, 93-97, 99-101, 103, 105, 106, 108, 111118, 120-126, 130, 132-138, 140144, 148, 151, 154, 155, 157-173, 175, 176, 178, 180-191, 194, 196, 198-201, 203-225, 228, 229, 231, 124
242, 252, 265, 269, 277, 283, 285, 286, 306, 308, 310, 313, 321, 335-339, 349-351, 376, 378, 380, 412, 413, 420, 421, 432, 435-438, 441, 449, 456, 457, 460, 469, 483-485, 501-505, 507, 509, 510, 516, 519, 522, 524-527, 550, 552, 553, 557, 561, 569, 571-573, 587, 589-592, 595, 608, 609, 613, 614, 616-618, 621, 622, 625-627, 629, 630, 633, 638, 640, 642-644, 649 20 3, 11, 23, 27 ? 35 ? 45, 73, 87, 94, 115, 116, 179, 184, 201, 204, 234, 301, 302, 380, 393-396, 418 21 4, 5, 13, 14, 23, 25-27, 34, 42, 56, 89, 98, 109, 121, 123, 124, 127-133, 135, 136, 138, 139, 141-143, 146, 150, 160-164, 166-173, 180-184, 190, 191, 193, 204, 215, 247, 249, 250, 252, 255, 259, 262, 263, 265, 266, 268, 282, 321, 337, 410-412 22 11, 12, 15, 16, 21-24, 30, 30-33, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52-54, 57, 60, 71, 73, 76, 79, 80, 86, 87, 90, 92, 93, 114, 124, 134, 135, 143149, 151, 152, 155, 157, 163-165, 168, 176, 180, 182-184, 195-197, 199, 200, 202, 205-209, 212-220, 222-224, 226, 228-230, 233, 240, 242, 243, 245-248, 250-252, 261, 275, 276, 278, 282-286, 288-300, 302, 305-308, 310, 311, 313, 315-330 23 2-4, 10, 13, 15, 27, 32, 33, 41, 43-46, 53, 60, 61, 63, 68-73, 78, 89, 92, 95, 103, 109, 145, 155, 164, 168, 171, 172, 184, 200, 231 24 19, 20, 26, 30, 32,
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
38, 72, 103, 108, 110-113, 119, 121, 124, 136, 142, 144, 148, 153, 154, 167, 254-262, 267, 269, 275, 282, 284-286, 290-292, 297, 298, 304, 305, 307, 308, 310, 325, 327-345, 347-355, 357-363, 367370, 372, 374, 385-387, 409, 449, 454, 468 25 11, 12, 15, 64, 123, 144, 150, 167, 171, 173, 180, 181, 217, 261, 278, 294-296, 304, 397 26 4, 5, 7, 10-14, 17-19, 22, 27, 29-31, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 63, 74, 75, 93, 99, 104, 105, 113, 132, 136, 137, 156, 166, 178, 183, 184, 188-192, 235, 237, 256, 257, 263, 280, 281 27 1, 19, 46, 47, 51, 57-59, 142, 143, 155, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 216, 224, 249, 250, 256, 270, 372, 389 28 3, 23, 26-29, 31, 34, 35, 99, 133, 216, 220, 266, 273, 277, 296, 302, 335, 350, 358-361 29/30 7, 24, 42, 44, 48-50, 52-58, 62, 64, 65, 67-70, 72, 75-80, 94, 127, 271, 384, 439, 441-449, 451, 454-459, 461-467, 469-475, 480, 484, 485, 487, 488, 490, 491, 495, 498, 506, 507, 511, 522, 530 31 15, 31, 37, 48, 55, 58, 59, 65, 67-71, 73, 7687, 89-96, 98, 100-108, 115, 120, 203, 221, 296 32 11, 110, 118, 141, 144, 149, 176, 177, 183, 191, 204-206, 210 33 3, 4, 6, 7-14, 16, 18, 19, 26-35, 37-47, 51-59, 61, 63, 64, 66, 67, 69-71, 73, 74, 77, 80-83, 85, 87, 89-94, 97-99, 102, 104-107, 109-115, 120, 123-127, 130, 131, 133, 135-137, 139-141, 125
143, 144, 147, 149-157, 161-169, 171-184, 188, 189, 192, 194, 195, 197-212, 214-216, 219-221, 223, 224 34 8, 13, 16, 17, 36, 51, 120, 123, 124, 130, 137, 144, 154, 172, 222, 225-227, 244, 245, 252, 319, 332 35 2, 6, 8, 12, 18, 28, 34, 82, 104, 139, 148, 185, 193, 203, 213, 217, 220, 222, 237, 257, 263 36/37 18, 20, 23, 28, 34, 56, 58, 60, 73, 102, 103, 105, 121, 123, 157, 158, 222, 238, 240, 270, 285, 286 38 2, 6, 104, 105, 141, 142 40 18, 44, 62, 64, 65, 86, 102, 129, 133, 145, 179, 188, 194, 196, 197, 215, 218, 225, 227, 229 41 33, 38, 43, 44, 48, 49, 81-83, 85, 86, 90, 97, 99, 100, 107, 108, 113, 117, 119, 124, 135, 153, 155, 156, 158, 163, 175 42 47, 49, 87, 110, 131, 278 43 23, 64-67, 74-76, 93, 96, 182, 236, 286, 289 44 28, 147, 210, 222 45 9, 15, 33, 39, 43-46, 48, 51, 52, 56-61, 63, 69-73, 75, 78, 92, 95, 97-99, 101, 102, 111, 117, 121, 136, 155, 156, 193, 204, 205, 220-222 46 28, 125, 173, 180, 244, 319, 330, 332, 349, 353, 363, 371 47 32, 36, 50, 53, 101, 137, 188, 190, 197, 199-207, 209-213, 282 48 36, 46, 64-66, 68, 81, 118, 162, 164, 172, 173, 180, 199, 207, 238, 289, 303, 304, 307, 313, 314 49 17, 21, 28, 45, 47, 48, 51, 52, 64, 77-79, 81, 83, 84, 87, 111, 145, 146, 150, 158, 159, 162, 169, 175, 186, 198 50 130 51 108,
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
120 52 104, 152 53 57, 65, 99, 102, 105 54 2, 11, 14, 15, 50, 72-74, 113, 131, 147-149, 173, 185, 195, 206, 207, 210, 212, 231, 235 55 6, 21, 35, 38, 52, 54-57, 74-78, 80-82, 102, 107, 115, 116, 132, 227, 231, 234, 235, 238, 239, 251, 252, 255, 256, 257, 273, 311, 312, 314, 318, 346, 360, 361, 364, 365, 381, 384, 400 56/57 9, 17, 27, 67, 78, 79, 81, 155, 183, 184 58 7, 61, 90, 132, 189, 205, 212, 214, 225 59 12, 88, 94, 188 60 56, 97, 104, 143, 159, 160, 206, 303, 306, 313 61 1-8, 11, 21, 44, 72, 79, 93, 108, 110, 112, 115, 116, 183, 192 62 1-6, 9-11, 13-15, 17, 18, 20, 27, 33, 39-41, 43-47, 49, 52-56, 59, 6164, 67, 69-72, 78-80, 83, 87-91, 96, 98-101, 103-106, 109-112, 117, 119, 121, 122, 124, 125, 128-132, 135, 138, 139, 141, 142, 145, 148, 152, 154, 157, 159, 165, 167, 169, 170, 174, 179, 180, 182, 183, 186-188, 190-192, 195, 198201, 204-210, 213, 214, 219, 229, 231, 233-240, 242-252, 254-257, 259, 260, 265-267, 269-280, 283, 291-297, 300, 301, 305, 306, 309-319, 321-330, 332, 334, 336, 338, 339, 354, 356, 366, 367, 369-375, 377, 379, 384, 387-390, 392-395, 397, 399, 405, 412 63 5, 10, 11, 21, 26, 27, 42, 43, 45, 47, 71, 76, 105, 106 64 10, 13, 17, 18, 51, 77, 78, 80, 83, 100, 101, 109, 113, 124 65 64, 70, 75, 126
138, 162-164, 184, 191, 193, 197, 210, 211, 215, 232, 233, 257, 281, 289, 313, 314, 333, 334, 359, 362, 366, 373, 376, 457, 469, 478 66 48, 107, 110, 169, 177, 191, 195, 211, 241, 272, 273, 299, 344, 370, 373, 378, 383, 388, 389, 397, 412, 421, 422, 423 67 5, 6, 23, 37, 56, 64, 89, 90, 95, 101, 126, 127, 135, 153, 211, 214 68 50, 81, 94, 101, 106-108, 111, 132 69 7 132 133 160 70 101 71 15, 21, 25, 58, 61, 70 74 6, 74, 164, 191, 193 75 353 76 15-17, 21, 22, 24-28, 31, 33, 34, 36, 38-42, 68, 126, 130, 153, 169, 170, 188, 279, 280, 316 77 14, 24, 55 78 1, 6, 8, 12, 15, 20, 28, 41, 55, 84, 89, 100, 105, 106, 158, 191, 192, 212, 219, 220, 226, 227, 229, 231, 233, 234, 275 79 7, 107, 108, 142, 143, 147, 168 81 253, 286 85 54, 154, 172, 173 87 10, 56, 72, 101, 135, 172, 175, 207, 210, 232, 255, 272, 273, 299, 300 88 7, 16, 30, 55-57, 59, 67, 77, 82, 85, 100, 106, 108, 138, 139, 141-143, 152, 169, 171, 180, 183, 190, 194, 238, 242, 259, 269, 297, 305, 308, 310, 311, 322, 327, 328 90 5, 123, 133 AUGUSTIN [Augustin, Augustiner, Augustinismus, Augustinus, augustinisch-] 1 430 2 59, 185, 227, 253, 264, 564/SZ 43, 139, 171, 190, 199, 427 5 367 7 257 8 29, 64, 104,
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
105, 262 9 144, 154 15 309 16 5, 41, 44, 563, 599, 602 17 119, 120, 125, 131, 150-156, 158, 159, 276, 305, 310 18 178, 261 20 180, 222, 379, 380, 393, 394, 404, 418 21 123, 211, 249, 399 22 179, 261, 331 23 3, 14, 41, 49, 69, 77, 78, 109, 110, 132, 221, 222, 225, 226 24 115, 130, 325, 327, 329, 361 26 63, 169, 178, 188, 222, 256, 257 27 243, 244, 246, 247, 265, 297 31 21, 120 34 72, 227 36/37 154, 172 39 129 46 125, 308, 309, 365 48 215, 301 49 48 54 143 55 30, 107, 275 58 57, 62, 205, 212, 238 59 1, 94 60 68, 98, 111, 114, 121, 158-164, 166-173, 175-178, 180, 182, 184, 186-188, 190, 192-194, 196-198, 200, 202206, 208-212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230-232, 234236, 238, 240-242, 244, 246, 247, 249, 256, 259-261, 263-265, 270, 272, 273, 275-277, 279, 281, 283287, 289, 290, 292-296, 298, 303 61 183 62 44, 45, 101, 330, 336, 369-371 63 12, 13, 23, 41, 105107, 111 64 18, 37, 44, 111 65 154, 202, 211, 213, 376 66 423 68 16, 77 69 159 74 185 76 11 79 15 87 168 88 87, 88, 328 89 45-47, 143, 323 90 155, 298, 444 CHRYSIPPE [Chrysipp] 22 157
CICRON [Cicero] 6.1 1 6.2 375 10 147, 148, 189 11 87 14 81 19 308 21 5 22 89 27 22 43 3 46 124, 365 55 20, 27, 40 76 196 89 117 DMOCRITE [Demokrit, Demokritos] 9 268 18 230, 231 19 2, 646 21 373 22 14, 39, 79-82, 89, 219, 220, 241, 242, 244, 245, 278 33 98 34 134, 293 36/37 227 41 80, 81, 211 58 89 62 129, 323 69 155 87 17 DIOGNE LARCE [Diogenes Lartius, Diogenes Laertios] 7 265 15 264 21 4 57 35 100 55 10, 19, 35 PICTTE [Epiktet] 33 208 PICURE [Epikur, Epikurer, epikurisch-] 6.1 272 7 270 8 74 19 2 22 21 44 55 45 220 54 35, 40 90 135 EUCLIDE [Eukleides, Euklid, euklidisch-] 6.1 532, 533 8 42, 43 10 22, 33 19 439, 479 22 51, 59, 109, 110 23 12 29/30 60 33 162 34 327 36/37 31, 47, 48 47 192, 193 ISOCRATE [Isokrates] 40 203 22
127
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
LEUCIPPE [Leukippos] 22 39, 79, 80, 219, 241, 242, 244 PHILOLAOS [Philolaos] 35 227 53 140 PHILON DALEXANDRIE [Philon, philonisch-] 22 15 62 44 PLATON [nachplatonisch-, Neuplatoniker, Neuplatonismus, Plato, Platon, Platoniker, platonisch-, platonisierend-, Platonismus, platonisch-, pseudoplatonisch, Vorplatoniker, vorplatonisch-] 1 1, 24, 46, 170, 204, 339, 365, 415 2 1, 3, 8, 14, 34, 43, 51, 52, 211, 527, 529, 531, 559/SZ 1-3, 6, 10, 25, 32, 39, 159, 244, 399, 400, 402, 423 3 8, 12, 239, 290, 293, 295, 307, 308 4 121, 134, 135, 179 5 82, 91, 98, 101-103, 105, 177, 195, 216, 217, 221, 232, 261, 263, 321-325, 340, 341, 344, 371 6.1 17, 23, 27, 70, 72, 78, 142, 143, 151-158, 161-170, 172177, 180, 183-186, 188-194, 198213, 215, 216, 220, 227, 388, 409, 421, 440, 446, 454, 456, 460, 463, 476, 486-488, 491, 496, 500, 527, 528, 530, 556, 570 6.2 8, 12, 15, 65, 71, 97, 103, 104, 113, 116, 118, 119, 122, 124, 179, 182, 187, 189, 190, 193-204, 206-208, 210, 213, 215, 227, 228, 231, 232, 245, 246, 263, 282, 309, 310, 312, 313, 128
367, 371-374, 377, 379, 380, 408, 413 7 12, 14, 18, 21, 31, 32, 36, 41, 46, 80, 86, 108, 115, 121, 124, 170, 187, 243, 257, 265, 268, 271, 277 8 12, 29, 42, 47, 66, 75, 76, 81-83, 112, 168, 187, 188, 199, 200, 203, 204, 219, 225, 226, 228, 231, 232, 255, 262 9 4, 122, 131, 133, 160, 161, 198, 203, 213-215, 217-219, 221-231, 234-238, 242, 275, 281, 301, 314, 315, 320, 322, 326, 328, 332, 334, 338, 341, 348, 354, 380, 395, 396, 400, 434, 437, 443 10 22, 24, 25, 69, 92, 95, 141 11 11, 12, 15-17, 22, 33, 34, 131, 147 12 30, 49, 67 14 13, 55, 60, 66, 70, 71, 76, 82, 84 15 10, 17, 36, 44, 159, 192, 201, 236, 239, 246, 266, 278, 289, 301, 304, 323-326, 328, 329, 369, 370, 424, 427, 428 16 37, 59, 71, 117, 218, 354, 373, 403, 413, 628, 629, 665, 728, 729, 737 17 18, 26, 78, 94, 95, 98, 155, 158, 177, 192, 214, 295, 313 18 5, 7, 9, 13, 14, 26, 31, 37, 84, 91, 95, 108, 109, 136, 137, 140, 143, 229, 288, 291, 297, 298, 301, 302, 305, 310, 319, 320, 329, 334, 335, 349, 352, 366, 385, 400, 402 19 1, 7, 9-14, 16, 21-23, 27, 45-47, 51, 52, 65, 68, 78, 85, 86, 100, 101, 103, 111, 120, 121, 124, 136, 163, 164, 189-195, 197-199, 201, 204-206, 210, 212, 216-220, 222, 228, 229, 231-233, 236, 238, 239, 242, 245, 246, 248-250, 252-254, 263, 266, 269, 271, 272, 275, 277-279, 285-298,
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
289, 292, 294, 304, 306-315, 318-322, 324, 325, 329, 332-335, 337-340, 343-354, 362, 367, 368, 375-380, 384-391, 393-397, 399, 400, 403, 404, 407-413, 415, 419-422, 424, 428, 432, 435-440, 444-447, 449, 451-454, 459-463, 466, 467, 469, 472-476, 479, 482-487, 489, 490, 492, 494-496, 498, 501, 502, 507, 508, 510-514, 516-519, 521-524, 526, 527, 529535, 539, 541-548, 552, 553, 556, 558, 559, 561-563, 566, 567-573, 575, 577-592, 594, 596-599, 603, 606-609, 611, 612, 621, 625, 629, 630, 638, 639, 641-643, 645, 646, 649, 652, 653 20 3, 99, 100-102, 109, 179, 180, 184, 201, 204, 235, 302 21 4, 13, 28, 52, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 70-72, 77, 92, 124, 142, 143, 163, 168, 169, 191, 193, 249, 337, 410 22 10, 12, 14, 15, 21, 28, 35, 40, 42-46, 51, 52, 64, 66, 70, 79, 84-86, 88-90, 92100, 102, 104, 106-109, 111-115, 117-121, 124, 125, 134, 140, 141, 143-146, 151, 179, 192, 193, 195, 196, 205, 207, 208, 216, 219, 220, 222-224, 235, 241, 243-245, 246, 248, 251, 252, 254, 255-258, 261, 262-269, 271-278, 280-286, 288, 290, 294, 298, 300, 313, 315, 317, 329, 331 23 3, 15, 27, 32, 33, 69, 72, 75, 95, 110 24 30, 40, 45, 72-75, 103, 113, 115, 151, 152, 154, 157, 174, 260, 275, 283, 295, 297, 307, 325, 400-405, 453, 461, 463, 464, 468, 469 25 3, 15, 45, 129
46, 117, 140, 167, 181, 261, 300, 397, 398, 405 26 5, 7, 10, 19, 27, 49, 52, 88, 98, 132, 140, 143, 180, 183, 184, 186, 187, 189, 191, 233, 237, 255, 281, 284 27 1, 24, 46, 57-60, 143, 154, 155, 169, 177, 187, 215, 216, 220, 224, 225, 235, 249, 314, 317, 319, 321, 372, 386 28 3, 23, 26, 29, 45, 115, 133, 252, 273, 276, 279, 282, 351, 352, 357-359 29/30 23, 34, 53, 55, 75, 271, 439, 484 31 37, 46, 48, 50, 55, 61, 63-65, 68, 70, 72, 74, 76, 89, 96, 115, 196 32 11, 15, 76, 93, 110, 118, 149, 183, 204 33 5, 13, 24, 27, 28, 30, 3739, 43, 60, 98, 125, 128, 137, 154, 162-165, 197-199 34 16-19, 21, 22, 25-27, 30, 31, 35-37, 44-48, 51, 52, 60, 66-68, 70, 71, 77, 82, 83, 85, 86, 88, 92-97, 99-112, 116, 118-126, 129, 130, 133, 134, 137, 146, 149, 151, 152, 154, 157, 158, 163, 164, 168, 169, 172-177, 180, 181, 185-188, 191, 194, 196, 197, 199, 203-205, 211, 215-218, 221-227, 232, 238, 241, 244, 245, 247-250, 252, 260, 262, 263, 265-267, 269, 270, 276, 279, 280, 283, 287, 289, 291, 293-296, 299, 300, 302, 305-307, 311, 312, 314, 315, 317, 318, 320, 324, 325, 328, 331, 332 35 18, 34, 89, 104, 148, 160, 184, 210, 217, 222, 223, 231, 237, 238, 263 36/37 18, 32, 34, 35, 85, 102, 123-125, 127, 128, 132, 135, 138, 145-148, 150, 151, 157, 164-171, 174, 179-182, 186,
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
189-196, 198-200, 202-207, 220222, 229, 231, 233, 234, 236, 237, 240-245, 248-252, 254-259, 287291, 295, 296 38 2 40 19, 44, 61, 62, 70, 71, 102, 113, 129, 130, 145, 179, 188-191, 193, 194, 205, 207, 218 41 2, 33, 38, 43-45, 48, 49, 76, 81, 83, 91, 99, 113, 153, 155, 211 42 10, 47, 49, 87, 90, 96, 140, 154, 158, 212 43 23, 30, 35, 85, 87, 93, 171, 182, 184-190, 193, 196-215, 218-220, 222-236, 238, 240-263, 265, 266, 270, 280, 285-287, 289 44 3, 179, 184, 213, 230, 231 45 9, 48, 57-61, 63-67, 71, 73, 84, 92, 94, 97, 99, 101, 111, 117, 118, 121, 138, 155, 179, 180, 186, 204, 220, 222, 223 46 61, 62, 144, 193, 203, 220, 283, 318, 343, 358 47 23, 30-32, 41, 43, 50, 53, 95, 112116, 118, 120, 122, 123, 127-130, 137, 181-183, 188, 190, 226, 227, 237, 245, 246, 282, 285, 288, 289 48 34, 46, 89, 118, 124, 126, 161, 164, 166, 172, 173, 175, 178, 180, 211, 268, 280, 287, 289, 290, 293, 294, 296-305, 307, 308, 310, 311, 313, 314, 316, 331, 334 49 21, 45, 47, 62, 77, 78, 81, 96, 110, 111, 149, 150, 162, 189, 198 50 3, 4, 21, 22, 41, 62, 66, 87, 104, 153, 154, 158 51 45, 66, 72, 97, 98 52 14, 34, 90, 91, 101, 127, 177 53 18, 19, 26-30, 44, 57, 95, 99, 105, 106, 108-110, 138, 140143 54 2, 7, 11, 15, 72, 73, 113, 130-132, 135, 136, 138-141, 143130
145, 148, 154, 155, 171, 173-175, 180, 182-187, 189, 190, 192, 195, 206, 207, 212, 214, 231, 235 55 13, 21, 31, 34, 35, 38, 42, 56, 57, 74-81, 85, 100, 102, 107, 115, 116, 124, 134, 142, 151, 226-228, 233-235, 238, 251-258, 270, 273, 275, 277, 311, 314, 339, 346, 361, 364, 384, 401 56/57 19-21, 106, 138, 210 58 2, 90, 212, 225, 263 59 12, 21, 23, 71, 88, 94, 121, 130, 151 60 17, 35, 38-40, 45-47, 49, 50, 104, 111, 123, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 173, 261, 271, 275, 277, 280, 281, 284-286, 290, 303, 306, 313 61 44, 47-50, 54, 72, 122 62 4, 5, 10, 34, 41, 54, 101, 107, 152, 155, 170, 187, 212, 214, 215, 228, 229, 254-256, 294, 295, 313, 316, 318, 320, 321, 328, 334, 336, 338, 358, 370 63 9, 11, 41-43, 60, 106 64 10, 11, 13, 17, 78, 100 65 42, 53, 64, 115, 117, 127, 134, 181, 182, 184, 188, 191, 194-196, 198, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 214-216, 218-222, 232, 257, 264, 271-274, 276, 294, 313, 315, 322, 331-337, 339, 355, 359, 361-363, 376, 390, 431, 453, 457, 458, 468, 478, 480, 507 66 36, 49, 90, 93, 107, 109, 127, 140, 143, 177, 189, 211, 242, 255, 281, 285, 293, 299, 342, 344, 380, 383-385, 388, 389, 399, 403, 422, 423 67 36, 42, 47, 88-90, 92, 95, 101, 102, 116, 117, 119, 130, 135, 153, 155, 157, 158, 163, 181, 210, 212, 214, 264 68 21, 44, 55, 81,
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
95, 105, 107, 111, 112, 149 69 35, 132, 133, 167 70 22, 31, 33, 45, 59, 74, 96, 101, 102, 111, 112, 161 71 9, 12, 14, 16, 21, 41, 45, 48, 58, 61, 63, 66, 98, 108, 109, 125, 139, 174, 270 74 16, 163 75 232, 353, 365 76 5, 11, 15, 22, 25-27, 31, 80, 95, 126, 130, 148, 153, 154, 188, 214, 344 77 91, 209 78 2, 3, 5, 9, 1115, 17, 18, 20-22, 28, 38, 41, 84, 100, 101, 105, 107, 176, 212, 227, 231-234, 240, 257, 315 79 7, 85, 107, 115, 116, 130, 132, 135, 139, 147, 164 81 258, 286 85 48, 81, 97, 147, 154 87 6, 7, 10, 14, 23, 26, 39, 43, 49, 58, 67, 77, 82, 88, 91, 92, 101, 113, 118, 131, 135, 139, 146, 149, 161-163, 166, 167, 169, 172-178, 193, 216, 223, 229, 232, 233, 240, 242, 244, 245, 251, 252, 262-264, 271, 275-281, 287, 293, 297, 299 88 13, 27, 29, 30, 53, 55, 57-62, 67, 75, 82, 83, 85, 86, 100, 138, 139, 141, 152, 169, 178, 183, 195, 221, 234, 238, 261, 265, 268, 269, 271, 273-277, 297, 305, 310, 311, 322, 326-328 89 20, 45, 59, 76, 126, 234, 268 90 5, 10, 16, 22, 23, 28, 32, 57, 62, 69, 74, 78, 81, 82, 94, 100, 115, 123, 127, 131-134, 136-138, 144, 149, 151, 167, 168, 179, 188, 280, 317, 318, 331, 332, 335, 338, 339, 342, 343, 347, 351, 378, 396, 417, 418
PLOTIN [Plotin, Plotinos, plotinisch-] 7 243 8 104, 255 15 427 16 44 19 63, 549 22 15, 156, 161, 179, 222, 296, 299 24 113, 327 26 256 28 23, 186 33 47 34 120 42 96, 175 49 48, 137 60 159, 220, 269, 272, 284, 288, 290, 291 62 334 64 18 75 224 PLUTARQUE [Plutarch] 5 214 7 265 15 35 22 67 52 184 55 35 PORPHYRE [Porphyrios] 9 300 POSIDONIOS [Poseidonios] 62 213 PYRRHON [Pyrrhon] 1 37 SNQUE [Seneca] 2 264/SZ 199 418, 420 43 3 6.1 1 20
SEXTUS EMPIRICUS [Sextus Empiricus, Sextus Empirikus] 6.2 118 7 265 15 264, 267 21 4, 19, 54 22 59, 87, 89, 232, 247 29/30 55 33 162 35 109, 113, 131 42 90, 93, 94, 96 48 175 5, 35, 225, 226, 233, 400 62 64
131
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
SOCRATE [Socrates, Sokrates, Sokratik, Sokratiker, sokratisch-] 1 348, 349, 365, 370, 371 5 102, 103, 105, 177 6.1 173, 180184 6.2 119, 122 7 31, 81, 138, 243 8 20, 22, 29, 188, 255 9 203, 223 10 171, 172 11 11, 15 12 115 15 129, 251 16 487, 737 18 122, 184, 240, 265, 370 19 11, 16, 195, 218, 231, 236, 238-246, 249-252, 258, 308, 309, 312, 314-319, 322, 324, 325, 328-330, 333, 335, 340, 348, 506, 526 21 313 22 14, 21, 43, 57, 71, 89-94, 96, 109-112, 114, 116, 120, 126, 128, 130, 131, 134, 136, 193, 194, 246, 248-252, 260, 263, 265, 266, 277, 278, 281, 282, 313 24 275, 402 26 180 27 154, 321 28 356 29/30 271 31 63, 64 33 162, 164 36/37 129-131, 135, 136, 141, 142, 179, 182, 246, 252-254, 261, 262 38 3 41 74 43 211, 218, 220-222, 224 48 175, 178 50 153 53 140, 141 54 139, 145, 174, 186, 190, 206 55 211 56/57 19 60 39, 85 61 49, 191
62 5, 22, 23, 107, 255, 294, 318 66 383 67 89 70 167 71 61 78 11 79 130-132 87 278 88 270 89 30, 176, 207, 307 THOPHRASTE [Theophrast, theophrastisch-] 5 323-325, 330, 331, 341 7 265 15 264 19 302, 305 22 5154 35 2, 12, 100, 193-194, 205, 211, 215, 220 55 35 62 64, 334 63 11 78 1 XNOCRATE [Xenokrates] 21 4 22 144 29/30 55 55 226 62 152 XNOPHON [Xenophon, xenophonisch-] 22 90 38 95 40 184 ZNON DLE [Zeno, Zenos, Zeno von Elea] 19 236, 238 22 70, 71, 73, 75, 76, 236, 240, 247 33 162 35 148 62 15
132
Bhdg 2, 2012
ISSN 2034-7189
Lappellation Concordance Heidegger , que nous utilisions dj dans le premier numro du Bulletin heideggrien, est dsormais le titre de louvrage que nous prparons cette anne pour les ditions Continuum (Londres/New York) : The Heidegger Concordance. Il se composera dindex de termes allemands, de termes grecs, de termes latins et de noms propres. Nous remercions les ditions Continuum de nous avoir autoris user ici de ce nom et donner un aperu de ce que notre livre renfermera. Les rfrences sont donnes suivant ldition de dernire main ( Gesamtausgabe, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 1975). Nous indiquons tout dabord le numro du tome (en caractres gras) et les pages o apparat le nom de lauteur ou un adjectif driv de son nom. Nous avons exclu de cet index les tables des matires et les titres qui ne sont gnralement pas de la main de Heidegger , ainsi que les postfaces ou les notes des diteurs. Les termes allemands auxquels lindex fait rfrence sont indiqus entre crochets. Dans lattente de la publication du tome 89 de la Gesamtausgabe, nous utilisons ce chiffre pour renvoyer aux Zollikoner Seminare, mais indiquons ici la pagination de ldition de Medard Boss, Zollikoner Seminare. Protokolle, Zwiegesprche, Briefe, Francfort-sur-le-Main, Vittorio Klostermann, 20063. Les rfrences au tome 2 de la Gesamtausgabe sont aussi indiques entre parenthses suivant la pagination de ldition originale de Sein und Zeit (Tbingen, Niemeyer, 200619). Nous offrons ici la seconde livraison de cet index nominum selon le dcoupage annonc dans le premier numro du Bulletin heideggrien : Antiquit I (Les Prsocratiques, VIIIe Ve s. av. J.-C.), Antiquit II (De Socrate Plotin, IVe IIIe s. ap. J.-C.), Moyen ge et Temps Modernes I (DAugustin Hume, IVe s. 1750), Temps Modernes II (De Kant Kierkegaard, 1750 1850), poque contemporaine (De Nietzsche Celan, 1850 1976). Nous remercions la fondation Alexander von Humboldt (www.avh.de) pour son appui financier et M. Benjamin Schrer pour son aide prcieuse.
133
Vous aimerez peut-être aussi
- Derrida, Jacques. La Voix Et Le PhénomèneDocument126 pagesDerrida, Jacques. La Voix Et Le Phénomènejose gaviria100% (12)
- 18 Partecipation Et CausalitéDocument649 pages18 Partecipation Et CausalitéSole Gonzalez100% (1)
- Michel Clouscard - Lëtre Et Le Code - Le Procès de Production D'un Ensemble Précapitaliste. (1972, La Haye, Mouton) PDFDocument629 pagesMichel Clouscard - Lëtre Et Le Code - Le Procès de Production D'un Ensemble Précapitaliste. (1972, La Haye, Mouton) PDFyohanes100% (2)
- MERLEAU PONTY Phénoménologie de La PerceptionDocument278 pagesMERLEAU PONTY Phénoménologie de La Perceptiondilapsuscalor100% (2)
- L'esthétique de Merleau-PontyDocument27 pagesL'esthétique de Merleau-PontyJuliana Ortegosa AggioPas encore d'évaluation
- Bulletin Heideggerien 2 2012Document133 pagesBulletin Heideggerien 2 2012tmmmmmmmm4Pas encore d'évaluation
- 2011 L'etant L'esse Et La Participation PDFDocument50 pages2011 L'etant L'esse Et La Participation PDFpablotrollanoPas encore d'évaluation
- L2 Descriptifs 2018 2019Document50 pagesL2 Descriptifs 2018 2019Link ZeldaPas encore d'évaluation
- Husserl, La Crise de L' Humanité EuropéenDocument81 pagesHusserl, La Crise de L' Humanité EuropéenRobert Francis Aquino100% (1)
- Lyotard - La Phénoménologie (Que Sais-Je)Document92 pagesLyotard - La Phénoménologie (Que Sais-Je)Ricardo Filipe Afonso MangeronaPas encore d'évaluation
- La Notion de Pulsion Chez Nietzsche Et FreudDocument35 pagesLa Notion de Pulsion Chez Nietzsche Et FreudAndré Ourednik100% (3)
- MARITAIN, J., Distinguier Pour Savoir, Ou Les Degres Du Savoir, 5 Ed., 1945 (En Francés)Document946 pagesMARITAIN, J., Distinguier Pour Savoir, Ou Les Degres Du Savoir, 5 Ed., 1945 (En Francés)Luciano II de Samosata100% (3)
- L'Horizon Et Le Destin de La PhénoménologieDocument18 pagesL'Horizon Et Le Destin de La PhénoménologieFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- (FR) L'Union Des Opposés - Mémoire (Philosophie, Ésotérisme, Héraclite, Hegel, Bible, Yi King, Zen... )Document89 pages(FR) L'Union Des Opposés - Mémoire (Philosophie, Ésotérisme, Héraclite, Hegel, Bible, Yi King, Zen... )ptitmaxounouPas encore d'évaluation
- Réduction Et Donation PDFDocument377 pagesRéduction Et Donation PDFGeorgy Chernavin100% (1)
- Ob 17bd33 La Querelle Des Universaux2Document8 pagesOb 17bd33 La Querelle Des Universaux2Alae Omar NejjarPas encore d'évaluation
- Aldo Giorgio Gargani - Le Paradigme Esthétique Dans L'analyse Philosophique de WittgensteinDocument14 pagesAldo Giorgio Gargani - Le Paradigme Esthétique Dans L'analyse Philosophique de WittgensteinGabbyPas encore d'évaluation
- Angèle Kremer-Marietti. Nietzsche Et L'épistémologie Réfléchissante (2000)Document21 pagesAngèle Kremer-Marietti. Nietzsche Et L'épistémologie Réfléchissante (2000)Matheus Ichimaru BedendoPas encore d'évaluation
- Art - Wahl - La Philosophie Spéculative de Whitehead PDFDocument39 pagesArt - Wahl - La Philosophie Spéculative de Whitehead PDFAurélia PeyricalPas encore d'évaluation
- Livre A Quoi SertDocument142 pagesLivre A Quoi SertMdmChghMhamdiDridi100% (1)
- Corvez, M. L'Être Et L'étant Dans La Philosophie de Martin Heidegger.Document24 pagesCorvez, M. L'Être Et L'étant Dans La Philosophie de Martin Heidegger.Fafaidegger100% (1)
- L Écho de L Oeuvre de J. Maréchal Chez J.B. Lotz Et E. Coreth Développement Phénoménologique de La Méthode TranscendantaleDocument18 pagesL Écho de L Oeuvre de J. Maréchal Chez J.B. Lotz Et E. Coreth Développement Phénoménologique de La Méthode TranscendantaleWillem KuypersPas encore d'évaluation
- Philosophie, Theorie Du Mal Et de L'amou - Alain BadiouDocument50 pagesPhilosophie, Theorie Du Mal Et de L'amou - Alain Badiouantirenegat100% (1)
- Heidegger Et La Métaphysique: Vers Un Double Dépassement: Laurent GirouxDocument23 pagesHeidegger Et La Métaphysique: Vers Un Double Dépassement: Laurent GirouxEdelyn DonDorisPas encore d'évaluation
- Lex Prien Ce Humain 00 BrunDocument654 pagesLex Prien Ce Humain 00 Brungranea1029Pas encore d'évaluation
- L'égoDocument379 pagesL'égoMed yahya BensalahPas encore d'évaluation
- Ponty, Merleau - Phenomenologie de La PerceptionDocument278 pagesPonty, Merleau - Phenomenologie de La PerceptionAni Yamamoto AkibaPas encore d'évaluation
- Ferdinand ALQUIÉ 1906-1985: © Encyclopædia Universalis France Page 1 Sur 2Document2 pagesFerdinand ALQUIÉ 1906-1985: © Encyclopædia Universalis France Page 1 Sur 2ihssane BouhnidPas encore d'évaluation
- Cours de Philo Domaine 1Document24 pagesCours de Philo Domaine 1Fagarou rek75% (4)
- 【Ponty, Merleau】Phenomenologie de la perceptionDocument554 pages【Ponty, Merleau】Phenomenologie de la perceptionPietrus GrahamPas encore d'évaluation
- LA PHILOSOPHIE DE LA NATURE (Cahier)Document47 pagesLA PHILOSOPHIE DE LA NATURE (Cahier)alfred100% (1)
- La Compréhension en Herméneutique. Un Héritage de BultmannDocument13 pagesLa Compréhension en Herméneutique. Un Héritage de Bultmannastaifi saidPas encore d'évaluation
- Merleau-Ponty - Phénoménologie de La PerceptionDocument278 pagesMerleau-Ponty - Phénoménologie de La PerceptionVinícius dos Santos100% (1)
- Laurent Bove La Strategie Du ConatusDocument169 pagesLaurent Bove La Strategie Du Conatusgdupres66100% (1)
- Derrida Lecteur de HusserlDocument11 pagesDerrida Lecteur de HusserlYvan KalievPas encore d'évaluation
- Scribd - MetaphisicDocument3 pagesScribd - MetaphisicBaruch R JhoiPas encore d'évaluation
- Suite Du SupportDocument10 pagesSuite Du Supportsowphalia15Pas encore d'évaluation
- Poly - Introduction À La Philosophie PDFDocument41 pagesPoly - Introduction À La Philosophie PDFNeima Quele Almeida da SilvaPas encore d'évaluation
- Sans Moi Ni Personne LantisubstantialismDocument178 pagesSans Moi Ni Personne LantisubstantialismnadaraPas encore d'évaluation
- Conche 2010 4Document13 pagesConche 2010 4Wesh DenPas encore d'évaluation
- Apprentissage Pour EnfantDocument5 pagesApprentissage Pour EnfantrodriguePas encore d'évaluation
- F. Gros Introduction À La Philosophie de Michel Foucault. M.F. Une Philosophie de La VéritéDocument7 pagesF. Gros Introduction À La Philosophie de Michel Foucault. M.F. Une Philosophie de La VéritéNicolasCaballeroPas encore d'évaluation
- Lontologie de Merleau Ponty Face A La SCDocument28 pagesLontologie de Merleau Ponty Face A La SCAlain Hilqiyyahu BillPas encore d'évaluation
- Freud Nietzsche PulsionDocument44 pagesFreud Nietzsche Pulsiongallon laurenPas encore d'évaluation
- TOSEL, André - Du Materialisme de Spinoza PDFDocument110 pagesTOSEL, André - Du Materialisme de Spinoza PDFDanielSantosdaSilva100% (1)
- La Conscience A-T-Elle Une Orig - Bitbol, Michel PDFDocument769 pagesLa Conscience A-T-Elle Une Orig - Bitbol, Michel PDFChristian Tellier100% (3)
- Support écrit 1e PartieDocument68 pagesSupport écrit 1e Partienourkada040905Pas encore d'évaluation
- Considerations Morales I.1Document11 pagesConsiderations Morales I.1Sébastian-Xavier Katz PinoPas encore d'évaluation
- Phénoménologie de La Perception: Maurice Merleau-PontyDocument539 pagesPhénoménologie de La Perception: Maurice Merleau-PontyAkash KumarPas encore d'évaluation
- J. Benoist, Sur L'adresse Du RéelDocument8 pagesJ. Benoist, Sur L'adresse Du RéelJean-marcRouvièrePas encore d'évaluation
- Raisons d'être. Le sens à l'épreuve de la science et de la religionD'EverandRaisons d'être. Le sens à l'épreuve de la science et de la religionPas encore d'évaluation
- Ontologie trinitaire: Penser et vivre à la lumière de la TrinitéD'EverandOntologie trinitaire: Penser et vivre à la lumière de la TrinitéPas encore d'évaluation
- La Vérité Humaine, un cours d'apologétique, tome I: Quel homme suis-je ?D'EverandLa Vérité Humaine, un cours d'apologétique, tome I: Quel homme suis-je ?Pas encore d'évaluation
- Philosophie de la Liberté (Tome I) Cours de philosophie moraleD'EverandPhilosophie de la Liberté (Tome I) Cours de philosophie moralePas encore d'évaluation
- MH Biblio Version 1.0Document0 pageMH Biblio Version 1.0Duque39Pas encore d'évaluation
- Lettre Nº2Document8 pagesLettre Nº2Duque39Pas encore d'évaluation
- Rgi 331 10 La Question de L Humanisme Chez Max SchelerDocument25 pagesRgi 331 10 La Question de L Humanisme Chez Max SchelerDuque39Pas encore d'évaluation
- ASPLF2012 CirculaireDocument6 pagesASPLF2012 CirculaireDuque39Pas encore d'évaluation
- Concevoir Une Formation: Progression Pédagogique Et AnimationDocument22 pagesConcevoir Une Formation: Progression Pédagogique Et AnimationacrygionPas encore d'évaluation
- Projet Didactique Classe VIII Le St. Valentin EvDocument4 pagesProjet Didactique Classe VIII Le St. Valentin EvCrisanRamonaPas encore d'évaluation
- Depot 14658Document3 pagesDepot 14658Anonymous VR3d1RPas encore d'évaluation
- memoireTANO Assande JacobDocument61 pagesmemoireTANO Assande JacobCephas ATTEREPas encore d'évaluation
- Feuilletage 2734Document25 pagesFeuilletage 2734tenelusPas encore d'évaluation
- Guide 2013 2014 Llce Espagnol PDFDocument25 pagesGuide 2013 2014 Llce Espagnol PDFNaO'coeur KebetePas encore d'évaluation
- Biais Cognitifs 2023Document15 pagesBiais Cognitifs 2023cadieric7Pas encore d'évaluation
- Concept de Base de La Communication.Document34 pagesConcept de Base de La Communication.yazidPas encore d'évaluation
- RésultatsDocument7 pagesRésultatsLWANGA OYEDOKOUPas encore d'évaluation