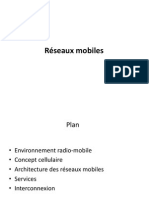Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours GSM
Cours GSM
Transféré par
Hamma Saidi0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues43 pagesTitre original
42489681-cours-GSM
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues43 pagesCours GSM
Cours GSM
Transféré par
Hamma SaidiDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 43
1
Lco|e Nat|ona|e des Sc|ences Un|vers|t Abde|ma|ek
App||ques - 1anger Lssaad|
Matire : Rseau CSM
Enseigne par : Dr. Mohammed Rda Britel
2
1. Introduction
Un systme de radiotlphonie a pour objectif premier de permettre l'accs au rseau
tlphonique partir d'un terminal portatif sur un territoire tendu (un pays, voire un
continent). Ce service utilise une liaison radiolectrique entre le terminal et le rseau. Selon
les systmes, plusieurs bandes de frquences sont utilises : parmi les principales, on compte
les bandes 450 MHz, 900 MHz et 1800 MHz.
Pour que le service soit disponible, il faut que la liaison radio entre le terminal et le rseau
soit de qualit suffisante, ce qui peut ncessiter une puissance importante des metteurs. Afin
de limiter cette puissance, l'oprateur du rseau radio mobile place un ensemble de stations de
base (BS, Base Station) sur le territoire couvrir pour que le terminal soit toujours moins de
quelques kilomtres de l'une d'entre elles. Ces BS sont, pour les usagers, les points d'accs au
rseau radio mobile.
La liaison entre le mobile et la BS est effectue sur un canal radio, c'est--dire sur une bande
de frquences du spectre allou l'oprateur.
La surface sur laquelle un terminal peut tablir une liaison avec une station de base
dtermine est appele une cellule. L'oprateur cherche donc raliser une couverture du
territoire par un ensemble de cellules contigus. Pour conomiser le spectre hertzien, il
rutilise les mmes frquences sur des cellules suffisamment loignes les unes des autres
pour que les communications qui utilisent la mme frquence ne se brouillent pas. Selon la
quantit de trafic couler dans la cellule, l'oprateur dispose plus ou moins de canaux radios
sur la station de base,
On appelle station mobile ou mobile (MS, mobile station) tout quipement terminal capable
de communiquer sur le rseau. Le mobile est compose d'un metteur / rcepteur et d'une
logique de commande. Il peut tre :
Un quipement installe demeure sur un vhicule,
Un portatif, c'est--dire un quipement de quelques centaines de grammes et de faible
puissance (de l'ordre du Watt) aisment transportable.
3
2. Rseaux mobiles / Rseaux fixes
L'utilisation de l'interface radio dans les communications introduit un certain nombre de
diffrences par rapport aux communications sur cble.
2.1. Spectre limite
Le spectre radio utilisable pour les radiocommunications, et par consquent la capacit
disponible pour l'accs radio, est gnralement limite par la rglementation. En effet,
contrairement aux communications filaires ou une population et une demande en capacit de
plus en plus importantes peuvent tre facilement desservies par le dploiement de cbles
supplmentaires pour connecter les abonnes au rseau, la largeur du spectre radio ne peut tre
tendue arbitrairement.
La technique cellulaire rsout partiellement ce problme on partageant la zone a couvrir en
cellules radio, chacune quipe par une station de base et en rutilisant le spectre radio aussi
souvent que possible. La rutilisation du spectre est principalement limite par les niveaux
des interfrences co-canales et adjacentes.
De plus, les constructeurs ont eu recours :
Une modulation spectralement efficace, c'est--dire transportant plus d'informations
dans une bande de frquences moins large (hausse du nombre de bits/Hz)
Un codage de compression de source (parole, donnes) permettant d'liminer la
redondance d'informations, de manire rduire le nombre de bits a transmettre dans
le temps imparti, et donc de rduire le dbit de transmission ncessaire et par la
mme la largeur de bande ncessaire.
L'objectif des concepteurs et des oprateurs de rseaux mobiles consiste donc transmettre le
maximum d'informations dans des canaux de largeur de bande fixe.
2.2. Qualit fluctuante des liens radios
Alors que dans un rseau filaire les liens de transmission possdent en fonctionnement normal
une qualit leve et constante, le lien radio est sujet a de multiples variations dues la
mobilit des usagers et aux changements des caractristiques de l'environnement: obstacles et
rflecteurs en mouvement, interfreurs et brouilleurs de toutes sortes,.
4
Ces problmes se manifestent par un niveau de BER (Bit Error Rate, taux d'erreur binaire) sur
Ie lien radio qui fluctue dans des marges importantes.
2.3. Point daccs inconnu et variable dans le temps
Contrairement a une connexion filaire ou les usagers communiquent via des points d'accs
rseau fixes, l'accs un rseau radio mobile permet l'usager de changer de point d'accs
rseau entre deux connexions et mme au cours dune connexion. Cela suppose donc une
gestion de la mobilit deux niveaux diffrents :
Du point de vue rseau pour permettre au systme de retrouver un abonne ou qu'il se situe
sous la couverture du rseau : gestion de la localisation {paging) ;
Du point de vue radio pour permettre une communication de se poursuivre sans
interruption lorsque l'abonne se dplace en cours d'appel et change de point d'accs rseau
(handover).
2.4. Scurit
Un dernier aspect lie l'utilisation du canal radio mobile est sa caractristique de medium
diffusant. Par consquent, les communications peuvent tre coutes et le canal peut tre
utilis par tout le monde (metteurs pirates). II est donc ncessaire de raliser des fonctions de
scurit permettant la confidentialit des communications et 1'authentifications des terminaux
souhaitant accder au systme.
3. La radiotlphonie dans le monde
3.1. Les systmes de premire gnration
Les systmes de premire gnration sont analogiques ; le signal de parole est transmis sur la
voie radio par une modulation analogique tout fait classique. La mthode d'accs utilise un
simple multiplexage en frquence. Dans les annes 80, de multiples systmes nationaux ont
t mis au point au Japon, en Italie, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Norvge, en Sude et
en Finlande,...
5
En France, l'oprateur national France Tlcoms est alors en situation de monopole ; en 1986,
il fait dvelopper le systme Radiocom 2000. Pour favoriser la croissance de la
radiotlphonie par un systme de concurrence, une autorisation d'exploitation est accorde
en dcembre 1987 a un second oprateur: la Socit Franaise de Radiotlphone SFR. Un
second rseau analogique est donc dvelopp en France, commercialis sous le nom de
"Ligne SFR".
A leur apoge en aot 1994, ces deux rseaux analogiques franais totalisaient 460 000
abonnes, soit un taux de pntration de 0,83 %. Ce taux tait tout fait modeste en
comparaison des autres pays europens (8 % dans les pays nordiques).
Des le milieu de l'anne 1995, le systme de deuxime gnration GSM, numrique,
supplante les rseaux analogiques en France avec plus de 500 000 clients.
Les principales diffrences entre les systmes de premire gnration et les systmes de
deuxime gnration sont les suivantes :
Lutilisation d'une modulation numrique dans les systmes de deuxime gnration.
Les avantages de ce type de modulation sont:
o la robustesse du signal ( qualit gale. le rapport C /I ncessaire est
moindre, c'est--dire que le signal C rsiste mieux aux brouillages);
o la capacit plus leve (par compression numrique de la parole et par
efficacit spectrale de la modulation, ce qui permet de faire "passer" plus
dutilisateurs simultanment)
La monte dans les frquences utilises pour les systmes de deuxime gnration.
Cette monte permet l'implantation de systmes haute densit grce la rduction
de porte du signal avec la monte en frquence : la taille rduite des cellules permet
d'offrir une capacit plus leve par unit de surface ;
Un accs multiple rparation dans le temps TDMA (GSM) ou dans les codes (IS-95 :
CDMA) pour les systmes de seconde gnration ;
Une normalisation europenne des systmes de deuxime gnration, qui permet aux
diffrents rseaux nationaux de s'interconnecter.
3.2. Normalisation par lETSI
6
La condition ncessaire pour offrir un service de tlphonie mobile sur toute l'Europe est de
disposer d'une bande de frquence commune sur l'ensemble du territoire europen.
En 1979, un accord a t conclu au sein du WARC (World Administrative Radio
Confrence), dpendant de l'UIT (Union Internationale des Tlcommunications), pour ouvrir
la bande des 900 MHz aux services mobiles.
En 1982, la CEPT (Confrence Europenne des Postes et Tlcommunications) alloue deux
sous bandes prcises de 25 MHz chacune :
Une sous bande de 890 a 915 MHz pour les transmissions des terminaux vers les
rseaux (sens montant)
Une sous bande de 915 a 930 MHz pour les transmissions dans le sens inverse (sens
descendant)
et cre un groupe d'tude, le Groupe Special Mobile. L'acronyme GSM sera rinterprte plus
tard (1990) pour spcifier un systme cellulaire europen.
En France, ce groupe d'tude est prsent au CNET et lance le projet MARATHON : Mobiles
ayant Accs au Rseau des Abonnes par Transmission Hertzienne Oprant en NUMERIQUE.
La France s'oriente donc ds le dpart pour un systme numrique alors que le choix n'est
toujours pas dtermine au niveau europen.
En 1987, le GSM entrine le choix de la transmission numrique avec multiplexage temporel
et frquentiel; le type de modulation, le codage de canal et le codage de la parole sont
galement choisis et permettent de fixer les bases ncessaires une laboration rapide des
spcifications.
Cette mme anne, les exploitants des rseaux de 13 pays europens signent un protocole
d'accord MoU (Memorandum of Understanding) pour 1'ouverture commerciale du GSM en
1991.
En fvrier 1988, France Tlcoms et les oprateurs de 10 autres pays europens lancent un
appel d'offres international auprs des industriels pour la ralisation de rseaux pilotes. En
7
septembre 1988, France Tlcoms choisit 2 consortiums qui comprennent chacun un
constructeur franais (Alcatel et Matra).
Le 25 mars 1991 en France, un arrt ministriel donne l'autorisation au deux oprateurs des
rseaux analogiques, France Tlcoms et SFR, de dployer un rseau GSM. Les contraintes
sont les suivantes :
Ouverture commerciale du service en 1992
70 % de la population couverte en 1995 (soit environ 45 % du territoire)
85 % de la population couverte en 1997 (soit environ 60 % du territoire) et elles
furent respectes par les deux oprateurs (ouverture commerciale annonce en juillet
1992). Les premiers rseaux pilotes ouvrent la fin de lanne 1991.
Des 1992, des rseaux ouvrent dans toute l'Europe avec la rfrence au sigle GSM qui perd
alors sa signification franaise pour l'appellation nettement plus vocatrice de "Global System
for Mobile communications".
En 1991, sous l'impulsion des britanniques, les spcifications GSM sont adaptes de faon
mineure pour permettre de dvelopper des systmes dans la bande des 1800 MHz. Ces
systmes sont dsigns par le terme DCS 1800, Digital Cellular System, et sont plus cibls
pour des environnements urbains. Ils correspondent a la transposition de la nonne GSM dans
la bande des 1800 MHz. De manire analogue au GSM 900 MHz, deux sous bandes (de
largeur 75 MHz chacune) sont rserves dans certains pays pour le DCS 1800. En septembre
1994, Bouygues Tlcoms est slectionn pour dployer un rseau DCS 1800 sur les grandes
villes de France avec l'obligation de couvrir 15 % de la population franaise dans les 18 mois.
Le rseau ouvre commercialement le 29 mai 1996.
En 1995, la phase 2 des recommandations GSM est entirement publie par l'ETSI (European
Telecommunications Standards Institue); elle unifie les systmes GSM 900 MHz et DCS
1800.
En mai 1996, la phase 2+ prvoit des terminaux bimode permettant l'interfonctionnement total
GSM 900 - DCS 1800. Elle envisage, entre autres, des nouveaux services supplmentaires
comme l'identification d'appels malveillants et des possibilits d'appels de groupe.
8
3.3. La norme GSM dans le monde
La norme GSM est maintenant adopte dans de nombreux pays. C'est l'unique norme
numrique de tlphonie cellulaire accepte en Europe. Dans la plupart des autres pays, elle
est en concurrence avec d'autres normes de radiotlphonie numrique, en gnral originaire
des Etats-Unis ou du Japon (IS-95).
Dans le monde, on comptait environ 220 millions d'abonnes GSM (et DCS) en novembre
1999. Le taux de pntration moyen en Europe de l'Ouest a dpass la barre des 20 % en
septembre 1998 avec un peu plus de 75 millions d'abonns.
Fin 1999, la barre des 100 millions d'abonnes europens a t largement dpasse. Les
donnes sont les suivantes :
Figure 1 : Taux de pntration du GSM en Europe
En France, les donnes sont les suivantes :
PARC D'ABONNES
OPERATEUR NOV.1998 FIN NOV. 1999 FIN SEP.2000
LIGNES
ANALOGIQUES
SFR NMT 40 500 - -
Radiocom 2000 12800 fin du service
GSM 900 SFR-Cegetel 3 664 000 6 367 700 9 169 100
Itineris (+Ola) 4 897 000 8 656 300 12 571 500
9
GSM 1800 (DCS) Bouygues Telecom 1 158 800 2 740 900 4 457 900
Tableau 1 : Taux de pntration du GSM en Europe
Le taux de pntration est de 43,6 % la fin du mois de septembre 2000 (plus de 26 millions
de tlphones portables).
4. Les principales caractristiques du systme GSM
Les diffrences entre le GSM 900 MHz et le DCS ( 1800 MHz) ne portent que sur les
bandes de frquences utilises. Du fait de l'attnuation en espace libre en f2 qui pnalise les
hautes frquences, le dploiement du systme DCS est plus contraignant quant la couverture
(il demande une plus grande densit de stations de base), mais la capacit offerte est de ce fait
nettement plus leve et de plus, la largeur de bande disponible est plus confortable.
Les deux systmes reposent sur une architecture et de interfaces identiques et ne diffrent que
sur l'aspect du dploiement cellulaire. Par la suite, l'appellation "GSM" fera donc allusion
aussi bien au GSM 900 qu'au DCS 1800, sauf mention contraire.
4.1 La diversit des services
L'objectif initial tait de spcifier un service de tlphonie mobile de voix et de donnes,
compatible avec les rseaux tlphoniques fixes analogiques ou numriques (RNIS ; Rseau
Numrique Intgration de Services). Un rseau GSM permet ainsi toute la palette des
services disponibles sur un rseau moderne : voix et donnes, fax, messagerie,.... De plus,
l'utilisation de la carte puce dans la carte SIM rend la souscription d'un abonnement
indpendante de l'achat du terminal.
4.2 Une architecture de rseau spcifi
Pour un interfonctionnement complet (entre les lments du rseau et entre les rseaux
nationaux), il est ncessaire de totalement spcifier les composants, les fonctionnalits et les
interfaces du rseau. La norme GSM spcifie ainsi compltement l'architecture du rseau
mobile PLMN Public Land Mobile Network, avec une distinction claire entre 2 sous-
systmes:
10
Le sous-systme radio
Le sous-systme rseau
Elle ne se limite donc pas l'interface radio comme la plupart des autres normes
radiomobiles. Cette spcification d'ensemble rend possible 1'interconnexion des diffrents
rseaux GSM, condition indispensable une offre de service globale sur l'Europe, voire le
monde. Ainsi, un abonn un rseau GSM donn peut accder des rseaux d'autres pays
sous rserve d'accord entre les oprateurs de ces pays (et de souscription de l'abonnement
International!), sans avoir faire de dmarche administrative et tout en recevant la facture de
son oprateur d'origine. Cette possibilit est appele roaming, ou itinrance internationale.
4.3 Une interface radio labore
L'interface radio, qui reprsente le maillon fragile de la chane de transmission reliant un
utilisateur mobile au rseau, a t particulirement tudie. Tout au long de la chane, des
traitements permettent l'tablissement et le maintien d'un lien en environnement perturb. En
effet, dans un systme radiomobile, le lien entre Ie terminal et le rseau est fluctuant du fait de
l'instabilit du canal radio et du dplacement du terminal. Une architecture spcifique est
dfinie sur l'interface radio pour permettre chaque station mobile de surveiller trs
priodiquement son environnement. De plus, des procdures lies l'tat "en veille" des
mobiles et au "handover" permettent d'assurer une continuit de service analogue celle du
rseau fixe.
5. Architecture du rseau GSM
Le rseau GSM est caractris par un accs trs spcifique : la liaison radio. II doit ensuite
permettre des communications entre les abonnes mobiles et des abonnes du rseau
tlphonique commute public (RTCP : en France, France Tlcoms et depuis le 01/01/1998 le
"7" de Cegetel et le "9" de Bouygues Tlcoms) et s'interface pour cela avec ce dernier par
des commutateurs. Enfin, comme tout rseau, il doit offrir l'oprateur des facilites
d'exploitation el de maintenance. Le rseau GSM est donc spar en 3 ensembles distincts :
Le sous-systme radio BSS ;
11
Il correspond la fonction de distribution du rseau de radiocommunication. Il est constitu
des stations de base BTS qui assurent le lien radiolectrique avec les abonns mobiles MS.
Les BTS sont gres par un contrleur de stations de base BSC qui assure galement la
fonction de concentration du trafic. En outre, le BSC est connecte un transcodeur TCU qui
permet de diminuer le nombre de liens MIC ncessaires entre le BSS et le NSS ;
Le sous-systme rseau NSS ;
Il regroupe toutes les fonctions de commutation et de routage, localises dans le MSC. Les
donnes de rfrence, propres chaque abonne, sont enregistres dans une base de donnes
repartie sur des enregistreurs de localisation nominaux HLR. Le MSC, afin de minimiser les
accs aux HLR, utilise un enregistreur de localisation temporaire, le VLR, contenant les
donnes de travail relatives aux abonnes prsents dans la zone gre par le MSC.
Le sous-systme d'exploitation el de maintenance OSS ;
Il est utilis par l'oprateur pour administrer son rseau, de manire locale par des OMC et de
manire gnrale par le NMC. Les fonctions de scurit et de contrle d'accs au rseau sont
assures par le centre d'authentification AUC et l'enregistreur des identits des quipements
EIR.
Le schma suivant prsente l'architecture gnrale d'un rseau GSM, hormis le systme OSS :
12
Figure 2. Architecture gnrale dun rseau GSM
5.1. Le sous-systme radio : BSS
13
5.1.1. La station de base : BTS
La BTS (Base Transceiver Station) est un ensemble d'metteurs- rcepteurs appels TRX.
Dans une premire approche, un TRX peut tre vu comme un couple de frquences (f
montante
;
f
descendante
) sur lequel 8 communications bidirectionnelles simultanes peuvent tre coules.
Le rle de la BTS est d'assurer l'interface entre le rseau fixe et les stations mobiles. La
communication avec les mobiles se fait par l'interface radio aussi appele interface Um. La
communication avec le rseau fixe, via le BSC, se fait par une interface filaire appele
interface A
bis
. Le transport des canaux de signalisation, de donnes et de parole s'effectue sur
des liaisons MIC 2 Mbits/s (32 IT 64 kbits/s). La BTS a la charge de la transmission radio
: modulation, dmodulation, galisation, codage correcteur d'erreur. Elle gre plus
gnralement la couche physique : multiplexage TDMA, saut de frquence (lent) et
chiffrement. Elle ralise aussi l'ensemble des mesures ncessaires pour vrifier qu'une
communication en cours se droule correctement et transmet directement ces mesures au
BSC, sans les interprter. Elle s'occupe en outre de la couche liaison de donnes pour
l'change de signalisation entre les mobiles et l'infrastructure ainsi que pour assurer la fiabilit
du dialogue.
II existe deux types de BTS ; les macro BTS classiques et les micros BTS. Ces dernires sont
prvues pour assurer la couverture de zones urbaines denses a l'aide de microcellules. Ce sont
des quipements de faible taille, de moindre puissance, moins chers et pouvant tre places a
l'extrieur des btiments.
Suivant le type d'environnement couvrir (urbain dense, suburbain, rural), les BTS
comportent un plus ou moins grand nombre de TRX. Plus la densit de trafic est importante
(urbain dense), plus chaque BTS doit couler un trafic important et donc plus elle ncessite
des TRX.
Le minimum est bien sur de 1 TRX, le maximum est dtermine par les constructeurs qui
proposent des configurations adaptes au trafic ; il est donc en constante volution.
Exemple 1998 :
14
Nokia : les BTS peuvent grer jusqu'a 6 TRX.
NMC : les BTS peuvent grer jusqu'a 8 TRX.
Si le mobile se trouve prs d'une BTS, la norme prvoit que le mobile ou la BTS peuvent
diminuer leur puissance d'mission. C'est le contrle de puissance (power control). Les BTS
sont connectes leur contrleur BSC :
soit en toile (1 MIC par BTS),
soit en chane (1 MIC est partage par plusieurs BTS),
soit en boucle (liaison en chane ferme permettant la redondance : une
liaison MIC coupe n'isole pas de BTS).
Cette dernire technique de connexion, dite de "drop and insert" permet de scuriser la
connexion des BTS au BSC et de rduire le nombre et la longueur des liaisons MIC
ncessaires sur l'interface Abis.
Figure 3 : Types de connexions BTS - BSC
5.1.2. Le contrleur de station de base : BSC
15
Le BSC (Base Station Controller) est l'organe intelligent du BSS. Il gre les ressources radio
des BTS qui lui sont attaches. Il ralise pour cela les procdures ncessaires l'tablissement
ou au rtablissement des appels et la libration des ressources la fin de chaque appel, ainsi
que les fonctions propres aux communications (contrle de puissance, dcision d'excution et
gestion du handover).
Il assure en outre une fonction de concentration des liaisons MIC vers le MSC. Initialement,
les constructeurs de BSC n'ont pas eu tous la mme philosophie concernant la capacit de
trafic de ces lments :
des BSC de faible capacit,
grant un moins grand nombre de BTS il faut donc davantage de BSC pour
couvrir la mme surface
minimisant ainsi les distances BTS-BSC rduction du cot d'exploitation
pour l'oprateur
particulirement adapts aux zones rurales faiblement peuples
des BSC de forte capacit
grant un plus grand nombre de BTS
augmentant donc les distances BTS-BSC moyennes
particulirement adapts aux zones urbaines forte densit de trafic
Exemple 1998 :
Nokia : les BSC peuvent grer 256 TRX chacun, soit par exemple 64 BTS a 4 TRX.
NMC : les BSC peuvent grer 160 TRX chacun, soit par exemple 40 BTS a 4 TRX.
Fin 2000, chaque BSC pourra couler jusqu'a 3000 Erlangs.
5.1.3. Le transcodeur : TCU
Les abonns transmettent des informations des dbits de 13 kbits/s (parole plein dbit) qui
sont ensuite adaptes et transportes partir de la BTS a 16 kbits/s. Or le rseau fixe, qui est
le plus souvent numrique, gre des circuits de parole a 64 kbits/s. II est donc ncessaire de
raliser dans le rseau un transcodage 16 kbits/s <=> 64 kbits/s. La norme n'impose pas
d'implanter les transcodeurs en un endroit particulier du rseau mais les place forcement dans
le BSS. Or, il est logique de transcoder les informations le plus tard possible, c'est--dire le
plus prs possible du MSC pour conomiser les circuits de parole.
16
Le TCU ou TRAU {Transcoder and Rate Adaptor Unit) a donc t plac entre le BSC et le
MSC dans le but de rduire le nombre des liaisons MIC ncessaires la transmission des
informations entre la BTS et le BSC. II est gnralement plac physiquement ct du MSC
mais fait fonctionnellement partie du BSC qui le commande donc distance.
Les informations sont "physiquement" transmises sur des circuits MIC 64 kbits/s (hormis
sur l'interface radio entre le mobile et la BTS). Sur chaque circuit MIC, il est donc possible de
transporter les informations de 4 circuits de parole 16 kbits/s.
L'adaptation de dbit ncessaire tant justement de 16 64 kbits/s (et inversement dans le
sens descendant), le TCU comporte donc 1 liaison MIC vers le BSC pour 4 liaisons vers le
MSC.
Figure 4: Transcodage de la parole
5.2. Le sous-systme rseau : NSS
5.2.1. Le commutateur (G)MSC
Le commutateur du rseau mobile MSC {Mobile-services Switching Centre) assure l'interface
entre le rseau mobile et les rseaux publics dj implants en cas d'appels entrants : il
s'appelle alors GMSC (Gateway MSC). Il assure la commutation des appels et constitue le
point de commande des taches de mise jour de la localisation des mobiles et du transfert des
appels.
Il commande les appels en provenance et destination du Rseau Tlphonique Public
Commute RTCP, du Rseau Numrique Intgration de Services RNIS (Numeris), des
rseaux publics mobiles PLMN (SFR, Itineris, Bouygues Tlcoms), des rseaux publics de
donnes PSDN (Transpac).
17
Le (G)MSC est essentiellement charg de l'tablissement des appels (rservation des
ressources, procdures d'identification et d'authentification, acheminement vers l'abonn
appel, commutation sur les circuits ddis la communication,...) entre un mobile et le
rseau, de la taxation des appels et de la transmission des messages courts. Il intervient aussi
dans certaines procdures de handover.
5.2.2. L'enregistreur de localisation : HLR
Le HLR {Home Location Register) est la base de donnes qui gre les abonnes dun PLMN
donne. Il mmorise les caractristiques de chaque abonn :
L'identit internationale de l'abonn : IMSI, unique, fixe et secrte, utilise par le
rseau,
Le numro d'annuaire 12 chiffres de l'abonn : MSISDN, commenant par 33 06 en
France,
Le profil de l'abonnement (services supplmentaires souscrits, autorisation d'appel
l'international,),
Un triplet (Kc, SRES, RAND) fourni au VLR, puis au MSC, lors de la procdure
d'authentification de l'abonn,
La localisation de l'abonn, c'est--dire le MSC / VLR ou il est enregistr
actuellement, mme si c'est sur un PLMN tranger (utile en cas de recherche de cet
abonn : le rseau s'adresse directement au HLR pour savoir ou se trouve l'abonn et
s'il est joignable).
Un HLR peut grer plusieurs centaines de milliers d'abonns et il constitue une machine
spcifique. A chaque abonn est associe un HLR unique ; le rseau identifie le HLR partir
du numro MSISDN ou de l'identit de labonn.
5.2.3. L'enregistreur de localisation des visiteurs : VLR
Le VLR (Visitor Location Register} est une base de donnes qui mmorise les informations
d'abonnement des abonns prsents dans une certaine zone gographique. Plusieurs MSC
peuvent tre relies au mme VLR, mais un MSC ne peut tre qu' un seul VLR et en gnral,
un VLR correspond un seul MSC. Les donnes mmorises par le VLR sont les mmes que
celles du HLR, mais concernent un sous-ensemble d'abonns : ceux prsents dans la zone
considre. De plus, le VLR contient pour chaque abonn :
18
Son identit temporaire TMSI (variable au cours du temps, parfois d'une
connexion l'autre);
Sa localisation plus prcise : sa zone de localisation.
La sparation matrielle entre le VLR et le MSC n'est pas trs prcise. On parle souvent de
l'ensemble MSC / VLR car si le MSC possde toutes ses fonctionnalits de commutation et
d'tablissement d'appel, c'est grce aux informations fournies par le VLR. Un ensemble MSC
/ VLR peut grer une centaine de milliers d'abonns.
5.3. Le sous-systme dexploitation et de maintenance : OSS
L'administration de rseau comprend toutes les activits qui permettent de mmoriser et de
contrler les performances et l'utilisation des ressources de faon offrir un certain niveau de
qualit aux usagers. Les diffrentes fonctions d'administration comprennent:
L'administration commerciale (dclaration des abonns, des terminaux,
facturation,...) ;
La gestion de la scurit (intrusion);
L'exploitation et la gestion des performances (observation du trafic et de la qualit,
charge du rseau,...)
Le contrle de la configuration du systme (mise a jour des logiciels dvolution et
des nouvelles fonctionnalits, introduction dans le rseau de nouveaux quipements);
La maintenance (tests des quipements)
5.3.1. L'administration du rseau : OMC et NMC
La diversit des quipements prsents dans un rseau GSM tant par leur type (metteurs-
rcepteurs, commutateurs, bases de donnes) que par le nombre de fournisseurs (au moins 2
pour faire jouer la concurrence) pousse adopter une approche structure et hirarchique de
la supervision du rseau. La norme prsente 2 niveaux :
Les OMC Oprations & Maintenance Centre;
Le NMC Network Management Centre.
Le NMC permet l'administration gnrale de l'ensemble du rseau par un contrle centralis,
alors que les OMC permettent une supervision locale des quipements. Plusieurs OMC vont,
19
par exemple, superviser des ensembles de BSC et de BTS sur diffrentes zones. D'autres
OMC vont superviser les MSC-VLR. Les incidents mineurs sont transmis aux OMC qui les
filtrent, tandis que les incidents majeurs remontent jusqu'au NMC.
5.3.2. L'enregistreur d'identit des quipements : EIR
L'EIR {Equipment Identity Register) est une base de donnes contenant les identits des
terminaux IMEI. Elle peut tre consulte lors des demandes de services d'un abonn pour
vrifier que le terminal utilis est autoris fonctionner sur le rseau.
L'accs au rseau peut tre refus parce que le terminal n'est pas homologu, qu'il perturbe le
rseau ou bien parce qu'il a fait l'objet d'une dclaration de vol.
L'EIR peut contenir 3 listes :
Une liste blanche de l'ensemble des numros d'homologation ;
Une liste noire des quipements vols et interdits d'accs. Le rseau peut mmoriser
l'identit IMSI d'un abonn utilisant un terminal inscrit sur cette liste et la transfrer
au systme d'administration pour permettre d'identifier les accs frauduleux (cela ne
sert donc rien de voler un terminal GSM !);
Une liste grise des terminaux prsentant des dysfonctionnements insuffisants pour
justifier une interdiction totale,
5.3.3. Le centre d'authentification : AUC
L'AUC {AUthentification Centre) mmorise pour chaque abonn une cl secrte Ki utilise
pour authentifier les demandes de service et chiffrer les communications. De plus, il contient
les algorithmes d'authentification et de Chiffrement (algorithmes A3 et AS) utiliss sur le
rseau. Un AUC est gnralement associ chaque HLR. L'ensemble peut mme parfois tre
intgr dans un mme quipement: la scurit relative au transfert des informations entre ces
deux entits fonctionnelles distinctes est alors optimale.
5.4. La station mobile : MS
La station mobile Mobile Station dsigne un quipement terminal muni d'une carte SIM qui
permet d'accder aux services de tlcommunications d'un rseau mobile GSM.
20
La carte SIM d'un abonn est gnralement du format d'une carte de crdit ("full sized"),
parfois mme juste du format de la puce ("plug-in"). Elle contient toutes les informations
ncessaires au bon fonctionnement du mobile :
Ses identits IMSI et TMSI,
ventuellement un code PIN (bloquant la carte aprs 3 essais, quivalent du code de
la carte bleue),
Sa cl de chiffrement KC ,
Sa cl d'authentification Ki,
Les algorithmes de chiffrement (A8, qui gnre Kc, et A5) et d'authentification A3.
Le terminal est muni d'une identit particulire, l'IMEI Cette identit permet, en autres, de
dterminer le constructeur de 1'equipement.
La norme dfinit plusieurs classes de terminaux suivant leur puissance maximale d'mission.
Cette puissance conditionne bien sur leur porte. La majorit des terminaux vendus sont des
portatifs dune puissance de 2 W pour GSM 900, de 1 W pour DCS 1800.
5.5. Architecture en couches
5.5.1. Les principales interfaces
Une interface est le lien entre 2 entits du rseau, sur lequel transitent des informations
particulires.
Par exemple, la BTS et le BSC sont connects, il existe donc une interface entre ces deux
entits, mais le HLR n'est pas directement lie a la BTS, donc il n'existe pas d'interface entre
ces deux entits.
Chaque interface, dsigne par une lettre, est totalement spcifie par la norme, c'est--dire
que les informations sont transmises dans des messages prcis, sous un format et un
emplacement du message prcis, des moments prcis.
Cela permet thoriquement d'utiliser les quipements de diffrents constructeurs sans aucune
incompatibilit. L'interface respecter de faon imprative est l'interface D car elle permet
21
un MSC / VLR de dialoguer avec le HLR de tout autre rseau. Sa conformit avec la norme
permet donc l'itinrance internationale. L'interface A spare le NSS du BSS. La conformit du
BSC et du MSC la recommandation permet aux oprateurs d'avoir diffrents fournisseurs
pour le NSS et le BSS.
NOM LOCALISATION UTILISATION
Um ou Air ou Radio MS BTS interface radio
Abis BTS BSC divers
A BSC MSC divers
B MSC VLR divers
E MSC MSC excution de certains handovers
D
VLR HLR gestion des informations d'abonnes et de
localisation, services supplmentaires.
Tableau 2 : Rsum des principales interfaces, du rseau GSM, ncessaires de connatre.
5.5.2. Le sous-systme radio
La recommandation GSM tablit un dcoupage des fonctions et une rparation de celles-ci sur
divers quipements. Par exemple, les handovers seront pris en charge par diverses entits
selon le type de handover effectu et les diffrentes phases de celui-ci. La structure en
couches reprend ce dcoupage en respectant la philosophie gnrale des couches OSI.
Dans le BSS, on retrouve principalement les trois couches basses de l'OSI : couche physique,
couche liaison de donnes et couche rseau, cette dernire tant dcoupe en plusieurs sous-
couches qui concernent plusieurs interfaces.
La couche 1 o couche physique dfinit l'ensemble des moyens de transmission et de
rception physique de l'information (traitement bit par bit). Sur les interfaces A et Abis, la
transmission est numrique, le plus souvent sur des voies MIC 64kbits/s. Sur l'interface
radio, cette couche est plus complique du fait des nombreuses oprations effectuer : codage
correcteur d'erreurs, multiplexage des canaux logiques, mesures radios effectuer.
La couche 2 ou liaison de donnes a pour objet de fiabiliser la transmission entre deux
quipement par un protocole dit de fiabilisation (traitement trame par trame). Les protocoles
22
adopts sur le BSS comportent un mcanisme d'acquittement et de retransmission des trames
et sont assez similaires au protocole HDLC. Ces protocoles sont: sur la liaison Abis, le LAPD
(utilise dans le RNIS) et entre la MS et la BTS, la spcificit de la couche physique requiert
un protocole driv du LAPD : le LAPDm (m pour mobile).
La couche 3 o couche rseau a pour objet d'tablir, de maintenir et de librer des circuits
commuts (parole ou donnes) avec un abonn du rseau fixe. Cette couche est divise en 3
sous-couches :
La sous-couche Radio Ressource RR intgre l'ensemble des aspects purement radios :
tablissement, maintenance et libration des diffrents canaux logiques. Dans la MS,
elle a pour rle de slectionner les cellules et de surveiller leur voie balise. La plupart
des messages RR transitent par la BTS sans interprtation et sont directement traits
par le BSC ou la MS : chiffrement, basculement du mobile vers un canal ddi sa
communication, excution du handover,. Cependant, certains messages, comme par
exemple l'ordre d'activation d'un TRX, concernent directement la BTS et sont
changs d'abord entre le BSC et la BTS, puis entre la BTS et la MS. Pour cela, la
BTS comporte donc une premire entit appele BTS Management pour traiter les
commandes en provenance du BSC (entit que l'on retrouvera donc dans le BSC) et
une seconde entit appele RR pour dialoguer avec le mobile. Cette entit RR est
comprise dans la sous-couche RR du mobile.
La sous-couche Mobility Management MM gre l'itinrance de la MS. Elle prend
donc en charge la mise jour de localisation du mobile, l'authentification et
l'identification de l'abonn, l'allocation du TMSI et la demande de service (en cas
d'appel sortant).
La sous-couche Connections Management CM est elle-mme dcoupe en 3 parties :
Lentit Call Control CC traite la gestion des connexions de circuits avec Ie
destinataire final: tablissement et fin d'appel, modifications en cours d'appel,
L'entit Short Message Service SMS assure la transmission et la rception des
messages courts,
L'entit Supplementary Services SS gre les services supplmentaires.
Les sous-couches CM et MM ne sont pas gres au sein du BSS, L'ensemble des messages
CM et MM transitent par la BTS et par le BSC sans tre analyss.
23
Figure 5. : Empilement des protocoles dans le BSS
5.5.3 Le sous-systme rseau
Lchange de signalisation au sein du NSS se fait en utilisant la Signalisation Smaphore n7
SS7, Cette signalisation n'est pas dtaill dans ce polycopie car elle ne concerne pas le
systme GSM en particulier : elle dfinit un standard au niveau mondial, optimis pour les
rseaux numriques, d'un haut niveau de fiabilit et volutif pour convenir l'laboration de
services futurs. Par opposition la signalisation voie par voie, la signalisation par canal
smaphore peut se dfinir comme une mthode dans laquelle une seule voie, le "canal
smaphore", achemine, grce des messages tiquets, l'information de signalisation se
rapportant une multiplicit de circuits de parole.
Les avantages de la SS7 sont les suivants :
la possibilit de transfrer de la signalisation pure indpendamment de
l'tablissement d'un circuit,
la possibilit de transfrer la signalisation fort dbit pendant une communication
sans que l'utilisateur ne soit gn,
la possibilit de rserver les circuits pour un appel seulement lorsque le
correspondant demande est rellement joignable.
La gestion de l'itinrance ncessite le dveloppement du protocole Mobile Application
PamMAP particulier au GSM et grant les dialogues entre les quipements du NSS.
24
Le protocole Message Transfer Part MTP en est une application aux 3 premires couches du
modle OSI. II est implant dans les MSC, VLR et HLR et offre un service de transfert fiable
des messages de signalisation reparti sur 3 niveaux :
Le niveau 1 dfinit les caractristiques physiques, lectriques et fonctionnelles de la
liaison et les moyens d'y accder. Les supports utilises sont en gnral les conduits
numriques MIC a 64 kbits/s,
Le niveau 2 dfinit les fonctions et les procdures de transfert des messages de
signalisation de faon a fournir un transfert fiable entre deux points. Il contient un
mcanisme de contrle de flux, de dtection d'erreur et de correction par
retransmission ;
Le niveau 3 dfinit une fonction de routage au sein du rseau SS7 national et une
fonction de gestion du rseau. La gestion du rseau est effectue par des procdures
de rtablissement et de maintien des conditions normales de fonctionnement. Elles
peuvent avoir pour effet de dtourner le trafic de signalisation sur un ou plusieurs
canaux de secours. Pour dtecter les dfaillances, elles utilisent les informations de
surveillance rpercutes par le niveau 2.
De mme, les protocoles Signalling Connection Part SCCP et Transaction Capabilities
Application Part TCAP sont implants partir du BSC et sont utiliss pour offrir l'itinrance
internationale et l'change de signalisation non lie l'tablissement d'un circuit.
Le protocole de gestion d'appel, le SSUTR2 en France ou VISUP dans d'autres pays, est
utilis pour l'tablissement des appels entre les diffrents MSC / VLR du rseau GSM et avec
les centraux du rseau fixe.
Enfin, entre le BSC et le MSC, une des applications du MAP, le BSS Application Part BSSAP
permet, grce deux nouveaux protocoles :
lechange des messages de gestion du lien BSC - MSC par le BSSMAP ;
l'encapsulation des messages des couches MM et CM par le protocole Direct Transfer
Application Part DTAP, rendant ainsi le BSC transparent aux messages changs
entre la MS et le MSC.
6. Canaux radios
6.1 Structure des canaux
25
Un systme radio mobile a besoin d'une partie du spectre radio pour fonctionner. Avant de le
spcifier en dtail, les concepteurs du systme doivent demander une bande de frquence
auprs de l'instance officielle charge de la gestion du spectre. Les bandes ddies par l'UIT,
d'ou une reconnaissance au niveau mondial, au systme GSM sont spcifies dans le tableau
suivant:
GSM 900 DCS 1800
bandes de frquences MHz 890 - 915 (Up)
935 - 960 (Down)
1710-1785 (Up)
1805-1880
(Down)
largeur de bande 2 x 25 MHz 2 x 75 MHz
cart duplex 45MHz 95MHz
nb intervalles de temps par trame TDMA 8
rapidit de modulation ~ 271 kbits/s
Dbit de la parole 13/12,2 et 5,6 kbits/s
accs multiple multiplexage temporel et frquentiel
puissance des terminaux 2 et 8W 0,25 et 1 W
Tableau 3-1 : Caractristiques frquentielles
6. 2 Rappels:
6. 2. 1 cart duplex et canal duplex
L'cart duplex du systme GSM est le dcalage en frquence entre la voie montante (du
mobile vers la BTS) et la voie descendante (de la BTS vers le mobile). Cette sparation entre
les voies montantes et descendantes facilite le filtrage et la sparation des voies.
Un canal est donc dit duplex s'il comporte une voie montante et une voie descendante. Dans le
systme GSM, tous les canaux de trafic allous aux abonns sont duplex (il faut pouvoir
parler sur la voie montante et couter sur la voie descendante).
6. 2. 2 Partage en frquence :
Chaque bande de frquences est partage en canaux (ou porteuses) duplex de largeur 200
kHz. La bande GSM 900 dispose donc de 125 canaux montants et autant de canaux
descendants, la bande DCS 1800 de 375 canaux montants et autant de canaux descendants. En
ralit, 124 et 374 porteuses sont disponibles dans les systmes GSM 900 et DCS 1800.
26
Numrotation des porteuses :
GSM 900 : pour 1 n 124 f = 935 + ( 0,2 x n ) MHz
DCS 1800 : pour 512 n 885 f = 1805,2 + [ 0,2 x (n - 512 ) ] MHz
Itineris dispose des 62 premiers canaux duplex de la bande GSM 900 et SFR des 62 derniers,
tandis que Bouygues Telecom dispose des 75 deniers canaux de la bande DCS 1800. Dans la
suite, le terme "frquence" dsignera le plus souvent le numro de la porteuse (entre 811 et
885 pour Bouygues Telecom) et non la valeur exacte de la frquence en MHz.
6. 2. 3 Partage en temps :
Chaque porteuse est divise en 8 intervalles de temps (IT, slots ou timeslots). La dure de
chaque timeslot est fixe 577 us (environ). Sur une mme porteuse, les timeslots sont
regroups par 8 en une trame TDMA. La dure de cette dernire est donc 4,615 ms. Les
timeslots sont numrots de 0 a 7.
Chaque utilisateur plein dbit utilise un slot par trame TDMA (toutes les 2 trames TDMA
pour un utilisateur demi- dbit). Un "canal physique" est donc constitue de la rptition
priodique d'un slot de la trame TDMA sur une frquence particulire. Dans ce slot, qui a une
notion temporelle, l'lment d'information est appel burst. On dit que le GSM est orient
circuit: il rserve chaque utilisateur une portion des ressources (1 timeslot parmi 8 sur une
paire de frquences), qui n'est partage avec personne d'autre, jusqu' la de connexion de
l'utilisateur.
27
Figure 5-1 : Partage en temps et en frquence d'une bande de frquences GSM
On peut donc dire que le GSM est un systme F/TDMA puisque les ressources sont partages
en frquence et en temps.
Enfin, dans le systme GSM, un mobile met et reoit des instants diffrents. Au niveau du
canal physique allou au mobile, l'mission et la rception d'informations sont donc dcales
dans le temps de 3 timeslots :
T : Canal TCH de trafic allou un utilisateur
Figure 5-2 : Canal physique GSM pour une transmission duplex sans saut de frquence
28
6. 3 Structure des informations
6.3.1 Codage des informations
Suivant la nature de 1'information transmettre, les messages d'information n'ont pas la
mme longueur ni la mme protection.
Figure 6-1 : Chane de transmission
La modulation utilise dans le systme GSM est la modulation GMSK (Gaussian-filtered
Minimum Shift Keying). Ses principales caractristiques sont les suivantes :
modulation de frquence ;
variation linaire de la phase sur un temps bit provoquant un dphasage de /2
chaque transmission de symbole ;
dbit en ligne : 270, 833 kbits/s (156,25 bits transmis en 577 s);
Le codage de source de la parole sert transformer le signal analogique de parole en un signal
numrique. Le but de ce codage est de rduire le dbit de faon minimiser la quantit
d'information transmettre. En effet, dans le systme GSM, la sortie de ce codeur, ne sont
transmis que les coefficients des filtres numriques linaires (long terme LTP et court terme
LPC) et le signal d'excitation (RPE) et non pas le signal de parole initial. L'lment qui
effectue ces oprations en mission et en rception est appel un "codec".
Pour la parole plein dbit, les 260 bits en sortie du codeur de source sont repartis en 3 classes
suivant leur importance, et le codage de canal n'est appliqu qu'aux classes qui doivent tre
les plus protges, c'est--dire les deux premires.
Bit
dinformation
de parole
Bit
dinformation
de parole
Codage de
source
Codage de
canal
Poinon
(facultative)
entrelacement
Insertion
dans un brust
Transmission
dans un slot
TDMA
29
Les bits de CRC (Cyclic Redundant Control) sont utiliss pour la dtection d'erreurs ; pour la
parole, si les 3 bits de CRC indiquent une erreur toute la trame est rejete; pour les canaux de
contrle, les 40 bits de CRC ont en plus une lgre capacit de correction d'erreur.
Les bits de trane sont utilises pour vider le registre a dcalage du codeur de canal.
Le codage de canal sert protger contre les erreurs en introduisant de la redondance. Ceci
conduit une augmentation du dbit, mais cette redondance est utilise en rception pour
corriger les erreurs.
Le codage de canal est ralis par des codes convolutionnels qui, avec l'algorithme de Viterbi,
assurent une correction efficace d'erreurs. Le codeur de canal utilise en GSM est de taux 1/2,
Le poinonnage est un lment facultatif de la chane d'mission. Il consiste supprimer un
certain nombre de bits dans le train de bits codes prts tre entrelacs, Ceci est fait dans le
but de faire "rentrer" le train de bits codes dans une boite du format voulu, 456 bits en
l'occurrence pour les donnes GSM. Tous les bits supplmentaires devront tre limins.
Cependant, si un train de bits a une longueur de (456 + n) bits, il est hors de question de lui
enlever les n derniers bits codes : cela supprimerait toute la dernire partie des informations.
On enlve donc les n bits rgulirement tout au long du train de bits, et on compte sur la
redondance et les performances du rcepteur pour corriger les effacements qui ont t ainsi
"volontairement" introduits et dont le rcepteur connait l'emplacement.
Figure 6-2 : Poinonnage
30
L'entrelacement est utilise pour rendre plus alatoire les positions des erreurs qui arrivent
gnralement en salves dans le contexte radio du fait des divers obstacles auxquels sont
soumis les signaux radios : immeubles, camions, feuillage...
La technique consiste mlanger les bits codes avant leur transmission dans un burst pour
augmenter les performances de correction des codes correcteurs. En fait l'entrelacement
permet de fragmenter les paquets d'erreurs et de les transformer en erreurs "isoles" afin de
faciliter leur correction.
6. 3 .2 Structure d'un burst d'information
Le burst d'information le plus couramment utilis a la structure gnrale suivante: une
squence d'apprentissage, des bits de donnes et quelques bits supplmentaires. La squence
d'apprentissage se trouve au milieu du burst car le canal radio tant fluctuant, il faut mieux
estimer le canal cet endroit; cela donne une estimation un demi-burst prs et non un
burst prs comme ce serait le cas si la squence tait place en fin ou en dbut de burst. II
existe 8 squences d'apprentissage sur le rseau, qui correspondent chacune un code BSIC
de BTS.
Figure 6. 3: Format d'un burst normal
En ralit, il n'y a que 57 bits d'information de part et d'autre de la squence d'apprentissage :
le 58
me
bit est utilis pour indiquer un transfert spcial de signalisation sur le canal logique
FACCH.
Dans le cas gnral (cf. Tableau 6. 2), l'entrelacement des 456 bits se fait sur 8 demi-bursts. II
se fait de la manire suivante :
les 456 bits de chaque bloc sont mlangs suivant un ordre dfini par la norme ;
31
les 456 bits sont regroups en 8 groupes de 57 bits (8x57 = 456);
chaque groupe est insr dans une moiti de burst; l'autre moiti du burst est occupe
par un autre groupe de 57 bits d'un autre bloc de 456 bits.
6. 4 Canaux logiques
Pour renforcer l'interface radio, qui est le maillon faible de la chane de transmission, un
certain nombre de fonctions de contrle ont t mises au point pour que le mobile se rattache
une BTS favorable, pour tablir une communication, surveiller son droulement et assurer
les handovers.
Ces fonctions de contrle engendrent des transferts de donnes: remontes des mesures,
messages de contrle... Plusieurs canaux logiques ont t ainsi dfinis pour les diffrents
types de fonction (veille, scrutation, mesures, contrle...); ils forment une architecture
complexe qu'il est ncessaire de connaitre pour comprendre le fonctionnement d'un mobile
pendant les diffrentes phases de communication ou pendant sa veille. Ils n'existent que sur
l'interface radio et perdent ensuite toute leur signification sur les autres interfaces du systmes
: Abis, Ater, A,...
Il faut sur l'interface radio :
diffuser des informations systme :
Broadcast Channels
prevenir les mobiles des appels entrants et faciliter leur accs au systme :
Common Control Channel
contrler les paramtres physiques avant et pendant les phases actives de transmission
: FACCH et SACCH
foumir des supports pour la transmission de la signalisation :
SDCCH
On n'utilise pas un canal physique plein pour chacune de ces taches : ce serait gcher de la
ressource radio car elles ne ncessitent pas, en gnral, un dbit comparable celui de la voix
code (TCH).
32
Le tableau ci-dessous rsume les principales caractristiques de codage des canaux logiques :
Canaux
logiques
nb bits avant
codage canal
CRC+
trane
taux de
codage
canal
poinon
(bits )
nb bits
en
sortie
entrelacement
TCH
parole
(plein
debit)
260(50+132+78) 3+4 1/2 - 456 8 demi blocs
TCH
donnees
(9,6
kbits/s)
4x60 ( dont 48
bits
designalisation)
0+4 1/2
32 456 22 blocs
FACCH 184 40+4 1/2 - 456 8 demi blocs
SACCH
SDCCH
PCH
AGCH
BCCH
184
40+4 1/2
- 456 4 blocs
RACH 8 6 + 4 1/2 - 36 non
SCH
25 10 + 4
1/2
- 78 non
Tableau 6. 4 : Rcapitulatif sur le codage des canaux logiques
Pour introduire plus de souplesse et allouer moins d'un slot par trame, on dfinit des structures
de multitrames.
La structure de multitrame est dfinie comme une succession d'un slot donn sur des
trames TDMA successives, c'est--dire sur un canal physique. Entre deux slots d'une
multitrame, il s'coule donc 4,615 ms.
Figure 6. 6 : Structure d'une multitrame GSM
33
Chaque multitrame transporte, avec une priodicit bien dfinie, un certain type
d'informations de contrle ou de signalisation. Cet ensemble de timeslots forme un canal
logique. Certaines multitrames sont dfinies 26 trames, d'autres 51 trames.
6. 4. 1 Classification des canaux logiques
On distingue deux grandes classes de canaux logiques : les canaux ddis et les canaux non
ddis :
Un canal logique ddi est duplex et fournit une ressource rserve un mobile. Le
rseau attribue au mobile dans une structure de multitrame un slot en mission et un
slot en rception dans lesquels le mobile est seul transmettre et recevoir. Dans la
mme cellule, aucun autre mobile ne peut transmettre dans le mme slot (c'est--dire
en mme temps) de la mme frquence.
Un canal logique non ddi est simplex et partag par un ensemble de mobiles. Dans
le sens descendant: diffusion des donnes, plusieurs mobiles sont l'coute du canal
Dans le sens montant: accs multiple selon la technique d' Aloha slotte .
34
Le tableau ci-dessous liste tous les types de canaux logiques et leur fonction
Broadcast Channel non ddi
diffusion
Frequency Correction Channel (FCCH) calage sur frquence
Synchronization Channel (SCH) synchronisation en temps &
identification de la BTS
Broadcast Control Channel (BCCH) information systeme
Common Control Channel
non ddi
diffusion et
accs multiple
Paging Channel (PCH) recherche du mobile en cas
d'appel entrant
Random Access Channel
(RACH)
accs alatoire du mobile
Access Grant Channel (AGCH) allocation de ressources
Cell Broadcast Channel (CBCH) diffusion de messages courts
Dedicated Control Channel
ddi
Stand-Alone Dedicated Control Channel
(SDCCH)
signalisation
Slow Associated Control Channel
(SACCH)
supervision lente de la
communication
Fast Associated Control Channel
(FACCH)
signalisation rapide
( handover)
Traffic Channel (TCH)
ddi
Full rate. Enhanced Full Rate &
Half Rate
parole
dbit utilisateur < 14.4 kbits/s donnes
Tableau 6. 5 : Types de canaux logiques et leur fonction
35
6. 4. 2 La voie balise
Chaque BTS d'un rseau radiomobile dispose d'une voie balise. La voie balise correspond
une frquence particulire appartenant l'ensemble des frquences alloues la BTS. Sur
cette frquence sont diffuses des informations particulires permettant aux mobiles de
dtecter la BTS, de se caler en frquence et en temps et de donner les caractristiques de la
cellule (identit, particularits et autorisation d'accs...).
A la mise sous tension, un mobile cherche se caler sur la voie balise de la BTS la plus
favorable autorise. En tat de veille, il surveille constamment le signal reu sur cette voie et
sur les voies balises des BTS du voisinage. Des que cela est ncessaire, il se cale sur une
nouvelle voie et change ainsi de cellule de service.
En communication, un mobile du voisinage de cette BTS mesure priodiquement sur cette
voie le niveau de signal qu'il reoit. Il dtermine par cette simple mesure s'il est porte de la
station, et s'il en est proche ou loign. Il remonte ensuite ces mesures dans les messages
MEASUREMENT REPORT en vue de l'execution d'un handover .
La voie balise des BTS correspond :
une frquence descendants: frquence balise sur laquelle les informations sont
diffuses a puissance constante pour permettre aux mobiles de faire des mesures de
puissances reues fiables; le contrle de puissance ne peut donc pas tre implant sur
cette voie ;
et a un ensemble de canaux logiques en diffusion sur cette frquence balise,
gnralement sur le slot 0 de la frquence; FCCH, SCH et BCCH. Le saut de
frquence ne peut donc pas tre implant sur cette voie;
a. Canal FCCH
Le canal FCCH consiste en un burst trs particulier mis environ toutes les 50 ms. Ce burst
est compose de 148 bits "0". Emis sur une frquence fo par la modulation GMSK., il donne
36
une sinusode parfaite de frquence fo + 1625/24 kHz qui permet au mobile de caler finement
son oscillateur. Le canal FCCH est prsent uniquement sur le slot 0 de la voie balise (fo).
b. Canal SCH
Le canal SCH fournit aux mobiles tous les lments ncessaires une synchronisation
complte en temps. La squence d'apprentissage est plus longue que dans un burst normal (64
bits au lieu de 26) pour permettre au mobile de faire une analyse fine du canal de
transmission.
Les informations diffuses sur le canal SCH sont les suivantes :
un numro de trame permettant au mobile de savoir quel canal SCH de la multitrame
il a dcod,
le code BSIC de la BTS dont le rle est de discriminer plusieurs BTS peu loignes
ayant la mme frquence balise :
Figure 6. 7 : Utilisation des codes BSIC dans un motif a 7 cellules
Le canal SCH est prsent uniquement sur le slot 0 de la voie balise; il est situ juste aprs le
canal FCCH.
c. Canal BCCH
37
Le canal BCCH permet la diffusion de donnes caractristiques de la cellule. Il comprend la
diffusion rgulire d'informations de plusieurs types dans les messages SYSTEM
INFORMATION. Les informations les plus importantes sont les suivantes:
le contrle de l'accs alatoire des mobiles sur le canal RACH (appels d'urgence
accepts ou refuss, nombre maximal de tentatives d'accs, classes de mobiles
autorises dans la cellule...);
la liste des frquences balises voisines scanner ;
l'identite de la cellule, sa zone de localisation ;
la structure exacte de la voie balise courante, qui permet au mobile de savoir quand il
doit couter les ventuels appels entrants ;
l'utilisation optionnelle du contrle de puissance et de la transmission discontinue (sur
les canaux autres que la voie balise);
les paramtres de slection de cellule (hysterisis, niveau minimal de puissance);
Le canal BCCH est prsent au moins sur le slot 0 de la voie balise et peut parfois aussi se
trouver sur les slots 2,4 ou 6 de cette mme voie.
6. 4.3 Les canaux de contrle commun
a. Canal RACH
Lorsque les mobiles veulent effectuer une opration sur le rseau, quelle qu'elle soit (mise
jour de localisation, envoi de messages courts, appel d'urgence ou normal (entrant ou
sortant)...)), ils doivent tablir une liaison avec le rseau. Pour cela, ils envoient vers la BTS
une requte trs courte code sur un seul burst. Cette requte est envoye sur des slots
particuliers en accs alatoire de type ALOHA discrtis (mission sans vrification pralable
de l'occupation du canal, mais seulement possible des instants prcis). L'ensemble des slots
rservs cette procdure s'appelle le canal RACH.
Le burst d'information utilis est trs court et ne suit pas le format de la Figure si dessous car
il faut laisser une marge de fluctuation au sein du slot RACH. En effet, le mobile ne connait
pas cet instant le dlai de propagation entre l'endroit ou il se trouve et la BTS. Le dlai de
garde est de 252 s, ce qui permet d'envisager une distance maximale entre la BTS et le
mobile d'environ 35 km.
38
Figure 6. 8 : Format du burst RACH
Le burst transmet les informations suivantes :
type de service demand (appel entrant, appel sortant, appel d'urgence, mise jour de
localisation, mission de message court),
un nombre alatoire utilis pour discriminer les mobiles en cas de collision qui permet
au mobile de reprer si la rponse lui est vritablement destine.
La squence d'apprentissage est un peu plus longue que dans les bursts normaux car le mobile
n'est pas compltement synchronis avec la BTS : il ne connait pas la distance qui les spare.
b. Canal AGCH
Lorsque le rseau reoit une requte de la part du mobile sur le canal RACH, il dcide de lui
allouer un canal de signalisation SDCCH afin d'identifier le mobile et dterminer prcisment
sa demande. L'allocation d'un tel canal ddi se fait sur des slots dfinis qui forment le canal
AGCH.
Le burst d'information contient les informations suivantes:
numro de slot
frquence alloue ou description du saut de frquence
valeur du timing advance
Le canal AGCH est prsent au moins sur le slot 0 de la voie balise et peut parfois aussi se
trouver sur les slots 2,4 ou 6 de cette mme voie.
c. Canal PCH
39
Lorsque le rseau dsire communiquer avec le mobile (appel entrant ou rception de message
court), la BTS diffuse l'identit du mobile sur un ensemble de cellules appel "zone de
localisation". Cette diffusion (appele paging) a lieu sur un ensemble de slots qui forment le
canal PCH. Tous les mobiles de la cellule coutent priodiquement le canal PCH et le mobile
concern par l'appel rpondra sur le canal RACH.
En utilisant comme identit d'appel le TMSI et non l'IMSI, il est possible pour le rseau
d'appeler jusqu'a 4 mobiles simultanment dans le mme message de paging.
Le canal PCH est prsent au moins sur le slot 0 de la voie balise et peut parfois aussi se
trouver sur les slots 2,4 ou 6 de cette mme voie.
d. Canal CBCH
Le canal CBCH est un canal descendant qui permet de diffuser aux usagers prsents dans la
cellule des informations spcifiques (informations routires, mto, promotions...). Il peut
utiliser certains slots 0 de la multitrame, mais son emploi est actuellement trs marginal.
6. 4. 4 Les canaux ddis
a. Canal TCH
Le canal TCH est utilis pour transmettre les informations utilisateurs :
la parole 13 kbits/s ("full rate" plein dbit), 12,2 kbits/s ("enhanced full rate",
commercialis sous le nom de"Digital Haute Resolution" chez Bouygues Telecom) ou
5,6 kbits/s ("half rate" demi- dbit, pas encore utilise par les oprateurs du fait de sa
relativement mauvaise qualit),
les donnes jusqu'a un dbit utilisateur de 14,4 kbits/s.
b. Canal SDCCH
Le canal SDCCH est utilis pour les tablissements des communications, les
missions/rceptions de messages courts et les mises jour de localisation. C'est le premier
canal ddi allou au mobile, avant son basculement ventuel sur un canal TCH. Sur ce canal
se droulent toutes les procdures d'authentification, didentification et de chiffrement.
Le canal SDCCH sert en particulier l'mission / rception de messages courts
(Tlmessages) ou la rception de services personnalises (abonnement aux services
40
"SCOOP" chez Bouygues Telecom: sport, news," astrologie, courses, loto,.) lorsque le mobile
n'est pas en communication l'instant de rception.
c.Canal SACCH
Le canal SACCH est un canal faible dbit: 1 burst d'information toutes les 26 trames. Il sert
contrler la liaison radio et ajuster en consquence certains paramtres afin de conserver
une qualit de service acceptable. Le canal SACCH supporte les informations suivantes :
dans le sens montant , remonte :
dans l'en-tte de tous les messages, des valeurs actuelles de puissance
d'mission du mobile et de son timing advance
dans le message MEASUREMENT REPORT, des mesures effectues par
le mobile sur le canal courant et sur les BTS voisines
dans le sens descendant , transmission dans les messages SYSTEM
INFORMATION :
dans l'en-tte de tous les messages, des valeurs commandes par la BTS
serveuse au mobile de puissance d'mission et de timing advance du
mobile
de l'identite et la zone de localisation de la cellule serveuse
de la liste des frquences scanner (correspondant aux voies balises des
BTS voisines)
des diverses fonctionnalits implmentes sur la cellule serveuse : contrle
de puissance, transmission discontinue et valeur du Radio Link Timeout
(RLT) en nombre de trames SACCH.
. 4. 5 Multiplexage TCH plein dbit -SACCH
Le codeur de source de parole plein dbit dlivr toutes les 20 ms un ensemble de bits qui
sont codes sur 8 demi-bursts. De manire temporelle, il faut donc transmettre 4 bursts de
41
parole toutes les 20 ms. Pendant une priode de 120 ms, il y a donc 24 bursts de parole
transmettre.
D'autre part, on a vu que le mobile pouvait mettre et recevoir des donnes toutes les 4,615
ms (un slot dtermin sur une frquence particulire). Pendant une priode de 120 ms, il y a
donc 120/4,615 soit 26 bursts d'information transmettre.
II reste donc deux slots libres. Un slot est utilis pour le canal SACCH, lautre slot est appel
slot idle et cette structure de multiplexage est rpte toutes les 120 ms, c'est--dire toutes les
26 trames TDMA (d'ou le nom de multitrame a 26).
26 trames TDMA = 120 ms
T : canal TCH Traffic CHannel i: trame idle
A : canal SACCH Slow Associated Control CHannel
Figure 6. 9 : Multitrame 26 pour Ie multiplexage TCH plein dbit / SACCH
Le slot idle est utilis par le mobile non pas pour se reposer mais pour scruter les voies balises
voisines que la BTS serveuse lui a indiques. Pendant ce laps de temps disponible, le mobile
tente de dcoder le code BSIC diffuse sur le canal SCH du slot 0 des voies balises, puis il
renvoie ces informations dans les messages MEASUREMENT REPORT, accompagnes des
mesures de puissance effectues.
42
Figure 6. 10 : Utilisation du slot idle
Le canal SACCH transporte, comme nous l'avons vu, de la signalisation faible dbit. Il ne
convient donc pas aux actions qui doivent tre faites rapidement comme le handover. En ces
cas d'urgence, on suspend la transmission des informations utilisateurs sur le canal TCH et on
utilise la capacit ainsi libre pour un autre canal, le canal FACCH, pour la transmission de
la signalisation rapide. Ce canal est vu comme un vol de capacit du TCH, il n'a pas de
structure
fixe dans les multitrames puisqu'il intervient ponctuellement, en cas de handover.
6. 4. 6 Multiplexage SDCCH-SACCH
De mme manire que pour le canal TCH, un canal SACCH est allou conjointement
chaque canal SDCCH, mais la structure de la multitrame est diffrente puisqu'il s'agit d'une
multitrame 51 trames. Sur la multitrame 26 taient multiplexs 1 canal TCH est son canal
SACCH associ. Sur cette multitrame 51 sont multiplexs 8 canaux SDCCH et leurs canaux
SACCH associs (une multitrame sur deux), comme illustre sur la Figure 6. 11.
43
51 frames TDMA = 235,38 ms
D: canal SDCCH Stand Alone Dedicatees Control Channel
A: Canal SACCH Stow Associated Control Channel
Figure 6. 11 : Multiplexage SDCCH-SACCH
6. 4. 7 Multiplexage des canaux non ddis
Suivant la capacit de la BTS, le PCH et l'AGCH ont des configurations variables. Cependant,
tous les canaux logiques non ddis sont multiplexes sur une multitrame 51 trames. Celle-ci
se trouve sur le slot 0 de la voie balise et parfois, en cas de forte capacit de la BTS, sur les
slots 2, 4 et 6 de cette voie.
Dans le cas contraire d'une configuration minimale (faible capacit de la BTS), le
multiplexage peut tre ventuellement complt par 4 canaux de signalisation ddis SDCCH
et leurs SACCH associs. La Figure 6. 12 : illustre la configuration minimale sur te slot 0 de
la voie balise :
51 frames TDMA = 235,38 ms
F : canal FCCH Frequency Correction Channel
S ; Canal SCH Synchronisation Channel
D : Canal SDCCH Stand-alone Dedicated Control Channel
A ; Canal SACCH Slow Associated Control Channel
Figure 6. 12 : Configuration minimale des canaux de contrles sur le slot 0 de la voie
balise
Vous aimerez peut-être aussi
- Déploiement Réseau 2G-3GDocument63 pagesDéploiement Réseau 2G-3GRACHID94% (49)
- TD Reseau MobileDocument2 pagesTD Reseau Mobilealaa_brhouma100% (5)
- 6 Le Réseau Mobile 5GDocument11 pages6 Le Réseau Mobile 5Gimane takhi100% (1)
- TP Fibre OptiqueDocument7 pagesTP Fibre OptiqueRACHID100% (1)
- Introduction Data MiningDocument32 pagesIntroduction Data MiningRachid ZinePas encore d'évaluation
- NGN (Next Generation NetworkDocument24 pagesNGN (Next Generation NetworkRachid ZinePas encore d'évaluation
- Systèmes De Communication Véhiculaire: Les perspectives d'avenir du transport intelligentD'EverandSystèmes De Communication Véhiculaire: Les perspectives d'avenir du transport intelligentPas encore d'évaluation
- 3G LteDocument49 pages3G LteAnovar_ebooks100% (7)
- 2-Architecture Reseau MobileDocument27 pages2-Architecture Reseau Mobileidir_live100% (1)
- 3G Et 4GDocument22 pages3G Et 4GSaf Bes100% (1)
- Reseaux GSM 06 OcrDocument39 pagesReseaux GSM 06 OcrMame Coumba DiopPas encore d'évaluation
- Etude de La Liaison BTS-BSC Du Réseau GSMDocument62 pagesEtude de La Liaison BTS-BSC Du Réseau GSMCire djoma Diallo100% (4)
- Mon Cour de GSMDocument66 pagesMon Cour de GSMMouctarfissiria Balde100% (1)
- Cours GSM Trii CFP 2010Document50 pagesCours GSM Trii CFP 2010Fabrice Thilaw100% (1)
- Le Systeme Cellulaire & La Reutilisation Des Frequences-EL DDIB HamidaDocument16 pagesLe Systeme Cellulaire & La Reutilisation Des Frequences-EL DDIB HamidaMéd El YazidPas encore d'évaluation
- PFE Calibration Modèle de Propagation GSM-3G-LTEDocument78 pagesPFE Calibration Modèle de Propagation GSM-3G-LTEKais Ameur100% (12)
- GSM Canaux LogiquesDocument60 pagesGSM Canaux LogiquesMouss69195% (22)
- Planification D'un Reseau 4G PDFDocument150 pagesPlanification D'un Reseau 4G PDFtounsimed100% (2)
- Rapport PFE Optimisation D'un Réseau Single RAN (3G) Et Planification LTEDocument75 pagesRapport PFE Optimisation D'un Réseau Single RAN (3G) Et Planification LTESaadAhmedBeihaqi71% (7)
- Exercices Réseau CellulaireDocument2 pagesExercices Réseau Cellulairerammal50% (4)
- RTC - Reseau Telephonique CommutéDocument17 pagesRTC - Reseau Telephonique Commutérazane3100% (4)
- (Cours Réseaux Et Télécoms Avec Exercices Corrigés - COURS1) PDFDocument21 pages(Cours Réseaux Et Télécoms Avec Exercices Corrigés - COURS1) PDFabdo-dz88% (24)
- Support de Cours FH EtudiantDocument124 pagesSupport de Cours FH EtudiantGossan Anicet100% (8)
- 2-Cours GSM Reseau Et EntitesDocument43 pages2-Cours GSM Reseau Et EntitesNafi F-Lady100% (2)
- TD Telecoms ATM CorrectionDocument4 pagesTD Telecoms ATM CorrectionNacim Belkhir57% (7)
- Ingénierie Des Reseaux MobilesDocument46 pagesIngénierie Des Reseaux MobilesHama Mossi Abdoul RazakPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Telephonie PDFDocument12 pagesChapitre 1 Telephonie PDFguedri houda100% (2)
- Interface Radio GSM GPRSDocument12 pagesInterface Radio GSM GPRSAchour AnisPas encore d'évaluation
- Cours 1 - Le Réseau GSM, GPRS Et EDGE PDFDocument77 pagesCours 1 - Le Réseau GSM, GPRS Et EDGE PDFToudjani Anouar50% (4)
- Architecture Réseau UMTSDocument13 pagesArchitecture Réseau UMTSIsmael KouassiPas encore d'évaluation
- Cours RéseauxTéléphoniquesRéseauxLocauxRadio Chap1Document28 pagesCours RéseauxTéléphoniquesRéseauxLocauxRadio Chap1Benabdi YousraPas encore d'évaluation
- Exposé GSMDocument13 pagesExposé GSMAmine Sys0% (1)
- Exercice PratiqueDocument51 pagesExercice PratiqueSimplice Gnang100% (2)
- Poly Télécom RéseauxDocument246 pagesPoly Télécom Réseauxhajar_mouradi100% (6)
- Planification Radio D'un Reseau 3GDocument60 pagesPlanification Radio D'un Reseau 3GSif Eddine Sellami83% (12)
- Leçon 2 Les Modèles de PropagationDocument19 pagesLeçon 2 Les Modèles de PropagationPouedeou Tchamba100% (4)
- Etude D'un Réseaux UMTSDocument60 pagesEtude D'un Réseaux UMTSÀméno Algéwàlôù100% (2)
- Géographie Générale PDFDocument43 pagesGéographie Générale PDFdocteurgynecoPas encore d'évaluation
- Chapitre 01 - GSM1Document25 pagesChapitre 01 - GSM1yassinne.rifaiPas encore d'évaluation
- Présentation GSMDocument151 pagesPrésentation GSMSalim Ismail100% (1)
- Gsm-3a SiDocument28 pagesGsm-3a Sisamvip100% (1)
- Technique D'accesDocument62 pagesTechnique D'accesKarim HachimPas encore d'évaluation
- Les Differentes GenerationsDocument32 pagesLes Differentes GenerationsLàmiiàe El100% (1)
- RRC 1Document10 pagesRRC 1lahbak abderrahmenePas encore d'évaluation
- Le Système AMPS (Advanced Mobile Phone System) Aux Etats-Unis en 1978 Le Système NMT (Nordic Mobile Telephone) en Europe en 1981Document68 pagesLe Système AMPS (Advanced Mobile Phone System) Aux Etats-Unis en 1978 Le Système NMT (Nordic Mobile Telephone) en Europe en 1981Djallo haman Hamadou babaniPas encore d'évaluation
- Technologie de 3 Eme GenerationDocument45 pagesTechnologie de 3 Eme GenerationsitouPas encore d'évaluation
- Telephone MobileDocument29 pagesTelephone Mobilemajhoul.911Pas encore d'évaluation
- Initiation Aux TelecomsDocument39 pagesInitiation Aux TelecomsRaYa DiawPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 - Cours - Réseaux MobileDocument33 pagesChapitre 5 - Cours - Réseaux MobileNlend IsraëlPas encore d'évaluation
- Gsm Gprs UmtsDocument92 pagesGsm Gprs UmtsFayçal SerePas encore d'évaluation
- Kaw TherDocument82 pagesKaw Therseifmechri603Pas encore d'évaluation
- Global System For Mobile Communications - WikipédiaDocument20 pagesGlobal System For Mobile Communications - WikipédiaZoumana Sangare officielPas encore d'évaluation
- Les Accès Boucles Locale RadioDocument31 pagesLes Accès Boucles Locale Radioemmanuel danra10Pas encore d'évaluation
- Global System For Mobile Communications: HistoireDocument14 pagesGlobal System For Mobile Communications: HistoireThomas Norbert NdalaPas encore d'évaluation
- GSM PDFDocument197 pagesGSM PDFgrtPas encore d'évaluation
- Chapitre 4-Les Nouvelles Générations de La Téléphonie MobileDocument8 pagesChapitre 4-Les Nouvelles Générations de La Téléphonie MobileNoureddine BougreaPas encore d'évaluation
- Module de Reseau CellulaireDocument83 pagesModule de Reseau CellulaireMarie N DiarraPas encore d'évaluation
- Session - 5.introduction-Reseaux Mobiles PDFDocument116 pagesSession - 5.introduction-Reseaux Mobiles PDFnizar200Pas encore d'évaluation
- GSM Et GPRSDocument16 pagesGSM Et GPRSwafa wafaPas encore d'évaluation
- Cours Réseaux Mobiles 2G 2022 Séance1Document60 pagesCours Réseaux Mobiles 2G 2022 Séance1alaeben2002Pas encore d'évaluation
- Réseaux de Neurones Artificiels By: Abdelouahid ELYAHYAOUIDocument35 pagesRéseaux de Neurones Artificiels By: Abdelouahid ELYAHYAOUIRachid ZinePas encore d'évaluation
- Umts - EnsatDocument155 pagesUmts - EnsatAnovar_ebooks100% (1)
- IS95 Et Les Systèmes 2G AméricainsDocument29 pagesIS95 Et Les Systèmes 2G AméricainsRachid ZinePas encore d'évaluation
- Cours Propagation RadioDocument59 pagesCours Propagation RadioRachid Zine100% (2)
- Cours GPSDocument19 pagesCours GPSRachid ZinePas encore d'évaluation
- Cours GPSDocument19 pagesCours GPSLarache ThamiPas encore d'évaluation
- Theorie de L Information Et CodageDocument151 pagesTheorie de L Information Et CodageHisham BaskyPas encore d'évaluation
- Poste Préfabriqué Béton MET PDFDocument4 pagesPoste Préfabriqué Béton MET PDFELHAOURI YASSINEPas encore d'évaluation
- Marketing Opérationel - Partie - BDocument65 pagesMarketing Opérationel - Partie - BHien Z. DidierPas encore d'évaluation
- Automatisation Des Systèmes IndustrielsDocument5 pagesAutomatisation Des Systèmes IndustrielsAymen KhalfaouiPas encore d'évaluation
- Les EPIDocument67 pagesLes EPIEve MarcellePas encore d'évaluation
- Support de Formation Schneider-N1Document228 pagesSupport de Formation Schneider-N1jjc8ypcctzPas encore d'évaluation
- DCG Corrigé UE09 2012 ComptabDocument8 pagesDCG Corrigé UE09 2012 ComptabMouna MounaPas encore d'évaluation
- Projet de Thèse 2019Document10 pagesProjet de Thèse 2019Reda JLILPas encore d'évaluation
- 7 - Le PortableDocument3 pages7 - Le PortableLeu GeorgianaPas encore d'évaluation
- Domotique-Helix by M. KonatéDocument19 pagesDomotique-Helix by M. KonatéKhadim GueyePas encore d'évaluation
- Repartition Pédagogique Spéciale 3ème Et 4ème Génie Electrique 2021-2022Document11 pagesRepartition Pédagogique Spéciale 3ème Et 4ème Génie Electrique 2021-2022Hakim Saidi100% (1)
- Cours Theme 1 Chap 1 Management CEJM2Document5 pagesCours Theme 1 Chap 1 Management CEJM2Anne LEFEBVREPas encore d'évaluation
- 8Document46 pages8Med Yacine Soufi0% (1)
- DSGC - Livret Professionnel - 2020-2021Document10 pagesDSGC - Livret Professionnel - 2020-2021Nokia DrissPas encore d'évaluation
- DémissionDocument4 pagesDémissionChaos TouchPas encore d'évaluation
- Chapitre I Généralités Sur Les Pétroles Bruts Et Les Gaz NaturelsDocument10 pagesChapitre I Généralités Sur Les Pétroles Bruts Et Les Gaz NaturelsjadePas encore d'évaluation
- Étude Mondiale Sur La Pauvreté - DjiboutiDocument130 pagesÉtude Mondiale Sur La Pauvreté - DjiboutiFranck RakotosonPas encore d'évaluation
- Intégration D'energie RenoublDocument21 pagesIntégration D'energie RenoublMzg NoorPas encore d'évaluation
- RVTourisme 2020Document201 pagesRVTourisme 2020Mouna Ben GhanemPas encore d'évaluation
- Théorie Des Vagues DDocument6 pagesThéorie Des Vagues Dadobe 225Pas encore d'évaluation
- Examen Corrigé Programmation Orientée ObjetDocument3 pagesExamen Corrigé Programmation Orientée ObjetIlham HijabistaPas encore d'évaluation
- Ob Adae9f Al4ma31tewb0109-Sequence-02 PDFDocument24 pagesOb Adae9f Al4ma31tewb0109-Sequence-02 PDFhamidonnPas encore d'évaluation
- Demarrage Des TVX CoursDocument4 pagesDemarrage Des TVX Coursdarine ben saidPas encore d'évaluation
- Labview tp2Document36 pagesLabview tp2Mouni TadjerPas encore d'évaluation
- Lettre M OFFICE MANAGERDocument1 pageLettre M OFFICE MANAGERLuc .DesirePas encore d'évaluation
- Partie-2-Microprocesseur + MemoireDocument14 pagesPartie-2-Microprocesseur + MemoireyaoPas encore d'évaluation
- CJC3 Hajar LamhamediDocument20 pagesCJC3 Hajar Lamhamediamine39Pas encore d'évaluation
- Injection Directe Essence PDFDocument7 pagesInjection Directe Essence PDFBa Hamzik HP100% (1)
- Rapport de Stage: Stage Effectué Du 20/05/2019 Au 05/07/2019 ÀDocument27 pagesRapport de Stage: Stage Effectué Du 20/05/2019 Au 05/07/2019 Àapi-507649878Pas encore d'évaluation
- Cours ATODocument41 pagesCours ATOBebe KossiPas encore d'évaluation
- Formations: Etude ClassiqueDocument2 pagesFormations: Etude ClassiqueEdzer AlexandrePas encore d'évaluation