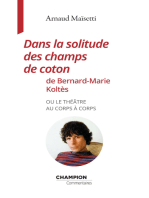Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Contes
Contes
Transféré par
Mima240000 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
20 vues17 pagesTitre original
177109300-Contes
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
20 vues17 pagesContes
Contes
Transféré par
Mima24000Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 17
ENFA Toulouse-Auzeville
Monique FIORAMONTI
Professeur de LETTRES
FLAUBERT
TROI S CONTES
&
Groupement de textes :
criture et originalit du Conte de Flaubert
tudier TROIS CONTES en classe de :
BAC PROFESSIONNEL 2
e
anne
ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Intgration au Rfrentiel de Bac Professionnel
n Objectif 3 = lire et crire :
- dcouvrir luvre littraire,
- dvelopper son imagination et son raisonnement.
3.1 = Analyser et comparer des textes littraires
3.2 = Enrichir ses connaissances littraires (du XVIIIe au XXe sicle)
3.3 = Crer des textes faisant appel limagination.
n preuve ponctuelle finale = questionnement : portant sur un (ou deux) texte(s) de nature
littraire et criture dun texte de fiction propos par le sujet (ou dun texte argumentatif, au choix de
llve).
n Le travail prsent ici peut sintgrer (moyennant quelques amnagements) en
classe de 2
nd
gnrale et technologique
Objectifs de la squence criture et Originalit du Conte de Flaubert
Reconnatre, analyser (pour pouvoir aussi les utiliser) les lments du rcit complexe associant narration
proprement dite, description-portrait, discours rapports = traitement de la temporalit et utilisation des
temps, fonctions de la description, tude des discours.
Identifier loriginalit du conte de Flaubert.
Dure : 6 sances et une valuation, soient 14 heures
Pr-acquis et pr-requis
Identification des types de textes (narratif et descriptif en particulier).
Connaissance de la notion de focalisation.
Reconnaissance des marques de lnonciation.
Connaissance du conte merveilleux et du conte fantastique : un rcit clos, plutt bref, une seule intrigue, peu de
personnages (intressants surtout par leur fonction dans le conte de fes), une histoire interprter, existence
du merveilleux ou irruption du surnaturel.
Remarque : les lves ont tous une reprsentation du conte de fes ; sils ont tudi en 3me ou en 2
nd
un conte fantastique, il faut videmment en tenir compte.
Sance n 1 : travail sur un texte dappui
1
Madame BOVARY
(Premire partie, chap. IX)
Texte : Le printemps reparut... la lampe.
Ltude du texte dappui a pour objet :
dapprofondir ou de mettre en place des notions qui seront rutilises lors de la lecture de
Trois Contes.
de permettre une comparaison entre roman et conte, en cours et en fin de squence.
denrichir largumentation sur loriginalit de Flaubert.
Trois axes de travail :
le traitement du temps ; temps et aspect des formes verbales au pass
le systme nonciatif
la constitution des personnages
I - TRAITEMENT DU TEMPS
Les repres chronologiques
Marques temporelles directes : le printemps... juillet... octobre... tout septembre... le
dimanche... lhiver...
Marques temporelles indirectes : les pincettes... les rayons ples du soleil... les carreaux
chargs de givre...
Le traitement de la temporalit : six mois en deux paragraphes (du dbut du printemps lautomne), et
tout le reste du texte pour lautomne et lhiver qui suivent. Ds la fin du deuxime paragraphe, les repres
sestompent, le temps semble extraordinairement tir, ou immobile.
Le jeu des temps du pass : pass simple, imparfait, pass compos.
a) IMPARFAITS
Dans le roman traditionnel, limparfait sert pour les descriptions, les actions qui durent ou se rptent dans le
pass. Ici, 27 formes avec des valeurs diverses :
Et elle restait... = exprime la consquence directe des phrases prcdentes ; mais rejoint aussi la
valeur qui suit :
Valeur durative et itrative confondues pour le plus grand nombre des autres verbes limparfait
Comme elle tait triste... elle coutait... etc. . A partir de Comme... la valeur itrative est trs nette,
indique par le dimanche .
Concordance des temps dans le Style Indirect Libre ( Elles allaient donc... , tout ce paragraphe
est en S.I.L.).
1
Ce texte dappui sert mettre en place, avec les lves, les notions de valeurs des temps, de constitution de personnage
romanesque.
On peut remarquer aussi le plus-que-parfait Dieu lavait voulu exprimant la fois lantriorit et la cause de
ce qui prcde.
b) PASSS SIMPLES
Disposition en trois tapes, alternant avec les paragraphes limparfait.
Les trois squences indiquent les tapes dun engrenage sinistre : le pass simple garde une forte valeur
temporelle, mme si les repres chronologiques prcis disparaissent ; il marque une succession d actions .
Valeur aspectuelle nette : scoula..., resta..., recommena...
Et lhiver fut froid... : un trimestre est rduit un instant. Cest l la valeur aspectuelle du pass simple qui
fait percevoir le procs globalement.
c) PASS COMPOS
Un seul, jai tout lu... , avec utilisation du Discours Direct. Le passage au D.D. se justifie par cette forme
significative de trois monosyllabes (multiplie par limparfait itratif qui suit : se disait-elle... .
Cette forme de pass accompli (en relation avec le prsent du moment de lnonciation) et leffet produit par les
monosyllabes, contribuent montrer que toute vasion est interdite dsormais Emma.
II - SYSTME NONCIATIF
Prsence du narrateur, ou de ses interlocuteurs, dans lnonc ?
Prsence de jugements de valeurs, directs ou indirects ?
Ici, le narrateur parle de son personnage la troisime personne, napparat pas directement, est
omniprsent .
Il montre son personnage en vision externe ( elle compta sur ses doigts... ).
Mais aussi le S.I.L. donne accs la pense dEmma = troisime et quatrime paragraphes.
A partir de Elle lcoutait... , laccs la vie intrieure dEmma ne rvle plus rien, toute vie
intrieure intellectuelle ou imaginaire a disparu.
III - CONSTITUTION DU PERSONNAGE
Il ny a pas de portrait, ni danalyse psychologique construite faite par un narrateur, mais ce sont des actions, des
sentiments, des sensations qui sont croqus.
Des actes drisoires : ( elle compta sur ses doigts... elle restait faire rougir les pincettes... ) et des
actes ngatifs ( elle abandonna... elle laissa... ).
Des sentiments eux aussi ngatifs : ( lennui... son cur de nouveau resta vide... La couture
lirritait... elle tait triste ).
Des sensations physiques pnibles : ( Elle eut des touffements ).
BILAN
Sur lutilisation des temps
Sur la constitution du personnage
qui amnent mettre en vidence dans ce passage de rcit les temps morts, le vide qui constitue la vie dun
personnage devenu fantme sans consistance, mur dans lennui.
Sance n 2
Un cur simple
(Chapitre I)
Axes de travail : La temporalit
La constitution des personnages
Le fonctionnement et la fonction des descriptions
Une rflexion pralable peut se mener autour des attentes cres par le titre du recueil, par celui du premier
conte.
Le titre mme du rcit, Un cur simple est plus mystrieux que celui du recueil.
Le mot cur renvoie-t-il : une personne, son courage, sa bont, son amour ?
Et ladjectif simple signifie-t-il : pur, loyal, humble, simplet ?
I - LANNONCE DUN RCIT
Les outils de la temporalit et leurs effets (date et dure de la chronologie ; relev et tude des temps
des verbes).
a) LIMPARFAIT : temps dominant dans le chapitre.
valeur itrative : les actes constituant la vie de Flicit (deuxime paragraphe ; paragraphe
elle se levait... ).
valeur durative :
Les deux derniers paragraphes traant une sorte de portrait de Flicit (encore que elle portait... confond
les deux valeurs).
Les deux valeurs se rejoignent pour amener la qualification ultime de Flicit qui semblait une femme en bois,
fonctionnant dune manire automatique . Le personnage, en 50 ans, na pas chang.
La description de la maison o rien non plus na chang durant ce demi-sicle.
b) LE PASS SIMPLE :
Le premier, envirent , dans la premire phrase de ce paragraphe qui est une suite dinformations
comme il est frquent en dbut de roman ou de rcit (ici au moins 8 informations ; et celle du verbe central sera la
moins exploite). Cette phrase prsente :
la dure de la fiction : (50 ans)
les personnages : (Mme Aubain, sa servante Flicit)
le milieu : (la Bourgeoisie)
Et le fait que lhistoire est acheve (temps de la narration / de la fiction).
- Ce pass simple rduit un point lespace dune vie (ou plutt, ici, de deux).
- Notion daspect du pass simple, temps perfectif apparat clairement : le procs est peru comme une
globalit.
c) LES AUTRES PASSS SIMPLES :
resta fidle : valeur proche de celle d envirent . En mme temps, ce verbe est inclus dans
une phrase limparfait et permet la mise en relief, le passage au premier plan de cette attitude. (cf. H. Weinrich,
Le Temps.)
vendit, quitta : aspect ponctuel classique du pass simple ( relier au fait que le pass simple,
temps perfectif note les vnements comme perus globalement, sinsrant dans un enchanement chronologique).
Idem pour marqua .
BILAN
Larticulation des temps du pass dans ce dbut de rcit met en vidence :
Le temps de la narration, postrieur celui de la fiction (cf. valeur du 1
er
pass simple).
Limportance dune qualit morale de Flicit (cf. valeur du pass simple elle resta fidle ).
La permanence dun dcor, dune relation, dun personnage travers le temps de toute une vie.
Qua-t-il pu se passer dans cette vie o rien ne semble stre pass ?
Les repres chronologiques
Une date prcise, 1809, celle du veuvage de Madame Aubain. Elle situe la fiction au XIXe sicle, mais ne donne
pas dindication exacte du moment o Madame Aubain et Flicit se sont rencontres. (Une indication cependant
donne par le plus-que-parfait elle avait pous... ).
II - LA DESCRIPTION DE LA MAISON
Repres spatiaux = progression balzacienne ; on va :
de lextrieur vers lintrieur
du sol en contrebas jusquau 2
e
tage
Inventaire des pices des meubles et du dcor : ( lambris, acajou, piano, bergres en tapisserie,
marbre, bibliothque, estampes ) voquent un intrieur bourgeois avec des prtentions (cf. la pendule
(qui) reprsentait un temple de Vesta ).
Le lexique = adjectifs ou expressions servant qualifier pices et meubles. Les mots troit... vieux...
Style Louis XV... ferm... meubles recouverts de draps... sentait le moisi... souvenir... marquent une
gne certaine.
La chambre de la servante, non dcrite, est la seule qui semble ouverte sur la nature.
BILAN
Un dcor petit-bourgeois qui a deux effets :
il enracine lhistoire dans une ralit
il rvle la situation sociale de la propritaire : gne financire, prtention, immobilisme (rien ne change
= cf. valeur dimparfaits).
nonciation : qui voit ? qui dcrit ?
Focalisation zro, narrateur effac mais qui apparat dans certains jugements ( souvenirs... ).
Madame Monsieur = qui est ici cit ? A qui renvoient les guillemets de citation, marques du
discours direct ?
III -LE PERSONNAGE DE
FLICIT
Quapprend-on delle dans ce premier chapitre ?
Un prnom
Sans nom (par opposition sa patronne dont on donne le nom de famille, prcd de Madame ; elle, est rduite
sa fonction de servante). La connotation de son prnom - le bonheur - semble une ironie.
Une attitude morale dominante : elle resta fidle
(Flaubert avait dabord crit et aima toujours sa matresse ).
Des savoir-faire (2 paragraphe) et une faon de vivre, de travailler, de shabiller rvlant sa conscience,
son conomie, sa pit.
Une silhouette et un visage dascte ( la fin).
BILAN
Un personnage simple :
par sa condition de servante
par sa fidlit
par la simplicit dune vie toujours recommence
par son humilit, son peu de souci de l'apparence.
CONCLUSION
u Ce dbut de rcit est en fait le rsum de toute une existence de personnages ordinaires dans un dcor petit-
bourgeois et provincial. Il met en exergue la simplicit du personnage principal, Flicit, sans que lon puisse
encore tre trs au clair sur lacception du mot.
en apparence anti-conte merveilleux
u On peut remarquer, de plus, que la description structure de dbut de roman pourrait voquer Balzac, mais
que, contrairement aux textes de Balzac, elle ne rvle pas ici grand chose de la vrit interne des personnages.
[cf. Dbut du Pre Goriot Sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne
(ch. I) ]
u On retrouve ici lutilisation des imparfaits et des passs simples comparable celle du texte dappui, ainsi que
la faon dvoquer un personnage par ses actes. Mais Flicit se dfinit au contraire dEmma par une vie
entirement occupe par des actes quotidiens au service des autres, et par sa dvotion = une femme de
bois .
Sance n 3
Un cur simple
(Chapitre IV)
La chambre de Flicit
Texte : Enfin il arriva... loiseau
Axes de travail : Fonctionnement et fonction de la description
Articulation description - rcit.
I - ORGANISATION DE LA DESCRIPTION
cf. chapelle... bazar = les deux composantes de la chambre ; orientent les relevs vers les rseaux lexicaux,
et sur une syntaxe de la juxtaposition.
Lordre ?
Contrairement la description du chapitre I, il ny a pas un ordre correspondant une logique
spatiale: cf. La fentre... contre les murs... sur la commode... au clou du miroir... au bord de la commode
( nouveau)... lenfoncement de la lucarne (encore la fentre)...
La description de la chambre est encadre par lvocation de Loulou, nouvel lment qui va devenir
lobjet - roi de lendroit.
Mode de prsentation des objets ?
Cest celui de lnumration, de la juxtaposition qui soulignent laspect htroclite. (L encore, il y
a une grande diffrence avec le chapitre I o objets et meubles voyaient leur disposition relative fixe par des
verbes comme salignaient... flanquaient... ).
Une exception : la description de Loulou, et de sa position dominante.
Quels objets ? avec quels qualificatifs ?
Objets sans valeur = bnitier en noix de coco... bote en coquillages... plusieurs bonnes
Vierges... .
- Ils traduisent la pit.
- Ou ils sont disparates en apparence mais sont en fait les traces de toutes les affections passes de
Flicit (ils ont appartenu son neveu, mort ; la petite Virginie, morte ; au petit Paul, devenu tranger).
BILAN
Description symbolique de lunivers affectif de Flicit = elle a entass tous les restes de son bonheur (?) disparu,
son neveu, les enfants, Loulou.
Ce dcor composite, disparate a pour elle un sens (cf. la casquette de Charles Bovary dont lhtrognit
esthtique rvlait le manque de got, ou le gteau de mariage qui trahissait la prtention).
II - LARTICULATION DESCRIPTION-RCIT
Cest lvocation de Loulou qui fait le lien entre la description et le rcit : ( Chaque matin... ).
Valeur des temps
Passage des imparfaits duratifs des imparfaits itratifs pour rendre compte de sa vie quotidienne =
monotonie apaise ; les seuls moments forts sont ceux des ftes religieuses.
A remarquer = labsence de tout repre chronologique. Le temps disparat, semble ne pas avoir de prise sur le
personnage.
Trois passs simples marquent les moments qui annoncent une volution de Flicit ( observa...
parut... suspendit... ). Elle remplace le portrait du Comte dArtois par limage dpinal o le Saint Esprit
ressemble au perroquet = amour profane et amour divin se confondent.
Le lexique
observa...
renvoient une vision subjective
parut...
Le discours rapport : le style indirect libre
- Ctait vraiment... Le Pre pour sannoncer navait pu choisir une colombe... - permet de traduire les
penses de Flicit, sa navet aussi.
BILAN
Flicit, dsormais solitaire, un moment avanc dune vie jonche de deuils - sa chambre en garde
les souvenirs - trouve la paix. Alors quEmma, au fil du temps, se dtruisait, se dfaisait, Flicit sest
constitue, construite travers une vie de malheurs.
Cet apaisement, elle le doit aussi la religion, la prire ; lidentification entre le perroquet et le Saint-
Esprit traduit-elle sa simplicit , sa navet ? ou bien son acceptation sereine de la vie ? Elle croit, et cela
suffit illuminer sa vie. (Peu importait la croyance pour Flaubert.)
v
Sance n 3 - 2e partie
Un cur simple
(Chapitre V)
La mort de Flicit
Axes de travail : Rinvestissement des connaissances acquises sur les temps verbaux : criture
du rcit simultan de la marche de la procession et de lagonie de Flicit.
Focalisation et nonciation.
Champs lexicaux.
Ces trois entres permettent de comprendre comment la mort devient une apothose (mystique) et un
bonheur combinant mysticisme et sensualit.
I - VERBES ET TEMPS VERBAUX
Un relev de verbes relatant la marche de la procession, lvolution de ltat de la servante montre liens et
correspondances entre les diffrentes tapes des deux phnomnes.
tude plus dtaille de lavant-dernier paragraphe = tout le village est agenouill devant le reposoir, cest--
dire, devant la chambre de Flicit.
II - FOCALISATION ET NONCIATION : qui voit ? qui raconte ?
La procession est vue tour tour selon des focalisation diffrentes :
Elle la voyait comme si elle let suivie... . Le rcit se fait en focalisation interne : il sagit de ce
quimagine Flicit (qui a suivi beaucoup de crmonies de ce genre = cf. Les processions de la Fte-Dieu la
ranimaient... - chap. IV).
Le murmure de la foule grossit... une fusillade branla... on distingua... Le clerg
parut... = point de vue neutre (focalisation zro). Il est vrai quil sagit de choses entendues et non vues (sauf
parut ), que Flicit peut entendre sans avoir imaginer. Il y a des indications de la subjectivit : belle
chasuble de M. le cur...
La Simonne grimpa sur sa chaise... = cest elle qui, den haut, peroit le reposoir, larrive du
prtre et des enfants de choeur.
Lagonie de Flicit est perue en focalisation zro et raconte par un narrateur omniscient qui sait ce que
pense la Simonne, qui interprte le visage de la mourante ( avec une sensualit mystique ), qui
connat mme ce quelle voit en mourant.
Choix par ce narrateur de elle crut voir qui laisse planer lambigut.
Le narrateur sefface = Flicit est seule (avec son perroquet !)
III - LE LEXIQUE = sensualit - religion
tude du lexique partir de Des guirlandes vertes... :
Fleurs - Couleurs - Lumire = importance des sens.
Expression vapeur dazur = fait le lien avec les encensoirs voqus dans le paragraphe prcdent ; relie
la religion et la nature (bleu du ciel dt).
Tout cela conduit lexpression sensualit mystique = lexpression la plus acheve du bonheur.
cf. aspects sensuels et sublimes de la religion unis dans la pense de Flaubert sur le mysticisme : je voudrais
bien tre mystique ; il doit y avoir de belles volupts croire au Paradis, se noyer dans les flots
dencens... cest un sensualisme bien plus fin que lautre, ce sont les volupts, les tressaillements, les
batitudes du coeur (Penses intimes - 1840).
La mort de Flicit en devient apaise, heureuse souriaient... se ralentirent... : valeur des deux
comparaisons).
Vision finale = identification totale entre lobjet profane qui avait t la fois objet de son affection et objet
transitionnel de sa foi et le Saint-Esprit. Il sagit bien dune mort mystique do tout hiatus entre terre et ciel a
disparu.
BILAN
Sens de cette apothose ? de cette irruption du merveilleux ? (estomp il est vrai par lattnuation de croit
voir ).
Flicit est-elle une sainte ? une simple desprit ? Le chapitre ferme le rcit mais ouvre la rflexion.
Elle a trouv la paix, le bonheur (cf. le prnom quelle porte) dans cette vie humble quelle a accepte.
La question de sa saintet ou de sa dbilit na pas de sens = limportant est de croire.
cf. Avez-vous jamais cru lexistence des Choses ? Est-ce que tout nest pas une illusion ! I l ny a de
vrai que les rapports , cest--dire, la faon dont nous percevons les objets - Lettre Maupassant,
aot 1878.
CONCLUSIONS
sur ltude
de ce premier GROUPE DE TEXTES
Un cur simpleet la notion de conte
PARADOXE :
u Un certain nombre dlments pourraient faire rattacher cette uvre un petit roman raliste , sachant
que Flaubert rcusait cet adjectif) = cette biographie dune femme du peuple ne semble en tout cas pas se
rattacher au conte merveilleux, malgr la prsence dun merveilleux - ambigu - final.
u Mais Flaubert garde deux aspects du type de conte quil admirait le plus, celui de Voltaire = un rcit
comportant libert et invention par rapport la ralit (merveilleux final, mais aussi absence de repres
chronologiques prcis, dsinvolture par rapport certains personnages ou certains pisodes), et surtout un rcit
porteur de sens.
cf. LIngnu qui disait que les contes sont les fables de philosophes (o ils mlangent merveilleux dans la
fiction et ralit dans la vision du monde).
Ici, il sagit dun conte... de la ralit quotidienne. Lassociation finale de la ralit et du merveilleux laisse planer
une ambigut sur le personnage de Flicit, mais pas sur le sens de cette petite histoire ; le personnage a trouv
dans la religion la paix et lacceptation de la vie.
[Emma Bovary spuisait chercher dans la ralit ce qui ny tait pas, rendant cette ralit encore plus
insupportable. Flicit, elle - la bien nomme malgr son ternelle misre - sait voir dans le rel ce qui ny est
sans doute pas mais qui rend sa vie, douce, heureuse (mme).]
u Ltude du traitement de la temporalit est un des points cls de la comparaison : la femme de bois a
domin ses cinquante annes de vie. Le temps na pas eu de prise sur elle, ne la pas entame, au contraire
dEmma victime du temps et de lennui.
u Il ne faut pas oublier que ce texte est le premier dune srie de trois... tudier plus tard.
v
Sance n 4
La Lgende de saint J ulien lHospitalier
(Chapitre III)
Texte jusqu : rsolut de mourir.
Le titre : renvoie au surnaturel autant par le mot lgende que par celui de saint . Le titre est
conclusif dans la mesure o il laisse peu de place limprvu. La lgende en gnral ne raconte pas toute une
vie mais ses temps forts (cf. La Lgende dore). Le titre renvoie un modle mdival, comme ce mot
conte.
Ici, moment o ce personnage noble a accompli sans le savoir une prdiction terrible et va sen aller errer loin
de sa vie facile.
Le passage lire et analyser constitue une narration.
I - Do un PREMIER TRAVAIL SUR LES REPRES TEMPORELS
tude des rapports des verbes au pass simple et des verbes limparfait :
Passs simples
Les tapes de lexclusion de Julien, de la punition quil sinflige. Laspect du procs peru globalement, et de
procs mis en vidence apparat clairement : cf. il vita les hommes ou il laventura dans des prils...
sauva des paralytiques qui renvoient des actions maintes fois recommences.
Imparfaits
Tout ce qui constitue le second plan qui explique, illustre, dveloppe ce que disent les verbes au Pass
Simple :
cf. il sen alla, mendiant... repris par il tendait la main... et tout le paragraphe suivant illustrant et
expliquant lerrance mendiante de Julien.
Labsence de date, de repres chronologiques prcis = les actions se succdent et se rptent sans
aucun repre. Sorte dternit. Est ainsi renforc laspect de rptition de lImparfait.
II - LE RCIT LGENDAIRE
Le surnaturel :
la terreur inexplique que Julien provoque chez les animaux eux-mmes,
les aventures extraordinaires ( il sauva... ),
la notion de maldiction ( Dieu qui lui avait inflig cette action... ).
La religion :
acceptation et recherche de la pnitence : il ne se rvoltait pas contre Dieu , par esprit
dhumilit, il racontait son histoire... il se fit un cilice... il monta sur les deux genoux toutes les collines ,
lobsession de la faute : Mais le vent... Mais limpitoyable... .
Remarque : labsence de discours rapport. Un seul exemple de discours narrativis il racontait son
histoire - on reste distance du personnage : on ne l entend pas parler, ni penser (dans tout le
conte, le discours direct est rare, le discours indirect libre absent).
BILAN
Nombreux lments de CONTE =
le personnage : un noble du Moyen Age qui se fait mendiant,
labsence dancrage dans le rel (ni lieux, ni dates ne sont identifis ; le non vraisemblable est intgr),
le surnaturel,
une vision de la religion trs dure : le personnage de plus en plus solitaire se punit de ses fautes,
relation avec Un cur simple: personnage solitaire dans un univers brutal, comme Flicit. Mais il
vit une religion beaucoup plus exigeante, dure (pas consolatrice). La religion est une norme absolue dont la
transgression est terriblement punie. On est loin de la Voie humide du XIXe Sicle dnonce par Flaubert
en opposition la Voie sche de Voltaire,
constitution avec les lves dune fiche sur lemploi des temps du pass dans le rcit ( laide de ce
texte et des textes prcdents).
v
Sance n 5
HRODIAS
(Chapitre I)
Texte : J e le connais... dit simplement le Ttrarque
u La fiction, inspire des textes bibliques, se passe au Ier sicle aprs J.- C., dans le milieu des hauts dignitaires
de lEmpire Romain. Les personnages appartiennent lHistoire (Evangiles ; Sutone) ; l action se droule en
un jour, dans un lieu identifi : la forteresse de Machaerous en Jude.
u Le dialogue, situ peu aprs le dbut du conte, met en scne le Ttrarque Hrode Antipas et son pouse
Hrodias qui a autrefois abandonn pour lui un premier mari et une enfant. Elle veut obtenir la tte de Iaokanann
(saint Jean Baptiste) emprisonn par le Ttrarque.
Axe de travail : Les paroles rapportes.
I - TUDE DES DIFFRENTS TYPES DE DISCOURS
et de leur utilisation
Discours Direct qui est la manire la plus mimtique de rapporter les paroles dun personnage.
Constatation : le discours direct est quasiment rserv aux paroles dHrodias ; il intervient aussi pour un
change laconique et brutal entre les deux poux.
Recensement des caractristiques de ce type de discours rapport.
Discours Indirect
Antipas objecta quil pourrait...
[ Elle songeait aussi que le Ttrarque... (il sagit des penses et non plus des paroles).]
Le Discours Indirect ici peu reprsent, dont on peut cependant relever quelques caractristiques, relve
davantage de la traduction, ou de la paraphrase. Et le verbe introducteur participe de cette interprtation par
le narrateur (cf. objecta... ).
Discours Indirect Libre
Trs reprsent dans ce passage - (absent dans La Lgende de saint Julien lHospitalier).
En particulier prend le relais de paroles dHrodias rapportes au Discours Direct :
- quant celui...
- Iaokanann lempchait de vivre... stupfiante
Dans le cas : Alors tout serait perdu... , le D.I.L. vient relayer le D. Indirect.
Enfin Rien ne pressait... , le D.I.L. est l employ seul.
Relev des spcificits du D.I.L.
Pas de mot subordonnant
Pas de verbe introducteur
Transposition des personnes et des temps du Discours Indirect
Transcription des intonations du Discours Direct
Avec des ambiguts : cf. selon pensait-elle...
Empche le D.D.
Rle ? =
Brouille l nonciation
Discours narrativis : Linanit... exasprait...
Le Discours Direct :
Met en vidence les paroles rapportes, ici utilises pour des paroles courtes, brutales ( je le connais !
non ! tais-toi ! et lchange dsagrable entre les deux poux).
Utilis aussi pour le portrait du prophte avec le crible de la subjectivit dHrodias.
Le Discours Indirect Libre :
vite la monotonie du D.D. et permet aux moments de D.D. dapparatre en premier plan ; vite la
lourdeur du D.I. Et certains moments constitue une nonciation ambigu.
II - LE SURNATUREL : le personnage de
Iaokanann
Le portrait trac par Hrodias. vu en
Les propos et les discours de Iaokanann focalisation intrieure
Les phnomnes mystrieux ( on avait mis des serpents... )
Iaokanann = tre farouche, solitaire, hors de la socit humaine ordinaire ; il appelle la maldiction sur la
pcheresse. Il reprsente la religion violente des premiers temps :
(on peut faire un parallle avec la bestialit des deux autres = le hros saint Julien est un cur froce , Flicit
prouve un amour bestial ).
BILAN
La notion de conte
Les trois rcits ont chacun un hros diffrent par le milieu et lpoque ; mais tous trois sont solitaires, isols dans
une socit ou un univers insensible, impitoyable. Tous trois sont des personnages enferms en eux-mmes :
Flicit est une femme de bois , Julien est tout entier dans son got du meurtre et de la chasse puis dans son
repentir, Iaokanann est prsent comme une bte furieuse ( bestialit des trois).
Mais tous trois sont habits par la religion (dans la vie quotidienne, dans la lgende des Saints, dans la Bible) qui
les sauve, par la religion qui tmoigne dun imaginaire riche, fort.
Ces histoires courtes sont bien des contes au sens de la fable philosophique voltairienne voque propos d' Un
cur simple. Et Un cur simplevoit sa valeur de conte affirme par son inscription dans le recueil.
Les procds dcriture du texte narratif
Pour trois rcits diffrents :
Traitement du temps : toute une vie - une srie dactions remarquables - un moment dcisif = repres
chronologiques ; utilisation des temps du pass.
Constitution dune fiche
Constitution et rle de la description
Discours rapports Constitution dune fiche.
Trois lments qui constituent le texte narratif complexe o sarticulent :
rcit / description et portrait / paroles des personnages.
VALUATION
Construire un sujet de bac professionnel avec questionnement / criture partir dun
texte (lexcution de I aokanann par exemple).
v
Vous aimerez peut-être aussi
- The Way of The Superior Man Français FR PDFDocument146 pagesThe Way of The Superior Man Français FR PDFKurt KlipPas encore d'évaluation
- Histoire Des ArtsDocument27 pagesHistoire Des ArtsSarah SalmiPas encore d'évaluation
- "Les Mains Libres" Paul EluardDocument12 pages"Les Mains Libres" Paul Eluardlukasesane100% (1)
- Le Roi LearDocument4 pagesLe Roi Learclaire_speich100% (1)
- FlaubertDocument21 pagesFlaubertMarina Sandu100% (2)
- La JeunepremiredossierpdagogiqueDocument14 pagesLa JeunepremiredossierpdagogiqueBach AbouPas encore d'évaluation
- Le Deuxième Sexe - Simone de BeauvoirDocument12 pagesLe Deuxième Sexe - Simone de BeauvoirPetite Phương0% (2)
- Pour Un Oui Ou Pour Un NonDocument2 pagesPour Un Oui Ou Pour Un NonMorganeBissonPas encore d'évaluation
- ColetteDocument99 pagesColetteRohayu -100% (1)
- Analyse À L'ombre Des Jeunes Filles en FleursDocument10 pagesAnalyse À L'ombre Des Jeunes Filles en FleursRosana Sosa100% (1)
- Carte Quizz Sur La LittératureDocument3 pagesCarte Quizz Sur La LittératureBé Né Dicte0% (1)
- Mosqu e CordoueDocument4 pagesMosqu e CordoueGustavo Monares Riquelme100% (1)
- Initiation À La Linguistique 1LMD S2Document10 pagesInitiation À La Linguistique 1LMD S2Liticia Lydia100% (1)
- Corrigé Possible Composition. L'homme Au Coeur Des Préoccupations de La RenaissanceDocument3 pagesCorrigé Possible Composition. L'homme Au Coeur Des Préoccupations de La RenaissanceSara Battiloro Araujosax100% (4)
- Anima AnimusDocument3 pagesAnima AnimusAna HAPas encore d'évaluation
- Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès: ou le théâtre au corps à corpsD'EverandDans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès: ou le théâtre au corps à corpsPas encore d'évaluation
- Fraisse - Proust Et SchellingDocument48 pagesFraisse - Proust Et SchellingFrancisco Salaris BanegasPas encore d'évaluation
- Sur Flaubert. Essai.Document8 pagesSur Flaubert. Essai.Margnac100% (1)
- Travailler Avec Les ContesDocument3 pagesTravailler Avec Les ContesdavidPas encore d'évaluation
- ConteDocument9 pagesConteAnonymous djdP36Pas encore d'évaluation
- Gradiva - Wilhelm Jensen (Analyse)Document8 pagesGradiva - Wilhelm Jensen (Analyse)Alexandra GhețePas encore d'évaluation
- Le Genre AutobiographiqueDocument19 pagesLe Genre AutobiographiqueSara LolliPas encore d'évaluation
- La Leçon D'ionescoDocument1 pageLa Leçon D'ionescoJosé Daniel Rojas AriasPas encore d'évaluation
- La Femme Fatale Dans La Litterature FrancaiseDocument17 pagesLa Femme Fatale Dans La Litterature FrancaiseAlexandra Gabriela Constantin100% (1)
- Study Guide - La Princesse de Clèves - Madame de La FayetteDocument11 pagesStudy Guide - La Princesse de Clèves - Madame de La Fayettelaura franzoPas encore d'évaluation
- L'œuvre Dramatique Danielle Chaperon, © 2003-2004 DPT de Français Moderne - Université de LausanneDocument20 pagesL'œuvre Dramatique Danielle Chaperon, © 2003-2004 DPT de Français Moderne - Université de Lausanneleonovitch20Pas encore d'évaluation
- 'L'Amour Dans La Poesie de Louise Labé''Document6 pages'L'Amour Dans La Poesie de Louise Labé''OanaBunPas encore d'évaluation
- Universalis 2017 La Chute D'albert CamusDocument5 pagesUniversalis 2017 La Chute D'albert CamusHarry MonamiPas encore d'évaluation
- Collectif - Proust Dans La Litt Rature Contemporaine PDFDocument281 pagesCollectif - Proust Dans La Litt Rature Contemporaine PDFhatem_amraniPas encore d'évaluation
- Elements Pour L Analyse Du Roman PDFDocument12 pagesElements Pour L Analyse Du Roman PDFAna-Maria PricopPas encore d'évaluation
- Sur Le Style de ChateaubriandDocument11 pagesSur Le Style de ChateaubriandRomain PtrPas encore d'évaluation
- Approche Globale Des Rêveries Du Promeneur Solitaire-RousseauDocument5 pagesApproche Globale Des Rêveries Du Promeneur Solitaire-RousseaureasonwaPas encore d'évaluation
- Correspondance SDocument10 pagesCorrespondance SKaty CataPas encore d'évaluation
- Les Principaux Genres LittérairesDocument1 pageLes Principaux Genres LittérairesEstephany De la GarzaPas encore d'évaluation
- Le Voysgeur Sans BagageDocument10 pagesLe Voysgeur Sans BagageDavid Merayo Fernández100% (1)
- Histoire Du ThéâtreDocument44 pagesHistoire Du ThéâtreNaina RavahitrarivoPas encore d'évaluation
- Flaubert, La Prose Comme Une PeintureDocument11 pagesFlaubert, La Prose Comme Une PeintureJavier TusoPas encore d'évaluation
- Principes Fondamentaux de L'histoire de L'art de Wölfflin Et L'Architecture Du Drame Shakespearien de WalzelDocument6 pagesPrincipes Fondamentaux de L'histoire de L'art de Wölfflin Et L'Architecture Du Drame Shakespearien de Walzelweberab1Pas encore d'évaluation
- Catégories Du Récit L'intertextualitéDocument4 pagesCatégories Du Récit L'intertextualitéÎmÀd ÀvëïrøPas encore d'évaluation
- Qu'est-Ce Que La LittératureDocument10 pagesQu'est-Ce Que La LittératureAnge Aristide DjedjePas encore d'évaluation
- Narratologie Et Étude Du PersonnageDocument17 pagesNarratologie Et Étude Du PersonnageEdson AvlisPas encore d'évaluation
- Sartre - Preface - Conscience Et Subjectivite PDFDocument21 pagesSartre - Preface - Conscience Et Subjectivite PDFLuiza HilgertPas encore d'évaluation
- Comment Les Idees de Todorov Ont Obscurci L'etude Du Recit Fantastique, Harry MorganDocument14 pagesComment Les Idees de Todorov Ont Obscurci L'etude Du Recit Fantastique, Harry MorganJames CarroPas encore d'évaluation
- 11 PDFsam Microzimas FINAL28Document2 pages11 PDFsam Microzimas FINAL28Jean PetitPas encore d'évaluation
- Structure Du MytheDocument10 pagesStructure Du MytheFatimeh TehamiPas encore d'évaluation
- Le Songe D'une Nuit D'étéDocument12 pagesLe Songe D'une Nuit D'étéAnonymous T8Ae9H8GVhPas encore d'évaluation
- Dossier AndromaqueDocument26 pagesDossier AndromaqueetazevedoPas encore d'évaluation
- La Phrase de ProustDocument3 pagesLa Phrase de ProustBabette HersantPas encore d'évaluation
- Animal MachineDocument161 pagesAnimal Machinepablo pavesiPas encore d'évaluation
- Premiere Meditation DESCARTESDocument4 pagesPremiere Meditation DESCARTESJames MoorePas encore d'évaluation
- Les Djinns ComentaireDocument2 pagesLes Djinns ComentaireMoraruElenaPas encore d'évaluation
- Milan Kundera - Les Testaments Trahis EssaiDocument127 pagesMilan Kundera - Les Testaments Trahis EssaiMike Burdick100% (1)
- Proust Et Le Monde SensibleDocument100 pagesProust Et Le Monde SensiblemaxiPas encore d'évaluation
- Le Sentiment D'être "À Sa Place" Dans Les Carnets de CamusDocument112 pagesLe Sentiment D'être "À Sa Place" Dans Les Carnets de Camusamelie_charcossetPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire 1 A Propos D'horaceDocument4 pagesLecture Linéaire 1 A Propos D'horacecélenn fabletPas encore d'évaluation
- Cours. Littérature Et Formes Esthétiques. 2021. Semestre 6. PR Fatima Ahnouch PDFDocument9 pagesCours. Littérature Et Formes Esthétiques. 2021. Semestre 6. PR Fatima Ahnouch PDFLahcen OtPas encore d'évaluation
- Camus Fiche LectureDocument6 pagesCamus Fiche LectureAbraham PérezPas encore d'évaluation
- Chapitre 10 Didier AnzieuDocument4 pagesChapitre 10 Didier AnzieuAibPas encore d'évaluation
- Littérature Et CinémaDocument23 pagesLittérature Et Cinémaredouane abdelmoumenPas encore d'évaluation
- Postmodernisme - Memoire - Kirill Gulevsky-Obolonsky (Revu) - LibreDocument23 pagesPostmodernisme - Memoire - Kirill Gulevsky-Obolonsky (Revu) - LibreManoel AlencarPas encore d'évaluation
- Theatre Tartuffe ProfDocument7 pagesTheatre Tartuffe ProfCoformation intergenerationnellePas encore d'évaluation
- Quelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustD'EverandQuelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustPas encore d'évaluation
- Tragédie: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandTragédie: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Résumé de Cours de Philosophie de Coulibaly AmadouDocument39 pagesRésumé de Cours de Philosophie de Coulibaly Amadouamiebarry117Pas encore d'évaluation
- Bases Theoriques de L'analyse de DiscoursDocument35 pagesBases Theoriques de L'analyse de Discours윤여준100% (3)
- Chap 1. Activité 2 Suite Être Citoyen Français Et EuropéenDocument1 pageChap 1. Activité 2 Suite Être Citoyen Français Et EuropéenLucas SANDRE100% (1)
- Rapport CSWSRDocument204 pagesRapport CSWSRkroumaPas encore d'évaluation
- ThoronetDocument2 pagesThoronetMarina PasarinPas encore d'évaluation
- Pere Barbier BiographieDocument8 pagesPere Barbier BiographieΦΧΦΠPas encore d'évaluation
- La Notion de Conseil Et Le Role Attendu Du ConseillerDocument5 pagesLa Notion de Conseil Et Le Role Attendu Du ConseillerLoic Guillaume Kingue DibonguePas encore d'évaluation
- La Gazette D'aliahovaDocument5 pagesLa Gazette D'aliahovaFenomenologia y filosofia primera. comPas encore d'évaluation
- Ibn Arabi Jawab Mustaqim Amma Sa Ala Anhu at Tirmidhi Al Hakim FR Slimane RezkiDocument44 pagesIbn Arabi Jawab Mustaqim Amma Sa Ala Anhu at Tirmidhi Al Hakim FR Slimane RezkiashmavrikPas encore d'évaluation
- CandidecontrolelectureDocument10 pagesCandidecontrolelecturemisslilylolPas encore d'évaluation
- Private ProDocument27 pagesPrivate ProAsmaa BengueddachPas encore d'évaluation
- Curso de Compagnon Sobre Os Gêneros LiteráriosDocument88 pagesCurso de Compagnon Sobre Os Gêneros Literáriosquadros_marianaPas encore d'évaluation
- La Forme Horizontale de L'entrepriseDocument21 pagesLa Forme Horizontale de L'entreprisekaoutar0% (1)
- Le Théâtre Et Son Double Compte RenduDocument5 pagesLe Théâtre Et Son Double Compte RenduEsprit PurPas encore d'évaluation
- Recurrence EXOSCORRIGESDocument8 pagesRecurrence EXOSCORRIGESRafa_Rafa_Mouih_3166Pas encore d'évaluation
- ExposéDocument3 pagesExposéfayein.louisarthurPas encore d'évaluation
- Maitriser Les Verbes Reguliers Et Irreguliers Avec Precision g11cgtDocument26 pagesMaitriser Les Verbes Reguliers Et Irreguliers Avec Precision g11cgtJonasPas encore d'évaluation
- Analyse Transactionnelle (Enregistrement Automatique)Document29 pagesAnalyse Transactionnelle (Enregistrement Automatique)Ali LaminPas encore d'évaluation
- Exercice Questions Sociologie de La CultureDocument2 pagesExercice Questions Sociologie de La CultureMAX MADSENPas encore d'évaluation
- Cours StatistiqueDocument70 pagesCours StatistiqueAyoub Mahi100% (1)
- Sepo Ppo b4Document7 pagesSepo Ppo b4asmaPas encore d'évaluation
- Vers Un Apprentissage Organisé Du Vocabulaire en 4ème AEPDocument4 pagesVers Un Apprentissage Organisé Du Vocabulaire en 4ème AEPcold hillPas encore d'évaluation
- Les Septs SagesDocument6 pagesLes Septs SagesSouleymane BahPas encore d'évaluation
- Table, Lieu de Communication - Michel MaffesoliDocument6 pagesTable, Lieu de Communication - Michel MaffesoliElmano MadailPas encore d'évaluation