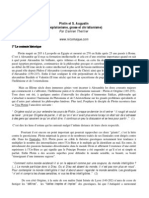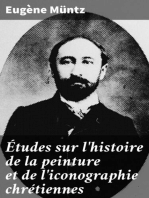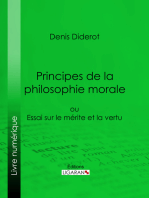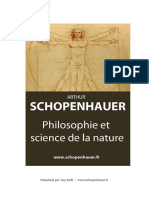Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
De L'amour Chez Spinoza
De L'amour Chez Spinoza
Transféré par
fabimacg60 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
10 vues13 pagesTitre original
De l'Amour Chez Spinoza
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
10 vues13 pagesDe L'amour Chez Spinoza
De L'amour Chez Spinoza
Transféré par
fabimacg6Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 13
1
De lamour chez Spinoza et dans lEthique en particulier
Stephane N. Ginsburgh
Janvier 2004
1. Introduction
Lamour est une Joie accompagne de lide dune cause extrieure
Cette dfinition tire de la troisime partie de lEthique est une des pierres de
ldifice intellectuel labor par Spinoza. On ralise ds lors trs vite quil est fort
difficile de parler dun aspect particulier de cet difice sans faire appel
larchitecture qui le sous-tend et aux lignes de force qui mnent la conclusion
finale, dont cette dfinition nest quune tape. Lamour nest pas une question qui
se traite part, elle dcoule et fait partie dun enchanement articul autour dune
srie dides fondamentales. Avant de parvenir lide suprme de la batitude
qui est lamour intellectuel de Dieu et la vertu elle-mme, il nous faut tablir une
topologie suffisamment prcise et entrer dans lEthique par les premires notions
essentielles : Dieu, les illusions de lhomme, lquivalence du corps et de lesprit,
les affects ou sentiments et finalement lamour de Dieu.
2. Forme de lEthique
La mthode adopte par Spinoza pour lEthique est tout sauf traditionnelle
puisquelle procde more geometrico, selon un mode gomtrique. Pourquoi
Spinoza adopte-t-il une manire aussi formelle et svre ? Parce quelle est la
2
condition de lapproche dductive et le fondement mme du rationalisme
spinoziste. Ce mode tient de la mthode mathmatique, celle de gomtres qui
dcriraient le triangle ou le cercle (un exemple utilis dans la deuxime partie) en
recherchant sa nature et ses proprits. Notons que quelques annes auparavant
dj, Hobbes, dans une volont de rendre la philosophie politique plus rigoureuse
et poursuivant lidal dune thique dmonstrative, se prononce en faveur de la
gomtrie comme modle de rflexion. Dans Lviathan, il dit de la gomtrie
quelle est la seule science que jusquici il ait plu Dieu doctroyer
lhumanit et que les conclusions de cette science ont t rendues
indiscutables.
1
3. Dieu. Sa nature et ses attributs
Le premier livre de lEthique souvre sur la question de Dieu par une srie de
dfinitions.
Ethique I, dfinition VI : Par Dieu, jentends un tre absolument infini, cest--
dire une substance consistant en une infinit dattributs, dont chacun exprime une
essence ternelle et infinie. Do lon dduit que Dieu dfini comme concept est
une substance infinie et unique, cest--dire non limite, englobant tout le Rel et
linfinit de ses manifestations.
De plus dans Ethique I, proposition XVIII : Dieu est cause immanente, mais non
transitive, de toutes choses. Ce qui signifie que Dieu contient non seulement tout
ce qui forme le Rel et ses manifestations, mais quil en est aussi la cause et est
lorigine de son intelligibilit. Et Dieu est cause de toutes choses par un
1
Norberto Bobbio, lEtat et la dmocratie internationale, Editions Complexe, Bruxelles,
2001, p. 85
3
enchanement infini qui se rpercute infiniment entre toutes les choses quil
produit.
Spinoza ajoute au dbut, dans Ethique I, dfinition VII : Cette chose est dite libre,
qui existe daprs la seule ncessit de sa nature et est dtermine par soi seule
agir. Dautre part, cette chose sera dite ncessaire, ou plutt contrainte, qui est
dtermine par une autre exister et produire un effet selon une raison certaine
et dtermine. Ce qui caractrise bien la substance quest Dieu, chose libre par
excellence et qui nest contrainte par rien sinon par son essence mme. Au
contraire, toutes les choses qui doivent leur existence Dieu sont contraintes par
lui. Cest ainsi que lon peut distinguer la Nature naturante quest Dieu de la
Nature nature, toutes choses produites par Dieu.
4. Illusion des causes finales et des dcrets libres
Malheureusement, la conscience de lhomme est dans lignorance de ces causes et
la conjure par une triple illusion.
- lillusion des causes finales : confondre les effets avec les causes
- lillusion des dcrets libres : la conscience se croit cause premire
- lillusion thologique : Dieu est le refuge de notre ignorance
Lillusion principale est celle du libre-arbitre que lhomme sapplique aussi bien
lui-mme qu Dieu. Or Dieu produit selon sa nature et non sa volont, ce quon
peut lire dans Ethique I, proposition XXXII : La volont ne peut tre appele
cause libre, mais seulement cause ncessaire. Et son corollaire 1 : Dieu ne produit
pas ses effets par la libert de sa volont. Ainsi, lhomme ne peut chapper en
aucune manire lenchanement causal qui prend son origine en Dieu, ni dcider
4
par sa propre volont de ses actes et de ses choix. Toute action de lhomme existe
comme effet dune cause extrieure. Nous verrons plus loin quel point lillusion
du libre-arbitre place lhomme dans une confusion qui lempche de connatre les
causes relles de ce dont il ptit moins de renverser cette croyance.
5. Le corps et lesprit
Dans la deuxime partie de lEthique, Spinoza traite de la Nature et de lOrigine
de lEsprit. Spinoza y rhabilite le corps (Etendue) par rapport lesprit (Pense)
en les prsentant comme lexpression de deux attributs de Dieu apprhendables
par lhomme (Ethique II, propositions I et II). Spinoza affirme laudacieuse ide
quil ny a aucune prminence de lun sur lautre, et quils sont une expression de
la mme chose. Gilles Deleuze reprend pour cette ide le terme de Paralllisme :
Le corps dpasse la connaissance quon en a ; et la pense ne dpasse pas moins
la conscience quon en a
2
, cest--dire quil existe un inconscient de la pense et
un inconnu du corps. Cette thse est trs importante, car, en tant qutres
conscients, nous recueillons les effets qui se manifesteront sous forme de joie ou
de tristesse comme nous le verrons plus loin et navons pas suffisamment
conscience des causes de ces effets.
2
Gilles Deleuze, Spinoza, Philosophie pratique, Ed. de Minuit, Paris, 1981, p. 29
5
6. Les affects et lamour comme affect
La troisime partie de lEthique, qui traite des affects (sentiments), est celle dans
laquelle Spinoza explicite la notion damour comme affect.
Dans les dfinitions qui ouvrent cette partie, Spinoza distingue action et passion.
Nous sommes actifs lorsque nous pouvons nous identifier comme la cause de ce
qui se produit et passifs dans le cas contraire. La passion est ds lors bien le fait de
ptir dune cause extrieure dont nous ne sommes pas responsables et qui, de plus,
peut chapper notre conscience. Et dans la Ethique III, dfinition III : Par
sentiments (affects), jentends les affections du corps, par lesquelles, la puissance
dagir de ce corps est augmente ou diminue, aide ou empche ; et en mme
temps les ides de ses affections. Nous pouvons donc exprimenter des affects de
manire active ou passive selon leur cause et ils peuvent savrer positifs ou
ngatifs selon leffet quils ont sur nous.
Dans la trs importante Proposition VI est expose la notion de Conatus ou Dsir :
Chaque chose, autant quil est en elle, sefforce de persvrer dans son tre. Bien
sr, cet effort de persvrer, ou encore de persister ne procde pas de la volont,
mais est partie intgrante de la nature de chaque chose et provient du principe
productif de Dieu. Ou comme crit dans Ethique III, proposition VII : Leffort par
lequel chaque chose sefforce de persvrer dans son tre nest rien part
lessence actuelle de cette chose. Il sagit donc bien sr dun principe positif et
cratif qui na rien voir avec le dsir de combler un manque.
Dans le scolie de Ethique III, proposition IX, il est plus particulirement question
de lhomme. Lorsque cet effort de persvrance se rapporte lhomme et est li au
corps et lesprit, il est nomm Apptit. Cest lessence mme de lhomme. Plus
loin encore, lApptit et le Dsir sont confondus en une seule dfinition : le dsir
6
est lapptit avec conscience de lui-mme. Et le scolie conclut par une ide trs
importante : Il est donc tabli par tout cela que nous ne faisons effort vers aucune
chose, que nous ne la voulons, ne lapptons ni ne la dsirons, parce que nous
jugeons quelle est bonne ; mais, au contraire, que nous jugeons quune chose est
bonne, parce que nous faisons un effort vers elle, que nous la voulons, lapptons
et la dsirons. Il sagit ici de lillusion des causes finales mentionne au point 4.
Lclaircissement apport est essentiel puisque Spinoza affirme que nous jugeons
et dcrtons une chose bonne parce que nous sommes attir par elle, que notre
conatus nous porte la vouloir et non le contraire. Lide trs humaine doublier
ce qui nous meut et de confondre notre dsir avec une volont libre est comme
celle dun petit enfant [qui] croit dsirer du lait, un jeune garon en colre vouloir
se venger, et un peureux senfuir. (Ethique III, proposition II et scolie).
Nous en venons la question mme des passions et de leur combinaison que
Spinoza analyse trs prcisment dans les propositions et scolies qui suivent la XI.
Nous retrouvons ses conclusions dans les dfinitions du chapitre Dfinition des
Sentiments qui clt la troisime partie.
Dfinition I : Le Dsir est lessence mme de lhomme, en tant quelle est conue
comme dtermine, par quelque sienne affection donne, faire quelque chose.
Dfinition II : La Joie est le passage de lhomme dune moindre une plus grande
perfection
Dfinition III : la Tristesse est le passage de lhomme dune plus grande une
moindre perfection
Par passage, Spinoza entend que la puissance dagir de lhomme est affecte, soit
augmente, soit diminue. Les autres affects sont des drivs de ces trois affects,
ce que nous dit Ethique III, proposition LVI : De la joie, de la tristesse et du dsir,
et consquemment de tout sentiment qui en est compos, comme le flottement de
7
lme, ou qui en drive, savoir lamour, la haine, lespoir, la crainte, etc., autant
despces sont donnes, quil y a despces dobjets par lesquels nous sommes
affects.
Ainsi, lamour sera une forme de joie, une joie accompagne de lide dune cause
extrieure. Cette dfinition de lamour montre que cest la joie, cest--dire
laltration de notre puissance dagir qui est au premier plan devant lobjet. Et ce
nest que notre perception de cet objet qui nous porte croire quil est la cause de
cet affect damour. La dfinition traditionnelle donne par la volont de celui qui
aime de se joindre la chose aime nexprime pas lessence de lamour mais sa
proprit dans laquelle il ne faut pas entendre volont comme libre dcision, mais
comme satisfaction de celui qui aime cause de la prsence de la chose aime.
Dautres affects sont successivement drivs et expliqus de la mme manire.
Comme un inverse de lamour, dans la dfinition qui suit, La Haine est la tristesse
accompagne de lide dune cause extrieure.
Dautres affects sont directement ou indirectement lis lamour, comme la
Dvotion qui est lAmour envers celui que nous admirons. La Disposition
favorable qui est lAmour envers quelquun qui fait du bien un autre et la
Surestime qui consiste avoir de quelquun, par Amour, une meilleure opinion
quil nest juste. La Misricorde, lOrgueil, la Gratitude et en particulier la
Gourmandise, lIvrognerie, lAvarice et la Lubricit quil est inutile de dtailler et
dont Spinoza dit quil ne concerne pas tant lacte que lapptit mme de lamour.
Il juge indispensable une meilleure connaissance des affects en gnral et fait le
constat quil en existe une infinit dautres.
Terminons ce point en considrant quelques propositions intressantes qui traitent
de lamour ou de sentiments qui lui sont apparents.
8
Ethique III, proposition XVII : Si nous imaginons quune chose, qui a coutume de
nous affecter dun sentiment de tristesse, a quelque chose de semblable une
autre, qui a coutume de nous affecter dun sentiment de joie galement grand,
nous aurons cette chose en haine et nous laimerons en mme temps. Spinoza
nomme cet tat intermdiaire entre deux sentiments contraires Flottement de lme
qui prsente une analogie avec le Doute du point de vue de la pense. Cette
situation que nous pouvons parfaitement visualiser est celle qui provoquera
lhsitation et les sentiments contraires damour et de haine. On peut ds lors
parfaitement concevoir quun mme objet puisse tre la source de nombreux
sentiments contradictoires en fonction de notre joie ou de notre tristesse.
Ethique III, proposition XXXI : Si nous imaginons que quelquun aime, ou dsire,
ou a en haine quelque chose que nous-mme aimons, dsirons, ou avons en haine,
par l mme, nous aimerons, etc. cette chose avec plus de constance. Mais si nous
imaginons quil a en aversion ce que nous aimons, ou inversement, alors nous
subirons le flottement de lme. Il semble clair ici que Spinoza conduit une
rflexion trs en avance sur son poque et qui est du ressort de la psychologie
individuelle. Cette proposition dcrit ltat dinfluence que nous subissons lorsque
nos sentiments lgard dune chose sont confirms ou contredits par ceux dun
autre. Nos sentiments nont pas toujours comme cause celle que nous imaginons et
il est ncessaire de recourir cette analyse psychologique pour en comprendre le
mcanisme.
Ethique III, proposition XXXV : Si quelquun imagine quun autre sattache la
chose aime par le mme lien damiti, ou par un plus troit, que celui par lequel
il lavait seul en possession, il sera affect de haine envers la chose aime elle-
mme, et portera envie cet autre. Nous avons la parfaite description du
sentiment de jalousie o intervient mme la notion de possession de la chose
aime. Spinoza souligne dans le scolie que la haine porte envers lautre sera
9
dautant plus grande quil constatera la joie exprime par le rival et dont il avait
lhabitude dtre affect lui-mme. Nous serons dautant plus attrists que nous
constaterons le bonheur de lobjet de notre amour et que notre propre amour sera
empch.
Et pour terminer, Ethique III, proposition XLVI : Si quelquun a t affect par un
autre, appartenant quelque classe ou nation diffrente de la sienne, dune joie
ou dune tristesse quaccompagne lide de cet autre, comme cause sous le nom
universel de la classe ou de la nation, il aimera ou aura en haine non seulement
cet autre, mais tous ceux de la mme classe ou de la mme nation. Pntrante
proposition qui dcrit le problme de la gnralisation dun sentiment lchelle
dune nation pour le transformer en prjug xnophobe ou son contraire. Cette
proposition, obtenue par dduction partir des dfinitions et axiomes de dpart
(comme les prcdentes dailleurs) est une rflexion extraordinairement moderne
dans le sens du dveloppement de ltude psychologique des ides et des
comportements. Il faudra malgr tout attendre le 19
me
sicle pour que lattention
des philosophes se porte sur la psychologie des masses, par exemple, et quen
close une discipline part entire.
7. Lamour de Dieu et la Batitude
Cette plonge dans la description des affects et de la servitude de lhomme serait
vaine sil ny avait chez Spinoza plus quun dsir de comprendre. Cest ce
quexplicitent les propositions de la cinquime et dernire partie de lEthique.
Ethique V, proposition VI : Dans la mesure ou lesprit comprend toutes les choses
comme ncessaires, il a sur les sentiments une puissance plus grande, autrement
dit il en ptit moins. Et la proposition X qui suit : Aussi longtemps que nous ne
10
sommes pas tourments par des sentiments qui sont contraires notre nature,
nous avons le pouvoir dordonner et denchaner les affections du corps suivant
un ordre conforme lentendement. Cest donc par la raison et la rflexion
systmatique sur les affects qui nous enchanent que nous parviendrons diriger
nos dsirs dans un sens positif, vers plus de joie. Lignorant qui continue de vivre
dans lillusion sera perptuellement ballott dun dsir lautre et victime de
passions tristes.
Lultime tape de cette connaissance est Dieu. Ethique V, proposition XV : Celui
qui se comprend, soi et ses sentiments, clairement et distinctement, aime Dieu, et
dautant plus quil se comprend davantage, soi et ses sentiments. Ethique V,
proposition XVI : Cet amour doit occuper lesprit au plus au point. Cest ainsi que
sopre un retour aux rflexions initiales de louvrage et que lhomme, en se
proccupant de ses affections, sinscrit de manire plus harmonieuse dans le rel.
Noublions pas les dfinitions de dpart : il faut considrer Dieu au sens dune
substance, cest--dire de la Nature elle-mme et de lensemble de ses
manifestations. Il ne sagit pas ici de plaire un Dieu immatriel en lui rendant un
culte obissant ou de suivre une loi morale transcendante, mais dexplorer comme
le dit Deleuze une typologie des modes dexistence immanents en toute
conscience de notre conatus. Ceci est clairement expos dans Ethique V,
proposition XLII : La Batitude nest pas la rcompense de la vertu, mais la vertu
elle-mme ; et nous nen jouissons pas parce que nous rprimons nos penchants,
mais cest au contraire parce que nous en jouissons, que nous pouvons rprimer
nos penchants. Les notions de rcompense et de rpression sont plutt associs
une morale, tandis que parvenir une juste jouissance de la vie nous permet
logiquement de rprimer nos penchants.
Il faut parvenir ce que Spinoza nomme la Batitude, dans une connaissance
souveraine qui se trouve au-del des expriences vagues de la perception sensible
11
du premier genre de connaissance, de la comprhension partielle par la rflexion
inductive quest le second genre de connaissance. Un troisime genre de
connaissance saisit lessence de chaque dsir particulier et qui se confond avec
lamour de Dieu. Ethique V, proposition XXXIII : Lamour intellectuel de Dieu,
qui nat du troisime genre de connaissance, est ternel. Et comme Dieu est infini,
parfait et quil jouit dune ide claire de lui-mme et sa propre cause, Il saime lui-
mme dun amour intellectuel infini. Spinoza conclut en rapportant cet amour
infini toutes les parties de Dieu, les hommes inclus, puisque lamour intellectuel
que lesprit lui porte est videmment une partie de lamour infini qui sapplique
lui-mme. Comme le montre Ethique V, proposition XXXVI : lamour
intellectuel envers Dieu est une partie de lamour infini dont Dieu saime lui-
mme.
8. Conclusion
Le chemin parcouru dans lEthique offre videmment un idal de sagesse difficile
atteindre et qui demande un renversement radical des valeurs. Spinoza reconnat
la fin de louvrage que ce chemin est rarement suivi dautant plus quil est ardu.
Car comment pourrait-il se faire, si le salut tait facile et quil pt tre trouv sans
grande peine, quil fut nglig par presque tous ? Mais tout ce qui est excellent est
aussi difficile que rare nous dit le dernier scolie. On pourrait aussi objecter
Spinoza sa mthode gomtrique qui, dans une volont dterministe, nous pousse
vers un systme binaire et quantitatif. Cet cueil est vit si nous considrons les
valeurs plutt comme qualitatives, soumises variations selon les objets et les
individus. LEthique noffre pas non plus une collection de dfinitions rigides,
mais plutt un modle de pense pratique.
12
Et ceux qui lui rtorquent que si Dieu est source de toute chose, cest aussi lui
qui cause notre tristesse, il rpond que dans la mesure o nous comprenons les
causes de la tristesse, celle-ci cesse dtre une passion et par consquent, nous
nous rjouissons de cette comprhension que nous avons de Dieu. En cela,
lEthique de Spinoza est ncessairement une thique de la joie, dont lamour est
une partie.
9. Bibliographie
- Baruch Spinoza, lEthique, trad. dA. Gurinot, IVREA, Paris, 1993
- Gilles Deleuze, Spinoza, Philosophie pratique, Ed. de Minuit, Paris, 1981
- Pierre-Franois Moreau, Spinoza, Seuil, coll. Ecrivains de toujours , Paris,
1975
- Charles Ramond, Le vocabulaire de Spinoza, Ellipses, coll. Vocabulaire de,
Paris, 1999
13
De lamour chez Spinoza et dans lEthique en particulier
Table
1 Introduction
2 Forme de lEthique
3 Dieu. Sa nature et ses attributs
4 Illusion des causes finales et des dcrets libres
5 Le corps et lesprit
6 Les affects et lamour comme affect
7 Lamour de Dieu et la Batitude
8 Conclusion
9 Bibliographie
Vous aimerez peut-être aussi
- Impérialisme Païen - Julius EvolaDocument180 pagesImpérialisme Païen - Julius EvolakcherelsalzburgPas encore d'évaluation
- La Philosophie EternelleDocument396 pagesLa Philosophie EternelleJean-Marc ChichePas encore d'évaluation
- L'Unité de L'être ParménidienDocument14 pagesL'Unité de L'être Parménidienvince34100% (1)
- La Loi N'est Pas Dans Le Ciel - Eric Smilevitch - MelamedDocument15 pagesLa Loi N'est Pas Dans Le Ciel - Eric Smilevitch - MelamedNathanaelPas encore d'évaluation
- Steiner Rudolf - La Chute Des Esprits Des TénèbresDocument296 pagesSteiner Rudolf - La Chute Des Esprits Des Ténèbreswxcvbnnbvcxw100% (5)
- Eric Tolone ETUDES ESOTERIQUESDocument118 pagesEric Tolone ETUDES ESOTERIQUESsantseteshPas encore d'évaluation
- PDFDocument30 pagesPDFDorismond EdelynPas encore d'évaluation
- Dupuis Charles-François - Origine de Tous Les Cultes, Ou Religion Universelle Volume 2Document645 pagesDupuis Charles-François - Origine de Tous Les Cultes, Ou Religion Universelle Volume 2slimane gPas encore d'évaluation
- Jung Bouddha OccidentalDocument6 pagesJung Bouddha OccidentalAudrey Vescovi-mouginPas encore d'évaluation
- Leibniz, Spinoza Et Le Problème de L'incroyance Au XVIIe SiècleDocument9 pagesLeibniz, Spinoza Et Le Problème de L'incroyance Au XVIIe SiècleAnonymous va7umdWyhPas encore d'évaluation
- Khunrath Amphithéâtre (FR) 1609Document126 pagesKhunrath Amphithéâtre (FR) 1609Alexis S.33% (3)
- La Connaissance Silencieuse, Des Évidences Antéprédicatives À Une Critique de L'apophaseDocument18 pagesLa Connaissance Silencieuse, Des Évidences Antéprédicatives À Une Critique de L'apophaseRangalanga MboangyPas encore d'évaluation
- Yvon Belaval (25 Novembre 1961) L'Histoire de La Phi Lo Sophie Et Son EnseignementDocument24 pagesYvon Belaval (25 Novembre 1961) L'Histoire de La Phi Lo Sophie Et Son EnseignementALBERTO PAULO NETOPas encore d'évaluation
- 06-'Je-Serai Là-Où Je-Sera' (Exode, 3, 14)Document4 pages06-'Je-Serai Là-Où Je-Sera' (Exode, 3, 14)Aurélien MarionPas encore d'évaluation
- Métaphysique AnalytiqueDocument44 pagesMétaphysique Analytiqueprecoce12100% (1)
- Papyrus Araméen Du LouvreDocument38 pagesPapyrus Araméen Du LouvreApache313Pas encore d'évaluation
- Descartes, Le MondeDocument10 pagesDescartes, Le MondeerahothPas encore d'évaluation
- Aristote PhysiqueDocument7 pagesAristote PhysiqueAyt Moha BrahimPas encore d'évaluation
- Les Méditations CartesiennesDocument26 pagesLes Méditations Cartesiennesjules borrelPas encore d'évaluation
- Charles Baudelaire - Fusées (1ere Partie Des Journaux Intimes)Document22 pagesCharles Baudelaire - Fusées (1ere Partie Des Journaux Intimes)lasolitudenuePas encore d'évaluation
- Hilaire de Barenton - Le Temple de Sib Zid Goudéa Patési de Lagash (1921)Document124 pagesHilaire de Barenton - Le Temple de Sib Zid Goudéa Patési de Lagash (1921)tonyf62Pas encore d'évaluation
- Isis Dévoilée Clef Des (... ) Blavatsky H Bpt6k65334jDocument484 pagesIsis Dévoilée Clef Des (... ) Blavatsky H Bpt6k65334jrichardPas encore d'évaluation
- Entre Mimesis Et AnalogieDocument10 pagesEntre Mimesis Et AnalogieAxelle JéromePas encore d'évaluation
- Paracelse - Le Ciel Des Philosophes PDFDocument7 pagesParacelse - Le Ciel Des Philosophes PDFalmareanPas encore d'évaluation
- Épître Du Feu PhilosophiqueDocument4 pagesÉpître Du Feu Philosophiqueon77eir2Pas encore d'évaluation
- La Croix D HendayeDocument5 pagesLa Croix D HendayeJHack2100% (1)
- Saint Anselme de Canterbury - ProslogionDocument16 pagesSaint Anselme de Canterbury - ProslogionAnonymous NE7Bwby7100% (1)
- Baruch Spinoza - Vocabulaire de SpinozaDocument6 pagesBaruch Spinoza - Vocabulaire de SpinozaMario Quispe100% (2)
- Oeuvre Philosophie 1 PDFDocument852 pagesOeuvre Philosophie 1 PDFSilexPas encore d'évaluation
- Memoire de M1 Giordano Bruno LUnivers LeDocument75 pagesMemoire de M1 Giordano Bruno LUnivers LeAli BenzPas encore d'évaluation
- 3021-B - L'eau Et L'épiDocument7 pages3021-B - L'eau Et L'épiSmooth BigmackPas encore d'évaluation
- Anthropologie Ternaire Travail en GroupeDocument7 pagesAnthropologie Ternaire Travail en GroupeBenjamin MilordPas encore d'évaluation
- Saint-Martin Louis-Claude - L Aurore Naissante Ou La Racine de La PhilosophieDocument14 pagesSaint-Martin Louis-Claude - L Aurore Naissante Ou La Racine de La PhilosophietiennosPas encore d'évaluation
- Conférence de Q. Meillassoux Sur Mallarmé - Le Signifiant OpaqueDocument6 pagesConférence de Q. Meillassoux Sur Mallarmé - Le Signifiant OpaquepanoptericPas encore d'évaluation
- DESCARTES Morale ProvisionDocument4 pagesDESCARTES Morale ProvisionLasauge EnsoiePas encore d'évaluation
- Thomas Romer, Lla Construction D'un Ancêtre. La Formation Du Cycle D'abrahamDocument19 pagesThomas Romer, Lla Construction D'un Ancêtre. La Formation Du Cycle D'abrahamaminickPas encore d'évaluation
- RT 21Document250 pagesRT 21Ivan BogdanovPas encore d'évaluation
- Israel Et Les Nations La Dialectique deDocument26 pagesIsrael Et Les Nations La Dialectique debamba225Pas encore d'évaluation
- Jamblique - Commentaire Du Traité D'aristote Sur L'âmeDocument8 pagesJamblique - Commentaire Du Traité D'aristote Sur L'âmeSophie de Saint-Jean100% (1)
- Sextus Empiricus CAPH - 115 - 0029 PDFDocument18 pagesSextus Empiricus CAPH - 115 - 0029 PDFMathieu BompointPas encore d'évaluation
- 03 La Dematerialisation StructuralisteDocument9 pages03 La Dematerialisation Structuralistebadid SusskindPas encore d'évaluation
- PLATON, L. Robin Tadd. Phedon 1926Document290 pagesPLATON, L. Robin Tadd. Phedon 1926André Decotelli100% (1)
- Guénon René - Le Sacré-Coeur Et La Légende Du Saint-Graal PDFDocument7 pagesGuénon René - Le Sacré-Coeur Et La Légende Du Saint-Graal PDFBelhamissiPas encore d'évaluation
- PaRDeS PDFDocument13 pagesPaRDeS PDFreussavelPas encore d'évaluation
- Ruyer Raymond Ruyer Par Lui MemeDocument13 pagesRuyer Raymond Ruyer Par Lui Memenadhamz100% (1)
- Plotin AugustinDocument5 pagesPlotin AugustinFarahBejiPas encore d'évaluation
- 9 Descartes Et Le Problème de DieuDocument5 pages9 Descartes Et Le Problème de DieuSourigo100% (1)
- Ernest Renan - L'Antechrist (1873)Document636 pagesErnest Renan - L'Antechrist (1873)Școala Solomonară / The Solomonary School100% (1)
- Hubert Larcher - L'Incorruption de La ChairDocument9 pagesHubert Larcher - L'Incorruption de La ChairRaphael888Pas encore d'évaluation
- Le Mystère Du ProcessusDocument23 pagesLe Mystère Du ProcessusJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Zoroastre de Perse - Clavis ArtisDocument68 pagesZoroastre de Perse - Clavis ArtisAlmuric59100% (1)
- Bachelard 4 ElementsDocument3 pagesBachelard 4 ElementsLPAPas encore d'évaluation
- Histoire Et Sagesse D'ahikar L'assyrienDocument370 pagesHistoire Et Sagesse D'ahikar L'assyrienJean De CompostellePas encore d'évaluation
- Mort, Mystère Et Oubli Dans La Pensée de Heidegger. MarquetDocument22 pagesMort, Mystère Et Oubli Dans La Pensée de Heidegger. MarquetNicolas Di BiasePas encore d'évaluation
- AdB - René Girard, Auteur SurfaitDocument12 pagesAdB - René Girard, Auteur SurfaitIo Pan100% (1)
- Carl Jung Thèse de Luc Beaubien PDFDocument360 pagesCarl Jung Thèse de Luc Beaubien PDFAnonymous IH8qCi100% (1)
- Exposé GIOTTO Alexia OrfanoudakisDocument25 pagesExposé GIOTTO Alexia Orfanoudakisapi-3709589100% (1)
- Joseph Moreau - Le Temps Selon Aristote - 1Document29 pagesJoseph Moreau - Le Temps Selon Aristote - 1duckbannyPas encore d'évaluation
- Études sur l'histoire de la peinture et de l'iconographie chrétiennesD'EverandÉtudes sur l'histoire de la peinture et de l'iconographie chrétiennesPas encore d'évaluation
- Le Prince de la Concorde: La vie lumineuse de Jean Pic de la MirandoleD'EverandLe Prince de la Concorde: La vie lumineuse de Jean Pic de la MirandolePas encore d'évaluation
- Principes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuD'EverandPrincipes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuPas encore d'évaluation
- Dissertation sur les psaumes traduite du latin de J.-B. Bossuet: Accompagnée de notesD'EverandDissertation sur les psaumes traduite du latin de J.-B. Bossuet: Accompagnée de notesPas encore d'évaluation
- De L'habitude Par Félix (... ) Ravaisson FélixDocument60 pagesDe L'habitude Par Félix (... ) Ravaisson FélixsantseteshPas encore d'évaluation
- Le Déclin de L'occident MémoireDocument107 pagesLe Déclin de L'occident MémoiresantseteshPas encore d'évaluation
- Seneque - La Providence Suivi de La Constance Du Sage (1996) PDFDocument103 pagesSeneque - La Providence Suivi de La Constance Du Sage (1996) PDFBreno Gomes100% (2)
- Faouzi Skali - LA VOIE SOUFIEDocument195 pagesFaouzi Skali - LA VOIE SOUFIEsantseteshPas encore d'évaluation
- La Mere - Agenda Vol7Document171 pagesLa Mere - Agenda Vol7santseteshPas encore d'évaluation
- Liberté Morale Et Causalité Chez Cudworth PDFDocument29 pagesLiberté Morale Et Causalité Chez Cudworth PDFsantseteshPas encore d'évaluation
- Origène PDFDocument140 pagesOrigène PDFsantseteshPas encore d'évaluation
- Pages Choisies JM GuyauDocument368 pagesPages Choisies JM GuyausantseteshPas encore d'évaluation
- Les Bases de La Morale de Guyau PDFDocument76 pagesLes Bases de La Morale de Guyau PDFsantseteshPas encore d'évaluation
- Arthur Schopenhauer-L'Art D'etre Heureux-SeuilDocument137 pagesArthur Schopenhauer-L'Art D'etre Heureux-SeuilsantseteshPas encore d'évaluation
- Technique Du Tao 18.Document41 pagesTechnique Du Tao 18.santseteshPas encore d'évaluation
- La Morale de DescartesDocument168 pagesLa Morale de Descartessantsetesh100% (1)
- Philosophie MédiévaleDocument382 pagesPhilosophie Médiévalesantsetesh100% (1)
- Philosophie Et Science de La NatureDocument227 pagesPhilosophie Et Science de La Naturesantsetesh100% (1)
- S2 02 LEtre Humain Ses Limites Et Ses PossibilitesDocument24 pagesS2 02 LEtre Humain Ses Limites Et Ses PossibilitessantseteshPas encore d'évaluation
- Les 40 Règles de Shams Ed-Din Mohammad TabriziDocument7 pagesLes 40 Règles de Shams Ed-Din Mohammad TabrizigggukPas encore d'évaluation
- Un Soir de Kythorn Où Le Jour Commence À RallongerDocument1 pageUn Soir de Kythorn Où Le Jour Commence À RallongerKevin AbilyPas encore d'évaluation
- Transformez Votre Vie PDFDocument161 pagesTransformez Votre Vie PDFLaïla Sakhraji100% (11)
- Yoga Sutras PatanjaliDocument240 pagesYoga Sutras PatanjaliLeandro Martínez100% (1)
- L'opinion, La Vérité. La Persuasion, La Certitude. Vérité de Raison Et Vérité de Fait.Document17 pagesL'opinion, La Vérité. La Persuasion, La Certitude. Vérité de Raison Et Vérité de Fait.Arthur TigreatPas encore d'évaluation
- La Pensee DerobeeDocument187 pagesLa Pensee Derobeejpirattaa0% (1)
- Cioran Emil Le Livre Des Leurres 1992 GallimardDocument119 pagesCioran Emil Le Livre Des Leurres 1992 GallimardSteve Besse100% (2)
- 2-Les Déviations Modernes PDFDocument237 pages2-Les Déviations Modernes PDFAdoté Aduayi-akuePas encore d'évaluation
- Le Cycle Humain - L'ideal de L'unite HumaineDocument66 pagesLe Cycle Humain - L'ideal de L'unite HumaineMichaël AbitbolPas encore d'évaluation
- Hegel Et Le "Tribunal Du Monde" Michel LavoieDocument12 pagesHegel Et Le "Tribunal Du Monde" Michel LavoieDario De MaioPas encore d'évaluation
- 1ère PartieDocument74 pages1ère PartiebanzailoicPas encore d'évaluation
- Les Méthodes en PhilosophieDocument238 pagesLes Méthodes en PhilosophiemaneezechielPas encore d'évaluation
- Le Jeu de La Vie Et Comment Le Jouer Auteur Florence Scovel ShinnDocument127 pagesLe Jeu de La Vie Et Comment Le Jouer Auteur Florence Scovel ShinnChristophe NshomboPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - L - Absoluite Ou L - Infinite (Itlâq) Et La Restriction (Taqyîd)Document47 pagesChapitre 1 - L - Absoluite Ou L - Infinite (Itlâq) Et La Restriction (Taqyîd)Daaray Cheikhoul XadimPas encore d'évaluation
- Histoire de La PhilosophieDocument18 pagesHistoire de La PhilosophieArthur HemonoPas encore d'évaluation
- Henry Michaux Et Les GouffresDocument8 pagesHenry Michaux Et Les GouffresFet BacPas encore d'évaluation
- Abellio Raymond - La Fosse de BabelDocument662 pagesAbellio Raymond - La Fosse de Babelaivlys enialpalPas encore d'évaluation
- SC Des Galets Du LotDocument10 pagesSC Des Galets Du LotLaurent HuardPas encore d'évaluation
- Clement RossetDocument2 pagesClement RossetJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Shasta PDFDocument11 pagesShasta PDFdroopy007Pas encore d'évaluation
- Réflexions sur l'Ὄχημα dans Les Eléments de Théologie de ProclusDocument7 pagesRéflexions sur l'Ὄχημα dans Les Eléments de Théologie de ProclusAnonymous o3QDRuLopPas encore d'évaluation
- CONSTRUCTIVISME ET STRUCTURALISME DANS LES FONDEMENTS DES MATHEMATIQUES Par Yvon Gauthier PDFDocument24 pagesCONSTRUCTIVISME ET STRUCTURALISME DANS LES FONDEMENTS DES MATHEMATIQUES Par Yvon Gauthier PDFmvianneyPas encore d'évaluation
- (Bibliothèque D'histoire de La Philosophie) Jean-Marie Vaysse - Totalite Et Finitude - Spinoza Et Heidegger-Vrin (2004)Document151 pages(Bibliothèque D'histoire de La Philosophie) Jean-Marie Vaysse - Totalite Et Finitude - Spinoza Et Heidegger-Vrin (2004)bernardgillesPas encore d'évaluation
- Spagirie 1-12 PDFDocument93 pagesSpagirie 1-12 PDFDaminos Ace100% (1)
- Qu'est-Ce Que Les Mathématiques ?Document8 pagesQu'est-Ce Que Les Mathématiques ?olivier lPas encore d'évaluation
- Édouard Jourdain-Proudhon Contemporain-JerichoDocument339 pagesÉdouard Jourdain-Proudhon Contemporain-JerichoKi WiPas encore d'évaluation
- Codex TenebraumDocument5 pagesCodex Tenebraumደጀን ኣባባPas encore d'évaluation
- Exercices - PhotosDocument13 pagesExercices - Photosmelany thetahealingPas encore d'évaluation