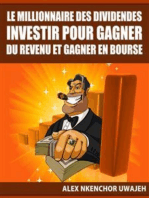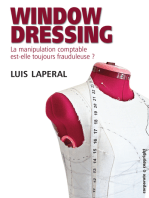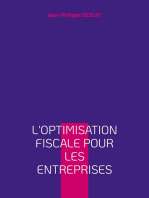Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Comptabilité Et Finance
Comptabilité Et Finance
Transféré par
Khaoula GhoudraniCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Comptabilité Et Finance
Comptabilité Et Finance
Transféré par
Khaoula GhoudraniDroits d'auteur :
Formats disponibles
Prsentation lIMA
Prsentation lIMA
Quel regard les financiers portent-ils sur la
Quel regard les financiers portent-ils sur la
comptabilit ?
comptabilit ?
La Lettre Vernimmen.net
Confidentiel
Par
Pascal Quiry &
Yann Le Fur
23 avril 2003
2
Plan
I. Introduction : quelle est la spcificit des financiers ?
II. Que cherchent les financiers dans les rapports annuels ?
III. Lapproche financire de quelques points complexes
IV. Quelles volutions de la comptabilit pouvons-nous
suggrer en tant quutilisateurs ?
3
I. INTRODUCTION : quelle est la spcificit des financiers ?
4
Introduction : quelle est la spcificit des financiers ?
Un financier sintresse la valeur pour prendre position
: acheter ou vendre.
Cest donc fondamentalement un marchand, dans la ralit
ou dans ltat desprit.
La valeur est une synthse entre :
la rentabilit attendue de linvestissement et aux flux quil va (peut-tre)
gnrer dans le futur ;
le risque li lincertitude pesant sur les flux futurs.
Le temps est donc une dimension fondamentale pour un
financier car il est porteur dopportunits (la rentabilit) et
dalas (le risque).
5
Le financier est :
soit un investisseur qui cherche valoriser au mieux les fonds investis ;
soit un prteur qui cherche dterminer la capacit quaura son client
rembourser lemprunt consenti.
Entre ces deux approches, lesprance de rentabilit et le
niveau de risque sont structurellement diffrents, mais le
raisonnement est fondamentalement le mme.
Lactionnaire comme le prteur se retrouvent autour du tableau
de flux de trsorerie / plan daffaires qui mesurent la capacit
de lentreprise :
rembourser sa dette ;
rmunrer ses capitaux propres ;
crer de la valeur.
Introduction : quelle est la spcificit des financiers ?
6
Les deux approches convergent vers les mmes objectifs :
apprcier la rcurrence des rsultats et leur niveau de risque ;
distinguer les flux de trsorerie des critures comptables ;
comprendre la capacit de lentreprise gnrer des flux de trsorerie ;
dterminer le vrai niveau dendettement ;
apprcier la rentabilit.
Un financier ne peut pas tre bon dans son domaine sil ne
matrise pas dabord correctement la comptabilit.
Introduction : quelle est la spcificit des financiers ?
7
II. Que cherchent les financiers dans les rapport annuels ?
8
Les premiers rflexes vitaux :
comprendre lactivit ;
lire le rapport des commissaires aux comptes / auditeurs (en particulier
les ventuelles rserves ou observations) ;
lire les principes comptables :
quels sont les principes comptable adopts ;
quels sont changements de principes comptables ;
quel traitement du goodwill, des stocks, des provisions,
On pourra alors lire les documents comptables proprement dits :
compte de rsultat, tableau de flux, bilan, notes et annexes.
II. Que cherchent les financiers dans les rapport
annuels ?
9
Apprcier la rcurrence des rsultats :
retraitement de lexceptionnel, participation des salaris ;
volatilit du rsultat dexploitation ainsi retrait ;
volatilit du flux de trsorerie disponible ;
apprciation du risque (et du du groupe) ;
avec comme objectif de pouvoir faire des prvisions.
Distinguer les flux de trsorerie des simples critures
comptables :
provisions / amortissements ;
mais aussi les profits de dilution, mali de fusion, plus-values lors
dapport dactifs, ...
II. Que cherchent les financiers dans les rapport
annuels ?
10
Comprendre la capacit de lentreprise apprhender les flux
de trsorerie :
repose sur lanalyse du primtre de consolidation et des mthodes de
consolidation retenues ;
ex : Lagardre / EADS.
Dterminer le vrai niveau dendettement :
saisonnalit (ex : Bonduelle) ;
titrisation, factoring (ex : Alstom) ;
dette dans des filiales non consolides (ex : Coca-cola) ;
oprations de fin dexercice sur les lments du besoin en fonds de
roulement ;
analyse des provisions pour risques et charges (ex : Alstom).
II. Que cherchent les financiers dans les rapport
annuels ?
11
Apprcier la rentabilit :
la rentabilit conomique
*
est le point dorgue de lanalyse financire ;
problme du goodwill.
*
Rsultat dexploitation x (1 - taux IS) / (immobilisations + besoin en fonds de roulement).
II. Que cherchent les financiers dans les rapport
annuels ?
12
III. Lapproche financire de quelques points complexes :
. La titrisation / le factoring sans recours
. Les locations oprationnelles
. Les provisions pour restructurations / litiges
. Les provisions pour retraites
. Les impts diffrs
. Les stock-options
. Le goodwill
13
La titrisation / le factoring sans recours
Les effets escompts non chus (problme des financiers dil y a 20
ans) nest plus un sujet ! Mais la titrisation et le factoring sans recours
permettent encore de sortir des crances ou des stocks du bilan.
Ces oprations reprsentent nanmoins indiscutablement un
financement souvent moins cher en apparence :
elles sont dailleurs particulirement prises par les investisseurs financiers
lors de la mise en place de LBO
ces financements assis sur des actifs relativement liquides renchrissent
mcaniquement les autres dettes financires
leur niveau dpend du niveau dactivit de la socit
Il convient donc financirement de rintgrer les montants sortis dans la
dette. Ce nest pas toujours possible car linformation nest pas toujours
disponible mme en annexe !
Lapproche financire de quelques points complexes
14
Lapproche financire de quelques points complexes
Les locations oprationnelles / locations financires
La distinction entre location financire et location oprationnelle est de
plus en plus difficile apprcier.
Dans certains secteurs (transport, exploitation de salles de cinma, ...)
les acteurs oprent avec un mix de (i) location oprationnelle, (ii)
location financire, (iii) proprit en propre. Les mix de modes
oprationnels diffrents ne permettent pas une comparaison des soldes
dexploitation, des multiples de valorisation.
Un raisonnement frquemment fait :
je possde une immobilisation dexploitation qui vaut 100 ;
je la vends pour ce prix et la reloue pour un loyer annuel de 9 ;
dans mon secteur, lactif conomique vaut 7 fois lEBE.
Rsultat : la valeur des capitaux propres monte de 100 - 7 x 9 = 37
15
Quelle justesse arithmtique, quelle fausset et navet financires !
lactif conomique en location est plus risqu que lactif conomique en
pleine proprit : loyers = dbours fixe de trsorerie qui lvent le point
mort en trsorerie
do un multiple de valorisation plus faible.
Les financiers (en particulier les analystes boursiers ou crdit sur ces
secteurs) ont donc pris lhabitude dintgrer dans la dette une
capitalisation des loyers. Un coefficient plus ou moins arbitraire de
capitalisation est utilis (entre 6 et 8 x). Le solde pris en considration
au compte de rsultat est alors lEBITDAR (earnings before interests,
taxes, depreciation, amortization and rentals)
Lapproche financire de quelques points complexes
16
Un peu de recul avant daborder dautres points :
Les deux exemples prcdents montrent que le financier cherche
reconstituer lactif conomique normal (immobilisations et besoins en
fonds de roulement) afin :
de faire des comparaisons ;
de dterminer le vrai niveau d endettement (valorisation / solvabilit).
Ceci implique de sabstraire des considrations :
de saisonnalit : BFR moyen et non BFR la clture ;
juridiques (proprit ou location, avec ou sans recours) ;
comptables (bilan / hors bilan).
Lapproche financire de quelques points complexes
17
Les provisions pour risques et charges
Les provisions pour retraites (voir plus loin)
Les provisions pour restructuration. Lapproche financire consiste
avant tout distinguer les provisions qui :
auront un impact cash (licenciements, dmnagements, frais de fermeture
dusine) : grossirement la valeur comptable peut tre considre comme
de la dette, plus finement la valeur actualise suivant lcoulement. Dans le
cadre dune valorisation par actualisation de flux, il convient soit dintgrer
les dpenses dans les flux de trsorerie soit dintgrer le stock dans la dette
(mais pas les deux!) ;
et celles qui nauront pas dimpact cash (principalement les provisions
dactifs immobiliss pour dprciation) ;
les provisions fictives ? En existe-t-il encore ?
Lapproche financire de quelques points complexes
18
Les provisions pour litiges. Gnralement considres comme ayant un
impact cash (et donc comme de la dette) et tant bien values par les
auditeurs. Lorsquun litige particulirement important existe une tude
spcifique est faite et conduit ventuellement diffrents
scnarios/fourchettes de valorisation.
Les impts diffrs passifs (voir plus loin)
Lapproche financire de quelques points complexes
19
Les provisions pour retraite
Au passif du bilan, la provision reprsente la valeur actuelle brute des
engagements de lentreprise. Sous dduction des actifs ventuels
affects la couverture de ce passif, on obtient une dette de nature
financire.
Au compte de rsultat, la variation des provisions pour retraites est de
deux natures :
financire : interest cost : revalorisation annuelle due au passage du temps
des engagements actuels, et produits des actifs de couverture ;
dexploitation : nouveaux droits acquis de lanne sous dduction des
paiements de lanne aux retraits actuels.
Traitement : linterest cost sort de lexploitation pour aller en rsultat
financier.
Lapproche financire de quelques points complexes
20
Impts diffrs passifs et actifs
De manire gnrale les impts diffrs reprsentent un poste obscur
pour les financiers !
Les impts diffrs actifs importants sont gnralement constitus
largement de reports fiscaux dficitaires activs. Financirement, ceux-
ci sont traits part notamment dans les valorisations. Les tapes
sont alors :
localiser ces reports fiscaux ;
apprcier la capacit bnficiaire de la ou des socits concernes ;
valoriser par actualisation de flux.
Nous extournons les autres impts diffrs (actifs et passifs) contre les
capitaux propres.
Lapproche financire de quelques points complexes
21
Les stock-options
Un sujet polmiques o la rigueur intellectuelle a parfois du mal se
faire entendre.
Pour un financier, les stock-options appauvrissent non lentreprise mais
l actionnaire.
Indpendamment du traitement comptable qui sera in-fine retenu, le
traitement financier est celui du fully diluted.
Produit probable actuel de lexercice des stock-options :
nombre doptions dun plan x delta x prix dexercice (Delta : mesure la
probabilit que loption achve sa vie dans la monnaie.
Lapproche financire de quelques points complexes
22
Le produit probable sert :
soit racheter des actions existantes pour leur valeur actuelle (treasury
method) ;
soit rembourser une partie de la dette ou accrotre les disponibilits
(mthode du placement de fonds).
Le nombre dactions est naturellement ajuste en consquence.
De la mme faon en matire de valorisation, la valeur des capitaux
propres de lentreprise qui a mis un nombre important de stock-options
est gale la valeur des actions majore de la valeur des stock-options.
Lapproche financire de quelques points complexes
23
Le goodwill
Dans un pass encore rcent un vrai problme :
comment traiter la dotation aux amortissements du goodwill dans le
compte de rsultat ?
limputation du goodwill sur les capitaux propres pose le problme de la
mesure fiable des rentabilits conomiques et des capitaux propres. Des
pans entiers de capitaux ont disparu, do des taux de rentabilit
comptables anormalement levs dans bon nombre de socits.
La situation actuelle dans les normes amricaines et probable dans les
normes franaises et internationales parat beaucoup plus satisfaisante :
permet des calculs de rentabilit plus fiables ;
rduit lcart entre la comptabilit et les flux de trsorerie, non rcurrence
des pertes de valeur du goodwill.
Lapproche financire de quelques points complexes
24
Par contre, il est faux de prtendre que la dprciation du goodwill ne
correspond pas un appauvrissement au prtexte quil ny a pas de flux
de trsorerie :
lactionnaire de lentreprise qui rmunre une acquisition par remise
dactions a t dilu. Il la accept parce quil escomptait que la taille du
gteau crotrait plus vite (plus de 30 % par exemple) que le nombre de
convives entre lesquels il est partag (plus 25 % par exemple) ;
maintenant on lui annonce que la taille du gteau ne saccrot plus de 30 %
mais simplement de 10 % parce que des actifs achets se sont rvls valoir
moins que prvu ;
malheureusement pour lui, le nombre de convives ne se rduit pas pour
autant. La taille de la part unitaire du gteau sest rduite de 12 % (110 /
125 - 1). Il y a donc bien eu appauvrissement de lactionnaire.
Lapproche financire de quelques points complexes
25
IV. Quelles volutions pour la comptabilit pouvons-nous suggrer en
tant quutilisateurs ?
. Sur lexistant
. Sur les projets
26
Quelles volutions pour la comptabilit pouvons-
nous suggrer en tant quutilisateurs ?
Les volutions rcentes ont dj permis de grands progrs !
La convergence des normes comptables permet maintenant sans faire
trop derreur de comparer un EBIT, un operating profit et un rsultat
dexploitation.
Avec la gnralisation et la modernisation des comptes consolids les
retraitements classiques que nous avons appris lcole ne sont plus
dactualit (crdit-bail, effets escompts) car intgrs dans les comptes.
Les comptes sont disponibles de plus en plus rapidement et lanalyse
financire est donc de moins en moins en retard sur la ralit
conomique.
27
Quelles volutions pour la comptabilit pouvons-
nous suggrer en tant quutilisateurs ?
Par rapport lexistant :
Boucler le tableau de flux sur la variation de lendettement bancaire et
financier net plutt que sur la trsorerie :
la trsorerie est un concept de liquidit qui est btard dans un tableau de
flux et sur la dfinition de laquelle il ny a pas de consensus ;
permet de rendre intelligible la dernire partie du tableau de flux :
financement par capitaux propres / financement par dettes.
Avoir le dtail de certains passages dans le tableau de flux :
rsultat net capacit dautofinancement : OK ;
variation des capitaux propres augmentation de capital : OK ;
reste faire : besoin en fonds de roulement variation du besoin en fonds
de roulement et variation des immobilisations investissement (parfois
donn).
28
Quelles volutions pour la comptabilit pouvons-
nous suggrer en tant quutilisateurs ?
Prsenter le compte de rsultat en ligne.
Rattacher la participation des salaris aux frais de personnel, devrait
aller de soi si les stock-options sont traits comme des frais de
personnel ...
Pas davis tranch sur le choix entre prsentation par nature ou par
destination du compte de rsultat, lidal tant davoir les deux !
Mieux distinguer dans le bilan les dettes financires, les dettes
dexploitation et les dettes hors exploitation.
A terme, rflchir prsenter le bilan en 5 blocs ?
I m m o b i l i s a t i o n s C a p i t a u x p r o p r e s
E n d e t t e m e n t b a n c a i r e
B e s o i n s e n f o n d s d e e t f i n a n c i e r n e t
r o u l e m e n t d ' e x p l o i t a t i o n
B F R h o r s e x p l o i t a t i o n
29
Quelles volutions pour la comptabilit pouvons-
nous suggrer en tant quutilisateurs ?
Sur les projets de lIASB
(1)
:
Un malentendu ? Bon nombre des projets de lIASB sont prsents
comme rpondant mieux aux besoins des apporteurs de capitaux
propres et donc, dans la logique IASB, la plupart des besoins des
autres utilisateurs.
Mais les financiers ne sont pas demandeurs :
de la gnralisation de la juste valeur ;
de la primaut du bilan sur le compte de rsultat !
Au contraire !
(1)
Voir la confrence lIMA de Dominique Thouvenin du 4 mars 2003.
30
Quelles volutions pour la comptabilit pouvons-
nous suggrer en tant quutilisateurs ?
La gnralisation de la juste valeur :
les financiers nont jamais attendu que le bilan traduise la valeur de
lentreprise. Il doit permettre au contraire de mesurer avec rigueur des
rentabilits ce qui ncessite des valeurs historiques, dautant que linflation
nest plus un sujet ;
de surcrot une juste valeur calcule au 31.12.n et connue / exploitable au
mieux en mars n + 1 na plus dintrt
La primaut du bilan sur le compte de rsultat :
les consquences sont pour linstant assez floues mais priori inquitantes
car pour un financier sil doit avoir primaut cest du compte de rsultat ou
du tableau de flux mais pas du bilan qui ne permet pas de prvoir
lexploitation de lentreprise.
31
Quelles volutions pour la comptabilit pouvons-
nous suggrer en tant quutilisateurs ?
La prsentation de la performance (projet IAS) :
TOTAL Rsultat avant Ajustement
ajustement de valeur de valeur
Oprations
. Exploitation
() XXX XXX XXX
() XXX XXX XXX
Rsultat d'exploitation XXX XXX XXX
. Autres oprations
() XXX XXX XXX
. Financier
()
- rsultat des entits mises en quivalence XXX XXX XXX
RESULTAT DES OPERATIONS XXX XXX XXX
FINANCEMENT XXX XXX XXX
IMPTS XXX - -
ACTIVITES ARRTEES XXX - -
RESULTAT GLOBAL XXX XXX XXX
32
Quelles volutions pour la comptabilit pouvons-
nous suggrer en tant quutilisateurs ?
Quelle utilit ?
Quel intrt de sparer dans le rsultat des oprations des lments
financiers (intrts et charges sur lments court terme ?) qui sy
rattachent et des lments de financement (intrts et charges sur lments
moyen / long terme) qui ne sy rattachent pas ? Conception dpasse en
finance.
Un scnario catastrophe :
une comptabilit tellement sophistique et dconnecte de la gestion de
lentreprise quelle ne sert plus rien, ni pour grer lentreprise, ni pour
mesurer sa rentabilit et apprcier son risque.
Vous aimerez peut-être aussi
- ContratDocument28 pagesContratchafPas encore d'évaluation
- 5 Acg Ingenierie Financiere Georges LegrosDocument35 pages5 Acg Ingenierie Financiere Georges LegrosSara MafueniPas encore d'évaluation
- Résumé VernimmenDocument36 pagesRésumé Vernimmenrvhr100% (1)
- Cas SL EDocument1 pageCas SL EWarren0% (1)
- Nouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiqueD'EverandNouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiquePas encore d'évaluation
- Résumé Livre VernimmenDocument40 pagesRésumé Livre VernimmenSimona Veseli100% (1)
- Corporate Finance PDFDocument67 pagesCorporate Finance PDFSimo BahammouPas encore d'évaluation
- Evaluation Vernimmen VernimmenDocument35 pagesEvaluation Vernimmen VernimmenFatim Zohra EssaafPas encore d'évaluation
- TitrisationDocument120 pagesTitrisationNaoufal FouadPas encore d'évaluation
- Devoir A Rendre: Documents AutorisésDocument10 pagesDevoir A Rendre: Documents AutorisésDheebiga KannanPas encore d'évaluation
- Valorisation et cession d'entreprise: Opérations de fusions et acquisitions d'entreprisesD'EverandValorisation et cession d'entreprise: Opérations de fusions et acquisitions d'entreprisesPas encore d'évaluation
- Finance D Entreprise 3 e ÉditionDocument72 pagesFinance D Entreprise 3 e ÉditionhichamPas encore d'évaluation
- Vernimmen - Chapitre 1Document15 pagesVernimmen - Chapitre 1youlbrynerPas encore d'évaluation
- Les Outils de La Gestion de TresorerieDocument24 pagesLes Outils de La Gestion de TresorerieAléxandèr M'ééħÐiî100% (2)
- Cours Us GAAPDocument8 pagesCours Us GAAPMoad ThaliPas encore d'évaluation
- Support Les Techniques Du Controle de Gestion Brasserie 2Document77 pagesSupport Les Techniques Du Controle de Gestion Brasserie 2aya chraibi100% (1)
- Cours LBODocument58 pagesCours LBONicolas Chastang100% (1)
- CVHLouahebDocument1 pageCVHLouahebh.louaheb607Pas encore d'évaluation
- Votre argent Chaque décision compte: Comptabilité pour tousD'EverandVotre argent Chaque décision compte: Comptabilité pour tousPas encore d'évaluation
- Maîtriser la Bourse : Guide complet pour investir avec succèsD'EverandMaîtriser la Bourse : Guide complet pour investir avec succèsPas encore d'évaluation
- Le Millionnaire Des Dividendes: Investir Pour Gagner Du Revenu Et Gagner En BourseD'EverandLe Millionnaire Des Dividendes: Investir Pour Gagner Du Revenu Et Gagner En BoursePas encore d'évaluation
- Window dressing: La manipulation comptable est-elle toujours frauduleuse ?D'EverandWindow dressing: La manipulation comptable est-elle toujours frauduleuse ?Pas encore d'évaluation
- Une approche simple de l'investissement passif: Un guide d'introduction aux principes théoriques et opérationnels de l'investissement passif pour construire des portefeuilles paresseux et performants dans le tempsD'EverandUne approche simple de l'investissement passif: Un guide d'introduction aux principes théoriques et opérationnels de l'investissement passif pour construire des portefeuilles paresseux et performants dans le tempsPas encore d'évaluation
- Des fonds communs de placement faciles à apprendre: Le guide d'introduction aux fonds communs de placement et aux stratégies d'investissement les plus efficaces dans le domaine de la gestion d'actifsD'EverandDes fonds communs de placement faciles à apprendre: Le guide d'introduction aux fonds communs de placement et aux stratégies d'investissement les plus efficaces dans le domaine de la gestion d'actifsÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Cours Diagnostic Financier PDFDocument37 pagesCours Diagnostic Financier PDFBen TanfousPas encore d'évaluation
- FINANCE D'entrepriseDocument40 pagesFINANCE D'entrepriseRoosvelt TalabertPas encore d'évaluation
- Diagnostic Financier Ou Carre MagiqueDocument25 pagesDiagnostic Financier Ou Carre MagiqueYassineYouhabPas encore d'évaluation
- Cel VL 2023Document2 pagesCel VL 2023cabinet comptable conseils kambyassoPas encore d'évaluation
- Ingenierie Financiere D Entreprise Corporate BankingDocument123 pagesIngenierie Financiere D Entreprise Corporate BankingAMOUSSA TaofickPas encore d'évaluation
- Cours B 800 D Poincelot PDFDocument57 pagesCours B 800 D Poincelot PDFlaviniaPas encore d'évaluation
- Mathématiques Financières de Base: Taux D'intérêt, Actualisation, CréditsDocument57 pagesMathématiques Financières de Base: Taux D'intérêt, Actualisation, CréditsTheonlyone01100% (3)
- Rentabilité Financière Et Levier FinancierDocument8 pagesRentabilité Financière Et Levier FinancierCheikh NgomPas encore d'évaluation
- Fusion Et ConsolidationDocument10 pagesFusion Et ConsolidationYacine AgawaPas encore d'évaluation
- S4 Questions de Cours en Analyse FinancièreDocument2 pagesS4 Questions de Cours en Analyse Financièrehalima elbadaouyPas encore d'évaluation
- Choix Des Investissements PDFDocument38 pagesChoix Des Investissements PDFSahim BelhimeurPas encore d'évaluation
- Support de Formation SYSCOHADA ReviséDocument86 pagesSupport de Formation SYSCOHADA ReviséMohamed TouréPas encore d'évaluation
- Analyse Financiere-2-1 PDFDocument79 pagesAnalyse Financiere-2-1 PDFgilberto100% (2)
- Cours de Comptabilite Des SocietesDocument41 pagesCours de Comptabilite Des Societeskouma juniorPas encore d'évaluation
- Devoir Gestio BudétaDocument32 pagesDevoir Gestio Budétadolfop100% (1)
- Gestion FinanciereDocument32 pagesGestion FinanciereKamil ChamPas encore d'évaluation
- Expose Normes Comptable 1Document7 pagesExpose Normes Comptable 1Huguette carole tatiana KipoPas encore d'évaluation
- Evaluation D'un Projet D'investissementDocument116 pagesEvaluation D'un Projet D'investissementMouhssine IrkmanePas encore d'évaluation
- Cas Et Corriges 4eme Master Finance H EDocument23 pagesCas Et Corriges 4eme Master Finance H EEl Goud ZakariaPas encore d'évaluation
- Financement À L'exportDocument23 pagesFinancement À L'exportKhadija ElkharouidPas encore d'évaluation
- Cours de Gestion l3 Fin 2020Document54 pagesCours de Gestion l3 Fin 2020Yves Digbe0% (1)
- Cpta Appro M8 Cpta Et TR Sorerie D F SERE 2007 PDFDocument32 pagesCpta Appro M8 Cpta Et TR Sorerie D F SERE 2007 PDFElijah WardPas encore d'évaluation
- Finance RAFDocument25 pagesFinance RAFSos ComptaPas encore d'évaluation
- 8-Fonds de Roulement NormatifDocument31 pages8-Fonds de Roulement NormatifEl Goud Zakaria100% (1)
- Comment Analyser Des Projets D'investissementsDocument15 pagesComment Analyser Des Projets D'investissementsIzabela Violeta100% (1)
- Cours de Finance IIDocument174 pagesCours de Finance IIYoussef LaghribiPas encore d'évaluation
- Marchés FinanciersDocument36 pagesMarchés FinanciersClimbié IB100% (1)
- Comptabilite Des SocietesDocument142 pagesComptabilite Des SocietesJonassy SumaïliPas encore d'évaluation
- Note de Cours Gestion Des Flux de Tresorerie OHADADocument10 pagesNote de Cours Gestion Des Flux de Tresorerie OHADARomial Ndzana100% (1)
- L'analyse Des Flux de TrésorerieDocument19 pagesL'analyse Des Flux de TrésorerieDetoh Brou AxelPas encore d'évaluation
- Valorisation Stratégique Et FinancièreDocument370 pagesValorisation Stratégique Et FinancièredurotimerPas encore d'évaluation
- 15 Instruments FinanciersDocument12 pages15 Instruments Financierssania651206100% (1)
- Examen Ingenierie Jan 2013Document3 pagesExamen Ingenierie Jan 2013NourAllah AouiniPas encore d'évaluation
- Evaluation D'entreprise Chap 3Document28 pagesEvaluation D'entreprise Chap 3assimil03Pas encore d'évaluation
- Finance D'entrepriseDocument74 pagesFinance D'entrepriseMohamed Dera100% (1)
- Exposé Gestion de Projet Et Montage FinancierDocument21 pagesExposé Gestion de Projet Et Montage Financiermbark abalouchPas encore d'évaluation
- Droit Des Biens IntroductionDocument6 pagesDroit Des Biens Introductionchupachoups100% (2)
- Eter IsskaDocument4 pagesEter IsskaNathanaelPas encore d'évaluation
- Programme S2Document52 pagesProgramme S2مول الحوتPas encore d'évaluation
- Hypotheque BenfarhatDocument3 pagesHypotheque BenfarhatMadjid Walid MadjidPas encore d'évaluation
- Regime Financier Des Societes D'assurances Dans Le Code Des Assurances CimaDocument10 pagesRegime Financier Des Societes D'assurances Dans Le Code Des Assurances CimaDeKOUAMOPas encore d'évaluation
- Copropriété 18-00Document13 pagesCopropriété 18-00Kassou Imane100% (1)
- Mandat AI00116623 - HALIB - AT839 PDFDocument2 pagesMandat AI00116623 - HALIB - AT839 PDFReda HbPas encore d'évaluation
- Droit Des Obligations III, L3 DroitDocument86 pagesDroit Des Obligations III, L3 DroitSophie100% (1)
- Performance Financiere D'une Institution de Microfinance en Republique Democratique Du CongoDocument48 pagesPerformance Financiere D'une Institution de Microfinance en Republique Democratique Du CongoAlliance's Ngokanyukudi91% (11)
- Un ChequeDocument7 pagesUn ChequeMarvin EliasPas encore d'évaluation
- Contentieux BancaireDocument376 pagesContentieux Bancairetarek brahimiPas encore d'évaluation
- Rapport Final - Dossier D'entreprise - Secteur BancaireDocument51 pagesRapport Final - Dossier D'entreprise - Secteur BancaireLeila Jalil80% (5)
- fr033 PDFDocument61 pagesfr033 PDFfrikach fatimaezzahraePas encore d'évaluation