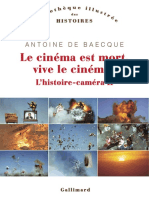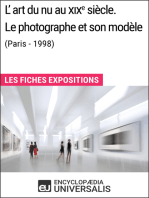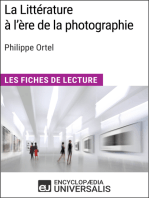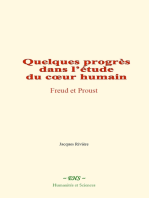Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Benjamin 1931
Benjamin 1931
Transféré par
Calina Cristina Dobrin0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues32 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues32 pagesBenjamin 1931
Benjamin 1931
Transféré par
Calina Cristina DobrinDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 32
L
e brouillard qui stend sur les commencements de la photographie
nest pas tout fait aussi pais que celui qui recouvre les dbuts de
limprimerie ; plus distinctement que pour celle-ci, peut-tre, lheure
tait venue de la dcouverte, plus dun lavait pressenti ; des hommes
qui, indpendamment les uns des autres, poursuivaient un mme but :
xer dans la camera obscura ces images, connues au moins depuis Lo-
nard
1
. Lorsque ce rsultat, aprs environ cinq ans defforts, fut accord
en mme temps Nipce et Daguerre, ltat, protant des difcults
des inventeurs pour dposer un brevet, sen saisit et, aprs ddomma-
gement des intresss, en t chose publique
2
. Ainsi furent poses les
conditions dun dveloppement sans cesse acclr, qui excluait pour
longtemps tout regard en arrire. Cest pourquoi les questions histo-
riques ou, si lon veut, philosophiques que suggrent lexpansion et le
dclin de la photographie sont demeures inaperues pendant des
dcennies. Et si elles commencent aujourdhui revenir la conscience,
cest pour une raison prcise. Les ouvrages les plus rcents
3
saccordent
sur le fait frappant que lge dor de la photographie lactivit dun
Hill ou dune Cameron, dun Hugo ou dun Nadar correspond sa
premire dcennie
4
. Or cest la dcennie qui prcde son industrialisa-
tion. Non que, ds les premiers temps, bonimenteurs et charlatans ne
se fussent empars de la nouvelle technique pour en tirer prot ; ils le
rent mme en masse. Mais ce point appartient plus aux arts de la foire
o, il est vrai, la photographie a jusqu prsent t chez elle qu
lindustrie. Celle-ci ne conquit du terrain quavec la carte de visite pho-
tographique, dont le premier fabricant, cest significatif, devint
7
Wal t er BE NJ AMI N
Petite histoire
de la photographie
Fig. 1.
Ouverture de la
Petite histoire
dans Die Litera-
rische Welt.
La premire
et la troisime
illustration sont
tires de Bossert
& Guttmann, la
seconde et la
quatrime de
Schwarz (cf. bibl.).
millionnaire
5
. Il ne serait pas tonnant que les pratiques photogra-
phiques, qui attirent aujourdhui pour la premire fois les regards sur
cet ge dor prindustriel, aient un lien souterrain avec lbranlement
de lindustrie capitaliste
6
. Cest pourquoi il nest pas facile, pour
connatre vritablement leur nature, de partir du charme des images
que nous prsentent les beaux ouvrages rcemment publis
7
sur la pho-
tographie ancienne*. Les tentatives de matriser thoriquement la chose
sont extrmement rudimentaires. Et quoique de nombreux dbats aient
t mens au sicle dernier ce propos, ceux-ci, au fond, ne se sont pas
librs du schma bouffon grce auquel une feuille chauvine, le Leipzi-
ger Stadtanzeiger [sic], pensait devoir combattre de bonne heure cet art
diabolique venu de France. Vouloir xer les images fugitives du miroir,
y lit-on, nest pas seulement chose impossible, comme cela ressort de
recherches allemandes approfondies, mais le seul dsir dy aspirer est
dj faire insulte Dieu. Lhomme a t cr limage de Dieu et aucune
machine humaine ne peut xer limage de Dieu. Tout au plus lartiste
enthousiaste peut-il, exalt par linspiration cleste, linstant de
suprme conscration, sur lordre suprieur de son gnie et sans laide
daucune machine, se risquer reproduire les divins traits de lhomme
8
.
Ici se montre dans toute sa pesante balourdise le concept trivial d art
auquel toute considration technique est trangre et qui sent venir sa
n avec lapparition provocante de la nouvelle technique. Sans sen aper-
cevoir, cest contre ce concept ftichiste et fondamentalement anti-
technique que les thoriciens de la photographie se sont battus pen-
dant prs de cent ans, naturellement sans le moindre rsultat. Car ils
nentreprenaient rien dautre que de justier le photographe devant le
tribunal que celui-ci mettait prcisment bas. Un tout autre soufe
anime lexpos par lequel le physicien Arago prsente et dfend lin-
vention de Daguerre, le 3 juillet 1839 devant la Chambre des dpu-
ts. Cest la beaut de ce discours que de tisser des liens avec tous les
aspects de lactivit humaine. Le panorama quil esquisse est sufsam-
ment ample pour que limprobable justication de la photographie face
la peinture, qui ne manque pas non plus, paraisse insigniante, alors
que se dvoile lide de la vritable porte de linvention. Quand des
8
t udes phot ographi ques, 1
*
Helmuth Th. Bossert et Heinrich Guttmann, Aus der Frhzeit der Photographie, 1840-1870
(200 g.), Francfort/Main, Societts-Verlag, 1930; Heinrich Schwarz, David Octavius Hill,
der Meister der Photographie (80 g.) Leipzig, Insel-Verlag, 1931 [note de W. B.].
observateurs, dit Arago, appliquent un nouvel instrument ltude de
la nature, ce quils en ont espr est toujours peu de chose relative-
ment la succession de dcouvertes dont linstrument devient lori-
gine
9
. Le discours dploie grands traits le domaine de la nouvelle
technique, de lastrophysique la philologie : ct de la perspective
de photographier les toiles, on rencontre lide denregistrer un
corpus dhiroglyphes gyptiens.
Les clichs de Daguerre taient des plaques argentes recouvertes
diode exposes dans la camera obscura, quil fallait incliner en tous sens
jusqu ce que, sous un clairage appropri, lon puisse reconnatre une
image dun gris tendre
10
. Elles taient uniques ; une plaque cotait en
moyenne 25 francs-or en 1839. Il ntait pas rare quon les conservt
comme des bijoux dans des crins. Mais dans la main de nombreux
peintres, elles devinrent une technique dappoint. Tout comme Utrillo,
soixante-dix ans plus tard, devait excuter ses fascinantes vues des mai-
sons de la banlieue de Paris non sur le vif, mais daprs cartes postales,
lAnglais David Octavius Hill, portraitiste renomm, ralisa une longue
srie de portraits pour sa fresque du synode de lglise cossaise. Mais
il t ces photographies lui-mme
11
. Et ce sont ces images sans valeur,
simples auxiliaires usage interne, qui confrent son nom sa place
historique, alors quil sest effac comme peintre
12
. Sans doute, plus
encore que la srie de ces ttes en efgie, quelques tudes nous font
pntrer plus profondment dans la nouvelle technique : non des por-
traits, mais les images dune humanit sans nom. Ces ttes, on les voyait
depuis longtemps sur les tableaux. Lorsque ceux-ci demeuraient dans
la famille, il tait encore possible de senqurir de loin en loin de liden-
tit de leur sujet. Mais aprs deux ou trois gnrations, cet intrt stei-
gnait : les images, pour autant quelles subsistaient, ne le faisaient que
comme tmoignage de lart de celui qui les avait peintes. Mais la pho-
tographie nous confronte quelque chose de nouveau et de singulier :
dans cette marchande de poisson de Newhaven
13
, qui baisse les yeux
au sol avec une pudeur si nonchalante, si sduisante, il reste quelque
chose qui ne se rduit pas au tmoignage de lart de Hill, quelque chose
quon ne soumettra pas au silence, qui rclame insolemment le nom de
celle qui a vcu l, mais aussi de celle qui est encore vraiment l et ne
se laissera jamais compltement absorber dans l art. Et je demande :
comment la parure de ces cheveux/Et de ce regard a-t-elle envelopp
les tres passs ! / Comment a embrass ici cette bouche o le
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
9
dsir/Absurde comme fume sans amme senroule
14
! Ou bien lon
dcouvre limage de Dauthendey
15
, le photographe, pre du pote,
lpoque de ses anailles avec la femme quil trouva un jour, peu aprs
la naissance de son sixime enfant, les veines tranches dans la chambre
coucher de sa maison de Moscou
16
[g. 2]. On la voit ici ct de lui,
on dirait quil la soutient, mais son regard elle est x au-del de lui,
comme aspir vers des lointains funestes. Si lon sest plong assez long-
temps dans une telle image, on aperoit combien, ici aussi, les contraires
se touchent : la plus exacte technique peut donner ses produits une
10
t udes phot ographi ques, 1
Fig. 2. K. Dauthendey
et sa ance,
le 1
er
septembre 1857,
Saint-Ptersbourg,
autoportrait.
valeur magique, beaucoup plus que celle dont pourrait jouir nos yeux
une image peinte. Malgr toute lingniosit du photographe, malgr
laffectation de lattitude de son modle, le spectateur ressent le besoin
irrsistible de chercher dans une telle image la plus petite tincelle de
hasard, dici et maintenant, grce quoi la ralit a pour ainsi dire brl
de part en part le caractre dimage le besoin de trouver lendroit invi-
sible o, dans lapparence de cette minute depuis longtemps coule,
niche aujourdhui encore lavenir, et si loquemment que, regardant en
arrire, nous pouvons le dcouvrir
17
. Car la nature qui parle
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
11
Fig. 3. C. Rudolf,
Palucca,
illustration de
Peinture Photo-
graphie Film de
Moholy-Nagy
(1925).
12
lappareil est autre que celle qui parle lil
18
; autre dabord en ce que,
la place dun espace consciemment dispos par lhomme, apparat un
espace tram dinconscient. Sil nous arrive par exemple couramment
de percevoir, ft-ce grossirement, la dmarche des gens, nous ne dis-
tinguons plus rien de leur attitude dans la fraction de seconde o ils
allongent le pas. La photographie et ses ressources, ralenti ou agran-
dissement
19
, la rvlent. Cet inconscient optique, nous ne le dcouvrons
qu travers elle, comme linconscient des pulsions travers la psycha-
nalyse. Les structures constitutives, les tissus cellulaires avec lesquels la
technique ou la mdecine ont coutume de compter tout cela est au
dpart plus proche de lappareil photo quun paysage vocateur ou un
portrait inspir. Mais en mme temps, la photographie dvoile dans ce
matriel les aspects physiognomoniques, les mondes dimages qui habi-
tent les plus petites choses sufsamment expressifs, sufsamment
secrets pour avoir trouv abri dans les rves veills, mais qui, ayant
chang dchelle, devenus nonables, font dsormais clairement
t udes phot ographi ques, 1
Fig. 4. Pou (agrandissement),
illustration de Peinture Photographie
Film de Moholy-Nagy (1925).
apparatre la diffrence entre technique et magie comme une varia-
tion historique. Ainsi Blossfeldt*, avec ses tonnantes photos de
plantes, a rvl la vue, sous la prle, la forme des colonnes antiques,
sous la fougre, la crosse piscopale, derrire des pousses de marron-
nier ou drable grossies dix fois, des totems, sous le chardon, un tym-
pan gothique
20
. Cest pourquoi les modles de Hill, pour qui le ph-
nomne de la photographie constituait encore une grande
exprience mystrieuse , ntaient pas trs loin de la vrit mme si
ce mystre se rduisait au sentiment de poser devant un appareil qui
pouvait engendrer en un temps trs court une image du monde visible,
aussi vivante et aussi vraie que la nature elle-mme
21
. On a dit de lap-
pareil de Hill quil faisait preuve dune grande discrtion. Mais ses
modles ne sont pas moins rservs ; ils gardent une certaine timidit
devant la chambre photographique, et le leitmotiv dun photographe
ultrieur de lge dor : ne regardez jamais lappareil
22
semble dcou-
ler de leur attitude. Il nest pas question ici de lacheteur impudemment
impliqu par le on te regarde danimaux, de personnes ou denfants,
et auquel il nest de meilleure rponse que lexpression du vieux Dau-
thendey propos de la daguerrotypie : On nosait pas dabord, rap-
porte-t-il, regarder trop longtemps les premires images quil produi-
sait. On avait peur de la prcision de ces personnages et lon croyait
que ces minuscules gures sur les images pouvaient nous apercevoir,
tant lon tait impressionn par linsolite prcision, linsolite dlit des
premires images daguerriennes
23
.
Ces premiers humains reproduits entrrent dans lespace visuel de
la photographie sans antcdents ou pour mieux dire sans lgende. Le
journal tait encore un objet de luxe que lon achetait rarement et quon
lisait plutt au caf, le procd photographique ntait pas encore
devenu lun de ses instruments, et peu nombreux taient les gens qui
voyaient leur nom imprim. Du visage humain manait un silence dans
lequel reposait le regard. En bref, toutes les potentialits de cet art du
portrait tenaient ce que le contact ntait pas encore tabli entre
actualit et photographie
24
. De nombreux portraits de Hill ont t ex-
cuts dans le cimetire des frres franciscains ddimbourg : rien nest
plus signicatif de cette poque si ce nest quel point les modles
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
13
*
Karl Blossfeldt, Urformen der Kunst (intr. Karl Nierendorf), 120 g., V. Ernst Wasmuth,
Berlin [1928] [note de W. B.].
semblent sy sentir chez eux. Sur une image de Hill, ce cimetire lui-
mme apparat vritablement comme un intrieur, une pice isole et
close o les monuments funraires slvent du sol, poss contre le mur
mitoyen, la faon dune chemine dont le foyer accueillerait des ins-
criptions au lieu de ammes [g. 5]. Mais jamais ce lieu naurait pu pro-
duire un tel effet si son choix navait repos sur des dterminations
techniques
25
. Avec la faible sensibilit des plaques anciennes, une
longue exposition en extrieur tait indispensable
26
. Ce qui supposait
pour loprateur de sinstaller le plus lcart possible, dans un endroit
14
t udes phot ographi ques, 1
Fig. 5. D. O. Hill
et R. Adamson,
Dans le cimetire,
dimbourg, v. 1845
(ill. tire de Bos-
sert & Guttmann,
non reproduite
dans Die Litera-
rische Welt).
o rien ne dranget ses
prparatifs. La synthse
de lexpression, obtenue
par la longue pose du
modle, dit Orlik de la
photographie ancienne,
est la principale raison pour
laquelle ces preuves, mal-
gr leur simplicit, produi-
sent un effet plus pntrant
et plus durable que des
photographies plus
rcentes, lgal de bons
portraits dessins ou
peints
27
. Le procd lui-
mme requrait que le
modle vive, non en
dehors, mais dans linstant :
pendant que durait la prise de vue, il pouvait stablir au sein de limage
dans le contraste le plus absolu avec les apparitions qui se manifes-
tent sur une photographie instantane. Celle-ci reprsente lexpression
dun environnement modi dans lequel, comme le remarque perti-
nemment Kracauer, il dpend dune fraction de seconde aussi brve
que celle du temps de pose qu un sportif devienne suffisamment
clbre pour que les photographes le fassent poser pour les journaux
illustrs
28
. Dans les anciennes images, tout tait fait pour durer ; non
seulement les incomparables groupes que formaient les personnes et
dont la disparition fut certainement lun des symptmes les plus pr-
cis de ce qui se passait dans la socit de la seconde moiti du [dix-
neuvime] sicle , mme les plis que faisait un vtement duraient plus
longtemps. Quon observe simplement la redingote de Schelling ; ainsi
vtu, celui-ci peut accder en toute conance lternit : les formes
quelle a prises son contact ne sont pas indignes des rides de son visage
[g. 6]. En bref, tout donne raison la supposition de Bernhard [sic]
von Brentano
29
selon laquelle un photographe de 1850 est la hau-
teur de son instrument , pour la premire et la dernire fois, avant
longtemps.
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
15
Fig. 6. Anon.,
Schelling (1775-
1854), 3
e
ill. de
la Petite histoire,
tire de Bossert
& Guttmann.
Les fameux plis
ont tous t
entirement
redessins.
II
Pour rendre plus prsent lextraordinaire effet du daguerrotype
ses dbuts, il faut se souvenir que la peinture de plein air avait com-
menc dvoiler de toutes nouvelles perspectives aux peintres les plus
avancs. Conscient que ctait prcisment dans ce domaine que la pho-
tographie prendrait le relais de la peinture, Arago, lorsquil renvoie dans
sa rtrospective historique aux travaux pionniers de Giovanni Battista
Porta
30
[sic], dclare explicitement : Quant aux effets dpendant de
limparfaite diaphanet de notre atmosphre, et quon a caractris par
le terme assez impropre de perspective arienne, les peintres exercs
eux-mmes nespraient pas que, pour les reproduire avec exactitude,
la chambre obscure [cest--dire la copie des images qui y apparaissent]
16
t udes phot ographi ques, 1
Fig. 7. Dbut de
la seconde
livraison de la
Petite histoire.
Alors quelle est
en partie consa-
cre Atget, les
illustrations sont
des photos de
Germaine Krull
appartenant
Benjamin.
pt leur tre daucun secours
31
. linstant mme o il fut accord
Daguerre de pouvoir xer les images de la chambre obscure, le tech-
nicien dit adieu au peintre. Pourtant, la vritable victime de la photo-
graphie ne fut pas la peinture de paysage mais le portrait en miniature.
Les choses se dvelopprent si rapidement que, ds 1840, la plupart
des innombrables miniaturistes embrassrent la profession de photo-
graphe, dabord accessoirement, puis plein temps
32
. Cest moins leurs
qualits dartistes qu leurs capacits dartisans quon doit la haute qua-
lit de la production photographique dalors. Cette gnration de tran-
sition devait seffacer petit petit ; il semble quune sorte de bndic-
tion biblique ait repos sur ces photographes : les Nadar, Stelzner,
Pierson, Bayard ont tous approch les quatre-vingt-dix ou cent ans
33
.
Finalement, les commerants se pressrent de partout pour accder
ltat de photographe, et quand se rpandit la retouche sur ngatif,
revanche du mauvais peintre sur la photographie, on assista un rapide
dclin du got
34
. Ce fut le temps o les albums de photographies com-
mencrent se remplir. On les trouvait de prfrence dans les recoins
les plus glacs des maisons, sur la console ou le guridon de la chambre
damis : relis de cuir avec de rpugnants fermoirs en mtal et des pages
dores sur tranche grosses comme le doigt, o se distribuent des gures
comiquement fagotes oncle Alex et tante Rika, Gertrude quand elle
tait petite, papa en premire anne de facult et enn, comble de honte,
nous-mme en Tyrolien de salon, jodlant, agitant son chapeau sur des
cimes peintes, ou en marin dlur, la jambe dappui bien droite, lautre
lgrement plie, comme il se doit, appuy sur un montant poli
35
. Les
accessoires de tels portraits pidestal, balustrade, table ovale rap-
pellent le temps o, cause de la longue dure de lexposition, il fallait
donner aux modles un point dappui, pour quils demeurent immobiles.
Si lon stait content au dbut dappuis-tte ou de supports, les tableaux
clbres et le dsir de faire artistique inspirrent bientt dautres acces-
soires. En premier lieu la colonne et le rideau. Les plus clairs dnon-
crent ces excs ds les annes 1860. Ainsi pouvait-on lire dans une
feuille spcialise anglaise : En peinture, la colonne a une apparence
de vrit, mais la faon dont elle est employe en photographie est
absurde, car elle est habituellement pose sur un tapis. Chacun sera
pourtant convaincu quune colonne de marbre ou de pierre ne peut avoir
un tapis pour fondation
36
. Cest cette poque que sont apparus ces
ateliers avec leurs draperies et leurs palmiers, leurs tapisseries et leurs
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
17
chevalets, mi-chemin de la reprsentation et de lexcution, de la salle
du trne et de la chambre de torture, dont un portrait du jeune Kafka
fournit un tmoignage poignant
37
[g. 8]. Debout dans un costume den-
fant trop troit et presque humiliant,
charg de passementeries, le garonnet,
g denviron six ans, est plac dans un
dcor de jardin dhiver. Des rameaux de
palmier se dressent larrire-plan. Et
comme pour rendre ces tropiques capi-
tonns encore plus touffants, le modle
tient dans sa main gauche un chapeau
dmesur larges bords, comme en por-
tent les Espagnols. Sans doute dispara-
trait-il dans cet arrangement, si les yeux
dune insondable tristesse ne dominaient
ce paysage fait pour eux.
Cette image, dans son infinie dsolation, est un pendant des
anciennes photographies, sur lesquelles les gens napparaissaient pas
encore abandonns et seuls au monde comme ce garonnet. Il y avait
une aura autour deux, un mdium qui confrait leur regard, lorsquil
y pntrait, plnitude et sret. L encore, lquivalent technique est
porte de main, et repose dans labsolu continuum de la lumire la plus
claire lobscurit la plus noire
38
. L encore est prserve la loi selon
laquelle la technique nouvelle pousse la prcdente son summum
39
,
puisque lancienne peinture de portrait, avant son dclin, avait produit
une oraison de mezzotinto. Il sagissait l bien sr dune technique de
reproduction, ainsi quen attestera plus tard son union avec la photo-
graphie. Chez Hill comme sur les gravures en mezzotinto, la lumire
se fraie malaisment un chemin hors de lombre : Orlik parle de cette
accumulation lumineuse due la dure de lexposition, qui confre
aux premires photographies leur grandeur
40
. Et parmi les contem-
porains de linvention, Delaroche remarquait dj une impression gn-
rale jamais atteinte auparavant, prcieuse, et qui ne nuit en rien la
tranquillit des masses
41
. Ainsi en va-t-il de la dtermination technique
du phnomne auratique. Certains portraits de groupe, tout particu-
lirement, retiennent encore un certain bonheur dtre ensemble, qui
apparat pour un court instant sur la plaque, avant de disparatre sur le
tirage original. Cest ce cercle de vapeur, qui sinscrira parfois joliment
18
t udes phot ographi ques, 1
Fig. 8. Anon.,
portrait de Kafka
enfant, apparte-
nant Benjamin
(ill. non repr. dans
Die Literarische
Welt).
et judicieusement dans lovale dsormais pass de mode de lencadre-
ment. De sorte quon se trompe, propos des incunables de la photo-
graphie, en soulignant leur got ou leur perfection artistique. Ces
images ont t ralises en des endroits o, pour chaque client, le pho-
tographe reprsentait un technicien de la nouvelle cole, mais o
chaque client tait, pour le photographe, le membre dune classe mon-
tante
42
dont laura venait se nicher jusque dans les plis de la redingote
ou de la lavallire. Car cette aura nest certes pas le simple produit dun
appareil primitif. Bien plus, il existait alors entre lobjet et la technique
une correspondance aussi aigu que devait ltre leur opposition dans
la priode du dclin. Bientt, en effet, les progrs de loptique devaient
fournir des instruments qui allaient chasser compltement lobscurit
et fournir un reet dle des phnomnes. Mais, partir des annes
1880, cette aura que le refoulement de lobscurit par des objectifs
plus lumineux avait refoule de limage tout comme la croissante dg-
nrescence de limprialisme bourgeois lavait refoule de la ralit
les photographes voyaient comme leur tche de la simuler par tous les
artices de la retouche, en particulier lusage de la gomme bichroma-
te
43
. Ainsi vit-on advenir, du moins dans le style Art nouveau, la mode
de tons crpusculaires, traverss de reets articiels ; pourtant, malgr
cette pnombre, se dessinait de plus en plus clairement une posture
dont la raideur trahissait limpuissance de cette gnration devant le
progrs technique.
Et pourtant, ce qui demeure dcisif en photographie, cest toujours
la relation du photographe sa technique
44
. Camille Recht la caract-
ris dans une belle mtaphore : Le violoniste, dit-il, doit dabord crer
la note, il doit la chercher, la trouver en un clair, tandis que le pianiste
frappe sur une touche : la note retentit. Le peintre comme le photo-
graphe ont un instrument leur disposition. Lusage du dessin et du
coloris correspondent la cration du violoniste ; le photographe par-
tage avec le pianiste laspect mcanique, soumis des lois contrai-
gnantes auxquelles chappe le violon. Aucun Paderewski ne recueillera
jamais la gloire ni nexercera la magie lgendaire dun Paganini
45
. Pour-
tant pour ler la mtaphore il est un Busoni
46
de la photographie,
et cest Atget. Tous deux taient des virtuoses, en mme temps que des
prcurseurs. Ils partagent un panouissement sans exemple dans leur
art, li la plus haute prcision. Mme leurs choix respectifs ne sont
pas sans parent. Atget tait un comdien qui, dgot par son mtier,
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
19
renona aux fards du thtre pour dmaquiller la vrit
47
. Il vivait Paris,
pauvre et inconnu, et bradait ses photos des amoureux gure moins
excentriques que lui. Il est mort rcemment, laissant derrire lui une
uvre de plus de quatre mille images
48
. Berenice Abbot, de New York,
a rassembl ces preuves et un recueil dune remarquable beaut, dit
par Camille Recht, vient de paratre
*
. Les journaux de son temps igno-
raient tout de lhomme qui faisait souvent le tour des ateliers avec ses
photographies, les distribuant pour quelques sous, souvent pour le prix
dune carte postale, de celles qui montraient si joliment la ville plon-
ge dans la nuit bleue, avec une lune retouche. Il avait atteint le ple
de la matrise suprme, mais sur cette matrise acharne dhomme de
grand mtier, lui qui vivait toujours dans lombre avait oubli de plan-
ter son drapeau. Cest pourquoi certains peuvent penser avoir dcou-
vert le ple quAtget avait atteint avant eux
49
. De fait, les photos pari-
siennes dAtget annoncent la photographie surraliste avant-garde de
la seule colonne vritablement importante que le surralisme ait russi
mettre en branle. Cest lui qui, le premier, dsinfecte latmosphre
touffante quavait propage le portrait conventionnel de lpoque du
dclin
50
. Il lave, il assainit cette atmosphre : il entame la libration des
objets de leur aura mrite incontestable de la plus rcente cole pho-
tographique. Quand les revues davant-garde Bifur ou Varit
51
publient,
sous les intituls Westminster, Lille, Anvers ou Breslau, de simples
dtails ici, un morceau de balustrade et la cime dun arbre chauve dont
les branches sentrecroisent devant un lampadaire gaz ; l, un mur
mitoyen ou un candlabre avec une boue de sauvetage sur laquelle on
peut lire le nom de la ville elles ne font que pointer littrairement des
motifs dcouverts par Atget. Il recherchait ce qui se perd et ce qui se
cache, et cest pourquoi ses images contredisent la sonorit exotique,
chatoyante, romantique des noms de ville : elles aspirent laura du rel
comme leau dun bateau qui coule. Quest-ce au fond que laura ? Un
singulier entrelacs despace et de temps : unique apparition dun loin-
tain, aussi proche soit-elle. Reposant par un jour dt, midi, suivre
une chane de montagnes lhorizon, ou une branche qui jette son
ombre sur le spectateur, jusqu ce que linstant ou lheure ait part leur
apparition cest respirer laura de ces montagnes, de cette branche. Il
20
t udes phot ographi ques, 1
*
[Eugne] Atget, Lichtbilder (dit par Camille Recht), d. Henri Jonquires, Paris,
Leipzig, 1931 [note de W. B.].
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
21
Fig. 9. Eugne Atget, March des Carmes, place Maubert (ill. tire de Lichtbilder, 1931).
y a en effet aujourdhui une propension aussi passionne rapprocher
les choses de soi, ou plutt des masses, qu triompher en chaque occa-
sion de lunicit par leur reproduction. Jour aprs jour, le besoin se fait
plus pressant de possder la plus grande proximit avec lobjet dans
limage ou plutt dans sa copie. Et la copie, telle que la livrent journaux
illustrs ou actualits lmes, se distingue videmment de limage. Uni-
cit et permanence sont aussi troitement lies dans celle-ci que fuga-
cit et reproductibilit dans celle-l. Dbarrasser lobjet de son enve-
loppe, en dtruire laura, est la marque dune perception dont le sens de
lgalit sest dvelopp de telle faon quelle lapplique galement
lunicit par la reproduction. Atget est presque toujours pass ct
des belles vues et des soi-disant curiosits
52
mais pas dune longue
range de bottines [g. 9], ni dune cour parisienne o salignent en rang
du matin au soir les charrettes bras, ni dune table aprs le repas, quand
la vaisselle na pas encore t range, comme il sen trouve au mme
instant des centaines de milliers, ni du bordel rue ***, n 5 dont le
22
t udes phot ographi ques, 1
Fig. 10.
Dbut de la
3
e
livraison de la
Petite histoire
Les illustrations
sont tires de
Sander (cf. bibl.).
cinq est crit en grand quatre endroits diffrents de la faade. Pour-
tant, curieusement, presque toutes ces images sont vides. Vide la porte
dArcueil prs des fortifs, vides les escaliers dhonneur, vides les cours,
vides les terrasses des cafs, vide, comme il se doit, la place du Tertre
53
.
Non pas dserts mais mornes ; sur ces images, la ville est vacue,
comme un appartement qui na pas encore trouv de nouveau locataire.
Ces capacits sont celles par lesquelles la photographie surraliste ins-
talle une salutaire distance entre lhomme et son environnement. Elle
laisse le champ libre au regard politiquement duqu, devant lequel
toute intimit cde la place lclaircissement du dtail.
III
Il est clair que ce nouveau regard trouvera moins son prot l o lon
a t le plus ngligent : dans le portrait commercial ofciel. Dun autre
ct, renoncer la gure humaine reprsente pour la photographie lob-
jectif le plus irralisable. celui qui lignorerait, les meilleurs lms russes
ont appris que le milieu
54
et le paysage ne se dvoilent que pour celui
qui, parmi les photographes, sait les saisir dans leur manifestation ano-
nyme sur un visage. Cependant, la condition de cette possibilit repose
presque exclusivement sur celui qui est reprsent. La gnration qui
ne tenait pas absolument passer la postrit par la photographie,
mais se retranchait avec pudeur dans son espace vital loccasion dun
tel crmonial comme Schopenhauer enfonc dans son fauteuil sur
le portrait excut en 1850 Francfort a laiss pour cette raison cet
espace vital avec elle sur la plaque : cette gnration na pas transmis
ses vertus. Cest alors que, pour la premire fois depuis plusieurs dcen-
nies, les lms russes permirent de laisser agir des gens devant une camra
sans en faire un usage photographique. Immdiatement, sur la plaque,
la gure humaine dvoilait une nouvelle, une incommensurable signi-
cation. Mais ce ntait plus du portrait. Qutait-ce ? Cest lminent
mrite dun photographe allemand que davoir rpondu cette ques-
tion. August Sander* a rassembl une srie de ttes qui ne le cde en
rien la puissante galerie physiognomonique dun Eisenstein ou dun
Poudovkine et il la fait dun point de vue scientique. Son uvre
globale est constitue de sept groupes correspondant une classe
sociale dtermine ; il doit tre publi sous la forme denviron quarante-
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
23
* August Sander, Antlitz der Zeit, Munich, Kurt Wolff, 1929 [note de W. B.].
cinq albums comprenant chacun douze photographies
55
. Pour lins-
tant, un recueil comprenant un choix de soixante reproductions est dis-
ponible, qui offre une matire inpuisable lobservation. Sander com-
mence par les paysans, les hommes attachs la terre, puis conduit
lobservateur travers toutes les couches et tous les mtiers jusquaux
reprsentants de la plus haute civilisation et redescend jusquaux
idiots
56
. Lauteur na pas abord cette tche considrable en savant,
inspir par des thories raciales ou sociales, mais, comme le prcise
lditeur, en observateur direct
57
. Cette observation est certainement
sans prjugs, audacieuse mais aussi tendre au sens du mot de Goethe :
Il existe une tendre exprience qui sidentie intrieurement lobjet
et devient ainsi une vritable thorie
58
. Ainsi nest-il pas surprenant
quun observateur comme Dblin sintresse prcisment aux aspect
scientiques de cette uvre et remarque : De mme quil existe une
anatomie compare, clairant notre comprhension de la nature et de
lhistoire de nos organes, de mme Sander nous propose-t-il la photo-
graphie compare : une photographie dpassant le dtail pour se pla-
cer dans une perspective scientique
59
. Ce serait piti que les condi-
tions conomiques empchent la poursuite de la publication dun corpus
aussi extraordinaire. En sus de cet encouragement sur le fond, on peut
en adresser un autre, plus prcis, lditeur. Des uvres comme celle
de Sander peuvent acqurir du jour au lendemain une actualit impr-
vue. Les changements de pouvoir qui nous attendent
60
requirent
comme une ncessit vitale damliorer et daiguiser le savoir physio-
gnomonique. Que lon soit de droite ou de gauche, il faudra shabituer
tre examin tout comme soi-mme on examinera les autres. Luvre
de Sander est plus quun recueil dimages : cest un atlas dexercices
61
.
Il nexiste notre poque aucune uvre dart que lon considre
aussi attentivement que son propre portrait photographique, ceux de
ses parents, de ses amis ou de ltre aim
62
, crivait ds 1907 Alfred
Lichtwark, ramenant ainsi linvestigation du domaine des distinctions
esthtiques vers celui des fonctions sociales. Ce nest qu partir de l
quelle peut poursuivre son avance. Il est signicatif que le dbat se
soit le plus souvent g autour dune esthtique de la photographie
comme art, alors quon naccordait par exemple pas la moindre atten-
tion au fait social nettement plus consistant de lart comme photogra-
phie. Pourtant, les effets de la reproduction photographique des
uvres sont dune tout autre importance pour la fonction de lart que
24
t udes phot ographi ques, 1
la ralisation dune photographie plus ou moins artistique dans laquelle
lvnement se transforme en prise photographique. De fait, lama-
teur rentrant chez lui avec son butin dpreuves artistiques originales
nest pas plus rjouissant quun chasseur qui ramnerait une telle masse
de gibier quil faudrait ouvrir un magasin pour lcouler. Le jour nest
pas loin o il y aura plus de journaux illustrs que de vendeurs de gibier
et de volaille. Mais oublions le shooting. Que lon se tourne vers la
photographie comme art ou vers lart comme photographie, laccent se
dplace sensiblement. Chacun a pu faire lobservation selon laquelle
une reprsentation, en particulier une sculpture, ou mieux encore un
dice, se laissent mieux apprhender en photo quen ralit. La ten-
tation est grande de repousser cela comme un dclin du sens artistique,
une dmission de nos contemporains. Mais ceux-ci doivent constater
combien, avec lapprentissage des techniques de reproduction, sest
modie la perception des grandes uvres. On ne les peroit plus
comme la cration dun individu: elles sont devenues des productions
collectives, si puissantes que pour les assimiler, il faut dabord les rape-
tisser. En n de compte, les procds de reproduction sont des tech-
niques de rduction qui confrent un certain degr de matrise des
uvres qui, sans cela, deviendraient inutilisables
63
.
Si lon cherchait la caractristique majeure des relations contem-
poraines de lart et de la photographie, ce serait linsupportable ten-
sion que leur impose la photographie des uvres dart. Nombre de
ceux qui, en tant que photographes, inuent sur la physionomie de
cette technique, viennent de la peinture. Ils lui ont tourn le dos aprs
avoir cherch rapprocher dune faon vivante et vidente ce moyen
dexpression de la vie actuelle. Plus tait vive leur attention au contem-
porain, plus leur point de dpart leur devenait problmatique. Comme
il y a quatre-vingts ans, la photographie a pris le relais de la peinture.
Le potentiel crateur de la nouveaut, dit Moholy-Nagy, est sou-
vent recouvert par les formes, les instruments ou les catgories
anciennes, que lapparition du nouveau rend dj caduques, mais qui,
sous sa pression mme, produisent une dernire oraison euphorique.
Ainsi, par exemple, la peinture futuriste (statique) nous livra une pro-
blmatique clairement dnie (qui sannula elle-mme plus tard) de la
simultanit cintique, de la mise en forme du moment temporel, et
cela une poque o le cinma existait dj, sans avoir fait cependant
lobjet dune rexion srieuse. [] Enn on peut avec prudence
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
25
considrer certains des peintres qui mettent aujourdhui en uvre des
moyens de reprsentation guratifs (noclassicisme et peintres de la
Neue Sachlichkeit) comme les prcurseurs dun nouvel art optique gu-
ratif qui nutilisera bientt plus que des moyens mcaniques et tech-
niques
64
. Et Tristan Tzara, en 1922 : Quand tout ce quon nomme
art fut bien couvert de rhumatismes, le photographe alluma les mil-
liers de bougies de sa lampe, et le papier sensible absorba par degrs
le noir dcoup par quelques objets usuels. Il avait invent la force dun
clair tendre et frais qui dpassait en importance toutes les constella-
tions destines nos plaisirs visuels
65
. Ceux qui ne sont pas venus des
beaux-arts la photographie par opportunisme, par hasard ou par com-
modit forment aujourdhui lavant-garde parmi les spcialistes, parce
que leur parcours les protge peu prs du plus grand danger de la
photographie actuelle : la tendance dcorative. La photographie
comme art, dit Sasha Stone, est un domaine trs dangereux
66
.
Si la photographie saffranchit du contexte que fournissent un San-
der, une Germaine Krull ou un Blossfeldt, si elle smancipe des int-
rts physiognomoniques, politiques ou scientiques, alors elle devient
cratrice. Laffaire de lobjectif devient le panorama ; lditorialiste
marron de la photographie entre en scne. Lesprit, surmontant la
mcanique, interprte ses rsultats exacts comme des mtaphores de
la vie
67
. Plus la crise actuelle de lordre social stend, plus ses moments
singuliers sentrechoquent avec raideur dans un antagonisme total, plus
la cration dont le caractre fondamental est la variabilit, la contra-
diction le pre et la contrefaon la mre devient un ftiche dont les
traits ne doivent lexistence qu lalternance des clairages la mode.
Le monde est beau
68
, telle est sa devise. En elle se dissimule la pos-
ture dune photographie qui peut installer nimporte quelle bote de
conserve dans lespace, mais pas saisir les rapports humains dans les-
quels elle pntre, et qui annonce, y compris dans ses sujets les plus
chimriques, leur commercialisation plutt que leur connaissance.
Mais puisque le vrai visage de cette cration photographique est la
publicit ou lassociation, son vritable rival est le dvoilement ou la
construction. La situation, dit Brecht, se complique du fait que, moins
que jamais, une simple reproduction de la ralit nexplique quoi que
ce soit de la ralit. Une photographie des usines Krupp ou AEG nap-
porte peu prs rien sur ces institutions. La vritable ralit est reve-
nue la dimension fonctionnelle. La rication des rapports humains,
26
t udes phot ographi ques, 1
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
27
Fig. 11. Man Ray, Salle manger, rayogramme
(illustration de lalbum lectricit, 1931).
La citation de Tristan Tzara est extraite de sa
prface de 1922 lalbum Les Champs dlicieux,
compos de rayogrammes de Man Ray
texte traduit par Benjamin en 1924
pour la revue G, et premier tmoignage
de son intrt pour la photographie.
cest--dire par exemple lusine elle-mme, ne les reprsente plus. Il y
a donc bel et bien quelque chose construire, quelque chose darti-
ciel, de fabriqu
69
. Le mrite des surralistes est davoir prpar
la voie une telle construction photographique. Une seconde tape
dans laffrontement entre photographie construite et photographie
cratrice fut le cinma russe. Rien l que de plus normal : les perfor-
mances de ses ralisateurs ntaient possibles que dans un pays o la
photographie ne repose pas sur lexcitation et la suggestion, mais sur
lexprimentation et lapprentissage. En ce sens, et en ce sens seule-
ment, peut-on encore donner une signication laccueil grandilo-
quent que t en 1855 le peintre dides mal dgrossi Antoine Wiertz
la photographie : Il nous est n, depuis peu dannes, une machine,
lhonneur de notre poque, qui, chaque jour, tonne notre pense et
effraie nos yeux. Cette machine, avant un sicle, sera le pinceau, la
palette, les couleurs, ladresse, lhabitude, la patience, le coup dil, la
touche, la pte, le glacis, la celle, le model, le ni, le rendu. []
Quon ne pense pas que le daguerrotype tue lart. [] Quand le
daguerrotype, cet enfant gant, aura atteint lge de maturit ; quand
toute sa force, toute sa puissance se seront dveloppes, alors le gnie
de lart lui mettra tout coup la main sur le collet et scriera : moi !
Tu es moi maintenant ! Nous allons travailler ensemble
70
.
Les mots par lesquels Baudelaire annonce la nouvelle technique ses
lecteurs quatre ans plus tard, dans son Salon de 1859, sont autrement plus
froids, voire pessimistes. Pas plus que ceux quon vient de citer, on ne
peut les lire aujourdhui sans en dplacer laccent. Mais comme ils for-
ment le pendant de lenthousiasme de Wiertz, ils ont gard la valeur
28
t udes phot ographi ques, 1
Fig. 12.
Waldemar
Titzenthaler,
Ruhrgebiet
(illustration tire
de Das Deutsche
Lichtbild, 1930).
aigu dune dfense contre toutes les usurpations de la photographie
artistique. Dans ces jours dplorables, une industrie nouvelle se pro-
duisit, qui ne contribua pas peu conrmer la sottise dans sa foi [],
que lart est et ne peut tre que la reproduction exacte de la nature [].
Un Dieu vengeur a exauc les vux de cette multitude. Daguerre fut
son messie
71
. Et : Sil est permis la photographie de suppler lart
dans quelques-unes de ses fonctions, elle laura bientt supplant ou
corrompu tout fait, grce lalliance naturelle quelle trouvera dans la
sottise de la multitude. Il faut donc quelle rentre dans son vritable
devoir, qui est dtre la servante des sciences et des arts
72
.
Mais une chose est passe inaperue de Wiertz comme de Baude-
laire, cest linjonction qui repose dans lauthenticit de la photogra-
phie. Si un reportage dont les clichs nont dautre effet que de sasso-
cier par le biais du langage permet de lescamoter, cela ne sera pas
toujours possible. Lappareil photo deviendra toujours plus petit, tou-
jours plus prompt saisir des images fugaces et caches, dont le choc
veille les mcanismes dassociation du spectateur. Ici doit intervenir la
lgende, qui engrne dans la photographie la littralisation des condi-
tions de vie, et sans laquelle toute construction photographique
demeure incertaine. Ce nest pas en vain que lon a compar les clichs
dAtget au lieu du crime
73
. Mais chaque recoin de nos villes nest-il pas
le lieu dun crime ? Chacun des passants nest-il pas un criminel ? Le
photographe successeur de laugure et de lharuspice na-t-il pas le
devoir de dcouvrir la faute et de dnoncer le coupable sur ses images ?
Lanalphabte de demain ne sera pas celui qui ignore lcriture, a-t-on
dit, mais celui qui ignore la photographie
74
. Mais ne vaut-il pas moins
encore quun analphabte, le photographe qui ne saurait pas lire ses
propres preuves ? La lgende ne deviendra-t-elle pas llment le plus
essentiel du clich ? Telles sont les questions par lesquelles les neuf
dcennies qui sparent les contemporains de la daguerrotypie dchar-
gent leurs tensions historiques. Cest la lueur de ces tincelles, sor-
tant de lombre du quotidien de nos grands-pres, que se montrent les
premires photographies, si belles et inapprochables.
Walter BENJAMIN
(Traduit de lallemand par Andr Gunthert)
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
29
Le texte est traduit partir de ldition originale
parue dans Die Literarische Welt, qui prsente
quelques diffrences de dtail avec la version des
Gesammelte Schriften(ci-dessous GS). Les divi-
sions correspondent aux trois livraisons de larticle, les
18 septembre, 25 septembre et 2 octobre 1931. Les notes
de Walter Benjamin sont signales par des astrisques,
celles du traducteur par des appels de note en chiffres.
Les rfrences des ouvrages cits en abrg sont dtailles
dans la bibliographie (voir p. 36).
Le traducteur tient remercier pour leur concours
Clment Chroux, Olivier Lugon et Jean-Claude
Lebensztejn. Ldition critique du texte a t labore
loccasion dun cours au dpartement Image photo-
graphique (Paris VIII), durant lanne universitaire
1995-1996.
1. Le dbut de larticle est fortement ins-
pir du texte de SCHWARZ, auquel sont
notamment empruntes la comparaison de
la photographie et de limprimerie (que lon
retrouve dans plusieurs autres ouvrages
dhistoire de la photographie allemands de
lpoque, cf. Erich STENGER, Geschichte der Pho-
tographie, Berlin, VDI Verlag, 1929), ainsi que
lide du caractre inluctable de linvention
( lheure tait venue) elle-mme
emprunte lhistoriographie de limprime-
rie et promise, via FREUND(1936), un grand
avenir. La fin de cette premire phrase
( xer dans la camera obscura) est reprise
presque mot pour mot de MATTHIES-MASU-
REN, p. 19.
2. ffentliche Sache, jeu de mots de
latiniste, est lquivalent allemand du fameux
Res publica. Benjamin oublie curieusement de
situer, par lindication dun millsime, les
dctiques temporels de son introduction.
Les cinq ans defforts correspondent la
priode de collaboration officielle entre
Nipce et Daguerre, inaugure par contrat
en 1829 et interrompue en 1833 par la mort
de Nipce, six ans avant la divulgation du
daguerrotype, en 1839.
3. Cf. BOSSERT & GUTTMANN ( dater de
cette poque, [les] crations [de la photo-
graphie] sont tellement fausses et prten-
tieuses, et si loin de notre conception
actuelle, quil faut sabstenir de reproduire des
photographies postrieures 1870, s. p.
[p. 3]) ; galement ORLIK, p. 36-37 et
SCHWARZ, p. 20.
4. Dans cette premire partie du texte, les
units historiques forges par Benjamin man-
quent singulirement de prcision. La
priode que suggrent ses exemples pourrait
recouvrir grossirement les annes 1850-
1860, soit la deuxime (et non la premire)
dcennie aprs la divulgation du daguerro-
type. Toutefois, David-Octavius Hill (et
Robert Adamson) ayant pratiqu la photo-
graphie entre 1843 et 1847, Charles-Victor
Hugo en 1852, Flix Nadar partir de 1854
et Julia Margaret Cameron partir de 1860,
il est impossible de runir leurs travaux sous
la mme dcennale. la dcharge de Benja-
min, les sources quil utilise proposent sou-
vent une chronologie confuse, en particulier
lors de la mention des procds ngatif-posi-
tif (ou photographie proprement dite, par
opposition lhliographie et au daguerro-
type) : Quelques chercheurs placent lori-
gine de la photographie vers 1860; cette
poque la daguerrotypie fut supplante par
le ngatif sur plaque de verre et le tirage sur
papier (BOSSERT & GUTTMANN, s. p. [p. 3]).
5. Il sagit dAndr-Adolphe Disdri (1819-
1889), qui dpose en 1854 le brevet de la
carte de visite photographique (cit notam-
ment par SCHWARZ). On notera encore une
fois le caractre hasardeux de la chronologie
esquisse par Benjamin.
6. Dclenche aux tats-Unis en octobre
1929, la crise conomique atteint lAlle-
magne n 1930 et bat son plein au moment
de la rdaction de cet article (le nombre de
chmeurs y passe de 3,7 millions en
30
t udes phot ographi ques, 1
NOTES
dcembre 1930 6 millions en dcembre
1931).
7. La Petite histoire doit probablement
son existence cette rare conjonction dito-
riale : la parution coup sur coup de trois
recueils dimages consacrs la photogra-
phie ancienne (BOSSERT & GUTTMANN,
SCHWARZ, ATGET; pour une situation histo-
riographique de ces ouvrages, voir Martin
GASSER, Histories of Photography, 1839-
1939, History of Photography, vol. 16, n 1,
printemps 1992, p. 55-57), elle-mme
contemporaine de la publication de plusieurs
autres albums remarquables (BLOSSFELDT,
RENGER-PATZSCH, SANDER). Benjamin avait
consacr ds 1928 une premire note de lec-
ture louvrage de Blossfeldt (Neues von
Blumen, cf. bibl.), et le premier projet de la
Petite histoire consiste probablement en
un compte rendu group desdites parutions.
8. Anon., Leipziger Anzeiger, v. 1840, cit
daprs DAUTHENDEY, p. 39-40 (cf. note 15).
Lerreur de Benjamin (Stadtanzeiger pour
Anzeiger) correspond laccentuation du
caractre local du journal. Corrige dans la
version des GS, cette erreur conduit Joan
Fontcuberta dnier toute ralit lextrait
cit (puis se tromper son tour, en inter-
vertissant Karl et Max Dauthendey, cf. Joan
FONTCUBERTA, Le Baiser de Judas. Photographie et
vrit, Arles, Actes-Sud, 1996, p. 22-23).
9. ARAGO, p. 500. Contrairement ce
quindique la note correspondante des GS,
Benjamin nutilise pas ici la version du dis-
cours traduite par Josef-Maria EDER dans sa
Geschichte der Photographie de 1905 (il na appa-
remment pas consult cet ouvrage), mais
celle de ldition allemande des uvres com-
pltes dARAGO (Smtliche Werke, d. de W. G.
Hankel, Leipzig, V. Otto Wigand, 1854-
1856, t. VII). Gisle Freund, qui nhsite pas,
dans sa thse de 1936, piller plusieurs
reprises la Petite histoire, reprend par
exemple textuellement lexpression de Ben-
jamin concernant Arago (cf. FREUND, p. 39.
Rappelons ce propos que Walter Benjamin
et Gisle Freund ne feront connaissance
quen 1932, prs dun an aprs la publication
de la Petite histoire).
10. Passage repris presque mot pour mot de
DAUTHENDEY, p. 32.
11. Reproduisant une tendance bien tablie
depuis le pictorialisme, les ouvrages alle-
mands de lpoque minimisent largement
(quand ils ne loublient pas tout fait) le
rle du photographe Robert Adamson
(1821-1848). Benjamin ne fait ici que suivre
ses sources : MATTHIES-MASUREN, ORLIK,
SCHWARZ ou BOSSERT & GUTTMANN.
12. Cf. SCHWARZ: Son nom est oubli, ses
tableaux ont disparu, rien ne pourrait les
tirer de loubli, sil navait laiss derrire lui
une uvre photographique incomparable
(p. 20).
13. Il sagit de la seconde des quatre repro-
ductions qui illustrent la premire livraison
de larticle de Benjamin dans la Literarische Welt
(voir g. 1), tire de louvrage de SCHWARZ
(g. 26) : le portrait de Mrs Elizabeth (Johns-
tone) Hall (cf. Sara STEVENSON, D. O. Hill and
R. Adamson, dimbourg, National Gallery of
Scotland, 1981, p. 196). Devant lloquence
de Benjamin, il est intressant de noter quil
ne connat de cette image (comme toutes les
photographies historiques auxquelles il est
fait allusion dans cet article) que les
mdiocres reproductions publies (pour les-
sentiel, dans SCHWARTZou BOSSERT & GUTT-
MANN).
14. Citation des quatre derniers vers du
pome Standbilder. Das sechste de Stefan
GEORGE (cf. bibl.). Linterrogation formule
par ces vers suit, au quatrain prcdent, la
description dimpressionnants portraits
( Peur et dsir veillent les noms son-
nants/De puissants princes et chefs en or et
rubis/Leurs ttes me regardent dans des
cadres craquels/Dans leur obscurit argen-
te et leur ple carmin).
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
31
15. Karl Dauthendey (1819-1896), pion-
nier du daguerrotype en Allemagne. Son
ls, le pote Max Dauthendey, lui consacrera
un livre de souvenirs, souvent mentionn
comme un ouvrage de rfrence sur les pre-
miers temps de la photographie (cf. ORLIK,
p. 33, BOSSERT & GUTTMANN, s. p. [p. 4]). Le
double portrait auquel fait allusion Benjamin,
reproduit daprs BOSSERT & GUTTMANN(g.
128, date 1857), constitue la premire illus-
tration de larticle. La surenchre interprta-
tive laquelle donne lieu ce trs banal por-
trait datelier prend visiblement sa source,
beaucoup plus que dans limage, dans le texte
autobiographique de Dauthendey (cf. note
suivante).
16. Benjamin opre ici une confusion extr-
mement intressante. Le livre de souvenirs de
Max Dauthendey relate brivement le dcs,
en 1855, de la premire femme de son pre,
Karl (cf. DAUTHENDEY, p. 114). Le rcit
enchane immdiatement sur la description
dune photographie plus ancienne du jeune
couple, conserve par la demi-sur de Max,
commente en ces termes : On ne voit
encore aucune trace du malheur futur sur cette
image, sinon que le mle regard de mon pre,
sombre et appuy, trahit une brutalit juv-
nile, susceptible de blesser cette femme qui
le contemple attentivement. (Ibid., p. 115).
Mais il ne sagit pas de la mme femme: celle
qui gure aux cts du photographe dans lou-
vrage de BOSSERT & GUTTMANN est la seconde
femme de Karl Dauthendey, Mlle Friedrich
(1837-1873), quil pousera deux ans plus
tard. Superposant la description narrative
dune photographie limage quil a sous les
yeux, Benjamin confond les deux pouses, et,
empruntant au rcit du pote sa technique de
prophtie rtrospective, il la dplace du
regard masculin au regard fminin produi-
sant sur cette image une construction com-
plexe, mais absolument fantasmatique (cf. A.
GUNTHERT, Le complexe de Gradiva, tudes
photographiques, n2, mai 1997, p. 118-121.
17. Souvenir des petites perceptions de
Leibniz: On peut mme dire quen cons-
quence de ces petites perceptions le prsent
est plein de lavenir et charg du pass []
et que dans la moindre des substances, des
yeux aussi perants que ceux de Dieu pour-
raient lire toute la suite des choses de luni-
vers (Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, Nouveaux
Essais sur lentendement humain (d. J. Brunsch-
wig), Paris, Flammarion, 1990, p. 42).
18. Le passage qui souvre ici (et se clt avec
la mention de Blossfeldt) reprend un dve-
loppement similaire de Malerei Photographie
Film de Lszl MOHOLY-NAGY (1925, p. 22).
Si lon doit bien Benjamin lexpression
dinconscient optique (Optisch-Unbewuss-
ten), celle-ci apparat comme le pendant du
devenir-conscient (Bewusstwerden) de
Moholy-Nagy (ibid.).
19. Zeitlupen oder Vergrsserungen, dit le texte
(hardiment traduit par. ralenti et acclr
par Maurice de Gandillac). Si lagrandisse-
ment (Vergrsserung) correspond bien un
procd photographique, que vient faire ici
Zeitlupe (ralenti, par opposition Zeitraffer :
acclr), terme de lunivers cinmatogra-
phique ? Il semble bien que Benjamin
confonde ce mot, demploi relativement
rcent en allemand, avec le substantif qui
exprime leffet visuel darrt sur image: lins-
tantan (Momentaufnahme). Outre le sens lit-
tral du terme (loupe temporelle), qui le
rapproche tout naturellement de Vergrsse-
rung, le texte de Moholy-Nagy, duquel sins-
pire ce passage (voir note ci-dessus), sarti-
cule bel et bien autour de deux types
dexemples : ceux issus de lanalyse scienti-
que du mouvement (marche, saut, galop),
ceux dus lagrandissement (formes zoolo-
giques, botaniques et minrales), appuys sur
plusieurs illustrations (MOHOLY-NAGY,
1925, p. 22). Le fait que Moholy utilise ga-
lement quelques pages plus loin le terme de
Zeitlupe (p. 29) peut venir conrmer cette
hypothse.
32
t udes phot ographi ques, 1
20. Cf. BLOSSFELDT, respectivement p. 17,
123, 37, 39, 99. Passage repris avec quelques
modications de W. B., Neues von Blu-
men, p. 153.
21. SCHWARZ, p. 42.
22. Henry H. SNELLING, The History and
Practice of the Art of Photography, 1849,
cit daprs SCHWARZ, ibid.
23. DAUTHENDEY, p. 46-47.
24. Cf. W. B., Nichts gegen die Illustrierte
(1925).
25. Ce passage sinspire dORLIK: Cest jus-
tement cette faiblesse dune nouvelle tech-
nique ses dbuts qui rend ses effets artis-
tiques si puissants (p. 38).
26. Il sagit bien sr dune approximation his-
torique. Comme on sait, les procds utili-
sables en extrieur furent longtemps beau-
coup moins sensibles que ceux qui
requraient la proximit immdiate du labo-
ratoire.
27. ORLIK, p. 38-39. Emil Orlik (1870-1932)
est un dessinateur et graphiste berlinois.
28. KRACAUER, p. 94.
29. Bernard von Brentano (1901-1964),
journaliste, crivain et ami de W. B. est alors
correspondant de la Frankfurter Zeitung. Nous
navons pu retrouver lorigine de la citation.
30. Giambattista Della Porta (v. 1535-
1615), physicien italien.
31. ARAGO, p. 465.
32. Le passage sur le portrait en miniature
est emprunt presque mot pour mot MAT-
THIES-MASUREN, p. 4-6 ( Sa premire vic-
time fut le portrait en miniature. La chose se
dveloppa si vite que la plupart des miniatu-
ristes actifs autour de 1840 devinrent photo-
graphes , etc.).
33. Flix Nadar (1820-1910), Carl Ferdi-
nand Stelzner (1805-1894), Louis Pierson
(1822-1913), Hippolyte Bayard (1801-
1887) : Benjamin trouve ces informations
dans les lgendes des illustrations de BOSSERT
& GUTTMANN (qui donne faussement 1818
pour date de naissance Pierson, lui faisant
atteindre 95 ans).
34. Emprunt manifeste, l encore, Licht-
wark dans MATTHIES-MASUREN (p. 7, Benja-
min croit bien faire en ajoutant la prcision
sur ngatif , quil reprend BOSSERT &
GUTTMANN, s. p. [p. 3]). dire vrai, la thse
de la monte de la retouche comme signe de
dcadence de la photographie est la convic-
tion la mieux partage des sources consultes
par W. B. (voir galement ORLIK, p. 37 ;
SCHWARTZ, p. 38). Cette thse est videm-
ment dnue de tout fondement historique,
et repose sur la vieille maldiction qui frappe
la pratique toujours honteuse, mais toujours
atteste de lintervention manuelle sur le
subjectile photographique (voir notamment
la controverse opposant Paul Prier Eugne
Durieu dans les colonnes du Bulletin de la Socit
franaise de photographie en 1855, extraits cits
in Andr ROUILL, La Photographie en France.
Textes et controverses : une anthologie. 1816-1871,
Paris, Macula, 1989, p. 272-276).
35. Plusieurs photographies du dbut du
sicle, issues de lalbum familial des Benjamin
(comprenant notamment Walter en Tyrolien
ou en marin) ont t publies, voir notam-
ment BRODERSEN, p. 19-21 et SCHEURMANN,
p. 16-17.
36. Henry Peach ROBINSON, Photographic
News, 1856, cit daprs MATTHIES-MASUREN,
p. 22 (lensemble du passage sur les acces-
soires est fortement inspir du mme
ouvrage, p. 55-57).
37. Le premier ouvrage consacr Franz
Kafka (Hellmuth KAISER, Franz Kafkas Inferno,
Vienne, 1931) vient de paratre. Benjamin,
qui sintresse depuis longtemps cet auteur
et a notamment prononc cette mme anne
un expos radiophonique consacr la paru-
tion du recueil La Muraille de Chine (Franz
Kafka: Beim Bau der chinesischen Mauer,
expos du 3 juillet 1931, Frankfurter Rund-
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
33
funk, GS, t. II, vol. 2, p. 676-683), est entr
en possession dune photographie de Kafka
enfant. La description quil en fournit dans la
Petite histoire sera reprise et dveloppe
plusieurs endroits, en particulier lanne sui-
vante dans un texte pour Enfance berlinoise, o
Benjamin sidentie au sujet de limage (Die
Mummerehlen/La commerelle, cf. bibl.).
38. Le dveloppement sur la manire noire
est emprunt, parfois mot pour mot,
SCHWARZ, p. 38-39.
39. Il sagit de la citation de Moholy-Nagy
que Benjamin fera plus loin (cf. infra, p. 25).
40. ORLIK, p. 38.
41. Paul DELAROCHE, cit daprs SCHWARZ,
p. 39. Celui-ci propose une adaptation alle-
mande (retraduite ici), qui inverse le sens du
texte original (cf. ARAGOp. 493: [] le ni
dun prcieux inimaginable ne trouble en rien
la tranquillit des masses, ne nuit en aucune
manire leffet gnral ).
42. Cf. ORLIK, p. 37.
43. Quoique reposant sur des informations
issues dORLIK (pour les objectifs) ou MAT-
THIES-MASUREN (pour les pratiques de la
retouche), le dveloppement sur laura appa-
rat bel et bien comme une hypothse propre
Benjamin. Faut-il y voir la raison de lex-
trme confusion du passage? Lassociation
des paramtres techniques ou sociologiques
eux-mmes hasardeux quil propose ne
renvoie aucune ralit identiable de lhis-
toire de la photographie.
44. Ide adapte de SCHWARZ, p. 13.
45. Ignace Paderewski (1860-1941) fut pia-
niste virtuose. Niccol Paganini (1782-
1840) est le plus clbre violoniste de tous
les temps. Camille Recht, in ATGET, p. 9. La
conclusion du parallle est la suivante: A-
t-on jamais compar un pianiste virtuose avec
un matre du violon? (Ibid.)
46. Ferruccio Busoni (1866-1924) pianiste
virtuose, sinstalle Berlin partir de 1894.
47. Emprunt Camille Recht : [Atget] en
avait assez du thtre. Lui qui avait t forc
pendant de longues annes [] de mimer les
pres nobles ou les tratres, avec le maquillage
et la barbe postiche des intrigants, se jeta avec
la joie de la dlivrance [] sur les petits sujets :
les gens, les maisons, les boutiques, les cafs
les choses du quotidien (ATGET, p. 9).
48. On croit pouvoir afrmer que ses cli-
chs atteignent un nombre de plusieurs mil-
liers entre six et huit mille, ibid., p. 26.
49. Ibid., p. 8.
50. Lopposition que formule ici Benjamin
puise peut-tre lune de ses dterminations
dans un fort contraste ditorial : face lava-
lanche de portraits nostalgico-romantiques
que prsentent les recueils tels ceux de
SCHWARTZ ou BOSSERT & GUTTMANN, lico-
nographie dATGET parat en effet dune
grande sobrit.
51. Cf. W. B., Surrealistische Zeitschriften
(1930).
52. ATGET, p. 17.
53. Ibid., respectivement g. 7, 87, 15, 64,
63, 89, 44, 34, 65.
54. En franais dans le texte : il sagit du
terme issu de la thorie naturaliste (voir
notamment mile ZOLA, Le Roman exprimen-
tal, Paris, Charpentier, 1881, p. 185 sq.).
55. SANDER (cit dans la traduction de La
Marcou), p. 1.
56. Ibid.
57. Ibid (mme en omettant les guillemets,
Benjamin continue de citer lannonce dito-
riale de louvrage).
58. GOETHE, p. 435. Cette pense fait suite
deux rexions concernant lagrandisse-
ment (n 507 et 508).
59. SANDER (cit dans la traduction de La
Marcou), p. 14. Sur la prface de Dblin, voir
Vincent Lavoie, Effeuillage du visage et
perte de soi, La Recherche photographique, n 14,
printemps 1993, p. 42-43.
34
t udes phot ographi ques, 1
60. Plusieurs changements de gouverne-
ment (dont un en octobre 1931, le mois de
la parution de la troisime livraison de la
Petite histoire) maillent une priode
trouble, qui a notamment vu les nazis obte-
nir 107 siges au Reichstag en septembre de
lanne prcdente.
61. On notera la grande cohrence du pas-
sage qui dbute avec la troisime livraison,
et son absence de lien avec les dveloppe-
ments prcdents lments qui indiquent
une rdaction spare, qui pourrait tre celle
de la note de lecture sur louvrage de Sander,
incorpore aprs coup dans lensemble form
par la Petite histoire.
62. MATTHIES-MASUREN, p. 16. Auteur de la
prface dun des ouvrages les plus sollicits
par Benjamin pour la rdaction de sa Petite
histoire, Alfred Lichtwark (1852-1914),
clbre historien dart, tait le directeur de la
Kunsthalle de Hambourg, o il organisa en
1893 la grande exposition pictorialiste Lart
de la photographie qui eurit secrtement.
63. Cest loccasion de son compte rendu
de louvrage de Blossfeldt (Neues von Blu-
men) que Benjamin avait engag la rexion
sur lagrandissement et la rduction. Esquis-
se ici de faon assez sommaire, cette pro-
blmatique culminera dans Luvre dart.
64. MOHOLY-NAGY (1925), p. 22 (traduc-
tion adapte de Catherine Wermester, p. 92).
65. TZARA, p. 416. La traduction que t Ben-
jamin en 1924 de la prface de Tzara pour
lalbum de photogrammes de Man Ray (Les
Champs dlicieux, Paris, Socit gnrale dim-
primerie et ddition, 1922), dont il reprend
ici un extrait, constitue la premire trace de
son intrt pour la photographie (cf. W. B.,
Die Photographie von der Kehrseite).
66. Cf. Sasha STONE, Photo-Kunstgewebe-
reien, Das Kunstblatt, vol. 12, 1928, p. 86.
Comme Germaine Krull, le photographe
Sasha Stone tait un ami personnel de W.
Benjamin.
67. Nous navons malheureusement pu
retrouver lorigine de cette citation, qui fait
toutefois penser aux critiques qui accueilli-
rent le clbre ouvrage dAlbert Renger-
Patzsch (cf. Carl Georg HEISE, [Einleitung],
RENGER-PATZSCH, p. 11, et Olivier LUGON,
La Photographie en Allemagne, Nmes, d. J.
Chambon, 1997, p. 135-159).
68. Allusion au titre de louvrage de RENGER-
PATZSCH: Die Welt ist schn.
69. BRECHT, p. 469. Exprimant la mme ide
un an plus tt, Brecht lattribue au marxiste
Sternberg propos des usines Ford (ibid., p.
443-444).
70. WI ERTZ, p. 309 (voir galement
ROUILL, op. cit., p. 245). Forme de termes
dun vocabulaire trs spcialis, la longue
numration de Wiertz ntait pas facile
traduire, et Benjamin a trbuch sur
quelques mots : sa version oublie celle,
confond model avec modle (Vorbild) et
traduit rendu par extrait (Extrakt). Mau-
rice de Gandillac ayant retraduit ce passage
de lallemand (comme toutes les autres cita-
tions de textes franais de la Petite his-
toire, lexception du Salon de Baude-
laire), il est amusant de constater que les
notes de ldition Pliade des uvres com-
pltes de Baudelaire citent leur tour cette
traduction de traduction hasardeuse (cf.
BAUDELAIRE, p. 1391). Publie en recueil en
1870, luvre littraire du peintre belge est
pourtant trs facilement accessible la
Bibliothque nationale, o Benjamin lui-
mme la consulta.
71. Ibid., p. 616-617.
72. Ibid., p. 618.
73. Cf. ATGET, p. 18.
74. MOHOLY-NAGY (1928), p. 5 (cit dans la
traduction de Catherine Wermester, p. 195).
Benjamin avait dj cit ds 1928 la cl-
brissime formule du professeur du Bauhaus,
dans son article sur Blossfeldt (Neues von
Blumen, p. 151).
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
35
I. Walter Benjamin
a) ditions de la Petite histoire
Kleine Geschichte der Photographie, Die
Literarische Welt, 7
e
anne, n38, 18 septembre,
p. 3-4 ; n 39, 25 septembre, p. 3-4 et
n 40, 2 octobre 1931, p. 7-8 [premire
dition du texte, qui a servi ici de rfrence pour la
traduction].
Kleine Geschichte der Photographie,
Gesammelte Schriften (d. Rolf Tiedemann,
Hermann Schweppenhuser et al.), Franc-
fort/Main, Suhrkamp, 1982, t. II, vol. 1,
p. 368-385 ; notes : vol. 3, p. 1130-1143
[dition allemande de rfrence, qui comporte une di-
tion critique, malheureusement lacunaire et parfois
fautive].
Petite histoire de la photographie,
Essais 1 (1922-1934) traduction franaise par
Maurice de Gandillac, Paris, Denol-Gon-
thier, 1983, p. 149-168 [rdition de la premire
traduction franaise, parue en 1971, souvent brillante,
mais qui comporte de nombreuses erreurs et ne corres-
pondait plus aux exigences actuelles de ltablissement
dun texte].
b) Autres textes de W. B.
sur la photographie
Die Photographie von der Kehrseite (tra-
duction allemande par W. B. de larticle de
Tristan Tzara, La photographie lenvers,
cf. ci-dessous, II, b), G- Zeitschrift fr Elementare Ges-
taltung, 1924, n 3, p. 29-30.
Nichts gegen die Illustrierte [1925], GS,
t. IV, vol. 1-2, p. 448-449.
Neues von Blumen [Die Literarische Welt,
1928], GS, t. III, p. 151-153, traduction fran-
aise par Christophe Jouanlanne, Du nou-
veau sur les eurs, in W. B., Sur lart et la pho-
tographie, Paris, Carr, 1997, p. 69-73.
Pariser Tagebuch (4. Feb.) [Die Literarische
Welt, 1930], GS, t. IV, vol. 1-2, p. 580-582.
Surrealistische Zeitschriften [Die Literari-
sche Welt, 1930], GS, t. IV, vol. 1-2, p. 595-596.
Die Mummerehlen [1932], Berliner Kind-
heit um Neunzehnhundert, GS, t. IV, vol. 1,
p. 260-263; traduction franaise par Jean
Lacoste, La commerelle, Sens unique prcd
de Enfance berlinoise, Paris, Maurice
Nadeau, 1988 (2
e
d. revue), p. 67-71.
Ein Kinderbild, Franz Kafka. Zur zehnten
Wiederkehr seines Todestages [1934], GS, t. II,
vol. 2, p. 416-425.
Daguerre oder die Panoramen [1935],
Das Passagen-Werk, GS, t. V, vol. 1, p. 48-49;
traduction franaise par Jean Lacoste,
Daguerre ou les panoramas, Paris, capitale du
XIX
e
sicle, Paris, Cerf, 1993, p. 37-38.
Pariser Brief II. Malerei und Photographie
[Die Literarische Welt, 1936], GS, t. III,
p. 495-507; traduction franaise par Marc B.
de Launay, Peinture et photographie,
Les Cahiers dart du Centre Georges Pompidou, n 1,
1979, p. 40-45.
Gisle Freund. La Photographie en France
au dix-neuvime sicle [Die Literarische Welt,
1936], GS, t. III, p. 542-544.
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner tech-
nischen Reproduzierbarkeit [1936], GS,
t. I, vol. 2, p. 431-508; traduction franaise
par Pierre Klossowski, Luvre dart lpo-
que de sa reproduction mcanise [1936],
crits franais (d. J.-M. Monnoyer), Paris,
Gallimard, 1991, p. 140-171; par Maurice de
Gandillac, Luvre dart lre de sa repro-
ductibilit technique [1971], Essais 2(op. cit.),
p. 87-126 ; par Christophe Jouanlanne,
Luvre dart lpoque de sa reproductibi-
lit technique, in W. B., Sur lart et la photogra-
phie, op. cit., p. 17-68.
Y. [Die Photographie] [v. 1928-v. 1937],
Das Passagen-Werk, GS, t. V, vol. 2, p. 824-846;
36
t udes phot ographi ques, 1
BIBLIOGRAPHIE
Pet i t e hi st oi r e de l a phot ographi e
37
traduction franaise par Jean Lacoste, Y. [La
photographie], Paris, capitale du XIX
e
sicle,
Paris, Cerf, 1993, p. 685-703.
ber einige Motive bei Baudelaire (XI)
[1939], GS, t. I, vol. 2, p. 644-650; traduc-
tion franaise par Maurice de Gandillac,
revue par Jean Lacoste, Sur quelques thmes
baudelairiens (XI), Charles Baudelaire. Un
pote lyrique lapoge du capitalisme, Paris, Payot,
s. d. [1982], p. 196-205.
Quelques autres mentions apparaissent et l
dans luvre de Benjamin propos de photographie
mais, en lespce, son travail de loin le plus important
reste la Petite histoire. Nombre de textes postrieurs
(en particulier Luvre dart) ne font que reprendre
ses principaux dveloppements.
II. Sources cites par W. B.
a) Sources historiques
Franois ARAGO, Le Daguerrotype,
uvres compltes (d. J.-A. Barral), t. VII, 1858,
p. 455-517.
Charles BAUDELAIRE, Salon de 1859, uvres
compltes, t. II (d. Cl. Pichois), Paris, Galli-
mard, 1976, p. 608-682.
Stefan GEORGE, Standbilder. Das Sechste
[1898], Smtliche Werke, t. V, Stuttgart, Klett-
Cotta, 1984, p. 58.
Johann Wolfgang von GOETHE, Maximen
und Reflexionen (509), Werke (d. W.
Weber, H. J. Schrimpf et al.), Munich, Beck,
1973 (7
e
d.), vol. 12, p. 435.
Antoine WIERTZ, La Photographie
[1855], uvres littraires, Paris, Librairie
internationale, 1870, p. 309-310.
b) Sources contemporaines
Eugne ATGET, Lichtbilder (intr. Camille
Recht), Paris, Leipzig, d. Jonquires, 1930.
Karl BLOSSFELDT, Urformen der Kunst (intr.
Karl Nierendorf) [1928], Dortmund,
Harenberg, 1995 (12
e
d.).
Helmuth BOSSERT, Heinrich GUTTMANN,
Aus der Frhzeit der Photographie. 1840-1870,
Francfort/Main, Societts-Verlag, 1930.
Bertolt BRECHT, Der Dreigroschenprozess.
Ein soziologisches Experiment [1930], Werke
(d. W. Hecht), Francfort/Main, Suhrkamp,
1992, t. XXI,p. 448-469.
Max DAUTHENDEY, Der Geist meines Vaters
[1912], Munich, Langen, 1925.
Siegfried KRACAUER, Die Photographie
[1927], Aufstze, t. II, Francfort/Main, Suhr-
kamp, 1992, p. 83-98; traduction franaise
par Susanne Marten et Jean-Claude Mouton,
La Photographie, Revue desthtique, n 25,
1994, p. 189-199.
Fritz MATTHIES-MASUREN, Knstlerische
Photographie (intr. Alfred Lichtwark), Berlin,
Marquardt, 1907.
Lszl MOHOLY-NAGY, Malerei Photographie
Film, Munich, Langen, 1925 [traduction fran-
aise de l dition de 1927 par C.
Wermester, J. Kempf et G. Dallez, Peinture
Photographie Film, Nmes, d. Jacqueline
Chambon, 1993].
Lszl MOHOLY-NAGY, Fotografie ist
Lichtgestaltung, Bauhaus, vol. II, n 1, jan-
vier 1928, p. 2-9 [traduction franaise par C.
Wermester, Photographie, mise en forme de
la lumire, inLszl Moholy-Nagy. Compositions
lumineuses, 1922-1943, Paris, Centre Georges
Pompidou, 1995, p. 193-197].
Emil ORLIK, ber Photographie, Kleine
Aufstze, Berlin, Propylen, 1924, p. 32-42.
Albert RENGER-PATZSCH, Die Welt ist schn
(d. C. G. Heise), Munich, Kurt Wolff, 1928.
August SANDER, Antlitz der Zeit (intr.
Alfred Dblin) [1929], Munich, Paris,
Schirmer/Mosel, 1990 [traduction franaise
par L. Marcou, Visage dune poque, mme d.].
Heinrich SCHWARZ, David Octavius Hill
(1802-1870). Der Meister der Photographie,
Leipzig, Insel V., 1931.
Sasha STONE, Photo-Kunstgewebereien,
Das Kunstblatt, vol. 12, 1928, p. 86-87.
Tristan TZARA, La photographie lenvers
[prface de lalbum de Man Ray, Les Champs
dlicieux, 1922], uvres compltes (d. Henri
Bhar), Paris, Flammarion, 1975, t. 1, p. 415-
417.
c) Sources consultes aprs la
publication de la Petite histoire
Eugne DISDRI, Manuel opratoire de photo-
graphie sur collodion instantan, Paris, A. Gaudin,
1853.
Louis FIGUIER, La Photographie au Salon de
1859, Paris, Hachette, 1860.
Gisle FREUND, Entwicklung der Photographie
in Frankreich et La Photographie au point de vue
sociologique, manuscrits, 1935.
Gisle FREUND, La Photographie en France au
XIX
e
sicle, Paris, Maison des Amis du livre,
1936.
NADAR (Flix TOURNACHON, dit), Quand
jtais photographe, Paris, Flammarion, 1900.
Camille RECHT (dir.), Die alte Photographie,
Paris, Leipzig, d. Jonquires, 1931.
Wolfgang SCHADE (d.), Historische Pho-
tos aus den Jahren 1840-1900, Europische
Dokumente, t. XIV, 1934.
III. tudes (slection)
a) tudes biographiques
Momme BRODERSEN, Spinne im eigenen Netz.
Walter Benjamins Leben und Werk, Bhl-Moos,
Elster V., 1990.
Ingrid & Konrad SCHEURMANN (dir.), Fr
Walter Benjamin, Francfort/Main, Suhrkamp,
1992.
Bernd WITTE, Walter Benjamin, une biographie
(trad. de lallemand par A. Bernold), Paris, d.
du Cerf, 1988.
b) W. B. et la photographie
Hubertus von AMELUNXEN, Dun tat
mlancolique en photographie. Walter
Benjamin et la conception de lallgorie
(trad. de lallemand par V. Meyer), Revue des
sciences humaines, t. LXXXI, n 210, avril-juin
1988, p. 9-23.
Alain BUISINE, Aura et halo, Eugne Atget ou
la mlancolie en photographie, Nmes, d.
Jacqueline Chambon, 1994, p. 115-122.
Andr GUNTHERT, Le temps retrouv.
Walter Benjamin et la photographie, in coll.
Jardins dhiver. Littrature et photographie, Paris,
Presses de lcole normale suprieure, 1997,
p. 43-54.
Philippe IVERNEL, Passages de frontires :
circulations de limage pique et dialectique
chez Brecht et Benjamin, Hors-Cadre, n 6,
1987, p. 139-140.
Catherine PERRET, La beaut dans le
rtroviseur, La Recherche photographique, n 16,
printemps 1994, p. 74-78.
Rainer ROCHLITZ, Walter Benjamin et la
photographie. Exprience et reproducti-
bilit technique, Critique, n 459-460, aot-
septembre 1985, p. 803-811.
Rainer ROCHLITZ, Destruction de laura:
photographie et lm, Le Dsenchantement de
lart. La philosophie de Walter Benjamin, Paris,
Gallimard, 1992, p. 174-194.
38
t udes phot ographi ques, 1
Vous aimerez peut-être aussi
- Cahiers Du Cinéma Vol. 37Document68 pagesCahiers Du Cinéma Vol. 37Gabriel Escobar100% (1)
- Les Enjeux Du Regard 01: Education À L'image, Pour Quoi Faire?Document41 pagesLes Enjeux Du Regard 01: Education À L'image, Pour Quoi Faire?PériphériePas encore d'évaluation
- Butor, Michel - Improvisations Sur FlaubertDocument184 pagesButor, Michel - Improvisations Sur FlaubertLarisa Elena TimoftePas encore d'évaluation
- LArt Du Portrait Conceptuel. Deleuze Et PDFDocument10 pagesLArt Du Portrait Conceptuel. Deleuze Et PDFslim tobePas encore d'évaluation
- Rohmer 2004 Le Goût de La BeautéDocument315 pagesRohmer 2004 Le Goût de La BeautéVinicius Noronha100% (1)
- Abdelkebir Khatibi - La Mémoire Tatouée - Autobiographie D'un Décolonisé-Denoël (1971)Document194 pagesAbdelkebir Khatibi - La Mémoire Tatouée - Autobiographie D'un Décolonisé-Denoël (1971)Kuru ReyPas encore d'évaluation
- Esthétique Du Mouvement CinématographiqueDocument74 pagesEsthétique Du Mouvement CinématographiqueAlessandra Francesca100% (1)
- 1-La Photographie PDFDocument96 pages1-La Photographie PDFMo MezghaniPas encore d'évaluation
- Un Exemple de Note Calcul (Robot)Document9 pagesUn Exemple de Note Calcul (Robot)ikramPas encore d'évaluation
- Benjamin - L'Oeuvre D'art À L'époque de Sa Reproductibilité TechniqueDocument50 pagesBenjamin - L'Oeuvre D'art À L'époque de Sa Reproductibilité TechniquekairoticPas encore d'évaluation
- LE JEU EN CLASSE DE FLE: Intérêts Et PratiquesDocument5 pagesLE JEU EN CLASSE DE FLE: Intérêts Et Pratiquesmaría fernandaPas encore d'évaluation
- Rapport-BattasOuhsaine PFEDocument110 pagesRapport-BattasOuhsaine PFEamine67% (3)
- Dubuffet Jean Asphyxiante Culture Ed AugmenteeDocument120 pagesDubuffet Jean Asphyxiante Culture Ed Augmenteewawaou412Pas encore d'évaluation
- Guide D'entretien D'embaucheDocument7 pagesGuide D'entretien D'embauchebasma88100% (2)
- L'image-Fente Ou L'inconscient de L'index - ParergonDocument32 pagesL'image-Fente Ou L'inconscient de L'index - ParergonAline Soares LimaPas encore d'évaluation
- Hajji PDFDocument51 pagesHajji PDFMazoz AyoubPas encore d'évaluation
- Baudelaire Le Salon de 1859Document50 pagesBaudelaire Le Salon de 1859Anonymous Vh6KTNceos100% (1)
- Aline Mura-Brunel - Silences Du Roman - Balzac Et Le Romanesque Contemporain (Faux Titre 252) (2004) PDFDocument328 pagesAline Mura-Brunel - Silences Du Roman - Balzac Et Le Romanesque Contemporain (Faux Titre 252) (2004) PDFDhafer OuazPas encore d'évaluation
- Figurations Des Marges Dans La Poésie D'andré Du BouchetDocument11 pagesFigurations Des Marges Dans La Poésie D'andré Du BouchetCANDELA SALGADO IVANICH100% (1)
- CarloGinzburg Traces 1979-2Document52 pagesCarloGinzburg Traces 1979-2RoRoPas encore d'évaluation
- Le Salon de 1845Document42 pagesLe Salon de 1845Florina OchiuzPas encore d'évaluation
- Mandrou - Histoire Et Cinéma (Annales, 1958)Document11 pagesMandrou - Histoire Et Cinéma (Annales, 1958)custionesPas encore d'évaluation
- Sur Benjamin - Esthétique PDFDocument9 pagesSur Benjamin - Esthétique PDFSenda Sferco100% (1)
- BAECQUEDocument39 pagesBAECQUEDascopFivePas encore d'évaluation
- Metz - Cinema Langue Ou LangageDocument40 pagesMetz - Cinema Langue Ou Langagedaricomp100% (1)
- Littérature Et CinémaDocument22 pagesLittérature Et Cinémasalimoh100% (1)
- Heidegger - de L'origine de L'oeuvre D'artDocument61 pagesHeidegger - de L'origine de L'oeuvre D'artGist Jon100% (1)
- Zazie dans le métro de Raymond Queneau (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandZazie dans le métro de Raymond Queneau (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Politiques Culturelles en FranceDocument221 pagesPolitiques Culturelles en FranceCelso BarbinPas encore d'évaluation
- Agamben Aby Warburg Et La Science Sans NomDocument14 pagesAgamben Aby Warburg Et La Science Sans NomjosefinaPas encore d'évaluation
- Lascaux Ou La Naissance de L'artDocument30 pagesLascaux Ou La Naissance de L'artTuğba ŞanlıPas encore d'évaluation
- Walter BENJAMIN L'oeuvre D'art À L'époque de Sa Reproductibilité TechniqueDocument47 pagesWalter BENJAMIN L'oeuvre D'art À L'époque de Sa Reproductibilité TechniqueJohn Malvoy100% (4)
- Walter Benjamin Petite Histoire de La PhotographieDocument17 pagesWalter Benjamin Petite Histoire de La PhotographiePatricia Ciriani EspejoPas encore d'évaluation
- Sartre Et La PhotographieDocument20 pagesSartre Et La PhotographieJamaa Ouarezzamen100% (1)
- Nef Des FousDocument205 pagesNef Des Fousdavid balibal100% (1)
- Présence Du CinémaDocument68 pagesPrésence Du CinémaLeticia WeberPas encore d'évaluation
- Lyotard - Questions Au CinemaDocument31 pagesLyotard - Questions Au CinemaZioraneskoPas encore d'évaluation
- Art Press Images Malgre ToutDocument3 pagesArt Press Images Malgre ToutjaviercanoramosPas encore d'évaluation
- Maison Cinema Et Le MondeDocument22 pagesMaison Cinema Et Le MondeMario ValeroPas encore d'évaluation
- Gilles Deleuze L'Image-mouvement (Cours)Document46 pagesGilles Deleuze L'Image-mouvement (Cours)tavosiPas encore d'évaluation
- Esthetique de La Vie OrdinaireDocument269 pagesEsthetique de La Vie OrdinaireNadjaPas encore d'évaluation
- Anal Litt 2 Le Texte DescriptifDocument15 pagesAnal Litt 2 Le Texte DescriptifIdir MazighPas encore d'évaluation
- Dominique Baque La Photographie PlasticienneDocument166 pagesDominique Baque La Photographie PlasticiennePeter Giovanni Melo FlórezPas encore d'évaluation
- La Vie Et L'habitude - Butler, Samuel PDFDocument304 pagesLa Vie Et L'habitude - Butler, Samuel PDFJulius1982Pas encore d'évaluation
- Étude de L'image Au Collège Et Au LycéeDocument16 pagesÉtude de L'image Au Collège Et Au LycéeRaluca DatcuPas encore d'évaluation
- Anthologie Negre Petits Contes Negres Pour Les Enfants Des Blancs PDFDocument22 pagesAnthologie Negre Petits Contes Negres Pour Les Enfants Des Blancs PDFKouassi Joachim KOFFIPas encore d'évaluation
- Antonio Casilli Cultures Du NumériqueDocument193 pagesAntonio Casilli Cultures Du NumériquegastonPas encore d'évaluation
- Actes Du Colloque de La Photographie Au Cinéma Quelle Passerelles (13-14-2004)Document59 pagesActes Du Colloque de La Photographie Au Cinéma Quelle Passerelles (13-14-2004)Jack ShepherdPas encore d'évaluation
- T.Adorno - L'art Et Les Arts (1967)Document11 pagesT.Adorno - L'art Et Les Arts (1967)krouglik100% (2)
- Ontologie de L'image PhotographiqueDocument4 pagesOntologie de L'image Photographiquedestroyallmonsters100% (1)
- L'art du nu au XIXe siècle. Le photographe et son modèle (Paris - 1998): Les Fiches Exposition d'UniversalisD'EverandL'art du nu au XIXe siècle. Le photographe et son modèle (Paris - 1998): Les Fiches Exposition d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La Littérature à l'ère de la photographie de Philippe Ortel: Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandLa Littérature à l'ère de la photographie de Philippe Ortel: Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Michel Foucault. La Peinture de Manet. Conférence À Tunis, Le 20 Mai 1971. Résumé Avec Illustrations.Document17 pagesMichel Foucault. La Peinture de Manet. Conférence À Tunis, Le 20 Mai 1971. Résumé Avec Illustrations.Veronikaoltre100% (1)
- BECKER - PhotographieDocument11 pagesBECKER - PhotographieAndreaPas encore d'évaluation
- BazinDocument13 pagesBazinCezar GheorghePas encore d'évaluation
- L'interprétation DétournéeDocument24 pagesL'interprétation Détournéesrodolfo100% (3)
- Sur Les Traces de Rosalind KraussDocument12 pagesSur Les Traces de Rosalind KrausseurostijlPas encore d'évaluation
- Jean-Marie Gleize, Poésie Et FigurationDocument3 pagesJean-Marie Gleize, Poésie Et FigurationXaverius MoralesPas encore d'évaluation
- Cinéma Des 3 ContinentsDocument45 pagesCinéma Des 3 ContinentsVideale.Pas encore d'évaluation
- Didi-Huberman, G., Le Lieu Malgré ToutDocument10 pagesDidi-Huberman, G., Le Lieu Malgré ToutDàidalosPas encore d'évaluation
- Emmanuel Barot-Camera Politica. Dialectique Du Réalisme Dans Le Cinéma Politique Et Militant - Vrin (2009)Document127 pagesEmmanuel Barot-Camera Politica. Dialectique Du Réalisme Dans Le Cinéma Politique Et Militant - Vrin (2009)Gastón GRPas encore d'évaluation
- Gascar Et L'écriture de La NatureDocument76 pagesGascar Et L'écriture de La NaturesofidavilaPas encore d'évaluation
- Alexandrescu Sori La Philosophie Des Images Aujourdhui PDFDocument25 pagesAlexandrescu Sori La Philosophie Des Images Aujourdhui PDFsombrapuraPas encore d'évaluation
- Quelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustD'EverandQuelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustPas encore d'évaluation
- Operator Manualofr44940a1 - GP39Document98 pagesOperator Manualofr44940a1 - GP39jamsPas encore d'évaluation
- DS Entrepreneuriat Mars 2020Document4 pagesDS Entrepreneuriat Mars 2020wiwiazPas encore d'évaluation
- Conception Et Realisation Du T - LEFAF Adil - 2899 PDFDocument62 pagesConception Et Realisation Du T - LEFAF Adil - 2899 PDFAbdou KarimPas encore d'évaluation
- L Interet de La Maitrise Des Processus Pour La Gestion Des EntrepotsDocument40 pagesL Interet de La Maitrise Des Processus Pour La Gestion Des EntrepotsFatima-zahra Damouh100% (2)
- ACO DESIGN - Communication Sur Les Pointeuses - Compte RenduDocument5 pagesACO DESIGN - Communication Sur Les Pointeuses - Compte RenduAnnie Prisca MANGUIYAPas encore d'évaluation
- La Dedipix Chez Les AdolescentsDocument6 pagesLa Dedipix Chez Les AdolescentsPAMPas encore d'évaluation
- Micromoteur CrouzetDocument164 pagesMicromoteur Crouzeteric_lalique8480Pas encore d'évaluation
- Catalogo Rosagres TAODocument16 pagesCatalogo Rosagres TAOAlejandro De La PeñaPas encore d'évaluation
- ST 160091Document138 pagesST 160091MustaphaPas encore d'évaluation
- Cycle Moyen1AMDocument4 pagesCycle Moyen1AMSoraia DjdPas encore d'évaluation
- Conception Du Portail WebDocument17 pagesConception Du Portail WebMontasser TaktakPas encore d'évaluation
- Chapitre 7 Les Études QuantitativesDocument12 pagesChapitre 7 Les Études QuantitativesJeanne Lauriane DIAVOU KOMBLAPas encore d'évaluation
- DR Garry Miller Le Coran Sublime Omar MAZRI 18 Juillet 2012 Cora PDFDocument15 pagesDR Garry Miller Le Coran Sublime Omar MAZRI 18 Juillet 2012 Cora PDFNamsaknoi7Pas encore d'évaluation
- La Méthode Des SimplexesDocument7 pagesLa Méthode Des SimplexesfaouziiiPas encore d'évaluation
- FR Wikipedia Org Wiki Syst C3 A8me D Information PDFDocument13 pagesFR Wikipedia Org Wiki Syst C3 A8me D Information PDFavengers2014Pas encore d'évaluation
- Examen 09 10Document5 pagesExamen 09 10ridhajamelPas encore d'évaluation
- Iwear VR920, Manuel de L'utilisateur (FR)Document19 pagesIwear VR920, Manuel de L'utilisateur (FR)mmaarrbbooPas encore d'évaluation
- Solidaire - Brochure PrésentationDocument16 pagesSolidaire - Brochure PrésentationSante_SociauxPas encore d'évaluation
- TP ServletDocument14 pagesTP ServletOns AttiaPas encore d'évaluation
- Acro2 PDFDocument12 pagesAcro2 PDFSmail Ben HamedPas encore d'évaluation