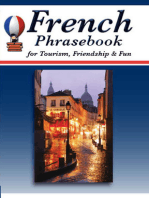Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Reussir Le DELF Niveau B2
Reussir Le DELF Niveau B2
Transféré par
Magda MironCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Reussir Le DELF Niveau B2
Reussir Le DELF Niveau B2
Transféré par
Magda MironDroits d'auteur :
Formats disponibles
Centre i nternati onal d' 6tudes pedagogi ques
"/*v
{*BXtil
\,/
R$mmm*r *m
du Cadre europ6en commun de ref6rence
ETTIGfI
Cent r e i nt er nat i onal d' et udes pddagogi ques
Commi ssi on nat i onal e du DELF et du DALF
R6ussir le
./\
{cqBXtF
\-./'
lf
du Cadre europ6en commun de r6f6rence
B6atri ce Dupoux
Anne-Marie Hnvano
Mayl i s MRrRI
Mathi eu Wrecrn
r.ftlkfl
Illustrations
Dom. f ouenne : pages
David Scrirna : pages
9 , 3 5 , 7 7 , 1 0 5 e t 1 2 1
28, 729 er I 56.
recherchd en vain les auteurs ou les avants droits de certains documents reproduits dans ce livre
sont rcserves aux Edi t i ons Di di . ' r.
Nous avons
Leurs droits
Concepti on graphi que
Concepti on graphi que
\ l i se en pages: Ni col e
couverture : Michele Bisgambiglia
i nteri eur: Isabel l e Aubours
Pel l i eux
'
l - r ' phot ocopi l l age, c' est l ' usage abusi f et col l ect i f de l a phot ocopi e sans aut or i sat i on des aut eur s
Lar gement r epandu dans l es 6t abl i ssement s d' ensei gnement , l e phot ocopi l l age
menace l , aveni r du
cn danger son equi l i br e economi que. I l pr i ve l es aut eur s d' une
t ust e
r emun6r at i on. En dehor s de
cr r pl st e' t out e r epr oduct i on t ot al e ou par t i el l e
de cet ouvr age est i nt er di t e. ,
La l oi du 11 mar s 1957 n' aut or i sant J aux t er mes des al i n6as 2 et 3 de l ' ar t i cl e 41, d' une par t , que l es copi es ou
r cpr oduct i ons st r i ct ement r eser v6es a I ' usage pr i ve du copi st e et non dest i nees a une ut i l i sat i on col l ect i ve D
et , d, aut r e
part. que l es anal vses et courtes ci tati ons dans un but d' exempl e et d' i l l ustri ti ons, u
toute represenrarl on ou
rcLrroducti on i ntegral e, ou parti el l e, fai te sans l e consentement de I' auteur ou de ses avants droi ts 6u avants cause,
e, \ t i l i i ci t e. ' ( al i nea 1. ' , de l ' ar t i cl e. l 0)
-
r Cet t e r epr 6sent at i on ou r epr oduct i on par quel que pr ocede que ce soi t ,
c( ) nst i t uer ai t donc une cont r ef agon sanct i onn6e par l es ar t i cl es
' t r 25
et sui vant s du Code
penal . ,
et des 6di t eur s.
l i v r e . " . i l - ^ .
I ' usage pr i ve du
t
Les Edi t i ons Di di er. i anvi er 2006
I SBN 978-2-27 8-057 51-2 In-rprime en France
SOMMAIRE
Preface
Avant-propos
Le Cadre europben conTmun de riferetrce pour
les langues
Presentation de I'epreuve DELF 82
DELF 82: nature des eoreuves
4
5
6
7
8
Cornpr6hension de I'oral
Pr6sentation
Pourvousentrai ner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vers I'epreuve
Exemple d'6preuve
Auto-evaluation
Cornpr6hension des 6crits
Presentation
Pour vous entrainer
Vers l'epreuve
Exempl e d' 6preuve
Auto-evaluation
Savoir argurnenter: Production 6crite et orale
Pour vous entralner 72
Auto-6r'aluation 98
Les articulateurs logiques du discours 99
L' expressi on d' une opi ni on 100
Producti on 6cri te 105
Presentati on
s
1 0
1 2
a 1
32
34
35
36
37
60
65
69
7 l
Pour vous entra
Vers I'epreurte
Auto-eval uati on i 19
Producti on oral e l 2I
Prei sentati on I22
Pour vous entrainer 123
Auto-eval uati on 132
La gestion du ternps et du stress 133
Sujet d'exarnen DELF 82
tner
1 0 6
1 0 7
1 1 ' 7
Gri i l e d' dval uati on: producti on 6cri te
-
producti on oral e
Transcriptions
Corri ges
r34
t42
t 44
t 5 4
PREFACE
Le DEI-R Di pl 6me d' etudes en l angue frangai se, et l e DALR Di pl dme approfondi de l angue
frangai se, sont l es certi fi cati ons offi ci el l es du mi ni stere frangai s de I' Educati on nati onal e en
ti angai s l angue 6trangdre. Depui s l eur cr6ati on en 1985, pres de 3000000 de candi dats se sont
presentes d ces 6preuves organi s6es dans l 5rl pays.
Ce succds s' expl i que en parti e par l ' 6mergence d' une soci 6te de l a mobi l i te, pl us exi geante en
terme de formati on. Vous tes nombreux d apprendre des l angues 6trangdres et i e frangai s en
parti cul i er et nous vous en fel i ci tons, nous qui
(ruvrons
pour i a constructi on d' un monde
pl uri l i ngue.
Le DELtr et l e DALF ont aussi construi t l eur succds sur des qual i tes qui font l eur force:
refl exi on pedagogi que, perti nence de l ' 6val uati on et qual i t6 du di sposi ti f. Leur harmoni sati on
sur le Cadre europien contntutT de riference pour les langues et la cr6ation de 6 dipl6mes correspon-
dant aux 6 ni veaux du Cadre s' i nscri vent dans cette dvnami oue.
La Commi ssi on nati onal e du DELF et du DALF est associ ee de l ongue date aux Edi ti ons
Di di er dans l a concepti on d' ouvrages d' entrai nerrent aux certi fi cati ons offi ci el l es franqai ses
(DELF-DALF et TCF), et
j e
sui s sure que cette col l ecti on ai dera l es candi dats qui souhai tent
val i der l eurs competences en frangai s a bi en se pr6parer a ces 6preuves. El l e consti tue aussi un
outi l de r6fri rence pour l eurs ensei gnants.
t , es DELF A1, A2, 81, 82 et l es DALF Cl et C2 ouvrent ai nsi de nouvel l es perspect i ves)
i nternati onal es pour l es candi dats, et pedagogi ques pour l es ensei gnants. On ne peut que s' en
rei oui r.
Christine TacI-raxrg
Responsabl e du Pol e Eval uati on et Certi fi cati ons
CIEP
AVANT:PROPOS
(.ct
(\uvrage
s' adresse aussi bi en aux apprenants de frangai s l angue 6trangdre adul tes et
ai , r l cscent s, apr ds 650 d 700 heur es d' appr ent i ssage, qu' a l eur s ensei gnant s. Ces der ni er s
prrurtoot 1' uti l i ser ponctuel l ement
en compl ement du manuel de cl asse ou de faeon sui vi e dans
.c cadre d' une sessi on de preparati on a I' examen. Les candi dats l i bres y trouveront I' ai de
r r cccssai r e pour se pr 6par er ef f i cacement aux examens. I l const i t ue donc un out i l
i ' cnrrai nement aux di fferentes epreuves du di pl 6me DELF 82.
l - ' r r uvr sge se compose de ci nq par t i es :
Jcur par t i es cor r espondant aux deux act i vi t es de r ecept i on : C) t t nt pt ' , : l t t t t si ot t . / ; / ' t r r i r 1,
(
..,n t prc ltensiott des ecrits
;
unc parti e preparatoi re aux acti vi t6s de producti on (Saz' oi r
arguntenter);
.i cux parti es correspondant aux comp6tences speci fi ques de Ia Prodtrcti on i cri te et de l a
I)ro.l t t c r t ttt t orale.
.\u tl l de l ' ou' u' rage, des remarques et consei l s accompagnent I' apprenant dans l a d6marche a
.urvrc
,cadres
gri ses), et di verses acti vi tes desti nees a enri chi r l e l exi que et d di versi fi er l es
i , . r mul at i ons sont pr oposees.
.\ l ' i nteri eur de chaque parti e sont d6cl i nees des batteri es d' exerci ces qui , progressi vementJ
Jntcnent l ' apprenant de l a d6couverte d l a mai tri se des savoi r-fai re et des tdches
qu' un
candi dat
ru DELF 82 doi t tre caoabl e de real i ser.
Dans l e-s pages Pouraous entvatnerrl ' apprenant trouvera des acti vi tes qui l ui permettronr de
.(\n,strui re et de devel opper l es comp6tences attendues pour r6ussi r l ' 6preuve.
I-cs exempl es gui d6s et l es ensembl es d' exerci ces proches de l a si tuati on d' examen de l a parti e
\crs I' epreuven I' ai deront ensui te d systemati ser l es savoi r-fai re exi ges par l ' epreuve.
.\ l a ttn de chaque parti e, l ' apprenant pourra fai re l e poi nt sur ses capaci tes d r6al i ser l es tAches
Jcmandees dans l a comp6tence donn6e, grAce i un tabl eau d' auto-6val uati on.
Entl n. un suj et type reuni ssant l es quatre comp6tences l ui permettra de se l i vrer A l ' exerci ce tel
. 1u' i l ser a pr esent e l e
j our
de i ' examen.
^\ l a fi n de I' ouvrage sont propos6s l es transcri pti ons des enregi strements sonores ai nsi que l es
corri g6s des exerci ces.
Lps,q.urEuBs
LE CADRE EUROPEEN COMMUN
DE REFERENCE POUR LES LANGUES
En 1991, l es experts de l a Di vi si on des pol i ti ques l i ngui sti ques du Consei l de I' Europe ont
deci de de l a crdati on d' un outi l prati que permettant:
. d' etabl i r cl ai rement l es el ements communs a attei ndre l ors des 6tapes de l ' apprenti ssage;
. de rendre l es 6val uati ons comparabl es d' une l angue d I' autre.
De cette reflexion est n6.le Cadre eLtropteTt cotnmun de rifdrence pour les langues: apprendre, ensei-
gner, i aal uer, publ i e aux E,di ti ons Di di er en 2001.
Le Cadre defi ni t si x ni veaux de cornp6tence en l angue, quel l e que soi t l a l angue. Il est de
pl us en pl us uti l i s6 pour l a r6forme des programmes nati onaux de l angues vi vantes et pour l a
comparai son des certi fi cats en l angues. Auj ourd' hui , I' i mpact du Cadre, tradui t et di ffuse en di x-
hui t l angues, depasse de l oi n l es fronti eres de l ' Europe.
I-c Consei l de I' IJni on europeenne
(Resol uti on de novembre 2001) recommande son uti l i sa-
rron. faci l i tant ai nsi l a mobi l i te 6ducati ve et professi onnel l e.
Si tue dans l a conti nui te des approches communi cati ves, ce texte de r6f6rence, non prescri pti f,
propose de nouvel l es pi stes de r6fl exi on comme l a pri se en compte des savoi rs anteri eurs du
suj et, l a pri maut6 a l a competence pragmati que et l a defense d' une comp6tence pl uri l i ngue et
pl uri cul turel l e.
Parce qu' i l adhere aux recommandati ons du Consei l de l ' Europe, l e mi ni stdre de I' Educati on
nari onal e frangai s a demande a l a Commi ssi on nati onal e du DELF et du DALF d' harmoni ser
ses certi fi cati ons sur l es si x ni veaux de competence en l angue du Cadre europ1en cornmun de
rifirence pour les langttes. Une r6forme du DELF et du DALF a donc ete realisee et six diplomes
ont ete mi s en pl ace en 2005, correspondant d chacun des si x ni veaux duCadre eLtrop1eni
DELF A1
DELF- .A2
DELF 81
DELF' 82
DALtr C I
DALF C2
ni veau A1
niveau .A2
niveau B 1
ni veau 82
niveau C I
ni veau C2
6
PRESENTATION DE L'EPREUVE
DELF 82
Aprcs avoi r l entement mai s strrement progress6 sur l e pl ateau i ntermedi ai re, I' apprenant de
nl vcau 82 decouvre qu' i l est arri v6 <,quel que part)), qu' i l voi t l es choses di fferemment et qu' i l a
a.qul : une nouvel l e perspecti ve.
l l a acqui s un degr6 d' i nd6pendance qui l ui permet d' argumenter pour defendre son opi ni on,
devcl opper son poi nt de vue et negoci er .
Dan. l e di scours soci al , son i nterventi on n' est pl us pergue comme source possi bl e de tensi ons.
nr Je :a part, ni pour ses i nterl ocuteurs.
I l cst capabl e :
Jc parl er avec naturel , ai sance et effi caci te;
l c
gr r r r t pr cndr e
dans l e det ai l ce qu' on l ui di t dans une l angue \ t anJt r d:
Jc pr endr e I ' i ni t i at i ve de l a par ol e, meme si cel a n' est pas t ouj our s f ai t avec el egance;
J' uti l i ser des phrases toutes fai tes (par exempl e: r, C' est une questi on di ffi ci l e.
,r)
pour gagner
du t emps.
Fl n ,' utrc. i l a acqui s un nouveau degr6 de consci ence de l a l angue, qui l ui permet de corri ger
i ur-mcrne l es erreurs qui ont debouche sur des mal entendus, de prendre note des
ufautes
Frcl L' reL-s' ,
et de control er consci emment son di scours pour l es traquer.
l - ' cxamen se di vi se en deux t emps:
.
l -c' epreuves col l ecti ves, d' une duree de 2 heures 30,
. c der oul ent l e m6me
j our ;
au nombr e de t r oi s, el l es se succedent dans I ' or dr e sui vant :
l a compr ehensi on de l ' or al ;
l a compr ehensi on des 6cr i t s;
I a pr oduct i on 6cr i t e.
.
L' epreuve i ndi vi duel l e de producti on oral e, i l aquei l e l e candi dat est convoquti separement, et
.1ur dure envi ron 50 mi nutes (30 mi nutes de pr6parati on et 20 mi nutes de passati on).
Cornpr6hensi on de I' oral (30 mi nutes envi ron)
Lc candi dat doi t repondre a deux questi onnai res de comprehensi on portant sur deux
J(rcuments enregi str6s. IJne seul e 6coute pour l e premi er document, ci eux 6coutes pour l e
:cCt' rod. (Duri e ntaxi ntal e des documents: 8 ni nutes.)
Cornpr6hensi on des 6cri ts (60 mi nutes)
Lc candi dat doi t repondre d des questi onnai res de comprehensi on portant sur deux documents
ccri ts: Lrn texte a caractdre i nformati f concernant l a France ou I' espace francophone; pui s un
l e\te argumentati f.
Producti on 6cri te
(60 mi nutes)
Lc candi dat doi t redi ger une pri se de posi ti on argument6e (contri buti on i un d6bat, l ettre
ti .rmel l e, arti cl e cri ti que, etc.).
Producti on oral e (20 mi nutes envi ron, prec6dees de 30 mi nutes de preparati on):
Lc candi dat doi t defendre un ooi nt de vue d narti r d' un court document d6cl encheur.
: DELF
'
DALF
DIPLOME D'ETUDES E,N LANGUE FRANQAISE
DELF 82
Niveau 82 du Cadre europden co?tlTtturt de rdfdrence pour
les langues
DELF 82
-
nature des 6preuves dur6e note sur
Compr6hensi on de l ' oral
> Reponse a des quest i onnai res de comprehensi on port ant sur deux document s enregi st res,
-
i nt ervi ew, bul l et i n d' i nf ormat i ons, et c.
(une
seul e 6cout e);
-
expose, conf erence. drscours, document ai re, emrssi on de radi o ou t 6l evi see
(2
ecout es)
Dtrree maximdle des douunen.ts: 8 ntin.
30 mi n
environ
t25
Compr6hensi on des 6cri ts
> Reponse a des
quest i onnai res
de comprehensi on
port ant
sur deux document s dcri t s
-
t ext e a caract dre i nf ormat rf concernant l a France ou I ' esoace f rancoDhone:
-
texte argumentati f.
t h t25
Producti on 6cri te
> Pri se de
posi t i on personnel l e
argument ee
(cont ri but i on
a un d6bat l et t re f ormel l e, art i cl e
cri t i que, et c. ),
i h t25
Producti on oral e
> Present at i on et d6f ense d' un ooi nt de vue a oadi r d' un court document decl encheur.
20 mi n
preparatton:
30 min
t25
Dur6e total e des 6preuves col l ecti ves: z h 50
> Note total sur 100.
> Seui l de r6ussi t e pour I ' obt ent i on du di pl 6me: 50/ 100.
> Not e mi ni mal e requi se par 6preuve: 5/ 25.
Cf f i MPRi l ref f i hJ5I ON
rem trffireet
*r,!ll'[,u
> Reponse a des
quest i onnai res de comprehensi on
port ant
sur deux document s enregi st res:
i nt er vi ew, bul l et i n d' i nf or mat i ons. , ,
( une
seul e ecout e) ;
-
expose, conf 6rence, di scours, document ai re, 6mi ssi on de radi o ou t 6l evi s6e
(deux
ecout es)
Dtrie nnxintale des docuntents: 8 ntitt.
COMPREHENSI ON
DE UORAL
l!"
niveau 82 (selon le Cadre europden) z
Je
peux comprendre des conf6rences et des di scours assez l ongs et meme sui vre une
argumentati on compl exe si l e suj et m' en est rel ati vement fami l i er et si l e pl an g6neral
de I' expos6 est i ndi que par des marqueurs expl i ci tes.
Je
peux comprendre l a pl upart des documentai res radi odi ffus6s en l angue standard et
j e
peux i denti fi er correctement I' humeur, l e ton, l e poi nt de vue, etc., du l ocuteur et Ie
contenu i nformati f.
l J6preuve
C' est l a premi dre 6preuve de l ' examen. El l e se compose de deux exerci ces enchai n6s.
. Duree de l ' examen: 30 mi nutes maxi mum. Les temps de l ecture des questi ons,
d' 6coute des documents et de reponse aux questi ons sont fi x6s.
. Note sur 25 poi nts (sur un total de 100 pour l ' 6preuve B2).Le nombre de poi nts
attri bu6s a l ' exerci ce 1 repr6sente envi ron
I/.r
du total .
Exercice 1
Pour l e premi er exerci ce, vous entendrez une seul e foi s un enregi strement sonore de
2 mi nutes envi ron
(extrai t
d' i ntervi ew, bul l eti n d' i nformati ons, publ i ci t6 ou annonce
radi ophoni que).
Le questi onnai re auquel vous devez r6pondre comporte 5 ou 6 questi ons fermees
(i l n' 1' a pas de r6ponse i r redi ger).
Vous pourrez l i re l es questi ons avant d' 6couter I' enregi strement, et preparer votre
6coute. Pui s vous 6couterez l ' enregi strement.Vous aurez ensui te 3 mi nutes pour
repondre aux quest i ons.
Ces questi ons permettront de veri fi er que vous tes capabl e d' i denti fi er et de
caract6ri ser l a nature, l a foncti on, l e thdme pri nci pal de ce documentr de repti rer l es
l ocuteurs, l eur r6l e, l eur poi nt de vue, de rep6rer l es i nformati ons essenti el l es, l es
pri nci paux arguments et i dees expri m6s. El l es porteront rarement sur des
i nformati ons tres detai l l ees.
Exerci ce 2
Pour l e deuxi dme exerci ce, vous entendrez deux foi s un enregi strement sonore de 5 d
6 mi nutes.
Ce pourra 6tre un extrait d'interview, de d6bat, de discours, de conf6rence en langue
standard. Vous devrez repondre d un questi onnai re d' une douzai ne de questi ons
portant sur l a comprehensi on gl obal e du document
(memes types de questi ons que
pour 1' exerci ce 1 de 1' 6preuve) ai nsi que sur Ia comprehensi on d' i nformati ons
pl us
pr6ci ses ou moi ns expl i ci tement expri mees.
Certai nes questi ons necessi teront une reponse redi g6e, mai s seul l e contenu (et non
mani ere de I' expri mer) sera al ors eval ue.
1 0
Vous pourrez i i re l es qucsti (rn\ | i \.i ,rnt l i r prcmi cre 6coute. Vous ecoutcrez une preml ere
fcri s I' enregi strement. Vous aurez cn:ui te I n-ri nutes pour commencer i i rpondre aux
questi ons.Vous ecoutereZ ur-rt- .l eusi i r.r-rc ti ri s 1' enregi strement.Vous aurez encore
r mi nut es pour compl et er r - os r i p. r n: e. .
Pour r6ussi r l ' 6preuve de cornprehensi on oral e, i l vous faut:
-
g6rer l e stress: tre pret a tc' rut ccouter rnai s d ne pas tout comprendre, construi re
du sens d parti r de ce qui est parti el l cment compri s, s' adapter d un debi t, un ton de
voi x ou un accent parti cul i ers! etc.
6tre un audi teur acti f: reperer tout ce qui sert, d I' oral , d donner du sens;
fai re i nstantan6ment l e tri entre l es i nformati ons uti l es a reteni r et cel l es qui ne l e
sont pas; m6mori ser une certai ne quanti t6 d' i nformati ons, prendre des notes sans
perdre l e fi I, etc.
utiliser des cornp6tences autres que celles rnobilis6es pour l'6coute, comme
par exempl e:
. l i re effi cacement un questi onnai re I
. prendre des notes.
Dans une premi ere parti e, Pour aous entrai ner, vous al l ez devel opper et entrai ner
vos capaci tes d' 6coute d travers des acti vi tes parfoi s el oi gnees de ce que vous devrez
f ai re l e
j our
de I' examen. Lai ssez-vous gui der, ces exerci ces ont pour obj ecti f de fai re
de vous des audi teurs acti fs, de vous donner confi ance, de vous convai ncre qu' on n' a
pas besoi n de sai si r tous l es mots pour tre performant, etc.
Dans une deuxi eme parti e, Vers I' dpreuT)e)vous al l ez travai l l er pl us systemati qucment
l es savoi r-fai re 6val ues dans l ' 6preuve 82.Vous pourrez 6couter une s6ri e de documents
courts et r6pondre d des questi ons pci rtant sur l a compr6hensi on
g6n6ral e et sur des
el ements de d6tai l .
Dans une t r oi si eme par t i e. vous pour r ez t est er vos compt ences sur une vr ai e epr euve
d' examen propos6e avec un bardme et un corri g6 compl ets.
l l
Pmx;r w'sn$s
? . %ra,3'p"r'.,&,t3/:47,{;llt.
'1,,tt;li,
li}tt'l}"{'tt{".1,.'t:::,i
,;'},{;:
t:t:f1,14t,..
Ti rer
parti
des sp6ci fi ci t6s de I' oral
Donner du sens d
part i r
de I ' i nt onat i on, du ryt hme, de l a m6l odi e
A I'oral, certaines inforntations so/tt traduites par autre chose que les Tytots :
I'intonation, la rndlodie, Ies pauses,
etc., rertseignent sur l'6tat d'esprit du locuteur,
son attitude, ses opinions et sentirnents. Ces 6l6ntents se?"aent aussi de ponctuation.
Ces prerni,Dres actiztitds aont oous pertltettre
de traoailley suy ces aspects
spdcifiques de I'oral.
Acti vi t6 1
Ecoutez l e document et di tes si I' i ntonati on de l a phrase marque une
questi on,
une excl amat i on ou une si mpl e d6cl arat i on.
Acti vi t6 2
Ecout ez l e document et i dent i f i ez l e sent i ment expri m6.
* t
enrrfi!nr
Proposi t i on
Col dre Joi e Doute l roni e Tri stesse Admi rat i on
Phrase l
Phrase 2
Phrase 3
Phr ase 4
Phrase 5
12
Act i vi t 6 3
Vous al l ez ent endre l a m6me phrase r6p6t 6e avec des i nt onat i ons di f f Erent es.
l dent i f i ez l e sent i ment
qu' el l e
expri me.
Proposi t i on 1
Pr onnqi t i on 2
Pr nnnc i t i nn ?
Proposi t i on 4
Act i vi t 6 4
Ecout ez l e document et di t es si l e t on est neut re,
pl ut Ot posi t i f ou
pl ut Ot
cri t i que.
Ton posi ti f Ton cri ti que Ton neutre
Proposi t i on 1
Pr nnnci t r nn 2
Proposi t i on 3
Proposi t i on 4
Proposi t i on 5
Proposi t i on 6
Act i vi t 6 5
Ecout ez l e document et di t es si on demande conf i rmat i on ou si on conf i rme une i nf ormat i on.
Demande de conf i rmat i on
Proposi t i on 1
Acti vi t6 6
a) Ecout ez l e document sui vant et soul i gnez l es mot s
qui
sont accent u6s
par l e
pr6sent at eur.
Savez-vous comment on qual i f i e parf oi s l es conduct eurs de m6t ro ? 0n l es appel l e des
hamst ers, et oui , pour l a bonne et si mpl e rai son qu' i l s f ont des t ours i l ongueur de
j ourn6e.
Et m6me si vous ne vi vez pas dans une grande vi l l e, l i r oi on t rouve pri nci pal ement l es
mt i t ros, vous en avez 6vi demment , ent endu parl er. C' est l ) que j e vous condui s auj ourd' hui ,
dans cet t e grande ent repri se qu' est l a RATP
-
l a R6gi e aut onome des t ransport s pari si ens.
Je vous f erai rencont rer un conduct eur de rame qui nous vi ent de I ' i l e de l a R6uni on.
l l s' appel l e Edouard Taburon et i l n' i magi nai t pas, quand i l vi vai t sous l es cocot i ers, qu' un j our
Et onnement l roni e
I
i l passerai t ses
j ourn6es ) quadri l l er sous t erre l a vi l l e de Pari s
1 3
b) A votre avi s, quel l e
est I' i ntenti on du
pr6sentateur
l orsqu' i l soul i gne certai nes expressi ons
dans l a derni dre
phrase?
Acti vi t6 7
Ecout ez l e document sui vant et
pl acez
l a ponct uat i on
t el l e
que
vous I ' ent endez. Vous aurez i
ut i l i ser l es vi rgul es
(pauses
court es i I ' i nt 6ri eur d' une phrase pour
i sol er l es uni t ds de sens),
l es poi nt s (rep6rabl es
par
une
pause
et un changement d' i d6e), l es poi nt s
d' i nt errogat i on
(pour
l es quest i ons),
et aussi l es deux-poi nt s
(. : ' ) qui pr6cddent
une 6num6rat i on.
Lorsque vous repdrez cert ai ns mot s accent u6s par l a personne qui parl e,
soul i gnez-l es.
a) Sophi e Li eut ar d a d6but 6 sa car r i dr e comme j our nal i st e
i nd6pencl ant c i l v a qr i at or ze ans d6j i
un i t i n6r ai r e ponct u6 de r encont r es d6t er mi nant es et de choi x di f f i ci l es ) . 19 ans auj our d' hui
el l e devi ent char g6e de pr og, r ammes au ser vi ce de pol i t i que 6t r angdr e de l a
l t r i nci pal e
chai ne
nat i onal e f r anqai se el l e nous r acont e ses d6but s avec une cer t ai ne 6mot i on
b) Vous avez mal au dos, r , os ar t i cul at i ons vous f ont gr i macer , vos dent s vous er r p6chcnt cl e
dor nr i l une t endi ni t e vous f ai t sout f r i r I a sol ut i on n' est pas f or c6ment l ' ant al gi que c' est - ) - di r e
l e r embde cl assi que cont r e l es cl oul eur s l es vi ei l l es t echni ques de nos gr ands- mdr es f r i ct i c. r ns
massages onguent s cat apl asr nes boui l l ot t e oLr au cont r ai r e gl agons et bai ns s. t l 6s peuvcnt vous
c' onveni r n' ut i l i sez I es mol 6cul es chi mi ques qu' en
cas de n6cessi t 6 absol uc
c) C) n t ' dat r se on v chant e on
l , par l e
) I ' ecol e mat er nel l e mai s pas seul ement on y j oue
et c' est
er ssent i el au moyen du
j eu
l ' ai r de r i en c' est l e j ugement
des enf ant s qr - r i est mobi l i s6 pour
cher cher cl es sol ut i ons aux si t r - r at i ons souvent cor npl exes qu' i l s doi vent 6cl ai r ci r pour t r ouver l a
l r i dce
j ust e pour t er mi ner l e puzzl e memor i ser une hi st oi r e i cl ent i f i er l es l et t r es de I ' al phabet
6cr i r e t out seul son pr enom aut ant d' act i vi t el s qui vont I ' ent r ai ner i d6vel opper l ' al t st r act r on car
c' est ) I ' 6col e mat er nel l e ent r e 3 et 6 ans qu' on f ai t ent r er pet i t
i
pet i t l es savoi r s de base
Ti rer
part i
du caract dre redondant de I ' oral
A I'oral, Ies rdpititions et les reforrnulations sont bien ptus
friquentes
qu'd. I't4crit.
Les inforrnations transntises le sont souoent plusieurs
fois
et sous differentes
fortnes.
Cela zsous laisse Ia possibilitd de <:irifier que oous azsez bien identifie les
inforntatiotts ou les opinions exprirndes.
Acti vi t6 8
1. Ecout ez I ' ext rai t sui vant et not ez en f ace de chacune des i d6es comment el l e est expri m6e
d' une aut re f agon dans l e document .
a) Les enf ant s ont l e gout de l a repet i t i on.
b) La memoi re t ravai l l e t res vi t e et t res bi en.
c) Les enf ant s ont l e go0t des sonor i t 6s nouvel l es.
- e
. . . . . . . . . . . " .
2. Quel ti tre choi si ri ez-vous pour
cet extrai t?
!
Les compt i nes, un excel l ent moyen de devel opper l e l angage
!
Les compt i nes, t r op de
<par
cGUr >, pas assez de sens
!
Les compt i nes, une bonne i ni t i at i on aux l angues 6t r angdr es
.+.
Act i vi t 6 9
Ecoutez I' extrai t sui vant et notez
pr6ci s6ment, dans l a col onne de droi te, une autre fagon
d' expri mer l e mme f ai t .
1 . J' a t oul ours adore danser.
2.
Qa
a et e une r evdl at i on.
3. C esr r , r ne danse de met i ssage.
La vr ol ence que
1' avai s
t ous l es
l our s
sous l es yeux.
5. Ca m' a
permi s
de m' ext eri ori ser.
A , : n o r v l o c r n mn r e n a l r o l t r q t t r t t n e s
v . J - v s u l
v t ' v v
l v v i
i v v ,
7. C est ur e cul t ur e qui est pr oche d' eux.
G6rer l e stress
Autant d.e
personnes, \utant de
fagons
de
patler, de rythnt'es, de ddbits, de tics de
parole, d'accents, etc. Nous oous
proposons de ttous entratner d
partir d'extraits
ians lesquels Ia
fagon
de s'exprinter des
personnes est ddroutante et dentande un
temps d'adaptation,Vous
poumez aztoir I'intpression d'6tre
perdu(e)t de ne presque
riei cornprendte
peut-Afue; pourtont, oous oenez que oous Afus capable de
percez;oir I' essentiel du ntessage,
Ces actizsitds ayant
pour objectif de ztous
farniliariser
azsec certaines dfficultds de
I'oral, z)ous
pourrez les 6couter autant de
fois
que ndcessaire'
Act i vi t 6 l 0
Lext rai t
que vous al l ez 6cout er est
parl 6 i un ryt hme i nhabi t uel l ement rapi de. Ecout ez-l e en
essayant de ne
pas vous l ai sser i mpressi onner
pal cet t e apparent e di t f i cul t 6, et r6pondez
aux
quest i ons.
l . Quel est l e t hdme
pri nci pal du document ?
I
Fai r e l e r eci t d' un 6v6nement t r agi que.
!
Donner des consei l s sur l a condui t e a t eni r au vol ant .
l
Anal yser l es causes de I ' i ns6cur i t 6 r out i er e.
2. Rel i ez l es 6l 6ment s de l a col onne de
gauche aux donn6es chi f f r6es de l a col onne de droi t e:
Nombre de mort s
Nombre t ot al de bl esses t
r 5
) 7
) 1 4
r 1 9
) 2 3
f 3 0
Nombre de secouri st es
1 5
3. a) C' est sur I' autoroute que
les gens
se tuent le plus.
f
vRAl
T
FAUX
b) Justi fi ez votre 16ponse en ci tant une i nformati on du texte.
4. Que di t l e
j ournal i st e?
[ ]
Les Frangai s sont des conduct eurs peu
at t ent i f s.
!
Les Franqai s respect ent peu l es l i mi t at i ons de vi t esse.
!
Les conduct eurs europeens se comport ent mal en France.
Act i vi t 6 1l
Dans I ' ext rai t sui vant , l a personne parl e
avec un accent sans dout e i nhabi t uel pour
vous. El l e
est
qu6b6coi se.
La comprendre peut
vous sembl er di f f i ci l e au premi er
abord. Ecout ez aut ant
de f oi s que
n6cessai re I ' enregi st rement et r6pondez aux quest i ons
ci -dessous.
1. Oue di t cet ext rai t ?
I
Tout es l es l angues amer i ndi ennes se sont mai nt enues.
f l
La mal orrt e des l angues ameri ndi ennes exi st ent t ouj ours.
-
La pl upar t
des l angues amer i ndi ennes ont di spar u.
2. D' ou vi ent l e nom Huron?
I
De l a l angue par l ee par ces i ndi gdnes
I
De l a coupe de cheveux de ces i ndi gdnes.
I
Du nom de l a r egi on dans l aquel l e vi vent ces i ndi gdnes.
3. Que
peut -on
di re de l a rel at i on des Hurons avec l eur l angue?
I
l l s par l ai ent souvent l es l angues de l eur s voi si ns.
I
l l s ont , auj ourd' hui comme hi er, essaye de prot eger
l eur l angue.
I
Leur l angue mat er nel l e passe
apr ds l e f r anqai s ou I ' angl ai s.
Act i vi t 6 12
Dans I ' ext rai t qui
sui t , c' est l a m6me personne qui
s' expri me. R6pondez aux quest i ons; el l es
se r6fdrent d des informations plus pr6cises.
1. Combi en y a{-i l d' l nui t s dans l e monde?
2. Combi en y
3. Quel mot l a
en a-t -i l au Qu6bec?
personne qui parl e
ut i l i se-t -el l e pour
caract 6ri ser l e mode de vi e des l roquoi s?
4. 0u vi vai ent -i l s i I ' arri v6e des Europ6ens?
5. Onf i l s 6t 6 rapi dement chass6s par
l es Europ6ens?
I
Oui , t r ds r api dement .
!
Our , apr ds quel ques
annees.
I
Non, i l s ont resi st 6 l ongt emps.
1 6
Act i vi t 6 13
Vous al l ez ent endre t roi s ext rai t s dans l esquel l es l es personnes parl ent
avec un d6bi t rapi de
et des accent s marqu6s. l l s' agi t d' un ent ret i en ent re un
j ournal i st e
et un ani mat eur d' une
6mi ssi on di f f us6e sur une radi o communaut ai re new-yorkai se; l ' 6mi ssi on s' appel l e Af ri can
f me. R6pondez aux quest i ons.
Ertrait I
l . 0ui
peut
6cout er l ' 6mi ssi on?
-
Excl usi vement i es Af r i cai ns de New Yor k.
-
Les Af ri cai ns des t roi s et at s voi si ns de New York.
Tor s l es Af r r cai ns des Et at s- Uni s.
2. Citez deux cat6gories de
personnes qui 6coutent r6gulidrement l' 6mission :
3. Af ri can l i me est l e seul programme
s' adressant aux communaut 6s af ri cai nes de l a vi l l e:
-
VRAI
T
FAUX
l )
u r i t r a > d t L p d J ,
Enrai t 2
Quel audi t oi re I ' ani mat eur souhai t e{-i I ci bl er ?
-
f ous l es f rancophones des Et at s-Uni s.
-
Pl us par t i cul i er ement l es mi nor i t 6s f r ancophones d' Amer i que du Nor d.
-
Tous l es f r ancophones qui s' i nt 6r essent d I ' Af r i que.
Extrai t 3
Pourquoi l e f rangai s at -i l 6t 6 choi si comme l angue d' expressi on?
-
Par ce que cer t ai ns audi t eur s ne par l ent pas bi en angl ai s
-
Par ce que c' est une f aqon de mai nt eni r vi vant e I ' i dent i t 6 des audi t eur s.
-
Pour ces deux r ai sons r euni es.
Tra i ter l es i nformati ons
(i nterpr6ter,
synth6ti ser, d6dui re, anti ci per,
etc.)
Act i vi t 6 14
Ecout ez I ' enregi st rement et choi si ssez une sui t e
possi bl e parmi
cel l es
qui
sont
propos6es.
Avant d' 6cout er,
prenez
l e t emps de l i re l es
proposi t i ons.
-
Proposi t i on I :
... et i l est 6l ' i dent pour cel a que l es grands-parents d' auj ourd' hui ont un r6l e mi ner-rr: l eur
eoncepti on de l ' 6ducati on entre r6gul i drerrent en confl i t al ' ec cel l e de l eurs enfants, i l s ne sont
pas autcl ri sds ) i nterveni r auprds de l eurs peti ts-enl ' ants.
-
Proposi t i on 2:
.. i l f aut d' ai l l eurs soul i gner que l es grands-parents assurent de ph-rs en pl us. ) l a pl ace des
Irarents.
l es condi ti ons d' une vrai e 6ducati cl n. que ce soi t en terme de di sponi bi l i td. de revenus.
d' affecti on: l es parents d' auj ourd' hLri consi ddrent l eurs enfants beaucoup trop t6t commc cl es
adultes autonomes. ils ne leur donnent
pas
le temps de
grandir.
!
Proposi t i on 3:
... c' est un 6qui l i bl e trds ddl i cat )
-s6rer
et i l faut trouver l a bonne di stance. i l faut i r l a l i ri s que
l es grands-parents soi ent pr6ts i r apporter une ai de. qu' i l s sachent 6tre pr6sents, mai s en rrurc'
temps. qu' i l s n' i nterfdrent pas trop dans l a faqon dont l e coupl e gdre l a vi e fami l i al e et dl i ve l cs
enfants.
1 7
Act i vi t 6 15
Ecoutez I' enregi strement et di tes si l es i nterventi ons du
j ournal i ste
sont neutres,
bi envei l l antes ou un
peu
d6rangeantes.
Questi on neutre
ou bi envei l l ant e
0uest i on derangeant e
Proposi t i on 1
Proposi t i on 2
Proposi t i on 3
Proposi t i on 4
Proposi t i on 5
Proposi t i on 6
Proposi t i on 7
Proposi t i on B
Act i vi t 6 16
Ecoutez I' enregi strement et caract6ri sez l e
poi nt
de vue
Just i f i cat i on l es mot s qui
vous ont
permi s
de f ai re vot re
6nonc6. Rel evez dans l a col onne
choi x.
Act i vi t 6 17
Li sez ci -dessous l a
quest i on
d' un
j ournal i st e
ext rai t e d' une 6mi ssi on sur l es grands-mdres.
Ecout ez ensui t e l a r6ponse de I ' i nvi t 6e et rep6rez, i I ' ai de des quest i ons 1, 2 et 3, l es mot s
qui l ui servent i rel i er l es di f f drent es i d6es qu' el l e
expri me.
On peut donc di re qu' i l y a une grande di fT6rence entre l e moddl e pl utdt stri ct. pl ut6t sdvdre.
que l a grand-mdre a v6cu quand el l e 6tai t el l e-mme acl ol escente. c-t m6me pl us tard quand el l e
est devenue adul te, et pui s l e moddl e beaucoup pl us l i bdral d' autourd' hui . Est-ce que l e moi s
de mai 68 est pass6 par l i ?
1. Quel s mot s permet t ent
d I ' i nvi t 6e d' expri mer qu' el l e est d' accord avec l a
j ournal i st e?
2. Quel s mots permettent d I' i nvi t6e de pr6ci ser
son avi s en formul ant une restri cti on?
3. Ouel mot
permet
de mettre en opposi ti on l a foncti on des parents et cel l e des grands-parents?
4. Quel ti tre choi si ri ez-vous
pour
cet extrai t:
I
Parent s, grands-parent s, l a conf usi on des r6l es?
I
Quel s
gr ands- par ent s devi endr ont l es enf ant s d' auj our d' hui ?
f l
I es ef f et s oaradoxaux des annees soi xani e-di x en mat i dre d' 6ducat i cn.
I
1 8
l
Acti vi t6 18
Ecoutez deux foi s I' enregi strement
pour
r6pondre aux
questi ons
sui vantes:
1. Ouel l e 6t ai t l a quest i on pos6e par l e
j ournal i st e?
I
Pour vous, quel s sont l es deux mot s qui caract 6ri sent l e mi eux vot re m6t i er?
I
Pensez-vous que ce m6t i er soi t adapt e pour une f emme?
f ]
Qu' est -ce
qui vous a ament i e a f ai re ce choi x?
2. Ouel regard l a personne porte-t-el l e sur son exp6ri ence aprds
pl usi eurs ann6es?
I
Posi t i f mai s nuanc6.
t r
Pl ut ot cr i t i que.
I
Enthousi aste et sans reserve.
3. a) A votre avi s,
quel l e est l a professi on de l a personne?
b) Ouel s sont l es mots
qui vous ont permi s de d6ci der?
:
Acti vi te 19
, Ecoutez deux fois I' enregistrement et r6pondez aux
questions suivantes.
i Vous 6tes
j aponai s,
vous r6si dez actuel l ement en Al l emagne, et vous voul ez 6tudi er un
g
semestre en France.
Dans quel pays devez-vous effectuer l a demande de vi sa ?
0uel l e
pi dce d' i denti t6 devez-vous fourni r?
Quel autre document est i ndi spensabl e?
1 .
2.
3.
Pr6parer l ' 6coute: l i re effi cacement l e
questi onnai re
Vous vous prparez d passer une 6preuve de compr6hension orale, mais n'oubliez pas que
pour bien la r6ussir, il vaut mieux aussi 6tre un bon lecteur... !
Voici quelques conseils
qui vous aideront i tirer le maximum d'informations de la lecture du
quesuonnarre.
Sachez d' abord que les questions respectent l' ordre du texte. Vous
naviguer sans cesse d'un bout i I'autre du questionnaire.
Parfois cependantr vous aurez d reporter des informations dans un
pourront tre r6parties tout au long du document.
n'aurez donc pas d
tableau, et ces informations
Dans un questionnaire, certaines
questions portent sur l'ensemble du document, d'autres sur
une partie precise.
Les questions de la premidre cat6gorie seront toujours plac6es en d6but de questionnaire, ou
au contraire d |a fin. Pour avoir des chances de r6pondre correctement a ce tlpe de question,
il faut avoir 6cout6 l'integralit6 du document avant de s6lectionner la r6ponse.
Comment
pouvez-vous identifier ces questions ?
#;;;;r";;;1"
;ilil; d";;';;i."o-ii.", interview, d6bat, micro-tronoir, etc.), sur
sa fonction
(informer, pol6miquer, critiquer, commenter, etc.), sur le theme g6n6ral, sur la
position des personnes qui s' expriment
(neutralit6, ironie, agressivit6, inqui6rude,
enthousiasme, etc.).
Voici quelques exemples:
Ge document est une 6mission i caractbre:
t r
p6dagogi que.
I
pol 6mi que. n di verti ssant.
Quel est I ' obj et pri nci pal du document ?
I
Communi quer l es r6sul t at s st at i st i ques d' une s6ri e de sondages.
t ]
Comment er l es resul t at s d' une seri e de sondages.
I
Cont est er l es resul t at s d' un sondage.
i l
l l l ust rer l es r6sul t at s d' un sondage.
Avec quel ton l a personne i nterrog6e parl e-t-el l e?
I
l r on i que.
I
Neut r e.
I
Bi envei l l ant .
I
Sol ennel .
Les questions peuvent Agalement faire appel d un travail de synthdse comme dans les
exemples suivants:
. Donnez
(ou
choi si ssez
parmi pl usi eurs proposi ti ons) un ti tre
pour l e document.
. 0uel l e opi ni on r6sume l e mi eux l a pens6e de l a personne i nt ervi ew6e?
. En d6fi ni ti ve,
quel est l e cri tdre qui sert i hi 6rarchi ser l es di ff6rentes castes?
Les questions de la seconde cat6gorie renvoient d des informations en g6n6ra1 plus
d6taill6es, et exigent parfois un relev6 pr6cis de donn6es (indications chiffr6es, sigle, identit6
ou fonction d'une personne). N'hesitez pas d prendre des notes des la premiere 6coute,
sur la feuille d'examen si vous tes absolument s0r(e) de la rponse, ou sur un espace de
brouillon s6par6.
Les questions A choix multiples (QCM) demandent une lecture prdcise; soyez trds attentif au
conrenu des diff6rentes possibilit6s propos6es car elles sont parfois trds proches.
Exempl e:
Comment l e nombre de donneurs 6vol ue-t -i l ?
I
l l y a de pl us en pl us de donneur s chez l es
j eunes.
t l
l l y a moi ns de donneur s, mai s i l s sont pl us j eunes.
t l
l l y a pl us de donneur s, mai s i l s sont moi ns
j eunes.
Attention i ne pas vous laisser abuser par certains mots. Il est important de prendre en
compte I'id6e compldte exprimde par l'item (c'est-d-dire la proposition de r6ponse).
Voici un exemple
guid6:
Des bistrots sur le plateau de Millevaches en plein hiver
Ea
existe. A cheval sur 3 ddpartements: la
Haute-Vienne, la Creuse et la CorrDze, plusieurs dizaines de vieux bistrots tentent d'animer cette
campagne d l'habitat dispers0, un pays oi la population est plut)t ddclinante. Alors pour le
faire
revivre,
des b4ndvoles ont crdd en 1998 l'association < Pays rve > qui propose des animations et des rencontres
varides. L'objectif ? Aller dans des lieux oil la vie est ld et oil elle peut se ddvelopper. par exemple les
auberges. . .
Ouel est I' obj et
pri nci pal du document?
n
Fai r e l a pr omot i on t our i st i que d' une r 6gi on
I
Rendre compt e d' un proj et col l ect i f .
I
At t i rer l es
j eunes
vers l a campagne.
Lid6e de r,igion isolhe peut tre rapproch6e de celle d'habitat disperse, mais cette reponse
n'est pas ia bonne car I'id6e de promotion
touristique n'est pas exprim6e dans le document.
De la mme fagon, la troisidme proposition semble une r6ponse possible: on peut trouver un
lien logique entre animer une campagne d Ia population dbclinante et attirer les
jeunes
aers les
campagne.r, mais le document n'expii*. pur dit..tement cette id6e. La bonne r6ponse est
donc le deuxieme choix propos6.
C'est en f'ait la partie soulign6e du document qui donne la cl6: des b6n6voles ont cr66 une
association (-+ collectif) pour dynamiser la vie lA ou elle existe dejir (-+ projet).
A vous de fai re l e m6me travai l avec I' extrai t sui vant, afi n de r6pondre sans h6si tati on i l a questi on
qui sui t :
In ville de Marseille, au sud de la France, a trds vite exploitd sct situcttion geograpltique et ses ac'tit'ittis
portuaires pour se ddvelopper autour de l'activitd lide alt sctvot't dont le procdde de
fabrication
est
plusieurs
.fois
mill4naire. L'essor et la rdputation des savonneries de la ville 4taient telles que la cit,!
phocdenne allait d4finitivement associer son nom d ce produit courant. On parle du savon de Marseille
ntnte si lo ville n'a
jamais
ddtenu de monopole sur la production. Justement, d la savonnerie qui nous
acctteille anjourd'hui, au domaine de l'Olivier, on continue de
fabriquer
des savons selon les recettes
d'autrefois.
Gochez l a bonne r6ponse:
I
Le savon de Mar sei l l e por t e l e nom de l a vi l l e ou i l a et e i nvent e.
I
Le savon de Marsei l l e est f abri que excl usi vement a Marsei l l e.
I
Le savon de Mar sei l l e peut 6t r e f abr i qu6 ai l l eur s qu' d Mar sei l l e.
Dernirire rernarque, il arrive que les questions soient li6es entre elles (ii faut avoir r6pondu
i la premidre question pour aborder la seconde).
Voici un exemple:
Dans un reportage sur tes vi ol ences e I' encontre des enfants, Cl ai re Bri sset, ddfenseure des
enfants,
pr6sente son acti on.
a) La mi ssi on essenti el l e de l a dEfenseure des enfants c0nGerul o:
n
essent i el l ement l es cas i ndi vi duel s.
t r
essent i el l ement l es si t uat i ons col l ect i ves.
I
l e ni veau col l ect i f et i ndi vi duel .
b) Qrel l es autres mi ssi ons doi t-el l e assumer?
Il faut donc, pour r6pond.re i la question b avoir r6pondu i la question a, c'est-A-dire avoir
rep6r6 la mission essentielle.
Accompagner l ' 6cout :
prgl tdre
des notes ?
Faut-il prendre des notes ?
Les avis divergent sur la question; chaque personne met en place des strat6gies d'6coute qui
lui sont propres. Vous connaissez probablement les v6tres. Dans le cadre de ces activit6s
d'entrainement, a[ltsz-vous malgr6 tout A tester la technique que vous n'utilisez pas
spontan6ment et obcervez si elle vous apporte de nouveaux savoir-faire.
Si vous choisissez de
prendre des notes, elles doivent effe brdves et non redigees, afin de ne
pas disperser votre attention. Il s' agit donc de quelques mots ou expressions importants et
non de phrases.
Les notes ont pour objectif de soulager votre m6moire. A partir des diff6rentes informations
que vous aurez notee$, vous pourrez 6galement etablir des liens, par exemple rep6rer des
ressemblances et des contradictions dans les propos entendus.
Enfin, vous aurez la possibilite, dans le temps pr6vu entre les 6coutes, de trouver une
formulation claire et simple de vos r6ponses i partir des notes.
On peut sans risque diie que les notes sont utiles lorsque le document est long (comme
dans
le cas du deuxidme exercice de l' 6preuve) et que vous n' tes pas strr(e) de m6moriser les
informations entendues.
Activit6 20
Ecoutez les extraits suivants, relevez les mots qui vous
paraissent importants, et
proposez
une synthdse en une ou deux courtes
phrases.
Extrait 1
Notes:
Extrait 2
Not es:
Acti vi t6 21
Vous allez entendre
quatre points de vue ditf6rents sur le redoublement. Pour chacun des
extraits, vous devrez dire si la personne est tout d fait favorable, plut6t
d6favorable,
partag6e, sans opi ni on affi chde. Notez, pendant l ' 6coute, l es deux ou troi s mots-cl 6s
qui
vous seront uti l es
pour reformul er I' argument qui souti ent l e
poi nt
de vue.
Extrait 1
Opinion:
I
tGs favorable
I
plutdt ddfavorable
!
partag6e
!
sans opinion affich6e
Mots-cl 6s:
Synthdse
Synthdse
Extrai t 2
trds favorable
!
plut6t d6favorable
!
partag6e
!
sans opinion atfich6e
Argument
Extrai t 3
A r o L r mo n t
!
pl ut6t d6tavorabl e
I
partag6e
f
sans opi ni on affi ch6e
Extrai t 4
Opi ni on:
fl
trds favorabl e
!
pl ut6t cl 6fi rvorabl e
I
parta-ude
\ l ot s- cl cs :
23
ti,,
* : - . J
M-WMW% W'ffiWWWWWW
Dans cette deuxidrne
partie,
vous al1e2 vous entfainer plus syst6matiquement d r6pondre aux
types de questions propos6es dans l' examen. Les supports propos6s sont brefs; c' est pour
cette raison que nous vous proposons, parfois, une seule 6coute. Avant de commencer
l'6coute, lisez toujours attentivement les questions.
fois sur des donn6es precises. D' autre fois, vous d.evrez
traiter I'inforur-ation pr6sente dans le texte: la r6ponse pourra ne pas 6tre exprim6e
explicitement, elle pourra se situer ir plusieurs endroits du document et vous devrez la
r6sumer, vous autez d mettre en relation plusieurs 6l6ments (rapprochements, comparaisons,
deductlons, etc.).
Lorsque la consigne indique une seule.6coute mais que vous n'avez pas r6ussi i
repondre aux questions, n' h6sitez pas d r66couter; ces exercices ont pour but de vous
entrainer et de vous permettre de progresser.
Activit6 1
Ecoutez une fois I' enregistrement et r6pondez aux
questions.
1 . Num6ro du t rai n : . . . . .
2. Premi er arrdt du trai n:
3. 0i peut-on prendre un caf6? ....
4. Est-i l possi bl e de fumer en
prenant un caf6? ....
Activit6 2
Ecoutez une foi s I' enregi strement et notez l e num6ro de t6l 6phone compl et:
Acti vi t6 3
Ecoutez une fois I' enregistrement et r6pondez pr6cis6ment
d la question.
1 . De quel
obj et
parl e-t-on ?
2. Not ez l e num6ro d' i mmat ri cul at i on compl et :
Acti vi t6 4
Ecoutez une fois I' enregistrement et compl6tez pr6cis6ment le tableau.
Longueur total e
du r6seau
Nombre de
l i gnes
Nombre total
de stations
Longueur moyenne
d' une l i gne
Date de d6but
des travaux
Heure habi t uel l e
de fermeture
Act i vi t 6 5
Ecout ez une f oi s I ' enregi st rement et compl 6t ez
pr6ci s6ment
l e t abl eau.
Si n6cessai re, 166cout ez I ' enregi st rement .
Act i vi t 6 6
Ecout ez une f oi s I ' enregi st rement et r6pondez pr6ci s6ment
i l a quest i on.
A combi en l es organi sat eurs ont -i l s 6val u6 l e nombre de mani f est ant s hi er?
Act i vi t 6 7
Ecout ez deux f oi s I ' enregi st rement
1. Que si gni f i ent l es l et t res ZEP? . . . .
et cochez l es bonnes r6ponses.
2.
"
Espaces l udi ques en mi l i eu scol ai re' est l e nom :
!
d' une associ at i on scol ai r e.
I
d' une i ni t i at i ve commune.
f
d' une ent r epr i se pr i vee.
3. Quel l es 6vol ut i ons posi t i ves peut -on
observer? Donnez-en au moi ns une
Act i vi t 6 8
Ecout ez deux f oi s I ' enregi st rement et cochez l es bonnes r6ponses. Except i onnel l ement ,
vous al l ez un peu t r avai l l er l es mat h6mat i ques. Ne cal cul ez
pas pr 6ci s6ment , 6val uez l es
or dr es de gr andeur .
1. Quel l e
proport i on de f ami l l es rest e au sol ei l sur l a pl age pendant pl us de quat re heures
consecut i ves ?
-
U . ! o - - e r o t i e .
. -
- : ^-
r cr r t e.
2. Quel l e
proport i on de mdres
prend l a prdcaut i on de met t re de l a crdme aprds chaque bai gnade?
-
5 0 %.
a
75%.
a
2o%.
3. Le sol ei l af f ect e l es enf ant s:
-
envi r on quat r e f oi s pl us vi t e que l es adul t es.
-
envi r on
qui nze f oi s
pl us
vi t e
que
l es adul t es.
- __1
envi r on deux f o s pl us vi t e que l es adul t es.
4. Sel on l e document ,
quel l e part i e du corps, aut re
que l a peau, peut et re mal t rai t 6e
par l e sol ei l ?
25
Acti vi t6 9
Cet t e act i vi t 6 vous propose de t est er vot re m6moi re i r t res court t crnrc. S(\ \ ' cz t ri s concent r6(e).
1. Que si gni f i e 0MEP?
!
Or gani sme mondi al d' educat i on pr i mai r e.
I
Or gani sat i on mondi al e pour l ' 6ducat i on pr 6scol ai r e
I
Or gani sat i on mondi al e pour l ' eval uat i on pr 6scol ai r e,
2. Compl 6t ez l e num6ro de t 6l 6phone:
Act i vi t 6 10
R6pondez aux
questi ons sui vantes.
Prenez le temps de lire trds attentivement
les questions avant de commencer.
Les choi x qui vous sont proposes portent
sur de fines nuances de sens.
1. 0uel est I ' obj et
pri nci pal du document ?
f
Al er t er I ' opi nr on publ r que ) par t i r des r 6sul t at s d' un sondage
!
Pr6sent er et comment er l es r6sul t at s d' une enqut e recent e.
[ ]
Met t r e en dout e l a val i di t e d' une enquet e nat i onal e,
I
Cr i t i quer une t endance de soci et e d par t i r des r esul t at s d' un sondage.
2. De quel l e f aEon l es Franqai s
pr6f drent -i l s donner de I ' argent ?
[ f
Par l e bi ai s de st ruct ures of f i ci el l es.
I
De f aEon i nf or mel l e dans l a r ue.
f
Le document ne donne pas cet t e i nf or mat i on.
3. En pl us du don d' argent et du don de sang, rel evez deux autres formes de g6n6rosi t6 menti onn6es
dans l e document :
A propos du don de sang,
que di t l e report age?
f
Les Franqai s sont gi obal ement en accorC avec l eurs parol es.
I
l l y a un gr and d6cal age ent r e ce
que l es Fr angai s di sent et ce qu' i l s f ont .
f
Les Fr angai s sont pl us gener eux qu' i l s ne l e pr 6t endent .
Comment l e nombre de donneurs 6vol ue{-i l ?
I
l l y a de pl us en pl us de donneur s, not amment des
l eunes.
E
l l y a moi ns de donneur s, mai s i l s sont pl us j eunes.
n
l l y a pl us de donneur s, mai s i l s sont moi ns
Jeunes.
Act i vi t 6 l 1
Dans cet exemple, vous aurez d relever une s6rie d' informations precises et rapprochees, mais
vous aurez deux 6cout es; i l est normal de ne pas repondre d l ' ensembl e des quest i ons des l a
premiere 6coute. Lisez attentivement les 5 questions avant de commencer.
R6pondez
pr6ci s6ment aux
questi ons sui vantes.
1. Quel l es ont 6t 6 l es t roi s annees marquant es
pour l es ph6nomdnes d' 6t oi l es f i l ant es?
2. Quel ordre de
grandeur correspond l e mi eux au nombre d' 6t oi l es qui peuvent
Ot re observ6es l es
nui t s de
pl ui e d' 6t oi l es f i l ant es?
:
100 000
4.
5.
26
E
10 000
I
1 0 0 c : _ _
3, 0i 6t ai ent l es personnes qui ont pu l e mi eux voi r l a derni dre t empet e d' 6t oi l es?
f
Sur t er r e. Sur mer .
!
En avr on.
Act i vi t 6 12
1 . UADEME c' est I ' agence de , . . , . . . . . . . et de l a mai t ri se de
2. Le poi nt de d6part de ce reportage c' est:
!
l a sor t i e d' une nouvel l e voi t ur e.
!
l a sor t i e d' un l i vr e sur l es voi t ur es.
!
une exposi t i on de voi t ures.
3. Cert ai nes voi t ures sont
quat re f oi s pl us pol l uant es que d' aut res.
I
VRAI
n
FAUX
l l
0n ne sai t pas
4. Compl 6t ez l e t abl eau:
Pri x du
gui de
l e gui de
5. Les peti tes voi tures sont:
-
pl us economi ques mai s moi ns ecol ogi ques.
-
mn i n c , 6 r ' n n n mi n r r o s m: i c , n l r r s 6 a n l o s i a r r e <
- n l r r c ^ ^ ^ h ^ mi ^ , r p c
o f n l r r c 6 r n l n o i n r r o c .
I I
p l u J EL U| l u l l l l \ - { u u J u r
| . J r u J
u u u r v E' VUL J
Act i vi t 6 13
Ecout ez I ' enregi st rement en vous at t achant aux i d6es expri m6es, et aprds avoi r l u
at t ent i vement l es
quest i ons. Essayez de r6pondre aux t roi s
quest i ons avec une seul e 6cout e.
Si n6cessai re, r66cout ez-l e document .
1. l l f aut que l es
j umeaux
soi ent t ouj ours ensembl e c' est :
-
ce que pensent l es parent s, d
j ust e
t i t re.
_
ce que pensent l es parent s, peut -et re a t ort .
-
ce que pense l e present at eur du document .
2. 0uel l e est l a f onct i on
pri nci pal e
de ce document ?
-
Donner des consei l s aux par ent s de
i umeaux
en di f f t cul t e.
-
Denr ont r er l e r ol e de l ' 6ducat i on dans l a const r uct i on de l ' i cl ent t t e.
C: ni est er l a di f f i cul t e des
j umeaux
) const r ut r e eLr r i der t t e.
3. Sel on ce document ,
qu' est -ce qui peut 6t re source d' angoi sse
pour l es
j umeaux?
. --
L' el oi gnement physi que de I ' aut re personne.
I
Le f ai t d' t re t rop sembl abl e a I ' aut re personne.
I
Le f ai t d' 6t re t ouj ours t res proche de I ' aut re personne.
Act i vi t 6 14
Ecout ez I ' enregi st rement et choi si ssez,
parmi l es
proverbes propos6s, cel ui qui pourrai t
servi r de t i t re
pour l e document .
Chal eur de r a . e' dt t l a hat e.
Pendant
r p
^
- s r e Vl ai . couvr e- t oi pl us que j amai s.
Ma r , mo S r : ' ! , . ' s . mo i s d e b o n h e u r .
f_ry$re
de modeles
Prese
Nombre de
gui des i mpri m6s
T
il
I
27
Acti vi t6 15
lJenregistrement suivant est un bulletin
I' aide des symboles et des informations
m6t6o d6taill6. Compl6tez la carte ci-dessous d
chitfr6es. Vous entendrez deux fois I' enregistrement.
- l
t
^ t -
, J-
r l r
ffi:
\**.*5
*
r k
Y
@
l l l r
x t * t
t l e*
ft {Fr
---,---.a,
t
@
{!.rrt
g\
*""& o
I
i
',i:
2.
Activit6 1 6
R6pondez i la s6rie de
questions
suivantes, aprds avoir 6cout6 deux fois I' enregistrement.
1. Compl 6t ez l e t abl eau:
Date de
paruti on de I' annonce Date l i mi te de candi dature P6ri ode concern6e
par l e contrat
I
mars i mai
I
avri l a
I
j ui n
a sePtembre
octobre
a) La personne dont voi ci l a carte d' i denti t6 peut-el l e Otre candi date?
Si non, pr6ci sez pour quel l e(s) rai son(s): .
Ouel rensei gnement, n6cessai re pour poser sa candi dature, n' est pas donn6 par l a carte d' i denti t6?
4. Ouel , est l e sal ai re propos6?
I
Moi ns de 1 255 euros.
I
Pl us de I 255 eur os.
n I 255 euros,
b)
3.
5
T": i.:::::::l:T:::
":"1::::::
i':::::: ii :iT:ii:::: Yl :.:::l::::
Acti vi t6 17
Rfpondez i l a s6ri e de questi ons
sui vantes, aprds avoi r 6cout6 deux foi s I' enregi strement.
1. A qui
snadresse I ' i nf ormat i on?
I
t
, n l arge publ i c.
I
A un publ i c
de pr of essi onnel s.
I
A de
j eunes
et udi ant s.
2
i'i't,_ii:::::.1l''':l'1ri:i'.::.'::::r::i::::i':::':'i::-:lt
:: ::: :::: :::
3. A I' i ssue de l a premi dre
6preuve, combi en restera-t-i l de candi dats?
4. Notez dans l e tabl eau l es dates retenues pour chacun des si tes:
Arcachon Marsei l l e Di nard
::t':1 l::::::: ::: :ii::iT ::lt:ll: ::::'"::: i
l ndi quez dans l e t abl eau l es i nf ormat i ons qui concernent l a f i nal e:
Li eu Date R6compense
Activit6 1 8
R6pondez i l a s6ri e de
questi ons
sui vantes, aprds avoi r 6cout6 deux foi s I' enregi strement.
1. Le document ent endu est :
I
une annonce d' exposi t i on.
I
un debut d' emi ssi on.
f
un report age compl et .
2. Sel on l e document , qui s' i nt 6resse act uel l ement aux m6t 6ori t es?
5.
6.
i l
Les randonneurs du d6sert .
I
Quel ques sci ent i f i ques.
I
Cer t ai ns hi st or i ens,
I
Des passi onnes d' or i gi ne di ver se.
3. Quel i nt6r0t repr6sentent-el l es d' un poi nt de vue sci enti fi que?
4. La pl upart des m6t6ori tes ont une masse i nsi gni fi ante:
I
VRAI
I
FAUX
I
Le document ne l e di t pas.
Acti vi t6 19
R6pondez i la s6rie de
questions
suivantes, aprds avoir 6cout6 deur fois I' enregistrement.
1. Quel suj et i nt6resse l a
i ournal i ste?
f ]
Les t echni ques d' ai de i l a nai ssance.
tr
Le meti er de sage-femme dans son ensembl e.
t r
Un cas part i cul i er dans l e met i er de sage-f emme.
2. Qu' est-ce
qui , pour El ara, compte l e pl us dans l e choi x d' une personne?
3. Gl ara a choi si Bertrand Le Fl och:
I
aprds I' avoi r rencontrd.
t r
aprds avoi r ent endu
parl er de l ui .
I
aprds l ui avoi r parl 6 par t el 6phone.
4. Pourquoi a-t-el l e choi si Bertrand Le Fl och?
I
Parce
que c' 6tai t un homme.
f
Par ce qu' i l 6t ai t di sPoni bl e.
I
Parce
qu' i l 6t ai t comp6t ent .
5. Gl ara est: sati sfai te de son choi x.
extrOmement sati sfai te de son choi x.
pas vrai ment sat i sf ai t e de son choi x.
Le Saton mondial de I'auto est ouvert
(plusieurs
rAponses possihles)=
I
uni quement aux f abr i cant s de v6hi cul es.
I
uni quement aux commerEant s de v6hi cul es.
I
excl usi vement aux prof essi onnel s de I ' aut omobi l e.
I
i r toute
personne i nt6ress6e.
a) Qu'est ce qui rend la voiture tris attractive?
Activit6 20
Avant de tester votre comp6tence sur un exemple d'6preuve complet, voici une dernidre
activit$ qui porte sur"url document long. Lisez d'abord I'ensemble des questions, puis
6coutez une fois l'enregistrement sans I'interrompre. Prenez le temps n6cessaire pour
compl6ter les r6ponses dont vous 6tes srir(e)s. Lorsque vous avez termin6, r66coutez
l'enregist..^.rrf en am6nageant des pauses, si cela vous semble utile ou indispensable.
R6pondez aux questions en cochant
(E) la bonne r6ponse ou en 6crivant I'information
demand6e.
, '
'
'
T
T
T
t .
2.
b) Dans
quel s endroi ts
pl us pr6ci s6ment?
3. En vi l l e,
quel s probl i mes g6ndrent I' automobi l e?
4. Qu' est-ce
qui a encourag6 I' i ndustri e automobi l e d concevoi r des voi tures moi ns pol l uantes?
5. Not ez dans l e t abl eau l ' 6vol ut i on des t aux de
pol l ut i on par rapport i auj ourd' hui :
Par rapport a 1990
f
Augment at i on
f
Dr mr nut r on
6. Quel
graphi que i l l ust re l e mi eux l es 6vol ut i ons des derni dres ann6es?
L6gende:
i ndi ce de pol l ut i on nombre cl e r oi t ut r-r
Graphi que G Graphi que D
7. D' i ci 2020, l es 6mi ssi ons
pol l uant es: rest eront st abl es.
di mi nuer ont .
augment eront l egdrement .
Cochez l a bonne rrl ponse:
[
30 mi l l i ons de voi t ur es cnt envi r on B ans
I
30 mi l l i ons de voi t ur es ont ent r e B et 20 ans.
I
30 mi l l r ons de vci i ur es ont ent r e O et 20 ans.
1993 marque une 6t ape i mport ant e. Pourquoi ?
10. Ce changement a{-i l concern6 t ous l es v6hi cul es? Donnez une rponse precl se.
1 1. Donnez un t i t re i ce document :
I
La voi t ur e pr opr e: ut opi e ou r eal i t 6?
f ]
La voi t ure : l uxe ou mal necessai re ?
l =l Le Sal on de l ' aut omobi l e, haut l i eu d' i nnovat i on
T
T
L]
8.
L
EXERCI CE I 6 points
Vous al l ez ent endre une seul e f oi s un enregi st rement s0n0re d' 1 a2 mi nut es envi ron.
-
Vous aurez t out d' abord 1 mi nut e
pour
l i re l es
quest i ons.
-
Pui s vous 6cout erez I ' enregi st rement . Concent rez-vous sur l e document .
-
Vous aurez ensui t e 3 mi nut es pour r6pondre aux
quest i ons.
R6pondez aux quest i ons en cochant
(X)
l a bonne r6ponse ou en 6cri vant I ' i nf ormat i on
demand6e.
1. Quel l e est l a f r6quence de di f f usi on de l ' 6mi ssi on 6cout 6e? I poi nt
f
Deux f oi s par moi s.
I
Une f oi s par moi s.
!
Deux f oi s par semai ne.
[ ]
Une f oi s par semai ne.
2. Lebut de cet t e 6mi ssi on est de:
f a r e i a pr omot i on d' un nouveau f est i val .
nr pqpnt pr r , n
pvpnf l ' r nt
cul t ur el ,
met t r e en val eur l e dynami sme d' une pet i t e vi l l e
Langon est c6l dbre
pour son:
I
Fest r val de musi que anci enne.
!
Fest i val des musi ques du monde.
f
Fest i val des musi ques 169i onal es.
Sur I ' ensembl e de sa dur6e, ce f est i val r6uni t :
!
quel ques mi l l i er s de per sonnes.
I
pl us de cent mi l l e per sonnes.
-
pr es d' ur mr l ; r on de per sonnes.
1 potnt
I point
J
L ]
3.
4.
5. Ci t ez un mot ut i l i s6
pour qual i f i er Manu Chao, I ' une des t 6t es d' af f i che: I pot ni
6. Quel l e est l a vocat i on premi dre des
"
Nui t s at ypi ques
"
? t pcrn!
!
Promouvoi r de nouveaux art i st es.
!
Pr oposer une aut r e vi si on du monde.
i l
Val or i ser i a di ver sr t e musi cal e et cul t ur el l e.
Crgani ser des rencont res ent re cel ebrt t es.
EXERCI CE 2 l 9 poi nts
Vous allez entendre
deuxlols
un enregistrement sonore de 3 i 4 minutes environ.
-
Vous aurez t out d' abord 1 mi nut e
pour l i re l es quest i ons.
-
Pui s vous 6c0ut erez une
premi dre f oi s I ' enregi st rement . Concent rez-vous sur l e document .
-
Vous aurez ensui t e 3 mi nut es
pour
commencel e r6pondre aux
quest i ons.
-
Vous 6cout erez une deuxi dme f oi s I ' enregi st rement .
-
Vous aurez encore 5 mi nut es pour compl 6t er vos r6ponses.
R6pondez aux
quest i ons en cochant
(X)
l a bonne r6ponse, ou en 6cri vant I ' i nf ormat i on
demand6e.
32
L
2.
3.
4.
5.
Quel est l e suj et du reportage?
- -
| a hi opr anhi e d' r n homme de t h66t r e.
!
Le r 6ci t d' un evenement par t i cul i er .
[ ]
Le r ecr t d' une car r i er e except i onnel l e.
A t a f i n des spect acl es, Lui s Mari ano:
F r p n o v : i f s p q : d mi r a t p r r r s d a n q s a l n p e
I
f uyai t di scrdt ement ses admi rat eurs.
f
of f rai t sa vest e d ses admt rat eurs.
Chaque
j our,
Lui s Mari ano recevai t envi ron:
I
50 a 60 l et t res.
n
100 l et t res.
!
au moi ns 200 l et t r es.
De qui provenai ent -el l es?
I
De f emmes.
f
D' hommes et de f emmes.
J
0n ne sai t pas.
Dans ces l et t res, quel l es demandes l ui 6t ai ent f ormul 6es?
f
Argent I
Phot ograPht es
I
Aut ographes !
Mari age
I
Empl oi f
Pl aces de sPect acl e
6. Pourquoi a-t-on cr66 l e mol mari ani te? Donnez une r6ponse
pr6ci se:
I p6t r , 1
2 points
7. Ouel s sont l e
pays et I ' ann6e de nai ssance de Lui s Mari ano?
8 . Qu e l 6 t a i t s o n s u r n o mq u a n d i l 6 t a i t e n f a n t e t i q u o i l e d e v a i t - i l ? Do n n e z u n e r e p 0 n s e p r e c r s e :
9. Sa f ami l l e s' i nst al l e i Bordeaux
pour des rai s0ns:
I
pol i t i ques.
!
economi ques.
I
pr of esst onnel l es.
10. Dans cet t e vi l l e, Lui s Mari ano sui t des 6t udes:
I
d' ar chi t ect ur e.
de cnant cnor al
'
d ar t s Ol ast l OLl eS.
11. Lorsqu' i l est ouvri er agri col e,
qui va l ui permet t re de
qui t t er cet uni vers et comment ?
12. A Pari s, i l cont i nue sa f ormat i on i I ' ai de:
!
d' une bour se d' et udes.
I
d un concour s.
[ ,
C une f SYgur
Per so-
r e l e.
13. Donnez deux i nf ormat i ons sur Franci s Lopez:
i
Dot rt
pa nt
i ar ' al c
14. Quel est l ' 6v6nement
qui a d6cl ench6 son succds?
l a s
!
l
AUTO.EVATUATION
Je
peux rester concentr6 m6me quand
i e
ne comprends
pas t out .
Je
peux donner du sens au message grAce i r I' i ntonati on,
au rythme) etc.
Je
pc' ux me fami l i ari ser rapi dement avec un accent parti cul i er
ou un rythme rapi de.
Je
peux comprendre l e sens general d' un document.
Je
peux trouver des l i ens entre l es i nformati ons du document.
Je
peux prendre en note l es mots qui me sembl ent
l es pl us i mportants tout en conti nuant a ecouter.
Je
peux di ri ger mon ecoute grace a l a l ecture des questi ons.
Je
peux comprendre des i nfbrmati ons preci ses et detai l i ees
dans un document radi ophoni que.
l
n
T
n
I
tr
T
T
I
I
I
n
n
I
ft
!
t--l
L]
tr
T
--.
L]
34
ffiffiWWWWWffif\dSIOT*
> Reponse a des
quest i onnai res de comprehensi on
port ant sur deux document s ecri t s,
-
t ext e a caract dre i nf ormat i f concernant l a France ou I ' espace f rancophone;
-
texte argumentati f.
COMPNTHENSI ON
DES TCRI TS
Il.
niveau 82 (selon le Cadre europden):,
Je
peux l i re avec un grand degr6 d' autonomi e en adaptant l e mode et l a rapi di te de
Iecture a di fferents textes et obj ecti fs et en uti l i sant l es references convenabl es de
mani ere s6l ecti ve.
Je
possdde un vocabul ai re de l ecture l arge et acti f mai s peux avoi r des di i fi cul tes avec
des expr essi ons peu f r equent es.
l J6preuve
Bi en qu' el l e porte sur deux textes di sti ncts, I' epreuve de comprehensi on des 6cri ts est
assez courte.
En t heure) vous devez tre capabl e de:
-
l i re deux textes d' une l ongueur a peu pres equi val ente (maxi mum
600 mots);
souvent) i l s' agi ra d' arti cl es de
j ournaux;
-
r6pondre d deux questi onnai res (comportant
chacun une peti te di zai ne de
quest i ons).
Pour r6ussi r cette 6preuve, i l vous faut donc:
6tre capabl e de l i re rapi dernent: sachant que vous ne devez pas consacrer pl us
de 30 mi nutes a chaque texte, i l faut que vous pui ssi ez rapi dement sai si r l e sens
general des textes.
-
connai tre l es sp6ci fi ci t6s des textes propos6s: l e premi er texte a toui ours pour
foncti on essenti el l e d' i nformer l e l ecteur (texte i nformati f), tandi s que l e second
cherche d convai ncre, defendre une posi ti on,
etc. (texte
argumenrati O
-
bi en cornprendre ce que l ' on vous dernande: l a cl e de l a reussi te, c' est souvent
de savoi r ce que I' on attend de vous !
Les acti vi tes de l a parti e Pour eous entrqtner vont vous permettre:
-
de deveni r un l ecteur effi cace;
-
de vous fami l i ari ser avec l es types de textes de I' epreuveB2;
-
d' apprendre comment repondre aux di ff6rentes questi ons qui peuvent vous 6tre
posees.
La parti e Vers I' dpreuoe \rous proposera ensui te des questi onnai res
compl ets.
36
Pour voug
WWWWWWW WW WWffiWWWW WWffiXffiEffiffi
TERRE
-> ll faut du souffle pour planter une 6olienne dans son
jardin
. Si le < petit 6olien >
s6duit de plus en plus de particuliers, les d6marches
et les investissements restent lourds et demandent une grande motivation.
Robert Laurent a 83 ans et une 6olienne dans son
jardin.
Pas pour faire
joli
mans <<pour
Atre inddpendant du pdtrole>>. Il poss6dait d6je sa pompe i chaleuq il voulait produire son
6lectncit6: il a investi 17000 euros dans son installation, fonctionnelle depuis le 5
juillet.
<<Maintenant, tout ddpendra duvent... >> L'envol6e des prix du brut donne des ailes au petit
6olien, beaucoup r6vent d'acqu6rir leur autonomie 6nerg6tique: 6lectricit6 ou eau chaude
gratuites. Mais ce march6 balbutiant requiert beaucoup d'6nergie et d'obstination de la part
des particuliers qui n'ont qu'une vague id6e du parcours d'obstacles d franchir.
\
t t
Quatre
mois pour obtenir un permis
".
<<Elle n'est pas bruyante, sauf quand elle tourne vite.>> Premier dans le d6partement de la
Dordogne d arborer sa petite 6olienne, Robert Laurent a d0 s'accrocher: premidre 6tape,
le permis de construire obligatoire si le mdt d6passe 12 mdtres. Pour l'obtenir, il faut
remplir des dossiers, fournir des plans d la direction de l'6quipement, s'assurer que le
service d'arch6ologie n'y voit pas d'inconv6nient. Jusque-li, tout est normal.
On lui demande alors d'envoyer son dossier h la Direction de l'aviation civile. Avis
favorable mais qui n'engage d rien: le dossier paft a I'arm6e de I'air d Bordeaux, laquelle
consulte la marine, la gendarmerie, I'arm6e de tene (d cause des h6licoptdres, des
interf6rences sur les liaisons radios...) et impose un lclairage clignotant sur 1'6olienne.
<<Finalement, en quatre mois,
j'ai
rdussi d obtenir mon pewnis, c'6tait une ddmarche
autant technique qu'intellectuelle.> Et pour laquelle il faut avoir le temps. A une
quinzaine de mdtres de sa maison, l'6olienne s'61dve d 24 mdtres, d6passant les arbres de
4 mdtres. Elle devrait fournir au retrait6 un tiers de sa consoffrmation d'6lectricit6. soit
entre 3000 et 4000 kWh par an.
Des commandes doubl6es chaque ann6e
U6olienne individuelle s6duit une clientdle vari6e du moment qu'elle dispose d'un bout de
terrain: <Nos clients sont des institutions, des colonies de vacances, des agriculteurs et
des particuliers entre 40 et 60 ans qui veulent mattriser leur cadre de vie, des
jeunes qui
se lancent ou des retraftAs qui s'ennuient>>, explique Olivier Krug, qui importe la plupart
de ses machines de 1'6tranger et les installe. Il a d6marrd en2003, ses commandes doublent
chaque ann6e. Mais ce march6 soumis i une forte demande est encore anarchique: <<ll y
a
encore beaucoup de bulles de savon
[des
vendeurs peu sdrieux], des machines qui ne
marchent pas, beaucoup de
frais
de mise au point et un rdseau mal ddveloppd.>>
t "' l
- *'
Sylvie BREr, Libdration,9 d6cembre 2005.
T:_"...":
laissez pas impressionner par un texte, mme si le thdme vous semble
difficile !
GrAce au paratexte (c'est-d-dire
tous les 6l6ments
(
en plus r du texte : la source, le
titre, le chapeau...), aux mots-cl6s et A la structure du texte) vous pourrez
touiours
vous rep6rer.
ldentifier rapidement le texte
enlruiner
w
Votre premier r6flexe, ovont m6me d'entrer dons lq lecture du texte, est de prendre
:
.onnoi rronce de l o source du texte
(outeur?
dqte? rubri que? support?l : ce sont vos
premiers indices.
Le plus souvent, il s'agira d'articles issus de
journaux
francophones
(voir illustration
page 37). C'est pourquoi il faut vous familiariser avec ces
journaux.
Le nom du
journal
ou de la revue d'ori est issu I'article peut vous renseigner
imrn6diatement sur le
type
d'article, dont il s'agit: artiile issu d'un quotidien, d'un
hebdomadai re, d' un mensuel , d' une revue sp6ci al i see
(sci ence, 6conomi e...), etc.
La date'vous permettra de voii s'il s'agit d'un article d'actualit6 ou non.
Enfin, selon que le statut de I'auterrr est precise ou non, vous saurez si vous avez
affaire d un sp6cialiste de la question ou i un simple
iournaliste.
Activit6 1
Voici trois exemples. Essayez de caract6riser chaque article en fonction des indices
qui
vous sont donn6s
par les sources.
1. Source : Le Journal du Matin
15. 10. I 974
Par Syl vai n Royan.
2. Source : Cahiers des sciences,
pr i nt emps 2005.
Par F. Garqon, chercheur en bi ol ogi e
mol 6cul ai r e.
Source t Courrier international
-
n" 758
-
I 2- I 8 mai 2005
Par Phi l i ppe Thur eau- Dangi n,
6di t ori al i st e,
Ce texte
est i ssu. . .
G'est
un ar t i cl e. .
l l a 6t6 6cri t
par . . .
I
d' un quot i di en
!
d' un hebdo
f
d' un mensuel
f ]
d' une revue
sp6ci al i s6e
I
d' act ual i t 6
fl
r6cent
I
assez anci en
I
un
j our nal i st e
I
un sp6ci al i st e
Ce texte
est i ssu. . .
C'est
un art i cl e. .
l l a 6t6 6cri t
par . . .
!
d' un
quot i di en
!
d' un hebdo
f ,
d' un mensuel
I
d' une r evue
sp6ci al i s6e
I
d' act ual i t 6
!
r6cent
f
assez anci en
I
un
j our nal i st e
I
un speci al i st e
Ce texte
est i ssu. . .
G'est
un art i cl e. .
l l a 6t6 6cri t
par . . .
I
d' un
quot i di en
!
d' un hebdo
I
d' un mensuel
f
d' une revue
sp6ci al i s6e
!
d' act ual i t 6
I
recent
I
assez anci en
I
un
j our nal i st e
E
un sp6ci al i st e
Lesti treSpeuVenttredonn6ssousndeuxfurmesdi sti nctes:
, . .
-
une,torrne no,minale
(c'est le cas ie ptus frrsQubnt).:
Entrainez-vous d passer ais6ment de I'un i l'autre: cela peut 6tre utile si l'on vous
demande d'expliquer un titre, de le reformuler, ou d'en cr6er un vous-m6me.
. :
Activitd 2
A. Voici une serie de titres d' articles. Pour chacun,
proposez
une
phrase compldte 6quivalente.
Exempl e: Pr6l dvements d' ADN chez l es mal ades
-+
De I' ADN a ete pr6l eve chez l es mal ades.
Votre second r6fiexe doit 6tre d'qnticiper sur le contenu;,d 'poifir' du
'fit
e
'dO'ltCrticle"
1. Tensi ons ent re Et at et syndi cat s sur l a quest i on sal ari al e
-+
2. Ret ards dans I ' op6rat i on de s6curi sat i on des 6col es
-+
3. Vi ct oi re 6crasant e en t roi s set s du
j eune
Br6si l i en
-+
4. Recrut ement s en masse d l a r6dact i on du
quot i di en
*)
5. Surpopul at i on dans l es f oyers de t ravai l l eurs mi grant s
-+
B. Voici une s6rie d' informations donn6es sous la forme d' une
phrase conjugu6e.
Nominalisez-les de manidre i les transformer en titre d' article.
Exempl es.' Une
gal eri e d' art recrute des personnes handi cap6es
-+
Recrutement de personnes
handi cap6es
par une
gal eri e d' art
1. La nat ure se venge.
-+
. . .
2. l - opi ni on
publ i que pour r ai t se r et our ner .
- +
. . .
3. ShangaT s' 6vei l l e d I ' Ouest .
-+
. . .
4. Qui nze
post es devrai ent 6t re suppri m6s.
-+
. . .
5. Les FranEai s ret ournent au ci n6ma.
--)
. . .
Les mgts du titre vous permettent souvent de savoir a quelle rubrique un texte
appartient.
Ces rubriques varient d'un
journal
A l'autre. Il est cependant
possible d'en d6limiter
quelques-unes, que I'on retrouve dans la plupart des
journaux
francophones:
-
< Politique D (dont: international,
iustice...) ;
-
< Soci 6t6 > (dont: vi e quoti di enne, 6ducati on...)
;
-
o Economi e > (dont: entrepri ses, bourse...)
;
-
- a"l;;. u (aottt : medias, ti*.t.. .)
;
-
<
lcielces
)) (dont: nouvelles technologies, sante...)
;
-
< Sport u.
Pour determiner la rubrique, il vous faut analyser les rnots-cl6s.
Reprenons i titre d'exemple les deux premiers titres de l'activitl 2 A:
-
Pr6ldvernents d'ADN chez les rnalades
-r rubrique < Science
))
ou
(
Sant6 >
rubri ques <Economi e,r
et <, Soci 6t6,r
-Tensions
entre Etat et syndicats sur la question salariale
-+
39
Activit6 3
Voici
plusieurs titres d' informations relatives i I' actualit6 de la France. Pour chaque titre,
soul i gnez l es mots-cl 6s,
pui s
cochezl a rubri que dans l aquel l e vous l e cl asseri ez.
la m1,L,iire dont il faut aborder',.1.e,ffie;
Dans les exemples suivants, choisissez la phrase qui correspond le mieux au sens.
1. Qui nze
postes devrai ent Otre suppri m6s.
f]
L' annonce de l a suppressi on des postes a 6t6 confi rm6e.
n
La suppressi on de post es aura probabl ement l i eu.
I
Contrai rement i ce qu' on pensai t, l es postes ne seront pas suppri m6s,
2. La scul pt euse Gami l l e Gl audel aura enf i n son mus6e.
I
On n' est pas sOr que ce mus6e exi stera.
I
La scul pteuse sera l a derni dre ) avoi r son mus6e.
tl
Ce mus6e 6tai t trds attendu.
Activit6 4
Uinformation peut parfois Etre rnodalisde: l'emploi d'un temps, d'un mode,
ou d'un mot particulier peut suffire d nuancer le sens d'un titre.
Il est important de ,.p.r", ces rttodalisateurs car ils vous donnent des indices sur
o,
ct
=
CI
o-
\C)
:9
o
C'
cn
. 9
C'
ct
(J
\El
q,
CJ
v,
o)
C'
.9
(J
ct)
\ct
c'
ct)
)F
ct
trt
cn
1 .Le chef d' Et at h6si t e ent re un r6f 6rendum
popul ai re
et un r6f drendum
parl ement ai re
2. D' aprds un chercheur f ranEai s, l e g6nome de l a poul e pourrai t
ai der i r compr endr e cel ui de I ' homme
3. l -op6ra Basti l l e l ancera sa sai son avec l e Tri stan de Wagner
+. t - Et at f ranEai s devrai t cdder 77
, 7
y"
du capi t al d' Ai r France
5. Li gue des champi ons: Monaco se qual i f i e
6. Ann6e du Br6si l : t ous l es rendez-vous de l a scdne cul t urel l e
7. Bourse de Pari s: l e CAC 40 ouvre en bai sse de 0, 39 % a
3760, 34
poi nt s
g.
D6couverte de cri staux d' eau i l a surface du
gros ast6roTde Quaoar
9. I nt ervi ew du pr6si dent du
groupe nat i onal i st e i r I ' Assembl 6e de
Corse
10. En i l e-de-France, I ' errance de
pl us en pl us f ort e des enf ant s
mal l og6s
11. Longt emps oubl i 6e, l a scul pt euse Cami l l e Cl audel aur a enf i n
son mus6e i r Nogent-sur-Sei ne
40
Troisidme 6l6ment sur lequel s' oppuyer: le chopeou de l' orticle
(c' est-d-dire lo petite
pr6sentotion de l' orticle que l' on trouve souvent enfre le titre et l' orticle lui-m6me).
En soulignant les mots-cl6s du chapeau, vous devez 6tre capable de rep6rer la
rubrique d'ou il est issu et les enilux de I'article qu'il pr6sente.
Activit6 5
Voici un chapeau issu du Monde du 7 d6cembre 2OO4 dans lequel nous avons soulign6 tous
les mots-cl6s.
Le gouvernement avai t promi s que l e FNAEG
(Fi chi er
nat i onal aut omat i se des emprei nt es
gdnet i ques) accuei l l er ai t 400000 nouveaux
pr of i l s d' aut eur s de cr i mes ou del i t s chaque ann6e.
Pour I ' heure. seul s 40000 ont 6t 6 ent r6s. Les ci nq l aborat oi res charg6s de t rai t er l es dossi ers
sont submerg6s. S' i l veut rempl i r ses obj ect i f s, I ' Et at devra en
payer l e pri x.
Pi otr Svour.
1 .
a)
b)
c)
d)
2.
D6termi nez l a rubri que :
A quel uni vers l es mots
gdn1ti que et l aboratoi res renvoi ent-i l s? ....
Quel domai ne l e mol
gouvernement 6voque-t-i l ?
De
quel champ l es mots cri mes et dossi ers rel dvent-i l s? "
A vot r e avi s,
quel est I ' uni ver s l e pl us i mpor t ant l ci ? Dans
quel l e r ubr i que cl asser i ez- vous
donc I ' ar t i cl e? . . . .
a) Dans l e chapeau, rel evez:
-
un verbe au
pl us-que-parf ai t :
-
un verbe au
pr6sent :
-
un ver be au f ut ur : , r . . i . . .
b) Pourquoi ces troi s temps sgnt-i l s uti l i s6s? Que
peut-on en d6dui re?
3. D' apri s tous ces 6l 6ments,
quel serai t l e mei l l eur ti tre i donner d I' arti cl e?
!
Nombre de cri mi nel s en hausse ma1916 l es ef f ort s de I ' Et at
I
Di versi f i cat i on t roubl ant e des prof i l s cri mi nel s i r l ' 6t ude en France
n
Cr i se de cr oi ssance
pour l e f i chi er des empr ei nt es cr i mi nel l es
Activit6 6
Relevez les mots-cl6s des chapeaux d' articles suivants. Pour chaque chapeau, choisissez la
rubri que et l e ti tre l es
pl us appr0pri 6s'
Ghapeau 1:
LE MONDE | 08. 12.04 | 14h s5
Les coupes budg6taires touchent durement les associations, qui redoutent de ne plus pouvoir remplir
leur r6le, notamment en matidre de coh6sion sociale. Le gouvernement leur suggdre de se tourner vers
les collectivit6s territoriales.
qui ne
jugent pas possible d'accroitre leur effort financier.
R6sis Guvorer et B6atrice JnnOrvrn.
A. Entourez la ruhrique: Politique Emploi Culture
B. Choi si ssez l e mei l l eur ti tre:
I
Ti rai l l ement s ent re I ' Et at et l es coi l ect i vi t 6s t erri t ori al es
f ]
Les associ at i ons en pert e
de vi t esse dans l e domai ne soci al
f ]
t f t at i mpose I ' aust 6ri t 6 au mouvement associ at i f
Chapeau 2:
A. Ent ourez l a rubri que: Economi e Terre
pol i t i que
B. Ghoi si ssez l e mei l l eur t i t re:
f
La pol l ut i on
at mosph6r i que, l oi n de di mi nuer , est en hausse
I
Espoi rs et d6sespoi rs au sommet i nt ernat i onal sur l e rdchauf f ement
f
Le cl i mat f ranEai s voue d se modi f i er dans l es prochai nes
annees
Chapeau 3:
Tdldrama n" 2871
On le croyait au bord du gouffre, on s'est tromp6... Le cin6ma va mieux. Les FranEais, notamment les
plus de 50 ans, se bousculent d nouveau dans les salles obscures. On a mome enregistr6, en2004,le
plus grand nombre d'entr6es depuis vingt ans. Enqu6te. Et gros plan sur Evreux, 6ionnante <capitale
franEaise de la cin6philie >.
Ent ourez l a rubri que: Cul t ure Loi si rs Economi e
Choi si ssez l e mei l l eur t i t re:
f
Succds du ci nema f rangai s
I
l l s r et our nent au ci nema
t r
Les seni ors ai ment l e ci n6ma
A.
B.
Porfois, le texte n'o pos
de chopeou s6por6 du reste de l'orticle.
Cependont, le d6but du texte doit vous permettre de foire les m6mes rep6roges.
i.,
Regardez bien les debuts de texte qui vous sont propos6s
dans cetre partie
-: lr
+ Dans la partie
Production,icrite
en effet, on pourra
vous demand.r a.
rediger un article' et donc d'adopter le sryle d'un
journaliste:
les introductions de
presse ne ressemblent pas aux introductions formelles: en apparence, elles sont
moins structur6es; et pourtant,
si vous observez bien, elles sont trds structur6es...
Prenez modele
E.ntrainez-vous
d vous poser
des questions
simples :
euoi? eui? euand?
oil?
Comment ? Pourquoi ?
Activit6 7
Voi ci pl usi eurs
d6buts d' arti cl es.
pour
chacun:
A. R6pondez aux
questions
z Ouoi? Oui? Ouand?
B. choi si ssez l a rubri que dans l aquel l e on cl asserai t ce document.
C. Trouvez un titre d chaque article.
LE MONDE | 06.12.04 | 20h39
Alors que s'ouvre d Buenos Aires la dixibme conf6rence des Nations Unies sur le climat, M6t6o France
confirme l'impact consid6rable pour la France du changement climatique si la concentration de gaz
6mis par les activit6s humaines continue d'augmenter dans l,atmosphdre.
D6but 1 :
LE MONDE | 08.12.04 | I4hss
Mention passable. En trois ans, la France n'a ni am6lior6, ni aggrav6 ses performances scolaires.
L enqu6te
pISA
(programme international de suivi des acquis), men6e par I'OCDE
(Organisation de
coop6ration et de d6veloppement 6conomiques) en 2003 et rendue publique mardi 7 d6cembre,
confirme les r6sultats du premier travail de ce type, effectu6 par I'organisation en 2000. UAllemagne,
oi les travaux de l'OCDE font d6bat, et, plus encore, 1'Espagne et l'Italie, r6ussissent moins bien. En
revanche, les
pays-Bas,
la Belgique, la R6publique Tchbque ou encore la Suisse font mieux, tandis que
la Finlande, la Cor6e et le Japon caracolent toujours en t6te.
Vi rgi ni e M,l l txcRE.
Oui ?
q u r r
Quand?
B. Ent ourez l a rubri que: Educat i on Economi e EuroPe
C. Trouvez un titre:
LE MONDE | 09.12.04 | 13h52
Selon une 6tude men6e conjointement par des chercheurs de nationalit6s franEaise, belge, turque et
bulgare, le manque de sommeil provoque, entre autres cons6quences physiologiques, une stimulation
de l,app6tit. D'autre part, si la r6duction du temps de sommeil s'installe sur un mode chronique, elle
uog-"nt" notablement le risque de survenue d' une surchar-ee ponddrale. r' oire d' une ob6site. Cette
6tude, publi6e dans le dernier num6ro, dat6 du 7 d6cembre. des Annals of Int.-rnal \1.' die inc- 3 i-jl.i
dirig6e parles docteurs Karine Spiegel
(Centre d' 6tude des
Tthmes
biologiquc:. Unirer\itL;
lihrc Jc
Bruxelles) et Eve Van Cauter
(d6partement de m6decine, universitd de Chicago t'
Jean-\-r' e: \-rt-' .
A. 0uoi ?
Oui ?
Ouand
?
B. Ent ourez l a rubri que: Sant 6 Tr avai l Mode de vi e
C. Trouvez un ti tre:
D6but 3:
LE MONDE | 09. 12.04 | r3h52
Les amoureux du
pal ai s
de l a ddcouverte et tous ceux qui se sont passi onn6s pour l a sci c' ncc t' n r i ' i t' tl tt
ses expositions
ou en participant d des exp6riences
peuvent 6tre rassur6s. Des rumeurs collcc'rrlant lu
d6localisation
de ce ternple Je la scien ce
-
cr6 par Jean Perrin d l'occasion de l'Exposition unir cr:elle
de l93j
-
avaient circul6 il y a quelque temps. Une telle 6ventualit6 avait suscit6 les inquidtudes d'une
partie du personnel, qui avait lanc6 une p6tition de ddfense du mus6e sur son site Internet
(http://palais-
decouverte.eitic.org/petition).
sign6e
par l7 000 personnes'
Chrisrine Galus.
A. Ouoi ?
B. Ent ourez
l a rubri que:
D6but 2:
C. Trouvez un titre:
Sci ence Cul t ur e Ur bani sme
I
Bien rep6rer la structure du texte
En vous
gppuyont
sur le chopeou de l'orticle, vous de,rez 6he copoble d'en,risoger
le d6roulement du texte.
Activit6 guid6e
Reprenons I'exernple de I'activit6 5 :
Le gouvernement avai t prol l s que l e FNAEG
Ifi chi er
nati onal automati s6 des emprei ntes
96n6ti quesJ
accuei l l :t:l aj 00 0O0 nouveaux profi l s d' auteurs de cri mes ou d6l i ts chaque ann6e.
Pour l ' heure, seul s 40 000 ont 6t6 entr6s. Les ci nq l aboratoi res charg6s de trai ter l es dossi ers
sont submerg6s. S' i l veut rempl i r ses obj ecti fs, I' Etat devra en pager l e pri x.
A l'aide des temps, nous avons vu que le chapeau peut tre s6par6 en 3 parties
distinctes, qui annoncent un plan possible pour l'article.
Voici les questions que pose chaque partie:
l. Le gouvernement avait promis que le FNAEG (fichier
national automatisd des
empreintes g6n6tiques) accueillerait 400000 nouveaux profils d'auteurs de crimes ou ddlits
chaque ann6e.
+
Quelles
sont les missions du FNAEG ?
2. Pour I'heure, seuls 40000 ont 6t6 entr6s. Les cinq laboratoires chargds de traiter les
dossiers sont submergds.
-+
Quel
est le bilan iu FI'{AEG et quelles sont les raisons de cette situation ?
3. S'il veut remplir ses objectifs, l'Etatdevra en payer le prix.
+
Quelles
sont les cons,iquences pour
I'Etat ?
Quelles
sont les perspectiaes
? :
9i ,1b*.rent
cornrnelrlan possible de l'article:
l. Missions du FNAEG
2. Bilan et explications
3. Cons6quences et perspectives
Activit6 8
Reprenons les chapeaux de I' activit6 6.
En imitant le raisonnement que
nous venons d' avoir, donnez les ditfdrentes parties
du
d6veloppement qu' on peut
attendre.
1. Les coupes budgetai res touchent durement l es associ ati ons, qui redoutent de ne pl us pouvoi r
rempl i r l eur r6l e, notamment en mati ere de coh6si on soci al e. Le gouvernement
l eur suggdre
de se tourner vers l es col l ecti vi t6s terri tori al es, qui ne
j ugent pas possi bl e
d' accroi tre l eur
effort financier.
Al ors que
s' ouvre a Buenos Ai res l a di xi dme conf 6rence des Nat i ons uni es sur l e cl i mat ,
Met eo France conf i rme I ' i mpact consi derabl e pour l a France du changement cl i mat i que si l a
concent rat i on de gaz 6mi s par l es act i vi t es humai nes cont i nue d' augment er dans
I ' at mosphdre.
t',
2.
3. On l e croyai t au bord du gouf f re, on s' est t romp6. . . Le ci n6ma va mi eux. Les Franqai s,
not amment l es pl us de 50 ans, se bouscul ent 2r nouveau dans l es sal l es obscures' On a
m6me enregi st re, en 2OO4, l e pl us grand nombre d' ent r6es depui s vi ngt ans. EnquOt e. Et
gr os pl an sur Evr eux, 6t onnant e
" capi t al e f r anEat se de l a ci n6phi l i e' .
Vous entrez ensuite dons l' orticle lui-m6me.
Lo
plupqrt
du temps, le texte sero orgqnis6 en pqrogrophes cloirement s6por6s:
n' oublie= pot qu", le plus souvent, d ihoque porogrophe correspond une id6e princi
Activit6 9
Voici un article dont le titre et les intertitres ont 6t6 supprim6s. Lisez-le
puis r6pondez aux
questions.
I N T E n' reuu"A%*Yo
N A L
Courrier international
-
B dec. 2OO4
lrrTREl
llntertitre
1l
Deborah Hengartner,
jeune lyc6enne de 18 ans, a pris I'initiative avec deux autres dldves de sa classe de
lancer
<une exp6rience vestimentaire in6dite dans une 6cole publique suisse: le port de I'uniforrne>>,
rapporte Le Tbmps. L id6e est n6e l'6t6 dernier, quand le d6bat sur le port du voile s'enflammait en
Fiance, entrainant la classe dans une r6flexion sur le poids des apparences vestimentaires,
prdcise le
quotidien genevois. Aprds un mois de test, le r6sultat n'est pas concluant: la classe est divis6e en deux
camps 6gaux et <<chacun campe sur ses positions>>'
llntertitre
2l
En Suisse, of <<le port de I'uniforme ne coffespond d aucune tradition, sinon comme label des
6tablissements
chics et chers>>, poursuit Le Temps, cette exp6rience
<<est embl6matique du nouvel
int6r0t suscit6 par I' id6e de l' uniforme d 1' 6cole>. Une id6e qui provoque un ddbat passionn6' En Suisse
aldmanique,
c,est Rtidi Niitzi, directeur d'6cole et prdsident du Parti radical soleurois. qui a lance le
d6bat cet automne par une lettre ouverte, dans laquelle il affirme:
<Uuniforrne garantit un
environnement
optimal )r I'enseignement.
I1 aide d rdpondre aux soucis de discipline. C'est un mo).en
d,assurer le calme dans les classes, de concentrer 1'6ldve sur le contenu.
> En Suisse romande. le
journal
a demand6 d Isabelle Henzide Boissoudy, cr6atrice d'un site d'informations
pour les parents, d'aborder
le sujet sur le forum du site.
<En quelques
jours, une vingtaine d'internautes 6taient impliqu6s dans une
discussion
trds engag6e.
>
llntertitre
3l
<< Les partisans de la tenue unique y voient un moyen de contrer la tyrannie des apparences'
dans ses
manifestations
plus ou moins violentes >>, notamment le racket, relate le quotidien. En revanche, ses
d6tracteurs
sont convaincus
qu'elle <ne r6soudrait en rien>> les probldmes de violence.
<Ils ont surtout
des frissons d l,id6e d'une
"uniformisation"
qui 6voque pour eux le totalitarisme>>,
reldve le
journal'
i...fi
yevidence,
<le sujet fait mouche, car il touche une r6alit6 qui suscite un malaise gdn6ral>. Le
d6bat reste encore ouvert...
46
1 .
2.
Quel est l e thdme
pri nci pal de I' arti cl e?
t l
Li nt r oduct i on de I ' uni f or me a I ' ecol e.
n
Les d6ri ves vest i ment ai res a I ' ecol e.
I
La t radi t i on du port de I ' uni f orme.
Quel est I'objectif de ce texte?
t r
I nf ormer l es l ect eurs d' une si t uat i on de cri se d l ' 6col e.
n
Pr6sent er l es enj eux d' une cont roverse d' act ual i t e.
t r
Comparer l e t rai t ement d' un t hdme d' act ual i t 6 en France et en Sui sse.
3. Quel est l e r6l e de chaque paragraphe? Fai tes correspondre une foncti on i chaque paragraphe:
4. Associ ez i chaque paragraphe I' i nterti tre qui annonce l e mi eux son contenu:
paragraphe 1 o
paragraphe 2 o
paragraphe 3 o
paragraphe 1 o
paragraphe 2 o
paragraphe 3 o
5. Donnez ensui te un ti tre d I' ensembl e de I' arti cl e:
o preci ser l e contexte du d6bat
o
presenter l es arguments du debat
o i nt rodui re l e debat par un exempl e
o Des opi ni ons t ranch6es dans chaque camp
r Un nouveau d6bat , i nedi t et
passi onne, en Sui sse
o DrOl e d' exp6ri ence dans un l yc6e sui sse
Porfois, les porogrophes sont longs et il n'est pos possible de les synth6tiser sous lo
forme d'une seule id6e. Pour uoui rep6rer, il est olbrr essentiel que vous vous oppuyiez
sur les
qrticulolions
du texte.
Activit6 10
Voici un article de Courrier lnternational.
I N T E R*%/--""EryftY O N A L
Courrier international
-
8 dec. 2OO4
RUSSIE
-
Une tour Eiffel pour les Parisiens de I'Oural
Il 6tait une fois un village de la Russie profonde, situ6 dans I'Oural. I1 abrite deux mille dmes, des
Parisiens. En effet, la capitale franEaise a son homonyme dans la r6gion de Tcheliabinsk, situ6 dans le
sud de laFd6ration de Russie (h la frontidre du Kazakhstan). Mais la comparaison s'arrOte li. <A part
son nom, le Paris russe (Parizh) ne rappelle en rien le vrai Paris. C'est un gros village typique de la
campagne provinciale>>, soulignent les Novyd lzvestia*.
Cependant, ce village va bientdt recevoir un nouvel attribut renforgant son <<parisianisme>>: une tour
Eiffel. <<Certes, en version r6duite, six fois plus petite que son illustre grande scur, soit environ
50 mdtres de haut. >
<< Avant, ce n'6tait qu'un rOve, voire une blague >>, assure un responsable local. Mais la r6aIit6 a rattrapl
la fiction quand il fut question de doter le village d'une tour de t6l6communications. Une petite tour
Eiffel pour un petit Paris, l'id6e plut d une soci6t6 priv6e, qui prendra en charge le co0t de I'op6ration.
Elle sera plac6e au centre du village, en face de la Maison de la culture. Sa construction devrait Otre
achev6e en mars 2005. <<Les Parisiens sont convaincus que cette nouvelle curiosit6 sera leur carte de
visite. A pr6sent, les habitants se mettent d r6ver d'un Arc de triomphe et de Champs-Elys6es. >
Les Novyd lzvestia rappellent que de telles appellations g6ographiques sont h6rit6es de la p6riode
napol6onienne et du retour des soldats russes d'Europe occidentale. Ainsi, <<dans la r6gion de
Tcheliabinsk, Paris n'est pas trds loin d'un autre village, Berlin>.
x
Joumal local.
Dans l e t abl eau:
-
cl assez l es mots soul i gn6s sel on l a cat6gori e dont i l s rel dvent et essayez de trouver un synonyme
pour chacun;
-
di tes i
quoi vous associ ez chacun de ces mots:
l ndi cat eur
de temps
Arti cul ateur
l ogi que
Mot
(ou groupe de
mots) 6qui val ent
l d6e
que vous associ ez
i I' empl oi de ces mots
l l 6t ai t
une f oi s
Conte de f6e, chose improbable,
6v6 n e m e nt m e rvei | | e ux, s u rp re n a nt
En effet
Mai s
0 p po sitio n, c o ntra di cti on
Cependant
Certes
Avant
Mai s
A
preseni
Ai nsi
o
%W- WffiWWW%ffiWW%WW
WWffi
%ffiS
DEUX TYPES
ffiWWffiWWW%
ffiWWWWWWWW*
ldentifier la nature et la fonction du texte
Face i un texte,
quelles questions vous
posez-vous?
t r
L'-une des
premidres choses a se demander est:
euelle.rt
lu fonction de ce texte? Dans
quel but l'auteur I'a-t-il 6crit?
. Si son but est de divertir le lecteur, de 1'6mouvoir ou de stimuler son imagination,
le texte sera essentiellement
narratif.
. S'il cherche i pr6senter des faits, en les exposant de maniere neutre' sans donner
son avis. son texte sera inforrnatif.
. son ,.*a. sera au contraire argurnentatif
s'il cherche d exprimer son opinion sur
il;il.1}l;uu"rde
d'un. *unlGre
personnelle, ou s'il incite le lecteur a s'engager
dans un d6bat.
Activit6 1 1
pour
chacun des extrai ts sui vants, di tes dans
quel but i l a 6t6 r6di g6. Indi quez l es 6l 6ments
qui vous ont
Permi s
de l e cl asser.
Extrait 1 :
l _ai gl e
geant de Haast , rapace de Nouvel l e-Z6l ande
de
prds de t roi s mdt res d' envergure,
aul ourO; t rui
di sparu, est
paradoxal ement l e descendant d' un
pet i t oi seau, devenu
grand gr6ce a
47
COMPREHENSI ON DES ECRI TS
Je
peux lire avec un grand degr6 d'autonomie en adaptant le mode et la rapidit6 de
lecture d diff6rents textes et objectifs et en utilisant les r6f6rences convenables de
manidre s6lective.
Je
possdde un vocabulaire de lecture large et actif mais peux avoir des difficult6s avec
des expressions peu fr6quentes.
lJ6preuve
Bien qu'elle porte sur deux textes distincts, l'6preuve de compr6hension des 6crits est
assez courte.
En I heure, vous devez tre capable de:
-
lire deux textes d'une longueur d peu prds 6quivalente (maximum 600 mots)
;
souvent, il s'agira d'articles de
journaux;
-
r6pondre d deux questionnaires (comportant
chacun une petite dizaine de
questi ons).
Pour r6ussir cette 6preuve, il vous faut donc:
-
6tre capable de lire rapidernent: sachant que vous ne devez pas consacrenplus
de 30 minutes d chaque texte, il faut que vous puissiez rapidement saisir le sens
g6n6ral des textes.
-
connaitre les sp6cificit6s des textes propos6s: le premier texte a toujours pour
fonction essentielle d'informer le lecteur (texte informatif), tandis que le second
cherche ir convaincre, d6fendre une position, etc. (texte argumentati|
-
bien cornprendre ce que I'on vous dernande: la cl6 de la r6ussite, c'est souvent
de savoir ce que l'on attend de vous !
Les activit6s de la partie Pour oous entratner vortt vous permettre:
-
de devenir un lecteur efficace;
-
de vous familiariser avec les types de textes de l'6preuve 82;
-
d'apprendre comment r6pondre aux diff6rentes questions qui peuvent vous 6tre
pos6es.
La partie Vers I'dpreuzse vous proposera ensuite des questionnaires complets.
Pour v$trserstrsf;mer
r
WWW WW&WW WW WWffiW WWW WWW WffiffiffiW
Ne vous laissez pas impressionner par un texte, m0me
difficile !
GrAce au paratexte (c'est-d-dire tous les 6l6ments
(
en
titre, le chapeau...), aux mots-cl6s et ir la structure du
vous reperer.
ldentifier rapidement le texte
TERRE
-> ll faut du souffle pour planter une 6olienne dans son
jardin
. Si le < petit 6olien, s6duit de plus en plus de particuliers, les d6marches
et les investissements restent lourds et demandent une grande motivation.
Robert Laurent a 83 ans et une 6olienne dans son
jardin.
Pas pour faire
ioli
mais <<pour
2tre inddpendant du pdtrole>. Il poss6dait d6jd sa pompe d chaleur, il voulait produire son
6lectncit6: il a investi 17000 euros dans son installation, fonctionnelle depuis le 5
juillet.
<<Maintenant, tout ddpendra duvent... >> Uenvol6e des prix du brut donne des ailes au petit
6olien, beaucoup rOvent d'acqu6rir leur autonomie 6nerg6tique: 6lectricit6 ou eau chaude
gratuites. Mais ce march6 balbutiant requiert beaucoup d'dnergie et d'obstination de la part
des particuliers qui n'ont qu'une vague id6e du parcours d'obstacles d franchir.
\
t t .
Quatre
mois pour obtenir un permis
'.,
<<Elle n'est pas bruyante, sauf quand elle tourne vite.>> Premier dans le d6partement de la
Dordogne d arborer sa petite 6olienne, Robert Laurent a d0 s'accrocher: premidre 6tape,
le permis de construire obligatoire si le mdt d6passe 12 mdtres. Pour I'obteniq il faut
remplir des dossiers, fournir des plans d la direction de 1'6quipement, s'assurer que le
service d'arch6ologie n'y voit pas d'inconv6nient. Jusque-ld, tout est normal.
On lui demande alors d'envoyer son dossier h la Direction de l'aviation civile. Avis
favorable mais qui n'engage d rien: le dossier pafi a I'arm6e de l'air d Bordeaux, laquelle
consulte la marine, la gendarmerie, I'arm6e de terre (d cause des h6licoptdres, des
interf6rences sur les liaisons radios...) et impose un lclakage clignotant sur l'6olienne.
<<Finalement, en quatre mois,
j'ai
r,iussi d obtenir mon permis, c',itait une ddmarche
autant technique qu'intellectuelle,> Et pour laquelle il faut avoir le temps. A une
quinzaine de mdtres de sa maison, 1'6o1ienne s'61dve d24 mdtres, d6passant les arbres de
4 mdtres. Elle devrait fournir au retrait6 un tiers de sa consommation d'6lectricite. soit
entre 3000 et 4000 kWh par an.
commandes doubl6es chaque ann6e
L 6olienne individuelle s6duit une clientdle vari6e du moment qu'elle dispose d'un bout de
temain: <Nos clients sont des institutions, des colonies de vacances, des agriculteurs et
des particuliers entre 40 et 60 ans qui veulent mattriser leur cadre de vie, des
jeunes qui
se lancent ou des retraitds qui s'ennuient>>, explique Olivier Krug, qui importe la plupart
de ses machines de 1'6tranger et les installe. Il a d6marr6 en 2003, ses commandes doublent
chaque ann6e. Mais ce march6 soumis h une forte demande est encore anarchique: <<ll y a
encore beaucoup de bulles de savon
[des
vendeurs peu sdrieux], des machines qui ne
marchent pas, beaucoup de
frais
de mise au point et un r,iseau mal ddvelopp6.>>
t . . . 1 ^*'
Sylvie BRIET, Libdration,9 d6cembre 2005.
si le thdme vous semble
plus u du texte: la sourc:e, le
texte, vous pourrez tourours
@
I
I
w
Votre premier r6flexe, ovont_ m6me d'entrer dons lo lecture du texte, est de prendre
.onnoirronce de lo source du texte (outeur?
dote? rubrique? support?) : ce sont vos
premiers indices.
. .,: . . |
.
? l l a
Le plus squvent, il,s'agiia d'articles, issus de
journaux
francophones (voir illustration
: ' g34ct et oa1i no: ' ' i ] ; 1f af f i ' CI : i 11aml t t i r i ser aVeccesj our naux.
Le nom du
jourual
,ou.de,la:revue
d?oir,est issu l'article peut vous renseigner
,
:'
,r'.'
.immidiatqment'sulle,fype,dlantic,le
d,ont il s'agit: article issu d'un quotidien, d'un
hehdornadairc,
,dlun
mensuelr d'une
:rerrue
sp6cialis6e (science, 6conomie. . .), etc,,
La date vou*,perrnettra de voir s'il s'agit d'un article d'actualit6 ou non. .
Enf i n, . sel onquel est at ut del naut euf est pr 6ci s6ounon, vouSSaur ezsi vous
affaire d un sp6cialiste de la question ou d un simple
journaliste.
Activit6 1
Voici trois exemples. Essayez de caract6riser chaque article en fonction des indices
qui
vous sont donn6s
par les sources.
1. Source : Le Journal du Matin
15. 10. L974
Par Syl vai n Royan.
2. Source : Cahiers des sciences,
pr i nt emps 2OO5.
Par F. Garqon, chercheur en bi ol ogi e
mol 6cul ai r e.
3. Source : Courrier international
-
n" 758
-
I 2-I 8 mai 2005
Par Phi l i ppe Thur eau- Dangi n,
6di t or i al i st e.
Ge texte
est i ssu. . .
G'est
un ar t i cl e. .
l l a 6t6 6cri t
par . . .
f
d' un quot i di en
!
d' un hebdo
f
d' un mensuel
f
d' une r evue
sp6ci al i s6e
I
d' act ual i t 6
f
r6cent
I
assez anci en
I
un
j our nal i st e
I
un sp6ci al i st e
Ge texte
est i ssu. . .
C'est
un art i cl e. .
l l a 6t6 6cri t
par . . .
I
d' un quot i di en
I
d' un hebdo
f
d' un mensuel
f
d' une revue
sp6ci al i s6e
!
d' act ual i t 6
!
recent
fl
assez anci en
I
r
un
un
j ournal i st e
sp6ci al i st e
Ge texte
est i ssu. . .
C'est
un art i cl e. .
l l a 6t6 6cri t
par . . .
I
d' un quot i di en
I
d' un hebdo
I
d' un mensuel
f ]
d' une revue
sp6ci al i s6e
!
d' act ual i t 6
!
recent
fl
assez anci en
T
T
UN
UN
j our nal i st e
speci al i st e
Votre second r6flexe doit 6tre d'onticiper sur le contenu, d portir du titre de I'orticle.
Les titres peuvent 6tre donnes sous deux formes distinctes:
F
-
une forme coniugu6e;
* :
" ' r ' : : : l : : :
Entrainez.vous d passer aismqrt de I'un d I'autre : cela
peut 6tre'utile si,l'on vous
dema de:d'expliquet un titreo,de le,reforrnuler, ou,dlen cr6er un vous-mme.
Activit6 2
A. Voici une s6rie de titres d' articles. Pour chacun,
proposez
une
phrase compldte 6quivalente.
Exemple: Pr6ldvements d' ADN chez les malades + De I' ADN a ete prelev6 chez les malades.
1. Tensi ons ent re Et at et syndi cat s sur l a quest i on sal ari al e
-+
2. Ret ards dans I ' op6rat i on de s6curi sat i on des 6col es
-+
3. Vi ct oi re 6crasant e en t roi s set s du
j eune
Br6si l i en
-+
4. Recrut ement s en masse a l a r6dact i on du quot i di en
-+
5. Surpopul at i on dans l es f oyers de t ravai l l eurs mi grant s
-)
B. Voici une s6rie d' informations donn6es sous la forme d' une
phrase
conjugu6e.
Nominalisez-les de manidre d les transformer en titre d' article.
Exempl es; Une gal eri e d' art recrute des personnes handi cap6es
-+
Recrutement de personnes
handi cap6es
par une gal eri e d' art
1. La nat ure se venge. + . . .
2. l -opi ni on publ i que pourrai t se ret ourner.
-)
3. ShangaT s' 6vei l l e d I ' Ouest .
-+
4. Qui nze
post es devrai ent et re suppri m6s.
-)
. . .
5. Les FranEai s ret ournent au ci n6ma.
-)
. . .
Les mots du titre vous permettent souvent de savoir a quelle rubrique un texte
apparuent.
Ces rubriques varient d'un
journal
i l'autre. Il est cependant possible d'en d6limiter
quelques-unes, que I'on retrouve dans la plupart des
iournaux
francophones:
*
< Politique
)) (dont: international,
iustice...) ;
-
< Soci6te r (dont: vie quotidienne, 6ducation...)
;
-
< Economi e r (dont: entrepri ses, bourse...)
;
-
< Cul ture u (dont: m6di as, l i wes...)
;
-
< Sciences
)) (dont: nouvelles technologies, sant6...)
;
*
< Sport >.
Pour d6terminer la rubrique, il vous faut analyser les rnots-cl6s.
n.pr."o"r a titr. d'.*.*ile les deux pre*i.r, titres de l'activit6,2 A:
-
Pr6ldvernents d'ADN chez les rnalades
-+ rubrique <, Science D ou
(
Sant6
>
rubri ques < Economi e,r
et a Soci6t6 r
-
Tensions entre Etrt et syndicats sur la question salariale
->
40
Activit6 3
Voici
plusieurs
titres d' informations relatives i I' actualit6 de la
souf i gnez l es mots-cl 6s,
pui s
cochezl a rubri que dans l aquel l e
France. Pour chaque titre,
vous le classeriez.
o,
trr
cl
o-
\C)
:9
o
ct
o
c,
o
ct
o
\El
o,
(J
3n
ot
C',
ot
(J
cn
\o,
G'
cn
t
o
trL
ct)
1 .Le chef d' Et at h6si t e ent re un r6f 6rendum popul ai re
et un r6f 6rendum
parl ement ai re
2. D' aprds un chercheur f ranEai s, l e g6nome de l a poul e pourrai t
ai der i compr endr e cel ui de I ' homme
3. l -op6ra Basti l l e l ancera sa sai son avec l e Tri stan de Wagner
4. LEt at f ranEai s devrai t c6der 17, 7"/ " du capi t al d' Ai r France
5. Li gue des champi ons: Monaco se qual i f i e
6. Ann6e du Br6si l : t ous l es rendez-vous de l a scdne cul t urel l e
7. Bourse de Pari s: l e CAC 40 ouvre en bai sse de 0, 39 % a
3760, 34
poi nt s
8. D6couverte de cri staux d' eau d l a surface du gros ast6roi de Quaoar
9. I nt ervi ew du presi dent du
groupe nat i onal i st e ) I ' Assembl 6e de
Corse
10. En i l e-de-France, I ' errance de pl us en pl us f ort e des enf ant s
mal l og6s
11. Longt emps oubl i 6e, l a scul pt euse Cami l l e Cl audel aur a enf i n
son mus6e d Nogent-sur-Sei ne
Activit6 4
Uinformation peut parfois dtte rnodatisde: l'emploi d'un temps, d'un mode,
oud' unmot part i cu1i erpeut suf f i rei n. uancerl esensd. ' unt i t re.
I1 est important de rep6rer ces rrtodalisateurs car ils vous donnent des indices sur
la manidre dont il faut aborder le texte.
Dans les exemples suivants, choisissez la phrase qui correspond le mieux au sens.
1. Oui nze
postes devrai ent 6tre suppri m6s.
I
L' annonce de l a suppressi on des
postes a 6t6 confi rm6e.
I
La suppressi on de post es aura probabl ement l i eu.
f]
Contrai rement d ce
qu' on pensai t, l es postes ne seront
pas suppri m6s.
2. La scul pt euse Gami l l e Gl audel aura enf i n son mus6e.
t]
On n' est pas sOr que ce mus6e exi stera.
I
La scul pteuse sera l a derni dre i avoi r son mus6e.
tr
Ce mus6e 6tai t trds attendu.
Troisidme 6l6ment sur lequel s' oppuyer: le chopeou de I' orticle.(c' est-d-dire lo petite
pr6sentotion de l' orticle que l' on trouve souvent entre le titre et l' orticle lui-m6me).
En soulignant les mots-cles du chapeau, vous devez tre capable de rep6rer la
rubrique d'ou il est issu et les enieux de I'article qu'il pr6sente.
Activit6 5
Voici un chapeau issu du Monde du 7 d6cembre 2OO4 dans lequel nous avons soulign6 tous
les mots-cl6s.
Le gouvernement avai t promi s que l e FNAEG
(Fi chi er
nai i onal aut omat i s6 des emprei nt es
genet i ques) accuei l l er ai t 400000 nouveaux
pr of i l s d' aut eur s de cr i mes ou del i t s chaque ann6e'
Pour I ' heure. seul s 40000 ont 6t 6 ent res. Les ci nq l aborat oi res charges de t rai t er l es dossi ers
sont submerg6s. S' i l veut rempl i r ses obj ect i f s, I ' Et at devra en
payer l e pri x.
Pi otr Svour.
1. D6t ermi nez l a rubri que:
a) A
quel uni vers l es mots g6n6ti que eI l aboratoi res renvoi ent-i l s?
b) Quel domai ne l e mot gouvernement evoque-t-i l ?
c) De
quel champ l es mots cri mes et dossi ers rel dvent-i l s? ..
d) A vot re avi s,
quel est I ' uni vers l e pl us i mport ant i ci ? Dans
quel l e rubri que cl asseri ez-vous
donc I ' ar t i cl e ? . . . .
2. a) Dans l e chapeau, rel evez:
-
un verbe au
pl us-que-Parf ai t :
-
un verbe au
present : .
-
un ver be au f ut ur : , . . . .
b) Pourquoi ces troi s temps sont-i l s uti l i s6s? Que
peut-on en dddui re?
3. D' aprds tous ces 6l 6ments,
quel serai t l e mei l l eurti tre i donner i I' arti cl e?
I
Nombre de cri mi nel s en hausse mal gr6 l es ef f ort s de I ' Et at
; 1
Di versi f i cat i on t roubl ant e des
prof i l s cri mi nel s ?r l ' 6t ude en France
n
Cri se de croi ssance
pour l e f i chi er des emprei nt es cri mi nel l es
Activit6 6
Relevez les mots-cl6s des chapeaux d' articles suivants. Pour chaque chapeau, choisissez la
rubri que et l e ti tre l es
pl us appropri 6s.
Chapeau 1:
LE MONDE I 08.12.04 | l 4hss
Les coupes budg6taires touchent durement les associations, qui redoutent de ne plus pouvoir remplir
leur r6le, notamment en matidre de coh6sion sociale. Le gouvernement leur suggbre de se tourner vers
les collectivit6s territoriales, qui ne
jugent pas possible d'accroitre leur effort financier.
R6sis GuYornr et Bdatrice JenOvp.
41
Vous aimerez peut-être aussi
- Rezolvari Connexions 3Document288 pagesRezolvari Connexions 3Andreea67% (27)
- DELF B2 Sujet Candidat 3Document2 pagesDELF B2 Sujet Candidat 3Julián DavidPas encore d'évaluation
- Vocabulaire Progressif Du Francais Avance LIVRE CORRIGESDocument216 pagesVocabulaire Progressif Du Francais Avance LIVRE CORRIGESAngel Autricum88% (75)
- Parcours jeunes et FLS: Activités pédagogiques en français langue seconde, niveau B2 – C1 du CECRD'EverandParcours jeunes et FLS: Activités pédagogiques en français langue seconde, niveau B2 – C1 du CECRPas encore d'évaluation
- Vocabulaire visuel du français: Les heures, les couleurs, la famille, la maisonD'EverandVocabulaire visuel du français: Les heures, les couleurs, la famille, la maisonÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Hachette - Difficultes Du Francais PDFDocument47 pagesHachette - Difficultes Du Francais PDFMagda Miron100% (2)
- FLE - Pratique - OraleDocument72 pagesFLE - Pratique - OraleLouise-Apolline Pulchérie de Larouillette95% (19)
- Compréhension Écrite FlexitarienDocument1 pageCompréhension Écrite FlexitarienPaula Chena100% (1)
- Delf B2Document14 pagesDelf B2J. Jorge TorresPas encore d'évaluation
- Production Ecrite b1Document1 pageProduction Ecrite b1Alexia PomoniPas encore d'évaluation
- Delf b2 Test 7Document42 pagesDelf b2 Test 7fanita2267% (3)
- DELF DALF Manuel Examinateur Correcteur 2011Document33 pagesDELF DALF Manuel Examinateur Correcteur 2011Liliana Necula75% (4)
- Le Sexe et la Langue: Petite grammaire du genre en français, où l’on étudie écriture inclusive, féminisation et autres stratégies militantes de la bien-pensanceD'EverandLe Sexe et la Langue: Petite grammaire du genre en français, où l’on étudie écriture inclusive, féminisation et autres stratégies militantes de la bien-pensancePas encore d'évaluation
- Amis Et Compagnie 1Document18 pagesAmis Et Compagnie 1Magda Miron67% (3)
- Présentation Rapport de Fin D'étude - Firewall LogAnalyser Bilel ZranDocument41 pagesPrésentation Rapport de Fin D'étude - Firewall LogAnalyser Bilel ZranBilel ZranPas encore d'évaluation
- Questions Methode Des TestsDocument69 pagesQuestions Methode Des TestsPierre Antonin EymardPas encore d'évaluation
- Réussir Le DELF B2Document187 pagesRéussir Le DELF B2Cesar DavidPas encore d'évaluation
- Delf b2 GuidaDocument97 pagesDelf b2 GuidaAlianza Francesa Tres Arroyos0% (1)
- L'apprentissage du français en vue de l'intégration: réflexions autour de formateurs migrants et d'élèves allophonesD'EverandL'apprentissage du français en vue de l'intégration: réflexions autour de formateurs migrants et d'élèves allophonesPas encore d'évaluation
- Enseigner les langues étrangères: Quels sont nos objectifs et nos priorités ?D'EverandEnseigner les langues étrangères: Quels sont nos objectifs et nos priorités ?Pas encore d'évaluation
- Exemple DELF B2Document12 pagesExemple DELF B2DanPas encore d'évaluation
- Lexiquemission Delf FR-FR b2Document27 pagesLexiquemission Delf FR-FR b2helenePas encore d'évaluation
- Demo Dalf c1 Candidat Pe LSH v1Document6 pagesDemo Dalf c1 Candidat Pe LSH v1Adam812100% (1)
- EditoDocument9 pagesEditonoelcohen0% (1)
- B2 SJ Exemple2 CandidatDocument13 pagesB2 SJ Exemple2 CandidatLovira LadieskaPas encore d'évaluation
- Examen - ModDocument28 pagesExamen - Modmercedesortegaortega972750% (2)
- Focus Ressources Preparation Delf DalfDocument15 pagesFocus Ressources Preparation Delf DalfAbby Herrera VergaraPas encore d'évaluation
- DELF - B2 Exam Example1Document9 pagesDELF - B2 Exam Example1Sonja50% (2)
- Présentation B2Document31 pagesPrésentation B2JM D75% (4)
- Delf BibliographieDocument2 pagesDelf BibliographieHenry Morales100% (2)
- Expression Ecrite b2 PDFDocument2 pagesExpression Ecrite b2 PDFCheryl50% (4)
- Delf B2Document13 pagesDelf B2Shahrouz Mohajer100% (2)
- Delf B2Document9 pagesDelf B2Arma AnPas encore d'évaluation
- b1 SJ Exemple1 CandidatDocument11 pagesb1 SJ Exemple1 Candidatemna51Pas encore d'évaluation
- Dalf C1Document3 pagesDalf C1Phương HàPas encore d'évaluation
- b2 Pro Exemple CandidatDocument15 pagesb2 Pro Exemple CandidatHoang-Vu Bui0% (1)
- Delf B2 Marqueurs Presentation OraleDocument1 pageDelf B2 Marqueurs Presentation OraleMustapha Mektan100% (1)
- Delf B2 PDFDocument8 pagesDelf B2 PDFVaryzaa ChaniagoPas encore d'évaluation
- c1 Nouveau Example1 Dalf CandidatDocument32 pagesc1 Nouveau Example1 Dalf Candidatyosra DridiPas encore d'évaluation
- Table de Contenus EditoDocument5 pagesTable de Contenus EditoDajana KantardžićPas encore d'évaluation
- Demo C1Document20 pagesDemo C1GUANYU LUPas encore d'évaluation
- Delf b2Document11 pagesDelf b2nicolas maamaryPas encore d'évaluation
- Comment Réussir Le DALF C1Document4 pagesComment Réussir Le DALF C1Cristiane Florek100% (1)
- Communication Progressive de Francais Des Affaires Interme Diaire PDFDocument164 pagesCommunication Progressive de Francais Des Affaires Interme Diaire PDFHrytsaichukKaterynaPas encore d'évaluation
- Livres DALF C1Document2 pagesLivres DALF C1Haricleia Plesoianu0% (2)
- DELF B2 Transcriptions CorrigesDocument40 pagesDELF B2 Transcriptions CorrigesTung NguyenPas encore d'évaluation
- Delf B1Document7 pagesDelf B1Salomé QuinteroPas encore d'évaluation
- Cle IzdanjaDocument10 pagesCle Izdanjaproba100% (1)
- Delf B2Document13 pagesDelf B2Shahrouz MohajerPas encore d'évaluation
- Delf Dalf b2 TP Candidat Coll Sujet Demo PDFDocument13 pagesDelf Dalf b2 TP Candidat Coll Sujet Demo PDFArShadPas encore d'évaluation
- Le Participe passé dans tous ses états: Petit traité de l'Accord du Participe passé avec être et avoirD'EverandLe Participe passé dans tous ses états: Petit traité de l'Accord du Participe passé avec être et avoirPas encore d'évaluation
- French Phrasebook for Tourism, Friendship & FunD'EverandFrench Phrasebook for Tourism, Friendship & FunÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3)
- Naturalisation Française : 100 Questions Réponses pour Réussir son EntretienD'EverandNaturalisation Française : 100 Questions Réponses pour Réussir son EntretienPas encore d'évaluation
- Knock de Jules Romains (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandKnock de Jules Romains (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Expressions françaises de tous les jours avec la traduction en russeD'EverandExpressions françaises de tous les jours avec la traduction en russeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- La coarticulation en français et en chinois : étude expérimentale et modélisation: ThèseD'EverandLa coarticulation en français et en chinois : étude expérimentale et modélisation: ThèsePas encore d'évaluation
- Se refaire la cerise: Florilège de 400 expressions familières mises en proseD'EverandSe refaire la cerise: Florilège de 400 expressions familières mises en prosePas encore d'évaluation
- Le Messager 14-2016 PDFDocument140 pagesLe Messager 14-2016 PDFMagda MironPas encore d'évaluation
- Le Messager 14-2016Document140 pagesLe Messager 14-2016Magda MironPas encore d'évaluation
- La Communication Dans La Classe de LangueDocument364 pagesLa Communication Dans La Classe de LangueMagda Miron0% (1)
- 15 Fiches Pédagogiques Niveau A2Document116 pages15 Fiches Pédagogiques Niveau A2Honghanh NguyenPas encore d'évaluation
- Carnet f1Document31 pagesCarnet f1Laura CubillosPas encore d'évaluation
- Reflets 3Document130 pagesReflets 3Magda Miron100% (3)
- Reflets 3Document129 pagesReflets 3Magda Miron100% (1)
- 26 - Fichier - Approche Pédagogique de La ChansonDocument4 pages26 - Fichier - Approche Pédagogique de La ChansonMagda MironPas encore d'évaluation
- Alter Ego 1 - ManuelDocument193 pagesAlter Ego 1 - ManuelAndrei Av95% (134)
- Reflets 3 Le Livre de L EleveDocument177 pagesReflets 3 Le Livre de L Eleveivecen90Pas encore d'évaluation
- 2397969898Document159 pages2397969898Magda MironPas encore d'évaluation
- Fileshare - Ro An1 Gramaire FR CristeaDocument283 pagesFileshare - Ro An1 Gramaire FR CristeaMagda MironPas encore d'évaluation
- 2397969898Document159 pages2397969898Magda MironPas encore d'évaluation
- Master Genie Civil 0Document3 pagesMaster Genie Civil 0ChawkiTrabelsiPas encore d'évaluation
- ChatDocument13 pagesChatAblaye NdiéguénePas encore d'évaluation
- Chapitre3 TCDMDocument20 pagesChapitre3 TCDMMohamedBenChiekhPas encore d'évaluation
- Revdh 755Document44 pagesRevdh 755maissaPas encore d'évaluation
- Atlas Routier 2021 Version FrancaiseDocument90 pagesAtlas Routier 2021 Version FrancaiseBoutas SoumiaPas encore d'évaluation
- Programme - Du - Francais - en - Secondaire - Tableau SynoptiqueDocument3 pagesProgramme - Du - Francais - en - Secondaire - Tableau SynoptiqueSalim SaliimPas encore d'évaluation
- OGILVIE, Bertrand. Lacan - La Formation Du Concept de SujetDocument129 pagesOGILVIE, Bertrand. Lacan - La Formation Du Concept de SujetOdimar FeitosaPas encore d'évaluation
- Argu Mentaire Diabete 2006Document158 pagesArgu Mentaire Diabete 2006api-26081450Pas encore d'évaluation
- 09b-ANOVA Plusieurs Critres de ClassificationDocument50 pages09b-ANOVA Plusieurs Critres de Classificationmehdi.chlif4374Pas encore d'évaluation
- Liberte: Ouyahia Défend Toufik Et Le DRSDocument26 pagesLiberte: Ouyahia Défend Toufik Et Le DRSAli Nabil BenzenounePas encore d'évaluation
- MemoireDocument111 pagesMemoireAbdelwahab El HadiriPas encore d'évaluation
- Kalimat at TawheedDocument4 pagesKalimat at Tawheedabouno3manPas encore d'évaluation
- En Quête de RienDocument10 pagesEn Quête de RienMónica PalacioPas encore d'évaluation
- Cours Ouverture AtlantiqueDocument9 pagesCours Ouverture Atlantiquejohanulrich70100% (1)
- 2018 AnnalesDocument21 pages2018 AnnalesSaeb zianghoPas encore d'évaluation
- Enquete MetierDocument4 pagesEnquete MetiersnakeyesvanePas encore d'évaluation
- UntitledDocument13 pagesUntitledrebuberPas encore d'évaluation
- Passé Composé 1.-Aprende Con MelDocument1 pagePassé Composé 1.-Aprende Con MelMelissa SEPas encore d'évaluation
- chatGPT Théorie Des RHDocument4 pageschatGPT Théorie Des RHMounia HantatPas encore d'évaluation
- U7 Fiche Methode Comment Determiner La Valeur Exacte D'N Cosinus Ou D'un SinusDocument1 pageU7 Fiche Methode Comment Determiner La Valeur Exacte D'N Cosinus Ou D'un SinusIkeoPas encore d'évaluation
- ThermoDocument4 pagesThermoAntes de Partir, A.C.Pas encore d'évaluation
- ListesradarsfixesDocument4 pagesListesradarsfixesYoussef MajdoubPas encore d'évaluation
- Assemblée Générale de La FGF Et Université de Perfectionnement Des Géomètres Francophones D'afrique SubsaharienneDocument72 pagesAssemblée Générale de La FGF Et Université de Perfectionnement Des Géomètres Francophones D'afrique SubsaharienneUnited Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)Pas encore d'évaluation
- Dictionnaire Économique - L'Économie Mot À Mot 20PDocument129 pagesDictionnaire Économique - L'Économie Mot À Mot 20PradoniainaPas encore d'évaluation
- Cahiers de Douai, Arthur Rimbaud, 1919.: Etude Linéaire de Ma BohêmeDocument4 pagesCahiers de Douai, Arthur Rimbaud, 1919.: Etude Linéaire de Ma BohêmeessertaizeemmaPas encore d'évaluation
- STATISTIQUEDocument62 pagesSTATISTIQUECelestin KibishingoPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Metrologie PDFDocument35 pagesChapitre 2 Metrologie PDFMariam Sajid100% (1)
- Inpsy 9504 0271Document10 pagesInpsy 9504 0271khalidsk1Pas encore d'évaluation