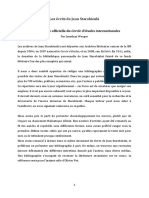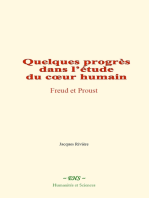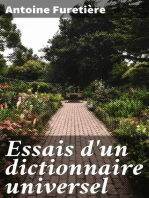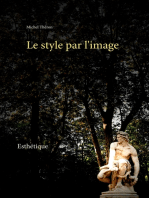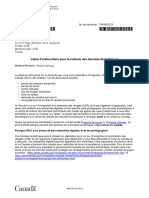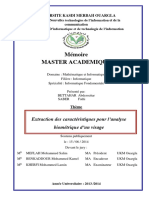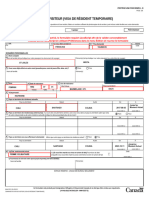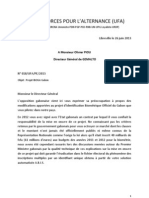Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Canguilhem - Normal Et Pathologique
Canguilhem - Normal Et Pathologique
Transféré par
Laurent DuvivierCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Canguilhem - Normal Et Pathologique
Canguilhem - Normal Et Pathologique
Transféré par
Laurent DuvivierDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bernard Dantier
(20 aout 2011)
(docteur de lcole des Hautes tudes en Sciences Sociales)
Textes de mthodologie en sciences sociales
choisis et prsents par Bernard Dantier
Statistique, moyenne, norme et anormalit :
Georges Canguilhem,
Le normal et le pathologique
EXTRAIT DE : CANGUILHEM, GEORGES, Le normal et le pathologique,
Paris, PUF, collection Galien , 1979 (1re dition 1966)
pp. 96-117, 155-157, 175-179.
Un document produit en version numrique par M. Bernard Dantier, bnvole,
Docteur en sociologie de lcole des Hautes tudes en Sciences Sociales
Courriel: b.dantier@icp.fr
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
dirige et fonde par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Site web: http://classiques.uqac.ca/
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de lUniversit du Qubec Chicoutimi
Site web: Site web: http://bibliotheque.uqac.ca/
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
Politique d'utilisation
de la bibliothque des Classiques
Toute reproduction et rediffusion de nos fichiers est interdite,
mme avec la mention de leur provenance, sans lautorisation
formelle, crite, du fondateur des Classiques des sciences sociales, Jean-Marie Tremblay, sociologue.
Les fichiers des Classiques des sciences sociales ne peuvent
sans autorisation formelle:
- tre hbergs (en fichier ou page web, en totalit ou en partie) sur un serveur autre que celui des Classiques.
- servir de base de travail un autre fichier modifi ensuite par
tout autre moyen (couleur, police, mise en page, extraits, support,
etc...),
Les fichiers (.html, .doc, .pdf, .rtf, .jpg, .gif) disponibles sur le
site Les Classiques des sciences sociales sont la proprit des
Classiques des sciences sociales, un organisme but non lucratif compos exclusivement de bnvoles.
Ils sont disponibles pour une utilisation intellectuelle et personnelle et, en aucun cas, commerciale. Toute utilisation des
fins commerciales des fichiers sur ce site est strictement interdite
et toute rediffusion est galement strictement interdite.
L'accs notre travail est libre et gratuit tous les utilisateurs. C'est notre mission.
Jean-Marie Tremblay, sociologue
Fondateur et Prsident-directeur gnral,
LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES.
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
Un document produit en version numrique par M. Bernard Dantier, bnvole,
Docteur en sociologie de lcole des Hautes tudes en Sciences Sociales
Courriel: b.dantier@icp.fr
Textes de mthodologie en sciences sociales choisis et prsents
par Bernard Dantier:
Statistique, moyenne, norme et anormalit :
Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique.
Extrait de:
CANGUILHEM, Georges, Le normal et le pathologique, Paris, PUF,
collection Galien , 1979 (1re dition 1966) pp. 96-117, 155-157, 175-179.
Utilisation des fins non commerciales seulement.
Polices de caractres utilise:
Pour le texte: Times New Roman, 14 points.
Pour les notes de bas de page: Times New Roman, 12 points.
Citation: Times New Roman, 12 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft
Word.
Mise en page sur papier format: LETTRE US, 8.5 x 11.
dition complte Chicoutimi, Ville de Saguenay, Royaume du Saguenay, Qubec, le 10 octobre 2011.
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
Textes de mthodologie en sciences sociales
choisis et prsents par Bernard Dantier:
Statistique, moyenne, norme et
anormalit : Georges Canguilhem,
Le normal et le pathologique
Extrait de:
CANGUILHEM, Georges, Le normal et le pathologique,
Paris, PUF, collection Galien , 1979
(1re dition 1966) pp. 96-117, 155-157, 175-179.
Par Bernard Dantier, sociologue
(20 aot 2011)
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
Statistique, moyenne, norme et anormalit :
Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique
Quelles sont la nature et la fonction de la norme dans les
sciences sociales ? La doxa scientifique moderne exige que ces
sciences, pour tre homologues telles, soient axiologiquement
neutres . Cette neutralit face aux valeurs (valeur au sens de
ce qui vaut la peine dagir parce quutile un besoin, un dsir) correspondrait une absence absolue dengagement (au sens
sartrien) en faveur de certaines valeurs (et non pas de toutes les
valeurs, car une valeur prend son sens en se diffrenciant dune
autre dans un systme dopposition; une valeur reste valeur tant
quelle en rejette dautres considres comme ne valant rien et
mme comme nuisibles, autrement dit une valeur consiste en ce
qui est prfrable ). La neutralit scientifique, somme toute, quivaut aussi bien une abstention lencontre de toute valeur
quinversement une adhsion pour toutes les valeurs (adhsion
qui accomplirait une quit parfaite pour toutes les exigences possibles de mme quen mme temps elle dsamorcerait, neutraliserait , les valeurs en les rassemblant dans une dissolvante unit
o elles perdraient leur diffrentielle nature).
La norme qui rendrait donc normales les sciences sociales (celles anormales tant compromises dans des finalits
trangres la valeur de la science qui consiste faire de la
science pour la science et non pour dautres fins quelle-mme,
que celles-ci soient morales, sociales, politiques, conomiques,
etc.) rsiderait dans une conduite non normative de ces sciences, non normative au sens de non-productrice de norme (au
singulier ou au pluriel). En tant non normative, une science sociale, dans ses fondements mthodologiques, nimpose pas a priori au
monde un devant tre (comme disait Hegel), accepte ltant
tel quil apparat et ninterprte pas comme normal tel fait et
anormal tel autre, ne rejetant ou rprouvant pas celui-ci au profit de celui-l. De mme une science sociale non normative,
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
normale , travaille mettre en question et tester la validit de
ses hypothses, sans les prposer comme des thses auxquelles le
rel expriment devrait se conformer ou, dfaut, tre ni comme
rel, ni au sein dune exprience qualifie de anormale .
Une science sociale se doit donc dtre exempte sa source de
norme daprs laquelle elle tudierait ses objets en valuant
leur normalit . Dans ces conditions, une norme ne peut prtendre lexistence quen dcoulant a posteriori des objets tudis.
La norme de lobjet dtude rendrait, en tant suivie, normale
ltude cet objet. Cest ce quon appellerait lobjectivit , autrement dit la normalit de la connaissance norme par ce quest
lobjet et non pas par ce qui motive (subjectivement) la dmarche
de la connaissance.
Il sagirait donc dnoncer, aprs observation, exprience et vrification, que tel objet prsente telle norme. Certes, mais comment
telle norme se manifeste par lobjet ? Nous dirions quelle se manifeste en montrant une action rgulire dans lobjet et dans tous
les autres objets appartenant une mme catgorie. Rgulire
au sens de constante, invariable, rpte, etc., ainsi quau sens de
qui suit la rgle ordinaire, est conforme aux normes comme le
dfinit par exemple le dictionnaire Antidote. Seraient de la sorte
hors norme, anormaux , des phnomnes non ordinaires,
extra-ordinaires .
Devons-nous donc penser et dire : doivent tre jugs anormaux, hors de la norme de lobjet tudi des phnomnes rares,
numriquement exceptionnels ? La normalit saccroitraitelle avec sa quantit ? Le comptage, laddition, et la comparaison
des sommes des additions serviraient-ils mesurer et attester la
plus ou moins normalit dun phnomne ou dune srie de phnomnes ? De plus nous devrions envisager que ces phnomnes
seront plus ou moins anormaux selon le plus ou moins grand cart
de leurs caractristiques celles attendues en fonction de la norme
en vigueur. Nous pourrions dj nous demander partir de quel
cart une manifestation sloigne trop de ce quelle devrait tre
selon la norme prise en rfrence. Nous apercevons ici que nous
entrons dans le domaine dangereux du devant tre et de la sub-
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
jectivit, cause de la dmarcation que nous devrions tracer entre
le normal et lanormal au sein de lcart. Le moyen de contourner
ce risque consisterait estimer que tout cart, le plus rduit et infime fut-il, ce qui est attendu dans tel cadre dexprience, devrait
tre jug anormal. Mais nous savons trop quaucun fait nest jamais totalement identique un autre et quune variabilit surgit
sans cesse dans ce qui est tudiable. Le dterminisme (qui
sapplique faire dpendre chaque vnement singulier dune loi
gnrale), ce dterminisme animant une science tente toujours, par
les grands nombres de ses observations, de dpasser le hasard agissant sur chaque unicit des cas; la science dterministe, par-del
les varits rencontres, multiplie les rencontres de ces varits
pour dvoiler dans leur ensemble une constante, quitte ce que
cette constante soit majoritaire et non totalitaire.
Comment alors, au travers des variations de lobjet et des autres
objets appartenant une catgorie, percevoir une norme agissante,
et non pas des normes diverses et toujours singulires qui ainsi ne
paraitraient plus normes ?
Le premier rflexe des sciences sociales, imitant les sciences de
la nature, conduit tenter de neutraliser les variations en oprant
dabord une conversion des caractristiques dun ensemble catgoriel de faits en quantits de certaines units. Par exemple, conversion des proprits dun tre humain en quantit dges (25 ans),
de sexe (un sexe masculin correspondant une quantit zro de
sexe fminin et vice versa), de revenus financiers (tant deuros ou
de dollars de salaire, etc.), de capital culturel comme dirait
Pierre Bourdieu (4 ou 7 annes dtudes suprieures, etc.), dactes
(achats de tels biens, sorties au cinma, etc.). La sociologie tend
fortement cette conversion quantitative de ce qui au dpart nest
saisissable que comme qualit, dans notamment sa mise en place
de variables indpendantes (par exemple lge, le sexe, le capital
culturel) et de variables dpendantes (telles pratiques de loisirs
culturels ou de consommations utilitaires, etc.) supposes tre les
effets des premires. Puis, aprs cette conversion dune qualit en
quantit, les sciences sociales, toujours dans leur rflexe imitatif,
calculent la somme des quantits recueillies avant de la diviser par
leur nombre, afin dobtenir la fameuse moyenne dune catgorie de
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
faits. De la sorte, on dcouvrira par exemple que les femmes ayant
un diplme gal ou suprieur quatre annes dtudes universitaires ont en moyenne 0,8 enfant et on estimera quune relation
causale sexercera entre ces deux quantits, dans un sens ou dans
lautre. On en viendra dduire quil est normal quune femme
ayant tudi au moins quatre annes luniversit ait 0,8 enfant (en
expliquant ventuellement que ce nombre rduit denfant est caus
par linvestissement en temps et en nergie que rclament de longues tudes suprieures, temps et nergie incompatibles avec le
temps et lnergie ncessaires une procration plus nombreuse).
Dans le mme mouvement on en viendra considrer que
lextrme minorit de femmes tant du mme niveau universitaire,
mais tant mres de 6 enfants, sera hors norme, au point mme de
juger anormal (inexplicable, non dtermin) leur nombre
denfants ou leur nombre dannes dtudes suprieures.
Mais nous constatons bien que cette norme que les sciences sociales tentent dtaler par une moyenne se rduit une fiction : 0,8
enfant ne permet videmment pas de faire natre un enfant. Claude
Bernard, dans son Introduction ltude de la mdecine exprimentale, se moquait dj des biologistes et physiologistes qui prtendaient par exemple dcouvrir la composante normale de lurine
humaine en recueillant et mlangeant toutes les urines dun urinoir
utilis par un maximum dindividus, en dnombrant les diverses
composantes de ce recueil avant den diviser la somme par le
nombre des individus fournisseurs.
Une moyenne ne se manifeste exactement chez aucun individu.
En recours, les sciences sociales, limitation encore des sciences
de la nature, essaient de corriger la fiction de la moyenne en calculant lcart type (faisant partie des paramtres dit de dispersion ), cart type qui prend en compte les carts de chaque quantit la moyenne de toutes les observations, mais pour son tour
produire une moyenne de ces carts. Certes plus lcart type sera
rduit (proche de zro, zro tant la moyenne) plus la moyenne
initiale devient susceptible dtre reprsentative dune vritable
constante, constante qui serait leffet direct de la norme. Mais toutefois lcart type, en se calculant par rapport la moyenne initiale,
conserve malgr tout la dfaillance mthodologique de celle-ci. On
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
peut aussi recourir la modale ou au mode qui est la valeur
(la quantit) prsente par le plus grand nombre dindividualits
dans une srie (par exemple sur 100 personnes, 33 ont accompli
cinq annes dtudes suprieures, ce 33 constituant la majorit
relative des cas). On sapplique de la sorte mettre au jour une valeur (cinq annes dtudes suprieures) qui soit effectivement prsente (relle) chez des individus et en mme temps relativement
majoritaire comme une esquisse de tendance. Mais l encore on
reste, quant au calcul de la norme, dans une approximation plus
prospective que descriptive.
Nous pouvons ici constater la difficult de rechercher une norme dans une constante la plus invariable possible. Nous avons dcrit les problmes rencontrs par des sciences sociales prenant modle sur les sciences de la nature en recherchant linvariance pour
capter la norme et devenir ainsi normales . Mais si nous inversions cette dmarche des sciences sociales en ne leur fixant plus
comme prototype une science telle la physique ? Si, en sciences
sociales, au lieu de rechercher la norme dans linvariance, nous la
cherchions dans la variance, la variation (autrement dit dans les
paramtres de dispersion) ?
Les recherches opres par le philosophe, mdecin et historien
des sciences Georges Canguilhem (1904-1995), dont un extrait est
prsent ci-dessous, montrent, lencontre des approches classiques, que mme dans lunivers de la biologie et de la physiologie
le normal rside dans lorganisme qui varie et ne demeure pas
stable et constant. La normalit se trouve dans les transformations
des normes par le vivant, lorganisme variant en fonction certes
des modifications des conditions environnementales, cependant
non pas dans un dterminisme unilatral o une cause extrieure au
vivant agirait sur les changements de celui-ci, mais dans une interaction o cest le vivant qui contient dans son dynamisme le facteur volutif. Dans ltre humain comme dans tout tre vivant, ce
qui persiste rester identique soi en dpit de mutations du milieu,
savre pathologique : lorganisme devient malade parce
nvoluant pas pour sadapter des modifications lentourant et le
conditionnant. Toutefois, tant que lorganisme survit dans sa maladie en saccrochant son organisation et son fonctionnement
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
10
antrieurs, en se conservant par la conservation malgr tout de
son mode de vie, il demeure dune certaine faon normal , parce
que toute vie comme toute existence ne subsiste pas sans une correspondance une condition de survie ou dexistence, cest--dire
sans une norme. Mais cette normalit est une normalit rduite
et phmre. Si lorganisme malade perd totalement les assises initiales sur lesquels il sest constitu, il disparat en tant incapable
de sortir de son ancienne norme de vie et de sen crer une nouvelle. Lorganisme sain, linverse, lest parce quencore dou de la
puissance de rnover sa norme (son mode dorganisation et de
fonctionnement) pour utiliser selon ses besoins la nouvelle configuration des ressources lentourant. En ce sens lorganisme sain
devient anormal si on le compare ce quil a t ou ce que sont
dautres organismes de la mme catgorie demeurant dans un environnement inchang. Cette anormalit, cette variation qui le fait
scarter de la moyenne le concernant, provient du pouvoir normatif du vivant : le vivant produit ses normes, et cela continuellement selon les altrations survenant dans son environnement
mais aussi selon lexpansivit et la crativit qui caractrisent le
vivant.
Selon nous, il ne sagit donc plus de reprer une normalit dans
une constance (reprsente entre autres par la moyenne ou une majorit numrique de telle caractristique), mais dans une inconstance. Puisque les sciences sociales sappliquent la vie humaine, elles seraient dans lerreur en sattachant dmontrer des tendances
sociales vers des rgularits. Lorsque la sociologie veut, notamment par des frquences statistiques, exposer des invariances dans
lorganisation et le fonctionnement dune socit en prtendant de
la sorte nous mettre en contact avec la formation mme de cette
socit et lanimation mme de son activit, soit elle ntudie que
de la matire physique et non vivante, soit elle sattarde sur une
socit pathologique qui se meurt et devient trangre la vie sociale.
Bernard Dantier, sociologue
20 aot 2011
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
11
Georges CANGUILHEM :
extrait de
CANGUILHEM, Georges, Les normal et le pathologique,
Paris, PUF, collection Galien , 1979 (1re dition 1966), pp.
96-117, 155-157, 175-179.
Nota : pour courter le texte et allger la lecture, nont pas t reproduites les
rfrences bibliographiques ajoutes par lauteur (des signes tels que () ou
[] indiquent ces suppressions).
Page 96 117.
Il semble que le physiologiste trouve dans le concept de
moyenne un quivalent objectif et scientifiquement valable du
concept de normal ou de norme. Il est certain que le physiologiste
contemporain ne partage plus l'aversion de Cl. Bernard pour tout
rsultat d'analyse ou d'exprience biologique traduit en moyenne,
aversion qui a peut-tre son origine dans un texte de Bichat : On
analyse l'urine, la salive, la bile, etc., prises indiffremment sur tel
ou tel sujet : et de leur examen rsulte la chimie animale, soit :
mais ce n'est pas l la chimie physiologique ; c'est, si je puis parler
ainsi, l'anatomie cadavrique des fluides. Leur physiologie se
compose de la connaissance des variations sans nombre qu'prouvent les fluides suivant l'tat de leurs organes respectifs [].
Claude Bernard n'est pas moins net. Selon lui, l'emploi des moyennes fait disparatre le caractre essentiellement oscillatoire et rythmique du phnomne biologique fonctionnel. Si par exemple on
cherche le nombre vrai des pulsations cardiaques par la moyenne
des mesures prises plusieurs fois en une mme journe sur un individu donn on aura prcisment un nombre faux . D'o cette
rgle : En physiologie, il ne faut jamais donner des descriptions
moyennes d'expriences parce que les vrais rapports des phnomnes disparaissent dans cette moyenne ; quand on a affaire des expriences complexes et variables, il faut en tudier les diverses cir-
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
12
constances et ensuite donner l'exprience la plus parfaite comme
type, mais qui reprsentera toujours un fait vrai []. La recherche de valeurs biologiques moyennes est dpourvue de sens en ce
qui concerne un mme individu, par exemple l'analyse de l'urine
moyenne des 24 heures est l'analyse d'une urine qui n'existe pas
puisque l'urine du jene diffre de l'urine de la digestion. Cette recherche est galement dpourvue de sens en ce qui concerne plusieurs individus. Le sublime du genre a t imagin par un physiologiste qui, ayant pris de l'urine dans un urinoir de la gare d'un
chemin de fer o passaient des gens de toutes les nations, crut pouvoir donner ainsi l'analyse de l'urine moyenne europenne [].
Sans vouloir ici reprocher Cl. Bernard de confondre une recherche et sa caricature et de charger une mthode de mfaits dont la
responsabilit revient ceux qui l'utilisent, on se bornera retenir
que, selon lui, le normal est dfini comme type idal dans des
conditions exprimentales dtermines, plutt que comme moyenne arithmtique ou frquence statistique.
Une attitude analogue est, nouveau et plus rcemment, celle
de Vendrys dans son ouvrage Vie et probabilit, o les ides de
Cl. Bernard sur la constance et les rgulations du milieu intrieur
sont systmatiquement reprises et dveloppes. Dfinissant les rgulations physiologiques comme l'ensemble des fonctions qui
rsistent au hasard [], ou si l'on veut des fonctions qui font
perdre l'activit du vivant le caractre alatoire qui serait le sien
si le milieu intrieur tait dpourvu d'autonomie vis--vis du milieu
extrieur, Vendrys interprte les variations subies par les constantes physiologiques la glycmie par exemple comme des
carts partir d'une moyenne, mais d'une moyenne individuelle.
Les termes d'cart et de moyenne prennent ici un sens probabilitaire. Les carts sont d'autant plus improbables qu'ils sont plus
grands. Je ne fais pas une statistique d'un certain nombre d'individus. Je considre un seul individu. Dans ces conditions, les termes de valeur moyenne et d'cart s'appliquent aux diffrentes valeurs que peut prendre dans la succession des temps un mme
composant du sang d'un mme individu []. Mais nous ne pensons pas que Vendrys limine par l la difficult que Cl. Bernard
rsolvait en proposant l'exprience la plus parfaite comme type,
c'est--dire comme norme de comparaison. Ce faisant Cl. Bernard
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
13
avouait expressment que le physiologiste apporte par son choix la
norme dans l'exprience de physiologie, et qu'il ne l'en retire pas.
Nous ne pensons pas que Vendrys puisse procder autrement. Il
dit qu'un homme a 1 /00 comme valeur moyenne de glycmie
lorsque normalement le taux de glycmie est 1 /00 et lorsque la
suite de l'alimentation ou d'un travail musculaire, la glycmie subit
des carts positifs ou ngatifs autour de cette valeur moyenne ?
Mais supposer qu'on se limite effectivement l'observation d'un
individu, d'o tire-t-on a priori que l'individu choisi pour sujet
d'examen des variations d'une constante reprsente le type humain?
Ou bien on est mdecin et c'est apparemment le cas de Vendrys et par consquent apte diagnostiquer le diabte ; ou bien
on n'a pas appris de physiologie au cours des tudes mdicales, et
pour savoir quel est le taux normal d'une rgulation on cherchera la
moyenne d'un certain nombre de rsultats, obtenus sur des individus placs dans des conditions aussi semblables que possible. Mais
enfin le problme est de savoir l'intrieur de quelles oscillations
autour d'une valeur moyenne purement thorique on tiendra les
individus pour normaux ?
Ce problme est trait avec beaucoup de clart et de probit par
A. Mayer [] et H. Laugier []. Mayer numre tous les lments de la biomtrie physiologique contemporaine : temprature,
mtabolisme de base, ventilation, chaleur dgage, caractristiques
du sang, vitesse de circulation, composition du sang, des rserves,
des tissus, etc. Or les valeurs biomtriques admettent une marge de
variation. Pour nous reprsenter une espce, nous avons choisi des
normes qui sont en fait des constantes dtermines par des moyennes. Le vivant normal est celui qui est conforme ces normes.
Mais devons-nous tenir tout cart pour anormal ? Le modle c'est
en ralit le fruit d'une statistique. Le plus souvent c'est le rsultat
de calculs de moyennes. Mais les individus vritables que nous
rencontrons s'en cartent plus ou moins et c'est prcisment en cela
que consiste leur individualit. Il serait trs important de savoir sur
quoi portent les carts et quels carts sont compatibles avec une
survie prolonge. Il faudrait le savoir pour les individus de chaque
espce. Une telle tude est loin d'tre faite [].
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
14
C'est la difficult d'une telle tude concernant l'homme que
Laugier expose. Il le fait d'abord en exposant la thorie de l'homme
moyen de Qutelet, sur laquelle on reviendra. tablir une courbe
de Qutelet, ce n'est pas rsoudre le problme du normal, pour un
caractre donn, par exemple la taille. Il faut des hypothses directrices et des conventions pratiques permettant de dcider quelle
valeur des tailles, soit vers les grandes, soit vers les petites, se fait
le passage du normal l'anormal. Le mme problme se pose si
l'on substitue un ensemble de moyennes arithmtiques un schma
statistique partir duquel tel individu s'carte plus ou moins, car la
statistique ne fournit aucun moyen pour dcider si l'cart est normal ou anormal. Peut-tre pourrait-on, par une convention que la
raison mme semble suggrer, tenir pour normal l'individu dont le
portrait biomtrique permet de prvoir que, hors accident, il aura la
dure de vie propre l'espce ? Mais les mmes interrogations reparaissent. Nous trouverons chez les individus qui meurent apparemment de snescence, une dispersion des dures de vie assez
tendue. Prendrons-nous comme dure de vie de l'espce la
moyenne de ces dures ou les dures maximales atteintes par quelques rares individus, ou quelque autre valeur ? []. Cette normalit du reste n'exclurait pas d'autres anormalits : telle difformit
congnitale peut tre compatible avec une trs longue vie. Si la
rigueur dans la dtermination d'une normalit partielle, l'tat
moyen du caractre tudi dans le groupe observ peut fournir un
substitut d'objectivit, la coupure autour de la moyenne restant arbitraire, en tout cas toute objectivit s'vanouit dans la dtermination d'une normalit globale. Etant donn l'insuffisance des donnes numriques de biomtrie et devant l'incertitude o nous sommes sur la validit des principes utiliser pour tablir la coupure
entre le normal et l'anormal, la dfinition scientifique de la normalit apparat comme actuellement inaccessible [].
Est-ce tre encore plus modeste ou au contraire plus ambitieux
que d'affirmer l'indpendance logique des concepts de norme et de
moyenne et par suite l'impossibilit dfinitive de donner sous forme de moyenne objectivement calcule l'quivalent intgral du
normal anatomique ou physiologique ?
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
15
Nous nous proposons de reprendre sommairement, partir des
ides de Qutelet et de l'examen trs rigoureux qu'en a fait Halbwachs, le problme du sens et de la porte des recherches biomtriques en physiologie. En somme, le physiologiste qui fait la critique de ses concepts de base aperoit bien que norme et moyenne
sont deux concepts pour lui insparables. Mais le second lui parat
immdiatement capable d'une signification objective et c'est pourquoi il essaie de lui ramener le premier. On vient de voir que cette
tentative de rduction se heurte des difficults actuellement, et
sans doute toujours, insurmontables. Ne conviendrait-il pas de renverser le problme et de se demander si la liaison des deux
concepts ne pourrait pas tre explique par subordination de la
moyenne la norme ? On sait que la biomtrie a d'abord t fonde, dans l'ordre anatomique, par les travaux de Galton, gnralisant les procds anthropomtriques de Qutelet. Qutelet tudiant
systmatiquement les variations de la taille de l'homme avait tabli
pour un caractre mesur sur les individus d'une population homogne et reprsent graphiquement, l'existence d'un polygone de
frquence prsentant un sommet correspondant l'ordonne
maximale et une symtrie par rapport cette ordonne. On sait que
la limite d'un polygone est une courbe et c'est Qutelet lui-mme
qui a montr que le polygone de frquence tend vers une courbe
dite en cloche qui est la courbe binomiale ou encore courbe
d'erreurs de Gauss. Par ce rapprochement, Qutelet tenait expressment signifier qu'il ne reconnaissait la variation individuelle
concernant un caractre donn (fluctuation) d'autre sens que celui
d'un accident vrifiant les lois du hasard, c'est--dire les lois qui
expriment l'influence d'une multiplicit inassignable de causes non
systmatiquement orientes, et dont les effets par consquent tendent s'annuler par compensation progressive. Or, cette interprtation possible des fluctuations biologiques par le calcul des probabilits apparaissait Qutelet de la plus haute importance mtaphysique. Elle signifiait, selon lui, qu'il existe pour l'espce humaine
un type ou module dont on peut dterminer facilement les diffrentes proportions []. Si cela n'tait point, si les hommes diffraient entre eux, par exemple sous le rapport de la hauteur, non par
l'effet de causes accidentelles, mais par l'absence de type selon lequel ils soient comparables, aucune relation dtermine ne pourrait
tre tablie entre toutes les mesures individuelles. S'il existe au
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
16
contraire un type relativement auquel les carts soient purement
accidentels, les valeurs numriques d'un caractre mesur sur une
foule d'individus doivent se rpartir selon une loi mathmatique, et
c'est ce qui arrive en fait. Par ailleurs, plus le nombre de mesures
opres sera grand, plus les causes perturbatrices accidentelles se
compenseront et s'annuleront et plus nettement apparatra le type
gnral. Mais surtout sur un grand nombre d'hommes dont la taille
varie entre des limites dtermines ceux qui approchent le plus de
la taille moyenne sont les plus nombreux, ceux qui s'en cartent le
plus sont les moins nombreux. ce type humain, partir duquel
l'cart est d'autant plus rare qu'il est plus grand, Qutelet donne le
nom d'homme moyen. Ce qu'on nglige gnralement de dire,
quand on cite Qutelet comme anctre de la biomtrie, c'est que,
selon lui, l'homme moyen n'est nullement un homme impossible
[]. La preuve de l'existence d'un homme moyen, dans un climat
donn, se trouve dans la manire dont les nombres obtenus pour
chaque dimension mesure (taille, tte, bras, etc.) se groupent autour de la moyenne en obissant la loi des causes accidentelles.
La moyenne de la taille dans un groupe donn est telle que le plus
grand des sous-groupes forms d'hommes ayant la mme taille est
l'ensemble des hommes dont la taille approche le plus de la
moyenne. Cela rend la moyenne typique tout fait diffrente de la
moyenne arithmtique. Quand on mesure la hauteur de plusieurs
maisons on peut obtenir une hauteur moyenne, mais telle qu'aucune maison peut ne se trouver dont la hauteur propre approche de la
moyenne. Bref, selon Qutelet, l'existence d'une moyenne est le
signe incontestable de l'existence d'une rgularit, interprte dans
un sens expressment ontologique : La principale ide pour moi
est de faire prvaloir la vrit et de montrer combien l'homme est
soumis son insu aux lois divines et avec quelle rgularit il les
accomplit. Cette rgularit du reste n'est point particulire
l'homme : c'est une des grandes lois de la nature qui appartient aux
animaux comme aux plantes, et l'on s'tonnera peut-tre de ne pas
l'avoir reconnue plus tt []. L'intrt de la conception de Qutelet est en ceci qu'il identifie dans sa notion de moyenne vritable
les notions de frquence statistique et de norme, car une moyenne
dterminant des carts d'autant plus rares qu'ils sont plus amples
c'est proprement une norme. Nous n'avons pas discuter ici le fondement mtaphysique de la thse de Qutelet, mais retenir sim-
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
17
plement qu'il distingue deux sortes de moyennes : la moyenne
arithmtique ou mdiane et la moyenne vraie, et que loin de prsenter la moyenne comme fondement empirique de la norme en
matire de caractres humains physiques, il prsente explicitement
une rgularit ontologique comme s'exprimant dans la moyenne.
Or, s'il peut paratre discutable de remonter jusqu' la volont de
Dieu pour rendre compte du module de la taille humaine, cela n'entrane pas pour autant qu'aucune norme ne transparaisse dans cette
moyenne. Et c'est ce qui nous parat pouvoir tre conclu de l'examen critique auquel Halbwachs a soumis les ides de Qutelet
[].
Selon Halbwachs, c'est tort que Qutelet considre la rpartition des tailles humaines autour d'une moyenne comme un phnomne auquel on puisse appliquer les lois du hasard. La condition
premire de cette application, c'est que les phnomnes, considrs
comme combinaisons d'lments en nombre inassignable, soient
des ralisations toutes indpendantes les unes des autres, telles
qu'aucune d'entre elles n'exerce d'influence sur celle qui la suit. Or
on ne peut pas assimiler des effets organiques constants des phnomnes rgis par les lois du hasard. Le faire c'est admettre que les
faits physiques tenant au milieu et les faits physiologiques relatifs
aux processus de croissance se composent de faon que chaque
ralisation soit indpendante des autres, au moment antrieur et au
mme moment. Or, cela est insoutenable du point de vue humain,
o les normes sociales viennent interfrer avec les lois biologiques,
en sorte que l'individu humain est le produit d'un accouplement
obissant toutes sortes de prescriptions coutumires et lgislatives d'ordre matrimonial. Bref, hrdit et tradition, accoutumance
et coutume sont autant de formes de dpendance et de liaison interindividuelle et donc autant d'obstacles une utilisation adquate
du calcul des probabilits. Le caractre tudi par Qutelet, la taille, ne serait un fait purement biologique que s'il tait tudi sur
l'ensemble des individus constituant une ligne pure, animale ou
vgtale. Dans ce cas les fluctuations de part et d'autre du module
spcifique seraient dues uniquement l'action du milieu. Mais
dans l'espce humaine la taille est un phnomne insparablement
biologique et social. Mme si elle est fonction du milieu, il faut
voir dans le milieu gographique en un sens le produit de l'activit
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
18
humaine. L'homme est un facteur gographique et la gographie
est toute pntre d'histoire sous forme de techniques collectives.
L'observation statistique a par exemple permis de constater l'influence de l'asschement des marais de Sologne sur la taille des
habitants []. Sorre admet que la taille moyenne de quelques
groupes humains s'est vraisemblablement leve sous l'influence
d'une alimentation amliore []. Mais, selon nous, si Qutelet
s'est tromp en attribuant la moyenne d'un caractre anatomique
humain une valeur de norme divine, c'est peut-tre seulement en
spcifiant la norme, mais non en interprtant la moyenne comme
signe d'une norme. S'il est vrai que le corps humain est en un sens
un produit de l'activit sociale, il n'est pas absurde de supposer que
la constance de certains traits, rvls par une moyenne, dpend de
la fidlit consciente ou inconsciente certaines normes de la vie.
Par suite, dans l'espce humaine, la frquence statistique ne traduit
pas seulement une normativit vitale mais une normativit sociale.
Un trait humain ne serait pas normal parce que frquent, mais frquent parce que normal, c'est--dire normatif dans un genre de vie
donn, en prenant ces mots de genre de vie au sens que lui ont
donn les gographes de l'cole de Vidal de La Blache.
Cela paratra encore plus vident si au lieu de considrer un caractre anatomique on s'attache un caractre physiologique global comme la longvit. Flourens aprs Buffon a recherch un
moyen de dterminer scientifiquement la dure naturelle ou normale de la vie de l'homme, utilisant en les corrigeant les travaux de
Buffon. Flourens rapporte la dure de vie la dure spcifique de
la croissance dont il dfinit le terme par la runion des os leurs
piphyses (). L'homme est vingt ans crotre et il vit cinq fois
vingt ans, c'est--dire cent ans. Que cette dure normale de la vie
humaine ne soit ni la dure frquente ni la dure moyenne, c'est ce
que spcifie bien Flourens : Nous voyons tous les jours des
hommes qui vivent quatre-vingt-dix et cent ans. Je sais bien que le
nombre de ceux qui vont jusque-l est petit, relativement au nombre de ceux qui n'y vont pas, mais enfin on y va. Et de ce qu'on y
va quelquefois il est trs permis de conclure qu'on y irait plus souvent, qu'on y irait souvent, si des circonstances accidentelles et extrinsques, si des causes troublantes ne venaient s'y opposer. La
plupart des hommes meurent de maladies ; trs peu meurent de
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
19
vieillesse proprement dite []. De mme Metchnikoff pense que
l'homme peut normalement devenir centenaire et que tout vieillard
qui meurt avant un sicle de vie est en droit un malade.
Les variations de la dure de vie moyenne chez l'homme au
cours des ges (39 ans en 1865 et 52 en 1920, en France et pour le
sexe masculin) sont bien instructives. Buffon et Flourens considraient l'homme, pour lui assigner une vie normale, du mme il de
biologiste qu'ils faisaient pour le lapin ou le chameau. Mais quand
on parle de vie moyenne, pour la montrer progressivement croissante, on la met en rapport avec l'action que l'homme, pris collectivement, exerce sur lui-mme. C'est en ce sens que Halbwachs traite la mort comme un phnomne social, estimant que l'ge o elle
survient rsulte en grande partie des conditions de travail et d'hygine, de l'attention la fatigue et aux maladies, bref de conditions
sociales autant que physiologiques. Tout se passe comme si une
socit avait la mortalit qui lui convient , le nombre des morts
et leur rpartition aux diffrents ges traduisant l'importance que
donne ou non une socit la prolongation de la vie []. En
somme, les techniques d'hygine collective qui tendent prolonger
la vie humaine ou les habitudes de ngligence qui ont pour rsultat
de l'abrger dpendant du prix attach la vie dans une socit
donne, c'est finalement un jugement de valeur qui s'exprime dans
ce nombre abstrait qu'est la dure de vie humaine moyenne. La dure de vie moyenne n'est pas la dure de vie biologiquement normale, mais elle est en un sens la dure de vie socialement normative. Dans ce cas encore, la norme ne se dduit pas de la moyenne,
mais se traduit dans la moyenne. Ce serait encore plus net si au lieu
de considrer la dure de vie moyenne dans une socit nationale,
prise en bloc, on spcifiait cette socit en classes, en mtiers, etc.
On verrait sans doute que la dure de vie dpend de ce que Halbwachs appelle ailleurs les niveaux de vie.
une telle conception, on objectera sans doute qu'elle vaut
pour des caractres humains superficiels et pour lesquels tout
prendre une marge de tolrance o les diversits sociales peuvent
se faire jour existe, mais qu'elle ne convient certainement ni pour
des caractres humains fondamentaux de rigidit essentielle, tels
que la glycmie ou la calcmie ou le PH sanguin, ni d'une faon
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
20
gnrale pour des caractres proprement spcifiques chez les animaux, auxquels aucune technique collective ne confre de plasticit relative. Certes, on n'entend pas soutenir que les moyennes anatomo-physiologiques traduisent chez l'animal des normes et des
valeurs sociales, mais on se demande si elles ne traduiraient pas
des normes et des valeurs vitales. On a vu, au sous-chapitre prcdent, l'exemple, cit par G. Teissier, de cette espce de papillons
oscillant entre deux varits avec l'une ou l'autre desquelles elle
tend se confondre, selon que le milieu permet l'une ou l'autre des
deux combinaisons compenses de caractres contrastants. On se
demande s'il n'y aurait pas l une sorte de rgle gnrale de l'invention des formes vivantes. En consquence, on pourrait donner
l'existence d'une moyenne des caractres les plus frquents un sens
assez diffrent de celui que lui attribuait Qutelet. Elle ne traduirait
pas un quilibre spcifique stable, mais l'quilibre instable de normes et de formes de vie affrontes momentanment peu prs gales. Au lieu de considrer un type spcifique comme rellement
stable, parce que prsentant des caractres exempts de toute incompatibilit, ne pourrait-on le tenir pour apparemment stable parce qu'ayant russi momentanment concilier par un ensemble de
compensations des exigences opposes. Une forme spcifique
normale ce serait le produit d'une normalisation entre fonctions et
organes dont l'harmonie synthtique est obtenue dans des conditions dfinies, et non pas donne. C'est peu prs ce que suggrait
Halbwachs, ds 1912, dans sa critique de Qutelet : Pourquoi
concevoir l'espce comme un type dont les individus ne s'cartent
que par accident ? Pourquoi son unit ne rsulterait-elle pas d'une
dualit de conformation, d'un conflit de deux ou d'un trs petit
nombre de tendances organiques gnrales qui, au total, s'quilibreraient ? Quoi de plus naturel, alors, que les dmarches de ses
membres expriment cette divergence par une srie rgulire
d'carts de la moyenne en deux sens diffrents... Si les carts
taient plus nombreux en un sens, ce serait le signe que l'espce
tend voluer dans cette direction sous l'influence d'une ou plusieurs causes constantes [].
En ce qui concerne l'homme et ses caractres physiologiques
permanents, seules une physiologie et une pathologie humaines
compares au sens o il existe une littrature compare des
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
21
divers groupes et sous-groupes ethniques, thiques ou religieux,
techniques, qui tiendraient compte de l'intrication de la vie et des
genres et des niveaux sociaux de vie, pourraient fournir une rponse prcise nos hypothses. Or, il semble que cette physiologie
humaine compare, faite un point de vue systmatique, reste encore crire par un physiologiste. Certes, il existe des recueils
compacts de donnes biomtriques d'ordre anatomique et physiologique concernant les espces animales et l'espce humaine dissocie en groupes ethniques, par exemple les Tabulae biologicae
(), mais ce sont l des rpertoires sans aucune tentative d'interprtation des rsultats de comparaisons. Nous entendons par physiologie humaine compare ce genre de recherches dont les travaux
de Eijkmann, de Benedict, de Ozorio de Almeida sur le mtabolisme basal dans ses rapports avec le climat et la race sont le meilleur exemple (). Mais il se trouve que cette lacune vient d'tre en
partie comble par les travaux rcents d'un gographe franais,
Sorre, dont Les fondements biologiques de la gographie humaine
nous ont t signals alors que la rdaction de cet essai tait termine. Nous en dirons quelques mots plus loin, la suite d'un dveloppement que nous tenons laisser dans son tat primitif, non pas
tant par souci d'originalit que comme tmoignage de convergence.
En matire de mthodologie, la convergence l'emporte de loin sur
l'originalit.
On nous accordera d'abord que la dtermination des constantes
physiologiques, par construction de moyennes exprimentalement
obtenues dans le seul cadre d'un laboratoire, risquerait de prsenter
l'homme normal comme un homme mdiocre, bien au-dessous des
possibilits physiologiques dont les hommes en situation directe et
concrte d'action sur eux-mmes ou sur le milieu sont videmment
capables, mme aux yeux les moins scientifiquement informs. On
rpondra en faisant remarquer que les frontires du laboratoire se
sont beaucoup largies depuis Claude Bernard, que la physiologie
tend sa juridiction sur les centres d'orientation et de slection professionnelle, sur les instituts d'ducation physique, bref que le physiologiste attend de l'homme concret, et non pas du sujet de laboratoire en situation assez artificielle, qu'il fixe lui-mme les marges
de variations tolres par les valeurs biomtriques. Lorsque A.
Mayer crit : La mesure de l'activit maximale de la musculature
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
22
chez l'homme est prcisment l'objet de l'tablissement des records
sportifs (), on pense la boutade de Thibaudet : Ce sont les
tables de record et non la physiologie qui rpondent cette demande : combien de mtres l'homme peut-il sauter ? (). En somme la physiologie ne serait qu'une mthode sre et prcise d'enregistrement et d'talonnage des latitudes fonctionnelles que l'homme
acquiert ou plutt conquiert progressivement. Si l'on peut parler
d'homme normal, dtermin par le physiologiste, c'est parce qu'il
existe des hommes normatifs, des hommes pour qui il est normal
de faire craquer les normes et d'en instituer de nouvelles.
Ce ne sont pas seulement les variations individuelles apportes
des thmes physiologiques communs chez l'homme blanc dit
civilis qui nous paraissent intressantes comme expression de la
normativit biologique humaine, mais plus encore les variations
des thmes eux-mmes de groupe groupe, selon les genres et les
niveaux de vie, en rapport avec des prises de position thiques ou
religieuses relativement la vie, bref des normes collectives de vie.
Dans cet ordre d'ide Ch. Laubry et Th. Brosse ont tudi, grce
aux techniques les plus modernes d'enregistrement, les effets physiologiques de la discipline religieuse qui permet aux yoguis hindous la matrise presque intgrale des fonctions de la vie vgtative. Cette matrise est telle qu'elle parvient la rgulation des mouvements pristaltiques et antipristaltiques, l'usage en tous sens
du jeu des sphincters anal et vsical, abolissant ainsi la distinction
physiologique des systmes musculaires stri et lisse. Cette matrise abolit par l mme l'autonomie relative de la vie vgtative.
L'enregistrement simultan du pouls, de la respiration, de l'lectrocardiogramme, la mesure du mtabolisme basal ont permis de
constater que la concentration mentale, tendant la fusion de l'individu avec l'objet universel, produit les effets suivants : rythme
cardiaque acclr, modification du rythme et de la hauteur du
pouls, modification de l'lectrocardiogramme : bas voltage gnralis, disparition des ondes, infime fibrillation sur la ligne isolectrique, mtabolisme basal rduit []. La clef de l'action du yogui
sur les fonctions physiologiques les moins apparemment soumises
la volont, c'est la respiration ; c'est elle qu'il est demand d'agir
sur les autres fonctions, c'est par sa rduction que le corps est plac
l'tat de vie ralentie comparable celui des animaux hiber-
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
23
nants []. Obtenir un changement du rythme du pouls allant de
50 150, une apne de 15 minutes, une abolition presque totale de
la contraction cardiaque, c'est bien faire craquer des normes physiologiques. A moins qu'on choisisse de tenir pour pathologiques
de tels rsultats. Mais c'est manifestement impossible : Si les yoguis ignorent la structure de leurs organes, ils sont matres incontests de leurs fonctions. Ils jouissent d'un tat de sant magnifique et cependant ils se sont inflig des annes d'exercices qu'ils
n'auraient pu supporter s'ils n'avaient respect les lois de l'activit
physiologique []. Laubry et Th. Brosse concluent qu'avec de
tels faits nous sommes en prsence d'une physiologie humaine assez diffrente de la simple physiologie animale : La volont
semble agir la faon d'une preuve pharmacodynamique et nous
entrevoyons ainsi pour nos facults suprieures un pouvoir infini
de rgulation et d'ordre []. D'o, sur le problme du pathologique, ces remarques de Th. Brosse : Considr sous cet angle de
l'activit consciente en rapport avec les niveaux psychophysiologiques qu'elle utilise, le problme de la pathologie fonctionnelle apparat intimement li celui de l'ducation. Consquence d'une
ducation sensorielle, active, motionnelle, mal faite ou non faite,
il appelle instamment une rducation. De plus en plus l'ide de
sant ou de normalit cesse de nous apparatre comme celle de la
conformit un idal extrieur (athlte pour le corps, bachelier
pour l'intelligence). Elle prend place dans la relation entre le moi
conscient et ses organismes psycho-physiologiques, elle est relativiste et individualiste [].
Sur ces questions de physiologie et de pathologie compare on
est rduit se contenter de peu de documents, mais, fait surprenant, bien que leurs auteurs aient obi des intentions non comparables, ils orientent l'esprit vers les mmes conclusions. Porak, qui
a cherch dans l'tude des rythmes fonctionnels et de leurs troubles
une voie vers la connaissance du dbut des maladies, a montr le
rapport entre les genres de vie et les courbes de la diurse et de la
temprature (rythmes lents), du pouls et de la respiration (rythmes
rapides). Les jeunes Chinois de 18 25 ans ont un dbit urinaire
moyen de 0,5 cm3 par minute, avec oscillations de 0,2 0,7 alors
que ce dbit est de 1 cm3 pour les europens, avec oscillations de
0,8 1,5. Porak interprte ce fait physiologique partir des in-
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
24
fluences gographiques et historiques combines dans la civilisation chinoise. De cette masse d'influences il en choisit deux capitales selon lui : la nature de l'alimentation (th, riz, vgtaux, germes) et les rythmes nutritifs, dtermins par l'exprience ancestrale ; le mode d'activit qui respecte mieux en Chine que dans
l'Occident le dveloppement priodique de l'activit neuromusculaire. La sdentarit des habitudes occidentales a sa rpercussion
nocive sur le rythme des liquides. Ce drangement n'existe pas en
Chine o on a conserv le got de la promenade dans le dsir
passionn de se confondre avec la nature [].
L'tude du rythme respiratoire (rythme rapide) fait apparatre
des variations en rapport avec le dveloppement et l'ankylose du
besoin d'activit. Ce besoin est lui-mme en rapport avec les phnomnes naturels ou sociaux qui scandent le travail humain. Depuis l'invention de l'agriculture, la journe solaire est un cadre dans
lequel s'inscrit l'activit de bien des hommes. La civilisation urbaine et les exigences de l'conomie moderne ont troubl les grands
cycles physiologiques d'activit, mais en laissent subsister des vestiges. Sur ces cycles fondamentaux se greffent des cycles secondaires. Alors que les changements de position dterminent des cycles
secondaires dans les variations du pouls, ce sont les influences
psychiques qui sont prpondrantes dans le cas de la respiration.
La respiration s'acclre ds le rveil, ds que les yeux s'ouvrent
la lumire : Ouvrir les yeux, c'est dj prendre l'attitude de l'tat
de veille, c'est dj orienter les rythmes fonctionnels vers le dploiement de l'activit neuro-motrice, et la souple fonction respiratoire est prompte la riposte au monde extrieur : elle ragit immdiatement l'ouverture des paupires []. La fonction respiratoire est, par l'hmatose qu'elle assure, si importante pour le dploiement explosif ou soutenu de l'nergie musculaire qu'une rgulation trs subtile doit dterminer dans l'instant des variations
considrables du volume d'air inspir. L'intensit respiratoire est
donc sous la dpendance de la qualit de nos attaques ou de nos
ractions, dans notre dbat avec le milieu. Le rythme respiratoire
est fonction de la conscience de notre situation dans le monde.
On s'attend ce que les observations de Porak le conduisent
proposer des indications thrapeutiques et hyginiques. C'est en
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
25
effet ce qui arrive. Puisque les normes physiologiques dfinissent
moins une nature humaine que des habitudes humaines en rapport
avec des genres de vie, des niveaux de vie et des rythmes de vie,
toute rgle dittique doit tenir compte de ces habitudes. Voici un
bel exemple de relativisme thrapeutique : Les Chinoises nourrissent leurs enfants de lait pendant les deux premires annes de la
vie. Aprs sevrage, les enfants ne se nourriront plus jamais de lait.
Le lait de vache est considr comme un liquide malpropre, tout
juste bon pour les porcs. Or, j'ai souvent essay le lait de vache
chez mes malades atteints de nphrite. L'ankylose urinaire se produisait aussitt. En remettant le malade au rgime th, riz, une belle crise urinaire rtablissait l'eurythmie []. Quant aux causes
des maladies fonctionnelles, elles sont presque toutes, si on les
prend leur dbut, des perturbations de rythmes, des drythmies,
dues la fatigue ou au surmenage, c'est--dire tout exercice dpassant la juste adaptation des besoins de l'individu l'environnement []. Impossible de maintenir un type dans sa marge de
disponibilit fonctionnelle. La meilleure dfinition de l'homme serait, je crois, un tre insatiable, c'est--dire qui dpasse toujours ses
besoins []. Voil une bonne dfinition de la sant qui nous
prpare comprendre son rapport avec la maladie.
Lorsque Marcel Labb tudie, principalement propos du diabte, l'tiologie des maladies de la nutrition, il aboutit des
conclusions analogues. Les maladies de la nutrition ne sont pas
maladies d'organes mais maladies de fonctions... Les vices de
l'alimentation jouent un rle capital dans la gense des troubles de
la nutrition... L'obsit est la plus frquente et la plus simple de ces
maladies cres par l'ducation morbide donne par les parents...
La plupart des maladies de la nutrition sont vitables... Je parle surtout des habitudes vicieuses de vie et d'alimentation que les individus doivent viter et que les parents dj atteints de troubles de la
nutrition doivent se garder de transmettre leurs enfants []. Ne
peut-on pas conclure que tenir l'ducation des fonctions pour un
moyen thrapeutique comme le font Laubry et Brosse, Porak et
Marcel Labb, c'est admettre que les constantes fonctionnelles sont
des normes habituelles. Ce que l'habitude a fait, l'habitude le dfait
et l'habitude le refait. Si l'on peut autrement que par mtaphore dfinir les maladies comme des vices, on doit pouvoir autrement que
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
26
par mtaphore dfinir les constantes physiologiques comme des
vertus, au sens antique du mot qui confond vertu, puissance et
fonction.
Les recherches de Sorre sur les rapports entre les caractristiques physiologiques et pathologiques de l'homme et les climats, les
rgimes alimentaires, l'environnement biologique ont, est-il besoin
de le dire, une tout autre porte que les travaux que nous venons
d'utiliser. Mais ce qui est remarquable c'est que tous ces points de
vue s'y trouvent justifis et leurs aperus confirms. L'adaptation
des hommes l'altitude et son action physiologique hrditaire
[], les problmes des effets de la lumire [ ], de la tolrance
thermique [], de l'acclimatement [], de l'alimentation aux dpens d'un milieu vivant cr par l'homme [], de la rpartition
gographique et de l'action plastique des rgimes alimentaires [],
de l'aire d'extension des complexes pathognes (maladie du sommeil, paludisme, peste, etc.) [] : toutes ces questions sont traites
avec beaucoup de prcision, d'ampleur et un bon sens constant.
Certes, ce qui intresse Sorre c'est avant tout l'cologie de l'homme, l'explication des problmes de peuplement. Mais tous ces problmes se ramenant finalement des problmes d'adaptation, on
voit comment les travaux d'un gographe prsentent un grand intrt pour un essai mthodologique concernant les normes biologiques. Sorre voit trs bien l'importance du cosmopolitisme de l'espce humaine pour une thorie de la labilit relative des constantes
physiologiques l'importance des tats de faux quilibre adaptatif
pour l'explication des maladies ou des mutations la relation des
constantes anatomiques et physiologiques aux rgimes alimentaires
collectifs, qu'il qualifie trs judicieusement de normes [] l'irrductibilit des techniques de cration d'une ambiance proprement
humaine des raisons purement utilitaires l'importance de l'action indirecte, par l'orientation de l'activit, du psychisme humain
sur des caractristiques longtemps tenues pour naturelles, telles
que taille, poids, diathses collectives. En conclusion, Sorre s'attache montrer que l'homme, pris collectivement, est la recherche
de ses optima fonctionnels , c'est--dire des valeurs de chacun
des lments de l'ambiance pour lesquelles une fonction dtermine s'accomplit le mieux. Les constantes physiologiques ne sont
pas des constantes au sens absolu du terme. Il y a pour chaque
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
27
fonction et pour l'ensemble des fonctions une marge o joue la capacit d'adaptation fonctionnelle du groupe ou de l'espce. Les
conditions optimales dterminent ainsi une zone de peuplement o
l'uniformit des caractristiques humaines traduit non pas l'inertie
d'un dterminisme mais la stabilit d'un rsultat maintenu par un
effort collectif inconscient mais rel []. Il va sans dire qu'il nous
plat de voir un gographe apporter la solidit de ses rsultats
d'analyse l'appui de l'interprtation propose par nous des constantes biologiques. Les constantes se prsentent avec une frquence et une valeur moyennes, dans un groupe donn, qui leur donne
valeur de normale, et cette normale est vraiment l'expression d'une
normativit. La constante physiologique est l'expression d'un optimum physiologique dans des conditions donnes, parmi lesquelles
il faut retenir celles que le vivant en gnral, et l'homo faber en
particulier, se donnent.
En raison de ces conclusions, nous interprterions un peu autrement que leurs auteurs les donnes si intressantes dues Pales
et Monglond concernant le taux de la glycmie chez les Noirs
d'Afrique []. Sur 84 indignes de Brazzaville, 66 % ont prsent
une hypoglycmie, dont 39 % de 0,90 g 0,75 g et 27 % audessous de 0,75 g. D'aprs ces auteurs le Noir doit tre considr
en gnral comme hypoglycmique. En tout cas, le Noir supporte
sans trouble apparent, et spcialement sans convulsions ni coma,
des hypoglycmies tenues pour graves sinon mortelles chez l'Europen. Les causes de cette hypoglycmie seraient chercher dans
la sous-alimentation chronique, le parasitisme intestinal polymorphe et chronique, le paludisme. Ces tats sont la limite de la
physiologie et de la pathologie. Du point de vue europen, ils sont
pathologiques ; du point de vue indigne, ils sont si troitement lis
l'tat habituel du Noir que si l'on n'avait pas les termes comparatifs du Blanc on pourrait le considrer presque comme physiologique []. Nous pensons prcisment que si l'Europen peut servir
de norme c'est seulement dans la mesure o son genre de vie pourra passer pour normatif. L'indolence du Noir apparat Lefrou,
comme Pales et Monglond en rapport avec son hypoglycmie
[]. Ces derniers auteurs disent que le Noir mne une vie la mesure de ses moyens. Mais ne pourrait-on pas dire aussi bien que le
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
28
Noir a les moyens physiologiques la mesure de la vie qu'il mne ?
La relativit de certains aspects des normes anatomophysiologiques et par suite de certains troubles pathologiques dans
leur rapport avec les genres de vie et le savoir-vivre, n'apparat pas
seulement par la comparaison des groupes ethniques et culturels
actuellement observables, mais aussi par la comparaison de ces
groupes actuels et des groupes antrieurs disparus. Certes, la palopathologie dispose de documents encore bien plus rduits que
ceux dont disposent la palontologie ou la palographie, et cependant les conclusions prudentes qu'on en peut tirer valent d'tre releves.
Pales, qui a fait en France une bonne synthse des travaux de ce
genre, emprunte Roy C. Moodie () une dfinition du document
palopathologique, savoir toute dviation de l'tat sain du corps
qui a laiss une empreinte visible sur le squelette fossilis []. Si
les silex taills et l'art des hommes de l'ge de pierre disent l'histoire de leurs luttes, de leurs travaux et de leur pense, leurs ossements voquent l'histoire de leurs douleurs []. La palopathologie permet de concevoir le fait pathologique dans l'histoire de l'espce humaine comme un fait de symbiose, s'il s'agit de maladies
infectieuses et cela ne concerne pas seulement l'homme, mais le
vivant en gnral et comme un fait de niveau de culture ou de
genre de vie, s'il s'agit de maladies de la nutrition. Les affections
dont les hommes prhistoriques ont eu ptir se prsentaient dans
des proportions bien diffrentes de celles qu'elles offrent actuellement considrer. Vallois signale que l'on relve, pour la seule
prhistoire franaise, 11 cas de tuberculose pour plusieurs milliers
d'ossements tudis []. Si l'absence de rachitisme, maladie par
carence de vitamine D, est normale une poque o l'on utilisait
des aliments crus ou peine cuits [], l'apparition de la carie dentaire, inconnue des premiers hommes, va de pair avec la civilisation, en rapport avec l'utilisation de fculents et la cuisson de la
nourriture, entranant la destruction des vitamines ncessaires
l'assimilation du calcium []. De mme l'ostoarthrite tait beaucoup plus frquente l'ge de la pierre taille et aux poques suivantes qu'elle ne l'est actuellement, et l'on doit l'attribuer, vraisem-
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
29
blablement, une alimentation insuffisante, un climat froid et
humide, puisque sa diminution, de nos jours, traduit une meilleure
alimentation, un mode de vie plus hyginique [].
On conoit aisment la difficult d'une tude laquelle chappent toutes les maladies dont les effets plastiques ou dformants
n'ont pas russi s'inscrire dans le squelette des hommes fossiles
ou exhums au cours de fouilles archologiques. On conoit la
prudence oblige des conclusions de cette tude. Mais dans la mesure o l'on peut parler d'une pathologie prhistorique on devrait
aussi pouvoir parler d'une physiologie prhistorique, comme on
parle, sans trop d'incorrection, d'une anatomie prhistorique. Encore ici, apparat le rapport des normes biologiques de vie avec le
milieu humain, la fois cause et effet de la structure et du comportement des hommes. Pales fait remarquer avec bon sens que si
Boule a pu dterminer sur l'Homme de la Chapelle aux Saints le
type anatomique classique de la race de Nanderthal, on pourrait
voir en lui sans trop de complaisance, le type le plus parfait
d'homme fossile pathologique, atteint de pyorrhe alvolaire, d'arthrite coxo-fmorale bilatrale, de spondylose cervicale et lombaire, etc. Oui, si l'on mconnaissait les diffrences du milieu cosmique, de l'quipement technique et du genre de vie qui font de
l'anormal d'aujourd'hui le normal d'autrefois.
S'il semble difficile de contester la qualit des observations utilises ci-dessus, peut-tre voudra-t-on contester les conclusions
auxquelles elles conduisent, concernant la signification physiologique de constantes fonctionnelles interprtes comme normes habituelles de vie. En rponse, on fera remarquer que ces normes ne
sont pas le fruit d'habitudes individuelles que tel individu pourrait
sa guise prendre ou laisser. Si l'on admet une plasticit fonctionnelle de l'homme, lie en lui la normativit vitale, ce n'est pas
d'une mallabilit totale et instantane qu'il s'agit ni d'une mallabilit purement individuelle. Proposer, avec toute la rserve qui
convient, que l'homme a des caractristiques physiologiques en
rapport avec son activit, ce n'est pas laisser croire tout individu
qu'il pourra changer sa glycmie ou son mtabolisme basai par la
mthode Cou, ni mme par le dpaysement. On ne change pas en
quelques jours ce que l'espce labore au cours de millnaires.
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
30
Voelker a montr qu'on ne change pas de mtabolisme basal en
passant de Hambourg en Islande. De mme, Benedict, en ce qui
concerne le dplacement des Amricains du Nord dans des rgions
subtropicales. Mais Benedict a constat que le mtabolisme des
Chinoises vivant depuis toujours aux Etats-Unis est plus bas que la
norme amricaine. D'une faon gnrale, Benedict a constat que
des Australiens (Kokatas) ont un mtabolisme plus bas que celui
de Blancs de mmes ge, poids et taille vivant aux Etats-Unis,
qu'inversement des Indiens (Mayas) ont un mtabolisme plus lev
avec pouls ralenti et tension artrielle abaisse de faon permanente. On peut donc conclure avec Kayser et Dontcheff : Il semble
dmontr que chez l'homme, le facteur climatique n'ait pas d'effet
direct sur le mtabolisme ; ce n'est que trs progressivement que le
climat, en modifiant le mode de vie et en permettant la fixation de
races spciales, a eu une action durable sur le mtabolisme de base ().
Bref, tenir les valeurs moyennes des constantes physiologiques
humaines comme l'expression de normes collectives de vie, ce serait seulement dire que l'espce humaine en inventant des genres
de vie invente du mme coup des allures physiologiques. Mais les
genres de vie ne sont-ils pas imposs ? Les travaux de l'cole franaise de gographie humaine ont montr qu'il n'y a pas de fatalit
gographique. Les milieux n'offrent l'homme que des virtualits
d'utilisation technique et d'activit collective. C'est un choix qui
dcide. Entendons bien qu'il ne s'agit pas d'un choix explicite et
conscient. Mais du moment que plusieurs normes collectives de vie
sont possibles dans un milieu donn, celle qui est adopte et que
son antiquit fait paratre naturelle reste au fond choisie.
Toutefois, dans certains cas, il est possible de mettre en vidence l'influence d'un choix explicite sur le sens de quelque allure
physiologique. C'est la leon qui se dgage des observations et des
expriences relatives aux oscillations de la temprature chez l'animal homotherme, au rythme nycthmral.
Les travaux de Kayser et de ses collaborateurs sur le rythme
nycthmral chez le pigeon ont permis d'tablir que les variations
de la temprature centrale de jour et de nuit chez l'animal homo-
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
31
therme sont un phnomne de la vie vgtative sous la dpendance
des fonctions de relation. La rduction nocturne des changes est
l'effet de la suppression des excitants lumineux et sonores. Le
rythme nycthmral disparat chez le pigeon rendu exprimentalement aveugle et isol de ses congnres normaux. Le renversement
de l'ordre dans la succession lumire-obscurit inverse le rythme
aprs quelques jours. Le rythme nycthmral est dtermin par un
rflexe conditionn entretenu par l'alternance naturelle du jour et
de la nuit. Quant au mcanisme, il ne consiste pas en une hypoexcitabilit nocturne des centres thermorgulateurs, mais la production supplmentaire durant le jour d'une quantit de chaleur se surajoutant la calorification rgle identiquement le jour et la nuit
par le centre thermorgulateur. Cette chaleur dpend des excitations manant du milieu et aussi de la temprature : elle augmente
avec le froid. Toute production de chaleur par l'activit musculaire
tant carte, c'est la seule augmentation du tonus de posture, le
jour, qu'il faut rapporter l'lvation donnant la temprature nycthmrale son allure rythme. Le rythme nycthmral de temprature est pour l'animal homotherme l'expression d'une variation
d'attitude de tout l'organisme l'gard du milieu. Mme au repos,
l'nergie de l'animal, s'il est sollicit par le milieu, n'est pas intgralement disponible, une partie est mobilise dans des attitudes toniques de vigilance, de prparation. La veille est un comportement
qui mme sans alertes ne va pas sans frais [].
Des observations et des expriences relatives l'homme et dont
les rsultats ont souvent paru contradictoires reoivent une grande
lumire des conclusions prcdentes. Mosso d'une part, Benedict
d'autre part n'ont pu dmontrer que la courbe thermique normale
dpend des conditions du milieu. Mais Toulouse et Piron affirmaient en 1907 que l'inversion des conditions de vie (activit nocturne et repos diurne) conditionnait chez l'homme l'inversion complte du rythme nycthmral de la temprature. Comment expliquer cette contradiction ? C'est que Benedict avait observ des sujets peu habitus la vie nocturne et qui aux heures de repos, pendant le jour, participaient la vie normale de leur milieu. Selon
Kayser, tant que les conditions exprimentales ne sont pas celles
d'une inversion complte du mode de vie, la dmonstration d'une
dpendance entre le rythme et le milieu ne peut tre donne. Ce qui
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
32
confirme cette interprtation ce sont les faits suivants. Chez le
nourrisson, le rythme nycthmral se manifeste progressivement,
parallle au dveloppement psychique de l'enfant. A l'ge de huit
jours, l'cart de temprature est 0,09, cinq mois de 0,37, entre 2
et 5 ans de 0,95. Certains auteurs, Osborne et Vlker ont tudi le
rythme nycthmral au cours de longs voyages, et constat que ce
rythme suit exactement l'heure locale []. Lindhard signale qu'au
cours d'une expdition danoise au Groenland, en 1906-1908, le
rythme nycthmral suivait l'heure locale et qu'on russit, dans le
Nord 7646', dcaler le jour de 12 heures sur un quipage entier, et aussi la courbe de temprature. Le renversement complet ne
put tre obtenu, en raison de la persistance de l'activit normale
().
Voil donc l'exemple d'une constante relative des conditions
d'activit, un genre collectif et mme individuel de vie et dont la
relativit traduit, par un rflexe conditionn dclenchement variable, des normes du comportement humain. La volont humaine
et la technique humaine peuvent faire de la nuit le jour non seulement dans le milieu o l'activit humaine se dveloppe, mais dans
l'organisme mme dont l'activit affronte le milieu. Nous ne savons
pas dans quelle mesure d'autres constantes physiologiques pourraient, l'analyse, se prsenter de la mme manire comme l'effet
d'une souple adaptation du comportement humain. Ce qui nous
importe c'est moins d'apporter une solution provisoire que de montrer qu'un problme mrite d'tre pos. En tout cas, dans cet exemple, nous pensons employer avec proprit le terme de comportement. Du moment que le rflexe conditionn met en jeu l'activit
du cortex crbral, le terme de rflexe ne doit pas tre pris au sens
strict. Il s'agit d'un phnomne fonctionnel global et non pas segmentaire.
En rsum, nous pensons qu'il faut tenir les concepts de norme
et de moyenne pour deux concepts diffrents dont il nous parat
vain de tenter la rduction l'unit par annulation de l'originalit
du premier. Il nous semble que la physiologie a mieux faire que
de chercher dfinir objectivement le normal, c'est de reconnatre
l'originale normativit de la vie. Le rle vritable de la physiologie,
suffisamment important et difficile, consisterait alors dterminer
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
33
exactement le contenu des normes dans lesquelles la vie a russi
se stabiliser, sans prjuger de la possibilit ou de l'impossibilit
d'une correction ventuelle de ces normes. Bichat disait que l'animal est habitant du monde alors que le vgtal l'est seulement du
lieu qui le vit natre. Cette pense est plus vraie encore de l'homme
que de l'animal. L'homme a russi vivre sous tous les climats, il
est le seul animal l'exception peut-tre des araignes dont
l'aire d'expansion soit aux dimensions de la terre. Mais surtout, il
est cet animal qui, par la technique, russit varier sur place mme
l'ambiance de son activit. Par l, l'homme se rvle actuellement
comme la seule espce capable de variation []. Est-il absurde de
supposer que les organes naturels de l'homme puissent la longue
traduire l'influence des organes artificiels par lesquels il a multipli
et multiplie encore le pouvoir des premiers ? Nous n'ignorons pas
que l'hrdit des caractres acquis apparat la plupart des biologistes comme un problme rsolu par la ngative. Nous nous permettons de nous demander si la thorie de l'action du milieu sur le
vivant ne serait pas la veille de se relever d'un long discrdit ().
Il est vrai qu'on pourrait nous objecter qu'en ce cas les constantes
biologiques exprimeraient l'effet sur le vivant des conditions extrieures d'existence et que nos suppositions sur la valeur normative
des constantes seraient dpourvues de sens. Elles le seraient assurment si les caractres biologiques variables traduisaient le changement de milieu comme les variations de l'acclration due la
pesanteur sont en rapport avec la latitude. Mais nous rptons que
les fonctions biologiques sont inintelligibles, telles que l'observation nous les dcouvre, si elles ne traduisent que les tats d'une matire passive devant les changements du milieu. En fait, le milieu
du vivant est aussi l'uvre du vivant qui se soustrait ou s'offre
lectivement certaines influences. De l'univers de tout vivant on
peut dire ce que Reininger dit de l'univers de l'homme : Unser
Weltbild ist immer zugleich ein Wertbild (), notre image du
monde est toujours aussi un tableau de valeurs.
() Pages 155 157
Dans la premire partie, nous avons recherch les sources historiques et analys les implications logiques du principe de pathologie, si souvent encore invoqu, selon lequel l'tat morbide n'est,
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
34
chez l'tre vivant, qu'une simple variation quantitative des phnomnes physiologiques qui dfinissent l'tat normal de la fonction
correspondante. Nous pensons avoir tabli l'troitesse et l'insuffisance d'un tel principe. Au cours de la discussion, et la lumire
des exemples apports, nous pensons avoir fourni quelques arguments critiques l'appui des propositions de mthode et de doctrine qui font l'objet de la seconde partie et que nous rsumerions
comme suit :
C'est par rfrence la polarit dynamique de la vie qu'on peut
qualifier de normaux des types ou des fonctions. S'il existe des
normes biologiques c'est parce que la vie, tant non pas seulement
soumission au milieu mais institution de son milieu propre, pose
par l mme des valeurs non seulement dans le milieu mais aussi
dans l'organisme mme. C'est ce que nous appelons la normativit
biologique.
L'tat pathologique peut tre dit, sans absurdit, normal, dans la
mesure o il exprime un rapport la normativit de la vie. Mais ce
normal ne saurait tre dit sans absurdit identique au normal physiologique car il s'agit d'autres normes. L'anormal n'est pas tel par
absence de normalit. II n'y a point de vie sans normes de vie, et
l'tat morbide est toujours une certaine faon de vivre.
L'tat physiologique est l'tat sain, plus encore que l'tat normal. C'est l'tat qui peut admettre le passage de nouvelles normes. L'homme est sain pour autant qu'il est normatif relativement
aux fluctuations de son milieu. Les constantes physiologiques ont,
selon nous, parmi toutes les constantes vitales possibles, une valeur
propulsive. Au contraire, l'tat pathologique traduit la rduction
des normes de vie tolres par le vivant, la prcarit du normal
tabli par la maladie. Les constantes pathologiques ont valeur rpulsive et strictement conservatrice.
La gurison est la reconqute d'un tat de stabilit des normes
physiologiques. Elle est d'autant plus voisine de la maladie ou de la
sant que cette stabilit est moins ou plus ouverte des remaniements ventuels. En tout cas, aucune gurison n'est retour l'innocence biologique. Gurir c'est se donner de nouvelles normes de
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
35
vie, parfois suprieures aux anciennes. Il y a une irrversibilit de
la normativit biologique.
Le concept de norme est un concept original qui ne se laisse
pas, en physiologie plus qu'ailleurs, rduire un concept objectivement dterminable par des mthodes scientifiques. Il n'y a donc
pas, proprement parler, de science biologique du normal. Il y a
une science des situations et des conditions biologiques dites normales. Cette science est la physiologie.
L'attribution aux constantes, dont la physiologie dtermine
scientifiquement le contenu, d'une valeur de normal traduit la
relation de la science de la vie l'activit normative de la vie et, en
ce qui concerne la science de la vie humaine, aux techniques biologiques de production et d'instauration du normal, plus spcialement la mdecine.
Il en est de la mdecine comme de toutes les techniques. Elle
est une activit qui s'enracine dans l'effort spontan du vivant pour
dominer le milieu et l'organiser selon ses valeurs de vivant. C'est
dans cet effort spontan que la mdecine trouve son sens, sinon
d'abord toute la lucidit critique qui la rendrait infaillible. Voil
pourquoi, sans tre elle-mme une science, la mdecine utilise les
rsultats de toutes les sciences au service des normes de la vie.
C'est donc d'abord parce que les hommes se sentent malades
qu'il y a une mdecine. Ce n'est que secondairement que les hommes, parce qu'il y a une mdecine, savent en quoi ils sont malades.
Tout concept empirique de maladie conserve un rapport au
concept axiologique de la maladie. Ce n'est pas, par consquent,
une mthode objective qui fait qualifier de pathologique un phnomne biologique considr. C'est toujours la relation l'individu
malade, par l'intermdiaire de la clinique, qui justifie la qualification de pathologique. Tout en admettant l'importance des mthodes
objectives d'observation et d'analyse dans la pathologie, il ne semble pas possible que l'on puisse parler, en toute correction logique,
de pathologie objective. Certes une pathologie peut tre mthodique, critique, exprimentalement arme. Elle peut tre dite objec-
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
36
tive, par rfrence au mdecin qui la pratique. Mais l'intention du
pathologiste ne fait pas que son objet soit une matire vide de
subjectivit. On peut pratiquer objectivement, c'est--dire impartialement, une recherche dont l'objet ne peut tre conu et construit
sans rapport une qualification positive et ngative, dont l'objet
n'est donc pas tant un fait qu'une valeur.
() Pages 175 179.
Dans la Critique de la Raison pure (mthodologie transcendantale : architectonique de la raison pure), Kant distingue les
concepts, quant leur sphre d'origine et de validit en scolastiques et en cosmiques, ceux-ci tant le fondement de ceux-l.
Nous pourrions dire des deux concepts de Norme et de Normal
que le premier est scolastique tandis que le second est cosmique ou
populaire. Il est possible que le normal soit une catgorie du jugement populaire parce que sa situation sociale est vivement, quoique
confusment, ressentie par le peuple comme n'tant pas droite.
Mais le terme mme de normal est pass dans la langue populaire
et s'y est naturalis partir des vocabulaires spcifiques de deux
institutions, l'institution pdagogique et l'institution sanitaire, dont
les rformes, pour ce qui est de la France au moins, ont concid
sous l'effet d'une mme cause, la Rvolution franaise. Normal est
le terme par lequel le XIXe sicle va dsigner le prototype scolaire
et l'tat de sant organique. La rforme de la mdecine comme
thorie repose elle-mme sur la rforme de la mdecine comme
pratique : elle est lie troitement, en France, comme aussi en Autriche, la rforme hospitalire. Rforme hospitalire comme rforme pdagogique expriment une exigence de rationalisation qui
apparat aussi en politique, comme elle apparat dans l'conomie
sous l'effet du machinisme industriel naissant, et qui aboutit enfin
ce qu'on a appel depuis la normalisation.
De mme qu'une cole normale est une cole o l'on enseigne
enseigner, c'est--dire o l'on institue exprimentalement des mthodes pdagogiques, de mme un compte-gouttes normal est celui
qui est calibr pour diviser en XX gouttes en chute libre un gramme d'eau distille, en sorte que le pouvoir pharmacodynamique
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
37
d'une substance en solution puisse tre gradu selon la prescription
d'une ordonnance mdicale. De mme, aussi, une voie normale de
chemin de fer est-elle, parmi les vingt et un cartements des rails
d'une voie ferre pratiqus jadis et nagure, la voie dfinie par
l'cartement de 1,44 m entre les bords intrieurs des rails, c'est-dire celle qui a paru rpondre, un moment de l'histoire industrielle et conomique de l'Europe, au meilleur compromis recherch
entre plusieurs exigences, d'abord non concourantes, d'ordre mcanique, nergtique, commercial, militaire et politique. De mme,
enfin, pour le physiologiste, le poids normal de l'homme, compte
tenu du sexe, de l'ge et de la taille, est le poids correspondant
la plus grande longvit prvisible (Ch. KAYSER, Le maintien
de l'quilibre, 1963. Wien, Springer).
Dans les trois premiers de ces exemples, le normal semble tre
l'effet d'un choix et d'une dcision extrieurs l'objet ainsi qualifi,
au lieu que dans le quatrime le terme de rfrence et de qualification se donne manifestement comme intrinsque l'objet, s'il est
vrai que la dure d'un organisme individuel est, dans la sant prserve, une constante spcifique.
Mais, bien regarder, la normalisation des moyens techniques
de l'ducation, de la sant, des transports de gens et de marchandises, est l'expression d'exigences collectives dont l'ensemble, mme
en l'absence d'une prise de conscience de la part des individus, dfinit dans une socit historique donne sa faon de rfrer sa
structure, ou peut-tre ses structures, ce qu'elle estime tre son
bien singulier.
Dans tous les cas, le propre d'un objet ou d'un fait dit normal,
par rfrence une norme externe ou immanente, c'est de pouvoir
tre, son tour, pris comme rfrence d'objets ou de faits qui attendent encore de pouvoir tre dits tels. Le normal c'est donc la
fois l'extension et l'exhibition de la norme. Il multiplie la rgle en
mme temps qu'il l'indique. Il requiert donc hors de lui, ct de
lui et contre lui, tout ce qui lui chappe encore. Une norme tire son
sens, sa fonction et sa valeur du fait de l'existence en dehors d'elle
de ce qui ne rpond pas l'exigence qu'elle sert.
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
38
Le normal n'est pas un concept statique ou pacifique, mais un
concept dynamique et polmique. Gaston Bachelard, qui s'est
beaucoup intress aux valeurs sous leur forme cosmique ou populaire, et la valorisation selon les axes de l'imagination, a bien
aperu que toute valeur doit tre gagne contre une antivaleur.
C'est lui qui crit : La volont de nettoyer veut un adversaire sa
taille (). Quand on sait que norma est le mot latin que traduit
querre et que normalis signifie perpendiculaire, on sait peu prs
tout ce qu'il faut savoir sur le domaine d'origine du sens des termes
norme et normal, imports dans une grande varit d'autres domaines. Une norme, une rgle, c'est ce qui sert faire droit, dresser,
redresser. Normer, normaliser, c'est imposer une exigence une
existence, un donn, dont la varit, la disparate s'offrent, au regard de l'exigence, comme un indtermin hostile plus encore
qu'tranger. Concept polmique, en effet, que celui qui qualifie
ngativement le secteur du donn qui ne rentre pas dans son extension, alors qu'il relve de sa comprhension. Le concept de droit,
selon qu'il s'agit de gomtrie, de morale ou de technique, qualifie
ce qui rsiste son application de tordu, de tortueux ou de gauche
().
De cette destination et de cet usage polmiques du concept de
norme il faut, selon nous, chercher la raison dans l'essence du rapport normal-anormal. Il ne s'agit pas d'un rapport de contradiction
et d'extriorit, mais d'un rapport d'inversion et de polarit. La
norme, en dprciant tout ce que la rfrence elle interdit de tenir
pour normal, cre d'elle-mme la possibilit d'une inversion des
termes. Une norme se propose comme un mode possible d'unification d'un divers, de rsorption d'une diffrence, de rglement d'un
diffrend. Mais se proposer n'est pas s'imposer. la diffrence
d'une loi de la nature, une norme ne ncessite pas son effet. C'est
dire qu'une norme n'a aucun sens de norme toute seule et toute
simple. La possibilit de rfrence et de rglement qu'elle offre
contient, du fait qu'il ne s'agit que d'une possibilit, la latitude
d'une autre possibilit qui ne peut tre qu'inverse. Une norme, en
effet, n'est la possibilit d'une rfrence que lorsqu'elle a t institue ou choisie comme expression d'une prfrence et comme instrument d'une volont de substitution d'un tat de choses satisfaisant un tat de choses dcevant. Ainsi toute prfrence d'un ordre
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
39
possible s'accompagne, le plus souvent implicitement, de l'aversion
de l'ordre inverse possible. Le diffrent du prfrable, dans un domaine d'valuation donn, n'est pas l'indiffrent, mais le repoussant, ou plus exactement le repouss, le dtestable. Il est bien entendu qu'une norme gastronomique n'entre pas en rapport d'opposition axiologique avec une norme logique. Par contre, la norme logique de prvalence de vrai sur le faux peut tre renverse en norme de prvalence du faux sur le vrai, comme la norme thique de
prvalence de la sincrit sur la duplicit peut tre renverse en
norme de prvalence de la duplicit sur la sincrit. Toutefois, l'inversion d'une norme logique ne donne pas une norme logique, mais
peut-tre esthtique, comme l'inversion d'une norme thique ne
donne pas une norme thique, mais peut-tre politique. En bref,
sous quelque forme implicite ou explicite que ce soit, des normes
rfrent le rel des valeurs, expriment des discriminations de
qualits conformment l'opposition polaire d'un positif et d'un
ngatif. Cette polarit de l'exprience de normalisation, exprience
spcifiquement anthropologique ou culturelle s'il est vrai que
par nature il ne faut entendre qu'un idal de normalit sans normalisation , fonde dans le rapport de la norme son domaine d'application, la priorit normale de l'infraction.
Une norme, dans l'exprience anthropologique, ne peut tre originelle. La rgle ne commence tre rgle qu'en faisant rgle et
cette fonction de correction surgit de l'infraction mme. Un ge
d'or, un paradis, sont la figuration mythique d'une existence initialement adquate son exigence, d'un mode de vie dont la rgularit ne doit rien la fixation de la rgle, d'un tat de non-culpabilit
en l'absence d'interdit que nul ne ft cens ignorer. Ces deux mythes procdent d'une illusion de rtroactivit selon laquelle le bien
originel c'est le mal ultrieur contenu. l'absence de rgles fait
pendant l'absence de techniques. L'homme de l'ge d'or, l'homme
paradisiaque, jouissent spontanment des fruits d'une nature inculte, non sollicite, non force, non reprise. Ni travail, ni culture,
tel est le dsir de rgression intgrale. Cette formulation en termes
ngatifs d'une exprience conforme la norme sans que la norme
ait eu se montrer dans sa fonction et par elle, ce rve proprement
naf de rgularit en l'absence de rgle signifie au fond que le
concept de normal est lui-mme normatif, il norme mme l'univers
Statistique, moyenne, norme et anormalit : G. Canguilhem, Le normal et le pathologique
40
du discours mythique qui fait le rcit de son absence. C'est ce qui
explique que, dans bien des mythologies, l'avnement de l'ge d'or
marque la fin d'un chaos. Comme l'a dit Gaston Bachelard : La
multiplicit est agitation. Il n'y a pas dans la littrature un seul
chaos immobile (). Dans les Mtamorphoses d'Ovide, la terre
du chaos ne porte pas, la mer du chaos n'est pas navigable, les formes ne persistent pas identiques elles-mmes. L'indtermination
initiale c'est la dtermination ultrieure nie. L'instabilit des choses a pour corrlat l'impuissance de l'homme. L'image du chaos est
celle d'une rgularit nie, comme celle d'un ge d'or est celle
d'une rgularit sauvage. Chaos et ge d'or sont les termes mythiques de la relation normative fondamentale, termes en relation telle
qu'aucun des deux ne peut s'empcher de virer l'autre. Le chaos a
pour rle d'appeler, de provoquer son interruption et de devenir un
ordre. Inversement, l'ordre de l'ge d'or ne peut durer, car la rgularit sauvage est mdiocrit ; les satisfactions y sont modestes
aurea mediocritas parce qu'elles ne sont pas une victoire remporte sur l'obstacle de la mesure. O la rgle est suivie sans conscience d'un dpassement possible toute jouissance est simple. Mais
de la valeur de la rgle elle-mme peut-on jouir simplement ? Jouir
vritablement de la valeur de la rgle, de la valeur du rglement, de
la valeur de la valorisation, requiert que la rgle ait t soumise
l'preuve de la contestation. Ce n'est pas seulement l'exception qui
confirme la rgle comme rgle, c'est l'infraction qui lui donne occasion d'tre rgle en faisant rgle. En ce sens, l'infraction est non
l'origine de la rgle, mais l'origine de la rgulation. Dans l'ordre du
normatif, le commencement c'est l'infraction. Pour reprendre une
expression kantienne, nous proposerions que la condition de possibilit des rgles ne fait qu'un avec la condition de possibilit de
l'exprience des rgles. L'exprience des rgles c'est la mise
l'preuve, dans une situation d'irrgularit, de la fonction rgulatrice des rgles.
Fin de lextrait
Vous aimerez peut-être aussi
- Digitalisation Bancaire PDFDocument30 pagesDigitalisation Bancaire PDFZaki Brahmi63% (16)
- Bachelard - L'expérience de L'espace Dans La Physique Contemporaine (1937)Document75 pagesBachelard - L'expérience de L'espace Dans La Physique Contemporaine (1937)Patrícia Netto100% (1)
- Guide Malveillance A L'usage Des MairesDocument20 pagesGuide Malveillance A L'usage Des Mairesmanu2933Pas encore d'évaluation
- Citoyens Sous Surveillance - La Fin de La Vie PrivéeDocument33 pagesCitoyens Sous Surveillance - La Fin de La Vie PrivéeHerne EditionsPas encore d'évaluation
- Bourdieu Contre FeuxDocument125 pagesBourdieu Contre FeuxMiquel Figueras Moreu100% (1)
- Cours M1 Paris IDocument62 pagesCours M1 Paris IBernardo JeanPas encore d'évaluation
- Jean-Jacques Rousseau: Les Dossiers d'UniversalisD'EverandJean-Jacques Rousseau: Les Dossiers d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Reconnaissance FacialeDocument42 pagesReconnaissance FacialeotmanPas encore d'évaluation
- Chalmers - Qu'Est-ce Que La Science (Ed1987)Document237 pagesChalmers - Qu'Est-ce Que La Science (Ed1987)Jacquelin100% (2)
- L'ONTOLOGIE EST-ELLE FONDAMENTALE?, Levinas - 1951 (Artigo)Document12 pagesL'ONTOLOGIE EST-ELLE FONDAMENTALE?, Levinas - 1951 (Artigo)Guilherme Varela100% (1)
- Imaginaire Du ComplotDocument351 pagesImaginaire Du ComplotFrançois Gravel100% (2)
- Cours Sécuritè Informatique 2010 Mode de CompatibilitéDocument149 pagesCours Sécuritè Informatique 2010 Mode de CompatibilitéHaythem ArfaouiPas encore d'évaluation
- Gaston BachelardDocument2 pagesGaston BachelardRezzoug HamzaPas encore d'évaluation
- Le Droit Des Gens by Rawls, JohnDocument160 pagesLe Droit Des Gens by Rawls, JohnMhammed100% (1)
- Weber Max L Ethique Protestante Et L Esprit Du CapitalismeDocument155 pagesWeber Max L Ethique Protestante Et L Esprit Du CapitalismeindiigenaisPas encore d'évaluation
- Etats Généraux de La Servitude (Irresponsabilité Et Ignominie en Milieu Scientifique) Suivi de Totem Et Tabous (2005)Document42 pagesEtats Généraux de La Servitude (Irresponsabilité Et Ignominie en Milieu Scientifique) Suivi de Totem Et Tabous (2005)croquignolPas encore d'évaluation
- Tiercelin - L'éthique Face Au Défi Sceptique Quelques Parades Pragmatistes (James, Putnam, Peirce) .Document48 pagesTiercelin - L'éthique Face Au Défi Sceptique Quelques Parades Pragmatistes (James, Putnam, Peirce) .ralphy dude100% (1)
- Biometrie IrisDocument20 pagesBiometrie IrisOmar Kainnou0% (1)
- Durkheim, Qu'Est-ce Qu'Un Fait SocialDocument4 pagesDurkheim, Qu'Est-ce Qu'Un Fait SocialGros Caca Liquide100% (1)
- Bourdieu - Pierre - Ce Que Parler Veut DireDocument8 pagesBourdieu - Pierre - Ce Que Parler Veut DireMiquel Figueras Moreu100% (1)
- Canguilhem, Erwin Straus Et La Phénoménologie La Question de L'organisme VivantDocument28 pagesCanguilhem, Erwin Straus Et La Phénoménologie La Question de L'organisme VivantFahmi Ben Hfaiedh100% (1)
- Ernst Mach La Connaissance Et L - ErreurDocument266 pagesErnst Mach La Connaissance Et L - Erreurdexterite99100% (3)
- Le Stoïcisme - Jean Baptiste GourinatDocument110 pagesLe Stoïcisme - Jean Baptiste GourinatNabil BouhafaraPas encore d'évaluation
- Saint-Martin Louis-Claude - L Aurore Naissante Ou La Racine de La PhilosophieDocument14 pagesSaint-Martin Louis-Claude - L Aurore Naissante Ou La Racine de La PhilosophietiennosPas encore d'évaluation
- Hommes Domestiques, Hommes SauvagesDocument280 pagesHommes Domestiques, Hommes SauvagesNoël Pécout100% (1)
- Lacan, Fonction Et Champ de La ParoleDocument63 pagesLacan, Fonction Et Champ de La ParoleMiquel Figueras MoreuPas encore d'évaluation
- La Différence Ontologique Chez M. HeideggerDocument29 pagesLa Différence Ontologique Chez M. Heideggervince34Pas encore d'évaluation
- Frémont, Le Pli DeleuzeDocument17 pagesFrémont, Le Pli DeleuzeLuca RodriguezPas encore d'évaluation
- La Mathesis Universalis Est Elle L'ontologie Formelle ? (Vincent Gerard)Document38 pagesLa Mathesis Universalis Est Elle L'ontologie Formelle ? (Vincent Gerard)mathesisuniversalisPas encore d'évaluation
- Rene Lew Positions 13 ProfesserDocument2 pagesRene Lew Positions 13 ProfesserFélix Boggio Éwanjé-ÉpéePas encore d'évaluation
- s3 PsychosesDocument783 pagess3 Psychosesglizano4474Pas encore d'évaluation
- PDF Theorie Du SyllogismeDocument70 pagesPDF Theorie Du SyllogismeJinOtaku100% (1)
- Rapport Complet Video SurveillanceDocument71 pagesRapport Complet Video SurveillanceZekri100% (8)
- Dossier La Violence Et Le Sacré René GirardDocument7 pagesDossier La Violence Et Le Sacré René GirardRobert LamothePas encore d'évaluation
- B. Russell - La Définition de " (La) Vérité" PDFDocument13 pagesB. Russell - La Définition de " (La) Vérité" PDFArnOmkar100% (1)
- DS 006 2013 Jus PDFDocument8 pagesDS 006 2013 Jus PDFCA E RovPas encore d'évaluation
- Etienne De Greeff (1898-1961): Psychiatre, criminologue et romancierD'EverandEtienne De Greeff (1898-1961): Psychiatre, criminologue et romancierPas encore d'évaluation
- Foucault - Les Anormaux (Resumé)Document8 pagesFoucault - Les Anormaux (Resumé)sariliberoPas encore d'évaluation
- Thèse - Viennet - Temps, Développement, Pathologies PDFDocument351 pagesThèse - Viennet - Temps, Développement, Pathologies PDFRodrigo CornejoPas encore d'évaluation
- Entretien Avec Jérôme Rousse-Lacordaire (Novembre 2009)Document19 pagesEntretien Avec Jérôme Rousse-Lacordaire (Novembre 2009)highrangePas encore d'évaluation
- Mésologiques - La Chôra Chez Platon - Augustin BerqueDocument6 pagesMésologiques - La Chôra Chez Platon - Augustin BerquemaxiPas encore d'évaluation
- CarnapDocument10 pagesCarnaphilladeclackPas encore d'évaluation
- Luc Foisneau - HOBBES ET LA THÉORIE MACHIAVÉLIENNE DE LA VIRTÙDocument22 pagesLuc Foisneau - HOBBES ET LA THÉORIE MACHIAVÉLIENNE DE LA VIRTÙYuri SilvaPas encore d'évaluation
- L'Épistémologie Française Et Le Problème de L'objectivité ScientifiqueDocument16 pagesL'Épistémologie Française Et Le Problème de L'objectivité ScientifiqueOndřej ŠvecPas encore d'évaluation
- Émergence de ProbabilitéDocument5 pagesÉmergence de Probabilitéachille7Pas encore d'évaluation
- Durkheim - Jugements de Valeurs Et Jugements de RealitéDocument13 pagesDurkheim - Jugements de Valeurs Et Jugements de RealitéJulio Santos FilhoPas encore d'évaluation
- Cassirer, Formes Symbolique Et Structuralisme ENSDocument15 pagesCassirer, Formes Symbolique Et Structuralisme ENSDaniel SdPas encore d'évaluation
- Luchelli, J.P. - These Le TransfertDocument310 pagesLuchelli, J.P. - These Le TransfertPatricio Andrés BelloPas encore d'évaluation
- SchreberDocument86 pagesSchreberaliodormanoleaPas encore d'évaluation
- DumezilDocument34 pagesDumezilMitoGriegoPas encore d'évaluation
- La Sociologie: Histoire Idées CourantsDocument22 pagesLa Sociologie: Histoire Idées CourantsBirame Boli Diop0% (1)
- Lacan Regard TableauDocument17 pagesLacan Regard TableauVero VeraPas encore d'évaluation
- Avenir, MJ - Methodologie Sans EpistemologieDocument15 pagesAvenir, MJ - Methodologie Sans EpistemologiecomunidadcomplejidadPas encore d'évaluation
- Durkheim (1893) de La Division Du Travail Social PDFDocument502 pagesDurkheim (1893) de La Division Du Travail Social PDFVincent ColonnaPas encore d'évaluation
- 06-'Je-Serai Là-Où Je-Sera' (Exode, 3, 14)Document4 pages06-'Je-Serai Là-Où Je-Sera' (Exode, 3, 14)Aurélien MarionPas encore d'évaluation
- Cours de QDocument19 pagesCours de QTarikBrikiPas encore d'évaluation
- Machiavel Et Spinoza, Le Temps D'une Rencontre - La Vie Des Idées PDFDocument7 pagesMachiavel Et Spinoza, Le Temps D'une Rencontre - La Vie Des Idées PDFAnonymous VNwWDqlrPas encore d'évaluation
- La Mort Aux TroussesDocument15 pagesLa Mort Aux TroussesEwerton M. LunaPas encore d'évaluation
- Alain Badiou - L'autonomie Du Processus EsthétiqueDocument16 pagesAlain Badiou - L'autonomie Du Processus EsthétiqueAustin E BeckPas encore d'évaluation
- Les Ecrits de Jean Starobinski PDFDocument44 pagesLes Ecrits de Jean Starobinski PDFSoledad RodriguezPas encore d'évaluation
- La Phénoménologie de Husserl Comme MétaphysiqueDocument30 pagesLa Phénoménologie de Husserl Comme MétaphysiqueLandry SEKIPas encore d'évaluation
- GreenDocument4 pagesGreenanaPas encore d'évaluation
- Quelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustD'EverandQuelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustPas encore d'évaluation
- Essais d'un dictionnaire universel: Contenant généralement tous les mots François tant vieux que modernes, & les termes de toutes les Sciences & des ArtsD'EverandEssais d'un dictionnaire universel: Contenant généralement tous les mots François tant vieux que modernes, & les termes de toutes les Sciences & des ArtsPas encore d'évaluation
- Yurupari Ou Les Figures Du DiableDocument13 pagesYurupari Ou Les Figures Du DiableMiquel Figueras MoreuPas encore d'évaluation
- Bourdieu - Sciences Sociales Et Engagement PolitiqueDocument8 pagesBourdieu - Sciences Sociales Et Engagement PolitiquepatslifePas encore d'évaluation
- Lévi-Strauss-guerre Et Commerce Chez Les Indiens D'amérique Du SudDocument10 pagesLévi-Strauss-guerre Et Commerce Chez Les Indiens D'amérique Du SudMiquel Figueras MoreuPas encore d'évaluation
- Imm5756 1-Ne5gyooDocument3 pagesImm5756 1-Ne5gyooBhl ZarroukPas encore d'évaluation
- Bettahar SaberDocument92 pagesBettahar SaberZinou Yahia CherifPas encore d'évaluation
- WISTA. Guide 5256 - Presenter Une Demande de Visa de VisiteurDocument5 pagesWISTA. Guide 5256 - Presenter Une Demande de Visa de VisiteurMackendy EmmanuelPas encore d'évaluation
- 1871 Em29112015 PDFDocument21 pages1871 Em29112015 PDFelmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- SG BanqueADistance ConditionsGeneralesBaDDocument20 pagesSG BanqueADistance ConditionsGeneralesBaDlaxaPas encore d'évaluation
- Mini ProjetDocument75 pagesMini ProjetBeñ Abdëlwahēd GhådãPas encore d'évaluation
- Initiation Sur La BiométrieDocument23 pagesInitiation Sur La BiométrieNaima.Lgarch100% (1)
- Monsieur Le Directeur Général de GEMALTODocument3 pagesMonsieur Le Directeur Général de GEMALTOFranck JocktanePas encore d'évaluation
- Weisungen Aug F PDFDocument263 pagesWeisungen Aug F PDFBoris JohnsonPas encore d'évaluation
- Controle Acces BiometriqueDocument3 pagesControle Acces Biometriquefrvoya2934Pas encore d'évaluation
- Ketreb IssadDocument76 pagesKetreb IssadCabrel TchoffoPas encore d'évaluation
- PFE Smart DoorDocument74 pagesPFE Smart DoorBaha Eddine DridiPas encore d'évaluation
- 2017 11 22 Mali Fichier Electoral Et Carte Nina Du Mali 1Document29 pages2017 11 22 Mali Fichier Electoral Et Carte Nina Du Mali 1ladji103Pas encore d'évaluation
- Bac Pro HG Septembre2022Document11 pagesBac Pro HG Septembre2022Z10 OffcielPas encore d'évaluation
- Introduction A - l'IADocument24 pagesIntroduction A - l'IArebekgermain0% (1)
- Titre Résumés Rapport 2015 PDFDocument175 pagesTitre Résumés Rapport 2015 PDFEl Arbi Abdellaoui AlaouiPas encore d'évaluation
- Imm5756 2-X79nivyDocument3 pagesImm5756 2-X79nivyMohammed Ameer100% (1)
- Memoire Finale Ferdi Dorsaf2023Document75 pagesMemoire Finale Ferdi Dorsaf2023ZoubirPas encore d'évaluation
- Mise en Œuvre D'un Système de Contrôle D'accès Basé Sur Reconaisance Facial Et Emprien DigitalDocument104 pagesMise en Œuvre D'un Système de Contrôle D'accès Basé Sur Reconaisance Facial Et Emprien DigitalAIMEN HAMOUDA100% (1)
- Chapitre 5 L'accès Aux RessourcesDocument7 pagesChapitre 5 L'accès Aux RessourceskryroussetPas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument12 pagesRapport de StageDany MbadingaPas encore d'évaluation
- Cours01 BiometrieDocument14 pagesCours01 BiometrievladimusPas encore d'évaluation
- ReconFacial AmelDocument26 pagesReconFacial Amelb_amel_a5Pas encore d'évaluation