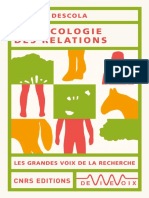Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Julien Bonhomme - Anthropologue Et:ou Initié-L'anthropologie Gabonaise À L'épreuve Du Bwiti
Transféré par
SKYHIGH4440 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
133 vues10 pagesJulien Bonhomme - Anthropologue et/ou initié-L’anthropologie gabonaise à l’épreuve du Bwiti
Titre original
Julien Bonhomme - Anthropologue et:ou initié-L’anthropologie gabonaise à l’épreuve du Bwiti
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentJulien Bonhomme - Anthropologue et/ou initié-L’anthropologie gabonaise à l’épreuve du Bwiti
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
133 vues10 pagesJulien Bonhomme - Anthropologue Et:ou Initié-L'anthropologie Gabonaise À L'épreuve Du Bwiti
Transféré par
SKYHIGH444Julien Bonhomme - Anthropologue et/ou initié-L’anthropologie gabonaise à l’épreuve du Bwiti
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 10
Julien Bonhomme
Anthropologue et/ou initié
L’anthropologie gabonaise a l’épreuve du Bwiti
Pagination de !dition papier : p. 207-226
« Que se passe-til lorsque I'anthropologie est prise en charge par les sociétés “exotiques”
clles-mémes — par les sociétés dites exotiques 7 Que se passe-til, par exemple, lorsque des
Africains entreprennent d’étudier leur propre société ou leur propre culture ? » (Hountondji,
1993 : 99). Cette question, posée par le philosophe béninois Paulin Hountondji, est loin
tre purement shétorique. La discipline anthropologique est née en Occident au XIX siécle
comme une science de Valtérité culturelle. Mais dans In seconde moitié du XX° sigcle,
diverses anthropologies nationales émergent progressivement en Afrique et ailleurs 8 cété des
anthropologies hégémoniques (nord-américaine, britannique, frangaise) (Ribeiro & Escobar,
2006). Or, ces anthropologies nationales se définissent moins par un rapport & Ialtérté que
por une relation complexe & leur propre identité — les anthropologues afticains travallant
‘tes majoritairement sur leur propre pays. Cette « anthropologie chez soi » (Ouattara, 2004 ;
Diawara 1985) place alors le chercheur dans la position délicate d”un insider-outsider,alliant
proximité culturelle et distance sociale et devant trouver sur le terrain un juste équilibre
entre engagement et 1a distanciation. Contemporain du patriement de V’anthropologie
occidentale vers une « anthropologie du proche », ’émergence de cet « afticanisme du
dedans » (Copans, 1991) n’en constitue pas pour autant un exact symétrique. Le statut
singulier de Vanthropologie africaine doit en effet étre replacé dans Vhistoire du passé
colonial de I’anthropologie africaniste. Danses années 1960, au moment de la décolonisation,
anthropologic a fort mawvaise séputation au sein des nations souverainesd” Afrique : accusée
du double péché de primitivisme et de colonialisme, elle est rejetée des nouvelles universités
ou bien fondue dans des départements de sociologie (Nkwi 1998, 2006). L’anthropologie
passéiste est ainsi écartée au profit d'une sociologie jugée plus modemiste, parce que pouvant
contribuer activement au développement du pays. Ce n’estqu’a partirde lain desannées 1980
que Y’anthropologie renaitra de ses cendres sur le continent afticain : Yuniversité de Nairobi
couvre un département d’anthropologie en 1985, celle de Yaoundé en 1993 ; la Pan African
‘Association of Anthropologists voit le jour en 1989.
Rejeton de cette histoire, Ia jeune anthropologie nationale africaine se setrouve prise
dons une tension structurelle ent dépendance et autonomic. Comme le dénonce P.
Hountongji, elle reste souvent prisonniése d’une situation d’extraversion et de dépendance
néocoloniale & Végard de 1'Occident : davantage Iue hors d'Afrique qu’en Afrique, la
discipline a une tendance & Y'autoexotisme : lanthropologue africain aurnit ainsi appris,
«A se segarder lui-méme avec les yeux des autres » (Hountondji, op. cit. : 106). Produit
une division intemationale du travail scientifique inégale, I’ethnographie ofricaine survit
en collectant des faits empiriques que T’anthropologie occidentale se séappropric en les
insérant dans ses théories. Face A cette situation de dépendance de In périphérie face au
centre, 'anthropologie afticaine est en quéte légitime d’autonomie. Conséquence directe de
cette situation, I'anthropologie afticaine, et plus largement le champ intellectuel afticain,
sont surdéterminés par un discours sur « V'identité dans sa double dimension politique et
culturelle » (Mbembe, 2000). Expert és identité culturelle, I'anthropologue devient alors
instrument d’un projet politique : le culturalisme anthropologique se setrouve au service
de T'idéologic du nationalisme culturel (ie. 1a reprise des discours savants sur I'identité
culturlie dans le cadre politique de In construction d’une identité nationale). De 18 les
cvitiques récunrentes, par certains intellectuels africains, de leurs collegues accusés d’étre
des intellectuels organiques liés au pouvoir (Eboussi-Boulaga, 1993), des « griots des
ségimesen place » (Hountondji, 1977), Les anthropologies nationals afrcaines seraient ainsi
consubstanticllement des anthropologies nationalistes (anthropologies of nation-building) par
‘Joursal des anthropologuee, 110-117 [2007
‘opposition aux anthropologies occidentales impésilistes (anthropologies of empire-building)
= pour reprendse une distinction avancée par George Stocking (1982).
L’anthropologie nationale au Gabon — sujet du présent asticle — ne fait pas exception
A cette histoire des anthropologies afticaines. Lors de sa cxéation en 1970, Iuaiversité
nationale du Gabon (sapidement sebaptisée université Omar-Bongo ou UOB) posséde des
dépastements d'histoire (Gray, 1994) et de sociologie (Mbah, 1987 & 2002), mais pas
aanthropologie, cette « science interdite » (Mayes, 1999). Ce nest qu'en 1997 qu'un
dépastement d'anthropologie se cxée A parti d'une scission du Département de sociologie.
Codisigg A ’origine par un aathropologue gabonais (formé en Frsace) et ancien ministre de a
Culture — Jean-Eimile Mbot — et un anthropologue frangais (océaniste de formation) résident
de tes longue date au Gabon ~ Raymond Mayer -, ce dépastement d’anthropologie offie
un cycle uaiversitaixe complet, de la premitse année au doctorat’. Le département se double
ua laboratose de secherche, avec I'intégration dans le gison de l'anthropologie du LUTO,
stoucture intesdisciplinaire cxéée en 1983 par Michel Voltz, coopérant fraucais en poste au
Gabon’. Le dépastement d’ Anthropologie de 1" UOB accueil ainsi aujourd'hui de nombreux
érudiaats, ravaillant dans immense mnjosité sur des texans gabonais (mime sice n'est pas
acessairement sur leur propre groupe ethnigue)’
Contribution modeste & une saciologie des « anthsopologies nationales », cet article esquisse
rune analyse de la production du savoir anthropologique au Gabon. Afin d’éviter les
considémtions top générales sur les anthropologies afficaines, voie pavée de pitges et
de polémiques (néocoloniclisme, afroceatsisme, ete), je préfere m’en tenis A ce que les
anthropologues ont toujours sule mieux faire : analyses se situation ethnogsaphique. L’zticle
Sappuie ainsi sur la description d'un événement singulies: le sémiinaie « Bwiti du Gabon »
organise par le LUTO du 8 au 13 mai 2000 a lunivessité Omar-Bongo. Ce séminaise fut
consacxé au Bwiti, société intiatique oviginaire du Gabon central suais aujourd'hui xépandue
das a majeuse pastie du pays, etdontle rite de passage impose I'absomption de ’hallucinogne
‘végétal iboga (tabemanthe iboga) (Femandez, 1982 ; Mary, 1999 ; Bonhomme, 2005). Ce
fut une des premitzes occasions de pavler en public d'une tradition initiatique jusque-
Bh entousée d'une chape de silence (du fait de Ia esainte ou de Ja diabolisation de la past
des profanes et du sespect obstiné du secret de Ia past des initiés). Le séminaire, auguel
jJassistai, fut une franche séussite, comme en témoigna la salle comble d'uaivessitaizes
et d'étudiants autant que de cusieus et d"initiés du Bwiti, L’hypothése de cet article est
que cet événement constitue use situation ethnogsphique pasticulitxement significative
Certes, le séminae portait sur un théme qui ne ssusait sésumer a lui seul V'ensemble des
champs d'investigation de l'anthropologie nationale. Sujet singuligvement « sensible », le
Bwiti constitue néanmoins une soute é'épreuve sévélatsice & pasts de laquelle il est possible
analyser I'anthvopologie gabonaise, sur le modéle des érudes de controverse proposées par
la sociologie de la conaaissance
L’anthropologie gabonaise en charge du « patrimoine
identitaire national »
Lenjeu principal — et paradoxal - du séminaise « Bwiti du Gabon » état de publicises une
‘undition initiatique seeséte. Méme si cela n'a pas encore été fait A ce jous, le collogue devait
aboutir’ la publication des actes scientifiques ainsi que d'une « version pour la sensibilisaton
du gyand public ». Dépassant audience académique, les anthropologues entendaient ainsi
touches toute Ia société gabonaise. La couverture médiatique de I'événement a été Ala hauteur
de cette ambition : articles dans le quotidien national, retransmission des interventions &
Ja mdio et & la télévision. Cette diffusion du discouss anthropologique au-dela du cescle
universitaire illus bien Ia fonction — explicitement affichée — du séminaive et, au-deld, de
Yanthropologie gabonaise : inventaise et la valosisation d’un patsimoine cultusel national”
Devant se démanquer de la sociologje dontelle est issue, la eune anthropologie gabonaise s'est
encffet donnée pour tiche de dresser une « encyclopédie des cultures » locales, A pasts d'une
collecte organisée « en fonction de l'intéét des populations elles-mémes » (Mayes, op. cit.)
Pasmi les missions officielles du LUTO figure ainsi la teaue annuelle dua « séminaise sus le
‘Joursal des anthropologuee, 110-117 [2007
patrimoine identitaire national »”.L’anthropologie gabonaise tie done sa légitimité, aussi bien
scientifique que politique, de sa participation active & Ia construction d'une identité nationale
qui passe par T'invention et a promotion d'un patrimoine culture! commun’. Au Gabon,
comme ailleurs en Afrique, cette contribution de I’anthropologie & 1a construction nationale
ne se focalise pas sur la question de Iintégration de minorités marginales (comme avec les
amérindiens ou les aborigenes australiens), mais plutét sur la question de 1a diversité ethnique
de pays compte une quarantaine d’« ethnies ») et sur celle du sous-développement rural
(aotamment par rapport & la macrocéphalie de Libreville)’. La constitution d°un patrimoine
culture! commun doit ainsi servir 8 séconcilier idéalement diversité ethnique et citoyenneté
nationale, modemité urbaine et traditions villageoises — projet qui illuste bien I'intication
intime des sphéses politique et universitaire au Gabon”
Mais cette entreprise de patrimonialisation culturelle doit également étre replacée dans le
contexte de la construction d’un patrimoine « bantu » a1”échelle plus vaste du sous-continent
Yanthropologie gabonaise est ainsi partie prenante du Centre international des civilisations
bantu (CICIBA), cxéé en 1983 A I'initiative d’ Omar Bongo, bast & Libreville, et ayant pour
but « la défense et 1a promotion de Ia culture bantu »''. Comme son nom V'indigue bien,
le projet méme du CICIBA constitue une prise de position trés nette, & la fois scientifique
et politique, dans le débat controversé pour déterminer si « bantu » désigne seulement une
famille linguistique ou également une unité culturelle™. Or, plusieurs des organisateurs du
séminaise du LUTO font eux-mémes partic des fondateurs historiques du CICIBA, et plus
tard du département d” Anthropologie de !'UOB. Et leurs yeux, le Bwiti représente une pice
esseatielle du patrimoine religieux bantu, prouvant ainsi importance culturelle du Gabon au
sein de la sous-tégion : selon l'argumentaise, le séminaire vise ainsi A comprendre pourquoi
con peut dire que « le Gabon est 1’ Afrique ce que le Tibet est A I"Asie, & savoir un centre
spitituel initiation religieuse »
Si elle avait été condamnée juste apres les indépendances au nom du développement et
de In modernisation, V'anthropologic africaine parvient A retrouver une certaine légitimité
cn sehabilitant les traditions culturelles mobilisées au service de Ia construction nationale.
Fhisaat écho ce retounement historique, les participants du séminaise du LUTO se sont
ainsi demandés sile Bwiti constituait un facteur de sous-développement ou de développement
pour le Gabon, et ont finalement opté publiquement pour Ia seconde réponse. Et Tune des
interventions porte précisément surle « Bwiti de développement ». L’anthropologie gabonaise
ne se veut done pas un conservatoise passéiste de Ia culture villageoise, mais entend ccuvrer
8 Ia reactivation modeme des traditions dans le cadre élargi du développement national
“Manifestation tangible de ce projet Ia semaine du séminaire s’estclose surune weillée de Bwiti
dans un mbandja (case cérémonielle) construit pour occasion sur le campus, juste demiére le
dépastement d’ Anthropologie. Selon les dires mémes des organisateurs, «c'est le Temple qui
vient investir "Université ». Cette entreprise passe ainsi par un nécessaire « réenchantement
de la tradition » (Mbembe, op. cit). L’argument écrit du séminaire du LUTO dépeint ainsi le
Bwiti comme une « sagesse millénaire qui fait partie de notre patrimoine culturel ». Promue
en ethnophilosophie & usage des jeunes générations, la tradition initiatique est « un facteur
susceptible d’apporter un nouveau senséla vie » et, selon une étrange expression, de « garantir
une survie pleine et harmonicuse »
L’anthropologie gabonaise entend ainsi ériger le Bwiti en une sorte de religion nationale
(alors méme que seule une toute petite minorité de Gabonais est effectivement initiée & Tune
ou Y'autre des branches du Bwiti). L’une des interventions s'intitule d'ailleurs « Le Bwiti
comme ereuset d'une culture gabonaise, pour une langue nationale ». Cette patrimonialisation
nationale des faits cultuels est pourtant une tiche problématique. Le Bwiti est organisé en
communautés initiatiques locales, autonomes et généralement sivales. Pendant le séminaire,
nombre d’initiés ont ainsi défendu le posticularisme de leur Bwiti contre toute tentative
de nationalisation. D’autres Vont revendiqué comme un patrimoine ethnique plutét que
national : le Bwiti « origine! » et « suthentique » des Mitsogo on des Gapinzi du Gabon
central (d°oit provient cette tradition initiatique), par opposition au Bwiti « synerétique »
‘Joursal des anthropologuee, 110-117 [2007
10
des Fang ou au Bwiti cosrompn et vénal de telle aute ethnie. Ces contestations multiples
moatrent qu’en définitive, Vintitulé méme du séminaise « Le Bwiti du Gaboa » est moins une
formule consensuelle qu’un pasi os€ : une soste d’énoncé pesformatif sésumaat le projet du
nationalisme cultusel de l'anthropologie gabonaise
‘Mais Ja construction dun patrimoine culture! seprésente également un enjeu international.
L’anthsopologic est en effet un protagoniste incontoumnable dans le processus de valosisation
de « savoirs endogénes » (Hountondji, 1994) reconnus et encourages par certaines institutions
intemationales (UNESCO, OMS ainsi que diverses organisations non gouvemnementales)
comme des facteurs de développement. Au prisme du discours anthropologique, les nganga
(devins-guérisseurs) devieaneat ainsi des « uadipsaticiens » et le Bwiti une « médecine
‘waditionnelle », acteurs et institutions pouvant alors étre revétus d’une Iégitimité nationale et
intemnatiouale”. Dans ce contexte globalisé, la valosisation anthropologique du Bwiti implique
également de sécis enjeux économiques ou touristiques, notamment & travers de possibles
usages thérapeutiques, voire pharmaceutiques, de Iiboga (hallucinogéne végétal utilisé lors
de initiation )*. Une joumée du séminaire estd’ailleurs consacrée Ades exposés sur ia culture
expérimentale de I'iboga en pépinitxe ou Ia psychophamacologie de Pibogaine (principal
alcaloide actif de Iiboga). Le pharmacologue et pharmacien Jean-Noél Gassita, président
A honneur du séminaise (et ancien directeur du LUTO), annonce ainsi que « Iiboga peut aider
Je Gabon & décoller franchement ». La plante sacrée, et & travers elle 1a culture, pourraient
penmette d'initier un nouveau cycle vertueux de développement économique, succédant &
ceux du bois, du minernietdu pétole : on annonce ainsi que « le toisiéme suillénaise sera celui
deY'iboga ». L’eunuiest que la flose est ua « patrimoine de I’bumsanite », seule une application
thérapeutique précise pouvant faire Vobjet d'un brevet exploitable économiquemeat. O:
Howard Lotsof, un ancien toxicomane américain reconverti en prosélyte de I'iboga, a dé
post plusieurs brevets sur les usages potentiellement antiaddictifs de I'ibogaine, doublant les
Gabonais et senforgant le sessentiment contre Ja biopisatesie occidentale". Un intervenaat
cexhoste ainsi les Gabonais & protéges ce patsimoine national qu’est le Bwiti « avant que les
‘Amézicains ne nous le prennent ».
La teaue du séminaixe coincide de fait avec ’émergence rpide d'un tousisme initiatique de
YBusope et de I’ Amésique du Nord vers le Gabon. Ce tousisme d’inspization new-age s’appuie
sur des ouvrages (Ravalec et al, 2004 ; Laval-Feantet, 2005) ow des sites intemet vantant les
anérites de I iboga"*. Parnes acteurs de ce réseau transnational en voie d’organisation,on peut
‘wouver un Finagais expatrié au Gaboa qui initie des étmaagess contactés par internet ou encore
‘ua Neanga gabonais désormais installé en Fraace et organisant des séminaises de découveste
surle Bwitien s€gion parisieane et des voyages initiatiques au Gabon. Etilestsignificatif que
plusieurs d’eatie ces « passeurs » ont pasticipé ou assisté au séminaise du LUTO,
Le « Bwiti du Gabon », oscillant ente patrimoine ethnique, patrimoine national, patrimoine
bantu et patvimoine de Phumanité, se setrouve ainsi au centre de tentatives d’appropsiation
conflictuelles. C’estdonc dansle contexte globalisé d'une « géopolitique du savoir» (Mignolo,
2000) qu’il faut replaces Je projet de I'anthropologie gaboaaise de patrimonialisation des
« savoiss indigenes ».
L’anthropologie gabonaise contestée par ses
« informateurs »
Le progmmme du séminaize seflétait fidelement Ia logique scientifique de Ianthropologie
classique, notamment Ia distinction entre discours savant et discours indigene. Chaque journée
devait en effet etre divisée en deux : une matinée consacsée aux exposés théosiques des
professeurs (anthropologues, mais aussi peychologues, sociologues, historiens, linguistes,
Dotanistes — presque tous gabonais — et un apsts-midi consacré aux « ateliess » ot des
« informateuss > initiés vienneat se confier & ua public encourngé pas les organisateurs & les
«csibles de questions ». La premiéze journée du séminaize a suffi 8 faise voles en éclats cette
sage séparation : les informateurs de I'aprés-midi refusent de liver leur savoir secret ; Ies
initiés interviennent dés le matin pour contester les professeurs ; certains participants sont Ala
fois professeurs et initiés ; le public prend les uns ct les autres partic. Au final, la majorité
‘Joursal des anthropologuee, 110-117 [2007
B
“
des interventions aura moins porté sur le Bwiti lu-méme que sur les ségles problématiques de
énonciation : non pas « qu’est-ce que le Bwiti 7» mais plutét « comment peut-onen pasler >
et « qui peut en parler 2 ». Ces controverses houleuses autour du statut du discours donnent
a voir de fagon exemplaire Ia place qu’occupe I'anthropologie nationale dans un champ de
savoirs parcourn de tensions et de remises en question.
Les controverses entre professeurs et initiés se cristallisent d’abord sur ’opposition entre un
savoir académique public et un savoir inititique secret. Au coeur de toutes les interactions
initintiques, Ie secret vaut en effet moins par son contenu sémantique que par sa fonction
selationnelle :'instauration d’une frontiére ente initiés et profanes, est Adie entre ceux qui
savent mais ne peuvent parler et ceux qui ne savent pas et n’ont done rien & dire". La volonté
des anthropologues gabonais de « lever le voile » sur le Bwiti place donc les initiés devant
un double-bind inédit: il leur faut « divulguer leur savoir tout en sespectant le secret ». Les
positions oscillent alors entre ésotéristes et exotéristes. Alors que les seconds voient dans le
séminaise une source possible de profit symbolique, les premiers opposeat leur silence obstin€
‘aux questions des anthropologues : « On ne peut pas dévoiler le secret. Deja, on en dit trop
ici, Je sisque la folie ou Ia mort ». Se taire est une fagon de réaffirmer I'importance du secret
et le pouvoir qu'il confére (Jamin, 1977), La sésistance peut posfois se fire plus hostile : un
professeur est pris A partic A ’entrée de 'UOB, accusé de vouloir « violer » Ia tradition et
ses secrets.
Crest donc a tentative de publicisation et d’appropriation du Bwiti par V’anthropologie
gabonaise pour en faire un patrimoine national qui est ici en question. Le « savoir » sur
le Bwiti est en effet un enjeu de pouvoir pour les anthropologues comme pour les initiés.
Les débats toument ainsi autour des prétentions de Ianthropologie & constituer le Bwiti en
objet de connaissance ~ sachant qu’il n'y a nomalement pas d’autre savoir sur le Bwiti que
le savoir des initiés eux-mémes. La légitimit€ méme du discours anthropologigue se trouve
frontalement critique : « Ici, quand les anthropologues patient, ils ne disent sien d"important.
1 faut initiation pour vniment comprendse ». En refusant de jouer les informateurs dociles,
les initiés contestent les normes de 1a pratique anthropologique, notamment les relations de
pouvoir constitutives de Ia situation d’inteslocution (1°« intesrogatoire » de Yinformateu). Is
porviennent méme & retoumeria situation & leur avantage & travers a soigneuse mise en scéne
de leur parole pendant le séminaire : insignes de 1a parole initiatique (chasse-mouches & la,
sain, plume de perroquet au front), formulesrituelles de salutation et "approbation, discours,
cn langue vemaculaire accompagné par la harpe ngombi et ponctué par des chants. Tous ces
marqueurs distinctifs permettent de faire valoir la pasole initiatique face & la parole profane
(Gisqualifiée et pasfois huée par I'assemblée), y compris celle des anthropologues.
Le discours anthropologique se trouve également contesté jusque sur son propre terrain.
Eminemment synerétique, le discours des initiés passe en effet par une séappropriation
anarchique de bribes du savoir scientifique (séférences anthropologiques, philosophiques,
paychologiques, neurobiologiques), souvent fortement matinées d’ésotérisme occidental
(oeférences & 1’Atlantide, & la télépathie, aux dieux extratemesties)". Cette capacité &
intervenir directement surle terrain académique s’explique par le fait que les initiés presents
‘au séminaire forment avant-garde intellectuelle et wrbaine du Bwiti”. Nombre de ces
« informateurs » appesticnnent en effet & une catégorie émergente d’acteurs intermédiaires
du champ anthropologique, habitués & graviter autour de Vuniversité, du Centre culture!
frongais (organisateur de nombreux événements culturels et scientifiques) ou encore du
musée des Arts et Traditions”. Hybrides modemes entre I’anthropologue diplémeé et ’ancien
informateur indigéne, ces médiateurs semi-professionnels ont su tier pouti d’une proximité
gfogmaphique, mais aussi socioculturelle, avec Vuniversité, en se seconvertissant pasfois,
en entrepreneurs culturels, partenaires ou fondateurs d°ONG locales, voire en animateurs
de radio. Ces nouvelles competences leur conférent alors une certaine légitimité dans
Je champ académique. Ainsi, malgré quelques tentatives de rectification savante pendant
Je séminaire, les universitaires n’arviveront pas 4 séoffimmer clairement la frontiére entre
professeurs et initiés. Cette confusion des statuts et des savoirs offie finalement loccasion
un saisissont retoumement opéré par des initiés qui n’hésitent pas se proclamer les seuls
‘Joursal des anthropologuee, 110-117 [2007
16
uw
18
« vrais anthropologues » et faire du Bwiti la seule vésitable « science de Phomme »". C'est
donc bien Ia revendication du monopole de Ja vétit€ qui est ici en jeu : I'« école de brousse »
contre univers
Mais les anthropologues ont en séalité eux-mémes encoumgé leur mise en cause. Les
uaivessitaises proclament en effet haut et fost que les initiés sont leurs « collegues ». Is
célébrent Ia figure mythique du villageois ct ses traditions ancestmles. Un orateur commence
méme son intervention en déclamat : « Nous sommes universitaires avec les plus hauts
diplémes, mais nous sommes analphabétes par rapport aux maitres bwitistes ». Cette
posture ambigué illustre bien le couble-bind dans lequel les anthsopologues sont également
pris”. Son nationalisme cultusel conduit I'anthropologie gabouaise & survalosiser le « savoir
‘waditionnel », dans une double stratégie de construction d'une identité nationale et de
démaucation face & ’hégémonie occidentale. La promotion publique du « Bwiti du Gabon »
participe ainsi de 'idée d'une « science africaine » pouvant faire pendant & la science
occidentale et eagendres une « renaissance afticaine »”. Mais!’anthsopologie, hésitiéve disecte
de cette science occidentale colonial, s'expose alors & te contestée en setous par ce savoir
aéotsaditionnel qu’elle coutribue poustant & promouvois
En définitive, te séminaire « Bwiti du Gabon » du LUTO a constitué une véritable mise
cen scéae publique de 'aathropologie nationale et de ses enjeus. D illuste de manitre
cexemplaise que Ia mission principale de lanthsopologie gabouaise conceme la construction
ct Ia valorisation dun patrimoine cultwel commun ~ exjeu qui lui pesmet de ae plus éxe
considésée comme un obstacle mais au costinise comme ua soutien dans Ventreprise politique
de construction nationale, Le fait que le theme du séminaixe de l'année 2000 ait en outre été
ua sujet particulitvement seasible permet de faixe d’autant mieux sessostis les controvesses
‘autour de la constitution d’un savoir aathropologique national sur les twaditions cultuselles. Les
changes entse anthropologues et initiés sur le Bwiti sonten effet structués par une oscillation
cate des statégies de coopération ou de sésistance. Leuss sapports sont ainsi pris dans une
tension ambivaleate entre l'opposition (antagonisme du savoir anthsopologique public et du
savoir initiatique secret) eta légitimation mutuelle (La constitution et a définition xéciproques
du savoir anthsopologique et des « savoirs traditionnels »). Mais les échanges pasfois virulents
cate les divers acteurs du séminaixe metteat également en jeu la légitimité et 'autonomie du
champ académique, notamment face au champ initintique et religieux.
Les statégies de contestation ou d’appropriation de T'anthsopologie par les initiés gabonais
nous invitent alors & s€fléchir sur les fondements mémes de Ia discipline anthropologique.
L’anthsopologie sepose classiquement sus une séparntion entre les anthsopologues et leurs
informateurs, le discours savant et le discours indigene, es lieux de 1a production conceptuetle
et les lieux de 1a production factuetle, bref entte I'université et le terrain. Or, la situation
gabonaise témoigne d'une superposition, ou en tout cas d’un rapprochement, entre ces deux
poles de Ia production du savoir anthropologique. Comme un pasticipant du séminaise Ya
justemeat fait eemarquer : « La sépasation n'est pas facile &faixe » entse des uaiversitaixes qui
sont également initi¢s (el, justement, I'anthropologue A initiative de ce séminaire annuel) et
indociles informateurs initi¢s qui se proclament anthropologues. Ce trouble épistémologique
nous montie ainsi ce quoi I'anthropologie doit nécessaixement se confroater lossqu’elle
re peut plus ét un discours savant tenu sus une population sans voix. Le monologisme
de Vanthropologie hégémonique qui pasle au nom des indigenes céde alors la place & ua
dialogisme plus ouvert : 'ethnogsaphe n'a plus affaise A des « informateuss » mais & des
inteslocuteurs capables de parier en leur nom propre, de revendiquer, de contedie et méme
de se tise obstinément. L’exemple du sminaise « Bwiti du Gabon » montre toutefois
qu'on ne sausait se contentes d'une célébration postmodeme béate de cette tansformation
provocation stimulante & entichir et renouveler le discours anthropologique, I'hétéroglossic
peut également se sévéler pauticulitrement inconfortable lorsqu’elle aboutit A miner la
legitimité et Yautonomie de Ia discipline. Cette mise &1’épreuve de l'anthropologie nationale
gabousise par le Bwiti suscite en définitive des intesvogations épistémologiques propses
A noumis une « anthsopologie reflexive » (Scholte, 1969 ; Ghasatian, 2002) en quéte de
séinveation permanente
‘Joursal des anthropologuee, 110-117 [2007
Je tiens & remercier Raymond Mayer pour ses précieuses informations ainsi que Paul Nchoji
Nkwi pour m‘avoir gracieusement transmis son article depuis le Cameroun. Je remercie
également les memibres du LUTO (Laboratoire universitaire de la tradition orale) et du
LABAN (Laboratoire d’anthropologie), ainsi que les participants du séminaire « Bwiti du
Gabon » & Vuniversité Omar-Bongo.
Bibliographic
ABDEL GHAFFAR M. A., 1982. « The State of Anthiopology ia Sudaa », Etinos, 47(1): 64-80,
ASHFORTH A.,2005. Witcher, Violence, end Democracy ix South Africa. Chicago, The Univesity
of Chicago Pres.
BARTH F., 1975. Ritual end Knowledge among the Baktaman af New Guinea. New Haven, Yale
University Press
BEAL D.,DBRIENZO P., 1997. Report on the Staten Ioend Project. The Ibogaine Story. New York,
‘Autouomedia.
BERNAULT F., 2001. « L'Aftigue et Ia modesuité des sciences sociales », Vingtiéme Sigele, 70,
127-138.
BLANCKAERT C. (dit), 2001. Les politiques de l'authvopologie. Discous et pratiques on France
(2860-1040), Pools, L'Hanmatan,
BONHOMME J., 2005. Le Miroir ot le Créne. Parcours invitique du Bwete Misoko (Gabon). Patis,
crs.
BONHOMMBJ.,2006, « La feuile surla langue, Piagumatique du secetintiatique », Cahiers gabonaie
a anthropologie, 17 : 19381953,
CIARCIA.G., 2001, « Bxotiguement votes », Terrain, 37: 105-122
COPANS J., 1971. « Pour use histoire et une sociologle des études afticaines », Cahiers d'études
efricaines, 43: 422-487
COPANS!., 1991. «Les noms du Gees. Bialde seclologie de la connaissance du Senegal partul-méme,
1950-1990 >, Cahiers d'études efricaines, 123 : 327-302.
DIAWARA M., 1985. « Let recherches en histoire ome menées par un autochtone ou L"inconvénieat
dene du cru », Cahiers d'études africaines, 97 5-19.
EBOUSSI-BOULAGA F,, 1993, « L'iatellectuel exotique », Politique fricaine, 51:26:34
FERNANDEZ J. W., 1982. Bwiti: on Eihnography ofthe Religious Imaginction in Africa. Princeton,
Princeton University Press
(GERHOLM T., HANNERZU,, 1982. « The Shaping of National Anthropotogies »,Etinos, 47(1): 5-35.
GHASARIAN C. (dir), 2002. De I'ethnographie a lanthropologie reflexive. Nowweaux terrains,
nouvelles pratiques, nowweaus enjews. Pas, Amand Colin
GRAY, 1994, « WhoDoes Historical Research in Gabon? Obstactes tothe Developmentofa Schotasty
‘Tindition », History in Africa, 21: 413-433,
GRIGNON C., PASSERON J-C., 1989. Le savant et le populaire. Misérabilisme et popalisne en
sociologie et en litéreure, Pasis, Seu
HOUNTONDITP. J., 1977. Sur la « philosophic aicaine ». Critique de Uetinophilsophie. Pats,
Maspero.
HOUNTONDITP. J. 1993 [1988] « Situation de 'anthropologue afticain, Note critique sur une forme
@rextaversion scietifigue >. in GOSSELIN G., Les nowveaux enjeux de Uanthropologie, Autour de
Georges Beiendier. Pais, L’Hamnattan : 99-108.
HOUNTONDITP. J. (dir), 1994, Les soir endogénes, Pistes pour une recherche. Pats, Katha
JAMINS., 1977. Les oie silence. Essci sur la fonction sociale du secret. Pass, Mas.
KIALOP., 2005. Pove et forestiers face a la forét gabonaise. Exuisse d'une enthropologie comparée
de laforét. Tatse de doctorat en anthropologic, co-tutelle université Omar Bongo (Gaboa) et université
Pacis 5
LABORATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA TRADITION ORALE, 2000. Le Bwiti du Gabon
Séminaire interdisciplinaire du 8 au 13 mai 2000. Librevilc,unlversité Omar Bongo.
‘Joursal des anthropologuee, 110-117 [2007
LABORATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA TRADITIONORALE, 2001. Ravines, Masques et Vision
Un vovage initaique traverse Gabon. Libseville, Les editions du LUTO.
LAVAL-JEANTET M,, 2005. Paroles d'un enfaur de Bwiti. Les enseignements d'Thoga. Pais,
Origine.
L'ESTOILE (ée) B..NEIBURGF. & SIGAUDL. (dir), 2000 « Antnopotogies, tats et Population »,
Revue de Synthése, 21-4)
LOMNITZC.,2000. « Bordeving on Anthropology. The Dialects of a National Tradition in Mexico »,
Revue de snthése 1213-4) 345-379.
MARY A, 1999. Le defi du merce. Le travail smnbaligue dela veligion d'eboga (Gabon). Pais,
HESS.
MARY A., 2005, « Le Bwith hewse du village global », Ruprure-solidarité,6 : 83-103.
MAYER R., 1999. « L’anthropotogie, science interdite ? Déconstructions et reconstructions de
ethnologie en Afrique au XX" sitele », Cahiers gabonaisd’anthropologie, 4: 49-462
MBA BITOME J., 1985. iyfluence de la religion iboga sar la médecine traditionnelle et les soins de
santé ax Gabon. These de doctorat en anthropologie, univessité Lyou-2,
MBAH J-F., 1987. La recherche en sciences sociales au Gabon. Pais, "Hannan,
MBAH J-F., 2002. « Les tribulations de la sociologie gabonalse : scleace des probleme sociaux ou
science des faits construits 7», Revue afrcaine de sociologie, 5: 1-14,
MBEMBE A., 2000. « A propos des écrturesafticalnes de sol », Politique Africaine, 77 : 16-43.
MIGNOLO W. D., 2000. Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltem Knowledges and
Border Thinking. Princeton, Priceton University Press.
MUDIMBE V.-Y., 1988. The invention of Africa, Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge
Bicomington, Indiana University Press
NKWIP.N., 1998. « An African Anthropology? Historical Landmatis and Trends of Anthnopotogy in
AStica », African Anthropology, (2): 192-217.
NKWIP. N,, 2006, « Anthropology in a Post-Colonial Aftica: the Survival Debate », in RIBEIRO G.
L. & ESCOBAR A. (eds), World Anthropologies. Disciplinary Transformations in Systems of Power.
Osford, Berg,
OBENGA T,, 1985. Les Bantu. Lengues-Peuples-Cwilistions. Paris, Présence Africalne.
OUATTARA F., 2004, « Une étrange famillait. Les exigences de I'anthsopologie “chez sol", Cahiers
a études efricaines, 443) : 035-657.
PERROIS L., 1986. Les chefod aeuvre de l'art gabonais au musée des Arts et Traditions de Libreville.
Libreviie, Rotary Club de Librevitl-Okoum¢.
RAVALEC V., PAICHELER A. & RAVALEC M,, 2004. Bois sacré: Initiation a I'iboga. Paris, Au
Diable Vauvest.
RIBEIRO G. L., ESCOBAR A. (eds), 2008, World Anthrepelogies. Disciplinary Transformations in
Systems of Power. Oxford, Berg.
ROSSATANGA-RIGNAULT G., 1993. « L'intoutemble condition du clere gabonalt », Politigue
efricaine, 51: 48-60,
SCHOLTEB. 1969. « Toward a Reflexive and Critical Authiopotogy », in HYMESD. (¢4), Reinventing
Anthropology. New York, Pantheon Press
SIMMEL G., 1996 [1908]. Secret et societés serétes, Patis, Cc.
STOCKING G. W., 1982; « Afterword: a View from the Center», E#hnos, 47(1): 173-186,
Notes
2 Ladimension antionalste de 1'anthropologie n’esteependant pas une spécificté aficaine, mais un tait
plus général des « anthropotogies du Sud ».C¥. Lomnitz 2000) sur ’anthropologie untioaate mexicaine.
Ceta ait, let anthropotogies « impésialistes » du Nowd ont elles aussi pasticipe & la construction des
‘dentités nationales (Bianckxext, 2001),
23 La premiése these de doctomt deliviée pas 'UOB a été souteaue en 2005 par unanthvopologue : Paulin
Kinto (2005)
‘Joursal des anthropologuee, 110-117 [2007
4 Use seconde strucrue universe le LABAN, est née d°une scission du LUTO en 2004
5 La premitre année univestitae d'anthropologie 4 1"UOB compte envison 200 érudiants, tle evele
coniplet en reunit envison 350,
6 Cete state gie de patrimonialisation nationale expligue fe exhortations des psticipant du séminalse a
« gabonlser» es echesches sure Bwitjusque- majoritarement menées par des chescheurs éuangess
(fnngais et anricains). Ceterevendication coast égulemeat une cstgue diece de Yextaversion
de Manthropologie afscaine : les autbopologues africans sefuient d'eue tutes pa leu collegues
cccideataus comme de tiple infornateurs
7 Le sémianise « Bwiti du Gabon » a sins succédé & « Modes taditionsels de gestion des
ccosysttmes » (1998), « Clans, lgnages et villages comme mémoise sociale du Gabon » (1999) et
a précédé tes « Technologies anciennes et attematives du Gabon » (2001) « Pyzmées d*Afsque
centile » (2002), « Les ginades figures gabonaises » (2004) ou encore « L'eeole gnbouaise et ton
patsinioine culture» (2005)
8 Faceote ls deux tesmes pulsque cette entepsise ne se stsume pasa uae pure invention (dans a mess
cuellesappuie sur des uadition cultuelies préesstates) amis quelle constitu cependant pus qu’ use
simple promotion (dons la mesure ot ele requalifi es fais sociocultures pour ls éiger en éléments
Vous aimerez peut-être aussi
- 9782307380108Document19 pages9782307380108Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Philosophie Africaine - WikipédiaDocument6 pagesPhilosophie Africaine - WikipédiaKombaïsso DjaktibelePas encore d'évaluation
- Philosophie AfricaineDocument4 pagesPhilosophie Africainedrago_rossoPas encore d'évaluation
- Sur la philosophie africaine: Critique de l�ethnophilosophieD'EverandSur la philosophie africaine: Critique de l�ethnophilosophiePas encore d'évaluation
- Anthropo de L'universalité CulturesDocument5 pagesAnthropo de L'universalité CulturesacaromcPas encore d'évaluation
- Trajectoire Et Dynamique de La Sociologie Générale D'afrique Noire - Yao AssogbaDocument30 pagesTrajectoire Et Dynamique de La Sociologie Générale D'afrique Noire - Yao AssogbaPensées NoiresPas encore d'évaluation
- Passé Et Present de La Psychologie en Afrique Subsaharienne Past and Present of Psychology in Subsaharan AfricaDocument43 pagesPassé Et Present de La Psychologie en Afrique Subsaharienne Past and Present of Psychology in Subsaharan AfricahaouamalboukarPas encore d'évaluation
- Cours Civilisations Africaines Licence 2Document14 pagesCours Civilisations Africaines Licence 2isaaczogba86Pas encore d'évaluation
- Chap 1Document5 pagesChap 1Roger Gabriel Alphonse Coly100% (1)
- Sociologie Dynamique Et Histoire À Partir de Faits Africains" de Georges BalandierDocument16 pagesSociologie Dynamique Et Histoire À Partir de Faits Africains" de Georges BalandierBabacar NiangPas encore d'évaluation
- Les Cultural Studies dans les mondes francophonesD'EverandLes Cultural Studies dans les mondes francophonesBoulou Ebanda de B'bériPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Methodologie de Recherche AppliqueeDocument4 pagesFiche de Lecture Methodologie de Recherche Appliqueejunior angel essenguePas encore d'évaluation
- Gnose MangeonDocument12 pagesGnose MangeonRayza GiardiniPas encore d'évaluation
- Thme I - La Problematique de La Philosophie en AfriqueDocument4 pagesThme I - La Problematique de La Philosophie en AfriquePatrick NgondamaPas encore d'évaluation
- CHRÉTIEN Jean-Pierre. Les Bantous PDFDocument25 pagesCHRÉTIEN Jean-Pierre. Les Bantous PDFDavid RibeiroPas encore d'évaluation
- (17683084 - Lusotopie) Lusotopie, Lusotopy. What Legacy, What FutureDocument17 pages(17683084 - Lusotopie) Lusotopie, Lusotopy. What Legacy, What Futurejessica falconiPas encore d'évaluation
- Ankh - 18 - 19 - 20 - T - Obenga - Leo Frobenius Et L'afriqueDocument12 pagesAnkh - 18 - 19 - 20 - T - Obenga - Leo Frobenius Et L'afriqueA CONTRARIO100% (1)
- Les Langues Africaines Et L ÉgyptienDocument33 pagesLes Langues Africaines Et L ÉgyptienIdren97100% (4)
- Les Écritures Africaines de Soi (1950-2010)Document533 pagesLes Écritures Africaines de Soi (1950-2010)Vernes WuteziPas encore d'évaluation
- Brève Histoire de Lanthropologie by Weber - Florence - Z Lib - OrgDocument284 pagesBrève Histoire de Lanthropologie by Weber - Florence - Z Lib - Orgyoucef sabriPas encore d'évaluation
- Construire L'universel Une Defi TransculturelDocument15 pagesConstruire L'universel Une Defi TransculturelMoctar ThioyePas encore d'évaluation
- Cours L1 Philo Afric Abad Kout-1Document25 pagesCours L1 Philo Afric Abad Kout-1john AkaPas encore d'évaluation
- Problematique de La Philosophie AfricaineDocument3 pagesProblematique de La Philosophie AfricaineYawilhit Calixte100% (2)
- Fichir Article 1162Document15 pagesFichir Article 1162Kafui NouwossePas encore d'évaluation
- LA QUÊTE DES ANTIQUITÉS ET L'AVENIR DE L'AFRIQUE: Une Nouvelle Lecture de Cheikh Anta Diop Et de Théophile ObengaDocument17 pagesLA QUÊTE DES ANTIQUITÉS ET L'AVENIR DE L'AFRIQUE: Une Nouvelle Lecture de Cheikh Anta Diop Et de Théophile ObengaJohnPas encore d'évaluation
- L'exposé Sur L'idée D'une Philosophie AfricaineDocument3 pagesL'exposé Sur L'idée D'une Philosophie AfricaineGackou Albert100% (3)
- A Questão Das Raças o Programa Da Unesco Chloé MaurelDocument22 pagesA Questão Das Raças o Programa Da Unesco Chloé MaurelBruna Gioia De BarrosPas encore d'évaluation
- AAC - Boulaga Défaites Et UtopiesDocument4 pagesAAC - Boulaga Défaites Et Utopiesjoach bargoPas encore d'évaluation
- Juifs DalgerieDocument9 pagesJuifs DalgerieAalam NifakPas encore d'évaluation
- Lainé-L'Anthropologie Biologique Pré-PrintDocument22 pagesLainé-L'Anthropologie Biologique Pré-Printvictoireakissi72Pas encore d'évaluation
- Préface de Cheikh Anta Diop À L'ouvrage L'afrique Dans L'antiquité - 1973 PDFDocument1 pagePréface de Cheikh Anta Diop À L'ouvrage L'afrique Dans L'antiquité - 1973 PDFEvelyneBrenerPas encore d'évaluation
- 203 - Domaine 1Document15 pages203 - Domaine 1Sadiksani IdiPas encore d'évaluation
- GERARD - Rouget Mission Ogooue CongoDocument25 pagesGERARD - Rouget Mission Ogooue CongoThibault RogerPas encore d'évaluation
- BerliozLeGoff Anthropologie HistoireDocument37 pagesBerliozLeGoff Anthropologie HistoireAlekss AndraPas encore d'évaluation
- L’autre politique: Choix de textes et introduction par Cosima CampagnoloD'EverandL’autre politique: Choix de textes et introduction par Cosima CampagnoloPas encore d'évaluation
- AnthropologieDocument21 pagesAnthropologieMamitiana Dolain RAKOTONIRINAPas encore d'évaluation
- Miran Vissoh Quand Ethnologue Et Imam Croisent Leurs Plumes. Récit D'un Voyage Au Pays de L'anthropologie CollaborativeDocument30 pagesMiran Vissoh Quand Ethnologue Et Imam Croisent Leurs Plumes. Récit D'un Voyage Au Pays de L'anthropologie Collaborative9ffphkrth7Pas encore d'évaluation
- Mama Africa Catherine Coquery VidrovitchDocument22 pagesMama Africa Catherine Coquery VidrovitchDiawara HawkeyePas encore d'évaluation
- 11 Philosophie Africaine-1Document2 pages11 Philosophie Africaine-1Elimane ThiamPas encore d'évaluation
- L'invention de L'afrique Gnose, Philosophie Et Ordre de La ConnaissanceDocument512 pagesL'invention de L'afrique Gnose, Philosophie Et Ordre de La ConnaissanceLendou Djibril Koffi100% (5)
- ChapDocument12 pagesChapkande MariamaPas encore d'évaluation
- INTRODUCTIO1Document7 pagesINTRODUCTIO1Alpha MARAPas encore d'évaluation
- Philosophie AfricaineDocument4 pagesPhilosophie AfricaineAlphonse Dominique Marie MbengPas encore d'évaluation
- CHIVA, Isac (1990) - Le Patrimoine Ethnologique - L'exemple de La France Cópia PDFDocument25 pagesCHIVA, Isac (1990) - Le Patrimoine Ethnologique - L'exemple de La France Cópia PDFeddychambPas encore d'évaluation
- Cheikh Anta Diop (PDFDrive)Document20 pagesCheikh Anta Diop (PDFDrive)Martial Alioune DossouPas encore d'évaluation
- Etudesafricaines 14132Document744 pagesEtudesafricaines 14132Khadime TouréPas encore d'évaluation
- Erotisme Et Ordre MoralDocument290 pagesErotisme Et Ordre MoralSébastien HubierPas encore d'évaluation
- Anthropologie Culmab1Document69 pagesAnthropologie Culmab1SergePas encore d'évaluation
- Etudesafricaines 86Document24 pagesEtudesafricaines 86Kouadio Arnaud AhigroPas encore d'évaluation
- Les Baobabs Ne Meurent Jamais - Hekima Delphine Abadie Sur Fabien Eboussi BoulagaDocument5 pagesLes Baobabs Ne Meurent Jamais - Hekima Delphine Abadie Sur Fabien Eboussi BoulagapngomoPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 - Limites Et Perspectives de La Sociologie AfricaineDocument3 pagesChapitre 4 - Limites Et Perspectives de La Sociologie AfricaineRoger Gabriel Alphonse ColyPas encore d'évaluation
- Une Écologie Des Relations (Philippe Descola)Document38 pagesUne Écologie Des Relations (Philippe Descola)Abdelali AffanePas encore d'évaluation
- Cours de PhiloDocument46 pagesCours de PhiloNdoupendjiPas encore d'évaluation
- Contes et légendes étiologiques dans l'espace européen: Essai littéraireD'EverandContes et légendes étiologiques dans l'espace européen: Essai littérairePas encore d'évaluation
- EASA Policy Paper - FRDocument12 pagesEASA Policy Paper - FRNgavidi Sardoumsou RobertPas encore d'évaluation
- Cours Problématique de L'historiographie AfricaineDocument9 pagesCours Problématique de L'historiographie AfricaineMalick TinePas encore d'évaluation
- Mondes Du TourismeDocument20 pagesMondes Du Tourismesabrine khelilPas encore d'évaluation
- HADOPI: Comment y Échapper? - Journal Du HackDocument4 pagesHADOPI: Comment y Échapper? - Journal Du HackSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- La Capacité Létale de La Digitale: Toxicité de La DigitaleDocument2 pagesLa Capacité Létale de La Digitale: Toxicité de La DigitaleSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Ces Médicaments Légaux Aussi Puissants Et Mortels Qu'une Drogue DureDocument3 pagesCes Médicaments Légaux Aussi Puissants Et Mortels Qu'une Drogue DureSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Les Toxiques Les Plus Courants Et Les Plus DangereuxDocument12 pagesLes Toxiques Les Plus Courants Et Les Plus DangereuxSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Échapper À Hadopi, Mode D'emploiDocument4 pagesÉchapper À Hadopi, Mode D'emploiSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Télécharger Sans Se Faire Repérer by Humm!Document2 pagesTélécharger Sans Se Faire Repérer by Humm!SKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Kakis: Le Fruit D'hiver ParfaitDocument3 pagesKakis: Le Fruit D'hiver ParfaitSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- On A Testé Le Régime 5.2 (5:2 À La Française) - L'Express StylesDocument5 pagesOn A Testé Le Régime 5.2 (5:2 À La Française) - L'Express StylesSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Quel Est Le Taux D'humidité Idéale Pour Votre Maison Ou Appartement ? - Température IdéaleDocument2 pagesQuel Est Le Taux D'humidité Idéale Pour Votre Maison Ou Appartement ? - Température IdéaleSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- La Tendance de La Pleine Conscience: Peut-On Vraiment Trouver Le Bonheur en Pensant ?Document5 pagesLa Tendance de La Pleine Conscience: Peut-On Vraiment Trouver Le Bonheur en Pensant ?SKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Le Steadyblog: Sur Le Tournage de Moby Dick: John Huston Et Gregory Peck by Erich LessingDocument9 pagesLe Steadyblog: Sur Le Tournage de Moby Dick: John Huston Et Gregory Peck by Erich LessingSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Guide Des Amphibiens Et Reptiles D'aquitaineDocument91 pagesGuide Des Amphibiens Et Reptiles D'aquitaineSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Candomblé - WikipédiaDocument9 pagesCandomblé - WikipédiaSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Conserver Livres Et Archives À Domicile - Restauration D'archives, Restauration de Livres, ReliureDocument3 pagesConserver Livres Et Archives À Domicile - Restauration D'archives, Restauration de Livres, ReliureSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Moby Dick (1956) de John Huston - This Is My MoviesDocument4 pagesMoby Dick (1956) de John Huston - This Is My MoviesSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Julien Bonhomme - La Feuille Sur La Langue-Pragmatique Du Secret InitiatiqueDocument16 pagesJulien Bonhomme - La Feuille Sur La Langue-Pragmatique Du Secret InitiatiqueSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Julien Bonhomme - A Propos Des Usages Rituels de Psychotropes Hallucinogènes (Substances, Dispositifs, Mondes)Document14 pagesJulien Bonhomme - A Propos Des Usages Rituels de Psychotropes Hallucinogènes (Substances, Dispositifs, Mondes)SKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Les Réseaux Pédocriminels D'élite, Partie I: de Joris Demmink À L'affaire Alcacer en Espagne - Histoire SecrèteDocument17 pagesLes Réseaux Pédocriminels D'élite, Partie I: de Joris Demmink À L'affaire Alcacer en Espagne - Histoire SecrèteSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Moby DickDocument3 pagesMoby DickSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Moby Dick de John Huston (1956) - Analyse Et Critique Du FilmDocument9 pagesMoby Dick de John Huston (1956) - Analyse Et Critique Du FilmSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Julien Bonhomme - Les Ancêtres Et Le Disque Dur-Visions D'iboga en Noir Et BlancDocument24 pagesJulien Bonhomme - Les Ancêtres Et Le Disque Dur-Visions D'iboga en Noir Et BlancSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Mes 7 Mots Allemands Préférés, Mon Coiffeur Et MoiDocument9 pagesMes 7 Mots Allemands Préférés, Mon Coiffeur Et MoiSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- La Réalité Des Abus Sexuels Rituels en France Et en Angleterre - Enfant de La SociétéDocument19 pagesLa Réalité Des Abus Sexuels Rituels en France Et en Angleterre - Enfant de La SociétéSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Stade Phallique - WikipédiaDocument2 pagesStade Phallique - WikipédiaSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Enorme Scandale en Belgique: Les Anonymous Publient Une Liste de Personnalités Impliquées Dans Le Réseau de L'affaire Dutroux. - Les Maîtres Du MondeDocument20 pagesEnorme Scandale en Belgique: Les Anonymous Publient Une Liste de Personnalités Impliquées Dans Le Réseau de L'affaire Dutroux. - Les Maîtres Du MondeSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Réseaux Pédophiles D'élite, Partie II: Un Bordel Pour Pédos Puissants Au Coeur de Londres - Histoire SecrèteDocument4 pagesRéseaux Pédophiles D'élite, Partie II: Un Bordel Pour Pédos Puissants Au Coeur de Londres - Histoire SecrèteSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Réseaux Pédophiles D'élite, Partie III: en Belgique, Gladio Tirait Les Ficelles Du Réseau - Histoire SecrèteDocument26 pagesRéseaux Pédophiles D'élite, Partie III: en Belgique, Gladio Tirait Les Ficelles Du Réseau - Histoire SecrèteSKYHIGH444100% (2)
- Mort À Venise - Lundi 18 Mai À 20h50 - ARTE CinemaDocument2 pagesMort À Venise - Lundi 18 Mai À 20h50 - ARTE CinemaSKYHIGH444Pas encore d'évaluation