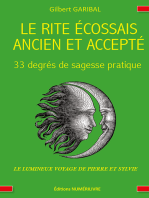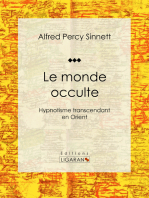Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Julien Bonhomme - La Feuille Sur La Langue-Pragmatique Du Secret Initiatique
Transféré par
SKYHIGH444Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Julien Bonhomme - La Feuille Sur La Langue-Pragmatique Du Secret Initiatique
Transféré par
SKYHIGH444Droits d'auteur :
Formats disponibles
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1938
LA FEUILLE SUR LA LANGUE
PRAGMATIQUE DU SECRET INITIATIQUE
Julien Bonhomme
(Universit Lyon-2)
Ltude des socits initiatiques, au Gabon comme ailleurs, est une entreprise
particulirement dlicate car elle enferme invitablement le chercheur dans le dilemme
du secret initiatique : le profane ne peut rien dire car il est ignorant ; liniti ne peut
rien dire car il est tenu au secret. Ainsi, lobservateur non-initi se verra constamment
reprocher, tant par les initis que les profanes, de navoir quune connaissance
superficielle et extrieure de son objet. Mais le chercheur qui acceptera de se
faire initier pour connatre le rituel de lintrieur se trouvera li par linterdiction de
divulguer son nouveau savoir aux profanes. On dit ainsi du nouvel initi du Bwete7
quil a dsormais la feuille sur la langue expression image de cet impratif de
silence. Cet cueil vaut dabord pour les chercheurs nationaux qui sont
personnellement pris dans le systme du secret initiatique, soit comme profanes soit
parfois comme initis. Mais il concerne galement les chercheurs trangers, ds lors
quils entendent respecter une certaine thique scientifique et quils reconnaissent tre
eux aussi invitablement partie prenante, ne serait-ce qu travers la diffusion de leurs
publications dans le pays o ils ont men leur terrain8. Au premier abord, ltude des
socits initiatiques semble donc enferme dans une contradiction structurelle : ou
bien ne pas savoir, ou bien ne pas pouvoir dire.
Il est pourtant possible de contourner ce dilemme la fois pistmologique et
thique. Il faut pour cela dplacer le regard port sur le secret initiatique. Ce quon
entend habituellement par secret initiatique renvoie la fois des contenus
particuliers et une relation gnrique. Le secret porte sur des contenus : lensemble
des noncs et des actes en droit inaccessibles aux profanes (divulgation de mythes,
rvlation de sacra, rituels secrets, etc.). Cette distribution ingale du savoir et de la
comptence initiatiques instaure des rapports de subordination entre acteurs. Le secret
dfinit donc galement une certaine forme relationnelle : ces noncs et ces actes,
indpendamment de leurs contenus particuliers, organisent un certain type de rapports
entre diffrentes classes de personnes (profanes et initis, ans et cadets, hommes et
femmes, et mme vivants et anctres). Lidologie initiatique disqualifie le savoir
tacite des profanes et survalorise le savoir prsum des initis. Les discours des initis
sont chargs de sous-entendus suggrant un sens profond inaccessible aux profanes,
comme sils ne parlaient pas la mme langue et apprhendaient le monde
Le Bwete (ou Bwiti) est un rite initiatique originaire des Mitsogo du Gabon central mais aujourdhui largement
rpandu, notamment dans la moiti sud du pays (Bonhomme 2005). Linitiation impose labsorption dun
hallucinogne vgtal, liboga (Tabernanthe iboga). Ce rite de passage, et le franchissement des tapes
initiatiques subsquentes, ouvrent laccs un savoir et des rituels secrets. Les donnes ethnographiques
utilises dans cet article ont t recueillies lors de sjours rpts de terrain dans plusieurs provinces du Gabon
(Ngouni, Estuaire, Ogoou-Lolo, Moyen-Ogoou) entre 2000 et 2006.
8
Sur le rle du secret dans le terrain anthropologique, voir Zemplni 1984, Zemplni 1996.
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1939
diffremment. A linverse, quand bien mme nombre de profanes en savent en fait
beaucoup sur le Bwete et ses secrets force dassister des veilles et de frquenter
des parents initis, ces non-initis restent fondamentalement dans une relation de
subordination vis--vis des initis. La relation a donc la capacit de perdurer
relativement indpendamment de contenus particuliers9.
Le dtail des secrets importe ainsi en ralit moins que la relation gnrique
quils instaurent. Le chercheur aura donc intrt focaliser son analyse sur la relation
au principe du secret plutt que sur ses contenus en partie contingents. Cest dire que
ltude du secret initiatique relve plus dune pragmatique que dune smantique. La
smantique est une analyse des noncs du point de vue de leur contenu signifiant. La
pragmatique dplace le regard de lnonc vers lnonciation, du contenu vers la
relation : elle sintresse moins ce qui est dit (la signification intrinsque du
message) qu la faon de le dire (le contexte de communication) (Austin 1970, Searle
1972, Ducrot 1991). Il sagit donc dtudier les contextes de transmission des secrets
initiatiques : qui transmet des secrets qui ? et selon quelles modalits spcifiques ?
Lapproche pragmatique se donne ainsi pour ambition danalyser non pas quels sont
les secrets initiatiques, mais plutt comment la dynamique de leur divulgation et de
leur rtention structure les relations entre profanes et initis, mais aussi entre initis.
Ce dplacement de regard permet ainsi lanthropologue dtudier le secret initiatique
sans avoir ncessairement trahir ses contenus particuliers.
Si cet article sintresse avant tout aux systmes initiatiques du Gabon le
Bwete en particulier , la comprhension de la logique du secret partir dun cas
ethnographique singulier possde en ralit une valeur paradigmatique, tant sont
frappantes les similitudes (au niveau des modalits pragmatiques et interactionnelles
du processus rituel, de ses fonctions sociales et parfois mme de son symbolisme)
entre des initiations relevant pourtant de contextes socioculturels trs diffrents
(Afrique, Mlansie, Australie entre autres).
Le secret organise au premier chef les relations entre profanes et initis. La
barrire du secret sert en effet dlimiter les frontires de la communaut initiatique :
dun ct ceux qui en sont et peuvent savoir, de lautre ceux qui nen sont pas et nont
pas le droit de savoir. Toutes les oprations rituelles dimportance ont ainsi lieu
lcart des profanes dans le secret du nzimbe, le site en fort rserv aux initis
(autrement appel bwenze). Les soupons rcurrents de sorcellerie lgard du Bwete
drivent justement de cette opacit constitutive du rituel : les initis comme les
sorciers agissent de nuit et en secret. Les profanes ne sauraient ainsi avoir quune
apprhension superficielle du Bwete qui se rsume de leur point de vue une
danse , seule partie publique du rituel laquelle ils peuvent assister.
Il importe cependant que des non-initis soient prsents aux veilles. La
position des spectateurs est en effet une position ncessaire. Les initis ont besoin de
spectateurs profanes pour se dmarquer deux en manifestant leur exclusion du secret
par exemple travers les alles et venues entre le mbandja10 et le nzimbe qui
9
Ce que le sociologue allemand Georg Simmel avait dj bien repr dans Secret et socits secrtes (Simmel
1996).
10
Le mbandja est le corps de garde qui fait office de temple aux crmonies de Bwete.
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1940
marquent lalternance entre squences publiques et squences secrtes. Pour reprendre
une expression dAndras Zemplni (1976), il sagit l dune scrtion du secret :
processus par lequel le secret sexhibe devant ses destinataires sans tre pour autant
rvl par ses dtenteurs. Les initis montrent aux non-initis quil y a du secret sans
toutefois leur rvler ce que sont ces secrets. Les apparitions publiques des migonzi du
Bwete Disumba constituent la meilleure illustration de cette ostension dissimulatrice.
Les masques blancs qui incarnent les esprits ancestraux migonzi apparaissent au bout
du village, alors que les hommes initis sont masss ct du corps de garde. Mme
sils doivent rester en retrait des initis, lassistance des profanes femmes et
enfants joue un rle crucial puisque la danse des masques leur est en ralit destine.
Leur prsence est en effet ncessaire pour faire exister le secret mystrieux des
migonzi. Cest bien l le rle du masque : il montre et cache tout la fois. Le secret
initiatique est donc moins une affaire de contenu que de relation : il nexiste que par
les interactions asymtriques qui relient et sparent initis et non-initis (Smith 1984,
Houseman 2002).
Dans le Bwete, lexclusion du secret concerne avant tout les femmes. Certes,
bien des garons et des hommes ne sont pas initis, mais au moins peuvent-ils ltre :
les hommes sont initis ou initiables11. La position des profanes sidentifie donc avec
celle des femmes. Quel que soit son sexe, un non-initi est une femme au regard
des hommes du Bwete. Chez les Mitsogo, des profanes sapprochant du lieu dune
crmonie de Bwete doivent ainsi avertir les initis par la formule a viga ageto
( les femmes arrivent ), et cela quel que soit leur sexe. La situation est la mme dans
le Mwiri, rite de passage ncessaire pour transformer un garon en homme.
Lopposition entre homme initi et femme profane y est fortement lie la question du
secret et de sa rtention : on ne peut pas confier des secrets un garon tant quil nest
pas initi au Mwiri car il nest pas garanti quil ne les trahira pas. En revanche, une
fois initi, il ne peut plus divulguer ces secrets aux profanes sous peine dtre aval par
le gnie Mwiri. Au moment de son initiation, le nophyte (mbuna) doit en effet prter
serment quil ne trahira jamais les secrets confis par les ans. Le Mwiri fonctionne
ainsi comme une sorte de police magique du secret.
Tout le systme initiatique masculin repose en dfinitive sur le postulat que les
femmes doivent rester exclues du secret justement parce quelles seraient par nature
incapables de ne pas le trahir. Les ans mettent ainsi en garde les cadets de ne pas
vomir le secret sur loreiller . Dans le Mwiri, on raconte que la pomme dAdam
donne aux hommes une capacit de rtention verbale qui fait deux les matres du
secret : interpose entre le cur et la bouche, la pomme dAdam agit comme un filtre
censurant les paroles quil ne faut pas laisser chapper. Et cest parce que les femmes
nont pas de pomme dAdam que leur parole nest pas fiable et quelles se rpandent
en bavardages et en commrages. Seul un vrai homme cest--dire un homme
initi peut avoir accs aux secrets. Cest pour cette raison que le Mwiri qui fabrique
les vrais hommes a galement pour fonction de protger le secret initiatique.
Les mythes dorigine racontent en outre comment tant le Bwete que le Mwiri
ont dabord t dcouverts par des femmes (gnralement au cours dune partie de
11
Sur cette construction initiatique de la masculinit, voir Houseman 1984.
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1941
pche la nasse, activit typiquement fminine) puis confisqus par les hommes dans
un second temps. On voit apparatre ici la circularit autorfrentielle qui structure le
systme relationnel du secret initiatique : le secret des hommes dont sont exclues les
femmes concerne justement lorigine mythique de cette exclusion. Le secret et sa
frontire servent donc en fait la domination masculine en lui donnant une
lgitimitation mythico-rituelle. Des institutions initiatiques comme le Bwete et le
Mwiri sont en effet des instruments du pouvoir masculin. Ce que les initis
reconnaissent parfois explicitement : si lhomme dit tout sa femme, que lui reste-til pour la dominer ? . Le secret initiatique a ainsi pour fonction de produire ou
reproduire les rapports sociaux de subordination entre les sexes (Jaulin 1967, Tuzin
1980, Herdt 1990, Hritier 1996).
Pourtant, dans certaines communauts du Bwete, les femmes peuvent galement
tre inities (mabundi du Bwete Misoko, yombo du Bwiti fang). Cela modifie
radicalement la configuration relationnelle du secret, puisque lopposition entre initi
et profane ne recouvre plus exactement la division sexuelle. Innovation dorigine
rcente dont les normes ne sont pas encore clairement fixes, le statut initiatique des
femmes dans le Bwete varie selon les communauts locales. Dans le cas des mabundi
du Misoko, on peut ainsi distinguer trois types possibles de rapports initiatiques entre
les sexes : la domination, lgalit ou la sparation. Tantt les mabundi sont perues
comme des inities infrieures, subordonnes aux hommes et nayant pas accs aux
secrets les plus profonds qui demeurent exclusivement masculins. Tantt les mabundi
revendiquent leur galit avec les nganga en ce qui concerne lactivit rituelle et le
savoir initiatique. Tantt enfin, les mabundi se conoivent comme formant une
branche initiatique autonome, collaborant avec les nganga pendant les veilles, mais
dtenant leurs secrets propres dont les hommes sont exclus. Dans ce dernier cas, elles
se rattachent alors de manire privilgie au Ndjembe (ou Nyembe) dont elles tirent
leur pouvoir et leurs secrets.
Il ne faudrait en effet pas oublier que les femmes possdent elles aussi leurs
propres socits initiatiques ct du Bwete. Certaines sont mixtes quoique majorit
fminine (Ombwiri, Elombo, Ombudi, etc.) ; mais dautres restent exclusivement
fminines (Ndjembe, au moins pour certaines tapes et certains rituels). On possde
malheureusement encore trop peu de donnes ethnographiques prcises sur le sujet
lanthropologie tant, ou du moins ayant longtemps t, une discipline plutt
masculine. Il serait pourtant du plus grand intrt dexaminer le statut du secret
initiatique dans le Ndjembe : est-il ou non organis selon une configuration
relationnelle symtrique par rapport au Mwiri ou au Bwete ? Si dans les initiations
masculines la relation au principe du secret se calque sur la division sexuelle, quen
est-il dans les initiations fminines ?
Si le secret orchestre dabord et avant tout les relations entre initis et profanes,
il organise en fait galement les relations entre ans et cadets initiatiques12. Les
initiateurs et les ans reconnaissent en effet maintenir dans lignorance ou le flou la
majorit des novices (banzi), slectionnant les cadets les plus prometteurs pour leur
12
La hirarchie du Bwete repose sur le systme de la parent initiatique : linitiateur est le pre dun novice, les
initis layant prcd sont ses ans, ceux qui le suivent sont ses cadets.
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1942
transmettre les secrets du Bwete et assurer ainsi la reproduction initiatique. Il ne suffit
donc pas dtre initi pour avoir immdiatement accs tous les secrets, bien au
contraire. Le statut de la langue initiatique du Bwete le montre bien. Pour parler le
Bwete , les initis font normalement usage dune langue secrte, transformation de la
langue ordinaire par un jeu complexe de transpositions mtaphoriques et demprunts
aux langues voisines13. Les initis pove appellent cela le mitimbo, et les initis fang le
popi (ou pop-na-pop).
Si ce cryptage verbal sert empcher les non-initis de comprendre les secrets,
il permet galement de perptuer le secret lintrieur de la socit initiatique, puisque
fait rvlateur les ans initiatiques font encore usage de cette langue sotrique
lorsquils sadressent aux cadets lcart de toute oreille profane (Sillans 1967). Le
fait que le discours initiatique possde toujours un sens cach derrire les paroles
littrales empche toute comprhension autonome de la part des cadets et impose le
recours linterprtation des ans. Le mitimbo sert donc en ralit moins protger le
secret qu le crer ou le suggrer. Il fait de lacquisition du savoir initiatique une
qute interminable reposant sur une relance indfinie de linterprtation : une formule
rituelle sotrique appelle une explication secrte qui elle-mme appelle une nouvelle
explication, et ainsi de suite. Lexgse initiatique se nourrit indfiniment dellemme : comme lcrit trs bien lanthropologue norvgien Fredrik Barth, le principe
des correspondances symboliques sert accrotre le secret et le mystre du rituel
(Barth 1975 : 189)14.
Lenseignement initiatique du Bwete sorganise explicitement selon les
mtaphores de la profondeur et de lorigine. Ce qui a le plus de valeur, ce qui est le
plus secret, cest le fond (go tsina en getsogo) et le dbut (go ebando) des choses. Les
ans commencent ainsi par raconter au novice les secrets les plus simples ( en haut,
en haut ) tout en lui indiquant quil y a derrire cela des secrets plus profonds ( au
fond, au fond ). Chaque signification secrte appelle en effet une autre explication
plus profonde, le contraste de la surface et de la profondeur tant toujours relatif. Le
savoir initiatique possde ainsi une structure feuillete en diffrents niveaux de
profondeur. Cest l une caractristique rcurrente du savoir initiatique qui nest pas
propre au Bwete : Fredrik Barth a par exemple dgag chez les Baktaman de
Papouasie-Nouvelle-Guine la mme structure du savoir initiatique quil compare aux
multiples pelures dun oignon ou aux poupes gigognes qui sembotent les unes dans
les autres (Barth 1975 : 82).
Cette structure feuillete du savoir est isomorphe la hirarchie initiatique : les
niveaux de profondeur du secret correspondent aux tapes successives qui marquent le
parcours initiatique. Tant que liniti na pas franchi telle ou telle tape rituelle, il y a
des significations secrtes qui lui sont encore inaccessibles. Et les ans soulignent de
manire fort dramatique les limites quils doivent simposer lorsquils parlent des
cadets encore inexpriments. De l, cette maxime rgulatrice de lenseignement
initiatique : qui connat peu, on dit peu ; qui connat beaucoup, on dit
13
Pour dautres exemples africains de langues secrtes en contexte initiatique, voir Leiris 1948, Bellman 1984.
Sur le savoir initiatique et la parole rituelle, voir galement Boyer 1980, Bloch 1974, Bloch 2005. Plus
largement, sur les usages sociaux de la parole, voir Bourdieu 1982.
14
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1943
beaucoup . En effet, pour ne pas dvaloriser les secrets de grande valeur, on ne les
divulgue quaux initis de grande valeur. Ce nest quentre pres initiateurs (nyima)
quil ny a thoriquement plus aucun secret et que le savoir initiatique peut tre partag
librement. Cette isomorphie prouve bien que le secret vaut autant entre initis qu
lgard des profanes. Ou plutt il vaut diffremment, comme lavait bien vu Georg
Simmel (1996 : 93-94) : lgard des profanes, il sagit dune sparation absolue (les
profanes nont pas accs aux secrets) ; entre initis, il sagit dune sparation continue
et relative (les initis ont accs certains secrets en fonction de leur grade ou ge
dans le Bwete).
Si les secrets des initis du Bwete gabonais et ceux des Baktaman de PapouasieNouvelle-Guine peuvent tre trs diffrents du point de vue de leurs contenus (car
relevant de traditions culturelles diffrentes), ils reposent nanmoins sur une mme
structure formelle et un mme type de relations hirarchiques entre initis. La forme
mme du savoir initiatique en fait ainsi un instrument de domination entre les mains
des ans. Indpendamment de ses contenus particuliers, le secret initiatique possde
en dfinitive une fonction sociale essentielle dans des socits lignagres o le pouvoir
trouve traditionnellement sa source dans lordre de la parent (Mayer 1992) : il sert en
effet reproduire les rapports de subordination aussi bien entre les sexes (frontire
externe entre hommes et femmes) quentre les gnrations (frontire interne entre
ans et cadets). Reste maintenant examiner comment cette domination des ans
masculins au principe du secret organise concrtement le systme des interactions dans
lenseignement initiatique.
La transmission du savoir initiatique se passe en brousse au nzimbe15. Ce site
dbrouss en fort reprsente le lieu du secret par contraste avec le village, lieu des
interactions quotidiennes. Et le fait que, pour parler des choses les plus secrtes, les
initis nhsitent pas se mettre nus (puisquil sagit de montrer la nudit du Bwete)
illustre bien la rupture de lenseignement initiatique par rapport au cadre ordinaire. Au
nzimbe, le savoir circule toujours dans le mme sens, celui de la hirarchie initiatique :
un an ou un pre initiateur, suppos savoir, enseigne un cadet, ne sachant pas mais
dsirant savoir. Cette subordination sexprime dans le systme des attitudes. Cest ce
que les initis appellent mabondo ou digoba, le respect d aux ans : Pour connatre
tout a, il faut suivre. Mabondo, cest le respect. Il faut plier les genoux (Anyepa,
18/04/2001)16. Et le cadet doit effectivement se mettre genoux pour recevoir la
connaissance. Cet agenouillement en signe de soumission reproduit la posture de la
bndiction. La transmission du savoir initiatique est en effet explicitement compare
la bndiction qui, elle aussi, va toujours des ans aux cadets.
Les ans commencent souvent par poser quelques nigmes aux cadets, afin de
tester leur niveau de connaissance, mais aussi de les obliger se dclarer ignorants, et
donc de raffirmer explicitement la relation dingalit au principe du savoir
initiatique. Et pendant tout le reste de la sance, les ans prennent soin de ne pas tout
dire afin de manifester encore leur pouvoir. Les tactiques les plus courantes consistent
15
En milieu urbain, un endroit discret comme un appentis prs du corps de garde ou une pice de la maison fait
souvent office de nzimbe par ncessit.
16
Je ne mentionne que le kombo (nom initiatique) de mes informateurs afin de prserver leur anonymat.
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1944
refuser dexpliquer, mentir, et surtout faire attendre et atermoyer. Le cadet peut poser
une question et lan rpondre une autre. Lan peut se contenter donner sa
bndiction sans divulguer la moindre information, arguant quune bndiction, cest
plus encore quun secret. Des brimades plus substantielles sont galement possibles :
Le Bwete, ce nest pas vite. Doucement, doucement. Dabord on vous brime. Cest la
haute brimade. Cest dur avant quon vous donne la signification rien que de la plume
de perroquet (Kudu, 8/10/2001).
Lenseignement initiatique au nzimbe ne consiste donc pas simplement
transmettre un savoir, mais plutt alterner divulgation et rtention des secrets. En
effet, toute divulgation dun secret met en scne une rtention qui en constitue le
revers ncessaire : Je vais touvrir le paquet du Mwiri. Mais je te donne seulement
les trois-l [lexplication des trois scarifications initiatiques au poignet] mais pas
celui-l [la marque du coude]. Je ne veux pas trop parler laffaire l (Dumu,
3/08/2001). Parler le Bwete, cest donc autant ne pas dire que rvler . Peu
importe alors le contenu dissimul du secret, du moment que le seul fait de le taire
affirme manifestement le rapport de subordination (Jamin 1977).
La relation de pouvoir entre an et cadet se traduit galement par lobligation
dune rtribution matrielle. Il faut poser le Bwete celui qui parle le Bwete. Si
lan donne un secret, le cadet doit lui donner quelque chose en retour. Le don du
savoir initiatique exige un contre-don immdiat, le plus souvent une contribution
financire. Lenseignement initiatique est donc pens comme un change. Et les initis
insistent sur le fait quil faut toujours refuser un Bwete en cadeau, que cela soit une
corce, un ftiche ou un secret : un Bwete sans contre-don serait un cadeau
empoisonn 17. Ce paiement du Bwete est souvent modique (quelques centaines de
francs CFA), mais peut parfois atteindre des sommes plus consquentes. Le prix
dpend de la valeur du savoir divulgu, cest--dire en ralit de la valeur de lan :
un pre initiateur, on donnera plus qu un an proche de soi. Si lestimation reste
purement tacite, elle est nanmoins prise en compte par les deux parties : un an qui
sestime ls en dira moins et le fera savoir en dclarant ostensiblement quil ne dira
quun mot du Bwete et ne divulguera quun petit secret.
Mais le destinataire de ce don est en ralit multiple. Le cadet donne lan,
mais en mme temps aux esprits ancestraux mikuku et au Bwete lui-mme : poser le
Bwete (on dit galement poser les mikuku ), cest toujours faire une offrande aux
esprits, mme si cest lan qui empoche largent. Sil ne sacquitte pas de la
contrepartie, le dbiteur est cens oublier tout ce qui lui a t racont ds la fin de la
sance : En donnant, tu crois que tu donnes la personne qui va attraper largent,
mais cest aux gnies que tu donnes. Cest pour faire en sorte que tout ce quils vont te
parler, a rentre dans la tte et dans le cur, et cest inoubliable (Ikuka,
18/04/2001). Le paiement du savoir sinscrit donc dans le systme gnral de la dette
initiatique qui structure tout le Bwete et les rapports entre initis. Etre initi au Bwete,
cest tre dbiteur dune dette infinie contracte envers les anctres mikuku et le Bwete
lui-mme. Cette dette est explicitement envisage comme une dette de vie : dette
17
Cadeau qui pourrait par exemple dissimuler une agression sorcellaire.
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1945
proprement inacquittable davoir t de nouveau mis au monde travers linitiation18.
Le pre initiateur nest alors que le mdiateur humain de cette renaissance.
Symboliquement, il occupe la seconde place, aprs le Bwete et les anctres, mme si
conomiquement, il reste le premier bnficiaire rel. Et les initis soulignent bien que
la dette narrte jamais dtre paye, y compris par les pres initiateurs travers les
dpenses et les efforts affrents au travail rituel. On voit donc que la relation entre
ans et cadets est elle-mme prise dans une relation dordre suprieur entre vivants et
anctres.
Dans cette relation de subordination entre ans et cadets, loralit tient une
place dimportance. Lenseignement initiatique est un enseignement exclusivement
oral, ce qui impose des contraintes spcifiques sur la mmorisation et donc la
transmission de ce type de savoir. Ainsi, une tradition orale ne sappuie pas sur une
mmorisation mcanique (apprentissage par cur) et une rptition lidentique, mais
bien plutt sur une remmoration constructive (Goody 1977) qui laisse une place
importante aux variations et aux innovations idiosyncrasiques (Bonhomme 2006,
Barth 1987). Loralit expose par consquent lapprentissage initiatique la menace de
loubli. Avant chaque sance au nzimbe, lan doit donc faire manger aux cadets un
peu dune mixture aide-mmoire , appele ekasi (ou dikasi), contenant miel, cola et
feuilles de tangimina (une commelinace indtermine). Le nom de cette feuille (dont
lenvers rouge et la forme voquent une langue) signifie se souvenir . Miel et cola
sont galement associs la parole. Lekasi permet ainsi au cadet qui reoit
lenseignement initiatique de ne pas oublier ce quon lui raconte.
La conception sous-jacente de loubli est en ralit singulirement complexe :
Cest un dikasi quon te donne pour que cela reste dans ta tte. Malgr nimporte
qui qui tu vas parler, tu as dj tout encaiss. Parce que si on te dit une parole
aujourdhui, toi aussi, tout de suite, tu dis lautre. Quand tu parles, cela reste avec
lautre, a part sur lui pour toujours. Donc on ne parle pas le Bwete nimporte
comment. Ce sont tes rserves, tes secrets (Magenge, 18/04/2001). Loubli ne
provient donc pas dun dfaut de concentration du cadet, mais plutt dune
dilapidation du savoir initiatique. Dire un secret un tiers, cest risquer de le perdre, de
loublier aussitt. Cest pour cela que lan mange galement sa part de la mixture : il
doit lui aussi conjurer le risque de perdre son savoir en le divulguant au cadet. La
transmission est dj un danger, une privation ce qui rvle bien que la valeur du
secret tient sa rtention.
Cest pourquoi coucher lenseignement initiatique par crit est interdit. Il sagit
l encore dune question de pouvoir. Loralit assure que les cadets dpendent
effectivement des ans pour tout ce qui regarde le Bwete. Dtach de toute
performance orale, lcrit est accessible et public, et mettrait par consquent en pril le
monopole des ans touchant le savoir initiatique et son interprtation19. Il est
dailleurs notable que les documents relatifs au Bwete (textes de chants ou de prires)
que les initis possdent parfois ne sont pas destins tre montrs des tiers ou alors
18
Le fait que les rites de passage accomplissent la renaissance des novices est un trait rcurrent des rituels
initiatiques, quelle que soit laire culturelle (Van Gennep 2000, La Fontaine 1985).
19
Sur oralit et criture, voir Goody 1979, Goody 1994.
1946
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
uniquement dans le secret du nzimbe. Le reste du temps, ces documents ne circulent
pas, mais sont soigneusement cachs avec les autres affaires rituelles de manire
neutraliser la menace de dilapidation.
Lenseignement initiatique du Bwete se situe donc loppos de la conception
du savoir scientifique (cf. figure 1). Le savoir scientifique na en effet de valeur que
sil est partag par la communaut scientifique dans son ensemble et quil est
disponible dans des livres ou des articles20 ; lidal humaniste du projet universitaire
repose de mme sur la diffusion la plus large possible des savoirs ( Universit
renvoie tymologiquement luniversel). Ceci nimplique pas, videmment, que le
savoir initiatique soit de moindre valeur par rapport au savoir scientifique (ni de valeur
suprieure), mais seulement que leurs modalits pragmatiques de transmission
diffrent sensiblement : publication versus scrtion. Le savoir scientifique privilgie
le recours lcriture parce quelle constitue un systme de traces fiables et
reproductibles : de l lusage scientifique du symbolisme logico-mathmatique. Le
savoir initiatique, itratif davantage que cumulatif, exige quant lui le recours
loralit afin den encadrer et limiter la transmission. Dans le premier cas, laccent
porte sur le contenu du message : la bonne information doit tre transmise. Dans le
second cas, laccent porte davantage sur lmetteur et le rcepteur du message : il faut
sassurer de lidentit du destinataire de linformation.
Savoir acadmique
Savoir initiatique
Lieu
Universit, Acadmie Nzimbe
Support
crit/Oral
Oral
Disponibilit Public
Secret
Dynamique
Rtention/Divulgation
Diffusion
Figure 1 : Savoir acadmique et savoir initiatique
La valeur du secret initiatique tient ainsi sa rtention plutt qu sa
divulgation : elle dpend donc moins de son contenu rel que du fait quil soit hors de
porte dun certain nombre de personnes. Sur lchelle des secrets, un nonc
initiatique a alors dautant plus de valeur que peu de personnes le partagent et y ont
accs. Valeur et diffusion du secret sont inversement proportionnelles. Pousser cette
logique jusquau bout conduit au paradoxe du maximum : linformation ayant la valeur
maximale est celle quune seule personne possde et quelle ne transmet pas (Barth
1975 : 217). Les initis du Bwete sont cruellement conscients de cette antinomie et en
ont mme fait le problme central de la reproduction intergnrationnelle du savoir
initiatique. Dun ct, il faut transmettre le Bwete : si on le garde pour soi, on est
maudit . La rtention du savoir menace en effet directement la prennit du systme
initiatique. Mais dun autre ct, si on le divulgue trop facilement, trop dinitis, ce
savoir perd sa valeur. Ce drame de la transmission du savoir est gnralement formul
20
Une connaissance scientifique nest avre (reconnue comme vraie) que lorsquelle est publie (rendue
publique) ce quont bien montr par les travaux en sociologie de la connaissance (Kuhn 1972, Latour 1989).
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1947
en termes de conflit de gnrations : les jeunes gaspillent le Bwete, les vieux refusent
de donner le Bwete.
Cette loi de la valeur du secret permet de comprendre le rle vritable de la
feuille aide-mmoire et du paiement de lenseignement initiatique qui servent en fait
tous deux conjurer la menace de dvalorisation. Si la transmission du savoir
initiatique constitue un risque de dilapidation, cest bien parce que la divulgation
autrui dun secret en diminue immdiatement la valeur. Il y a ainsi vritablement une
conomie du secret : dire, cest risquer de perdre, car dire un secret, cest le dvaluer.
Comme lcrit Georg Simmel (1996 : 64), un secret connu par deux personnes nest
dj plus un secret .
Une formule initiatique affirme que le Bwete ne finit jamais, sauf le jour de la
mort . Cela signifie dabord que lacquisition du savoir initiatique est une tche
interminable. Mais lexpression possde une seconde signification plus profonde qui
renvoie lconomie du secret. La mort nest pas seulement un terme accidentel au
savoir ; elle est aussi le moment essentiel de la divulgation de ce savoir secret. Pour
viter la fois la dvalorisation de son savoir initiatique pour cause de transmission et
sa disparition pour cause de rtention, un pre initiateur doit ainsi attendre le jour de sa
propre mort pour divulguer ses secrets de plus grande valeur. Il doit toujours garder
par-devers lui au moins un dernier secret pour ne le rvler que le jour de sa mort son
fils initiatique prfr. Et sil meurt sans avoir eu loccasion de transmettre ce secret, il
le dvoilera post-mortem dans un message onirique adress son hritier. Les secrets
de plus grande valeur ne se disent donc qu lagonie, comme lexplique fort bien ce
commentaire dun initi : Le matre a toujours un secret pour lui-mme personnel.
Cest peut-tre le jour o il voit quil ne peut plus vivre quil va le dire quelquun.
Mais tant quil vit encore, cest avec lui dans la tte. Toujours une dernire botte
secrte. Les enfants, tu vas leur parler des choses qui sont en haut. Mais en bas, en
bas l, tu es oblig de garder a pour toi-mme. Jusqu ce que tu vois que tel enfant
est assez mr, ou bien le jour de ta mort, tu vas lui lguer telle chose (Kudu,
8/10/2001).
Lultime divulgation garantit la fois la prennit et la valorisation du Bwete21.
Par ce biais, il est assur que le savoir initiatique reste proprement interminable car il
recle toujours des significations secrtes dont la divulgation espre est indfiniment
diffre. Le secret, cest donc la forme mme de la communication initiatique : sa
rtention et sa divulgation sont comme les pulsations lmentaires qui scandent la
circulation des noncs initiatiques. Mais le rapport entre secret et mort au principe de
la logique de circulation du savoir initiatique est encore plus profond que cela. Non
seulement un initi doit attendre son dernier jour pour rvler ses derniers secrets ;
mais plus fondamentalement encore, il na lui-mme accs aux derniers secrets du
Bwete que le jour de sa propre mort.
21
Une autre justification consiste dire quil faut toujours garder au moins un secret par-devers soi afin de ne
pas tre vulnrable aux sorciers : dire ses secrets, cest donner prise aux sorciers. En effet, divulguer un secret,
cest le dvaloriser, et par consquent se dvaloriser soi-mme, cest--dire saffaiblir. De mme, dans le Bwete
Disumba, un initi possde au moins deux kombo (noms initiatiques) : un kombo public qui peut tre connu des
profanes, un kombo secret qui nest connu que des ans initiatiques.
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1948
On ne peut en effet vritablement voir le Bwete qu linstant de mourir : On
ne va jamais finir. Tu narriveras jamais au fond au fond. Tant que tu vis, tu ne
pourras pas vraiment dfinir le Bwete. Cest le jour de la mort o tu verras carrment
toute la Bible du Bwete comme a. Ds que tu vois a, il faut que tu te dises que cest
fini. Tu vas voir vraiment le fond du Bwete. Personne ne peut voir a vivant, au grand
jamais. Sign par eux-mmes les aeux qui ont envoy a. Le vieux lui-mme, il na pas
fini le Bwete. Parce que finir le Bwete, cest la mort. Cest significatif pourquoi on dit
a (Ndongo, 15/10/2001). Cest dire que le Bwete relve dune apprhension
impossible : il ne se dvoile que lorsquil nest plus possible de le voir. Et tout le
paradoxe du Bwete se concentre dans cet clair instantan du dernier souffle. De son
vivant, liniti, aussi expriment soit-il, ne peut pas savoir ce quest vritablement le
Bwete. Il doit toujours suspecter quil subsiste un secret dcisif quil ignore.
Ce lien intime entre secret et mort sexplique par le statut minent des anctres
dans la hirarchie initiatique : les anctres et le Bwete lui-mme qui nest rien dautre
que lincarnation mtonymique de tous les aeux sont les matres du secret
initiatique. Le Bwete, son rituel et son savoir, sont en effet un legs des aeux et de
Nzambe, le premier anctre mythique : comme le dit un proverbe mitsogo, tout ce
que nous savons, nous lavons appris de nos anctres . Les anctres sont donc les
seuls personnages omniscients en matire de savoir initiatique. De l, la justification
traditionnelle des initis quand ils ne peuvent donner la signification de tel ou tel geste
du rituel : nos aeux faisaient dj comme cela . Cest pourquoi un initi ne peut
dcouvrir le dernier secret du Bwete que le jour de sa mort, lorsquil rejoint le village
de ses aeux, et devient lui-mme un anctre parmi les anctres. La place matresse
occupe par les anctres place de la totalit du savoir et de la tradition structure
ainsi toutes les autres relations initiatiques. Le dernier des secrets le plus important
nest jamais rvl et ne possde par consquent pas de contenu smantique vritable.
Le secret initiatique ne renvoie donc pas un corpus dnoncs fixes. Cest plutt un
systme gnral de communication qui relie et spare initis et profanes, hommes et
femmes, ans et cadets, vivants et anctres, articulant ainsi lensemble des relations
hirarchiques au fondement de lorganisation sociale traditionnelle22. Dans la mesure
o les initiateurs eux-mmes ignorent le dernier secret des anctres, il serait donc
rducteur de ne voir dans le Bwete, et plus largement dans les initiations masculines,
quun instrument de pouvoir au service des ans masculins. Peu importe les
subterfuges et les fausses rvlations des ans, le secret initiatique ne se rsume pas
une simple manipulation cynique ; il organise plus fondamentalement les modalits
cognitives du rapport au savoir religieux et la tradition rituelle (Boyer 1988, Boyer
1990).
Il ne faudrait cependant pas penser que ce systme de relations initiatiques
structur par le secret soit fig dans un ordre social immuable. Les traditions
religieuses, comme toute autre institution sociale, ne se reproduisent quen se
transformant continuellement (Sahlins 1989). Jai dj voqu comment lirruption
22
Les femmes et les anctres occupent une place de choix dans les initiations masculines de socits pourtant
fort loignes. Mais selon les cas, laccent sera plutt mis sur les unes ou sur les autres. Il est notable que les
initiations africaines sont davantage structures par le rapport aux anctres alors que les initiations
mlansiennes sont littralement obsdes par le rapport au fminin.
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1949
rcente des femmes mabundi dans certaines communauts du Bwete modifiaient les
logiques relationnelles du secret initiatique. Dans le cas du Gabon, cette
reconfiguration du clivage sexuel dun champ initiatique traditionnellement rgi par
lopposition entre possession fminine et vision masculine (Mary 1983a) semble
oprer par volutions progressives plutt que par une remise en cause radicale comme
cela peut tre le cas ailleurs23.
La transformation des rapports sociaux entre les gnrations, pas plus que celle
entre les sexes, ne laisse pas indemne le secret initiatique. Les dynamiques religieuses
en Afrique centrale comme en Afrique de louest sont marques par la floraison
rcurrente dinnovations rituelles de cadets cherchant smanciper de la tutelle des
ans, voire faire sortir le religieux du champ de la parent lignagre (Tonda 2002).
Les cadets disputent ainsi aux ans le monopole du savoir religieux et de ses secrets.
Par rapport au Bwete plus traditionaliste des Mitsogo, le Bwiti des Fang est galement
un bon exemple de cette transformation du secret (Fernandez 1982, Mary 1983b, Mary
1999). Peu aprs quils ont emprunt le Bwete aux Mitsogo lors de leur rencontre dans
les chantiers forestiers autour de Lambarn dans les annes 1900-1910, les Fang ont
opr une profonde entreprise de rforme de la socit initiatique : abandon des
ftiches et des reliquaires danctres, syncrtisme chrtien, tendance prophtique,
fminisation des fidles, mais galement attnuation sensible de la logique du secret.
Linfluence du christianisme, la fois religion du Livre et religion universaliste, nest
certainement pas pour rien dans cette transformation : contrairement au savoir
initiatique traditionnel, le christianisme divulgue une part substantielle de sa tradition
dans la Bible, document crit universellement disponible.
Inversement, la logique du secret oral a pu galement toucher en retour le statut
de lcrit preuve que larticulation entre oralit et criture est bien plus complexe
quun simple rapport dopposition. En effet, les initis du Bwete partagent souvent une
conception cryptologique du texte religieux, faisant ainsi basculer le christianisme de
lexotrisme vers lsotrisme : il faut savoir lire entre les lignes de la Bible pour
avoir accs aux vritables secrets cachs dans le message chrtien. Le nom de Jsus
peut alors donner lieu des exgses secrtes, prtexte disputes entre initis et
chrtiens proslytes. Certains initis ont mme pu rinventer leur propre compte
lcriture en linsrant dans le systme du secret religieux. Ainsi en est-il dEkangNgoua (1925-1977), prophte rformateur du Bwiti fang qui, bien quillettr, a invent
une criture cryptographique afin de consigner son savoir religieux (Swiderski 1984).
Soigneusement couches dans des cahiers dcolier, les critures dEkang-Ngoua
oscillent entre le texte et le dessin et ne sont pas destines transmettre fidlement un
message (voir figure 2, daprs Swiderski 1984 : 630, 632). Il sagit plutt dune
tentative dappropriation du prestige quasi-magique des lettrs et de lcriture, la
manire du chef nambikwara dcrit par Claude Lvi-Strauss lors de son terrain
brsilien (Lvi-Strauss 1955 : 347-360). Dans la mesure o Ekang-Ngoua est en effet
le seul pouvoir lire et donc interprter ses critures, ces dernires servent
23
Pour un exemple particulirement spectaculaire de dvoilement volontaire par les hommes de leurs secrets
initiatiques aux femmes, dans un contexte de crise millnariste en Papouasie-Nouvelle-Guine, voir Tuzin 1997.
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1950
davantage dissimuler, ou plutt suggrer un savoir dissimul, qu le consigner
publiquement pour le prserver et le transmettre.
Figure 2 : Les critures dEkang-Ngoua
Le champ initiatique et religieux est donc travers par des tensions concernant
les statuts du secret, de loralit et de lcriture. Lanthropologue peut alors jouer de
ces tensions pour trouver sa place sur le terrain initiatique. Lethnographe apparat
comme un scripteur et un curieux professionnel, toujours poser des questions, carnet
et stylo en main (auxquels peuvent sajouter magntophone, appareil photographique
et camra). Son enqute constitue donc une remise en question frontale du secret.
Quil dcide alors dtre initi ou non pour les besoins de son travail, lanthropologue
se retrouve confront au problme de la transgression de linterdit de lcrit
confrontation sur le terrain qui prfigure le problme de la publication de ses donnes
ethnographiques. Sil nentend pas cder une auto-censure qui pourrait aboutir de
lanthropologie-fiction (Moizo 1997), lethnographe doit ainsi parvenir ngocier
lautorisation denquter et de publier. Or, les tensions et les divergences dattitudes
entre initis et communauts locales quant la valeur et au respect du secret lui
permettent habituellement une marge de manuvre.
Mon exprience ethnographique concernant le terrain gabonais ma en effet
convaincu quil est gnralement possible de ngocier l intrusion de
lanthropologue dans les secrets initiatiques, dans la mesure o toute socit se donne
habituellement les moyens damnager et de justifier la transgression occasionnelle de
ses propres normes. Au sein dune communaut initiatique, cela peut souvent se
ngocier par de simples offrandes destines obtenir laccord du Bwete et des mikuku
petits arrangements avec les anctres. Certains interlocuteurs, reprenant le leitmotiv
de lanthropologie de lurgence, justifient la transgression du secret par la ncessit de
sauver la tradition en les couchant par crit ( un vieillard qui meurt, cest une
bibliothque qui brle ). Dautres associent explicitement le carnet de terrain une
sorte de journal intime, un trsor que lethnologue pourra valoriser sa guise ds
lors quil en aura lui-mme pay le prix symbolique et matriel travers son
investissement personnel dans la socit initiatique. Dautres encore oprent une
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1951
remise en cause plus radicale du secret initiatique : lexistence du secret ne tient qu
lgosme dans cherchant prserver leur pouvoir et leur savoir au dtriment de la
communaut. Parler lethnologue est alors un acte dmancipation. La transgression
participe mme parfois dune tentative de reconversion de la socit initiatique en une
religion universaliste : le Bwete appartient tout le monde . Lanthropologue peut
alors se voir confier la tche insigne d crire la Bible du Bwete . Cette transgression
peut enfin sinscrire dans une stratgie de lutte contre la sorcellerie, dans la mesure o
lgosme est le premier mobile des sorciers : faire entrer le Bwete dans le rgne de la
publicit devrait alors permettre en quelque sorte de couper lherbe sous le pied des
sorciers.
Placer ainsi les socits initiatiques et leurs secrets sous le regard scrutateur de
lanthropologue exige, en un geste de retour rflexif, de porter conjointement son
attention sur le savoir acadmique lui-mme. La saisie comparative de la logique de
circulation des noncs dans les champs initiatique et acadmique est en effet une
condition ncessaire pour amnager un lieu possible de rencontre entre eux, cest-dire pour pouvoir faire circuler des noncs dun champ lautre24. Dans lesprit du
sminaire interdisciplinaire sur le Bwiti du Gabon qui sest tenu du 8 au 13 mai
2000 lUniversit Omar Bongo sous la direction du Laboratoire Universitaire de la
Tradition Orale, il faut ainsi penser et rinventer les rapports de coopration et
dopposition entre savoir initiatique et savoir acadmique (Bonhomme paratre).
Cest l une condition ncessaire pour viter le conflit frontal et strile entre publicit
acadmique et secret initiatique et nouer un dialogue entre initis et chercheurs qui ne
soit pas un dialogue de sourds. Et cest sans doute galement la constitution dune
tradition anthropologique nationale qui est en jeu dans ce dfi pour inventer un rapport
original sa propre tradition culturelle.
BIBLIOGRAPHIE
Austin, J.L.
1970 Quand dire, cest faire, Paris, Seuil.
Barth, F.
1975 Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea, New Haven, Yale
University Press.
1987 Cosmologies in the making. A generative approach to cultural variation in
inner New Guinea, Cambridge, Cambridge University Press.
Bellman, B.L.
1984 The language of secrecy. Symbols and metaphors in Poro ritual, New
Brunswick, Rutgers University Press.
Bloch, M.
1974 Symbols, song, dance and features of articulation. Is religious an extreme
form of traditional authority ? European Journal of Sociology, 15(1), pp.5581.
24
Erwan Dianteill (2000) a montr comment lcriture a jou un rle important dans la constitution et la
transmission des traditions religieuses afro-cubaines, par contraste avec le primat de loralit et du secret dans les
traditions africaines originelles. Il est dailleurs rvlateur que, parmi les nombreux crits circulant parmi les
adeptes des religions afro-cubaines, on puisse trouver certains ouvrages anthropologiques.
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1952
2005 Ritual and deference in Essays on Cultural Transmission, Oxford, Berg.
Bonhomme, J.
2005 Le Miroir et le Crne. Parcours initiatique du Bwete Misoko (Gabon), Paris,
d. du CNRS.
2006 Transmission et tradition initiatiques en Afrique centrale , Annales Fyssen,
n21.
paratre, Anthropologue et/ou initi. Lanthropologie gabonaise lpreuve du
Bwiti , Journal des anthropologues, n110.
Bourdieu, P.
1982 Ce que parler veut dire, Paris, Fayard.
Boyer, P.
1980 Les figures du savoir initiatique , Journal des Africanistes, 50(2), pp.31-58.
1988 Barricades mystrieuses et piges pense. Introduction lanalyse des
popes fang, Paris, Socit dethnologie.
1990 Tradition as truth and communication, Cambridge, Cambridge University
Press.
Dianteill, E.
2000 Des dieux et des signes. Initiation, criture et divination dans les religions
2001 Afro-cubaines, Paris, EHESS.
Ducrot, O.
1991 Dire et ne pas dire, Paris, Hermann.
Fernandez, J.W.
1982 Bwiti: ethnography of religious imagination in Africa, Princeton University
Press.
Goody, J.
1977 Mmoire et apprentissage dans les socits avec et sans criture. La
transmission du Bagr , LHomme 17(1), pp.29-52.
1979 La raison graphique. La domestication de la pense sauvage, Paris, Minuit.
1994 Entre loralit et lcriture, Paris, PUF.
Herdt, G.
1990 Secret societies and secret collectives , Oceania, 60(4), pp.360-381.
Hritier, F.
1996 Masculin / Fminin. La pense de la diffrence, Paris, Odile Jacob.
Houseman, M.
1984 Les artifices de la logique initiatique , Journal des Africanistes, 54(1), pp.
41-65.
2002 Dissimulation and simulation as forms of religious reflexivity , Social
Anthropology, 10(1), pp.77-89.
Jamin, J.
1977 Les lois du silence. Essai sur la fonction sociale du secret, Paris, Maspro.
Jaulin, R.
1967 La mort sara. Lordre de la vie ou la pense de la mort au Tchad, Paris, Plon.
Kuhn, T.S.
1972 [1962] La structure des rvolutions scientifiques, Paris, Flammarion.
La Fontaine, J.S.
1985 Initiation. Ritual drama and secret knowledge across the world, Manchester,
Manchester University Press.
Laboratoire Universitaire de la Tradition Orale
2000 Le Bwiti du Gabon. Sminaire interdisciplinaire du 8 au 13 mai 2000,
Universit Omar Bongo, Libreville.
Cahiers gabonais danthropologie n17-2006
1953
Latour, B.
1989 La science en action, Paris, La Dcouverte.
Leiris, M.
1948 La langue secrte des Dogons de Sanga, Paris, Institut dethnologie.
Lvi-Strauss, C.
1955 Tristes Tropiques, Paris, Plon.
Mary, A.
1983a Lalternative de la vision et de la possession dans les socits religieuses et
thrapeutiques du Gabon , Cahiers dtudes africaines, n91, pp.281-310.
1983b La naissance lenvers, Paris, LHarmattan.
1999 Le dfi du syncrtisme, Le travail symbolique de la religion deboga (Gabon),
Paris, EHESS.
Mayer, R.
1992 Histoire de la famille gabonaise, Libreville/Paris, CCF St-Exupry/Spia.
Moizo, B.
1997 Lanthropologie aboriginaliste : de lapplication la fiction in M. Agier
(dir.), Anthropologues en dangers, Paris, Jean-Michel Place.
Sahlins, M.
1989 Des les dans lhistoire, Paris, Gallimard.
Searle, J.R.
1972 Les actes de langage, Paris, Hermann.
Sillans, R.
1967 Motombi: rcits et nigmes initiatiques des Mitsogho du Gabon central, thse
de doctorat, Facult des lettres et sciences humaines, Universit ParisSorbonne.
Simmel, G.
1996 [1908] Secret et socits secrtes, Paris, Circ.
Smith, P.
1984 Le mystre et ses masques chez les Bedik , LHomme, 24(3-4), pp.5-33.
Swiderski, S.
1984 Ekang Ngoua, rformateur religieux au Gabon , Anthropos, n79, pp.627635.
Tonda, J.
2002 La gurison divine en Afrique centrale (Congo, Gabon), Paris, Karthala.
Tuzin, D.F.
1980 The Voice of the Tambaran. Truth and illusion in Ilahita Arapesh religion,
University of California Press, Berkeley.
1997 The Cassowarys Revenge. The life and death of masculinity in a New Guinea
society, University of Chicago Press.
Van Gennep, A.
2000 [1909] Les rites de passage, Paris, Picard.
Zemplni, A.
1976 La chane du secret , Nouvelle Revue de Psychanalyse, n14 ( Du
Secret ), pp.313-324.
1984 Secret et sujtion. Pourquoi ses informateurs parlent-ils lethnologue?
Traverses, n30-31, pp.102-115.
1996 Savoir taire. Du secret et de lintrusion ethnologique dans la vie des autres ,
Gradhiva, n20, pp.23-41.
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours de Gnose PDF - Leçon 1: La Sagesse GnostiqueDocument34 pagesCours de Gnose PDF - Leçon 1: La Sagesse GnostiqueIGEAC AFRICA100% (8)
- Le Silence, Le Secret, Le Sacré PVI 158Document8 pagesLe Silence, Le Secret, Le Sacré PVI 158Pierre Fichet100% (2)
- III-1 Pierre RiffardDocument6 pagesIII-1 Pierre RiffardMartnPas encore d'évaluation
- Connais Toi Toi-MêmeDocument5 pagesConnais Toi Toi-MêmeGrégory Perchut100% (1)
- Esoterisme de Luc BenoistDocument54 pagesEsoterisme de Luc Benoistbenyeah100% (2)
- Guide InitiationDocument22 pagesGuide Initiationluqman100% (1)
- Magie Et Religion Annamites - Paul Giran (1912)Document464 pagesMagie Et Religion Annamites - Paul Giran (1912)MonkScribd100% (2)
- Manitara Olivier-La Pensee Dans Les Mondes SubtilsDocument171 pagesManitara Olivier-La Pensee Dans Les Mondes SubtilsCorridor Des Sous100% (6)
- La Gnose UniverselleDocument88 pagesLa Gnose Universellekabballerodelagruta100% (3)
- La philosophie dans le boudoir: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLa philosophie dans le boudoir: Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Enorme Scandale en Belgique: Les Anonymous Publient Une Liste de Personnalités Impliquées Dans Le Réseau de L'affaire Dutroux. - Les Maîtres Du MondeDocument20 pagesEnorme Scandale en Belgique: Les Anonymous Publient Une Liste de Personnalités Impliquées Dans Le Réseau de L'affaire Dutroux. - Les Maîtres Du MondeSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Le Miroir Et Le Crâne - Chapitre VI. Les Secrets Du Bwɛnzɛ Savoir Et Enseignement InitiatiquesDocument13 pagesLe Miroir Et Le Crâne - Chapitre VI. Les Secrets Du Bwɛnzɛ Savoir Et Enseignement Initiatiquesgabin elougaPas encore d'évaluation
- Voir Par-Derrière Sorcellerie, Initiation Et Perception Au GabonDocument27 pagesVoir Par-Derrière Sorcellerie, Initiation Et Perception Au GabonHadlyyn CuadrielloPas encore d'évaluation
- Origine Des Cercles Ésotériques Occidentaux - CopieDocument26 pagesOrigine Des Cercles Ésotériques Occidentaux - CopieMon Assureur conseilPas encore d'évaluation
- Bidou - Représentations de Lespace Dans La Mythologie Tatuyo - Indiens TucanoDocument63 pagesBidou - Représentations de Lespace Dans La Mythologie Tatuyo - Indiens TucanodecioguzPas encore d'évaluation
- 9782290130650Document30 pages9782290130650LESLY VICTORPas encore d'évaluation
- Fiche Récapitulative - Cours 2 - Secret Et PsychologieDocument6 pagesFiche Récapitulative - Cours 2 - Secret Et PsychologieManuunPas encore d'évaluation
- Fournier Le Génie-Parent - FrançaisDocument19 pagesFournier Le Génie-Parent - FrançaisTchant Amoun-shankarPas encore d'évaluation
- Annexe Parchemin N°3Document14 pagesAnnexe Parchemin N°3tchoundaatchokePas encore d'évaluation
- Benoist Luc Lésotérisme PDFDocument23 pagesBenoist Luc Lésotérisme PDFRenéPas encore d'évaluation
- Et 1 - 3Document2 pagesEt 1 - 3sylla AboubakarPas encore d'évaluation
- Initiation MaçonniquesDocument30 pagesInitiation MaçonniquesAmbroise LovessePas encore d'évaluation
- Dieu Au Fond de Nous, Ou La Mystique Comme Débordement Du SilenceDocument12 pagesDieu Au Fond de Nous, Ou La Mystique Comme Débordement Du SilencePatrickPas encore d'évaluation
- 9782290130650Document30 pages9782290130650LWANGA OYEDOKOU100% (1)
- ACT RITUALISEES Et2 Act1 Rituels Ethnologie Et Sociologie Et Definition Des Rites Et Des RituelsDocument3 pagesACT RITUALISEES Et2 Act1 Rituels Ethnologie Et Sociologie Et Definition Des Rites Et Des RituelsJennifer CABARRUSPas encore d'évaluation
- La Longue QueteDocument273 pagesLa Longue QueteJean PeuplusPas encore d'évaluation
- Initiation Au Sacerdoce Du FaDocument18 pagesInitiation Au Sacerdoce Du FaAymericPas encore d'évaluation
- Jean DubuisDocument9 pagesJean DubuisDonald AristorPas encore d'évaluation
- Initiation-Rudolff Steiner-ModifierDocument71 pagesInitiation-Rudolff Steiner-ModifierTom GymZenPas encore d'évaluation
- Nicolas Beaufils, La Valeur de Vérité de L'expérience Mystique 2003Document108 pagesNicolas Beaufils, La Valeur de Vérité de L'expérience Mystique 2003priapePas encore d'évaluation
- Mystique VajraynaDocument14 pagesMystique Vajraynanatacha deerPas encore d'évaluation
- Mythes de La Culture Luba ExtraitDocument9 pagesMythes de La Culture Luba Extraitblaise kabeyaPas encore d'évaluation
- Etude Sur Le SacréDocument34 pagesEtude Sur Le Sacrékhoaphamfr100% (1)
- 3 & 4 Points-De-Vue-Initiatiques 1971Document128 pages3 & 4 Points-De-Vue-Initiatiques 1971Valérie Hombert-scohierPas encore d'évaluation
- 9782130367529Document24 pages9782130367529papandiayediouf28Pas encore d'évaluation
- 0_@Sagesse Des Contes SoufisDocument178 pages0_@Sagesse Des Contes Soufisfreddybuk3Pas encore d'évaluation
- Nature Du Rituel Maà Onnique - 02 - 2016Document2 pagesNature Du Rituel Maà Onnique - 02 - 2016Dominique LucianiPas encore d'évaluation
- Adultère Peulhe Jda - 0249-7476 - 1987 - Num - 29 - 1 - 1360Document26 pagesAdultère Peulhe Jda - 0249-7476 - 1987 - Num - 29 - 1 - 1360KAYZERPas encore d'évaluation
- Gravrand H-Naq Et Sorcellerie Sereer-75XI2Document40 pagesGravrand H-Naq Et Sorcellerie Sereer-75XI2Evariste OuattaraPas encore d'évaluation
- Figures Du Maître - Chapitre IV. Comment Passer de L'ignorance À La Connaissance - Presses Universitaires de RennesDocument23 pagesFigures Du Maître - Chapitre IV. Comment Passer de L'ignorance À La Connaissance - Presses Universitaires de Rennesrobertam213Pas encore d'évaluation
- ! Delacroix Etudes D'histoire Et de Psychologie Du MysticismeDocument501 pages! Delacroix Etudes D'histoire Et de Psychologie Du MysticismeRobert FrippPas encore d'évaluation
- Petit Abécédaire de La Pensée Spiralaire de René Barbier Sur L'Édudacion (Work in Progress)Document44 pagesPetit Abécédaire de La Pensée Spiralaire de René Barbier Sur L'Édudacion (Work in Progress)Joop-le-philosophePas encore d'évaluation
- LVDP - Cours D'ésotérisme - 06 La Mystique Chrétienne OccidentaleDocument8 pagesLVDP - Cours D'ésotérisme - 06 La Mystique Chrétienne OccidentaleCyrille breuil100% (1)
- Le SecretDocument42 pagesLe SecretIMOTEP50% (2)
- La Doctrine Secrete Des Jours de L'apocalypse 1Document304 pagesLa Doctrine Secrete Des Jours de L'apocalypse 1Oleg100% (8)
- Le rite écossais ancien et accepté - 33 degrés de sagesse pratique: Le lumineux voyage de Pierre et SylvieD'EverandLe rite écossais ancien et accepté - 33 degrés de sagesse pratique: Le lumineux voyage de Pierre et SylviePas encore d'évaluation
- SecretDocument3 pagesSecretGina AndradePas encore d'évaluation
- Maltraitance Et Cultures by Ali Aouattah Georges Devereux Christian Dubois Douakou Kouassi Patrick LDocument70 pagesMaltraitance Et Cultures by Ali Aouattah Georges Devereux Christian Dubois Douakou Kouassi Patrick LJoël BernatPas encore d'évaluation
- Le Culte Des Ancetres Au QuotidienDocument6 pagesLe Culte Des Ancetres Au QuotidienLouhab KrouchePas encore d'évaluation
- 001 La FM Pièges DieuDocument5 pages001 La FM Pièges DieuPlume vivantePas encore d'évaluation
- Les Lumieres Du PasseesDocument7 pagesLes Lumieres Du PasseesffmcjfrPas encore d'évaluation
- Sérouya Henri La KabbaleDocument58 pagesSérouya Henri La KabbalePiero MancusoPas encore d'évaluation
- Les Premieres Organisations Pulsionnelles Et Le Moi CorporelDocument25 pagesLes Premieres Organisations Pulsionnelles Et Le Moi CorporelFernanda DrumondPas encore d'évaluation
- La Différence Entre Sacré Et ProfaneDocument5 pagesLa Différence Entre Sacré Et ProfaneJoseph Jean SamuelPas encore d'évaluation
- Citas Conferencia EsquizofreniaDocument18 pagesCitas Conferencia Esquizofreniabryan zuñigaPas encore d'évaluation
- Le Sacré-La Tradition PrimordialeDocument2 pagesLe Sacré-La Tradition PrimordialeamramPas encore d'évaluation
- POSSESSION ANTHROPOLOGIE ARTICLE WIKIPEDIA (5 Pages - 955 Ko)Document5 pagesPOSSESSION ANTHROPOLOGIE ARTICLE WIKIPEDIA (5 Pages - 955 Ko)inscriresitePas encore d'évaluation
- A1 - La Sagesse GnostiqueDocument14 pagesA1 - La Sagesse Gnostiquetookilos biblexPas encore d'évaluation
- PHI 121 Textes À Lire Avec Les ÉtudiantsDocument15 pagesPHI 121 Textes À Lire Avec Les ÉtudiantsKamPas encore d'évaluation
- Anthropologie de La CommunicationDocument16 pagesAnthropologie de La CommunicationIvanna Da Silva AfonsoPas encore d'évaluation
- HADOPI: Comment y Échapper? - Journal Du HackDocument4 pagesHADOPI: Comment y Échapper? - Journal Du HackSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- La Capacité Létale de La Digitale: Toxicité de La DigitaleDocument2 pagesLa Capacité Létale de La Digitale: Toxicité de La DigitaleSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Ces Médicaments Légaux Aussi Puissants Et Mortels Qu'une Drogue DureDocument3 pagesCes Médicaments Légaux Aussi Puissants Et Mortels Qu'une Drogue DureSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Les Toxiques Les Plus Courants Et Les Plus DangereuxDocument12 pagesLes Toxiques Les Plus Courants Et Les Plus DangereuxSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Échapper À Hadopi, Mode D'emploiDocument4 pagesÉchapper À Hadopi, Mode D'emploiSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Télécharger Sans Se Faire Repérer by Humm!Document2 pagesTélécharger Sans Se Faire Repérer by Humm!SKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Kakis: Le Fruit D'hiver ParfaitDocument3 pagesKakis: Le Fruit D'hiver ParfaitSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- On A Testé Le Régime 5.2 (5:2 À La Française) - L'Express StylesDocument5 pagesOn A Testé Le Régime 5.2 (5:2 À La Française) - L'Express StylesSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Quel Est Le Taux D'humidité Idéale Pour Votre Maison Ou Appartement ? - Température IdéaleDocument2 pagesQuel Est Le Taux D'humidité Idéale Pour Votre Maison Ou Appartement ? - Température IdéaleSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- La Tendance de La Pleine Conscience: Peut-On Vraiment Trouver Le Bonheur en Pensant ?Document5 pagesLa Tendance de La Pleine Conscience: Peut-On Vraiment Trouver Le Bonheur en Pensant ?SKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Le Steadyblog: Sur Le Tournage de Moby Dick: John Huston Et Gregory Peck by Erich LessingDocument9 pagesLe Steadyblog: Sur Le Tournage de Moby Dick: John Huston Et Gregory Peck by Erich LessingSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Guide Des Amphibiens Et Reptiles D'aquitaineDocument91 pagesGuide Des Amphibiens Et Reptiles D'aquitaineSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Candomblé - WikipédiaDocument9 pagesCandomblé - WikipédiaSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Conserver Livres Et Archives À Domicile - Restauration D'archives, Restauration de Livres, ReliureDocument3 pagesConserver Livres Et Archives À Domicile - Restauration D'archives, Restauration de Livres, ReliureSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Moby Dick (1956) de John Huston - This Is My MoviesDocument4 pagesMoby Dick (1956) de John Huston - This Is My MoviesSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Julien Bonhomme - Anthropologue Et:ou Initié-L'anthropologie Gabonaise À L'épreuve Du BwitiDocument10 pagesJulien Bonhomme - Anthropologue Et:ou Initié-L'anthropologie Gabonaise À L'épreuve Du BwitiSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Julien Bonhomme - A Propos Des Usages Rituels de Psychotropes Hallucinogènes (Substances, Dispositifs, Mondes)Document14 pagesJulien Bonhomme - A Propos Des Usages Rituels de Psychotropes Hallucinogènes (Substances, Dispositifs, Mondes)SKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Les Réseaux Pédocriminels D'élite, Partie I: de Joris Demmink À L'affaire Alcacer en Espagne - Histoire SecrèteDocument17 pagesLes Réseaux Pédocriminels D'élite, Partie I: de Joris Demmink À L'affaire Alcacer en Espagne - Histoire SecrèteSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Moby DickDocument3 pagesMoby DickSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Moby Dick de John Huston (1956) - Analyse Et Critique Du FilmDocument9 pagesMoby Dick de John Huston (1956) - Analyse Et Critique Du FilmSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Julien Bonhomme - Les Ancêtres Et Le Disque Dur-Visions D'iboga en Noir Et BlancDocument24 pagesJulien Bonhomme - Les Ancêtres Et Le Disque Dur-Visions D'iboga en Noir Et BlancSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Mes 7 Mots Allemands Préférés, Mon Coiffeur Et MoiDocument9 pagesMes 7 Mots Allemands Préférés, Mon Coiffeur Et MoiSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- La Réalité Des Abus Sexuels Rituels en France Et en Angleterre - Enfant de La SociétéDocument19 pagesLa Réalité Des Abus Sexuels Rituels en France Et en Angleterre - Enfant de La SociétéSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Stade Phallique - WikipédiaDocument2 pagesStade Phallique - WikipédiaSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Réseaux Pédophiles D'élite, Partie II: Un Bordel Pour Pédos Puissants Au Coeur de Londres - Histoire SecrèteDocument4 pagesRéseaux Pédophiles D'élite, Partie II: Un Bordel Pour Pédos Puissants Au Coeur de Londres - Histoire SecrèteSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Réseaux Pédophiles D'élite, Partie III: en Belgique, Gladio Tirait Les Ficelles Du Réseau - Histoire SecrèteDocument26 pagesRéseaux Pédophiles D'élite, Partie III: en Belgique, Gladio Tirait Les Ficelles Du Réseau - Histoire SecrèteSKYHIGH444100% (2)
- Mort À Venise - Lundi 18 Mai À 20h50 - ARTE CinemaDocument2 pagesMort À Venise - Lundi 18 Mai À 20h50 - ARTE CinemaSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Log-Introduction A La Log Terrain-Ocb-FinalDocument225 pagesLog-Introduction A La Log Terrain-Ocb-FinalOlivier BigirimanaPas encore d'évaluation
- Guide de Planification Strategique Et OrganisationnelleDocument44 pagesGuide de Planification Strategique Et OrganisationnelleMustapha Bouallala100% (2)
- Module03-Manuel EmployeDocument8 pagesModule03-Manuel EmployeAbdel Motaleb AL-Saady100% (1)
- Art Dicquemare 314 317Document17 pagesArt Dicquemare 314 317laure_rouxPas encore d'évaluation
- Processus Du Développement Logiciel - Paradigmes & PerspectivesDocument226 pagesProcessus Du Développement Logiciel - Paradigmes & Perspectivesbadr79100% (3)
- GPAO - Gestion de Production Assistée Par OrdinateurDocument23 pagesGPAO - Gestion de Production Assistée Par OrdinateurAyoub Jaaouani25% (4)
- Catalogue ABFDocument79 pagesCatalogue ABFamina ayariPas encore d'évaluation
- À Quoi Sert La CommunicationDocument3 pagesÀ Quoi Sert La CommunicationFräulein Zineb HamdounePas encore d'évaluation
- Filières Agroalimentaires en Afrique Comment Rendre Le Marché Plus Efficace ?Document314 pagesFilières Agroalimentaires en Afrique Comment Rendre Le Marché Plus Efficace ?Onguene SyntiaPas encore d'évaluation
- Composer Un ArticleDocument11 pagesComposer Un ArticleMihaela AntonPas encore d'évaluation
- Siad LogistiqueDocument17 pagesSiad LogistiqueHamza MechehatPas encore d'évaluation
- Secus 11 03Document29 pagesSecus 11 03kakalenehemiePas encore d'évaluation
- Assou Mathias Esgis Iir3 MemoireDocument20 pagesAssou Mathias Esgis Iir3 MemoireAnonymous i3bqG5Pas encore d'évaluation
- Devenir Un Cybercitoyen: Séance Pédagogique: Le ContexteDocument3 pagesDevenir Un Cybercitoyen: Séance Pédagogique: Le ContexteInes Ben DhahbiPas encore d'évaluation
- Perspectives Des Entreprises - Série ITC Sur Les Mesures Non Tarifaires - WebDocument107 pagesPerspectives Des Entreprises - Série ITC Sur Les Mesures Non Tarifaires - WebMouna BaqPas encore d'évaluation
- Projet: Réalisation D'une Base de Données Sujet: Gestion Des Ressources Humaines Logiciel: Microsoft AccessDocument19 pagesProjet: Réalisation D'une Base de Données Sujet: Gestion Des Ressources Humaines Logiciel: Microsoft AccessStephane DjeukeuPas encore d'évaluation
- Etude de Marchã© Huile de Table-ConvertiDocument7 pagesEtude de Marchã© Huile de Table-ConvertiAmine ElfanouniPas encore d'évaluation
- QCMDocument26 pagesQCMSara ElmrabetPas encore d'évaluation
- Iot Et Prise de DecsionDocument18 pagesIot Et Prise de Decsionmerad mohamedPas encore d'évaluation
- Simondon 27 Fev 1960 Forme Information PotentielsDocument45 pagesSimondon 27 Fev 1960 Forme Information PotentielsAline VieiraPas encore d'évaluation
- Guide Pme Pensez Pi PDFDocument117 pagesGuide Pme Pensez Pi PDFphotos najiPas encore d'évaluation
- Manuel de Techniques RédactionnellesDocument140 pagesManuel de Techniques RédactionnellesAbdou Aziz BoyePas encore d'évaluation
- L1 - Fichier Syllabus - S1Document28 pagesL1 - Fichier Syllabus - S1lamine.gacem.lgPas encore d'évaluation
- Doctor atDocument270 pagesDoctor atmalika amriPas encore d'évaluation
- Module de CommunicationDocument21 pagesModule de CommunicationattiamoPas encore d'évaluation
- Analyse Fonctionnelle Interne - Chaine Dénergie Et Dinformation - Copie FinaleDocument8 pagesAnalyse Fonctionnelle Interne - Chaine Dénergie Et Dinformation - Copie FinaleOuechtati Mounir100% (1)
- Info Systemes Cote IvoireDocument46 pagesInfo Systemes Cote IvoirecomoncomPas encore d'évaluation
- Journal Le Soir D Algerie 05.10.2016Document21 pagesJournal Le Soir D Algerie 05.10.2016LiegeoisPas encore d'évaluation
- Séance 1-Management Des SIs Évolués PDFDocument28 pagesSéance 1-Management Des SIs Évolués PDFessid sabraPas encore d'évaluation
- Cours Veille Technologique2Document107 pagesCours Veille Technologique2Menjli ChaoukiPas encore d'évaluation