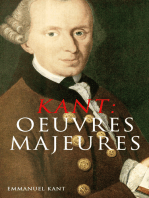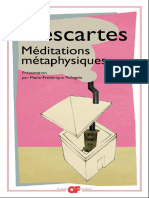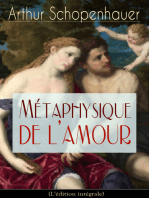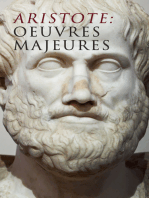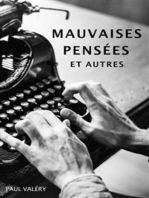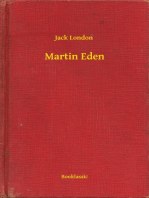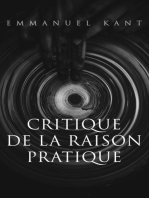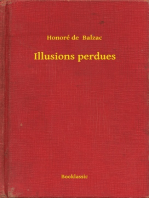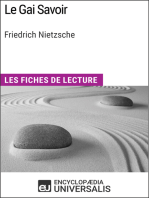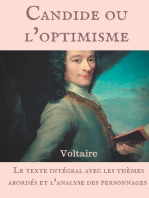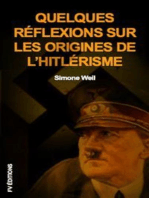Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
L'Etre Et Le Néant
L'Etre Et Le Néant
Transféré par
Ekaterina KulakovaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
L'Etre Et Le Néant
L'Etre Et Le Néant
Transféré par
Ekaterina KulakovaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Jean-Paul Sartre
L'tre
et le nant
Essai d'ontologie
phnomnologique
DITI ON CORRI GE
AVEC I NDEX PAR
ARLETTE ELKAM-SARTRE
Gallimard
Ce livre a initialement paru dans la
Bibliothque des Ides" e 1943.
ditions Gallimard, 1943.
Au Castor
Introduction
LA RECHERCHE DE L'TRE
L'IDE DE PHNOMNE
La pense moderne a ralis un progrs considrable en rduisant
l'existant l a srie des apparitions qui l e manifestent. On visait par l
supprimer un certain nombre de dualismes qui embarrassaient la
philosophie et les remplacer par le monisme du phnomne. Y a
t-on russi ?
Il est certain qu' on s'est dbarrass en premier lieu de ce dualisme
qui oppose dans l'existant l ' intrieur l'extrieur. Il n'y a plus
d'extrieur de l'existant, si l'on entend par l une peau superficielle
qui dissimulerait aux regards la vritable nature de l'objet. Et cette
vritable nature, son tour, si elle doit tre l a ralit secrte de la
chose, qu'on peut pressentir ou supposer mais jamais atteindre parce
qu'elle est intrieure l'objet considr, n'existe pas non plus.
Les apparitions qui manifestent l' existant ne sont ni intrieures ni
extrieures : eltes se valent toutes, el l es renvoient toutes d'autres
apparitions et aucune d'elles n'est privilgie. La force, par exemple,
n'est pas un cana/us mtaphysique et d'espce inconnue qui se
masquerait derrire ses effets (acclrations, dviations, etc.) : elle
est l'ensemble de ces effets. Pareiltement le courant lectrique n' a pas
d'envers secret : il n'est rien que l'ensemble des actions physico
chimiques (lectrolyses, i ncandescence d' un filament de carbone,
dplacement de l'aiguille du galvanomtre, etc. ) qui le manifestent.
Aucune de ces actions ne suffit l e rvler. Mais elle n'indique rien
qui soit derrire elle: elle indique elte-mme et l a srie totale. Il
s'ensuit, videmment, que l e dualisme de l'tre et du paratre ne
saurait pl us trouver droit de ci t en philosophie. L'apparence renvoie
11
la srie totale des apparences et non un rel cach qui aurait
drain pour lui tout l'tre de l'existant. Et l'apparence, de son ct,
n'est pas une mani festation inconsistante de cet tre. Tant qu'on a pu
croire aux ralits noumnales, on a prsent l 'apparence comme un
ngati f pur. C'tait ce qui n'est pas l' tre ; elle n'avait d'autre tre
que celui de l ' i llusion et de l'erreur. Mais cet tre mme tait
emprunt, i l tait lui-mme un fa ux-semblant et l a difficult l a plus
grande qu'on pouvait rencontrer, c'tait de maintenir assez de
cohsion et d'existence l'apparence pour qu'elle ne se rsorbe pas
d'el l e-mme au sein de l'tre non phnomnal. Mais si nous nous
sommes une fois dpris de ce que Nietzsche appelait l'illusion des
et si nous ne croyons plus l'tre-de-derrire
l'apparition, celle-ci devient, au contraire, pleine positivit, son
essence est un paratre qui ne s'oppose plus l'tre, mais qui en
est l a mesure, au contraire. Car l ' tre d' un existant, c'est prcisment
ce q u' i l parat. Ainsi parvenons-nous l'ide de phnomne, telle
qu' on peut la rencontrer, par exemple, dans l a Phnomnologie
de Husserl ou de Hei degger, le phnomne ou le relatif-absolu.
Relatif, le phnomne le demeure car le paratre suppose par
essence quelqu'un qui paratre. Mais il n'a pas la double relativit de
l'Erscheinung kanti enne. I l n' i ndi que pas, par-dessus son paule, un
tre vritable qui serait, l ui , l' absol u. Ce qu'il est, i l l'est absol ument,
car il se dvoile comme il est. Le phnomne peut tre tudi et dcrit
en tant que tel, car i l est absolument indicatif de lui-mme.
Du mme coup va tomber la dualit de la puissance et de l'acte.
Tout est en acte. Derrire l'acte il n' y a ni puissance, ni exis , ni
vert u. Nous refuserons, par exempl e, d'entendre par gnie -au
sens o l'on di t que Proust avait du gnie ou qu' il tait un
gnie -une puissance singulire de produire certaines uvres, qui ne
s'puiserait pas, j ustement, dans l a production de celles-ci. Le gnie
de Proust, ce n'est ni l'uvre considre isolment, ni le pouvoir
subjectif de la produire : c'est l'uvre considre comme l'ensemble
des manifestations de l a personne. C'est purquoi, enfin, nous
pouvons gal ement rejeter le dualisme de l'apparence et de l'essence.
L'apparence ne cache pas l'essence, elle l a rvle : elle est l'essence.
L'essence d' un existant n'est plus une vertu enfonce au creux de cet
existant, c'est l a l oi manifeste qui prside l a succession de ses
apparitions, c'est l a raison de l a srie. Au nomi nalisme de Poincar,
dfinissant une ralit physique (l e courant lectrique, par exemple),
comme l a somme de ses diverses manifestations, Duhem avait raison
d'opposer sa propre thorie, qui faIsan du concept l'unit synthtique
de ces manifestations. Et , certes, la phnomnologie n'est rien moins
qu'un nominal isme. Mais, en dfi nitive, l'essence comme raison de la
srie n'est que le lien des apparitions, c'est--dire elle-mme une
apparition. C' est ce qui explique qu' i l puisse y avoir une intuition des
12
essences (l a Wesenschau de Husserl, par exemple) . Ainsi l'tre
phnomnal se manifeste, i l manifeste son essence aussi bien que son
existence et il n'est rien que la srie bien lie de ces manifestations.
Est-ce di re que nous ayons russi supprimer tous les dualismes
en rduisant l'existant ses manifestations ? Il semble plutt que nous
les ayons tous convertis en un dualisme nouveau : celui du fini et de
J'infi ni . L'existant, en effet, ne saurait se rdui re une srie finie de
manifestations, puisque chacune d'elles est un rapport un sujet en
perptuel changement. Quand un objet ne se livrerait qu' travers une
seule Abschattung , l e seul fait d'tre sujet implique la possibil it
de mul tiplier les points de vue sur cette Abschattung . Cela suffit
pour multiplier l ' i nfini Abschattung considre. En outre, si la
srie d'apparitions tait fi nie, cela signifierait que les premires
apparues n' ont pas l a possibilit de reparaftre, ce qui est absurde, ou
qu'elles peuvent tre toutes donnes l a fois, ce qui est plus absurde
encore. Concevons bi en, en effet, que notre thorie du phnomne a
remplac la ralit de la chose par l ' objectivit du phnomne et
qu'elle a fond celle-ci sur un recours l'infi ni . La ralit de cette
tasse, c'est qu'elle est l et qu'elle n'est pas moi. Nous traduirons cel a
en disant que la srie de ses apparitions est l ie par une raison qui ne
dpend pas de mon bon plaisir. Mais l'apparition rduite elle-mme
et sans recours l a srie dont elle fait partie ne saurait tre qu'une
plnitude intuitive et subjective : la mani re dont le sujet est affect.
Si le phnomne doit se rvler transcendant, i l faut que le sujet l ui
mme transcende l'apparition vers la srie total e dont elle est un
membre. I l faut qu'i l saisisse le rouge travers son impression de
rouge, Le rouge, c'est--dire l a raison de l a srie ; l e courant
lectrique travers J'lectrolyse, etc. Mai s si l a transcendance de
l'objet se fonde sur la ncessit pour l 'apparition de se faire toujours
transcender, i l en rsulte qu'un objet pose par principe la srie de ses
apparitions comme infinies. Ainsi l'apparition qui est finie s'indique
elle-mme dans sa finitude, mais exige en mme temps, pour tre
saisie comme apparition-de-ce-qui-apparat, d' tre dpasse vers
l'infi ni . Cette opposition nouvel l e, le fini et l'infini , ou mieux
l'infini dans le fini , remplace l e dualisme de l'tre et du paratre :
ce qui parat, en effet, c'est seulement un aspect de l'objet et l'objet
est tout entier dans cet aspect et t out entier hors de lui. Tout entier
dedans en ce qu'il se manifeste dans cet aspect : i l s'indique lui-mme
comme l a structure de l'apparition, qui est en mme temps la raison
de la srie. Tout entier dehors, car la srie elle-mme n'apparatra
jamais ni ne peut apparatre. Ainsi , le dehors s'oppose de nouveau au
dedans et l'tre-qui-ne-parat-pas l'apparition. Pareillement une
certaine puissance revient habiter le phnomne et l ui confrer sa
transcendance mme : la puissance d' tre dvelopp en une srie
d'apparitions relles ou possibles. Le gnie de Proust, mme rduit
13
aux uvres produites, n'en quivaut pas moins l ' i nfinit des points
de vue possibles qu'on pourra prendre sur cette uvre et qu' on
nommera < < l'inpuisabilit> de l ' uvre proustienne. Mai s cette
inpuisabilit qui implique une transcendance et un recours l ' i nfi ni ,
n'est-el l e pas une exi s , au moment mme o on la saisit sur
l'objet ? L'essence enfin est radicalement coupe de l'apparence
individuelle qui la manifeste, puisqu'elle est par principe ce qui doit
pouvoir tre mani fest par une srie de manifestations individuelles.
A remplacer ainsi une diversit d'oppositions par un dualisme
uni que qui les fonde toutes, avons-nous gagn ou perdu ? C'est ce que
nous verrons bientt. Pour l 'insta nt, la premire consquence de l a
thorie du phnomne , c'est que l'apparition ne renvoie pas
l'tre comme le phnomne kantien au noumne. Puisqu'il n' y a rien
derrire elle et qu'elle n'indique qu'elle-mme (et l a srie totale des
apparitions), elle ne peut tre supporte par un autre tre que le sien
propre, elle ne saurait tre la mi nce pellicule de nant qui spare
l ' tre-sujet de l ' tre-absolu. Si l 'essence de l'apparition est un
paratre qui ne s'oppose plus aucun tre, il y a un problme
lgi ti me de l'tre de ce paratre. C'est ce problme qui nous occupera
ici et qui sera le point de dpart de nos recherches sur l'tre et le
nant
.
I I
L E PHNOMN E D' TRE E T L' TRE DU PHNOMNE
L'apparition n'est soutenue par aucun existant diffrent d'elle: el l e
a son tre propre. L'tre premier que nous rencontrons dans nos
recherches ontologiques, c' est donc l'tre de l'apparition. Est-il lui
mme une apparition ? Il le sembl e d' abord. Le phnomne est ce qui
se manifeste et l' tre se manifeste tous en quelque faon, puisque
nous pouvons en parler et que nous en avons une certaine compr
hension. Ainsi doit-il y avoir un phnomne d'tre, une apparition
d'tre, descriptible comme telle. L'tre nous sera dvoil par quelque
moyen d'accs immdiat, l'ennui, l a nause, etc. , et l'ontologie sera la
description du phnomne d'tre tel qu' il se manifeste, c'est--dire
sans intermdiaire. Pourtant, il convient de poser toute ontologie
une question pralable : le phnomne d'tre ainsi atteint est-il
identique l ' tre des phnomnes, c'est--dire : l'tre qui se dvoile
moi, qui m'apparat, est-il de mme nature que l'tre des existants qui
m'apparaissent ? Il semble qu'il n' y ai t pas de di fficult : Husserl a
montr comment une rduction eidtique est toujours possi ble, c'est-
14
-dire comment on peut toujours dpasser le phnomne concret vers
son essence et, pour Heidegger, l a ralit-humaine est ontico
ontologi que, c'est--dire qu'elle peut toujours dpasser le phnomne
vers son tre. Mais l e passage de l'objet singulier l'essence est
passage de l'homogne l ' homogne. En est-il de mme du passage
de l'existant au phnomne d' tre ? Dpasser l'existant vers le
phnomne d'tre, est ce bien le dpasser vers son tre, comme on
dpasse le rouge particul i er vers son essence ? Regardons mieux.
Dans un objet singulier, on peut toujours distinguer des qualits
comme l a couleur, l'odeur, etc. Et, partir de cel les-ci , on peut
toujours fixer une essence qu'elles impliquent, comme le signe
implique la signification. L'ensemble objet-essence fait un tout
organis : l'essence n'est pas dans l'objet, elle est le sens de l'objet, la
raison de la srie d'apparitions qui le dvoilent. Mais l'tre n'est ni
une qualit de l'objet saisissable parmi d'autres, ni un sens de l'objet.
L'objet ne renvoie pas l ' tre comme une signifi cation : il serait
impossi bl e, par exemple, de dfi nir l'tre comme une prsence
puisque l'absence dvoile aussi l ' tre, puisque ne pas tre l, c'est
encore tre. L'objet ne possde pas l'tre, et son existence n'est pas
une participation l ' tre, ni tout autre genre de relati on. Il est, c'est la
seule manire de dfinir sa faon d'tre ; car l'objet ne masque pas
l'tre, mais i l ne le dvoile pas non plus : i l ne le masque pas, car i l
serait vain d'essayer d'carter certaines qualits de l'existant pour
trouver l ' tre derrire el l es, l'tre est l'tre de toutes galement -i l
ne l e dvoile pas, car i l serait vain de s'adresser l'objet pour
apprhender son tre. L'existant est phnomne, c'est--dire qu'il se
dsigne lui-mme comme ensemble organis de qualits. Lui-mme
et non son tre. L'tre est simplement la condition de tout dvoile
ment : il est tre-pour-dvoiler et non tre dvoil. Que signifie donc
ce dpassement vers l'ontologique dont parle Heidegger ? A coup sr,
j e puis dpasser cette table ou cette chaise vers son tre et poser la
question de l'tre-table ou de l'tre-chaise. Mais, cet instant, j e
dtourne les yeux de l a table-phnomne pour fixer l'tre-phno
mne, qui n'est plus l a condition de tout dvoilement -mais qui est
lui-mme un dvoil , une apparition et qui , comme tel l e, a son tour
besoin d' un tre sur l e fondement duquel i l puisse se dvoiler.
Si l'tre des phnomnes ne se rsout pas en un phnomne d'tre
et si pourtant nous ne pouvons rien dire sur l'tre qu'en consultant ce
phnomne d'tre, l e rapport exact qui unit l e phnomne d'tre
l'tre du phnomne doi t tre tabl i avant tout. Nous pourrons l e
faire pl us aisment si nous considrons que l'ensemble des remarques
prcdentes a t di rectement inspir par l'intuition rvlante du
phnomne d'tre. En considrant non l'tre comme condition du
dvoil ement , mai s l'tre comme apparition qui peut tre fixe en
concepts, nous avons compris tout d'abord que l a connaissance ne
15
pouvait el l e seul e rendre raison de l'tre, c'est--dire que l'tre du
phnomne ne pouvait se rduire au phnomne d'tre. En un mot,
le phnomne d'tre est ontologique au sens o l'on appelle
ontologique la preuve de saint Anselme et de Descartes. Il est un
appel d'tre; i l exige, en tant que phnomne, un fondement qui soit
transphnomnal . Le phnomne d'tre exige la transphnomnalit
de l ' tre. Cela ne veut pas dire que l'tre se trouve cach derrire les
phnomnes (nous avons vu que l e phnomne ne peut pas masquer
l'tre) - ni que le phnomne soit une apparence qui renvoie un
tre distinct (c'est en tant qu'apparence que le phnomne est, c'est-
dire qu'il s' indique sur le fondement de l'tre). Ce 1ui est impliqu
par l es considrations qui prcdent, c'est que l'tre du phnomne,
quoique coextensif au phnomne, doit chapper l a condition
phnomnale -qui est de n'exister que pour autant qu'on se rvle
-et que , par consquent, i l dborde et fonde la connaissance qu'on
en prend.
III
LE COGITO * PRRFLEXI F ^ ET L' TRE DU P ERCI PERE ?
On sera peut-tre tent de rpondre que les difficults mentionnes
plus haut tiennent toutes une certaine conception de l'tre, une
manire de ralisme ontologique tout fait i ncompatible avec l a
notion mme d'apparition. Ce qui mesure l'tre de l'apparition c'est,
en effet, qu'elle apparat. Et , puisque nous avons born l a ralit au
phnomne, nous pouvons dire du phnomne qu'il est comme i l
apparat. Pourquoi ne pas pousser l'ide jusqu' s a limite et dire que
l'tre de l'apparition c'est son apparatre ? Ce qui est simplement une
faon de choisir des mots nouveaux pour habil l er le vieil esse est
percipi de Berkeley. Et c'est bien, en effet, ce que fera un Husserl,
lorsque, aprs avoir effectu la rduction phnomnologique, i l
traitera le nome d'irrel et dclarera que son esse est un
percipi .
Il ne parat pas que la clbre formule de Berkeley puisse nous
satisfaire. Ceci pour deux raisons essentielles, tenant l'une la nature
du percipi, l'autre celle du percipere.
Nature du percipere . - Si toute mtaphysique, en effet,
suppose une thorie de la connaissance, en revanche toute thorie de
la connaissance suppose une mtaphysique. Cela signifie, entre autres
choses, qu'un idalisme soucieux de rduire l'tre la connaissance
qu'on en prend, devrait auparavant assurer de quelque manire l ' tre
16
de la connaissance. Si l'on commence, au contraire, par poser celle-ci
comme un donn, sans se proccuper d' en fonder l"tre et si l' on
affirme ensuite esse est percipi , la totalit perception-peru ,
faute d'tre soutenue par un tre solide, s'effondre dans le nant.
Ainsi l'tre de la connaissance ne peut tre mesur par la connais
sance ; il chappe au percipi 1. Ainsi l'tre-fondement du percipere
et du percipi doi t chapper lui-mme au percipi: il doit tre
transphnomnal . Nous revenons notre point de dpart. Toutefois
on peut nous accorder que le percipi renvoie un tre qui chappe
aux lois de l ' apparition, mais tout en maintenant que cet tre
transphnomnal est l'tre du sujet. Ainsi le percipi renverrait au
percipiens-Ie connu la connaissance et celle-ci l'tre connaissant
en tant qu'il est , non en tant qu' i l est connu, c'est--dire l a
conscience. C'est ce qu' a compris Husserl : car si le nome est pour
lui un corrlatif i rrel de la nose, dont la loi ontologique est le
percipi, l a nose, au contraire, lui apparat comme l a ralit, dont l a
caractristique principale est de se donner la rflexion qui l a
connat, comme ayant t dj l avant . Car la l oi d'tre du sujet
connaissant, c'est d'tre-conscient. La conscience n'est pas un mode
de connaissance particulier, appel sens intime ou connaissance de
soi, c'est l a dimension d'tre transphnomnale du sujet.
Essayons de mieux comprendre cette dimension d'tre. Nous
disions que la conscience est l'tre connaissant en tant qu' il est et non
en tant qu' il est connu. Cela signifie qu' il convient d'abandonner le
primat de la connaissance, si nous voulons fonder cette connaissance
mme. Et, sans doute, l a conscience peut connatre et se connatre.
Mais elle est , en elle-mme , autre chose qu'une connaissance
retourne sur soi.
Toute conscience, Husserl \ ' a montr, est conscience de quelque
chose. Cela signifie qu'il n'est pas de conscience qui ne soit position
d' un objet transcendant, ou, si \'on prfre, que la conscience n' a pas
de . Il faut renoncer ces donnes neutres qui
pourraient, selon le systme de rfrences choisi, se constituer en
monde ou en psychique . Une table n'est pas dans la cons
cience, mme titre de reprsentation. Une table est dans l'espace,
ct de la fentre, etc. L'existence de la tabl e, en effet, est un centre
d'opacit pour l a conscience ; i l faudrait un procs infini pour
inventorier le contenu total d'une chose. Introduire cette opacit dans
la conscience, ce serait renvoyer l'infi ni l'inventaire qu'elle peut
dresser d'elle-mme, faire de l a conscience une chose et refuser le
1. Il va de soi que toute tentative pour remplacer le percipere par une autre
aUwde de la ralit humaine resterait pareillement i nfructueuse. Si l'on
admettait que l'tre se rvle l'homme dans l e faire _ encore faudrait il
assurer l'tre du faire en dehors de l'action.
17
cogilO. La premire dmarche d' une philosophie doit donc tre pour
expulser les choses de la conscience et pour rtablir le vrai rapport de
celle-ci avec le monde, savoir que la conscience est conscience
positionnelle du monde. Toute conscience est positionne lIe en ce
qu'elle se transcende pour atteindre un objet, et elle s'puise dans
cette position mme : tout ce qu'il y a d'inlenlion dans ma conscience
actuelle est dirig vers le dehors, vers la table ; toutes mes activits
judicatives ou pratiques, toute mon affectivit du moment se trans
cendent , visent la table et s'y absorbent. Toute conscience n'est pas
connaissance (il y a des consciences affectives, par exemple), mais
toute conscience connaissante ne peut tre connaissance que de son
objet.
Pourtant la condition ncessaire et suffisante pour qu' une cons
cience connaissante soit connaissance de son objet, c'est qu'elle soit
conscience d' elle-mme comme tant cette connaissance. C'est une
condition ncessaire : si ma conscience n' tait pas conscience d' tre
conscience de tabl e, elle serait donc conscience de cette table sans
avoir conscience de l'tre ou, si l'on veut, une conscience qui
s'ignorerait soi-mme, une conscience i nconsciente - ce qui est
absurde. C'est une condition suffisante : il suffit que j'aie conscience
d'avoir conscience de cette table pour que j 'en aie en effet conscience.
Cela ne suffit certes pas pour me permettre d'affirmer que cette table
existe en soi mais bien qu'elle existe pour moi.
Que sera cette conscience de conscience ? Nous subissons un tel
point l ' i llusion du primat de l a connaissance, que nous sommes tout
de suite prts faire de la conscience de conscience une idea ideae la
manire de Spinoza, c'est--dire une connaissance de connaissance.
Alain ayant exprimer cette vidence : Savoir, c'est avoir cons
cience de savoir ", la traduit en ces termes : Savoir, c'est savoir
qu'on sait. " Amsi aurons-nous dfini l a rfexion ou conscience
positionnelle de la conscience, ou mieux encore connaissance de la
conscience. Ce serait une conscience complte et di rige vers quelque
chose qui n'est pas elle, c'est--dire vers la conscience rflchi e. Elle
se t ranscenderait donc et, comme l a conscience posi tionnelle du
monde, s'puiserait viser son objet. Seulement cet objet serait lui
mme une conscience.
Il ne parat pas que nous puissions accepter cette interprtation de
l a cOIlscience de conscience. La rduction de l a conscience la
connaissance, en effet, implique qu'on i ntroduit dans la conscience la
dualit sujet-objet, qui est typique de l a connaissance. Mais si nous
acceptons la l oi du couple connaissant-connu, un troisime terme sera
ncessaire pour que le connaissant devienne connu son tour et nous
serons placs devant ce dilemme : ou nous arrter un terme
quelconque de la srie : connu -connaissant connu - connaissant
connu du connaissant, etc. , alors c'est l a totalit du phnomne qui
18
tombe dans l 'i nconnu, c'est-:dire que nous butons toujours contre
une rflexion non consciente de soi et terme dernier -ou bien nous
affirmons l a ncessit d'une rgression l' infi ni (idea ideae ideae,
etc. ) , ce qui est absurde. Ainsi l a ncessit de fonder ontologique
ment l a connaissance se doublerait ici d'une ncessit nouvelle : celle
de la fonder pistmologiquement. N'est-ce pas qu' il ne faut pas
introduire la loi du couple dans la conscience ? La conscience de soi
n'est pas couple. Il faut, si nous voulons viter l a rgression l'infini,
qu'elle soit rapport i mmdiat et non-cognitif de soi soi.
D' ai lleurs la conscience rflexive pose l a conscience rflchie
comme son objet : je porte, dans l ' acte de rflexion, des jugements
sur la conscience rflchie, j 'en ai honte, j'en suis fier, je la veux, je la
refuse, etc. La conscience i mmdiate que je prends de percevoir ne
me permet ni de juger, ni de voul oi r, ni d'avoir honte. Elle ne connat
pas ma percepti on, elle ne la pose pas : tout ce qu'il y a d'intention
dans ma conscience actuelle est dirig vers l e dehors, vers le monde.
En revanche, cette conscience spontane de ma perception est
constitutive de ma conscience perceptive. En d'autres termes, toute
conscience positionnelle d'objet est en mme temps conscience non
positionnelle d'elle-mme. Si je compte les cigarettes qui sont dans
cet tui, j 'ai l'i mpression du dvoilement d'une proprit objective de
ce groupe de cigarettes : elles sont douze. Cette proprit apparat
ma conscience comme une proprit existant dans le monde. Je puis
fort bien n'avoir aucune conscience positionnelle de l es compter. Je
ne me connais pas comptant . La preuve en est que l es enfants qui
sont capables de faire une addition spontanment, ne peuvent pas
expliquer ensuite comment ils s'y sont pris ; les tests de Piaget qui le
dmontrent constituent une excellente rfutation de l a formule
d'Alain : Savoir, c'est savoir qu'on sait. Et pourtant, au moment o
ces cigarettes se dvoilent moi comme douze, j' ai une conscience
non-thtique de mon activit addi ti ve. Si l ' on m' i nterroge, en effet, si
l'on me demande : Que faites-vous l ? je rpondrai aussitt:
Je compte et cette rponse ne vise pas seulement la conscience
instantane que je puis atteindre par la rflexion, mais celles qui sont
passes sans avoir t rflchi es, celles qui sont pour toujours
irrflchies dans mon pass immdiat. Ainsi n'y a-t-il aucune espce
de primat de la rflexion sur la conscience rflchi e : ce n'est pas
celle-l qui rvle celle-ci elle-mme. Tout au contraire, c'est l a
conscience non-rflexive qui rend l a rflexion possible : i l y a un
cogito prrflexif qui est la condition du cogito cartsien. En mme
temps, c'est l a conscience non-thtique de compter qui est la
condition mme de mon activit additive. S'il en tait autrement,
comment l'addition serait-elle Je thme unificateur de mes cons
ciences ? Pour que ce thme prside toute une srie de synthses
d'unifications et de rcognitions, i l faut qu' i l soit prsent lui-mme,
19
non comme une chose mais comme une intention opratoire qui ne
peut exister que comme rvlante-rvle , pour employer une
expression de Hei degger. Ainsi, pour compter, faut-il avoir cons
cience de compter.
Sans doute, dira-t-on, mais i l y a cercIe. Car ne faut-il pas que je
compte en fait pour que je puisse avoir conscience de compter ? Il est
vrai . Pourtant, i l n'y a pas cercIe ou, si J'on veut, c'est l a nature mme
de la conscience d' exister en cercIe . C'est ce qui peut s'exprimer
en ces termes : toute existence consciente existe comme consciente
d'exister. Nous comprenons prsent pourquoi la conscience pre
mire de conscience n'est pas positionne Ile : c'est qu'elle ne fait qu'un
avec la conscience dont elle est conscience. D'un seul coup elle se
dtermine comme conscience de perception et comme perception.
Ces ncessits de la syntaxe nous ont oblig j usqu'ici parler de la
conscience non positionnelle de soi . Mais nous ne pouvons user
plus longtemps de cette expression o le de soi veille encore
l'ide de connaissance. (Nous mettrons dsormais le de entre
parenthses, pour indiquer qu' i l ne rpond qu' une contrainte
grammaticale. )
Cette conscience (de) soi , nous ne devons pas la considrer comme
une nouvelle conscience, mais comme le seul mode d'existence qui soit
possible pour une conscience de quelque chose. De mme qu'un objet
tendu est contraint d'exister selon les trois dimensions, de mme une
intenti on, un plaisir, une douleur ne sauraient exister que comme
conscience i mmdi ate (d') eux-mmes. L'tre de l'intention ne peut
tre que conscience, sinon l'intention serait chose dans l a conscience_
Il ne faut donc pas entendre ici que quelque cause extrieure (un
trouble organi que, une impulsion inconsciente, une autre ErIeb
nis ) pourrait dterminer un vnement psychique -un plaisir, par
exemple - se produire, et que cet vnement ainsi dtermin dans
sa structure matrielle serait astreint, d'autre part, se produire
comme conscience (de) soi . Ce serait faire de l a conscience non
thtique une qualit de la conscience positionne Ile (au sens o l a
percepti on, conscience positionnelle de cette table, aurait par surcrot
l a qual i t de conscience (de) soi) et retomber ainsi dans l ' i llusion du
primat thorique de l a connaissance. Ce serai t, en outre, faire de
l'vnement psychique une chose, et le qualifier de conscient comme
je peux qualifier, par exemple, ce buvard de rose. Le plaisir ne peut
pas se distinguer -mme logiquement -de la conscience de plaisir.
La conscience (de) plaisir est constitutive du plaisir, comme l e mode
mme de son existence, comme la matire dont il est fait et non
comme une forme qui s' imposerait aprs coup une matire
hdoniste. Le plaisir ne peut exister avant l a conscience de plaisir
- mme sous la forme de virtualit, de puissance. Un plaisir en
puissance ne saurait exister que comme conscience (d') tre en
20
puissance, il n' y a de virtualits de conscience que comme conscience
de virtualits.
Rciproquement, comme je le montrais tout l'heure, i l faut viter
de dfinir l e plaisir par la conscience que j 'en prends. Ce serait
tomber dans un i dal isme de l a conscience qui nous ramnerait par
des voies dtournes au primat de l a connaissance. Le plaisir ne doit
pas s'vanouir derrire la conscience qu' il a (de) lui-mme : ce n'est
pas une reprsentation, c'est un vnement concret, plein et absolu. Il
n'est pas plus une qualit de la conscience (de) soi que l a conscience
(de) soi n'est une qualit du plaisir. I l n'y a pas plus d'abord une
conscience qui recevrait ensuite l'affection plaisir , comme une eau
qu'on colore , qu'il n'y a d'abord un plaisir (inconscient ou psychologi
que) qui recevrait ensuite la qualit de conscient, comme un faisceau
de lumire. Il y a un tre indivisible, indissoluble -non point une
substance soutenant ses qualits comme de moi ndres tres, mais un
tre qui est existence de part en part. Le plaisir est l'tre de la
conscience (de) soi et l a conscience (de) soi est la l oi d'tre du plaisir.
C'est ce qu'exprime fort bien Heidegger, lorsqu'il crit (en parlant du
Dasein , vrai dire, non de l a conscience) : Le " comment"
(essentia) de cet tre doit, pour autant qu'il est possible en gnral
d'en parler, tre conu partir de son tre (existentia). Cela signifie
que l a conscience n'est pas produite comme exemplaire singulier
d'une possibilit abstraite, mais qu'en surgissant au sein de l'tre elle
cre et soutient son essence, c'est--dire l'agencement synthtique de
ses possibilits.
Cela veut dire aussi que l e type d'tre de l a conscience est
l ' inverse de celui que nous rvle la preuve ontologique : comme l a
conscience n'est pas possible avant d'tre, mais que son tre est l a
source et la condition de toute possibilit, c'est son existence qui
implique son essence. Ce que Husserl exprime heureusement en
parlant de sa ncessit de fait . Pour qu'i l y ait une essence du
plaisir, i l faut qu' il y ait d'abord le fait d'une conscience (de) ce plaisir.
Et c'est en vain qu' on tenterait d' i nvoquer de prtendues lois de l a
conscience, dont l ' ensemble articul en constituerait l'essence : une
loi est un objet transcendant de connaissance ; i l peut y avoir
conscience de l oi , non loi de l a conscience. Pour les mmes raisons, i l
est impossible d'assigner une conscience une autre motivation
qu'elle-mme. Sinon il faudrait concevoir que l a conscience, dans l a
mesure o elle est un effet , est non consciente (de) soi. I l faudrait
que, par quelque ct, elle ft sans tre consciente (d') tre. Nous
tomberions dans cette i l lusion trop frquente qui fait de la conscience
un demi-inconscient ou une passivit. Mais la conscience est cons
cience de part en part. Elle ne saurait donc tre limite que par elle
mme.
Cette dtermination de l a conscience par soi ne doit pas tre conue
21
comme une gense, comme un deveni r, car il faudrait supposer que l a
conscience est antrieure sa propre existence. I l ne faut pas non plus
concevoir cette cration de soi comme un acte. Sinon, en effet, l a
conscience serait conscience (de) soi comme acte, ce qui n'est pas. La
consci ence est un plein d'existence et cette dtermination de soi par
soi est une caractristique essentiell e. Il sera mme prudent de ne pas
abuser de l ' expression cause de soi , qui laisse supposer une
progression, un rapport de soi-cause soi-effet . I l serait plus juste de
di re, tout simplement : l a conscience existe par soi . Et par l il ne faut
pas entendre qu' el l e se tire du nant . Il ne saurait y avoir de
nant de conscience avant la conscience. Avant la conscience,
on ne peut concevoir qu'un plein d'tre dont aucun lment ne peut
renvoyer une conscience absente. Pour qu' i l y ait nant de
conscience, i l faut une conscience qui a t et qui n'est plus et une
conscience tmoi n qui pose le nant de la premi re conscience pour
une synthse de rcognitions. La conscience est antrieure au nant et
se tire de l ' tre 1.
On aura peut-tre quelque peine accepter ces conclusions. Mais si
on les regarde mieux, elles paratront parfaitement claires : l e
paradoxe n'est pas qu' i l y ai t des existences par soi , mais qu' i l n' y ai t
pas qu'elles. Ce qui est vri tablement impensable, c'est l'existence
passive, c'est--dire une existence qui se perptue sans avoir la force
ni de se produire ni de se conserver. De ce point de vue il n'est rien de
pl us i nintelligible que le principe d' i nertie. Et, en effet, d'o
viendrait la conscience, si el le pouvait de quelque
chose ? Des l i mbes de l'inconscient ou du physiologique. Mais si l'on
se demande comment ces limbes, leur tour, peuvent exister et d'o
ils tirent leur existence, nous nous trouvons ramens au concept
d'existence passive, c'est--dire que nous ne pouvons absolument plus
comprendre comment ces donnes non conscientes, qui ne tirent pas
leur existence d'elles-mmes, peuvent cependant la perptuer et
trouver encore la force de produire une conscience. C'est ce que
marque assez la grande faveur qu'a connue la preuve a contingentia
mundi .
Ainsi, en renonant au primat de la connaissance, nous avons
dcouvert l' tre du connaissant et rencontr l'absolu, cet absolu mme
que les rationalistes du xvu sicle avaient dfini et constitu
logiquement comme un objet de connaissance. Mais, prcisment
parce qu' i l s'agit d' un absolu d'existence et non de connaissance, il
chappe cette fameuse objection selon laquelle un absolu connu
1. Cela ne signifie nullement que la conscience est le fondement de son tre.
Mais au contraire, comme nous le verrons plus loin, i l y a une contingence
plnire de l'tre de la conscience. Nous voulons seulement indiquer : 1 que
rien n'est cause de la conscience; 2 qu'elle est cause de sa propre manire
d'tre.
22
n'est pl us un absolu, parce qu'il devient relatif la connaissance qu'on
en prend. En fait, l ' absolu est ici non pas l e rsultat d'une construc
tion logique sur le terrain de la connaissance, mais l e sujet de la plus
concrte des expriences. Et i l n'est point relatif cette exprience,
parce qu' i l eSI cette exprience. Aussi est-ce un absolu non substan
tiel. L'erreur ontologique du rationalisme cartsi en, c'est de n' avoir
pas vu que, si l ' absolu se dfinit par l e primat de l'existence sur
l'essence, il ne saurait tre conu comme une substance. La cons
cience n' a rien de substantiel, c'est une pure apparence ^_ en ce sens
qu'elle n'existe que dans la mesure o elle s'apparat. Mais c'est
prcisment parce qu'elle est pure apparence, parce qu'elle est un
vide total (puisque le monde entier est en dehors d' el l e), c'est cause
de cette identit en elle de l'apparence et de l'existence qu'elle peut
tre considre comme l'absolu.
IV
L'TRE DU PERCIPI
Il sembl e que nous soyons parenu au terme de notre recherche.
Nous avions rdui t les choses la totalit lie de leurs apparences,
puis nous avons constat que ces apparences rclamaient un tre qui
ne ft pl us lui-mme apparence. Le percipi nous a renvoy un
percipiens )', dont l'tre s'est rvl nous comme conscience.
Ainsi aurions-nous atteint le fondement ontologique de la connais
sance, l'tre premier qui toutes les autres apparitions apparaissent,
l'absolu par rapport quoi tout phnomne est relatif. Ce n'est point
le sujet, au sens kantien du terme, mais c'est la subjectivit mme,
l'immanence de soi soi. Ds prsent , nous avons chapp
l'idalisme : pour celui-ci l'tre est mesur par la connaissance, ce qui
le soumet l a loi de dualit ; i l n' y a d'tre que connu, s'agt-il de l a
pense mme : l a pense ne s'apparat qu' t ravers ses propres
produits, c'est--dire que nous ne la saisissons jamais que comme l a
signification des penses faites ; et le philosophe en qute de la pense
doit interroger les sciences constitues pour l'en tirer, titre de
condition de leur possibilit. Nous avons saisi, au contraire, un tre
qui chappe l a connaissance et qui l a fonde, une pense qui ne se
donne point comme reprsentation ou comme signification des
penses expri mes, mais qui est directement saisie en tant qu'elle est
-et ce mode de saisissement n'est pas un phnomne de connais
sance, mais c'est la structure de l 'tre. Nous nous trouvons prsent
sur le terrain de la phnomnologie husserlienne, bien que Husserl
23
l ui-mme n'ait pas toujours t fidle son i ntuition premire.
Sommes-nous satisfait? Nous avons rencontr un tre transphnom
na!, mais est-ce bi en l'tre auquel renvoyait le phnomne d' tre, est
ce bien l' tre du phnomne ? Autrement dit l'tre de la conscience
suffit-il fonder l ' tre de l' apparence en tant qu'apparence ? Nous
avons arrach son tre au phnomne pour le donner la conscience,
et nous comptions qu'elle l e l ui restituerait ensuite. Le pourra-t-el l e ?
Cest ce que va nous apprendre un examen des exigences ontologi
ques du percipi.
Notons d'abord qu'il y a un tre de la chose perue en tant qu'elle
est perue. Mme si je voulais rduire cette table une synthse
d'impressions subjectives, au moi ns faut-il remarquer qu'elle se
rvle, en tanl que lable, travers cette synthse, qu'elle en est l a
limite transcendante, la raison et l e but . La table est devant l a
connaissance et ne saurait tre assimile la connaissance qu'on en
prend, sinon el l e serait conscience, c'est--dire pure immanence, et
el l e s'vanouirait comme table. Pour l e mme motif, mme si une
pure distinction de raison doit l a sparer de l a synthse d'impressions
subjectives travers l aquel l e on l a sai si t, du moins ne peut-elle pas
tre cette synthse : ce serait la rdui re une activit synthtique de
liaison. En tant, donc, que le connu ne peut se rsorber dans l a
connaissance, i l faut l ui reconnatre un tre. Cet tre, nous dit-on ,
c'est l e percipi. Reconnaissons tout d'abord que l'tre d u percipi ne
peut se rduire cel ui du percipiens c'est--dire la conscience
pas plus que la tabl e ne se rduit la l i aison des reprsentations. Tout
au pl us, pourrait-on di re qu' i l est relatif cet tre. Mais cette relativit
ne dispense pas d'une inspection de l'tre du percipi.
Or, l e mode du percipi est le passif. Si donc l'tre du phnomne
rside dans son percipi, cet tre est passivit. Relativit et passivi t,
tel l es seraient l es structures caractristiques de l ' esse en tant que
celui-ci se rduirait au percipi. Qu'est-ce que la passivi t ? Je sui s
passif lorsque j e reois une modification dont je ne suis pas l'origine
- c'est--dire ni le fondement ni le crateur. Ainsi mon tre
supporte-t-il une manire d'tre dont i l n'est pas la source. Seule
ment, pour supporter, encore faut-il que j 'existe et, de ce fait, mon
existence se si tue toujours au-del de la passivit. Supporter
passivement , par exemple, est une conduite que je liens et qui
engage ma l i bert aussi bi en que rejeter rsolument . Si je doi s
tre pour toujours celui-qui-a-t-offens il faut que je persvre
dans mon tre, c'est--dire que je m'affecte moi-mme de l ' existence.
Mai s, par l mme, je reprends mon compte, en quelque sorte, et
j 'assume mon offense, je cesse d'tre passif vis--vis d'elle. D'o cette
alternative : ou bien je ne suis pas passif en mon tre, alors je deviens
le fondement de mes affections mme si tout d'abord je n'en ai pas t
l'origine - ou bien je suis affect de passivit jusqu'en mon
24
existence, mon tre est un tre reu et alors tout tombe dans le nant.
Ainsi la passivit est un phnomne doublement relatif : relatif
J'activit de celui qui agit et l'existence de celui qui ptit. Cela
implique que l a passivit ne saurait concerner l'tre mme de
l'existant passif : el le est une relation d'un tre un autre tre et non
d' un tre un nant. Il est impossible que l e percipere affecte l e
perceptum de l'tre, car pour tre affect i l faudrait que le perceptum
ft dj donn en quelque faon, donc qu' il existe avant d'avoir reu
l'tre. On peut concevoir une cration, la condition que l'tre cr
se reprenne, s' arrache au crateur pour se refermer sur soi aussitt et
assumer son t re : c'est en ce sens qu' un livre existe contre son auteur.
Mais si l'acte de cration doit se continuer indfiniment, si l'tre cr
est soutenu jusqu'en ses plus infimes parties, s'il n'a aucune indpen
dance propre, s'il n'est en lui-mme que du nant, alors l a crature ne
se distingue aucunement de son crateur, elle se rsorbe en lui ; nous
avions affaire une fausse transcendance et le crateur ne peut mme
pas avoir l ' il lusion de sortir de sa subjectivit 1.
D'ailleurs l a passivit du patient rclame une passivit gale chez
l'agent -c'est ce qu'exprime l e principe de l'action et de la raction:
c'est parce qu' on peut broyer, treindre, couper notre main que notre
main peut broyer, couper, treindre. Quelle est la part de passivit
qu'on peut assigner l a perception, l a connaissance ? Elles sont tout
activit, tout spontanit. C'est prcisment parce qu'elle est sponta
nit pure, parce que rien ne peut mordre sur elle, que la conscience
ne peut agir sur rien. Ainsi l'esse est percipi exigerait que la
conscience, pure spontanit qui ne'peut agir sur rien, donne l'tre
un nant transcendant en lui conservant son nant d'tre : autant
d'absurdits. Husserl a tent de parer ces objections en introduisant
la passivit dans la nose : c'est la hyl ou flux pur du vcu et matire
des synthses passives. Mais il n'a fait qu'ajouter une difficult
supplmentaire celles que nous mentionnions. Voil rintroduites,
en effet, ces donnes neutres dont nous montrions tout l'heure
l'impossibilit. Sans doute ne sont-elles pas des contenus de
conscience, mais el l es n' en demeurent que pl us inintelligibles. La hyl
ne saurait tre, en effet, de la conscience, sinon elle s'vanouirait en
translucidit et ne pourrait offrir cette base impressionnelle et
rsistante qui doi t tre dpasse vers l' objet. Mai s si el l e n'appartient
pas la conscience, d'o tire-t-elle son t re et son opacit ? Comment
peut-elle garder la fois l a rsistance opaque des choses et l a
subjectivit de l a pense ? Son esse ne peut l ui venir d'un percipi
puisqu'elle n'est mme pas perue, puisque l a conscience la trans
cende vers les objets. Mais si elle le tire d'elle seule, nous retrouvons
1. C'est pour cette raison que la doctrine cartsienne de la substance trouve
son achvement logique dans le spinozisme.
25
le problme i nsoluble du rapport de la conscience avec des existants
indpendants d'ell e. Et si mme on accordait Husserl qu'il y a une
couche hyl ti que de l a nose, on ne saurait concevoir comment la
conscience peut transcender ce subjectif vers l'objectivit. En don
nant la hyl l es caractres de l a chose et les caractres de la
consci ence, Husserl a cru faciliter le passage de l'une l'autre, mais il
n'est arriv qu' crer un tre hybride que la conscience refuse et qui
ne saurait faire partie du monde.
Mais, en outre, nous l ' avons vu, le percipi implique que l a loi d'tre
du perceptum est l a relativit. Peut-on concevoir que l'tre du connu
soit relatif l a connaissance ? Que peut signifier la relativit d' tre,
pour un existant, sinon que cet existant a son tre en autre chose
qu'en lui-mme, c'est--dire en un existant qu'il n'est pas ? Certes il ne
serait pas i nconcevable qu'un tre ft extrieur soi, si l ' on entendait
par l que cet tre est sa propre extriorit. Mais ce n'est pas le cas ici.
L'tre peru est devant la conscience, elle ne peut l'atteindre et i l ne
peut y pntrer et, comme il est coup d' elle, i l existe coup de sa
propre existence. Il ne servirait rien d'en faire un irrel, l a manire
de Husserl ; mme titre d'irrel, i l faut bien qu'il existe.
Ainsi l es deux dterminations de relativit et de passivit, qui
peuvent concerner des manires d'tre, ne sauraient en aucun cas
s'appliquer l'tre. L'esse du phnomne ne saurait tre son percipi.
L'tre transphnomnal de la conscience ne saurait fonder l'tre
transphnomnal du phnomne. On voit l'erreur des phnom
nistes : ayant rduit, juste titre, l'objet l a srie lie de ses
apparitions, ils ont cru avoir rdui t son tre la succession de ses
manires d'tre et c'est pourquoi i l s l'ont expliqu par des concepts
qui ne peuvent s'appliquer qu' des manires d'tre, car ils dsignent
des relations entre une pluralit d'tres dj existants.
v
LA PREUVE ONTOLOGI QUE
On ne fait pas l'tre s a part : nous croyions tre dispens
d'accorder l a transphnomnalit l' tre du phnomne, parce que
nous avons dcouvert l a transphnomnalit de l'tre de la cons
cience. Nous allons voir, tout au contraire , que cette transphnom
nalit mme exige celle de l'tre du phnomne. Il y a une preuve
ontologique tirer non du cogito rfexif, mais de l'tre prrflexif
du percipims. C'est ce que nous al l ons tenter d'exposer prsent.
Toute conscience est conscience de quelque chose. Cette dfinition
26
de la conscience peut tre prise en deux sens bien distincts: ou bi en
nous entendons par l que la conscience est constitutive de l'tre de
son objet, ou bi en cela signifie que l a conscience en sa nature la plus
profonde est rapport un tre transcendant. Mais la premire
acception de l a formule se dtrui t d'elle-mme : tre conscience de
quelque chose c'est tre en face d'une prsence concrte et pleine qui
n'est pas la conscience. Sans doute peut-on avoir conscience d' une
absence. Mai s cette absence parat ncessairement sur fond de
prsence. Or, nous l ' avons vu, l a conscience est une subjectivit relle
et l ' i mpression est une plnitude subjective. Mais cette subjectivit ne
saurait sortir de soi pour poser un objet transcendant en l ui confrant
la pl nitude impressi onnelle. Si donc l'on veut tout prix que l'tre
du phnomne dpende de l a conscience, i l faut que l'objet se
distingue de la conscience non par sa prsence, mais par son absence,
non par sa plnitude, mais par son nant. Si l'tre appartient la
conscience, l'objet n'est pas la conscience non dans la mesure o il est
un autre tre, mais dans celle o i l est un non-tre. Cest le recours
l'infi ni , dont nous parlions dans la premire section de cet ouvrage.
Pour Husserl , par exemple, l ' ani mation du noyau hyltique par les
seules i ntentions qui peuvent trouver leur remplissement (Erfllung)
dans cette hyl ne saurait suffire nous faire sortir de la subjectivit.
Les intentions vritablement obj ectivantes, ce sont les intentions
vides, celles qui visent par-del l'apparition prsente et subjective la
totalit infinie de la srie d'appari ti ons. Entendons, en outre, qu'elles
les visent en tant qu'elles ne peuvent jamais tre donnes toutes la
foi s. Cest l ' i mpossibilit de principe pour les termes en nombre infini
de la srie d'exister en mme temps devant la conscience en mme
temps que l' absence relle de tous ces termes, sauf un, qui est le
fondement de l'objectivit. Prsentes, ces impressions -fussent-elles
en nombre i nfi ni -se fondraient dans le subjectif, c'est leur absence
qui leur donne l'tre objectif. Ainsi l'tre de l'objet est un pur non
tre. Il se dfinit comme un manque. Cest ce qui se drobe, ce qui ,
par principe, ne sera jamai s donn, ce qui se livre par profils fuyants
et successifs. Mais comment l e non-tre peut-il tre le fondement de
l'tre ? Comment le subjectif absent et atlendu devient-il par l
l'objectif ? Une grande joie que j 'espre, une douleur que je redoute
acquirent de ce fait une certaine transcendance, je raccorde. Mais
cette transcendance dans l ' i mmanence ne nous fait pas sortir du
subjectif. Il est vrai que les choses se donnent par profils -c'est-
dire tout simplement par apparitions. Et i l est vrai que chaque
apparition renvoie d'autres apparitions. Mais chacune d'elles est
dj elle toute seule un tre transcendant, non une matire
impressionnelle subjective -une plnitude d'tre, non un manque
une prsence, non une absence. Cest en vain qu'on tentera un tour de
passe-passe, en fondant l a ralit de l'objet sur la plnit ude subjective
27
i mpressionne Ile et son objectivit sur le non-tre : jamais l'objectif ne
sortira du subjectif, ni le transcendant de l ' i mmanence, ni l'tre du
non-tre. Mai s, di ra-t-on, Husserl dfinit prcisment la conscience
comme une transcendance. En effet : c'est l ce qu'il pose ; et c'est sa
dcouverte essentielle. Mais ds l e moment qu'il fait du nome un
irrel , corrlatif de l a nose, et dont l'esse est un percipi, il est
totalement infidle son principe.
La conscience est conscience de quelque chose : cela signifie que la
transcendance est structure constitutive de l a conscience ; c'est--dire
que l a conscience nat porte sur un tre qui n'est pas elle. C'est ce
que nous appelons l a preuve ontologique. On rpondra sans doute
que l'exigence de la conscience ne prouve pas que cette exigence
doive tre satisfaite. Mais cette objection ne saurait valoir contre une
analyse de ce que Husserl appelle i ntentionnalit et dont i l a mconnu
le caractre essentiel. Di re que l a conscience est conscience de
quelque chose cela signifie qu'il n' y a pas d' tre pour la conscience en
dehors de cette obligation prcise d'tre intuition rvlante de
quelque chose, c'est--dire d'un tre transcendant. Non seulement la
subjectivit pure choue se transcender pour poser l'objectif, si elle
est donne d'abord, mais encore une subjectivit pure s'vanoui
rai t . Ce qu'on peut nommer proprement subjectivit, c'est la cons
cience (de) conscience. Mai s il faut que cette conscience (d'tre)
conscience se qual i fie en quelque faon et elle ne peut se qualifier que
comme intuition rvlante, sinon elle n'est rien. Or, une intuition
rvlante implique un rvl. La subjectivit absolue ne peut se
constituer qu'en face d'un rvl, l'immanence ne peut se dfinir que
dans l a saisie d'un transcendant. On croira retrouver ici comme un
cho de la rfutation kantienne de l'idalisme problmati que. Mais
c'est bien plutt Descartes qu'il faut penser. Nous sommes ici sur le
plan de l'tre, non de la connaissance : il ne s'agit pas de montrer que
les phnomnes du sens interne impliquent l'existence de phno
mnes objectifs et spatiaux, mais que la conscience implique dans son
tre un tre non conscient et transphnomnal. En particulier i l ne
servirait ri en de rpondre qu'en effet l a subjectivit implique
l'objectivit et qu'elle se constitue elle-mme en constituant l'objec
ti f : nous avons vu que la subjectivit est impuissante constituer
l ' objectif. Dire que l a conscience est conscience de quelque chose,
c'est di re qu' el le doit se produire comme rvlation rvle d' un tre
qui n'est pas el l e et qui se donne comme existant dj lorsqu'elle le
rvle.
Ainsi nous tions parti de la pure apparence et nous sommes arriv
en plein tre. La conscience est un tre dont l'existence pose
l'essence, et, inversement, el l e est conscience d'un tre dont l'essence
implique l'existence, c'est--dire dont l'apparence rclame d'tre.
L'tre est partout. Certes, nous pourrions appliquer la conscience la
28
dfi niti on que Heidegger rserve au Dasein et dire qu'elle est un tre
pour l equel i l est dans son tre question de son tre, mais i l faudrait la
complter et l a formuler peu prs ainsi : la conscience est un tre
pour lequel il est dans son tre question de son tre en tant que cet tre
implique un tre autre que lui.
Il est bien entendu que cet tre n'est autre que l'tre transphnom
nal des phnomnes et non un tre noumnal qui se cacherait derrire
eux. C'est l'tre de cette table, de ce paquet de tabac, de la lampe,
plus gnralement l'tre du monde qui est impliqu par la conscience.
Elle exige simplement que l'tre de ce qui apparat n'existe pas
seulement en tant qu' i l apparat. L'tre transphnomnal de ce qui est
pour la conscience est lui-mme en soi.
VI
L' TRE EN SOI
Nous pouvons prsent donner quelques prcisions sur l e phno
mne d'tre que nous avons consult pour tablir nos remarques
prcdentes. La conscience est rvlation-rvle des existants et les
existants comparaissent devant la conscience sur le fondement de leur
tre. Toutefois, la caractristi que de l'tre d'un existant, c'est de ne
pas se dvoiler lui-mme, en personne, la conscience ; on ne peut
pas dpouiller un existant de son tre, l'tre est le fondement toujours
prsent de l'existant, il est partout en lui et nulle part, il n'y a pas
d'tre qui ne soit tre d'une manire d'tre et qu'on ne saisisse
travers la manire d'tre qui le manifeste et le voile en mme temps.
Toutefois, la conscience peut toujours dpasser l'existant, non point
vers son tre, mais vers le sens de cet tre. C'est ce qui fait qu'on peut
l'appeler ontico-ontologique, puisqu'une caractristique fondamen
tale de sa transcendance, c'est de transcender l'antique vers l'ontolo
gique. Le sens de l'tre de l'existant, en tant qu'il se dvoile la
conscience, c'est le phnomne d'tre. Ce sens a lui-mme un tre,
sur le fondement de quoi i l se manifeste. C'est de ce point de vue
qu'on peut entendre l e fameux argument de l a scolastique, selon
lequel i l y avait un cercle vicieux dans toute proposition qui
concernait l'tre, puisque tout j ugement sur l'tre impliquait dj
l'tre. Mais en fait i l n'y a pas de cercle vicieux car i l n'est pas
ncessaire de dpasser nouveau l'tre de ce sens vers son sens : le
sens de l'tre vaut pour l'tre de tout phnomne, y compris son tre
propre. Le phnomne d'tre n'est pas l'tre, nous l'avons dj
marqu. Mais il i ndi que l'tre et l'exige - quoique, vrai dire, la
29
preuve ontologique que nous mentionnions plus haut ne vaille pas
spcialement ni uniquement pour lui : i l y a une preuve ontologique
valabl e pour tout le domaine de la conscience. Mais cette preuve
suffit justifi er tous l es enseignements que nous pourrons tirer du
phnomne d'tre. Le phnomne d'tre, comme tout phnomne
premier, est immdiatement dvoil l a conscience. Nous en avons
chaque i nstant ce que Hei degger appelle une comprhension
prontologique, c'est--dire qui ne s'accompagne pas de fixation en
concepts et d'lucidation. Il s'agit donc pour nous, prsent, de
consulter ce phnomne et d'essayer de fixer par ce moyen l e sens
de l 'tre. Il faut remarquer toutefois :
1 que cette lucidation du sens de l ' tre ne vaut que pour l'tre
du phnomne. L'tre de la conscience tant radicalement autre,
son sens ncessitera une lucidation particulire partir de la
rvlation-rvle d' un autre type d'tre, l ' tre-pour-soi, que nous
dfinirons plus loin et qui s'oppose l'tre-en-soi du phnomne ;
2 que l'lucidation du sens de l ' tre en soi que nous allons tenter
ici ne saurait tre que provisoire. Les aspects qui nous seront rvls
impliquent d' autres significations qu' il nous faudra saisir et fixer
ultrieurement . En particulier l es rflexions qui prcdent ont
permis de disti nguer deux rgions d'tre absolument tranches:
l'tre du cogito prrflexif et l ' tre du phnomne. Mais, bien que le
concept d'tre ait ainsi cette particularit d'tre scind en deux
rgions i ncommunicables, il faut pourtant expliquer que ces deux
rgions puissent tre places sous la mme rubrique. Cela ncessi
tera l'inspection de ces deux types d'tre et i l est vident que nous
ne pourrons vritablement saisir le sens de l'un ou de l'autre que
lorsque nous pourrons tablir leurs vritables rapports avec la notion
de l'tre en gnral, et l es relations qui les unissent. Nous avons
tabli en effet , par l'examen de la conscience non positionnelle (de)
soi, que l'tre du phnomne ne pouvait en aucun cas agir sur la
conscience. Par l , nous avons cart une conception raliste des
rapports du phnomne avec l a conscience. Mais nous avons montr
aussi, par l'examen de la spontanit du cogito non rflexif, que la
conscience ne pouvait sortir de sa subjectivit, si celle-ci lui tait
donne d'abord, et qu'elle ne pouvait agir sur l'tre transcendant ni
comporter sans contradiction l es lments de passivit ncessaires
pour pouvoir constituer partir d'eux un tre transcendant : nous
avons cart ainsi la solution idaliste du problme. Il semble que
nous nous soyons ferm toutes les portes et que nous nous soyons
condamn regarder l'tre transcendant et la conscience comme
deux totalits closes et sans communication possible. Il nous faudra
montrer que le problme comporte une autre solution, par del le
ralisme et l ' i dalisme.
Toutefois, il est un certain nombre de caractristiques qui peuvent
30
tre fixes i mmdiatement parce qu'elles ressortent d'elles-mmes,
pour l a plupart, de ce que nous venons de dire.
La claire vision du phnomne d'tre a t obscurcie souvent par
un prjug trs gnral que nous nommerons l e crationnisme.
Comme on supposait que Dieu avait donn l'tre au monde, l'tre
paraissait toujours entach d'une certaine passivit. Mais une cra
tion ex nihilo ne peut expliquer le surgissement de l'tre, car si l'tre
est conu dans une subjectivit, ft-elle divine, il demeure un mode
d'tre intrasubjectif. Il ne saurait y avoir, dans cette subjectivit ,
mme l a reprsentation d'une objectivit et par consquent elle ne
saurait mme s'affecter de la volont de crer de l ' objectif. D'ailleurs
l'tre, ft-il pos soudain hors du subjectif par la fulguration dont
parle Lei bni z, i l ne peut s'affirmer comme tre qu'envers et contre
son crateur, sinon il se fond en l ui : la thorie de la cration
conti nue, en tant l'tre ce que les Allemands appellent la
Selbststandigkeit ", le fait s'vanouir dans la subjectivit divine. Si
l'tre existe en face de Di eu, c'est qu'il est son propre support, c'est
qu'il ne conserve pas la moindre trace de la cration divine. En un
mot , mme s'il avait t cr, l'tre-en-soi serait inexplicable par la
crati on, car il reprend son tre par del celle-ci. Cela quivaut dire
que l'tre est incr. Mais i l ne faudrait pas en conclure que l'tre se
cre lui-mme, ce qui supposerait qu'il est antrieur soi . L'tre ne
saurait t re causa sui la manire de l a conscience. L'tre est soi.
Cela signifie qu'il n'est ni passivit ni activit. L'une et l'autre de ces
notions sont humaines et dsignent des conduites humaines ou les
instruments des conduites humaines. Il y a activit lorsqu'un tre
conscient dispose des moyens en vue d' une fin . Et nous appelons
passifs les objets sur lesquels s'exerce notre activit, en tant qu'ils ne
visent pas spontanment l a fin laquelle nous les faisons servir. En un
mot, l'homme est actif et les moyens qu'il emploie sont dits passifs.
Ces concepts, ports l'absolu, perdent toute signification. En
particulier, l'tre n'est pas actif : pour qu'il y ait une fin et des
moyens, i l faut qu'il y ait de l'tre. A plus forte raison ne saurait-il
tre passif, car pour tre passif il faut tre. La consistance-en-soi de
l'tre est par del l'actif comme le passif. I l est galement par del la
ngation comme l'affirmation. L'affirmation est toujours affirmation
de quelque chose, c'est--dire que l'acte affirmatif se distingue de la
chose affirme. Mais si nous supposons une affirmation dans laquelle
l'affirm vient remplir l'affirmant et se confond avec lui , cette
affirmation ne peut pas s'affirmer, par trop de plnitude et par
inhrence immdiate du nome l a nose. C'est bien l ce qu'est
l'tre, si nous l e dfinissons, pour rendre les ides plus claires, par
rapport la conscience : i l est le nome dans l a nose, c'est--dire
l'inhrence soi sans la moindre distance. De ce point de vue, i l ne
faudrait pas l'appeler immanence ", car l 'immanence est malgr
31
tout rapport soi , elle est le plus petit recul qu' on puisse prendre de soi
soi . Mai s l'tre n'est pas rapport soi, il est soi. Il est une immanence
qui ne peut pas se raliser, une affi rmation qui ne peut pas s'affirmer,
une act ivit qui ne peut pas agir, parce qu'il s'est empt de soi-mme.
Tout se passe comme si pour librer l 'affirmation de soi du sein de l'tre
il fallait une dcompression d'tre. N'entendons pas d'ailleurs que
l'tre est une affi rmation de soi indiffrencie : l'indiffrenciation de
l'en-soi est par del une infinit d'affirmations de soi, dans la mesure o
i l y a une i nfinit de manires de s' affi rmer. Nous rsumerons ces
premiers rsultats en disant que l' Tre eST en soi.
Mais si l'tre est en soi, cela signifie qu' i l ne renvoie pas soi,
comme la conscience (de) soi : ce soi, il l'est. Il l'est au point que la
rflexion perptuelle qui constitue l e soi se fond en une identit. C'est
pourquoi l ' tre est , au fond, par del le soi et notre premire formule
ne peut tre qu'une approximation due aux ncessits du langage. En
fait , l ' t re est opaque lui-mme prcisment parce qu' il est rempli
de l ui-mme. C'est ce que nous exprimerons mieux en disant que
l'Tre est ce qu'il est. Cette formul e, en apparence, est strictement
analytique. En fait, elle est loin de se ramener au principe d' i dentit,
en tant que celui-ci est le principe i nconditionn de tous les jugements
analytiques. D'abord, elle dsigne une rgion singulire de l 'tre :
cel l e de l'Tre en soi. Nous verrons que l'tre du pour soi se dfinit au
contraire comme tant ce qu' i l n'est pas et n'tant pas ce qu'il est. I l
s'agit donc ici d' un principe rgional et , comme tel , synthti que. En
outre, il faut opposer cette formul e : l'tre en soi est ce qu' i l est,
celle qui dsigne l'tre de la conscience : celle-ci, en effet, nous le
verrons, a Tre ce qu'elle est. Ceci nous renseigne sur l'acception
spciale qu' i l faut donner au est de la phrase l'tre est ce qu'il
est . Du moment qu'il existe des tres qui ont tre ce qu'ils sont, l e
fai t d' tre ce qu' on est n' est nullement une caractristique purement
axiomatique : il est un principe contingent de l'tre en soi. En ce sens,
le principe d' identi t, principe des j ugements analytiques, est aussi un
principe rgional synthtique de l 'tre. Il dsigne l'opacit de l'tre
en-soi. Cette opacit ne tient pas de notre position par rapport l'en
soi , au sens o nous serions obligs de l'apprendre et de l'observer
parce que nous sommes dehors . L'tre-en-soi n'a point de dedans
qui s'opposerait un dehors et qui serait analogue un jugement,
une l oi, une conscience de soi . L'en-soi n' a pas de secret : il est
massif. En un sens, on peut le dsigner comme une synthse. Mais
c'est la plus i ndissoluble de toutes : la synthse de soi avec soi. Il en
rsulte videmment que l'tre est isol dans son tre et qu'il
n' entretient aucun rapport avec ce qui n'est pas l ui . Les passages, les
devenirs, tout ce qui permet de di re que l'tre n' est pas encore ce qu'il
sera et qu'il est dj ce qu'il n'est pas, tout cela l ui est refus par
principe. Car l'tre est l'tre du devenir et de ce fait il est par del le
32
devenir. Il est ce qu'il est, cela signifie que, par lui-mme, il ne saurait
mme pas ne pas tre ce qu'il n'est pas ; nous avons vu en effet qu'il
n'enveloppait aucune ngati on. I l est pl ei ne positivit. Il ne connat
donc pas l'altrit : il nese pose jamais comme autre qu'un autre tre ; il
ne peut souteni r aucun rapport avec J'autre. Il est lui-mme indfini
ment et il s'puise J'tre. De ce point de vue nous verrons plus tard
qu'il chappe la temporal i t. Il est, et quand il s'effondre on ne peut
mme pas dire qu'il n'est plus. Ou, du moins, c'est une conscience qui
peut prendre conscience de l ui comme n'tant plus, prcisment parce
qu'elle est temporelle. Mai s lui-m me n'existe pas comme un manque
l o il tait : la pleine positivit d'tre s'est reforme sur son
effondrement . Il tait et prsent d'autres tres sont : voil tout.
Enfin -ce sera notre troisime caractristique -J ' tre-en-soi est.
Cela signi fie que J'tre ne peut tre ni driv du possi hl e, ni ramen au
ncessai re. La ncessit concerne la liaison des propositions idales
mais non celle des existants. Un existant phnomnal ne peut jamais
tre driv d'un autre existant, en t ant qu'il est existant. C'est ce qu'on
appelle la contingence de l' tre-en-soi. Mai s l'tre-en-soi ne peut pas
non plus tre driv d'un possible. Le possible est une structure du
pour-soi, c'est--dire qu'il appartient J'autre rgion d'tre. L'tre-en
soi n'est jamai s ni possible ni impossi bl e, il est. C'est ce que la
conscience exprimera -en termes anthropomorphiques -en disant
qu'il est de trop, c'est--dire qu'elle ne peut absolument le driver de
rien, ni d' un autre tre, ni d' un possible, ni d' une loi ncessaire. Incr,
sans raison d' tre, sans rapport aucun avec un autre tre, l'tre-en-soi
est de trop pour J' terni t.
L'tre est. L'tre est en soi . L'tre est ce qu' i l est. Voi l les trois
caractres que l'examen provisoire du phnomne d' tre nous permet
d'assigner l ' tre des phnomnes. Pour l'instant, i l nous est
impossible de pousser pl us l oi n notre i nvestigation. Ce n'est pas
l'examen de l'en-soi -qui n'est jamais que ce qu'il est -qui nous
permettra d'tabl i r et d'expliquer ses relations avec le pour-soi. Ainsi,
nous sommes parti des apparitions et nous avons t conduit pro
gressivement poser deux types d'tre : l'en-soi et le pour-soi, sur
lesquels nous n'avons encore que des renseignements superficiels et
incomplets. Une foule de questions demeurent encore sans rponse :
quel est le sens profond de ces deux types d'tre ? Pour quelles raisons
appartiennent-i ls l' un et l'autre l' tre en gnral ? Ouel est le sens de
l'tre, en tant qu' il comprend en lui ces deux rgions d'tre radicalement
tranches ? Si l'idalisme et le ralisme chouent l'un et l'autre
expliquer les rapports qui unissent en fait ces rgions en droit
incommunicables, quelle autre solution peut-on donner ce problme ?
et comment l'tre du phnomne peut-il tre transphnomnal ?
Ce st pour tenter de rpondre ces questions que nous avons crit le
prsent ouvrage.
Premire partie
LE PROBLME DU NANT
CHAPI TRE PREMI ER
L'origine de la ngation
L' I NTER ROGATI ON
Nos recherches nous ont conduit au sein de l'tre. Mais aussi elles
ont abouti une impasse puisque nous n'avons pu tablir de liaison
entre les deux rgions d'tre que nous avons dcouvertes. C'est sans
doute que nous avions choisi une mauvaise perspective pour conduire
notre enqute . Descartes s'est trouv en face d' un problme analogue
lorsqu'il dut s' occuper des relations de l'me avec le corps. I l
conseillait alors d' en chercher l a solution sur l e terrain de fait o
s'oprait l ' uni on de l a substance pensante avec l a substance tendue,
c'est--dire dans l'imagination. Le consei l est prcieux : certes notre
souci n'est pas celui de Descartes et nous ne concevons pas
l'imagination comme lui. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il ne
convient pas de sparer d'abord les deux termes d' un rapport pour
essayer de les rejoindre ensuite : l e rapport est synthse. Par suite les
rsultats de l ' analyse ne sauraient se recouvrir avec les moments de
cette synthse. M. Laporte di t que l'on abstrait lorsqu'on pense
l'tat isol ce qui n'est point fait pour exister isolment. Le concret,
par opposition, est une totalit qui peut exister par soi seule. Husserl
est du mme avis : pour l ui , le rouge est un abstrait car la couleur ne
saurait exister sans la figure. Par contre l a chose temporo
spatiale, avec toutes ses dterminations, est un concret. De ce poi nt
de vue, la conscience est un abstrait, puisqu'elle recle en elle-mme
une origine ontologique vers l'en-soi et, rciproquement, le phno
mne est un abstrait aussi puisqu'i l doit paratre la conscience.
Le concret ne saurait tre que la totalit synthtique dont la
conscience comme le phnomne ne constituent que des moments. Le
37
concret, c'est l'homme dans le monde avec cette union spcifi que de
l'homme au monde que Heidegger, par exemple, nomme tre-dans
le monde . Interroger l'exprience , comme Kant, sur ses condi
tions de possibilit, effectuer une rduction phnomnologique,
comme Husserl , qui rduira le monde l'tat de corrlatif nomati
que de l a conscience, c'est commencer dlibrment par l' abstrait.
Mais on ne parviendra pas plus restituer le concret par la sommation
ou l 'organisation des lments qu'on en a abstraits, qu'on ne peut,
dans l e systme de Spinoza, atteindre la substance par l a sommation
infinie de ses modes. La relation des rgions d'tre est un jai llisse
ment primitif et qui fait partie de l a structure mme de ces tres. Or
nous la dcouvrons ds notre premire inspection. I l suffit d'ouvrir les
yeux et d' interroger en toute navet cette totalit qu'est l' homme
dans-le-monde. C'est par la description de cette totalit que nous
pourrons rpondre ces deux questions : 1 Quel est le rapport
synthtique que nous nommons l 'tre-dans-Ie-monde ? 2 Que doi
vent tre l ' homme et le monde pour que le rapport soit possible entre
eux ? A vrai dire, les deux questions dbordent l'une sur l'autre et
nous ne pouvons esprer y rpondre sparment. Mais chacune des
conduites humaines, tant conduite de l ' homme dans le monde, peut
nous livrer la fois l ' homme, le monde et le rapport qui les unit, la
condition que nous envisagions ces conduites comme des ralits
objectivement saisissables et non comme des affections subjectives
qui ne se dcouvriraient qu'au regard de la rflexion.
Nous ne nous bornerons pas l 'tude d'une seule conduite. Nous
essaierons au contraire d' en dcrire pl usieurs et de pntrer, de
conduite en conduite, j usqu'au sens profond de l a relation homme
monde . Mais i l convient avant tout de choisir une conduite premire
qui puisse nous servir de fil conducteur dans notre recherche.
Or cette recherche mme nous fournit la conduite dsire : cet
homme que je suis, si je le saisis tel qu' i l est en ce moment dans le
monde, je constate qu'il se tient devant l'tre dans une attitude i nter
rogative. Au moment mme o je demande : Est-il une conduite qui
puisse me rvler le rapport de l'homme avec le monde ? , je pose une
question. Cette question je puis la considrer d' une faon objective,
car i l i mporte peu que le questionnant soit moi-mme ou le lecteur qui
me lit et qui questionne avec moi. Mais d'autre part, elle n'est pas
simplement l ' ensemble objectif des mots tracs sur cette feuille : elle
est indiffrente aux signes qui l'expriment. En un mot, c'est une atti
ude humaine pourvue de signification. Que nous rvle cette attitude ?
Dans toute question nous nous tenons en face d'un tre que nous
interrogeons. Toute question suppose donc un tre qui questionne et
un tre qu' on questi onne. Elle n'est pas le rapport primitif de
l ' homme l'tre-en-soi, mais au contraire elle se tient dans les limites
de ce rapport et elle l e suppose. D'autre part nous interrogeons l'tre
38
interrog sur quelque chose. Ce sur quoi j'interroge l'tre participe
la transcendance de l'tre : j' interroge l'tre sur ses manires d'tre
ou sur son tre. De ce point de vue l a question est une varit de
l'attente : j 'at tends une rponse de l'tre interrog. C'est--dire que,
sur l e fond d'une familiarit printerrogative avec l ' tre, j'attends de
cet tre un dvoilement de son tre ou de sa manire d'tre. La
rponse sera un oui ou un non. C'est l 'existence de ces deux
possi bilits galement objectives et contradictoires qui distingue par
principe la question de l'affirmation ou de la ngation. Il existe des
questions qui ne comportent pas, en apparence, de rponse ngative
- comme, par exemple, cel le que nous posions plus haut : Que
nous rvle cette attitude ? Mais, en fait , on voit qu' il est toujours
possible de rpondre par Rien ou Personne ou Jamais
des questions de ce type. Ainsi, au moment o je demande : Est-il
une conduite qui puisse me rvler l e rapport de l'homme avec le
monde ? , j 'admets par principe l a possibi l i t d'une rponse ngative
telle que : Non, une pareille conduite n'existe pas. Cela signifie
que nous acceptons d' tre mis en face du fai t transcendant de la non
existence d' une tel l e conduite. On sera peut-tre tent de ne pas
croire l'existence objective d'un non-tre ; on dira simplement que
le fai t , en ce cas, me renvoie ma subjectivit : j'apprendrais de l'tre
transcendant que la conduite cherche est une pure ficti on. MaIS, tout
d'abord, appeler cette conduite une pure fiction, c'est masquer la
ngation sans l'ter. pure fiction quivaut ici n'tre
qu'une ficti on . Ensuite, dtruire la ralit de la ngation, c'est faire
s'vanouir la ralit de la rponse. Cette rponse, en effet , c'est l 'tre
mme qui me la donne, c'est donc l ui qui me dvoile la ngation. I l
existe donc, pour l e questionnant, l a possibilit permanente et
objective d' une rponse ngative. Par rapport cette possibilit le
questionnant, du fait mme qu'il questionne, se pose comme en tat
de non-dtermination : il ne sait pas si la rponse sera affirmative ou
ngative. Ainsi la question est un pont jet entre deux non-tres :
non-tre du savoir en l' homme, possibilit de non-tre dans l'tre
transcendant. Enfin la question implique l'existence d'une vrit. Par
la question mme, le questionnant affirme qu' i l attend une rponse
objective, telle qu'on en puisse dire : C'est ainsi et non autrement.
En un mot la vrit, titre de diffrenciation de l'tre, introduit un
troisime non-tre comme dterminant de l a question : le non-tre de
limitation. Ce triple non-tre conditionne toute interrogation et, en
particulier, l 'i nterrogation mtaphysique -qui est noIre i nterrogation.
Nous ti ons parti la recherche de l'tre et i l nous semblait avoir
t conduit au sein de l' tre par la srie de nos i nterrogations. Or,
voil qu'un coup d'il jet sur l'interrogation elle-mme, au moment
o nous pensions toucher au but, nous rvle tout coup que nous
sommes envi ronns de nant. C'est la possibilit permanente du non-
39
tre, hors de nous et en nous, qUI conditionne nos questions sur l'tre.
Et c'est encore l e non-tre qui va circonscrire la rponse : ce que
l'tre sera s'enlvera ncessairement sur le fond de ce qu'il n'Ist pas.
Quelle que soit cette rponse, elle pourra se formuler ainsi : L'tre
est cela et, en dehors de cela, rien.
Ai nsi une nouvelle composante du rel vient de nous apparatre : l e
non-tre. Notre problme se complique d'autant, car nous n'avons
plus seulement traiter des rapports de l'tre humain l'tre en soi,
mai s aussi des rapports de l' tre avec le non-tre et de ceux du non
tre humain avec l e non-tre transcendant. Mais regardons-y mieux.
Il
LES NGATI ONS
On va nous objecter que l'tre en soi ne saurait fournir de rponses
ngatives. Ne disi ons-nous pas nous-mme qu' i l tait par-del l'affir
mati on comme la ngation ? D'ail leurs l'exprience banale rduite
elle-mme ne semble pas nous dvoiler de non-tre. Je pense qu' i l y a
quinze cents francs dans mon portefeuille et je n' en trouve plus que
treize cents : cela ne signifie point, nous dira-t-on, que l'exprience
m' ai t dcouvert l e non-tre de quinze cents francs mais tout simple
ment que fai compt treize bil lets de cent francs. La ngation
proprement dite m'est imputable, elle apparatrait seulement au
niveau d'un acte judicatoire par lequel j' tablirais une comparaison
entre le rsultat escompt et le rsultat obtenu. Ainsi l a ngation
serait simplement une qualit du jugement et l'attente du question
nant serait une attente du jugement-rponse. Quant au nant, il
tirerait son origine des jugements ngatifs, ce serait un concept
tablissant l ' uni t transcendante de tous ces j ugements, une fonction
proposi tionnelle du type : X n'est pas. On voit o conduit cette
thorie : on vous fait remarquer que l'tre-en-soi est pleine positivit
et ne contient en lui mme aucune ngation. Ce jugement ngatif,
d'autre part, titre d'acte subjectif, est assimil rigoureusement au
jugement affirmatif : on ne voit pas que Kant, par exemple, ait
distingu dans sa texture interne l'acte j udicatoire ngatif de l'acte
affirmatif ; dans les deux cas on opre une synthse de concepts ;
simplement cette synthse, qui est un vnement concret et plein de
la vie psychique, s'opre i ci au moyen de la copule est et l au
moyen de la copule n'est pas : de la mme faon, l'opration
manuelle de triage (sparation) et l'opration manuelle d'assemblage
(union) sont deux conduites objectives qui possdent la mme ralit
40
de fai t . Ainsi la ngation serait au bout de l'acte judicatif sans
tre, pour autant , dans l'tre. Elle est comme un irrel enserr
entre deux pleines ralits dont aucune ne la revendique : l ' tre-en
soi interrog sur la ngation renvoie au j ugement, puisqu'il n' est que
ce qu'il est -et le jugement , entire positivit psychi que, renvoie
l'tre puisqu' il formule une ngation concernant l'tre et, par
consquent, transcendante. La ngation, rsultat d' oprations psychi
ques concrtes, soutenue dans l 'existence par ces oprations mmes,
incapable d'exister par soi , a l 'existence d' un corrlatif nomatique,
son esse rside tout juste dans son percipi. Et l e nant, unit
conceptuelle des jugements ngatifs, ne saurait avoir la moindre
ralit si ce n'est celle que les Stociens confraient leur lecton .
Pouvons-nous accepter cette conception ?
La question peut se poser en ces termes : la ngation comme
structure de l a proposition judicative est-elle l'origine du nant -
ou, au contraire, est-ce le nant, comme structure du rel, qui est
l'origine et le fondement de l a ngation ? Ainsi le problme de l'tre
nous a renvoy celui de la question comme attitude humaine et le
problme de la question nous renvoie celui de l'tre de la ngation.
Il est vident que le non-tre apparat toujours dans les limites
d'une attente humaine. C'est parce que j e m'attends trouver quinze
cents francs que je n'en trouve que treize cents. C'est parce que le
physicien attend telle vrification de son hypothse que l a nature peut
lui dire non. Il serait donc vain de nier que la ngation apparaisse sur
le fond primitif d' un rapport de l'homme au monde ; le monde ne
dcouvre pas ses non-tres qui ne les a d'abord poss comme des
possibilits. Mais est-ce dire que ces non-tres doivent tre rduits
de la pure subjectivit ? Est-ce dire qu'on doive leur donner
l'importance et l e type d'existence du lecton stocien, du nome
husserlien ? Nous ne le croyons pas.
Tout d'abord i l n'est pas vrai que l a ngation soit seulement une
qualit du jugement ; la question se formule par un jugement
interrogatif mais elle n'est pas j ugement : c'est une conduite prjudi
cative ; je peux interroger du regard, du geste ; par l'interrogation je
me tiens d' une certaine manire en face de l'tre et ce rapport l'tre
est un rapport d'tre, le jugement n'en est que l'expression faculta
tive. De mme ce n'est pas ncessairement un homme que le
questionneur questionne sur l 'tre : cette conception de l a question,
en en faisant un phnomne i ntersubjectif, la dcolle de l ' tre auquel
elle adhre et l a laisse en l'air comme pure modalit de di alogue. I l
faut concevoir que l a question dialogue est au contraire une espce
particulire du i nterrogation et que l'tre interrog n'est pas
d'abord un tre pensant : si mon auto a une panne, c'est le
carburateur, les bougies, etc. , que j'interroge ; si ma montre s'arrte,
je puis interroger l'horloger sur les causes de cet arrt, mais c'est aux
41
diffrents mcanismes de la montre que l'horloger, son tour, posera
des questions. Ce que j'attends du carburateur, ce que l ' horloger
attend des rouages de l a montre, ce n'est pas un jugement, c'est un
dvoilement d'tre sur le fondement de quoi l'on puisse porter un
j ugement . Et si j'allends un dvoilement d'tre, c'est que je suis
prpar du mme coup l'ventualit d' un non-tre. Si j'i nterroge le
carburateur, c'est que je considre comme possible qu' il n'y ait
rien
dans le carburateur. Ainsi ma question enveloppe par nature
une certaine comprhension prjudicative du non-tre ; elle est, en
elle-mme, une relation d'tre avec le non-tre, sur l e fond de la
transcendance originel l e, c'est--dire d' une relation d'tre avec l'tre.
Si, d'ailleurs, la nature propre de l' interrogation est obscurcie par le
fait que les questions sont frquemment poses par un homme
d' autres hommes, il convient de remarquer ici que de nombreuses
conduites non j udicatives prsentent dans sa puret originelle cette
comprhension immdiate du non-tre sur fond d'tre. Si nous
envisageons, par exemple, l a destruction, il nous faudra bien recon
natre que c'est une activit qui pourra sans doute utiliser le jugement
comme un instrument mais qui ne saurait tre dfinie comme
uniquement ou mme principalement judicative. Or elle prsente l a
mme structure que l ' interrogati on. En un sens, certes, l'homme est
le seul tre par qui une destruction peut tre accomplie. Un
plissement gologique, un orage ne dtruisent pas -ou, du moins, ils
ne dtruisent pas directement : ils modifient simplement l a rpartition
des masses d' tres. Il n'y a pas moins aprs l'orage qu'avant. Il y a
autre chose. Et mme cette expression est impropre car, pour poser
l'altrit, i l faut un tmoin qui puisse retenir le pass en quelque
manire et l e comparer au prsent sous la forme du ne-plus . En
l'absence de ce tmoin, il y a de l'tre, avant comme aprs l 'orage :
c'est tout. Et si le cyclone peut amener la mort de certains tres
vivants, cette mort ne sera destruction que si elle est vcue comme
tel l e. Pour qu' i l y ait destruction, il faut d'abord un rapport de
l ' homme l 'tre, c'est--dire une transcendance ; et dans l es limites
de ce rapport il faut que l ' homme saisisse un tre comme destructible.
Cela suppose un dcoupage limitatif d'un tre dans l'tre, ce qui, nous
l'avons vu propos de la vri t, est dj nantisati on. L'tre
considr est cela et, en dehors de cela , rien. L'artilleur qui l ' on
assigne un objectif prend soin de pointer son canon sel on telle
direction, l'exclusion de toutes les autres. Mais cela ne serait rien
encore si l'tre n'tait dcouvert comme fragile. Et qu'est-ce que la
fragilit sinon une certaine probabilit de non-tre pour un tre
donn dans des ci rconstances dtermines ? Un tre est fragile s'il
porte en son tre une possibilit dfinie de non-tre. Mais derechef
c'est par l ' homme que l a fragilit arrive l'tre, car l a limitation
individualisante que nous mentionnions tout l ' heure est condition
42
de la fragi lit : un tre est fragile et non pas tout l'tre qui est au-del de
toute destruction possi ble. Ainsi le rapport de limitation individuali
sante que l'homme entretient avec lin tre sur le ftmd premier de son
rapport l'tre fait arriver la fragilit en cet tre comme apparition
d'une possibilit permanente de non-tre. Mais ce n'est pas tout : pour
qu' i l y ait destructibilit, i l faut que l'homme se dtermine en face de
cette possibilit de non-tre, soit positivement, soit ngativement ; il
faut qu'il prenne les mesures ncessaires pour la raliser (destruction
proprement dite) ou, par une ngation du non-tre, pour la maintenir
toujours au niveau d'une simple possibilit (mesures de protection).
Ainsi c'est l ' homme qui rend les villes destructi bles, prcisment parce
qu'il les pose comme fragiles et comme prcieuses et parce qu'il prend
leur gard un ensemble de mesures de protecti on. Et c'est cause de
l'ensemble de ces mesures qu'un sisme ou une ruption volcanique
peuvent dtruire ces villes ou ces constructions humaines. Et l e sens
premier et le but de l a guerre sont contenus dans la moi ndre dification
de l'homme. Il faut donc bien reconnatre que l a destruction est chose
essentiellement humai ne et que c'est l'homme qui dtruit ses villes par
l'intermdiaire des sismes ou directement, qui dtruit ses bateaux par
l'intermdiaire des cyclones ou di rectement. Mais en mme temps i l
faut avouer que la destruction suppose une comprhension prjudica
tive du nant en tant que tel et une conduite en face du nant. En outre
la destruction, bien qu'arrivant l'tre par l' homme, est unfait objectif
et non une pense. C'est bien dans l'tre de cette potiche que s'est
imprime la fragi lit et sa destruction serait un vnement irrversible
et absolu que je pourrais seulement constater. Il y a une transphnom
nalit du non-tre comme de l'tre. L'examen de l a conduite
destruction nous amne donc aux mmes rsultats que l'examen de
la conduite interrogative.
Mais si nous voulons dcider coup sr, il n'est que de considrer un
jugement ngatif en lui-mme et de nous demander s'il fait apparatre
le non-tre au sein de l'tre ou s'il se borne fixer une dcouverte
antrieure. J 'ai rendez-vous avec Pierre quatre heures. J'arrive en
retard d'un quart d'heure : Pierre est toujours exact ; m'aura-t-il
attendu ? Je regarde la sal l e, les consommateurs et je dis : Il n'est pas
l. Y a-t-il une intuition de l'absence de Pierre ou bien l a ngation
n'intervient-elle qu'avec l e jugement ? A premire vue il semble
absurde de parler ici d' i ntuition puisque justement il ne saurait y avoir
intuition de rien et que l'absence de Pierre est ce rien. Pourtant la
conscience populaire tmoigne de cette intuition. Ne dit-on pas, par
exempl e : J 'ai tout de suite vu qu' i l n'tait pas l ? S' agit-il d'un
simple dplacement de l a ngation ? Regardons-y de plus prs.
Il est certain que l e caf, par soi-mme, avec ses consommateurs,
ses tables, ses banquettes, ses glaces, sa lumire, son atmosphre
enfume, et les bruits de voix, de soucoupes heurtes, de pas qui le
43
remplissent, est un pl ein d'tre. Et toutes les intuitions de dtail que
je puis avoir sont remplies par ces odeurs, ces sons, ces couleurs, tous
phnomnes qui ont un tre transphnomnai. Pareillement l a
prsence actuelle de Pierre en un l i eu que je ne connais pas est aussi
plnitude d'tre. II semble que nous trouvions le plein partout. Mais il
faut observer que, dans la perception, il y a toujours constitution
d'une forme sur un fond. Aucun objet, aucun groupe d'objets n' est
spcialement dsign pour s'organiser en fond ou en forme : tout
dpend de l a direction de mon attention. Lorsque j'entre dans ce
caf, pour y chercher Pierre, i l se fait une organisation synthtique de
tous les objets du caf en fond sur quoi Pierre est donn comme
devant paratre. Et cette organisation du caf en fond est une
premire nantisation. Chaque lment de l a pice, personne, tabl e,
chaise, tente de s'isoler, de s'enlever sur le fond constitu par l a
totalit des autres objets et retombe dans l' indiffrenciation de ce
fond, i l se dilue dans ce fond. Car le fond est ce qui n'est vu que par
surcrot, ce qui est l ' objet d'une attention purement margi nale. Ai nsi
cette nantisation premire de toutes les formes, qui paraissent et
s'engloutissent dans l a totale quivalence d'un fond, est l a condition
ncessaire pour l'apparition de l a forme principale, qui est ici l a
personne de Pierre. Et cette nantisation est donne mon intuition,
je suis tmoin de l'vanouissement successif de tous les objets que je
regarde, en particulier des visages, qui me retiennent un instant (< Si
c'tait Pierre ? ) et qui se dcomposent aussitt prcisment parce
qu'ils ne sont pas l e visage de Pierre. Si , toutefois, je dcouvrais
enfi n Pierre, mon intuition serait remplie par un lment solide, je
serais soudain fascin par son visage et tout le caf s'organiserait
autour de l ui , en prsence discrte. Mais j ustement Pierre n'est pas l .
Cela ne veut point dire que je dcouvre son absence en quelque lieu
prcis de l'tablissement. En fait Pierre est absent de tout le caf ; son
absence fige l e caf dans son vanescence, le caf demeure fond, il
persiste s'offrir comme totalit indiffrencie ma seule attention
margi nal e, i l glisse en arrire, i l poursuit sa nantisation. Seulement il
se fait fond pour une forme dtermine, i l la porte partout au-devant
de lui, i l me la prsente partout et cette forme qui se glisse
constamment entre mon regard et les objets solides et rels du caf,
c'est prcisment un vanouissement perptuel, c'est Pierre s'enle
vant comme nant sur le fond de nantisation du caf. De sorte que ce
qui est offert l 'intuition, c'est un papillotement de nant, c'est le
nant du fond, dont l a nantisation appel l e, exige l'apparition de la
forme, et c'est l a forme -nant qui glisse comme un rien l a surface
du fond. Ce qui sert de fondement au j ugement : Pierre n'est pas
l , c'est donc bien l a saisie intuitive d'une double nantisation. Et,
certes, l'abse
r
ce de Pierre suppose un rapport premier de moi ce
caf ; i l Y a une infinit de gens qui sont sans rapport aucun avec ce
44
caf faute d'une attente relle qui constate leur absence. Mais,
prcisment, je m'attendais voir
'
Pierre et mon attente a fait arriver
l'absence de Pierre comme un vnement rel concernant ce caf,
c'est un fait objectif, prsent, que cette absence, je l'ai dcouverte et
elle se prsente comme un rapport synthtique de Pierre l a pice
dans laquelle je le cherche : Pierre absent hante ce caf et il est la
condition de son organisation nant isante en fond. Au lieu que les
jugements que je peux m'amuser porter ensuite, tels que Welling
ton n'est pas dans ce caf, Paul Valry n'y est pas non plus, etc. ",
sont de pures significations abstraites, de pures applications du
principe de ngation, sans fondement rel ni efficacit, et i l s ne
parviennent pas tablir un rapport rel entre l e caf, Wellington ou
Valry : l a relation : n'est pas " est ici simplement pense. Cela
suffit montrer que l e non-tre ne vient pas aux choses par le
jugement de ngation : c'est l e jugement de ngation au contraire qui
est conditionn et soutenu par l e non-tre.
Comment, d'ailleurs, en serait-il autrement ? Comment pourrions
nous mme concevoir l a forme ngative du jugement si tout est
plnitude d'tre et positivit ? Nous avions cru, un instant, que l a
ngation pouvait surgir de l a comparaison institue entre le rsultat
escompt et le rsultat obtenu. Mais voyons cette comparaison ; voici
un premier jugement, acte psychique concret et positif, qui constate
un fait : Il y a 1 300 francs dans mon portefeuille et en voici un
autre, qui n'est autre chose, lui non plus, qu'une constatation de fait
et une affirmation : Je m'attendais trouver 1 50 francs. Voil
donc des faits rels et objectifs, des vnements psychiques positifs,
des jugements affirmatifs. O la ngation peut-elle trouver place ?
Croit-on qu'elle est application pure et simple d'une catgorie ? Et
veut-on que l'esprit possde en soi le non comme forme de triage et
de sparati on ? Mai s en ce cas, c'est jusqu'au moindre soupon de
ngativit qu' on te l a ngat i on. Si l'on admet que la catgorie du
non, catgorie existant en fail dans l'esprit, procd positif et concret
pour brasser et systmatiser nos connaissances, est dclenche
soudain par l a prsence en nous de certains j ugements affirmatifs et
qu'elle vient soudain marquer de son sceau certaines penses qui
rsultent de ces j ugements, on aura soigneusement dpoui l l , par ces
considrati ons, l a ngati on de toute fonction ngative. Car la
ngation est refus d'existence. Par el l e, un tre (ou une manire
d'tre) est pos puis rejet au nant. Si la ngation est catgorie, si
elle n'est qu'un tampon i ndiffremment pos sur certains jugements,
o prendra-t-on qu'elle puisse nantir un tre, le faire soudain surgir
et le nommer pour le rejeter au non-tre ? Si les jugements antrieurs
sont des constatations de fait, comme celles que nous avons prises en
exemple, il faut que la ngation soit comme une invention libre, il faut
qu'elle nous arrache ce mur de positivit qui nous enserre : c'est une
45
brusque solution de continuit qui ne peut en aucun cas rsulter des
affi rmations antrieures, un vnement original et i rrductible. Mais
nous sommes ici dans la sphre de la conscience. Et la conscience ne
peut produire une ngation si non sous forme de conscience de
ngation . Aucune catgorie ne peut habiter " la conscience et y
rsider la manire d' une chose. Le non, comme brusque dcouverte
intuitive, apparat comme conscience (d'tre) conscience du non. En
un mot, s'il y a de l'tre partout, ce n'est pas seulement le nant, qui ,
comme le veut Bergson, est i nconcevable : de l'tre on ne drivera
jamais la ngation. La condition ncessaire pour qu' i l soit possible de
dire lion, c'est que le non-tre soit une prsence perptuel l e, en nous
et en dehors de nous, c'est que l e nant hante l'tre.
Mais d'o vient le nant ? Et s'il est la condition premire de la
conduite interrogative et, plus gnral ement, de toute enqute
phi losophique ou scientifi que, quel est le rapport premier de l 'tre
humain au nant , quelle est la premire conduite nantisante ?
I I I
LA CONCEPTI ON DI ALECTI QUE DU NANT
I l est encore trop tt pour que nous puissions prtendre dgager
le sens de ce nant en face duquel l ' i nterrogation nous a tout coup
jet. Mais il y a quelques prcisions que nous pouvons donner ds
prsent. Il ne serait pas mauvais en particulier de fixer les rapports de
l' tre avec le non-tre qui le hante. Nous avons constat en effet un
certain paral llisme entre l es conduites humai nes en face de l ' tre et
cel l es que l' homme ti ent en face du nant ; et i l nous vient aussitt l a
tentation de considrer l ' tre et le non-tre comme deux composantes
complmentaires du rel , l a faon de l'ombre et de la lumire : il
s'agirait en somme de deux notions rigoureusement contemporaines
qui s' uniraient de telle sorte dans l a production des existants, qu' i l
serait vain de les considrer isolment. L'tre pur et le non-tre pur
seraient deux abstractions dont l a runion seule serait la base de
ralits concrtes.
Tel est certainement le point de vue de Hegel. C'est dans l a
Logique, en effet , qu' i l tudie l es rapports de l ' Etre et du Non-Etre et
i l appel l e cette logique le systme des dterminations pures de la
pense . Et i l prcise sa dfinition
!
: Les penses, telles qu'on les
1. Introduction P. L. , 2< d. E. * XXIV, cit par Lefebvre : Morceaux
choisis.
46
reprsente ordinairement, ne sont pas des penses pures, car on
entend par tre pens un tre dont l e contenu est un contenu
empirique. Dans l a logique, les penses sont saisies de telle faon
qu'elles n'ont d'autre contenu que le contenu de la pense mme et
qui est engendr par el le. " Certes ces dterminations sont ce qu'il y
a de plus intime dans les choses mai s, en mme temps, lorsqu'on les
considre en et pour elles-mmes , on les dduit de la pense elle
mme et on dcouvre en elles-mmes l eur vrit. Toutefois, l'effort
de la logique hglienne sera pour mettre en vidence l'incompl
tude des notions (qu'elle) considre tour tour et l'obligation, pour
les entendre, de s'lever une notion plus complte, qui les dpasse
en les i ntgrant 1 . On peut appliquer Hegel ce que Le Senne dit de
la philosophie de Hamelin : Chacun des termes i nfrieurs dpend
du terme suprieur, comme l'abstrait du concret qui lui est ncessaire
pour l e raliser. Le vritable concret , pour Hegel, c'est l'Existant,
avec son essence, c'est l a Totalit produite par l'intgration synthti
que de tous les moments abstraits qui se dpassent en elle, en
exigeant leur complment . En ce sens, l ' Etre sera abstracti on, la plus
abstrai te et la pl us pauvre, si nous le considrons en lui-mme, c'est
-dire en le coupant de son dpassement vers l' Essence. En effet :
L'Etre se rapporte l'Essence comme l' immdiat au mdiat. Les
choses, en gnral, .. sont ", mais l eur tre consiste manifester leur
essence. L'Etre passe en l ' Essence ; on peut exprimer ceci en disant :
.. L'tre prsuppose l'Essence. " Bien que l ' Essence apparaisse, par
rapport l'Etre, comme mdie, l ' Essence est nanmoins l'originel
vritabl e. L'Etre retourne en son fondement ; l ' Etre se dpasse en
l'Essence 2.
Ainsi, l'Etre coup de l 'Essence qui en est le fondement devient
la simple immdiatet vide . Et c'est bien ainsi que le dfi ni t l a
Phnomnologie de l'Esprit, qui prsente l ' Etre pur du point de vue
de la vrit comme l'immdiat. Si le commencement de l a logique
doit tre l'immdiat, nous trouverons donc le commencement dans
l'Etre, qui est l ' i ndtermination qui prcde toute dtermination,
l'indtermin comme point de dpart absolu .
Mais aussitt l 'Etre ainsi dtermin passe en son contraire.
Cet Etre pur, crit Hegel dans la Petite Logique, est l'abstraction
pure et, par consquent, l a ngati on absolue qui, prise, elle aussi,
dans son moment immdiat , est le non-tre. " Le nant n'est-il pas,
en effet, simple identit avec lui-mme, vide complet, absence de
dterminations et de contenu ? L'tre pur et le nant pur sont donc la
1. Laportc : Le problme de l'Abstraction, p. 25 (Presses universitaires,
1940) .
2. Esquisse de fa logique, crite par Hegel, entre 180S et IS l l , pour servir de
base ses cours au gymnase de Nuremberg.
47
mme chose. Ou plutt, il est vrai de dire qu'ils diffrent. Mais
comme ici l a di ffrence n'est pas encore une di ffrence dtermine,
car l'tre et le non-tre constituent le moment immdiat, telle qu'elle
est en eux, cette diffrence ne saurait tre nomme, elle n'est qu' une
pure opinion 1 . Cela signifie concrtement qu' il n'y a rien dans le
ciel et sur terre qui ne contienne en soi et l'tre et le nant
2
.
I l est encore trop tt pour discuter en elle-mme l a conception
hglienne : c'est l'ensemble des rsultats de notre recherche qui
nous permettra de prendre position vis--vis d'elle. Il convient
seulement de faire observer que l'tre est rduit par Hegel une
signification de l'existant. L'tre est enveloppe par l'essence, qui en
est le fondement et l'origine. Toute la thorie de Hegel se fonde sur
ride qu'il faut une dmarche philosophique pour retrouver au dbut
de l a logique l ' immdiat partir du mdiatis, l ' abstrait partir du
concret qui le fonde. Mais nous avons dj fait remarquer que l'tre
n'est pas, par rapport au phnomne, comme l'abstrait par rapport au
concret. L'tre n'est pas une structure parmi d'autres , un moment
de l'objet, il est l a condition mme de toutes les structures et de tous
les moments, i l est le fondement sur lequel se manifesteront les
caractres du phnomne. Et, pareillement, i l n'est pas admissible
que l'tre des choses manifester leur essence . Car,
alors, il faudrait un tre de cet tre. Si, d'ailleurs, l'tre des choses
consistait manifester, on voit mal comment Hegel pourrait fixer
un moment pur de l ' Etre o nous ne trouverions mme pas trace de
cette structure premire. I l est vrai que l'tre pur est fix par
l'entendement , isol et fig dans ses dterminations mmes. Mais si le
dpassement vers l'essence constitue le caractre premier de l'tre et
si l'entendement se borne dterminer et persvrer dans les
dterminations , on ne voit pas comment, prcisment, il ne
dtermine pas l'tre comme consistant manifester . On dira que,
pour Hegel , toute dtermination est ngation. Mais l'entendement,
en ce sens, se borne ni er de son objet qu' il soit autre qu' il n'est . Cela
suffi t , sans doute, empcher toute dmarche di alectique, mais cela
ne devrait pas suffire pour faire disparatre jusqu'aux germes du
dpassement. En tant que l'tre se dpasse en autre chose, i l chappe
aux dterminations de l'entendement, mais en tant qu'il se dpasse,
c'est--dire qu'il est au plus profond de soi l'origine de son propre
dpassement, i l se doit au contraire d'apparatre tel qu' i l est
l'entendement qui le fige dans ses dterminations propres. Affirmer
q
ue l'tre n'est que ce qu'il est, ce serait du moins laisser l'tre intact
en tant qu' il est son dpassement. C'est l l'ambigut de l a notion
hglienne de dpassement qui tantt parat tre un jaillissement
1. Hegel : P. L. , E. LXXXVIII.
2. Hegel : Grande Logique, chap. 1 .
48
du plus profond de l'tre considr et tantt un mouvement externe
par lequel cet tre est entran. Il ne suffit pas d'affirmer que
l'entendement ne trouve en l'tre que ce qu'il est, il faut encore
expliquer comment l'tre, qui est ce qu'il est, peut n' tre que cela :
une semblable explication ti rerait sa lgitimit de la considration du
phnomne d'tre en tant que tel et non des procds ngateurs de
l'entendement.
Mais ce qu' i l convient ici d'exami ner c'est surtout l 'affirmation de
Hegel selon laquelle l'tre et le nant constituent deux contraires dont
la diffrence, au niveau d'abstracti on considr, n'est qu'une simple
opinion .
Opposer l'tre au nant comme la thse et l'antithse, la faon de
l'entendement hglien, c'est supposer entre eux une contempora
nit logique. Ainsi deux contraires surgissent en mme temps
comme les deux termes-limites d'une srie logique . Mais il faut
prendre garde ici que les contraires seuls peuvent joui r de cette
simultanit parce qu'il s sont galement positifs (ou galement
ngatifs). Mais le non-tre n'est pas le contraire de l'tre, i l est son
contradictoire. Cela implique une postriorit logique du nant sur
l'tre puisqu' i l est l'tre pos d'abord puis ni. Il ne se peut donc pas
que l'tre et le non-tre soient des concepts de mme contenu
puisque, au contraire, le non-tre suppose une dmarche irrductible
de l'esprit : quelle que soit l ' i ndiffrenciation primitive de l'tre, le
non-tre est cette mme indiffrenciation nie. Ce qui permet Hegel
de faire passer l ' tre dans l e nant, c'est qu'il a introduit
implicitement l a ngation dans sa dfinition mme de l'tre. Cela va
de soi , puisqu'une dfinition est ngative, puisque Hegel nous a di t,
en reprenant une formule de Spinoza, que omnis determinatio est
negatio. Et n' crit-il pas : N' i mporte quelle dtermination ou
contenu qui distinguerait l ' tre d' autre chose, qui poserait en l ui un
contenu, ne permettrait pas de le mai ntenir dans sa puret. Il est la
pure indtermination et le vide. On ne peut rien apprhender en
lui . . + Ainsi est-ce lui qui introduit du dehors en l'tre cette
ngation qu'il retrouvera ensuite lorsqu' i l le fera passer dans le non
tre. Seulement, i l y a i ci un jeu de mots sur la notion mme de
ngation. Car si j e nie de l'tre toute dtermination et tout contenu,
ce ne peut tre qu'en affirmant qu'au moins i l es/. Ainsi, qu'on ni e de
l'tre tout ce qu'on voudra, on ne saurait faire qu' i l ne soit pas, du fait
mme que l'on nie qu' i l soit ceci ou cela. La ngation ne saurait
atteindre le noyau d'tre de l'tre qui est plnitude absolue et entire
positivit. Par contre, le non-tre est une ngation qui vise ce noyau
de densit plnire lui-mme. C'est en son cur que l e non-tre se
nie. Lorsque Hegel crit 1 (L'tre et l e nant) sont des abstractions
1 . PL, 2< d., E. LXXXVII.
49
vides et l ' une d'elles est aussi vide que l'autre , il oublie que le vide
est vide de quelque chose 1 . Or, l ' tre est vide de toute dtermination
autre que l'identit avec lui-mme ; mais le non-tre est vide d'tre.
En un mot, ce qu'il faut rappeler ici contre Hegel, c'est que l'tre est
et que le nant n'est pas.
Ainsi, quand mme l'tre ne serait le support d'aucune qualit
diffrencie , le nant l ui serait logiquement postrieur puisqu'il
suppose l'tre pour le nier, puisque la qualit irrductible du non
vient se surajouter cette masse i ndi ffrencie d'tre pour la livrer.
Cela ne signifie pas seulement que nous devons refuser de mettre tre
et non-tre sur le mme pl an, mais encore que nous devons prendre
garde de ne jamais poser le nant comme un abme originel d'o l'tre
sortirait. L'usage que nous faisons de la notion de nant sous sa forme
fami lire suppose toujours une spcification pralable de l'tre. Il est
frappant, cet gard, que la langue nous fournisse un nant de choses
(< Rien ) et un nant d' tres humains ( Personne ). Mais l a
spcification est plus pousse encore dans l a majorit des cas : on di t,
en dsignant une collection particulire d'objets : Ne touche
rien , c'est--dire, trs prcisment, rien de cette collection.
Pareillement, celui qu'on interroge sur des vnements bien dter
mins de la vie prive ou publique rpond : Je ne sais rien et ce
rien comporte l'ensemble des faits sur lesquels on l'a interrog.
Socrate mme, avec sa phrase fameuse : Je sais que je ne sais
rien , dsigne par ce rien prcisment la totalit de l'tre considre
en tant que Vrit. Si , adoptant un instant le point de vue des
cosmogonies naves, nous essayions de nous demander ce qu' i l y
avait )} avant qu' i l y et un monde et que nous rpondions rien ,
nous serions bien forcs de reconnatre que cet avant )> comme ce
rien sont effet rtroactif. Ce que nous nions aujourd'hui, nous
qui sommes installs dans l'tre, c'est qu'il y et de l ' tre avant cet
tre. La ngation mane ici d' une conscience qui se retourne vers les
origines. Si nous tions ce vide originel son caractre d' tre vide de
ce monde-ci et de tout ensemble ayant pris la forme de monde,
comme aussi bien son caractre d'avant qui prsuppose un aprs par
rapport auquel j e le constitue comme avant, c'est la ngation mme
qui s'vanouirait, faisant place une totale indtermination qu' il
serait impossibl e de concevoir, mme et surtout titre de nant.
Ainsi , en renversant la formule de Spinoza, nous pourrions di re que
toute ngation est dtermination. Cela signifie que l'tre est antrieur
au nant et le fonde. Par quoi il faut entendre non seulement que
l' tre a sur l e nant une prsance logique mais encore que c'est de
l'tre que le nant tire concrtement son efficace. C'est ce que nous
1. Ce qui est d'autant plus trange qu'il est le premIer avoir not que
toute ngation est ngation dtermine q cest--dire porte sur un contenu.
50
exprimions en disant que le nant hante l'tre. Cela signifie que l'tre
n'a nul besoin de nant pour se concevoir et qu'on peut inspecter sa
notion exhaustivement sans y trouver la moindre trace du nant. Mais
au contraire l e nant qui Il est pas ne saurait avoir qu'une existence
emprunte : c'est de l'tre qu'il prend son tre ; son nant d' tre ne se
rencontre que dans les l i mites de l'tre et la disparition totale de l'tre
ne serait pas l'avnement du rgne du non-tre, mais au contraire
l'vanouissement concomitant du nant : il /l'y a de /o/l-tre qu' la
surface de l'tre.
IV
LA CONCEPTI ON PHNOMNOLOGI QUE DU NANT
Il est vrai qu'on peut concevoir d'autre manire la complmentarit
de l'tre et du nant. On peut voir dans l'un et l'autre deux
composantes galement ncessaires du rel, mais sans faire passer
l'tre dans le nant, comme Hegel, ni i nsister, comme nous le
tentions, sur la postriorit du nant : on mettrait l'accent au
contraire sur les forces rciproques d'expulsion qu'tre et non-tre
exerceraient l'un sur l'autre, le rel tant, en quelque sorte, la tension
rsultant de ces forces antagonistes. C'est vers cette conception
nouvelle que s'oriente Heidegger 1 .
I l ne faut pas longtemps pour voir l e progrs que s a thorie du
Nant reprsente pa r rapport celle de Hegel. D' abord, l'tre et l e
non-tre ne sont plus des abstractions vi des. Heidegger, dans son
ouvrage principal, a montr l a lgitimit de l'interrogation sur l'tre :
celui-ci n' a plus ce caractre d'universel scolastique, qu'i! gardait
encore chez Hegel ; il Y a un sens de l'tre qu'il faut lucider ; il y a
une comprhension prontologique de l'tre, qui est enveloppe
dans chacune des conduites de l a ralit-humaine c'est--dire
dans chacun de ses projets. De la mme faon, les apories qu'on a
coutume de soulever ds qu' un philosophe touche au problme du
Nant se rvlent sans porte : elles n'ont de valeur qu'en tant
qu'elles limitent l ' usage de l'entendement et elles montrent simple
ment que ce problme n'est pas du ressort de l'entendement. Il existe
au contraire de nombreuses attitudes de la ralit-humaine qui
impliquent une comprhension du nant : la haine, la dfense, le
regret , etc. Il y a mme pour le Daseill une possibilit permanente de
1. Heidegger : Qu'es/-ce que la mwphysique ? (trad. Corbin, N. R.F.,
1938).
51
se trouver en face du nant et de le dcouvrir comme phno
mne : c'est l'angoisse. Toutefois, Heidegger, tout en tablissant les
possibilits d'une saisie concrte du nant, ne tombe pas dans l'erreur
de Hegel, i l ne conserve pas au non-tre un tre, ft-ce un tre
abstrai t : le nant n'est pas, i l se nantise. II est soutenu et
conditionn par la transcendance. On sait que, pour Heidegger, l'tre
de la ralit-humaine se dfinit comme tre-dans-le-monde Et le
monde est le complexe synthtique des ralits ustensiles en tant
qu'elles s'indiquent les unes les autres suivant des cercles de plus en
plus vastes et en tant que l'homme se fait annoncer partir de ce
complexe ce qu'il est. Cela signifie l a fois que l a ralit-humaine
surgit en tant qu'elle est investie par l'tre, elle se trouve (sich
befinden) dans l'tre -et , la fois, que c'est la ralit-humaine qui
fait que cet tre qui l'assige se dispose autour d'elle sous forme de
monde. Mais elle ne peut faire paratre l'tre comme totalit
organise en monde qu'en le dpassant. Toute dtermination, pour
Hei degger, est dpassement , puisqu'elle suppose recul, prise de point
de vue. Ce dpassement du monde, condition de l a surrection mme
du monde comme tel , le Dasein l'opre vers lui-mme. La caractristi
que de l'ipsit, en effet (Selbstheit) , c'est que l'homme est toujours
spar de ce qu' i l est par toute l a largeur de l'tre qu'il n'est pas. I l
s' annonce lui-mme de l' autre ct du monde et i l revient
s'intrioriser vers lui-mme partir de l 'horizon : l'homme est un
tre des lointains . C'est dans l e mouvement d'intriorisation qui
traverse tout l ' tre que l'tre surgit et s'organise comme monde, sans
qu'il y ai t priorit du mouvement sur l e monde, ni du monde sur le
mouvement . Mais cette apparition du soi par del l e monde, c'est-
dire de la totalit du rel , est une mergence de la ralit-humaine
dans le nant. C'est dans le nant seul qu'on peut dpasser l'tre. En
mme temps, c'est du point de vue de rau-del du monde que l'tre
est organis en monde, ce qui signifie d'une part que la ralit
humaine surgit comme mergence de l'tre dans le non-tre et d'autre
part que le monde est en suspens dans le nant. L'angoisse est l a
dcouverte de cette double et perptuelle nantisation. Et c'est
partir de ce dpassement du monde que le Dasein va raliser l a
contingence du monde, c'est--dire poser la question : D'o vient
qu'il y ait quelque chose plutt que rien ? La contingence du monde
apparat donc l a ralit-humaine en tant qu'elle s'est installe dans
le nant pour la saisir.
Voici donc l e nant cernant l'tre de toute part et, du mme coup,
expuls de l'tre ; voici que le nant se donne comme ce par quoi le
monde reoit ses contours de monde. Cette solution peut-elle nous
satisfaire ?
Certes, on ne saurait nier que l'apprhension du monde comme
monde est nantisante. Ds que le monde parat comme monde, il se
52
donne comme n'tant que cela. L contrepartie ncessaire de cette
apprhension est donc bien J' mergence de la ralit-humaine dans le
nant. Mais d'o vient l e pouvoir qu'a l a ralit-humaine d'merger
ainsi dans le non-tre ? Sans nul doute, Heidegger a raison d'insister
sur le fait que la ngation tire son fondement du nant. Mais si le
nant fonde l a ngati on, c'est qu' il enveloppe en lui comme sa
structure essenti el l e le non. Autrement dit, ce n'est pas comme vi de
indiffrenci ou comme altrit qui ne se poserait pas comme altrit J
que le nant fonde la ngation. Il est l'origine du jugement ngatif
parce qu'il est lui-mme ngation. Il fonde la ngation comme acte
parce qu'il est la ngation comme tre. L nant ne peut tre nant
que s'il se nantise expressment comme nant du monde ; c'est-
dire si dans sa nantisation il se dirige expressment vers ce monde
pour se constituer comme refus du monde. L nant porte l'tre en
son cur. Mais en quoi l'mergence rend-elle compte de ce refus
nantisant ? Loin que la transcendance, qui est projet de soi par
del . v . , puisse fonder l e nant, c'est au contraire le nant qui est au
sein mme de l a transcendance et qui la conditionne. Or, la
caractristique de la philosophie heideggrienne, c'est d'utiliser pour
dcrire le Dasein des termes positifs qui masquent tous des ngations
implicites. Le Dasein est hors de soi, dans le monde , il est un
tre des lointains , i l est souci i l est ses propres possibilits
etc. Tout cela revient dire que l e Dasein n'est pas } en soi, qu'il
n'est lui-mme dans une proximit immdiate et qu' il
dpasse le monde en tant qu' il se pose lui-mme comme n'tanl
pas en soi et comme n'tant pas le monde. En ce sens, c'est Hegel qui a
raison contre Heidegger, lorsqu' i l dclare que J'Esprit est le ngatif.
Seulement, on peut poser l'un et l'autre la mme question sous des
formes peine diffrentes ; on doit dire Hegel : Il ne suffit pas de
poser l'esprit comme l a mdiation et le ngatif, i l faut montrer l a
ngativit comme structure de l'tre de l'esprit. Que doit tre l'esprit
pour qu' il puisse se constituer comme Et J'on peut
demander Heidegger : Si l a ngation est la structure premire de
la transcendance, que doi t tre l a structure premire de l a ralit
humaine pour qu'elle puisse transcender le monde ? Dans les deux
cas on nous montre une activit ngatrice et l'on ne se proccupe pas
de fonder cette activit sur un tre ngatif. Et Heidegger, en outre,
fait du nant une sorte de corrlatif intentionnel de la transcendance
sans voir qu'il l'a dj insr dans la transcendance mme, comme sa
structure originel l e.
Mais. en outre, quoi sert d' affirmer que le nant fonde l a
ngation, si c'est pour faire ensuite une thorie du non-tre qui
coupe, par hypothse, le nant de toute ngation concrte ? Si
1 . Ce que Hegel appellerait altrit immdiate
53
j 'merge dans le nant par del le monde, comment ce nant extra
mondain peut-il fonder ces petits lacs de non-tre que nous rencon
t rons chaque instant au sein de l 'tre ? Je dis que Pierre n'est pas
l , que je n' ai plus d'argent , etc. Faut-il vraiment dpasser le
monde vers le nant et revenir ensuite jusqu' l'tre pour fonder ces
j ugements quotidiens ? Et comment l'opration peut-elle se faire ? II
ne s'agit nul l ement de faire glisser le monde dans le nant, mais
si mplement, en se tenant dans l es limites de l'tre, de refuser un
attribut un sujet. Di ra-t-on que chaque attribut refus, chaque tre
ni est happ par un seul et mme nant extra-mondain, que le non
tre est comme l e plein de ce qui n'est pas, que le monde est en
suspens dans le non-tre, comme l e rel au sein des possibles ? En ce
cas, i l faudrait faire que chaque ngation et pour origine un
dpassement particulier : l e dpassement de l 'tre vers l'autre. Mais
qu' est-ce que ce dpassement, sinon tout simplement la mdiation
hglienne - et n'avons-nous pas dj et vainement demand
Hegel le fondement nantisant de la mdiation ? Et d' ai l leurs, si
mme l'explication valait pour les ngations radicales et simples qui
refusent un objet dtermin toute espce de prsence au sein de
l ' tre (( le Centaure n'existe pas Il n
'
y a pas de raison pour qu'il
soi t en retard - Les anciens Grecs ne pratiquaient pas la
polygamie ) et qui, la rigueur, peuvent contribuer constituer le
nant comme une sorte de lieu gomtrique de tous l es projets
manqus, de toutes les reprsentations inexactes, de tous les tres
disparus ou dont l'ide est seulement forge, cette interprtation du
non-tre ne vaudrait plus pour un certain type de ralits - vrai
di re l es plus frquentes - qui i ncluent le non-tre dans leur tre.
Comment admettre, en effet, qu'une partie d'elles soit dans l'univers
et toute une autre partie dehors dans le nant extra-mondain ?
Prenons, par exemple, la notion de distance, qui conditionne la
dtermination d' un emplacement , l a localisation d'un poi nt. Il est
facile de voir qu' el le possde un moment ngatif : deux points sont
distants lorsqu'ils sont spars par une certaine longueur. C'est dire
que la longueur, attri but positif d' un segment de droite, intervient ici
titre de ngation d'une proximit absolue et i ndi ffrencie. On
voudra peut-tre rduire la distance n'tre que l a longueur du
segment dont les deux points considrs, A et B, seraient l es limites.
Mais ne voit-on pas qu'on a chang la direction de l'attention, dans ce
cas, et que l'on a, sous le couvert du mme mot, donn un autre objet
l ' i ntui ti on ? Le complexe organis qui est constitu par le segment
avec ses deux termes-limites peut fourni r en effet deux objets
diffrents la connaissance . On peut en effet se donner le segment
comme objet i mmdiat de l ' i ntuition ; auquel cas ce segment figure
une tension pleine et concrte dont la longueur est un attribut positif
et les deux points A et B n'apparaissent que comme un moment de
54
l'ensemble, c'est--dire en tant qu'ils sont impliqus par le segment
lui-mme comme ses l i mi tes ; alors la ngation expulse du segment et
de sa longueur se rfugie dans l es deux limites : dire que l e point B est
limite du segment, c'est dire que l e segment ne s'tend pas au-del de
ce poi nt. La ngation est ici structure secondaire de l'objet. Si au
contraire on dirige son attention sur les deux points A et B, ils
s'enlvent comme objets immdiats de l ' i ntuition, sur fond d'espace.
Le segment s'vanouit comme objet plein et concret, i l est saisi
partir des deux points comme le vide , le ngatif qui les spare : l a
ngation s'chappe des points, qui cessent d'tre limites, pour
imprgner l a longueur mme du segment titre de distance. Ainsi la
forme totale constitue par le segment et ses deux termes avec l a
ngation intrastructurale est susceptible de se laisser saisir de deux
manires. Ou pl utt, il y a deux formes et la condition de l'apparition
de l'une est la dsagrgation de l'autre, exactement comme, dans la
percepti on, on constitue tel objet comme forme en repoussant tel
autre objet j usqu' en faire unfond et rciproquement. Dans les deux
cas, nous trouvons la mme quantit de ngation qui tantt passe
dans la notion de limites et tantt dans la notion de distance, mais qui,
en aucun cas, ne peut tre supprime. Dira-t-on que l' ide de distance
est psychologique et qu'elle dsigne seulement l'tendue qu'il faut
franchir pour al l er du point A au point B ? Nous rpondrons que l a
mme ngation est i ncluse dans ce franchir puisque cette notion
exprime prcisment la rsistance passive de l'loignement. Nous
admettrons volontiers avec Hei degger que la ralit-humaine est
dsloignante c'est--dire qu'elle surgit dans le monde comme ce
qui cre, et, la fois, fait s'vanouir les distances (ent-fernend). Mais
ce dsloignement, mme s' il est la condition ncessaire pour qu' i l y
ait en gnral un loignement, enveloppe l'loignement en lui
mme comme la structure ngative qui doit tre surmonte. En vain
tentera-t-on de rduire l a distance au simple rsultat d'une mesure :
ce qui est apparu, au cours de la description qui prcde, c'est que les
deux points et l e segment qui est compris entre eux ont l'unit
indissoluble de ce que les Allemands appellent une Gestalt La
ngation est le ciment qui ralise cette unit. Elle dfinit prcisment
le rapport immdiat qui lie ces deux points et qui les prsente
l'intuition comme l'unit i ndissolubl e de la distance. Cette ngation,
vous la couvrez seulement si vous prtendez rduire l a distance la
mesure d'une longueur, car c'est el l e qui est l a raison d' tre de cette
mesure.
Ce que nous venons de montrer par l'examen de la distance, nous
aurions pu tout aussi bien le faire voi r en dcrivant des ralits comme
l'absence, l'altration, l'altrit, l a rpulsi on, le regret, l a distraction,
etc. Il existe une quantit i nfinie de ralits qui ne sont pas seulement
objets de jugement, mais qui sont prouves, combattues, redoutes,
55
etc. , par l'tre humain, et qui sont habites par la ngation dans leur
intrastructure, comme par une condition ncessaire de leur existence.
Nous les appellerons des ngatits. Kant en avait entrevu l a porte
lorsqu' il parlait de concepts limitatifs (i mmortalit de l'me), sortes
de synthses entre l e ngatif et l.e positif, o l a ngation est condition
de positivit. La fonction de l a ngation varie suivant l a nature de
l'objet considr : entre l es ralits pleinement positives (qui pour
tant retiennent l a ngation comme condition de l a nettet de leurs
contours, comme ce qui les arrte ce qu'elles sont) et celles dont la
positivit n'est qu'une apparence qui dissimule un trou de nant tous
les i ntermdiaires sont possibl es. Il devient i mpossible, en tout cas, de
rejeter ces ngations dans un nant extramondain puisqu'elles sont
disperses dans l ' tre, soutenues par l'tre et conditions de la ral i t.
L nant ultra-mondain rend compte de l a ngation absolue ; mais
nous venons de dcouvrir un pullulement d'tres intra-mondains qui
possdent autant de ralit et d'efficience que les autres tres, mais
qui enferment en eux du nontre. Il s requirent une explication qui
demeure dans les l i mites du rel . Le nant , s'il n'est soutenu par
l ' tre, se dissipe en tant que nant, et nous retombons sur l'tre. Le
nant ne peut se nantiser que sur fond d'tre : si du nant peut tre
donn, ce n'est ni avant ni aprs l ' tre, ni, d'une manire gnrale, en
dehors de l'tre, mais c'est au sei n mme de l'tre, en son cur,
comme un ver.
v
L' ORI GI NE DU NANT
Il convient prsent de jeter un coup d' i l en arrire et de mesurer
le chemin parcouru. Nous avons pos d'abord l a question de ,'tre.
Pui s, nous retournant sur cette question mme, conue comme un
type de conduite humaine, nous l ' avons interroge son tour. Nous
avons alors d reconnatre que , si la ngation n'existait pas, aucune
question ne saurait tre pose, en particulier celle de l'tre. Mais cette
ngation el le-mme, envisage de pl us prs, nous a renvoy au nant
comme son origine et son fondement : pour qu'il y ait de l a ngation
dans l e monde et pour que nous puissions, par consquent, nous
interroger sur l'tre, i l faut que l e nant soit donn en quelque faon.
Nous nous sommes aperu qu'on ne pouvait concevoir l e nant en
dehors de l'tre, ni comme notion complmentaire et abstraite, ni
comme mi lieu i nfi ni o l'tre serait en suspens. Il faut que le nant
soit donn au cur de ,'tre, pour que nous puissions saisir ce type
56
particulier de ralits que nous avons appeles des ngatits. Mais ce
nant intra-mondain, l ' tre-en-soi ne saurait le produire : la notion
d'tre comme pleine positivit ne contient pas le nant comme une de
ses structures. On ne peut mme pas dire qu'elle en est exclusive : el l e
est sans rapport aucun avec l ui . De l la question qui se pose nous
prsent avec une urgence particulire : si le nant ne peut tre conu
ni en dehors de l'tre ni partir de l 'tre et si, d'autre part , tant non
tre, il ne peut tirer de soi l a force ncessaire pour { se nantiser
d'o vient le nant ?
Si l'on veut serrer de prs le problme, il faut d'abord reconnatre
que nous ne pouvons concder au nant la proprit de { se
nantiser . Car, bien que le verbe { se nantiser ait t conu pour
ter au nant jusqu'au moindre semblant d'tre, i l faut avouer que
seul l'tre peut se nantiser, car, de quel que faon que ce soit, pour se
nantiser il faut tre. Or, le nant n 'est pas. Si nous pouvons en
parler, c'est qu'il possde seulement une apparence d'tre, un tre
emprunt, nous l'avons not plus haut. Le nant n'est pas, le nant
est t ; l e nant ne se nantise pas, le nant { est nantis .
Reste donc qu' i l doi t exister un tre -qui ne saurait tre l'en-soi
et qui a pour proprit de nantiser le nant , de le supporter de son
tre, de l'tayer perptuellement de son existence mme, un tre par
quoi le nant vient aux choses. Mais comment cet tre doi t-il tre par
rapport au nant pour que, par l ui , le nant vienne aux choses ? Il faut
observer d'abord que l'tre envisag ne peut tre passif par rapport au
nant : il ne peut le recevoir ; le nant ne pourrait venir cet tre
sinon par un autre tre -ce qui nous renverrait l' i nfi ni . Mais,
d'autre part, l'tre par qui l e nant vient au monde ne peut produire le
nant en demeurant indiffrent cette producti on, comme l a cause
stocienne qui produit son effet sans s'altrer. I l serait i nconcevable
qu'un tre qui est pleine positivit maintienne et cre hors de soi un
nant d' tre transcendant, car i l n'y aurait rien en l'tre par quoi l'tre
puisse se dpasser vers le non-tre. L'tre par qui le nant arrive dans
le monde doit nantiser le nant dans son tre et, mme ainsi, il
courrait encore le risque d'tablir le nant comme un transcendant au
cur mme de l'immanence, s'il ne nantisait le nant dans son tre
propos de son tre. L'tre par qui le nant arrive dans le monde est un
tre en qui , dans son tre, il est question du nant de son tre : l'tre
par qui le nant vient au monde doit lre son propre nant. Et par l i l
faut entendre non un acte nantisant, qui requerrait son tour un
fondement dans l ' tre, mai s une caractristique ontologique de l'tre
requis. Reste savoir dans quelle rgion dlicate et exquise de l'tre
nous rencontrerons l'tre qui est son propre nant.
Nous serons aid dans notre recherche par un examen plus complet
de la conduite qui nous a servi de point de dpart. Il faut donc reveni r
l'interrogati on. Nous avons vu, on s'en souvient, que toute question
57
pose, par essence, l a possibilit d'une rponse ngative. Dans l a
question on i nterroge un tre sur son tre ou sur sa manire d'tre. Et
cette mani re d'tre ou cet tre est voil : une possibilit reste
toujours ouverte pour qu' i l se dvoile comme un nant . Mais du fait
mme qu'on envisage qu'un existant peut toujours se dvoiler comme
rien, toute question suppose qu'on ralise un recul nantisant par
rapport au donn, qui devient une simple prsentation, oscillant entre
l 'tre et l e nant. Il i mporte donc que le questionneur ait la possibilit
permanente de se dcrocher des sries causales qui constituent l 'tre
et qui ne peuvent produire que de l'tre. Si nous admettions en effet
que la question est dtermine dans le questionneur par le dtermi
nisme universel , elle cesserait non seulement d'tre intelligi bl e, mais
mme concevabl e. Une cause relle, en effet, produit un effet rel et
l ' tre caus est tout entier engag par la cause dans l a positivit : dans
l a mesure o i l dpend dans son tre de l a cause, i l ne saurait y avoir
en lui l e moi ndre germe de nant ; en tant que l e questionneur doit
pouvoir oprer par rapport au questionn une sorte de recul
nantisant, il chappe l'ordre causal du monde, i l se dsenglue de
l 'tre. Cela signifie que, par un double mouvement de nantisation, il
nantise l e questionn par rapport lui, en l e plaant dans un tat
neutre, entre l 'tre et l e non-tre -et qu'i l se nantise lui-mme par
rapport au questionn en s'arrachant l'tre pour pouvoir sortir de
soi la possibilit d'un non-tre. Ainsi, avec l a question, une certaine
dose de ngatit est i ntroduite dans l e monde : nous voyons le nant
iriser le monde, chatoyer sur les choses. Mais, en mme temps, l a
question mane d' un questionneur qui se motive l ui -mme dans son
tre comme questionnant, en dcollant de l'tre. Elle est donc, par
dfi ni ti on, un processus humai n. L'homme se prsente donc, au
moins dans ce cas, comme un tre qui fait clore l e nant dans l e
monde, en tant qu' i l s'affecte lui-mme de non-tre cette fin.
Ces remarques peuvent nous servir de fil conducteur pour examiner
l es ngatits dont nous parlions prcdemment . A n'en point douter
ce sont des ralits transcendantes : l a distance, par exemple,
s'impose nous comme quel que chose dont i l faut tenir compte, qu'il
faut franchir avec effort . Pourtant ces ralits sont d'une nature trs
particulire : el l es marquent toutes i mmdiatement un rapport essen
tiel de l a ralit-humaine au monde. El l es tirent leur origine d'un acte
de l 'tre humai n, ou d' une attente ou d'un projet, el l es marquent
toutes un aspect de l 'tre en tant qul apparat l'tre humain qui
s'engage dans l e monde. Et les rapports de l'homme au monde
qu' i ndi quent l es ngatits n'ont rien de commun avec les relations a
posteriori qui se dgagent de notre activit empirique. Il ne s'agit pas
non plus de ces rapports d'ustellsilit par quoi les objets du monde se
dcouvrent , sel on Hei degger, la ralit-humaine Toute nga
tit apparat plutt comme une des conditions essentielles de ce
58
rapport d'ustensilit. Pour que la totalit de l'tre s'ordonne autour
de nous en ustensiles, pour qu'elle se morcelle en complexes
diffrencis qui renvoient les uns aux autres et qui peuvent servir, i l
faut que l a ngation surgisse, non comme une chose parmi d'autres
choses, mais comme une rubrique catgorielle prsidant l'ordon
nance et la rpartition des grandes masses d'tre en choses. Ainsi la
surrection de l'homme au milieu de l'tre qui l'investit fait que se
dcouvre un monde. Mais le moment essentiel et primordial de cette
surrection, c'est l a ngation. Ainsi avons-nous atteint l e terme
premier de cette tude : l'homme est l'tre par qui le nant vient au
monde. Mais cette question en provoque aussitt une autre : Que
doit tre l' homme en son tre pour que par lui le nant vienne
l'tre ?
L'tre ne saurait engendrer que l'tre et, si l'homme est englob
dans ce processus de gnration, il ne sortira de lui que de l'tre. S'il
doit pouvoir i nterroger sur ce processus, c'est--dire le mettre en
questi on, i l faut qu' il puisse l e teni r sous sa vue comme un ensemble,
c'est--dire se mettre lui-mme en dehors de l'tre et du mme coup
affaiblir l a structure d'tre de l'tre. Toutefois i l n'est pas donn la
ralit-humaine d'anantir, mme provisoirement, l a masse d'tre qui
est pose en face d' el le. Ce qu'elle peut modifier, c'est son rapport
avec cet tre. Pour elle, mettre hors de circuit un existant particulier,
c'est se mettre elle-mme hors de circuit par rapport cet existant. En
ce cas elle lui chappe, elle est hors d'atteinte, i l ne saurait agir sur
elle, elle s'est retire par-del un nant. Cette possibilit pour la
ralit-humaine de scrter un nant qui l'isole, Descartes, aprs les
Stociens, lui a donn un nom : c'est l a libert. Mais la libert n'est ici
qu'un mot. Si nous voulons pntrer plus avant dans la question, nous
ne devons pas nous contenter de cette rponse et nous devons nous
demander prsent : Que doit tre l a libert humaine si l e nant doit
venir par elle au monde ?
Il ne nous est pas encore possible de traiter dans toute son ampleur
le problme de l a libert. 1 En effet les dmarches que nous avons
accomplies jusqu'ici montrent clairement que la libert n'est pas une
facult de l' me humaine qui pourrait tre envisage et dcrite
isolment. Ce que nous cherchions dfinir, c'est l' tre de l'homme
en tant qu'il conditionne l'apparition du nant et cet tre nous est
apparu comme libert. Ainsi la libert comme condition requise la
nantisation du nant n'est pas une proprit qui appartiendrait, entre
autres, l 'essence de l'tre humain. Nous avons dj marqu
d'ailleurs que l e rapport de l'existence l'essence n'est pas chez
l'homme semblable ce qu' i l est pour les choses du monde. La libert
humaine prcde l'essence de l'homme et l a rend possible, l 'essence
1. Cf. IV partie, chapitre premier.
59
de l'tre humai n est en suspens dans sa libert. Ce que nous appelons
libert est donc impossible distinguer de l'tre de la ralit-humaine.
L' homme n'est point d'abord pour tre libre ensuite, mais i l n'y a pas
de di ffrence entre l 'tre de l ' homme et son tre libre . Il ne s'agit
donc pas ici d'aborder de front une question qui ne pourra se traiter
exhaustivement qu' l a lumire d'une lucidation rigoureuse de l'tre
humain ; mais nous avons traiter de la libert en liaison avec le
problme du nant et dans la stricte mesure o elle conditionne son
appari ti on.
Ce qui parat d' abord avec vidence c'est que l a ralit-humaine ne
peut s'arracher au monde -dans la question, l e doute mthodique,
le doute sceptique, l ' bwX1, etc. - que si , par nature, elle est
arrachement elle-mme. C'est ce que Descartes avait vu, qui fonde
le doute sur la l i bert en rclamant pour nous l a possibilit de
suspendre nos j ugements -et Alain aprs l ui . C'est aussi en ce sens
que Hegel affirme la libert de l'esprit, dans la mesure o l'esprit est
la mdiati on, c'est -dire le Ngatif. Et d'ailleurs, c'est une des
directions de la philosophie contemporaine que de voir dans l a
conscience humaine une sorte d'chappement soi : tel est le sens de
la transcendance heideggerienne ; l'intentionnalit de Husserl et de
Brentano a elle aussi, plus d' un chef, le caractre d' un arrachement
soi . Mais ce n'est pas encore comme i ntrastructure de l a conscience
que nous envisagerons l a libert : nous manquons pour l'instant des
instruments et de l a technique qui nous permettraient de mener bien
cette entreprise. Ce qui nous intresse prsentement, c'est une
opration temporelle, puisque l' interrogation est, comme le doute,
une conduite : elle suppose que l'tre humain repose d'abord au sein
de l'tre et s' en arrache ensuite par un recul nantisant. C'est donc un
rapport soi au cours d' un processus temporel que nous envisageons
ici comme condition de la nantisation. Nous voulons simplement
montrer qu' en assi mi lant l a conscience une squence causale
indfi ni ment continue, on la transmue en une plnitude d'tre et,
par l, on l a fait rentrer dans l a totalit i l l i mite de l'tre, comme le
marque bien la vanit des efforts du dterminisme psychologique
pour se dissocier du dterminisme universel et pour se constituer
comme srie part. La chambre de l'absent, les livres qu' i l feui l letait;
les objets qu' i l touchait ne sont , par eux-mmes, que des livres, des
objets, c'est--dire des actualits pleines : les traces mmes qu' i l a
l aisses ne peuvent tre dchiffres comme traces de l ui qu'
l'intrieur d'une si tuati on o il est dj pos comme absent ; l e livre
corn, aux pages uses, n'est pas par lui-mme un livre que Pierre a
feuillet , qu' i l ne feuillette pl us : c'est un volume aux pages replies,
fatigues, i l ne peut renvoyer qu' soi ou des objets prsents, la
lumire qui l'claire, la table qui le supporte, si on le considre
comme la motivation prsente et transcendante de ma perception ou
60
mme comme le flux synthtique et rgl de mes i mpressions
sensibles. II ne servirait rien d'invoquer une association par
contigut, comme Platon dans le Phdon, qui ferait paratre une
image de l'absent en marge de la perception de l a lyre ou de la cithare
qu'il a touches. Cette image, si on la considre en elle-mme et dans
l'esprit des thories classiques, est une certaine plnitude, c'est un fait
psychi que concret et positi f. . Par suite i l faudra porter sur elle un
jugement ngatif double face : subjectivement, pour signifier que
l'image n'est pas une perception - objectivement pour nier de ce
Pierre dont je forme l 'image qu'il soit l prsentement. C'est le
fameux problme des caractristiques de l'image vraie, qui a proc
cup tant de psychologues, de Taine Spaier. L'association, on le
voit, ne supprime pas le problme : el le le repousse au niveau rflexif.
Mais de toute faon elle rclame une ngation, c'est--dire tout le
moins un recul nantisant de l a conscience vis--vis de l'image saisie
comme phnomne subjectif, pour la poser prcisment comme
n'tant qu'un phnomne subjectif. Or j'ai tent de montrer ai lleurs
1
que, si nous posons d'abord l'image comme une perception renais
sante, il est radicalement impossible de la distinguer ensuite des
perceptions actuelles. L'image doit enfermer dans sa structure mme
une thse nantisante. Elle se constitue comme image en posant son
objet comme existant ailleurs ou n'existant pas. Elle porte en elle une
double ngation : elle est nantisation du monde d'abord (en tant
qu'il n'est pas le monde qui offrirait prsentement titre d'objet
actuel de perception l'objet vis en image), nantisation de l'objet de
l'image ensuite (en tant qu' i l est pos comme non actuel) et, du mme
coup, nantisation d'elle-mme (en tant qu'elle n'est pas un processus
psychique concret et plein). En vai n invoquera-t-on, pour expliquer
que je saisis l'absence de Pierre dans la chambre, ces fameuses
intentions vides de Husserl, qui sont, pour une grande part,
constitutives de la perception. Il y a, en effet, entre les di ffrentes
intentions perceptives des rapports de motivation (mais la motivation
n'est pas la causation) et, parmi ces intentions, les unes sont pleines,
c'est--dire remplies par ce qu' elles visent, et les autres vides. Mais
comme prcisment la matire qui devrait remplir les intentions vides
n'est pas, ce ne peut tre elle qui les motive dans leur structure. Et
comme les autres intentions sont pleines, elles ne peuvent pas non
plus motiver les intentions vides en tant qu'elles sont vides. D'ai lleurs
ces intentions sont des natures psychiques et ce serait une erreur de
les envisager la manire de choses, c'est--dire de rcipients qui
seraient donns d'abord, qui pourraient tre, selon l es cas, vides ou
remplis et qui seraient, par nature, indi ffrents l eur tat de vi de ou
de remplissement. II semble que Husserl n'ait pas toujours chapp
1. L'Imagination, Alcan, 1936.
61
cette illusion chosiste. Pour tre vide, il faut qu'une intention soit
consciente d'elle-mme comme vide et prcisment comme vide de la
matire prcise qu'elle vise. Une intention vide se constitue elle
mme comme vide dans l'exacte mesure o elle pose sa matire
comme inexistante ou absente. En un mot, une intention vide est une
conscience de ngation qui se transcende vers un objet qu'elle pose
comme absent ou non existant . Ainsi, quelle que soit l'explication que
nous en donnions, l'absence de Pierre requiert, pour tre constate
ou sentie, un moment ngatif par lequel la conscience, en l'absence de
toute dtermination antrieure, se constitue elle-mme comme nga
tion. En concevant, partir de mes perceptions de la chambre qu' i l
habi ta, cel ui qui n' est plus dans l a chambre, je suis de toute ncessit
amen a faire un acte de pense qu'aucun tat antrieur ne peut
dterminer ni motiver, bref oprer en moi-mme une rupture avec
l'tre. Et, en tant que j 'use continuellement des ngatits pour isoler
et dterminer les existants, c'est--dire pour les penser, l a succession
de mes consciences est un perptuel dcrochage de l'effet par
rapport la cause, puisque tout processus nantisant exige de ne tirer
sa source que de lui-mme. En tant que mon tat prsent serait un
prolongement de mon tat antrieur, toute fissure par o pourrait se
glisser l a ngation serait entirement bouche. Tout processus
psychique de nantisation implique donc une coupure entre le pass
psychique immdiat et le prsent. Cette coupure est prcisment le
nant. Au moins, dira-t-on, reste-t-il l a possibilit d'i mplication
successive entre l es processus nantisants. Ma constatation de
l'absence de Pierre pourrait encore tre dterminante pour mon
regret de ne pas le voir ; vous n'avez pas exclu l a possibilit d'un
dterminisme des nantisations. Mais, outre que l a premire nanti
sation de la srie doit ncessairement tre dcroche des processus
positifs antrieurs, que peut bien signifier une motivation du nant
par l e nant ? Un tre peut bien se nantiser perptuellement, mais
dans la mesure o i l se nantise i l renonce tre l'origine d'un autre
phnomne, ft-ce une seconde nantisation.
Reste expliquer quelle est cette sparation, ce dcollement des
consciences qui conditionne toute ngation. Si nous considrons la
conscience antrieure envisage comme motivation, nous voyons tout
de suite avec vidence que rien n'est venu se glisser entre cet tat et
l'tat prsent. Il n'y a pas eu de solution de continuit dans le flux du
droulement temporel : sinon nous reviendrions l a conception
inadmissibl e de l a divisibilit infinie du temps et du point temporel ou
instant comme limite de la divisi on. Il n'y a pas eu non plus
intercalage brusque d' un lment opaque qui aurait spar l 'antrieur
du postrieur comme une lame de couteau spare un fruit en deux. Ni
non plus d'affaiblissement de la force motivante de l a conscience
antrieure : el l e demeure ce qu'elle est, elle ne perd rien de son
62
urgence. Ce qui spare l'antrieur du postri eur, c'est prcisment
rien. Et ce rien est absolument infranchissable, justement parce qu'il
n'est rien ; ca, dans tout obstacle franchir, i l y a un positif qui se
donne comme devant tre franchi. Mais dans le cas qui nous occupe,
vainement chercherait-on une rsistance briser, un obstacle
franchir. La conscience antrieure est toujours l (encore qu'avec la
modification de passit ) , el l e entretient toujours une relation
d'interpntration avec la conscience prsente, mais sur le fond de ce
rapport existentiel, elle est mise hors jeu, hors de circuit, entre
parenthses, exactement comme l'est, aux yeux de celui qui pratique
l'broX' phnomnologique, l e monde en lui et hors de lui. Ainsi l a
condition pour que la ralit-humaine puisse nier tout ou partie du
monde, c'est qu' el l e porte l e nant en elle comme le rien qui spare
son prsent de tout son pass. Mais ce n'est pas tout encore, car ce
rien envisag n'aurait pas encore le sens du nant : une suspension de
l'tre qui resterait innomme, qui ne serait pas conscience de
suspendre l'tre , viendrait du dehors de la conscience et aurait pour
effet de la couper en deux, en rintroduisant l'opacit au sein de cette
lucidit absolue
'
. En outre, ce rien ne serait nullement ngatif. Le
nant , nous l'avons vu plus haut, est fondement de la ngation parce
qu'il la recle en lui , parce qu' i l est la ngation comme tre. Il faut
donc que l 'tre conscient se constitue lui-mme par rapport son
pass comme spar de ce pass par un nant ; il faut qu'il soit
conscience de cette coupure d'tre, mais non comme un phnomne
qu'il subit : comme une structure conscientielle qu'il est. La libert
c'est l'tre humain mettant son pass hors de jeu en scrtant son
propre nant. Entendons bien que cette ncessit premire d'tre son
propre nant n' apparat pas l a conscience par intermittence et
l'occasion de ngations singulires : il n'est pas de moment de la vie
psychique o n'apparaissent, titre de structures secondaires au
moins, des conduites ngatives ou interrogatives ; et c'est continuelle
ment que la conscience se vit el l e-mme comme nantisation de son
tre pass.
Mais on croira sans doute pouvoir nous renvoyer ici une objection
dont nous nous sommes frquemment servi : si la conscience nanti
sante n'existe que comme conscience de nantisation, on devrait
pouvoir dfinir et dcrire un mode perptuel de conscience, prsent
comme consci ence, et qui serait conscience de nantisation. Cette
conscience existe-t-el l e ? Voil donc la nouvelle question qui est
souleve ici : si la libert est l'tre de l a conscience, la conscience doit
tre comme conscience de libert . Quelle est la forme que prend cette
conscience de l i bert ? Dans la l i bert l'tre humain est son propre
pass (comme aussi son avenir propre) sous forme de nantisation. Si
1. Voir Introduction : III.
63
nos analyses ne nous ont pas gar, il doit exister pour l'tre humain,
en tant qu' i l est conscient d'tre, une certaine manire de se tenir en
face de son pass et de son avenir comme tant, la fois, ce pass et
cet avenir et comme ne les tant pas. Nous pourrons fournir cette
question une rponse immdiate : c'est dans l'angoisse que l'homme
prend conscience de sa libert ou, si l' on prfre, l'angoisse est le
mode d'tre de la libert comme conscience d'tre, c'est dans
l ' angoisse que la libert est dans son tre en question pour ellemme.
Ki erkegaard dcrivant l'angoisse avant la faute la caractrise
comme angoisse devant la libert. Mais Heidegger, dont on sait
combien il a subi l ' i nfluence de Ki erkegaard l, considre au contraire
l ' angoisse comme la saisie du nant. Ces deux descriptions de
l ' angoisse ne nous paraissent pas contradictoires : elles s'impliquent
l'une l'autre au contraire.
II faut donner raison d'abord Ki erkegaard : l ' angoisse se distin
gue de l a peur par ceci que la peur est peur des tres du monde et que
l ' angoisse est angoisse devant moi. Le vertige est angoisse dans la
mesure o je redoute non de tomber dans l e prcipice mais de m'y
jeter. Une situation qui provoque la peur en tant qu'elle risque de
modifier du dehors ma vie et mon tre provoque l'angoisse dans la
mesure o je me dfie de mes ractions propres cette situation. La
prparation d'arti llerie qui prcde l'attaque peut provoquer la peur
chez le soldat qui subit le bombardement, mais l'angoisse commen
cera chez lui quand il essaiera de prvoir les conduites qu' i l opposera
au bombardement, lorsqu'il se demandera s'il va pouvoir tenir .
Pareillement le mobilis qui rejoint son dpt au commencement de
la guerre peut, en certains cas, avoir peur de la mort ; mais, beaucoup
pl us souvent, il a peur d'avoir peur , c'est--dire qu'il s'angoisse
devant l ui -mme. La pl upart du temps les situations prilleuses ou
menaantes sont facettes : elles seront apprhendes travers un
sentiment de peur ou un sentiment d'angoisse selon qu'on envisagera
la situation comme agissant sur l ' homme ou l'homme comme agissant
sur la situati on. L'homme qui vient de recevoir un coup dur de
perdre dans un krach une grosse partie de ses ressources, peut avoir
peur de la pauvret menaante . Il s'angoissera l'instant d'aprs
quand, en se tordant nerveusement les mains (raction symbolique
l'action qui s'impose mais qui demeure entirement indtermine), il
s'crie : Qu' est-ce que je vais faire ? Mais qu'est-ce que je vais
faire ? En ce sens la peur et l'angoisse sont exclusives l'une de
l' autre, puisque la peur est apprhension irrflchie du transcendant
et l ' angoisse apprhension rflexive du soi , l' une nat de la destruction
de l'autre et le processus normal, dans le cas que je viens de citer, est
un passage constant de l'une l'autre. Mais i l existe aussi des
1 . J. Wahl : Etudes kierkegaardiennes : Kierkegaard et Heidegger.
64
situations o l'angoisse apparat pure, c'est--dire sans tre jamais
prcde ni suivie de l a peur. Si , par exemple, on m'a lev une
dignit nouvelle et charg d'une mission dlicate et flatteuse, je puis
m'angoisser la pense que je ne serai pas capable, peut-tre, de la
rempl i r, sans avoir peur le moins du monde des consquences de mon
chec possible.
Que signifie l'angoisse, dans les di ffrents exemples que je viens de
donner ? Reprenons l'exemple du vertige. Le vertige s'annonce par la
peur : je suis sur un sentier troit et sans parapet qui longe un
prcipice. Le prcipice se donne moi comme viter, il reprsente
un danger de mort. En mme temps je conois un certain nombre de
causes relevant du dterminisme universel qui peuvent transformer
cette menace de mort en ralit : je peux glisser sur une pierre et
tomber dans l 'abme, la terre friable du sentier peut s'effondrer sous
mes pas. A travers ces diffrentes prvisions, je suis donn moi
mme comme une chose, je suis passif par rapport ces possibilits,
elles viennent moi du dehors ; en tant que je suis aussi un objet du
monde, soumis l'attraction universel l e, ce ne sont pas mes possibi
lits. A ce moment apparat la peur qui est saisie de moi-mme
partir de la situation comme transcendant destructible au milieu des
transcendants, comme objet qui n'a pas en soi l'origine de sa future
disparition. La raction sera d'ordre rfexi f : je ferai attention
aux pierres du chemin, je me tiendrai le plus loin possible du bord du
sentier. Je me ralise comme repoussant de toutes mes forces l a
situation menaante et je projette devant moi un certain nombre de
conduites futures destines loigner de moi l es menaces du monde.
Ces conduites sont mes possi bi l i ts. J'chappe l a peur du fait mme
que je me place sur un plan o mes possibilits propres se substituent
des probabilits transcendantes o l'activit humaine n'avait aucune
place. Mais ces conduites, prcisment parce qu'elles sont mes
possibilits, ne m'apparaissent pas comme dtermines par des causes
trangres. Non seulement i l n'est pas rigoureusement certain
qu'elles seront efficaces, mais surtout il n'est pas rigoureusement
certain qu'elles seront tenues, car elles n'ont pas d'existence suffi
sante par soi ; on pourrait dire, en abusant du mot de Berkeley, que
leur tre est un tre-tenu et que l eur possibilit d'tre n'est
qu'un devoir-tre-tenu 1 . De ce fait leur possibilit a pour condition
ncessaire la possibilit de conduites contradictoires (ne pas faire
attention aux pierres du chemi n, courir, penser autre chose) et la
possibilit des conduites contraires (aller me jeter dans le prcipice).
Le possible que je fais mon possi bl e concret ne peut paratre comme
mon possible qu'en s'enlevant sur le fond de l'ensemble des possibles
1 . Nous reviendrons sur les possibles dans la deuxime partie de cet
ouvrage.
65
logiques que comporte la situation. Mais ces possibles refuss, leur
tour, n'ont d'autre tre que leur tre-tenu , c'est moi qui les
maintiens dans l'tre et, inversement, leur non-tre prsent est un
ne pas devoir tre tenu . Nulle cause extrieure ne les cartera.
Moi seul je suis la source permanente de leur non-tre, je m'engage
en eux ; pour faire paratre mon possible, je pose les autres possibles
afin de les nanti r. Cela ne produirait pas l' angoisse si je pouvais me
saisir moi-mme dans mes rapports avec ces possibles comme une
cause produisant ses effets. En ce cas l ' effet dfini comme mon
possibl e serai t rigoureusement dtermin. Mais il cesserait alors
d'tre possible, il deviendrait simplement -venir. Si donc je voulais
viter l 'angoisse et l e vertige, i l suffirait que je puisse considrer les
motifs (i nstinct de conservation, peur antrieure, etc.) qui me font
refuser la situation envisage comme dterminante de ma conduite
antrieure, l a faon dont l a prsence, en un point dtermi n, d'une
masse donne est dterminante des trajets effectus par d'autres
masses : il faudrait que je saisisse en moi un rigoureux dterminisme
psychologique. Mais, prcisment, je m'angoisse parce que mes
conduites ne sont que possibles et cel a signifie justement que , tout en
constituant un ensemble de motifs de repousser cette situation, je
saisis au mme moment ces motifs comme insuffisamment efficaces.
Au moment mme o je me saisis moi-mme comme tant horreur du
prcipice, j 'ai conscience de cette horreur comme non dterminante
par rapport ma conduite possi bl e. En un sens, cette horreur appelle
une conduite de prudence, elle est, en el l e-mme, bauche de cette
conduite et, en un autre sens, elle ne pose les dveloppements
ultrieurs de cette conduite que comme possibles, prcisment parce
que j e ne la saisis pas comme cause de ces dveloppements ultrieurs,
mais comme exigence, appel , etc. , etc. Or, nous l'avons vu, la
conscience d'tre est l'tre de la conscience. Il ne s'agit donc pas ici
d'une contemplation que j e pourrais faire aprs coup d'une horreur
dj constitue : c'est l'tre mme de l'horreur de s'apparatre elle
mme comme n'tant pas cause de la conduite qu'elle appel l e. En un
mot, pour viter l a peur, qui me livre un avenir transcendant
rigoureusement dtermin , je me rfugie dans la rflexion, mais celle
ci n'a m'offrir qu'un avenir indtermin. Cela veut dire qu'en
constituant une certaine conduite comme possible et prcisment
parce qu'elle est mon possible, je me rends compte que rien ne peut
m'obliger tenir cette conduite. Pourtant je suis bien l-bas dans
l'avenir, c'est bien vers celui que je serai tout l'heure, au dtour du
sentier, que je me tends de toutes mes forces et en ce sens il y a dj
un rapport entre mon tre futur et mon tre prsent. Mais au sei n de
ce rapport, un nant s'est gliss : je ne suis pas celui que je serai.
D' abord je ne l e suis pas parce que du temps m'en spare. Ensuite
parce que ce que je suis n'est pas le fondement de ce que je serai.
66
Enfin parce qu'aucun existant actuel ne peut dterminer rigoureuse
ment ce que je vais tre. Comme pourtant je suis dj ce que je serai
(sinon je ne serai pas intress tre tel ou tel ), je suis celui que je
serai sur le mode de ne l'tre pas. C'est travers mon horreur que j e
suis port vers l'aveni r et elle se nantise en ce qu'elle constitue
l'avenir comme possible. C'est prcisment la conscience d'tre son
propre avenir sur le mode du n'tre-pas que nous nommerons
l'angoisse. Et, prcisment, l a nantisation de l'horreur comme motif,
qui a pour effet de renforcer l'horreur comme tat, a pour contrepar
tie positive l'apparition des autres conduites (en particulier de celle
qui consiste se jeter dans le prcipice) comme mes possibles
posibles. Si rien ne me contraint sauver ma vie, rien ne m'empche
de me prcipiter dans l'abme. La conduite dcisive manera d'un moi
que je ne suis pas encore. Ainsi le moi que j e suis dpend en lui-mme
du moi que j e ne suis pas encore, dans l'exacte mesure o le moi qu
je ne suis pas encore ne dpend pas du moi que j e suis. Et le vertige
apparat comme la saisie de cette dpendance. Je m'approche du
prcipice et c'est moi que mes regards cherchent en son fond. A partir
de ce moment , je joue avec mes possibles. Mes yeux, en parcourant
l'abme de haut en bas, miment ma chute possible et la ralisent
symboliquement ; en mme temps l a conduite de suicide, du fait
qu'elle devient mon possible possible, fait apparatre son tour
des motifs possibles de l ' adopter (le suicide ferait cesser l'angoisse).
Heureusement ces motifs leur tour, du seul fait qu' ils sont motifs
d'un possi bl e, se donnent comme inefficients, comme non dtermi
nants : ils ne peuvent pas plus produire le suicide que mon horreur de
la chute ne peut me dterminer l'viter. C'est cette contre-angoisse
qui en gnral fait cesser l'angoisse en l a transmuant en indcisi on.
L'indcisi on, son tour, appelle la dcision : on s'loigne brusque
ment du bord du prcipice et on reprend sa route.
L'exemple que nous venons d'analyser nous a montr ce que nous
pourrions appeler angoisse devant l'avenir . Il en existe une autre :
l'angoisse devant le pass. C'est celle du joueur qui a li brement et
sincrement dcid de ne plus jouer et qui , lorsqu'il s'approhe du
tapis vert }' , voit soudain fondre toutes ses rsolutions. On a
souvent dcrit ce phnomne comme si la vue de la table de jeu
rveillait en nous une tendance qui entrai t en conflit avec notre
rsolution antrieure et finissait par nous entraner malgr celle-ci .
Outre qu'une pareille description est faite en termes chosistes et
qu'elle peuple l'esprit de forces antagonistes (c'est, par exernrle, la
trop fameuse lutte de la raison contre les passions des moralistes) ,
elle ne rend pas compte des faits. En ralit - les lettres de
Dostoevsky sont l pour en tmoigner -i l n' y a ri en en nous qui
ressemble un dbat intrieur, comme si nous avions peser des
motifs et des mobiles avant de nous dcider. La rsolution antrieure
67
de ne plus jouer est toujours l et, dans la plupart des cas, l e
joueur mis en prsence de l a tabl e de jeu se retourne vers el l e pour lui
demander secours : car i l ne veut pas jouer ou pl utt, ayant pri s sa
rsolution l a veil l e, i l se pense encore comme ne voulant plus jouer, i l
croit une efficace de cette rsolution. Mais ce qu' i ! saisit alors dans
l'angoisse, c'est prcisment la totale i n efficience de l a rsolution
passe. Elle est l, sans doute, mais fige, i nefficace, dpasse du fait
mme que j ' ai conscience d' elle. El l e est moi encore, dans la mesure
o je ralise perptuellement mon identit avec moi-mme travers
le flux temporel , mais el l e n'est plus moi du fait qu'elle est pour ma
consci ence. Je lui chappe, el l e manque la mission que je lui avais
donne. L encore, je la suis sur l e mode du n'tre-pas. Ce que l e
joueur saisit cet instant, c'est encore l a rupture permanente du
dtermi ni sme, c'est le nant qui l e spare de l ui-mme : j'aurais tant
souhait ne plus jouer ; mme, j 'ai eu, hi er, une apprhension
synthtique de l a situation (ruine menaante, dsespoir de mes
proches) comme m'interdisant de jouer. Il me semblait que j'avais
ainsi constitu une barrire relle entre l e jeu et moi , et, voici que je
m'en aperois tout coup, cette apprhension synthtique n'est plus
qu'un souvenir d'ide, un souvenir de sentiment : pour qu'elle vienne
m'aider nouveau il faut que je la refasse ex nihilo et l ibrement ; elle
n' est plus qu'un de mes possibles, comme l e fait de jouer en est un
autre, ni plus ni moins. Cette peur de dsoler ma fami l l e, il faut que je
la retrouve, que je l a recre comme peur vcue, el l e se tient derrire
moi comme un fantme sans os, il dpend de moi seul que je lui prte
ma chair. Je suis seul et nu comme l a veille devant la tentation et,
aprs avoir difi patiemmen des barrages et des murs, aprs m'tre
enferm dans l e cercle magique d'une rsol uti on, je m'aperois avec
angoisse que rien ne m'empche de jouer. Et l'angoisse c'est moi,
puisque par le seul fait de me porter l'existence comme conscience
d'tre, je me fais n'tre pas ce pass de bonnes rsolutions que je suis.
En vain objecterait-on que cette angoisse a pour unique condition
l'ignorance du dterminisme psychologique sous-jacent : j e serais
anxi eux faute de connatre les mobiles rels et efficaces qui, dans
l'ombre de l'inconscient, dterminent mon action. Nous rpondrons
d' abord que l'angoisse ne nous est pas apparue comme une preuve de
l a libert humaine : celle-ci s'est donne nous comme l a condition
ncessaire de l ' interrogation. Nous voulions seulement montrer qu'il
existe une conscience spcifique de libert et nous avons voulu
montrer que cette conscience tait l ' angoisse. Cela signifie que nous
avons voulu tablir l 'angoisse dans sa structure essentielle comme
conscience de libert. Or, de ce point de vue, l'existence d'un
dterminisme psychologique ne saurait infirmer les rsultats de notre
description : ou bi en, en effet, l ' angoisse est ignorance ignore de ce
dterminisme - et alors el l e se saisit bien, en effet, comme libert.
68
Ou bi en on prtend que l 'angoisse est conscience d' i gnorer les causes
relles de nos actes. L'angoisse viendrait ici de ce que nous
pressentirions, tapis au fond de nous-mmes, des motifs monstru!ux
qui dclencheraient soudain des actes coupabl es. Mais en ce cas nous
nous apparatrions comme choses du monde et nous serions nous
mmes notre propre situation transcendante. Alors l'angoisse s'va
nouirait pour faire place la peur, car c' est l a peur qui est
apprhension synthtique du transcendant comme redoutable.
Cette l i bert , qui se dcouvre nous dans l'angoisse, peut se
caractriser par l'existence de ce rien qui s'insinue entre les motifs et
l'acte. Ce n'est pas parce que je sui s l i bre que mon acte chappe la
dtermination des motifs, mais, au contraire, l a structure des motifs
comme i nefficients est condition de ma libert. Et si l'on demande
quel est ce rien qui fonde l a lihert, nous rpondrons qu'on ne peut l e
dcri re, puisqu'il n'est pas, mais qu'on peut au moi ns en livrer l e sens,
en tant que ce rien est t par l'tre humain dans ses rapports avec lui
mme. Il correspond l a ncessit pour le motif de ne 'paratre
comme motif que comme corrlation d'une conscience de motif. En
un mot, ds que nous renonons l'hypothse des contenus de
conscience, nous devons reconnatre qu' i l n'y a jamais de motif dans
la conscience : il n'en est que pour la conscience. Et du fait mme que
le motif ne peut surgir que comme apparition, i l se constitue lui-mme
comme i nefficace. Sans doute n'a-t-il pas l'extriorit de la chose
temporo-spatiale, il appartient toujours la subjectivit et il est saisi
comme mien mais il est , par nature, transcendance dans l'immanence
et la conscience l ui chappe par le fait mme de le poser, puisque c'est
elle qu' i l incombe prsent de l ui confrer sa signification et son
importance. Ainsi le rien qui spare le motif de la conscience se
caractrise comme transcendance dans l'immanence ; c'est en se
produisant el l e-mme comme i mmanence que l a conscience nantise
le rien qui l a fait exister pour elle-mme comme transcendance. Mais
l'on voit que ce nant, qui est l a condition de toute ngation
transcendante, ne peut tre lucid qu' partir de deux autres
nantisations primordiales : 1 la conscience n'est pas son propre
motif en tant qu'elle est vide de tout contenu. Ceci nous renvoie une
structure nantisante du cogito prrflexif ; 2() la conscience est en
face de son pass et de son avenir comme en face d'un soi qu'elle est
sur le mode du n'tre-pas. Cela nous renvoie une structure
nantisante de la temporal i t.
Il ne saurai t tre encore question d'lucider ces deux types de
nantisation : nous ne disposons pas, pour le moment, des techniques
ncessaires. Il suffit de marquer que l'explication dfinitive de la
ngation ne pourra tre donne en dehors d'une description de la
conscience (de) soi et de la temporalit.
Ce qu' i l convient de noter ici, c'est que l a libert qui se manifeste
69
par l 'angoisse se caractrise par une obligation perptuellement
renouvele de refaire l e Moi qui dsigne l'tre libre. Lorsqu'en effet
nous montrions, tout l'heure, que mes possibles taient angoissants
parce qu'il dpendait de moi seul de les soutenir dans leur existence,
cela ne voulait pas dire qu'ils drivaient d'un moi qui , lui au moins,
serait donn d'abord et passerait, dans le flux temporel, d'une
conscience une autre conscience. Le joueur qui doit raliser
nouveau l'aperception synthtique d' une sluation qui lui interdirait
de jouer doit rinventer du mme coup l e moi qui peut apprcier cette
situation, qui est en situation . Ce moi , avec son contenu a priori et
historique, c'est l'essence de l'homme. Et l'angoisse comme manifes
tation de la libert en face de soi signifie que l'homme est toujours
spar par un nant de son essence. Il faut reprendre ici le mot de
Hegel : Wesen ist was gewesen ist. L'essence, c'est ce qui a t.
L'essence, c'est tout ce qu'on peut indiquer de l'tre humain par les
mots : cela est. Et de ce fait , c'est l a totalit des caractres qui
expliquent l'acte. Mais l'acte est toujours par del cette essence, i l
n'est acte humain qu'en tant qu'il dpasse toute explication qu'on en
donne, prcisment parce que tout ce qu'on peut dsigner chez
l'homme par l a formule : cela est, de ce fait mme a t. L'homme
emporte avec lui continuellement une comprhension prjudicative
de son essence mais de ce fait mme i l est spar d'elle par un nant.
L'essence, c'est tout ce que l a ralit-humaine saisit d'elle-mme
comme ayant t. Et c'est ici qu'apparat l'angoisse comme saisie du
soi en tant qu'il existe comme mode perptuel d'arrachement ce qui
est ; mieux encore : en tant qu'il se fait exister comme tel. Car nous ne
pouvons jamais saisir une comme une consquence
vivante de cette nature qui est l a ntre. L'coulement de notre
conscience constitue au fur et mesure cette nature, mais elle
demeure toujours derrire nous et elle nous hante comme l'objet
permanent de notre comprhension rtrospective. C'est en tant que
cette nature est une exigence sans tre un recours qu'elle est saisie
comme angoissante.
Dans l'angoisse la libert s'angoisse devant elle-mme en tant
qu'elle n'est j amais sollicite ni entrave par rien. Reste, dira-t-on,
que l a libert vient d'tre dfinie comme une structure permanente de
l'tre humain : si l'angoisse l a manifeste elle devrait tre un tat
permanent de mon affectivit. Or elle est, au contraire, tout fait
except i onnel l e. Comment expliquer la raret du phnomne
d' angoisse ?
Il faut noter tout d'abord que les situations les plus courantes de
notre vie, celles o nous saisissons nos possibles comme tels dans et
par la ralisation active de ces possibles, ne se manifestent pas nous
par l'angoisse parce que leur structure mme est exclusive de
l'apprhension angoisse. L'angoisse, en effet, est l a reconnaissance
70
d'une possibilit comme ma possibilit, c'est--dire qu'elle se consti
tue lorsque l a conscience se voit coupe de son essence par le nant
ou spare du futur par sa libert mme. Cela signifie qu'un rien
nantisant m'te toute excuse et que, en mme temps, ce que je
projette comme mon tre futur est toujours nantis et rduit au rang
de simple possibilit parce que le futur que je suis reste hors de mon
atteinte. Mais il convient de remarquer que, dans ces di ffrents cas,
nous avons affaire une forme temporelle o je m'attends dans le
futur, o je me donne rendez-vous de l'autre ct de cette heure, de
cette journe ou de ce mois . L'angoisse est la crainte de ne pas me
trouver ce rendez-vous, de ne plus mme vouloir m'y rendre. Mais
je puis aussi me trouver engag dans des actes qui me rvlent mes
possibili ts dans l ' instant mme o ils les ralisent. C'est en allumant
cette cigarette que j ' apprends ma possibilit concrte ou, si l'on veut,
mon dsir de fumer ; c'est par l ' acte mme d'attirer moi ce papier et
cette plume que je me donne comme ma possibilit la plus immdiate
l'action de travailler cet ouvrage : m'y voil engag et je l a dcouvre
dans l e moment mme o dj je m'y j ette. En cet instant, certes, elle
demeure ma possibilit, puisque j e puis chaque i nstant me
dtourner de mon travail, repousser le cahier, visser le capuchon de
mon stylo. Mais cette possibilit d'interrompre l'action est rejete au
second rang du fait que l'action qui se dcouvre moi travers mon
acte tend cristalliser comme forme transcendante et relativement
indpendante. La conscience de l'homme en action est conscience
irrflchie. Elle est conscience de quelque chose et le transcendant
qui se dcouvre elle est d' une nature particulire : c'est une
structure d'exigence du monde qui dcouvre corrlativement en elle
des rapports complexes d'ustensi li t. Dans l'acte de tracer les lettres
que j e trace, l a phrase totale, encore inacheve, se rvle comme
exigence passive d'tre trace. Elle est l e sens mme des lettres que j e
forme et son appel n'est pas mis en question puisque, justement, je ne
puis tracer l es mots sans les transcender vers elle et que je l a dcouvre
comme condition ncessaire du sens des mots que je trace. En mme
temps et dans le cadre mme de l'acte, un complexe indicatif
d'ustensiles se rvle et s'organise (plume-encre-papier-Iignes-marge,
etc. ), complexe qui ne peut tre saisi pour lui-mme mais qui surgit au
sein de l a transcendance qui me dcouvre la phrase crire comme
exigence passive. Ai nsi , dans la quasi-gnralit des actes quotidiens,
je suis engag, j 'ai pari et j e dcouvre mes possibles en l es ralisant
et dans l ' acte mme de les raliser comme des exigences, des
urgences, des ustensilits. Et sans doute, en tout acte de cette espce,
demeure-t-il l a possibilit d'une mise en question de cet acte, en tant
qu'il renvoie des fins plus lointaines et plus essentielles comme ses
significations ultimes et mes possibilits essentielles. Par exemple, la
phrase que j 'cris est l a significati on des lettres que je trace, mais
71
l'ouvrage entier que je veux produire est la signification de la phrase.
Et cet ouvrage est une possibilit propos de laquel le je peux sentir
l'angoisse : i l est vraiment mon possible et je ne sais si je le
continuerai demain ; demai n, par rapport lui , ma libert peut
exercer son pouvoir nantisant. Seulement , cette angoisse implique la
saisie de l' ouvrage en tant que tel comme ma possibilit : i l faut que je
me place di rectement en face de l ui et que je ralise mon rapport
l ui . Cela veut dire que je ne dois pas seulement poser son sujet des
questions objectives du type : Faut-il crire cet ouvrage ? car ces
questi ons me renvoient simplement des significations objectives
plus vastes, telles que : ( Est-il opportun de l'crire en ce moment ?
( Ne fait-il pas double emploi avec tel autre livre ? Sa matire est
elle d' un intrt suffisant ? A-t-elle t suffisamment mdite ? ,
etc. , toutes significations qui demeurent transcendantes et se donnent
comme une foule d'exigences du monde. Pour que ma libert
s'angoisse propos du livre que j 'cris, i l faut que ce livre apparaisse
dans son rapport avec moi , c'est--dire il faut que je dcouvre d' une
part mon essence en tant que ce que j' ai t (j'ai t voulant crire ce
livre , j e rai conu, j 'ai cru qu'il pouvait tre i ntressant de l'crire
et je me suis constitu de telle sorte qu'on ne peut plus me
comprendre sans tenir compte de ce que ce livre a t mon possible
essentiel ) ; d'autre part , l e nant qui spare ma libert de cette
essence U'ai t voulant l' crire , mais rien, mme pas ce que j'ai
t, ne peut me contraindre l'crire) ; enfin, le nant qui me spare
de ce que je serai (je dcouvre l a possibilit permanente de
l'abandonner comme l a condition mme de la possi bilit de l'crire et
comme l e sens mme de ma libert). Il faut que je saisisse ma libert,
dans l a constitution mme du livre comme mon possible, en tant
qu'elle est destructrice possible, dans le prsent et dans l'avenir, de ce
que je suis. C'est dire qu'il me faut me placer sur le plan de la
rflexi on. Tant que je demeure sur le plan de l'acte, l e livre crire
n'est que la signification lointaine et prsuppose de l'acte qui me
rvle mes possibles : il n' en est que l'implication, i l n'est pas
thmatis et pos pour soi, il fait pas question ; il n'est conu ni
comme ncessaire ni comme contingent, il n'est que le sens perma
nent et loi ntai n partir duquel je peux comprendre ce que j 'cris
prsentement et , de ce fait, il est conu comme tre, c'est--dire que
c'est seulement en le posant comme le fond existant sur lequel ma
phrase prsente et existante merge, que je peux confrer ma
phrase un sens dtermin. Or, nous sommes chaque instant lancs
dans le monde et engags. Cela signifie que nous agissons avant de
poser nos possibles et que ces possibles qui se dcouvrent comme
raliss ou en train de se raliser renvoient des sens qui ncessite
rai ent des actes spciaux pour tre mis en questi on. Le rveil qui
sonne le mati n renvoie l a possibi lit d'aller mon travail qui est ma
72
possibilit. Mais saisir l'appel du rveil comme appel, c'est se lever.
L'acte mme de se lever est donc rassurant. car il lude la question :
Est-ce que le travail est ma possibilit ? et par consquent il ne me
met pas en mesure de saisir l a possi bilit du quitisme, du refus de
travail et finalement du refus du monde et de la mort. En un mot,
dans la mesure o saisir le sens de l a sonnerie, c'est tre dj debout
son appel, cette saisie me garantit contre l'intuition angoissante que
c'est moi qui confre au rveil son exigence : moi et moi seul . De la
mme faon, ce qu'on pourrait appeler la moralit quotidienne est
exclusive de l'angoisse thique. II y a angoisse thique lorsque je me
considre dans mon rapport originel aux valeurs. Celles-ci , en effet,
sont des exigences qui rclament un fondement. Mais ce fondement
ne saurait tre en aucun cas l'/re, car toute valeur qui fonderait sa
nature idale sur son tre cesserait par l mme d'tre valeur et
raliserait l'htronomie de ma volont. La valeur tire son tre de son
exigence et non son exigence de son tre. Elle ne se livre donc pas
une intuition contemplative qui la saisirait comme lant valeur et par
l mme, lui terait ses droits sur ma libert. Mais elle ne peut se
dvoiler, au contraire, qu' une libert active qui l a fait exister
comme valeur du seul fait de la reconnatre pour telle. II s'ensuit que
ma libert est l'uni que fondement des valeurs et que rien, absolument
rien, ne me j ustifie d'adopter telle ou telle chelle de valeurs. En tant
qu'tre par qui les valeurs existent je suis injustifiable. Et ma libert
s'angoisse d'tre le fondement sans fondement des valeurs. Elle
s'angoisse en outre parce que les valeurs, du fait qu'elles se rvlent
par essence une libert, ne peuvent se dvoiler sans tre du mme
coup mises en puisque la possibilit de renverser
l'chelle des valeurs apparat complmentairement comme ma possi
bilit. C'est l'angoisse devant les valeurs qui est reconnaissance de
l'idalit des valeurs.
Mais, l'ordinaire, mon attitude vis--vis des valeur5 est minem
ment rassurante. C'est que, en effet, je suis engag dans un monde de
valeurs. L'aperception angoisse des valeurs comme soutenues dans
l'tre par ma libert est un phnomne postrieur et mdiatis.
L'immdiat, c'est le monde avec son urgence et, dans ce monde o je
m'engage, mes actes font l ever des valeurs comme des perdrix, c'est
par mon i ndignation que m'est donne l'antivaleur bassesse dans
mon admiration que m'est donne la valeur grandeur Et , surtout,
mon obissance une foule de tabous, qui est rell e, me dcouvre ces
tabous comme existants en fait. Ce n'est pas aprs contemplation des
valeurs morales que les bourgeois qui se nomment eux-mmes les
honntes gens sont honntes : mais ils sont jets, ds leur surgisse
ment dans le monde, dans une conduite dont le sens est l' honntet.
Ainsi l'honntet acquiert un tre, elle n'est pas mise en question ; les
valeurs sont semes sur ma route comme mi lle petites exigences
73
rel l es semblables aux criteaux qui interdisent de marcher sur le
gazon.
Ai nsi, dans ce que nous appellerons le monde de l'immdiat, qui se
livre not re conscience i rrflchie, nous ne nous apparaissons pas
d'abord pour tre jets ensule dans des entreprises. Mais notre tre
est i mmdiatement en situation ", c'est--dire qu'il surgit dans des
entreprises et se connat d'abord en tant qu'il se reflte sur ces
entreprises. Nous nous dcouvrons donc dans un monde peupl
d'exigences, au sein de projets en cours de ralisation " : j'cris, je
vais fumer, j 'ai rendez-vous ce soir avec Pierre, i l ne faut pas que
j'oublie de rpondre Simon, je n'ai pas l e droit de cacher plus
longtemps l a vrit Claude. Toutes ces menues attentes passives du
rel , toutes ces valeurs banales et quotidiennes tirent leur sens, vrai
dire, d'un premier projet de moi-mme qui est comme mon choix de
moi-mme dans le monde. Mais prcisment, ce projet de moi vers
une possibilit premire, qui fait qu' il y a des valeurs, des appels, des
attentes et en gnral un monde, ne m'apparat qu'au-del du monde
comme l e sens et la signification abstraits et logiques de mes
entreprises. Pour l e reste, i l y a concrtement des rveils, des
criteaux, des feuilles d'impts, des agents de police, autant de garde
fous contre l' angoisse. Mais ds que l'entreprise s'loigne de moi, ds
que je suis renvoy moi-mme parce que je dois m'attendre dans
l'avenir, je me dcouvre tout coup comme celui qui donne son sens
au rveil, celui qui s'interdit, partir d'un criteau, de marcher sur
une plate-bande ou sur une pelouse, celui qui prte son urgence
l 'ordre du chef, celui qui dcide de l'intrt du livre qu'il crit, celui
qui fai t, enfi n, que des valeurs existent pour dterminer son action
par l eurs exigences. J'merge seul et dans l'angoisse en face du projet
unique et premier qui constitue mon tre, toutes les barrires, tous les
garde-fous s'croulent, nantiss par la conscience de ma libert : je
n'ai ni ne puis avoir recours aucune valeur contre le fait que c'est
moi qui maintiens l'tre les valeurs ; rien ne peut m'assurer contre
moi-mme, coup du monde et de mon essence par ce nant que je
suis, j 'ai raliser le sens du monde et de mon essence : j 'en dcide,
seul , injustifiable et sans excuse.
L'angoisse est donc la saisie rflexive de l a libert par elle-mme,
en ce sens elle est mdiation car, quoique conscience i mmdiate
d'elle-mme, elle surgit de la ngation des appels du monde, elle
apparat ds que je me dgage du monde o j e m'tais engag, pour
m' apprhender moi-mme comme conscience qui possde une com
prhension prontologique de son essence et un sens prjudicatif de
ses possibles ; el l e s'oppose l'esprit de srieux qui saisit les valeurs
partir du monde et qui rside dans la substantification rassurante et
chosiste des valeurs. Dans le srieux je me dfinis partir de l'objet,
en laissant de ct a priori comme impossibles toutes les entreprises
74
que je ne suis pas en train d'entreprendre et en saisissant comme
venant du monde et constitutif de mes obligations et de mon tre le
sens que ma libert a donn au monde. Dans l'angoisse, j e me saisis
la fois comme totalement libre et comme ne pouvant pas ne pas faire
que le sens du monde lui vienne par moi.
n ne faudrait pourtant pas croire qu' il sufft de se porter sur le plan
rfexif et d'envisager ses possibles lointains ou immdiats pour se
saisir dans une pure angoisse. En chaque cas de rflexion, l'angoisse
nat comme structure de l a conscience rflexive en tant qu'elle
considre l a conscience rflchie ; mais i l reste que j e peux tenir des
conduites vis--vis de ma propre angoisse, en particulier des conduites
de fuite. Tout se passe en effet comme si notre conduite essentielle et
immdiate vis--vis de l 'angoisse, c'tait la fuite. Le dterminisme
psychologi que, avant d'tre une conception thorique, est d'abord
une conduite d' excuse ou, si l'on veut, le fondement de toutes les
conduites d'excuse. Il est une conduite rflexive vis--vis de
l 'angoisse, i l affirme qu' i l y a en nous des forces antagonistes dont l e
type d'existence est comparable cel ui des choses, i l tente de combler
les vides qui nous entourent, de rtablir les liens du pass au prsent,
du prsent au futur, il nous pourvoit d' une nature productrice de nos
actes et ces actes mmes i l en fait des transcendants, il les dote d'une
inertie et d'une extriorit qui leur assignent leur fondement en autre
chose qu'en eux-mmes et qui rassurent minemment parce qu'elles
constituent un jeu permanent d'excuses, i l nie cette transcendance de
la ralit-humai ne qui l a fait merger dans l'angoisse par del sa
propre essence ; du mme coup, en nous rduisant n'tre jamais que
c que nous sommes, il rintroduit en nous la positivit absolue de
l'tre-en-soi et, par l, nous rintgre au sein de l'tre.
Mais ce dterminisme, dfense rfexive contre l'angoisse, ne se
donne pas comme une intuition rflexive. Il ne peut ri en contre
l'vidence de la libert, aussi se donne-t-il comme croyance de refuge,
comme l e terme idal vers lequel nous pouvons fuir l 'angoisse. Cela
se manifeste, sur l e terrain philosophique, par le fait que les
psychologues dterministes ne prtendent pas fonder leur thse sur
les pures donnes de l'observation interne. Ils la prsentent comme
une hypothse satisfaisante et dont la valeur vient de ce qu'elle rend
compte des faits-ou comme un postulat ncessaire l'tablissement
de toute psychologie. Ils admettent l'existence d'une conscience
immdiate de libert, que leurs adversaires leur opposent sous l e nom
de preuve par l'intuition du sens intime . Simplement, ils font
porter le dbat sur la valeur de cette rvlation interne. Ainsi,
l'intuition qui nous fait nous saisir comme cause premire de nos tats
et de nos actes n'est discute par personne. Reste qu'il est la porte
de chacun de nous d'essayer de mdiatiser l'angoisse en s'levant au
dessus d'elle et en la jugeant comme une illusion qui viendrait de
75
l'ignorance o nous sommes des causes relles de nos actes. Le
problme qui se posera alors, c'est celui du degr de croyance en cette
mdiation. Une angoisse juge est-elle une angoisse dsarme ?
Evidemment non ; pourtant, un phnomne neuf prend ici naissance,
un processus de distraction par rapport l'angoisse qui, derechef,
suppose en lui un pouvoir nantisant.
A lui seul , le dterminisme ne suffirait pas fonder cette
distraction, puisqu'il n'est qu'un postulat ou une hypothse. JI est un
effort de fuite plus concret et qui s'opre sur le terrain mme de la
rfexi on. C'est tout d' abord une tentative de distraction par rapport
aux possibles contraires de mOIl possible. Lorsque je me constitue
comme comprhension d'un possible comme mon possibl e, il faut
bien que je reconnaisse son existence au bout de mon projet et que j e
le saisisse comme moi-mme, l-bas, m'attendant dans l'avenir,
spar de moi par un nant. En ce sens je me saisis comme origine
premire de mon possible et c'est ce qu'on nomme ordinairement la
conscience de l i bert, c'est cette structure de la conscience et elle
seule que les partisans du libre arbitre ont en vue quand ils parlent de
l'intuition du sens intime. Mais il arrive que j e m'efforce, en mme
temps, de me distraire de l a constitution des autres possibles qui
contredisent mon possible. Je ne puis faire, vrai dire, que je ne pose
l eur existence par le mme mouvement qui engendre comme mien le
possible choisi, je ne puis empcher que je les constitue comme
possibles vivants, c'est--dire comme ayant la possibilit de devenir
mes possibles. Mais je m'efforce de les voir comme dots d' un tre
transcendant et purement logique, bref, comme des choses. Si
j'envisage sur le plan rfexif l a possibilit d'crire ce livre comme ma
possibilit, je fais surgir entre cette possibilit et ma conscience un
nant d' tre qui l a constitue comme possibilit et que je saisis
prcisment dans l a possibilit permanente que la possibilit de ne
l'crire pas soit ma possibilit. Mais cette possibilit de ne pas l'crire,
je tente de me comporter envers elle comme vis--vis d'un objet
observable et j e me pntre de ce que je veux y voir : j'essaie de la
saisir comme devant tre simplement mentionne pour mmoire,
comme ne me concernant pas. Il faut qu'elle soit possibilit externe,
par rapport moi, comme l e mouvement par rapport cette bille
i mmobile. Si je pouvais y parvenir, les possibles antagonistes de mon
pssible, constitus comme entits logiques, perdraient leur efficace ;
ils ne seraient plus menaants puisqu'ils seraient des dehors, puisqu'ils
cerneraient mon possible comme des ventualits purement conceva
bles, c'est--dire, au fond, concevables par un autre ou comme
possibles d'un autre qui se trouverait dans le mme ca. Ils appartien
draient la situation objective comme une structure transcendante ;
ou, si l'on prfre et pour utiliser la terminologie de Heidegger : moi
j'crirai ce livre mais on pourrait aussi ne pas l'crire. Ainsi me
76
dissimulerais-je qu'ils sont moi-mme et conditions immanentes de l a
possibilit de mon possibl e. Ils conserveraient juste assez d'tre pour
conserver mon possible son caractre de gratuit, de libre possibilit
d'un tre libre, mais ils seraient dsarms de leur caractre mena
ant : ils ne m'intresseraient pas, l e possible lu apparatrait, du fait
de l'lection, comme mon seul possible concret et, par suite, le nant
qui me spare de lui et qui lui confre justement sa possibi l i t serait
combl .
Mais l a fuite devant l'angoisse n'est pas seulement effort de
distraction devant l 'avenir : elle tente aussi de dsarmer la menace du
pass. Ce que j e tente de fuir, ici, c'est ma transcendance mme, en
tant qu'elle soutient et dpasse mon essence. J'affirme que je suis
mon essence, sur le mode d'tre de l'en-soi. En mme temps,
toutefois, je refuse de considrer cette essence comme elle-mme
historiquement constitue et comme impliquant alors l'acte comme le
cercle implique ses proprits. Je la saisis, ou du moins j' essaie de la
saisir, comme l e commencement premier de mon possible et je
n'admets point qu'elle ait en elle-mme un commencement ; j 'affirme
alors qu'un acte est libre lorsqu'il reflte exactement mon essence.
Mais, en outre, cette libert qui m' i nquiterait si elle tait l i bert en
face du Moi, je tente de la reporter au sein de mon essence, c'est-
dire de mon Moi . II s'agit d' envisager l e Moi comme un petit Dieu qui
m'habiterait et qui possderait ma libert comme une vertu mtaphy
sique. Ce ne serait plus mon tre qui serait libre en tant qu'tre, mais
mon Moi qui serait libre au sein de ma conscience. Fiction minem
ment rassurante puisque la libert a t enfonce au sein d'un tre
opaque : c'est dans l a mesure o mon essence n'est pas translucidit,
o elle est transcendante dans l'immanence, que la l i bert deviendrait
une de ses proprits. En un mot, i l s'agit de saisir ma libert dans
mon Moi comme la libert d'autrui 1 . On voit les thmes principaux de
cette fiction : mon Moi devient l'origine de ses actes comme autrui
des siens, titre de personne dj constitue. Certes, i l vit et se
transforme, on concdera mme que chacun de ses actes puisse
contribuer le transformer. Mais ces transformations harmonieuses
et continues sont conues sur ce type biologique. Elles ressemblent
celles que je peux constater chez mon ami Pierre lorsque je le revois
aprs une sparation. C'est ces exigences rassurantes que Bergson a
expressment satisfait lorsqu'il a conu sa thorie du Moi profond,
qui dure et s'organise, qui est constamment contemporain de l a
conscience que j'en prends et qui ne saurait tre dpass par el l e, qui
se trouve l'origine de nos actes non comme un pouvoir cataclysmi
que, mais comme un pre engendre ses enfants, de sorte que l'acte,
sans dcouler de l'essence comme une consquence rigoureuse, sans
1. Cf. Ill" partie, chap. 1.
77
mme tre prvisible, entretient avec elle un rapport rassurant, une
ressemblance familiale : i l va plus loin qu'elle, mais dans l a mme
voie, il conserve, certes, une irrductibilit certaine, mais nous nous
reconnaissons et nous nous apprenons en lui comme un pre peut se
reconnatre et s'apprendre dans le fils qui poursuit son uvre. Ainsi,
p
ar une projection de l a libert -que nous saisissons en nous-dans
un obj et psychique qui est le Moi , Bergson a contribu masquer
notre angoisse, mais c'est aux dpens de l a conscience mme. Ce qu'il
a constitu et dcrit de la sorte, ce n'est pas notre libert, telle qu'elle
s' apparat elle-mme : c'est la libert d'autrui.
Tel est donc l'ensemble des processus par lesquels nous essayons de
nous masquer l ' angoisse : nous saisissons notre possible en vitant de
considrer les autres possibles dont nous faisons les possibles d'un
autrui i ndiffrenci : ce possible, nous ne voulons pas le voir comme
soutenu l'tre par une pure libert nantisante, mais nous tentons
de l e saisir comme engendr par un objet dj constitu, qui n 'est
autre que notre Moi , envisag et dcrit comme la personne d'autrui.
Nous voudrions conserver de l'intuition premire ce qu'elle nous livre
comme notre indpendance et notre responsabili t, mais il s'agit pour
nous de mettre en veilleuse tout ce qui est en elle nantisation
originel le ; toujours prts d'ailleurs nous rfugier dans l a croyance
au dterminisme si cette libert nous pse ou si nous avons besoin
d' une excuse. Ainsi fuyons-nous l 'angoisse en tentant de nous saisir
du dehors comme autrui ou comme une chose. Ce qu'on a coutume
d'appeler rvlation du sens intime ou intuition premire de notre
l i bert n'a rien d'origi nel : c'est un processus dj construit , express
ment destin nous masquer l 'angoisse, l a vritable donne
i mmdiate de notre libert .
Parvenons-nous par ces diffrentes constructions touffer ou
dissimul er notre angoisse ? Il est certain que nous ne saurions l a
supprimer puisque nous sommes angoisse. Quant ce qui est de l a
voiler, outre que l a nature mme de l a conscience et sa translucidit
nous interdisent de prendre l'expression la lettre, i l faut noter le
type particulier de conduite que nous signifions par l : nous pouvons
masquer un objet extrieur parce qu'il existe indpendamment de
nous ; pour l a mme raison, nous pouvons dtourner notre regard ou
notre attention de l ui , c'est--dire tout simplement fixer les yeux sur
quelque autre objet ; ds ce moment, chaque ralit - la mienne et
celle de l'obj et -reprend sa vie propre et le rapport accidentel qui
unissait l a conscience l a chose disparat sans altrer pour cela l' une
ou l'autre existence. Mais si j e suis ce que je veux voiler, l a question
prend un tout autre aspect : je ne puis en effet vouloir ne pas voir
un certain aspect de mon tre que si je suis prcisment au fait de
l 'aspect que je ne veux pas voir. Ce qui signifie qu' il faut que je
l' indique dans mon tre pour pouvoir m'en dtourner ; mieux encore,
78
il faut que j'y pense constamment pour prendre garde de ne pas y
penser. Par l , il faut entendre non seulement que je dois, par
ncessit, emporter perptuellement avec moi ce que je veux fui r
mais aussi que je dois viser l'objet de la fuite pour le fuir, ce qui
signifie que l'angoisse, une vise i ntentionnelle de l'angoisse et une
fuite de l'angoisse vers les mythes rassurants doivent tre donnes
dans l'unit d'une mme conscience. En un mot, je fuis pour ignorer
mais je ne peux ignorer que je fuis et la fuite de l'angoisse n'est qu'un
mode de prendre conscience de l'angoisse. Ainsi ne peut-elle,
proprement parler, tre ni masque ni vi te. Pourtant, fuir
l'angoisse ou tre l'angoisse, ce ne saurait tre tout fait la mme
chose : si j e suis mon angoisse pour l a fuir, cela suppose que j e puis
me dcentrer par rapport ce que j e suis, que je puis tre l'angoisse
sous la forme de ne l'tre pas , que je puis disposer d'un pouvoir
nantisant au sein de l'angoisse mme. Ce pouvoir nantisant nantit
l'angoisse en tant que je la fuis et s'anantit lui-mme en tant que j e la
suis pour la fuir. C'est ce qu'on nomme la mauvaise foi. II ne s'agit
donc pas de chasser l ' angoisse de la conscience, ni de la constituer en
phnomne psychique inconscient ; mais tout simplement je puis me
rendre de mauvaise foi dans l'apprhension de l'angoisse que je suis
et cette mauvaise foi, destine combler l e nant que je suis dans
mon rapport moi-mme, implique prcisment c nant qu'elle
suppri me.
Nous voi l au terme de notre premire description. L'examen de la
ngation ne saurait nous conduire plus loin. El l e nous a rvl
l'existence d'un type particulier de conduite : l a conduite en face du
non-tre, qui suppose une transcendance spciale qu'il convient
d'tudier part . Nous nous trouvons donc en prsence de deux ek
stases humaines : l ' ek-stase qui nous j ette dans l 'tre-en-soi et l ' ek
stase qui nous engage dans le non-tre. II semble que notre premier
problme, qui concernait seulement les rapports de l'homme l'tre,
soit par l considrablement compliqu ; mais il n'est pas i mpossible
non plus qu'en poussant jusqu'au bout notre analyse de l a transcen
dance vers le non-tre nous obtenions des renseignements prcieux
pour la comprhension de toute transcendance. Et d'ailleurs, le
problme du nant ne peut tre exclu de notre enqute : si l'homme
se comporte en face de l'tre-en-soi - et notre interrogation
philosophique est un type de ce comportement -, c'est qu'il n'est pas
cet tre. Nous retrouvons donc le non-tre comme condition de la
transcendance vers l'tre. Il faut donc nous accrocher au problme du
nant et ne pas l e lcher avant sa complte lucidation.
Seulement , l ' examen de l'interrogation et de la ngation a donn
tout ce qu' il pouvait. Nous avons t renvoy de l l a libert
empirique comme nantisation de l ' homme au sein de la temporalit
et comme condition ncessaire de l'apprhension transcendante des
79
ngatits. Reste fonder cette libert empirique elle-mme. Ell e ne
saurait tre la nantisation premire et le fondement de toute
nantisation. Elle contribue en effet constituer des transcendances
dans l ' i mmanence qui conditionnent toutes les transcendances nga
tives. Mais le fait mme que les transcendances de l a libert
empirique se constituent dans l 'i mmanence comme transcendances
nous montre qu' i l s'agit de nantisations secondaires qui supposent
l'existence d'un nant originel : elles ne sont qu'un stade dans la
rgressi on analytique qui nous mne des transcendances nga
tits jusqu' l'tre qui est son propre nant. I l faut videmment
trouver l e fondement de toute ngation dans une nantisation qui
serait exerce au sein mme de l'immanence ; c'est dans l ' immanence
absolue, dans l a subjectivit pure du cogito instantan que nous
devons dcouvrir l'acte originel par quoi l'homme est lui-mme son
propre nant. Que doit tre l a conscience dans son tre pour que
l ' homme en el l e et partir d' el l e surgisse dans l e monde comme l ' tre
qui est son propre nant et par qui le nant vient au monde ?
Il sembl e que nous manquions i ci de l ' i nstrument qui nous
permettrait de rsoudre ce nouveau problme : l a ngation n'engage
directement que la libert. Il convient de trouver dans la libert mme
la conduite qui nous permettra de pousser pl us loi n. Or, cette
conduite qui nous mnera jusqu'au seuil de l'immanence et qui
demeure pourtant suffisamment objective pour que nous puissions
dgager objectivement ses conditions de possibilit, nous l'avons dj
rencontre. N'avons-nous pas marqu tout l'heure que, dans la
mauvaise foi , nous tion-l'angoissepour-la-fuirg dans l'unit d'une
mme conscience ? Si la mauvaise foi doit tre possible, il faut donc
que nous puissions rencontrer dans une mme conscience l'uni t de
l' tre et du n'tre-pas, l'tre-pour-n'tre-pas. C'est donc l a mauvaise
foi qui va faire, prsent, l'objet de notre interrogati on. Pour que
l'homme puisse questionner, i l faut qu' i l puisse tre son propre nant,
c'est--dire : il ne peut tre l'origine du non-tre dans l'tre que si
son tre se transit en lui-mme, par lui-mme, de nant : ainsi
apparaissent les transcendances du pass et du futur dans l'tre
temporel de l a ralit-humaine. Mai s la mauvaise foi est i nstantane.
Que doit donc tre la conscience dans l'instantanit du cogito
prrflexif, si l ' homme doit pouvoir tre de mauvaise foi ?
CHAPI TRE I I
La mauvaise foi
MAUVAI SE FOI ET MENSONGE
L'tre humai n n'est pas seulement l'tre par qui des ngatits se
dvoilent dans le monde, il est aussi celui qui peut prendre des
attitudes ngatives vis--vis de soi . Nous avions dfi ni , dans notre
introduction, l a conscience comme un tre pour lequel i l est dans
son tre question de son tre en tant que cet tre implique un tre
autre que lui . Mais, aprs l'lucidation de la conduite i nterrogative,
nous savons prsent que cette formule peut aussi s'crire : La
conscience est un tre pour lequel i l est dans son tre conscience du
nant de son tre. Dans la dfense ou velO, par exemple, l'tre
humain ni e une transcendance future. Mais cette ngation n'est pas
constatative. Ma conscience ne se borne pas envisager une ngatit.
Elle se constitue elle-mme, dans sa chair, comme nantisation d' une
possibilit qu' une autre ralit-humaine projette comme sa possibi
lit. Pour cela elle doit surgir dans le monde comme un Non et c'est
bien comme un Non que l'esclave saisit d'abord l e matre, ou que le
prisonnier qui cherche s'vader saisit l a sentinelle qui le surveille. Il
y a mme des hommes (gardiens, surveillants, geliers, etc.) dont la
ralit sociale est uniquement celle du Non, qui vivront et mourront
en n'ayant jamais t qu'un Non sur l a terre. D'autres, pour porter le
Non dans leur subjectivit mme, ne s'en constituent pas moins, en
tant que personnes humaines, comme une ngation perptuelle : l e
sens et l a fonction de ce que Scheler appelle l'homme du ressenti
ment , c'est le Non. Mais i l existe des conduites plus subtiles et dont
la description nous mnerait plus loin dans l'i ntimit de la cons
cience : l' ironie est de celles-l. Dans l'ironie, l'homme anantit, dans
81
l ' unit d'un mme act e, ce qu' i l pose, il donne croire pour n'tre pas
cru, il affirme pour nier et nie pour affirmer, i l cre un objet positif
mais qui n'a d'autre tre que son nant. Ainsi les attitudes de
ngation envers soi permettent de poser une nouvelle question : que
doit tre l' homme en son tre pour qu'il lui soit possibl e de se nier ?
Mais il ne saurait s'agir de prendre dans son universalit l'attitude de
ngation de soi . Les conduites qui peuvent se ranger sous cette
rubrique sont trop diverses, nous risquerions de n'en retenir que la
forme abstraite. Il convient de choisir et d'examiner une attitude
dtermine qui, l a fois, soit essentielle la ralit-humaine et, la
foi s, telle que l a conscience, au lieu de diriger sa ngation vers l e
dehors, l a tourne vers elle-mme. Cette attitude nous a paru devoir
tre l a mauvaise foi.
Souvent on l'assimil e au mensonge. On dit indiffremment d'une
personne qu'elle fait preuve de mauvaise foi ou qu'elle se ment elle
mme. Nous accepterons volontiers que l a mauvaise foi soit men
songe soi , condition de distinguer immdiatement l e mensonge
soi du mensonge tout court. Le mensonge est une attitude ngative,
on en conviendra. Mais cette ngation ne porte pas sur l a conscience
el l e-mme, elle ne vise que le transcendant. L'essence du mensonge
impl ique, en effet, que le menteur soit compltement au fait de l a
vrit qu'il dguise. On ne ment pas sur ce qu'on ignore, on ne ment
pas lorsqu'on rpand une erreur dont on est soi-mme dupe, on ne
ment pas lorsqu'on se t rompe. L'idal du menteur serait donc une
conscience cynique, affirmant en soi l a vri t, l a niant dans ses
paroles et niant pour l ui-mme cette ngation. Or, cette double
attitude ngative porte sur du transcendant : l e fait nonc est
transcendant, puisqu'il n'existe pas, et l a premire ngation porte sur
une vrit, c'est--dire sur un type particulier de transcendance.
Quant la ngation intime que j' opre corrlativement l 'affirmation
pour moi de la vrit, el l e porte sur des paroles, c'est--dire sur un
vnement du monde. En outre, la disposition intime du menteur est
positive : el l e pourrait faire l'objet d' un jugement affirmatif : le
menteur a l'intention de tromper et i l ne cherche pas se dissimuler
cette intention ni masquer l a translucidit de la conscience ; au
contraire, c'est elle qu' il se rfre lorsqu'il s'agit de dcider des
conduites secondaires, elle exerce explicitement un contrle rgula
teur sur toutes ses attitudes. Quant l'intention affiche de dire la
vrit J e n e voudrais pas vous tromper, cela est vrai, j e l e jure ,
etc. ) , sans doute est-el l e l'objet d' une ngation intime, mais aussi
n'est-elle pas reconnue par l e menteur comme son intention. Elle est
joue, mi me, c'est l'intention du personnage qu'il joue aux yeux de
son interlocuteur, mais ce personnage, prcisment parce qu'il n'est
pas, est un transcendant. Ainsi, le mensonge ne met pas en jeu
l'intrastructure de la conscience prsente, toutes les ngations qui le
82
constituent portent sur des objets qui de ce fait sont chasss de l a
conscience, i l ne requiert donc pas de fondement ontologique spcial
et les explications que requi ert l'existence de l a ngation en gnral
sont valables sans changement, dans le cas de la tromperie. Sans
doute avons-nous dfini le mensonge idal ; sans doute arrive-t-il
assez souvent que le menteur soit plus ou moins victime de son
mensonge, qu'il s'en persuade demi : mais ces formes courantes et
vulgaires du mensonge en sont aussi des aspects abtardis, elles
reprsentent des intermdiaires entre le mensonge et l a mauvaise foi.
Le mensonge est une conduite de transcendance.
Mais c'est que le mensonge est un phnomne normal de ce que
Heidegger appelle le Mi tsein . Il suppose mon existence, l'exis
tence de l'autre, mon existence pour l'autre et l'existence de l'autre
pour moi . Ainsi n' y a-t-il aucune di fficult concevoir que le menteur
doive faire en toute l uci dit le projet du mensonge et qu'il doive
possder une entire comprhension du mensonge et de l a vrit qu'i!
altre. I I suffit qu'une opacit de principe masque ses intentions
l'autre, il suffit que l 'autre puisse prendre le mensonge pour la vrit.
Par le mensonge, l a conscience affirme qu'elle existe par nature
comme cache autrui, elle utilise son profit l a dualit ontologique
du moi et du moi d'autrui.
Il ne saurait en tre de mme pour l a mauvaise foi , si celle-ci,
comme nous l ' avons di t, est bien mensonge soi. Certes, pour celui
qui pratique l a mauvaise foi , i l s'agit bien de masquer une vrit
dplaisante ou de prsenter comme une vrit une erreur plaisante.
La mauvaise foi a donc en apparence la structure du mensonge.
Seulement, ce qui change tout, c'est que dans l a mauvaise foi, c'est
moi-mme que je masque la vrit. Ainsi, la dualit du trompeur et
du tromp n'existe pas i ci . La mauvaise foi implique au contraire par
essence l'unit d'une conscience. Cela ne signifie pas qu'elle ne puisse
tre conditionne par l e Mitsein , comme d'ailleurs tous l es
phnomnes de la ralit-humai ne , mais le Mitsein ne peut que
solliciter la mauvaise foi en se prsentant comme une situation que la
mauvaise foi permet de dpasser ; la mauvaise foi ne vient pas du
dehors la ralit-humai ne. On ne subit pas sa mauvaise foi, on n'en
est pas infect , ce n'est pas un tat. Mais la conscience s'affecte elle
mme de mauvaise foi . Il faut une intention premire et un projet de
mauvaise foi : ce projet i mplique une comprhension de la mauvaise
foi comme telle et une saisie prrflexive (de) la conscience comme
s'effectuant de mauvaise foi . Il s'ensuit d'abord que cel ui qui l ' on
ment et cel ui qui ment sont une seul e et mme personne, ce qui
signifie que je doi s savoi r en tant que trompeur la vri t qui m'est
masque en tant que je suis tromp. Mieux encore, je dois savoir trs
prcisment cette vrit pour me l a cacher plus soigneusement -et
ceci non pas deux moments di ffrents de l a temporal i t -ce qui
83
permettrait la rigueur de rtablir un semblant de dualit - mais
dans la structure unitaire d' un mme projet. Comment donc l e
mensonge peut-il subsister si la dual i t qui le conditionne est
suppri me ? A cette difficult s'en ajoute une autre qui drive de l a
totale translucidit de l a conscience. Celui qui s'affecte de mauvaise
foi doit avoir conscience de sa mauvaise foi puisque l'tre de la
consci ence est conscience d'tre. Il semble donc que je doive tre de
bonne foi au moins en ceci que je suis conscient de ma mauvaise foi .
Mais alors tout ce systme psychique s'anantit. On conviendra, en
effet, que si j 'essaie dlibrment et cyniquement de me menti r,
j' choue compltement dans cette entreprise, le mensonge recule et
s'effondre sous l e regard ; i l est rui n, par-derrire, par la conscience
mme de me mentir qui se constitue i mpitoyablement en de de mon
projet comme sa condi ti on mme. I l y a l un phnomne vanescent,
qui n' existe que dans et par sa propre distinction. Certes, ces
phnomnes sont frquents et nous verrons qu' i l y a en effet une
vanescence de la mauvaise foi , i l est vi dent qu'elle oscille
perptuellement entre l a bonne foi et l e cynisme. Toutefoi s, si
l'existence de l a mauvaise foi est fort prcaire, si elle appartient ce
genre de structures psychiques qu'on pourrait appeler mtasta
bles , elle n' en prsente pas moins une forme autonome et durable ;
elle peut mme tre l'aspect normal de la vie pour un trs grand
nombre de personnes. On peut vivre dans la mauvaise foi , ce qui ne
veut pas dire qu' on n'ait de brusques rveils de cynisme ou de bonne
foi , mais ce qui implique un styl e de vie constant et particulier. Notre
embarras semble donc extrme puisque nous ne pouvons ni rejeter ni
comprendre la mauvaise foi .
Pour chapper ces di fficults, on recourt volontiers l'incons
cient. Dans l ' i nterprtation psychanalytique, par exemple, on utili
sera l'hypothse d'une censure, conue comme une ligne de dmarca
ti on avec douane, services de passeports, contrle des devises, etc. ,
pour rtablir l a dualit du trompeur et du tromp. L'instinct -ou s i
l'on prfre les tendances premi res et les complexes de tendances
constitus par notre histoire individuelle -figure ici la ralit. Il n'est
ni vrai ni faux puisqu'il n'existe pas pour soi. Il est simplement, tout
juste comme cette table qui n'est ni vraie ni fausse en soi mais
simplement relle. Quant aux symbolisations conscientes de l'instinct,
elles ne doivent pas tre prises pour des apparences mais pour des
faits psychi ques rels. La phobie, le lapsus, le rve existent rellement
titre de faits de conscience concrets, de l a mme faon que les
paroles et l es attitudes du menteur sont des conduites concrtes et
rellement existantes. Simplement le sujet est devant ces phnomnes
comme l e tromp devant les conduites du trompeur. I l les constate
dans leur ralit et doit les i nterprter. Il y a une vrit des conduites
du trompeur : si le tromp pouvait les rattacher la situation o se
84
trouve le trompeur et son projet de mensonge, elles deviendraient
parties intgrantes de la vrit, titre de conduites mensongres.
Pareil l ement, il y a une vrit des actes symboliques : c'est cell e que
dcouvre le psychanalyste lorsqu' i l les rattache l a situation histori
que du mal ade, aux complexes inconscients qu' il s expri ment, au
barrage de l a censure. Ainsi , l e sujet se trompe sur le sens de ses
conduites, i l l es saisit dans leur existence concrte mais non pas dans
leur vril, faute de pouvoir les driver d'une situation premire et
d'une constitution psychique qui lui demeurent trangres. C'est
qu'en effet, par l a distinction du a et du moi , Freud a scind
en deux la masse psychique. Je suis moi, mais je ne suis pas a. Je n' ai
point de posi ti on privilgie par rapport mon psychisme non
conscient. Je suis mes propres phnomne psychiques, en tant que j e
l es constate dans leur ralit consciente : par exemple, j e suis cette
impulsion voler tel ou tel l ivre cet talage, je fais corps avec el l e, j e
l'claire et j e me dtermine en fonction d' el l e commettre l e vol.
Mais je ne suis pas ces faits psychiques, en tant que j e l es reois
passivement et que je suis oblig de faire des hypothses sur leur
origine et l eur vritable signification, tout j uste comme l e savant fait
des conjectures sur la nature et l'essence d' un phnomne extrieur :
ce vol, par exempl e, que j 'interprte comme une impulsion imm
diate dtermine par la raret, l 'intrt ou le prix du volume que je
vais drober, i l est en vrit un processus dri v d'autopunition qui se
rattache plus ou moi ns directement un complexe d'dipe. Il y a
donc une vrit de l'impulsion au vol , qui ne peut tre atteinte que
par des hypothses pl us ou moi ns probables. Le critre de cette vrit
ce sera l'tendue des faits psychiques conscients qu'elle explique ; ce
sera aussi , d'un point de vue plus pragmati que, l a russite de la cure
psychiatrique qu' el l e permet. Finalement, la dcouverte de cette
vrit ncessitera l e concours du psychanalyste, qui apparat comme
le mdiateur entre mes tendances i nconscientes et ma vie consciente.
Autrui apparat comme pouvant seul effectuer l a synthse entre la
thse inconsciente et l 'antithse consciente. Je ne puis me connatre
que par l ' i ntermdi ai re d'autrui, ce qui veut dire que je suis par
rapport mon a dans l a position d'autrui. Si j'ai quelques notions
de psychanal yse, je peux essayer, dans des circonstances particulire
ment favorables, de me psychanalyser moi-mme. Mais cette tenta
tive ne pourra russir que si je me dfie de toute espce d'intuition,
que si j 'applique mon cas du dehors des schmes abstraits et des
rgles apprises. Quant aux rsultats, qu'ils soient obtenus par mes
seuls efforts ou avec l e concours d'un technicien, ils n'auront jamais la
certitude que confre l'intuition : ils possderont simplement la
probabilit toujours croissante des hypothses scientifiques. L' hypo
thse du complexe d'dipe, comme l 'hypothse atomique, n'est rien
d'autre qu'une ide exprimental e , el l e ne se distingue pas,
85
comme di t Peirce, de l'ensemble des expriences qu'elle permet de
raliser et des effets qu'elle permet de prvoir. Ai nsi , la psychanalyse
substitue la notion de mauvaise foi l ' i de d'un mensonge sans
menteur, elle permet de comprendre comment je puis non pas me
menti r mais tre menti, puisqu'elle me place par rapport moi-mme
dans l a situation d'autrui vis--vis de moi , el le remplace l a dualit du
trompeur et du tromp, condition essentielle du mensonge, par celle
du a et du moi , ell e introduit dans ma subjectivit l a plus
profonde la structure intersubjecti ve du Mitsein. Pouvons-nous nous
satisfaire de ces explicati ons ?
A la considrer de plus prs, la thorie psychanalytique n'est pas si
simple qu'elle parat d'abord. Il n'est pas exact que le a se
prsente comme une chose par rapport l ' hypothse du psychana
lyste, car la chose est i ndi ffrente aux conjectures qu'on fait sur elle et
le a , au contraire, est touch par celles-ci lorsqu'elles approchent
de l a vrit. Freud, en effet , signale des rsistances lorsque, l a fin de
la premire priode, le mdecin approche de l a vrit. Ces rsistances
sont des conduites objectives et saisies du dehors : le mal ade
tmoigne de l a dfiance, refuse de parl er, donne des comptes rendus
fantaisistes de ses rves, parfois mme se drobe entirement la
cure psychanalytique. I l est permis toutefois de demander quelle part
de lui-mme peut ainsi rsister. Ce ne peut tre le Moi envisag
comme ensemble psychique des faits de conscience : il ne saurait en
effet souponner que le psychiatre approche du but puisqu'il est plac
devant le sens de ses propres ractions, exactement comme le
psychiatre lui -mme. Tout au plus lui est-il possible d'apprcier
objectivement l e degr de probabilit des hypothses mises, comme
pourrait l e faire un tmoin de la psychanalyse, et d'aprs l'tendue
des faits subjectifs qu' elles expliquent. Et d'ailleurs, cette probabilit
l ui paratrait-elle confiner l a certitude, qu'il ne saurait s'en affiger
puisque, la plupart du temps, c'est lui qui , par une dcision
consciente, s'est engag dans l a voie de l a thrapeutique psychanalyti
que. Dira-t-on que l e malade s'inquite des rvlations quotidiennes
que l e psychanalyste lui fait et qu' i l cherche s'y drober tout en
feignant ses propres yeux de vouloir continuer la cure ? En ce cas, il
n'est plus possible de recourir l ' i nconscient pour expliquer l a
mauvaise foi : el l e est l, en plei ne conscience, avec toutes ses
contradictions. Mais ce n'est pas ainsi que le psychanalyste entend,
d'ailleurs, expli quer ces rsistances : pour lui elles sont sourdes et
profondes, elles viennent de l oi n, elles ont leurs racines dans l a chose
mme qu' on veut lucider.
Pourtant, elles ne sauraient maner non plus du complexe qu'il faut
mettre au j our. En tant que tel, ce complexe serait plutt le
collaborateur du psychanalyste puisqu'il vise s'exprimer dans l a
claire consci ence, puisqu'il ruse avec l a censure et cherche l'luder.
86
Le seul plan sur lequel nous pouvons situer le refus du ujet, c'est
celui de la censure. Elle seule peut saisir les questions ou les
rvlations du psychanalyste comme s'approchant de plus ou moins
prs des tendances relles qu' el l e s'applique refouler, elle seule
parce qu' elle est seule savoir ce qu'elle refoule.
Si en effet nous repoussons le langage et l a mythologie chosiste de
la psychanal yse, nous nous apercevons que la censure, pour appliquer
son activit avec discernement, doit connatre ce qu'elle refoul e. Si
nous renonons en effet toutes les mtaphores reprsentant l e
refoulement comme un choc de forces aveugles, force est bien
d'admettre que la censure doit choisir et, pour choisir, se reprsenter.
D'o viendrai t , autrement, qu' el l e laisse passer les i mpulsions
sexuelles licites, qu'elle tolre que les besoins (faim, soif, sommeil)
s'expriment dans l a claire conscience ? Et comment expliquer qu'elle
peut relcher sa surveillance, qu'el le peut mme tre trompe par les
dguisements de l ' instinct ? Mai s il ne suffit pas qu'elle discerne les
tendances maudites, i l faut encore qu'elle les saisisse comme
refouler, ce qui i mplique chez elle tout le moins une reprsentation
de sa propre activit. En un mot , comment la censure discernerait
elle les i mpulsions refoulables sans avoir conscience de les discerner ?
Peut-on concevoir un savoir qui serait ignorance de soi ? Savoir, c'est
savoir qu' on sai t, disait Al ai n. Disons plutt : tout savoir est
conscience de savoir. Ainsi les rsistances du malade impliquent au
niveau de la censure une reprsentation du refoul en tant que tel,
une comprhension du but vers quoi tendent les questions du
psychanalyste et un acte de l i aison synthtique par lequel elle
compare la vrit du complexe refoul l ' hypothse psychanalytique
qui le vise. Et ces di ffrentes oprations leur tour impliquent que la
censure est consciente (de) soi. Mais de quel type peut tre la
conscience (de) soi de la censure ? Il faut qu' elle soit conscience (d')
tre conscience de l a tendance refouler, mais prcisment pour n'en
tre pas conscience. Qu'est-ce dire sinon que l a censure doit tre de
mauvaise foi ? La psychanal yse ne nous a rien fait gagner puisque,
pur supprimer l a mauvaise foi , elle a tabl i entre l 'inconscient et la
conscience une conscience autonome et de mauvaise foi. C'est que ses
efforts pour tablir une vritable dualit -et mme une trinit (Es,
!ch,
ber-Ich s'exprimant par la censure) - n'ont abouti qu' une
terminologie verbale. L'essence mme de l'ide rflexive de se
dissimuler quelque chose i mplique l'unit d' un mme psychisme et
par consquent une double activit au sein de l'unit, tendant d'une
part maintenir et reprer la chose cacher et d'autre part la
repousser et l a voi ler ; chacun des deux aspects de cette activit est
complmentaire de l ' autre, c'est--dire qu'il l ' i mplique dans son tre.
En sparant par l a censure le conscient de l ' i nconscient, la psychana
lyse n'a pas russi dissocier les deux phases de l'acte, puisque la
87
libido est un conatus aveugle vers l'expression consciente et que le
phnomne conscient est un rsultat passif et truqu : elle a simple
ment localis cette double activit de rpulsion et d'attraction au
ni veau de la censure. Reste d'ailleurs, pour rendre compte de l'unit
du phnomne total (refoul ement de l a tendance qui se dguise et
passe sous forme symbol i que) , tablir des liaisons comprhensi
bl es entre ses di ffrents moments. Comment l a tendance refoule
peut-elle se dguiser si el l e n'enveloppe pas : 1 la conscience
d'tre refoul e, 2 la conscience d'avoir t repousse parce qu'elle
est ce qu'elle est, 3 un projet de dguisement ? Aucune thorie
mcani que de l a condensation ou du transfert ne peut expliquer ces
modificati ons dont la tendance s' affecte elle-mme, car la description
du processus de dguisement i mplique un recours voil l a finalit.
Et , pareillement, comment rendre compte du plaisir ou de l'angoisse
qui accompagnent l 'assouvissement symbolique et conscient de la
tendance, si la conscience n'enveloppe pas, par del la censure, une
comprhension obscure du but atteindre en tant qu' i l est si multan
ment dsir et dfendu ? Pour avoir rejet l'unit consciente du
psychi que, Freud est ohlig de sous-entendre partout une uni t
magique reliant les phnomnes distance et par del les obstacles,
comme l a participation pri mi tive unit la personne envote et la
figurine de cire faonne son i mage. La Trieh i nconsciente est
affecte, par participation, du caractre refoule ou maudite ,
qui s'tend tout travers elle, la colore et provoque magiquement ses
symbolisations. Et semblahlement , le phnomne conscient est tout
entier color par son sens symholique, bien qu' i l ne puisse apprhen
der ce sens par lui-mme et dans l a claire conscience. Mais, outre son
infriorit de pri ncipe, l'explication par l a magie ne supprime pas la
coexistence - l'tage inconscient, l 'tage de l a censure et celui
de l a conscience -de deux structures contradictoires et complmen
taires, qui s'i mpl i quent et se dtruisent rciproquement. On a
hypostasi chosifi la mauvaise foi, on ne l'a pas vite. C'est ce
qui a incit un psychiatre viennois, Stekel , se dgager de l'obdi ence
psychanalytique et crire dans La Femme frigide 1 : Chaque fois
que j'ai pu pousser mes investigations assez loin, j' ai constat que le
nud de la psychose tait conscient. Et d'ailleurs, les cas qu' i l
rapporte dans son ouvrage tmoignent d' une mauvaise foi pathologi
que dont le freudisme ne saurait rendre compte. Il s'agira, par
exemple, de femmes qu'une dception conjugale a rendues frigides,
c'est--dire qui parviennent se masquer l a jouissance que leur
procure l ' acte sexuel . On notera d'abord qu' i l s'agit pour elles de se
dissi mul er non des complexes profondment enfoncs dans les
tnbres demi physiologiques, mai s des conduites objectivement
1. N. R. F. [ 1 937J.
88
dcelables et qu'elles n e peuvent pas ne pas enregistrer dans le
moment o elles les tiennent : frquemment , en effet, le mari rvle
Stekel que sa femme a donn des signes objectifs de plaisir et ce sont
ces signes que la femme, i nterroge, s'applique farouchement nier.
Il s'agit ici d'une activit de distraction. Pareillement les confessions
que Stekel sait provoquer nous apprennent que ces femmes patholo
giquement frigides s'appliquent se distraire par avance du plaisir
qu'elles redoutent : beaucoup, par exempl e, lors de l'acte sexuel,
dtournent leurs penses vers leurs occupations quotidiennes, font les
comptes de leur mnage. Qui viendra parler i ci d'inconscient ?
Pourtant, si la femme frigide distrait ainsi sa conscience du plaisir
qu'elle prouve, ce n'est point cyniquement et en plein accord avec
elle-mme : c'est pour se prouver qu'elle est frigide. Nous avons bien
affaire un phnomne de mauvaise foi puisque les efforts tents
pour ne pas adhrer au plaisir prouv impliquent la reconnaissance
que le plaisir est prouv et que, prcisment, ils l ' i mpliquent pour la
nier. Mais nous ne sommes plus sur le terrain de l a psychanalyse.
Ainsi, d' une part, l'explication par l ' i nconscient, du fait qu'elle rompt
l'unit psychique, ne saurait rendre compte des faits qui, premire
vue, paraissent relever d'el l e . Et, d'autre part, i l existe une infinit de
conduites de mauvaise foi qui repoussent explicitement ce type
d'eXplicati on, parce que leur essence implique qu'elles ne peuvent
apparatre que dans l a translucidit de l a conscience. Nous retrouvons
intact l e problme que nous avions tent d'luder.
I I
LES CONDUITES D E MAUVAI SE FOI
Si nous voulons nous tirer d' embarras, i l convient d'examiner de
plus prs les conduites de mauvaise foi et d'en essayer une descrip
tion. Cette description nous permettra peut-tre de fixer avec plus de
nettet les conditions de possibilit de la mauvaise foi, c'est--dire de
rpondre notre question de dpart : Que doit tre l'homme en son
tre, s'il doit pouvoir tre de mauvaise foi ? )
Voici, par exemple, une femme qui s'est rendue un premier
rendez-vous. Elle sait fort bien les intentions que l ' homme qui lui
parle nourrit son gard. Elle sait aussi qu'il lui faudra prendre tt ou
tard une dcision. Mais elle n'en veut pas sentir l 'urgence : elle
s'attache seulement ce qu'offre de respectueux et de discret
l'attitude de son partenaire. Elle ne saisit pas cette conduite comme
une tentative pour ral i ser ce qu'on nomme l es premires
89
approches , c'est--dire qu'elle ne veut pas voir les possibilits de
dveloppement temporel que prsente cette conduite : el l e borne ce
comportement ce qu' il est dans le prsent, elle ne veut pas lire dans
les phrases qu'on l ui adresse autre chose que leur sens explicite ; si on
lui dit : Je vous admire tant elle dsarme cette phrase de son
arrire-fond sexuel, elle attache aux discours et l a conduite de son
interlocuteur des significations i mmdiates qu'el l e envisage comme
des qualits objectives. L'homme qui l ui parle l ui semble sincre et
respectueux comme l a table est ronde ou carre, comme l a tenture
murale est bl eue ou grise. Et les qualits ainsi attaches la personne
qu' el l e coute se sont ainsi figes dans une permanence chosiste qui
n'est autre que la projection dans l 'coulement temporel de leur strict
prsent. C'est qu'elle n' est pas au fait de ce qu' el l e souhaite : elle est
profondment sensible au dsir qu'el le inspire, mais le dsir cru et nu
l'humilierait et lui ferait horreur. Pourtant, elle ne trouverait aucun
charme un respect qui serait uniquement du respect. Il faut , pour la
satisfaire, un sentiment qui s'adresse tout entier sa personne, c'est-
dire sa libert plnire, et qui soit une reconnaissance de sa libert.
Mais il faut, en mme temps, que ce sentiment soit tout entier dsir,
c'est--dire qu' il s'adresse son corps en tant qu'objet. Cette fois
donc, elle refuse de saisir le dsir pour ce qu'il est, elle ne lui donne
mme pas de nom, el l e ne l e reconnat que dans l a mesure o i l se
transcende vers l'admiration, l'estime, le respect et o il s'absorbe
tout entier dans les formes plus leves qu'il produit, au point de n'y
figurer plus que comme une sorte de chaleur et de densit. Mais voici
qu'on lui prend l a mai n. Cet acte de son interlocuteur risque de
changer la situation en appelant une dcision i mmdiate : abandon
ner cette mai n, c'est consentir de soi-mme au flirt, c'est s'engager.
La retirer, c'est rompre cette harmonie trouble et instable qui fait l e
charme de l ' heure. I l s'agit de reculer l e pl us loin possible l ' instant de
l a dcision. On sait ce qui se produit alors : la jeune femme
abandonne sa mai n, mais ne s
'
aperoit pas qu' el l e l'abandonne. El l e
ne s'en aperoit pas parce qu'il se trouve par hasard qu'elle est, ce
moment, tout esprit. El l e entrane son interlocuteur jusqu'aux
rgions les plus leves de la spculation sentimentale, elle parle de la
vie, de sa vie, el le se montre sous son aspect essentiel : une personne,
une conscience. Et pendant ce temps, le divorce du corps et de l ' me
est accompli ; l a mai n repose inerte entre les mai ns chaudes de son
partenaire : ni consentante ni rsistante -une chose.
Nous dirons que cette femme est de mauvaise foi. Mais nous
voyons aussitt qu' el l e use de diffrents procds pour se maintenir
dans cette mauvaise foi. Elle a dsarm les conduites de son
partenaire en les rduisant n'tre que ce qu'elles sont, c'est--dire
exister sur le mode de l 'en-soi . Mais el l e se permet de jouir de son
dsir, dans la mesure o elle le saisira comme n' tant pas ce qu'il est,
90
c'est--dire o elle en reconnatra la transcendance. Enfin, tout en
sentant profondment l a prsence de son propre corps - au point
d'tre trouble peut-tre -, elle se ralise comme n 'tant pas son
propre corps et ell e le contemple de son haut comme un objet passif
auquel des vnements peuvent arriver, mais qui ne saurait ni les
provoquer ni les viter, parce quc tous ses possibles sont hors de lui.
Quelle unit trouvons-nous dans ces di ffrents aspects de l a mauvaise
foi ? C'est un certain art de former des concepts contradictoires, c'est
-dire qui uni ssent en eux une ide et la ngation de cette ide. Le
concept de base qui est ainsi engendr utilise la double proprit de
l'tre humain, d'tre une facticit et une transcendance. Ces deux
aspects de la ralit-humaine sont, vrai di re, et doivent tre
susceptibles d' une coordination valable. Mais l a mauvaise foi ne veut
ni les coordonner ni les surmonter dans une synthse. Il s'agit pour
elle d'affirmer leur identit tout en conservant leurs diffrences. Il
faut affirmer la facticit comme tant la transcendance et l a transcen
dance comme tant la facticit, de faon qu'on puisse, dans l'instant
o on saisit l ' une, se trouver brusquement en face de J'autre. Le
prototype des formules de mauvaise foi nous sera donn par certaines
phrases clbres qui ont t justement conues, pour produire tout
leur effet, dans un esprit de mauvaise foi. On connat, par exemple,
ce titre d' un ouvrage de Jacques Chardonne : L'amour, c'est
beaucoup plus que l'amour. On voit comment ici se fait l'unit entre
l'amour prsent dans sa facticit, contact de deux pidermes ",
sensualit, gosme, mcanisme proustien de l a jalousie, lutte adl
rienne des sexes, etc. -et l'amour comme transcendance, l e fleuve
de feu mauriacien, l'appel de l'infi ni , l'ros platonici en, la sourde
intuition cosmique de Lawrence, etc. Ici c'est de la facticit que l 'on
part, pour se trouver soudain, par del le prsent et la condition de
fait de l ' homme, par del l e psychologique, en pleine mtaphysique.
Au contraire, ce titre d' une pice de Sarment : Je suis trop grand
pour moi , qui prsente aussi les caractres de la mauvaise foi , nous
jette d'abord en pleine transcendance pou
i
nous emprisonner soudain
dans les troites limites de notre essence de fait. On retrouvera ces
structures dans la phrase fameuse : II est devenu ce qu' il tait ou
dans son envers non moins fameux : Tel qu'en lui-mme enfin
l'ternit l e change. Bien entendu, ces diffrentes formules n'ont
que l'apparence de l a mauvaise foi , elles ont t explicitement
conues sous cette forme paradoxale pour frapper l ' esprit et le
dcontenancer par une nigme. Mais prcisment c'est cette appa
rence qui nous importe. Ce qui compte ici , c'est qu'elles ne
constituent pas des notions nouvelles et solidement structures ; elles
sont bties au contraire de faon rester en dsagrgation perptuelle
et pour qu'un glissement perptuel soit possible du prsent naturaliste
la transcendance et inversement. On voit, en effet, l ' usage que la
91
mauvaise foi peut faire de ces jugements qui visent tous tablir que
je ne suis pas ce que je suis. Si je n'tais que ce que j e suis, je
pourrais, par exempl e, envisager srieusement ce reproche qu' on me
fai t, m' i nterroger avec scrupule et peut-tre serais-je contraint d'en
reconnatre la vrit. Mais prcisment par la transcendance,
j'chappe tout ce que j e suis. Je n' ai mme pas discuter le bien
fond du reproche, au sens o Suzanne dit Figaro : Prouver que
j'ai raison serai t accorder que j e puis avoir tort. } Je suis sur un plan
o aucun reproche ne peut m'atteindre, puisque ce que je suis
vraiment, c'est ma transcendance ; je m'enfuis, je m'chappe, je laisse
ma gueni l l e aux mains du sermonneur. Seulement, l'ambigut
ncessaire la mauvaise foi vient de ce qu'on affirme i ci que je suis
ma transcendance sur le mode d' tre de la chose. Et c'est seulement
ainsi , en effet , que j e puis me sentir chapper tous ces reproches.
C'est en ce sens que notre j eune femme purifie le dsir de ce qu'il a
d' humi l i ant, en n'en voulant considrer que la pure transcendance qui
l ui vi te mme de le nommer. Mais inversement, le j e sui s trop
grand pour moi ", en nous montrant la transcendance mue en
facticit, est la source d' une i nfi ni t d'excuses pour nos checs ou nos
fai blesses. Pareillement la j eune coquette maintient la transcendance
dans la mesure o le respect, l'estime mani fests par les conduites de
son soupirant sont dj sur le plan du transcendant. Mais elle arrte l
cette transcendance, elle l ' empte de toute la facticit du prsent : le
respect n'est rien d'autre que du respect, i l est un dpassement fig
qui ne se dpasse plus vers rien.
Mai s ce concept mtastable transcendance-facticit ", s'il est un
des instruments de base de l a mauvaise foi , n'est pas seul en son
genre. On usera pareillement d'une autre duplicit de l a ralit
humai ne que nous exprimerons grossirement en disant que son tre
pour-soi i mplique complmentairement un tre-pour-autrui. Sur une
quelconque de mes conduites, i l m'est toujours possible de faire
converger deux regards, le mi en et celui d'autrui. Or, prcisment, l a
conduite ne prsentera pas l a mme structure dans l ' un et l'autre cas.
Mai s comme nous le verrons plus tard, comme chacun le sent, il n'y a
pas entre ces deux aspects de mon tre une diffrence d'apparence
tre, comme si j'tais moi-mme la vrit de moi-mme et comme si
autrui ne possdait de moi qu' une image dforme. L'gale dignit
d'tre de mon tre pour autrui et de mon tre pour moi-mme permet
une synthse perptuellement dsagrgative et un jeu d'vasion
perptuelle du pour-soi au pour-autrui et du pour-autrui au pour-soi .
On a v u aussi l'usage que notre jeune femme faisai t de notre tre-au
mi lieu-du-monde, c'est--dire de notre prsence i nerte d'objet passif
parmi d'autres objets, pour se dcharger soudain des fonctions de son
tre-dans-Ie-monde, c'est--dire de l'tre qui fait qu'il y a un monde
en se projetant par del le monde vers ses propres possibilits.
92
Signalons enfin les synthses confusionnelles qui jouent sur l 'ambi
gut nantisante des trois ek-stases temporelles, affirmant l a fois
que je suis ce que j 'ai t (l 'homme qui s'arrte dlibrment une
priode de sa vie et refuse de prendre en considration les change
ments ultrieurs) et que je ne suis pas ce que j'ai t (l'homme qui, en
face des reproches ou de la rancune, se dsolidarise totalement de son
pass en insistant sur sa libert et sur sa re-cration perptuel l e).
Dans tous ces concepts, qui n' ont qu'un rl e transitif dans l es
raisonnements et qui sont limins de la conclusion, comme les
imaginaires dans les calculs des physiciens, nous retrouvons la mme
structure : i l s'agit de constituer la ralit-humaine comme un tre qui
est ce qu'il n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est.
Mais que faut-il prcisment pour que ces concepts de dsagrga
tion puissent recevoir mme un faux-semblant d'existence, pour qu'ils
puissent apparatre un instant l a conscience, ft-ce dans un
processus d'vanescence ? Un examen rapide de l ' i de de sincrit,
l'antithse de la mauvaise foi , sera trs instructif cet gard. En effet,
la sincrit se prsente comme une exigence et par consquent el l e
n'est pas un tat. Or quel est l'idal atteindre en ce cas ? I l faut que
l'homme ne soi t pour lui-mme que ce qu' il est, en un mot qu' i l soit
pleinement et uniquement ce qu' il est. Mais n'est-ce pas prcisment
la dfi nition de l'en-soi -ou, si l ' on prfre, le principe d'identit ?
Poser comme idal l'tre des choses, n'est-ce pas avouer du mme
coup que cet tre n'appartient pas l a ralit-humaine et que l e
principe d' identit, loin d' tre un axiome universellement universel,
n'est qu'un principe synthtique j ouissant d'une universalit simple
ment rgional e ? Ainsi, pour que les concepts de mauvaise foi
puissent au moins un instant nous faire i l l usion, pour que la franchise
des purs (Gi de, Kessel) puisse valoir pour la ralit
humaine comme idal, il faut que le principe d'identit ne reprsente
pas un principe constitutif de la ralit-humaine, il faut que l a ralit
humaine ne soit pas ncessairement ce qu'elle est , puisse tre ce
qu'elle n'est pas. Qu'est-ce que cela signifie ?
Si l 'homme est ce qu'i! est, l a mauvaise foi est tout jamais
impossible et l a franchise cesse d' tre son idal pour devenir son tre ;
mais l'homme est-il ce qu'il est et , d'une manire gnrale, comment
peut-on tre ce qu'on est, lorsqu'on est comme conscience d'tre ? Si
la franchise ou sincrit est une val eur universell e, i l va de soi que sa
maxime il faut tre ce qu' on est ne sert pas uniquement de
principe rgulateur pour l es jugements et l es concepts par lesquels
j'expri me ce que je suis. Elle pose non pas simplement un idal du
connatre mais un idal d'tre, elle nous propose une adquation
absolue de l'tre avec lui-mme comme prototype d'tre. En ce sens il
faut nous faire tre ce que nous sommes. Mais que sommes-nous donc
si nous avons l ' obligation constante de nous faire tre ce que nous
93
sommes, si nous sommes sur le mode d'tre du devoir tre ce que
nous sommes ? Considrons ce garon de caf. II a l e geste vif et
dppuy, un peu trop prcis, un peu trop rapide, il vient vers les
consommateurs d'un pas un peu trop vif, i l s'incline avec un peu trop
d'empressement, sa voi x, ses yeux expriment un intrt un peu trop
plein de sol l i citude pour la commande du client, enfin le voil qui
revi ent , en essayant d' i miter dans sa dmarche l a rigueur inflexible
d 'on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte
de tmrit de funambule, en le mettant dans un quilibre perptuel
lement instable et perptuellement rompu, qu'il rtablit perptuelle
ment d'un mouvement lger du bras et de l a main. Toute sa conduite
nous semble un jeu. Il s'applique enchaner ses mouvements comme
s'ils taient des mcanismes se commandant les uns les autres, sa
mimique et sa voix mme semblent des mcanismes ; i l se donne la
prestesse et la rapidit impitoyable des choses. I l joue, i l s'amuse.
Mai s quoi donc joue-t-il ? I l ne faut pas l'observer longtemps pour
s' en rendre compte : i l joue tre garon de caf. Il n'y a rien l qui
puisse nous surprendre : le jeu est une sorte de reprage et
d' i nvestigation. L'enfant joue avec son corps pour l'explorer, pour en
dresser l'inventaire ; l e garon de caf joue avec sa condition pour la
raliser. Cette obligation ne di ffre pas de celle qui s'impose tous les
commerant s : leur condition est toute de crmoni e, le public
rclame d'eux qu'ils la ralisent comme une crmoni e, il y a la danse
de l'picier, du tailleur, du commissaire-priseur, par quoi ils s'effor
cent de persuader leur cl ientl e qu'ils ne sont rien autre qu'un
picier, qu'un commissaire-priseur, qu'un tailleur. Un picier qui
rve est offensant pour l'acheteur, parce qu' il n'est plus tout fait un
picier. La politesse exige qu' i l se contienne dans sa fonction
d'picier, comme le soldat au garde--vous se fait chose-soldat avec
un regard direct mai s qui ne voit point, qui n'est plus fait pour voir,
puisque c'est le rglement et non l'intrt du moment qui dtermine
le point qu' i l doit fixer (le regard fix di x pas ) . Voil bien des
prcautions pour emprisonner l'homme dans ce qu' i l est. Comme si
nous vivions dans la crainte perptuelle qu'il n'y chappe, qu'il ne
dborde et n' lude tout coup sa condition. Mais c'est que,
paralllement, du dedans le garon de caf ne peut tre i mmdiate
ment garon de caf, au sens o cet encrier est encrier, o l e verre est
verre. Ce n' est point qu'il ne puisse former des jugements rflexifs ou
des concepts sur sa condi ti on. Il sait bien ce qu'elle signifie :
l'obligation de se lever ci nq heures, de balayer le sol du dbit avant
l'ouverture des salles, de mettre l e percolateur en trai n, etc. Il connat
l es droits qu' elle comporte : le droit au pourboire, les droits
syndicaux, etc. Mais tous ces concepts, tous ces jugements renvoient
au transcendant . Il s'agit de possibilits abstraites, de droits et de
devoirs confrs a un sujet de droit . Et c'est prcisment ce sujet
94
que j'ai tre et que je ne suis point. Ce n'est pas que je ne veuille pas
l'tre ni qu'il soit un autre. Mais plutt il n'y a pas de commune
mesure entre son tre et le mien. I l est une reprsentation }} pour les
autres et pour moi -mme, cela si gnifie que je ne puis l'tre qu'en
reprsentation. Mais prcisment si je me le reprsente, je ne le suis
point, j ' en suis spar, comme l 'objet du sujet, spar par rien, mais
ce rien m'isole de lui, je ne puis l'tre, je ne puis que jouer l'tre,
c'est--di re m'imaginer que je le suis. Et, par l mme, je l'affecte de
nant. J' ai beau accomplir l es fonctions de garon de caf, j e ne puis
l'tre que sur l e mode neutralis, comme l'acteur est Haml et, en
faisant mcaniquement l es gestes typiques de mon tat et en me visant
comme garon de caf i maginaire travers ces gestes pris comme
analogon 1. Ce que je tente de raliser, c'est un tre-en-soi du
garon de caf, comme s'i! n'tait pas justement en mon pouvoir de
confrer leur valeur et leur urgence mes devoirs d'tat, comme s'il
n'tait pas de mon libre choix de me lever chaque matin ci nq heures
ou de rester au l i t, quitte me faire renvoyer. Comme si, du fait
mme que je soutiens ce rle l'existence, j e ne l e transcendais pas de
toute part, je ne me constituais pas comme un au-del de ma
conditi on. Pourtant il ne fait pas de doute que je suis en un sens
garon de caf -sinon ne pourrais-je m'appeler aussi bien diplomate
ou journaliste ? Mais si je l e suis, ce ne peut tre sur le mode de l'tre
en soi. Je le suis sur le mode d'tre ce que je ne suis pas. Il ne s'agit pas
seulement des conditions sociales, d'ailleurs ; je ne suis jamais aucune
de mes attitudes, aucune de mes conduites. Le beau parleur est celui
qui joue parler, parce qu' il ne peut tre parlant : l 'lve attentif qui
veut tre attentif, l' i l riv sur l e matre, les oreilles grandes ouvertes,
s'puise ce point jouer l'attentif qu'il finit par ne plus rien couter.
Perptuellement absent mon corps, mes actes, je suis en dpit de
moi-mme cette divine absence }> dont parle Valry. Je ne pui s dire
ni que je suis i ci ni que je n'y suis pas, au sens o l'on dit cette bote
d'allumettes est sur l a table : ce serait confondre mon tre-dans
le-monde avec un tre-au-mi l ieu-du-monde . Ni que je suis
debout, ni que je suis assis : ce serait confondre mon corps avec la
totalit i di osyncrasique dont il n'est qu'une des structures. De toute
part j'chappe l ' tre et pourtant j e suis.
Mais voici un mode d'tre qui ne concerne plus que moi : je suis
triste. Cette tristesse que je suis, ne la suis-je point sur l e mode d'tre
ce que je suis ? Qu'est-elle, pourtant, sinon l'unit i ntentionnelle qui
vient rassembler et animer l'ensemble de mes conduites ? El l e est le
sens de ce regard terne que je jette sur l e monde, de ces paules
votes, de cette tte que je baisse, de cette mollesse de tout mon
corps. Mais ne sais-je poi nt, dans le moment mme o je tiens
1. Cf. L'Imaginaire (N. R.F., 1940). Conclusion.
95
chacune de ces conduites, que je pourrais ne pas la teni r ? Qu'un
tranger paraisse soudain et j e relverai l a tte, je reprendrai mon
allure vive et allante, que restera-t-il de ma tristesse, sinon que j e lui
donne complai samment rendez-vous tout l ' heure, aprs le dpart du
visiteur ? N' est-ce pas d' ailleurs el le-mme une conduite que cette
tristesse, n'est-ce pas l a conscience qui s'affecte elle-mme de tristesse
comme recours magique contre une situation trop urgente 1 ? Et, dans
ce cas mme, tre triste, n'est-ce pas d'abord se faire triste ? Soit,
dira-t-on_ Mais se donner l'tre de la tristesse, n'est-ce pas malgr tout
recevoir cet tre ? Peu importe, aprs tout, d'o j e le reois_ Le fai t,
c'est q u' une conscience qui s'affecte de tristesse est triste, prcisment
cause de cela. Mais c'est mal comprendre la nature de l a
conscience : l' tre-triste n'est pas un tre tout fait que je me donne,
COmme je puis donner ce livre mon ami. Je n'ai pas qualit pour
m'affecter d'tre. Si je me fais triste , je dois me faire triste d'un bout
l 'autre de ma tristesse, je ne puis profiter de l'lan acquis et laisser
filer ma tristesse sans la recrer ni la porter, la manire d'un corps
inerte qui poursuit son mouvement aprs le choc initial : il n'y a
aucune inertie dans la conscience. Si je me fais triste, c'est que je ne
suis pas triste ; l'tre de la tristesse m'chappe par et dans ('acte mme
par quoi je m'en affecte. L'tre-en-soi de la tristesse hante perptuel
lement ma conscience (d') tre triste, mais c 'est comme une valeur
que je ne puis raliser, comme un sens rgulateur de ma tristesse, non
comme sa modalit constitutive.
Di ra-t-on que ma conscience, au moins, est, quel que soit l'objet ou
l'tat dont el le se fait conscience ? Mai s comment distinguer de la
tristesse ma conscience (d') tre triste ? N'est-ce pas tout un ? I l est
vrai , d'une certaine manire, que ma conscience est , si l'on entend par
l qu'elle fait partie pour autrui de la totalit d'tre sur quoi des
jugements peuvent tre ports. Mais il faut remarquer, comme l'a
bien vu Husserl , que ma conscience apparat originellement autrui
COmme une absence. C'est l'objet toujours prsent comme sens de
toutes mes attitudes et de toutes mes conduites -et toujours absent,
car i l se donne l'intuition d'autrui comme une question perptuelle,
mieux encore, comme une perptuelle libe
r
t. Lorsque Pierre me
regarde, je sais sans doute qu'il me regarde, ses yeux -choses du
monde -sont fixs sur mon corps - chose du monde : voil le fait
objectif dont je puis di re : il est. Mai s c'est aussi un fait du monde. L
sens de ce regard n'est poi nt et c'est ce qui me gne : quoi que je
fasse, souri res, promesses, menaces - rien ne peut dcrocher
l ' approbati on, le libre jugement que je qute, je sais qu' i l est toujours
au-del, j e le sens dans mes conduites mmes qui n'ont plus le
caractre ouvrier qu'elles maintiennent l'gard des choses, qui ne
1. Esquisse d'une thorie des motions. Hermann, Paris, 1939.
96
sont plus pour moi-mme, dans la mesure o je le, relie autrui, que
de simples prsentations et attendent d'tre constitues en gracieuses
ou disgracieuses, sincres ou insincres, etc . , par une apprhension
qui est toujours au-del de tous mes efforts pour l a provoquer, qui n e
sera jamais provoque par eux que s i d' el l e-mme elle leur prte sa
force, qui n'est qu' en tant qu'elle se fait provoquer par l e dehors, qui
est comme sa propre mdiatrice avec le transcendant. Ai nsi l e fait
objectif de l'tre-en-soi de la conscience d' autrui se pose pour
s'vanoui r en ngativit et en libert : la conscience d'autrui est
comme n'tant pas, son tre-en-soi de maintenant et d'ici ,
c'est de n'tre pas.
La conscience d'autrui est ce qu'elle n'est pas.
Et d'ailleurs ma propre consci ence ne m'apparat pas dans son tre
comme l a conscience d'autrui. El l e est parce qu'elle se fait puisque
son tre est conscience d'tre. Mais cela signifie que le faire soutient
l'tre ; la conscience a tre son propre tre, elle n'est jamais
soutenue par l'tre, c'est el l e qui soutient l'tre au sein de l a
subjectivit, ce qui signifie derechef qu'elle est habite par l'tre mais
qu'elle ne l'est point : elle n'est pas ce qu'elle est.
Que signifie, dans ces conditions, l'idal de sincrit sinon une
tche i mpossible remplir et dont l e sens est en contradiction avec l a
structure de ma conscience ? Etre sincre, disions-nous, c'est tre ce
qu'on est. Cela suppose que je ne suis pas origi nel lement ce que j e
suis. Mais i ci, naturel lement, l e t u dois, donc tu peux de Kant est
sous-entendu. Je puis devenir sincre : voil ce qu'impliquent mon
devoir et mon effort de sincrit. Or, prcisment, nous constatons
que la structure origi nel l e du n' tre pas ce qu'on est d'avance
impossible tout devenir vers l'tre en soi ou tre ce qu'on est . Et
cette impossibilit n'est pas masque la conscience : au contraire
elle est l'toffe mme de l a consci ence, elle est la gne constante que
nous prouvons, el l e est notre incapacit mme nous reconnatre,
nous constituer comme tant ce que nous sommes, elle est cette
ncessit qui veut que, ds que nous nous posons comme un certain
tre par un j ugement lgitime, fond sur l'exprience interne ou
correctement dduit de prmisses a priori ou empiriques, par cette
position mme nous dpassons cet tre - et cela non pas vers un
autre tre : vers l e vi de, vers l e rien. Comment donc pouvons-nous
blmer autrui de n'tre pas sincre ou nous rjouir de notre sincrit,
puisque cette sincrit nous apparat dans l e mme temps comme
impossibl e ? Comment pouvons-nous amorcer mme, dans l e dis
cours, dans la confessi on, dans l ' examen de conscience, un effort de
sincrit, puisque cet effort sera vou par essence l'chec et que,
dans le temps mme o nous l'annonons, nous avons une compr
hension prjudicative de sa vanit ? Il s'agit en effet pour moi , lorsque
je m'exami ne, de dterminer exactement ce que je suis, pour me
97
rsoudre J'tre sans dtours -quitte me mettre, par la suite, en
qute des moyens qui pourront me changer. Mais qu'est-ce di re,
sinon qu'il s'agit pour moi de me constituer comme une chose ?
Dterminerai-je l'ensemble des moti fs et des mobiles qui m' ont
pouss faire tell e ou tel l e action ? Mai s c' est dj postul er un
dterminisme causal qui constitue l e fl ux de mes consciences comme
une sui te d'tats physiques. Dcouvrirai-je en moi des tendances ,
ft-ce pour me l es avouer dans la honte ? Mais n'est-ce pas oublier
dlibrment que ces tendances se ralisent avec mon concours,
qu'el l es ne sont pas des forces de l a nature mais que je leur prte l eur
efficience par une perptuelle dcision sur l eur valeur ? Porterai-je un
jugement sur mon caractre, sur ma nature ? N'est-ce pas me voi l er,
dans l' i nstant mme, ce que je sai s de reste, c' est que j e juge ainsi un
pass auquel mon prsent chappe par dfinition ? La preuve en est
que le mme homme qui, dans la sincrit, pose qu'il est ce que, en
fait, i l tai t, s' i ndigne contre la rancune d'autrui et tente de l a
dsarmer en affirmant qu' i l ne saurait plus tre ce qu' i l tait. On
s'tonne et on s'afflige volontiers que l es sanctions des tribunaux
atteignent un homme qui , dans sa neuve libert, n'est plus l e coupable
qu'il tai t. Mais, en mme temps, on exige de cet homme qu'il se
reconnaisse comme tant ce coupable. Qu'est-ce donc alors que l a
sincrit , si non prcisment un phnomne de mauvaise foi ?
N'avions-nous pas montr en effet qu' i l s'agit, dans la mauvaise foi,
de constituer la ralit-humaine comme un tre qui est ce qu'il n'est
pas et qui n'est pas ce qu'il est ?
Un homosexuel a frquemment un intolrable sentiment de
culpabilit et son existence tout entire se dtermine par rapport ce
senti ment. On en augurera volontiers qu' i l est de mauvaise foi. Et, en
effet, i l arrive frquemment que cet homme, tout en reconnaissant
son penchant homosexuel, tout en avouant une une chaque faute
singulire qu' i l a commise, refuse de toutes ses forces de se considrer
comme un pdraste . Son cas est part , singulier ; il y
entre du j eu, du hasard, de la malchance ; ce sont des erreurs passes,
elles s'expliquent par une certaine conception du beau que les femmes
ne sauraient satisfai re, il faut y voi r plutt les effets d' une recherche
inquite que les manifestations d'une tendance bien profondment
enracine, etc. Voil assurment un homme d' une mauvaise foi qui
touche au comique puisque, reconnaissant tous les faits qui lui sont
imputs, i l refuse d' en tirer l a consquence qui s'impose. Aussi son
ami, qui est son plus svre censeur, s'agace-t-il de cette duplicit : le
censeur ne demande qu' une chose -et peut-tre alors se montrera
t-il indulgent : que le coupable se reconnaisse coupabl e, que J'homo
sexuel dclare sans dtours -dans l ' humilit ou l a revendi cation, peu
importe Je suis un pdraste ^+ Nous demandons ici : qui est de
mauvaise foi ? L'homosexuel ou le champion de l a sincrit ? L'hol1lo-
98
sexuel reconnat ses fautes, mais i l lutte de toutes ses forces contre
l'crasante perspective que ses erreurs lui constituent un destin. Il ne
veut pas se laisser considrer comme une chose : i l a l'obscure et forte
comprhension qu' un homosexuel n'est pas homosexuel comme cette
table est table ou comme cet homme roux est roux. Il lui semble qu' il
chappe toute erreur ds qu' il l a pose et qu' i l la reconnat , mi eux
mme, que l a dure psychi que, par el l e-mme, le l ave de chaque
faute, l ui constitue un avenir indtermi n, l e fait renatre neuf. A
t-il tort ? Ne reconnat-il pas, par l ui-mme, le caractre singulier et
irrductible de l a ralit-humai ne ? Son attitude enveloppe donc une
indniable comprhension de l a vrit. Mais, en mme temps, il a
besoin de cette perptuelle renaissance, de cette constante vasion
pour vivre ; i l faut qu'il se mette constamment hors d'atteinte pour
viter le terrible j ugement de la collectivit. Aussi joue-t-il sur l e mot
d'tre. Il aurait raison en effet s'il entendait cette phrase : Je ne suis
pas pdraste au sens de Je ne suis pas ce que j e suis . C'est-
dire, s'il dclarait : Dans la mesure o une srie de conduites sont
dfinies conduites de pdraste, et o j'ai tenu ces conduites, je suis
un pdraste. Dans la mesure o l a ralit-humaine chappe toute
dfinition par les conduites, je n'en suis pas un. Mais i l glisse
sournoisement vers une autre acception du mot tre . Il entend
n'tre pas au sens de n' tre pas en soi . Il dclare n' tre pas
pdraste au sens o cette table n'est pas un encrier. Il est de
mauvaise foi .
Mais le champi on de la sincrit n' ignore pas l a transcendance de la
ralit-humaine et sait, au besoi n, la revendi quer son profit. Il en
use mme et l a pose dans son exigence prsente : ne veut-il pas, au
nom de la si ncrit - donc de l a libert -, que l'homosexuel se
retourne sur l ui-mme et se reconnaisse homosexuel ; ne laisse-t-i1 pas
entendre qu'une pareille confession l ui attirera l'indulgence ? Qu'est
ce que cela signi fi e, sinon que l'homme qui se reconnatra homo
sexuel ne sera plus le mme que l' homosexuel qu-il reconnat tre et
s'vadera dans l a rgion de l a l i bert et de l a bonne volont ? Il lui
demande donc d' tre ce qu' i l est pour ne plus tre ce qu'il est. C'est le
sens profond de la phrase : Pch avou est moiti pardonn. Il
rclame du coupable qu' i l se constitue comme une chose, prcisment
pour ne plus l e traiter en chose. Et cette contradiction est constitutive
de l'exigence de sincrit. Qui ne voit, en effet, ce qu' i l y a
d'offensant pour autrui et de rassurant pour moi, dans une phrase
comme : Bah ! c'est un pdraste , qui raye d'un trait une
inquitante libert et qui vi se dsormais constituer tous les actes
d'autrui comme des consquences dcoulant rigoureusement de son
essence. Voil pourtant ce que le censeur exige de sa victime : qu'elle
se constitue elle-mme comme chose, qu' el l e l ui remette sa libert
comme un fief, pour qu'il l a l ui rende ensui te comme un suzerain
99
son fal . Le champion de la sincrit, dans la mesure o il veut se
rassurer, alors qu' i l prtend juger, dans la mesure o i l demande
une l i bert de se constituer, en tant que libert, comme chose, est de
mauvaise foi . II s'agit seulement i ci d' un pisode de cette lutte mort
des consciences que Hegel nomme le rapport du matre et de
J'esclave
. On s'adresse une conscience pour lui demander, au nom
de sa nature de consci ence, de se dtruire radicalement comme
conscience, en l ui faisant esprer, par del cette destruction, une
renaissance.
Soit, dira-t-on, mais notre homme se fait abusivement de l a
sincrit une arme contre autrui. I l ne faut pas aller chercher l a
sincrit dans les relations du Mitsein , mais, l o el l e est pure,
dans l es relations vis--vis de soi-mme. Mais qui ne voit que la
sincrit objective se constitue de l a mme faon ? Qui ne voit que
J'homme si ncre se constitue comme une chose, prcisment , pour
chapper cette condition de chose, par l ' acte mme de sincrit ?
L'homme qui s'avoue qu' i l est mchant a troqu son inquitante
l i bert-pour-le-mal contre un caractre inanim de mchant : i l
est mchant , i l adhre soi , i l est ce qu' i l est. Mais du mme coup, i l
s'vade de cette chose, puisqu'il est celui qui l a contemple, puisqu'il
dpend de l ui de l a maintenir sous son regard ou de la laisser
s'effondrer en une infinit d'actes particuliers. Il tire un mrite de sa
sincrit et l' homme mritant n'est pas l e mchant, en tant qu'il est
mchant, mai s en tant qu' i l est par del sa mchancet.
En mme temps, la mchancet est dsarme puisqu'elle n'est rien,
si ce n'est sur le plan du dtermi nisme, et que, en l'avouant, j e pose
ma l i bert vis--vis d' ell e ; mon avenir est vierge, tout m'est permis.
Ai nsi , la structure essentielle de l a si ncrit ne diffre pas de celle de
l a mauvaise foi , puisque l ' homme sincre se constitue comme ce qu'il
est pour ne l' tre pas. C'est ce qui explique cette vrit reconnue par
tous, qu' on peut deveni r de mauvaise foi force d'tre sincre . Ce
serait , dit Valry, l e cas de Stendhal . La sincrit totale et constante
comme effort constant pour adhrer soi est, par nature, un effort
constant pour se dsolidariser de soi ; on se libre de soi par l ' acte
mme par l equel on se fai t obj et pour soi. Dresser l'inventaire
perptuel de ce qu'on est, c'est se renier constamment et se rfugier
dans une sphre o l'on n'est plus ri en, qu'un pur et libre regard. La
mauvaise foi , disions-nous, a pour but de se mettre hors d'atteinte,
c'est une fuite. Nous constatons, prsent, qu'il faut user des mmes
termes pour dfinir la sincrit. Qu'est-ce dire ?
C'est que, finalement, le but de la sincrit et celui de la mauvaise
foi ne sont pas si diffrents. Certes , i l y a une sincrit qui porte sur le
pass et qui ne nous proccupe pas ici ; je suis sincre , si j 'avoue avoir
eu tel plaisir ou telle intention. Nous verrons que si cette sincrit est
possible, c'est que, dans sa chute au pass, l'tre de l'homme se
100
constitue comme un tre en soi . Mais seule nous importe ici la
sincrit qui se vise elle-mme dans l'immanence prsente. Quel est
son but ? Faire que je m'avoue ce que je suis pour qu'enfin je concide
avec mon tre ; en un mot, faire que je sois sur le mode de l'en-soi, ce
que je suis sur le mode du n' tre pas ce que je suis . Et son
postulat, c'est que je suis dj , au fond, sur le mode de l'en-soi, ce
que j'ai tre. Ainsi , trouvons-nous, au fond de l a sincrit, un
i ncessant jeu de mi roir et de reflet, un perptuel passage de l 'tre qui
est ce qu'il est l 'tre qui n'est pas ce qu' i l est et, inversement, de
l'tre qui n'est pas ce qu'il est l'tre qui est ce qu' i l est. Et quel est le
but de la mauvaise foi ? Faire que je sois ce que je suis, sur l e mode du
n'tre pas ce qu'on est ou que je ne sois pas ce que je suis, sur le
mode de J'tre ce qu'on est . Nous retrouvons ici le mme jeu de
glaces. C'est que, en effet, pour qu'il y ai t intention de sincrit, il
faut qu' J'origine, la fois , je sois et je ne sois pas ce que je suis. La
sincrit ne m'assigne pas une mani re d'tre ou qualit particulire,
mais, propos de cette qual i t, elle vise me faire passer d'un mode
d'tre un autre mode d'tre. Et ce deuxime mode d'tre, idal de l a
sincrit, il m'est interdi t, par nature, d' y atteindre et , dans l e
moment mme o je m'efforce d' y atteindre, j'ai l a comprhension
obscure et prjudicative que je n'y atteindrai pas. Mais, de mme,
pour que je pui sse seulement concevoir une intention de mauvaise
foi, il faut que, par nature, j'chappe dans mon tre mon tre. Si
j'tais triste ou lche, l a manire dont cet encrier est encrier, l a
possibilit de l a mauvaise foi ne saurait mme tre conue. Non
seulement je ne pourrais chapper mon tre, mais je ne pourrais
mme imaginer que j'y puisse chapper. Mais si l a mauvaise foi est
possible, titre de simple proj et, c'est que, j ustement, i l n'y a pas de
diffrence si tranche entre tre et n' tre pas, lorsqu' i l s'agit de mon
tre. La mauvaise foi n'est possible que parce que l a sincrit est
consciente de manquer son but par nature. Je ne puis tenter de me
saisir comme n'tant pas lche, alors que je le suis , que si cet
tre lche est lui-mme en question dans le moment mme o
il est, s' i l est lui-mme une question, si dans l e moment mme o j e
veux l e saisir il m'chappe de toutes parts et s'anantit. La condition
pour que je puisse tenter un effort de mauvaise foi, c'est qu'en un
sens, je ne sois pas ce lche que je ne veux pas tre. Mais si je n'tais
pas lche, sur l e mode simple du n'tre-pas-ce-qu'on-n'est-pas, je
de bonne foi , en dclarant que je ne suis pas lche. Ainsi , ce
lche insaisissabl e, vanescent, que je ne sui s pas, il faut, en outre,
que je le sois en quelque faon. Et qu'on n' entende pas par l que je
dois tre un peu lche, au sens o un peu signifie dans une
certaine mesure lche - et non-lche dans une certaine mesure .
Non : c'est totalement lche, et sous tous les aspects, que je dois la
fois tre et n'tre pas. Ainsi, en ce cas, l a mauvaise foi exige que je ne
101
sois pas ce que je suis, c'est--dire qu' i! y ait une di ffrence
impondrable qui spare l'tre du non-tre dans le mode d'tre de la
ralit-humaine. Mais la mauvaise foi ne se borne pas refuser les
qualits que je possde, ne pas voir l'tre que je suis. Elle tente
aussi de me constituer comme tant ce que je ne suis pas. Elle me
saisit positivement comme courageux, alors que je ne le suis pas. Et
cela n'est possible, derechef, que si je suis ce que je ne suis pas, c'est
-dire que si le non-tre, en moi , n'a mme pas l'tre titre de non
tre. Sans dou te est-il ncessaire que je ne sois pas courageux, sinon
la mauvaise foi ne serait pas foi mauvaise. Mais il faut en outre que
mon effort de mauvaise foi enveloppe la comprhension ontologique
que, dans l'ordi naire mme de mon tre, ce que je suis, je ne le suis
pas vraiment, et qu'il n'y a pas une telle diffrence entre l'tre
d' tre-triste , par exemple -ce que je suis sur le mode du n'tre
pas ce que je suis -, et l e ne-pas-tre du ne-pas-tre-courageux
que je veux me dissimuler. Il faut , en outre, et surtout que la ngation
mme d'tre soit elle-mme l'objet d'un perptuel nantissement,
que le sens mme du ne pas tre soit perptuellement en question
dans la ralit-humaine. Si j e n'tais pas courageux l a faon dont cet
encrier n'est pas une tabl e, c'est--dire si j 'tais isol dans ma lchet,
but sur el l e, incapable de l a mettre en relation avec son contraire, si
je n'tais pas capable de me dterminer comme lche, c'est--dire de
nier de moi le courage, et par l d'chapper ma lchet dans le
moment mme que je la pose, s'il ne m'tait par principe impossible
de conci der avec mon n 'tre-pas-courageux, aussi bien qu'avec mon
tre-lche, tout projet de mauvaise foi me serait interdit. Ainsi , pour
que la mauvaise foi soit possible, il faut que la sincrit elle-mme soit
de mauvaise foi. La condition de possibilit de la mauvaise foi, c'est
que la ralit-humai ne, dans son tre le pl us immdiat, dans
l'intrastructure du cogito prrflexif, soit ce qu'elle n'est pas et ne soit
pas ce qu'elle est.
I I I
LA FOI DE LA MAUVAI SE FOI
Mais nous n'avons i ndi qu, pour l'instant , que les conditions qui
rendent la mauvaise foi concevabl e, les structures d'tre qui permet
tent de former des concepts de mauvaise foi. Nous ne saurions nous
borner ces considrations : nous n'avons pas encore disti ngu la
mauvaise foi du mensonge ; les concepts amphiboliques que nous
avons dcrits pourraient, sans aucun doute, tre utiliss par un
102
menteur pour dconcerter son interlocuteur, encore que leur amphi
boli e, tant fonde sur l' tre de l'homme et non sur quelque
circonstance empiri que, puisse et doive apparatre tous. Le vrita
ble problme de la mauvaise foi vient videmment de ce que la
mauvaise foi est foi. Ell e ne saurait tre ni mensonge cynique ni
vidence, si l'vidence est la possession intuitive de l'objet. Mais si
l'on nomme croyance l'adhsion de l'tre son objet, lorsque l'objet
n'est pas donn ou est donn indistinctement, alors la mauvaise foi est
croyance, et l e problme essenti el de l a mauvaise foi est un problme
de croyance. Comment peut-on croire de mauvaise foi aux concepts
qu'on forge tout exprs pour se persuader ? Il faut noter, en effet, que
le projet de mauvaise foi doit tre lui-mme de mauvaise foi : j e ne
suis pas seulement de mauvaise foi , au terme de mon effort, quand
j'ai construit mes concepts amphiboliques et quand je me suis
persuad. A vrai dire, je ne me suis pas persuad : pour autant que je
pouvais l 'tre, je l' ai toujours t. Et i l a fallu qu'au moment mme
o je me disposais me faire de mauvaise foi, j e fusse de mauvaise foi
vis--vis de ces dispositions mmes. Me les reprsenter comme de
mauvaise foi , c'et t du cynisme ; l es croire sincrement i nnocentes,
c'et t de la bonne foi. La dcision d'tre de mauvaise foi n'ose pas
dire son nom, elle se croit et ne se croit pas de mauvaise foi . Et c'est
elle qui , ds l e surgissement de l a mauvaise foi , dcide de toute
l'attitude ultrieure et, en quelque sorte, de la Weltanschauung de la
mauvaise foi. Car la mauvaise foi ne conserve pas les normes et l es
critres de la vrit, comme i l s sont accepts par la pense critique de
bonne foi . Ce dont el l e dcide, en effet, d'abord, c'est de l a nature de
la vrit . Avec la mauvaise foi apparat une vrit, une mthode de
penser, un type d'tre des objets ; et ce monde de mauvaise foi , dont
le sujet s'entoure soudai n, a pour caractristique ontologique que
l'tre y est ce qu'il n'est pas et n'y est pas ce qu'il est. En consquence,
un type d' vidences singulier apparat : l'vidence non persuasive. La
mauvaise foi saisit des vidences, mais elle est d'avance rsigne ne
pas tre remplie par ces vi dences, ne pas tre persuade et
transforme en bonne foi : elle se fait humble et modeste, el l e
n'ignore pas, dit-el l e, que la foi est dcision, et qu'aprs chaque
intuition, i l faut dcider et vouloir ce qui est. Ainsi , la mauvaise foi
dans son projet primitif, et ds son surgissement, dcide de la nature
exacte de ses exigences, el l e se dessine tout entire dans l a rsolution
qu'elle prend de ne pas trop demander, de se tenir pour satisfaite
quand el l e sera mal persuade, de forcer par dcision ses adhsions
des vrits incertaines. Ce projet premier de mauvaise foi est une
dcision de mauvaise foi sur la nature de l a foi . Entendons bien qu' i l
ne s'agit pas d'une dcision rflchie et volontaire, mai s d'une
dtermination spontane de notre tre. On se met de mauvaise foi
comme on s'endort et on est de mauvaise foi comme on rve. Une fois
103
ce mode d'tre ralis, il est aussi difficile d'en sortir que de se
rvei l ler : c'est que la mauvaise foi est un type d'tre dans le monde,
comme l a veille ou le rve, qui tend par lui-mme se perptuer,
encore que sa structure soit du type mtastable. Mais l a mauvaise foi
est consciente de sa structure et elle a pris ses prcautions en dcidant
que l a structure mtastable tait l a structure de l'tre et que la non
persuasion tait l a structure de toutes les convictions. Reste que si la
mauvaise foi est foi et qu' el l e enveloppe dans son projet premier sa
propre ngation (elle se dtermine tre mal convaincue pour se
convaincre que je suis ce que j e ne suis pas) i l faut que, l'origi ne,
une foi qui se veut mal convaincue soi t possible. Quelles sont l es
conditions de possibilit d' une pareille foi ?
Je crois que mon ami Pierre a de l'amiti pour moi. Je le crois de
bonne foi. J e le crois et je n' en ai pas d'intui ti on accompagne
d'vidence, car l 'objet mme, par nature, ne se prte pas l'intuition.
Je le crois, c'est--dire que je me laisse al ler des i mpulsions de
confi ance, que je dcide d' y croire et de me tenir cette dcision, que
j e me conduis, enfin, comme si j'en tais certain, le tout dans l'unit
synthtique d' une mme attitude. Ce que j e dfinis ainsi comme
bonne foi , c'est ce que Hegel nommerait l'immdiat, c'est l a foi du
charbonni er. Hegel montrerait aussitt que l'immdiat appelle la
mdiation et que l a croyance, en devenant croyance pour soi, passe
l'tat de non-croyance. Si je crois que mon ami Pierre m'aime, cela
veut dire que son amiti me parat comme le sens de tous ses actes. La
croyance est une conscience particulire du sens des actes de Pierre.
Mais si je sais que je crois, la croyance m' apparat comme pure
dtermination subjective, sans corrlatif extrieur. C'est ce qui fait du
mot mme de croire un terme indiffremment utilis pour
indiquer l 'inbranlable fermet de la croyance ( Mon Di eu, je crois
en vous ) et son caractre dsarm et strictement subjectif. (( Pierre
est-il mon ami ? Je n'en sais ri en : je le crois. ) Mais la nature de la
conscience est tel l e qu'en el l e le mdiat et l'immdiat sont un seul et
mme tre. Croire, c'est savoir qu'on croit et savoir qu'on croit, c'est
ne plus croire. Ainsi croire c'est ne plus croire, parce que cela n'est
que croire, ceci dans l ' uni t d'une mme conscience non-thtique (de)
soi . Certes, nous avons forc ici la description du phnomne en le
dsignant par le mot de savoir ; la conscience non-thtique n'est pas
savoir. Mais el l e est, par sa translucidit mme, l'origine de tout
savoir. Ai nsi , la conscience non-thtique (de) croire est destructrice
de la croyance. Mais, en mme temps, la loi mme du cogito
prrflexif i mplique que l'tre du croire doit tre la conscience de
croire. Ainsi, l a croyance est un tre qui se met en question dans son
propre tre, qui ne peut se raliser que dans sa destruction, qui ne
peut se manifester soi qu'en se niant ; c'est un tre pour qui tre,
c'est paratre, et paratre, c'est se nier. Croire, c'est ne pas croire. On
104
en voit la raison : l 'tre de la conscience est d'exister par soi , donc de
se faire tre et par l de se surmonter. En ce sens, la conscience est
perptuellement chappement soi , la croyance devient non
croyance, l'immdi at mdiation, l'absolu relati f et l e relatif absol u.
L'idal de l a bonne foi (croire ce qu'on croit) est, comme cel ui de l a
sincrit (tre ce qu'on est) , un idal d'tre-en-soi. Toute croyance
n'est pas assez croyance, on ne croit jamais ce qu'on croit. Et, par
suite, le projet pri mi ti f de la mauvaise foi n'est que l'utilisation de
cette autodestruction du fait de conscience. Si toute croyance de
bonne foi est une i mpossible croyance, i l y a place prsent pour
toute croyance i mpossible. Mon incapacit croire que je suis
courageux ne me rebutera plus, puisque, justement, toute croyance
ne peut jamais assez croire. Je dfinirai comme ma croyance cette
croyance impossible. Certes, je ne pourrai me dissimuler que je crois
pour ne pas croire et que je ne crois pas pour croire. Mais le subtil et
total anantissement de la mauvaise foi par el le-mme ne saurait me
surprendre : il exi ste, au fond de toute foi. Qu'est-ce donc ? Au
moment o je veux me croire courageux, je sais que je suis lche ? Et
cette certitude viendrait dtruire ma croyance ? Mais, d'abord, je ne
suis pas plus courageux que lche, s' i l faut l'entendre sur le mode
d'tre de l'en-soi. En second l i eu, je ne sais pas que je suis courageux,
une pareille vue sur moi ne peut s'accompagner que de croyance, car
elle dpasse la pure certitude rflexive. En troisime li eu, il est bien
vrai que l a mauvaise foi n'arrive pas croire ce qu'elle veut croire.
Mais c'est prcisment en tant qu'acceptation de ne pas croire ce
qu'el l e croit qu'elle est mauvaise foi. La bonne foi veut fuir le ne
pas-croire-ce-qu'on-croit dans l'tre ; l a mauvaise foi fuit l'tre dans
le ne-pas-croire-ce-qu'on-croit . Elle a dsarm par avance toute
croyance : celles qu'elle voudrait acqurir et, du mme coup, les
autres, celles qu'elle veut fuir. En voulant cette autodestruction de la
croyance, d'o l a science s'vade vers l'vidence, elle ruine les
croyances qu'on l ui oppose, qui se rvlent elles-mmes n 'tre que
croyance. Ainsi pouvons-nous mieux comprendre l e phnomne
premier de mauvaise foi.
Dans l a mauvaise foi , il n'y a pas mensonge cynique, ni prparation
savante de concepts trompeurs. Mai s l'acte premier de mauvaise foi
est pour fuir ce qu'on ne peut pas fuir, pour fui r ce qu'on est. Or, le
projet mme de fuite rvle la mauvaise foi une intime dsagrga
tion au sein de l'tre, et c'est cette dsagrgation qu'elle veut tre.
C'est que, vrai di re, les deux attitudes i mmdiates que nous
puvons prendre en face de notre tre sont conditionnes par la
nature mme de cet tre et son rapport immdiat avec l'en-soi. La
bonne foi cherche fuir la dsagrgation intime de mon tre vers l'en
soi qu'elle devrait tre et n'est point. La mauvaise foi cherche fuir
l'en-soi dans l a dsagrgation i nti me de mon tre. Mais cette
105
dsagrgation mme, el l e la nie comme elle nie d'elle-mme qu'elle
soit mauvaise foi. Fuyant par le non-tre-ce-qu'on-est l'en-soi que
je ne suis pas sur l e mode d'tre ce qu'on n'est pas, la mauvaise foi ,
qui se renie comme mauvaise foi, vise l'en-soi que je ne suis pas sur l e
mode du n'tre-pas-ce-qu'on-n' est-pas 1 . Si l a mauvaise foi est
possi bl e, c'est qu'elle est la menace immdiate et permanente de tout
projet de l'tre humai n, c'est que la conscience recle en son tre un
risque permanent de mauvaise foi . Et l'origine de ce risque, c'est que
la conscience, la fois et dans son tre, est ce qu'elle n'est pas et n'est
pas ce qu' elle est. A la lumire de ces remarques, nous pouvons
aborder prsent l'tude ontologique de la conscience, en tant qu'elle
est non l a totalit de l'tre humai n, mais le noyau instantan de cet
tre.
1. S'il est indiffrent d'tre de honne ou de mauvaise foi, parce que la
mauvaise foi ressaisit l a bonne foi et se gl isse l'origine mme de son projet,
cela ne veut pas dire qu'on ne puisse chapper radicalement l a mauvaise foi.
Mais cela suppose une reprise de l'tre pourri par lui'mme, que nous
nommerons authenticit et dont la descri ption n'a pas place ici.
Deuxime partie
L' TRE- POUR- S OI
CHAPI TRE PREMI ER
Les structures immdiates du poursoi
LA PRSENCE S OI
La ngation nous a renvoy la libert, celle-ci l a mauvaise foi et
la mauvaise foi l 'tre de l a conscience comme sa condition de
possibi lit. Il convient donc de reprendre, l a l umire des exigences
que nous avons tablies dans les chapitres prcdents, l a description
que nous avions tente dans l' introduction de cet ouvrage, c'est--dire
qu'il faut revenir sur l e terrain du cogito prrflexif. Mais l e cogiro ne
fivre jamais que ce qu'on lui demande de livrer. Descartes l ' avait
interrog sur son aspect foncti onnel : Je doute, je pense et , pour
avoir voulu passer sans fil conducteur de cet aspect fonctionnel la
dialectique existenti el l e, i l est tomb dans l' erreur substantialiste.
Husserl, instruit par cette erreur, est demeur craintivement sur le
plan de la description fonctionnell e. De ce fait, i l n'a jamais dpass
la pure description de l ' apparence en tant que tel l e, i l s'est enferm
dans le cogito, il mrite d'tre appel, malgr ses dngations,
phnomniste plutt que phnomnologue ; et son phnomnisme
ctoie chaque instant ldalisme kantien. Heidegger, voulant viter
ce phnomnisme de la descri ption qui conduit l' isolement mgari
que et antidialectique des essences, aborde directement l'analytique
existentielle sans passer par le cogito. Mais l e Dasein , pour avoir
t priv ds l'origine de l a di mension de conscience, ne pourra
jamais reconqurir cette dimension. Heidegger dote la ralit
humaine d' une comprhension de soi qu' i l dfinit comme un pro-jet
ek-statique de ses propres possibili ts. Et il n' entre pas dans nos
intentions de nier l ' existence de ce projet. Mais que serait une
comprhension qui, en soi-mme, ne serait pas conscience (d') tre
109
comprhension ? Ce caractre ek-statique de la ralit-humaine
retombe dans un en-soi chosiste et aveugle s'il ne surgit de la
conscience d'ek-stase. A vrai dire, i l faut partir du cogito, mais on
peut di re de l ui , en parodiant une formule clbre, qu' il mne tout
condi ti on d' en sortir. Nos recherches prcdentes, qui portaient sur
les condi ti ons de possibilit de certaines conduites, n'avaient pour but
que de nous mettre en mesure d' i nterroger le cogito sur son tre et de
nous fournir l ' instrument dialectique qui nous permettrait de trouver
dans le cogito l ui-mme l e moyen de nous vader de l ' i nstantanit
vers la totalit d' tre que constitue la ralit-humaine. Revenons
donc l a description de la conscience non-thti que (de) soi,
exami nons ses rsultats et demandons-nous ce que signifi e, pour la
consci ence, la ncessit d'tre ce qu'elle n'est pas et de ne pas tre ce
qu' el l e est.
L'tre de la conscience, crivions-nous dans l ' Introducti on, est un
tre pour lequel i l est, dans son tre, question de son tre. Cela
signifie que l'tre de la conscience ne concide pas avec lui-mme dans
une adquation pl ni re. Cette adquation, qui est celle de l ' en-soi,
s' expri me par cette si mple formul e : l' tre est ce qu' i l est. Il n'est pas,
dans l 'en-soi , une parcelle d'tre qui ne soit el l e-mme sans
di stance. Il n'y a pas dans l'tre ainsi conu la plus petite bauche de
dualit ; c'est ce que nous exprimerons en disant que l a densit d'tre
de l 'en-soi est i nfinie. C'est le plein, Le principe d'identit peut tre
di t synthti que, non seulement parce qu'il l i mite sa porte une
rgion dfinie, mais surtout parce qu'il ramasse en lui l 'infini de la
densit . A est A signifie : A existe sous une compression i nfi ni e,
une densit infi ni e, L'identit , c'est le concept li mite de l ' unification ;
i l n' est pas vrai que l'en-soi ai t besoin d'une unification synthtique de
son tre : la l i mi te extrme d' el le-mme, l'unit s'vanouit et passe
dans l ' identit. L'identique est l ' i dal de l'un et l'un arrive dans le
monde par la ralit-humai ne. L'en-soi est pl ei n de lui-mme et l'on
ne saurait imaginer plnitude plus totale, adquation plus parfaite du
contenu au contenant : il n'y a pas l e moindre vide dans l'tre, la
moindre fissure par o se pourrait glisser le nant.
La caractristique de la conscience, au contraire, c'est qu'elle est
une dcompression d'tre. Il est impossible en effet de la dfinir
comme conci dence avec soi . De cette table , je puis dire qu'elle est
purement et si mpl ement cette tabl e. Mais de ma croyance je ne puis
me borner di re qu' el l e est croyance : ma croyance est conscience
(de) croyance. On a souvent di t que le regard rflexif altre le fait de
conscience sur l equel il se dirige . Husserl lui-mme avoue que le faIt
d'tre vue entrane pour chaque Erlebnis une modi fication
total e. Mais nous croyons avoir montr que la condition premire de
toute rflexivit est un cogito prrflexif. Ce cogito, certes, ne pose
pas d'objet, il reste i ntraconscientiel. Mais il n'en est pas moins
1 10
homologue au cogito rflexif en ce qu'il apparat comme la ncessit
premire, pour l a conscience i rrflchie, d' tre vue par elle-mme ; i l
comporte donc originellement ce caractre dirimant d'exister pour un
tmoi n, bi en que ce tmoin pour qui la conscience existe soi t elle
mme. Ainsi, du seul fait que ma croyance est saisie comme croyance,
elle n'est plus que croyance, c'est--dire qu'elle n'est dj plus
croyance, elle est croyance troubl e. Ainsi, l e jugement ontologique,
la croyance est conscience (de) croyance ne saurait en aucun cas
tre pris pour un jugement d'identit : le sujet et l'attribut sont
radicalement diffrents et ceci, pourtant, dans l' unit i ndissoluble
d'un mme tre.
Soit, dira-t-on, mais au moi ns faut-il dire que la conscience (de)
croyance est conscience (de) croyance. Nous retrouvons ce niveau
l'identit et l' en-soi. Il s'agissai t seul ement de choisir convenablement
le plan o nous saisirions notre objet. Mai s cela n'est pas vrai :
affirmer que la conscience (de) croyance est conscience (de)
croyance, c'est dsolidariser la conscience de l a croyance, supprimer
la parenthse et faire de la croyance un objet pour la conscience, c'est
faire un saut brusque sur le plan de la rflexivit. Une conscience (de)
croyance qui ne serait que conscience (de) croyance devrai t , en effet,
prendre conscience (d' ) elle-mme comme conscience (de) croyance.
La croyance deviendrait pure quali fication transcendante et nomati
que de l a conscience ; l a conscience serait libre de se dterminer
comme i l lui plairait en face de cette croyance ; elle ressemblerait ce
regard impassible que la conscience de Victor Cousin jette sur les
phnomnes psychiques pour les clairer tour tour. Mais l'analyse
du doute mthodique que Husserl a tente a bien mis en lumire ce
fait que seule la conscience rflexive peut se dsolidariser de ce que
pose la conscience rflchie. C'est au niveau rflexif seulement qu'on
peut tenter une boxr, une mise entre parenthses, qu'on peut
refuser ce que Husserl appelle l e Mi tmachen . La conscience (de)
croyance, tout en altrant irrparablement la croyance, ne se
distingue pas d' el l e, elle est pour faire l'acte de foi . Ainsi sommes
nous oblig d'avouer que la conscience (de) croyance est croyance.
Ainsi saisissons-nous son origine ce double jeu de renvoi : la
conscience (de) croyance est croyance et la croyance est conscience
(de) croyance. En aucun cas nous ne pouvons dire que la conscience
est conscience, ni que la croyance est croyance. Chacun des termes
renvoie l ' autre et passe dans l'autre, et pourtant chaque terme est
diffrent de l 'autre. Nous l'avons vu, la croyance, ni le plaisir, ni la
joie ne peuvent exister avant d'tre conscients, la conscience est l a
mesure de l eur tre ; mai s i l n' en est pas moins vrai que l a croyance,
du fait mme qu'elle ne peut exister que comme trouble, existe ds
l'origine comme s'chappant soi , comme brisant l'unit de tous les
concepts o l'on peut vouloir l' enfermer.
1 1 1
Ainsi, consci ence (de) croyance et croyance sont un seul et mme
tre dont la caractristi que est l ' i mmanence absolue . Mais ds qu'on
veut saisir cet t re, i l glisse entre les doigts et nous nous trouvons en
face d' une bauche de dualit, d'un jeu de reflets, car l a conscience
est reflet ; mais j ustement en tant que reflet elle est le rflchissant et,
si nous tentons de l a saisir comme rflchissant, elle s'vanouit et
nous retombons sur le reflet . Cette structure du reflet-refltant a
dconcert les philosophes qui ont voulu l'expliquer par un recours
l'infi ni , soit en posant comme Spinoza une idea-ideae qui appelle une
idea-ideae ideae, etc. , soit en dfi nissant, l a manire de Hegel, le
retour sur soi comme l e vritable infini. Mais l'introduction de l'infini
dans l a conscience, outre qu' i l fige l e phnomne et l'obscurcit, n'est
qu'une thorie explicative expressment destine rduire l'tre de la
conscience cel ui de l 'en-soi. L'existence objective du reflet
refltant , si nous l ' acceptons comme il se donne, nous oblige au
contraire concevoir un mode d'tre diffrent de l'en-soi : non pas
une unit qui contient une dualit, non pas une synthse qui dpasse
et lve les moments abstraits de la thse et de l'antithse, mais une
dualit qui est unit, un reflet qui est sa propre rflexion. Si nous
cherchons en effet atteindre l e phnomne total, c'est--dire l'unit
de cette dualit ou conscience (de) croyance, i l nous renvoie aussitt
l'un des termes et ce terme son tour nous renvoie I" organisation
unitaire de l' i mmanence. Mais si au contraire nous voulons partir de
la dual it comme tel l e et poser conscience et croyance comme un
couple, nous rencontrons l'idea-ideae de Spinoza et nous manquons le
phnomne pr rflexif que nous voulions tudier. C'est que l a
conscience prrflexive est conscience (de) soi. Et c'est cette notion
mme de soi qu' i l faut tudier, car elle dfinit l'tre mme de la
conscience.
Remarquons tout d' abord que l e terme d'en-soi , que nous avons
emprunt la tradition pour dsigner l ' tre transcendant, est
impropre. A la limite de la concidence avec soi, en effet, le soi
s'vanouit pour laisser place l'tre identique. Le soi ne saurait tre
une proprit de l'tre-en-so. Par nature, il est un rfchi, comme
l 'i ndi que assez l a syntaxe et, en particulier, l a rigueur logique de la
syntaxe latine et les distinctions strictes que la grammaire tablit entre
l'usage du ejus et celui du . L soi renvoi e, mais i l renvoie
prcisment au sujet. Il indique un rapport du sujet avec lui-mme et
ce rapport est prcisment une dual i t, mais une dualit particulire
puisqu'elle exige des symboles verbaux particuliers. Mais, d'autre
part, l e soi ne dsigne l'tre ni en tant que sujet ni en tant que
compl ment . Si, en effet, je considre l e se de il s'ennuie , par
exemple, je constate qu' i l s'entrouvre pour laisser paratre derrire lui
l
e sujet lui-mme. I l n'est point le sujet, puisque l e sujet sans rapport
soi se condenserait dans l'identit de l'en-soi ; i l n'est pas non plus
1 12
une articulation consistante du rel puisqu' i l l ai sse paratre le sujet
derrire lui. En fait, l e soi ne peut tre saisi comme un existant rel :
le sujet ne peut tre soi, car la concidence avec soi fai t, nous l ' avons
vu, disparatre l e soi . Mais il ne peut pas non pl us ne pas tre soi ,
puisque le soi est i ndication du sujet lui -mme. Le soi reprsente donc
une distance i dal e dans l'immanence du sujet par rapport lui
mme , une faon de ne pas tre sa propre concidence, d'chapper
l'identit tout en la posant comme uni t, bref, d'tre en quilibre
perptuel l ement instable entre l ' identit comme cohsion absolue
sans trace de diversit et l' uni t comme synthse d'une multiplicit.
Cest ce que nous appellerons la prsence soi. La loi d'tre du pour
soi, comme fondement ontologique de la conscience, c'est d'tre lui
mme sous l a forme de prsence soi .
Cette prsence soi , on ra prise souvent pour une plnitude
d'existence et un prjug fort rpandu parmi l es philosophes fait
attri buer la conscience l a plus haute di gni t d'tre. Mais ce postulat
ne peut tre mai ntenu aprs une description plus pousse de l a notion
de prsence. En effet, toute prsence implique dualit, donc
sparation au moi ns virtuelle. La prsence de l'tre soi implique un
dcollement de l 'tre par rapport soi . La concidence de l'identique
est l a vritahle pl nitude d'tre, justement parce que dans cette
concidence il n'est l aiss de place aucune ngativit. Sans doute le
principe d'identit peut appeler le principe de non-contradiction,
comme Hegel l ' a vu. L'tre qui est ce qu' i l est doit pouvoir tre l'tre
qui n'est pas ce qu'il n'est pas. Mais d'ahord cette ngati on, comme
toutes les autres, vient l a surface de l'tre par l a ralit-humaine,
comme nous l'avons montr, et non par une di al ectique propre
l'tre lui-mme. En outre, ce principe ne peut dnoter que les
rapports de l'tre avec l'extrieur, puisque justement il rgit les
rapports de l'tre avec ce qu'il n'est pas. Il s'agit donc d' un principe
constitutif des relations externes, telles qu' el l es peuvent apparatre
une ralit-humai ne prsente l'tre-en-soi et engage dans l e
monde ; i l ne concerne pas l es rapports internes de l'tre ; ces
rapports, en tant qu' i ls poserai ent une altrit, n'existent pas. Le
principe d'identit est la ngation de toute espce de relation au sein
de l'tre-en-soi. Au contraire, l a prsence soi suppose qu'une fissure
impalpable s'est glisse dans l'tre. S'il est prsent soi , c'est qu'il
n'est pas tout fait soi . La prsence est une dgradation immdiate de
la concidence, car el l e suppose l a sparat i on. Mais si nous deman
dons prsent : qu'est ce qui spare le sujet de lui-mme, nous
sommes contraints d'avouer que ce n'est rien. Ce qui spare,
l'ordinai re, c'est une distance dans l'espace, un laps de temps, un
diffrend psychologique ou si mplement l ' individualit de deux co
prsents, bref une ralit qualifie. Mais, dans le cas qui nous occupe,
rien ne peut sparer la conscience (de) croyance de l a croyance,
1 13
puisque la croyance n'est rien d' autre que la conscience (de) croyance.
Introduire dans l ' unit d'un cogito prrflexif un lment qualifi
extrieur ce cogito, ce serait en briser l ' uni t, en dtruire la
translucidi t ; il y aurait alors dans l a conscience quelque chose dont
elle ne serait pas conscience, et qui n'existerait pas en soi-mme
comme conscience. La sparation qui spare la croyance d'elle-mme
ne se l aisse ni saisir ni mme concevoir part. Cherche-t-on la
dceler, elle s'vanouit : on retrouve l a croyance comme pure
i mmanence. Mai s si au contraire on veut saisir la croyance en tant que
telle, al ors la fissure est l , paraissant lorsqu'on ne veut pas l a voir,
disparaissant ds qu'on cherche l a contempler. Cette fissure est
donc l e ngatif pur. La distance, l e laps de temps, le di ffrend
psychologique peuvent tre saisis en eux-mmes et renferment
comme tels des lments de posi tivit, i l s ont une simple fonction
ngative. Mais la fissure intraconscientielle est un rien en dehors de ce
qu'elle ni e et ne peut avoir d'tre qu' en tant qu'on ne la voit pas. Ce
ngatif qui est nant d'tre et pouvoir nantisant tout ensemble, c'est
le nant. Nul le part nous ne pourrions le saisir dans une pareille
puret. Partout ailleurs il faut, d' une faon ou d'une autre , lui
confrer l'tre-en-soi en tant que nant. Mais le nant qui surgit au
cur de la conscience n 'est pas. I l est t. La croyance, par exemple,
n' est pas contigut d'un tre avec un autre tre , elle est sa propre
prsence soi, sa propre dcompression d' tre. Si non l'unit du pour
soi s'effondrerait en dualit de deux en-soi . Ainsi le pour-soi doit-il
tre son propre nant. L'tre de la conscience, en tant que cons
ci ence, c'est d'exi ster distance de soi comme prsence soi et cette
distance nul l e que l'tre porte dans son tre, c'est le Nant. Ainsi,
pour qu'il existe un soi, i l faut que l ' uni t de cet tre comporte son
propre nant comme nantisation de l'identi que. Car le nant qui se
glisse dans la croyance, c'est son nant, le nant de la croyance
comme croyance en soi, comme croyance aveugle et pleine, comme
foi dl) charbonni er . Le pour-soi est l'tre qui se dtermi ne lui
mme exister en tant qu'il ne peut pas concider avec l ui -mme,
On comprend, ds l ors, qu' en i nterrogeant sans fi l conducteur ce
cogito prrfl exi f, nous n'ayons trouv le nant nulle part. On ne
trouve pas, on n e dvoile pas le nant la faon dont on peut trouver,
dvoiler un tre, Le nant est toujours un ailleurs. C'est l' obligation
pour l e pour-soi de n'exister jamais que sous l a forme d'un ailleurs par
rapport l ui -mme, d'exister comme un tre qui s'affecte perptuel
lement d'une i nconsistance d' tre. Cette i nconsistance ne renvoie pas
d' ai l l eurs un autre tre, elle n'est qu' un renvoi perptuel de soi
soi, du reflet au refl tant, du refltant au reflet . Toutefoi s, ce renvoi
ne provoque pas au sein du pour-soi un mouvement i nfi ni , i l est
don n dans l ' uni t d' un seul acte : le mouvement infini n'appartient
qu'au regard rfl exi f qui veut saisir le phnomne comme totalit et
1 14
qui est renvoy du reflet au reftant, du reftant au reflet sans
pouvoir s'arrter. Ainsi, l e nant est ce trou d'tre, cette chute de
l'en-soi vers l e soi par quoi se constitue le pour-soi. Mais ce nant ne
peut tre t que si son existence d'emprunt est corrlative d' un
acte nantisant de l' tre. Cet acte perptuel par quoi l'en-soi se
dgrade en prsence soi, nous l 'appellerons acte ontologi que. Le
nant est la mise en question de l'tre par l'tre, c'est--dire
justement la conscience ou pour-soi . C'est un vnement absolu qui
vient l'tre par l'tre et qui , sans avoir l'tre, est perptuellement
soutenu par l'tre. L'tre en soi tant isol dans son tre par l a totale
positivit, aucun tre ne peut produire de l 'tre et rien ne peut arriver
l'tre par l'tre, si ce n'est le nant. Le nant est l a possibilit propre
de l'tre et son uni que possibilit. Encore cette possibilit originelle
n'apparat-elle que dans l'acte absolu qui la ralise. Le nant tant
nant d'tre ne peut venir l'tre que par l'tre lui-mme. Et sans
doute vi ent-il l' tre par un tre singulier, qui est l a ralit-humaine.
Mais cet tre se constitue comme ralit-humaine en tant qu'il n'est
rien que le projet originel de son propre nant. La ralit-humaine,
c'est l' tre en tant qu' i l est dans son tre et pour son tre fondement
unique du nant au sein de l'tre.
I I
LA FACTI CIT DU POUR- SOI
Pourtant, l e pour-soi est. I l est, di ra-t-on, ft-ce titre d'tre qui
n'est pas ce qu' i l est et qui est ce qu'i l n'est pas. Il est puisque, quels
que soient les cueils qui vi ennent la faire chouer, le projet de l a
sincrit est au moi ns concevable. Il est, titre d'vnement, au sens
o je puis dire que Philippe II a t, que mon ami Pierre est, existe ; il
est en tant qu'il apparat dans une condition qu'il n'a pas choisie, en
tant que Pierre est bourgeois franais de 1 942, que Schmitt tait
ouvrier berlinois de 1 870 ; il est en tant qu'il est jet dans un monde,
dlaiss dans une situation , i l est en tant qu' il est pure contin
gence, en tant que pour l ui comme pour les choses du monde, comme
pour ce mur, cet arbre, cette tasse, l a question originelle peut se
poser : Pourquoi cet tre-ci est-il tel et non autrement ? Il est, en
tant qu'il y a en lui quelque chose dont il n'est pas le fondement : sa
prsence au monde.
Cette saisie de l'tre par lui-mme comme n'tant pas son propre
fondement, elle est au fond de tout cogito. Il est remarquable, cet
gard, qu'elle se dcouvre i mmdiatement au cogito rfexif de
1 15
Descartes. Lorsque Descartes, en effet, veut tirer profit de sa
dcouverte, il se saisit lui-mme comme un tre imparfait, puisqu'il
doute . Mais, en cet tre imparfai t , i l constate l a prsence de ride
de parfai t. Il apprhende donc un dcalage entre l e type d'tre qu'il
peut concevoir et l'tre qu'il est . Cest ce dcalage ou manque d'tre
qui est l'origine de l a seconde preuve de l'existence de Dieu. Si l'on
carte en effet la termi nologie scolastique , que demeure-t-il de cette
preuve : le sens trs net que l'tre qui possde en lui ri de de parfait
ne peut tre son propre fondement, sinon il se serait produit
conformment cette ide. En d'autres termes : un tre qui serait son
propre fondement ne pourrait souffrir le moindre dcalage entre ce
qu'il est et ce qu' i l conoit, car il se produirait conformment sa
comprhension de l'tre et ne pourrait concevoir que ce qu'il est.
Mais cette apprhension de l'tre comme un manque d' tre en face de
l'tre est d' abord une saisie par le cogito de sa propre contingence, Je
pense donc j e suis. Que suis-j e ? Un tre qui n'est pas son propre
fondement, qui , en tant qu'tre, pourrait tre autre qu' i l est dans la
mesure o il n'explique pas son tre. C'est cette intuition premire de
notre propre contingence que Hei degger donnera comme la motiva
tion premi re du passage de l'inauthentique l'authentique, El l e est
i nqui tude, appel de la conscience Ruf des Gewissens ), senti
ment de cul pabi l i t. A vrai dire, la description de Heidegger laisse
trop cl ai rement paratre le souci de fonder ontologiquement une
Ethique dont il prtend ne pas se proccuper, comme aussi de
concilier son humanisme avec l e sens religieux du transcendant.
L'i ntuition de notre contingence n'est pas assimilabl e un sentiment
de culpabi l i t. Il n'en demeure pas moins que dans l'apprhension de
nous-mme par nous-mme, nous nous apparaissons avec les carac
tres d'un fait injustifiable.
Mai s ne nous saisissions-nous pas, tout l'heure l, comme cons
ci ence, c'est--dire comme un tre qui existe par soi ? Comment
pouvons-nous tre dans l'unit d'un mme surgissement l'tre, cet
tre qui existe par soi comme n'tant pas le fondement de son tre ?
Ou, e n d' autres termes, comment le pour-soi qui , en tant qu' i l est,
n'est pas son propre tre, au sens o il en serait le fondement, peut-il
tre, en tant qu' i l est pour-soi, fondement de son propre nant ? La
rponse est dans l a question.
Si l'tre, en effet, est l e fondement du nant en tant que
nanti sation de son propre tre, cela ne veut pas dire pour autant qu'il
est l e fondement de son tre. Pour fonder son propre tre, i l faut
exister distance de soi et cela i mpl iquerait une certaine nantisation
de l'tre fond comme de l'tre fondant, une dualit qui serait unit :
nous retomberions dans le cas du pour-soi . En un mot, tout effort
1 . Cf. i ci mme, I ntroduction, parag. I I I .
1 16
pour concevoir l'ide d'un tre qui serait fondement de son tre
aboutit , en dpit de lui-mme, former celle d' un tre qui, contingent
en tant qu'tre-en-soi, serait fondement de son propre nant. L'acte
de causation par o Dieu est causa sui est un acte nantisant comme
toute reprise de soi par soi, dans l'exacte mesure o la relation
premire de ncessit est un retour soi, une rflexivit. Et cette
ncessit origi nel l e, son tour, parat sur le fondement d'un tre
contingent, celui, prcisment, qui est pour tre cause de soi . Quant
l'effort de Leibniz pour dfinir le ncessaire partir du possible -
dfinition reprise par Kant - il se conoit du point de vue de la
connaissance et non du point de vue de l'tre. Le passage du possible
l'tre tel que l e conoit Leibniz (le ncessaire est un tre dont la
possibilit implique l'existence) marque le passage de notre ignorance
la connaissance. La possibilit ne peut tre en effet ici possibilit
qu'au regard de notre pense, puisqu'elle prcde l'existence. Elle est
possibilit externe par rapport l'tre dont elle est possibilit,
puisque l'tre en dcoule comme une consquence d'un principe.
Mais nous avons marqu plus haut que l a notion de possibilit pouvait
tre considre sous deux aspects . On peut en faire, en effet, une
indication subjective (i l est possible que Pierre soit mort signifie
l'ignorance o je suis du sort de Pierre) et dans ce cas c'est le tmoin
qui dcide du possible en prsence du monde ; l'tre a sa possibilit
hors de soi, dans l e pur regard qui jauge ses chances d' tre ; la
possibilit peut bien nous tre donne avant l'tre, mais c'est nous
qu'elle est donne et elle n'est point possibilit de cet tre ; i l
n'appartient pas la possibilit de l a bi l l e qui roule sur l e tapis d'tre
dvie par un pli de l'toffe ; la possibilit de dviation n'appartient
pas non plus au tapis, elle ne peut qu'tre tablie synthtiquement par
le tmoin comme un rapport externe. Mais la possibilit peut aussi
nous apparatre comme structure ontologique du rel : alors elle
appartient certains tres comme leur possibilit, el le est la possibi
lit qu'ils sont, qu'ils ont tre. En ce cas, l'tre soutient l"tre ses
propres possibilits, i l en est le fondement et il ne se peut donc pas
que la ncessit de l'tre puisse se tirer de sa possibilit. En un mot,
Dieu, s'il existe, est contingent.
Ainsi l'tre de la conscience, en tant que cet tre est en soi pour se
nantiser en pour-soi, demeure contingent, c'est--dire qu'il n'appar
tient pas la conscience de se le donner, ni non plus de le recevoir des
autres. Outre, en effet, que la preuve ontologique, comme la preuve
cosmologique, choue constituer un tre ncessaire, l ' explication et
le fondement de mon tre en tant que je suis un tel tre ne sauraient
tre cherchs dans l'tre ncessaire : les prmisses Tout ce qui est
contingent doit trouver un fondement dans un tre ncessaire. Or je
suis contingent marquent un dsir de fonder et non le rattachement
explicatif un fondement rel . Elles ne sauraient aucunement rendre
1 17
compte, en effet, de cette contingence-ci, mais seulement de l'ide
abstrai te de contingence en gnral. En outre, i l s'agit l de valeur,
non de fait
1
. Mais si l' tre-en-soi est contingent, il se reprend lui
mme en se dgradant en pour-soi . Il est pour se perdre en pour-soi.
En un mot, l'tre est et ne peut qu'tre. Mais la possibilit propre de
l'tre - celle qui se rvle dans l'acte nantisant - c'est d'tre
fondement de soi comme conscience par l'acte sacrificiel qui le
nanti t ; le pour-soi c'est l'en-soi se perdant comme en-soi pour se
fonder comme conscience. Ainsi la conscience tient-elle d'elle-mme
son tre-conscience et ne peut renvoyer qu' elle-mme en tant
qu'elle est sa propre nantisation mais ce qui s'anantit en conscience,
sans pouvoir tre dit fondement de la conscience, c'est l'en-soi
contingent. L'en-soi ne peut rien fonder ; s'il se fonde lui-mme c'est
en se donnant l a modi fication du pour-soi. Il est fondement de lui
mme en tant qu'il n'est dj plus en-soi ; et nous rencontrons ici
l'origine de tout fondement. Si l ' tre en-soi ne peut tre ni son propre
fondement ni celui des autres tres, le fondement en gnral vient au
monde par le pour-soi . Non seulement le pour-soi, comme en-soi
nanti s, se fonde lui-mme mais avec l ui apparat le fondement pour
l a premire fois.
Reste que cet en-soi englouti et nantis dans l'vnement absolu
qu'est l ' apparition du fondement ou surgissement du pour-soi
demeure au sein du pour-soi comme sa contingence originelle. La
conscience est son propre fondement mais i l reste contingent qu'il y
ait une conscience plutt que du pur et simple en-soi l'infini.
L'vnement absolu ou pour-soi est contingent en son tre mme. Si
je dchi ffre les donnes du cogito prrflexif je constate, certes, que
l e pour-soi renvoie soi. Quoi qu' i l soit, i l l'est sur le mode de
conscience d'tre. La soif renvoie la conscience de soif qu'elle est
comme son fondement -et inversement. Mais l a totalit reflt
refltant , si el l e pouvait tre donne, serait contingence et en-soi.
Seul ement cette total it ne peut tre atteinte, puisque je ne puis dire
ni que la conscience de soif est conscience de soif, ni que la soif est
soif. El l e est l , comme totalit nantise, comme unit vanescente
du phnomne. Si je saisis l e phnomne comme pluralit, cette
pluralit s' i ndi que el le-mme comme unit totalitaire et, par l, son
sens est l a contingence, c'est--dire que je puis me demander :
pourquoi suis-je soif, pourquoi suis-je conscience de ce verre, de ce
Moi ? Mais ds que je considre cette totalit en elle-mme, el le se
nantit sous mon regard, ell e n'est pas, elle est pour ne pas tre et je
reviens au pour-soi saisi dans son bauche de dualit comme
fondement de soi : j 'ai cette colre parce que je me produis comme
1. Ce raisonnement est explicitement bas, en effet, sur les exigences de la
raison.
1 18
conscience de colre ; supprimez cette causation de soi qui constitue
l'tre du pour-soi et vous ne rencontrerez plus rien, mme pas l a
colre-en-soi car la colre existe par nature comme pour-soi .
Ainsi le pour-soi est soutenu par une perptuelle contingence, qu' il
reprend son compte et s'assimile sans jamais pouvoir la supprimer.
Cette contingence perptuellement vanescente de l'en-soi qui hante
le pour-soi et l e rattache l ' tre-ensoi sans jamais se laisser saisir,
c'est ce que nous nommerons l a facticit du pour-soi . Cest cette
facticit qui permet de dire qu' i l est, qu'il existe, bien que nous ne
puissions jamais la raliser et que nous la saisissions toujours travers
le poursoi. Nous signalions plus haut que nous ne pouvons rien tre
sans jouer l'tre 1. Si je suis garon de caf, crivions-nous, ce ne
peut tre que sur le mode de ne l'tre pas. Et cela est vrai : si je
pouvais tre garon de caf, je me constituerais soudain comme un
bloc contingent d' i dentit. Cela n'est point : cet tre contingent et en
soi m' chappe toujours. Mais pour que je puisse donner librement un
sens aux obligations que comporte mon tat , il faut qu'en un sens, au
sein du pour-soi, comme totalit perptuellement vanescente, l'tre
ensoi comme contingence vanecente de ma situation soit donn.
C'est ce qui ressort bien du fait que, si je dois jouer tre garon de
caf pour l'tre, du moins aurai-je beau jouer au diplomate ou au
marin : je ne le serai pas. Ce fait i nsaisissable de ma condition, cette
impalpable diffrence qui spare la comdie ralisante de la pure et
simple comdie, c'est ce qui fait que le pour-soi, tout en choisissant le
sens de sa situation et en se constituant lui-mme comme fondement
de lui-mme en situation, ne choisit pas sa position. Cest ce qui fait
que je me saisis la fois comme totalement responsable de mon tre,
en tant que j 'en suis le fondement et, l a fois, comme totalement
injustifiable. Sans l a facticit la conscience pourrait choisir ses
attaches au monde, l a faon dont les mes, dans La Rpublique,
choisissent leur condition : je pourrais me dterminer natre
ouvrier ou natre bourgeois . Mais d'autre part la facticit ne
peut me constituer comme lant bourgeois ou tanl ouvrier. Elle n'est
mme pas, proprement parler, une rsistance du fait , puisque c'est
en la reprenant dans l'infrastructure du cogito prrflexif que je lui
confrerai son sens et sa rsistance. Elle n'est qu'une indication que je
me donne moi-mme de l ' tre que je dois rejoindre pour tre ce que
je suis. Il est impossible de la saisir dans sa nudit brute, puisque tout
ce que nous trouverons d'elle est dj repris et librement construit. Le
simple fait d'tre l , cette table, dans cette pice, est dj le pur
objet d' un concept-limite et ne saurait tre atteint en tant que tel. Et
pourtant il est contenu dans ma conscience d'tre l comme sa
contingence plnire, comme l'en-soi nantis sur le fond de quoi le
1 . Ire partie, chapitre II, 2e section : Les conduites de mauvaise foi .
1 19
pour-soi se produi t l ui -mme comme conscience d'tre l . Le pour-soi
s'approfondissant lui-mme comme conscience d'tre l ne dcou
vrira jamais en soi que des motivations, c'est--dire qu' i l sera
perptuellement renvoy lui-mme et sa libert constante (Je suis
l pour. . . etc. ) . Mais l a contingence qui transit ces motivations, dans
la mesure mme o elles se fondent totalement elles-mmes, c'est la
facticit du pour-soi . Le rapport du pour-soi , qui est son propre
fondement en tant que pour-soi , l a facticit peut tre correctement
dnomm : ncessit de fait. Et c'est bien cette ncessit de fait que
Descartes et Husserl saisissent comme onstituant l'vidence du
cogito. Ncessaire, le pour-soi l'est en tant qu' i l se fonde lui-mme. Et
c'est pourquoi i l est l'objet rflchi d'une intuition apodictique : je ne
peux pas douter que je sois. Mai s en tant que ce pour-soi, tel qu' i l est,
pourrait ne pas tre, il a toute l a contingence du fait. De mme que
ma libert nantisante se saisit elle-mme par l'angoisse, le pour-soi
est conscient de sa facticit : il a le sentiment de son entire gratuit,
il se saisit comme tant l pour rien, comme tant de trop.
Il ne faut pas confondre la facticit avec cette substance cartsienne
dont l'attribut est l a pense. Certes la substance pensante n'existe
qu'autant qu'elle pense et, tant chose cre, elle participe la
contingence de l'ens creatum. Mais elle est. Elle conserve le caractre
d'en-soi dans son intgrit, bien que le pour-soi soit son attribut. C'est
ce qu'on nomme l ' i llusion substantialiste de Descartes. Pour nous, au
contraire, l ' apparition du pour-soi ou vnement absolu renvoie bien
l'effort d'un en-soi pour se fonder : il correspond une tentative de
l' tre pour lever la contingence de son tre ; mais cette tentative
aboutit la nantisation de l'en-soi, parce que l'en-soi ne peut se
fonder sans i ntroduire le soi, ou renvoi rfl exi f et nantisant, dans
l'identit absolue de son tre et par consquent sans se dgrader en
pour-soi. Le pour-soi correspond donc une destruction dcompri
mante de l'en-soi et l'en-soi se nantit et s'absorbe dans sa tentative
pour se fonder. Il n'est donc pas une substance dont le pour-soi serait
l'attribut et qui produirait la pense sans s'puiser dans cette
production mme. Il demeure simplement dans le pour-soi comme un
souvenir d' tre, comme son inj ustifiable prsence au monde. L'tre
en-soi peut fonder son nant mais non son tre ; dans sa dcompres
sion il se nantit en un pour-soi qui devient en tant que pour-soi son
propre fondement ; mais sa contingence d' en-soi demeure hors de
prise. C'est ce qui reste de l'en-soi dans le pour-soi comme facticit et
c'est ce qui fait que l e pour-soi n'a qu'une ncessit de fait, c'est-
dire qu' i l est le fondement de son tre-conscience ou existence, mais
qu' i l ne peut en aucun cas fonder sa prsence. Ainsi la conscience ne
peut en aucun cas s'empcher d' tre et pourtant elle est totalement
responsable de son tre.
120
I I I
LE POUR- SOI ET L' TRE DE LA VALEUR
Une tude de l a ralit-humaine doit commencer par J e cogito.
Mais le Je pense cartsien est conu dans une perspective
instantaniste de la temporalit. Peut-on trouver au sein du cogito un
moyen de transcender cette instantanit ? Si la ralit-humaine se
limitait l'tre du Je pense, elle n' aurait qu'une vrit d'instant. Et i l
est bien vrai qu'elle est chez Descartes une totalit instantane,
puisqu'elle n'lve, par elle-mme, aucune prtention sur l'avenir,
puisqu'il faut un acte de cration continue pour la faire passer
d'un instant l'autre. Mais peut-on mme concevoir une vrit de
l'instant ? Et le cogito n'engage-t-il pas sa manire le pass et
l'avenir ? Heidegger est tellement persuad que le Je pense de Husserl
est un pige aux alouettes fascinan t et engluant, qu'il a totalement
vit le recours la conscience dans sa description du Dasein. Son but
est de le montrer i mmdiatement comme souci, c'est--dire comme
s'chappant soi dans l e projet de soi vers les possibilits qu'il est.
C'est ce projet de soi hors de soi qu' i l nomme la comprhension
(Verstand) et qui lui permet d'tablir la ralit-humaine comme tant
rvlante-rvle . Mais cette tentative pour montrer d'abord
l'chappement soi du Dasein va rencontrer son tour des difficults
insurmontables : on ne peut pas supprimer d'abord la dimension
conscience , ft-ce pour l a rtablir ensuite. La comprhension n'a
de sens que si elle est conscience de comprhension. Ma possibilit ne
peut exister comme ma possi bilit que si c'est ma conscience qui
s'chappe soi vers el l e. Sinon tout l e systme de l'tre et de ses
possibilits tombera dans l'inconscient, c'est--dire dans l'en-soi.
Nous voil rejet vers l e cogito. I l faut en partir. Peut-on l'largir sans
perdre les bnfices de l'vidence rflexive ? Que nous a rvl la
description du pour-soi ?
Nous avons rencontr d'abord une nantisation dont l'tre du pour
soi s'affecte en son tre. Et cette rvlation du nant ne nous a pas
paru dpasser les bornes du cogito. Mais regardons-y mieux.
Le pour-soi ne peut soutenir la nantisation sans se dterminer lui
mme comme un dfaut d'tre. Cela signifie que l a nantisation ne
concide pas avec une simple introduction du vide dans la conscience.
Un tre extrieur n'a pas expuls l' en-soi de la conscience, mais c'est
le pour-soi qui se dtermine perptuellement lui-mme n 'tre pas
" en-soi. Cela signifie qu' i l ne peut se fonder lui-mme qu' partir de
Jen-soi et contre l'en-soi. Ainsi la nantisation, tant nantisation
d'tre, reprsente l a l i aison OrIginelle entre l'tre du pour-soi et l'tre
121
de l ' en-soi . L'en-soi concret et rel est tout entier prsent au cur de
l a conscience comme ce qu' el l e se dtermine elle-mme ne pas tre.
Le cogito doit nous amener ncessairement dcouvrir cette prsence
totale et hors d'atteinte de l"en-soi. Et, sans doute, le fait de cette
prsence sera-t-il la transcendance elle-mme du pour-soi . Mais
prcisment c'est la nantisation qui est l " origine de la transcendance
conue comme lien originel du pour-soi avec l'en-soi. Ainsi entre
voyons-nous un moyen de sortir du cogito. Et nous verrons plus loin,
en effet, que l e sens profond du cogito c'est de rejeter par essence
hors de soi. Mais il n'est pas temps encore de dcrire cette
caractristique du pour-soi. Ce que l a description ontologique a fait
immdiatement paratre, c'est que cet tre est fondement de soi
comme dfaut d'tre, c'est--dire qu' i l se fait dterminer en son tre
par un tre qu' i l n'est pas.
Toutefois i l est bien des faons de n'tre pas et certaines d'entre
elles n'atteignent pas l a nature i nti me de l'tre qui n'est pas ce qu'il
n'est pas. Si, par exemple, je dis d'un encrier qu'il n'est pas un oiseau,
l"encrier et l"oiseau demeurent intouchs par la ngation. Celle-ci est
une relation externe qui ne peut tre tablie que par une ralit
humaine tmoi n. Par contre, i l est un type de ngations qui tablit un
rapport interne entre ce qu'on nie et ce de quoi on le nie 1 . De toutes
les ngations internes, celle qui pntre le plus profondment dans
l'tre, celle qui constitue dans son tre l'tre dont elle nie avec l'tre
qu'elle ni e, c'est le manque. Ce manque n'appartient pas la nature
de l 'en-soi , qui est tout positivit. Il ne parat dans le monde qu'avec
le surgissement de la ralit-humai ne. C'est seulement dans le monde
humai n qu'il peut y avoir des manques. Un manque suppose une
trinit : ce qui manque ou manquant, ce quoi manque ce qui
manque ou existant, et une totalit qui a t dsagrge par le
manque et qui serait restaure par la synthse du manquant et de
l'existant : c'est le manqu. L'tre qui est livr l'intuition de la
ralit-humaine est toujours ce quoi il manque ou existant. Par
exemple, si je dis que la lune n'est pas pleine et qu'il lui manque un
quartier, je porte ce j ugement sur une intuition pleine d' un croissant
de lune. Ainsi ce qui est livr l'intuition est un en-soi qui , en lui
mme, n'est ni complet ni incomplet, mais qui est ce qu'il est tout
simplement, sans rapport avec d' autres tres. Pour que cet en-soi soit
saisi comme croissant de l une, i l faut qu'une ralit-humaine dpasse
le donn vers le projet de la totalit ralise - ici le disque de la
pleine l une - et revienne ensuite vers l e donn pour le constituer
1 . A ce type de ngation appartient l'opposition hglienne. Mais cette
opposition doi t elle mme sc fonder sur la ngati on interne primitive, c'est
dire sur le manque. Par exemple, si l'inessentiel devient son tour l'essentiel,
c'est parce qu'
i l est ressenti comme un manque au sein de l'essentiel.
122
comme croissant de l une. C'est--dire pour le raliser dans son tre
partir de la totalit qui en devient le fondement. Et dans ce mme
dpassement le manquant sera pos comme ce dont l'adjonction
synthtique l'existant reconstituera la totalit synthtique du
manqu. En ce sens l e manquant est de mme nature que l'existant, il
suffirait d'un renversement de l a situation pour qu'il devienne
existant quoi manque ce qui manque, tandis que l'existant devien
drait manquant. Ce manquant comme complmentaire de l'existant
est dtermin dans son tre par l a totalit synthtique du manqu.
Ainsi, dans le monde humain, l'tre incomplet qui se livre l'intuition
comme manquant est constitu par le manqu -c'est--dire par ce
qu'il n'est pas - dans son tre ; c'est la pleine lune qui confre au
croissant de l une son tre de croissant ; c'est ce qui n'est pas qui
dtermine ce qui est ; il est dans l ' tre de l'existant, comme corrlatif
d'une transcendance humaine, de mener hors de soi j usqu' l ' tre
qu'il n'est pas comme son sens.
La ralit-humai ne, par quoi le manque apparat dans le monde,
doit tre elle-mme un manque. Car l e manque ne peut venir de l ' tre
que par le manque, l'en-soi ne peut tre occasion de manque l'en
soi. En d'autres termes, pour que l'tre soit manquant ou manqu, il
faut qu'un tre se fasse son propre manque ; seul un tre qui manque
peut dpasser l'tre vers le manqu.
Que la ralit -humaine soit manque, l'existence du dsir comme
fait humain suffirait l e prouver. Comment expliquer l e dsir, en
effet, si l'on veut ) voir un tat psychique, c'est--dire un tre dont l a
nature est d' tre ce qu' i l est ? Un tre qui est ce qu' i l est, dans l a
mesure o i l est considr comme tant ce qu' i l est, n'appelle rien
soi pour se complter. Un cercle inachev n'appelle l' achvement
qu'en tant qu'il est dpass par l a transcendance humaine. En soi il
est complet et parfaitement posi ti f comme courbe ouverte. Un tat
psychique qui existerait avec l a suffisance de cette courbe ne saurait
pssder par surcrot l e moindre appel vers autre chose : i l serait
lui-mme, sans aucune relation avec ce qui n'est pas l ui ; il faudrait,
pur le constituer comme faim ou soif, une transcendance extrieure
qui le dpasse vers l a totalit faim apaise , comme elle dpasse le
croissant de lune vers la pleine lune. On ne se tirera pas d'affaire en
faisant du dsir un conatus conu l'image d'une force physique. Car
le conatus, derechef, mme si on lui concde l'efficience d'une cause,
ne saurait possder en lui-mme l es caractres d'un apptit vers un
autre tat. Le cana/us comme producteur d'tats ne saurait s'identifier
au dsir comme appel d' tat. Un recours au paralllisme psycho
physiologique ne permettrait pas davantage d'carter ces di fficults :
la soif comme phnomne organique, comme besoin physiologi
que d'eau n'existe pas. L'organisme priv d'eau prsente certains
phnomnes positifs, par exemple, un certain paississement coagu-
123
lescent du liquide sanguin, lequel provoque son tour certains autres
phnomnes . L'ensemble est un tat positif de l'organisme qui ne
renvoie qu' lui-mme, tout juste comme l 'paississement d'une
solution dont l ' eau s'vapore ne peut tre considr en lui-mme
comme un dsir d'eau de la solution, Si l'on suppose une exacte
correspondance du mental et du physiologique, cette correspondance
ne peut s'tablir que sur fond d'identit ontologique, comme l'a vu
Spi noza. En consquence, l ' tre de la soif psychique sera l'tre en soi
d' un tat et nous sommes renvoy derechef une transcendance
tmoi n. Mais al ors la soif sera dsir pour cette transcendance, non
pour elle-mme : el l e sera dsi r aux yeux d'autrui . Si le dsir doit
pouvoir tre soi-mme dsir, i l faut qu'il soit l a transcendance elle
mme, c'est-a-dire qu'il soit par nature chappement soi vers l'objet
dsir. En d' autres termes, il faut qu'il soit un manque -mais non
pas un manque-objet , un manque subi , cr par le dpassement qu'il
n'est pas : i l faut qu'i l soit son propre manque de . . . Le dsir est
manque d'tre, il est hant en son tre le plus intime par l 'tre dont i l
est dsir. Ai nsi tmoigne-t-il de l'existence du manque dans l'tre de
la ralit-humaine. Mais si la ralit-humai ne est manque, par elle
surgit dans l ' tre l a t rinit de l'existant, du manquant et du manqu.
Quels sont au j uste les trois termes de cette trinit ?
Ce qui joue ici le rle de l'existant, c'est ce qui se livre au cogito
comme l'immdiat du dsir ; par exemple, c'est ce pour-soi que nous
avons saisi comme n'tant pas ce qu' i l est et tant ce qu'il n'est pas.
Mais que peut tre le manqu ?
Pour rpondre cette questi on, il nous faut revenir sur l'ide de
manque et dterminer mi eux le li en qui unit l'existant au manquant.
Ce lien ne saurait tre de si mple contigut. Si ce qui manque est si
profondment prsent, dans son absence mme, au cur de l'exis
tant, c'est que l'existant et le manquant sont d'un mme coup saisis et
dpasss dans l ' unit d'une mme totalit. Et ce qui se constitue soi
mme comme manque ne peut le faire qu'en se dpassant vers une
grande forme dsagrge. Ainsi l e manque est apparition sur le fond
d'une totalit. Il i mporte peu d'ailleurs que cette totalit ait t
originel lement donne et soit prsentement dsagrge < les bras de
la Vnus de Milo manquent . . . ) ou qu'ell e n'ait jamais encore t
ralise I l manque d e courage ). Ce qui importe, c'est seulement
que le manquant et l ' existant se donnent ou soient saisis comme
devant s'anantir dans l'unit de la totalit manque. Tout ce qui
manque manque . . . pour . . . Et ce qui est donn dans l'unit d'un
surgissement primitif, c'est l e pour, conu comme n'tant pas encore
ou n'tant pl us, absence vers laquelle se dpasse ou est dpass
l'existant tronqu qui se constitue par l mme comme tronqu. Quel
est le pour de l a ralit-humaine ?
Le pour-soi, comme fondement de soi , est le surgissement de l a
124
ngation. Il se fonde en tant qu'il nie de soi un certain tre ou une
manire d' tre. Ce qu'il nie ou nantit, nous le savons, c'est l'tre-en
soi. Mai s non pas n'importe quel tre-en-soi : la ralit-humaine est
avant tout son propre nant. Ce qu' elle nie ou nantit de soi comme
pour-soi , ce ne peut tre que soi. Et, comme elle est constitue dans
son sens par cette nantisation et cette prsence en elle de ce qu'elle
nantit titre de nantis, c'est l e soi-comme-lre-en-soi manqu qui
fait le sens de l a ralit-humai ne. En tant que, dans son rapport
primitif soi , la ralit-humaine n'est pas ce qu'el l e est, son rapport
soi n'est pas pri mitif et ne peut tirer son sens que d'un premier
rapport qui est le rapport nul ou identit. C'est le soi qui serait ce qu'il
est, qui permet de saisir l e pour-soi comme n'tant pas ce qu' i est ; l a
relation ni e dans l a dfinition du pour-soi - et qui , comme telle,
doit tre pose d'abord -, c'est une relation, donne comme
perptuel lement absente , du pour-soi lui-mme sur le mode de
l'identit . Le sens de ce trouble subtil par quoi la soif s'chappe et
n'est pas soif, en tant qu' el le est conscience de soif, c'est une soif qui
serait soif et qui la hante. Ce que l e pour-soi manque, c'est l e soi -ou
soi-mme comme en-soi.
11 ne faudrait pas confondre, toutefois, cet en-soi manqu avec celui
de la facticit. L'en-soi de l a facticit, dans son chec se fonder, s'est
rsorb en pure prsence au monde du pour-soi . L'en-soi manqu, au
contraire, est pure absence. L'chec de l 'acte fondant, en outre, a fait
surgir de l'en-soi le pour-soi comme fondement de son propre nant.
Mais le sens de l'acte fondant manqu demeure comme transcendant.
L pour-soi dans son tre est chec, parce qu' i l n'est fondement que
de soi-mme en tant que nant. A vrai dire cet chec est son tre
mme, mais il n'a de sens que s'il se saisit l ui-mme comme chec en
prsence de l'tre qu' i l a chou tre, c'est--dire de l'tre qui serait
fondement de son tre et non plus seulement fondement de son
nant, c'est--dire qui serait son fondement en tant que concidence
avec soi. Par nature le cogito renvoie ce dont il manque et ce qu'il
manque, parce qu' i l est cogito hant par l ' tre, Descartes l'a bien vu ;
et telle est l'origine de la transcendance : la ralit-humaine est son
propre dpassement vers ce qu'el le manque, elle se dpasse vers l'tre
particulier qu'elle serait si elle tait ce qu'elle est. La ralit-humaine
n'est pas quelque chose qui existerait d'abord pour manquer par aprs
de ceci ou de cela : elle existe d'abord comme manque et en liaison
synthtique i mmdiate avec ce qu'elle manque. Ainsi l 'vnement
pur par quoi la ralit-humaine surgit comme prsence au monde est
saisie d'elle-mme par soi comme son propre manque. La ralit
humaine se saisit dans sa venue l'existence comme tre incomplet.
Elle se saisit comme tant en tant qu'elle n'est pas, en prsence de la
totalit singulire qu'el l e manque et qu'elle est sous forme de ne l'tre
pas et qui est ce qu'elle est. La ralit-humaine est dpassement
125
perptuel v ers une concidence avec soi qui n'est jamais donne. Si
le cogito tend vers l 'tre, c'est que par sa surrection mme i l se
dpasse vers l'tre en se qualifiant dans son tre comme l'tre qui
la concidence avec soi manque pour tre ce qu'il est. Le cogito est
i ndissolublement l i l'tre-en-soi, non comme une pense son
objet - ce qui relativiserait l'en-soi - mais comme un manque
ce qui dfinit son manque. En ce sens la seconde preuve cart
si enne est rigoureuse ; l'tre i mparfait se dpasse vers l'tre par
fait ; l'tre qui n' est fondement que de son nant se dpasse vers
l'tre qui est fondement de son tre. Mais l'tre vers quoi la
ralit-humaine se dpasse n'est pas un Dieu transcendant ; i l est
au cur d' elle-mme, il n'est qu'elle-mme comme total it.
C' est que, en effet, cette totalit n' est pas l e pur et simpl e en-soi
contingent du transcendant. Ce que l a conscience saisit comme
l'tre vers quoi el l e se dpasse, s'il tait pur en-soi , conciderait
avec l'anantissement de la conscience. Mais l a conscience ne se
dpasse point vers son anantissement, elle ne veut pas se perdre
dans l 'en-soi d'identit l a l imite de son dpassement. C'est pour
l e pour-soi en tant que tel que l e pour-soi revendique l'tre-en-soi.
Ai nsi cet tre perptuellement absent qui hante le pour-soi , c'est
lui-mme fig en en-soi . C'est l'impossible synthse du pour-soi et
de l ' en-soi ; i l serait son propre fondement non en tant que nant
mais en tant qu'tre et garderait en l ui l a translucidit ncessaire de
la conscience en mme temps que la concidence avec soi de l'tre
en soi . Il conserverait en l ui ce retour sur soi qui conditionne toute
ncessit et tout fondement. Mais ce retour sur soi se ferait sans
distance, il ne serait point prsence soi, mais identit soi . Bref,
eet tre serait justement le soi que nous avons montr ne pouvoir
exister que comme rapport perptuellement vanescent, mais i l le
serait en tant qu' tre substantiel. Ai nsi la ralit-humaine surgit
comme telle en prsence de sa propre totalit ou soi comme
manque de cette totalit . Et cette totalit ne peut tre donne par
nature, puisqu'elle rassemble en soi les caractres incompatibles de
l'en-soi et du pour-soi. Et qu'on ne nous reproche pas d'inventer
plaisir un tre de cette espce ; lorsque cette totalit dont l'tre et
l'absence absolue sont hypostasis comme transcendance par del
le monde, par un mouvement ultrieur de l a mdiation, elle prend
le nom de Di eu. Et Di eu n'est-il pas la fois un tre qui est ce
qu' i l est en tant qu' i l est tout positivit et le fondement du monde
- et la fois un tre qui n'est pas ce qu'il est et qui est ce qu'il
n'est pas, en tant que conscience de soi et que fondement nces
saire de lui-mme ? La ralit-humaine est souffrante dans son tre,
parce qu'elle surgit l 'tre comme perptuellement hante par une
totalit qu'elle est sans pouvoir l'tre, puisque justement elle ne
pourrait atteindre l 'en-soi sans se perdre comme pour-soi. El l e est
126
donc par nature conscience mal heureuse, sans dpassement possible
de l'tat de malheur.
Mais quel est au j uste dans son tre cet t re vers quoi se dpasse la
conscience mal heureuse ? Di rons-nous qu' i l n'existe pas ? Ces contra
dictions que nous relevons en lui prouvent seulement qu'il ne peut pas
tre ralis. Et rien ne peut valoir contre cette vrit d'vidence : la
conscience ne peut exister qu'engage dans cet tre qui la cerne de
toute part et la transit de sa prsence fantme -cet tre qu'elle est et
qui pourtant n'est pas elle. Dirons-nous que c'est un tre relatif la
conscience ? Ce serait le confondre avec l 'objet d'une thse. Cet tre
n'est pas pos par et devant la conscience ; i l n'y a pas conscience de
cet tre, puisqu'il hante la conscience non-thtique (de) soi . Il la
marque comme son sens d'tre et elle n'est pas plus conscience de lui
qu'elle n'est conscience de soi. Pourtant, i l ne saurait non plus
chapper la conscience : mais en tant qu'elle se porte l'tre comme
conscience (d') tre, il est l. Et prcisment ce n'est pas la conscience
qui confre son sens cet tre, comme elle fait cet encrier ou ce
crayon ; mais sans cet tre qu' elle est sous forme de ne l'tre pas,
la conscience ne serait pas conscience, c'est--dire manque : c'est de
lui, au contraire, qu'elle tire pour elle-mme sa signification de
conscience. Il surgit en mme temps qu'elle, la fois dans son cur et
hors d' elle, i l est la transcendance absolue dans l ' immanence absolue,
il n'y a priorit ni de lui sur la conscience ni de la conscience sur lui :
ils font couple. Sans doute ne saurait-il exister sans le pour-soi , mais le
pour-soi non plus ne saurait exister sans l ui . La conscience se tient par
rapport cet tre sur le mode d'tre cet tre, car il est elle-mme, mais
comme un tre qu'elle ne peut pas tre. I l est elle-mme, au cur
d'elle-mme et hors d'atteinte, comme une absence et un irralisable,
et sa nature est d'enfermer en soi sa propre contradiction ; son
rapport au pour-soi est une i mmanence totale qui s'achve en totale
transcendance.
Il ne faut pas concevoir cet tre, d'ailleurs, comme prsent la
conscience avec les seuls caractres abstraits que nos recherches ont
tablis. La conscience concrte surgit en si tuation et elle est cons
cience singulire et individualise de cette situation et (d') elle-mme
en situation. C'est cette conscience concrte que le soi est prsent et
tous les caractres concrets de la conscience ont leurs corrlat ifs dans
la totalit du soi . Le soi est individuel, et c'est comme son achvement
individuel qu'il hante le pour-soi . Un sentiment, par exemple, est
sentiment en prsence d'une norme, c'est--dire d'un sentiment de
mme type mais qui serait ce qu' il est . Cette norme ou totalit du soi
affectif est directement prsente comme manque souffert au cur
mme de la souffrance. On souffre et on souffre de ne pas souffrir
assez. La souffrance dont nous par/ons n'est jamais tout fait celle
que nous ressentons. Ce que nous appelons la belle ou la
127
bonne ou l a souffrance et qui nous meut, c'est la
souffrance que nous lisons sur le visage des autres, miux encore sur
les portraits , sur la face d' une statue, sur un masque tragique. C'est
une souffrance qui a de l'tre. El le s'offre nous comme un tout
compact et objectif, qui n'attendait pas notre venue pour tre et qui
dborde la conscience que nous en prenons ; elle est l , au milieu du
monde, i mpntrabl e et dense, comme cet arbre ou cette pierre, ell e
dure ; enfin, e lle est ce qu'elle est ; nous pouvons dire d'elle : cette
souffrance l-bas, qui s'exprime par ce rictus, par ce froncement de
sourcils. El le est supporte et offerte par l a physionomie, mais non
cre. Elle s'est pose sur elle, el le est au-del de la passivit comme
de l'acti vi t, de la ngation comme de l ' affirmation : elle est. Et
cependant elle ne peut tre que comme conscience de soi. Nous
savons bi en que ce masque n'exprime pas la grimace i nconsciente
d'un dormeur, ni le rictus d'un mort : i l renvoie des possibles, une
situation dans l e monde. La souffrance est le rapport conscient ces
possibles, cette si tuation, mais solidifi, coul dans le bronze de
l'tre ; et c'est en tant que tel l e qu'elle nous fascine : elle est comme
une approximati on dgrade de cette souffrance-en-soi qui hante
notre propre souffrance. La souffrance que je ressens, au contraire,
n'est jamai s assez souffrance, du fait qu'el le se nantit comme en soi
par l'acte mme o el l e se fonde. El le s'chappe comme souffrance
vers la consci
ence de souffrir. Je ne puis jamais tre surpris par elle,
car elle n'est que dans l 'exacte mesure o je l a ressens. Sa
translucidit lui te toute profondeur. Je ne puis l'observer, comme
j'observe celle de la statue, puisque je la fais et que je la sais. S' i l faut
souffrir, j e voudrais que ma souffrance me saisisse et me dborde
comme un orage : mais il faut , au contraire, que je l'lve
l'existence dans ma l i bre spontanit. Je voudrais la fois l'tre et la
subir, mais cette souffrance norme et opaque qui me transporterait
hors de moi , elle m'effleure continuellement de son aile et je ne peux
la saisir, je ne trouve que moi, moi qui me plains, moi qui gmis, moi
qui doi s, pour raliser cette souffrance que je suis, jouer sans rpit la
comdie de souffrir. Je me tords les bras, je crie, pour que des tres
en soi , des sons, des gestes, courent par le monde, chevauchs par la
souffrance en soi que je ne peux tre. Chaque plainte, chaque
physionomie
de celui qui souffre vise sculpter une statue en soi de la
souffrance.
Mais cette statue n'existera jamais que par les autres, que
pour les autres. Ma souffrance souffre d'tre ce qu'elle n'est pas, de
n' tre pas ce qu'elle est ; sur le point de se rejoindre elle s'chappe,
spare d'el le par rien, par ce nant dont elle est elle-mme le
fondement. Elle bavarde parce qu'elle n'est pas assez, mais son idal
est le silence. Le silence de la statue, de l ' homme accahl qui baisse le
front et se voile la face sans rien dire. Mais cet homme silencieux,
c'est pour moi qu' i l ne parle pas. En lui-mme, il bavarde i ntarissable-
128
ment, car les mots du langage intrieur sont comme des esquisses du
soi de la souffrance. C'est mes yeux qu'il est cras de
souffrance : en lui i l se sent responsable de cette douleur qu' il veut en
ne l a voul ant pas et qu' il ne veut pas en l a voulant et qui est hante
par une perptuel l e absence, celle de la souffrance immobile et
muette qui est l e soi, la totalit concrte et hors d'atteinte du pour-soi
qui souffre, le pour de la ralit-humaine en souffrance. On le voit,
cette souffrance-soi qui visite ma souffrance n'est jamais pose par
celle-ci. Et ma souffrance relle n'est pas un effort pour atteindre au
soi. Mais elle ne peut tre souffrance que comme conscience (de)
n'tre pas assez souffrance en prsence de cette souffrance pl nire et
absente.
.
Nous pouvons prsent dtermi ner avec plus de nettet ce qu'est
l'tre du soi : c'est l a valeur. La valeur, en effet, est affecte de ce
double caractre, que les moralistes ont fort incompltement expli
qu, d'tre inconditionnellement et de n'tre pas. En tant que valeur,
en effet , l a valeur a l 'tre ; mais cet existant normatif n'a prcisment
pas d'tre en tant que ralit. Son tre est d' tre valeur, c'est--dire
de n'tre pas tre. Ainsi l 'tre de la valeur en tant que valeur, c'est
l'tre de ce qui n'a pas d'tre. La valeur semble donc insaisissable :
la prendre comme tre, on risque de mconnatre totalement son
irralit et d'en faire, comme l es sociologues, une exigence de fait
parmi d' autres faits. En ce cas l a contingence de l'tre tue l a valeur.
Mais, inversement , si on n'a d'yeux que pour l'idalit des valeurs, on
va leur retirer l'tre et, faute d'tre, elles s'effondrent. Sans doute
puis-j e, comme Scheler l'a montr, atteindre l'intuition des valeurs
partir d'exemplifications concrtes : je puis saisir l a noblesse sur un
acte noble. Mais la valeur ainsi apprhende ne se livre pas comme
tant de plain-pied dans l'tre avec l'acte qu'elle valorise - la
faon, par exempl e, de l'essence rouge par rapport au rouge
singulier. Elle se donne comme un au-del des actes envisags,
comme la limite, par exemple, de la progression infinie des actes
nobles. La valeur est par del l'tre. Pourtant , si nous ne nous payons
pas de mots, i l faut reconnatre que cet tre qui est par del l'tre
possde au moins l'tre en quel que faon. Ces considrations
suffisent nous faire admettre que la ralit-humaine est ce par quoi
la valeur arrive dans le monde. Or, l a valeur a pour sens d'tre ce vers
quoi un tre dpasse son tre : tout acte valoris est arrachement
son tre vers . . . La valeur tant toujours et partout le par-del de tous
les dpassements, peut tre considre comme l'unit inconditionne
de tous les dpassements d'tre. Et par l elle fait couple avec la
ralit qui originellement dpasse son tre et par qui le dpassement
vient l'tre, c'est--dire avec l a ralit-humaine. Et l'on voit aussi
que la valeur, tant l'au-del inconditionn de tous les dpassements,
doit tre originellement l'au-del de l 'tre l ui-mme qui dpasse, car
129
c'est la seule manire dont el l e puisse tre l'au-del originel de tous les
dpassements possibl es. Si tout dpassement doit pouvoir se dpasser,
en effet, i l faut que l'tre qui dpasse soit, a priori, dpass en tant qu'il
est la source mme des dpassements ; ainsi la valeur prise son origine
ou valeur suprme est rau-del et le pour de la transcendance. Elle est
l'au-del qui dpasse et fonde tous mes dpassements, mais vers quoi je
ne peux jamais me dpasser, puisque justement mes dpassements la
supposent. Elle est le manqu de tous les manques, non le manquant.
La val eur, c'est l e soi en tant qu' i l hante l e cur du pour-soi comme ce
pour quoi il est. La valeur suprme vers quoi la conscience se dpasse
tout instant par son tre mme, c'est l'tre absolu du soi, avec ses
caractres d' identit, de puret, de permanence, etc. , et en t ant qu' il
est fondement de soi. C' est ce qui nous permet de concevoir pourquoi
la valeur peut la fois tre et ne pas tre. Elle est comme le sens et l'au
del de tout dpassement, el l e est comme l'en-soi absent qui hante
l'tre pour soi. Mais ds qu'on la considre, on voit qu'elle est elle
mme dpassement de cet tre-en-soi , puisqu'elle se le donne. Elle est
par del son propre tre puisque, son tre tant du type de la
concidence avec soi, elle dpasse aussitt cet tre, sa permanence, sa
puret , sa consistance, son identit, son silence, en rclamant ces
qualits titre de prsence soi . Et , rciproquement, si on dbute par
la considrer comme prsence soi, cette prsence aussitt est
solidifie, fige en en-soi . En outre, elle est en son tre la totalit
manque vers quoi un tre se fait tre. Elle surgit pour un tre non en
tant que cet tre est ce qu'il est, en pleine contingence, mais en tant
qu'il est fondement de sa propre nantisation. En ce sens la valeur
hante l'tre en tant qu'il se fonde, non en tant qu'il est : elle hante la
libert. Cela signifie que l e rapport de la valeur au pour-soi est trs
particulier : elle est l'tre qu' i l a tre en tant qu'il est fondement de
son nant d' tre. Et s' i l a tre cet tre, ce n'est pas sous l ' emprise
d' une contrainte extrieure, ni parce que la valeur, comme le premier
moteur d' Aristote , exercerait sur lui une attraction de fai t, ni en vertu
d'un caractre reu de son tre, mais c'est qu' il se fait tre dans son tre
comme ayant t re cet tre. En un mot l e soi, l e pour-soi et leur
rapport se tiennent la fois dans les limites d'une libert incondition
ne-en ce sens que rien ne fait exister la valeur, si ce n'est cette libert
qui du mme coup me fait exister moi-mme -et la fois dans les
bornes de la facticit concrte, en tant que, fondement de son nant, le
pour-soi ne peut tre fondement de son tre. Il y a donc une totale
contingence de l'tre-pour-la-valeur, qui reviendra ensuite sur toute la
morale, pour la transir et la relativiser-et , en mme temps, une libre
et absolue ncessit
'
.
1 . On sera tent peut tre de traduire la trinit envisage en termes
hgliens ct de faire de l'en soi la thse, du pour soi l'anti thse ct de l'cn soi
1 30
La valeur dans son surgissement originel n'est point pose par le
pour-soi : elle lui est consubstantielle -au point qu'il n'y a point de
conscience qui ne soit hante par sa valeur et que la ralit-humaine
au sens large enveloppe le pour-soi et la valeur. Si la valeur hante le
pour-soi sans tre pose par l ui , c'est qu'elle n'est pas l'objet d'une
thse : en effet, il faudrait pour cel a que le pour-soi ft lui-mme
objet de position, puisque valeur et pour-soi ne peuvent surgir que
dans l ' unit consubstantielle d' un couple. Ainsi le pour-soi comme
conscience non-thtique (de) soi n'existe pas en face de la valeur, au
sens o, pour Leibniz, la monade existe seule, en face de Dieu . La
valeur n'est donc point connue, ce stade, puisque l a connaissance
pose l'objet en face de la conscience. Elle est seulement donne avec
la translucidit non-thtique du pour-soi, qui se fait tre comme
conscience d'tre, el l e est partout et nulle part, au cur du rapport
nantisant reflet-refltant , prsente et hors d'atteinte, vcue
simplement comme le sens concret de ce manque qui fait mon tre
prsent. Pour que la valeur devienne l'objet d'une thse, i l faut que le
pour-soi qu'elle hante comparaisse devant le regard de la rflexion.
La conscience rflexi ve, en effet, pose l' Erlebnis rflchie dans sa
nature de manque et dgage du mme coup la valeur comme le sens
hors d'atteinte de ce qui est manqu. Ainsi l a conscience rflexive
peut-elle tre dite, proprement parler, conscience morale puis
qu'elle ne peut surgir sans dvoiler du mme coup les valeurs. Il va de
soi que je demeure l i bre, dans ma conscience rflexive, de di riger
mon attention sur el l es ou de l es ngliger - exactement comme i l
dpend de moi de regarder plus particulirement, sur cette table, mon
stylo ou mon paquet de tabac. Mais qu'elles soient ou non l'objet
d'une attention ci rconstancie, elles sont.
Il n'en faudrait pas conclure, cependant, que le regard rflexif soit
le seul qui puisse faire apparatre l a valeur ; et que nous projetions par
analogie le valeurs de notre pour-soi dans le monde de la transcen
dance. Si l'objet de l ' intuition est un phnomne de la ralit
humai ne, mais transcendant, il se livre aussitt avec sa valeur, car le
pour soi ou Valeur la synthse. Mais il faut obserer ici que, si le pour soi
manque de l' en soi, l'en soi ne manque pas du pour soi. I l n'y a donc pas
rciprocit dans l'opposition. En un mN, l e pour soi demeure inessentiel ct
contingent par rapport l'en soi et c'est cette inessentialit que nous appelions
plus haut sa facticit. En out re, la synthse ou Valeur serait bien un retour la
thse, donc un retour sur soi , mais comme elle est totalit irralisable, le pour
soi n'est pas un moment qui puisse tre dpass. Comme tel, sa nature le
rapprohe beaucoup plus des ralits ambigus . de Kierkegaard. En outre,
nous trouvons ici un double jeu d'oppositions unilatrales : le pour soi, en un
sens, manque de l'en soi, qui ne manque pas de lui ; mais en un autre, il
manque de son possible (ou pour soi manquant) qui ne manque pas non plus de
lui.
131
pour-soi d'autrui n'est pas un phnomne cach et qui se donnerait
seulement comme la conclusion d' un raisonnement par analogie. Il
se manifeste origi nel lement mon pour-soi et mme, nous le
verrons, sa prsence comme pour-autrui est condition ncessaire de
la constituti on du pour-soi comme tel . Et dans ce surgissement du
pour-autrui , la valeur est donne comme dans l e surgissement du
pour-soi , encore que sur un mode d'tre di ffrent. Mais nous ne
saurions trai ter de la rencontre objective des valeurs dans le monde
tant que nous n'avons pas lucid la nature du pour-autrui . Nous
renvoyons donc l ' examen de cette question l a troisime partie du
prsent ouvrage.
I V
L E POUR SOI ET L' TRE DES POSSI BLES
Nous avons vu que l a ralit-humaine tait un manque et qu'elle
manquait, en tant que pour-soi , d'une certaine concidence avec elle
mme. Concrtement, chaque pour-soi ( Erlebnis) particulier manque
d' une certaine ralit particulire et concrte dont l'assimilation
synthtique le transformerait en soi. I l manque de . . . pour . . . comme le
di sque brch de l a lune manque de ce qu'il faudrait pour le
complter et l e transformer en pleine lune. Ainsi le manquant surgit
dans le processus de transcendance et se dtermine par un retour vers
l'existant partir du manqu. Le manquant ainsi dfini est transcen
dant par rapport l'existant et complmentaire. Il est donc de mme
nature : ce qui manque au croissant de lune pour tre l une, c'est
prcisment un bout de lune ; ce qui manque l'angle obtus ABC,
pour faire deux droits, c'est l'angle CBD. Ce qui manque donc au
pour-soi pour s'intgrer au soi, c'est du pour-soi. Mais il ne saurait
s'agir en aucun cas d' un pour-soi tranger, c'est--dire d'un pour-soi
que j e ne suis pas. En fait, puisque l'idal surgi, c'est la concidence
du soi , le pour-soi manquant est un pour-soi que je suis. Mais d'un
autre ct, si je l' tais sur l e mode de l'identi t, l'ensemble
deviendrait en-soi. Je suis l e pour-soi manquant sur l e mode d'avoir
tre le pour-soi que je ne suis pas, pour m'identifier lui dans l'unit
du soi. Ainsi le rapport transcendant originel du pour-soi esquisse
perptuellement comme un projet d'identification du pour-soi un
pour-soi absent qu'il est et dont i l manque. Ce qui se donne comme le
manquant propre de chaque pour-soi et qui se dfinit rigoureusement
comme manquant ce pour-soi prcis et aucun autre, c'est le
1 32
possible du pour-soi. Le possible surgit du fond de nantisation du
pour-soi . Il n' est pas conu thmatiquement par aprs comme moyen
de rejoindre le soi. Mais le surgissement du pour-soi comme
nantisation de l ' en-soi et dcompression d'tre fait surgir l e possible
comme un des aspects de cette dcompression d'tre, c'est--dire
comme une mani re d'tre distance de soi ce qu'on est. Ainsi le
pour-soi ne peut apparatre sans tre hant par l a valeur et projet
vers ses possibles propres. Pourtant, ds qu' i l nous renvoie ses
possibles, l e cogito nous chasse hors de l'instant vers ce qu'il est sur le
mode de ne l'tre-pas.
Mais pour mieux comprendre comment l a ralit-humaine est, la
fois, et n'est pas ses propres possibilits, il nous faut revenir sur cette
notion de possible et tenter de l 'l ucider.
Il en est du possible comme de l a valeur : on a l a plus grande
difficult comprendre son tre, car i l se donne comme antrieur
l'tre dont il est la pure possibilit et pourtant, en tant que possible du
moins, il faut bien qu' i l ai t l'tre. Ne dit-on pas : Il est possible qu' i l
vienne }} ? On appel l e volontiers possible , depui s Lei bni z, un
vnement qui n' est point engag dans une srie causale existante,
telle qu'on puisse l e dterminer coup sr, et qui n'enveloppe aucune
contradiction, ni avec lui-mme, ni avec l e systme considr. Ainsi
dfini le possible n'est possible qu'au regard de la connaissance,
puisque nous ne sommes en mesure ni d'affirmer ni de nier le possible
envisag. De l deux attitudes en face du possible : on peut
considrer, comme Spinoza, qu' il n'existe qu'au regard de notre
ignorance et qu'il s'vanouit quand elle s'vanouit. En ce cas, le
possible n'est qu'un stade subjectif sur le chemin de l a connaissance
parfait e ; il n'a que l a ralit d' un mode psychique ; en tant que
pense confuse ou tronque, il a un tre concret mais non en tant que
proprit du monde. Mais i l est loisible aussi de faire de l'infinit des
possibles l'objet des penses de l'entendement divi n, l a faon de
Leibniz, ce qui leur confre une manire de ralit absolue ; en
rservant l a volont divine l e pouvoir de raliser l e meilleur systme
d'entre eux. En ce cas, bien que l ' enchanement des perceptions de la
monade soit rigoureusement dtermin et qu'un tre tout-connaissant
puisse tablir avec certitude l a dcision d'Adam partir de l a formule
mme de sa substance, il n'est pas absurde de dire : Il est possible
qu'Adam ne cuei l l e pas la pomme. Cela signifie seulement qu'il
existe, titre de pense de l'entendement divi n, un autre systme de
compossibles, tel qu'Adam y figure comme n'ayant pas mang l e fruit
de l'arbre de Science. Mais cette conception di ffre-t-elle tant de celle
de Spinoza ? En fait la ralit du possible est uniquement celle de l a
pense di vi ne. Cela signifie qu' i l a l ' tre comme pense qui n'a point
t ralise. Sans doute l'ide de subjectivit a t ici porte sa
limite, car il s'agit de l a conscience di vine, non de l a mienne ; et si l'on
133
a pris soi n de confondre au dpart subjectivit et finitude, la
subjectivit s'vanouit quand l'entendement devient i nfi ni . Il n'en
reste pas moi ns que l e possible est une pense qui n'est que pense.
Leibniz l ui-mme semble avoir voulu confrer une autonomie et une
sorte de l ourdeur propre aux possibles, puisque plusieurs des
fragments mtaphysiques publis par Couturat nous montrent les
possibles s'organi sant eux-mmes en systmes de compossibles et le
plus plein, l e plus riche tendant de soi se raliser. Mais i l n'y a l
qu'une esquisse de doctrine et Leibniz ne l ' a pas dveloppe -sans
doute parce qu' el l e ne pouvait l"tre : donner une tendance vers l'tre
aux possibl es, cel a signifie ou bien que le possible est dj de l'tre
plein et qu' i l a le mme type d'tre que l'tre -au sens o l'on peut
donner au bourgeon une tendance devenir fleur -ou bien que le
possible au sein de l'entendement divin est dj une ide-force et que
le maximum d' i des-forces organis en systme dclenche automati
quement la volont divine. Mais dans ce dernier cas nous ne sortons
pas du subjectif. Si donc l 'on dfinit le possible comme non
contradictoire, il ne peut avoir l'tre que comme pense d' un tre
antrieur au monde rel ou antrieur la connaissance pure du
monde tel qu' i l est . Dans les deux cas, le possible perd sa nature de
possibl e et se rsorbe dans l ' tre subjectif de la reprsentation.
Mais cet tre-reprsent du possible ne saurait rendre compte de sa
nature , puisqu'il la dtruit, au contraire. Nous ne saisissons nullement
l e possibl e, dans l ' usage courant que nous en faisons, comme un
aspect de notre ignorance, ni non plus comme une structure non
contradictoire appartenant un monde non ralis et en marge de ce
monde-ci. Le possible nous apparat comme une proprit des tres.
C'est aprs avoir jet un coup d' il sur l e ciel que je dcrte : Il est
possible qu' i l pleuve et je n'entends pas ici possible comme
sans contradiction avec l'tat prsent du ciel . Cette possibilit
appartient au ciel comme une menace, elle reprsente un dpasse
ment des nuages que je perois vers la pluie et ce dpassement, les
nuages le portent en eux-mmes, ce qui ne signifie pas qu'il sera
ralis, mais seulement que la structure d'tre du nuage est transcen
dance vers la pluie. La possibilit est donne ici comme appartenance
un tre particulier dont elle est un pouvoir, comme le marque assez
le fait qu'on dit indiffremment d' un ami qu'on attend : Il est
possible qu' i l vienne ou Il peut venir . Ainsi, le possi bl e ne
saurait se rduire une ralit subjective. Il n'est pas non plus
antrieur au rel ou au vrai. Mais i l est une proprit concrte de
ralits dj existantes. Pour que la pluie soit possibl e, i l faut qu'il y
ait des nuages au ci el . Supprimer l"tre pour tablir le possible dans sa
puret est une tentative absurde ; la procession souvent cite qui va
du non-tre l'tre en passant par le possible ne correspond pas au
rel. Certes, l'tat possible n'est pas encore ; mais c'est l'tat possible
134
d'un certain existant qui soutient par son tre la possibilit et l e non
tre de son tat futur.
Il est certain que ces quelques remarques risqueraient de nous
conduire l a puissance aristotlicienne. Et ce serait tomber de
Charybde en Scylla que d'viter l a conception purement logique du
possible pour tomber dans une conception magique. L'tre-en-soi ne
peut tre en puissance ni avoir des puissances En soi i l est ce
qu'il est dans la plnitude absolue de son identit. Le nuage n'est pas
pluie en puissance , i l est, en soi, une certaine quantit de vapeur
d'eau qui , pour une temprature donne et une pression donne, est
rigourusement ce qu'elle est. L'en-soi est en cte. Mais l'on peut
concevoir assez clairement comment l e regard scientifique, dans sa
tentative pour dshumaniser le monde, a rencontr les possibles
comme puissances et s'en est dbarrass en en faisant les purs
rsultats subjectifs de notre calcul l ogi que et de notre ignorance. La
premire dmarche scientifique est correcte : le possible vient au
monde par la ralit-humaine. Ces nuages ne peuvent se changer en
pluie que si j e l es dpasse vers la pl ui e, de mme que le disque
brch de la lune ne manque d'un croissant que si je la dpasse vers
la pleine l une. Mais fallait-i l , par aprs, faire du possible une simple
donne de notre subjectivit psychi que ? De mme qu' il ne saurait y
avoir de manque dans le monde que s' i l vient au monde par un tre
qui est son propre manque, de mme il ne saurait y avoir au monde de
possi bi l i t, qu'elle ne vienne par un tre qui est soi-mme sa propre
possibi l i t. Mais prcisment la possibilit ne peut, par essence,
concider avec la pure pense des possibil its. Si en effet l a possi bilit
n'est pas donne d'abord comme structure objective des tres ou d' un
tre particulier, la pense, de quel que faon qu'on l ' envisage, ne
saurait enfermer en el le le possible comme son contenu de pense. Si
nous considrons, en effet , les possibles au sein de l'entendement
diVIn, comme contenu de la pense divine, les voil qui deviennent
purement et simplement des reprsentations concrtes. Admettons par
hypothse pure -et bien qu'on ne puisse comprendre d'o viendrait
un tre tout positif ce pouvoir ngatif -que Dieu ait le pouvoir de
nier, c'est--dire de porter sur ses reprsentations des jugements
ngatifs : on ne saisirait pas pour autan t comment i l transformerait
ces reprsentations en possibles. Tout au plus la ngation aurait-elle
pour effet de les constituer comme sans correspondant rel . Mais
dire que le Centaure n'existe pas, ce n'est nullement dire qu'il est
possibl e. Ni l'affirmation ni la ngation ne peuvent confrer une
reprsentation le caractre de possi bi l i t. Et si l'on prtend que ce
caractre peut tre donn par une synthse de ngation et d'affirma
tion, encore faut-il remarquer qu' une synthse n'est pas une somme
et qu'il faut rendre compte de cette synthse titre de totalit
organi que pourvue d'une signification propre et non partir des
135
lments dont elle est synthse. Pareillement, la pure constatation
subjective et ngative de notre ignorance touchant le rapport au rel
d' une de nos ides ne saurait rendre compte du caractre de
possi bi l it de cette reprsentation : elle pourrait seulement nous
mettre en tat d' i ndi ffrence vis--vis d' ell e, mais non pas l ui confrer
ce droit sur le rel , qui est la structure fondamentale du possibl e. Si
l'on ajoute que certaines tendances me portent attendre de
prfrence ceci ou cela, nous dirons que ces tendances, loin d'expli
quer l a transcendance, la supposent au contraire : il faut dj, nous
l'avons vu, qu'elles existent comme manque. En outre, si le possible
n'est pas donn en quelque faon, elles pourront nous inciter
souhaiter que ma reprsentation corresponde adquatement l a
ral i t, mais non pas me confrer un droi t sur le rel. En un mot, l a
saisie du possible comme tel suppose un dpassement originel. Tout
effort pour tabl i r le possible partir d'une subjectivit qui serait ce
qu'elle est, c'est--dire qui se refermerait sur soi, est vou par
principe l'chec.
Mai s s'il est vrai que le possible est une option sur l'tre et s'il est
vrai que l e possible ne peut venir au monde que par un tre qui est sa
propre possi bilit, cela implique pour la ralit-humaine la ncessit
d'tre son tre sous forme d'option sur son tre. Il y a possibilit
lorsque, au l ieu d' tre purement et simplement ce que je suis, je suis
comme l e Droit d' tre ce que je suis. Mais ce droit mme me spare
de ce que j 'ai le droit d'tre. Le droit de proprit n'apparat que
lorsqu'on me conteste ma proprit, lorsque dj, en fait, par
quel que ct el l e n'est plus moi ; la j ouissance tranquille de ce que
je possde est un pur et simple fai t , non un droit. Ainsi, pour qu'il y
ai t possible, il faut que la ralit-humaine, en tant qu'elle est elle
mme, soit autre chose qu'elle-mme. Le possible est cet lment du
pour-soi qui lui chappe par nature en tant qu' i l est pour-soi. L
possible est un nouvel aspect de la nantisation de l'en-soi en pour
soi.
Si l e possible, en effet, ne peut venir au monde que par un tre qui
est sa propre possibilit, c'est que l'en-soi, tant par nature ce qu'il
est, ne peut pas avoir de possibles. Son rapport une possibilit
ne peut tre tabl i que de l'extrieur, par un tre qui se tient en face
des possi bi l i ts mmes. La possibilit d'tre arrte par un pl i du tapis
n'appartient ni la bille qui roule, ni au tapis : el l e ne peut surgir que
dans l'organisation en systme de la bi l l e et du tapis par un tre qui a
une comprhension des possibles. Mais cette comprhension ne
pouvant l ui veni r du dehors, c'est--dire de l'en-soi, ni se limiter
n'tre qu' une pense comme mode subjectif de la conscience, elle
doi t concider avec la structure objective de l'tre qui comprend les
possibles. Comprendre la possibilit en tant que possibilit ou tre ses
propres possibilits, c'est une seule et m@me ncessit pour l'tre en
136
qui , dans son tre, il est question de son tre. Mais prcisment, tre
sa propre possibilit, c'est--dire se dfinir par ell e, c'est se dfinir par
cette partie de soi-mme qu'on n'est pas, c'est se dfinir comme
chappement--soi vers . . . En un mot, ds le moment o je veux
rendre compte de mon tre immdiat en tant simplement qu'il est ce
qu'il n'est pas et qu'il n'est pas ce qu' il est, je suis rejet hors de l ui
vers un sens qui est hors d'atteinte et qui ne saurait d'aucune faon
tre confondu avec une reprsentation subjective immanente. Des
cartes se saisissant par le cogito comme doute ne peut esprer dfinir
ce doute comme doute mthodique ou simplement comme doute s'il
se limite ce que saisit l e pur regard instantan. Le doute ne peut
s'entendre qu' partir de la possibilit toujours ouverte pour lui
qu'une vidence le lve " ; il ne peut se saisir comme doute qu'en
tant qu' i l renvoie des possibilits d' broxfj, non encore ralises
mais toujours ouvertes. Aucun fait de conscience n'est proprement
parler cette conscience - dt-on mme, comme Husserl , doter assez
artificiellement cette conscience de pro tensions intrastructurales qui ,
n'ayant en l eur tre aucun moyen de dpasser la conscience dont elles
sont une structure, s' affaissent piteusement sur elles-mmes et
ressemblent des mouches qui se cognent le nez la fentre sans
pouvoir franchir le carreau ; une conscience, ds qu'on veut l a dfinir
comme doute, percepti on, soif, etc . , nous renvoie au nant de ce qui
n'est pas encore. La conscience (de) lire n'est pas conscience (de) lire
cette lettre, ni ce mot , ni cette phrase, ni mme ce paragraphe -mais
conscience (de) l i re ce livre, ce qui me renvoie toutes les pages non
lues encore, toutes les pages dj lues, ce qui arrache par dfinition
la conscience soi. Une conscience qui ne serait que conscience de ce
qu'elle est serait oblige d'peler.
Concrtement, chaque pour-soi est manque d'une certaine conci
dence avec soi. Cela signifie qu'il est hant par la prsence de ce avec
quoi il devrait concider pour tre soi. Mais comme cette concidence
en soi est aussi concidence avec soi , ce qui manque au pour-soi
comme l'tre dont l'assimilation le ferait soi, c'est encore le pour-soi.
Nous avons vu que le pour-soi tait prsence soi : ce qui manque
la prsence soi ne peut l ui faire dfaut que comme prsence soi.
Le rapport dterminant du pour-soi son possible est un relchement
nantisant du lien de prsence soi : ce relchement va jusqu' l a
transcendance puisque l a prsence soi dont manque le pour-soi est
prsence soi qui n'est pas. Ainsi le pour-soi en tant qu'il n'est pas soi
est une prsence soi qui manque d'une certaine prsence soi et
c'est en tant que manque de cette prsence qu'il est prsence soi.
Toute conscience manque de . . . pour. Mais i l faut bien entendre que le
manque ne l ui vient pas du dehors comme celui du croissant de lune
la lune. Le manque du pour-soi est un manque qu' i l est. C'est
l'esquisse d'une prsence soi comme ce qui manque au pour-soi, qui
137
est ce qui constitue l 'tre du pour-soi comme fondement de son
propre nant. Le possible est une absence constitutive de la cons
cience e n tant qu' el l e se fait elle-mme. Une soif -par exemple
n'est j amais assez soif en tant qu'elle se fait soif, elle est hante par la
prsence du soi ou soif-soi. Mais en tant qu'elle est hante par cette
valeur concrte, el l e se met en question dans son tre comme
manquant d'un certain pour-soi qui la raliserait comme soif comble
et qui l ui confrerait l'tre-en-soi . Ce pour-soi manquant c'est le
Possi bl e. Il n' est pas exact, en effet, qu'une soif tende vers son
anantissement en tant que soif : il n'est aucune conscience qui vise
sa suppression en tant que telle. Pourtant, la soif est un manque, nous
l'avons marqu plus haut. En tant que telle, elle veut se combler, mais
cette soif comble, qui se raliserait par l'assimilation synthtique,
dans un acte de concidence, du pour-soi-dsir ou soif avec l e pour
soi-rpltion ou acte de boire, n'est pas vise comme suppression de
soif, au contraire. Elle est la soif passe l a plnitude d' tre, la soif
qui saisit et s'incorpore la rpltion comme l a forme aristotlicienne
saisit et transforme la matire, elle devient la soif ternelle. C'est un
point de vue trs postrieur et rflexif que celui de l'homme qui boit
pour se dbarrasser de sa soif, comme celui de l'homme qui va dans
les maisons publiques pour se dbarrasser de son dsir sexuel. La soif,
le dsi r sexuel , l'tat irrfchi et naf, veulent jouir d'eux-mmes,
i l s cherchent cette concidence avec soi qu'est l'assouvissement, o la
soif se connat comme soif dans l e temps mme o l e boire l a remplit,
o, de ce fait mme du remplissement, elle perd son caractre de
manque tout en se faisant tre soif dans et par le remplissement. Ainsi
Epicure a-t-il tort et raison la foi s : par lui-mme, en effet, le dsir
est un vide. Mais aucun projet irrflchi ne vise tout simplement
supprimer ce vi de. Le dsir par lui-mme tend se perptuer,
l ' homme tient farouchement ses dsirs. Ce que l e dsir veut tre,
c'est un vide combl mais qui informe sa rpltion comme un moule
informe le bronze qu' on a coul dedans. Le possible de l a conscience
de soif, c'est la conscience de boire. On sait de reste que la
concidence du soi est impossibl e car le pour-soi atteint par la
ralisation du possible se fera tre comme pour-soi, c'est--dire avec
un autre horizon de possibles. De l la dception constante qui
accompagne la rpltion, le fameux : N'est-ce que cela ? qui ne
vise pas le plaisir concret que donne l'assouvissement, mais l'vanes
cence de la concidence avec soi . Par l , nous entrevoyons l'origine de
la temporalit, puisque la soif est son possible en mme temps qu'elle
ne l'est pas. Ce nant qui spare l a ralit-humaine d' elle-mme est
la source du temps. Mais nous y reviendrons. Ce qu' i l faut noter c'est
que le pour-soi est spar de la prsence soi qui lui manque et qui
est son possible propre, en un sens par rien et en un autre sens par la
totalit de l'existant au monde, en tant que le pour-soi manquant ou
138
possibl e est pour-soi comme prsence un certain tat du monde. En
ce sens, l'tre par del lequel le pour-soi projette la concidence avec
soi, c'est le monde ou di stance d'tre i nfinie par del laquelle
l'homme doit se rejoindre son possible. Nous appellerons circuit
de l'ipsit le rapport du pour-soi avec le possible qu' i l est - et
monde la totalit de l ' tre en tant qu' elle est traverse par le
circuit de l ' i psit.
Nous pouvons ds prsent claircir l e mode d'tre du possible. Le
possibl e est ce de quoi manque le pour-soi pour tre soi . II ne convient
pas de dire, en consquence, qu'il est en tant que possible. A moins
que l ' o
.
n n' entende par tre celui d'un existant qui est t en tant
qu'il n'est pas t, ou, si l ' on veut, l'apparition distance de ce que je
suis. II n'existe pas comme une pure reprsentati on, ft-el l e nie,
mais comme un rel manque d'tre qui, titre de manque, est par
del l'tre. II a l'tre d' un manque et, comme manque, il manque
d'tre. Le possible n'est pas, le possible se possibilise, dans l'exacte
mesure o l e pour-soi se fait tre, il dtermine par esquisse
schmatique un emplacement de nant que le pour-soi est par del
lui-mme. Naturellement, i l n'est pas d'abord thmatiquement pos :
il s'esquisse par del le monde et donne son sens ma perception
prsente, en tant qu'elle est saisie du monde dans l e circuit d'ipsit.
Mais il n'est pas non plus ignor ou inconscient : i l esquisse les limites
de l a conscience non-thtiq ue (de) soi en tant que conscience non
thtique. La conscience irrflchie (de) soi f est saisie du verre d'eau
comme dsirable, sans position centripte du soi comme but du dsir.
Mais l a rpltion possible parat comme corrlatif non positionnel de
la conscience non-thtique (de) soi , l'horizon du verre-au-milieu
du-monde.
v
LE MOI ET LE CI RCUIT DE L' I PSIT
Nous avons tent de montrer dans un article des Recherches
philosophiques que l'Ego n'appartenait pas au domaine du pour
soi. Nous n'y reviendrons pas. Notons seulement ici l a raison de l a
transcendance de l'Ego : comme ple unificateur des Erlebnisse
l'Ego est en-soi , non pour-soi. S' i l tait de l a conscience , en effet,
il serait soi-mme son propre fondement dans la translucidit de
l'immdiat. Mai s alors, il serait ce qu'il ne serait pas et ne serait pas ce
qu'il serai t, ce qui n'est nul lement le mode d' tre du Je. En effet la
conscience que je prends du Je ne l'puise jamais et ce n'est pas elle
139
non plus qui l e fait venir l'existence : il se donne toujours comme
ayant t l avant elle - et en mme temps comme possdant des
profondeurs qui ont se dvoiler peu peu. Ainsi l'Ego apparat l a
conscience comme un en-soi transcendant, comme un existant du
monde humain, non comme de la conscience. Mais i l n' en faudrait pas
conclure que le pour-soi est une pure et simple contemplation
i mpersonnelle Simpl ement, loin que l'Ego soit le ple personna
lisant d' une conscience qui, sans lui, demeurerait au stade imperson
nel, c'est au cont rai re la conscience dans son ipsit fondamentale qui
permet l'apparition de l ' Ego, dans certaines conditions, comme le
phnomne transcendant de cette ipsit. En effet , nous l'avons vu, il
est impossi bl e de di re de l'en-soi qu'il est soi. Il est, tout simplement .
Et, en ce sens, du Je dont on fait bien tort l ' habitant de l a
conscience, on di r a qu' i l est l e Moi de l a conscience, mais non
qu'il est son propre soi. Ainsi, pour avoir hypostasi l'tre-rflchi du
pour-soi en un en-soi , on fige et dtruit le mouvement de rflexion sur
soi : l a conscience serait pur renvoi l'Ego comme son soi, mais
l'Ego ne renvoie plus ri en, on a transform le rapport de rflexivit
en un simple rapport centripte, l e centre tant par aill eurs un nud
d'opacit. Nous avons montr au contraire que le soi par principe ne
pouvait habiter l a conscience. I l est, si l' on veut, la raison du
mouvement i nfini par quoi le reflet renvoie au refltant et celui-ci au
reflet ; par dfinition il est un i dal , une limite. Et ce qui le fait surgir
comme l imi te, c'est la ralit nantisante de la prsence de l'tre
l'tre dans l'unit de l'tre comme type d'tre. Ai nsi , ds qu'el l e
surgi t, l a conscience, par le pur mouvement nanti sant de la
rflexion, se fai t personnelle : car ce qui confre un tre l'existence
personnel l e, ce n'est pas l a possession d'un Ego -qui n'est que le
signe de l a personnalit -mais c'est le fait d'exister pour soi comme
prsence soi. Mais, en outre, ce premier mouvement rflexif en
entrane un second ou ipsit. Dans l'ipsit mon possi bl e se rflchit
sur ma enscience et la dtermine comme ce qu'elle est. L'ipsit
reprsente un degr de nantisation plus pouss que la pure prsence
soi du cogito prrflexif, en ce sens que le possible que je suis n'est
pas une prsence au pour-soi comme l e reflet au refltant, mais qu'il
est prsence-absente. Mais de ce fait l'existence du renvoi comme
structure d'tre du pour-soi est plus nettement marque encore. Le
pour-soi est soi l-bas, hors d'atteinte, aux lointains de ses possibi
lits. Et c'est cette libre ncessit d'tre l-bas ce qu'on est sous forme
de manque qui constitue l'ipsit ou second aspect essentiel de la
personne. Et comment dfinir en effet la personne sinon comme libre
rapport soi ? Quant au monde, c'est--dire la totalit des tres, en
tant qu'ils existent l' i ntrieur du circuit d' i psit, il ne saurait tre
que ce que la ralit-humai ne dpasse vers soi, ou, pour emprunter
Heidegger sa dfi ni ti on : Ce partir de quoi la ralit-humaine se
140
fait annoncer ce qu' elle est 1. Le possible, en effet, qui est mon
possibl e, est pour-soi possible et comme tel prsence l'en-soi comme
conscience de l'en-soi . Ce que je cherche en face du monde, c'est la
concidence avec un pour-soi que je suis et qui est conscience du
monde. Mais ce possible qui est prsent-absent flon-thtiquement la
conscience prsente n'est pas prsent titre d'objet d'une conscience
posi tionnel le , sinon il serait rflchi. La soif comble qui hante ma
soif actuelle n'est pas conscience (de) soi comme soif comble : el l e
est conscience thtique du verre se buvant et conscience non position
nelle (de) soi. Elle se fait donc transcender vers le verre dont elle est
conscience et , comme corrlati f de cette conscience possible non
thtique, le verre-bu hante le verre pl ei n comme son possible et le
constitue comme verre boire. Ainsi le monde, par nature, est-il
mien en tant qu' i l est l e corrl ati f en-soi du nant, c'est--dire de
l'obstacle ncessaire par del quoi je me retrouve comme ce que je
suis sous la forme d'avoir l'tre . Sans monde pas d'ipsit, pas
de personne ; sans l ' ipsi t , sans la personne, pas de monde. Mais
cette appartenance du monde la personne n'est j amais pose sur le
plan du cogito prrflexif. Il serait absurde de dire que l e monde en
tant qu' i l est connu, est connu comme mi en. Et pourtant cette
moit du monde est une structure fugitive et toujours prsente
que je vis. Le monde (est) mien parce qu' i l est hant par des possibles
dont sont consciences les consciences possibles (de) soi que je suis et
ce sont ces possibles en tant que tels qui lui donnent son unit et son
sens de monde.
L'examen des condui tes ngatives et de l a mauvai se foi nous a
permis d'aborder l'tude ontologique du cogito et l'tre du cogito
nous est apparu comme tant l'tre-pour-soi. Cet tre s'est transcend
sous nos yeux vers l a valeur et les possibles, nous n'avons pu le
contenir dans les bornes substantialistes de l'instantanit du cogito
cartsien. Mai s, prcisment pour cel a, nous ne saurions nous
contenter des rsultats que nous venons d'obtenir : si l e cogito refuse
l'instantanit et s' i l se transcende vers ses possibles, ce ne peut tre
que dans le dpassement temporel. C'est dans le temps que le
pour-soi est ses propres possibles sur le mode du n'tre pas c'est
dans le temps que mes possibles apparaissent l ' horizon du monde
qu'ils font mi en. Si donc la ralit-humaine se saisit ell e-mme
comme temporelle et si le sens de sa transcendance est sa temporalit,
nous ne pouvons esprer que l'tre du pour-soi sera lucid avant que
nous ayons dcrit et fix la signification du Temporel. C'est seulement
alors que nous pourrons aborder l'tude du problme qui nous
occupe : celui de l a relation originelle de l a conscience avec l'tre.
1 . Nous verrons au cha
p
itre I I I de cet te mme partie cc que cette dfinition
-que nous adoptons provisoirement offre d' insuffisant et derron.
CHAPI TRE Il
La temporalit
P HNOMNOLOGI E
DES TROI S DI MENSI ONS TEMPORELLES
La temporalit est videmment une structure organise et ces trois
prtendus lments du temps : pass, prsent, aveni r, ne doivent
pas tre envisags comme une collection de data dont il faut faire
la somme -par exempl e, comme une srie i nfinie de maintenant
dont l es uns ne sont pas encore, dont les autres ne sont plus -mais
comme des moments structurs d'une synthse originel l e. Sinon nous
rencontrerons d' abord ce paradoxe : l e pass n'est plus, l'avenir n'est
pas encore, quant au prsent instantan, chacun sait bien qu'il n'est
pas du tout, il est la l i mite d'une division infinie, comme le point sans
dimension. Ainsi toute la srie s'anantit et doublement, puisque le
mai ntenant futur, par exemple, est un nant en tant que futur et
se ralisera en nant lorsqu'il passera l'tat de maintenant
prsent. La seule mthode possible pour tudier la temporalit c'est
de l'aborder comme une totalit qui domine ses structures secon
daires et qui leur confre leur signification. C'est ce que nous ne
perdrons jamais de vue. Toutefois nous ne pouvons nous lancer dans
un examen de l 'tre du Temps sans avoir lucid pralablement par
une description prontologique et phnomnologique le sens trop
souvent obscur de ses trois dimensions. Il faudra seulement consid
rer cette description phnomnologique comme un travail provisoire
dont le but est seulement de nous faire accder une intuition de la
temporalit gl obal e. Et surtout il faut faire paratre chaque dimension
envisage sur le fond de l a totalit temporelle en gardant toujours
prsente la mmoi re 1' Unselbstst3ndigkeit de cette dimension.
142
A) Le Pass.
Toute thorie sur l a mmoire implique une prsupposition sur
l'tre du pass. Ces prsuppositions, qui n'ont jamais t lucides,
ont obscurci le probl me du souvenir et celui de l a temporalit en
gnral . Il faut donc poser une bonne fois l a question : quel est l 'tre
d' un tre pass ? Le bon sens oscille entre deux conceptions gaIe
ment vagues : le pass, di t-on, n'est plus. De ce point de vue, i l
semble qu'on veui l l e attribuer l ' tre au seul prsent. Cette prsuppo
sition ontologique a engendr la fameuse thorie des traces cr
braIes : puisque le pass n'est pl us, puisqu'il s'est effondr dans le
nant, si l e souvenir conti nue d'exister i l faut que ce soit ti tre de
modification prsente de notre tre ; par exemple, ce sera une
empreinte prsentement marque sur un groupe de cellules cr
brales. Ainsi tout est prsent : le corps, la perception prsente et le
pass comme trace prsente dans le corps ; tout est en acte : car la
trace n'a pas une existence virtuelle en tant que souvenir ; elle est tout
entire trace actuelle. Si le souveni r renat, c'est dans le prsent, l a
suite d' un processus prsent, c'est--dire comme rupture d' un quili
bre protoplasmique dans le groupement cellulaire consi dr. Le
paralllisme psychophysiologique, qui est i nstantan et extra-tempo
rel, est l pour expliquer comment ce processus physiologique est
corrlatif d'un phnomne strictement psychique mais galement
prsent : l'apparition de l ' image-souvenir dans la consci ence. La
notion plus rcente d'engramme ne fait rien de pl us, si non qu'elle
pare cette thorie d'une terminologie pseudo-scientifique. Mais si
tout est prsent , comment expliquer l a passil du souvenir, c'est-
dire le fait qu'en son intention une conscience qui se remmore
transcende l e prsent pour viser l'vnement l o il tait. Nous avons
montr ailleurs qu' i l n'est aucun moyen de distinguer de la perception
l'image, si l'on a fait d'abord de celle-ci une perception renaissante 1 .
Nous rencontrons ici l es mmes i mpossibilits. Mais en pl us nous
nous tons le moyen de distinguer le souvenir de l'image : ni l a
faiblesse du souvenir, ni sa pl eur, ni son incompltude, ni les
contradictions qu' i l offre avec les donnes de l a perception ne
sauraient l e distinguer de l 'image-fiction puisqu'elle offre les mmes
caractres ; et d' ai lleurs ces caractres tant des qualits prsentes du
souvenir ne sauraient nous faire sortir du prsent pour nous di riger
vers le pass. En vain invoquera-t-on l 'appartenance au moi ou
moit du souvenir, comme Claparde, son " intimit , comme
JaJ ; S. Ou bien ces caractres manifestent seulement une atmosphre
prsente qui enveloppe le souvenir -et alors i l s demeurent prsents
1. L'Imagination, AJcan, 1936.
143
et renvoient au prsent . Ou bien i l s sont dj une relation au pass en
tant que tel -mai s alors i ls prsupposent ce qu' il faut expl i quer. On a
cru se dbarrasser aisment du problme en rduisant la reconnais
sance une bauche de localisation et celle-ci un ensemble
d'oprations i ntellectuelles facilites par l' existence de cadres
sociaux de la mmoire . Ces oprations existent, n'en point douter,
et doivent faire l'objet d'une tude psychologique. Mais si le rapport
au pass n'est donn en quelque manire, elles ne sauraient le crer.
En un mot , si l ' on a commenc par faire de l'homme un insulaire,
enferm dans l'lot instantan de son prsent et si tous ses modes
d'tre , ds qu'ils paraissent, sont vous par essence un perptuel
prsent , on s'est t radicalement tous les moyens de comprendre son
rapport originel au pass. Pas plus que les gntistes ne sont
parvenus constituer l'tendue avec des lments intendus, nous ne
parviendrons constituer la dimension pass avec des lments
emprunts exclusivement au prsent.
La conscience populaire a tant de peine, d'ailleurs, refuser une
existence relle au pass, qu'elle admet, en mme temps que cette
premire thse, une autre conception, galement imprcise, selon
laquelle le pass aurait une sorte d'existence honoraire. Etre pass,
pour un vnement, ce serait tout simplement tre mis la retraite,
perdre l'efficience sans perdre l'tre. La phi losophie bergsonienne a
repris cette ide : en tournant au pass, un vnement ne cesse pas
d'tre, il cesse d'agir, tout simplement, mais il demeure sa place ,
sa date, pour l'ternit. Nous avons ai nsi restitu l'tre au pass et
c'est fort bien fait, nous affirmons mme que la dure est multiplicit
d' i nterpntration et que l e pass s'organise continuellement avec le
prsent. Mais nous n'avons pas pour autant rendu raison de cette
organisation et de cette i nterpntration ; nous n'avons pas expliqu
que le pass puisse renatre , nous hanter, bref, exister pour nous.
S' i l est inconscient comme le veut Bergson, et si l'inconscient c'est
l ' i nagissant , comment peut-il s' i nsrer dans la trame de notre
conscience prsente ? Aurait-il une force propre ? Mais cette force,
alors, est prsente, puisqu'elle agit sur le prsent ? Comment mane
t-elle du pass en tant que tel ? Renversera-t-on l a questi on, comme
Husserl, et montrera-t-on dans la conscience prsente un jeu de
rtentions qui accrochent les consciences d'antan, l es maintien
nent leur date et les empchent de s'anantir ? Mais si le cogito
husserlien est donn d'abord comme instantan, i l n'est aucun moyen
d'en sortir. Nous avons vu, au chapitre prcdent, les protensions se
cogner en vain aux vitres du prsent sans pouvoir les briser. II en est
de mme pour les rtenti ons. Husserl a t, tout au long de sa carrire
philosophique, hant par l'ide de la transcci ' hnce et du dpasse
ment. Mai s les instruments phil osophiques dont il disposait, en
particul i er sa conception idaliste de l'existence, lui taient les
14
moyens de rendre compte de cette transcendance : son intentionna
lit n'en est que la caricature. La conscience husserlienne ne peut en
ralit se transcender ni vers le monde, ni vers l'avenir, ni vers le
pass.
Ai nsi nous n'avons rien gagn concder l'tre au pass car, aux
termes de cette concession, il devrait tre pour nous comme n'tant
pas. Que le pass soit, comme le veulent Bergson et Husserl, ou ne
soit plus, comme l e veut Descartes, cela n'a gure d'importance si l'on
a commenc par couper les ponts entre lui et notre prsent.
Si en effet on confre un privilge au prsent comme prsence au
monde , on se place, pour aborder le problme du pass, dans la
perspective de l'tre intramondain. On envisage que nous existons
d'abord comme contemporains de cette chaise ou de cette table, on se
fait i ndiquer par le monde la signification du temporel. Or, si l'on se
place au milieu du monde, on perd toute possibilit de distinguer ce
qui n 'est plus de ce qui n'est pas. Pourtant, dira-t-on, ce qui n'est plus
a du moins t, au lieu que ce qui n'est pas n'a aucun lien d'aucune
sorte avec l 'tre. Cela est vrai. Mais la loi d'tre de l'instant i ntra
mondai n, nous l'avons vu, peut s' exprimer par ces simples mots :
L' tre est -qui indiquent une plnitude massive de positivits o
rien de ce qui n'est pas ne peut tre reprsent de quelque faon que
ce soit, ft-ce par une trace, un vide, un rappel , une hystrsis
L'tre qui est s'puise tout entier tre ; de ce qui n'est pas, de ce qui
n'est plus il n' a rien faire. Aucune ngation, qu'elle soit radicale ou
adoucie en ne . . . plus , ne peut trouver place en cette densit
absolue. Aprs cela le pass peut bien exister sa faon : les ponts
sont coups. L'tre n'a mme pas oubli son pass : ce serait
encore une manire de liaison. Le pass a gliss de lui comme un
songe.
Si la conception de Descartes et celle de Bergson peuvent tre
renvoyes dos dos, c'est qu'elles tombent l'une et l'autre sous le
mme reproche. Qu'il s'agt d' anantir le pass ou de lui conserver
l'existence d'un dieu l are, ces auteurs ont envisag son sort part, en
l'isolant du prsent ; et quelle que ft leur conception de l a cons
cience, ils ont confr celle-ci l ' existence de l'en-soi, ils l'ont
considre comme tant ce qu'elle tait. Il n'y a pas lieu d'admirer
ensuite qu'ils chouent relier le pass au prsent, puisque le prsent
ainsi conu va refuser le pass de toutes ses forces. S'ils avaient
considr l e phnomne temporel dans sa totalit, ils auraient vu que
pass est d'abord mien, c' est--dire qu'il existe en fonction
d'un certain tre que je sui. Le pass n'est pas rien, il n'est pas non
plus le prsent, mais i l appartient sa source mme comme li un
certain prsent et un certain futur. Cette moit dont nous
parlait Claparde, ce n'est pas une nuance subj ective qui vient briser
le souvenir : c'est un rapport ontologique qui unit l e pass au prsent.
145
Mon pass n'apparat jamais dans l'isolement de sa passit , i l
serait mme absurde d 'envisager qu'i l puisse exister comme tel : i l est
originellement pass de ce prsent. Et c'est l ce qu' i l faut lucider
d'abord.
rcris que Paul , en 1920, tait lve de l'Ecole polytechnique. Qui
est-ce qui tait ? Paul , videmment : mai s quel Paul ? Le j eune
homme de 1 920 ? Mai s le seul temps du verbe tre qui convienne
Paul considr en 1 920, en tant qu'on lui attribue la qualit de
polytechnici en, c'est le prsent. Tant qu'il fut , il fallait dire de l ui : i l
est . Si c'est un Paul devenu pass qui a t lve de Polytechni que,
tout rapport avec l e prsent est rompu : l 'homme qui supportait cette
qual i ficati on, le suj et, est rest l-bas, avec son attribut, en 1920. Si
nous voul ons qu'une remmoration demeure possible, il faudrait,
dans cette hypothse, admettre une synthse rcognitive qui vnt du
prsent pour al l er maintenir le contact avec l e pass. Synthse
i mpossible concevoir si elle n'est pas un mode d'tre origi nel . A
dfaut d'une sembl abl e hypothse, il nous faudra abandonner le pass
son superbe i sol ement. Que signifierait d'ail leurs une pareille
scission de la personnalit ? Proust admet sans doute la pluralit
successive des Moi , mais cette conception, si on l a prend l a lettre,
nous fait retomber dans les di fficults insurmontables qu'ont rencon
tres, en leur temps, les associationnistes. On suggrera peut-tre
l 'hypothse d' une permanence dans le changement : celui qui fut
l ve de Polytechni que, c'est ce mme Paul qui existait en 1 920 et qui
existe prsent. Cest lui dont, aprs avoir dit : i l est lve de
Polytechnique on di t prsent : i l est ancien lve de Polytechni
que . Mais ce recours la permanence ne peut nous tirer d'affaire :
si rien ne vient prendre l'coulement des maintenant rebrousse
poi! pour constituer la srie temporelle et, dans cette srie, des
caractres permanents, la permanence n'est rien qu'un certain
contenu instantan et sans paisseur de chaque
individuel . I l faut qu' i l y ait un pass, et, par suite, quelque chose ou
quelqu'un qui tait ce pass, pour qu'i l y ait une permanence ; l oi n que
cel l e-ci puisse aider constituer le temps, elle le suppose pour s' y
dvoiler et dvoi l er avec el le le changement. Nous revenons donc ce
que nous entrevoyions plus haut : si la rmanence existentielle de
l'tre sous forme de pass ne surgit pas originellement de mon prsent
actuel , si mon pass d'hier n'est pas comme une transcendance en
arrire de mon prsent d'auj ourd'hui , nous avons perdu tout espoir
de relier l e pass au prsent. Si donc je dis de Paul qu'il fur ou qu'il
tait lve de Polytechnique, c'est de ce Paul qui prsentement est et
dont je dis aussi qu' i l est quadragnaire que j e le dis. Ce n'est pas
l'adolescent qui tait polytechnici en. De celui-l, tant qu'il fut, on
devait dire : il est. Cest le quadragnaire qui l'tait. A vrai dire
l'homme de trente ans l'tait aussi. Mais que serait cet homme de
146
trente ans, son tour, sans le quadragnaire qui le fut ? Et le
quadragnaire lui-mme, c'est l'extrme pointe de son prsent qu' il
tait polytechnici en. Et finalement c'est l'tre mme de 1' Erleb
nis qui a mission d' tre quadragnaire, homme de trente ans,
adolescent , sur mode de ravoir-t. De cette Erlebnis on dit
aujourd'hui qu'elle est ; du quadragnaire et de l'adolescent aussi on a
dit, en leur temps, ils sont ; aujourd'hui i ls font partie du pass et le
pass lui-mme est au sens o, prsentement, c'est le pass de Paul ou
de cette Erlebnis . Ainsi l es temps particuliers du parfait dsignent
des tres qui existent tous rel l ement, quoique en des modes d'tre
divers, mais dont l ' un est la fois et tait l'autre ; le pass se caractrise
comme pass de quelque chose ou de quelqu' un, on a un pass. C'est
cet ustensile, cette soci t, cet homme qui ont leur pass. Il n'y a pas
d'abord un pass universel qui se particulariserait ensuite en passs
concrets. Mais, au contraire, ce que nous trouvons d'abord, ce sont
des passs. Et le problme vritable - que nous aborderons au
chapitre suivant - sera de saisir par quel processus ces passs
individuels peuvent s' uni r pour former le pass.
On obj ectera peut-tre que nous nous sommes donn la partie belle
en choisissant un exemple dans lequel le sujet qui tait existe
encore prsentement. On nous citera d' autres cas. Par exemple, de
Pierre, qui est mort, je puis dire : il aimait la musique . En ce cas,
sujet comme attribut sont passs. Et i l n'y a pas de Pierre actuel
partir duquel puisse surgir cet tre-pass. Nous en convenons. Nous
en convenons mme au point de reconnatre que le got de l a
musique n' a j amais t pass pour Pierre. Pierre a toujours t
contemporain de ce got qui tai t son got ; sa personnalit vivante
ne l ui a pas survcu, ni lui elle. En consquence, ici, ce qui est pass,
c'est Pierre-aimant-la-musique. Et j e puis poser la question que je
posais tout l ' heure : de qui ce Pierre-pass est-il le pass ? Ce ne
saurait tre par rapport un Prsent universel qui est pure affirmation
d'tre ; c'est donc le pass de mon actualit. Et, de fai t, Pierre a t
pour-moi et j' ai t pour-lui. Nous le verrons, l 'existence de Pierre
m'a attei nt j usqu'aux moelles, elle a fait partie d' un prsent dans-Ie
monde, pour-moi et pour-autrui qui tait mon prsent, du vivant
de Pierre -un prsent que j'ai t. Ainsi les objets concrets disparus
sont passs en tant qu' ils font partie du pass concret d'un survivant.
Ce qu' il y a de terrible dans l a Mort, dit Malraux, c'est qu'elle
transforme l a vie en Destin. Il faut entendre par l qu'elle rduit le
pour-soi-pour-autrui l ' tat de simple pour-autrui. De l'tre de
Pierre mort, aujourd'hui , j e suis seul responsabl e, dans ma libert. Et
les morts qui n'ont pu tre sauvs et transports bord du pass
concret d'un survivant, ils ne sont pas passs, mais, eux et leurs
passs, ils sont anantis.
Il y a donc des tres qui ont des passs. Tout l'heure nous
147
avons ci t indiffremment un instrument, une socit, un homme.
Avions-nous raison ? Peut-on attribuer originellement un pass tous
les existants finis ou seul ement certaines catgories d'entre eux ?
C'est ce que nous pourrons plus faci lement dterminer, si nous
examinons de plus prs cette notion trs particulire : avoir un
pass. On ne peut pas avoir un pass comme on a une
automobile ou une curie de courses. C'est--dire que l e pass ne
saurait tre possd par un tre prsent qui lui demeurerait stricte
ment extrieur, comme je demeure, par exemple, extrieur mon
stylographe. En un mot , au sens o la possession exprime ordinaire
ment un rapport externe du possdant au possd, l ' expression de
possessi on est insuffisante. Les rapports externes dissimuleraient un
abme infranchissable entre pass et prsent qui seraient deux
donnes de fait sans communication relle. Mme l ' interpntration
absolue du prsent par l e pass, telle que la conoit Bergson, ne
rsout pas l a difficult parce que cette i nterpntration qui est
organisation du pass avec le prsent vient, au fond, du pass mme
et qu'elle n'est qu'un rapport d'habitation. Le pass peut bien alors
tre conu comme tant dans le prsent, mais on s'est t les moyens
de prsenter cette i mmanence autrement que comme celle d' une
pierre au fond de l a rivire. Le pass peut bien hanter l e prsent, il ne
peut pas l'tre ; c'est l e prsent qui est son pass. Si donc on tudie les
rapports du pass au prsent partir du pass, on ne pourra jamais
tablir de l'un l ' autre des relations interes. Un en-soi, par
consquent, dont l e prsent est ce qu'il est, ne saurait avoir de
pass. Les exemples cits par Chevalier l'appui de sa thse, en
particulier l es faits d' hystrsis, ne permettent pas d'tablir une action
du pass de l a matire sur son tat prsent. Aucun d'eux, en effet, qui
ne puisse s'interprter par les moyens ordinaires du dterminisme
mcaniste. De ces deux clous, nous dit Chevalier, l'un vient d'tre fait
et n' a j amais servi, l'autre a t tordu, puis dtordu coups de
marteau : ils offrent un aspect rigoureusement semblable. Pourtant
au premier coup l ' un s'enfoncera tout droit dans l a cloison et l'autre
se tordra de nouveau : action du pass. A notre sens, il faut tre un
peu de mauvaise foi pour voir l l'action du pass ; cette explication
i nintelligible de l'tre qui est densit il est facile de substituer la seule
explication possibl e : les apparences extrieures de ces clous sont
semblables, mais l eurs structures molculaires prsentes diffrent
sensi blement. Et l'tat molculaire prsent est chaque instant l'effet
rigoureux de l'tat molculaire antrieur, ce qui ne signifie point pour
l e savant qu' il y ait passage d' un instant l 'autre et permanence
du pass, mais seulement liaison irrversible entre les contenus de
deux instants du temps physi que. Donner pour preuve de cette
permanence du pass la rmanence de l'aimantation dans un morceau
de fer doux, ce n'est pas faire preuve de beaucoup plus de srieux : i l
148
s'agit l en effet d'un phnomne qui survit sa cause, non d'une
subsistance de la cause en tant que cause l'tat pass. Depuis
longtemps l a pierre qui a trou l'eau a rencontr le fond de la mare,
que des ondes concentriques parcourent encore sa surface : on ne fait
point appel je ne sais quelle action du pass pour expliquer ce
phnomne ; le mcanisme en est presque visible. Il ne semble pas
que les faits d' hystrsis ou de rmanence ncessitent une explication
d'un type diffrent. En fait il est bien clair que le mot d' avoir un
pass , qui l aisse supposer un mode de possession o le possdant
pourrait tre passif et qui comme tel ne choque pas, appliqu l a
matire, doi t tre remplac par celui d' tre son propre pass. I l n' y a
de pass que pour un prsent qui ne peut exister sans tre l-bas,
derrire lui , son pass, c'est--dire : seuls ont un pass les tres qui
sont tels qu' i l est question dans leur tre de leur tre pass, qui ont
tre leur pass. Ces remarques nous permettent de refuser a priori le
pass l'en-soi (ce qui ne signifie pas non plus que nous devions le
cantonner dans le prsent). Nous ne trancherons pas la question du
pass des vivants. Nous ferons seulement observer que s'il fallait -ce
qui n'est nul lement certain - accorder un pass la vie, ce ne
pourrait tre qu'aprs avoir prouv que l'tre de l a vie est tel qu'il
comporte un pass. En un mot, i l faudrait pralablement prouver que
la matire vivante est autre chose qu' un systme physico-chimique_
L'effort inverse - qui est celui de Chevalier - et qui consiste
donner l'urgence plus forte du pass comme constitutive de l'origina
lit de la vi e, est un vmpov np7Epov totalement dpourvu de
signification. Pour la ralit-humaine seule l'existence d' un pass est
manifeste, parce qu'il a t tabli qu'elle a tre ce qu
'
ele est. C'est
par le pour-soi que l e pass arrive dans le monde parce que son Je
suis est sous la forme d' un Je me suis .
Qu'est-ce donc que signifie tait ? Nous voyons d' abord que
c'est un transitif. Si je di s : Paul est fatigu , on peut contester
peut-tre que l a copule ait une valeur ontologique, on voudra peut
tre n'y voir qu'une indication d' inhrence. Mais lorsque nous disons
Paul tait fatigu , l a signification essentielle du tait saute aux
yeux : Paul prsent est actuellement responsable d'avoir eu cette
fatigue au pass. S'il ne soutenait cette fatigue avec son tre, il n'y
aurait mme pas oubli de cet tat, mais il y aurait un n'tre-plus ,
rigoureusement identique un n' tre-pas . La fatigue serait
perdue. L'tre prsent est donc le fondement de son propre pass ; et
c'est ce caractre de fondement que mani feste le tait . Mais i l ne
faut pas entendre qu'i l le fonde sur le mode de l'indiffrence et sans
en tre profondment modifi : tait signifie que l ' tre prsent a
tre dans son tre le fondement de son pass en tant lui-mme ce
pass. Qu'est-ce que cela signifie ; comment l e prsent peut-il tre le
pass ?
149
Le nud de la question rside videmment dans le terme de
tait qui , servant d' i ntermdiaire entre le prsent et l e pass, n'est
lui-mme ni tout fait prsent ni tout fait pass. Il ne peut tre en
effet ni l'un ni l'autre , puisque, dans ce cas, i l serait contenu
t'intrieur du temps q ui dnoterait son tre. Le terme tait
dsigne donc le saut ontologique du prsent dans le pass et
reprsente une synthse originelle de ces deux modes de temporalit.
Que faut-il entendre par cette synthse ?
Je vois d'abord que le terme tait est un mode d'tre. En ce
sens je suis mon pass. Je ne t' ai pas, je le suis : ce qu'on me dit
touchant un acte que j'ai fait hier, une humeur que j'ai eue, ne me
laisse pas i ndiffrent : je suis bless ou flatt, je me cabre ou j e laisse
di re, je suis atteint j usqu'aux moelles. Je ne me dsolidarise pas de
mon pass. Sans dout e, la longue, j e puis tenter cette dsolidarisa
tian, je puis dclarer que je ne suis plus ce que j' tais , arguer d' un
changement, d' un progrs. Mais i l s'agit d' une raction seconde et qui
se donne pour tet t e. Ni er ma solidarit d'tre avec mon pass sur tel
ou tel poi nt particul i er, c'est l'affirmer pour l'ensemble de ma vie. A
la l i mi te, l ' i nstant i nfi nitsimal de ma mort , je ne serai plus que mon
pass. Lui seul me dfi ni ra. C'est ce que Sophocle entend exprimer
l orsque, dans les Trachiniennes, il fait dire Djanire : C'est une
maxi me reue depuis longtemps parmi les hommes. qu'on ne saurait
se prononcer sur l a vie des mortels et dire si elle a t heureuse ou
mal heureuse avant l eur mort. C'est aussi le sens de cette phrase de
Malraux que nous ci ti ons plus haut : La mort change l a vie en
destin. C'est enfin ce qui frappe l e croyant lorsqu'il ralise avec
effroi que, au moment de l a mort, les jeux sont faits, i l ne reste plus
une carte jouer. La mort nous rejoint nous-mmes, tels qu'en
nous-mmes l'ternit nous a changs. Au moment de la mort nous
sommes, c'est--di re nous sommes sans dfense devant les jugements
d'autrui ; on peut dcider en vrit de ce que nous sommes, nous
n'avons plus aucune chance d'chapper au total qu'une intelligence
toute-connaissante pourrait faire. Et le repentir de la dernire heure
est un effort total pour fai re craquer tout cet tre qui s'est lentement
pris et sol i difi sur flOUS, un dernier sursaut pour nous dsolidariser de
ce que nous sommes. En vain : la mort fige ce sursaut avec l e reste, il
ne fait plus qu'entrer en composition avec ce qui l'a prcd, comme
un facteur parmi d'autres, comme une dtermination singulire qui
s'entend seulement partir de l a totalit. Par la mort le pour-soi se
mue pour toujours en en-soi dans l a mesure o il a gliss tout entier
au pass. Ainsi l e pass est la totalit toujours croissante de l ' en-soi
que nous sommes. Toutefois, tant que nous ne sommes pas morts,
nous ne sommes pas cet en-soi sur le mode de l ' identit. Nous avons
l'tre. La rancune cesse l'ordinaire la mort : c'est que l'homme a
rejoi nt son pass, il l'est, sans pour cela en tre responsable, Tant
150
qu'il vi t il est l'objet de ma rancune, c'est--dire que je lui reproche
son pass non seulement en tant qu' i l l'est mais en tant qu'il le reprend
chaque instant et l e soutient l ' tre, en tant qu' i l en est responsable.
Il n'est pas vrai que la rancune fige l' homme dans ce qu'il tai t , sinon
elle survivrait l a mort : elle s'adresse au vivant qui est librement
dans son tre ce qu'i l tait. Je suis mon pass et si je ne l'tais pas,
mon pass n'existerait plus ni pour moi ni pour personne. Il n'aurait
plus aucune relation avec l e prsent. Cela ne signifie nullement qu'il
ne serait pas mais seulement que son tre serait indcelable. Je suis
celui par qui mon pass arrive dans ce monde. Mais il faut bien
entendre que je ne l ui donne pas l'tre. Autrement dit i l n'existl pas '
titre de ma reprsentation. Ce n'est pas parce que je me
reprsente mon pass qu'il existe. Mais c'est parce que je suis
mon pass qu' i l entre dans l e monde et c'est partir de son tre-dans
le-monde que je pui s, suivant certain processus psychologique, me le
reprsenter. Il est ce que j'ai tre mais i l di ffre purtant par nature
de mes possibles. Le possible, que j' ai aussi tre, reste, comme mon
possible concret, ce dont le contraire est galement possible -
quoique un degr moindre. Au contraire le pass est ce qui est sans
aucune possibilit d' aucune sorte, ce qui a consum ses possibilits.
J'ai tre ce qui ne dpend plus aucunement de mon pouvoir-tre, ce
qui est dj en soi tout ce qu'il peut tre. Le pass que je suis, j' ai
l'tre sans aucune possibilit de ne l'tre pas. J'en assume la totale
responsabil i t comme si je pouvais l e changer et pourtant je ne puis
tre autre chose que l ui . Nous verrons plus tard que nous conservons
continuellement la possibilit de changer la signification du pass, en
tant que celui-ci est un ex-prsent ayant eu un a\enir. Mais au contenu
du pass en tant que tel je ne puis rien ter ni ajouter. Autrement dit
le pass que j'tais est ce qu'il est ; c'est un en-soi comme les choses du
monde. Et le rapport d' tre que j'ai soutenir avec le pass est un
rapport du type de l'en-soi . C'est--dire de l ' i dentification soi .
Mai s d'autre part j e ne sui s pas mon pass. Je ne le suis pas puisque
je l'tais. La rancune d'autrui me surprend et m'indigne toujours :
comment peut-on har, en celui que je suis, celui que j' tais ? La
sagesse antique a beaucoup i nsist sur ce fait : je ne puis rien noncer
sur moi qui ne soit devenu faux quand je l'nonce. Hegel n'a pas
ddaign d'employer cet argument. Quoi que je fasse, quoi que je
dise, au moment que je veux l'tre, dj je l e faisais, je le disais. Mais
examinons mi eux cet aphorisme : i l revient di re que tout j ugement
que je porte sur moi est dj faux quand je le porte, c'est--dire que je
suis devenu autre chose. Mais que faut-il entendre par alllre chose ? Si
nous entendons par l un mode de la ralit-humaine qui jouirait du
mme type existentiel que celui auquel on refuse l'existence prsente,
cela revient dclarer que nous avons commis une erreur dans
l'attribution du prdicat au sujet et qu'un autre prdicat restait
1 51
dttribuable : i l aurai t seulement fallu le viser dans l'avenir i mmdiat.
De l a mme faon un chasseur qui vise un oiseau l o il le voit le
manque parce que l'oiseau n'est dj plus cette place quand le
projectile y parvient . II l'atteindra au contraire s'i l vise un peu en
avant, un poi nt o le volatile n'est pas encore parvenu. Si l' oiseau
n'est pl us cette place c'est qu' i l est dj une autre ; de toute faon i l
est quelque part. Mais nous verrons que cette conception latique du
mouvement est profondment errone : si vraiment on peut di re que
l a flche est en AB, alors l e mouvement est une succession d'immobi
lits. Pareill ement, si l'on conoit qu' i l y a eu un instant infinitsimal,
qui n'est plus, o j 'ai t ce que je ne suis dj plus, on me constitue
avec une srie d'tats figs qui se succdent comme les i mages d'une
lanterne magique. Si je ne l e suis pas, ce n'est pas cause d' un lger
dcalage entre la pense j udicative et l'tre, d' un retard entre le
j ugement et le fai t , c'est que, par principe, en mon tre i mmdiat,
dans la prsence de mon prsent je ne le suis pas. En un mot ce n'est
pas parce qu' i l y a un changement, un devenir conu comme passage
l'htrogne dans l ' homognit de l'tre, que je ne suis pas ce que
j'tais ; mais s' i l peut y avoir un devenir, au contraire, c'est que, par
principe , mon tre est htrogne mes manires d'tre. L'explica
ti on du monde par le deveni r, conu comme synthse d'tre et de
non-tre, est vite donne. Mais a-t-on rflchi que l'tre en devenir ne
pouvait tre cette synthse que s'i l l'tait lui-mme dans un acte qui
fonderait son propre nant ? Si je ne suis dj plus ce que j'tais i l faut
pourtant que j'aie l'tre dans l ' uni t d'une synthse nantisante que
je soutiens moi-mme l'tre, sinon je n'aurais aucune relation
d'aucune sorte avec ce que je ne suis plus et ma pleine positivit serait
exclusive du non-tre essentiel au devenir. Le devenir ne peut tre un
donn, un mode d'tre i mmdiat de l'tre, car si nous concevons un
pareil tre, en son cur l ' tre et l e non-tre ne sauraient tre que
juxtaposs et aucune structure impose ou extere ne peut l es fondre
l ' un l 'autre. La liaison de l'tre et du non-tre ne peut tre
qu' i nterne : c'est dans l 'tre en tant qu'tre que doit surgir le non
tre, dans l e non-tre que l 'tre doit pointer et ceci ne saurait tre un
fait, une loi naturelle , mais un surgissement de l'tre qui est son
propre nant d'tre. Si donc je ne suis pas mon propre pass, ce ne
peut tre sur l e mode originel du deveni r, mais en tant que jai l'tre
pour ne pas l'tre et que jai ne pas l
'
tre pour l'tre. Ceci doit nous
clairer sur la nature du mode tais : si je ne suis pas ce que
j 'tais, ce n'est pas parce que j'ai dj chang, ce qui supposerait le
temps dj donn, c'est parce que je suis par rapport mon tre sur le
mode de liaison interne du n'tre-pas.
Ai nsi c'est en tant que je suis mon pass que je puis ne l'tre pas ;
c'est mme cette ncessit d' tre mon pass qui est le seul fondement
possible du fait que je ne le suis pas. Si non, chaque instant, je ne le
152
serai ni ne le serai pas, sauf aux yeux d'un tmoin rigoureusement
externe, qui aurait lui-mme, d'ail leurs, tre son pass sur l e mode
du n'tre-pas.
Ces remarques peuvent nous faire comprendre ce qu'il y a d'inexact
dans le scepticisme d' origine hraclitenne qui insiste uniquement sur
ce que j e ne suis dj plus ce que j e dis tre. Sans doute , tout ce qu'on
peut di re que j e sui s, je ne le suis pas. Mais c'est mal di t d'affirmer
que je ne l e suis dj plus, car je ne l' ai jamais t, si l'on entend par l
tre en soi ; et d' autre part il ne s'ensuit pas non plus que je fasse
erreur e n disant l ' tre, puisqu'il faut bi en que j e le sois pour ne pas
["tre : j e le suis sur le mode du tais .
Ai nsi , tout ce qu' on peut dire que j e suis au sens de l 'tre en soi,
avec une pleine densit compacte (il est colreux, i l est fonctionnaire,
il est mcontent), c'est toujours mon pass. C'est au pass que je suis
ce que je suis. Mais d'un autre ct, cette lourde plnitude d'tre est
derrire moi , il y a une distance absolue qui la coupe de moi et la fait
retomber hors de ma porte, sans contact, sans adhrences. Si j 'tais
ou si j' ai t heureux, c'est que je ne le suis pas. Mais cel a ne veut pas
dire que je sois mal heureux : si mplement je ne puis tre heureux
qu'au pass ; ce n'est pas parce que j 'ai un pass que je porte ainsi
mon tre derrire moi : mais le pass n'est justement que cette
structure ontologique qui m'oblige tre ce que je suis par-derrire.
C'est l ce que si gnifie tait . Par dfi ni ti on, le pour-soi existe sous
l'obligation d'assumer son tre et i l ne peut rien tre que pour soi.
Mais prcisment i l ne peut assumer son tre que par une reprise de
cet tre qui l e met distance de cet tre. Par l'affirmation mme que
j e suis sur l e mode de l'en-soi, j 'chappe cette affirmation car el l e
i mpl i que dans sa nature mme une ngation. Ainsi le pour-soi est
toujours par del ce qu' i l est du fait qu' i l l'est pour-soi et qu'il a
l'tre. Mais en mme temps c'est bien son tre et non un autre tre
qui demeure en arrire de lui . Ainsi comprenons-nous le sens du
tait qui caractrise simplement l e type d'tre du pour-soi , c'est-
dire la relation du pour-soi son tre. Le pass c'est l'en-soi que j e
suis en tant que dpass.
Reste tudi er la faon mme dont le pour-soi tait son propre
pass. Or on sait que l e pour-soi parat dans l'acte originel par quoi
l'en-soi se nantise pour se fonder. Le pour-soi est son propre
fondement en tant qu' i l se fait l ' chec de l 'en-soi pour tre l e sien.
Mais il n'est pas parvenu pour autant se dlivrer de l'en-soi. L'en-soi
dpass demeure et le hante comme sa contingence originelle. Il ne
peut j amais l'atteindre, ni se saisi r jamais comme tant ceci ou cela,
mais il ne peut non plus s'empcher d'tre distance de soi ce qu' i l
est. Cette contingence, cette l ourdeur distance du pour-soi , qu' i l
n'est j amais mais qu' i l a tre comme l ourdeur dpasse et conserve
dans le dpassement mme, c'est la facticit, mais c'est aussi le pass.
153
Facticit et pass sont deux mots pour dsigner une seule et mme
chose. Le Pass, en effet , comme la Facticit, c'est la contingence
invulnrable de l'en-soi que j 'ai tre sans aucune possi bi l it de ne
l ' tre pas. C'est l ' i nvitable de l a ncessit de fait , non titre de
ncessit mais ti tre de fai t. C'est l 'tre de fait qui ne peut dterminer
l e contenu de mes motivations, mais qui les transit de sa contingence
parce qu'elles ne peuvent le supprimer ni le changer mais qu' i l est au
contraire ce qu'elles emportent ncessairement avec elles pour le
modi fi er, ce qu'elles conservent pour le fuir, ce qu'elles ont tre
dans l eur effort mme pour ne l 'tre pas, ce partir de quoi elles se
font ce qu'elles sont. C'est ce qui fait qu' chaque instant je ne suis
pas diplomate et mari n, que je suis professeur, quoique je ne puisse
que jouer cet tre sans pouvoir j amais le rejoindre. Si je ne puis
rentrer dans le pass, ce n'est pas par quelque vertu magique qui le
mettrait hors d'atteinte mais simplement parce qu'il est en-soi et que
je suis pour-moi ; l e pass c'est ce que je suis sans pouvoir le vivre. Le
pass, c'est la substance. En ce sens le cogito cartsien devrait se
formuler plutt : pense donc j 'tais. Ce qui trompe, c'est
l ' apparente homognit du pass et du prsent. Car cette honte que
j'ai prouve hi er, c'tait du pour-soi quand je l'prouvai s. On croit
donc qu' elle est demeure pour-soi aujourd' hui , on en conclut donc
tort que, si je n' y puis rentrer, c'est qu'elle n'est plus. Mais il faut
i nverser le rapport pour atteindre au vrai : entre le pass et le prsent
il y a une htrognit absolue et si je n'y puis entrer c'est qu' il est.
Et la seule faon dont je pourrais l'tre c'est d'tre moi-mme en soi
pour me perdre en lui sous la forme de l ' identification : ce qui m'est
refus par essence. En effet, cette honte que j' ai prouve hier et qui
tait honte pour soi , el l e est toujours honte prsent et, de par son
essence, elle peut se dcrire comme pour-soi encore. Mais el l e n'est
plus pour soi dans son tre car el l e n'est plus comme reflet-refltant.
Descriptible comme pour-soi , el l e est tout simplement. Le pass se
donne comme du pour-soi devenu en-soi. Cette honte, tant que je la
vis, n'est pas ce qu'elle est. A prsent que j e l'tais, je puis dire :
c'tait une honte ; el l e est devenue ce qu'elle tait, derrire moi ; elle a
la permanence et la constance de l ' en-soi , elle est ternelle sa date,
elle a l a totale appartenance de l ' en-soi soi-mme. En un sens, donc,
l e pass qui est la fois pour-soi et en-soi ressemble l a valeur ou soi,
que nous dcrivions au chapitre prcdent ; comme elle il reprsente
une certaine synthse de l'tre qui est ce qu' i l n'est pas et n'est pas ce
qu'il est avec celui qui est ce qu'il est. C'est en ce sens qu'on peut
parler d'une valeur vanescente du pass. De l vient que le souvenir
nous prsente l'tre que nous tions avec une plnitude d'tre qui lui
confre une sorte de posie. Cette douleur que nous avions, en se
figeant au pass, elle ne cesse pas de prsenter le sens d' un pour-soi et
cependant el l e existe en elle-mme, avec l a fixit silencieuse d'une
1 54
douleur d' autrui , d'une douleur de statue. El l e n' a plus besoin de
comparatre devant soi pour se fai re exister. Elle est et, au contraire,
son caractre de pour-soi , loin d'tre le mode d'tre de son tre ,
devient si mplement une mani re d'tre, une qualit. C'est pour avoir
contempl le psychique au pass que les psychologues ont prtendu
que l a conscience tait une qualit qui pouvait ou non l' affect er, sans
le modifier dans son tre. Le psychique pass est d'abord et i l est
pour-soi ensuite, comme Pierre est blond , comme cet arbre est un
chne.
Mais, prcisment pour cela, le pass qui ressemble l a valeur n 'est
pas la valeur. Dans la valeur le pour-soi devient soi en dpassant et en
fondant son tre, i l y a reprise de l'en-soi par le soi ; de ce fait la
contingence de l 'tre cde la place la ncessit. Le pass, au
contraire , est d'abord en soi . Le pour-soi est soutenu l'tre par l'en
soi, sa raison d'tre n'est plus d'tre pour-soi : il est devenu en-soi et
nous apparat, de ce chef, dans sa pure contingence. I l n'y a aucune
raison pour que notre pass soit tel ou tel : i l apparat, dans l a totalit
de sa srie, comme le fait pur dont i l faut tenir compte en tant que
fai t, comme le gratuit. Il est en somme l a valeur inverse, l e pour-soi
repris par l'en-soi , paissi par l'en-soi au point de ne pouvoir plus
exister comme reflet pour le refl tant ni comme refltant pour l e
reflet, mai s simplement comme une indication en-soi du couple
refltant-reflet. C'est pourquoi le pass peut l a rigueur tre l ' obj et
vis par un pour-soi qui veut raliser l a val eur et fuir l'angoisse que l ui
donne l a perptuelle absence du soi . Mais i l est radicalement distinct
de la valeur par essence : i l est prcisment l'indicatif dont aucun
impratif ne se peut dduire, i l est le fait propre de chaque pour-soi ,
l e fait conti ngent et inaltrable que j 'tais.
Ainsi le pass est un pour-soi ressaisi et noy par l'en-soi. Comment
cela peut-il se faire ? Nous avons dcrit ce que signifiait tre pass
pour un vnement et avoir un pass pour une ralit-humaine. Nous
avons vu que le pass est une loi ontologique du pour-soi, c'est--dire
que tout ce que peut tre un pour-soi , il doit l'tre l-bas, derrire soi ,
hors de porte. C'est en ce sens que nous pouvons accepter le mot de
Hegel : Wesen t was gewesen ist. Mon essence est au pass, c'est
la loi de son tre. Mais nous n'avons pas expliqu pourquoi un
vnement concret du pour-soi devient pass. Comment un pour-soi
qui tait son pass devient-il le pass qu'a tre un nouveau pour-soi ?
Le passage au pass est modi fication d' tre. Quelle est cette
modification ? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir le rapport du
pour-soi prsent avec l'tre. Ainsi , comme nous pouvions l ' augurer,
l'tude du pass nous renvoie celle du prsent.
155
B) Le Prsent.
A l a di ffrence du pass qui est en-soi , le prsent est pour-soi . Quel
est son tre ? I l y a une antinomie propre au prsent : d'une part, on
le dfinit vol ontiers par l'tre ; est prsent ce qui est par opposition au
futur qui n'est pas encore et au pass qui n'est pl us. Mai s, d'autre
part, une analyse rigoureuse qui prtendrait dbarrasser le prsent de
tout ce qui n'est pas l ui , c'est--dire du pass et de l'avenir immdiat,
ne trouverait plus en fait qu' un instant infinitsimal, c'est--di re,
comme le remarque Husserl dans ses Leons sur la conscience interne
du Temps, le terme idal d'une division pousse l'infini : un nant.
Ai nsi , comme chaque fois que nous abordons l'tude de la ralit
humaine d'un point de vue nouveau, nous retrouvons ce couple
indissoluble, l ' Etre et l e Nant.
Quelle est l a signification premire du prsent ? Il est clair que ce
qui existe au prsent se distingue de toute autre existence par son
caractre de prsence. Lors de l'appel nomi nal , le soldat ou l'lve
rpond Prsent ! au sens de . Et prsent s'oppose
absent aussi bi en qu' pass. Ai nsi le sens du prsent c'est la prsence
. . . Il convient donc de nous demander quoi le prsent est prsence
et qui est prsent. Cela nous conduira sans doute lucider ensuite
l'tre mme du prsent.
Mon prsent c'est d'tre prsent. Prsent quoi ? A cette table,
cette chambre, Paris, au monde, bref, l'tre-en-soi . Mais,
i nversement, l'tre-en-soi est-il prsent moi et l'tre-en-soi qu'il
n'est pas ? Si cela tait, le prsent serait un rapport rciproque de
prsences. Mais i l est facile de voir qu'il n' en est rien. La prsence . . .
est un rapport interne de l'tre qui est prsent avec les tres auxquels
il est prsent. En aucun cas, il ne peut s'agir de la simple relation
externe de contigut . La prsence . . . signi fie l 'existence hors de soi
prs de . . . Ce qui peut tre prsent . . . doit tre tel dans son tre qu'il
y ai t en celui-ci un rapport d'tre avec les autres tres. Je ne pui s tre
prsent cette chaise que si je suis uni elle dans un rapport
ontologique de synthse, que si je suis l-bas dans l'tre de cette
chaise comme n'tant pas cette chaise. L'tre qui est prsent . . . ne
peut donc tre en repos en-soi , l'en-soi ne peut tre prsent, pas
plus qu'il ne peut tre pass : il est, tout si mplement. Il ne peut tre
question d'une si mul tanit quelconque d' un en-soi avec un autre en
soi , sauf du point de vue d'un tre qui serait coprsent aux deux en-soi
et qui aurait en lui-mme le pouvoir de prsence. Le prsent ne
saurait donc tre que prsence du pour-soi l'tre-en-soi. Et cette
prsence ne saurait tre l 'effet d'un acci dent, d'une concomit ance ;
elle est suppose au contraire par toute concomitance et doit tre une
structure ontologique du pour-soi . Cette table doit tre prsente
156
cette chaise dans un monde que la ralit-humaine hante comme une
prsence. Autrement di t , on ne saurait concevoir un type d'existant
qui serait d'
abord pour-soi pour tre ensuite prsent l'tre. Mais le
pour-soi se fait prsence l'tre en se faisant tre pour-soi et cesse
d'tre prsence en cessant d'tre pour-soi. Le pour-soi se dfinit
comme prsence l'tre .
A quel tre le pour-soi se fait-il prsence ? La rponse est claire :
c'est tout l'tre-en-soi que le pour-soi est prsence. Ou plutt l a
prsence du pour-soi est ce qui fai t qu' i l y a une totalit de l'tre-en
soi. Car, par ce mode mme de prsence J'tre en tant qu'tre, toute
possibilit est carte que le pour-soi soit plus prsent un tre
privilgi qu'aux autres tres. Mme si la facticit de son existence
fait qu'il soit l plutt qu' ailleurs, tre l n'est pas tre prsent. L'tre
l dtermine seulement la perspective selon laquelle se ralise la
prsence l a totalit de l'en-soi. Par l le pour-soi fait que les tres
soient pour une mme prsence. Les tres se dvoilent comme
coprsents dans un monde o le pour-soi les unit avec son propre sang
par ce total sacrifice ek-statique de soi qui se nomme la prsence.
Avant l e sacrifice du pour-soi il et t impossible de di re que les
tres existassent ensemble ni spars. Mais l e pour-soi est l'tre par
qui l e prsent entre dans l e monde ; les tres du monde sont
coprsents, en effet, en tant qu'un mme pour-soi leur est la fois
prsent tous. Ai nsi ce qu' on appelle ordinairement prsent, pour les
en-soi , se di stingue nettement de leur tre, encore qu' i l ne soit rien de
plus : c'est seulement leur coprsence en tant qu'un pour-soi leur est
prsent.
Nous savons maintenant qui est prsent et quoi le prsent est
prsent. Mai s qu'est-ce que la prsence ?
Nous avons vu que ce ne saurait tre la pure coexistence de deux
existants, conue comme une simple relation d'extriorit, car elle
exigerai t un troisime terme pour tablir cette coexistence. Ce
troisime terme existe dans l e cas de l a coexistence des choses au
milieu du monde : c'est le pour-soi qui tablit cette coexistence en se
faisant coprsent toutes. Mais, dans le cas de la prsence du pour
soi J'tre-en-soi, il ne saurait y avoir de troisime terme. Nul
tmoin, ft-ce Dieu, ne peut l'tablr, cette prsence, le pour-soi lui
mme ne peut l a connatre que si elle est dj. Toutefois elle ne
saurait tre sur le mode de l'en-soi. Cela signifie qu'originellement le
pour-soi est prsence J'tre en tant qu'il est soi-mme son propre
tmoin de coexistence. Comment devons-nous l'entendre ? On sait
que le pour-soi est J ' tre qui existe sous forme de tmoin de son tre.
Or le pour-soi est prsent J'tre s'il est intentionnellement dirig
hors de soi sur cet tre. Et il doit adhrer l'tre aussi troitement
qu'il est possible sans identification. Cette adhrence, nous verrons
au chapitre prochain qu'elle est raliste, du fait que l e pour-soi nat
157
soi dans une l i aison originelle avec l ' tre : il est soi-mme tmoi n de
soi comme /l 'tant pas cet tre. Et de ce fait il est hors de lui, sur l ' tre
et dans l'tre comme n'tant pas cet tre. C'est ce que nous pouvions
ddui re, d'ai l l eurs, de l a signification mme de l a prsence : l a
prsence un tre implique qu' on est li cet tre par un lien
d' i ntriorit, sinon aucune liaison du prsent avec l'tre ne serait
possi ble ; mais ce lien d'intriorit est un lien ngatif, il nie de l 'tre
prsent qu' i l soit l'tre auquel il est prsent. Sinon le lien d'intriorit
s'vanouirait en pure et simple i dentification. Ainsi l a prsence
l' tre du pour-soi i mplique que le pour-soi est tmoin de soi en
prsence de l ' tre comme n'tant pas l 'tre ; l a prsence l'tre est
prsence du pour-soi en tant qu' i l n'est pas. Car l a ngation porte non
sur une di ffrence de manire d' tre qui distinguerait le pour-soi de
l ' tre, mais sur une diffrence d'tre. C'est ce qu'on exprime
brivement en disant que l e prsent n
'
est pas.
Que signifie ce non-tre du prsent et du pour-soi ? Pour le saisir i l
faut revenir au pour-soi, son mode d'exister et esquisser brivement
une description de sa relation ontologique l'tre. Du pour-soi en
tant que tel, on ne saurait jamais dire : i l est, au sens o l'on dit, par
exempl e : i l est neuf heures c'est--dire au sens de l a totale adqua
tion de l'tre avec soi-mme qui pose et supprime le soi et qui donne
les dehors de l a passivit. Car l e pour-soi a l'existence d'une
apparence couple avec un tmoi n d'un reflet qui renvoie un
refltant sans qu' il y ait aucun objet dont le reflet serait reflet. Le
pour-soi n' a pas d'tre parce que son tre est toujours distance : l
bas dans le refltant, si vous considrez l'apparence, qui n'est
apparence ou reflet que pour l e refltant ; l-bas dans le reflet, si vous
considrez l e refltant qui n'est plus en soi que pure fonction de
reflter ce reflet. Mais en outre, en lui-mme, le pour-soi n'est pas
l ' tre, car i l se fait tre explicitement pour-soi comme n'tant pas
l'tre . Il est conscience de . . . comme ngation intime de . . . La
structure de base de l'intentionnalit et de l'ipsit, c'est la ngation,
comme rapport intere du pour-soi la chose ; le pour-soi se constitue
dehors, partir de l a chose comme ngation de cette chose ; ainsi son
premier rapport avec l'tre en soi est-il ngation ; i l est sur le
mode du pour-soi, c'est--dire comme existant dispers en tant qu'il
se rvle lui-mme comme n'tant pas l'tre. li chappe doublement
l ' tre, par dsagrgation intime et ngation expresse. Et le prsent
est prcisment cette ngation de l ' tre, cette vasion de l'tre en tant
que l'tre est l comme ce dont on s'vade. Le pour-soi est prsent
l'tre sous forme de fuite ; le prsent est une fuite perptuelle en face
de l 'tre. Ainsi avons-nous prcis l e sens premier du prsent : le
prsent n
'
est pas ; l ' i nstant prsent mane d' une conception ralisante
et chosiste du pour-soi ; c'est cette conception qui amne dnoter le
pour-soi par le moyen de ce qui est et quoi il est prsent , par
158
exemple, de cette aiguille sur le cadran. En ce sens, il serait absurde
de dire qu' i l est neuf heures pour le pour-soi ; mais le pour-soi peut
tre prsent une aiguille pointe sur neuf heures. Ce qu'on nomme
faussement le prsent, c'est l'tre quoi le prsent est prsence. Il est
impossible de saisir le prsent sous forme d' i nstant car l'instant serait
le moment o le prsent est. Or le prsent n'est pas, i l se prsentifie
sous forme de fuite.
Mais le prsent n'est pas seulement non-tre prsentifiant du pour
soi. En tant que pour-soi, il a son tre hors de lui , devant et derrire.
Derrire, il tait son pass et devant i l sera son futur. Il est fuite hors
de l'tre coprsent et de l ' tre qu' i l tait vers l'tre qu' i l sera. En tant
que prsent il n'est pas ce qu' i l est (pass) et il est ce qu' i l n'est pas
(futur). Nous voil donc renvoys au Futur.
C) Le Futur.
Notons d' abord que l'en-soi ne peut tre futur ni contenir une part
de futur. La pleine lune n'est future, quand j e regarde ce croissant,
que dans le monde qui se dvoile la ralit-humaine : c'est par l a
ralit-humai ne que le futur arrive dans l e monde. En soi ce quartier
de lune est ce qu' i l est. Rien en lui n'est en puissance. Il est acte. I l n'y
a donc pas plus de futur que de pass comme phnomne de
temporalit originelle de l'tre-en-soi. Le futur de l'en-soi, s' i l
existai t, existerait en soi, coup de l ' tre comme le pass. Quand bi en
mme on admettrait, comme Laplace, un dterminisme total qui
permt de prvoir un tat futur, encore faudrait-il que cette circons
tance future se profile sur un dvoilement pralable de l'avenir en
tant que tel, sur un tre--veni r du monde -ou alors c'est que l e
temps est une illusion et que le chronologique dissimule un ordre
strictement logique de dducti bi li t. Si l'avenir se profile l'horizon
du monde, ce ne peut tre que par un tre qui est son propre avenir,
c'est--dire qui est -venir pour lui-mme, dont l'tre est constitu par
un venir--soi de son tre. Nous retrouvons ici des structures ek
statiques analogues celles que nous avons dcrites pour le pass.
Seul un tre qui a tre son tre, au lieu simplement de l'tre, peut
avoir un avenir.
Mais qu'est-ce au juste qu'tre son avenir ? Et quel type d'tre
possde de l ' avenir ? Il faut renoncer d'abord l'ide que l'avenir
existe comme reprsentation. Tout d'abord l'avenir est rarement
reprsent ". Et quand il l'est, comme di t Heidegger, il est
thmatis et cesse d'tre mon avenir, pour devenir l'objet indiffrent
de ma reprsentation. Ensuite, ft-il reprsent, il ne saurait tre l e
contenu de ma reprsentation , car ce contenu, si contenu il y
avai t, devrait tre prsent . Dira-t-on que ce contenu prsent sera
159
ani m par une i ntenti on futurante ? Cela n' aurait poi nt de sens. Si
mme cette intention existait, i l faudrait qu'elle ft elle-mme
prsente - et al ors le problme de l'avenir n'est susceptible de
recevoir aucune solution -ou bien qu' el l e transcende l e prsent dans
l'avenir et alors l'tre de cette intention est -venir, il faut reconnatre
l 'avenir un tre di ffrent du simple percipi. Si d'ailleurs le pour-soi
tai t born dans son prsent, comment pourrait-il se reprsenter
l ' aveni r ? Comment en aurait-il la connaissance ou le pressentiment ?
Aucune i de forge ne saurait l ui en fournir un quivalent. Si d' abord
on a confin le prsent dans le prsent, il va de soi qu' i l n' en sortira
j amai s. Il ne servirait rien de le donner comme gros de l'avenir .
Ou bi en cette expression ne signifie ri en, ou bien elle dsigne une
efficience actuelle du prsent, ou bien elle indique la loi d' tre du
pour-soi comme ce qui est soi-mme futur, et dans ce dernier cas,
elle marque seulement ce qu' i l faut dcrire et expliquer. Le pour-soi
ne saurait tre gros de l' avenir ni attente de l'avenir ni
connaissance de l'avenir que sur le fond d'une relation originelle
et prjudicative de soi soi : on ne peut concevoir pour l e pour-soi la
moi ndre possi bi l i t d'une prvision thmatique, ft-ce celle des tats
dtermins de l ' univers scientifi que, moins qu'il ne soit l'tre qui
vient lui-mme partir de l'aveni r, l'tre qui se fait exister comme
ayant son tre hors de lui-mme l'avenir. Prenons un exemple
simple : cette position que je prends vivement sur le court n'a de sens
que par l e geste que je ferai ensuite avec ma raquette pour renvoyer la
bal l e par-dessus le filet. Mais je n'obis pas la claire reprsenta
ti on du geste futur ni l a ferme volont de l'accomplir.
Reprsentations et vol i tions sont des idoles inventes par les psycho
logues. C'est le geste futur qui , sans mme tre thmatiquement pos,
revient en arrire, sur les positions que j'adopte, pour les clairer, les
lier et les modifier. Je suis d'abord d' un seul jet l-bas sur ce court,
renvoyant la bal l e, comme manque moi -mme, et les positions
intermdiaires que j 'adopte ne sont que des moyens de me rappro
cher de cet tat futur pour m'y fondre, chacune d'elles n'ayant tout
son sens que par cet tat futur. Il n'est pas un moment de ma
conscience qui ne soit pareillement dfi ni par un rapport interne un
futur ; que j 'crive, que je fume, que je boive, que je me repose, le
sens de mes consciences est toujours distance, l-bas, dehors. En ce
sens, Heidegger a raison de dire que le Dasein est toujours
infi ni ment plus que ce qu' i l serait si on le limitait son pur prsent .
Mi eux encore, cette limitation serait impossible car on ferait alors du
prsent un en-soi. Ainsi a-t-on justement di t que la finalit tait la
causalit renverse, c'est--dire l'efficience de l'tat futur. Mais on a
trop souvent oubl i de prendre cette formule au pied de la lettre.
Il ne faut pas entendre par futur un maintenant qui ne serait pas
encore. Nous retomberions dans l'en-soi et surtout nous devrions
160
envisager le temps comme un contenant donn et stati que. Le futur
est ce que j'ai tre en tant que je peux ne pas l'tre. Rappelons-nous
que le pour-soi se prsentifie devant l' tre comme n'tant pas cet tre
et ayant t son tre au pass. Cette prsence est fuite. Il ne s'agit pas
d'une prsence attarde et en repos auprs de l'tre mais d' une
vasion hors de l 'tre vers . . . Et cette fui te est double car en fuyant
l'tre qu' elle n'est pas, l a prsence fuit l ' tre qu' el l e tai t. Vers quoi
fuit-elle ? N'oubl ions pas que le pour-soi , en tant qu' i l se prsentifie
l'tre pour le fui r, est un manque. Le Possible est ce de quoi manque
le pour-soi pour tre soi ou si l'on prfre l'appari tion di stance de ce
que je suis. On saisit ds lors l e sens de la fuite qui est prsence : elle
est fuite vers son tre, c'est--dire vers le soi qu' el l e sera par
concidence avec ce qui l ui manque. Le futur est l e manque qui
l'arrache, en tant que manque, l'en-soi de la prsence. Si el l e ne
manquait de ri en elle retomberait dans l'tre et perdrait jusqu' l a
prsence l'tre pour acqurir en change l'isolement de l a complte
identit. C'est l e manque en tant que tel qui l ui permet d'tre
prsence, c'est parce qu'elle est hors d' el le-mme vers un manquant
qui est au-del du monde, c'est cause de cela qu'elle peut tre hors
d'elle-mme comme prsence un en-soi qu'elle n'est pas. Le futur
c'est l'tre dterminant que le pour-soi a tre par del l'tre. Il y a
un futur parce que le pour-soi a tre son tre au l i eu de l'tre tout
simpl ement. Cet tre que le pour-soi a tre, il ne saurait tre l a
faon des en-soi coprsents, si non i l serait sans avoir tre t ; on ne
saurait donc l'imaginer comme un tat compltement dfi ni , qui
seul manquerait l a prsence, comme Kant di t que l 'existence n'ajoute
rien de plus l'objet du concept. Mais i l ne saurai t non plus n'exister
pas, sinon le pour-soi ne serait qu' un donn. Il est ce que le pour-soi
se fait tre en se saisissant perptuellement pour soi comme inachev
par rapport l ui . Il est ce qui hante distance le couple reflet
refltant et ce qui fait que le reflet est saisi par l e refltant (et
rciproquement) comme un Pas-encore . Mais il faut prcisment que
ce manquant soi t donn dans l ' unit d' un seul surgissement avec le
pour-soi qui manque, sinon i l n' y aurait rien par rapport q uoi le
pour-soi se saisisse comme pas-encore. Le futur s'est rvl au pour
soi comme ce que le pour-soi n'est pas encore, en tant que le pour-soi
se constitue non-thtiquement pour soi comme un pas-encore dans la
perspective de cette rvlation et en tant qu' i l se fait tre comme un
projet de lui-mme hors du prsent vers ce qu' i l n'est pas encore. Et
certes le futur ne peut tre sans cette rvlation. Et cette rvlation
exige el le-mme d' tre rvle soi, c'est--dire qu' el l e exige la
rvlation du pour-soi soi-mme, sinon l'ensemble Rvlation,
rvl , tomberait dans l'inconscient, c'est--dire dans l'en-soi. Ainsi
seul un tre qui est soi-mme son rvl, c'est--dire dont l'tre est
en question pour soi , peut avoir un futur. Mais, rciproquement, un
161
tel tre ne peut tre pour soi que dans la perspective d'un pas-encore
car il se saisit lui-mme comme un nant, c'est--dire comme un tre
dont le complment d'tre est distance de soi . A distance, c'est-
dire par del l ' tre. Ainsi tout ce que le pour-soi est par del l'tre est
le futur.
Que signifie ce par del Pour l e saisir i l faut noter que le futur
a une caractristique essentielle du pour-soi : i l est prsence (future) a
l'tre. Et prsence de ce pour-soi-ci, du pour-soi dont il est le futur
Lorsque je dis : je serai heureux, c'est ce pour-soi prsent qui sera
heureux, c'est l' Erl ebni s actuell e, avec tout ce qu'elle tait et
qu'elle trane derrire soi . Et elle le sera comme prsence l 'tre,
c'est--dire comme prsence future du pour-soi un tre cofutur. En
sorte que ce qui m'est donn comme le sens du pour-soi prsent, c'est
ordinairement l'tre cofutur en tant qu'il se dvoilera au pour-soi
futur comme ce quoi ce pour-soi sera prsent. Car le pour-soi est
conscience thtique du monde sous forme de prsence et non
conscience thtique de soi . Ainsi ce qui se dvoile ordinairement la
consci ence, c'est le monde futur, sans qu' elle prenne garde que c'est le
monde en tant qu' i l apparatra une consci ence, l e monde en tant
qu'il est pos comme futur par l a prsence d'un pour-soi venir. Ce
monde n'a de sens comme futur qu'en tant que j 'y suis prsent comme
un autre que je serai, dans une autre position physique, affective,
sociale, etc. Pourtant c'est lui qui est au bout de mon pour-soi prsent
et par del l 'tre-en-soi et c'est pour cela que nous avons tendance
prsenter d'abord le futur comme un tat du monde et nous faire
paratre ensuite sur ce fond de monde. Si j'cris, j 'ai conscience des
mots comme crits et comme devant tre crits. Les mots seuls
paraissent l e futur qui m' attend. Mais le seul fait qu'ils apparaissent
comme crire i mplique qu'crire comme conscience non-thtique
(de) soi est la possibi lit que je suis. Ainsi l e futur, comme prsence
future d' un pour-soi un tre, entrane l'tre-en-soi avec lui dans le
futur. Cet tre auquel i l sera prsent, i l est l e sens de l' en-soi
coprsent au pour-soi prsent, comme le futur est le sens du pour-soi.
Le futur est prsence un tre cofutur parce que le pour-soi ne peut
exister que hors de soi prs de l'tre et que le futur est un pour-soi
futur. Mais ai nsi , par le futur, un avenir arrive au monde, c'est--dire
que l e pour-soi es! son sens comme prsence un tre qui est par del
l'tre. Par l e pour-soi un par-del de l'tre est dvoil auprs duquel i l
a tre ce qu' i l est. Je dois, suivant l a formule clbre, devenir ce
que j ' tais , mais c'est dans un monde lui-mme devenu que je dois
le devenir. Et dans un monde devenu partir de ce qu' i l est. Cela
signifie que je donne au monde des possibilits propres partir de
l'tat que je saisis sur l ui : le dtermi nisme parat sur le fond du projet
futurant de moi -mme. Ainsi le futur se distinguera de l ' imaginaire,
o je suis galement ce que je ne suis pas, o je trouve galement
162
mon sens dans un tre que j' ai tre mais o ce pour-soi que j 'ai
tre merge du fond de nantisation du monde, ct du monde de
l'tre.
Mais l e futur n'est pas uniquement prsence du pour-soi un tre
situ par del l ' tre. Il est quelque chose qui attend le pour-soi que je
suis. Ce quel que chose, c'est moi-mme : lorsque je dis que je serai
heureux, i l est bien entendu que c'est mon moi prsent, tranant son
pass aprs soi , qui sera heureux. Ainsi l e futur c'est moi en tant que
je m'attends comme prsent un tre par del l'tre. Je me projette
vers le futur pour m'y fondre avec ce dont je manque, c'est--dire ce
dont l'adjonction synthtique mon prsent ferait que je sois ce que
je sui s. Ai nsi ce que l e pour-soi a tre comme prsence l' tre par
del l 'tre, c'est sa propre possibil i t. Le futur est le point idal o la
compressi on subite et infi nie de la facticit ( Pass), du pour-soi
(Prsent) et de son possible (Avenir) ferait surgir enfin le Soi comme
existence en soi du pour-soi. Et le projet du pour-soi vers le futur qu' i l
est est un projet vers l' en-soi . En ce sens l e pour-soi a tre son futur
parce qu' i l ne peut tre l e fondement de ce qu' i l est que devant soi et
par del l'tre : c'est la nature mme du pour-soi que de devoir tre
un creux toujours futur . De ce fait il ne sera jamais devenu, au
prsent, ce qu' i l avait tre, au futur. Le futur tout entier du pour-soi
prsent tombe au pass comme futur avec ce pour-soi lui-mme. Il
sera futur pass d'un certain pour-soi ou futur antrieur. Ce futur ne
se ralise pas. Ce qui se ralise, c'est un pour-soi dsign par le futur
et qui se consti tue en liaison avec ce futur. Par exempl e, ma position
finale sur le court a dtermin du fond de l'avenir toutes mes positions
intermdiaires et finalement elle a t rejoi nte par une position ultime
identique ce qu'elle tait l'avenir comme sens de mes mouve
ments. Mais prcisment ce rejoignement est purement idal , i l
ne s'opre pas rellement : le futur ne se laisse pas rejoindre, i l glisse
au pass comme ancien futur et le pour-soi prsent se dvoile dans
toute sa facti cit, comme fondement de son propre nant et derechef
comme manque d'un nouveau futur. De l cette dception ontologi
que qui attend le pour-soi chaque dbouch dans le futur : Que la
Rpublique tait belle sous l'Empire ! Mme si mon prsent est
rigoureusement identique en son contenu au futur vers quoi je me
proj etais par del l' tre, ce n'est pas ce prsent vers quoi je me
proj etais car je me projetais vers le futur en tant que futur, c'est-
dire en tant que poi nt de rejoignement de mon tre, en tant que lieu
du surgissement du Soi.
A prsent nous sommes mieux mme d' i nterroger le futur sur son
tre, puisque ce futur que j'ai tre c'est simplement ma possibilit de
prsence l'tre par del l'tre. En ce sens le futur s'oppose
rigoureusement au pass. Le pass est bien en effet l'tre que je suis
hors de moi, mais c'est l'tre que je suis sans possibilit de ne l'tre
163
pas. C'est ce que nous avons appel : tre son pass derrire soi . Le
futur que j'ai tre, au contraire, est tel dans son tre que je peux
seulement l'tre car ma libert le ronge dans son tre par en dessous.
Cela signifie que le futur constitue le sens de mon pour-soi prsent,
comme le projet de sa possibi l i t, mais qu'il ne prdtermine
aucunement mon pour-soi venir, puisque le pour-soi est toujours
dlaiss dans cette obligation nantisante d'tre le fondement de son
nant. Le futur ne fait que presquisser le cadre dans lequel le pour
soi se fer a tre comme fuite prsentifiante l'tre vers un autre futur.
Il est ce que je serais si je n'tais pas libre et ce que je ne peux avoir
tre que parce que je suis libre. En mme temps qu'il parat
l ' horizon pour m' annoncer ce que je suis partir de ce que je serai
(<
Que fais-tu ? Je suis en train de clouer ce tapis, de pendre au
mur ce tableau ) , par sa nature de futur prsent-pour-soi il se
dsarme puisque le pour-soi qui sera, sera sur le mode de se
dtermi ner lui-mme tre, et que le futur, devenu futur pass
comme presquisse de ce pour-soi , ne pourra que le solliciter, titre
de pass, d'tre ce qu'i l se fait tre. En un mot, je suis mon futur dans
la per
sp
ective constante de la possibilit de ne l'tre pas. De l cette
angoisse que nous avons dcrite plus haut et qui vient de ce que je ne
suis pas assez ce futur que j'ai tre et qui donne son sens mon
prsent : c'est que je suis un tre dont le sens est toujours problmati
que. En vain le pour-soi voudrait-il s'enchaner son possible, comme
l'tre qu'il est hors de lui-mme mais qu'il est, au moins, srement
hors de lui-mme : le pour-soi ne peut jamais tre que problmati
quement son futur, car il est spar de lui par un nant qu'il est ; en un
mot il est libre et sa l i bert est elle-mme sa propre limite. Etre libre
c'est tre condamn tre l i bre. Ainsi le futur n'a pas d'tre en tant
que fut
ur. Il n'est pas en soi et i l n'est pas non plus sur le mode d' tre
du pour-soi puisqu'il est le sens du pour-soi . Le futur n'est pas, il se
possibilise. Le futur est la possibilisation continuelle des possibles
comme le sens du pour-soi prsent , en tant que ce sens est
problmatique et qu' i l chappe radicalement comme tel au pour-soi
prsent.
Le futur, ainsi dcri t, ne correspond pas une suite homogne et
chronologiquement ordonne d'instants venir. Certes i l y a une
hi rarchie de mes possibles. Mais cette hirarchie ne correspond pas
l'ordre de la temporalit universelle tel qu'il s'tablira sur les bases de
la temporalit origi nel l e. Je suis une infinit de possibilits, car le sens
du pour-soi est complexe et ne saurait tenir en une formule. Mai s telle
possibilit est plus dterminante pour le sens du pour-soi prsent que
telle autre qui est plus proche dans le temps universel . Par exemple,
c'est vraiment un possible que je suis, cette possibilit d'aller voir
deux heures un ami que je n'ai pas revu depuis deux ans. Mais les
possibles plus proches -possibilits d'y aller en taxi, en autobus, en
164
mtro, pied -restent prsentement indtermins. Je ne suis aucune
de ces possibilits. Aussi y a-t-il des t rous dans la srie de mes
possibilits. Les trous seront combls, dans l'ordre de la connais
sance, par la constitution d'un temps homogne et sans lacunes -
dans l'ordre de l'acti on, par la vol ont, c'est--di re par le choix
rationnel et thmatisant, en fonction de mes possibles, de possibilits
qui ne sont pas, qui ne seront jamais mes possi bilits et que je
raliserai sur le mode de la totale indi ffrence pour rejoindre un
possible que je SUIS.
I l
ONTOLOGI E DE LA TEMPORALI T
A) La temporalit statique.
Notre description phnomnologique des trois ek-stases tempo
relles doit nous permettre d'aborder prsent la temporalit comme
structure totalitaire organisant en elle l es structures ek-statiques
secondaires. Mais cette nouvelle tude doit se faire de deux points de
vue diffrents.
La temporalit est souvent considre comme indfinissable.
Chacun admet pourtant qu'elle est avant tout successi on. Et la
successi on son tour peut se dfi ni r comme un ordre dont le principe
ordonnateur est la relation avant-aprs. Une multiplicit ordonne
selon l'avant-aprs, telle est la multiplicit temporelle. Il convient
donc, pour commencer, d'envisager la constitution et les exigences
des termes avant et aprs . C'est ce que nous appellerons l a
statique temporelle, puisque ces notions d'avant et d'aprs peuvent
tre envisages sous leur aspect strictement ordinal et indpendam
ment du changement proprement dit. Mais le temps n'est pas
seulement un ordre fixe pour une multiplicit dtermine : en
observant mieux l a temporalit nous constatons le fair de la succes
sion, c'est--dire le fai t que tel aprs devient un avant, que le prsent
devient pass et l e futur futur-antrieur. C'est ce qu'il conviendra
d'exami ner en second lieu sous l e nom de Dynamique temporelle.
Sans aucun doute c'est dans la dynamique temporelle qu'il faudra
chercher le secret de la constitution statique du temps. Mais i l est
prfrable de diviser les difficults. En un sens, en effet, on peut di re
que la statique temporelle peut tre envisage part comme une
certaine structure formelle de la temporalit -ce que Kant appelle
l'ordre du temps -et que l a dynamique correspond l'coulement
165
matriel ou, suivant la terminologie kantienne, au cours du temps. Il
y a donc intrt envisager cet ordre et ce cours successivement.
L'ordre avant-aprs se dfi ni t tout d'abord par l ' i rrversibilit.
On appellera successive une srie telle qu'on ne puisse en envisager
les termes qu' un un et dans un seul sens. Mais on a voulu voir dans
l'avant et dans l'aprs -prcisment parce que les termes de la srie
se dvoilent un un et que chacun est exclusif des autres - des
formes de sparati on. Et en effet c'est bien le temps qui me spare,
pa r exempl e, de la ralisation de mes dsirs. Si je suis oblig
d'attendre cette ralisation, c'est qu'el le est situe aprs d'autres
vnements. Sans l a succession des aprs ", je serais tout de suite ce
que je veux tre, i l n'y aurait plus de distance entre moi et moi , ni de
sparation entre l 'action et l e rve. C'est essentiellement sur cette
vertu sparatrice du temps que les romanciers et les potes ont i nsist,
ai nsi que sur une i de voisine qui ressortit d'ai lleurs la dynamique
temporelle : c'est que tout maintenant est destin devenir un
autrefois . Le temps ronge et creuse, il spare, il fuit. Et c'est
encore titre de sparateur-en sparant l'homme de sa peine ou de
l'objet de sa peine - qu' i l gurit.
Laisse faire l e temps , dit l e roi don Rodrigue. D'une faon
gnrale, on a t surtout frapp de la ncessit qu' i l y a pour tout
tre tre cartel en une dispersion infinie d'aprs qui se succdent.
Mme les permanents, mme cette table qui demeure invariable
pendant que je change doit taler et rfracter son tre dans la
dispersion temporelle. Le temps me spare de moi-mme, de ce que
j 'ai t, de ce que je veux tre, de ce que je veux faire, des choses et
d'autrui . Et c'est le temps qui est choisi pour mesure pratique de la
distance : on est une demi-heure de telle ville, une heure de telle
autre, i l faut trois jours pour accompl i r tel travail , etc. Il rsulte de ces
prmisses qu'une vision temporelle du monde et de l'homme s'effon
drera en un miettement d'avant et d'aprs. L'unit de cet miette
ment, l' atome temporel, ce sera l'instant, qui a sa place avant certains
i nstants dtermins et aprs d'autres instants, sans comporter d' avant
ni d'aprs l' intrieur de sa forme propre. L'instant est inscable et
i ntemporel, pui sque la temporalit est succession ; mais le monde
s'effondre en une poussire infinie d' instants et c'est un problme
pour Descartes, par exemple, que de savoir comment il peut y avoir
passage d'un instant un autre i nstant : car les instants sont
juxtaposs, c'est--dire spars par rien et pourtant sans communica
ti on. Pareillement Proust se demande comment son Moi peut passer
d' un i nstant l'autre, comment, par exemple, il retrouve, aprs une
nuit de sommei l , prcisment son Moi de la veille plutt que
n' importe quel autre ; et, plus radicalement, les empiristes, aprs
avoir ni la permanence du Moi , essaient vainement d'tablir un
sembl ant d' uni t transversale travers les instants de la vie psychi-
1 66
que. Ainsi, lorsqu'on considre isolment le pouvoir dissolvant de l a
temporalit, force est d'avouer que le fait d'avoir exist un instant
donn ne constitue pas un droit pour exister l ' i nstant suivant, pas
mme une hypothque ou une option sur l'avenir. Et le problme est
alors d'expliquer qu'il y ait un monde, c'est--dire des changements
lis et des permanences dans l e temps.
Pourtant la temporalit n'est pas uniquement ni mme d'abord
sparation. Il suffit pour s'en rendre compte d'envisager plus prcis
ment la notion d'avant et d'aprs. A, disons-nous, est aprs B. Nous
venons d'tablir une relation expresse d'ordre entre A et B, ce qui
suppose donc leur unification au sein de cet ordre mme. N' y et-il
entre A et B d'autre rapport que celui-l, du moins suffirait-il pour
assurer leur liaison, car i l permettrait la pense d'aller de l'un
l'autre et de les uni r dans un j ugement de succession. Si donc le temps
est sparation, du moins est-il une sparation d'un type spcial : une
division qui runi t. Soit, di ra-t-on, mais cette relation unificatrice est
par excellence une relation externe. Lorsque les associationnistes
voulurent tablir que les impressions de l'esprit n'taient retenues les
unes avec les autres que par des l i ens purement externes, n'est-ce pas
la relation d' avant-aprs, conue comme simple contigut ,
qu'ils rduisirent finalement toutes les liaisons associatives ?
Sans doute. Mais Kant n'a-t-il pas montr qu' i l fallait l'unit de
l'exprience et, par l , l ' unification du divers temporel , pour que l e
moindre li en d'association empirique ft mme concevable ? Consid
rons mieux l a thorie associationniste. Elle s'accompagne d'une
conception moniste de l'tre comme tant partout l'tre-en-soL
Chaque impression de l'esprit est en elle-mme ce qu'elle est, el l e
s'isole dans sa pl ni tude prsente, el l e ne comporte aucune trace de
l'avenir, aucun manque. Hume, lorsqu'il l ance son fameux dfi , s'est
proccup d'tablir cette l oi , qu' i l prtend tirer de l'exprience : on
peut inspecter comme on veut une impression forte ou faibl e, on ne
trouvera jamais rien en el l e-mme qu'elle-mme de sorte que toute
liaison d'un antcdent et d'un consquent, pour constante qu'elle
puisse tre, demeure inintelligi bl e. Supposons donc un contenu
temporel A existant comme un tre en soi et un contenu temporel B,
postrieur au premier et existant de [ a mme manire, c'est--dire
dans l'appartenance soi de l'identit. Il faut remarquer d'abord que
cette identit avec soi les oblige exister chacun sans sparation
aucune de soi , ft-elle temporel l e, donc dans l'ternit ou dans
l'instant, ce qui revi ent au mme puisque l'instant, n' tant point
dfini intrieurement par la liaison avant-aprs, est intemporel. On
demande, dans ces conditions, comment l'tat A peut tre antrieur
['tat B. Il ne servirait rien de rpondre que ce ne sont pas les tats
qui sont antrieurs ou postrieurs mais [es instants qui les contien
nent : car les instants sont en soi par hypothse, comme [es tats. Or
167
l'antriorit de A sur B suppose dans la nature mme de A (instant Ol
tat) une incompltude qui pointe vers B. Si A est antrieur B, c'est
en B que A peut recevoir cette dtermination. Si non ni le surgisse
ment ni l'anantissement de B isol dans son instant ne peut confrer
A isol dans l e sien la moindre qualit particulire. En un mot, si A
doi t tre antrieur B, il faut qu' i l soit dans son tre mme en B
comme futur soi . Et rciproquement B, s'il doit tre postrieur A,
doi t traner derrire soi-mme en A qui l ui confrera son sens de
postriorit. Si donc nous concdons a priori l'tre en soi A et B, i l
est i mpossible d' tabl i r entre eux la moi ndre liaison de succession.
Cette liaison en effet serait une relation purement externe et comme
tel l e, i l faudrait admettre qu'elle reste en l'air, prive de substrat, sans
pouvoir mordre ni sur A ni sur B, dans une sorte de nant intemporel.
Reste la possibilit que ce rapport avant-aprs ne puisse exister que
pour un tmoin qui l'tablit. Seulement, si ce tmoin peut tre la
fois en A et en B c'est qu' i l est lui-mme temporel et le problme va
se poser nouveau pour l ui . Ou bi en, au contraire , i l peut
transcender le temps par un don d'ubiquit temporelle qui quivaut
l ' i ntemporalit. C'est la solution laquelle Descartes et Kant se sont
pareillement arrts : pour eux, l ' unit temporelle au sein de laquelle
le rapport synthtique avant-aprs se dvoile est confre la
multiplicit des instants par un tre qui chappe lui-mme la
temporalit. Ils partent l'un comme l'autre de la prsupposition d'un
temps qui serait forme de division et qui se dissout lui-mme en pure
multiplicit. L'unit du temps ne pouvant tre fournie par l e temps
lui-mme, ils en chargent un tre extra temporel : Dieu et sa cration
continue chez Descartes, l e Je Pense et ses formes d'unit synthti
que chez Kant. Seulement, chez le premier, l e temps est uni fi par
son contenu matriel qui est maintenu l'existence par une perp
tuelle cration ex nihilo, chez l e second, au contraire, c'est la forme
mme du temps que s'appliqueront les concepts de l ' entendement
pur. De toute faon c'est un intemporel (Dieu ou Je Pense) qui est
charg de pourvoir des intemporels (les i nstants) de leur temporalit.
L temporalit devient une si mpl e relation externe et abstraite entre
des substances intemporelles : on veut la reconstruire tout entire
avec des matriaux a-temporels. Il est vident qu'une pareille
reconstruction faite d'abord contre le temps ne peut conduire ensuite
au temporel . Ou bien en effet nous temporaliserons implicitement et
sournoisement l ' i ntemporel , ou bi en, si nous lui gardons scrupuleuse
ment son i ntemporal i t, le temps deviendra une pure i llusion
humai ne, un songe. Si l e temps est rel, en effet, il faut que Dieu
attende que le sucre fonde ; il faut qu' i l soit l-bas dans l'avenir et
hi er dans l e pass pour oprer l a liaison des moments, car il est
ncessaire qu'i l aille les prendre l o i l s sont. Ainsi sa pseudo
intemporalit dissimule d'autres concepts, celui de l'infinit tempo-
168
relie et de l'ubiquit temporelle. Mai s ceux-ci ne peuvent avoir un
sens que pour une forme synthtique d'arrachement soi qui ne
correspond plus aucunement l'tre en soi. Si , au contraire, on
appui e, par exemple, l'omniscience de Di eu sur son extratemporalit,
alors i l n' a nul besoin d' attendre que l e sucre fonde pour voir qu' i l
fondra. Mais alors l a ncessit d'attendre et par consquent la
temporalit ne peuvent reprsenter qu' une i l lusion rsultant de la
finitude humai ne, l ' ordre chronologique n'est rien que l a perception
confuse d'un ordre logique et ternel. L'argument peut s'appliquer
sans aucune modification au Je pense kanti en. Et i l ne servirait
rien d'objecter que, chez Kant, le temps a une unit en tant que tel
puisqu' il surgit, comme forme a priori, de l' intemporel ; car il s'agit
moins de rendre compte de l'unit totale de son surgissement que des
liaisons i ntratemporelles de l'avant et de l'aprs. Parlera t-on d'une
temporalit virtuelle que l'unification a fait passer l'acte ? Mais cette
succession virtuelle est moins cor prhensible encore que la succes
sion relle dont nous parlions tout l'heure. Qu'est-ce qu'une
succession qui attend l'unification pour devenir succession ? A qui,
quoi appartient-elle ? Et pourtant, si elle n'est pas dj donne
quelque part , comment l' intemporel pourrait-il l a scrter sans y
perdre toute intemporalit, comment mme pourrait-elle maner de
lui sans le briser ? D' ailleurs l ' ide mme d'unification est ici
parfaitement incomprhensible. Nous avons suppos en effet deux
en-soi isols leur place, leur date. Comment peut-on les unifier ?
S'agit-il d' une unification relle ? En ce cas, ou bien nous nous payons
de mots -et l ' unification ne mordra pas sur deux en-soi isols dans
leur identit et leur compltude respectives - ou bien i l faudra
constituer une unit d' un type neuf, prcisment l'unit ek-statique :
chaque tat sera hors de soi, l-bas, pour tre avant ou aprs l'autre.
Seulement i l aura fal l u briser leur tre, le dcomprimer, en un mot le
temporaliser et non pas seulement les rapprocher. Or, comment
l'unit intemporelle du Je Pense, comme simple facult de penser,
sera-t-el l e susceptible d'oprer cette dcompression d'tre ? Dirons
nous que l ' uni fication est virtuelle, c'est--dire qu'on a projet par
del les impressions un type d' unit assez semblable au nome
husserlien ? Mais comment un intemporel ayant unir des intempo
rels concevra-t-il une unification du type de la succession ? Et si ,
comme il faudra en convenir alors, l'esse du temps est un percipi,
comment se constitue le percipitur ; en un mot, comment un tre de
structure a-temporelle pourrait-il apprhender comme temporels (ou
intentionnaliser comme tels) des en-soi isols dans leur intempora
lit ? Ainsi, en tant qu' el le est la fois forme de sparation et forme
de synthse, la temporalit ne se laisse ni driver d'un intemporel ni
imposer du dehors des i ntemporels.
Leibniz, en raction contre Descartes, Bergson, en raction contre
169
Kant, n' ont voulu voir leur tour dans la temporaliT qu' un pur
rapport d' i mmanence et de cohsi on. Lei bni z considre le problme
du passage d'un instant l'autre et sa solution, la cration continue,
comme un faux problme avec une solution i nuti l e : Descartes, selon
lui, aurait oubl i la continuit du temps. En affi rmant la conrinuiT du
tem ps, nous nous i nterdisons de concevoir celui-ci comme form
d' i nstants et , s' i l n' y a pl us d' i nstanTs, il n' y a pl us de rapport avant
aprs entre les inSTanTs. Le temps est une vaste continuiT d'coule
ment, l aquel l e on ne peut aucunement assigner d'lments premiers
qui exiSTerai ent en-soi .
Cest oublier que l'avant-aprs est aussi une forme qui spare. Si l e
temps est une conti nuit donne avec une i ndni abl e tendance la
sparation, on peut poser sous une autre forme la question de
Descartes : d'o vient la puissance cohsive de l a continuit ? Sans
doute i l n' y a pas d' l ments premiers juxtaposs dans un continu.
Mai s c'est prcismenr parce qu' il est d'abord unificati on. C'est parce
que je ti re la ligne droite, comme di t Kant, que la ligne droite,
ralise dans l'unit d'un seul acte, est autre chose qu'un pointill
i nfi ni . Qui donc lire l e temps ? Celte conti nui t, en un mOT, est un fait
dont il faut rendre compte. Elle ne saurait tre une soluti on. Qu'on se
rappelle d'ai l l eurs la fameuse dfinition de Poincar : une srie a, b,
e, di t-i l , est conti nue lorsqu'on peut crire : a = b, b = e, a - c. Cette
dfi ni tion est excel l enre en ce qu'elle nous fait pressenri r, justement,
un type d'tre qui est ce qu' i l n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est : en
vertu d' un axiome, a = c ; en vertu de la continuit elle-mme, a - c.
Ai nsi a est et n'est pas quivalent c. Et b, gal a et gal c, est
di ffrent de l ui -mme en tant que a n'est pas gal c. Mais cette
dfi niti on i ngni euse reste un pur jeu d'esprit tant que nous l ' envisa
geons dans la perspective de l'en-soi . Et si el l e nous fournit un type
d'tre qui , en mme temps, est et n'est pas, elle ne nous en fournit ni
les principes ni le fondement. Tout reste faire. Dans l'tude de la
temporal i t, en particulier, on conoit bien quel service peut nous
rendre l a conti nui t, en i ntercalant entre l ' i nstant a et l'instant c, si
rapprochs soient-il s, un intermdiaire b, tel que, selon la formul e a =
b, b = c, a - c, il soit la fois indiscernable de a et indiscernable de C
qui sont parfai tement discernables l ' un de l'autre. C'est l ui qui
ralisera l e rapport avant-aprs, c'est l ui qui sera avant lui-mme, en
tant qu' i l est i ndiscernable de a et de c. A l a bonne heure. Mais
comment un tel tre peut-il exister ? D'o lui vient sa nature ek
statique ? Comment cette scission qui s'bauche en lui ne s'achve
t-elle pas, comment n'explose-t-il pas en deux termes dont l' un se
fondrait a et l ' autre c ? Comment ne pas voir qu' i l y a un problme
de son uni t ? Peut-tre un examen plus approfondi des condiTions de
possibi lit de cet tre nous aurait-il appris que seul l e pour-soi
pouvait exister ai nsi dans l'unit ek-statique de soi . Mais prcisment
1 70
cet examen n' a pas t tent et la cohsi on temporelle chez Leibniz
dissimule au fond l a cohsion par i mmanence absolue du logique,
c'est--dire l ' i denti t. Mais, prcisment, si l 'ordre chronologique est
continu i l ne saurai t symboliser avec l 'ordre d'identit car l e continu
n'est pas compati bl e avec l ' i denti que.
Parei l l ement Bergson, avec sa dure qui est organisation mlodi
que et multipl icit d' i nterpntrati on, ne semble pas voir qu'une
organisation de multi plicit suppose un acte organisateur. II a raison
contre Descartes, lorsqu' i l supprime l'instam; mais Kant a raison
contre lui en affi rmant qu'il n'y a pas de synthse donne. Ce pass
bergsonien, qui adhre au prsent et le pntre mme, n'est gure
qu'une figure de rhtori que. Et c'est ce que montrent bien les
difficults que Bergson a rencontres dans sa thorie de la mmoire.
Car, si l e pass, comme i l l'affi rme, est l ' i nagissant , i l ne peut que
rester en arrire, il ne reviendra j amais pntrer le prsent sous forme
de souveni r, moins qu' un tre prsent n'ai t pris tche d'exister en
outre ek-statiquement au pass. Et, sans doute, chez Bergson, c'est
bien un mme tre qui dure. Mai s justement cela ne fait que mieux
sentir l e besoin d'claircissements ontologiques. Car nous ne savons
pas, pour fini r, si c'est l'tre qui dure ou si c'est l a dure qui est l'tre.
Et si la dure est l ' tre, alors i l faut nous dire quelle est la structure
ontologique de la dure ; et si c'est, au contraire, l'tre qui dure, i l
faut nous montrer ce qui , dans son tre, l ui permet de durer.
Que pouvons-nous conclure, au terme de cette discussion ? Tout
d'abord ceci : la temporalit est une force dissolvante mais au sein
d'un acte uni ficateur, c'est moins une mul tiplicit rel l e - qui ne
saurait recevoir ensuite aucune unit et, par sui te, qui n'existerait
mme pas comme multiplicit - qu'une quasi-multiplicit, qu'une
bauche de dissociation au sein de l ' uni t. Il ne faut pas essayer
d'envisager part l'un ou l'autre de ces deux aspects : poser d'abord
l'unit temporel l e, nous risquons de ne pl us rien comprendre l a
successi on irrversible comme sens de cette unit ; mai s considrer
la succession dsagrgeante comme le caractre originel du temps,
nous risquons de ne plus mme pouvoir comprendre qu'il y ait un
temps. Si , donc, il n'y a aucune priorit de l ' unit sur la multiplicit ni
de l a multiplicit sur l'unit, il faut concevoir la temporalit comme
une unit qui se mul ti pl i e, c'est--dire que l a temporalit ne peut tre
qu'un rapport d' tre au sein du mme tre. Nous ne pouvons
l'envisager comme un contenant dont l'tre serait donn car ce serait
renoncer pour toujours comprendre comment cet tre en-soi peut se
fragmenter en mul tiplicit ou comment l'en-soi des contenants
mi ni ma ou instants peut se runir dans l'unit d'un temps. La
temporalit n'est pas. Seul un tre d' une certaine structure d'tre peut
tre temporel dans l'unit de son tre. L'avant et l ' aprs ne sont
intelligibles, nous l'avons not, que comme relation interne. C'est l-
171
bas dans l ' aprs que ravant se fait dterminer comme avant et
rciproquement. En un mot, l'avant n'est i ntel ligible que si c'est l' tre
qui est avunt lui-mme. C'est--dire que la temporalit ne peut que
dsigner le mode d'tre d'un tre qui est soi-mme hors de soi. La
temporalit doit avoir la structure de l'ipsit. C'est seulement en
effet parce que le soi est soi l-bas hors de soi, dans son tre, qu'il
peut t re,avant ou aprs soi , qu'il peut y avoir en gnral de l 'avant et
de l'aprs, Il n'y a de temporalit que comme intrastructure d' un tre
qui a tre son tre, c'est--dire comme intrastructure du pour-soi.
Non que le pour-soi ait une priorit ontologique sur la temporalit.
Mais la temporal it est l'tre du pour-soi en tant qu'il a l'tre ek
statiquement. La temporalit n'est pas, mais l e pour-soi se tempora
l i se en existant.
Rciproquement, notre tude phnomnologique du Pass, du
Prsent et de l ' Avenir nous permet de montrer que le pour-soi ne
peut tre, sinon sous la forme temporelle.
Le pour-soi surgissant dans l'tre comme nantisation de l' en-soi se
constitue la fois sous toutes les dimensions possibles de nantisa
ti on. De quelque ct qu'on le considre, i l est l'tre qui ne tient soi
mme que par un fil ou plus prcisment c'est l 'tre qui , tant, fait
exister toutes l es di mensions possibles de sa nantisation. On
dsignait dans le monde antique la cohsion profonde et la dispersion
du peuple jui f du nom de diaspora . C'est ce mot qui nous servira
pour dsigner le mode d'tre du pour-soi : il est di aspori que. L'tre
en-soi n'a qu'une di mension d'tre, mais l'apparition du nant comme
ce qui est t au cur de l'tre complique l a structure existentielle en
faisant apparatre le mi rage ontologique du Soi . Nous verrons plus
tard que la rfl exion, la t ranscendance et l ' tre-dans-Ie-monde, l ' tre
pour-autrui, reprsentent plusieurs dimensions de la nantisation ou,
si l'on prfre, plusieurs rapports originels de l'tre avec soi. Ainsi le
nant i ntroduit l a quasi-multiplicit au sein de l'tre. Cette quasi
multiplicit est le fondement de toutes les multiplicits intramon
dai nes car une multiplicit suppose une unit premire au sein de
laquel l e s'bauche l a multiplicit. En ce sens, il n'est pas vrai, comme
le prtend Meyerson, qu'il y ait un scandale du divers et que la
responsabilit de ce scandale incombe au rel . L'en-soi n'est pas
di vers, il n'est pas multiplicit et pour qu' il reoive la multiplicit
comme caractristique de son tre-au-milieu-du-monde, il faut le
surgissement d' un tre qui soit prsent l a fois chaque en-soi isol
dans son identit . C'est par la ralit humaine que la multiplicit
vi ent au monde, c'est la quasi-multiplicit au sein de l ' tre-pour-soi
qui fait que le nombre se dvoile dans le monde. Mais quel est le sens
de ces di mensions multiples ou quasi multiples du pour-soi ? Ce sont
ses di ffrents rapports son tre. Lorsqu'on est ce qu'on est, tout
si mpl ement, i l n' y a qu'une manire d'tre son tre. Mais ds le
172
moment o l'on n'est plus son tre, di ffrentes manires de l'tre tout
en ne l'tant pas surgissent si mul tanment. Le pour-soi, pour nous en
tenir aux premires ek-stases -celles qui , l a fois, marquent l e sens
originel de l a nantisation et reprsentent la moindre nantisation ,
peut et doit l a fois ; ] " n e pas tre c e qu'il est ; 2" tre ce qu'il n'est
pas ; 3" dans l'unit d'un perptuel renvoi, tre ce qu'il n'est pas et ne
pas tre ce qu'i l est . I l s'agit bi en de troi s di mensi ons ek-statiques, l e
sens de l ' ek-stase tant la di stance soi . Il est impossible de concevoir
une conscience qui n' existerait pas selon ces trois dimensions. Et si le
cogilO dcouvre d'abord l'une d' elles, cela ne veut point dire qu' elle
soit premire mais seulement qu'el l e se dvoile plus faci lement. Mais
par el l e seule elle est unsel bststandi g ^ et el l e laisse voir aussitt les
autres dimensions. Le pour-soi est un tre qui doit exister la fois
dans toutes ses dimensions. Ici la distance, conue comme distance
soi , n' est rien de rel , rien qui sail d' une manire gnrale comme en
soi ; c'est simpl ement le rien, le nant qui esl t ) comme
sparati on. Chaque dimension est une faon de se projeter vainement
vers l e Soi, d'tre ce qu'on est par del un nant, une manire
diffrente d'tre ce flchissement d'tre, cette frustration d'tre que
le pour-soi a tre. Considrons chacune d'elles isolment.
Dans la premire l e pour-soi a tre son tre derrire soi, comme
ce qu'il est sans en tre l e fondement. Son tre est l, contre lui, mais
un nant l'en spare, le nant de l a facticit. Le pour-soi comme
fondement de son nant -et comme tel ncessaire -est spar de sa
contingence origi nel l e en ce qu'il ne peut ni l 'ter ni s' y fondre. Il est
pour lui-mme mais sur l e mode de l ' i rrmdiable et du gratuit. Son
tre est pour lui mais i l n'est pas pour cet tre, car prcisment cette
rciprocit du reflet-refltant ferait disparatre la contingence origi
nelle de ce qui est. Prcisment parce que l e pour-soi se saisit sous la
forme de l'tre, i l est distance comme un jeu de reflet-refltant qui
s'est coul dans l ' en-soi et dans lequel ce n'est plus l e reflet qui fait
exister l e refltant ni l e refl tant qui fait exister l e refl et. Cet tre que
le pour-soi a tre, de ce fait i l se donne comme quelque chose sur
quoi i l n' y a plus revenir, prcisment parce que l e pour-soi ne peut
pas le fonder sur le mode reflet-refl tant mais en tant qu'il fonde
seulement l a liaison de cet tre lui -mme. Le pour-soi ne fonde
point l'tre de cet tre mais seulement le fait que cet tre puisse tre
donn. Il s'agit l d' une ncessit inconditionnelle ; quel que soit l e
pour-soi considr, i l est en un certain sens, i l est puisqu'il peut ,tre
nomm, puisqu'on peut affirmer ou nier de lui certains caractres.
Mais en tant qu'il est pour-soi, il n'est jamais ce qu' i l est. Ce qu' i l est
est derrire l ui , comme l e perptuel dpass. C'est prcisment cette
facticit dpasse que nous nommons le pass. Le pass est donc une
structure ncessaire du pour-soi , car le pour-soi ne peut exister que
comme un dpassement nantisant et ce dpassement i mpl i que un
173
dpass . Il e st donc i mpossible, quelque moment que nous
considrions un pour-soi , de l e saisir comme n'ayant-pas-encore de
pass. Il ne faudrait pas croire que le pour-soi existe d'abord et surgit
au monde dans l ' absolue nouveaut d' un tre sans pass, pour se
consti tuer ensuite et peu peu un pass. Mai s quelle que soit la
surrecti on dans le monde du pour-soi , il vient au monde dans l'unit
ek-stati que d'un rapport avec son pass : i l n'y a pas un commence
ment absol u qui deviendrait pass sans avoir de pass, mais, comme
le pour-soi , en tant que pour-soi, a tre son pass, il vient au monde
avec un pass. Ces quel ques remarques permettent d' envisager sous
un jour un peu nouveau l e problme de la naissance. Il parat en effet
scandaleux que la conscience apparaisse quelque moment,
qu'elle vi enne habiter l ' embryon, bref, qu' i l y ait un moment o l e
vivant en formati on soit sans conscience et un moment o une
conscience sans pass s'y emprisonne. Mai s le scandale cessera s'il
apparat qu'il ne saurait y avoir de conscience sans pass. Cela ne veut
pas di re, toutefoi s, que toute conscience suppose une conscience
antrieure fige dans l ' en-soi . Ce rapport du pour-soi prsent au
pour-soi devenu en-soi nous masque le rapport primitif de passit qui
est un rapport du pour-soi l'en-soi pur. C'est en effet en tant que
nantisation de l'en-soi que le pour-soi surgit dans l e monde et c'est
par cet vnement absolu que se constitue l e pass en tant que tel
comme rapport originel et nantisant du pour-soi J'en-soi . Ce qui
constitue originel l ement l ' tre du pour-soi , c'est ce rapport un tre
qui n'est pas conscience, qui existe dans la nuit totale de l ' i dentit et
que
l e
pour-soi est cependant obl i g d'tre, hors de l ui , derrire l ui.
Avec cet tre, auquel en aucun cas on ne peut ramener l e pour-soi,
par rapport auquel l e pour-soi reprsente une nouveaut absolue, le
pour-soi se sent une profonde soli darit d'tre, qui se marque par le
mot d'avant : l'en-soi c'est ce que le pour-SOi tait avant. En ce sens,
on conoit fort bien que notre pass ne nous apparaisse point comme
l i mit par un trait net et sans bavures - ce qui se produirait si la
conscience pouvait jaillir dans le monde avant d'avoir un pass -
mais qu' il se perde, au contraire, dans un obscurcissement progressif,
jusqu'en des tnbres qui pourtant sont encore nous-mmes ; on
conoit le sens ontol ogique de cette solidarit choquante avec le
ftus, solidarit que nous ne pouvons ni nier ni comprendre. Car
enfin ce ftus c'tait moi , il reprsente la limite de fait de ma mmoire
mais non la l i mi te de droit de mon pass. Il y a un problme
mtaphysique de l a naissance, dans la mesure o je peux m' inquiter
de savoir comment c'est d' un tel embryon que je suis n ; et ce
problme est peut-tre i nsoluble. Mais i l n'y a pas de problme
ontologiq ue : nous n'avons pas nous demander pourquoi il peut y
avoi r une naissance des consciences, car la conscience ne peut
s'apparatre soi-mme que comme nantisation d'en-soi, c'est--dire
174
comme tant dj ne. La naissance, comme rapport d'tre ek
statique l'en-soi qu' el l e n'est pas et comme constitution a priori de l a
passit , est une l oi d' tre du pour-soi. Etre pour-soi c'est tre n.
Mais i l n'y a pas lieu de poser ensuite des questi ons mtaphysiques sur
l'en-soi d'o est n le pour-soi , telles que : Comment y avait-il un
en-soi avanl la naissance du pour-soi , comment l e pour-soi est-il n de
cel en-soi plutt que de tel autre, etc. Toutes ces questions ne
tiennent pas compte de ce que c'est par le pour-soi que l e pass en
gnral peut exi ster. S' i l y a un avant, c'est que le pour-soi a surgi
dans l e monde et c'est partir du pour-soi qu'on peut l'tablir. Dans
la mesure o l'en-soi est fait coprsent au pour-soi, un monde
apparat en place des isolements d'en-soi. Et dans ce monde i l est
possible d' oprer une dsignation et de dire : cel objet-ci , cet objet-l.
En ce sens , en tant que l e pour-soi , dans son surgissement l'tre, fait
qu'il existe un monde de coprsences, il fait apparatre aussi son
avant comme coprsent des en-soi dans un monde ou, si l'on
prfre, dans un tat du monde qui a pass. En sorte que, en un sens,
le pour-soi apparat comme tant n du monde car l'en-soi dont i l est
n est au mi li eu du monde, comme coprsent pass parmi des
coprsents passs : i l y a surgissement, dans l e monde et partir du
monde, d' un pour-soi qui n'tait pas avant et qui est n. Mais, en un
autre sens, c' est le pour-soi qui fait qu'il existe un avant, d'une
manire gnrale, et, dans cet avant, des coprsents uni s dans l'unit
d'un monde pass et tel s qu'on pui sse dsigner l ' un ou l'autre d'entre
eux en disant : cel obj et. Il n'y a pas d
'
abord un temps universel o
apparatrait soudain un pour-soi n'ayant pas encore de pass. Mais
c'est partir de la naissance, comme loi d'tre originelle et a priori du
pour-soi , que se dvoile un monde avec un temps universel dans
lequel on peut dsigner un moment o l e pour-soi n'tait pas encore
et un moment o i l apparat, des tres donl il n'est pas n et un tre
dont il est n. La naissance est l e surgissement du rapport absolu de
passit comme tre ekstatique du pour-soi dans l'en-soi. Par el l e
apparat un Pass du Monde. Nous y reviendrons. Qu' i l nous suffise
de noter ici que la conscience ou pour-soi est un tre qui surgit l'tre
par del un irrparable qu'il est, et que cet irrparable, en tant qu'il
est derrire l e pour-soi , au mi l i eu du monde, c'est l e pass. Le pass
comme tre irrparable que j'ai tre sans aucune possibilit de ne
l'tre pas, n'entre pas dans l' unit reflet-refltant de l'Erleb
nis : i l est dehors. Pourtant il n'est pas non plus comme ce dont il y
a conscience, au sens o, par exemple, la chaise perue est ce dont i l
y a conscience perceptive. Dans l e cas de la perception de la chaise,
il y a thse, c'est--dire saisie et affirmation de la chaise comme l'en
soi que la conscience n'est pas. Ce que la consci ence a tre sur le
mode d'tre du pour-soi , c'est le ne-pas-tre-chaise. Car son ne-pas
tre-chaise est, nous l e verrons, sous forme de conscience ( de) ne-pas-
175
tre, c'est--dire apparence de ne-pas-tre, pour un tmoin qui n'est
l
que p
our tmoigner de ce non-tre. La ngation est donc explicite
et const i tue le lien d'tre entre l'objet peru et le pour-soi. Le pour
soi n'est rien de pl us que ce rien translucide qui est ngation de la
chose p
erue. Mais bien que le pass soit dehors, la liaison n'est pas
ici de mme type car le pour-soi se donne comme tant le pass. De ce
fai t il ne peut y avait thse du pass, car on ne pose que ce qu'on n'est
pas. Ai nsi , dans
la perception de l' objet, le pour-soi s'assume pour soi
c
omme n' tant pas l 'objet, au lieu que, dans le dvoilement du pass,
le pour-soi s'assume comme tant le pass et n'en est spar que par sa
nature de pour-soi , qui ne peut rien tre. Ainsi n'y a-t-il pas thse du
pass et pourtant le pass n'est pas immanent au pour-soi. Il hante le
pour-soi dans le moment mme o le pour-soi s'assume comme
n'tant
pas tel le ou telle chose particulire. Il n'est pas l'objet du
regard du pour-soi. Ce regard translucide lui-mme se di rige, par
del la
chose, vers l'avenir. Le pass en tant que chose qu' on est sans
la poser , en tant que ce qui hante sans tre remarqu, est derrire le
pour-soi , en dehors de son champ thmatique, qui est devant lui
comme ce qu'il claire. Le pass est pos contre le pour-soi,
assum comme ce qu' i l a tre, sans pouvoir tre ni affirm, ni ni , ni
thmatis , ni absorb par l ui . Ce n'est pas, certes, que l e pass ne
puisse
tre objet de thse pour moi , ni mme qu'il ne soit souvent
thmatis . Mais c'est alors qu' i l est l'objet d' une recherche explicite
et, dans ce cas, l e pour-soi s'affirme comme n'tant pas ce pass qu'il
pose. Le pass n'est plus derrire ; i l ne cesse point d'tre pass, mais
moi je
cesse de l'tre : sur l e mode primaire j 'tais mon pass sans le
connatre (mai s non point sans en avoir conscience), sur le mode
secondai re, je connais mon pass mais je ne l 'tais plus. Comment se
peut-il , dira-t-on, que j' ai e conscience de mon pass si ce n'est sur le
mode thtique ? Pourtant le pass est l, constamment, c'est l e sens
mme de l'objet que je regarde et que j 'ai dj vu, des visages
familiers qui m' entourent , c'est le dbut de ce mouvement qui se
poursuit prsentement et dont je ne saurais dire qu'il est circulaire si
je n'tais moi-mme au pass le tmoin de son commencement, c'est
l'origine et le trempli n de toutes mes actions, c'est cette paisseur du
monde, constamment donne et qui permet que je m'oriente et me
repre, c'est moi-mme en tant que je me vis comme une personne (il
y a a
ussi une structure veni r de l'Ego), bref, c'est mon lien
contingent et gratuit au monde et moi-mme en tant que je le vis
conti
nuellement comme dlaissement total . Les psychologues le
nomment savoir. Mai s out re que, par ce terme mme, i l s le
psychologisent i l s s'tent l e moyen d'en rendre compte. Car le
savoir
est partout et conditionne tout, mme la mmoire : en un mot
la mmoire i ntellectuelle suppose l e savoir, et qu'est-ce que leur
savoir, s'il faut entendre par l un fait prsent, si ce n'est une mmoire
1 76
intellectuel l e ? Ce savoir souple, i nsinuant, changeRnt qui fait la
trame de toutes nos penses et qui se compose de mi l l e indications
vides, de mille dsignations qui pointent derrire nous, sans image,
sans mots, sans thse , c'est mon pass concret en tant que je l'tais,
en tant qu'irrparable profondeur-en-arrire de toutes mes penses et
de tous mes sentiments.
Dans sa seconde dimension de nantisati on, l e pour-soi se saisit
comme un certain manque. I l est ce manque et i l est aussi l e manquant
car il a tre ce qu'il est. Boire ou tre buvant, cela veut dire n'avoir
jamais fini de boire, avoir encore tre buvant par del le buvant que
je suis. Et quand j 'ai fini de boire , j'ai bu : l'ensemble glisse au
pass. Buvant actuel lement je suis donc ce buvant que j 'ai tre et
que j e ne suis pas ; toute dsignation de moi-mme m'chappe dans l e
pass si el l e doi t tre lourde et pl ei ne, si el l e doit avoir l a densit de
l'identi que, Si elle m'atteint dans l e prsent, c'est qu'elle s'cartle
elle-mme dans l e Pas-encore, c'est qu'elle me dsigne comme
total it inacheve et qui ne peut pas s'achever. Ce Pas-encore est
rong par la libert nantisante du pour-soi. Il n'est pas seulement
tre--distance : il est amenuisement d'tre. Ici l e pour-soi, qui tait
en avant de soi dans l a premire dimension de nantisation, est en
arrire de soi . En avant, en arrire de soi : jamai s soi. C'est l e sens
mme des deux ek-stases Pass, Futur et c'est pour cela que la valeur
en soi est par nature l e repos en soi, l ' intemporalit ! L'ternit que
l'homme recherche , ce n'est pas l'i nfinit de la dure, de cette vaine
course aprs soi dont je suis moi-mme responsable : c'est l e repos en
soi, l'atemporalit de l a concidence absolue avec soi.
Enfi n, dans l a troisime dimension, l e pour-soi dispers dans l e jeu
perptuel du reft-refltant s'chappe lui-mme dans l'unit d'une
mme fuite. Ici l'tre est partout et nulle part : o qu'on cherche le
saisir, il est en face, il s'est chapp. C'est ce chass-crois au sein du
pour-soi qui est la Prsence l'tre,
Prsent, pass, futur la fois, dispersant son tre dans trois
dimensions, le pour-soi , du seul fait qu'il se nantise, est temporeL
Aucune de ces dimensions n'a de priorit ontologique sur les autres,
aucune d' el l es ne peut exister sans les deux autres. Toutefois il
convient malgr tout de mettre l'accent sur l ' ek-stase prsente - et
non comme Heidegger sur l'ek-stase future -parce que c'est en tant
que rvlation lui-mme que le pour-soi est son pass, comme ce
qu'il a -tre-pour-soi dans un dpassement nantisant, et c'est
comme rvlation soi qu'il est manque et qu'il est hant par son
futur, c'est--dire par ce qu'il est pour soi l-bas, distance. Le
prsent n' est pas ontologiquement antrieur au pass et au futur,
il est conditionn par eux tout autant qu'il les conditionne, mais il est
le creux de non-tre indispensable la forme synthtique totale de la
temporalit.
177
Ainsi la temporalit n'est pas un temps universel contenant tous les
tres et en parti cul i er les ralits-humaines. Elle n'est pas non plus
une loi de dvel oppement qui s' i mposerait du dehors l ' tre. Elle
n'est pas non pl us l 'tre mais elle est l'intrastructure de l'tre qui est
sa propre nantisation, c'est--dire le mode d'tre propre l'tre
pour-soi. Le pour-soi est l'tre qui a tre son tre sous l a forme
diasporique de l a temporal i t.
B) Dynamique de la temporalit,
Que le surgissement du pour-soi se fasse ncessairement suivant les
trois dimensions de l a temporal i t, cela ne nous apprend rien sur le
problme de la dure qui ressortit l a dynamique du temps. Au
premi er abord, l e problme semble double : pourquoi le pour-soi
subit-il cette modification de son tre qui le fait devenir pass ? Et
pourquoi un nouveau pour-soi surgit-il ex nihilo pour devenir le
prsent de ce pass-l ?
Ce problme a t longtemps masqu par une conception de l'tre
humai n comme en-soi. C'est le nerf de la rfutation kantienne de
l ' i dalisme berkeleyen, c'est un argument favori de Leibniz, que le
changement i mplique de soi la permanence, Si nous supposons ds
lors une certaine permanence intemporelle qui demeure travers le
temps, la temporalit se rduit n' tre plus que la mesure et l'ordre
du changement. Sans changement point de temporalit, puisque le
temps ne saurait avoi r de prise sur le permanent et l' identi que, Si , par
ailleurs, comme chez Leibniz, le changement lui-mme est donn
comme l'explication logique d'un rapport de consquences pr
misses, c'est--dire comme le dveloppement des attributs d'un sujet
permanent, alors i l n'y a pl us de temporalit relle.
Mais cette conception repose sur bien des erreurs. Tout d'abord la
subsistance d' un lment permanent ct de ce qui change ne peut
permettre au changement de se constituer comme tel , sauf aux yeux
d'un tmoi n qui serait l ui-mme unit de ce qui change et de ce qui
demeure, En un mot, l' unit du changement et du permanent est
ncessaire la constitution du changement comme tel. Mais ce terme
mme d' unit , dont Leibniz et Kant ont abus , ne signifie pas grand
chose i ci . Que veut-on dire avec cette unit d'lments disparates ?
N' est-elle qu' un rattachement purement extrieur ? Alors el l e n' a pas
de sens, Il faut qu'el l e soit unit d'tre. Mais cette unit d'tre revient
exi ger que le permanent soit ce qui change ; et, par l, ell e est ek
stati que par essence ; en outre el l e est destructrice du caractre d'en
soi de l a permanence et du changement. Qu'on ne dise point que
permanence et changement sont pris ici comme des phnomnes et
n'ont qu' un tre relatif : l'en-soi ne s'oppose pas aux phnomnes,
178
comme le noumne. Un phnomne est en soi, aux termes mmes de
notre dfinition, lorsqu'il est ce qu' i l est, ft-ce en relation avec un
sujet ou un autre phnomne. Et d'ai l l eurs l'apparition de l a relation,
comme dterminant les phnomnes les uns par rapport aux autres,
suppose, antrieurement, l e surgissement d'un tre ek-statique qui
peut tre ce qu' il n'est pas pour fonder l'ailleurs et le rapport.
Le recours l a permanence pour fonder l e changement est
d'ailleurs parfaitement i nutile. Ce qu' on veut montrer c'est qU" 1r
changement absolu n'est plus proprement parler un changement,
puisqu' il ne reste plus rien qui change -ou par rapport quoi i l y ait
changement. Mais en fait i l suffit que ce qui change soit sur le mode
pass son ancien tat pour que la permanence devi enne superflue ; en
ce cas, l e changement peut tre absol u, il peut s'agir d' une mtamor
phose qui atteigne l'tre tout entier : i l ne s'en constituera pas moins
comme changement par rapport un tat antrieur qu' il sera au pass
sur le mode du tait . Ce lien au pass remplaant l a pseudo
ncessit de l a permanence, l e problme de la dure peut et doit se
poser propos de changements absolus. I l n'y en a pas d'autres
d'ailleurs, mme dans l e monde . Jusqu' un certain seuil, ils sont
inexistants ; pass ce seui l , ils s'tendent l a forme totale, comme
l'ont montr les expriences des Gestal tistes.
Mais en outre, lorsqu'il s'agit de la ralit-humaine, ce qui est
ncessaire c'est l e changement pur et absolu qui peut fort bien
d'ailleurs tre changement sans rien qui change et qui est la dure
mme. Mme si nous admettions, par exemple, la prsence absolu
ment vide d' un pour-soi un en-soi permanent, comme simple
conscience de ce pour-soi, l'existence mme de l a conscience impli
querait l a temporalit puisqu' elle aurait tre, sans changement, ce
qu'elle est, sous forme de l'avoir t . Il n'y aurait donc pas
ternit mais ncessit constante pour l e pour-soi prsent de devenir
pass d'un nouveau
.
prsent et cela en vertu de l'tre mme de la
conscience. Et si l'on nous disait que cette reprise perptuelle du
prsent au pass par un nouveau prsent implique un changement
interne du pour-soi, nous rpondrions qu'alors c'est l a temporalit du
pour-soi qui est fondement du changement et non l e changement qui
fonde l a temporalit. Rien ne peut donc nous masquer ces problmes
qui semblent d'abord insolubles : pourquoi le prsent devient-il
pass ? quel est ce nouveau prsent qui jaillit alors ? d' o vient-il et
pourquoi survient-i l ? Et notons bien, comme l e montre notre
hypothse d' une conscience vide , que ce qui fait question ici, ce
n'est pas l a ncessit, pour une permanence, de cascader d'instant en
instant tout en demeurant matri el l ement une permanence : c' est la
ncessit pour l'tre, quel qu' il soit , de se mtamorphoser tout entier
la fois, forme et contenu, de s'abmer dans l e pass et de se
produire, l a fois, ex nihilo, vers l e futur.
179
Mais y a-t-il deux problmes ? Exa
m
inons mieux : le prsent ne
saurait passer si ce n'est en devenant l'avant d'un pour-soi qui s'en
constitue comme l'aprs. Il n'y a donc qu'un seul phnomne :
surgissement d'un nouveau prsent passifiant le prsent qu'il tait et
passification d'un prsent entranant l'apparition d'un pour-soi pour
l eq
uel ce prsent va devenir pass. Le phnomne du devenir
temporel est une modification globale, puisqu'un pass de rien ne
serait pl us un pass, puisqu'un prsent doit tre ncessairement
prsent de ce pass. Cette mtamorphose, d'ailleurs, n'atteint pas
seul ement le prsent pur : l e pass antrieur et le futur sont
gal ement touchs. Le pass du prsent qui a subi la modification de
pa
ssit devient pass d' un pass ou plus-que-parfait. En ce qui le
concerne, l ' htrognit du prsent et du pass est supprime du
coup, puisque ce qui se distinguait du pass comme prsent est
devenu pass. Au cours de la mtamorphose, l e prsent reste prsent
de
ce pass mais il devient prsent pass de ce pass. Cela signifie
d' abord qu' i l est homogne la srie du pass qui remonte de lui
jusqu' la naissance, ensuite qu' il n'est plus son pass sous forme
d'avoir l ' tre mais sur le mode d 'avoir eu l'tre. La liaison entre
pass et plus-que-parfait est une l i aison qui est sur le mode de l'en
soi ; et el l e parat sur l e fondement du pour-soi prsent . C'est lui qui
soutient la' srie du pass et des plus-que-parfaits souds en un seul
bl oc.
Le futur, d'autre part, bien qu'atteint pareillement par la mtamor
phose, ne cesse pas d'tre futur, c'est--dire de demeurer hors du
pour-soi, en avant, par del J'tre, mais il devient fatur d'un pass ou
futur antrieur. Il peut entretenir deux sortes de relations avec le
prsent nouveau, selon qu'i l s'agit du futur immdiat ou du futur
loi
ntai n. Dans l e premier cas, le prsent se donne comme tant ce
fut
ur par rapport au pass : Ce que j'attendais, l e voici. Il est le
prsent de son pass sur l e mode du futur antrieur de ce pass. Mais
en mme temps qu' i l est pour-soi comme le futur de ce pass, i l se
ralise comme pour-soi, donc comme n'tant pas ce que le futur
pr
omettait d' tre. Il y a ddoublement : le prsent devient futur
antrieur du pass tout en niant qu' i l soit ce futur. Et le futur primitif
n'est point ralis : il n'est plus futur par rapport au prsent, sans
cesser d' tre futur par rapport au pass. Il devient le coprsent
i rralisable du prsent et conserve une idalit totale. C'est donc l
ce que j 'attendais ? Il demeure futur idalement coprsent au
prsent, comme futur irralis du pass de ce prsent.
Dans le cas o le futur est loign, i l demeure futur par rapport au
nouveau prsent, mai s, si le prsent ne se constitue pas lui-mme
comme manque de ce futur, i l perd son caractre de possibilit. En ce
cas, le futur antri eur devient possible indiffrent par rapport au
nouveau prsent et non pas son possible. En ce sens il ne se possibilise
1 80
plus mais il reoit l'tre-en-soi en tant que possi bl e. Il devient possible
donn, c'est--dire possible en soi d'un pour-soi devenu en-soi. Hi er,
i l a t possi bl e -comme mon possible -que je parte l undi prochain
l a campagne. Aujourd'hui ce possible n'est pl us mon possible, i l
demeure l ' objet thmatis de ma contemplation titre du possible
toujours futur que j'ai t. Mais son seul lien avec mon prsent, c'est
que j 'ai tre sur le mode du tais ce prsent devenu pass dont il
n'a cess d' tre, par del mon prsent , le possi bl e. Mais futur et
prsent pass se sont solidifis en en-soi sur le fondement de mon
prsent. Ainsi le futur, au cours du processus temporel, passe l'en
soi sans perdre jamais son caractre de futur. Tant qu'il n'est pas
atteint par le prsent, i l devient simpl ement futur donn. Lorsqu'il est
atteint i l est affect du caractre d'idalit ; mais cette idalit est
idalit en soi car elle se prsente comme manque donn d'un pass
donn et non comme l e manquant qu' un pour-soi prsent a tre sur
le mode du n'tre pas. Lorsque l e futur est dpass, i l demeure
jamais, en marge de la srie des passs, comme futur antrieur : futur
ant
rieur de tel pass devenu plus-que-parfait, futur idal donn
comme coprsent un prsent devenu pass.
Reste examiner la mtamorphose du pour-soi prsent en pass
avec surgissement connexe d'un nouveau prsent. L'erreur serait de
croire qu'il y a abolition du prsent antrieur avec surgissement d'un
prsent en-soi qui retiendrait une image du prsent disparu. En un
sens, i l conviendrait presque d'inverser les termes pour trouver l a
vrit, puisque la passification de l'ex-prsent est passage l'en-soi,
tandis que l'apparition d'un nouveau prsent est nantisation de cet
en-soi. Le prsent n'est pas un nouvel en-soi, i l est ce qui n'est pas, ce
qui est par del l'tre ; i l est ce dont on ne peut dire i l est qu'au
pass ; le pass n'est point abol i , il est ce qui est devenu ce qu'il tait,
il est l'tre du prsent. Enfin, nous l 'avons assez marqu, l e rapport
du prsent au pass est un rapport d' tre, non de reprsentation.
En sorte que l e premier caractre qui nous frappe, c'est le
ressaisissement du pour-soi par l'tre, comme s'il n'avait plus l a force
de soutenir son propre nant. La fissure profonde que l e pour-soi a
tre se comble , le nant qui doit tre t cesse de l'tre, il est
expuls, dans la mesure o l ' tre-pour-soi passifi devient une
qualit de l 'en-soi. Si j'ai prouv telle tristesse, au pass, ce n'est plus
en tant que je me suis fait l'prouver, cette tristesse n' a plus l'exacte
mesure d'tre que peut avoir une apparence qui se fai t son propre
tmoi n ; el l e est parce qu' el l e a t, l'tre lui vient quasiment comme
une ncessit externe. Le pass est une fatalit rebours : le pour-soi
peut se faire ce qu'il veut, i l ne peut pas chapper l a ncessit d' tre
irrmdiablement pour un nouveau pour-soi ce qu' il a voulu tre. De
ce fait l e pass est un pour-soi qui a cess d'tre prsence transcen
dante l'en-soi. En soi l ui-mme, il est tomb au milieu du monde. Ce
181
que j 'ai tre, je le suis comme prsence au monde que je ne suis pas,
mais ce que j 'tais, je l 'tais au milieu du monde, la manire des
choses, titre d'existant intramondain. Toutefois, ce monde dans
l equel l e pour-soi a tre ce qu' i l tait ne peut tre celui mme auquel
il est actuellement prsent. Ainsi se constitue l e pass du pour-soi
comme prsence passe un tat pass du monde. Mme si le monde
n' a subi aucune variation pendant que l e pour-soi passait du
prsent au pass, du moins est-il saisi comme ayant subi le mme
changement formel que nous dcrivions tout l'heure au sein de
l ' tre-pour-soi. Changement qui n'est plus qu'un reflet du vritable
changement interne de l a conscience. Autrement dit, le pour-soi
tombant au pass comme ex-prsence l'tre devenue en-soi devient
un tre au-milieu-du-monde et l e monde est retenu dans la
di mension passe comme ce au milieu de quoi le pour-soi pass est en
soi . Comme la Sirne dont l e corps humain s'achve en queue de
poisson , le pour-soi extra-mondain s'achve derrire soi en chose
dans le monde. Je suis colreux, mlancolique, j'ai l e complexe
d'dipe ou le complexe d'infriorit, pour toujours, mais au pass,
sous la forme du tais , au milieu du monde, comme je suis
fonctionnaire ou manchot, ou proltaire. Au pass, le monde
m' enserre et j e me perds dans l e dterminisme universel, mais je
transcende radicalement mon pass vers l'avenir, dans l a mesure
mme o je l'tais .
Un pour-soi ayant exprim tout son nant , ressaisi par l ' en-soi et se
di l uant dans le monde, tel est le pass que j 'ai tre, tel est l ' avatar
du pour-soi . Mais cet avatar se produit en unit avec l'apparition d'un
pour-soi qui se nantise comme prsence au monde et qui a tre le
pass qu' i l transcende. Quel est l e sens de ce surgissement ? Il faut se
garder d' y voir l'apparition d'un tre neuf. Tout se passe comme si le
prsent tait un perptuel trou d' tre, aussitt combl et perptuelle
ment renaissant : comme si le prsent tait une fuite perptuelle
devant l'engluement en en-soi qui le menace jusqu' la victoire
finale de l'en-soi qui l'entranera dans un pass qui n'est plus pass
d' aucun pour-soi . C'est la mort qui est cette victoire, car la mort est
l ' arrt radical de la temporalit par passification de tout le systme
ou, si l'on prfre, ressaisissement de l a totalit humaine par l'en-soi.
Comment pouvons-nous expliquer ce caractre dynamique de la
temporalit ? Si celle-ci n'est point -et nous esprons l'avoir montr
- une qualit contingente qui s'ajoute l ' tre du pour-soi , il faut
pouvoir montrer que sa dynami que est une structure essentielle du
pour-soi conu comme l'tre qui a tre son propre nant. Nous nous
retrouvons, sembl e-t-i l , notre point de dpart .
Mais la vrit c'est qu' il n'y a pas de problme. Si nous avons cru en
rencontrer un, c'est que, malgr nos efforts pour penser le pour-soi
comme tel , nous n'avons pu nous empcher de le figer en en-soi. C'est
1 82
si nous partons de l ' en-soi , en effet , que l'apparition du changement
peut constituer un problme : si l ' en-soi est ce qu'il est, comment
peut-il ne plus l'tre ? Mais si l'on part au contraire d'une comprhen
sion adquate du pour-soi, ce n'est plus l e changement qu'il convient
d'expliquer : ce serait plutt l a permanence, si elle pouvait exister. Si
nous considrons, en effet, notre description de l ' ordre du temps, en
dehors de tout ce qui pourrait l ui venir de son cours, i l apparat
clairement qu'une temporalit rduite son ordre devi endrai t aussi
tt temporalit en soi. Le caractre ek-statique de l'tre temporel n'y
changerait rien, puisque ce caractre se retrouve au pass, non
comme constitutif du pour-soi mais comme qual i t supporte par l'en
soi. Si nous envisageons en effet un futur en tant qu'il est purement et
simplement futur d'un pour-soi, lequel est pour-soi d'un certain pass
et si nous considrons que le changement est un problme nouveau
par rapport l a description de l a temporalit comme tel l e, nous
confrons au futur conu comme ce futur une immobilit instantane,
nous faisons du pour-soi une qualit fige et que l'on peut dsigner ;
l'ensemble enfin devient totalit faite, le futur et le pass bornent le
pour-soi et lui constituent des limites donnes. L'ensemble, comme
temporalit qui est, se trouve ptrifi autour d'un noyau solide qui est
l'instant prsent du pour-soi et le problme est bien alors d'expliquer
comment de cet instant peut surgir un autre instant avec son cortge
de pass et de futur. Nous avons chapp l ' i nstantanisme, dans l a
mesure o l'instant serait l a seule ralit en-soi borne par un nant
d'avenir et un nant de pass, mais nous y sommes retombs, en
admettant implicitement une succession de totalits temporelles dont
chacune serait centre autour d'un instant. En un mot, nous avons
dot l'instant de dimensions ek-statiques mais nous ne l'avons pas
supprim pour autant, ce qui signifie que nous faisons supporter l a
totalit temporelle par l'intemporel ; l e temps, s'il est, redevient un
songe.
Mais le changement appartient naturellement au pour-soi en tant
que ce pour-soi est spontanit. Une spontanit dont on pourrait
dire el l e est ou, simplement, celte spontanit devruit se laisser
dfinir par el l e-mme, c'est--dire qu' el l e serait fondement non
seulement de son nant d'tre mais aussi de son tre et que,
simultanment, l ' tre l a ressaisirait pour l a figer en donn. Une
spontanit qui se pose en tant que spontanit est oblige du mme
coup de refuser ce qu' el l e pose, si non son tre deviendrait de l'acquis
et c'est en vertu de l ' acquis qu'elle se perptuerait l'tre. Et ce refus
lui-mme est un acquis qu' el l e doit refuser sous peine de s'engluer
dans un prolongement inerte de son existence. On dira que ces
notions de prolongement et d'acquis supposent dj la temporalit et
cela est vrai . Mais c'est que l a spontanit constitue elle-mme
l'acquis par l e refus et l e refus par l'acquis, car elle ne peut tre sans se
183
temporal iser. Sa nature propre est de ne pas profiter de l ' acquis
qu' elle constitue en se ralisant comme spontanit . Il est impossible
de concevoir autrement la spontanit moins de l a contracter dans
un instant et par l mme de la figer en en-soi, c'est--dire de
supposer un temps transcendant. En vain objectera t-on que nous ne
pouvons rien penser sinon sous l a forme temporelle et que notre
expos contient une ptition de principe, puisque nous temporalisons
l ' tre pour en faire, peu aprs, sortir le temps ; en vain rappellera-t-on
les passages de la Critique o Kant montre qu'une spontanit
intemporel l e est inconcevable mais non contradictoire. Il nous parat
au contraire qu'une spontanit qui ne s'vaderait pas d'elle-mme et
qui ne s'vaderait pas de cette vasion mme , dont on pourrait dire :
el l e est ceci , et qui se laisserait enfermer dans une dnomination
i mmuabl e serait prcisment une contradicti on et qu'elle quivau
drait finalement une essence particulire affirmative, ternel sujet
qui n'est j amais prdicat. Et c'est prcisment son caractre de
spontani t qui constitue l'irrversibilit mme de ses vasions
puisque, prcisment, ds qu'elle apparat, c'est pour se refuser et
que l'ordre position refus ne peut tre renvers. La position
mme, en effet, s'achve en refus sans atteindre jamais la plnitude
affirmative, sinon elle s'puiserait dans un en-soi instantan et c'est
seulement titre de refuse qu' el le passe j'tre dans la totalit de
son accomplissement. La srie unitaire des acquis-refuss a
d' ai lleurs sur le changement une priorit ontologique, car le change
ment est simplement le rapport des contenus matriels de l a sri e. Or,
nous avons montr l'irrversibilit mme de l a temporalisation
comme ncessaire la forme entirement vide et a priori d'une
spontanit .
Nous avons expos
notre thse en usant du concept de spontanit
qui nous a paru pl us familier nos lecteurs. Mais nous pouvons
prsent reprendre ces ides dans la perspective du pour-soi et avec
notre terminologie propre. Un pour-soi qui ne durerait pas demeure
rait sans doute ngation de l'en-soi transcendant et nantisation de
son propre tre sous la forme du reflet refltant . Mais cette
nantisation deviendrait un donn, c'est--dire qu'elle acquerrait l a
conti ngence de l'en-soi, et le pour-soi cesserait d'tre le fondement de
son propre nant ; il ne serait pl us rien comme ayant l'tre, mais
dans l'unit nantisante du couple reflet-refl tant, i l serait. La fuite du
pour-soi est refus de la contingence, par l'acte mme qui le constitue
comme tant fondement de son nant. Mais cette fuite constitue
prcisment en contingence ce qui est fui : le pour-soi fui est l aiss sur
pl ace. Il ne saurait s'anantir puisque je le suis, mais i l ne saurait non
plus tre comme fondement de son propre nant puisqu'il ne peut
tre que dans la fuite : i l s'est accompli. Ce qui vaut pour le pour-soi
comme prsence . . . convient naturellement aussi la totalit de la
1 84
temporal isati on. Cette totalit n'est jamais acheve, el l e est totalit
qui se refuse et qui se fuit, elle est arrachement soi dans l'unit d'un
mme surgissement, totalit insaisissable qui , au moment o elle se
donne, est dj par del ce don de soi.
Ainsi le temps de la conscience, c'est l a ralit-humaine qui se
temporalise comme totalit qui est elle-mme son propre inachve
ment , c'est le nant se glissant dans une totalit comme ferment
dtotalisateur. Cette totalit qui court aprs soi et se refuse la fois,
qui ne saurait trouver en elle-mme aucun terme son dpassement,
parce qu'elle est son propre dpassement et qu'elle se dpasse vers
elle-mme, ne saurai t, en aucun cas, exister dans les limites d'un
instant. I l n'y a jamais d'instant o l'on pui sse affirmer que le pour-soi
est, parce que, prcisment, l e pour-soi n'est jamais. Et la tempora
lit, au contraire, se temporalise tout entire comme refus de
l'instant.
I I I
TEMPORALI T ORI GI NELLE
ET TEMPORALI T PSYCHI QUE :
LA RFLEXI ON
Le pour-soi dure sous forme de conscience non-thtique (de) durer.
Mais je puis sentir le temps qui coule et me saisir moi-mme
comme unit de succession. En ce cas, j 'ai conscience de durer. Cette
conscience est thtique et ressemble fort une connaissance, tout de
mme que l a dure qui se temporalise sous mon regard est assez
proche d' un objet de connaissance . Quel rapport peut-il exister entre
la temporalit originell e et cette temporalit psychique que j e
rencontre ds que je me saisis moi-mme en train de durer ? Ce
problme nous conduit aussitt un autre probl me, car la cons
cience de dure est conscience d' une conscience qui dure ; par suite,
poser la question de l a nature et des droits de cette conscience
thtique de dure revient poser celle de l a nature et des droits de la
rflexion. C'est la rflexion, en effet, que la temporalit apparat
sous forme d
dure psychique et tous les processus de dure
psychique appartiennent l a conscience rflchie. Avant donc de
nous demander comment une dure psychique peut se constituer
comme objet i mmanent de rflexion, nous devons tenter de rpondre
cette question pralable : comment la rflexion est-elle possible
pour un tre qui ne peut tre qu'au pass ? La rflexion est donne
par Descartes et par Husserl comme un type d' i ntuition privilgie
1 85
parce qu'elle saisit la conscience dans un acte d'immanence prsente
et inst antane . Gardera-t-elle sa certitude si l'tre dont elle a
connatre est pass par rapport elle ? Et comme toute notre
ontologie a son fondement dans une exprience rflexive, ne risque
t-elle pas de perdre tous ses droits ? Mais, au fait , est-ce bien l'tre
pass qui doit faire l'objet des consciences rflexives ? Et la rflexion
elle-mme, si el l e est pour-soi, doit-elle se limiter une existence et
une certitude i nstantanes ? Nous ne pouvons en dcider que si nous
faisons retour sur le phnomne rflexif pour en dterminer la
structure.
La rflexi on, c' est l e pour-soi conscient de lui-mme. Comme le
pour-soi est dj conscience non-thtique (de) soi , on a coutume de
reprsenter la rflexion comme une conscience nouvelle, brusque
ment apparue, braque sur la conscience rflchie et vivant en
symbiose avec el l e. On reconnat l l a vieille idea ideae de Spinoza.
Mai s, outre qu'il est difficile d'expliquer le surgissement ex nihilo
de la conscience rflexive, il est tout fait impossible de rendre
compte de son unit absolue avec la conscience rflchie, unit qui,
seul e, rend concevables les droits et l a certitude de l'intuition
rflexive. Nous ne saurions, en effet, dfinir ici l ' esse du rflchi
comme un percipi, puisque, prcisment, son tre est tel qu' il n'a pas
besoin d'tre peru pour exister- Et son rapport premier avec la
rflexion ne peut tre la relation unitaire d'une reprsentation avec
un sujet pensant. Si l'existant connu doit avoir l a mme dignit d'tre
que l'existant connaissant, c'est, en somme, dans l a perspective du
ralisme naf qu' i l faut dcrire le rapport de ces deux existants. Mais,
prcisment, nous allons rencontrer alors la difficult majeure du
ralisme : comment deux touts isols, indpendants et pourvus de
cette suffisance d'tre que les Allemands nomment Selbststandig
keit , peuvent-ils entretenir des rapports entre eux, et singulire
ment ce type de relations i nternes qu'on nomme la connaissance ? Si
nous concevons d'abord la rflexion comme une conscience auto
nome, jamais nous ne pourrons la runir ensuite la conscience
rflchi e. El l es feront toujours deux et si , par impossi ble, la
conscience rflexive pouvait tre conscience de la conscience rfl
chie, ce ne pourrait tre qu'une liaison externe entre les deux
consciences, tout au plus pourrions-nous imaginer que la rflexion,
isole en soi, possde comme une image de la conscience rflchie et
nous retomberions dans l'idalisme ; l a connaissance rflexive et, en
particul i er, le cogito perdraient leur certitude et n'obtiendraient en
change qu'une certaine probabilit, d'ail leurs mal dfinissable. Il
convient donc que la rflexion soit unie par un lien d'tre au rflchi,
que la conscience rflexive soit la conscience rflchie.
Mais, d' autre part, i l ne saurait tre question ici d' une identification
totale du rflexi f au rfl chi , qui supprimerait du coup le phnomne
1 86
de rflexion en ne laissant subsister que la dual it fantme reflet
refltant . Nous rencontrons
i
ci, une fois de pl us, ce type d'tre qui
dfinit le pour-soi : la rflexion exige, si el l e doit tre vidence
apodictique, que le rflexif soit le rflchi. Mais, dans la mesure o
elle est connaissance, i l faut que le rflchi soit objet pour le rflexif,
ce qui implique sparation d'tre. Ainsi faut-il la fois que le rflexif
soit et ne soit pas rflchi. Cette structure ontologi que, nous l'avons
dcouverte dj au cur du pour-soi . Mais elle n'avait pas alors tout
fait la mme signification. Elle supposait, en effet, dans les deux
termes refl t et refl t ant de la dual it bauche une
Unselbststandigkeit radical e, c'est--dire une telle incapacit de
se poser sparment, que la dualit restait perptuellement vanes
cente et que chaque terme, en se posant pour J'autre, devenait l'autre.
Mais, dans le cas de la rflexion, i l en va un peu autrement, puisque le
reflet-refltant rflchi existe pour un reflet-refltant rflexif.
Autrement dit, le rflchi est apparence pour l e rflexif sans cesser
pour cela d'tre tmoin (de) soi et l e rflexif est tmoin du rflchi
sans cesser pour cela d'tre soi-mme apparence. C'est mme en
tant qu' i l se reflte en soi que l e rflchi est apparence pour le rflexif,
et le rflexif ne peut tre tmoin qu'en tant qu'il est conscience (de)
l'tre, c'est--dire dans la mesure exacte o ce tmoin qu'il est est
reflet pour un refltant qu'il est aussi. Rflchi et rflexif tendent
donc chacun l a Selbststandigkeit et le rien qui les spare les
divise plus profondment que le nant du pour-soi ne spare l e reflet
du refltant. Seulement, il faut noter : lO que la rflexion comme
tmoin ne saurait avoir son t re de tmoin que dans et par
l'apparence, c'est--dire qu'il est profondment atteint dans son tre
par sa rflexivit et que, en tant que tel , il ne peut jamais atteindre
la Sel bststandigkeit qu'il vise, puisqu'il tire son tre de sa fonction
et sa fonction du pour-soi rfl chi ; 2 que le rflchi est profond
ment altr par la rflexion, en ce sens qu' il est conscience (de) soi
comme conscience rflchie de tel ou tel phnomne transcendant. Il
se sait regard ; il ne saurait mi eux se comparer, pour user d'une
image sensible, qu' un homme qui crit, courb sur une table et qui,
tout en crivant, sait qu'il est observ par quelqu'un qui se tient
derrire lui. Il a donc, en quelque sorte, dj conscience (de) lui
mme comme ayant un dehors ou, plutt, l ' bauche d'un dehors,
c'est--dire qu' i l se fait lui-mme objet pour . . . en sorte que son sens
de rflchi est insparable du rflexif, existe l-bas, distance de l ui
dans l a conscience qui l e rflchit. En ce sens, i l ne possde pas pl us la
Selbststandigkeit que le rfl exif lui-mme. Husserl nous dit que le
rflchi se donne comme ayant t l avant la rflexion Mais
nous ne devons pas nous y tromper : la Sel bststandigkeit de
l'irrflchi en tant qu'irrflchi , par rapport toute rflexion possible,
187
ne passe pas dans le phnomne de rflexi on, puisque, prcisment,
le phnomne perd son caractre d' irrflchi . Devenir rflchie, pour
une conscience, c'est subir une modification profonde en son tre et
perdre prcisment l a Selbststandigkeit qu'elle possdait en tant
que quasi-total i t reflte-refltante . Enfin, dans la mesure o un
nant spare le rflchi du rflexif, ce nant qui ne peut tirer son tre
de lui-mme doit tre t . Entendons par l que seule une
structure d' tre unitaire peut tre son propre nant, sous forme
d'avoir l'tre. Ni le rflexif, en effet , ni le rflchi ne peuvent
dcrter ce nant sparateur. Mais la rfl exion est un tre, tout
comme le pour-soi irrflchi , non une addition d'tre, un tre qui a
tre son propre nant ; ce n'est pas l'apparition d'une conscience
neuve dirige sur le pour-soi, c'est une modification intrastructurale
que le pour-soi ralise en soi , en un mot, c'est le pour-soi lui-mme
qui se fait exister sur l e mode rflexif-rflchi au lieu d'tre
simplement sur le mode reflet-refltant, ce nouveau mode d'tre
laissant d'ailleurs subsister l e mode reflet-refltant, titre de struc
ture interne primaire. Celui qui rflchit sur moi , ce n'est pas je ne
sais quel pur regard intemporel, c'est moi, moi qui dure, engag dans
le circuit de mon ipsit, en danger dans le monde, avec mon
historicit. Simplement , cette historicit et cet tre dans l e monde et
ce circuit d'ipsit, l e pour-soi que je suis les vit sur le mode du
ddoublement rflexif.
Nous l'avons vu, l e rflexif est spar du rflchi par un nant.
Ainsi , le phnomne de rflexion est une nantisation du pour-soi qui
ne l ui vient pas du dehors, mais qu'il a tre. D' o peut venir cette
nantisation plus pousse ? Quelle peut en tre l a motivation ?
Dans le surgissement du pour-soi comme prsence l'tre, il y a
une dispersion originelle : le pour-soi se perd dehors, auprs de l'en
soi et dans les trois ek-stases temporelles. I l est hors de lui-mme et,
au plus intime de soi, cet tre-po ur-soi est ek-statique puisqu'il doit
chercher son tre ai l leurs, dans l e refltant s'il se fait reflet, dans le
reflet s'il se pose comme refltant . Le surgissement du pour-soi
entrine l'chec de l'en-soi qui n'a pu tre son propre fondement. La
rflexion demeure une possibilit permanente du pour-soi comme
tentative de reprise d'tre. Par l a rflexion, le pour-soi qui se perd
hors de lui tente de s'intrioriser dans son tre, c'est un deuxime
effort pour se fonder ; i l s'agit, pour lui, d'tre pour soi mme ce qu'i!
est. Si , en effet , la quasi-dualit reflet-refltant tait ramasse en une
totalit pour un tmoin qui serait elle-mme, elle serait ses propres
yeux ce qu'elle est. Il s'agit, en somme, de surmonter l'tre qui se fuit
en tant ce qu'il est sur l e mode de n'tre pas et qui s'coule en tant
son propre coulement , qui fuit entre ses propres doigts, et d'en faire
un donn, un donn qui , enfin, est ce qu'if est ; i l s'agit de ramasser en
188
l'unit d'un regard cette totalit inacheve qui n'est acheve que
parce qu'elle est elle-mme son i nachvement, de s'chapper de la
sphre du perptuel renvoi qui a tre soi-mme renvoi et,
prcisment parce qu'on s'est vad des mail l es de ce renvoi , de le
faire tre comme renvoi vu, c'est--dire comme renvoi qui est ce qu'il
est. Mais, en mme temps, il faut que cet tre qui se reprend et se
fonde comme donn, c'est--dire qui se confre la contingence de
l'tre pour l a sauver en l a fondant, soit lui-mme ce qu'il reprend et
fonde, ce qu'il sauve de l'parpillement ek-statique. La motivation de
la rfexion consiste en une double tentative simultane d'objectiva
tion et d'intriorisation. Etre soi-mme comme l'objet-en-soi dans
l'unit absolue de l ' intriorisation, voil ce que l'tre-rflexion a
tre.
Cet effort, pour tre soi-mme son propre fondement, pour
reprendre et domi ner sa propre fuite en intriorit, pour tre enfin
cette fuite, au lieu de la temporaliser comme fuite qui se fuit, doit
aboutir un chec, et c'est prcisment cet chec qui est la rflexion.
En effet, cet tre qui se perd, c'est lui-mme qui a le reprendre et i l
doi t tre cette reprise sur l e mode d'tre qui est le si en, c'est--dire sur
le mode du pour-soi, donc de la fuite. C'est en lant que pour-soi que le
pour-soi tentera d'tre ce qu'il est, ou, si l'on prfre, il sera pour soi
ce qu' il est-pour-soi . Ainsi, la rflexion ou tentative de reprendre le
pour-soi par retournement sur soi aboutit l'apparition du pour-soi
pour le pour-soi . L'tre qui veut fonder dans l'tre n'est lui-mme
fondement que de son propre nant. L'ensemble demeure donc en
soi nantis. Et, en mme temps, l e retournement de l ' tre sur soi ne
peut que faire apparatre une distance entre ce qui se retourne et ce
sur quoi i l y a retournement . Ce retournement sur soi est arrachement
soi pour se retourner. C'est ce retournement qui fait apparatre le
nant rfexif. Car l a ncessit de structure du pour-soi exige qu' il ne
puisse tre rcupr dans son tre que par un tre qui existe lui-mme
sans forme de pour-soi. Ainsi, l'tre qui opre la reprise doit se
constituer sur l e mode du pOlir-soi et l'tre qui doit tre repris doit
exister comme pour-soi. Et ces deux tres doivent tre le mme tre,
mais prcisment, en tant qu'il se reprend, il fait exister entre soi et
soi , dans l'unit de l'tre, une distance absolue. Ce phnomne de
rfexion est une possibilit permanente du pour-soi , parce que la
scissiparit rfl exive est en puissance dans l e pour-soi rflchi : i l
suffit , en effet, que l e pour-soi refltant se pose pour lui comme
tmoin du reflet et que le pour-soi reflet se pose pour lui comme reflet
de ce refltant. Ai nsi, la rflexion, comme effort de rcupration d'un
pour-soi par un pour-soi qu'il est sur le mode du n'tre-pas, est un
stade de nantisation intermdiaire entre l 'existence du pour-soi pur
et simple et l'existence pour autrui comme acte de rcupration d'un
189
pour-soi par un pour-soi qu'il n'est pas sur le mode du n'tre-pas 1 .
La rflexion ainsi dcrite peut-elle tre limite dans ses droits et
dans sa porte par le fait que le pour-soi se temporalise ? Nous ne le
croyons pas.
I l convient de distinguer deux espces de rflexion, si nous voulons
saisir le phnomne rflexif dans ses rapports avec l a temporalit : la
rflexion peut tre pure ou impure. La rflexion pure, simple
prsence du pour-soi rflexif au pour-soi rflchi , est la fois la forme
originelle de la rfexion et sa forme idale ; celle sur le fondement de
l aquelle parat la rflexion impure et celle aussi qui n'est j amais
donne d' abord, celle qu'il faut gagner par une sorte de catharsis. La
rflexion i mpure ou complice, dont nous parlerons plus l oi n, enve
loppe la rflexion pure, mais la dpasse parce qu'elle tend ses
prtentions plus l oin.
Quels sont les titres et les droits de la rflexion pure l'vidence ?
C'est videmment que le rflexif est le rflchi . Sorti de l , nous
n' aurions aucun moyen de lgitimer la rflexion. Mais le rflexif est le
rflchi en toute immanence, quoique sous la forme du ne-pas-tre
en-soi . C'est ce que montre bien le fait que le rflchi n'est pas tout
fait objet, mais quasi-objet pour la rflexion. En effet, la conscience
rflchie ne se livre pas encore comme un dehors la rflexion, c'est
-dire comme un tre sur lequel on peut prendre un point de vue ,
par rapport auquel on peut raliser un recul, accrotre ou diminuer la
distance qui en spare. Pour que la conscience rflchie soit vue du
dehors , et pour que l a rfexion puisse s'orienter par rapport elle,
i l faudrait que le rflexif ne ft pas l e rflchi, sur le mode de n'tre
pas ce qu'il n'est pas : cette scissiparit ne sera ralise que dans
l'existence pour autrui. La rflexion est une connaissance, cela n'est
pas douteu'x, elle est pourvue d' un caractre positionnel ; elle affirme
la conscience rflchie. Mais toute affirmation, nous le verrons
bientt , est conditionne par une ngation : affirmer cel obj et, c'est
nier simultanment que j e sois cet objet. Connatre, c'est se faire
autre. Or, prcisment, le rfexif ne peut se faire tout fait autre que
l e rflchi , puisqu'il eSI-pour-tre le rflchi. Son affirmation est
arrte en chemin, parce que sa ngation ne se ralise pas entire
ment . Il ne se dtache donc pas tout fait du rflchi et ne peut pas
l'embrasser d' un point de vue . Sa connaissance est totalitaire,
c'est une intuition fulgurante et sans relief, sans point de dpart ni
point d'arrive. Tout est donn l a fois dans une sorte de proximit
1. Nous retrouvons ici celle scission de l'gal soi mme q donl Hegel
fail le propre de la conscience. Mais cette scission, au lieu de conduire, comme
dans la Phnomnologie de l'Esprit, une i nt gration plus haute, ne fait que
creuser plus profondment et plus irrmdiablement le nant qui spare l a
conscience de soi . La conscience est hglienne, mais c'est sa pl us grande
illusion.
190
absol ue. Ce que nous nommons ordinairement connatre suppose des
reliefs, des plans, un ordre, une hirarchie. Mme les essences
mathmatiques se dcouvrent nous avec une orientation par rapport
d' autres vrits, certaines consquences ; elles ne se dvoilent
jamais avec toutes leurs caractristiques la fois. Mais l a rflexion qui
nous livre le rfchi non comme un donn, mais comme l'tre que
nous avons tre, dans une indistinction sans point de vue, est une
connaissance dborde par elle-mme et sans explication. En mme
temps, elle n'est jamais surprise par elle-mme, el le ne nous apprend
rien, elle pose seulement. Dans la connaissance d'un objet transcen
dant, en effet, il y a dvoilement de l'objet, et l'objet dvoil peut
nous dcevoir ou nous tonner. Mais dans le dvoilement rflexif, i l y
a position d' un tre qui tait dj dvoilement dans son tre. La
rfl exion se borne faire exister pour soi ce dvoilement ; l'tre
dvoil ne se rvl e pas comme un donn, mais avec le caractre du
dj dvoil . La rflexion est reconnaissance plutt que connais
sance. Elle implique une comprhension pr-rflexive de ce qu'elle
veut rcuprer comme motivation originelle de la rcupration.
Mais si le rflexif est le rflchi, si cette unit d' tre fonde et limite
les droits de l a rflexion, il convient d'ajouter que le rflchi lui
mme est son pass et son aveni r. I l ne fait donc pas de doute que le
rflexif, quoique dbord perptuellement par l a totalit du rflchi
qu'il est sur le mode du n'tre pas, tend ses droits d'apodicticit
cette totalit mme qu' i l est. Ai nsi , la conqute rflexive de Des
cartes, le cogito, ne doit pas tre limite l'instant infinitsimal . C'est
ce qu' on pouvait conclure, d'ailleurs, du fait que la pense est un acte
qui engage le pass et se fait presquisser par l'avenir. Je doute donc
je suis, dit Descartes. Mais que resterait-il du doute mthodique, si on
pouvait le limiter l'instant ? Une suspension de jugement, peut-tre.
Mais une suspension de jugement n'est pas un doute, elle n'en est
qu'une structure ncessaire. Pour qu'il y ait doute, i l faut que cette
suspension soit motive par l'insuffisance des raisons d'affirmer ou de
nier - ce qui renvoie au pass - et qu'elle soit maintenue
dlibrment jusqu' l'intervention d'lments nouveaux, ce qui est
dj projet de l'avenir. Le doute parat sur le fond d'une comprhen
sion prontologique du connatre et d'exigences concernant le vrai.
Cette comprhension et ces exigences qui donnent au doute toute sa
signification, engagent la totalit de la ralit-humaine et son tre
dans l e monde, elles supposent l' existence d'un objet de connaissance
et de doute, c'est--dire d'une permanence transcendante dans le
temps universel ; c'est donc une conduite lie que le doute, une
conduite qui reprsente un des modes de l ' tre-dans-Ie-monde de la
ralit-humaine. Se dcouvrir doutant, c'est dj tre en avant de soi
mme dans le futur qui recle l e but , la cessation et la signification de
ce doute, en arrire de soi dans le pass qui recle les motivations
191
constituantes du doute et ses phases, hors de soi dans le monde
comme prsence l'objet dont on doute. Les mmes remarques
s'appliqueraient n' importe quelle constatation rfexive : je l i s, je
rve, je perois, j 'agis. Ou bien elles doivent nous conduire refuser
l'vidence apodictique la rflexion : alors la connaissance originelle
que j'ai de moi s'effondre dans l e probable, mon existence mme
n'est qu'une probabilit, car mon t re-dans-l'instant n'est pas un tre,
- ou bien i l faut tendre les droits de la rflexion la totalit
humaine, c'est--dire au pass, l'aveni r, la prsence, l'objet. Or,
si nous avons vu juste, la rflexion , c'est le pour-soi qui cherche se
reprendre lui-mme comme totalit en perptuel inachvement. C'est
l'affi rmation du dvoilement de l ' tre qui est lui-mme son propre
dvoilement . Comme le pour-soi se temporalise, i l en rsulte : 10 que
la rflexion, comme mode d'tre du pour-soi , doit tre comme
temporalisation et qu'elle est elle-mme son pass et son aveni r ; 20
qu'elle tend, par nature, ses droits et sa certitude jusqu'aux
possibi l i ts que je suis et jusqu'au pass que j'tais. Le rflexif n'est
pas saisie d' un rflchi instantan, mais i l n'est pas lui-mme
instantanit. Cela ne signifie pas que l e rflexif connaisse avec son
futur, le futur du rflchi , avec son pass, le pass de la conscience
connatre. C'est , au contraire, par le futur et le pass que le rflexif et
le rflchi se distinguent dans l ' uni t de leur tre. Le futur du rflexif,
en effet, est l'ensemble des possibilits propres que le rflexif a tre
comme rflexif. En tant que tel , i l ne saurait envelopper une
conscience du futur rflchi . Les mmes remarques vaudraient pour
le pass rflexif, encore que celui-ci se fonde, fi nalement, dans le
pass du pour-soi originel. Mais l a rflexion, si elle tire sa signification
de son avenir et de son pass, est dj, en tant que prsence fuyante
une fuite, ek-statiquement tout au long de cette fuite. Autrement dit,
le pour-soi qui se fait exister sur l e mode du ddoublement rflexif, en
tant que pour-soi, tire son sens de ses possibilits et de son avenir ; en
ce sens, l a rflexi on est un phnomne diasporique ; mais, en tant que
prsence soi, i l est prsence prsente toutes ses dimensions ek
statiques. Reste expliquer, dira-t-on, pourquoi cette rflexion,
prtendue apodictique, peut commettre tant d'erreurs touchant
prcisment ce pass que vous lui donnez l e droit de connatre. Je
rponds qu' el l e n'en commet aucune dans la mesure exacte o elle
saisit le pass comme ce qui hante le prsent sous forme non
thmatique. Lorsque j e dis : Je l i s, j e doute, j 'espre, etc. , nous
l'avons montr, je dborde de l oi n mon prsent vers l e pass. Or, en
aucun de ces cas, je ne puis me tromper. L'apodicticit de la rflexion
ne fait pas de doute, dans la mesure o elle saisit le pass tout juste
comme il est pour la conscience rflchie qui a l'tre. Si , d'autre
part, je puis commettre mainte erreur en me rappelant, sur le mode
rflexif, mes sentiments ou mes i des passs, c'est que je suis sur le
192
plan de la mmoire : ce moment-l, je ne suis plus mon pass, malS
je l e thmatise. Nous n' avons plus affaire alors l'acte rflexif.
Ai nsi , l a rflexion est conscience des lrois dimensions ek-statiques.
Elle est conscience non-thtique (d') coulement et conscience
thtique de dure. Pour el l e, l e pass et l e prsent du rflchi se
mettent exister comme des quasi dehors, en ce sens qu'ils ne sont
pas seulement retenus dans l ' uni t d'un pour-soi qui puise leur tre
en ayant l ' tre mais aussi pour un pour-soi qui est spar d'eux par
un nant, pour un pour-soi qui , bien qu'existant avec eux dans l'unit
d'un tre, n'a pas tre leur tre. Par elle aussi, l'coulement tend
tre comme un dehors esquiss dans l ' i mmanence. Mais la rflexion
pure ne dcouvre encore la temporalit que dans sa non-substantialit
origi nel l e, dans son refus d'tre en-soi , elle dcouvre les possibles en
tant que possibles, allgs par la l i bert du pour-soi , elle dvoile l e
prsent comme transcendant , et si l e pass l ui apparat comme en-soi ,
encore est-ce sur l e fondement de l a prsence. Enfin, elle dcouvre l e
pour-soi dans sa totalit dtotaIise en tant que l' individualit
incomparable qu'elle est elle mme sur l e mode d'avoir l'tre ; elle le
dcouvre comme le rflchi , par excellence, l'tre qui n'est jamais
que comme soi et qui est toujours ce soi distance de lui-mme,
dans l'aveni r, dans l e pass, dans l e monde. La rflexion saisit donc l a
temporal i t en tant qu'elle se dvoile comme le mode d'tre unique et
incomparable d' une ipsit, c'est--dire comme historicit.
Mais la dure psychologique que nous connaissons et dont nous
faisons quotidiennement usage, en tant que successions de formes
temporelles organises, est l'oppos de l'historicit. C'est, en effet,
le tissu concret d'units psychiques d'coulement. Cette joi e, par
exemple, est une forme organise qui parat aprs une tristesse et,
auparavant, i l y a eu cette humiliation que j 'ai prouve hier. C'est
entre ces units d'coulement, qualits, tats, actes, que s'tablissent
communment les relations d'avant et d'aprs, et ce sont ces units
qui peuvent mme servir dater. Ai nsi , la conscience rflexive de
l'homme-dans-Ie-monde se trouve, dans son existence quotidienne,
en face d'objets psychiques, qui sont ce qu'ils sont, qui paraissent sur
la trame continue de notre temporalit comme des dessins et des
motifs sur une tapisserie et qui se succdent la faon des choses du
monde dans le temps universel , c'est--dire en se remplaant sans
entret enir entre eux d' autres relations que des relations purement
externes de successi on. On parle d'une joie que j'ai ou que j'ai eue, on
dit que c'est ma joie comme si j'en tais l e support et qu'elle se
dtachait de moi comme l es modes finis chez Spinoza se dtachent sur
le fond de l'attribut. On di t mme que j'prouve cette joie, comme si
elle venait s' i mprimer comme un sceau sur l e tissu de ma temporalisa
tian ou, mi eux encore, comme si la prsence en moi de ces
sentiments, de ces ides, de ces tats tait une sorte de visitation.
193
Nous ne saurions appeler illusion cette dure psychique constitue
par l'coulement concret d' organisations autonomes, c'est--dire, en
somme, par la succession de faits psychiques, de faits de conscience :
c'est l eur ralit, en effet, qui fait l'objet de la psychologie ;
pratiquement, c'est au niveau du fait psychique que s'tablissent les
rapports concrets entre les hommes, revendications, jalousies, ran
cunes, suggestions, luttes, ruses, etc. Pourtant, il n'est pas concevable
que le pour-soi irrflchi qui s'historialise dans son surgissement soii
lui mme ces qualits, ces tats et ces actes. Son unit d' tre
s'effondrerait en mul tiplicit d'existants extrieurs les uns aux autres,
l e probl me ontologique de la temporalit rapparatrait et, cette
fois, nous nous serions t les moyens de le rsoudre, car, s'il est
possible au pour-soi d'tre son propre pass, i l serait absurde d'exiger
de ma joi e qu'elle ft la tristesse qui l'a prcde, mme sur le mode
du n' tre-pas . Les psychologues donnent une reprsentation
dgrade de cette existence ek-statique lorsqu'ils affi rment que les
faits psychiques sont relatifs les uns aux autres et que le coup de
tonnerre entendu aprs un long silence est apprhend comme
coup-de-tonnerre-aprs-un-long-silence . C'est fort bien fait, mais
ils se sont interdit d'expliquer cette relativit dans l a succession en lui
tant tout fondement ontologi que. En fait, si l'on saisit le pour-soi
dans son hi storicit , la dure psychique s'vanouit, les tats, les
qualits et les actes disparaissent pour laisser la place l'tre-pour-soi
en tant que tel , qui n'est que comme l'individualit unique dont le
processus d'historialisation est i ndivisible. C'est lui qui s'coule, qui
s'appelle du fond de l'avenir, qui s'alourdit du pass qu'il tait, c'est
lui qui historialise son ipsit et nous savons qu' il est, sur le mode
pri mai re ou irrflchi, conscience du monde et non de soi . Ainsi, les
qualits, les tats ne sauraient tre des tres dans son tre (au sens o
l' uni t d'coulement joie serait contenu ou fait de cons
cience) , il n'existe de lui que des colorations i nternes non position
nelIes qui ne sont autres que lui-mme, en tant qu'il est pour-soi et qui
ne peuvent tre apprhendes en dehors de lui.
Nous voici donc en prsence de deux temporalits : la temporalit
originelle, dont nous sommes la temporalisation, et la temporalit
psychique qui apparat l a fois comme incompatible avec le mode
d'tre de notre tre et comme une ralit intersubjective, objet de
science, but des actions humaines (au sens, par exemple, o je mets
tout en uvre pour me faire aimer d'Anny, pour lui donner de
l'amour pour moi ) . Cette temporalit psychique, videmment
drive, ne peut procder directement de la temporalit originelle ;
celI e-ci ne constitue rien d'autre qu'elle-mme. Quant la tempora
lit psychique, elle est incapable de se constituer, car elle n'est qu'un
ordre successif de faits. D'ailleurs, la temporalit psychique ne saurait
apparatre au pour-soi irrflchi qui est pure prsence ek-statique au
1 94
monde : c'est la rflexion qu'elle se dvoile, c'est la rflexion qui
doit la consti tuer. Mais comment l a rflexion le pourrait-elle, si elle
est pure et simple dcouverte de l 'historicit qu'elle est ?
Cest i ci qu' i l faut distinguer la rflexion pure de la rflexion impure
ou constituante : car c'est la rflexion impure qui constitue la
succession des faits psychiques ou psych. Et ce qui se donne
premirement dans l a vie quotidi enne, c'est la rflexion i mpure ou
constituante, encore qu'elle enveloppe en elle la rfexion pure
comme sa structure originelle. Mais celle-ci ne peut tre atteinte que
par suite d' une modification qu'elle opre sur elle-mme et qui est en
forme de calharsis. Ce n'est pas ici le lieu de dcrire l a motivation et la
structure de cette calharsis. Ce qui nous importe, c'est la description
de la rflexi on i mpure en tant qu'elle est constitution et dvoilement
de la temporalit psychique .
La rfl exi on, nous l'avons vu, est un type d'tre o le pour-soi est
pour tre lui-mme ce qu' i l est. La rflexion n'est donc pas un
surgissement capricieux dans la pure indiffrence d'tre, mais elle se
produit dans la perspective d'un pour. Nous avons vu ici mme, en
effet, que le pour-soi est l'tre qui , dans son tre, est fondement d'un
pour. La signification de la rflexion est donc son tre-pour. En
particulier, le rfl exi f est le rflchi se nantisant lui-mme pour se
rcuprer. En ce sens, le rflexif, en tant qu' i l a tre le rflchi,
s'chappe du pour-soi qu'il est comme rflexif sous forme d'avoir
l'tre . Mais si c'tait seulement pour tre le rfchi qu' i l a tre, il
chapperai t au pour-soi pour le retrouver ; partout, et de quelque
manire qu'il s'affecte, l e pour-soi est condamn tre-pour-soi.
Cest bien l , en effet, ce que dcouvre l a rflexion pure. Mais la
rflexion impure, qui est le mouvement rfexif premier et spontan
(mais non originel) , est-pour-tre le rfl chi comme en-soi. Sa
motivation est en elle-mme dans un double mouvement -que nous
avons dcrit - d'i ntriorisation et d'objectivation : saisir le rflchi
comme en-soi pour se faire tre cet en-soi qu'on saisit. La rflexion
impure n'est donc saisie du rflchi comme tel que dans un circuit
d'ipsit o elle se tient en rapport immdiat avec un en-soi qu'elle a
tre. Mais d'autre part cet en-soi qu'elle a tre, c'est le rflchi en
tant que le rflexif tente de l'apprhender comme tant en-soi . Cela
signifie qul existe trois formes dans la rflexion impure : le rfexif,
le rflchi et un en-soi que le rflexif a tre en tant que cet en-soi
serait le rflchi et qui n'est autre que le pour du phnomne rflexif.
Cet en-soi est presquiss derrire le rflchi-pour-soi par une
rflexion qui traverse le rflchi pour le reprendre et le fonder, il est
comme la projection dans l'en-soi du rflchi-pour-soi , en tant que
signification : son tre n'est point d'tre mais d'lre-l, comme le
nant. 11 est le rflchi en tant qu'objet pur pour l e rflexif. Ds que la
rfexion prend un point de vue sur le rflexif, ds qu'elle sort de cette
195
intuition fulgurante et sans relief o le rflchi se donne sans point de
vue au rflexif. ds qu' el l e se pose comme n'tant pas le rflchi et
qu' el l e dtermi ne ce qu'il est, la rflexion fait apparatre un en-soi
susceptible d't re dtermi n, qualifi, derrire l e rflchi . Cet en-soi
transcendant ou ombre porte du rflchi dans l'tre, i l est ce que le
rflexif a tre en tant qu'il est ce que le rflchi est. I l ne se confond
nullement avec la valeur du rflchi , qui se donne la rflexion dans
l' i ntuition total itaire et i ndi ffrencie -ni avec la valeur qui hante le
rflexif comme absence non-thtique et comme le pour de la
conscience rfl exive, en tant qu'elle est conscience non positionnelle
(de) soi . C'est l'obj et ncessaire de toute rflexion ; i l suffi t, pour qu'il
surgisse, que l a rflexion envisage le rflchi comme objet : c'est la
dcision mme par laquel l e la rflexion se dtermine considrer l e
rflchi comme objet qui fait apparatre l'en-soi comme objectivation
transcendante du rflchi . Et l'acte par lequel la rflexion se
dtermine prendre l e rflchi comme objet est, en lui-mme :
la position du rflexif comme n 'tant pas le rfl chi, 2 prise de point
de vue par rapport au rflchi. En ralit, d'ailleurs, ces deux
moments ne font qu'un puisque la ngation concrte que l e rflexif se
fait tre par rapport au rflchi se manifeste prcisment dans et par
le fait de prendre un point de vue. L'acte objectivant, on l e voi t, est
dans le strict prolongement du ddoublement rflexif, puisque ce
ddoublement se fait par approfondissement du nant qui spare le
reflet du refltant. L'objectivation reprend l e mouvement rflexif
comme n'tant pas le rflchi pour que le rflchi paraisse comme
objet pour le rflexif. Seulement cette rflexion est de mauvaise foi
car si el l e parat trancher le lien qui uni t l e rflchi au rflexif, si el l e
semble dcl arer que l e rflexif n'est pas le rflchi sur l e mode de
n' tre pas ce qu'on n'est pas, alors que dans le surgissement rflexif
originel l e rflexif n'est pas l e rflechi sur l e mode de n'tre pas ce
qu'on est, c'est pour reprendre ensuite l ' affirmation d'identit et
affirmer de cet en-soi que je le suis . En un mot la rflexion est de
mauvaise foi en tant qu' el l e se constitue comme dvoilement de
l'objet que je me suis. Mais en second lieu cette nantisation plus
radicale n'est pas un vnement rel et mtaphysique : l'vnement
rel , l e troisime procs de nantisation, c'est l e pour-autrui. La
rflexion i mpure est un effort avort du pour-soi pour tre autrui en
restant soi. L'objet transcendant apparu derrire l e pour-soi rflchi
est le seul tre dont le rflexif puisse, en ce sens, dire qu' i l ne l'est pas.
Mais c'est une ombre d'tre. Il est t et l e rflexif a l'tre pour ne
l'tre pas. C'est cette ombre d'tre, corrlatif ncessaire et constant
de l a rflexion i mpure, que le psychologue tudie sous le nom de fait
psychique. Le fai t psychique est donc l'ombre du rflchi en tant que
l e rfl exi f a l'tre ek-statiquement sur le mode du n'tre-pas. Ainsi
l a rflexion est i mpure lorsqu'elle se donne comme intuition du
196
pour-soi en en-soi ; ce qui se dvoile elle n'est pas l'historicit
temporelle et non substantielle du rfchi ; c'est, par del ce rflchi ,
l a substantialit mme de formes organises d'coul ement. L'unit de
ces tres virtuels se nomme la vie psychique ou psych, en-soi virtuel
et transcendant qui sous-tend la temporalisation du pour-soi, La
reflexion pure n'est jamais qu' une quasi-connaissance ; mais de la
Psych seule i l peut y avoir connaissance rfl exi ve. On retrouvera ,
naturel l ement, dans chaque objet psychique, les caractres du
rfchi rel , mais dgrads en en-soi. C'est ce dont une brve
description a priori de la psych nous permettra de nous rendre
compte.
1 Par psych nous entendons l'Ego, ses tats , ses qualits et ses
actes. L'Ego sous la double forme grammaticale du Je et du Moi
reprsente notre personne, en tant qu'unit psychique transcendante,
Nous l'avons dcrit ailleurs. Cest en tant qu' Ego que nous sommes
sujets de fait et sujets de droi t, actifs et passifs, agents volontaires,
objets possi bles d'un jugement de valeur ou de responsabilit.
Les qual its de l ' Ego reprsentent l'ensemble des virtualits,
latences, puissances qui constituent notre caractre et nos habitudes
(au sens grec de l) . C'est une qualit d'tre colreux,
travailleur, jaloux, ambitieux, sensuel , etc. Mais i l faut reconnatre
aussi des qualits d'une autre sorte qui ont notre histoire pour origine
et que nous appellerons habitudes : je peux tre vieilli, las, aigri,
diminu, en progrs, je peux m' apparatre comme ayant acquis de
l'assurance l a suite d'un succs ou au contraire comme ayant
contract peu peu des gots et des habitudes, une sexualit de
malade ( la suite d'une longue maladie).
Les tats se donnent, en opposition avec les qualits qui existent
en puissance , comme existant en acte, La haine, l'amour, la
jalousie sont des tats. Une mal adie, en tant qu'elle est saisie par le
malade comme ralit psychophysiologique, est un tat. De la mme
faon, nombre de caractristiques qui s'attachent de l'extrieur ma
personne peuvent, en tant que j e les vis, devenir des tats : l'absence
(par rapport telle personne dfinie) , l ' exi l , l e dshonneur, le
triomphe sont des tats. On voit ce qui distingue la qualit de l'tat :
aprs ma colre d'hier, mon survit comme simple
disposition latente me mettre en colre. Au contraire, aprs l ' action
de Pierre et l e ressentiment que j'en ai prouv, ma hai ne survit
comme une ralit actuelle, bi en que ma pense soit prsentement
occupe d'un autre objet. La quali t, en outre, est une di sposition
d'esprit inne ou acquise qui contribue qualifier ma personne.
L'tat, au contraire, est beaucoup plus accidentel et contingent : c'est
quelque chose qui m'arrive. II existe cependant des i ntermdiaires
entre tats et qualits : par exempl e, la haine de Pozzo di Borgo pour
Napolon, bien qu'existant en fait et reprsentant un rapport affectif
197
conti ngent e ntre Pozzo et Napolon 1er, tai t constitutive de la
personne Pozzo.
Par actes i l faut entendre toute activit synthtique de la personne,
c'est--dire toute disposition de moyens en vue de fins, non en tant
que le pour-soi est ses propres possibilits, mais en tant que l'acte
reprsente une synthse psychi que transcendante qu'il doit vivre. Par
exemple, l ' entranement du boxeur est un acte parce qu'il dborde et
souti ent l e pour-soi qui , par ai l leurs, se ralise dans et par cet
entranement. I l en est de mme pour la qute du savant, pour l e
travail de l 'artiste, pour la campagne lectorale du politicien. Dans
tous les cas l'acte comme tre psychique reprsente une existence
transcendante et la face objective du rapport du pour-soi avec le
monde.
2 Le Psychique se donne uniquement une catgorie spciale
d'actes cognitifs : les actes du pour-soi rflexif. Sur l e plan irrflchi ,
en effet , l e pour-soi est ses propres possibilits sur l e mode non
thtique et comme ses possibilits sont prsences possi bles au monde
par del l 'tat donn du monde, ce qui se rvle thtiquement mais
non thmatiquement travers elles, c'est un tat du monde synthti
quement li l'tat donn . En consquence les modifications
apporter au monde se donnent thtiquement dans les choses pr
sentes comme des potentialits objectives qui ont se raliser en
empruntant notre corps comme instrument de l eur ralisation. C'est
ainsi que l ' homme en colre voit sur le visage de son interlocuteur la
qualit obj ective d'appeler un coup de poing. D'o l'expression de
tte
gifles , de menton qui attire les coups , etc. Notre corps
apparat seulement ici comme un mdium en transe. C'est par l ui qu'a
se raliser une certaine potentialit des choses (boisson-devant-tre
bue, secou rs-devant -tre-port, bte-n uisible-devant -tre-crase,
etc. ) , la rflexion surgissant sur ces entrefaites saisit la relation
ontologique du pour-soi ses possibles mais en tant qu'objet. Ainsi
surgit l'acle, comme objet virtuel de l a conscience rflexive. Il m'est
donc impossible d'avoir en mme temps et sur l e mme plan
conscience de Pierre et de mon amiti pour l ui : ces deux existences
sont toujours spares par une paisseur de pour-soi . Et ce pour-soi
lui-mme est une ralit cache : dans le cas de la conscience non
rflchie, il est mais non-thtiquement et il s' efface devant l'objet du
monde et ses potentialits. Dans le cas du surgissement rflexif il est
dpass vers l'objet virtuel que le rflexif a tre. Seule une
conscience rflexive pure peut dcouvrir le pour-soi rflchi dans sa
ralit. Nous nommons psych la totalit organise de ces existants
qui font un cortge permanent la rflexion impure et qui sont l'objet
naturel des recherches psychologiques.
3 Les objets, quoique virtuels, ne sont pas des abstraits, i l s ne sont
pas viss vide par le rflexif mais ils se donnent comme l'en-soi
198
concret que le rflexif a tre par del le rflchi . Nous appellerons
vidence l a prsence i mmdiate et en personne de la haine, de
l'exil, du doute mthodique au pour-soi rflexif. Que cette prsence
existe, i l suffit pour s'en convaincre de se rappeler les cas de notre
exprience personnelle o nous avons essay de nous rappeler un
amour mort, une certaine atmosphre i ntellectuelle que nous avons
vcue autrefois. Dans ces di ffrents cas nous avions nettement
conscience de viser vide ces di ffrents objets. Nous pouvions en
former des concepts particuliers, en tenter une description littraire,
mais nous savions qu'ils n'taient pas l. Pareillement i l y a des
priodes d'intermittence pour un amour vivant, pendant lesquelles
nous savons que nous aimons mais nous ne le sentons point. Ces
intermi ttences du cur ont t fort bien dcrites par Proust. Par
contre il est possible de saisir plein un amour, de le contempler.
Mais i l faut pour cela un mode d'tre particulier du pour-soi rflchi :
c'est travers ma sympathie du moment devenue le rflchi d'une
conscience rflexive, que je puis apprhender mon amiti pour
Pierre. En un mot i l n'est pas d'autre moyen de prsentifier ces
qualits, ces tats ou ces actes que de les apprhender travers une
conscience rflchie dont ils sont l'ombre porte et l'objectivation
dans l'en-soi.
Mais cette possibilit de prsentifier un amour prouve mieux que
tous l es arguments la transcendance du psychique. Quand je dcouvre
brusquement, quand je vois mon amour, je saisis du mme coup qu'il
est devant la conscience. Je puis prendre des points de vue sur lui, le
juger, je ne suis pas engag en l ui comme le rflexif dans le rflchi .
De Ce fait mme, je l'apprhende comme n 'tant pas du pour-soi. Il
est infiniment pl us lourd, plus opaque, pl us consistant que cette
transparence absolue. C'est pourquoi l'vidence avec laquelle le
psychique se donne l'intuition de la rflexion impure n'est pas
apodictique. Il y a dcalage en effet entre l e futur du pour-soi rflchi
qui est constamment rong et allg par ma l i bert et le futur dense et
menaant de mon amour qui lui donne prcisment son sens d'amour.
Si je ne saisissais pas en effet dans l'objet psychique son futur d'amour
comme arrt, serait-ce encore un amour ? Ne tomberait-il pas au
rang de caprice ? Et le caprice lui-mme n'engage-t-il pas l'avenir dans
la mesure o il se donne comme devant demeurer caprice et ne jamais
se changer en amour ? Ainsi le futur toujours nantis du pour-soi
empche toute dtermination en soi du pour-soi comme pour-soi qui
aime ou qui hait ; et l'ombre projete du pour-soi rflchi possde
naturellement un futur dgrad en en-soi et qui fait corps avec elle en
dterminant son sens. Mais en corrlation avec la nantisation
continuelle de futurs rflchis, l'ensemble psychique organis avec
son futur demeure seulement probable. Et il ne faut point entendre
par l une qualit externe qui viendrait d' une relation avec ma
199
connaissance et qui pourrait se transformer le cas chant en
certitude, mais une caractristique ontologique.
4 L'objet psychi que , tant l'ombre porte du pour-soi rflchi,
possde en dgrad les caractres de la conscience. En particulier il
a pparat comme une totalit acheve et probable l o le pour-soi se
fait exister dans l ' unit diasporique d' une totalit dtotalise. Cela
si gnifie que le psychique, apprhend travers les trois dimensions
ek-stati ques de la temporalit, apparat comme constitu par la
synthse d' un Pass, d'un Prsent et d' un Avenir. Un amour, une
e ntreprise est l ' unit organise de ces trois dimensions. I l ne suffit pas
de dire, en effet, qu' un amour a " un avenir, comme si le futur tait
extrieur l'objet qu' il caractrise : mais l'avenir fait partie de la
forme organise d'coulement amour ", car c'est son tre au futur
qui donne l'amour son sens d'amour. Mais du fait que le psychique
est en-soi, son prsent ne saurait tre fuite ni son avenir possibilit
pure. Il y a, dans ces formes d'coulement, une priorit essentielle du
pass, qui est ce que le pour-soi tait et qui suppose dj la
transformation du pour-soi en en-soi. Le rflexif projette un psychi
que pourvu des trois dimensions temporelles, mais il const itue ces
trois dimensions uniquement avec ce que le rflchi tait. Le futur est
dj : sinon comment mon amour serait-il amour ? Seulement il n'est
pas donn encore : c'est un maintenant " qui n'est pas encore
dvoi l . Il perd donc son caractre de possibilit-que-j'ai- tre : mon
amour, ma joie n'ont pas tre leur futur, ils le sont dans la tranquille
indiffrence de l a j uxtaposition, comme ce stylo est la fois plume et,
l-bas, capuchon. Le prsent, pareillement, est saisi dans sa qualit
relle d'tre-l. Seulement cet tre-l est constitu en ayant-t-I . Le
prsent est dj tout constitu et arm de pied en cap, c'est un
maintenant " que l'instant apporte et remporte comme un costume
tout fait ; c'est une carte qui sort du j eu et qui y rentre. Le passage
d' un maintenant " du futur au prsent et du prsent au pass ne lui
fait subir aucune modi fication puisque, de toute faon, futur ou non,
il est dj pass. C'est ce que manifeste bien le recours naf que les
psychologues font l'inconscient pour distinguer les trois mainte
nant " du psychique : on appellera prsent, en effet, le maintenant qui
est prsent la conscience. Ceux qui sont passs ou futurs ont
exactement les mmes caractres, mais ils attendent dans les limbes
de l ' i nconscient et, l es prendre dans ce milieu i ndiffrenci, il nous
est impossible de discerner en eux le pass du futur : un souvenir qui
survit dans l'inconscient est un maintenant } pass et, la fois, en
tant qu' i l attend d'tre voqu, un maintenant futur. Ainsi la
forme psychique n'est pas tre ", el le est dj faite ; elle est dj
tout entire pass, prsent, avenir, sur l e mode a t . Il ne s'agit
plus, pour les maintenant qui la composent, que de subir un un,
avant de retourner au pass, le baptme de la conscience.
200
Il en rsulte qu'en la forme psychique coexistent deux modalits
d'tre contradictoires, puisque, la fois, elle est dj [aile et qu'elle
apparat dans l'unit cohsive d' un organisme et, la foi s, elle ne peut
exister que par une succession de maintenant qui tendent chacun
s'isoler en en-soi. Cette joi e, par exemple, passe d'un instant
l'autre parce que son futur existe dj comme aboutissement terminal
et sens donn de son dveloppement, non comme ce qu'elle a tre,
mais ce qu'elle a t dj dans l'avenir.
En effet l a cohsion intime du psychique n'est rien autre que l ' unit
d'tre du pour-soi hypostasie dans l'en-soi. Une haine n'a point de
parties : ce n'est pas une somme de conduites et de consciences, mais
elle se donne travers les conduites et les consciences comme l ' unit
temporelle sans parties de leurs apparitions. Seulement l'unit d' tre
du pour-soi s'explique par le caractre ek-statique de son tre : il a
tre en plei ne spontanit ce qu' i l sera. Le psychique, au contraire,
est-t . Cela signifie qu'il est incapable de se dterminer par soi
l'existence. Il est soutenu en face du rflexif par une sorte d'inertie ; et
les psychologues ont souvent insist sur son caractre pathologi
que . C'est en ce sens que Descartes peut parler des passions de
l ' me ; c'est cette inertie qui fai t, bien que le psychique ne soi t pas
sur le mme plan d'tre que les existants du monde, qu'il puisse tre
apprhend comme en relation avec ces existants. Un amour est
donn comme provoqu par l'objet aim. Par suite la cohsion
totale de la forme psychique devient i nintelligible puisqu'elle n' a pas
tre cette cohsion, puisqu'elle n'est pas sa propre synthse, puisque
son unit a le caractre d'un donn. Dans la mesure o une haine est
une succession donne de maintenant tout faits et inertes, nous
trouvons en elle le germe d'une divisibilit l ' i nfini. Et cependant
cette divisibilit est masque, nie en tant que le psychique est
l'objectivation de l ' unit ontologique du pour-soi . De l une sorte de
cohsion magique entre les mai ntenant successifs de la haine , qui
ne se donnent comme parties que pour nier ensuite leur extriorit.
C'est cette ambigut que met en l umire la thorie de Bergson sur la
conscience qui dure et qui est mul tiplicit d' i nterpntration Ce
que Bergson atteint ici , c'est le psychi que, non l a conscience conue
comme pour-soi. Que signifie i nterpntration en effet ? Non pas
l'absence en droit de toute divisi bi l i t. En effet, pour qu'il y ait
interpntration, il faut qu' i l y ait des parties qui s'interpntrent.
Seulement ces parties qui, en droi t, devraient retomber dans leur
i sol ement, se coulent les unes dans les autres par une cohsion
magique et totalement inexpl ique, et cette fusion totale dfie
prsent l ' analyse. Cette proprit du psychique, Bergson ne songe
nullement la fonder sur une structure absolue du pour-soi : i l l a
constate comme un donn ; c'est une simple intuition qui lui
rvle que le psychique est une multiplicit intriorise. Ce qui
201
accentue encore son caractre d'inerti e, de datum passif, c'est qu'elle
existe sans tre pour une conscience, thtique ou non. Elle est sans
tre conscience (d')tre , puisque dans l'attitude naturelle, l'homme la
mconnat entirement et qu' i l faut le recours l'intuition pour la
saisir. Ai nsi un objet du monde peut-il exister sans tre vu et se
dvoiler aprs coup, lorsque nous avons forg l es instruments
ncessaires pour l e dceler. Les caractres de la dure psychique sont,
pour Bergson, un pur fait contingent d'exprience : i l s sont ainsi
parce qu'on les rencontre ainsi, voil tout. Ainsi l a temporalit
psychique est un datum i nerte, assez voisin de la dure bergsonienne,
qui subir sa cohsion i nti me sans la faire, qui est perptuellement
temporalise sans se temporaliser, o l 'i nterpntration de fait,
irrati onnel l e et magi que , d'lments qui ne son! point unis par une
relation e k-statique d' tre, ne peut se comparer qu' l ' acti on magique
d'envotement distance et dissimule une multiplicit de mainte
nant dj tout faits. Et ces caractres ne viennent pas d'une erreur
de psychologues, d'un dfaut de connaissance, ils sont constitutifs de
la temporalit psychi que, hypostase de la temporalit origi nel l e.
L' uni t absol ue du psychique, en effet, est la projection de l'unit
ontologique et e k-stati que du pour-soi . Mais comme cette projection
se fait dans l 'en-soi qui est ce qu' il est dans la proximit sans distance
de l ' i denti t, l ' unit ek-statique se morcelle en une infinit de
mai ntenant qui sont ce qu' i l s sont et qui , prcisment cause de
cela, tendent s'isoler dans leur identit-en-soi. Ainsi, participant la
fois de l 'en-soi et du pour-soi, la temporalit psychique recle une
contradiction qui ne se surmonte pas. Et cela ne doit pas nous
tonner : produite par l a rflexion impure, il est naturel qu'elle soit
te ce qu' ell e n'est pas et qu' el l e ne soit pas ce qu'elle est-te .
C'est ce que rendra plus sensible encore un examen des relations
que les formes psychi ques entretiennent les unes avec les autres au
sei n du temps psychi que. Notons tout d'abord que c'est bien
l ' i nterpntration qui rgit l a liaison des sentiments, par exempl e, au
sein d'une forme psychique complexe. Chacun connat ces sentiments
d' ami ti nuancs d'envie, ces haines pntres malgr tout
d' estime , ces camaraderies amoureuses, que les romanciers ont
sOuvent dcrits. I l est certain aussi que nous saisissons une amiti
nuance d'envie la faon d' une tasse de caf avec un nuage de lait.
Et sans doute cette approximation est-elle grossi re. Pourtant, i l est
certai n que l'amiti amoureuse ne se donne pas comme une si mpl e
spcificati on du genre ami ti , comme l e triangle isocle est une
spcification du genre triangle. L'amiti se donne comme tout entire
pntre par l'amour tout enti er et pourtant elle n'est pas l'amour,
elle ne se fait pas amour : sinon elle perdrait son autonomie
d'ami ti . Mais il se constitue un objet inerte et en-soi que le langage a
peine nommer, o l'amour en-soi et autonome s'tend magique-
202
ment travers toute l'amiti, comme la jambe s'tend travers toute
la mer dans l a avyxvar stocienne.
Mais l es processus psychiques impliquent aussi l'action distance
de formes antrieures sur des formes postri eures. Nous ne saurions
concevoir cette action distance sur l e mode de la causalit simple
qu'on trouve, par exemple, dans la mcanique classique et qui
suppose l'existence totalement inerte d'un mobile enferm dans
l'i nstant ; ni non plus sur celui de l a causalit physique, conue la
faon de Stuart Mi l l , et qui se dfinit par la succession constante et
inconditionne de deux tats dont chacun, en son tre propre, est
exclusif de l'autre. En tant que l e psychique est objectivation du pour
soi, il possde une spontanit dgrade, saisie comme qualit interne
et donne de sa forme et d'ailleurs insparahle de sa force cohsive. Il
ne saurait donc se donner rigoureusement comme produit par la
forme antrieure. Mai s, d'autre part, cette spontanit ne saurait se
dterminer elle-mme l 'existence, puisqu'elle n'est saisie que
comme dtermination parmi d'autres d'un existant donn. I l s'ensuit
que l a forme antrieure a faire natre distance une forme de mme
nature qui s'organise spontanment comme forme d'coulement. I l
n' y a pas ici d'tre qui ait tre son futur et son pass, mais seulement
des successions de formes passes, prsentes et futures, mais qui
existent toutes sur l e mode de l'ayant-t , et qui s'influencent
distance les unes les autres. Cette influence se manifestera soit par
pntrati on, soit par motivation. Dans l e premier cas, le rflexif
apprhende comme un seul objet deux objets psychiques qui avaient
d'abord t donns sparment. Il en rsulte soit un objet psychique
neuf dont chaque caractristique sera la synthse des deux autres, soit
un ohjet en lui-mme inintelligihle qui se donne l a fois comme tout
l' un et tout l'autre, sans qu'il y ait altration ni de l'un ni de l ' autre.
Dans la motivati on, au contraire, les deux objets demeurent chacun
sa place. Mais un objet psychique, tant forme organise et multipli
cit d'interpntration, ne peut agir que tout entier la fois sur un
autre objet tout entier. Il s'ensuit une action totale et distance par
influence magique de l'un sur l'autre. Par exemple, c'est mon
humiliation d'hier qui motive tout entire mon humeur de ce matin,
etc. Que cette action distance soit totalement magique et irration
nelle, c'est ce que prouvent, mieux que toute analyse, les efforts vains
des psychologues i ntellectualistes pour la rduire, en restant sur l e
plan du psychi que, une causalit intell igible par une analyse
intellectuel l e. C'est ainsi que Proust cherche perptuellement
retrouver par dcomposition intellectualiste dans la succession tem
porelle des tats psychi ques des liens de causalit rationnel l e entre ces
tats. Mais au terme de ces analyses, i l ne peut nous offrir que des
rsultats semhlahles celui-ci :
Sitt que Swann pouvait se reprsenter (Odette) sans horreur,
203
qu'il revoyait de la bont dans son sourire et que le dsir de l'enlever
tout autre n'tait plus ajour par la jalousie son amour, cet amour
redevenait un got pour les sensations que l ui donnait la personne
d'Odette, pour le plaisir qu'il avait admirer comme un spectacle ou
interroger comme un phnomne, le lever d'un de ses regards, la
formation d'un de ses sourires, J' mission d'une intonation de sa voix.
Et ce pl ai si r diffrent de tous les autres avait fini par crer en lui un
besoin d'elle, qu'elle seule pouvait assouvir par sa prsence ou ses
lettres . . . Ai nsi , par le chimisme mme de son mal, aprs avoir fait de
la jalousie avec son amour, il recommenait fabriquer de la
tendresse, de la pi ti pour Odette 1 .
Ce texte concerne videmment le psychique. On y voit en effet des
sentiments i ndi vi dualiss et spars par nature, qui agissent les uns
sur les autres. Mais Proust cherche clarifier leurs actions et les
classer , esprant par l rendre i ntel ligibles les alternatives par o
Swann doit passer. Il ne se borne pas dcrire les constatations qu'il a
pu faire lui-mme (l e passage par oscillation de la jalousie
haineuse l ' amour tendre), il veut expliquer ces constatations.
Quels sont les rsultats de cette analyse ? L'inintelligibilit du
psychique est-elle leve ? I l est facile de voi r que cette rduction un
peu arbitraire des grandes formes psychiques des lments plus
simples accuse, au contraire, l ' i rrationalit magique des relations que
soutiennent entre eux les objets psychiques. Comment l a jalousie
ajoute-t-elle l'amour le dsir de l'enlever tout autre ? Et
comment ce dsir une fois additionn l'amour (toujours l ' i mage du
nuage de lait ajout au caf) l 'empche-t-il de redevenir un got
pour l es sensations que lui donnait la personne d'Odette ? Et
comment le plaisir peut-il crer un besoi n ? Et l'amour, comment
fabrique-t-il cette j alousie qui , en retour, l ui ajoutera l e dsir
d'enlever Odette tout autre ? Et comment, dlivr de ce dsir, va
t-il de nouveau fabriquer de la tendresse ? Proust tente de constituer ici
un chi mi sme symbolique, mais les images chimiques dont il se sert
sont simplement capables de masquer des motivations et des actions
irrationnelles. On essaie de nous entraner vers une interprtation
mcaniste du psychique qui , sans tre plus intelligible, dformerait
compltement sa nature. Et pourtant, on ne peut s'empcher de nous
montrer entre les tats d'tranges relations presque interhumaines
(crer, fabriquer, ajouter) qui laisseraient presque supposer que ces
objets psychi ques sont des agents anims. Sous les descriptions de
Proust, l'analyse i ntel l ectualiste marque chaque instant ses l i mites :
el l e ne peut oprer ses dcompositions et ses classifications qu'en
surface et sur un fond d'irrationalit totale. I l faut renoncer rduire
l 'irrationnel de l a causalit psychique : cette causalit est l a dgrada-
1 . Du ct de chez Swann, 37' dition, II, p. 82. C'est moi qui souligne.
204
tion en magique, dans un en-soi qui est ce qu'il est sa place, d'un
pour-soi ek-statique qui est son tre distance de soi . L'action
magique di stance et par influence est le rsultat ncessaire de ce
relchement des liens d'tre. Le psychologue doit dcrire ces liens
irrationnels et les prendre comme une donne premire du monde
psychi que.
Ai nsi , l a conscience rflexive se constitue comme conscience de
dure et, par l , l a dure psychique apparat la conscience. Cette
temporalit psychique comme projection dans l'en-soi de la tempora
lit originelle est un tre virtuel dont J'coulement fantme ne cesse
d'accompagner la temporalisation ek-statique du pour-soi , en tant
que cel l e-ci est saisie par l a rflexion. Mais elle disparat totalement si
le pour-soi demeure sur le plan irrflchi ou si la rflexion impure se
purifi e. La temporalit psychique est semblable en ceci la tempora
lit originelle qu'elle apparat comme un mode d'tre d'objets
concrets et non comme un cadre ou une rgle prtabli e. Le temps
psychique n'est que la collection lie des objets temporels. Mais sa
diffrence essentielle avec la temporalit originel l e, c'est qu'il est, au
lieu que cel l e-ci se temporalise. En tant que tel , i l ne peut tre
constitu qu'avec du pass et le futur ne peut tre qu'un pass qui
viendra aprs le pass prsent, c'est--dire que la forme vide avant
aprs est hypostasie et ordonne les relations entre objets galement
passs. En mme temps, cette dure psychique qui ne saurait tre par
soi doit perptuellement tre te. Perptuellement oscillante entre la
multiplicit de juxtaposition et l a cohsion absolue du pour-soi ek
stati que, cette temporalit est compose de maintenant qui ont
t, qui demeurent l a place qui leur est assigne, mais qui
s'influencent distance dans leur totalit ; c'est ce qui la rend assez
sembl abl e la dure magique du bergsonisme. Ds qu'on se place sur
le plan de la rflexion impure, c'est--dire de la rflexion qui cherche
dterminer l'tre que je suis, un monde entier apparat, qui peuple
cette temporalit. Ce monde, prsence virtuelle, objet probable de
mon intention rflexive, c'est le monde psychique ou psych. En un
sens, son existence est purement idale ; en un autre, i l est, puisqu'il
est-t, puisqu' i l se dcouvre l a conscience : i l est mon ombre , i l
est ce qui se dcouvre moi quand je veux me voir ; comme, en outre,
il peut tre ce partir de quoi l e pour-soi se dtermine tre ce qu'il a
tre (je n' i rai pas chez telle ou telle personne cause de
J'antipathie que j' prouve son gard, je me dcide telle ou telle
action en prenant considrati on de ma haine ou de mon amour, je
refuse de d iscuter pol i ti que, car je connais mon temprament
colreux et je ne veux pas risquer de m'irriter) , ce monde fantme
existe comme siruation relle du pour-soi. Avec ce monde transcen
dant qui se loge dans le deveni r infini d' indiffrence antihistorique, se
constitue prcisment comme unit virtuelle d'tre la temporalit dite
205
i nterne " ou qual itative ", qui est l'objectivation en en-soi de la
temporalit origi nel l e. Il y a l l'esquisse premire d'un dehors " :
le pour-soi se voit presque confrer un dehors ses propres yeux ;
mais ce dehors est purement virtuel. Nous verrons plus loin l'tre
pour-autrui ralser l 'bauche de ce dehors
CHAPITRE I I I
La transcendance
Pour parvenir jusqu' une description aussi complte que possible
du pour-soi, nous avions choisi comme fil conducteur l'examen des
conduites ngatives. C'est en effet , nous l ' avons vu, la possibilit
permanente du non-tre, hors de nous et en nous, qui conditionne les
questions que nous pouvons poser et les rponses que l ' on peut y
faire. Mai s notre but premier n'tait pas seulement de dvoiler les
structures ngatives du pour-soi . Dans notre I ntroduction, nous
avions rencontr un problme, et c'est ce problme que nous voulions
rsoudre : quelle est la relation originelle de l a ralit-humaine avec
l'tre des phnomnes ou tre-en-soi ? Ds notre Introducti on, en
effet, nous avons d repousser la solution raliste et la solution
idaliste. Il nous a paru, la foi s, que l'tre transcendant ne pouvait
aucunement agir sur la conscience et que l a conscience ne pouvait
construire le transcendant en objectivant des l ments emprunts
sa subjectivit. Par l a suite, nous avons compris que le rapport
originel l'tre ne pouvait tre la relation externe qui unirait deux
substances primitivement isoles. La relation des rgions d'tre est
un jaillissement primitif, crivions-nous, et qui fait partie de l a
structure mme de ces tres. Le concret s'est dcouvert nous
comme l a totalit synthtique dont l a conscience comme le phno
mne ne constituent que des articulations. Mais si, en un sens, la
conscience considre dans son isole n
i
ent est une abstraction, si les
phnomnes - et mme le phnomne d'tre - sont pareillement
abstraits, en tant qu'ils ne peuvent exister comme phnomnes sans
paratre une conscience, l'tre des phnomnes, comme en-soi qui
est ce qu' i l est, ne saurait tre considr comme une abstraction. Il n' a
besoin pour tre que de lui-mme, i l ne renvoie qu' lui. D'autre part,
notre description du pour-soi nous l'a montr au contraire comme
aussi loign qu'il est possible d' une substance et de l'en soi ; nous
avons vu qu' i l tait sa propre nantisation et qu' i l ne pouvait tre que
207
dans l'unit ontologique de ses ek-stases. Si donc la relation du pour
soi l'en-soi doit tre originellement constitutive de l'tre mme qui
se met en relati on, i l ne faut pas entendre qu'elle puisse tre
constitutive de l ' en-soi , mais bien du pour-soi . C'est dans l e pour-soi
seul qu'il faut chercher la cl de ce rapport l'tre que l'on nomme,
par exempl e , connaissance . Le pour-soi est responsable dans son tre
de sa rel ati on avec l 'en-soi ou, si l 'on prfre, il se produi t
originellement sur le fondement d' une relation l'en-soi . C'est ce que
nous pressenti ons dj lorsque nous dfinissions l a conscience un
tre pour l equel i l est, dans son tre, question de son tre en tant que
cet tre i mpl i que un tre autre que l ui . Mai s, depuis que nous avons
formul cette dfiniti on, nous avons acquis de nouvelles connais
sances. En particulier nous avons saisi l e sens profond du pour-soi
comme fondement de son propre nant. N' est-il pas temps, prsent.
d' uti l iser ces connaissances pour dterminer et expliquer cette
relatIon ek-statique du pour-soi l'en-soi sur l e fondement de laquelle
peuvent apparatre en gnral le connare et l'agir ? Ne sommes-nous
pas en mesure de rpondre notre question premire ? Pour tre
conscience non-thtique (de) soi, la conscience doit tre conscience
thtique de quel que chose , nous l'avons marqu. Or, ce que nous
avons tudi j usqu'ici , c' est l e pour-soi comme mode d' tre originel
de l a conscience non-thtique (de) soi. Ne sommes-nous pas condui t
par l mme dcrire l e pour-soi dans ses relations mmes avec l ' en
soi , en tant que celles-ci sont constitutives de son tre ? Ne pouvons
nous ds prsent trouver une rponse des questions du type de
celles-ci : l 'en-soi tant ce qu' i ! est, comment et pourquoi l e pour-soi
a-t-il tre dans son tre connaissance de l'en-soi ? Et qu'est-ce que la
connaissance en gnral ?
LA CONNAI SSANCE COMME TYPE DE RELATI ON
ENTRE LE POUR SOI ET L' EN SOI
I I n' est d'autre connaIssance qu'intuitive. La dduction et l e
discours, Improprement appels connaissances, ne sont que de
instruments qui conduisent l ' i ntuition. Lorsqu'on attei nt celle-ci, l es
moyens uti liss pour l'attei ndre s'effacent devant elle ; dans l es cas o
el l e ne peut tre attei nte, l e raisonnement et le discours demeurent
comme des plaques i ndicatrices qui pointent vers une i ntui tion hors
de porte ; si , enfi n, elle a t atteinte mais n'est pas un mode present
de ma conscience, les maxi mes dont je me sers demeurent comme des
208
rsultats d'oprations antrieurement effectues, comme ce que
Descartes nommait des souvenirs d'ides . Et si l'on demande ce
qu'est l ' i ntui ti on, Husserl rpondra, d' accord avec l a plupart des
phi losophes, que c'est l a prsence de l a chose (Sache) en personne
la consci ence. La connaissance est donc du type d'tre que nous
dcrivions au chapitre prcdent sous le nom de prsence . . . .
Mais nous avions tabli justement que l'en-soi ne pouvait jamais de
lui-mme tre prsence. L'tre-prsent, en effet, est un mode d'tre
ek-statique du pour-soi. Nous sommes donc obligs de renverser les
termes de notre dfinition : l'intuition est la prsence de la conscience
l a chose. C'est donc sur la nature et le sens de cette prsence du
pour-soi l 'tre que nous devons revenir maintenant.
Nous avions tabli , dans notre I ntroduction, en nous servant du
concept non lucid de conscience , l a ncessit pour la conscience
d' tre conscience de quelque chose. C'est par ce dont elle est
conscience , en effet, qu'elle se distingue ses propres yeux et qu'elle
peut tre consdence (de) soi ; une conscience qui ne serait pas
conscience de quelque chose ne serait conscience (de) rien. Mais
prsentement, nous avons lucid l e sens ontologique de l a cons
cience ou pour-soi. Nous pouvons donc poser le problme en termes
plus prcis et nous demander : que peut signifier cette ncessit pour
l a conscience d'tre-conscience de quelque chose, si on l'envisage sur
le plan ontologique, c'est--dire dans la perspective de l'tre-pour
soi ? On sait que le pour-soi est fondement de son propre nant sous
forme de l a dyade fantme : reflet-refl tant. Le refltant n'est que
pour reflter l e reflet et le refl et n'est reflet qu'en tant qu'il renvoie au
refl tant. Ainsi, les deux termes bauchs de la dyade pointent l'un
vers l'autre et chacun engage son tre dans l ' tre de l'autre. Mais si le
refl tant n'est rien d'autre que refltant de ce reflet et si le reflet ne
peut se caractriser que par son tre pour se reflter dans ce
refltant , les deux termes de la quasi-dyade, accotant l'un contre
l'autre leurs deux nants, s'anantissent conjointement. Il faut que le
refltant reflte quelque chose pour que l'ensemble ne s'effondre pas
dans le ri en. Mais si l e reflet, d'autre part, tait quelque chose,
indpendamment de son tre-po ur-se-reflter, il faudrait qu' i l ft
qualifi non en tant que refl et, mais en-soi. Ce serait introduire
l'opacit dans l e systme reflet-refltant et surtout parachever la
scissiparit bauche. Car dans l e pour-soi , le reflet est aussi le
refltant. Mais si le reflet est qual i fi , il se spare du refltant et son
apparence se spare de sa ralit ; le cogito devient impossible. Le
reflet ne peut tre la foi s quelque chose reflter et rien que s' i l
se fai t qual i fi er par autre chose que l ui ou, si l'on prfre, s' i l se
reflte en tant que relation un dehors qu'il n'est pas. Ce qui dfinit
le reflet pour le refltant, c'est toujours ce quoi il eSI prsence.
Mme une joi e, sa;sie sur le plan de l'irrflchi, n'est rien d'autre que
209
l a p rsence reflte un monde riant et ouvert, plein d' heureuses
perspectives. Mais les quelques lignes qui prcdent nous font dj
prvoir que l e n'tre-pas est structure essentielle de la prsence. La
prsence enveloppe une ngation radicale comme prsence ce qu'on
n'est pas. Est prsent moi ce qui n'est pas moi . On notera d' ai lleurs
que ce n'tre-pas est impliqu a priori par toute thorie de l a
con naissance . I l est i mpossible de construire la notion d'objei si nous
n'avons pas originellement un rapport ngatif dsignant l'objet
comme ce qui n'est pas l a conscience. C'est ce que rendait assez bien
l'expression de non-moi qui fut de mode un temps, sans qu'on pt
dceler, chez ceux qui l ' employai ent, le moindre souci de fonder ce
non " qui qualifiait originellement le monde extrieur. En fai t, ni l a
liaison des reprsentations, ni l a ncessit de certains ensembles
subjectifs, ni l 'irrversibilit temporel l e, ni l e recours l'infini ne
peuvent servir constituer l'objet comme tel, c'est--dire servir de
fondement une ngation ultrieure qui dcouperait l e non-moi et
l'opposerait au moi comme tel , si justement cette ngation n' tait
donne d'abord et si el le n'tait l e fondement a priori de toute
exprience. La chose c'est, avant toute comparaison, avant toute
construction, ce qui est prsent la conscience comme n'tant pas de
la conscience. Le rapport originel de prsence, comme fondement de
la connaissance, est ngatif. Mais comme la ngation vient au monde
par le pour-soi et que l a chose est ce qu'elle est, dans l'indiffrence
absolue de l'identit, ce ne peut tre la chose qui se pose comme
n'tant pas l e pour-soi. La ngation vient du pour-soi lui-mme. Il ne
faut pas concevoir cette ngation sur l e type d'un jugement qui
porterait sur l a chose elle-mme et nierait d' el l e qu'elle ft l e pour
soi : ce type de ngation ne saurait se concevoir que si le pour-soi tait
une substance toute faite et, mme dans ce cas, il ne pourrait maner
que d'un tiers tablissant du dehors un rapport ngatif entre deux
tres. Mais par l a ngation origi nell e, c'est l e pour-soi qui se constitue
comme n'tant pas la chose. En sorte que la dfinition que nous
donnions tout l ' heure de la conscience peut s'noncer comme suit,
dans la perspective du pour-soi : Le pour-soi est un tre pour qui
son tre est en question dans son tre en tant que cet tre est
essentiellement une certaine mani re de ne pas tre un tre qu'il pose
du mme coup comme autre que l ui . La connaissance apparat donc
comme un mode d' tre. Le connatre n'est ni un rapport tabli aprs
coup entre deux tres, ni une activit de l'un de ces deux tres, ni une
qualit ou proprit ou vertu. C'est l ' tre mme du pour-soi en tant
qu' i l est prsence . . . , c'est--dire en tant qu' i l a tre son tre en se
faisant ne pas tre un certain tre qui il est prsent. Cela signifie que
l e pour-soi ne peut tre que sur l e mode d'un reflet se faisant reflter
comme n'tant pas un certain t re. Le quelque chose qui doit
qualifier le reflt, pour que l e couple reflet-refltant ne s' effon-
210
dre pas dans le nant, est ngation pure. Le reflt se fait qualifier
dehors auprs d'un certain tre comme n 'tant pas cet tre ; c'est
prcisment ce qu'on appelle : tre conscience de quelque chose.
Mais il faut prciser ce que nous entendons par cette ngation
originelle. I I convient , en effet, de distinguer deux types de ngation :
la ngation extere et la ngation i nterne. La premire apparat
comme un pur lien d'extriorit tabli entre deux tres par un tmoi n.
Lorsque j e di s, par exemple : La tasse n'est pas l'encrier ^ i l est
bien vident que le fondement de cette ngation n'est ni dans la table
ni dans l'encrier. L'un et l'autre de ces objets sont ce qu' il s sont , voil
tout. La ngation est comme une liaison catgorielle et idale que
j'tablis entre eux sans l es modi fier en quoi que ce soi t, sans l es
enrichi r ni les appauvrir de l a moi ndre qualit : i l s ne sont pas mme
effleurs par cette synthse ngative. Comme elle ne sert ni l es
enri chir ni les constituer, eIl e demeure strictement externe. Mais on
peut dj devi ner le sens de l'autre ngation, si l'on considre des
phrases comme Je ne suis pas riche ou Je ne suis pas beau .
Prononces avec une certaine mlancol i e, elles ne signifient pas
seulement qu'on se refuse une certaine qual i t, mais que le refus l ui
mme vi ent influencer dans sa structure interne l ' tre positif qui on
l'a refuse. Lorsque je dis : Je ne suis pas beau , je ne me borne
pas nier de moi, pris comme tout concret, une certai ne vertu qui , de
ce fai t, passe dans le nant en laissant intacte l a totalit positive de
mon tre (comme lorsque je dis : Le vase n' est pas bl anc, il est
gris - L'encrier n'est pas sur la tabl e, il est sur la chemine ) :
j'entends signifier que ne pas tre beau est une certaine vertu
ngative de mon tre, qui me caractrise de l'intrieur et , en tant que
ngati vi t, c'est une qualit relle de moi-mme que e n'tre pas
beau et cette qualit ngative expliquera aussi bien ma mlancol i e,
par exempl e, que mes insuccs mondai ns. Par ngation interne, nous
entendons une relation telle entre deux tres que celui qui est ni de
l'autre qualifie l ' autre, par son absence mme, au cur de son
essence. La ngation devient alors un lien d' tre essentiel , puisque
l'un au moins des tres sur lesquels elle porte est tel qu' i l inique vers
l'autre, qu'il porte l'autre en son cur comme une absence. II est clair
toutefois que ce type de ngation ne saurait s'appl iquer l'tre-en
soi. I l appartient par nature au pour-soi . Seul l e pour-soi peut tre
dtermin dans son tre par un tre qu'il n'est pas. Et si la ngation
interne peut apparatre dans le monde -comme lorsqu'on dit d'une
perle qu'elle est fausse, d' un fruit qu' i l n'est pas mr, d'un uf qu' i l
n'est pas frai s, etc. -c' est par le pour-soi qu'elle vient au monde,
comme toute ngation en gnral . Si donc c'est au pour-soi seul qu'il
appartient de connatre, c'est qu' i l appartient l ui seul de s'apparatre
comme n'tant pas ce qu'il connat. Et, comme ici apparence et tre
ne font qu'un -puisque le pour-soi a l'tre de son apparence -, il
21 1
faut concevoi r que le pour-soi enveloppe dans son tre l'tre de
l'obje t qu'il n'est pas en tant qu' i l est en question dans son tre
comme n'tant pas cet tre .
Il faut se dprendre ici d' une i l lusion qui pourrait se formuler ainsi :
pour se constituer soi-mme comme n'/alll pas tel tre, il faut
pral ablement avoi r, de quelque manire que ce soit , une connais
sance de cet t re, car je ne pui s j uger de mes di ffrences avec un tre
dont je ne sais ri en. Il est bien certain que dans notre existence
empirique, nous ne pouvons savoir en quoi nous di ffrons d'un
Japonais ou d'un Angl ai s, d'un ouvrier ou d'un souverain avant
d' avoi r quel que noti on de ces diffrents tres. Mais ces distinctions
empi ri ques ne saurai ent nous servir de base ici, car nous abordons
l ' tude d'une relati on ontologique qui doit rendre toute exprience
possi bl e et qui vise tabl i r comment un objet en gnral peut exister
pour l a conscience. Il ne se peut donc que j 'aie quelque exprience de
l'objet comme ohj et qui n'est pas moi , avant de l e constituer comme
obj et . Mais ce qui rend, au contraire, toute exprience possi ble, c'est
un surgissement a priori de l'objet pour l e sujet ou, puisque le
surgissement est le fait originel du pour-soi , un surgissement originel
du pour-soi comme prsence l'ohjet qu' i l n'est pas. I l convient donc
d' i nverser les termes de l a formule prcdente : le rapport fondamen
tal par quoi l e pour-soi a tre comme n'tant pas cel tre particulier
quoi i l est prsent est l e fondement de toute connaissance de cet
tre. Mais il faut mi eux dcrire cette premire relation si nous voulons
la rendre comprhensible .
Ce qui demeure de vrai dans l'nonc de l'illusion intellectualiste
que nous dnoncions au paragraphe prcdent, c'est que je ne puis
me dtermi ner n' tre pas un objet qui est origi nellement coup de
tout l i en avec moi. Je ne puis ni er que j e sois lei tre, distance de cet
tre. Si je conois un tre entirement clos sur soi, cet tre en lui
mme sera tout uni ment ce qu'il est et, de ce fait , i l ne se trouvera de
place en l ui ni pour une ngation, ni pour une connaissance. C'est en
fait parti r de l'tre qu' i l n'est pas qu' un tre peut se faire' annoncer ce
qu'il n' est pas. Ce qui signifi e, dans l e cas de la ngation i nterne, que
c'est l-bas dans et sur J'tre qu'il n'est pas que le pour-soi s'apparat
comme n'tant pas ce qu' i l n'est pas. En ce sens, la ngation interne
est un lien ontologique concret. Il ne s'agit point ici d'une de ces
ngations empi riques o les qual i ts nies se distinguent d'abord par
l eur absence ou mme leur non-tre. Dans la ngation i nterne, l e
pour-soi est cras sur ce qu' i l ni e. Les qualits nies sont prcisment
ce qu' i l y a de pl us prsent au pour-soi , c'est d'el l es qu' i l tire sa force
ngative et qu' i l la renouvelle perpt uellement. En ce sens, il faut les
voir comme un facteur constitutif de son tre, car il doit tre l-bas
hors de lui sur el les, i l doit tre eiles pour nier qu' i l les soit. En un
mot, l e terme-origine de l a ngation interne, c'est J'en-soi, l a chose
212
qui est l ; et en dehors d'elle il n' y a ri en, sinon un vi de, un nant qui
ne se distingue de l a chose que par une pure ngation dont celte chose
fournit le contenu mme. La di fficult que rencontre le matrialisme
driver la connaissance de l'objet vient de ce qu'il veut produire une
substance partir d'une autre substance. Mais cette difficult ne
saurait nous arrter, car nous affirmons qu' i l n'y a, en dehors de l'en
soi, rien, sinon un reflet de ce rien qui est l ui-mme polaris et dfini
par l' en-soi en tant qu' i l est prcisment l e nant de cet en-soi, le rien
individualis qui n'est rien que parce qu' i l n 'est pas l'en-soi. Ainsi,
dans ce rapport ek-statique qui est constitutif de la ngation interne et
de la connaissance, c'est l'en-soi en personne qui est ple concret dans
sa plnitude et le pour-soi n'est rien d'autre que l e vide o se dtache
l ' en-soi . Le pour-soi est hors de lui dans l ' en-soi, puisqu'il se fait
dfinir par ce qu' i l n'est pas ; le lien premier de l 'en-soi au pour-soi est
donc un lien d' tre. Mais ce lien n'est ni un manque, ni une absence.
Dans l e cas de l'absence, en effet, je me fais dterminer par un tre
que je ne suis pas et qui n'est pas, ou n'est pas l : c'est -dire que ce
qui me dtermine est comme un creux au mi l i eu de ce que j 'appellerai
ma plnitude empi ri que. Au contraire dans la connaissance, prise
comme lien d'tre ontologique, l ' tre que je ne suis pas reprsente la
plnitude absolue de l'en-soi. Et j e suis, au contraire, l e nant,
l'absence qui se dtermine l'existence partir de ce plein. Ce qui
signifie que dans ce type d'tre qu' on appelle l e connatre, l e seul tre
qu' on puisse rencontrer et qui est perptuellement l, c'est le connu.
Le connaissant n' est pas, il n'est pas saisissabl e. Il n'est rien d'autre
que ce qui fait qu' i l y a un tre-l du connu, une prsence -car de lui
mme l e connu n' est ni prsent ni absent, il est simplement. Mais
cette prsence du connu est prsence rien, puisque le connaissant est
pur reflet d'un n' tre-pas, elle parat donc, travers la translucidit
totale du connaissant, comme prsence absolue. L'exemplification
psychologique et empirique de cette relation originelle nous est
fournie par les cas de fascination. Dans ces cas, en effet, qui
reprsentent l e fait immdiat du connatre, le connaissant n'est
absolument rien qu'une pure ngati on, il ne se trouve ni ne se
rcupre nul l e part, i l n'est pas ; la seule qualification qu' i l puisse
supporter, c'est qu' i l n'est pas, prcisment, tel objet fascinant. Dans
la fascination i l n' y a plus rien qu' un objet gant dans un monde
dsert. Et pourtant, l'intuition fascine n' est aucunement fusion avec
l'obj et. Car la condition pour qu' il y ait fascination, c'est que l'objet
s'enlve avec un relief absolu sur un fond de vide, c'est -dire que j e
sois prcisment ngation i mmdi ate de l ' objet et rien que cela. C'est
encore cette ngation pure que nous rencontrons la base des
intuitions panthistiques que Rousseau a parfois dcrites comme des
vnements psychiques concrets de son histoire. Il nous dclare alors
qu'il se fondait avec l'univers, que l e monde seul se trouvait
213
soudai n prsent , comme prsence absolue et totalit inconditionne.
Et certes, nous pouvons comprendre cette prsence totale et dserte
du monde, son pur t re-l , certes nous admettons fort bien qu'
ce moment privilgi, i l n'y ait rien eu d'autre que le monde. Mais
cela ne signifie point, comme Rousseau veut l'admettre, qu'il y ait
fusi on de la conscience avec le monde. Cette fusion signifierait la
sol i di fication du pour-soi en en-soi et , du coup, la disparition du
monde et de l'en-soi
comme prsence. I l est vrai qu' i l n'y a rien de
plus que le monde, dans l'intuition panthistique, sauf ce qui fait que
l'en-soi est prsent comme monde, c'est--dire une ngation pure qui
est conscience non-thtique (de) soi comme ngation. Et, prcis
ment parce que la connaissance n' est pas absence mais prsence, il n'y
a rien qui spare le connaissant du connu. On a souvent dfini
l ' i ntui ti on comme prsence i mmdiate du connu au connaissant, mais
il est rare qu'on ai t rflchi sur les exigences de la notion d'immdiat.
L'immdiatet est l' absence de tout mdiateur ; et cela va de soi ,
si non l e mdi ateur serai t connu et non le mdi ati s. Mai s si nous ne
pouvons poser aucun i ntermdiaire, i l faut que nous repoussions la
fois l a continuit et l a discontinuit comme type de prsence du
connaissant au connu. Nous n' admettrons pas, en effet, qu' i l y a
continuit du connaissant au connu, car elle suppose un terme
i ntermdiaire qui soit la fois connaissant et connu, ce qui supprime
l 'autonomie du connaissant en face du connu en engageant l'tre du
connaissant dans l'tre du connu. La structure d'objet disparat alors,
puisque l'objet exige d 'tre ni absolument par l e pour-soi en tant
qu'tre du pour-soi. Mais nous ne pouvons pas non plus considrer le
rapport originel du pour-soi l ' en-soi comme un rapport de disconti
nuit. Certes, la sparation entre deux lments discontinus est un
vide, c'est--dire un rien, mais un rien ralis, c'est--dire en-soi. Ce
rien substantialis est comme tel une paisseur non conductrice, il
dtruit l ' i mmdiat de l a prsence, car i l est devenu quelque chose en
tant que ri en. La prsence du pour-soi l 'en-soi ne pouvant
s'exprimer ni en termes de continuit ni en termes de discontinuit est
pure identit nie. Pour la faire mieux saisir, usons d'une comparai
son : lorsque deux courbes sont tangentes l ' une l'autre, elles offrent
un type de prsence sans intermdiaires. Mais aussi l ' i l ne saisit-il
qu une seule ligne sur toute la longueur de leur tangence. Si mme
l' on masquai t les deux courbes et qu' il ft seulement permis de voir la
longueur AB o elles sont tangentes l'une l'autre, il serait
i mpossible de les di stinguer. C'est qu'en effet, ce qui les spare est
rien : i l n' y a ni continuit ni discontinuit, mais pure identit.
Dmasquons tout coup les deux figures, et nous les saisirons de
nouveau comme tant deux sur toute l eur longueur ; et cel a ne vient
pas d' une brusque sparation de fait, qui se serait ralise tout coup
entre elles, mais de ce que les deux mouvements par lesquels nous
21 4
tirons les deux courhes pour les percevoir enveloppent chacun une
ngation comme acte constituant. Ainsi, ce qui spare les deux
courhes au lieu mme de leur tangence n'est rien, mme pas une
distance : c'est une pure ngati vi t comme contrepartie d'une syn
thse constituante. Cette image nous fera mieux saisir l e rapport
d' i mmdiatet qui unit origi nel l ement le connaissant au connu. Il se
trouve en effet, l'ordinaire, qu' une ngation porte sur un quelque
chose qui prexiste la ngation et en constitue la matire : si je
di s, par exempl e, que l ' encrier n' est pas la tabl e, tahle et encrier sont
des objets dj constitus dont l'tre en soi fera le support du
jugement de ngatif. Mais, dans l e cas du rapport connaissant
connu , i l n'y a rien du ct du connaissant qui puisse faire l e support
de l a ngation : i l n'y a aucune diffrence, aucun principe de
distinction pour sparer en-soi l e connaissant du connu. Mai s, dans
l ' i ndistinction totale de l'tre, il n'y a rien qu'une ngation qui n'est
mme pas, qui a tre, qui ne se pose mme pas comme ngation. En
sorte que la connaissance , final ement, et l e connaissant lui-mme ne
sont ri en sinon le fait qu'il y a de l'tre, que l'tre en soi se donne
et s'enlve en relief sur l e fond de ce rien. En ce sens nous pouvons
appel er la connaissance : la pure solitude du connu. C'est assez di re
que le phnomne originel de connaissance n 'ajoute rien l'tre et ne
cre ri en. Par l ui l ' tre n'est pas enrichi, car la connaissance est
ngativit pure. El l e fait seulement qu'il y ait de l'tre. Mais ce fait
qu' i l y ait de l'tre n'est pas une dtermination i nterne de l'tre
qui est ce qu'il est - mais de la ngativit. En ce sens tout
dvoil ement d'un caractre positif de l'tre est la contrepartie d'une
dtermination ontologique du pour-soi dans son tre comme ngati
vit pure. Par exempl e, comme nous le verrons plus l oi n, le
dvoi l ement de la spatialit de l'tre ne fait qu'un avec l ' apprhension
non positionne Ile du pour-soi par lui-mme comme intendu. Et le
caractre intendu du pour-soi n'est point une mystrieuse vertu
positive de spiritualit qui se masquerait sous une dnomination
ngative : c'est une relation ek-statique par nature, car c'est par et
dans l 'extension de l ' en-soi transcendant que l e pour-soi se fait
annoncer et ralise sa propre inextension. Le pour-soi ne saurait tre
i ntendu d'abord pour entrer ensuite en relation avec un tre tendu
car, de quelque faon que nous l e considrions, l e concept d' i ntendu
ne saurait avoir de sens par soi , il n'est rien que ngation de l'tendue.
Si l ' on pouvait supprimer, par i mpossibl e, l'tendue des dtermina
tions dvoil es de l'en-soi , le pour-soi ne demeurerait pas aspatial, il
ne serait ni tendu ni intendu et i l deviendrait impossible de l e
caractriser d'une faon quelconque par rapport l'tendue. En ce
cas, l ' tendue est une dtermination transcendante que le pour-soi a
apprhender dans la mesure exacte o i l se ni e lui-mme comme
tendu. C'est pourquoi le terme qui nous parat l e mieux signifier ce
215
rapport i nterne du connatre et de l'tre est le mot de raliser , que
nous uti lisions tout l'heure, avec son double sens ontologique et
gnost i que. Je ralise un projet en tant que je lui donne l 'tre, mais je
ralise aussi ma situati on en tant que j e la vi s, que je la fais tre avec
mon tre, je ralise la grandeur d'une catastrophe, la di fficult
d'une entreprise. Connatre, c'est raliser aux deux sens du terme.
C'est faire qu'il y ait de l'tre en ayant tre l a ngation reflte de
cet tre : le rel est ralisation. Nous appellerons transcendance cette
ngation interne et ralisante qui dvoile l 'en-soi en dterminant le
pour-soi dans son tre.
Il
DE LA DTERMI NATI ON COMME NGATI ON
A quel tre l e pour-soi est-il prsence ? Notons tout de suite que la
question est mal pose : l'tre est ce qu'il est, il ne peut possder en
l ui-mme la dtermi nation celui-ci qui rpond l a question
lequel ? En un mot , la question n' a de sens que si elle est pose
dans un monde. En consquence, le pour-soi ne peut tre prsent
celui-ci plutt qu' celui-l, puisque c'est sa prsence qui fait qu'il y a
un celui-ci plutt qu' un celui-l . Nos exemples, pourtant,
nous ont montr un pour-soi niant concrtement qu'il soit un tel tre
singulier. Mais c'est que nous dcrivions l e rapport de connaissance
en nous souciant avant tout de mettre au jour sa structure de
ngativit. En ce sens, du fait mme qu'elle tait dvoile sur des
exemples,
cette ngativit tait dj seconde. La ngativit comme
transcendance originelle ne se dtermine pas partir d'un ceci, mais
el l e fai t qu' un ceci exi ste. La prsence originelle du pour-soi est
prsence l ' tre. Dirons-nous al ors qu'elle est prsence toul l'tre ?
Mais nous retomberions dans notre erreur prcdente. Car la totalit
ne peut venir l'tre que par le pour-soi . Une totalit, en effet,
suppose un rapport interne d' tre entre les termes d'une quasi
multiplici t, de la mme faon qu'une mul ti plicit suppose, pour tre
cette mul ti pl i ci t, un rapport interne totalisateur entre ses lments ;
c'est en ce sens que l'addition elle-mme est un acte synthtique. La
totalit ne peut veni r aux tres que par un tre qui a tre en leur
prsence sa propre totalit. C'est prcisment le cas du pour-soi,
totalit dtotalise qui se temporalise dans un inachvement perp
tuel . C'est le pour-soi dans sa prsence l' tre qui fait qu' i l y ait tout
l 'tre. Entendons bien en effet que cet tre-ci ne peut tre dnomm
comme ceci que sur fond de prsence de tout l'tre. Cela ne veut point
216
dire qu'un tre ait besoin de tout l ' tre pour exister, mais que le pour
soi se ralise comme prsence ralisante cet tre sur fond originel
d'une prsence ralisante tout. Mais rciproquement l a totalit,
tant relation interne ontologique des ceci, ne peut se dvoiler que
dans et par les ceci singuliers. Ce qui signifie que le pour-soi se ralise
comme prsence ralisante tout l'tre, en tant que prsence
ralisante aux ceci - et aux ceci singuliers en tant que prsence
ralisante tout l'tre. En d'autres termes, l a prsence au monde du
pour-soi ne peut se raliser que par sa prsence une ou plusieurs
choses particulires et, rciproquement, sa prsence une chose
particulire ne se peut raliser que sur le fond d' une prsence au
monde. La perception ne s'articule que sur le fond ontologique de la
prsence au monde et le monde se dvoile concrtement comme fond
de chaque perception si ngulire. Reste expliquer comment l e
surgissement du pour-soi l'tre peut faire qu' i l y ait un toUl et des
ceci.
La prsence du pour-soi l'tre comme totalit vient de ce que le
pour-soi a tre, sur le mode d'tre ce qu'il n'est pas et de n' tre pas
ce qu'il est , sa propre totalit comme totalit dtotalise. En tant, en
effet, qu' i l se fait tre dans l'unit d'un mme surgissement comme
tout ce qui n'est pas l ' tre, l'tre se tient devant lui comme toUl ce que
l e pour-soi n'est pas. La ngation originelle, en effet, est ngation
radicale. Le pour-soi, qui se tient devant l ' tre comme sa propre
totalit, tant lui-mme le tout de la ngation est ngation du tout.
Ai nsi , l a totalit acheve ou monde se dvoile comme constitutive de
l'tre de la totalit i nacheve par qui l'tre de l a totalit surgit l'tre.
C'est par l e monde que le pour-soi se fai t annoncer lui-mme
comme totalit dtotalise, ce qui signifie que, par son surgissement
mme, l e pour-soi est dvoilement de l'tre comme totalit, en tant
que le pour-soi a tre sa propre totalit sur le mode dtotalis. Ainsi
l e sens mme du pour-soi est dehors dans l'tre, mais c'est par le
pour-soi que l e sens de l' tre apparat. Cette totalisation de l'tre
n'ajoute rien l' tre, elle n'est rien que l a manire dont l'tre se
dvoile comme n
'
tant pa le pour-soi, la manire dont il y a de l'tre ;
elle parat hors du pour-soi, chappant toute atteinte, comme ce qui
dtermine l e pour-soi dans son tre. Mais l e fait de dvoiler l'tre
comme totalit n'est pas une atteinte l'tre, pas plus que le fait de
compter deux tasses sur la table n'atteint chacune des tasses dans son
existence ou dans sa nature. Ce n'est pourtant pas une pure
modification subjective du pour-soi puisque c'est par lui, au contraire,
que toute subjectivit est possi bl e. Mais, si l e pour-soi doit tre le
nant par quoi il y a de l'tre, il ne peut y avoir de l'tre
originellement que comme total i t . Ainsi donc, la connaissance est le
monde ; pour parler comme Heidegger : l e monde et, en dehors de
cela, rien. Seulement ce rien n'est pas originellement ce dans quoi
217
merge la ralit-humaine. Ce rien est la ralit-humaine el l e-mme,
comme l a ngation radicale par quoi le monde se' dvoi l e. Et, certes,
la seule apprhension du monde comme totalit fait apparatre du
ct du monde un nant qui soutient et encadre cette totalit. C'est
mme ce nant qui dtermine la totalit comme telle en tant que le
rien absolu qui est laiss en dehors de la totalit : c'est bien pour cela
que la total isation n'ajoute rien l'tre puisqu'elle est seulement le
rsultat de l' apparition du nant comme l i mi te de l'tre. Mais ce
nant n'est rien, sinon la ralit-humaine se saisissant elle-mme
comme exclue de l ' tre et perptuellement par del l'tre, en
commerce avec l e ri en. Il revient au mme de dire : l a ralit
humaine est ce par quoi l'tre se dvoile comme totalit - ou la
ralit-humaine est ce qui fait qu' i l n' y a rien en dehors de l'tre.
Ce rien comme possibilit qu'il y ai t un par-del du monde, en tant :
1 que cette possibilit dvoile l'tre comme monde ; 2" que la ralit
humaine a tre cette possibilit - consti tue, avec la prsence
originelle l ' tre, l e circuit de l'ipsit.
Mais la ralit-humaine ne se fait totalit i nacheve des ngations
qu' en tant qu' el l e dborde une ngation concrte qu'elle a tre
comme prsence actuelle l'tre. Si elle tait en effet pure conscience
(d' ) tre ngation syncrtique et indiffrencie, elle ne pourrait se
dterminer el l e-mme et donc ne pourrait tre totalit concrte,
quoique dtotalise, de ses dterminations. Elle n'est totalit qu'en
tant qu' el l e chappe, par toutes ses autres ngations, la ngation
concrte qu'el l e est prsentement : son tre ne peut tre sa propre
totalit que dans la mesure o i l est dpassement, vers le tout qu' i l a
tre, de la structure partielle qu' i l est. Sinon il serait ce qu' i l est
simplement et ne pourrait aucunement tre considr comme totalit
ou comme non-totalit. Au sens, donc, o une structure ngative
partielle doit paratre sur le fond des ngations i ndiffrencies que je
suis -et dont el l e fait partie -je me fais annoncer par l'tre-en-soi
une certaine ralit concrte que j'ai n'tre pas. L'tre que je ne suis
pas prsentement, en tant qu' i l parat sur le fond de la totalit de
l'tre, c'est le ceci. Ceci , c'est ce que je ne suis pas prsentement, en
tant que j 'ai n'tre ri en de l'tre ; c'est ce qui se dvoile sur fond
i ndiffrenci d' tre, pour m'annoncer la ngation concrte que j' ai
tre sur le fond totalisateur de mes ngations. Cette relation originelle
du tout et du ceci est l a source de la relation que l a Gestalllheorie
a mise au jour entre le fond et la forme. Le ceci parat toujours sur un
fond, c'est--dire sur la totalit i ndiffrencie de l ' tre en tant que le
pour-soi en est ngation radicale et syncrtique. Mai s il peut toujours
se di l uer dans cette totalit i ndiffrencie lorsque surgira un autre
ceci. Mais l'apparition du ceci ou de la forme sur le fond, tant
corrlative de l ' apparition de ma propre ngation concrte sur le fond
syncrtique d'une n gation radicale, implique que je sois et ne sois
218
pas la fois cette ngation totalitaire ou, si l' on prfre, que je la sois
sur le mode du n'tre-pas , que je ne l a sois pas sur l e mode de
l'tre. C'est seul ement ainsi, en effet, que l a ngation prsente
paratra sur l e fond de la ngation radicale qu'elle est. Sinon, en effet ,
elle en serait entirement coupe ou bi en elle se fondrait en el l e.
L'apparition du ceci sur l e tout est corrlative d' une certaine faon
qu'a le pour-soi d'tre ngation de lui-mme. Il y a un ceci parce que
je ne sui s pas encore mes ngations futures et que j e ne suis pl us mes
ngations passes. Le dvoilement du ceci suppose que l ' accent soi t
mi s sur une certaine ngation avec recul des autres dans l'vanouis
sement syncrtique du fond, c'est--dire que le pour-soi ne puisse
exister que comme une ngation qui se constitue sur le recul en
totalit de l a ngativit radicale. Le pour-soi n'est pas le monde, l a
spatialit, la permanence, l a matire, bref l 'en-soi en gnral, mais sa
manire de ne-I es-tre-pas c'est d' avoir ne pas tre cette table, ce
verre, cette chambre sur le fond total de ngativit. Le ceci suppose
donc une ngation de l a ngation -mais une ngation qui a tre la
ngation radical e qu' el l e nie, qui ne cesse de s'y rattacher par un fil
ontologique et qui reste prte s'y fondre par surgissement d' un autre
ceci. En ce sens le ceci se dvoile comme ceci par recul en fond de
monde de tous les autres ceci, sa dtermination -qui est l'origine
de toutes les dterminations -est une ngation. Entendons bien que
cette ngation -vue du ct du ceci -est tout i dal e. El l e n'ajoute
rien l'tre et ne lui retranche rien. L'tre envisag comme ceci est ce
qu'il est et ne cesse pas de l'tre, i l ne devient pas. En tant que tel, il
ne peut pas tre hors de lui-mme dans l e tout comme structure du
tout, ni non plus tre hors de l ui -mme dans l e tout pour nier de l ui
mme son i denti t avec l e tout. La ngation ne peut veni r au ceci que
par un tre qui a tre la fois prsence au tout de l ' tre et au ceci,
c'est--dire par un tre ek-statique. Et comme elle laisse le ceci intact
en tant qu'tre en soi, comme elle n'opre pas une synthse relle de
tous les ceci en total i t, la ngation constitutive du ceci est une
ngation du type extere, la relation du ceci au tout est une relation
d'extriorit. Ainsi voyons-nous paratre l a dtermination comme
ngation externe corrlative de l a ngation interne, radicale et
ek-statique que je suis. C'est ce qui explique l e caractre ambigu du
monde qui se dvoile la fois comme totalit synthtique et comme
collection purement additive de tous les ceci. En tant, en effet, que le
monde est totalit qui se dvoile comme ce sur quoi le pour-soi a
tre radicalement son propre nant, le monde s'offre comme syncr
tisme d' i ndiffrenciati on. Mais en tant que cette nantisation radicale
est toujours par del une nantisation concrte et prsente, l e monde
parat toujours prt s'ouvrir comme une bote pour laisser appara
tre un ou plusieurs ceci qui taient dj, au sein de l'indiffrenciation
du fond, ce qu'il s sont maintenant comme forme diffrencie. Ainsi,
219
en nous rapprochant progressivement d' un paysage qui nous tait
donn par grandes masses, voyons-nous apparatre des objets qui se
donnent comme ayant t dj l titre d' l ments d' une collection
discont i nue de ceci ; ainsi, dans les expriences de la Gestalttheorie, le
fond continu, lorsqu' i l est apprhend comme forme, clate en
multiplicit d'lments discontinus. Ainsi le monde, comme corrlatif
d'une totalit dtotalise, apparat comme totalit vanescente , en ce
sens qu' i l n'est jamais synthse relle mais l i mitation idale par l e rien
d'une col lection de ceci. Ainsi le continu comme qualit formelle du
fond l aisse-t-il paratre le discontinu comme type de la relation
externe entre l e ceci et l a totalit. C'est prcisment cette vanes
cence perptuelle de l a totalit en collection, du continu en discontinu
que l'on appelle l ' espace. L'espace en effet ne saurait tre un tre. I l
est un rapport mouvant entre des tres qui n'ont aucun rapport. Il est
la totale indpendance des en-soi, en tant qu'elle se dvoile un tre
qui est prsence tout l'en-soi comme i ndpendance des uns par
rapport aux autres ; c'est la faon unique dont des tres peuvent se
rvler comme n'ayant aucun rapport, l'tre par qui l e rapport vient
au monde ; c'est--dire l'extriorit pure. Et comme cette extriorit
ne peut appartenir ni l'un ni l'autre des ceci considrs, et que, par
ai l leurs, en tant que ngativit purement locale elle est destructrice
d'elle-mme, elle ne peut ni tre de soi , ni tre te L'tre
spatialisant est le pour-soi en tant que co prsent au tout et au ceci ;
l ' espace n'est pas le monde mais c'est l'i nstabilit du monde saisi
comme total i t, en tant qu' i l peut toujours se dsagrger en multipli
cit externe. L'espace n'est pas l e fond ni la forme, mais l'idalit du
fond en tant qu' i l peut toujours se dsagrger en formes, i l n'est ni le
continu ni l e discont i nu, mais le passage permanent du continu au
discontinu. L'existence de l'espace est la preuve que l e pour-soi en
faisant qu'il y ait de l 'tre n'ajoute rien l'tre, il est l'idalit de la
synthse. En ce sens il est l a fois totalit, dans l a mesure o i l tire
son origine du monde et la fois rien en tant qu'il aboutit au
pullulement des ceci. Il ne se laisse pas apprhender par l'intuition
concrte, car il n'est pas mais il est spatialis continment. Il dpend
de l a temporalit et apparat dans la temporalit en tant qu'il ne peut
venir au monde que par un tre dont l e mode d'tre est la
temporalisati on, car il est la faon dont cet tre se perd ek
statiquement pour raliser l'tre. La caractristique spatiale du ceci
ne s'ajoute pas synthtiquement au ceci, mais elle est seulement sa
place , c'est--dire son rapport d'extriorit au fond en tant que ce
rapport peut s'effondrer en multiplicit de rapports externes avec
d'autres ceci quand le fond lui-mme se dsagrge en multiplicit de
formes. En ce sens il serait vain de concevoir l'espace comme une
forme impose par la structure a priori de notre sensibilit aux
phnomnes : l'espace ne saurait tre une forme car i l n'est rien ; il
220
est, au contraire, la marque que rien, sinon la ngation - et encore
comme type de rapport externe qui l aisse intact ce qu' i l unit - ne
peut veni r J'en-soi par le pour-soi. Quant au pour-soi , s' i l n'est pas
l'espace, c'est qu' i l s'apprhende prcisment comme n'tant pas
J ' tre-en-soi en tant que l'en-soi se dvoile lui sur le mode
d'extriorit qu'on nomme l'tendue. C'est prcisment en tant qu'il
nie de lui-mme l'extriorit en se saisissant comme ek-statique qu'il
spatialise J'espace. Car le pour-soi n'est pas avec l'en-soi dans un
rapport de juxtaposition ou d'extriorit indiffrente : sa relation
avec J'en-soi comme fondement de toutes les relations est l a ngation
interne et il est au contraire ce par quoi l'tre-en-soi vient
l'extriorit i ndiffrente par rapport d' autres tres existant dans un
monde. Lorsque J'extriorit d' i ndiffrence est hypostasie comme
substance existant en et par soi -ce qui ne peut se produire qu' un
stade i nfrieur de l a connaissance -, elle fait l'objet d'un type
d'tudes particulier sous le nom de gomtrie et devient une pure
spcification de la thorie abstraite des multiplicits.
Reste dterminer quel type d'tre possde l a ngation externe en
tant qu'elle vient au monde par l e pour-soi . Nous savons qu'elle
n'appartient pas au ceci : ce journal ne nie pas de lui-mme qu'il soit
l a table sur laquelle i l s'enlve, inon i l serait ek-statiquement hors de
soi dans l a table qu'il nie et sa relation elle serait une ngation
interne ; il cesserait par l mme d'tre en-soi pour devenir pour-soi.
La relation dterminative du ceci ne peut donc appartenir ni au ceci ni
au cela ; elle les cerne sans les toucher, sans leur confrer l e moindre
caractre neuf ; elle les laisse pour ce qu'ils sont. En ce sens nous
devons modifier la clbre formule de Spinoza : Omnis determina
tio est negatio , dont Hegel disait que sa richesse est infinie, et
dclarer plutt que toute dtermination qui n'appartient pas l'tre
qui a tre ses propres dterminations est ngation idale. I l serait
inconcevable d'ail leurs qu'il en ft autrement. Mme si nous consid
rions les choses, la manire d'un psychologisme empi rio-criticiste,
comme des contenus purement subjectifs, on ne pourrait concevoir
que le sujet ralist des ngations synthtiques internes entre ces
contenus moins de les tre dans une i mmanence ek-statique radicale
qui terait tout espoir d'un passage l'objectivit. A plus forte raison
nous ne pouvons imaginer que le pour-soi opre des ngations
synthtiques dformantes entre des transcendants qu'il n'est pas. En
ce sens la ngation externe constitutive du ceci ne peut paratre un
caractre objectif de la chose, si nous entendons par objectif ce qui
appartient par nature J'en-soi -ou ce qui, d'une manire ou d'une
autre, constitue rellement l'objet comme il est. Mais nous ne devons
pas en conclure que la ngation externe a une existence subjective
comme pur mode d'tre du pour-soi. Le type d'existence du pour-soi
est pure ngation interne, l'existence en lui d'une ngation externe
221
serait di ri mante pour son existence mme. Elle ne saurait tre, par
consquent, une manire de disposer et de classer les phnomnes en
tant qu'ils ne seraient que des phantasmes subjectifs, el l e ne saurait
non plus subjectiviser l'tre en tant que son dvoilement est
constitutif du pour-soi . Son extriorit mme exige donc qu'elle
demeure en l'air extrieure a u pour-soi comme l'en-soi. Mais
d'autre part, prcisment parce qu'elle est extriorit, elle ne peut
tre par soi, elle refuse tous les supports, elle est unselbstsUindig
par nature et pourtant ne peut se rapporter aucune substance. Elle
est un rien. C'est bien parce que l ' encrier n'est pas l a table -ni non
plus la pipe ni le verre, etc. - que nous pouvons l e saisir comme
encrier. Et pourtant, si je di s : l'encrier n'est pas l a table, je ne pense
rien. Ainsi la dtermination est un rien qui n'appartient titre de
structure interne ni la chose ni la conscience, mais dont l'tre est
d'tre-cit par le pour-soi travers un systme de ngations internes
dans lesquelles l'en-soi se dvoile dans son indiffrence tout ce qui
n'est pas soi . En tant que l e pour-soi se fait annoncer par l 'en-soi ce
qu' i l n'est pas, sur le mode de l a ngation interne, l ' i ndi ffrence de
l ' en-soi en tant qu' i ndiffrence que l e pour-soi a n'tre pas se rvle
dans l e monde comme dtermination.
I I I
QUALI T ET QUANTI T, POTENTI ALI T, USTENSI LIT
La qual i t n' est rien d 'autre que l ' tre du ceci lorsqu' i l est considr
en dehors de toute relation externe avec le monde ou avec d'autres
ceci. On l'a trop souvent conue comme une simple dtermination
subjective et son tre-qualit a t confondu alors avec la subjectivit
du psychi que. Le probl me a paru alors tre surtout d'expliquer l a
constitution d' un ple-objet, conu comme l'unit transcendante des
qualits. Nous avons montr que ce problme est insoluble. Une
qualit ne s'objective pas si elle est subjective. A supposer que nous
ayons projet l'unit d' un ple-objet au-del des qualits, chacune de
celleS-CI, au mi eux, se donnerait di rectement comme l'effet subjectif
de l'action des choses sur nous. Mais le jaune du citron n'est pas un
mode subjectif d' apprhension du citron : i l est le citron. Et il n'est
pas vrai non plus que l'x-objet apparaisse comme la forme vide qui
retient ensemble des qualits disparates. En fai t, le ci tron est tendu
tout travers ses qual i ts et chacune de ses qualits est tendue tout
travers chacune des autres. C'est l'acidit du citron qui est jaune, c'est
le j aune du citron qui est acide ; on mange l a couleur d'un gteau et le
222
got de ce gteau est l 'instrument qui dvoile sa forme et sa couleur
ce que nous appellerons l'intuition alimentaire ; rciproquement, si je
plonge mon doigt dans un pot de confitures, la froideur gluante de
cette confiture est rvlation de son got sucr mes doigts. La
flui di t, la tideur, la couleur bleutre, la mobilit onduleuse de l'eau
d'une piscine sont donnes d'un coup au travers les unes des autres et
c'est cette i nterpntration totale qui se nomme l e ceci. C'est ce que
les expriences des peintres et en particulier de Czanne ont bien
montr : il n'est pas vrai , comme l e croit Husserl, qu'une ncessit
synthtique unisse inconditionnellement la couleur et la forme ; mais
c'est l a forme qui est couleur et lumire ; si l e peintre fait varier l'un
quelconque de ces facteurs les autres varient aussi, non parce qu'ils
seraient lis par on ne sait quelle l oi mais parce qu'ils ne sont au fond
qu' un seul et mme tre. En ce sens, toute qualit de l'tre est tout
l'tre ; elle est la prsence de son absolue contingence, elle est son
irrductibilit d'indiffrence ; l a saisie de la qualit n'ajoute rien
l'tre sinon le fait qu'il y a de l'tre comme ceci. En ce sens la qualit
n'est point un aspect extrieur de l'tre : car l'tre, n'ayant point de
dedans , ne saurait avoir de dehors . Simplement, pour qu'il y
ai t qualit, il faut quil y ait de l'tre pour un nant qui par nature ne
soit pas l'tre. Pourtant l ' tre n' est pas en soi qual i t, quoi qu' i l ne soit
rien de pl us ni de moi ns. Mais la qualit, c'est l'tre tout entier se
dvoilant dans les l imites du il y a . Ce n'est point le dehors de
l'tre, c'est tout l 'tre en tant qu'il ne peut y avoir de l ' tre pour l'tre
mais seulement pour ce qui se fait n'tre pas l ui . La relation du pour
soi la qualit est relation ontologique. L'intuition de la qualit n'est
point la contemplation passive d'un donn et l'esprit n'est point un
en-soi qui demeure ce qu' i l est dans cette contemplation, c'est--dire
qui reste sur le mode de l ' i ndi ffrence par rapport au ceci contempl.
Mais le pour-soi se fait annoncer ce qu'il n'est pas par l a qualit.
Percevoir l e rouge comme couleur de ce cahier c'est se reflter soi
mme comme ngation interne de cette qualit. C'est--dire que
l'apprhension de la qualit n'est pas remplissement (Erfllung)
comme le veut Husserl, mais i nformation d' un vide comme vide
dtermin de cette qualit. En ce sens l a qualit est prsence
perptuellement hors d'atteinte. Les descriptions de la connaissance
sont trop frquemment alimentaires. Il reste encore trop de prlo
gisme dans la philosophie pistmologique et nous ne sommes pas
encore dbarrasss de cette i l lusion primitive (dont il nous faudra
rendre compte plus l oi n) suivant laquelle connatre, c'est manger,
c'est--dire ingrer l ' objet connu, s'en remplir (ErfllIung) et l e
digrer assimilation ). Nous rendrons mi eux compte du phno
mne originel de l a perception en insistant sur l e fait que la qualit se
tient par rapport nous dans un rapport de proximit absolue -elle
est l , elle nous hante -sans se donner ni se refuser, mais il faut
223
ajouter que cette proximit implique une distance. Elle est ce qui est
i mmdiatement hors d' atteinte, ce qui , par dfinition, nous indique
nous-mme comme un vi de. Ce dont la contemplation ne peut
qu'accrotre notre soif d'tre, comme l a vue des nourritures hors
d'atteinte augmentait l a faim de Tantale. La qualit est l' i ndication de
ce que nous ne sommes pas et du mode d' tre qui nous est refus. La
perception du bl anc est conscience de l ' i mpossibilit de principe que
l e pour-soi existe comme couleur, c'est--dire en tant ce qu' il est. En
ce sens, non seulement l'tre ne se distingue pas de ses qualits mais
encore toute apprhension de qualit est apprhension d'un ceci, la
qualit quel l e qu' elle soit se dvoile nous comme un tre. L'odeur
que je respire soudai n, les yeux clos, avant mme que j e l ' ai e
rapporte un objet odorant, est dj un tre-odeur et non une
i mpression subjective ; la l umi re qui frappe mes yeux, l e mati n,
travers mes paupires closes, est dj un tre-lumire. C'est ce qui
paratra vi dent pour peu qu' on rflchisse que la qualit est. En tant
qu'tre qui est ce qu' i l est, elle peut bien apparatre une subjectivit
mais elle ne peut s'insrer dans l a trame de cette subjectivit qui est ce
qu'elle n'est pas et qui n' est pas ce qu' el l e est. Di re que la qualit est
un tre-qual i t, ce n' est nul l ement la doter d'un support mystrieux
analogue l a substance, c'est simplement faire remarquer que son
mode d'tre est radicalement diffrent du mode d'tre pour-soi
L'tre de la blancheur ou de l'acidit, en effet, ne saurait aucunement
tre saisi comme ek-statique. Si l'on demande, prsent, comment i l
se fait que l e ceci ai t des qualits, nous rpondrons qu' en fait l e
ceci se libre comme totalit sur fond de monde et qu' i l se donne
comme uni t i ndiffrencie. C'est le pour-soi qui peut se ni er de
diffrents points de vue en face du ceci et qui dvoile l a qualit
comme un nouveau ceci sur fond de chose. A chaque acte ngateur
par quoi l a l ibert du pour-soi constitue spontanment son tre
correspon
d
un dvoilement total de l'tre par un profil . Ce profil
n'est rien qu' un rapport de la chose au pour-soi ralis par le pour-soi
lui-mme. C'est la dtermination absolue de la ngativit : car il ne
suffit pas que le pour-soi par une ngation originelle ne soit pas l' tre,
ni qu'il ne soit pas cet tre, i l faut encore, pour que sa dtermination
comme nant d'tre soit plnire, qu'il se ralise comme une certaine
manire irremplaable de n'tre pas cet tre ; et cette dtermination
absolue qui est dtermination de l a qualit comme profil du ceci
appartient la l i bert du pour-soi ; elle n 'est pas ; elle est comme
tre ; c'est ce que chacun peut se rendre prsent en considrant
combi en le dvoilement d'une qualit de l a chose apparat toujours
comme une gratuit de fait saisie travers une l ibert ; je ne puis fai re
que cette corce ne soi t verte, mai s c'est moi qui fais que j e l a saisisse
comme vert-rugueux ou rugosit-verte. Seulement le rapport forme
fond, i ci , est assez diffrent de la relation du ceci au monde. Car, au
224
lieu que la forme paraisse sur un fond i ndi ffrenci , elle est
entirement pntre par le fond, ell e le retient en elle comme sa
propre densit i ndi ffrencie. Si je saisis l 'corce comme verte, sa
luminosit-rugosit se dvoile comme fond interne i ndiffrenci
et plnitude d'tre du vert. Il n'y a ici aucune abstraction, au sens o
l'abstraction spare ce qui est uni , car l'tre parat toujours tout entier
dans son profi l . Mais la ralisation de l'tre conditionne l'abstraction,
car l ' abstraction n'est pas l' apprhension d'une qualit en l'air
mais d'une quali t-ceci o l ' i ndi ffrenciation du fond interne tend
vers l'quilibre absolu. Le vert abstrait ne perd pas sa densit d'tre
- sinon il ne serait plus rien qu' un mode subjectif du pour-soi -,
mais la lumi nosi t , la forme, la rugosit, etc. , qui se donnent travers
l ui se fondent dans l'quilibre nantisant de la pure et simple
massivit. L'abstraction est cependant un phnomne de prsence
l'tre, puisque l'tre abstrait garde sa transcendance. Mais elle ne
saurait se raliser que comme une prsence l'tre par del l'tre :
elle est dpassement. Cette prsence de l'tre ne peut tre ralise
qu'au niveau de l a possi bi l i t et en tant que le pour-soi a tre ses
propres possibi l i ts. L'abstrait se dvoile comme le sens que la qualit
a tre en tant que coprsente la prsence d'un pour-soi venir.
Ainsi le vert abstrait est le sens--venir du ceci concret en tant qu'il se
rvle moi par son profil vert-lumineux-rugueux . I l est la
possibi li t propre de ce profil en tant qu'elle se rvle travers les
possibilits que je suis ; c'est--dire en tant qu'elle est te. Mais ceci
nous renvoie l'ustensilit et l a temporalit du monde : nous y
reviendrons. Qu' i l nous suffise de dire, pour l' i nstant, que l'abstrait
hante le concret comme une possibilit fige dans l'en-soi que le
concret a tre. Quelle que soit notre percepti on, comme contact
originel avec l'tre , l'abstrait est toujours l mais venir et c'est dans
l'avenir, avec mon aveni r, que je le saisis : i l est corrlatif de la
possi bi lit propre de ma ngation prsente et concrte en tant que
possi bi lit de n'tre plus que cette ngati on. L'abstrait est l e sens du
ceci en tant qu' i l se rvle l'avenir travers ma possibilit de figer en
en-soi l a ngation que j ' ai tre. Que si l'on nous rappelle l es apories
classiques de l'abstraction, nous rpondrons qu'elles proviennent du
fait que l' on suppose distincts la constitution du ceci et l'acte
d'abstraction. Il est certain que si le ceci ne comporte pas ses propres
abstraits, il n'est aucune possi bil i t de les en tirer par aprs. Mais c'est
dans la constitution mme du ceci comme ceci que s'opre l ' abstrac
tion comme dvoi l ement du profil mon avenir. Le pour-soi est
abstracteur non parce qu' i l pourrait raliser une opration
psychologique d' abstracti on mais parce qu' i l surgit comme prsence
l'tre avec un aveni r, c'est--dire un par-del l'tre. En-soi l ' tre n'est
ni concret ni abstrait, ni prsent ni futur : il est ce qu'il est. Pourtant
l'abstraction n'enrichit pas l'tre, elle n'est que le dvoilement d' un
225
nant d'tre par del l ' tre. Mais nous mettons au dfi de formuler les
obj ections classiques l 'abstraction sans les driver implicitement de
l a considration de l'tre comme un ceci.
Le rapport originel des ceci entre eux ne saurait tre ni l'interac
tion , ni la causalit, ni mme l e surgissement sur mme fond de
monde. Si nous supposons en effet l e pour-soi prsent un ceci, les
autres ceci existent en mme temps dans l e monde '> , mais titre
i ndiffrenci : ils constituent le fond sur lequel l e ceci envisag
s'enl ve en relief. Pour qu'un rapport quelconque s'tablisse entre un
ceci et un autre ceci, i l faut que l e second ceci se dvoile en surgissant
du fond du monde l'occasion d'une ngation expresse que l e pour
soi a tre. Mais il convient en mme temps que chaque ceci soit tenu
distance de l 'autre comme n'tan pa l'autre, par une ngation du
type purement externe. Ainsi l a relation originelle de ceci cela est
une ngation externe. Cela apparat comme n' tant pas ceci. Et cette
ngation externe se dvoile au pour-soi comme un transcendant, elle
est dehors, elle est en-soi. Comment devons-nous l a comprendre ?
L'apparition du ceci-cela ne peut se produire d'abord que comme
total i t. L rapport premier est ici l'unit d' une totalit dsagrgable ;
le pour-soi se dtermi ne en bloc ne pas tre ceci-cela sur fond de
monde. Le ceci-cela c'est ma chambre tout entire en tant que j' y
suis prsent. Cette ngation concrte ne disparatra pas lors de l a
dsagrgation du bloc concret en ceci et cel a. Au contraire, el l e est l a
condition mme de l a dsagrgation. Mais sur ce fond de prsence et
par ce fond de prsence, l'tre fait paratre son extriorit d'indiff
rence : el l e se dvoile moi en ce que la ngation que je suis est une
unit-multiplicit pl utt qu' une totalit i ndiffrencie. Mon surgisse
ment ngatif J'tre se morcelle en ngations indpendantes qui n' ont
d' autre lien que d'tre ngations que j'ai tre, c'est--dire qui tirent
leur unit interne de moi et non de J'tre. Je suis prsent cette table,
ces chaises et comme tel j e me constitue synthtiquement comme
ngation polyvalente, mais cette ngation purement interne, en tant
qu'el l e est ngation de l'tre, est transie par des zones de nant ; elle
se nantit titre de ngation, el l e est ngation dtotalise. A travers
ces striages de nant que j'ai tre comme mon propre nant de
ngation, parat J' indiffrence de J'tre. Mais cette indiffrence, j 'ai
l a raliser par ce nant de ngation que j'ai tre, non en tant que j e
suis origi nel l ement prsent au ceci mais en tant que j e suis aussi
prsent au cela. C'est dans et par ma prsence la table que je ralise
l ' indiffrence de la chaise -que prsentement j 'ai aussi ne pas tre
-comme une absence de trempl i n, un arrt de mon l an vers le ne
pas-tre, une rupture du circuit. Cela parat ct de ceci, au sein
d' un dvoilement totalitaire comme ce dont j e ne puis aucunement
p rofi ter pour me dterminer n'tre pas ceci. Ainsi l e clivage vient de
l ' tre mais il n 'y a de clivage et de sparation que par la prsence
226
tout l'tre au pour-soi. La ngation de l'unit des ngations, en tant
qu'ell e est dvoil ement de l 'i ndiffrence de l'tre et qu'ell e saisit
l' indiffrence du ceci sur l e cela et du cela sur le ceci, est dvoilement
du rapport originel des ceci comme ngation externe. Le ceci n'est pas
cel a. Cette ngation externe dans l'unit d'une totalit dsagrgable
s'exprime par l e mot et . Ceci n'est pas cela s'crit ceci et
cela . L ngation externe a le double caractre d' tre-en-soi et
d'tre idal i t pure. El l e est en-soi en ce qu'elle n'appartient
nullement au pour-soi , c'est mme travers l'intriorit absolue de sa
ngation propre (puisque dans l ' i ntuition esthtique , j'apprhende un
objet imaginaire) que l e pour-soi dcouvre l ' indiffrence de l'tre
comme extriorit. I l ne s'agit nullement, d'ailleurs, d'une ngation
que l'tre a tre : el l e n'appartient aucun des ceci considrs ; el l e
est purement et simplement ; el l e est ce qu'elle est. Mais en mme
temps el l e n' est aucunement un caractre du ceci, el le n'est point
comme une de ses qualits. Elle est mme totalement indpendante
des ceci, prcisment parce qu'elle n 'est ni l ' un ni l'autre. Car
l'indiffrence de l'tre n'est rien, nous ne pouvons ni la penser n i
mme l a percevoir. Elle signifie purement et simplement que
l'anantissement ou les variations du cela ne peuvent en ri en engager
les ceci ; en ce sens el l e est seulement un nant en-soi sparant les ceci
et ce nant est la seule manire dont la conscience peut raliser la
cohsion d'identit qui caractrise l'tre. Ce nant idal et en-soi,
c'est la quantit. La quantit, en effet , est extriorit pure ; elle ne
dpend aucunement des termes additionns e t n'est que l ' affirmation
de l eur i ndpendance. Compter, c'est faire une discrimination idale
l ' i ntrieur d'une totalit dsagrgabl e et dj donne. Le nombre
obtenu par l'addition n'appartient aucun des ceci compts ni non
plus l a totalit dsagrgabl e en tant qu'elle se dvoile comme
totalit. Ces trois hommes qui parlent devant moi , ce n'est pas en tant
que je les saisis d'abord comme groupe en conversation que j e les
compte ; et l e fait de les compter trois laisse parfaitement intacte
l'unit concrte de leur groupe. Ce n'est pas une proprit concrte
du groupe que d'tre groupe de trois . Mais ce n'est pas non pl us
une proprit de ses membres. D'aucun d' eux on ne peut dire qu' i l est
trois, ni mme qu' i l est troisime car la qualit de troisime n'est
qu'un reflet de l a libert du pour-soi qui compte ; chacun d'eux peut
tre troisi me, aucun d'eux ne l'est. Le rapport de quantit est donc
une relation en-soi, mais purement ngative, d'extriorit. Et c'est
prcisment parce qu'elle n'appartient ni aux choses ni aux totalits,
qu'eUe s'isole et se dtache l a surface du monde comme un reflet de
nant sur l'tre . Etant pure relation d'extriorit entre les ceci, elle
est el le-mme extrieure aux ceci et , pour finir, extrieure elle
mme . Elle est l 'insaisissable i ndiffrence de l'tre - qui ne peut
apparatre que s'il y a de l'tre et qui , quoique appartenant l'tre, ne
227
peut lui venir que d'un pour-soi, en tant que cette indiffrence ne peut
se dvoi l er que par l'extriorisation l'infini d'un rapport d'extrio
rit qui doit tre extrieur l'tre et lui-mme. Ainsi espace et
quantit ne sont qu'un seul et mme type de ngation. Par cela seul
que ceci et cela se dvoilent comme n'ayant aucun rapport moi qui
suis mon propre rapport, l'espace et l a quantit viennent au monde,
car l'un et l'autre sont l e rapport des choses qui n'ont aucun rapport
ou, si l ' on prfre, le nant de rapport saisi comme rapport par l ' tre
qui est son propre rapport. Par l mme, on peut voir que ce qu'on
nomme avec Husserl l es catgories (unit-multiplicit-rapport de tout
partie - plus et moins -autour - ct de - la suite de -
premi er, second, etc. - un, deux, trois, etc. -dans et hors de -
etc. ) ne sont que des brassages idaux des choses, qui les laissent
entirement intactes, sans les enrichir ni les appauvrir d'un iota, et
qu'el l es indiquent seulement l'infime diversit des manires dont la
l ibert du pour-soi peut raliser l'indiffrence de l'tre.
Nous avons trait l e problme du rapport originel du pour-soi
l ' tre comme si le pour-soi tait une simple conscience instantane
tel le qu' el l e peut se rvler au cogito cartsien. A vrai dire, nous
avons dj rencontr l 'chappement soi du pour-soi en tant qu'il est
condition ncessaire de l'apparition des ceci et des abstraits. Mais l e
caractre ek-statique du pour-soi n'tait encore qu'implicite. Si nous
avons d procder ainsi pour la clart de l'exposition, i l n'en faudrait
pas conclure que l'tre se dvoile un tre qui serait d'abord prsence
pour se constituer aprs coup en futur. Mais c'est un tre qui surgit
comme -venir soi-mme que l'tre-en-soi se dvoile. Cela signifie
que la ngation que l e pour-soi se fait tre en prsence de l'tre a une
di mension ek-statique d'avenir : c'est en tant que je ne suis pas ce que
j e suis (relation ek-statique mes propres possibilits) que j'ai ne
pas tre l ' tre-en-soi comme ralisation dvoilante du ceci. Cela
signifie que je suis prsence au ceci dans l ' inachvement d'une totalit
dtotalise. Qu'en rsulte-t-il pour l e dvoilement du ceci ?
En tant que je sui s toujours par del ce que je suis, -venir moi
mme, l e ceci quoi j e suis prsent m'apparat comme quelque chose
que je dpasse vers moi-mme. Le peru est originellement l e
dpass, i l est comme un conducteur du circuit de l'ipsit, et i l
apparat dans les l i mites de ce circuit. Dans l a mesure o j e me fais
tre ngation du ceci, je fuis cette ngation vers une ngation
complmentaire dont l a fusion avec la premire devrait faire appara
tre l 'en-soi que je suis ; et cette ngation possible est en liaison d'tre
avec l a premire, el l e n'est pas quelconque, mais el l e est prcisment
l a ngation complmentaire de ma prsence la chose. Mais comme
le pour-soi se constitue, en tant que prsence, comme conscience non
posi tionnel l e (de) soi , il se fait annoncer hors de lui, par l'tre, ce qu'il
n'est pas ; i l rcupre son tre au-dehors sur le mode reflet-
228
refltant ; la ngation complmentaire qu'il est comme sa possibilit
propre est donc ngation-prsence, c'est--dire que l e pour-soi a
l'tre comme conscience non-thtique (de) soi et comme conscience
thtique de l'tre-par-del-l'tre. Et l ' tre-par-del-l'tre est li au
ceci prsent, non par un rapport quelconque d'extriorit, mais par
un lien prcis de complmentarit qui se tient en exacte corrl ation
avec le rapport du pour soi et de son avenir. Et tout d'abord, l e ceci se
dvoile dans la ngation d'un tre qui se fait ne pas tre ceci non
titre de si mple prsence, mais comme ngation qui est -venir el l e
mme, qui est sa propre possibilit par del son prsent. Et cette
possibilit qui hante l a pure prsence comme son sens hors d'atteinte
et comme ce qui lui manque pour tre en soi est d'abord comme une
projection de l a ngation prsente titre d'engagement. Toute
ngati on, en effet, qui n'aurait point par del elle-mme, au futur,
comme possibilit qui vient elle et vers laquelle elle se fuit, l e sens
d' un engagement perdrait toute sa signification de ngation. Ce que l e
pour-soi nie, i l l e nie avec dimension d'avenir , qu' i l s'agisse d' une
ngation externe : ceci n' est pas cela, cette chaise n'est pas une table
- ou d'une ngation interne portant sur soi-mme. Dire que ceci
n'est pas cela , c'est poser l ' extriorit du ceci par rapport au cela,
soit pour maintenant et pour l'avenir - soit dans le strict mainte
nant , mais alors l a ngation a un caractre provisoire qui constitue
l'avenir comme pure extriorit par rapport l a dtermination
prsente ceci et cela Dans les deux cas, l e sens vient la ngation
partir du futur ; toute ngation est ek-statique. En tant que le pour
soi se nie l'avenir, le ceci dont il se fait ngation se dvoile comme
venant lui-mme de l'avenir. La possibilit que la conscience est
non-thtiquement comme conscience (de) pouvoir n'tre pas ceci se
dvoile comme potentialit du ceci d' tre ce qu'il est. La premire
potentialit de l'objet, comme corrlatif de l'engagement, structure
ontologique de la ngation, c'est la permanence, qui vient perptuel
lement lui du fond de l'avenir. Le dvoilement de l a table comme
table exige une permanence de table qui lui vient du futur et qui n'est
point un donn purement constat, mais une potentialit. Cette
permanence, d'ailleurs, ne vient pas la table d'un futur situ dans
l ' infini temporel : l e temps infini n'existe pas encore ; l a table ne se
dvoile pas comme ayant l a possibilit d'tre indfiniment table. Le
temps dont i l s'agit ici n'est ni fini ni infini : simplement l a potentialit
fait apparatre la dimension du futur.
Mais l e sens -venir de la ngation est d'tre ce qui manque la
ngation du pour-soi pour devenir ngation en soi. En ce sens, la
ngation est, au futur, prcision de la ngation prsente. C'est au
futur que se dvoile le sens exact de ce que j'ai ne pas tre comme
corrlatif de l a ngation exacte que j'ai tre. La ngation poly
morphe du ceci o l e vert est form d'une totalit rugosit-lumire
229
ne prend son sens que si el l e a tre ngation du vert, c'est--dire
d'un tre-vert dont l e fond tend vers l'quilibre d'indiffrenciation :
en un mot le sens-absent de ma ngation polymorphe, c'est une
ngation resserre d' un vert pl us purement vert sur fond indiffren
ci. Ai nsi, le vert pur vient au vert-rugosit-lumire du fond de
l ' aveni r comme son sens. Nous saisissons ici l e sens de ce que nous
avons appel abstraction. L'existant ne possde pas son essence
comme une qual i t prsente. Il est mme ngation de l ' essence : le
vert n 'est jamais vert. Mais l'essence vient du fond de l'avenir
l ' existant, comme un sens qui n'est jamais donn et qui le hante
toujours. C'est le pur corrlatif de l'idali t pure de ma ngation. En
ce sens i l n' y a j amais d'opration abstractive, si l'on entend par l un
acte psychologique et affirmatif de slection opr par un esprit
consti tu. Loin qu'on abstraie certaines qualits partir des choses, i l
faut voir au contraire que l 'abstraction comme mode d'tre origi nel
du pour-soi est ncessaire pour qu' il y ait en gnral des choses et un
monde . L'abstrait est une structure du monde ncessaire au surgisse
ment du concret et le concret n'est concret qu'en tant qu'il va vers son
abstrait, qu' i l se fai t annoncer par l'abstrait ce qu'il est : le pour-soi
est dvoi lant-abstrayant dans son tre. On voit que, de ce point de
vue, la permanence et l'abstrait ne font qu' un. Si la table a, en tant
que table, une potentialit de permanence, c'est dans l a mesure o
elle a tre tabl e. La permanence est pure possibilit pour un ceci
d'tre conforme son essence.
Nous avons vu, dans l a deuxime partie de cet ouvrage, que l e
possible que j e suis et le prsent que je fuis taient entre eux dans l e
rapport de ce qui manque avec ce quoi i l manque. La fusion idale
de ce qui manque avec ce quoi manque ce qui manque, comme
totalit irralisable, hante l e pour-soi et l e constitue dans son tre
mme comme nant d' tre. C'est, disions-nous, l ' en-soi-pour-soi, ou
l a valeur. Mais cette val eur n'est pas, sur l e pl an irrflchi, saisie
thtiquement par l e pour-soi, elle est seulement condition d'tre. Si
nos dductions SOnt exactes, cette indication perptuelle d' une fusion
irralisable doit s'apparatre non pas comme structure de la cons
cience irrflchi e, mais comme indication transcendante d'une struc
ture idale de l ' objet . Cette structure peut tre facilement dvoile ;
corrlativement l'indication d' une fusion de la ngation polymorphe
avec l a ngation abstraite qui est son sens, une indication transcen
dante et idale doit se dvoiler : celle d'une fusion du ceci existant
avec son essence -venir. Et cette fusion doit tre telle que l'abstrait
soit fondement du concret et simultanment l e concret fondement de
l'abstrai t ; en d' autres termes, l'existence concrte en chair et en
os doit tre l'essence, l'essence doit se produire elle-mme comme
concrti on totale , c'est--dire avec la pleine richesse du concret, sans
que pourtant nous puissions trouver en el l e autre chose qu'elle-mme
230
dans sa totale puret. Ou, si l'on prfre, la forme doit tre elle
mme - et totalement -sa propre matire. Et rciproquement la
matire doit se produire comme forme absolue. Cette fusion impossi
ble et perptuel lement indique de l'essence et de l 'existence
n'appartient ni au prsent ni l'avenir, elle indique plutt la fusion du
pass, du prsent et de l'avenir, et se prsente comme synthse
oprer de la totalit temporel l e. C'est la valeur, en tant que
transcendance ; c' est elle que l ' on nomme la beaut. La beaut
reprsente donc un tat idal du monde, corrlatif d'une ralisation
idale du pour-soi , o l'essence et l'existence des choses se dvoile
raient comme identit un tre qui , dans ce dvoilement mme, se
fondrait avec lui-mme dans l ' unit absolue de l 'en-soi. C'est
prcisment parce que le beau n'est pas seulement une synthse
transcendante oprer, mais qu'il ne peut se raliser que dans et par
une totalisation de nous-mme, c'est prcisment pour cela que nous
voulons l e beau et que nous saisissons l'univers comme manquant du
beau, dans la mesure o nous-mme nous nous saisissons comme un
manque. Mais le beau n'est pas pl us une potentialit des choses que
l ' en-soi-pour-soi n' est une possi bilit propre du pour-soi . I l hante l e
monde comme un irralisabl e. Et dans la mesure o l ' homme ralise
l e beau dans l e monde, i l l e ralise sur le mode imaginaire. Cela veut
dire que dans l'intuition esthtique, j'apprhende un objet i maginaire
travers une ralisation imaginaire de moi-mme comme totalit en
soi et pour-soi. A l'ordinaire, le beau, comme valeur, n'est pas
thmatiquement explicit comme valeur-hors-de-porte-du-monde. I l
est implicitement apprhend sur l es choses comme une absence ; i l se
dvoile implicitement travers l'imperfection du monde.
Ces potentialits origi nel l es ne sont pas l es seules qui caractrisent
l e ceci. Dans la mesure, en effet, o l e pour-soi a tre son tre par
del son prsent, i l est dvoilement d'un au-del de l'tre qualifi qui
vient au ceci du fond de l'tre. En tant que l e pour-soi est par del le
croissant de lune, auprs d'un tre-par del-l'tre qui est l a pleine
l une future, la l une pleine devient potentialit du croissant de lune ;
en tant que le pour-soi est par del le bourgeon, prs de la fleur, l a
fleur est potentialit du bourgeon. Le dvoilement de ces potentia
lits nouvelles implique un rapport originel au pass. C'est dans l e
pass que la liaison du croissant de lune la lune, du bourgeon l a
fleur s'est peu peu dcouverte. Et le pass du pour-soi est pour l e
pour-soi comme savoir. Mai s ce savoir ne demeure pas comme un
donn inerte. I l est derrire l e pour-soi, sans doute, inconnaissable
comme tel et hors d'atteinte. Mais, dans l'unit ek-statique de son
tre, c'est partir de ce pass que le pour-soi se fait annoncer ce qu'il
est l'avenir. Mon savoir touchant la lune m'chappe en tant que
connaissance thmatique. Mais j e le suis et ma faon de l'tre c'est
au moins dans certains cas - de faire venir moi ce que je ne suis
231
pl us sous la forme de ce que je ne suis pas encore. Cette ngation du
ceci -que j 'ai t -je la sui s doublement : sur le mode du n'tre
plus et du n'tre-pas-encore. Je suis par del le croissant de lune
comme possibilit d'une ngation radicale de la lune comme disque
plei n et , corrlativement au retour de ma ngation future vers mon
prsent, la plei ne lune revient vers le croissant pour le dterminer en
ceci comme ngation : el l e est ce qui l ui manque et ce dont l e manque
le fait tre comme croissant. Ainsi, dans l'unit d'une mme ngation
ontologique, j' attribue la dimension de futur au croissant en tant que
croissant - sous forme de permanence et d'essence - et je le
constitue comme croissant de l une par le retour dterminant vers lui
de ce qui lui manque. Ai nsi se constitue la gamme des potentialits
qui va de la permanence jusqu'aux puissances. La ralit-humaine, en
se dpassant vers sa propre possibilit de ngation, se fait tre ce par
quoi la ngation par dpassement vient au monde ; c'est par l a ralit
humai ne que le manque vient aux choses sous forme de puissance
d' i nachvement de sursis de potentialit .
Toutefois, l'tre transcendant du manque ne saurait avoir l a nature
du manque e k-statique dans l ' i mmanence. Regardons-y mieux. L'en
soi n'a pas tre sa propre potentialit sur le mode du pas-encore. Le
dvoilement de l'en-soi est originellement dvoilement de l'identit
d' i ndiffrence. L'en-soi est ce qu'il est sans aucune dispersion ek
statique de son tre. I l n'a donc point tre sa permanence ou son
essence ou le manquant qui l ui manque comme j'ai tre mon avenir.
Mon surgissement dans le monde fait surgir corrlativement les
potentialits. Mais ces potentialits se figent dans leur surgissement
mme, elles sont ronges par l'extriorit. Nous retrouvons ici ce
doubl e aspect du transcendant qui, dans son ambigut mme, a
donn naissance l ' espace : une totalit qui s'parpille en relations
d'extriorit . La potentialit revient du fond de l'avenir sur le ceci
pour le dterminer, mais le rapport du ceci comme en-soi sa
potentialit est un rapport d'extriorit. Le croissant de lune est
dtermin comme manquant ou priv de - par rapport la pleine
l une. Mais dans l e mme temps, i l se dvoile comme tant pleinement
ce qu'il est, ce signe concret dans le ciel, qui n' a besoin de rien pour
tre ce qu'il est. I l en est de mme pour ce bourgeon, pour cette
al lumette qui est ce qu'elle est, qui son sens d'tre-allumette
demeure extrieur, qui peut sans doute s'enfammer mais qui,
prsentement, est ce bout de bois bl anc avec une tte noire. Les
potentialits du ceci, bien qu'en connexion rigoureuse avec l ui , se
prsentent comme des en-soi et sont en tat d'indiffrence par
rapport lui. Cet encrier peut tre cass, jet contre le marbre de la
chemine o il s'crasera. Mais cette potentialit est entirement
coupe de lui , car el l e n'est que le corrlatif transcendant de ma
possibilit de l e jeter contre l e marbre de la chemine. En lui-mme,
232
il n'est ni cassable ni incassable : il est. Cela ne veut point dire que je
puisse considrer un ceci en dehors de toute potentialit : du seul fait
que j e suis mon propre futur, le ceci se dvoile comme pourvu de
potentialits ; saisir l'allumette comme bout de bois blanc avec une
tte noire, ce n'est pas la dpouiller de toute potentialit, mais
simplement lui en confrer de nouvelles (une nouvelle permanence
une nouvelle essence). Pour que l e ceci ft entirement dpourvu de
potentialits, i l faudrait que je fusse un pur prsent, ce qui est
inconcevable. Seulement, le ceci a diverses potentialits qui sont
quivalentes, c'est--dire en tat d'quivalence par rapport lui. C'est
que, en effet, i l n'a point les tre. En outre, mes possi bles ne sont
point, mais se possibilisent, parce qu'ils sont rongs du dedans par ma
libert. C'est--dire que, quel que soit mon possibl e, son contraire est
galement possible. Je peux briser cet encrier mais aussi bien le
ranger dans un tiroir ; je peux tser, par del l e croissant, la pleine
l une, mais aussi bien rclamer l a permanence du croissant comme tel.
En consquence, l'encrier se trouve pourvu de possibles quivalents :
tre rang dans un tiroir, tre bris . Ce croissant de lune peut tre une
courbe ouverte dans le ci el ou un disque en sursi s. Ces potentialits,
qui reviennent sur l e ceci sans tre tes par lui et sans avoir l'tre,
nous les appellerons probabilits, pour marquer qu'elles existent sur
l e mode d'tre de l 'en-soi. Mes possibles ne sont point, il s se
possibilisent. Mais l es probables ne se probabi lisent point : ils
sont en soi, en tant que probables. En ce sens, l ' encrier est, mais son
tre-encrier est un probable, car l'avoir--tre-encrier de l'encrier
est une pure apparence qui se fond aussitt en relation d'extriorit.
Ces potentialits ou probabilits qui sont l e sens de J'tre, par del
l'tre, prcisment parce qu'elles sont en-soi par del /'tre, sont des
riens. L'essence de l ' encrier est te comme corrlative de la ngation
possi bl e du pour-soi , mais elle n'est pas l'encrier et elle n'est pas
l'tre : en tant qu' el l e est en soi, el l e est ngation hypostasie, rifie,
c'est--dire prcisment qu' el l e est un rien, el l e appartient au
manchon de nant qui entoure et dtermine le monde. Le pour-soi
rvle l ' encrier comme encrier. Mais cette rvlation se fait par del
l'tre de l'encrier, dans ce futur qui n'est pas ; toutes les potentialits
de l'tre, depuis la permanence jusqu' la potentialit qualifie, se
dfinissent comme ce que l'tre n 'est pas encore sans jamais qu'il ait
vritablement les tre. Ici encore l a connaissance n'ajoute ni ne
retranche rien l ' tre, el le ne l e pare d'aucune qualit nouvelle. Elle
fait qu' i l y ait de l'tre en le dpassant vers un nant qui n'entretient
avec l ui que des rapports ngatifs d'extriorit : ce caractre de pur
nant de la potentialit ressort assez des dmarches de la science qui,
visant tablir des rel ations de simple extriorit, supprime radicale
ment le potentiel, c'est--dIre l'essence et les puissances. Mais d'autre
part, sa ncessit comme structure significative de la perception
233
apparat assez clairement pour qu' on se dispense d'y insister : la
connaissance scientifi que, en effet , ne peut ni surmonter ni supprimer
la structure potenti alisante de l a perception ; elle l a suppose "u
contraire.
Nous avons tent de montrer comment la prsence du pour-soi
l'tre dvoi l ai t celui -ci comme chose ; et, pour la clart de l'exposi
tion, nous avons d montrer successivement les di ffrentes structures
de l a chose : le ceci et la spatialit, la permanence, l ' essence et les
potentialits. I l va de soi , cependant, que cet expos successif ne
correspond pas une priorit relle de certains de ces moments sur les
autres : l e surgissement du pour-soi fait se dvoiler la chose avec la
totalit de ses structures. I l n'en est pas une d'ailleurs qui n'implique
toutes les autres : l e ceci n' a pas mme d'antriorit logique sur
l'essence, i l la suppose au contraire et, rciproquement, l'essence est
essence de ceci. Semblablement , le ceci comme tre-qualit ne peut
paratre que sur fond de monde, mais l e monde est collection des
ceci : et la relation dsagrgative du monde aux ceci, des ceci au
monde est la spatial i t. Il n'y a donc ici aucune forme substantielle,
aucun principe d'unit pour se teni r derrire les modes d'apparition
du phnomne : tout est donn d'un coup sans aucune primaut.
Pour les mmes raisons, i l serait erron de concevoir une primaut
quelconque du reprsentatif. Nos descriptions nous ont amen, en
effet, mettre en relief la chose dans le monde et, de ce fait , nous
pourrions tre tent de croire que l e monde et la chose se dvoilent au
pour-soi dans une sorte d'intuition contemplative : ce serait aprs
coup seulement que les objets seraient rangs les uns par rapport aux
autres dans un ordre pratique d'ustensilit. Une pareille erreur sera
vite si l'on veut bi en considrer que l e monde parat l 'i ntrieur du
circuit de l'ipsit. Il est ce qui spare le pour-soi de lui-mme ou,
pour employer une expression heideggerienne : ce partir de quoi l a
ralit-humaine se fai t annoncer ce qu'elle est. Ce projet vers soi du
pour-soi , qui constitue l 'ipsit, n'est aucunement un repos contem
platif. C'est un manque, nous l'avons dit, mais non point un manque
donn : c'est un manque qui a tre soi-mme son propre manque.
Il faut bi en comprendre, en effet, qu'un manque constat ou manque
en-soi s'vanouit en extriorit ; nous l'avons marqu dans les pages
prcdentes. Mai s un tre qui se constitue soi-mme comme manque
ne peut se dterminer que l-bas sur cela qui l ui manque et qu' i l est,
bref, par un arrachement soi perptuel vers le soi qu'il a tre. Cela
signifie que l e manque ne peut tre soi-mme son propre manque
que comme manque refus : la seule liaison proprement interne de ce
qui manque de . = . ce qui manque, c'est l e refus. Dans la mesure, en
effet, o l ' tre qui manque de . = n'est pas ce qui lui manque, nous
saisissons en lui une ngation. Mais si cette ngation ne doit pas
s'vanoui r en pure extriorit - et avec el l e toute possibilit de
234
ngation en gnral -son fondement est dans la ncessit pour l'tre
qui manque de . . . d'tre ce qui lui manque. Ainsi , le fondement de la
ngation est ngation de ngation. Mais cette ngation-fondement
n'est pas plus un donn que l e manque dont el l e est un moment
essentiel : el l e est comme ayant tre : l e pour-soi se fait tre, dans
l'unit fantme reflet-refltant , son propre manque, c'est- dire
qu'il se projette vers lui en l e refusant . C'est seulement comme
manque supprimer que le manque peut tre manque interne pour l e
pour-soi et l e pour-soi ne peut raliser son propre manque qu'en
ayant l'tre, c'est--dire en tant projet vers sa suppression. Ainsi,
l e rapport du pour-soi son avenir n'est jamais statique ni donn,
mai!'avenir vient au prsent du pour-soi pour l e dterminer en son
cur en tant que l e pour-soi est dj l-bas l'avenir comme sa
suppression. Le pour-soi ne peut tre ici manque que s' il est l bas
suppression du manque ; mais une suppression qu'il a tre sur l e
mode du n'tre-pas. C'est cette relation originel le qui permet ensuite
de constater empiriquement des manques particuliers comme man
ques souferts ou endurs. Elle est fondement, en gnral, de
l'affectivit : c'est elle aussi qu'on tentera d'expl iquer psychologique
ment en installant dans le psychique ces idoles et ces fantmes qu'on
nomme tendances ou apptits. Ces tendances ou ces forces, que l'on
insre par violence dans l a psych, ne sont pas comprhensibles en
el l es-mmes, car l e psychologue les donne comme des existants en
soi , c'est--dire que leur caractre mme de force est contredit par
leur repos intime d'indiffrence et que leur unit est parpille en
pure relation d' extriorit. Nous ne pouvons les saisir qu' titre de
projection dans l'en-soi d'une relation d'tre i mmanente du pour-soi
soi , et cette relation ontologique est prcisment le manque.
Mais c manque ne peut tre saisi thtique ment et connu par la
conscience irrflchie (pas plus qu' i l n'apparat la rflexion impure
et complice qui l'apprhende comme objet psychique, c'est--dire
comme tendance ou comme sentiment) . Il n'est accessible qu' la
rflexion purifiante, dont nous n' avons pas nous occuper ici. Sur le
plan donc de la conscience du monde, i l ne peut s'apparatre qu'en
projection, comme un caractre transcendant et idal. Si, en effet, ce
qui manque au pour-soi est prsence idale un tre-par-del-l'tre.
l'tre-par-del-l'tre est originel l ement saisi comme manque--I'tre
Ainsi , le monde se dvoile comme hant par des absences raliser et
chaque ceci parat avec un cortge d'absences qui l'indiquent et le
dterminent. Ces absences ne diffrent pas au fond des potentialits.
Simpl ement, nous en saisissons mieux l a signification. Ainsi , les
absences indiquent le ceci comme ceci et, inversement, le ceci pointe
vers les absences. Chaque absence tant tre-par-del-I'tre, c'est-
dire en-soi absent, chaque ceci pointe vers un autre tat de son tre ou
vers d' autres tres. Mai s, bien entendu, cette organisation en
235
complexes i nicatifs se fige et se ptrIfie en en-soi, puisqu'il s'agit
d' en-soi , toutes ces indications muettes et ptrifies, qui retombent
dans l'i ndiffrence de l'isol ement dans l e temps mme qu'el l es
surgissent , ressembl ent au sourire de pierre, aux yeux vides d' une
statue. En sorte que l es absences qui apparaissent derrire les choses
n'apparaissent pas comme absences prsentifier par les choses. On
ne peut pas dire non plus qu'elles se dvoilent comme raliser par
moi, puisque l e moi est une structure transcendante de l a psych qui
apparat seul ement la conscience rflexive. Ce sont des exigences
pures qui se dressent comme vides remplir au milieu du circuit
d ' ipsit . Si mplement leur caractre de vides remplir par l e pour
soi se mani feste la conscience i rrfchie par une urgence directe
et personnel l e qui est vcue comme telle sans tre rapporte
quelqu'un ni thmatise. C'est dans et par le fait mme de les vivre
comme prtentions que se rvle ce que nous avons appel, dans un
autre chapitre, leur ipsit. Ce sont les tches ; et ce monde est un
monde de tches. Par rapport aux tches, l e ceci qu'elles indiquent est
l a fois ceci de ces tches - c'est--dire l'en-soi unique qui se
dtermi ne par elles et qu'elles i ndiquent comme pouvant les remplir
et ce qui n' a aucunement tre ces tches, puisqu'il est dans l ' uni t
absolue de l'i denti t. Cette liaison dans l'isolement, ce rapport
d' i nertie dans l e dynamique, c'est ce que nous nommerons le rapport
de moyen fi n. C'est un tre-pour dgrad, lamin par l'extriorit et
dont l 'idalit transcendante ne peut se concevoir que comme
corrlatif de l'tre-pour que le pour-soi a tre. Et la chose, en tant
q
u'elle repose l a fois dans l a batitude quite de l'indiffrence et
que pourtant el l e i ndique au-del d' el l e des tches remplir qui l ui
annoncent ce qu'el l e a tre, c'est l'i nitrument ou l'ustensil e. Le
rapport originel des choses entre elles, celui qui parat sur le
fondement de la relation quantitative des ceci, c'est donc l e rappor
d' ustensilit. Et cette ustensilit n'est pas postrieure ou subordonne
aux structures prcdemment i ndi ques : en un sens, elle les suppose,
en un autre el l e est suppose par elles. La chose n'est point d'abord
chose pour tre ensuite ustensi l e ; elle n'est point d'abord ustensile
pour se dvoi l er ensui te comme chose : el l e est chose-ustensile. Il est
vrai , t outefois, qu' ell e se dcouvrira la qute ultrieure du savant
comm
e purement chose, c'est--dire dpouille de toute ustensilit.
Mais c'est que l e savant ne se soucie que d'tablir les pures relations
d'extriorit ; l e rsul tat, d'ailleurs, de cette qute scientifi que, c'est
que l a chose elle-mme, dpouille de toute instrumentalit, s'va
pore pour finir en extriorit absol ue. On voit dans quelle mesure il
faut corriger la formul e de Heidegger : certes, le monde apparat dans
le ci rcuit d'ipsit, mais le circuit tant non-thtique, l'annonciation
de ce que je suis n e peut tre el l e-mme thtique. Etre dans le
monde, ce n'est pas s' chapper du monde vers soi-mme, mai s c'est
236
s'chapper du monde vers un au-del du monde qui est le monde
futur. Ce que m' annonce l e monde est uniquement mondain .
Reste que, si l e renvoi l'infini des ustensiles ne renvoie jamais un
pour-soi que j e suis, l a totalit des ustensiles est l e corrlatif exact de
mes possibilits. Et , comme je suis mes possibilits, l ' ordre des
ustensiles dans l e monde est l'image projete dans l'en-soi de mes
possibilits, c'est--dire de ce que je suis. Mais cette image mondai ne,
je ne puis j amais l a dchiffrer : je m' y adapte dans et par J'action ; i l
faut l a scissiparit rflexive pour que je puisse tre moi-mme un
obj et . Ce n'est donc pas par inauthenticit que l a ralit-humaine se
erd dans l e monde ; mais tre-dans-le-monde, pour elle, c'est se
perdre radicalement dans le monde par l e dvoilement mme qui fait
qu'il y a un monde, c'est tre renvoy sans relche, sans mme la
possi bi l i t d' un quoi bon , d'ustensile en ustensile, sans autre
recours que la rvolution rflexive. Il ne servirait rien de nous
objecter que la chane des pour quoi est suspendue des pour
qui ( Worumwillen). Certes, l e Worumwil l en nous renvoie une
structure de l'tre que nous n'avons pas lucide encore : l e pour
autrui . Et le pour qui apparat constamment derrire les instru
ments. Mais ce pour qui, dont l a constitution est diffrente du pour
quoi , n' interrompt pas la chane . Il en est un mail l on, simplement,
et i l ne permet pas, lorsqu'il est envisag dans l a perspective de
l'instrumentalit, d'chapper l ' en-soi . Certes, ce vtement de travail
est pour l 'ouvrier. Mais c'est pour que l'ouvrier puisse rparer la
toiture sans se salir. Et pourquoi ne doit-il pas se salir ? Pour ne pas
dpenser en achat de vtement l a plus grande part de son salaire.
C'est qu' en effet ce salaire l ui est allou comme la quantit d'argent
mi ni ma qui lui permettra de subvenir son entretien ; et, prcis
ment, il s'entretient pour pouvoir appliquer sa puissance de
travail l a rparation des toitures. Et pourquoi doit-il rparer la
toiture ? Pour qu' il ne pleuve pas dans l e bureau o des employs font
un travail de comptabilit, etc. Cela ne signifie point que nous
devi ons touj ours saisir autrui comme un i nstrument d'un type
particul ier, mais simplement que, lorsque nous considrons autrui
partir du monde, nous n'chappons point pour autant au renvoi
l'infini des complexes d'ustensil it.
Ai nsi , dans l a mesure o l e pour-soi est son propre manque comme
refus, corrlativement son lan vers soi , l'tre se dvoile l ui sur
fond de monde comme chose-ustensile et l e monde surgit comme
fond i ndi ffrenci de complexes i ndicatifs d'ustensilit. L'ensemble
de ces renvois est dpourvu de signification, mais c'est en ce sens qu'il
n'y a mme pas de possibilit pour poser sur ce plan le problme de l a
signification. On travaille pour vivre et l ' on vit pour travailler. La
question du sens de l a totalit vie-travail : Pourquoi est-ce que
je travaill e, moi qui vis ? Pourquoi vivre si c'est pour travailler ne
237
peut se poser que sur le plan rfl exi f puisqu'elle implique une
dcouverte du pour-soi par lui-mme.
Reste expl i quer pourquoi, comme corrlatif de la pure ngation
que j e suis, l ' ustensil it peut surgi r dans l e monde. Comment ne suis
je pas ngation strile et indfiniment rpte du ceci en tant que pur
ceci ? Comment cette ngation peut-elle dvoi l er une pluralit de
tches qui sont mon image, si j e ne suis rien que l e pur nant que j'ai
tre ? Pour rpondre cette question, il faut se rappeler que le pour
soi n 'est pas purement et simpl ement un avenir qui vient au prsent. I l
a t re aussi son pass sous forme du tais . Et l'implication ek
stati que des trois di mensions temporelles est tel l e que si l e pour-soi
est un tre qui se fait annoncer l e sens de ce qu' il tait par son avenir,
c'est , dans l e mme surgissement, aussi un tre qui a tre son sera
dans l es perspectives d' un certain tais qu'il fuit. En ce sens, i l
faut toujours chercher l a signification d'une di mension temporelle
ailleurs, dans une autre dimension ; c'est ce que nous avons appel la
diaspora ; car l'unit d'tre diasporique n'est pas une pure apparte
nance donne : c'est l a ncessit de raliser la diaspora en se faisant
conditionner l-bas, dehors, dans l 'unit de soi. La ngation donc que
je suis et qui dvoile le ceci a donc tre sur l e mode du tais .
Cette pure ngation qui , en tant que simple prsence, n'est pas, a son
tre derrire el l e, comme pass ou facticit. En tant que telle, i l faut
reconnatre qu'elle n' est jamais ngation sans racines. Mais el l e est,
au contraire, ngation qualifie, si l'on veut bien entendre par l
qu' el l e trane sa qualification derrire el l e comme l'tre qu'elle a ne
pas tre sous l a forme du tai s . La ngation surgit comme
ngation non-thtique tu pass, sur l e mode de la dtermination
i nterne, en tant qu' el l e se fait ngation thtique du ceci. Et le
surgissement se produit dans l ' uni t d'un double tre pour ,
puisque l a ngation se produit l'existence, sur l e mode reflet
refltant, comme ngation du ceci, pour chapper au pass qu'elle est
et elle chappe au pass pour se dgager du ceci en l e fuyant dans son
tre vers l ' avenir. C'est ce que nous appellerons l e point de vue du
p
our-soi sur le monde. Ce point de vue, assimilable la facticit, est
qualification ek-statique de la ngation comme rapport originel l'en
soi. Mais, d'autre part, nous l'avons vu, tout ce qu'est l e pour-soi, il
l'est sur l e mode du tais comme appartenance ek-statique au
monde. Ce n'est pas au futur que je retrouve ma prsence, puisque le
futur me livre l e monde comme corrlatif d'une conscience -venir ;
mais mon tre m'apparat au pass, quoique non-thmatiquement,
dans l e cadre de l ' tre-en-soi, c'est--dire en relief au milieu du
monde. Sans doute, cet tre est encore conscience de . . . c' est--dire
pour-soi ; mais c'est un pour-soi fig en en-soi et, par suite, c'est une
conscience du monde dchue au milieu du monde. Le sens du
ralisme, du naturalisme et du matrialisme est au pass : ces trois
238
philosophies sont des descriptions du pass comme s' il tait prsent.
Le pour-soi est donc double fuite du monde : il chappe son propre
tre-au-milieu-du-monde comme prsence un monde qu'il fuit. Le
possible est l e l ibre terme de la fuite. Le pour-soi ne peut fuir vers un
transcendant qu'il n'est pas, mais seulement vers un transcendant
qu' il est. C'est ce qui te toute possibilit d'arrt cette fuite
perptuelle : s'il est permis d'user d'une image vulgaire, mais qui fera
mieux saisir ma pense , qu'on se rappelle l 'ne qui tire derrire lui
une carriole et qui tente d'attraper une carotte qu' on a fixe au bout
,
d'un bton assujetti lui-mme aux brancards. Tout effort de l'ne
pour happer la carotte a pour effet de faire avancer l'at telage tout
enti er et l a carotte el le-mme qui demeure toujours la mme
distance de l'ne. Ainsi courons-nous aprs un possible que notre
course mme fait apparatre, qui n'est rien que notre course et qui se
dfinit par l mme comme hors d'atteinte. Nous courons vers nous
mme et nous sommes, de ce fai t , l'tre qui ne peut pas se rejoindre.
En un sens, la course est dpourvue de signification, puisque le terme
n'est j amais donn, mais invent et projet mesure que nous
courons vers l ui . Et, en un autre sens, nous ne pouvons pas lui refuser
cette signification qu'elle rejette, puisque malgr tout le P9ssible est
l e sens du pour-soi : mais plutt il y a et i l n'y a pas sens de la fuite.
Or, dans cette fuite mme du pass que j e suis vers l'avenir que je
suis, l'avenir se prfigure par rapport au pass en mme temps qu'il
confre au pass tout son sens. L'avenir est le pass dpass comme
en-soi donn vers un en-soi qui serait son propre fondement, c'est-
dire qui serait en tant que j 'aurais l ' tre . Mon possible est la reprise
libre de mon pass en tant que cette reprise peut le sauver en le
fondant. Je fuis l'tre sans fondement que j ' tais vers J'acte fondateur
que je ne puis tre que sur le mode du serais. Ainsi, le possible est le
manque que l e pour-soi se fait tre, c'est--dire ce qui manque la
ngation prsente en tant qu'elle est ngation qualifie (c'est--dire
ngation qui a sa qualit hors de soi au pass). En tant que tel, il est
lui-mme qualifi. Non pas t itre de donn qui serait sa propre
qualit sur l e mode de l' en-soi, mais comme indication de la reprise
qui fonderait la qualification ek-statique que l e pour-soi tait. Ainsi la
soif est tridimensionnelle : elle est fuite prsente d'un tat de vide que
le pour-soi tait. Et c'est cette fuite mme qui confre l'tat donn
son caractre de vide ou de manque : au pass, le manque ne saurait
tre manque, car le donn ne peut manquer que s'il est dpass
vers . . . par un tre qui est sa propre transcendance. Mais cette fuite est
fuite vers . . . et c'est ce vers qui l ui donne son sens. En tant que
tel l e, elle est elle-mme manque qui se fair, c'est--dire la fois
constitution au pass du donn comme manque ou potentialit et
reprise libre du donn par un pour-soi qui se fait manque sous la
forme reflet rfltant , c'est--dire comme conscience de manque.
239
Et ce vers quoi se fuit le manque , en tant qu' i l se fait conditionner
dans son tre-manque par ce dont i l manque. c'est la possibilit qu'il
est d'tre soif qui ne serait pl us manque, c'est--dire soif-rpltion. Le
possible est indication de rpltion et l a valeur, comme tre-fantme
qui entoure et pntre de part en part le pour-soi, est l'indication
d' une soif qui s erait l a fois donne comme elle l'tait -et
reprise - comme le jeu du reflet-refltant la constitue ek
stati quement. I l s'agit, on le voit , d' une plnitude qui se dtermine
eI I e-mme comme soif. A l ' esquisse de cette plnitude, l e rapport ek
stati que pass-prsent fournit la structure soif comme son sens et
le possible que j e suis doit fournir l a densit mme, sa chair de
pl nitude, comme rpltion. Ainsi, ma prsence l'tre qui le
dtermine en ceci est ngation du ceci en tant que je suis aussi manque
qualifi auprs de ceci. Et dans la mesure o mon possible est
prsence possible l 'tre-pardel-l'tre, la qual ification de mon
possible dvoile un tre-pardel-l'tre comme l'tre dont l a copr
sence est coprsence rigoureusement lie une rpltion -venir.
Ai nsi se dvoile dans l e monde l' absence comme tre raliser, en
tant que cet tre est corrlatif de l'tre-possible dont je manque. Le
verre d'eau apparat comme devant-tre-bu, c'est--dire comme
corrlatif d' une soif saisi e non-thtiquement et dans son tre mme
comme devant tre rempl ie. Mais ces descriptions, qui impliquent
toutes une relation au futur du monde, seront plus claires si nous
montrons, prsent, comment, sur le fondement de la ngation
origineI I e, le temps du monde ou temps universel se dvoile la
conscience.
I V
LE TEMPS DU MONDE
Le temps universel vient a u monde par l e pour-soi. L'en-soi ne
dispose pas de temporalit prcisment parce qu'il est en-soi et que la
temporalit est l e mode d'tre unitaire d'un tre qui est perptuelle
ment distance de soi pour soi. Le pour-soi, au contraire, est
temporalit, mais il n'est pas conscience de temporalit, sauf lorsqu'il
se produit lui-mme dans l e rapport rflexif-rflchi . Sur l e mode
irrflchi il dcouvre la temporalit sur l'tre, c'est--dire dehors. La
temporalit universel l e est objective.
240
A) Le Pass.
Le ceci n' apparat pas comme un prsent qui aurait ensuite
devenir pass et qui , auparavant, tait futur. Cet encrier, ds que je l e
perois, a dj dans son existence ses trois dimensions temporelles.
En tant que j e l e saisis comme permanence, c'est--dire comme
essence, i l est dj au futur, quoique je ne lui sois pas prsent dans
mon actuelle prsence mais comme -venir--moi-mme. Et, du
mme coup, j e ne puis le saisir sinon comme ayant dj t l , dans l e
monde, en tant que j 'y tais dj , moi-mme, comme prsence. En ce
sens i l n'existe point synthse de rcognition , si l'on entend par
l une opration progressive d'identification qui, par organisation
successive des maintenant , confrerait une dure l a chose
perue. Mais le pour-soi dispose J'clatement de sa temporalit tout
au long de J'en-soi dvoil comme au long d'un mur immense et
monotone dont i l ne voit pas l e bout. Je sui s cette ngation originelle
que j ' ai tre, sur l e mode du pas-encore et du dj, auprs de J'tre
qui est ce qu'il est . Si donc nous supposons une conscience surgissant
dans un monde immobil e, auprs d' un tre unique qui serait
i mmuablement ce qu'il est, cet tre se dvoilera avec un pass et un
avenir d' immuabil it qui ne ricessiteront aucune opration de
synthse et qui ne feront qu' un avec son dvoilement mme.
L'opration ne serait ncessaire que si l e pour-soi avait, du mme
coup, reteni r et constituer son propre pass. Mais du simple fait
qu' i l est son propre pass, comme aussi son avenir propre, l e
dvoilement de l 'en-soi ne peut tre que temporalis. Le ceci se
dvoil e temporellement non parce qu'il se rfracterait travers une
forme a priori du sens interne, mais parce qu'il se dvoile un
dvoilement dont J'tre mme est temporalisation. Toutefois l'a
temporalit de J'tre est reprsente dans son dvoilement mme : en
tant qu'il est saisi par et dans une temporalit qui se temporalise, le
ceci parat origi nel lement comme temporel ; mais en tant qu'il est ce
qu' i l e'st, i l refuse d'tre sa propre temporalit, il reflte seulement l e
temps ; en outre i l renvoie l e rapport ek-statique i nterne -qui est la
source de l a temporalit - comme une pure relation objective
d' extriorit. La permanence, comme compromis entre l'identit
intemporelle et l'unit ek-statique de temporalisation, apparatra
donc comme le pur glissement d' instants en-soi, petits nants spars
les uns des autres et runis par un rapport de simple extriorit, la
surface d'un tre qui conserve une i mmuabilit atemporelle. Il n'est
donc pas vrai que l'intemporalit de l'tre nous chappe : elle est, au
contraire, donne dans le temps, elle fonde la manire d'tre du temps
universel.
En tant, donc, que le pour-soi tait ce qu' i l est, l'ustensile ou la
241
chose l ui apparat comme ayant t dj l . Le pour-soi ne peut tre
prsence au ceci que comme prsence qui tait ; toute perception est
en el le-mme, et sans aucune opration , une reconnaissance. Or,
ce qui se rvle travers l ' unit ek-statique du pass et du prsent,
c'est un tre identique. Il n' est point saisi comme tant le mme au
pass et au prsent, mais comme tant lui. La temporalit n'est qu'un
organe de vision. Pourtant ce lui qu'il est, l e ceci l'tait dj. Ainsi
apparat-il comme ayant un pass. Seulement, ce pass, i l refuse de
l 'tre, i l l'a seul ement. La temporalit, en tant qu' el l e est saisie
obj ectivement , est donc un pur fantme, car elle ne se donne pas
comme temporalit du pour-soi, ni non plus comme temporalit que
l 'en-soi a tre. En mme temps, le pass transcendant tant en-soi
titre de transcendance ne saurait tre comme ce que le prsent a
tre, il s'isol e dans un fantme de Selbststandigkeit . Et comme
chaque moment du pass est un ayant-t prsent , cet isolement
se poursuit l'intrieur mme du pass. En sorte que l e ceci
i mmuabl e se dvoile travers un papillotement et un morcellement
l 'infini d' en-soi fantmes. C'est ainsi que se rvlent moi ce verre ou
cette table : ils ne durent pas, i l s sont ; et le temps coule sur eux. Sans
doute di ra-t-on que je ne liois pas l eurs changements. Mais c'est
introduire ici inopportunment un point de vue scientifique. Ce point
de vue, que rien ne j ustifi e, est contredit par notre perception mme :
la pi pe, le crayon, tous ces tres qui se livrent tout entiers dans chacun
de leurs profils et dont la permanence est tout indiffrente la
multiplicit ds profi l s, sont aussi, quoique se dvoilant dans l a
temporalit, transcendants toute temporalit. La chose " existe
d'un seul j et , comme forme ", c'est--dire comme un tout qui n'est
affect par aucune des variations superficielles et parasitaires que
nous pouvons y VOI r. Chaque ceci se dvoile avec une loi d'tre qui
dtermine son seuil, c'est--dire le niveau de changement o il cessera
d'tre ce qu' i l est pour n'tre plus, simplement. Et cette loi d'tre qui
exprime l a permdnence est une structure immdiatement dvoile
de son essence, el l e dtermine une potentialit-limite du ceci celle
de disparatre du monde. Nous y reviendrons. Ainsi l e pour-soi saisit
la temporalit sur l 'tre, comme pur reflet qui se joue la surface de
l'tre sans aucune possibilit de l e modifier. Cette nantit absolue et
fantmale du temps, le savant l a fixera en concept sous l e nom
d'homognit. Mais la saisie transcendante et sur l'en-soi de l'unit
ek-statique du pour-soi temporalisant s'opre comme apprhension
d' une forme vide d'unit temporelle, sans aucun tre qui fonde cette
unit en l'tant. Ai nsi apparat donc, sur l e plan prsent-pass, cette
curieuse unit de la dispersion absolue qu'est la temporalit externe,
o chaque avant et chaque aprs est en-soi , isol des autres par
son extriorit d' i ndiffrence et o pourtant ces instants sont runis
dans l ' uni t d' tre d' un mme tre, cet tre commun ou Temps
242
n'tant autre que la dispersion mme, conue comme ncessit et
substantialit . Cette nature contradictoire ne saurait paratre que sur le
double fondement du pour-soi et de l'en-soi . A partir de l, pour la
rflexion scienti fi que, en tant qu'elle vise hypostasier la relation
d'extriorit, l'en-soi sera conu -c'est--dire pens vide -non
comme une transcendance vise travers l e temps, mais comme un
contenu qui passe d'i nstant en instant ; mieux encore, comme une
multiplicit de contenus extrieurs les uns aux autres et rigoureuse
ment semblables les uns aux autres.
Notre description de la temporalit universelle a t tente jusqu'ici
dans l'hypothse o rien ne viendrait de l'tre, sauf son immuabilit
intemporel l e. Mais prcisment quelque chose vient de l'tre : ce que
nous appellerons, faute de mieux, abolitions et apparitions. Ces
apparitions et ces abolitions doivent faire l'objet d'une lucidation
purement mtaphysique et non ontologique, car on ne saurait
concevoir leur ncessit ni partir des structures d'tre du pour-soi ni
partir de celles de l ' en-soi : leur existence est celle d'un fait contingent
et mtaphysique. Nous ne savons pas au juste ce qui vi ent de l'tre dans
le phnomne d'apparition puisque ce phnomne est dj le fait d'un
ceci temporalis. Cependant l'exprience nous apprend qu'il y a des
surgissements et des anantissements de ceci divers et, comme nous
savons, prsent, que la perception dvoile l'en-soi et, en dehors de
l'en-soi, rien, nous pouvons considrer l 'en-soi comme le fondement de
ces surgissements et de ces anantissements. Nous voyons clairement
en outre que l e principe d'identit, comme loi d'tre de l ' en-soi , exige
que l'abolition et l'apparition soient total ement extrieures l'en-soi
apparu ou aboli : sinon l' en-soi serait la fois et ne serait pas.
L'abolition ne saurait tre cette dchance d' tre qu'est une fin. Seul le
pour-soi peut connatre ces dchances parce qu'il est soi-mme sa
propre fi n. L'tre, quasi-affirmation o l ' affirmant est empt par
l 'affirm, existe sans finitude interne, dans la tension propre de son
affirmation-soi . Son jusque-l lui est totalement extrieur.
Ainsi l'abolition signifie non la ncessit d'un aprs, qui ne peut se
manifester que dans un monde et pour un pour-soi , mais d'un quasi
aprs. Ce quasi-aprs peut s'exprimer ai nsi : l'tre en-soi ne peut
oprer la mdiation entre lui-mme et son nant . Semblablement, les
apparitions ne sont pas des aventures de l'tre apparaissant. Cette
antriorit soi que supposerait l'aventure, nous ne pouvons la trouver
que dans le pour-soi, dont l'apparition comme la fin sont des aventures
internes. L'tre est ce qu'il est . Il est sans se mettre tre , sans
enfance, ni jeunesse : l'apparu n'est pas sa propre nouveaut, i l est
d'emble tre, sans rapport avec un avant qu' il aurait tre sur le mode
du n'tre-pas et o il aurait tre comme pure absence. Ici encore nous
trouvons une quasi-succession, c'est--dire une extriorit complte de
l'apparu par rapport son nant.
243
Mais pour que cette extriorit absolue soit donne sous la forme
du
i l y a , i l faut dj un monde ; c'est--dire l e surgissement d' un
pour-soi . L'ext riorit absolue de l'en-soi par rapport l ' en-soi fait
que le na
nt
mme qu'est l e quasi-avant de l'apparition ou l e quasi
aprs de l'abolition ne saurait mme trouver place dans la plnitude
de l'tre. C'est seulement dans l 'unit d' un monde et sur fond de
monde que peut apparatre un ceci qui n 'tait pas, que peut tre
dvoil ce rapport-d'absence-de-rapport qu' est l'extriorit ; l e nant
d'tre qU'es
.
t l ' ant
iorit pa
.
r rapport
,
un qui n'tait p
.
as )
ne peut vemr que retrospectlvement, a un par un pOur-SOl qUi
est son propre nant et sa propre antriori t. Ainsi l e surgissement et
l ' anantissement du ceci sont des phnomnes ambigus : ce qui vient
l ' tre par l e pour-soi, ici encore, c'est un pur nant , l e n'tre-pas
enCOre et l e n'tre-plus. L'tre considr n' en est pas l e fondement, ni
non plus l e monde comme totalit saisie avant ou aprs. Mais d'autre
part, en tant que l e surgissement se dvoi l e dans l e monde par un
pour-soi qui est son propre avant et son propre aprs, l'apparition se
donne d'abord comme une aventure ; nous saisissons le ceci apparu
comme tant dj l dans l e monde comme sa propre absence, en tant
que nous-mmes nous tions dj prsents un monde d'o i l tait
absent. Ainsi la chose peut surgir de son propre nant. Il ne s'agit pas
l d'une vue conceptuelle de l'esprit mais d'une structure origi nel l e de
l a perception .
Les expriences de la Gestalllheorie montrent clai re
ment que la pure apparition est toujours saisie comme surgissement
dy-amique
,
l'apparu vient en courant l 'tre, du fond du nant. Nous
avons ici, en mme temps, l'origine du principe de causalit .
L'idal de l a causalit n'est pas la ngation de l'apparu en t ant que tel,
comme l e voudrait un Meyerson, ni non plus l'assignation d' un lien
permanent d'extriorit entre deux phnomnes. La causalit pre
mi re, c'est la saisie de l'apparu avant qu'il apparaisse, comme tant
dj l dans son propre nant pour prparer son apparition. La
causalit est simpl ement l a saisie premire de l a temporalit de
l'apparu comme mode ek-statique d' tre. Mais l e caractre aventu
reux de l'vnement comme la constitution ek-statique de l'apparition
se dsagrgent dans la perception mme, l'avant et l'aprs se figent
dans son nant-en-soi , l'apparu dans son indiffrente identit, le non
tre de l 'apparu l ' instant antrieur se dvoile comme plnitude
i ndiffrente de l'tre existant cet instant, l e rapport de causalit se
dsagrge en pur rapport d'extriorit entre des ceci antrieurs
l'apparu et l 'apparu lui-mme. Ainsi l ' ambigut de l'apparition et de
la dispari ti on vient de ce qu'el l es se donnent, comme le monde,
comme l 'espace, comme l a potentialit et l'ustensilit, comme l e
temps universel l ui-mme, sous l ' aspect de totalits en perptuelle
dsagrgation.
Tel est donc le pass du monde, fait d'instants homognes et relis
24
les uns aux autres par un pur rapport d'extriorit. Par son pass,
nous l'avons dj not, le pour-soi se fond dans l'en-soi. Au pass le
pour-soi devenu en-soi se rvle comme tant au mi lieu du monde : il
est, i l a perdu sa transcendance. Et, de ce fait, son tre se passifie
dans le temps : i l n'y a aucune di ffrence entre l e pass du pour-soi et
le pass du monde qui lui fut coprsent sinon que le pour-soi a tre
son propre pass. Ainsi n' y a-t-il qu'un pass, qui est pass de l'tre
ou pass objectif dans lequel j'tais. Mon pass est pass dans le
monde, appartenance que je suis, que je fuis, la totalit de l ' tre
pass. Cela signifie qu'il y a concidence pour une des dimensions
temporelles entre l a temporalit ek-statique que j 'ai tre et le temps
du monde comme pur nant donn. C'est par le pass que j 'appar
tiens la temporalit universel l e, c' est par le prsent et le futur que
j' y chappe.
B) Le Prsent.
Le prsent du pour-soi est prsence l'tre et, en tant que tel , il
n'est pas. Mais il est dvoilement de l'tre. L'tre qui parat la
prsence se donne comme tant au prsent. C'est pour cette raison
que l e prsent se donne antinomiquement comme n' tant pas,
lorsqu'il est vcu, et comme tant la mesure unique de l ' tre en tant
qu'il se dvoile comme tant ce qu' i l est au prsent. Non que l'tre ne
dborde le prsent, mai s cette surabondance d'tre ne peut tre saisie
qu' travers l ' organe d'apprhension qu'est le pass, c'est--dire
comme ce qui n'est plus. Ainsi ce livre sur ma table est au prsent et i l
tait (identique lui-mme) au pass. Ainsi l e prsent s e dvoile-t-il
travers la temporalit originelle comme l'tre universel et en mme
temps i l n'est rien -rien de plus que l ' tre -, i l est pur glissement l e
long de l'tre, pur nant.
Les rflexions qui prcdent sembleraient indiquer que rien ne
vi ent de l ' tre au prsent sauf son tre. Ce serait oublier que l ' tre se
dvoile au pour-soi soit comme immobile, soit comme en mouve
ment, et que les deux notions de mouvement et de repos sont en
rapport di alectique. Or, l e mouvement ne saurait tre driv ontolo
giquement de la nature du pour-soi , ni de sa relation fondamentale
l'en-soi , ni de ce que nous pouvons dcouvrir originellement dans le
phnomne de l'tre. Un monde sans mouvement serait concevable.
Certes on ne saurait envisager la possibilit d'un monde sans
changement, sauf titre de possibilit purement formelle, mais le
changement n'est point l e mouvement. L changement est altration
de la qualit du ceci ; il se produi t, nous l'avons vu, d'un bloc par
surgissement ou dsagrgation d'une forme. Le mouvement suppose,
au contraire, la permanence de la qui ddit. Si un ceci devait l a fois
245
tre translat d'un l i eu en un autre et subir pendant cette translation
une al trati on radicale de son tre, cette altration serait ngatrice du
mouvemen t puisqu' i l n'y aurait plus rien qui ft en mouvement. Le
mouvement est pur changement de lieu d'un ceci demeurant par
ailleurs inaltr, comme le montre assez l e postul at de l'homognit
de l'espace. Le qu' on ne saurait dduire d'aucune
caractristique essenti ell e existants en prsence, qui fut ni par
l'o
ntologie late et qui ncessita, dans l'ontologie cartsi enne, le
fameux recours la chiquenaude , a donc la valeur exacte d'un
fait, i l participe rentire contingence de l'tre et doit tre accept
comme un donn . Certes nous verrons tout l'heure qu'il faut un
pour-soi pour qu'il y ait du mouvement, ce qui rend particulire
ment di fficile l 'assignation exacte de ce qui vient de l 'tre dans l e
mouvement pur ; mai s i l est hors de doute, en tout cas, que l e pour
soi, ici comme ail l eurs, n'ajoute rien l'tre ; ici comme ailleurs i l est
le pur Rien sur fon d duquel l e mouvement s'enlve. Mais s'il nous est
interdi t , par l a nature mme du mouvement, d' en essayer une
dduction, du moi ns est-il possible et mme ncessaire d' en faire une
description. Que faut-il donc concevoir comme sens du mouvement ?
On croit que le mouvement est simple affection de l'tre parce que
l e mobile se retrouve aprs l e mouvement tel qu'il tait antrieure
ment . On a souvent pos en principe que l a translation ne dformait
pas l a figure transl ate, tant i l paraissait vident que l e mouvement se
surajoutait l 'tre sans le modifi er ; et il est certain , nous l'avons vu,
que la quiddit du ceci demeure i naltre. Rien n' est plus typique de
<tte conception que l a rsistance qu' a rencontre une thorie comme
celle de Fitzgeral d sur l a contraction , ou comme celle d'Einstein
sur
l es variations de l a masse , parce qu'elles semblaient attaquer
plus
particulirement ce qui fait l'tre du mobile. De l vient
videmment le principe de l a relativit du mouvement, qui se
comprend merveil l e si celui-ci est une caractristique extrieure de
l'tre et si aucune modi fication intrastructurale ne l e dtermine. L
mOuvement devient alors une relation tellement externe de l'tre
SOn entourage qu' il devient quivalent de dire que l'tre est en
mOuvement et ses entours en repos, ou rciproquement que les
entours sont en mouvement et l'tre considr en repos. De ce point
de vue l e mouvement n'apparat ni comme un tre ni comme un mode
d'tre, mais comme un rapport entirement dsubstantialis.
Mais le fait que le mobile soit identique lui-mme au dpart et
l'arrive, c'est--dire dans les deux stases qui encadrent le mouve
ment, ne prjuge en rien de ce qu'il a t quand i l tait mobile.
Autant vaudrait dire que l'eau qui bout dans un autoclave ne subit
aucune transformation pendant l'bullition sous prtexte qu'elle
prsente les mmes caractres quand el l e est froide et quand el l e est
refroidie. Le fait qu'on peut assigner di ffrentes positions successives
24
6
au mobile pendant son mouvement et que, chaque pOSltlOn, i l
apparat semblabl e lui-mme ne doi t pas nous arrter non plus, car
ces positions dfinissent l'espace parcouru et non le mouvement lui
mme. C'est au contraire cette tendance mathmatique traiter le
mobile comme un tre en repos qu'on dplacerait l e long d'une ligne
sans l e tirer de son repos, c'est cette tendance qui est l'origine des
apories lati ques.
Ai nsi l'affirmation que l 'tre reste inchang dans son tre, qu' il soi t
en repos ou en mouvement , doi t nous apparatre comme un simple
postulat que nous ne saurions accepter sans critique. Pour le
soumettre cette critique, revenons sur les arguments latiques et en
particulier sur celui de la flche. La flche, nous dit-on, lorsqu'elle
passe par la position AB, y est exactement comme y serait une
flche en repos, avec l'extrmit de sa pointe en A et l'extrmit de sa
queue en B. Cela semble vident si l' on admet que le mouvement se
superpose l'tre et que, en consquence, rien ne vient dceler si
l ' tre est en mouvement ou en repos. En un mot, si l e mouvement est
un accident de l ' tre, l e mouvement et le repos sont indiscernables.
Les arguments qu' on a coutume d'opposer l a plus clbre des
apories latiques, celle d'Achille et de l a Tortue, sont sans porte ici.
A quoi bon en effet objecter que les Elates ont tabl sur la division
l'infini de l ' espace sans tenir un compte gal de celle du temps ? Il
n' est pas question i ci de position ni d'instant, mai s d'tre. Nous
approchons d' une conception correcte du problme lorsque nous
rpondons aux Elates qu'ils ont considr non l e mouvement, mais
l 'espace qui sous-tend l e mouvement. Mais nous nous bornons alors
indiquer la question sans la rsoudre : quel doit tre, en effet, l'tre
du mobile, pour que sa quiddit demeure inaltre, et que pourtant,
dans son tre, il soit distinct d'un tre en repos ?
Si nous essayons de mettre au clair nos rsistances aux arguments
de Znon, nous constatons qu'elles ont pour origine une certaine
conception naturelle du mouvement : nous admettons que l a fche
passe en AB mais il nous parat que passer en un lieu ne saurait
tre quivalent y demeurer, c'est--dire y tre. Seulement nous
faisons, en gnral, une grave confusion car nous estimons que le
mobi l e ne fait que passer en AB (c'est--dire qu'il n'y est jamais) et,
en mme temps, nous continuons supposer que, en soi-mme, i l est.
De la sorte, en mme temps, il serait en soi et ne serait pas en AB.
C'est l'origine de l ' aporie des Elates : comment la flche ne serait
ell e pas en AB, puisque, en AB, el l e est ? Autrement di t, pour viter
l'aporie elatique, il faut renoncer au postulat gnralement admis
selon lequel l'tre en mouvement conserve son tre-en-so- Passer
seulement en AB, c'est tre-de-passage. Qu'est-ce que passer ? C'est
l a fois tre en un lieu et n'y tre pas. En aucun moment on ne peut
dire que l'tre de passage est ici , sous peine de l'arrter brusquement ;
247
mais on ne saurait dire non plus qu' il n'est pas, ni qu'il n'y est pas, ni
qu'il est ailleurs. Son rapport avec le lieu n'est pas un rapport
d'occlation. Mais nous avons vu plus haut que la place d'un ceci en
repos tait son rapport d'extriorit au fond en tant que ce rapport
peut s'effondrer en multiplicit de rapports externes avec d'autres ceci
quand le fond lui-mme se dsagrge en multiplicit de formes 1 . Le
fondement de l'espace est donc l ' extriorit rciproque qui vient
l'tre par le pour-soi et dont l'origine est que l'tre est ce qu'il est. En
un mot c'est l 'tre qui dfinit son lieu en se rvlant un pour-soi
Comme i ndi ffrent aux autres tres. Et cette indiffrence n'est rien
que son i dentit mme, son absence de ralit ek-statique, en tant
qu'elle est saisie par un pour-soi qui est dj prsence d'autres ceci.
Du seul fait donc que le ceci est ce qu'il est, il occupe une place, il est
en un l i eu, c' est--dire il est mis en rapport par le pour-soi avec les
autres ceci comme n'ayant pas de rapports avec eux. L'espace est le
nant de rapport saisi comme rapport par l'tre qui est son propre
rapport. Le fait de passer en un lieu au lieu d'y tre ne peut donc
s'interp
rter qu' en termes d'tre. Cela signifie que l e lieu tant fond
par l'tre , l' tre n'est plus assez pour fonder son lieu : i l l 'esquisse
seulement ; ses relations d'extriorit avec les autres ceci ne peuvent
tre tablies par le pour-soi , parce qu'il est ncessaire qu'il les
tablisse partir d' un ceci qui est. Mais cependant ces relations ne
sauraient s'anantir, parce que l'tre partir duquel el l es s'tablissent
n'est pas un pur nant. Simplement, dans le maintenant mme o
On les tabl i t, i l est dj extrieur elles, c'est--dire qu'en
simultanit avec leur dvoilement, dj se dvoilent de nouvelles
relations d'extriorit dont le ceci considr est le fondement et qui
sont avec les premires dans un rapport d'extriorit. Mais cette
extriorit continue des relations spatiales qui dfinissent l e lieu de
l' tre ne peut trouver son fondement que dans l e fait que le ceci
considr est extrieur soi. Et, en effet , dire que le ceci passe en un
lieu, signifie qu'il n'y est dj plus quand il y est encore, c' est--dire
qu'il est, par rapport lui-mme, non pas dans un rapport ek-statique
d'tre mais dans un pur rapport d'extriorit. Ainsi y a-t-il lieu
dans la mesure o le ceci se dvoile comme extrieur aux autres ceci.
Et il y a passage en ce lieu dans la mesure o l'tre ne se rsume plus
dans cette extriorit mais au contraire lui est dj extrieur. Ainsi le
mouvement est l'tre d'un tre qui est extrieur soi . La seule
question mtaphysique qui se pose l'occasion du mouvement est
celle de l'extriorit soi . Que devons-nous entendre par l ?
Dans le mouvement, l'tre ne change en rien lorsqu'il passe de A en
B. Cela signifie que sa qualt, en tant qu'elle reprsente l'tre qui se
dvoile comme ceci au pour-soi, ne se transforme pas en une autre
1. Chap. III, section II.
248
qualit. Le mouvement n'est nullement assimilable au devenir ; il
n' altre pas l a qualit dans son essence, pas pl us qu'il ne l'actualise. La
qualit demeure exactement ce qu'elle est : c'est sa manire d'tre qui
est change. Cette bille rouge qui roule sur le billard ne cesse point
d'tre rouge, mais ce rouge qu'elle est, elle ne l'est pas de la mme
manire que lorsqu'elle tait en repos : il demeure en suspens entre
l'abolition et la permanence. En tant, en effet, que dj en B, il est
extrieur ce qu'il tait en A, i l Y a anantissement du rouge, mais en
tant qu' il se retrouve en C, par del B, il est extrieur cet
anantissement mme. Ainsi chappe-t-il l'tre par l'abolition et
l'abolition par l'tre. Il se rencontre donc une catgorie de ceci dans le
monde, dont le propre est de n'tre jamais, sans que pour cela ils
soient des nants. Le seul rapport que l e pour-soi puisse saisir
originellement sur ces ceci, c'est l e rapport d'extriorit soi. Car
l'extriorit tant le rien, il faut qu'il y ait un tre qui soit soi-mme
son propre rapport pour qu'il y ait de l 'extriorit soi . En un
mot, il nous est impossible de dfinir en purs termes d' en-soi ce qui se
rvle un pour-soi comme extriorit--soi. Cette extriorit ne
peut se dcouvrir que pour un tre qui est dj soi-mme l bas ce
qu' il est ici, c'est--dire pour une conscience. Cette extriorit--soi,
qui apparat comme une pure maladie de l'tre, c'est--dire comme
l'impossi'biIit qu'il y a pour certains ceci l a fois d'tre soi et d'tre
leur propre nant, doit se marquer par quelque chose qui soit comme
un rien dans le monde, c'est--dire comme un rien substantifi.
L'extriorit--soi n'tant nullement ek-statique, en effet, le rapport
du mobile soi-mme est pur rapport d' indiffrence et ne peut se
dcouvrir qu' un tmoin. C'est une abolition qui ne peut pas se faire
et une apparition qui ne peut pas se faire. Ce rien qui mesure et
signifie l'extriorit--soi , c'est la trajectoire, comme constitution
d'extriorit dans J'unit d'un mme tre. La trajectoire c'est la ligne
qui se tire, c'est--dire une brusque apparence d'unit synthtique
dans l ' espace, un faux-semblant qui s'effondre aussitt en multiplicit
infinie d'extriorit. Quand le ceci est en repos l'espace est ; quand il
est en mouvement, l ' espace s'engendre ou devient. La trajectoire n'est
jamais, puisqu'elle est rien : elle s'vanouit aussitt en pures relations
d'extriorit entre divers lieux, c'est--dire dans la simple extriorit
d'indiffrence ou spatialit. Le mouvement n'est pas davantage ; c'est
le moindre-tre d'un tre qui ne peut parvenir ni s'abolir ni tre
tout fait ; c'est l e surgissement, au sein mme de l'en-soi, de
l'extriorit d'indiffrence. Ce pur vacillement d'tre est aventure
contingente de l'tre. Le pour-soi ne peut le saisir qu' travers l ' ek
stase temporelle et dans une identification ek-statique et permanente
du mobile avec soi. Celte i dentification ne suppose aucune opration
et, en particulier, aucune synthse de rcognition , mais elle n'est
rien d'autre, pour le pour-soi , que l'unit d'tre ek-statique du pass
249
avec l e prsent. Ainsi l ' identificati on temporelle du mobile avec soi,
travers la position constante de sa propre extriorit, fait se dvoiler
l a t rajectoire, c'est--dire fait surgir l'espace sous la forme d'un
devenir vanescent. Par l e mouvement, l'espace s'engendre dans le
temps ; le mouvement tire la ligne, comme trac de l'extriorit soL
La ligne s'vanouit en mme temps que le mouvement et ce fantme
d' unit temporel l e de l'espace se fond continment dans l'espace
intemporel, c'est--dire dans la pure multiplicit de dispersion qui est
sans devenir.
Le pour-soi est, au prsent, prsence l'tre. Mais l'identit
ternel l e du permanent ne permet pas de saisir cette prsence comme
un reflet sur les choses, puisque rien ne vient di ffrencier ce qui est de
ce qui tait dans la permanence. La dimension prsente du temps
universel serait donc insaisissable s'il n'y avait l e mouvement. C'est le
mouvement qui dtermine en prsent pur l e temps universel. D'abord
parce qu'il se rvle comme vacillement prsent : dj, au pass, il
n'est plus rien qu'une ligne vanescente, un si ll age qui se dfai t ; au
futur, i l n'est pas du tout, faute d e pouvoir tre son propre projet ; il
est comme la progression constante d'une lzarde dans l e mur. Son
tre a d'aill eurs l'ambigut insaisissable de l'instant car on ne saurait
dire ni qu'il est ni qu'il n'est pas ; en outre peine parat-il que dj i l
est dpass et extrieur soi. I l symbolise donc parfaitement avec l e
prsent du pour-soi : l ' extriorit soi de l'tre qui ne peut ni tre ni
ne pas tre renvoie au pour-soi l ' i mage -projete sur l e pl an de l ' en
soi -d' un tre qui a tre ce qu' i l n' est pas et ne pas tre ce qu'il
est. Toute l a di ffrence est cell e qui spare l'extriorit--soi - o
l'tre n' est pas pour tre sa propre extriorit mais qui est tre , au
contraire, par l'identification d'un tmoin ek-statique - de la pure
ek-stase temporalisante o l'tre a tre ce qu'il n'est pas. Le pour
soi se fait annoncer son prsent par le mouvant ; il est son propre
prsent en si multanit avec le mouvement actuel, c'est le mouve
ment qui sera charg de raliser le temps universel, en tant que le
pour-soi se fait annoncer son propre prsent par le prsent du mobile.
Cette ralisation mettra en val eur l ' extriorit rciproque des ins
tants, puisque l e prsent du mobile se dfinit - cause de l a nature
mme du mouvement - comme extriorit son propre pass et
extriorit cette extriorit. La division l'infini du temps est
fonde dans cette extriorit absolue.
C) Le Futur.
Le futur originel est possibilit de cette prsence que j'ai tre par
del le rel un en-soi qui est par del l ' en-soi rel. Mon futur
entrane comme coprsence future l'esquisse d'un monde futur et,
250
comme nous l'avons vu, c'est ce monde futur qui se dvoile au pour-soi
que je serai et non les possibilits mmes du pour-soi , qui ne sont
connaissables que par l e regard rflexif. Mes possibles tant l e sens de
ce que je suis surgissant du mme coup comme un par-del de l'en-soi
quoi je suis prsence, le futur de l'en-soi qui se rvle mon futur est en
liaison directe et troite avec le rel quoi je suis prsence. C'est l'en
soi prsent modifi, car mon futur n'est autre que mes possibilits de
prsence un en-soi que j' aurais modifi. Ainsi l e futur du monde se
dvoile mon futur. I l est fait de la gamme des potentialits, qui va de
la simple permanence et de l'essence pure de l a chose jusqu'aux
puissances. Ds que j e fixe l'essence de la chose, que je la saisis comme
table ou encrier, je suis dj l-bas au futur, d' abord parce que son
essence ne peut tre qu' une coprsence ma possibilit ultrieure de
n' tre-plu-que-cette-ngation, ensuite parce que sa permanence et
son ustensilit mme de table ou d' encrier nous renvoient au futur.
Nous avons suffisamment dvelopp ces remarques dans les sections
prcdentes pour nous dispenser d'y insister. Ce que nous voulons
noter seulement c'est que toute chose, ds son apparition comme
chose-ustensile, loge certaines de ses structures et proprits d' emble
dans l e futur. Ds l 'apparition du monde et des ceci, il y a un futur
universel . Seulement nous avons marqu plus haut que tout tat }
futur du monde lui demeure tranger, en pleine extriorit rciproque
d' indiffrence. I l y a des futurs du monde qui se dfinissent par des
chances et deviennent des probables autonomes, qui ne se probabili
sent pas mais qui sont en tant que probables, comme des mainte
nant } tout constitus, avec leur contenu bien dtermi n, mais pas
encore raliss. Ces futurs appartiennent chaque ceci ou collection de
ceci mais ils sont dehors. Qu'est-ce donc alors que l'avenir universel ? Il
faut l e voir comme l e cadre abstrait de cette hirarchie d'quivalences
que sont les futurs, contenant d' extriorits rciproques qui est lui
mme extriorit, somme d'en-soi qui est elle-mme en soi . C'est dire
que, quel que soit l e probable qui doive l'emporter, i l y a et i l y aura un
avenir mais, de ce fai t, cet avenir indiffrent et extrieur au prsent,
compos de maintenant indi ffrents les uns aux autres et runis par
l e rapport substantifi d'avant-aprs (en tant que ce rapport, vid de
son caractre ek-stati que, n' a plus que l e sens d'une ngation externe),
est une srie de contenants vides runis les uns aux autres par l ' unit de
la dispersion. En ce sens, tantt l'avenir apparat comme une urgence
et une menace, en tant que j 'accole troitement l e futur d' un ceci son
prsent par l e projet de mes propres possibilits par del l e coprsent ,
tantt cette menace se dsagrge en pure extriorit et j e ne saisis plus
l' aveni r que sous l'aspect d'un pur contenant formel , indiffrent ce
qui le remplit et homogne l'espace, en tant que simple loi
d' extriorit, et tantt enfin i l se dcouvre comme un nant en-soi, en
tant qu' il est dispersion pure par del l'tre.
25 1
Ainsi les di mensions temporel les travers lesquelles le ceci
i ntemporel nous est donn, avec son a-temporalit mme, prennent
des qualits nouvelles lorsqu'elles apparaissent sur l'objet : l'tre-en
soi, l'obj ectivi t, l'extriorit d' i ndi ffrence, la dispersion absolue. Le
Temps, en tant qu'il se dcouvre une temporalit ek-statique qui se
temporalise, est partout transcendance soi et renvoi de l'avant
l'aprs et de l ' aprs l'avant. Mais cette transcendance soi, en tant
qu' il se fait saisir sur l 'en-soi , i l n' a pas l'tre, el l e est te en l ui . La
cohsion du temps est un pur fantme, refet objectif du projet ek
statique du pour-soi vers soi-mme et de la cohsion en mouvement
de l a ralit-humaine. Mais cette cohsion n'a aucune raison d'tre si
l 'on considre le temps par lui-mme, elle s'effondre aussitt en une
mul tiplicit absol ue d'instants qui , considrs sparment, perdent
toute nature temporel l e et se rduisent purement et simplement la
totale a-temporalit du ceci. Ainsi le temps est pur nant en-soi qui ne
peut sembler avoir un tre que par l' acte mme dans lequel le pour-soi
le franchit pour l ' uti liser. Encore cet tre est-il celui d'une forme
singulire qui s'enlve sur fond indiffrenci de temps et que nous
appellerons le laps de temps. En effet notre premire apprhension
du temps objectif est pratique : c'est en tant mes possibilits par del
l 'tre coprsent, que je dcouvre le temps objectif comme l e
corrlatif, dans l e monde, du nant qui me spare de mon possibl e.
De ce point de vue l e temps apparat comme forme fini e, organise,
au sei n d' une dispersion indfinie ; l e laps de temps est comprim de
temps au sei n d' une absolue dcompression et c'est l e projet de nous
mme vers nos possibles qui ralise la compression. Ce comprim de
temps est certes une forme de dispersion et de sparation car i l
exprime dans l e monde l a distance qui me spare de moi-mme. Mais
d'autre part, comme j e ne me projette jamais vers un possible qu'
travers une srie organise de possibles dpendants qui sont ce que
j 'ai tre pour tre . . . et comme l eur dvoilement non thmatique et
non positionnel est donn dans le dvoilement non positionnel d u
possibl e majeur vers quoi j e me projette, l e temps se dvoile moi
comme forme temporelle objective, comme chelonnement organis
des probabl es : cette forme objective ou laps est comme la trajectoire
de mon acte.
Ainsi le temps apparat par trajectoires. Mais, de mme que les
trajectoires spatiales se dcompriment et s'effondrent en pure spatia
lit stati que, ainsi la trajectoire temporelle s'effondre ds qu'elle n'est
pas simplement vcue comme ce qui sous-entend objectivement notre
attente de nous-mme. Les probables, en effet, qui se dcouvrent
moi tendent naturellement s'isol er en probables en soi et occuper
une fraction rigoureusement spare du temps objectif, le laps de
temps s'vanouit, l e temps s e rvle comme chatoiement de nant l a
surface d' un tre rigoureusement a-temporel.
252
v
LA CONNAI SS ANCE
Cette rapide esquisse du dvoilement du monde au pour-soi nous
permet de conclure. Nous accorderons l'idalisme que l'tre du
pour-soi est connaissance de l'tre mais en ajoutant qu' il y a un tre
de cette connaissance. L'identit de l'tre du pour-soi et de la
connaissance ne vient pas de ce que l a connaissance est la mesure de
l'tre mais de ce que le pour-soi se fait annoncer ce qu'il est par l'en
soi , c'est--dire de ce qu' il est, dans son tre, rapport l'tre. La
connaissance n'est rien d' autre que la prsence de l ' tre au pour-soi et
l e pour-soi n' est que l e rien qui ralise cette prsence. Ainsi l a
connaissance est-el l e, par nature, tre ek-statique et elle se confond
de ce fait avec l'tre ek-statique du pour-soi. Le pour-soi n'est pas
pour connatre ensuite et l'on ne peut pas dire non plus qu'il n'est
qu'en tant qu'il connat ou qu'il est connu, ce qui ferait vanouir l'tre
en une infinit rgle de connaissances particulires. Mais c'est le
surgissement absolu du pour-soi au milieu de l'tre et par del l'tre,
partir de l'tre qu' i l n'est pas et comme ngation de cet tre et
nantisation de soi, c' est cet vnement absolu et premier qui est
connaissance. En un mot, par un renversement radical de la position
idaliste, l a connaissance se rsorbe dans l'tre : elle n' est ni un
attribut, ni une fonction, ni un accident de l'tre ; mais il n'y a que de
l'tre. De ce point de vue i l apparat comme ncessaire d'abandonner
entirement l a position idaliste et, en particulier, i l devient possible
d'envisager le rapport du pour-soi l'en-soi comme une relation
ontologique fondamentale ; nous pourrons mme, l a fin de ce livre,
considrer cette articulation du pour-soi par rapport l'en-soi comme
l'esquisse perptuellement mouvante d'une quasi-totalit que nous
pourrons nommer l' EIre. Du point de vue de cette totalit, le
surgissement du pour-soi n'est pas seulement l'vnement absolu
pour l e pour-soi , c'est aussi quelque chose qui arrive l'en-soi, l a seule
aventure possible de l'en-soi : tout se passe en effet comme si le pour
soi, par sa nantisation mme, se constituait en conscience de . . . ,
c'est--dire par sa transcendance mme chappait cette l oi de l'en
soi en qui l'affirmation est empte par l 'affirm. Le pour-soi par sa
ngation de soi devient affirmation de l'en-soi. L'affirmation inten
tionnel l e est comme l'envers de l a ngation interne ; il ne peut y avoir
affirmation que par un tre qui est son propre nant et d' un tre qui
n'est pas l'tre affirmant. Mais alors dans l a quasi-totalit de l'Etre,
l'affirmation arrive l ' en-soi : c'est l'aventure de l 'en-soi que d'tre
affirm. Cette affirmation qui ne pouvait tre opre comme affirma-
253
tion de soi par l ' en-soi sans tre destructrice de son tre-en-soi, il
arrive l ' en-soi qu'el l e se ralise par le pour-soi ; elle est comme une
ek-stase passive de l ' en-soi qui le laisse inaltr et qui pourtant
s'effectue en lui et partir de lui. Tout se passe comme s'il y avait une
passion du pour-soi qui se perdait lui-mme pour que l'affi rmation
monde arrive l 'en-soi. Et, certes, cette affirmation n'existe que
pour l e pour-soi , elle est l e pour-soi l ui -mme et disparat avec lui.
Mais el l e n'est pas dans le pour-soi , car el l e est l ' ek-stase mme et si l e
pour-soi est l'un de ses termes (l ' affirmant), l'autre terme, l'en-soi, l ui
est rellement prsent ; c' est dehors, sur l'tre, qu' il y a un monde qui
se dcouvre moi .
Au raliste, d' autre part, nous concderons que c'est l'tre mme
qui est prsent la conscience dans la connaissance et que le pour-soi
n'ajoute rien l'en-soi, sinon le fait mme qu'il y ait de l'en-soi , c'est
-dire la ngation affirmative. Nous avons pris tche en effet de
mOntrer que le monde et la chose-ustensil e, l ' espace et l a quantit
comme le temps uni versel taient de purs nants substantialiss et ne
modifiai ent en rien l'tre pur qui se rvle travers eux. En ce sens,
tout est donn, tout est prsent moi sans distance et dans son entire
ralit ; rien de ce que je vois ne vient de moi, il n'y a rien en dehors
de ce que je vois ou de ce que j e pourrais voir. L'tre est partout
autour de moi, il semble que je puisse le toucher, le saisir ; la
reprsentation, comme vnement psychique, est une pure invention
des philosophes. Mais cet tre qui m' i nvestit de toute part et dont
rien ne me spare, c'est prcisment rien qui m' en spare et ce rien,
parce qu'il est nant , est infranchissabl e. Il y a de l ' tre parce que
j e suis ngation de l ' tre et l a mondanit, l a spatialit, la quantit,
l ' ustensil it , la temporalit ne viennent l'tre que parce que je suis
ngation de l'tre , elles n'ajoutent rien l'tre, elles sont de pures
conditions nantises du i l y a , el l es ne font que raliser l e il y a.
Mais ces conditions qui ne sont rien me sparent plus radicalement de
l'tre que ne l e feraient des dformations prismatiques travers
lesquelle j e pourrais encore esprer le dcouvrir. Di re qu' i l y a de
l'tre n'est rien et pourtant c'est oprer une totale mtamorphose,
puisqu'il n 'y a d' tre que pour un pour-soi. Ce n'est pas dans sa
qualit propre que l'tre est relatif au pour-soi , ni dans son tre, et par
l nous chappons au relativisme kantien ; mais c'est dans son il y
a , puisque dans sa ngation interne le pour-soi affirme ce qui ne
peut s' affirmer, connat l'tre tel qu'il est alors que l e t el qu' il est
ne saurait apparteni r l ' tre. En ce sens, la fois le pour-soi est
prsence i mmdiate l'tre et, la fois, i l se glisse comme une
distance infinie entre lui-mme et ['tre. C'est que l e connatre a pour
idal l'tre-ce-qu'on-connat et pour structure originelle l e ne-pas
tre-ce-qui-est-connu. Mondanit, spatialit, etc. , ne font qu'expri
mer ce ne-pas-tre. Ainsi j e me retrouve partout entre moi et l'tre
254
comme le rien qui n 'est pas l'tre. Le monde est humain. On voit l a
position trs particulire de la conscience : l'tre est partout, contre
moi , autour de moi , il pse sur moi , il m'assige et je suis
perptuellement renvoy d'tre en tre, cette table qui est l c'est de
l'tre et rien de plus ; cette roche, cet arbre, ce paysage : de l'tre et
autrement rien. Je veux saisir cet tre et je ne trouve plus que moi.
C'est que l a connaissance, intermdiaire entre l'tre et le non-tre,
me renvoie l'tre absolu si je la veux subjective et me renvoie moi
mme quand je crois saisir l'absolu. Le sens mme de la connaissance
est ce qu' i l n'est pas et n'est pas ce qu' i l est, car pour connatre l ' tre
tel qu' i l est, il faudrait tre cet tre, mais il n'y a de tel qu'il est
que parce que je ne suis pas l'tre que je connais et si je le devenais l e
tel qu'il est s'vanouirait et ne pourrait mme plus tre pens. Il
ne s'agit l ni d'un scepticisme - qui suppose prcisment que le tel
qu'il est appartient l'tre - ni d' un relativisme. La connaissance
nous met en prsence de l'absolu et i l y a une vrit de la
connaissance. Mais cette vrit, quoique ne nous livrant rien de plus
et rien de moins que l'absolu, demeure strictement humaine.
On s'tonnera peut-tre que nous ayons trait le problme du
connatre sans poser l a question du corps et des sens ni nous y rfrer
une seule fois. Il n' entre pas dans notre dessein de mconnatre ou de
ngliger l e rle du corps. Mais i l importe avant tout, en ontologie
comme partout ailleurs, d'observer dans le discours un ordre rigou
reux. Or le corps, quelle que puisse tre sa fonction, apparat d'abord
comme du connu. Nous ne saurions donc rapporter lui la connais
sance, ni traiter de lui avant d'avoir dfini le connatre, ni driver de
l ui , en quel que faon et de quelque manire que ce soit, le connatre
dans sa structure fondamentale. En outre le corps -notre corps a
pour caractre particulier d'tre essentiellement le connu par autrui :
ce que je connais c'est l e corps des autres et l'essentiel de ce que j e
sai de mon corps vient de l a faon dont les autres l e voient. Ainsi l a
nature de mon corps me renvoie l'existence d'autrui et mon tre
pour-autrui. Je dcouvre avec lui, pour l a ralit-humaine, un autre
mode d'existence aussi fondamental que l'tre-pour-soi et que j e
nommerai l' tre-pour-autrui . Si je veux dcrire de faon exhaustive l e
rapport de l'homme avec l'tre il faut prsent que j'aborde l'tude
de cette nouvelle structure de mon tre : le pour-autrui. Car l a
ralit-humaine doi t tre dans son tre , d'un seul et mme surgisse
ment, pour-soi-pour-autrui.
Troisime partie
LE POUR- AUTRUI
CHAPI TRE PREMI ER
L'existence d'autrui
LE PROBLME
Nous avons dcrit l a ralit-humaine partir des conduites
ngatives et du cogito. Nous avons dcouvert , en suivant ce fil
conducteur, que la ralit-humaine tait-pour-soi. Est-ce l tout ce
qu'ell e est ? Sans sortir de notre attitude de description rflexive,
nous pouvons rencontrer des modes de conscience qui semblent, tout
en demeurant en eux-mmes strictement pour-soi, indiquer un type
de structure ontologique radicalement diffrent. Cette structure
ontologique est mienne, c'est mon sujet que je me soucie et pourtant
ce souci pour-moi me dcouvre un tre qui est mon tre sans tre
pour-moi.
Considrons, par exemple, la honte. I l s'agit d'un mode de
conscience dont la structure est identique toutes celles que nous
avons prcdemment dcrites. Ell e est conscience non positionnelle
(de) soi comme honte et, comme tel l e, c'est un exemple de ce que les
Allemands appellent Erlebnis , elle est accessible la rflexion.
En outre sa structure est i ntentionnel l e, elle est apprhension
honteuse de quelque chose et ce quelque chose est moi. J'ai honte de
ce que je suis. La honte ralise donc une relation intime de moi avec
moi : j 'ai dcouvert par la honte un aspect de mon tre. Et pourtant,
bien que certaines formes complexes et drives de la honte puissent
apparatre sur le plan rflexif, la honte n'est pas originellement un
phnomne de rflexion. En effet , quels que soient les rsultats que
l'on puisse obtenir dans la solitude par la pratique religieuse de la
honte, la honte dans sa structure premire est honte devant quel
qu'un Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire : ce geste colle
259
moi , je ne le j uge ni ne le bl me, je le vis simplement, je le ralise
sur le mode du pour-soi. Mais voici tout coup que je lve la tte :
quel qu'un tait l et m' a vu. Je ralise tout coup toute la vulgarit de
mon geste et j 'ai honte. II est certain que ma honte n'est pas rflexive,
car la prsence d'autrui ma conscience , ft-ce la manire d'un
catalyseur, est incompatible avec l 'attitude rflexive : dans l e champ
de ma rflexion je ne puis jamais rencontrer que la conscience qui est
mienne. Or autrui est le mdiateur indispensable entre moi et moi
mme : j 'ai hont e de moi tel que j'apparais autrui. Et, par
l'apparition mme d'autrui , j e suis mis en mesure de porter un
jugement sur moi-mme comme sur un objet, car c'est comme objet
que j ' apparais autrui . Mais pourtant cet objet apparu autrui, ce
n'est pas une vaine image dans l'esprit d'un autre. Cette image en
effet serait entirement imputable autrui et ne saurait me tou
cher . Je pourrais ressentir de l'agacement, de la colre en face
d'elle, comme devant un mauvais portrait de moi, qui me prte une
lai deur ou une bassesse d'expression que je n'ai pas ; mais je ne
saurais tre attei nt j usqu'aux moelles : la honte est, par nature,
reconnaissance. Je reconnais que je suis comme autrui me voit. II ne
s'agit cependant pas de la comparaison de ce que je suis pour moi ce
que j e suis pour autrui, comme si je trouvais en moi , sur le mode
d'tre du pour-soi, un quivalent de ce que je suis pour autrui .
D'abord cette comparaison ne se rencontre pas en nous, titre
d'opration psychique concrte : la honte est un frisson immdiat qui
me parcourt de l a tte aux pi eds sans aucune prparation discursive.
Ensuite, cette comparaison est i mpossibl e : je ne puis mettre en
rapport ce que je suis dans l'intimit sans distance, sans recul , sans
perspective du pour-soi avec cet tre injustifiable et en-soi que je suis
pour autrui. II n'y a ici ni talon ni table de correspondance. La
notion mme de vulgarit implique d'ailleurs une relation intermona
dique. On n'est pas vulgaire tout seul . Ainsi autrui ne m'a pas
seulement rvl ce que j 'tais : il m' a constitu sur un type d'tre
nouveau qui doit supporter des qualifications nouvelles. Cet tre
n 'tait pas en puissance en moi avant l'apparition d'autrui car il
n'aurait su trouver de place dans le pour-soi ; et mme si l'on se plat
me doter d'un corps entirement constitu avant que ce corps soit
pour l es autres, on ne saurait y loger en puissance ma vulgarit ou ma
maladresse, car ell es sont des significations et, comme telles, elles
dpassent le corps et renvoient l a fois un tmoin susceptible de les
comprendre et la totalit de ma ralit-humaine. Mais cet tre
nouveau qui apparat pour autrui ne rside pas en autrui ; j' en suis
responsabl e, comme l e montre bien ce systme ducatif qui consiste
faire honte aux enfants de ce qu'ils sont. Ainsi la honte est honte
de soi devant autrui ; ces deux structures sont insparables. Mais du
mme coup, j 'ai besoin d'autrui pour saisir plein toutes les
260
structures de mon tre, le pour-soi renvoie au pour-autrui. Si donc
nous voulons saisir dans sa totalit l a relation d'tre de l'homme
l'tre-en-soi, nous ne pouvons nous contenter des descriptions
esquisses dans les prcdents chapitres de cet ouvrage ; nous devons
rpondre deux questions bien autrement redoutables : tout d'abord
celle de l'existence d'autrui, ensuite celle de mon rapport d'tre avec
l'tre d'autrui .
I I
L' CUEI L DU SOLI PSI SME
I l est curieux que le problme des Autres n'ait jamais vraiment
inquit les ralistes. Dans la mesure o l e raliste se donne tout ,
il lui parat sans doute qu' il se donne autrui. Au milieu du rel , en
effet , quoi de plus rel qu'autrui ? C'est une substance pensante de
mme essence que moi, qui ne saurait s'vanouir en qualits secondes
et qualits premires et dont je trouve en moi les structures
essentielles. Toutefois, dans la mesure o le ralisme tente de rendre
compte de l a connaissance par une action du monde sur l a substance
pensante, il ne s'est pas souci d'tablir une action immdiate et
rciproque des substances pensantes entre elles : c'est par l'interm
diaire du monde qu'elles communiquent ; entre l a conscience d'autrui
et l a mi enne, mon corps comme chose du monde et le corps d'autrui
sont les intermdiaires ncessaires. L'me d'autrui est donc spare
de l a mienne par toute l a distance qui spare tout d'abord mon me
de mon corps, puis mon corps du corps d'autrui, enfin le corps
d'autrui de son me. Et, s'il n'est pas certain que le rapport du pour
soi au corps soit un rapport d'extriorit (nous aurons traiter plus
tard de ce problme), au moins est-il vident que l a relation de mon
corps avec le corps d'autrui est une relation de pure extriorit
indi ffrente. Si les mes sont spares par leurs corps, elles sont
distinctes comme cet encrier est distinct de ce livre, c'est--dire qu'on
ne peut concevoir aucune prsence immdiate de l 'une l'autre. Et si
mme l'on admet une prsence immdiate de mon me au corps
d'autrui , il s'en faut encore de toute l'paisseur d'un corps que
j'atteigne son me. Si donc l e ralisme fonde sa certitude sur la
prsence en personne de la chose spatio-temporelle ma cons
cience, il ne saurait rclamer l a mme vidence pour la ralit de
l ' me d'autrui, puisque, de son aveu mme , cette me ne se donne
pas en personne l a mienne : elle est une absence, une signification,
le corps indique vers el l e sans l a livrer ; en un mot, dans une
261
philosophie fonde sur l' intuition, il n'y a aucune intuition de l'me
d'autrui . Or, si l'on ne joue pas sur les mots, cela signifie que le
ralisme ne fait aucune place l'intuition d'autrui : il ne servirait
rien de dire qu'au moins le corps de j'autre nous est donn, et que ce
corps est une certaine prsence d'autrui ou d'une partie d'autrui : i l
est vrai que J e corps appartient l a totalit que nous nommons
ralit-humaine comme une de ses structures. Mais prcisment i l
n'est corps de l'homme qu'en tant qu'il existe dans l'unit indissoluble
de cette total i t, comme l'organe n'est organe vivant que dans la
totalit de l'organisme. La position du ralisme, en nous livrant l e
corps non point envelopp dans la totalit humaine mais part,
comme une pierre ou un arbre ou un morceau de cire, a tu aussi
srement le corps que le scalpel du physiologiste en sparant un
morceau de chair de l a totalit du vivant. Ce n'est pas le corps d'autrui
qui est prsent l ' intuition raliste : c'est un corps. Un corps qui , sans
doute, a des aspects et une ;u; particuliers, mais qui appartient
cependant la grande famille des corps. S'il est vrai que pour un
ralisme spiritualiste, l'me est plus facile connatre que le corps, le
corps sera plus facil e connatre que l'me d'autrui.
A vrai dire, l e raliste se soucie assez peu de ce problme : c'est
qu'il tient l'existence d'autrui pour certaine. C'est pourquoi la
psychologie raliste et positive du XIXe sicle, prenant pour accorde
l'existence de mon prochain, se proccupe exclusivement d'tablir les
moyens que j 'ai de connatre cette existence et de dchiffrer sur le
corps les nuances d'une conscience qui m'est trangre. Le corps,
dira-t-on, est un objet dont 1' U; rclame une interprtation
particulire. L' hypothse qui rend le mieux compte de ses comporte
ments, c'est celle d'une conscience analogue l a mienne et dont il
reflterait les di ffrentes motions. Reste expliquer comment nous
faisons cette hypothse : on nous dira tantt que c'est par analogie
avec ce que je sais de moi-mme et tantt que c'est l'exprience qui
nous apprend dchiffrer, par exemple, la coloration subite d'un
visage comme promesse de coups et de cris furieux. On reconnatra
volontiers que ces procds peuvent seulement nous donner d'autrui
une connaissance probable : il reste toujours probable qu'autrui ne
soit qu' un corps. Si l es animaux sont des machines, pourquoi l'homme
que je vois passer dans la rue n'en serait-il pas une ? Pourquoi
l 'hypothse radicale des bhaviouristes ne serait-elle pas l a bonne ?
Ce que je saisis sur ce visage n'est rien que l 'effet de certaines
contractions musculaires et cel les-ci leur tour ne sont que l'effet
d' un influx nerveux dont je connais le parcours. Pourquoi ne pas
rduire l' ensemble de ces ractions des rflexes simples ou
conditionns ? Mais la plus grande partie des psychologues demeurent
convaincus de l'existence d'autrui comme ralit totalitaire de mme
structure que l a leur propre. Pour eux l'existence d'autrui est certaine
262
et la connaissance que nous en avons est probable. On voit le
sophisme du ralisme. En fait, il faut renverser les termes de cette
affirmation et reconnatre que, si autrui ne nous est accessible que par
l a connaissance que nous en avons et si cette connaissance est
seulement conjecturale, l 'existence d'autrui est seulement conjectu
rale et c'est le rle de la rflexion critique que de dterminer son
degr exact de probabilit. Ainsi, par un curieux retournement, pour
avoir pos l a ralit du monde extrieur, le raliste est forc de verser
dans l'idalisme lorsqu'il envisage l ' existence d'autrui. Si le corps est
un objet rel agissant rellement sur la substance pensante, autrui
devient une pure reprsentation, dont l'esse est un simple percipi,
c'est--dire dont l 'existence est mesure par la connaissance que nous
en avons. Les thories plus modernes de l'Einfhlung, de la sympa
thie et des formes ne font que perfectionner la description de nos
moyens de prsentifier autrui, mais elles ne mettent pas l e dbat sur
son vritable terrain : qu'autrui soit d'abord senti ou qu'il apparaisse
dans l ' exprience comme une forme singulire avant toute habitude
et en l' absence de toute i nfrence analogique, il n'en demeure pas
moins que l'objet signifiant et senti , que la forme expressive renvoient
purement et simplement une totalit humaine dont l'existence
demeure purement et simplement conjecturale.
Si le ralisme nous renvoie ainsi l'idalisme, n'est-il pas plus avis
de nous mettre immdiatement dans l a perspective idaliste et
critique ? Puisque autrui est ma reprsentation , ne vaut-il pas
mieux i nterroger cette reprsentation au sein d'un systme qui rduit
l'ensemble des objets un groupement li de reprsentations et qui
mesure toute existence par la connaissance que j'en prends ?
Nous trouverons pourtant peu de secours chez un Kant : proc
cup, en effet, d'tablir les lois universelles de la subjectivit, qui sont
les mmes pour tous, il n'a pas abord la question des personnes. Le
sujet est seulement l'essence commune de ces personnes, i l ne saurait
pas plus permettre de dterminer leur multiplicit que l'essence
d'homme, pour Spinoza, ne permet de dterminer celle des hommes
concrets. II semble donc d'abrd que Kant et rang le problme
d'autrui parmi ceux qui ne relevaient pas de sa critique. Pourtant
regardons-y mieux : autrui, comme tel, est donn dans notre exp
rience ; c'est un objet et un objet particulier. Kant s'est plac du point
de vue du sujet pur pour dterminer les conditions de possibilit non
seulement d' un objet en gnral, mais des diverses catgories
d'objets : l'objet physique, l'objet mathmatique, l'objet beau ou laid
et celui qui prsente des caractres tlologiques. De ce point de vue
on a pu reprocher des lacunes son uvre et vouloir, par exemple,
tablir l a suite d'un Di lthey les conditions de possibilit de l'objet
historique, c'est--dire tenter une critique de la raison historique.
Pareillement, s'il est vrai qu'autrui reprsente un type particulier
263
d'ohjet qui se dcouvre notre exprience, il est ncessaire, dans l a
perspective mme d 'un kantisme rigoureux, de se demander com
ment l a connaissance d'autrui est possible, c'est--dire d'tablir les
conditions de possibilit de l'exprience des autres.
Il serait tout fait erron, en effet, d'assimiler le problme d'autrui
celui des ralits noumnales. Certes, s'il existe des autrui et s'ils
sont sembl ables moi , la question de leur existence intelligible peut
se poser pour eux comme celle de mon existence noumnale se pose
pour moi ; certes, aussi , l a mme rponse vaudra pour eux et pour
moi : cette existence noumnale peut tre seulement pense, mais
non conue. Mais lorsque je vise autrui dans mon exprience
quotidienne, ce n'est nullement une ralit noumnale que je vise,
pas plus que j e ne saisis ou ne vise ma ralit intelligible lorsque j e
prends connaissance de mes motions ou de mes penses empiriques.
Autrui est un phnomne qui renvoie d'autres phnomnes : une
colre-phnomne qu'il ressent contre moi, une srie de penses qui
lui apparaissent comme des phnomnes de son sens intime ; ce que je
vise en autrui ce n'est rien de pl us que ce que je trouve en moi-mme.
Seulement ces phnomnes sont radicalement distincts de tous les
autres.
En premier lieu, l'apparition d'autrui dans mon exprience se
manifeste par l a prsence de formes organises telles que la mi mique
et l'expression, les actes et les conduites. Ces formes organises
renvoient une uni t organisatrice qui se situe par principe en dehors
de notre exprience. C'est la colre d'autrui, en tant qu'elle apparat
son sens intime et qu'elle se refuse par nature mon aperception, qui
fait la signification et qui est peut-tre la cause de la srie de
phnomnes que j e saisis dans mon exprience sous l e nom d'expres
sion ou de mi mique. Autrui , comme unit synthtique de ses
expriences et comme volont autant que comme passi on, vient
organiser mon exprience. Il ne s'agit pas de la pure et simple action
d' un noumne i nconnaissable sur ma sensibilit, mais de la constitu
tion dans le champ de mon exprience, par un tre qui n' est pas moi ,
de groupes lis de phnomnes. Et ces phnomnes, la diffrence
de tous les autres, ne renvoient pas des expriences possibles mais
des expriences qui , par principe, sont en dehors de mon exprience
et appartiennent un systme qui m'est inaccessible. Mais d'autre
part la condition de possibilit de toute exprience, c'est que le sujet
organise ses impressions en systme li. Aussi ne trouvons-nous dans
les choses que ce que nous y avons mis . L'autre ne peut donc nous
apparatre sans contradiction comme organisant notre exprience : i l
y aurait surdtermination du phnomne. Pouvons-nous encore
utiliser ici la causalit ? Cette question est bien faite pour marquer le
caractre ambigu de l'autre dans une philosophie kantienne. En effet,
l a causalit ne saurait lier entre eux que des phnomnes. Mais
264
prcisment la colre qu'autrui ressent est un phnomne et l'expres
sion furieuse que je perois en est un autre. Peut-il y avoir entre eux
un lien causal ? Il serait conforme leur nature phnomnale ; et, en
ce sens, j e ne me prive poi nt de considrer la rougeur du visage de
Paul comme l'effet de sa colre : ceci fait partie de mes affirmations
courantes. Mais d'autre part la causalit n'a de sens que si elle relie
des phnomnes d'une mme exprience et contribue constituer
cette exprience. Peut-elle servir de pont entre deux expriences
radicalement spares 7 Il faut noter ici qu' en l ' utilisant ce titre, j e
lui ferai perdre sa nature d'unification idale des apparitions empiri
ques : la causalit kantienne est uni fication des moments de mon
temps sous la forme de l'irrversibilit. Comment admettre qu'elle
unifiera mon temps et celui de l' autre ? Quelle relation temporelle
tablir entre la dcision de s'exprimer, phnomne apparu dans la
trame de l'exprience d'autrui, et l' expressi on, phnomne de mon
exprience ? La simultanit ? La succession ? Mais comment un
instant de mon temps peut-il tre en rapport de simultanit ou de
succession avec un instant du temps d'autrui ? Mme si une harmonie
prtablie et d'ailleurs incomprhensible dans la perspective kan
tienne faisait correspondre instant par instant les deux temps envi
sags, ils n'en resteraient pas moins deux temps sans relation,
puisque, pour chacun d'eux, la synthse unificative des moments est
un acte du sujet. L'universalit des temps, chez Kant, n'est que
l' universalit d'un concept, elle signifie seulement que chaque tempo
ralit doit possder une structure dfinie, que les conditions de
possibilit d'une exprience temporelle sont valables pour toutes les
temporalits. Mais cette identit de l' essence temporelle n'empche
pas plus la diversit incommunicable des temps que l'identit de
l'essence d'homme n'empche la diversit incommunicable des cons
ciences humaines. Ainsi, le rapport des consciences tant par nature
impensable, le concept d'autrui ne saurait constituer notre exp
rience : i l faudra le ranger, avec les concepts tlologiques, parmi les
concepts rgulateurs. Autrui appartient donc la catgorie des
comme si , c'est une hypothse a priori qui n' a d'autre justification
que l ' unit qu' elle permet d'oprer dans notre exprience et qui ne
saurait tre pense sans contradiction. S'il est possible en effet de
concevoir, titre de pure occasion de la connaissance, l'action d' une
ralit intelligible sur notre sensibil i t, i l n' est mme pas pensable,
par contre , qu'un phnomne , dont la ralit est strictement relative
son apparition dans l'exprience d'autrui, agisse rellement sur un
phnomne de mon exprience. Et mme si nous admettions que
l'action d'un intelligible s'exerce la fois sur mon exprience et sur
celle d'autrui (au sens o la ralit intelligible affecterait autrui dans
la mesure mme o eHe m'affecterait), il n'en demeurerait pas moins
radicalement impossible d'tablir ou mme de postuler un parall-
265
lisme et une tahle de correspondance entre deux systmes qui se
consti tuent spontanment 1.
Mais, d'autre part , l a qualit de concept rgulateur convient-elle
bien au concept d'aut rui ? Il ne s'agit pas en effet d'tahlir une unit
plus forte entre les phnomnes de mon exprience au moyen d'un
concept purement formel qui permettrait seulement des dcouvertes
de dtail dans les obj ets qui m'apparaissent. Il ne s'agit pas d'une
sorte d'hypothse a priori ne dpassant pas le champ de mon
exprience et incitant des recherches nouvelles dans les limites
mmes de ce champ. La perception de l'objet-autrui renvoie un
systme cohrent de reprsentations et ce systme n'est pas le mien.
Cela signifie qu'autrui n'est pas, dans mon exprience, un phnomne
qui renvoie mon exprience, mais qu' il se rfre par principe des
phnomn(s situs en dehors de toute exprience possible pour moi .
Et, certes, l e concept d' autrui permet des dcouvertes et des
prvisions au sein de mon systme de reprsentations, un resserre
ment de la trame des phnomnes : grce l'hypothse des autres j e
puis prvoir ce geste partir de celle expression. Mais ce concept ne se
prsente pas comme ces notions scientifiques (l es imaginaires, par
exempl e) qui interviennent au cours d'un calcul de physique, comme
des instruments, sans tre prsentes dans l'nonc empirique du
problme et pour tre l i mines des rsultats. Le concept d'autrui
n'est pas purement instrumental : loin qu' il existe pour servir
l'unification des phnomnes, il faut dire, au contraire, que certaines
catgories de phnomnes semblent n'exister que pour lui. L'exis
tence d'un systme de significations et d'expriences radicalement
distinct du mi en est le cadre fixe vers lequel indiquent dans leur
coulement mme des sries diverses de phnomnes. Et ce cadre,
par principe extrieur mon exprience, se remplit peu peu. Cet
autrui dont nous ne pouvons saisir l a relation moi et qui n' est jamais
donn, nous le constituons peu peu comme un objet concret : il
n'est pas l'instrument qui sert prvoir un vnement de mon
exprience, mais ce sont les vnements de mon exprience qui
servent constituer autrui en tant qu'autrui, c'est--dire en tant que
systme de reprsentations hors d'atteinte comme un objet concret et
connaissabl e. Ce que j e vi se constamment travers mes expriences,
ce sont les sentiments d'autrui, les ides d'autrui , les volitions
d'autrui , le caractre d'autrui. C'est que, en effet, autrui n'est pas
seulement cel ui que je vois, mais celui qui me voit. Je vise autrui en
tant qu'il est un systme li d'expriences hors d'atteinte dans lequel
je figure comme un objet parmi les autres. Mais dans l a mesure o j e
1 . Mme si nous admettions l a mtaphysique kantienne de la nature et l a
table des principes qu'a dresse Kant, i l serait possible de concevoir des
physiques radicalement diffrentes partir de ces principes.
266
m' efforce de dtermi ner la nat ure concrte de ce systme de
reprsentations et la place que j'y occupe ti tre (j'ohj et, je transcende
radicalement l e champ de mon exprience : je m'occupe d'une srie
de phnomnes qui , par princ
i
pe, ne pourront jamais tre accessibles
mon i ntui ti on et, par consquent, j 'outrepasse les droits de ma
connaissance ; je cherche lier e ntre elles des expriences qui ne
seront j amais mes expriences et , par consquent, ce travail de
construction et d' unification ne peut en rien servir l 'unification de
ma propre exprience : dans l a mesure o autrui est une absence i l
chappe la nalllre. On ne saurait donc qualifier autmi de concept
rgulateur. Et certes des ides comme l e Monde, par exemple,
chappent aussi par principe mon exprience ; mais au moins s'y
rapportent-elles et n' ont-el l es de sens que par el l e. Autrui , au
contraire, se prsente, en un certain sens, comme la ngation radicale
de mon exprience, puisqu'il est celui pour qui je suis non sujet mais
obj et . Je m' efforce donc, comme sujet de connaissance, de dtermi
ner comme objet le sujet qui nie mon caractre de sujet et me
dtermine lui-mme comme objet.
Ainsi l'autre ne peut tre, dans la perspective idaliste, considr ni
comme concept constitutif ni comme concept rgulateur de ma
connaissance. I I est conu comme rel et pourtant j e ne puis concevoir
son rapport rel avec moi, je le construis comme ohjet et pourtant i l
n'est pas livr par l'intui ti on, je l e pose comme sujet et pourtant c'est
titre d'objet de mes penses que j e le considre. Il ne reste donc que
deux solutions pour l'idaliste : ou hien se dharrasser entirement
du concept de l ' autre et prouver qu'il est inutile la constitution de
mon exprience ; ou bien affirmer l'existence relle d'autrui, c'est-
dire poser une communication relle et extra-empirique entre les
consciences.
La premire solution est connue sous le nom de solipsisme : si
pourtant el l e se formul e, en conformit avec sa dnomination,
comme affirmation de ma solitude ontologique, el le est pure hypo
thse mtaphysique, parfaitement injustifie et -gratuite, car el l e
revient dire qu'en dehors de moi rien n'existe, elle dpasse donc l e
champ strict de mon exprience. Mais si el l e se prsente plus
modestement comme un refus de quitter l e terrain solide de l'exp
rience, comme une tentative positive pour ne pas faire usage du
concept d'autrui , elle est parfaitement logique, elle demeure sur le
plan du positivisme critique et, bien qu' el l e s'oppose aux tendances
les plus profondes de notre tre, elle tire sa justification des
contradictions de la notion des autres considre dans la perspective
idaliste. Une psychologie qui se voudrait exacte et objective, comme
l e bhaviourisme de Watson, ne fait en somme qu'adopter le
solipsisme comme hypothse de travai l . II ne s'agira pas de nier la
prsence, dans le champ de mon exprience, d'objets que nous
267
pourrons nommer tres psychiques mais seulement de pratiquer
une sorte d' E.foXri touchant l'existence de systmes de reprsenta
tions organises par un sujet et situes en dehors de mon exp
rience.
En face de cette sol ution, Kant et la majorit des postkantiens
conti nuent d' affirmer l'existence d'autrui . Mais ils ne peuvent se
rfrer qu'au bon sens ou nos tendances profondes pour justifier
leur affirmati on. On sait que Schopenhauer traite l e solipsiste de
fou enferm dans un blockhaus imprenable . Voi l un aveu
d'impuissance. Cest qu' en effet, par la position de l ' existence de
l'autre, on fai t clater soudain les cadres de l'idalisme et l'on
retombe dans un ralisme mtaphysi que. Tout d'abord, en posant
une plmalit de systmes clos et qui ne peuvent communiquer que
par l e dehors, nous rtablissons implicitement la notion de sub
stance. Sans doute ces systmes sont non-substantiels, puisqu'ils sont
simples systmes de reprsentat
i
ons. Mais leur extriorit rcipro
que est extriorit en soi ; elle est sans tre connue ; nous n'en
saisissons mme pas les effets de mani re certaine, puisque l ' hypo
thse solipsiste demeure toujours possible . Nous nous bornons
poser ce nant en-soi comme un fait absolu : il n'est pas relatif, en
effet, notre connaissance d'autrui, mais c'est l ui , au contraire, qui
la conditionne. Donc, mme si les consciences ne sont que de pures
liaisons conceptuelles de phnomnes, mme si l a rgle de leur
existence est l e percipere et l e percipi , i l n'en demeure pas
moins que l a multiplicit de ces systmes relationnels est multiplicit
en-soi et qu' el l e l es transforme immdiatement en systmes en soi .
Mais en outre, si je pose que mon exprience de la colre d'autrui a
pour corrlatif dans un autre systme une exprience subjective de
colre, j e restitue l e systme de l 'image vraie, dont Kant avait eu si
grand souci de se dbarrasser. Certes i l s'agit d' un rapport de
convenance entre deux phnomnes, l a colre perue dans l es gestes
et mi miques et la colre apprhende comme ralit phnomnale
du sens i ntime - et non d'un rapport entre un phnomne et une
chose en soi. Mais i l n'en demeure pas moins que l e critre de la
vrit est ici l a conformit de la pense son objet, non l'accord des
reprsentations entre elles. En effet, prcisment parce qu'ici tout
recours au noumne est cart, le phnomne de l a colre ressentie
est celui de l a colre constate comme l e rel objectif son image,
Le problme est bien cel ui de l a reprsentation adquate, puisqu'il y
a un rel et un mode d'apprhension de ce rel. S' il s'agissait de ma
propre colre, je pourrais en effet considrer ses manifestations
subjectives et ses manifestations physiologiques et objectivement
dcelables comme deux sries d' effets d' une mme cause, sans que
l ' une des sries reprsentt l a vrit de l a colre ou sa ralit et
l'autre seulement son effet ou son image. Mais si l'une des sries des
268
phnomnes rside en autrui et l'autre en moi , l'une fonctionne
comme l a ralit de l'autre et l e schma raliste de l a vrit est le seul
qui puisse s'appliquer ici.
Ainsi nous n'avons abandonn l a position raliste du problme que
parce qu'el l e aboutissait ncessairement l'idalisme ; nous nous
sommes dlibrment plac dans l a perspective idaliste et nous n'y
avons rien gagn car celle-ci, inversement, dans la mesure o elle
refuse l'hypothse solipsiste, aboutit un ralisme dogmatique et
totalement injustifi. Voyons si nous pouvons comprendre cette
inversion brusque des doctrines et si nous pouvons tirer de ce
paradoxe quelque enseignement qui facilitera une position correcte
de la question.
A l 'origine du probl me de l'existence d'autrui, il y a une
prsupposition fondamentale : autrui , en effet, c'est l'autre, c'est-
dire le moi qui n'est pas moi ; nous saisissons donc ici une ngation
comme structure constitutive de l'tre-autrui. La prsupposition
commune l'idalisme et au ralisme, c'est que la ngation consti
tuante est ngation d'extriorit. Autrui , c'est celui qui n'est pas moi
et que j e ne suis pas. Ce ne-pas indique un nant comme lment de
sparation donn entre autrui et moi-mme. Entre autrui et moi
mme il y a un nant de sparation. Ce nant ne tire pas son origine
de moi-mme, ni d'autrui, ni d' une relation rciproque d'autrui et de
moi-mme ; mais i l est, au contraire, originellement le fondement de
toute relation entre autrui et moi , comme absence premire de
relation. C'est que, en effet, autrui m'apparat empiriquement
l 'occasion de la perception d' un corps et ce corps est un en-soi
extrieur mon corps ; l e type de relation qui unit et spare ces deux
corps est la relation spatiale comme le rapport des choses qui n'ont
pas de rapport entre elles, comme l'extriorit pure en tant qu'elle est
donne. Le raliste qui croit saisir autrui travers son corps estime
donc qu'il est spar d'autrui comme un corps d'un autre corps, ce qui
signifie que le sens ontologique de l a ngation contenue dans le
jugement : Je ne suis pas Paul est du mme type que celui de l a
ngation contenue dans le jugement : La table n' est pas la chaise.
Ainsi la sparation des consciences tant imputable aux corps, i l y a
comme un espace originel entre l es consciences di verses, c'est--dire,
prcisment, un nant donn, une distance absol ue et passivement
subie. L'idalisme, certes, rduit mon corps et le corps d'autrui des
systmes objectifs de reprsentati on. Mon corps, pour Schopenhauer,
n'est rien d'autre que l'objet immdiat . Mais on ne supprime pas
pour cela l a distance absolue entre les consciences. Un systme total
de reprsentations -c'est--dire chaque monade -ne pouvant tre
limit que par soi-mme ne saurait entretenir de rapport avec ce qui
n'est pas lui. Le sujet connaissant ne peut ni limiter un autre sujet ni
se faire limiter par lui . I l est isol par sa plnitude positive et, par
269
suite, entre l ui-mme et un autre systme pareillement isol une
sparation spaliafe est conserve comme le type mme de l'extrio
ri t. Ainsi , c'est encore l' espace qui spare implicitement ma cons
cience de celle d' autrui. Encore faut-il ajouter que l ' idaliste, sans y
prendre garde, recourt un troisime homme pour faire appara
tre cette ngation d'extriorit. Car, nous l'avons vu, toute relation
externe, en tant qu'elle n'est pas constitue par ses termes mmes,
requiert un tmoi n pour l a poser. Ainsi, pour l'idaliste comme pour
le raliste, une conclusion s'impose : du fait qu'autrui nous est rvl
dans un monde spatial, c'est un espace rel ou idal qui nous spare
d' a utrui .
Cette prsupposition ent rane une grave consquence : si, en effet,
je dois tre par rapport autrui sur le mode de l'extriorit
d' i ndi ffrence, je ne saurais pas plus tre affect en mon tre par le
surgissement ou l 'abolition d'autrui qu'un en-soi par l'apparition ou la
disparition d' un autre en-soi. Par suite, du moment qu'autrui ne peut
agir sur mon tre par son tre, la seule faon dont i l peut se rvler
moi , c'est d'apparatre comme objet ma connaissance. Mais il faut
entendre par l que je dois constituer autrui comme l'unification que
ma spontanit impose une di versit d'impressions, c'est--dire que
je suis celui qui constitue autrui dans le champ de son exprience,
Autrui ne saurait donc tre pour moi qu'une image, mme si, par
ailleurs, toute l a thorie de l a connaissance que j 'ai difie vise
repousser cette notion d' image ; et seul un tmoin qui serait extrieur
l a fois moi-mme et autrui pourrait comparer l'image au modle
et dcider si elle est vraie. Ce tmoin, par ailleurs, pour tre autoris
ne devrait pas tre son tour vis--vis de moi-mme et d'autrui dans
un rapport d'extriorit , si non il ne nous connatrait que par des
images. Il faudrait que, dans l'unit ek-statique de son tre, i l soit l a
fois ici, sur moi , comme ngation interne de moi-mme et l-bas sur
autrui, comme ngation intere d'autrui. Ainsi ce recours Di eu,
qu' on trouverait chez Leibniz, est purement et simplement recours
la ngation d' intriorit : c'est ce que dissimule la notion thologique
de cration : Di eu la fois est et n'est pas moi-mme et autrui
puisqu'il nous cre. Il convient, en effet, qu'il soit moi-mme pour
saisir ma ralit sans intermdiaire et dans une vidence apodictique
et qu'il ne soit pas moi, pour garder son impartialit de tmoin et pour
pouvoir l-bas tre et n'tre pas autrui. L'image de l a cration est l a
pl us adquate ici , puisque dans l'acte crateur, je vois jusqu'au fond
ce que je cre -car ce que je cre c'est moi -et cependant ce que je
cre s'oppose moi en se refermant sur soi dans une affirmation
d'objectivit. Ainsi la prsupposition spatialisante ne nous laisse pas
l e choix : i l faut recourir Dieu ou tomber dans un probabilisme qui
laisse l a porte ouverte au solipsisme. Mai s cette conception d' un Dieu
qui est ses cratures nous fait tomber dans un nouvel embarras : c' est
270
celui que manifeste le problme des substances dans la pense
postcartsienne. Si Dieu est moi et s'il est autrui, qu'est-ce donc qui
garantit mon existence propre ? Si la cration doit tre continue, je
demeure toujours en suspens entre une existence distincte et une
fusion panthiste dans l'Etre Crateur. Si la cration est un acte
originel et si je me suis referm contre Dieu, rien ne garantit plus
Di eu mon existence, car il n'est plus uni moi que par un rapport
d'extriorit, comme le sculpteur la statue acheve, et derechef i l ne
peut me connatre que par des images. Dans ces conditions, la notion
de Dieu, tout en nous rvl ant l a ngation d'intriorit comme la
seule liaison possible entre des consciences, laisse paratre toute son
insuffisance : Dieu n'est ni ncessaire ni suffisant comme garant de
l'existence de l'autre ; en outre, l ' existence de Dieu comme i nterm
diaire entre moi et autrui suppose dj la prsence en liaison
d' i ntriorit d'un autrui moi-mme, puisque Dieu, tant dot des
qualits essentielles d'un Esprit, apparat comme la quintessence
d'autrui et puisqu'il doit pouvoir dj tre en liaison d'intriorit avec
moi-mme pour qu'un fondement rel de l'existence d'autrui soit
valable pour moi. Il semble donc qu'une thorie positive de l'exis
tence d'autrui devrait pouvoir l a fois viter le solipsisme et se passer
du recours Dieu si el l e envisageait ma relation originelle autrui
comme une ngation d'intriori t, c'est--dire comme une ngation
qui pose la distinction originelle d'autrui et de moi-mme dans la
mesure exacte o elle me dtermine par autrui et o elle dtermine
autrui par moi. Est-il possible d'envisager la question sous cet aspect ?
I I I
HUSSERL, HEGEL , HEI DEGGER
I l semble que l a philosophie du XIXe et du XXe sicle ait compris
qu'on ne pouvait chapper au sol i psisme si l'on envisageait d'abord
moi-mme et autrui sous l'aspect de deux substances spares : toute
union de ces substances, en effet , doit tre tenue pour impossible.
C'est pourquoi l'examen des thories modernes nous rvle un effort
pour saisir au sein mme des consciences une liaison fondamentale et
transcendante autrui qui serait constitutive de chaque conscience
dans son surgissement mme. Mais si l'on parat abandonner le
postulat de la ngation externe, on conserve sa consquence essen
ti el l e, c'est--dire l 'affirmation que ma liaison fondamentale autrui
est ralise par la connaissance.
Lorsque Husserl, en effet, se proccupe, dans les Mditations
271
cartsiennes et dans Formate und Transzendentate Logik, de rfuter l e
solipsisme, i l croit y parvenir en mOIJtrant que l e recours autrui est
condition indispensable de la constitution d'un monde. Sans entrer
dans l e dtail de la doctri ne, nous nous bornerons indiquer son
principal ressort : pour Husserl , l e monde tel qu'il se rvle la
conscience est intermonadique. Autrui n'y est pas seulement prsent
comme telle apparition concrte et empirique mais comme une
condition permanente de son unit et de sa richesse. Que j e considre
dans l a solitude ou en compagnie cette table ou cet arbre ou ce pan de
mur, autrui est toujours l comme une couche de significations
constitutives qui appartiennent l'objet mme que je considre ; en
bref, comme l e vritable garant de son objectivit. Et comme notre
moi psychophysique est contemporain du monde, fait partie du
monde et tombe avec l e monde sous l e coup de l a rduction
phnomnologique, autrui apparat comme ncessaire l a constitu
tion mme de ce moi. Si j e dois douter de l ' existence de Pierre, mon
ami -ou des autres en gnral -en tant que cette existence est par
principe en dehors de mon expri ence, i l faut que j e doute aussi de
mon tre concret, de ma ralit empirique de professeur, ayant tel l e
ou tell e incl ination, tel les habitudes, tel caractre. Il n'y a pas de
privilge pour mon moi : mon Ego empirique et l'Ego empirique
d'autrui apparaissent en mme temps dans l e monde ; et la significa
tion gnrale autrui est ncessaire l a constitution de l'un comme
de l ' autre de ces Ego . Ai nsi , chaque objet, l oin d'tre, comme
pour Kant, constitu par une simple relation au sujet , apparat dans
mon exprience concrte comme polyval ent, i l se donne originelle
ment comme possdant des systmes de rfrences une pluralit
indfinie de consciences ; c'est sur l a table, sur le mur qu'autrui se
dcouvre moi , comme ce quoi se rfre perptuellement l ' objet
considr, aussi bien qu' l'occasion des apparitions concrtes de
Pierre ou de Paul .
Certes, ces vues ralisent un progrs sur les doctrines classiques. Il
est incontestable que l a chose-ustensile renvoie ds sa dcouverte
une pluralit de pour-soi . Nous aurons y revenir. Il est certain aussi
que l a signification autrui ne peut venir de l'exprience, ni d' un
raisonnement par analogie opr l ' occasion de l'exprience : mais,
bien au contraire, c' est l a lueur du concept d'autrui que l'exprience
s'interprte. Est-ce dire que le concept d'autrui est a priori ? Nous
essaierons, par la suite , de l e dterminer. Mais malgr ces incontesta
bles avantages, la t horie de Husserl ne nous parat pas sensibl ement
diffrente de celle de Kant . C' est que, en effet, si mon Ego empirique
n'est pas plus sr que celui d'autrui, Husserl a conserv l e sujet
transcendantal , qui en est radical ement distinct et qui ressemble fort
au sujet kantien. Or, ce qu' i l faudrait montrer, ce n'est pas l e
paralllisme des Ego empiriques, qui ne fait de doute pour
272
personne, c'est celui des sujets transcendantaux. C'est que, en effet,
autrui n'est jamais ce personnage empirique qui se rencontre dans mon
exprience : c'est le sujet transcendantal auquel ce personnage renvoie
par nature. Ainsi le vritable problme est-il celui de la liaison des
sujets transcendantaux par del l'exprience . Si l'on rpond que, ds
l'origine, le sujet transcendantal renvoie i d'autres sujets pour la
constitution de l'ensemble nomatique, il est facile de rpondre qu'il y
renvoie comme des significations. Autrui serait ici comme une
catgorie supplmentaire qui permettrait de constituer un monde, non
comme un tre rel existant par del ce monde. Et, sans doute, l a
catgorie d'autrui i mpl i que, dans sa signification mme, un renvoi
de l'autre ct du monde un sujet, mais ce renvoi ne saurait tre
qu'hypothtique, il a la pure valeur d'un contenu de concept
unificateur ; il vaut dans et pour l e monde, ses droits se limitent au
monde et autrui est par nature hors du monde. Husserl s'est d'ailleurs
t la possibilit mme de comprendre ce que peut signifier l'tre extra
mondain d'autrui, puisqu'il dfinit l'tre comme la simple indication
d'une srie infinie d'oprations effectuer. On ne saurait mieux
mesurer l'tre par la connaissance. Or, en admettan t mme que la
connaissance en gnral mesure l\tre, l'tre d'autrui se mesure dans sa
ralit par la connaissance qu'autrui prend de lui-mme, non par celle
que j 'en prends. Ce qui est atteindre par moi, c'est autrui, non en tant
que j 'en prends connaissance, mais en tant qu'il prend connaissance de
soi, ce qui est impossible : cela supposerait, en effet, l'identification en
i ntriorit de moi-mme autrui. Nous retrouvons donc ici cette
distinction de principe entre autrui et moi-mme, qui ne vient pas de
l'extriorit de nos corps, mais du simple fait que chacun de nous existe
en intriorit et qu' une connaissance valable de l'intriorit ne peut se
faire qu'en intriorit, ce qui interdit par principe toute connaissance
d'autrui tel qu' il se connat , c'est--dire tel qu'il est. Husserl l'a compris
d'ailleurs puisqu'il dfinit autrui , tel qu'il se dcouvre notre
exprience concrte, comme une absence. Mais, dans la philosophie de
Husserl du moins, comment avoir une intuition pleine d'une absence ?
Autrui est l'objet d'intentions vides, autrui se refuse par principe et
fuit ; la seule ralit qui demeure est donc celle de mon intention :
autrui, c'est le nome vide qui correspond ma vise vers autrui, dans
la mesure o i l parat concrtement dans mon exprience ; c'est un
ensemble d'oprations d' unification et de constitution de mon exp
rience, dans la mesure o il parat comme un concept transcendantal.
Husserl rpond au solipsiste que l ' existence d'autrui est aussi sre que
celle du monde en comprenant dans le monde mon existence
psychophysique ; mais le solipsiste ne dit pas autre chose : elle est aussi
sre, dira-t-il , mais pas plus. L'existence du monde est mesure,
ajoutera-t-il, par la connaissance que j'en prends ; i l ne saurait en aller
autrement pour l'existence d'autrui.
273
l'avais cru, aut refois, pouvoir chapper au solipsisme en refusant
Husserl l 'existence de son Ego transcendantal 1 . Il me semblait
alors qu' i l ne demeurait plus rien dans ma conscience qui ft privilgi
par rapport autrui, puisque je la vidais de son sujet. Mais, en fait ,
bien que j e demeure persuad que l'hypothse d'un sujet transcen
dantal est inutile et nfaste , son abandon ne fait pas avancer d'un pas
la question de l 'existence d' autrui . Si mme, en dehors de l ' Ego
empirique, i l n' y avait rien d'autre que la conscience de cet Ego -
c'est--dire un champ transcendantal sans sujet -il n'en demeurerait
pas moins que mon affirmation d'autrui postule et rclame l'exis
tence, par del le monde, d'un semblable champ transcendantal ; et,
par sui te, l a seule faon d'chapper au solipsisme serait, ici encore, de
prouver que ma conscience transcendantale, dans son tre mme, est
affecte par l'existence extra-mondaine d' autres consciences de mme
type. Ainsi, pour avoir rduit J'tre une srie de significations, la
seule liaison que Husserl a pu tablir entre mon tre et celui d'autrui
est celle de l a connaissance ; il ne saurait donc, pas plus que Kant,
chapper au solipsisme.
Si, sans observer les rgles de l a succession chronologique, nous
nous conformons celles d' une sorte de dialectique intemporelle, l a
solution que Hegel donne au problme, dans l e premier volume de l a
Phnomnologie de l' Esprit, nous paratra raliser un progrs impor
tant sur celle que propose HusserL Ce n'est plus, en effet , l a
constitution du monde et de mon ego empirique que l ' apparition
d'autrui est indispensable : c'est l'existence mme de ma conscience
comme conscience de soi . En tant que conscience de soi , en effet, le
Moi se saisit lui-mme. L'galit moi moi ou Je suis je est
l'expression mme de ce fait. Tout d'abord cette conscience de soi est
pure identit avec elle-mme ; pure existence pour soi. Elle a la
certitude de soi-mme, mais cette certitude est encore prive de
vrit. En effet, cette certitude serait vraie seulement dans l a mesure
o sa propre existence pour soi lui apparatrait comme objet
i ndpendant. Ainsi l a conscience de soi est d'abord comme une
rel ation syncrtique et sans vrit entre un sujet et un objet non
encore objectiv qui est ce sujet lui-mme. Son impulsion tant de
raliser son concept en devenant consciente d'elle-mme tous
gards, elle tend se faire valable extrieurement en se donnant
objectivit et existence manifeste : il s'agit d'expliciter le Je suis je
et de se produire soi-mme pour objet afin d'atteindre le stade ultime
du dveloppement -stade qui naturellement est, en un autre sens, le
premier moteur du devenir de l a conscience -et qui est l a conscience
de soi gnrale qui se reconnat dans d'autres consciences de soi et qui
est identique avec el les et avec elle-mme. Le mdiateur, c'est l'autre.
1. La Transcendance de l'Ego , in Recherches philosophiques, 1937.
274
L'autre apparat avec moi-mme , puisque la conscience de soi est
identique avec el le-mme par l'excl usion de tout autre. Ainsi le fait
premier c'est la pluralit des consciences et cette pluralit est ralise
sous forme d' une double et rciproque relation d'exclusion. Nous
voil en prsence du lien de ngation par intriorit que nous
rclamions tout l'heure. Aucun nant externe et en soi ne spare ma
conscience de l a conscience d' autrui , mai s c' est par le fai t mme
d'tre moi que j 'exclus l'autre : l'autre est ce qui m'exclut en tant
soi, ce que j 'exclus en tant moi . Les consciences sont directement
portes les unes sur les autres dans une imbrication rciproque de leur
tre. Cela nous permet, en mme temps, de dfinir la manire dont
m' apparat l'autre : il est ce qui est autre que moi, donc il se donne
comme obj et inessentiel, avec un caractre de ngativit. Mais cet
autre est aussi une conscience de soi. Tel quel i l m' apparat comme un
objet ordinaire, immerg dans l'tre de la vie. Et c'est ainsi,
galement, que j 'apparais l' autre : comme existence concrte,
sensible et i mmdiate. Hegel se place ici sur le terrain non de la
relation univoque qui va de moi (apprhend par le cogito) l 'autre,
mais de la relation rciproque qu' i l dfinit : le saisissement de soi de
l'un dans l'autre . En effet, c'est seulement en tant qu'il s'oppose
l'autre que chacun est absolument pour soi ; il affirme contre l'autre et
vis--vis de l'autre son droi t d' tre individualit. Ai nsi le cogito lui
mme ne saurait tre un point de dpart pour la philosophie ; il ne
saurait natre, en effet, qu'en consquence de mon apparition pour
moi comme individualit et cette apparition est conditionne par la
reconnaissance de l'autre. Loin que le problme de l'autre se pose
partir du cogito, c'est, au contrai re, l'existence de l'autre qui rend le
cogito possible comme l e moment abstrait o le moi se saisit comme
objet. Ai nsi l e moment que Hegel nomme l'tre pour l'autre est un
stade ncessaire du dveloppement de l a conscience de soi ; le chemin
de l'intriorit passe par l'autre. Mais l'autre n'a d' intrt pour moi
que dans la mesure o i l est un autre Moi , un Moi-objet pour Moi et,
inversement, dans l a mesure o i l refte mon Moi , c'est--dire en
tant que j e suis objet pour lui. Par cette ncessit o j e suis de n'tre
objet pour moi que l-bas, dans l'autre, je dois obtenir de l'autre la
reconnaissance de mon tre. Mais si ma conscience pour soi doit tre
mdie avec elle-mme par une autre conscience, son tre-pour-soi
et par consquent son tre en gnral - dpend de l'autre. Tel
j 'apparais l' autre, tel j e suis. En outre, puisque l'autre est tel qu'il
m'apparat et que mon tre dpend de l'autre, la faon dont j e
m'apparais - c'est--di re l e moment du dveloppement de ma
conscience de moi -dpend de l a faon dont l'autre m'apparat. La
valeur de l a reconnaissance de moi par l'autre dpend de celle de l a
reconnaissance de l'autre par moi . En ce sens, dans l a mesure o
l'autre me saisit comme li un corps et i mmerg dans la vie, j e ne
275
suis moi-mme qu'un alltre. Pour me faire reconnatre par l'autre, j e
dois risquer ma propre vi e. Risquer sa vie, en effet, c'est se rvler
comme non li la forme obj ective ou quelque existence dtermi
ne ; comme non li la vie. Mais en mme temps j e poursuis l a morl
de l'autre. Cela signifie que j e veux me faire mdier par un autre qui
soit seulement autre, c'est--dire par une conscience dpendante,
dont le caractre essentiel est de n'exister que pour une autre. Cela se
produira dans le moment mme o je risquerai ma vie car j'ai fait,
dans l a lutte contre l'autre, abstraction de mon tre sensible en le
risquant ; l 'autre , au contraire, prfre l a vie la libert en montrant
ainsi qu'il n'a pas pu se poser comme non li l a forme objective. II
demeure donc l i aux choses externes en gnral ; i l m'apparat et
s'apparat l ui-mme comme inessentiel. II est l' Esclave et je suis le
Matre ; pour lui c'est moi qui suis l'essence. Ainsi apparat l a fameuse
relation Matre-Esclave qui devait si profondment infuencer
Marx. Nous n'avons pas entrer dans ses dtails. Qu' il nous suffise de
marquer que l ' Esclave est l a vrit du Matre ; mais cette reconnais
sance unil atrale et ingale est insuffisante, car l a vrit de sa
certitude de soi est pour le Matre conscience inessentielle ; il n'est
donc pas certain de l'tre pour soi en tant que vrit. Pour que cette
vrit soit atteinte, il faudra un moment dans lequel le matre fasse
vis--vis de soi ce qu'il fait vis--vis de l'autre et o l'esclave fait vis-
vis de l'autre ce qu' il fait vis--vis de soi 1 . A ce moment paratra la
conscience de soi gnrale qui se reconnat dans d'autres consciences
de soi et qui est identique avec el l es et avec elle-mme.
Ainsi l'intuition gniale de Hegel est ici de me faire dpendre de
l'autre en mon tre. Je suis, dit-il , un tre pour soi qui n'est pour soi
que par un autre. C'est donc en mon cur que l'autre me pntre. Il
ne saurait tre mi s en doute sans que j e doute de moi-mme puisque
l a conscience de soi est relle seulement en tant qu'elle connat son
cho (et son reflet) dans une autre
2
Et comme l e doute mme
impl ique une conscience qui existe pour soi , l'existence de l'autre
conditionne ma tentative pour douter d'elle au mme titre que chez
Descartes mon existence conditionne le doute mthodique. Ainsi l e
solipsisme semble dfinitivement mis hors de combat. En passant de
Husserl Hegel , nous avons accompli un progrs immense : d' abord
la ngation qui constitue autrui est directe, interne et rciproque ;
ensuite el l e prend partie et entame chaque conscience au plus
profond de son tre ; le problme est pos au niveau de l 'tre intime,
du Je uni versel et transcendantal ; c'est dans mon tre essentiel que je
dpends de l'tre essentiel d'autrui et, loin que l'on doive opposer
mon tre pour moi-mme mon tre pour autrui, !'tre-pour-autrui
1. Phnomnologie de l'esprit, p. 148. Edition Lasson.
2. Propedewik, p. 20, 1 " dition des uvres compltes.
276
apparat comme une condition ncessaire de mon tre pour moi
mme.
Et pourtant cette solution, malgr son ampleur, malgr la richesse
et l a profondeur des aperus de dtail dont fourmille la thorie du
Matre et de l'Esclave, parviendra-t-elle nous satisfai re ?
Certes, Hegel a pos la question de l'tre des consciences. C'est
l'tre-pour-soi et l'tre-pour-autrui qu' il tudi e et il donne chaque
conscience comme enfermant l a ralit de l'autre. Mais il est non
moins certain que ce problme ontologique reste partout formul en
termes de connaissance. Le grand ressort de l a lutte des consci ences,
c'est l'effort de chacune pour transformer sa certitude de soi en vrit.
Et nous savons que cette vrit ne peut tre atteinte qu'en tant que
ma conscience devient ohjet pour l'autre en mme temps que l'autre
devient ohjet pour l a mienne. Ainsi la question pose par l'idalisme
-comment l'autre peut-il tre objet pour moi ? -Hegel rpond en
demeurant sur le terrain mme de l' idalisme : s'il y a un Moi en
vrit pour qui l'autre est obj et , c' est qu' i l y a un al/tre pour qui le Moi
est objet. C'est encore la connaissance qui est ici mesure de l'tre et
Hegel ne conoit mme pas qu'il puisse y avoir un tre-pour-autrui
qui ne soit pas finalement rductible un tre-objet . Aussi la
conscience de soi universelle qui cherche se dgager, travers
toutes ces phases dialectiques, est-elle assimilable, de son propre
aveu, une pure forme vide : l e Je suis je . Cette proposition sur
la conscience de soi, crit-i l , est vide de tout contenu 1 . Et ailleurs :
(c'est) le processus de l'abstraction absolue qui consiste dpasser
toute existence immdiate et qui aboutit l ' tre purement ngatif de
la conscience identique avec el l e-mme. Le terme mme de ce
conflit dialectique , la conscience de soi universelle, ne s'est pas
enrichi au milieu de ses avatars : elle s'est entirement dpouille, au
contraire, el le n'est plus que l e Je sais qu' un autre me sait comme
moi-mme Sans doute c'est que pour l'idalisme absolu l'tre et l a
connaissance sont identiques. Mai s quoi nous entrane cette
assimilation ?
Tout d'abord ce Je suis je , pure formule universelle d'identit,
n' a rien de commun avec [a conscience concrte que nous avons tent
de dcrire dans notre Introduction. Nous avions alors tabli que l'tre
de l a consci ence (de) soi ne pouvait se dfinir en termes de
connaissance. La connaissance commence avec la rflexion, mais le
jeu du refet-refltant n'est pas un couple sujet-objet, ft-ce
l'tat implicite, i l ne dpend en son tre d'aucune conscience
transcendante, mais son mode d'tre est prcisment d'tre en
question pour soi-mme. Nous avons montr ensuite, dans l e premier
chapitre de notre seconde partie, que la relation du reflet au refltant
1. Propedeutik, p. 20, I r dition des uvres compltes.
277
n'tait nul l ement une relation d' i dentit et ne pouvait se rduire au
Moi Moi ou au Je suis je de Hegel. Le refet se fait ne pas
tre le refltant ; il s'agit l d' un tre qui se nantise dans son tre et
qui cherche en vai n se fondre soi-mme comme soi. S'il est vrai
que cette descripti on est la seule qui permette de comprendre le fait
original de conscience, on jugera que Hegel ne parvient pas rendre
compte de ce redoublement abstrait du Moi qu' i l donne comme
quivalent l a conscience de soi. Enfin nous sommes parvenu
dbarrasser la pure conscience irrflchie du Je transcendantal qui
l'obscurcit et nous avons montr que l'ipsit, fondement de l'exis
te'lce personnelle , tait toute diffrente d'un Ego ou d'un renvoi de
'Ego lui-mme. Il ne saurait donc tre question de dfi ni r la
conscienC en termes d' gologie transcendantal e. En un mot la
conscience est un tre concret et sui generis, non une relation
abstraite et injustifiable d'identit, elle est ipsit et non sige d'un
Ego opaque et inutil e, son tre est susceptible d'tre atteint par une
rfl exion transcendantale et i l y a une vrit de l a conscience qui ne
dpend pas d' autrui, mais l'tre mme de l a conscience tant
indpendant de la connaissance prexiste sa vrit ; sur ce terrain,
comme pour le ralisme naf, c'est l ' tre qui mesure la vrit, car l a
vrit d' une intuition rflexive se mesure sa conformit l'tre : l a
conscience tait l avant d'tre connue. Si donc l a conscience s'affirme
en face d'autrui c'est qu' el l e revendique la reconnaissance de son tre
et non d' une vrit abstraite. On conoit mal en effet que l a lutte
ardente et prilleuse du matre et de l'esclave ait pour unique enjeu la
reconnaissance d' une formule aussi pauvre et aussi abstraite que l e
Je suis je . Il y aurait d' ailleurs une duperie dans cette l utte mme,
puisque l e but enfi n atteint serait l a conscience de soi universel l e,
i ntuition du soi existant par soi . A Hegel, il faut , i ci comme
partout, opposer Kierkegaard, qui reprsente les revendications de
l ' i ndi vi du en tant que tel. C'est son accomplissement comme individu
que rclame l'individu, l a reconnaissance de son tre concret et non
l ' explicitation objective d' une structure universel l e. Sans doute les
droits que je rclame autrui posent l'universalit du soi ; l a
respectabilit des personnes exige l a reconnaissance de ma personne
comme universel . Mais c'est mon tre concret et individuel qui se
coule dans cet universel et qui l e remplit, c'est pour cet tre-l que je
rclame des droits, l e particulier est ici support et fondement de
l ' uni versel ; l ' uni versel , en ce cas, ne saurait avoir de signification s'il
n'existe dessein de l'individuel.
De cette assimilation de l'tre la connaissance vont rsulter, ici
encore, bon nombre d'erreurs ou d'impossibilits. Nous les rsume
rons ici sous deux chefs, c'est--dire que nous dresserons contre Hegel
une double accusation d'optimisme.
En premier l i eu, Hegel nous parat pcher par un optimisme
278
pistmologique. Il lui parat en effet que la vrit de la conscience de
soi peut apparatre, c'est--dire qu'un accord objectif peut tre ralis
entre les consciences sous le nom de reconnaissance de moi par autrui
et d'autrui par moi. Cette reconnaissance peut tre simultane et
rciproque ; Je sais qu'autrui me sait comme soi-mme , el l e
produit en vrit l ' universalit de l a conscience de soi. Mais l"nonc
correct du problme d'autrui rend impossible ce passage l ' universel .
Si, en e ffet, autrui doi t me renvoyer mon soi , i l faut qu' au terme
au moi ns de l'volution dialecti que, il y ait une commune mesure
entre ce que je suis pour lui, ce qu' i l est pour moi, ce que je suis pour
moi, ce qu' i l est pour lui. Certes, cette homognit n' existe pas au
dpart , Hegel en convient ; l a relation Matre-Esclave n'est pas
rciproque. Mais i l affi rme que la rciprocit doit pouvoir s'tablir.
Cest qu' en effet i l fait au dpart une confusion -si habile qu'el l e
sembl e volontaire - entre l'objectit et la vie. L'autre, dit-il,
m'apparat comme objet. Or, l'objet c'est Moi dans l'autre. Et
lorsqu' i l veut mi eux dfinir cette objecti t, i l y discerne trois
lments 1 : Ce saisissement de soi de l'un dans l'autre est ; 1 Le
moment abstrait de l'identit avec soi. 2 Chacun a pourtant aussi
cette particularit qu'il se manifeste l'autre en tant qu'objet externe,
en tant qu'existence concrte et sensible immdiate. 3 Chacun est
absolument pour soi et individuel en tant qu'oppos l'autre . . . On
voit que le moment abstrait de l ' i dentit avec soi est donn dans l a
connaissance de l' autre . Il est donn avec deux autres moments de l a
structure total e. Mais, chose curieuse chez un philosophe de la
Synthse , Hegel ne s'est pas demand si ces trois lments ne
ragissai ent pas l ' un sur l'autre de manire constituer une forme
neuve et rfractaire l'analyse. Il prcise son point de vue dans l a
Phnomnologie de l'Esprit en dclarant que l'autre apparat d'abord
comme i nessentiel (c'est le sens du troisime moment cit plus haut)
et comme conscience immerge dans l ' tre de la vie . Mais i l s'agit
d'une pure coexistence du moment abstrait et de la vie. Il suffit donc
que moi ou l'autre nous risquions notre vie pour que, dans l'acte
mme de s'offrir au danger, nous ralisions la sparation analytique
de la vie et de la conscience : Ce que l'autre est pour chaque
conscience, elle-mme l'est pour l 'autre ; chacune accomplit en elle
mme et son tour, par son activit propre. et par l'activit de l'autre,
cette pure abstraction de l'tre pour soi . . . Se prsenter comme pure
abstraction de la conscience de soi , c'est se rvler comme pure
ngation de sa forme objective, c'est se rvler comme non li
quelque existence dtermine . . . c'est se rvler comme non li l a
vie
2
Et sans doute Hegel dira pl us l oi n que, par l'exprience du
1. Propedeutik, p. 18.
2. Phnomnologie de l'Esprit. Ibi d.
279
risque et du danger de mort, la conscience de soi apprend que la vie
l ui est aussi essenti elle que l a conscience pure de soi ; mais c'est d'un
tout autre point de vue et i l n'en demeure pas moins que j e puis
toujours sparer la pure vrit de l a conscience de soi , en l'autre, de sa
vie. Ainsi l ' esclave saisit l a conscience de soi du matre, il en est l a
vrit, encore que, nous l'avons vu, cette vrit n'est point encore
adquate.
Mais est-ce la mme chose de dire qu'autrui m' apparat par
pri ncipe comme objet ou de di re qu' il m' apparat comme li
quel que existence particulire, comme immerg dans la vie? Si nous
demeurons ici sur l e plan des pures hypothses logiques, nous
remarquerons tout d'abord qu'autrui peut fort bien tre donn une
conscience sous forme d' objet sans que cet objet soit prcisment li
cet objet contingent que l ' on nomme un corps vivant . En fait, notre
exprience ne nous prsente que des individus conscients et vivants ;
mai s en droi t, il faut remarquer qu'autrui est objet pour moi parce
qu' i l est autrui et non parce qu' il apparat l'occasion d'un corps
objet ; si non nous retomberions dans l'illusion spatialisante dont nous
parlions pl us haut. Ainsi , ce qui est essentiel autrui en tant qu'autrui
c'est l'objectivit et non l a vie. Hegel , d' ail l eurs, tait parti de cette
constatation l ogique. Mais s'il est vrai que la liaison d' une conscience
la vie ne dforme point en sa nature le moment abstrait de l a
conscience de soi qui demeure l , immerg, toujours susceptible
d'tre dcouvert, en est-il de mme pour l'objectivit ? Autrement
dit, puisque nous savons qu'une conscience est avant d'tre connue,
une conscience connue n'est-elle pas totalement modifie du fait
mme qu' el l e est connue ? Apparatre comme objet pour une
conscience, est-ce encore tre conscience ? A cette question i l est
facil e de rpondre : l'tre de l a conscience de soi est tel qu'en son tre
i l est question de son tre, cela signifie qu'el l e est pure intriorit.
Elle est perptuel l ement renvoi un soi qu' el l e a tre. Son tre se
dfinit par ceci qu' el le est cet tre sur le mode d'tre ce qu'elle n'est
pas et de ne pas tre ce qu'elle est. Son tre est donc l'exclusion
radicale de toute obj ectivit : je suis celui qui ne peut pas tre objet
pour moi -mme, celui qui ne peut mme pas concevoir pour soi
l'existence sous forme d'objet (sauf sur l e plan du ddoublement
rfexif -mai s nous avons vu que l a rflexion est l e drame de l'tre
qui ne peut pas tre objet pour lui-mme). Ceci non cause d' un
manque de recul ou d' une prvention intellectuelle ou d' une l imite
impose ma connaissance, mais parce que l'objectivit rclame une
ngation explicite : l'objet, c'est ce que j e me fais ne pas tre, au l i eu
que j e suis, moi , cel ui que j e me fai s tre. Je me sui s partout, je ne
saurais m'chapper, j e me ressaisis par-derrire, et si mme j e
pouvais tenter de me faire objet, dj je serais moi au cur de cet
objet que j e suis et du centre mme de cet objet j'aurais tre l e sujet
280
qui le regarde. C'est d' ailleurs ce que Hegel pressentait lorsqu'il disait
que l'existence de l'autre est ncessaire pour que je sois objet pour
moi. Mais en posant que la conscience de soi s'exprime par l e Je suis
je c'est--dire en l'assimilant l a connaissance de soi , i l manquait
les consquences tirer de ces constatations premires, puisqu'il
introduisait dans l a conscience mme quelque chose comme un objet
en puissance, qu'autrui aura seul ement dgager sans le modifier.
Mais si prcisment tre objet c'est n'tre-pas-moi, le fait d'tre objet
pour une conscience modifie radicalement la conscience non dans ce
qu' elle est pour soi , mais dans son apparition autrui. La wnscience
d'autrui , c'est ce que je peux simplement contempler et qui , de ce
fait, m'apparat comme pur donn, au lieu d'tre ce qui a tre moi.
C'est ce qui se livre moi dans le temps universel , c'est--dire dans la
dispersion originelle des moments au lieu de m'apparatre dans l' unit
de sa propre temporalisation. Car la seule conscience qui puisse
m'apparatre dans sa propre temporalisation, c'est la mienne, et el l e
ne l e peut qu' en renonant toute objectivit. En un mot, le pour-soi
est inconnaissable par autrui comme pour-soi. L'objet que j e saisis
sous le nom d'autrui m'apparat sous une forme radicalement autre ;
autrui n'est pas pour soi comme il m'apparat, je ne m'apparais pas
comme je suis pour autrui ; je suis aussi incapable de me saisir pour
moi comme je suis pour autrui , que de saisir ce qu'est autrui pour soi
partir de l'objet-autrui qui m'apparat. Comment donc pourrait-on
tablir un concept universel subsumant, sous l e nom de conscience de
soi , ma conscience pour moi et (de) moi et ma connaissance d'autrui ?
Mais il y a plus : d'aprs Hegel, l'autre est objet et je me saisis comme
objet en l ' autre. Or, l'une de ces affirmations dtruit l'autre : pour
que j e puisse m'apparatre comme objet en l 'autre, il faudrait que je
saisisse l'autre en tant que suj et, c'est--dire que je l'apprhende dans
son intriorit. Mais en tant que l 'autre m'apparat comme objet,
mon objectivit pour lui ne saurait m'apparatre : sans doute j e saisis
que l'objet-autre se rapporte moi par des intentions et des actes,
mais du fait mme qu'il est objet , l e miroir-autrui s'obscurcit et ne
reflte plus ri en, car ces intentions et ces actes sont des choses du
monde , apprhendes dans l e Temps du Monde, constates, contem
ples et dont la signification est objet pour moi. Ainsi puis-je
seulement m'apparatre comme qualit transcendante quoi se
rfrent les actes d'autrui et ses intentions ; mais prcisment ,
l'objectivit d'autrui dtruisant mon objectivit pour l ui , c'est en tant
que sujet interne que je me saisis comme ce quoi se rapportent ces
intentions et ces actes. Et il faut bien entendre ce saisissement de moi
par moi-mme en purs termes de conscience , non de connaissance :
en ayant tre ce que je suis sous forme de conscience ek-statique
(de) moi, je saisis autrui comme un objet indiquant vers moi. Ainsi
l'optimisme de Hegel aboutit un chec : entre l'objet-autrui et moi-
281
suj et, il n'y a aucune commune mesure, pas plus qu'entre l a
conscience (de) soi et la conscience de l'autre. Je ne puis pas me
connatre en autrui si autrui est d'abord objet pour moi et j e ne peux
pas non plus saisir autrui dans son tre vrai, c'est--dire dans sa
subjectivit. Aucune connaissance universelle ne peut tre tire de la
relation des consciences. C'est ce que nous appellerons leur spara
tion ontologi que.
Mai s i l est une autre forme d'optimisme , chez Hegel, pl us
fondamental e. C'est ce qu'il convient de nommer l'optimisme ontolo
gique. Pour l ui , en effet, l a vrit est vrit du Tout. Et i l se place du
point de vue de la vrt, c'est--dire du Tout , pour envisager le
probl me de J' autre. Ainsi, lorsque le monisme hglien considre l a
relation des consciences, i l ne se place en aucune conscience
particulire. Bi en que le Tout soit raliser, i l est dj l comme l a
vrit de tout ce qui est vrai ; aussi, lorsque Hegel crit que toute
conscience, tant identique avec elle-mme, est autre que l'autre, i l
s'est tabl i dans l e tout, en dehors des consciences, et les considre du
point de vue de l'Absolu. Car les consciences sont des moments du
tout , des moments qui sont, par eux-mmes, unselbststandig , et l e
tout est mdi ateur entre l es consciences. De l un optimisme
ontologique parallle l'optimisme pistmologique : la pluralit
peut et doit tre dpasse vers la totalit. Mais si Hegel peut affirmer
l a ralit de ce dpassement, c'est qu' i l se l'est dj donn au dpart.
En fai t, il a oubli sa propre conscience, il est le Tout et, en ce sens,
s'il rsout si facilement l e problme des consciences, c'est qu'il n'y a
jamais eu pour l ui de vritable problme ce sujet. II ne se pose pas l a
questi on, en effet, des relations de sa propre conscience avec celle
d'autrui, mai s, faisant entirement abstraction de la sienne, i l tudie
purement et simplement le rapport des consciences d'autrui entre
elles, c'est--dire l e rapport de consciences qui sont pour lui dj des
objets, dont l a nature, d'aprs lui, est prcisment d' tre un type
particulier d' objets - l e sujet-objet - et qui, du point de vue
totalitaire o i l se place, sont rigoureusement quivalentes entre elles,
bien l oin qu'aucune d'elles soit spare des autres par un privilge
particulier. Mais si Hegel s'oubl i e, nous ne pouvons oublier Hegel.
Cela signifie que nous sommes renvoy au cogito. Si , en effet, comme
nous l'avons tabl i, l'tre de ma conscience est rigoureusement
irrductible l a connaissance, alors j e ne puis transcender mon tre
vers une relation rciproque et universelle d'o je pourrais voir
comme quivalents l a fois mon tre et celui des autres : je dois, au
contraire, m'tablir dans mon tre et poser le problme d'autrui
p
artir de mon tre. En un mot, le seul point de dpart sr est
l 'intriorit du cogito. Il faut entendre par l que chacun doit pouvoir,
en partant de sa propre intriorit, retrouver l'tre d'autrui comme
une transcendance qui conditionne l'tre mme de cette intriorit, ce
282
qui implique ncessairement que la multiplicit des consciences est
par principe indpassabl e, car je puis bi en, sans doute, me transcen
der vers un Tout, mais non pas m'tablir en ce Tout pour me
contempler et contempler autrui. Aucun optimisme logique ou
pistmologique ne saurait donc faire cesser le scandale de la pluralit
des consciences. Si Hegel l'a cru, c'est qu'il n'a jamais saisi la nature
de cette dimension particulire d'tre qu'est l a conscience (de) soi. La
tche qu'une ontologie peut se proposer, c'est de dcrire ce scandale
et de l e fonder dans la nature mme de l'tre : mais elle est
impuissante l e dpasser. Il se peut -nous le verrons mieux tout
l'heure - qu' on puisse rfuter le solipsisme et montrer que l'exis
tence d'autrui est pour nous vidente et certaine. Mais quand bien
mme nous aurions fait participer l'existence d'autrui la certitude
apodictique du cogito c'est--dire de ma propre existence -nous
n'aurions pas pour cela dpass autrui vers quelque totalit
intermonadique. La dispersion et la lutte des consciences demeure
ront ce qu' elles sont : nous aurons simplement dcouvert leur
fondement et leur vritable terrai n.
Que nous a apport cette longue critique ? Ceci simplement : c'est
que mon rapport autrui est d'abord et fondamentalement une
relation d'tre tre, non de connaissance connaissance, si le
solipsisme doit pouvoir tre rfut. Nous avons vu, en effet, l'chec
de Husserl qui , sur ce plan particulier, mesure l'tre par l a connais
sance et celui de Hegel qui identifie connaissance et tre. Mais nous
avons reconnu galement que Hegel, bien que sa vision soit obscurcie
par l e postulat de l'idalisme absolu, a su placer le dbat son
vritable niveau. Il semble que Hei degger, dans Sein und Zeit, ait tir
profit des mditations de ses devanciers et qu'il se soit profondment
pntr de cette double ncessit : 10 la relation des ralits
humaines doit tre une relation d'tre ; 2 cette relation doit faire
dpendre les ralits-humaines les unes des autres, en leur tre
essenti el. Au moi ns sa thorie rpond-elle ces deux exigences. Avec
sa manire brusque et un peu barbare de trancher les nuds gordiens,
plutt que de tcher les dnouer, il rpond la question pose par
une pure et simple dfinilion. Il a dcouvert plusieurs moments
d'ailleurs insparables, sauf par abstraction -dans l'tre-dans-le
monde qui caractrise la ralit-humaine. Ces moments sont
monde , tre-dans et tre . Il a dcrit le monde comme ce
par quoi la ralit-humaine se fait annoncer ce qu'elle est ; l'tre
dans il l'a dfi ni comme Befindlichkeit et Verstand ; reste
parler de l'rre, c'est--dire du mode sur lequel la ralit-humaine est
son tre-dans-le-monde. C'est le Mit-Sein , nous dit-il ; c'est--dire
. . . . Ainsi la caractristique d'tre de la ralit-humaine,
c'est qu'eIIe est son tre avec les autres. I l ne s'agit pas d'un hasard ; je
ne suis pas d' abord pour qu' une contingence me fasse ensuite
283
rencontrer autrui : il est question ici d'une structure essentielle de
mon tre. Mais cette structure n'est pas tablie du dehors et d'un
poi nt de vue totalitaire, comme chez Hegel : certes Heidegger ne part
pas du cogito, au sens cartsien de la dcouverte de la conscience par
elle-mme ; mais la ralit-humaine qui se dvoile lui et dont il
cherche fixer par concepts les structures, c'est la sienne propre.
Dasein ist je mnes ?q crit-i l . C'est en explicitant la comprhen
sion prontologique que j 'ai de moi-mme, que je saisis l'tre-avec
autrui comme une caractristique essentielle de mon tre. En un mot,
je dcouvre l a relation transcendante autrui comme constituant mon
tre propre, tout juste comme j' ai dcouvert que l'tre-dans-le
monde mesurait ma ralit-humaine. Ds lors, le problme d' autrui
n'est plus qu'un faux problme : autrui n'est plus d'abord telle
existence particulire que je rencontre dans le monde - et qui ne
saurait tre indispensable ma propre existence, puisque j'existais
avant de la rencontrer -, c'est le terme ex-centrique qui contribue
la constituti on de mon tre. C'est l'examen de mon tre en tant qu' i l
me rejette hors de moi vers des structures qui , la fois, m'chappent
et me dfinissent , c'est cet examen qui me dvoile originellement
autrui . Notons, en outre, que le type de liaison autrui a chang :
avec le rali sme, l'idalisme, Husserl, Hegel, le type de relation des
consciences tait l 'tre pour : autrui m'apparaissait et mme me
consti tuait en tant qu' i l tait pour moi ou que j'tais pour l ui ; le
problme tai t la reconnaissance mutuelle de consciences places en
face les unes des autres, qui s'apparaissaient les unes aux autres dans
le monde et qui s'affrontaient. L'tre-avec ,> a une signification toute
di ffrente : avec ne dsigne pas le rapport rciproque de reconnais
sance et de lutte qui rsulterait de l'apparition au milieu du monde
d' une ral i t-humai ne autre que la mi enne. Il exprime plutt une
sorte de solidarit ontologique pour l'exploitation de ce monde.
L'autre n'est pas li originellement moi comme une ralit onti que
apparaissant au mi l i eu du monde, parmi les ustensiles '> , comme un
type d'objet particulier : il serait, en ce cas, dj dgrad et le rapport
qui l ' uni rait moi ne pourrait j amais acqurir la rciprocit. L'autre
n'est pas objet. Il demeure, dans sa liaison moi , ralit-humaine,
l'tre par quoi il me dtermine en mon tre, c'est son tre pur saisi
comme tre-dans-le-monde - et on sait que dans ,> doit
s'entendre au sens de colo , habito , non celui de insum ,> ;
tre-dans-le-monde, c'est hanter le monde, non pas y tre englu -
et c'est en mon tre-dans-le-monde qu' il me dtermine. Notre
relation n'est pas une opposition defront, c'est plutt une interdpen
dance par ct : en tant que je fais qu'un monde existe comme
complexe d'ustensiles dont j e me sers dessein de ma ralit
humai ne , je me fais dterminer en mon tre par un tre qui fait que le
mme monde existe comme complexe d' ustensiles dessein de sa
284
ralit. I l ne faudrait pas d'ailleurs comprendre cet tre-avec comme
une pure col latralit passivement reue de mon tre. Etre, pour
Heidegger, c'est tre ses propres possibilits, c'est se faire tre. C'est
donc un mode d'tre que je me fais tre. Et cela est si vrai que je suis
responsable de mon tre pour autrui en tant que je le ralise
librement dans l'authenticit ou l'inauthenticit. C'est en toute libert
et par un choix origi nel , que, par exempl e, je ralise mon tre-avec
sous la forme du on . Et si l'on demande comment mon tre-avec
peut exister pour-moi , il faut rpondre que je me fais annoncer par l e
monde ce que je suis. En particul ier, lorsque je sui s sur le mode de
l'inauthenticit, du on , l e monde me renvoie comme un reflet
impersonnel de mes possibilits inauthentiques sous l'aspect d'usten
siles et de complexes d'ustensiles qui appartiennent tout le
monde et qui m'appartiennent en tant que je suis tout l e
monde : vtements tout faits, transports en commun, parcs, jardins,
l ieux publics, abris faits pour que quiconque puisse s'y abriter, etc.
Ainsi je me fais annoncer comme quiconque par le complexe indicatif
d'ustensiles qui m'indique comme un Worumwillen et l'tat
inauthentique -qui est mon tat ordinaire tant que je n'ai pas ralis
l a conversion l'authenticit -me rvle mon tre avec non comme
l a relation d' une personnalit unique avec d'autres personnalits
gal ement uniques, non comme l a liaison mutuelle des plus
irremplaabl es des tres , mais comme une totale interchangeabilit
des termes de la relation. La dtermination des termes manque
encore, je ne suis pas oppos l'autre, car je ne suis pas moi : nous
avons l ' uni t sociale de l'on. Poser le problme sur le plan de
l ' i ncommuni cabilit de sujets i ndividuels, c'tait commettre un
mpOY :prpOY ; mettre l e monde les jambes en l'air : l'authenti
cit et l'individualit se gagnent : je ne serai ma propre authenticit
que si, sous l'influence de l'appel de la conscience (Ruf des Gewis
sens) , j e m'l ance vers la mort, avec dcision-rsolue (Entschlossen
heit), comme vers ma possibilit la plus propre. A ce moment , je me
dvoile moi-mme dans l'authenticit et les autres aussi je les lve
avec moi vers l'authentique.
L'image empirique qui symboliserait l e mieux l'intuition heidegg
rienne n'est pas celle de la lutte, c'est celle de l'quipe. Le rapport
origi nel de l' autre avec ma conscience n'est pas le toi et moi, c'est l e
nous et l 'tre-avec heideggrien n'est pas la position claire et distincte
d'un individu en face d'un autre individu, n'est pas la connaissance,
c'est la sourde existence en commun du coquipier avec son quipe,
cette existence que le rythme des avirons ou l es mouvements rguliers
du barreur rendront sensible aux rameurs et que le but commun
atteindre, la barque ou la yole dpasser et le monde entier
(spectateurs, performance, etc. ), qui se profile l ' horizon, leur
manifesteront. C'est sur le fond commun de cette coexistence que le
285
brusque dvoilement de mon tre-pour-mourir me dcoupera soudain
dans une absolue solitude en commun en levant en mme temps
les autres jusqu' cette solitude.
Cette fois, on nous a bien donn ce que nous demandions : un tre
qui implique l 'tre d'autrui en son tre. Et pourtant, nous ne saurions
nous consi drer comme satisfait. Tout d'abord, l a thorie de
Heidegger nous offre plutt l'indication de l a solution trouver que
cette solution lle-mme. Quand bi en mme nous admettrions sans
rselVes cette substitut ion de l'tre-avec l'tre-pour , el l e
demeurerait pour nous une simple affirmation sans fondement. Sans
doute rencontrons-nous certains tats empiriques de notre tre -en
particulier ce que les All emands dnomment du terme intraduisi bl e
de Stimmung qui semblent rvler une coexistence de consciences
plutt qu' une relation d'opposition. Mais c'est prcisment cette
coexistence qu'il faudrait expliquer. Pourquoi devient-ell e l e fonde
ment uni que de notre tre, pourquoi est-elle le type fondamental de
notre rapport avec les autres, pourquoi Hei degger s'est-il cru autoris
passer de cette constatation empirique et ontique de l'tre-avec la
position de la coexistence comme structure ontologique de mon
tre-dans-le-monde ? Et quel type d' tre a cette coexistence ?
Dans quel l e mesure la ngation qui fait d'autrui un autre et qui l e
constitue comme inessentiel est-elle maintenue ? Si on la supprime
entirement, n'allons-nous pas tomber dans un monisme ? Et si on
doi t l a conserver comme structure essentielle du rapport autrui,
quelle modification faut-il lui faire subir pour qu'elle perde le
caractre d'opposition qu' el l e avait dans l 'tre-pour-autrui et pour
qu' el l e acquire ce caractre de liaison solidarisante qui est la
structure mme de l ' tre-avec? Et comment pourrons-nous passer de
l l'exprience concrte d'autrui dans l e monde, comme lorsque je
vois de ma fentre un passant qui marche dans la rue ? Certes, i l est
tentant de me concevoir comme me dcoupant par l'lan de ma
libert, par le choix de mes possibilits uniques sur l e fond indiffren
ci de l ' humai n -et peut-tre cette conception renferme-t-el le une
part importante de vrit. Mai s, sous cette forme au moins, ell e
soul ve des objections considrables.
Tout d'abord
,
le point de vue ontologique rejoint ici le point de vue
abstrait du sujet kantien. Dire que la rali t-humaine -mme si c'est
ma ralit-humaine est-avec par structure ontologique, c'est
dire qu' el l e est-avec par nature, c'est--dire au titre essentiel et
universel. Si mme cette affirmation tait prouve, cela ne permet
trait d'expliquer aucun tre-avec concret ; autrement di t, la coexis
tence ontologique qui apparat comme structure de mon tre-dans
le-monde ne peut aucunement servir de fondement un tre avec
ontique comme, par exempl e, l a coexistence qui parat dans mon
ami ti avec Pierre ou dans l e couple que j e forme avec Anny. Ce
286
qu' il faudrait montrer, en effet, c'est que l'tre-avec-Pierre ou
l'tre-avec-Anny est une structure constitutive de mon tre
concret. Mais cela est impossible, du point de vue o Heidegger s'est
plac. L'autre dans la relation avec , prise sur le plan ontologique,
ne saurait en effet pas plus tre dtermin concrtement que la
ralit-humaine directement envisage et dont il est l'alter-ego : c'est
un terme abstrait et, de ce fait unselbslindig, qui n'a aucunement en
lui le pouvoir de devenir cel autre, Pierre ou Anny. Ainsi la relation
du Mitsein ne saurait nous servir aucunement rsoudre le
problme psychologique et concret de la reconnaissance d'autrui. Il y
a deux plans incommunicables et deux problmes qui exigent des
solutions spares. Ce n'est, dira-t-on, qu'un des aspects de la
di fficult qu'prouve Hei degger passer, en gnral, du plan
ontologique au plan ontique, de l 'tre-dans-le-monde en gnral
ma relation avec cet ustensile particulier, de mon tre-pour-mourir,
qui fait de ma mort ma possibilit la plus essentiel l e, celle mort
ontique que j 'aurai, par rencontre avec tel ou tel existant externe.
Mais cette difficult peut la rigueur tre masque dans tous les
autres cas, puisque, par exemple, c'est la ralit-humaine qui fait
qu'un monde existe o une menace de mort qui la concerne se
dissimule ; mieux mme, si l e monde est, c'est qu'il est mortel au
sens o l'on dit qu'une blessure est mortelle. Mais l'impossibilit de
passer d'un plan l'autre clate au contraire l'occasion du problme
d'autrui . C'est que, en effet, si dans le surgissement ek-statique de
son tre-dans-le-monde l a ralit-humaine fait qu'un monde existe,
on ne saurait dire, pour autant , de son tre-avec qu'il fait surgir une
autre ralit-humai ne. Certes, j e suis l'tre par qui i l y a (es gibt)
de l'tre. Di ra-t-on que je suis l'tre par qui il y a une autre
ralit-humaine ? Si l'on entend par l que je suis l'tre pour qui il y a
pour moi une autre ralit-humai ne, c'est un pur et simple truisme. Si
l'on veut dire que je suis l'tre par qui il y a des autres en gnral,
nous retombons dans le solipsisme. En effet, cette ralit-humaine
avec qui je suis, elle est elle-mme dans-Ie-monde-avec-moi
elle est le fondement libre d'un monde (comment se fait-il que ce soit
le mien ? On ne saurait dduire de l'tre-avec l ' i dentit des mondes
dans quoi les ralits-humaines sont), elle est ses propres possibi
lits. Elle est donc pour elle sans attendre que je fasse exister son tre
sous la forme du il y a . Ainsi je puis constituer un monde comme
mortel , mais non une ralit-humaine comme tre concret qui est
ses propres possibilits. Mon tre-avec saisi partir de mon tre
ne peut tre considr que comme une pure exigence fonde dans
mon tre, et qui ne constitue pas la moindre preuve de l 'existence
d'autrui , l e moindre pont entre moi et l'autre.
Mieux mme, cette relation ontologique de moi un autrui
abstrait, du fait mme qu'elle dfinit en gnral mon rapport autrui,
287
loin de faci li ter une relation particulire et ontique de moi Pierre,
rend radi calement impossible toute liaison concrte de mon tre un
autrui singul i er donn dans mon exprience. Si, en effet, ma relation
avec autrui est a priori, elle puise toute possibilit de relation avec
autrui . Des relations empiriques et conti ngentes ne sauraient en tre
des spcifications ni des cas particuliers ; i l n'y a de spcifications
d' une loi que dans deux circonstances : ou bien l a loi est tire
inductive ment de faits empiriques et singuliers ; et ce n'est pas l e cas
ici ; ou bien elle est a priori et unifie l'exprience, comme les concepts
kantiens. Mai s, dans ce cas, prcisment, elle n' a de porte que dans
les li mi tes de l ' exprience : j e ne trouve dans les choses que ce que j'y
ai mis. Or, l a mise en rapport de deux tre-dans-le-monde
concrets ne saurait appartenir mon exprience ; elle chappe donc
au domaine de l'lre-avec. Mais comme, prcisment, la loi conslitue
son propre domai ne, elle exclut a priori tout fait rel qui ne serait pas
construit par elle. L'existence d'un temps comme forme a priori de
ma sensibilit m'exclurait a priori de toute liaison avec un temps
noumnal qui aurait les caractres d'un tre. Ainsi , l'existence d' un
tre-avec ontologique et, par sui te, a priori rend impossible toute
liaison on tique avec une ralit-humaine concrte qui surgirait pour
soi comme un transcendant absolu. L'tre-avec conu comme struc
ture de mon tre m'isole aussi srement que les arguments du
solipsi sme. C'est que la transcendance heideggrienne est un concept
de mauvaise foi : elle vise, certes, dpasser l'idalisme, et elle y
parvi ent dans la mesure o celui-ci nous prsente une subjectivit en
repos en elle-mme et contemplant ses propres images. Mais l'ida
lisme ainsi dpass n'est qu'une forme btarde de l'idalisme, une
sorte de psychologisme empirio-criticiste. Sans doute l a ralit
humai ne hei deggrienne existe hors de soi . Mais prcisment
cette existence hors de soi est la dfinition du soi, dans l a doctrine de
Heidegger. Elle ne ressemble ni l'ek-stase platonicienne o l'exis
tence est rel l ement alination, existence chez un autre, ni la vision
en Di eu de Mal ebranche, ni notre propre conception de l'ek-stase et
de l a ngation i nterne. Heidegger n'chappe pas l' i dalisme : sa
fuite hors de soi , comme structure a priori de son tre, l'isole aussi
srement que l a rflexion kantienne sur les conditions a priori de
notre exprience ; ce que l a ralit-humaine retrouve, en effet, au
terme i naccessi bl e de cette fuite hors de soi , c'est encore soi : la fuite
hors de soi est fuite vers soi, et le monde apparat comme pure
distance de soi soi. Il serait vain, en consquence, de chercher dans
Sein und Zeil l e dpassement simultan de tout idalisme et de tout
ralisme. Et l es difficults que rencontre l'idalisme en gnral
lorsqu'il s'agit de fonder l'existence d' tres concrets semblables
nous et qui chappent en tant que tels notre expri ence, qui ne
relvent pas dans l eur constitution mme de notre a priori, s'lvent
288
encore devant la tentative de Heidegger pour faire sortir la ralit
humai ne de sa solitude. Il semble y chapper parce que tantt il
prend l e comme et tantt
comme hors-de-soi-en-autrui Mais l a deuxime acception du
hors-de-soi qu'il glisse sournoisement au dtour de ses raisonne
ments est strictement incompatible avec la premire : au sein mme
de ses ek-stases, la ralit-humaine reste seule. C'est que - et ce
sera l l e nouveau profit que nous aurons tir de l'examen critique
de la doctrine heideggrienne -l 'existence d'autrui a la nature d'un
fait contingent et irrductible. On rencontre autrui, on ne le consti
tue pas. Et si ce fait doit pourtant nous apparatre sous l'angle de la
ncessit , ce ne saurait tre avec celle qui appartient aux condi
tions de possibilit de notre exprience , ou si l'on prfre, avec la
ncessit ontologique : la ncessit de l'existence d'autrui doit tre,
si elle existe, une ncessit contingente ", c'est--dire du type
mme de l a ncessit de fait avec laquelle s'impose le cogito. Si
autrui doit pouvoir nous tre donn, c'est par une apprhension
directe qui laisse la rencontre son caractre de facticit, comme le
cogito lui-mme l aisse toute sa facticit ma propre pense, et qui
pourtant participe l'apodicticit du cogito lui-mme, c'est--dire
son indubitabilit.
Ce long expos de doctrine n'aura donc pas t inutile s'il nous
permet de prciser les conditions ncessaires et suffisantes pour
qu'une thorie de l'existence d'autrui soit valable.
1) Une semblable thorie ne doit pas apporter une preuve nouvelle
de l'existence d'autrui, un argument meilleur que les alltres contre le
solipsisme. En effet si le solipsisme doit tre rejet, ce ne peut tre
que parce qu' il est impossible ou, si l ' on prfre, parce que nul n'est
vraiment solipsiste. L'existence d'autrui sera toujours rvocable en
doute, moins prcisment qu' on ne doute d'autrui qu'en paroles et
abstraitement , de la mme faon que je puis crire sans mme
pouvoir le penser que je doute de ma propre existence . En un mot
l'existence d'autrui ne doit pas tre une probabilit. La probabilit en
effet ne peut concerner que les objets qui apparaissent dans notre
exprience ou dont des effets nouveaux peuvent paratre dans notre
exprience. Il n'y a de probabilit que si une confirmation ou une
infirmation peut en tre chaque instant possible. Si autrui est, par
principe et dans son pour-soi hors d e mon exprience, l a
probabilit de son existence comme un autre soi ne pourra jamais tre
ni confirme ni infirme, elle ne peut ni crotre ni dcrotre, ni mme
se mesurer : elle perd donc son tre mme de probabilit et devient
une pure conj ecture de romancier. De la mme faon, M. Lalande a
289
bien montr 1 qu' une hypothse sur l ' existence d'tres vivants sur l a
plante Mars demeurera purement conjecturale et sans aucune
chance d'tre vraie ni fausse, tant que nous ne disposerons pas
d'instruments ou de thories scientifiques nous permettant de faire
apparatre des faits confirmant ou infirmant cette hypothse. Mais l a
structure d' autrui est tel l e, par principe, qu'aucune exprience
nouvelle ne pourra jamais tre conue, qu'aucune thorie neuve ne
viendra confi rmer ou i nfirmer l'hypothse de son existence, qu'aucun
i nstrument ne viendra rvler des faits nouveaux m'incitant affirmer
ou rejeter cette hypothse. Si donc autrui n'est pas immdiatement
prsent moi et si son existence n'est pas aussi sre que l a mienne,
toute conjecture sur lui est totalement dpourvue de sens. Mais
prcisment j e ne conjecture pas l ' existence d'autrui : je l 'affirme.
Une thorie de l'existence d'autrui doit donc simplement m' i nterro
ger dans mon tre, claircir et prciser le sens de cette affirmation et
surtout, l oi n d'inventer une preuve, expliciter le fondement mme de
cette certitude. Autrement dit, Descartes n'a pas prouv son exis
tence . C'est qu'en effet j'ai toujours su que j 'existais, je n'ai j amais
cess de pratiquer le cogito. Pareillement , mes rsistances au solip
sisme - qui sont aussi vives que celles que pourrait soulever une
tentative pour douter du cogito prouvent que j 'ai toujours su
qu'autrui existait, que j'ai toujours eu une comprhension totale
encore qu' i mpl i ci te de son existence, que cette comprhension
prontologi que renferme une i ntelligence plus sre et plus
profonde de l a nature d'autrui et de son rapport d' tre mon tre que
toutes les thories qu'on a pu btir en dehors d'elle. Si l'existence
d' autrui n'est pas une vaine conjecture, un pur roman, c'est qu'il y a
quelque chose comme un cogito qui la concerne. C'est ce cogito qu' il
faut mettre au jour, en explicitant ses structures et en dterminant sa
porte et ses droits.
2) Mais, d'autre part, l'chec de Hegel nous a montr que l e seul
dpart possi bl e tait l e cogito cartsien. Lui seul nous tablit,
d' ai l l eurs, sur l e terrain de cette ncessit de fait qui est celui de
l'existence d'autrui . Ai nsi ce que nous appelions, faute de mi eux, l e
cogito de l'existence d'autrui se confond avec mon propre cogito. I l
faut que l e cogito, examin une fois de plus, me jette hors de l ui sur
autrui , comme i l m'a jet hors de lui sur l'En-soi ; et cel a, non pas en
me rvlant une structure a priori de moi-mme qui pointerait vers un
autrui galement a priori, mais en me dcouvrant l a prsence
concrte et i ndubitable de tel ou tel autrui concret, comme i l m'a dj
rvl mon existence incomparable, contingente, ncessaire pour
tant , et concrte. Ai nsi c'est au pour-soi qu'il faut demander de nous
livrer l e pour-autrui , l 'immanence absolue qu'il faut demander de
1. Les thories de /'induction et de l'exprimentation.
290
nous rejeter dans la transcendance absolue : au plus profond de moi
mme j e dois trouver non des raisons de croire autrui, mais autrui
lui-mme comme n'tant pas moi .
3) Et ce que l e cogito doi t nous rvler, ce n'est pas un objet
autrui . On aurait d rflchir depuis longtemps ceci que qui dit objet
dit probable. Si autrui est objet pour moi il me renvoie l a
probabi l i t. Mai s la probabi l i t se fonde uni quement sur l a
congruence l ' i nfini de nos reprsentations. Autrui n'tant ni une
reprsentati on, ni un systme de reprsentations, ni une unit
ncessaire de nos reprsentations, ne peut tre probable ; i l ne saurait
tre d'abord obj et. Si donc i l est pour nous ce ne peut tre ni comme
facteur constitutif de notre connaissance du monde ni comme facteur
constitutif de notre connaissance du moi, mais en tant qu' i l int
resse notre tre et cela, non en tant qu'il contribuerait a priori le
constituer, mais en tant qu' i l l'intresse concrtement et ontique
ment dans les circonstances empiriques de notre facticit.
4) S'il s'agit de tenter, en quelque sorte, pour autrui , ce que
Descartes a tent pour Dieu avec cette extraordinaire preuve par
l'ide de parfait qui est tout entire anime par l'intuition de la
transcendance, cela nous oblige repousser, pour notre apprhension
d'autrui comme autrui, un certain type de ngation que nous avons
appel ngation externe. Autrui doit apparatre au cogito comme
n'tant pas moi. Cette ngation peut se concevoir de deux faons : ou
bien elle est pure ngation externe et elle sparera autrui de moi
mme comme une substance d'une autre substance -en ce cas toute
saisie d'autrui est par dfinition impossible -, ou bien elle sera
ngation interne, ce qui signifie liaison synthtique et active des deux
termes dont chacun se constitue en se niant de l'autre. Cette relation
ngative sera donc rciproque et de double intriorit. Cela signifie
d'abord que l a multiplicit des autrui ne saurait tre une col/ection
mais une totalit -en ce sens nous donnons raison Hegel -puisque
chaque autrui trouve son tre en l'autre ; mais aussi que cette Totalit
est telle qu' i l est par principe impossible de se placer au point de vue
du tout . Nous avons vu, en effet, qu'aucun concept abstrait de
conscience ne peut sortir de la comparaison de mon tre-pour-moi
mme avec mon objectit pour autrui. En outre cette totalit -
comme celle du pour-soi - est totalit dtotalise, car l'existence
pour-autrui tant refus radical d'autrui, aucune synthse totalitaire et
unificatrice des autrui n'est possible.
C'est partir de ces quelques remarques que nous essaierons
d'aborder, notre tour, l a question d'autrui.
291
I V
LE REGARD
Cette femme que je vois venir vers moi, cet homme qui passe dans
l a rue, ce mendiant que j 'entends chanter de ma fentre sont pour
moi des objets, cela n' est pas douteux. Ainsi est-il vrai qu' une, au
moins, des modal its de l a prsence moi d'autrui est l'objectit. Mai s
nous avons vu que si cette relation d'objectit est l a relation
fondamentale d'autrui moi-mme, l'existence d'autrui demeure
purement conjecturale. Or, i l est non seulement conjectural mais
probable que cette voix que j'entends soit celle d'un homme et non l e
chant d' un phonographe, i l est infiniment probable que le passant que
j 'aperois soi t un homme et non un robot perfectionn. Cel a signifie
que mon apprhension d'autrui comme objet, sans sortir des l i mites
de la probabi l i t et cause de cette probabilit mme, renvoie par
essence une sai sie fondamentale d'autrui, o autrui ne se dcouvrira
plus moi comme objet mais comme prsence en personne . En
un mot, pour qu'autrui soit objet probable et non un rve d' objet, i l
faut que son objectit ne renvoie pas une solitude originelle et hors
de mon attei nte, mais une l i aison fondamentale o autrui se
manifeste autrement que par la connaissance que j'en prends. Les
thories classiques ont raison de considrer que tout organisme
humai n peru renvoie quelque chose et que ce quoi i l renvoie est le
fondement et la garantie de sa probabilit. Mais leur erreur est de
croire que ce renvoi indique une existence spare, une conscience
qui serait derrire ses manifestations perceptibles comme l e noumne
est derrire l'Empfindung kanti enne. Que cette conscience existe ou
non l ' tat spar, ce n' est pas elle que renvoie le visage que je
voi s, ce n'est pas el l e qui est la vrit de l'objet probable que je
perois. Le renvoi de fait un surgissement gmell o l'autre est
prsence pour moi est donn en dehors de la connaissance propre
ment dite - ft-elle conue sous une forme obscure et i neffable du
type de l ' i ntuition -, bref, un tre-en-couple-avec-l'autre En
d'autres termes, on a gnralement envisag l e problme d' autrui
comme si la relation premire par quoi autrui se dcouvre est
l ' objecti t, c' est--dire comme si autrui se rvlait d'abord -
directement ou indirectement - notre perception. Mais comme
cette perception, par sa nature mme, se rfre autre chose qu'
el l e-mme et qu' el l e ne peut renvoyer ni une srie i nfinie
d'apparitions de mme type - comme l e fait , pour l'idalisme, la
perception de la table ou de la chaise -ni une entit isole situe
par principe hors de mon atteinte, son essence doit tre de se rfrer
292
une premire relation de ma conscience celle d'autrui, dans laquelle
autrui doit m'tre donn di rectement comme sujet quoique en liaison
avec moi , et qui est l e rapport fondamental, l e type mme de mon
tre-pour-autrui .
Toutefois i l ne saurait s'agir i ci de nous rfrer quelque
exprience mystique ou un ineffable. C'est dans la ralit quoti
dienne qu'autrui nous apparat et sa probabilit se rfre la ralit
quoti di enne. Le probl me se prcise donc : y a-t-il dans l a ralit
quotidienne une relation origi nel l e autrui qui puisse tre constam
ment vise et qui, par suite, puisse se dcouvrir moi, en dehors de
toute rfrence un inconnaissable religieux ou mysti que ? Pour le
savoir i l faut i nterroger plus nettement cette apparition banale
d'autrui dans le champ de ma perception : puisque c'est elle qui se
rfre ce rapport fondamental , elle doit tre capable de nous
dcouvrir, au moins titre de ralit vise, le rapport auquel ell e se
rfre.
Je suis dans un jardin public. Non loin de moi, voici une pelouse et,
le long de cette pelouse, des chaises. Un homme passe prs des
chaises. Je vois cet homme, j e le saisis comme un objet l a fois et
comme un homme. Qu'est-ce que cela signifie ? Que veux-je dire
lorsque j 'affirme de cet objet qu'il est un homme ?
Si je devais penser qu' i l n'est ri en d'autre qu'une poupe, je lui
appliquerais les catgories qui me servent ordinairement grouper l es
,< choses temporo-spatiales. C'est--dire que j e le saisirais comme
tant ct des chaises, 2,20 m de l a pelouse, comme exerant
une certaine pression sur l e sol, etc. Son rapport avec les autres objets
serait du type purement additif ; cel a signifie que j e pourrais l e faire
disparatre sans que les relations des autres objets entre eux en soient
notablement modifies. En un mot, aucune relation neuve n'appara
trait par lui entre ces choses de mon univers : groupes et synthtises
de mon ct en complexes instrumentaux, elles se dsagrgerai ent du
sien en mul tiplicits de relations d' i ndiffrence. Le percevoir comme
homme, au contraire, c'est saisir une relation non additive de la chaise
lui , c'est enregistrer une organisation sans distance des choses de
mon univers autour de cet objet privilgi. Certes, la pelouse
demeure 2,20 m de l ui ; mais elle est aussi lie l ui , comme pelouse,
dans une relation qui transcende l a di stance et l a contient la fois. Au
l i eu que l es deux termes de l a distance soient indiffrents, interchan
geables et dans un rapport de rciprocit, la distance se dplie partir
de l'homme que je vois et jusqu' la pelouse comme le surgissement
synthtique d'une relation univoque. Il s'agit d'une relation sans
parties, donne d'un coup et l ' i ntrieur de laquelle se dplie une
spatialit qui n'est pas ma spatialit , car, au lieu d'tre un groupement
vers moi des objets, il s'agit d' une orientation qui me fuit. Certes,
cette relation sans distance et sans parties n' est nullement l a relation
293
originelle d'autrui moi-mme que je cherche : d'abord elle concerne
seulement l'homme et les choses du monde. Ensuite, elle est objet de
connaissance encore ; je l'expri merai , par exemple, en disant que cet
homme voit l a pelouse, ou qu' i l se prpare, malgr l'criteau qui le
dfend, marcher sur le gazon. etc. Enfi n, elle conserve un pur
caractre de probabi l i t : d'abord, il est probable que cet objet soit un
homme ; ensui te, ft-il certain qu' i l en soit un, i l reste seulement
probable qu'il voie l a pelouse au moment o je le perois : il peut
rver quelque entreprise sans prendre nettement conscience de ce
qui l'environne, i l peut tre aveugle, etc. Pourtant, cette relation
neuve de l'objet-homme l'objet-pelouse a un caractre particuli er :
el le m'est la fois donne tout entire, puisqu'elle est l, dans l e
monde , comme un obj et que je puis connatre (c'est bien, en effet,
une relation objective que j 'exprime en di sant : Pierre a jet un coup
d'i l sur sa montre, Jeanne a regard par la fentre, etc. ) et, la fois,
el l e m' chappe tout entire ; dans l a mesure o l'objet-homme est le
terme fondamental de cette relati on, dans l a mesure o el l e va vers lui
el l e m'chappe, je ne pui s me mettre au centre : la distance qui se
dpl ie entre la pelouse et l ' homme, travers le surgissement
synthtique de cette relation premire, est une ngation de la distance
que j'tablis -comme pur type de ngation externe -entre ces deux
objets. Elle apparat comme une pure dsintgration des relations que
j 'apprhende entre les objets de mon univers. Et cette dsi ntgration,
ce n'est pas moi qui l a ralise ; el le m' apparat comme une relation
que je vise vide travers les distances que j 'tablis origi nellement
entre les choses. C'est comme un arrire-fond des choses qui
m' chappe par principe et qui leur est confr du dehors. Ainsi
l'apparition, parmi les objets de mon univers, d'un lment de
dsintgration de cet univers, c'est ce que j 'appelle l'apparition d'un
homme dans mon uni vers. Autrui, c'est d'abord la fuite permanente
des choses vers un terme que je saisis la fois comme objet une
certaine distance de moi, et qui m'chappe en tant qu'il dplie autour
de lui ses propres di stances. Mais cette dsagrgation gagne de proche
en proche ; s' i l existe entre la pelouse et autrui un rapport sans
distance et crateur de distance, i l en existe ncessairement un entre
autrui et la statue qui est sur son socle au milieu de la pelouse, entre
autrui et l es grands marronniers qui bordent l'alle ; c'est un espace
tout entier qui se groupe autour d' autrui et cet espace est fait avec
mon espace ; c'est un regroupement auquel j' assiste et qui m'chappe,
de tous l es objets qui peuplent mon univers. Ce regroupement ne
s'arrte pas l ; le gazon est chose qual i fie : c'est ce gazon vert qui
existe pour autrui ; en ce sens la qualit mme de l'objet, son vert
profond et cru se trouve en relation di recte avec cet homme ; ce vert
tourne vers autrui une face qui m'chappe. Je saisis la relation du
vert autrui comme un rapport objectif, mais je ne puis saisir le
294
vert comme il apparat autrui . Ainsi tout coup un objet est apparu
qui m'a vol le monde. Tout est en place, tout existe toujours pour
moi , mais tout est parcouru par une fuite i nvi sible et fige vers un
objet nouveau. L'apparition d'aut rui dans le monde correspond donc
un glissement fig de tout l ' univers, une dcentration du monde
qui mine par en dessous l a centralisation que j 'opre dans le mme
temps.
Mai s aUTrui est encore objet pour moi. Il apparti ent mes
distances : l'homme est l , vingt pas de moi , il me tourne le dos. En
tant que tel , il est de nouveau deux mtres vi ngt de la pelouse, six
mtres de la statue ; par l la dsintgration de mon univers est
contenue dans les limites de cet univers mme. I l ne s'agit pas d' une
fuite du monde vers le nant ou hors de lui-mme ; mai s plutt, il
sembl e qu' il est perc d'un trou de vidange, au milieu de son tre, et
qu' il s'coul e perptuellement par ce trou. L'univers, l'coulement et
le trou de vi dange, derechef tout est rcupr, ressaisi et fig en
objet : tout cel a est l pour moi comme une structure partielle du
monde, bi en qu' il s'agisse, en fait, de l a dsintgration totale de
l'univers. Souvent, d'ailleurs, il m'est permis de contenir ces dsint
grations dans des limites plus troites : voici, par exempl e, un homme
qui l i t, en se promenant. La dsintgration de l ' univers qu' i l
reprsente est purement virtuelle : i l a des oreilles qui n'entendent
point, des yeux qui ne voient rien que son livre. Entre son livre et l ui ,
je saisis une relation indniable et sans distance, du type de celle qui
liait, tout l'heure, le promeneur au gazon. Mais, cette fois, la forme
s'est referme sur soi-mme : j 'ai un objet plein saisi r. Au milieu du
monde, j e peux dire homme-lisant comme je di rais pierre
froi de , pl uie fine ; je saisis une Gestalt close dont la leCTUre
forme la qualit essentielle et qui , pour le reste, aveugle et sourde, se
laisse connatre et percevoir comme une pure et si mple chose
temporo-spatiale et qui semble avec l e reste du monde dans la pure
relation d' extriorit i ndi ffrent e. Si mplement la qualit mme
homme-lisant , comme rapport de l ' homme au livre, est une petite
lzarde particulire de mon univers ; au sein de cette forme solide et
visible, i l se fait un vidage particulier, elle n'est massive qu'en
apparence, son sens propre est d'tre, au milieu de mon univers, dix
pas de moi , au sein de cette massivit, une fuite rigoureusement
colmate et localise.
Tout cel a, donc, ne nous fait nul lement quitter le terrain o autrui
est objet. Tout au plus, avons-nous affaire un type d'objectivit
particulier, assez voisin de celui que H usser! dsigne par le mot
d'absence, sans toutefois marquer qu' autrui se dfi ni t, non comme
l'absence d' une conscience par rapport au corps que je vois, mais par
l'absence du monde que je perois au sein mme de ma perception de
ce monde. Autrui est, sur ce pl an, un objet du monde qui se laisse
295
dfini r par le monde. Mais cette relation de fuite et d'absence du
monde par rapport moi n'est que probabl e. Si c'est elle qui dfinit
l'objectivit d' autrui , quelle prsence originelle d'autrui se rfre
t-elle ? Nous pouvons rpondre prsent : si autrui-objet se dfinit en
liaison avec l e monde comme l'obj et qui voil ce que je vois, ma l iaison
fondamental e avec autrui-sujet doi t pouvoir se ramener ma
possibilit permanente d' tre vu par autrui. C'est dans et par la
rvlation de mon tre-objet pour autrui que j e dois pouvoir saisir la
prsence de son tre-sujet. Car, de mme qu'autrui est pour moi-sujet
un objet probable , de mme je ne puis me dcouvrir en train de
devenir objet probable que pour un sujet certain. Cette rvlation ne
saurait dcouler du fait que mon univers est objet pour l'objet-autrui,
comme si l e regard d' autrui , aprs avoir err sur l a pelouse et sur les
objets envi ronnants, venai t, en suivant un chemin dfi ni , se poser sur
moi . J'ai marqu que je ne saurais tre objet pour un objet : il faut
une conversion radicale d'autrui qui le fasse chapper l'objectivit.
Je ne saurais donc considrer le regard que me jette autrui comme
une des manifestations possibles de son tre objectif : autrui ne
saurait me regarder comme i l regarde le gazon. Et, d'ailleurs, mon
objectivit ne saurait elle-mme dcouler pour moi de l'objectivit du
monde puisque , prcisment, je suis celui par qui il y a un monde ;
c'est--dire celui qui , par principe, ne saurait tre l'objet pour soi
mme. Ainsi , ce rapport que je nomme tre-vu-par-autrui , loin
d'tre une des relations signifies, entre autres, par le mot d'homme,
reprsente un fait irrductible qu'on ne saurait dduire ni de l ' essence
d'autrui-objet ni de mon tre-sujet. Mais, au contraire , si le concept
d'autrui-objet doit avoir un sens, i l ne peut le tenir que de la
conversion et de la dgradation de cette relation originelle . En un
mot, ce quoi se rfre mon apprhension d'autrui dans le monde
comme lanl probablemenl un homme , c'est ma possibilit perma
nente d'tre-vu-par-lui, c'est--dire l a possibilit permanente pour
un sujet qui me voit de se substituer l 'objet vu par moi. L' tre-vu
par-autrui est la vrit du voir-autrui . Ainsi, l a notion d' autrui
ne saurait, en aucun cas, viser une conscience solitaire et extra
mondaine que je ne puis mme pas penser : l'homme se dfinit par
rapport au monde et par rapport moi-mme ; i l est cet objet du
monde qui dtermine un coulement interne de l'univers, une
hmorragie i nterne ; i l est le sujet qui se dcouvre moi dans cette
fuite de moi-mme vers l'objectivation. Mais l a relation originelle de
moi-mme autrui n'est pas seulement une vrit absente vise
travers la prsence concrte d'un objet dans mon univers ; elle est
aussi un rapport concret et quotidien dont je fais chaque instant
l'exprience : chaque instant autrui me regarde ; i l nous est donc
facile de tenter, sur des exemples concrets, la description de cette
liaison fondamentale qui doit faire l a base de toute thorie d'autrui ; si
296
autrui est , par principe, celui qui me regarde, nous devons pouvoir
expliciter le sens du regard d'autrui .
Tout regard dirig vers moi se mani feste en liaison avec l'apparition
d'une forme sensihle dans notre champ perceptif, mais contrairement
ce qu'on pourrait croire, i l n'est li aucune forme dtermine.
Sans doute, ce qui manifeste le plus souvent un regard, c'est la
convergence vers moi de deux glohes oculaires. Mais i l se donnera
tout aussi bien l'occasion d'un froissement de hranches, d'un bruit
de pas suivi du silence, de l'entrehillement d'un volet, d'un lger
mouvement d' un rideau. Pendant un coup de main, les hommes qui
rampent dans les huissons saisissent comme regard viter, non deux
yeux, mais toute une ferme blanche qui se dcoupe contre le ciel, en
haut d'une colline. Il va de soi que l'ohjet ai nsi constitu ne manifeste
encore le regard qu' titre prohable. Il est seulement probable que,
derrire le buisson qui vient de remuer, quelqu'un est emhusqu qui
me guette. Mai s cette probabilit ne doit pas nous retenir pour
l'instant : nous y reviendrons ; ce qui importe d' abord est de dfi nir
en lui -mme le regard. Or, l e huisson, l a ferme ne sont pas le regard .
ils reprsentent seulement l'il, car l' i l n'est pas saisi d'abord
comme organe sensible de vision, mais comme support du regard. Ils
ne renvoient donc jamais aux yeux de chair du guetteur embusqu
derrire le ri deau, derrire une fentre de la ferme : eux seuls, i l s
sont dj des yeux. D'autre part, l e regard n' est ni une qualit parmi
d'autres de l'objet qui fait fonction d' i l, ni la forme totale de cet
objet, ni un rapport mondain qui s'tablit entre cet objet et moi.
Bien au contraire, loin de percevoir l e regard sur les objets qui le
manifestent, mon apprhension d' un regard tourn vers moi parat
sur fond de destruction des yeux qui me regardent ; si j'appr
hende le regard, je cesse de percevoir les yeux : ils sont l, ils
demeurent dans le champ de ma perception, comme de pures
prsentations, mais je n'en fais pas usage, ils sont neutraliss, hors
jeu, ils ne sont plus objet d'une thse, i ls restent dans l'tat de mise
hors circuit o se t rouve le monde pour une conscience qui
effectuerait la rduction phnomnologique prescrite par Husserl. Ce
n'est jamais quand des yeux vous regardent qu'on peut les trouver
beaux ou lai ds, qu'on peut remarquer leur couleur. Le regard d'autrui
masque ses yeux, il sem hIe aller devant eu. Cette illusion provient de
ce que les yeux, comme objets de ma perception, demeurent une
distance prcise qui se dplie de moi eux - en un mot, je suis
prsent aux yeux sans distance, mais eux sont distants du lieu o je
me trouve - tandis que l e regard, l a fois, est sur moi sans
distance et me tient distance, c'est--dire que sa prsence immdiate
moi dploie une distance qui m'carte de lui . Je ne puis donc diriger
mon attention sur le regard sans, du mme coup, que ma perception
se dcompose et passe l'arrire-plan. Il se produit ici quelque chose
297
d'analogue ce que j 'ai tent de montrer ailleurs au sujet de
l'imagi naire 1 ; nous ne pouvons, disais-je alors, percevoi r et imaginer
la fois, i l faut que ce soit l' un ou l'autre. Je dirais volontiers ici :
nous ne pouvons percevoir le monde et saisir en mme temps un
regard fix sur nous ; i l faut que ce soit l'un ou l'autre. Cest que
percevoir, c'est regarder, et saisir un regard n'est pas apprhender un
objet-regard dans l e monde ( moi ns que ce regard ne soit pas dirig
sur nous), c'est prendre conscience dtre regard. Le regard que
manifestent l es yeux, de quelque nature qu'ils soient, est pur renvoi
moi -mme. Ce que je saisis i mmdiatement lorsque j 'entends craquer
les branches derrire moi , ce n'est pas qu'il y a quelqu'un, c'est que je
suis vulnrabl e, que j'ai un corps qui peut tre bless, que j 'occupe
une place et que je ne puis, en aucun cas, m'vader de l'espace o je
suis sans dfense, bref, que je suis vu. Ainsi , le regard est d'abord un
intermdiaire qui renvoie de moi moi-mme. De quelle nature est
cet i ntermdiai re ? Que signifie pour moi : tre vu ?
I maginons que j ' en sois venu, par jalousie, par intrt, par vice,
coller mon oreille contre une porte, regarder par le trou d' une
serrure. Je suis seul et sur le plan de la conscience non-thtique (de)
moi . Cela signifie d'abord qu'il n' y a pas de moi pour habiter ma
conscience. Ri en, donc, quoi je puisse rapporter mes actes pour les
qualifier. Ils ne sont nullement connus, mais je les suis et, de ce seul
fai t, i l s portent en eux-mmes leur totale justification. Je suis pure
conscience des choses et les choses, prises dans le ci rcuit de mon
ipsi t, m'offrent leurs potentialits comme rplique de ma cons
cience non-thtique (de) mes possibilits propres. Cela signifie que,
derrire cette porte, un spectacle se propose comme voir , une
conversation comme entendre . La porte, la serrure sont la foi s
des instruments et des obstacles : i l s se prsentent comme mani er
avec prcaution ; l a serrure se donne comme regarder de prs et
un peu de ct , etc. Ds lors je fais ce que j 'ai faire ; aucune
vue transcendante ne vient confrer mes actes un caractre de
donn sur quoi puisse s'exercer un j ugement : ma conscience colle
mes actes ; elle est mes actes ; ils sont seulement commands par les
fins atteindre et par les instruments employer. Mon attitude, par
exemple, n'a aucun dehors , elle est pure mise en rapport de
l'instrument (trou de l a serrure) avec l a fin atteindre (spectacle
voir) , pure manire de me perdre dans le monde, de me faire boire
par les choses comme l'encre par un buvard, pour qu'un complexe
ustensile orient vers une fin se dtache synthtiquement sur fond de
monde. L'ordre est i nverse de l'ordre causal : c'est la fin atteindre
qui organise tous les moments qui la prcdent ; la fin justifie les
moyens, les moyens n'existent pas pour eux-mmes et en dehors de l a
1. L'Imaginaire. N. R. F. , 1 940.
298
fin. L'ensemble d'ailleurs n'existe que par rapport un libre projet de
mes possibilits : c'est prcisment la jalousie, comme possi bi lit que
je suis, qui organise ce complexe d' ustensilit en le transcendant vers
elle-mme. Mais, cette jalousi e, je la suis, je ne la connais pas. Seul le
complexe mondain d'ustensilit pourrait me l'apprendre si je le
contemplais au lieu de le fai re. C'est cet ensemble dans le monde avec
sa double et inverse dtermi nati on - il n'y a de spectacle voir
derrire la porte que parce que je suis jaloux, mais ma jalousie n'est
rien, sinon le simple fait objectif quil y a un spectacle voir derrire
la porte -que nous nommerons situation. Cette situation me reflte
la fois ma facticit et ma libert : l'occasion d'une certai ne
structure obj ective du monde qui m' entoure, el l e me renvoie ma
l i bert sous forme de tches faire l i brement ; i l n' y a l aucune
contrainte, puisque ma libert ronge mes possibles et que corrlative
ment les potentialits du monde s'indiquent et se proposent seule
ment. Aussi ne puisje me dfinir vrai ment comme tant en situation :
d'abord parce que je ne suis pas conscience positionnelle de moi
mme ; ensui te, parce que je suis mon propre nant. En ce sens et
puisque je suis ce que je ne suis pas et que je ne suis pas ce que je suis
je ne peux mme pas me dfinir comme tant vraiment en train
d'couter aux portes, j'chappe cette dfinition provisoire de moi
mme par toute ma transcendance ; c'est l, nous l'avons vu, l'origine
de la mauvaise foi ; ainsi, non seulement je ne puis me connatre, mais
mon tre mme m'chappe quoique je sois cet chappement mme
mon tre et je ne suis rien tout fait ; il n'y a rien l qu'un pur nant
entourant et faisant ressortir un certain ensemble objectif se dcou
pant dans le monde, un systme rel, un agencement de moyens en
vue d'une fin .
Or, voici que j'ai entendu des pas dans l e corridor : on me regarde.
Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que je suis soudain atteint dans
mon tre et que des modifications essenti ell es apparaissent dans mes
structures -modi fications que je puis sai si r et fixer conceptuellement
par le cogito rflexif.
D'abord, voici que j'existe en tant que moi pour ma conscience
irrflchie. C'est mme cette irruption du moi qu'on a le plus souvent
dcrite : je me vois parce qu'on me voi t , a-t-on pu crire. Sous cette
forme, ce n'est pas entirement exact. Mais examinons mieux : tant
que nous avons considr le pour-soi dans sa solitude, nous avons pu
soutenir que l a conscience irrflchie ne pouvait tre habite par un
moi : le moi ne se donnai t , titre d' objet, que pour la conscience
rfl exi ve. Mais voici que le moi vient hanter la conscience irrflchi e.
Or, la conscience irrflchie est conscience du monde. Le moi existe
donc pour el l e sur le plan des obj ets du monde ; ce rle qui
n'incombait qu' la conscience rflexive : l a prsentification du moi ,
appart ient prsent l a conscience irrflchie. Seulement, l a
299
conscience rflexive a directement le moi pour objet . La conscience
irrflchie ne saisit pas la personne directement et comme son objet :
la personne est prsente la conscience en tant qu'elle est objet pour
autrui. Cel a signifie que j 'ai tout d' un coup conscience de moi en tant
que je m'chappe, non pas en tant que je suis le fondement de mon
propre nant, mais en tant que j 'ai mon fondement hors de moi. Je ne
suis pour moi que comme pur renvoi autrui. Toutefois, i l ne faut pas
entendre ici que l'objet est autrui et que l 'ego prsent ma conscience
est une structure secondaire ou une signification de l'objet-autrui ;
autrui n'est pas objet ici et ne saurait tre objet, nous l'avons montr,
sans que , du mme coup, le moi cesse d'tre objet-pour-autrui et
s'vanouisse . Ainsi, je ne vise pas autrui comme objet, ni mon ego
comme objet pour moi-mme, je ne puis mme pas di riger une
intention vide vers cet ego comme vers un objet prsentement hors de
mon atteinte ; en effet , i l est spar de moi par un nant que je ne puis
combler, puisque je le saisis en tant qu'il n'est pas pour moi et qu'il
existe par principe pour l'autre ; je ne l e vise donc point en tant qu'il
pourrait m'tre donn un jour, mais, au contraire, en tant qu'il me
fuit par principe et qu' i l ne m'appartiendra jamais. Et, pourtant, je le
suis, j e ne l e repousse pas comme une image trangre, mais i l m'est
prsent comme un moi que je suis sans le connatre, car c'est dans la
honte (en d'autres cas, dans l'orgueil) que je le dcouvre. C'est l a
honte ou l a fiert qui me rvlent le regard d'autrui et moi-mme au
bout de ce regard, qui me font vivre, non connatre, l a situation de
regard. Or, l a honte, nous l e notions au dbut de ce chapitre, est
honte de soi, elle est reconnaissance de ce que je suis bien cet objet
qu'autrui regarde et juge. Je ne puis avoir honte que de ma libert en
tant qu'elle m' chappe pour devenir objet donn. Ainsi, originelle
ment, l e lien de ma conscience irrflchie mon ego-regard est un
l i en non de connatre mais d'tre. Je suis, par del toute connaissance
que je puis avoir, ce moi qu' un autre connat. Et ce moi que je suis, je
l e suis dans un monde qu'autrui m'a alin, car le regard d'autrui
embrasse mon tre et corrlativement les murs, la porte, la serrure ;
toutes ces choses-ustensiles, au mi lieu desquelles je suis, tournent
vers l ' autre une face qui m'chappe par principe. Ainsi je suis mon
ego pour l'autre au milieu d'un monde qui s'coule vers l'autre. Mais,
tout l ' heure, nous avions pu appeler hmorragie interne l'coule
ment de mon monde vers autrui-objet : c'est qu'en effet, l a saigne
tait rattrape et localise du fait mme que je figeais en objet de mon
monde cet autrui vers lequel ce monde saignait ; ainsi, pas une goutte
de sang n' tai t perdue, tout tait rcupr, cern, localis, bien qu'en
un tre que je ne pouvais pntrer. Ici, au contraire, l a fuite est sans
terme, elle se perd l 'extrieur, l e monde s'coule hors du monde et
je m'coule hors de moi ; l e regard d'autrui me fait tre par del mon
tre dans le monde, au milieu d'un monde qui est la fois celui-ci et
30
par del ce monde-ci. Avec cet tre que je suis et que la honte me
dcouvre, quelle sorte de rapports puis-je entretenir ?
En premier lieu, une relation d'tre. Je suis cet tre. Pas un instant,
je ne songe le nier, ma honte est un aveu. Je pourrai, plus tard, user
de mauvaise foi pour me le masquer, mais l a mauvaise foi est, elle
aussi, un aveu, puisqu'elle est un effort pour fuir l'tre que je suis.
Mais cet tre que je suis, je ne le suis pas sur le mode du avoir
tre ni sur celui du tais " : je ne le fonde pas en son tre ; je ne
puis le produire directement, mais il n'est pas non plus l 'effet indirect
et rigoureux de mes actes, comme lorsque mon ombre, par terre, mon
reflet , dans l a glace, s'agitent en liaison avec les gestes que je fais. Cet
tre que je suis conserve une certaine indtermination, une certaine
imprvisibil it. Et ces caractrist iques nouvelles ne viennent pas
seulement de ce que je ne puis connatre autrui, elles proviennent
aussi et surtout de ce qu'autrui est libre ; ou, pour tre exact et en
renversant les termes, la libert d'autrui m'est rvle travers
l'inquitante indtermination de l'tre que je suis pour l ui . Ainsi, cet
tre n'est pas mon possible, il n'est pas toujours en question au sein
de ma libert : i l est, au contraire, l a limite de ma libert, son
dessous , au sens o on parle du dessous des cartes ", il m'est
donn comme un fardeau que je porte sans jamais pouvoir me
retourner vers lui pour le connatre, sans mme pouvoir en sentir le
poids ; s'il est comparable mon ombre, c'est une ombre qui se
projetterait sur une matire mouvante et imprvisible et telle
qu'aucune table de rfrences ne permettrait de calculer les dforma
tions rsultant de ces mouvements. Et pourtant, il s'agit bien de mon
tre et non d' une image de mon tre. Il s'agit de mon tre tel qu'il
s'crit dans et par l a li bert d'autrui. Tout se passe comme si j 'avais
une dimension d'tre dont j 'tais spar par un nant radical : et ce
nant, c'est la libert d'autrui ; autrui a faire tre mon tre pour-Iui
en tant qu' i l a tre son tre ; ainsi, chacune de mes libres conduites
m'engage dans un nouveau milieu o la matire mme de mon tre
est l'imprvisible libert d'un autre. Et pourtant, par ma honte mme,
je revendique comme mienne cette libert d'un autre, j 'affirme une
unit profonde des consciences, non pas cette harmonie des monades
qu'on a pris parfois pour garantie d'objectivit, mais une unit d'tre,
puisque j'accepte et je veux que les autres me confrent un tre que je
reconnais.
Mais cet tre, la honte me rvle que je l e suis. Non pas sur le mode
de l'tais ou du avoir tre ", mais en-soi. Seul , je ne puis raliser
mon tre-assis ; tout au plus, peut-on dire que je le suis la fois et
ne le suis pas. Il suffit qu' autrui me regarde pour que je sois ce que je
suis. Non pour moi-mme, certes : je ne parviendrai jamais raliser
cet tre-assis que je saisis dans le regard d'autrui, je demeurerai
toujours conscience ; mais, pour l'autre. Une fois de plus l'chappe-
301
ment nantisant du pour-soi se fige, une fois de pl us l'en-soi se
reforme sur le pour-soi . Mais, une fois de plus, cette mtamorphose
s'opre distance : pour l'autre, je suis assis comme cet encrier est sur
la table ; pour l'autre, je suis pench sur le trou de la serrure, comme
cet arbre est inclin par le vent. Ainsi ai-je dpouill, pour l'autre, ma
transcendance. C'est qu' en effet, pour quiconque s'en fait le tmoin,
c'est--dire se dtermine comme n'tant pa cette transcendance, elle
devi ent transcendance purement constate, transcendance-donne,
c'est--dire qu'elle acquiert une nature du seul fait que l'autre, non
par une dformation quelconque ou par une rfracti on qu'il lui
imposerait travers ses catgories, mais par son tre mme, lui
confre un dehors. S'il y a un autre, quel qu'il soit, o qu'il soit, quels
que soient ses rapports avec moi , sans mme qu'il agisse autrement
sur moi que par le pur surgissement de son tre, j 'ai un dehors, j 'ai
une nature ; ma chute originelle c'est l'existence de l'autre ; et la honte
est - comme l a fiert - l'apprhension de moi-mme comme
nature , encore que cette nature mme m'chappe et soit i nconnaissa
ble comme telle. Ce n'est pas, proprement parler, que je me sente
perdre ma l i bert pour devenir une chose, mais elle est l-bas, hors de
ma libert vcue, comme un attri but donn de cet tre que j e suis
pour l ' autre. Je saisis l e regard de l'autre au sein mme de mon acte,
comme solidification et alination de mes propres possibilits. Ces
possibilits, en effet, que je suis et qui sont l a condition de ma
transcendance, par l a peur, par l'attente anxieuse ou prudente, j e
sens qu'elles se donnent ail leurs un autre comme devant tre
transcendes leur tour par ses propres possibilits. Et l'autre,
comme regard, n'est que cela : ma transcendance transcende. Et,
sans doute, je suis toujours mes possibilits, sur le mode de la
conscience non-thtique (de) ces possibilits ; mais, en mme temps,
l e regard me les aline : jusque-l, je saisissais thtique ment ces
possibilits sur l e monde et dans l e monde, titre de potentialit des
ustensiles ; l e coin som bre, dans l e couloir, me renvoyait la possibilit
de me cacher comme une simple qualit potentielle de sa pnombre,
comme une invite de son obscurit ; cette qualit ou ustensilit de
l'objet n'appartenait qu' lui seul et se donnait comme une proprit
objective et i dal e, marquant son appartenance relle ce complexe
que nous avons appel situation. Mais, avec le regard d'autrui, une
organisation neuve des complexes vi ent se surimprimer sur l a
premire. Me saisir comme vu, en effet, c'est me saisir comme vu
dans le monde et partir du monde. Le regard ne me dcoupe pas
dans l ' uni vers, i l vient me chercher au sein de ma situation et ne saisit
de moi que des rapports indcomposables avec les ustensiles : si j e
suis vu COmme assis, j e dois tre vu comme assis-sur-une-chaise >', si
je suis sai si comme courb, c'est comme courb-sur-Ie-trou-de-Ia
Serrure , etC. Mais, du coup, l'alination de moi qu'est l'tre-regard
302
implique l'alination du monde que j'organise. Je suis vu comme assis
sur cette chaise en tant que je ne la vois point, en tant qu' il est
impossibl e que je la voie, en tant qu'elle m'chappe pour s'organiser,
avec d'autres rapports et d' autres distances, au milieu d'autres objets
qui, pareillement, ont pour moi une face secrte, en un complexe
neuf et orient di ffremment. Ainsi, moi qui, en tant que je suis mes
possibles, suis ce que je ne suis pas et ne suis pas ce que j e suis, voil
que je suis quelqu'un. Et ce que je suis - et qui m'chappe par
principe -je le suis au milieu du monde, en tant qu' i l m'chappe. De
ce fait, mon rapport l'objet ou potentialit de l'objet se dcompose
sous le regard d'autrui et m'apparat dans le monde comme ma
pssibilit d'utiliser l'obj et , en tant que cette possibilit m'chappe
par principe, c'est--dire en tant qu'elle est dpasse par l'autre vers
ses propres possibi l i ts. Par exemple, l a potentialit de l'encoignure
sombre devient possibilit donne de me cacher dans l'encoignure, du
seul fait que l'autre peut la dpasser vers sa possibilit d'clairer
l'encoignure avec sa lampe de poche. Elle est l, cette possibilit, je l a
saisis, mais comme absente, comme en l'autre, par mon angoisse et
par ma dcision de renoncer cette cachette qui est peu sre .
Ainsi, mes possibilits sont prsentes ma conscience irrflchie en
tant que l'autre me guette. Si je vois son attitude prte tout , sa main
dans la poche o i l a une arme, son doigt pos sur l a sonnette
lectrique et prt alerter au moindre geste de ma part le poste de
garde, j'apprends mes possibilits du dehors et par l ui , en mme
temps que je les suis, un peu comme on apprend sa pense
objectivement par le langage mme en mme temps qu'on la pense
pour la couler dans le langage. Cette tendance m'enfuir, qui me
domine et m'entrane et que je suis, je la lis dans ce regard guetteur et
dans cet autre regard : l'arme braque sur moi. L'autre me l'apprend,
en tant qu'il l'a prvue et qu'il y a dj par. Il me l'apprend en tant
qu'il la dpasse et l a dsarme. Mais je ne saisis pas ce dpassement
mme, je saisis simplement la mort de ma possibilit. Mort subtile :
car ma possibilit de me cacher demeure encore ma possibilit ; en
tant que je la suis, elle vit toujours ; et le coin sombre ne cesse de me
faire signe, de me renvoyer sa potentialit. Mais si l'ustensilit se
dfinit comme le fait de pouvoir tre dpass vers . . . ", alors ma
possibilit mme devient ustensil i t. Ma possibilit de me cacher dans
l'encoignure devient ce qu'autrui peut dpasser vers sa possibilit de
me dmasquer, de m'identifier, de m'apprhender. Pour autrui, elle
est l a fois un obstacle et un moyen comme tous les ustensiles.
Obstacl e, car elle l'obligera certains actes nouveaux (avancer vers
moi, allumer sa lampe de poche). Moyen, car une fois dcouvert dans
le cul-de-sac, je suis pris Autrement dit, tout acte fait contre
autrui peut, par principe, tre pour autrui un instrument qui le servira
contre moi . Et je saisis prcisment autrui, non pas dans la claire
303
vision de ce qu' i l peut faire de mon acte, mais dans une peur qd vit
toutes mes possibilits comme ambivalentes. Autrui, c'est la mort
cache de mes possibilits en tant que je vis cette mort comme cache
au milieu du monde. La liaison de ma possibilit l'ustensile n'est
plus que celle de deux instruments qui sont agencs dehors l'un avec
l ' autre, en vue d' une fin qui m'chappe. C'est la fois l'obscurit du
coin sombre et ma possibilit de m'y cacher qui sont dpasses par
autrui, l orsque, avant que j'ai e pu faire un geste pour m'y rfugier, il
cl ai re l'encoignure avec sa lanterne. Ainsi, dans la brusque secousse
qui m'agite lorsque je saisis le regard d'autrui, il y a ceci que, soudai n,
je vis une ali nation subtile de toutes mes possibilits qui sont
agences loin de moi, au milieu du monde, avec les objets du monde.
Mais i l rsulte de l deux i mportantes consquences. La premire,
c'est que ma possibilit devient hors de moi probabilit. En tant
qu'autrui la saisit comme ronge par une li bert qu' il n'est pas, dont i l
se fait l e tmoin et dont i l calcule l es effets, elle est pure indtermina
tion dans le jeu des possibles et c'est prcisment ainsi que je la
devi ne. C'est ce qui, plus tard, lorsque nous sommes en liaison directe
avec autrui par l e l angage et que nous apprenons peu peu ce qu' il
pense de nous, pourra la fois nous fasciner et nous faire horreur :
Je te jure que je le ferai ! - a se peut bien. Tu me le dis, j e
veux bien t e croire ; i l est possible, e n effet, que t u l e fasses. Le sens
mme de ce dialogue implique qu'autrui est originellement plac
devant ma libert comme devant une proprit donne d'indtermi
nation et devant mes possibles comme devant mes probables. C'est ce
qu'origi nellement je me sens tre l-bas, pour autrui, et cette
esquisse-fantme de mon tre m'atteint au cur de moi-mme, car,
par la honte et la rage et l a peur, j e ne cesse pas de m'assumer comme
t el . De m'assumer l'aveuglette, puisque je ne connais pas ce que
j 'assume : j e l e suis, simplement.
D'autre part, l'ensemble ustensile-possibilit de moi-mme en face
de l'ustensile m' apparat comme dpass et organis en monde par
autrui . Avec le regard d' autrui , la situation m'chappe ou, pour
user d' une expression banale, mais qui rend bien notre pense : je ne
suis plus matre de la situation. Ou, plus exactement, j'en demeure le
matre, mais elle a une dimension relle par o elle m'chappe, par o
des retournements imprvus la font tre autrement qu'elle ne parat
pour moi . Certes, il peut arriver que, dans l a stricte solitude, je fasse
un acte dont les consquences soient rigoureusement opposes mes
prvisions et mes dsirs : je tire doucement une planchette pour
amener moi ce vase fragile. Mais ce geste a pour effet de faire
tomber une statuette de bronze qui brise le vase en mille morceaux.
Seulement , i l n'y a rien ici que j e n'eusse pu prvoir, s i j 'avais t plus
attentif, si j'avais remarqu la disposition des objets, etc. : rien qui
m'chappe par principe. Au contraire, l'apparition de l ' autre fait
304
apparatre dans la situation un aspect que je n'ai pas voul u, dont je ne
suis pas matre et qui m' chappe par principe, puisqu'il est pour
l'aulre. C'est ce que Gide a heureusement appel l a part du
diable . C'est l'envers imprvisibl e et pourtant rel. C'est cette
imprvisibilit que l'art d'un Kafka s'attachera dcrire, dans Le
Procs et Le Chteau : en un sens, tout ce que font K. et l ' arpenteur
leur appartient en propre et, en tant qu'ils agissent sur le monde, les
rsultats sont rigoureusement conformes leurs prvisions : ce sont
des actes russis. Mais, en mme temps, la vrit de ces actes leur
chappe constamment ; ils ont par principe un sens qui est leur vrai
sens et que ni K. ni l ' arpenteur ne connatront jamais. Et, sans doute,
Kafka veut atteindre ici la transcendance du divin ; c'est pour le divin
que l'acte humai n se constitue en vrit. Mais Dieu n'est ici que le
concept d'autrui pouss l a limite. Nous y reviendrons. Cette
atmosphre douloureuse et fuyante du Procs, cette ignorance qui,
pourtant, se vit comme ignorance, cette opaci t total e qui ne peut que
se pressentir travers une totale translucidit, ce n'est rien autre que
l a description de notre tre-au-milieu-du-monde-pour-autrui . Ainsi
donc, l a situation, dans et par son dpassement pour autrui, se fige et
s'organise autour de moi en forme, au sens o les gestaltistes usent de
ce terme : il y a l une synthse donn e dont je suis structure
essentielle ; et cette synthse possde l a fois la cohsion ek-statique
et le caractre de l 'en-soi . Mon lien ces gens qui parlent et que j 'pie
est donn d'un coup hors de moi, comme un substrat inconnaissable
du lien que j'tablis moi-mme. En particulier, mon propre regard ou
liaison sans distance ces gens est dpouil l de sa transcendance, du
fait mme qu'il est regard-regard. Les gens que je vois, en effet, je
les fige en objets, je suis, par rapport eux, comme autrui par rapport
moi ; en les regardant, je mesure ma puissance. Mais si autrui les
voit et me voit, mon regard perd son pouvoir : i l ne saurait
transformer ces gens en objets pour autrui, puisqu'ils sont dj objets
de son regard. Mon regard manifeste simplement une relation au
milieu du monde de l'objet-moi l'objet-regard , quelque chose
comme l'attraction que deux masses exercent l'une sur l ' autre
distance. Autour de ce regard s'ordonnent, d'une part, les objets -la
distance de moi aux regards eiiste prsent, mais elle est resserre,
circonscrite et comprime par mon regard, l'ensemble distance
objets est comme un fond sur l equel l e regard se dtache l a
manire d' un ceci sur fond de monde -, d'autre part, mes
attitudes qui se donnent comme une srie de moyens utiliss pour
mainteni r le regard. En ce sens, je constitue un tout organis qui
est regard, je suis un objet-regard, c'est--dire un complexe ustensile
dou de finalit interne et qui peut se disposer lui-mme dans un
rapport de moyen fin pour raliser une prsence tel autre objet par
del la distance. Mais la distance m'est donne. En tant que j e suis
305
regard , je ne dplie pas la distance, j e me borne la franchir. Le
regard d'autrui me confre la spatialit. Se saisir comme regard c'est
se saisir comme spatialisant-spatialis.
Mais le regard d'autrui n'est pas seulement saisi comme spatiali
sant : i l est aussi lemporalisanl. L'apparition du regard d'autrui se
manifeste pour moi par une Eriebnis qu' il m'tait, par principe,
i mpossible d'acqurir dans la solitude : ceIIe de l a simultanit. Un
monde pour un seul pour-soi ne saurait comprendre de simultanit,
mais seulement des coprsences, car l e pour-soi se perd hors de l ui
partout dans l e monde et l i e tous l es tres par l' unit de sa seule
prsence. Or, la simultanit suppose l a liaison temporeIIe de deux
existants qui ne sont lis par aucun autre rapport. Deux existants qui
exercent l ' un sur l'autre une action rciproque ne sont pas simultans
prcisment parce qu'ils appartiennent au mme systme. La simulta
ni t n'appartient donc pas aux existants du monde, el l e suppose la
co prsence au monde de deux prsents envisags comme prsences-.
Est simultane, la prsence de Pierre au monde avec ma prsence. En
ce sens, le phnomne originel de simultanit, c'est que ce verre soit
pour Paul en mme temps qu'il est pour moi. Cela suppose donc un
fondement de toute simultanit qui doit ncessairement tre l a
prsence d' un autrui qui se temporalise ma propre temporaiisation.
Mais, prcisment, en tant qu'autrui se temporalise, i l me temporaiise
avec l ui : en tant qu'il s'lance vers son temps propre, je lui apparais
dans l e temps universel. Le regard d'autrui, en tant que je le saisis,
vient donner mon temps une dimension nouvelle. En tant que
prsent saisi par autrui comme mon prsent, ma prsence a un
dehors ; cette prsence qui se prsentifie pour moi s'al i ne pour moi
en prsent qui autrui se fait prsent ; j e suis jet dans l e prsent
universel , en tant qu'autrui se fait tre prsence moi . Mais l e
prsent universel o je viens prendre ma place est pure alination de
mon prsent universel, l e temps physique s'coule vers une pure et
libre temporalisation que je ne suis pas ; ce qui se profil e l'horizon
de cette simultanit que j e vis, c'est une temporalisation absolue
dont un nant me spare.
En tant qu'objet tempora-spatial du monde, en tant que structure
essentiel l e d' une situation tempora-spatiale dans le monde, je m'offre
aux apprciations d'autrui. Cela aussi, j e le saisis par le pur exercice
du cogito : tre regard, c'est se saisir comme objet inconnu
d'apprciations inconnaissables, en particulier d'apprciations de
valeur. Mais, prcisment, en mme temps que, par la honte ou l a
fiert, j e reconnais l e bien-fond de ces apprciations, j e ne cesse pas
de les prendre pour ce qu'elles sont : un dpassement l ibre du donn
vers des possibilits. Un jugement est l'acte transcendantal d'un tre
libre. Ai nsi , tre vu me constitue comme un tre sans dfense pour
une libert qui n'est pas ma libert . C'est en ce sens que nous pouvons
306
nous considrer comme des esclaves , en tant que nous apparais
sons autrui. Mais, cet esclavage n'est pas le rsultat -historique et
susceptible d'tre surmont - d'une vie la forme abstraite de l a
conscience. Je suis esclave dans la mesure o j e suis dpendant dans
mon tre au sein d'une lihert qui n\ost pas la mi enne et qui est l a
condition mme de mon tre. En tant que j e suis objet de valeurs qui
viennent me qual i fier sans que je puisse agir sur cette qualification, ni
mme la connatre , j e suis en esclavage. Du mme coup, en tant que
j e suis l'instrument de possibilits qui ne sont pas mes possibilits,
dont je ne fais qu' entrevoir la pure prsence par del mon tre, et qui
nient ma transcendance pour me constituer en moyen vers des fins
que j 'ignore, j e suis en danger. Et ce danger n'est pas un accident,
mais la structure permanente de mon tre-pour-autrui.
Nous voil au terme de cette descri ption. Il faut noter d'abord,
avant que nous puissions l ' utiliser pour nous dcouvrir autrui, qu'elle
a t faite tout entire sur le plan du cogito. Nous n'avons fait
qu'expliciter l e sens de ces ractions subjectives au regard d' autrui
que sont l a peur (sentiment d'tre en danger devant l a libert
d'autrui ), la fiert ou la honte (sentiment d'tre enfin ce que j e suis,
mais ailleurs, l-has pour autrui), l a reconnaissance de mon esclavage
(sentiment de l 'alination de toutes mes possibilits) . En outre, cette
explicitation n'est aucunement une fixation conceptuelle de connais
sances plus ou moins obscures. Que chacun se reporte son
exprience : il n'est personne qui n'ait t un jour surpris dans une
attitude coupable ou simplement ridicule. La modification brusque
que nous prouvons alors n'est nullement provoque par l ' irruption
d'une connaissance. Elle est bien plutt en elle-mme une solidifica
tion et une stratification brusque de moi-mme qui laisse intactes mes
possihilits et mes structures pour-moi , mais qui me pousse tout
coup dans une di mension neuve d'existence : la dimension du non
rvl. Ainsi, l'apparition du regard est saisie par moi comme
surgissement d'un rapport ek-statique d'tre, dont l'un des termes est
moi , en tant que pour-soi qui est ce qu'il n'est pas et qui n'est pas ce
qu'i! est , et dont l'autre terme est encore moi , mais hors de ma
porte, hors de mon acti on, hors de ma connaissance. Et ce terme,
tant prcisment en liaison avec les infinies possibilits d'un autrui
libre, est en l ui-mme synthse infinie et inpuisable de proprits
non rvles. Par le regard d'autrui, j e me vis comme fig au milieu
du monde, comme en danger, comme irrmdiahl e. Mais je ne sais ni
quel j e suis, ni quelle est ma place dans l e monde, ni quelle face ce
monde o j e sui s tourne vers autrui.
Ds lors nous pouvons prciser l e sens de ce surgissement d'autrui
dans et par son regard. En aucune faon, autrui ne nous est donn
comme ohj et. L'ohj ectivation d'autrui serait l'effondrement de son
tre-regard. D' ai l l eurs, nous l'avons vu, le regard d'autrui est l a
307
disparition mme des yeux d'autrui comme objets qui manifestent l e
regard. Autrui ne saurait mme pas tre objet vis vide l' horizon
de mon tre pour autrui . L'objectivation d'autrui, nous le verrons, est
une dfense de mon tre qui me libre prcisment de mon tre pour
autrui en confrant autrui un tre pour moi . Dans le phnomne du
regard, autrui est, par principe, ce qui ne peut tre objet. En mme
temps, nous voyons qu' i l ne saurait tre un terme du rapport de moi
moi-mme qui me fait surgir pour moi-mme comme le non-rvl.
Autrui ne saurait tre non plus vis par mon attention : si, dans l e
surgissement du regard d'autrui, j e faisais attention au regard ou
autrui, ce ne pourrait tre que comme des objets, car l'attention est
direction i ntentionnelle vers des objets. Mais il n'en faudrait pas
conclure qu'autrui est une condition abstraite, une structure concep
tuelle du rapport ek-statique : il n' y a pas ici, en effet, d'objet
rellement pens dont i l puisse tre une structure universelle et
formel l e. Autrui est certes l a condition de mon tre-nan-rvl. Mais
i l en est l a condition concrte et individuelle. Il n'est pas engag dans
mon tre au milieu du monde comme une de ses parties intgrantes,
puisque prcisment il est ce qui transcende ce monde au milieu
duquel j e suis comme non-rvl, comme tel i l ne saurait donc tre ni
objet ni lment formel et constituant d' un objet. II ne peut
m'apparatre -nous l'avons vu -comme une catgorie unificatrice
ou rgulatrice de mon exprience, puisqu'il vient moi par rencontre.
Qu'est-il donc ?
Tout d'abord, il est l'tre vers qui j e ne tourne pas mon attention. I l
est celui qui me regarde et que j e ne regarde pas encore, celui qui me
livre moi-mme comme non-rvl, mais sans se rvler lui-mme ,
celui qui m'est prsent e n tant qu'il me vise e t non pas e n tant qu'il est
vis : il est le ple concret et hors d'atteinte de ma fuite, de
l'alination de mes possibles et de l ' coulement du monde vers un
autre monde qui est l e mme et pourtant incommunicable avec celui
ci. Mais il ne saurait tre disti nct de cette alination mme et de cet
coul ement , i l en est l e sens et l a direction, i l hante cet coulement,
non comme un l ment rel ou catgoriel, mais comme une prsence
qui se fige et se mondanise si je tente de l a prsentifier et qui n'est
jamais plus prsente, plus urgente que lorsque j e n' y prends pas
garde. Si j e suis tout entier ma honte, par exemple, autrui est l a
prsence i mmense et invisible qui soutient cette honte et l ' embrasse
de toute part , c'est le mi l ieu de soutien de mon tre-nan-rvl .
Voyons ce qui se manifeste d'autrui comme non-rvlable travers
mon exprience vcue du non-rvl .
Tout d'abord, l e regard d'autrui, comme condition ncessaire de
mon objectivit, est destruction de toute objectivit pour moi . Le
regard d'autrui m'atteint travers le monde et n'est pas seulement
transformation de moi-mme, mais mtamorphose totale du monde.
308
Je suis regard dans un monde regard. En particulier, le regard
d'autrui -qui est regard-regardant et non regard-regard -nie mes
distances aux objets et dplie ses distances propres. Ce regard
d'autrui se donne immdiatement comme ce par quoi la distance vient
au monde au sein d'une prsence sans distance. Je recule, je suis
dmuni de ma prsence sans distance mon monde et j e suis pourvu
d' une distance autrui : me voil quinze pas de la porte, six
mtres de l a fentre. Mais autrui vient me chercher pour me
constituer une certaine distance de lui. Tant qu'autrui me constitue
comme si x mtres de lui , il faut qu'il soit prsent moi sans
distance. Ainsi, dans l'exprience mme de ma distance aux choses et
autrui , j'prouve la prsence sans distance d'autrui moi . Chacun
reconnatra, dans cette description abstraite, cette prsence imm
diate et brlante du regard d'autrui qui l' a souvent rempli de honte.
Autrement di t, en tant que je m'prouve comme regard, se ralise
pour moi une prsence transmondaine d'autrui : ce n'est pas en tant
qu'il est au milieu de mon monde qu' autrui me regarde, mais c'est
en tant qu'il vient vers le monde et vers moi de toute sa transcen
dance, c'est en tant qu' il n'est spar de moi par aucune distance, par
aucun objet du monde, ni rel, ni idal, par ancun corps du monde,
mais par sa seule nature d'autrui. Ainsi, l'apparition du regard
d'autrui n'est pas apparition dans le monde : ni dans le mien ni
dans celui d'autrui ; et le rapport qui m'unit autrui ne saurait
tre un rapport d'extriorit l'intrieur du monde, mais, par le
regard d'autrui, je fais l'preuve concrte qu' i l y a un au-del du
monde. Autrui m'est prsent sans aucun intermdiaire comme une
transcendance qui n'est pas la mienne. Mais cette prsence n'est pas
rciproque : il s'en faut de toute l 'paisseur du monde pour que je
sois, moi, prsent autrui . Transcendance omniprsente et insaisissa
ble, pose sur moi sans intermdiaire en tant que je suis mon tre
non-rvl, et spare de moi par l 'i nfini de l'tre, en tant que je suis
plong par ce regard au sein d' un monde complet avec ses distances et
ses ustensiles : tel est le regard d'autrui, quand j e l'prouve d'abord
comme regard.
Mais, en outre, autrui , en figeant mes possibi lits, me rvle
l'impossibilit o je suis d'tre objet, sinon pour une autre libert. Je
ne puis tre objet pour moi-mme car j e suis ce que je suis ; livr ses
seules ressources, l 'effort rflexif vers le ddoublement aboutit
l'chec, je suis touj ours ressaisi par moi. Et lorsque je pose navement
qu'il est possible que je sois, sans m'en rendre compte, un tre
objectif, je suppose implicitement par l mme l'existence d'autrui,
car comment serais-je objet si ce n'est pour un sujet ? Ainsi autrui est
d'abord pour moi l'tre pour qui j e suis objet, c'est--dire l'tre par
qui je gagne mon objectit. Si j e dois seulement pouvoir concevoir
une de mes proprits sur le mode objectif, autrui est dj donn. Et
309
il est donn non comme tre de mon univers, mais comme sujet pur.
Ainsi ce sujet pur que j e ne puis, par dfinition, connatre, c'est--dire
poser comme objet, i l est toujours l, hors de porte et sans distance
lorsque j'essaie de me saisir comme objet. Et dans l'preuve du
regard, en m'prouvant comme objectit non rvle, j 'prouve
directement et avec mon tre l'insaisissable subjectivit d'autrui.
Du mme coup, j 'prouve son i nfinie libert. Car c'est pour et par
une l i bert et s eulement pour et par el l e que mes possibles peuvent
tre l i mits et figs. Un obstacle matriel ne saurait figer mes
possibilits, il est seul ement l 'occasion pour moi de me projeter vers
d'autres possi bl es, il ne saurait leur confrer un dehors. Ce n'est pas l a
mme chose de rester chez soi parce qu' il pleut ou parce qu'on vous a
dfendu de sortir. Dans le premier cas, je me dtermine moi-mme
demeurer, par la considration des consquences de mes actes ; j e
dpasse l'obstacle pl uie vers moi-mme et j'en fais un instrument.
Dans l e second cas, ce sont mes possibilits mmes de sortir ou de
demeurer qui me sont prsentes comme dpasses et figes, et
qu' une libert prvoit et prvient la fois. Ce n'est pas caprice si ,
souvent, nous faisons tout naturel l ement et sans mcontentement ce
qui nous irriterait si un autre nous l e commandait. C'est que l'ordre et
l a dfense exigent que nous fassions l'preuve de l a libert d'autrui
travers notre propre esclavage. Ai nsi, dans le regard, la mort de mes
possibilits me fait prouver l a l ibert d'autrui ; elle ne se ralise
qu'au sein de cette libert et j e suis moi , pour moi-mme inaccessi bl e
et pourtant moi-mme, jet , dlaiss au sei n de la libert d'autrui . En
l i ai son avec cette preuve , mon appartenance au temps universel ne
peut m'apparatre que comme contenue et ralise par une temporali
sation autonome, seul un pour-soi qui se temporalise peut me j eter
dans l e temps.
Ai nsi , par l e regard, j'prouve autrui concrtement comme sujet
libre et conscient qui fait qu'il y a un monde en se temporalisant vers
ses propres possibi l its. Et l a prsence sans intermdiaire de ce sujet
est l a condition ncessaire de toute pense que j e tenterais de former
sur moi-mme. Autrui, c'est ce moi-mme dont rien ne me spare,
absolument rien si ce n'est sa pure et totale libert, c'est--dire cette
i ndtermination de soi-mme que seul il a tre pour et par soi .
Nous en savons assez, prsent, pour tenter d'expliquer ces
rsistances inbranlables que l e bon sens a toujours opposes
l ' argumentation solipsiste. Ces rsistances se fondent en effet sur l e
fait qu'autrui se donne moi comme une prsence concrte et
vidente que je ne pui s aucunement tirer de moi et qui ne peut
aucunement tre mi se en doute ni faire l'objet d'une rduction
phnomnologi que ou de toute autre noXr .
Si l ' on me regarde , en effet, j'ai conscience d'tre objet. Mais cette
conscience ne peut se produire que dans et par l'existence de l'autre.
310
En cela Hegel avait raison. Seulement , cette autre conscience et cette
autre libert ne me sont jamais donnes, puisque, si elles l'tai ent,
elles seraient connues, donc objet, et que j e cesserais d'tre objet. Je
ne puis non plus en tirer le concept ou la reprsentation de mon
propre fond. D' abord parce que je ne l es conois " pas, ni ne me les
reprsente : de semblables expressions nous renverraient encore
au connatre , qui s'est mis par principe hors de jeu. Mais en outre
toute preuve concrte de libert que je puis oprer par moi-mme
est preuve de ma libert, toute apprhension concrte de conscience
est conscience (de) ma conscience, la notion mme de conscience ne
fait que renvoyer mes consciences possibles : en effet , nous avons
tabli, dans notre introduction, que l'existence de la libert et de l a
conscience prcde et conditionne leur essence ; en consquence, ces
essences ne peuvent subsumer que des exemplifications concrtes de
ma consci ence ou de ma libert. En troisime lieu, libert et
conscience d'autrui ne sauraient tre non plus des catgories servant
l'unification de mes reprsentations. Certes, Husserl l'a montr, l a
structure ontologique de mon monde rclame qu'il soit aussi
monde pour autrui. Mais dans la mesure o autrui confre un type
d'objectivit particulier aux objets de mon monde, c'est qu'il est dj
dans ce monde titre d'objet. S'il est exact que Pierre, lisant en face
de moi, donne un type d'objectivit particulier la face du livre qui se
tourne vers l ui , c'est une face que je peux voir par principe (encore
m'chappe-t-elle, nous l'avons vu, en tant, prcisment, qu'elle est
lue), qui appartient au monde o je suis et par consquent qui se l i e
par del l a di stance et par un l i en magique l'objet-Pierre. Dans ces
conditions, l e concept d'autrui peut en effet tre fix comme forme
vide et utilis constamment comme renforcement d'objectivit pour
l e monde qui est le mi en. Mais la prsence d'autrui dans son regard
regardant ne saurait contribuer renforcer le monde, elle l e
dmondanise au contraire car ell e fait justement que le monde
m'chappe. L'chappement moi du monde, lorsqu'il est relatif et
qu'il est chappement vers l'objet-autrui , renforce l'objectivit ;
l'chappement moi du monde et de moi-mme, lorsqu' i l est absolu
et qu'il s'opre vers une libert qui n'est pas la mienne, est une
dissolution de ma connaissance : l e monde se dsintgre pour se
rintgrer l-bas en monde, mais cette dsintgration ne m'est pas
donne, je ne puis ni la connatre ni mme seulement l a penser. La
prsence moi d'autrui-regard n'est donc ni une connaissance, ni une
projection de mon tre, ni une forme d'unification ou catgorie. Elle
est et je ne puis la driver de moi .
En mme temps je ne saurais l a faire tomber sous le coup de
l'
oX7 phnomnologique. Celle-ci , en effet, a pour but de mettre le
monde entre parenthses pour dcouvrir la conscience transcendan
tale dans sa ralit absolue. Que cette opration soit possible ou non
311
e n gnral, c'est ce qu' i l ne nous apparti ent pas de dire ici. Mais, dans
l e cas qui nous occupe, elle ne saurait mettre hors jeu autrui puisque,
en tant que regard-regardant, i l n'appartient prcisment pas au
monde. J'ai honte de moi devant autrui , disions-nous. La rduction
phnomnologique doit avoir pour effet de mettre hors jeu l'objet de
l a honte, pour mieux faire ressortir la honte mme, dans son absolue
subj ectivit . Mais autrui n'est pas l' objet de l a honte : c'est mon acte
ou ma situation dans l e monde qui en sont les objets. Eux seuls
pourraient la rigueur tre rduits ^ Autrui n'est mme pas une
condition obj ective de ma honte. Et pourtant, il en est comme l'tre
mme. La honte est rvlation d'autrui non la faon dont une
conscience rvle un objet, mais la faon dont un moment de la
conscience i mplique latralement un autre moment, comme sa
motivation. Eussions-nous atteint la conscience pure, par l e cogito, et
cette conscience pure ne serait-elle que conscience (d'tre) honte, l a
conscience d'autrui l a hanterait encore, comme prsence i nsaisissa
bl e, et chapperait par l toute rduction. Ceci nous marque assez
que ce n'est pas dans le monde qu'il faut d'abord chercher autrui,
mais du ct de la conscience, comme une conscience en qui et par
qui l a conscience se fait tre ce qu'elle est. De mme que ma
conscience saisie par l e cogito tmoigne indubitablement d'elle-mme
et de sa propre existence, certaines consciences particulires, par
exemple la conscience-honte , tmoignent au cogito et d'elles
mmes et de l'existence d'autrui, indubitablement.
Mais, dira-t-on, n'est-ce pas simplement que le regard d'autrui est
le sens de mon objectivit-pour-moi ? Par l nous retomberions dans
l e solipsisme : lorsque j e m'intgrerais comme objet au systme
concret de mes reprsentations, le sens de cette objectivation serait
projet hors de moi et hypostasi comme autrui.
Mais il faut noter ici que :
10 Mon objectit pour moi n'est nullement l'explicitation du Ich
bin Ich de Hegel . Il ne s'agit nullement d'une identit formel l e, et
mon tre-objet ou tre-pour-autrui est profondment diffrent de
mon tre-pour-moi. En effet, l a notion d'objectit, nous l'avons fait
remarquer dans notre premire partie, exige une ngation explicite.
L'objet c'est ce qui n'est pas ma conscience et, par suite, ce qui n'a
pas l es caractres de l a conscience , puisque l e seul existant qui a pour
moi les caractres de l a conscience, c'est la conscience qui est mienne.
Ainsi , le moi-objet-pour-moi est un moi qui n'est pas moi , c'est--dire
qui n'a pas les caractres de l a conscience. Il est conscience dgrade ;
l'objectivation est une mtamorphose radicale et, si mme je pouvais
me voir cl airement et distinctement comme objet, ce que je verrais ne
serait pas la reprsentation adquate de ce que je suis en moi-mme
312
et pour moi-mme, de ce monstre i ncomparable et prfrable
tout dont parle Malraux, mais la saisie de mon tre-hors-de-moi,
pour l'autre, c'est--dire la saisie objective de mon tre-autre, qui est
radicalement diffrent de mon tre-pour-mpi et qui n
'
y renvoie point.
Me saisir comme mchant, par exemple; ce ne pourrait tre me
rfrer ce que je suis pour moi-mme, car j e ne suis ni ne puis tre
mchant pour moi. D'abord parce que j e ne suis pas plus mchant,
pour moi-mme, que j e ne suis fonctionnaire ou mdecin. Je suis
en effet sur l e mode de n'tre pas ce que je suis et d'tre ce que je ne
sui s pas. La qualification de mchant, au contraire, me caractrise
comme un en soi. Ensuite, parce que si je devais tre mchant pour
moi, il faudrait que je le fusse sur le mode d'avoir l'tre, c'est--dire
que je devrais me saisir et me vouloir comme mchant. Mais cela
signifierait que je dois me dcouvrir comme voulant ce qui m'apparat
moi-mme comme l e contraire de mon Bien et prcisment parce
que c'est l e Mal ou contraire de mon Bi en. Il faut donc expressment
que je veui l l e l e contraire de ce que je veux dans un mme moment et
sous l e mme rapport, c'est--dire que je me hasse moi-mme en
tant, prcisment, que j e suis moi-mme. Et, pour raliser pleine
ment sur l e terrain du pour-soi cette essence de mchancet, il
faudrait que j e m'assume comme mchant, c'est--dire que je
m'approuve par l e mme acte qui me fait me blmer. On voit assez
que cette notion de mchancet ne saurait aucunement tirer son
origine de moi en tant que je suis moi. Et j 'aurai beau pousser jusqu'
ses extrmes l i mites l'ek-stase, ou arrachement moi qui me constitue
pour-moi, je ne parviendrai jamais me confrer la mchancet ni
mme l a concevoir pour moi si je suis livr mes propres
ressources. C'est que je suis mon arrachement moi-mme, je suis
mon propre nant ; i l suffit qu'entre moi et moi je sois mon propre
mdiateur pour que toute objectivit disparaisse. Ce nant qui me
spare de l'objet-moi, j e ne dois pas l'tre ; car i l faut qu'il y ait
prsentation moi de l'objet que je suis. Ainsi ne saurais-je me
confrer aucune qualit sans la mdi ati on d'un pouvoir objectivant
qui n'est pas mon propre pouvoir et que je ne puis feindre ni forger.
Sans doute cela s'est dit : on a dit depuis longtemps qu'autrui
m'apprenait qui je suis. Mais les mmes qui soutenaient cette thse
affirmaient d'autre part que je tire l e concept d'autrui de moi-mme,
par rflexion sur mes propres pouvoirs et par projection ou analogi e.
Ils demeuraient donc au sein d' un cercle vicieux, dont i l s ne pouvaient
sortir. En fait, autrui ne saurait tre le sens de mon objectivit, il en
est la condition concrte et transcendante. C'est que, en effet, ces
qualits de mchant , de jaloux ", de sympathique ou antipa
thique , etc. , ne sont pas de vains songes : l orsque j'en use pour
qualifier autrui , je vois bien que je veux l'atteindre en son tre. Et
pourtant je ne puis les vivre comme mes propres ralits : elles ne se
31 3
refusent point, si autrui me les confre, ce que je suis pour-moi ;
lorsque autrui me fait une description de mon caractre, je ne me
reconnais point et pourtant je sais que c'est moi . Cet tranger
qu'on me prsente je l'assume aussitt, sans qu'il cesse d'tre un
tranger. C'est qu'il n'est pas une simple unification de mes reprsen
tations subjectives, ni un Moi que je suis, au sens du Ich bin
Ich , ni une vaine image qu'autrui se fait de moi et dont i l porterait
seul la responsabilit : ce moi incomparable au moi que j' ai tre est
encore moi , mais mtamorphos par un milieu neuf et adapt ce
mili eu, c'est un tre, mon tre mais avec des dimensions d'tre et des
modalits entirement neuves, c'est moi spar de moi par un nant
i nfranchissable, car j e suis ce moi, mais je ne suis pas ce nant qui me
spare de moi. C' est le moi que j e sui s par une ek-stase ul time et qui
transcende toutes mes ek-stases, puisque ce n' est pas l ' ek-stase que
j' ai tre. Mon tre pour-autrui est une chute travers l e vi de absolu
vers l ' objectivit. Et comme cette chute est alination, je ne puis me
faire tre pour moi-mme comme objet car en aucun cas je ne puis
m'aliner moi-mme.
2 Autrui , d'aill eurs, ne me constitue pas comme objet pour moi
mme , mais pour lui. Autrement dit, i l ne sert pas de concept
rgulateur ou constitutif pour des connaissances que j 'aurais de moi
mme. La prsence d'autrui ne fait donc pas apparatre l e moi
objet : je ne saisis rien qu'un chappement moi vers . . . Mme
lorsque l e langage m'aura rvl qu'autrui me ti ent pour mchant ou
pour j al oux, je n' aurai jamais une i ntuition concrte de ma mchan
cet ou de ma jal ousie. Ce ne seront jamais que des notions fugaces,
do
nt la nature mme sera de m'chapper : je ne saisirai pas ma
mchancet, mai s, propos de tel ou tel acte, je m'chapperai moi
mme, je sentirai mon alination et mon coulement vers un tre
que je pourrai seulement penser vide comme mchant et que
pourtant j e me sentirai tre, que j e vivrai distance par l a honte ou l a
peur.
Ainsi mon moi-objet n'est ni connaissance ni unit de connais
sance, mais malaise, arrachement vcu l'unit ek-statique du pour
soi , limite que j e ne puis atteindre et que pourtant je suis. Et l'autre,
par qui ce moi m'arrive, n'est ni connaissance ni catgorie, mais le fait
de l a prsence d'une libert trangre. En fait, mon arrachement
m
oi et le surgissement de la libert d'autrui ne font qu' un, j e ne puis
les ressentir et les vivre qu'ensemble, je ne puis mme tenter de les
concevoir l'un sans l'autre. Le fait d'autrui est incontestable et
m' atteint en pl ein cur. Je l e ralise par l e malaise ; par lui je suis
perptuel lement en danger dans un monde qui est ce monde et que
pourtant je ne puis que pressentir ; et autrui ne m' apparat pas comme
314
un tre qui serait d'abord constitu pour me rencontrer ensuite mais
comme un tre qui surgit dans un rapport originel d'tre avec moi et
dont l'indubitabilit et la ncessit de fait sont celles de ma propre
conscience.
Restent pourtant de nombreuses difficults. En partiulier, nous
confrons autrui par la honte une prsence indubitahle. Or, nous
avons vu qu'il est seulement probable qu'autrui me regarde. Cette
ferme qui, au sommet de la colline, semble regarder les soldats du
corps franc, il est certain qu'elle est occupe par l ' ennemi ; mai s i l
n'est pas certain que les soldats ennemis guettent prsentement par
ses fentres. Cet homme, dont j'entends l e pas, derrire moi , i l n'est
pas certain qu'il me regarde, son visage peut tre dtourn, son
regard fix terre ou sur un livre ; et enfin, d'une manire gnrale,
les yeux qui sont fixs sur moi , il n'est pas sr que ce soient des yeux,
ils peuvent tre seulement faits la ressemblance d'yeux rels.
En un mot, le regard ne devient-il pas probable son tour, du fait que
je puis constamment me croire regard, sans l'tre ? Et toute notre
certitude de l'existence d'autrui ne reprend-elle pas de ce fait un
caractre purement hypothtique ?
La difficult peut s'noncer en ces termes : l'occasion de certaines
apparitions dans l e monde qui me paraissent manifester un regard, j e
saisis en moi-mme un certain tre-regard avec ses structures
propres qui me renvoient l ' existence relle d'autrui . Mais i l se peut
que je me sois tromp : peut-tre que les objets du monde que j e
prenais pour des yeux n'taient pas des yeux, peut-tre que l e vent
seul agitai t l e buisson derrire moi , en un mot peut-tre que ces objets
concrets ne manifestaient pas rellement un regard. Que devient en ce
cas ma certitude d'tre regard ? Ma honte tait en effet honte devant
quelqu'un : mais personne n'est l . Ne devient-elle pas, de ce fai t,
honte devant personne, c'est--dire, puisqu'elle a pos quelqu'un l ou
i l n' y avai t personne, honte fausse ?
Cette difficult ne saurait nous reteni r longtemps et nous ne
l'aurions mme pas mentionne si elle n'avait l'avantage de faire
progresser notre recherche et de marquer plus purement la nature de
notre tre-po ur-autrui . Elle confond en effet deux ordres de connais
sance distincts et deux types d'tre incomparables. Nous avons
toujours su que l'objet-dans-le-monde ne pouvait tre que probabl e.
Cela vi ent de son caractre mme d'objet. I l est probable que l e
passant est un homme ; et s' i l tourne les yeux vers moi , bien que,
aussitt, j 'prouve avec certitude " tre-regard, j e ne pui s faire passer
cette certitude dans mon exprience d'autrui-objet. Elle ne me
dcouvre en effet que l'autrui-sujet, prsence transcendante au
monde et condition relle de mon tre-objet. En tout tat de cause, i l
est donc impossibl e de transfrer ma certitude d'autrui-sujet sur
l'autrui-objet qui fut l' occasion de cette certitude et, rciproquement,
315
d'infi rmer l'vidence de l'apparition d'autrui-sujet partir de l a
probabilit constituti onnel l e d'autrui-objet. Mi eux encore, l e regard,
nous l ' avons montr, apparat sur fond de destruction de l'objet qui l e
manifeste. Si ce passant gros et l ai d qui s'avance vers moi en sautillant
me regarde tout coup, c'en est fait de sa laideur et de son obsit et
de ses sautillements ; pendant l e temps que je me sens regard i l est
pure l ibert mdiatrice entre moi-mme et moi . L'tre-regard ne
saurait donc dpendre de l 'objet qui manifeste l e regard. Et puisque
ma honte, comme Erlebnis saisissable rflexivement, tmoigne
d'autrui au mme titre que d' elle-mme, je ne vais pas la remettre en
question l'occasion d'un objet du monde qui peut, par principe, tre
rvoqu en doute. Autant vaudrait douter de ma propre existence
parce que les perceptions que j 'ai de mon propre corps (lorsque je
vois ma main, par exemple) sont sujettes l'erreur. Si donc l'tre
regard, dgag dans toute sa puret, n'est pas l i au corps d'autrui
plus que ma conscience d'tre conscience, dans la pure ralisation du
cogito, n'est l i e mon propre corps, i l faut considrer l'apparition de
certains objets dans le champ de mon exprience, en particulier l a
convergence des yeux d'autrui dans ma direction, comme une pure
monition, comme l'occasion pure de raliser mon tre-regard, la
faon dont, pour un Platon, les contradictions du monde sensible sont
l'occasion d'oprer une conversion philosophique. En'un mot, ce qui
est certain c'est que je suis regard, ce qui est seulement probable c'est
que le regard soit li tel l e ou tel l e prsence intramondaine. Cela n'a
rien pour nous surprendre d'ailleurs, puisque, nous l'avons vu, ce ne
sont jamais des yeux qui nous regardent : c'est autrui comme sujet.
Reste pourtant, dira-t-on, que je puis dcouvrir que j e me suis
tromp : me voil courb sur l e trou de l a serrure ; tout coup
j 'entends des pas. Je suis parcouru par un frisson de honte :
quel qu'un m' a vu. Je me redresse, je parcours des yeux le corridor
dsert : c'tait une fausse alerte. Je respire. N'y a-t-il pas eu l une
exprience qui s'est dtruite d'elle-mme ?
Regardons-y mi eux. Est-ce que ce qui s'est rvl comme erreur,
c'est mon tre-objectif pour autrui ? En aucune faon. L'existence
d'autrui est si l oi n d' tre mise en doute que cette fausse alerte peut
trs bi en avoir pour consquence de me faire renoncer mon
entreprise. Si j e persvre au contraire, je sentirai mon cur battre et
j 'pierai l e moindre bruit, le moi ndre craquement des marches de
l'escalier. Loi n qu'autrui ai t disparu avec ma premire alerte, i l est
partout prsent, en dessous de moi, au-dessus de moi, dans les
chambres voisines et j e continue sentir profondment mon tre
pour-autrui ; il se peut mme que ma honte ne disparaisse pas : c'est
le rouge au front, prsent, que je me penche vers la serrure , je ne
cesse plus d'prouver mon tre-po ur-autrui ; mes possibilits ne
cessent pas de mourir , ni les distances de s e dplier vers moi
316
partir de l'escalier o quelqu'un pourrait tre , partir de ce coin
sombre o une prsence humaine pourrait se cacher. Mieux
encore, si je tressail l e au moindre bruit, si chaque craquement
m'annonce un regard, c'est que je suis dj en tat d'tre-regard.
Qu'est-ce-donc, en bref, qui est apparu mensongrement et qui s'est
dtruit de soi lors de l a fausse alert e ? Ce n'est pas autrui-sujet, ni sa
prsence moi : c'est la facticit d'autrui, c'est--dire la liaison
contingente d'autrui un tre-objet dans mon monde. Ainsi ce qui est
douteux, ce n'est pas autrui lui-mme, c'est l'tre-l d'autrui : c'est-
dire cet vnement historique et concret que nous pouvons exprimer
par les mots : Il y a quelqu'un dans cette chambre.
Ces remarques vont nous permettre d'aller plus loi n. La prsence
d'autrui dans le monde ne saurait dcouler analytiquement, en effet,
de la prsence d'autrui-sujet moi puisque cette prsence originelle
est transcendante , c'est--dire tre-par-del-Ie-monde. J'ai cru qu'au
trui tait prsent dans l a pice, mais je m'tais tromp : i l n'tait pas
l ; il tait absent l>. Qu'est-ce donc que l 'absence ?
A prendre l'expression d'absence dans son usage empirique et
quotidien, i l est clair que je ne l'emploierai pas pour dsigner
n'importe quelle espce de n' tre-pas-l . En premier lieu, si je ne
trouve pas mon paquet de tabac sa place ordinaire, je ne dirai pas
qu'il en est absent ; bien que pourtant je puisse dclarer qu'il devrait
tre l . C'est que l a place d'un objet matriel ou d'un instrument,
bi en qu' el l e puisse parfois l ui tre assigne avec prcision, ne dcoul e
pas de sa nature. Celle-ci peut tout juste l ui confrer un lieu ; mais
c'est par moi que l a place d'un instrument se ralise. La ralit
humaine est l'tre par qui une place vient aux objets. Et c'est la
ralit-humaine seule, en tant qu' el l e est ses propres possibilits, qui
peut originellement prendre une pl ace. Mais d'autre part je ne dirai
pas non plus que l'Aga Khan ou l e Sultan du Maroc sont absents de
cet appartement-ci, mais bien que Pierre, qui y demeure ordinaire
ment, en est absent pour l e quart d'heure. En un mot l'absence se
dfinit comme un mode d'tre de l a ralit-humaine par rapport aux
lieux et places qu' el l e a elle-mme dtermins par sa prsence.
L'absence n'est pas nant de liens avec une place, mais au contraire,
je dtermine Pierre par rapport une place dtermine en dclarant
qu'il en est absent. Enfin je ne parlerai pas de l'absence de Pierre par
rapport un lieu de la nature, mme s'il a coutume d'y passer. Mais
au contraire, je pourrai dplorer son absence un pique-nique qui a
lieu en quelque contre o il n' a jamais t. L'absence de Pierre se
dfinit par rapport une pl ace o il devrait se dterminer lui-mme
tre mais cette place el le-mme est dlimite comme place non par l e
site ou mme par des relations sol itaires du l i eu Pierre lui-mme
mais par l a prsence d'autres ralits-humaines. C'est par rapport
d'autres hommes que Pierre est absent. L'absence est un mode d'tre
317
concret de Pierre par rapport Thrse : c'est un l i en entre des
ra lits-humaines, non pas entre l a ralit-humaine et l e monde.
C'est par rapport Thrse que Pierre est absent de ce lieu. L'absence
est donc un lien d'tre entre deux ou plusieurs ralits-humaines, qui
ncessite une prsence fondamentale de ces ralits les unes pour les
autres et qui n'est , d'ailleurs, qu'une des concrtisations particulires
de cette prsence. Etre <bsent, pour Pierre par rapport Thrse,
c'est une faon particulire de lui tre prsent. L'absence en effet n' a
de signification que si tous l es rapports de Pierre avec Thrse sont
sauvegards : i l l'aime, i l est son mari , il <ssure sa subsistance, etc. En
particulier l'absence suppose l a conservation de l'existence concrte
de Pierre : la mort n'est pas une absence. De ce fait la distance de
Pierre Thrse ne change rien au fai t fondamental de leur prsence
rciproque. En effet, si nous considrons cette prsence du point de
vue de Pierre, nous voyons qu' el l e signifie ou bien que Thrse est
existante au milieu du monde comme objet-autrui, ou bien qu'il se
sent exister pour Thrse comme pour un sujet-autrui. Dans le
premi er cas, l a distance est fait contingent et ne signifie rien par
rapport au fait fondamental que Pierre est celui par qui i l y a un
monde comme Totalit et que Pierre est prsent sans distance ce
monde comme cel ui par qui l a distance exi ste. Dans le second cas, o
que soit Pierre i l se sent exister pour Thrse sans distance : elle est
distance de l ui dans la mesure o el l e l'loigne et dplie une distance
entre elle et lui ; le monde entier l'en spare. Mais i l est sans distance
pour el le en tant qu'il est objet dans l e monde qu'elle fait arriver
l' tre. En aucun cas, par consquent, l'loignement ne saurait
modi fi er ces relations essentielles. Que la distance soit petite ou
grande, entre Pierre-objet et Thrse-sujet, entre Thrse-objet et
Pierre-sujet, il y a l ' paisseur infinie d'un monde ; entre Pierre-sujet
et Thrse-objet, entre Thrse-sujet et Pierre-objet il n'y a pas du
tout de distance. Ainsi les concepts empiriques d'absence et de
prsence sont-ils deux spcifications d'une prsence fondamentale de
Pierre Thrse et de Thrse Pierre ; ils ne font que l'exprimer
d'une faon ou d'une autre et n'ont de sens que par elle. A Londres,
aux I ndes, en Amrique, sur une le dserte, Pierre est prsent
Thrse demeure Paris, il ne cessera de lui tre prsent qu' sa
mort. C'est qu'un tre n'est pas situ par son rapport avec les lieux,
par son degr de longitude et son degr de latitude : i l se situe dans un
espace humai n, entre le ct de Guermantes et le ct de chez
Swann , et c'est l a prsence i mmdiate de Swann, de la duchesse de
Guermantes qui permet de dplier cet espace hodologique o il se
si tue. Or cette prsence a l i eu dans l a transcendance ; c'est l a prsence
moi , dans l a transcendance, de mon cousin du Maroc qui me permet
de dplier entre moi et lui ce chemin qui me situe-dans-Ie-monde et
qu' on pourrait nommer l a route du Maroc. Cette route, en effet, n'est
3 18
rien que la distance entre l'autrui-objet que je pourrais percevoir en
liaison avec mon tre-pour [et) l'autrui-sujet qui m'est prsent
sans distance. Ainsi suis-je situ par l' infinit diversit des routes qui
me conduisent des objets de mon monde en corrlation avec la
prsence immdiate des sujets transcendants. Et comme le monde
m'est donn tout la fois, avec tous ses tres, ces routes reprsentent
seulement l'ensemble des complexes instrumentaux qui permettent
de faire paratre titre de ceci sur fond de monde un objet-autrui
qui y est dj contenu implici t ement et rellement. Mais ces
remarques peuvent tre gnralises : ce ne sont pas seulement
Pierre , Ren, Lucien qui sont absents ou prsents par rapport moi
sur fond de prsence originelle ; car ils ne contribuent pas seuls me
situer : je me situe aussi comme Europen par rapport des
Asiatiques ou des ngres, comme vieillard par rapport des jeunes
gens, comme magistrat par rapport aux dlinquants, comme bour
geois par rapport des ouvriers, etc. En un mot c'est par rapport
tout homme vivant que toute ralit-humaine est prsente ou absente
sur fond de prsence originelle. Et cette prsence originelle ne peut
avoir de sens que comme tre-regard ou comme tre-regardant,
c'est--dire selon qu'autrui est pour moi obj et ou moi-mme objet
pour-autrui. L'tre-pour-autrui est un fait constant de ma ralit
humaine et je le saisis avec sa ncessit de fait dans la moindre pense
que je forme sur moi-mme. O que j'aille, quoi que j e fasse, je ne
fais que changer mes distances autrui-objet, qu'emprunter des
routes vers autrui . M'loigner, me rapprocher, dcouvrir tel objet
autrui particulier, ce n'est qu' effectuer des variations empiriques sur
le thme fondamental de mon tre-pour-autrui . Autrui m'est prsent
partout comme ce par quoi je deviens objet. Aprs cela, je puis bien
me tromper sur la prsence empirique d'un objet-autrui que j e viens
de rencontrer sur ma route . Je puis bien croire que c'est Anny qui
vient vers moi sur le chemin et dcouvrir que c'est une personne
inconnue : la prsence fondamentale d'Anny moi n'en est pas
modifie. Je puis bi en croire que c'est un homme qui me guette dans
la pnombre et dcouvrir que c'est un tronc d'arbre que j e prenais
pour un tre humain : ma prsence fondamentale tous les hommes,
la prsence moi-mme de tous les hommes n'en est pas altre. Car
l'apparition d' un homme comme objet dans le champ de mon
exprience n'est pas ce qui m' apprend qu'il y a des hommes. Ma
certitude de l'existence d'autrui est indpendante de ces expriences
et c'est el l e, au contraire, qui les rend possibles. Ce qui m'apparat
alors et sur quoi je peux me t romper, ce n'est pas autrui ni le lien rel
et concret d'autrui moi , mais c'est un ceci qui peut reprsenter un
homme-objet comme aussi bien ne pas le reprsenter. Ce qui est
seulement probable , c'est la distance et la proximit relle d'autrui,
c'est--dire que son caractre d'objet et son appartenance au monde
31 9
que je fais se dvoiler ne sont pas douteux, en tant simplement que
par mon surgissement mme j e fais qu'un autrui apparat. Seulement
cette objectivit se fond dans l e monde titre d'" autrui quelque part
dans le monde : autrui-objet est certain comme apparition, corrla
tive de la reprise de ma subjectivit, mais il n'est jamais certain
qu'autrui soit cet objet. Et pareillement l e fait fondamental, mon tre
obj et pour un suj et , est d'une vidence de mme type que l ' vidence
rflexive , mais non pas l e fait que, en ce moment prcis et pour un
autrui singulier, je me dtache comme ceci sur fond de monde,
pl utt que de rester noy dans l ' indistinction d'un fond. Que j 'existe
prsentement comme objet pour un Allemand, quel qu'il soit, cela est
indubitable. Mais est-ce que j'existe titre d'Europen, de Franais,
de Parisien dans l ' indiffrenciation de ces cl lectivits ou titre de ce
Parisien autour duquel l a population parisienne et l a collectivit
fra naise s'organisent soudain pour lui servir de fond ? Sur ce point, je
ne pourrai jamais obtenir que des connaissances probables, encore
qu'elles puissent tre infiniment probables.
Nous pouvons saisir prsent l a nature du regard : il y a, dans tout
regard, J'apparition d'un autrui-objet comme prsence concrte et
probable dans mon champ perceptif et , l 'occasion de certaines
attitudes de cet autrui , j e me dtermine moi-mme saisir par la
honte, J 'angoisse , etc. , mon tre-regard . tre-regard se
prsente comme l a pure probabilit que je soi s prsentement ce ceci
concret -probabilit qui ne peut tirer son sens et sa nature mme de
probable que d' une certitude fondamentale qu'autrui m' est toujours
prsent en tant que je suis toujours pour autrui. L'preuve de ma
condition d' homme, objet pour tous les autres hommes vivants, jet
dans l'arne sous des millions de regards et m'chappant moi-mme
des mi l lions de fois, je la ralise concrtement l'occasion du
surgissement d'un objet dans mon univers, si cet objet m'indique que
j e suis probabl ement objet prsentement titre de ceci diffrenci
pour une conscience. C'est l'ensemble du phnomne que nous
appelons regard. Chaque regard nous fait prouver concrtement
et dans la certitude indubitable du cogito que nous existons pour
tous l es hommes vivants, c'est--dire qu'il y a (des) consciences pour
qui j'existe. Nous mettons entre parenthses pour bien
marquer qu'autrui-sujet prsent moi dans ce regard ne se donne pas
sous forme de pluralit , pas plus d'ailleurs que comme unit (sauf
dans son rapport concret un autrui-objet particulier). La pluralit
n'appartient en effet qu'aux objets, elle vient l'tre par l'apparition
d'un pour-soi mondifiant. L'tre-regard faisant surgir pour nous
(des) sujets nous met en prsence d'une ralit non nombre. Ds
que j e regarde, au contraire , ceux qui me regardent, l es consciences
autres s'isolent en multiplicit. Si , d'autre part, me
d
tournant du
regard comme occasion d'preuve concrte, j e cherche penser
320
vide l'indistinction infinie de la prsence humaine et l'unifier sous l e
concept du sujet infini qui n' est jamai s objet, j'obtiens une notion
purement formelle qui se rfre une srie infinie d'preuves
mystiques de l a prsence d'autrui, l a notion de Dieu comme sujet
omniprsent et infini pour qui j'existe. Mais ces deux objectivations,
l'objectivation concrte et dnombrante comme l'objectivation uni
fiante et abstraite, manquent l ' une et l'autre l a ralit prouve, c'est
-dire la prsence prnumrique d'autrui . Ce qui rendra plus
concrtes ces quelques remarques, c'est cette observation que tout l e
monde peut faire : s' i l nous arrive de paratre en public pour
interprter un rle ou faire une confrence, nous ne perdons pas de
vue que nous sommes regards et nous excutons l'ensemble des actes
que nous sommes venus faire en prsence du regard, mieux, nous
tentons de constituer un tre et un ensemble d'objets pour ce regard
Mais nous ne dnombrons pas le regard. Tant que nous parlons,
attenti fs aux seules ides que nous voulons dvelopper, l a prsence
d'autrui demeure indiffrencie. Il serait faux de l'unifier sous les
rubriques la classe , l'auditoire , etc. : nous n'avons pas en effet
conscience d'un tre concret et individualis avec une conscience
collective ; ce sont l des i mages qui pourront servir aprs coup
traduire notre exprience et qui la trahiront plus qu' moiti. Mais
nous ne saisissons pas non pl us un regard plural. Il s'agit plutt d'une
ralit impalpable, fugace et omniprsente qui ralise en face de nous
notre Moi non-rvl et qui collabore avec nous dans la production de
ce Moi qui nous chappe. Si , au contraire, je veux vrifier que ma
pense a t bi en comprise, et si je regarde mon tour l'auditoire, je
verrai tout coup apparatre des ttes et des yeux. En s'objectivant l a
ralit prnumrique d'autrui s'est dcompose et pluralise. Mais
aussi le regard a disparu. C'est cette ralit prnumrique et
concrte, bien plus qu' un tat d'inauthenticit de l a ralit
humaine, qu' il convient de rserver l e mot de on . Perptuelle
ment, o que j e sois, on me regarde. On n'est jamais saisi comme
objet, il se dsagrge aussitt .
Ainsi le regard nous a mis sur la trace de notre tre-po ur-autrui et i l
nous a rvl l'existence indubitable de cet autrui pour qui nous
sommes. Mais i l ne saurait nous conduire plus loin : ce qu'il nous faut
examiner prsent, c'est le rapport fondamental de Moi l'Autre, tel
qu'il s'est dcouvert nous, ou, si l'on prfre, nous devons prsent
expliciter et fixer thmatiquement tout ce qui est compris dans les
limites de ce rapport originel et nous demander quel est l'tre de cet
tre-pour-autrui.
Une considration qui nous aidera dans notre tche et qui se
dgage des remarques prcdentes, c'est que l'tre-pour-autrui n'est
pas une structure ontologique du pour-soi : nous ne pouvons pas
songer, en effet , driver comme une consquence d'un principe
321
l'tre-po ur-autrui de l'tre-pour-soi , ni , rciproquement, l'tre-pour
soi de l ' tre-pour-autrui. Sans doute notre ralit-humaine exige
t-elle d' tre simultanment pour-soi et pour-autrui , mais nos
recherches prsentes ne visent pas constituer une anthropologie. Il
ne serait peut-tre pas impossible de concevoir un pour-soi totale
ment libre de tout pour-autrui et qui existerait sans mme souponner
l a possibilit d'tre un objet. Simpl ement ce pour-soi ne serait pas
homme . Ce que le cogito nous rvle ici , c'est simplement une
ncessit de fait : il se trouve - et cela est indubitable -que notre
tre en liaison avec son tre-pour-soi est aussi pour autrui ; l'tre qui
se rvle l a conscience rflexive est pour-soi-pour-autrui ; le cogito
cartsien ne fait qu' affirmer la vrit absolue d'un fait : celui de mon
existence ; de mme, l e cogito un peu largi dont nous usons ici nous
rvle comme un fait l'existence d' autrui et mon existence pour
autrui . C'est tout ce que nous pouvons dire. Aussi mon tre-pour
autrui, comme le surgissement l'tre de ma conscience, a le
caractre d'un vnement absolu. Comme cet vnement est la fois
historialisation -car je me temporalise comme prsence autrui
et condition de toute histoire, nous l'appellerons historialisation
anthistorique. Et c'est ce titre, titre de temporalisation anthisto
rique de l a simultanit, que nous l'envisagerons ici . Par anthistori
que nous n'entendrons point qu'il soit dans un temps antrieur
l ' histoire -ce qui n'aurait aucun sens -mais qu'il fait partie de cette
temporalisation originelle qui s'historialise en rendant l'histoire
possible. C'est comme fait -comme fait premier et perptuel -, non
comme ncessit d'essence que nous tudierons J'tre-pour-autrui .
Nous avons vu prcdemment l a di ffrence qui spare la ngation
du type interne de l a ngation externe. En particulier nous avons not
que l e fondement de toute connaissance d' un tre dtermin est le
rapport originel par quoi, dans son surgissement mme, le pour-soi a
tre comme n'tant pas cet tre. La ngation que le pour-soi ralise
ainsi est ngation interne ; l e pour-soi la ralise dans sa pleine libert ;
mieux, il est cette ngation en tant qu'il se choisit comme finitude.
Mais el l e l e reli e indissolublement J'tre qu' i l n'est pas et nous avons
pu crire que l e pour-soi enveloppe dans son tre J'tre de l'objet qu' il
n'est pas, en tant qu' il est en question dans son tre comme n'tant
pas cet tre, Ces remarques sont applicables sans changement
essentiel l a relation premire du pour-soi avec autrui. S'i l y a un
Autrui en gnral, i l faut avant tout que je soi s cel ui qui n'est pas
l' autre et c'est dans cette ngation mme opre par moi sur moi que
j e me fais tre et qu'autrui surgit comme autrui. Cette ngation qui
constitue mon tre et qui , comme di t Hegel , me fait apparatre
comme le Mme en face de l'Autre me constitue sur l e terrain de
l ' ipsit non-thtique en Moi mme . Par quoi i l ne faut pas
entendre qu' un moi vient habiter notre conscience, mais que l'ipsit
322
se renforce en surgissant comme ngation d'une autre ipsit et que
ce renforcement est saisi positivement comme le choix continu de
l'ipsit par elle-mme comme la mme ipsit et comme cette ipsit
mme. Un pour-soi qui aurait tre son soi sans tre soi-mme serait
concevabl e. Simplement le pour-soi que je suis a tre ce qu'il est
sous forme du refus de l'autre, c'est--dire comme soi-mme. Ainsi,
en utilisant les formules appliques la connaissance du Non-moi en
gnral, nous pouvons di re que le pour-soi, comme soi-mme,
enveloppe l'tre d'autrui dans son tre en tant qu'il est en question
dans son tre comme n'tant pas autrui. En d'autres termes, pour que
la conscience puisse n'tre pas autrui et , donc, pour qu'il puisse y
avoir un autrui sans que ce n' tre pas , condition du soi-mme,
soit purement et simplement l'objet de l a constatation d'un tmoin
troisime homme , il faut qu'elle ait tre elle-mme et spontan
ment ce n 'tre-pas, il faut qu'elle se dgage librement d'autrui et s'en
arrache, en se choisissant comme un nant qui simplement est autre
que l'autre et, par l, se rejoint dans le soi-mme ^o Et cet
arrachement mme qui est l'tre du pour-soi fait qu'il y a un autrui.
Cela ne signifie point qu'il donne l' tre l'autre, mais simplement
qu'il lui donne l' tre autre ou condition essentielle du il y a . Et il
va de soi que, pour le pour-soi , le mode d'tre-ce-qui-n'est-pas-autrui
est tout entier transi par le Nant, le pour-soi est ce qui n'est pas
autrui sur le mode nantisant du reflet-refltant ; le ne-pas-tre
autrui n'est jamai s donn mais perptuellement choisi dans une
rsurrection perptuelle, la conscience ne peut ne pas tre autrui
qu'en tant qu'elle est conscience (de) soi-mme comme n'tant pas
autrui . Ainsi la ngation interne, ici comme dans le cas de la prsence
au monde, est un lien unitaire d'tre : il faut qu'autrui soit prsent de
toute part la conscience et mme qu'il l a traverse tout entire pour
que l a conscience puisse s'chapper, prcisment en n'tant rien, cet
autrui qui risque de l'engluer. Si brusquement la conscience tait
quelque chose , la distinction de soi-mme et d'autrui disparatrait au
sein d'une indiffrenciation totale.
Seulement cette descri ption doit comporter une addition essentielle
qui va en modifier radicalement la porte. Lorsque, en effet, la
conscience se ralisait comme n'tant pas tel ou tel ceci dans le
monde, l a relation ngative n'tait pas rciproque : le ceci envisag ne
se faisait pas ne pas tre la conscience ; elle se dterminait en lui et par
lui ne pas l' tre, mais il demeurait, par rapport elle, dans une pure
extriorit d' indi ffrence ; c'est que, en effet, il conservait sa nature
d'en soi et c'est comme en-soi qu'il se rvlait la conscience dans l a
ngation mme par quoi le pour-soi se faisait tre en ni ant de soi qu'il
ft en-soi. Mai s lorsqu'il s'agit d'autrui, au contraire, l a relation
ngative interne est une relation de rciprocit. L'tre que la
conscience a ne pas tre se dfinit comme un tre qui a ne pas tre
323
cette consci ence. C'est que, en effet , lors de la perception du ceci dans
le monde, la conscience ne diffrait pas seulement du ceci par son
individualit propre mais aussi par son mode d'tre. Elle tait pour
soi en face de l ' En-soi. Au lieu que, dans le surgissement d'autrui, el l e
ne diffre aucunement de l'autre quant son mode d'tre : l'autre est
ce qu'elle est, il est pour-soi et conscience, i l renvoie des possibles
qui sont ses possi bles, i l est soi-mme par exclusion de l'autre ; i l ne
saurait tre question de s'opposer l'autre par une pure dtermina
tion numrique. Il n'y a pas ici deux ou plusieurs consciences : la
numration suppose un tmoin externe en effet et elle est pure et
si mple constatation d'extriorit. I l ne peut y avoir d'autre pour l e
pour-soi que dans une ngation spontane et prnumrique. L'autre
n'existe pour la conscience que comme soi-mme refus. Mais
prcisment parce que l'autre est un soi-mme, il ne peut tre pour
moi et par moi soi-mme refus qu' en tant qu'il est soi-mme qui me
refuse. Je ne puis ni saisir ni concevoir une conscience qui ne me
saisisse point. La seule conscience qui est sans aucunement me saisir
ni me refuser et que je puis moi-mme concevoir, ce n'est pas une
conscience isole quelque part hors du monde, c'est l a mienne
propre. Ainsi l'autre que j e reconnais pour refuser de l'tre, c'est
avant tout celui pour qui mon pour-soi est. Celui que je me fais ne pas
tre, en effet , ce n'est pas seulement en tant que je le nie de moi qu'il
n'est pas moi, mais je me fais prcisment ne pas tre un tre qui se
fait ne pas tre moi. Seulement cette double ngation est en un sens
destructrice d'elle-mme : ou bien en effet je me fais ne pas tre un
certain tre et alors il est objet pour moi et j e perds mon objectit
pour lui ; dans ce cas l'autre cesse d'tre l'autre-moi, c'est--dire le
sujet qui me fai t tre objet par refus d'tre moi ; ou bien cet tre est
bien l'autre et se fait n'tre pas moi , mais en ce cas je deviens objet
pour lui ; et il perd son objectit propre. Ainsi, originellement, l'autre
est le Non-moi-non-objet. Quels que soient les processus ultrieurs de
l a dialectique de l ' Autre, si l'autre doit tre d'abord l'autre, i l est celui
qui , par principe, ne peut se rvler dans l e surgissement mme par
quoi j e nie tre l ui . En ce sens, ma ngation fondamentale ne peut
tre directe, car i l n'y a rien sur quoi elle puisse porter. Ce que je
refuse d'tre finalement ce ne peut rien tre que ce refus d'tre moi
par quoi l'autre me fait objet ; ou, si l'on prfre, je refuse mon Moi
refus ; je me dtermine comme moi-mme par refus du Moi-refus ;
je pose ce Moi refus comme Moi-alin dans le surgissement mme
par quoi je m'arrache autrui. Mai s, par l mme, j e reconnais et
j 'affi rme non seulement autrui mai s l'existence de mon Moi-pour
autrui ; c'est que, en effet , je ne puis pas ne pas tre autrui si j e
n'assume pas mon tre-objet pour autrui. La disparition du Moi
alin entranerait l a disparition d'autrui par effondrement du Moi
mme. Je m'chappe d'autrui en lui laissant mon Moi alin entre les
324
mains. Mais comme je me choisis comme arrachement autrui,
j 'assume et je reconnais pour mien ce Moi alin. Mon arrachement
autrui, c'est--dire mon Moi-mme, est par structure essentielle
assomption comme mien de ce Moi qu' autrui refuse ; i l n'est mme
que cela. Ainsi ce Moi alin et refus est la fois mon lien autrui et
le symbole de notre sparation absolue. Dans la mesure, en effet, o
je suis celui qui fait qu'il y a un Autrui par l'affirmation de mon
ipsit, l e Moi-objet est mien et je l e revendique car la sparation
d'autrui et de moi-mme n'est jamais donne et j'en suis perptuelle
ment responsable dans mon t re. Mais en tant qu'autrui est corespon
sable de notre sparation originel l e, ce Moi m'chappe, puisqu'il est
ce qu'autrui se fait ne pas tre. Ainsi j e revendique comme mien et
pour moi , un moi qui m'chappe et comme je me fais ne pas tre
autrui , en tant qu'autrui est spontanit identique la mienne, c'est
prcisment comme Moi-m'chappant que je revendique ce Moi
obj et. Ce Moi-objet est Moi que je suis dans la mesure mme o il
m'chappe et je l e refuserais au contraire comme mi en s'il pouvait
concider avec moi-mme en pure ipsit. Ainsi mon tre-pour
autrui, c'est--dire mon Moi-objet, n'est pas une image coupe de
moi et vgtant dans une conscience trangre : c'est un tre
parfaitement rel , mon tre comme condition de mon ipsit en face
d'autrui et de l'ipsit d'autrui en face de moi. C'est mon tre-dehors :
non pas un tre subi et qui serait lui-mme venu du dehors mais un
dehors assum et reconnu comme mon dehors. II ne m'est possible,
en effet, de nier de moi autrui qu' en tant qu'autrui est lui-mme
sujet. Si je refusais immdiatement autrui comme pur objet -c'est-
dire comme existant au milieu du monde -ce n'est pas autrui que je
refuserais, mais bien un objet qui , par principe, n'aurait rien de
commun avec la subjectivit ; j e demeurerais sans dfense vis--vis
d'une assi mi l ation totale de moi autrui , faute de me tenir sur mes
gardes dans le vrai domaine d' autrui, la subjectivi t, qui est aussi mon
domaine. Je ne puis tenir autrui distance qu'en acceptant une limite
ma subjectivit. Mais cette limite ne saurait ni venir de moi ni tre
pense par moi, car j e ne pui s me limiter moi-mme, sinon je serais
une totalit finie. D'autre part , selon les termes de Spinoza, la pense
ne peut tre limite que par la pense. La conscience ne peut tre
limite que par la conscience. La l imite entre deux consciences, en
tant qu' el l e est produite par la conscience limitante et assume par la
conscience l i mite, voil donc ce qu'est mon Moi-objet. Et nous
devons l ' entendre aux deux sens du mot limite . Du ct du
limitant, en effet, la limite est saisie comme le contenu qui me
contient et me cerne, l e manchon de vi de qui m'excipe comme totalit
en me mettant hors jeu ; du ct du l i mit, elle est tout phnomne
d'ipsit comme la limite mathmatique est l a srie qui tend vers
elle sans j amais l'atteindre ; tout l 'tre que j ' ai tre est sa limite
325
comme une courbe asymptote une droite. Ainsi suis-je une totalit
dtotalise et indfi ni e, contenue dans une totalit finie qui la cerne
distance et que je suis hors de moi sans pouvoir jamais ni la raliser ni
mme l'atteindre. Une bonne i mage de mes efforts pour me saisir et
de l eur vani t serai t donne par cette sphre dont parle Poincar et
dont l a temprature dcrot de son centre sa surface : des tres
vivants tentent de parvenir jusqu' la surface de cette sphre en
partant de son centre, mais l'abaissement de l a temprature provoque
chez eux une contraction continment croissante ; ils tendent
devenir i nfiniment plats mesure qu'ils approchent du but et, de ce
fait, ils en sont spars par une distance infinie. Pourtant cette limite
hors d'atteinte qu'est mon Moi-objet n'est pas idale : c'est un tre
rel. Cet tre n'est point en-soi car i l ne s'est pas produit dans l a pure
extriorit d'indiffrence ; mais il n'est pas non plus pour-soi, car il
n'est pas l 'tre que j 'ai tre en me nantisant. Il est prcisment
mon tre-pour-autrui, cet tre cartel entre deux ngations d'origine
oppose et de sens inverse ; car autrui n 'est pas ce Moi dont i l a
l'intuition et moi , je n 'ai pas l'intuition de ce Moi que je suis. Pourtant
ce Moi, produit par l'un et assum par l'autre, tire sa ralit absolue
de ce qu'il est l a seule sparation possible entre deux tres foncire
ment identiques quant leur mode d'tre et qui sont immdiatement
prsents l'un l'autre, puisque, l a conscience pouvant seule limiter la
conscience , aucun terme moyen n'est concevable entre eux.
C'est partir de cette prsence moi d'autrui-sujet, dans et par
mon objectit assume, que nous pouvons comprendre l'objectiva
tion d'autrui comme second moment de mon rapport l'autre. En
effet la prsence d'autrui par del ma limite non rvle peut servir
de motivation pour mon ressaisissement de moi-mme en tant que
libre ipsit. Dans l a mesure o j e me ni e comme autrui et o autrui
se manifeste d'abord, il ne peut se manifester que comme autrui,
c'est--dire comme sujet par del ma limite, c'est--dire comme ce
qui me l i mi te. Rien en effet ne peut me limiter sinon autrui . I l
apparat donc comme ce qui, dans sa pleine libert et dans sa libre
projection vers ses possibles, me met hors de jeu et me dpouille de
ma transcendance, en refusant de faire avec (au sens de l'alle
mand : mit-machen) . Ainsi dois-je saisir d'abord et uniquement celle
des deux ngations dont j e ne suis pas l e responsable, celle qui ne
vi ent pas moi par moi . Mai s dans l a saisie mme de cette ngation
surgit l a conscience (de) moi cor me moi-mme, c'est--dire que j e
puis prendre une conscience explicite (de) moi en tant que j e suis
aussi responsable d'une ngation d'autrui qui est ma propre possibi
lit. C'est l'explicitation de l a seconde ngation, celle qui va de moi
autrui. A vrai dire, elle tait dj l, mais masque par l'autre,
puisqu'elle se perdait pour faire apparatre l'autre. Mais prcisment
l'autre est motif pour que l a nouvel le ngation paraisse : car s'il y a un
326
autrui qui me met hors jeu en posant ma transcendance comme
purement contemple, c'est que je m'arrache autrui en assumant ma
limite. Et la conscience (de) cet arrachement ou conscience (d'tre) le
mme par rapport l ' autre est conscience (de) ma libre spontanit.
Par cet arrachement mme qui met l'autre en possession de ma limite,
j e jette dj l'autre hors de j eu. En tant donc que j e prends
conscience (de) moi-mme comme d'une de mes libres possibilits et
que je me projette vers moi-mme pour raliser cette ipsit, me voil
responsable de l'existence d' autrui : c'est moi qui fais, par l ' affirma
tion mme de ma libre spontani t, qu'il y ait un autrui et non pas
simplement un renvoi infini de la conscience elle-mme. autrui se
trouve donc mis hors jeu, comme ce qu'il dpend de moi de ne pas
tre et, par l, sa transcendance n'est plus transcendance qui me
transcende vers lui-mme, elle est transcendance purement contem
pl e, circuit d'ipsit simplement donn. Et comme je ne puis raliser
la fois les deux ngations, la ngation nouvelle, quoique ayant
l'autre pour motivation, l a masque son tour : autrui m'apparat
comme prsence dgrade. C'est qu'en fait l'autre et moi sommes
coresponsables de l ' existence de l'autre, mais c'est par deux nga
tions telles que j e ne puis prouver l'une sans qu'elle masque aussitt
l'autre. Ainsi autrui devient maintenant ce que je limite dans ma
projection mme vers le n'tre-pas-autrui. Naturellement il faut
concevoir ici que la motivation de ce passage est d'ordre affectif. Rien
n'empcherait, par exemple, que je demeure fascin par ce Non
rvl avec son au-del, si j e ne ralisais prcisment ce Non-rvl
dans la crainte, dans la honte ou dans la fiert. Et, prcisment, le
caractre affectif de ces motivations rend compte de l a contingence
empirique de ces changements de point de vue. Mais ces sentiments
eux-mmes ne sont rien de plus que notre faon d'prouver affective
ment notre tre-po ur-autrui. La crainte, en effet, implique que j e
m'apparais comme menac titre de prsence au milieu du monde,
non titre de pour-soi qui fait qu'i l y a un monde. C'est l'objet que je
suis qui est en danger dans le monde et qui , comme tel , cause de son
indissol uble unit d' tre avec l'tre que j 'ai tre, peut entraner la
ruine du pour-soi que j'ai tre avec l a sienne propre. La crainte est
donc dcouverte de mon tre-objet l'occasion de l'apparition d'un
autre objet dans mon champ perceptif. Elle renvoie l'origine de
toute crainte qui est l a dcouverte craintive de mon objectit pure et
simple en tant qu'el l e est dpasse et transcende par des possibles
qui ne sont pas mes possibles. C'est en me jetant vers mes propres
possibles que j 'chapperai la crainte, dans la mesure o j e
considrerai mon objectit comme inessentielle. Cela ne se peut que
si je me saisis en tant que je suis responsable de l'tre d'autrui. Autrui
devient alors ce que je me fais ne pas tre et ses possibilits sont
possibilits que je refuse et que je puis simplement contempler, donc
327
mortes-possibil i ts. Par l je dpasse mes possibilits prsentes, en
tant que je l es envisage comme pouvant toujours tre dpasses par
les possibilits d'a utrui , mais je dpasse aussi les possibilits d'autrui ,
en l es considrant du point de vue de la seule qualit qu' il ait sans
qu'el l e soit sa possibilit propre -son caractre mme d'autrui, en
tant que je fais qu' i l y ait un autrui -et en les considrant comme
possibi l i ts de me dpasser que je puis toujours dpasser vers de
nouvel les possibil i ts. Ainsi , du mme coup, j'ai reconquis mon tre
pour-soi par ma conscience (de) moi comme foyer perptuel d'infinies
possibi l i ts et j 'ai transform les possibilits d'autrui en mortes
possibilits en les affectant toutes du caractre de non-vcu-par-moi,
c'est--dire de simplement donn.
La honte n'est, parei llement, que le sentiment originel d'avoir mon
tre dehors, engag dans un autre tre et, comme tel , sans dfense
aucune, clair par l a lumire absolue qui mane d'un pur sujet : c'est
la conscience d' tre irrmdiablement ce que j 'tais toujours, en
sursis , c'est--dire sur le mode du pas-encore ou du dj
plus . La honte pure n'est pas sentiment d'tre tel ou tel objet
rprhensible mai s, en gnral, d'tre un objet, c'est--dire de me
reconnatre dans cet tre dgrad, dpendant et fig que je suis pour
autrui. La honte est sentiment de chute originelle, non du fait que
j'aurais commis t el le ou telle faute , mais simplement du fait que je
suis tomb dans l e monde, au milieu des choses, et que j 'ai besoin
d
e la mdiation d'autrui pour tre ce que je suis. La pudeur et, en
particulier, la crainte d'tre surpris en tat de nudit ne sont qu'une
spcification symbolique de l a honte originelle : le corps symbolise ici
notre objectit sans dfense. Se vtir, c'est dissimuler son objectit,
c'est rclamer l e droit de voir sans tre vu, c'est--dire d'tre pur
sujet. C'est pourquoi l e symbole biblique de l a chute, aprs l e pch
origi nel , c'est le fait qu'Adam et Eve connaissent qu'ils sont nus .
La raction l a hont e consistera justement saisir comme objet celui
qui saisissait ma propre objectit. Ds lors, en effet, qu'autrui
m'apparat comme objet, sa subjectivit devient une simple proprit
de l'objet considr. Elle se dgrade et se dfinit comme ensemble
de proprits objectives qui se drobent moi par principe . Autrui
objet une subjectivit comme cette bote creuse a un
intrieur . Et, par l , je me rcupre : car je ne puis tre objet pour
un objet. Je ne ni e point qu'autrui demeure en liaison avec moi par
Son i ntrieur , mais la conscience qu'il a de moi , tant conscience
objet, m'apparat comme pure i ntriorit sans efficace : c'est une
proprit parmi d'autres de cet intrieur , quelque chose de
comparable une pellicule i mpressionnable dans l a chambre noire
d'un appareil photographique. En tant que j e fais qu'il y ait un autrui,
je me saisis comme source libre de l a connaissance qu'autrui a de moi
et autrui me parat affect en son tre par cette connaissance qu'il a de
328
mon tre, en tant que je l'ai affect du caractre d'autrui . Cette
connaissance prend alors un caractre subjectif, au nouveau sens de
relatif , c'est--dire qu'elle reste dans l e sujet-objet comme une
qualit relative l ' tre-autrui dont je l'ai affecte. Elle ne me touche
plus : el l e est une i mage en lui de moi. Ainsi l a subjectivit s'est
dgrade en intriorit, la libre conscience en pure absence de
principes, les possibilits en proprits et l a connaissance par quoi
autrui m'atteint dans mon tre en pure image de moi dans la
conscience d' autrui. La honte motive l a raction qui l a dpasse et
la supprime en tant qu'elle enferme en elle une comprhension
implicite et non thmatise du pouvoir-tre-objet du sujet pour qui j e
suis objet. Et cette comprhension implicite n'est autre que l a
conscience (de) mon tre-moi-mme c'est--dire de mon ipsit
renforce . En effet dans la structure qu'exprime l e " J'ai honte de
moi , l a honte suppose un moi-objet pour l'autre mais aussi une
ipsit qui a honte et qu'exprime imparfaitement l e " Je de l a
formul e. Ainsi l a hont e est apprhension unitaire de trois dimen
sions : l'ai honte de moi devant autrui.
Si l' une de ces dimensions vient disparatre, la honte disparat,
aussi. Si pourtant je conois l e on sujet devant qui j'ai honte, en
tant qu'il ne peut devenir objet sans s'parpiller en une pluralit
d'autrui, si j e le pose comme l'unit absolue du sujet qui ne peut
aucunement devenir objet, je pose par l l'ternit de mon tre-objet
et je perptue ma honte. C'est la honte devant Dieu, c'est--dire la
reconnai ssance de mon objectit devant un sujet qui ne peut jamais
devenir objet ; du mme coup je ralise dans l ' absolu et j ' hypostasie
mon objectit : la position de Dieu s'accompagne d'un chosisme de
mon objectit ; mi eux, je pose mon tre-objet-pour-Dieu comme plus
rel que mon pour-soi ; j'existe alin et je me fais apprendre par mon
dehors ce que je dois tre. C'est l 'origine de la crainte devant Dieu.
Les messes noi res, profanations d'hosties, associations dmoniaques,
etc., sont autant d'efforts pour confrer le caractre d' objet au Sujet
absol u. En voulant le Mal pour le Mal, je tente de contempler l a
transcendance divi ne - dont le Bi en est la possibilit propre -
comme transcendance purement donne et que je transcende vers le
Mal . Alors je fais souffrir Dieu, je " l 'irrite etc. Ces tentatives,
qui impliquent la reconnaissance absolue de Dieu comme sujet qui ne
peut tre objet, portent en elles leur contradiction et sont en
perptuel chec.
La fiert, elle, n'exclut pas la honte originel l e. C'est mme sur l e
terrain de l a honte fondamentale ou honte d'tre objet qu'elle
s'difie. C'est un sentiment ambigu : dans la fiert, je reconnais
autrui comme sujet par qui l'objectit vient mon tre, mais je me
reconnais en outre comme responsable de mon objectit ; j e mets
l'accent sur ma responsabilit et je l'assume. En un sens l a fiert est
329
donc d'abord rsignation : pour t re fier d'tre cela, il faut que je me
sois d'abord rsign n'tre que cela. I l s'agit donc d' une premire
raction la honte et c'est dj une raction de fuite et de mauvaise
foi , car, sans cesser de tenir autrui pour sujet, j 'essaye de me saisir
comme affectant autrui par mon objectit. En un mot il y a deux
attitudes authentiques : celte par laquelle je reconnais autrui comme
le sujet par qui je viens l'objectit - c'est la honte ; cel!e par
laquelle j e me saisis comme l e projet libre par qui autrui vient l'tre
autrui -c'est l 'orgueil ou affirmation de ma libert en face d'autrui
objet. Mais la fiert -ou vanit -est un sentiment sans quilibre et
de mauvaise foi : je tente, dans l a vanit, d'agir sur autrui en tant que
je suis objet ; cette beaut ou cette force ou cet esprit qu'il me confre
en tant qu'il me constitue en objet, je prtends en user, par un choc
en retour, pour l'affecter passivement d'un sentiment d'admiration ou
d'amour. Mais ce sentiment, comme sanction de mon tre-objet,
j'exige en outre qu'autrui le ressente en tant qu' il est sujet, c'est-
dire comme l ibert. C'est la seule manire en effet de confrer
l'objectivit absolue ma force ou ma beaut. Ainsi le sentiment
que j 'exige d'autrui porte en l ui-mme sa propre contradiction
puisque je dois en affecter autrui en tant qu'il est libre. Il est ressenti
sur l e mode de l a mauvaise foi et son dveloppement interne l e
conduit la dsagrgation. En effet, pour joui r de mon tre-objet que
j 'assume, j e tente de le rcuprer comme objet ; et comme autrui en
est l a cl , j e tente de m'emparer d'autrui pour qu'il me livre l e secret
de mon tre. Ainsi la vanit me pousse m' emparer d'autrui et l e
constituer comme un objet, pour fouiller au sein de cet objet et pour y
dcouvrir mon objectit propre. Mais c'est tuer la poule aux ufs
d'or. En constituant autrui comme objet, je me constitue comme
image au cur d' autrui-objet ; de l la dsillusion de la vanit : cette
i mage que j 'ai voulu saisir, pour la rcuprer et la fondre mon tre,
j e ne m' y reconnais plus, je dois bon gr mal gr l'imputer autrui
comme une de ses proprits subjectives ; libr malgr moi de mon
objectit , j e demeure seul en face d' autrui-objet, dans mon inqualifia
bl e ipsit que j 'ai tre sans pouvoir jamais tre relev de ma
foncti on.
Honte , crainte et fiert sont donc mes ractions originelles, el l es ne
sont que les diverses manires dont j e reconnais autrui comme sujet
hors d'atteinte et el l es enveloppent en elles une comprhension de
mon ipsit qui peut et doit me servir de motivation pour constituer
autrui en objet.
Cet autrui-objet qui m'apparat soudain, i l ne demeure point une
pure abstraction objective. Il surgit devant moi avec ses significations
particulires. Il n'est pas seulement l'objet dont la libert est une
proprit comme transcendance transcende. Il est aussi en colre
ou joyeux ou attentif , il est sympathique ou antipathi-
330
que , il est avare , emport " , etc. C'est que, en effet, en me
saisissant comme moi-mme, je fais qu'autrui-objet existe au mi l i eu
du monde. Je reconnais sa transcendance mais j e la reconnais non
comme transcendance transcendante mai s comme transcendance
transcende. Elle apparat donc comme un dpassement des usten
siles vers certaines fins, dans l'exacte mesure o j e dpasse dans un
projet unitaire de moi-mme ces fins, ces ustensiles et ce dpassement
par autrui des ustensiles vers les fins. C'est que, en effet, je ne me
saisis jamais abstraitement comme pure possibilit d'tre moi-mme,
mais je vis mon ipsit dans sa projection concrte vers telle ou telle
fin : j e n' existe que comme engag et je ne prends conscience (d') tre
que comme tel. A ce titre je ne saisis autrui-objet que dans un
dpassement concret et engag de sa transcendance. Mais, rcipro
quement, l ' engagement d' autrui qui est son mode d'tre m'apparat.
en tant qu' il est transcend par ma transcendance, comme engage
ment rel, comme enracinement. En un mot, en tant que j 'existe pour
moi, mon engagement dans une situation doit se comprendre au
sens o l ' on dit : Je suis engag envers un tel, je me suis engag
rendre cet argent, etc. Et c'est cet engagement qui caractrise
autrui-sujet, puisque c'est un autre moi-mme. Mais cet engagement
objectiv, lorsque je saisis autrui comme objet, se dgrade et devient
un engagement-objet au sens o l'on dit : Le couteau est engag
profondment dans la plaie ; l'arme s'tait engage dans un dfil.
Il faut comprendre en effet que l 'tre-au-milieu-du-monde qui vient
autrui par moi est un tre rel . Ce n'est point une pure ncessit
subjective qui me l e fait connatre comme existant au milieu du
monde. Et pourtant, d'autre part, autrui n'est pas de lui-mme perdu
dans ce monde. Mais j e l e fais se perdre au milieu du monde qui est
mien du seul fait qu'il est pour moi celui que j 'ai ne pas tre, c'est-
dire du seul fait que j e le tiens hors de moi comme ralit purement
contemple et dpasse vers mes propres fins. Ainsi l'objectivit n'est
pas la pure rfraction d'autrui travers ma conscience : elle vient
autrui par moi comme une qualification relle : je fais qu'autrui soit
au milieu du monde. Ce que je saisis donc comme caractres rels
d'autrui c'est un tre-en-situation : en effet je l 'organise au mi lieu du
monde en tant qu'il organise l e monde vers lui-mme, je le saisis
comme l' unit objective d'ustensiles et d'obstacles. Nous avons
expliqu dans l a deuxime partie de cet ouvrage 1 que la totalit des
ustensiles est l e corrlatif exact de mes possibilits. COflme j e suis
mes possibilits, l'ordre des ustensiles dans le monde est l'image
projete dans l ' en-sdi de mes possibilits, c'est--dire de ce que je
suis. Mais cette image mondaine, je ne puis jamais la dchiffrer, je
m' y adapte dans et par l'action. Autrui, en tant qu'il est sujet, se
1 . 2< partie, chap. III, . III.
33]
trouve pareillement engag dans son image. Mais en tant que je l e
saisis comme objet, au contraire, c'est cette image mondaine qui me
saute aux yeux : autrui devient l ' i nstrument qui se dfinit par son
rapport avec tous les autres instruments, il est un ordre de mes
ustensiles qui est enclav dans l'ordre que j' impose ces ustensiles :
saisir autrui, c'est saisir cet ordre-enclave et le rapporter une
absence centrale ou intriorit ; c'est dfinir cette absence comme
coulement fig des objets de mon monde vers un objet dfi ni de mon
univers. Et le sens de cet coulement m'est fourni par ces objets eux
mmes : c'est la disposition du marteau et des clous, du ciseau et du
marbre, en tant que je dpasse cette disposition sans en tre l e
fondement, qui dfinit l e sens de cette hmorragie intramondaine.
Ainsi l e monde m'annonce autrui en sa totalit et comme totalit.
Certes l'annonce demeure ambigu. Mais c'est parce que j e saisis
J'ordre du monde vers autrui comme totalit i ndiffrencie sur fond
de quoi paraissent quelques structures explicites. Si je pouvais
expl iciter tous les complexes ustensiles en tant qu'ils sont tourns vers
autrui, c'est--dire si je pouvais saisir non seulement la place que l e
marteau et l es clous occupent dans ce complexe d'ustensilit mais
encore la rue, l a vil l e, la nation, etc. , j'aurais dfini explicitement et
totalement l'tre d'autrui comme objet. Si j e me trompe sur une
intention d'autrui, ce n' est nullement parce que je rapporte son geste
une subjectivit hors d'atteinte : cette subjectivit en soi et par soi
n' a aucune commune mesure avec l e geste, car elle est transcendance
pour soi , transcendance indpassabl e. Mais c'est parce que j 'organise
le monde entier autour de ce geste autrement qu'il ne s'organise en
fait. Ainsi, du seul fait qu'autrui parat comme objet, il m'est donn
par principe comme totalit. il s'tend tout travers l e monde comme
puissance mondaine d'organisation synthtique de ce monde. Simple
ment, je ne puis pas plus expliciter cette organisation synthtique que
j e ne puis expliciter le monde lui-mme en tant qu'il est mon monde.
Et la diffrence entre autrui-sujet, c'est--dire entre autrui tel qu'il est
pour-soi, et autrui-objet n'est pas une diffrence du tout l a partie ou
du cach au rvl : car autrui-objet est par principe un tout
coextensif la totalit subjective ; rien n'est cach et, en tant que les
objets renvoient d'autres objets, je puis accrotre indfiniment ma
connaissance d'autrui en explicitant indfiniment ses rapports aux
autres ustensiles du monde ; et l'idal de l a connaissance d'autrui
demeure l ' explicitation exhaustive du sens d'coulement du monde.
La diffrence de principe entre autrui-objet et autrui-sujet vient
uni quement de ce fait qu'autrui-sujet ne peut aucunement tre connu
ni mme conu comme tel : i J n'y a pas de problme de la
connaissance d'autrui-sujet et les objets du monde ne renvoient pas
sa subjectivit ; ils se rfrent seulement son objectit dans le
monde comme sens -dpass vers mon ipsit -de l'coulement
332
intramondai n. Ainsi la prsence d'autrui moi comme ce qui fait mon
objectit est prouve comme une totalit-suj et ; et si je me retourne
vers cette prsence pour la saisir, j 'apprhende nouveau autrui
comme totalit : une totalit-objet coextensive la totalit du monde.
Et cette apprhension se fait d'un coup : c'est partir du monde tout
entier que je vi ens autrui-objet. Mais ce ne sont jamais que des
rapports singuliers qui sortiront en relief comme formes sur fond du
monde. Autour de cet homme que je ne connais pas et qui lit dans l e
mtro, l e monde tout entier est prsent. Et ce n'est pas son corps
seulement -comme objet dans le monde - qui l e dfinit dans son
tre : c'est sa carte d'identit, c'est la di rection de l a rame de mtro
o il est mont, c'est la bague qu' il porte au doigt. Non pas titre de
signes de ce gu 'il est -cette notion de signe nous renverrai t, en effet,
une subjectivit que j e ne pui s mme concevoir et dans laquelle
prcisment i l n'est rien proprement parier puisqu'il est ce qu'il
n'est pas et qu'il n'est pas ce qu'il est -mais titre de caractristiques
relles de son tre. Seulement, si je sais qu'il est au milieu du monde,
en France, Paris en train de lire , je ne puis, faute de voir sa carte
d'identit, que supposer qu'il est tranger (ce qui signifie : supposer
qu'il est soumis un contrle, qu'il figure sur telle liste de la
prfecture, qu'il faut lui parler en hollandais, en italien pour obtenir
de lui tel ou tel gest e, que la poste internationale achemine vers lui
par telle ou telle voie des lettres portant tel ou tel timbre, etc. ).
Pourtant cette carte d'identit m'est donne par principe au mi lieu du
monde. Elle ne m' chappe pas - ds qu' el l e a t cre, el l e s'est
mise exister pour moi . Simplement elle existe l'tat implicite
comme chaque point du cercle que j e vois comme forme acheve ; et
il faudrait changer la totalit prsente de mes rapports au monde pour
la faire paratre comme ceci explicite sur fond d' univers. De la mme
faon, la colre d'autrui-objet, telle qu'elle se manifeste moi
travers ses cris, ses trpignements et ses gestes menaants, n'est pas l e
signe d'une colre subjective et cache ; el l e ne renvoie rien, qu'
d'autres gestes et d'autres cris. Elle dfinit autrui, elle est autrui.
Certes, je puis me tromper et prendre pour une vraie colre ce qui
n'est qu'une irritation simule. Mai s c'est seulement par rapport
d'autres gestes et d'autres actes objectivement saisissables que j e
peux me tromper : j e me trompe si j e saisis l e mouvement de la main
comme intention relle de frapper. C'est--dire que j e me trompe si je
l'interprte en fonction d'un geste objectivement dcelable et qui
n'aura pas l i eu. En un mot la colre objectivement saisie est une
disposition du monde autour d' une prsence-absence intramondaine.
Est-ce dire qu' il faille donner raison aux bhaviouristes ? Assur
ment non : car les bhaviouristes, s'ils interprtent l'homme partir
de sa situation, ont perdu de vue sa caractri stique principale qui est
la transcendance-transcende. Autrui en effet, c'est l'objet qui ne
333
saurait tre l i mi t lui-mme, c'est l'objet qui ne se comprend qu'
partir de sa fi n . Et, sans doute, le marteau et la scie ne se
comprennent pas diffremment. L'un et l'autre se saisissent par leur
fonction, c'est--dire par leur fi n. Mais c'est justement qu'ils sont dj
humains. Je ne puis les comprendre qu'en tant qu'ils me renvoient a
une organisation-ustensile dont autrui est le centre, en tant qu'ils font
partie d'un complexe tout entier transcend vers une fin que je
transcende mon tour. Si donc l'on peut comparer autrui une
machi ne, c'est en tant que la machine, comme fait humain, prsente
dj la trace d'une transcendance-transcende, en tant que les
mtiers, dans une filature, ne s'expliquent que par les tissus qu'ils
produisent ; le point de vue bhaviouriste doit s'inverser et cette
i nversion laissera intacte d'ailleurs l'objectivit d' autrui car ce qui est
objectif d'abord -que nous l'appelions signification, l a faon des
psychologues franais et anglais, intention la faon des phnomno
logues, transcendance comme Heidegger, ou forme, comme les
Gestal tistes - c'est le fait qu'autrui ne peut se dfinir autrement que
par une organisati on totalitaire du monde et qu' i l est la cl de cette
organisation. Si donc je reviens du monde autrui pour le dfinir,
cela ne vient pas de ce que le monde me ferait comprendre autrui
mais bien de ce que l' obj et-autrui n'est rien d'autre qu'un centre de
rfrence autonome et intramondain de mon monde. Ainsi, l a peur
objective que nous pouvoris apprhender lorsque nous percevons
autruiobj et , ce n'est pas l'ensemble des manifestations physiologi
ques de dsarroi que nous voyons ou que nous mesurons avec le
sphygmographe ou le stthoscope la peur, c'est la fuite, c'est
l'vanouissement. Et ces phnomnes eux-mmes ne se livrent pas
nous comme pure srie de gestes mais comme transc.endance
transcende la fuite ou l'vanouissement, ce n'est pas seulement
cette Course perdue travers l es ronces, ni cette lourde chute sur les
pierres du chemi n ; c'est un bouleversement total de l'organisati on
ustensile qui avait
au
trui pour centre. Ce soldat qui fuit, il avait tout
l'heure encore autrui-l'ennemi au bout de son fusil. La distance de
l'ennemi l ui tait mesure par la trajectoire de sa balle et je pouvais,
moi aussi , saisir et transcender cette distance comme distance
s'organisant autour du centre soldat Mais voil qu'il jette son
fusil dans le foss
et
qu' il se sauve. Aussitt la prsence de l'ennemi
l'environne et le presse ; l ' ennemi , qui tait tenu distance par la
trajectoire des balles, bondit sur lui, l'instant mme o la trajectoire
s'effondre ; en mme temps cet arrire-pays qu'il dfendait et contre
lequel i l s'accotait comme un mur, tourne soudain, s'ouvre en ventail
et devient l'avant, l ' horizon accueillant vers quoi i l se rfugie. Tout
cela, je le constate objectivement et c'est prcisment cela que je
saisis comme peur. La peur n'est rien autre qu'une conduite magique
tendant supprimer par incantation les objets effrayants que nous ne
334
pouvons tenir distance
!
. Et c'est prcisment travers ses rsultats
que nous saisissons la peur, car elle se donne nous comme un
nouveau type d'hmorragie intramondaine du monde l e passage du
monde un type d'existence magique.
Il faut prendre garde cependant qu'autrui n'est objet qualifi pour
moi que dans la mesure o je puis l'tre pour lui. Il s'objectivera donc
comme parcelle non i ndividualise du on ou comme absent ,
purement reprsent par ses lettres et ses rcits, ou comme celui-ci
prsent en fait, selon que j'aurai moi-mme t pour l ui lment du
on ou cher absent ou un celui-ci concret. Ce qui dcide dans
chaque cas du type d'objectivation d'autrui et de ses qualits c'est la
fois ma situation dans l e monde et sa situation, c'est--dire les
complexes ustensiles que nous avons organiss chacun et les diffrents
ceci qui paraissent l ' un et l'autre sur fond de monde. Tout cela
nous ramne naturellement la facticit. C'est ma facticit et la
facticit d'autrui qui dcident si autrui peut me voir et si je puis voir
tel autrui . Mais ce problme de la facticit sort des cadres de cet
expos gnral nous l ' envisagerons au cours du prochain chapitre.
Ainsi j 'prouve l a prsence d'autrui comme quasi-totalit des sujets
dans mon tre-objet-pour-autrui et, sur le fond de cette totalit, j e
puis prouver pl us particulirement la prsence d'un sujet concret,
sans pouvoir toutefois le spcifier en tel autrui. Ma raction de
dfense mon objectit fera comparatre autrui devant moi titre de
tel ou tel objet. A ce titre il m'apparatra comme un celui-ci , c'est
-dire que sa quasi-totalit subjective se dgrade et devient totalit
objet coextensive la totalit du monde. Cette totalit se rvle moi
sans rfrence l a subj ectivit d'autrui l e rapport d'autrui-sujet
autrui-obj et n'est nullement comparable celui qu'on a coutume
d'tablir, par exemple, entre l'objet de l a physique et l'objet de la
percepti on. Autrui-obj et se rvle moi pour ce qu'il est, il ne
renvoie qu' lui-mme. Simplement autrui-objet est tel qu'il m'appa
rat, sur le plan de l'objectit en gnral et dans son tre-objet ; il
n'est mme pas concevable que je rapporte une connaissance
quelconque que j'ai de lui sa subjectivit telle que je l 'prouve
l'occasion du regard. Autrui-objet n'est qu'objet, mais ma saisie de
lui enveloppe la comprhension de ce que je pourrai toujours et par
principe faire de lui une autre preuve en me plaant sur un autre plan
d'tre ; cette comprhension est constitue, d'une part, par le savoir
de mon preuve passe, qui est d'ailleurs, comme nous l'avons vu, l e
pur pass (hors d'atteinte et que j 'ai tre) de cette preuve, et
d'autre part , par une apprhension implicite de l a dialectique de
l'autre l'autre, c'est prsentement ce que j e me fais ne pas tre.
Mais, bien que pour l'instant je me dlivre de l ui , je lui chappe, il
1. Cf. notre Esquisse d'une thorie phnomnologique des motions.
335
demeure autour de l ui la possibilit permanente qu'il se fasse autre.
Toutefois, cette possibilit, pressentie dans une sorte de gne et de
contrainte qui fait l a spcificit de mon attitude en face d'autrui
objet, est proprement parler inconcevable : d'aborr, parce que je ne
puis concevoir de possibilit qui ne soit ma possibilit, ni apprhender
de transcendance, sauf en l a transcendant, c'est--dire en la saisissant
comme transcendance transcende ; ensuite parce que cette possibi
lit pressentie n'est pas l a possibilit d'autrui-obj et : les possi bilits
d'autrui-objet sont des mortes-possibilits qui renvoient d'autres
aspects objectifs d'autrui ; l a possibilit propre de me saisir comme
objet tant possibi l i t d' autrui-sujet n'est actuellement pour moi
possi bilit de personne : elle est possibilit absolue -et qui ne ti re sa
source que d'elle-mme - du surgissement, sur fond d' anantisse
ment total d'autrui-objet, d'un autrui-sujet que j 'prouverai travers
mon objectivit-pour-l ui . Ainsi, autrui-objet est un instrument explo
sif que je manie avec apprhension, parce que j e pressens autour de
l ui l a possibilit permanente qu'on l e fasse clater et que, avec cet
clatement, j'prouve soudain l a fuite hors de moi du monde et
l'alination de mon tre. Mon souci constant est donc de contenir
autrui dans son objectivit et mes rapports avec autrui-objet sont faits
essentiellement de ruses destines l e faire rester objet. Mais i l suffit
d' un regard d'autrui pour que tous ces artifices s' effondrent et que
j'prouve de nouveau l a transfiguration d'autrui . Ainsi suis-je ren
voy de transfiguration en dgradation et de dgradation en transfigu
ration, sans jamais pouvoir ni former une vue d'ensemble de ces deux
modes d'tre d'autrui -car chacun d'eux se suffit lui-mme et ne
renvoie qu' l ui - ni me tenir fermement l'un d'entre eux -car
chacun a une instabilit propre et s'effondre pour que l'autre surgisse
de ses ruines ; il n'est que les morts pour tre perptuellement objets
sans deveni r j amais sujets, car mourir n'est point perdre son
objectivit au milieu du monde - tous les morts sont l, dans le
monde autour de nous - mais, c'est perdre toute possibilit de se
rvler comme sujet un autrui.
A ce niveau de notre recherche, une fois lucides les structures
essentielles de l'tre-pour-autrui, nous sommes tent, videmment,
de poser l a question mtaphysique : Pourquoi y a-t-il des autres ?
L'existence des autres, nous l'avons vu, n'est pas, en effet, une
consquence qui puisse dcouler de l a structure ontologique du pour
soi. Cest un vnement premier, certes, mais d'ordre mtaphysique,
c'est--dire qui ressortit la contingence de l'tre. Cest propos de
ces existences mtaphysiques que se pose, par essence, la question du
pourquoi.
Nous savons de reste que l a rponse au pourquoi ne peut que nous
renvoyer une contingence origi nel l e, mais encore faut-il prouver
que le phnomne mtaphysique que nous considrons est d'une
336
contingence irrductible. En ce sens, I"ontologie nous parat pouvoir
se dfinir comme l'explicitation des structures d'tre de l'existant pris
comme totalit et nous dfinirons plutt l a mtaphysique comme la
mise en question de l'existence de l'existant. C'est pourquoi , en vertu
de la contingence absolue de l'existant, nous sommes assur que toute
mtaphysi que doit s'achever par cela est , c'est--dire par une
intuition directe de cette contingence.
Est-il possible de poser l a question de l'existence des autres ? Cette
existence est-el l e un fait irrductible ou doit-elle tre drive d'une
contingence fondamental e ? Telles sont les questions pralables que
nous pouvons poser notre tour au mtaphysicien qui questionne sur
l'existence des autres.
Examinons de plus prs l a possibilit de la question mtaphysique.
Ce qui nous apparat d'abord, c'est que l'tre-pour-autrui reprsente
la troisi me ek-stase du pour-soi. La premire ek-stase est , en effet, le
projet tridimensi onnel du pour-soi vers un tre qu'il a tre sur le
mode du n' tre-pas. Elle reprsente l a premire fissure, la nantisa
tion que l e pour-soi a tre lui-mme, l ' arrachement du pour-soi
tout ce qu' i l est, en tant que cet arrachement est constitutif de son
tre. La deuxime ek-stase ou ek-stase rfl exive est arrachement cet
arrachement mme. La scissiparit rflexive correspond un effort
vain pour prendre un point de vue sur la nantisation qu'a tre l e
pour-soi, afin que cette nantisation comme phnomne simplement
donn soit nantisation qui est. Mais en mme temps, l a rflexion
veut rcuprer cet arrachement qu'elle tente de contempler comme
donne pure, en affirmant de soi qu' elle est cette nantisation qui est.
La contradiction est flagrante : pour pouvoir saisir ma transcendance,
il faudrait que je la transcende. Mais, prcisment, ma propre
transcendance ne peut que transcender, je la suis, je ne puis me servir
d'elle pour la constituer comme transcendance transcende : je suis
condamn tre perptuellement ma propre nantisation. En un
mot, la rflexion est l e rflchi . Toutefois, l a nantisation rflexive est
plus pousse que celle du pur pour-soi comme simpl e conscience (de)
soi . Dans la conscience (de) soi , en effet, les deux termes de l a dualit
reflt-refltant avaient une tel l e incapacit se prsenter spar
ment que la dualit restait perptuellement vanescente et que
chaque terme, en se posant pour l'autre, devenait l ' autre. Mais, dans
le cas de l a rflexi on, i l en va autrement, puisque l e reflet-refl
tant rflchi existe pour un reflet-refltant rflexif. Rflchi et
rfl exif tendent donc chacun l'indpendance et l e rien qui les spare
tend les diviser plus profondment que le nant, que le pour-soi a
tre, ne spare le reflet du refltant . Pourtant, ni le rfl exif ni le rfl
chi ne peuvent scrter ce nant sparateur, sinon la rflexion serait
un pour-soi autonome venant se braquer sur l e rflchi , ce qui serait
supposer une ngation d'extriorit comme condition pralable d'une
337
ngation d'intriori t. Il ne saurait y avoir de rflexion si elle n'est
pas tout entire un tre, un tre qui a tre son propre nant.
Ai nsi , l ' ek-stase rflexive se trouve sur le chemi n d'une ek-stase plus
radicale : l'tre-pour-autrui. Le terme ultime de la nantisation, l e
pl e i dal devrait tre , en effet, l a ngation externe, c'est--dire une
scissiparit en-soi ou extriorit spatiale d'indiffrence. Par rapport
cette ngation d'extriorit, les trois ek-stases se rangent dans l 'ordre
que nous venons d'exposer, mais elles ne sauraient aucunement
l'atteindre, el l e demeure, par pri nci pe, idale : en effet, l e pour-soi
ne peut raliser de soi par rapport un tre quelconque une ngation
qui serait en soi , sous peine de cesser du mme coup d'tre-pour-soi.
La ngation constitutive de l'tre-pour-autrui est donc une ngation
interne, c'est une nantisation que le pour-soi a tre, tout comme la
nantisation rflexive. Mais ici , la scissiparit s'attaque l a ngation
mme : ce n'est plus seulement l a ngation qui ddouble l'tre en
reflt et refltant et son tour le couple reflt-refltant en (reflt
refltant) reflt et en ( reflt-refltant) refltant. Mais l a ngation se
ddouble en deux ngations internes et inverses, dont chacune est
ngation d'intriorit et qui, pourtant, sont spares l'une de l' autre
par un insaisissable nant d'extriorit. En effet, chacune d'elles
s'puisant nier d'un pour-soi qu'il soit l'autre et tout engage dans
cet tre, qu'elle a tre, ne dispose plus d'elle-mme pour nier de soi
qu' elle soit l a ngation inverse. Ici, tout coup, apparat l e donn,
non comme rsultat d'une identit d'tre-en-soi, mais comme une
sorte de fantme d'extriorit qu' aucune des deux ngations n' a
tre et qui pourtant les spare. A vrai di re, nous trouvions dj
l ' amorce de cette inversion ngative dans l'tre rflexif. En effet, l e
rflexif comme tmoin est profondment atteint dans son tre par sa
rflexivit et de ce fait, en tant qu' il se fait rflexif, i l vise n'tre pas
le rflchi . Mais, rciproquement, l e rflchi est conscience (de) soi
comme conscience rflchie de tel ou tel phnomne transcendant.
Nous disions de lui qu'il se sait regard. En ce sens, il vise de son ct
n'tre pas le rflexif puisque toute conscience se dfinit par sa
ngativit. Mais cette tendance un double schisme tait reprise et
touffe par le fait que, malgr tout, le rflexif avait tre le rflchi
et que le rflchi avait tre l e rflexif. La double ngation demeurait
vanescente. Dans le cas de l a troisime ek-stase, nous assistons
comme une scissiparit rflexive plus pousse. Les consquences
peuvent nous surprendre : d'une part, puisque les ngations sont
effectues en intriorit, autrui et moi-mme ne pouvons pas venir
l'un l'autre du dehors. Il faut qu'il y ait un tre moi-autrui qui ait
tre la scissiparit rciproque du pour-autrui, tout juste comme la
totalit rflexif-rflchi est un tre qui a tre son propre nant,
c'est--dire que mon ipsit et cell e d'autrui sont des structures d'une
mme totalit d'tre. Ainsi Hegel semble avoir raison : c'est le point
338
de vue de la totalit qui est le poi nt de vue de l 'tre, le vrai pomt de
vue. Tout se passe comme si mon ipsit en face de celle d'autrui tait
produite et maintenue par une totalit qui pousserait l'extrme sa
propre nantisation ; l 'tre pour autrui parat tre l e prolongement de
la pure scissiparit rflexive. En ce sens, tout se passe comme si les
autres et moi-mme nous marquions l 'effort vai n d'une totalit de
pour-soi pour se ressaisir et pour envelopper ce qu'elle a tre sur l e
mode pur et simpl e de l'en-soi ; cet effort pour se ressaisir comme
objet, pouss ici l a limite, c'est--dire bien au-del de la scission
rfl exive, amnerai t le rsultat inverse de la fin vers quoi se
projetterait cette totalit : par son effort pour tre conscience de soi,
la totalit-pour-soi se constituerait en face du soi comme conscience
soi qui a ne pas tre le soi dont elle est conscience ; et rciproque
ment le soi-objet pour tre devrait s'prouver comme t par et pour
une conscience qu' il a ne pas tre s'il veut tre. Ainsi natrait le
schi sme du pour-autrui ; et cette division dichotomique se rpterait
lnfini pour constituer les consciences comme miettes d'un clate
ment radical. Il y aurait des autres, par suite d'un chec inverse de
l'chec rflexif. Dans l a rflexi on, en effet, si je ne parviens pas me
saisir comme obj et, mais seulement comme quasi-objet, c'est que j e
suis l 'obj et que j e veux saisi r ; j'ai tre l e nant qui me spare de
moi : j e ne puis chapper mon ipsit ni prendre de point de vue sur
moi-mme ; ainsi, je n' arrive pas me raliser comme tre, ni me
saisir dans la forme du i l y a , l a rcupration choue parce que l e
rcuprant est soi-mme l e rcupr. Dans l e cas de l'tre-pour
autrui, au contraire, la scissiparit est pousse pl us avant , le (reflet
reftant) reft se distingue radicalement du (reflet-refltant) refl
tant et par l mme peut tre objet pour l ui . Mais cette foi s, l a
rcupration choue parce que l e rcupr n'est pa l e rcuprant.
Ainsi, la totalit qui n'est pas ce qu' el l e est en tant ce qu'elle n'est
pas, par un effort radical d'arrachement soi, produirait partout son
tre comme un ai l leurs : l e papillotement d'tre-en-soi d'une totalit
brise, toujours ai l l eurs, toujours distance, jamais en lui-mme,
maintenu pourtant toujours l'tre par l e perptuel clatement de
cette totali t, tel serai t l'tre des autres et de moi-mme comme
autre.
Mais d'autre part , en simultanit avec ma ngation de moi-mme,
autrui nie de soi qu'il soit moi . Ces deux ngations sont pareillement
indispensables l'tre-pour-autrui et elles ne peuvent tre runies par
aucune synthse. Non point parce qu' un nant d'extriorit les aurait
spares l'origi ne, mais plutt parce que l'en-soi ressaisirait chacune
par rapport l'autre, du seul fait que chacune n 'est pas l'autre, sans
avoir ne pas l 'tre. Il y a ici comme une limite du pour-soi qui vient du
pour-soi lui -mme mais qui, en tant que l i mi te, est indpendante
du pour-soi : nous retrouvons quelque chose comme l a facticit et
339
nous ne pouvons concevoir comment la totalit dont nous parlions
tout l'heure aurait pu, au sein mme de l'arrachement l e plus
radical, produire en son tre un nant qu'elle n'a aucunement tre.
II semble, en effet , qu'il se soit gliss dans cette totalit pour la briser,
comme l e non-tre dans l'atomisme de Leucippe se glisse dans la
totalit d'tre parmnidienne pour l a faire clater en atomes. Il
reprsente donc la ngation de toute totalit synthtique partir de
laquelle on prtendrait comprendre la pluralit des consciences. Sans
doute , i l est insaisissable, puisqu'il n'est produit ni par l'autre ni par
moi-mme, ni par un intermdiaire, car nous avons tabli que les
consciences s'prouvent l'une l'autre sans intermdiaire. Sans doute,
o que nous portions notre vue, nous ne rencontrons comme objet de
la descri pti on qu'une pure et simple ngation d'intriorit. Et
pourtant, i l est l, dans l e fait irrductible qu'il y a dualit de
ngations. I l n'est certes pas l e fondement de la multiplicit des
consciences, car s'il prexistait cette multiplicit i l rendrait impossi
ble tout tre-pour autrui ; i l faut le concevoir au contraire comme
l'expression de cette multiplicit : il apparat avec elle. Mais, comme
il n' y a rien qui puisse l e fonder, ni conscience particulire ni totalit
s'clatant en consciences, il apparat comme contingence pure et
irrductible, comme le fait qu'il ne suffit pas que je nie de moi autrui
pour qu'autrui existe, mais qu'il faut encore qu'autrui me nie de lui
mme en simultanit avec ma prpre ngation. I l est la facticit de
rtre-pour-autrui .
Ainsi, nous arrivons cette conclusion contradictoire : l'tre-pour
autrui ne peut tre que s'il est t par une totalit qui se perd pour
qu'il surgisse, ce qui nous condui rait postuler l'existence et la
passion de l'esprit. Mais, d'autre part, cet tre-pour-autrui ne peut
exister que s'il comporte un i nsaisissable non-tre d'extriorit
qu'aucune total i t, ft-elle l'esprit, ne peut produire ni fonder. En un
sens, l'existence d'une pluralit de consciences ne peut pas tre un fait
premier et nous renvoie un fait originel d'arrachement soi qui
serait le fait de l'esprit ; ainsi la question mtaphysique : Pourquoi y
a-t-il des consci ences ? recevrait une rponse. Mais en un autre sens,
la facticit de cette pluralit semble tre irrductible et si l'on
considre l'esprit partir du fait de la pluralit, i l s'vanouit ; la
question mtaphysique n' a plus de sens : nous avons rencontr la
contingence fondamentale et nous ne pouvons y rpondre que par un
c'est ainsi . Ainsi l'ek-stase originelle s'approfondit : il semble
qu' on ne puisse faire au nant sa part. L pour-soi nous est apparu
comme un tre qui existe en tant qu'il n'est pas ce qu'il est et qu'i! est
ce qu'il n' est pas. La totalit ek-statique de l'esprit n' est point
simplement totalit dtotalise, mais elle nous apparat comme un
tre bris dont on ne peut dire ni qu'il existe ni qu'il n'existe pas.
Ainsi, notre description nous a permis de satisfaire aux conditions
340
pralables que nous avons poses toute thorie sur l'existence
d'autrui ; la multiplicit des consciences nous apparat comme une
synthse et non comme une collection ; mais c'est une synthse dont la
totalit est inconcevabl e.
Est-ce di re que ce caractre antinomique de l a totalit est lui
mme un irrductible ? Ou, d'un point de vue suprieur, pouvons
nous le faire disparatre ? Devons-nous poser que l'esprit est l'tre qui
est et n'est pas, comme nous avons pos que l e pour-soi est ce qu'il
n'est pas et n' est pas ce qu' i l est ? La question n' a pas de sens. Elle
supposerait, en effet, que nous ayons la possibilit de prendre un
pOnt de vue sur la totalit, c'est--dire de l a considrer du dehors.
Mais c'est i mpossible puisque, prcisment, j 'existe comme moi
mme sur le fondement de cette totalit et dans la mesure o je suis
engag en ell e. Aucune conscience , ft-ce cel l e de Dieu, ne peut
voir l'envers c'est--dire saisir l a totalit en tant que telle. Car si
Dieu est conscience, il s'intgre la totalit. Et si, par sa nature, i l est
un tre par del la conscience, c'est--dire un en-soi qui serait
fondement de lui-mme, l a totalit ne peut lui apparatre que comme
objet alors il manque sa dsagrgation interne comme effort
subjectif de ressaisissement de soi, ou comme sujet alors, comme il
n'est pas ce sujet, i l ne peut que l 'prouver sans l e connatre. Ainsi,
aucun point de vue sur l a totalit n'est concevable : l a totalit n'a pas
de dehors et la question mme du sens de son envers est
dpourvue de signification. Nous ne pouvons al l er plus loin.
Nous voici parvenu au terme de cet expos. Nous avons appris que
l'existence d' autrui tait prouve avec vidence dans et par l e fait de
mon objectivit. Et nous avons vu aussi que ma raction ma propre
alination pour autrui se traduisait par l 'apprhension d' autrui
comme objet. En bref, autrui peut exister pour nous sous deux
formes : si je l'prouve avec vidence, je manque le connatre ; si je
le connais, si j'agis sur l ui , je n' atteins que son tre-objet et son
existence probable au milieu du monde ; aucune synthse de ces deux
formes n'est possible. Mais nous ne saurions nous arrter ici : cet
objet qu'autrui est pour moi et cet objet que je suis pour autrui , ils se
manifestent comme corps. Qu'est-ce donc que mon corps ? Qu'est-ce
que le corps d'autrui ?
CHAPI TRE I I
Le corps
L problme du corps et de ses rapports avec la conscience est
souvent obscurci par le fait qu' on pose de prime abord le corps
comme une certaine chose ayant ses lois propres et susceptible d'tre
dfinie du dehors, alors qu'on atteint l a conscience par l e type
d'intuition intime qui lui est propre. Si, en effet, aprs avoir saisi
ma conscience dans son i ntriorit absolue, et par une srie
d'actes rflexifs, je cherche l' unir un certain objet vivant, constitu
par un systme nerveux, un cerveau, des glandes, des organes
digestifs, respiratoires et circulatoires, dont l a matire mme est
susceptible d'tre analyse chimiquement en atomes d'hydrogne, de
carbone, d'azote, de phosphore, etc. , je vais rencontrer d' i nsurmon
tables difficults : mais ces difficults proviennent de ce que je tente
d'unir ma conscience non mon corps mais au corps des autres. En
effet, l e corps dont j e viens d' esquisser l a description n'est pas mon
corps tel qu' il est pour moi. Je n'ai jamais vu ni ne verrai mon
cerveau, ni mes gl andes endocrines. Mais simplement, de ce que j' ai
vu dissquer des cadavres d' hommes, moi qui suis un homme, de ce
que j' ai l u des traits de physiologie, j e conclus que mon corps est
exactement constitu comme tous ceux qu'on m'a montrs sur une
table de dissection ou dont j' ai contempl l a reprsentation en
couleur dans des livres. Sans doute me dira-t-on que les mdecins qui
m'ont soign, l es chirurgiens qui m'ont opr ont pu faire l'exprience
directe de ce corps que je ne connais pas par moi-mme. Je n' en
disconviens pas et je ne prtends pas que j e soi s dpourvu de cerveau,
de cur ou d' estomac. Mais il importe avant tout de choisir l'ordre de
nos connaissances : partir des expriences que l es mdecins ont pu
faire sur mon corps, c'est parti r de mon corps au milieu du monde et
tel qu'il est pour autrui . Mon corps tel qu' i l est pour moi ne
m'apparat pas au milieu du monde. Sans doute j'ai pu voir moi
mme sur un cran, pendant une radioscopie, l' image de mes
342
vertbres, mais j'tais prcisment dehors, au milieu du monde ; j e
saisissais un obj et entirement constitu, comme un ceci parmi
d'autres ceci, et c'est seulement par un raisonnement que je le
ramenais tre mien : il tait beaucoup plus ma proprit que mon
tre.
II est vrai que j e vois, que j e touche mes jambes et mes mains. Et
rien ne m'empche de concevoir un dispositif sensible tel qu'un tre
vivant pourrait voir un de ses yeux pendant que l'il vu dirigerait son
regard sur le monde. Mais il est remarquer que, dans ce cas encore,
j e suis l'autre par rapport mon il : je le saisis comme organe
sensible constitu dans le monde de telle et tel le faon, mais je ne puis
l e voir voyant , c'est--dire l e saisir en tant qu'il me rvle un
aspect du monde. Ou bien i l est chose parmi les choses, ou bien il est
ce par quoi les choses se dcouvrent moi . Mais il ne saurait tre les
deux en mme temps. Pareillement je vois ma main toucher les
objets, mais je ne l a connais pas dans son acte de l es toucher. C'est la
raison de principe pour laquelle l a fameuse sensation d'effort de
Maine de Biran n' a pas d'existence rel l e. Car ma main me rvle l a
rsistance des obj ets, l eur duret ou l eur mollesse et non elle-mme.
Ainsi ne vois-je pas ma main autrement que je ne vois cet encrier. Je
dploie une distance de moi elle et cette distance vient s'intgrer
dans les distances que j'tablis entre tous les objets du monde.
Lorsqu'un mdecin prend ma jambe malade et l'examine, pendant
que, dress demi sur mon lit, je l e regarde faire, i l n'y a aucune
diffrence de nature entre la perception visuelle que j'ai du corps du
mdecin et celle que j 'ai de ma propre jambe. Mieux, elles ne se
distinguent qu' titre de structures diffrentes d'une mme perception
globale ; et il n'y a pas de diffrence de nature entre la perception que
le mdecin prend de ma jambe et celle que j'en prends moi-mme
prsentement. Sans doute, quand je touche ma jambe avec mon
doigt, je sens que ma jambe est touche. Mais ce phnomne de
double sensation n' est pas essentiel : le froid, une piqre de morphine
peuvent le faire disparatre ; cela suffit montrer qu'il s'agit de deux
ordres de ralit essentiellement diffrents. Toucher et tre touch,
sentir qu'on touche et sentir qu'on est touch, voil deux espces de
phnomnes qu'on tente en vain de runir sous l e nom de double
sensation . En fait, ils sont radicalement distincts et ils existent sur
deux plans incommunicables. Lorsque je touche ma jambe, d'ailleurs,
ou lorsque je la vois, je la dpasse vers mes propres possibilits :
c'est, par exempl e, pour enfiler mon pantal on, pour refaire un
pansement autour de ma pl aie. Et, sans doute puis-je en mme temps
disposer ma jambe de faon que j e puisse plus commodment
travailler sur el l e. Mais cela ne change rien au fait que je la
transcende vers la pure possibilit de me gurir et que, par suite,
je l ui suis prsent sans qu'elle soit moi ni que je sois elle. Et ce que j e
343
fais tre ainsI , c'est la cnose jambe ", ce n'est pas la j ambe comme
possibilit que je suis de marcher, de courir ou de jouer au football.
Ainsi , dans la mesure o mon corps indique mes possibilits dans l e
monde , l e voir, l e toucher, c' est transformer ces possihilits qui sont
mi ennes en mortes-possi bi l its. Cette mtamorphose doit entraner
ncessairement une ccit complte quant ce qu'est le corps en tant
que possibilit vivante de courir, de danser, etc. Et, certes, la
dcouverte de mon corps comme objet est bien une rvlation de son
tre. Mais l'tre qui m'est ainsi rvl est son tre-pour-autrui. Que
cette confusion conduise des absurdits, c'est ce qu'on peut
clairement voir propos du fameux problme de l a vision renver
se ". On connat l a question que posent les physiologistes : Com
ment pouvons-nous redresser les ohjets qui se peignent renverss sur
notre rti ne ? " On connat aussi l a rponse des philosophes : I l n'y
a pas de probl me. Un obj et est droit ou renvers par rapport au reste
de l ' uni vers. Percevoir tout l'univers renvers ne signifie rien, car i l
faudrai t qu'il ft renvers par rapport quelque chose. " Mais ce qui
nous intresse particulirement, c' est l'origine de ce faux problme :
c'est que l'on a voul u lier ma conscience des objets au corps de l'autre.
Voici la bougie, le cristallin qui sert de l enti l l e, l 'i mage renverse sur
l'cran de la rti ne. Mais prcisment, l a rti ne entre ici dans un
systme physique, el l e est cran et cela seulement ; le cristallin est
lentille et seulement l enti l l e , tous deux sont homognes en leur tre
la bougie qui complte le systme. Nous avons donc dlibrment
choisi le point de vue physi que, c'est--dire l e point de vue du dehors,
de l'extriorit, pour tudier l e problme de l a vision ; nous avons
considr un il mort au mi li eu du monde visible pour rendre compte
de l a visibilit de ce monde. Comment s'tonner ensuite qu' cet
objet l a conscience , qui est i ntriorit absolue, refuse de se laisser
l ier ? Les rapports que j'tablis entre un corps d'autrui et l'objet
extrieur sont des rapports rellement existants, mais i l s ont pour tre
l'tre du pour-autrui ; i ls supposent un centre d'coulement intramon
dain dont la connaissance est une proprit magique de l'espce
action distance ". Ds l'origine, ils se placent dans l a perspective
de l ' autre-obj et. Si donc nous voulons rflchir sur la nature du corps,
il faut tablir un ordre de nos rflexions qui soit conforme l'ordre de
l ' tre : nous ne pouvons continuer confondre les plans ontologiques
et nous devons examiner successivement l e corps en tant qu'tre
pour-soi et en tant qu' tre-pour-autrui ; et pour viter des absurdits
du genre de la vision renverse ", nous nous pntrerons de l'ide
gue ces deux aspects du corps, tant sur deux plans d'tre diffrents et
incommunicables, sont irrductibles l'un l'autre. C'est tout entier
gue l'tre-po ur-soi doit tre corps et tout entier qu'il doit tre
conscience : il ne saurait tre uni un corps. Pareillement l 'tre-po ur
autrui est corps tout entier ; i l n' y a pas l de phnomnes
34
fais tre ainsI , c'est la cnose jambe ", ce n'est pas la j ambe comme
possibilit que je suis de marcher, de courir ou de jouer au football.
Ainsi , dans la mesure o mon corps indique mes possibilits dans l e
monde , l e voir, l e toucher, c' est transformer ces possihilits qui sont
mi ennes en mortes-possi bi l its. Cette mtamorphose doit entraner
ncessairement une ccit complte quant ce qu'est le corps en tant
que possibilit vivante de courir, de danser, etc. Et, certes, la
dcouverte de mon corps comme objet est bien une rvlation de son
tre. Mais l'tre qui m'est ainsi rvl est son tre-pour-autrui. Que
cette confusion conduise des absurdits, c'est ce qu'on peut
clairement voir propos du fameux problme de l a vision renver
se ". On connat l a question que posent les physiologistes : Com
ment pouvons-nous redresser les ohjets qui se peignent renverss sur
notre rti ne ? " On connat aussi l a rponse des philosophes : I l n'y
a pas de probl me. Un obj et est droit ou renvers par rapport au reste
de l ' uni vers. Percevoir tout l'univers renvers ne signifie rien, car i l
faudrai t qu'il ft renvers par rapport quelque chose. " Mais ce qui
nous intresse particulirement, c' est l'origine de ce faux problme :
c'est que l'on a voul u lier ma conscience des objets au corps de l'autre.
Voici la bougie, le cristallin qui sert de l enti l l e, l 'i mage renverse sur
l'cran de la rti ne. Mais prcisment, l a rti ne entre ici dans un
systme physique, el l e est cran et cela seulement ; le cristallin est
lentille et seulement l enti l l e , tous deux sont homognes en leur tre
la bougie qui complte le systme. Nous avons donc dlibrment
choisi le point de vue physi que, c'est--dire l e point de vue du dehors,
de l'extriorit, pour tudier l e problme de l a vision ; nous avons
considr un il mort au mi li eu du monde visible pour rendre compte
de l a visibilit de ce monde. Comment s'tonner ensuite qu' cet
objet l a conscience , qui est i ntriorit absolue, refuse de se laisser
l ier ? Les rapports que j'tablis entre un corps d'autrui et l'objet
extrieur sont des rapports rellement existants, mais i l s ont pour tre
l'tre du pour-autrui ; i ls supposent un centre d'coulement intramon
dain dont la connaissance est une proprit magique de l'espce
action distance ". Ds l'origine, ils se placent dans l a perspective
de l ' autre-obj et. Si donc nous voulons rflchir sur la nature du corps,
il faut tablir un ordre de nos rflexions qui soit conforme l'ordre de
l ' tre : nous ne pouvons continuer confondre les plans ontologiques
et nous devons examiner successivement l e corps en tant qu'tre
pour-soi et en tant qu' tre-pour-autrui ; et pour viter des absurdits
du genre de la vision renverse ", nous nous pntrerons de l'ide
gue ces deux aspects du corps, tant sur deux plans d'tre diffrents et
incommunicables, sont irrductibles l'un l'autre. C'est tout entier
gue l'tre-po ur-soi doit tre corps et tout entier qu'il doit tre
conscience : il ne saurait tre uni un corps. Pareillement l 'tre-po ur
autrui est corps tout entier ; i l n' y a pas l de phnomnes
34
parce que cette fusion de la droite et de la gauche, de ravant et de
l'arrire, mot iverait l'vanouissement total des ceci au sein d'une
indist i nction primitive. Si pareillement le pied de l a tahle dissimule
mes yeux les arahesques du tapis, ce n'est point par suite de quelque
finitude et de quelque i mperfecti on de mes organes visuels, mais c'est
qu' un tapis qui ne serait ni dissimul par la table, ni sous elle ni au
dessus d'el l e, ni ct d' el l e, n' aurait pl us aucun rapport d'aucune
sorte avec elle et n'appartiendrait plus au monde o il y a la
table : l'en-soi qui se mani feste sous l'aspect du ceci retournerait son
identi t d'indiffrence ; l'espace mme, comme pure relation d'ext
riorit , s'vanouirait. La constitution de l'espace comme multiplicit
de rel ations rciproques ne peut s'oprer, en effet , que du point de
vue abstrait de la science : elle ne saurait tre vcue, elle n'est mme
pas reprsentabl e ; le triangle que je trace au tableau pour m'aider
dans mes raisonnements abstraits est ncessairement droite du
cercle tangent un de ses cts, dans la mesure o i l est sur l e tableau.
Et mon effort est pour dpasser les caractristiques concrtes de l a
figure trace l a craie en ne tenant pas plus compte de son
orientation par rapport moi que de l'paisseur des lignes ou de
J'imperfection du dessin.
Ainsi , du seul fai t qu'il y a un monde, ce monde ne saurait exister
sans une orientation univoque par rapport moi . L'idalisme a
justement insist sur le fait que la relation fait le monde. Mais comme
i l se plaait sur l e terrain de l a science newtonienne, i l concevait cette
relation comme relation de rciprocit. Il n'atteignait ainsi que les
concepts abstraits d'extriorit pure, d'action et de raction, etc. , et,
de ce fai t mme, i l manquait l e monde et ne faisait qu'expliciter l e
concept-limite d'objectivit absolue. Ce concept revenait en somme
cel ui de monde dsert ou de monde sans les hommes , c'est-
dire une contradiction, puisque c'est par la ralit-humaine qu' il y a
un monde. Ainsi, le concept d'objectivit, qui visait remplacer l'en
soi de la vrit dogmatique par un pur rapport de convenance
rciproque entre des reprsentations, se dtruit lui-mme si on l e
pousse j usqu'au bout . Les progrs de la science, d'ailleurs, ont
conduit rejeter cette notion d'objectivit absolue. Ce qu'un Broglie
est conduit appeler est un systme de relations
univoques d'o l 'observateur n'est pas exclu. Et si la micro-physique
doit rintgrer l ' observateur au sein du systme scientifique, ce n'est
pas titre de pure subjectivit -cette notion n'aurait pas plus de sens
que celle d'ohjectivit pure - mai s comme un rapport originel au
monde, comme une place , comme ce vers quoi s'orientent tous les
rapports envisags. C'est ainsi, par exemple, que l e principe d'ind
termination de Heisenberg ne peut tre considr ni comme une
i nfirmation, ni comme une confirmation du postulat dterministe.
Simplement, au lieu d'tre pure l i aison entre les choses, i l enveloppe
346
en soi le rapport originel de l ' homme aux choses et sa place dans l e
monde. C'est ce que marque assez, par exempl e, l e fait qu'on ne peut
pas faire crotre de quantits proportionnelles les dimensions de corps
en mouvement sans changer leurs relations de vitesse. Si j'examine
l'il nu, puis au microscope le mouvement d'un corps vers un autre, il
me paratra cent fois pl us rapide dans le second cas, car, bi en que l e
corps en mouvement ne se soit pas rapproch davantage du corps vers
lequel i l se dplace, il a parcouru dans l e mme temps un espace cent
fois plus grand. Ainsi, l a notion de vitesse ne signifie plus rien si el l e
n'est vitesse par rapport des dimensions donnes de corps en
mouvement. Mais c'est nous-mmes qui dcidons de ces dimensions
par notre surgissement mme dans l e monde, et il faut bien que nous
en dcidions, sinon elles ne serCienl pas du tout. Ainsi sont-elles
relatives non l a connaissance que nous en prenons, mais notre
engagement premier au sein du monde. C'est ce qu'exprime parfaite
ment la thorie de l a relativit : un observateur plac au sein d'un
systme ne peut dterminer par aucune exprience si l e systme est en
repos ou en mouvement. Mais cette relativit n'est pas un relati
visme : elle ne concerne pas l a connaissance ; mieux encore, elle
implique l e postulat dogmatique selon lequel l a connaissance nous
livre ce qui es/. La relativit de l a science moderne vise l'tre.
L'homme et le monde sont des tres relatifs et le principe de leur tre
est l a relation. Il s'ensuit que l a relation premire va de l a ralit
humaine au monde : Surgir, pour moi , c'est dplier mes distances aux
choses et par l mme faire quI y ait des choses. Mais, par suite, les
choses sont prcisment choses-qui-existent--distance-de-moi .
Ainsi le monde me renvoie cette relation univoque qui est mon tre et
par quoi je fais qu'il se rvle. Le point de vue de la connaissance
pure est contradictoire : i l n'y a que le point de vue de la connaissance
engage. Ce qui revient dire que la connaissance et l'action ne sont
que deux faces abstraites d' une relation originel l e et concrte.
L'espace rel du monde est l'espace que Lewin nomme hodologi
que . Une connaissance pure, en effet, serait connaissance sans
point de vue, donc connaissance du monde situe par principe hors du
monde. Mais cela n'a point de sens : l'tre connaissant ne serait que
connaissance, puisqu'il se dfinirait par son objet et que son objet
s'vanouirait dans l'indistinction totale de rapports rciproques. Ainsi
la connaissance ne peut tre que surgissement engag dans un point
de vue dtermin que l'on est.
tre, pour l a ralit-humaine, c'est
tre-l ; c'est--dire l sur cette chaise , l , cette table , l ,
au sommet de cette montagne, avec ces dimensions, cette orientation,
etc. . C'est une ncessit ontologique.
Encore faut-il bien s'entendre. Car cette ncessit apparat entre
deux contingences : d'une part en effet, s' il est ncessaire que j e sois
sous forme d'tre-l, i l est tout fait contingent que j e sois, car je ne
347
suis pas le fondement de mon tre ; d'autre part, s'il est ncessaire que
j e sois engag dans tel ou tel point de vue, i l est contingent que ce soit
prcisment dans celui-ci, l ' exclusion de tout autre. C'est cette
double contingence, enserrant une ncessit, que nous avons appele
la facticit du pour-soi . Nous l'avons dcrite dans notre deuxime
parti e. Nous avons montr alors que l ' en-soi nantis et englouti dans
l'vnement absolu qu'est l'apparition du fondement ou surgissement
du pour-soi demeure au sein du pour-soi comme sa contingence
origi nell e. Ai nsi l e pour-soi est soutenu par une perptuelle contin
gence qu'il reprend son compte et s'assimi l e sans jamais pouvoir la
supprimer. Nulle part l e pour-soi ne la trouve en lui-mme, nul l e part
il ne peut l a saisir et la connatre, ft-ce par le cogito rflexif, car i l la
dpasse toujours vers ses propres possibilits et il ne rencontre en soi
que l e nant qu'il a tre. Et pourtant elle ne cesse de l e hanter et
c'est el l e qui fai t que je me saisisse la fois comme totalement
responsabl e de mon tre et comme totalement injustifiable. Mais
cette injustifiabiIit, l e monde m' en renvoie l'image sous l a forme de
l'unit synthtique de ses rapports univoques moi. Il est absolument
ncessaire q ue le monde m'apparaisse en ordre. Et en ce sens, cet
ordre c' est moi, c'est cette image de moi que nous dcrivions dans le
dernier chapitre de notre deuxime partie. Mais i l est tout fait
contingent qu'il soit cet ordre. Ainsi apparat-il comme agencement
ncessaire et injustifiable de l a totalit des tres. Cet ordre absolu
ment ncessaire et totalement inj ustifiable des choses du monde, cet
ordre qui est moi-mme en tant que mon surgissement le fait
ncessai rement exister et qui m'chappe en tant que je ne suis ni l e
fondement de mon tre ni le fondement d' un tel tre, c'est l e corps tel
qu' il est sur l e plan du pour-soi . En ce sens, on pourrait dfinir l e
corps comme la forme contingente que prend la ncessit de ma
contingence. Il n'est rien autre que l e pour-soi ; i l n'est pas un en-soi
dans l e pour-soi, car alors il figerait tout. Mais il est le fait que le pour
soi n'est pas son propre fondement , en tant que ce fait se traduit par la
ncessit d'exister comme tre contingent engag parmi les tres
contingents. En tant que tel , le corps ne se distingue pas de la
situation du pour-soi, puisque, pour l e pour-soi, exister ou se situer ne
font qu'un ; et il s'identifie d' autre part au monde tout entier, en tant
que l e monde est l a situation totale du pour-soi et la mesure de son
existence. Mais une situation n'est pas un pur donn contingent : bi en
au contraire, el l e ne se rvle que dans la mesure o le pour-soi l a
dpasse vers l ui-mme. Par sui te, l e corps-pour-soi n'est jamais un
donn que j e puisse connatre : i l est l , partout comme l e dpass, i l
n'existe qu' en tant que je lui chappe en me nantisant ; i l est ce que
j e nanti se. Il est l'en-soi dpass par l e pour-soi nantisant et
ressaisissant l e pour-soi dans ce dpassement mme. JI est l e fai t que
j e sui s ma propre motivation sans tre mon propre fondement ; l e fait
348
que je ne suis rien sans avoir tre ce que je suis et que pourtant, en
tant que j 'ai tre ce que je suis, je suis sans avoir tre. En un sens
donc, le corps est une caractristique ncessaire du pour-soi : i l n'est
pas vrai qu'il soit l e produit d'une dcision arbitraire d'un dmiurge,
ni que l 'uni on de l'me et du corps soit le rapprochement contingent
de deux substances radicalement distinctes ; mais, au contraire, i l
dcoule ncessairement de la nature du pour-soi qu'il soit corps, c'est
-dire que son chappement nantisant ["tre se fasse sous forme
d'un engagement dans le monde. Et pourtant, en un autre sens, le
corps manifeste bien ma contingence, il n'est mme que cette
contingence : les rationalistes cartsiens avaient raison d'tre frapps
par cette caractristique ; en effet, il reprsente l'individuation de
mon engagement dans le monde. Et Platon n'avait pas tort non plus
de donner le corps comme ce qui individualise l' me. Seulement, il
serait vain de supposer que [ "me est l e corps en tant que l e pour-soi
est sa propre i ndividuation.
Nous saisirons mieux la porte de ces remarques si nous tentons
d'en faire ["application au problme de la connaissance sensible.
Le problme de l a connaissance sensible s'est pos l'occasion de
l'apparition au mil ieu du monde de certains objets que nous
nommons l es sens. Nous avons d'abord constat qu'autrui avait des
yeux et, par l a suite, des techniciens dissquant des cadavres ont
appris l a structure de ces objets ; ils ont distingu la corne du
cristal l i n et l e cristallin de l a rtine. Il s ont tabli que l'objet cristallin
se classait dans une famille d'objets particuliers : les lentilles, et qu'on
pouvait appliquer l'objet de leur tude les lois d'optique gomtri
que qui concernent les lentilles. Des dissections plus prcises, opres
au fur et mesure que les instruments chirurgicaux se perfection
naient , nous ont appris qu'un faisceau de nerfs partait de la rtine
pour aboutir au cerveau. Nous avons examin au mi croscope les nerfs
des cadavres et nous avons dtermin exactement leur trajet, leur
point de dpart et leur point d'arrive. L'ensemble de ces connais
sances concernait donc un certain objet spatial nomm l'il ; elles
impliquaient l ' existence de ["espace et du monde ; elles impliquaient,
en outre, que nous pouvions voir cet il, le toucher, c'est--dire que
nous soyons nous-mmes pourvus d'un point de vue sensible sur l es
choses. Enfi n, entre notre connaissance de ["il et l'il lui-mme,
s'interposaient toutes nos connaissances techniques (l'art de faonner
des scalpels, des bistouris) et scientifiques (p. ex. l'optique gomtri
que qui permet de construire et d'utiliser les microscopes). Bref,
entre moi et [" il que j e dissque, le monde tout entier, tel que j e le
fais apparatre par mon surgissement mme, s'interpose. Par l a suite,
un examen plus pouss nous a permis d'tablir l'existence de
terminaisons nerveuses diverses la priphrie de notre corps. Nous
sommes mme parvenus agir sparment sur certaines de ces
349
terminaisons et raliser des expriences sur des sujets vivants. Nous
nous sommes alors trouvs en prsence de deux objets du monde :
d'une part, l 'excitant ; d'autre part, le corpuscule sensible ou l a
terminaison nereuse libre que nous excitions. L'excitant tait un
objet physico-chi mi que, courant lectrique, agent mcanique ou
chi mi que, dont nous connaissions avec prcision les proprits, et que
nous pouvi ons faire varier en intensit ou en dure de faon dfi ni e. Il
s'agissait donc de deux objets mondains et leur relation i ntramon
daine pouvait tre constate par nos propres sens ou par le moyen
d'instruments. La connaissance de cette relation supposait derechef
tout un systme de connaissances scientifiques et techniques, bref
l'existence d' un monde et notre surgissement originel dans l e monde.
Nos i nformations e mpiriques nous ont permis, en outre, de concevoir
un rapport entre l 'intrieur de l'autre-objet et l'ensemble de ces
constatations objectives. Nous avons appris, en effet, qu'en agissant
sur ceriains sens, nous provoquions une modification dans l a
conscience de l'autre. Nous l'avons appris par le langage, c'est--dire
par des ractions significatives et objectives de l'autre. Un objet
physique - l 'excitant, un objet physiologique - le sens, un objet
psychique -l ' autre, des manifestations objectives de signification
le l angage : tels sont les termes de la relation objective que nous
avons voulu tablir. Aucun d'eux ne pouvait nous permettre de sortir
du monde des objets. Il nous est arriv aussi de servir de sujet aux
recherches des physiologistes ou des psychologues. Si nous nous
prtions quel que exprience de ce genre, nous nous trouvions
soudain dans un l aboratoire et nous percevions un cran plus ou
moi ns clair, ou bien nous ressentions de petites secousses lectri
ques, ou bien nous tions frls par un objet que nous ne pouvions
pas trs exactement dterminer, mais dont nous saisissions la
prsence globale au mil ieu du monde et contre nous. Pas un instant
nous n'tions isols du monde, tous ces vnements se passaient pour
nous dans un laboratoire, au milieu de Paris, dans l e btiment sud de
l a Sorbonne ; et nous demeurions en prsence d'autrui, et le sens
mme de l' exprience exigeait que nous puissions communiquer avec
lui par le l angage. De temps autre, l ' exprimentateur nous
demandait si l'cran nous paraissait plus ou moins clair, si la
pression qu' on exerait sur notre main nous semblait plus ou moins
forte, et nous rpondions - c'est--dire que nous donnions des
renseignements objectifs sur des choses qui apparaissaient au milieu
de notre monde. Peut-tre un exprimentateur malhabile nous a-t-il
demand si notre sensation de lumire tait plus ou moins forte,
plus ou moi ns intense . Cette phrase n'aurait eu aucun sens pour
nous, puisque nous tions au milieu d'objets, en train d'observer ces
objets, si l 'on ne nous avait appris de longue date appeler
sensation de l umire l a lumire objective telle qu'elle nous
350
apparat dans le monde un instant donn. Nous rpondions donc
que l a sensation de lumire tait, par exemple, moins intense, mais
nous entendions par l que l'cran tait, notre avis, moins clair. Et
ce notre avis ne correspondait rien de rel , car nous saisissions
en fair l'cran comme moins clair, si ce n'est un effort pour ne pas
confondre l'obj ectivit du monde pour nous avec une objectivit plus
rigoureuse, rsultat de mesures exprimentales et de raccord des
esprits entre eux. Ce que nous ne pouvions en tout cas connatre, c'est
un certain obj et que l'exprimentateur observait pendant ce temps et
qui tait notre organe visuel ou certaines terminaisons tactiles. Le
rsultat obtenu ne pouvait donc tre, l a fin de l'exprience, que la
mise en relation de deux sries d'objers : ceux qui se rvlaient nous
pendant l'exprience et ceux qui se rvlaient pendant le mme temps
l'exprimentateur. L'clairement de l'cran appartenait mon
monde ; mes yeux comme organes objectifs appartenaient au monde
de l'exprimentateur. La l i aison de ces deux sries prtendait donc
tre comme un pont entre deux mondes ; en aucun cas, elle ne pouvait
tre une table de correspondance entre l e subjectif et l'objectif.
Pourquoi , en effet , appellerait-on subjectivit l'ensemble des
objets l umi neux, ou pesants, ou odorants tels qu' i ls m'apparaissaient
dans ce laboratoire, Paris, un jour de fvrier, etc. ? Et, si nous
devions malgr tout considrer cet ensemble comme subjectif,
pourquoi reconnatre l'obj ectivit au systme des objets qui se
rvlaient simultanment l'exprimentateur, dans ce mme labora
toire, ce mme jour de fvri er ? Il n'y a pas ici deux poids ni deux
mesures : nulle part nous ne rencontrons quelque chose qui se donne
comme purement senti, comme vcu pour moi sans objectivation. Ici
comme toujours, j e suis conscient du monde et, sur fond de monde,
de certains obj ets transcendants ; comme toujours, je dpasse ce qui
m'est rvl vers la possibi l it que j 'ai tre, par exemple vers cel l e
de rpondre correctement l'exprimentateur et de permettre
l'exprience de russir. Sans doute, ces comparaisons peuvent donner
certains rsultats objectifs : par exemple , je puis constater que l'eau
tide me parat froide lorsque j 'y plonge ma main aprs l'avoir
plonge dans l 'eau chaude. Mais cette constatation que l'on nomme
pompeusement l oi de relativit des sensations ne concerne
nullement les sensations. Il s'agit bien d' une qualit de l'objet qui
m'est rvle : l'eau tide est froide quand j 'y plonge ma main
chaude. Si mplement, une comparaison de cette qualit objective de
l'eau un renseignement galement objectif -cel ui que me donne l e
thermomtre - me rvle une contradiction . Cette contradiction
motive de ma part un libre choix de l'objectivit vrai e. J'appellerai
subjectivit l ' objectivit que je n'ai pas choisi e. Quant aux raisons de
la relativit des sensati ons , un examen plus pouss me les rvlera
dans certaines structures objectives et synthtiques que je nommerai
351
des formes (Gestalt). L"illusion de Mller-Lyer, la relativit des sens,
etc. , sont autant de noms donns des lois objectives concernant les
structures de ces formes. Ces lois ne nous renseignent pas sur des
apparences, mais elles concernent des structures synthtiques. Je
n'interviens i ci que dans l a mesure o mon surgissement dans le
monde fait natre l a mise en rapport des objets l es uns avec les autres.
Comme t el s, ils se rvlent en tant que formes. L'objectivit
scientifique consiste considrer les structures part, en les isolant
du tout : ds lors, elles apparaissent avec d'autres caractristiques.
Mais, en aucun cas, nous ne sortons d"un monde existant. On
montrerait de mme que ce qu'on nomme seuil de l a sensation , ou
spcificit des sens, se ramne de pures dterminations des objets
en tant que tels.
Pourtant, on a voulu que ce rapport objectif de l'excitant l'organe
sensible se dpasse lui-mme vers une relation de J'objectif (excitant
organe sensibl e) au subjectif (sensation pure), ce subjectif tant dfini
par l'action qu 'exercerait sur nous l'excitant par l ' i ntermdiaire de
l'organe sensible. L"organe sensible nous parat affect par l'excitant :
les modifications protoplasmiques et physico-chimiques qui parais
sent, en effet, dans l'organe sensible, ne sont pas produites par cet
organe l ui -mme : elles lui viennent du dehors. Du moins, nous
l'affirmons pour demeurer fidles au principe d'inertie qui constitue
la nature tout entire en extriorit. Lorsque donc nous tablissons
une corrlation entre le systme objectif : excitant-organe sensoriel,
que nous percevons prsentement, et l e systme subjectif qui est pour
nous l"ensembl e des proprits internes de l ' autre-objet, force nous
est d'admettre que l a modalit nouvelle qui vient de paratre dans
cette subjectivit, en liaison avec l'excitation du sens, est, el l e aussi,
produite par autre chose qu"elle-mme. Si elle se produisait spontan
ment, en effet , du coup elle serait tranche de tout lien avec l'organe
excit ou, si l'on prfre, l a relation qu'on pourrait tablir entre eux
serait quelconque. Nous concevrons donc une uni t objective corres
pondant la plus petite
e
t la plus courte des excitations perceptibles
et nous la nommerons sensation. Cette unit, nous l a doterons de
l'inertie, c'est--dire qu' el le sera pure extriorit puisque, conue
partir du ceci, elle participera l ' extriorit de l'en-soi. Cette
extriorit projete au cur de la sensation l'atteint presque dans son
existence mme : la raison de son tre et l'occasion de son existence
sont en dehors d"elle. Elle est donc extriorit soi-mme. En mme
temps, sa raison d'tre ne rside pas dans quelque fait intrieur de
mme nature qu' el l e, mais dans un objet rel , l'excitant, et dans l e
changement qui affecte un autre objet rel , l'organe sensible.
Pourtant, comme i l demeure inconcevable qu'un certain tre, existant
sur un certain pl an d'tre et incapable de se soutenir par l ui seul
J'tre, puisse tre dtermin exister par un existant qui se tient sur
352
un plan d'tre radicalement distinct, je conois, pour soutenir l a
sensation et pour l ui fournir de l'tre, un mi l i eu homogne elle et
constitu l ui aussi en extriorit. Ce mi l i eu, j e l e nomme esprit ou
parfois mme conscience. Mais cette conscience, je l a conois comme
conscience de l'autre, c'est--dire comme un objet. Nanmoins,
comme les relations que je veux tablir entre l'organe sensible et l a
sensation doi vent tre universelles, j e pose que la conscience ainsi
conue doit tre aussi ma conscience, non pour l'autre, mais en soi.
Ainsi ai-je dtermin une sorte d'espace interne dans lequel certaines
figures nommes sensations se forment l'occasion d'excitations
extrieures. Cet espace tant passivit pure, je dclare qu'il subit ses
sensations. Mais, par l, je n'entends pas seulement qu'il est le milieu
interne qui l eur sert de matrice. Je m'inspire prsent d'une vision
biologique du monde, que j' emprunte ma conception objective de
l'organe sensoriel considr, et je prtends que cet espace interne vit
sa sensation. Ainsi la vie est une liaison magique que j'tablis
entre un milieu passif et un mode passif de ce milieu. L'esprit ne
produit pas ses propres sensations et , de ce fait, el l es l ui demeurent
extrieures ; mais, d' autre part, il se les approprie en les vivant.
L'unit du vcu et du vivant n'est plus, en effet, juxtaposition
spatiale ni rapport de contenu contenant : c'est une i nhrence
magique. L'esprit est ses propres sensations tout en demeurant
distinct d' el l es. Aussi, l a sensation devient un type particulier
d'objet : i nert e, passif et simplement vcu. Nous voil oblig de lui
donner l a subjectivit absolue. Mais i l faut s'entendre sur ce mot de
subj ectivit. Il ne signifie pas ici l'appartenance un sujet, c'est--dire
une ipsit qui se motive spontanment. La subjectivit du
psychologue est d' une tout autre espce : elle manifeste, au contraire,
l'inertie et l'absence de toute transcendance. Est subjectif ce qui ne
peut pas sortir de soi-mme. Et, prcisment, dans la mesure o la
sensation, tant pure extriorit, ne peut tre qu'une impression dans
l'esprit, dans la mesure o elle n'est que soi , que cette figure qu'un
remous a forme dans l'espace psychique, elle n'est pas transcen
dance, elle est l e pur et simple subi, la simple dtermination de notre
rceptivit : el l e est subjectivit parce qu'elle n'est aucunement
prsentative ni reprsentative. Le subjectif d'autrui-objet, c'est pure
ment et simplement une cassette ferme. La sensation est dans la
cassette.
Telle est la notion de sensation. On voit son absurdit. Tout
d'abord, elle est purement invente. Elle ne correspond rien de ce
que j 'exprimente en moi-mme ou sur autrui. Nous n'avons jamais
saisi que l ' univers objectif ; toutes nos dterminations personnelles
supposent l e monde et surgissent comme des relations au monde. La
sensation suppose, elle, que l ' homme soit dj dans l e monde,
puisqu' i l est pourvu d'organes sensibles, et el l e apparat en l ui comme
353
pure cessation de ses rapports avec le monde. En mme temps, cette
pure subjectivit se donne comme la base ncessaire sur laquelle il
faudra reconstruire toutes ces relations transcendantes que son
apparition vient de faire disparatre . Ainsi rencontrons-nous ces trois
moments de pense : 1 Pour tablir la sensatipn, on doit partir d'un
certain ralisme : on prend pour valable notre perception d'autrui,
des sens d'autrui et des instruments inducteurs. 2 Mais au niveau de
l a sensation, tout ce ralisme disparat : l a sensation, pure modifica
tion subi e, ne nous donne de renseignements que sur nous-mme, elle
est du vcu . 3 Et pourtant, c'est elle que je donne comme base de
ma connaissance du monde extrieur. Cette base ne saurait tre le
fondement d'un contact rel avec les choses : elle ne nous permet pas
de concevoir une structure intentionnelle de l'esprit. Nous devrons
appeler objectivit non une liaison immdiate avec l'tre, mais
certains accolements de sensations qui prsenteront plus de perma
nence, ou plus de rgularit, ou qui s'accorderont mi eux avec
l'ensemble de nos reprsentations. En particulier, c'est ainsi que nous
devrons dfini r notre perception d'autrui, des organes sensibles
d'autrui et des instruments inducteurs : i l s'agit de formations
subjectives d'une cohrence particulire, voil tout. Il ne saurait tre,
ce niveau, question d'expliquer ma sensation par l'organe sensible
tel que je l e perois chez autrui ou chez moi-mme, mais bien au
contraire c'est l' organe sensible que j'explique comme une certaine
association de mes sensations. On voit l e cercle invitable. Ma
perception des sens d'autrui me sert de fondement pour une
explication de sensations et en particulier de mes sensations ; mais
rciproquement, mes sensations ainsi conues constituent la seule
ralit de ma perception des sens d'autrui. Et, dans ce cercle, le mme
objet : l'organe sensible d'autrui, n'a ni la mme nature, ni l a mme
vrit chacune de ses apparitions. Il est d'abord ralit et,
prcisment parce qu'il est ralit, i l fonde une doctrine qui le
contredit. En apparence la structure de la thorie classique de la
sensation est exactement celle de l 'argument cynique du Menteur, o
c'est prcisment parce que le Crtois dit vrai qu'il se trouve mentir.
Mais, en outre, nous venons de le voir, une sensation est subjectivit
pure. Comment veut-on que nous construisions un objet avec la
subjectivit ? Aucun groupement synthtique ne peut confrer la
qualit objective ce qui est par principe du vcu. S'il doit y avoir
perception d'objets dans le monde , il faut que nous soyons, ds notre
surgissement mme, en prsence du monde et des objets. La
sensation, notion hybride entre le subjectif et l'objectif, conue
partir de l'objet, et appli que ensuite au sujet, existence btarde dont
on ne saurait dire si elle est de fait ou de droit, l a sensation est une
pure rverie de psychologue, il faut la rejeter dlibrment de toute
thorie srieuse sur les rapports de la conscience et du monde,
354
Mais si la sensation n'est qu'un mot, que deviennent les sens ? On
reconnatra sans doute que nous ne rencontrons jamais en nous
mme cette impression fantme et rigoureusement subjective qu'est
la sensation, on avouera que j e ne saisis jamais que le vert de ce
cahier, de ce feuill age et jamais la sensation de vert ni mme le
quasi-vert que Husserl pose comme la matire hyltique que
l'intention anime en ve
i
t-obj et ; on se dclarera sans peine convaincu
de ce que, supposer que la rduction phnomnologique soit
possible - ce qui reste prouver -, elle nous mettrait en face
d'objets mi s entre parenthses, comme purs corrlatifs d'actes
positionnels, mais non pas de rsidus impressionnels. Mais il n'en
demeure pas moins que les sens demeurent. Je vois l e vert, je touche
ce marbre poli et froid. Un accident peut me priver d'un sens tout
entier : je puis perdre la vue, devenir sourd, etc. Qu'est-ce donc
qu'un sens qui ne nous donne pas de sensation ?
La rponse est aise. Constatons d'abord que l e sens est partout et
partout insaisissabl e. Cet encrier, sur la table, m'est donn immdia
tement sous l a forme d'une chose et pourtant i l m' est donn par la
vue. Cela signifie que sa prsence est prsence visible et que j 'ai
conscience qu'il m' est prsent comme visible, c'est--dire conscience
(de) le voir. Mais, en mme temps que la vue est connaissance de
l'encrier, l a vue se drobe toute connaissance : i l n' y a pas
connaissance de la vue. Mme l a rflexion ne nous donnera pas cette
connaissance. Ma conscience rflexive me donnera, en effet, une
connaissance de ma conscience rflchie de l'encrier, mais non pas
celle d'une activit sensoriel l e. C'est en ce sens qu'il faut prendre l a
clbre formule d'Auguste Comte : L'il ne peut pas se voir lui
mme. I l serait admissible, en effet, qu'une autre structure organi
que, une disposition contingente de notre appareil visuel permette
un troisime i l de voir nos deux yeux pendant qu'ils voient. Ne puis
je pas voir et toucher ma main pendant qu'elle touche ? Mais je
prendrais alors l e point de vue de l'autre sur mon sens : je verrais des
yeux-objets ; je ne puis voir l 'il voyant, j e ne puis toucher la main en
tant qu'elle touche. Ainsi, l e sens, en tant qu'il est-pour-moi, est un
insaisissable : i l n'est pas l a collection infinie de mes sensations
puisque j e ne rencontre jamais que des objets du monde ; d'autre
part, si je prends sur ma conscience une vue rflexive, je rencontrerai
ma conscience de telle ou telle chose-dans-Ie-monde, non mon sens
visuel ou tactile ; enfin, si j e puis voir ou toucher mes organes
sensibles, j 'ai l a rvlation de purs objets dans le monde, non pas
d'une activit dvoilante ou constructrice. Et cependant, le sens est
l : il y a l a vue, l e toucher, l'oue.
Mais si, d'autre part, j e considre l e systme des objets vus qui
m'apparaissent, je constate qu'ils ne se prsentent pas moi en un
ordre quelconque : ils sont orients. Puisque, donc, l e sens ne peut se
355
dfinir ni par un acte saisissable ni par une succession d'tats vcus, i l
nous reste tenter de l e dfinir par ses objets. Si la vue n'est pas l a
somme des sensations visuelles, ne peut-elle tre l e systme des objets
vus ? En ce cas, il faut revenir sur cette ide d'orientation que nous
signalions tout l'heure , et tenter d'en saisir la signification.
Notons, en premier l i eu, qu'elle est une structure constitutive de la
chose. L'objet parat sur fond de monde et se manifeste en relation
d'extriorit avec d'autres ceci qui viennent d'apparatre. Ainsi son
dvoilement i mplique la constitution complmentaire d'un fond
i ndi ffrenci qui est le champ perceptif total ou monde. La structure
formelle de cette relation de la forme au fond est donc ncessaire ; en
un mot , l ' existence d'un champ visuel ou tactile ou auditif est une
ncessit : l e silence est, par exempl e, l e champ sonore de bruits
i ndi ffrencis sur lequel s'enlise le son particulier que nous envisa
geons. Mais l a l i aison matrielle d'un tel ceci au fond est l a fois
choisie et donne. El l e est choisie en tant que le surgissement du
PCur-soi est ngation explicite et interne d'un tel ceci sUr fond de
monde : je regarde l a tasse ou l'encrier. Elle est donne en ce sens
que mon choix s'opre partir d'une distribution originelle des ceci,
qui manifeste la Jacticit mme de mon surgissement. I l est ncessaire
que le livre m' apparaisse droite ou gauche de la table. Mais il est
contingent qu' i l m'apparaisse prcisment gauche et, enfin, je suis
libre de regarder le livre sur la tabl e ou la table supportant le livre.
C'est cette contingence entre la ncessit et la libert de mon choix
que nous nommons l e sens. Elle implique que l'objet m'apparaisse
toujours tout entier la fois c'est l e cube, l'encrier, la tasse que je
vois - mais que cette apparition ai t toujours l i eu dans une perspec
tive particulire qui traduise ses relations au fond de monde et aux
autres ceci. C'est toujours la note du violon que j'entends. Mais il est
ncessaire que je l ' en tende travers une porte ou par la fentre ouverte
ou dans la sal l e de concert : sinon l'objet ne serait plus au milieu du
monde et ne se manifesterait plus un existant-surgissant-dans-le
monde. Mai s, d'autre part, s'il est bien vrai que tous les ceci ne
peuvent paratre la fois sur fond de monde et que l'apparition de
certains d'entre eux provoque la fusion de certains autres avec le
fond, s'il est vrai que chaque ceci ne peut se manifester que d'une
seule manire la fois, bien qu'il existe pour lui une infinit de faons
d'apparatre, ces rgles d' apparition ne doivent pas tre considres
comme subjectives et psychologiques : elles sont rigoureusement
objectives et dcoulent de la nature des choses. Si l'encrier me cache
une portion de la tabl e, cela ne provient pas de la nature de mes sens,
mais de l a nature de l'encrier et de la lumire. Si l'objet rapetisse en
s'loignant, il ne faut pas l'expliquer par on ne sait quelle illusion de
l'observateur, mais par l es lois rigoureusement externes de la
perspective. Ainsi , par ces lois objectives, un centre de rfrence
356
rigoureusement objectif est dfini : c'est l ' i l, par exemple, en tant
que, sur un schma de perspective, il est l e point vers lequel toutes l es
lignes objectives viennent converger. Ainsi, l e champ perceptif se
rfre un centre objectivement dfini par cette rfrence et situ
dans le champ mme qui s'oriente autour de l ui . Seul ement, ce centre,
comme structure du champ perceptif considr, nous ne l e voyons
pas : nou le sommes. Ai nsi , l'ordre des objets du monde nous
renvoie perptuellement l ' image d'un objet qui, par principe, ne peut
tre objet pour nous puisqu'il est ce que nous avons tre. Ainsi , la
structure du monde implique que nous ne pouvons voir sans tre
visibles. Les rfrences intra-mondaines ne peuvent se faire qu' des
objets du monde et l e monde vu dfinit perptuellement un objet
visible auquel renvoient ses perspectives et ses dispositions. Cet objet
apparat au milieu du monde et en mme temps que l e monde : il est
toujours donn par surcrot avec n'importe quel groupement d'objets,
puisqu'il est dfini par l'orientation de ces objets : sans lui , i l n'y
aurait aucune orientation, puisque toutes les orientations seraient
quival entes ; i l est l e surgissement contingent d'une orientation
parmi l'infinie possibilit d'orienter l e monde ; i l est cette orientation
leve l 'absolu. Mais sur ce plan, cet objet n'existe pour nous qu'
titre d'indication abstraite : i l est ce que tout m'indique et ce que je ne
puis saisir par principe, puisque c'est ce que je suis. Ce que j e suis, en
effet , par principe, ne peut tre objet pour moi en tant que j e le suis.
L'objet qu'indiquent les choses du monde et qu'elles cernent de leur
ronde est pour soi-mme et par principe un non-objet. Mais l e
surgissement de mon tre, en dpliant l es distances partir d'un
centre, par J'acte mme de ce dpliement dtermine un objet qui est
lui-mme en tant qu'il se fait indi quer par le monde et dont pourtant
je ne saurais avoir l'intuition comme objet car je le suis, moi qui suis
prsence moi-mme comme l'tre qui est son propre nant. Ainsi
mon tre-dans-le-monde, par l e seul fait qu'il ralise un monde, se fait
indiquer lui-mme comme un tre-au-milieu-du-monde par le
monde qu'il ralise, et cel a ne saurait tre autrement, car i l n'est
d'autre manire d'entrer en contact avec l e monde que d'tre du
monde. Il me serait impossible de raliser un monde o j e ne serais
pas et qui serait pur objet de contemplation survolante. Mai s, au
contraire, il faut que je me perde dans l e monde pour que l e monde
existe et que j e puisse le transcender. Ainsi , dire que j e suis entr
dans le monde, venu au monde , ou qu' i l y a un monde ou que j'ai
un corps, c'est une seule et mme chose. En ce sens, mon corps est
partout sur l e monde : il est aussi bien l-bas, dans le fait que l e bec de
gaz masque J'arbuste qui crot sur l e trottoir, que dans l e fait que l a
mansarde, l-haut, est au-dessus des fentres du sixime ou dans celui
que J'auto qui passe se meut de droite gauche derrire le camion, ou
que la femme qui traverse la rue parat plus petite que l 'homme qui
357
est assis la terrasse du caf. Mon corps est la fois coextensif au
monde, pandu tout travers les choses et, la fois, ramass en ce
seul point qu'elles indiquent toutes et que je suis sans pouvoir l e
connatre, Ceci doit nous permettre de comprendre ce que sont les
sens.
Un sens n'est pas donn avant l es objets sensibles ; n'est-il pas, en
effet, susceptible d'apparatre autrui comme objet ? Il n'est pas non
plus donn aprs eux : i l faudrait alors supposer un monde d'images
incommunicables, simples copies de l a ralit, sans que le mcanisme
de leur apparition soit concevable. Les sens sont contemporains des
objets : ils sont mme les choses en personne, telles qu'elles se
dvoilent nous en perspective. Ils reprsentent simplement une
rgle objective de ce dvoilement. Ainsi, la vue ne produit pas de
sensations visuelles, elle n' est pas affecte non plus par des rayons
lumineux, mais c'est l a collection de tous les objets visibles en tant
que leurs relations objectives et rciproques se rfrent toutes
certaines grandeurs choisies -et subies la fois-comme mesures et
un cert ain centre de perspective. De ce point de vue, le sens n'est
aucunement assimilable la subjectivit. Toutes les variations que
l'on peut enregistrer dans un champ perceptif sont en effet des
variations objectives. En particulier, le fait qu'on peut supprimer l a
vision en fermant les paupires est un fait extrieur qui ne renvoie
pas la subjectivit de l'apercepti on. La paupire, en effet, est un
objet peru parmi les autres objets et qui me dissimule les autres
objets par suite de sa relation objective avec eux : ne plus voir les
autres objets de ma chambre parce que j'ai ferm les yeux, c'est voir
le rideau de ma paupire ; de la mme faon que, si je pose mes gants
sur un tapis de table, ne plus voir tel dessin du tapis, c'est prcisment
voir les gants. Semblablement, les accidents qui affectent un sens
appartiennent toujours l a rgion des objets : Je vois jaune ,
parce que j ' ai l a j aunisse ou parce que j e porte des lunettes jaunes.
Dans les deux cas, la raison du phnomne n'est pas dans une
modification subjective du sens, ni mme dans une altration
organique, mais dans une relation objective entre des objets mon
d
ains : dans les deux cas, nous voyons travers quelque chose et
la vrit de notre vision est objecti ve. Si , enfin, d'une faon ou d'une
autre, le centre de rfrence visuel est dtruit (la destruction ne
pouvant venir que du dveloppement du monde selon ses lois
propres, c'est--dire exprimant d' une certaine manire ma facticit) ,
les objets visibles ne s'anantissent pas du mme coup. I l s continuent
d'exister pour moi, mais ils existent sans aucun centre de rfrence
comme totalit visible, sans apparition d'aucun ceci particulier, c'est
-dire dans la rciprocit absolue de leurs relations. Ainsi, c'est le
surgissement du pour-soi dans le monde qui fait exister du mme coup
le monde comme totalit des choses et les sens comme l a manire
358
objective dont les qualits des choses se prsentent. Ce qui est
fondamental, c'est mon rapport au monde et ce rapport dfinit la
fois le monde et l es sens, selon l e point de vue o l'on se place. L
ccit, le daltonisme, la myopie reprsentent originellement la faon
dont il y a pour moi un monde, c'est--dire qu'ils dfinissent mon sens
visuel en tant que celui-ci est la facticit de mon surgissement. C'est
pourquoi mon sens peut tre connu et dfini objectivement par moi
mais vide, partir du monde : i l suffit que ma pense rationnelle et
universalisante prolonge dans l'abstrait les indications que les choses
me donnent moi-mme sur mon sens et qu'elle reconstitue le sens
partir de ces signaux comme l ' hi storien reconstitue une personnalit
historique d'aprs les vestiges qui l'indiquent. Mais dans ce cas, j'ai
reconstruit le monde sur le terrain de l a pure rationalit en
m'abstrayant du monde par l a pense : je survole l e monde sans m'y
attacher, je me mets dans l'attitude d'objectivit absolue et l e sens
devient un objet parmi l es obj ets, un centre de rfrence relatifet qui,
lui-mme, suppose des coordonnes, Mais, par l mme, j'tablis en
pense la relativit absolue du monde, c'est--dire que je pose
l'quivalence absolue de tous les centres de rfrence. Je dtruis la
mondanit du monde, sans mme m'en douter. Ainsi , le monde, en
indiquant perptuellement l e sens que je suis et en m' invitant le
reconstituer, m'incite liminer l'quation personnelle que je suis en
restituant au monde le centre de rfrence mondain par rapport
auquel le monde se dispose. Mai s, du mme coup, je m'chappe
par la pense abstraite -du sens que je suis, c'est--dire que je coupe
mes attaches au monde, je me mets en tat de simple survol et le
monde s'vanouit dans l'quivalence absolue de ses infinies relations
possi bles. Le sens, en effet, c'est notre tre-dans-le-monde en tant
que nous avons l'tre sous forme d' tre-au-milieu-du-monde.
Ces remarques peuvent tre gnralises ; elles peuvent s'appliquer
mon corps tout entier, en tant qu'il est l e centre de rfrence total
qu'indiquent l es choses. En particulier, notre corps n'est pas seule
ment ce qu'on a longtemps appel l e sige des cinq sens ; il est
aussi l 'instrument et le but de nos actions. Il est mme impossible de
distinguer l a sensation de l 'action , selon les termes mmes de
l a psychologie classique : c'est ce que nous indiquions lorsque nous
faisions remarquer que l a ralit ne se prsente nous ni comme
chose ni comme ustensile mais comme chose-ustensil e. C'est pourquoi
nous pourrons prendre comme fil conducteur, pour notre tude du
corps en tant qu'il est centre d'action, les raisonnements qui nous ont
servi dvoiler l a vritable nature des sens.
Ds qu'on formul e en effet l e problme de l'action, on risque de
tomber dans une confusion de grave consquence. Lorsque je prends
ce porte-plume et que je l e plonge dans l 'encrier, j'agis. Mais si je
regarde Pierre qui , dans l e mme instant, approche une chaise de l a
359
tabl e, je constate aussi qu' il agit. Il y a donc ici un risque trs net de
commettre l ' erreur que nous dnoncions propos des sens, c'est-
dire d' i nterprter mon action tel l e qu'elle est-pour-moi partir de
l'action de l ' autre. Ce st que, en effet, l a seule action que je puis
connatre dans le temps mme qu'elle a l i eu, c'est l'action de Pierre.
Je vois son geste et je dtermine son but en mme temps : il approche
une chaise de la table pour pouvoir s'asseoir prs de cette table et
crire l a lettre qu'il m'a dit vouloir crire. Ainsi puis-j e saisir toutes
les positions intermdiaires de la chaise et du corps qui l a meut
comme des organisations instrumentales : elles sont des moyens pour
parvenir une fin poursuivi e, Le corps de l'autre m'apparat donc ici
comme un i nstrument au milieu d'autres instruments. Non point
seul ement comme un outil faire des outils, mais encore comme un
outil manier des outils, en un mot comme une machine-outi l . Si
j'interprte l e rl e de mon corps par rapport mon action, la lueur
de mes connaissances du corps de l'autre, je me considrerai donc
comme disposant d'un certain instrument que je peux disposer mon
gr et qui , son tour, disposera l es autres instruments en fonction
d'une certaine fin que je poursuis. Ainsi sommes-nous ramen la
distinction cl assique de l'me et du corps : l'me utilise l'outil qu'est
l e corps. L paralllisme avec l a thorie de l a sensation est complet :
nous avons vu en effet que cette thorie partait de la connaissance du
sens de l'autre et qu' el l e me dotait ensuite de sens exactement
semblables aux organes sensibles que je percevais sur autrui. Nous
avons vu aussi l a di fficult que rencontrait immdiatement une
semblable thorie : c'est qu'alors je perois l e monde et singulire
ment l'organe sensible d'autrui travers mon propre sens, organe
dformant, milieu rfringent qui ne peut me renseigner que sur ses
propres affections. Ainsi l es consquences de la thorie ruinent
l'objectivit du principe mme qui a servi l es tablir. La thorie de
l'action, ayant une structure analogue, rencontre des difficults
analogues ; si je pars, en effet, du corps d'autrui, je l e saisis comme un
instrument et en tant que je m'en sers moi-mme comme d'un
instrument : je puis en effet l' utilier pour parvenir des fins que je ne
saurais atteindre seul ; j e commande ses actes par des ordres ou par
des prires ; je puis aussi les provoquer par mes propres actes, en
mme temps je dois prendre des prcautions vis--vis d'un outil d'un
maniement particulirement dangereux et dlicat. Je suis, par rapport
lui , dans l ' attitude complexe de l 'ouvrier vis--vis de sa machine
outil lorsque , simultanment, i l en dirige l es mouvements et vite
d'tre happ par elle. Et, derechef, pour utiliser au mieux de mes
intrts l e corps d'autrui , j'ai besoin d'un instrument qui est mon
propre corps, tout de mme que, pour percevoir l es organes sensibles
d'autrui, j 'ai besoin d'autres organes sensibles qui sont l es miens
propres. Si donc je conois mon corps l ' image du corps d'autrui,
360
c'est un instrument dans le monde que je dois manier dlicatement et
qui est comme la cl du mani ement des autres outils. Mais mes
rapports avec cet instrument privilgi ne peuvent tre eux-mmes
que techniques et j'ai besoin d'un instrument pour manier cet
instrument, ce qui nous renvoie l'infini. Ainsi donc, si je conois
mes organes sensibles comme ceux de l ' autre, ils requirent un organe
sensible pour les percevoir - et si je saisis mon corps comme un
instrument semblable au corps de J'autre, i l rclame un instrument
pour l e manier -et si nous refusons de concevoir ce recours l'infini,
alors i l nous faut admettre ce paradoxe d' un instrument physique
mani par une me, ce qui, on l e sai t , fait tomber dans d'inextricables
apories. Voyons plutt si nous pouvons tenter ici comme l de
restituer au corps sa nature-pour-nous. Les objets se dvoilent nous
au sein d'un complexe d' ustensilit o ils occupent une place
dtermine. Cette place n'est pas dfinie par de pures coordonnes
spatiales mais par rapport des axes de rfrence pratiques. Le
verre est sur la tablelle , cela veut dire qu'il faut prendre garde de ne
pas renverser le verre si l'on dplace l a tablette. Le paquet de tabac
est sur la chemine : cela veut di re qu'il faut franchir une distance de
trois mtres si l ' on veut aller de l a pipe au tabac, en vitant certains
obstacles, guri dons, fauteuil s, etc. qui sont disposs entre la
chemine et la table. En ce sens l a perception ne se distingue
aucunement de J' organisation pratique des existants en monde.
Chaque ustensile renvoie d'autres ustensiles : ceux qui sont ses
cls et ceux dont il est la cl. Mais ces renvois ne seraient pas saisis
par une conscience purement contemplative : pour une semblable
conscience, l e marteau ne renverrait point aux clous ; i l serait ct
d'eux ; encore l'expression de ct perd-elle tout son sens si el l e
n'esquisse point un chemin qui va du marteau au cl ou et qui doit tre
franchi . L'espace originel qui se dcouvre moi est l'espace hodologi
que ; i l est sillonn de chemins et de routes, i l est instrumental et i l est
le site des outils. Ainsi le monde, ds le surgissement de mon pour
soi, se dvoile comme indication d'actes faire, ces actes renvoient
d'autres actes, ceux-l d'autres et ainsi de suite. I l est remarquer
toutefois que si, de ce point de vue, la perception et l'action sont
indiscernables, J'action se prsente cependant comme une certame
efficacit du futur qui dpasse et transcende l e pur et simple peru. Le
peru, tant ce quoi mon pour-soi est prsence, se dvoile moi
comme co-prsence, il est contact immdiat , adhrence prsente, i l
m'effleure. Mais, comme tel , i l s'offre sans que je puisse au orsenl l e
saisi r. La chose perue est prometteuse et frleuse ; et char une des
proprits qu'elle promet de me dvoiler, chaque abandon tacitem:nt
consenti, chaque renvoi signifiant aux autres objets engage J'avenir.
Ainsi suis-je en prsence de choses qui ne sont que promesses, par
del une ineffable prsence que je ne puis possder et qui est le pur
361
tre-l des choses, c'est--dire le mien, ma facticit, mon corps.
La tasse est l, sur la soucoupe, elle m'est donne prsentement avec
son fond qui est l, que tout indique, mais que je ne vois pas. Et si je
veux le voi r, c'est--dire l'expliciter, le faire apparatre-sur-fond-de
tasse , il faut que je saisisse la tasse par l'anse et que je la renverse :
le fond de la tasse est au bout de mes projets et il est quivalent de
di re que l es aut res structures de la tasse l'indiquent comme un
lment indispensable de la tasse ou de di re qu'elles me l'indiquent
comme l'action qui m'appropriera le mieux la tasse dans sa significa
tion. Ainsi le monde, comme corrlatif des possibilits que je suis,
apparat, ds mon surgissement, comme l'esquisse norme de toutes
mes actions possibles. La perception se dpasse naturellement vers
l'action ; mi eux, elle ne peut se dvoiler que dans et par des projets
d'acti on. Le monde se dvoile comme un creux toujours futur ,
parce que nous sommes toujours futurs nous-mmes.
Pourtant, il faut noter que ce futur du monde, qui nous est ainsi
dvoi l , est strictement objectif. Les choses-instruments indiquent
d'autres instruments ou des manires objectives d'en user avec elles :
le clou est enfoncer de telle et telle manire, le marteau
saisir par le manche , la tasse tre saisie par l'anse , etc. Toutes
ces proprits des choses se dvoilent immdiatement et les grondifs
latins les traduisent merveille. Sans doute sont-elles corrlatives des
projets non-thtiques que nous sommes, mais elles se rvlent
seulement comme structures du monde : potentialits, absences,
ustensilits. Ainsi , le monde m'apparat comme objectivement arti
cul ; il ne renvoie j amai s une subjectivit cratrice mais l'infini
des complexes ustensiles.
Toutefois, chaque instrument renvoyant un autre instrument et
celui-ci un autre, tous finissent par indiquer un instrument qui est
comme leur cl tous. Ce centre de rfrence est ncessaire, sinon,
toutes les instrumentalits devenant quivalentes, le monde s'va
nouirait par totale indiffrenciation des grondifs. Carthage est
delenda pour les Romains, mais servanda pour les Carthagi
nois. Sans relation avec ces centres, elle n'est plus rien, elle retrouve
l'indiffrence de l ' en-soi, car les deux grondifs s'annihilent. Toute
fois il faut bi en voir que l a cl n'est jamais donne moi mais
seulement i ndique en creux . Ce que je saisis objectivement dans
l'action, c'est un monde d'instruments qui s'accrochent les uns aux
autres et chacun d'eux, en tant qu' i l est saisi dans l'acte mme par
quoi je m'y adapte et le dpasse, renvoie un autre instrument qui
doit me permettre de l'utiliser. En ce sens le clou renvoie au marteau
et l e marteau renvoie l a main et au bras qui l'utilisent. Mais ce n'est
que dans la mesure o je fais planter des clous par autrui que la main
et le bras devi ennent leur tour des instruments que j'utilise et que je
dpasse vers leur potentialit. En ce cas, la main d'autrui me renvoie
362
l'instrument qui me permettra d'utiliser cette main (menaces
promesses-salaire, etc. ). Le terme premier est partout prsent mais il
est seulement indiqu : je ne saisis pas ma main dans l'acte d'crire
mais seulement l e porte-pl ume qui crit ; cela signifie que j'utilise l e
porte-pl ume pour tracer des lettres mais non pas ma main pour tenir
le porte-pl ume. Je ne suis pas, par rapport ma main, dans la mme
attitude utilisante que par rapport au porte-plume ; j e suis ma main.
C'est--dire qu'elle est l ' arrt des renvois et leur aboutissement. La
main, c'est seulement l'utilisation du porte-plume. En ce sens elle est
la fois le terme inconnaissable et inutilisable qu'indique l ' i nstrument
dernier de l a srie livre crire -caractres tracer sur le papier
-porte-plume et, l a fois, l'orientation de la srie tout entire : l e
livre i mprim lui-mme s' y rfre. Mais j e ne puis la saisir -en tant
qu'elle agit du moins -que comme l e perptuel renvoi vanescent de
toute l a srie. Ainsi , dans un duel l'pe, au bton, c'est le bton
que je survei l l e des yeux et que je manie ; dans l'acte d'crire, c'est la
pointe de la pl ume que je regarde, en liaison synthtique avec la ligne
ou le quadrillage trac sur l a feuille de papier. Mais ma main s'est
vanoui e, el l e s'est perdue dans le systme complexe d'ustensilit
pour que ce systme existe. El l e en est le sens et l'orientation,
simplement.
Ainsi nous trouvons-nous, semble-t-il , devant une doubl e ncessit
contradictoire : tout instrument n'tant utilisable -et mme saisissa
ble -que par le moyen d' un autre instrument, l'univers est un renvoi
objectif indfini d'outil outi l . En ce sens la structure du monde
implique que nous ne puissions nous insrer dans l e champ d'ustensi
lit qu' en tant nous-mme ustensile, que nous ne puissions agir sans
tre agis. Seulement, d'autre part, un complexe d'ustensiIit ne peut
se dvoiler que par la dtermination d'un sens cardinal de ce
complexe et cette dtermination est elle-mme pratique et active -
planter un cl ou, semer des grai nes. En ce cas, l'existence mme du
complexe renvoie immdiatement un centre. Ainsi ce centre est l a
fois un outil objectivement dfini par l e champ instrumental qui se
rfre lui et la fois l'outil que nous ne pouvons pas utiliser puisque
nous serions renvoys l'infini. Cet instrument, nous ne l'employons
pas, nous l e sommes. II ne nous est pas donn autrement que par
l'ordre ustensi l e du monde, par l'espace hodologique, par les
relations univoques ou rciproques des machines, mais i l ne saurait
tre donn mon action : je n'ai pas m' y adapter ni y adapter un
autre outi l , mais i l est mon adaptation mme aux outils, l'adaptation
que je suis. C'est pourquoi , si nous mettons part la reconstruction
analogi que de mon corps d'aprs l e corps d'autrui, i l reste deux
manires de saisir le corps : ou bien i l est connu et dfini objective
ment partir du monde, mais vide ; i l suffit pour cela que la pense
rationalisante reconstitue l'instrument que je suis partir des
363
indications que donnent les ustensiles que j'utilise, mais en ce cas
l'outil fondamental devient un centre de rfrence relatif qui suppose
lui-mme d' autres outils pour l'utiliser, et, du mme coup, l ' instru
mentalit du monde disparat, car elle a besoin, pour se dvoiler,
d'une rfrence un centre absolu d'instrumentalit ; l e monde de
l'action devient l e monde agi de l a science classique, l a conscience
survole un univers d' extriorit et ne peut plus entrer dans le monde
d' aucune manire. Ou bien le corps est donn concrtement et plein
comme la di sposition mme des choses, en tant que l e pour-soi la
dpasse vers une disposition nouvelle ; en ce cas i l est prsent dans
toute acti on, encore qu'invisible -car l'action rvle l e marteau et
les clous, l e frein et l e changement de vitesse, non l e pied qui freine
ou la main qui martle -, il est vcu et non connu. C'est ce qui
explique que la fameuse sensation d'effort par quoi Maine de
Biran tentait de rpondre au dfi de Hume est un mythe psychologi
que. Nous n'avons jamais l a sensation de notre effort , mais nous
n'avons pas non plus les sensations priphriques, musculaires,
osseuses, tendineuses, cutanes par lesquelles on a tent de la
remplacer : nous percevons l a rsistance des choses. Ce que je perois
quand je veux porter ce verre ma bouche, ce n'est pas mon effort,
c'est sa lourdeur, c'est--dire sa rsistance entrer dans un complexe
ustensile, que j 'ai fait paratre dans le monde. Bachelard
1
reproche
avec raison la phnomnologie de ne pas tenir assez compte de ce
qu'il nomme coefficient d'adversit des objets. Cela est juste et
vaut pour la transcendance de Heidegger comme pour l'i ntentionna
lit husserlienne. Mais i l faut bien comprendre que l ' ustensilit est
premire : c'est par rapport un complexe d' ustensilit originel que
les choses rvlent leurs rsistances et leur adversit. La vis se rvle
trop grosse pour se visser dans l 'crou, l e support trop fragile pour
supporter le poids que je veux soutenir, la pierre trop lourde pour
tre souleve j usqu' la crte du mur, etc. D'autres objets appara
tront comme menaants pour un complexe-ustensile dj tabli,
l'orage et l a grle pour la moisson, l e phylloxra pour l a vigne, l e feu
pour la maison. Ainsi , de proche en proche et travers les complexes
d'ustensilit dj tablis, l eur menace s'tendra jusqu'au centre de
rfrence que tous ces ustensiles indiquent et elle l'indiquera son
tour travers eux. En ce sens, tout moyen est la fois favorable et
adverse, mais dans les limites du projet fondamental ralis par le
surgissement du pour-soi dans le monde. Ainsi mon corps est-il
indiqu originel l ement par les complexes-ustensiles et secondaire
ment par les engins destructeurs. Je vis mon corps en danger sur les
engins menaants comme sur les instruments dociles. I l est partout :
la bombe qui dtruit ma maison entame aussi mon corps, en tant que
1 . Bachelard : L'Eau er les Rves, 1942. Editions Jos Corti.
364
la maison tait dj une indication de mon corps. Cest que mon corps
s'tend toujours travers l'outil qu' il utilise : il est au bout du bton
sur l equel je m' appui e, contre la terre ; au bout des lunettes
astronomiques qui me montrent les astres ; sur la chaise, dans la
maison tout entire, car il est mon adaptation ces outils.
Ainsi, au terme de ces exposs, la sensation et l'action se sont
rejointes et ne font plus qu' une. Nous avons renonc nous doter
d'abord d'un corps pour tudier ensuite l a faon dont nous saisissons
ou modifions le monde travers l ui . Mais, au contraire , nous avons
donn pour fondement au dvoilement du corps comme tel notre
relation origi nel l e au monde, c'est--dire notre surgissement mme au
milieu de l'tre. Loin que le corps soit pour nous premier et qu'il nous
dvoile les choses, ce sont les choses-ustensiles qui, dans l eur
apparition originell e, nous indiquent notre corps. Le corps n' est pas
un cran entre les choses et nous : il manifeste seulement l'individua
lit et la contingence de notre rapport originel aux choses-ustensiles.
En ce sens, nous avions dfini le sens et l'organe sensible en gnral
comme notre tre-dans-le-monde en tant que nous avons l'tre sous
forme d'tre-au-milieu-du monde. Nous pouvons dfinir pareillement
l'action comme notre tre-dans-le-monde, en tant que nous avons
l'tre sous forme d't re-instrument-au-milieu-du-monde. Mais si j e
suis au milieu du monde, c'est parce que j' ai fait qu' il y ait un monde
en transcendant J'tre vers moi-mme ; et si je suis instrument du
monde, c'est parce que j'ai fait qu'il y ait des instruments en gnral
par le projet de moi-mme vers mes possibles. Ce n'est que dans un
monde qu' il peut y avoir un corps et une relation premire est
indispensable pour que ce monde existe. En un sens le corps est ce
que je suis i mmdiatement ; en un autre sens j' en suis spar par
l'paisseur infinie du monde, il m' est donn par un reflux du monde
vers ma facticit et l a condition de ce reflux perptuel est un perptuel
dpassement.
Nous pouvons prsent prciser la nature-pour-nous de notre
corps. Les remarques prcdentes nous ont permis, en effet, de
conclure que le corps est perptuel l ement l e dpass. Le corps, en
effet, comme centre de rfrence sensi bl e, c'est ce au del de quoi je
suis, en tant que je suis immdiatement prsent au verre ou la table
ou l'arbre lointain que j e perois. La perception, en effet, ne peut se
faire qu' la place mme o J ' objet est peru et sans distance. Mais en
mme temps ell e dploie les distances et ce par rapport quoi l'objet
peru indique sa distance comme une proprit absolue de son tre,
c'est le corps. Pareillement, comme centre instrumental des com
plexes ustensiles, l e corps ne peut tre que le dpass : il est ce que je
dpasse vers une combinaison nouvelle des complexes et ce que
j'aurai perptuel l ement dpasser, quelle que soit la combinaison
instrumentale laquelle je serai parvenu, car toute combinaison, ds
365
que mon dpassement la fige dans son tre, indique le corps comme l e
centre de rfrence de son immobilit fige. Ainsi l e corps, tant l e
dpass, est l e Pass. C'est l a prsence immdiate au pour-soi des
chos es sensibles , en tant que cette prsence indique un .:entre de
rfrence et qu'elle est dj dpasse, soit vers l'apparition d'un
nouveau ceci, soit vers une combinaison nouvelle de choses-usten
sil es. Dans chaque projet du pour-soi , dans chaque perception, le
corps est l, i l est le Pass immdiat en tant qu'il affleure encore au
Prsent qui l e fuit. Cela signifie qu'il est l a fois point de vue et point
de dpart : un poi nt de vue, un point de dpart que je suis et que j e
dpasse l a fois vers ce que j 'ai tre. Mais ce point de vue
perptuellement dpass et qui renat perptuellement au cur du
dpassement, ce point de dpart que je ne cesse de franchir et qui est
moi-mme restant en arrire de moi , il est l a ncessit de ma
conti ngence. Ncessaire, il l'est doublement . D'abord parce qu'il est
le ressaisissement continuel du pour-soi par l ' en-soi et l e fait
ont ologique que le pour-soi ne peut tre que comme l'tre qui n'est
p
as son propre fondement : avoir un corps, c'est tre l e fondement de
son propre nant et ne pas tre l e fondement de son tre ; j e suis mon
corps dans la mesure o je suis ; j e ne l e suis pas dans la mesure o je
ne suis pas ce que j e suis ; c'est par ma nantisation que j e l ui
chappe. Mais je n' en fais pas pour cela un objet : car c'est
perptuellement ce que je suis que j'chappe. Et le corps est
ncessaire encore comme l'obstacle dpasser pour tre dans le
monde, c'est--dire l'obstacle que je suis moi-mme. En ce sens, il
n'est pas di ffrent de l ' ordre absolu du monde, cet ordre que j e fais
arriver l'tre en l e dpassant , vers un tre--venir, vers l ' tre-par
del-l'tre. Nous pouvons saisir clairement l' unit de ces deux
ncessits : tre-pour-soi c'est dpasser le monde et faire qu'il y ait un
monde en l e dpassant. Mais dpasser l e monde, c'est prcisment ne
pas l e survol er, c' est s'engager en lui pour en merger, c'est
ncessairement se faire cette perspective de dpassement. En ce sens
l a finitude est condition ncessaire du projet originel du pour-soi. La
condition ncessaire pour que je sois, par del un monde que je fais
venir l ' tre, ce que je ne suis pas et que je ne sois pas ce que je suis,
c'est qu'au cur du pourchas infini que j e suis, il y ait perptuelle
ment un insaisissable donn. Ce donn que j e suis sans avoir l'tre
- sinon sur le mode du n'tre-pas - j e ne puis ni l e saisir ni le
connatre, car il est partout repris et dpass, utilis pour mes projets,
assum. Mais d'autre part tout me l' indique, tout le transcendant
l'esquisse en creux par sa transcendance mme, sans que je puisse
j amais me retourner sur ce qu' il i ndi que puisque je suis l'tre indiqu.
En particulier il ne faut pas entendre l e donn i ndiqu comme pur
centre de rfrence d'un ordre statique des choses-ustensiles ; mais au
contraire leur ordre dynamique, qu' i l dpende ou non de mon action,
366
s'y rfre selon des rgles et, par l mme, le centre de rfrence est
dfini dans son changement comme dans son identit. Il ne saurait en
tre autrement puisque c'est en ni ant de moi-mme que je sois l'tre,
que j e fais venir le monde l'tre et puisque c'est partir de mon
pass, c'est--dire en me proj etant au del de mon tre propre, que je
pui s ni er de moi-mme que j e soi s tel ou tel tre. De ce poi nt de vue le
corps, c'est--dire cet insaisissable donn, est une condition nces
saire de mon action : si, en effet, l es fins que je poursuis pouvaient
tre atteintes par vu purement arbitraire, s'il suffisait de souhaiter
pour obtenir et si des rgles dfi ni es ne dterminaient pas l 'usage des
ustensiles, j e ne pourrais j amais distinguer en moi le dsir de la
volont, ni le rve de l'acte, ni le possible du rel . Aucun pro-jet de
moi-mme ne serait possi bl e puisqu'il suffirait de concevoir pour
raliser ; par suite mon t re-pour-soi s'anantirait dans l ' indistinction
du prsent et du futur. Une phnomnologie de l'action montrerait,
en effet , que l'acte suppose une solution de continuit entre la simple
conception et la ralisation, c'est--dire entre une pense universelle
et abstraite : il faut que l e carburateur de l 'auto ne soit pas
encrass , et une pense technique et concrte dirige sur ce
carburateur tel qu'il m'apparat avec ses dimensions absolues et sa
position absolue. La condition de cette pense technique, qui ne se
distingue pas de l'acte qu' el l e dirige, c'est ma finitude, ma contin
gence, ma facticit enfi n. Or, prcisment, je suis de fait en tant que
j'ai un pass et ce pass immdiat me renvoie l'en-soi premier sur
nantisation de quoi je surgis par la naissance. Ainsi le corps comme
facticit est l e pass en tant qu' il renvoie originellement une
naissance, c'est--dire la nantisation premire qui me fait surgir de
l'en-soi que je suis de fait sans avoir l'tre. Naissance, pass,
contingence, ncessit d' un point de vue, condition de fait de toute
action possible sur le monde : tel est le corps, tel il est pour moi. Il
n'est donc nullement une addition contingente mon me, mais au
contraire une structure permanente de mon tre et la condition
permanente de possibilit de ma conscience comme conscience du
monde et comme projet transcendant vers mon futur. De ce point de
vue nous devrons reconnatre la fois qu'il est tout fait contingent et
absurde que je sois infirme, fils de fonctionnaire ou d'ouvrier,
irascible et paresseux et qu' il est pourtant ncessaire que je sois cela
ou autre chose, Franais ou Al lemand ou Anglais, etc. , proltaire ou
bourgeois, ou aristocrate, etc., infirme et chtif ou vigoureux,
irascible ou de caractre concil iant , prcisment parce que j e ne puis
survoler le monde sans que le monde s'vanouisse. Ma naissance, en
tant qu' el l e conditionne l a faon dont les objets se dvoilent moi (les
objets de luxe ou de premire ncessit sont plus ou moins accessi
bles, certaines ralits sociales m' apparaissent comme interdites, il y a
des barrages et des obstacles dans mon espace hodologique), ma race
367
en tant qu'elle est indique par l'attitude d'autrui vis--vis de moi (ils
se rvlent comme mprisants ou admiratifs, comme en confiance ou
en dfiance), ma classe en tant qu'elle se rvle par l e dvoilement de
la communaut sociale laquelle j 'appartiens, en tant que les lieux
que je frquente s' y rfrent ; ma nationalit, ma structure physiologi
que, en tant que les instruments l'impliquent par la faon mme dont
ils se rvlent rsistants ou dociles et par leur coefficient mme
d'adversit, mon caractre, mon pass, en tant que tout ce que j'ai
vcu est indiqu comme mon point de vue sur l e monde par le monde
lui-mme : tout cela, en tant que je l e dpasse dans l'unit synthti
que de mon tre-dans-le-monde, c'est mon corps, comme condition
ncessaire de l ' existence d'un monde et comme ralisation contin
gente de cette condition. Nous saisissons prsent dans toute sa clart
la dfinition que nous donnions plus haut du corps dans son tre
pour-nous : le corps est l a forme contingente que prend la ncessit
de ma contingence. Cette contingence, nous ne pouvons jamais la
saisir comme tell e, en tant que notre corps est pour nous ; car nous
sommes choix et tre c'est, pour nous, nous choisir. Mme cette
infirmit dont je souffre, du fait mme que je vis, j e l'ai assume, je la
dpasse vers mes propres projets, j 'en fais l'obstacle ncessaire pour
mon tre et j e ne puis tre infirme sans me choisir infirme, c'est--dire
choisir la faon dont j e constitue mon i nfirmit (comme intolra
bl e
, humil iante , dissimuler , rvler tous , objet
d'orgueil , j ustification de mes checs etc. ). Mais cet insaisissa
bl e corps, c'est prcisment l a ncessit qu'il y ait un choix, c'est-
dire que je ne sois pas tout la fois. En ce sens ma finitude est
condition de ma libert , car il n' y a pas de libert sans choix et, de
mme que le corps conditionne la conscience comme pure conscience
du monde, il la rend possible jusque dans sa libert mme.
Reste concevoir ce que le corps est pour moi, car, prcisment
parce qu'il est insaisissabl e, il n'appartient pas aux objets du monde,
c'est--dire ces objets que je connais et que j 'utilise ; et pourtant,
d'un autre ct, puisque je ne puis rien tre sans tre conscience de ce
que je suis, il. faut qu' i l soit donn en quelque manire ma
conscience. En un sens, certes, i l est ce qu'indiquent tous les
ustensiles que je saisis et j e l 'apprhende sans l e connatre dans les
indications mmes que je perois sur les ustensiles. Mais si nous nous
bornions cette remarque, nous ne saurions distinguer, par exemple,
l e corps de l a lunette astronomique travers laquelle l'astronome
regarde les pl antes. Si, en effet, nous dfinissons le corps comme
point de vue contingent sur le monde, i l faut reconnatre que la notion
de point de vue suppose un double rapport : un rapport avec les
choses sur lesquelles il es! point de vue et un rapport avec l'observa
teur pour lequel il es! point de vue. Cette deuxime relation est
radical ement diffrente de la premire, lorsqu'il s'agit de corps-point-
368
de-vue ; el l e ne s'en distingue pas vraiment lorsqu'il s'agit d'un point
de vue dans l e monde (lorgnettes, belvdre, loupe, etc.) qui soit un
instrument objectif distinct du corps. Un promeneur qui contemple
un panorama d'un belvdre voit aussi bien le belvdre que l e
panorama : i l voit les arbres entre les colonnes du belvdre, l e toit
du belvdre lui cache le ci el , etc. Toutefois la distance entre l ui
et l e belvdre est, par dfinition, moins grande qu'entre ses yeux et
l e panorama. Et l e point de vue peut se rapprocher du corps, jusqu'
se fondre presque avec lui, comme on voi t , par exemple, dans le cas
des l unettes, lorgnons, monocles, etc. , qui deviennent, pour ainsi
dire, un organe sensible supplmentaire. A l a limite - et si nous
concevons un point de vue absolu -la distance entre lui et celui pour
qui il est point de vue s'anantit. Cela signifie qu'il deviendrait
impossible de se reculer pour prendre du champ et constituer sur
le point de vue un nouveau point de vue. C'est l prcisment, nous
l'avons vu, ce qui caractrise le corps. Il est l 'instrument que j e ne
puis utiliser au moyen d'un autre instrument, l e point de vue sur
lequel je ne puis plus prendre de point de vue. C'est que, en effet, sur
l e sommet de cette col l i ne, que je nomme prcisment un beau
point de vue j e prends un point de vue, dans l' i nstant mme o j e
regarde l a valle, et ce point de vue sur le point de vue est mon corps.
Mais sur mon corps je ne saurais prendre de point de vue sans un
renvoi l ' i nfini . Seulement, de ce fait, l e corps ne saurait tre pour
moi transcendant et connu ; la conscience spontane et irrflchie
n'est plus conscience du corps. Il faudrait plutt dire, en se servant
comme d'un transitif du verbe exister, qu' eUe existe son corps. Ainsi
la relation du corps-point-de-vue aux choses est une relation objective
et la relation de la conscience au corps est une relation existentielle.
Que devons-nous entendre par cette dernire relation ?
Il est vident, tout d'abord, que la conscience ne peut exister son
corps que comme consci ence. Ainsi donc mon corps est une structure
consciente de ma conscience. Mais, prcisment parce qu'il est le
point de vue sur lequel il ne saurait y avoir de point de vue, il n'y a
point, sur le plan de la conscience irrfchi e, une conscience du
corps. Le corps appartient donc aux structures de la conscience non
thtique (de) soi . Pouvons-nous cependant l'identifier purement et
simplement cette conscience non-thtique ? Cela n'est pas possible
non plus car la conscience non-thtique est conscience (de) soi en tant
que projet l ibre vers une possibilit qui est sienne, c'est--dire en tant
qu'elle est le fondement de son propre nant. L conscience non
positionnelle est conscience (du) corps comme de ce qu'elle surmonte
et nantit en se faisant conscience, c'est--dire comme de quelque
chose qu' el l e est sans avoir l ' tre et par-dessus quoi elle passe pour
tre ce qu'elle a tre. En un mot, la conscience (du) corps est
latrale et rtrospective ; l e corps est le nglig, le pass sou
369
silence , et cependant c'est ce qu'elle est ; elle n'est mme rien
d'autre que corps, le reste est nant et silence. La conscience du corps
est comparable la conscience du signe. Le signe, d'ailleurs, est du
ct du corps, c' est une des structures essentielles du corps. Or l a
c
onscience du signe existe, sinon nous ne pourrions comprendre l a
signification. Mais l e signe est l e dpas vers la signification, ce qui
est nglig au profit du sens, ce qui n'est j amais saisi pour soi-mme,
ce au del de quoi l e regard se dirige perptuellement. La conscience
(du) corps tant conscience latrale et rtrospective de ce qu'elle est
sans avoir l 'tre, c'est--dire de son insaisissable contingence, de ce
partir de quoi el l e se fait choix, est conscience non-thtique de l a
manire dont el l e est affecte. La conscience du corps se confond avec
l 'affectivit origi nel l e, Encore faut-il bi en saisir le sens de cette
affectivit ; et, pour cela, une distinction est ncessaire. L'affectivit,
tel l e que l 'introspection nous l a rvle en effet, est dj affectivit
constitue ; elle est conscience du monde. Toute haine est haine de
quelqu'un ; toute colre est apprhension de quelqu'un comme
odieux ou injuste ou fauti f; avoir de l a sympathie pour quelqu'un
c'est l e trouver sympathique , etc. Dans ces diffrents exemples,
une intention transcendante se dirige vers l e monde et l'appr
hende comme tel . Il y a donc dj dpassement, ngation interne ;
nous sommes sur le plan de la transcendance et du choix. Mais
Scheler a bien marqu que cette intention doit se distinguer des
qualits affectives pures. Par exemple, si j'ai mal la tte , je puis
dcouvrir en moi une affectivit intentionnelle dirige vers ma
douleur pour l a souffrir pour l ' accepter avec rsignation ou pour
la rejeter, pour l a valoriser (comme injust e, comme mrite, comme
purifiant e, comme humil iante, etc. ) , pour l a fuir. Ici, c'est l'intention
mme qui est affection, elle est acte pur et dj projet, pure
conscience de quelque chose. Ce ne saurait tre el l e qui peut tre
considre comme conscience (du) corps.
Mais, prcisment , cette intention ne saurait tre le tout de
l'affectivit. Puisqu'elle est dpassement, el l e suppose un dpass.
C'est ce que prouve d'ailleurs l ' existence de ce que Baldwin appelle
improprement des abstraits motionnels Cet auteur, en effet, a
tabli que nous pouvions raliser affectivement en nous certaines
motions sans les ressentir concrtement . Si, par exempl e, on me
raconte tel vnement pnible qui vient d' assombrir la vie de Pierre,
je m'crierai : Comme il a d souffrir ! Cette souffrance, je ne l a
connais pas et cependant j e ne l a ressens pas en fait. Ces interm
diaires entre l a connaissance pure et l'affection vraie, Baldwin les
nomme abstraits Mai s l e mcanisme d' une semblable abstraction
demeure bien obscur. Qui abstrai t ? Si , selon la dfinition de
M. Laporte, abstraire c'est penser part des structures qui ne
peuvent exister spares, i l faut ou bien que nous assimilions les
370
abstraits motionnels de purs concepts abstraits d'motions ou que
nous reconnaissions que ces abstraits ne peuvent exister en tant que
tels comme modalits relles de la conscience. En fait, l es prtendus
abstraits motionnels sont des i ntentions vides, de purs projets
d'motion. C'est--dire que nous nous dirigeons vers la douleur et l a
honte, nous nous tendons vers el l es, l a consci ence se transcende mais
vide. La douleur est l, objective et transcendante, mais i l lui
manque l ' existence concrte. Il vaudrait mieux appeler ces significa
tions sans matire des images affectives ; leur i mportance pour la
cration artistique et la comprhension psychologique est i ndni able.
Mais ce qui importe ici , c'est que ce qui les spare d'une honte relle
c'est l 'absence du vcu . Il existe donc des qualits affectives pures
qui sont dpasses et transcendes par des projets affectifs. Nous n'en
ferons point, comme Scheler, on ne sait hyl emporte par
le flux de la conscience : il s'agit simplement pour nous de la faon
dont la conscience existe sa contingence ; c'est la texture mme de la
conscience en tant qu' elle dpasse cette texture vers ses possibilits
propres, c'est l a manire dont l a conscience existe, spontanment et
sur l e mode non-thtique, ce qu' el l e constitue thtiquement mais
implicitement comme point de vue sur l e monde. Ce peut tre la
douleur pure, mais ce peut tre aussi l ' humeur, comme tonalit
affective non-thtique, l ' agrable pur, l e dsagrable pur ; d'une
faon gnrale, c'est tout ce que l ' on nomme l e cnesthsique. Ce
cnesthsique parat rarement sans tre dpass vers l e monde
par un projet transcendant du pour-soi ; comme tel , il est fort difficile
de l'tudier part. Pourtant i l existe quelques expriences privilgies
o l'on peut le saisir dans sa puret , en particulier celle de la douleur
qu'on nomme physique . C'est donc cette exprience que nous
allons nous adresser pour fixer conceptuellement les structures de la
conscience (du) corps.
J'ai mal aux yeux mais j e dois finir ce soir l a l ecture d'un ouvrage
philosophique. Je lis. L'objet de ma consci ence est le livre et,
travers le livre, les vrits qu'il signifie. Le corps n'est nullement saisi
pour lui-mme, i l est point de vue et point de dpart : les mots
glissent les uns aprs les autres devant moi , je les fais glisser, ceux du
bas de l a page, que je n'ai pas encore vus, appartiennent encore un
fond relatif ou fond-page qui s'organise sur l e fond-livre et sur
le fond absolu ou fond de monde ; mais du fond de leur indistinction
ils m'appel l ent, ils possdent dj le caractre de totalit friable, ils se
donnent comme faire glisser sous ma vue . En tout cela, le corps
n'est donn qu'implicitement : le mouvement de mes yeux n' apparat
qu'au regard d'un observateur. Pour moi , je ne saisis thtiquement
que ce surgissement fig des mots, les uns aprs les autres. Pourtant ,
la succession des mots dans l e temps objectif est donne et connue
travers ma temporalisation propre. Leur mouvement immobile est
371
donn travers un mouvement , de ma conscience ; et ce mouve
ment de conscience, pure mtaphore qui dsigne une progression
temporelle, c' est exactement pour moi l e mouvement de mes yeux : il
est i mpossible que je distingue le mouvement de mes yeux de la
progression synthtique de mes consciences sans recourir au point de
vue d' autrui. Pourtant, dans le moment mme o j e lis j'ai mal aux
yeux. Notons d'abord que cette douleur peut elle-mme tre indique
par l es objets du monde, c'est--dire par le livre que je lis : les mots
peuven t s'arracher avec plus de difficult au fond indiffrenci qu'ils
constituent ; ils peuvent trembler, papilloter, leur sens peut se donner
malaisment, l a phrase que je viens de l i re peut se donner deux fois,
trois fois comme non comprise , comme relire . Mais ces
indications mmes peuvent faire dfaut -par exempl e, dans le cas o
ma l ecture m'absorbe et o j 'oubl i e ma doul eur (ce qui ne
signifie nul l ement qu' ell e a disparu, puisque, si je viens en prendre
connaissance dans un acte rflexif ultrieur, elle se donnera comme
ayant toujours t l) ; et, de toute faon, ce n'est pas l ce qui nous
intresse, nous cherchons saisir l a manire dont l a conscience existe
sa doul eur.
Mais dira-t-on, avant tout, comment la douleur se donne
t-elle comme douleur des yeu? N'y a-t-il pas l un renvoi intention
nel un objet transcendant, mon corps en tant prcisment qu' il
existe dehors, dans l e monde ? II est incontestable que l a douleur
conti ent un renseignement sur elle-mme : i l est impossi bl e de
confondre une doul eur des yeux avec une doul eur du doigt ou de
l'estomac. Pourtant , l a douleur est totalement dpourue d'intention
nalit. Il faut s'entendre : si la douleur se donne comme douleur des
yeux i l n' y a
pas l de mystrieux signe local ni non plus de
connaissance. Seul ement l a douleur est prcisment les yeux en tant
que l a conscience l es existe . Et comme telle, elle se distingue par
son existence mme, non par un critre ni par rien de surajout, de
toute autre douleur. Certes, la dnomination : douleur des yeux
suppose tout un travail constitutif que nous aurons dcrire. Mais au
moment o nous nous plaons il n' y a pas encore l i eu de le considrer,
car il n'est pas fait : l a douleur n'est pas envisage d'un point de vue
rflexif, elle n' est pas rapporte un corps-po ur-autrui. Elle est
douleur-yeux ou doul eur-vision ; el l e ne se distingue pas de ma faon
de saisir les mots transcendants. C'est nous qui l'avons nomme
douleur des yeux, pour la clart de l 'exposition ; mais elle n'est pas
nomme dans la conscience, car el l e n'est pas connue. Simplement
elle se distingue, i neffablement et par son tre mme, des autres
douleurs possi bl es.
Cette douleur, cependant, n'existe nul l e part parmi les objets
actuels de l ' univers. Elle n'est pas droite ni gauche du livre, ni
parmi les vrits qui se dvoilent travers l e livre, ni dans mon corps
objet (celui que voit autrui, celui que je peux toucher partiellement et
372
partiell ement voir), ni dans mon corps-point-de-vue en tant qu'il est
implicitement indiqu par le monde. Il ne faut pas dire non plus
qu'elle est en surimpression comme une harmonique, super
pose aux choses que je vois. Ce sont l des i mages qui n'ont pas de
sens. El l e n'est donc pas dans l'espace. Mais elle n'appartient pas non
pl us au temps objectif : el l e se temporalise et c'est dans et par cette
temporalisation que peut apparatre l e temps du monde. Qu'est-elle
donc ? Simplement la matire translucide de la conscience, son tre
l, son rattachement au monde, en un mot la contingence propre de
l'acte de lecture. El l e existe par del toute attention et toute
connaissance, puisqu'elle se glisse dans chaque acte d'attention et de
connaissance, puisqu'ell e est cet acte mme, en tant qu'il est sans tre
fondement de son tre.
Et pourtant, mme sur ce pl an d'tre pur, l a douleur comme
rattachement contingent au monde ne peut tre existe nop thtique
ment par la conscience que si el le est dpasse. La conscience
douloureuse est ngation interne du monde ; mais en mme temps
elle existe sa douleur-c'est--dire soi-mme -comme arrachement
soi. La douleur pure, comme simple vcu, n'est pas susceptibl e
d'tre atteinte : el l e serait de l 'espce des indfinissables et des
indescriptibles, qui sont ce qu'ils sont. Mais l a conscience doulou
reuse est projet vers une conscience ultrieure qui serait vide de toute
douleur, c'est--dire dont la contexture, dont l ' tre-l serait non
douloureux. Cet chappement latral, cet arrachement soi qui
caractrise l a conscience douloureuse ne constitue pas pour autant la
douleur comme objet psychique : c' est un projet non-thtique du
pour-soi ; nous ne l 'apprenons que par l e monde, par exemple i l est
donn dans l a faon dont l e livre apparat comme devant tre l u
un rythme prcipit dont les mots se pressent les uns contre l es
autres, dans une ronde infernale et fige, dont l'univers tout entier est
frapp d'inquitude. Par ailleurs - et c'est l e propre de l'existence
corporelle - l'ineffable qu'on veut fuir se retrouve au sein de cet
arrachement mme, c'est l ui qui va constituer l es consciences qui l e
dpassent, i l est l a contingence mme et l'tre de l a fuite qui veut l e
fuir. Nul l e part ailleurs nous ne toucherons de plus prs cette
nantisation de l'en-soi par l e pour-soi et l e ressaisissement du pour
soi par l'en-soi qui alimente cette nantisation mme.
Soit, dira-t-on. Mai s vous vous faites l a partie trop bel l e en
choisissant un cas o la doul eur est prcisment douleur de l'organe
en fonction, douleur de l'il pendant qu'il regarde, de la mai n
pendant qu' el l e saisit. Car enfi n, j e pui s souffrir d' une blessure au
doigt pendant que j e lis. En ce cas, i l serait difficile de soutenir que
ma douleur est la contingence mme de mon acte de l ire .
Notons d'abord que, si absorb que j e puisse tre par ma lecture, j e
ne cesse pas pour autant de faire venir l e monde l ' tre ; mieux : ma
373
lecture est un acte qui implique dans sa nature mme l'existence du
monde comme un fond ncessaire. Cela ne signifie nullement que
j'aie une moi ndre conscience du monde mais que j'en ai conscience
comme fond. Je ne perds point de vue les couleurs, les mouvements
qui m' entourent, je ne cesse pas d'entendre les sons, simplement ils se
perdent dans la totalit i ndiffrencie qui sert de fond ma lecture.
Corrlativement, mon corps ne cesse d'tre indiqu par le monde
comme le point de vue total sur la totalit mondaine, mais c'est l e
monde comme fond qui l ' i ndique. Ainsi, mon corps ne cesse pas
d'tre exist en totalit dans l a mesure o i l est la contingence totale de
ma conscience. Il est la fois ce que la totalit du monde comme fond
indique et la totalit que j 'existe affectivement en connexion avec
l'apprhe
nsion objective du monde. Mais dans la mesure o un ceci
particul i er se dtache comme forme sur fond de monde, i l indique
corrlat ivement vers une spcification fonctionnelle de [ a totalit
corporel l e et, du mme coup, ma conscience existe une forme cor
porelle qui s'enlve sur l a totalit-corps qu'elle existe. Le [ivre est l u
et , dans l a mesure o j 'existe et o je dpasse l a contingence de l a
vision ou, si [ 'on veut, de l a lecture, les yeux paraissent comme forme
sur fond de totalit corporel l e. Bi en entendu, sur ce plan d'existence,
les yeux ne sont pas l'organe sensoriel vu par autrui, mais seulement
la contexture mme de ma conscience de voir, en tant que cette
conscience est une structure de ma conscience plus large du monde.
Avoir conscience, en effet , c'est toujours avoir conscience du monde
et ainsi l e monde et le corps sont toujours prsents, quoique de faon
diffrente, ma consci ence. Mais cette conscience totale du monde
est conscience du monde comme fond pour tel ou tel ceci particulier et
ainsi, de mme que [ a conscience se spcifie dans son acte mme de
nantisation, i [ y a prsence d'une structure singulire du corps sur
fond total
de
corporit. Dans [ e moment mme o je lis, je ne cesse
donc pas d'tre un corps, assis dans tel fauteui l , trois mtres de l a
fentre, dans des conditions de pression et de temprature donnes.
Et cette douleur mon index gauche, je ne cesse pas de l'exister
comme mon corps en gnral. Seulement, je l'existe en tant qu'elle
s'vanouit dans [ e fond de corporit comme une structure subordon
ne [a totalit corporelle. El l e n'est ni absente ni i nconsciente :
simplement el l e fait partie de cette existence sans distance de l a
conscience positionnelle pour elle-mme. Si , tout ['heure , je tourne
les pages du livre, la douleur de mon index, sans deveni r pour cela
objet de connaissance, passera au rang de conti ngence existe comme
forme sur une nouvelle organisation de mon corps comme fond total
de contingence. Ces remarques correspondent d'ailleurs cette
observation empi rique : c'est qu'il est plus facile de se distraire
d'une douleur de l'index ou des reins lorsqu'on lit que d' une douleur
des yeux. Car l a douleur des yeux est prcisment ma lecture et les
374
mots que je l i s m' y renvoient chaque instant, au lieu que ma douleur
du doigt ou des reins, tant l'apprhension du monde comme fond,
est elle-mme perdue, comme structure partiel l e, dans le corps
comme apprhension fondamentale du fond de monde.
Mais voici que je cesse de lire, tout coup, et je m'absorbe
prsent saisir ma douleur. Cela signifie que je dirige sur ma
conscience prsente ou conscience-vision une conscience rflexive.
Ainsi la texture actuelle de ma conscience rflchie - en particulier
ma douleur -est apprhende et pose par ma conscience rflexive.
Il faut se rappeler ici ce que nous avons dit de la rflexion : c'est une
saisie totalitaire et sans point de vue, c'est une connaissance dborde
par elle-mme et qui tend s'objectiver, projeter l e connu
distance, pour pouvoir le contempler et le penser. Le mouvement
premier de l a rflexion est donc pour transcender la qualit conscien
tielle pure de douleur vers un objet-douleur. Ainsi , nous en tenir
ce que nous avons nomm rflexion complice, la rflexion tend faire
de la douleur un psychique. Cet objet psychique apprhend travers
la douleur, c'est le mal. Cet objet a toutes les caractristiques de la
douleur mais il est transcendant et passif. C'est une ralit qui a son
temps propre - non pas l e temps de l'univers extrieur ni celui de la
conscience : le temps psychique. Elle peut alors supporter des
apprciations et des dterminations diverses. Comme telle elle est
distincte de la conscience mme et parat travers elle ; elle demeure
permanente pendant que l a conscience volue et c'est cette perma
nence mme qui est condition de l 'opacit et de la passivit du mal.
Mais d'autre part ce mal , en tant que saisi travers la conscience, a
tous les caractres d' uni t, d'intriorit et de spontanit de l a
conscience, mai s dgrads. Cette dgradation lui confre l' individua
lit psychique. C' est--dire tout d'abord qu'il a une cohsion absolue
et sans parties. En outre, i l a sa dure propre, puisqu'il est hors de l a
conscience et possde un pass et un avenir. Mais cette dure qui
n'est que la projection de l a temporalisation originelle est multiplicit
d'interpntration. Ce mal est pntrant , caressant , etc. Et
ces caractristiques ne visent qu' rendre la faon dont ce mal se
profile dans l a dure : ce sont des qualits mlodiques. Une douleur
qui se donne par lancements suivis d'arrts n'est pas saisie par la
rflexion comme pure alternance de consciences douloureuses et de
consciences non douloureuses : pour la rflexion organisatrice, les
brefs rpits font partie du mal, comme l es silences font partie d'une
mlodie. L'ensembl e constitue l e rythme et l'al/ure du mal. Mais en
mme temps qu' il est objet passif, le mal, en tant qu' il est vu travers
une spontanit absolue qui est la conscience, est projection dans
l'en-soi de cette spontanit. En tant que spontanit passive i l est
magique : il se donne comme se prolongeant de lui-mme, comme
entirement matre de sa forme temporelle. Il apparat et disparat
375
autrement que l es objets spatio-temporels : si je ne vois plus la table,
c'est que j 'ai dtourn la tte ; mais si j e ne sens plus mon mal , c'est
qu' il est parti . En fai t , il se produit ici un phnomne analogue
ce que les psychologues de la forme appellent illusion stroboscopique.
La disparition du mal , en dcevant les projets du pour-soi rflexif, se
donne comme mouvement de recul, presque comme volont. Il y a un
ani misme du mal : il se donne comme un tre vivant qui a sa forme, sa
dure propre, ses habitudes. Les malades ont avec l ui une sorte
d'intimit : quand il apparat, ce n'est pas comme un phnomne
neuf, c'est, dira l e malade, ma crise de l ' aprs-midi . Ainsi, la
rflexion ne rel i e pas entre eux l es moments d'une mme crise, mais,
par del une journe entire, el le relie l es crises entre elles
Toutefois, cette synthse de rcognition a un caractre spcial : elle
ne vise pas constituer un objet qui demeurerait existant mme
lorsqu'il ne serait pas donn la conscience ( l a faon d'une haine
qui demeure assoupie ou reste dans l ' inconscient ) . En fait,
quand l e mal s'en va, il disparat pour de bon, il n'y en a plus
\tais i l s'ensuit cette curieuse consquence que, lorsqu'il rapparat, i l
' UIgi t, dans sa passivit mme, par une sorte de gnration sponta
ne Par exempl e, on en sent doucement les approches , l e voici
qui renat : c'est l ui . Ainsi, les premires douleurs, pas plus
que les autres, ne sont apprhendes pour elles-mmes comme
texture simple et nue de l a conscience rflchie : elles sont les
annonces du mal ou mi eux le mal lui-mme, qui nat lentement,
comme une locomotive qui se met l entement en marche. Mais,
d'autre part, il faut bien voir que je constitue l e mal avec de la
douleur. Cela ne signifie nul l ement que je saisisse le mal comme
cause de la douleur, mais pl utt , il en est de chaque douleur concrte
comme d' une note dans une mlodie : elle est la fois la mlodie tout
entire et un temps de la mlodie. A travers chaque douleur, je
saisis l e mal tout entier et pourtant i l les transcende toutes, car i l est la
totalit synthtique de toutes les douleurs, l e thme qui se dveloppe
par elles et travers el l es. Mais la matire du mal ne ressemble pas
celle d' une ml odie : d'abord, c'est du vcu pur, il n' y a aucune
distance de l a conscience rflchie l a douleur ni de la conscience
rflexive la conscience rflchie. Il en rsulte que l e mal est
transcendant mais sans distance. Il est hors de ma consci ence, comme
totalit synthtique, et dj tout prs d'tre ailleurs, mais d'un autre
ct, il est en el l e, i l pntre en el l e, par toutes ses dentelures, par
toutes ses notes qui sont ma conscience.
A ce niveau, qu' est devenu le corps ? Il y a eu, remarquons-l e, une
sorte de scissi on, lors de l a projection rflexive : pour la conscience
irrflchie l a douleur tait l e corps ; pour l a conscience rflexive le
mal est distinct du corps, i l a sa forme propre, i l vient et s'en va.
Au niveau rflexif o nous nous sommes plac, c'est--dire avant
'76
l'interention du pour-autrui, le corps n'est pas explicitement et
thmatiquement donn la conscience. La conscience rflexive est
conscience du mal . Seulement, si le mal a une forme qui lui est propre
et un rythme mlodique qui lui confre une individualit transcen
dant e, il adhre au pour-soi par sa matire, puisqu'il est dvoil
travers la douleur et comme l'unit de toutes mes douleurs de mme
type. Il est mien en ce sens que je l ui donne sa matire. Je l e saisis
comme sou tenu et nourri par un certain milieu passif, dont la passivit
est l'exacte projection dans l'en-soi de la facticit contingente des
douleurs et qui est ma passivit. Ce milieu n'est pas saisi pour lui
mme, sinon comme l a matire de la statue est saisie quand j e perois
sa forme, et pourtant il est l : il est la passivit que ronge le mal et qui
lui donne magiquement de nouvelles forces, comme la terre i Ante.
Cest mon corps sur un nouveau plan d'existence, c'est--dire comme
pur corrlatif nomatique d'une conscience rflexive. Nous l'appelle
rons corps psychique. Il n'est encore aucunement connu, car l a
rflexion qui cherche saisir l a conscience douloureuse n'est pas
encore cognitive . Elle est affectivit en son surgissement origi nel . Elle
saisit bi en l e mal comme un obj et , mais comme un objet affectif. On
se dirige d'abord sur sa douleur pour la har, pour l'endurer avec
patience, pour l'apprhender comme intolrable, quelquefois pour
l'aimer, pour s'en rjouir (si elle annonce la dlivrance, la gurison),
pour l a valoriser de quelque faon. Et, bien entendu, c'est l e mal
qu' on valorise, ou, mi eux, qui surgit comme corrlatif ncessaire de l a
valorisati on. Le mal n' est donc poi nt connu, i l est souffert et le corps,
pareillement, se dvoile par le mal et l a conscience l e souffre
galement . Pour enrichir de structures cognitives le corps tel qu'il se
donne l a rflexion, i l faudra le recours l'autre ; nous ne pouvons en
parler prsent, car i l faut dj avoir mis au j our les structures du
corps-pour-autrui. Cependant, ds a prsent, nous pouvons noter que
ce corps psychi que, tant la projection, sur le plan de l'en-soi, de
l'intracontexture de l a conscience, fait la mati re implicite de tu les
phnomnes de la psych. Tout de mme que le corps originel tait
exist par chaque conscience comme sa contingence propre, le corps
psychique est souffert comme la contingence de la haine ou de
l'amour, des actes et des qualits, mais cette contingence a un
caractre neuf : en tant qu'existe par l a conscience, elle tait l e
ressaisissement de la conscience par l ' en-soi : en tant que soufferte,
dans l e mal ou l a hai ne ou l ' entreprise, par l a rflexion elle est
projete dans l'en-soi. Elle reprsente, de ce fait, la tendance de
chaque objet psychique, par del sa cohsion magique, se morceler
en extriorit, el l e reprsente, par del les rapports magiques qui
unissent l es objets psychiques entre eux, l a tendance de chacun d'eux
s'isoler dans une i nsularit d'indiffrence : c'est donc comme un
espace implicite sous-tendant l a dure mlodique du psychique. En
377
tant que le corps est la matire contingente et indiffrente de tous nos
vnements psychiques, l e corps dtermine un espace psychique. Cet
espace n' a ni haut ni bas, ni droite ni gauche, i l est encore sans
parties, en tant que l a cohsion magique du psychique vient combat
tre sa tendance au morcellement d'indiffrence. Il n'en est pas moins
une caractristique rel l e de l a psych : non que l a psych soit unie
un corps, mais sous son organisation mlodique, le corps est sa
substance et sa perptuelle condition de possibilit. C'est lui qui
parat ds que nous nommons l e psychique ; c' est lui qui est l a base
du mcanisme et du chimisme mtaphoriques dont nous usons pour
classer et pour expli quer les vnements de l a psych ; c'est l ui que
nous visons et que nous informons dans l es images (consci ences
imageantes) que nous produisons pour viser et prsentifier des
sentiments absents ; c'est lui, enfin, qui motive et, en quelque mesure,
justifie des thories psychologiques comme celle de l'inconscient, des
problmes comme celui de l a conservation des souvenirs.
Il va sans dire que nous avons choisi l a douleur physique titre
d' exemple et qu'il y a mi l le autres faons, contingentes elles-mmes,
d'exister notre contingence. En particulier, lorsque aucune douleur,
aucun agrment, aucun dsagrment prcis ne sont exists par l a
conscience, l e pour-soi ne cesse pas de se projeter par del une
contingence pure et pour ainsi di re non qualifie. La conscience ne
cesse pas d'avoi r un corps. L'affectivit cnesthsique est alors
pure saisie non-positionnelle d'une contingence sans couleur, pure
apprhension de soi comme existence de fait. Cette saisie perptuelle
par mon pour-soi d'un got fade et sans distance qui m'accompagne
j usque dans mes efforts pour m'en dlivrer et qui est mon got, c'est
ce que nous avons dcrit ailleurs sous l e nom de Naue. Une nause
discrte et insurmontable rvle perptuellement mon corps ma
conscience : il peut arriver que nous recherchions l'agrable ou la
douleur physique pour nous en dlivrer, mais ds que l a douleur ou
l'agrable sont exists par l a conscience, ils manifestent leur tour sa
facticit et sa contingence et c'est sur fond de nause qu'ils se
dvoil ent. Loin que nous devions comprendre ce terme de nause
comme une mtaphore tire de nos curements physiologiques,
c'est, au contraire, sur son fondement que se produisent toutes l es
nauses concrtes et empiriques (nauses devant l a viande pourri e, le
sang frais, l es excrments, etc. ) qui nous conduisent au vomissement.
378
I l
LE CORPS POUR AUTRUI
Nous venons de dcrire l'tre de mon corps pour-moi. Sur ce plan
ontologique, mon corps est tel que nous l ' avons dcrit et il n 'esi que
cela. En vain y chercherait-on l es traces d' un organe physiologique ,
d'une constitution anatomique e t spatiale. Ou bi en il est le centre de
rfrence i ndiqu vide par l es objets-ustensiles du monde, ou bien i l
est la cOnlingence que le pour-soi exisle ; plus exactement, ces deux
modes d'tre sont complmentaires. Mais l e corps connat les mmes
avatars que l e pour-soi lui-mme : i l a d'autres plans d'existence. Il
existe aussi pour aUlrui. C' est dans cette nouvelle perspective
ontologique que nous devons prsent l'tudier. II revient au mme
d'tudier la faon dont mon corps apparat autrui ou celle dont l e
corps d'autrui m'apparat. Nous avons tabl i , en effet, que l es
structures de mon tre-po ur-autrui sont identiques celles de l'tre
d'autrui pour moi . C'est donc partir de ces dernires que nous
tablirons la nature du corps-po ur-autrui (c'est--dire du corps
d'autrui) pour des raisons de commodi t.
Nous avons montr dans l e prcdent chapitre que l e corps n'est
pas ce qui me manifeste autrui d'abord. Si, en effet, la relation
fondamental e de mon tre celui d'autrui se rduisait au rapport de
mon corps au corps de l 'autre, elle serait pure relation d'extriorit.
Mais ma liaison autrui est inconcevable si el l e n'est pas une ngation
interne. Je dois saisir autrui d'abord comme ce pour quoi j 'existe
comme objet ; l e ressaisissement de mon ipsit fait apparatre autrui
comme objet dans un second moment de l 'historialisation anthistori
que ; l'apparition du corps d'autrui n'est donc pas la rencontre
premire, mai s, au contraire, elle n'est qu' un pisode de mes relations
avec autrui et, plus spcialement , de ce que nous avons nomm
l'objectivation de l'autre ; ou, si l'on veut , autrui existe pour moi
d'abord et je l e saisis dans son corps ensuile ; le corps d'autrui est pour
moi une structure secondaire.
Autrui , dans l e phnomne fondamental de l 'objectivation de
l'autre, m' apparat comme transcendance transcende. C'est--dire
que, du seul fait que j e me projette vers mes possi bi lits, je dpasse et
transcende sa transcendance, elle est hors de jeu ; c'est une transcen
dance-objet. Je saisis cette transcendance dans le monde et, originel
lement, comme une certaine disposition des choses-ustensiles de mon
monde, en tant qu'elles i ndiquent par surcrot un centre de rfrence
secondaire qui est au milieu du monde et qui n'est pas moi. Ces
indications ne sont poi nt, la diffrence des i ndications qui m'indi-
379
quent, consti tutives de la chose indiquante : ce sont des proprits
latral es de l ' objet. Autrui , nous l'avons vu, ne saurait tre un
concept consti t utif du monde. Elles ont donc toutes une contingence
originelle et le caractre d'un vnement. Mais l e centre de rfrence
qu'el l es indi quent est bien l'autre comme transcendance simplement
cont emple ou transcende. C' est bien autrui que me renvoie l a
di sposition secondaire des objets comme l'organisateur ou au
bnficiaire de cette disposition, bref, un i nstrument qui dispose l es
ustensi l es en vue d' une fi n qu' i l produit lui-mme. Mais cette fi n,
son tour, je la dpasse et l'utilise, elle est au milieu du monde et j e
peux m'en servi r pour mes propres fins. Ainsi, autrui est d'abord
i ndi qu par l es choses comme un instrument. Moi aussi, les choses
m' indi quent comme un instrument et je suis corps, prcisment en
t ant que je me fais i ndi quer par l es choses. C'est donc autrui comme
corps que les choses indiquent par leurs dispositions latrales et
secondaires. Le fait est mme que je ne connais pas d'ustensiles qui
ne se rfrent secondairement au corps de l'autre. Mais j e ne pouvais
prendre aucun point de vue, tout l'heure, sur mon corps en tant qu'il
tait dsign par les choses. Il est, en effet , l e point de vue sur l equel
je ne peux prendre aucun poi nt de vue, l ' instrument que je ne peux
uti l i ser au moyen d' aucun instrument. Lorsque, par l a pense
universalisant e, j'essayais de l e penser vide comme pur instrument
au milieu du monde, il en rsultait aussitt l'effondrement du monde
en tant que tel. Au contraire, du seul fait que je ne suis pas l'autre, son
corps m'apparat origi nel l ement comme un point de vue sur lequel je
peux prendre un point de vue, un instrument que j e peux utiliser avec
d'autres i nstruments. Il est indi qu par l a ronde des choses-ustensil es,
mai s i l indique son tour d'autres objets et finalement il s'intgre
mon monde e t c'est mon corps qu' il indique. Ainsi le corps d'autrui
est radicalement diffrent de mon corps-pour-moi : il est l'outil que j e
ne suis pas et que j'utilise (ou qui me rsiste, ce qui revient au mme) .
I l se prsente moi originellement avec un certain coefficient objectif
d'utilit et d'adversit. Le corps d'autrui, c'est donc autrui lui-mme
comme transcendance-instrument. Les mmes remarques s'appli
quent au corps d'autrui comme ensemble synthtique d'organes
sensibles. Nous ne dcouvrons pas dans et par l e corps d'autrui la
possibilit qu'a autrui de nous connatre. Elle se dvoile fondamenta
l ement dans et par mon tre-objet pour autrui, c'est--dire qu'elle est
la structure essentielle de notre relation originelle autrui. Et dans
cette relation origi nel l e, l a fuite de mon monde vers autrui est
galement donne. Par l e ressaisissement de mon ipsit, j e trans
cende l a transcendance d'autrui en tant que cette transcendance est
permanent e possibilit de me saisir comme objet. De ce fait, elle
devient transcendance purement donne et dpasse vers mes buts
propres, transcendance qui est-l simplement et l a connaissance
380
qu'autrui a de moi et du monde devient connaIssance-objet. C'est-
dire qu'elle est une proprit donne d'autrui, proprit que je peux
mon tour connatre. A vrai dire, cette connaissance que j'en prends
demeure vide, en ce sens que je ne connatrai jamais l'acte de
connatre : cet acte tant pure transcendance ne peut tre saisi que
par lui-mme sous forme de conscience non-thtique ou par la
rflexion issue de l ui . Ce que je connais
,
c'est seulement la connais
sance comme tre-l ou, si l'on veut, l'tre-l de la connaissance.
Ainsi , cette relativit de l'organe sensoriel qui se dvoilait ma raison
universalisante, mais qui ne pouvait tre pense -quand il s'agissait
de mon propre sens -sans dterminer l 'effondrement du monde, j e
l a saisis d'abord lorsque j e saisis autrui-objet et j e l a saisis sans
danger, puisque, autrui faisant partie de mon univers, sa relativit ne
saurait dterminer l'effondrement de cet univers. Ce sens d'autrui est
sens connu comme connaissant. On voit comment, l a fois, s'explique
l'erreur des psychologues, qui dfinissent mon sens par le sens
d'autrui et qui donnent l'organe sensible tel qu'il est pour moi une
relativit qui appartient son tre-pour-autrui, et la fois comment
cette erreur devient vrit si nous l a replaons son niveau d'tre
aprs avoir dtermin l'ordre vrai de l'tre et du connatre. Ainsi, les
objets de mon monde i ndiquent latralement un centre-de-rfrence
objet qui est autrui. Mais ce centre, son tour, m'apparat d'un point
de vue sans point de vue qui est le mien, qui est mon corps ou ma
contingence. En un mot, pour employer une expression impropre
mais courante, j e connais autrui par les sens. De mme qu'autrui est
l'instrument que j 'utilise au moyen de l'instrument que j e suis et
qu'aucun instrument ne peut plus utiliser, de mme il est l'ensemble
d'organes sensibles qui se rvlent ma connaissance sensible, c'est-
dire qu'il est une facticit qui apparat une facticit. Ainsi peut-il y
avoir, sa vraie place dans l'ordre du connatre et de l'tre, une tude
des organes sensibles d'autrui tels qu'ils sont connus sensoriellement
par moi. Et cette tude tiendra l e plus grand compte de la fonction de
ces organes sensibles qui est de connatre. Mais cette connaissance,
son tour, sera pur objet pour moi : de l , par exemple, le faux
problme de la vision renverse . En fait, originellement, l'organe
sensoriel d'autrui n'est aucunement un instrument de connaissance
pour autrui, i l est simplement l a connaissance d'autrui, son pur acte
de connatre en tant que cette connaissance existe sur le mode de
l'objet dans mon univers.
Toutefois, nous n'avons encore dfini l e corps d'autrui qu'en tant
qu'il est indiqu latralement par les choses-ustensiles de mon
univers. Cela ne nous donne point, vrai dire, son tre-l de chair
et d'os . Certes, le corps d'autrui est partout prsent dans l'indica
tion mme qu' en donnent les choses-ustensiles en tant qu'elles se
rvlent comme utilises par lui et comme connues par lui. Ce salon
381
o j'attends le matre de maison me rvl e, dans sa totalit, le corps
de son propritaire : ce fauteuil est fauteuil-o-il-s'assied, ce bureau
est bureau-sur-lequel-il-crit, cette fentre est fentre par o entre la
l umire-qui-c\ ai re-Ies-obj ets-qu' il-voit . Ainsi est-il esquiss de
toutes parts et cette esquisse est esquisse-objet ; un objet peut venir
tout i nstant la remplir de sa matire. Mais encore est-il que le matre
de maison
n'est pas l . Il est ailleurs, il est absent.
Mai s, j ustement, nous avons vu que l'absence est une structure de
l'tre-l. Etre a bsent, c'est tre-ailleurs-dans-mon-monde ; c'est tre
dj d onn pour moi. Ds que je reois une lettre de mon cousin
d'Afrique , son tre-ailleurs m'est donn concrtement par les indica
tions mmes de cette lettre, et cet tre-ailleurs est un tre-quelque
part : c'est dj son corps. On n'expliquerait pas autrement que la
lettre mme de l a femme aime meuve sensuellement son amant :
t out le corps de l'aime est prsent comme absence sur ces lignes et
sur ce papier. Mais l'tre-ailleurs tant un tre-l par rapport un
ensemble concret de choses-ustensiles, dans une situation concrte,
est dj facticit et contingence . Ce n'est pas seulement la rencontre
que j e fai s aujourd'hui de Pierre qui dfinit sa contingence et la
mi enne, mais son absence d'hier dfinissait pareillement nos contin
gences et nos facticits. Et cette facticit de l'absent est implicitement
donne dans ces choses-ustensiles qui l'indiquent ; sa brusque appari
tion n'y ajoute rien. Ainsi , le corps d' autrui, c'est sa facticit comme
ustensile et comme synthse d' organes sensibles en tant qu'elle se
rvle ma facticit. Elle m'est donne ds l qu'autrui existe pour
moi dans l e monde, l a prsence d' autrui ou son absence n'y change
rien-
Mais voici que Pierre parat , il entre dans ma chambre. Cette
apparition ne change rien la structure fondamentale de mon rapport
l ui : elle est contingence, mais comme son absence tait contin
gence. Les objets l'indiquent moi : l a porte qu'il pousse indique une
prsence humaine quand elle s'ouvre devant l ui , de mme le fauteuil
o i l s'assied, etc. ; mais les objets ne cessaient de l'indiquer, pendant
son absence. Et, certes, j 'existe pour lui, i l me parle ; mais j' existais
pareillement hi er, lorsqu'il m' envoyait ce pneumatique qui est
prsentement sur ma table pour m' aviser de sa venue. Pourtant, il y a
quelque chose de neuf : c'est qu'il parat prsent sur fond de monde
comme un ceci que je peux regarder, saisir, utiliser directement.
Qu'est-ce que cela signifie ? Tout d'abord, c'est que l a facticit
d'autrui, c'est--dire la contingence de son tre, est explicite
prsent, au l i eu d'tre implicitement contenue dans les indications
latrales des choses-ustensiles. Cette facticit, c'est prcisment celle
qu'il
existe dans et par son pour-soi ; c'est celle qu'il vit perptuelle
ment par la nause comme saisie non-positionne Ile d'une contingence
qu'il est, comme pure apprhension de soi en tant qu'existence de
3
82
fait. En un mot, c'est sa cnesthsie. L'apparition d'autrui est
dvoi lement du got de son tre comme existence immdiate.
Seulement , j e ne saisis pas ce got comme il le saisit. La nause pour
lui n'est pas connaissance, elle est apprhension non-thtique de l a
contingence qu' il est ; el l e est dpassement de cette contingence vers
des possi bilits propres du pour-soi ; elle est contingence existe,
contingence subie et refuse. C'est cette mme contingence -et rien
d'autre -que j e saisis prsentement. Seulement, je ne suis pas cette
contingence. Je l a dpasse vers mes propres possibilits, mais ce
dpassement est transcendance d'un autre. Elle m'est entirement
donne et sans recours ; elle est i rrmdiable. Le pour-soi d'autrui
s'arrache cette contingence et la dpasse perptuellement. Mais, en
tant que je transcende l a transcendance d'autrui, j e l a fige ; elle n'est
plus un recours contre la facticit ; bien au contraire, elle participe
son tour la facticit ; elle en mane. Ainsi, rien ne vient s'interposer
entre la contingence pure d'autrui comme got pour soi et ma
conscience. C'est bien ce got tel qu' il est exist que je saisis.
Seulement, du seul fait de mon altrit, ce got apparat comme un
ceci connu et donn au milieu du monde. Le corps d'autrui m' est
donn comme J'en-soi pur de son tre -en-soi parmi des en-soi et
que j e dpasse vers mes possibilits. Le corps d' autrui se rvle donc
par deux caractristiques galement contingentes : il est ici et pourrait
tre ailleurs, c' est--dire les choses-ustensiles pourraient se disposer
autrement par rapport lui, l'indiquer autrement, les distances de la
chaise lui pourraient tre autres -il est comme ceci et pourrait tre
autrement, c'est--dire que je saisis sa contingence originelle sous
forme d'une configuration objective et contingente. Mais, en ralit,
ces deux caractres ne font qu'un. La seconde ne fait que prsentifier,
qu'expliciter pour moi la premire. Le corps d'autrui, c'est le fait pur
de l a prsence d'autrui dans mon monde comme un tre-l qui se
traduit par un tre-comme-ceci. Ainsi, J'existence mme d' autrui
comme autrui-pour-moi implique qu' i l se dvoile comme outil
possdant l a proprit de connatre et que cette proprit de
connatre soi t l i e une existence quelconque objective. Cest ce que
nous nommerons l a ncessit pour autrui d'tre contingent pour moi.
Ds l qu'il y a un autrui, on doit donc conclure qu'il est un
instrument pourvu d'organes sensibles quelconques. Mai s ces consi
drations ne font que marquer la ncessit abstraite pour autrui
d'avoir un corps. Le corps d' autrui, en tant que je l e rencontre, c'est
le dvoilement comme objet-po ur-moi de la forme contingente que
prend la ncessit de cette contingence. Tout autrui doit avoir des
organes sensibles mais non pas ncessairement ces organes sensibles,
mais non pas un visage et, enfi n, non pas ce visage. Mais visage,
organes sensibles, prsence : tout cela n'est autre chose que l a forme
contingente de l a ncessit pour autrui de s'exister comme apparte-
383
nant une race
,
une classe, un mi l i eu, etc . , en tant que cette forme
contingente est dpasse par une transcendance qui n'a pas l'exister.
Ce qui est got de soi pour autrui devient pour moi chair de l'autre. La
chair est conti ngence pure de la prsence. Elle est ordinairement
masque par le vtement, l e fard, la coupe de cheveux ou de barbe,
J'expression, etc. Mais, au cours d'un long commerce avec une
personne, il vient toujours un instant o tous ces masques se dfont et
o je me trouve en prsence de la contingence pure de sa prsence ; en
ce cas, sur un visage ou sur les autres membres d'un corps, j'ai
l'intuition pure de l a chair. Cette intuition n'est pas seulement
connaissance ; elle est apprhension affective d'une contingence
absolue, et cette apprhension est un type particulier de nause.
Le corps d'autrui, c'est donc la facticit de la transcendance
transcende en tant qu'elle se rfre ma facticit. Je ne saisis jamais
autrui comme corps sans saisir en mme temps, de faon non
explicite, mon corps comme l e centre de rfrence indiqu par autrui.
Mais, de mme, on ne saurait percevoir l e corps d'autrui comme chair
titre d'objet isol ayant avec les autres ceci de pures relations
d'extriorit. Ceci n'est vrai que pour le cadavre. Le corps d'autrui
comme chair m' est i mmdiatement donn comme centre de rfrence
d'une situation qui s'organise synthtiquement autour de lui et il est
insparable de cette situation ; i l ne faut donc pas demander comment
l e corps d'autrui peut tre d'abord corps pour moi et ensuite venir en
situation. Mais autrui m'est originel l ement donn comme corps en
situation. Il n'y a donc pas, par exempl e, corps d'abord et action
ensuite. Mais le corps est l a contingence objective de l'action d'autrui.
Ainsi retrouvons-nous, sur un autre plan, une ncessit ontologique
que nous avions marque l'occasion de l'existence de mon corps
pour moi : la contingence du pour-soi , disions-nous, ne peut tre
existe que dans et par une transcendance, elle est l e ressaisissement
perptuel l ement dpass et perptuellement ressaisissant du pour-soi
par l 'en-soi sur fond de nantisation premire. Semblablement ici, un
corps d'autrui comme chair ne saurait s'insrer dans une situation
pralablement dfinie. Mais il est prcisment ce partir de quoi i l y a
situation. Ici aussi il ne saurait exister que dans et par une
transcendance. Seul ement, cette transcendance est d'abord transcen
de ; el le est elle-mme objet. Ainsi, l e corps de Pierre, ce n'est pas
d'abord une main qui pourrait ensuite prendre ce verre : une pareille
conception tendrait mettre l e cadavre l'origine du corps vivant.
Mais c'est le complexe main-verre en tant que la chair de la mai n
marque l a contingence originelle de ce complexe. Loin que l a relation
du corps aux objets soit un probl me, nous ne saisissons j amais le
corps en dehors de cette relation. Ainsi , le corps d'autrui est-il
signifiant. La signification n'cst rien autre qu'un mouvement fig de
transcendance. Un corps est corps en tant que cette masse de chair
384
qu'il est se dfinit par la tabl e qu'il regarde , la chaise qu' i l prend, l e
trottoir sur lequel i l marche, etc. Mais, pousser l es choses plus
avant, il ne saurait tre question d'puiser les significations qui
constituent l e corps par l a rfrence aux actions concertes,
l'utilisation rationnelle des complexes-ustensiles. Le corps est totalit
des relations signifiantes au monde : en ce sens, i l se dfinit aussi par
rfrence l'air qu'il respire, l'eau qUIl boit, la viande qu'il
mange. Le corps ne saurait apparatre, en effet , sans soutenir, avec la
totalit de ce qui est, des relations signifiantes. Comme l'action, la vie
est transcendance-transcende et signification. Il n' y a pas de
diffrence de nature entre la vie conue comme totalit et l'action. La
vie reprsente l 'ensemble des significations qui se transcendent vers
des objets qui ne sont pas poss comme des ceci sur fond de monde.
La vie est l e corps-fond d'autrui , par opposition au corps-forme, en
tant que ce corps-fond peut tre saisi, non plus par le pour-soi d'autrui
titre i mplicite et non-positi onnel, mais prcisment explicitement et
objectivement par moi : i l par<t alors comme forme signifiante sur
fond d'univers, mais sans cesser d' tre fond pour autrui et prcis
ment en tant que fond. Mais, i ci , i l convient de faire une distinction
importante : le corps d'autrui, en effet, apparat mon corps .
Cela signifie qu' il y a une facticit de mon point de vue sur autrui. En
ce sens, i l ne faut poi nt confondre ma possibilit de saisir un organe
(un bras, une main) sur fond de totalit corporelle et mon apprhen
sion explicite du corps d'autrui ou de certaines structures de ce corps
en tant qu' elles sont vcues par autrui comme corps-fond. C'est dans
l e deuxime cas seulement que nous saisissons autrui comme vie.
Dans le premier, en effet, il peut arriver que nous saisissions comme
fond ce qui est forme pour lui. Lorsque je regarde sa main, l e reste du
corps s' unifie en fond. Mais c' est peut-tre prcisment son front ou
son thorax qui existe non-thtiquement comme forme sur un fond o
ses bras et ses mains se sont dilus.
De l rsulte, bien entendu, que l'tre du corps d'autrui est une
totalit synthtique pour moi. Cela signifi e : 1 que j e ne saurais
jamais saisir le corps d'autrui sinon partir d'une situation totale qui
l'indique ; 2 que je ne saurais percevoir isolment un organe
quelconque du corps d'autrui, et que je me fais toujours indiquer
chaque organe singulier partir de l a totalit de la chair ou de la vie.
Ainsi, ma perception du corps d'autrui est-elle radicalement diff
rente de ma perception des choses.
10 Autrui se meut entre des limites qui apparaissent en liaison
immdiate avec ses mouvements, et qui sont les termes partir
desquels j e me fais indiquer l a signification de ces mouvements. Ces
limites sont en mme temps spatiales et temporelles. Spatialement,
c'est l e verre plac distance de Pierre qui est la signification de son
geste actuel. Ainsi vais-je, dans ma perception mme, de l'ensemble
385
table-verre-boutei l l e, etc. au mouvement du bras pour me faire
annoncer ce qu' i l est. Si le bras est visible et si le verre est cach, j e
p
erois l e mouvement de Pierre partir de J'ide pure de situation et
partir de t ermes viss vide par del les objets qui me cachent l e
v
erre, comme signification du geste. Temporellement, j e saisis
touj ours le geste de Pierre en tant qu'il m'est prsentement rvl
partir de termes futurs vers lesquels il tend. Ainsi me fais-je annoncer
l e
prsent du corps par son futur et, plus gnralement encore, par le
futur du monde. On ne pourra jamais rien comprendre au problme
psychologique de la perception du corps d'autrui, si J'on ne saisit pas
d' abord cette vrit d'essence, que l e corps d'autrui est peru tout
au
trement que l es autres corps : car pour l e percevoir, on va toujours
de ce qui est hors de l ui , dans J'espace et dans le temps, lui-mme ;
on saisit son geste rebrousse-poil par une sorte d'inversion du
temps et de l'espace. Percevoir autrui, c'est se faire annoncer par l e
monde ce qu' i l est.
2 Je ne perois jamais un bras qui se lve l e long d'un corps
i mmobi l e : je perois Pierre-qui-Ive-Ia-mai n. Et il ne faut pas
entendre par l que j e rapporte par jugement le mouvement de la
main une conscience qui le provoquerait ; mais je ne puis saisir
le mouvement de la main ou du bras que comme une structure
temporel l e du corps entier. C'est le tout ici qui dtermine l 'ordre et
l es mouvements des parties. Pour se convaincre de ce qu'il s'agit bien
ici d' une perception originel l e du corps d'autrui, il suffit de se
rappel er J'horreur que peut susciter la vue d' un bras cass qui n'a
pas l 'ai r d'appartenir au corps ou quelqu'une de ces perceptions
rapides o nous voyons par exemple une main (dont l e bras est cach)
grimper comme une araigne le long du battant d'une porte. Dans ces
diffrents cas, i l y a dsintgration du corps ; et cette dsintgration
est saisie comme extraordinaire. On connat, d'autre part, les preuves
positives dont ont souvent argu les gestaltistes. Il est frappant, en
effet, que la photographie enregistre un grossissement norme des
mains de Pierre lorsqu'il les tend en avant (parce qu'elle les saisit dans
leurs dimensions propres et sans liaison synthtique la totalit
corporel l e) , t andis que nous percevons ces mmes mains sans
grossissement apparent si nous les regardons J'il nu. En ce sens, le
corps apparat partir de la situation comme totalit synthtique de la
vie et de J'action.
I l va de soi, aprs ces quelques remarques, que l e corps de Pierre ne
se distingue aucunement de Pierre-pour-moi . Seul existe pour moi l e
corps d'autrui , avec ses diffrentes significations ; tre objet-pour
autrui ou tre-corps, ces deux modalits ontologiques sont traduc
tions rigoureusement quivalentes de l'tre-pour-autrui du pour-soi.
Ainsi , l es si gnifications ne renvoient-elles pas un psychisme
mystrieux : e ll es sont ce psychisme, en tant qu'i! est transcendance-
386
transcende. Sans doute y a-t-il une cryptologie du psychique :
certains phnomnes sont cachs . Mais cela ne signifie nullement
que les significations se rfrent un au-del du corps . Elles se
rfrent au monde et el l es-mmes. En particulier ces manifestations
motionnelles ou, d'une faon plus gnral e, les phnomnes impro
prement appels d'expression ne nous indiquent nullement une
affection cache et vcue par quel que psychisme, qui serait l'objet
immatriel des recherches du psychologue : ces froncements de
sourcil s, cette rougeur, ce bgaiement, c e lger tremblement des
mains, ces regards en dessous qui semblent l a fois timides et
menaants n'expriment pas l a colre, ils sont l a colre. Mais i l faut
bien l'entendre : en soi-mme un poing serr n'est rien et ne signifie
rien. Mais aussi ne percevons-nous jamais un poing serr : nous
percevons un homme qui, dans une certaine situation, serre le poing.
Cet acte signifi ant, considr en liaison avec l e pass et les possibles,
compris partir de l a totalit synthtique corps en situatior ' , est la
colre. El l e ne renvoie rien d'autre qu' des actions dans k monde
(frapper, insulter, etc. ) , c'est--dire de nouvelles attitudes signi
fiantes du corps. Nous ne pouvons pas sortir de l :
psychique est enti rement livr la perception, et il est inconceva
ble en dehors de structures corporelles. Si l ' on ne s'en est pas rendu
compte j usqu'ici, ou si ceux qui l'ont soutenu, comme les bhaviou
ristes, n' ont pas trs bien compris eux-mmes ce qu'ils voulaient dire
et ont soulev l e scandale autour d'eux, c'est qu' on croit volontiers
que toutes les perceptions sont de mme type. En fait, la perception
doit nous livrer i mmdiatement l'objet spatio-temporel . Sa structure
fondamentale est l a ngation interne ; et elle me livre l'objet tel qu'il
est, non point comme une vaine image de quelque ralit hors
d'atteinte. Mais, prcisment pour cela, chaque type de ralit
correspond une structure de perception nouvell e. L corps est l'objet
psychique par excellence, le seul objet psychique. Mais si l ' on
consi dre qu' i l est transcendance-transcende, sa perception ne
saurait par nature tre du mme type que cell e des objets inanims. Et
i l ne faut pas entendre par l qu'elle se serait progressivement
enrichie mais que, originellement, elle est d' une autre structure. Ainsi
n'est-il pas ncessaire de recourir l ' habitude ou au raisonnement par
analogi e, pour expliquer que nous comprenions les conduites expres
sives : ces conduites se livrent originellement l a perception comme
comprhensi bl es ; leur sens fait partie de l eur tre comme l a couleur
du papier fait partie de l'tre du papier. II n'est donc pas plus
ncessaire de se reporter d'autres conduites pour les comprendre,
qu'il ne faut se reporter la couleur de l a tabl e, du feuillage ou
d'autres papiers pour percevoir celle de l a feuille qui est pose devant
moi.
Cependant, le corps d'autrui nous est donn immdiatement
387
comme ce que l 'autre est. En ce sens, nous le saisissons comme ce qui
est perptuel l ement dpass vers un but par chaque signification
particul i re. Prenons un homme qui marche. Ds l'origine, je
comprends sa marche partir d' un ensemble spatio-temporel (rue
chausse-trottoir-magasins-autos, etc. ), dont certaines structures
reprsentent le sens--venir de la marche. Je perois cette marche en
allant du futur au prsent -encore que le futur dont il est question
appartienne au temps universel et soit un pur maintenant qui n'est
pas encore l. La marche elle-mme, pur devenir insaisissable et
nantisant, c'est le prsent. Mais ce prsent est dpassement vers un
t
erme futur de quelque chose qui marche : par del l e prsent pur et
insaisissable du mouvement du bras, nous tentons de saisir l e substrat
du mouvement . Ce substrat que nous ne saisissons jamais tel qu'il est,
sauf dans l e cadavre, il est pourtant toujours l comme le dpass, le
pass. Lorsque j e parle d'un bras-en-mouvement , je considre ce bras
qui tait en repos comme substance du mouvement. Nous avons
marqu, dans notre deuxime partie, qu' une pareille conception n'est
pas soutenable : ce qui se meut ne peut tre le bras immobile, l e
mouvement est une maladie de J'tre. I I n' en est pas moins vrai que l e
mouvement psychique se rfre deux termes, l e terme futur de son
aboutissement et l e terme pass : l'organe immobile qu' il al tre et
d
passe. Et je perois prcisment l e mouvement-du-bras comme un
perptuel et i nsaisissable renvoi vers un tre-pass. Cet tre-pass (le
bras, la jambe, l e corps tout entier en repos), je ne l e vois point, je ne
puis jamais que l'entrevoir travers l e mouvement qui l e dpasse et
auquel j e suis prsence, comme on entrevoit un caillou au fond de l a
rivire, travers l e mouvement des eaux. Pourtant, cette immobilit
d'tre toujours dpasse, jamais ralise, laquelle je me rfre
p
erptuel l ement pour nommer ce qui est en mouvement, c'est l a
facticit pure, l a pure chair, l e pur en-soi comme pass perptuelle
ment passifi de la transcendance-transcende.
Ce pur en-soi qui n'existe qu' titre de dpass, dans et par ce
dpassement, il tombe au rang de cadavre s'il cesse d'tre rvl et
masqu la fois par l a transcendance-transcende. A titre de cadavre,
c'est--dire de pur pass d'une vie, de simple vestige, i l n'est encore
vraiment comprhensible qu' partir du dpassement qui ne l e
dpasse plus : i l est ce qui a t dpass vers des situations perptuelle
ment renouveles. Mais en tant que, d'autre part, i l apparat au
prsent comme pur en-soi, il existe par rapport aux autres ceci dans
la simple relation d'extriorit i ndiffrente : l e cadavre n'est plu
en situation. En mme temps, i l s'effondre, en lui-mme, dans une
multiplicit d'tres soutenant, chacun avec les autres, des relations de
pure extriorit. L'tude de J ' extriorit qui sous-tend toujours la
facticit, en tant que cette extriorit n'est jamais perceptible que sur
l e cadavre, c'est J 'anatomie. La reconstitution synthtique du vivant
388
partir des cadavres, c'est la physiologie. Elle s'est condamne, ds l e
dpart, ne rien comprendre l a vi e puisqu'elle l a conoit simple
ment comme une modalit particulire de l a mort, puisqu'elle voit la
divisibilit l'infini du cadavre comme premire et qu'elle ne connat
pas l'unit synthtique du dpassement vers pour quoi la divisibi
lit l ' infini est pur et simple pass. Mme l'tude de l a vie chez l e
vivant , mme l es vivisections, mme l'tude de l a vie du protoplasme,
mme l'embryologie ou l ' tude de l 'uf ne sauraient retrouver l a vie :
l'organe que l'on observe est vivant, mais il n'est pas fondu dans
l'unit synthtique d'une vie, il est compris partir de l'anatomie,
c'est--dire partir de la mort. I l y aurait donc une erreur norme
croire que le corps d'autrui qui se dvoile originellement nous, c'est
le corps de l 'anatomo-physiologie, La faute est aussi grave que de
confondre nos sens pour nous avec nos organes sensoriels pour
autrui . Mais le corps d'autrui est la facticit de l a transcendance
transcende en tant que cette facticit est perptuellement naissance,
c'est--dire qu' el le se rfre l ' extriorit d'indiffrence d'un en-soi
perptuell ement dpass.
Ces considrations permettent d'expliquer ce que nous nommons le
carac/re. Il faut remarquer, en effet, que l e caractre n'a d' existence
distincte qu' titre d' objet de connaissance pour autrui. La conscience
ne connat point son caractre moins de se dterminer rflexive
ment partir du point de vue de l'autre -, el l e l'existe en pure
indistinction, non thmatiquement et non thtiquement, dans
l'preuve qu' el l e fait de sa propre contingence et dans l a nantisation
par quoi elle reconnat et dpasse sa facticit. C'est purquoi la pure
description introspective de soi ne livre aucun caractre : le hros de
Proust n'a pas de caractre directement saisissable ; il se livre
d'abord, en tant qu'il est conscient de lui-mme, comme un ensemble
de ractions gnrales et communes tous les hommes < mca
nismes de l a passion, des motions, ordre d' apparition des souve
nirs, etc. ), o chacun peut se reconnatre : c'est que ces ractions
appartiennent l a nature gnrale du psychique. Si nous arrivons
(comme ra tent Abraham dans son livre sur Proust) dterminer le
caractre du hros proustien ( propos, par exemple, de sa faiblesse,
de sa passivit, de l a liaison singulire chez lui de l'amour et de
l'argent), c'est que nous interprtons les donnes brutes : nous
prenons sur el l es un point de vue extrieur, nous les comparons et
nous tentons d' en dgager des relations permanentes et objectives.
Mais ceci ncessite un recul : tant que le lecteur, suivant l'optique
gnrale de l a lecture, s'identifie au hros de roman, le caractre de
Marcel l ui chappe ; mieux, i l n'existe pas ce niveau. Il
n'apparat que si j e brise l a complicit qui m'unit l 'crivain, que si je
considre l e livre non pl us comme un confident, mais comme une
confidence, mieux encore : comme un documen/. Ce caractre
389
n'exist e donc que sur le plan du pour-autrui et c'est la raison pour
l aquel l e les maximes et les descriptions des moralistes , c'est--dire
des aut eurs franais qui ont entrepris une psychologie objective et
social e, ne se recouvrent jamais avec l'exprience vcue du sujet.
Mai s si le caractre est essentiellement pour autrui, il ne saurait se
distinguer du corps, tel que nous l'avons dcrit. Supposer, par
exempl e
,
que le temprament est cause du caractre, que le t emp
rament sanguin est cause de l'irascibilit, c'est poser le caractre
comme une entit psychique, prsentant tous les aspects de l'objecti
vit et cependant subjective et subie par le sujet. En fait, lrascibilit
d'aut rui est connue du dehors et ds l'origine transcende par ma
transcendance. En ce sens, elle ne se distingue pas du temprament
sanguin par exempl e. Dans les deux cas, nous saisissons la mme
rougeur apoplectique, les mmes aspects corporels, mais nous
transcendons autrement ces donnes suivant nos projets : nous
aurons affaire au temprament si nous envisageons cette rougeur
comme mani festation du corps-fond, c'est--dire en la coupant de ses
l i ens avec la situation ; si mme nous tentons de la comprendre
partir du cadavre, nous pourrons en amorcer l'tude physiologique et
mdicale ; si , au contraire, nous l'envisageons en venant elle partir
de l a situation global e, elle sera la colre elle-mme, ou encore une
promesse de col re, ou mieux, une colre en promesse, c'est--dire
un rapport permanent avec les choses-ustensiles, une potentialit.
Entre l e temprament et l e caractre, il n'y a donc qu'une diffrence
de raison, et le caractre s'identifie avec le corps. Cest ce qui justifie
les tentatives de nombreux auteurs pour instituer une physiognomo
nie comme base des tudes caractrologiques et, en particul ier, les
bel les tudes de Kretschmer sur le caractre et la structure du corps.
Le caractre d'autrui, en effet , est immdiatement donn l'intuition
comme ensemble synthtique. Cela ne signifie pas que nous puissions
aussitt le dcrire. I l faudra du temps pour faire paratre des
structures di ffrencies, pour expliciter certaines donnes que nous
avons tout de suite saisies affectivement, pour transformer cette
indistinction globale qu'est le corps d'autrui en forme organise. Nous
pourrons nous tromper, i l sera loisible aussi de recourir des
connaissances gnrales et discursives (lois empiriquement ou statisti
quement tablies propos d'autres sujets) pour interprter ce que
nous voyons. Mais, de toute faon, il ne s'agit que d'expliciter et
d'organiser, en vue de l a prvision et de l'action, le contenu de notre
intuition premi re. Cest sans aucun doute ce que veulent dire les
gens qui rptent que la premire impression ne trompe pas . Ds
la premire rencontre, en effet, autrui est donn tout entier et
immdiatement , sans voile ni mystre. Apprendre, ici, c'est compren
dre, dvelopper et apprcier.
Toutefoi s, c'est dans ce qu'il est qu'autrui est ainsi donn. Le
390
caractre ne di ffre pas de la facticit, c'est--dire de la contingence
originel le. Or, nous saisissons autrui comme libre ; nous avons
marqu plus haut que l a libert est une qualit objective d'autrui
comme pouvoir inconditionn de modifier les situations. Ce pouvoir
ne se distingue pas de celui qui constitue originellement autrui , et qui
est cel ui de faire qu'une situation existe en gnral : puvoir modifier
une situation, en effet, c'est faire prcisment qu'une situation existe.
La libert objective d'autrui n'est que transcendance-transcende ;
elle est l ibert-objet, nous l'avons tabl i . En ce sens, autrui apparat
comme ce qui doit se comprendre partir d' une situation perptuelle
ment modifie. C'est ce qui fait que l e corps est toujours le pas. En
ce sens, l e caractre d'autrui se livre nous comme le dpass. Mme
l'irascibilit comme promesse de col re est toujours promesse dpas
se. Ai nsi , le caractre se donne comme la facticit d'autrui en tant
qu'elle est accessible mon intuition, mai s en tant aussi qu'elle n'est
que pour tre dpasse. En ce sens, se mettre en colre , c'est dj
dpasser l ' i rascibilit du fait mme qu'on y consent, c'est lui donner
un sens ; la colre apparatra donc comme la reprise de l ' irascibilit
par la l ibert-objet. Cela ne veut point dire que nous sommes
renvoys par l une subjectivit, mais seulement que ce que nous
transcendons ici , c'est non seulement l a facticit d'autrui, mais sa
transcendance, non seulement son tre, c'est--dire son pass, mais
son prsent et son avenir. Bien que l a colre d'autrui m' apparaisse
toujours comme libre-colre (ce qui est vident, du fait mme que j e
l a juge), j e puis toujours l a transcender, c'est--dire l'attiser ou l a
calmer, mi eux, c'est en l a transcendant e t seulement ainsi que j e l a
saisis. Ainsi, l e corps, tant la facticit de l a transcendance-transcen
de, est toujours corps-qui-indique-au-del-de-Iui-mme : la fois
dans l'espace -c'est la situation -et dans le temps-c'est la libert
objet. Le corps pour autrui est l'objet magique par excellence. Ainsi,
l e corps d'autrui est-il toujours corps-plus-que-corps , parce qu'au
trui m'est donn sans intermdiaire et totalement dans l e dpasse
ment perptuel de sa facticit. Mai s ce dpassement ne me renvoie
pas une subjectivit : il est le fait objectif que le corps-que ce soit
comme organisme, comme caractre, ou comme outil -ne m'appa
rat jamais sans alentours, et doit tre dtermin partir de ces
alentours. Le corps d'autrui ne doit pas tre confondu avec son
objectivit. L'objectivit d'autrui est sa transcendance comme trans
cende. Le corps est la facticit de cette transcendance. Mais
corporit et objectivit d'autrui sont rigoureusement insparables.
391
I I I
LA TROI SI ME DI MENSI ON ONTOLOGI OUE DU CORPS
J'existe mon corps : telle est sa premire dimension d'tre. Mon
corps est utilis e t connu par autrui : tel l e est sa seconde dimension.
Mais en tant que jf suis pour autrui, autrui se dvoile moi comme l e
sujet pour l equel je sui s objet. Il s'agit mme l, nous l'avons vu, de
ma relation fondamentale avec autrui. J'existe donc pour moi comme
connu par autrui - en particulier dans ma facticit mme. J'existe
pour moi comme connu par autrui titre de corps. Telle est la
troisime dimension ontologique de mon corps. C'est elle que nous
allons tudier prsent ; avec el le, nous aurons puis l a question des
modes d'tre du corps.
Avec l'apparition du regard d'autrui, j'ai l a rvlation de mon tre
objet, c'est--dire de ma transcendance comme transcende. Un moi
objet se rvle moi comme l'tre inconnaissable, comme la fuite en
autrui que je suis en pleine responsabilit. Mais, si je ne puis
connatre ni mme concevoir ce moi dans sa ralit, au moins ne suis
j e pas sans saisir certaines de ses structures formelles. En particulier
j e me sens atteint par autrui dans mon existence de fait ; c'est de mon
tre-I-pour-autrui que je suis responsable. Cet tre-l est prcis
ment l e corps. Ainsi, la rencontre d'autrui ne m'atteint pas seulement
dans ma transcendance : dans et par la t ranscendance qu'autrui
dpasse, l a facticit que ma transcendance nantise et transcende
existe pour autrui et, dans l a mesure o je suis conscient d' exister
pour autrui, je saisis ma propre facticit non plus seulement dans sa
nantisation non-thtique, non plus seulement en l'existant, mais dans
sa fuite vers un tre-au-mi l i eu-du-monde. Le choc de l a rencontre
avec autrui , c'est une rvlation vide pour moi de l'existence de mon
corps, dehors, comme un en-soi pour l'autre. Ainsi mon corps ne se
donne pas simplement comme l e vcu pur et simple : mais ce vcu
mme, dans et par le fait contingent et absolu de l'existence d'autrui,
se prolonge dehors dans une dimension de fuite qui m'chappe. La
profondeur d'tre de mon corps pour moi, c'est ce perptuel
dehors de mon dedans l e plus intime. Dans la mesure o
l'omniprsence d' autrui est le fait fondamental , l'objectivit de mon
tre-l est une dimension constante de ma facticit : j'existe ma
contingence en tant que j e la dpasse vers mes possibles et en tant
qu'elle me fuit sournoisement vers un irrmdiable. Mon corps est l
non seulement comme le point de vue que j e suis, mais encore comme
un point de vue sur lequel sont pris actuellement des points de vue
que je ne pourrai jamais prendre ; i l m'chappe de toute part. Cela
'92
signifie d'abord que cet ensemble de sens, qui ne peuvent se saisir
eux-mmes, se donnent comme saisis aill eurs et par d'autres. Cette
saisie qui se manifeste ainsi vide n'a pas l e caractre d' une ncessit
ontologique, on ne peut pas la driver de l'existence mme de ma
facticit, mais c'est un fait vident et absolu ; elle a le caractre d'une
ncessit de fait. Comme ma facticit est pure contingence et se
rvle moi non-thtiquement comme ncessit de fait, l'tre-pour
autrui de cette facticit vient multiplier la contingence de cette
facticit : elle se perd et me fuit dans un infini de contingence qui
m'chappe. Ainsi, dans le moment mme
'
o je vis mes sens comme
ce point de vue intime sur lequel je ne puis prendre aucun point de
vue, leur tre-po ur-autrui me hante : ils sont. Pour l'autre, ils sont
comme cette table ou cet arbre sont pour moi, ils sont au milieu de
quelque mond! ; ils sont dans et par l'coulement absolu de mon
monde vers autrui. Ainsi, la relativit de mes sens, que j e ne puis
penser abstraitement sans dtruire mon monde, est en mme temps
perptuellement prsentifie moi par l'existence de l ' autre ; mais
c'est une pure et insaisissable apprsentation. De la mme faon, mon
corps est pour moi l'i nstrument que je suis et qui ne peut tre utilis
par aucun instrument ; mais dans l a mesure o autrui, dans la
rencontre originelle, transcende vers ses possibilits mon tre-l, cet
instrument que je suis m'est prsentifi comme instrument plong
dans une srie instrumentale infi ni e, encore que je ne puisse d'aucune
manire prendre un point de vue de survol sur cette srie. Mon corps,
en tant qu'al i n, m'chappe vers un tre-outil-parmi-des-outils, vers
un tre-organe-sensible-saisi-par-des-organes sensibles, cela avec une
destruction alinante et un effondrement concret de mon monde qui
s'coule vers autrui et qu'autrui ressaisira en son monde. Lorsque,
par exemple, un mdecin m'ausculte , je perois son oreille et, dans l a
mesure o l es objets du monde m' i ndiquent comme centre de
rfrence absolu, cette orei l l e perue indique certaines structures
comme formes que j 'existe sur mon corps-fond. Ces structures sont
prcisment -et dans le mme surgissement de mon tre -du vcu
pur, ce que j'existe et que j e nanti se. Ainsi avons-nous ici, en
premier lieu, l a liaison originelle de l a dsignation et du vcu : les
choses perues dsignent ce que j 'existe subjectivement. Mais ds
que je saisis, sur l'effondrement de l'objet sensible oreille , l e
mdecin comme entendant les bruits de mon corps, sentant mon
corps avec son corps, le vcu dsign devient dsign comme chose
hors de ma subjectivit, au mi l i eu d'un monde qui n'est pas le mien,
Mon corps est dsign comme al i n. L'exprience de mon alination
se fait dans et par des structures affectives comme la timidit. Se
sentir rougir , se sentir transpirer , etc. , sont des expressions
impropres dont le timide use pour expliquer son tat : ce qu'il entend
par l, c'est qu'il a une conscience vive et constante de son corps tel
393
qu'il est , non pour l ui , mais pour l'autre. Ce malaise constant, qui est
saisie de l 'alination de mon corps comme irrmdiabl e, peut
dterminer des psychoss comme l'reutophobie ; celles-ci ne sont
rien autre que la saisie mtaphysique et horrifie de l'existence de
mon corps pour l'autre. On dit volontiers que l e timide est embar
rass par son propre corps A vrai dire, cette expression est
impropre : je ne saurais tre embarrass par mon corps tel que je
l'existe. C'est mon corps tel qu' i l est pour l 'autre qui devrait
m'embarrasser. Et encore, l non plus, l'expression n'est pas heu
reuse, car je ne puis tre embarrass que par une chose concrte
prsente l ' i ntrieur de mon univers et qui me gne pour l'emploi
d'autres outils. Ici rembarras est plus subti l , car ce qui me gne est
absent ; je ne rencontre jamais mon corps pour autrui comme un
obstacle ,
c'est au contraire parce qu'il n'est j amais l, parce qu'il
demeure insaisissable, qu'il peut tre gnant. Je cherche l'atteindre,
le matriser, m' en servir comme d'un instrument -puisque aussi
bien il se donne comme instrument dans un monde pour l ui donner
le model et l'attitude qui convi ennent ; mais prcisment, il est par
principe hors d'atteinte et tous les actes que je fais pour me
l'approprier m'chappent leur tour et se figent distance de moi
comme corps-po ur-l'autre. Ainsi doisje agir perptuellement
l'aveuglette , tirer au j ug, sans jamais connatre les rsultats de
mon tir. C'est pourquoi l ' effort du timide, aprs qu'il aura reconnu l a
vanit de ces tentatives, sera pour supprimer son corps-pour-I'autre.
Lorsqu'il souhaite n'avoir plus de corps , tre invisible , etc. , ce
n'est pas son corps-pour-Iui qu' il veut anantir, mais cette i nsaisissa
ble dimension du corps-alin.
C'est qu'en effet nous attribuons au corps-po ur-l'autre autant de
ralit qu'au corps-pour-nous. Mieux, le corps-pour-l'autre c'est le
corps-pour-nous, mais insaisissable et alin. I l nous parat alors que
l'autre accomplit pour nous une fonction dont nous sommes incapa
bles, et qui pourtant nous incombe : nous voir comme nous sommes.
Le langage, en nous rvlant vide -l es principales structures de
notre corps-po ur-autrui (alors que le corps exist est i neffabl e), nous
incite nous dcharger entirement de notre mission prtendue sur
autrui. Nous nous rsignons nous voir par les yeux de l ' autre ; cela
signifie que nous tentons d'apprendre notre tre par les rvlations du
l angage. Ainsi apparat tout un systme de correspondances verbales,
par lequel nous nous faisons dsigner notre corps tel qu' il est pour
l'autre, en utilisant ces dsignations pour nommer notre corps tel qu'il
est pour nous. C'est ce niveau que se fait l'assimilation analogique
du corps d'autrui et de mon corps. Il est ncessaire en effet -pour
que je puisse penser que mon corps est pour autrui comme l e corps
d'autrui est pour moi - que j 'aie rencontr autrui dans sa
subjectivit objectivante, puis comme objet ; il faut, pour que j e j uge
394
le corps d'autrui comme objet semblable mon corps, qu'il m'ait t
donn comme objet et que mon corps m'ait dvoil de son ct une
dimensi on-obj et. Jamai s l'analogie ou la ressemblance ne peut
constituer d'abord l'objet-corps d'autrui et l'objectivit de mon
corps ; mais au contraire, ces deux obj ectits doivent exister prala
blement pour qu'un principe analogique puisse jouer. Ici donc, c'est
le langage qui m'apprend les structures pour autrui de mon corps. Il
faut bien concevoir toutefois que ce n'est pas sur le plan i rrflchi que
le l angage avec ses significations peut se glisser entre mon corps et ma
conscience qui l'existe. Sur ce plan l'alination du corps vers autrui et
sa troisime dimension d'tre ne peuvent qu'tre prouves vide,
elles ne sont qu' un prolongement de la facticit vcue. Aucun
concept , aucune i ntuition cognitive ne peut s'y attacher. L'objectit
de mon corps-pour-autrui n'est pas objet pour moi et ne saurait
constituer mon corps comme objet : el l e est prouve comme fuite du
corps que j'existe. Pour que les connaissances qu' autrui a de mon
corps et qu'il me communique par le langage puissent donner mon
corps-pour-moi une structure d'un type particulier, i l faut qu'elles
s'appliquent un objet et que mon corps soit dj objet pour moi.
C'est donc au niveau de la conscience rflexive qu'elles peuvent
entrer en jeu : elles ne qualifieront pas la facticit en tant que pur
exit de la consci ence non-thti que, mais bien la facticit comme
quasi-objet apprhend par l a rflexion. C'est cette couche concep
tuelle qui , en s'insrant entre l e quasi-objet et la conscience rflexive,
achvera l'objectivation du quasi-corps psychique. La rflexion, nous
l'avons vu, apprhende l a factici t et la dpasse vers un irrel, dont
l'esse est un pur percipi et que nous avons nomm psychique. Ce
psychique est constitu. Les connaissances conceptuelles que nous
acqurons dans notre histoire et qui nous viennent toutes de notre
commerce avec autrui vont produire une couche constitutive du corps
psychique. En un mot, en tant que nous souffrons rflexivement notre
corps, nous le constituons en quasi-objet par la rflexion complice -
ainsi l ' obseration vient de nous-mmes. Mais ds que nous l e
connaissons, c'est--dire ds que nous l e saisissons dans une intuition
purement cognitive, nous le constituons par cette intuition mme avec
les connaissances d'autrui, c'est--dire tel qu'il ne saurait jamais tre
pour nous de lui-mme. Les structures connaissables de notre corps
psychi que indiquent donc simplement et vide son alination
perptuel l e. Au l i eu de vivre cette alination, nous la constituons
vide en dpassant la facticit vcue vers le quasi-objet qu'est le corps
psychique et en dpassant derechef ce quasi-objet soufert vers des
caractres d'tre qui ne sauraient, par principe, m'tre donns et qui
sont simplement signifis.
Revenons, par exemple, notre description de l a douleur physi
que }. Nous avons vu comment la rflexi on, en la souffrant la
395
constituait en mal. Mais nous avions d alors arrFter notre descrip
tion, car les moyens nous manquaient pour aller plus loi n. A prsent,
nous pouvons poursuivre : l e mal que je souffre, je peux l e viser dans
son en-soi , c'est--dire, prcisment, dans son tre-pour-autrui. A ce
moment je le connais, c'est--dire que je le vise dans sa dimension
d'tre qui m'chappe, dans la face qu'il tourne vers les autres, et ma
vise s'imprgne du savoir que le langage m'a apport, c'est--dire
que j'uti l ise des concepts instrumentaux qui me viennent d'autrui,
que je n' aurai s en aucun cas pu former seul ni penser de moi-mme
diriger sur mon corps. C'est au moyen des concepts d'autrui que j e
connais mon corps. Mais i l s'ensuit que, dans la rflexion mme, j e
prends l e point de vue d'autrui sur mon corps ; je tente de l e saisir
comme si j 'tais par rapport lui autrui. Il est vident que les
catgories que j'applique alors au mal le constituent vide, c'est-
dire dans une dimension qui m'chappe. Pourquoi parler alors
d'intuition ? C'est que, malgr tout, l e corps souffert sert de noyau, de
matire aux significations alinantes qui le dpassent : c'est ce mal qui
m'chappe vers des caractristiques nouvelles que j'tablis comme
des limites et des schmas vides d'organisation. C'est ainsi, par
exemple, que mon mal, souffert comme psychique, m'apparatra
rflexivement comme mal d'estomac. Comprenons bien que la
douleur d'estomac est l'estomac lui-mme en tant que vcu
douloureusement. En tant que telle, elle n'est, avant l'intervention de
la couche alinante cognitive, ni signe local, ni identification. L
gastralgi e, c'est l'estomac prsent la conscience comme qualit pure
de douleur. En tant que tel , nous l ' avons vu, l e mal se distingue de lui
mme - et sans opration intellectuelle d'identification ou de
discrimination -de toute autre douleur, de tout autre mal. Seule
ment ce niveau l'estomac est un ineffable, il ne saurait tre
nomm ni pens : il est seulement cette forme soufferte qui s'enlve
sur fond de corps-exist. Le savoir objectivant qui dpasse prsent
l e mal souffert vers l'estomac nomm est savoir d'une certaine nature
objective de l'estomac : je sais qu'il a une forme de cornemuse, que
c'est une poche, qu'il produit des sucs, des diastases, qu'il est
envelopp d'un muscle tunicier fibres lisses, etc. Je peux aussi savoir
-parce qu'un mdecin me l'a appris -qu' i l est atteint d'un ulcre.
Et, derechef, cet ulcre, je peux me le reprsenter plus ou moins
nettement. Je peux l'envisager comme un rongeur, une lgre
pourriture interne ; j e peux le concevoir par analogie avec les abcs,
les boutons de fivre, le pus, les chancres, etc. Tout cela, par
principe, provient ou des connaissances que j 'ai acquises des autres
ou des connaissances que les autres ont de moi. De toute faon cela
ne saurait constituer mon mal en tant que j'en jouis mais en tant qu'il
m' chappe. L'estomac et l 'ul cre deviennent des directions de fuite,
des perspectives d'alination de J'objet dont je jouis. C'est alors
396
qu'apparat une couche nouvelle d'existence : nous avions dpass l a
douleur vcue vers le mal souffert ; nous dpassons l e mal vers l a
maladie. La mal adi e, comme psychique, est certes bi en diffrente de
l a maladie connue et dcrite par le mdecin : c'est un tat. Il n'est
question ici ni de microbes ni de lsions de tissus, mais d'une forme
synthtique de destruction. Cette forme m'chappe par principe ; elle
se rvle de temps autre par des bouffes de douleur, par des
crises de mon mal, mais, le reste du temps, elle demeure hors
d'atteinte sans disparatre. Elle est alors objectivement dcelable
pour les autres : les autres me l'ont apprise, les autres peuvent la
diagnostiquer ; elle est prsente pour les autres, alors mme que je
n'en ai aucune conscience. C'est donc en sa nature profonde un pur et
simple tre pour autrui. Et, lorsque je ne souffre pas, j e parle d'elle, je
me conduis vis--vis d'elle comme vis--vis d'un objet qui par principe
est hors d'attei nte, dont les autres sont les dpositaires. Je ne bois pas
de vin, si j 'ai des coliques hpatiques, pour ne pas rveiller mes
douleurs de foi e. Mais mon but prcis : ne pas rveiller mes douleurs
de foi e, ne se distingue aucunement de cet autre but : obir aux
dfenses du mdecin qui me les a rvles. Ainsi un autre est
responsable de ma maladie. Et pourtant cet objet qui me vient par les
autres conserve des caractres de spontanit dgrade qui viennent
de ce que je le saisis travers mon mal. Notre intention n'est pas de
dcrire ce nouvel objet, ni d'insister sur ses caractres de spontanit
magique, de finalit destructrice, de puissance mauvaise, sur sa
familiarit avec moi et sur ses rapports concrets avec mon tre (car
c'est, avant tout, ma maladie). Nous voulons seulement faire remar
quer que, dans l a maladie mme, le corps est donn ; de mme qu'il
tait le support du mal, il est prsent la substance de la maladie, ce
qui est dtruit par elle, ce travers quoi cette forme destructrice
s'tend. Ainsi l'estomac ls est prsent travers l a gastralgie comme
la matire mme donc est faite cette gastralgie. Il est l, i l est prsent
l'intuition et je I"apprhende travers l a douleur soufferte, avec ses
caractres. Je l e saisis comme ce qui est rong, une poche en
forme de cornemuse ^q etc. Je ne le vois pas, certes, mais je sais qu'il
est ma douleur. De l les phnomnes faussement nomms
endoscopie . En ralit, l a douleur elle-mme ne m'apprend rien
sur mon estomac, contrairement ce que prtend Sollier. Mais, par et
dans la douleur, mon savoir constitue un estomac-pour-autrui, qui
m'apparat comme une absence concrte et dfinie avec tout juste
autant de caractres objectifs que j' ai pu en connatre. Mais, par
principe, l'objet ainsi dfini est comme l e ple d'alination de ma
douleur ; c'est, par principe, ce que je suis sans avoir l'tre et sans
pouvoir le transcender vers autre chose. Ainsi , de mme qu'un tre
pour-autrui hante ma facticit non-thtiquement vcue, de mme un
tre-objet-pour-autrui hante, comme une dimension d'chappement
397
de mon corps psychique, la facticit constitue en quasi-objet pour l a
rfexi on complice. De mme, la pure nause peut tre dpasse vers
une dimension d'alination : elle me livrera alors mon corps-pour
autrui dans sa tournure , son allure sa physionomie ; el l e
se donnera alors comme dgot de mon visage, dgot de ma chair
trop bl anche, de mon expression trop fixe, etc. Mais i l faut renverser
les termes ; ce n'est point de tout cela que j'ai dgot. Mais la nause
est tout cela comme exist non-thtique ment. Et c'est ma connais
sance qui l a prolonge vers ce qu'elle est pour autrui . Car c'est autrui
qui saisit ma nause , comme chair, prcisment, et dans l e caractre
nauseux de toute chair.
Nous n'avons pas puis avec les remarques prcdentes la
description des apparitions de mon corps. Il reste dcrire ce que
nous nommerons un type aberrant d'apparition. En effet, j e puis voir
mes mains, toucher mon dos, sentir l'odeur de ma sueur. Dans ce cas,
ma ma
i n, par exempl e, m'apparat comme un objet parmi d'autres
objets. Elle n'est plus indique par les alentours comme centre de
rfrence ; elle s'organise avec eux dans l e monde et c'est elle qui
indique, comme eux, mon corps comme centre de rfrence. Elle fait
partie du monde. De mme, el l e n'est plus l'instrument que je ne puis
manier
avec des instruments ; au contraire, elle fait partie des
ustensiles que je dcouvre au milieu du monde ; je puis l'utiliser au
moyen de mon autre mai n, par exempl e, comme lorsque j e frappe de
la main droite sur mon poing gauche qui enserre une amande ou une
noi x. Ma mai n s'intgre alors au systme infini des ustensiles-utiliss.
Il n'y a rien dans ce nouveau type d'apparition qui puisse nous
inquit
er ou nous faire revenir sur les considrations prcdentes.
Toutefois, i l fallait le mentionner. Il doit s'expliquer facilement, l a
condition qu'on l e remette sa place dans l'ordre des apparitions du
corps, c'est--dire la condition qu'on l'examine en dernier lieu et
comme une curiosit de notre constitution. Cette apparition de
ma mai n signifie simplement, en effet, que, dans certains cas bi en
dfini s, nous pouvons prendre sur notre propre corps le point de vue
d'autrui, ou, si l' on veut, que notre propre corps peut nous apparatre
comme le corps d'autrui. Les penseurs qui sont partis de cette
apparition pour faire une thorie gnrale du corps ont radicalement
invers les termes du problme et se sont exposs ne rien
comprendre la question. Il faut bien remarquer, en effet, que cette
possibilit de voir notre corps est une pure donne de fait, absolu
ment contingente. Elle ne saurait tre dduite ni de la ncessit
d'avoir un corps pour le pour-soi ni des structures de fait du corps
pour-autrui . On pourrait concevoir faci lement des corps qui ne
pourrai
ent prendre aucune vue sur eux-mmes ; i l semble mme que
ce soit l e cas pour certains insectes qui, quoique pourvus d' un systme
nerveux diffrenci et d"organes sensibles, ne peuvent utiliser ce
398
systme et ces organes pour se connatre. Il s'agit donc l d'une
particularit de structure que nous devons mentionner sans tenter de
la dduire. Avoir des mains, avoir des mains qui peuvent se toucher
l'une l ' autre : voil deux faits qui sont sur le mme plan de
contingence et qui , en tant que tels , relvent ou de la pure description
anatomique ou de la mtaphysi que. Nous ne saurions les prendre
pour fondement d' une tude de la corporit.
Il faut noter, en outre, que cette apparition du corps ne nous livre
pas le corps en tant qu'il agit et peroit, mais en tant qu'il est agi et
peru. En un mot, nous l'avions fait remarquer au dbut de ce
chapitre, on pourrait concevoir un systme d'organes visuels qui
permettrait un il de voir l'autre. Mais l'il qui serait vu serait vu
en tant que chose, non en tant qu'tre de rfrence. Pareillement, la
main que je prends n'est pas saisie en tant que main qui prend, mais
en tant qu' objet saisissable. Ainsi, la nature de notre corps pour nou
nous chappe entirement dans l a mesure o nous pouvons prendre
sur lui le point de vue d'autrui. Il faut remarquer d'ailleurs que, mme
si la disposition des organes sensibles permet de voir l e corps comme
il apparat autrui , cette apparition du corps comme chose-ustensile
est trs tardive chez l'enfant ; elle est, en tout cas, postrieure la
consci ence (du) corps proprement dite et du monde comme complexe
d'ustensilit ; elle est postrieure la perception des corps d'autrui.
L'enfant, depuis longtemps, sait prendre, tirer lui, repousser, tenir,
quand il apprend prendre sa main, l a voir. Des observations
frquentes ont montr que l ' enfant de deux mois ne voit pas sa main
comme sa mai n. Il Ia regarde et, s 'il l'loigne de son champ visuel, i l
tourne la t t e et l a cherche du regard comme s' i l ne dpendait pas de
lui qu'elle revienne se placer s ous sa vue. C'est par une srie
d'oprations psychologiques et de synthses d'identification et de
rcognition qu'il parviendra tablir des tables de rfrences entre le
corps-exist et l e corps-vu. Encore faut-il qu'il ait d'abord commenc
son apprentissage du corps d'autrui . Ainsi , l a perception de mon
corps se place, (.hronologiquement, aprs la perception du corps
d'autrui.
Considre sa place et sa date, dans sa contingence originelle,
on ne voit pas qu'elle puisse tre l 'occasion de problmes nouveaux
Le corps est l'instrument que je suis. I l est ma facti cit d' tre au
milieu-du-monde en tant que je la dpasse vers mon tre-dans-le
monde. Il m'est radicalement impossible, certes, de prendre un point
de vue global sur cette factici t, sinon je cesserais de l ' tre. Mais qu'y
a-t-il d'tonnant ce que certaines structures de mon corps, sans
cesser d'tre centres de rfrence pour les objets du monde,
s'ordonnent, d'un point de vue radicalement diffrent, aux autres
objets pour indiquer avec eux tel ou tel de mes organes sensibles
comme centre de rfrence partiel et s'enlevant comme forme sur le
399
corps-fond ? Que mon il se voie lui-mme, c'est impossible par
nature. Mais qu'y a-t-il d'tonnant ce que ma main touche mes
yeux ? Si l 'on devait s'en montrer surpris, c'est qu'on aurait saisi la
ncessit pour l e pour-soi de surgir comme point de vue concret sur le
monde, t itre d'obl igation i dal e strictement rductible des
relations connaissables entre les objets et de simples rgles pour le
dveloppement de mes connaissances, au lieu d'y voir la ncessit
d'une existence concrte et contingente au milieu du monde.
CHAPI TRE I I I
Les relations concrtes avec autrui
Nous n'avons fait, jusqu'ici, que dcrire notre relation fondamentale
avec l'autre. Cette relation nous a permis d'expliciter les trois
dimensions d'tre de notre corps. Et, bien que le rapport originel avec
autrui soit premi er par rapport la relation de mon corps avec l e corps
d'autrui , il nous est apparu clairement que la connaissance de la nature
du corps tait i ndispensable toute tude des relations particulires de
mon tre avec celui d'autrui. Celles-ci supposent , en effet, de part et
d'autre, la facticit, c'est--dire notre existence comme corps au milieu
du monde. Non que l e corps soit l'instrument et l a cause de mes
relations avec autrui. Mais i l en constitue la signification, i l en marque
les limites : c'est comme corps-en-situation que j e saisis l a transcen
dance-transcende de l'autre et c'est comme corps-en-situation que j e
m'prouve dans mon al i nation au profit de l'autre. Ces relations
concrtes, nous pouvons les examiner prsent, puisque nous sommes
au fait de ce qu'est notre corps. Elles ne sont pas de simples
spcification's de l a relation fondamentale : bien que chacune enve
loppe en eUe la relation originelle avec autrui comme sa structure
essentiel l e et son fondement, elles sont des modes d'tre entirement
neufs du pour-soi. Elles reprsentent, en effet, les diffrentes attitudes
du pour-soi dans un monde o il y a l'autre. Chacune d'elles prsente
donc sa manire la relation bilatrale : pour-soi-pour-autrui, en-soi.
Si donc nous arrivons expliciter les structures de nos relations les plus
primitives avec l'autre-dans-le-monde, nous aurons achev notre
tche ; nous nous interrogions, en effet, au dbut de ce travail , sur les
rapports du pour-soi avec l 'en-soi ; mais nous avons appris, prsent,
que notre tche tait plus complexe : il y a relation du pour-soi avec
l'en-soi en prsence de l'autre. Lorsque nous aurons dcrit ce fait
concret, nous serons en mesure de conclure sur les rapports fondamen
taux de ces trois modes d'tre et nous pourrons peut-tre amorcer une
thorie mtaphysique de l'tre en gnral.
401
Le pour-soi Comme nantisation de l'en-soi se temporalise comme
fuite vers. Il dpasse, en effet, sa facticit -ou tre donn ou pass
ou corps -
v
ers l' en-soi qu'il serait s'il pouvait tre son propre
fondement. C'est ce que l'on traduira en termes dj psychologiques
-et , de ce fait, impropres quoique plus clairs peut-tre -en disant
que le pour-soi tente d'chapper son existence de fait, c'est--dire
son tre-l , comme en-soi dont il n'est aucunement le fondement , et
q
ue cette fuite a lieu vers un avenir impossible et toujours poursuivi
o le pour-soi serait en-soi-pour-soi, c'est--dire un en-soi qui serait
J ui-mme son propre fondement. Ainsi, le pour-soi est fui te et
poursuite la foi s ; la fois, il fuit l'en-soi et il le poursuit ; le pour-soi
est poursuivant-poursuivi. Mais nous rappelons, pour diminuer l e
d anger d'une interprtation psychologique des remarques prc
dentes, que le
p
our-soi n' est pas d'abord pour tenter ensuite d'attein
dre l 'tre : en un mot, nous ne devons pas l e concevoir comme un
existant qui serait pourvu de tendances, comme ce verre est pourvu
de certaines qualits particulires. Cette fuite poursuivante n'est pas
un donn qui
s'ajoute par surcrot l'tre du pour-soi , mais l e pour
soi es/ cette fuite mme ; elle ne se distingue pas de la nantisation
originelle, dire que l e pour-soi est poursuivant-poursuivi ou qu'il est
sur le mode d' avoir tre son tre ou qu'il n' est pas ce qu'il est et qu'il
est ce qu'i l n' est pas, c'est une seule et mme chose. Le pour-soi n'est
pas l ' en-soi et ne saurait l ' tre ; mais il est relation l'en-soi ; il est
mme l'unique relation possible l'en-soi, cern de tout ct par l'en
soi, il n' y chappe que parce qu'il n'est rien et i l n' en est spar par
rien. Le pour-soi est fondement de toute ngativit et de toute
relation, il es/ la
re/a/ion.
Cel a tant, l e surgissement d'autrui atteint l e pour-soi en plein
cur. Par et pour autrui , l a fuite poursuivante est fige en en-soi.
Dj, l ' en-soi l a ressaisissait au fur et mesure, dj elle tait l a fois
ngation radicale du fait, position absolue de la valeur, et, la fois,
transie de facticit de part en part : au moins s'chappait-elle par la
temporalisation ; au moins son caractre de totalit dtotalise lui
confrait-il un
p
erptuel ailleurs . Mais c'est cette totalit mme
q
u'autrui fait
comparatre devant lui et qu'il transcende vers son
propre ailleurs. C'est cette totalit qui se totalise : pour autrui, je suis
irrmdiablement ce que je suis et ma libert mme est un caractre
donn mon tre. Ainsi l ' en-soi me ressaisit jusqu'au futur et me fige
tout entier dans ma fuite mme, qui devient fuite prvue et
contempl e, fuite donne. Mais cette fuite fige n'est jamais la fuite
que je suis pour
moi : el l e est fige dehors. Cette objectivit de ma
fuite, j e l'prouve comme une alination que j e ne puis ni transcender
ni connatre. E
t
pourtant , du seul fait que je l' prouve et qu'elle
confre ma fu
ite
cet en-soi qu'elle fuit, j e dois me retourner vers elle
et prendre des attitudes vis--vis d'elle. Telle est l'origine de mes
402
rapports concrets avec autrui : ils sont command<s tout entiers par
mes attitudes vis--vis de l'objet que j e suis pour autrui. Et comme
l'existence d'autrui me rvle l'tre que je suis, sans que je puisse ni
m'approprier cet tre ni mme l e concevoir, cette existence motivera
deux attitudes opposes : autrui me regarde et, comme tel, il dtient
le secret de mon tre, il sait ce que je suis ; ainsi, le sens profond de
mon tre est hors de moi, emprisonn dans une absence ; autrui
barre sur moi. Je puis donc tenter, en tant que je fuis l'en-soi que j e
suis sans l e fonder, de nier cet tre qui m'est confr du dehors ; c'est
-dire que je puis me retourner sur autrui pour lui confrer mon
tour l'objectit, puisque l'objectit d'autrui est destructrice de mon
objectivit pour autrui. Mais, d'autre part, en tant qu'autrui comme
libert est fondement de mon tre-en-soi, je puis chercher rcuprer
cette libert et m'en emparer, sans lui ter son caractre de libert :
si je pouvais, en effet, m'assimiler cette l i bert qui est fondement de
mon tre-en-soi , je serais moi-mme mon propre fondement.
Transcender l a transcendance d'autrui ou, au contraire, engloutir en
moi cette transcendance sans lui ter son caractre de transcendance,
telles sont les deux attitudes primitives que je prends vis--vis
d'autrui. Et, l encore, il convient d'entendre les mots avec pru
dence : il n'est point vrai que je sois d'abord et que je cherche
ensuite objectiver ou assimiler autrui ; mais dans la mesure o l e
surgissement de mon tre est surgissement en prsence d'autrui, dans
la mesure o je suis fuite poursuivante et poursuivant poursuivi , je
suis, la raci ne mme de mon tre, pro-jet d'objectivation ou
d'assi milation d'autrui. Je suis preuve d' autrui : voil l e fait originel .
Mais cette preuve d'autrui est en elle-mme attitude envers autrui,
c'est--dire que je puis tre en prsence d'autrui sans tre cet en
prsence sous forme d'avoir l'tre. Ainsi dcrivons-nous encore
des structures d'tre du pour-soi, encore que la prsence d'autrui
dans le monde soit un fait absolu et vident par soi, mais contingent,
c'est--dire i mpossible dduire des structures ontologiques du
pour-soi.
Ces deux tentatives que je suis sont opposes. Chacune d'elles est
la mort de l'autre, c'est--dire que l'chec de l'une motive l'adoption
de l'autre. Ainsi n'y a-t-il pas dialectique de mes relations envers
autrui, mais cercle - encore que chaque tentative s'enrichisse de
l'chec de l'autre. Aussi tudierons-nous successivement l'une et
l'autre. Mais i l convient de noter qu'au sein mme de l'une, l'autre
demeure toujours prsente, prcisment parce qu'aucune des deux ne
peut tre tenue sans contradiction. Mieux, chacune d'elles est en
l'autre et engendre l a mort de l'autre ; ainsi ne pouvons-nous jamais
sortir du cercle. Il convient de ne pas perdre de vue ces quelques
remarques en abordant l'tude de ces attitudes fondamentales envers
autrui. Ces attitudes se produisant et se dtruisant en cercle, il est
403
aussi arbitraire de commencer par l'une que de commencer par
l ' autre. Toutefois, comme il faut choisir, nous envisagerons d'abord
les conduites par lesquelles le pour-soi tente de s'assimiler la libert
d'autrui.
LA PREMI RE ATTITUDE ENVERS AUTRU I
L ' AMOUR, LE LANGAGE, LE MASOCHI SME
Tout ce qui vaut pour moi vaut pour autrui . Pendant que je tente de
me librer de l' emprise d'autrui, autrui tente de se librer de la
mienne ; pendant que j e cherche asservir autrui, autrui cherche
m'asservir. Il ne s'agit null ement ici de relations unilatrales avec un
objet-en-soi, mais de rapports rciproques et mouvants. Les descrip
tions qui vont suivre doivent donc tre envisages dans la perspective
du confit. Le conflit est le sens originel de l' tre-pour-autrui.
Si nous partons de la rvlation premire d'autrui comme regard,
nous devons reconnatre que nou prouvons notre insaisissable tre
pour-autrui sous la forme d' une possession. Je suis possd par
autrui ; le regard d'autrui faonne mon corps dans sa nudit, le fait
natre, le sculpte, le produit comme il est, le voit comme je ne le verrai
j amais. Autrui dtient un secret : le secret de ce que je suis. Il me fait
tre et, par cela mme, me possde, et cette possession n'est rien
autre que la conscience de me possder. Et moi, dans la reconnais
sance de mon objectit, j' prouve qu'il a cette conscience. A titre de
conscience, autrui est pour moi la fois ce qui m'a vol mon tre et ce
qui fait qu' il y a un tre qui est mon tre. Ainsi ai-je la
comprhension de cette structure ontologique ; je suis responsable de
mon tre-pour-autrui, mais je n'en suis pas le fondement ; il m'appa
rat donc sous forme d' un donn contingent dont je suis pourtant
responsable, et autrui fonde mon tre en tant que cet tre est sous la
forme du i l y a ; mais il n'en est pas responsable, quoiqu'il le fonde
en toute libert , dans et par sa libre transcendance. Ainsi, dans l a
mesure o j e me dvoile moi-mme comme responsable de mon
tre, je revendique cet tre que j e suis ; c'est--dire que je veux le
rcuprer ou, en termes plus exacts, je suis projet de rcupration de
mon tre. Cet tre qui m'est apprsent comme mon tre, mais
distance, comme le repas de Tantale, je veux tendre la main pour
m'en emparer et le fonder par ma libert mme. Car, si , en un sens,
mon tre-objet est insupportable contingence et pure possession
de moi par un autre, en un autre sens cet tre est comme l'indication
404
de ce qu'il faudrait que je rcupre et que je fonde pour tre
fondement de moi . Mais c'est ce qui n'est concevable que si j e
m'assimile l a libert d'autrui . Ainsi, mon projet de rcupration de
moi est fondamentalement projet de rsorption de J'autre. Toutefois
ce projet doit laisser intacte la nature de l'autre. C'est--dire que :
10 Je ne cesse pas pour cel a d' affirmer autrui, c'est--dire de ni er de
moi que je soi s l ' autre : l ' autre tant fondement de mon tre ne
saurait se diluer en moi sans que mon tre-pour-autrui s'vanouisse.
Si donc j e projette de ral iser l' unit avec autrui , cela signifie que je
projette de m'assimiler l'altrit de l'autre en tant que tel l e, comme
ma possibilit propre. Il s'agit, en effet, pour moi de me faire tre en
acqurant la possibilit de prendre sur moi l e point de vue de l'autre.
Mais i l ne s'agit pas cependant d' acqurir une pure facult abstraite
de connaissance. Ce n'est pas l a pure catgorie de l'autre que j e
projette de m'appropri er : cette catgorie n'est ni conue ni mme
concevable. Mais, l'occasion de l'preuve concrte, soufferte et
ressentie, de l ' autre, c'est cet autre concret comme ralit absolue
que je veux m' i ncorporer dans son altrit. 2 L'autre que je veux
assimi l er n'est aucunement l ' autre-objet. Ou, si l'on veut, mon projet
d'incorporation de l 'autre ne correspond nullement un ressaisisse
ment de mon pour-soi comme moi-mme et un dpassement de l a
transcendance de J'autre vers mes propres possibilits. Il ne s'agit pas
pour moi d'effacer mon objectivit en objectivant l'autre, ce qui
correspondrait me dlivrer de mon tre-pour-autrui, mais, bien au
contraire, c'est en tant qu'autre-regardant que je veux m'assimiler
l'autre et ce projet d'assimilation comporte une reconnaissance
accrue de mon tre-regard. En un mot, je m' identifie totalement
mon tre-regard pour maintenir en face de moi la libert regardante
de l'autre et, comme mon tre-objet est la seule relation possible de
moi l'autre, c' est cet tre-objet seul qui peut me servir d' instrument
pour oprer l ' assimilation moi de l'autre libert. Ainsi, comme
raction l'chec de la troisime ek-stase, l e pour-soi veut s'identifier
l a libert d'autrui , comme fondant son tre-en-soi. Etre soi-mme
autrui - idal toujours vis concrtement sous forme d'tre soi
mme cet autrui - c'est la valeur premire des rapports avec autrui ;
cela signifie que mon tre-pour-autrui est hant par l'indication d'un
tre-absolu qui serait soi en tant q u'autre et autre en tant que soi et
qui, se donnant librement comme autre son tre-soi et comme soi son
tre-autre, serait l 'tre mme de la preuve ontologique, c'est--dire
Dieu. Cet idal ne saurait se raliser sans que je surmonte la
contingence originelle de mes rapports autrui, c'est--dire l e fait
qu'il n'y a aucune relation de ngativit interne entre la ngation par
quoi autrui se fait autre que moi et la ngation par quoi je me fais
autre que J'autre. Nous avons vu que cette contingence est insurmon
table : elle est le fait de mes relations avec autrui, comme mon corps
405
est le fait de mon tre-dans-Ie-monde. L'unit avec autrui est donc,
en fai t , irralisabl e. El l e l'est aussi en droit, car l 'assimilation du
pour-soi et d'autrui dans une mme transcendance entranerait
ncessairement la disparition du caractre d'altrit d'autrui. Ainsi ,
la condition pour que je projette l ' identification moi d'autrui c'est
que je persiste nier de moi que je sois l'autre. Enfi n, ce projet
d' unification est source de confit puisque, tandis que je m'prouve
comme objet pour autrui et que je projette de l'assimiler dans et par
cette preuve, autrui me saisit comme objet au milieu du monde et
ne projette nullement de m'assimiler l ui . Il serait donc ncessaire
-puisque l'tre pour autrui comporte une double ngation interne
- d'agir sur la ngation interne par quoi autrui transcende ' ma
transcendance et me fait exister pour l'autre, c'est--dire d'agir sur la
libert d'autrui.
Cet idal irralisable, en tant qu' il hante mon projet de moi-mme
en prsence d' autrui , n'est pas assimilable l'amour en tant que
l'amour est une entreprise, c'est--dire un ensemble organique de
projets vers mes possibilits propres. Mais i l est l 'idal de l'amour,
son motif et sa fin, sa valeur propre. L'amour comme relation
primitive autrui est l ' ensemble des projets par lesquels j e vise
raliser cette valeur.
Ces projets me mettent en liaison directe avec l a libert d'autrui.
C'est en ce sens que l'amour est conflit. Nous avons marqu, en
effet, que l a l i bert d'autrui est fondement de mon tre. Mai s,
prcisment parce que j'existe par l a libert d'autrui, je n' ai aucune
scurit, j e suis en danger dans cette libert ; elle ptrit mon tre et
me fait tre, el l e me confre et m'te des valeurs, et mon tre reoit
d'elle un perptuel chappement passif soi . Irresponsable et hors
d'atteinte, cette libert protiforme dans laquelle je me suis engag
peut m'engager son tour dans mil l e manires d'tre diffrentes.
Mon projet de rcuprer mon tre ne peut se raliser que si je
m'empare de cette libert et que j e l a rduis tre libert soumise
ma libert. Simultanment, c'est la seule faon dont je puisse agir
sur la libre ngation d'intriorit par quoi l'autre me constitue en
autre, c'est--dire par quoi je puisse prparer les voies d' une
identification future de l'autre moi. C'est ce qui sera pl us clair,
peut-tre, si l'on mdite sur ce problme d' aspect purement psycho
logique : pourquoi l'amant veut-il tre aim ? Si l'amour, en effet,
tait pur dsir de possession physique, i l pourrait tre, en bien des
cas, facilement satisfait. Le hros de Proust, par exemple, qui
installe chez lui sa matresse, peut l a voir et l a possder toute
heure du jour et a su l a mettre dans une totale dpendance
matri el l e, devrait tre tir d'inquitude. On sait pourtant qu' i l est,
au contraire, rong de souci. C'est par sa conscience qu'Albertine
chappe Marcel, lors mme qu'il est ct d'elle et c'est pourquoi
406
il ne connat de rpit que s'il la contemple pendant son sommeil . Il est
donc certain que J ' amour veut captiver la conscience . Mais
pourquoi l e veut-i l ? Et comment ?
Cette notion de proprit par quoi on explique si souvent
l'amour ne saurait tre premire , en effet. Pourquoi voudrais-je
m'approprier autrui si ce n'tait j ustement en tant qu'autrui me fait
tre ? Mais cela implique justement un certain mode d'appropria
tion : c'est de l a l ibert de l'autre en tant que telle que nous voulons
nous emparer. Et non par volont de puissance : l e tyran se moque de
l'amour ; i l se contente de l a peur. S'il recherche l'amour de ses sujets,
c'est par politique et s'il trouve un moyen plus conomique de les
asservir, i l l ' adopte aussitt. Au contraire, celui qui veut tre aim ne
dsire pas l 'asservissement de l'tre aim. Il ne tient pas devenir
l'objet d' une passion dbordante et mcanique. Il ne veut pas
possder un automatisme, et si on veut l'humilier, i l suffit de lui
reprsenter l a passion de l'aim comme l e rsul tat d'un dterminisme
psychologique : l 'amant se sentira dvaloris dans son amour et dans
son tre. Si Tristan et Iseut sont affols par un philtre, ils intressent
moins ; et il arrive qu' un asservissement total de l'tre ai m tue
l'amour de ramant. Le but est dpass : l 'amant se retrouve seul si
l'aim s'est transform en automate. Ainsi l'amant ne dsire-t-il pas
possder l'aim comme on possde une chose ; il rclame un type
spcial d'appropriation. Il veut possder une libert comme libert.
Mais, d'autre part, i l ne saurait se satisfaire de cette forme
minente de
la libert qu'est l'engagement libre et volontaire. Qui se
contenterait d'un amour qui se donnerait comme pure fidlit l a foi
jure ? Qui donc accepterait de s'entendre di re : Je vous aime parce
que je me suis librement engag vous aimer et que je ne veux pas me
ddire ; j e vous aime par fidlit moi-mme ? Ainsi l'amant
demande le serment et s'irrite du serment. Il veut tre aim par une
libert et rclame que cette libert comme libert ne soit plus libre. I l
veut l a fois que l a libert de l'autre se dtermine elle-mme
devenir amour -et cela, non poi nt seulement au commencement de
l'aventure mais chaque instant -et, la fois, que cette libert soit
captive par elle-mme, qu'elle se retourne sur elle-mme, comme
dans l a fol i e, comme dans l e rve, pour vouloir sa captivit. Et cette
captivit doit tre dmission libre et enchane la fois entre nos
mains. Ce n'est pas le dterminisme passionnel que nous dsirons
chez autrui, dans l'amour, ni une l ibert hors d'atteinte : mais c'est
une l i bert qui joue le dterminisme passionnel et qui se prend son
jeu. Et, pour lui-mme, l'amant ne rclame pas d'tre cause de cette
modification radicale de l a libert, mais d'en tre l'occasion unique et
privilgie. Il ne saurait en effet vouloir en tre l a cause sans pl onger
aussi tt l'aim au milieu du monde comme un outil que l'on peut
transcender. Ce n'est pas Ii l'essence de l'amour. Dans l'amour, au
407
contraire, l'amant veut tre tout au monde pour l'aim : cela
signifie qu' i l se range du ct du monde ; il est ce qui rsume et
symbolise le monde, i l est un ceci qui enveloppe tous les autres ceci, il
est et accep
t e
d'tre objet. Mais, d'autre part, il veut tre l 'objet dans
l equel la l i bert d'autrui accepte de se perdre, l'objet dans lequel
l'autre accepte de trouver comme sa facticit seconde, son tre et sa
raison d'tre ; l'objet l i mi te de l a transcendance, celui vers lequel la
transcendance d'autrui transcende tous les autres objets mais qu'elle
ne peut aucunement transcender. Et, partout, i l dsire l e cercle de l a
libert d'autrui ; c'est--dire qu' chaque instant" dans l'acceptation
que la
li
ber
t
d'autrui fait de cette limite sa transcendance, cette
acceptation soit dj prsente comme mobile de l'acceptation consi
dre. C'est titre de fin dj choisie qu'il veut tre choisi comme fin.
Ceci nOus permet de saisir fond ce que l'amant exige de l'aim : il ne
veut pas agir sur la libert de l'autre mais exister a priori comme la
limite objective de cette libert, c'est--dire tre donn d' un coup
avec el l e et dans son surgissement mme comme la limite qu'elle doit
accepter pour tre libre. De ce fait mme, ce qu'il exige est un
engluement, un emptement de la libert d'autrui par el l e-mme :
cette l i mite de
structure est en effet un donn et la seule apparition du
donn comme limite de l a libert signifie que la libert se fait exister
l ' i ntrieur du donn en tant sa propre interdiction de le dpasser. Et
cette interdiction est envisage par l'amant la fois comme vcue,
c'est--dire COmme subie -en un mot comme une facticit -et la
fois comme librement consentie. Elle doit pouvoir tre librement
consentie puisqu'elle doit ne faire qu'un avec l e surgissement d'une
l ibert
q
ui se choisit comme libert. Mais el l e doit tre seulement
vcue puisqu'elle doit tre une i mpossibilit toujours prsente, une
facticit qui reflue sur la l i bert de l'autre jusqu' son cur ; et cela
s'exprime psychologiquement par l ' exigence que la libre dcision de
m'aimer que l 'aim a prise antrieurement se glisse comme mobile
envotant l'intrieur de son libre engagement prsent.
On saisit pr'sent l e sens de cette exigence : cette facticit qui doit
tre limite de fait pour autrui, dans mon exigence d'tre aim, et qui
doit finir par tre sa propre facticit, c'est ma facticit. C'est en tant
que je sui s J'objet qu'autrui fait venir l'tre que je dois tre la l i mite
inhrente sa transcendance mme ; de manire qu'autrui, en
surgissant l'tre, me fasse tre comme l'indpassable et l'absolu,
non en tant que pour-soi nantisant mais comme tre-pour-autrui-au
milieu-du-monde. Ainsi vouloir tre aim, c'est infecter l ' autre de sa
propre factici t, c'est vouloir le contraindre vous recrer perptuel
lement comme l a condition d' une l i bert qui se soumet et qui
s'engage ; c'est voul oir la fois que l a libert fonde l e fait et que le fait
ait prminence sur la libert. Si ce rsultat pouvait tre atteint il en
rsulterai t en premier lieu que je serais en scurit dans l a conscience
408
de l' autre. D'abord oarce que le moti f de mon inquitude et de ma
honte, c'est que je me saisis et m'prouve dans mon tre-pour-autrui
comme ce qui peut toujours tre dpass vers autre chose, ce qui est
pur objet de jugement de valeur, pur moyen, pur outi l . Mon
inquitude vient de ce que j ' assume ncessairement et l ibrement cet
tre qu'un autre me fait tre dans une absolue libert : Dieu sait
qu'est-ce que je sui s pour l ui ! Dieu sai t comment il me pense. Cela
signifie : Dieu sait comment i l me fait tre et je suis hant par cet
tre que j e crains de rencontrer un j our au dtour d' un chemin, qui
m'est si tranger et qui est pourtant mon tre et dont je sais, aussi,
que, malgr mes efforts, je ne l e rencontrerai jamais. Mais si l'autre
m'aime, je deviens l 'indpassable, ce qui signifie que je dois tre l a fin
absolue ; en ce sens, je suis sauv de l'ustensilit ; mon existence au
milieu du monde devient l'exact corrlatif de ma transcendance-pour
moi, puisque mon indpendance est sauvegarde absolument. L'objet
que l'autre doit me faire tre est un objet-transcendance, un centre de
rfrence absolu autour duquel s'ordonnent comme purs moyens
toutes les choses-ustensiles du monde. En mme temps, comme limite
absolue de l a libert, c'est--dire de l a source absolue de toutes les
valeurs, je suis protg contre toute dvalorisation ventuelle ; je suis
l a valeur absolue. Et, dans l a mesure o j 'assume mon tre-pour
autrui , je m'assume comme valeur. Ai nsi , vouloir tre aim, c'est
vouloir se placer au del de tout le systme de valeurs pos par autrui
comme la condition de toute valorisation et comme le fondement
objectif de. toutes les valeurs. Cette exigence fait le thme ordinaire
des conversations entre amants soit que, comme dans La Porte
trite, celle qui veut tre ai me s'identifie avec une morale asctique
de dpassement de soi et veuille incarner l a limite idale de ce
dpassement - soit que, plus ordinairement, l'amant exige que
l'aim lui sacrifie dans ses actes la morale traditionnelle, s'inquitant
de savoir si l'aim trahirait ses amis pour l ui , volerait pour lui ,
tuerait pour l ui etc. De ce poi nt de vue, mon tre doit chapper
au regard de l ' aim ; ou pl utt, il doit tre l'objet d'un regard d'une
autre structure : je ne dois plus tre vu sur fond de monde comme un
ceci parmi d'autres ceci, mais le monde doit se rvler partir de moi .
Dans la mesure, en effet, o le surgissement de la libert fait qu'un
monde existe, je dois tre, comme condition-limite de ce surgisse
ment, la condition mme du surgissement d' un monde. Je dois tre
celui dont la fonction est de faire exister les arbres et l'eau, les villes et
l es champs et l es autres hommes pour l es donner ensuite l'autre qui
l es dispose en monde, tout de mme que la mre, dans les socits
matronymiques, reoit les titres et le nom, non pour les garder, mais
pour les transmettre immdiatement ses enfants. En un sens, si j e
dois tre ai m, je suis l'objet par procuration de quoi l e monde
existera pour l'autre ; et en un autre sens, je suis l e monde. Au l i eu
409
d'tre un ceci se dtachant sur fond de monde, je suis l'objet-fond sur
quoi le monde se dtache. Ainsi suis-je rassur : le regard de l'autre
ne me transit plus de finitude ; il ne fige plus mon tre en ce que je suis
simpl ement ; je ne saurais tre regard comme laid, comme petit,
comme lche, puisque ces caractres reprsentent ncessairement
une l i mitation de fait de mon tre et une apprhension de ma finitude
comme fi nitude. Certes, mes possibles demeurent possibilits trans
cendes, mortes-possibilits ; mais j'ai tous les possibles ; je suis
toutes les mortes-possibilits du monde ; par l je cesse d'tre l ' tre
qui se comprend partir d'autres tres ou partir de ses actes ; mais,
dans l' intuition amoureuse que j 'exige, je dois tre donn comme une
total i t absolue partir de laquelle tous l es tres et tous ses actes
propres doivent t re compris. On pourrait dire, en dformant un peu
une clbre formule stocienne, que l'aim peut faire trois fois l a
culbute . L' i dal du sage et l ' i dal de celui qui veut tre ai m
concident, en effet, en ceci que l' un et l'autre veulent tre totalit
objet accessible une intuition globale qui saisira les actions dans le
monde de l'aim et du sage comme des structures partielles qui
s'interprtent partir de l a totalit. Et, de mme que la sagesse se
propose comme un tat atteindre par une mtamorphose absolue,
de mme l a libert d'autrui doit se mtamorphoser absolument pour
me faire accder l'tat d' aim.
Cette description cadrerait assez, jusqu'ici, avec la fameuse des
cription hglienne des rapports du matre et de l 'esclave. Ce que le
matre hglien est pour l'esclave, l'amant veut l'tre pour l'aim.
Mais l'anal ogie s' arrte ici , car l e matre n'exige, chez Hegel, que
latralement et, pour ainsi dire, implicitement, l a libert de l'esclave,
au lieu que l' amant exige d'abord la libert de l'aim. En ce sens, si je
dois tre aim par l 'autre, je dois tre choisi librement comme aim.
On sait que, dans l a terminologie courante de l'amour, l'aim est
dsign du terme d'lu. Mais ce choix ne doit pas tre relatif et
contingent : l'amant s'irrite et se sent dvaloris lorsqu'il pense que
l'aim l'a choisi parmi d'autres. Alors, si je n'tais pas venu dans
cette ville,
si je n'avais pas frquent chez les tel , tu ne
m' aurais pas connu, tu ne m' aurais pas aim ? Cette pense affige
l' amant : son amour devient amour parmi d' autres, limit par la
facticit de l' aim et par sa propre facticit, en mme temps que par la
contingence des rencontres : i l devient amour dans le monde, objet
qui suppose l e monde et qui peut son tour exister pour d'autres. Ce
qu' i l exige, il le t raduit par des mots maladroits et entachs de
chosisme ; il dit : Nous tions faits l'un pour l'autre ou encore
il emploie l'expression d'me sur . Mais il faut interprter : il sait
bien qu' tre faits l ' un pour l'autre , cela se rfre un choix
originel. Ce choix peut tre celui de Di eu, comme de l'tre qui est
choix absol u ; mais Dieu ne reprsente ici que l e passage l a limite
4
1 0
dans l ' exigence d'absolu. En fai t , ce que l'amant exige, c'est que
l'aim ait fait de lui choix absolu. Cela signifie que l 'tre-dans-Ie
monde de l' aim doit tre un tre-aimant. Ce surgissement de l'aim
doit tre libre choix de l'amant. Et comme l'autre est fondement de
mon tre-obj et, j' exige de lui que le l i bre surgissement de son tre ait
pour fin unique et absolue son choi x de moi, c'est--dire qu' il ait
choisi d'tre pour fonder mon objectit et ma facticit. Ainsi , ma
facti cit est sauve . Elle n' est plus ce donn impensable et
insurmontable que je fuis : elle est ce pour quoi l 'autre se fait exister
librement ; elle est comme fin qu' i l se donne. Je l 'ai i nfect de ma
factici t, mais comme c'est en tant que libert qu'il en a t i nfect, il
me la renvoie comme facticit reprise et consentie : i l en est le
fondement pour qu'elle soit sa fin. A partir de cet amour, je saisis
donc autrement mon ali nation et ma facticit propre. Elle est -en
tant que pour-autrui -non plus un fait , mais un droit. Mon existence
est parce qu'elle est appele. Cette existence en tant que j e l ' assume
devient pure gnrosit. Je suis parce que je me prodigue. Ces veines
aimes sur mes mains, c'est par bont qu'elles existent. Que je suis
bon d'avoir des yeux, des cheveux, des sourcils et de les prodiguer
inlassablement dans un dbordement de gnrosit ce dsir
inlassable qu'autrui se fait librement tre. Au lieu que, avant d'tre
aims, nous tions inquiets de cette protubrance injustifi e, injusti
fiable qu'tait notre existence ; au l i eu de nous sentir de trop ,
nous sentons prsent que cette existence est reprise et voulue dans
ses moindres dtails par une l i bert absolue qu'elle conditionne en
mme temps - et que nous voulons nous-mmes avec notre propre
libert. C'est l l e fond de l a j oi e d'amour, lorsqu'elle existe : nous
sentir j ustifis d'exister.
Du mme coup, si l'aim peut nous aimer, i l est tout prt tre
assimil par notre libert ; car cet tre-ai m que nous souhaitons, c'est
dj la preuve ontologique appl i que notre tre-pour-autrui . Notre
essence objective implique l'existence de l'autre et, rciproquement,
c'est l a libert de l'autre qui fonde notre essence. Si nous pouvions
intrioriser tout l e systme, nous serions fondement de nous-mmes.
Tel est donc l e but rel de l ' amant, en tant que son amour est une
entreprise, c'est--dire un pro-jet de soi-mme. Ce projet doit
provoquer un conflit. L'aim, en effet, saisit l'amant comme un autre
objet parmi les autres, c'est--dire qu' i l l e peroit sur fond de monde,
l e transcende et l 'utilise. L'aim est regard. Il ne saurait donc utiliser
sa transcendance fixer une l i mi te ultime ses dpassements ni sa
libert se captiver elle-mme. L'aim ne saurait vouloir aimer.
L'amant doit donc sduire l' ai m ; et son amour ne se distingue pas de
cette entreprise de sduction. Dans l a sducti on, je ne tente
nullement de dcouvrir autrui ma subjectivit : je ne pourrais le
faire, d'ailleurs, qu'en regardant l ' autre ; mais par ce regard je ferais
41 1
disparatre la subjectivit d'autrui et c'est eUe que je veux m'assimi
ler. Sduire, c'est assumer entirement et comme un risque courir
mon obj ectit pour autrui, c'est me mettre sous son regard et me faire
regarder par lui , c'est courir le danger d'tre-vu pour faire un nouveau
dpart et m'approprier l'autre dans et par mon objectit. Je refuse de
quitter le terrain o j'prouve mon objectit ; c'est sur ce terrain que
je veux engager l a lutte en me faisant objet fascinant. Nous avons
dfi ni la fasci nation comme tat dans notre seconde partie : c'est,
disions-nous, l a conscience non-thtique d'tre l e rien en prsence de
l'tre. La sduction vise occasionner chez autrui la conscience de sa
nantit en face de l'objet sduisant. Par la sduction, je vise me
constituer comme un plein d' tre et me faire reconnatre comme tel.
Pour cela, je me constitue en objet signifiant. Mes actes doivent
indiquer dans deux directions. D'une part, vers ce qu'on appeUe tort
subjectivit et qui est plutt profondeur d' tre objectif et cach ;
l'acte n'est pas fait pour lui-mme seulement, mais il indique une srie
i nfi ni e et i ndiffrencie d'autres actes rels et possibles que je donne
comme constituant mon tre objectif et inaperu. Ainsi tent-je de
guider l a transcendance qui me transcende et de l a renvoyer l'infini
de mes mortes-possi bilits, prcisment pour tre l'indpassable et
dans la mesure justement o le seul i ndpassable est l'infini. D'autre
part, chacun de mes actes tente d' i ndiquer la plus grande paisseur de
monde possible et doit me prsenter comme li aux plus vastes
rgions du monde, soit que je prsente le monde l'aim et que je
tente de me constituer comme l'intermdiaire ncessaire entre lui et
l e monde, soit, simplement, que je manifeste par mes actes des
puissances varies l ' infini sur le monde (argent, pouvoir, relations,
etc. ) . Dans le premier cas, je tente de me constituer comme un infini
de profondeur ; dans le second cas, de m'identifier au monde. Par ces
diffrents procds, je me propose comme i ndpassable. Cette pro
position ne saurait se suffire eUe-mme, eUe n'est qu'un investisse
ment de l'autre, eUe ne saurait prendre valeur de fait sans le
consentement de l a libert de J'autre qui doit se captiver en se
reconnaissant comme nant en face de ma plnitude d'tre absolue.
On dira que ces diverses tentatives d'expression supposent l e
langage. Nous n'en disconviendrons pas ; nous dirons mieux : eUes
sont le langage ou, si l'on veut, un mode fondamental du langage.
Car, s'il existe des problmes psychologiques et historiques touchant
l'existence, l'apprentissage et l'utilisation de telle langue particulire,
il n'y a aucun problme particulier touchant ce qu'on nomme
J'invention du langage. Le l angage n'est pas un phnomne surajout
J'tre-pour-autrui : il est origineUement l'tre-pour-autrui, c'est-
dire le fait qu'une subjectivit s'prouve comme objet pour l'autre.
Dans un uni vers de purs objets, le langage ne saurait en aucun cas
tre invent , puisqu'il suppose originellement un rapport un
412
autre sujet ; et dans l'intersubjectivit des pour-autrui, il n'est pas
ncessaire de l'inventer. car il est dj donn dans la reconnaissance
de l'autre. Du seul fait que, quoi que je fasse, mes actes l ibrement
conus et excuts, mes pro-jets vers mes possibilits ont dehors un
sens qui m'chappe et que j 'prouve, j e suis langage. C'est en ce sens
- et en ce sens seulement - que Heidegger a raison de dclarer
que : je suis ce que je dis
1
. Ce langage n'est pas, en effet, un instinct
de la crature humaine constitue, i l n'est pas non plus une invention
de notre subjectivit ; mais i l ne faut pas non plus le ramener au pur
tre-hors-de-soi ) du Dasein. Il fait partie de l a condion humaine,
i l est originellement l 'preuve qu'un pour-soi peut faire de son tre
pour-autrui et, ultrieurement, le dpassement de cette preuve et
son utilisation vers des possibilits qui sont mes possi bilits, c'est-
dire vers mes possibilits d'tre ceci ou cela pour autrui. Il ne se
distingue donc pas de la reconnaissance de l'existence d'autrui. Le
surgissement de l'autre en face de moi comme regard fait surgir le
langage comme condition de mon tre. Ce langage primitif n'est pas
forcment la sduction ; nous en verrons d'autres formes ; nous avons
d'ailleurs marqu qu' i l n'y a aucune attitude primitive en face d'autrui
et qu'elles se succdent en cercle, chacune impliquant l'autre. Mais,
inversement, l a sduction ne suppose aucune forme antrieure du
langage : elle est tout entire ralisation du langage ; cela signifie que
le langage peut se rvler entirement et d' un coup par la sduction
comme mode d'tre primitif de l'expressi on. Il va de soi que par
langage nous entendons tous les phnomnes d'expression et non pas
la parole articule qui est un mode driv et secondaire dont
l'apparition peut faire l'objet d' une tude historique. En particulier,
dans l a sduction, l e langage ne vise pas donner connatre, mais
faire prouver.
Mais en cette tentative premire pour trouver un langage fascinant,
je vais l'aveuglette, puisque j e me guide seulement sur la forme
abstraite et vide de mon objectit pour l'autre. Je ne puis mme pas
concevoi r quel effet auront mes gestes et mes attitudes, puisqu'ils
seront toujours repris et fonds par une libert qui les dpassera et
puisqu'ils ne peuvent avoir de signification que si cette libert leur en
confre une. Ainsi le sens de mes expressions m'chappe tou
jours ; je ne sais jamais exactement si j e signifie ce que j e veux
signifier ni mme si je suis signifiant ; en cet instant prcis, i l faudrait
que je lise en l'autre, ce qui, par principe, est inconcevable. Et, faute
1. La formule est de A. de Waehlens : La Philosophie de Martin Heidegger,
Louvain, 1942, p. 99. Cf. aussi le texte de Heidegger qu'il cite : Diese
Bezeugung meint hier nicht einen nachtraglichen und bei herlaufenden Aus
druck des Menschseins, sondern sic macht das Dasein des Menschen mit aus.
(Ho/der/in und das Wesen der Dichtung, p. 6. )
413
de savoi r ce que j'exprime en fai t, pour autruI, Je constitue mon
langage comme un phnomne incomplet de fuite hors de moi. Ds
que je m'expri me, je ne puis que conjecturer le sens de ce que
j'expri me, c'est--dire, en somme, le sens de ce que je suis, puisque,
dans cette perspective, exprimer et tre ne font qu' un. Autrui est
toujours l, prsent et prouv comme ce qui donne au langage son
sens. Chaque expression, chaque geste, chaque mot est, de mon ct,
preuve concrte de la ralit alinante d'autrui. Ce n'est pas
seulement l e psychopathe qui peut dire - comme dans le cas, par
exempl e , des psychoses d' influence 1 - On me vole ma pense .
Mais le fait mme de l'expression est un vol de pense, puisque la
pense a besoin du concours d'une libert alinante pour se constituer
comme objet. C'est pourquoi ce premier aspect du langage -en tant
que c' est moi qui l'utilise pour l'autre - est sacr. L'objet sacr, en
effet , est un objet du monde qui indique une transcendance par del
le monde. Le langage me rvle la libert de celui qui m'coute en
silence, c'est--dire sa transcendance.
Mais dans le mme moment, pour l'autre, j e demeure objet
signifiant - ce que j 'ai toujours t. Il n'est aucun chemin qui ,
partir de mon objectit, puisse indiquer l'autre ma transcendance.
Les attitudes, les expressions et les mots ne peuvent jamais lui
i ndi quer que d'autres attitudes, d'autres expressions et d' autres mots.
Ainsi , l e langage demeure pour autrui simple proprit d' un objet
magique et objet magique lui-mme : i l est une action distance dont
autrui connat exactement l'effet. Ainsi, le mot est sacr quand c'est
moi qui l'utilise, et magique quand l ' autre l'entend. Ainsi, je ne
connais pas plus mon langage que mon corps pour l'autre. Je ne puis
m'entendre parler ni me voir sourire. Le problme du langage est
exactement parallle au problme des corps et les descri ptions qui ont
valu dans un cas valent dans l'autre.
Cependant l a fasci nation, mme si elle devait occasionner en autrui
un tre-fasci n, ne parviendrait pas de soi occasionner l'amour. On
peut tre fascin par un orateur, par un acteur, par un quilibriste :
cela ne signifie pas qu'on l ' ai me. On ne saurait en dtacher les yeux,
certes ; mais i l s'enlve encore sur fond de monde, et la fascination ne
pose pas l'objet fascinant comme terme ultime de l a transcendance ;
bien au contraire, elle est transcendance. Quand donc l'aim devien
dra-t-il aimant son tour ?
La
rponse est simple : l orsqu'il projettera d' tre aim. En soi
autrui-objet n'a j amais assez de force pour occasionner l'amour. Si
1. D'ailleurs, la psychose d'innuence, comme la gnralit des psychoses,
est preuve exclusive et traduite par des mythes d'un grand fait mtaphysique :
ici le fait dalination. Un fou ne fait jamais que raliser sa manire l a
condition humaine.
414
l'amour a pour idal l'appropriation d'autrui en tant qu'autrui, c'est
-dire en tant que subjectivit regardante, cet idal ne peut tre
proj et qu' partir de ma rencontre avec autrui-sujet, non avec
autrui-objet. La sduction ne peut parer autrui-objet qui tente de me
sduire que du caractre d'objet prcieu possder ; elle me
dterminera peut-tre risquer gros pour l e conquri r ; mais ce dsir
d'appropriation d'un objet au milieu du monde ne saurait tre
confondu avec l'amour. L'amour ne saurait donc natre chez l'aim
que de l'preuve qu'il fait de son alination et de sa fuite vers l'autre.
Mais, de nouveau, l'aim, s'il en est ainsi , ne se t ransformera en
amant que s'il projette d'tre aim, c'est--dire si ce qu'il veut
conqurir n'est point un corps mais l a subjectivit de l'autre en tant
que telle. Le seul moyen, en effet, qu'il puisse concevoir pour raliser
cette appropriation, c'est de se faire aimer. Ainsi nous apparat-il
qu'aimer est, dans son essence, le projet de se faire aimer. D'o cette
nouvelle contradiction et ce nouveau conflit : chacun des amants est
entirement captif de l'autre en tant qu' i l veut se faire aimer par lui
l'exclusion de tout autre ; mais en mme temps, chacun exige de
l'autre un amour qui ne se rduit nullement au projet d' tre-aim
Ce qu'il exige, en efet, c'est que l 'autre, sans chercher originellement
se faire ai mer, ait une intuition la fois contemplative et affective de
son ai m comme la limite obj ective de sa libert, comme le
fondement inluctable et choisi de sa transcendance, comme l a
totalit d' tre et l a valeur suprme . L'amour ainsi exig de l'autre ne
saurait rien demander : i l est pur engagement sans rciprocit. Mais,
prcisment, cet amour ne saurait exister sinon titre d'exigence de
l'amant ; et c'est tout autrement que l'amant est captiv : i l est captif
de son exigence mme ; dans la mesure en effet o l'amour est
exigence d' tre aim, il est une libert qui se veut corps et qui exige
un dehors, donc une libert qui mi me l a fuite vers l'autre, une libert
qui, en tant que libert, rclame son alination. La libert de l'amant,
dans son effort mme pour se faire aimer comme objet par l'autre,
s'aline en se coulant dans l e corps-pour-l'autre, c'est--dire se
produit l 'existence avec une dimension de fuite vers l'autre ; elle est
perptuel refus de se poser comme pure ipsit, car cette affirmation
de soi comme soi-mme entranerait l'effondrement d'autrui comme
regard et le surgissement de l'autre-obj et, donc un tat de choses o
la possibilit mme d'tre aim disparat puisque l'autre se rduit sa
dimension d'objectivit. Ce refus constitue donc l a libert comme
dpendante de l ' autre et l'autre comme subjectivit devient bien
limite insurpassable de l a libert du pour-soi, but et fin suprme en
tant qu' il dtient la cl de son tre. Nous retrouvons bien ici l'idal de
l'entreprise amoureuse : l a libert aline. Mais c'est celui qui veut
tre aim, qui, en tant qu'il veut qu'on l'aime, aline sa libert. Ma
libert s'aline en prsence de l a pure subjectivit de l'autre qui fonde
415
mon objectivit ; elle ne saurait du tout s'aliner en face de l'autre
objet. Sous cette forme, en effet, l'alination de l'aim dont rve
l 'amant serait contradictoire puisque l'aim ne peut fonder l'tre de
l ' amant qu'en l e transcendant par principe vers d'autres objets du
monde ; donc cette transcendance ne peut constituer la fois l 'objet
qu'eIIe dpasse comme objet transcend et comme objet-limite de
toute transcendance. Ainsi, dans le couple amoureux, chacun veut
tre l'objet pour qui la libert de l'autre s'aline dans une intuition
originelle ; mais cette intuition qui serait l'amour proprement parier
n'est qu' un idal contradictoire du pour-soi ; aussi chacun n'est-il
alin que dans la mesure exacte o il exige l'alination d'autrui.
Chacun veut que l'autre l'aime, sans se rendre compte qu'aimer c'est
voul
o
ir tre ai m et qu'ainsi en voulant que l'autre l 'ai me il veut
seulement que l ' autre veuille qu'il l ' ai me. Ainsi les relations amou
reuses sont-eIIes un systme de renvois indfinis analogue au pur
reflet-reflt de la conscience, sous le signe idal de la valeur
amour , c'est--dire d' une fusion des consciences o chacune
d'elles conserverait son altrit pour fonder l'autre. C'est que, en
effet, les consciences sont spares par un nant insurmontable
puisqu'il est l a fois ngation interne de l'une par l'autre et nant de
fait entre les deux ngations internes. L'amour est un effort contradic
toire pour surmonter la ngation de fait tout en conservant l a
ngation interne. J'exige que l'autre m'aime et je mets tout en uvre
pour raliser mon projet ; mais si l'autre m'aime, il me doit
radicalement par son amour mme : j' exigeais de lui qu' il fonde mon
tre comme objet privilgi en se maintenant comme pure subjecti
vit en face de moi ; et, ds qu'il m'aime, il m'prouve comme sujet et
s'abme dans son objectivit en face de ma subjectivit. Le problme
de mon tre-pour-autrui demeure donc sans solution, l es amants
demeurent chacun pour soi dans une subjectivit totale ; rien ne vient
les relever de leur devoir de se faire exister chacun pour soi ; rien ne
vient lever leur contingence ni les sauver de l a factici t. Au moins
chacun a-t-il gagn de n'tre plus en danger dans la libert de l 'autre
-mais tout autrement qu' il ne le croit : ce n'est point, en effet, parce
que l'autre le fait tre comme objet-limite de sa transcendance, mais
parce que l'autre l'prouve comme subjectivit et ne veut l'prouver
que comme tel . Encore le gain est-il perptuellement compromis :
d'abord, chaque instant, chacune des consciences peut se librer de
ses chanes et contempler tout coup l ' autre comme objet. Alors
l'envotement cesse, l'autre devient moyen parmi les moyens, il est
bien alors objet pour autrui, comme il le dsire, mais objet-outil,
objet perptuellement transcend ; l ' i l l usion, le jeu de glaces qui fait
la ralit concrte de l'amour, cesse tout coup. Ensuite, dans
l'amour, chaque conscience cherche mettre son tre-pour-autrui
l'abri dans la l i bert de l'autre. Cela suppose que l'autre est par del
416
le monde comme pure subjectivit, comme l'absolu par quoi l e
monde vient l'tre. Mai s i l suffit que l es amants soient regards
ensemble par un tiers pour que chacun prouve I"objectivation, non
seulement de soi-mme, mais de l'autre. Du mme coup l'autre n'est
plus pour moi la transcendance absolue qui me fonde dans mon tre,
mais il est transcendance-transcende, non par moi, mais par un
autre ; et mon rapport originel l ui , c'est--dire ma relation d'tre
aim l 'amant, se fige en morte-possibilit. Ce n'est plus le rapport
prouv d'un objet-limite de toute transcendance la libert qui le
fonde : mais c'est un amour-objet qui s'aline tout entier vers l e tiers.
Telle est la vraie raison pourquoi les amants recherchent la solitude.
C'est que l'apparition d'un tiers, quel qu'il soit, est destruction de leur
amour. Mais la solitude de fait (nous sommes seuls dans ma chambre)
n'est aucunement solitude de draie. En fait, mme si personne ne nous
voit, nous existons pour rOUles les consciences et nous avons
conscience d'exister pour toutes : il en rsulte que l'amour comme
mode fondamental de l'tre-pour-autrui a dans son tre-pour-autrui
la racine de sa destruction. Nous venons de dfinir l a triple
destructibilit de J'amour : en premier lieu il est, par essence, une
duperie et un renvoi l' infi ni , puisque aimer est vouloir qu'on
m'aime, donc vouloir que l'autre veuille que j e l'aime. Et une
comprhension prontologique de cette duperie est donne dans
l'lan amoureux lui-mme : de l la perptuelle insatisfaction de
l'am
nt . Elle ne vient pas, comme on l'a trop souvent dit, de
l'indigni t de l'tre ai m, mais d'une comprhension implicite de ce
que l'intuition amoureuse est, comme intuition-fondement , un idal
hors d'atteinte. Plus on m'aime, plus je perds mon tre, plus je suis
remis mes propres responsabilits, mon propre pouvoir tre. En
second lieu, l e rveil de l'autre est toujours possible, il peut d'un
moment l'autre me faire comparatre comme objet : de l l a
perptuelle inscurit de l'amant. En troisime l i eu l'amour est un
absolu perptuellement relativis par les autres. I l faudrait tre seul
au monde avec l'aim pour que l'amour conserve son caractre d'axe
de rfrence absolu. De l l a perptuelle honte (ou fiert - ce qui
revient au mme ici) de l'amant.
Ainsi c'est en vain que j'aurai tent de me perdre dans l'objectif :
ma passion n'aura servi de rien ; l'autre m'a renvoy - soit par lui
mme, soit par les autres - mon injustifiable subj ectivit. Cette
constatation peut provoquer un total dsespoir et une tentative neuve
pour raliser l'assimilation d'autrui et de moi-mme. Son idal sera
l'inverse de celui que nous venons de dcrire : au lieu de projeter
d'absorber l'autre en lui conservant son altrit, je projetterai de me
faire absorber par l'autre et de me perdre en sa subjectivit pour me
dbarrasser de l a mienne. L'entreprise se traduira sur le plan concret
par l'attitude masochiste : puisque autrui est l e fondement de mon
417
t re-pour-autrui , si Je m'en remettais autrui du soin de me faire
exister, je ne serais plus qu'un tre-en-soi fond dans son tre par une
li bert. Ici c'est ma propre subjectivit qui est considre comme
obstacle l'acte primordial par quoi autrui me fonderait dans mon
t re ; c'est elle qu' i l s'agit avant tout de nier avec ma propre libert. Je
tente donc de m'engager tout entier dans mon tre-objet, je refuse
d'tre rien de plus qu'objet, je me repose en l'autre ; et comme
j 'prouve cet tre-objet dans la honte, je veux et j'aime ma honte
comme signe profond de mon objectivit ; et comme autrui me saisit
comme obj et par l e dsir sexuel l, je veux tre dsir, je me fais objet
de dsir dans l a honte. Cette attitude ressemblerait assez celle de
l ' amour si, au lieu de chercher exister pour l'autre comme objet
l i mite de sa transcendance, je ne m'acharnais au contraire me faire
traiter comme un objet parmi les autres, comme un instrument
utiliser : c' est en effet ma transcendance qu'il s'agit de nier, non l a
si enne. Je n'ai pas, cette fois, projeter de captiver sa libert, mai s au
contraire je souhaite que cette libert soi t et se veuille radicalement
l i bre. Ai nsi , plus je me sentirai dpass vers d'autres fins, plus je
jouirai de l'abdication de ma transcendance. A l a li mi te, je projette
de n'tre plus rien qu'un objet, c'est--dire radicalement un en-soi.
Mais en tant qu'une libert qui aura absorb la mienne sera le
fondement de cet en-soi, mon tre redeviendra fondement de soi
mme. L masochisme, comme le sadisme 2, est assomption de
culpabilit. Je suis coupable, en effet, du seul fait que j e suis objet.
Coupable envers moi-mme, puisque je consens mon alination
absolue, coupable envers autrui, car je lui fournis l'occasion d'tre
coupable, c'est--dire de manquer radicalement ma li bert comme
telle. Le masochisme est une tentative non pour fasciner l'autre, par
mon objectivi t, mai s pour me faire fasciner moi-mme par mon
objectivit-pour-autrui , c'est--dire pour me faire constituer en objet
par autrui de telle sorte que je saisisse non-thtiquement ma
subjectivit comme un rien, en prsence de l'en-soi que je reprsente
aux yeux d'autrui. Il se caractrise comme une espce de vertige : le
vertige non devant l e prcipice de roc et de terre, mais devant l 'abme
de la subjectivit d'autrui.
Mai s l e masochisme est et doit tre en lui-mme un chec : pour me
faire fasciner par mon moi-objet, en effet, il faudrait que je puisse
raliser l'apprhension intuitive de cet objet tel qu'il est pour l'autre,
ce qui est par principe impossible. Ai nsi le moi alin, loin que je
puisse mme commencer me fasci ner sur lui, demeure, par principe,
insaisissable. Le masochiste a beau se traner genoux, se montrer
dans des postures ridicules, se faire utiliser comme un simple
1. Cf. au paragraphe suivant.
2. Ibid.
418
instrument i nani m, c'est pour l'autre qu'il sera obscne ou simple
ment passif, pour l 'autre qu'il subira ces postures ; pour l ui , i l est
jamais condamn se [es donner. C'est dans et par sa transcendance
qu'il se dispose comme un tre transcender ; et plus i l tentera de
goter son objectivit, plus il sera submerg par l a conscience de sa
subjectivit, jusqu' l 'angoisse. En particulier le masochiste qui paye
une femme pour qu' el l e le fouette, la traite en instrument et, de ce
fait , se pose en transcendance par rapport elle. Ainsi le masochiste
finit par traiter l 'autre en objet et par le transcender vers sa propre
objectivit. On se rappel l e, par exemple, les tribulations de Sacher
Masoch qui , pour se faire mpriser, insulter, rduire une position
humiliante, tait contraint d'utiliser le grand amour que les femmes
lui portaient, c'est--dire d'agir sur elles en tant qu'elles s'prouvaient
comme un objet pour l ui . Ainsi , de toute faon, l'objectivit du
masochiste lui chappe et i l peut mme arriver, i l arrive l e plus
souvent qu'en cherchant saisir son objectivit il trouve l'objectivit
de l'autre, ce qui libre, malgr l ui , sa subjectivit. L masochisme est
donc par principe un chec. Cela n'a rien qui puisse nous tonner si
nous pensons que le masochisme est un vice et que le vice est, par
principe, l'amour de l'chec. Mais nous n' avons pas dcrire ici les
structures propres du vice. I l nous suffit de signaler que le maso
chisme est un perptuel effort pour anantir la subjectivit du sujet en
l a faisant rassimi l er par l " autre et que cet effort est accompagn de
l'puisante et dl icieuse conscience de l'chec, au point que c'est
l'chec lui-mme que l e sujet finit par rechercher comme son but
principal J.
II
DEUXI ME ATTITUDE ENVERS AUTRUI
L' I NDI FFRENCE LE DSI R , LA HAI NE, LE SADI SME
L'chec de l a premire attitude envers l 'autre peut tre l 'occasion
pour moi de prendre la seconde. Mais vrai dire, aucune des deux
n'est rellement premire : chacune d'elles est une raction fonda
mentale l ' tre-pour-autrui comme situation originelle. Il se peut
donc que, par l ' i mpossibilit mme o je suis de m'assimiler la
J. Aux termes de cette descripti on, il est une forme au moins de l'exhibition
nisme qui doit se classer parmi les attitudes masochistes. Par exemple, lorsque
Rousseau exhibe aux lavandires non l'objet obscne, mais l'objet ridicule .
Cf. Confessions, chap. Il l.
419
conscience de l'autre par l ' intermdiaire de mon objectit pour l ui , je
sois condui t me tourner dlibrment vers l'autre et le regarder.
En ce cas , regarder le regard d'autrui , c'est se poser soi-mme dans sa
propre l i bert et tenter, du fond de cette libert, d'affronter la l i bert
de l'autre. Ai nsi l e sens du conflit recherch serait de mettre en pleine
lumire la lutte de deux liberts affrontes en tant que liberts. Mais
cette i ntenti on doit tre immdiatement due, car du seul fait que je
m' affermi s dans ma libert en face d'autrui , j e fais de l'autre une
transcendance-transcende, c'est--dire un objet. C'est l ' histoire de
cet chec que nous allons tenter de retracer prsent. On en saisit le
schma di recteur : sur autrui qui me regarde, je braque mon regard
mon tour. Mais un regard ne se peut regarder : ds que je regarde
vers le regard, il s'vanouit, je ne vois plus que des yeux. A cet
instant, autrui devient un tre que je possde et qui reconnat ma
libert. Il semble que mon but soit atteint puisque je possde l ' tre
qui a l a cl de mon objectit et que je puis lui faire prouver ma
l i bert de mi l l e manires. Mais en ralit, tout s'est effondr, car
l ' tre qui me reste entre les mains est un autrui-objet. En tant que tel,
il a perdu la cl de mon tre-objet et il possde de moi une pure et
simple i mage, qui n'est rien d'autre qu'une de ses affections objec
tives et qui ne me touche plus ; et s'il prouve l es effets de ma l i bert,
si je puis agir sur son tre de mil le manires et transcender ses
possibilits avec toutes mes possibilits, c'est en tant qu'il est objet
dans le monde et, comme tel, hors d'tat de reconnatre ma l i bert.
Ma dception est entire puisque je cherche m'approprier la l ibert
d' autrui et que je m'aperois d' un coup que je ne puis agir sur l ' autre
qu'en tant que cette libert s'est effondre sous mon regard. Cette
dception sera le ressort de mes tentatives ultrieures pour rechercher
la libert d'autrui travers l 'objet qu'il est pour moi et pour trouver
des conduites privilgies qui pourraient m'approprier cette libert
travers une appropriation totale du corps d'autrui. Ces tentatives, on
s'en doute, sont par principe voues l'chec.
Mais i l se peut aussi que le regarder l e regard soit ma raction
originelle mon tre-pour-autrui . Cela signifie que j e peux, dans mon
surgissement au monde, me choisir comme regardant l e regard de
l'autre et btir ma subjectivit sur l 'effondrement de celle de l'autre.
C'est cette attitude que nous nommerons l'indiffrence envers autrui.
Il s'agit alors d'une ccit vis--vis des autres. Mais le terme de
ccit ne doit pas nous induire en erreur : je ne subis pas cette
ccit comme un tat ; je suis ma propre ccit l 'gard des autres et
cette ccit enveloppe une comprhension implicite de l'tre-po ur
autrui , c'est--dire de la transcendance d'autrui comme regard. Cette
comprhension est simplement ce que je me dtermine moi-mme
masquer. Je pratique alors une sorte de solipsisme de fait ; les autres,
ce sont ces formes qui passent dans la rue, ces objets magiques qui
420
sont susceptibles d'agir distance et sur lesquels je peux agir par des
conduites dtermines. J' y prends peine garde, j'agis comme si
j'tais seul au monde ; je frle les gens comme j e frle les murs, je
les vite comme j' vi te des obstacles, leur li bert-objet n'est pour moi
que leur coeffi cient d'adversit ; je n' i magine mme pas qu'ils
puissent me regarder. Sans doute ont-ils quelque connaissance de
moi ; mais cette connaissance ne me touche pas : i l s'agit de pures
modifications de l eur tre qui ne passent pas d'eux moi et qui sont
entaches de ce que nous nommons subjectivit-subie ou sub
jectivit-objet , c'est--dire qu'elles traduisent ce qu'ils sont, non ce
que je suis et qu'elles sont l'effet de mon action sur eux. Ces gens
sont des fonctions : le poinonneur de tickets n'est rien que fonction
de poinonner ; l e garon de caf n'est rien que fonction de servir les
consommateurs. A partir de l, il sera possi ble de les utiliser au mieux
de mes intrts, si je connais leurs cls et ces matres-mots qui
peuvent dclencher leurs mcanismes. De l cette psychologie
moraliste que l e XVII
"
sicle franais nous a li vre ; de l ces traits
du XVIII
e
sicle, Le Moyen de parvenir, de Broalde de Verville ; Les
Liaisons dangereuses, de Laclos ; Trait de l'ambition, de Hrault de
Schelles, qui nous livrent une connaissance pratique de l'autre et l'art
d'agir sur lui . Dans cet tat de ccit, j'ignore concurremment la
subjectivit absolue de l' autre comme fondement de mon tre-en-soi
et mon tre-pour-l'autre, en particulier mon corps pour l'autre .
En un sens, j e suis tranquillis ; j 'ai du toupet c'est--dire que je
n'ai aucunement conscience de ce que l e regard de l'autre peut figer
mes possibilits et mon corps ; je suis dans l ' tat oppos celui qu'on
nomme timidit. Jai de l'aisance, je ne suis pas embarrass de moi
mme, car je ne suis pas dehors, je ne me sens pas alin. Cet tat de
ccit peut se poursuivre longtemps, au gr de ma mauvaise foi
fondamentale, i l peut s'tendre avec des rpits sur plusieurs annes,
sur toute une vie : il y a des hommes qui meurent sans avoir -sauf
pendant de brves et terrifiantes illuminations - souponn ce
qu'tait l'autre. Mai s, y ft-on entirement plong, on ne cesse
d'prouver son i nsuffisance. Et, comme toute mauvaise foi , c'est lui
qui nous fournit des motifs pour sortir de lui : car l a ccit l'gard de
l'autre fait concurremment disparatre toute apprhension vcue de
mon objectivit. Pourtant, l'autre comme l i bert et mon objectivit
comme moi-alin sont l, inaperus, non thmatiss, mais donns
dans ma comprhension mme du monde et de mon tre dans le
monde. L poinonneur de tickets, mme s'il est considr comme
pure fonction, me renvoie de par sa fonction mme un tre-dehors,
encore que cet tre-dehors ne soit ni saisi ni saisissable. De l un
sentiment perptuel de manque et de malaise. C' est que mon projet
fondamental envers autrui -quelle que soi t l'attitude que je prenne
-est double : il s'agit d' une part de me protger contre l e danger que
421
me fait courir mon tre-dehors-dans-la-Iibert-d'autrui et d'autre part
d 'utiliser autr ui pour totaliser enfin la totalit dtotalise que je suis,
pour fermer l e cercle ouvert et faire enfin que je sois fondement de
moi-mme. Or
,
d'une part, la disparition d'autrui comme regard me
rejette dans mon injustifiable subjectivit et rduit mon tre cette
perptuelle po ursuite-poursuivie vers un en-soi-pour-soi insaisissa
ble ; sans l ' autre, je saisis plein, nu cette terri bl e ncessit d'tre
l ibre qui est mon l ot, c'est--dire l e fait que je ne puis m'en remettre
qu' moi du soin de me faire tre, encore que je n'aie pas choisi d'tre
et que je sois n, Mais d'autre part, bien que la ccit envers l' autre
me dlivre en apparence de la crainte d'tre en danger dans la libert
de l'autre, elle enveloppe malgr tout une comprhension implicite de
cette l i bert. El le me pl ace donc au dernier degr de l'objectivit, au
moment mme o je puis me croire absolue et unique subjectivit,
puisque je suis vu sans mme pouvoir prouver que je suis vu et me
dfendre par cette preuve contre mon tre-vu . Je suis possd
sans pouvoir me retourner vers qui me possde. Dans l'preuve
directe d'autrui comme regard, je me dfends en prouvant l'autre et
l a possibilit me reste de transformer l'autre en objet. Mais si l'autre
est objet pour moi pendant qu'il me regarde, alors j e suis en danger
sans l e savoir. Ainsi , ma ccit est i nquitude parce qu'elle s'accom
pagne de l a conscience d'un regard errant et insaisissable qui
risque de m'aliner mon insu. Ce malaise doit occasionner une
tentative nouvelle pour m'emparer de l a libert d'autrui. Mais cela
signifiera que j e vais me retourner sur l'obj et-autrui qui me frle et
tenter de l'utiliser comme instrument pour atteindre sa libert.
Seulement, prcisment parce que j e m'adresse l'objet autrui , je
ne puis l ui demander compte de sa transcendance, et mme, tant
moi-mme sur l e pl an de l'objectivation d'autrui, je ne puis mme
concevoir ce que je veux m'approprier. Ainsi suis-je dans une attitude
irritante et contradictoire vis--vis de cet objet que je considre : non
seul ement je ne puis obtenir de lui ce que je veux, mais en outre cette
qute provoque un vanouissement du savoir mme qui concerne ce
que j e veux ; je m'engage dans une recherche dsespre de la libert
de l ' autre et, en cours de route, je me trouve engag dans une
recherche qui a perdu son sens ; tous mes efforts pour rendre son sens
l a recherche n'ont pour effet que de l e lui faire perdre davantage et
de provoquer mon tonnement et mon malaise, tout juste comme
lorsque j 'essaie de retrouver le souvenir d'un rve et que ce souvenir
fond entre mes doigts en me laissant une vague et irritante impression
de connaissance totale et sans objet ; tout j uste comme lorsque j e
tente d'expliciter l e contenu d' une fausse rminiscence et que
l'explication mme la fait se fondre en translucidit.
Ma tentative originelle pour me saisir de la subjectivit libre de
l'autre travers son objectivit-po ur-moi est l e dsir sexuel. On
422
s'tonnera peut-tre de voir mentionner au niveau d'attitudes pre
mires qui mani festent simplement notre manire originelle de
raliser l ' tre-pour-autrui un phnomne qui est class d'ordinaire
parmi les ractions psycho-physiologiques . Pour l a plupart des
psychologues en effet le dsir, comme fait de conscience, est en
troite corrl ation avec la nature de nos organes sexuels et c'est
seulement en liaison avec une tude approfondie de ceux-ci qu'on
pourra le comprendre. Mais comme l a structure di ffrencie du corps
(mammifre, vivipare, etc.) et, partant , la structure particulire du
sexe (utrus, trompes, ovaires, etc. ) sont du domaine de l a contin
gence absolue et ne ressortissent nul lement l'ontologie de l a
conscience ou du Dasein , il semble qu'il en soit de mme pour
le dsir sexuel. De mme que les organes sexuels sont une informa
tion contingente et particulire de notre corps, de mme le dsir qui y
correspond serait une modalit contingente de notre vie psychique,
c'est--dire qu' i l ne saurait tre dcrit qu' au niveau d'une psychologie
empirique appuye sur la biologie. C'est ce que manifeste assez le
nom d'instinct sexuel qu'on rserve au dsir et toutes les structures
psychiques qui s'y rapportent. Ce terme d'instinct qualifie toujours,
en effet , des formations contingentes de la vie psychique qui ont le
double caractre d'tre coextensives toute l a dure de cette vie -
ou, en tout cas, de ne point provenir de notre histoire -et de ne
pouvoi r, cependant, tre dduites partir de l'essence mme du
psychique. C'est pourquoi l es philosophies existentielles n'ont pas cru
devoir se proccuper de l a sexualit. Heidegger, en particulier, n'y
fait pas l a moindre al l usion dans son analytique existentiel l e, en sorte
que son Dasein nous apparat comme asexu. Et sans doute peut
on considrer en effet que c'est une contingence pour l a ralit
humaine que de se spcifier en masculine ou fminine ; sans
doute peut-on di re que le problme de la diffrenciation sexuelle n'a
rien faire avec celui de l' Existence (Existenz), puisque l'homme,
comme l a femme, existe , ni pl us ni moins.
Ces raisons ne sont pas absolument convaincantes. Que la diff
rence sexuelle soit du domai ne de la facticit, nous l'accepterons l a
rigueur. Mai s cel a doit-il signifier que l e pour-soi est sexuel par
accident , par l a pure contingence d'avoir un tel corps ? Pouvons
nous admettre que cette immense affaire qu'est la vie sexuelle vienne
de surcrot l a condition humaine ? Il apparat pourtant au premier
regard que l e dsir et son inverse, l'horreur sexuelle, sont des
structures fondamentales de l'tre-pour-autrui . Evidemment, si l a
sexualit ti re son origine du sexe comme dtermination physiologique
et contingente de l'homme, el le ne saurait tre indispensable l'tre
du pour-autrui. Mais n'a-t-on pas le droit de se demander si le
problme ne serait pas, par hasard, du mme ordre que celui que
nous avons rencontr propos des sensations et des organes
423
sensibles ? L'homme, dit-on, est un tre sexuel parce qu'i l pvssde un
sexe. Et si c'tait l'inverse ? Si l e sexe n'tait que l ' i nstrument et
comme l image d' une sexualit fondamentale ? Si l'homme ne poss
dait un sexe que parce qu' i l est originellement et fondamentalement
un tre sexuel , en tant qu' tre qui exi ste dans l e monde en liaison avec
d'autres hommes ? La sexualit enfantine prcde la maturation
physiologique des organes sexuels ; l es eunuques ne cessent pas pour
autant de dsirer. Ni beaucoup de vi ei l lards. Le fait de pouvoir
disposer d'un organe sexuel apte fconder et procurer de l a
jouissance ne reprsente qu' une phase et un aspect de notre vi e
sexuelle. I l y a un mode de sexual i t avec possibilit d'assouvisse
ment et le sexe form reprsente et concrtise cette possibilit. Mais
i l y a d' autres modes de l a sexualit sur l e type de l'inassouvissement
et , si l ' on ti ent compte de ces modal its, i l faut reconnatre que l a
sexual i t, apparaissant avec l a naissance, ne disparat qu'avec l a mort.
Jamais d' ail leurs la turgescence du pnis ni aucun autre phnomne
physiologique ne peuvent expliquer ni provoquer le dsir sexuel -
pas pl us que la vaso-constriction ou la dilatation pupil l aire (ni l a
si mpl e conscience de ces modifications physiologiques) ne pourront
expl i quer ou provoquer l a peur. Ici comme l, bien que l e corps ait un
rle important jouer, il faut, pour bi en comprendre, nous reporter
l 'tre-dans-le-monde et l'tre-po ur-autrui : je dsire un tre
humai n, non un insecte ou un mol l usque, et je l e dsire en tant qu' i l
est et que j e sui s en situation dans l e monde et qu'il est un autre pour
moi et que j e suis pour lui un autre. Le problme fondamental de l a
sexualit peut donc se formul er ai nsi : l a sexualit est-el l e un accident
contingent li notre nature physiologique ou est-elle une structure
ncessaire de l 'tre-pour-soi-pour-autrui ? Du seul fait que l a question
peut se poser en ces termes, c'est l ' ontologie qu' i l revient d'en
dcider. El le ne saurait l e fai re, prcisment, que si ell e se proccupe
de dtermi ner et de fixer l a signifi cati on de l ' existence sexuelle pour
l ' autre. Etre sexu en effet signifie - au terme de la description du
corps que nous avons tente au chapitre prcdent - exister
sexuel lement pour un autrui qui existe sexuellement pour moi -
tant bien entendu que cet autrui n'est pas forcment ni d'abord pour
moi ni moi pour l ui -un existant htrosexuel mais seulement un
tre sexu en gnral. Considre du poi nt de vue du pour-soi , cette
saisie de la sexualit d'autrui ne saurait tre la pure contemplation
dsintresse de ses caractres sexuels primaires ou secondaires.
Autrui n'est pas d'abord sexu pour moi parce que je conclus de l a
rpartition de son systme pi l eux, de l a rudesse de ses mai ns, du son
de sa voi x, de sa force qu' i l est du sexe mascul i n. Il s'agit l de
conclusions drives qui se rfrent un tat premier. L'apprhen
sion premi re de la sexualit d' autrui , en tant qu'elle est vcue et
soufferte , ne saurait tre que le dsir ; c'est en dsirant l ' autre (ou en
424
me dcouvrant comme incapable de le dsirer) ou en saisissant son
dsir de moi que je dcouvre son tre-sexu ; et le dsir me dcouvre
la fois mon tre-sexu et son tre-sexu, mon corps comme sexe et
son corps. Nous voil donc renvoy, pour dcider de la nature et du
rang ontologique du sexe, l' tude du dsir. Qu'est-ce donc que l e
dsir ?
Et d'abord de quoi y a-t-il dsi r ?
Il faut renoncer d'emble l ' ide que le dsir serait dsir de volupt
ou dsir de faire cesser une douleur. De cet tat d'immanence, on ne
voit pas comment le sujet pourrait sortir pour attacher " son dsir
un objet. Toute thorie subjectiviste et immanentiste chouera
expliquer que nous dsirions une femme et non simplement notre
assouvissement. Il convient donc de dfinir le dsir par son objet
transcendant. Toutefois, i l serait tout fait inexact de di re que le dsir
est dsir de <{ possession physique de l'objet dsir, si l'on entend ici
par possder : faire l'amour avec. Sans doute l'acte sexuel dlivre
pour un moment du dsir et il se peut qu'en certains cas il soit pos
explicitement comme l'aboutissement souhaitable du dsi r-lorsque
celui-ci, par exemple, est douloureux et fatigant. Mais i l faut alors que
le dsir soit lui-mme l ' objet qu' on pose comme <{ supprimer et
c'est ce qui ne saurait se faire que par le moyen d'une conscience
rflexive. Or le dsir est par soi-mme irrflchi ; il ne saurait donc se
poser lui-mme comme objet supprimer. Seul un rou se reprsente
son dsir, le traite en objet, l'excite, le met en veilleuse, en diffre
l'assouvissement, etc. Mais alors, il faut le remarquer, c'est le dsir
qui devient le dsirabl e. L'erreur vient ici de ce qu'on a appris que
l'acte sexuel supprimait le dsir. On a donc joint une connaissance au
dsir lui-mme et, pour des raisons extrieures son essence
(procrati on, caractre sacr de la maternit, force exceptionnelle du
plaisir provoqu par l ' jacul ati on, valeur symbolique de l ' acte
sexuel) , on l ui a attach du dehors la volupt comme son assouvisse
ment normal. Aussi l ' homme moyen ne peut-il, par paresse d'esprit et
conformisme, concevoir d'autre fin son dsir que l'jaculation. C'est
ce qui a permis de concevoir le dsir comme un instinct dont l'origine
et l a fin sont strictement physiologiques, puisque, chez l'homme par
exemple, il aurait pour cause l 'rection et pour terme final l'jacula
tion. Mais le dsir n'implique nullement par soi l'acte sexuel, i l ne le
pose pas thmatiquement, il ne l ' bauche mme pas, comme on voit
lorsqu'il s'agit du dsir de trs jeunes enfants ou d'adultes qui
ignorent la {{ technique de l' amour. Pareillement le dsir n'est dsir
d'aucune pratique amoureuse spciale ; c'est ce que prouve assez la
diversit de ces pratiques, qui varient avec les groupes sociaux. D'une
manire gnrale, le dsir n'est pas dsir de faire. Le
intervient aprs coup, s'adjoint du dehors au dsir et ncessite un
apprentissage : il y a une technique amoureuse qui a ses fins propres
425
et ses moyens. Le dsir ne pouvant donc ni poser sa suppression
comme sa fi n suprme, ni lire pour but ultime un acte particulier, est
purement et simpl ement dsir d'un objet transcendant . Nous retrou
vons ici cette intenti onnalit affective dont nous parlions aux chapi
tres prcdents et que Scheler et Husserl ont dcrite. Mais de quel
objet y a t-i l dsir ? Di ra-t-on que le dsir est dsir d'un corps ? En un
sens on ne saurait le nier. Mais il faut s'entendre. Certes c'est le corps
qui trouble : un bras ou un sein entrevu, un pied peut-tre. Mais i l
faut bien voir d'abord que nous ne dsirons jamais le bras ou l e sein
dcouvert que sur le fond de prsence du corps entier comme totalit
organique. Le corps l ui-mme, comme totalit, peut tre masqu ; je
puis ne voir qu'un bras nu. Mais il est l ; i l est ce partir de quoi je
saisis le bras comme bras ; i l est aussi prsent, aussi adhrent au bras
que je vois que les arabesques du tapis que cachent les pieds de la
table sont adhrentes et prsentes aux arabesques que je vois. Et mon
dsir ne s'y trompe pas : i l s'adresse non une somme d'lments
physiologiques mais une forme totale ; mieux : une forme en
situation. L'atti tude, nous le verrons plus loin, fait beaucoup pour
provoquer le dsir. Or, avec l'attitude, les entours sont donns et
finalement l e monde. Mais, du coup, nous voil aux antipodes du
simple prurit physiologique : le dsir pose le monde et dsire l e corps
partir du monde et l a belle main partir du corps. Il suit exactement
l a dmarche que nous dcrivions au chapitre prcdent et par laquelle
nous saisissons l e corps d'autrui partir de sa situation dans le monde.
Cela n' a, du reste, rien pour tonner, puisque l e dsir n'est autre
qu' une des grandes formes que peut prendre l e dvoilement du corps
d'autrui . Mais prcisment pour cela, nous ne dsirons pas le corps
COmme pur objet matriel : le pur objet matriel, en effet, n'est pas
en situation. Ainsi cette totalit organique qui est immdiatement
prsente au dsir n'est dsirable qu'en tant qu'elle rvle non
seulement la vie mais encore la conscience adapte. Toutefois, nous
le verrons, cet tre-en-situation d'autrui que dvoile l e dsir est d'un
type entirement original. La conscience envisage, d'ailleurs, n'est
encore qu'une proprit de l'objet dsir, c'est--dire qu'elle n'est
rien d'autre que le sens d'coulement des objets du monde, en tant
prcisment que cet coulement est cern, localis et fait partie de
mon monde. Certes, on peut dsirer une femme qui dort , mai s c'est
dans la mesure o ce sommeil apparat sur fond de conscience. La
conscience demeure donc toujours l'horizon du corps dsir : elle
fait son sens et son unit. Un corps vivant comme totalit organique
en situation avec l a conscience l'horizon : tel est l'objet auquel
s'adresse l e dsir. Et qu'est-ce que l e dsir veut de cet objet ? Nous ne
pouvons pas l e dterminer sans avoir rpondu une question
pralable : qui est-ce qui dsire ?
Sans aucun doute, celui qui dsire c'est moi et le dsir est un mode
4
26
singulier de ma subjectivit. Le dsir est conscience puisqu'il ne peut
tre que comme conscience non-positionnelle de lui-mme. Toute
fois, i l ne faudrait pas croire que la conscience dsirante ne diffre de
la conscience cognitive, par exemple, que par la nature de son obj et.
Se choisir comme dsi r, pour l e pour-soi, ce n' est pas produire un
dsir en demeurant i ndiffrent et inaltr, comme la cause stocienne
produit son effet : c'est se porter sur un certain plan d'existence qui
n'est pas le mme, par exemple, que celui d' un pour-soi qui se choisit
comme tre mtaphysique. Toute consci ence, on l'a vu, soutient un
certain rapport avec sa propre facticit. Mais ce rapport peut varier
d'un mode de conscience l'autre. La facticit de la conscience
douloureuse, par exemple, est facticit dcouverte dans une fuite
perptuelle. Il n'en est pas de mme pour la facticit du dsir.
L'homme qui dsire existe son corps d' une manire particulire et ,
par l , i l se place un niveau particulier d'existence. En effet , chacun
conviendra de ce que le dsir n' est pas seulement envie, claire et
translucide envie qui vise travers notre corps un certain objet. Le
dsir est dfini comme trouble. Et cette expression de trouble peut
nous servir mieux dterminer sa nature : on oppose une eau trouble
une eau transparente ; un regard trouble un clair regard. L'eau
trouble est toujours de l'eau ; el l e en a gard la fluidit et les
caractres essentiels ; mais sa translucidit est trouble par une
prsence insaisissable qui fait corps avec el l e, qui est partout et nulle
part et qui se donne comme un emptement de l'eau par elle-mme.
Certes, on pourra l'expliquer par l a prsence de fines particules
solides en suspens dans le liquide : mais cette explication est celle du
savant. Notre saisie originelle de l'eau trouble nous la livre comme
altre par l a prsence d'un quelque chose d'invisible qui ne se
distingue pas d'elle-mme et se manifeste comme pure rsistance de
fait. Si l a conscience dsirante est trouble, c'est qu'elle prsente une
analogie avec l'eau trouble. Pour prciser cette analogi e, i l convient
de comparer le dsir sexuel avec une autre forme de dsir, par
exemple avec la fai m. La faim, comme le dsir sexuel , suppose un
certain tat du corps, dfi ni ici comme appauvrissement du sang,
scrtion salivaire abondante, contractions du tunicier, etc. Ces
divers phnomnes sont dcrits et classs du point de vue d'autrui. Ils
se manifestent , pour le pour-soi , comme pure facticit. Mais cette
facticit ne compromet pas l a nature mme du pour-soi car le pour-soi
l a fuit i mmdiatement vers ses possibles, c'est--dire vers un certain
tat de faim-assouvie dont nous avons marqu dans notre deuxime
partie qu'il tait l 'en-soi-pour-soi de la fai m. Ainsi, l a faim est pur
dpassement de l a facticit corporel l e et , dans la mesure o le pour
soi prend conscience de cette facticit sous forme non-thtique, c'est
i mmdiatement comme d'une facticit dpasse qu' il en prend
conscience. Le corps est bien ici l e pass, l e d-pass. Dans le dsir
427
sexuel , certes, on peut retrouver cette structure commune tous les
apptits : un tat du corps. L'autre peut noter diverses modifications
physiologiques (rection du pnis, turgescence des mamelons des
seins, modifications du rgime circulatoire, lvation de la tempra
ture, etc. ). Et la conscience dsirante existe cette facticit ; c'est
partir d'elle nous dirions volontiers : travers el l e -que le corps
dsir a pparat comme dsirable. Toutefois si nous nous bornions l e
dcrire ai nsi, l e dsir sexuel apparatrait comme un dsir sec et clair,
comparable au dsir de boire et de manger. Il serait fuite pure de l a
facti cit vers d'autres possibles. Or chacun sait qu' un abme spare l e
dsir sexuel des autres apptits. On connat cette formule trop
clbre : Faire l ' amour avec une jol i e femme lorsqu'on en a envi e,
comme on boi t un verre d'eau glace lorsqu'on a soif et l ' on sait
aussi t out ce qu' el l e a d' insatisfaisant pour l' esprit et mme de
scandaleux. C'est qu'on ne dsire pas une femme en se tenant tout
entier hors du dsir, l e dsir me compromet ; je suis complice de mon
dsir. Ou plutt l e dsir est tout entier chute dans l a complicit avec l e
corps. I l n' est pour chacun que de consulter son exprience : on sait
que dans le dsir sexuel l a conscience est comme empte, il semble
qu'on se laisse envahir par la facticit, qu' on cesse de la fuir et qu'on
glisse vers un consentement passif au dsir. A d'autres moments, il
sembl e que la facticit envahisse la conscience dans sa fuite mme et
l a rende opaque elle-mme. C'est comme un soulvement pteux du
fait. Aussi, les expressions qu'on emploie pour dsigner l e dsir en
marquent assez l a spcificit. On dit qu'il vous prend, qu'il vous
submerge, qu' il vous transit. Imagine-t-on les mmes mots employs
pour dsigner l a fai m? A-t-on ide d'une faim qui submergerait
Cela n'aurait de sens l a rigueur que pour rendre compte des
impressions de l ' inaniti. Mais, au contraire, l e plus faible dsi r est
dj submergeant. On ne peut pas le tenir distance, comme la faim,
et penser autre chose en conservant tout juste comme un signe
du corps-fond une tonalit indiffrencie de l a conscience non
thtique qui serait le dsir. Mais le dsir est consentement au dsir. La
conscience alourdie et pme glisse vers un alanguissement compara
bl e au sommeil. Chacun a pu observer d'ailleurs cette apparition du
dsir chez autrui : tout coup l ' homme qui dsire devient d'une
tranquillit lourde qui effraie ; ses yeux se fixent et semblent mi-clos,
ses gestes sont empreints d'une douceur lourde et pteuse ; beaucoup
semblent s'endormir. Et lorsqu'on lutte contre l e dsir , c'est
prcisment l'alanguissement qu'on rsiste. Si l 'on russit rsister,
le dsir avant de disparatre deviendra tout sec et tout clair, semblable
l a faim ; et puis il y aura un { rveil ; on se sentira lucide mais avec
l a tte l ourde et le cur battant. Naturellement , toutes ces descrip
tions sont i mpropres : elles marquent plutt la faon dont nous
interprtons l e dsir. Mais cependant elles indiquent l e fait premier
428
du dsir : dans le dsir la conscience choisit d'exister sa facticit sur
un autre pl an. Elle ne la fui t plus, el l e tente de se subordonner sa
propre contingence -en tant qu'elle saisit un autre corps -c'est-
dire une autre contingence -comme dsirable. En ce sens, le dsir
n'est pas seul ement le dvoi l ement du corps d'autrui mais la
rvlation de mon propre corps. Et cel a, non pas en tant que ce corps
est instrument ou point de vue, mais en tant qu'il est pure facticit,
c'est--dire simple forme contingente de l a ncessit de ma contin
gence. Je sens ma peau et mes muscles et mon souffle et je les sens
non pour les transcender vers quelque chose comme dans l 'motion
ou l'apptit mais comme un dalUm vivant et inerte, non pas
simplement comme l ' i nstrument souple et discret de mon action sur le
monde mais comme une passion par o je suis engag dans le monde
et en danger dans le monde. L pour-soi n'est pas cette contingence, i l
continue l'exister, mais i l subit l e vertige de son propre corps ou, si
l'on prfre, ce vertige est prcisment sa manire d'exister son corps.
La conscience non-thtique se laisse aller au corps, veut tre corps et
n'tre que corps. Dans le dsir, le corps, au lieu d'tre seulement la
contingence que fuit le pour-soi vers des possibles qui lui sont
propres, devient en mme temps l e possible le plus immdiat du pour
soi ; le dsir n'est pas seulement dsir du corps d'autrui ; i! est, dans
l'unit d'un mme acte, le pro-jet non thtiquement vcu de s'enliser
dans le corps ; ainsi le dernier degr du dsir pourra-toi! tre
l'vanouissement comme dernier degr de consentement au corps.
C'est en ce sens que le dsir peut tre dit dsir d'un corps pour un
autre corps. C'est en fait un apptit vers le corps d'autrui qui est vcu
comme vertige du poursoi devant son propre corps ; et l'tre qui
dsire, c'est la conscience se faiant corps.
Mais s'il est vrai que le dsir est une conscience qui se fait corps
pour s'approprier l e corps d'autrui saisi comme totalit organique en
situation avec la conscience l'horizon, quelle est l a signification
du dsir ; c'est--dire : pourquoi l a conscience se fait-elle -ou tente
t-elle vainement de se faire -corps et qu'attend-ell e de l'objet de son
dsi r ? Il sera facile de rpondre si l'on rflchit que, dans le dsir, je
me fais chair en prsence d'autrui pour m'approprier la chair d'autrui.
Cela signifie qu' il ne s'agi t pas seulement de saisir des paules ou des
flancs ou d'attirer un corps contre moi : il faut encore les saisir avec
cet instrument particulier qu'est l e corps en tant qu'il empte la
conscience. En ce sens, lorsque je saisis ces paules, on pourrait dire
non seulement que mon corps est un moyen pour toucher les paules
mais que les paules d'autrui sont un moyen pour moi de dcouvrir
mon corps comme rvlation fascinante de ma facticit, c'est--dire
comme chair. Ainsi le dsir est dsir d'appropriation d'un corps en
tant que cette appropriation me rvle mon corps comme chair. Mais
ce corps que j e veux m'approprier, je veux me l'approprier comme
429
chair Or, c'est ce qu' i l n'est pas d'abord pour moi : le corps d'autrui
apparat comme forme synthtique en acte ; nous l'avons vu, on ne
saurait percevoir l e corps d'autrui comme chair pure, c'est--dire
titre d'objet isol ayant avec l es autres ceci des relations d'extriorit,
Le corps d'autrui est originellement corps en situation ; l a chair au
contraire apparat comme contingence pure de la prsence, Elle est
ordinairement masque par les fards, les vtements, etc. ; surtout,
ell e est masque par les mouvemellls ; rien n'est moins en chair
qu'une danseuse, ft-elle nue. Le dsir est une tentative pour
dshabi l l er le crps de ses mouvements comme de ses vtements et de
le faire exister comme pure chair ; c'est une tentative d'incaration du
corps d'autrui . C'est en ce sens que les caresses sont appropriation du
corps de l 'autre : il est vident que, si les caresses ne devaient tre que
des effl eurements, des frlements, i l ne saurait y avoir de rapport
entre elles et le puissant dsir qu' elles prtendent combler ; elles
demeureraient en surface, comme des regards, et ne sauraient
m'approprier l ' autre. On sait combien parat dcevant ce mot
fameux : Contact de deux pidermes. " L caresse ne se veut pas
simpl e contact ; il sembl e que l'homme seul peut la rduire un
contact et qu' alors i l manque son sens propre. C'est que la caresse
n'est pas simple effl eurement : elle est faonnement. En caressant
autrui, je fais natre sa chair par ma caresse, sous mes doigts. La
caresse est l'ensemble des crmonies qui incarent autrui. Mais,
dira-t-on, n'tait-il pas incarn dj ? Justement non. La chair
d'autrui n' existait pas explicitement pour moi , puisque je saisissais le
corps d'autrui en situation ; el l e n'existait pas non plus pour lui
puisqu'il la transcendait vers ses possibilits et vers l'objet. La caresse
fait natre autrui comme chair pour moi et pour lui-mme. Et par
chair, nous n' entendons pas une partie du corps, telle que derme, tissu
conjonctif ou, prcisment, piderme ; il ne s'agit pas non plus
forcment du corps en repos ou assoupi , quoique souvent ce soit
ainsi qu' il rvl e mieux sa chair. Mais la caresse rvle la chair en
dshabillant l e corps de son action, en le scindant des possibilits qui
l 'entourent : elle est faite pour dcouvrir sous l'acte l a trame d'inertie
-c'est--dire le pur tre-l " - qui l e soutient : par exemple en
prenant et en caressant la main de l'autre, j e dcouvre, sous la
prhension que cette main est d'abord, une tendue de chair et d'os
qui peut tre prise ; et, pareillement, mon regard caresse lorsqu'il
dcouvre, sous ce bondissement que sont d'abord les jambes de la
danseuse, l ' tendue lunaire des cuisses. Ainsi la caresse n' est aucune
ment distincte du dsir : caresser des yeux ou dsirer ne font qu'un ; le
dsir s'exprime par la caresse comme la pense par le langage. Et
prcisment la caresse rvle l a chair d'autrui comme chair moi
mme et autrui. Mais elle rvle cette chair de faon trs
particulire : empoigner autrui l ui rvle bien son inertie et sa
430
passivit de transcendance-transcende ; mais ce n'est pas l l e
caresser . Dans la caresse, ce n'est pas mon corps comme forme
synthtique en action qui caresse autrui : mais c'est mon corps de chair
qui fait natre l a chair d'autrui. La caresse est faite pour faire natre par
le plaisir le corps d'autrui autrui et moi-mme comme passivit
touche dans la mesure o mon corps se fait chair pour le toucher avec
sa propre passivit, c'est--dire en se caressant lui plutt qu'en le
caressant. C'est pourquoi les gestes amoureux ont une langueur qu'on
pourrait presque dire tudie : i l ne s'agit pas tant de prendre une
partie du corps de l'autre que de porter son propre corps contre le corps
de l'autre. Non pas tant de pousser ou de toucher, au sens actif, mais de
poser contre. Il semble que je porte mon propre bras comme un objet
inanim et que j e le pose contre le flanc de la femme dsire ; que mes
doigts que je promne sur son bras soient inertes au bout de ma mai n.
Ai nsi l a rvlation de l a chai r d' autrui se fait par ma propre chair ; dans
le dsir et dans l a caresse qui l' exprime, j e m'incarne pour raliser
l'incarnation d'autrui ; et l a caresse, en ralisant l'incarnation de
l'autre, me dcouvre ma propre incarnation ; c'est--dire que je me fais
chair pour entraner l'autre raliser pour soi et pour moi sa propre
chair et mes caresses font natre pour moi ma chair en tant qu'elle est,
pour autrui , chair le faisant natre la chair ; j e lui fais goter ma chair
par sa chair pour l'obliger se sentir chair. Et de la sorte apparat
vritablement la possession comme double incarnation rciproque.
Ainsi, dans l e dsir, i l y a tentative d' i ncarnation de l a conscience (c'est
ce que nous appelions tout l'heure emptement de l a conscience.
conscience trouble, etc.) pour raliser l' i ncarnation de l'autre.
Reste dterminer quel est le motif du dsir ou, si l'on prfre, son
sens. Car, si l ' on a suivi les descriptions que nous avons tentes ici, on
aura compris depuis longtemps que, pour le pour-soi , tre c'est choisir
sa manire d' tre sur fond d' une contingence absolue de son tre-l. Le
dsir n'arrive donc poi nt la consci ence comme la chaleur arrive au
morceau de fer que j' approche de la flamme. La conscience se choisit
dsir. Pour cela, certes, il convient qu' elle ai t un motif : j e ne dsire pas
n'importe qui, n' importe quand. Mais nous avons montr, dans l a
premire partie de ce livre, que l e motif tait suscit partir du pass et
que l a conscience, en se retournant sur l ui , lui confrait son poids et sa
valeur. Il n'y a donc aucune diffrence entre le choix du motif du dsir
et le sens du surgissement -dans les trois dimensions ek-statiques de
la dure -d' une conscience qui se fait dsirante. Le dsir, comme les
motions ou l 'attitude i maginante ou, en gnral, toutes les attitudes
du pour-soi, a une signification qui l e constitue et l e dpasse. La
description que nous venons de tenter n'aurait aucun intrt si elle ne
devait pas nous conduire poser l a question : pourquoi la conscience
se nan tise-t -elle sous forme de d si r ?
Une ou deux remarques pralables vont nous aider rpondre
431
cette question. En premier lieu, i l faut noter que la conscience
dsirant e ne dsire pas son objet sur fond de monde inchang.
Autrement dit, i l ne s'agit pas de faire paratre le dsirable comme un
certain ceci sur le fond d'un monde qui garderait ses relations
instrumentales avec nous et son organisation en complexes d'usten
siles. Il en est du dsir comme de l'motion : nous avons marqu
ail leurs J que l ' motion n'est pas la saisie d'un objet mouvant dans
un monde inchang mais, comme e1 1 e correspond une modification
globale de la conscience et de ses rel ations au monde, el l e se traduit
par une altration radicale du monde. Le dsir est pareillement une
modification radicale du pour-soi puisque le pour-soi se fait tre sur
un autre plan d'tre, i l se dtermine exister son corps diffremment,
se fai re empter par sa facticit. Corrlativement le monde doit
venir l'tre pour l ui d'une manire neuve : il y a un monde du dsir.
Si mon corps, en effet, n'est plus senti comme l'instrument qui ne
put tre util is par aucun instrument, c'est--dire comme l'organisa
tion synthtique de mes actes dans le monde ; s'il est vcu comme
chair, c'est comme renvois ma chair que je saisis les obj ets du
monde. Cela signifie que j e me fais passif par rapport eux et que
c'est du point de vue de cette passivit, dans et par elle qu'ils se
rvlent moi (car la passivit est l e corps et l e corps ne cesse pas
d'tre point de vue). Les objets sont alors l'ensemble transcendant
qui me rvle mon incarnation. Un contact est caresse, c'est--dire
que ma perception n'est pas utilisation de l'objet et dpassement du
prsent en vue d' une fin ; mais percevoir un objet, dans l'attitude
dsirante, c'est me caresser lui. Ainsi suis-je sensibl e, plus qu' la
forme de l'objet et plus qu' son instrumentalit, sa matire
(grumel euse, lisse, tide, graisseuse, rche, etc.) et je dcouvre dans
ma perception dsirante quel que chose comme une chair des objets.
Ma chemise frotte contre ma peau et je la sens : elle qui d'ordinaire
est pour moi l'objet le plus lointain devient l e sensible immdiat, l a
chaleur de l 'air, l e souffle du vent, l es rayons du soleil, etc. , tout m'est
prsent d' une certaine manire, comme pos sans distance sur moi et
rvlant ma chair par sa chair. De ce point de vue, l e dsir n'est pas
seulement l'emptement d' une conscience par sa facticit, il est
corrlativement l'engluement d'un corps par l e monde ; et le monde
se fait engluant ; l a conscience s'enlise dans un corps qui s'enlise dans
l e monde 2. Ainsi l 'idal qui se propose ici c'est l' tre-au-milieu-du-
1. Cf. notre Esquisse d'une thorie phnomnologique des motions.
2. Bien entendu, il faut tenir compte ici, comme partout, du cofficient
d'adversit des choses. Les objets ne sont pas seulement caressants . Mais,
dans la prspective gnrale de la caresse, ils peuvent apparatre aussi comme
anti caresses , c'est dire d'une rudesse, d'une cacophonie, d'une duret
qui, prcisment parce que nous sommes en tat de dsir, nous heurtent d'une
faon insupportable.
432
monde ; le pour-soi tente de raliser un tre-au-milieu-du-monde,
comme pro-j et ultime de son tre-dans-Ie-monde ; c'est pourquoi la
volupt est si souvent lie
l
a mort - qui est aussi une mtamor
phose ou tre-au-mili eu-du-monde -, on connat par exemple le
thme de la fausse morte , si abondamment dvelopp dans toutes
les littratures.
Mais le dsir n' est pas d'abord ni surtout une relation au monde. Le
monde ne parat ici que comme fond pour des relations explicites avec
l'autre. Ordinairement c'est l'occasion de la prsence de l'autre que
le monde se dcouvre comme monde du dsir. Accessoirement il peut
se dcouvrir comme tel l'occasion de l'absence de tel autre ou mme
l'occasion de l'absence de tout autre. Mais nous avons dj not que
l'absence est un rapport existentiel concret de l'autre moi qui parat
sur le fond origi nel de l'tre-pour-autrui. Je puis, certes, en dcou
vrant mon corps dans la solitude, me sentir brusquement comme
chair, touffer de dsir et saisir le monde comme touffant .
Mais ce dsir solitaire est un appel vers un autre ou vers la prsence
de l'autre indiffrenci. Je dsire me rvler comme chair par et pour
une autre chair. l' essaie d'envoter l'autre et de le faire paratre ; et le
monde du dsir indique en creux l'autre que j' appelle. Ainsi le dsir
n'est nullement un accident physiologique, un prurit de notre chair
qui pourrait nous fixer fortuitement sur la chair de l'autre. Mais, bien
au contraire, pour qu'il y ait ma chair et l a chair de l'autre, il faut que
la conscience se coule pralablement dans l e moule du dsir. Ce dsir
est un mode primitif des relations avec autrui, qui constitue l'autre
comme chair dsirable sur l e fond d'un monde de dsir.
Nous pouvons prsent expliciter le sens profond du dsir. Dans la
raction primordiale au regard d'autrui, en effet, je me constitue
comme regard. Mais si je regarde le regard, pour me dfendre contre
la libert d'autrui et la transcender comme libert, la libert et le
regard de l ' autre s'effondrent : je vois des yeux, je vois un tre-au
milieu-du-monde. Dsormais l'autre m'chappe : j e voudrais agir sur
sa libert, me l'approprier, ou, du moins, me faire reconnatre comme
libert par elle mais cette libert est morte, elle n'est absolument plus
dans le monde o j e rencontre l'autre-objet, car sa caractristique est
d'tre transcendante au monde. Certes je puis saisir l'autre, l'empoi
gner, l e bouscul er ; je pui s, si je dispose de la puissance, le
contraindre tels ou tels actes, telles ou telles paroles ; mais tout se
passe comme si j e voulais m'emparer d'un homme qui s'enfuirait en
me laissant son manteau entre les mains. C'est le manteau, c'est la
dpouille que je possde ; j e ne m' emparerai j amais que d'un corps,
objet psychique au milieu du monde ; et, bien que tous les actes de ce
corps puissent s'interprter en termes de libert, j'ai entirement
perdu la cl de cette interprtation : je ne puis agir que sur une
facticit. Si j 'ai conserv l e savoir d' une libert transcendante
433
d'autrui, ce savoir m'irrite en vai n, en i ndiquant une ralit qui est par
principe hors de mon attei nte et en me rvlant chaque i nstant que
j e l a manque, que tout ce que j e fai s est l'aveuglette et prend
son sens ailleurs, dans une sphre d'existence dont j e suis exclu par
principe. Je puis faire crier grce ou demander pardon, mais
j'ignorerai toujours ce que cette soumission signifie pour et dans la
libert de l'autre. En mme temps, d' ai lleurs, mon savoir s'altre : j e
perds l'exacte comprhension de l 'tre-regard, qui est, on l e sai t, la
seul e mani re dont j e puis prouver la libert de l'autre. Ainsi suis-je
engag dans une entreprise dont j' ai oubli jusqu'au sens. Je suis
gar en face de cet autre que j e vois et que j e touche et dont je ne
sais plus que faire. C'est tout j uste si j 'ai conserv le souvenir vague
d'un certai n au-del de ce que je vois et de ce que je touche, au-del
dont je sais qu'il esl prcisment ce que je veux m'approprier. C'est
alors que je me fais dsir. Le dsir est une conduite d'envotement. Il
s'agit, puisque je ne puis saisir l'autre que dans sa facticit objective,
de faire engluer sa libert dans cette facticit : i l faut faire qu'elle y
soit prise comme on di t d' une crme qu'elle est prise, de faon
que le pour-soi d' autrui vienne affleurer la surface de son corps,
qu' i l s' tende tout travers de son corps et qu'en touchant ce corps, je
touche enfin la libre subjectivit de l'autre. C'est l l e vrai sens du mot
de possession. Il est certain que je veux possder le corps de l'autre ;
mai s je veux le possder en tant qu' i l est lui-mme un possd ,
c'est--dire en tant que la conscience de l'autre s'y est identifie. Tel
est l'idal impossible du dsir : possder l a transcendance de l'autre
comme pure transcendance et pourtant comme corps ; rduire l'autre
sa simple facticit, parce qu'il est alors au milieu de mon monde,
mais faire que cette fact icit soit une apprsentation perptuelle de sa
transcendance nantisante.
Mai s vrai di re la facticit de l'autre (son pur tre-l) ne peut tre
donne mon i ntui tion sans une modification profonde de mon tre
propre. Tant que je dpasse vers mes possibilits propres ma facticit
personnelle, tant que j 'existe ma facticit dans un lan de fuite, je
dpasse aussi la facticit de l'autre comme, d'ailleurs, la pure
existence des choses. Dans mon surgissement mme, je les fais
merger l'existence instrumentale, leur tre pur et simple est
masqu par l a complexit des renvois indicatifs qui constituent leur
maniabilit et leur ustensilit. Prendre un porte-plume, c'est dj
dpasser mon tre-l vers la possibilit d'crire, mais c'est aussi
dpasser le porte-plume comme simple existant vers sa potentialit et
celle-ci, derechef, vers certains existants futurs qui sont les mots
devant-tre-tracs et finalement le livre-devant-tre-crit . C'est
pourquoi l'tre des existants est ordinairement voil par leur fonction.
Il en est de mme pour l'tre de l' autre : si l ' autre m' apparat comme
domestique, comme employ, comme fonctionnaire, ou simplement
434
comme le passant que je dois viter ou comme cette voix qui parle
dans l a chambre voisine et que je cherche comprendre (ou, au
contraire, que je veux oublier car elle m'empche de dormir ), ce
n'est pas seulement sa transcendance extra-mondaine qui m'chappe,
mais aussi son tre-l comme pure existence contingente au milieu
du monde. Cest que, justement, en tant que je le traite comme
domestique ou comme employ de bureau, je le dpasse vers ses
potentialits (transcendance-transcende, mortes-possibilits) par l e
projet mme par quoi je dpasse et nantise ma propre facticit. Si j e
veux revenir sa simple prsence et la goter comme prsence, i l faut
que je tente de me rduire la mienne propre. Tout dpassement de
mon tre-l est en effet dpassement de celui de l'autre. Et si le
monde est autour de moi comme l a situation que je dpasse vers moi
mme, al ors je saisis l'autre partir de sa situation, c'est--dire dj
comme centre de rfrence. Et certes l' autre dsir doit aussi tre
saisi en situation : c'est une femme dans le monde, debout prs d'une
table, nue sur un lit ou assise mes cls que je dsire. Mais si l e dsir
reflue de la situation sur l'tre qui est en situation, c'est pour
dissoudre l a situation et corroder les relations d'autrui dans le
monde : le mouvement dsirant qui va des entours l a personne
dsire est un mouvement isol ant , qui dtruit les entours et cerne l a
personne considre pour faire ressortir sa pure facticit. Mais
justement cela n'est possible que si chaque objet qui me renvoie la
personne se fige dans sa pure contingence en mme temps qu'il me
l'indique ; et, par suite, ce mouvement de retour l'tre d'autrui est
mouvement de retour moi, comme pur tre-l. Je dtruis mes
possibilits pour dtruire celles du monde et constituer l e monde en
monde du dsi r , c'est--dire en monde dstructur, ayant perdu
son sens et o les choses sont saillantes comme des fragments de
matire pure, comme des qualits brutes. Et, comme le pour-soi est
choix, cela n'est possible que si je me pro-jette vers une possibilit
neuve : cette d'tre par mon corps comme l'encre par un
buvard , cette de me rsumer en mon pur tre-l. Ce projet, en tant
qu'il n'est pas simplement conu et pos thmatiquement mais vcu,
c'est--dire en tant que sa ralisation ne se distingue pas de sa
conception, c'est le trouble. Il ne faut pas comprendre, en effet , les
descriptions prcdentes, comme si je me mettais dlibrment en
tat de trouble avec le dessein de retrouver l e pur tre-l de
t'autre. Le dsir est un pro-jet vcu qui ne suppose aucune dlibra
tion pralable, mais qui comporte en soi-mme son sens et son
interprtation. Ds que je me jette vers la facticit de l'autre, ds que
je veux carter ses actes et ses fonctions pour l'atteindre dans sa chair,
je m' i ncarne moi-mme, car je ne puis ni vouloir ni mme concevoir
t'incarnation de l'autre si ce n'est dans et par ma propre incarnation ;
et mme t'esquisse vide d' un dsir (comme lorsqu'on dshabille
435
distraitement une femme du regard ) est une esquisse vide du
troubl e, car je ne dsire qu'avec mon trouble, je ne dnude l 'autre
qu'en me dnudant moi-mme, je n'bauche et n' esquisse la chair de
l'autre qu'en esqui ssant ma propre chair.
Mais mon incaration n'est pas seulement la condition pralable de
l'apparition de l'a utre mes yeux comme chair. Mon but est de le faire
s'incarner ses propres yeux comme chair, il faut que je l'entrane sur le
terrain de la fact icit pure, il faut qu' i l se rsume pour lui-mme
n'tre que chai r. Ainsi serai-je rassur sur les possibilits permanentes
d'une transcendance qui peut chaque instant me transcender de toute
part : elle ne sera plus que ceci ; elle demeurera incluse dans les bornes
d'un objet ; e n outre, de ce fait mme, j e pourrai la toucher, l a tter, la
possder. Aussi l ' autre sens de mon i ncarnation -c'est--dire de mon
trouble -c'est qu' el l e est un l angage envotant. Je me fais chair pour
fasciner autrui par ma nudit et pour provoquer en l ui le dsir de ma
chair, justement parce que ce dsi r ne sera rien d'autre, en l'autre,
qu'une incarnation semblable l a mienne. Ainsi l e dsir est-il une
invi te au dsir. C'est ma chai r seule qui sai t trouver l e chemi n de l a
chai r d' autrui et j e porte ma chai r contre sa chair pour l ' vei l l er au sens
de l a chair. Dans l a caresse, en effet, lorsque je glisse lentement ma
main inerte contre l e flanc de l'autre, j e l ui fais tter ma chair et c'est ce
qu'il ne peut fai re, lui-mme, qu' en se rendant i nerte ; le frisson de
plaisir qui l e parcourt alors est prcisment l 'veil de sa conscience de
chair. Etendre ma mai n, l ' carter ou l a serrer, c'est redevenir corps en
acte ; mais, du mme coup, c'est faire s'vanouir ma main comme
chair. La laisser couler insensiblement l e long de son corps, la rduire
un doux frlement presque dnu de sens, une pure existence, une
pure matire un peu soyeuse, un peu satine, un peu rche, c'est
renoncer pour soi-mme tre cel ui qui tablit les repres et dploie
les distances, c'est se faire muqueuse pure. A ce moment, la
communion du dsir est ralise : chaque consci ence, en s'incarnant, a
ralis l ' i ncarnation de l'autre, chaque trouble fait natre le trouble de
l'autre et s' en est accru d'autant. Par chaque caresse, je sens ma propre
chair et l a chair de l' autre travers ma propre chair et j'ai conscience
que cette chair que j e sens et m'approprie par ma chair est chair-sentie
par-l'autre. Et ce n'est pas par hasard que le dsir, tout en visant le
corps entier, l 'atteint surtout travers les masses de chair l es moins
di ffrencies, les pl us grossirement i nnerves, les moins capables de
mouvement spontan, travers l es seins, les fesses, les cuisses, l e
ventre : el l es sont comme l'image de la facticit pure. Ce st pour cela
aussi que la vritable caresse, c'est l e contact des deux corps dans leurs
parties les plus charnelles, le contact des ventres et des poitrines : la
mai n qui caresse est malgr tout dlie, trop proche d' un outil
perfectionn, mais l'panouissement des chairs l ' une contre l'autre et
l 'une par l'autre est le but vritable du dsir.
436
Toutefois le dsir est lui-mme vou l'chec. Nous avons vu en
effet que l e cot, qui le termi ne ordinairement, n'est pas son but
propre. Certes, plusieurs l ments de notre structure sexuelle sont la
traduction ncessaire de l a nature du dsir. En particulier l' rection
du pni s et du clitoris. Elle n'est rien d'autre, en effet , que
l'affirmation de la chair par l a chair. Il est donc absolument ncessaire
qu'elle ne se fasse pas volontairement, c'est--dire que nous ne
puissions en user comme d'un instrument, mais qu' i l s'agisse, au
contraire, d' un phnomne biologique et autonome dont l'panouis
sement autonome et involontaire accompagne et signifie l'enlisement
de l a conscience dans le corps. Ce qu' i l faut bien entendre, c'est
qu'aucun organe dli, prhensif et reli des muscles stris ne
pouvait tre un organe sexuel , un sexe ; le sexe, s'il devait apparatre
comme organe, ne pouvait tre qu'une manifestation de la vie
vgtati ve. Mais la contingence reparat si nous considrons que,
justement, il y a des sexes et de tels sexes. En particulier l a
pntration du ml e dans l a femel l e, bien que conforme cette
incarnation radicale que veut tre le dsir (que l'on remarque, en
effet, la passivit organique du sexe dans le cot : c'est le corps tout
entier qui s'avance et recule, qui porte le sexe en avant ou qui le
retire ; ce sont les mains qui aident l'intromission du pni s ; l e pnis
lui- mme apparat comme un i nstrument qu' on mani e, qu'on
enfonce, qu' on retire, qu'on utilise , et pareillement l'ouverture et l a
lubrification du vagin ne peuvent tre obtenues volontairement),
demeure une modalit parfai tement contingente de notre vie
sexuelle. Et c'est aussi une contingence pure que l a volupt sexuelle
proprement di te. A vrai dire, i l est normal que l'engluement de la
conscience dans le corps ait son aboutissement, c'est--dire une sorte
d'extase particulire o l a conscience ne soit plus que conscience (du)
corps et , par suite, conscience rflexive de la corporit. Le plaisir, en
effet - comme une douleur trop vive -motive l'apparition d'une
conscience rflexive qui est attention au plaisir . Seulement le
plaisir est la mort et l'chec d'l dsi r. I l est la mort du dsir parce qu'il
n'est pas seulement son achvement mais son terme et sa fin. Ceci
n'est d' ai l l eurs qu'une contingence organique : il se fait que l'incarna
tion se manifeste par l'rection et que l'rection cesse avec l'jacula
tion. Mais en outre le plaisir est l ' cluse du dsir parce qu' i l motive
l'appariti on d' une conscience rflexive de plaisir, dont l'objet devient
la jouissance, c'est--dire qui est attention l'incarnation du pour-soi
rfchi et , du mme coup, oubli de l ' i ncarnation de l'autre. Ceci
n'appartient plus au domaine de l a contingence. Sans doute il
demeure contingent que le passage la rflexion fascine se fasse
l'occasi on de ce mode particulier d' i ncarnation qu'est le plaisir -
aussi bi en y a-t-il de nombreux cas de passage au rflexif sans
interventi on du plaisir - mais ce qui est un danger permanent du
437
dsir
, en tant qu'il est tentative d'incarnation, c'est que la conscience,
en s'incarnant, perde de vue l'incarnation de l'autre et que sa propre
incarnation l'absorbe jusqu' devenir son but ultime. En ce cas le
plaisir de caresser se transforme en plaisir d'tre caress, ce que le
pour-soi demande, c'est de sentir son corps s'panouir en lui jusqu'
la nause. Du coup i l y a rupture de contact et le dsir manque son
but. Il arrive mme souvent que cet chec du dsir motive un passage
au masochisme, c'est--dire que la conscience, se saisissant dans sa
facticit, exige d'tre saisie et transcende comme corps-pour-autrui
par la conscience de l'autre : en ce cas l'autre-objet s'effondre et
l'autre-regard apparat et ma conscience est conscience pme dans sa
chair sous le regard de l'autre.
Mais , inversement, l e dsir est l'origine de son propre chec en
tant qu'il est dsir de prendre et de s'approprier. Il ne suffit pas en
effet que l e trouble fasse natre l'i ncarnation de l'autre : le dsir est
dsir de s'approprier cette conscience incarne. Il se prolonge donc
naturellement non plus par des caresses, mais par des actes de
prhension et de pntration. La caresse n'avait pour but que
d'imprgner de conscience et de libert l e corps de l'autre. A prsent,
ce corps satur, i l faut le prendre, l'empoigner, entrer en lui . Mais du
seul fai t que je tente prsent de saisir, de traner, d' empoigner, de
mordre , mon corps cesse d'tre chai r, i l redevient l'instrument
synthtique que je suis ; et du mme coup l'autre cesse d'tre
incarnation : i l redevient un instrument au milieu du monde que je
saisis partir de sa situation. Sa conscience qui affleurait la surface
de sa chair et que je tentais de goter avec ma chair
1
s'vanouit sous
ma vue : il ne demeure plus qu'un objet avec des images-objets dans
son intrieur. En mme temps mon trouble disparat : cela ne signifie
pas que je cesse de dsirer, mais le dsir a perdu sa matire, il est
devenu abstrait ; il est dsir de manier et de prendre, je m'acharne
prendre, mais mon acharnement mme fait disparatre mon i ncarna
tion : prsent, je dpasse de nouveau mon corps vers mes propres
possibi l its (ici l a possibilit de prendre) et, pareillement, l e corps
d'autrui, dpass vers ses potentialits, tombe du rang de chair au
rang de pur objet. Cette situation implique la rupture de l a rciprocit
d'incarnation qui tait prcisment le but propre du dsir : l'autre
peut rester troubl ; i l peut demeurer pour lui chair ; et je puis le
comprendre ; mais c'est une chair que je ne saisis plus par ma chair,
une chair qui n'est plus que l a propril d'un autre-objet et non
l'incarnation d'une autre-conscience. Ainsi suis-je corps (totalit
synthtique en situation) en face d'une chair. Je me retrouve, peu
de chose prs, dans l a situation dont je tentais justement de sortir par
1 . Dona Prouhzc (Le Soulier de Sarin, Il' journe) : * I l ne connatra pas le
got que j'ai. ^
438
le dsir, c'est--dire que j'essaie d'utiliser l'objet-autrui pour lui
demander compte de sa transcendance et que, prcisment parce qu'il
est tout objet, il m' chappe de toute sa transcendance . J'ai mme,
nouveau, perdu la comprhension nette de ce que je recherche, et
pourtant j e sui s engag dans la recherche. Je prends et j e me
dcouvre en train de prendre, mais ce que je prends dans mes mains
est autre chose que ce que je voulais prendre ; j e le sens et j'en
souffre, mais sans tre capable de dire ce que j e voulais prendre car,
avec mon troubl e, l a comprhension mme de mon dsir m' chappe ;
je suis comme un dormeur qui , s'veillant, se trouverait en train de
crisper ses mains sur le rebord du lit sans se rappeler le cauchemar qui
a provoqu son geste. C'est cette situation qui est J 'origine du
sadisme.
Le sadisme est passion, scheresse et acharnement. Il est acharne
ment parce qu'il est l'tat d'un pur-soi qui se saisit comme engag
sans comprendre quoi il s'engage et qui persiste dans son engage
ment sans avoir une claire conscience du but qu'il s'est propos ni un
souvenir prcis de la valeur qu'il a attache cet engagement. Il est
scheresse parce qu'il apparat lorsque le dsir s'est vid de son
trouble. Le sadique a ressaisi son corps comme totalit synthtique et
centre d'action ; i l s'est replac dans la fuite perptuelle de sa propre
facticit, i l s'prouve en face de l'autre comme pure transcendance ; il
a en horreur pour lui l e trouble, i l le considre comme un tat
humiliant ; il se peut aussi , simplement, qu'il ne puisse pas le raliser
en lui. Dans la mesure o il s'acharne froid, o i l est la fois
acharnement et scheresse, le sadique est un passionn. Son but est,
comme celui du dsir, de saisir et d' asservir l' autre non seulement en
tant qu'autre-objet, mais en tant que pure transcendance incarne.
Mais l'accent est mi s, dans le sadisme, sur l'appropriation instrumen
tale de l'autre-incarn. L moment du sadisme en effet, dans l a
sexualit, c'est celui o l e pour-soi incarn dpasse son incarnation
pour s'approprier l'incarnation de l'autre. Aussi le sadisme est, la
fois, refus de s'incarner et fuite de toute facticit et, l a fois, effort
pour s'emparer de la facticit de l'autre. Mais, comme il ne peut ni ne
veut raliser l'incarnation de l'autre par sa propre incarnation,
comme, de ce fait mme, il n' a d'autre ressource que de traiter l'autre
en objet-ustensil e, i l cherche utiliser le corps de l'autre comme un
outil pour faire raliser l'autre l' existence incarne. Le sadisme est
un effort pour incarner autrui par la violence et cette incarnation de
doit tre dj appropriation et utilisation de l'autre. Le
sadique cherche dnuder l'autre -comme le dsir - de ses actes
qui le masquent. Il cherche dcouvrir la chair sous l'action. Mais au
lieu que le pour-soi du dsir se perde dans sa propre chair pour
rvler autrui qu'il est chair, l e sadique refuse sa propre chair en
mme temps qu'il dispose des instruments pour rvler de force sa
439
chair autrui . L'ohjet du sadisme est l'appropriation i mmdiate.
Mais l e sadisme est en porte faux car i l ne jouit pas seulement de la
chair d'autrui mais, en liaison directe avec cette chair, de sa non
incarnation propre. Il veut l a non-rciprocit des rapports sexuels, il
jouit d' tre puissance appropriante et lihre en face d' une libert
captive par l a chair. C'est pourquoi l e sadisme veut prsentifier l a
chair autrement l a conscience d'autrui : il veut l a prsentifier en
traitant autrui comme un i nstrument ; i l la prsentifie par l a douleur.
Dans l a douleur, en effet, l a facticit envahit l a conscience et,
final ement, l a conscience rflexive est fascine par la facticit de la
conscience irrflchie. I l y a donc bien une incarnation par l a douleur.
Mais en mme temps l a douleur est procure par des instruments ; le
corps du pour-soi suppliciant n'est plus qu'un instrument donner de
la douleur. Ai nsi l e pour-soi ds l ' origine peut se donner l'illusion de
s'emparer instrumentalement de la libert de l'autre, c'est--dire de
couler cette l i bert dans de l a chair, sans cesser d'tre celui qui
provoque, qui empoigne, qui saisi t, etc.
Quant au type d' incarnation que le sadisme voudrait raliser, c'est
prcisment ce que l 'on nomme l'obscne. L'obscne est une espce
de l'tre-pour-autrui , qui appartient au genre du disgracieux. Mais
tout disgracieux n'est pas ohscne. Dans l a grce, l e corps apparat
comme un psychique en situation. Il rvle avant tout sa transcen
dance, comme transcendance-transcende ; i l est en acte et se
comprend partir de la situation et de la fin poursuivi e. Chaque
mouvement est donc saisi dans un processus perceptif qui se porte du
futur au prsent. A ce compte, l'acte gracieux a, d' une part, la
prcision d' une machine bi en adapte et, d'autre part, la parfaite
i mprvisibilit du psychique, puisque, nous l'avons vu, le psychique
est, pour autrui, l'objet imprvisible. L'acte gracieux est donc
chaque instant parfaitement comprhensible en tant que l ' on consi
dre ce qui, en l ui , est coul. Mieux mme, cette part coule de
l'acte est sous-tendue par une sorte de ncessit esthtique qui vient
de sa parfaite adaptation. En mme temps l e but -venir cl aire l'acte
ans sa totalit ; mais toute l a part future de l'acte demeure
i mprvisi bl e, encore que l'on sente sur l e corps mme en acte qu' el le
apparatra comme ncessaire et adapte ds qu' el l e sera coule.
C'est cette image mouvante de l a ncessit et de la libert (comme
proprit de l'autre-objet) qui constitue proprement parler la grce.
Bergson en a donn une bonne description. Dans la grce le corps est
l'instrument qui manifeste la libert. L'acte gracieux, en tant qu' il
rvle le corps comme outil de prcision, lui fournit chaque instant
sa j ustification d'exister : l a mai n est pour prendre et manifeste
d'ahord son tre-pour-prendre. En tant qu'elle est saisie partir
d' une situation qui exige la prhension, el l e apparat comme exige
elle-mme dans son tre, el l e est appele. Et en tant qu'elle manifeste
440
sa libert par l ' imprvisibilit de son geste, elle parat l'origine de
son tre : i l semble qu'elle se produise elle-mme sous l'appel
justificateur de l a situation. La grce figure donc l ' image objective
d'un tre qui serait fondement de soi-mme pour - . . La facticit est
donc habille et masque par la grce : la nudit de la chair est tout
entire prsente, mais elle ne peut tre vue. En sorte que l a suprme
coquetterie et l e suprme dfi de la grce, c'est d'exhiber le corps
dvoil, sans autre vtement, sans autre voile que la grce elle-mme.
Le corps l e plus gracieux est l e corps nu que ses actes entourent d'un
vtement invisi bl e en drobant entirement sa chair, bi en que la chair
soit totalement prsente aux yeux des spectateurs. Le disgracieux
apparat au contraire lorsqu'un des lments de la grce est contrari
dans sa ralisation. Le mouvement peut devenir mcanique. En ce cas
le corps fait toujours partie d'un ensemble qui le j ustifi e, mais titre
de pur instrument ; sa transcendance-transcende disparat et avec
elle s'vanouit la situation comme surdtermination latrale des
objets-ustensiles de mon univers. Il se peut aussi que les actes soient
heurts et violents : auquel cas c'est J'adaptation la situation qui
s'effondre ; la situation demeure, mai s i l se glisse comme un vi de, un
hiatus entre el l e et l'autre en situation. Dans ce cas l'autre demeure
libre, mais cette libert n'est saisie que comme pure imprvisibilit et
elle ressemble au clinamen des atomes picuriens, bref un indter
minisme. En mme temps l a fin demeure pose et c'est toujours
partir de l'avenir que nous percevons le geste de l'autre. Mais l a
dsadaptation entrane cette consquence que l ' interprtation per
ceptive par l'avenir est toujours trop large ou trop troite : c'est une
interprtation par peu prs. Par suite, la j ustification du geste et de
J'tre de l'autre est imparfaitement ralise ; l a l i mite, le maladroit
est un i nj ustifiabl e ; toute sa facticit, qui tait engage dans la
situation, est absorbe par el l e, reflue sur l ui . Le maladroit libre
inopportunment sa facticit et l a place soudain sous notre vue : l o
nous nous attendions saisir une cl de la situation, manant
spontanment de la situation mme, nous rencontrons soudain l a
contingence i nj ustifiable d' une prsence inadapte ; nous sommes mi s
en face de l'existence d' un existant. Toutefois si le corps est tout
entier dans l'acte, la facticit n'est pas encore chair. L'obscne
apparat lorsque le corps adopte des postures qui le dshabillent
entirement de ses actes et qui rvlent l'inertie de sa chair. La vue
d'un corps nu, de dos, n'est pas obscne. Mais certains dandinements
involontaires de l a croupe sont obscnes. C'est qu' alors ce sont les
jambes seules qui sont en acte chez l e marcheur et la croupe semble
un coussin isol qu'elles portent et dont l e balancement est pure
obissance aux lois de la pesanteur. Elle ne saurait se justifier par la
situation ; elle est entirement destructrice de toute situation, au
contrai re , puisqu'eIle a l a passivit de l a chose et qu'elle se fait porter
441
comme une chose par les jambes. Du coup elle se acouvre comme
facticit inj ustifi abl e, elle est de trop ", comme tout tre contingent.
El le s'isole dans ce corps dont l e sens prsent est la marche, elle est
nue, mme si quelque toffe la voi le, car elle ne participe plus la
transcendance-transcende du corps en acte ; son mouvement de
balancier, au l i eu de s'interprter partir de l'-venir, s'interprte et
se connat partir du pass, comme un fait physique. Ces remarques
peuvent naturellement s'appliquer aux cas o c'est tout le corps qui se
fait chair, soit par je ne sais quelle mollesse de ses gestes, qui ne peut
s' i nterprter par la situation, soit par une dformation de sa structure
(prolifration des cellules graisseuses, par exemple) qui nous exhibe
une facticit surabondante par rapport l a prsence effective
qu'exige l a situation. Et cette chair rvle est spcifiquement
obscne lorsqu' el l e se dcouvre quelqu'un qui n'est pas en tat de
dsir et sans exciter son dsir. Une dsadaptation particulire qui
dtruit la situat ion dans le temps mme o je la saisis et qui me livre
l 'panouissement inerte de l a chair comme une brusque apparition
sous le mince vtement des gestes qui l'habillent, alors que je ne suis
pas, par rapport cette chair, en tat de dsir : voil ce que je
nommerai l'obscne.
On voit ds lors le sens de l' exigence sadique : l a grce rvle l a
libert comme proprit de l'autre-objet et renvoie obscurment,
comme font les contradictions du monde sensible dans le cas de l a
rminiscence platonicienne, un au-del transcendant dont nous ne
gardons qu'un souvenir brouill et que nous ne pouvons atteindre que
par une modification radicale de notre tre, c'est--dire en assumant
rsolument notre tre-pour-autrui . En mme temps elle dvoile et
v
oile la chair de l'autre, ou, si l'on prfre, elle la dvoile pour la
v
oiler aussitt : l a chair est, dans la grce, l'autre inaccessibl e. Le
sadique vise dtruire la grce pour constituer rellement une autre
synthse de l' autre : il veut faire paratre la chair d'autrui ; dans son
apparition mme l a chair sera destructrice de la grce et la facticit
rsorbera l a libert-objet de l'autre. Cette rsorption n'est pas
anantissement : pour l e sadique c'est l'autre-libre qui se manifeste
comme chair ; l'identit de l'alllre-objet n'est pas dtruite travers ces
avatars ; mais les relations de l a chair la libert sont inverses : dans
l a
g
rce la libert contenait et voilait la facticit ; dans la nouvelle
synthse op
rer , c'est la facticit qui contient et masque la libert.
Le sadique vise donc faire paratre la chair brusquement et par la
contrainte, c'est--dire par l e concours non de sa propre chair, mais
de son corps comme instrument. Il vise faire prendre l'autre des
attitudes et des positions telles que son corps paraisse sous l'aspect de
l'obscne ; ainsi demeure-t-il sur l e plan de l'appropriation instrumen
tale puisqu'il fait natre l a chair en agissant par la force sur l'autre, et
l'autre devient un instrument entre ses mains -le sadique manie l e
442
corps de l'autre, pse sur ses paules pour l'incliner vers la terre et
faire ressortir ses reins, etc. - et d'autre part le but de cette
utilisation instrumentale est i mmanent l'utilisation mme : le
sadique traite l'autre comme instrument pour faire paratre la chair de
l'autre ; le sadique est l 'tre qui apprhende l'autre comme l'instru
ment dont la fonction est sa propre incarnation. L'idal du sadique
sera donc d'atteindre le moment o l'autre sera dj chair sans cesser
d'tre instrument, chair faire natre de la chai r ; o les cuisses, par
exempl e, s'offrent dj dans une passivit obscne et panouie et sont
encore des instruments qu'on manie, qu' on carte et que l'on courbe,
pour faire saillir davantage les fesses et pour les incarner leur tour.
Mais ne nous y trompons pas : ce que le sadique recherche ainsi avec
tant d'acharnement, ce qu'il veut ptrir avec ses mains et plier sous
son poing, c'est la libert de l'autre : elle est l, dans cette chair, c'est
elle qui est cette chair, puisqu'il y a une facticit de l'autre ; c'est donc
elle que le sadique tente de s'appropri er. Ainsi l'effort du sadique est
pour engluer autrui dans sa chair par l a violence et par la douleur, en
s'appropriant l e corps de l'autre par le fait qu'il l e traite comme chair
faire natre de l a chai r ; mais cette appropriation dpasse le corps
qu'elle s'approprie, car elle ne veut le possder qu'en tant qu'il a
englu en l ui la libert de l'autre. C'est pourquoi le sadique voudra
des preuves manifestes de cet asservissement par la chair de la libert
de l'autre : il visera faire demander pardon, il obligera par la torture
et la menace l ' autre s'humilier, renier ce qu'il a de plus cher. On a
dit que c'tait par got de domination, par volont de puissance. Mais
cette explication est vague ou absurde. C'est le got de la domination
qu'il faudrait expliquer d'abord. Et ce got, prcisment, ne saurait
tre antrieur au sadisme comme son fondement, car il nat comme
lui et sur le mme plan que lui, de l'inquitude en face de l'autre. En
fait si le sadique se plat arracher un reniement par la torture, c'est
pour une raison analogue celle qui permet d'interprter le sens de
l'amour. Nous avons vu en effet que l'amour n'exige pas l'abolition de
l a libert de l'autre, mais son asservissement en tant que libert, c'est
-dire son asservissement par elle-mme. Pareillement le sadisme ne
cherche pas supprimer la l i bert de celui qu'il torture mais
contraindre cette libert s'identifier librement la chair torture.
C'est pourquoi le moment du plaisir est, pour le bourreau, celui o l a
victime renie ou s'humilie. En effet, quelle que soit l a pression
exerce sur l a victime, le reniement demeure libre, il est une
production spontane, une rponse l a situation ; il manifeste l a
ralit-humaine ; quelle qu'ait t la rsistance de la victime et si
longtemps qu' el le ai t attendu avant de crier grce, elle aurait pu,
malgr tout, attendre dix minutes, une mi nut e, une seconde de plus.
Elle a dcid du moment o la douleur devenait insupportable. Et l a
preuve en est qu'elle vi vra son reniement, par la suite, dans le
443
remords et la honte. Ainsi lui est-il entirement imputable. Mais
d'autre part le sadique s' en considre en mme temps comme l a
cause. Si l a victime rsiste et refuse de crier grce, le jeu n' en est que
pl us plaisant : un tour de vi s de plus, une torsion supplmentaire et
les rsistances finiront par cder. Le sadique se pose comme ayant
tout le temps . Il est cal me, i l ne se presse pas, i l dispose de ses
instruments comme un technicien , i l les essaie les uns aprs les autres,
comme le serrurier essaie diverses cls une serrure ; il jouit de cette
situation ambigu et contradictoire : d'une part, en effet, i l fait celui
qui dispose patiemment, au sei n du dterminisme universel, des
moyens en vue d'une fin qui sera automatiquement atteinte -comme
la serrure s'ouvrira automatiquement quand le serrurier aura trouv
la bonne cl -, d'autre part cette fin dtermine ne peut tre
ralise que par une libre et entire adhsion de l'autre. Elle reste
donc jusqu'au bout et la fois prvisible et imprvisible. Et l'objet
ralis est, pour le sadique, ambigu, contradictoire et sans quilibre
puisqu'il est l a fois l'effet rigoureux d'une utilisation technique du
dterminisme et la manifestation d'une libert inconditionne. Et le
spectacle qui s'offre au sadi que est celui d'une libert qui lutte contre
J'panouissement de la chair et qui , finalement, choisit librement de
se faire submerger par l a chair. Au moment du reniement, le rsultat
cherch est atteint : le corps est tout enti er chair pantelante et
obscne, il garde la position que les bourreaux lui ont donne, non
celle qu'il aurait prise de lui-mme, les cordes qui le lient le
soutiennent comme une chose i nerte et, par l mme, il a cess d'tre
l' objet qui se meut spontanment. Et c'est justement ce corps-l
qu' une libert choisit de s'ident ifier par le reniement ; ce corps
dfigur et haletant est l ' i mage mme de la libert brise et asservie.
Ces quel ques indications ne visent pas puiser le problme du
sadisme. Nous voulions simplement montrer qu' il est en germe dans
l e dsir lui-mme, comme l' chec du dsir : ds lors en effet que j e
cherche prendre l e corps d'autrui que j 'ai amen s'incarner par
mon incarnation, je romps l a rciprocit d' incarnation, je dpasse
mon corps vers ses propres possibilits et je m'oriente vers le sadisme.
Ainsi l e sadisme et l e masochisme sont-ils les deux cueils du dsir,
soit que je dpasse l e trouble vers une appropriation de la chair de
J'autre, soit que, enivr de mon propre trouble, je ne fasse plus
attention qu' ma chair et que j e ne demande plus rien l'autre, sinon
d'tre le regard qui m'aide raliser ma chair. C'est cause de cette
inconsistance du dsir et de sa perptuelle oscillation entre ces deux
cueils que l'on a coutume d'appel er la sexualit normale du nom
de sadico-masochiste .
Toutefois l e sadisme lui-mme , comme l'indiffrence aveugle et
comme le dsir, renferme le principe de son chec. Tout d'abord il y a
incompatibilit profonde entre l'apprhension du corps comme chair
444
et son utilisation instrumentale. Si de la chair je fais un instrument,
elle me renvoie d'autres instruments et des potentialits, bref un
futur, elle est partiellement justifie d'tre-l par la situation que je
cre autour de moi, comme l a prsence des clous et de la natte
clouer contre le mur justifie l'existence du marteau. Du coup sa
nature de chair, c'est--dire de facticit i nutilisable, fait place celle
de chose-ustensile. Le complexe chair-ustensile que le sadique a
tent de crer se dsagrge. Cette dsagrgation profonde peut tre
masque tant que l a chair est instrument rvler la chair, car ainsi
j'ai constitu un ustensile fin immanente. Mais lorsque l'incarnation
est acheve, lorsque j'ai bien devant moi un corps pantelant, j e ne sais
plus comment utiliser cette chair : aucun but ne saurait plus lui tre
assign puisque prcisment j'ai fait paratre son absolue contin
gence. Elle est l et elle est l pour rien . En ce sens j e ne puis
m'en emparer en tant qu'elle est chair, je ne puis l'intgrer un
systme complexe d'instrumenta lit sans que sa matrialit de chair,
sa carnation m' chappe aussitt . Je ne puis que demeurer interdit
devant elle, dans l'tat d' tonnement contemplatif, ou alors m' incar
ner mon tour, me laisser prendre par le trouble, pour me replacer au
moins sur l e terrain o la chair se dconvre la chair dans son entire
carnation. Ainsi l e sadisme, au moment mme o son but va tre
atteint, cde la pl ace au dsir. Le sadisme est l'chec du dsir ct le
dsir l'chec du sadisme. On ne peut sortir du cercle que par
l'assouvissement et l a prtendue possession physique . En celle-ci,
en effet, une nouvelle synthse du sadisme et du dsir est donne : l a
turgescence du sexe manifeste l ' incarnati on, le fait d'entrer
dans . . . ou d'tre pntre ralise symboliquement la tentative
d'appropriation sadique et masochiste. Mais si l e plaisir permet de
sortir du cercl e, c'est qu' i l t ue la fois l e dsir et la passion sadique
sans l es assouvir.
En mme temps et sur un tout autre plan, le sadisme recle un
nouveau motif d'chec. C'est en effet l a libert transcendante de l a
victime qu' i l cherche s'approprier. Mai s prcisment cette libert
demeure par principe hors d'attei nte. Et plus l e sadique s'acharne
traiter l'autre en instrument, plus cette libert lui chappe. Il ne
saurait agir que sur la libert comme proprit objective de J'autre
objet. C'est--dire sur l a libert au milieu du monde avec ses mortes
possibilits. Mais justement son but tant de rcuprer son t re-pour
autrui, i l l e manque par principe, car l e seul autrui auquel i l a affaire
c'est J'autre dans le monde qui n'a du sadique acharn sur lui que des
images dans sa tte .
Le sadique dcouvre son erreur lorsque sa victime l e regarde, c'est
-dire lorsqu' i l prouve l'alination absolue de son tre dans la libert
de l'autre : i l ralise al ors non seulement qu'il n'a pas rcupr son
tre-dehors , mais encore que l'activit par laquelle i l cherche le
445
rcuprer est elle-mme transcende et fige en sadisme comme
habitus et proprit avec son cortge de mortes-possibilits et que
cette transformation a lieu par et pour l'autre qu' i l veut asservir, Il
dcouvre alors qu'il ne saurait agir sur l a libert de l'autre, mme en
contraignant l'autre s'humilier et demander grce, car c'est
prcisment dans et par l a libert absolue de l'autre qu'un monde
vient exister, o i l y a un sadique et des instruments de torture et
cent prtextes s'humilier et se renier. Personne n'a mieux rendu la
puissance du regard de la victime sur ses bourreaux que Faulkner
dans l es dernires pages de Lumire d'aot. Des de bien
viennent de s' acharner sur le ngre Christmas et ils l'ont mascul.
Christmas agonise :
Mais l'homme, par terre, n'avait pas boug. Il gisait l, les yeux
ouverts, vides de tout 'sauf de connaissance. Quelque chose, une
ombre, entourait sa bouche. Pendant un long moment, il les regarda
avec des yeux tranquilles, insondables, intolrables. Puis son visage,
son corps, semblrent s'effondrer, se ramasser et, des vtements
lacrs autour des hanches et des reins, le flot comprim de sang noir
j aillit comme un soupir brusquement expir . . . et, de cette noire
explosion, l'homme sembla s'lever et flotter jamais dans leur
mmoire. Quels que soient les e ndroits o ils contempleront les
dsastres anciens et les espoirs nouveaux (paisibles valles, ruisseaux
paisibles et rassurants de l a vieillesse, visages refltants des enfants) ,
j amais ils n'oublieront cela. Ce sera toujours l, rveur, tranquille,
constant, sans jamais plir, sans jamais rien offrir de menaant, mais
par soi-mme serein, par soi-mme triomphant 1. De nouveau, dans la
vill e, lgrement assourdi par les murs, le hurlement de la sirne
monte vers son invraisemblable crescendo, se perd hors des limites de
l'audition 2.
Ainsi cette explosion du regard d' autrui dans le monde du sadique
fait s'effondrer le sens et le but du sadisme. En mme temps l e
sadisme dcouvre que c'tait cette libert-l qu'il voulait asservir et , en
mme temps, i l se rend compte de l a vanit de ses efforts. Nous voil
une fois de plus renvoy de l'tre-regardant l 'tre-regard, nous ne
sortons pas de ce cercle.
Nous n' avons pas voulu, par ces quelques remarques, puiser la
question sexuelle ni surtout celle des attitudes envers autrui. Nous
avons voulu, si mpl ement, marquer que l'attitude sexuelle tait un
comportement primitif envers autrui . Que ce comportement enve
loppe ncessairement en lui la conti ngence originelle de l'tre-pour
autrui et celle de notre facticit propre, cela va sans dire. Mais qu'il
1 . C'est moi qui souligne.
2. Lumire d'aot. N. R. F. , 1935, p. 385.
446
soit soumis ds l'origine une constitution physiologique et empiri
que, c'est ce que nous ne saurions admettre. Ds qu'il y a l e corps
et qu'il y a l' autre, nous ragissons par le dsir, par l'amour et par
les attitudes drives que nous avons mentionnes. Notre structure
physiologique ne fait qu'exprimer symboliquement et sur l e terrain de
l a contingence absolue l a possibilit permanente que nous sommes de
prendre l' une ou l ' autre de ces attitudes. Ai nsi pourrons-nous dire
que l e pour-soi est sexuel dans son surgissement mme en face
d'autrui et que, par l ui , la sexualit vient au monde.
Nous ne prtendons videmment pas que les attitudes envers autrui
se rduisent ces attitudes sexuelles que nous venons de dcrire. Si
nous nous sommes longuement tendu sur elles, c'est deux fins :
tout d'abord parce qu'elles sont fondamentales et que, finalement,
toutes les conduites complexes des hommes les uns envers les autres
ne sont que des enrichissements de ces deux attitudes originelles (et
d'une troisime, la haine, que nous allons bientt dcrire) . Sans doute
les conduites concrtes (collaboration, lutte, rivalit, mulation,
engagement, obissance l, etc.) sont infiniment plus dlicates
dcrire, car el les dpendent de la situation historique et des particula
rits concrtes de chaque relation du pour-soi avec l'autre ; mais elles
enferment toutes en elles comme leur squelette l es relations sexuelles.
Et cela non pas cause de l'existence d'une certaine libido qui se
glisserait partout, mais simplement parce que l es attitudes que nous
avons dcrites sont l es projets fondamentaux par quoi l e pour-soi
ralise son tre-pour-autrui et tente de transcender cette situation de
fait. Ce n' est pas ici le lieu de montrer ce que la piti, l'admiration, le
dgot, l ' envi e, la gratitude, etc. , peuvent contenir d'amour et de
dsir. Mais chacun pourra l e dterminer en se reportant sa propre
exprience, comme aussi l'intuition eidtique de ces diverses
essences. Cela ne signifie pas, naturellement, que ces diffrentes
attitudes sont de simples dguisements emprunts par l a sexualit.
Mais il faut entendre que la sexualit s'y intgre comme l eur
fondement et qu' el l es l'enveloppent et la dpassent comme la notion
de cercIe enveloppe et dpasse celle de segment tournant autour
d'une de ses extrmits qui demeure fixe. Ces attitudes-fondements
peuvent demeurer voiles, comme un squelette par la chair qui
l'entoure : c'est mme ce qui se produit l'ordinaire ; la contingence
des corps, la structure du projet originel que je suis, l 'histoire que
j'historialise peuvent dterminer l ' attitude sexuelle demeurer ordi
nairement impl icite, l'intrieur de conduites plus complexes : en
particulier il n'est pas frquent que l'on dsire explicitement les autres
du mme sexe . Mais, derrire les interdits de la morale et les
tabous de la socit, la structure originel le du dsir demeure, au
1. Voir aussi l'amour maternel, la piti, la bont, etc.
47
moins sous cett e forme particulire de trouble que l'on nomme l e
dgot sexuel . Et i l ne faut pas entendre cette permanence du projet
sexuel comme s'il devait demeurer en nous l'tat inconscient.
Un proj et du pour-soi ne peut exister que sous forme consciente.
Simplement i l e xiste comme intgr une structure particulire dans
laquelle il se fond. C'est ce que les psychanalystes ont senti lorsqu'ils
ont fait de l'affectivit sexuelle une tabula rasa qui tirait toutes ses
dterminations de l'histoire individuelle. Seulement il ne faudrait pas
croire que la sexualit est l'origine indtermine : en fait eIle
comporte toutes ses dterminations ds l e surgissement du pour-soi
dans un monde o il y a des autres. Ce qui est indtermin et ce
qui doit tre fix par l 'histoire de chacun, c'est le type de relation avec
l'autre, l'occasion duquel l'attitude sexuelle (dsir-amour, maso
chisme-sadisme) se mani festera dans sa puret explicite.
C'est prcisment parce que ces attitudes sont originelles que nous
les avons choisies pour montrer l e cercle des rapports avec autrui.
Comme el les sont intgres en effet dans toutes les attitudes envers les
autres, el l es entranent dans leur circularit l ' intgralit des conduites
envers autrui . De mme que l'amour trouve son chec en lui-mme et
que l e dsir surgit de la mort de l'amour pour s'effondrer son tour et
faire pl ace l ' amour, toutes l es conduites envers l'autre-objet
comprennent en el l es une rfrence implicite et voile un autre
sujet et cette rfrence est l eur mort ; sur la mort de la conduite
envers l'autre-objet surgit une attitude neuve qui vise s'emparer de
l'autre-sujet et celle-ci rvl e, son tour, son inconsistance et
s'effondre pour faire pl ace la conduite inverse. Ainsi sommes-nous
renvoys indfiniment de l'autre-objet l'autre-sujet et rciproque
ment ; l a course ne s'arrte j amais et c'est cette course, avec ses
inversions brusques de direction, qui constitue notre relation autrui.
A quelque moment que l'on nous considre nous sommes dans l'une
ou l'autre de ces attitudes -i nsatisfaits de l'une comme de l'autre ;
nous pouvons nous maintenir plus ou moins longtemps dans l'attitude
adopte, selon notre mauvaise foi ou selon les circonstances particu
lires de notre histoire ; mais jamais el l e ne se suffit elle-mme ; el l e
indique toujours obscurment vers l'autre. C'est qu'en effet nous ne
saurions prendre une attitude consistante envers autrui que s' i l nous
tait la fois rvl comme sujet et comme objet, comme transcen
dance-transcendante et comme transcendance-transcende, ce qui est
principiellement impossibl e. Ai nsi, sans cesse ballotts de l'tre
regard l'tre-regard, tombant de l'un l'autre par des rvolutions
alternes, nous sommes toujours, quelle que soit l'attitude adopte,
en tat d'instabilit par rapport autrui ; nous poursuivons l'idal
impossible de l'apprhension simultane de sa libert et de son
objectivit ; pour user des expressions de Jean Wahl, nous sommes
tantt par rapport l'autre en tat de trans-descendance (lorsque
448
nous l'apprhendons comme objet et l ' i ntgrons au monde), tantt en
tat de trans-ascendance (lorsque nous l'prouvons comme une
transcendance qui nous transcende) ; mai s aucun de ces deux tats ne
se suffit lui-mme ; et nous ne pouvons jamais nous pl acer
concrtement sur un plan d'galit, c'est--dire sur le plan o l a
reconnaissance de la libert d'autrui entranerait la reconnaissance
par autrui de notre l ibert. Autrui est par principe l'insaisissable : i l
me fuit quand j e l e cherche et me possde quand j e l e fuis. Voudrais
je mme agir, selon les prceptes de la morale kantienne, en prenant
pour fin inconditionne la libert de l 'autre, cette l ibert deviendrait
transcendance-transcende du seul fait que j'en fais mon but ; et
d'autre part , j e ne saurais agir son profit qu'en util isant l'autre-objet
comme i nstrument pour raliser cette libert. Il faudra bien en effet
que je saisisse l'autre en situation comme un objet-instrument ; et
mon seul pouvoir sera donc de modifier la sit uation par rapport
l'autre et l'autre par rapport la situation, Ainsi suis-je conduit ce
paradoxe qui est l'cueil de toute politique librale et que Rousseau a
dfini d' un mot : je dois contraindre l'autre tre libre. Cette
contrainte, pour ne pas s'exercer toujours, ni le plus frquemment,
sous forme de violence, n'en rgle pas moins les rapports des hommes
entre eux. Si je console, si je rassure, c'est pour dgager la libert
d'autrui des craintes ou des douleurs qui l'obscurcissent ; mais l a
consolation ou l'argument rassurant est l'organisation d'un systme
de moyens fin destin agir sur l'autre et par consquent l'intgrer
son tour comme chose-ustensile dans le systme. Bien plus, l e
consolateur opre une distinction arbitraire ent re la libert, qu' il
assimil e l'usage de la Raison et l a recherche du Bi en, et
l'affliction, qui l ui parat l e rsultat d' un dterminisme psychique. I l
agit donc pour sparer l a libert de l 'afflicti on, comme on spare l'une
de l'autre les deux composantes d'un produit chimique. Du seul fait
qu'il considre la libert comme pouvant tre trie , i l la transcende et
lui fait violence et il ne peut, sur le terrain o il se place, saisir cette
vrit : c'est que c'est l a libert elle-mme qui se fait affliction et que,
par suite, agir pour librer la libert de l ' affliction c'est agir contre l a
libert.
Il ne faudrait pas croire cependant qu'une morale du laisser
faire et de la tolrance respecterait davantage la libert d'autrui :
ds lors que j' existe, j 'tablis une l i mite de fait la libert d'autrui, j e
suis cette limite et chacun de mes projets trace cette limite autour de
l'autre : l a charit, l e l aisser-faire, l a tolrance - ou toute attitude
abstentionniste -est un projet de moi-mme qui m'engage et qui
engage autrui sans son assentiment. Raliser la tolrance autour
d'autrui, c'est faire qu'autrui soit jet de force dans un monde
tolrant. C'est l ui ter par principe ces l i bres possibilits de rsistance
courageuse, de persvrance, d'affirmation de soi qu' il et eu
449
l'occasion de dvelopper dans un monde d'intolrance. C'est ce qui
est plus mani feste encore, si l'on considre le problme de l'duca
tion : une ducation svre traite l ' enfant en instrument, puisqu'elle
tente de le plier par l a force des valeurs qu'il n'a pas admises ; mais
une ducation librale, pour user d'autres procds, n'en fait pas
moins choix a priori des principes et des valeurs au nom desquels
l'enfant sera trai t. Traiter l ' enfant par persuasion et douceur, ce n'en
est pas moins le contraindre. Ainsi , l e respect de l a libert d'autrui est
un vain mot : si mme nous pouvions projeter de respecter cette
libert , chaque attitude que nous prendrions vis--vis de l'autre serait
un viol de cette libert que nous prtendions respecter. L'attitude
extrme qui se donnerait comme totale indiffrence en face de l'autre
n'est pas non pl us une solution : nous sommes dj jets dans le
monde en face de l'autre, notre surgissement est libre limitation de sa
libert et rien, pas mme le suicide, ne peut modifier cette situation
origi nell e ; quel s que soient nos actes, en effet , c'est dans un monde
o i l y a dj l 'autre et o je suis de trp par rapport l'autre, que
nous les accomplissons.
C'est de cette situation singulire que semble tirer son origine la
notion de culpabilit et de pch. C'est en face de l ' autre que je suis
coupable. Coupable d'abord lorsque, sous son regard, j 'prouve mon
al inati on et ma nudit comme une dchance que je dois assumer ;
c'est le sens du fameux : Il s connurent qu' il s taient de
l'Ecriture. Coupable en outre, lorsque, mon tour, j e regarde autrui,
parce que, du fait mme de mon affirmation de moi-mme, je le
constitue comme objet et comme instrument, et j e fais venir lui
cette al i nation qu'il devra assumer. Ainsi, l e pch originel , c'est
mon surgissement dans un monde o i l y a l'autre et, quelles que
soient mes relations ultrieures avec l'autre, elles ne seront que des
variations sur le thme origi nel de ma culpabilit .
Mais cette culpabilit s'accompagne d'impuissance, sans que cette
impuissance russisse me laver de ma culpabili t . Quoi que j e fasse
pour la libert de l ' autre, nous l'avons vu, mes efforts se rduisent
traiter l'autre comme instrument et poser sa libert comme
transcendance-transcende : mais, d'autre part, quel que soit le
pouvoir de contrainte dont j e dispose, je n'atteindrai jamai s autrui
que dans son tre-obj et. Je ne pourrai jamais fournir sa libert que
des occasions de se manifester, sans jamais russir l 'accrotre ou la
diminuer, la diriger ou m'en emparer. Ainsi suis-je coupable
envers autrui dans mon tre mme , parce que le surgissement de mon
tre le dote malgr l ui d'une nouvelle dimension d'tre, et impuissant
d'autre part profiter de ma faute ou la rparer.
Un pour-soi qui, en s'historialisant, a fait l 'exprience de ces
diffrents avatars, peut se dterminer, en pleine connaissance de la
vanit de ses efforts antrieurs, poursuivre la mort de l'autre. Cette
450
libre dtermination se nomme la haine. Elle implique une rsignation
fondamentale : l e pour-soi abandonne sa prtention de raliser une
uni on avec l'autre ; i l renonce util iser l ' autre comme instrument
pour rcuprer son tre-en-soi. Il veut simplement retrouver une
libert sans limites de fait ; c'est--dire se dbarrasser de son
insaisissable tre-objet-pour-l'autre et abolir sa dimension d'alina
tion. Cela quivaut projeter de raliser un monde o l ' autre n'existe
pas. Le pour-soi qui hait accepte de n'tre plus que pour-soi ; instruit
par ses diverses expriences de l'impossibilit o il est d'utiliser son
tre-pour-autrui, i l prfre encore n'tre qu'une nantisation libre de
son tre, une totalit dtotalise, une poursuite qui s'assigne ses
propres fins. Celui qui hait projette de ne plus du tout tre objet ; et la
haine se prsente comme une position absolue de la libert du pour
soi en face de l'autre. C'est pourquoi, en premier lieu, la haine
n'abaisse pas l'objet ha. Car elle pose l e dbat sur son vritable
terrain : ce que j e hais en l'autre, ce n'est pas tel l e physionomie, tel
travers, telle action particulire. C'est son existence en gnral,
comme transcendance-transcende. C'est pourquoi la haine implique
une reconnaissance de l a libert de l'autre. Seulement, cette recon
naissance est abstraite et ngative : la haine ne connat que l'autre
objet et s'attache cet objet. C'est cet objet qu' el l e veut dtruire,
pour supprimer du mme coup la transcendance qui le hante. Cette
transcendance n'est que pressentie, comme au-del inaccessible,
comme perptuelle possibilit d'alination du pour-soi qui hait. Elle
n'est donc jamais saisie pour elle-mme : elle ne pourrait l'tre
d'ailleurs sans devenir objet, mais je l'prouve comme un caractre
perptuell ement fuyant de l'objet-autrui, comme un aspect non
donn non-fait de ses qualits empiriques les plus accessibles,
comme une sorte de monition perptuelle qui m'avertit que la
question n'est pas l C'est pourquoi l'on hait Ira vers l e psychique
rvl, non ce psychique lui-mme ; c'est pourquoi aussi il est
indiffrent de har la transcendance de l'autre travers ce que nous
nommons empiriquement ses vices ou ses vertus. Ce que je hais, c'est
l a totalit-psychique tout entire en tant qu'el l e me renvoie la
transcendance de l'autre : je ne m'abaisse pas har tel dtail objectif
particulier. C'est l ce qui distingue har et dtester. Et la haine ne
parat pas ncessairement l'occasion d'un mal que je viens de subir.
Elle peut natre, au contraire, l o on serait en droit d'attendre de l a
reconnaissance, c'est--dire l'occasion d' un bienfait : l 'occasion qui
sollicite l a haine, c'est simplement l'acte d'autrui par quoi j' ai t mis
en tat de subir sa libert. Cet acte en lui-mme est humiliant : i l est
humiliant en tant que rvlation concrte de mon objectit instru
mentale en face de l a libert d'autrui. Cette rvlation s'obscurcit
aussitt, s' enfonce dans le pass et devient opaque. Mais, prcis
ment, el l e me laisse le sentiment qu' il y quelque chose dtruire
451
pour me librer. C'est pour cela, d'ailleurs, que la reconnaissance est
si proche de l a haine : tre reconnaissant d' un bienfai t, c'est
reconnatre que l ' autre tait entirement libre en agissant comme il l'a
fait . Aucune contrainte, ft-ce celle du devoir, ne l'y a dtermin. Il
est l'ent i er responsable de son acte et des valeurs yui ont prsid son
accomplissement. Moi, je n'ai t yue le prtexte, la matire sur quoi
son acte s'est exerc. A partir de cette reconnaissance, l e pour-soi
peut projeter l 'amour ou la haine son choix : i l ne peut plus ignorer
l'autre.
La deuxime consquence de ces remarques, c'est que la haine est
hai ne de tous les autres en un seul . Ce que je veux atteindre
symbol i quement en poursuivant la mort de tel autre, c'est le principe
gnral de l'existence d'autrui. L'autre que je hais reprsente en fait
les autres. Et mon projet de le supprimer est projet de supprimer
autrui en gnral, c'est--dire de reconqurir ma libert non-substan
tiel l e de pour-soi. Dans la haine, une comprhension est donne de ce
que ma dimension d'tre-alin est un asservissement rel qui me
vient par les autres. C'est l a suppression de cet asservissement qui est
projete. C'est pourquoi la haine est un sentiment noir, c'est--dire
un sentiment qui vise la suppression d'un autre et qui, en tant que
projet, se projette consciemment contre la dsapprobation des autres.
La haine que l'autre porte un autre, je la dsapprouve, el l e
m' i nquite et j e cherche l a supprimer parce que, bi en que j e ne sois
pas explicitement vis par el l e, je sais qu'elle me concerne et qu'elle
se ralise contre moi. Et elle vise, en effet, me dtruire non en tant
qu' ell e chercherait me supprimer, mais en tant qu'elle rclame
principalement ma dsapprobation pour pouvoir passer outre. La
haine rclame d'tre hae, dans la mesure o har l a haine quivaut
une reconnaissance inquite de la libert du hassant.
Mais la hai ne, son tour, est un chec. Son projet initial, en effet,
est de supprimer l es autres consciences. Mais si mme el l e y
parvenait, c'est--dire si el l e pouvait abolir l'autre dans le moment
prsent, elle ne pourrait faire que l'autre n'ait pas t. Mieux encore,
l'abolition de l ' autre, pour tre vcue comme l e triomphe de l a haine,
i mplique l a reconnaissance explicite qu'autrui a exist. Ds lors, mon
tre-pour-autrui, en glissant au pass, devient une dimension irrm
diable de moi-mme. I l est ce que j'ai tre comme l'ayant-t. Je ne
saurais donc m' en dlivrer. Au moins, dira-t-on, j'y chappe pour le
prsent, j'y chapperai dans l e futur : mais non. Cel ui qui, une fois, a
t pour autrui est contamin dans son tre pour le restant de ses
j ours, autrui ft-il entirement supprim : il ne cessera de saisir sa
dimension d'tre-pour-autrui comme une possibilit permanente de
son tre. Il ne saurait reconqurir ce qu'il a alin ; il a mme perdu
tout espoir d'agir sur cette alination et de l a tourner son profit
puisque l 'autre dtruit a emport la cl de cette al ination dans la
452
tombe. Ce que j 'tais pour l'autre est fig par la mort de l'autre et je
le serai irrmdiablement au pass ; je le serai aussi, et de la mme
manire, au prsent si je persvre dans l'attitude, les projets et le
mode de vi e qui ont t jugs par l'autre. La mort de l'autre me
constitue comme objet irrmdi abl e, exactement comme ma propre
mort. Ainsi, le triomphe de la haine se transforme, dans son
surgissement mme, en chec. La haine ne permet pas de sortir du
cercle. Elle reprsente simplement l'ultime tentative, la tentative du
dsespoir. Aprs l'chec de cette tentative, i l ne reste plus au pour-soi
qu' rentrer dans le cercle et se laisser indfiniment ballotter de
l' une l'autre des deux attitudes fondamentales 1.
I I I
L' TRE AVEC " ( MI TSEI N) ET LE NOUS "
On voudra sans doute nous faire observer que notre description est
i ncomplte, puisqu'elle ne laisse pas place certaines expriences
concrtes o nous nous dcouvrons, non pas en confit avec autrui,
mais en communaut avec lui. Et i l est vrai que nous disons
frquemment nous . L'existence mme et l'usage de cette forme
grammaticale renvoient ncessairement une exprience relle du
Mi/sein. Nous peut tre sujet et , sous cette forme, il est assimilable
un pluriel du je . Et, certes, le paralllisme de la grammaire et de
l a pense est, en bien des cas, plus que douteux ; peut-tre mme
faudrait-il rviser entirement la question et tudier le rapport du
langage la pense sous une forme entirement neuve. Il n' en est pas
moi ns vrai que l e nous sujet ne parat pas concevable s'il ne se
rfre au moi ns la pense d'une pluralit de sujets qui se saisiraient
simultanment et l'un par j'autre comme subjectivits, c'est--dire
comme transcendances-transcendantes et non comme transcendances
transcendes. Si l e mot nous ne doit pas tre un simplefatus vocis,
il dnote un concept subsumant une infinie varit d'expriences
possibles. Et ces expriences paraissent a priori en contradiction avec
l'preuve de mon tre-objet pour autrui ou avec l'exprience de l'tre
objet d'autrui pour moi. Dans le nous sujet, personne n'est objet.
Le nous enveloppe une pluralit de subjectivits qui se reconnaissent
les unes les autres comme subjectivits, Toutefois, cette reconnais-
1. Ces considrations n'excluent pas l a possibilit d'une morale de la
dlivrance et du salut. Mais celle ci doit tre atteinte au terme d'une conversion
radicale dont nous ne pouvons parler ici.
453
sance ne fait pas l ' objet d'une thse explicite : ce qui est pos
explicitement, c'est une action commune ou l'objet d'une perception
commune. Nous rsistons, nous montons l'assaut, nous
condamnons l e coupabl e, nous regardons tel ou tel spectacl e.
Ai nsi, l a reconnaissance des subjectivits est anal ogue cel l e de la
conscience non-thti que par elle-mme : mieux, elle doit tre opre
latralement par une conscience non-thtique dont l'objet thtique est
tel ou tel spectacle du monde. La meil l eure exemplification du nou
peut nous tre fournie par le spectateur d' une reprsentation thtrale,
dont l a conscience s'puise saisir l e spectacle imaginaire, prvoir les
vnements par des schmes anticipateurs, poser des tres imagi
naires comme le hros, le tratre, la captive, etc. , et qui pourtant, dans
J e surgissement mme qui l e fait conscience du spectacle, se constitue
non-thti quement comme conscience (d') tre co-spectateur du specta
cle. Chacun connat, en effet, cette gne inavoue qui nous treint dans
une salle demi vide ou, au contraire, cet enthousiasme qui se
dchane et se renforce dans une salle pleine et enthousiaste. Il est
certain, par ai l l eurs, que l ' exprience du nous-suj et peut se manifester
en n' i mporte quel l e circonstance. Je suis l a terrasse d'un caf :
j 'observe les autres consommateurs et je me sais observ. Nous
demeurons ici dans l e cas l e plus banal du conflit avec autrui (l'tre
obj et de l'autre pour moi , mon tre-objet pour l'autre). Mais voici que,
tout coup, un incident quelconque des rues vi ent se produire : une
collision lgre, par exempl e, entre un triporteur et un taxi . Aussitt,
dans l ' i nstant mme o j e deviens spectateur de J'incident, je
m'prouve non- thtiquement comme engag dans un nous. Les
rivalits, les lgers conflits antrieurs ont disparu et les consciences qui
fournissent l a matire du nous sont prcisment celles de tous les
consommateurs : nous regardons l'vnement, nous prenons parti .
C'est cet unanimisme qu' un Romains a voulu dcrire dans La Vie
unanime ou dans Le Vin blanc de La Villelle. Nous voil revenu au
Mitsein de Heidegger. Etai t-ce donc l a peine de l e critiquer plus haut l ?
Nous ferons seul ement remarquer ici que nous n'avons pas song
mettre en doute l' exprience du nous. Nous nous sommes born
montrer que cette exprience ne pouvait tre le fondement de notre
conscience d' autrui. Il est clair, en effet, qu'elle ne saurait constituer
une structure ontologique de l a ralit-humaine : nous avons prouv
que l'existence du pour-soi au milieu des autres tait l'origine un fait
mtaphysi que et contingent. En outre, il est clair que le nous n'est pas
une conscience intersubjective, ni un tre neuf qui dpasse et englobe
ses parties comme un tout synthtique, la manire de la conscience
collective des soci ol ogues. Le nous est prouv par une conscience
particulire ; i l n'est pas ncessaire que tous les consommateurs de l a
1 . Troisime partie, chap. 1
454
terrasse soient conscients d'tre nous pour que je m'prouve comme
tant engag dans un nous avec eux. On connat ce schme banal de
dialogue : Nous sommes trs mcontents. Mais non, mon cher,
parlez pour vous. Cela i mpl ique qu'il y ai t des consciences
aberrantes du nous qui n'en soient pas moins, comme telles, des
consciences parfaitement normales. S'il en est ainsi , il est ncessaire,
pour qu'une conscience prenne conscience d'tre engage dans un
nous, que l es autres consciences qui entrent en communaut avec el l e
l ui aient t donnes d'abord de quelque autre manire ; c'est--dire
titre de transcendance-transcendante, ou de transcendance-transcen
de. Le nous est une certaine exprience particulire qui se produit ,
dans des cas spciaux, sur l e fondement de l'tre-pour-l'autre en
gnral. Ltrepour-lautre prcde et fonde l'tre-avec-l'autre.
En outre , le philosophe qui veut tudier l e nous doit prendre ses
prcautions et savoir de quoi il parle. Il n' y a pas seulement, en effet,
un nous-sujet : la grammaire nous apprend qu'il y a aussi un nous
complment, c' est--dire un nous-objet. Or, d'aprs tout ce qui a t
dit jusqu'ici, i l est facil e de comprendre que le nous de Nous l es
regardons ne saurait tre sur le mme pl an ontologique que le nous
de i l s nous regardent . Il ne saurait s'agir ici de subjectivits qua
subj ectivits. Dans la phrase : Ils me regardent , je veux indiquer
que je m'prouve comme obj et pour autrui, comme Moi alin,
comme transcendance-transcende. Si la phrase Ils nous regar
dent doit indiquer une exprience rel l e, il faut que dans cette
exprience j 'prouve que j e suis engag avec d'autres dans une
communaut de transcendances-transcendes de Moi alins. Le
nous i ci renvoie une exprience d'tres-objets en commun. Ainsi y a
t-il deux formes radicalement diffrentes de l'exprience du nous et
les deux formes correspondent exactement l ' tre-regardant et
l'tre-regard qui constituent les relations fondamentales du pour-soi
avec l'autre. Ce sont ces deux formes du nous qu'il convient d'tudier
prsent ,
A) Le nous -objet.
Nous commencerons par examiner la seconde de ces expriences :
il est pl us facil e en effet d' en saisir la signification et elle nous servira
peut-tre de voie d'accs pour l' tude de l'autre. Il faut remarquer
d'abord que le nous-objet nous prcipite dans le monde ; nous
l'prouvons par l a honte comme une alination communautaire, C'est
ce que marque cet pisode significatif o des galriens suffoquent de
colre et de honte parce qu'une belle femme pare vient visiter leur
navire, voit leurs hai llons, leur labeur et leur misre. Il s'agit bien ici
d'une honte commune et d'une alination commune. Comment donc
455
est-i l possible de s'prouver en communaut avec d'autres comme
obj ets ? Il faut, pour l e savoir, revenir aux caractres fondamentaux
de notre tre-pour-l'autre.
Nous avons jusqu'ici envisag l e cas simple o j e suis seul en face de
l' autre seul. En ce cas j e l e regarde ou i l me regarde, je cherche
transcender sa transcendance ou j 'prouve la mienne comme trans
cende et j e sens mes possibilits comme mortes-possibilits. Nous
formons un couple et nous sommes en situation l ' un par rapport
l ' autre. Mais cette situation n' a d'existence objective que pour l'un ou
pour l'autre. Il n' y a, en effet , pas d'envers de notre relation
rciproque. Seulement nous n'avons pas tenu compte, dans notre
description, du fait que ma relation avec l'autre parat sur le fond
infini de ma relation et de sa relation tous [es autres. C'est--dire la
quasi-totalit des consciences. De ce seul fait ma relation avec cet
autre, que j 'prouvais tout l'heure comme fondement de mon tre
pour-autrui, ou l a relation de l'autre avec moi peuvent chaque
instant, et selon les motifs qui interviennent , tre prouves comme
objets pour [es autres. C'est ce qui se manifestera clairement dans le
cas de l'apparition d'un tiers. Supposons, par exemple, que l'autre me
regarde. Dans cet instant , j e m'prouve comme entirement alin et
j e m'assume comme tel . Survient l e tiers. S' i l me regarde, j e Les
prouve communaut
a
ire ment comine ' Eux (eux-sujets) travers
mon alination. Cet eux tend, nous le savons, vers l'on. Il ne
change rien au fait que je suis regard, il ne renforce pas -ou peine
- mon alination originelle. Mais si l e tiers regarde l'autre qui me
regarde, l e problme est plus complexe. Je puis en effet saisir l e tiers
non directement mais sur l'autre qui devient autre-regard (par l e
ti ers). Ai nsi l a transcendance tierce transcende la transcendance qui
me transcende et , par l, contribue la dsarmer. II se constitue i ci un
tat mtastable qui se dcomposera bientt, soi t que j e m'allie au
tiers pour regarder l'autre qui se transforme alors en notre objet -et
ici j e fais une exprience du nous-sujet dont nous parlerons plus loi n
soit que j e regarde l e tiers et qu'ainsi j e transcende cette tierce
transcendance qui transcende l'autre. En ce cas le tiers devient objet
dans mon univers, ses possibilits sont mortes-possibilits, il ne saurait
me dlivrer de l ' autre. Pourtant il regarde l'autre qui me regarde. Il
s'ensuit une situation que nous nommerons indtermine et non
conclusive, puisque je sui s objet pour l'autre, qui est objet pour le
tiers, qui est obj et pour moi. La libert seul e, en appuyant sur l ' un ou
l'autre de ces rapports, peut donner une structure cette situation.
Mais i l se peut aussi que l e tiers regarde l ' autre que je regarde. En
ce cas, j e pui s les regarder tous deux et, ai nsi , dsarmer l e regard du
tiers. Le tiers et l'autre m'apparatront alors comme Eux-objets. Je
puis aussi saisir sur l'autre le regard du tiers, dans la mesure o, sans
voir l e tiers, j e saisis sur les conduites de l'autre qu'il se sait regard.
456
Dans ce cas j'prouve sur l'autre et propos de l'autre la transcen
dance-transcendante du tiers. Je l'prouve comme une alination
radicale et absolue de l'autre. Il s'enfuit de mon monde ; i l ne
m'appartient plus, i l est objet pour une autre transcendance. Il ne
perd donc pas son caractre d'objet mais i l devient ambigu ; i l
m'chappe non par sa transcendance propre mai s par l a transcen
dance du tiers. Quoi que je puisse saisir sur lui et de lui, prsent, i l
est toujours autre ; autant de fois autre qu' i l y a d'autres pour l e
percevoir et le penser. Pour me r-approprier l'autre, il faut que je
regarde le tiers et que j e l ui confre l'objectit. Cela n'est pas
toujours possibl e, d' une part, et, d'autre part, le tiers lui-mme peut
tre regard par d'autres tiers, c'est--dire tre indfiniment autre
que j e ne l e vois. Il en rsulte une inconsistance originelle de l ' autre
objet et une course l ' infini du pour-soi qui cherche se r
approprier cette objectit. C'est l a raison, nous l'avons vu, qui fait
que les amants s'isolent. Je peux m'prouver comme regard par l e
tiers pendant que j e regarde l'autre. En ce cas j'prouve mon
alination non-positionnellement dans le temps mme o je pose
l'alination de l' autre. Mes possibilits d'utiliser l'autre comme
instrument, je l es prouve comme mortes-possibilits et ma transcen
dance qui s'apprte transcender l'autre vers mes fins propres
retombe en transcendance-transcende. Je lche prise. L'autre n'en
devient pas pour cela sujet, mai s j e ne me sens plus qualifi pour
l'objectit. Il devient un neutre ; quel que chose qui est purement et
simplement l et dont je ne fais rien. Ce sera l e cas par exemple, si
l'on me surprend en train de battre et d'humilier un faible. L'appari
tion du tiers me dcroche ; l e faible n'est plus ni battre
humilier i l n'est plus rien qu'existence pure, plus rien, mme pl us
un faibl e ou, s'il l e redevient, ce sera par l e truchement du tiers,
j'apprendrai du tiers que c'tait un faible Tu n' as pas honte, tu
t'acharnes sur un faible, etc. ), l a qualit de faible lui sera confre
mes yeux par le tiers ; el l e ne fera plus partie de mon monde mais d'un
univers o je suis avec l e faibl e pour l e tiers.
Ceci nous amne enfi n au cas qui nous occupe : j e suis engag dans
un conflit avec l'autre. Le tiers survient et nous embrasse l ' un et
l'autre de son regard. J'prouve corrlativement mon alination et
mon objectit. Je suis dehors, pour autrui , comme objet au milieu
d'un monde qui n'est pas le mien . Mais l'autre, que je regardais
ou qui me regardait, subit la mme modification et je dcouvre cette
modification de l'autre en simul tanit avec celle que j 'prouve.
L'autre est objet au mi l i eu du monde du tiers. Cette objectit n'est
d'ailleurs pas une simple modification de son tre qui serait parallle
celle que je subis mais les deux objectits viennent moi et l'autre
dans une modification globale de l a situation o j e suis et o l'autre se
trouve. Il y avait, avant le regard du tiers, une situation circonscrite
457
par l es possibilits de l'autre et o j'tais titre d'instrument et une
situation i nverse circonscrite par mes propres possibilits et qui
comprenait l'autre. Chacune de ces situations tait la mort de l'autre
et nous ne pouvions saisir l'une qu'en objectivant l'autre. A l'appari
tion du ti ers j'prouve, d'un mme coup, que mes possibilits sont
alines et , du mme coup, je dcouvre que les possibilits de l'autre
sont mortes-possibilits. La situation ne disparat pas pour autant,
mais elle fuit hors de mon monde et du monde de l'autre, elle se
constitue au milieu d' un tiers monde en forme objective : en ce tiers
monde el l e est vue, juge, transcende, utilise mais du coup il se fait
un nivell ement des deux situations inverses, il n 'y a plus de structure
de priorit qui aille de moi l'autre ou, inversement, de l'autre moi ,
puisque nos possibilits sont pareillement pour le tiers mortes
possibilits. Cela signifie que j 'prouve soudain l'existence, dans l e
monde du tiers , d' une situation-forme objective o, l'autre et moi,
nous figurons titre de structures quivalentes et solidaires. Le conflit
ne surgit pas, dans cette situation objective, du libre surgissement de
nos transcendances mais il est constat et transcend par l e tiers
comme un donn de fait qui nous dfinit et nous retient lun avec
l'autre. La possibilit que l'autre a de me frapper et celle que j'ai de
me dfendre, loin d'tre exclusives l'une de l'autre, se compltent et
s'entranent, s'impliquent l'une l'autre pour le tiers titre de mortes
possibilits et c'est prcisment ce que j 'prouve titre non-thtique
et sans en avoir de connaissance. Ainsi ce que j' prouve c'est un tre
dehors o je suis organis avec l'autre en un tout indissoluble et
objectif, un tout o je ne me distingue plus originellement de l'autre
mais que je concours, solidairement avec l'autre, constituer. Et dans
la mesure o j 'assume par principe mon tre-dehors pour le tiers, je
dois assumer pareillement l'tre-dehors de l'autre ; ce que j'assume,
c'est la communaut d'quivalence par quoi j' existe engag dans une
forme que j e concours comme l'autre constituer. En un mot, je
m'assume comme engag dehors en l'autre et j'assume l'autre comme
engag dehors en moi. Et c'est cette assomption fondamentale de cet
engagement que je porte devant moi sans l e saisir, c'est cette
reconnaissance libre de ma responsabilit en tant qu'elle inclut la
responsabilit de l'autre qui est l'preuve du nous-objet. Ainsi le
nous-objet n'est jamais connu, au sens o une rflexion nous livre la
connaissance de notre Moi par exempl e ; il n'est jamais senti, au sens
o un sentiment nous rvle un obj et concret tel que l'antipathique, l e
hassabl e, l e troublant, etc. Il n'est pas non plus simplement prouv,
car ce qui est prouv c'est la pure situation de solidarit avec l'autre.
Le nous-objet ne se dcouvre que par l'assomption que je fais de cette
situation, c'est--dire par l a ncessit o j e suis, au sein de ma libert
assumante, d'assumer aussi l'autre, cause de la rciprocit interne
de l a situation. Ainsi puis-je dire Je me bats contre l'autre , en
458
l'absence du tiers. Mais ds qu' i l parat , lcs possibilits de l'autre et
les miennes propres s'tant niveles en mortes-possibilits, le rapport
devient rciproque et je suis contraint d'prouver que nous nous
battons En effet la formule : Je le bats et il me bat serait
nettement insuffisante : en fait je le bats parce qu'il me bat et
rciproquement ; le projet du combat a germ dans son esprit comme
dans le mien et , pour le tiers, il s'unifie en un seul projet, commun
cet eux-objet qu' i l embrasse par son regard et qui constitue mme la
synthse unificatrice de cet eux . C'est donc en tant qu'apprhend
par le tiers comme partie intgrante du eux que je dois m'assu
mer. Et ce eux par une subjectivit comme son sens-pour
autrui devient le nous. La conscience rflexive ne saurait saisir ce
nous. Son apparition concide au contraire avec l'effondrement du
nous ; le pour-soi se dgage et pose son ipsit contre les autres. Il faut
concevoir en effet qu'originellement l'appartenance au nous-objet est
sentie comme une alination plus radicale encore du pour-soi puisque
celui-ci n'est plus seulement contraint d'assumer ce qu'il est pour
autrui mais encore une totalit qu'il n'est pas, quoiqu'il en fasse partie
intgrante. En ce sens le nous est brusque preuve de la condition
humaine comme engage parmi les autres en tant qu'elle est un fait
objectivement constat. Le nous-objet bi en qu'prouv l'occasion
d'une solidarit concrte et centr sur cette solidarit (je serai
honteux trs prcisment parce que nous avons t surpris en train de
nous battre) a une signification qui dpasse l a circonstance particu
lire o i l est prouv et qui vise englober mon appartenance
comme objet l a totalit humaine (moins la conscience pure du tiers)
saisie galement comme objet. Il correspond donc une exprience
d'humiliation et d'impuissance : celui qui s'prouve comme consti
tuant un nous avec les autres hommes se sent englu parmi une
infinit d'existences trangres, i l est ali n radicalement et sans
recours.
Certaines situations paraissent plus propres que d'autres susciter
l'preuve du nous. En particulier, le travail en commun : lorsque
plusieurs personnes s'prouvent comme apprhendes par le tiers
pendant qu'elles uvrent solidairement un mme objet, le sens mme
de l'objet manufactur renvoie la collectivit uvrante comme un
nous. Le geste que j e fais e t qui est appel par l e montage raliser
n'a de sens que s'il est prcd par tel geste de mon voisin et suivi par
tel autre de tel autre travailleur. Il s'ensuit une forme de nous plus
facilement accessible puisque c'est l'exigence de l'objet lui-mme et
ses potentialits comme son coefficient d'adversit qui renvoient au
nous-objet des travailleurs. Nous nous prouvons donc comme
apprhends ti tre de nous travers un objet crer . La
matrialit met son sceau sur notre communaut solidaire et nous
nous apparaissons comme une disposition instrumentale et technique
459
de moyens dont chacun a sa place assigne par une fin. Mais si
quelques situations paraissent ainsi empiriquement plus favorables au
surgissement du nous, i l ne faut pas perdre de vue que taUle situation
h umaine , tant engagement au milieu des autres, est prouve
comme nous ds que le tiers apparat. Si j e marche dans l a rue,
derrire cet homme que j e ne vois que de dos, j' ai avec l ui le
mi ni mum de relations techni ques et pratiques que l'on puisse
concevoir . Pourtant, i l suffit qu'un tiers me regarde, regarde la
chausse, le regarde pour que j e sois li l ui par l a solidarit du
nous : nous arpentons l'un derrire l'autre l a rue BIomet, par un
matin de j uil l et. Il y a toujours un poi nt de vue duquel des pour-soi
divers peuvent tre unis par un regard dans l e nous. Rciproquement,
de mme que l e regard n'est que la manifestation concrte du fait
originel de mon existence pour l' autre , de mme donc que je
m' prouve existant pour l'autre en dehors de toute apparition
si ngulire d'un regard, de mme i l n'est pas ncessaire qu'un regard
concret nous fige et nous transperce pour que nous puissions nous
prouver comme intgrs dehors un nous. Il suffit que la total it
dtotalise humanit existe pour qu'une pluralit quelconque
d' individus s'prouve comme nous par rapport tout ou partie du
reste des hommes, que ces hommes soient prsents en chair et en
os , ou qu'ils soient rels mais absents. Ainsi puis-je toujours me
saisir, en prsence ou en l'absence de tiers, comme pure ipsit ou
comme intgr un nous. Ceci nous amne quelques nous
spciaux, en particulier celui qu'on conscience de classe
La conscience d e classe est, videmment, l'assomption d'un nous
particulier, l'occasion d'une situation collective plus nettement
structure qu' l'ordinaire. Il nous importe peu de dfinir ici cette
situation ; ce qui nous intressera seulement, c'est l a nature du nous
de l'assomption. Si une socit, de par sa structure conomique ou
pol i ti que, se divise en classes opprimes et en classes opprimantes, la
situation des cl asses opprimantes offre aux classes opprimes l ' i mage
d'un tiers perptuel qui les considre et les transcende par sa l i bert.
Ce n'est aucunement l a duret du travail, la bassesse du niveau de vie
ou l es souffrances endures qui constitueront l a collectivit opprime
en classe ; la solidarit du travai l , en effet, pourrait -nous l e verrons
dans le paragraphe suivant -constituer en nous-sujet la collecti
vit l aborieuse, en tant que cell e-ci - quel que soit d'ailleurs le
coefficient d'adversit des choses - s'prouve comme transcendant
les objets i ntra-mondains vers ses fins propres ; l e niveau de vie est
chose toute relative et qui sera diffremment apprcie selon les
circonstances (il pourra tre subi ou accept ou revendiqu au nom
d'un idal commun) ; les souffrances endures, si on les considre en
elles-mmes, ont plutt pour effet d'isoler les personnes qui souffrent
que de les runir, elles sont, en gnral, sources de conflit. Enfin, la
460
comparaison pure et simple que les membres de la collectivit
opprime peuvent faire entre la duret de leur condition et les
privilges dont jouissent les classes opprimant es ne saurait, en aucun
cas, suffire consti tuer une conscience de classe ; tout au plus
provoquera-t-el le des jalousies individuelles ou des dsespoirs parti
culiers ; elle n'a pas la possi bilit d' unifier et de faire assumer par
chacun l ' uni fication. Mais l'ensemble de ces caractres, en tant qu'il
constitue la condition de la classe opprime, n'est pas simplement subi
ou accept. II serait galement erron, pourtant, de dire que,
l'origine, il est saisi par la classe opprime comme impos par la classe
opprimante ; il faut longtemps, au contraire, pour construire et pour
rpandre une thorie de l'oppressi on. Et cette thorie n'aura qu'une
valeur explicatil'e. Le fait premier, c'est que le membre de la
collectivit opprime qui, en tant que simple personne, est engag
dans des conf1its fondamentaux avec d'autres membres de cette
collectivit (amour, haine, rivalit d' i ntrts, etc. ) saisit sa condition
et celle des autres membres de cette collectivit comme regarde et
pense par des consciences qui l ui chappent . Le matre , l e
seigneur fodal , l e bourgeois ou l e capitaliste apparais
sent, non seulement comme des puissants qui commandent, mais,
encore et avant tout, comme les tiers, c'est--dire ceux qui sont en
dehors de la communaut opprime et pour qui cette communaut
existe. C'est donc pour eux et dans leur libert que la ralit de la
classe opprime va exister. Il s l a font natre par leur regard. C'est
eux et par eux que se dcouvre l'identit de ma condition et de celle
des autres opprims ; c'est pour eux que j 'existe en situation organise
avec d'autres et que mes possibles comme mortes-possibilits sont
rigoureusement quivalents aux possibles des autres ; c'est pour eux
que je suis un ouvrier et c'est par et dans leur rvlation comme
autrui-regard que je m'prouve comme un parmi d'autres. Cela
signifie que je dcouvre le nou o je suis i ntgr ou la classe
dehors, dans le regard du tiers et c'est cette alination collective que
j'assume en disant nous . De ce point de vue, les privilges du tiers
et nos charges, nos misres n'ont d'abord qu'une valeur de
signification ; il s signi fi ent l'indpendance du tiers par rapport nous ;
ils nous prsentent pl us nettement notre alination ; comme ils n'en
sont pas moins endurs, comme, en particulier, notre labeur, notre
fatigue n'en sont pas moins soufferts, c'est travers cette souffrance
subie que j 'prouve mon tre-regard-comme-chose-engage-dans
une-totalit-des-choses. C'est partir de ma souffrance, de ma misre
que je suis collectivement saisi avec les autres par l e tiers, c'est--dire
partir de l'adversit du monde, partir de la facticit de ma
condition. Sans le tiers, quelle que soit l'adversit du monde, j e me
saisirais comme transcendance triomphante ; avec l'apparition du
tiers, je nous prouve comme saisis partir des choses et comme
461
choses vai ncues par le monde. Ainsi , la classe opprime trouve son
unit de cl asse dans la connaissance que la classe opprimante prend
d'elle et l ' apparition chez l'opprim de l a conscience de classe
correspond l'assomption dans la honte d'un nous-obj et. Nous
verrons, dans l e paragraphe suivant, ce que peut tre l a conscience
de classe pour un membre de la classe opprimante. Ce qui nous
importe ici , en tout cas et ce que montre assez J'exemple que nous
venons de choisir, c'est que J'preuve du nous-objet suppose celle de
J'tre-pour-autrui dont el l e n'est qu'une modalit plus complexe. Elle
rentre donc, titre de cas particulier, dans l e cadre de nos
descriptions prcdentes. El l e renferme d' ailleurs en elle-mme une
puissance de dsagrgation, puisqu'elle s'prouve par l a honte et que
l e nous s'effondre ds que l e pour-soi revendique son ipsit en face
du tiers et le regarde son tour. Cette revendication individuelle de
l'ipsit n' est d'ailleurs qu'une des faons possibles de supprimer l e
nous-objet. L'assomption du flOU, dans certains cas fortement
structurs, tel s, par exempl e, que l a conscience de classe, implique l e
projet non plus de se dlivrer du nous par une reprise individuelle
d'ipsit, mais de dlivrer l e nous tout entier par l'objectit en l e
transformant en nous-sujet. I l s'agit, au fond, d' une varit du projet
dj dcrit de transformer le regardant en regard ; c'est l e passage
ordinaire d' une des deux grandes attitudes fondamentales du pour
autrui J' autre. La classe opprime ne peut, en effet, s'affirmer
comme nous-sujet que par rapport la classe opprimante et aux
dpens de celle-ci, c'est--dire en [a transformant en eux-objets
son tour. Si mplement la personne, engage objectivement dans l a
classe, vise entraner la classe tout entire dans et par son projet de
retournement. En ce sens, J'preuve du nous-objet renvoie celle du
nous-sujet, comme l ' preuve de mon tre-ob jet-po ur-l'autre me
renvoie l 'exprience de l 'tre-objet-d'autrui-pour-moi . Pareille
ment, nous trouverons dans ce qu'on nomme la psychologie des
foules des engouements collectifs (boulangisme, etc. ) qui sont une
forme particulire d'amour : la personne qui dit nous reprend
alors, au sein de la foul e, l e projet originel d'amour, mais ce n'est plus
son propre compte ; elle demande au tiers de sauver la collectivit
entire dans son objectit mme, en y sacrifiant sa libert. Ici comme
plus haut, l 'amour du conduit au masochisme. C'est ce qu'on voit
dans le cas o l a collectivit se rue dans la servitude et exige d'tre
traite en objet. Il s'agit, l encore, des multiples projets i ndividuels
des hommes dans la foule : la foule a t constitue comme foule par
l e regard du chef ou de l'orateur ; son unit est une unit-objet que
chacun de ses membres lit dans l e regard du tiers qui l a domine, et
chacun fait alors l e projet de se perdre dans cette objectit, de
renoncer entirement son ipsit afin de n'tre plus qu'un instru
ment aux mains du chef. Mais cet instrument o il veut se fondre, ce
462
n'est plus son pur et simple pour-autrui personnel, c'est la totalit
objective-foul e. La matrialit monstrueuse de la foule et sa ralit
profonde (bien que seulement prouves) sont fascinantes pour
chacun de ses membres ; chacun exige d'tre noy dans la foule
instrument par l e regard du chef 1 .
En ces di ffrents cas, nous avons toujours vu l e nous-objet se
constituer partir d'une situation concrte o se trouvait pl onge une
partie de l a totalit -dtotalise humanit l'exclusion de l 'autre.
Nous ne sommes nous qu'aux yeux des autres, et c'est partir du
regard des autres que nous nous assumons comme nous. Mais ceci
implique qu' i l puisse exister un projet abstrait et irralisable du pour
soi vers une totalisation ahsolue de lui-mme et de tous les autres. Cet
effort de rcupration de la totalit humaine ne peut avoir lieu sans
poser l'existence d' un tiers, distinct par principe de l'humanit et aux
yeux de qui eUe est tout entire objet . Ce tiers, irralisable, est
simplement l'objet du concept-limite d'altrit. C'est ce qui est tiers
par rapport tous les groupements possibles, ce qui, en aucun cas, ne
peut entrer en communaut avec un groupement humain quelconque,
l e tiers par rapport auquel aucun autre ne peut se constituer comme
tiers ; ce concept ne fait qu'un avec celui de l'tre-regardant qui ne
peut jamais tre regard, c'est--dire avec l'ide de Dieu. Mais Dieu
se caractrisant comme absence radicale, l'effort pour raliser l'hu
manit comme ntre est sans cesse renouvel et aboutit sans cesse
un chec. Ainsi le nous humaniste -en tant que nous-objet -se
propose-t-il chaque conscience individuelle comme un idal impos
sible atteindre, encore que chacun garde l'illusion de pouvoir y
parvenir en largissant progressivement le cercle des communauts
auxqueUes il appartient ; ce nous humaniste demeure un concept
vide, une pure indication d' une extension possible de l'usage ordi
naire du nous. Chaque fois que nous uti lisons le nous en ce sens (pour
dsigner l ' humanit souffrante, l'humanit pcheresse, pour dtermi
ner un sens objectif de l'Histoire, en considrant l'homme comme un
objet qui dveloppe ses potentialits) , nous nous bornons indiquer
une certaine preuve concrte subir en prsence du tiers absol u,
c'est--dire de Dieu. Ai nsi l e concept-limite d'humanit (comme l a
totalit du nous-objet) et le concept-limite de Dieu s'impliquent l ' un
J'autre et sont corrlatifs.
1. Cf. les nombreux cas de refus d'ipsit. Le pour soi refuse d'merger dans
l'angoisse hors du nous.
463
B) Le /lOus-sujet.
C'est le monde qui nous annonce notre appartenance une
communaut-sujet , en particulier J'existence dans le monde d'objets
manufacturs. Ces objets ont t uvrs par des hommes pour des
eux-sujets, c'est--dire pour une transcendance non individualise et
non dnombre qui concide avec le regard indi ffrenci que nous
appelions plus haut l e on , car le travai lleur - servile ou non -
travaille en prsence d' une transcendance i ndi ffrencie et absente,
dont il se borne esquisser en creux sur l'objet travaill les libres
possibi lits. En ce sens, le travailleur, quel qu'il soit, prouve dans le
travail son t re-i nstrument pour l'autre ; l e travail , quand i l n'est pas
strictement dest i n aux fins propres du travailleur, est un mode
d'alination. La transcendance alinante est ici l e consommateur,
c'est--dire l e on dont l e travai l l eur se borne prvoir les projets.
Lors donc que j ' emploie un objet manufactur, je rencontre sur lui
l'esquisse de ma propre transcendance ; i l m'indique le geste faire,
je dois tourner, pousser, tirer ou appuyer. Il s'agit d'ailleurs d' un
impratif hypothti que ; i l me renvoie une fi n qui est galement du
monde : si j e veux m'asseoir, si j e veux ouvrir la bote, et c. Et cette
fin, elle-mme, a t prvue, dans la constitution de l'obj et, comme
fi n pose par une transcendance quelconque. El le appartient
prsent l'objet comme sa potentialit la plus propre. Ainsi est-il vrai
que l'objet manufactur m' annonce comme on moi-mme,
c'est--dire me renvoie l' image de ma transcendance comme celle
d' une transcendance quel conque. Et si je laisse canaliser mes
possibilits par l 'ustensile ai nsi constitu, j e m'prouve moi -mme
comme transcendance quelconque : pour al l er de la station de mtro
Trocadro Svres-Babylone on change La Motte
Picquet Ce changement est prvu, indiqu sur les plans, etc. ; si j e
change de ligne La Motte-Picquet, j e suis l e on qui change.
Certes, je me diffrencie de chaque usager du mtro tant par le
surgissement i ndi vi duel de mon tre que par les fins lointaines que je
poursuis. Mais ces fins dernires sont seulement J'horizon de mon
acte. Mes fi ns prochai nes sont les fi ns du on , et je me saisis
comme i nterchangeable avec un quelconque de mes voisins. En ce
sens, nous perdons notre individualit relle, car l e projet que nous
sommes, c'est prcisment l e projet que sont les autres. En ce couloir
de mtropolitai n, i l n'y a qu'un seul et mme projet, inscrit depuis
longtemps dans l a matire, et o vient se couler une transcendance
vivante et indiffrencie. Dans la mesure o j e me ralise dans l a
solitude comme transcendance quelconque, j e n' ai que J'exprience
de l'tre-indiffrenci (si , seul dans ma chambre, j' ouvre une bote de
conserves avec l ' ouvre-bote convenable) ; mais si cette transcendance
464
indiffrencie projette ses projets quelconques en liaison avec d'au
tres transcendances prouves comme prsences relles et pareille
ment absorbes dans des projets quelconques identiques mes
projets, alors j e ralise mon proj et comme un entre mille projets
identiques projets par une mme transcendance indiffrencie, alors
j'ai l'exprience d'une transcendance commune et dirige vers un but
unique, dont j e ne suis qu'une particularisation phmre ; je
m'insre dans l e grand courant humain qui, i nlassablement et depuis
qu'il existe un mtro, ruisselle dans les couloirs de l a station La
Motte-Picquet-Grenelle . Mais i l faut noter : lO que cette exprience
est d'ordre psychologique et non ontologique. Elle ne correspond
nullement une unification relle des pour-soi considrs. Elle ne
vient pas non plus d'une preuve immdiate de leur transcendance en
tant que telle (comme dans l'tre-regard) mais elle est motive, bien
plutt, par l a double apprhension objectivante de l'objet transcend
en commun et des corps qui entourent le mi en. En particulier, l e fait
que je sois engag avec les autres dans un rythme commun que je
contribue faire natre est un moti f particulirement sollicitant pour
que j e me saisisse comme engag dans un nous-sujet. C'est le sens de
la marche cadence des soldats, c'est le sens aussi du travail rythm
des quipes. Il faut remarquer, en effet, que, dans ce cas, le rythme
mane librement de moi ; c'est un projet que je ralise par ma
transcendance ; i l synthtise un futur avec un prsent et un pass,
dans une perspective de rptition rgulire ; c'est moi qui produis ce
rythme ; mais en mme temps il se fond avec le rythme gnral de
travail ou de marche de la communaut concrte qui m'entoure ; i l ne
prend son sens que par elle ; c'est ce que j 'prouve, par exempl e,
lorsque l e rythme que j 'adopte est contre-temps . Pourtant
l'enveloppement de mon rythme par le rythme des autreS est
apprhend latralement ; je n'utilise pas comme instrument le
rythme collectif, j e ne le contemple pas non plus -au sens o je
contemplerais, par exempl e, des danseurs sur une scne -, i l
m'entoure et m' emporte sans tre objet pour moi ; j e ne le transcende
pas vers mes possibilits propres, mais je coule ma transcendance
dans sa transcendance et ma fin propre - excuter tel travail,
parvenir en tel lieu -est une fin du on qui ne se distingue pas de
la fin propre de l a collectivit. Ainsi le rythme que je fais natre nat
en liaison avec moi et latralement comme rythme collectif ; il est
mon rythme dans l a mesure o il est leur rythme et rciproquement.
C'est l prcisment l e motif de l'exprience de nous-sujet : il est
finalement notre rythme. Mais ceta ne peut tre, on te voit, que si ,
pralablement, par l'acceptation d' une fin commune et d' instruments
communs, j e me constitue comme transcendance indiffrencie en
rejetant mes fins personnelles au del des fins collectives prsente
ment poursuivies. Ainsi, au lieu que dans l'preuve de l'tre-pour-
465
autrui , le surgissement d'une dimension d'tre concrte et relle est l a
condition de l'preuve mme, l'exprience du nous-sujet est un pur
vnement psychologique et subjectif en une conscience singulire,
qui correspond une modification intime de la structure de cette
conscience mais qui n'apparat pas sur l e fondement d'une relation
ontologique concrte avec les autres et qui ne ralise aucun Mit
sein . I l s'agit seul ement d'une manire de me sentir au milieu des
autres. Et, sans doute, cette exprience pourra tre recherche
comme symbole d'une unit absolue et mtaphysique de toutes les
transcendances ; il sembl e, en effet, qu'elle supprime l e conflit
origi nel des transcendances en les faisant converger vers l e monde ; en
ce sens, l e nous-sujet idal serait l e nous d' une humanit qui se
rendrait matresse de l a terre. Mais l ' exprience du nou demeure sur
l e terrain de la psychologie individuelle et reste un simple symbole de
l'unit souhaitable des transcendances ; elle n'est null ement, en effet,
apprhensi on latrale et relle des subjectivits en tant que telles par
une subjectivit singulire ; les subjectivits demeurent hors d'at
teinte et radicalement spares. Mais ce sont les choses et les corps,
ce sont les canalisations matriel les de ma transcendance qui me
disposent l a saisir comme prolonge et appuye par les autres
transcendances, sans que je sorte de. moi .ni que les autres sortent
d'eux ; j' apprends que je fais partie d'un nous par l e monde. C'est
pourquoi mon exprience du nous-sujet n' implique nul lement une
exprience sembl abl e et corrlative chez les autres ; c'est pourquoi
aussi el l e est si instable car elle suppose des organisations particulires
au mil ieu du monde et disparat avec ces organisations. A vrai dire, il
y a, dans l e monde, une foule de formations qui m'indiquent comme
quelconque ; d'abord t ous l es ustensiles, depuis l es outi l s proprement
dits jusqu'aux immeubles, avec l eurs ascenseurs, leurs conduites
d'eau ou de gaz, leur lectricit, en passant par les moyens de
transport, les magasins, etc. Chaque devanture, chaque vitrine me
renvoie mon image comme transcendance indiffrencie. En outre,
l es rapports professionnel s et techniques des autres avec moi m'an
noncent encore comme quelconque : pour l e garon de caf, j e suis le
consommateur ; pour le poinonneur de tickets, j e suis l'usager du
mtro. Enfi n, l'incident des rues qui survient brusquement devant l a
terrasse du caf o j e sui s assis m' i ndi que encore comme spectateur
anonyme et comme pur regard qui fait exister cet i ncident comme un
dehors . C'est galement l'anonymat du spectateur qu'indique la
pice de thtre l aquel l e j'assiste ou l'exposition de tableaux que je
visite. Et, certes, je me fais quelconque lorsque j 'essaie des chaus
sures ou que je dbouche une bouteille ou que j' entre dans un
ascenseur ou que j e ris au thtre. Mais l'preuve de cette transcen
dance i ndi ffrencie est un vnement intime et contingent qui ne
concerne que moi. Certaines circonstances particulires qui viennent
466
du monde peuvent y ajouter l'i mpression d'tre nous. Mais il ne
saurait s'agir en tout cas que d'une impression purement subjecti ve et
qui n' engage que moi .
2 L'exprience du nous-sujet ne saurait tre premire, el l e ne peut
constituer une attitude origi nel l e envers les autres, puisqu' el l e
suppose, au contraire, pour se raliser, une double reconnaissance
pralable de l'existence d'autrui. Tout d'abord, en effet, l'objet
manufactur n'est tel que s'il renvoie des producteurs qui l'ont fait
et des rgles d'emploi qui ont t fixes par d'autres. En face d'une
chose inanime et non ouvre, dont je fixe moi-mme le mode
d'emploi et laquelle j'assigne moi-mme un usage neuf (si , par
exemple, j' utilise une pierre comme marteau), j 'ai conscience non
thtique de ma personne, c'est--dire de mon ipsit, de mes fins
propres et de ma l i bre inventivit. Les rgles d'usage, les modes
d'emploi des objets manufacturs, l a fois rigides et idaux comme
des tabous, me mettent par structure essentielle en prsence de
l'autre ; et c'est parce que l'autre me traite comme une transcendance
indiffrencie que je peux me raliser moi-mme comme tel. Je n'en
veux pour exemple que ces grands panneaux qui surmontent l es
portes d' une gare, d' une salle d'attente et o l ' on a crit les mots de
sortie ou d' entre , ou encore ces doigts i ndicateurs sur les
affiches, qui dsignent un i mmeuble ou une direction. 11 s'agit encore
d'impratifs hypothtiques. Mais ici la formulation de l'impratif
laisse clairement transparatre l'autre qui parle et qui s'adresse
directement moi. C'est bien moi que la phrase imprime est
destine, elle reprsente bien une communication immdiate de
l'autre moi : je suis vis. Mais si l'autre me vise, c'est en tant que j e
suis transcendance indiffrencie. Ds lors, si j 'emprunte pour sortir
l'issue dsigne comme sortie je n' en use point dans la l ibert
absolue de mes projets personnels : je ne constitue pas un outil par
invention, je ne dpasse pas l a pure matrialit de la chose vers mes
possibl es ; mais entre l'objet et moi une transcendance humaine s'est
dj glisse, qui guide la mienne ; l'objet est dj humanis, il signifie
le rgne humain . La sortie - la considrer comme pure
ouvert!lre qui donne sur l a rue - est rigoureusement quivalente
l'entre ; ce n'est pas son coefficient d'adversit ou son utilit visible
qui la dsigne comme sortie. Je ne me pl ie pas l'objet lui-mme,
lorsque je l'utilise comme sorti e : je m'accommode de l'ordre
humai n ; je reconnais par mon acte mme l'existence de l'autre,
j'tablis un dialogue avec l'autre. Tout cela, Heidegger l ' a fort bien
dit. Mais l a conclusion qu'il oublie d'en tirer c'est que, pour que
l'objet apparaisse comme manufactur, il faut que l'autre soit donn
d'abord de quelque autre manire. Qui n'aurait pas dj l'exprience
de l'autre ne pourrait aucunement distinguer l'objet manufactur de
la pure matrialit d'une chose non ouvre. Si mme il devait l'utiliser
467
conformment au mode d'emploi prvu par le fabricant, il rinvente
rait ce mode d' empl oi et raliserait ainsi une libre appropriation d'une
chose naturel l e. Sortir par l ' issue dnomme sortie sans avoir lu
l'criteau ou sans connatre la langue, c'est tre comme l e fou des
Stociens qui di t ^ i l fait jour en plein jour, non par suite d'une
consta tation objective, mais en vertu des ressorts intrieurs de sa
fol i e. Si donc l'objet manufactur renvoie aux autres, et par l ma
transcendance indiffrencie, c'est parce que je connais dj les
autres. Ainsi l'exprience du nous-sujet se construit sur l'preuve
originelle d' autrui et ne saurait tre qu'une exprience secondaire et
subordonne.
Mais en outre, nous l'avons vu, se saisir comme transcendance
indiffrenci e, c'est--dire, au fond, comme pure exemplification de
l ' espce humai ne , ce n'est pas encore s'apprhender comme
structure partielle d' un nous-sujet. I l faut, en effet, pour cel a, se
dcouvrir comme quelconque au sei n d' un courant humai n quelcon
que. Il faut donc tre entour par les autres. Nous avons vu aussi que
les autres ne sont aucunement prouvs comme sujets dans cette
exprience, ni non plus saisis comme objets. Il s ne sont pas poss du
tout. Certes, j e pars de leur existence de fait dans le monde et de la
perception
de leurs actes, mais je ne saisis pas positionnellement l eur
facticit ou leurs gestes : j 'ai une conscience latrale et non position
ne lIe de leurs corps comme corrlatifs de mon corps, de leurs actes
comme s'panouissant en liaison avec mes actes, de telle sorte que j e
ne puis dterminer si ce sont mes actes qui font natre leurs actes ou
leurs actes qui font natre les miens. Il suffit de ces quel ques
remarques pour faire comprendre que l ' exprience du flOU ne peut
me donner originel l ement connatre comme autres les autres qui
font partie du nous. Bi en au contraire, il faut qu'il y ait d'abord
quelque savoir de ce qu' est autrui pour qu'une exprience de mes
relations avec autrui puisse tre ralise sous forme de Mitsein .
Le Mitsein l ui seul serait impossible sans reconnaissance pralable
de ce qu'est l'autre : je suis avec . . . , soit ; mais avec qui ? En outre,
si mme cette exprience tait ontologiquement premire, on ne voit
pas comment on pourrait passer, sans une modification radicale de
cette exprience, d'une transcendance totalement i ndiffrencie
l'preuve des personnes singulires. Si l'autre n'tait donn par
ailleurs, l 'exprience du nous, en se brisant, ne donnerait naissance
qu' l ' apprhension de purs obj ets-instruments dans l e monde
circonscrit par ma transcendance.
Ces quel ques observations ne prtendent pas puiser la question du
nous. Elles visent seul ement indiquer que l'exprience du nous
sujet n'a aucune valeur de rvlation mtaphysique ; el l e dpend
troitement des diffrentes formes du pour-autrui et n'est qu'un
enrichissement empirique de certaines d'entre el les. C'est cela,
468
vi demment, qu' i l faut attribuer l'extrme instabilit de cette exp
rience. El l e vient et disparat capri cieusement, nous laissant en face
d'autres-objets ou bi en d'un on qui nous regarde. Elle apparat
comme un apaisement provisoire qui se constitue au sein du confli t
mme, non comme une solution dfinitive de ce conflit. Vainement
souhaiterait-on un nous humain dans lequel l a totalit intersubjective
prendrait conscience d'elle-mme comme subj ectivit unifie. Un
semblable idal ne saurait tre qu'une rverie produite par un passage
l a limite et l'absolu partir d'expriences fragmentai res et
strictement psychologiques. Cet idal lui-mme , d'ailleurs, implique
la reconnaissance du conflit des transcendances comme tat origi nel
de l'tre-pour-autrui . C'est ce qui explique un paradoxe apparent :
l'unit de la classe opprime provenant de ce qu'elle s'prouve
comme nous-objet en face d'un on i ndiffrenci qui est le tiers ou l a
classe opprimante, on serait tent de croire que, symtri quement, l a
classe opprimante s e saisit comme nous-sujet en face de l a classe
opprime. Or la faibl esse de l a classe opprimante c'est que, bien que
disposant d'appareils prcis et rigoureux de coerciti on, el l e est, en
elle-mme, profondment anarchique. Le bourgeois ne se dfi ni t
pas seulement comme un certain homo oeconomicu disposant de
pouvoir et de privilges prcis au sei n d'une socit d' un certain type :
il se dcrit de l'intrieur comme une conscience qui ne reconnat pas
son appartenance une classe. Sa situation, en effet, ne lui permet
pas de se saisir comme engag dans un nous-objet en communaut
avec les autres membres de la classe bourgeoise. Mais, d'autre part, l a
nature mme du nous-sujet implique qu' il n'en fasse que des
expriences fugaces et sans porte mtaphysi que. Le bourgeois
nie communment qu' il y ait des classes, il attribue l'existence d'un
proltariat l'action d'agitateurs, des incidents fcheux, des
injustices pouvant tre rpares par des mesures de dtail : i l affirme
l'existence d'une solidarit d'intrts entre l e capital et le travai l ; i l
oppose l a solidarit de classe une solidarit plus vaste, l a solidarit
nationale o l'ouvrier et le patron s'intgrent en un Mitsein qui
supprime l e conflit. Il ne s'agit pas l, comme on l ' a trop souvent di t,
de manuvres ou d' un refus imbcile de voi r l a situation sous son vrai
jour ; mais l e membre de la classe opprimante voit en face de l ui ,
comme un ensemble objectif eux-sujets l a totalit de la classe
opprime sans raliser corrlativement sa communaut d'tre avec les
autres membres de la classe opprimante : les deux expriences ne
sont aucunement complmentaires ; i l suffi t, en effet, d'tre seul en
face d' une collectivit opprime pour l a saisir comme objet-instru
ment et pour se saisir soi-mme comme ngation-interne de cette
collectivit, c'est--dire simplement comme l e tiers impartial. C'est
seulement lorsque l a classe opprime, par la rvolte ou l'augmenta
tion brusque de ses pouvoirs, se pose en face des membres de la classe
469
opprimante comme on-regard , c'est seulement alors que l es
oppresseurs s'prouveront comme nous. Mais ce sera dans la crainte
et l a honte et comme nous-objet.
Ainsi n 'y a-t-i l aucune symtrie entre l'preuve du nous-objet et
l'expri ence du nous-sujet. La premire est l a rvlation d'une
dimension d'existence rell e et correspond un simple enrichisse
ment de l 'preuve originel l e du pour-autrui. L'autre est une exp
rience psychologique ralise par un homme historique, plong dans
un univers travail l et dans une socit de type conomique dfini ;
el l e ne rvle rien de particulier, c'est une Erlebnis purement
subjective.
I I apparat donc que l'exprience du nous, bien que rel l e, n'est pas
de nature modifier les rsultats de nos recherches antrieures.
S'agit-il du nous-obj et ? Il est directement dpendant du tiers, c'est-
dire de mon tre-po ur-l'autre et c'est sur l e fondement de mon tre
dehors-pour-I'autre qu' il se consti tue. S'agit-il du nous-sujet ? C'est
une exprience psychologique qui suppose, d'une faon ou d' une
autre, que l'existence de l ' autre en tant que tell e nous ait t rvle.
C'est donc en vain que la ralit-humaine chercherait sortir de ce
di l emme : transcender l'autre ou se laisser transcender par l ui .
L'essence des rapports entre consciences n'est pas l e Mitsein, c'est l e
conflit.
Au terme de cette longue description des relations du pour-soi avec
l'autre, nous avons donc acquis cette certitude : le pour-soi n'est pas
seul ement un tre qui surgit comme nantisation de l'en-soi qu'il est
et ngation interne de l 'en-soi qu' il n'est pas. Cette fuite nantisante
est entirement ressaisie par l'en-soi et fige en en-soi ds qu'apparat
l 'autre. Le pour-soi seul est transcendant au monde, i l est l e rien par
quoi i y a des choses. L'autre en surgissant confre au pour-soi un
tre-en-soi-au-milieu-du-monde comme chose parmi l es choses. Cette
ptrification de l ' en-soi par le regard de l'autre est le sens profond du
mythe de Mduse. Nous avons donc avanc dans notre recherche .
nous voulions dterminer, en effet, la relation originel le du pour-soi
l'en-soi . Nous avons appris d'abord que le pour-soi tait nantisation
et ngation radicale de l ' en-soi ; prsent, nous constatons qu'il est
aussi, du seul fait du concours de l ' autre et sans contradiction aucune,
totalement en-soi, prsent au mi l ieu de l'en-soi. Mais ce deuxime
aspect du pour-soi reprsente son dehors : l e pour-soi , par nature, est
l'tre qui ne peut concider avec son tre-en-soi.
Ces remarques pourraient servir de bases une thorie gnrale de
l'tre qui est le but mme que nous poursuivons. Toutefois, il est
encore trop tt pour l ' amorcer : il ne suffit pas, en effet, de dcrire le
pour-soi comme projetant simpl ement ses possibilits par del l'tre
en-soi. Le projet de ces possibilits ne dtermine pas statiquement l a
configuration du monde : i l change l e monde chaque instant. Si
470
nous lisons Heidegger, par exemple , nous sommes frapp, de ce point
de vue, de l'i nsuffisance de ses descriptions hermneutiques. En
adoptant sa terminologi e, nous dirons qu' il a dcrit l e Dasein comme
l'existant qui dpassait les existants vers leur tre. Et l'tre ici signifie
le sens ou la manire d'tre de l'existant. Et il est vrai que le pour-soi
est l'tre par qui les existants rvlent leur manire d'tre. Mais
Heidegger passe sous si lence le fait que le pour-soi n'est pas
seulement l 'tre qui constitue une ontologie des existants, mais qu'il
est encore l 'tre par qui des modifications ontiques surviennent
l'existant en tant qu'existant . Cette possibilit perptuelle d'agir,
c'est--dire de modifier l' en-soi dans sa matrialit ontique, dans sa
chair , doit, videmment , tre considre comme une caractristi
que essentielle du pour-soi ; comme tel l e elle doit trouver son
fondement dans un rapport originel du pour-soi l'en-soi que nous
n'avons pas encore mis au jour. Qu'est-ce qu'agir? Pourquoi le pour
soi agit-il ? Comment peut-il agir ? Telles sont les questions auxquelles
i l nous faut prsent rpondre. Nous avons tous les lments d' une
rponse : l a nantisation, la facticit et l e corps, l'tre-pour-autrui, l a
nature propre de l'en-soi . I l convient de les i nterroger nouveau.
Quatrime partie
AVOI R, FAI RE ET TRE
Quatrime partie
AVOI R, FAI RE ET TRE
Avoir, faire et tre sont les catgories cardinales de l a ralit
humai ne. Elles subsument sous elles toutes les conduites de l'homme.
Le connatre, par exemple, est une modalit de l'avoir. Ces catgories
ne sont pas sans liaison entre el l es, et plusieurs auteurs ont insist sur
ces rapports. C'est une relation de cette espce que Denis de
Rougemont met au jour lorsqu'il crit dans son article sur Don Juan :
II n'tait pas assez pour avoi r. Et c'est encore une semblable
liaison qu'on indique lorsqu'on montre un agent moral faisant pour se
faire et se faisant pour tre.
Cependant, la tendance antisubstantialiste ayant vaincu dans la
philosophie moderne, la plupart des penseurs ont tent d' imiter sur l e
terrain des conduites humaines ceux de leurs prdcesseurs qui avaient
remplac en physique l a substance par l e simple mouvement. Le but de
la morale a t longtemps de fournir l'homme le moyen d'tre. C'tait
l a signification de la morale stocienne ou de l 'Ethique de Spinoza.
Mais si l'tre de l ' homme doit se rsorber dans l a succession de ses
actes, le but de la morale ne sera plus d'lever l'homme une dignit
ontologique suprieure. En ce sens, la morale kantienne est l e premier
grand systme thique qui substitue l e faire l ' tre comme valeur
suprme de l'action. Les hros de L'Espoir sont pour la plupart sur l e
terrain du faire et Malraux nous montre l e conflit des vieux dmocrates
espagnols, qui tentent encore d' tre, avec les communistes dont l a
morale se rsout en une srie d' obligations prcises et circonstancies,
chacune de ces obligations visant un faire particul ier. Qui a raison ? La
valeur suprme de l'activit humaine est-elle un faire ou un tre ? Et,
quelle que soit l a solution adopte, que devient l'avoir ? L'ontologie
doit pouvoir nous renseigner sur ce problme ; c'est d'ailleurs une de
ses tches essentielles, si l e pour-soi est l'tre qui se dfinit par l'action.
Nous ne devons donc pas terminer cet ouvrage sans esquisser, dans ses
grands traits, l'tude de l'action en gnral et des rel ations essentielles
du faire, de l'tre et de l'avoir.
CHAPITRE PREMI ER
tre et faire : la libert
LA CONDITI ON PREMI RE DE L' ACTI ON,
C' EST LA LI BERT
I l est trange qu' on ait pu raisonner perte de vue sur l e
dterminisme et l e li bre arbitre, citer des exemples en faveur de l ' une
ou de l'autre thse, sans ten ter, au pralable, d'expliciter l es
structures contenues dans l'ide mme d'action. Le concept d'acte
contient en effet de nombreuses notions subordonnes que nous
aurons organiser et hirarchiser : agir, c'est modifier l a figure du
monde, c'est disposer des moyens en vue d'une fin, c'est produire un
complexe instrumental et organis tel que, par une srie d'enchane
ments et de liaisons, la modification apporte l'un des chanons
amne des modifications dans toute la srie et, pour finir, produise un
rsultat prvu. Mais ce n'est pas encor l ce qui nous importe. I l
convient, e n effet, de remarquer d'abord qu'une action est par
principe intentionnelle. Le fumeur maladroit qui a fait, par mgarde,
exploser une poudrire n'a pas agi. Par contre, l' ouvrier charg de
dynamiter une carrire et qui a obi aux ordres donns a agi lorsqu'il
a provoqu l'explosion prvue : i l savait, en effet, ce qu'il faisait ou, si
l'on prfre, i l ralisait intentionnellement un projet conscient. Cela
ne signifie pas, certes, qu'on doive prvoir toutes les consquences de
son acte : l'empereur Constantin ne prvoyait pas, en s'tablissant
Byzance, qu'il crerait une ci t de culture et de langue grecques, dont
l'apparition provoquerait ultrieurement un schisme dans l'Eglise
chrtienne et contribuerait affaiblir l' Empire romain. Il a pourtant
fait un acte dans l a mesure o il a ralis son projet de crer une
nouvelle rsidence en Orient pour les empereurs. L'adquation du
477
rsul tat l'intention est ici suffisante pour que nous puissions parler
d' action. Mais, s'il doit en tre ainsi, nous constatons que l'action
i mpl i que ncessairement comme sa condition la reconnaissance d'un
desideratum , c'est--dire d'un manque objectif ou encore d'une
ngatit. L'intention de susciter Rome une rivale ne peut venir
Constantin que par la saisie d'un manque objectif : Rome manque
d'un contrepoids ; cette ville encore profondment paenne, il
faudrait opposer une cit chrtienne qui, pour l'instant, fait dfaut,
Crer Constantinople ne se comprend comme acte que si d'abord la
conception d'une ville neuve a prcd l ' action elle-mme ou si,
tout l e moins, cette conception sert de thme organisateur toutes les
dmarches ultrieures. Mais cette conception ne saurait tre la pure
reprsentation de l a ville comme possible. El l e l a saisit dans sa
caractristique essentielle qui est d'tre un possible dsirable et non
ralis. Cela signifie que, ds l a conception de l'acte, la conscience a
pu se retirer du monde plein dont el l e est conscience et quitter l e
terrai n de l'tre pour aborder franchement cel ui du non-tre. Tant
que ce qui est est considr exclusivement dans son tre, la conscience
est renvoye perptuellement de l'tre l'tre et ne saurait trouver
dans J 'tre un motif pour dcouvrir le non-tre. Le systme i mprial ,
en tant que Rome en est la capitale, fonctionne positivement et d'une
certaine faon relle qui se laisse facilement dvoiler. Dira-t-on que
les impts rentrent mal, que Rome n'est pas l'abri des invasions,
qu' el le n'a pas la situation gographique qui convient la capitale
d'un empire mditerranen que les barbares menacent, que la
corruption des murs y rend la di ffusion de l a religion chrtienne
difficil e ? Comment ne pas voir que toutes ces considrations sont
ngatives, c'est--dire qu'elles visent ce qui n'est pas, non ce qui est.
Dire q
ue 60 % des i mpts prvus ont t recouvrs peut passer la
rigueur pour une apprciation positive de l a situation telle qu'elle est,
Dire qu'ils rentrent mal, c'est considrer la situation travers une
situation pose comme fin absolue et qui prcisment n'est pas. Dire
que l a corruption des murs y entrave l a di ffusion du christianisme,
ce n'est pas considrer cette diffusion pour ce qu'elle est, c'est--dire
pour une propagation un rythme que les rapports des ecclsiastiques
peuvent nous mettre mme de dterminer : c'est l a poser en elle
mme comme insuffisante, c'est--dire comme souffrant d'un nant
secret. Mais elle n' apparat telle, justement, que si on la dpasse vers
une situation-limite pose a priori comme valeur -par exemple vers
un certain rythme des conversions religieuses, vers une certaine
moralit de l a masse -et cette situation-limite ne peut tre conue
partir de la simple considration de l'tat rel des choses, car la plus
belle fi l l e du monde ne peut donner que ce qu'elle a et, de mme, la
situation la plus misrable ne peut, d'elle-mme, que se dsigner
comme el l e est, sans aucune rfrence un nant idal . Et tant que
478
l'homme est plong dans la situation histori que, il lui arrive de ne
mme pas concevoir l es dfauts et l es manques d'une organisation
politique ou conomique dtermi ne, non comme on dit sottement
parce qu'il en a l ' habitude , mais parce qu'il la saisit dans sa
plnitude d'tre et qu'il ne peut mme imaginer qu'il puisse en tre
autrement. Car il faut ici inverser l 'opinion gnrale et convenir de ce
que ce n'est pas l a duret d'une situation ou l es souffrances qu' el l e
impose qui sont motifs pour qu' on conoive un autre tat de choses o
i l en irait mieux pour tout l e monde ; au contraire, c'est partir du
jour o l ' on peut concevoir un autre tat de choses qu'une lumire
neuve tombe sur nos peines et sur nos souffrances et que nous
dcidons qu'elles sont insupportables. L'ouvrier de 1830 est capable
de se rvolter si l'on baisse les salaires, car i l conoit facilement une
situation o son misrable niveau de vi e serait moins bas cependant
que celui qu'on veut lui imposer. Mais i l ne se reprsente pas ses
souffrances comme i ntolrables, i l s'en accommode, non par rsigna
tion, mais parce qu' il manque de la culture et de la rflexion
ncessaires pour lui faire concevoir un tat social o ces souffrances
n'existeraient pas. Aussi n'agit-il pas. Matres de Lyon, l a suite
d'une meute, les ouvriers de la Croix-Rousse ne savent que faire de
leur victoire, i l s rentrent chez eux, dsorients, et l'arme rgulire
n'a pas de peine les surprendre. Leurs malheurs ne leur paraissent
pas habituels , mai s plutt naturels : ils sont, voil tout, i l s
constituent l a condition de l'ouvrier ; ils ne sont pas dtachs, ils ne
sont pas vus en claire lumire et, par sui te, i l s sont intgrs par
l'ouvrier son tre, i l souffre sans considrer sa souffrance et sans l ui
confrer de valeur : souffrir et tre ne font qu'un pour l ui ; sa
souffrance est la pure teneur affective de sa conscience non
positionnelle, mais i l ne l a contemple pas. El l e ne saurait donc tre
par el le-mme un mobile pour ses actes. Mais tout au contraire, c'est
lorsqu' il aura fait le projet de l a changer qu'elle lui paratra
intolrable. Cela signifie qu'il devra avoir pris du champ, du recul par
rapport el l e et avoir opr une doubl e nantisation : d'une part, en
effet , i l faudra qu' i l pose un tat de choses idal comme pur nant
prsent , d'autre part i l faudra qu' i l pose l a situation actuelle comme
nant par rapport cet tat de choses. Il l ui faudra concevoir un
bonheur attach sa classe comme pur possible - c'est--dire
prsentement comme un certain nant ; d'autre part, il reviendra sur
la situation prsente pour l'clairer l a l umire de ce nant et pour l a
nantiser son tour en dclarant : Je ne suis pas heureux. I l
s'ensuit ces deux importantes consquences : 10 aucun tat de fait,
quel qu'il soit (structure politique, conomique de l a socit, tat
psychologique, etc. ) , n'est susceptible de motiver par lui-mme un
acte quelconque. Car un acte est une projection du pour-soi vers ce
qui n'est pas et ce qui est ne peut aucunement dterminer par l ui-
479
mme ce qui n'est pas. 2 aucun tat de fait ne peut dterminer l a
conscience le saisir comme ngatit ou comme manque . Mieux
encore, aucun tat de fait ne peut dterminer la conscience le dfinir
et l e circonscrire puisque, comme nous l'avons vu, l a formule de
Spinoza : Omnis determinatio est negatio reste profondment
vraie. Or, toute action a pour condition expresse non seulement l a
dcouverte d' un tat de choses comme manque de . . + , c'est--dire
comme ngatit, mais encore - et pralablement -la constitution
de l'tat de choses considr en systme isol. Il n 'y a d'tat de fait
satisfaisant ou non -que par la puissance nantisante du pour-soi.
Mais cette puissance de nantisation ne peut se borner raliser un
simple recul par rapport au monde. En tant, en effet, que la
conscience est investie par l'tre, en tant qu'elle souffre simple
ment ce qui est, elle doit tre englobe dans l'tre : c'est la forme
organise ouvrier-trouvant-sa-souffrance-naturelle , qui doit tre
surmonte et nie pour qu'elle puisse faire l'objet d'une contempla
tion rvlante. Cela signifie videmment que c'est par pur arrache
ment soi-mme, et au monde, que l'ouvrier peut poser sa souffrance
comme souffrance insupportable et, par consquent, en faire le
mobile de son action rvolutionnaire. Cela implique donc pour l a
conscience la possibilit permanente de faire une rupture avec son
propre pass, de s'en arracher pour pouvoir l e considrer la lumire
d'un non-tre et pour pouvoir l ui confrer la signification qu'il a
partir du projet d'un sens qu'il n 'a pas. En aucun cas et d'aucune
manire, l e pass par lui-mme ne peut produire un acte, c'est--dire
l a position d'une fin qui se retourne sur lui pour l'clairer. C'est ce
qu'avait entrevu Hegel lorsqu'il crivait que l 'esprit est le ngatif
encore qu'i l ne semble pas s'en tre souvenu lorsqu'il a d exposer sa
thorie propre de l'action et de l a libert. En effet, ds lors qu'on
attribue la conscience ce pouvoir ngatif vis--vis du monde et
d' elle-mme, ds lors que la nantisation fait partie intgrante de la
position d'une fin, i l faut reconnatre que la condition indispensable et
fondamentale de toute action c'est la libert de l ' tre agissant.
Ainsi nous pouvons saisir au dpart l e dfaut de ces discussions
fastidieuses entre dterministes et partisans de l a libert d' indiff
rence. Ces derniers se proccupent de trouver des cas de dcision
pour lesquels il n'existe aucun motif antrieur, ou des dlibrations
concernant deux actes opposs, galement possibles et dont les motifs
(et les mobiles) sont rigoureusement de mme poids. A quoi les
dterministes ont beau jeu de rpondre qu'il n' y a pas d'action sans
motif et que l e geste le plus insignifiant (lever la main droite plutt
que la mai n gauche, etc. ) renvoie des motifs et des mobiles qui lui
confrent sa signification. Il ne saurait en tre autrement puisque
toute action doit tre intentionnelle : elle doit, en effet, avoir une fin
et la fin son tour se rfre un motif. Telle est, en effet, l'unit des
480
trois ek-stases temporelles : la fin ou temporalisation de mon futur
implique un motif (ou mobi l e), c'est--dire indique vers mon pass, et
le prsent est surgissement de l'acte. Parler d'un acte sans motif, c'est
parler d'un acte auquel manquerait la structure intentionnelle de tout
acte et l es partisans de l a libert, en l a cherchant au niveau de l'acte
en train de se fai re, ne sauraient aboutir qu' la rendre absurde. Mais
les dterministes leur tour se font la partie trop belle en arrtant leur
recherche l a pure dsigna tian du motif et du mobile. La question
essentielle est en effet par del l 'organisation complexe motif
intention-acte-fin ! : nous devons, en effet , nous demander comment
un motif (ou un mobile) peut tre constitu comme tel. Or, nous
venons de voir que, s'il n' est pas d'acte sans motif, ce n'est nullement
au sens o l'on peut dire qu'il n' est pas de phnomne sans cause.
Pour tre motif, en effet, l e motif doit tre prouv comme tel .
Certes, cela ne signifie nul l ement qu' il doive tre thmatiquement
conu et explicit comme dans le cas de la dlibration. Mais du
moins cela veut-il dire que l e pour-soi doit lui confrer sa valeur de
mobile ou de motif. Et , nous venons de le voir, cette constitution du
motif comme tel ne saurait renvoyer un autre existant rel et positif,
c'est--dire un motif antrieur. Si non, la nature mme de l'acte,
comme engag i ntentionnel l ement dans l e non-tre, s'vanouirait. Le
mobile ne se comprend que par l a fi n, c'est--dire par du non
existant ; l e mobile est donc en l ui-mme une ngatit. Si j' accepte un
salaire de misre, c'est sans doute par peur - et la peur est un
mobile. Mai s c'est peur de mourir de faim ; c'est--dire que cette peur
n' a de sens que hors d' eI l e dans une fi n pose idalement qui est l a
conservation d' une vi e que j e saisis comme en danger . Et cette
peur ne se comprend son tour que par rapport la valeur que je
donne i mplicitement cette vie, c'est--dire qu'elle se rfre ce
systme hirarchis d'objets idaux que sont les valeurs. Ainsi le
mobile se fait apprendre ce qu'il est par l'ensemble des tres qui ne
sont pas , par les existences idales et par l'avenir. De mme que l e
futur revient sur le prsent et l e pass pour l'clairer, de mme c'est
l'ensemble de mes projets qui revient en arrire pour confrer au
mobile sa structure de mobil e. C'est seul
e
ment parce que j'chappe
l'en-soi en me nantisant vers mes possibilits que cet en-soi peut
prendre val eur de motif ou de mobil e. Motifs et mobiles n'ont de sens
qu' l'i ntrieur d'un ensemble pro-jet qui est justement un ensemble
de non-existants. Et cet ensemble, c'est finalement moi-mme comme
transcendance, c'est moi en tant que j 'ai tre moi-mme hors de
moi. Si nous nous rappel ons l e principe que nous avons tout l'heure
tabli , savoir que c'est l a saisie d'une rvolution comme possible qui
donne l a souffrance de l'ouvrier sa val eur de mobil e, nous devons en
conclure que c'est en fuyant une situation vers notre possibilit de l a
modifi er que nous organisons cette situation en complexe de motifs et
481
de mobiles. La nantisation par quoi nous prenons du recul par
rapport la si tuation ne fait qu'un avec l'ek-stase par laquelle nous
nous pro-jetons vers une modification de cette situation. Il en rsulte
qu'il est impossible, en effet , de trouver un acte sans mobile, mais
qu'il n' en faut pas conclure que le mobi l e est cause de l'acte : il en est
partie intgrante. Car, comme l e projet rsolu vers un changement ne
se distingue pas de l'acte, c'est en un seul surgissement que se
constituent l e mobi l e, l'acte et la fin. Chacune de ces trois structures
rcl ame les deux autres comme sa signification. Mais la totalit
organise des trois ne s'explique plus par aucune structure singulire
et son surgissement comme pure nantisation temporalisante de l'en
soi ne fait qu' un avec l a libert. C'est l'acte qui dcide de ses fins et de
ses mobiles, et l'acte est l'expression de la libert.
Nous ne pouvons cependant en demeurer ces considrations
superficielles : si la condition fondamentale de l'acte est la libert, i l
nous faut tenter de dcrire plus prcisment la libert. Mais nous
rencontrons d'abord une grosse di fficult : dcrire, l'ordinaire, est
une activit d'explicitation visant les structures d'une essence singu
l i re. Or, l a l i bert n' a pas d'essence. Elle n'est soumise aucune
ncessit logique ; c'est d'elle qu'il faudrait dire ce que Heidegger dit
du Dasen en gnral : En elle l'existence prcde et commande
l'essence. La libert se fait acte et nous l'atteignons ordinairement
travers l'acte qu'elle organise avec les motifs, les mobiles et les fins
qu' i l impl ique. Mais prcisment parce que cet acte a une essence, il
nous apparat comme constitu ; si nous voulons remonter l a
puissance constitutive, i l faut abandonner tout espoir de lui trouver
une essence. Celle-ci , en effet, exigerait une nouvelle puissance
constitutive et ainsi de suite l' i nfi ni . Comment donc dcrire une
existence qui se fait perptuel l ement et qui refuse d'tre enferme
dans une dfinition ? La dnomination mme de est
dangereuse si l'on doit sous-entendre que le mot renvoie un
concept, comme l es mots font l'ordinaire. I ndfinissable et innom
mable, l a libert ne serait-elle pas indescriptible ?
Nous avons rencontr de semblables difficults lorsque nous avons
voulu dcrire l'tre du phnomne et le nant. Elles ne nous ont pas
arrt. C'est qu'en effet i l peut y avoir des descriptions qui ne visent
pas l'essence mais l'existant lui-mme, dans sa singularit. Je ne
saurais, certes, dcrire une libert qui serait commune l'autre et
moi-mme ; je ne saurais donc envisager une essence de la libert.
C'est au contraire la l i bert qui est fondement de toutes les essences,
puisque c'est en dpassant le monde vers ses possibilits propres que
rhomme dvoile les essences intramondaines. Mais i l s'agit en fait de
ma libert. Pareillement, d'ailleurs, lorsque fai dcrit la consci ence, i l
ne pouvait s'agir d' une nature commune certains individus, mais
bien de ma conscience singulire qui, comme ma libert, est par del
482
l'essence ou - comme nous l'avons montr plusieurs reprises -
pour qui tre c'est avoir t. Cette conscience, je disposais prcis
ment, pour l ' atteindre dans son existence mme, d'une exprience
particulire : l e cogito. Husserl et Descartes, Gaston Berger l ' a
montr l , demandent au cogito de l eur livrer une vrit d' essence :
chez l ' un nous atteindrons la liaison de deux natures simples, chez
l'autre nous saisirons l a structure eidtique de la conscience. Mais, si
la conscience doit prcder son essence en existence, ils ont commis
l'un et l 'autre une erreur. Ce qu' on peut demander au cogito, c'est
seulement de nous dcouvrir une ncessit de fait. C'est aussi au
cogito que nous nous adresserons pour dterminer la libert comme
libert qui est ntre, comme pure ncessit de fai t, c'est--dire comme
un existant cont ingent mais que j e ne peux pas ne pas prouver. Je
suis, en effet, un existant qui apprend sa libert par ses actes ; mais je
suis aussi un existant dont l'existence individuelle et unique se
temporalise comme libert. Comme t el je suis ncessairement cons
cience (de) l ibert, puisque rien n'existe dans la conscience sinon
comme conscience non-thtique d'exister. Ainsi ma libert est
perptuel l ement en question dans mon tre ; elle n' est pas une qualit
surajoute ou une proprit de ma nature ; elle est trs exactement
l'toffe de mon tre ; et comme mon tre est en question dans mon
tre, j e dois ncessairement possder une certaine comprhension de
la libert. C'est cette comprhension que nous avons dessei n,
prsent, d'expliciter.
Ce qui pourra nous aider atteindre la l ibert en son cur, ce sont
les quelques remarques que nous devons prsent rsumer ici . Nous
avons, en effet, tabli ds notre premier chapitre que si la ngation
vient au monde par l a ralit-humaine, celle-ci doit tre un tre qui
peut raliser une rupture nantsante avec le monde et avec soi
mme ; et nous avions tabli que la possibilit permanente de cette
rupture ne faisait qu'une avec la libert . Mais, d'autre part, nous
avions constat que cette possi bilit permanente de nantiser ce que
je suis sous forme de l'avoir-t impl ique pour l ' homme un type
d'existence particulier. Nous avons pu alors dterminer, partir
d'analyses comme cel l e de l a mauvaise foi , que l a ralit-humaine
tait son propre nant. Etre, pour le pour-soi, c'est nantiser l'en-soi
qu'il est. Dans ces conditions, l a libert ne saurait tre rien autre que
cette nantisation. C'est par el l e que l e pour-soi chappe son tre
comme son essence, c'est par elle qu'il est toujours autre chose que
ce qu'on peut dire de lui, car au moins est-il celui qui chappe cette
dnomination mme, celui qui est dj par del le nom qu'on l ui
donne, l a proprit qu'on l ui reconnat. Di re que le pour-soi a tre
ce qu'il est, dire qu'il est ce qu' il n'est pas en n'tant pas ce qu'il est,
1. Gaston Berger : Le Cogito chez Husserl et chez Descartes, 1940.
483
dire qu'en l ui l'existence prcde et conditionne l'essence ou inverse
ment, selon la formule de Hegel, que pour lui Wesen ist was
gewesen ist , c'est dire une seule et mme chose, savoir que
l'homme est libre. Du seul fait , en effet, que j 'ai conscience des motifs
qui sollicitent mon action, ces motifs sont dj des objets transcen
dants pour ma conscience, ils sont dehors ; en vain chercherai-je m' y
raccrocher : j' y chappe par mon existence mme. Je suis condamn
exister pour toujours par del mon essence, par del les mobiles et les
motifs de mon acte : j e suis condamn tre libre. Cela signifie qu'on
ne saurait trouver ma libert d' autres limites qu'elle-mme ou, si
) 'on prfre, que nous ne sommes pas libres de cesser d' tre libres.
Dans l a mesure o le pour-soi veut se masquer son propre nant et
s'incorporer l ' en-soi comme son vritable m0de d'tre, il tente aussi
de se masquer sa libert. Le sens profond du dterminisme, c'est
d'tablir en nous une continuit sans faille d'existence en soi. Le
mobile conu comme fait psychique, c'est--dire comme ralit pleine
et donne, s'articule, dans l a vision dterministe, sans solution de
continuit, l a dcision et l'acte, qui sont conus galement comme
donnes psychiques. L'en-soi s'est empar de tous ces data , l e
mobile provoque l'acte comme l a cause son effet, tout est rel, tout
est pl ei n. Ainsi, le refus de l a libert ne peut se concevoir que comme
tentative pour se saisir comme tre-en-soi ; l'un va de pair avec
l'autre ; l a ralit-humaine est un tre dans lequel il y va de sa libert
dans son tre parce qu'il tente perptuellement de refuser de l a
reconnatre. Psychologiquement. cel a revient, chez chacun de nous,
essayer de prendre les mobiles et les motifs comme des choses. On
tente de l eur en confrer la permanence ; on essai e de se dissimuler
que leur nature et leur poids dpendent chaque moment du sens que
j e l eur donne, on les prend pour des constantes : cela revient
considrer le sens que je leur donnais tout l'heure ou hier -qui,
cel ui-l, est irrmdiable, parce qu'il est pass et d'en extrapoler le
caractre fig jusqu'au prsent. J'essaie de me persuader que le motif
esr comme il rair. Ainsi passerait-il de pied en cap de ma conscience
passe ma conscience prsente : il l'habiterait. Cela revient tenter
de donner une essence au pour-soi. De l a mme faon on posera les
fins comme des transcendances, ce qui n'est pas une erreur. Mais au
lieu d'y voir des transcendances poses et maintenues dans leur tre
par ma propre transcendance, on supposera que j e les rencontre en
surgissant dans le monde : el l es vi ennent de Dieu, de l a nature, de
ma nature, de l a soci t. Ces fins toutes faites et prhumaines
dfi niront donc l e sens de mon acte avant mme que je l e conoive,
de mme que les motifs, comme pures donnes psychiques, le
provoqueront sans mme que je m' en aperoive. Motif, acte, fin
constituent un continuum , un plein. Ces tentatives avortes pour
touffer la libert sous le poids de l'tre - elles s'effondrent quand
484
surgit tout coup l ' angoisse devant la libert - montrent assez que
la libert concide en son fond avec l e nant qui est au cur de
l'homme. C'est parce que l a ralit-humaine n'est pas assez qu'elle
est libre, c'est parce qu'elle est perptuel lement arrache elle
mme et que ce qu'elle a t est spar par un nant de ce qu'elle
est et de ce qu'elle sera. C'est enfin, parce que son tre prsent lui
mme est nant i sat i on sous la forme du reflet-refltant .
L'homme est l i bre parce qu'il n' est pas soi mai s prsence soi.
L'tre qui est ce qu'il est ne saurait tre libre. La libert, c'est
prcisment l e nant qui est t au cur de l'homme et qui contraint
la ralit-humaine se faire, au lieu d'tre. Nous l'avons vu, pour la
ralit-humaine, tre c'est se choisir : rien ne lui vient du dehors, ni
du dedans non pl us, qu'elle puisse recevoir ou accepter. El l e est
entirement abandonne, sans aucune aide d'aucune sorte, l ' insou
tenable ncessit de se faire tre jusque dans le moindre dtail.
Ainsi, l a libert n'est pas un tre : elle est l'tre de l 'homme, c'est-
dire son nant d'tre. Si l'on concevait d'abord l' homme comme un
plein, il serait absurde de chercher en l ui , par aprs, des moments
ou des rgions psychiques o i l serait libre : autant chercher du vide
dans un rcipient qu' on a pralablement rempli j usqu'aux bords.
L'homme ne saurait tre tantt libre et tantt esclave : il est tout
entier et toujours libre ou il n'est pas.
Ces remarques peuvent nous conduire, si nous savons les utiliser,
des dcouvertes nouvelles. Elles nous permettront d'abord de tirer
au clair les rapports de la l ibert avec ce qu' on nomme la
volont . Une tendance, assez commune, en effet , vise assimiler
les actes libres aux actes volontaires, et rserver l'explication
dterministe au monde des passions. C'est, en somme, l e point de
vue de Descartes. La volont cartsienne est libre, mais i l y a des
passions de l'me . Encore Descartes tentera-t-il une interprta
tion physiologique de ces passions. Plus tard on tentera d'instaurer
un dterminisme purement psychologique. Les analyses intellectua
listes qu'un Proust, par exempl e, a tentes de l a jalousie ou du
snobisme peuvent servir d'il l ustrations cette conception du mca
nisme passionnel . Il faudrait donc concevoir l'homme comme la
fois libre et dtermin ; et le problme essentiel serait celui des
rapports de cette libert i nconditionne avec l es processus dter
mins de l a vie psychique : comment domi nera-t-elle les passions,
comment les utilisera-t-elle son profit ? Une sagesse qui vient de
loin - l a sagesse stoci enne - enseignera composer avec ses
passions pour pouvoir les dominer ; bref, on conseillera de se
conduire par rapport l'affectivit comme fait l ' homme vis--vis de
la nature en gnral, lorsqu'il l ui obit pour mieux l a commander.
La ralit-humaine apparat donc comme un libre pouvoir assig
par un ensembl e de processus dtermins. On distinguera des actes
485
entirement l ibres, des processus dtermins sur lesquels la volont
libre a pouvoi r, des processus qui chappent par principe l a volont
humaine.
On voit que nous ne saurions aucunement accepter une semblable
concepti on. Mais tentons de mieux comprendre les raisons de notre
refus. Il est une objection qui va de SOI et que nous ne perdrons pas de
temps dvelopper : c'est qu'une pareille dualit tranche est
inconcevable au sein de l'unit psychique. Comment concevoir, en
effet, un tre qui serait un et qui, pourtant, d'une part, se constitue
rait comme une srie de faits dtermins les uns par les autres et, par
sui te, existants en extriorit et, d'autre part, comme une spontanit
se dterminant tre et ne relevant que d'elle-mme ? A priori, cette
spontanit ne serait suscepti bl e d'aucune action sur un dterminisme
dj constitu : sur quoi pourrait-elle agi r ? sur l'objet lui-mme (l e
fait psychique prsent) ? Mais comment pourrait-elle modifier un en
soi qui par dfinition n'est et ne peut tre que ce qu'il est ? Sur la loi
mme du processus ? Mais i l revient au mme d'agir sur l e fait
psychique prsent pour le modifier en lui-mme ou d'agir sur lui pour
modifier ses consquences. Et, dans les deux cas, nous rencontrons l a
mme impossibilit que nous signalions plus haut. D'ailleurs, de quel
instrument cette spontanit disposerai t-elle ? Si l a main peut pren
dre, c'est qu' el l e peut tre prise. L spontanit, tant par dfinition
hors d'alleinle, ne peut, son tour, alleindre : elle ne peut que se
produire el l e-mme. Et , si elle devait disposer d'un instrument
spci al , il faudrait donc l e concevoir comme une nature i ntermdiaire
entre l a vol ont l i bre et les passions dtermines, ce qui n'est pas
admissible. Inversement, bien entendu, les passions ne sauraient
avoir aucune prise sur l a volont. Il est en effet impossible un
processus dtermin d'agir sur une spontanit, exactement comme il
est impossi bl e aux objets d'agir sur la conscience. Aussi toute
synthse des deux types d'existants est impossible : ils ne sont pas
homognes, ils demeureront chacun dans leur incommunicable soli
tude, Le seul l ien que pourrait avoir une spontanit nantisante avec
les processus mcaniques, c'est de se produire elle-mme par ngation
interne partir de ces existants, Mais prcisment alors, elle ne sera
qu' en tant qu' el l e niera d' ell e-mme qu' el le soit ces passions
Dsormais l ' ensemble du n80 dtermin sera ncessairement saisi
par l a spontanit comme un pur transcendant, c'est--dire comme ce
qui est ncessairement dehors, comme ce qui n'est pas elle, Cette
ngation i nterne n'aurait donc pour effet que de fondre l e n80dans
le monde et il existerait, pour une libre spontanit qui serait la fois
volont et conscience, comme un objet quelconque au milieu du
monde. Cette discussion montre que deux solutions et deux seule
ment sont possibles : ou bien l'homme est entirement dtermin (ce
qui est inadmissible, en particul ier parce qu'une conscience dtermi-
486
ne, c'est--dire motive en extriorit, devient pure extriorit elle
mme et cesse d'tre conscience) ou bien l'homme est entirement
libre.
Mais ces remarques ne sont pas encore ce qui nous importe
particulirement. Elles n'ont qu'une porte ngative. L'tude de la
volont doit nous permettre, au contraire, d'aller plus avant dans la
comprhension de la libert. Et c'est pourquoi ce qui nous frappe
d'abord c'est que, si la volont doit tre autonome, i l est impossible
de l a considrer comme un fait psychique donn, c'est--dire en-soi .
Elle ne saurait appartenir l a catgorie des tats de conscience
dfinis par l e psychologue . Ici comme partout ailleurs nous constatons
que l'tat de conscience est une pure idole de l a psychologie positive.
La volont est ncessairement ngativit et puissance de nantisation
si elle doit tre libert. Mais alors nous ne voyons plus pourquoi on lui
rserverait l'autonomie. On conoit mal, en effet, ces trous de
nantisation qui seraient les volitions et qui surgiraient dans la trame
par ailleurs dense et pleine des passions et du miBo en gnral. Si la
volont est nantisation , i l faut que l'ensemble du psychique soit
semblabl ement nantisation. D'ailleurs - et nous y reviendrons
bientt - o prend-on que l e fait de passion ou que l e pur et
simple dsir ne soient pas nantisants ? La passion n'est-elle pas
d'abord projet et entreprise, ne pose-t-elle pas justement un tat de
choses comme intolrable et n'est-elle pas contrainte de ce fait de
prendre du recul par rapport lui et de le nantiser en l'isolant et en
le considrant la lumire d'une fin, c'est--dire d'un non-tre ? Et la
passion n'a-t-elle pas ses fins propres qui sont prcisment reconnues
dans l e moment mme o elle les pose comme non-existantes ? Et si la
nantisation est prcisment l'tre de l a libert, comment refuser
l'autonomie aux passions pour l'accorder la volont ?
Mais il y a plus : loin que la volont soit la manifestation unique ou
du moi ns privilgie de l a libert, el l e suppose, au contraire, comme
tout vnement du pour-soi , le fondement d'une libert origi nelle
pour pouvoir se constituer comme volont. La volont, en effet, se
pose comme dcision rflchie par rapport certaines fins. Mais ces
fins elle ne les cre pas. Elle est plutt une manire d'tre par rapport
elles : el l e dcrte que la poursuite de ces fins sera rflchie et
dlibre. La passion peut poser les mmes fins. Je puis, par exemple,
devant une menace, m'enfuir toutes jambes, par peur de mourir. Ce
fait passionnel n'en pose pas moins implicitement comme fin suprme
la valeur de l a vie. Tel autre comprendra, au contraire, qu'il faut
demeurer en place, mme si la rsistance parat d'abord plus
dangereuse que la fuite ; i l tiendra Mais son but, encore que
mieux compris et explicitement pos, demeure l e mme que dans l e
cas de l a raction motionnel l e. Simplement les moyens de l'atteindre
sont plus clairement conus, certains d'entre eux sont rejets comme
487
douteux ou inefficaces, les autres sont plus solidement organiss. La
diffrence porte ici sur l e choix des moyens et sur l e degr de rflexion
et d'explication, non sur la fin. Pourtant, le fuyard est dit passion
nel et nous rservons l'pithte de volont aire l'homme qui
rsiste. Il s'agit donc d'une diffrence d'attitude subjective par
rapport une fin transcendante. Mais si nous ne voulons pas tomber
dans l 'erreur que nous dnoncions plus haut, et considrer ces fins
transcendantes comme pr-humaines et comme une limite a priori de
notre transcendance, nous sommes bien obligs de reconnatre
qu'elles sont la projection temporalisante de notre libert. La ralit
humaine ne saurait recevoir ses fins, nous l'avons vu, ni du dehors, ni
d' une prtendue nature intrieure. Elle les choisit et, par ce choix
mme, leur confre une existence transcendante comme la limite
externe de ses projets. De ce point de vue -et si l'on entend bien que
l'existence du Dasein prcde et commande son essence -la ralit
humaine, dans et par son surgissement mme, dcide de dfinir son
tre propre par ses fins. C'est donc la position de mes fins ultimes qui
caractrise mon tre et qui s'identifie au jai llissement originel de la
l i bert qui est mienne. Et ce jail l issement est une exitence, i l n'a rien
d'une essence ou d'une proprit d'un tre qui serait engendr
conjointement une ide. Ainsi la libert, tant assimilable mon
existence , est fondement des fins que je tenterai d'attei ndre, soit par
l a volont, soit par des efforts passionnels. Elle ne saurait donc se
l i miter aux actes volontaires. Mais les volitions sont, au contraire,
comme les passions, certaines attitudes subjectives par lesquelles
nous tentons d' atteindre aux fins poses par la libert originelle. Par
libert origi nell e, bien entendu, i l ne faut pas entendre une libert qui
serait antrieure l'acte volontaire ou passionn, mais un fondement
rigoureusement contemporain de l a volont ou de l a passion et que
celles-ci manifestent chacune sa manire. Il ne faudrait pas non plus
opposer la libert l a volont ou l a passion comme le moi
profond de Bergson au moi superficiel : l e pour-soi est tout entier
ipsi t et ne saurait avoir de moi-profond moins que l'on
n' ent ende par l certaines structures transcendantes de la psych. La
libert n'est rien autre que l' existence de notre volont ou de nos
passi ons, en tant que cette existence est nantisation de la facticit,
c'est--dire celle d'un tre qui est son tre sur l e mode d'avoir l'tre.
Nous y reviendrons. Retenons en tout cas que la volont se dtermine
dans le cadre de mobiles et de fins dj poses par l e pour-soi dans un
projet transcendant de lui-mme vers ses possibles. Sinon, comment
purrait-on comprendre la dlibration qui est apprciation des
moyens par rapport des fins dj existantes ?
Si ces fins sont dj poses, ce qui reste dcider tout instant c'est
la faon dont je me conduirai vis--vis d'elles, autrement dit l'attitude
que j e prendrai. Serai-je volontaire ou passionn ? Qui peut le
488
dcider sinon moi ? Si , en effet , nous admettions que les circonstances
en dcident pour moi (par exemple, je pourrais tre volontaire en
face d' un petit danger, mais si l e pril crot, je tomberais dans la
passion) nous supprimerions par l toute libert : il serait absurde, en
effet , de dclarer que l a volont est autonome lorsqu'elle appara t,
mais que les circonstances extrieures dterminent rigoureusement l e
moment de son apparition. Mais comment soutenir, d'autre part ,
qu'une volont qui n' existe pas encore peut dcider soudain. de briser
l'enchanement des passions et de surgir soudain sur les dbris de cet
enchanement ? Une pareille conception amnerait considrer la
volont comme un pouvoir qui , tantt se manifesterait l a cons
cience, et tantt demeurerait cach, mais qui possderait en tout cas
la permanence et l' existence en-soi d' une proprit. C'est prcis
ment ce qui est inadmissible : il est certain, cependant, que l'opinion
commune conoit l a vie morale comme une lutte entre une volont
chose et des passions-substances. I l y a l comme une sorte de
manichisme psychologique absolument insoutenable. En fait, il ne
suffit pas de vouloir : il faut vouloir vouloir. Soit par exemple une
situation donne : j e puis y ragir motionnellement. Nous avons
montr aill eurs que l'motion n'est pas un orage physiologique 1 :
c'est une rponse adapte la situation ; c'est une conduite dont le
sens et la forme sont l'objet d'une i ntention de la conscience qui vise
atteindre une fin particulire par des moyens particuliers. L'vanouis
sement, l a cataplexic, dans l a peur, visent supprimer le danger en
supprimant la conscience du danger. Il y a intention de perdre
conscience pour abolir le monde redoutable o la conscience est
engage et qui vient l'tre par elle. Il s'agit donc de conduites
magiques provoquant des assouvissements symboliques de nos dsirs
et qui rvlent, du mme coup, une couche magique du monde. En
opposition ces conduites, l a conduite volontaire et rationnelle
envisagera techni quement la situation, refusera l e magique et s'appli
quera saisir les sries dtermines et les complexes instrumentaux
qui permettent de rsoudre les problmes. Elle organisera un systme
de moyens en se basant sur le dterminisme instrumental. Du coup,
elle dcouvrira un monde technique, c'est--dire un monde dans
lequel chaque complexe-ustensile renvoie un autre complexe plus
large et ainsi de sui te. Mais qui me dcidera choisir l'aspect magique
ou l'aspect technique du monde ? Ce ne saurait tre le monde lui
mme - qui , pour se manifester, attend d'tre dcouvert. Il faut
donc que le pour-soi, dans son projet, choisisse d'tre celui par qui l e
monde se dvoile comme magique ou rationnel , c'est--dire qu' i l doi t,
comme l i bre pro jet de soi , se donner l'existence magique ou
1 . J. P. Sartre : Esquise d'une thorie phnomnologique des motions,
Hermann, 1939.
489
l'existence rationnel l e. De l'une comme de l'autre il est responsable ;
car il ne peut tre que s'il s'est choisi. Il apparat donc comme le libre
fondement de ses motions comme de ses volitions. Ma peur est libre
et manifeste ma libert, j'ai mis toute ma libert dans ma peur et je
me suis choi si peureux en telle ou telle circonstance ; en tel l e autre
j'existerai comme volontaire et courageux et j 'aurai mis toute ma
libert dans mon courage. I l n'y a, par rapport l a libert, aucun
phnomne psychique privilgi. Toutes mes manires d'tre l a
mani festent galement puisqu'elles sont toutes des faons d'tre mon
propre nant.
C'est ce que marquera mieux encore l a description de ce qu' on
nomme l es motifs et les mobiles de l'action. Nous avons esquiss
cette description dans les pages prcdentes : i l convient prsent d'y
revenir et de la reprendre plus prcisment. Ne dit-on pas en effet que
la passion est mobile de l'acte -ou encore que l'acte passionnel est
celui qui a la passion pour mobile ? Et l a volont n'apparat-elle pas
comme l a dcision qui succde une dli bration au sujet des mobiles
et des motifs ? Qu'est-ce donc qu'un motif ? Qu'est-ce qu' un mobile ?
On entend ordinairement par motifl a raison d'un acte ; c'est--dire
l'ensemble des considrations rationnelles qui l e justifient. Si le
gouvernement dcide une conversion des rentes, i l donnera ses
motifs : di mi nution de l a dette publique, assainissement de l a
Trsorerie . C'est galement par des motifs que l es historiens ont
coutume d'expliquer l es actes des ministres ou des monarques ; une
dclaration de guerre, on cherchera des motifs : l'occasion est
propice, l e pays attaqu est dcompos par les troubles intrieurs, i l
est temps de mettre fi n un conflit conomique qui risque de
s'terniser. Si Clovis se convertit au catholicisme, al ors que tant de
roi s barbares sont ariens, c' est qu' il voi t l une occasion de se concilier
l es bonnes grces de l'piscopat, tout-puissant en Gaul e, etc. On
notera que l e motif se caractrise, de ce fait, comme une apprciation
objective de la situation. Le motif de la conversion de Clovis, c'est
l'tat pol i ti que et religieux de la Gaule, c'est le rapport de forces entre
l ' piscopat, les grands propritaires et le petit peuple ; ce qui motive
la conversion des rentes, c'est l'tat de l a dette publ i que. Toutefois,
cette apprciation objective ne peut se faire qu' la lueur d'une fin
prsuppose et dans l es limites d'un projet du pour-soi vers cette fin.
Pour que l a puissance de l'piscopat se rvle Clovis, comme motif
d' une conversion, c'est--dire pour qu'il puisse envisager les cons
quences objectives que pourrait avoir cette conversion, il faut d'abord
qu' i l ait pos comme fin l a conqute de la Gaule. Si nous supposons
d' autres fins Clovis, i l peut trouver dans la situation de l'piscopat
des motifs de se faire arien ou de demeurer paen. Il peut mme ne
trouver aucun motif d' agir de telle ou telle faon dans l a considration
de l'tat de l'Eglise : i l ne dcouvrira donc rien ce sujet , i l laissera la
490
situation de l'piscopat l'tat de non-dvoil , dans une obscurit
totale. Nous appellerons donc motif l a saisie objective d'une situation
dtermine en tant que cette situation se rvle, la lumire d'une
certaine fi n, comme pouvant servir de moyen pour atteindre cette fin.
Le mobi l e, a u contraire, est considr ordinairement comme un fai t
subjectif. C' est l'ensemble des dsirs, des motions et des passions qui
me poussent accomplir un certain acte. L'historien ne recherche les
mobiles et n' en fait tat qu'en dsespoir de cause, lorsque les motifs
ne suffisent pas expliquer l'acte envisag. Lorsque Ferdinand Lot,
par exempl e, crit, aprs avoir montr que les raisons qu'on donne
ordi nairement l a conversion de Constantin sont insuffisantes ou
errones : Puisqu'il est avr que Constantin avait tout perdre et,
en apparence, ri en gagner embrasser l e christianisme, i l n'y a
qu'une conclusion possi bl e, c'est qu'il a cd une impulsion
soudaine, d'ordre pathologique ou divi n, comme on voudra 1 , il
abandonne l ' expli cation par les motifs qui l ui parat i rrvlante et l ui
prfre l'explication par les mobi l es. L'explication doi t tre alors
cherche dans l'tat psychique -mme dans l'tat mental -de
l'agent historique. Il s' ensui t naturellement que l'vnement devient
entirement contingent puisqu'un autre i ndividu, avec d'autres pas
sions et d'autres dsirs, aurait agi diffremment. Le psychologue, au
contraire de l ' historien, cherchera de prfrence les mobiles : i l
suppose ordinairement, en effet, qu'ils sont contenus dans l'tat
de conscience qui a provoqu l'acti on. L'acte rationnel idal serait
donc celui pour lequel les mobiles seraient pratiquement nuls et qui
serait inspir uniquement par une apprciation objective de la
situation. L'acte i rrationnel ou passionnel sera caractris par la
proportion inverse. Reste expliquer la relation des motifs aux
mobiles dans le cas banal o ils existent les uns et les autres. Par
exemple, je puis adhrer au parti socialiste parce que j' estime que ce
parti sert les i ntrts de la justice et de l ' humanit, ou parce que je
crois qu'il deviendra la principale force historique dans les annes qui
suivront mon adhsion : ce sont l des motifs. Et, en mme temps, j e
puis avoir des mobiles : sentiment de piti ou de charit pour
certaines catgories d'opprims, honte d' tre du bon ct de l a
barricade , comme dit Gi de, ou encore complexe d' infriorit, dsir
de scandaliser mes proches, etc. Que pourra-t-on vouloir dire
lorsqu'on affirmera que j 'ai adhr au parti socialiste cause de ces
motifs el de ces mobiles ? Il s'agit videmment de deux couches de
significations radicalement distinctes. Comment les comparer, com
ment dterminer la part de chacune d'elles dans l a dcision envisa
ge ? Cette difficult, qui est certes la plus grande de celles que suscite
1 . Ferdinand Lot : La fin du monde antique et le dbut du moyen ge, p. 35.
Renaissance du Livre, 1927.
491
la distinction courante entre motifs et mobiles, n' a jamais t rsolue ;
peu de gens, mme, l'ont simplement entrevue. C'est qu'elle revient,
sous une autre forme, poser l'existence d'un conflit entre la volont
et les passions. Mais si la thorie classique se rvle incapable
d'assigner au motif et au mobile leur influence propre dans l e cas
simple o ils concourent l' un et l'autre entraner une mme
dcision, il lui sera tout fait impossible d'expliquer et mme de
concevoir un conflit de motifs et de mobiles dont chaque groupe
solliciterait une dcision particulire. Tout est donc reprendre du
dbut.
Certes, le motif est objectif : c'est l'tat de choses contemporain,
tel qu'il se dvoile une conscience. I l est objectif que la plbe et
l' aristocratie romaines sont corrompues du temps de Constantin ou
que l'Eglise catholique est prte favoriser un monarque qui , du
temps de Clovis, l'aidera triompher de l'arianisme. Toutefois cet
tat de choses ne peut se rvler qu' un pour-soi, puisque, en
gnral, le pour-soi est l'tre par lequel il y a un monde. Mieux
encore, i l ne peut se rvler qu' un pour-soi qui se choisit de telle ou
telle manire, c'est--dire un pour-soi qui s'est fait son individualit.
Il faut s'tre projet de telle ou tel le manire pour dcouvrir les
implications instrumentales des choses-ustensiles. Objectivement le
couteau est un instrument fait d' une lame et d'un manche. Je puis le
saisir objectivement comme instrument trancher, couper ; mais,
dfaut de marteau, je puis, inversement, le saisir comme instrument
marteler : j e puis me servir de son manche pour enfoncer un clou et
cette saisie n' est pas moins objective. Lorsque Clovis apprcie l'aide
que peut lui fournir l'Eglise, i l n'est pas certain qu'un groupe de
prlats ou mme qu'un vque particulier lui ait fait des ouvertures,
ni mme qu'un membre du clerg ait clairement pens une alliance
avec un monarque catholique. Les seuls faits strictement objectifs,
ceux qu' un pour-soi quelconque peut constater, c'est l a grande
puissance de l'Eglise sur les populations de Gaule et l'inquitude de
l 'Eglise touchant l'hrsie ari enne. Pour que ces constatations s'orga
nisent en motif de conversion, il faut les isoler de l'ensemble - et
pour cela les nantiser - et i l faut les transcender vers leur
potentialit propre : la potentialit de l'Eglise objectivement saisie
par Clovis sera d'apporter son soutien un roi converti. Mais cette
potentialit ne peut se rvler que si on dpasse la situation vers un
tat de choses qui n'est pas encore, bref, vers un nant. En un mot, le
monde ne donne de conseils que si on l'i nterroge et on ne peut
l' interroger que pour une fin bien dtermine. Loin donc que le motif
dtermine l'acti on, i l n' apparat que dans et par le projet d'une
action. C' est dans et par le proj et d'installer sa domination sur toute
la Gaule que l'tat de l'Eglise d'Occident apparat objectivement
Clovis comme un motif de se convertir. Autrement dit, la conscience
492
qui dcoupe le motif dans l 'ensemble du monde a dj sa structure
propre, el l e s'est donn ses fins, el l e s'est projete vers ses possibles et
elle a sa manire propre de se suspendre ses possibilits : cette
manire propre de tenir ses possibles est ici l ' affectivit. Et cette
organisation interne que la conscience s'est donne, sous forme de
conscience non-positionnelle (de) soi, est rigoureusement corrlative
du dcoupage des motifs dans le monde. Or, si l'on y rflchit, on doit
reconnatre que la structure interne du pour-soi par quoi il fait surgir
dans le monde des motifs d'agir est un fait irrationnel au sens
historique du terme. Nous pouvons bi en, en effet, comprendre
rationnel l ement l'utilit technique de l a conversion de Clovis, dans
l'hypothse o il aurait proj et de conqurir l a Gaule. Mais nous ne
pouvons faire de mme quant son projet de conqute. Il ne peut
s'expliquer . Faut-il J'interprter comme un effet de l'ambition de
Clovis ? Mais prcisment qu'est-ce que l ' ambition, sinon le dessein
de conquri r ? Comment l'ambition de Clovis se serait-elle distingue
du projet prcis de conqurir la Gaule ? Il serait donc vain de
concevoir ce projet originel de conqute comme pouss par un
mobile prexistant, qui serait l 'ambi tion. Il est bien vrai que
l'ambition est un mobile, puisqu'elle est toute subjectivit. Mais
comme elle ne se distingue pas du projet de conqurir, nous dirons
que ce projet premier de ses possibilits, la l ueur duquel Clovis
dcouvre un motif de se convertir, est prcisment le mobile. Alors,
tout s'claire et nous pouvons concevoir les relations de ces trois
termes, motifs, mobiles, fins. Nous avons affaire ici un cas
particul i er de l 'tre-dans-Ie-monde : de mme que c'est l e surgisse
ment du pour-soi qui fait qu' i l y ai t un monde, de mme c'est ici son
tre mme, en tant que cet tre est pur projet vers une fin, qui fait
qu'il y ait une certaine structure objective du monde qui mrite l e
nom de motif l a lueur de cette fin . Le pour-soi est donc conscience
de ce motif. Mais cette conscience positionnelle du motif est par
principe conscience non-thtique de soi comme projet vers une fin.
En ce sens el l e est mobil e, c'est--dire qu'elle s'prouve non
thtiquement comme projet plus ou moins pre, plus ou moins
passionn vers une fin dans l e moment mme o elle se constitue
comme conscience rvlante de l'organisation du monde en motifs.
Ainsi motif et mobile sont corrlatifs, exactement comme la
conscience non-thtique (de) soi est le corrlatif ontologique de la
conscience thtique de l'objet. De mme que la conscience de
quelque chose est conscience (de) soi, de mme l e mobile n'est rien
autre que la saisie du motif en tant que cette saisie est consciente (de)
soi. Mais il s'ensuit videmment que l e motif, l e mobile et la fin sont
les trois termes indissolubles du jaillissement d'une conscience
vivante et libre qui se projette vers ses possibilits et se fait dfinir par
ces possibilits.
493
D'o vient alors que le mobile apparat au psychologue comme
contenu affectif d'un fait de conscience en tant que ce contenu
dtermine un autre fait de conscience ou dcision ? C'est que le
mobile, qui n' est rien autre que la conscience non-thtique de soi,
glisse au pass avec cette conscience mme et cesse d'tre vivant en
mme temps qu'elle. Ds qu' une conscience est passifie, elle est ce
que j 'ai tre sous la forme du tais . Ds lors, quand je reviens
sur ma conscience d'hier, elle garde sa signification intentionnelle et
son sens de subjectivit, mais, nous l'avons vu, elle est fige, elle est
dehors comme une chose, puisque le pass est en soi . Le mobile
devi ent alors ce donl il y a conscience. Il peut m'apparatre sous forme
de savoir ; nous avons vu, en effet, plus haut, que le pass mort
hante le prsent sous l'aspect d' un savoir ; il se peut aussi que je me
retourne vers lui pour l'expliciter et le formuler en me guidant sur le
savoir qu' il est prsentement pour moi . En ce cas, il est objet de
conscience, il est cette conscience mme donl j'ai conscience. I l
apparat donc -comme mes souvenirs en gnral - l a fois comme
mien et comme transcendant . Nous sommes, l'ordinaire, entours
de ces mobiles o nous n' entrons plus parce que nous n'avons pas
seulement dcider concrtement d'accomplir tel ou tel acte, mais
encore accomplir des actions que nous avons dcides la veille ou
poursuivre des entreprises o nous sommes engags ; d'une faon
gnrale, la conscience, quelque moment qu'elle se saisisse,
s'apprhende comme engage et cette apprhension mme iinplique
un savoir des mobiles de l'engagement ou mme une explication
thmatique et positionnelle de ces motifs. Il va de soi que la saisie du
mobile renvoie aussitt au motif son corrlatif, puisque le mobile,
mme passifi et fig en en-soi, garde du moins pour signification
d'avoir t conscience d' un motif, c'est--dire dcouverte d'une
structure objective du monde. Mais, comme le mobile est en-soi et
que l e motif est objectif, ils se prsentent comme un couple sans
diffrence ontologique ; on a vu, en effet, que notre pass se perd au
milieu du monde. Voil pourquoi nous les traitons sur le mme pied
et pourquoi nous pouvons parler des motifs et des mobiles d' une
action, comme s'ils pouvaient entrer en conflit ou concourir les uns et
les autres dans une proportion dtermine la dcision.
Seulement, si l e mobile est transcendant, s'il est seulement l'tre
irrmdiable que nous avons tre sur le mode du tais , si ,
comme tout notre pass, i l est spar de nous par une paisseur de
nant, i l ne peut agir que s'il est repris ; par lui-mme il est sans force.
Cest donc par le jaillissement mme de la conscience engage qu'une
valeur et un poids seront confrs aux mobiles et aux motifs
antrieurs. Il ne dpend pas d'elle qu'ils aient t et elle a pour
mission de leur maintenir l'existence au pass. J'ai voulu ceci ou cela :
voil qui demeure irrmdiable et qui constitue mme mon essence
494
puisque mon essence est ce que j' ai t. Mais l e sens que ce dsir, que
cette crainte, que ces considrations objectives sur le monde ont pour
moi quand prsentement je me projette vers mes futurs, c'est moi seul
qui peux en dcider. Et je n'en dcide, prcisment, que par l'acte
mme par lequel je me pro-jette vers mes fins. La reprise des mobiles
anciens -ou leur rejet ou leur apprciation neuve -ne se distingue
pas du projet par quoi je m'assigne des fins nouvelles et par quoi, la
lumire de ces fins, je me saisis comme dcouvrant un motif d'appui
dans l e monde. Mobiles passs, motifs passs, motifs et mobiles
prsents, fins futUres s'organisent en une indissoluble unit par le
surgissement mme d' une libert qui est par del les motifs, les
mobiles et les fins.
De cela rsulte que l a dlibration volontaire est toujours truque.
Comment, en effet, apprcier des motifs et des mobiles auxquels
prcisment j e confre leur valeur avant toute dli bration et par le
choix que je fais de moi-mme ? L'illusion ici vient de ce qu'on
s'efforce de prendre les motifs et les mobiles pour des choses
entirement transcendantes, que je soupserais comme des poids et
qui possderaient un poids comme une proprit permanente,
cependant que , d'autre part, on veut y voir des contenus de
conscience ; ce qui est contradictoire. En fait, motifs et mobiles n'ont
que l e poids que mon projet, c'est--dire l a libre production de la fin
et de l'acte comme raliser, l eur confre. Quand je dlibre, les
jeux sont faits. Et si je dois en venir dlibrer, c'est simplement
parce qu'il entre dans mon projet originel de me rendre compte des
mobiles par la dlibrtion plutt que par telle ou telle autre forme de
dcouverte (par la passion, par exemple, ou tout simplement par
l'action, qui rvle l'ensemble organis des motifs et des fins comme
mon l angage m'apprend ma pense) . Il y a donc un choix de la
dlibration comme procd qui m'annoncera ce que je projette, et
par suite ce que je sui s. Et le choix de la dlibration est organis avec
l'ensemble mobiles-motifs et fin par la spontanit libre. Quand la
volont intervient, la dcision est prise et elle n'a d'autre valeur que
celle d'une annonciatrice.
L'acte volontaire se distingue de l a spontanit non volontaire en
ce que l a seconde est conscience purement irrflchie des motifs
travers le projet pur et simple de l'acte. Pour le mobile, dans l'acte
irrflchi , i l n'est point objet pour lui-mme mais simple conscience
non-positionnel l e (de) soi . La structure de l'acte volontaire, au
contrai re, exige l'apparition d'une conscience rflexive qui saisit le
mobile comme quasi-obj et, ou mme qui l'intentionne comme objet
psychique travers la conscience rflchi e. Pour celle-ci, l e mobile
tant saisi par l'intermdiaire de la conscience rflchie est comme
spar ; pour reprendre la formule clbre de Husserl, la simple
rflexion vol ontaire , par sa structure de rflexivit, pratique
495
l'.xlj l ' gard du motif, elle le tient en suspens, elle l e met entre
parenthses. Ainsi peut-il s'amorcer une semblance de dlibration
apprciative, du fait qu'une nantisation plus profonde spare la
conscience rflexive de l a conscience rflchie ou mobile et du fait
que le mobile est en suspens. Toutefois, on l e sait, si le rsultat de la
rflexion est d'largir l a faille qui spare le pour-soi de lui-mme, tel
n'est pas, pour autant, son but. Le but de la scissiparit rflexive est,
nous l 'avons vu, de rcuprer le rflchi, de manire constituer cette
totalit irralisable en-soi-pour-soi qui est la valeur fondamentale
pose par l e pour-soi dans l e surgissement mme de son tre. Si donc
la vol ont est par essence rflexive, son but n'est pas tant de dcider
quel l e fin est atteindre puisque, de toute faon, les j eux sont faits,
l'intention profonde de la volont porte plutt sur la manire
d'atteindre cette fin dj pose. Le pour-soi qui existe sur le mode
vol ontaire veut se rcuprer lui-mme en tant qu'il dcide et agit. Il
ne veut pas seulement tre port vers une fin, ni tre celui qui se
choisit comme port vers telle fin : i l veut encore se rcuprer lui
mme en tant que projet spontan vers telle ou telle fi n. L'idal de la
volont, c'est d'tre un en-soi-po ur-soi en tant que projet vers une
certaine fin : c'est videmment un idal rflexif et c'est l e sens de la
satisfaction qui accompagne un jugement tel que J'ai fait ce que j 'ai
voul u. Mais i l est vident que la scissiparit rflexive en gnral a
son fondement dans un projet plus profond qu'elle-mme, que nous
appelions faute de mieux motivation dans l e chapitre I I I de notre
deuxime partie. Il faut , prsent que nous avons dfini l e motif et l e
mobile, nommer ce projet qui sous-tend l a rflexion, une intention.
Dans la mesure donc o l a volont est un cas de rflexion, l e fait de se
placer pour agir sur le pl an volontaire rclame pour fondement une
intention plus profonde. Il ne suffit pas au psychologue de dcrire tel
sujet Comme ralisant son projet sur l e mode de l a rflexion
volontaire ; il faut encore qu'il soit capable de nous livrer l'intention
profonde qui fait que le sujet ralise son projet sur ce mode de l a
vol ition plutt que sur tout autre mode, tant bien entendu,
d'ailleurs, que n' i mporte quel mode de conscience et amen la
mme ralisation, une fois les fins poses par un projet original . Ainsi
avons-nous attei nt une libert plus profonde que l a volont, simple
ment en nous montrant plus exigeants que les psychologues, c'est-
dire en posant la question du pourquoi, l o ils se bornent constater
le mode de conscience comme volitionnel.
Cette brve tude ne vise pas puiser la question de l a volont : il
conviendrait, au contraire, de tenter une description phnomnologi
que de l a volont pour elle-mme. Ce n'est pas notre but : nous
esprons avoir montr simplement que l a volont n'est pas une
manifestation privil gie de l a libert, mais qu'elle est un vnement
psychique d'une structure propre, qui se constitue sur le mme plan
496
que les autres et qui est support, ni plus ni moins que les autres, par
une libert originelle et ontologique.
Du mme coup, la libert apparat comme une totalit inanalysa
ble : les motifs, les mobiles et les fins, comme aussi bien la manire de
saisir les motifs, les mobiles et les fins, sont organiss unitairement
dans les cadres de cette libert et doivent se comprendre partir
d'elle. Est-ce dire qu'il faille se reprsenter la libert comme une
srie d'-coups capricieux et comparables au clinamen picurien ?
Suis-je libre de vouloir n'importe quoi n'importe quel moment ? Et
dois-je, chaque instant, lorsque j e veux expliquer tel ou tel projet,
rencontrer l'irrationnel d'un choix libre et contingent ? Tant qu'i! a
paru que la reconnaissance de la l i bert avait pour consquence ces
conceptions dangereuses et en complte contradiction avec l'exp
rience, de bons esprits se sont dtourns de l a croyance en la libert :
on a mme pu affirmer que le dterminisme -si on se gardait de l e
confondre avec le fatalisme -tait plus humain que la thorie du
libre arbitre ; si , en effet , i! met en relief l e conditionnement
rigoureux de nos actes, au moins donne-t-il la raison de chacun d'eux
et, s'il se l i mite ngoureusement au psychique, s'i! renonce chercher
un conditionnement dans l'ensemble de l'univers, il montre que la
liaison de nos actes est en nous-mmes : nous agissons comme nous
sommes et nos actes contribuent nous faire.
Considrons de plus prs cependant les quelques rsultats certains
que notre analyse nous a permis d'acqurir. Nous avons montr que
la libert ne faisait qu'un avec l' tre du pour-soi : la ralit-humaine
est l ibre dans l'exacte mesure o elle a tre son propre nant. Ce
nant, nous l'avons vu, elle a l'tre dans de multiples dimensions '
d'abord en se temporalisant, c'est--dire en tant toujours distance
d'elle-mme, ce qui implique qu'elle ne peut jamais se laisser
dterminer par son pass tel ou tel acte - ensuite en surgissant
comme conscience de quelque chose et (de) soi-mme, c'est--dire en
tant prsence soi et non simplement soi , ce qui implique que rien
n'existe dans la conscience qui ne soit conscience d'exister et que, en
consquence, ri en d'extrieur l a conscience ne peut la motiver -
enfin en tant transcendance, c'est--dire non pas quelque chose qui
serait d'abord pour se mettre ensuite en relation avec telle ou telle fin,
mais a u contraire un tre qui est originellement pro-jet, c'est--dire
qui se dfinit par sa fin.
Ainsi n' entendons-nous nullement parler ici d'arbitraire ou de
caprice : un existant qui, comme conscience, est ncessairement
spar de tous les autres, car ils ne sont en liaison avec lui que dans l a
mesure o i l s sont pour lui, qui dcide de son pass sous forme de
tradition l a lumire de son futur, au l i eu de l e laisser purement et
simplement dterminer son prsent, et qui se fait annoncer ce qu'il est
par autre chose que lui, c'est--dire par une fin qu'il n'est pas et qu'il
497
projette de l'autre ct du monde, voil ce que nous nommons un
existant libre. Cela ne signifie aucunement que je sois libre de me
lever ou de m'asseoir, d'entrer ou de sortir, de fuir ou de faire face au
danger, si l'on entend par libert une pure contingence capricieuse,
i llgal e, gratuite et incomprhensible. Certes, chacun de mes actes,
ft-ce l e pl us peti t, est entirement libre, au sens que nous venons de
prciser ; mais cela ne signifie pas qu'il puisse tre quelconque, ni
mme qu' i l soit imprvisible. Pourtant, dira-t-on, s i l ' on ne peut l e
comprendre ni partir de l'tat du monde ni partir de l'ensemble de
mon pass pris comme chose irrmdiable, comment serait-il possible
qu'il ne ft pas gratuit ? Regardons-y mi eux.
Pour l'opinion courant e, tre libre ne signifie pas seulement se
choisi r. Le choi x est di t libre s'il est tel qu' il et pu tre autre qu' il
n' est. Je suis parti en excursion avec des camarades. Au bout de
plusieurs heures de marche ma fatigue crot, el le finit par devenir trs
pnible. Je rsiste d'abord et puis, tout coup, je me laisse aller, j e
cde, j e jette mon sac sur l e bord de l a route et je me laisse tomber
ct de l ui . On me reprochera mon acte et l'on entendra par l que
j'tais l i bre, c'est--dire non seulement que rien ni personne n' a
dtermin mon acte, mai s encore que j'aurais pu rsister ma fatigue,
faire comme mes compagnons de route et attendre l'tape pour
prendre du repos. Je me dfendrai en disant que j'tais trop fatigu.
Qui a raison ? Ou plutt, l e dbat n'est-il pas tabli sur des bases
errones ? Il ne fait pas de doute que j'eusse pu faire autrement, mais
le probl me n'est pas l. Il faudrait plutt le formuler ainsi : pouvais
je faire autrement sans modifier sensiblement la totalit organique
des projets que je suis, ou bien l e fait de rsister ma fatigue, au lieu
de demeurer une pure modification locale et accidentelle de mon
comportement , ne peut-il se produire qu' l a faveur d' une transfor
m
ation radicale de mon tre-dans-le-monde -transformation d'ail
leurs possible. Autrement dit : j 'aurais pu faire autrement, soit ; mais
quel prix ?
A cette question nous allons d'abord rpondre par une description
thorique qui nous permettra de saisir le principe de notre thse. Nous
verrons ensuite si l a ralit concrte ne se montre pas plus complexe
et si , sans contredire aux rsultats de notre recherche thorique, elle
ne nous amnera pas les assouplir et les enrichir.
Notons d'abord que l a fatigue en elle-mme ne saurait provoquer
ma dcision. Elle n'est - nous l'avons vu propos de la douleur
p
hysique - que l a faon dont j 'existe mon corps. El l e ne fait pas
d' abord l 'objet d'une conscience positionnelle, mais elle est la
facticit mme de ma conscience. Si donc je marche travers la
campagne
, ce qui se rvle moi c'est le monde environnant, c'est lui
qui est l'objet de ma conscience, c'est l ui que j e transcende vers des
possibilits qui me sont propres - celle, par exemple, d'arriver ce
498
soir au l i eu que je me suis fix d'avance. Seulement, dans la mesure
o je saisis ce paysage avec mes yeux qui dplient les distances, avec
mes jambes qui gravissent les ctes et font, de ce fait, apparatre et
disparatre de nouveaux spectacles, de nouveaux obstacles, avec mon
dos qui porte l e sac, j'ai une conscience non-positionnelle (de) ce
corps - qui rgle mes rapports avec l e monde et qui signifie mon
engagement dans l e monde -sous forme de fatigue. Objectivement
et en corrlation avec cette conscience non-thtique, les routes se
rvlent comme i nterminables, l es pentes comme plus dures, l e soleil
comme plus ardent , etc. Mais j e ne pense pas encore ma fatigue, je ne
la saisis pas comme quasi-objet de ma rflexion. Vient un moment,
pourtant, o je cherche la considrer et la rcuprer : de cette
intention mme i l faudra fourni r une interprtation. Prenons-la,
cependant, pour ce qu' elle est . El l e n'est point apprhension contem
plative de ma fatigue : mais -nous l'avons vu propos de la douleur
-je souffre ma fatigue. C'est--dire qu'une conscience rflexive se
dirige sur ma fatigue pour l a vivre et pour l ui confrer une valeur et
un rapport pratique moi-mme. C'est seulement sur ce plan que la
fatigue m'apparatra comme supportable ou intolrable. Elle ne sera
jamais rien de cel a en elle-mme, mais c'est le pour-soi rflexif qui , en
surgissant, souffre l a fatigue comme intolrable. Ici se pose l a
question essenti el l e : mes compagnons de route sont en bonne sant
comme moi ; ils sont peu de chose prs aussi entrans que moi, en
sorte que, bien qu' il ne soit pas possible de comparer des vnements
psychiques qui se droulent dans des subjectivits diffrentes, j e
conclus ordinairement -et l es tmoins concluent d'aprs l a consid
ration objective de nos corps-pour-autrui - qu'ils sont peu prs
aussi fatigus que moi . D'o vient donc qu'ils souffrent diffrem
ment de leur fatigue ? On dira que la diffrence vient de ce que j e
suis douillet et qu'ils ne l e sont pas. Mais, bi en que cette
apprciation ai t une porte pratique indniable et qu'on puisse tabler
sur elle lorsqu'il s'agira de dcider si on me convie ou non une autre
excursion, el l e ne saurait nous satisfaire ici . Nous l'avons vu, en effet,
tre ambitieux, c'est projeter de conqurir un trne ou des honneurs ;
ce n'est pas une donne qui pousserait la conqute, c'est cette
conqute elle-mme. Pareil l ement, tre douillet ne saurait tre
une donne de fait et n'est qu'un nom donn la faon dont je souffre
ma fatigue. Si donc j e veux comprendre quelles conditions je puis
souffrir une fatigue comme i ntolrabl e, i l ne convient pas de
s'adresser de prtendues donnes de fait, qui se rvlent n'tre
qu'un choix, il faut tenter d'examiner ce choix lui-mme et voir s'il ne
s'explique pas dans la perspective d'un choix plus large o il
s'intgrerait comme une structure secondaire . Si j' interroge, en effet,
l'un de ces compagnons, il m'expliquera qu'il est fatigu, certes, mais
qu'il aime sa fatigue : i l s' y abandonne comme un bain, el l e lui
499
parat en quel que sorte l'instrument privilgi pour dcouvrir l e
monde qui l'entoure, pour s'adapter la rudesse rocailleuse des
chemi ns , pour dcouvrir l a valeur " montagneuse des pentes ; de
mme c'est cette insolation lgre de sa nuque et ce lger bourdonne
ment d'orei lles qui lui permettront de raliser un contact direct avec
le solei l . Enfin, l e sentiment de l ' effort est pour lui celui de la fatigue
vai ncue. Mais comme sa fatigue n'est rien d'autre que la passion qu'il
endure pour que l a poussire des chemins, les brlures du solei l , la
rudesse des routes existent au maximum, son effort, c'est--dire cette
familiarit douce avec une fatigue qu'il aime, laquelle il s'aban
donne et que, pourtant, il dirige, se donne comme une manire de
s'appropri er l a montagne, de l a souffrir jusqu'au bout et d'en tre
vai nqueur. Nous verrons dans notre prochain chapitre, en effet, le
sens du mot avoi r et dans quell e mesure faire est le moyen de
s'approprier. Ai nsi l a fatigue de mon compagnon est vcue dans un
projet plus vaste d'abandon confiant l a nature, de passion consentie
pour qu'el le existe au plus fort, et, en mme temps, de domination
douce et d'appropriation. C'est seulement dans et par ce projet
qu'elle purra se comprendre et qu'elle aura pour l ui une significa
tion. Mais cette signification et ce projet plus vaste et plus profond
sont encore par eux-mmes unselbststandig . Ils ne se suffisent
pas. Car ils supposent prcisment un rapport particulier de mon
compagnon son corps, d'une part, et aux choses, d'autre part. II est
faci lement comprhensible, en effet, qu'il y a autant de manires
d'exister son corps qu'il y a de pour-soi, bien que, naturellement,
certaines structures originelles soient invariables et constituent en
chacun l a ralit-humaine : nous nous occuperons ailleurs de ce qu'on
a improprement appel l a relation de l'individu l ' espce et des
conditions d'une vrit universell e. Pour l'instant, nous pouvons
concevoir, d'aprs mi l l e vnements signifiants, qu'i l y a, par
exempl e, un certain type de fuite devant l a facticit qui consiste
prcisment s'abandonner cette facticit, c'est--dire, en somme,
la reprendre en
confiance et l'aimer, pour tenter de la rcuprer.
Ce projet originel de rcupration est donc un certain choix que le
pour-soi fait de lui-mme en prsence du problme de l ' tre. Son
pro
j
et demeure une nantisation, mais cette nantisation revient sur
l'en-soi qu' el l e nantise et se traduit par une valorisation singulire de
la facticit. C'est ce qu'expriment notamment les mil l e conduites dites
d'abandon. S'abandonner la fatigue, l a chaleur, la faim et l a
soif, se laisser al l er sur une chai se, sur un lit avec volupt, se
dtendre, tenter de se laisser boi re par son propre corps, non plus
sous les yeux de l'autre, comme dans le masochisme, mais dans la
solitude origi nel l e du pour-soi , tous ces comportements ne se laissent
j amais l imiter eux-mmes et nous le sentons bien puisque, chez un
autre, ils agacent ou attirent : l eur condition est un projet initial de
500
rcupration du corps, c'est--dire une tentative de solution du
problme de l'absolu (de l'en-soi-pour-soi ). Cette forme initiale peut
elle-mme se l i miter une tolrance profonde de la facticit : le
projet de se faire corps signifiera alors un abandon heureux
mi l l e petites gourmandises passagres, mi l le petits dsirs, mille
faiblesses. Qu'on se rappel l e, dans Ulysse de Joyce, M. Bloom
humant avec faveur, pendant qu' i l satisfait des besoins naturels,
l'odeur intime qui monte de dessous lui . Mais i l se peut aussi -et
c'est le cas de mon compagnon - que, par le corps et par la
complaisan au corps, l e pour-soi cherche rcuprer l a totalit du
non-conscient, c'est--dire tout l'univers en tant qu'il est ensemble de
choses matriel l es. En ce cas l a synthse vise de l ' en-soi avec le pour
soi sera la synthse quasi panthiste de la totalit de l ' en-soi avec le
pour-soi qui le rcupre. Le corps ici est un instrument de la
synthse : i l se perd dans l a fatigue, par exemple, pour que cet en-soi
existe au plus fort. Et comme c'est l e corps que le pour-soi existe
comme sien, cette passion du corps concide pour le pour-soi avec le
projet de faire exister " l'en-soi. L'ensembl e de cette attitude -qui
est celle d'un de mes compagnons de route -peut se traduire par l e
sentiment obscur d'une sorte de mi ssion : il fait cette excursion parce
que la montagne qu' i l va gravir et les forts qu'il va traverser existent,
il a mission d'tre celui par qui l eur sens sera manifest. Et, par l , i l
tente d'tre cel ui qui les fonde dans l eur existence mme. Nous
reviendrons dans notre prochain chapitre sur ce rapport appropriatif
du pour-soi au monde, mais nous ne disposons pas encore des
lments ncessaires pour l 'l uci der pl ei nement. Ce qui parat
vident, en tout cas, aprs notre analyse, c'est que l a faon dont mon
compagnon souffre sa fatigue demande ncessairement pour tre
comprise une analyse rgressive qui nous conduit jusqu' un projet
initial. Ce projet que nous avons esquiss est-il cette fois selbststan
dig ? Certes - et i l est facile de s'en convaincre : en effet, nous
avons atteint de rgression en rgression le rapport originel que le
pour-soi choisit avec sa facticit et avec l e monde. Mais ce rapport
originel est-il rien d'autre que l 'tre-dans-Ie-monde lui-mme du
pour-soi en tant que cet tre-dans-le-monde est choix, c'est--dire que
nous avons atteint le type originel de nantisation par quoi le pour-soi
a tre son propre nant ? A partir de l , aucune interprtation ne
peut tre tente, car elle supposerait implicitement l 'tre-dans-Ie
monde du pour-soi , comme toutes les dmonstrations qu'on a tentes
du postulat d'Euclide supposaient implicitement l'adoption de ce
postul at.
Ds l ors, si j'applique l a mme mthode pour interprter la faon
dont je souffre ma fatigue, je saisirai d'abord en moi une dfiance de
mon corps -par exemple -, une manire de ne pas vouloir faire
avec l ui . . . , de le compter pour rien, qui est simplement un des
501
nombreux modes possibles pour moi d'exister mon corps. Je dcouvri
rai sans peine une mfiance analogue vis--vis de l' en-soi et, par
exempl e , un projet originel pour rcuprer l'en-soi que je nantis, par
l'intermdiaire des autres, ce qui me renvoie un des projets i nitiaux
que nous numrions dans l a partie prcdente. Ds lors ma fatigue,
au lieu d'tre soufferte en souplesse sera apprhende en
raideur , comme un phnomne importun dont je veux me dbarras
ser -et cela tout simplement parce qu' el l e incarne mon corps et ma
contingence brute au mil ieu du monde, alors que mon projet est de
fai re sauver mon corps et ma prsence dans l e monde par les regards
de l 'autre. Je suis renvoy moi aussi mon projet originel, c'est--dire
mon tre-dans-le-monde, en tant que cet tre est choix.
Nous ne nous dissimulons pas combien la mthode de cette analyse
laisse dsirer. C'est que tout est faire dans ce domaine : i l s'agit,
en effet, de dgager les significations impl iques par un acte - par
tout acte - et de passer de l des significations plus riches et plus
profondes jusqu' ce qu'on rencontre la signification qui n'implique
plus aucune autre signification et qui ne renvoie qu' el l e-mme.
Cette dialectique remontante est pratique spontanment par l a
plupart des gens, on peut mme constater que dans l a connaissance de
sOI-mme ou dans celle d'autrui, une comprhension spontane est
donne de l a hi rarchie des interprtations. Un geste renvoie une
Weltanschauung et nous l e senlons. Mais personne n' a tent de
dgager systmatiquement les significations impliques par un acte.
Une seule cole est partie de l a mme vidence originelle que nous :
c'est l'cole freudienne. Pour Freud, comme pour nous, un acte ne
saurait se borner lui-mme : i l renvoie immdiatement des
structures plus profondes. Et l a psychanalyse est l a mthode qui
permet d'expliciter ces structures. Freud se demande comme nous :
quelles conditions est-il possible que tel l e personne ait accompli tel l e
action particulire ? Et i l refuse comme nous d'interprter l ' action par
le moment antcdent, c'est--dire de concevoir un dterminisme
psychique horizontal . L'acte l ui parat symbolique, c'est--dire qu' il
l ui semble traduire un dsir plus profond, qui l ui-mme ne saurait
s'interprter qu' partir d' une dtermination initiale de la libido du
sujet. Seul ement Freud vise ainsi constituer un dterminisme
";ertical . En outre, sa conception va ncessairement, par ce biais,
renvoyer au pass du suj et. L'affectivit, pour l ui , est la base de
l'acte sous forme de tendances psychophysiologiques. Mais cette
affectivit est originellement chez chacun de nous une table rase : ce
sont les circonstances extrieures et, pour tout dire, l'histoire du sujet
qui dcidera si telle ou telle tendance se fixera sur tel ou tel obj et .
C'est l a situati on de l'enfant au milieu de sa famil l e qui dterminera
en lui l a naissance du complexe d'dipe : dans d'autres socits
composes de familles d' un autre type -et, comme on l'a remarqu,
502
par exemple, chez l es primitifs des les de Corail du Pacifique -ce
complexe ne saurait se former. En outre, ce sont encore des
circonstances extrieures qui dcideront si, l'ge de la pubert, ce
complexe se ( liquide , ou demeure, au contraire, l e ple de l a vie
sexuelle. De la sorte et par l'intermdiaire de l'histoire, le dtermi
nisme vertical de Freud demeure ax sur un dterminisme horizontal.
Certes, tel acte symbolique exprime un dsir sous-j acent et contem
porai n, de mme que ce dsir manifeste un complexe plus profond et
ceci dans l'unit d' un mme processus psychique ; mais l e complexe
n'en prexiste pas moins sa manifestation symbolique et c'est l e
pass qui l ' a constitu tel qu' i l est, suivant des connexions classiques :
transfert, condensation, etc. , que nous trouvons mentionnes non
seulement dans l a psychanalyse, mais dans toutes les tentatives de
reconstruction dterministe de la vie psychique. En consquence, la
dimension du futur n'existe pas pour la psychanalyse. La ralit
humaine perd une de ses ek-stases et elle doit s'interprter unique
ment par une rgression vers le pass partir du prsent. En mme
temps les structures fondamentales du sujet, qui sont signifies par ses
actes, ne sont pas signifies pour lui, mais pour un tmoin objectif qui
use de mthodes discursives pour expliciter ces significations. Aucune
corprhension prontologique du sens de ses actes n'est accorde au
sujet. Et cela se conoit assez bien, puisque, malgr tout, ces actes ne
sont qu' un effet du pass -qui est, par principe, hors d'atteinte -au
l i eu de chercher i nscrire leur but dans l e futur.
Aussi devons-nous nous borner nous i nspirer de la mthode
psychanalytique, c'est--dire que nous devons tenter de dgager les
significations d' un acte en partant du principe que toute action, si
insignifiante soit-ell e, n'est pas l e simple effet de l'tat psychique
antrieur et ne ressortit pas un dterminisme linaire, mais qu'elle
s'intgre, au contraire, comme une structure secondaire dans des
structures globales et , final ement, dans la totalit que je suis. Sinon,
en effet, j e devrais me comprendre ou comme un flux horizontal de
phnomnes, dont chacun est conditionn en extriorit par le
prcdent - ou comme une substance supportant l'coulement
dpourvu de sens de ses modes. Ces deux conceptions nous ramne
raient confondre l e pour-soi avec l'en-soi. Mais si nous acceptons la
mthode de la psychanalyse -et nous y reviendrons longuement au
chapitre suivant - nous devons l ' appliquer en sens inverse. Nous
concevons, en effet, tout acte comme phnomne comprhensible et
nous n'admettons pas plus l e hasard dterministe que Freud. Mais
au lieu de comprendre le phnomne considr partir du pass,
nous concevons l'acte comprhensif comme un retour du futur vers le
prsent. La faon dont j e souffre ma fatigue n'est nullement
dpendante du hasard de l a pente que je gravis ou de la nuit plus ou
moins agite que j 'ai passe : ces facteurs peuvent contribuer
503
constituer ma fatigue elle-mme, non la faon dont je la souffre. Mais
nous refusons de voir en elle, avec un disciple d'Adler, une expression
du complexe d'infriorit , par exemple, au sens o ce complexe serait
une formati on antrieure. Qu'une certaine faon rageuse et raidie de
lutter contre la fatigue puisse exprimer ce qu'on nomme complexe
d'infriorit nous n' en disconvenons pas. Mais l e complexe d'infrio
rit l ui-mme est un projet de mon propre pour-soi dans le monde en
prsence de l 'autre . Comme tel , il est toujours transcendance, comme
tel encore, mani re de se choisir. Cette i nfriorit contre laquelle je
lutte et que pourtant je reconnais, je l ' ai choisie ds l'origine ; sans
doute est-elle signifie par mes diverses conduites d'chec , mais
prcisment elle n'est rien d'autre que la totalit organise de mes
conduites d' chec, comme pl an projet, comme devis gnral de mon
tre et chaque conduite d'chec est el l e-mme transcendance puisque
j e dpasse chaque fois le rel vers mes possibilits : cder la
fatigue par exempl e, c'est transcender l e chemin faire en l ui
constituant l e sens de chemin trop di fficile parcourir . I l est
impossible de considrer srieusement le sentiment d' infriorit sans
le dterminer partir du futur et de mes possibilits. Mme des
constatations comme je suis laid , je suis bte , etc. , sont, par
nature, des anticipations. Il ne s'agit pas de la pure constatation de ma
laideur, mai s de l a saisie du coefficient d'adversit que prsentent l es
femmes ou l a socit mes entreprises. Et cel a ne saurait se dcouvrir
que par et dans le choix de ces entreprises. Ainsi le complexe
d' i nfri
o
rit est projet libre et global de moi-mme, comme infrieur
devant l 'autre, i l est l a mani re dont j e choisis d'assumer mon tre
pour-autrui, la solution libre que je donne l'existence de l'autre, ce
scandale insurmontable. Ainsi faut-il comprendre mes ractions
d'infriorit et mes conduites d'chec partir de la libre esquisse de
mon infriorit comme choix de moi-mme dans le monde. Nous
accordons aux psychanalystes que toute raction humaine est, a
priori, comprhensibl e. Mais nous leur reprochons d'avoir justement
mconnu cette comprhensibilit initiale en tentant d'expliquer l a
raction considre par une raction antrieure, ce qui rintroduit l e
mcanisme causal : l a comprhension doit se dfinir autrement. Est
comprhensible toute action comme projet de soi-mme vers un
possi ble. El l e est comprhensible d'abord en tant qu'elle offre un
contenu rati onnel immdiatement saisissable -j e pose mon sac sur l e
sol pour me reposer un instant - c'est--dire en tant que nous
saisissons immdiatement le possible qu'elle projette et la fin qu' elle
vise. El l e est comprhensible ensuite en ce que l e possible considr
renvoie d' autres possibles, ceux-ci d'autres et ainsi de suite jusqu'
l ' ultime possibilit que je suis. Et la comprhension se fait en deux
sens inverses : par une psycho-analyse rgressive, on remonte de
l 'acte considr j usqu' mon possible ul time -par une progression
504
synthti que, de ce possi bl e ultime on redescend jusqu' l ' acte
envisag et on saisit son intgration dans la forme totale.
Cette forme, que nous nommons notre possibilit ultime, n'est pas
un possible parmi d'autres -ft-ce, comme le veut Heidegger, la
possibilit de mourir ou de ne plus raliser de prsence dans l e
monde . Toute possibilit singulire, en effet, s'articule dans un
ensembl e. I l faut concevoir au contraire cette possibilit ultime
comme l a synthse unitaire de tous nos possibles actuels ; chacun de
ces possibles rsidant dans l a possibilit ultime l'tat indiffrenci
jusqu' ce qu'une circonstance particulire vienne l e mettre en relief
sans supprimer pour cela son appartenance l a totalit. Nous avons
marqu, en effet, dans notre seconde partie l, que l'apprhension
perceptive d' un objet quelconque se faisait sur fond de monde. Nous
entendions par l que ce que les psychologues ont coutume d'appeler
perception ne pouvait pas se limiter aux objets proprement
vus ou entendus , etc. , un certain instant, mais que l es objets
considrs renvoient par des implications et des significations diverses
la totali t de l'existant en soi partir de laquelle i ls sont
apprhends. Ai nsi n'est-il pas vrai que j e passe de proche en proche
de cette table l a chambre o je sui s, puis, en sortant, de l au
vestibule, l'escalier, l a rue, pour concevoir enfin comme rsultat
d'un passage l a limite le monde comme la somme de tous les
existants. Mais bien au contraire, je ne puis percevoir une chose
ustensile quelconque, si ce n'est partir de l a totalit absolue de tous
les existants, car mon tre premier est tre-dans-Ie-monde. Ainsi
trouvons-nous dans les choses, en tant qu'il y a des choses pour
l'homme, un appel perptuel vers l ' i ntgration qui fait que pour les
saisir nous descendons de l' i ntgration totale et i mmdiatement
ralise j usqu' telle structure singulire qui ne s'interprte que par
rapport cette totalit. Mais si d'autre part il y a un monde, c'est
parce que nous surgissons au monde d' un coup et en totalit. Nous
avons marqu, en effet, dans ce mme chapitre consacr la
transcendance, que l'ensoi n'tait capable d'aucune unit mondaine
par soi seul. Mais notre surgissement est une passion en ce sens que
nous nous perdons dans l a nantisation pour qu'un monde existe.
Ainsi le phnomne premier de l ' tre-dans-Ie-monde est la relation
originelle entre l a totalit de l'en-soi ou monde et ma propre totalit
dtotalise : je me choisis tout entier dans l e monde tout entier. Et de
mme que j e viens du monde un ceci particulier, je viens de moi
mme comme totalit dtotalise l ' esquisse d' une de mes possibi
lits singulires, puisque j e ne puis saisir un ceci particulier sur fond
de monde qu' l'occasion d' un projet particulier de moi-mme. Mais
en ce cas, de mme que j e ne puis saisir tel ceci que sur fond de
1. Ibid. , chap. III, 2e partie.
505
monde, en le dpassant vers tel l e ou telle possibilit, de mme je ne
pui s me projeter par del l e ceci vers telle ou telle possibilit que sur
fond de mon ultime et totale possibilit. Ainsi mon ultime et totale
possibilit comme intgration originelle de tous mes possibles singu
liers et l e monde comme la totalit qui vient aux existants par mon
surgissement l 'tre sont deux notions rigoureusement corrlatives.
Je ne puis percevoir le marteau (c' est--dire baucher le marteler )
que sur fond de monde ; mais rciproquement, je ne puis baucher cet
acte de marteler que sur fond de l a totalit de moi-mme et
partir d' elle.
Ainsi l'acte fondamental de libert est trouv ; et c'est lui qui donne
son sens l'action particulire que j e puis tre amen considrer :
cet acte constamment renouvel ne se distingue pas de mon tre ; il
est choix de moi-mme dans le monde et du mme coup dcouverte
du monde. Ceci nous permet d'viter l'cueil de l 'inconscient que la
psychanalyse rencontrait au dpart . Si rien n'est dans la conscience
qui ne soit conscience d' tre, pourrait-on nous objecter en effet, i l
faut que ce choix fondamental soi t choix conscient ; or, prcisment,
pouvez-vous affirmer que vous tes conscient, lorsque vous cdez l a
fatigue, de toutes les implications que suppose cet act e ? Nous
rpondrons que nous en sommes parfaitement conscients. Seulement
cette conscience el le-mme doit avoir pour limite la structure de l a
conscience en gnral et du choix que nous faisons.
En ce qui concerne ce dernier, i l faut insister sur l e fait qu'il ne
s'agit nul l ement d'un choix dlibr. Et cela, non parce qu'il serait
moins conscient ou moins explicite qu'une dl ibration mais au
contraire parce qu'il est l e fondement de toute dlibration et que,
comme nous l ' avons vu, une dlibration requiert une interprtation
partir d'un choix originel . Il faut donc se dfendre de l'illusion qui
ferait de l a libert originelle une position de motifs et de mobiles
comme objets, puis une dcision partir de ces motifs et de ces
mobil es. Bi en au contraire, ds qu' i l y a motif et mobil e, c'est--dire
apprciation des choses et des structures du monde, i l y a dj
position des fins, et, par consquent, choix. Mais cela ne signifie pas
que l e choix profond soit pour autant inconscient. Il ne fait qu'un avec
l a conscience que nous avons de nous-mme. Cette conscience, on l e
sai t , ne saurai t tre que non-positionnelle : elle est conscience-nous
puisqu'elle n e se distingue pas de notre tre. Et comme notre tre est
prcisment notre choix origi nel , l a conscience (de) choix est
identique l a conscience que nous avons (de) nous. Il faut tre
conscient pour choisir et i l faut choisir pour tre conscient. Choix et
conscience sont une seule et mme chose. C'est ce que beaucoup de
psychologues ont senti lorsqu'ils ont dclar que l a conscience tait
slection . Mais faute de ramener cette slection son fondement
ontologique, i l s sont rests sur un terrain o la slection apparaissait
506
comme une fonction gratuite d'une conscience par ailleurs substan
tielle. C'est, en particulier, ce qu'on pourrait reprocher Bergson.
Mais s'il est bien tabli que la conscience est nantisation, on conoit
qu'avoir conscience de nous-mme et nous choisir ne font qu'un.
C'est ce qui explique les difficults que des moralistes comme Gide
ont rencontres lorsqu'ils ont voulu dfinir l a puret des sentiments.
Quelle diffrence y a-t-il, demandait Gide l, entre un sentiment voulu
et un sentiment prouv ? A vrai dire, i l n'y en a aucune : vouloir
aimer et aimer ne font qu'un puisque aimer c'est se choisir aimant
en prenant conscience d' ai mer. Si le mx80 est libre, il est choix. Nous
avons assez marqu -en particulier dans l e chapitre qui concerne la
Temporalit -que l e cogito cartsien doit tre tendu. En fait, nous
l'avons vu, prendre conscience (de) soi ne signifie jamais prendre
conscience de l'instant, car l'instant n'est qu'une vue de l'esprit et, si
mme il existait, une conscience qui se saisirait dans l'instant ne
saisirait plus rien. Je ne puis prendre conscience de moi que comme
un tel homme engag dans telle ou telle entreprise, escomptant tel ou
tel succs, redoutant telle ou telle issue, et, par l'ensemble de ces
anticipations, esquissant tout entire sa figure. Et c'est bien ainsi que
je me saisis, en ce moment o j'cris ; j e ne suis pas l a simple
conscience perceptive de ma main qui trace des signes sur le papier, je
suis bien en avant de cette main jusqu' l'achvement du livre et
jusqu' la signification de ce livre -et de l'activit philosophique en
gnral -dans ma vie ; et c'est dans le cadre de ce projet, c'est--dire
dans l e cadre de ce que je suis, que s'insrent certains projets vers des
possibilits plus restreintes comme d'exposer telle ide de telle ou
telle manire ou de cesser d'crire pendant un moment ou de
feuilleter un ouvrage o je cherche telle ou telle rfrence, etc.
Seulement, l'erreur serait de croire qu' ce choix global correspond
une conscience analytique et di ffrenci e. Mon projet ultime et initial
- car il est les deux l a fois - est, nous le verrons, toujours
l'esquisse d'une solution du problme de l'tre. Mais cette solution
n'est pas d'abord conue puis ralise : nous sommes cette solution,
nous la faisons exister par notre engagement mme et nous ne
saurions donc l a saisir qu'en la vivant. Ainsi sommes-nous toujours
prsents tout entiers nous-mmes, mais prcisment parce que nous
sommes tout entiers prsents, nous ne pouvons esprer avoir une
conscience analytique et dtaille de ce que nous sommes. Cette
conscience, d'ailleurs, ne saurait tre que non-thtique.
Mais, d'autre part, l e monde nous renvoie exactement, par son
articul ation mme, l'image de ce que nous sommes. Non que nous
puissions -nous l'avons vu de reste -dchiffrer cette image c'est-
dire la dtailler et la soumettre l'analyse -mais parce que le monde
1. Journal des Faux monnayeurs.
507
nous apparat ncessairement comme nous sommes ; c'est en effet en
l e
dpassant vers nous-mmes que nous l e faisons apparatre tel qu' i l
est. Nous choi sissons l e monde -non dans sa contexture en-soi, mais
dans sa signification -en nous choisissant. Car la ngation interne,
par quoi en ni ant de nous que nous soyons le monde nous le faisons
apparatre comme monde, ne saurait exister que si el l e est en mme
temps projection vers un possibl e. C'est la faon mme dont j e me
confie l 'i nani m, dont j e m'abandonne mon corps - ou, au
contraire , dont je me raidis contre l'un et l ' autre -qui fait apparatre
mon corps et le monde inanim, avec leur valeur propre. En
consquence, l aussi j e jouis d'une pleine conscience de moi-mme
et de mes projets fondamentaux, et, cette fois, cette conscience est
positionnel l e. Seul ement, prcisment parce qu'elle est positionnelIe,
ce qu'elle me livre est l' image transcendante de ce que j e suis. La
valeur des choses, leur rle instrumental, leur proximit et leur
loignement rels (qui sont sans rapport avec leur proximit et leur
loignement spatiaux) ne font rien d'autre qu'esquisser mon image,
c'est--dire mon choix. Mon vtement (uniforme ou complet-veston,
chemise souple ou empese) nglig ou soign, recherch ou vulgaire,
mes meubles, l a rue o j 'habite, la ville o j e rside, les livres dont je
m'entoure , les divertissements que je prends, tout ce qui est mien,
c'est--dire final ement l e monde dont j' ai perptuellement conscience
- au moins titre de signification implique par l'objet que j e
regarde ou que j' emploie -, tout m'apprend moi-mme mon choix,
c'est
--dire mon tre. Mais telle est la structure de l a conscience
positionnel l e que je ne puis ramener cette connaissance une saisie
subjective de moi-mme et qu'elle me renvoie d'autres objets que j e
produis ou que j e dispose en liaison avec l'ordre des prcdents sans
pouvoir m' apercevoir que je sculpte ainsi de plus en plus ma figure
dans le monde. Ainsi avons-nous pleinement conscience du choix que
nous sommes. Et si l'on objecte qu'il faudrait, selon ces remarques,
avoir conscience non de nous tre choisis, mais de nous choisir, nous
rpondrons que cette conscience se traduit par le double
ment de l'angoisse et de l a responsabilit. Angoisse, dlaissement,
responsabilit, soit en sourdine, soit en pleine force, constituent en
effet l a qualit de notre conscience en tant que celle-ci est pure et
simpl e libert.
Nous posions tout l'heure une question : j'ai cd l a fatigue,
disions-nous, et sans doute j'aurais pli faire autrement mais quel
prix ? Nous sommes prsent en mesure d'y rpondre. Notre analyse,
en effet, vient de nous montrer que cet acte n'tait pas gratuit. Certes,
il ne s'expliquait pas par un mobile ou un motif conu comme l e
cont enu d'un tat de conscience antrieur ; mais il devait s' inter
prter partir d' un proj et originel dont il faisait partie intgrante.
Ds lors, i l devient vident qu'on ne peut supposer que l'acte et pu
508
tre modifi sans supposer en mme temps une modification fonda
mentale de mon choix originel de moi-mme. Cette faon de cder
la fatigue et de me l aisser tomber sur le bord de la route exprime un
certain raidissement initial contre mon corps et l'en-soi inanim. Elle
se place dans l e cadre d'une certaine vision du monde o l es difficults
peuvent paratre ne pas valoir la peine d'tre supportes et o,
prcisment, le mobile, tant pure conscience non-thtique et, par
consquent, projet initial de soi vers une fin absolue (un certain
aspect de l'en-soi-pour-soi), est saisie du monde (chaleur, loigne
ment de l a ville, vanit des efforts, etc. ) comme motif d'arrter ma
marche. Ainsi ce possible : m'arrter, ne prend, en thorie, son sens
que dans et par la hi rarchie des possibles que j e suis partir du
possible ultime et initial. Cela n'implique pas que j e doive ncessaire
ment m'arrter, mais seulement que je ne puis refuser de m'arrter
que par une conversion radicale de mon tre-dans-le-monde, c'est-
dire par une brusque mtamorphose de mon projet initial , c'est--dire
par un autre choix de moi-mme et de mes fins. Cette modification est
d'ailleurs toujours possible. L'angoisse qui, lorsqu'elle est dvoile,
manifeste notre conscience notre libert, est tmoin de cette
modificabilit perptuelle de notre projet initial . Dans l'angoisse,
nous ne saisissons pas simplement le fait que les possibles que nous
projetons sont perptuellement rongs par notre libert venir, nous
apprhendons en outre notre choix, c'est--dire nous-mme, comme
injustifiable, c'est--dire que nous saisissons notre choix comme ne
drivant d'aucune ralit antrieure et comme devant servir de
fondement, au contraire, l'ensemble des significations qui consti
tuent la ralit. L'inj ustifiabilit n'est pas seulement la reconnais
sance subjective de la contingence absolue de notre tre, mais encore
celle de l 'i ntriorisation et de la reprise notre compte de cette
contingence. Car le choix -nous le verrons -issu de l a conti ngence
de l'en-soi qu'il nantise, la transporte sur le plan de la dtermination
gratuite du pour-soi par lui-mme. Ainsi sommes-nous perptuelle
ment engags dans notre choix et perptuellement conscients de ce
que nous-mmes pouvons brusquement inverser ce choix et renverser
la vapeur, car nous projetons l'avenir par notre tre mme et nous l e
rongeons perptuellement par notre libert existentielle, nous annon
ant nous-mme ce que nous sommes par l'avenir, et sans prises sur
cet avenir qui demeure toujours possible sans passer j amais au rang
de rel. Ainsi sommes-nous perptuellement menacs de l a nantisa
tion de notre choix actuel , perptuellement menacs de nous choisir
-et par consquent de devenir -autres que nous sommes. Du seul
fait que notre choix est absolu, il est fragile, c'est--dire qu'en posant
par lui notre libert, nous posons du mme coup sa possibilit
perptuelle de devenir un en-de passifi pour un au-del que je
serai .
509
Toutefoi s
,
entendons bien que notre choix actuel est tel qu'il ne
nous fourni t aucun motif pour le passifier par un choix ultrieur. En
effet, c'est lui qui cre originel l ement tous les motifs et tous les
mobiles qui peuvent nous conduire des actions partielles, c'est l ui
qui dispose l e monde avec ses significations, ses complexes-ustensiles
et Son coefficient d'adversit. Ce changement absolu qui nous menace
de notre nai ssance notre mort reste perptuellement imprvisible et
i ncomprhensible. Si mme nous envisageons d'autres attitudes
fondamentales comme possibles, nous ne les considrons jamais que
du dehors, comme des comportements de l'autre. Et si nous tentons
d'y rapporter nos conduites, elles ne perdront pas pour cela leur
caractre d'extriorit et de transcendances-transcendes. Les com
prendre , en effet, ce serait dj les avoir choisies. Nous allons y
revenir.
En outre, nous ne devons pas nous reprsenter l e choix originel
comme se produisant d'un instant l'autre ; ce serait revenir la
conception instantaniste de l a conscience dont un Husserl n' a pu
sortir. Puisque, au contraire, c'est la conscience qui se temporalise, i l
faut concevoir que l e choi x originel dploie l e temps et ne fait qu'un
avec l'unit des trois ek-stases. Nous choisir, c'est nous nantiser,
c'est--dire faire qu'un futur vienne nous annoncer ce que nous
sommes en confrant un sens notre 'pass. Ainsi n'y a-t-il pas une
succession d'instants spars par des nants comme chez Descartes et
tels que mon choix l'instant t ne puisse agir sur mon choix de
l ' i nstant tl Choisir, c'est faire que surgisse avec mon engagement une
certaine extension finie de dure concrte et conti nue, qui est
prcisment celle qui me spare de la ralisation de mes possibles
originels. Ainsi l ibert, choix, nantisation, temporalisati on, ne font
qu' une seul e et mme chose.
Pourtant l 'instant n'est pas une vai ne invention des philosophes.
Certes, il n' y a point d' i nstant subjectif lorsque je me suis engag dans
ma tche ; en ce moment, par exempl e, o j'cris, tchant de saisir et
de mettre en ordre mes ides, il n'y a pas pour moi d'instant, i l n' y a
qu'une perptuelle poursuite-poursuivie de moi-mme vers les fins
qui me dfinissent (l 'explicitation des ides qui doivent faire le fond
de cet ouvrage) ; et pourtant nous sommes perptuel l ement menacs
par l'instant. C'est--di re que nous sommes tels, par l e choix mme de
notre libert , que nous pouvons toujours faire apparatre l'instant
comme rupture de notre unit ek-statique. Qu'est-ce donc que
l'instant ? L'instant ne saurait tre dcoup dans l e processus de
tempmalisation d'un projet concret : nous venons de l e montrer.
Mais i l ne saurait non plus tre assimil au terme initial ou au terme
final (s'il doit exister) de ce processus. Car l'un comme l'autre de ces
termes sont agrgs de l'intrieur la totalit du processus et en font
partie intgrante. Il s n'ont donc l'un et l'autre qu'une des caractristi-
510
ques de l'instant : le terme initial , en effet, est agrg au processus dont
il est terme i ni tial , en ce quI est son commencement. Mai s, d'autre
part , i l est l i mit par un nant antrieur en ce qu'il est un
commencement. Le terme final est agrg au processus qu' i l termine
en ce qu'il est sa fin : l a dernire note appartient l a mlodie. Mais il
est suivi d'un nant qui le limite en ce qu' i l est une fin. L'instant, s'il doit
pouvoir exister, doi t tre born par un double nant. Cela n'est
nullement concevable s' il doit tre donn antrieurement tous les
processus de temporalisation, nous l'avons montr. Mais dans le
dveloppement mme de notre temporalisati on, nous pouvons pro
duire des instants si certains processus surgissent sur l'effondrement
des processus antrieurs. L'instant sera alors un commencement el une
fin. En un mot , si la fin d'un projet concide avec le commencement
d'un autre projet, une ralit temporelle ambigu surgira qui sera
limite par un nant antrieur en ce qu'elle est commencement et par
un nant postrieur en ce qu'elle est fin. Mais cette structure
temporelle ne sera concrte que si le commencement se donne l ui
mme comme fin du processus qu' i l passifi e. Un commencement qui
se donne comme fin d'un projet antrieur, tel doi t tre l'instant. I l
n'existera donc que si nous sommes nous-mme commencement et
fin dans l'unit d' un mme acte . Or, c'est prcisment ce qui se produit
dans le cas d'une modification radicale de notre projet fondamental.
Par l e libre choix de cette modification, en effet, nous temporal isons un
projet que nous sommes et nous nous faisons annoncer par un futur
l'tre que nous avons choisi ; ainsi le prsent pur appartient l a
temporalisation nouvelle comme commencement, et il reoit du futur
qui vient de surgir sa nature propre de commencement. C'est l e futur
seul, en effet , qui peut revenir sur le prsent pur pour l e qualifier de
commencement, sinon ce prsent ne serait qu'un prsent quelconque.
Ainsi l e prsent du choix appartient dj, comme structure intgre,
la nouvelle totalit amorce. Mai s, d'autre part, il ne se peut pas que ce
choix ne se dtermine pas en liaison avec le pass qu'il a tre. Il est
mme, par principe, dcision de saisir comme pass le choix auquel il se
substi tue. Un athe converti n' est point simplement un croyant : c'est
un croyant qui a ni de lui-mme l ' athisme, qui a passifi en lui son
projet d'tre athe. Ainsi le nouveau choix se donne comme
commencement en tant qu'il est une fin et comme fin en tant qu'il est
commencement ; i l est born par un double nant et, comme tel, il
ialise une cassure dans l'unit ek-statique de notre tre. Cependant,
l'instant n'est l ui-mme qu'un nant car, o que nous portions notre
vue, nous ne saisirons qu'une temporalisation continue, qui sera, selon
la direction de notre regard, ou bien la srie acheve et close qui vient
de passer, en entranant son terme final avec el l e - ou bien la
temporalisation vivante qui commence et dont le terme initial est
happ et entran par la possibi l i t future.
5 1 1
Ainsi tout choix fondamental dfinit la direction de la poursuite
poursuivie en mme temps qu'il se temporalise. Cela ne signifie pas
qu' il donne lin lan initial, ni qu'il y ait quelque chose comme de
l'acquis dont j e puisse profiter tant que j e me tiens dans les l i mites de
ce choix. La nantisation se poursuit continment, au contraire, et
par suite la reprise l i bre et conti nue du choix est indispensable.
Seulement , cette reprise ne se fait pas d'instant en instant tant que j e
reprends l ibrement mon choix : c'est qu'alors i l n' y a pas d'instant ; l a
reprise est si troitement agrge l'ensemble du processus qu'elle
n' a aucune signification instantane ni n'en peut avoir. Mais prcis
ment parce qu'il est libre et perptuellement repris par la libert, mon
choix a pour l i mi te la libert mme ; c'est--dire qu'il est hant par l e
spectre de l'instant. Tant que j e reprendrai mon choix, l a passifica
tion du processus se fera en parfaite continuit ontologique avec l e
prsent. Le processus passifi reste organis l a nantisation
prsente sous forme d'un savoir, c'est--dire de signification vcue et
i ntriorise, sans jamais tre objet pour l a conscience qui se projette
vers ses fi ns propres. Mai s, prcisment parce que j e suis libre, j'ai
toujours la possi bi lit de poser en objet mon pass i mmdiat. Cela
signifie que
,
alors que ma conscience antrieure tait pure conscience
non-posi tionnelle (du) pass, en tant qu'elle se constituait elle-mme
comme ngation interne du rel co-prsent et qu'elle se faisait
annoncer son sens par des fins poses comme re-prises , lors du
nouveau choix la conscience pose son propre pass comme objet,
c'est--dire qu' el l e l'apprcie et prend ses repres par rapport l ui.
Cet acte d'objectivation du pass immdiat ne fait qu' un avec l e choix
nouveau d'autres fins : il contribue faire jai llir l'instant comme
brisure nantisante de la t emporalisation.
La comprhension des rsultats obtenus par cette analyse sera plus
aise pour le lecteur si nous l es comparons une autre thorie de l a
libert, par exempl e celle de Leibniz. Pour Leibniz comme pour
nous, lorsque Adam prend l a pomme, il et t possible qu'il ne l a
prt pas. Mais pour l ui , comme pour nous, l es implications de ce geste
sont si nombreuses et si ramifies que, finalement, dclarer qu' il et
t possible qu'Adam ne prt pas l a pomme revient dire qu'un autre
Adam et t possible. Ainsi la contingence d'Adam ne fait qu'un
avec sa li bert, puisque cette contingence signifie que cet Adam rel
est entour d' une i nfi ni t d'Adams possibles dont chacun est caract
ris, par rapport l ' Adam rel , par une altration l gre ou profonde
de tous ses attri buts, c'est--dire finalement de sa substance. Pour
Leibniz, donc, l a l i bert rclame par l a ralit-humaine est comme
l'organisation de trois notions di ffrentes : est libre celui qui : 1 se
dtermine rati onnel lement faire un acte ; 2 est tel que cet acte se
comprend pleinement par la nature mme de celui qui l ' a commis ;
3 est contingent, c'est--dire exist e de telle sorte que d'autres
512
individus commettant d'autres actes propos de la mme situation
eussent t possibles. Mais, cause de la connexion ncessaire des
possibles, un autre geste d'Adam n'et t possible que pour et par un
autre Adam et l'existence d'un autre Adam impliquait celle d'un
autre monde. Nous reconnaissons avec Leibniz que le geste d'Adam
engage la personne d'Adam entire et qu'un autre geste se ft
compris la lueur et dans les cadres d'une autre personnalit
d'Adam. Mais Leibniz retombe dans un ncessitarisme tout fait
oppos a l'ide de libert lorsqu'i l place la formule mme de la
substance d'Adam au dpart comme une prmisse qui amnera l ' acte
d'Adam comme une de ses conclusions partielles, c'est--dire lorsqu'il
rduit l'ordre chronologique n'tre qu'une expression symbolique
de l'ordre logique. I l en rsul te d'une part, en effet, que J'acte est
rigoureusement ncessit par l'essence mme d'Adam, aussi la
contingence , qui rend la libert possible, selon Leibniz, se trouve tout
entire contenue dans l 'essence d' Adam. Et cette essence n'est point
choisie par Adam lui-mme, mais par Dieu. Aussi est-il vrai que l ' acte
commis par Adam dcoule ncessairement de l'essence d'Adam et
qu'en cela il dpend d'Adam l ui -mme et de nul autre, ce qui est
certes une condition de la libert. Mais l'essence d'Adam, elle, est un
donn pour Adam l ui -mme : Adam ne l'a pas choisie, i l n'a pu
choisir d'tre Adam. En consquence, il ne porte nullement l a
responsabilit de son tre. Il i mporte peu, par suite, qu'on puisse l ui
attribuer, une fois qu' i l est donn, l a responsabilit relative de son
acte. Pour nous, au contrai re, Adam ne se dfinit point par une
essence, car l'essence est, pour l a ralit-humaine, postrieure
l'existence. Il se dfinit par le choix de ses fins, c'est--dire par le
surgissement d' une temporalisation ek-statique qui n' a rien de
commun avec l'ordre logique. Ainsi la contingence d'Adam exprime
le choix fini qu' i l a fait de lui-mme. Mais ds lors ce qui lui annonce
sa personne est futur et non pass : i l choisit de se faire apprendre ce
qu'il est par les fins vers lesquel l es il se projette -c'est--dire par l a
totalit de ses gots, de ses i ncl inations, de ses haines, etc. , en tant
qu'il y a une organisation thmatique et un sens inhrent cette
totalit. Nous ne saurions ainsi tomber dans l'objection que nous
faisions Leibniz quand nous l ui disions : Certes, Adam a choisi de
prendre l a pomme, mais i l n' a pas choisi d'tre Adam. Pour nous,
en effet, c'est au ni veau du choi x d'Adam par l ui -mme, c'est--dire
de l a dtermination de l'essence par l'existence, que se place le
problme de la libert. En outre, nous reconnaissons avec Leibniz
qu'un autre geste d'Adam, i mpliquant un autre Adam, implique un
autre monde, mais nous n'entendons pas par autre monde une
telle organisation des compossibles que l'autre Adam possible y
trouve sa place : si mpl ement, un autre tre-dans-Ie-monde d'Adam
correspondra l a rvlation d'une autre face du monde. Enfin, pour
513
Leibniz, le geste possible de l'autre Adam, tant organis dans un
autre monde possible, prexiste de toute ternit, en tant que
possi bl e, l a ralisation de l'Adam contingent et rel. Ici encore
l ' essence prcde l'existence pour Leibniz et l'ordre chronologique
dpend de l'ordre ternel du logique. Pour nous, au contraire, le
possible n'est que pure et informe possibilit d'tre autre, tant qu'il
n'est pas exit comme possible par un nouveau projet d'Adam vers
des possibilits neuves. Ainsi l e possible de Leibniz demeure-t-il
ternellement possible abstrait, au lieu que, pour nous, le possible
n'apparat qu'en se possibilisant, c'est--dire en venant annoncer
Adam ce qu' il est. Par suite, l'ordre de l'explication psychologique
chez Leibniz va du pass au prsent, dans la mesure mme o cette
succession exprime l'ordre ternel des essences ; tout est finalement
fig dans l'ternit logique et l a seule contingence est celle du
principe, ce qui signifie qu'Adam est un postulat de l'entendement
divi n. Pour nous, au contraire, l'ordre de l'interprtation est rigou
reusement chronologique, il ne cherche nullement rduire le temps
un enchanement purement logique (raison) ou logico-chronologique
(caue, dterminisme) . Il s'interprte donc partir du futur.
Mai s, surtout, ce sur quoi i l vaut l a peine d'insister, c'est que toute
notre analyse prcdente est purement thorique. En thorie seule
ment un autre geste d'Adam n'est possible que dans les limites d'un
bouleversement total des fins par quoi Adam se choisit comme
Adam. Nous avons prsent les choses de l a sorte -et nous avons pu
sembler leibniziens de ce fait -pour exposer d'abord nos vues avec le
maximum de simplicit. En fait, l a ralit est bien autrement
complexe . C'est qu'en effet l'ordre d'interprtation est purement
chronologique et non logique : l a comprhension d'un acte partir
des fins originelles poses par l a libert du pour-soi n'est pas une
intellection. Et la hirarchie descendante des possibles, depuis le
p.ossible ultime et initial jusqu'au possible driv que l'on veut
comprendre, n'a rien de commun avec l a srie dductive qui va d'un
principe sa consquence. Tout d'abord, la liaison du possible driv
(se raidir cOntre la fatigue ou s'y abandonner) au possible fondamen
tal n'est pas une liaison de dductibilit. C'est une liaison de totalit
structure partielle. La vue du projet total permet de comprendre
la structure singulire considre. Mais les gestaltistes nous ont
montr que l a prgnance des formes totales n'exclut pas l a variabilit
de certaines structures secondaires. Il est certaines lignes que j e puis
ajouter Ou retrancher une figure donne sans altrer son caractre
spcifique. Il en est d'autres, au contraire, dont l'adjonction entrane
la disparition immdiate de la figure et l'apparition d'une autre figure.
Il en va de mme quant au rapport des possibles secondaires avec l e
possible fondamental ou totalit formel l e de mes possibles. La
signification du possible secondaire considr renvoie toujours,
514
certes, la signification totale que je suis. Mais d'autres possibles
auraient pu remplacer celui-ci sans que l a signification totale s'altrt,
c'est -dire qu'ils auraient toujours et aussi bien indiqu cette totalit
comme la forme qui permettait de les comprendre -ou, dans l'ordre
ontologique de l a ralisation, ils eussent pu tout aussi bien tre pro
jets comme des moyens d'atteindre la totalit et dans la lumire de
cette totalit. En un mot, l a comprhension est l'interprtation d'une
liaison de fait et non la saisie d'une ncessit. Ainsi l'interprtation
psychologique de nos actes doit frquemment revenir l a notion
stocienne des i ndiffrents . Pour soulager ma fatigue, i l est
indiffrent que je m'asseye au bord de la route ou que j e fasse cent
pas de plus pour m'arrter l'auberge que j 'aperois de loin. Cela
signifie que l a saisie de la forme complexe et globale que j'ai choisie
comme mon possible ultime ne suffie pa rendre compte du choix de
l'un des possibles plutt que de l'autre. Il y a l non pas un acte
dpourvu de mobiles et de motifs, mais une invention spontane de
mobiles et de motifs qui, tout en se pl aant dans l e cadre de mon
choix fondamental, l'enrichit d'autant. De mme chaque ceci doit
paratre sur fond de monde et dans la perspective de ma facticit,
mais ni ma facticit ni le monde ne permettent de comprendre
pourquoi je saisis prsentement ce verre plutt que cet encrier comme
forme s'enlevant sur le fond. Par rapport ces indiffrents, notre
libert est en tire et inconditionne. Ce fait de choisir un possible
indiffrent , puis de l'abandonner pour un autre ne fera d'ailleurs pas
surgir d'instant comme dcoupement de l a dure : mais au contraire
ces libres choix s' intgrent tous - mme s'ils sont successifs et
contradictoi res - dans l'unit de mon projet fondamental. Cela ne
signifie nul l ement qu'on doive les saisir comme gratuits : quels qu'ils
soient, en effet , il s s'interprteront toujours partir du choix originel
et , dans l a mesure o i l s J'enrichissent et l e concrtisent, ils
apporteront toujours avec eux leur mobile, c'est -dire la conscience
de leur motif ou, si J ' on prfre, l'apprhension de la situation comme
articule de tel l e ou telle faon.
Ce qui rendra en outre J'apprciation rigoureuse de la liaison du
possi bl e secondaire au possible fondamental particulirement dli
cate, c'est qu'il n'existe aucun barme a priori auquel on puisse se
reporter pour dcider de cette liaison. Mais, au contraire, c'est l e
pour-soi l ui mme qui choisit de considrer l e possible secondaire
comme significatif du possible fondamental . L o nous avons
J'impression que le sujet libre tourne l e dos son but fondamental,
nous i ntroduisons souvent l e coefficient d'erreur de J'observateur,
c'est--dire que nous usons de nos balances propres pour apprcier le
rapport de J'acte envisag avec les fins ultimes. Mais l e pour-soi, dans
sa libert, n' invente pas seulement ses fins primaires et secondaires :
il invente du mme coup tout le systme d'interprtation qui permet
515
de l i er l es unes aux autres. Il ne saurait donc, en aucun cas, tre
questi on d'tablir un systme de comprhension universel des possi
bl es secondaires partir des possibles primaires ; mais en chaque cas,
le suj et doit fournir ses pierres de touche et ses critres personnels.
Enfi n l e pour-soi peut prendre des dcisions volontaires en
opposition avec les fi ns fondamentales qu'il a choisies. Ces dcisions
ne peuvent tre que volontaires, c'est--dire rflexives. Elles ne
peuvent provenir, en effet , que d' une erreur commise de bonne ou de
mauvaise foi sur les fins que je poursuis et cette erreur ne peut tre
commise que si l'ensemble des mobiles que je suis sont dcouverts
titre d'objet par la conscience rflexive. La conscience irrfchi e,
tant projection spontane de soi vers ses possibilits, ne peut jamais
se tromper sur el l e-mme : i l faut se garder, en effet, d'appeler erreur
sur soi les erreurs d'apprciation touchant l a situation objective -
erreurs qui peuvent entraner dans le monde des consquences
absol ument opposes celles qu'on voulait atteindre, sans cependant
qu'il y ait eu mconnaissance des fins proposes. L'attitude rflexi ve,
au contraire, entrane mi ll e possibilits d'erreur, non pas dans l a
mesure o el l e saisit l e pur mobile - c'est--dire l a conscience
rflchi e - comme un quasi-obj et, mais en tant qu'elle vise
constituer travers cette conscience rfchie de vritables objets
psychiques qui, eux, sont des objets seulement probables, comme
nous l ' avons vu dans l e chapitre I I I de notre deuxime partie, et qui
peuvent mme tre des objets faux. I l m'est donc possibl e, en
fonction d' erreurs sur moi-mme, de m'imposer rflexivement, c'est
-dire sur le plan volontaire, des projets qui contredisent mon projet
initial, sans toutefois modifier fondamentalement le projet initi al .
C'est ainsi, par exemple, que si mon projet initial vise me choisir
comme i nfrieur au mil ieu des autres (ce qu'on nomme complexe
d'infriorit) et si le bgaiement, par exemple , est un comportement
qui se comprend et s' i nterprte partir du projet premier, je puis,
pour des raisons sociales et par une mconnaissance de mon propre
choix d'infriorit, dcider de me corriger de mon bgaiement. Je
puis mme y parvenir sans que pourtant j 'aie cess de me sentir et de
me voul oir infrieur. Il me suffira, en effet, d'utiliser des moyens
techniques pour obtenir un rsultat. C'est ce qu'on nomme ordinaire
ment rforme vol ontaire de soi. Mais ces rsultats ne feront que
dplacer l ' i nfirmit dont je souffre : une autre natra sa place, qui
exprimera sa manire l a fi n totale que je poursuis. Comme cette
inefficacit profonde de l'acte volontaire dirig sur soi peut surpren
dre, nous allons analyser de plus prs l'exemple choisi.
Il convient de remarquer d'abord que le choix des fins totales, bien
que t otalement libre , n'est pas ncessairement ni mme frquemment
opr dans la joi e. Il ne faut pas confondre la ncessit o nous
sommes de nous choisir avec l a volont de puissance. Le choix peut
516
tre opr dans la rsignation ou l e malaise, il peut tre une fuite, il
peut se raliser dans l a mauvaise foi. Nous pouvons nous choisir
comme fuyant, insaisissable, hsitant, etc. ; nous pouvons mme
choisir de ne pas nous choisir : dans ces diffrents cas, des fins sont
poses par del une situation de fait et l a responsabilit de ces fins
nous incombe : quel que soit notre tre, il est choix ; et il dpend de
nous de nous choisir comme grand ou noble ou bas et
humili . Mais si, prcisment, nous avons choisi l'humiliation
comme toffe mme de notre tre, nous nous raliserons comme
humili, aigri, infrieur, etc. Il ne s'agit pas l de donnes dpourvues
de signification. Mais celui qui se ralise comme humili se constitue
par l comme un moyen d'atteindre certaines fins : l'humiliation
choisie peut tre, par exemple, assimil e, comme l e masochisme, un
instrument destin nous dlivrer de J'existence pour-soi, elle peut
tre un projet de nous dmettre de notre libert angoissante au profit
des autres ; notre projet peut tre de faire entirement absorber notre
tre-po ur-soi par notre tre-po ur-autrui. De toute faon, le com
plexe d'infriorit ne peut surgir que s'il est fond sur une l ibre
apprhension de notre tre-pour-autrui. Cet tre-pour-autrui comme
situation agira titre de motif, mais il faut pour cela qu'il soit
dcouvert par un mobile qui n'est autre que notre libre projet. Ainsi
l'infriorit sentie et vcue est l'instrument choisi pour nous faire
semblable une chose, c'est--dire pour nous faire exister comme pur
dehors au milieu du monde. Mais i l va de soi qu' el le doit tre vcue
conformment l a nature que nous l ui confrons par ce choix, c'est-
dire dans la honte, la colre et J ' amertume. Ainsi choisir l'infriorit
ne veut pas dire se contenter doucement d' une aurea mediocritas,
c'est produire et assumer les rvoltes et le dsespoir qui constituent l a
rvlation de cette infriorit. Je pui s m'obstiner, par exemple, me
manifester dans un certain ordre de travaux et d'uvres parce que j ' y
suis infrieur, alors qu' en tel autre domaine, je pourrais sans difficult
m'galer l a moyenne. C'est cet effort i nfructueux que j'ai choisi
parce qu'il est infructueux : soit parce que je prfre tre le dernier
plutt que de me perdre dans l a masse -soit parce que j 'ai choisi l e
dcouragement et la honte comme meilleur moyen d'atteindre
l'tre. Mais il va de soi que je ne puis choisir comme champ d'action l e
domaine o j e suis i nfrieur que si ce choix i mplique l a volont
rfchie d'y tre suprieur. Choisir d'tre un artiste infrieur, c'est
choisir ncessairement de vouloir tre un grand artiste, sinon
l'infriorit ne serait ni subie, ni reconnue : choisir, en effet, d'tre un
modeste artisan n' implique nullement la recherche de l ' infriorit,
c'est un simple exempl e du choix de l a finitude. Au contraire, le choix
de l'infriorit i mplique la constante ralisation d'un cart entre l a fin
poursuivie par l a volont et l a fin obtenue. L'artiste qui se veut grand
et qui se choisit infrieur maintient intentionnellement cet cart, il est
517
comme Pnlope et dtruit la nuit ce qu' i l fait le jour. En ce sens, lors
de ses ralisations artistiques, i l se maintient constamment sur le plan
volontaire et dploie de ce fait une nergie dsespre. Mais sa
vol ont mme est de mauvaise foi , c'est--dire qu' el l e fuit la
reconnaissance des vraies fins choisies par la conscience spontane et
qu'elle constitue des objets psychiques faux comme mobiles pour
pouvoir dlibrer sur ces mobiles et se dcider partir d'eux (amour
de l a gloire, amour du beau, etc. ). La volont ici n'est nullement
oppose au choix fondamental, mais bi en au contraire elle ne se
comprend dans ses buts et dans sa mauvaise foi de principe que dans
la perspective du choix fondamental de l' infriorit. Mieux encore, si,
titre de conscience rflexive, el l e constitue de mauvaise foi des
objets psychiques faux titre de mobiles, au contraire titre de
conscience irrflchie et non-thtique (de) soi, el l e est conscience (d' )
tre de mauvai se foi et par suite conscience (du) projet fondamental
poursuivi par le pour-soi. Ainsi le divorce entre conscience spontane
et volont n'est pas une donne de fait purement constate. Mais, au
contraire, cette dualit est projete et ralise initialement par notre
l i bert fondamental e ; el le ne se conoit que dans et par l'unit
profonde de notre projet fondamental qui est de nous choisir comme
infrieur. Mais, prcisment, ce divorce implique que l a dlibration
volontaire dcide, avec mauvaise foi, de compenser ou de masquer
notre infriorit par des uvres dont le but profond est de nous
permettre au contraire de mesurer cette infriorit. Ainsi, on le voit,
notre analyse nous permet d'accepter les deux plans o Adler situe le
complexe d' infriori t : comme l ui nous admettons une reconnais
sance fondamentale de cette infriorit et comme lui nous admettons
un dveloppement touffu et mal quilibr d' actes, d' uvres et
d'affirmations destins compenser ou masquer ce sentiment
profond. Mais : 1 Nous nous dfendons de concevoir l a reconnais
sance fondamentale comme inconsciente : elle est si loin d'tre
inconsciente qu' el l e constitue mme la mauvaise foi de l a volont. De
ce fait, nous n'tablissons pas entre l es deux plans considrs l a
diffrence de l ' inconscient et du conscient, mai s celle qui spare l a
conscience irrflchi e et fondamentale de la conscience rflchie qui
en est tributaire. 2 L concept de mauvaise foi -nous l'avons tabli
dans notre premire partie - nous parat devoir remplacer ceux de
censure, de refoulement et d'inconscient dont Adler fait usage.
3 L'unit de la conscience, telle qu'elle se rvle au cogito, est trop
profonde pour que nous admettions cette scission en deux plans sans
qu' el l e soit reprise par une intention synthtique plus profonde qui
ramne un plan l ' autre et les unifie. En sorte que nous saisissons une
signification de plus dans l e complexe d'i nfriorit : non seulement l e
complexe d' infriorit est reconnu, mais cette reconnaissance est
choix ; non seul ement l a volont cherche masquer cette infriorit
51 8
par des affirmations instables et faibles, mais une intention plus
profonde l a traverse qui choisit prcisment la faiblesse et l'instabilit
de ces affirmations, dans l'intention de rendre plus sensible cette
infriorit que nous prtendons fuir et que nous prouverons dans la
honte et dans le sentiment de l'chec. Ainsi celui qui souffre de
Minderwertigkeit choisi d'tre l e bourreau de soi-mme. Il a
choisi la honte et la souffrance, ce qui ne veut pas dire, bien au
contraire, qu'il doive prouver de la joie lorsqu'elles se ralisent avec
le plus de violence .
.
Mais pour tre choisis de mauvaise foi par une volont qui se
produit dans les l i mites de notre projet initial , ces nouveaux possibles
ne s'en ralisent pas moins dans une certai ne mesure contre le projet
i nitial . Dans la mesure o nous voul ons nous masquer notre
infriorit, prcisment pour la crer, nous pouvons vouloir suppri
mer notre timidit et notre bgaiement qui manifestent sur l e plan
spontan notre projet initial d'infriori t. Nous entreprendrons alors
un effort systmatique et rflchi pour faire disparatre ces manifesta
tions. Nous faisons cette tentative dans l ' tat d'esprit o sont les
malades qui viennent trouver le psychanalyste. C'est- dire que d'une
part nous nous appliquons une ralisati on, que d'autre part nous
refusons : ainsi l e malade se dcide volontairement venir trouver le
psychanalyste pour tre guri de certains troubles qu'il ne peut plus se
dissimuler ; et, du seul fait qu'il se remet entre les mains du mdecin,
i l court le risque d' tre guri. Mais d'autre part, s'il court ce risque,
c'est pour se persuader lui-mme qu'il a tout fait en vain pour tre
guri et, donc, qu' i l est ingurissabl e. II aborde donc l e traitement
psychanalytique avec mauvaise foi et mauvaise volont. Tous ses
efforts auront pour but de l e faire chouer, cependant qu'il continue
volontairement s'y prter. Pareillement les psychasthniques que
Janet a tudis souffrent d'une obsession qu'ils entretiennent inten
tionnellement et veulent en tre guris_ Mai s prcisment leur volont
d'en tre guris a pour but d' affirmer ces obsessions comme souf
frances et par consquent de les raliser dans toute leur violence. On
sait le reste. le malade ne peut avouer ses obsessions, il se roule par
terre, sanglote, mais ne se dcide pas faire l a confession requise. Il
serait vai n de parler ici d'une lutte de la volont contre la maladie :
ces processus se droulent dans l ' uni t eK-statique de la mauvaise foi,
chez un t re qui est ce qu' i l n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est.
Parei l l ement lorsque l e psychanalyste est prs de saisir le projet initial
du malade, celui-ci abandonne l e traitement ou se met mentir. En
vain expliquerait-on ces rsistances par une rbellion ou une inqui
tude inconscient e : comment donc l'inconscient pourrait-il tre
inform des progrs de l'enqute psychanalytique, moins d'tre
prcisment une conscience ? Mais si le malade joue l e jeu j usqu'au
bout, il faut qu' i l subisse une gurison partielle, c'est--dire il faut
51 9
qu' i! produise en l ui la disparition des phnomnes morbides qui l'ont
amen requrir l 'aide du mdeci n. Ainsi aura-t-il choisi le moindre
mal : venu pour se persuader qu' i l est ingurissable, i l est contraint
pour viter de saisir son projet en pleine l umi re et, par suite, de l e
nantiser et de deveni r librement autre - de repartir en jouant l a
gurison. Parei l lement les mthodes que j'emploierai pour me gurir
du bgai ement et de l a ti midit ont pu tre essayes de mauvaise foi.
I! n'en demeure pas moins que je puis tre contraint de reconnatre
l eur efficace. En ce cas timi di t et bgaiement disparatront : c'est le
moindre mal. Une assurance factice et volubile viendra les remplacer.
Mais il en est de ces gurisons comme de la gurison de l 'hystrie par
traitement lectrique. On sait que cette mdication peut amener la
disparition d'une contracture hystrique de l a jambe, mais qu'on
verra, quelque temps aprs, l a contracture reparatre au bras. C'est
que l a gurison de l'hystrie ne peut se produire qu'en totalit, car
l 'hystrie est un projet totalitaire du pour-soi . Les mdications
partielles ne font qu' en dplacer les manifestations. Ainsi la gurison
de la timidit ou du bgaiement est consentie et choisie dans un projet
qui va la ralisation d'autres troubles, par exemple, prcisment,
la ralisation d' une assurance vaine et pareillement dsquilibre.
Comme, en effet, l e surgissement d'une dcision volontaire trouve
son mobile dans l e libre choix fondamental de mes fins, el l e ne peut
s'attaquer ces fins mmes si non en apparence ; c'est donc seulement
dans le cadre de mon projet fondamental que la volont peut avoir de
l ' efficace ; et j e ne pui s me dlivrer de mon complexe d'infrio
rit que par une modification radicale de mon projet qui ne saurait
aucunement trouver ses motifs et ses mobiles dans le projet antrieur,
mme pas dans les souffrances et les hontes que j' prouve, car celles
ci ont pour destination expresse de raliser mon projet d'i nfriorit.
Ainsi ne puis-je mme pas concevoir, tant que je suis dans l e
complexe d' i nfriorit, que je puisse mme en sortir, car si mme j e
rve d' en sortir, ce rve a sa fonction prcise qui est de me mettre
mme d'prouver davantage l' abjection de mon tat, il ne peut donc
s'interprter que dans et par l 'intention i nfriorisante. Et pourtant,
chaque moment, je saisis ce choix i nitial comme contingent et
injustifiable, chaque moment je suis donc pied d'uvre pour le
considrer soudain objectivement et, par suite, pour le dpasser et le
passifier en faisant surgir l 'instant librateur. De l mon angoisse, la
peur que j'ai d' tre soudain exorcis, c'est--dire de deveni r radicale
ment autre ; mai s de l aussi le surgissement frquent de conver
sions qui me font mtamorphoser totalement mon projet originel .
Ces conversions, qui n'ont pas t tucies par les philosophes, ont
souvent inspi r, au contraire, les littrateurs. Qu'on se rappelle
l'instant o l e Philoctte de Gide abandonne jusqu' sa haine, son
projet fondamental , sa raison d' tre et son tre ; qu'on se rappelle
520
l'instant o Raskolnikov dcide de se dnoncer. Ces instants extraor
dinaires et merveilleux, o le projet antrieur s'effondre dans le pass
la lumire d'un projet nouveau qui surgit sur ses ruines et qui ne fait
encore que s'esquisser, o l'humiliation, l ' angoisse, l a joie, l ' espoir se
marient troitement, o nous lchons pour saisir et o nous saisissons
pour lcher, ont souvent paru fournir l'image la plus claire et la plus
mouvante de notre libert. Mais i l s n'en sont qu'une manifestation
parmi d'autres.
Ainsi prsent, le de l'inefficacit des dcisions
volontaires paratra plus i noffensif : il revient dire que, par la
volont, nous pouvons nous construire entirement, mais que la
volont qui prside cette construction trouve elle-mme son sens
dans l e projet originel qu'elle peut paratre nier ; que par suite cette
constructi on a une fonction tout autre que celle qu'elle affiche ; et
qu'enfin el l e ne peut atteindre que des structures de dtail et qu'elle
ne modifiera jamais l e projet original dont el l e est issue, pas plus que
les consquences d'un thorme ne peuvent se retourner contre l ui et
le changer.
Au terme de cette longue discussion, i l sembl e que nous soyons
parvenu prciser un peu notre comprhension ontologique de la
libert. Il convient prsent de reprendre en une vue d'ensemble l es
diffrents rsultats obtenus.
1 Un premier regard sur la ralit-humaine nous apprend que,
pour elle, tre se rduit faire. Les psychologues du XIX
e
sicle qui
ont montr les structures motrices des tendances, de l'attenti on, de la
perception, etc. , ont eu raison. Seulement, l e mouvement lui-mme
est acte. Ainsi ne trouvons-nous aucune donne dans la ralit
humaine, au sens o le temprament, l e caractre, les passions, les
principes de l a raison seraient des data acquis ou inns, existant la
manire des choses. La seule considration empirique de l'tre
humain l e montre comme une unit organise de conduites ou de
comportements Etre ambitieux, lche ou irascibl e, c'est simple
ment se conduire de telle ou tel l e manire, en telle ou tel le
circonstance. Les bhaviouristes ont eu raison de considrer que la
seule tude psychologique positive devait tre cel l e des conduites
dans des situations rigoureusement dfinies. De mme que l es
travaux de Janet et des gestaltistes nous ont mi s mme de dcouvrir
les conduites motionnelles, de mme doit-on parler de conduites
perceptives puisque l a perception ne se conoit jamais en dehors
d'une attitude vis--vis du monde. Mme l ' attitude dsintresse du
savant, Hei degger l'a montr, est une prise de position dsintresse
vis--vis de l'objet et, par suite, une conduite parmi d'autres. Ainsi l a
ralit-humaine n' est pas d'abord pour agir, mais tre pour el l e, c'est
agir et cesser d'agir, c'est cesser d'tre.
2 Mais si la ral it-humaine est action cela signifie videmment
521
que sa dtermination l'action est elle-mme action. Si nous refusons
ce principe, et si nous admettons qu'elle peut tre dtermine
l'action par un tat antrieur du monde ou d'elle-mme, cela revient
mettre un donn l'origine de la srie. Ces actes alors disparaissent en
tant qu' actes pour faire place une srie de mouvements. C'est ainsi
que la notion de conduite se dtruit d'elle-mme chez Janet et chez les
bhaviouristes. L'existence de l'acte implIque son autonomie.
3 D'ailleurs, si l'acte n'est pas pur mouvement, i l doit se dfinir par
une intention. De quelque manire que l'on considre cette intention,
elle ne peut tre qu'un depassement du donn vers un rsultat
obteni r. Ce donn, en effet, tant pure prsence ne saurait sortir de
soi. Prcisment parce qu' il est, il est pleinement et uniquement ce
qu' i l est. Il ne saurait donc rendre raison d' un phnomne qui tire
tout son sens d'un rsultat atteindre, c'est--dire d'un inexistant.
Lorsque les psychologues, par exemple, font de l a tendance un tat de
fait, ils ne voient pas qu'ils lui tent tout caractre d'apptit (ad
petitio) . Si, en effet, la tendance sexuelle peut se diffrencier du
sommei l , par exempl e, ce ne peut tre que par sa fin et, prcisment,
cette fin n'est pas. Les psychologues auraient d se demander quelle
pouvait tre la structure ontologique d'un phnomne tel qu'il se fait
annoncer ce qu' i l est par quelque chose qui n'est pas encore,
L'intention, qui est la structure fondamentale de l a ralit-humai ne,
ne peut donc, en aucun cas, s'expliquer par un donn, mme si l'on
prtend qu'elle en mane. Mais si l'on veut l'interprter par sa fin, il
faut prendre garde de ne pas confrer cette fin une existence de
donn. Si l'on pouvait admettre, en effet, que l a fin est donne
antrieurement l'effet pour l'atteindre, i l faudrait alors concder
cette fin une sorte d'tre-en-soi au sein de son nant et une vertu
attractive de type proprement magique. Nous n' arriverions pas plus,
d'ailleurs, comprendre l a liaison d'une ralit-humaine donne avec
une fin donne par ailleurs que celle de la conscience-substance avec
l a ralit-substance dans les thses ralistes. Si l a tendance, ou l'acte,
doit s'interprter par sa fin, c'est que l'intention a pour structure de
poser sa fin hors de soi. Ainsi l'intention se fait tre en choisissant l a
fin qui l'annonce.
4 L'intention tant choi x de l a fin et l e monde se rvlant travers
nos conduites, c'est l e choix intentionnel de la fin qui rvle le monde
et l e monde se rvle tel ou tel (en tel ou tel ordre) selon la fi n choisie.
La fi n, clairant l e monde, est un tat du monde obtenir et non
encore existant . L'intention est conscience thtique de l a fin. Mais
elle ne peut l ' tre qu'en se faisant conscience non-thtique de sa
possibilit propre. Ainsi , ma fin peut tre un bon repas, si j ' ai faim.
Mais ce repas projet par del l a route poussireuse o je chemine,
comme le sens de cette route (elle va vers un htel o la table est mise,
o les plats sont prpars, o l' on m'attend, etc. ) , ne peut tre saisi
522
que corrlativement mon projet non-thtique vers ma propre
possibilit de manger ce repas. Ainsi par un surgissement double mais
unitaire l' intention claire l e monde partir d' une fin non encore
existante et se dfinit el l e-mme par le choix de son possible. Ma fin
est un certain tat objectif du monde, mon possible est une certaine
structure de ma subjectivit ; l'une se rvle l a conscience thtique,
J'autre reflue sur la conscience non-thtique pour l a caractriser.
5 Si le donn ne peut expliquer l'intention, il faut que celle-ci
ralise par son surgissement mme une rupture avec le donn quel
qu' il soit. I l ne saurait en tre autrement, sinon nous aurions une
plnitude prsente succdant, en continuit, une plnitude prsente
et nous ne saurions prfigurer l'avenir. Cette rupture est d'ailleurs
ncessaire J'apprciation du donn. Jamais, en effet, le donn ne
pourrait tre un moti f pour une acti on s' i l n' tai t apprci. Mai s cette
apprciation ne peut tre ralise que par un recul par rapport au
donn, une mise entre parenthses du donn, qui suppose justement
une rupture de continuit. En outre, J'apprciation, si elle ne doit pas
tre gratuite, doit se faire l a l umire de quelque chose. Et ce
quelque chose qui sert apprcier l e donn ne peut tre que l a fin.
Ainsi, l'intention, d'un mme surgissement unitaire, pose la fin, se
choisit et apprcie le donn partir de la fin. Dans ces conditions, l e
donn est apprci en fonction de quelque chose qui n'existe pas
encore ; c'est l a lumire du non-tre que l'tre-en-soi est clair. I l
en rsulte une double coloration nantisante du donn : d'une part, i l
est nantis en ce que l a rupture avec l ui lui fait perdre tout efficace
sur J'intention ; d'autre part, il subit une nouvelle nantisation du fait
qu'on lui rend cet efficace partir d'un nant, l'apprciation. La
alit-humaine tant acte ne peut se concevoir que comme rupture
avec le donn, dans son tre. Elle est J'tre qui fait qu'i! y a du donn
en brisant avec l ui et en l'clairant l a lumire du non-encore
existant.
6 Cette ncessit pour l e donn de n'apparatre que dans l es cadres
d'une nantisation qui le rvle ne fait qu'un avec l a ngation interne
que nous dcrivions dans notre deuxime partie. Il serait vain
d'imaginer que l a conscience puisse exister sans donn : elle serait
alors conscience (d') elle-mme comme conscience de rien, c'est-
dire le nant absolu. Mais si la conscience existe partir du donn,
cela ne signifie nullement que l e donn la conditionne : elle est pure
et simple ngation du donn , elle existe comme dgagement d'un
certain donn existant et comme engagement vers une certaine fin
encore non existante. Mais en outre, cette ngation interne ne peut
tre l e fait que d'un tre qui est en perptuel recul par rapport soi
mme. S'il n'tait pas sa propre ngation, il serait ce qu'il est, c'est-
dire un pur et simple donn ; de ce fait, i l n'aurait aucune liaison avec
tout autre datum puisque l e donn, par nature, n'est que ce qu'il est.
523
Ainsi, toute possibilit d'apparition d' un monde serait exclue. Pour
ne pas cre un donn, i l faut que l e pour-soi se constitue perptuelle
ment comme en recul par rapport soi, c'est--dire se laisse derrire
lui comme un datum qu'il n'est dj plus. Cette caractristique du
pour-soi impl ique qu' i l est l'tre qui ne trouve aucun secours, aucun
point d'appui en ce qu' i l tait. Mais au contraire l e pour-soi est libre et
peut faire qu'il y ait un monde parce qu'il est l'tre qui a tre ce qu'il
tait la lumire de ce qu'il sera. La libert du pour-soi apparat donc
comme son tre. Mais comme cette libert n'est pas un donn, ni une
propri t, elle ne peut tre qu'en se choisissant . La libert du pour-soi
est toujours engage ; il n'est pas question ici d'une libert qui serait
pouvoi r indtermin et qui prexisterait son choix. Nous ne nous
saisissons jamais que comme choix en trai n de se faire. Mais la libert
est simpl ement l e fait que ce choix est toujours inconditionn.
70 Un pareil choix, fait sans point d'appui, et qui se dicte lui
mme ses motifs, peut paratre absurde et l'est, en effet. C'est que la
libert est choix de son tre, mais non pas fondement de son tre.
Nous reviendrons sur ce rapport de la l i bert et de la facticit dans l e
prsent chapitre. II nous suffira de dire, pour l ' instant, que la ralit
humaine peut se choisir comme elle l'entend, mais ne peut pas ne pas
se choisir, el l e ne peut mme pas refuser d'tre : le suicide, en effet,
est choix et affirmation d'tre. Par cet tre qui lui est donn, el l e
participe l a contingence universelle de l ' tre et, par l mm, ce
que nous nommions absurdit. Ce choix est absurde, non parce qu'il
est sans raison, mais parce qu'il n'y a pas eu possibilit de ne pas
choisir. Quel qu' il soit, le choix est fond et ressaisi par l'tre, car il
est choix qui est. Mais ce qu'il faut noter ici , c'est que ce choix n'est
pas absurde au sens o, dans un univers rationnel, un phnomne
surgirait qui ne serait pas reli aux autres par des raisons : i l est
absurde en ce sens qu'il est ce par quoi tous les fondements et toutes
les raisons viennent l ' tre, ce par quoi l a notion mme d'absurde
reoit un sens. Il est absurde comme tant par del toutes les raisons.
Ainsi l a libert n'est pas purement et simplement la contingence en
tant qu' el l e se retourne vers son tre pour l'clairer l a lumire de sa
fin, el le est perptuel chappement l a contingence, el l e est
i ntriorisation, nantisation et subjectivisation de l a contingence qui ,
ainsi modifie, passe tout entire dans l a gratuit du choix.
80 Le projet libre est fondamental, car i l est mon tre. Ni l'ambition
ni l a passion d'tre ai m, ni l e complexe d' infriorit ne peuvent tre
considrs comme projets fondamentaux. Il faut, au contraire, qu'ils
se comprennent partir d' un premier projet, qui se reconnat ce
qu' i l ne peut plus s'interprter partir d'aucun autre et qui est total.
Une mthode phnomnologique spciale sera ncessaire pour expli
citer ce projet initial . C'est elle que nous appelons psychanalyse
existenti el l e. Nous en parlerons dans notre prochain chapitre. Ds
524
prsent, nous pouvons dire que le projet fondamental que je suis est
un projet concernant non mes rapports avec tel ou tel objet particulier
du monde, mais mon tre-dans-Ie-monde en totalit et que-puisque
le monde lui-mme ne se rvle qu' l a lumire d'une fin -ce projet
pose pour fin un certain type de rapport l'tre que l e pour-soi veut
entretenir. Ce projet n'est point instantan car il ne saurait tre
dans l e temps. Il n'est pas non plus intemporel pour se donner
du temps par aprs. C'est pourquoi nous repoussons l e choix du
caractre intelligibl e de Kant. La structure du choi x implique
ncessairement qu' il soit choix dans l e monde. Un choix qui serait
choix partir de rien, choix contre rien ne serait choix de rien et
s'anantirait comme choix. Il n' y a de choix que phnomnal, si l ' on
entend bien toutefois que l e phnomne est ici l ' absol u. Mais dans
son surgissement mme i l se temporalise puisqu' il fait qu'un futur
vient clairer le prsent et l e constituer comme prsent en donnant
aux data en-soi la signification de passit. Cependant, il ne faut
pas entendre par l que le projet fondamental est coextensif l a
vie entire du pour-soi , L libert tant tre-sans-appui et sans
tremplin, l e projet, pour tre, doi t tre constamment renouvel. Je
me choisis perptuellement et ne puis jamais tre titre d'ayant-t
choisi, sinon je retomberais dans la pure et simple existence de l'en
soi. La ncessit de me choisir perptuellement ne fait qu' un avec l a
poursuite-poursuivie que je suis. Mais, prcisment parce qu'il s'agit
d'un choix, ce choix, dans la mesure o i l s'opre, dsigne en gnral
d'autres choix comme possibles. La possibilit de ces autres choix
n'est ni explicite ni pose, mais elle est vcue dans le sentiment
d'injustifiabilit et c'est elle qui s'exprime par l e fait de l'absurdit de
mon choix et , par consquent, de mon tre. Ai nsi ma libert ronge
ma libert. Etant libre, en effet, je projette mon possible total, mais
je pose par l que je suis libre et que je peux toujours nantiser ce
projet premier et l e passifier. Ainsi, dans l e moment o l e pour-soi
pense se saisir et se faire annoncer par un nant pro-jet ce qu'il est, il
s'chappe car il pose par l mme qu' i l peut tre autre qu'il est. Il lui
suffira d'expliciter son injustifiabilit pour faire surgir l'instant, c'est
-dire l 'apparition d' un nouveau projet sur l 'effondrement de
l'ancien. Toutefois, ce surgissement du nouveau projet ayant pour
condition expresse la nantisation de l'ancien, l e pour-soi ne peut se
confrer une existence neuve : ds lors qu'il repousse l e projet prim
dans le pass, i l a tre ce projet sous l a forme du tais cela
signifie que ce projet prim appartient dsormais sa situation.
Aucune loi d'tre ne peut assigner un nombre a priori aux diffrents
projets que je suis : l 'existence du pour-soi conditionne en effet son
essence. Mais i l faut consulter l'histoire de chacun pour s'en faire,
propos de chaque pour-soi singulier, une ide singulire. Nos projets
particuliers touchant la ralisation dans l e monde d'une fin particu-
525
lire s'intgrent dans le projet global que nous sommes. Mais
prcisment parce que nous sommes tout entiers choix et acte, ces
projets partiels ne sont pas dtermins par le projet global : ils
doivent tre eux-mmes des choix et une certaine marge de contin
gence, d'imprvisibilit et d' absurde est l aisse chacun d'eux,
encore que chaque projet, en tant qu'il se projette, tant spcification
du projet global l'occasion d'lments particuliers de la situation, se
comprend toujours par rapport la totalit de mon tre-dans-le
monde.
Par ces quelques observations, nous pensons avoir dcrit l a libert
du pour-soi dans son existence originelle. Mais on aura remarqu que
cette libert requiert un donn, non comme sa condition, mais plus
d'un titre : tout d'abord, l a libert ne se conoit que comme
nantisation d'un donn ( 5) et, dans la mesure o elle est ngation
interne et conscience, elle participe ( 6) l a ncessit qui prescrit la
conscience d'tre conscience de quelque chose. En outre, la libert est
libert de choisir, mais non l a libert de ne pas choisir. Ne pas choisir,
en effet, c'est choisir de ne pas choisir. II en rsulte que l e choix est
fondement de l ' tre-choisi, mais non pas fondement du choisir. D'o
l'absurdit ( 7) de la libert. L encore, el l e nous renvoie un
donn, qui n'est autre que la facticit mme du pour-soi. Enfin, l e
projet global , bi en qu'clairant l e monde en sa totalit, peut se
spcifier l'occasion de tel ou tel lment de l a situation et, par
consquent, de la contingence du monde. Toutes ces remarques nous
renvoient donc un problme difficile : celui des rapports de la
l i bert l a facti ci t. Elles rejoignent d' ailleurs les objections
concrtes qu'on ne manquera pas de nous fai re : puis-je choisir d'tre
grand si je suis peti t ? d'avoir deux bras si je suis manchot ? etc. , qui
portent j ustement sur les limites que ma situation de fait
apporterait mon libre choix de moi-mme. Il convient donc
d' examiner l ' autre aspect de la libert, son revers : sa relation
avec la facticit.
Il
LI BERT ET FACTI CI T : LA SI TuATI ON
L' argument dcisif utilis par le bon sens contre l a libert consiste
nous rappel er notre impuissance. Loin que nous puissions modifier
notre situation notre gr, il semble que nous ne puissions pas nous
changer nous-mmes. Je ne suis libre ni d'chapper au sort de ma
526
classe, de ma nation, de ma fami l l e, ni mme d' di fier ma puissance
ou ma fortune, ni de vaincre mes apptits les plus insignifiants ou mes
habitudes. Je nais ouvrier, Franais, hrdo-syphilitique ou tubercu
leux. L'histoire d'une vi e, quelle qu'elle soit, est l 'histoire d'un chec.
Le coefficient d'adversit des choses est tel qu'il faut des annes de
patience pour obtenir le plus infime rsultat. Encore faut-il obir
la nature pour la commander , c'est--dire insrer mon action dans
les mailles du dterminisme. Bien plus qu'il ne parat se faire ,
l'homme semble tre fai t par l e climat et l a terre, l a race et la
classe, la langue, l'histoire de la collectivit dont i l fait partie,
l'hrdit , les circonstances individuelles de son enfance, les habi
tudes acquises, l es grands et les petits vnements de sa vie.
Cet argument n' a jamais profondment troubl l es partisans de l a
libert humaine : Descartes, le premier, reconnaissait l a fois que la
volont est infinie et qu'i l faut tcher nous vaincre plutt que l a
fortune C'est qu' il convient ici d e faire des distincti ons ; beaucoup
des faits noncs par les dterministes ne sauraient tre pris en
considrati on. Le coeffi cient d'adversit des choses, en particulier, ne
saurait tre un argument contre notre libert, car c'est par nou, c'est
-dire par la position pralable d'une fin, que surgit ce coefficient
d'adversit. Tel rocher, qui manifeste une rsistance profonde si je
veux l e dplacer, sera, au contraire, une aide prcieuse si je veux
l'escalader pour contempler le paysage. En lui-mme -s'il est mme
possible d'envisager ce qu'il peut tre en lui-mme - i l est neutre,
c'est--dire qu'il attend d'tre clair par une fin pour se manifester
comme adversaire ou comme auxi liaire. Encore ne peut-il se manifes
ter de l ' une ou l'autre manire qu' l ' i ntrieur d' un complexe
ustensile dj tabli . Sans les pics et les piolets, les sentiers dj
tracs, la technique de l'ascension, le rocher ne serait ni facile ni
malais gravi r ; l a question ne se poserait pas, i l ne soutiendrait
aucun rapport d'aucune sorte avec l a technique de l'alpinisme. Ainsi,
bien que les choses brutes (ce que Heidegger appelle les existants
bruts ) puissent ds l ' origine limiter notre libert d'action, c'est
notre libert elle-mme qui doit pralablement constituer l e cadre, la
technique et les fins par rapport auxquels elles se manifesteront
comme des limites. Si le rocher, mme, se rvle comme trop
difficile gravir et si nous devons renoncer l ' ascension, notons
qu'i! ne s'est rvl tel que pour avoir t originel l ement saisi comme
gravissable c'est donc notre libert qui constitue les limites
qu'elle rencontrera par la suite. Certes, aprs ces remarques, il
demeure un residuum innommable et i mpensable qui appartient
l'en-soi considr et qui fait que, dans un monde clair par notre
libert, tel rocher sera plus propice l'escalade et tel autre non. Mais
loin que ce rsidu soit originellement une limite de l a libert, c'est
grce lui -c'est -dire l'en-soi brut, en tant que tel - qu'elle
527
surgit comme l ibert. Le sens commun conviendra avec nous, en
effet, que l ' tre dit libre est celui qui peut raliser ses projets. Mais
pour que l'acte puisse comporter une ralisation, i l convient que la
simple project i on d'une fin possible se distingue a priori de la
ralisation de cette fin. S'il suffit de concevoir pour raliser, me voil
pl ong dans un monde semblable celui du rve, o le possible ne se
di stingue pl us aucunement du rel. Je suis condamn ds lors voir le
monde se modifi er au gr des changements de ma conscience, je ne
puis pas prati quer, par rapport ma conception, la mise entre
parenthses et la suspensi on de jugement qui distingueront une
simple fiction d'un choix rel . L'objet apparaissant ds qu'il est
simplement conu ne sera plus ni choisi ni seulement souhait. La
distinction entre l e simple souhait, la reprsentation que j e pourrais
choisir et le choix tant aboli e, la libert disparat avec el l e. Nous
sommes libres lorsque le terme ultime par quoi nous nous faisons
annoncer ce que nous sommes est une fin, c'est--dire non pas un
existant rel , comme celui qui , dans la supposition que nous avons
faite, viendrait combler notre souhait, mais un objet qui n'existe pas
encore. Mais ds lors cette fin ne saurait tre transcendante que si elle
est spare de nous en mme temps qu'accessibl e. Seul un ensemble
d'existants rels peut nous sparer de cette fin -de mme que cette
fin ne peut tre conue que comme tat -venir des existants rels qui
m'en sparent . Elle n'est autre que l'esquisse d'un ordre des existants,
c'est--dire d' une srie de dispositions faire prendre aux existants
sur l e fondement de leurs relations actuelles. Par l a ngation-interne,
en effet, le pour-soi claire les existants dans leurs rapports mutuels
par l a fin qu' i l pose, et proj ette cette fin partir des dterminations
qu'il saisit en l'existant. Il n'y a pas de cercle, nous l'avons vu, car le
surgissement du pour-soi se fait d'un seul coup. Mais, s'il en est ainsi,
l'ordre mme des exi stants est indispensable la libert elle-mme.
Cest par eux qu'el l e est spare et rejointe par rapport l a fin qu'elle
poursuit et qui l ui annonce ce qu' el l e est. En sorte que les rsistances
que la libert dvoi l e dans l'existant, loin d'tre un danger pour la
li bert, ne font que l ui permettre de surgir comme libert. Il ne peut y
avoir de pour-soi l i bre que comme engag dans un monde rsistant.
En dehors de cet engagement, les notions de libert, de dtermi
nisme, de ncessit
perdent j usqu' leur sens.
Il faut, en outre, prciser contre l e sens commun que l a formule
tre libre ne signifie pas obtenir ce qu'on a voulu , mai s se
dterminer vouloir (au sens large de choisir) par soi-mme .
Autrement dit, le succs n' i mporte aucunement l a libert. L
discussion qui oppose le sens commun aux philosophes vient i ci d'un
mal entendu : le concept empirique et populaire de libert produit
de circonstances hi storiques, pol i tiques et morales quivaut
d' obtenir les fins choisies . Le concept technique et
528
philosophique de libert, le seul que nous considrions ici , signifie
seulement : autonomie du choix. Il faut cependant noter que le choix
tant identique au faire suppose, pour se distinguer du rve et du
souhait, un commencement de ralisation. Ainsi ne dirons-nous pas
qu'un captif est toujours libre de sortir de prison, ce qui serait
absurde, ni non plus qu' i l est toujours libre de souhaiter l'largisse
ment, ce qui serait une l apalissade sans porte, mais qu' i l est toujours
libre de chercher s'vader (ou se faire l ibrer) -c'est--dire que
quelle que soit sa condition, il peut pro-jeter son vasion et
s'apprendre lui-mme la valeur de son projet par un dbut d'action.
Notre description de l a l i bert, ne distinguant pas entre le choisir et le
faire, nous oblige renoncer du coup la distinction entre l 'i ntention
et l'acte. On ne saurait pas plus sparer l'intention de l'acte que la
pense du l angage qui l'exprime et, comme il arrive que notre parole
nous apprend notre pense, ainsi nos actes nous apprennent nos
intenti ons, c'est--dire nous permettent de les dgager, de les
schmatiser, et d'en faire des objets au lieu de nous borner les vivre,
c'est--dire en prendre une conscience non-thtique. Cette distinc
tion essentielle entre l a l i bert du choix et l a l i bert d'obtenir a
certainement t vue par Descartes, aprs le stocisme. Elle met un
terme toutes les discussions sur vouloir et pouvoir qui
opposent aujourd'hui encore les partisans et l es adversaires de la
libert.
Il n'en est pas moi ns vrai que l a libert rencontre ou semble
rencontrer des l i mites, du fait du donn qu'elle dpasse ou nantit.
Montrer que l e coefficient d'adversit de l a chose et son caractre
d'obstacle (joint son caractre d'ustensile) est indispensable
l'existence d'une l i bert, c'est se servir d'un argument double
tranchant car s'il permet d'tabl i r que la libert n'est pas dirime par
le donn, il indique d'autre part quelque chose comme un condition
nement ontologique de la libert. Ne serait-on pas fond dire,
comme certains phi losophes contemporains : sans obstacle, pas de
libert ? Et comme nous ne pouvons admettre que l a l i bert se cre
elle-mme son obstacle - ce qui est absurde pour quiconque a
compris ce qu'est une spontanit -, il semble y avoir ici comme une
prsance ontologique de l'en-soi sur le pour-soi. Il faut donc
considrer les remarques antrieures comme de simples tentatives
pour dblayer l e terrain, et reprendre du dbut l a question de la
facticit.
Nous avons tabli que le pour-soi tait libre. Mais cela ne signifie
pas qu'il soit son propre fondement. Si tre libre signifiait tre son
propre fondement, i l faudrait que la libert dcidt de l 'existence de
son tre. Et cette ncessit peut s' entendre de deux faons. D'abord,
i l faudrait que l a libert dcidt de son tre-libre, c'est--dire non
seulement qu'elle ft choix d'une fin, mais qu'el l e ft choix d' el l e-
529
mme comme l i bert. Cela supposerait donc que la possibilit d'tre
l i bre et la possibilit de n'tre pas libre existent galement ayant le
li bre choix de l ' une d'elles, c'est--dire avant le libre choix de la
l i bert. Mais comme i l faudrait alors une libert prala
b
le qui
choisisse d'tre I i b . e, c'est--dire, au fond, qui choisisse d'tre ce
qu'elle est dj, nous serions renvoys l'infini, car el l e aurait besoin
d'une autre libert antrieure pour la choisir et ainsi de suite. En fait,
nous sommes une libert qui choisit mais nous ne choisissons pas
d' tre l ibres : nous sommes condamns l a libert, comme nous
l'avons dit plus haut, jets dans l a libert ou, comme dit
dlaisss . Et , comme on le voit, ce dlaissement n' a d'autre
origine que l'existence mme de la libert. Si donc l'on dfinit la
l i bert comme l ' chappement au donn, au fait, i l y a un fair de
l'chappement au fai t. Cest l a facticit de la libert.
Mais l e fait que l a libert n'est pas son fondement peut tre encore
entendu d' une autre faon, qui amnera des conclusions identiques.
Si , en effet , l a l i bert dcidait de l'existence de son tre, i l ne faudrait
pas seul ement que l'tre comme non-libre soit possi ble, i l faudrait
encore que soit possible mon inexistence absolue. En d'autres termes,
nous avons vu que dans l e projet initial de l a l i bert la fin se retournait
sur les motifs pour les constituer ; mais si l a libert doit tre son
propre fondement , l a fin doit, en outre, se retourner sur l ' existence
el le-mme pour l a faire surgir. On voit ce qui en rsulterait : l e pour
soi se tirerait l ui-mme du nant pour atteindre la fin qu' il se propose.
Cette existence l gitime par sa fin serait existence de droie, non de
fair. Et il est vrai que, parmi les mille manires qu'a l e pour-soi
d'essayer de s'arracher sa contingence originelle, i l en est une qui
consiste tenter de se faire reconnatre par autrui comme existence
de droit. Nous ne tenons nos droits individuels que dans l e cadre
d' un vaste projet qui tendrait nous confrer l'existence partir de la
fonction que nous remplissons. C'est la raison pour laquelle l ' homme
tente si souvent de s'identifier sa fonction et cherche ne voir en lui
mme que l e prsident de la Cour d'appel , le trsorier-payeur
gnral , etc. Chacune de ces fonctions a son existence justifie par
sa fin, en effet. Etre identifi l ' une d'elles c'est prendre sa propre
existence comme sauve de la contingence. Mais ces efforts pour
chapper la contingence originel l e ne font que mieux tablir
l 'existence de cel l e-ci. La libert ne saurait dcider de son existence
par la fin qu' el l e pose. Sans doute, el l e n'existe que par le choix
qu' el l e fait d' une fi n, mais el l e n'est pas matresse du fait qu'il y a une
l i bert qui se fait annoncer ce qu' el l e est par sa fin. Une libert qui se
produirait ell e-mme l'existence perdrait son sens mme de libert.
En effet, l a l i bert n'est pas un simple pouvoir indtermi n. Si elle
tait tel le, elle serait nant ou en-soi ; et c'est par une synthse
aberrante de l ' en-soi et du nant qu'on a pu la concevoir comme un
530
pouvoir nu et prexistant ses choix. Elle se dtermine par son
surgissement mme en un fai re . Mais, nous l'avons vu, faire
suppose la nantisation d'un donn. On fait quelque chose de quelque
chose. Ainsi la libert est manque d'tre par rapport un tre donn
et non pas surgissement d'un tre plein. Et si elle est ce trou d'tre, ce
nant d'tre que nous venons de di re, elle suppose tout l'tre pour
surgir au cur de l'tre comme un trou. Elle ne saurait donc se
dterminer l ' existence partir du nant, car toute production
partir du nant ne saurait tre que de l'tre-en-soi. Nous avons
d'ailleurs prouv dans la premire partie de cet ouvrage que le nant
ne pouvait apparatre null e part si ce n'est au cur de l'tre. Nous
rejoignons ici les exigences du sens commun : empiriquement, nous
ne pouvons tre libres que par rapport un tat de choses et malgr
cet tat de choses. On dira que je suis libre par rapport cet tat de
choses lorsqu'il ne me contraint pas. Ainsi , l a conception empirique
et pratique de la libert est toute ngative, elle part de la considra
tion d'une si tuation et constate que cette situation me laisse libre de
poursuivre telle ou telle fin. On pourrait dire, mme, que cette
situation conditi onne ma. libert en ce sens qu'elle est l pour ne pas
me contraindre. Otez l a dfense de circuler dans les rues aprs le
couvre-feu - et que pourra bi en signifier pour moi l a libert (qui
m'est confre, par exemple, par un sauf-conduit) de me promener l a
nuit ?
Ainsi la libert est un moindre tre qui suppose l'tre, pour s'y
soustraire. Elle n'est libre ni de ne pas exister, ni de ne pas tre libre.
Nous allons saisir aussitt la liaison de ces deux structures ; en effet,
comme la libert est chappement l'tre, elle ne saurait se produire
ct de l'tre, comme latralement et dans un projet de survol : on
ne s'chappe pas d'une gele o l'on n'tait pas enferm. Une
projection de soi en marge de l ' tre ne pourrait aucunement se
constituer comme nantisation de cet tre. La libert est chappe
ment un engagement dans l ' tre, elle est nantisation d'un tre
qu'elle est. Cela ne signifie pas que la ralit-humaine existe d'abord
pour tre libre ensuite. Ensuite et d'abord sont des termes crs par l a
libert elle-mme. Simplement l e surgissement de l a libert se fait par
la double nantisation de l'tre qu'elle est et de l'tre au mi l ieu duquel
elle est. Naturel l ement, elle n'est pas cet tre au sens d'tre-en-soi .
Mais elle fait quil y a cet tre qui est sien derrire elle, en l'clairant
dans ses i nsuffisances l a l umire de la fin qu'elle choisit : elle a tre
derrire el l e cet tre qu'elle n'a pas choisi et, prcisment dans l a
mesure o el l e se retourne sur lui pour l'clairer, el l e fait que cet tre
qui est sien apparaisse en rapport avec l e plenum de l'tre, c'est--dire
existe au milieu du monde. Nous disions que l a libert n'est pas libre
de ne pas tre l i bre et qu'elle n'est pas libre de ne pas exister. C'est
qu'en effet l e fait de ne pas pouvoir ne pas tre libre est la facticit de
531
la libert , et le fait de ne pas pouvoir ne pas exister est sa contingence.
Contingence et facticit ne font qu' un : il y a un tre que la libert a
tre sous forme du n 'tre-pas (c'est--dire de la nantisation). Exister
comme le fait de l a l i bert ou avoir tre un tre au milieu du monde,
c'est une seule et mme chose et cel a signifie que l a libert est
originel lement rapport au donn.
Mais quel est ce rapport au donn ? Et faut-il entendre par l que l e
donn (l ' en-soi) condi ti onne l a l ibert ? Regardons-y micux : l e
donn n'est ni cause de la libert (puisqu' il ne peut produire que du
donn), ni raison (puisque toute raison vient au monde par l a
libert). Il n' est pas non pl us condition ncessaire de la libert,
puisque nous sommes sur l e terrain de la pure contingence. I I n'est
pas non plus une matire indispensable sur quoi la libert doive
s'exercer, car ce serait supposer que la libert existe comme une
forme aristotlici enne ou comme un pneuma stoci en, toute faite, et
qu' el le cherche une matire ouvrer. Il n'entre en ri en dans la
constitution de la l i bert puisque celle-ci s'intriorise comme ngation
interne du donn. Simpl ement, i l est la pure contingence que la
libert s'exerce ni er en se faisant choix, i l est la plnitude d'tre que
la libert colore d' i nsuffisance et de ngatit en l'clairant la lumire
d'une fin qui n'existe pas, il est la libert mme en tant qu'elle existe
et que, quoi qu' el l e fasse, el l e ne peut chapper son existence. Le
lecteur a compris que ce donn n'est autre chose que l'en-soi nantis
par le pour-soi qui a l'tre, que le corps comme point de vue sur le
monde, que l e pass comme essence que l e pour-soi tait : trois
dsignations pour une mme ralit. Par son recul nantisant, la
libert fait qu'un systme de relations s'tablisse, du point de vue de
l a fin, entre l es en-soi, c'est--dire entre le plenum d'tre qui se
rvle alors comme monde et l ' tre qu' el l e a tre au mi l i eu de ce
plenum et qui se rvle comme un tre, comme un ceci qu' el l e a
tre. Ai nsi, par sa projection mme vers une fin, la libert constitue
comme tre au mil i eu du monde un datum particulier qu'elle a tre.
Elle ne l e choisit pas, car ce serait choisir sa propre existence, mais
par l e choix qu' el l e fait de sa fin, elle fait qu'il se rvle de telle ou
tel le faon, sous telle ou telle l umire, en liaison avec la dcouverte
du monde l ui -mme. Ainsi , l a contingence mme de l a libert et le
monde qui environne cette contingence de sa propre contingence ne
l ui apparatront qu' la lumire de la fin qu'elle a choisie, c'est--dire
non pas comme existants bruts, mais dans l'unit d'clairage d'une
mme nantisati on. Et l a libert ne saurait jamais ressaisir cet
ensemble comme pur datum, car il faudrait que ce ft en dehors de
tout choix et, donc, qu'elle cesse d'tre libert. Nous appellerons
situation l a contingence de l a libert dans le plenum d'tre du monde
en tant que ce datum, qui n'est l que pour ne pas contraindre l a
libert, ne se rvle cette libert que comme dj clair par l a fin
532
qu'elle choisit . Ainsi le datum n'apparat j amais comme existant brut
et en-soi au pour-soi ; i l se dcouvre toujours comme mOlif puisqu'il
ne se rvle qu' la lueur d' une fin qui l'claire. Situation et
motivation ne font qu' un. Le pour-soi se dcouvre comme engag
dans l' tre, investi par l'tre, menac par l'tre ; il dcouvre l'tat de
choses qui l' entoure comme moti f pour une raction de dfense ou
d'attaque. Mais il ne peut faire cette dcouverte que parce qu'il pose
librement la fin par rapport laquelle l'tat de choses est menaant ou
favorabl e. Ces remarques doivent nous apprendre que la sirualion,
produit commun de la contingence de l'en-soi et de la libert, est un
phnomne ambigu dans lequel il est i mpossible au pour-soi de
discerner l'apport de la libert et de l ' existant brut. De mme, en
effet, que la l i bert est chappement une contingence qu'elle a
tre pour lui chapper, de mme la situation est libre coordination et
libre qualification d'un donn brut qui ne se laisse pas qualifier
n'importe comment. Me voil au pied de ce rocher qui m'apparat
comme non escal adable . Cela signifie que le rocher m'apparat
la lumire d' une escalade projete -projet secondaire qui trouve son
sens partir d'un projet ini ti al qui est mon tre-dans-Ie-monde. Ai nsi,
le rocher se dcoupe sur fond de monde par l'effet du choix i ni ti al de
ma libert. Mais, d'autre part, ce dont ma libert ne peut dcider,
c'est si l e rocher escalader se prtera ou non l'escalade. Cela
fait partie de l'tre brut du rocher. Toutefois le rocher ne peut
manifester sa rsistance l'escalade que s'il est intgr par la libert
dans une situation dont le thme gnral est l'escalade. Pour l e
simple promeneur qui passe sur la route et dont le l i bre projet est
pure ordination esthtique du paysage, le rocher ne se dcouvre ni
comme escaladable, ni comme non-escaladable : i l se manifeste
seulement comme beau ou l ai d. Ai nsi est-il impossible de dterminer
en chaque cas particulier ce qui revient la libert et ce qui revient
l'tre brut du pour-soi . Le donn en soi comme rsistance ou comme
aide ne se rvle qu' l a lumire de l a l i bert pro-jetante. Mais la
libert pro-jetante organise un clairage tel que l'en-soi s'y dcouvre
comme il eSI, c'est--dire rsistant ou propice, tant bien entendu que
la rsistance du donn n'est pas directement recevable comme qualit
en-soi du donn mais seulement comme indication, travers un libre
clairage et une libre rfracti on, d' un quid insaisissable. C'est donc
seulement dans et par le libre surgissement d'une libert que l e
monde dveloppe et rvle les rsistances qui peuvent rendre l a fin
projete irralisable. L'homme ne rencontre d'obstacle que dans le
champ de sa libert. Mieux encore : i l est impossible de dcrter a
priori ce qui revient l ' existant brut et la libert dans le caractre
d'obstacle de tel existant particulier. Ce qui est obstacle pour moi , en
effet, ne l e sera pas pour un autre. II n' y a pas d'obstacle absol u, mais
l'obstacle rvle son coefficient d'adversit travers les techniques
533
librement inventes, l i brement acquises ; il le rvle aussi en fonction
de la valeur de la fin pose par la libert. Ce rocher ne sera pas un
obstacle si je veux, cote que cote , parvenir au haut de l a montagne ;
il me dcouragera, au contraire, si j 'ai librement fix des limites
mon dsir de faire l'ascension projete. Ainsi le monde, par des
coefficients d' adversit, me rvle la faon dont je tiens aux fins que
je m' assigne ; en sorte que je ne puis j amais savoir s'il me donne un
renseignement sur moi ou sur l ui . En outre, l e coefficient d'adversit
du donn n'est j amais simple rapport ma libert comme pur
jai l lissement nantisant : i l est rapport clair par la libert entre le
datum qu'est le rocher et le datum que ma libert a tre, c'est--dire
entre le contingent qu'elle n'est pas et sa pure facticit. A dsir gal
d'escalade, le rocher sera ais gravir pour tel ascensionniste
athltique, diffi ci l e pour tel autre, novice, mal entran et au corps
malingre. Mais le corps ne se rvle son tour comme bien ou mal
ent ran que par rapport un choix l i bre . C'est parce que je suis l et
que j 'ai fait de moi ce que je sui s que le rocher dveloppe par rapport
mon corps un coefficient d'adversit. Pour l'avocat demeur la
vi l l e et qui plai de, l e corps dissi mul sous sa robe d'avocat, l e rocher
n'est ni difficile ni ais gravir : il est fondu dans l a totalit monde
sans en merger aucunement. Et , en un sens, c'est moi qui choisis
mon corps comme malingre, en l 'affrontant aux di fficults que je fais
natre (alpinisme , cyclisme, sport ). Si je n' ai pas choisi de faire du
sport, si j e demeure dans l es villes et si je m'occupe exclusivement de
ngoce ou de travaux i ntellectuels, mon corps ne sera aucunement
qual i fi de ce poi nt de vue. Ainsi commenons-nous entrevoir l e
paradoxe de la l i bert : i l n' y a de l i bert qu'en situation et i l n' y a de
situation que par l a libert. La ralit-humaine rencontre partout des
rsistances et des obstacles qu'elle n'a pas crs ; mais ces rsistances
et ces obstacles n' ont de sens que dans et par le libre choix que la
ralit-humaine est. Mais pour mieux saisir l e sens de ces remarques
et pour en tirer l e profit qu'elles comportent, i l convient prsent
d'analyser l eur l umi re quel ques exemples prcis. Ce que nous
avons appel facticit de la libert, c'est l e donn qu'elle a tre et
qu' el l e claire de son projet. Ce donn se mani feste de plusieurs
manires, encore que dans l ' uni t absolue d'un mme clairement.
C'est ma place, mon corps, mon pass, ma position en tant qu'elle est
dj dtermine par l es indications des autres, enfin ma relarion
fondamentale autrui. Nous allons examiner successivement et sur
des exemples prcis ces diffrentes structures de la situation. Mais i l
ne faudra jamai s perdre de vue qu'aucune d'elles n'est donne seule
et que, lorsqu'on en considre une isolment, on se borne la faire
paratre sur le fond synthtique des autres.
534
A) Ma place.
Elle se dfinit par l'ordre spatial et la nature singulire des ceci qui
se rvlent moi sur fond de monde. C'est naturellement le lieu que
j'habite (mon pays avec son sol, son climat, ses richesses, sa
configuration hydrographique et orographique) , mais c'est aussi,
plus simplement, la disposition et l'ordre des objets qui prsente
ment m'apparaissent (une table, de l'autre ct de la table une
fentre, la rue et l a mer), et qui m' i ndiquent comme la raison mme
de leur ordre. Il ne se peut pas que j e n'aie pas une place, sinon je
serais, par rapport au monde, en tat de surol, et le monde ne se
manifesterait plus d'aucune faon, nous l'avons vu antrieurement.
Par ailleurs, bien que cette place actuelle puisse m'avoir t assigne
par ma libert (j'y suis venu j e n'ai pu l'occuper qu'en fonction
de celle que j'occupais antrieurement et en suivant des chemins
tracs par les objets eux-mmes. Et cette place antrieure me
renvoie une autre, celle-ci une autre , ainsi de suite jusqu' la
contingence pure de ma place, c'est--dire jusqu' celle de mes places
qui ne renvoie plus rien de moi : la place que m'assigne la
naissance. Il ne servirait rien, en effet, d'expliquer cette dernire
place par celle qu'occupait ma mre lorsqu'elle m'a mis au monde :
la chane est rompue, les places librement choisies par mes parents
ne sauraient aucunement valoir comme explication de mes places ; et
si l'on considre rune d'entre elles dans sa liaison avec ma place
originelle - comme lorsqu'on dit par exemple : je suis n
Bordeaux, parce que mon pre y fut nomm fonctionnaire -j e suis
n Tours parce que mes grands-parents y avaient des proprits et
ma mre se rfugia prs d'eux, lorsque, pendant sa grossesse, on lui
apprit la mort de mon pre -, c'est pour mieux faire ressortir
combien pour moi la naissance et la place qu' elle m'assigne sont
choses contingentes. Ainsi natre c'est, entre autres caractristiques,
prendre sa place ou plutt, d'aprs ce que nous venons de dire, la
recevoir. Et comme cette place originelle sera celle partir de
laquelle j'occuperai de nouvelles places selon des rgles dtermi
nes, i l semble qu'il y ait l une forte restriction de ma libert. La
question s' embroui lle, d'ailleurs, ds qu'on y rflchit : les partisans
du libre arbitre montrent, en effet , qu' partir de toute place
prsentement occupe, une i nfinit d'autres places s'offrent mon
choix ; les adversaires de la libert insistent sur le fait qu'une infinit
de places me sont refuses de ce fait et qu'en outre les objets
tournent vers moi une face que je n'ai pas choisie et qui est exclusive
de toutes les autres ; ils ajoutent que ma place est trop profondment
lie aux autres conditions de mon existence (rgime alimentaire,
climat, etc. ) pour ne pas contribuer me faire. Entre partisans et
535
adversaires de la libert, la dcision semble impossible. C'est que le
dbat n'a pas t port sur son vritable terrain.
En fait, si nous voulons poser la question comme i l faut, il convient
de partir de cette antinomie : l a ralit-humaine reoit originellement
sa place au mi l i eu des choses - la ralit-humaine est ce par quoi
quelque chose comme une place vient aux choses. Sans ralit
humai ne, il n'y aurait ni espace ni place et pourtant cette ralit
humai ne par qui remplacement vi ent aux choses vient recevoir sa
place parmi les choses, sans en tre aucunement matresse. A vrai
dire, il n' y a pas l de mystre : mais la description doit partir de
l'antinomie, c'est elle qui nous livrera l'exact rapport de libert et de
facticit.
L'espace gomtrique, c'est--di re l a pure rciprocit des relations
spatiales, est un pur nant, nous l'avons vu. Le seul emplacement
concret qui puisse se dcouvrir moi, c'est l'tendue absolue, c'est-
di re, justement, celle qui est dfinie par ma place considre comme
centre et pour laquelle les distances se comptent absolument de
l'objet moi , sans rciprocit. Et la seule tendue absolue est celle
qui se dplie partir d'un lieu que j e suis absolument. Aucun autre
point ne pourrait tre choisi comme centre absolu de rfrence,
moins d'tre entran aussitt dans la relativit universell e. S'il y a
une tendue, dans les limites de laquelle je me saisirai comme libre ou
comme non-libre , qui se prsentera moi comme auxiliaire ou
comme adverse (sparatrice) , ce ne peut tre que parce qu'avant tout
j'existe ma place, sans choix, sans ncessit non plus, comme le pur
fait absolu de mon tre-l. Je suis l : non pas ici mais l. Voil le fait
absolu et incomprhensible qui est l'origine de l'tendue et, par
suite, de mes rapports originels avec les choses (avec celles-ci, plutt
qu'avec celles-l ). Fait de pure contingence -fait absurde.
Seulement , d'autre part, cette place que je suis est un rapport.
Relation univoque, sans doute, mais relation tout de mme. Si je me
borne exister ma place, j e ne puis tre en mme temps ailleurs pour
tablir ce rapport fondamental, je ne puis mme avoir une compr
hension obscure de l'objet par rapport auquel se dfinit ma place. Je
ne puis qu'exIster les dterminations intrieures que les objets
insaisissables et impensables qui m'entourent sans que j e le sache
peuvent provoquer en moi . Du mme coup, la ralit mme de
l'tendue absolue disparat et je suis dlivr de tout ce qui ressemble
une place. Par ailleurs, ni libre ni non-libre : pur existant, sans
contrainte, sans aucun moyen non plus de nier la contrainte. Pour que
quelque chose comme une tendue dfinie originellement comme ma
place vi enne au monde et du mme coup me dfinisse rigoureuse
ment, i l ne faut pas seulement que j' existe ma place, c'est--dire que
j'aie tre l : il faut aussi que je puisse n'y pas tre tout fait pour
pouvoir tre l-bas, auprs de l'objet que je situe dix mtres de moi,
536
et partir duquel j e me fais annoncer ma place. Le rapport univoque
qui dfinit ma place s'nonce en effet comme rapport entre quelque
chose que je suis et quelque chose que j e ne suis pas. Ce rapport pour
se rvler doit tre tabli . Il suppose donc que j e sois mme de faire
les oprations suivantes : 10 chapper ce que je suis et le nantiser de
telle sorte que, tout en tant cependant exist, ce que je suis puisse
pourtant se rvler comme terme d' un rapport. Ce rapport est donn
immdiatement, en effet, non dans la simple contemplation des
objets (on pourrait nous objecter, si nous tentions de driver l'espace
de la contemplation pure, que les objets sont donns avec des
dimensions absolues, non avec des distances absolues) , mais de notre
action i mmdiate (< il vient sur nous , vitons-le , je lui cours
aprs etc. ), et il implique comme tel une comprhension de ce que
je suis comme tre-l. Mais en mme temps, il faut bien dfinir ce que
je suis partir de l'tre-l d'autres ceci. Je suis, comme tre-l, celui
sur qui on vient en courant, celui qui a encore une heure monter
avant d'tre la cime de la montagne, etc. Quand donc j e regarde la
cime du mont, par exemple, il s'agit d'un chappement moi
accompagn d'un reflux que j' opre partir du sommet de la
montagne vers mon tre-l pour me situer. Ainsi dois-je tre ce que
j' ai tre par le fait mme d' y chapper. Pour que je me dfinisse
par ma place, i l convient d'abord que je m'chappe moi-mme,
pour aller poser les coordonnes partir desquelles je me dfinirai
plus troitement comme centre du monde. Il convient de noter que
mon tre-l ne peut aucunement dterminer le dpassement qui va
fixer et situer les choses, puisqu' i l est pur donn, incapable de pro
jeter et que, d'ailleurs, pour se dfinir troitement comme tel ou tel
tre-l, il faut dj que le dpassement suivi du reflux l'ait dtermin.
20 chapper par ngation interne aux ceci-au-milieu-du-monde que je
ne suis pas et par quoi je me fais annoncer ce que je suis. Les dcouvrir
et y chapper, c'est l'effet, nous l'avons vu, d' une seule et mme
ngation. L encore la ngation i nterne est premire et spontane par
rapport au datum comme d-couvert. On ne saurait admettre
qu'il provoque notre apprhension ; mais au contraire pour qu'il y ait
un ceci qui annonce ses distances l'tre-l que j e suis, il faut
justement que je m' en chappe par pure ngation. Nantisation,
ngation interne, retour dterminant sur l'tre-l que je suis, ces trois
oprations n'en font qu'une. Elles sont seulement des moments d'une
transcendance originelle qui s'lance vers une fin, en me nantisant,
pour me faire annoncer par l e futur ce que je suis. Ainsi c'est ma
libert qui vient me confrer ma place et la dfinir comme telle en me
situant ; je ne puis tre rigoureusement limit cet tre-l que j e suis,
que parce que ma structure ontologique est de n'tre pas ce que je
suis et d'tre ce que je ne suis pas.
Par ailleurs, cette dtermination de l'emplacement, qui suppose
537
toute la transcendance, ne saurait avoir lieu que par rapport une fin.
C'est la lumi re de l a fin que ma place prend sa significati on. Car je
ne saurais jamais tre simplement l. Mais prcisment ma place est
saisie comme un exil ou au contraire comme ce l i eu naturel, rassurant
et favori , que Mauriac, par comparaison avec la place laquelle le
taureau bless revient toujours dans l'arne, appelait querencia : c'est
par rapport ce que je projette de faire -par rapport avec le monde
en totalit et, donc, avec tout mon tre-dans-Ie-monde, que ma place
m'apparat comme un auxiliaire ou un empchement. Etre en place
c'est tre d'abord loin de . . . ou prs de . . . -c' est--dire que l a place
est pourvue d'un sens par rapport un certain tre non encore
existant que l ' on veut atteindre. C'est l'accessibilit ou l ' i naccessibi
lit de cette fin qui dfi ni t la place. C'est donc la lumire du non
tre et du futur que ma position peut tre actuellement comprise :
tre-l c'est n' avoir qu'un pas faire pour atteindre la thire,
pouvoir tremper la plume dans l'encre en tendant l e bras, devoir
tourner l e dos l a fentre si je veux lire sans me fatiguer les yeux,
devoir enfourcher ma bicyclette et supporter pendant deux heures les
fatigues d' un aprs-midi torri de, si je veux voir mon ami Pierre,
prendre l e train et passer une nuit blanche, si j e veux voir Anny. Etre
l, pour un colonial, c'est tre vingt jours de la France - mieux
encore : s'il est fonctionnaire et qu'il attend son voyage pay, c'est
tre six moi s et sept j ours de Bordeaux ou d'Etaples. Etre-I, pour
un soldat , c'est tre cent dix, cent vingt jours de la classe ; le futur
- un futur pro-jet - intervient partout : c'est ma vi e future
Bordeaux, Etaples, la libration future du soldat, le mot futur que
j e tracerai avec une plume humecte d'encre, c'est tout cela qui me
signifie ma place et qui me la fait exister dans l'nervement ou
l' i mpatience ou la nostalgi e. Au contraire, si j e fuis un groupe
d'hommes ou l'opinion publ i que, ma place est dfinie par le temps
qu' i l faudrait ces gens pour me dcouvrir au fond du village o je
gte, pour parvenir ce village, etc. En ce cas, cet isolement est ce qui
m'annonce ma place comme favorable. Etre en place, ici, c'est tre
l'abri.
Ce choix de ma fin se glisse jusque dans les rapports purement
spatiaux (haut et bas, droite et gauche, etc. ) , pour lui donner une
signification existenti elle. La montagne est crasante , si je
demeure ses pieds ; au contraire, si je suis son sommet, elle est
reprise par le projet mme de mon orgueil et symbolise l a supriorit
que je m' attribue sur les autres hommes. La place des fleuves, la
distance l a mer, etc. , entrent en j eu et sont pourvues de signi fication
symbolique : constitue l a lumi re de ma fin, ma place me rappelle
symboli quement cette fin dans tous ses dtails comme dans ses
liaisons d'ensemble. Nous y reviendrons lorsque nous voudrons
mieux dfinir l'objet et les mthodes de la psychanalyse existentielle.
538
Le rapport brut de distance aux objets ne peut jamais se laisser saisir
en dehors des significations et des symboles qui sont notre manire
mme de l e constituer. D'autant que ce rapport brut n'a lui-mme de
sens que par rapport au choix des techniques qui permettent de
mesurer les distances et de les parcourir. Tel l e vi l l e sise vingt
kilomtres de mon village et relie lui par un tramway est beaucoup
plus proche de moi qu'un sommet pierreux situ quatre kilomtres,
mais deux mille huit cents mtres d'altitude. Heidegger a montr
comment les proccupations quotidiennes assignent des places aux
ustensiles qui n'ont rien de commun avec la pure distance gomtri
que : mes lunettes, dit-il, une fois sur mon nez, sont beaucoup plus
loin de moi que l'objet que je vois travers elles.
Ainsi faut-il dire que la facticit de ma place ne m'est rvle que
dans et par l e libre choix que je fais de ma fin. La libert est
indispensable la dcouverte de ma facticit. Je l'apprends, cette
facticit, de tous les points du futur que j e pro-j ette ; c'est partir de
ce futur choisi qu' el l e m'apparat avec ses caractres d'impuissance,
de contingence, de faiblesse, d'absurdit. C'est par rapport mon
rve de voir New York, qu'il est absurde et douloureux que je vive
Mont-de-Marsan. Mais rciproquement, la facticit est la seule ralit
que l a libert peut dcouvrir, la seule qu'elle puisse nantiser par la
position d'une fin, l a seule partir de laquelle cela ait un sens de
poser une fin. Car si la fi n peut clairer la situation, c' est qu'elle est
constitue comme modification projete de cette situation. La place
apparat partir des changements que je projette. Mais changer
implique justement quelque chose changer qui est justement ma
place. Ainsi , la libert est l'apprhension de ma facticit. I l serait
absolument vain de chercher dfinir ou dcrire le quid de cette
facticit avant que la libert se retourne sur elle pour la saisir
comme une dficience dtermine. Ma place, avant que la libert ait
circonscrit mon emplacement comme un manque d'une certaine
espce, n'est , proprement parler, rien du tout , puisque l'ten
due mme partir de laquelle se comprend toute place -n'existe
pas. D'autre part, l a question elle-mme est inintelligible, car elle
comporte un avant n' a pas de sens : c'est la libert mme, en
effet, qui se temporalise suivant les directions de l'avant et de l'aprs.
Il n'en demeure pas moins que ce quid brut et impensable est ce
sans quoi l a libert ne saurait tre libert. Il est l a facticit mme de
ma libert.
C'est seulement dans l'acte par lequel l a libert a dcouvert la
facticit et l'a apprhende comme place, que cette place ainsi dfinie
se manifeste comme entrave mes dsirs, obstacle, etc. Comment
serait-il possible autrement qu'elle ft un obstacl e ? Obstacle quoi ?
contrainte quoi faire ? On prte ce mot un migrant qui allait
quitter la France pour l'Argentine, aprs l'chec de son parti
539
politique : comme on l ui faisait observer que l'Argentine tait bien
loin : Loin de quoi ? demanda-t-il. Et i l est bien certain que si
l ' Argentine apparat loin ceux qui demeurent en France, c'est
par rapport un projet national implicite qui valorise leur place de
Franais. Pour l e rvolutionnai re internationaliste, l'Argenti ne est un
centre du monde, comme n' importe quel autre pays. Mais si,
prcisment, nous avons d'abord constitu l a terre franaise, par un
projet premi er, comme notre place absolue - et si quelque catas
trophe nous contraint de nous exiler -, c'est par rapport ce projet
init i al que l ' Argentine apparatra comme bien loin , comme
terre d'exil ; c'est par rapport lui que nous nous sentirons
expatris. Ai nsi la libert cre elle-mme les obstacles dont nous
souffrons. C'est elle-mme qui, en posant sa fin -et en l a choisissant
comme inaccessible ou diffici lement accessible -, fai t apparatre
notre emplacement comme rsistance insurmontable ou difficilement
surmontable nos projets. C'est el l e encore qui , en tablissant les
liaisons spatiales entre les objets, comme premier type de rapport
d'ustensili t, en dcidant des techniques qui permettent de mesurer et
de franchir les distances, constitue sa propre restriction. Mais,
prcisment, i l ne saurait y avoir de libert que restreinte, puisque la
libert est choix. Tout choix, nous l e verrons, suppose limination et
slection ; tout choix est choix de la finitude. Ainsi l a libert ne
saurait-elle tre vrai ment l i bre qu'en constituant la facticit comme sa
propre restricti on. Il ne servirait donc rien de dire que je ne suis pas
libre d'aller New York, du fai t que je suis un petit fonctionnaire de
Mont-de-Marsan. C'est , au contraire, par rapport mon projet
d'aller New York que je vais me situer Mont-de-Marsan. Mon
emplacement dans le monde, l e rapport de Mont-de-Marsan New
York et l a Chine seraient tout autres si, par exemple , mon projet
tait de devenir un cultivateur enrichi de Mont-de-Marsan. Dans le
premier cas, Mont-de-Marsan parat sur fond de monde en liaison
organise avec New York, Mel bourne et Shangha ; dans le second, i l
merge sur fond de monde indiffrenci. Quant l'importance relle
de mon projet d' al ler New York, moi seul en dcide : ce peut tre
tout juste une manire de me choisir comme mcontent de Mont-de
Marsan ; et , en ce cas, tout est centr sur Mont-de-Marsan, simple
ment j'prouve l e besoin de nantiser perptuellement ma place, de
vivre en recul perptuel par rapport l a cit que j'habite -ce peut
tre aussi un projet o je m'engage tout entier. Dans l e premier cas,
je saisirai ma place comme obstacle insurmontable et j 'aurai simple
ment us d' un biais pour l a dfinir indirectement dans l e monde ; dans
l e second cas, au contraire, les obstacles n'existeront plus, el l e ne sera
pas un point d'attache, mais un point de dpart : car pour aller New
York, il faut bi en un point de dpart, quel qu'il soit. Ainsi me saisirai
j e, quel que moment que ce soi t , comme engag dans le monde,
540
ma place contingente. Mais c'est prcisment cet engagement qui
donne son sens ma place contingente et qui est ma libert. Certes,
en naissant, je prends place, mais je suis responsable de la place que
je prends. On voit pl us clairement ici le lien i nextricable de libert et
de facticit dans la situati on, puisque sans l a facticit l a libert
n'existerait pas - comme pouvoir de nantisation et de choix -et
que, sans l a l ibert, l a facticit ne serait pas dcouverte et n'aurait
mme aucun sens.
B) Mon pass.
Nous avons un pass. Sans doute avons-nous pu tablir que ce
pass ne dtermi nai t pas nos actes comme le phnomne antrieur
dtermine l e phnomne consquent, sans doute avons-nous montr
que l e pass tait sans force pour constituer l e prsent et presquisser
l'avenir. I l n'en demeure pas moins que la libert qui s'chappe vers l e
futur ne saurait se donner de pass au gr de ses caprices ni , plus
forte raison, se produire el l e-mme sans pass. Elle a tre son
propre pass et ce pass est irrmdiabl e ; il semble mme, au
premier abord, qu' el l e ne puisse en aucune faon l e modifier : l e
pass est ce qui est hors d'atteinte et qui nous hante distance, sans
que nous puissions mme nous retourner en face pour le considrer.
S'il ne dtermi ne pas nos actions, au moins est-il tel que nous ne
pouvons prendre de dcision nouvelle sinon partir de lui. Si j'ai
prpar l'Ecole navale et si je suis devenu officier de marine,
quelque moment que je me reprenne et que j e me considre, je suis
engag ; l'instant mme o je me saisis, je suis de quart sur le pont
du bateau que je commande en second. Je puis bien subitement
m'insurger contre ce fait, donner ma dmissi on, dcider mon suicide :
ces mesures extrmes sont prises l'occasion du pass qui est le mien ;
si elles visent le dtruire, c'est qu' i l existe, et mes dcisions les plus
radicales ne peuvent qu'aller jusqu' prendre position ngative vis-
vis de mon pass. Mais c'est, au fond, reconnatre son importance
immense de plate-forme et de point de vue ; toute action destine
m'arracher mon pass doit d'abord tre conue partir de ce pass
l, c'est--dire doit avant tout reconnatre qu'elle nat partir de ce
pass singulier qu' el l e veut dtruire ; nos actes, dit le proverbe, nous
suivent. Le pass est prsent et se fond insensiblement dans le
prsent : c'est l e costume que j'ai choisi il y a six mois, la maison que
j'ai fait btir, le livre que j'ai entrepris l'hiver dernier, ma femme, les
promesses que je l ui ai faites, mes enfants ; tout ce que je suis, j 'ai
l'tre sur le mode de l'avoir-t. Ainsi l' i mportance du pass ne
saurait tre exagre, puisque pour moi Wesen ist was gewesen
ist , tre c'est avoir t. Mais nous retrouvons ici l e paradoxe
541
prcdemment i ndiqu : je ne saurais me concevoir sans pass ;
mi eux, j e ne saurais plus rien penser sur moi, puisque j e pense sur ce
que je suis et que je suis au pass ; mais d'autre part je suis l'tre par
qui le pass vient soi-mme et au monde.
Examinons de plus prs ce paradoxe : la libert tant choix est
changement. Elle se dfinit par la fin qu'elle pro-jette, c'est--dire par
le futur qu'elle a tre. Mais, prcisment parce que le futur est l'tat
qui-n'esr-pas-encore de ce qui est, il ne peut se concevoir que dans une
troite l iaison ce qui est. Et ce ne saurait tre ce qui est qui claire ce
qui n'est pas encore : car ce qui est est manque et, par sui te, ne peut
tre connu comme tel qu' partir de ce dont il manque. C'est la fin qui
claire ce qui est. Mais pour aller chercher l a fin -venir pour se faire
annoncer par elle ce qu'est ce qui est, il faut tre dj au del de ce
qui est, dans un recul nantisant, qui le fait clairement paratre,
l'tat de systme isol. Ce qui est ne prend donc son sens que lorsqu'il
est dpass vers l'avenir. Ce qui est est donc le pass. On voit comme,
la fois, l e pass est indispensable au choix de l'avenir, titre d ce
qui doit tre chang , comme, par suite, aucun dpassement libre ne
saurait se faire sinon parti r d' un pass -et comme, d' autre part,
cette na/ure mme de pass vient au pass du choix originel d'un
futur. En particulier le caractre irrmdiable vient au pass de mon
choix mme du futur : si l e pass est ce partir de quoi je conois et
projette un tat de choses nouveau dans le futur, il est lui-mme ce
qui est laiss sur place, ce qui, par consquent, est lui-mme hors de
toute perspective de changement : ainsi pour que l e futur soit
ralisable, il faut que le pass soit irrmdiable.
Je puis fort bien ne pas exister : mais si j'existe, je ne puis manquer
d'avoir un pass. Telle est la forme que prend ici la ncessit de ma
contingence . Mais, d'autre part, nous J'avons vu, deux caractristi
ques existentielles qualifient avant tout l e pour-soi :
10 rien n'est dans la conscience qui ne soit conscience d'tre ;
2 mon tre est en question dans mon tre -cela veut dire que rien
ne me vient qui ne soit choisi.
Nous avons vu, en effet, que le pass qui ne serait que pass
s'croulerait dans une existence honoraire o il aurait perdu tout lien
avec le prsent. Pour que nous ayons un pass, il faut que nous l e
maintenions l ' existence par notre projet mme vers l e futur : nous
ne recevons pas notre pass ; mais la ncessit de notre contingence
implique que nous ne pouvons pas ne pas le choisir. C'est ce que
signifie avoir tre son propre pass - on voit que cette
ncessit, envisage ici du point de vue purement temporel, ne se
distingue pas, au fond, de la structure premire de la libert qui doit
tre nantisation de l'tre qu'elle est et qui, par cette nantisation
mme, fait qu'il y a un tre qu' elle est.
Mais si la libert est choix d'une fin en fonction du pass,
542
rciproquement le pass n'est ce qu'il est que par rapport la fin
choisie. I l y a dans le pass un lment immuable : j 'ai eu l a
coqueluche ci nq ans - et un l ment par excellence variable : l a
signification du fai t brut par rapport la totalit de mon tre. Mais
comme, d'autre part, l a signification du fait pass le pntre de part
en part (je ne puis me rappel er ma coqueluche d'enfant, en
dehors d' un projet prcis qui en dfinit l a signification) , i l m'est
impossible finalement de distinguer l'existence brute immuable du
sens variable qu'elle comport e. Dire J'ai eu la coqueluche cinq
ans suppose mille pro-jets, en particulier l'adoption du calendrier
comme systme de reprage de mon existence individuelle donc
une prise de position originelle vis--vis du social -, la croyance
dcide dans les relations que les tiers font de mon enfance -et qui
va certainement avec un respect ou une affection pour mes parents,
qui en forme le sens, etc. Le fait brut lui-mme est : mais en dehors
des tmoignages d'autrui, de sa date, du nom technique de la maladie
-ensemble de significations qui dpendent de mes projets -, que
peut-il bien tre ? Ainsi, cette existence brute, quoique ncessairement
existante et immuable, reprsent e comme le but idal et hors
d'atteinte d'une explication systmatique de toutes les significations
incluses dans un souvenir. Il y a, sans doute, une matire pure du
souveni r, au sens o Bergson parle de souvenir pur : mais lorsqu'elle
se manifeste, ce n'est jamais que dans et par un projet qui comporte
l'apparition dans sa puret de cette matire.
Or la signification du pass est troitement dpendante de mon
projet prsent. Cela ne signifie nullement que je puis faire varier au
gr de mes caprices l e sens de mes actes antrieurs ; mais, bien au
contrai re, que le projet fondamental que j e suis dcide absolument de
l a signification que peut avoir pour moi et pour l es autres le pass que
j'ai tre. Moi seul en effet peux dcider chaque moment de la
porte du pass : non pas en discutant, en dlibrant et en apprciant
en chaque cas l'importance de tel ou tel vnement antrieur, mais en
me pro-jetant vers mes buts, j e sauve le pass avec moi et j e dcide
par l'action de sa signification. Cette crise mystique de ma quinzime
anne, qui dcidera si elle a t pur accident de pubert ou au
contraire premier signe d'une conversion future ? Moi , selon que je
dciderai - vingt ans, trente ans -de me convertir. Le projet de
conversion confre d'un seul coup une crise d'adolescence l a valeur
d'une prmonition que je n'avais pas prise au srieux. Qui dcidera si
le sjour en prison que j 'ai fait, aprs un vol, a t fructueux ou
dplorable ? Moi, selon que je renonce voler ou que je m'endurcis.
Qui peut dcider de l a valeur d' enseignement d'un voyage, de la
sincrit d'un serment d'amour, de la puret d'une intention passe,
etc. ? C'est moi, toujours moi, selon les fins par lesquelles je les
claire.
543
Ainsi tout mon pass est l , pressant, urgent, imprieux, mais je
choisis son sens et les ordres qu'il me donne par l e projet mme de ma
fi n. Sans doute ces engagements pris psent sur moi , sans doute le l i en
conjugal autrefois assum, la maison achete et meuble l' an dernier
limitent mes possibilits et me dictent ma conduite : mais c'est
prcisment parce que mes projets sont tels que j e r-assume l e lien
conj ugal , c'est--dire prcisment parce que j e ne projette pas le rejet
du lien conjugal, parce que je n'en fais pas un lien conjugal pass,
dpass, mort mais que, au contraire, mes projets, impliquant la
fidlit aux engagements pris ou la dcision d'avoir une vie
honorable de mari et de pre, etc. , viennent ncessairement clairer
le serment conjugal pass et lui confrer sa valeur toujours actuelle.
Ainsi l 'urgence du pass vient du futur. Que soudain, l a manire du
hros de Schlumberger l, je modifie radicalement mon projet fonda
mental, que je cherche, par exemple, me dlivrer de la continuit du
bonheur, et mes engagements antrieurs perdront toute leur urgence.
I ls ne seront plus l que comme ces tours et ces remparts du Moyen
Age, que l'on ne saurait ni er, mais qui n'ont d'autre sens que celui de
rappeler, comme une tape antrieurement parcourue, une civilisa
tion et un stade d' existence politique et conomique aujourd'hui
dpasss et parfaitement morts. C'est l e futur qui dcide si le pass est
vivant ou mort. L pass, en effet, est originellement projet, comme
le surgissement actuel de mon tre . Et , dans la mesure mme o i l est
projet, i l est anticipation ; son sens lui vient de l'avenir qu'il
presquisse. Lorsque le pass glisse tout entier au pass, sa valeur
absolue dpend de l a confirmation ou de l'infirmation des anticipa
tions qu'il tait. Mais c'est prcisment de ma libert actuelle qu'il
dpend de confirmer le sens de ces anticipations en les reprenant
son compte, c'est--dire en anticipant, leur suite, l'avenir qu'elles
anticipaient ou de les infirmer en anticipant simplement un autre
avenir. En ce cas, le pass retombe comme attente dsarme et
dupe ; i l est sans forces C'est que l a seule force du pass lui vient
du futur : de quelque manire que je vive ou que j 'apprcie mon
pass, je ne puis le faire qu' la lumire d'un pro-jet de moi sur le
futur. Ainsi l'ordre de mes choix d'avenir va dterminer un ordre de
mon pass et cet ordre n'aura rien de chronologique. Il y aura d'abord
le pass toujours vivant et toujours confirm : mon engagement
d'amour, tels contrats d'affaires, telle image de moi-mme quoi je
suis fidle. Puis le pass ambigu qui a cess de me plaire et que je
retiens par un biais : par exemple, ce costume que je porte -et que
j'achetai une certaine poque o j'avais le got d'tre la mode
me dplat souverainement prsent et, de ce fait, le pass o je l'ai
choisi est vritablement mort. Mais d'autre part mon projet actuel
1. Schlumbcrger : Un homme heureux, N. R.F.
544
d'conomie est tel que je dois continuer porter ce costume plutt
que d'en acqurir un autre. Ds lors i l appartient un pass mort et
vivant la fois. comme ces institutions sociales qui ont t cres pour
une fin dtermine et qui ont survcu au rgime qui les avait tablies,
parce qu'on les a fait servir des fins toutes diffrentes, parfois mme
opposes. Pass vivant, pass demi-mort, survivances, ambiguts,
antinomies : l'ensemble de ces couches de passit est organis par
l'unit de mon proj et . C'est par ce projet que s'installe le systme
complexe de renvois qui fait entrer un fragment quelconque de mon
pass dans une organisation hirarchise et plurivalente o, comme
dans l'uvre d'art, chaque structure partielle indique, de diverses
manires, diverses autres structures partielles et la structure totale.
Cette dcision touchant la valeur, l'ordre et la nature de notre
pass, est d'ailleurs tout simplement l e choix historique en gnral . Si
les socits humaines sont historiques, cela ne provient pas simple
ment de ce qu'elles ont un pass, mais de ce qu'elles le reprennent
titre de monument. Lorsque le capitalisme amricain dcide d' entrer
dans la guerre europenne de 1914- 1 91 8 parce qu'il y voit l'occasion
de fructueuses oprations, i l n'est pas historique : il est seulement
utilitaire. Mais lorsque, la lumire de ses projets utilitaires, i l
reprend les relations antrieures des Etats-Unis avec l a France et leur
donne le sens d'une dette d'honneur payer par les Amricains aux
Franais, i l devient historique et, en particulier, i l s'historialisera par
le mot clbre : La Fayette, nous voici ! Il va sans dire que si une
vision diffrente de leurs i ntrts actuels avait amen les Etats-Unis
se ranger aux cts de l'Allemagne, ils n'eussent pas manqu
d'lments passs reprendre sur l e plan monumental : on et pu
imaginer par exemple une propagande base sur la fraternit de
sang et qui et essentiellement tenu compte de l a proportion des
Allemands dans l'migration en Amrique du XIX
c
sicle. Il serait
vain de considrer ces renvois au pass comme de pures entreprises
publicitaires : en effet, le fait essentiel c'est qu'elles sont ncessaires
pour entraner l'adhsion des masses et donc que les masses exigent
un pro-jet politique qui claire et j ustifie leur pass ; en outre, i l va de
soi que le pass est ainsi cr : il y a eu ainsi constitution d'un pass
commun France-Amrique qui signifiait d'une part les grands intrts
conomiques des Amricains et d' autre part les affinits actuelles de
deux capitalismes dmocratiques. On a vu pareillement les gnra
tions nouvelles, vers 1938, soucieuses des vnements internationaux
qui se prparai ent, clairer brusquement la priode 1918-1938 d'un
jour nouveau et l a nommer, avant mme que l a guerre de 1 939 et
clat, l ' Entre-deux-guerres . Du coup, l a priode considre tait
constitue en forme limite, dpasse et renie, au lieu que ceux qui
l'avaient vcue, se pro-jetant vers un avenir en continuit avec leur
prsent et l eur pass i mmdiat, l'avaient prouve comme le dbut
545
d'une progression continue et ill imite. Le projet actuel dcide donc
si une priode dfinie du pass est en continuit avec le prsent ou si
elle est un fragment discontinu d'o l'on merge et qui s'loigne.
Ainsi faudrait-il une histoire humaine finie pour que tel vnement,
par exemple l a prise de la Bastil l e, ret un sens dfinitif. Personne ne
nie , en effet, que la Bastille a t prise en 1789 : voil le fait
i mmuabl e. Mais doit-on voir dans cet vnement une meute sans
consquence, un dchanement du populaire contre une forteresse
demi dmantel e, que la Convention, soucieuse de se crer un pass
publicitaire, sut transformer en action d'clat ? Ou faut-il le consid
rer comme la premire manifestation de la force populaire, par quoi
elle s'affermit, se donna confiance et se mit mme d'oprer la
marche sur Versailles Journes d'Octobre ? Celui qui voudrait
en dcider aujourd'hui oublierait que l' historien est lui-mme hito
rique, c'est--dire qu'il s'historialise en clairant l'Histoire la
lumire de ses projets et de ceux de sa socit. Ainsi faut-il dire que le
sens du pass social est perptuellement en sursis .
Or, exactement comme les socits, l a personne humaine a un
pass monumental et en sursis. C'est cette perptuelle remise en
question du pass que les sages ont sentie de bonne heure et que les
tragiques grecs exprimrent, par exemple, par ce proverbe qui revient
dans toutes leurs pices : Nul ne peut tre dit heureux avant sa
mort. Et l'historialisation perptuelle du pour-soi est affirmation
perptuelle de sa libert.
Cela di t, il ne faudrait pas croire que le caractre en sursis du
pass apparaisse au pour-soi sous forme d' un aspect vague ou
inachev de son histoire antrieure. Au contraire, tout autant que le
choix du pour-soi, qu'il exprime sa manire, l e pass est saisi par le
pour-soi chaque moment comme rigoureusement dtermin. Pareil
lement, l'arc de Titus ou la colonne Trajane, quelle que soit par
ailleurs rvolution historique de leur sens, apparaissent au Romain
ou au touriste qui les considre, comme des ralits parfaitement
individualises. Et, l a lumire du projet qui l'claire, il se rvle
comme parfaitement contraignant. Le caractre sursitaire du pass
n'est, en effet, aucunement un mi racle, il ne fait qu'exprimer, sur le
plan de la passification et de l ' en-soi, l'aspect pro-jectif et en
attente qu'aval l a ralit-humaine avant de tourner au pass. C'est
parce que cette ralit-humaine tait un libre pro-jet rong par une
imprvisible libert qu'elle devient au pass tributaire des projets
ultrieurs du pour-soi. Cette homologation qu'elle attendait d' une
libert future, el l e se condamne, en se passifiant, l'attendre
perptuellement. Ainsi , le pass est indfiniment en sursis parce que
l a ralit-humaine tait et sera perptuellement en attente. Et
l'attente comme le sursis ne font qu'affirmer plus nettement encore la
l i bert comme leur constituante originelle. Dire que le pass du pour-
546
soi est en sursis, dire que son prsent est une attente, dire que son
futur est un libre projet ou qu'il ne peut rien tre sans avoir l'tre ou
qu'il est une totalit-dtotalise, c'est une seule et mme chose. Mais
prcisment cela n'impli que aucune indtermination dans mon pass
tel qu'il se rvle moi prsentement : cela veut simplement mettre
en question les droits de ma dcouverte actuelle de mon pass tre
dfinitive. Mais de mme que mon prsent est attente d'une
confirmation ou d' une infirmation que rien ne permet de prvoir, de
mme le pass , emport dans cette attente, est prcis dans la mesure
mme o elle est prcise. Mais son sens, bien que rigoureusement
individualis, est totalement dpendant de cette attente qui, elle
mme, se met sous la dpendance d' un nant absolu, c'est--dire d'un
libre projet qui n'est pas encore. Mon pass est donc une proposition
concrte et prcise qui , en tant que telle, attend ratification. C'est
certainement une des significations que Le Procs de Kafka tente de
mettre au jour, ce caractre perptuellement processif de la ralit
humaine. Etre libre, c'est tre perptuellement en instance de libert.
Reste que le pass - s'en tenir mon libre choix actuel -est, une
fois que ce choix l ' a dtermi n, partie intgrante et condition
ncessaire de mon projet. Un exemple l e fera mieux comprendre. Le
pass d'un demi-solde , sous la Restauration, c'est d'avoir t un
hros de l a retraite de Russie. Et ce que nous avons expliqu jus
qu'ici permet de comprendre que ce pass mme est un libre choix de
futur. C'est en choisissant de ne pas se rallier au gouvernement de
Louis XVIII et aux nouvelles murs, en choisissant de souhaiter
jusqu' la fin le retour triomphal de l'Empereur, en choisissant de
conspirer mme pour hter ce retour et de prfrer une demi-solde
une solde entire, que le vieux soldat de Napolon se choisit un pass
de hros de la Brsina. Cel ui qui aurait fait le pro-jet de se rallier au
nouveau gouvernement n' aurait certes pas choisi le mme pass.
Mais, rciproquement, s'il n'a qu'une demi-solde, s'il vit dans une
misre peine dcente, s'il s'aigrit et s'il souhaite l e retour de
l'Empereur, c'est qu' i l fut un hros de l a retraite de Russie.
Entendons-nous : ce pass n'agit pas avant toute reprise constituante
et il ne s'agit aucunement de dterminisme ; mais une fois choisi l e
pass soldat de l'Empire , les conduites du pour-soi ralisent ce
pass. Il n' y a mme aucune diffrence entre choisir ce pass et l e
raliser par ses conduites. Ai nsi , le pour-soi, en s'efforant de faire de
son pass de gloire une ralit intersubjective, l a constitue aux yeux
des autres titre d'objectivit-pour-autrui (rapports des prfets, par
exemple, sur l e danger que reprsentent ces vieux soldats). Trait par
les autres comme tel, i l agit dsormais pour se rendre digne d'un pass
qu'i! a choisi pour compenser sa misre et sa dchance prsentes. II
se montre i ntransigeant, il perd toute chance de pension : c'est qu'il
ne peut pas dmriter de son pass. Ainsi nous choisissons notre
547
pass la lumire d'une certaine fin, mais ds lors il s'impose et nous
dvore : non point qu'il ait une existence de soi et diffrente de celle
que nous avons tre, mais simplement parce que : 1 il est la
matriali sation actuellement rvle de la fin que nous sommes ; 2 il
apparat au milieu du monde, pour nous et pour autrui ; il n'est jamais
seul, mais il plonge dans le pass universel et, par l, i l se propose
l'apprciation d'autrui . De mme que le gomtre est libre d'engen
drer telle figure qui lui plat, mais qu' il ne peut en concevoir une
qu'elle n' entretienne aussitt une i nfinit de rapports avec lnfinit
des autres figures possibles, de mme notre libre choix de nous
mme, en faisant surgir un certain ordre apprciatif de notre pass,
fait apparatre une infinit de rapports de ce pass au monde et
autrui et cette infinit de rapports se prsente nous comme une
infinit de conduites tenir, puisque notre pass mme, c'est au futur
que nous l'apprcions. Et nous sommes contraints de tenir ces
conduites dans la mesure o notre pass parat dans le cadre de notre
projet essenti el . Vouloir ce projet, en effet, c'est vouloir ce pass et
vouloir ce pass, c'est vouloir le raliser par mille conduites secon
daires. Logiquement, les exigences du pass sont des impratifs
hypothti ques : Si tu veux avoir tel pass, agis de telle ou telle
sorte. Mais comme le premier terme est choix concret et catgo
rique, l' i mpratif, lui aussi, se transforme en impratif catgorique.
Mais la force de contrainte de mon pass tant emprunte mon
choix libre et rflchissant et la puissance mme que s'est donne ce
choix, il est impossible de dtermi ner a priori le pouvoir contraignant
d' un pass. Ce n' est pas seulement de son contenu et de l'ordre de ce
contenu que mon choix libre dcide, c'est aussi de l'adhrence de mon
pass mon actualit. Si , dans une perspective fondamentale que
nous n'avons pas dterminer encore, un de mes principaux projets
est de progresser, c'est--dire d'tre toujours et cote que cote plus
avanc dans une certaine voie que je ne l'tais la veille ou l 'heure
d'auparavant, ce projet progressif entrane une srie de dcollements
par rapport mon pass. Le pass, c'est alors ce que je regarde du
haut de mes progrs, avec une sorte de piti un peu mprisante, c'est
ce qui est strictement objet passif d'apprciation morale et de
jugement - comme j 'tais sot, ou comme j 'tais
mchant ! , ce qui n'existe que pour que je m'en puisse dso
lidariser. Je n' y entre plus ni ne veux plus y entrer. Ce n'est pas,
certes, qu'il cesse d'exister, mais il existe seulement comme ce moi
que je ne suis plus, c'est--dire cet tre que j'ai tre comme moi que je
ne suis plus. Sa fonction est d'tre ce que j'ai choisi de moi pour m'y
opposer, ce qui me permet de me mesurer. Un pareil pour-soi se
choisit donc sans solidarit avec soi , ce qui veut dire, non qu' il abolit
son pass, mais qu' il le pose pour ne pas tre solidaire avec lui, pour
affirmer justement sa totale libert (ce qui est pass est un certain
548
genre d'engagement vis--vis du pass et une certaine espce de
tradition). Au contraire, il est des pour-soi dont l e projet implique l e
refus du temps et l'troite solidarit avec l e pass. Dans leur dsir de
trouver un terrain solide, ceux-ci ont, au contraire, lu le pass
comme ce qu'ils sont, le reste n'tant que fui t e i ndfinie et indigne de
tradition. Ils ont choisi d'abord le refus de l a fuite, c'est--dire le refus
de refuser ; l e pass, par suite, a pour fonction d'exiger d'eux la
fidlit. Ainsi verra-t-on les premiers confesser ddaigneusement et
lgrement une faute qu'ils ont commise, au lieu que l a mme
confession sera impossible aux autres, moins qu'ils ne changent
dlibrment leur projet fondamental ; ils useront alors de toute la
mauvaise foi du monde et de toutes les chappatoires qu'ils pourront
inventer, pour viter d'entamer cette foi dans ce qui est, qui constitue
une structure essentielle de leur projet.
Ainsi, comme l'emplacement, le pass s'intgre l a situation
lorsque le pour-soi , par son choix du futur, confre sa facticit
passe une valeur, un ordre hirarchique et une urgence partir
desquels elle motive ses actes et ses conduites.
C) Mes entours.
Il ne faut pas confondre mes entours avec la place que j 'occupe
et dont nous avons parl prcdemment. Les entours sont les choses
ustensles qui m'entourent, avec leurs coefficients propres d'adversit
et d'ustensilit. Certes, en occupant ma place, je fonde la dcouverte
des entours et, en changeant de place - opration que je ralise
librement, comme nous l'avons vu -, je fonde l'apparition de
nouveaux entours. Mais, rciproquement, l es entours peuvent chan
ger ou tre changs par d'autres sans que je sois pour rien dans leur
changement. Certes, Bergson a bien marqu, dans Matire et
mmoire, qu'une modification de ma place entrane le changement
total de mes entours, alors qu'il faudrait envisager une modification
totale et simultane de mes entours pour qu'on puisse parler d'une
modification de ma place ; or, ce changement global des entours est
inconcevabl e. Mais il n'en demeure pas moins que mon champ
d'action est perptuellement travers d'apparitions et de disparitions
d'objets, dans lesquelles je n'entre pour rien. D'une faon gnrale,
le coefficient d' adversit et d' ustensilit des complexes ne dpend pas
uniquement de ma place, mais de la potentialit propre des ustensiles.
Ainsi suis-je jet, ds lors que j 'existe, au milieu d'existences
diffrentes de moi, qui dveloppent autour de moi, pour et contre
moi, leurs potentialits ; je veux arriver au plus vite, sur ma
bicyclette, la ville voisine. Ce projet implique mes fins personnelles,
l'apprciation de ma place et de la distance de l a ville ma place et la
549
libre adaptation des moyens (eforts) la fin poursuivie. Mais un pneu
crve, l e soleil est trop ardent, le vent souffle de front, etc. , tous
phnomnes que j e n'avais pas prvus : ce sont les entours. Certes, ils
se manifestent dans et par mon projet principal ; c'est par lui que le
vent peut apparatre comme vent debout ou comme bon vent, par
lui que le soleil se rvle comme chaleur propice ou incommode.
L'organi sation synthtique de ces perptuels accidents constitue
l'unit de ce que les Allemands appellent mon Umwelt, et cet
Umwelt ne peut se dcouvrir que dans les limites d'un libre
proj et, c'est--dire du choix des fins que je suis. Il serait cependant
beaucoup trop simple de nous en tenir l dans notre description. S'il
est vrai que chaque objet de mon entourage s'annonce dans une
situation dj rvle et que l a somme de ces objets ne peut
constituer elle seule une situation ; s'il est vrai que chaque ustensile
s'enlve sur fond de situation dans le monde, i l n'en demeure pas
moins que la transformation brusque ou l'apparition brusque d'un
ustensile peut contribuer un changement radical de la situation :
que mon pneu crve et ma distance du village voisin change tout
coup ; c'est une distance compter en pas, prsent, et non en tours
de roue. Je puis acqurir de ce fait la certitude que la personne que je
veux voir aura dj pris l e train quand j' arriverai chez el le, et cette
certitude peut entraner d'autres dcisions de ma part (retour mon
point de dpart, envoi d'un tlgramme, etc. ). Je puis mme, sr de
ne pas pouvoir, par exemple, conclure avec cette personne le march
proj et, me retourner vers quelqu'un d'autre et signer un autre
contrat. Peut-tre mme abandonnerai-je entirement ma tentative et
devrai-je enregistrer un chec total de mon projet ? En ce cas, j e dirai
que je n 'ai pas pu prvenir Pierre temps, m'entendre avec lui, etc.
Cette reconnaissance explicite de mon impuissance n'est-elle pas
l'aveu le plus net des limites de ma libert ? Sans doute, ma libert de
choisir, nous l'avons vu, n'est pas confondre avec ma libert
d'obtenir. Mais n'est-ce pas mon choix mme qui est ici en j eu,
puisque l'adversit des entours est prcisment, dans beaucoup de
cas, l'occasion du changement de mon projet ?
Il convi ent, avant d'aborder le fond du dbat, de le prciser et de le
limiter. Si les changements qui surviennent aux entours peuvent
entraner des modifications mes projets, ce ne peut tre que sous
deux rserves. La premire, c'est qu'ils ne peuvent entraner l'aban
don de mon projet principal, qui sert, au contraire, mesurer leur
i mportance. Si , en effet , ils sont saisis comme motifs d'abandonner teI
ou tel projet, ce ne peut tre qu' la lumire d'un projet plus
fondamental ; sinon, ils ne sauraient tre aucunement des motifs,
puisque le motif est apprhend par la conscience-mobile qui est elle
mme libre-choix d' une fi n. Si les nuages qui couvrent l e ciel peuvent
m'inciter renoncer mon proj et d'excursion, c'est qu'ils sont saisis
550
dans une libre projection o la valeur de l 'excursion est lie un
certain tat du ciel , ce qui renvoie de proche en proche l a valeur
d'une excursion en gnral, ma relation la nature et l a place
qu'occupe cette relation dans l'ensemble des relations que je soutiens
avec le monde . En second lieu, en aucun cas, l'objet apparu ou
disparu ne peut provoquer une renonciation un projet, mme
partielle. I l faut que cet obj et , en effet, soit apprhend comme un
manque dans l a situation originelle ; i l faut donc que le donn de son
apparition ou de sa disparition soit nantis, que je prenne du recul
par rapport lui et, par consquent, que je me dcide de moi
mme en prsence de lui . Nous l'avons dj montr, mme les
tenailles du bourreau ne nous dispensent pas d'tre libres. Cela ne
signifie pas qu'il soit toujours possible de tourner la difficult, de
rparer le dgt, mais simplement que l'impossibilit mme de
continuer dans une certaine direction doi t tre librement constitue ;
elle vient aux choses par notre libre renonciation, au l i eu que notre
renonciation soit provoque par l'impossibilit de la conduite tenir.
Ceci dit , il faut reconnatre que la prsence du donn, ici encore,
loin d'tre un obstacle notre libert, est rclame par son existence
mme. Cette l i bert est une certaine libert que je suis. Mais qui suis
je, sinon une certaine ngation interne de l'en-soi ? Sans cet en-soi
que je ni e, je m'vanouirais en nant. Nous avions indiqu, dans
notre introduction, que la conscience pouvait servir de preuve
ontologique de l'existence d' un en-soi. S' i l y a, en effet, conscience
de quelque chose, i l faut originellement que ce quelque chose ait
un tre rel, c'est--dire non relatif la conscience. Mais nous voyons
prsent que cette preuve a une porte plus large : si je dois pouvoir
faire quelque chose en gnral , il faut que j' exerce mon action sur des
tres dont l'existence est indpendante de mon existence en gnral et
singulirement de mon action. Mon action peut me rvler cette
existence ; eJle ne l a conditionne pas. Etre libre, c'est tre-libre-po ur
changer. La libert implique donc l'existence des entours changer :
obstacles franchir, outils utiliser. Certes, c'est elle qui les rvle
comme obstacles, mais elle ne peut qu'interprter par son libre choix
le sens de leur tre. Il faut qu' i ls soient simplement l, tout bruts, pour
qu'il y ait libert. Etre li bre, c'est tre-libre-pour-faire et c'est tre
libre-dans-le monde. Mais s' i l en est ainsi, la libert, en se reconnais
sant comme libert de changer, reconnat et prvoit implicitement
dans son projet originel l'existence indpendante du donn sur quoi
elle s'exerce. Cest la ngation interne qui rvle l'en-soi comme
indpendant et c'est cette indpendance qui constitue l'en-soi son
caractre de chose. Mais ds lors ce que pose l a libert par le simple
surgissement de son tre, c'est qu' elle est comme ayant affaire autre
chose que soi. Faire, c'est prcisment changer ce qui n' a pas besoin
d'autre chose que soi pour exi ster, c'est agir sur ce qui, par principe,
551
est indiffrent l'acti on, peut poursuivre son existence ou son devenir
sans el l e. Sans cette indiffrence d'extriorit de l'en-soi , la notion
mme de faire perdrait son sens (nous l ' avons montr plus haut
propos du souhait et de la dcision) et, par suite, la libert elle-mme
s'effondrerait. Ainsi, l e projet mme d'une libert en gnral est un
choix qui implique l a prvision et l'acceptation de rsistances par
ailleurs quelconques. Non seulement c'est la libert qui constitue le
cadre o des en-soi par ailleurs i ndi ffrents se rvleront comme des
rsistances, mais encore son proj et mme , en gnral, est projet de
faire dans un monde rsistant, par victoire sur ses rsistances. Tout
projet l i bre prvoit, en se pro-jetant , la marge d'imprvisibilit due
l'indpendance des choses, prci sment parce que cette indpen
dance est ce partir de quoi une li bert se constitue. Ds que j e pro
j ette d'al ler au village voisin pour retrouver Pierre, les crevaisons, le
vent debout , mil le accidents prvisibles et imprvisibles sont
donns dans mon projet mme et en constituent le sens. Aussi l a
crevaison i nopine qui drange mes projets vi ent prendre sa place
dans un monde presquiss par mon choix, car j e n'ai j amais cess, si
j e puis dire, de l'attendre comme inopine. Et mme si ma route a t
interrompue par quelque chose quoi j 'tais cent lieues de penser,
comme une inondation ou un boulis, en un certain sens, cet
imprvisible tait prvu : dans mon pro-jet une certaine marge
d' i ndtermi nation tait faite pour l ' imprvisible comme les
Romains rservai ent, dans leur templ e, une place aux dieux inconnus,
et cela, non par exprience des coups durs ou prudence empiri
que, mais par la nature mme de mon projet. Ainsi, d'une certaine
manire, peut-on dire que la ralit-humaine n'est surprise par rien.
Ces remarques nous permettent de mettre au jour une nouvelle
caractristique d'un libre choix : tout projet de l a libert est projet
ouvert, et non projet ferm. Bi en qu' entirement individualis, i l
contient en l ui l a possibilit de ses modifications ultrieures. Tout
projet implique en sa structure la comprhension de l a SelbstsUin
digkeit des choses du monde. Cest cette perptuel l e prvision de
l'imprvisible, comme marge d'indtermination du projet que je suis,
qui permet de comprendre que l'accident ou l a catastrophe, au lieu de
me surprendre par son indit et son extraordinaire, m'accable
toujours par un certain aspect de dj vu - dj prvu , par son
vidence mme et une sorte de ncessit fataliste que nous exprimons
par un a devait arriver . II n'est j amais rien qui tonne, dans le
monde, rien qui surprenne, moi ns que nous ne nous dterminions
nous-mmes l' tonnement. Et le thme originel de l'tonnement
n'est pas que telle ou telle chose particulire existe dans les limites du
monde, mais plutt qu'il y ait un monde en gnral, c'est--dire que je
sois j et parmi une totalit d'existants foncirement indiffrents
moi . C'est que, en choisissant une fin, j e choisis d'avoir des rapports
552
avec ces existants et que ces existants aient des rapports entre eux ; j e
choisis qu'ils entrent e n combinaison pour m'annoncer ce que j e suis.
Ainsi l'adversit que les choses me tmoignent est presquisse par
ma libert comme une de ses conditions et c'est sur une signification
librement proj ete de l ' adversit en gnral que tel ou tel complexe
peut manifester son coefficient individuel d'adversit.
Mais, comme chaque fois qu' i l est question de la situation, il faut
insister sur le fait que l'tat de choses dcrit a un envers : si la libert
presquisse l'adversit en gnral , c'est comme une faon de sanc
tionner l'extriorit d' indiffrence de l'en-soi. Sans doute, l'adversit
vient aux choses par la libert, mai s c'est en tant que la libert claire
sa facticit comme tre-au-mi l i eu-d'un-en-soi-d'indiffrence . La
libert se donne les choses comme adverses, c'est--dire leur confre
une significati on qui les fait choses ; mais c'est en assumant le donn
mme qu'il sera signifiant, c'est--dire en assumant pour l e dpasser
son exil au mi l i eu d'un en-soi i ndi ffrent . Rciproquement d'ailleurs
l e donn contingent assum ne saurait supporter mme cette significa
tion premire et support de toutes les autres, exil au milieu de
l'indiffrence , que dans et par une assomption libre du pour-soi.
Telle est, en effet, la structure primitive de la situation ; el l e apparat
ici dans toute sa clart : c'est par son dpassement mme du donn
vers ses fins que l a l i bert fait exister l e donn comme ce donn-ci
auparavant, il n' y avait ni ceci, ni cel a, ni ici - et le donn ainsi
dsign n'est pas form de manire quelconque, il est existant brut,
assum pour tre dpass. Mais, en mme temps que la libert est
dpassement de ce donn-ci, el l e se choisit comme ce dpassement-ci
du donn. La libert n'est pas un dpassement quelconque d' un
donn quelconque ; mais en assumant l e donn brut et en l ui
confrant son sens, el l e s'est choisie du coup : sa fin est j ustement de
changer ce donn-ci, tout de mme que le donn apparat comme ce
donn-ci l a lueur de l a fin choisi e. Ainsi le surgissement de la libert
est cristallisation d'une fin travers un donn et dcouverte d'un
donn la lumire d'une fin ; ces deux structures sont simultanes et
insparables. Nous verrons, en effet, plus loin que les valeurs
universelles des fins choisies ne se dgagent que par l' analyse ; tout
choix est choix d'un changement concret apporter un donn
concret. Toute situation est concrte.
Ainsi l'adversit des choses et leurs potentialits en gnral sont
claires par la fin choisie. Mais i l n' y a de fin que pour un pour-soi
qui s'assume comme dlaiss au mil ieu de l'indiffrence. Par cette
assomption, il n'apporte rien de neuf ce dlaissement contingent et
brut, sauf une signification ; il fait qu'il y a dsormais un dlaissement,
i l fait que ce dlaissement est dcouvert comme situation.
Nous avons vu, au chapitre IV de notre deuxime partie, que le
pour-soi, par son surgissement, faisait que l'en-soi venait au monde ;
553
d'une faon plus gnrale encore, il tait le nant par quoi il y
avai t de l'en-soi, c'est--dire des choses. Nous avons vu aussi que la
ralit en-soi tait l, sous l a mai n, avec ses qualits, sans aucune
dformation ni adjonction. Simplement, nous sommes spars d'elle
par les diverses rubriques de nantisation que nous instaurons par
notre surgissement mme : monde, espace et temps, potentialits.
Nous avons vu, en particulier, que , bien que nous soyons entours de
prsences (ce verre, cet encrier, cette table, etc. ), ces prsences
taient insaisissables comme telles car elles ne livraient quoi que ce
soit d'elles qu' au bout d' un geste ou d' un acte pro-jet par nous, c'est
-dire au futur. A prsent, nous pouvons comprendre le sens de cet
tat de choses : nous ne sommes spars des choses par rien, sinon
par notre libert ; c'est elle qui fait qu'il y a des choses, avec toute leur
indiffrence, l eur imprvisibilit et leur adversit, et que nous
sommes i nluctabl ement spars d' elles, car c'est sur fond de
nantisation qu'elles apparaissent et qu'elles se rvlent comme lies
les unes aux autres. Ainsi, le projet de ma l i bert n'ajoute rien aux
choses : il fait quil y ait des choses, c'est--dire prcisment des
ralits pourvues d' un coefficient d'adversit et d'utilisabilit ; i l fait
que ces choses se dcouvrent dans l'exprience, c'est--dire s'enlvent
successivement sur fond de monde au cours d'un processus de
temporalisation ; i l fait enfin que ces choses se manifestent comme
hors d'atteinte, indpendantes, spares de moi par l e nant mme
que je scrte et que je suis. Cest parce que la libert est condamne
tre libre, c'est--dire ne peut se choisir comme libert, qu'il y a des
choses, c'est--dire une plnitude de contingence au sein de laquelle
elle est elle-mme contingence ; c'est par l'assomption de cette
contingence et par son dpassement qu'il peut y avoir la fois un
choix et une organisation de choses en situation ; et c'est la contin
gence de l a libert et la contingence de l 'en-soi qui s'expriment en
situation par l'imprvisibilit et l ' adversit des entours. Ainsi suis-je
absolument libre et responsable de ma situation. Mais aussi ne suis-je
jamais libre qu'en situation.
D) Mon prochain.
Vivre dans un monde hant par mon prochai n, ce n'est pas
seulement pouvoir rencontrer l' autre tous les dtours du chemin,
c'est aussi se trouver engag dans un monde dont les complexes
ustensiles peuvent avoir une signification que mon libre projet ne leur
a pas d'abord donne. Et c'est aussi, au milieu de ce monde pourvu
dj de sens, avoir affaire une signification qui est mienne et que je
ne me suis pas donne non plus, que je me dcouvre comme
possdant dj . Lors donc que nous nous demandons ce que peut
554
signifier pour notre situation le fait originel et contingent d'exister
dans un monde o il y a aussi l'autre, l e problme ainsi formul
exige que nous tudiions successivement trois couches de ralit qui
entrent en jeu pour constituer ma situation concrte : les ustensiles
dj signifiants (la gare, l'indicateur de chemin de fer, l'uvre d'art,
l'affiche de mobilisation), la signification que je dcouvre comme dj
mienne (ma national i t, ma race, mon aspect physique) et enfin
l'autre comme centre de rfrence auquel renvoient ces significations.
Tout serait fort simple, en effet, si j'appartenais un monde dont
les significations se dcouvriraient simplement la lumire de mes
fins propres. Je disposerais, en effet, les choses en ustensiles ou en
complexes d'ustensilit dans l es limites de mon propre choix de moi
mme ; c'est ce choix qui ferait de la montagne un obstacle difficile
surmonter ou un point de vue sur la campagne, etc. ; le problme ne
se poserait pas de savoir quelle signification cette montagne peut
avoir en soi, puisque j e suis celui par qui les significations viennent
la ralit en soi. Ce problme serait encore trs simplifi si j 'tais une
monade sans portes ni fentres et si je savais seulement, de quelque
faon que ce soi t, que d'autres monades existaient ou taient
possibles, chacune d'elles confrant aux choses que je vois des
significations nouvelles. Dans ce cas, qui est celui que les philosophes
se sont borns trop souvent examiner, il me suffi rait de tenir
d'autres significations comme possibles et, finalement, l a pluralit des
significations correspondant l a pluralit des consciences conciderait
tout simplement pour moi avec l a possibilit toujours ouverte de faire
de moi-mme un aUlre choix. Mais nous avons vu que cette
conception monadique reclait un solipsisme cach prcisment parce
qu'elle va confondre la pluralit des significations que je peux
attacher au rel et la pluralit des systmes signifiants dont chacun
renvoie une conscience que je ne suis pas. Et, d'ailleurs, sur le
terrain de l'exprience concrte, cette description monadique se
rvle insuffisante ; il existe, en effet, autre chose dans mon
monde qu'une pluralit de significations possibles ; il existe des
significations objectives qui se donnent moi comme n'ayant pas t
mises au jour par moi . Moi par qui les significations viennent aux
choses, j e me trouve engag dans un monde dj signifiant et qui me
rflchit des significations que je n'y ai pas mises. Qu'on songe, par
exemple, la quantit innombrable de significations indpendantes
de mon choi x, que j e dcouvre si je vis dans une ville : rues, maisons,
magasins, tramways et autobus, plaques indicatrices, bruits d'avertis
seurs, musique de T. S. F. , etc. Dans l a solitude, certes, je dcouvrais
l'existant brut et i mprvisible : ce rocher, par exemple, et je me
bornais, en somme, faire qu'il y et un rocher, c' est--dire cet
existant-ci et en dehors de lui ri en. Mais je lui confrais, tout le
moins, sa signification gravir , viter , contempler ,
555
etc. Lorsque, au dtour d' une rue, je dcouvre une maison, ce n'est
pas seulement un existant brut que je rvle dans le monde, je ne fais
pas seulement qu'il y ait un ceci " qualifi de telle ou telle faon ;
mai s la signification de l'objet qui se rvle alors me rsiste et
demeure indpendante de moi : je dcouvre que l'immeuble est
maison de rapport ou ensemble des bureaux de la Compagnie du gaz,
ou prison, etc. , la signification est ici contingente, indpendante de
mon choix, el l e se prsente avec l a mme indiffrence que la ralit
mme de l'en-soi : elle s'est faite chose et ne se distingue pas de la
qualit de l'en-soi . Pareillement, le coefficient d'adversit des choses
m'est dcouvert avant d' tre prouv par moi ; des foules d'indica
ti ons me mette nt en garde : Ralentir, tournant dangereux
Attention, cole Danger de mort Cassis cent mtres
etc. Mais ces significations, tout e n tant profondment imprimes
dans les choses et tout en participant leur extriorit d' i ndiffrence
-au moins en apparence - n' en sont pas moins des indications de
conduite tenir qui me concernent directement. Je traverserai dans
les clous, je pntrerai dans tel magasin pour y acheter tel ustensile,
dont le mode d'emploi est trs prcisment indiqu dans une notice
qu' on dlivre aux acheteurs, j ' userai ensuite de cet ustensile, un stylo,
par exempl e, pour remplir tel ou tel formulaire dans des conditions
dtermi nes. Ne vais-je pas trouver l d'troites limites ma libert ?
Si je ne suis pas point par point les indications fournies par les autres,
je ne m'y reconnatrai plus, je me tromperai de rue, je manquerai
mon train, etc. D'ailleurs ces indications sont le plus souvent
i mpratives : Entrez par l Sortez par l voil ce que
signifient l es mots d' Entre et de Sortie, peints au-dessus des portes.
Je m'y soumets ; ell es viennent ajouter au coefficient d'adversit, que
j e fais natre sur les choses, un coefficient proprement humain
d'adversi t. En outre, si je me soumets cette organisation, j e
dpends d'elle : l es bnfices dont elle me pourvoit peuvent tarir ; un
trouble intrieur, une guerre et voil les produits de premire
ncessit qui se rarfi ent, sans que j' y sois pour rien. Je suis
dpossd, arrt dans mes projets, priv du ncessaire pour accom
plir mes fins. Et surtout nous avons not que les modes d'emploi,
dsignations, ordres, dfenses, plaques indicatrices s'adressent moi
en tant que je suis quelconque ; dans l a mesure o j 'obis, o je
m'insre dans la filire, j e me soumets aux buts d'une ralit-humaine
quelconque et je les ralise par des techniques quelconques : je suis
donc modifi dans mon tre propre, puisque je suis les fins que j 'ai
choisies et les techniques qui les ralisent ; fins quelconques,
techniques quelconques, ralit-humaine quelconque. En mme
temps, puisque le monde ne m'apparat j amais qu' travers les
techniques que j' util ise, le monde, lui aussi, est modifi. Ce monde vu
travers l 'usage que je fais de l a bicyclette, de l'auto, du trai n, pour Je
556
parcourir, me dcouvre un visage rigoureusement corrlatif aux
moyens que j'utilise, donc le viage qu'il offre tout le monde. I l doit
videmment s'ensuivre, dira-t-on, que ma libert m'chappe de toute
part : il n'y a plus de situation comme organisation d'un monde
signifiant autour du libre choix de ma spontanit, il y a un tat qu'on
m'impose. C'est ce qu'il convient d'examiner prsent.
Il est hors de doute que mon appartenance un monde habit a la
valeur d'un fait. Elle renvoie, en effet, au fait originel de la prsence
d'autrui dans le monde, fait qui, nous l'avons vu, ne peut tre dduit
de la structure ontologique du pour-soi. Et, bien que ce fait ne fasse
que rendre plus profond l'enraci nement de notre facticit, il ne
dcoule pas non plus de notre facticit, en tant que celle-ci exprime l a
ncessit de la contingence du pour-soi ; mais plutt, il faut dire : l e
pour-soi exite de fait, c'est--dire que son existence ne peut tre
assimilable ni une ralit engendre conformment une loi , ni un
libre choix ; et, parmi les caractristiques de fait de cette facticit ,
c'est--dire parmi celles qui ne peuvent ni se dduire ni se prouver,
mais qui se laissent voir " simplement, i l en est une que nous
nommons l'existence-dans-Ie-monde-en-prsence-d'autres. Si cette
caractristique de fait doit ou non tre reprise par ma libert pour tre
efficace d'une manire quelconque, c'est ce que nous discuterons un
peu plus loin. Il n'en demeure pas moins qu'au niveau des techniques
d'appropriation du monde, du fait mme de l'existence de l'autre
rsulte le fait de la proprit collective des techniques. La facticit
s'exprime donc ce niveau par le fait de mon apparition dans un
monde qui ne se rvle moi que par des techniques collectives et
dj constitues, qui visent me le faire saisir sous un aspect dont le
sens a t dfini n dehors de moi. Ces techniques vont dterminer
mon appartenance aux collectivits : l'espce humaine, la collecti
vit nationale, au groupe professionnel et familial. Il faut mme le
souligner : en dehors de mon tre-pour-autrui -dont nous parlerons
plus loin -la seule faon positive que j 'ai d'exister mon appartenance
de fait ces collectivits, c'est l'usage que je fais constamment des
techniques qui relvent d'elles. L'appartenance l'espce humaine se
dfinit, en effet, par l'usage de techniques trs lmentaires et trs
gnrales : savoir marcher, savoir prendre, savoir j uger du relief et de
la grandeur relative des objets perus, savoir parler, savoir distinguer,
en gnral , le vrai du faux, etc. Mais ces techniques, nous ne les
possdons pas sous cette forme abstraite et universelle : savoir parler,
c n'est pas savoir nommer et comprendre les mots en gnral, c'est
savoir parler une certaine langue, et par l mani fester son apparte
nance l'humanit au niveau de l a collectivit nationale. D'ailleurs,
savoir parler une langue ce n'est pas avoir une connaissance abstraite
et pure de l a langue telle que la dfinissent les dictionnaires et les
grammaires acadmiques : c'est la faire sienne travers les dforma-
551
tians et les sl ections provinciales, professionnelles, familiales. Ainsi
peut-on dire que l a ralit de notre appartenance l.humain est notre
nationalit et que l a ralit de notre nationalit est notre apparte
nance la fami l l e, la rgion, la profession, etc. , au sens o l a
ralit du langage est l a langue et la ralit de l a langue l e dialecte,
l'argot, le patoi s, etc. Et, rciproquement, l a vrit du dialecte est la
langue, l a vrit de l a langue est l e langage ; cela signifie que les
techniques concrtes par quoi se manifeste notre appartenance la
famil l e , la localit renvoient des structures plus abstraites et plus
gnrales qui en constituent comme l a signification et l'essence,
celles-ci d'autres, plus gnrales encore, jusqu' ce qu'on arrive
l'essence universelle et parfaitement simple d'une technique quelcon
que par quoi u n tre quelconque s'approprie le monde.
Ainsi, tre Franais, par exemple, n'est que la vrit d'tre
Savoyard. Mais tre Savoyard, cela n'est pas simplement habiter les
hautes valles de Savoie : c'est, entre mil l e autres choses, faire du ski
l ' hiver, utiliser le ski comme mode de transport. Et, prcisment,
c'est faire du ski selon la mthode franaise, non selon cell e de
l'Arlberg ou des Norvgiens
1
. Mais puisque la montagne et les pentes
neigeuses ne s'apprhendent qu' travers une technique, c'est prcis
ment dcouvrir l e sens franais des pentes de ski ; selon, en effet,
qu' on utilisera la mthode norvgienne, plus propice aux pentes
douces, ou l a mthode franaise, plus propice aux pentes rudes, une
mme pente apparatra comme plus rude ou plus douce, exactement
comme une monte apparatra comme plus ou moins rude au cycliste,
selon qu'il se sera mis en moyenne ou en petite vitesse . Ainsi le
skieur franais dispose d'une vitesse franaise pour descendre les
terrains de ski, et cette vitesse lui dcouvre un type particulier de
pentes, o qu' i l soit, c'est--dire que les Alpes suisses ou bavaroises,
l e Telemark ou le Jura lui offriront toujours un sens, des difficults,
un complexe d'ustensilit ou d'adversit purement franais. Il serait
ais de montrer pareillement que la plupart des tentatives pour dfinir
la classe ouvrire reviennent prendre comme critre l a production,
l a consommation ou un certain type de Weltanschauung ressortis
sant au compl exe d' infriorit (Marx-Halbwachs-de Man), c'est-
dire, dans tous l es cas, certaines techniques d' laboration ou d'appro
priation du monde, travers lesquelles il offre ce que nous pourrions
appeler son visage proltaire , avec ses oppositions violentes, ses
grandes masses uniformes et dsertiques, ses zones de tnbres et ses
plages de l umi re, les fins simples et urgentes qui l'clairent.
Or, i l est vi dent - bien que mon appartenance tell e classe,
1. Nous simplifions : il y a des influences, des interfrences de technique ; la
mthode de l'Arlberg a longtemps prvalu chez nous. Le lecteur pourra
facilement rtablir les faits dans leur complexit.
558
telle nation ne dcoule pas de ma facticit comme structure ontologi
que de mon pour-soi - que mon existence de fait, c'est--dire ma
naissance et ma place, entrane mon apprhension du monde et de
moi-mme travers certaines techniques. Or, ces techniques que je
n'ai pas choisies, el l es confrent au monde ses significations. Ce n'est
plus moi, semble-t-i l , qui dcide partir de mes fins si le monde
m'apparat avec l es oppositions simples et tranches de l'univers
proltarien , ou avec les nuances innombrables et retorses du
monde bourgeois . Je ne sui s pas seulement jet en face de
l'existant brut, j e suis jet dans un monde ouvrier, franai s, lorrain ou
mridional qui m' offre ses significations sans que j'aie rien fait pour
les dceler.
Regardons-y mi eux. Nous avons montr tout l'heure que ma
nationalit n'tait que la vrit de mon appartenance une province,
une fami l l e, un groupement professionnel . Mais faut-il s'arrter
l ? Si la langue n'est que l a vrit du dialecte, le dialecte est-il la
ralit absolument concrte ? L'argot professionnel comme on le
parl e, le patois alsacien tel qu' une tude l i nguistique et statistique
permet d'en dterminer les lois est-il l e phnomne premier, celui qui
trouve son fondement dans l e fait pur, dans la contingence originelle ?
Les recherches des l i nguistes peuvent ici tromper : leurs statistiques
mettent au jour des constantes, des dformations phontiques ou
smantiques d' un type donn, elles permettent de reconstituer
l'volution d'un phonme ou d'un morphme dans une priode
donne, en sorte qu' il semble que le mot ou l a rgle syntaique soit
une ralit individuelle, avec sa signification et son histoire. Et, de
fait , les individus semblent avoir peu d'influence sur l'volution de la
langue. Des faits sociaux comme les invasions, les grandes voies de
communication, les relations commerciales semblent tre les causes
essentielles des changements linguistiques. Mais c'est qu'on ne se
place pas sur l e vritable terrain du concret : aussi n'est-on pay que
selon ses propres exigences. Depuis longtemps les psychologues ont
fait remarquer que le mot n'tait pas l'lment concret du langage
mme le mot du di alecte, mme le mot fami l i al avec ses dformations
particulires ; la structure lmentaire du l angage, c'est l a phrase.
C'est l'intrieur de la phrase, en effet, que le mot peut recevoir une
fonction rel le de dsignation ; en dehors d'elle, i l est tout juste une
fonction propositi onnelle, quand ce n'est pas une pure et simple
rubrique destine grouper des significations absolument disparates.
L o il parat seul dans le discours, il prend un caractre holophras
tique , sur lequel on a souvent insist ; cela ne signifie pas qu'il ne
puisse se limiter de lui-mme un sens prcis, mais qu'il est intgr
un contexte comme une forme secondaire une forme principale. Le
mot n' a donc qu'une existence purement virtuelle en dehors des
organisations complexes et actives qui l'intgrent. I l ne saurait donc
559
exister dans une conscience ou un inconscient avant l'usage qui en
est fait : la phrase n'est pas faite de mots. Il ne faut pas s'en temr l ;
Paulhan a montr dans Les Fleurs de Tarbes que des phrases entires,
l es lieux communs , exactement comme les mots, ne prexistent
pas l'emploi qu'on en fait. Lieux communs si elles sont envisages
du dehors, par le lecteur, qui recompose le sens du paragraphe en
passant d' une phrase l'autre, ces phrases perdent l eur caractre
banal et conventionnel si on se place au point de vue de l'auteur, qui,
lui , voyait la chose exprimer et allait au plus press, en produisant
un acte de dsignation ou de recration sans s'attarder considrer
les lments mmes de cet acte. S' i l en est ainsi, ni les mots, ni l a
syntaxe, ni l es phrases toutes faites ne prexistent l 'usage qu'on
en fait. L'unit verbale tant la phrase signifi ante, celle-ci est un acte
constructif qui ne se conoit que par une transcendance qui dpasse et
nantise l e donn vers une fin. Comprendre le mot l a lueur de la
phrase, c'est trs exactement comprendre n'importe quel donn
partir de la situation, et comprendre la situation la lumire des fins
originelles. Comprendre une phrase de mon i nterlocuteur, c'est, en
effet , comprendre ce qu' i l veut dire , c'est--dire pouser son
mouve ment de transcendance, me jeter avec lui vers des possibles,
vers des fins et revenir ensuite sur l'ensemble des moyens organiss
pour les comprendre par leur fonction et leur but. Le langage parl,
d'ailleurs, est toujours dchiffr partir de la situation. Les rf
rences au temps, l'heure, la place, aux entours, la situation de la
ville, de l a province, du pays sont dO/lnes avant l a parole. Il suffit
que j' ai e lu les journaux et que je voie la bonne mine et l'air SOUCieux
de Pierre pour comprendre le a ne va pas avec lequel il
m'aborde ce mati n. Ce n'est pas sa sant ne va pas puisqu'il a
le teint feuri , ni ses affaires, ni son mnage : c'est la situation de
notre vi l l e ou de notre pays. Je l e savais dj ; en lui demandant a
va ? j 'esquissais dj une interprtation de sa rponse, je me portais
dj aux quatre coins de l'horizon, prt revenir de l sur Pierre pour
le comprendre. Ecouter le discours, c'est parler avec non pas
simplement parce qu'on mime pour dchiffrer, mais parce qu'on se
projette originellement vers les possibles et qu'on doit comprendre
partir du monde.
Mais si l a phrase prexiste au mot, nous sommes renvoys au
discoureur comme fondement concret du discours. Ce mot peut bien
sembler vivre par lui-mme, si on l e pche dans des phrases
d'poques diverses ; cette vie emprunte ressemble celle du couteau
des films fantastiques qui se plante de lui-mme dans la poire ; elle est
faite de l a juxtaposition d'instantans, elle est cinmatographique et
se constitue dans l e temps universel . Mais si les mots paraissent vivre
lorsqu'on projette l e film smantique ou morphologique, ils ne vont
pas j usqu' constituer des phrases , ils ne sont que les t races du
560
passage des phrases, comme les routes ne sont que les traces du
passage des plerins ou des caravanes. La phrase est un projet qui ne
peut s'interprter qu' partir de la nantisation d'un donn (celui-l
mme qu'on veut dsigner) partir d' une fin pose (sa dsignation,
qui elle-mme suppose d'autres fins par rapport auxquelles elle n'est
qu'un moyen) . Si l e donn, pas plus que le mot, ne peuvent
dterminer l a phrase, mais si, au contraire, la phrase est ncessaire
pour clairer le donn et comprendre le mot, la phrase est un moment
du libre choix de moi-mme, et c'est comme telle qu'elle est comprise
par mon interlocuteur. Si la langue est la ralit du langage, si le
dialecte ou l'argot sont l a ralit e la langue, la ralit du dialecte est
l'acte libre de dsignation par lequel je me choisis dsignant. Et cet
acte libre ne saurait tre assemblage de mots. Certes, s'il tait pur
assemblage de mots con formment des recettes techniques (les lois
grammaticales) , nous pourrions parler de limites de fait imposes la
libert du parleur ; ces limites seraient marques par la nature
matrielle et phontique des mots, le vocabulaire de la langue
utilise, le vocabulaire personnel du parleur (les n mots dont i l
dispose), le gnie de l a langue , etc. Mais nous venons de montrer
qu'il n'en tait pas ainsi. On a pu soutenir rcemment 1 qu'il y avait
comme un ordre vivant des mots, des lois dynamiques du langage,
une vie impersonnelle du logos, bref que le langage tait une nature et
que l'homme devait le servir pour pouvoir l'utiliser sur quelques
points, comme i l fait de la Nature. Mais c'est qu'on a considr le
langage unefois qu'il esl mort, c'est--dire une fois qu'il a l parl, en
lui insufflant une vie impersonnelle et une force, des affinits et des
rpulsions qu'on a empruntes en fait la libert personnelle du pour
soi qui parle. On a fait du langage une langue qui se parle tOUle seule.
Voil bien l'erreur ne pas commettre, pour le l angage comme pour
tOUles les autres techniques. Si l'on fait surgir l'homme au milieu de
techniques qui s'appliquent toutes seules, d'une langue qui se parle,
d'une science qui se fait, d'une vi lle qui se btit selon ses lois propres,
si l'on fige les significations en en-soi tout en leur conservant une
transcendance humai ne, on rduira le rle de l'homme celui d'un
pilote, utilisant les forces dtermines des vents, des vagues, des
mares, pour diriger un navire. Mais de proche en proche, chaque
technique, pour tre dirige vers des fins humaines, exigera une autre
technique : par exemple, pour diriger un bateau, i l faut parler. Ainsi
arriverons-nous peut-tre la technique des techniques - qui
s'appliquera toute seule son tour - mais nous avons perdu pour
toujours la possibilit de rencontrer le technicien.
Si, tout au contraire, c'est en parlant que nous faisons qu'il y ait des
mots, nous ne supprimons pas pour cela les liaisons ncessaires et
1. Brice Parain : Essai sur le logos platonicien.
561
techniques ou l es liaisons de fair qui s'articulent l'intrieur de l a
phrase. Bien mi eux : nous fondons cette ncessi t. Mais pour qu' el l e
apparaisse. prcisment, pour que les mots entretiennent des rap
ports entre eux, pour qu'ils s'accrochent - ou se repoussent - l es
uns l es autres, i l faut qu'ils soi ent uni s dans une synthse qui ne vient
pas d'eux ; supprimez cette unit synthtique et l e bloc langage
s'effri te ; chaque mot retourne sa solitude et perd en mme temps
son unit en s'cartelant entre diverses significations incommunica
bles. Ai nsi est-ce l ' i ntrieur du projet libre de la phrase que
s'organisent les lois du langage ; c'est en parlant que je fais l a
grammaire ; la libert est l e seul fondement possible des lois de l a
langue. Pour qui, d'ailleurs, y a-t-il des l oi s de la langue ? Paulhan a
donn l es lments d' une rponse : ce n'est pas pour celui qui parle,
c'est pour celui qui coute. Celui qui parle n'est que l e choix d'une
signification et ne saisit l'ordre des mots qu' en tant qu'il le fait 1 . Les
seuls rapports qu'i l saisira l'intrieur de ce complexe organis, ce
sont spcifiquement ceux qu'il a tablis. Si , par la suite, on dcouvre
que deux ou plusieurs mots entretiennent entre eux, non pas un mais
plusieurs rapports dfinis et qu' il en rsulte une multiplicit de
significations qui se hirarchisent ou s'opposent pour une mme
phrase, bref, si l'on dcouvre l a part du diable , ce ne peut tre
qu'aux deux conditions suivantes : 10 i l faut que les mots aient t
rassembls et prsents par un libre rapprochement signifiant ; 20 il
faut que cette synthse soit vue du dehors, c'est--dire par autrui et
au cours d'un dchiffrement hypothtique des sens possibles de ce
rapprochement. En ce cas, en effet , chaque mot saisi d'abord comme
carrefour de significations est li un autre mot saisi galement
comme tel. Et le rapprochement sera multivoque. La saisie de sens
vrai, c'est--dire expressment voulu par l e parleur, pourra rejeter
dans l'ombre ou se subordonner l es autres sens, elle ne les supprimera
pas. Ainsi , le l angage, libre proj et pour moi, a des lois spcifiques
pour l'autre. Et ces lois elles-mmes ne peuvent j ouer qu' l'intrieur
d'une synthse originelle. On saisit donc toute l a diffrence qui spare
l'vnement phrase d'un vnement naturel. Le fait de nature se
produit conformment une loi qu'il manifeste, mais qui est pure
rgle extrieure de production, dont le fait envisag n'est qu'un
exemple. La phrase comme vnement contient en elle-mme l a
loi de son organisation et c'est l'intrieur du libre projet de dsigner
que des relations lgales entre les mots peuvent surgi r. Il ne saurait,
en effet, y avoir de lois de la parole avant qu'on parle. Et toute parole
est libre projet de dsignation ressortissant au choix d'un pour-soi
1. Je simplifie : on peut aussi apprendre sa pense par sa phrase. Mais c'est
parce qu'il est possible de prendre sur elle, dans une certaine mesure, le point
de vue d'autrui, exactement comme sur notre propre corps.
562
personnel et devant s'interprter partir de la situation globale de ce
pour-soi. Ce qui est premier, c'est la situation, partir de laquelle je
comprends l e sens de l a phrase, ce sens n'tant pas en lui-mme
considrer comme une donne, mais comme une fin choisie dans un
libre dpassement des moyens. Telle est l a seule ralit que les
travaux du linguiste puissent rencontrer. A partir de cette ralit, un
travail d'analyse rgressive pourra mettre au jour certaines structures
plus gnrales, plus simples, qui sont comme des schmas lgaux.
Mais ces schmas qui vaudront , par exemple, comme lois du dialecte,
sont en eux-mmes des abstraits. Loin qu'ils prsident l a constitu
tion de l a phrase et qu'ils soient le moule dans lequel elle se coule, ils
n'existent que dans et par cette phrase. En ce sens, la phrase apparat
comme libre invention de ses lois. Nous retrouvons ici tout simple
ment la caractristique originelle de toute situation : c'est par son
dpassement mme du donn comme tel (l'appareil linguistique) que
le libre projet de la phrase fait apparatre le donn comme ce donn
(ces lois d'arrangement et de prononciation dialectales). Mais l e libre
projet de l a phrase est prcisment dessein d'assumer ce donn-ci, i l
n'est pas assomption quelconque, mais vise d'une fin non encore
existante travers des moyens existants auxquels i l confre justement
leur sens de moyen. Ainsi, la phrase est arrangement de mots qui ne
deviennent ces mots que par leur arrangement mme. C'est bien ce
qu'ont senti linguistes et psychologues et leur embarras peut nous
servir ici de contre-preuve : ils ont cru dcouvrir, en effet, un cercle
dans l'laboration de la parol e, car, pour parler, il faut connatre sa
pense. Mais comment connatre cette pense, titre de ralit
explicite et fixe en concepts, si ce n'est justement en la parlant ?
Ainsi, le l angage renvoie la pense et la pense au langage. Mais
nous comprenons prsent qu'il n' y a pas cercle ou, plutt , que ce
cercle - dont on a cru sortir par l'invention de pures idoles
psychologiques, comme l'image verbale ou l a pense sans i mages et
sans mots -n'est pas spcial au langage : i l est l a caractristique de la
situation en gnral. I l ne signifie pas autre chose que l a liaison ek
statique du prsent, du futur et du pass, c'est--dire la libre
dtermination de l ' existant par l e non-encore-existant et du non
encore-existant par l'existant. Aprs cel a, il sera loisible de dcouvrir
des schmes opratoires abstraits qui reprsenteront comme la vrit
lgale de la phrase : l e schme dialectal - le schme de l a langue
nationale -le schme linguistique en gnral. Mais ces schmes, loin
de prexister la phrase concrte, sont affects par eux-mmes
d' Unselbststindigkeit et n'existent j amais qu'incarns et soutenus dans
leur incarnation mme par une libert. Bien entendu, l e langage n'est
ici que l'exemple d'une technique sociale et universel l e. Il en irait de
mme pour toute autre technique : c'est l e coup de hache qui rvle la
hache, c'est l e marteler qui rvle l e marteau. Il sera loisible de
563
dceler dans une course particulire la mthode franaise du ski et,
dans cette mthode, l'art gnral de skier comme possibilit humaine.
Mais cet art humain n'est jamais rien par soi seul, il n'existe pas en
puissance, il s'incarne et se manifeste dans l 'art actuel et concret du
skieur. Ceci nous permet d'baucher une solution des rapports de
l'individu l'espce. Sans espce humai ne, pas de vrit, cela est
certain ; il ne demeurerait qu'un pullulement irrationnel et contingent
de choix i ndivi duels, auxquels nulle loi ne saurait tre assigne. Si
quelque chose comme une vrit existe, susceptible d'unifier les choix
i ndividuel s, c'est l'espce humaine qui peut nous la fournir. Mais si
l ' espce est l a vrit de l'individu, elle ne saurait tre un donn dans
l ' i ndividu sans contradiction profonde. Comme les lois du langage
sont soutenues et incarnes par le libre projet concret de la phrase,
ainsi l'espce humaine - comme ensemble de techniques propres
dfinir l'activit des hommes -, loin de prexister un individu qui la
manifesterait, comme telle chute particulire exemplifie la loi de la
chute des corps, est l'ensemble de relations abstraites soutenues par le
l i bre choix individuel. Le pour-soi , pour se choisir personne, fait
qu'existe une organisation interne qu'il dpasse vers lui-mme et cette
organisation technique interne est en lui le national ou l'humai n.
Soit, nous dira-t-on. Mais vous avez lud le problme. Car ces
organisati ons linguistiques ou techniques, le pour-soi ne les a pas
c res pour s'atteindre : il les a reprises d'autrui. La rgle de l'accord
des participes n'existe pas, je le veux bi en, en dehors du libre
rapprochement de participes concrets en vue d'une fin de dsignation
particulire. Mais lorsque j'utilise cette rgle, je l'ai apprise des
autres, c'est parce que les autres, dans leurs projets personnels, l a
font tre que je m'en sers moi-mme. Mon langage est donc
subordonn au langage d'autrui et finalement au langage national.
Nous ne songeons pas le nier. Aussi bien ne s'agit-il pas pour nous
de montrer le pour-soi comme libre fondement de son tre : le pour
soi est li bre mai s en condition, et c'est ce rapport de la condition la
libert que nous cherchons prciser sous le nom de situation. Ce que
nous venons d' tablir, en effet, n'est qu'une partie de la ralit. Nous
avons montr que l'existence de significations qui n'manent pas du
pour-soi ne saurait constituer une limite externe de sa libert. Le
pour-soi n'est pas homme d'abord pour tre soi-mme ensuite et il ne
se constitue pas comme soi-mme partir d'une essence d' homme
donne a priori ; mais, tout au contraire, c'est dans son effort pour se
choisir comme soi personnel que le pour-soi soutient l' existence
certaines caractristiques sociales et abstraites qui font de lui un
homme ; et les liaisons ncessaires qui suivent les lments de
l'essence d'homme ne paraissent que sur le fondement d'un libre
choi x ; en ce sens, chaque pour-soi est responsable dans son tre de
l'existence d'une espce humai ne. Mais il nous faut encore claircir le
564
fait indniable que le pour-soi ne peut se choisir qu'au del de
certaines significations dont i l n' est pas l'origine. Chaque pour-soi , en
effet, n' est pour-soi qu' en se choisissant au del de l a nationalit et de
l'espce, de mme qu'il ne parle qu' en choisissant la dsignation au
del de l a syntaxe et des morphmes. Cet au-del suffit assurer
sa totale indpendance par rapport aux structures qu'il dpasse ; mais
i l n'en demeure pas moins qu'il se constitue en au-del par rapport
ces structures-ci. Qu'est-ce que cel a signifie ? C'est que le pour-soi
surgit dans un monde qui est monde pour d'autres pour-soi . Tel est le
donn. Et, par l mme, nous l'avons vu, l e sens du monde lui est
alin. Cela signifie justement qu' i l se trouve en prsence de sens qui
ne viennent pas au monde par l ui . Il surgit dans un monde qui se
donne l ui comme dj regard, sillonn, explor, labour dans tous
les sens et dont la contexture mme est dj dfinie par ces
investigations ; et dans l'acte mme par quoi i l dploie son temps, il se
temporalise dans un monde dont le sens temporel est dj dfini par
d'autres temporalisations : c'est le fait de la simultanit. 1\ ne s'agit
pas ici d'une limite de la libert, mais plutt c'est dans ce monde-l
que le pour-soi doit tre libre, c'est en tenant compte de ces
circonstances - et non pas ad libitum - qu'il doit se choisir. Mais,
d'autre part, le pour-soi, en surgissant , ne subit pas l'existence de
l'autre, i l est contraint de se la manifester sous forme d'un choix. Car
c'est par un choix qu'il saisira l'autre comme autre-sujet ou comme
autre-objet 1 . Tant que l'autre est pour lui autre-regard i l ne saurait
tre question de techniques ou de significations trangres ; l e pour
soi s'prouve comme objet dans l 'Univers sous le regard de l'autre.
Mais ds que l e pour-soi , dpassant l'autre vers ses fins, en fait une
transcendance-transcende, ce qui tait libre dpassement du donn
vers des fins lui apparat comme conduite signifiante et donne dans
le monde (fige en en-soi). L'autre-obj et devient un indicateur de fins
et, par son libre proj et, le pour-soi se jette dans un monde o des
conduites-objets dsignent des fins. Ainsi , la prsence de l'autre
comme transcendance transcende est rvlante de complexes donns
de moyens fins. Et, comme la fin dcide des moyens et l es moyens
de la fin, par son surgissement en face d'autrui-objet, l e pour-soi se
fait indiquer des fins dans l e monde ; i l vient un monde peupl de
fins. Mais si , de l a sorte, les techniques et leurs fins surgissent au
regard du pour-soi, il faut bien voir que c'est par la libre prise de
position du pour-soi en face de l'autre qu' el l es deviennent des
techniques. L'autre l ui seul ne peut faire que ses projets se rvlent
au pour-soi comme techniques ; et , par l e fai t, pour l'autre en tant
qu'il se transcende vers ses possibles, il n'existe pas de technique mais
1. Nous verrons plus loin que le problme est plu5 complexe. Mais ces
remarques suffisent pour l'instant.
565
un faire concret qui se dfinit partir de sa fin individuelle. Le
cordonnier qui ressemelle une chaussure ne se sent pas en train
d'appli quer une t echnique , i l saisit la situation comme exigeant telle
ou telle action, ce bout de cuir, l, comme rclamant un clou, etc. L
pour-soi fait surgir les techniques dans le monde comme conduites de
l'autre en tant que transcendance-transcende, ds qu'il prend position
vis--vis de l'autre. C'est ce moment et ce moment seulement
qu'apparaissent dans le monde bourgeois et ouvriers, Franais et
Allemands, hommes enfin. Ainsi l e pour-soi est-il responsabl e de ce
que les conduites de l'autre se rvlent dans le monde comme
techniques. Il ne peut faire que le monde o il surgit soit sillonn par
telle ou telle technique (il ne peut faire qu'il apparaisse dans un monde
ou rgi par l'conomie naturelle ou dans une
civilisation parasitaire mais i l fait que ce qui est vcu par l'autre
comme projet l i bre existe dehors comme technique, prcisment en
se faisant celui par qui un dehors vient l'autre. Ainsi, c'est en se
choisissant et en s'historialisant dans le monde que le pour-soi
historialise le monde lui-mme et fait qu'il soit dat par ses techni
ques. A partir de l, prcisment parce que les techniques apparais
sent comme des objets, le pour-soi peut choisir de se les approprier.
En surgissant dans un monde o Pierre et Paul parlent d'une certaine
faon, prennent l eur droite en roulant bicyclette ou en auto, etc. , et
en constituant en objets signifiants ces li bres conduites, l e pour-soi
fait qu' il y a un monde o on prend sa droite, o on parle franais,
etc. ; il fait que les lois internes de l'acte d' autrui qui taient fondes
et soutenues par une libert engage dans un projet deviennent rgles
objectives de la conduite-objet et ces rgles deviennent universelle
ment valables pour toute conduite analogue, l e support des conduites
ou agent-objet devenant d'ailleurs quelconque. Cette historialisation
qui est l 'effet de son libre choix ne restreint nullement sa libert ; mais
bien au contraire, c'est dans ce monde-l et dans nul autre que sa
libert est en jeu ; c'est propos de son existence dans ce monde-l
qu' il se met en question. Car tre libre n' est pas choisir le monde
historique o l' on surgit - ce qui n'aurait point de sens - mais se
choisir dans le monde, quel qu'il soi t. En ce sens, il serait absurde de
supposer qu' un certain tat des techniques soit restrictif des possibi
lits humaines. S ans doute un contemporain de Duns Scot ignore
l'usage de l'automobile ou de l'avion ; mais i l n'apparat comme
ignorant que de notre point de vue nous qui le saisissons
privativement partir d'un monde o l'auto et l'avion existent. Pour
lui qui n' a aucun rapport d'aucune sorte avec ces objets et les
techniques qui s'y rfrent, il y a l comme un nant absolu,
impensable et indcelable. Un semblable nant ne saurait aucune
ment limiter le pour-soi qui se choisit : il ne saurait tre saisi comme
un manque, de quelque faon qu'on le considre. Le pour-soi qui
566
s'historialise du temps de Duns Scot se nantise donc au cur d'un
plein d'tre, c'est--dire d' un monde qui , comme l e ntre, est tout ce
qu'il peut tre. Il serait absurde de dclarer que l ' artillerie lourde fit
dfaut aux Albigeois pour rsister Simon de Montfort : car l e
seigneur de Trencavel ou l e comte de Toulouse se sont choisis tels
qu'ils furent dans un monde o l'artillerie n' avait aucune place, ils ont
envisag leur politique dans ce monde-l, ils ont fait des plans de
rsistance militaire dans ce monde ; ils se sont choisis sympathisants
aux Cathares dans ce monde ; et comme ils ne furent que ce qu'ils
choisirent d' t re, il s ont t absolument dans un monde aussi
absolument plein que celui des Panzerdivisionen ou de la R. A. F. Ce
qui vaut pour des techniques aussi matrielles vaut pour des
techniques plus subtiles : le fait d'exister comme petit seigneur de
Languedoc au temps de Raymond VI n'est pas dterminant si l'on se
place dans le monde fodal o ce seigneur existe et o il se choisit. I l
n'apparat comme privatif que si l'on commet l'erreur de considrer
cette division de l a Francia et du Midi, du point de vue actuel de
l'unit franaise. L monde fodal offrait au seigneur vassal de
Raymond VI d'i nfinies possibilits de choix ; nous n'en possdons pas
davantage. Une question aussi absurde est souvent pose dans une
manire de rve utopique : qu'aurait t Descartes, s'il et connu l a
physique contemporaine ? C'est supposer que Descartes possde une
nature a priori plus ou moins limite et altre par l'tat de la science
de son temps et que l'on pourrait transporter cette nature brute
l'poque contemporaine o elle ragirait des connaissances plus
amples et plus prcises. Mais c'est oublier que Descartes est ce qu'il a
choisi d'tre, qu' il est un choix absolu de soi partir d'un monde de
connaissances et de techniques que ce choix assume et claire l a
fois. Descartes est un absolu j ouissant d'une date absolue et
parfaitement i mpensable une autre date, car i l a fait sa date en se
faisant lui-mme. C'est l ui et non un autre qui a dtermin l' tat exact
des connaissances mathmatiques immdiatement avant l ui , non pas
par un vain recensement qui ne pourrait tre fait d'aucun point de vue
et par rapport aucun axe de coordonnes, mais en tablissant les
principes de la gomtrie analytique, c'est--dire en inventant prci
sment l'axe de coordonnes qui permettrait de dfinir l'tat de ces
connaissances. Ici encore, c'est la libre invention et le futur qui
permettent d'clairer le prsent, c'est l e perfectionnement de la
technique en vue d'une fin qui permet d'apprcier l'tat de l a
techni que.
Ai nsi lorsque le pour-soi s'affirme en face de l'autre-objet, il
dcouvre du mme coup les techniques. Ds lors il peut se les
approprier, c'est--dire les intrioriser. Mais du coup : 1 en utilisant
une technique i l l a dpasse vers sa fi n, i l est toujours par del la
technique qu'il utilise ; 2 du fait qu'elle est intriorise, la technique,
567
qui tait pure conduite signifiante et fige d'un quelconque autre
objet , perd son caractre de technique, el l e s'intgre purement et
simplement au libre dpassement du donn vers les fins ; elle est
reprise et soutenue par la libert qui la fonde, tout juste comme l e
dialecte ou le langage est soutenu par le l i bre projet de la phrase. La
fodalit comme rapport technique d'homme homme n'existe pas,
el l e n'est qu' un pur abstrait, soutenu et dpass par les mille projets
individuels de tel homme lige par rapport son seigneur. Par l nous
n'entendons nul lement parvenir une sorte de nominalisme histori
que. Nous ne voulons pas dire que la fodalit est la somme des
relations de vassaux suzerains. Nous pensons au contraire qu'elle est
la structure abstraite de ces relations ; tout projet d'un homme de ce
temps doit se ral iser comme dpassement vers l e concret de ce
moment abstrait. Il n'est donc pas ncessaire de gnraliser partir
de nombreuses expriences de dtail pour tablir les principes de la
technique fodale : cette technique existe ncessairement et compl
tement dans chaque conduite individuelle et on peut la mettre au jour
en chaque cas. Mais elle n'y est que pour tre dpasse. De l a mme
faon, le pour-soi ne saurait tre une personne, c'est--dire choisir les
fins qu'il est, sans tre homme, membre d'une collectivit nationale,
d'une classe, d'une famil l e, etc. Mais ce sont des structures abstraites
qu' i l soutient et dpasse par son projet. Il se fait Franais, mridional,
ouvrier, pour tre soi l'horizon de ces dterminations. Et, pareille
ment, le monde qui se rvle lui apparat comme pourvu de
certaines significations corrlatives des techniques adoptes. Il appa
rat comme monde-pour-Ie-Franais, monde-po ur-l'ouvrier , etc. ,
avec toutes les caractristiques que l'on peut deviner. Mais ces
caractristiques n' ont pas de Sel bststandigkeit : c'est avant tout
son monde, c' est--dire l e monde i l lumin par ses fins, qui se laisse
dcouvrir comme Franais, proltarien, etc.
Pourtant , l'existence de l'autre apporte une limite de fait ma
libert. C' est qu' en effet, par l e surgissement de l'autre apparaissent
certaines dterminations que je suis sans les avoir choisies. Me voici,
en effet, Jui f ou Aryen, beau ou laid, manchot, etc. Tout cela, je le
suis pour l'autre, sans espoir d'apprhender ce sens que j'ai dehors ni
plus forte raison de l e modifier. Le langage seul m'apprendra ce que
je suis ; encore ne sera-ce j amais que comme objet d'intention vide :
l'intuition m' en est jamais refuse. Si ma race ou mon aspect
physique n' tait qu'une image e n autrui ou l'opinion d'autrui sur moi
nous en aurions tt fini : mais nous avons vu qu'il s'agit de caractres
objectifs qui me dfinissent dans mon tre-po ur-autrui ; ds qu'une
libert autre que la mienne surgit en face de moi, je me mets exister
dans une nouvel l e dimension d'tre et, cette fois, i l ne s'agit pas pour
moi de confrer un sens des existants bruts, ni de reprendre mon
compte le sens que d'autres ont confr certains objets : c'est moi-
568
mme qui me vois confrer un sens et je n'ai pas la ressource de
reprendre mon compte ce sens que j' ai puisqu'il ne saurait m'tre
donn sinon titre d'indication vide. Ainsi , quelque chose de moi
selon cette nouvelle dimension - existe la faon du donn, du
moins pour moi, puisque cet tre que j e suis est subi, i l est sans tre
exist. Je l'apprends et le subis dans et par les relations que
j'entretiens avec les autres ; dans et par leurs conduites mon gard ;
je rencontre cet tre l'origine de mille dfenses et de mi l le
rsistances que je heurte chaque instant : parce que je suis un
mineur, j e n' aurai pas tel et tel droi t -parce que j e suis un Juif, dans
certaines socits, j e serai priv de certaines possibilits, etc. Pour
tant, je ne puis en aucune faon me sentir Juif ou me sentir mineur ou
paria ; c'est tel point que je puis ragir contre ces interdictions en
dclarant que la race, par exempl e, est une pure et simple imagination
collective ; que seuls existent des individus. Ainsi je rencontre ici tout
coup l'alination totale de ma personne : j e suis quelque chose que
je n'ai pas choisi d' tre ; qu'en va-t-i1 rsulter pour la situation ?
Nous venons, il faut le reconnatre, de rencontrer une limite relle
notre libert, c'est--dire une manire d'tre qui s' impose nous sans
que notre libert en soit le fondement. Encore faut-il s'entendre : l a
limite impose ne vient pas de l'action des autres. Nous avons not,
dans un prcdent chapitre, que l a torture mme ne nous dpossde
pas de notre libert : c'est librement que nous y cdons. De manire
plus gnrale , l a rencontre d'une dfense sur ma route : Dfense
aux Juifs de pntrer ici , Restaurant juif, dfense aux Aryens
d'entrer , etc. , nous renvoie au cas envisag plus haut (les techni
ques collectives) et cette dfense ne peut avoir de sens que sur et par
le fondement de mon libre choix. Suivant, en effet, les libres
possibilits choisies, j e puis enfreindre la dfense, l a tenir pour nulle,
ou lui confrer au contraire une valeur coercitive qu'elle ne peut tenir
que du poids que j e lui accorde. Sans doute conserve-t-elle entire
ment son caractre manation d'une volont trangre , sans
doute a-t-elle pour structure spcifique de me prendre pour objet et de
manifester par l une transcendance qui me transcende. Il n' en
demeure pas moins qu' ell e ne s'incarne dans mon univers et ne prend
sa force propre de contrainte que dans les limites de mon propre choix
et selon que je prfre en toute circonstance la vie la mort ou au
contraire que j' estime, dans certains cas particuliers, la mort comme
prfrable certains types de vie, etc. La vritable limite de ma
libert est purement et simplement dans le fait mme qu'un autre me
saisit comme autre-objet et dans cet autre fait corollaire que ma
situation cesse pour l'autre d'tre situation et devient forme objective
dans laquelle j ' existe titre de structure objective. C'est cette
objectivation alinante de ma situation qui est la limite constante et
spcifique de ma situation, tout comme l'objectivation de mon tre-
569
pour-soi en tre-pour-autrui est la limite de mon tre. Et c'est
prcisment ces deux limites caractristiques qui reprsentent les
bornes de ma l i bert. En un mot , du fait de l'existence d'autrui,
j'existe dans une situation qui a un dehors et qui, de ce fait mme, a
une dimension d' al i nation que j e ne puis aucunement lui ter, pas
plus que je ne puis agir directement sur eUe. Cette limite ma libert
est , on le voit, pose par la pure et simple existence d'autrui , c'est-
dire par le fait que ma transcendance existe pour une transcendance.
Ai nsi , saisissons-nous une vrit de grande importance : nous avons
vu tout l'heure , en nous tenant dans le cadre de l'existence-pour-soi,
que seule ma libert pouvait l i miter ma libert ; nous voyons
prsent, en faisant rentrer l'existence de l'autre dans nos considra
tions, que ma libert sur ce nouveau plan trouve aussi ses limites dans
l'existence de la libert d'autrui . Ainsi , sur quelque plan que nous
nous placions, les seules limites qu'une libert rencontre, elle les
trouve dans la libert. De mme que la pense, selon Spinoza, ne
peut tre limite que par de la pense, de mme la libert ne peut tre
li mi te que par la libert et sa limitation vient, comme finitude
interne, du fait qu'elle ne peut pas ne pas tre libert, c'est--dire
qu' eUe se condamne tre libre ; et, comme finitude externe, du fait
qu'tant libert, elle est pour d'autres liberts qui l'apprhendent
librement, la l umire de leurs propres fins.
Ceci pos, il faut d'abord noter que cette alination de la situation
ne reprsente pas une faiUe interne ni l'introduction du donn comme
rsistance brute dans la situation telle que je la vis. Bien au contraire,
l'alination n'est ni une modificati on interne ni un changement partiel
de la situation ; elle n'apparat pas au cours de la temporalisation ; je
ne l a rencontre jamais dans la situation et eUe n'est, par consquent,
jamais livre mon intuition. Mai s, par principe, elle m'chappe, elle
est l'extriorit mme de la situation, c'est--dire son tre-dehors
pour-l'autre. I l s'agit donc d'un caractre essentiel de toute situation
en gnral ; ce caractre ne saurait agir sur son contenu, mais il est
accept et repris par celui mme qui se met en situation. Ainsi, le sens
mme de notre libre choix est de faire surgir une situation qui
l'exprime et dont une caractristique essentielle est d'tre aline,
c' est--dire d'exister comme form en soi pour l'autre. Nous ne
pouvons chapper cette alination, puisqu'il serait absurde de
songer mme exister autrement qu'en situation. Cette caractristi
que ne se manifeste pas par une rsistance interne mais, au contraire,
el l e s'prouve dans et par son insaisissabilit mme. C'est donc,
finalement, non un obstacle de front que rencontre la libert, mais
une sorte de force centrifuge dans sa nature mme, une faiblesse dans
sa pte qui fait que tout ce qu' elle entreprend aura toujours une face
qu'elle n' aura pas choisie, qui lui chappe et qui , pour l'autre, sera
pure existence. Une libert qui se voudrait libert ne pourrait que
570
vouloir du mme coup ce caractre. Pourtant, il n'appartient pas la
nature de la libert, car il n'y a pas ici de nature ; d'ai lleurs, y en et-il
une, on ne pourrait l'en dduire puisque l'existence des autres est un
fait entirement contingent ; mais venir au monde comme libert en
face des autres, c'est venir au monde comme alinable. Si se vouloir
libre, c'est choisir d'tre dans ce monde-ci en face des autres, celui qui
se veut tel voudra aussi la passion de sa libert.
La situation aline, d'autre part, et mon propre tre-alin ne sont
pas objectivement dcels et constats par moi ; en premier lieu, en
effet, nous venons de voir que, par principe, tout ce qui est alin
n'existe que pour l'autre. Mais, en outre, une pure constatation, si
mme elle tait possible, serait insuffisante. Je ne puis, en effet,
prouver cette alination sans, du mme coup, reconnatre l'autre
comme transcendance . Et cette reconnaissance, nous l'avons vu,
n'aurait aucun sens, si elle n'tait libre reconnaissance de la libert
d'autrui . Par cette reconnaissance libre d'autrui travers l'preuve
que je fais de mon alinati on, j'assume mon tre-pour-autrui, quel
qu'il puisse tre, et je l'assume prcisment parce qu'il est mon trait
d'union avec autrui. Ainsi, j e ne puis saisir autrui comme libert que
dans l e libre projet de l e saisir comme tel (il reste, en effet, toujours
possible que j e saisisse librement autrui comme objet) et l e libre
projet de reconnaissance d'autrui ne se distingue pas de l a libre
assomption de mon tre-pour-autrui. Voici donc que ma libert, en
quelque sorte, rcupre ses propres limites car j e ne puis me saisir
comme limit par autrui qu'en tant qu'autrui existe pour moi et je ne
puis faire qu'autrui existe pour moi comme subjectivit reconnue
qu'en assumant mon tre-pour-autrui . Il n'y a pas de cercIe : mais par
la libre assomption de cet tre-alin que j'prouve, je fais soudain
que la transcendance d'autrui existe pour moi en tant que telle. C'est
seulement en reconnaissant la libert (quel que soit l'usage qu'ils en
font) des antismites et en assumant cet tre-juif que je suis pour eux,
c'est seulement ainsi que l'trejuif apparatra comme limite objective
externe de la situation : s'il me plat, au contraire, de les considrer
comme purs objets, mon tre-juif disparat aussitt pour faire place
la simple conscience (d') tre libre transcendance inqualifiable.
Reconnatre les autres et, si j e suis Juif, assumer mon tre-juif ne font
qu'un. Ainsi, la libert de l'autre confre des limites ma situation,
mais j e ne puis prouver ces limites que si je reprends cet tre pour
l'autre que je suis et si je lui donne un sens la lumire des fins que
j'ai choisies. Et, certes, cette assomption mme est aline, elle a son
dehors, mais c'est par elle que j e peux prouver mon tre-dehors
colllme dehors.
Ds lors, comment prouverai-je les limites objectives de mon
tre : Juif, Aryen, l ai d, beau, roi , fonctionnaire, intouchable, etc. ,
lorsque le l angage m'aura renseign sur celles qui sont mes limites ?
571
Ce ne saurait tre de la faon dont je saisis intuitivement la beaut, la
laideur, la race de l'autre, ni non plus la faon dont j 'ai conscience
non-thtique (de) me proj eter vers telle ou telle possibilit. Ce n' est
pas que ces caractres objectifs doivent tre ncessairement abstraits :
les uns sont abstraits, les autres non. Ma beaut ou ma laideur ou
l'insigni fiance de mes traits sont saisies par l'autre dans leur pleine
concrtion et c'est cette concrtion que son langage m'indiquera ;
c'est vers elle que je me tendrai vide. Il ne s'agit donc nullement
d' une abstracti on, mais d'un ensemble de structures dont certaines
SOnt abstraites, mais dont la totalit est un concret absolu, ensemble
qui , simplement, m'est indiqu comme m' chappant par principe.
C'est, en effet, ce que je suis ; or, nous l'avons not au dbut de notre
deuxime parti e, le pour-soi ne peut rien tre. Pour-moi , je ne suis pas
plus professeur ou garon de caf que beau ou lai d, Juif ou Aryen,
spirituel , vulgaire ou distingu. Nous appellerons ces caractristiques
des irralisables. Il faut se dfendre de les confondre avec des
imaginaires. Il s'agit d'existences parfaitement relles, mais ceux pour
qui ces caractres sont rellement donns ne sont pas ces caractres ;
et moi qui les suis, je ne puis les raliser : si l'on me dit que je suis
vulgaire, par exempl e, j'ai souvent saisi par intuition sur d'autres la
nature de la vulgarit ; ainsi puis-je appliquer le mot de vulgaire
ma personne. Mais je ne puis lier la signification de ce mot ma
personne. Il y a l tout j uste l'indication d' une liaison oprer (mais
qui ne pourrait se faire que par i ntriorisation et subjectivation de la
vulgarit
, ou par objectivation de la personne, deux oprations qui
entranent l'effondrement immdiat de la ralit traite). Ainsi
sommes-nous e ntours l'infini d'irralisables. Certains d'entre ces
irralisables, nous les sentOnS vivement comme d' irritantes absences.
Qui n'a senti une profonde dception de ne pouvoir, aprs un long
exi l , raliser SOn retour qu' il est Paris . Les objets sont l et
s'offrent fami li rement, mais moi je ne suis qu'une absence, que le
pur nant qui est ncessaire pour qu'i! y ait Paris. Mes amis, mes
proches m'offrent l'image d'une terre promise lorsqu'ils me disent :
Enfi n ! te voi l, tu es rentr, tu es Paris ! Mais l'accs de cette
terre promise m'est entirement refus. Et si la plupart des gens
mritent le reproche de faire deux poids, deux mesures , selon
qu'il s' agit des autres ou d'eux-mmes, s'ils Ont tendance rpondre,
lorsqu'ils se sentent coupables d' une faute qu'ils ont blme la veille
chez autrui : a n'est pas la mme chose , c'est que, en effet, c
n'est pas la mme chose L'une des actions, en effet , est objet donn
d'apprciation morale, l'autre est pure transcendance qui porte sa
justification dans son existence mme, puisque son tre est choix.
Nous pourrons convaincre son auteur, par une comparaison des
rsultats, que les deux actes ont des rigoureusement
identiques , mai s sa bonne volont la plus perdue ne lui permettra
572
pas de raliser cette identit ; de l , une bonne partie des troubles de
la conscience morale, en particulier l e dsespoir de ne pouvoir
vraiment se mpriser, de ne pouvoir se raliser comme coupable, de
sentir perptuel l ement un cart entre les significations exprimes :
Je suis coupable, j'ai pch etc. , et l'apprhension relle de l a
situation. Bref, de l , toutes les angoisses de l a mauvaise cons
cience , c'est--dire de la conscience de mauvaise foi qui a pour idal
de se juger, c' est--dire de prendre sur soi le point de vue de l'autre.
Mais si quelques espces part iculires d'irralisables ont frapp plus
que d'autres, si elles ont fait l'obj et de descriptions psychologiques,
elles ne doivent pas nous aveugler sur le fait que les irralisables sont
en nombre infi ni , puisqu'ils reprsentent l'envers de la situation.
Cependant, ces irralisables ne nous sont pas seulement appr
sents comme irralisables : pour qu'ils aient , en effet , l e caractre
d'irralisables, il faut qu'ils se dvoilent la lumire de quelque
projet visant les raliser. Et c'est bien, en effet, ce que nous notions
tout l 'heure, lorsque nous montrions l e pour-soi assumant son tre
pour-l'autre dans et par l'acte mme qui reconnat l'existence de
l'autre. Corrlativement, donc, ce projet assomptif, les irralisables
se dvoilent comme raliser . D'abord, en effet , l'assomption se
fait dans la perspective de mon projet fondamental : je ne me borne
pas recevoir passivement la signification laideur , infirmit ,
race , etc. , mais, au contraire, je ne puis saisir ces caractres
simple titre de signification - qu' la lumire de mes fins propres.
C'est ce qu'on exprime - mais en renversant compltement l es
termes - quand on di t que l e fai t d'tre d' une certaine race peut
dterminer une raction d'orgueil ou un complexe d'infriorit. En
fait la race, l ' infirmit, la laideur ne peuvent apparatre que dans les
limites de mon propre choix d' infriorit ou d'orgueil 1 ; autrement
dit, elles ne peuvent apparatre qu'avec une signification que ma
libert l eur confre ; cel a signifi e, une fois de plus, qu'elles sont pour
l'autre, mais qu' el les ne peuvent tre, pour moi , que si j e l es choisi.
La loi de ma libert, qui fait que je ne puis tre sans me choisir,
s'applique ici mme : je ne choisis pas d'tre pour l'autre ce que j e
suis mais j e ne puis tenter d'tre pour moi ce que j e suis pour l'autre
qu'en me choisissant tel que j'apparais l'autre, c'est--dire par une
assomption lective. Un Juif n'est pas Juif d'abord, pour tre ensuite,
honteux ou fi er ; mais, c'est son orgueil d'tre Juif, sa honte ou son
indiffrence qui lui rvlera son tre-j uif ; et cet tre-juif n'est rien en
dehors de la libre manire de le prendre. Simplement, bien que j e
dispose d'une infinit de manires d'assumer mon tre-pour-autrui, j e
ne puis pas ne pas l'assumer : nous retrouvons ici cette condamnation
la libert que nous dfinissions pl us haut comme facticit ; je ne puis
1 . Ou de tout autre choix de mes fins.
573
ni m'ahstenir totalement par rapport ce que je suis (pour l'autre)
car refuser n'est pas s'abstenir, c'est assumer encore - ni le subir
passivement (ce qui, en un sens, revient au mme) ; dans la fureur, la
haine, l 'orguei l , la honte, le refus cur ou la revendication joyeuse
i l faut que je choisisse d' tre ce yue je sui s.
Ainsi , l es irralisables se dcouvrent au pour-soi comme irralisa
bles--raliser . Ils ne perdent pas pour cela leur caractre de
lmites ; bien au contraire, c'est comme limites objectives et externes
qu'ils se prsentent au pour-soi comme intrioriser. Ils ont donc un
caractre nettement obligatoire. Il ne s'agit pas, en effet, d'un
instrument se dcouvrant comme utiliser dans le mouvement du
libre projet que je suis. Mais ici l'irralisable apparat la fois comme
limite donne a priori ma situation (puisque je suis tel pour l' autre)
et, par consquent, comme existant, sans attendre que je lui donne
l'existence ; et, la fois, comme ne pouvant exister que dans et par le
libre projet par quoi j e l'assumerai -l'assomption tant videmment
identique l 'organisation synthtique de toutes les conduites visant
raliser pour moi l'irralisable. En mme temps, comme il se donne
titre d'irralisahle, il se manifeste comme au del de toutes les
tentatives que je puis faire pour le raliser. Un a priori qui requiert
mon engagement pour tre, tout en ne dpendant que de cet
engagement et en se plaant d'emble au del de toute tentative pour
le raliser, qu'est-ce donc, sinon prcisment un impratif? Il est , en
effet, intrioriser, c'est--dire qu'il vient du dehors, comme tout fait ;
mais prcisment l'ordre, quel qu'il soit, se dfinit toujours comme
une extriorit reprise en intriorit. Pour qu'un ordre soit ordre -et
non flatus vocis ou pure donne de fait qu'on cherche simplement
tourner -, il faut que je le reprenne avec ma libert, que j'en fasse
une structure de mes libres projets. Mais pour qu' i l soit ordre et non
libre mouvement vers mes propres fins, il faut qu'il garde au sein
mme de mon libre choix le caractre d'extriorit. C'est l'extriorit
qui demeure extriorit jusyue dans et par la tentative du pour-soi
pour l ' intrioriser. C'est prcisment la dfinition de l'irralisable
raliser, c'est pourquoi il se donne comme un impratif. Mais on peut
aller plus loin dans la description de cet irralisable : il est, en effet,
ma limite. Mai s, prcisment parce qu' i l est ma limite, il ne peut
exister comme li mite d' un tre donn, mais comme limite de ma
libert. Cela signifie que ma libert, en choisissant librement, se
choisit ses l i mi tes ; ou, si l'on prfre, le libre choix de mes fins, c'est
-dire de ce que je suis pour moi, comporte l'assomption des limites
de ce choix, quelles qu'elles puissent tre. Ici encore le choix est choix
de finitude comme nous le marquions plus haut, mais au lieu que la
finitude choisie soit finitude interne, c'est--dire dtermination de la
libert par elle-mme, la finitude assume par la reprise des irralisa
bles est finitude externe ; je choisis d'avoir un tre distance, qui
574
limite tous mes choix et constitue leur envers, c' est--dire que j e
choisis que mon choix soit born par autre chose que lui-mme.
Duss-je m'en irriter et tenter par tous les moyens -comme nous
l'avons vu dans la partie prcdente de cet ouvrage -de rcuprer
ces limites, la pl us nergique des tentatives de rcupration ncessite
d'tre fonde dans la reprise libre comme limis des limites qu'on
veut intrioriser. Ainsi la libert reprend a son compte et fait rentrer
dans la situation les limites irralisables, en choisissant d'tre libert
limite par la libert de l 'autre. En consquence, les limites externes
de la situation deviennent siwarion-limite, c'est--dire qu'elles sont
incorpores l a situation de l'intrieur, avec l a caractristique
irralisable , comme raliser , comme envers
choisi et fuyant de mon choix, elles deviennent un sens de mon effort
dsespr pour tre, bien qu'elles soient situes a priori par del cet
effort, exactement comme la mort - autre type d'irralisable, que
nous n'avons pas considrer pour l'instant - devient situation
limite, la condition qu'elle soit prise pour un vnement de la vie,
encore qu'elle indique vers un monde o ma prsence et ma vie ne se
ralisent plus, c' est--dire vers un au-del de la vie. Le fait qu'il y ait
un au-del de la vi e, en tant qu' il ne prend son sens que par et dans ma
vie et que pourtant il demeure pour moi irralisable ; le fait qu' il y ait
une libert au del de ma libert, une situation par del ma situation
et pour laquelle ce que je vis comme situation est donn comme
forme objective au mi lieu du monde : voil deux types de situation
limite qui ont le caractre paradoxal de limiter ma libert de toute
part et cependant de n'avoir d'autre sens que celui que leur confre
ma libert. Pour l a classe , pour la race, pour le corps, pour autrui,
pour la fonction, etc . , il y a un tre-libre-pour. .. . Par lui l e pour
soi se projette vers un de ses possibles, qui est toujours son possible
ultime : parce que la possibilit envisage est possibilit de se voir,
c'est -dire d'tre un autre que soi pour se voir du dehors. Dans un cas
comme dans l'autre il y a projection de soi vers un ultime , qui ,
intrioris par l mme, devient sens thmatique et hors de porte de
possibles hirarchiss. On peut tre-pour-tre-Franais , tre
pour-tre-ouvrier , un fils de roi peut tre-po ur-rgner . Il s'agit
l de limites et d'/als ngateurs de notre tre, que nous avons
assumer, au sens, par exemple, o le Juif sioniste s'assume rsolu
ment dans sa race, c'est--dire assume concrtement et une fois pour
toutes l'alination permanente de son tre ; de mme l'ouvrier
rvolutionnaire, par son projet rvolutionnaire mme, assume un
. Et nous pourrons faire remarquer, comme
Heidegger -bien que les expressions authentique et inauthen
tique qu'il emploie soient douteuses et peu sincres cause de leur
contenu moral implicite -, que l'attitude de refus et de fuite qui
demeure toujours possible est , en dpi t d' el le-mme, libre assomp-
575
tion de ce qu'elle fuit. Ainsi , le bourgeois se fait bourgeois en niant
qu' i l y ait des classes, comme l'ouvrier se fait ouvrier en affirmant
qu' el l es existent et en ralisant son tre-dans-la-classe par son
activit rvolutionnaire. Mais ces limites externes de la libert,
prcisment parce qu'elles sont externes et qu'elles ne s'intriorisent
que comme irralisables, ne seront jamais un obstacle rel pour elle,
ni une limite subi e. La libert est totale et infinie, ce qui ne veut pas
dire qu'elle n'ait pas de limites mais qu'elle ne les rencontre jamais.
Les seules limites que l a libert heurte chaque instant, ce sont celles
qu'elle s'impose elle-mme et dont nous avons parl, propos du
pass, des entours et des techniques.
E) Ma mort.
Aprs que la mort ait paru l 'inhumain par excellence puisque c'tait
ce qu'il y a de l'autre ct du ( mur , on s'est avis tout coup de la
considrer d' un tout autre point de vue, c'est--dire comme un
vnement de la vie humaine. Ce changement s'explique fort bien : la
mort est un terme et tout terme (qu'il soit final ou initial) est un Janus
bifrons, soit qu' on l'envisage comme adhrant au nant d'tre qui
l i mi te le processus considr, soit, au contraire, qu' on le dcouvre
comme aggluti n la srie qu' il termine, tre appartenant un
processus existant et d'une certaine faon constituant sa signification.
Ainsi l'accord final d'une mlodie regarde par tout un ct vers l e
silence, c'est--dire vers le nant de son qui suivra l a mlodie ; en un
sens i l est fait avec du silence, puisque l e silence qui suivra est dj
prsent dans l 'accord de rsolution comme sa signification. Mais par
tout un autre ct il adhre ce plenum d'tre qu'est la mlodie
envisage : sans lui cette mlodie resterait en l'air et cette indcision
final e remonterait contre-courant de note en note pour confrer
chacune d'elles un caractre inachev. L mort a toujours t - tort
ou raison, c'est ce que nous ne pouvons encore dterminer -
considre comme le terme final de la vie humaine. En tant que telle,
i l tait naturel qu'une philosophie surtout proccupe de prciser la
position humaine par rapport l'inhumain absolu qui l'entoure,
considrt d'abord l a mort comme une porte ouverte sur l e nant de
ralit-humaine, que ce nant ft d'ailleurs la cessation absolue d'tre
ou l'existence sous une forme non-humaine. Ainsi , pourrons-nous
di re qu'il y a eu -en corrlation avec les grandes thories ralistes
une conception raliste de la mort, dans la mesure o celle-ci
apparaissait comme un contact immdiat avec le non-humain ; par l
el l e chappait l ' homme, en mme temps qu'elle le faonnait avec de
l'absolu non-humai n. Il ne se pouvait pas, bien entendu, qu'une
conception idaliste et humaniste du rel tolrt que l ' homme
576
rencontrt l'inhumai n, ft-ce comme sa limite. Il et suffi alors, en
effet, de s e placer du point de vue de cette limite pour clairer
l'homme d'un jour non-humain 1. La tentative idaliste pour rcup
rer la mort n' a pas t primitivement l e fait de philosophes, mais celui
de potes comme Rilke ou de romanciers comme Malraux. Il suffisait
de considrer la mort comme terme ultime appartenant la srie. Si la
srie rcupre ainsi son terminus ad quem prcisment cause de
cet ad qui en marque l'intriorit, la mort comme fin de la vie
s'intriorise et s'humanise ; l'homme ne peut plus rencontrer que de
l'humain ; i l n'y a plus d'autre ct de l a vie, et l a mort est un
phnomne humai n, c'est le phnomne ul ti me de l a vie, vie encore.
Comme telle, elle influence contre-courant la vie entire ; la vie se
limite avec de la vi e, elle devient comme le monde einsteinien finie
mais illimite l a mort devient l e sens de la vie comme l'accord de
rsolution est le sens de la mlodie ; i l n' y a rien l de miraculeux : elle
est un terme de la srie considre et , on le sait, chaque terme d'une
srie est toujours prsent tous les termes de la srie. Mais la mort
ainsi rcupre ne demeure pas simplement humaine, elle devient
mienne ; en s'intriorisant, elle s'individualise ; ce n'est plus l e grand
inconnaissable qui limite l'humain mais c'est le phnomne de ma vie
personnelle qui fait de cette vie une vie unique, c'est--dire une vie
qui ne recommence pas, o l'on ne reprend jamais son coup. Par l je
deviens responsable de ma mort comme de ma vie. Non pas du
phnomne empirique et contingent de mon trpas, mais de ce
caractre de finitude qui fait que ma vi e, comme ma mort, est ma vie.
C'est en ce sens que Rilke s'efforce de montrer que la fin de chaque
homme ressemble sa vie, parce que toute la vie individuelle a t
prparation de cette fi n ; en ce sens que Malraux, dans Les Conqu
rants, montre que la culture europenne, en donnant certains
Asiatiques le sens de leur mort, les pntre soudain de cette vrit
dsesprante et eni vrante que la vie est unique . Il tait rserv
Heidegger de donner une forme phi losophique cette humanisation
de la mort : si, en effet, le Dasein ne subit rien, prcisment parce
qu'il est projet et anticipati on, i l doit tre anticipation et projet de sa
propre mort comme possibilit de ne plus raliser de prsence dans le
monde. Ainsi la mort est devenue l a possibilit propre du Dasein,
l'tre de la ralit-humaine se dfini t comme Sein zum Tode En
tant que le Dasein dcide de son projet vers l a mort, il ralise l a
libert-pour-mourir et se constitue l ui-mme comme totalit par le
libre choix de la finitude.
Une semblable thorie, ce qu'il parat d'abord, ne peut que nous
sduire : en intriorisant la mort, elle sert nos propres desseins ; cette
limite apparente de notre libert, en s' intriorisant, est rcupre par
1. Voir, par exemple, le platonisme raliste de Morgan, dans Sparkenbroke.
577
la l i bert. Pourtant ni la commodit de ces vues, ni la part
incontestable de vrit qu'elles renferment ne doivent nous garer. Il
faut reprendre du dbut l'examen de la question.
Il est certain que l a ralit-humaine, par qui l a mondanit vient au
rel , ne saurait rencontrer l ' i nhumain ; le concept d'inhumain lui
mme est un concept d'homme. I l faut donc abandonner tout espoir,
mme si en soi l a mort tait un passage un absolu non-humain, de la
considrer comme une lucarne sur cet absolu. La mort ne nous rvle
rien que sur nous-mme et d'un point de vue humain. Cela signifie-t-il
qu' elle appartient a priori la ralit-humaine ?
Ce qu'il faut noter tout d'abord c'est le caractre absurde de la
mort. En ce sens, toute tentation de l a considrer comme un accord
de rsolution au terme d' une mlodie doit tre rigoureusement
carte. On a souvent dit que nous tions dans la situation d'un
condamn, parmi les condamns, qui ignore l e jour de son excution,
mais qui voit excuter chaque jour ses compagnons de gele. Ce n'est
pas tout fait exact : il faudrait plutt nous comparer un condamn
mort qui se prpare bravement au dernier supplice, qui met tous ses
soins faire belle figure sur l'chafaud et qui , entre-temps, est enlev
par une pidmie de grippe espagnole. C'est ce que la sagesse
chrtienne a compris, qui recommande de se prparer la mort
comme si elle pouvait survenir taule heure. Ainsi espre-t-on la
rcuprer en l a mtamorphosant en mort attendue . Si le sens de
notre vie devient l'attente de la mort, en effet , celle-ci ne peut, en
survenant, que poser son sceau sur la vi e. C'est au fond ce qu'il y a de
plus positif dans la dcision rsolue (Entschlossenheit) de Heideg
ger. Malheureusement ce sont l des conseils plus faciles donner
qu' suivre, non pas cause d' une faiblesse naturelle l a ralit
humai ne ou d'un pro-jet originel d'inauthenticit, mais de la mort
elle-mme. On peut, en effet, attendre une mort particulire, mais
non pas la mort. Le tour de passe-passe ralis par Heidegger est
assez facile dceler : il commence par individualiser la mort de
chacun de nous, en nous indiquant qu'elle est la mort d' une personne,
d' un individu ; l a seule chose que personne ne puisse faire pour
moi ; ensuite de quoi il utilise cette i ndividualit incomparable qu'il
a confre l a mort partir du Dasein pour individualiser l e Dasein
lui-mme : c'est en se projetant librement vers sa possibilit ultime
que l e Dasein accdera l'existence authentique et s'arrachera la
banalit quotidienne pour atteindre l'unicit irremplaable de la
personne. Mais il y a l un cercle : comment, en effet, prouver que la
mort a cette i ndividualit et l e pouvoir de la confrer ? Certes, si la
mort est dcrite comme ma mort, je puis l'attendre : c est une
possibilit caractrise et distincte . Mais la mort qui me frappera est
elle ma mort ? Tout d'abord il est parfaitement gratuit de dire que
mourir est la seule chose que personne ne puisse faire pour moi .
578
Ou plutt il y a l une mauvaise foi vidente dans le raisonnement : si
l'on consi dre, en effet, la mort comme possibilit ultime et subjec
tive, vnement qui ne concerne que le pour-soi, il est vident que nul
ne peut mouri r pour moi . Mais alors i l suit de l qu'aucune de mes
possibilits, prise de ce poi nt de vue - qui est celui du cogito -,
qu'elle soit prise dans une existence authentique ou inauthentique, ne
peut tre projete par un autre que moi. Nul ne peut aimer pour moi ,
si l'on entend par l faire ces serments qui sont mes serments,
prouver ces motions (si banales soient-elles), qui sont mes mo
tions. Et l e mes ne concerne nul lement ici une personnalit
conquise sur la banalit quotidienne (ce qui permettrait Heidegger
de nous rtorquer qu' il faut justement que je sois libre pour
mourir pour qu'un amour que j' prouve soit mon amour et non
l'amour en moi de On ) mais tout simplement cette ipsit que
Heidegger reconnat expressment tout Dasein -qu' il existe sur l e
mode authentique ou inauthentique -lorsqu'il dclare que Dasein
ist je meines Ainsi, d e ce point d e vue, l'amour l e plus banal est,
comme la mort, irremplaable et unique : nul ne peut aimer pour
moi. Que si, au contraire, on considre mes actes dans l e monde, du
point de vue de leur foncti on, de leur efficience et de leur rsultat, il
est certain que l'autre peut toujours faire ce que je fais : s'il s'agit de
rendre cette femme heureuse , de sauvegarder sa vi e ou sa libert, de
lui donner les moyens de faire son salut, ou simplement de raliser
avec elle un foyer, de lui faire des enfants , si c' est l ce qu'on
appelle aimer, alors un autre pourra aimer ma place, i l pourra
mme aimer pour moi : c'est l e sens mme de ces sacrifices, conts
mille fois dans les romans sentimentaux qui nous montrent l e hros
amoureux, souhaitant le bonheur de l a femme qu'il aime et s'effaant
devant son rival parce que celui-ci saura l'aimer mieux que l ui . Ici
le rival est nommment charg d'aimer pour, car aimer se dfinit
simplement comme rendre heureux par l'amour qu'on l ui porte .
Et il en sera ainsi de toutes mes conduites. Seulement, ma mort
rentrera aussi dans cette catgorie : si mourir c'est mourir pour
difier, pour tmoigner, pour la patrie, etc. , n'importe qui peut
mourir ma place -comme dans la chanson, o l'on tire la courte
paille celui qui est mang. En un mot il n'y a aucune vertu
personnalisante qui soit particulire ma mort. Bien au contraire,
elle ne devient ma mort que si j e me place dj dans la perspective de
la subjectivit ; c'est ma subjectivit, dfinie par le cogito prrfexif,
qui fait de ma mort un irremplaable subjectif et non la mort qui
donnerait l'ipsit irremplaable mon pour-soi. En ce cas la mort ne
saurait se caractriser parce qu'elle est mort comme ma mort et, par
suite, sa structure essentielle de mort ne suffit pas faire d'elle cet
vnement personnalis et qualifi qu'on peut attendre.
Mais, en outre, la mort ne saurait aucunement tre attendue, si el le
579
n'est pas trs prcisment dsigne comme ma condamnation mort
(l'excution qui aura lieu dans huit jours, l'issue de ma maladie que je
sais prochaine et brutale, etc. ) , car elle n'est autre que la rvlation
de l'absurdit de toute attente, ft-ce justement de son attente. En
premier lieu, en effet , il faudrait distinguer soigneusement deux sens
du verbe attendre qu' on a continu de confondre ici : s'attendre
la mort n'est pas attendre la mort . Nous ne pouvons attendre qu'un
vnement dtermin que des processus galement dtermins sont
en trai n de raliser. Je peux attendre l ' arrive du train de Chartres,
parce que j e sais qu'il a quitt la gare de Chartres et que chaque tour
de roue le rapproche de la gare de Paris. Certes, i l peut prendre du
retard, un accident peut mme se produire : mais i l n'en demeure pas
moins que le processus lui-mme, par lequel l'entre en gare se
ralisera, est en cours et les phnomnes qui peuvent retarder ou
supprimer cette entre en gare signifient seulement ici que le
processus n' est qu'un systme relativement clos, relativement isol et
qu'il est en fait plong dans un univers structure fibreuse ,
comme dit Meyerson. Aussi puis-je dire que j 'attends Pierre et que
je m'attends ce que son train ait du retard . Mais prcisment la
possibilit de ma mort signifie seulement que je ne suis biologique
ment qu'un systme relativement clos, relativement isol, elle marque
seulement l'appartenance de mon corps la totalit des existants. Elle
est du type du retard probable des trains, non du type de l'arrive de
Pierre. El l e est du ct de l'empchement imprvu, inal/endu, dont il
faut toujours tenir compte, en lui conservant son caractre spcifique
d'inattendu, mais qu' on ne peut attendre, car i l se perd de lui-mme
dans l'indtermin. En admettant, en effet, que les facteurs se
conditionnent rigoureusement, ce qui n'est mme pas prouv et
requiert donc une option mtaphysi que, leur nombre est infini et
leurs implications infiniment infinies ; leur ensemble ne constitue pas
un systme, au moins du point de vue considr, l'effet envisag -
ma mort -ne saurait tre prvu pour aucune date ni par consquent
attendu. Peut-tre, pendant que j 'cris paisiblement en cette cham
bre, l'tat de l' univers est-il tel que ma mort s'est considrablement
rapproche ; mais peut-tre, au contraire, vient-elle de s'loigner
considrablement. Si j 'attends, par exempl e, un ordre de mobilisa
tion, je puis considrer que ma mort est prochaine, c'est--dire que
les chances d'une mort prochaine ont considrablement augment ;
mais il se peut justement qu' au mme moment une confrence
internationale se soit runie en secret et qu'elle ait trouv le moyen de
prolonger la paix. Ainsi ne puis-je dire que l a minute qui passe me
rapproche de l a mort. II est vrai qu'elle m'en rapproche si j e considre
tout fait en gros que ma vie est limite. Mai s, l'intrieur de ces
limites, trs lastiques (je puis mourir centenaire ou trente-sept ans,
demain), je ne puis savoir si elle me rapproche ou m' loigne de ce
580
terme, en effet. C'est qu'il y a une di ffrence considrable de qualit
entre la mort la limite de la vieillesse ou la mort soudaine qui nous
anantit dans l'ge mr ou dans Ii jeunesse. Attendre la premire, c'est
accepter que la vie soit une entreprise limite, une manire entre autres
de choisir la finitude et lire nos fi ns sur le fondement de la finitude.
Attendre l a seconde, ce serait attendre que ma vie soit une entreprise
manque. S' i l n'existait que des morts de viei ll esse (ou par condamna
tion explicite), je pourrais allendre ma mort. Mais prcisment le
propre de la mort, c'est qu' elle peut toujours surprendre avant terme
ceux qui l'attendent telle ou telle date. Et si la mort de vieillesse peut
se confondre avec la finitude de notre choix et, par suite, se vivre
comme l'accord de rsolution de notre vie (on nous donne une tche et
on nous donne du temps pour l a remplir), la mort brusque, au
contraire, est telle qu'elle ne saurait aucunement s'attendre, car elle est
indtermine et on ne peut l'attendre aucune date, par dfinition :
elle comporte toujours, en effet, la possibilit que nous mourions par
surprise avant la date attendue et , par consquent, que notre attente
soit comme at/ente une duperi e, ou que nous survivions cette date et,
comme nous n'tions que cette attente, que nous nous survivions
nous-mme. Comme, d'ailleurs, la mort brusque n'est qualitative
ment diffrente de l'autre que dans l a mesure o nous vivons l'une ou
l'autre, comme, biologiquement, c'est--dire du point de vue de
l'univers, elles ne diffrent aucunement quant leurs causes et aux
facteurs qui les dterminent, l'indtermination de l'une rejaillit en fait
sur l'autre ; cela signifie qu' on ne peut que par aveuglement ou
mauvaise foi allendre une mort de vi ei llesse. Nous avons, en effet,
toutes les chances de mourir avant d'avoir rempli notre tche ou, au
contraire, de l ui survivre. Il y a donc un nombre de chances trs faible
pour que notre mort se prsente, comme celle de Sophocle, par
exemple, la manire d'un accord de rsolution. Mais si c'est
seulement la chance qui dcide du caractre de notre mort, et, donc, de
notre vie, mme l a mort qui ressemblera le plus une fin de mlodie ne
peut tre attendue comme telle ; le hasard, en en dcidant, lui te tout
caractre de fin harmonieuse. Une fin de mlodie, en effet, pour
confrer son sens la mlodi e, doit maner de la mlodie elle-mme.
Une mort comme celle de Sophocle ressemblera donc un accord de
rsolution mais n'en sera point une, tout juste comme l'assemblage de
lettres form par l a chute de quelques cubes ressemblera peut-tre un
mot, mais n'en sera point un. Ainsi , cette perptuelle apparition du
hasard au sein de mes projets ne peut tre saisie comme ma possibilit,
mais, au contraire, comme la nantisation de toutes mes possibilits,
nantisation qui elle-mme ne fait plus partie de mes possibilits. Ainsi,
la mort n'est pas ma possibilit de ne plus raliser de prsence dans le
monde, mais une nantisation toujours possible de mes possibles, qui est
hors de mes possibilits.
581
C'est d'ailleurs ce qui peut s'exprimer d'une faon un peu diff
rente, en partant de la considration des significations. La ralit
humaine est signifiante, nous le savons. Cela veut dire qu'elle se fait
annoncer ce qu'elle est par ce qui n'est pas ou, si l 'on prfre, qu'elle
est venir soi-mme. Si donc elle est perptuellement engage dans
son propre futur, cela nous entrane dire qu'elle attend confirmation
de ce futur. En tant que futur, en effet, l'avenir est presquisse d'un
prsent qui sera ; on se remet dans les mains de ce prsent qui, seul,
titre de prsent , doit pouvoir confirmer ou infirmer la signification
presquisse que je suis. Comme ce prsent sera lui-mme libre
reprise du pass l a lumire d'un nouveau futur, nous ne saurions le
dterminer, mais seulement le pro-jeter et l'attendre. Le sens de ma
conduite actuelle, c'est l'admonestation que je veux faire subir telle
personne qui m' a gravement cffens. Mais que sais-je si cette
admonestation ne se transformera pas en balbutiements irrits et
timides et si l a signification de ma conduite prsente ne se transfor
mera pas au pass ? La libert limite la libert, le pass tire son sens
du prsent. Ainsi, comme nous l'avons montr, s'explique ce
paradoxe que notre conduite actuelle nous est la fois totalement
translucide (cogito prrflexif) et, la fois, totalement masque par
une libre dtermination que nous devons attendre : l'adolescent est
la fois parfaitement conscient du sens mystique de ses conduites, et,
la fois, doit s' en remettre tout son futur pour dcider s'il est en train
de passer par une crise de pubert ou de s'engager pour de bon
dans l a voie de la dvotion. Ainsi notre libert ultrieure, en tant
qu'elle est non pas notre actuelle possibilit, mais le fondement de
possibilits que nous ne sommes pas encore, constitue comme une
opacit en pleine translucidit, quelque chose comme ce que Barrs
appelait le mystre en pleine lumire . De l cette ncessit pour
nous de nous attendre. Notre vie n'est qu' une longue attente : attente
de l a ralisation de nos fins, d'abord (tre engag dans une entreprise,
c'est en attendre l'issue) , attente de nous-mme surtout (mme si
cette entreprise est ralise, mme si j'ai su me faire aimer, obtenir
telle distincti on, telle faveur, reste dterminer l a place, le sens et la
valeur de cette entreprise mme dans ma vie) . Cela ne provient pas
d' un dfaut contingent de l a nature humaine, d'une nervosit qui
nous empcherait de nous limiter au prsent et qui pourrait tre
corrige par l'exercice, mais de la nature mme du pour-soi qui est
dans la mesure o il se temporalise. Aussi faut-il considrer notre vie
comme tant faite non seulement d'attentes, mais d'attentes d'at
tentes qui attendent elles-mmes des attentes. C'est l la structure
mme de l'ipsit : tre soi , c'est venir soi. Ces attentes videmment
comportent toutes une rfrence un terme ultime qui serait attendu
sans plus rien attendre. Un repos qui serait tre et non plus attente
d'tre. Toute l a srie est suspendue ce terme ultime qui n'est jamais
582
donn par principe et qui est la valeur de notre tre, c'est--dire,
videmment, une plnitude du type en-soi, pour-soi ". Par ce terme
ulti me, la reprise de notre pass serait faite une fois pour toutes ; nous
saurions pour toujours si telle preuve de jeunesse a t fructueuse ou
nfaste, si teIle crise de pubert tait caprice ou relle prformation
de mes engagements ultrieurs, la courbe de notre vie serait fixe
pour toujours. En un mot, le compte serait arrt. Les chrtiens ont
essay de donner la mort comme ce terme ul ti me. Le R. P. Boisselot,
dans une conversation prive qu'il eut avec moi, me donnait
entendre que l e Jugement dernier ", c'tait prcisment cet arrt du
compte, qui fait qu'on ne peut pl us reprendre son coup et qu'on est
enfin ce qu'on a t, irrmdiablement.
Mais il y a l une erreur analogue celle que nous signalions plus
haut chez Leibniz, encore qu'eIle se place l'autre bout de l'exis
tence. Pour Leibniz, nous sommes libres, puisque tous nos actes
dcoulent de notre essence. Il suffit cependant que notre essence n'ait
point t choisie par nous pour que toute cette libert de dtail
recouvre une totale servitude : Dieu a choisi l'essence d'Adam.
Inversement, si c'est l'arrt du compte qui donne son sens et sa valeur
notre vie, peu importe que tous les actes dont est fai te la trame de
notre vie aient t libres : le sens mme nous en chappe si nous ne
choisissons pas nous-mme le moment o l e compte s'arrtera. C'est
ce qu'a bien senti l'auteur libertin d'une anecdote dont Diderot s'est
fait l'cho. Deux frres comparaissent au tribunal divin, le jour du
jugement. Le premier dit Dieu : Pourquoi m'as-tu fait mourir si
jeune ? " et Di eu rpond : Pour te sauver. Si tu avais vcu plus
longtemps, tu aurais commis un cri me, comme ton frre. " Alors, le
frre demande son tour : Pourquoi m'as-tu fait mourir si vieux ?
Si la mort n'est pas l i bre dtermination de notre tre, elle ne saurait
terminer notre vi e : une mi nute de plus ou de moins et tout change
peut-tre ; si cette mi nute est ajoute ou te mon compte, mme
en admettant que je l ' empl oi e li brement, le sens de ma vie
m'chappe. Or, la mort chrtienne vi ent de Dieu : i l choisit notre
heure ; et, d'une faon gnrale, je sais clairement que, mme si c'est
moi qui fai s, en me temporalisant, qu'il y ait en gnral des minutes et
des heures, l a mi nute de ma mort n'est pas fixe par moi : les
squences de l'univers en dcident .
S'il en est ai nsi , nous ne pouvons mme plus dire que l a mort
confre un sens du dehors l a vi e : un sens ne peut venir que de la
subjectivit mme. Puisque la mort ne parat pas sur l e fondement de
notre libert, elle ne peut qu'ter la vie toute signification. Si j e suis
attente d'attentes d'attente et si , d'un coup, l'objet de mon attente
dernire et celui qui attend sont supprims, l'attente en reoit
rtrospectivement le caractre d'absurdit. Trente ans ce jeune
homme a vcu dans l'attente d'tre un grand crivai n ; mais cette
583
attente elle-mme ne se suffisait pas : elle serait obstination vaniteuse
et insense, ou comprhension profonde de sa valeur selon les livres
qu'il crirait . Son premier livre est paru, mais, lui seul , que signifie
t-il ? C'est un livre de dbut. Admettons qu'il soit bon : i l ne prend
son sens que par J'avenir. S'il est unique, i l est la fois inauguration et
testament. Il n'avait qu'un livre crire, i l est limit et cern par son
uvre ; il ne sera pas un grand crivain . Si le roman prend sa place
dans une srie mdiocre, c'est un accident . S'il est suivi d'autres
livres meilleurs il peut classer son auteur au premier rang. Mais voici
justement que la mort frappe J'crivain, au moment mme o il
s'prouve anxieusement pour savoir s'il aura l'toffe d'crire un
autre ouvrage, au moment o i l s'attend. Cela suffit pour que tout
tombe dans l'indtermin : je ne puis dire que l'crivain mort est
J'auteur d'un seul livre (au sens o il n'aurait eu qu'un seul livre
crire) ni non plus qu'il en a crit plusieurs (puisque, en fai t, un seul
est paru) . Je ne puis rien dire : supposons Balzac mort avant Les
Chouans, i l resterait J'auteur de quelques excrables romans d'aven
tures. Mais, du coup, J'attente mme que ce jeune mort fUI, cette
attente d'tre un grand homme, perd toute espce de signification ;
elle n'est ni aveuglement ttu et vaniteux, ni vritable sens de sa
propre valeur, puisque rien, jamais, n'en dcidera. Il ne servirait
rien, en effet , de tenter d'en dcider en considrant les sacrifices qu'il
a consentis son art, la vie obscure et rude qu'il a consenti mener :
tant de mdiocres ont eu la force de faire de semblables sacrifices. Au
contraire, la valeur finale de ces conduites reste dfinitivement en
suspens ; ou, si J ' on prfre, J'ensemble -conduites particulires,
attentes, valeurs - tombe d' un coup dans J'absurde. Ainsi, la mort
n'est jamais ce qui donne son sens la vie : c'est au contraire ce qui
lui te par principe toute signification. Si nous devons mourir, notre
vi e n' a pas de sens parce que ses problmes ne reoivent aucune
solution et parce que la signification mme des problmes demeure
indtermine.
Il serait vain de recourir au suicide pour chapper cette ncessit.
Le suicide ne saurait tre considr comme une fin de vie dont je
serais le propre fondement. Etant acte de ma vi e, en effet, il requiert
lui-mme une signification que seul l'avenir peut lui donner ; mais
comme il est le dernier acte de ma vie, il se refuse cet aveni r ; ainsi
demeure-t-il totalement indtermin. Si j'chappe la mort, en effet,
ou si je me manque , ne jugerai-je pas plus tard mon suicide
comme une lchet ? L'vnement ne pourra-t-il pas me montrer que
d'autres solutions taient possibles ? Mais comme ces solutions ne
peuvent tre que mes propres projets, elles ne peuvent apparatre que
si je vis. Le suicide est une absurdit qui fait sombrer ma vie dans
l'absurde.
Ces remarques, on l e notera, ne sont pas tires de la considration
584
de la mort, mais, au contraire, de celle de la vie ; c'est parce que le
pour-soi est l'tre pour qui l'tre est en question dans son tre, c'est
parce que le pour-soi est l'tre qui rclame toujours un aprs, qu'il n'y
a aucune place pour la mort dans l'tre qu'il est pour-soi. Que
pourrait donc signifier une attente de l a mort, si ce n'est l'attente d'un
vnement indtermin qui rduirait toute attente l'absurde, y
compris celle mme de la mort ? L'attente de la mort se dtruirait
elle-mme, car elle serait ngation de toute attente. Mon pro-jet vers
une mort est comprhensible (suicide, martyre, hrosme), mais non
le projet vers ma mort comme possibilit indtermine de ne plus
raliser de prsence dans l e monde, car ce projet serait destruction de
tous les projets. Ainsi, la mort ne saurait tre ma possibilit propre ;
elle ne saurait mme pas tre une de mes possibilits.
D'ailleurs, la mort, en tant qu'elle peut se rvler moi, n'est pas
seulement la nantisation toujours possible de mes possibles -
nantisation hors de mes possibilits -, elle n'est pas seulement le
projet qui dtruit tous les projets et qui se dtruit lui-mme,
l'impossible destruction de mes attentes : elle est l e triomphe du point
de vue d'autrui sur l e point de vue que je suis sur moi-mme. C'est
sans doute ce que Malraux entend, lorsqu'il crit de la mort, dans
L'Espoir, qu'elle transforme la vie en destin . La mort, en effet,
n'est que par son ct ngatif nantisation de mes possibilits :
comme, en effet, je ne suis mes possibilits que par nantisation de
l'tre-en-soi que j 'ai tre, la mort comme nantisation d'une
nantisation est position de mon tre comme en-soi, au sens o, pour
Hegel, la ngation d'une ngation est affirmation. Tant que l e pour
soi est en vie , il dpasse son pass vers son avenir et l e pass est ce
que le pour-soi a tre. Lorsque l e pour-soi cesse de vivre , ce
pass ne s'abolit pas pour autant : la disparition de l'tre nantisant
ne le touche pas dans son tre qui est du type de l'en-soi ; il s'abme
dans l'en-soi. Ma vie tout entire est, cela signifie non point qu'elle est
une totalit harmonieuse, mais qu'elle a cess d'tre son propre sursis
et qu'elle ne peut plus se changer par la simple conscience qu' el l e a
d'elle-mme. Mais, tout au contraire, le sens d'un phnomne
quelconque de cette vie est fix dsormais, non par lui-mme, mais
par cette totalit ouverte qu'est l a vie arrte. Ce sens, titre
primaire et fondamental, est absence de sens, nous l'avons vu. Mais,
litre secondaire et driv, mille chatoiements, mille irisations de sens
relatifs peuvent se j ouer sur cette absurdit fondamentale d'une vie
. Par exemple, quelle qu'en ait t la vanit ultime, i l reste
que la vie de Sophocle a t heureuse, que la vi e de Balzac a t
prodigieusement laborieuse, etc. Naturellement, ces qualifications
gnrales peuvent tre serres de plus prs ; nous pouvons risquer une
description, une analyse, en mme temps qu'une narration de cette
vie. Nous obtiendrons des caractres plus distincts ; par exemple,
585
nous pourrons dire de telle morte, comme Mauriac d'une de ses
hrones, qu' el le a vcu en dsespre prudente nous pourrions
saisir le sens de de Pascal (c'est--dire de sa
i ntrieure) comme somptueux et amer , ainsi que l'crivait Nietz
sche. Nous pouvons aller j usqu' qualifier tel pisode de lchet
ou d' i ndl icatesse , sans perdre de vue, toutefois, que l'arrt
contingent de cet tre-en-perptuel-sursis qu'est le pour-soi vivant
permet seul et sur le fondement d'une absurdit radicale de confrer
le sens relatif l'pisode considr et que ce sens est une signification
essentiellement provisoire dont le provisoire est accidentellement pass
au dfi nitif. Mais ces di ffrentes explications du sens de la vi e de
Pi erre avaient pour effet , lorsque c'tait Pierre lui-mme qui les
oprait sur sa propre vie, d' en changer la signification et l' orientation,
car toute description de sa propre vie, lorsqu'elle est tente par le
pour-soi , est projet de soi par del cette vi e et , comme le projet
altrant est, du mme coup, agglomr la vie qu'il altre, c'est la
propre vi e de Pierre qui mtamorphosait son sens en se temporalisant
continment. Or, prsent que sa vie est morte, seule la mmoire de
l'autre peut empcher qu'elle se recroqueville dans sa plnitude en soi
en coupant toutes ses amarres avec le prsent . La caractristique
d' une vie morte, c'est que c'est une vie dont l'autre se fait l e gardien.
Cela ne signifie pas simplement que l'autre retient la vie du
disparu en en effectuant une reconstitution explicite et cognitive.
Bien au contraire, une semblable reconstitution n'est qu'une des
attitudes possibles de l'autre par rapport la vie morte et, par suite, le
caractre vi e reconstitue } (dans le milieu familial par les souvenirs
des proches, dans le milieu historique) est un destin particulier qui
vient marquer certaines vi es l'exclusion d'autres. Il en rsulte
ncessairement que l a qualit oppose vie tombe dans l'oubli
reprsente aussi un destin spcifique et descriptible qui vient de
certaines vi es partir de l'autre. Etre oubl i , c'est faire l'objet d'une
attitude de l'autre et d'une dcision implicite d'autrui. Etre oubli,
c'est, en fait, tre apprhend rsolument et pour toujours commt.
lment fondu dans une masse (les grands fodaux du XIII
'
sicle
les bourgeois whigs d u XVIII
e
, les fonctionnaires sovitiques ,
etc. ) , ce n'est nullement s 'anantir, mais c'est perdre son existence
personnelle pour tre constitu avec d'autres en existence collective.
Ceci nous montre bi en ce que nous dsirions prouver, c'est que l'autre
ne saurait tre d'abord sans contact avec les morts pour dcider
ensuite (ou pour que les circonstances dcident) qu'il aurait telle ou
telle relation avec certains morts particuliers (ceux qu'il a connus de
leur vivant, les grands morts etc. ). En ralit, l a relation aux
morts - tous les morts -est une structure essentielle de la relation
fondamentale que nous avons nomme tre-po ur-autrui Dans
son surgissement l'tre, le pour-soi doit prendre position par
586
rapport aux morts ; son projet initial les organise en larges masses
anonymes ou en individualits distinctes ; et ces masses collectives,
comme ces individualits, il dtermine leur recul ou leur proximit
absolue, il dplie les distances temporelles d'elles lui en se
temporalisant, tout comme i l dpl i e les distances spatiales partir de
ses entours ; en se faisant annoncer par sa fin ce qu'il est, i l dcide de
l'importance propre des collectivits ou des individualits disparues ;
tel groupe qui sera strictement anonyme et amorphe pour Pierre, sera
spcifi et structur pour moi ; tel autre, purement uniforme pour
moi , laissera paratre pour Jean certaines de ses composantes
individuelles. Byzance, Rome, Athnes, la deuxime Croisade, la
Convention, autant d'immenses ncropoles que je puis voir de loin ou
de prs, d' une vue cavalire ou dtaille, suivant la position que je
prends, que j e suis , au point qu' i l n'est pas i mpossible -pour peu
qu'on l'entende comme i l faut -de dfinir une personne par ses
morts, c'est--dire par les secteurs d' i ndividualisation ou de collectivi
sation qu'elle a dtermins dans l a ncropole, par les routes et les
sentiers qu'elle a tracs, par les enseignements qu'elle a dcid de se
faire donner, par les racines y a pousses. Certes, les morts
nous choisissent, mais il faut d'abord que nous les ayons choisis. Nous
retrouvons ici le rapport originel qui unit la facticit la libert ; nous
choisissons notre attitude envers les morts, mais i l ne se peut pas que
nous n'en choisissions pas une. L'indiffrence l 'gard des morts est
une attitude parfaitement possible (on en trouverait des exemples
chez les Heimatlos , chez certains rvolutionnaires ou chez des
individualistes) . Mais cette i ndiffrence -qui consiste faire re
mourir morts -est une conduite parmi d'autres vis -vis d' eux.
Ainsi, de par sa facticit mme, le pour-soi est jet dans une entire
responsabilit , vis--vis des morts ; il est oblig de dcider libre
ment de leur sort. En particulier, lorsqu'il s'agit des morts qui nous
entourent, i l ne se peut pas que nous ne dcidions pas - explicite
ment ou implicitement - du sort de leurs entreprises ; cela est
manifeste lorsqu'il s'agit du fils qui reprend l'entreprise de son pre
ou du disciple qui reprend l'cole et les dotrines de son matre. Mais,
bien que le lien soit moins clairement visible dans bon nombre de
circonstances, cela est vrai aussi dans tous les cas o l e mort et le
vivant considrs appartiennent l a mme collectivit historique et
concrte. C'est moi, ce sont les hommes de ma gnration qui
dcident du sens des efforts et des entreprises de la gnration
antrieure, soit qu'ils reprennent et continuent leurs tentatives
soiales et politiques, soit qu'ils ralisent dcidment une cassure et
rejettent les morts dans l' inefficience. Nous l'avons vu, c'est l'Amri
que de 1917 qui dcide de la valeur et du sens des entreprises de La
Fayette. Ainsi , de ce point de vue, apparat clairement l a diffrence
entre la vie et la mort : la vie dcide de son propre sens, parce qu'elle
587
est toujours en sursis, elle possde par essence un pouvoir d'auto
critique et d' auto-mtamorphose qui fait qu'elle se dfinit comme un
pas-encore ou qu'elle est, si l'on veut, comme changement de ce
qu'elle est . La vie morte ne cesse pas pour cela de changer et,
pourtant, elle est faite. Cela signifie que, pour elle, les jeux sont faits
et qu'elle subira dsormais ses changements sans en tre aucunement
responsable. Il ne s'agit pas seulement pour elle d'une totalisation
arbitraire et dfinitive ; i l s'agit, en outre, d'une transformation
radicale ; rien ne peut plus lui arriver de l'intrieur, elle est entire
ment close, on n'y peut plus rien faire entrer ; mais son sens ne cesse
point d'tre modifi du dehors. Jusqu' la mort de cet aptre de l a
paix, l e sens de ses entreprises (folie ou sens profond du rel , russite
ou chec) tait entre ses mains ; tant que je serai l, il n' y aura pas
de guerre . Mais dans la mesure o ce sens dpasse les bornes d'une
simple individualit, dans l a mesure o l a personne se fait annoncer
ce qu'elle est par une situation objective raliser (la paix en
Europe), la mort reprsente une totale dpossession : c'est l'autre qui
dpossde l 'aptre de la paix du sens mme de ses efforts et, donc, de
son tre, en se chargeant , en dpit de lui-mme et par son
surgissement mme, de transformer en chec ou en russite, en folie
Ou en intuition de gnie, l'entreprise mme par quoi l a personne se
faisait annoncer ce qu'elle tait en son tre. Ainsi l'existence mme de
la morl nous aline tout entier, dans notre propre vie, au profit
d'autrui. Etre mort , c'est tre en proie aux vivants. Cela signifie donc
que celui qui tente de saisir le sens de sa mort future doit se dcouvrir
comme proie future des autres. Il y a donc un cas d'alination que
nous n'avons pas envisag, dans la section de cet ouvrage que nous
consacrions au Pour-Autrui : les alinations que nous avions tu
dies, en effet, taient de celles que nous pouvions nantiser en
transformant l'autre en transcendance-transcende, de mme que
nous pouvions nantiser notre dehors par l a position absolue et
subjective de notre libert ; tant que j e vis, je peux chapper ce que
je sui pour l 'autre en me faisant rvler, par mes fins librement
poses, que je ne suis rien et que j e me fais tre ce que je suis ; tant
que je vis, je peux dmentir ce que l'autre dcouvre de moi en me
pro-jetant dj vers d'autres fins et, en tout cas, en dcouvrant que
ma dimension d'tre-po ur-moi est incommensurable avec ma dimen
sion d'tre-pour-l'autre. Ainsi chapp-je sans cesse mon dehors et
suis-je sans cesse ressaisi par lui sans que, en ce combat douteux ,
la victoire dfi nitive appartienne l'un ou l'autre de ces modes d' tre.
Mais l e fait de la mort, sans s'allier prcisment l'un ou l'autre des
adversaires dans ce combat mme, donne la victoire finale au point de
vue de l'autre, en transportant l e combat et l'enjeu sur un autre
terrain, c'est--dire en supprimant soudain un des combattants. En ce
sens, mourir, c'est tre condamn, quelle que soit la victoire
588
phmre qu'on a remporte sur l'autre et mme si l'on s'est servi de
l'autre pour sculpter sa propre statue , ne plus exister que par
l'autre et teni r de l ui son sens et le sens mme de sa victoire. Si l' on
partage, en effet, les vues ralistes que nous avons exposes dans
notre troisime partie, on devra reconnatre que mon existence
d'aprs la mort n'est pas la simple survie spectral e, la
conscience de l'autre , de simples reprsentations (images, souve
nirs, etc. ) qui me concerneraient. Mon tre-pour-autrui est un tre
rel et, s'il demeure entre les mai ns d'autrui comme un manteau que
je lui abandonne aprs ma disparition, c'est titre de dimension relle
de mon tre -di mension devenue mon unique dimension -et non
de spectre inconsistant. Richel i eu, Louis XV, mon grand-pre ne sont
aucunement la somme de mes souvenirs, ni mme l a somme des
souvenirs ou des connaissances de tous ceux qui en ont entendu
parler ; ce sont des tres objectifs et opaques, mais qui, simplement,
sont rduits l a seule di mension d'extriorit. A ce titre, ils
poursuivront leur histoire dans le monde humai n, mais ils ne seront
plus jamais que des transcendances-transcendes au mi lieu du
monde ; ainsi, non seulement la mort dsarme mes attentes en tant
dfinitivement l'attente et en laissant dans l' i ndtermin la ralisation
des fins qui m' annoncent ce que je suis -mais encore elle confre un
sens du dehors tout ce que je vis en subjectivit ; elle ressaisit tout ce
subjectif qui se dfendait, tant qu' i 1 vivait , contre l'extriorisation
et elle le prive de tout sens subjectif pour le livrer, au contraire,
toute signification objective qu'il plaira l'autre de l ui donner. Il
convient toutefois de faire remarquer que ce destin ainsi confr
ma vie demeure lui aussi en suspens, en sursis, car la rponse cette
question : Quel sera, en dfinitive, le destin historique de Robes
pierre ? dpend de l a rponse cette question pralable : L'His
toire a-t-elle un sens ? , c'est--dire doit-elle s'achever ou seule
ment se terminer ? Cette question n'est pas rsolue -elle est peut
tre insoluble, puisque toutes les rponses qu'on y fait (y compris la
rponse de l'idalisme : de l'Egypte est l'histoire de
l'Egyptologie sont elles-mmes historiques.
Ainsi, en admettant que ma mort peut se dcouvrir dans ma vi e,
nous voyons qu'elle ne saurait tre un pur arrt de ma subjectivit
qui, tant vnement intrieur de cette subjectivit, ne concernerait
finalement qu'elle. S'il est vrai que le ralisme dogmatique a eu tort
de voir dans la mort l'tat de mort, c'est--dire un transcendant la
vie, i l n'en demeure pas moi ns que la mort telle que je peux la
dcouvrir comme mienne engage ncessairement autre chose que
moi. En tant, en effet, qu'elle est nantisation toujours possible de
mes possibles, elle est hors de mes possibilits et j e ne saurais donc
l'attendre, c'est--dire me jeter vers elle comme vers une de mes
possibilits. Elle ne saurait donc appartenir l a structure ontologique
589
du pour-soi . En tant qu'elle est le triomphe de l'autre sur moi , elle
renvoie un fai t , fondamental, certes, mais totalement contingent,
comme nous l'avons vu, qui est l'existence de l'autre. Nous ne
connatrions pas celle mort, si l'autre n'existait pas ; elle ne saurait ni
se dcouvrir nous, ni surtout se constituer comme la mtamorphose
de notre t re en destin ; elle serait , en effet, la disparition simultane
du pour-soi et du monde , du subjectif et de l'objectif, du signifiant et
de toutes les significations. Si la mort, dans une certaine mesure, peut
se rvler nous comme la mtamorphose de ces significations
particulires qui sont mes significations, c'est par suite du fait de
l'existence d' un autre signifiant qui assure la relve des significations
et des signes. Cest cause de l ' autre que ma mort est ma chute hors
du monde , titre de subjectivit, au lieu d'tre l'anantissement de la
conscience et du monde. Il y a donc un indniable et fondamental
caractre de fait, c'est--dire une contingence radicale dans la mort
comme dans l'exist ence d'autrui . Cette contingence la soustrait par
avance toutes les conjectures ontologiques. Et mditer sur ma vie en
la considrant partir de la mort , ce serait mditer sur ma subjectivit
en prenant sur elle l e point de vue de l'autre ; nous avons vu que cela
n'est pas possible.
Ainsi, nous devons conclure, contre Hei degger, que loin que la
mort soit ma possibilit propre, lie est 'n fait contingent qui , en tant
que t el , m'chappe par principe et ressortit origi nellement ma
facticit. Je ne saurais ni dcouvri r ma mort , ni l'attendre ni prendre
une attitude envers el l e, car elle est ce qui se rvle comme
l'indcouvrable, ce qui dsarme toutes les attentes, ce qui se glisse
dans toutes les atti tudes et particulirement dans celles qu'on
prendrait vis--vis d' elle, pour les transformer en conduites extriori
ses et figes dont le sens est pour toujours confi d'autres qu'
nous-mme. La mort est un pur fait, comme l a naissance ; el l e vient
nous du dehors et elle nous transforme en dehors. Au fond, elle ne se
distingue aucunement de la naissance, et c'est l'identit de la
naissance et de la mort que nous nommons facticit.
Est-ce di re que l a mort trace les limites de notre libert ? En
renonant l'tre-pour-mourir de Heidegger, avons-nous renonc
pour toujours l a possibilit de donner librement notre tre une
signification dont nous soyons responsables ?
Bien au contraire, il nous semble que la mort, en se dcouvrant
nous comme elle est, nous libre enti rement de sa prtendue
contrai nte. C'est ce qui apparatra plus clairement pour peu qu'on y
rflchisse.
Mais tout d'abord il convient de sparer radicalement les deux
ides ordinairement uni es de mort et de finitude. On semble croire
d'ordinaire que c'est la mort qui constitue et qui nous rvle notre
finitude. De cette contamination rsulte que la mort prend figure de
590
ncessit ontologique et que la finitude, au contraire, emprunte l a
mort son caractre de contingence. Un Heidegger, e n particulier,
sembl e avoir bti toute sa thorie du Sein-zum-Tode sur l'identifi
cation rigoureuse de la mort en la finitude ; de la mme faon,
Malraux, lorsqu'il nous di t que la mort nous rvle l'unicit de l a vi e,
semble considrer justement que c'est parce que nous mourons que
nous sommes i mpuissants reprendre notre coup et, donc, fini s.
Mais, considrer l es choses d'un peu prs, on s'aperoit de l eur
erreur : l a mort est un fait contingent qui ressortit la factici t ; l a
finitude est Une structure ontologique du pour-soi qui dtermine l a
libert et n'existe que dans et par l e libre projet de la fin qui
m'annonce mon tre. Autrement di t , l a ralit-humaine demeurerait
finie, mme si elle tait immortel l e, parce qu'elle se fait finie en se
choisissant humai ne. Etre fi ni , en effet, c'est se choisir, c'est--dire se
faire annoncer ce qu'on est en se projetant vers un possible,
l'exclusion des autres. L'acte mme de libert est donc assomption et
cration de l a finitude. Si je me fais, j e me fais fini et, de ce fait , ma
vi e est unique. Ds l ors, fuss-je immortel , i l m'est interdit de
mon coup ; c'est l ' irrversibilit de la temporalit qui
me l'interdit, et cette irrversibilit n' est autre que le caractre propre
d'une libert qui se temporalise. Certes, si je suis immortel et que
j'aie d carter l e possible B pour raliser le possible A, l'occasion se
reprsentera pour moi de raliser ce possible refus. Mais, du seul fait
que cette occasion se prsentera aprs l'occasion refuse, elle ne sera
point l a mme et, ds lors, c'est pour l'ternit que je me serai fait fini
en cartant irrmdiablement l a premire occasi on. De ce point de
vue, l'immortel comme l e mortel nat plusieurs et se fait un seul . Pour
tre temporellement indfi ni e, c'est--dire sans bornes, sa vi e
n'en sera pas moins finie dans son tre mme parce qu'il se fait
unique. La mort n'a rien y voi r ; el l e survient entre-temps , et l a
ralit-humai ne, en se rvlant sa propre finitude, ne dcouvre pas,
pour autant, sa mortalit.
Ainsi, la mort n'est aucunement structure ontologique de mon tre,
du moins en tan t qu' i l est pour-soi ; c'est l 'autre qui est mortel dans
son tre. Il n' y a aucune place pour l a mort dans l'tre-pour-soi ; i l ne
peut ni l'attendre, ni l a raliser, ni se projeter vers el l e ; elle n'est
aucunement l e fondement de sa finitude et, d'une faon gnrale, el l e
ne peut ni tre fonde du dedans comme pro-jet de la libert
originelle, ni tre reue du dehors comme une qualit par l e pour-soi.
Qu'est-elle donc ? Rien d'autre qu'un certain aspect de la facticit et
de l'tre-pour-autrui , c'est--dire rien d'autre que du donn. Il est
absurde que nous soyons ns, il est absurde que nous mourions ;
d'autre part, cette absurdit se prsente comme l'alination perma
nente de mon tre - possibilit qui n'est plus ma possibilit, mais
celle de l'autre. C'est donc une l i mi te externe et de fait de ma
591
subjectivit. Mais ne reconnat-on pas ici la description que nous avons
tente au paragraphe prcdent ? Cette limite de fait que nous devons
assurer, en un sens, puisque rien ne nous pntre du dehors et qu' i l faut
bien en un sens que nous prouvions la mort si nous devons pouvoir
simplement la nommer, mais qui , d'autre part, n'est jamais renconrre
par l e pour-soi , puisqu'elle n'est rien de lui, sinon la permanence
indfinie de Son tre-pour-l'autre, qu'est-ce si non, prcisment , un des
irralisables ? Qu'est-ce, sinon un aspect synthtique de nos envers ?
Muriel reprsente l ' tre prsent que je suis pour-autrui ; mort
reprsente le sens futur de mon pour-soi actuel pour l'autre. Il s'agit
donc bien d'une l i mi te permanente de mes proj ets ; et, comme telle,
cette limite est assumer. C'est donc une extriorit qui demeure
extriorit jusque dans et par la tentative du pour-soi pour la raliser .
ce que nous avons dfini plus haut comme l'irralisable raliser. Il n'y
a pas de diffrence au fond entre le choix par lequel la libert assume sa
mort comme li mi te i nsaisissable et i nconcevable de sa subjectivit et
celui par quoi el l e choisit d'tre l i bert limite par le fait de la libert de
l' autre. Ainsi, la mort n'est pas ma possibilit, au sens prcdemment
dfi ni ; elle est si tuation-limite, comme envers choisi et fuyant de mon
choi x. Elle n'est pas mon possi bl e, au sens o el l e serait ma fin propre
qui m'annoncerait mon tre ; mais du fait qu'elle est inluctable
ncessit d'exister ai l l eurs comme un dehors et un en-soi , el l e est
intriorise comme ultime , c'est--dire comme sens thmatique et
hors de porte des possibles hi rarchiss. Ainsi, me hante-t-elle au
cur mme de chacun de mes projets comme leur inluctable envers.
Mai s, prci sment, comme envers assumer non comme ma
possibilit, mai s comme la possibilit qu'i! n'y ait plus pour moi de
possibilits, elle ne m'entame pas. La libert qui est ma libert demeure
totale et infinie ; non que la mort ne la l i mi te pas, mais parce que la
libert ne rencontre jamais cette l i mite, l a mort n'est aucunement un
obstacle mes projets ; el l e est seulement un destin ailleurs de ces
projets. Je ne suis pas libre pour mourir mais j e suis un libre
mortel . La mort chappant mes projets parce qu'elle est irralisable,
j'chappe moi -mme l a mort dans mon projet mme. Etant ce qui est
toujours au del de ma subjectivit, il n'y a aucune place pour el l e dans
ma subjecti vi t. Et cette subjectivit ne s'affirme pas contre el l e, mais
indpendamment d' el l e, bien que cette affirmation soit i mmdiate
ment aline. Nous ne saurions donc ni penser la mort, ni l'attendre, ni
nous armer contre el l e ; mais aussi nos projets sont-ils, en tant que
projets -non par suite de notre aveuglement, comme dit le chrtien,
mais par principe -, indpendants d'el l e. Et, bien qu'i! y ait
d'innombrables attitudes possibles en face de cet irralisable
raliser par-dessus l e march , il n'y a pas l i eu de les classer en
authentiques et inauthentiques, puisque, justement, nous mourons
toujours par-dessus le march.
592
Ces diffrentes descriptions, portant sur ma place, mon pass, mes
entours, ma mort et mon prochai n, n' ont pas la prtention d'tre
exhaustives, ni mme dtailles. Leur but est simplement de nous
permettre une conception plus claire de ce qu'est une situation .
Grce elles, il va nous tre possible de dfinir plus prcisment cet
tre-en-situation qui caractrise l e pour-soi en tant qu'il est
responsable de sa manire d'tre sans tre fondement de son tre.
10 Je suis un existant au milieu d'autres existants. Mais je ne puis
raliser cette existence au milieu d'autres, j e ne puis saisir les
existants qui m' entourent comme objets ni me saisir moi-mme
comme existant entour ni mme donner un sens cette notion d'" au
milieu que si j e me choisis moi-inme, non dans mon tre mais dans
ma manire d'tre. Le choix de cette fin est choix d'un non-encore
existant. Ma position au mi lieu du monde, dfinie par le rapport
d'ustensilit ou d'adversit des ralits qui m'entourent ma propre
facticit, c'est--dire la dcouverte des dangers que je cours dans le
monde, des obstacles que je peux y rencontrer, des aides qui peuvent
m'tre offertes, la lueur d'une nantisation radicale de moi-mme et
d'une ngation radicale et interne de l'en-soi , opres du point de vue
d'une fin librement pose, voil ce que nous nommons la situation.
2 La situation n'existe qu' en corrlation avec le dpassement du
donn vers une fi n. Elle est la faon dont le donn que j e suis et le
donn que j e ne sui s pas se dcouvrent au pour-soi que j e suis sur le
mode de ne l'tre-pas. Qui dit situation dit donc position apprhen
de par le pour-soi qui est en situation . Il est impossible de
considrer une situation du dehors : elle se fige en forme en soi. En
consquence, la situation ne saurait tre dite ni objective ni subjec
tive, encore que les structures partielles de cette situation (la tasse
dont je me sers, la table sur laquelle je m'appuie, etc.) puissent et
doivent tre rigoureusement objectives.
La situation ne saurait tre subjective, car elle n'est ni la somme ni
l'unit des impressions que nous font les choses : elle est les choses
elles-mmes et moi-mme parmi les choses ; car mon surgissement
dans le monde comme pure nantisation d'tre n'a d'autre effet que
de faire qu'il y ait des choses et n'y ajoute rien. Sous cet aspect, la
situation trahit ma facticit, c'est--dire le fait que les choses sont l
simplement comme elles sont , sans ncessit ni possibilit d'tre
autrement, et que je suis l parmi elles.
Mais elle ne saurait non plus tre objective, au sens o elle serait un
pur donn que le sujet constaterait sans t re nullement engag dans l e
systme ainsi constitu. En fait, la situati on, de par l a signification
mme du donn (signification sans quoi il n'y aurait mme pas de
donn), reflte au pour-soi sa libert. Si l a situation n'est ni subjective
ni objective, c'est qu'elle ne constitue pas une connaissance ni mme
une comprhension affective de l'tat du monde par un sujet ; mais
593
c'est une relation d'tre entre un pour-soi et l'en-soi qu'il nantise. La
situation, c'est le sujet tout entier (i l n'est rien d'autre que sa
situation) et c'est aussi l a chose tout enti re (il n'y a jamais rien de
plus que les choses) . C'est le sujet clairant les choses par son
dpassement mme, si l ' on veut ; ou c'est les choses renvoyant au
sujet son image. C'est la totale facticit, la contingence absolue du
monde, de ma naissance, de ma place , de mon pass, de mes entours,
du fait de mon prochain -et c'est ma libert sans limites comme ce
qui fait qu'il y a pour moi une facticit. C'est cette route pou3sireuse
et montante, cette soif ardente que j' ai , ce refus des gens de me
donner boire, parce que je n'ai pas d'argent ou que je ne suis pas de
leur pays ou de leur race ; c'est mon dlaissement au milieu de ces
populations hostiles, avec cette fatigue de mon corps qui m'emp
chera peut-tre d'atteindre l e but que je m'tais fix. Mais c'est
prcisment aussi ce but, non en tant que j e l e formule clairement et
explici tement, mais en tant qu'i l est l, partout autour de moi , comme
ce qui unifie et explique tous ces faits, ce qui les organise en une
totalit descriptible au l i eu d'en faire un cauchemar en dsordre.
3 Si le pour-soi n'est rien d'autre que sa situation, i l suit de l que
l'tre-en-situation dfinit la ralit-humaine, en rendant compte la
fois de son tre-l et de son tre-par-del. La ralit-humaine est, en
effet , l' tre qui est toujours par del son tre-l. Et la situation est la
totalit organise de l ' tre-l i nterprte et vcue dans et par l'tre
par-del. Il n'y a donc pas de situation privilgie ; nous entendons
par l qu'il n'est pas de situation o le donn toufferait sous son
poids l a libert qui le constitue comme tel -ni , rciproquement, de
situation o le pour-soi serait plus libre que dans d'autres. Ceci ne
doit pas s'entendre au sens de cette libert intrieure } bergso
nienne que Politzer raillait dans La fin d' une parade philosophique et
qui aboutissait tout simplement reconnatre l 'esclave l'indpen
dance de l a vie intime et du cur dans les chanes. Lorsque nous
dclarons que l' esclave est aussi l i bre dans les chanes que son matre,
nous ne voulons pas parler d'une libert qui demeurerait indtermi
ne. L'esclave dans les chanes est libre pour les briser ; cela signifie
que le sens mme de ses chanes l ui apparatra la lumire de la fin
qu' i l aura choisie : rester esclave ou risquer l e pis pour s'affranchir de
la servitude. Sans doute, l'esclave ne pourra pas obtenir les richesses
et le niveau de vie du matre ; mais aussi ne sont-ce point l les objets
de ses projets, il ne peut que rver la possession de ces trsors ; sa
facticit est telle que le monde l ui apparat avec un autre visage et qu'il
a poser, rsoudre d'autres problmes ; en particulier, i l l ui faut
fondamental ement se choisir sur le terrain de l'esclavage et, par l
mme, donner un sens cette obscure contrainte. S'il choisit, par
exemple , la rvolte, l 'esclavage, l oin d'tre d'abord un obstacle
cette rvolte, ne prend son sens et son cfficient d'adversit que par
594
elle. Prcisment parce que la vi e de l'esclave qui se rvolte et meurt
au cours de la rvolte est une vi e li bre, prcisment parce que la
situation claire par un libre projet est pleine et concrte, prcis
ment parce que le problme urgent et capital de cette vie est :
atteindrai-je mon but ? , prcisment pour tout cela, la situation
de l'esclave est incomparable avec celle du matre. Chacune d'elles
ne prend, en effet, son sens que pour le pour-soi en situation et
partir du libre choix de ses fins. La comparaison ne saurait tre
opre que par un tiers et , par consquent, elle n'aurait lieu
qu'entre deux formes objectives au milieu du monde ; elle serait
tablie d'ailleurs la lumire du pro-jet li brement choisi par ce
tiers : il n'y a aucun point de vue absolu duquel on puisse se placer
pour comparer des situations diffrentes, chaque personne ne ralise
qu'une situation : la sienne.
4 La situation, tant claire par des fins qui ne sont elles-mmes
pro-jetes qu' partir de l'tre-l qu'elles clairent, se prsente
comme minemment concrte. Certes, elle contient et soutient des
structures abstraites et universelles, mais ell e doit se comprendre
comme le visage singulier que le monde tourne vers nous, comme
notre chance unique et personnelle. On se souvient de cet apologue
de Kafka : un marchand vi ent plaider son procs au chteau ; un
garde terrible lui barre l'entre. Il n'ose passer outre, attend et
meurt en attente. A l'heure de mourir, i l demande au gardien :
D'ou vient que j 'tais seul attendre ? Et le gardien lui rpond :
porte n'tait faite que pour toi . Tel est bien le cas du pour
soi, si l'on veut bi en ajouter qu'en outre, chacun se fait sa propre
porte. L concrtion de la situation se traduit en particulier par l e
fait que le pour-soi ne vise jamais des fins fondamentales abstraites
et universelles. Sans doute verrons-nous au prochain chapitre que l e
sens profond du choi x est uni versel et que, par l , le pour-soi fait
qu'existe une ralit-humaine comme espce. Encore faut-il dgager
le sens, qui est implicite ; et c'est cela que nous servira l a
psychanalyse existentielle. Et , une fois dgag, le sens terminal et
initial du pour-soi apparatra comme un unselbststandig qui a
besoin, pour se manifester, d'une concrtion particulire 1. Mais l a
fin du pour-soi telle qu'elle est vcue et poursuivie dans le projet par
quoi i l dpasse et fonde l e rel se rvle dans sa concrtion au pour
soi, comme un changement particulier de l a situation qu' i! vit (briser
ses chanes, tre roi des Francs, librer l a Pologne, lutter pour le
proltariat). Encore ne sera-ce mme point d' abord pour le prolta
riat en gnral qu'on pro-jettera de lutter, mais le proltariat sera
vis travers tel groupement ouvrier concret auquel la personne
appartient. C'est qu' en effet la fin n'claire le donn que parce
1. Cf. le chapitre suivant.
595
qu'elle est choisie comme dpassement de ce donn. Le pour-soi ne
surgit pas avec une fin toute donne. Mais faisant la situation, il
se fait , et inversement.
5 La situation, pas plus qu'elle n'est objective ou subjective, ne
saurait tre considre comme le l i bre effet d' une libert ou comme
l'ensemble des contraintes que je subis ; elle provient de l'clairement
de la contrainte par l a libert qui lui donne son sens de contrainte.
Entre les e xistants bruts, i l ne saurait y avoir de liaison, c'est l a libert
qui fonde l es liaisons en groupant les existants en complexes
ustensiles et c'est elle qui projette la raison des liaisons, c'est--dire sa
fi n. Mais, prcisment parce que, ds lors, je me projette vers une fin
travers un monde de liaisons, je rencontre prsent des squences,
des sries lies, des complexes et je dois me dterminer agir selon
des lois. Ces lois et la faon dont j'en use dcident de l'chec ou de la
russite de mes tentatives. Mais c'est par l a libert que les relations
lgales vi ennent au monde. Ainsi la libert s'enchane-t-elle dans le
monde comme libre projet vers des fins.
6 Le pour-soi est temporalisation ; cela signifie qu'il n'est pas ; il
se fait . C'est la situation qui doi t rendre compte de cette
permanence substantielle qu' on reconnat volontiers aux personnes
< il n'a pas chang , i l est toujours l e mme ) et que l a personne
prouve empi riquement, dans bien des cas, comme tant l a sienne.
L libre persvrance dans un mme projet, en effet, n'implique
aucune permanence, bien au contraire, c'est un perptuel renouvelle
ment de mon engagement, nous l'avons vu. Mais les ralits
enveloppes et claires par un projet qui se dveloppe et se confirme
prsentent au contraire l a permanence de l'en-soi et, dans la mesure
o elles nous renvoient notre image, elles nous tayent de leur
prennit ; i l est frquent mme que nous prenions leur permanence
pour l a ntre. En particulier, la permanence de l a place et des
entours, des jugements sur nous du prochain, de notre pass figure
une image dgrade de notre persvrance. Durant que je me
temporalise, j e suis toujours Franais, fonctionnaire ou proltaire
pour autrui. Cet irralisable a l e caractre d'une limite invariable de
ma situation. Semblablement, ce qu'on appelle temprament ou
caractre d' une personne et qui n'est autre que son libre projet en
tant qu'il est-pour-autrui apparat aussi, pour le pour-soi , comme un
irralisable invariant. Alain a fort bi en vu que le caractre est
serment. Celui qui dit je ne suis pas commode c'est un libre
engagement la colre qu' il contracte et , du mme coup, une libre
interprtation de certains dtails ambigus de son pass. En ce sens il
n'y a poi nt de caractre -il n'y a qu' un pro-jet de soi-mme. Mais il
ne faut pas mconnatre cependant l'aspect donn du caractre. Il
est vrai que pour l'autre, qui me saisit comme autre-objet, je suis
colri que, hypocrite ou franc, lche ou courageux. Cet aspect m'est
596
renvoy par le regard d'autrui : par l'preuve de ce regard, le
caractre, qui tai t libre projet vcu et conscient (de) soi, devient un
irralisable ne varietur assumer. Il dpend alors non seulement
de l'autre mais de la position que j'ai prise vis--vis de l'autre et de ma
persvrance maintenir cette position : tant que j e me laisserai
fasciner par le regard d'autrui , mon caractre figurera mes propres
yeux, comme irralisable ne varietur q l a permanence substantielle
de mon tre - comme le donnent entendre des phrases banales et
quotidiennement prononces, telles que : J' ai quarante-cinq ans et
ce n' est pas aujourd'hui que j e vai s me mettre changer. L
caractre est mme souvent ce que le pour-soi tente de rcuprer
pour devenir l'en-soi-pour-soi qu' i l projette d'tre. Il faut noter
toutefois que cette permanence du pass, des entours et du caractre
ne sont pas des qualits donnes ; elles ne se rvlent sur les choses
qu'en corrlation avec l a continuit de mon projet. Il serait vain
d'esprer, par exempl e, qu'on retrouvera, aprs une guerre, aprs un
long exil, tel paysage montagneux comme inaltr et de fonder sur
l'inertie et la permanence apparente de ces pierres l'espoir d'une
renaissance du pass. Ce paysage ne dcouvre sa permanence qu'
travers un projet persvrant : ces montagnes ont un sens l'intrieur
de ma situation - elles figurent d' une faon ou d'une autre mon
appartenance une nation en pai x, matresse d'elle-mme et qui
occupe un certain rang dans l a hirarchie internationale. Que je les
retrouve aprs une dfaite et pendant l'occupation d'une partie du
territoire, elles ne sauraient du tout m'offrir le mme visage : c'est
que moi-mme j'ai d'autres pro-jets, je me suis engag diffremment
dans le monde.
Enfi n, nous avons vu que des bouleversements intrieurs de l a
situation par changements autonomes des entours sont toujours
prvoi r. Ces changements ne peuvent jamais provoquer un change
ment de mon projet, mais ils peuvent amener, sur le fondement de ma
libert, une simplification ou une complication de la situation. Par l
mme, mon projet initial se rvlera moi avec plus ou moins de
simplicit. Car une personne n' est jamais ni simple ni complexe : c'est
sa situation qui peut tre l'un ou l'autre. Je ne suis rien en effet que le
projet de moi-mme par del une situation dtermine et ce projet
me pr-esquisse partir de l a situation concrte comme i l illumine
d'ailleurs la situation partir de mon choix. Si donc la situation dans
son ensemble s'est simplifie, si des boulis, des effondrements, des
rosions lui ont imprim un aspect tranch, des traits grossiers, avec
de violentes oppositions, je serai moi-mme simple, car mon choi x
le choix que je suis - tant apprhension de cette situation-l ne
saurait tre que simple. Des complications nouvelles en renaissant
auront pour effet de me prsenter une situation complique par del
laquelle j e me retrouverai compliqu. C'est ce que chacun a pu
597
constater s'il a remarqu quelle simplicit presque animale reve
naient les prisonniers de guerre par suite de l'extrme simplification
de leur situation ; cette simplification ne pouvait modifiei leur projet
l ui -mme dans sa signification ; mais sur le fondement mme de la
l i bert, elle entranait une condensation et une uniformisation des
entours qui se constituaient dans et par une apprhension plus nette,
plus brutale et plus condense des fins fondamentales de la personne
captive. Il s'agit, en somme, d' un mtabolisme interne, non d'une
mt amorphose globale qui intresserait aussi la forme de la situation.
Ce sont pourtant des changements que j e dcouvre comme change
ments dans ma vi e , c'est--dire dans les cadres unitaires d'un
mme projet.
I I I
LI BERT ET RES P ONS ABI LI T
Bi en que l es considrations qui vont suivre intressent plutt le
moraliste, on a j ug qu'il ne serait pas inutile, aprs ces descriptions
et ces argumentations, de revenir sur l a libert du pour-soi et
d'essayer de comprendre ce que reprsente pour la destine humaine
l e fai t de cette libert.
La consquence essentielle de nos remarques antrieures, c'est que
l'homme, tant condamn tre libre, porte le poids du monde tout
entier sur ses paules : i l est responsable du monde et de lui-mme en
tant que manire d'tre. Nous prenons l e mot de responsabilit en
son sens banal de conscience (d' ) tre l'auteur incontestable d'un
vnement ou d'un objet . En ce sens, la responsabilit du pour-soi
est accablante , puisqu'il est celui par qui i l se fait qu'il y ait un monde ;
et , puisqu'il est aussi celui qui se fait tre, quelle que soit donc la
situation o il se trouve, le pour-soi doit assumer entirement cette
situation avec son coefficient d'adversit propre, ft-il i nsoutenable ;
il doit l'assumer avec la conscience orgueilleuse d'en tre l'auteur, car
les pires inconvnients ou les pires menaces qui risquent d'atteindre
ma personne n' ont de sens que par mon projet ; et c'est sur le fond de
l'engagement que je suis qu'ils paraissent. Il est donc insens de
songer se plaindre, puisque rien d'tranger n' a dcid de ce que
nous ressentons, de ce que nous vivons ou de ce que nous sommes.
Cette responsabilit absolue n'est pas acceptation d'ailleurs : elle est
simple revendication logique des consquences de notre libert. Ce
qui m'arrive m' arrive par moi et j e ne saurais ni m'en affecter ni me
rvolter ni m' y rsigner. D'ailleurs, tout ce qui m'arrive est mien ; i l
598
faut entendre par l, tout d'abord, que je suis toujours la hauteur de
ce qui m'arrive, en tant qu'homme, car ce qui arrive un homme par
d'autres hommes et par lui-mme ne saurait tre qu'humain. Les plus
atroces situations de la guerre, les pires tortures ne crent pas d'tat
de choses inhumain : il n' y a pas de situation inhumaine ; c'est
seulement par la peur, la fuite et le recours aux conduites magiques
que je dciderai de l' i nhumain ; mais cette dcision est humaine et j' en
porterai l'entire responsabilit. Mais la situation est mienne en outre
parce qu'elle est l'image de mon libre choix de moi-mme et tout ce
qu'elle me prsente est mien en ce que cela me reprsente et me
symbolise. N'est-ce pas moi qui dcide du coefficient d'adversit des
choses et jusque de leur imprvisi bilit en dcidant de moi-mme ?
Ainsi n'y a-t-il pas d'accidents dans une vie ; un vnement social qui
clate soudain et m' entrane ne vient pas du dehors ; si je suis mobilis
dans une guerre, cette guerre est ma guerre, elle est mon image et je
la mrite. Je la mrite d'abord parce que je pouvais toujours m'y
soustraire, par Je suicide ou la dsertion : ces possibles ultimes sont
cux qui doivent touj ours nous tre prsents lorsqu'il s'agit d'envisa
ger une situation. Faute de m'y tre soustrait, je l'ai choisie ; ce peut
tre par veuleri e, par lchet devant l'opinion publique, parce que j e
prfre certaines valeurs celle du refus mme de faire la guerre
(l'estime de mes proches, l'honneur de ma famille, etc. ). De toute
faon, il s'agit d' un choix. Ce choix sera ritr par la suite d'une
faon continue jusqu' la fin de l a guerre ; i l faut donc souscrire au
mot de 1. Romains 1 : A la guerre, i l n' y a pas de victimes
innocentes. Si donc j'ai prfr la guerre la mort ou au
dshonneur, tout se passe comme si je portais l' entire responsabilit
de cette guerre. Sans doute, d'autres l'ont dclare et l'on serait
tent, peut-tre, de me considrer comme simple complice. Mais
cette notion de complicit n'a qu'un sens juridique ; ici, elle ne tient
pas ; car il a dpendu de moi que pour moi et par moi cette guerre
n'existe pas et j' ai dcid qu'elle existe. Il n'y a eu aucune contrainte,
car la contrainte ne saurait avoir aucune prise sur une libert ; je n'ai
eu aucune excuse, car, ainsi que nous l'avons dit et rpt dans ce
livre, le propre de la ralit-humai ne, c'est qu'elle est sans excuse. I l
ne me reste donc qu' revendiquer cette guerre. Mais, en outre, elle
est mienne parce que, du seul fait qu'elle surgit dans une situation que
je fais tre et que je ne puis l'y dcouvrir qu'en. m'engageant pour ou
contre elle, je ne puis plus distinguer prsent le choix que je fais de
moi du choix que je fais d'elle : vivre cette guerre, c'est me choisir par
elle et la choisir par mon choix de moi-mme. Il ne saurait tre
question de l'envisager comme quatre ans de vacances ou de
sursis comme une suspension de sance , l ' essentiel d e mes
1 . J. Romains : Les Hommes de bonne volont ; Prlude Verdun .
599
responsabilits tant ailleurs, dans ma vie conjugale, familiale,
professi onnel l e. Mais dans cette guerre que j 'ai choisie, je me choisis
au jour le jour et je la fais mienne en me faisant. Si elle doit tre
quatre annes vides, c'est moi qui en porte la responsabilit. Enfin,
comme nous l'avons marqu au paragraphe prcdent, chaque
personne est un choix absolu de soi partir d'un monde de
connai ssances et de techniques que ce choix assume et claire la
fois ; chaque personne est un absolu jouissant d'une date absolue et
parfaitement impensable une autre date. I l est donc oiseux de se
demander ce que j 'aurais t si cette guerre n'avait pas clat, car je
me suis choisi comme un des sens possibles de l'poque qui menait
insensibl ement l a guerre ; je ne me distingue pas de cette poque
mme, je ne pourrais tre transport une autre poque sans
contradicti on. Ainsi suis je cette guerre qui borne et l imite et fait
comprendre la priode qui l'a prcde. En ce sens, la formule que
nous citions tout l'heure : il n'y a pas de victimes innocentes , il
faut , pour dfinir plus nettement l a responsabilit du pour-soi,
ajouter celle-ci : On a l a guerre qu'on mrite. Ainsi, totalement
libre, i ndiscernable de l a priode dont j'ai choisi d'tre l e sens, aussi
profondment responsable de la guerre que si je l'avais moi-mme
dclare, ne pouvant rien vivre sans l ' intgrer ma situation, m'y
engager tout entier et la marquer de mon sceau, je dois tre sans
remords ni regrets comme je suis sans excuse, car, ds l'instant de
mon surgissement l'tre, je porte le poids du monde moi tout seul,
sans que rien ni personne ne puisse l'allger.
Pourtant cette responsabilit est d'un type trs particulier. On me
rpondra, en effet, que je n'ai pas demand natre , ce qui est
une faon nave de mettre l'accent sur notre facticit. Je suis
responsable de tout, en effet, sauf de ma responsabilit mme car je
ne suis pas le fondement de mon tre. Tout se passe donc comme si
j'tais contraint d'tre responsabl e. Je suis dlaiss dans le monde,
non au sens o j e demeurerais abandonn et passif dans un univers
hostil e, comme la planche qui flotte sur l'eau, mais, au contraire, au
sens o j e me trouve soudain seul et sans aide, engag dans un monde
dont je porte l'entire responsabi l i t, sans pouvoir, quoi que je fasse,
m'arracher, ft-ce un instant, cette responsabilit, car de mon dsir
mme de fuir les responsabilits, je suis responsabl e ; me faire passif
dans le monde, refuser d'agir sur les choses et sur les autres, c'est
encore me choisir, et le suicide est un mode parmi d'autres d'tre
dans-le-monde. Cependant je retrouve une responsabilit absolue du
fai t que ma facticit, c'est--dire ici l e fait de ma naissance, est
insaisissable directement et mme inconcevabl e, car ce fait de ma
naissance ne m'apparat jamais brut, mais toujours travers une
reconstruction pro-jective de mon pour-soi ; j'ai honte d'tre n ou je
m'en tonne, ou je m' en rjouis, ou, en tentant de m'ter la vie,
600
j 'affirme que je vis et j'assume cette vie comme mauvaise. Ainsi, en
un certain sens, j e choisis d'tre n. Ce choix lui-mme est affect
intgralement de facticit, puisque je ne peux pas ne pas choisir ; mais
cette facticit son tour n'apparatra qu'en tant que je la dpasse vers
mes fins. Ainsi, la facticit est partout, mais insaisissable ; je ne
rencontr jamais que ma responsabi lit, c'est pourquoi j e ne puis
demander Pourquoi suis je n ? , maudire l e jour de ma naissance
ou dclarer que je n'ai pas demand natre, car ces diffrentes
attitudes envers ma naissance, c'est--dire envers l e fait que je ralise
une prsence dans le monde, ne sont pas autre chose, prcisment,
que des manires d'assumer en pleine responsabilit cette naissance
et de l a faire mienne ; ici encore, je ne rencontre que moi et mes
projets, en sorte que finalement mon dlaissement , c'est--dire ma
facticit, consiste simplement en ce que je suis condamn tre
intgral ement responsable de moi-mme. Je suis l ' tre qui est comme
tre dont l'tre est en question dans son tre. Et cet est de mon
tre est comme prsent et insaisissable.
En ces conditions, puisque tout vnement du monde ne peut se
dcouvrir moi que comme occasion (occasion mise
p
rofit,
manque. nglige, etc. ), ou, mieux encore, puisque tout ce qui nous
arrive peut tre considr comme une chance, c'est--dire ne peut
nous apparatre que comme moyen de raliser cet tre qui est en
question dans notre tre, et puisque les autres, comme transcen
dances-transcendes, ne sont, eux aussi , que des occasions et des
chances, la responsabilit du pour-soi s'tend au monde entier comme
monde-peupl. C'est ainsi, prcisment, que l e pour-soi se saisit dans
l'angoisse, c'est--dire comme un tre qui n'est fondement ni de son
tre, ni de l' tre de l'autre, ni des en-soi qui forment le monde, mais
qui est contraint de dcider du sens de l' tre, en lui et partout hors de
lui. Celui qui ralise dans l ' angoisse sa condition d'tre jet dans une
responsabilit qui se retourne jusque sur son dlaissement n'a plus ni
remords, ni regret, ni excuse ; il n'est pl us qu'une libert qui se
dcouvre parfaitement elle-mme et dont l'tre rside en cette
dcouverte mme. Mais, on l'a marqu au dbut de cet ouvrage, la
plupart du temps, nous fuyons l'angoisse dans la mauvaise foi.
CHAPI TRE I I
Faire et avoir
LA PSYCHANALYS E EXI STENTI ELLE
S' i l est vrai que l a ralit-humai ne, comme nous avons tent de
l'tablir, s'annonce et se dfinit par l es fins qu'elle poursuit, une tude
et une classification de ces fins devient indispensable. Nous n'avons,
en effet , dans l e chapitre prcdent, considr l e pour-soi que sous
l'angle de son libre projet, c'est--dire de l'lan par lequel i l se jette
vers sa fin. Il convient prsent d' i nterroger cette fin elle-mme, car
elle fait partie de l a subjectivit absolue, comme sa limite transcen
dante et objective. C'est ce qu'a pressenti l a psychologie empirique
qui admet qu'un homme particul i er se dfinit par ses dsirs. Mais
nous devons ici nous mettre en garde contre deux erreurs : tout
d'abord l e psychologue empirique, en dfinissant l'homme par ses
dsirs, reste victime de l'i l l usion substantialiste. II voit l e dsir comme
tant dans l 'homme titre de contenu de sa conscience et il croit
que le sens du dsir se trouve inhrent au dsir lui-mme. Ainsi vite
t-il tout ce qui pourrait voquer l ' ide d'une transcendance. Mais si j e
dsire une maison, un verre d' eau, un corps de femme, comment ce
corps, ce verre, cet i mmeuble pourraient-ils rsider en mon dsir et
comment mon dsir peut-il tre autre chose que la conscience de ces
objets comme dsirables ? Gardons-nous donc de considrer les dsirs
comme de petites entits psychiques habitant l a conscience : i l s sont
l a conscience ell e-mme dans sa structure originelle pro-jective et
transcendante, en tant qu'eUe est par principe conscience de quelque
chose.
L'autre erreur, qui entretient des liaisons profondes avec l a
premire, consiste considrer l a recherche psychologique comme
602
termine ds qu' on a atteint l'ensemble concret des dsirs empiriques.
Ainsi, un homme se dfinirait par le faisceau de tendances que
l'observation empirique aura pu tablir. Naturellement, le psycholo
gue ne se bornera pas toujours faire la somme de ces tendances : i l
se plaira mettre au jour leurs parents, leurs convenances et
harmonies, il cherchera prsenter l'ensemble des dsirs comme une
organisation synthtique, dans laquelle chaque dsir agit sur les
autres et les influence. Un critique, par exemple, voulant tenter la
psychologie de Flaubert, crira qu'il parat avoir connu comme
tat normal , dans sa premire jeunesse, une exaltation continuelle
faite du double sentiment de son ambition grandiose et de sa force
invincible . . . L'effervescence de son jeune sang se tourna donc en
passion littraire, ainsi qu'il arrive vers la dix-huitime anne aux
mes prcoces qui trouvent dans l'nergie du style ou les intensits
d'une fiction de quoi tromper l e besoin d'agir beaucoup ou de trop
sentir, qui les tourmente 1 .
Il y a, dans ce passage, un effort pour rduire la personnalit
complexe d'un adolescent quelques dsirs premiers, comme le
chimiste rduit les corps composs n'tr qu'une combinaison de
corps simples. Ces donnes premi res seront l'ambition grandiose, l e
besoin d'agir beaucoup et de trop sentir ; ces lments, lorsqu'ils
entrent en combinaison, produisent une exaltation permanente.
Celle-ci , se nourrissant - comme Bourget le fait remarquer en
quelques mots que nous n'avons pas cits -de lectures nombreuses
et bien choisies, va chercher se tromper en s'exprimant dans des
fictions qui J'assouviront symboliquement et la canaliseront. Et voil,
esquisse, l a gense d' un temprament littraire.
Mais tout d'abord une semblable analyse psychologique part du
postulat qu' un fai t i ndi vi duel est produit par l ' i ntersection de l oi s
abstraites et universell es. Le fait expliquer - qui est ici l es
dispositions l i ttrai res du j eune Flaubert - se rsout en une
combinaison de dsirs typiques et abstraits tel s qu' on les rencontre
chez l'adolescent en gnral . Ce qui est concret i ci , c'est
seulement l eur combinaison ; en eux-mmes i l s ne sont que des
schmes. L'abstrait est donc, par hypothse, antrieur au concret et le
concret n'est qu'une organisation de qualits abstraites ; l'individuel
n'est que l ' i ntersection de schmes universels. Mais -outre l'absur
dit logique d' un pareil postulat - nous voyons clairement, dans
l'exemple choisi , qu'il choue expliquer ce qui fait prcisment
l'individualit du pro-jet considr. Que le besoin de trop sentir
-schme universel -se trompe et se canalise en devenant besoin
d'crire, ce n'est pas l'explication de la vocation de Flaubert, c'est
ce qu'il faudrait expliquer au contraire. Sans doute on pourra
1. Paul Bourget : Essais de psychologie contemporaine : G. Flaubert.
603
i nvoquer mille circonstances tnues et inconnues de nous qui ont
faonn ce besoin de sentir en besoin d'agir. Mais d'abord c'est
renoncer expliquer et s'en remettre prcisment l'indcelable l ,
En outre, c'est rejeter l'individuel pur, qu'on a banni de l a subjecti
vit de Flaubert, dans les circonstances extrieures de sa vi e, Enfin, la
correspondance de Flaubert prouve que, bien avant l a crise de
l'adolescence , ds sa plus petite enfance, Flaubert tait tourment
du besoi n d'crire,
A chaque tage de l a description prcite, nous rencontrons un
hiatus, Pourquoi l'ambition et le sentiment de sa force produisent-ils
chez Fl aubert de l'exaltation plutt qu'une attente tranquille ou
qu' une i mpatience sombre ? Pourquoi cette exaltation se spcifie
t-elle en besoin de trop agir et de trop senti r ? Ou plutt que vient faire
ce besoin apparu soudai n, par une gnration spontane, la fin du
paragraphe ? Et pourquoi , au lieu de chercher s'assouvir dans des
actes de vi olence, dans des fugues, des aventures amoureuses ou dans
la dbauche, choisit-il prcisment de se satisfaire symboliquement ?
Et pourquoi cette satisfaction symboli que, qui pourrait d'ailleurs ne
pas ressortir l'ordre artistique (i l y a aussi le mysticisme, par
exemple) , se trouve-t-eHe dans l 'criture, plutt que dans l a pei nture
ou la musique '! l'aurais pu, crit quelque part Flaubert, tre un
grand acteur. Pourquoi n'a-t-il pas tent de l'tre ? En un mot, nous
n'avons ri en compris, nous avons vu une succession de hasards, des
dsirs sortant tout arms les uns des autres, sans qu'il soit possible
d' en saisir l a gense, Les passages, les devenirs, les transformations
nous ont t soigneusement voils et l'on s'est bor mettre de
l'ordre dans cette succession en invoquant des squences empirique
ment constates (besoin d'agir prcdant chez l 'adolescent le besoin
d'crire) , mai s, la lettre, inintelligibles, Voil pourtant ce qu'on
nomme de l a psychologie, Ouvrez une biographi e au hasard, et c'est
le genre de description que vous y trouverez, plus ou moins coupe
par des rcits d'vnements extrieurs et des allusions aux grandes
idoles explicatives de notre poque, hrdi t, ducation, milieu,
constitution physiologique. I l arrive cependant, dans les meilleurs
ouvrages, que la liaison, tablie entre l ' antcdent et le consquent
ou entre deux dsirs concomitants et en rapport d'action rciproque,
ne soit pas seulement conue sur l e type des squences rgulires ;
parfois elle est comprhensible , au sens o Jaspers l'entend dans
son trait gnral de Psychopathologi e. Mais cette comprhension
demeure une saisie de liaisons gnrales. Par exemple on saisira le lien
entre chastet et mysticisme, entre faiblesse et hypocrisie. Mais nous
1 . Comme l'adolescence de Flaubert. en effet. pour autant que nous
pouvons la connatre, n'offre rien de particuli er cet gard, il faut supposer
l'action de faits impondrables qui chappent par principe au critique.
604
ignorons toujours la relation concrte entre cette chastet (cette
abstinence par rapport telle ou telle femme, cette lutte contre telle
tentation prcise) et le contenu individuel du mysticisme ; exactement
d'ailleurs comme la psychiatrie se satisfait lorsqu'elle a mis en lumire
les structures gnrales des dlires et ne cherche pas comprendre le
contenu i ndividuel et concret des psychoses (pourquoi cet homme se
croit-il telle personnalit historique plutt que n'importe quelle
autre ; pourquoi son dlire de compensation se satisfait-il avec telles
ides de grandeur plutt qu'avec t elles autres, etc. ).
Mais surtout ces explications psychologiques " nous renvoient
finalement des donnes premires inexplicables. Ce sont les corps
simples de la psychologie. On nous di t, par exemple, que Flaubert
avait une ambition grandiose " , et toute la description prcite
s'appuie sur cette ambition originelle. Soit. Mais cette ambition est un
fait irrductible qui ne satisfait aucunement l'esprit. C'est que
l'irrductibilit, ici, n' a d'autre raison qu'un refus de pousser plus loin
l'analyse. L o le psychologue s'arrte, le fait envisag se donne
comme premier. C'est ce qui explique cet tat trouble de rsignation
et d'insatisfaction o nous laisse la lecture de ces essais psycholog
ques : Voil, se dit-on, Flaubert tait ambitieux. II tait comme
a. " I I serait aussi vain de se demander pourquoi i l tait tel que de
chercher savoir pourquoi il tait grand et blond : il faut bien
s'arrter quelque part, c'est la contingence mme de toute existence
relle . Ce rocher est couvert de mousse, l e rocher voisin ne l'est
point. Gustave Flaubert avait de l'ambition littraire et son frre
Achille en tait dpourvu. C'est ainsi. Ainsi dsirons-nous connatre
les proprits du phosphore et tentons-nous de les rduire la
structure des molcules chimiques qui le composent. Mais pourquoi y
a-t-il des molcules de ce type ? C'est ainsi, voil tout. La psychologie
de Flaubert consistera ramener, si c'est possible, la complexit de
ses condui tes, de ses sentiments et de ses gots quelques proprits,
assez comparables celles des corps chimiques, et au del desquelles
ce serait une niaiserie que de vouloir remonter, Et pourtant nous
sentons obscurment que Flaubert n'avait pas reu " son ambition.
Elle est signifi ante, donc elle est libre. Ni l'hrdit, ni l a condition
bourgeoise , ni l'ducation ne peuvent en rendre compte ; bien moins
encore les considrations physiologiques sur l e temprament ner
veux " qui ont t de mode pendant quelque temps : le nerf n'est pas
signifiant, c'est une substance collodale qui doit se dcrire en elle
mme et qui ne se transcende pas pour se faire annoncer par d'autres
ralits ce qu'elle est. II ne saurait donc aucunement fonder une
signification. En un sens l'ambition de Flaubert est un fait avec toute
sa contingence -et il est vrai qu'il est impossible de remonter au del
du fait -mais en un autre, elle se fait et notre insatisfaction nous est
un garant de ce que nous pourrions saisir par del cette ambition
605
quelque chose de plus, quelque chose comme une dcision radicale
qui , sans cesser d'tre contingente, serait le vritable irrductible
psychique. Ce que nous exigeons -et qu'on ne tente jamais de nous
donner -c'est donc un vritable irrducti ble, c'est--dire un i rrduc
tible dont l ' irrductibilit serait vidente pour nous, ne serait pas
prsente comme le postulat du psychologue et le rsultat de son
refus ou de son incapacit d'aller pl us l oi n, mais dont la constatation
s'accompagnerait chez nous d'un sentiment de satisfaction. Et cette
exigence ne vient pas chez nous de cette poursuite i ncessante de la
cause, de cette rgression l'infini qu'on a souvent dcrite comme
constitutive de la recherche rationnelle et qui , par consquent, loin
d'tre spcifique de l'enqute psychologique, se retrouverait dans
toutes les disciplines et dans tous les problmes. Ce n'est pas la qute
enfantine d' un parce que qui ne donnerait lieu aucun pour
quoi ? - mais c'est, au contraire, une exigence fonde sur une
comprhension prontologique de la ralit-humaine et sur le refus
connexe de considrer l'homme comme analysable et comme rducti
bl e des donnes premires, des dsirs (ou tendances )
dtermins, supports par le sujet comme des proprits par u n objet.
Si nous devions, en effet, le considrer comme tel , il faudrait choisir :
Flaubert, l' homme, que nous pouvons aimer ou dtester, blmer ou
louer, qui est pour nous l'autre, qui attaque directement notre tre
propre du seul fait qu'il a exist, serait originellement un substrat non
qualifi de ces dsirs, c'est--dire une sorte de glaise indtermine qui
aurai t les recevoir passivement - ou bi en i l se rduirait au simple
faisceau de ces tendances irrductibles. Dans les deux cas, l'homme
disparat ; nous ne retrouvons plus celui auquel telle ou telle
aventure est arrive : ou bien, en cherchant la personne, nous
rencontrons une substance mtaphysique, inutile et contradictoire
ou bi en l'tre que nous cherchons s'vanouit en une poussire de
phnomnes l i s entre eux par des rapports externes. Or, ce que
chacun de nous exige dans son effort mme pour comprendre autrui,
c'est d'abord qu'on n'ait jamais recourir cette ide de substance,
i nhumaine parce qu'elle est en de de l ' humai n. C'est ensuite que,
pourtant, l'tre considr ne s'effrite pas en poussire et qu'on puisse
dcouvrir en lui cette unit - dont la substance n'tait qu'une
caricature -et qui doit tre unit de responsabilit, unit aimable ou
hassable, blmable ou louable, bref personnelle. Cette unit qui est
l ' tre de l'homme considr est libre unification. Et l ' unification ne
saurait veni r aprs une diversit qu'elle unifi e. Mais tre, pour
Flaubert comme pour tout sujet de biographie , c'est s'unifier dans
le monde. L'unification irrductible que nous devons rencontrer, qui
est Flaubert et que nous demandons aux biographes de nous rvler,
c'est donc l'unification d'un projet originel, unification qui doit se
rvler nous comme un absolu non substantiel. Ainsi devons-nous
606
renoncer aux irrductibles de dtail et, en prenant pour critre
l'vidence mme, ne pas nous arrter dans notre recherche avant qu'il
soit vident que nous ne pouvons ni ne devons pas aller plus loin. En
particulier nous ne devons pas plus essayer de reconstituer une
personne par ses inclinations qu'on ne doit tenter, selon Spinoza, de
reconstituer l a substance ou ses attributs par l a sommation des modes.
Tout dsir prsent comme irrductible est d'une contingence
absurde et entrane dans l'absurdit l a ralit-humaine prise dans son
ensemble. Si , par exemple, je dclare d' un de mes amis qu'il aime
canoter , j e propose dlibrment d'arrter l l a recherche. Mais,
d'autre part, je constitue ainsi un fait contingent que rien ne peut
expliquer et qui , s'il a la gratuit de l a dcision libre, n'en a
aucunement l'autonomie. Je ne puis, en effet, considrer cette
inclination au canotage comme le projet fondamental de Pierre, elle a
en soi quelque chose de secondaire et de driv. Pour un peu, ceux
qui dcrivent ainsi un caractre par touches successives donneraient
entendre que chacune de ces touches -chacun des dsirs envisags
-est relie aux autres par des rapports de pure contingence et de
simple extriorit. Ceux qui, au contraire, tenteront d'expliquer cette
affection entreront dans la voi e de ce que Comte appelait le
matrialisme, c'est--dire de l'explication du suprieur par l ' infrieur.
On dira, par exemple, que le suj et considr est un sportif, qui aime
les efforts violents et, en outre, un campagnard qui aime particulire
ment les sports de plein air. Ainsi placera-t-on au-dessous du dsir
expliquer des tendances plus gnrales et moins diffrencies, qui
sont celui-ci tout uniment comme l es genres zoologiques l'espce.
Ainsi l'explication psychologi que, lorsqu'elle ne dcide pas tout
coup de s'arrter, est tantt la mi se en relief de purs rapports de
concomitance ou de succession constante et, tantt, une simple
classification. Expliquer l'inclination de Pierre pour le canotage, c'est
en faire un membre de la famille des inclinations pour les sports en
plein air et c'est rattacher cette famille celle des tendances au sport
en gnral. Nous pourrons d'ai l l eurs trouver des rubriques encore
plus gnrales et plus pauvres si nous classons le got du sport comme
un des aspects de l'amour du risque qui sera donn lui-mme comme
une spcification de l a tendance fondamentale au jeu. Il est vident
que cette classification soi-disant explicative n'a pas plus de valeur ni
d'intrt que les classifications de l'ancienne botanique : elle revient
supposer comme celles-ci l'antriorit d'tre de l'abstrait sur l e
concret -comme si la tendance au jeu existait d'abord en gnral
pour se spcifier ensuite sous l'action des circonstances en amour
du sport, celui-ci en inclination pour l e canotage et cette dernire,
enfi n, en dsir de canoter sur telle rivire particulire, dans telles
conditions et en telle saison - et, comme elles, elle choue
expliquer l'enrichissement concret que subi t, chaque tage, l a
607
tendance abstraite qu'el l e considre. Et comment croire cependant
un dsir de canoter qui ne serait que dsir de canoter ? Peut-on
vraiment admettre qu'il va se rduire si simplement ce qu'il est ? Les
plus perspicaces parmi les moralistes ont montr comme un dpasse
ment du dsir par lui-mme ; Pascal a cru dcouvrir par exemple dans
l a chasse, l e j eu de paume, cent autres occupations, le besoin de
divertissement -c'est--dire qu' i l mettait au jour, dans une activit
qui serait absurde si on la rduisait elle-mme, une signification qui
l a transcende -c'est--dire une indication qui renvoie la ralit de
l'homme en gnral et sa condition. Pareillement Stendhal, malgr
ses attaches avec les idologues, Proust, malgr ses tendances
intellectualistes et analytiques, n'ont-ils pas montr que l'amour, la
jalousie ne sauraient se rduire au strict dsir de possder une femme,
mais qu'ils visent s'emparer, travers l a femme, du monde tout
entier : c'est le sens de l a cristallisation stendhalienne et c'est
prcisment cause de cel a que l'amour, tel que l e dcrit Stendhal,
apparat comme un mode de l'tre-dans-Ie-monde , c'est--dire
comme un rapport fondamental du pour-soi au monde et soi-mme
(ipsit) travers telle femme particulire : la femme ne reprsente
qu'un corps conducteur qui est plac dans le circuit. Ces analyses
peuvent tre i nexactes ou incompltement vraies : elles ne nous en
font pas moi ns souponner une autre mthode que la pure description
analytique. Et semblablement, les remarques des romanciers catholi
ques qui , dans l'amour charnel , voient aussitt son dpassement vers
Di eu, dans Don Juan l'ternel insatisfait dans l e pch la place
vide de Dieu . Il ne s'agit pas ici de retrouver un abstrait derrire le
concret : l'lan vers Dieu n'est pas moins concret que l'lan vers telle
femme particulire. Il s'agit au contraire de retrouver, sous des
aspects partiels et incomplets du sujet, la vritable concrtion qui ne
peut tre que la totalit de son lan vers l'tre, son rapport originel
soi , au monde et l'autre, dans l 'unit de relations internes et d'un
projet fondamental. Cet lan ne saurait tre que purement individuel
et unique ; loin de nous loigner de la personne, comme le fait, par
exempl e, l 'analyse de Bourget qui constitue l ' individuel par somma
tion de maximes gnrales, il ne nous fera pas trouver sous le besoin
d'crire -et d' crire de tels livres -le besoin d'activit en gnral :
mais, au contraire, repoussant galement la thorie de la glaise docile
et cel l e du faisceau de tendances, nous dcouvrirons la personne dans
le projet i ni ti al qui la constitue. C'est pour cette raison que se
dvoilera avec vidence l'irrductibilit du rsultat atteint : non parce
qu'il est l e pl us pauvre et le plus abstrait, mais parce qu' il est le plus
riche ; l'intuition ici sera saisie d'une plnitude individuelle.
La question se pose donc peu prs en ces termes : si nous
admettons que l a personne est une totalit, nous ne pouvons esprer
la recomposer par une addition ou une organisation des diverses
608
tendances que nous avons empiriquement dcouvertes en el l e. Mais,
au contraire, en chaque incl ination, en chaque tendance, elle
s'exprime tout entire, quoique sous un angle diffrent, un peu
comme la substance spinoziste s'exprime tout entire dans chacun de
ses attributs. S' il en est ai nsi , nous devons dcouvrir en chaque
tendance, en chaque conduite du sujet, une signification qui la
transcende. Telle jalousie date et singulire dans laquelle l e sujet
s'historia lise par rapport une certaine femme signifie, pour qui sait
la lire, l e rapport global au monde par quoi le sujet se constitue
comme un soi-mme. Autrement dit, cette attitude empirique est par
elle-mme l'expression du choix d'un caractre intelligible . Et ce
n'est pas mystre s'il en est ainsi - et i l n'y a pas non plus un plan
intelligible que nous puissions seulement penser, tandis que nous
saisirions et conceptualiserions uniquement l e plan d'existence empi
rique du sujet : si l ' attitude empirique signifie le choix du caractre
intelligible, c'est qu'elle est elle-mme ce choix. Le caractre singulier,
en effet, du choix intelligible, nous y reviendrons, c'est qu'il ne saurait
exister que comme la signification transcendante de chaque choix
concret et empirique : il n'est point effectu d'abord en quelque
inconscient ou sur l e plan noumnal pour s'exprimer ensuite dans telle
attitude observable, i l n'a mme pas de prminence ontologique sur
le choix empirique, mais i l est, par principe, ce qui doit toujours se
dgager du choix empirique comme son au-del et l'infinit de sa
transcendance. Ainsi, si je rame sur l a rivire, je ne suis rien d'autre
- ni ici ni dans un autre monde - que ce pro-jet concret de
canotage. Mais ce projet lui-mme, en tant que totalit de mon tre,
exprime mon choix originel dans des circonstances particulires, il
n'est rien d'autre que le choix de moi-mme comme totalit en ces
circonstances. C'est pourquoi une mthode spciale doit viser
dgager cette signification fondamentale qu'il comporte et qui ne
saurait tre que l e secret individuel de son tre-dans-Ie-monde. C'est
donc plutt par une comparaison des diverses tendances empiriques
d'un sujet que nous tenterons de dcouvrir et de dgager l e projet
fondamental qui leur est commun toutes -et non par une simple
sommation ou recomposition de ces tendances : en chacune la
personne est tout entire.
Il y a naturellement une infinit de projets possibles comme i l y a
une infinit d'hommes possibles. Si toutefois nous devons reconnatre
certains caractres communs entre eux et tenter de les classer en
catgories plus larges, i l convient d'abord d'instituer des enqutes
individuelles sur les cas que nous pouvons tudier plus aisment.
Dans ces enqutes nous serons conduits par ce principe : ne s'arrter
que devant l'irrductibilit vidente, c'est--dire ne j amais croire
qu'on a atteint le projet initial tant que la fin projete n'apparat pas
comme l'tre mme du sujet considr. C'est pourquoi nous ne
609
saurions nous arrter des classifications en projet authentique et
projet inauthentique de soi-mme comme celle que veut tablir
Heidegger. Outre qu'une parei l l e classification est entache d'un
souci thique, en dpit de son auteur et par sa terminologie mme,
elle est base, en somme, sur l'attitude du sujet envers sa propre
mort. Mais si la mort est angoissante et si , par suite, nous pouvons
fuir l 'angoisse ou nous y jeter rsol ument, c'est un truisme de dire que
c'est parce que nous tenons la vie. Par suite, l ' angoisse devant la
mort, la dcision rsolue ou la fuite dans l 'i nauthenticit ne sauraient
tre considres comme des projets fondamentaux de notre tre. Ils
ne sauraient tre compris, au contraire, que sur le fondement d'un
projet premier de vivre, c'est--dire sur un choix origi nel de notre
tre. Il convient donc en chaque cas de dpasser les rsultats de
l'hermneutique heideggerienne vers un projet plus fondamental
encore. Ce pro j et fondamental ne doit renvoyer, en effet, aucun
autre et doit tre conu par soi. Il ne saurait donc concerner ni la
mort, ni l a vi e, ni aucun caractre particulier de l a condition
humaine : le pro j et originel d'un pour-soi ne peut viser que son tre ; le
projet d'tre ou dsir d'tre ou tendance tre ne provient pas en
effet d' une diffrenciation physiologique ou d'une contingence empi
rique ; i l ne se distingue pas, en effet, de l'tre du pour-soi . Le pour
soi, en effet, est un tre dont l'tre est en question dans son tre sous
forme de projet d'tre. Etre pour-soi c'est se faire annoncer ce qu'on
est par un possible sous l e signe d'une valeur . Possibl e et valeur
appartiennent l ' tre du pour-soi . Car le pour-soi se dcrit ontologi
quement comme manque d'tre, et le possible appartient au pour-soi
comme ce qui lui manque, de mme que la valeur hante le pour-soi
comme la totalit d'tre manque. Ce que nous avons exprim, dans
notre deuxime parti e, en termes de manque peut aussi bien
s'expri mer en termes de libert. Le pour-soi choisit parce qu'il est
manque, l a libert ne fait qu' un avec le manque, elle est le mode
d'tre concret du manque d'tre. Ontologiquement, il revient donc au
mme de dire que la val eur et le possible existent comme limites
internes d' un manque d'tre qui ne saurait exister qu'en tant que
manque d'tre - ou que la libert en surgissant dtermine son
possible et par l mme circonscrit sa valeur. Aussi ne peut-on
remonter plus haut et rencontre-t-on l'irrductible vident lorsqu'on
atteint le projet d'tre, car on ne peut videmment remonter plus haut
que l'tre, et entre projet d'tre, possibl e, valeur et, d' autre part,
l'tre, il n'y a aucune di ffrence. L'homme est fondamentalement
dsir d'tre et l ' existence de ce dsir ne doit pas tre tablie par une
induction empirique ; el l e ressort d'une description a priori de l'tre
du pour-soi, puisque l e dsir est manque et que l e pour-soi est l'tre
qui est soi-mme son propre manque d'tre. Le projet originel qui
s'exprime dans chacune de nos tendances empiriquement observables
61 0
est donc le projet d'tre ; ou, si l'on prfre , chaque tendance
empirique est avec le projet originel d'tre dans un rapport d' expres
sion et d'assouvissement symbol i que, comme les tendances cons
cientes, chez Freud, par rapport aux complexes et la libido
originel l e. Ce n'est point d'ailleurs que l e dsir d'tre soit d'abord
pour se faire exprimer ensuite par les dsirs a posteriori ; mais il n'est
rien en dehors de l'expression symbolique qu'il trouve dans les dsirs
concrets. Il n'y a pas d'abord un dsir d'tre, puis mille sentiments
particuliers, mais le dsir d'tre n'existe et ne se manifeste que dans et
par l a jalousie, l ' avarice, l ' amour de l ' art, l a lchet, l e courage, les
mille expressions contingentes et empiriques qui font que l a ralit
humaine ne nous apparat jamais que manifeste par un tel homme,
par une personne singulire.
Quant l'tre qui est l'obj et de ce dsir, nous savons a priori ce
qu'il est. Le pour-soi est J'tre qui est soi-mme son propre manque
d'tre. Et l'tre dont manque l e pour-soi, c'est l'en-soi . Le pour-soi
surgit comme nantisation de l'en-soi et cette nantisation se dfinit
comme pro-jet vers l ' en-soi : entre l'en-soi nanti et l'en-soi projet,
le pour-soi est nant . Ainsi l e but et l a fin de l a nantisation que je
suis, c'est l'en-soi. Ainsi la ralit-humaine est dsir d'tre-en-soi.
Mais l'en-soi qu'elle dsire ne saurait tre pur en-soi contingent et
absurde, comparable en tout point celui qu'elle rencontre et qu'elle
nantit. La nantisation, nous l'avons vu, est en effet assimilable
une rvolte de l'en-soi qui se nantit contre sa contingence. Dire que
le pour-soi existe sa facticit , comme nous l'avons vu au chapitre
concernant le corps, cela revient dire que l a nantisation est vain
effort d'un tre pour fonder son propre tre et que c'est l e recul
fondateur qui provoque l'infime dcalage par o le nant entre dans
l'tre. L'tre qui fait l'objet du dsir du pour-soi est donc un en-soI
qui serait lui-mme son propre fondement, c'est--dire qui serait
sa facticit comme le pour-soi est ses motivations. En outre le pour
soi, tant ngation de l'en-soi , ne saurait dsirer le retour pur et
simple l'en-soi. Ici comme chez Hegel , la ngati on de la ngation ne
saurait nous ramener notre point de dpart. Mai s tout au contraire
ce pourquoi le pour-soi rclame l'en-soi, c'est prcisment la totalit
dtotalise En-soi nantis en pour-soi ; en d'autres termes le
pour-soi projette d'tre en tant que pour-soi, un tre qui soit ce qu'il
est ; c'est en tant qu'tre qui est ce qu' i l n'est pas et qui n'est pas ce
qu'il est que l e pour-soi projette d'tre ce qu'il est ; c'est en tant que
conscience qu'il veut avoir l 'impermabilit et l a densit infinie de
l'en-soi ; c'est en tant que nantisation de l ' en-soi et perptuelle
vasion de l a contingence et de l a facticit qu'il veut tre son propre
fondement. C'est pourquoi le possible est pro-jet en gnral comme
ce qui manque au pour-soi pour devenir en-soi-pour-soi ; et la valeur
fondamentale qui prside ce projet est j ustement l'en-soi-pour-soi,
611
c'est--di re l'idal d'une conscience qui serait fondement de son
propre tre-en-soi par la pure conscience qu'elle prendrait d'elle
mme. C'est cet idal qu'on peut nommer Di eu. Ainsi peut-on dire
que ce qui rend le mieux concevable le projet fondamental de la
ralit-humai ne, c'est que l ' homme est l'tre qui projette d'tre Dieu.
Quels que puissent tre ensuite les mythes et les rites de la religion
considre
,
Dieu est d'abord sensible au cur de l'homme comme
ce qui l ' annonce et l e dfinit dans son projet ultime et fondamental.
Et si l 'homme possde une comprhension prontologique de l'tre
de Dieu, ce ne sont ni les grands spectacles de la nature, ni la
puissance de la socit qui la l ui ont confre : mais Dieu, valeur et
but suprme de la transcendance, reprsente la limite permanente
partir de laquelle l'homme se fait annoncer ce qu'il est. Etre homme,
c'est tendre tre Dieu ; ou, si l'on prfre, l'homme est fondamenta
lement dsir d'tre Di eu.
Mais, di ra-t-on, s'il en est ai nsi , si l ' homme dans son surgissement
mme est port vers Dieu comme vers sa limite, s'il ne peut choisir
d'tre que Di eu, que peut devenir la libert ? Car l a libert n'est rien
d'autre qu'un choix qui se cre ses propres possibilits, tandis qu'il
sembl e ici que ce projet initial d'tre Di eu qui dfinit l 'homme
s'apparente d' assez prs une nature humaine ou une
essence . Nous rpondrons cel a, prcisment , que si le sens du
dsir est en dernier recours le projet d'tre Di eu, le dsir n'est jamais
constitu p
ar ce sens, mais au contraire il reprsente toujours une
invention particulire de ses fins. Ces fins, en effet, sont poursuivies
partir d'une situation empirique particulire ; et c'est mme cette
poursuite qui constitue l es entours en situation. Le dsir d'tre se
ralise toujours comme dsir de manire d'tre. Et ce dsir de
manire d'tre s'exprime son tour comme le sens des myriades de
dsirs concrets qui constituent la trame de notre vie consciente. Ainsi
nous trouvons-nous devant des architectures symboliques trs com
plexes et qui sont au moins trois degrs. Dans le dsir empirique, je
puis discerner une symbolisation d'un dsir fondamental et concret
qui est la personne et qui reprsente la manire dont elle a dcid que
l'tre serait en question dans son tre ; et ce dsir fondamental , son
tour, exprime concrtement et dans le monde, dans la situation
singulire qui investit la personne, une structure abstraite et signi
fiante qui est l e dsir d'tre en gnral et qui doit tre considr
comme la ralit-humaine dans la personne, ce qui fait sa communaut
avec autrui, ce qui permet d'affirmer qu'il y a une vrit de l ' homme
et non pas seul ement des individualits incomparables. La concrtion
absolue et la compltude, l'existence comme totalit appartiennent
donc au dsir libre et fondamental ou personne. Le dsir empirique
n' en est qu' une symbolisation. Il y renvoie et en tire son sens tout en
demeurant partiel et rductible, car i l est le dsir qui ne peut tre
612
conu par soi. D' autre part, le dsir d'tre, dans sa puret abstrai te,
est la vrit du dsi r concret fondamental , mai s n'existe pas titre de
ralit. Ai nsi le projet fondamental ou personne ou l i bre ralisation
de la vrit humaine est partout, dans tous les dsirs (avec les
restrictions exprimes au chapitre prcdent et touchant par exemple
les indiffrents ; il ne se saisit jamais qu' travers les dsirs
comme nous ne pouvons saisir l'espace qu' travers les corps qui
l'informent, encore que l'espace soit une ralit singulire et non un
concept -ou, si l ' on veut, il est comme l'objet de Husserl , qui ne se
livre que par des Abschattungen et qui pourtant ne se laisse
absorber par aucune Abschattung. Nous pouvons comprendre,
d'aprs ces remarques, que la structure abstraite et ontologique
dsir a beau reprsenter la structure fondamentale et
humaine de la personne, elle ne saurait tre une entrave sa libert.
La libert , en effet, nous l'avons dmontr au chapitre prcdent, est
rigoureusement assimilable la nantisation : le seul tre qui peut
tre dit libre, c'est l'tre qui nantit son tre. Nous savons d' ailleurs
que la nantisation est manque d'tre et ne saurait tre autrement. La
libert est prcisment l'tre qui se fait manque d'tre. Mais comme
le dsir, nous l'avons tabli, est identique au manque d'tre, la libert
ne saurait surgir que comme tre qui se fait dsir d'tre, c'est -dire
comme projet-pour-soi d'tre en-soi-pour-soi. Nous avons atteint ici
une structure abstraite qui ne saurait tre aucunement considre
comme la nature ou l 'essence de la libert, car la libert est existence
et l'existence, en elle, prcde l'essence ; la libert est surgissement
immdiatement concret et ne se distingue pas de son choix, c'est-
dire de la personne. Mais la structure considre peut tre dite la
vrit de la libert, c'est--dire qu'elle est la signification humaine de
la libert.
La vrit humaine de la personne doit pouvoir tre tablie, comme
nous l'avons tent, par une phnomnologie ontologique - l a
nomenclature des dsirs empiriques doit faire l'objet de recherches
proprement psychologiques ; l'observation et l'induction, au besoin
l'exprience pourront servir dresser cette liste et indiquer au
philosophe les relations comprhensibles qui peuvent unir entre eux
diffrents dsirs, diffrents comportements, mettre en lumire
certaines liaisons concrtes entre des situations exprimentale
ment dfinies (et qui ne naissent, au fond, que des restrictions
apportes, au nom de la positivit, la situation fondamentale du
sujet dans l e monde) et l e sujet d'exprience. Mais, l'tablissement
et la classification des dsirs fondamentaux ou personnes, aucune de
ces deux mthodes ne saurait convenir. II ne saurait tre question, en
effet, de dterminer a priori et ontologiquement ce qui apparat dans
toute l ' imprvisibilit d'un acte libre. Et c'est pourquoi nous nous
bornerons ici indiquer trs sommairement les possibilits d'une telle
613
enqute et ses perspectives : que l'on puisse soumettre un homme
quelconque une semblable enqute , voil qui appartient l a ralit
humai ne en gnral ou, si l ' on prfre, voil ce qui peut tre tabli
par une ontologie . Mais l'enqute el le-mme et ses rsultats sont, par
principe , tout fait en dehors des possibilits d'une ontologie.
D' autre part, l a pure et simple description empirique ne peut nous
donner que d es nomenclatures et nous mettre en prsence de pseudo
irrductihles (dsir d'crire, de nager, got du risque, jalousi e, etc.).
Il ne convient pas seulement , en effet, de dresser l a liste des
conduites, des tendances et des inclinations, il faut encore les
dchiffrer, c'est--dire il faut savoir les interroger. Cette enqute ne
peut tre mene que selon les rgles d'une mthode spcifique. C'est
cette mthode que nous appelons la psychanalyse existentielle.
Le principe de cette psychanalyse est que l ' homme est une totalit
et non une collection ; qu'en consquence, i l s'exprime tout entier
dans l a plus insignifiante et l a plus superficielle de ses conduites -
autrement dit, qu'il n'est pas un got, un tic, un acte humain qui ne
soit rvlateur.
Le but de l a psychanalyse est de dchiffrer les comportements
empiriques de l ' homme, c'est--dire de mettre en pleine lumire les
rvlations que chacun d'eux contient et de les fixer conceptuelle
ment.
Son point de dpart est l'exprience ; son point d'appui est la
comprhension prontologique et fondamentale que l'homme a de
l
a
personne humai ne. Bien que la plupart des gens, en effet, puissent
ngliger les indications contenues dans un geste, une parol e, une
mi mique et se mprendre sur l a rvlation qu'ils apportent, chaque
personne humai ne n'en possde pas moi ns a priori le sens de l a valeur
rvlatrice de ces manifestations, n'en est pas moins capable de les
dchiffrer, si du moins el l e est aide et conduite par la mai n. Ici
comme ailleurs, la vrit n'est pas rencontre par hasard, elle
n'appartient pas un domaine o i l faudrait l a chercher sans en avoir
jamai s eu de prescience, comme on peut aller chercher les sources du
Nil ou du Niger. Elle appartient a priori l a comprhension humaine
et l e travail essentiel est une hermneutique, c'est--dire un dchif
frage, une fixation et une conceptualisation.
Sa mthode est comparative : puisque, en effet, chaque conduite
humaine symbolise sa manire le choix fondamental qu'il faut
mettre au jour, et puisque, en mme temps, chacune d'elles masque
ce choix sous ses caractres occasionnels et son opportunit histori
que, c'est par la compCraison de ces conduites que nous ferons jaillir
la rvlation unique qu'elles expriment toutes de manire diffrente.
L'esquisse premire de cette mthode nous est fournie par la
psychanalyse de Freud et de ses disciples. C'est pourquoi il convient
ici de marquer plus prcisment en quoi l a psychanalyse existentielle
614
s'inspirera de la psychanalyse proprement dite et en quoi elle en
diffrera radicalement.
L'une comme l'autre considrent toutes les manifestations objecti
vement dcelables de la vi e psychique comme entretenant des
rapports de symbolisation symbole avec des structures fondamen
tales et globales qui constituent proprement la personne. L'une comme
l'autre considrent qu'il n'y a pas de donnes premires -inclinations
hrites, caractre, etc. La psychanalyse existentielle ne connat rien
avant le surgissement originel de la libert humaine ; la psychanalyse
empirique pose que l'affectivit premire de l'individu est une cire
vierge avant son histoire. La libido n'est rien en dehors de ses fixations
concrtes, sinon une possibilit permanente de se fixer n'importe
comment sur n'importe quoi . L'une comme l'autre considrent l' tre
humain comme une historialisation perptuelle et cherchent, plus qu'
dcouvrir des donnes statiques et constantes, dceler le sens,
l'ori entation et les avatars de cette histoire. De ce fait, l'une comme
l'autre considrent l'homme dans le monde et ne conoivent pas qu'on
puisse i nterroger un homme sur ce qu'il est sans tenir compte avant tout
de sa situation. Les enqutes psychanalytiques visent reconstituer la
vie du sujet de la naissance l'instant de la cure ; elles utilisent tous les
documents objectifs qu'elles pourront trouver : lettres, tmoignages,
journaux i nti mes, renseignements sociaux de toute espce. Et ce
qu'elles visent restituer est moins un pur vnement psychique qu' un
couple : l'vnement crucial de l'enfance et la cristallisation psychique
autour de cet vnement. Ici encore il s'agit d'une situation. Chaque
historique , de ce point de vue, sera considr la fois comme
facleur de l'volution psychique et comme symbole de cette volution.
Car i l n'est rien en lui-mme, il n'agit que selon la faon dont il est pris
et cette manire mme de le prendre traduit symboliquement la
disposition i nterne de l'individu.
Psychanalyse empirique et psychanalyse existentielle recherchent
l'une et l'autre une attitude fondamentale en situation qui ne saurait
s'expri mer par des dfinitions simples et logiques, parce qu'elle est
antrieure toute logique, et qui demande tre reconstruite selon des
lois de synthse spcifiques. La psychanalyse empirique cherche
dterminer le complexe, dont le nom mme indique la polyvalence de
toutes les significations qui s'y rapportent. La psychanalyse existen
tielle cherche dterminer le choix originel. Ce choix originel
s'oprant face au monde et tant choix de la position dans le monde est
totalitaire comme l e complexe ; il est antrieur l a logique comme le
complexe ; c'est lui qui choisit l'attitude de la personne en face de la
logique et des principes ; i l n'est donc pas question de l'interroger
conformment la logique. Il ramasse en une synthse prlogique la
totalit de l'existant et, comme tel, i l est le centre de rfrences d'une
infinit de significations polyvalentes.
615
L' une comme l'autre, nos deux psychanalyses n'estiment pas que le
sujet soit e n position privilgie pour procder ces enqutes sur lui
mme. El l es se veulent, l ' une et l'autre, une mthode strictement
objective , traitant comme des documents les donnes de l a rflexion
aussi bi en que les tmoignages d'autrui . Sans doute le sujet peul
effectuer sur lui-mme une enqute psychanalytique. Mais il faudra
qu'il renonce d' un coup tout le bnfice de sa position particulire et
qu' i l s'i nterroge exactement comme s'i! tait autrui . La psychanalyse
empirique part, en effet, du postulat de l'existence d'un psychisme
inconscient qui se drobe par principe l'intuition du sujet. La
psychanalyse existentielle rejette l e postulat de l ' inconscient : l e fait
psychique est, pour el l e, coextensif la conscience. Mais si l e projet
fondamental est pleinement vcu par le sujet et, comme tel , totale
ment conscient, cela ne signifie nul lement qu' il doive tre du mme
coup connu par lui, tout au contraire ; nos lecteurs se souviendront
peut-tre du soin que nous avons mis dans notre Introduction
distinguer conscience et connaissance. Certes, nous l'avons vu aussi,
la rflexion peut tre cons
I
dre comme une quasi-connaissance.
Mais ce qu' el l e saisit chaque instant, ce n'est pas le pur projet du
pour-soi tel qu'il est symboliquement exprim - et souvent de
plusieurs faons l a fois - par le comportement concret qu'elle
apprhende : c'est l e comportement concret lui-mme, c'est--dire le
dsir singulier et dat dans l'enchevtrement touffu de sa caractristi
que. Elle saisit la fois symbole et symbolisation ; elle est, certes,
entirement constitue par une comprhension prontologique du
projet fondamental ; mieux encore, en tant que la rflexion est aussi
conscience non-thtique de soi comme rflexion, el l e eSI ce mme
proj et, aussi bien que l a conscience non-rflexive. Mais il ne s'ensuit
pas qu' el l e dispose des instruments et des techniques ncessaires pour
isoler le choix symbolis, pour le fixer par des concepts et pour le
mettre tout seul en pleine lumire. Elle est pntre d'une grande
lumire sans pouvoir exprimer ce que cette lumire claire. Il ne s'agit
point d'une nigme indevine, comme le croient les freudiens : tout
est l, l umi neux, la rflexion joui t de tout, saisit tout. Mais ce
mystre en pleine l umire vient plutt de ce que cette jouissance
est prive des moyens qui permettent ordinairement l'analyse et la
conceptualisation. El l e saisit tout, tout la fois, sans ombre, sans
relief, sans rapport de grandeur, non point que ces ombres, ces
valeurs, ces rel iefs, existent quelque part et l ui soient cachs, mais
plutt parce qu'il appartient une autre attitude humaine de les
tablir et qu' i ls ne sauraient exister que par el pour la connaissance.
L rflexion, ne pouvant servir de base la psychanalyse existentielle,
lui fournira donc simplement des matriaux bruts sur lesquels le
psychanalyste devra prendre l'attitude objective. Ainsi seulement
pourra-t-il connatre ce qu'il comprend dj. Il rsulte de l que les
616
complexes extirps des profondeurs inconscientes, comme les projets
dcels par l a psychanalyse existentiel l e, seront apprhends du point
de vue d'autrui. Par suite, l'objet ainsi mis au jour sera articul selon
les structures de la transcendance-transcende, c'est--dire que son
tre sera l ' tre-pour-autrui ; mme si d' ai lleurs le psychanalyste et le
sujet de la psychanalyse ne font qu'un. Ainsi le projet mis au jour par
l'une et l'autre psychanalyse ne pourra tre que la totalit de la
personne, l'irrd uctible de la transcendance tels qu'ils sont dans leur
tre-pour-l'autre. Ce qui chappe pour toujours ces mthodes
d'investigation, c'est le projet tel qu' i l est pour soi, le complexe dans
son tre propre. Ce projet-pour-soi ne peut tre que joui ; il y a
incompatibilit entre l'existence pour soi et l'existence objective.
Mais l'objet des psychanalyses n'en a pas moins l a ralit d'un tre ; sa
connaissance par le sujet peut, en outre, contribuer clairer la
rflexion et celle-ci peut devenir alors une jouissance qui sera quasi
savoir.
L s'arrtent les ressemblances entre les deux psychanalyses. Elles
diffrent en effet dans l a mesure o l a psychanalyse empirique a
dcid de son irrductible au lieu de le laisser s'annoncer lui-mme
dans une intuition vidente. La libido ou la volont de puissance
constituent, en effet, un rsidu psychobiologique qui n'est pas clair
par lui-mme, et qui ne nous apparat pas comme devant tre le terme
irrductible de l a recherche. C'est finalement l'exprience qui tablit
que le fondement des complexes est cette libido ou cette volont de
puissance et les rsultats de l'enqute empirique sont parfaitement
contingents, ils ne convainquent pas : rien n' empche de concevoir a
priori une ralit-humaine qui ne s'exprimerait pas par la volont
de puissance, dont l a libido ne constituerait pas le projet originel et
indiffrenci . Le choix, au contraire, auquel remontera l a psychana
lyse existentiell e, prcisment parce qu'il est choix, rend compte de sa
contingence originelle, car la contingence du choix est l'envers de sa
libert. En outre, en tant qu'il se fonde sur le manque d'tre, conu
comme caractre fondamental de l'tre, il reoit la lgitimation
comme choix et nous savons que nous n'avons pas pousser plus loin.
Chaque rsultat sera donc l a fois pleinement contingent et
lgitimement irrductible. Il demeurera d'ailleurs toujours singulier,
c'est--dire que nous n'atteindrons pas comme but ultime de l a
recherche et fondement de tous les comportements un terme abstrait
et gnral, l a l i bido par exempl e, qui serait diffrencie et concrtise
en complexes puis en conduites de dtail sous l'action des faits
extrieurs et de l'histoire du sujet, mais au contraire un choix qui
reste unique et qui est, ds l'origine, la concrtion absolue ; les
conduites de dtail peuvent exprimer ou particulariser ce choix, mais
elles ne sauraient le concrtiser plus qu' i l ne l'est dj. C'est que ce
choix n'est rien autre que l 'tre de chaque ralit-humaine, et qu'il
617
revient au mme de dire que telle conduite partielle est ou qu'elle
exprime le choix originel de cette ralit-humai ne, puisque, pour la
ralit-humai ne , il n'y a pas de diffrence entre exister et se choisir.
De ce fait, nous comprenons que l a psychanalyse existentielle n'a pas
remonter du complexe fondamental , qui est justement l e choix
d'tre, jusqu' une abstraction comme l a libido qui l'expliquerait. Le
complexe est choix ultime, il est choix d'tre et se fait tel. Sa mise au
jour le rvlera chaque fois comme videmment irrductible. Il
s'ensuit ncessairement que la libido et la volont de puissance
n'apparatront l a psychanalyse existentielle ni comme des caractres
gnraux et communs tous les hommes, ni comme des i rrductibles.
Tout au plus se pourra-t-il que l'on constat e, aprs enqute, qu'elles
expriment, titre d'ensembles particuliers, chez certains sujets, un
choix fondamental qui ne saurait se rduire l'une ou l'autre. Nous
avons vu, en effet , que le dsir et l a sexualit en gnral expriment un
effort originel du pour-soi pour rcuprer son tre alin par autrui.
L volont de puissance suppose aussi, originellement, l'tre-po ur
autrui, l a comprhension de l'autre et le choix de faire son salut par
l'autre. L fondement de cette attitude doit tre dans un choix
premier qui fasse comprendre l'assimilation radicale de l'tre-en-soi
pour-soi l'tre-pour-l'autre.
Le fait que l e terme ultime de cette enqute existentielle doit tre
un choix diffrencie mieux encore la psychanalyse dont nous esquis
sons l a mthode et les traits principaux : el l e renonce par l mme
supposer une action mcanique du milieu sur le sujet considr. Le
milieu ne saurait agir sur le sujet que dans la mesure exacte o il le
comprend, c'est--dire o i l le transforme en situation. Aucune
description objective de ce milieu ne saurait donc nous servir. Ds
l'origi ne, le mi lieu conu comme situation renvoie au pour-soi
choisissant, tout j uste comme l e pour-soi renvoie au milieu de par son
tre dans le monde. En renonant toutes les causa tians mcaniques,
nous renonons du mme coup toutes l es interprtations gnrales
du symbolisme envisag. Comme notre but ne saurait tre d'tablir
des lois empiriques de successi on, nous ne saurions constituer une
symbolique universelle. Mais le psychanalyste devra chaque coup
rinventer une symbolique en fonction du cas particulier qu'il
envisage. Si l'tre est une totalit, il n'est pas concevable en effet qu'il
puisse exister des rapports lmentaires de symbolisation (fces or,
pelote pingles sein, etc. ) , qui gardent une signification constante
en chaque cas, c'est--dire qui demeurent inaltrs lorsqu'on passe
d' un ensemble signifiant un autre ensembl e. En outre, le psychana
lyste ne perdra jamais de vue que le cheix est vivant et, par suite, peut
toujours tre rvoqu par le sujet tudi. Nous avons montr, dans le
chapitre prcdent, l ' importance de l'instant qui reprsente les
brusques changements d'orientation et la prise d'une position neuve
618
en face d'un pass immuable. Ds ce moment, on doit toujours tre
prt considrer que les symboles changent de signification et
abandonner la symbolique utilise j usqu'alors. Ainsi la psychanalyse
existentielle se devra d'tre entirement souple et de se calquer sur les
moindres changemements observables chez le sujet : il s'agit ici de
comprendre l'individuel et souvent mme l'instantan. La mthode
qui a servi pour un sujet ne pourra, de ce fait mme, tre employe
pour un autre sujet ou pour le mme sujet une poque ultrieure.
Et , prcisment parce que le but de l'enqute doit tre de dcouvrir
un choix, non un tat, cette enqute devra se rappeler en toute
occasion que son objet n'est pas une donne enfouie dans les tnbres
de l'inconscient, mais une dtermination libre et consciente - qui
n'est pas mme un habitant de l a conscience, mais qui ne fait qu'un
avec cette conscience el l e-mme. La psychanalyse empirique, dans l a
mesure o sa mthode vaut mieux que ses principes, est souvent sur l a
voie d'une dcouverte existenti el l e, encore qu'elle s'arrte toujours
en chemi n. Lorsqu'elle approche ainsi du choix fondamental, les
rsistances du sujet s'effondrent tout coup et il reconnat soudain
l'image de lui qu'on lui prsente, comme s'il se voyait dans une glace.
Ce tmoignage involontaire du sujet est prcieux pour le psychana
lyste ; il Y voit l e signe qu'il a touch son but ; il peut passer des
investigations proprement dites l a cure. Mais rien dans ses principes
ni dans ses postulats initiaux ne lui permet de comprendre ni d'utiliser
ce tmoignage. D'ou lui en viendrait le droit ? Si vraiment l e
complexe est inconscient, c'est--dire s i l e signe est spar du signifi
par un barrage, comment le sujet pourrait-il le reconnatre ? Est-ce l e
complexus inconscient qui s e reconnat ? Mais n'est-il pas priv de
comprhension ? Et s'il fallait lui concder l a facult de comprendre
les signes, ne faudrait-il pas du mme coup en faire un inconscient
conscient ? Qu' est-ce que comprendre, en effet, sinon avoir cons
cience qu'on a compris ? Dirons-nous, au contraire, que c'est l e sujet
en tant que conscient qui reconnat l'image offerte ? Mais comment la
comparerait-il sa vritable affection puisqu'elle est hors de porte et
qu'il n'en a j amais eu connaissance ? Tout au plus pourra-t-il juger
que l'explication psychanalytique de son cas est une hypothse
probable, qui tire sa probabilit du nombre de conduites qu'elle
explique. Il se trouve donc, par rapport cette interprtation, dans la
position d' un tiers, du psychanalyste lui-mme, i l n' a pas de position
privilgie. Et s'il roit la probabilit de l'hypothse psychanalyti
que, cette simple croyance qui demeure dans les limites de sa
conscience peut-elle entraner la rupture des barrages qui endiguent
les tendances inconscientes ? Le psychanalyste a sans doute l ' i mage
obscure d'une brusque concidence du conscient et de l'inconscient.
Mais i l s'est t les moyens de concevoir positivement cette conci
dence.
619
Pourtant l ' i l l umination du sujet est un fait. Il y a bien l une
intuition qui s'accompagne d'vidence. Le sujet, guid par le psycha
nalyste, fait pl us et mieux que de donner son assentiment une
hypothse : il touche, il voit ce qu' i l est. Cela n'est vraiment
comprhensi ble que si l e sujet n'a jamais cess d'tre conscient de ses
tendances profondes, mi eux, que si ces tendances ne se distinguent
pas de sa conscience elle-mme. En ce cas, comme nous l'avons vu
plus haut, l ' i nterprtation psychanalytique ne lui fait pas prendre
conscience de ce qu' il est : el l e lui en fai t prendre connaissance. C'est
donc la psychanalyse existentielle qu'il revient de revendiquer
comme dcisoire l ' i ntuition finale du suj et.
Cette comparaison nous permet de mi eux comprendre ce que doit
tre une psychanalyse existentielle , si elle doit pouvoir exister. C'est
une mthode destine mettre en lumire, sous une forme rigoureu
sement objecti ve, le choix subjectif par l equel chaque personne se fait
personne, c'est--dire se fait annoncer elle-mme ce qu'el l e est. Ce
qu' elle cherche tant un choix d'tre en mme temps qu' un tre, elle
doit rduire l es comportements singuliers aux relations fondamen
tales, non de sexualit ou de volont de puissance, mais d'tre qui
s'expri ment dans ces comportements. Elle est donc guide ds
l'origine vers une comprhension de l'tre et ne doit s'assigner d'autre
but que de trouver l'tre et la manire d'tre de l'tre en face de cet
tre. Avant d' atteindre ce but, il lui est interdit de s'arrter. Elle
util isera l a comprhension de l'tre qui caractrise l'enquteur en tant
qu' i l est lui-mme ralit-humaine ; et comme elle cherche dgager
l'tre de ses expressions symboliques, el l e devra rinventer chaque
fois, sur l es bases d' une tude comparative des conduites, une
symbol i que destine les dchiffrer. Le critre de l a russite sera
pour el le le nombre de faits que son hypothse permet d'expliquer et
d' unifi er, comme aussi l'intuition vidente de l'irrductibilit du
terme attei nt. A ce critre s'ajoutera, dans tous les cas o cela sera
possibl e, le tmoignage dcisoire du sujet. Les rsultats ainsi attei nts
-c'est--dire les fi ns dernires de l'individu -pourront alors faire
l'objet d'une cl assification et c'est sur la comparaison de ces rsultats
que nous pourrons tablir des considrations gnrales sur l a ralit
humaine en tant que choix empi ri que de ses propres fins. Les
conduites tudies par cette psychanalyse ne seront pas seulement les
rves, les actes manqus, les obsessions et les nvroses mais aussi et
surtout les penses de la veille, l es actes russis et adapts, l e style,
etc. Cette psychanalyse n'a pas encore trouv son Freud ; tout au plus
peut-on en trouver le pressentiment dans certaines biographies
particulirement russies. Nous esprons pouvoir tenter d'en donner
ailleurs deux exemples, propos de Flaubert et de Dostoevsky. Mais
il nous i mporte peu, i ci , qu' el le exi ste : l ' i mportant pour nous c'est
qu'elle soit possible.
620
I I
FAI RE ET AVOI R : L A POSSESSI ON
Les renseignements que l'ontol ogie peut acqurir sur les conduites
et sur l e dsir doivent servir de principes la psychanalyse existen
tiel l e. Cela signifie, non qu' i ! existe avant toute spcification des
dsirs abstraits et communs tous les hommes, mais que les dsirs
concrets ont des structures qui ressortissent l'tude de l'ontologie
parce que chaque dsir, aussi bi en le dsir de manger ou de dormir
que le dsir de crer une uvre d'art, exprime toute la ralit
humaine. Comme nous l ' avons montr ailleurs l, en effet, la connais
sance de l ' homme doit tre totalit aire ; des connaissances empiriques
et partielles sont, sur ce terrai n, dpourvues de signification. Nous
aurons donc achev notre tche si nous utilisons les connaissances que
nous avons acquises jusqu'ici j eter les bases de la psychanalyse
existenti elle. C'est l, en effet, que doit s'arrter l ' ontologie : ses
dernires dcouvertes sont les premiers principes de la psychanalyse.
A partir de l, i l est ncessaire d'avoir une autre mthode puisque
l'objet est diffrent. Qu' est-ce donc que l'ontologie nous apprend sur
le dsir, en tant que le dsi r est l'tre de la ralit-humaine ?
Le dsir est manque d' tre , nous l'avons vu. En tant que tel , i l est
directement porl sur l'tre dont i l est manque. Cet tre, nous l'avons
vu, c'est l ' en-soi-pour-soi, la conscience devenue substance, la
substance devenue cause de soi , l 'Homme-Dieu. Ainsi l ' tre de la
ralit-humai ne est origi nel lement non une substance mais un rapport
vcu : les termes de ce rapport sont l'en-soi originel , fig dans sa
contingence et sa facticit et dont la caractristique essentielle est
qu'i! esl, qu' i l existe, et, d' autre part, l ' en-soi-pour-soi ou valeur, qui
est comme l ' i dal de l'en-soi contingent et qui se caractrise comme
par del toute contingence et toute existence. L'homme n'est ni l ' un
ni l'autre de ces tres, car i l n'est poi nt : i l est ce qu' i l n' est pas et i l
n'est pas ce qu' i l est , i l est l a nantisation de l ' en-soi contingent en
tant que le soi de cette nantisation est sa fuite en avant vers l'en-soi
cause de soi. La ralit-humai ne est pur effort pour devenir Di eu,
sans qu' i l y ait aucun substrat donn de cet effort, sans qu' i l y ai t rien
qui s'efforce ainsi . Le dsir exprime cet effort.
Toutefois, l e dsir n'est pas seulement dfini par rapport l' en-soi
cause-de-soi . Il est aussi relatif un existant brut et concret que l'on
nomme couramment l ' objet du dsir. Cet obj et sera tantt un
1 . Esquisse d'une thorie phnomnologique des motions, Hermann, Paris,
1939.
621
morceau de pai n, tantt une automobile, tantt une femme, tantt un
objet non encore ralis et pourtant dfini : comme lorsque l'artiste
dsire crer une uvre d'art. Ainsi le dsir exprime par sa strur,ture
mme l e rapport de l ' homme avec un ou plusieurs objets dans le
monde .
i l
est un des aspects de l ' tre-dans-Ie-monde. De ce point de
vue , i l semble d'abord que ce rapport ne soit pas d' un type unique. Ce
n'est que par abrviation que nous parlons du dsir de quelque
chose . En fait mi l l e exemples empiriques montrent que nous
dsirons possder tel objet ou faire telle chose ou tre quel qu' un. Si je
dsire ce tabl eau, cela signifie que j e dsire l'acheter, pour me
l'approprier. Si je dsire crire un livre, me promener, cela signifie
que je dsire faire ce livre, faire cette promenade. Si je me pare, c'est
que je dsire tre beau ; je me cultive pour tre savant, etc. Ainsi , du
premier coup, l es trois grandes catgories de ('existence humaine
concrte nous apparaissent dans l eur relation originelle : faire, avoir,
tre.
I l est
fa
cile de voir, cependant, que le dsir de faire n'est pas
irrductible. On fait l ' objet pour entretenir un certain rapport avec
l ui . Ce rapport neuf peut tre i mmdiatement rductible l 'avoir .
Par exemple, je tail l e une canne dans une branche d'arbre (je fais
une canne avec une branche) pour avoir cette canne. Le faire se
rduit un moyen d'avoir. C'est le cas le plus frquent. Mais il peut
aussi se faire que mon activit n'apparaisse pas sur-le-champ comme
rductibl e. El l e peut sembler gratuite comme dans le cas de la
recherche scientifi que, du sport, de la cration esthtique. Pourtant,
dans ces diffrents cas, l e faire n'est pas non plus irrductible. Si je
cre un tableau, un drame , une mlodie, c'est pour tre l'origine
d'une existence concrte. Et cette existence ne m' intresse que dans
l a mesure o le lien de cration que j'tablis entre elle et moi me
donne sur el l e un droit de proprit particulier. Il ne s'agit pas
seul ement que tel tableau, dont j 'ai l'ide, existe ; il faut encor" u !l
existe par moi. L'idal serait videmment, en un sens, que j e le
soutienne l'tre par une sorte de cration continue et que, de la
sorte, il soit mien comme une manation perptuellement renouve
l e. Mai s, en un autre sens, il faut qu' il se distingue radicalement de
moi-mme, pour tre mien et non pas moi ; le danger serait ici,
comme
da
ns la thorie cartsienne des substances, que son tre se
rsorbe en mon tre par dfaut d' indpendance et d'objectivit ; et
ainsi faut-il aussi qu' i l existe en soi, c'est--dire qu'il renouvelle
perptuellement son existence de lui mme. Ds lors mon uvre
m'apparat comme une cration continue mais fige dans l 'en-soi ;
ell e porte i ndfiniment ma marque c'est--dire qu' elle est indfi
ni ment pense. Toute uvre d'art est une pense, une
ide ; ses caractres sont nettement spirituels dans la mesure o
elle n'est rien qu'une significati on. Mais, d'autre part, cette significa-
622
tion, cette pense, qui , en un sens, est perpt uellement en acte,
comme si j e la formais perptuel l ement, comme si un esprit la
concevait sans relche - un esprit qui serait mOIl esprit -, cette
pense se soutient seule l'tre, elle ne cesse point d' tre en acte
quand je ne l a pense pas actuel l ement. Je suis donc avec elle dans le
double rapport de la conscience qui la conoit et de la conscience qui
la rencontre. C'est prcisment ce double rapport que j 'exprime en
disant qu'elle est mienne. Nous en verrons l e sens, lorsque nous
aurons prcis l a signification de l a catgorie avoir . Et c'est pour
entreteni r ce double rapport dans la synthse d'appropriation que j e
cre mon uvre. C'est, en effet, cette synthse de moi et de non-moi
(intimit, translucidit de la pense ; opacit, indiffrence de l'en-soi)
que j e vise et qui fera prcisment de l'uvre ma proprit. En ce
sens, ce ne sont pas seulement l es uvres proprement artistiques que
je m'approprierai de cette faon, mais cette canne que j'ai taille dans
une branche, el l e va, elle aussi, m'appartenir doublement : en
premier lieu, comme un objet d'usage qui est ma disposition et que
je possde comme je possde mes vtements ou mes livres, en second
lieu comme mon uvre. Ainsi ceux qui prfrent s'entourer d'objets
usuels qu'ils ont fabriqus eux-mmes raffinent sur l'appropriation.
Ils runissent sur un seul objet et dans un mme syncrtisme
l'appropriation par jouissance et l'appropriation par cration. Nous
retrouvons l ' unit d' un mme projet depuis l e cas de la cration
artistique j usqu' celui de la cigarette qui est mei lleure quand on l a
roule soi-mme . Nous retrouverons tout l'heure ce projet
propos d' un type de proprit spciale qui en est comme l a
dgradation et que l ' on appelle l e luxe, car, nous l e verrons, l e luxe ne
dsigne pas une qualit de l'objet possd mais une qualit de l a
possession.
C'est encore s'approprier - nous ( ' avons montr dans l e pram
bule de cette quatrime partie - que connatre. Et c'est pourquoi la
recherche scientifique n'est rien d'autre qu'un effort d'appropriation.
La vrit dcouverte, comme l'uvre d'art, est ma connaissance ;
c'est le nome d' une pense qui ne se dcouvre que lorsque je forme
la pense et qui, de ce fait, apparat d'une certaine manire comme
maintenu par moi l'existence. C'est par moi qu'une face du monde
se rvl e, c'est moi qu'elle se rvl e. En ce sens, je suis crateur et
possesseur. Non que je considre comme pure reprsentation l ' aspect
de l'tre que je dcouvre, mais, tout au contraire, parce que cet
aspect qui ne se dcouvre que par moi est profondment et relle
ment. Je puis dire que je l e manifeste, au sens o Gide nous dit que
nous devons toujours manifester . Mais je retrouve une indpen
dance analogue celle de l'uvre d'art dans le caractre de vrit de
ma pense, c'est--dire dans son objectivit. Cette pense que j e
forme et qui tire de moi son existence, el l e poursuit en mme temps
623
par el l e seule son existence dans la mesure o el l e est pense de tous.
El l e est doublement moi puisqu'elle est le monde se dcouvrant moi
et moi chez les autres, moi formant ma pense avec J'esprit de J ' autre
et doublement referme contre moi puisqu'elle est l'tre que je m
suis pas (en tant qu'il se rvle moi) et puisqu'elle est pense de
tous, ds son apparition, pense voue J'anonymat. Cette synthse
de moi et de non-moi peut s'exprimer ici encore par le terme de mien.
Mais, en outre, dans J'ide mme de dcouverte, de rvlation, une
ide de jouissance appropriative est incluse. La vue est jouissance,
voir c'est dflorer. Si J'on examine les comparaisons ordinairement
utilises pour exprimer le rapport du connaissant au connu, on voit
que beaucoup d'entre elles se prsentent comme un certain viol par la
vue. L'objet non connu est donn comme i mmacul, comme vierge,
comparable une blancheur. Il n'a pas encore l ivr son secret,
J'homme ne le lui a pas encore arrach . Toutes les images insistent
sur l'ignorance O est J'objet des recherches et des instruments qui le
visent : il est inconscient d'tre connu, il vaque ses affaires sans
s'apercevoir du regard qui l'pie comme une femme qu'un passant
surprend son bain. Des images plus sourdes et plus prcises, comme
celle des invioles de la nature, voquent plus
nettement l e cot. On arrache les voiles de la nature, on la dvoile (cf.
Le Voile de Sais, de Schiller) ; toute recherche comprend toujours
l'ide d'une nudit qu' on met l'air en cartant les obstacles qui la
couvrent, comme Acton carte les branches pour mieux voir Diane
au bain. Et d'ailleurs la connaissance est une chasse. Bacon l a nomme
chasse de Pan. Le savant est l e chasseur qui surprend une nudit
blanche et qui la viol e de son regard. Aussi l'ensemble de ces i mages
nous rvle-t-il quelque chose que nous nommerons le complexe
d'Acton. En prenant d'ailleurs cette ide de chasse pour fil conduc
teur, nous dcouvrons un autre symbole d'appropriation, peut-tre
plus primitif encore : car on chasse pour manger. La curiosit chez
l' animal est toujours sexuelle ou a limentaire. Connatre c'est manger
des yeux J. Nous pouvons noter ici, en effet, en ce qui concerne la
connaissance par les sens, un processus inverse de celui qui se rvlait
propos de l'uvre d'art. Pour celle-ci, nous marquions en effet son
rapport d'manation fige l ' esprit. L'esprit la produit continuelle
ment et cependant elle se tient toute seule et comme dans l ' indiff
rence par rapport cette production. Cette relation existe telle quelle
dans l'acte de connaissance. Mais elle n'exclut pas son inverse : dans
le connatre, la conscience attire soi son objet et se l' incorpore ; la
connaissance est assimilation ; les ouvrages de l'pistmologie fran
aise groui l lent de mtaphores alimentaires (absorption, digestion
1 . Pour l'enfant, connatre c'est manger effectivement. Il veut goter ce qu'il
voit.
624
assimilation). Ainsi y a-t-il un mouvement de dissolution qui va de
l'objet au sujet connaissant. Le connu se transforme en moi, devient
ma pense et par l mme accepte de recevoir son existence de moi
seul. Mais ce mouvement de dissolution se fige du fait que l e connu
demeure la mme place, indfiniment ahsorb, mang et indfini
ment intact, tout entier digr et cependant tout entier dehors,
indigeste comme un caillou. On remarquera l'importance dans l es
imaginations naves du symbole du digr indigeste , le caillou
dans l'estomac de l'autruche, Jonas dans l'estomac de la balei ne. Il
marque un rve d'assimilation non destructrice. Le malheur est que
-comme l e notait Hegel - le dsir dtruit son objet. (En ce sens,
disait-i l , l e dsir est dsir de manger. ) En raction contre cette
ncessit dialectique, le pour-soi rve d'un objet qui serait entire
ment assi mil par moi, qui serait moi, sans se dissoudre en moi, en
gardant sa structure d'en-soi car, justement, ce que je dsire, c'est cet
objet et , si je l e mange, je ne l'ai plus, je ne rencontre plus que moi .
Cette synthse impossible de l'assimilation et de l'intgrit conserve
de l'assimil se rejoint, dans ses racines les plus profondes, avec les
tendances fondamentales de la sexualit. La possession charnelle
en effet nous offre l' image irritante et sduisante d'un corps perp
tuellement possd et perptuel l ement neuf, sur lequel la possession
ne laisse aucune trace. C'est ce que symbolise profondment l a
qualit de lisse , de poli . Ce qui est lisse peut se prendre, se
tter, et n'en demeure pas moins impntrable, n' en fuit pas moins
sous l a caresse appropriative, comme l'eau. C'est pourquoi l'on
insiste tant, dans l es descriptions rotiques, sur l a blancheur lisse du
corps de l a femme. Lisse : qui se reforme sous l a caresse, comme
l'eau se reforme sur l e passage de la pierre qui l'a troue. Et, en
mme temps, nous l'avons vu, l e rve de l'amant est bien de
s'identifi er avec l ' objet ai m tout en lui gardant son individualit :
que l'autre soit moi , sans cesser d'tre autre. C'est prcisment l ce
que nous rencontrons dans la qute scientifique : l'objet connu,
comme l e caillou dans l'estomac de l ' autruche, est tout entier en moi ,
assimil , transform en moi-mme, et i l est tout entier moi ; mai s en
mme temps i l est i mpntrable, i ntransformable, entirement lisse,
dans une nudit indiffrente de corps aim et vainement caress. Il
reste dehors, connatre c'est manger au dehors sans consommer. On
voit les courants sexuels et alimentaires qui se fondent et s'interpn
trent , pour constituer l e complexe d'Acton et le complexe de Jonas,
on voit l es racines digestives et sensuelles qui se runissent pour
donner naissance au dsir de connatre. La connaissance est la fois
pntration et caresse de surface, digestion et contemplation
distance d'un objet indformable, production d'une pense par
cration continue et constatation de l a totale indpendance objective
de cette pense. L'objet connu, c'est ma pense comme chose. Et c'est
625
prcisment ce que j e dsire profondment lorsque je me mets en
qute : saisir ma pense comme chose et la chose comme ma pense.
L rapport syncrtique qui fond ensemble des tendances si diverses ne
saurait tre qu' un rapport d'appropriation. C'est pourquoi le dsir d
connatre est, si dsintress qu'il puisse paratre, un rapport d'appro
p
riation. Le connatre est une des formes que peut prendre l'avoir.
Reste un type d'activit qu'on prsente volontiers comme entire
ment gratuit : l 'activit de jeu et les tendances }} qui s'y rapportent.
Peut-on dcel er dans l e sport une tendance appropriative ? Certes i l
faut remarquer d'abord que l e j eu, en s'opposant l'esprit de srieux,
semble l'atti tude la moins possessive, il enl ve au rel sa ralit. II y a
srieux quand on part du monde et qu'on attribue plus de ralit au
monde qu' soi-mme, tout le moins quand on se confre une ralit
dans l a mesure o on appartient au monde. Ce n'est pas par hasard
que le matrialisme est srieux, ce n'est pas par hasard non plus qu'il
se retrouve toujours et partout comme l a doctrine d'lection du
rvolutionnaire. C'est que les rvolutionnaires sont srieux. Ils se
connaissent d' abord partir du monde qui les crase et ils veulent
changer ce monde qui les crase. En cela ils se retrouvent d'accord
avec l eurs vi eux adversaires les possdants, qui se connaissent eux
aussi et s'apprcient partir de leur position dans le monde. Ainsi
toute pense srieuse est paissie par le monde, elle coagule ; elle est
une dmission de l a ralit-humaine en faveur du monde. L'homme
srieux est du monde )} et n' a plus aucun recours en soi ; il
n'envisage mme plus l a possibilit de sortir du monde, car i l s'est
donn lui-mme le type d'existence du rocher, l a consistance,
l'inertie, l'opacit de l'tre-au-milieu-du-monde. Il va de soi que
l'homme sri eux enfouit au fond de lui-mme l a conscience de sa
libert, il est de mauvaise foi et sa mauvaise foi vise le prsenter
ses propres yeux comme une consquence : tout est consquence,
pour l ui , et j amais i l n' y a de principe ; c'est pourquoi i l est si attentif
aux consquences de ses actes. Marx a pos le dogme premier du
srieux lorsqu' i l a affirm la priorit de l'objet sur le sujet et l'homme
est srieux quand i l se prend pour un objet.
Le jeu, en effet , comme l'ironie kierkegaardienne, dlivre l a
<ubjectivit. Qu'est-ce qu'un jeu, en effet, si non une activit dont
h.')mme est l'origine premire, dont l'homme pose lui-mme les
princi;-es et qui ne peut avoir de consquences que selon les principes
poss ? Ds qu' un homme se saisit comme libre et veut user de sa
libert, quell e que puisse tre d'ailleurs son angoisse, son activit est
de j eu : i l en est, en effet, le premier principe, i l cha-pe la nature
nature, i l pose l ui-mme la valeur et les rgles de ses actes et ne
consent payer que selon les rgles qu'il a lui-mme poses et
dfi nies. D' o, en un sens, l e peu de ralit )} du monde. II semble
donc que J'homme qui joue, appliqu se dcouvrir comme libre dans
626
son action elle-mme, ne saurait aucunement se soucier de possder
un tre du monde. Son but, qu'il le vise travers l es sports ou le mime
ou les jeux proprement dits, est de s'atteindre lui-mme comme un
certain tre, prcisment l'tre qui est en question dans son tre.
Toutefois ces remarques n'ont pas pour effet de nous montrer que le
dsir de faire est, dans l e jeu, irrductible. Elles nous apprennent, au
contraire, que l e dsir de faire s'y rduit un certain dsir d'tre.
L'acte n'est pas l ui-mme son propre but ; ce n'est pas non plus sa
fin explicite qui reprsente son but et son sens profond ; mais l'acte a
pour fonction de manifester et de prsentifier elle mme la libert
absolue qui est l'tre mme de la personne. Ce type particulier de
projet qui a l a l ibert pour fondement et pour but mriterait une
tude spcial e. I l se diffrencie radicalement, en effet , de tous le,
autres en ce qu'il vise un type d'tre radicalement diffrent . Il faudrait
expliquer tout au long en effet ses rapports avec l e projet d'tre-Dieu
qui nous a paru la structure profonde de la ralit-humaine. Mais
cette tude ne peut tre faite ici : el l e ressortit en effet une thique
et el l e suppose qu' on ait pralablement dfini la nature et le rle de l a
rflexion purifiante (nos descriptions n'ont vis jusqu'ici que l a
rflexion complice ) ; el l e suppose en outre une prise de position
qui ne peut tre que morale en face des valeurs qui hantent l e pour
soi. Il n' en demeure pas moins que le dsir de jeu est fondamentale
ment dsir d'tre. Ainsi les trois catgories tre , faire ,
avoir se rduisent, ici comme partout, deux : l e faire est
purement transitif. Un dsir ne peut tre, en son fond, que dsir d'tre
ou dsir d'avoir. D'autre part il est rare que le jeu soit pur de toute
tendance appropriative. Je laisse de ct le dsir de raliser une
performance, de battre un record, qui peut agir comme stimulant du
sportif ; j e ne parle mme pas de celui d'avoir un beau corps, des
muscles harmonieux qui ressortit au dsir de s'approprier objective
ment son propre tre-pour-autrui. Ces dsirs n'interviennent pas
toujours et d' ailleurs ne sont pas fondamentaux. Mais dans l'acte
sportif mme il y a une composante appropriative. Le sport est en
effet libre transformation d' un milieu du monde en lment de
soutien de l'action. De ce fait, comme l'art, il est crateur. Soit un
champ de neige, un alpage. Le voir, c'est dj le possder. En lui
mme, il est dj saisi par la vue comme symbole de l'tre 1. Il
reprsente l'extriorit pure, la spatialit radicale ; son indiffrencia
tion, sa monotonie et sa blancheur manifestent l'absolue nudit de l a
substance ; il est l 'en-soi qui n'est qu'en-soi, l'tre du phnomne qui
se manifeste tout coup en dehors de tout phnomne. En mme
temps son immobi l it solide exprime la permanence et la rsistance
objective de l'en-soi, son opacit et son impntrabilit. Cette
1. Voir au 3.
627
premire jouissance intuitive ne saurait pourtant me suffire. Cet en
soi pur, semblable au plenum absolu et intelligible de l'tendue
cartsienne, me fascine comme la pure apparition du non-moi ; ce que
je veux alors, c'est prcisment que cet en-soi soit par rapport moi
dans un rapport d' manation tout en demeurant en soi. C'est dj l e
sens des bonshommes de neige, des boules de neige que font les
gamins : le but est de faire quel que chose avec cette neige , c'est-
dire de l ui i mposer une forme qui adhre si profondment la matire
que cell e-ci paraisse exister en vue de celle-l. Mais si je m'approche,
si j e veux ta blir un contact appropriatif avec le champ de neige, tout
change : son chelle d'tre se modifie, il existe pouce par pouce au
lieu d'exister par grands espaces ; et des taches, des brindilles, des
crevasses viennent individualiser chaque centimtre carr. En mme
temps sa solidit fond en eau : j 'enfonce dans la neige jusqu'aux
genoux ; si je prends de la neige dans mes mains, elle se liqufie entre
mes doigts, el l e coule, i l n'en reste plus rien : l 'en-soi se transforme en
nant. Mon rve de m'approprier la neige s'vanouit en mme temps.
D'ailleurs j e ne sais que faire de cette neige que je suis venu voir de
prs : je ne puis m' emparer du champ, j e ne puis mme le
reconstituer comme cette totalit substantielle qui s'offrait mes
regards et qui s'est brusquement et doublement effondre. Le sens du
ski n'est pas seulement de me permettre des dplacements rapides et
d'acqurir une habilet technique, ni non plus de jouer en augmentant
mon gr ma vitesse ou les difficults de l a course ; c'est aussi de me
permettre de possder ce champ de neige. A prsent, j'en fais quelque
chose. Cela signifie que, par mon activit mme de skieur, j'en
modifie l a matire et le sens. Du fait qu' i l m'apparat prsent, dans
ma course mme, comme pente descendre, i l retrouve une
continuit et une unit qu' i l avait perdues. Il est prsent tissu
conjonctif. Il est compris entre deux termes, i l unit le point de dpart
au point d'arrive ; et , comme, dans la descente, j e ne l e considre
pas en l ui -mme, pouce par pouce , mais que je fixe toujours un point
atteindre, par del la position que j 'occupe, il ne s'effondre pas en
une i nfinit de dtails individuels, il est parcouru vers l e point que je
m'assigne. Ce parcours n'est pas seulement une activit de dplace
ment, c'est aussi et surtout une activit synthtique d'organisation et
de liaison : j'tends devant moi le champ de ski de la mme faon que
le gomtre, selon Kant, ne peut apprhender une ligne droite qu'en
la ti rant. Par ai lleurs cette organisation est marginale et non focal e :
ce n' est pas pour lui-mme et en lui-mme que le champ de neige est
unifi ; le but pos et clairement saisi, l'objet de mon attention, c'est
l e terme d'arrive. L'espace neigeux se masse par en dessous,
lmpl i citement ; sa cohsion est cel l e de l'espace blanc compris
l' mtrieur d' une circonfrence, par exemple, lorsque je regarde l a
l igne noire du cercIe sans prendre garde explicitement sa surface.
628
Et, prcisment parce que je le maintiens marginal, implicite et sous
entendu, i l s'adapte moi , je l'ai bi en en main, je le dpasse vers sa
fin, com1le le tapissier dpasse le marteau dont il se sert vers sa fin
qui est de clouer une tenture au mur. Aucune appropriation ne peut
tre plus complte que cette appropriation instrumental e ; l'activit
synthtique d'appropriation est ici une activit technique d'utilisa
tion. La neige surgit comme la matire de mon acte, l a manire dont
le surgissement du marteau est pur remplissement du marteler. En
mme temps, j 'ai choisi un certain point de vue pour apprhender
cette pente neigeuse : ce point de vue est une vitesse dtermine, qui
mane de moi, que je peux augmenter ou diminuer mon gr, et qui
constitue l e champ parcouru en un objet dfini, entirement distinct
de ce qu'il serait une autre vitesse. La vitesse organise les ensembles
son gr ; tel objet fait ou non partie d'un groupe particulier, selon
que j 'ai pris ou non telle ou telle vitesse (qu'on songe, par exemple,
la Provence vue pied , en auto , en chemin de fer ,
bicyclette ; el l e offre autant de visages diffrents selon que Bziers
est une heure, une matine, deux jours de Narbonne, c'est-
dire selon que Narbonne s'isole et se pose pour soi avec ses environs
ou qu'elle constitue un groupe cohrent avec Bziers et Ste, par
exemple. Dans ce dernier cas, l e rapport la mer de Narbonne est
directement accessible l'intuition ; dans l'autre, i l est ni, il ne peut
faire l'objet que d'un pur concept) . Je suis donc celui qui informe le
champ de neige par la libre vitesse que je me donne. Mais, du mme
coup, j'agis sur ma matire. La vitesse ne se borne pas imposer une
forme une matire donne par ailleurs ; elle cre une matire. La
neige, qui s'enfonait sous mon poids lorsque je marchais, qui fondait
en eau quand je tentais de la prendre, se solidifie tout coup sous
l'action de ma vi tesse ; elle me porte. Ce n'est pas que j 'aie perdu de
vue sa lgret, sa non-substantialit, sa perptuelle vanescence.
Bi en au contraire : c'est prcisment cette lgret, cette vanes
cence, cette secrte liquidit qui me portent, c'est--dire qui se
condensent et se fondent pour me porter. C'est que j'ai avec la neige
un rapport d'appropriation spcial : l e glissement. Ce rapport sera
tudi plus loin avec dtai l . Ds prsent, nous pouvons en saisir le
sens. En glissant, je demeure, dit-on, superficiel. Cela n'est pas
exact ; certes, j'effleure seulement l a surface, et cet effleurement, en
lui-mme, vaut toute une tude. Mais j e n' en ralise pas moins une
synthse en profondeur ; j e sens la couche de neige s'organiser
jusqu'au plus profond d'elle-mme pour me supporter ; l e glissement
est action distance, i l assure ma matrise sur la matire sans que j'aie
besoin de m' enfoncer dans cette matire et de m'engluer en elle pour
la dompter. Gl isser, c'est l e contraire de s'enraciner. La racine est
dj moiti assimile l a terre qui la nourrit, elle est une concrtion
vivante de la terre ; elle ne peut utiliser la terre qu'en se faisant terre,
629
c'est--dire, en un sens, en se soumettant la matire qu'elle veut
utiliser. Le glissement, au contraire, ralise une unit matrielle en
profondeur sans pntrer plus loin que l a surface ; i l est comme un
matre redout qui n' a pas besoin d' insister ni d'lever l e ton pour tre
obi . Admirable image de la puissance. De l l e fameux consei l ;
Glissez, mortels, n'appuyez pas , qui ne signifie pas ; Demeurez
superfici el s, n'approfondissez pas , mais, au contraire ; Ralisez
des synthses en profondeur, mais sans vous compromettre. Et
prcisment l e gl i ssement est appropriation car l a synthse de
soutnement ralise par la vitesse n'est valable que pour le glisseur
et dans le temps mme qu'il glisse. La solidit de la neige n'est valable
que pour moi , n'est sensible qu' moi ; c'est un secret qu'elle livre
moi seul et qui dj n'est plus vrai , derrire moi. Ce glissement ralise
donc une relation strictement indivi duel l e avec la matire, une
relation historique ; el l e se rassemble et se solidifi e pour me porter et
retombe, pme, en son parpi llement, derrire moi . Ainsi ai-je
ralis pour moi l ' uni que par mon passage. L'idal du glissement sera
donc un glissement qui ne laisse pas de trace ; c'est le glissement sur
l'eau (barque, canot automobile, surtout ski nautique qui, quoique
tard venu, reprsente comme la l imite vers laquelle tendaient, de ce
poi nt de vue, les sports nautiques). Le glissement sur l a neige est dj
moins parfait ; i l y a une trace derrire moi, j e me suis compromis, si
lgrement que ce soit. Le glissement sur l a glace, qui raye la glace et
trouve une matire dj tout organise, est de qualit trs infrieure,
et s' i ! se sauve malgr tout, c' est pour d'autres raisons. De l , l a
dception lgre qui nous prend toujours lorsque nous regardons
derrire nous les empreintes que nos skis ont laisses sur la neige ;
comme ce serait mieux si el l e se reformait sur notre passage !
Lorsque, d' ail leurs, nous nous laissons gl i sser sur la pente, nous
sommes habits par l'illusion de ne pas marquer, nous demandons la
neige de se comporter comme cette eau qu'elle est secrtement. Ainsi
l e glissement apparat comme assimilable une cration continue ;
la vitesse, comparable la conscience et symbolisant ici la cons
cience 1, fait natre, tant qu'elle dure, en la matire, une qualit
profonde qui ne demeure qu'autant que l a vitesse existe, une sorte de
rassembl ement qui vainc son extriorit d'indiffrence et qui se dfait
comme une gerbe derrire l e mobile glissant. Unification informatrice
et condensation synthtique du champ de neige qui se ramasse en une
organisation instrumentale, qui est utilis, comme l e marteau ou
l'encl ume, et qui s'adapte docilement l'action, qui la sous-entend et
l a rempl it, action continue et cratrice sur l a matire mme de la
neige, solidification de l a masse neigeuse par le glissement, assimila-
1. Nous avons vu dans l a troisime partie le rapport du mouvement au pour
soi.
630
tion de la neige l ' eau qui porte, docile et sans mmoire, au corps nu
de la femme, que la caresse laisse intact et trouble jusqu' en son
trfonds ; telle est l 'action du skieur sur l e rel . Mais en mme temps
la neige demeure i mpntrahle et hors d'atteinte ; en un sens, l'action
du skieur ne fait que dvelopper ses puissances. Il lui fait rendre ce
qu'elle peut rendre ; la matire homogne et solide ne lui livre solidit
et homognit que par l'acte sportif, mais cette solidit et cette
homognit demeurent des proprits closes en la matire. Cette
synthse du moi et du non-moi que ralise ici l'action sportive
s'exprime, comme dans le cas de la connaissance spculative et de
l'uvre d'art , par l ' affirmation du droit du skieur sur la neige . C'est
mon champ de neige : je l 'ai cent fois parcouru, cent fois j 'ai fait
natre en lui par ma vitesse cette force de condensation et de soutien,
il est moi.
A cet aspect de l'appropriation sportive, il faudrait ajouter cet
autre : la difficult vaincue. I l est pl us gnralement compris et nous y
insisterons peine. Avant de la descendre, cette pente neigeuse, il a
fal l u que je la gravisse . Et cette ascension m' a offert une autre face de
la neige : la rsistance. l'ai senti cette rsistance avec ma fatigue et
j'ai pu mesurer chaque instant les progrs de ma victoire. Ici la neige
est assimile l'autre et les expressions courantes dompter ,
vaincre ! g dominer , etc. , marquent assez qu'il s'agit d'tablir,
entre moi et l a neige, le rapport du matre l'esclave. Nous
retrouverons cet aspect de l'appropriation dans l'ascension, dans la
nage, dans l a course d'obstacles, etc. Le pic sur lequel on a plant un
drapeau est un pic qu'on s'est appropri. Ainsi, un aspect capital de
l'activit sportive -et en particulier des sports de plein air -c'est la
conqute de ces masses normes d'eau, de terre et d'air qui semblent
a priori indomptables et i nuti l isables ; et, en chaque cas, i l s'agit de
possder non pas l' lment pour l ui-mme, mais l e type d'existence
en-soi qui s'exprime par le moyen de cet lment : c'est l'homog
nit de la suhstance qu'on veut possder sous les espces de la neige ;
c'est l'impntrabilit de l ' en-soi et sa permanence intemporelle
qu'on veut s'approprier sous les espces de la terre ou du roc, etc,
L'art, la science, l e jeu sont des activits d'appropriat ion, soit
totalement, soit partiellement et, ce qu'elles veulent s'approprier, par
del l'objet concret de leur qute, c'est l'tre lui-mme, l'tre absolu
de l'en soi.
Ainsi , l'ontologie nous apprend que le dsir est originellement dsir
d'tre et qu'il se caractrise comme libre manque d'tre, Mais elle
nous apprend aussi que le dsir est rapport avec un existant concret au
milieu du monde et que cet existant est conu sur le type de l'en-soi ;
elle nous apprend que la relation du pour-soi cet en-soi dsir est
l'appropriation, Nous sommes donc en prsence d'une double dter
mination du dsir : d'une part l e dsir se dtermine comme dsir
631
d'tre un certain tre qui est l'en-soi pour-soi et dont l'existence est
idale ; d'autre part, le dsir se dtermine, dans l ' i mmense majorit
des cas l, comme relation avec un en-soi contingent et concret dont il
projette l'appropriation. Y a-t-il surdtermination ? Ces deux caract
ristiques sont-elles compatibles ? La psychanalyse existentielle ne
saurait tre assure de ses principes que si l'ontologie a dfini
pralablement le rapport de ces deux tres : l 'en-soi concret et
contingent ou objet du dsir et l ' en-soi-pour-soi ou idal du dsir, et
que si el le a explicit la relation qui unit l'appropriation, comme type
de rapport l'en-soi , l'tre mme, comme type de rapport l ' en-soi
pour-soi. C'est ce qu' i l nous faut tenter prsent.
Qu'est-ce que s'approprier ou, si l'on prfre, qu'entend-on par
possder un objet en gnral ? Nous avons vu la rductibilit de la
catgori e du faire, qui laisse entrevoir tantt l 'tre, tantt l'avoir ; en
est-il de mme de la catgorie de l'avoir ?
Je vois que, dans un grand nombre de cas, possder un objet, c'est
pouvoir en user. Pourtant, je ne me satisfais pas de cette dfinition :
j'use, en ce caf, de cette soucoupe et de ce verre ; pourtant, i l s ne
sont pas moi ; je ne saurais user de ce tableau qui pend mon
mllr, et cependant i l est moi. Et il n' importe pas non plus que, dans
certains cas, j 'ai e le droit de dtruire ce que je possde ; il serait bien
ahstrai t de dfi ni r l a proprit par ce droit-l ; et, d'ailleurs, dans une
socit dont l'conomie est dirige , un patron peut possder son
usine sans avoir le droit de la fermer ; dans la Rome impriale, le
matre possdait son esclave et n'avait pas le droit de le mettre mort.
D'ailleurs que signifie ici droit de dtruire, droit d' user ? Je vois que
ce droit me renvoie au social et que la proprit semble se dfi ni r dans
les cadres de la vie en socit. Mais j e vois aussi que l e droit est
purement ngatif et se borne empcher autrui de dtruire ce qui
m'appartient ou d'en user. Sans doute, tentera-t-on de dfinir la
proprit comme une fonction sociale. Mais, d'abord, de ce que la
socit confre en effet le droit de possder, selon certains principes,
il ne s'ensuit pas qu' elle cre le rapport d'appropriation. C'est tout au
plus si elle l e lgitime. Bien au contraire, pour que la proprit puisse
tre leve au rang de sacre, i l faut tout d'abord qu' el l e existe
comme rel ati on spontanment tablie entre le pour-soi et l'en-soi
concret. Et si nous pouvons envisager pour l'avenir une organisation
collective pl us j uste o la possession individuelle cessera -au moins
dans certai nes l i mites -d'tre protge et sanctifi e, cela ne signifie
pas pour autant que l e l i en appropriatif cessera d'exister ; il se peut
qu' i l demeure, en effet, au moins titre de relation prive de l'homme
la chose. Ai nsi , dans l es socits primitives o l e l i en conjugal n'est
1. Sauf dans le cas prcis o i l est simplement dsir d'tre : dsir d'tre
heureux, d'tre fort, etc.
632
pas encore l gitim et o la transmISSIon des qualits est encore
matronymi que, ce lien sexuel existe tout l e moins comme une sorte
de concubinage. Donc i l faut distinguer possession et droit de
possession. Pour la mme raison, je dois repousser toute dfinition du
type de l a dfinition proudhonienne : La proprit, c'est le vol
car elle est ct de la question. I l se peut, e n effet , que la proprit
prive soit le produit du vol et que l e
'
maintien de cette proprit ait
pour effet la spoliation d'autrui. Mais, quels que soient ses origines et
ses effets, la proprit n'en demeure pas moins descriptible et
dfinissable en elle-mme. Le voleur s'estime propritaire de l 'argent
qu'il a vol . Il s'agit donc de dcrire la relation prcise du voleur au
bien drob, aussi bien que celle du propritaire lgitime l a
proprit honntement acquise
Si j e considre l'objet que j e possde, j e vois que l a qualit de
possd ne le dsigne pas comme une pure dnomination externe
marquant son rapport d'extriorit avec moi ; bien au contraire, cette
qualit le dfinit profondment, ell e m'apparat et apparat aux autres
comme faisant partie de son tre. C'est au point qu'on peut dfinir
certains hommes, dans les socits primitives, en disant que ce sont
des possds ; en eux-mmes, ils sont donns comme appartenant . . .
C'est c e q u e marquent aussi l es crmonies funbres primitives, o
l'on enterre l es morts avec les objets qui leur appartiennept.
L'explication rationnelle : pour qu'ils puissent s'en servir ", est
videmment venue aprs coup. I I semble plutt qu' l'poque o ce
genre de coutumes est apparu spontanment, i l ne semblait pas
ncessaire de s'interroger ce suj et. Les objets avaient cette qualit
singulire d' tre aux morts. Il s formaient un tout avec lui, i l n'tait pas
plus question d'enterrer le dfunt sans ses objets usuels que de
l'enterrer, par exemple, sans une de ses jambes. Le cadavre, la coupe
dans laquelle il buvait, le couteau dont i l se servait font un seul mort.
L coutume de brler les veuves malabaraises s'entend fort bien
quant son principe : la femme a t possde ; l e mort l'entrane
donc dans sa mort, elle est morte en droit ; il n'y a plus qu' l'aider
passer de cette mort en droit une mort de fait. Ceux des objets qui
ne sont pas susceptibles d'tre ensevelis sont hants. Le spectre n'est
rien que la matrialisation concrte de 1' tre-possd , de la maison
et des meubl es. Dire qu'une maison est hante, c'est dire que ni
l'argent ni la peine n'effaceront l e fait mtaphysique et absolu de sa
possession par un premier occupant. Il est vrai que les spectres qui
hantent les manoirs sont des dieux lares dgrads. Mais les dieux lares
eux-mmes, que sont-ils, sinon des couches de possession qui se sont
dposes une une sur les murs et les meubles de l a maison ?
L'expression mme qui dsigne l e rapport de l'objet son propri
taire marque assez la pntration profonde de l'appropriation : tre
possd, c'est tre + . + Cela signifie que c'est dans son tre que l'objet
633
possd est attei nt. Nous l'avons vu, d'ailleurs, la destruction du
possdant entrane la destruction de droit du possd et, inversement,
la survie du possd entrane la survie de droit du possdant. Le lien
de possession est un lien interne d'tre. Je rencontre le possdant dans
et par l'obj et qu'il possde. C'est videmment l'explication de
l'i mportance des reliques ; et nous n'entendons pas seulement par l
les reliques religieuses, mais aussi et surtout l'ensemble des proprits
d' un homme i l lustre (Muse Victor-Hugo, objets ayant appartenu
Balzac, Flaubert, etc. ) , dans lesquel les nous essayons de les
retrouver ; les souvenirs d'un mort aim qui semblent perp
tuer sa mmoire.
Ce lien i nt erne et ontologique du possd avec l e possdant (que
des coutumes comme celle de la marque au fer rouge ont souvent
tent de matrialiser) ne saurait s'expliquer par une thorie ra
liste de l ' appropriation. S'il est vrai que l e ralisme se dfinit
comme une doctrine qui fait du sujet et de l'objet deux substances
Illdpendantes et possdant l' existence pour soi et par soi , on ne
saurait pas plus concevoir l'appropriation que la connaissance , qui en
est une des formes ; l'une comme l'autre, elles demeureront des
rapports externes unissant pour un temps l e sujet l'objet. Mais nous
avons vu que l'existence substantielle doit tre attribue l'objet
connu. Il en est de mme pour la proprit en gnral : c'est l'objet
possd qui existe en soi , qui se dfinit par la permanence, l'a tempo
ral i t en gnral , la suffisance d' tre, en un mot, la substantialit.
C'est donc du ct du sujet possdant qu'il faut mettre l ' Unselbststn
digkeil. Une substance ne saurait s'approprier une autre substance et
si nous saisissons sur les choses une certaine qualit de
c'est que, origi nellement, l e rapport interne du pour-soi l 'en-soi qui
est sa proprit tire son origine de l'insuffisance d'tre du pour-soi. Il
va de soi que l'objet possd n'est pas rellement affect par l'acte
d'appropri ation, pas plus que l'objet connu n'est affect par la
connaissance : il demeure intouch (sauf dans l e cas o le possd est
un tre humai n, un esclave, une prostitue , etc. ) . Mais cette qualit
de possd ne l'en affecte pas moins idalement dans sa signification :
en un mot , son sens est de reflter au pour-soi cette possession.
Si l e possdant et l e possd sont uni s par une relation interne
base sur l 'i nsuffisance d'tre du pour-soi, la question qui se pose est
de dterminer l a nature et l e sens du couple qu'ils forment. La
relation interne tant synthti que, en effet , opre l'unification du
possdant et du possd. Cela signifie que l e possdant et l e possd
constituent idalement une ralit unique. Possder, c'est s'unir un
objet possd sous l e signe de l'appropriation ; vouloir possder, c'est
vouloir s'unir un objet par ce rapport. Ainsi , l e dsir d'un objet
particul i er n'est pas simple dsir de cet objet , c'est le dsir de s'unir
l'objet par un rapport interne, de ranire constituer avec l ui l'unit
634
possdant-possd Le dsir d'avoir est a u fond rductible au
dsir d'tre par rapport un certain objet dans une certaine relation
d'tre.
Pour dterminer cette relation, les remarques prcdentes sur les
conduites du savant, de l'artiste et du sportif nous seront trs utiles.
Nous avons dcouvert, en chacune de ces conduites, une certaine
attitude appropriative. Et l'appropriation en chaque cas s'est mar
que par le fait que l'objet nous apparaissait l a fois comme
manation subjective de nous-mme et, la fois, comme dans un
rapport d'extriorit indiffrente avec nous. Le mien nous est donc
apparu comme une relation d'tre intermdiaire entre l'intriorit
absol ue du moi et l'extriorit absolue du non-moi. C'est, dans un
mme syncrtisme, l e moi devenant non-moi et l e non-moi devenant
moi. Mais il faut mieux dcrire ce rapport. Dans l e projet de
possession, nous rencontrons un pour-soi unselbststlndig spar
par un nant de la possibilit qu' i l est. Cette possibilit est possibilit
de s'approprier l'objet. Nous rencontrons en outre une valeur qui
hante le pour-soi et qui est comme l ' indication idale de l'tre total
qui se raliserait par l'union dans l 'identit du possible et du pour-soi
qui est son possible, c'est--dire ici l'tre qui se raliserait si j' tais
dans l'unit i ndissol ubl e de l'identique, moi-mme et ma proprit.
Ainsi l 'appropriation serait un rapport d'tre entre un pour-soi et un
en-soi concret, et ce rapport serait hant par l'indication idale d'une
identification entre ce pour-soi et l'en-soi possd.
Possder, c'est avoir moi, c'est--dire tre la fin propre de
l'existence de l'objet. Si la possession est entirement et concrte
ment donne, l e possdant est la raison d'tre de l'objet possd. Je
possde ce stylo, cela veut dire : ce stylo existe pour moi, a t fait
pour moi. Originellement d'ailleurs, c'est moi qui fais pour moi
l'objet que je veux possder. Mon arc, mes flches, cela signifie les
objets que j ' ai faits pour moi. La division du travail fait plir ce
rapport premier sans le fai re disparatre. L luxe en est une
dgradation ; je possde, dans l a forme primitive du luxe, un objet
que j 'ai fait faire pour moi , par des gens moi (esclaves, domestiques
ns dans la maison). L luxe est donc la forme de proprit l a plus
voisine de la proprit primitive, c'est lui qui met, aprs elle, l e mieux
en lumire le rapport de cration qui constitue originellement
l'appropriation. Ce rapport, dans une socit o l a division du travail
est pousse la limite, est masqu mais non supprim : l'objet que j e
possde a t achet par moi. L'argent reprsente ma force ; i l est
moins une possession par lui-mme q u'un instrument possder.
C'est pourquoi, sauf dans le cas trs particulier de l'avarice, l ' argent
s'efface devant sa possibilit d'achat ; il est vanescent, il est fait pour
dvoiler l ' objet, la chose concrte ; il n'a qu'un tre transitif. Mais
moi, il apparat comme une force cratrice : acheter un objet, c'est un
635
acte symbolique qui vaut pour crer l'objet. C'est pourquoi l'argent
est synonyme de puissance : non seulement parce qu'il est, en effet,
susceptible de nous procurer ce que nous dsirons, mais surtout parce
qu' il reprsente l 'efficacit de mon dsir en tant que tel . Prcisment
parce qu' il est transcend vers la chose, dpass et simplement
impliqu, il reprsente mon lien magique l'objet. L'argent supprime
la liaison technique du sujet l'objet et rend l e dsir i mmdiatement
oprant comme les souhaits de l a lgende. Arrtez-vous une vitrine,
avec de l'argent en poche : les objets exposs sont dj plus qu'
moiti vous. Ainsi un lien d' appropriation s'tablit par l'argent
entre le pour-soi et l a collection totale des objets du monde. Par l ui , le
dsir, en tant que tel , est dj i nformateur et crateur. Ainsi ,
travers une dgradation continue, le lien de cration est maintenu
entre l e sujet et l'obj et. Avoir, c'est d'abord crer. Et l e lien de
proprit qui s'tablit alors est un lien de cration continue : l'objet
possd est insr par moi dans l a forme de mes entours, son
existence est dtermine par ma situation et par son intgration dans
cette situation mme. Ma l ampe, ce n'est pas seulement cette
ampoule lectrique, cet abat-jour, ce support de fer forg : c'est une
certaine puissance d'clairer ce bureau, ces livres, cette table ; c' est
une certain e nuance lumineuse de mon travail nocturne, en liaison
avec mes habitudes de lire ou d'crire tard ; elle est anime, colore,
dfi ni e par l'usage que j' en fais ; el l e est cet usage et n' existe que par
l. Isole de mon bureau, de mon travail, pose dans un lot d'objets
sur l e sol de l a sal l e des ventes, el l e s'est radicalement teinte , elle
n'est plus ma lampe ; mme plus une lampe en gnral, elle est
revenue la matrialit originel l e. Ainsi suis-je responsabl e de
l'existence dans l' ordre humain de mes possessions. Par la proprit,
je les lve j usqu' un certain type d'tre fonctionnel ; et ma simple
vie m'apparat comme cratrice, justement parce que, par sa conti
nui t, el l e perptue l a qualit de possd en chacun des objets de ma
possession : j' entrane l'tre, avec moi, l a collection de mes entours.
Si on me les arrache, ils meurent, comme mon bras mourrait si on
l'arrachait de moi .
Mai s l e rapport originel et radi cal de cration est un rapport
d'manation. Les difficults rencontres par la thorie cartsienne de
l a substance sont l pour nous dcouvrir ce rapport. Ce que je cre
si j ' entends par crer : faire venir matire et forme l 'existence -
c'est moi . Le drame du crateur absol u, s' il existait, serait l'impossibi
lit de sortir de soi, car sa crature ne saurait tre que lui-mme : d'o
tirerait-el l e, en effet, son objectivit et son indpendance, puisque sa
forme et sa matire sont de moi. Seul e une sorte d'inertie pourrait la
reformer en face de moi ; mais pour que cette inertie mme puisse
jouer, il faut que je la soutienne l'existence par une cration
continue. Ainsi, dans la mesure o je m'apparais comme crant les
636
objets par le seul rapport d'appropriation, ces objets sont moi. Le
stylo et la pipe, le vtement, le bureau, la maison, c'est moi. La
totalit de mes possessions rflchit la totalit de mon tre. Je suis ce
que j'ai. C'est moi que je touche sur cette tasse, sur ce bibelot. Cette
montagne que je gravis, c'est moi dans la mesure o je la vaincs ; et
lorsque je suis son sommet, que j'ai acquis , au prix de mes
efforts, ce large point de vue sur l a valle et sur les cimes
environnantes, je suis l e point de vue ; le panorama, c'est moi dilat
jusqu' l'horizon, car i l n'existe que par moi , que pour moi.
Mais l a cration est un concept vanescent qui ne peut exister que
par son mouvement. Si on l'arrte, i l disparat. Aux limites extrmes
de son acception, il s'anantit ; ou bien je ne retrouve que ma pure
subjectivit ou bien je rencontre une matrialit nue et indiffrente
qui n'a plus aucun rapport avec moi . La cration ne saurait se
concevoir et se maintenir que comme passage continu d'un terme
l'autre. I 1 faut que , dans le mme surgissement, l'objet soit totalement
moi et totalement indpendant de moi. C'est bien ce que nous
croyons raliser dans la possession. L'objet possd, en tant que
possd, est cration continue ; mai s pourtant i l demeure l , i l existe
par soi, i l est en-soi ; si je m' en dtourne, il ne cesse pas d'exister pour
cela ; si je m'en vais, i l me reprsente dans mon bureau, dans ma
chambre, cette place du monde. Ds l'origine, i l est impntrable.
Ce stylo est tout entier moi, au point mme que je ne l e distingue
mme plus de l'acte d'crire, qui est mon acte. Et pourtant , d'autre
part, il est intact, ma proprit ne l e modifie pas ; ce n'est qu'une
relation idale de moi l ui . En un sens, je jouis de ma proprit si j e
la dpasse vers l'usage, mai s si j e veux l a contempler, l e l i en de
possession s'efface, j e ne comprends plus ce que signifie possder. La
pipe est l, sur la table, indpendante, indiffrente. Je la prends dans
mes mains, je la palpe, je l a contemple, pour raliser cette appropria
tion ; mais justement parce que ces gestes sont destins me donner
la jouissance de cette appropriation, ils manquent l eur but, j e n'ai
qu'un bout de bois inerte entre les doigts. C'est seulement lorsque je
dpasse mes objets vers un but, lorsque je les utilise, que j e puis jouir
de leur possessi on. Ainsi, l e rapport de cration continue enveloppe
en lui comme sa contradiction implicite l'indpendance absol ue et en
soi des objets crs. La possession est un rapport magique ; je suis ces
objets que je possde, mais dehors, face moi : je les cre comme
indpendants de moi ; ce que je possde, c'est moi hors de moi , hors
de toute subjectivit, comme un en-soi qui m'chappe chaque
instant et dont je perptue chaque instant la cration. Mais
prcisment parce que je suis toujours hors de moi ailleurs, comme
un incomplet qui se fait annoncer son tre par ce qu'il n'est pas,
lorsque je possde, je m'aline au profit de l'objet possd. Dans le
rapport de possession, l e terme fort c'est la chose possde, je ne suis
637
rien en dehors d'elle qu' un nant qui possde, rien d'autre que pure et
simple possession , un incomplet, un insuffisant, dont la suffisance et
la compltude sont dans cet objet l-bas. Dans la possession, je suis
mon propre fondement en tant que j'existe en soi : en tant, en effet,
que l a possession est cration continue, je saisis l'objet possd
comme fond par moi dans son tre ; mais en tant, d'une part, que la
cration est manation, cet objet se rsorbe en moi, i l n'est que moi ,
e
t en tant, d' autre part, qu'i! est originellement en-soi, il est non-moi ,
il est moi en face de moi , objectif, en soi, permanent, impntrable,
existant par rapport moi dans l e rapport d'extriorit, d' indiff
rence. Ainsi, je suis fondement de moi en tant que j'existe comme
indiffrent et en-soi par rapport moi. Or, c'est prcisment le projet
mme de l' en-soi-pour-soi . Car cet tre idal est dfi ni comme un en
soi qui, en tant que pour-soi , serait son propre fondement, ou comme
un pour-soi dont le projet originel ne serait pas une manire d'tre,
mais un tre, prcisment l ' tre-en-soi qu'il est. On voit que
l'appropriation n'est pas autre chose que l e symbole de l'idal du
pour-soi ou valeur . Le couple pour-soi possdant et en-soi possd
vaut pour l'tre qui est pour se possder lui-mme et dont la
possession est sa propre cration, c'est--dire Dieu. Ainsi, le poss
dant vise jouir de son tre en-soi, de son tre-dehors. Par la
possession je rcupre un tre-objet assimilable mon tre-pour
autrui. Par l mme, autrui ne saurait me surprendre : l'tre qu'il veut
faire surgir et qui est moi-pour-I'autre, je le possde dj, j 'en jouis.
Ainsi, l a possession est, en outre, une dfense contre l'autre. Le mien,
c'est moi comme non-subjectif, en tant que j'en suis le libre
fondement.
Toutefoi s, on ne saurait trop insister sur l e fait que cette relation est
symbolique et idale. Je ne satisfais pas plus mon dsir originel d'tre
moi-mme mon propre fondement par l'appropriation que le
malade de Freud ne satisfait son complexe d'dipe lorsqu'il rve
qu' un soldat tue le Tsar (c'est--dire son pre). C'est pourquoi la
proprit apparat l a fois au propritaire comme donne d'un coup,
dans l'ternel , et comme eigeant l ' infinit du temps pour se raliser.
Aucun geste d'utilisation ne ralise vraiment la jouissance appropria
tive ; mais i l renvoi e d'autres gestes appropriatifs dont chacun n' a
qu' une valeur incantatoire. Possder une bicyclette, c'est pouvoir
d'abord l a regarder, puis l a toucher. Mais toucher se rvle de soi
mme comme insuffisant ; ce qu' i! faut, c'est pouvoir monter dessus
pour faire une promenade. Mais cette promenade gratuite est elle
mme insuffisante ; i l faudrait utiliser l a bicyclette pour faire des
courses. Et cela nous renvoie des utilisations plus longues, plus
compltes, de longs voyages travers l a France. Mais ces voyages
eux-mmes se dcomposent en mille comportements appropriatifs
dont chacun renvoie aux autres. Finalement, comme on pouvait l e
638
prvoir, il a suffi de tendre un billet de banque pour que la bicyclette
m'appartienne mais il faudra ma vie entire pour raliser cette
possessi on ; c'est bien ce que je sens en acqurant l'objet : la
possession est une entreprise que l a mort rend toujours inacheve.
Nous en saisissons l e sens, prsent : c'est qu'il est impossible de
raliser la relation symbolise par l'appropriation. En soi, l'appro
priation n'a rien de concret. Ce n'est pas une activit relle (comme
manger, boire, dormir, etc.) qui servirait, par surcrot, de symbole
un dsir particul i er. Elle n'existe, au contraire, qu' titre de symbole ,
c'est son symbolisme qui lui donne s a signification, sa cohsion, son
existence. On ne saurait donc trouver en elle une jouissance positive
en dehors de sa valeur symbolique ; elle n'est que l'indication d' une
jouissance suprme (celle de l 'tre qui serait fondement de soi
mme) , qui est toujours par del tous les comportements appropria
tifs destins la raliser. C'est prcisment la reconnaissance de
l'impossibilit qu' i l y a possder un objet, qui entrane pour le pour
soi une violente envie de le dtruire. Dtruire, c'est rsorber en moi ,
c'est entretenir avec l'treen-soi de l ' objet dtruit un rapport aussi
profond que dans la cration. Les flammes qui brlent la ferme
laquel l e j'ai mis le feu ralisent peu peu la fusion de la ferme avec
moi-mme : en s'anantissant, el l e se change en moi. Du coup, j e
retrouve l a relation d'tre de l a cration, mais inverse : j e suis l e
fondement de l a grange qui brle ; j e suis cette grange, puisque j e
dtruis son tre . La destruction ralise -peut-tre plus finement que
la cration -l 'appropriation, car l'objet dtruit n'est pl us l pour se
montrer impntrable. Il a l'impntrabilit et l a suffisance d'tre de
l'en-soi qu' i l a t ; mai s, en mme temps, i l a l'invisibilit et la
translucidit du nant que je suis, puisqu' i l n'est plus. Ce verre que
j'ai bris et qui tait ) sur cette table, y est encore, mai s comme une
transparence absolue ; j e voi s tous l es tres au travers ; c'est ce que l es
cinastes ont tent de rendre par l a surimpression : i l ressemble une
conscience quoi qu'i l ai t l'irrparabilit de l'en-soi. En mme temps, i l
est positivement mi en parce que seul l e fait que j'ai tre ce que
j'tais retient l'objet dtruit de s'anantir : j e l e recre en me
recrant ; ainsi , dtruire c'est recrer en s'assumant comme seul
responsable de l'tre de ce qui existait pour tous. La destruction est
donc ranger parmi les comportements appropriatifs. D'ailleurs,
beaucoup de conduites appropriatives ont une structure, entre autres,
de destructivit : utiliser, c'est user. En usant de ma bicycl ette, j e
l'use, c'est--dire que l a cration continue appropriative se marque
par une destruction partiel l e. Cette usure peut peiner, pour des
raisons strictement utilitaires, mais, dans l a plupart des cas, elle cause
une joi e secrte, presque une jouissance : c'est qu'elle vient de nous ;
nous consommons. On remarquera comme cette expression de
consommation ) dsigne la fois une destruction appropriative et
639
une j ouissance alimentaire. Consommer, c'est anantir et c'es\
manger ; c'est dtruire en s' incorporant. Si je roule sur ma bicyclette,
je puis me dpiter d'en user les pneus, parce qu'il est di fficile d' en
trouver d'autres ; mais l ' i mage de jouissance que j e joue avec mon
corps est celle d'une appropriation destructive, d' une cration
destruction . La bicyclette en glissant, e
'
n me portant, par son
mouvement mme est cre et faite mienne ; mais cette cration
s'imprime profondment dans l'objet par l'usure lgre et continue
qu'elle l ui communique et qui est comme la marque au fer rouge de
l'esclave. L'objet est moi car c'est moi qui l'ai us ; l'usure du mien,
c'est l ' envers de ma vie 1 .
Ces remarques permettront de mieux comprendre l e sens de
certains senti ments ou comportements ordinairement considrs
comme irrductibles ; par exempl e, la gnrosit. En effet, l e don est
une forme primi tive de destruction. On sait que l e potlatch, par
exempl e, comporte l a destruction de quantits normes de marchan
dises. Ces destructions sont dfi l'autre, elles l'enchanent. A ce
niveau, il est i ndiffrent que l'objet soit dtruit ou donn l'autre : de
l'une ou l'autre manire, l e potlatch est destruction et enchanement
de l' autre . Je dtruis l'objet en l e donnant aussi bien qu'en l ' anantis
sant ; je lui supprime l a qualit de mien qui le consti tuait profond
ment dans son tre, je l ' te de ma vue, je le' constitue -par rapport
ma tabl e, ma chambre -en absent ; moi seul lui conserverai l'tre
spectral et transparent des objets passs, parce que j e suis celui par
qui l es tres poursui vent une existence honoraire aprs leur anantis
sement. Ainsi la gnrosit est avant tout fonction destructrice. La
rage de donner qui prend certains moments certaines gens est, avant
tout, rage de dtrui re, elle vaut pour une attitude de forcen, un
amour s'accompagnant de bris d'objets. Mais cette rage de
dtruire qu' i l y a au fond de l a gnrosit n'est pas autre chose qu' une
rage de possder. Tout ce que j 'abandonne, tout ce que j e donne, j' en
joui s d' une manire suprieure par l e don que j 'en fais ; l e don est une
jouissance pre et brve, presque sexuelle : donner, c'est jouir
possessive ment de l'objet qu'on donne, c' est un contact destructif
appropriatif. Mais, en mme temps, le don envote cel ui qui l' on
donne, i l l'oblige recrer, maintenir l' tre par une cration
continue ce moi dont je ne veux plus, que je viens de possder
jusqu' l ' anantissement et dont il ne reste finalement qu'une image.
Donner, c'est asservir. Cet aspect du don ne nous i ntresse pas ici, car
il concerne surtout les rapports avec l'autre. Ce que nous voulions
marquer, c'est que l a gnrosit n'est pas irrductible : donner, c'est
1. Brummell mettait son lgance n'avoir jamais que des vtements dj
un peu uss. Il avait horreur du neuf : ce qui est neuf endimanche , parce
qu'il n'est personne.
640
s'approprier par la destruction en utilisant cette destruction pour
s'asservir l'autre . La gnrosit est donc un sentiment structur par
l'existence d'autrui et qui marque une prfrence vers l'appropriation
par destruction. Par l, elle nous guide vers le nant plus encore que
vers J'en-soi (il s'agit d'un nant d'en-soi qui est videmment lui
mme en-soi , mais qui, en tant que nant, peut symboliser avec l'tre
qui est son propre nant). Si donc la psychanalyse existentielle
rencontre la preuve de la gnrosit d'un sujet, elle doit chercher plus
loin son projet originel et se demander pourquoi le sujet a choisi de
s'approprier par destruction plutt que par cration. La rponse
cette question dcouvrira la relation originelle l'tre qui constitue la
personne tudie.
Ces observations ne vi saient qu' mettre en lumire le caractre
idal du lien appropriatif et l a fonction symbolique de toute conduite
appropriative. Il faut ajouter que le symbole n'est pas dchiffr par le
sujet lui-mme. Cela ne vient pas de ce que la symbolisation se
prparerait dans un inconscient, mais de la structure mme de J' tre
dans-le-monde. Nous avons vu, en effet, dans le chapitre consacr la
transcendance, que J'ordre des ustensiles dans le monde tait l'image,
proj ete dans l'en-soi , de mes possibilits, c'est--dire de ce que je
suis, mai s que j e ne pouvais jamais dchiffrer cette image mondaine
puisqu'il ne fallait rien de moins que la scissiparit rflexive pour que
je puisse tre pour moi-mme comme une bauche d'objet. Ainsi , le
circuit de l'ipsit tant non-thtique et, par suite, l'annonciation de
ce que j e suis demeurant non-thmatique, cet tre-en-soi de moi
mme que le monde me renvoie ne peut qu' tre masqu ma
connaissance. Je ne pui s que m'y adapter dans et par l'action
approximative qui l a fait natre. En sorte que possder ne signifie
nullement savoir q u'on est avec l'objet possd dans un rapport
identifiant de cration-destruction, mais prcisment tre dans ce
rapport ou, mi eux encore, tre ce rapport. Et l'objet possd a pour
nous une qual it i mmdiatement saiissable et qui le transforme tout
entier -la qualit d'tre mien mais cette qualit est en elle-mme
rigoureusement indchiffrable , elle se rvle dans et par l'action, elle
manifeste qu'elle a une signification particulire, mais elle s'vanOUIt
sans rvler sa structure profonde et sa signification ds que nous
voulons prendre du recul par rapport J'objet et le contempler. Ce
recul, en effet, est par lui-mme destructeur de la liaison appropria
tive : l'instant d'avant, j'tais engag dans une totalit idale et,
prcisment parce que j'tais engag dans mon tre, j e ne pouvais le
connatre ; l' i nstant d'aprs, l a totalit s'est rompue et je ne pui s en
dcouvrir le sens sur les morceaux disjoints qui l'ont compose,
comme il est visible dans cette exprience contemplative que certains
malades font , malgr eux, et que l'on nomme dpersonnalisation.
Nous sommes donc contraints de recourir l a psychanalyse existen-
641
tiel l e pour nous rvler en chaque cas particulier la signification de
cette synthse appropriative dont nous venons de dterminer l e sens
gnral et abstrait par l'ontologie.
Reste dtermi ner en gnral l a signification de 1 objet possd.
Cette recherche doit complter nos connaissances sur le projet
appropriatif. Qu'est-ce donc que nous cherchons nous approprier ?
Il est facile de voi r , d' une part et dans l'abstrait , que nous visons
origi nellement possder non tant la manire d'tre de l'objet que
l'tre l ui-mme de cet objet -c'est, en effet, titre de reprsentant
concret de l ' tre-en-soi que nous dsirons nous l'approprier, c'est-,
dire nous saisir comme fondement de son tre en tant qu' il est nous
mme idalement - et, d'autre part, empiriquement, que l'objet
appropri ne vaut j amais pour lui tout seul, ni pour son usage
individuel. Aucune appropriation si n
'
gulire n'a de sens en dehors de
ses prolongements indfinis ; l e stylo que j e possde vaut pour tous les
stylos ; c'est la cl asse des stylos que je possde en sa personne. Mais,
en outre, c'est la possibilit d'crire, de tracer des traits d'une certaine
forme et d' une certaine couleur (car j e contamine l'i nstrument lui
mme et l'encre dont je fais usage) , que je possde en l ui : ces traits,
leur couleur, leur sens, sont condenss en lui comme aussi bien le
papier, sa rsistance spci al e, son odeur, etc. I l se fait propos de
toute possession l a synthse cristallisatrice que Stendhal a dcrite pour
l e seul cas de l ' amour. Chaque objet possd, qui s'enlve sur fond de
monde, manifeste l e monde tout entier, comme l a femme aime
manifeste l e ciel, la plage, l a mer qui l'entouraient lorsqu'elle est
apparue. S'approprier cet objet, c'est donc s'approprier l e monde
symboliquement. Chacun peut l e reconnatre en se reportant son
exprience ; pour moi , j e citerai un exemple personnel , non pour
prouver mais pour guider l'enqute du lecteur.
II y a quel ques annes, je fus amen dcider de ne plus fumer. L
dbut fut rude et , la vrit, je ne me souciais pas tant du got du
tabac que j'al l ais perdre que du sens de l'acte de fumer. Toute une
cristallisation s'tait faite : j e fumais au spectacle, l e mati n en
travail l ant, le soir aprs dner, et il me semblait qu'en cessant de
fumer j 'al lais ter son intrt au spectacle, sa saveur au repas du soir,
sa frache vivacit au travail du mati n. Quel que dt tre l'vnement
inattendu qui frapperait mes yeux, il me semblait qu'il tait fonda
mentalement appauvri ds lors que je ne pouvais plus l 'accueil l i r en
fumant . Etre-susceptible-d' tre-rencontr-par-moi-fumant : tel l e
tai t la qualit concrte qui s'tait pandue universellement sur les
choses. II me semblait que j'allais la l eur arracher et que, au milieu de
cet appauvrissement universel, i l valait un peu moins la peine de
vi vre. Or, fumer est une raction appropriative destructrice. Le tabac
est un symbol e de l'tre appropri , puisqu'il est dtruit sur le
rythme de mon souffle par une manire de destruction continue ,
642
qu' i l passe en moi et que son changement en moi-mme se manifeste
symboliquement par la transformation du solide consum en fume.
La liaison du paysage vu en fumant ce petit sacrifice crmatoire tait
tell e, nous venons de le voi r, que celui-ci tait comme le symbole de
celui-l. Cela signifie donc que la raction d'appropriation destruc
trice du tabac valait symbol i quement pour une destruction appropria
tive du monde entier. A travers le tabac que je fumais, c'tait l e
monde qui brlait, qui se fumait, qui se rsorbait en vapeur pour
rentrer en moi. Je dus, pour mainteni r ma dcision, raliser une sorte
de dcristallisation, c'est--dire que je rduisis, sans trop m'en rendre
compte, l e tabac n'tre plus ri en que lui-mme : une herbe qui
grille ; j e coupai ses liens symboliques avec le monde, j e me persuadai
que je n'terais rien la pice de t htre, au paysage, au livre que j e
lisais, si j e l es considrais sans ma pipe, c'est--dire que je me rabattis
sur d'autres modes de possession de ces objets que cette crmonie
sacrificielle. Ds que j'en fus persuad, mon regret se rduisit fort
peu de chose : je dplorai de ne plus devoir sentir l'odeur de l a
fume, l a chal eur du fourneau entre mes doigts, etc. Mais du coup
mon regret tait dsarm et fort supportable.
Ainsi, ce que, fondamentalement, nous dsirons nous approprier,
dans un objet, c'est son tre et c'est l e monde. Ces deux fins de
l'appropriation n' en font en ralit qu'une . Je cherche, derrire l e
phnomne, possder l 'tre du phnomne. Mais cet tre fort
di ffrent, nous l'avons vu, du phnomne d'tre, c'est l 'tre-en-soi, et
non pas seulement l 'tre de telle chose particulire. Ce n'est point
qu'i! y ait ici passage l'universel, mais plutt l ' tre considr dans sa
nudit concrte devient du coup l'tre de l a totalit. Ainsi l e rapport
de possession nous apparat clairement : possder, c'est vouloir
possder le monde travers un objet particul i er. Et comme la
possession se dfinit comme effort pour se saisir, titre de fonde
ment, d'un tre en tant qu' i l est nous-mme idalement, tout projet
possessif vise constituer le pour-soi comme fondement du monde ou
totalit concrte de l'en-soi en tant que cette totalit est, comme
totalit, l e pour-soi lui-mme existant sur le mode de l'en-soi. Etre
dans-le-monde, c'est projeter de possder le monde, c'est--dire saisir
le monde total comme ce qui manque au pour-soi pour qu'il devienne
en-soi-pour-soi ; c'est s'engager dans une totalit, qui est prcisment
l'idal, ou val eur, ou totalit totalise et qui serait idalement
constitue par l a fusion du pour-soi , comme totalit dtotalise qui a
tre ce qu'elle est, avec l e monde, comme totalit de l'en-soi qui est
ce qu'il est. Il faut bien comprendre, en effet, que le pour-soi n'a pas
pour projet de fonder un tre de raison, c'est--dire un tre qu'il
concevrait d'abord -forme et matire - pour lui donner ensuite
l'existence : cet tre, en effet, serait un pur abstrait, un universel ; sa
conception ne saurait tre antrieure l'tre-dans-Ie-monde, mais
643
elle le supposerait au contraire, comme elle supposerait la compr
hension pront ologique d'un tre minemment concret et d'abord
prsent qui est le l de l'tre-l premier du pour-soi, c'est--di re
l'tre du monde ; le pour-soi n'est point pour penser d'abord
l'universel et pour se dterminer en fonction de concepts : i l est son
choix et son choix ne saurait tre abstrait, sinon l'tre mme du pour
soi serait abstrai t . L'tre du pour-soi est une aventure i ndividuelle et
le choix doit tre choix individuel d'tre concret . Cela vaut, nous
l'avons vu, pour la situation en gnral. Le choix du pour-soi est
toujours choix de la situation concrte dans sa singularit incompara
ble. Mais cel a vaut aussi pour le sens ontologique de ce choix.
Lorsque nous di sons que l e pour-soi est projet d'tre, i l ne conoit pas
l'tre-en-soi qu'il projette d'tre comme une structure commune
tous les exi stants d' un certain type : son projet n'est aucunement une
conception, nous l ' avons vu. Ce qu' i l projette d'tre l ui apparat
comme une totalit minemment concrte : c'est cet tre. Et, sans
doute, peut-on prvoir dans ce projet les possibilits d'un dveloppe
ment universalisant ; mais c'est l a faon dont on dira d'un amant
qu'il aime toutes les femmes ou toute l a femme dans une femme. Cet
tre concret dont il projette d'tre le fondement ne pouvant tre
conu, comme nous venons de l e voi r, parce qu'il est concret, ne
saurait tre imagin non plus, car l 'i maginaire est nant et cet tre est
tre mi nemment. Il faut qu' i l existe, c'est--dire qu'il soit rencontr,
mais que sa rencontre ne fasse qu'un avec le choix que le pour-soi fait.
Le pour-soi est une rencontre-choix, c'est--dire qu'il se dfinit
comme choix de fonder l'tre dont i l est rencontre. Cela signifie que
l e pour-soi, comme entreprise i ndividuel l e, est choix de ce monde,
comme totalit d'tre individuel l e ; i l ne le dpasse pas vers une
universalit logique mais vers un nouvel tat concret du mme
monde, dans l equel l'tre serait en-soi fond par le pour-soi , c'est-
dire qu'il le dpasse vers un tre-concret-par-del-l'tre-concret
existant. Ai nsi l 'tre-dans-le-monde est projet de possession de ce
monde et l a valeur qui hante le pour-soi est l'indication concrte d'un
tre individuel constitu par l a fonction synthtique de ce pour-soi-ci
et de ce monde-ci. L'tre, en effet , o qu'il soit, d'o qu' i l vienne et
de quelque faon qu'on l e considre, qu' i l soit en-soi ou pour-soi ou
l'idal impossible de l ' en-soi-pour-soi , est, dans sa contingence
premire, une aventure individuel l e.
Ainsi pouvons-nous dfinir l es relations qui unissent l a catgorie
d'tre et cel le d'avoir. Nous avons vu que l e dsir peut tre
originellement dsir d'tre ou dsir d'avoir. Mais l e dsir d'avoir n'est
pas irrducti bl e. Alors que l e dsir d'tre porte directement sur le
pour-soi et projette de lui confrer sans i ntermdiaire la dignit d'en
soi-pour-soi , l e dsir d'avoir vise le pour-soi sur, dans et travers le
monde. C'est par l'appropriation du monde que l e projet d'avoir vise
64
raliser la mme valeur que l e dsir d'tre. C'est pourquoi ces
dsirs, qu' on peut distinguer par l 'analyse, sont insparables dans l a
ralit ; on ne trouve pas de dsir d' tre qui ne se double d'un dsir
d'avoir et rciproquement ; i l s'agit au fond de deux directions de
l'attention propos d'un mme but, ou, si l'on prfre, de deux
interprtations d'une mme situation fondamentale, rune tendant
confrer l ' tre au pour-soi sans dtour, l'autre tablissant le circuit de
J'ipsit, c'est--dire intercalant le monde entre l e pour-soi et son
tre. Quant la situation originel l e, c'est le manque d'tre que j e suis,
c'est--dire que j e me fais tre. Mais prcisment J'tre dont je me fais
moi-mme manque est rigoureusement individuel et conCret ; c'est
J'tre qui existe dj et au milieu duquel je surgis comme tant son
manque. Ainsi l e nant mme que je suis est individuel et concret,
comme tant celle nantisation et non pas une autre.
Tout pour-soi est libre choi x ; chacun de ses actes, l e plus
insignifiant comme l e plus considrable, traduit ce choix et en mane ;
c'est ce que nous avons nomm notre libert . Nous avons maintenant
saisi l e sens de ce choix ; i l est choix d'tre, soit directement, soit par
appropriation du monde, ou plutt les deux la fois. Ainsi ma li bert
est-elle choix d'tre Dieu et tous mes actes, tous mes projets,
traduisent ce choix et le refltent de mille et mille manires, car i l est
une i nfinit de manires d' tre et de mani
r
es d'avoir. La psychana
lyse existentielle a pour but de retrouver, travers ces projets
empiriques et concrets, l a manire originelle que chacun a de choisir
son tre. Reste expliquer, dira-t-on, pourquoi je choisis de possder
le monde travers tel ou tel ceci particulier. Nous pourrions rpondre
que c'est l prcisment le propre de la libert. Pourtant, l'objet lui
mme n'est pas irrductibl e. Nous visons en lui son tre travers sa
manire d'tre, ou qualit . Et la qualit - en particulier la qualit
matriell e, fluidit de J'eau, densit de la pierre, etc. -tant mani re
d'tre ne fait que prsentifier J'tre d' une certaine faon. Ce que nous
choisissons, c'est donc une certaine faon dont l'tre se dcouvre et se
fait possder. Le j aune et le rouge, le got de la tomate ou des pois
casss, le rugueux et le tendre ne sont aucunement pour nous des
donnes irrductibles ; ils traduisent symboliquement nos yeux une
certaine faon que l'tre a de se donner et nous ragissons par le
dgot ou l e dsir, selon que nous voyons J'tre affleurer d' une faon
ou d' une autre leur surface. La psychanalyse existentiel l e se doit de
dgager le sens ontologique des qualits. C'est seulement ainsi -et
non par des considrations sur la sexualit -qu' on expliquera, par
exemple, certaines constantes des imaginations potiques (le
gologique , chez Rimbaud, l a fluidit de l ' eau chez Poe), ou tout
simplement les gots de chacun, ces fameux gots dont on dit qu'il ne
faut pas en discuter, sans se rendre compte qu'ils symbolisent leur
manire toute une Weltanschauung , tout un choix d'tre et que de
645
l vient l eur vidence aux yeux de cel ui qui les a faits siens. Il convient
donc que nous esquissions ici cette tche particulire de l a psychana
lyse existentiel l e, titre de suggestion pour des recherches ult
rieures. Car ce n'est pas au niveau du got pour l e sucr ou pour
l'amer, etc. , que le choix libre est irrducti bl e, mais au niveau du
choix de l ' aspect de l'tre qui se rvle travers et par l e sucr, l ' amer,
etc_
I I I
DE LA QUALIT COMME RVLATRI CE DE L' TRE
I l s'agit tout si mplement de tenter une psychanalyse des choses.
C'est ce que M. Bachelard a essay avec beaucoup de talent dans son
dernier livre, L'Eau et les rves. II y a dans cet ouvrage de grandes
promesses ; en particulier, c'est une vritable dcouverte que celle de
l'i magination matrielle . A vrai dire, ce terme d'imagination ne
nous convient pas, ni , non pl us, cette tentative de chercher derrire
les choses et leur matire glatineuse, solide ou fluide, les images
que nous y projetterions. La perception, nous l'avons dmontr
ailleurs 1, n' a rien de commun avec l ' i magination : elle l'exclut
rigoureusement , au contraire, et inversement. Percevoir n'est nulle
ment assembler des images avec des sensations : ces thses, d'origine
associationni ste, sont bannir entirement ; et, par suite, l a psycha
nal yse n'a pas rechercher des images, mais bien expliciter des sens
appartenant rel l ement aux choses. Sans aucun dout e, le sen
humain du poisseux, du visqueux, etc. , n'appartient pas l ' en-soi.
Mais les potentialits non plus, nous l ' avons vu, ne lui appartiennent
pas et pourtant ce sont elles qui constituent l e monde. Les significa
tions matrielles, le sens humain des aiguilles de neige, du grenu, du
tass, du graisseux, etc . , sont aussi relles que l e monde, ni plus ni
moins, et venir au monde, c'est surgir au milieu de ces significations.
Mais il s'agit sans doute d'une simple di ffrence de terminologi e ; et
M. Bachelard parat plus hardi et semble livrer le fond de sa pense
lorsqu'il parle, dans ses cours, de psychanalyser les plantes ou
lorsqu'il i nti tul e un de ses ouvrages Psychanalyse du feu. Il s'agit, en
effet, d'appliquer non au sujet, mais aux choses, une mthode de
dchiffrement objecti f qui ne suppose aucun renvoi pralable au
sujet. Lorsque, par exemple, je veux dterminer l a signification
objective de la nei ge, je vois, par exemple, qu' el l e fond certaines
1. Cf. L'Imaginaire, N. R.F. , 1940.
646
tempratures et que cette fonte de la neige est sa mort. Il s'agit l
simpl ement d' une constatation objective. Et lorsque je veux dtermi
ner l a signification de cette fonte, il faut que je l a compare d' autres
objets situs dans d'autres rgions d'existence mais galement objec
tifs, galement transcendants, ides, amitis, personnes, dont je puis
dire aussi qu'ils fondent (l'argent fond dans mes mains ; je suis en
nage, j e fonds en eau ; certaines ides - au sens de significations
sociales objectives - font boul e de neige et d'autres fondent l ;
comme i l a maigri, comme i l a fondu) ; sans doute obtiendrai-je ainsi
un certain rapport liant certaines formes de l 'tre certaines autres.
La comparaison de la neige fondante certaines autres fontes plus
mystrieuses (par exemple, au contenu de certains vieux mythes : le
tailleur des contes de Grimm prend un fromage dans ses mains, fait
croire que c'est une pierre, le serre si fort que l e petit-lait s'en
goutte ; l es assistants croient qu'il a fait goutter une pierre, qu'il en a
exprim le liquide) peut nous renseigner sur une liquidit secrte des
solides, au sens o Audiberti , bien inspir, a parl de la noirceur
secrte du lait. Cette liquidit, qui devra se comparer elle-mme au
suc des fruits et au sang de l'homme -qui est lui aussi quelque chose
comme notre secrte et vitale liquidit -, nous renvoie une certaine
possibilit permanente du compact granuleux (dsignant une certaine
qualit d'tre de l'en-soi pur) de se mtamorphoser en fuidit
homogne et indiffrencie (autre qualit d'tre de l'en-soi pur). Et
nous saisissons ici ds son origin e et avec toute sa signification
ontologique l'antinomie du continu et du discontinu, ples fminins et
mascul ins du monde, dont nous verrons ensuite le dveloppement
dialectique jusqu' la thorie des quanta et la mcanique ondulatoire.
Ainsi pourrons-nous arriver dchiffrer l e sens secret de la neige, qui
est un sens ontologique. Mais en tout cel a, o est l e rapprt au
subjectif ? l'imagination ? Nous n'avons fait que comparer des
structures rigoureusement objectives et formuler l ' hypthse qui peut
unifier et grouper ces structures. C'est purquoi la psychanalyse prte
ici sur l es choses el les-mmes, non sur les hommes. C'est aussi
purquoi je me dfierais plus que M. Bachelard, ce niveau, de
recourir aux imaginations matri el l es des potes, fussent-ils Lautra
mont, Rimbaud ou Poe. Certes, il est passionnant de rechercher l e
Bestiaire de Lautramont Mais si, e n effet, nous sommes, dans
cette recherche, revenus au subjectif, nous n'atteindrons des rsultats
vraiment signifiants que si nous considrons Lautramont comme
prfrence origi nel l e et pure de l'animalit 2 et si nous avons
dtermin d'abord le sens objectif de l'animalit. Si en effet Lautra-
1. Qu'on se rappelle aussi la monnaie fondante de Daladier.
2. D'une certaine animalit, c'est exactement ce que Scheler appelle les
valeurs vitales.
67
mont est ce qu'il prfre, il faut d' abord savoir la nature de ce qu' il
prfre. Et, certes, nous savons bien qu' i l va mettre dans
l ' animalit autre chose et plus que je n'y mets. Mais ces enrichisse
nents subjectifs qui nous renseignent sur Lautrmont sont polariss
par la structure obj ective de l'animalit. C'est pourquoi la psychana
l yse existentielle de Lautramont suppose d'abord un dchiffrement
ju sens objectif de l'animal. Pareillement, je songe de longue date
tablir un lapidaire de Rimbaud. Mais quel sens aurait-il, si nous
n' avions tabli pralablement la signification du gologique en
gnral ? Mais, dira-t-on, une signification suppose l'homme. Nous ne
disons pas autre chose. Seulement, l'homme, tant transcendance,
tablit le signifi ant par son surgissement mme et le signifiant, cause
de la structure mme de la transcendance, est un renvoi d'autres
transcendants qui peut se dchiffrer sans recours la subjectivit qui
l'a tabli. L'nergie potentielle d'un corps est une qualit objective de
ce corps qui doit tre calcule objectivement en tenant uniquement
compte de circonstances objectives. Et, pourtant, cette nergie ne
peut veni r habiter un corps que dans un monde dont l'apparition est
corrlative de celle d' un pour-soi. Pareillement, on dcouvrira, par
une psychanalyse rigoureusement objective, d'autres potentialits
plus profondment engages dans la matire des choses et qui restent
entirement transcendantes, encore qu'elles correspondent un choix
plus fondamental encore de l a ralit-humaine, un choix de l'tre.
Ceci nous amne prciser le second point par o nous diffrons de
M. Bachelard. Il est certain, en effet, que toute psychanalyse doit
avoir ses principes a priori. En particulier, elle doit savoir ce qu'eUe
cherche, sinon comment pourrait-elle le trouver ? Mais comme le but
de sa recherche ne saurait tre tabli lui-mme par la psychanalyse,
sous pei ne de cercle vicieux, il faut qu'il soit l'objet d'un postulat
ou qu' on le demande l'exprience - ou qu' on l'tablisse par le
moyen de quelque autre discipline. La libido freudienn e est videm
ment un simple postulat : la volont de puissance adlrienne semble
une gnralisation sans mthode des donnes empiriques -et il faut
bien qu'elle soit sans mthode puisque c'est elle qui permet de jeter
les bases d' une mthode psychanalytique. M. Bachelard semble s'en
rapporter ces devanciers ; le postulat de la sexualit semble dominer
ses recherches ; d'autres fois, nous sommes renvoys la mort, au
traumatisme de la naissance, la volont de puissance ; bref, sa
psychanalyse semble plus sre de sa mthode que de ses principes et
sans doute compte-t-elle sur ses rsultats pour l'clairer sur le but
prcis de sa recherche. Mais c'est mettre la charrue devant les bufs,
j amai s les consquences ne permettront d'tablir le principe, pas plus
que la sommation des modes finis ne permettra de saisir l a substance.
Il nous parat donc qu'il faut abandonner ici ces principes empiriques
ou ces postulats qui feraient de l'homme, a priori, une sexualit ou
68
une volont de puissance, et qu' il convient d'tablir rigoureusement
l e but de l a psychanalyse partir de l'ontologie. C'est ce que nous
avons tent dans le paragraphe prcdent. Nous avons vu que la
ralit-humaine, bien avant de pouvoir tre dcrite comme libido ou
volont de puissance, est choix d'tre, soit directement, soit par
appropriation du monde. Et nous avons vu que -lorsque l e choix se
porte sur l'appropriation - chaque chose est choisie en dernire
analyse, non pour son potentiel sexuel, mais par suite de l a manire
dont elle rend l ' tre, de l a faon dont l'tre affleure sa surface. Une
psychanalyse des choses et de l eur matire doi t donc se proccuper
avant tout d'tablir la faon dont chaque chose est le symbole objectif
de l'tre et du rapport de la ralit-humaine cet tre. Nous ne nions
pas qu'il faille dcouvrir, par aprs, tout un symbolisme sexuel dans l a
nature, mais c' est une couche secondaire et rductible qui suppose
d'abord une psychanalyse des structures prsexuelles. Ainsi, consid
rerions-nous l'tude de M. Bachelard sur l'eau, qui fourmille d'aper
us ingnieux et profonds, comme un ensemble de suggestions,
comme une collection prcieuse de matriaux qui devraient tre
utiliss, prsent, par une psychanalyse consciente de ses principes.
Ce que l'ontologie peut apprendre l a psychanalyse, en effet, c'est
tout d'abord l'origine vraie des significations des choses et leur
relation vraie la ralit-humaine. Elle seule, en effet, peut se placer
sur l e plan de l a transcendance et saisir d'une seule vue l'tre-dans-Ie
monde avec ses deux termes, parce que, seul e, elle se place
originellement dans l a perspective du cogito. C'est encore l'ide de
facticit et celle de situation qui nous permettront de comprendre le
symbolisme existentiel des choses. Nous avons vu, en effet, qu'il est
possible thoriquement et pratiquement impossible de distinguer l a
facticit du projet qui la constitue en situation. Celte constatation doit
nous servir ici : il ne faudrait pas croire, en effet, nous l'avons vu, que
l e ceci, dans l'extriorit d'indiffrence de son tre et indpendam
ment du surgissement d'un pour-soi , ait une signification quelconque.
Certes, sa qualit, nous l'avons vu, n'est rien d'autre que son tre. Le
jaune du citron, disions-nous, n' est pas un mode subjectif d'appr
hension du citron : il est ie cilron. Nous avons montr aussi 1 que le
citron tout entier est tendu travers ses qualits et que chacune des
qualits est tendue travers les autres ; c'est ce que nous avons
nomm justement ceci. Toute qualit de l'tre est tout l'tre ; el l e est
l a prsence de son absolue contingence, el l e est son irrductibilit
d'indiffrence. Toutefois, ds notre seconde partie, nous insistions
sur l'insparabilit, dans la qualit mme, du projet et de la facticit.
Nous crivions, en effet : Pour qu' i l y ait qualit, il faut qu'il y ail de
l'tre pour un nant qui par nature ne soit pas l'tre . . . la qualit, c'est
1. Ile partie, chap. III, 3.
649
l'tre tout entier se dvoilant dans les limites du il y a. Ainsi , ds
l'origine, nous ne pouvons mettre la signification de la qualit au
compte de l't re en soi, puisqu'il faut dj le il y a c'est--dire la
mdiation nantisante du pour-soi , pour qu' i l y ait des qualits. Mais
nous comprenons facilement partir de ces remarques que la
significati on de la qualit marque son tour quelque chose comme un
renforcement du il y a ? q puisque, justement , nous prenons notre
appui sur el l e pour dpasser le il y a " vers l'tre tel qu' i l est
absolument et en soi. Dans chaque apprhension de qualit, il y a, en
ce sens, un effort mtaphysique pour chapper notre condition,
pour percer l e manchon de nant du i l y a et pour pntrer j usqu'
l'en-soi pur. Mais nous ne pouvons videmment que saisir l a qualit
comme symbole d'un tre qui nous chappe totalement, encore qu'il
soit totalement l, devant nous, c'est--dire , en somme, faire fonc
tionner l'tre rvl comme symbol e de l'tre en soi . Cela signifie
justement qu' une nouvelle structure du i l y a se constitue, qui est
la couche signi ficative, encore que cette couche se rvle dans l ' unit
absolue d' un mme projet fondamental. C'est ce que nous appelle
rons la teneur mtaphysique de toute rvlation intuitive de l'tre ; et
c'est prcisment ce que nous devrons atteindre et dvoiler par la
psychanalyse. Quelle est la teneur mtaphysique du jaune, du rouge,
du poli, du rugueux ? Quel est - question qu'on posera aprs ces
questions l ment aires - le coefficient mtaphysique du citron, de
l ' eau, de l ' hui l e, etc. ? Autant de problmes que la psychanalyse se
doit de rsoudre si ell e veut comprendre un jour pourquoi Pierre aime
l es oranges et a horreur de l'eau, pourquoi i l mange volontiers de la
tomate et refuse de manger des fves, pourquoi i l vomit s'il est forc
d'avaler des hutres ou des ufs crus.
Seul ement, nous avons montr aussi l'erreur qu'il y aurait, par
exempl e, croire que nous projetons nos dispositions affectives
sur la chose, pour l'clairer, ou la colorer. D'abord, en effet, nous
avons vu depuis l ongtemps qu'un sentiment n'est nullement une
disposition intrieure, mais un rapport objectivant et transcendant,
qui se fait apprendre par son objet ce qu'il est. Mais ce n'est pas tout :
un exemple nous montrera que l ' explication par la projection (c'est le
sens du trop fameux un paysage est un tat d' me ) est une ptition
de principe. Soit, par exempl e, cette qualit particulire qu'on
nomme l e visqueux. I l est certain qu'elle signifie pour l'adulte
europen une foule de caractres humains et moraux qui peuvent
faci l ement se rduire des relations d'tre. Une poigne de main est
visqueuse, un sourire est visqueux, une pense, un sentiment peuvent
tre visqueux. L'opi ni on commune est que j 'ai d'abord eu l ' exp
rience de certaines conduites et de certaines attitudes morales qui me
dplaisent et que je condamne ; et que, d'autre part, j'ai l ' intuition
sensible du visqueux. Par aprs j 'tablirais une liaison entre ces
650
sentiments et la viscosit, et le visqueux fonctionnerait comme
symbole de toute une classe de sentiments et d'attitudes humains,
l'aurais donc enrichi l e visqueux en projetant sur lui mon savoir
touchant cette catgorie humai ne de conduites, Mais comment
accepter cette explication par projection ? Si nous supposons que
nous avons saisi d'abord l es sentiments comme qualits psychiques
pures, comment pourrions-nous saisir l eur relation au visqueux ? Le
sentiment saisi dans sa puret qualitative ne pourra se rvler que
comme une certaine disposition purement i ntendue, blmable par
son rapport certaines valeurs et certai nes consquences ; en aucun
cas, il ne fera image si l'image n'est pas donne d' abord. Et,
d'autre part, si l e visqueux n'est pas charg originellement d'un sens
affectif, s'il ne se donne que comme une certaine qualit matri el l e,
on ne voi t pas comment i l pourrait tre jamais lu comme reprsen
tant symbol ique de certaines uni ts psychiques. En un mot, pour
tablir consciemment et clairement une relation symbolique entre l a
viscosit et la bassesse poisseuse de certains individus, i l faudrait que
nous saisissions dj l a bassesse dans l a viscosit et la viscosit dans
certaines bassesses. II s' ensuit donc que l'explication par l a projection
n'explique ri en, puisqu'elle suppose ce qu'il faudrait expliquer.
D'ailleurs, chappt-el l e cette objection de principe, ce serait pour
en rencontrer une autre, tire de l'exprience et non moins grave :
J'explication par projection i mplique en effet que le sujet projetant
soit parvenu par l'exprience et l'analyse une certaine connaissance
de la structure et des effets des attitudes qu'il nommera visqueuses.
Dans cette conception, en effet, l e recours la viscosit n'enrichit
point comme une connaissance notre exprience de la bassesse
humaine ; tout au plus sert-elle d'unit thmatique, de rubri que
image des connaissances dj acquises. D' un autre ct, l a
viscosit proprement di te et considre l'tat isol pourra nous
paratre pratiquement nuisible (parce que les substances visqueuses
collent aux mai ns, aux vtements, parce qu'elles tachent), mais non
pas rpugnante. Nous ne saurions, en effet, expliquer le dgot
qu'elle inspire que par la contamination de cette qualit physique
avec certaines qualits morales. Il devrait donc y avoir comme un
apprentissage de la valeur symbolique du visqueux. Mais l'observa
tion nous apprend que les pl us jeunes enfants tmoignent de l a
rpulsion en prsence du visqueux, comme s' i l tait dj contamin de
psychique ; el l e nous apprend aussi qu'ils comprennent, ds qu'ils
savent parler, la valeur des mots de mou ", bas ", etc. , appliqus
l a description de sentiments. Tout se passe comme si nous
surgissions dans un univers o les sentiments et les actes sont tout
chargs de matrialit, ont une toffe substantielle, sont vraiment
mous, plats, visqueux, bas, levs, etc. , et o les substances mat
rielles ont originellement une signification psychique qUi les rend
651
rpugnantes, horrifiantes, attirantes, etc. Aucune explication par
projection ou par analogie n'est ici recevabl e. Et, pour nous rsumer,
i l est impossible que nous tirions la valeur de symbole psychique du
visqueux de la qualit brute du ceci comme aussi bien que nous
projetions cette signification sur le ceci partir d'une connaisance
des attitudes psychiques considres. Comment faut-il donc concevoir
cette immense symbol i que universelle qui se traduit par nos rpu
gnances , nos haines, nos sympathies, nos attirances pour des objets
dont la matrialit devrait, par principe, demeurer non-signifiante ?
Pour fai re des progrs dans cette tude, il faut abandonner un certain
nombre de post ul ats. En particulier, nous ne devons plus postuler a
priori que l'attribution de la viscosit tel ou tel sentiment n'est
qu'une image et non une connaissance -nous devons aussi refuser
d' admettre, avant plus ample information, que c'est le psychique qui
permet d' informer symboliquement l a matire physique et qu' il y a
priorit de notre exprience de la bassesse humaine sur la saisie du
visqueux comme signifiant.
Revenons au projet originel. Il est projet d'appropriation. Il
contraint donc l e visqueux rvler son tre ; le surgissement du
pour-soi l ' tre tant appropriatif, l e visqueux peru est visqueux
possder c'est--dire que le lien origi nel de moi au visqueux est que
je projette d'tre fondement de son tre, en tant qu'i! est moi-mme
idalement. Ds l ' origine donc, i l apparat comme un possible moi
mme fonder ; ds l'origine, i l est psychi. Cela ne signifie
aucunement que je l e dote d' une me, la faon de l'animisme
primitif, ni de vertus mtaphysiques, mais seulement que sa matria
lit mme se rvle moi comme ayant une signification psychique
cette signification psychique ne faisant qu'un, d'ailleurs, avec l a
valeur symbolique qu' i l a par rapport l'tre-en-soi. Cette manire
appropriative de faire rendre au visqueux toutes ses significations peut
tre considre comme un a priori formel , encore qu'elle soit libre
projet et qu'elle s'identifi e avec l'tre du pour-soi lui-mme ; c'est
qu'en effet el l e ne dpend pas originellement de l a manire d'tre du
visqueux, mais seulement de son tre-l brut, de sa pure existence
rencontre ; elle serait semblable pour toute autre rencontre en tant
qu'elle est simple projet d'appropriation, en tant qu'elle ne se
distingue en rien du pur il y a et qu'elle est, selon qu'on l 'envisage
d'une faon ou de l 'autre, pure libert ou pur nant. Mais c'est
prcisment dans le cadre de ce projet appropriatif que le visqueux se
rvle et dveloppe sa viscosit. Cette viscosit est donc dj - ds
l'apparition premire du visqueux - rponse une demande, dj
don de soi ; l e visqueux parat comme dj l'bauche d'une fusion du
monde avec moi ; et ce qu' il m' apprend de lui , son caractre de
ven/ouse qui m'aspire, c'est dj une rplique une interrogation
concrte ; il rpond avec son tre mme, avec sa manire d'tre, avec
652
toute sa matire. Et la rponse qu' il donne est la fois pleinement
adapte la question et la fois opaque et indchiffrable car elle est
riche de toute son indicible matri al i t. Elle est claire en tant qu'elle
s'adapte exactement la question : le visqueux se laisse saisir comme
ce dont j e manque, i l se laisse palper par une enqute appropriative ;
c'est cette bauche d'appropriation qu'il laisse dcouvrir sa visco
sit. Elle est opaque parce que, prcisment, si la forme signifiante
est veille dans l e visqueux par le pour-soi, c'est avec toute sa
viscosit qu'il vient l a remplir. Il nous renvoie donc une signification
plei ne et dense et cette signification nous livre l'tre-en-soi, en tant
que le visqueux est prsentement ce qui manifeste le monde, et
l'bauche de nous-mme, en tant que l'appropriation esquisse quelque
chose comme un acte fondant du visqueux. Ce qui revient vers nous
alors, comme une qual i t objective, est une nature neuve qui n' est ni
matrielle (et physique), ni psychique, mais qui transcende l'opposi
tion du psychique et du physique en se dcouvrant nous comme
l'expression ontologique du monde tout entier, c'est--dire qui s'offre
comme rubrique pour classer tous les ceci du monde, qu'il s'agisse
d'organisations matrielles ou de transcendances transcendes. Cela
signifie que l'apprhension du visqueux comme tel a, du mme coup,
cr une manire particulire de se donner pour l'en-soi du monde,
elle symbolise l'tre sa faon, c'est--dire que tant que dure le
contact avec le visqueux, tout se passe pour nous comme si la viscosit
tait le sens du monde tout entier, c'est--dire l'unique mode d'tre
de l' tre-en-soi, la faon, dont, pour les primitifs du clan du lzard,
tous l es objets sont lzards. Quel peut tre, dans l'exemple choisi, l e
mode d'tre symbolis par le visqueux ? Je vois d'abord que c'est
l'homognit et l'imitation de l a liquidit. Une substance visqueuse,
comme la poix, est un fluide aberrant. Elle nous parat d'abord
manifester l'tre partout fuyant et partout semblable lui-mme, qui
s'chappe de toute part et sur lequel, cependant, on peut flotter,
l'tre sans danger et sans mmoire qui se change ternellement en lui
mme, sur lequel on ne marque pas et qui ne saurait marquer sur
nous, qui glisse et sur lequel on glisse, qui peut se possder par le
glissement (canot, canot automobile, ski nautique, etc. ), et qui ne
possde jamais, parce qu'il roule sur vous, l'tre qui est ternit et
temporalit infini e, parce qu' i l est changement perptuel sans ri en qui
change et qui symbolise le mieux, par cette synthse d'ternit et de
temporalit, une fusion possible du pour-soi comme pure temporalit
et de l'en-soi comme ternit pure. Mais aussitt le visqueux se rvle
essentiellement comme louche, parce que l a fluidit existe chez lui au
ralenti ; il est emptement de la liquidit, il reprsente en lui-mme
un triomphe naissant du solide sur le liquide, c'est--dire une
tendance de l'en-soi d'indiffrence, que reprsente l e pur solide,
figer la liquidit, c'est--dire absorber le pour-soi qui devrait le
653
fonder. Le visqueux est l'agonie de l'eau ; il se donne lui-mme
comme un phnomne en devenir, i l n' a pas la permanence dans le
changement de l 'eau, mais au contraire . i l reprsente comme une
coupe opre dans un changement d'tat . Cette instabilit fige du
visqueux dcourage la possession. L'eau est plus fuyante, mais on
peut la possder dans sa fuite mme, en tant que fuyante. Le visqueux
fuit d' une fuite paisse qui ressemble celle de l'eau comme le vol
lourd et ras de terre de la poule ressemble celui de l'pervier. Et
cette fuite mme ne peut tre possde car elle se nie en tant que
fuite. Elle est presque, dj, une permanence solide. Rien ne
tmoigne mieux de ce caractre louche de substance entre deux
que la l enteur avec laquelle le visqueux se fond avec lui
mme : une goutte d' eau touchant la surface d'une nappe d'eau est
instantanment t ransmue en nappe d'eau ; nous ne saisissons pas
l'op
ration comme une absorption quasi buccale de la goutte par la
nappe, mais plutt comme une spiritualisation et une dsindividuali
sation d'un tre singulier qui se dissout de soi-mme dans le grand
tout
dont il est issu. Le symbole de la nappe d'eau semble jouer un
rle trs important dans l a constitution des schmes panthistiques ; il
rvle un type particulier de rapport de l'tre l'tre. Mais si nous
considrons le visqueux, nous constatons (bien qu'il ait conserv
mystrieusement toUle l a fluidit, au ralenti ; il ne faut pas l e
confondre avec l es pures o l a fluidit, bauche, subit de brusques
cassages, de brusques stoppages, et o la substance, aprs une
bauche de coulage, boule brusquement cul par-dessus tte) qu'il
prsente une hystrsis constante dans le phnomne de l a transmuta
tion en soi-mme : le miel qui coule de ma cuiller sur le miel contenu
dans l e pot commence par sculpter la surface, i l se dtache sur elle en
relief et sa fusion au tout se prsente comme un affaissement, un
ravalement qui apparat l a fois comme un dgonflage (qu'on songe
l'i mportance pour les sensibilits enfantines du bonhomme de bau
druche qu' on souffle comme le verre et qui se dgonfle en laissant
chapper un lamentable gmissement) et comme l'talement, le
raplatissement des seins un peu mrs d'une femme qui s'tend sur le
dos. Il y a, en effet , dans ce visqueux qui se fond en lui-mme, l a fois
une rsistance visible, comme un refus de l'individu qui ne veut pas
s'ana
ntir dans le tout de l'tre, et , en mme temps, une mollesse
pousse son extrme consquence : car le mou n'est pas autre chose
qu' un anantissement qui s'arrte mi-chemin ; le mou est ce qui
nous renvoie le mieux l'image de notre propre puissance destructrice
et de ses limites. La lenteur de la di sparition de la goutte visqueuse au
sein du tout est prise d'abord en mollesse, puisque c'est comme un
anantissement retard et qui semble chercher gagner du temps ;
mais cette mollesse va jusqu'au bout : la goutte s'enlise dans la nappe
de visqueux. De ce phnomne vont natre plusieurs caractres du
654
visqueux : d'abord c'est qu' il est mou au contact. Jetez de l'eau sur l e
sol : eI l e coule. Jetez une substance visqueuse : elle s'tire, ell e
s'tale, elle s'aplatit, elle est molle ; touchez le visqueux, il ne fuit
pas : il cde. Il y a dans l'insaisissabilit mme de l ' eau une duret
impitoyable qui lui donne un sens secret de mtal : finalement elle est
incompressible comme l'acier. Le visqueux est compressibl e. Il donne
donc d'abord l' impression d'un tre qu' on peut possder. Double
ment : sa viscosit, son adhrence soi l'empche de fuir, je puis
donc le prendre dans mes mains, sparer une certaine quantit de
miel ou de poix du reste du pot et, par l, crer un objet individuel par
une cration continue ; mais, en mme temps, [a mollesse de cette
substance, qui s'crabouille dans mes mains, me donne l' impression
que je dtruis perptuellement. Il y a bien l l'image d'une destruc
tion-crati on. Le visqueux est docile. Seulement, au moment mme
o je crois le possder, voil que, par un curieux renversement, c'est
lui qui me possde. C'est l qu'apparat son caractre essentiel : sa
mollesse fait ventouse. L'objet que je tiens dans ma main, s'il est
solide, j e peux le lcher quand il me plat ; son inertie symbolise pour
moi mon entire puissance : je le fonde, mais i l ne me fonde point ;
c'est le pour-soi qui ramasse en lui-mme l'en-soi et qui l'lve
jusqu' l a dignit d'en-soi, sans se compromettre, en restant toujours
puissance assimilante et cratrice ; c'est le pour-soi qui absorbe l'en
soi. Autrement dit, la possession affirme la primaut du pour-soi dans
l'tre synthtique En-soi-Pour-soi . Mais voici que le visqueux
renverse les termes : le pour-soi est soudain compromis. J' carte les
mains, je veux lcher l e visqueux et il adhre moi , il me pompe, il
m'aspire ; son mode d'tre n'est ni l'inertie rassurante du solide, ni un
dynamisme comme celui de ['eau qui s'puise me fuir : c'est une
activit molle, baveuse et fminine d'aspiration, il vit obscurment
sous mes doigts et je sens comme un vertige, il m'attire en lui comme
le fond d'un prcipice pourrait m'attirer. Il y a comme une fascination
tactile du visqueux. Je ne suis plus le matre d'arrter le processus
d'appropriation. Il continue. En un sens, c'est comme une docilit
suprme du possd, une fidlit de chien qui se donne, mme quand
on ne veut plus de lui, et en un autre sens, c'est, sous cette docilit,
une sournoise appropriation du possdant par le possd . On voit ici
le symbole qui se dcouvre brusquement : il y a des possessions
vnneuses ; il Y a possi bilit que l'en-soi absorbe le pour-soi ; c'est-
dire qu' un tre se constitue l ' inverse de l' En-soi-Pour-soi , o
l'en-soi attirerait le pour-soi dans sa contingence, dans son extriorit
d'indiffrence, dans son existence sans fondement. A cet instant, j e
saisis tout coup le pige du visqueux : c'est une fluidit qui me
retient et qui me compromet, j e ne puis glisser sur l e visqueux, toutes
ses ventouses me retiennent, i[ ne peut glisser sur moi : i l s'accroche
comme une sangsue. Le glissement pourtant n'est pas simplement ni
655
comme par le solide, il est dgrad : le visqueux semble s'y prter, i l
m' y invite, car une nappe de visqueux au repos n'est pas sensiblement
distincte d' une nappe de liquide trs dense ; seulement c'est une
attrape : le glissement est suc par la substance glissante, et il laisse
sur moi des traces. Le visqueux apparait comme un liquide vu dans un
cauchemar et dont toutes les proprits s'animeraient d'une sorte de
vie et se retourneraient contre moi . Le visqueux, c'est l a revanche de
l'en-soi . Revanche doucetre et fminine qui se symbolisera sur un
autre plan par la qualit de sucr. C'est pourquoi le sucr comme
douceur au got - douceur indlbile, qui demeure indfiniment
dans l a bouche et survit l a dglutition - complte parfaitement
l'essence du visqueux. Le visqueux sucr est l'idal du visqueux ; il
symbolise l a mort sucre du pour-soi (la gupe qui s'enfonce dans la
confiture et s' y noie) . Mais, en mme temps, le visqueux c'est moi, du
seul fait que j 'ai bauch une appropriation de la substance vis
queuse. Cette succion du visqueux que je sens sur mes mains bauche
comme une continuit de la substance visqueuse moi-mme. Ces
longues et molles colonnes de substance qui tombent de moi jusqu'
la nappe visqueuse (lorsque, par exemple, aprs y avoir plong ma
main, je l' en arrache) symbolisent comme une coule de moi-mme
vers le visqueux. Et l ' hystrsis que j e constate dans la fusion de l a
base de ces colonnes, avec la nappe, symbolise comme la rsistance
de mon tre l 'absorption de l'en-soi. Si j' enfonce dans l'eau, si j ' y
plonge, si j e m' y laisse couler, j e ne ressens aucune gne car je n' ai ,
aucun degr, la crainte de m'y diluer : je demeure un solide dans sa
fluidit . Si j 'enfonce dans le visqueux, j e sens que j e vais m' y perdre,
c'est--dire me diluer en visqueux, prcisment parce que le visqueux
est en instance de solidification. Le pteu prsenterait le mme
aspect que le visqueux, de ce point de vue, mais i l ne fascine pas, i l ne
t;ompromet pas, parce qu' il est i nerte. I l y a, dans l'apprhension
mme du visqueux, substance collante, compromettante et sans
qui l i bre , comme la hantise d' une mtamorphose Toucher du
visqueux, c'est risquer de se diluer en viscosit.
Or, cette dilution, par elle-mme est dj effrayante, parce qu'elle
est absorption du pour-soi par l' en-soi comme de l'encre par un
buvard. Mais, en outre, il est effrayant, tant faire que de se
mtamorphoser en chose, que cc soit prcisment une mtamorphose
en visqueux. Si mme j e pouvais concevoir une li qufaction de moi
mme, c'est--dire une transformation de mon tre en eau, je n'en
serais pas outre mesure affect, car l'eau est le symbole de l a
conscience ' son mouvement, sa fluidit, cette solidarit non solidaire
de son tre, sa fuite perptuell e, etc. , tout en elle me rappelle le pour
soi ; au point que les premiers psychologues qui ont marqu l e
caractre de dure de l a conscience (James, Bergson) l'ont trs
frquemment compare un fleuve. C'est le fleuve qui voque le
656
mieux l ' i mage de l'interpntration constante des parties d'un tout et
de leur perptuelle dissociabilit, disponibilit. Mais l e visqueux
offre une i mage horrible : il est horrible en soi de devenir visqueuse
pour une conscience. C'est que l'tre du visqueux est adhrence
molle et , par ventouses de toutes ses parties, solidarit et complicit
sournoise de chacune avec chacune , effort vague et mou de chacune
pour s'individualiser, que suit une retombe, un aplatissement vid
de l'indivi du, suc de toute part par la substance. Une conscience
qui deviendrait visqueuse se transformerait donc par emptement de
ses ides. Nous l'avons ds notre surgissement dans l e monde, cette
hantise d' une conscience qui voudrait s'lancer vers l e futur, vers
un projet de soi et qui se sentirait, dans le moment mme o elle
aurait conscience d' y parvenir, retenue sournoisement, invisiblement
par la succion du pass et qui devrait assister sa lente dilution
dans ce pass qu'el l e fuit, l'invasion de son projet par mille
parasites j usqu' ce qu'enfin el l e se perde compltement elle-mme.
De cette horrible condition, l e vol de l a pense des psychoses
d'influence nous donne la meilleure image. Mais qu' est-ce donc
que traduit cette crainte, sur l e pl an ontologique, sinon juste
ment la fuite du pour-soi devant l ' en-soi de la facticit, c'est--dire
justement la temporalisation ? L'horreur du visqueux c'est l'hor
reur que le temps ne devienne visqueux, que la facticit ne pro
gresse continment et insensiblement et n'aspire le pour-soi qui
l'existe . C'est l a crainte non de l a mort, non de l'en-soi pur, non
du nant, mais d'un type d'tre particulier, qui n'existe pas plus que
l'en-soi-pour-soi et qui est seulement reprsent par l e visqueux. Un
tre idal que j e rprouve de toutes mes forces et qui me hante
comme l a valeur me hante dans mon tre : un tre idal o l'en-soi
non fond a priorit sur l e pour-soi et que nous nommerons une
aJJlivaleur.
Ainsi, dans l e projet appropriatif du visqueux, la viscosit se rvle
soudain comme symhole d'une antivaleur, c'est--dire d'un type
d'tre non ralis, mais menaant , qui va hanter perptuellement la
conscience comme l e danger constant qu' el l e fuit et , de ce fait,
transforme soudain le projet d'appropriation en projet de fuite.
Quel que chose est apparu qui ne rsulte d'aucune exprience
antrieure, mais seulement de la comprhension prontologique de
l'en-soi et du pour-soi et qui est proprement le sens du visqueux. En
un sens, c'est une exprience, puisque la viscosit est une dcouverte
intuitive ; et, en un autre sens, c'est comme l 'invention d'une aventure
de l'tre. A partir de l apparat pour l e pour-soi un certain danger
neuf, un mode d'tre menaant et viter, une catgorie concrte
qu'il retrouvera partou'. Le visqueux ne symbolise aucune conduite
psychique, a priori : il manifeste une certaine relation de l'tre avec
lui-mme et cette relation est originellement Dsychise parce que ie
657
l ' ai dcouverte dans une bauche d'appropriation et que la viscosit
m'a renvoy mon image. Ainsi suis-je enrichi , ds mon premier
contact avec le visqueux, d'un schme ontologique valable, par del
la distinction du psychique et du non-psychique, pour interprter
le sens d'tre de tous les existants d'une certaine catgorie, cette
catgorie surgissant d'ailleurs comme un cadre vide avant l'exp
rience des diffrentes espces de visqueux. Je l'ai jete dans l e
monde par mon projet originel en face du visqueux, el l e est une
structure objective du monde en mme temps qu'une antivaleur,
c'est--dire qu' el l e dtermine un secteur o viendront se ranger
les objets visqueux. Ds lors, chaque fois qu' un objet manifestera
pour moi ce rapport d'tre, qu'il s'agisse d' une poigne de main,
d'un sourire ou d' une pense, il sera par dfinition saisi comme
visqueux, c'est--dire que, par del sa contexture phnomnale, il
m'apparatra comme constituant, en unit avec les poix, les colles,
les miels, etc . , le grand secteur ontologique de la viscosit. Et,
rciproquement, dans l a mesure o l e ceci que je veux m'approprier
reprsente l e monde entier, le visqueux, ds mon premier contact
intuitif, m'apparat riche d'une foule de significations obscures et de
renvois qui le dpassent. Le visqueux se dcouvre de lui-mme
comme beaucoup plus que le visqueux ds son apparition i l
transcende toutes distinctions entre psychi que et physique, entre
l'existant brut et l es significations du monde : i l est un sens possible
de l'tre. La premire exprience que l'enfant peut faire du visqueux
l 'enrichit donc psychologiquement et moralement : i l n'aura pas
besoin d'attendre l'ge d'homme pour dcouvrir le genre de bassesse
agglutinante que l ' on nomme, au figur, visqueux el l e est l ,
auprs de l ui , dans l a viscosit mme du miel ou de l a glu. Ce que
nous disons du visqueux vaut pour tous les objets qui entourent
l' enfant : la simpl e rvlation de leur matire tend son horizon
jusqu'aux extrmes limites de l'tre et le dote, du mme coup, d'un
ensemble de cls pour dchiffrer l'tre de tous les faits humains.
Cela ne signifie point qu' il connaisse l'origine les laideurs de l a
vi e, l es caractres , ou, au contraire, les beauts , de l'exis
tence. Simpl ement il est en possession de tous les sens d'tre dont
laideurs et beauts, conduites, traits psychiques, relations sexuelles,
etc. , ne seront jamai s que des exemplifications particulires. Le
gluant, le pteux, le vaporeux, etc. , les trous de sable et de terre, les
cavernes, la l umire, l a nuit, etc. , l ui rvlent des modes d'tre
prpsychiques et prsexuels, qu'il passera sa vie, par la suite,
expliciter. I l n' y a pas d'enfant innocent . En particulier, nous
reconnatrons volontiers, avec les freudiens, les innombrables rela
tions que certaines matires et certaines formes qui entourent les
enfants entretiennent avec la sexualit. Mais nous n'entendons pas
par l qu'un instinct sexuel, dj constitu, les a charges de
658
signification sexuel l e. Il nous parat , au contraire, que ces matires
et ces formes sont saisies pour elles-mmes et qu' elles dcouvrent
l'enfant des modes d'tre et des relations l' tre du pour-soi qui
vont claircir et faonner sa sexualit. Pour ne citer qu'un exemple,
beaucoup de psychanalystes ont t frapps de l'attirance qu'exer
aient sur l' enfant toutes les espces de trous (trous dans l e sable,
dans la terre, grottes, cavernes, anfractuosits), et ils ont expliqu
cette attirance soit par le caractre anal de la sexualit enfantine,
soit par l e choc prnatal, soit mme par un pressentiment de l'acte
sexuel proprement dit. Nous ne saurions retenir aucune de ces
explications : celle du traumatisme de la naissance est hautement
fantaisiste. Celle qui assi mile le trou l'organe sexuel fminin
suppose chez l ' enfant une exprience qu'il ne saurait avoir ou un
pressentiment qu' on ne peut justifier. Quant la sexualit anale
de l'enfant, nous ne songeons pas la ni er, mais pour qu'elle vienne
clairer et charger de symbole les trous qu'il rencontre dans l e
champ perceptif, i l faudrait que l ' enfant saisisse son anus comme un
trou ; mieux, i l faudrait que la saisie de l ' essence du trou, de
l'orifice, corresponde la sensation qu' i l a de son anus. Mais nous
avons assez montr le caractre subjectif du corps-pour-moi " pour
que l'on comprenne l'impossibilit o est l'enfant de saisir une partie
quelconque de son corps comme structure objective de l ' univers.
C'est pour autrui que l'anus apparat comme orifice. Il ne saurait
tre vcu comme tel ; mme les soins intimes que la mre donne
l'enfant ne sauraient le dcouvrir sous cet aspect, puisque l'anus,
zone rogne, zone de douleur, n'est pas pourvu de terminaisons
nerveuses tactil es. C'est, au contraire, par autrui -par les mots que
la mre emploie pour dsigner le corps de l ' enfant - que celui-ci
apprend que son anus est un trou. C'est donc la nature objective du
trou peru dans l e monde qui va clairer pour lui la structure
objective et l e sens de la zone anal e, c'est el l e qui va donner un sens
transcendant aux sensations rognes qu' i l se bornait jusque-l
exister . Or, en lui-mme, le trou est le symbole d'un mode d'tre
que la psychanalyse existentielle se doit d'claircir. Nous ne pouvons
y insister i ci . On voit tout de suite, cependant, quI se prsente
originel l ement comme un nant avec ma propre
chair : l'enfant ne peut se tenir de mettre son doigt ou son bras
entier dans le trou. Il me prsente donc l'image vide de moi-mme ;
je n'ai qu' m' y couler pour me faire exister dans le monde qui
m'attend. L'idal du trou est donc l ' excavation qui se moulera
soigneusement sur ma chair, de manire que, en m'y gnant et en
m' y adaptant troitement, je contribuerai faire exister le plein
d'tre dans l e monde. Ainsi, boucher l e trou, c'est originellement
faire l e sacrifice de mon corps pour que la plnitude d'tre existe,
c'est--dire subir la passion du pour-soi pour faonner, parfaire et
659
sauver la totalit de l'en-soi 1. Nous saisissons l, son origine, une
des tendances les plus fondamentales de la ralit-humaine : la
tendance remplir. Nous retrouverons cette tendance chez l'adoles
cent et chez l ' adulte ; une bonne partie de notre vie se passe boucher
les trous, remplir les vides, raliser et fonder symboliquement le
pl ei n. L'enfant reconnat, partir de ses premires expriences, qu'il
est lui-mme trou. Lorsqu' i l se met le doigt dans l a bouche, i l tente
de murer les trous de son visage, il attend que le doigt se fonde avec
les lvres et l e palais et bouche l'orifice buccal, comme on bouche
avec du ci ment l a lzarde d'un mur, il recherche la densit, la
plnitude uni forme et sphrique de l'tre parmnidien ; et s'i! suce
son doigt, c'est prcisment pour le diluer, pour le transformer en une
pte collante qui obturera le trou de sa bouche. Cette tendance est
certainement une des plus fondamentales parmi celles qui servent de
soubassement l'acte de manger : l a nourriture c'est le mastic qui
obturera l a bouche ; manger, c'est, entre autres choses, se boucher.
C'est seul ement partir de l que nous pouvons passer l a sexualit ;
l'obscnit du sexe fminin est celle de toute chose bante ; c'est un
appel d' tre, comme d'ailleurs tous les trous ; en soi la femme appelle
une chair trangre qui doive l a transformer en plnitude d'tre par
pntration et dilution. Et inversement la femme sent sa condition
comme un appel, prcisment parce qu'elle est troue . C'est la
vritable origine du complexe adlrien. Sans aucun doute le sexe est
bouche, et bouche vorace qui avale le pnis - ce qui peut bien
amener l'ide de castrati on : l'acte amoureux est castration de
l ' homme -mais c'est avant tout que le sexe est trou. Il s'agit donc ici
d'un apport prsexuel qui deviendra une des composantes de la
sexualit comme attitude humaine empirique et complexe, mais qui ,
loin de ti rer son origine de l'tre-sexu , n' a ri en de commun avec l a
sexualit fondamentale dont nous avons expliqu l a nature au
l i vre I I I . I l n' en demeure pas moins que l'exprience du trou, lorsque
l'enfant voi t l a rali t, enveloppe le pressentiment ontologique de
l'exprience sexuelle en gnral ; c'est avec sa chair que l'enfant
bouche l e trou, et le trou, avant toute spcification sexuelle, est une
attente obscne, un appel de chair.
On saisi t l 'i mportance que revtira, pour l a psychanalyse existen
tielle, l ' lucidation de ces catgories existentielles, i mmdiates et
concrtes. Nous saisissons, partir de l, des projets trs gnraux de
l a ral i t-humai ne. Mais ce qui intresse le psychanalyste au premier
chef, c'est de dterminer le projet libre de la personne singulire
partir de la relation individuelle qui l'unit ces diffrents symboles de
l'tre, Je pui s ai mer les contacts visqueux, avoir horreur des trous,
1. Il faudrait noter aussi l'importance de l a tendance inverse, l a tendance
percer des trous, qui demanderait elle seule une analyse existentielle.
660
etc. Cela ne signifie point que le visqueux, le graisseux, le trou, etc. ,
aient perdu pour moi leur signification ontologique gnrale, mais, au
contraire, que, cause de cette significati on, j e me dtermine de telle
ou telle manire par rapport eux. Si l e visqueux est bien le symbole
d'un tre o le pour-soi est bu par l ' en-soi, que suis-je donc moi qui ,
l' encontre des autres, aime le visqueux ? A quel projet fondamental
de moi-mme suis-je renvoy si je veux expliciter cet amour d'un en
soi enlisant et louche ? Ai nsi , les gots ne restent pas des donnes
irrductibles ; si on sait les interroger, ils nous rvlent les projets
fondamentaux de l a personne. II n' est pas jusqu'aux prfrences
alimentaires qui n'aient un sens. On s'en rendra compte si l'on veut
bien rflchir que chaque got se prsente , non comme un datum
absurde qu'on devrait excuser, mais comme une valeur vidente. Si
j' aime le got de rail, il me parat irrationnel que d'autres puissent ne
pas l ' aimer. Manger, en effet, c' est s'approprier par destruction, c'est
en mme temps se boucher avec un certain tre. Et cet tre est donn
comme une synthse de temprature, de densit et de saveur
proprement dite. En un mot, cette synthse signifie un certain tre ; et
lorsque nous mangeons, nous ne nous bornons pas, par l e got,
connatre certaines qualits de cet tre ; en l es gotant, nous nous l es
approprions. Le got est assimilation ; la dent rvl e, par l ' acte mme
de broyer, l a densit du corps qu' el l e transforme en bol alimentaire.
Aussi l ' i ntuition synthtique de l'aliment est-elle en elle-mme
destruction assimilatrice. Elle me rvle l'tre avec lequel je vais faire
ma chair. Ds lors, ce que j 'accepte ou que je rejette avec dgot,
c'est l'tre mme de cet existant, ou, si l'on prfre, la totalit de
l'aliment me propose un certain mode d'tre de l'tre que j'accepte ou
que je refuse. Cette totalit est organise comme une forme, dans
laquelle les qualits de densit et de temprature, plus sourdes,
s'effacent derrire la saveur proprement dite qui les exprime. Le
sucr par exemple exprime le visqueux, lorsque nous mangeons
une cuillere de miel ou de mlasse, comme une fonction analytique
exprime une courbe gomtrique. Cela signifie que toutes l es qualits
qui ne sont pas la saveur proprement dite, ramasses, fondues,
enfonces dans la saveur, reprsentent comme la matire de la saveur.
(Ce biscuit au chocolat qui rsiste d'abord sous l a dent, puis qui cde
brusquement et s' effrite, sa rsistance, puis son effritement sont
chocolat . ) El l es s'unissent , d' ai l l eurs, certaines caractristiques
temporelles de l a saveur, c' est--dire son mode de temporalisation.
Certains gots se donnent d'un coup, d'autres sont comme des fuses
retardement, d'autres se livrent par paliers, certains s'amenuisent
lentement jusqu' disparatre, et d' autres s'vanouissent au moment
mme o l'on croit s'en emparer. Ces qualits s'organisent avec la
densit et l a temprature ; el l es expriment, en outre, sur un autre plan
l'aspect visuel de l'aliment. Si je mange un gteau rose, l e got en est
661
rose ; le l ger parfum sucr et l'onctuosit de la crme au beurre sont
le rose. Ainsi je mange rose comme je vois sucr. On comprend que
la saveur , de ce fait, reoive une architecture complexe et une matire
diffrencie ; c'est cette matire structure -qui nous apprsente un
type d' tre singulier - que nous pouvons assimiler ou rejeter avec
des nauses, selon notre projet originel. Il n'est donc nullement
indiffrent d'aimer les hutres ou les palourdes, les escargots ou les
crevettes , pour peu que nous sachions dmler l a signification
existentielle de ces nourritures. D'une faon gnrale il n'y a pas de
got ou d'inclination irrducti bl e. Ils reprsentent tous un certain
choix appropriatif de l ' tre. C'est la psychanalyse existentielle de les
comparer et de les classer. L'ontologie nous abandonne ici : elle nous
a simplement permis de dterminer les fins dernires de la ralit
humaine , ses possibles fondamentaux et la valeur qui la hante.
Chaque ralit- humaine est l a fois projet direct de mtamorphoser
son propre pour-soi en en-soi-pour-soi et projet d'appropriation du
monde comme totalit d'tre-en-soi, sous les espces d' une qualit
fondamentale. Toute ralit-humaine est une passion, en ce qu'elle
projette de se perdre pour fonder l'tre et pour constituer du mme
coup l' en-soi qui chappe l a contingence en tant son propre
fondement, l ' Ens causa sui que les religions nomment Dieu. Ainsi la
passion de l'homme est-elle inverse de celle du Christ, car l'homme se
perd en tant qu'homme pour que Dieu naisse. Mais l'ide de Dieu est
contradictoire et nous nous perdons en vain ; l'homme est une passion
inutil e.
CONCLUS I ON
EN SOI ET POUR SOI : APERUS MTAPHYS I OUES
II nous est, prsent, permis de conclure. Nous aVIOns, ds notre
introduction, dcouvert l a conscience comme un appel d'tre et nous
avions montr que le cogito renvoyait immdiatement un tre-en-soi
oDjel de la conscience. Mais aprs description de l'en-soi et du pour
soi , il nous avait paru difficile d'tablir un lien entre eux et nous
avions craint de tomber dan un dualisme insurmontable. Cc dua
lisme nous menaait encore d'une autre faon : dans l a mesure, en
effet, o l'on pouvait dire du pour-soi qu'il tait, nous nous trouvions
en face de deux modes d'tre radicalement distincts, celui du pour-soi
qui a tre ce qu' il est, c'est--dire qui est ce qu'il n'est pas et qui
n' est pas ce qu' il est, et celui de l' en-soi qui est ce qu'il est. Nous nous
sommes demand alors si la dcouverte de ces deux types d'tre
n' aboutissait pas tahlir un hiatus scindant l'Etre, comme catgorie
gnrale appartenant a tous les existants, en deux rgions incommuni
c3bles et dans chacune desquelles la notion d'Etre devait tre prise
dans une acception originale et singulire.
Nos recherches nous ont permis de rpondre l a premire de ces
questions : le pour-soi et l'en-soi sont runis par une liaison synthti
que qui n'est autre que le pour-soi lui-mme. Le pour-soi, en effet,
n'est pas autre chose que la pure nantisation de l ' en-soi , l est
comme un trou d'tre au sein de l'Etre. On connat cette plaisante
fiction par quoi certains vulgarisateurs ont coutume d'illustrer le
principe de conservation de l'nergie : s'il arrivait , disent-ils, qu'un
seul des atomes qui constituent l ' univers ft ananti , i l en rsulteraIt
une catastrophe qui s'tendrait l ' univers entier et ce serait, en
665
particul ier, la fin de l a Terre et du systme stellaire. Cette image peut
nous servir ici : le pour-soi apparat comme une menue nantisation
qui prend son origine au sein de l'tre ; et il suffit de cette nantisation
pour qu' un boul eversement total arrive l'en-soi. Ce bouleverse
ment, c'est le monde. Le pour-soi n'a d'autre ralit que d'tre la
nantisation de l'tre. Sa seule qualification l ui vient de ce qu' il est
nantisation de l ' en-soi individuel et singulier et non d'un tre en
gnral. Le pour-soi n'est pas le nant en gnral mais une privation
singulire ; il se constitue en privation de cet tre-ci. Nous n'avons
donc pas lieu de nous interroger sur l a manire dont l e pour-soi peut
s'unir l ' en-soi puisque le pour-soi n'est aucunement une substance
autonome. En tant que nantisation, il est t par l'en-soi ; en tant que
ngation interne, i l se fait annoncer par l'en-soi ce qu'il n'est pas, et,
consquemment, ce qu' il a tre. Si l e cogito conduit ncessairement
hors de soi, si la conscience est une pente glissante sur laquelle on ne
peut s'installer sans se trouver aussitt dvers dehors sur l'tre-en
soi, c'est qu' el l e n'a par elle-mme aucune suffisance d'tre comme
subjectivit absolue, elle renvoie d'abord la chose. Il n'y a pas d'tre
pour l a conscience en dehors de cette obligation prcise d'tre
intuition rvlante de quelque chose. Qu'est-ce dire, sinon que l a
conscience est l'Autre platonicien ? On connat les belles descriptions
que l ' Etranger du Sophiste donne de cet autre, qui ne peut tre saisi
que comme en un rve qui n'a d'tre que son tre-autre, c'est-
dire qui ne joui t que d'un tre emprunt, qui , considr en lui-mme,
s'vanouit et ne reprend une existence marginale que si l'on fixe ses
regards sur l ' tre, qui s'puise tre autre que lui-mme et autre que
l'tre. Il semble mme que Platon ait vu l e caractre dynamique que
prsentait l'altrit de l'autre par rapport lui-mme, puisque, dans
certains textes, il y voit l'origine du mouvement. Mais il pouvait
pousser plus l oi n encore : il aurait vu alors que l'autre ou non-tre
relatif ne pouvai t avoir un semblant d'existence qu' titre de
conscience. Etre autre que l'tre, c'est tre conscience (de) soi dans
l'unit des ek-stases temporalisantes. Et que peut tre, en effet,
l
'altrit, sinon l e chass-crois de reflt et de refltant que nous
avons dcrit au sein du pour-soi, car la seule faon dont l'autre puisse
exister comme autre, c'est d'tre conscience (d') tre autre. L'altrit
est, en effet, ngation interne et seule une conscience peut se
constituer comme ngation interne. Toute autre conception de
l ' altrit reviendrait l a poser comme en-soi, c'est--dire tablir
entre elle et l ' tre une relation externe, ce qui ncessiterait la
prsence d' un tmoin pour constater que l 'autre est autre que l'en-soi.
Et , d'autre part, l'autre ne saurait tre autre sans maner de l'tre ; en
cel a, il est relatif l'en-soi, mais i l ne saurait non plus tre autre sans
se faire autre, sinon son altrit deviendrait un donn, donc un tre
susceptible d'tre considr en-sol. En tant qu' il est relatif l'en-soi,
666
l'autre est affect de facticit ; en tant qu'il se fait lui-mme, il est un
absolu. C'est ce que nous avons marqu lorsque nous disions que le
pour-soi n'est pas fondement de son tre-comme-nant-d'tre, mais
qu'il fonde perptuellement son nant-d'tre. Ainsi , le pour-soi est un
absolu unselbststandig ce que nous avons appel un absolu non
substantiel. Sa ralit est purement interrogative. S'il peut poser des
questions, c'est que lui-mme est touj ours en question ; son tre n'est
jamais donn, mais interrog, puisqu'il est toujours spar de lui
mme par le nant de l'altrit ; le pour-soi est toujours en suspens
parce que son tre est un perptuel sursis. S'il pouvait jamais le
rejoindre, l'altrit disparatrait du mme coup et, avec elle, les
possibles, l a connaissance, le monde. Ainsi , l e problme ontologique
de la connaissance est rsolu par l'affirmation de la primaut
ontologique de l'en-soi sur le pour-soi. Mais c'est pour faire natre
aussitt une interrogation mtaphysique. Le surgissement du pour-soi
partir de l'en-soi n'est, en effet, aucunement comparable la gense
dialectique de l'Autre platonicien partir de l'tre. Etre et autre sont,
en effet , pour Platon, des genres. Mais nous avons vu, au contraire,
que l ' tre est une aventure indivi duelle. Et, pareillement, l'apparition
du pour-soi est l'vnement absolu qui vient l ' tre. Il y a donc place
ici pour un problme mtaphysique qui pourrait se formuler ainsi :
Pourquoi le pour-soi surgit-il partir de l'tre ? Nous appelons
mtaphysique, en effet, l'tude des processus individuels qui ont
donn naissance ce monde-ci comme totalit concrte et singulire.
En ce sens, la mtaphysique est l'ontologie comme l'histoire la
sociologie. Nous avons vu qu'il serait absurde de se demander
pourquoi l'tre est, outre que la question ne saurait avoir de sens que
dans les limites d'un pour-soi et qu'elle suppose mme la priorit
ontologique du nant sur l'tre, alors que nous avons dmontr la
primaut de l'tre sur le nant ; elle ne saurait se poser que par suite
d'une contamination avec une question extrieurement analogue et
pourtant fort diffrente : Pourquoi est-ce qu'il y a de l'tre ? Mais
nous savons prsent qu'il faut distinguer avec soin ces deux
questions. La premire est dpourvue de sens : tous les pourquoi ,
en effet, sont postrieurs l'tre et l e supposent . L'tre est, sans
raison, sans cause et sans ncessit ; la dfinition mme de l'tre nous
livre sa contingence originelle. A la seconde, nous avons dj
rpondu, car elle ne se pose pas sur le terrain mtaphysique, mais sur
celui de l'ontologie : Il y a de l'tre parce que l e pour-soi est tel
qu'il y ait de l'tre. Le caractre de phnomne vient l'tre par le
pour-soi . Mais si les questions sur l'origine de l'tre ou sur l'origine du
monde sont dpourvues de sens ou reoivent une rponse dans le
secteur mme de l 'ontologie, il n' en est pas de mme pour l ' origine du
pour-soi . Le pour-soi est tel, en effet, qu'il a le droit de se retourner
,ur sa propre origine. L'tre par qui l e pourquoi arrive dans l'tre a le
667
droit de poser son propre pourquoi, puisqu'il est lui-mme une
interrogation, un pourquoi. A cette question, l'ontologie ne saurait
rpondre, car il s'agit ici d'expliquer un vnement, non de dcrire les
structures d'un tre. Tout au plus peut-elle faire remarquer que l e
nant qui est t par l ' en-soi n'est pas un si mpl e vi de dpourvu de
significat ion. Le sens du nant de l a nantisation, c'est d'tre t pour
fonder l'tre. L'ontologie nous fournit deux renseignements qui
peuvent servir de base la mtaphysique : c'est, d'abord, que tout
processus de fondement de soi est rupture de l'tre-identique de l'en
soi , recul de l'tre par rapport lui-mme et apparition de l a prsence
soi ou conscience. C'est seulement en se faisant pour-soi que l'tre
pourrait aspirer tre cause de soi. La conscience comme nantisa
tion de l 'tre apparat donc comme un stade d'une progression vers
l ' immanence de la causalit, c'est--dire vers l'tre cause de soi.
Seulement l a progression s'arrte l par suite de l'insuffisance d'tre
du pour-soi. La temporalisation de la conscience n'est pas un progrs
ascendant vers la dignit de causa sui , c'est un coulement de
surface dont l'origine est, au contraire, l'impossibilit d'tre cause de
soi. Aussi l'ens causa sui demeure comme l e manqu, l'indication d'un
dpassement i mpossible en hauteur qui conditionne, par sa non
existence mme, l e mouvement plan de la conscience ; ainsi l'attrac
tion verticale que la lune exerce sur l'ocan a pour effet l e
dplacement horizontal qu'est la mare. L'autre indication que l a
mtaphysique peut puiser dans l'ontologie, c' est que l e pour-soi est
efectivement perptuel projet de se fonder soi-mme en tant qu'tre
et perptuel chec de ce projet. La prsence soi avec les diffrentes
directions de sa nantisation (nantisation ek-statique des trois
dimensions temporelles, nantisation gmelle du couple reflt
refltant) reprsente l e premier surgissement de ce projet ; la
rfexion reprsente l e redoublement du projet qui se retourne sur
lui-mme pour se fonder au moins en tant que projet et l'aggravation
du hiatus nantisant par l'chec de ce projet lui-mme ; le faire et
[
'avoir ", catgories cardinales de la ralit-humaine, se rduisent
i mmdiatement ou mdiatement au projet d'tre ; enfin, l a pl uralit
des uns et des autres peut s'interprter comme une dernire tentative
pour se fonder, aboutissant l a sparation radicale de l'tre et de la
conscience d'tre.
Ainsi l'ontologie nous apprend : 1 que si l 'en-soi devait se fonder,
il ne pourrait mme le tenter qu'en se faisant conscience, c'est--dire
que le concept de causa sui emporte en soi celui de prsence soi,
c'est--dire de la dcompression d'tre nantisante ; 2 que la
conscience est en fait projet de se fonder, c'est--dire d'atteindre la
dignit de l'en-soi-pour-soi ou en-soi-cause-de-soi . Mais nous ne
saurions en tirer davantage. Rien ne permet d'affirmer, sur le plan
ontologique, que l a nantisation de l'en-soi en pour-soi a, ds
668
l'origine et au sein mme de l'en-soi, pour signification le projet
d'tre cause de soi. Bien au contraire, l'ontologie se heurte ici une
contradiction profonde, puisque c'est par l e pour-soi que la possibilit
d'un fondement vient au monde. Pour tre projet de se fonder, i l
faudrait que l 'en-soi ft originellement prsence soi , c'est--dire
qu'il ft dj conscience. L'ontologie se bornera donc dclarer que
tout se passe comme si l'en-soi, dans un projet pour se fonder lui
mme, se donnai t la modification du pour-soi. C'est la mtaphysi
que de former les hypothses qui permettront de concevoir ce
processus comme l'vnement absolu qui vient couronner l'aventure
individuelle qu'est l'existence de l'tre. II va de soi que ces hypothses
demeureront hypothses puisque nous ne saurions attendre ni confir
mation ni infirmation ultrieure. Ce qui fera leur validit, c'est
seulement la possibilit qu'elles nous donneront d'unifier les donnes
de l'ontologie. Cette unification ne devra naturellement pas se
constituer dans la perspective d'un devenir historique, puisque la
temporalit vi ent l'tre par le pour-soi. Il n'y aurait donc aucun sens
se demander ce qu'tait l'tre avant l'apparition du pour-soi. Mais l a
mtaphysique n' en doi t pas moins tenter de dterminer la nature et le
sens de ce processus ant-historique et source de toute histoire qu'est
l'articulation de l'aventure individuelle (ou existence de l'en-soi) avec
l'vnement absolu (ou surgissement du pour-soi ). En particulier,
c'est au mtaphysicien que revient l a tche de dcider si l e mouve
ment est ou non une premire tentative de l'en-soi pour se fonder
et quels sont les rapports du mouvement comme maladie de l'tre
avec le pour-soi comme maladie plus profonde et pousse jusqu' la
nantisation.
Reste envisager l e deuxime problme, que nous avons formul
ds notre i ntroduction : Si l'en-soi et l e pour-soi sont deux modalits
de l'tre, n'y a-t-il pas un hiatus au sein mme de l'ide d'tre et sa
comprhension n'est-elle pas scinde en deux parts incommunicables
du fait que son extension est constitue par deux classes radicalement
htrognes ? Qu' y a-t-il de commun, en effet, entre l'tre qui est ce
qu'il est et l'tre qui est ce qu'il n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est ?
C qui peut nous aider ici , cependant, c'est la conclusion de nos
recherches prcdentes ; nous venons de montrer, en effet, que l'en
soi et le pour-soi ne sont pas juxtaposs. Bien au contraire, le pour-soi
sans l'en-soi est quelque chose comme un abstrait : il ne saurait pas
plus exister qu'une couleur sans for
m
e ou qu'un son sans hauteur et
sans timbre ; une conscience qui ne serait conscience de rien serait un
rien absolu. Mai s si la conscience est lie l'en-soi par une relation
interne, cela n e signifie-t-il pas qu'elle s'articule avec lui pour
constituer une totalit et n' est-ce pas cette totalit que revient la
dnomination d'tre ou de ralit ? Sans doute, le pour-soi est
nantisation, mais, titre de nantisation, il est ; et il est en unit a
669
priori avec l'en-soi . AInsi, les Grecs avaient-ils coutume de distInguer
la ralit cosmique qu' i ls nommaient 10 nO de la totalit constitue
par celle-ci et par l e vide infini qui l ' entourait - totalit qu'ils
nommaient 10 oov. Certes, nous avons pu nommer l e pour-soi un
rien et dclarer qu' i l n'y a en dehors de l'en-soi, rien, sinon un
refet de ce rien qui est lui-mme polaris et dfini par l'en-soi en tant
qu'il est prcisment le nant de cet en-soi. Mais ici comme dans la
philosophie grecque, une question se pose : qu'appellerons-nous rel,
quoi attribuerons-nous l'tre ? Au cosmos ou ce que nous
nommions plus haut 10 oov ? A l'en-soi pur ou l'en-soi entour de
ce manchon de nant que nous avons dsign du nom de pour-soi ?
Mais s i nous devions considrer l'tre total comme constitu par
l'organisation synthtique de l ' en-soi et du pour-soi, n'allons-nous pas
retrouver l a difficult que nous voulions viter ? Ce hiatus que nous
dcelions dans le concept d'tre, n' al lons-nous pas l e rencontrer
prsent dans l 'existant lui-mme ? Quelle dfinition donner, en effet,
d'un existant qui , en tant qu'en-soi, serait ce qu' i l est et, en tant que
pour-soi , serait ce qu'il n'est pas ?
Si nous voulons rsoudre ces difficults, il faut bien nous rendre
compte de ce que nous exigeons d'un existant pour le considrer
comme une totalit : il faut que l a diversit de ses structures soit
retenue en une synthse unitaire, de telle sorte que chacune d'elles,
envisage part, ne soit qu'un abstrait. Et, certes, la conscience
envisage part n'est qu'une abstraction, mais l'en-soi lui-mme n'a
pas besoin de pour-soi pour tre : l a passion du pour-soi fait
seulement qu'il y ait de l'en-soi. Le phnomne d'en oi est un abstrait
sans la conscience mais non son tre.
Si nous voulions concevoir une organisation synthtique telle que l e
pour-soi soit insparable de l'en-soi et que, rciproquement, l'en-soi
soit indissolublement l i au pour-soi, i l faudrait l a concevoir de telle
sorte que l'en-soi reoive son existence de la nantisation qui en fait
prendre conscience. Qu' est-ce dire sinon que la totalit indissoluble
d'en-soi et de pour-soi n'est concevable que SOl
1
S l a forme de l'tre
cause de soi ? C'est cet tre et nul autre qui pourrait valoir
absolument comme ce oov dont nous parlions tout l'heure. Et si
nous pouvons poser l a question de l'tre du pour-soi articul l'en
soi, c'est que nous nous dfinissons a priori par une comprhension
prontologique de l'ens caua sui. Sans doute, cet ens caua sui est
impossible et son concept, nous l'avons vu, enveloppe une contradic
tion. Il n' en demeure pas moins que, puisque nous posons la question
de l'tre du oov en nous plaant du point de vue de l'ens caua sui,
c'est ce point de vue qu'il faut nous mettre pour examiner les lettres
de crance de ce oov. N'est-il pas, en effet, apparu du seul fait du
surgissement du pour-soi et l e pour-soi n'est-il pas originellement
projet d'tre cause de soi ? Ainsi commenons-nous saisir la nature
670
de la ralit totale. L'tre total, celUi dont Il concept ne serait pas
scind par un hiatus et qui, pourtant, n'exclurait pas l'tre nantisant
nantis du pour-soi , celui dont l'existence serait synthse unitaire de
l'en-soi et de l a conscience, cet tre idal serait l'en-soi fond par le
pour-soi et identique au pour-soi qui le fonde, c'est--dire l'ens causa
sui. Mais, prcisment parce que nous nous plaons du point de vue
de cet tre idal pour juger l'tre rel que nous appelons oov, nous
devons constater que l e rel est un effort avort pour atteindre la
dignit de cause-de-soi. Tout se passe comme si le monde, l'homme et
l'homme-dans-le-monde n'arrivaient raliser qu'un Dieu manqu.
Tout se passe donc comme si l'en-soi et l e pour-soi se prsentaient en
tat de dsintgration par rapport une synthse idale. Non que
l'intgration ait jamais eu lieu, mais prcisment au contraire parce
qu'elle est toujours indique et toujours impossible. C'est l e perp
tuel chec qui explique la fois l'indissolubilit de l'en-soi et du pour
soi et leur relative indpendance. Pareill ement, lorsque l'unit des
fonctions crbrales est brise, des phnomnes se produisent qui
prsentent l a foi s une autonomie relative et qui, l a fois, ne peuvent
se manifester que sur fond de dsagrgation d'une totalit. C'est cet
chec qui explique l e hiatus que nous rencontrons la fois dans le
concept de l'tre et dans l'existant. S'il est impossible de passer de l a
notion d'tre-en-soi celle d' tre-pour-soi et de l es runir en un genre
commun, c'est que le passage de fait de l ' un l'autre et leur runion
ne se peuvent oprer. On sait que, pour Spinoza et pour Hegel, par
exemple, une synthse arrte avant la synthtisation complte, en
figeant les termes dans une relative dpendance et, la fois, dans une
indpendance relative, se constitue du coup en erreur. Par exemple,
c'est dans l a notion de sphre que, pour Spinoza, la rotation d'un
demi-cercle autour de son diamtre trouve sa justification et son sens.
Mais si nous imaginons que l a notion de sphre est par principe hors
d'atteinte , le phnomne de rotation du demi-cercle devient faux ; on
l'a dcapit ; l ' i de de rotation et l'ide de cercle se tiennent l'une
l'autre sans pouvoir s'unir dans une synthse qui les dpasse et les
justifie : l'une demeure irrductible l'autre. C'est prcisment ce
qui se passe ici. Nous dirons donc que l e oov considr est,
comme une notion dcapi te, en dsintgration perptuelle. Et c'est
titre d' ensemble dsintgr qu'il se prsente nous dans son
ambigut , c'est--dire qu'on peut ad libitum insister sur la dpen
dance des tres considrs ou sur leur indpendance. Il y a ici un
passage qui ne se fait pas, un court-circuit. Nous retrouvons sur ce
plan cette notion de totalit dtotalise que nous avions dj
rencontre propos du pour-soi lui-mme et propos des consciences
d'autrui. Mais c'est une troisime espce de dtotalisation. Dans la
totalit simplement dtotalise de la rflexion, l e rflexif avait tre le
rflchi et le rflchi avait tre le rflexif. La double ngation
671
demeurait vanescente. Dans le cas du pour-autrUI, le (reflct
refltant) reflt se distinguait du (reflet-refl tant) refltant en ce que
chacun avait ne pas tre l'autre. Ainsi le pour-soi et l'autre-po ur-soi
constituent un tre o chacun confre l'tre-autre l'autre en se
faisant autre. Quant la totalit du pour-soi et de l'en-soi , elle a pour
caractristique que le pour-soi se fait l'autre par rapport l'en-soi,
mais que l'en-soi n'est nullement autre que le pour-soi en son tre : i l
est, purement et simplement. Si l e rapport de l'en-soi au pour-soi tait
la rciproque du rapport du pour-soi l'en-soi, nous retomberions
dans l e cas de l'tre-pour-autrui. Mais, prcisment, i l ne l'est pas, et
c'est cette absence de rciprocit qui caractrise le fOV dont nous
parlions tout l ' heure. Dans cette mesure, il n'est pas absurde de
poser l a question de la totalit. Lorsque, en effet, nous avons tudi
le pour-autrui , nous avons constat qu'il fallait qu'il y et un tre
moi-autrui ayant tre la scissiparit rflexive du pour-autrui.
Mais en mme temps, cet tre nous apparaissait
comme ne pouvant exister que s'il comportait un insaisissable non
tre d'extriorit. Nous nous sommes demand alors si l e caractre
antinomique de la totalit tait en lui-mme un irrductible et si nous
devions poser l'esprit comme l'tre qui est et qui n'est pas. Mais il
nous est apparu que l a question de l'unit synthtique des consciences
n'avait pas de sens, car elle supposait que nous avions la possibilit de
prendre un point de vue sur la totalit ; or, nous existons sur le
fondement de cette totalit et comme engags en elle.
Mais si nous ne pouvons prendre de point de vue sur la totalit
c'est que l'autre, par principe, se nie de moi comme je me ni e de l ui .
C'est l a rciprocit du rapport qui m'interdit tout jamais de le saisir
dans son intgrit. Tout au contraire, dans l e cas de la ngation
interne pour-soi-en-soi, le rapport n'est pas rciproque, et j e suis l a
fois un des termes du rapport et l e rapport lui-mme. Je saisis l'tre,
je suis saisie de l'tre, je ne suis que saisie de l'tre ; et l'tre que j e
saisis ne se pose pas contre moi pour me saisir mon tour ; i l est ce qui
est saisi. Simplement son tre ne concide aucunement avec son tre
saisi. En un sens donc, je peux poser la question de la totalit. Certes,
j'existe ici comme engag dans cette totalit, mais je puis en tre
conscience exhaustive, puisque je suis la fois conscience de l'tre et
conscience (de) moi . Seulement, cette question de l a totalit n'appar
tient pas au secteur de l'ontologie. Pour l'ontologie, les seules rgions
d'tre qui peuvent s'lucider sont celles de l'en-soi, du pour-soi et de
l a rgion idale de la cause de soi I l reste indiffrent pour elle de
considrer l e pour-soi articul l'en-soi comme une dualit tranche
ou comme un tre dsintgr. C'est la mtaphysique de dcider s'il
sera plus profitable la connaissance (en particulier la psychologie
phnomnologi que, l'anthropologie, etc. ) de traiter d'un tre que
nous nommerons le phnomne, et qui serait pourvu de deux
672
dimensions d'tre, la dimension cn-soi et la dimension pour-soi (de ce
point de vue, i l n' y aurait qu' un phnomne : l e monde) comme, dans
l a physique einstei ni enne, on a trouv avantageux de parler d'un
vnement conu comme ayant des dimensions spatiales et une
dimension temporelle et comme dterminant sa place dans un espace
temps ; ou s'il demeure prfrable malgr tout de conserver la vieille
dualit conscience-tre . La seule remarque que puisse hasarder ici
l'ontologie, c'est que, dans le cas o il paratrait utile d'employer la
notion nouvelle de phnomne, comme totalit dsintgre, i l
faudrait en parler l a fois en termes d'immanence et de transcen
dance. L'cuei l , en effet, serait de tomber dans le pur immanentisme
(idalisme husserlien) ou dans le pur transcendantisme qui envisage
rait le phnomne comme une nouvelle espce d'objet. Mais l'imma
nence sera toujours l i mite par la dimension d'en-soi du phnomne
et la transcendance par sa dimension de pour-soi.
C'est aprs avoir dcid sur l a question de l'origine du pour-soi et
de l a nature du phnomne de monde que l a mtaphysique pourra
aborder diffrents problmes de premire importance, en particulier
celui de l'action. L'action, en effet, est considrer la fois sur le
plan du pour-soi et sur celui de l ' en-soi, car i l s'agit d'un projet
d'origine immanente qui dtermine une modification dans l'tre du
transcendant. Il ne servirait rien, en effet, de dclarer que l'action
modifie seulement l 'apparence phnomnale de la chose : si l'appa
rence phnomnale d'une tasse peut tre modifie jusqu' l'anantis
sement de la tasse en tant que tasse, et si l'tre de la tasse n'est autre
que sa qualit, l'action envisage doit tre susceptible de modifier
l'tre mme de l a tasse. Le problme de l'action suppose donc
l'lucidation de l 'efficace transcendant de la conscience, et nous met
sur le chemin de son vritable rapport d'tre avec l'tre. Il nous rvle
aussi, par suite des rpercussions de l ' acte dans le monde, une
relation de l'tre avec l'tre qui, bien que saisie en extriorit par le
physicien, n'est ni l'extriorit pure, ni l ' immanence, mais nous
renvoie l a notion de forme gestaltiste. C'est donc partir de l qu'on
pourra tenter une mtaphysique de la nature.
I I
PERSPECTI VES MORALES
L'ontologie ne saurait formul er el l e-mme des prescnptlOns
morales. El l e s'occupe uniquement de ce qui est, et il n'est pas
possi bl e de tirer des impratifs de ses i ndicatifs. Elle laisse entrevoir
673
cependant ce que sera une thique qui prendra ses responsabilits en
face d' une ralit-humaine en situation_ El l e nous a rvl , en effet,
l'origine et la nature de l a valeur ; nous avons vu que c'est l e manque,
par rapport auquel l e pour-soi se dtermine dans son tre comme
manque. Du fai t que l e pour-soi existe, nous l'avons vu, la valeur
surgit pour hanter son tre-pour-soi. Il s'ensuit que les diffrentes
tches du pour-soi peuvent faire l 'objet d' une psychanalyse existen
tiel l e , car el l es visent toutes produire la synthse manque de l a
conscience et de l'tre sous l e signe de la valeur ou cause de soi . Ainsi
l a psychanalyse existentielle est une description morale, car elle nous
livre le sens thique des diffrents projets humains ; elle nous indique
l a ncessit de renoncer l a psychologie de l'intrt, comme toute
interprtation utilitaire de la conduite humaine, en nous rvlant la
signification idale de toutes les attitudes de l'homme. Ces significa
tions sont par del l'gosme et l'altruisme, par del aussi l es
comportements di ts dsintresss. L'homme se fait homme pour tre
Di eu, peut-on di re : et l'ipsit, considre de ce point de vue, peut
paratre un gosme ; mais prcisment parce qu'il n'y a aucune
commune mesure entre la ralit-humaine et l a cause de soi qu' el l e
veut tre, on peut tout aussi bien dire que l ' homme se perd pour que
l a cause de soi existe. On envisagera alors toute existence humaine
comme une passion, l e trop fameux amour-propre n'tant qu'un
moyen librement choisi parmi d' autres pour raliser cette passion.
Mais l e rsultat principal de l a psychanalyse existentielle doit tre de
nous faire renoncer l'esprit de srieux. L'esprit de srieux a pour
double caractristi que, en effet, de considrer les valeurs comme des
donnes transcendantes indpendantes de la subj ectivit humaine, et
de transfrer l e caractre dsirable , de la structure ontologique
des choses leur simpl e constitution matriel l e. Pour l'esprit de
srieux, en effet , l e pain est dsirable, par exemple, parce qu' il faut
vivre (valeur crite au ciel intelligible) et parce qu' il est nourrissant.
Le rsultat de l'esprit de srieux qui, comme on sait, rgne sur l e
monde est de faire boire comme par un buvard l es valeurs symboli
ques des choses par leur idiosyncrasie empirique ; i l met en avant
l'opacit de l'objet dsir et le pose, en lui-mme, comme dsirable
irrductible. Aussi sommes-nous dj sur l e pl an de la moral e, mais
concurremment sur celui de l a mauvaise foi, car c'est une morale qui a
honte d'elle-mme et n'ose dire son nom ; elle a obscurci tous ses buts
pour se dlivrer de l'angoisse. L'homme recherche l'tre l'aveu
glette, en se cachant l e libre projet qu'est cette recherche ; i l se fait tel
qu' i l soit attendu par des tches places sur sa route. Les objets sont
des exigences muettes, et i l n'est rien en soi que l 'obissance passive
ces exigences.
La psychanalyse existentiel l e va lui dcouvrir l e but rel de sa
recherche qui est l 'tre comme fusion synthtique de l'en-soi avec le
674
pour-soi ; el l e va le mettre au fai t de sa passion. A vrai dire, il est
beaucoup d' hommes qui ont pratiqu sur eux-mmes cette psychana
lyse, et qui n' ont pas attendu de connatre ses principes, pour s'en
servir comme d' un moyen de dlivrance et de salut. Beaucoup
d'hommes savent, en effet , que le but de leur recherche est l'tre ; et ,
dans la mesure o i l s possdent cette connaissance, i l s ngligent de
s'approprier l es choses pour elles-mmes et tentent de raliser
l'appropriation symbolique de leur tre-en-soi. Mais dans la mesure
o cette tentative participe encore de l ' esprit de srieux et o ils
peuvent croire encore que leur mission de faire exister l'en-soi-pour
soi est cri te dans les choses, ils sont condamns au dsespoir, car ils
dcouvrent en mme temps que toutes les activits humaines sont
quivalentes -car elles tendent toutes sacrifier l ' homme pour faire
surgir l a cause de soi - et que toutes sont voues par principe
l'chec. Ainsi revient-il au mme de s'enivrer solitairement ou de
conduire l es peuples. Si l ' une de ces activits l'emporte sur l'autre, ce
ne sera pas cause de son but rel , mais cause du degr de
conscience qu' el le possde de son but idal ; et, dans ce cas, i l arrivera
que l e quitisme de l'ivrogne solitaire l'emportera sur l'agitation vaine
du conducteur de peuples.
Mais l'ontologie et la psychanalyse existentiel l e (ou l'application
spontane et empirique que les hommes ont toujours faite de ces
disciplines) doivent dcouvrir ragent moral qu'il est l'tre par qui les
valeurs existent. C'est alors que sa l i bert prendra conscience d'elle
mme et se dcouvrira dans l 'angoisse comme l ' unique source de la
valeur, et l e nant par qui l e monde existe. Ds que la qute de l'tre
et l'appropriation de l'en-soi lui seront dcouvertes comme ses
possibles, el l e saisira par et dans l'angoisse qu'ils ne sont possibles que
sur fond de possibilit d' autres possibles. Mai s jusque-l, encore que
l es possibl es pussent tre choisis et rvoqus ad libitum, le t hme qui
faisait l'unit de tous l es choix de possibles, c'tait l a valeur ou
prsence idale de l'ens causa sui. Que deviendra l a libert, si el l e se
retourne sur cette valeur ? L'emportera-t-eHe avec elle, quoi qu'elle
fasse et dans son retournement mme vers l'en-soi-pour-soi , sera
t-eUe ressaisie par-derrire par la valeur qu'eUe veut contempler ? Ou
bien, du seul fait qu'eUe se saisit comme libert par rapport elle
mme, pourra-t-elle mettre un terme au rgne de l a valeur ? Est-il
possible, en particulier, qu'elle se prenne elle-mme pour valeur en
tant que source de toute valeur ou doit-elle ncessairement se dfinir
par rapport une valeur transcendante qui l a hante ? Et dans l e cas o
el l e pourrait se vouloir eUe-mme comme son proprt- possible et sa
valeur dtermi nante, que faudrait-il entendre par l ? Une libert qui
se veut l ibert, c'est en effet un tre-qui-n'est-pas-ce-qu'il-est et qui
est-ce-qu'il-n'est-pas qui choisit, comme idal d'tre, l'tre-ce-qu'i1-
n'est-pas et le n'tre-pas-ce-qu'il-est. Il choisit donc non de se
675
reprendre, mai s de se fuir, non de concider avec soi, mais d'tre
toujours distance de soi . Que faut-il entendre par cet tre qui veut
se teni r en respect, tre distance de lui-mme ? S'agit-il de la
mauvaise foi ou d' une autre attitude fondamentale ? Et peut-on vivre
ce nouvel aspect de l 'tre ? En particulier, la libert, en se prenant
elle-mme pour fin, chappera-t-elle toute situation ? Ou, au
contraire, demeurera-t-ell e situe ? Ou se situera-t-elle d'autant plus
prcisment et d'autant plus individuellement qu'elle se projettera
davantage dans l ' angoisse comme libert en condition et qu'elle
revendiquera davantage sa responsabilit, titre d'existant par qui le
monde vient l'tre ? Toutes ces questions, qui nous renvoient la
rflexion pure et non complice, ne peuvent trouver leur rponse que
sur l e terrain moral. Nous y consacrerons un prochain ouvrage.
INDEX DES NOMS PROPRES
(Sont mentionns aussi les noms d'auteurs auxquels i l est fait clairement
allusion.)
Abraham, P. : 389.
Adler, A. : 91 , 504, 51 8, 648, 660.
Alain : 18, 1 9, 60, 87, 596.
Anselme (saint) : 16.
Aristote : 130, 135, 138, 532.
Assoiationnistes : 146, 167, 646.
Audiberti, J. : 647.
Bachelard, G. : 36, 646-649.
Bacon, F. : 624.
Baldwin, J. M. : 370.
Balzac, H. de : 584, 585, 634.
Barrs, M. : 582.
Beaumarchais, P. A. Caron de : 92.
Behaviouristes (psychologie du com
portement) : 262, 333, 334, 387,
521 , 522.
Berger, G. : 483.
Bergson, H. : 46, 77, 78, 144, 145,
148, 169, 1 71 , 201 , 202, 205, 440,
488, 507, 543, 549, 594, 656.
Berkeley, G. : 16, 17, 65, 178.
Broalde de Yerille, F. Y. : 421 .
Boisselot (le Pre) : 583
Boulanger, G. (gnral) : 462.
Bourget , P. : 603, 68.
Brentano, F. : 60.
Broglie, L. de : 346.
Brummel, G. : 640.
Czanne, P. : 223.
Chardonne, J. : 91 .
Chevalier, J. : 148, 149.
Claparde, . : 143, 145.
Claudel, P. : 438.
Clovis (roi des Francs) : 490, 492,
493.
Comte, A. : 355, 607.
Constantin 1er (empereur romain) :
477, 478, 491 , 492.
Corbin, H. : 51.
Corneille (P. ) : 166.
Cousin, Y. : 1 1 1 .
Couturat, L. : 134.
Daladier, . : 647.
Descartes, R. : 16, 19, 23-25, 28, 37,
59, 60, 109, 115, 1 16, 120, 121 ,
1 25, 126, 137, 141, 145, 154, 166,
168 171, 186, 191, 201 , 20, 228,
246, 271 , 276, 290, 291 , 322, 345,
349, 483, 485, 507, 510, 527, 529,
567, 622, 628, 636.
Diderot, D. : 583-584.
Dilthey, W. : 263.
Dostoevsky, F M. : 67, 521 , 620.
Duhem, P. : 12
Duns Scott, J. : 566, 567.
Einstein, A. : 246, 577, 673.
picure : 1 38, 441 , 497.
Euclide : 501 .
Faulkner, W. : 446.
Fitzgerald, G. F. : 246.
Flaubert, A. : 605.
Flaubert, G. : 603-606, 620, 634.
Freud, S. (et freudisme) : 84-89, 502,
503, 61 1 , 61 4 620, 638, 645, 648,
69, 658, 659.
Gestaltistes (partisans de la thorie
de la Forme) : 55, 179, 21 8, 220,
244, 305 , 334, 352, 376, 386, 514,
521 , 673.
Gide, A. : 93, 305, 491 , 507, 520,
623.
Grimm, J. et W. : 647.
Halbwachs, M. : 558.
Hamelin, O. : 47. [
Hegel, G. W. F. : 46 54, 60, 70, 1 0,
104, 1 1 2, 1 1 3, 122, 1 30, 1 51 , 155,
190, 221 , 271 , 274 284, 290, 291 ,
31 2, 322, 339, 410, 480, 484, 585,
61 1 , 625 , 671 .
Heidegger , M. : 12, 1 5 , 20, 2 1 , 29,
30, 38, 51 53, 55, 58, 60, 64, 76, 83,
1 09, 1 1 6, 1 21 . 140, 1 59, 160, 177,
21 7, 234, 236, 271 , 283-289, 334,
364, 41 3, 423, 454, 467, 471 , 482,
505, 521 , 5n, 530, 539, 575, 577,
578, 579, 590, 591 , 610.
Heisenberg, W. : 346.
Hraclite : 1 53.
Hrault de Schelles, M. J. : 421.
Hlderlin, F. : 413.
Hugo, V. : 634.
Hume, D. : 1 67, 364.
Husserl, E. : 12 14, 16, 17, 21 , 24 28,
37, 38, 41 . 60-61 , 96, 109- 1 1 1 , 120,
1 21 , 1 37, 144, 145, 156, 169, 186,
1 87, 209, 223, 228, 271 274, 276,
283, 285, 295, 297, 3 1 1 , 355, 364,
426 483, 495, 510, 613, 673.
James, W . . 143, 656.
Janet, Pierre. : 519, 521 , 522.
Jaspers, K. : 604_
Joyce, J. : 501 .
Kafa, F. : 305, 547, 595.
Kant, E. : 1 2, 1 4, 23, 28, 38, 40, 56,
97, 109, 1 1 7, 1 61 , 165 1 71 , 178,
184, 254, 263-266, 268, 272, 274,
286, 288, 292, 449, 475, 525, 628.
Kessel, J. : 93.
Kierkegaard, S. : 64, 131, 278, 626.
Kretschmer, E. : 390.
Laclos, P. Choderlos de : 421 .
La Fayette, M. J. de Motier, marquis
de : 545, 587.
Lalande, A. : 289, 290.
Laplace, P. S. , marquis de ' 159_
Laporte, J. : 37, 47, 370.
Lautramont : 647, 648.
Lawrence, D. H .
.
91 .
Lefebvre, H. : 46.
Leihniz, G. W. : 31 , 1 17, 1 31 , 1 33,
169 1 71 , 1 78, 270, 512 514, 583.
Le Senne, R. : 47.
Leucippe : 340.
Lewin, K. : 347.
Lot, F. : 491 .
Louis XVIII : 547.
Maine de Biran : 343, 364.
Malebranche, N. de : 288.
Malraux, A. : 147, 150, 313, 475,
577, 585, 591 .
Man, H. de : 558.
Marx, K. : 276, 558, 626.
Mauriac, F. : 91 , 538, 586
Meyerson, . : 172, 244, 58l
Mi l l , J. Stuart : 203.
Montfort, S. de , comte de Leices
ter : 567.
Morgan, Ch. : 577.
Ml l er-Lyer, F. : 352.
Napolon l" : 197, 198, 547
Newton, 1 . : 346.
Nietzsche, F. : 12, 586.
Parain, B. : 561.
Parmnide : 340, 660.
Pascal, B. : 586, 608.
Paulhan, 1. : 560, 562.
Peirce, Ch. S. : 86.
Piaget, 1. : 19.
Platon : 61, 91, 119, 288, 316, 349,
442, 577, 66, 667.
Poe, E. A. : 65, 647.
Poincar, H. : 12, 170, 326.
Politzer, G. : 594.
Pozzo di Borgo, Ch. A. , comte : 197,
198.
Proudhon, 1. : 633.
Proust, M. : 12-14, 91, 146, 166, 199,
203, 204, 389, 406, 485, 608.
Raymond VI (comte de Toulouse) :
567.
Rilke, R. M. : 577.
Rimbaud, A. : 65, 647, 648.
Robespierre, M. de : 590.
Romains, 1. : 454, 599.
Rougemont, D. de : 475.
Rousseau, J.-l. : 213, 214, 419, 449.
Sacher Masoch, L. de : 419.
Sarment, J. : 91.
Scheler, M. : 81, 129, 370, 371, 426,
67.
Schiller, F. : 624.
Schlumberger, 1. : 544.
Schopenhauer, A. : 268, 269.
Shakespeare, W. : 95.
Socrate : 50.
Sollier, P. A. : 397.
Sophocle : 150, 581, 585.
Spaier, A. : 61.
Spinoza, B. : 18, 25, 38, 49, 50, 112,
124, 133, 134, 186, 193, 221, 263,
325, 475, 480, 570, 6f7, 609, 671.
Stekel, W. : 88, 89.
Stendhal : 10, 608, 63.
Stociens : 41, 57, 59, 203, 410, 427,
468, 475, 485, 515, 529, 532.
Taine, H. : 61 .
Trencavel (vi comte de Carcas
sonne) : 567.
Valry, P. : 95, 100.
Waehlens, A. de : 413.
Wahl , J. : 64, 448 449.
Watson, J. B. : 267.
Znon d'le : 152, 246, 247.
I NDEX DES UVRES CITES
OU VOQUES
la recherche du temps perdu : 203, 204, 318, 406, 407, 485.
Amour (L'), c'est beaucoup plus que l'amour : 91.
Chteau (Le) : 305
Chouans (Les), ou la Bretagne en 1799 : 584.
Cd (Le) : 166.
Cogito dans la philosophie de Husserl (Le) : 483.
Comment rendre nos ides claires ? (article de Ch. Peirce in Revue Philosophi-
que, janvier 1879) : 86.
Concept d'angoisse (Le) : 64.
Confessions (Les) : 419.
Conqurants (Les) : 577.
Contes de Grimm : 647.
Correspondance de Faubert : 604.
Ct de Guermantes (Le) : 318.
Crime et chtiment : 521 .
Critique de la raison pure : 184. Cf. aussi E. Kant, i ndex des noms propres.
De l'infuence de l'tat de sensibilit de l'estomac sur le chimisme stomacal : 39", .
Dicours de la Mthode (et autres all usions aux uvres de Descartes) : cf.
i ndex des noms propres.
Don Juan (article de D. de Rougemont in Nouvelle Revue Franaie nO 310, du
1er juillet 1 939) : 473.
Du ct de chez Swann ( la recherche du temps perdu) : 203, 204, 318.
Eau (L') et les rves : 364, 646-649.
Enqute sur l'entendement humain (D. Hume) : 167.
Espoir (L') : 147, 150, 473, 585.
Esquisse d'une thorie des morions : 96, 335, 432, 489, 62l.
Essai de psychologie contemporaine (sur Gustave Flaubert) : 603 sq.
Essai sur le logos pzatonlcn : 561.
thique (de Spinoza) : 473. Cf. aussi Spinoza, dans l'index des noms propres.
tre (L') et le temps : 283-289. Cf. aussi Heidegger, dans l'index des noms
propres.
tudes kierkgaardiennes : 64.
Femme frigide (La) : 88.
Fin de la nuit (La) : 586.
Fin du monde antique (La) et le dbut du moyen ge : 491 .
Fin d'une parade philosophique : le bergsonisme : 594.
Fleurs de Tarbes (Les) : 560 562.
Fleuve de feu (Le) : 91.
Formalisme en thique (Le) et l'thique matriale des valeurs (Max Scheler) :
129.
Formale und transzendentale Logik (Husserl) : 272.
Grande logique (Hegel) : 48.
Holderlin und da Wesen der Dichtung (Holderlin et l'essence de la posie) :
413.
Homme du ressentiment (L') : 81.
Ides directrices pour une phnomnologie : cf. Husserl, index des noms
propres.
Identit et ralit (
. Meyerson) : 172, 244, 580.
Imaginaire (L') : 95, 298, 646.
Imagination (L') : 61, 143.
Je suis trop grand pour moi : 91.
Joural des Faux-Monnayeurs : 507.
Leon sur la conscience intere du temps : 156.
Lettres de Dostoevski : 67.
L(aisons dangereues (Les) : 421.
Lumire d'aot : 446.
Mariage de Figaro (Le) : 92.
Matire et mmoire : 549.
Mditations cartsiennes : 272. Cf. aussi Husser, index des noms propres.
Moyen de parvenir (Le) : 421.
Mystre en pleine lumire (Le) : 582.
Nause (La) : 378.
Opuscules et fragments indits de Leibniz (par L. Coutura!) : 134. Cf. aussi
Leibniz, index des noms propres.
Petite logique (Enzyklopidie, Hegel) : 46-50.
Phdon : 61 .
Phnomnologie de l'Esprit (La) : 47, 100, 190, 274-276, 279, 280, 410 180_
Philoctte (par A. Gide) : 520.
Philosophie de Marlin Heidegger (La) : 413.
Porte troite (La) : 409.
Prlude Verdun : 599, 600.
Prisonnire (La) ( la recherche du temps perdu) : 406.
Problme de l'abstraction (Le) : 37, 47, 370.
Procs (Le) : 305, 547.
Propedeutik : cf. Schma de la Logique.
Proust (par P. Abraham) : 389.
Psychanalyse du feu : 646.
Psychopathologie gnrale (K. Jaspers) : 604.
Qu'est-ce que la mtaphysique? : 51 sq.
Rpublique (La) : 1 19.
Schma de la Logique (ou Propdeutique philosophique) : 47, 276, 277, 279.
Sophiste (Le) : 666.
Soulier de satin (Le) : 438. .
Sparkenbroke : 577.
Structure du corps (La) et le caractre : 390.
Sur les principes de la connaissance humaine (G. Berkeley) : 16.
Thories de l'induction et de l'exprimentation : 289 290.
Thorie physique (La), son objet, sa structure (P. Duhem) : 12.
Trachiniennes (Les) : 150.
Trait de l'ambition : 42l.
Trait des passions : 20L
Transcendance de l'Ego (La) : 139, 140, 274.
Ulysse : 50l.
Un homme heureux : 544.
Vie unanime (La) : 454.
Vin blanc de la Villette (Le) : 454.
Voile de Sas (Le) : 624.
I NTRODUCTI ON LA RECHERCHE DE L'
TRE
1 . L'ide de phnomne
II. Le phnomne d'tre et l'tre du phnomne
III. Le cogito prrflexif et l'tre du percipere
IV. L'tre du percipi
V. La preuve ontologique
VI. L'tre en soi
Premire partie
LE PROBL
ME DU N
ANT
1. L'interrogation
II. Les ngations
CHAPITRE PREMI ER
L'origine de la ngation
III. La conception dialectique du nant
IV. La conception phnomnologique du nant
v. L'origine du nant
CHAPITRE II
La mauvaise foi
1. Mauvaise foi et mensonge
II. Les conduites de mauvaise foi
III. La foi ) de la mauvaise foi
1 1
14
16
23
26
29
37
40
46
51
56
81
89
102
Deuxime partie
L'
TRE- POUR- SOI
CHAPI TRE PREMI ER
Les structures immdiates du pour-soi
1. La prsence soi
II. La facticit du pour-soi
I I I . Le pour-soi et l 'tre de l a valeur
IV. Le pour-soi et l'tre des possibles
v. Le moi et le circuit de l'ipsit
CHAPI TRE I I
La temporalit
109
1 15
121
132
139
1. Phnomnologie des trois dimensions temporelles 142
I I . Ontologie de la temporalit 165
III. Temporalit originelle et temporalit psychique : l a
I .
II.
III.
IV.
v.
I.
II.
I I I.
IV.
rflexion 185
CHAPITRE I I I
La transcendance
La connaissance comme type de relation entre le pour-soi
et l'en-soi 208
De l a dtermination comme ngation 216
Qual it et quantit, potentialit, ustensilit 222
Le Temps du Monde 240
La connaissance 253
Troiime partie
LE POU R- A UTR UI
CHAPITRE PREMI ER
L'existence d'autrui
Le problme 259
L'cueil du solipsisme 261
Husserl, Hegel, Heidegger 271
Le regard
292
CHAP I TRE I I
Le corps
1. Le corps comme tre-pour-soi : La facticit
II. Le corps-pour-autrui
III. La troisime dimension ontologique du corps
CHAPITRE I I I
Les relations concrtes avec autrui
1. La premire attitude envers autrui : l'amour, le langage,
345
379
392
l e masochisme 404
II. Deuxime attitude envers autrui : l' i ndiffrence, le dsir,
la haine, le sadisme 419
III. L' tre-avec (Mi/sein) et le nous
453
Quatrime partie
AVOI R, FAI RE ET TRE
CHAPI TRE PREMI ER
EIre et faire : la libert
1. La condi ti on premire de l'action, c'est la libert
II. Libert et facticit : La situation
I I I . Libert et responsabilit
CHAPI TRE II
Faire et avoir
1. La psychanalyse existentiell e
I I . Faire et avoir : La possession
III. De l a qualit comme rvlatrice de l'tre
CONCLUSI ON
1 . En-soi e t pour-soi : aperus mtaphysiques
II. Perspectives morales
Index des noms propres
Index des uvres cites ou voques
477
526
598
602
621
646
665
673
677
681
Vous aimerez peut-être aussi
- CIORAN Sur Les Cimes Du DesespoirDocument136 pagesCIORAN Sur Les Cimes Du DesespoirJean-Marie Suc100% (4)
- Idees Directrices Pour Une PhenomenologieDocument602 pagesIdees Directrices Pour Une PhenomenologieLaura Hunter96% (24)
- Les Mots Et Les Choses - FoucaultDocument322 pagesLes Mots Et Les Choses - FoucaultIgor Arréstegui92% (13)
- Incoherence de La Philosophie Al Ghazali PDFDocument364 pagesIncoherence de La Philosophie Al Ghazali PDFSaadeddine AIT SI AHMEDPas encore d'évaluation
- Jean-Paul Sartre - Situations IDocument303 pagesJean-Paul Sartre - Situations IAdalberto Mejía100% (6)
- Cioran, Emil - La Tentation D'existerDocument96 pagesCioran, Emil - La Tentation D'existerKarim Khelifi100% (1)
- A. Camus - L'ÉtrangerDocument180 pagesA. Camus - L'Étrangerlasolitudenue93% (15)
- 18 Partecipation Et CausalitéDocument649 pages18 Partecipation Et CausalitéSole Gonzalez100% (1)
- Histoire de La Folie À L'age Classique M FoucaultDocument295 pagesHistoire de La Folie À L'age Classique M Foucaultigoramelo100% (9)
- Milan Kundera - L'insoutenable Légèreté de L'êtreDocument397 pagesMilan Kundera - L'insoutenable Légèreté de L'êtrealaouet100% (9)
- Sartre - Verite Et ExistenceDocument145 pagesSartre - Verite Et Existencescrazed100% (2)
- L'Experience Interieure - Georges BatailleDocument160 pagesL'Experience Interieure - Georges Batailletchouang_zu86% (7)
- MythologiesDocument239 pagesMythologiesyeteneklibayripley90% (10)
- Le Système Des Objets - Jean BaudrillardDocument288 pagesLe Système Des Objets - Jean BaudrillardMeriam Ben Amor63% (8)
- Le Vocabulaire de Merleau-PontyDocument64 pagesLe Vocabulaire de Merleau-Pontyegonschiele9100% (4)
- Merleau-Ponty Humanisme Et TerreurDocument241 pagesMerleau-Ponty Humanisme Et TerreurTrad Anon100% (5)
- KANT: Oeuvres Majeures: Critique de la raison pratique + Doctrine de la vertu + Doctrine du droit + La Métaphysique des mœurs + Qu'est-ce que les Lumières ? + Les Derniers Jours d'Emmanuel Kant + Analyse de sa philosophie…D'EverandKANT: Oeuvres Majeures: Critique de la raison pratique + Doctrine de la vertu + Doctrine du droit + La Métaphysique des mœurs + Qu'est-ce que les Lumières ? + Les Derniers Jours d'Emmanuel Kant + Analyse de sa philosophie…Pas encore d'évaluation
- Foucault Histoire de La Sexualite Vol 1 La Volonte de SavoirDocument212 pagesFoucault Histoire de La Sexualite Vol 1 La Volonte de Savoirrandom_thotz4344100% (2)
- Jean-Paul Sartre - Critique de La Raison DialectiqueDocument381 pagesJean-Paul Sartre - Critique de La Raison DialectiqueVinícius dos Santos100% (8)
- Levinas - Autrement Qu'être Ou Au-Delà L'essenceDocument286 pagesLevinas - Autrement Qu'être Ou Au-Delà L'essencenorega000100% (10)
- Jean-Paul Sartre - Qu'Est-ce Que La Littérature - (1973, Gallimard)Document309 pagesJean-Paul Sartre - Qu'Est-ce Que La Littérature - (1973, Gallimard)nalpas100% (10)
- Le Vocabulaire de Michel FoucaultDocument71 pagesLe Vocabulaire de Michel FoucaultAndre Parente100% (1)
- Edmond Husserl, Méditations CartésiennesDocument146 pagesEdmond Husserl, Méditations CartésiennesAlexandra Muresan100% (5)
- Merleau-Ponty - Phénoménologie de La PerceptionDocument278 pagesMerleau-Ponty - Phénoménologie de La PerceptionVinícius dos Santos100% (1)
- Platon Oeuvre PhedonDocument293 pagesPlaton Oeuvre PhedonStéphane Godefroid100% (1)
- Les Méditations Métaphysiques de de René DescartesDocument22 pagesLes Méditations Métaphysiques de de René DescartesRou Roumaissa100% (1)
- Gilles Deleuze - Spinoza - Philosophie Pratique-Minuit (2003)Document176 pagesGilles Deleuze - Spinoza - Philosophie Pratique-Minuit (2003)Philippe Zhan100% (1)
- Gilles Deleuze - Cours Sur SpinozaDocument531 pagesGilles Deleuze - Cours Sur SpinozaSangwoon Rhee100% (1)
- Le Monde comme volonté et comme représentation: Tome ID'EverandLe Monde comme volonté et comme représentation: Tome IPas encore d'évaluation
- Métaphysique de l'amour (L'édition intégrale): Psychologie des désirsD'EverandMétaphysique de l'amour (L'édition intégrale): Psychologie des désirsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Du contrat social ou Principes du droit politiqueD'EverandDu contrat social ou Principes du droit politiqueÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (2)
- Être et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandÊtre et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Critique de la raison pratique: L'éthique kantienne et la philosophie morale - Réponse à la question: que dois-je faire? (La suite de la Critique de la raison pure)D'EverandCritique de la raison pratique: L'éthique kantienne et la philosophie morale - Réponse à la question: que dois-je faire? (La suite de la Critique de la raison pure)Pas encore d'évaluation
- Le Théâtre et son double: Nouvelle édition augmentée d'une biographie d'Antonin Artaud (texte intégral)D'EverandLe Théâtre et son double: Nouvelle édition augmentée d'une biographie d'Antonin Artaud (texte intégral)Pas encore d'évaluation
- Le Gai Savoir de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLe Gai Savoir de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le Pèse-Nerfs – Fragments d'un Journal d'Enfer – L'Art et la MortD'EverandLe Pèse-Nerfs – Fragments d'un Journal d'Enfer – L'Art et la MortPas encore d'évaluation
- La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Dictionnaire des Idées & Notions en Littérature et en Théâtre: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire des Idées & Notions en Littérature et en Théâtre: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Critique du jugement suivie des observations sur le sentiment du beau et du sublime: Tome 1 et 2D'EverandCritique du jugement suivie des observations sur le sentiment du beau et du sublime: Tome 1 et 2Pas encore d'évaluation
- Voltaire : Candide ou l'optimisme: Le texte intégral avec les thèmes abordés et l'analyse des personnagesD'EverandVoltaire : Candide ou l'optimisme: Le texte intégral avec les thèmes abordés et l'analyse des personnagesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Éthique à Nicomaque d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandÉthique à Nicomaque d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La volonté de Puissance: Essai d'une transmutation de toutes les valeurs (Études et Fragments)D'EverandLa volonté de Puissance: Essai d'une transmutation de toutes les valeurs (Études et Fragments)Pas encore d'évaluation
- Quelques réflexions sur les origines de l’hitlérisme: Premium EbookD'EverandQuelques réflexions sur les origines de l’hitlérisme: Premium EbookPas encore d'évaluation
- Proust A La Recherche Du Temps Perdu 04Document350 pagesProust A La Recherche Du Temps Perdu 04ronanbreardPas encore d'évaluation
- Sand LeliaDocument606 pagesSand LeliauriblackPas encore d'évaluation
- Spinoza, Ethique - David BosmanDocument228 pagesSpinoza, Ethique - David BosmanBernard SimonPas encore d'évaluation
- Charles Baudelaire - Fusées (1ere Partie Des Journaux Intimes)Document22 pagesCharles Baudelaire - Fusées (1ere Partie Des Journaux Intimes)lasolitudenuePas encore d'évaluation
- La Transcendance Immanante - BouddhismeDocument12 pagesLa Transcendance Immanante - BouddhismeRodrigo Barros GewehrPas encore d'évaluation
- L'analogie Selon Balthasar 1Document11 pagesL'analogie Selon Balthasar 1Maxime PorcoPas encore d'évaluation
- L'épistémologie de HegelDocument12 pagesL'épistémologie de HegelWilfried EponouPas encore d'évaluation
- Wittgensteins Conception of MeaningDocument129 pagesWittgensteins Conception of MeaningSebastian Zuluaga100% (1)
- Phénoménologie Et Réalisme 5Document3 pagesPhénoménologie Et Réalisme 5bressolettePas encore d'évaluation
- PhilosophieDocument7 pagesPhilosophieSerePas encore d'évaluation
- Cahier #39: Henry CorbinDocument4 pagesCahier #39: Henry CorbinHerne Editions80% (5)
- Moreau Joseph La Signification Du ParmenideDocument36 pagesMoreau Joseph La Signification Du ParmenideaoaddiePas encore d'évaluation
- PDF Kant Analytique Transcendantale Lachieze-ReyDocument88 pagesPDF Kant Analytique Transcendantale Lachieze-Reydavid labor100% (1)
- Caron, M. Le Corps Chez HeideggerDocument22 pagesCaron, M. Le Corps Chez HeideggerJosé Carlos CardosoPas encore d'évaluation
- Programme Fort Et Programme Faible en Sociologie de La Connaissance PDFDocument12 pagesProgramme Fort Et Programme Faible en Sociologie de La Connaissance PDFTiago AlmeidaPas encore d'évaluation
- Edmund HusserlDocument38 pagesEdmund HusserlPlacide Lahoury0% (1)
- Épistémologie Et Didactique Des SciencesDocument5 pagesÉpistémologie Et Didactique Des SciencesAlkaPas encore d'évaluation
- Résumé Cours de Philosophie Sur La ConscienceDocument4 pagesRésumé Cours de Philosophie Sur La Consciencecheikhibrahimandiaye2022Pas encore d'évaluation
- BIDEZ, J., Psellus Et Le Commentaire Du Timée de ProclusDocument7 pagesBIDEZ, J., Psellus Et Le Commentaire Du Timée de ProclusAndrei OrobanPas encore d'évaluation
- Johannes Clauberg - Methodus Cartesiana Et OntologieDocument337 pagesJohannes Clauberg - Methodus Cartesiana Et OntologiejorgePas encore d'évaluation
- (Christianisme Catholicisme) Boulanger - Manuel D'apologétique CatholiqueDocument369 pages(Christianisme Catholicisme) Boulanger - Manuel D'apologétique CatholiqueIoana RatiuPas encore d'évaluation
- Karl Popper - Logique de La Découverte Scienti Que, Chapitre IDocument4 pagesKarl Popper - Logique de La Découverte Scienti Que, Chapitre Ilepton50100% (1)
- Cour de Philosophie LivraitDocument38 pagesCour de Philosophie LivraitRaphaël ChiegainPas encore d'évaluation
- La Transparence Et L'énonciationDocument61 pagesLa Transparence Et L'énonciationSalaheddin Chaqui100% (2)
- Fiche (Livre) - Préface À La Seconde Édition - Critique de La Raison Pure, KantDocument4 pagesFiche (Livre) - Préface À La Seconde Édition - Critique de La Raison Pure, KantAudrey L.Pas encore d'évaluation
- SoufismeDocument289 pagesSoufismenirguna100% (1)
- Kant, Critique de La Raison Pure, Analytique, II, 3Document19 pagesKant, Critique de La Raison Pure, Analytique, II, 3Antoine LeandriPas encore d'évaluation
- Romano Phenomenologie Et Grammaire Des CouleursDocument30 pagesRomano Phenomenologie Et Grammaire Des CouleursnadhamzPas encore d'évaluation
- Beguin - Stanislas Breton PDFDocument22 pagesBeguin - Stanislas Breton PDFvolentrianglePas encore d'évaluation
- De La Notion de Principe Chez AristoteDocument26 pagesDe La Notion de Principe Chez AristoteFrancisMontyPas encore d'évaluation
- Philo Tle - L3 - La Connaissance de LhommeDocument6 pagesPhilo Tle - L3 - La Connaissance de LhommeYao william KouadioPas encore d'évaluation