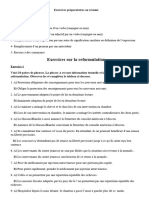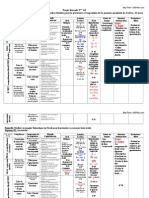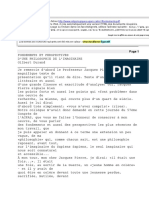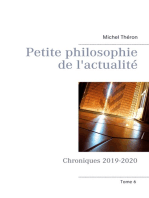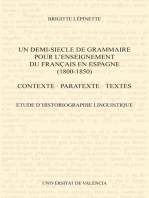Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Structuralisme SC Soc
Structuralisme SC Soc
Transféré par
Priestess Laïla BeriadanwenTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Structuralisme SC Soc
Structuralisme SC Soc
Transféré par
Priestess Laïla BeriadanwenDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bernard Dantier
(docteur en sociologie de lcole des Hautes tudes en Sciences Sociales) (8 juillet 2008)
Textes de mthodologie en sciences sociales choisis et prsents par Bernard Dantier
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale
Extrait de : Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, Agora, 1958 et 1974, pp. 328-378.
Un document produit en version numrique par M. Bernard Dantier, bnvole, Docteur en sociologie de lcole des Hautes tudes en Sciences Sociales Courriel : bernard.dantier@orange.fr Dans le cadre de la collection : "Les classiques des sciences sociales" dirige et fonde par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi Site web : http ://classiques.uqac.ca/ Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque Paul-mile-Boulet de lUniversit du Qubec Chicoutimi Site web : Site web : http ://bibliotheque.uqac.ca/
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss
Politique d'utilisation de la bibliothque des Classiques
Toute reproduction et rediffusion de nos fichiers est interdite, mme avec la mention de leur provenance, sans lautorisation formelle, crite, du fondateur des Classiques des sciences sociales, Jean-Marie Tremblay, sociologue. Les fichiers des Classiques des sciences sociales ne peuvent sans autorisation formelle: - tre hbergs (en fichier ou page web, en totalit ou en partie) sur un serveur autre que celui des Classiques. - servir de base de travail un autre fichier modifi ensuite par tout autre moyen (couleur, police, mise en page, extraits, support, etc...), Les fichiers (.html, .doc, .pdf., .rtf, .jpg, .gif) disponibles sur le site Les Classiques des sciences sociales sont la proprit des Classiques des sciences sociales, un organisme but non lucratif compos exclusivement de bnvoles. Ils sont disponibles pour une utilisation intellectuelle et personnelle et, en aucun cas, commerciale. Toute utilisation des fins commerciales des fichiers sur ce site est strictement interdite et toute rediffusion est galement strictement interdite. L'accs notre travail est libre et gratuit tous les utilisateurs. C'est notre mission. Jean-Marie Tremblay, sociologue Fondateur et Prsident-directeur gnral, LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss
Un document produit en version numrique par M. Bernard Dantier, bnvole, Docteur en sociologie de lcole des Hautes tudes en Sciences Sociales Courriel : bernard.dantier@orange.fr
Textes de mthodologie en sciences sociales choisis et prsents par Bernard Dantier :
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale
Extrait de : Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, Agora, 1958 et 1974, pp. 328-378.
Utilisation des fins non commerciales seulement.
Polices de caractres utilise : Pour le texte : Times New Roman, 14 points. Pour les notes de bas de page : Times New Roman, 12 points. Citation : Times New Roman, 12 points. dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2004. Mise en page sur papier format : LETTRE (US letter, 8.5 x 11)
dition complte Chicoutimi, Ville de Saguenay, Qubec, le11 juillet 2008.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss
Textes de mthodologie en sciences sociales choisis et prsents par Bernard Dantier :
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale
Extrait de :
Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, Agora, 1958 et 1974, pp. 328-378.
Par Bernard Dantier, sociologue (8 juillet 2008)
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale
La recherche dune structure, selon Claude Lvi-Strauss, est une mthode globale dapprhension dune socit, applicable ainsi tous ses secteurs et non pas rductible lune de ses composantes qui serait suppose en tre une ou la structure . La notion de structure sociale ne se rapporte pas la ralit empirique, mais aux modles construits d'aprs celle-ci. () Les relations sociales sont la matire premire employe pour la construction des modles qui rendent manifeste la structure sociale ellemme. Llaboration dun modle constitue le fondement de la dmarche, un modle intgrant dune socit tous les faits observs (par recueil ethnographique) et observables (par une prvision des volutions), les mettant tous en relation en sorte que la modification dun lment y entrane celle de tous les autres dans un systme commun. Selon lauteur, certaines disciplines, comme la sociologie et lethnologie, se prtent davantage la construction de modles, partir des donnes issues du travail empirique dautres disciplines comme lhistoire et lethnographie (mais, lencontre de cette conception, nous pourrions nous interroger dune part sur la possibilit de recueillir des faits sans thorisation prliminaire et sans modle dobservation et dautre part sur la possibilit de recueillir la totalit des faits quels quils soient). Entre ces disciplines et leurs procds respectifs, les modles sinscrivent dans des organisations ou reprsentations distinctes et complmentaires du temps. Dun ct le temps mcanique chez lethnologie qui ne donne pas la primaut la chronologie (Ferdinand de Saussure dont sinspire lauteur parlant lui de synchronie , cest--dire dtude dun ensemble de faits un mme instant en dehors de tout
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss
enchanement et de toute volution temporels) cette option ayant la prfrence de lauteur qui attribue une certaine valeur aux recherches inscrites sur les relations dans lespace ; dun autre ct le temps statistique , non rversible et cumulatif ( diachronique chez Saussure), avec un avant et un aprs (temps moins pris par lauteur qui y craint des ruptures et des htrognits entre les faits ainsi recueillis et relis). Cest par et dans un milieu commun , compos par des limites autour dun espace et dun temps solidaires, que stablissent le modle et la structure affrente. Nettement influenc par les travaux de Sigmund Freud comme par ceux de Ferdinand de Saussure, Lvi-Strauss programme latteinte de la structure profonde de la socit, plus que celle superficielle et apparente, en pntrant linconscient de cette socit, au-del des reprsentations collectives et des normes institues que celle-ci se donne en quelque sorte aprs-coup pour se penser au second degr, (constructions mentales secondaires quil faut aussi dailleurs prendre en compte comme des effets de la structure profonde et primordiale, comme appartenant elle et reprsentant certains de ses aspects de ses dimensions). Ainsi le conscient doit donner accs linconscient qui le commande avec plus ou moins de dformations (sans que pour autant cet inconscient de la structure porte chez Lvi-Strauss les problmatiques de conflit et de malaise que Freud attribue aux rapports entre ordre social et pulsions individuelles). La structure dune socit agit et se manifeste essentiellement en terme de rgles , - au-del de la relative particularit dune culture (que Lvi-Strauss considre comme un ensemble dcarts significatifs observs sur des faits ethnographiques par rapport un autre ensemble, en sorte quun mme individu peut appartenir plusieurs cultures selon les chelles du dcoupage et de la mesure des carts). Dans ce cadre, les rgles structurelles organisent divers types d ordres (systme de parent, organisation politique et sociale, stratifications socio-conomiques), ordres qui sont intgrables dans un ordre gnral. Ces rgles, indpendantes de la nature des joueurs individuels ou groups, impliquent, selon lauteur, dautres notion telles celles de partie , de
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss
coup , de choix , de stratgie . En tant que rgles elles sexercent notamment sur les changes et les communications : communications des femmes (par lexogamie, les mariages et les alliances) des biens et des services (dans le march dit conomique ) des messages (changes linguistiques), toutes ces communications participant avec certaines analogies un systme commun et global (dans lequel nous retrouvons la recherche du fait social total que Marcel Mauss avait initie dans son Essai sur le don ). Lauteur, qui promeut la pluridisciplinarit jusqu la transdisciplinarit, espre ainsi long terme la fusion entre lanthropologie sociale, la science conomique et la linguistique afin que soit mise en place une science totale et cohrente des communications dune socit toujours organise comme un jeu sous un ensemble de rgles. Ainsi, le chercheur en sciences sociales, pour peu quil soit soucieux de se protger la fois des dangers de la spcialisation disciplinaire qui la form et de ceux du dcoupage et de la slection de lobjet dtude quil choisit, aura grand profit lire ou relire le panorama structuraliste que ci-dessous Claude Lvi-Strauss, en 1952, nous propose des problmatiques et des rsultats des recherches appliques aux hommes et leurs socits. Bernard Dantier, sociologue 8 juillet 2008
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss
Claude Lvi-Strauss :
extrait de
Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, Agora, 1958 et 1974, pp. 328-378. (Pour allger le texte, la plupart des notes de bas de page nont pas t reproduites.)
Table des matires de lextrait La notion de structure en ethnologie I. DFINITION ET PROBLMES DE MTHODE. a) b) c) II. Observation et exprimentation Conscience et inconscient Structure et mesure
MORPHOLOGIE SOCIALE OU STRUCTURES DE GROUPE
III. STATIQUE SOCIALE, OU STRUCTURES DE COMMUNICATION. IV. DYNAMIQUE SOCIALE : STRUCTURES DE SUBORDINATION. a) b) Ordre des lments (individus et groupes) dans la structure sociale. Ordres des ordres.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss
LA NOTION DE STRUCTURE EN ETHNOLOGIE
Retour la table des matires
La notion de structure sociale voque des problmes trop vastes et trop vagues pour qu'on puisse les traiter dans les limites d'un article. Le programme de ce symposium l'admet implicitement : des thmes voisins du ntre ont t assigns d'autres participants. Ainsi, des tudes telles que celles consacres au style, aux catgories universelles de la culture, la linguistique structurale, se rapportent de trs prs notre sujet, et le lecteur du prsent travail devra aussi s'y rfrer. En outre, quand on parle de structure sociale, on s'attache surtout aux aspects formels des phnomnes sociaux ; on sort donc du domaine de la description pour considrer des notions et des catgories qui n'appartiennent pas en propre l'ethnologie, mais qu'elle voudrait utiliser, l'instar d'autres disciplines scientifiques qui, depuis longtemps, traitent certains de leurs problmes comme nous souhaiterions faire des ntres. Sans doute, ces problmes diffrentils quant au contenu, mais nous avons, tort ou raison, le sentiment que nos propres problmes pourraient en tre rapprochs, condition d'adopter le mme type de formalisation. L'intrt des recherches structurales est, prcisment, qu'elles nous donnent l'esprance que des sciences, plus avances que nous sous ce rapport, peuvent nous fournir des modles de mthodes et de solutions. Que faut-il donc entendre par structure sociale ? En quoi les tudes qui s'y rapportent diffrent-elles de toutes les descriptions, analyses et thories visant les relations sociales, comprises au sens large, et qui se confondent avec l'objet mme de l'anthropologie ? Les auteurs ne sont gure d'accord sur le contenu de cette notion ;
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 10
certains mme, parmi ceux qui ont contribu l'introduire, paraissent aujourd'hui le regretter. Ainsi Kroeber, dans la deuxime dition de son Anthropology :
La notion de "structure" n'est probablement rien d'autre qu'une concession la mode : un terme au sens bien dfini exerce tout coup un singulier attrait pendant une dizaine d'annes ainsi le mot "arodynamique" , on se met l'employer tort et travers, parce qu'il sonne agrablement l'oreille. Sans doute, une personnalit typique peut tre considre du point de vue de sa structure. Mais la mme chose est vraie d'un agencement physiologique, d'un organisme, d'une socit quelconque ou d'une culture, d'un cristal ou d'une machine. N'importe quoi la condition de n'tre pas compltement amorphe possde une structure. Ainsi semble-t-il que le terme "structure" n'ajoute absolument rien ce que nous avons dans l'esprit quand nous l'employons, sinon un agrable piquant (Kroeber, 1948, p. 325). ()
Ce texte vise directement la prtendue structure de la personnalit de base ; mais il implique une critique plus radicale, qui met en cause l'usage mme de la notion de structure en anthropologie. Une dfinition n'est pas seulement indispensable en raison des incertitudes actuelles. D'un point de vue structuraliste qu'il faut bien adopter ici, ne ft-ce que pour que le problme existe, la notion de structure ne relve pas d'une dfinition inductive, fonde sur la comparaison et l'abstraction des lments communs toutes les acceptations du terme tel qu'il est gnralement employ. Ou le terme de structure sociale n'a pas de sens, ou ce sens mme a dj une structure. C'est cette structure de la notion qu'il faut d'abord saisir, si on ne veut pas se laisser submerger par un fastidieux inventaire de tous les livres et articles portant sur les relations sociales : leur liste seule excderait les limites de ce chapitre. Une seconde tape permettra de comparer notre dfinition provisoire avec celles que d'autres auteurs semblent admettre, de faon explicite ou implicite. Nous procderons cet examen dans la section consacre la parent, puisque c'est le principal contexte dans lequel la notion de structure apparat. En fait, les ethnologues se sont presque exclusivement occups de structure propos des problmes de parent.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 11
I. Dfinition et problmes de mthode.
Retour la table des matires
Le principe fondamental est que la notion de structure sociale ne se rapporte pas la ralit empirique, mais aux modles construits d'aprs celle-ci. Ainsi apparat la diffrence entre deux notions si voisines qu'on les a souvent confondues, je veux dire celle de structure sociale et celle de relations sociales Les relations sociales sont la matire premire employe pour la construction des modles qui rendent manifeste la structure sociale elle-mme. En aucun cas celle-ci ne saurait donc tre ramene l'ensemble des relations sociales, observables dans une socit donne. Les recherches de structure ne revendiquent pas un domaine propre, parmi les faits de socit ; elles constituent plutt une mthode susceptible d'tre applique divers problmes ethnologiques, et elles s'apparentent des formes d'analyse structurale en usage dans des domaines diffrents. Il s'agit alors de savoir en quoi consistent ces modles qui sont l'objet propre des analyses structurales. Le problme ne relve pas de l'ethnologie, mais de l'pistmologie, car les dfinitions suivantes n'empruntent rien la matire premire de nos travaux. Nous pensons en effet que pour mriter le nom de structure, des modles doivent exclusivement satisfaire quatre conditions. En premier lieu, une structure offre un caractre de systme. Elle consiste en lments tels qu'une modification quelconque de l'un d'eux entrane une modification de tous les autres. En second lieu, tout modle appartient un groupe de transformations dont chacune correspond un modle de mme famille, si bien que l'ensemble de ces transformations constitue un groupe de modles.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 12
Troisimement, les proprits indiques ci-dessus permettent de prvoir de quelle faon ragira le modle, en cas de modification d'un de ses lments. Enfin, le modle doit tre construit de telle faon que son fonctionnement puisse rendre compte de tous les faits observs. () a) Observation et exprimentation.
Retour la table des matires
Ces deux niveaux seront toujours distingus. L'observation des faits, et l'laboration des mthodes permettant de les utiliser pour construire des modles, ne se confondent jamais avec l'exprimentation au moyen des modles eux-mmes. Par exprimentation sur les modles , j'entends l'ensemble des procds permettant de savoir comment un modle donn ragit aux modifications, ou de comparer entre eux des modles de mme type ou de types diffrents. Cette distinction est indispensable pour dissiper certains malentendus. N'y a-t-il pas contradiction entre l'observation ethnographique, toujours concrte et individualise, et les recherches structurales auxquelles on prte souvent un caractre abstrait et formel pour contester qu'on puisse passer de la premire aux secondes ? La contradiction s'vanouit ds qu'on a compris que ces caractres antithtiques relvent de deux niveaux diffrents ou, plus exactement, correspondent deux tapes de la recherche. Au niveau de l'observation, la rgle principale on pourrait mme dire la seule est que tous les faits doivent tre exactement observs et dcrits, sans permettre aux prjugs thoriques d'altrer leur nature et leur importance. Cette rgle en implique une autre, par voie de consquence : les faits doivent tre tudis en eux-mmes (quel processus concrets les ont amens l'existence ?) et aussi en relation avec l'ensemble (c'est--dire que tout changement observ en un point sera rapport aux circonstances globales de son apparition). Cette rgle et ses corollaires ont t clairement formuls par K. Goldstein (1951, pp. 18-25) en termes de recherches psychophysiologiques ; ils sont aussi applicables d'autres formes d'ana-
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 13
lyse structurale. Du point de vue qui est le ntre, ils permettent de comprendre qu'il n'y a pas contradiction, mais intime corrlation, entre le souci du dtail concret propre la description ethnographique, et la validit et la gnralit que nous revendiquons pour le modle construit d'aprs celle-ci. r On peut en effet concevoir beaucoup de modles diffrents mais commodes, divers titres, pour dcrire et expliquer un groupe de phnomnes. Nanmoins, le meilleur sera toujours le modle vrai, c'est--dire celui qui, tout en tant le plus simple, rpondra la double condition de n'utiliser d'autres faits que ceux considrs, et de rendre compte de tous. La premire tche est donc de savoir quels sont ces faits.
b) Conscience et inconscient.
Retour la table des matires
Les modles peuvent tre conscients ou inconscients, selon le niveau o ils fonctionnent. Boas, qui revient le mrite de cette distinction, a montr qu'un groupe de phnomnes se prte d'autant mieux l'analyse structurale que la socit ne dispose pas d'un modle conscient pour l'interprter ou le justifier (1911, p. 67). On sera peut-tre surpris de voir citer Boas comme un des matres de la pense structuraliste ; certains lui attribueraient plutt un rle oppos. J'ai essay de montrer dans un autre travail () que l'chec de Boas, au point de vue structuraliste, ne s'explique pas par l'incomprhension ou l'hostilit. Dans l'histoire du structuralisme, Boas a plutt t un prcurseur. Mais il a prtendu imposer aux recherches structurales des conditions trop rigoureuses. Certaines ont pu tre assimiles par ses successeurs, mais d'autres taient si svres et difficiles satisfaire qu'elles eussent strilis le progrs scientifique dans quelque domaine que ce soit. Un modle quelconque peut tre conscient ou inconscient, cette condition n'affecte pas sa nature. Il est seulement possible de dire qu'une structure superficiellement enfouie dans l'inconscient rend plus probable l'existence d'un modle qui la masque, comme un cran, la conscience collective. En effet, les modles conscients
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 14
qu'on appelle communment des normes comptent parmi les plus pauvres qui soient, en raison de leur fonction qui est de perptuer les croyances et les usages, plutt que d'en exposer les ressorts. Ainsi, l'analyse structurale se heurte une situation paradoxale, bien connue du linguiste : plus nette est la structure apparente, plus difficile devient-il de saisir la structure profonde, cause des modles conscients et dforms qui s'interposent comme des obstacles entre l'observateur et son objet. L'ethnologue devra donc toujours distinguer entre les deux situations o il risque de se trouver plac. Il peut avoir construire un modle correspondant des phnomnes dont le caractre de systme n'a pas t peru par la socit qu'il tudie. C'est la situation la plus simple, dont Boas a soulign qu'elle offrait aussi le terrain le plus favorable la recherche ethnologique. Dans d'autres cas, cependant, l'ethnologue a affaire, non seulement des matriaux bruts, mais aussi des modles dj construits par la culture considre, sous forme d'interprtations. J'ai dj not que de tels problmes peuvent tre trs imparfaits, mais ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de cultures dites primitives ont labor des modles de leurs rgles de mariage, par exemple meilleurs que ceux des ethnologues professionnels (). Il y a donc deux raisons pour respecter ces modles faits la maison . D'abord, ils peuvent tre bons, ou, tout au moins, offrir une voie d'accs la structure ; chaque culture a ses thoriciens, dont l'uvre mrite autant d'attention que celle que l'ethnologue accorde des collgues. Ensuite, mme si les modles sont tendancieux ou inexacts, la tendance et le genre d'erreurs qu'ils reclent font partie intgrante des faits tudier ; et peut-tre comptent-ils parmi les plus significatifs. Mais, quand il donne toute son attention ces modles, produits de la culture indigne, l'ethnologue n'aura garde d'oublier que des normes culturelles ne sont pas automatiquement des structures. Ce sont plutt d'importantes pices l'appui pour aider dcouvrir celles-ci, tantt documents bruts, tantt contributions thoriques, comparables celles apportes par l'ethnologue lui-mme. Durkheim et Mauss ont bien compris que les reprsentations conscientes des indignes mritent toujours plus d'attention que les thories issues comme reprsentations conscientes galement
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 15
de la socit de l'observateur. Mme inadquates, les premires offrent une meilleure voie d'accs aux catgories (inconscientes) de la pense indigne, dans la mesure o elles leur sont structuralement lies. Sans sous-estimer l'importance et le caractre novateur de cette dmarche, on doit pourtant reconnatre que Durkheim et Mauss ne l'ont pas poursuivie aussi loin qu'on l'et souhait. Car les reprsentations conscientes des indignes, tout intressantes qu'elles soient pour la raison qui vient d'tre indique, peuvent rester objectivement aussi distantes de la ralit inconsciente que les autres. ()
c) Structure et mesure.
Retour la table des matires
On dit parfois que la notion de structure permet d'introduire la mesure en ethnologie. Cette ide a pu rsulter de l'emploi de formules mathmatiques ou d'apparence telle dans des ouvrages ethnologiques rcents. Il est sans doute exact que, dans quelques cas, on soit parvenu assigner des valeurs numriques des constantes. Ainsi, les recherches de Kroeber sur l'volution de la mode fminine, qui marquent une date dans l'histoire des tudes structuralistes (Richardson et Kroeber, 1940) ; et quelques autres, dont nous parlerons plus loin. Pourtant, il n'existe aucune connexion ncessaire entre la notion de mesure et celle de structure. Les recherches structurales sont apparues dans les sciences sociales comme une consquence indirecte de certains dveloppements des mathmatiques modernes, qui ont donn une importance croissante au point de vue qualitatif, s'cartant ainsi de la perspective quantitative des mathmatiques traditionnelles. Dans divers domaines : logique mathmatique, thorie des ensembles, thorie des groupes et topologie, on s'est aperu que des problmes qui ne comportaient pas de solution mtrique pouvaient tout de mme tre soumis un traitement rigoureux. ()
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 16
d) Modles mcaniques et modles statistiques.
Retour la table des matires
Une dernire distinction se rapporte l'chelle du modle compare celle des phnomnes. Un modle dont les lments constitutifs sont l'chelle des phnomnes sera appel modle mcanique , et modle statistique celui dont les lments sont une chelle diffrente. Prenons comme exemple les lois du mariage. Dans les socits primitives, ces lois peuvent tre reprsentes sous forme de modles o figurent les individus, effectivement distribus en classes de parent ou en clans ; de tels modles sont mcaniques. Dans notre socit, il est impossible de recourir ce genre de modle, car les divers types de mariage y dpendent de facteurs plus gnraux : taille des groupes primaires et secondaires dont relvent les conjoints possibles ; fluidit sociale, quantit d'information, etc. Pour parvenir dterminer les constantes de notre systme matrimonial (ce qui n'a pas encore t tent), on devrait donc dfinir des moyennes et des seuils : le modle appropri serait de nature statistique. Entre les deux formes il existe sans doute des intermdiaires. Ainsi, certaines socits (dont la ntre) utilisent un modle mcanique pour dfinir les degrs prohibs, et s'en remettent un modle statistique en ce qui concerne les mariages possibles. D'ailleurs, les mmes phnomnes peuvent relever des deux types de modles, selon la manire dont on les groupe entre eux ou avec d'autres phnomnes. Un systme qui favorise le mariage des cousins croiss, mais o cette formule idale correspond une certaine proportion seulement des unions recenses, demande, pour tre expliqu de faon satisfaisante, la fois un modle mcanique et un modle statistique. Les recherches structurales n'offriraient gure d'intrt si les structures n'taient traduisibles en modles dont les proprits formelles sont comparables, indpendamment des lments qui les composent. Le structuraliste a pour tche d'identifier et d'isoler les
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 17
niveaux de ralit qui ont une valeur stratgique du point de vue o il se place, autrement dit, qui peuvent tre reprsents sous forme de modles, quelle que soi la nature de ces derniers. Parfois aussi, on peut envisager simultanment les mmes donnes en se plaant des points de vue diffrents qui ont tous une valeur stratgique, bien que les modles correspondant chacun soient tantt mcaniques, tantt statistiques. Les sciences exactes et naturelles connaissent des situations de ce type ; ainsi, la thorie de corps en mouvement relve de la mcanique si les corps physiques considrs sont peu nombreux. Mais, quand ce nombre s'accrot au-del d'un certain ordre de grandeur, il faut recourir la thermodynamique, c'est--dire substituer un modle statistique au modle mcanique antrieur ; et cela, bien que la nature des phnomnes soit demeure la mme dans les deux cas. Des situations de mme genre se prsentent souvent dans les sciences humaines et sociales. Soit, par exemple, le suicide : on peut l'envisager dans deux perspectives diffrentes. L'analyse de cas individuels permet de construire ce qu'on pourrait appeler des modles mcaniques de suicide, dont les lments sont fournis par le type de personnalit de la victime, son histoire individuelle, les proprits des groupes primaire et secondaire dont elle fut membre, et ainsi de suite ; mais on peut aussi construire des modles statistiques, fonds sur la frquence des suicides pendant une priode donne, dans une ou plusieurs socits, ou encore dans des groupes primaires et secondaires de types diffrents, etc. Quelle que soit la perspective choisie, on aura ainsi isol des niveaux o l'tude structurale du suicide est significative, autrement dit, autorisant la construction de modles dont la comparaison soit possible : 1 pour plusieurs formes de suicides ; 2 pour des socits diffrentes, et 3 pour divers types de phnomnes sociaux. Le progrs scientifique ne consiste donc pas seulement dans la dcouverte de constantes caractristiques pour chaque niveau, mais aussi dans l'isolement de niveaux non encore reprs, o l'tude de phnomnes donns conserve une valeur stratgique. C'est ce qui s'est produit avec l'avnement de la psychanalyse qui a dcouvert
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 18
le moyen d'tablir des modles correspondant un nouveau champ d'investigation : la vie psychique du patient prise dans sa totalit. Ces considrations aideront mieux comprendre la dualit (on serait tent de dire : la contradiction) qui caractrise les tudes structurales. On se propose d'abord d'isoler des niveaux significatifs, ce qui implique le dcoupage des phnomnes. De ce point de vue, chaque type d'tudes structurales prtend l'autonomie, l'indpendance par rapport tous les autres et aussi par rapport l'investigation des mmes faits, mais fonde sur d'autres mthodes. Pourtant, nos recherches n'ont qu'un intrt, qui est de construire des modles dont les proprits formelles sont, du point de vue de la comparaison et de l'explication, rductibles aux proprits d'autres modles relevant eux-mmes de niveaux stratgiques diffrents. Ainsi pouvons-nous esprer abattre les cloisons entre les disciplines voisines et promouvoir entre elles une vritable collaboration. Un exemple illustrera ce point. Le problme des rapports entre l'histoire et l'ethnologie a fait rcemment l'objet de nombreuses discussions. En dpit des critiques qui m'ont t adresses (), je maintiens que la notion de temps n'est pas au centre du dbat. Mais, si ce n'est pas une perspective temporelle propre l'histoire qui distingue les deux disciplines, en quoi consiste leur diffrence ? Pour rpondre, il faut se reporter aux remarques prsentes dans le prcdent paragraphe et replacer l'histoire et l'ethnologie au sein des autres sciences sociales. L'ethnographie et l'histoire diffrent d'abord de l'ethnologie et de la sociologie, pour autant que les deux premires sont fondes sur la collecte et l'organisation des documents, tandis que les deux autres tudient plutt les modles construits partir, et au moyen, de ces documents. En second lieu, l'ethnographie et l'ethnologie correspondent respectivement deux tapes d'une mme recherche qui aboutit en fin de compte des modles mcaniques, tandis que l'histoire (et les autres disciplines gnralement classes comme ses auxiliaires ) aboutit des modles statistiques. Les relations entre nos
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 19
quatre disciplines peuvent donc tre ramenes deux oppositions, l'une entre observation empirique et construction de modles (comme caractrisant la dmarche initiale), l'autre entre le caractre statistique ou mcanique des modles, envisags au point d'arrive. Soit, en affectant arbitrairement le signe + au premier terme, et le signe au second terme de chaque opposition :
Histoire Sociologie Ethnographie Ethnologie observation empirique / construction de modles modles mcaniques / modles statistiques + + + +
On comprend ainsi comment il se fait que les sciences sociales, qui toutes doivent ncessairement adopter une perspective temporelle, se distinguent par l'emploi de deux catgories de temps. L'ethnologie fait appel un temps mcanique , c'est--dire rversible et non cumulatif : le modle d'un systme de parent patrilinaire ne contient rien qui indique s'il a toujours t patrilinaire, ou s'il a t prcd par un systme matrilinaire, ou encore par toute une srie d'oscillations entre les deux formes. Par contre, le temps de l'histoire est statistique : il n'est pas rversible et comporte une orientation dtermine. Une volution qui ramnerait la socit italienne contemporaine la Rpublique romaine serait aussi inconcevable que la rversibilit des processus qui relvent de la deuxime loi de la thermodynamique. La discussion qui prcde prcise la distinction, propose par Firth, entre la notion de structure sociale o le temps ne joue aucun rle, et celle d'organisation sociale o il est appel intervenir (1951, p. 40). De mme pour le dbat prolong entre les tenants de l'anti-volutionnisme boasien et M. Leslie White (1949). Boas et son cole se sont surtout occups de modles mcaniques o la notion d'volution n'a pas de valeur heuristique. Cette notion prend un sens plein sur le terrain de l'histoire et de la sociologie, mais la
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 20
condition que les lments auxquels elle se rapporte ne soient pas formuls en termes d'une typologie culturaliste qui utilise exclusivement des modles mcaniques. Il faudrait, au contraire, saisir ces lments un niveau assez profond pour tre sr qu'ils resteront identiques, quel que soit le contexte culturel o ils interviennent (comme les gnes, qui sont des lments identiques susceptibles d'apparatre en combinaisons diffrentes, desquelles rsultent les types raciaux, c'est--dire des modles statistiques). Il est enfin ncessaire qu'on puisse dresser de longues sries statistiques. Boas et son cole ont donc raison de rcuser la notion d'volution : elle n'est pas signifiante au niveau des modles mcaniques qu'ils utilisent exclusivement, et M. White a tort de prtendre rintgrer la notion d'volution, puisqu'il persiste utiliser des modles du mme type que ses adversaires. Les volutionnistes rtabliraient plus aisment leur position s'ils consentaient substituer aux modles mcaniques des modles statistiques, c'est--dire dont les lments soient indpendants de leur combinaison et restent identiques travers une priode de temps suffisamment longue. () La distinction entre modle mcanique et modle statistique offre un autre intrt : elle permet d'clairer le rle de la mthode comparative dans les recherches structurales. Radcliffe-Brown et Lowie ont tenu l'un et l'autre surestimer ce rle. Ainsi, le premier crit (1952, p. 14) :
On tient gnralement la sociologie thorique pour une science inductive. L'induction est, en effet, le procd logique qui permet d'infrer des propositions gnrales de la considration d'exemples spciaux. Le professeur Evans-Pritchard... parat parfois penser que la mthode logique d'induction, employant la comparaison, la classification et la gnralisation, ne peut tre applique aux phnomnes humains et la vie sociale... Quant moi, je tiens que l'ethnologie se fonde sur l'tude comparative et systmatique d'un grand nombre de socits.
Dans une tude antrieure, Radcliffe-Brown disait propos de la religion (1945, p. 1) :
La mthode exprimentale applique la sociologie religieuse... enseigne que nous devons mettre nos hypothses l'preuve d'un nombre suffisant de religions diffrentes ou de cultes religieux particuliers,
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 21
confronts chacun avec la socit particulire o ils se manifestent. Une telle entreprise dpasse les capacits d'un chercheur unique, elle suppose la collaboration de plusieurs.
Dans le mme esprit, Lowie commence par souligner (1948 a, p. 38) que la littrature ethnologique est remplie de prtendues corrlations qui n'ont aucune base exprimentale ; et il insiste sur la ncessit d'largir la base inductive de nos gnralisations (1848 a, p. 68). Ainsi ces deux auteurs sont d'accord pour donner un fondement inductif l'ethnologie ; en quoi ils se sparent non seulement de Durkheim : Quand une loi a t prouve par une exprience bien faite, cette preuve est valable universellement (1912, p. 593), mais aussi de Goldstein. Comme on l'a dj not, celui-ci a formul de la faon la plus lucide ce qu'on pourrait appeler les rgles de la mthode structuraliste en se plaant un point de vue assez gnral pour les rendre valides, au-del du domaine limit pour lequel il les avait d'abord conues. Goldstein remarque que la ncessit de procder une tude dtaille de chaque cas entrane, comme consquence, la restriction du nombre des cas qu'on pourra considrer de cette faon. Ne risque-t-on pas alors de s'attacher des cas trop spciaux pour qu'on puisse formuler, sur une base aussi restreinte, des conclusions valables pour tous les autres ? Il rpond (1951, p. 25) : Cette objection mconnat compltement la situation relle : tout d'abord, l'accumulation de faits mme trs nombreux ne sert de rien s'ils ont t tablis d'une manire imparfaite, elle ne conduit jamais la connaissance des choses telles qu'elles se passent actuellement... Il faut choisir des cas tels qu'ils permettent de porter des jugements dcisifs. Mais alors ce qu'on aura tabli dans un cas vaudra aussi pour les autres. Peu d'ethnologues accepteraient d'endosser cette conclusion. Pourtant, la recherche structuraliste serait vaine si l'on n'tait pleinement conscient du dilemme de Goldstein : soit tudier des cas nombreux, d'une faon toujours superficielle et sans grand rsultat ; soit se limiter rsolument l'analyse approfondie d'un petit nombre de cas, et prouver ainsi qu'en fin de compte, une exprience bien faite vaut une dmonstration.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 22
Comment expliquer cet attachement de si nombreux ethnologues la mthode comparative ? N'est-ce pas, ici encore, qu'ils confondent les techniques propres construire et tudier les modles mcaniques et statistiques ? La position de Durkheim et de Goldstein est inexpugnable en ce qui concerne les premiers : par contre, il est vident qu'on ne peut fabriquer un modle statistique sans statistiques, autrement dit, sans accumuler des faits trs nombreux. Mais, mme dans ce cas, la mthode ne peut tre appele comparative : les faits rassembls n'auront de valeur que s'ils relvent tous d'un mme type. On revient toujours la mme option, qui consiste tudier fond un cas, et la seule diffrence tient au mode de dcoupage du cas , dont les lments constitutifs seront (selon le patron adopt) l'chelle du modle projet, ou une chelle diffrente. Nous avons essay jusqu' prsent d'lucider quelques questions de principe, qui concernent la nature mme de la notion de structure sociale. Il devient ainsi plus facile de procder un inventaire des principaux types de recherche, et de discuter quelques rsultats.
II. Morphologie sociale ou structures de groupe.
Retour la table des matires
Dans cette deuxime section, le terme groupe ne dsigne pas le groupe social, mais plus gnralement, la manire dont les phnomnes sont groups entre eux. D'autre part, il rsulte de la premire section de ce travail que les recherches structurales ont pour objet l'tude des relations sociales l'aide de modles. Or, il est impossible de concevoir les relations sociales en dehors d'un milieu commun qui leur serve de systme de rfrence. L'espace et le temps sont les deux systmes de rfrence qui permettent de penser les relations sociales, ensemble ou isolment.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 23
Ces dimensions d'espace et de temps ne se confondent pas avec celles qu'utilisent les autres sciences. Elles consistent en un espace social et en un temps social , ce qui signifie qu'elles n'ont d'autres proprits que celles des phnomnes sociaux qui les peuplent. Selon leur structure particulire, les socits humaines ont conu ces dimensions de faons trs diffrentes. L'ethnologue ne doit donc pas s'inquiter de l'obligation o il peut se trouver d'utiliser des types qui lui sont inhabituels, et mme d'en inventer pour les besoins du moment. On a dj remarqu que le continuum temporel apparat rversible ou orient, selon le niveau offrant la plus grande valeur stratgique o on doit se placer du point de vue de la recherche en cours. D'autres ventualits peuvent aussi se prsenter : temps indpendant de celui de l'observateur, et illimit ; temps, fonction du temps propre (biologique) de l'observateur, et limit ; temps analysable ou non en parties, qui sont elles-mmes homologues entre elles, ou spcifiques, etc. Evans-Pritchard a montr qu'on peut ramener des proprits formelles de ce type l'htrognit qualitative, superficiellement perue par l'observateur, entre son temps propre et des temps qui relvent d'autres catgories : histoire, lgende ou mythe (1939, 1940). Cette analyse, inspire par l'tude d'une socit africaine, peut tre tendue notre propre socit (Bernot et Blancard, 1953). En ce qui concerne l'espace, Durkheim et Mauss ont t les premiers dcrire les proprits variables qu'on doit lui reconnatre pour pouvoir interprter la structure d'un grand nombre de socits dites primitives (1901-1902). Mais c'est de Cushing qu'on affecte aujourd'hui de ddaigner qu'ils se sont d'abord inspirs. L'uvre de Frank Hamilton Cushing tmoigne en effet d'une pntration et d'une invention sociologiques, qui devraient valoir son auteur une place la droite de Morgan, parmi les grands prcurseurs des recherches structurales. Les lacunes, les inexactitudes releves dans ses descriptions, le grief mme qu'on a pu lui faire d'avoir surinterprt ses observations, tout cela est ramen de plus justes proportions quand on comprend que Cushing cherchait moins dcrire concrtement la socit zuni qu' laborer un mo-
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 24
dle (la clbre division en sept parties) permettant d'expliquer sa structure et le mcanisme de son fonctionnement. Le temps et l'espace sociaux doivent aussi tre distingus selon l'chelle. L'ethnologue utilise un macro-temps et un microtemps ; un macro-espace et un micro-espace . De faon parfaitement lgitime, les tudes structurales empruntent leurs catgories aussi bien la prhistoire, l'archologie, et la thorie diffusionniste, qu' la topologie psychologique fonde par Lewin, ou la sociomtrie de Moreno. Car des structures de mme type peuvent tre rcurrentes des niveaux trs diffrents du temps et de l'espace, et rien n'exclut qu'un modle statistique (par exemple, un de ceux labors en sociomtrie) ne se rvle plus utile pour construire un modle analogue, applicable l'histoire gnrale des civilisations, qu'un autre directement inspir des faits emprunts ce seul domaine. Loin de nous, par consquent, l'ide que les considrations historiques et gographiques soient sans valeur pour les tudes structurales, comme le croient encore ceux qui se disent fonctionnalistes . Un fonctionnaliste peut tre tout le contraire d'un structuraliste, l'exemple de Malinowski est l pour nous en convaincre. Inversement, l'uvre de G. Dumzil et l'exemple personnel de A. L. Kroeber (d'esprit si structuraliste, bien qu'il se soit longtemps consacr des tudes de distribution spatiale) prouvent que la mthode historique n'est nullement incompatible avec une attitude structurale. Les phnomnes synchroniques offrent pourtant une homognit relative qui les rend plus faciles tudier que les phnomnes diachroniques. Il n'est donc pas surprenant que les recherches les plus accessibles, en fait de morphologie, soient celles qui touchent aux proprits qualitatives, non mesurables, de l'espace social, c'est--dire la faon dont les phnomnes sociaux se distribuent sur la carte, et les constantes qui ressortent de cette distribution. A cet gard, l'cole dite de Chicago et ses travaux d'cologie urbaine avaient suscit de grands espoirs, trop vite dus. Les problmes d'cologie sont discuts dans un autre chapitre de ce symposium, je
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 25
me contenterai donc de prciser au passage les relations qui existent entre les notions d'cologie et de structure sociale. Dans les deux cas ; on s'occupe de la distribution des phnomnes sociaux dans l'espace, mais les recherches structuralistes portent exclusivement sur les cadres spatiaux dont les caractres sont sociologiques, c'est--dire ne dpendent pas de facteurs naturels tels ceux de la gologie, de la climatologie, de la physiographie, etc. Les recherches dites d'cologie urbaine offrent donc un intrt exceptionnel pour l'ethnologue : l'espace urbain est suffisamment restreint, et assez homogne ( tous gards autres que le social) pour que ses proprits qualitatives puissent tre attribues directement des facteurs internes, d'origine la fois formelle et sociale. Au lieu de s'attaquer des communauts complexes o il est difficile de faire la part respective des influences du dehors et du dedans, il et t peut-tre plus sage de se limiter comme l'avait fait Marcel Mauss (1924-1925) ces communauts, petites et relative- ment isoles, qui sont les plus frquentes dans l'exprience de l'ethnologue. On connat quelques tudes de ce genre, mais elles dpassent rarement le niveau descriptif ; ou, quand elles le font, c'est avec une timidit singulire. Personne n'a srieusement cherch quelles corrlations peuvent exister entre la configuration spatiale des groupes, et les proprits formelles qui relvent des autres aspects de leur vie sociale. Pourtant, de nombreux documents attestent la ralit et l'importance de telles corrlations, principalement en ce qui concerne, d'une part la structure sociale, et de l'autre, la configuration spatiale des tablissements humains : villages ou campements. Me limitant ici l'Amrique, je rappellerai que la forme des campements des Indiens des Plaines varie avec l'organisation sociale de chaque tribu. Il en est de mme de la distribution circulaire des huttes, dans les villages G du Brsil central et oriental. Dans les deux cas, il s'agit de rgions assez homognes au point de vue linguistique et culturel, et o l'on dispose d'une bonne srie de variations concomitantes. D'autres problmes se posent, quand on compare des rgions ou des types d'tablissements diffrents, qui vont de pair avec des structures sociales diffrentes ; ainsi, la configuration circulaire des villages G d'une part, et celle, en rues parallles, des cits des
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 26
Pueblo. Dans ce dernier cas, on peut mme procder une tude diachronique, grce aux documents archologiques, qui attestent d'intressantes variations. Existe-t-il une relation entre le passage des structures semi-circulaires anciennes aux structures parallles actuelles d'une part, et, de l'autre, le transfert des villages du fond des valles aux plateaux ? Et comment s'est produit le changement dans la rpartition des habitations entre les diffrents clans, que les mythes dcrivent comme trs systmatique, alors qu'elle semble aujourd'hui tre le fait du hasard ? Je ne prtends pas que la configuration spatiale des villages reflte toujours l'organisation sociale comme un miroir, ni qu'elle la reflte tout entire. Ce serait une affirmation gratuite pour un grand nombre de socits. Mais, n'y a-t-il pas quelque chose de commun toutes celles si diffrentes par ailleurs o l'on constate une relation (mme obscure) entre configuration spatiale et structure sociale ? Et, plus encore, entre celles o la configuration spatiale reprsente la structure sociale, comme le ferait un diagramme trac au tableau noir ? En ralit, les choses sont rarement aussi simples qu'il parat. J'ai essay de montrer ailleurs1 que le plan du village bororo n'exprime pas la vritable structure sociale, mais un modle prsent la conscience indigne, bien qu'il soit de nature illusoire et qu'il contredise les faits. On possde ainsi le moyen d'tudier les phnomnes sociaux et mentaux partir de leurs manifestations objectives, sous une forme extriorise et pourrait-on dire cristallise. Or, l'occasion n'en est pas seulement offerte par des configurations spatiales stables, comme les plans de village. Des configurations instables, mais rcurrentes, peuvent tre analyses et critiques de la mme faon. Ainsi, celles qu'on observe dans la danse, dans le rituel, etc. On se rapproche de l'expression mathmatique en abordant les proprits numriques des groupes, qui forment le domaine traditionnel de la dmographie. Depuis quelques annes, pourtant, des chercheurs venus d'horizons diffrents dmographes, sociologues, ethnologues tendent s'associer, pour jeter les bases d'une dmographie nouvelle, qu'on pourrait appeler qualitative : moins proccupe des variations continues au sein de groupes humains,
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 27
arbitrairement isols pour des raisons empiriques, que des discontinuits significatives entre des groupes considrs comme des touts, et dlimits en raison de ces discontinuits. Cette sociodmographie , comme dit Mlle de Lestrange, est dj de plainpied avec l'anthropologie sociale. Il se pourrait qu'un jour, elle devnt le point de dpart obligatoire de toutes nos recherches. Les ethnologues doivent donc s'intresser, plus qu'ils n'ont fait jusqu' prsent, aux recherches dmographiques d'inspiration structuraliste : celles de Livi sur les proprits formelles de l'isolt minimum capable de se perptuer ; ou celles, voisines, de Dahlberg. L'effectif des populations sur lesquelles nous travaillons peut tre trs proche du minimum de Livi, et parfois mme infrieur. De plus, il existe une relation certaine entre le mode de fonctionnement et la durabilit d'une structure sociale, et l'effectif de la population. N'y aurait-il pas des proprits formelles des groupes qui seraient directement et immdiatement fonction du chiffre absolu de la population, indpendamment de toute autre considration ? Dans l'affirmative, il faudrait commencer par dterminer ces proprits et par leur faire une place, avant de chercher d'autres interprtations. On envisagera ensuite les proprits numriques qui n'appartiennent pas au groupe considr comme un tout, mais aux sousensembles du groupe et leurs relations, dans la mesure o les uns et les autres manifestent des discontinuits significatives. A cet gard, deux lignes de recherches offrent un grand intrt pour l'ethnologue : I. - Celles qui se rattachent la fameuse loi de sociologie urbaine dite rank-size, permettant, pour un ensemble dtermin, d'tablir une corrlation entre la taille absolue des villes (calcule d'aprs le chiffre de population) et la position de chacune dans un ensemble ordonn, et mme, semble-t-il, de dduire un des lments partir de l'autre. () II. Les travaux de certains dmographes franais, fonds sur la dmonstration de Dahlberg que les dimensions absolues d'un isolt peuvent tre calcules d'aprs la frquence des mariages
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 28
consanguins (Dahlberg, 1948). Sutter et Tabah (1951) sont ainsi parvenus calculer la taille moyenne des isolats pour tous nos dpartements, rendant du mme coup accessible l'ethnologue le systme matrimonial complexe d'une socit moderne. La taille moyenne de l'isolat franais varierait de moins de 1 000 un peu plus de 2 800 personnes. On s'aperoit ainsi que le rseau d'individus dfini par les relations d'intermariage est mme dans une socit moderne de taille trs infrieure ce qu'on aurait pu supposer : peine dix fois plus grande que celle des plus petites socits dites primitives, c'est--dire du mme ordre de grandeur. Faut-il en conclure que les rseaux d'intermariage sont peu prs constants, en taille absolue, dans toutes les socits humaines ? Dans l'affirmative, la nature complexe d'une socit rsulterait moins d'une dilatation de l'isolat primitif, que de l'intgration d'isolats relativement stables dans des ensembles de plus en plus vastes, mais caractriss par d'autres types de liens sociaux (conomiques, politiques, intellectuels), Sutter et Tabah ont aussi montr que les plus petits isolais ne se rencontrent pas exclusivement dans les rgions recules, telles que les zones montagneuses, mais aussi (et mme davantage) dans les grands centres urbains ou leur voisinage : les dpartements du Rhne (avec Lyon), de la Gironde (avec Bordeaux), et de la Seine (avec Paris) figurent en queue de liste avec des isolats de 740, 910 et 930 personnes, respectivement. Dans le dpartement de la Seine, qui se confond pratiquement avec l'agglomration parisienne, la proportion des mariages consanguins est plus leve que dans l'un quelconque des 15 dpartements ruraux qui l'entourent. Tout cela est essentiel, parce que l'ethnologue peut esprer, grce ces travaux, retrouver dans une socit moderne et complexe des units plus petites, de mme nature que celles qu'il tudie le plus souvent. Nanmoins, la mthode dmographique doit tre complte d'un point de vue ethnologique. La taille absolue des isolats n'puise pas le problme ; on devra aussi dterminer la longueur des cycles matrimoniaux. Toutes proportions gardes, un petit isolat peut consister en un rseau de cycles tendus (du mme ordre de grandeur que l'isolt lui-mme) ; et un grand isolat peut tre fait (un peu la faon d'une cotte de mailles) de cycles courts. Mais alors, il devient ncessaire de dresser des gnalogies, c'est--
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 29
dire que le dmographe, mme structuraliste, ne saurait se passer de l'ethnologue. Cette collaboration peut aider clarifier un autre problme, celui-l thorique. Il s'agit de la porte et de la validit de la notion de culture, qui a donn lieu de vives discussions entre ethnologues anglais et amricains au cours de ces dernires annes. En s'attachant surtout l'tude de la culture, les ethnologues d'outreAtlantique n'ont-ils fait comme l'a crit Radcliffe-Brown -que rifer une abstraction ? Pour le matre anglais, l'ide de culture europenne est une abstraction, au mme titre que celle de culture propre telle ou telle tribu africaine . Rien n'existe que des tres humains, lis les uns aux autres par une srie illimite de relations sociales (Radcliffe-Brown, 1940 b). Fausse querelle , rpond Lowie (1942, pp. 520-521). Pas si fausse, cependant, puisque le dbat renat priodiquement. De ce point de vue, on aurait tout intrt placer la notion de culture sur le mme plan que la notion gntique et dmographique d'isolat. Nous appelons culture tout ensemble ethnographique qui, du point de vue de l'enqute, prsente, par rapport d'autres, des carts significatifs. Si l'on cherche dterminer des carts significatifs entre l'Amrique du Nord et l'Europe, on les traitera comme des cultures diffrentes ; mais, supposer que l'intrt se porte sur des carts significatifs entre disons -- Paris et Marseille, ces deux ensembles urbains pourront tre provisoirement constitus comme deux units culturelles. L'objet dernier des recherches structurales tant les constantes lies de tels carts, on voit que la notion de culture peut correspondre une ralit objective, tout en restant fonction du type de recherche envisag. Une mme collection d'individus, pourvu qu'elle soit objectivement donne dans le temps et dans l'espace, relve simultanment de plusieurs systmes de culture universel, continental, national, provincial, local, etc. ; et familial, professionnel, confessionnel, politique, etc. Dans la pratique, pourtant, ce nominalisme ne saurait tre pouss jusqu' son terme. En fait, le terme de culture est employ pour regrouper un ensemble d'carts significatifs dont l'exprience prouve que les limites concident approximativement. Que cette conci-
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 30
dence ne soit jamais absolue, et qu'elle ne se produise jamais tous les niveaux la fois, ne doit pas nous interdire d'utiliser la notion de culture ; elle est fondamentale en ethnologie et possde la mme valeur heuristique que celle d'isolat en dmographie. Logiquement, les deux notions sont du mme type. D'ailleurs, ce sont les physiciens eux-mmes qui nous encouragent conserver la notion de culture, puisque N. Bohr crit : Les diffrences traditionnelles (des cultures humaines) ressemblent, beaucoup d'gards, aux manires diffrentes, mais quivalentes, selon lesquelles l'exprience physique peut tre dcrite (1939, p. 9)
III. Statique sociale, ou structures de communication.
Retour la table des matires
Une socit est faite d'individus et de groupes qui communiquent entre eux. Cependant, la prsence ou l'absence de communication ne saurait tre dfinie de manire absolue. La communication ne cesse pas aux frontires de la socit. Plutt que de frontires rigides, il s'agit de seuils, marqus par un affaiblissement ou une dformation de la communication, et o, sans disparatre, celle-ci passe par un niveau minimum. Cette situation est suffisamment significative pour que la population (au-dehors comme audedans) en prenne conscience. La dlimitation d'une socit n'implique pourtant pas que cette conscience soit claire, condition ralise seulement dans des cas de prcision et de stabilit suffisantes. Dans toute socit, la communication s'opre moins trois niveaux : communication des femmes ; communication des biens et des services ; communication des messages. Par consquent, l'tude du systme de parent, celle du systme conomique et celle du systme linguistique offrent certaines analogies. Toutes trois relvent de la mme mthode ; elles diffrent seulement par le niveau stratgique o chacune choisit de se situer au sein d'un univers commun. On pourrait mme ajouter que les rgles de parent et de mariage dfinissent un quatrime type de communication : celui
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 31
des gnes entre les phnotypes. La culture ne consiste donc pas exclusivement en formes de communication qui lui appartiennent en propre (comme le langage), mais aussi et peut-tre surtout en rgles applicables toutes sortes de jeux de communication , que ceux-ci se droulent sur le plan de la nature ou sur celui de la culture. L'analogie qui vient d'tre affirme entre sociologie de la parent, science conomique et linguistique, laisse subsister une diffrence entre les trois modes de communication correspondants : ils ne sont pas la mme chelle. Envisags sous le rapport des taux de communication pour une socit donne, les intermariages et l'change des messages diffrent entre eux, quant l'ordre de grandeur, peu prs comme les mouvements des grosses molcules de deux liquides visqueux, traversant par osmose la paroi difficilement permable qui les spare, et ceux d'lectrons mis par des tubes cathodiques. Quand on passe du mariage au langage, on va d'une communication rythme lent une autre, rythme trs rapide. Diffrence facilement explicable : dans le mariage, objet et sujet de communication sont presque de mme nature (femmes et hommes, respectivement) ; tandis que, dans le langage, celui qui parle ne se confond jamais avec ses mots. Nous sommes donc en prsence d'une double opposition : personne et symbole ; valeur et signe. On comprend mieux, ainsi, la position intermdiaire des changes conomiques par rapport aux deux autres formes : les biens et les services ne sont pas des personnes (comme les femmes) ; mais, la diffrence des phonmes, ce sont encore des valeurs. Et pourtant, bien qu'ils ne soient intgralement ni des symboles, ni des signes, on a besoin de symboles et de signes pour les changer ds que le systme conomique atteint un certain degr de complexit. Trois ordres de considrations dcoulent de notre manire de concevoir la communication sociale : 1 Les rapports entre science conomique et tudes de structure sociale peuvent tre mieux dfinis. Jusqu' prsent, les ethnologues ont manifest beaucoup de dfiance envers la science conomique. Cela, en dpit des relations troites qui sont apparues entre les
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 32
deux disciplines chaque fois qu'un rapprochement s'est produit. Depuis les travaux novateurs de Mauss (1904-1905, 1923-1924) jusqu'au livre de Malinowski consacr au kula(l922) son chefd'uvre toutes les recherches ont montr que la thorie ethnologique dcouvre, grce l'analyse des faits conomiques, quelques-unes des plus belles rgularits dont elle puisse faire tat. Mais l'atmosphre mme o s'est dveloppe la science conomique devait rebuter l'ethnologue : pleine d'pres conflits entre les doctrines, imbue de morgue et d'sotrisme. D'o le sentiment que la science conomique se payait surtout d'abstractions. Quel rapport pouvait-il y avoir entre l'existence concrte des groupements humains rellement observables, et des notions telles que la valeur, l'utilit et le profit ? La nouvelle formulation des problmes conomiques propose par von Neumann et Morgenstern (1944) devrait, au contraire, inciter les conomistes et les ethnologues la collaboration. D'abord, et bien que la science conomique aspire chez ces auteurs une expression rigoureuse, son objet ne consiste plus en notions abstraites, mais en individus ou groupes concrets, qui se manifestent dans des rapports empiriques de coopration ou de comptition. Aussi inattendu que le rapprochement puisse paratre, ce formalisme rejoint donc certains aspects de la pense marxiste. () En second lieu, et pour la mme raison, nous y trouvons pour la premire fois des modles mcaniques du type de ceux qu'utilisent sans doute dans des domaines trs diffrents l'ethnologie et la logique, et propres servir d'intermdiaire entre les deux. Les modles de von Neumann proviennent de la thorie des jeux, mais ressemblent ceux que les ethnologues emploient en matire de parent. Kroeber avait d'ailleurs dj compar certaines institutions sociales des jeux d'enfants appliqus (1942, p. 215). A vrai dire, il existe une grande diffrence entre les jeux de socit et les rgles du mariage : les premiers sont destins permettre chaque joueur d'obtenir, pour son avantage, des carts diffrentiels aussi grands que possible partir d'une rgularit statistique initialement donne. Les rgles du mariage agissent en sens
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 33
inverse : rtablir une rgularit statistique, en dpit des valeurs diffrentielles qui se manifestent entre les individus et les gnrations. On pourrait dire que les secondes constituent des jeux l'envers , ce qui ne les empche pas d'tre justiciables des mmes mthodes. D'ailleurs, dans les deux cas, une fois fixes les rgles, chaque individu ou groupe essaye de jouer le jeu de la mme faon, c'est-dire pour accrotre ses propres avantages aux dpens d'autrui. Sur le plan du mariage, ce sera en obtenant plus de femmes, ou une pouse plus enviable, en fonction de critres esthtiques, sociaux ou conomiques. Car la sociologie formelle ne s'arrte pas la porte du romanesque ; elle y pntre, sans crainte de se perdre dans le ddale des sentiments et des conduites. Von Neumann n'a-t-il pas propos une thorie mathmatique d'une conduite aussi subtile et, pourrait-on croire, aussi subjective que le bluff au poker (von Neumann et Morgenstern, 1944, pp. 186-219) ? 2 S'il est permis d'esprer que l'anthropologie sociale, la science conomique et la linguistique s'associeront un jour, pour fonder une discipline commune qui sera la science de la communication, reconnaissons nanmoins que celle-ci consistera surtout en rgles. Ces rgles sont indpendantes de la nature des partenaires (individus ou groupes) dont elles commandent le jeu. Comme le dit von Neumann (op. cit., p. 49) : Le jeu consiste dans l'ensemble des rgles qui le dcrivent. On pourra aussi introduire d'autres notions : partie, coup, choix et stratgie. () De ce point de vue, la nature des joueurs est indiffrente, ce qui compte tant seulement de savoir quand un joueur peut choisir, et quand il ne le peut pas. 3 On en vient ainsi introduire, dans les tudes relatives la parent et au mariage, des conceptions drives de la thorie de la communication. L' information d'un systme de mariage est fonction du nombre d'alternatives dont dispose l'observateur pour dfinir le statut matrimonial (c'est--dire celui de conjoint possible, prohib, ou assign) d'un individu quelconque, par rapport un prtendant dtermin. Dans un systme moitis exogamiques, cette information est gale l'unit. Dans une typologie australienne, elle augmente avec le logarithme du nombre des classes matri-
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 34
moniales. Un systme thorique de panmixie (o chacun pourrait pouser n'importe qui) ne prsenterait aucune redondance , puisque chaque choix matrimonial serait indpendant de tous les autres. Inversement, les rgles du mariage constituent la redondance du systme considr. On pourra aussi calculer le pourcentage des choix libres (non pas absolument, mais par rapport certaines conditions postules par hypothse) qui se produisent dans une population matrimoniale donne, et assigner une valeur numrique son entropie , relative et absolue. Ds lors, une autre possibilit s'ouvrira : la conversion des modles statistiques en modles mcaniques et inversement. Ce qui revient dire que le foss sera combl entre dmographie et ethnologie, et qu'on disposera d'une base thorique pour la prvision et l'action. Soit notre propre socit comme exemple ; le libre choix d'un conjoint y est limit par trois facteurs : a) degrs prohibs ; b) dimension de l'isolat ; c) rgles de conduite admises, qui restreignent la frquence relative de certains choix au sein de l'isolat. Avec ces donnes, on peut calculer l'information du systme, c'est-dire convertir un systme matrimonial faiblement organis et essentiellement fond sur des moyennes, en un modle mcanique, comparable toute la srie de modles mcaniques des rgles du mariage, dans les socits plus simples que la ntre. De mme, et nous rfrant plus spcialement ces dernires, l'tude statistique des choix matrimoniaux d'un nombre suffisamment grand d'individus permettrait de trancher des problmes controverss, tels le nombre des classes matrimoniales de la tribu australienne faussement appele Murngin, valu, selon les auteurs, 32,7, moins de 7,4 et 3, avant que des enqutes rcentes n'aient dcid en faveur du dernier chiffre. Jusqu'ici, je me suis efforc d'valuer l'apport ventuel de quelques types de recherches mathmatiques l'ethnologie. Le principal bnfice que nous pouvons en esprer consiste, nous l'avons vu, dans l'offre qui nous est faite d'un concept unificateur la notion de communication grce auquel on pourra consolider en une seule discipline des recherches considres comme trs diffrentes, et acqurir certains outils thoriques et mthodologiques
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 35
indispensables au progrs dans cette direction. J'aborde maintenant un autre problme : l'anthropologie sociale est-elle en mesure d'utiliser ces instruments, et comment ? Au cours des dernires annes, l'anthropologie sociale s'est principalement intresse aux faits de parent. Elle a ainsi reconnu le gnie de Lewis Morgan dont les Systems of Consanguinity and Affinity of th Human Family (1871) ont simultanment fond l'anthropologie sociale et les tudes de parent, tout en expliquant pourquoi la premire doit attacher tant d'importance aux secondes. De tous les faits sociaux, ceux qui touchent la parent et au mariage manifestent au plus haut point ces caractres durables, systmatiques et continus jusque dans le changement, qui donnent prise l'analyse scientifique. A ces considrations de Morgan, ajoutons que le domaine de la parent est celui qui revient en propre l'ethnologue, au sein du grand royaume de la communication. En dpit du dveloppement des tudes de parent, il ne faut pas se dissimuler que notre documentation est bien mince. Si l'on nglige l'histoire pour considrer exclusivement le prsent, l'univers humain comptait sans doute, encore rcemment, 3 4 000 socits distinctes ; mais Murdock estime que nous pouvons seulement raisonner sur 250, chiffre encore trop optimiste mon sens. N'a-t-on donc pas assez travaill ? Ou n'est-ce pas, au contraire, une consquence de cette illusion inductive dj dnonce plus haut ? On s'est parpill sur trop de cultures, on a cherch accumuler des informations nombreuses et superficielles, et l'on s'aperoit finalement que beaucoup sont inutilisables. A cette situation, il ne faut pas s'tonner que les spcialistes ragissent chacun selon son temprament. Certains prfrent considrer des rgions peu nombreuses, o l'information est suffisamment dense. D'autres largissent l'ventail ; d'autres encore cherchent une solution intermdiaire. Le cas des Pueblo est frappant : pour peu de rgions du monde trouverait-on une si grande abondance de documents, et de qualit aussi douteuse. On se sent parfois dsespr devant l'norme matriel accumul par Voth, Fewkes, Dorsey, Parsons et jusqu' certain point Stevenson : il est peine utilisable, tant ces auteurs se sont fivreusement employs entasser les informations, sans se
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 36
demander ce qu'elles signifiaient, et surtout, en s'interdisant les hypothses qui pouvaient seules permettre de les contrler. Avec Lowie et Kroeber, la situation a heureusement chang ; mais certaines lacunes sont irrmdiables. Ainsi, l'absence de donnes statistiques sur les mariages, qui auraient pu tre recueillies depuis un demi-sicle. Pourtant, un ouvrage rcent de Fred Eggan (1950) montre bien ce qu'on peut attendre d'tudes intensives et exhaustives, portant sur un domaine limit. Il analyse des formes voisines, dont chacune prserve une rgularit structurale, quoiqu'elles offrent, les unes par rapport aux autres, des discontinuits qui deviennent significatives quand on les compare des discontinuits homologues, mais relevant d'autres domaines tels que l'organisation clanique, les rgles du mariage, le rituel, les croyances religieuses, etc. Cette mthode vraiment galilenne 1 permet d'esprer qu'un jour, nous atteindrons un niveau d'analyse o la structure sociale sera de plain-pied avec d'autres types de structure : mentale, et surtout linguistique. Pour nous borner un exemple : le systme de parent hopi fait appel trois modles de temps diffrents : 1 une dimension vide , statique et rversible, illustre par les lignes de la mre du pre et du pre de la mre, o des termes identiques se rptent mcaniquement au long des gnrations ; 2 un temps progressif, non rversible, dans la ligne d'Ego (femelle) avec des squences du type : grand-mre > mre > sur > enfant > petitenfant ; 3 un temps ondulatoire, cyclique, rversible, dans la ligne d'Ego (mle) dfinie par une alternance continuelle entre deux termes : sur et enfant de sur respectivement. Ces trois dimensions sont rectilignes. Toutes ensemble, elles s'opposent la structure circulaire de la ligne d'Ego (femelle) chez les Zuni, o trois termes : mre de la mre (ou fille de la fille), -mre, fille, se trouvent disposs en anneau ferm. A cette clture du systme correspond, Zuni, pour les autres lignes, une grande pauvret de la terminologie, tant en ce qui concerne le
1
C'est--dire cherchant dterminer la loi des variations concomitantes au lieu de s'attacher, la manire aristotlicienne, aux simples corrlations inductives.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 37
cercle de famille que les distinctions opres dans son sein. Comme l'tude des aspects du temps relve aussi de la linguistique, la question du rapport entre leurs formes linguistique et gnalogique se trouve immdiatement pose. () L'anthropologie serait plus avance si ses tenants avaient russi se mettre d'accord sur le sens de la notion de structure, l'usage qu'on peut en faire, et la mthode qu'elle implique. Ce n'est, hlas, pas le cas, mais on peut trouver une consolation et un encouragement pour l'avenir constater qu'il est au moins possible de comprendre les divergences et de prciser leur porte. Essayons donc d'esquisser rapidement les conceptions les plus rpandues, en les comparant celle qui a t propose au dbut de ce chapitre. Le terme de structure sociale voque immdiatement le nom de A. R. Radcliffe-Brown1. Son uvre ne se limite certes pas l'tude des systmes de parent ; mais il a choisi ce terrain pour formuler ses conceptions mthodologiques dans des termes auxquels tout ethnologue pourrait souscrire. Quand nous tudions les systmes de parent, note Radcliffe-Brown, nous nous assignons les buts suivants : 1 dresser une classification systmatique ; 2 comprendre les traits propres chaque systme : ) soit en rattachant chaque trait un ensemble organis ; b) soit en y reconnaissant un exemple particulier d'une classe de phnomnes dj identifie ; 3 enfin, parvenir des gnralisations valables sur la nature des socits humaines. Et voici sa conclusion : L'analyse cherche ramener la diversit [de. 2 300 systmes de parent] un ordre, quel qu'il puisse tre. Derrire la diversit, on peut en effet discerner des principes gnraux, en nombre limit, qui sont appliqus et combins de faons diverses (1941, p. 17). Il n'y a rien ajouter ce programme lucide, sinon souligner que Radcliffe-Brown l'a exactement appliqu son tude des systmes australiens : assemblant une masse prodigieuse d'informations ; introduisant un ordre l o il n'y avait que chaos ; dfinissant des notions essentielles, telles que celles de cycle, de paire et de couple. Sa dcouverte du systme Kariera, dans la rgion prcise et avec toutes les caractristiques postules par lui avant mme de se rendre en Australie, restera, dans l'histoire de la pense structuraliste, comme une mmorable russite dductive (1930-1931).
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 38
L'Introduction de Radcliffe-Brown aux African Systems of Kinship and Marriage a d'autres mrites : ce vritable trait de la parent en rduction entreprend d'intgrer les systmes occidentaux (considrs dans leurs formes les plus anciennes) dans une thorie gnrale. D'autres ides de Radcliffe-Brown (notamment, celles relatives l'homologie de la terminologie et des attitudes) seront voques plus loin. Aprs avoir rappel les titres de gloire de Radcliffe-Brown, je dois souligner qu'il se fait, des structures sociales, une conception diffrente de celle avance dans le prsent travail. La notion de structure lui apparat comme un concept intermdiaire entre ceux de l'anthropologie sociale et de la biologie : II existe une analogie vritable et significative entre structure organique et structure sociale (1940 b, p. 6). Loin d'lever le niveau des tudes de parent jusqu' la thorie de la communication, comme j'ai propos de le faire, Radcliffe-Brown le ramne celui de la morphologie et de la physiologie descriptives (1940 b, p. 10). Il reste ainsi fidle l'inspiration naturaliste de l'cole anglaise. Au moment o Kroeber et Lowie soulignaient dj le caractre artificiel des rgles de parent et de mariage, Radcliffe-Brown persistait dans la conviction (qu'il partagea avec Malinowski) que les liens biologiques sont, tout la fois, l'origine et le modle de tous les types de liens familiaux. De cette attitude de principe dcoulent deux consquences. La position empiriste de Radcliffe-Brown explique sa rpugnance distinguer clairement structure sociale et relations sociales. En fait, toute son uvre rduit la structure sociale l'ensemble des relations sociales existantes dans une socit donne. Sans doute at-il parfois esquiss une distinction entre structure et forme structurale. Mais le rle qu'il accorde cette dernire notion est purement diachronique. Dans la pense thorique de Radcliffe-Brown, son rendement est des plus faibles (1940 b, p. 4). La distinction elle-mme a fait l'objet d'une critique de Fortes, qui a beaucoup contribu introduire dans nos recherches une autre opposition, trangre la pense de Radcliffe-Brown, et laquelle on a vu que j'attache moi-mme une grande importance : celle entre modle et ralit : La structure ne peut tre directement apprhende dans
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 39
la "ralit concrte..." Quand on s'attache dfinir une structure, on se place, pourrait-on dire, au niveau de la grammaire et de la syntaxe, et non celui de la langue parle (Fortes, 1949, p. 56). En second lieu, l'assimilation, propose par Radcliffe-Brown, de la structure sociale aux relations sociales, l'incite dissocier la premire en lments calqus sur la forme la plus simple de relation qu'on puisse concevoir, celle entre deux personnes : La structure de parent d'une socit quelconque consiste en un nombre indtermin de relations dyadiques... Dans une tribu australienne, toute la structure sociale se rduit un rseau de relations de ce type, dont chacune unit une personne une autre... (1940 b, p. 3). Ces relations dyadiques constituent-elles vraiment la matire premire de la structure sociale ? Ne sont-elles pas plutt le rsidu - obtenu par analyse idale d'une structure prexistante, dont la nature est plus complexe ? Sur ce problme mthodologique, la linguistique structurale pourrait beaucoup nous apprendre. Bateson et Mead ont travaill dans la direction indique par Radcliffe-Brown. Dj pourtant, dans Naven (1936), Bateson dpassait le niveau des relations dyadiques pures, puisqu'il s'attachait les classer en catgories, admettant ainsi qu'il y a autre chose et plus, dans la structure sociale, que les relations elles-mmes : quoi donc, sinon la structure, pose pralablement aux relations ? Enfin, les relations dyadiques, telles que les conoit RadcliffeBrown, forment une chane qui peut tre allonge indfiniment par adjonction de relations nouvelles. D'o la rpugnance de notre auteur traiter la structure sociale comme un systme. Sur ce point majeur, il se spare donc de Malinowski. Sa philosophie se fonde sur la notion du continu ; l'ide de discontinuit lui est toujours reste trangre. On comprend mieux, ainsi, son hostilit envers la notion de culture, dj note, et son indiffrence aux enseignements de la linguistique. Observateur, analyste et classificateur incomparable, RadcliffeBrown doit souvent quand il se veut thoricien. Il se contente de formules relches, recouvrant mal des ptitions de principe. A-t-
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 40
on vraiment expliqu les prohibitions du mariage, en montrant qu'elles aident les systmes de parent correspondants se perptuer sans altration (Radcliffe-Brown, 1949 b) ? Les traits remarquables des systmes dits crow-omaha peuvent-ils tre entirement interprts en fonction de la notion de ligne (id., 1941) ? J'aurai l'occasion d'exprimer d'autres doutes. Mais dj, ces interrogations expliquent pourquoi l'uvre de Radcliffe-Brown, en dpit de son importance intrinsque, a pu tre si prement critique. Pour Murdock, les interprtations de Radcliffe-Brown se rduiraient des abstractions verbales, riges en causes premires (1949, p. 121). Lowie s'exprime peu prs de la mme faon (1937, pp. 224-225). La controverse rcente entre Radcliffe-Brown (1951) d'une part, Lawrence et Murdock de l'autre (1949), n'offre plus gure qu'un intrt historique, mais elle claire encore les positions mthodologiques de ces auteurs. Aux environs de 1949, on disposait d'une bonne description, par Lloyd Warner (19301931,1937 a), du systme de parent australien encore appel Murngin () ; quelques incertitudes subsistaient cependant, surtout en ce qui concerne la clture du systme, postule par l'hypothse (le systme tant dcrit comme intransitif), mais pratiquement impossible vrifier. Il est frappant de constater que, pour Radcliffe-Brown, le problme n'existe pas. Si toute organisation sociale se rduit un conglomrat de relations de personne personne, le systme est extensible indfiniment : pour tout individu masculin il y a, au moins thoriquement, une femme qui sera avec lui dans la relation de fille du frre de la mre (type de conjoint prescrit dans la socit en question). Et pourtant, le problme surgit sur un autre plan : car les indignes ont choisi d'exprimer les relations interpersonnelles au moyen d'un systme de classes, et la description de Warner (comme il l'a reconnu lui-mme) ne permet pas de comprendre comment, dans certains cas au moins, un individu donn peut satisfaire, la fois, aux exigences du systme des classes et celles du systme des relations. Autrement dit, s'il prsente le degr de parent requis il ne tombera pas dans la classe correspondante, et inversement.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 41
Pour surmonter cette difficult, Lawrence et Murdock ont invent un systme qui concidait la fois avec la rgle prfrentielle du mariage et grce certaines transformations avec le systme de classes dcrit par Warner. Mais il s'agit l d'un jeu gratuit, dont on constate vite qu'il soulve plus de difficults nouvelles qu'il n'en rsout d'anciennes. Dj, le systme restitu par Warner se heurtait un gros obstacle : il impliquait que les indignes perussent clairement des relations de parent si loignes que l'hypothse mme en devenait psychologiquement invraisemblable. La solution de Lawrence et Murdock exigerait bien davantage. Dans ces conditions, on peut se demander si le systme cach ou inconnu, propre rendre compte du modle conscient, mais maladroit, que les Murngin ont emprunt rcemment des voisins dots de rgles trs diffrentes des leurs, ne doit pas tre plus simple que ce dernier, et non pas plus compliqu. L'attitude systmatique et formaliste de Murdock s'oppose celle, empiriste et naturaliste, de Radcliffe-Brown. Pourtant, Murdock reste, presque autant que son adversaire, imbu d'un esprit psychologique et mme biologique, qui le pousse vers des disciplines priphriques, comme la psychanalyse et la psychologie du comportement. Russit-il ainsi se librer de l'empirisme, qui pse si lourdement sur les interprtations de Radcliffe-Brown ? On peut en douter, puisque ce recours extrieur l'oblige laisser inacheves ses propres hypothses, ou les parfaire au moyen d'emprunts qui leur donnent un caractre hybride, et parfois mme contredisent l'objectif initial formul en termes ethnologiques. Au lieu de considrer les systmes de parent comme des moyens sociaux destins remplir une fonction sociale, Murdock en vient finalement les traiter comme des consquences sociales de prmisses exprimes en termes de biologie et de psychologie. L'apport de Murdock aux tudes structurales peut tre envisag sous deux aspects. En premier lieu, il a voulu rajeunir la mthode statistique. Tylor l'avait dj employe pour vrifier des corrlations supposes et en dcouvrir de nouvelles. L'emploi de techniques modernes a permis Murdock d'accomplir des progrs certains dans cette direction.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 42
On a souvent soulign les obstacles auxquels se heurte la mthode statistique en ethnologie (Lowie, 1948 a, chap. m). Comme Murdock en est aussi averti que quiconque, je me contenterai de rappeler le danger du cercle vicieux : la validit d'une corrlation, mme fonde sur une frquence statistique impressionnante, dpend, en fin de compte, de la validit du dcoupage auquel on s'est livr pour dfinir les phnomnes mis en corrlation. Par contre, la mthode reste toujours efficace pour dnoncer les corrlations acceptes tort. De ce point de vue ngatif et critique, certaines conclusions de Murdock peuvent tre considres comme acquises. Murdock s'est galement employ reconstituer l'volution historique des systmes de parent ou, tout au moins, dfinir certaines lignes d'volution possibles ou probables, l'exclusion de quelques autres. Il aboutit ainsi un surprenant rsultat : plus souvent qu'on ne croit depuis que Lowie (1920, chap. m) s'est attaqu l'hypothse similaire de Lewis Morgan le systme de parent de type hawaen reprsenterait une forme primitive. Prenons garde, pourtant, que Murdock ne raisonne pas sur des socits relles, observes dans leur contexte historique et gographique, et considres comme des ensembles organiss, mais sur des abstractions, et mme si l'on peut dire des abstractions au second degr : il commence par isoler l'organisation sociale des autres aspects de la culture, et parfois, les systmes de parent de l'organisation sociale ; aprs quoi, il dcoupe arbitrairement l'organisation sociale (ou le systme de parent) en pices et en morceaux, selon des principes inspirs par les catgories traditionnelles de la thorie ethnologique, plutt que par une analyse relle de chaque groupe. Dans ces conditions, sa reconstruction historique reste idologique : elle consiste abstraire les lments communs chaque stade pour dfinir le stade immdiatement antrieur, et ainsi de suite. Il est clair qu'une telle mthode ne peut aboutir qu' un rsultat : les formes les moins diffrencies apparatront comme les plus anciennes, et les formes complexes se verront assigner des positions de plus en plus rcentes, en proportion de leur complexit. Un peu comme si on faisait remonter le cheval moderne l'ordre des vertbrs, plutt qu'au genre Hipparion.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 43
Les rserves qui prcdent ne cherchent pas diminuer les mrites de Murdock : il a rassembl des documents abondants et souvent ngligs ; il a pos des problmes. Mais prcisment, sa technique semble plus propre dcouvrir et identifier les problmes qu' les rsoudre. Sa mthode reste encore imbue d'un esprit aristotlicien ; peut-tre toute science doit-elle passer par l. Au moins fait-il uvre de bon disciple d'Aristote en affirmant que les formes culturelles tmoignent, sur le plan de l'organisation sociale, d'un degr de rgularit et d'une conformit aux exigences de la pense scientifique, qui ne diffre pas, de faon significative, de celui auquel les sciences dites naturelles nous ont accoutums (1949, p. 259). Le lecteur, qui se reportera aux distinctions proposes au dbut de cet article, voudra bien observer que Radcliffe-Brown tend confondre observation et exprimentation, tandis que Murdock ne distingue pas suffisamment entre modles statistiques et modles mcaniques : il cherche construire des modles mcaniques l'aide d'une mthode statistique, tche impossible, au moins de la faon directe qui est la sienne. Symtriquement, on pourrait caractriser l'uvre de Lowie () comme un effort acharn pour rpondre une seule question : quels sont les faits ? Nous avons dit que, mme pour le structuraliste, cette question est la premire laquelle il faille rpondre, et qu'elle commande toutes les autres. Les recherches sur le terrain et la rflexion thorique de Lowie commencent une poque o l'ethnologie est comme farcie de prjugs philosophiques, aurole de mysticisme sociologique. On lui a parfois reproch d'avoir ragi cette situation de faon purement ngative (Kroeber, 1920) : il le fallait. A ce moment, la premire tche consistait dmontrer ce que les faits n'taient pas. Lowie a donc courageusement entrepris de dsintgrer les systmes arbitraires et les prtendues corrlations. Il a ainsi libr si l'on peut dire une nergie intellectuelle o nous n'avons pas fini de puiser. Peut-tre est-il moins facile de dceler ses contributions positives, en raison de l'extrme discrtion qu'il met formuler sa pense, et de sa rpugnance envers les constructions thoriques. Ne se dfinit-il pas quelque part lui-mme comme un sceptique actif ? C'est lui pourtant qui, ds
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 44
1915, justifiait de la faon la plus moderne les tudes de parent : La substance mme de la vie sociale peut tre parfois analyse de faon rigoureuse en fonction du mode de classification des parents et allis (1915, 1929 c). Dans le mme article, il renversait la perspective troitement historique qui bornait l'horizon ethnologique, sans permettre d'apercevoir les facteurs structuraux universellement l'uvre ; il dfinissait dj l'exogamie en termes gntiques, comme un schme institutionnel engendrant les mmes effets partout o il est prsent, sans qu'il soit ncessaire d'invoquer des considrations historico-gographiques, pour comprendre les analogies entre socits loignes. Quelques annes plus tard, Lowie pulvrise le complexe matrilinaire (1919) en utilisant une mthode qui devait le conduire deux rsultats essentiels pour le structuraliste. En niant que tout trait d'apparence matrilinaire dt tre interprt comme une survivance ou un vestige du complexe , il permettait sa dcomposition en variables. En second lieu, les lments ainsi librs devenaient disponibles pour dresser des tables de permutations entre les caractres diffrentiels des systmes de parent (Lowie, 1929 a). De deux faons galement originales, il ouvrait ainsi la porte aux tudes structurales : quant au systme des appellations, et quant au rapport entre celui-ci et le systme des attitudes. Cette dernire orientation devait tre suivie par d'autres (Radcliffe-Brown, 1924 ; Lvi-Strauss, 1945) (). Nous sommes encore redevables Lowie d'autres dcouvertes. Le premier, sans doute, il a tabli le caractre bilinaire de plusieurs systmes prtendus unilinaires (1920, 1929 b) ; il a dmontr l'influence exerce par le mode de rsidence sur le type de filiation (1920) ; il a dissoci les conduites familiales de rserve ou de respect, et la prohibition de l'inceste (1920, pp. 104-105). Toujours soucieux d'envisager les organisations sociales d'un double point de vue : rgles institutionnelles d'une part, mais aussi expressions moyennes de ractions psychologiques individuelles (dans un sens qui contredit parfois les rgles, et qui les inflchit toujours), c'est ce mme Lowie, si critiqu pour sa trop fameuse dfinition de la culture, faite de pices et de morceaux , qui nous a donn des monographies qui comptent parmi les plus pntrantes, les mieux
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 45
quilibres de toute la littrature ethnologique (1935,1948 ()). Enfin, on connat le rle jou par Lowie dans le dveloppement des tudes sud-amricaines. Directement ou indirectement, par ses conseils ou ses encouragements, il a contribu ouvrir l'ethnologie un domaine difficile et trop nglig.
IV. dynamique sociale : structures de subordination.
a) Ordre des lments (individus et groupes) dans la structure sociale.
Retour la table des matires
Notre position personnelle sur les problmes qui prcdent n'a pas besoin d'tre expose ici. Malgr nos efforts vers l'objectivit, elle transparat suffisamment au cours de ce chapitre. Pour l'auteur de ces lignes, les systmes de parent, les rgles de mariage et de filiation, forment un ensemble coordonn dont la fonction est d'assurer la permanence du groupe social, en entrecroisant, la faon d'un tissu, les relations consanguines et celles fondes sur l'alliance. Ainsi esprons-nous avoir contribu lucider le fonctionnement de la machine sociale, extrayant perptuellement les femmes de leurs familles consanguines pour les redistribuer dans autant de groupes domestiques, lesquels se transforment leur tour en familles consanguines, et ainsi de suite. () En l'absence d'influences externes, cette machine fonctionnerait indfiniment, et la structure sociale conserverait un caractre statique. Tel n'est cependant pas le cas. On doit donc introduire dans le modle thorique des lments nouveaux, dont l'intervention puisse expliquer les transformations diachroniques de la structure, en mme temps qu'elle rendrait compte des raisons pour lesquelles une structure sociale ne se rduit jamais un systme de parent. Il y a trois faons diffrentes de rpondre cette double question.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 46
Comme il est de rgle, on se demandera d'abord quels sont les faits. Des annes ont pass depuis que Lowie dplorait la carence des travaux anthropologiques en matire d'organisation politique. A cet gard, on enregistrera quelques progrs dont nous sommes redevables Lowie lui-mme, dans ses travaux les plus rcents, au moins en ce qui concerne l'Amrique du Nord (1927, 1948 ()) et au grand ouvrage sur l'Afrique, dirig par Fortes et EvansPritchard (1940). Lowie a utilement prcis quelques catgories fondamentales : classes sociales, sodalits , tat. La deuxime mthode consisterait mettre en corrlation les phnomnes relevant du niveau dj isol, c'est--dire les phnomnes de parent, et ceux du niveau immdiatement suprieur, dans la mesure o on peut les relier entre eux. Deux problmes se posent alors : 1 les structures fondes sur la parent peuvent-elles, d'elles-mmes, manifester des proprits dynamiques ; 2 de quelle faon les structures de communication et les structures de subordination ragissent-elles les unes sur les autres. Le premier problme est celui de l'ducation : un moment dtermin, chaque gnration se trouve en effet dans une relation de subordination ou de dominance avec celle qui la prcde ou celle qui la suit. C'est ainsi que Margaret Mead et d'autres ont choisi de poser le problme. Il existe aussi une manire plus thorique de procder, qui consiste rechercher les corrlations entre certaines positions (statiques) dans la structure de parent (rduite sa terminologie) et les conduites (dynamiques) correspondantes, telles qu'elles s'expriment dans les droits, devoirs et obligations d'une part, et de l'autre, dans les privilges, prohibitions, etc. Pour Radcliffe-Brown, une correspondance terme terme est vrifiable entre ce qu'on pourrait appeler le systme des attitudes et le systme des appellations. Chaque terme de parent correspondrait une conduite prescrite, positive ou ngative ; et chaque conduite diffrentielle serait connote par un terme. D'autres ont soutenu qu'une telle correspondance tait invrifiable dans la prati-
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 47
que, ou qu'elle ne dpassait jamais le niveau d'une approximation assez grossire. J'ai propos moi-mme une interprtation diffrente, fonde sur une relation dialectique entre attitudes et appellations. Les conduites diffrentielles entre parents tendent s'organiser sur le mme modle que la terminologie, mais elles constituent aussi un moyen de rsoudre les difficults, et de surmonter les contradictions inhrentes cette terminologie mme. Ainsi, les rgles de conduite entre parents, dans une socit quelconque, traduiraient une tentative pour rsoudre les contradictions dcoulant du systme terminologique et des rgles d'alliance. Dans la mesure o les premires tendent se constituer en systme, de nouvelles contradictions apparaissent qui provoquent une rorganisation de la terminologie, laquelle retentit sur les attitudes et ainsi de suite, sauf pendant de rares priodes d'quilibre, vite menaces. () Un autre problme se pose quand on considre des socits o le systme de parent ne rgit pas des alliances matrimoniales entre gaux. Que se passet-il, en effet, si les partenaires des changes matrimoniaux sont des groupes hirarchiss, en fait ou en droit, du point de vue politique ou conomique ? Par ce biais, nous sommes conduits examiner diverses institutions : d'abord la polygamie, dont j'ai montr qu'elle repose parfois sur l'intgration de deux formes de garanties : l'une collective et politique, l'autre individuelle et conomique () ; ensuite l'hypergamie (ou l'hypogamie). Ce dernier problme, jusqu' prsent fort nglig, mriterait une tude attentive dont dpend une thorie cohrente du systme des castes, et indirectement de toutes les structures sociales fondes sur des distinctions de statut. La troisime et dernire mthode a un caractre plus formel que les prcdentes. Elle consisterait dans une tude a priori de tous les types de structures concevables, rsultant de relations de dpendance et de domination apparaissant au hasard. Le traitement mathmatique, par Rapoport (1949), des phnomnes cycliques de domination chez les poules ouvre cet gard d'intressantes perspectives. Sans doute ces chanes cycliques et intransitives semblent-elles offrir peu de rapport avec les structures sociales qu'on serait tent de leur comparer. Ces dernires (ainsi le cercle du kava en Polynsie) sont toujours transitives et non cycliques :
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 48
celui qui sige au bas bout est, par dfinition, exclu du haut bout. () Par contre, l'tude des systmes de parent montre que, dans certaines conditions, la transformation d'un ordre transitif et non cyclique en un autre, intransitif et cyclique, n'est pas inconcevable. On peut l'observer dans une socit hypergamique avec mariage prfrentiel d'un homme avec la fille du frre de la mre. Un tel systme consiste en une chane, termine une extrmit par une fille du plus haut rang, et donc incapable de trouver un mari qui ne lui soit pas infrieur, et l'autre, par un garon jamais priv d'pouse (puisque toutes les filles du groupe, l'exception de sa sur, ont un rang suprieur au sien). Par consquent, ou bien la socit en question succombe ses contradictions, ou bien son systme transitif et non cyclique doit se transformer en systme intransitif et cyclique, temporairement ou localement. () Ainsi s'introduisent dans nos tudes des notions telles que celles de transitivit, d'ordre et de cycle, qui se prtent un traitement formel et permettent l'analyse de types gnraliss de structures sociales o les niveaux de communication et de subordination peuvent tre intgrs. Ira-t-on plus loin encore, jusqu' l'intgration des ordres, actuels et virtuels ? Dans la plupart des socits humaines, ce qu'on nomme ordre social relve d'un type transitif et non cyclique : si A est suprieur B, et B suprieur C, A doit tre suprieur C, et C ne peut pas tre suprieur A. Pourtant, les socits mmes qui obissent pratiquement ces rgles conoivent d'autres types d'ordres qu'on pourrait appeler virtuels ou idaux , que ce soit sur le plan de la politique, du mythe ou de la religion, et ces ordres sont parfois intransitifs et cycliques. Ainsi, les contes de rois pousant des bergres, ou la critique de la dmocratie amricaine par Stendhal, comme un systme o un gentleman est aux ordres de son picier.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 49
b) Ordres des ordres.
Retour la table des matires
Pour l'ethnologue, la socit enveloppe un ensemble de structures correspondant divers types d'ordres. Le systme de parent offre un moyen d'ordonner les individus selon certaines rgles ; l'organisation sociale en fournit un autre ; les stratifications sociales ou conomiques, un troisime. Toutes ces structures d'ordre peuvent tre elles-mmes ordonnes, la condition de dceler quelles relations les unissent, et de quelle faon elles ragissent les unes sur les autres du point de vue synchronique. Ainsi, Meyer Fortes (1949) a-t-il essay, non sans succs, de construire des modles gnraux qui intgrent les proprits de divers modles spciaux (parent, organisation sociale, rapports conomiques, etc.). Ces tentatives pour formuler un modle total d'une socit donne, confrontent l'ethnologue une difficult dj envisage au dbut de ce chapitre : jusqu' quel point la faon dont une socit conoit ses diverses structures d'ordre, et les relations qui les unissent, correspond-elle la ralit ? J'ai dj indiqu que plusieurs rponses taient possibles, en fonction des documents considrs. Mais jusqu' prsent, nous n'avons envisag que des ordres vcus , c'est-dire des ordres qui sont eux-mmes fonction d'une ralit objective et qu'on peut aborder de l'extrieur, indpendamment de la reprsentation que les hommes s'en font. On observera maintenant que de tels ordres vcus en supposent toujours d'autres, dont il est indispensable de tenir compte pour comprendre non seulement les prcdents, mais la manire dont chaque socit essaye de les intgrer tous dans une totalit ordonne. Ces structures d'ordre, conues et non plus vcues , ne correspondent directement aucune ralit objective ; la diffrence des premires, elles ne sont pas susceptibles d'un contrle exprimental, puisqu'elles vont jusqu' se rclamer d'une exprience spcifique avec laquelle, d'ailleurs, elles se confondent parfois. Le seul contrle auquel nous puissions les soumettre, pour les analyser, est donc celui des ordres du premier type, ou ordres vcus . Les ordres conus cor-
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 50
respondent au domaine du mythe et de la religion. On peut se demander si l'idologie politique des socits contemporaines ne relve pas aussi de cette catgorie. () A la suite de Durkheim, Radcliffe-Brown a bien montr que les faits religieux devaient tre tudis comme partie intgrante de la structure sociale. Pour lui, le rle de l'ethnologue est d'tablir des corrlations entre divers types de religions et divers types d'organisations sociales (1945). Si sa sociologie religieuse se solde finalement par un chec, c'est, semble-t-il, pour deux raisons. En premier lieu, il a rattach directement les croyances et le rituel des tats affectifs. En second lieu, il a voulu atteindre d'emble une expression gnrale du rapport entre la socit et la religion, alors que nous avons surtout besoin d'tudes concrtes, permettant de construire des sries rgulires de variations concomitantes. Il en est rsult une sorte de discrdit qui pse lourdement sur l'ethnologie religieuse. Pourtant, les mythes, le rituel et les croyances religieuses forment un domaine plein de promesses pour les tudes structurales et, pour rares qu'elles soient, les recherches rcentes semblent particulirement fcondes. Plusieurs auteurs ont rcemment entrepris d'tudier des systmes religieux comme des ensembles structurs. Des travaux monographiques comme The Road of Life and Death de P. Radin (1945), et Kunapipi, de R. M. Berndt (1951), s'inspirent de cette conception. La voie est ainsi ouverte aux recherches systmatiques, dont Navaho Religion, de G. Reichard (1950) offre un bon exemple. Mais on ne ngligera pas, pour autant, les analyses de dtail, portant sur les lments permanents et non permanents des reprsentations religieuses d'une population donne, pendant un laps de temps relativement court, ainsi que Lowie les a conues. Peut-tre parviendrons-nous alors construire, en ethnologie religieuse, ces modles petite chelle, destins l'analyse comparative de variations concomitantes tels qu'ils s'imposent dans toute recherche visant l'explication des faits sociaux (Nadel, 1952). Cette mthode ne permettra de progresser que lentement ; mais elle fournira des conclusions qui compteront parmi les mieux tablies et les plus convaincantes, de celles que nous pouvons esprer en
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 51
matire d'organisation sociale. Nadel a dj dmontr qu'il existe une corrlation entre l'institution du chamanisme et certaines attitudes psychologiques caractristiques des socits correspondantes (1946). En comparant des documents indo-europens provenant de l'Islande, de l'Irlande et du Caucase, M. Dumzil est parvenu interprter un personnage mythologique jusqu'alors nigmatique, mettre son rle et ses manifestations en corrlation avec certains traits spcifiques de l'organisation sociale des populations tudies (1948) ; Wittfogel et Goldfrank ont isol des variations significatives de certains thmes mythologiques chez les Indiens Pueblo, les rattachant l'infrastructure socio-conomique de chaque groupe (1943). Monica Hunter a prouv que les croyances magiques taient directement fonction de la structure du groupe social (Hunter-Wilson, 1951). Tous ces rsultats joints d'autres qui ne peuvent tre comments ici, faute de place donnent l'espoir que nous serons un jour en mesure de comprendre, sinon la fonction des croyances religieuses dans la vie sociale (c'est chose faite depuis Lucrce) mais les mcanismes qui leur permettent de remplir cette fonction. Quelques mots, en guise de conclusion. Notre tude a dbut par une analyse de la notion de modle, et c'est elle encore qui rapparat la fin. L'anthropologie sociale est une jeune science ; il est naturel qu'elle cherche construire ses modles l'imitation des plus simples, parmi ceux que lui prsentent des sciences plus avances. Ainsi s'explique l'attrait de la mcanique classique. Mais n'avons-nous pas, cet gard, t victimes d'une illusion ? Comme l'a remarqu von Neumann (von Neumann et Morgenstern, 1944, p. 14) : II est infiniment plus simple d'laborer la thorie presque exacte d'un gaz contenant environ 1025 particules libres que celle du systme solaire qui comprend seulement 9 grands corps. Or, l'anthropologie en qute de modles se trouve devant un cas intermdiaire : les objets dont nous nous occupons rles sociaux et individus intgrs dans une socit dtermine sont beaucoup plus nombreux que ceux de la mcanique newtonienne, tout en ne l'tant pas assez pour relever de la statistique et du calcul des probabilits. Nous sommes donc placs sur un terrain hybride et quivoque ; nos faits sont trop compliqus pour tre abords d'une faon, et pas assez pour qu'on puisse les aborder de l'autre.
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 52
Les nouvelles perspectives ouvertes par la thorie de la communication rsultent, prcisment, des mthodes originales qu'il a fallu laborer pour traiter des objets les signes qu'on peut dsormais soumettre une analyse rigoureuse, bien que leur nombre soit trop lev pour la mcanique classique, mais encore trop restreint pour que les principes de la thermodynamique leur soient applicables. La langue est faite de morphmes de l'ordre de quelques milliers et des calculs limits suffisent pour dgager des rgularits significatives dans la frquence des phonmes. Sur un tel terrain, le seuil d'application des lois statistiques s'abaisse, en mme temps que s'lve celui partir duquel il devient possible d'utiliser des modles mcaniques. Et du mme coup, l'ordre de grandeur des phnomnes se rapproche de celui auquel l'anthropologue est accoutum. L'tat prsent des recherches structurales en anthropologie est donc le suivant. On a russi isoler des phnomnes qui sont du mme type que ceux dont les thories de la stratgie et de la communication permettent dj l'tude rigoureuse. Les faits anthropologiques sont une chelle suffisamment voisine de celle de ces autres phnomnes, pour offrir l'espoir d'un traitement analogue. N'est-il pas surprenant qu'au moment mme o l'anthropologie se sent plus proche que jamais de devenir une science vritable, le terrain manque l o on le croyait solide ? Les faits eux-mmes se drobent : trop peu nombreux, ou rassembls dans des conditions qui ne permettent pas de les comparer avec une scurit suffisante. Sans qu'il en soit de notre faute, nous dcouvrons que nous nous sommes conduits en botanistes amateurs, cueillant au hasard des chantillons htroclites, les maltraitant et les mutilant pour les conserver dans nos herbiers. Et nous voici tout coup appels mettre en ordre des sries compltes, dfinir les nuances originelles, mesurer des parties minuscules que nous retrouvons dtriores, si mme elles n'ont pas t dtruites. Quand l'anthropologue voque les tches qui attendent et tout ce qu'il devrait tre en position d'accomplir, le dcouragement le gagne : comment y parvenir avec les documents dont il dispose ? C'est un peu comme si la physique cosmique tait appele se construire au moyen des observations d'astronomes babyloniens. Et pourtant, les corps clestes sont
Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 53
toujours l, tandis que les cultures indignes qui nous fournissent nos documents disparaissent un rythme rapide, ou se transforment en objets d'un nouveau genre, o nous ne pouvons esprer trouver des informations du mme type. Ajuster les techniques d'observations un cadre thorique qui est fort en avance sur elles, voil une situation paradoxale que l'histoire des sciences illustre rarement. Il incombe l'anthropologie moderne de relever ce dfi.
Fin de lextrait
Vous aimerez peut-être aussi
- Exercices Preparatoires Au ResuméDocument10 pagesExercices Preparatoires Au ResuméHalima HasnaPas encore d'évaluation
- Les Constituant Ou Unités LinguistiquesDocument3 pagesLes Constituant Ou Unités LinguistiquesНаталя Кардаш100% (1)
- 1guide de L Etudiant Final - BM PDFDocument74 pages1guide de L Etudiant Final - BM PDFkkPas encore d'évaluation
- Exercice Sur Les Genres JournalistiqueDocument2 pagesExercice Sur Les Genres JournalistiqueAugustin Van AchterPas encore d'évaluation
- Les Principes Généraux Du StructuralismeDocument13 pagesLes Principes Généraux Du StructuralismeAnonymous S7l8anSBgRPas encore d'évaluation
- 3.2 Structuralisme TesniereDocument44 pages3.2 Structuralisme TesniereWillamy FernandesPas encore d'évaluation
- Lire Un Texte LittéraireDocument6 pagesLire Un Texte LittérairePreparador Oposición Maestros y Profesores de FrancésPas encore d'évaluation
- 1 Syntaxe Def SyntagmesDocument5 pages1 Syntaxe Def SyntagmesPedro Daniel Franco Briceño100% (1)
- Grammaire Française. Actif PassifDocument2 pagesGrammaire Française. Actif PassifGema Carretero SalasPas encore d'évaluation
- La Technique Du RésuméDocument4 pagesLa Technique Du RésuméPaul Trần Trung NghĩaPas encore d'évaluation
- SociologieDocument9 pagesSociologieMaryem Ben100% (1)
- LEXICOLOGIEDocument7 pagesLEXICOLOGIEHope NaiduPas encore d'évaluation
- Système de Logique Déductive Et Inductive - LIVRE I: DES NOMS ET DES PROPOSITIONS PDFDocument129 pagesSystème de Logique Déductive Et Inductive - LIVRE I: DES NOMS ET DES PROPOSITIONS PDFSerge BièvrePas encore d'évaluation
- COURS INTRODUCTOIRE - Quest-Ce Que La Littérature, Explication de Texte, 17e SiècleDocument26 pagesCOURS INTRODUCTOIRE - Quest-Ce Que La Littérature, Explication de Texte, 17e SiècleMilicaPas encore d'évaluation
- Décrire L'imageDocument5 pagesDécrire L'imagenaopressaoPas encore d'évaluation
- Le StructuralismeDocument15 pagesLe StructuralismeGhina AlifahPas encore d'évaluation
- Theorie de ChaosDocument2 pagesTheorie de ChaosمروةPas encore d'évaluation
- Communication Les Discours PublicitairesDocument7 pagesCommunication Les Discours PublicitairesSoufiane SegPas encore d'évaluation
- Methodes de La Critique LitteraireDocument10 pagesMethodes de La Critique LitteraireSantiago Henriquez Urban100% (1)
- La Didactique Des Disciplines CE1 - CE2Document53 pagesLa Didactique Des Disciplines CE1 - CE2lenovodPas encore d'évaluation
- French Class 10th LessonDocument3 pagesFrench Class 10th LessonsmallvillevqPas encore d'évaluation
- L'enseignement Du Français Par Gustave LansonDocument214 pagesL'enseignement Du Français Par Gustave Lansongargamel0940Pas encore d'évaluation
- Le Projet Déroulé 3AP N°3 2008-2009Document4 pagesLe Projet Déroulé 3AP N°3 2008-2009walid100% (1)
- La PragmatiqueDocument21 pagesLa PragmatiqueLo StPas encore d'évaluation
- Définitions Du Signe LinguistiqueDocument2 pagesDéfinitions Du Signe Linguistiqueallagos2Pas encore d'évaluation
- Open Cours de Linguistique-Converted 6Document70 pagesOpen Cours de Linguistique-Converted 6Sara NasbanPas encore d'évaluation
- GRIBENSKI, Michel - Litterature Et Musique Quelques Aspects de L'etude de Leurs Relations (Labyrinthe 19, 2004-3) PDFDocument21 pagesGRIBENSKI, Michel - Litterature Et Musique Quelques Aspects de L'etude de Leurs Relations (Labyrinthe 19, 2004-3) PDFAlejandra Spagnuolo100% (1)
- Journalisme, Histoire NaturelleDocument31 pagesJournalisme, Histoire NaturelleCandyhoneyPas encore d'évaluation
- L'Enseignement de La Grammaire À Travers Un Texte Poétique en FLE À L'école Secondaire Cas Des Lycées D'akbouDocument106 pagesL'Enseignement de La Grammaire À Travers Un Texte Poétique en FLE À L'école Secondaire Cas Des Lycées D'akbouKhawla MehenniPas encore d'évaluation
- Langage, Langue Et ParoleDocument8 pagesLangage, Langue Et ParoleludusludusPas encore d'évaluation
- Cahiers Internationaux de Sociolinguistique 2021-1 (N° 18)Document194 pagesCahiers Internationaux de Sociolinguistique 2021-1 (N° 18)Rachid Houssam LegsayerPas encore d'évaluation
- Guide RechDidactBaT 06092011 PDFDocument523 pagesGuide RechDidactBaT 06092011 PDFAhmed MadiPas encore d'évaluation
- Décalages: Les Niveaux de L'analyse LinguistiqueDocument28 pagesDécalages: Les Niveaux de L'analyse LinguistiqueClaudiene DinizPas encore d'évaluation
- Deleuze StructuralismeDocument24 pagesDeleuze StructuralismeToukanphPas encore d'évaluation
- La Structure Du Texte ArgumentatifDocument6 pagesLa Structure Du Texte ArgumentatifInesAguiles100% (1)
- Plantin - 2009 - Un Lieu Pour Les Figures Dans La Théorie de L'argumentationDocument15 pagesPlantin - 2009 - Un Lieu Pour Les Figures Dans La Théorie de L'argumentationAshlar TrystanPas encore d'évaluation
- Compétences Interlignes Ce2Document4 pagesCompétences Interlignes Ce2ptikabutoPas encore d'évaluation
- Théorie de L'histoire Sartre PDFDocument31 pagesThéorie de L'histoire Sartre PDFcaritofg100% (1)
- Charaudeau - Une Proble Discursive de L'émotion PDFDocument31 pagesCharaudeau - Une Proble Discursive de L'émotion PDFsorokzPas encore d'évaluation
- WWW Cours de Droit NetDocument26 pagesWWW Cours de Droit NetMohammed JniyehPas encore d'évaluation
- Etudes Semantiques Et Pragmatiques Sur Le Temps, Aspect Et La ModaliteDocument206 pagesEtudes Semantiques Et Pragmatiques Sur Le Temps, Aspect Et La ModaliteDante DarmawangsaPas encore d'évaluation
- 28 PDFDocument143 pages28 PDFHã Nã NePas encore d'évaluation
- Le Structuralisme FiguratifDocument27 pagesLe Structuralisme FiguratifBoujemaa RbiiPas encore d'évaluation
- Modélisation Sémantique, Syntaxique Et Lexicale de La Paraphrase MilicevicDocument328 pagesModélisation Sémantique, Syntaxique Et Lexicale de La Paraphrase Milicevicion_farcasanu100% (2)
- La Logique Des Possibles NarratifsDocument18 pagesLa Logique Des Possibles NarratifsOlinca OlveraPas encore d'évaluation
- Fiche Séquence - Clis - Lecture Avec Ratus + - Le Son ADocument10 pagesFiche Séquence - Clis - Lecture Avec Ratus + - Le Son AJalila RiahiPas encore d'évaluation
- Les Erreurs de Prononciation Les Plus Communes Des Étudiants de FrançaisDocument89 pagesLes Erreurs de Prononciation Les Plus Communes Des Étudiants de FrançaisRayan DPas encore d'évaluation
- Cours FrancaisDocument14 pagesCours FrancaisFuRiLaX 4EverPas encore d'évaluation
- Individus Et Culture - Comment Devenons-Nous Des Acteurs SociauxDocument2 pagesIndividus Et Culture - Comment Devenons-Nous Des Acteurs SociauxMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Creolisation Et Changement Linguistique PDFDocument12 pagesCreolisation Et Changement Linguistique PDFOmar OuchenPas encore d'évaluation
- L'humour Dans Les InteractionsDocument610 pagesL'humour Dans Les InteractionsWatrinPas encore d'évaluation
- Distributionnalisme CRDocument3 pagesDistributionnalisme CRAbdou SounniPas encore d'évaluation
- Ecritures CréativesDocument6 pagesEcritures CréativesSOUAD BENABBESPas encore d'évaluation
- Générativisme Et CognitivismeDocument12 pagesGénérativisme Et CognitivismescribdabdouPas encore d'évaluation
- Claude Hagege - La Structure Des Langues, 5e EditionDocument129 pagesClaude Hagege - La Structure Des Langues, 5e EditionCheval LaomaPas encore d'évaluation
- Discours Manipulation - Texte LyonDocument14 pagesDiscours Manipulation - Texte LyonCharaf Adam LaasselPas encore d'évaluation
- PDF Télécharger Sujet de Mémoire Didactique Du Français Gratuit PDFDocument1 pagePDF Télécharger Sujet de Mémoire Didactique Du Français Gratuit PDFsaid tiouidiouinePas encore d'évaluation
- Petite philosophie de l'actualité: Chroniques 2019-2020D'EverandPetite philosophie de l'actualité: Chroniques 2019-2020Pas encore d'évaluation
- Un demi-siecle de grammaire pour l'enseignement du français en Espagne (1800-1850). Contexte, paratexte, textes.: Etude d'historiographie linguistiqueD'EverandUn demi-siecle de grammaire pour l'enseignement du français en Espagne (1800-1850). Contexte, paratexte, textes.: Etude d'historiographie linguistiquePas encore d'évaluation
- Discours Du Grand Rabbin Au Cimetière de PragueDocument11 pagesDiscours Du Grand Rabbin Au Cimetière de Praguejuliusevola1100% (2)
- Examens Sciences S1 FPT PDFDocument30 pagesExamens Sciences S1 FPT PDFABRAHAM NENEPas encore d'évaluation
- Commentaire Littéraire - Guillevic, EuclidiennesDocument3 pagesCommentaire Littéraire - Guillevic, EuclidiennesManon MalaisPas encore d'évaluation
- Brochure de Rentrée Histoire 2023-2024 - Final - 28.09.23Document45 pagesBrochure de Rentrée Histoire 2023-2024 - Final - 28.09.23Luiza VasconcellosPas encore d'évaluation
- 41 L'Ange HAHAHELDocument5 pages41 L'Ange HAHAHELFeno HasinaPas encore d'évaluation
- Résumé Et Analyse de L'étranger D'albert CamusDocument7 pagesRésumé Et Analyse de L'étranger D'albert CamusmademoiselleavajhmPas encore d'évaluation
- Essai Sur L'histoire de La Psychothérapie InstitutionnelleDocument33 pagesEssai Sur L'histoire de La Psychothérapie InstitutionnellemmmiriaaamPas encore d'évaluation
- Messe Saint GabrielDocument4 pagesMesse Saint GabrielWend-Yam NANPas encore d'évaluation
- Programme Master MADocument9 pagesProgramme Master MAADEL CENAPas encore d'évaluation
- Education Des Maladies Hypertendue (HTA) : 1 IntroductionDocument8 pagesEducation Des Maladies Hypertendue (HTA) : 1 IntroductionŇøu ŞsāPas encore d'évaluation
- 11 12 FRDocument5 pages11 12 FRAliXmetecPas encore d'évaluation
- Mon Pe768re Il Maime 386Document2 pagesMon Pe768re Il Maime 386Bienvenu KonePas encore d'évaluation
- Commentaire Fiche ComplèteDocument4 pagesCommentaire Fiche Complèteclo.trmPas encore d'évaluation
- Le Symbolisme - Déchiffrer Le MondeDocument6 pagesLe Symbolisme - Déchiffrer Le MondePhuong Anh HoPas encore d'évaluation
- New RCPI01-TP - 4 - Thread 2 - 2018Document6 pagesNew RCPI01-TP - 4 - Thread 2 - 2018Victor RobidetPas encore d'évaluation
- D'un Maître À L'autre - L'histoire D'un Transfert Amadou Hampaté Bâ Entre Tierno Bokar Et Theodore MonodDocument30 pagesD'un Maître À L'autre - L'histoire D'un Transfert Amadou Hampaté Bâ Entre Tierno Bokar Et Theodore MonodIbrahima SakhoPas encore d'évaluation
- Cours Drive v0Document13 pagesCours Drive v0api-251463655Pas encore d'évaluation
- Edition Du 21 Octobre 2010Document32 pagesEdition Du 21 Octobre 2010Annonces de la SeinePas encore d'évaluation
- Exigences de La Norme ISO 45001 V2018-1Document23 pagesExigences de La Norme ISO 45001 V2018-1DEMESSE BertrandPas encore d'évaluation
- L'électrophorèse Des Protéines SériquesDocument7 pagesL'électrophorèse Des Protéines SériquesAhlem MansouriPas encore d'évaluation
- (123dok - Net) Les Tratomes Sacro Coccygiens de Lenfant Au Service de Chirurgie Pdiatrique B A Propos de 16 CasDocument163 pages(123dok - Net) Les Tratomes Sacro Coccygiens de Lenfant Au Service de Chirurgie Pdiatrique B A Propos de 16 Cashassnae.elaroussePas encore d'évaluation
- Acoustique These Guillaume VandernootDocument318 pagesAcoustique These Guillaume Vandernootjer31Pas encore d'évaluation
- Cours Mpsi 13. Fonctions de 2 Variables R. Ferréol 09 - 10Document9 pagesCours Mpsi 13. Fonctions de 2 Variables R. Ferréol 09 - 10Florian SeiininPas encore d'évaluation
- La Recherche Dite Qualitative de La Dynamique de Son Évolution Aux Acquis Indéniables Et Aux Questionnements Présents. Marta Anadon - CHDocument27 pagesLa Recherche Dite Qualitative de La Dynamique de Son Évolution Aux Acquis Indéniables Et Aux Questionnements Présents. Marta Anadon - CHpecescdPas encore d'évaluation
- EDN en Fiches Et en Schémas Anesthésie-RéanimationDocument123 pagesEDN en Fiches Et en Schémas Anesthésie-RéanimationkaoutarbentikoukPas encore d'évaluation