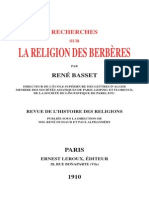Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Durkheim - Les Formes Elementaires
Transféré par
Hugo MartinoCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Durkheim - Les Formes Elementaires
Transféré par
Hugo MartinoDroits d'auteur :
Formats disponibles
mile Durkheim
LES FORMES LMENTAIRES DE LA VIE RELIGIEUSE
Le systme totmique en Australie Livre I : Questions prliminaires
Livre 1er de 3
Un document produit en version numrique par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt Dans le cadre de: "Les classiques des sciences sociales" Une bibliothque numrique fonde et dirige par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi Site web: http://classiques.uqac.ca/ Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque Paul-mile-Boulet de lUniversit du Qubec Chicoutimi Site web: http://bibliotheque.uqac.ca/
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
Politique d'utilisation de la bibliothque des Classiques
Toute reproduction et rediffusion de nos fichiers est interdite, mme avec la mention de leur provenance, sans lautorisation formelle, crite, du fondateur des Classiques des sciences sociales, Jean-Marie Tremblay, sociologue. Les fichiers des Classiques des sciences sociales ne peuvent sans autorisation formelle: - tre hbergs (en fichier ou page web, en totalit ou en partie) sur un serveur autre que celui des Classiques. - servir de base de travail un autre fichier modifi ensuite par tout autre moyen (couleur, police, mise en page, extraits, support, etc...), Les fichiers (.html, .doc, .pdf., .rtf, .jpg, .gif) disponibles sur le site Les Classiques des sciences sociales sont la proprit des Classiques des sciences sociales, un organisme but non lucratif compos exclusivement de bnvoles. Ils sont disponibles pour une utilisation intellectuelle et personnelle et, en aucun cas, commerciale. Toute utilisation des fins commerciales des fichiers sur ce site est strictement interdite et toute rediffusion est galement strictement interdite. L'accs notre travail est libre et gratuit tous les utilisateurs. C'est notre mission. Jean-Marie Tremblay, sociologue Fondateur et Prsident-directeur gnral, LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi revue et corrige avec ajout des mots grecs manquants par Bertrand Gibier, bnvole, professeur de philosophie au Lyce de Montreuil-sur-Mer (dans le Pas-de-Calais), bertrand.gibier@ac-lille.fr , partir de : MILE DURKHEIM (1912), LES FORMES LMENTAIRES DE LA VIE RELIGIEUSE. LE SYSTME TOTMIQUE EN AUSTRALIE. Livre I. Questions prliminaires (pp. 1-138 de ldition papier). Paris, Les Presses universitaires de France, 1968, cinquime dition, 647 pages. Collection Bibliothque de philosophie contemporaine. Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times New Roman 12 points. Pour les notes de bas de page : Times New Roman 10 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2001 pour Macintosh. Mise en page sur papier format LETTRE (US letter), 8.5 x 11) dition complte le 15 fvrier 2002 par Jean-Marie Tremblay Chicoutimi, Qubec, revue, corrige avec ajout des mots grecs manquants par Bertrand Gibier le 28 juin 2008.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
Table des matires
. Carte ethnographique de lAustralie
INTRODUCTION :
I.
OBJET DE LA RECHERCHE. Sociologie religieuse et thorie de la connaissance
II.
- Objet principal du livre: analyse de la religion la plus simple qui soit connue, en vue de dterminer les formes lmentaires de la vie religieuse. - Pourquoi elles sont plus faciles atteindre et expliquer travers les religions primitives. - Objet secondaire de la recherche : gense des notions fondamentales de la pense ou catgories. Raisons de croire qu'elles ont une origine religieuse et, par suite, sociale. - Comment, de ce point de vue, on entrevoit un moyen de renouveler la thorie de la connaissance.
LIVRE I:
QUESTIONS PRLIMINAIRES
Dfinition du phnomne religieux et de la religion
CHAPITRE I :
Utilit d'une dfinition pralable de la religion; mthode suivre pour procder cette dfinition. Pourquoi il convient d'examiner d'abord les dfinitions usuelles. I. II. III. - La religion dfinie par le surnaturel et le mystrieux. - Critique : la notion du mystre n'est pas primitive - La religion dfinie en fonction de l'ide de Dieu ou d'tre spirituel. - Religions sans dieux. - Dans les religions distes, rites qui n'impliquent aucune ide de divinit - Recherche d'une dfinition positive. - Distinction des croyances et des rites. Dfinition des croyances. - Premire caractristique : division bipartite des choses en sacres et en profanes. Caractres distinctifs de cette division. - Dfinition des rites en fonction des croyances, - Dfinition de la religion - Ncessit d'une autre caractristique pour distinguer la magie de la religion. - L'ide d'glise. -Les religions individuelles excluent-elles l'ide d'glise ?
IV.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
CHAPITRE II :
I. - L'animisme
Les principales conceptions de la religion lmentaire
Distinction de l'animisme et du naturisme I. - Les trois thses de l'animisme : 1 Gense de l'ide d'me; 2 Formation de l'ide d'esprit ; 3 Transformation du culte des esprits en culte de la nature II. - Critique de la premire thse. - Distinction de l'ide d'me et de l'ide double. - Le rve ne rend pas compte de l'ide d'me III. - Critique de la seconde thse. - La mort n'explique pas la transformation de l'me en esprit. -Le culte des mes des morts n'est pas primitif . IV. - Critique de la troisime thse. - L'instinct anthropomorphique. Critique qu'en a faite Spencer; rserves ce sujet. Examen des faits par lesquels on croit prouver l'existence de cet instinct. Diffrence entre l'me et les esprits de la nature. L'anthropomorphisme religieux n'est pas primitif. V. Conclusion: l'animisme rduit la religion n'tre qu'un systme d'hallucinations .
CHAPITRE III :
II. - Le naturisme
Les principales conceptions de la religion lmentaire (suite)
Historique de la thorie I. - Expos du naturisme d'aprs Max Mller II. - Si la religion a pour objet d'exprimer les forces naturelles, comme elle les exprime d'une manire errone, on ne comprend pas qu'elle ait pu se maintenir. - Prtendue distinction entre la religion et la mythologie III. - Le naturisme n'explique pas la distinction des choses en sacres et en profanes
CHAPITRE IV
Le totmisme comme religion lmentaire historique de la question, mthode pour la traiter
I. II.
- Histoire sommaire de la question du totmisme - Baisons de mthode pour lesquelles l'tude portera spcialement sur le totmisme australien. -De la place qui sera faite aux faits amricains
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
LIVRE II: LES CROYANCES LMENTAIRES
CHAPITRE I : Les croyances proprement totmiques
I. - Le totem comme nom et comme emblme I. II. III. - Dfinition du clan. - Le totem comme nom du clan. - Nature des choses qui servent de totems. Manires dont est acquis le totem. - Les totems de phratries, de classes matrimoniales - Le totem comme emblme. - Dessins totmiques gravs ou sculpts sur les objets; tatous ou dessins sur les corps - Caractre sacr de l'emblme totmique. - Les churinga. - Le nurtunja. - Le waninga. - Caractre conventionnel des emblmes totmiques
CHAPITRE Il :
Les croyances proprement totmiques (suite)
II. - L'animal totmique et l'homme I. - Caractre sacr des animaux totmiques. - Interdiction de les manger, de les tuer, de cueillir les plantes totmiques Tempraments divers apports ces interdictions. - Prohibitions de contact. - Le caractre sacr de l'animal est moins prononc que celui de l'emblme - L'homme. - Sa parent avec l'animal ou la plante totmique, - Mythes divers qui expliquent cette parent. - Le caractre sacr de l'homme est plus apparent sur certains points de l'organisme: le sang, les cheveux, etc. - Comment ce caractre varie avec le sexe et l'ge. - Le totmisme n'est pas une zooltrie ni une phytoltrie
II.
CHAPITRE III :
III. I. Il.
Les croyances proprement totmiques (suite)
Le systme cosmologique du totmisme et la notion de genre - Les classifications des choses par clans, phratries, classes - Gense de la notion de genre : les premires classifications de choses empruntent leurs cadres la socit. - Diffrences entre le sentiment des ressemblances et l'ide de genre. - Pourquoi celle-ci est d'origine sociale - Signification religieuse de ces classifications : toutes les choses classes dans un clan participent de la nature du totem et de son caractre sacr. - Le systme cosmologique du totmisme. - Le totmisme comme religion tribale
III.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
CHAPITRE IV :
Les croyances proprement totmiques (fin)
IV. - Le totem individuel et le totem sexuel I. Il. - Le totem individuel comme prnom; son caractre sacr. - Le totem individuel comme emblme personnel. - Liens entre l'homme et son totem individuel. - Rapports avec le totem collectif - Les totems des groupes sexuels. - Ressemblances et diffrences avec les totems collectifs et individuels. - Leur caractre tribal
CHAPITRE V :
Origines de ces croyances
I. - Examen critique des thories I. II. - Thories qui drivent le totmisme d'une religion antrieure : du culte des anctres (Wilken et Tylor) du culte de la nature (Jevons). - Critique de ces thories - Thories qui drivent le totmisme collectif du totmisme individuel. - Origines attribues par ces thories au totem individuel (Frazer, Boas, Hill Tout). - Invraisemblance de ces hypothses. Raisons qui dmontrent l'antriorit du totem collectif - Thorie rcente de Frazer : le totmisme conceptionnel et local. - Ptition de principe sur laquelle elle repose. - Le caractre religieux du totem est ni. - Le totmisme local n'est pas primitif - Thorie de Lang : le totem ne serait qu'un nom. - Difficults pour expliquer de ce point de vue le caractre religieux des pratiques totmiques - Toutes ces thories n'expliquent le totmisme qu'en postulant des notions religieuses qui lui seraient antrieures
III. IV. V.
CHAPITRE VI :
Origines de ces croyances (suite)
II. - La notion de principe ou mana totmique et l'ide de force I. II. - La notion de force ou principe totmique. - Son ubiquit. - Son caractre la fois physique et moral - Conceptions analogues dans d'autres socits intrieures. - Les dieux Samoa. - Le wakan des Sioux, l'orenda des Iroquois, le mana en Mlansie. - Rapports de ces notions avec le totmisme. L'Arnkulta der, Arunta - Antriorit logique de la notion de force impersonnelle sur les diffrentes personnalits mythiques. - Thories rcentes qui tendent admettre cette antriorit - La notion de force religieuse est le prototype de la notion de force en gnral
III. IV.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
CHAPITRE VII : Origines de ces croyances (fin)
III. - Gense de la notion de principe ou mana totmique I. Il. - Le principe totmique est le clan, mais pens sous des espces sensibles - Raisons gnrales pour lesquelles la socit est apte veiller la sensation du sacr et du divin. -La socit comme puissance morale imprative; la notion d'autorit morale. - La socit comme force qui lve l'individu au-dessus de lui-mme. - Faits qui prouvent que la socit cre du sacr - Baisons spciales aux socits australiennes. - Les deux phases par lesquelles passe alternativement la vie de ces socits : dispersion, concentration. - Grande effervescence collective pendant les priodes de concentration. Exemples. - Comment l'ide religieuse est ne de cette effervescence Pourquoi la force collective a t pense sous les espces du totem : c'est que le totem est l'emblme du clan. - Explication des principales croyances totmiques - La religion n'est pas un produit de la crainte. - Elle exprime quelque chose de rel. - Son idalisme essentiel. - Cet idalisme est un caractre gnral de la mentalit collective. -Explication de l'extriorit des forces religieuses par rapport leurs substrats. - Du principe la partie vaut le tout - Origine de la notion d'emblme: l'embImatisme, condition ncessaire des reprsentations collectives. - Pourquoi le clan a emprunt ses emblmes au rgne animal et au rgne vgtal - De l'aptitude du primitif confondre les rgnes et les classes que nous distinguons. -Origines de ces confusions. - Comment elles ont fray la voie aux explications scientifiques. - Elles n'excluent pas la tendance la distinction et l'opposition
III.
IV.
V. VI.
CHAPITRE VIII : La notion dme
I. Il. - Analyse de l'ide d'me dans les socits australiennes - Gense de cette notion. - La doctrine de la rincarnation d'aprs Spencer et Gillen: elle implique que l'me est une parcelle du principe totmique. - Examen des faits rapports par StrehIow; ils confirment la nature totmique de l'me - Gnralit de la doctrine de la rincarnation. - Faits divers l'appui de la gense propose - L'antithse de l'me et du corps: ce qu'elle a d'objectif. - Rapports de l'me individuelle et de l'me collective. - L'ide d'me n'est pas chronologiquement postrieure l'ide de mana. - Hypothse pour expliquer la croyance la survie - L'ide d'me et l'ide de personne; lments impersonnels de la personnalit
III. IV. V. VI.
CHAPITRE IX :
I.
LA NOTION D'ESPRITS ET DE DIEUX
- Diffrence entre l'me et l'esprit. - Les mes des anctres mythiques sont des esprits, ayant des fonctions dtermines. - Rapports entre l'esprit ancestral, l'me individuelle et le totem individuel. Explication de ce dernier. - Sa signification sociologique II. - Les esprits de la magie III. - Les hros civilisateurs IV. - Les grands dieux. - Leur origine. - Leur rapport avec l'ensemble du systme totmique. -Leur caractre tribal et international V. - Unit du systme totmique
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
LIVRE III :
CHAPITRE I :
I.
LES PRINCIPALES ATTITUDES RITUELLES
Le culte ngatif et ses fonctions. les rites asctiques
II.
III. IV.
- Le systme des interdits. - Interdits magiques et religieux. Interdits entre choses sacres d'espces diffrentes. Interdits entre sacr et profane. - Ces derniers sont la base du culte ngatif. Principaux types de ces interdits; leur rduction deux types essentiels - L'observance des interdits modifie l'tat religieux des individus. - Cas o cette efficacit est particulirement apparente : les pratiques asctiques. - Efficacit religieuse de la douleur. -Fonction sociale de l'asctisme - Explication du systme des interdits: antagonisme du sacr et du profane, contagiosit du sacr - Causes de cette contagiosit. - Elle ne peut s'expliquer par les lois de l'association des ides. - Elle rsulte de l'extriorit des forces religieuses par rapport leurs substrats. Intrt logique de cette proprit des forces religieuses
CHAPITRE II :
Le culte positif
1. - Les lments du sacrifice La crmonie de l'Intichiuma dans les tribus de l'Australie centrale. - Formes diverses qu'elle prsente - Forme Arunta. - Deux phases. - Analyse de la premire visite aux lieux saints, dispersion de poussire sacre, effusions de sang, etc., pour assurer la reproduction de l'espce totmique - Deuxime phase: consommation rituelle de la plante ou de l'animal totmique - Interprtation de la crmonie complte. - Le second rite consiste en une communion alimentaire. Raison de cette communion - Les rites de la premire phase consistent en oblations. - Analogies avec les oblations sacrificielles. L'Intichiuma contient donc les deux lments du sacrifice. - Intrt de ces faits pour la thorie du sacrifice - De la prtendue absurdit des oblations sacrificielles. - Comment elles s'expliquent: dpendance des tres sacrs par rapport leurs fidles. - Explication du cercle dans lequel parait se mouvoir le sacrifice. - Origine de la priodicit des rites positifs
I. II. III. IV.
V.
CHAPITRE III :
Le culte positif (suite)
II - Les rites mimtiques et le principe de causalit I. II. - Nature des rites mimtiques. - Exemples de crmonies o ils sont employs pour assurer la fcondit de l'espce - Ils reposent sur le principe : le semblable produit le semblable. - Examen de l'explication qu'en donne l'cole anthropologique. - Raisons qui font qu'on imite l'animal ou la plante. - Raisons qui font attribuer ces gestes une efficacit physique. - La foi. - En quel sens elle est fonde sur l'exprience. - Les principes de la magie sont ns dans la religion - Le principe prcdent considr comme un des premiers noncs du principe de causalit.
III.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
10
-Conditions sociales dont ce dernier dpend. - L'ide de force impersonnelle, de pouvoir, est d'origine sociale. - La ncessit du jugement causal explique par l'autorit inhrente aux impratifs sociaux
CHAPITRE IV :
Le culte positif (suite)
III. - Les rites reprsentatifs ou commmoratifs I. II. III. - Rites reprsentatifs avec efficacit physique. - Leurs rapports avec les crmonies antrieurement dcrites. - L'action qu'ils produisent est toute morale - Rites reprsentatifs sans efficacit physique. - Ils confirment les rsultats prcdents. - L'lment rcratif de la religion; son importance; ses raisons d'tre. - La notion de fte. - Ambigut fonctionnelle des diffrentes crmonies tudies; elles se substituent les unes aux autres. - Comment cette ambigut confirme la thorie propose.
CHAPITRE V :
Les rites piaculaires et l'ambigut de la notion du sacr
Dfinition du rite piacuIaire . I. II. - Les rites positifs du deuil. - Description de ces rites. - Comment ils s'expliquent. - Ils ne sont pas une manifestation de sentiments privs. - La mchancet prte l'me du mort ne peut pas davantage en rendre compte. - Ils tiennent l'tat d'esprit dans lequel se trouve le groupe. - Analyse de cet tat. - Comment il prend fin par le deuil. - Changements parallles dans la manire dont l'me du mort est conue. - Autres rites piaculaires : la suite d'un deuil public, d'une rcolte insuffisante, d'une scheresse, d'une aurore astrale. - Raret de ces rites en Australie. - Comment ils s'expliquent. - Les deux formes du sacr: le pur et l'impur. - Leur antagonisme. - Leur parent. - Ambigut de la notion du sacr. - Explication de cette ambigut. - Tous les rites prsentent le mme caractre .
III. IV.
CONCLUSION
Dans quelle mesure les rsultats obtenus peuvent tre gnraliss. . I. - La religion s'appuie sur une exprience bien fonde, mais non privilgie. - Ncessit d'une science pour atteindre la ralit qui fonde cette exprience. - Quelle est cette ralit : les groupements humains. - Sens humain de la religion. - De l'objection qui oppose la socit idale et la socit relle. Comment s'expliquent, dans cette thorie, l'individualisme et le cosmopolitisme religieux . - Ce qu'il y a d'ternel dans la religion. - Du conflit entre la religion et la science; il porte uniquement sur la fonction spculative de la religion. - Ce que cette fonction parat appele devenir . - Comment la socit peut-elle tre une source de pense logique, c'est--dire conceptuelle ? Dfinition du concept : ne se confond pas avec l'ide gnrale ; se caractrise par son impersonnalit, sa communicabilit. - Il a une origine collective. - L'analyse de son contenu tmoigne dans le mme sens. - Les reprsentations collectives comme notions-types auxquelles les individus participent. - De l'objection d'aprs laquelle elles ne seraient impersonnelles qu' condition d'tre vraies, - La pense conceptuelle est contemporaine de l'humanit. - Comment les catgories expriment des choses sociales. - La catgorie par excellence est le concept de totalit qui ne peut tre suggr que par la socit. - Pourquoi les relations qu'expriment les catgories ne pouvaient devenir conscientes que dans la socit. - La socit n'est pas un tre alogique. - Comment les catgories tendent se dtacher des groupements gographiques
II. III.
IV.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
11
dtermins Unit de la science, d'une part, de la morale et de la religion de l'autre. - Comment la socit rend compte de cette unit. - Explication du rle attribu la socit : sa puissance cratrice. Rpercussions de la sociologie sur la science de l'homme.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
12
Carte ethnographique De lAustralie
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
13
INTRODUCTION
OBJET DE LA RECHERCHE Sociologie religieuse et thorie de la connaissance I
.
Nous nous proposons d'tudier dans ce livre la religion la plus primitive et la plus simple qui soit actuellement connue, d'en faire l'analyse et d'en tenter l'explication. Nous disons d'un systme religieux qu'il est le plus primitif qu'il nous soit donn d'observer quand il remplit les deux conditions suivantes : en premier lieu, il faut qu'il se rencontre dans des socits dont l'organisation n'est dpasse par aucune autre en simplicit ; il faut de plus qu'il soit possible de l'expliquer sans faire intervenir aucun lment emprunt une religion antrieure.
1
Ce systme, nous nous efforcerons d'en dcrire l'conomie avec l'exactitude et la fidlit que pourraient y mettre un ethnographe ou un historien. Mais l ne se bornera pas notre tche. La sociologie se pose d'autres problmes que l'histoire ou que l'ethnographie. Elle ne cherche pas connatre les formes primes de la civilisation dans le seul but de les connatre et de les reconstituer. Mais, comme toute science positive, elle a, avant tout, pour objet d'expliquer une ralit actuelle, proche de nous, capable, par suite, d'affecter nos ides et nos actes : cette ralit, c'est l'homme et, plus spcialement l'homme d'aujourd'hui, car il n'en est pas que nous soyons plus intresss bien connatre. Nous n'tudierons donc pas la religion trs archaque dont il va tre question pour le seul plaisir d'en raconter les bizarreries et les singularits. Si nous l'avons prise comme objet de notre recherche, c'est qu'elle nous a paru plus apte que toute autre faire comprendre la nature religieuse de l'homme, c'est--dire nous rvler un aspect essentiel et permanent de l'humanit.
1
Dans le mme sens, nous dirons de ces socits qu'elles sont primitives et nous appellerons primitif l'homme de ces socits. L'expression, sans doute, manque de prcision, mais elle est difficilement vitable et, d'ailleurs, quand on a pris soin d'en dterminer la signification elle est sans inconvnients.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
14
Mais cette proposition ne va pas sans soulever de vives objections. On trouve trange que, pour arriver connatre l'humanit prsente, il faille commencer par s'en dtourner pour se transporter aux dbuts de l'histoire. Cette manire de procder apparat comme particulirement paradoxale dans la question qui nous occupe. Les religions passent, en effet, pour avoir une valeur et une dignit ingales ; on dit gnralement qu'elles ne contiennent pas toutes la mme part de vrit. Il semble donc qu'on ne puisse comparer les formes les plus hautes de la pense religieuse aux plus basses sans rabaisser les premires au niveau des secondes. Admettre que les cultes grossiers des tribus australiennes peuvent nous aider comprendre le christianisme, par exemple, n'est-ce pas supposer que celui-ci procde de la mme mentalit, c'est--dire qu'il est fait des mmes superstitions et repose sur les mmes erreurs ? Voil comment l'importance thorique, qui a t parfois attribue aux religions primitives, a pu passer pour l'indice d'une irrligiosit systmatique qui, en prjugeant les rsultats de la recherche, les viciait par avance. Nous n'avons pas rechercher ici s'il s'est rellement rencontr des savants qui ont mrit ce reproche et qui ont fait de l'histoire et de l'ethnographie religieuse une machine de guerre contre la religion. En tout cas, tel ne saurait tre le point de vue d'un sociologue. C'est, en effet, un postulat essentiel de la sociologie qu'une institution humaine ne saurait reposer sur l'erreur et sur le mensonge : sans quoi elle n'aurait pu durer. Si elle n'tait pas fonde dans la nature des choses, elle aurait rencontr dans les choses des rsistances dont elle n'aurait pu triompher. Quand donc nous abordons l'tude des religions primitives, c'est avec l'assurance qu'elles tiennent au rel et qu'elles l'expriment; on verra ce principe revenir sans cesse au cours des analyses et des discussions qui vont suivre, et ce que nous reprocherons aux coles dont nous nous sparerons, c'est prcisment de l'avoir mconnu. Sans doute, quand on ne considre que la lettre des formules, ces croyances et ces pratiques religieuses paraissent parfois dconcertantes et l'on peut tre tent de les attribuer une sorte d'aberration foncire. Mais, sous le symbole, il faut savoir atteindre la ralit qu'il figure et qui lui donne sa signification vritable. Les rites les plus barbares ou les plus bizarres, les mythes les plus tranges traduisent quelque besoin humain, quelque aspect de la vie soit individuelle soit sociale. Les raisons que le fidle se donne lui-mme pour les justifier peuvent tre, et sont mme le plus souvent, errones ; les raisons vraies ne laissent pas d'exister ; c'est affaire la science de les dcouvrir. Il n'y a donc pas, au fond, de religions qui soient fausses. Toutes sont vraies leur faon : toutes rpondent, quoique de manires diffrentes, des conditions donnes de l'existence humaine. Sans doute, il n'est pas impossible de les disposer suivant un ordre hirarchique. Les unes peuvent tre dites suprieures aux autres en ce sens qu'elles mettent en jeu des fonctions mentales plus leves, qu'elles sont plus riches d'ides et de sentiments, qu'il y entre plus de concepts, moins de sensations et d'images, et que la systmatisation en est plus savante. Mais, si relles que soient cette complexit plus grande et cette plus haute idalit elles ne suffisent pas ranger les religions correspondantes en des genres spars. Toutes sont galement des religions, comme tous les tres vivants sont galement des vivants, depuis les plus humbles plastides jusqu' l'homme. Si donc nous nous adressons aux religions primitives, ce n'est pas avec l'arrire-pense de dprcier la religion d'une manire gnrale ; car ces religions-l ne sont pas moins respectables que les autres. Elles rpondent aux mmes ncessits, elles jouent
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
15
le mme rle, elles dpendent des mmes causes; elles peuvent donc tout aussi bien servir manifester la nature de la vie religieuse et, par consquent, rsoudre le problme que nous dsirons traiter. Mais pourquoi leur accorder une sorte de prrogative ? Pourquoi les choisir de prfrence toutes autres comme objet de notre tude ? - C'est uniquement pour des raisons de mthode. Tout d'abord, nous ne pouvons arriver comprendre les religions les plus rcentes qu'en suivant dans l'histoire la manire dont elles se sont progressivement composes. L'histoire est, en effet, la seule mthode d'analyse explicative qu'il soit possible de leur appliquer. Seule, elle nous permet de rsoudre une institution en ses lments constitutifs, puisqu'elle nous les montre naissant dans le temps les uns aprs les autres. D'autre part, en situant chacun d'eux dans l'ensemble de circonstances o il a pris naissance, elle nous met en mains le seul moyen que nous ayons de dterminer les causes qui l'ont suscit. Toutes les fois donc qu'on entreprend d'expliquer une chose humaine, prise un moment dtermin du temps - qu'il s'agisse d'une croyance religieuse, d'une rgle morale, d'un prcepte juridique, d'une technique esthtique, d'un rgime conomique - il faut commencer par remonter jusqu' sa forme la plus primitive et la plus simple, chercher rendre compte des caractres par lesquels elle se dfinit cette priode de son existence, puis faire voir comment elle s'est peu peu dveloppe et complique, comment elle est devenue ce qu'elle est au moment considr. Or, on conoit sans peine de quelle importance est, pour cette srie d'explications progressives, la dtermination du point de dpart auquel elles sont suspendues. C'tait un principe cartsien que, dans la chane des vrits scientifiques, le premier anneau joue un rle prpondrant. Certes, il ne saurait tre question de placer la base de la science des religions une notion labore la manire cartsienne, c'est--dire un concept logique, un pur possible, construit par les seules forces de l'esprit. Ce qu'il nous faut trouver, c'est une ralit concrte que, seule, l'observation historique et ethnographique peut nous rvler. Mais si cette conception cardinale doit tre obtenue par des procds diffrents, il reste vrai qu'elle est appele avoir, sur toute la suite des propositions qu'tablit la science, une influence considrable. L'volution biologique a t conue tout autrement partir du moment o l'on a su qu'il existait des tres monocellulaires. De mme, le dtail des faits religieux est expliqu diffremment, suivant qu'on met l'origine de l'volution le naturisme, l'animisme ou telle autre forme religieuse. Mme les savants les plus spcialiss, s'ils n'entendent pas se borner une tche de pure rudition, s'ils veulent essayer de se rendre compte des faits qu'ils analysent, sont obligs de choisir telle ou telle de ces hypothses et de s'en inspirer. Qu'ils le veuillent ou non, les questions qu'ils se posent prennent ncessairement la forme suivante : comment le naturisme ou l'animisme ont-ils t dtermins prendre, ici ou l, tel aspect particulier, s'enrichir ou s'appauvrir de telle ou telle faon ? Puisque donc on ne peut viter de prendre un parti sur ce problme initial et puisque la solution qu'on en donne est destine affecter l'ensemble de la science, il convient de l'aborder de front; c'est ce que nous nous proposons de faire. D'ailleurs, en dehors mme de ces rpercussions indirectes, l'tude des religions primitives a, par elle-mme, un intrt immdiat qui est de premire importance. Si, en effet, il est utile de savoir en quoi consiste telle ou telle religion particulire, il
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
16
importe davantage encore de rechercher ce que c'est que la religion d'une manire gnrale. C'est ce problme qui, de tout temps, a tent la curiosit des philosophes, et non sans raison; car il intresse l'humanit tout entire. Malheureusement, la mthode qu'ils emploient d'ordinaire pour le rsoudre est purement dialectique : ils se bornent analyser l'ide qu'ils se font de la religion, sauf illustrer les rsultats de cette analyse mentale par des exemples emprunts aux religions qui ralisent le mieux leur idal. Mais si cette mthode doit tre abandonne, le problme reste tout entier et le grand service qu'a rendu la philosophie est d'empcher qu'il n'ait t prescrit par le ddain des rudits. Or il peut tre repris par d'autres voies. Puisque toutes les religions sont comparables, puisqu'elles sont toutes des espces d'un mme genre, il y a ncessairement des lments essentiels qui leur sont communs. Par l, nous n'entendons pas simplement parler des caractres extrieurs et visibles qu'elles prsentent toutes galement et qui permettent d'en donner, ds le dbut de la recherche, une dfinition provisoire; la dcouverte de ces signes apparents est relativement facile, car l'observation qu'elle exige n'a pas dpasser la surface des choses. Mais ces ressemblances extrieures en supposent d'autres qui sont profondes. A la base de tous les systmes de croyances et de tous les cultes, il doit ncessairement y avoir un certain nombre de reprsentations fondamentales et d'attitudes rituelles qui, malgr la diversit des formes que les unes et les autres ont pu revtir, ont partout la mme signification objective et remplissent partout les mmes fonctions. Ce sont ces lments permanents qui constituent ce qu'il y a d'ternel et d'humain dans la religion; ils sont tout le contenu objectif de l'ide que l'on exprime quand on parle de la religion en gnral. Comment donc est-il possible d'arriver les atteindre ? Ce n'est certainement pas en observant les religions complexes qui apparaissent dans la suite de l'histoire. Chacune d'elles est forme d'une telle varit d'lments qu'il est bien difficile d'y distinguer le secondaire du principal et l'essentiel de l'accessoire. Que l'on considre des religions comme celles de l'gypte, de l'Inde ou de l'antiquit classique ! C'est un enchevtrement touffu de cultes multiples, variables avec les localits, avec les temples, avec les gnrations, les dynasties, les invasions, etc. Les superstitions populaires y sont mles aux dogmes les plus raffins. Ni la pense ni l'activit religieuse ne sont galement rparties dans la masse des fidles; suivant les hommes, les milieux, les circonstances, les croyances comme les rites sont ressentis de faons diffrentes. Ici, ce sont des prtres, l, des moines, ailleurs, des lacs ; il y a des mystiques et des rationalistes, des thologiens et des prophtes, etc. Dans ces conditions, il est difficile d'apercevoir ce qui est commun tous. On peut bien trouver le moyen d'tudier utilement, travers l'un ou l'autre de ces systmes, tel ou tel fait particulier qui s'y trouve spcialement dvelopp, comme le sacrifice ou le prophtisme, le monachisme ou les mystres; mais comment dcouvrir le fond commun de la vie religieuse sous la luxuriante vgtation qui le recouvre ? Comment, sous le heurt des thologies, les variations des rituels, la multiplicit des groupements, la diversit des individus, retrouver les tats fondamentaux, caractristiques de la mentalit religieuse en gnral ? Il en va tout autrement dans les socits infrieures. Le moindre dveloppement des individualits, l'tendue plus faible du groupe, l'homognit des circonstances extrieures, tout contribue rduire les diffrences et les variations au minimum. Le groupe ralise, d'une manire rgulire, une uniformit intellectuelle et morale dont nous ne trouvons que de rares exemples dans les socits plus avances. Tout est commun tous. Les mouvements sont
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
17
strotyps; tout le monde excute les mmes dans les mmes circonstances et ce conformisme de la conduite ne fait que traduire celui de la pense. Toutes les consciences tant entranes dans les mmes remous, le type individuel se confond presque avec le type gnrique. En mme temps que tout est uniforme, tout est simple. Rien n'est fruste comme ces mythes composs d'un seul et mme thme qui se rpte sans fin, comme ces rites qui sont faits d'un petit nombre de gestes recommencs satit. L'imagination populaire ou sacerdotale n'a encore eu ni le temps ni les moyens de raffiner et de transformer la matire premire des ides et des pratiques religieuses ; celle-ci se montre donc nu et s'offre d'elle-mme l'observation qui n'a qu'un moindre effort faire pour la dcouvrir. L'accessoire, le secondaire, les dveloppements de luxe ne sont pas encore venus cacher le principal . Tout est rduit l'indispensable, ce sans quoi il ne saurait y avoir de religion. Mais l'indispensable, c'est aussi l'essentiel, c'est--dire ce qu'il nous importe avant tout de connatre,
2
Les civilisations primitives constituent donc des cas privilgis, parce que ce sont des cas simples. Voil pourquoi, dans tous les ordres de faits, les observations des ethnographes ont t souvent de vritables rvlations qui ont rnov l'tude des institutions humaines. Par exemple, avant le milieu du XIXe sicle, on tait convaincu que le pre tait l'lment essentiel de la famille; on ne concevait mme pas qu'il pt y avoir une organisation familiale dont le pouvoir paternel ne ft pas la clef de vote. La dcouverte de Bachofen est venue renverser cette vieille conception. jusqu' des temps tout rcents, on considrait comme vident que les relations morales et juridiques qui constituent la parent n'taient qu'un autre aspect des relations physiologiques qui rsultent de la communaut de descendance; Bachofen et ses successeurs, Mac Lennan, Morgan et bien d'autres, taient encore placs sous l'influence de ce prjug. Depuis que nous connaissons la nature du clan primitif, nous savons, au contraire, que la parent ne saurait se dfinir par la consanguinit. Pour en revenir aux religions, la seule considration des formes religieuses qui nous sont le plus familires a fait croire pendant longtemps que la notion de dieu tait caractristique de tout ce qui est religieux. Or, la religion que nous tudions plus loin est, en grande partie, trangre toute ide de divinit ; les forces auxquelles s'adressent les rites y sont trs diffrentes de celles qui tiennent la premire place dans nos religions modernes, et pourtant elles nous aideront mieux comprendre ces dernires. Rien donc n'est plus injuste que le ddain o trop d'historiens tiennent encore les travaux des ethnographes. Il est certain, au contraire, que l'ethnographie a trs souvent dtermin, dans les diffrentes branches de la sociologie, les plus fcondes rvolutions. C'est, d'ailleurs, pour la mme raison que la dcouverte des tres monocellulaires, dont nous parlions tout l'heure, a transform l'ide qu'on se faisait couramment de la vie. Comme, chez ces tres trs simples, la vie est rduite ses traits essentiels, ceux-ci peuvent tre plus difficilement mconnus. Mais les religions primitives ne permettent pas seulement de dgager les lments constitutifs de la religion ; elles ont aussi ce trs grand avantage qu'elles en facilitent l'explication. Parce que les faits y sont plus simples, les rapports entre les faits y sont aussi plus apparents.
2
Ce n'est pas dire, sans doute, que tout luxe fasse dfaut aux cultes primitifs. Nous verrons, au contraire, qu'on trouve, dans toute religion, des croyances et des pratiques qui ne visent pas des fins troitement utilitaires (liv. III, chap. IV, 2). Mais ce luxe est indispensable la vie religieuse; il tient son essence mme. D'ailleurs, il est beaucoup plus rudimentaire dans les religions infrieures que dans les autres, et c'est ce qui nous permettra d'en mieux dterminer la raison d'tre.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
18
Les raisons par lesquelles les hommes s'expliquent leurs actes n'ont pas encore t labores et dnatures par une rflexion savante ; elles sont plus proches, plus parentes des mobiles qui ont rellement dtermin ces actes. Pour bien comprendre un dlire et pour pouvoir lui appliquer le traitement le plus appropri, le mdecin a besoin de savoir quel en a t le point de dpart. Or cet vnement est d'autant plus facile discerner qu'ont peut observer ce dlire une priode plus proche de ses dbuts. Au contraire, plus on laisse la maladie le temps de se dvelopper, plus il se drobe l'observation ; c'est que, chemin faisant, toute sorte d'interprtations sont intervenues qui tendent refouler dans l'inconscient l'tat originel et le remplacer par d'autres travers lesquels il est parfois malais de retrouver le premier. Entre un dlire systmatis et les impressions premires qui lui ont donn naissance, la distance est souvent considrable. Il en est de mme pour la pense religieuse. A mesure qu'elle progresse dans l'histoire, les causes qui l'ont appele l'existence, tout en restant toujours agissantes, ne sont plus aperues qu' travers un vaste systme d'interprtations qui les dforment. Les mythologies populaires et les subtiles thologies ont fait leur oeuvre : elles ont superpos aux sentiments primitifs des sentiments trs diffrents qui, tout en tenant aux premiers dont ils sont la forme labore, n'en laissent pourtant transpirer que trs imparfaitement la nature vritable. La distance psychologique entre la cause et l'effet, entre la cause apparente et la cause effective, est devenue plus considrable et plus difficile parcourir pour l'esprit. La suite de cet ouvrage sera une illustration et une vrification de cette remarque mthodologique. On y verra comment, dans les religions primitives, le fait religieux porte encore visible l'empreinte de ses origines : il nous et t bien plus malais de les infrer d'aprs la seule considration des religions plus dveloppes. L'tude que nous entreprenons est donc une manire de reprendre, mais dans des conditions nouvelles, le vieux problme de l'origine des religions. Certes, si, par origine, on entend un premier commencement absolu, la question n'a rien de scientifique et doit tre rsolument carte. Il n'y a pas un instant radical o la religion ait commenc exister et il ne s'agit pas de trouver un biais qui nous permette de nous y transporter par la pense. Comme toute institution humaine, la religion ne commence nulle part. Aussi toutes les spculations de ce genre sontelles justement discrdites ; elles ne peuvent consister qu'en constructions subjectives et arbitraires qui ne comportent de contrle d'aucune sorte. Tout autre est le problme que nous nous posons. Ce que nous voudrions, c'est trouver un moyen de discerner les causes, toujours prsentes, dont dpendent les formes les plus essentielles de la pense et de la pratique religieuse. Or, pour les raisons qui viennent d'tre exposes, ces causes sont d'autant plus facilement observables que les socits o on les observe sont moins compliques. Voil pourquoi nous cherchons nous rapprocher des origines . Ce n'est pas que nous entendions prter aux religions infrieures des vertus particulires. Elles sont, au contraire, rudimentaires et grossires ; il ne saurait donc tre question d'en faire des sortes de modles que les religions ultrieures n'auraient eu qu' reproduire. Mais leur grossiret mme les rend instructives ; car elles se trouvent constituer ainsi des expriences commodes o les faits et leurs relations sont
3
On voit que nous donnons ce mot d'origines, comme au mot de primitif, un sens tout relatif. Nous entendons par l non un commencement absolu, mais l'tat social le plus simple qui soit actuellement connu, celui au del duquel il ne nous est pas prsentement possible de remonter. Quand nous parlerons des origines, des dbuts de l'histoire ou de la pense religieuse, c'est dans ce sens que ces expressions devront tre entendues.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
19
plus faciles apercevoir. Le physicien, pour dcouvrir les lois des phnomnes qu'il tudie, cherche simplifier ces derniers, les dbarrasser de leurs caractres secondaires. Pour ce qui concerne les institutions, la nature fait spontanment des simplifications du mme genre au dbut de l'histoire. Nous voulons seulement les mettre profit. Et sans doute, nous ne pourrons atteindre par cette mthode que des faits trs lmentaires. Quand nous en aurons rendu compte, dans la mesure o ce nous sera possible, les nouveauts de toute sorte qui se sont produites dans la suite de l'volution ne seront pas expliques pour cela. Mais si nous ne songeons pas nier l'importance des problmes qu'elles posent, nous estimons qu'ils gagnent tre traits leur heure et qu'il y a intrt ne les aborder qu'aprs ceux dont nous allons entreprendre l'tude.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
20
II
.
Mais notre recherche n'intresse pas seulement la science des religions. Toute religion, en effet, a un ct par o elle dpasse le cercle des ides proprement religieuses et, par l, l'tude des phnomnes religieux fournit un moyen de renouveler des problmes qui, jusqu' prsent, n'ont t dbattus qu'entre philosophes. On sait depuis longtemps que les premiers systmes de reprsentations que l'homme s'est fait du monde et de lui-mme sont d'origine religieuse. Il n'est pas de religion qui ne soit une cosmologie en mme temps qu'une spculation sur le divin. Si la philosophie et les sciences sont nes de la religion, c'est que la religion elle-mme a commenc par tenir lieu de sciences et de philosophie. Mais ce qui a t moins remarqu, c'est qu'elle ne s'est pas borne enrichir d'un certain nombre d'ides un esprit humain pralablement form; elle a contribu le former lui-mme. Les hommes ne lui ont pas d seulement, pour une part notable, la matire de leurs connaissances, mais aussi la forme suivant laquelle ces connaissances sont labores. Il existe, la racine de nos jugements, un certain nombre de notions essentielles qui dominent toute notre vie intellectuelle; ce sont celles que les philosophes, depuis Aristote, appellent les catgories de l'entendement : notions de temps, d'espace , de genre, de nombre, de cause, de substance, de personnalit, etc. Elles correspondent aux proprits les plus universelles des choses. Elles sont comme les cadres solides qui enserrent la pense ; celle-ci ne parat pas pouvoir s'en affranchir sans se dtruire, car il ne semble pas que nous puissions penser des objets qui ne soient pas dans le temps on dans l'espace, qui ne soient pas nombrables, etc. Les autres notions sont contingentes et mobiles ; nous concevons qu'elles puissent manquer un homme, une socit, une poque; celles-l nous paraissent presque insparables du fonctionnement normal de l'esprit. Elles sont comme l'ossature de l'intelligence. Or, quand on analyse mthodiquement les croyances religieuses primitives, on rencontre naturellement sur son chemin les principales d'entre ces catgories. Elles sont nes dans la religion et de la religion; elles sont un produit de la pense religieuse. C'est une constatation que nous aurons plusieurs fois faire dans le cours de cet ouvrage.
4
Cette remarque a dj quelque intrt par elle-mme; mais voici ce qui lui donne sa vritable porte. La conclusion gnrale du livre qu'on va lire, c'est que la religion est une chose minemment sociale. Les reprsentations religieuses sont des reprsentations collectives qui expriment
4
Nous disons du temps et de l'espace que ce sont des catgories parce qu'il n'y a aucune diffrence entre le rle que jouent ces notions dans la vie intellectuelle et celui qui revient aux notions de genre ou de cause (v. sur ce point HAMELIN, Essai sur les lments principaux de la reprsentation, p. 63, 76, Paris, Alcan, puis P.U.F.).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
21
des ralits collectives; les rites sont des manires d'agir qui ne prennent naissance qu'au sein des groupes assembls et qui sont destins susciter, entretenir ou refaire certains tats mentaux de ces groupes. Mais alors, si les catgories sont d'origine religieuse, elles doivent participer de la nature commune tous les faits religieux : elles doivent tre, elles aussi, des choses sociales, des produits de la pense collective. Tout au moins - car, dans l'tat actuel de nos connaissances en ces matires, on doit se garder de toute thse radicale et exclusive - il est lgitime de supposer qu'elles sont riches en lments sociaux. C'est, d'ailleurs, ce qu'on peut, ds prsent, entrevoir pour certaines d'entre elles. Qu'on essaie, par exemple, de se reprsenter ce que serait la notion du temps, abstraction faite des procds par lesquels nous le divisons, le mesurons, l'exprimons au moyen de signes objectifs, un temps qui ne serait pas une succession d'annes, de mois, de semaines, de jours, d'heures! Ce serait quelque chose d' peu prs impensable. Nous ne pouvons concevoir le temps qu' condition d'y distinguer des moments diffrents. Or quelle est l'origine de cette diffrenciation ? Sans doute, les tats de conscience que nous avons dj prouvs peuvent se reproduire en nous, dans l'ordre mme o ils se sont primitivement drouls ; et ainsi des portions de notre pass nous redeviennent prsentes, tout en se distinguant spontanment du prsent. Mais, si importante que soit cette distinction pour notre exprience prive, il s'en faut qu'elle suffise constituer la notion ou catgorie de temps. Celle-ci ne consiste pas simplement dans une commmoration, partielle ou intgrale, de notre vie coule. C'est un cadre abstrait et impersonnel qui enveloppe non seulement notre existence individuelle, mais celle de l'humanit. C'est comme un tableau illimit o toute la dure est tale sous le regard de l'esprit et o tous les vnements possibles peuvent tre situs par rapport des points de repres fixes et dtermins. Ce n'est pas mon temps qui est ainsi organis ; c'est le temps tel qu'il est objectivement pens par tous les hommes d'une mme civilisation. Cela seul suffit dj faire entrevoir qu'une telle organisation doit tre collective. Et, en effet, l'observation tablit que ces points de repre indispensables par rapport auxquels toutes choses sont classes temporellement, sont emprunts la vie sociale. Les divisions en jours, semaines, mois, annes, etc., correspondent la priodicit des rites, des ftes, des crmonies publiques . Un calendrier exprime le rythme de l'activit collective en mme temps qu'il a pour fonction d'en assurer la rgularit.
5 6
Il en est de mme de l'espace. Comme l'a dmontr Hamelin l'espace n'est pas ce milieu
7
5 6
Voir l'appui de cette assertion dans HUBERT et MAUSS, Mlanges d'histoire religieuse (Travaux de l'Anne sociologique), le chapitre sur La reprsentation du temps dans la religion (Paris, Alcan). On voit par l toute la diffrence qu'il y a entre le complexus de sensations et d'images qui sert nous orienter dans la dure, et la catgorie de temps. Les premires sont le rsum d'expriences individuelles qui ne sont valables que pour l'individu qui les a faites. Au contraire, ce qu'exprime la catgorie de temps, c'est un temps commun au groupe, c'est le temps social, si l'on peut ainsi parier. Elle est elle-mme une vritable institution sociale. Aussi est-elle particulire l'homme; l'animal n'a pas de reprsentation de ce genre. Cette distinction entre la catgorie de temps et les sensations correspondantes pourrait tre galement faite propos de l'espace, de la cause. Peut-tre aiderait-elle dissiper certaines confusions qui entretiennent les controverses dont ces questions sont l'objet. Nous reviendrons sur ce point dans la conclusion de cet ouvrage ( 4). Op. cit., p. 75 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
22
vague et indtermin qu'avait imagin Kant : purement et absolument homogne, il ne servirait rien et n'offrirait mme pas de prise la pense. La reprsentation spatiale consiste essentiellement dans une premire coordination introduite entre les donnes de l'exprience sensible. Mais cette coordination serait impossible si les parties de l'espace s'quivalaient qualitativement, si elles taient rellement substituables les unes aux autres. Pour pouvoir disposer spatialement les choses, il faut pouvoir les situer diffremment : mettre les unes droite, les autres gauche, celles-ci en haut, celles-l en bas, au nord ou au sud, l'est ou l'ouest, etc. etc., de mme que, pour pouvoir disposer temporellement les tats de la conscience, il faut pouvoir les localiser des dates dtermines. C'est dire que l'espace ne saurait tre lui-mme si, tout comme le temps, il n'tait divis et diffrenci. Mais ces divisions, qui lui sont essentielles, d'o lui viennent-elles ? Par lui-mme, il n'a ni droite ni gauche, ni haut ni bas, ni nord ni sud, etc. Toutes ces distinctions viennent videmment de ce que des valeurs affectives diffrentes ont t attribues aux rgions. Et comme tous les hommes d'une mme civilisation se reprsentent l'espace de la mme manire, il faut videmment que ces valeurs affectives et les distinctions qui en dpendent leur soient galement communes; ce qui implique presque ncessairement qu'elles sont d'origine sociale .
8
Il y a, d'ailleurs, des cas o ce caractre social est rendu manifeste. Il existe des socits en Australie et dans l'Amrique du Nord o l'espace est conu sous la forme d'un cercle immense, parce que le camp a lui-mme une forme circulaire , et le cercle spatial est exactement divis comme le cercle tribal et l'image de ce dernier. Il y a autant de rgions distingues qu'il y a de clans dans la tribu et c'est la place occupe par les clans l'intrieur du campement qui dtermine l'orientation des rgions. Chaque rgion se dfinit par le totem du clan auquel elle est assigne. Chez les Zui, par exemple, le pueblo comprend sept quartiers; chacun de ces quartiers est un groupe de clans qui a eu son unit : selon toute probabilit, c'tait primitivement un clan unique qui s'est ensuite subdivis. Or l'espace comprend galement sept rgions et chacun de ces sept quartiers du monde est en relations intimes avec un quartier du pueblo, c'est--dire avec un groupe de clans. Ainsi, dit Cushing, une division est cense tre en rapport avec le nord; une autre reprsente l'ouest, une autre le sud , etc. Chaque quartier du pueblo a sa couleur caractristique qui le symbolise ; chaque rgion a la sienne qui est exactement celle du quartier correspondant. Au cours de l'histoire, le nombre des clans fondamentaux a vari; le nombre des rgions de l'espace a vari de la mme manire. Ainsi, l'organisation sociale a t le modle de l'organisation spatiale qui est comme un dcalque de la premire. Il n'y a pas jusqu' la distinction de la droite et de la gauche qui, loin d'tre implique dans la nature de l'homme en gnral, ne soit trs vraisemblablement le produit de reprsentations religieuses, partant collective .
9 10 11 12
9 10 11 12
Autrement, pour expliquer cet accord, il faudrait admettre que tous les individus, en vertu de leur constitution organico-psychique, sont spontanment affects de la mme manire par les diffrentes parties de l'espace : ce qui est d'autant plus invraisemblable que, par elles-mmes, les diffrentes rgions sont affectivement indiffrentes. D'ailleurs les divisions de l'espace changent avec les socits ; c'est la preuve qu'elles ne sont pas fondes exclusivement dans la nature congnitale de l'homme. Voir DURKHEIM et MAUSS, De quelques formes primitives de classification in Anne sociol., VI, p. 47 et suiv. Ibid., p. 34 et suiv. Zui Creation Myths, in 13th Rep. of the Bureau of Amer. Ethnology, p. 367 et suiv. V. HERTZ, La prminence de la main droite. tude de polarit religieuse, in Rev. philos., dcembre
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
23
On trouvera plus loin des preuves analogues relatives aux notions de genre, de force, de personnalit, d'efficacit. On peut mme se demander si la notion de contradiction ne dpend pas, elle aussi, de conditions sociales. Ce qui tend le faire croire, c'est que l'empire qu'elle a exerc sur la pense a vari suivant les temps et les socits. Le principe d'identit domine aujourd'hui la pense scientifique; mais il y a de vastes systmes de reprsentations qui ont jou dans l'histoire des ides un rle considrable et o il est frquemment mconnu : ce sont les mythologies, depuis les plus grossires jusqu'aux plus savantes . Il y est, sans cesse, question d'tres qui ont simultanment les attributs les plus contradictoires, qui sont la fois uns et plusieurs, matriels et spirituels, qui peuvent se subdiviser indfiniment sans rien perdre de ce qui les constitue; c'est, en mythologie, un axiome que la partie vaut le tout. Ces variations par lesquelles a pass dans l'histoire la rgle qui semble gouverner notre logique actuelle prouvent que, loin d'tre inscrite de toute ternit dans la constitution mentale de l'homme, elle dpend, au moins en partie, de facteurs historiques, par consquent sociaux. Nous ne savons pas exactement quels ils sont; mais nous pouvons prsumer qu'ils existent.
13 14
Cette hypothse une fois admise, le problme de la connaissance se pose dans des termes nouveau. Jusqu' prsent, deux doctrines seulement taient en prsence. Pour les uns, les catgories ne peuvent tre drives de l'exprience : elles lui sont logiquement antrieures et la conditionnent. On se les reprsente comme autant de donnes simples, irrductibles, immanentes l'esprit humain en vertu de sa constitution native. C'est pourquoi on dit d'elles qu'elles sont a priori. Pour les autres, au contraire, elles seraient construites, faites de pices et de morceaux, et c'est l'individu qui serait l'ouvrier de cette construction.
15
Mais l'une et l'autre solution soulvent de graves difficults. Adopte-t-on la thse empiriste ? Alors, il faut retirer aux catgories toutes leurs proprits
1909. Sur cette mme question des rapports entre la reprsentation de l'espace et la forme de la collectivit, voir dans BATZEL, Politische Geographie, le chapitre intitul Der Raum im Geist der Vlker. Nous n'entendons pas dire que la pense mythologique l'ignore, mais qu'elle y droge plus souvent et plus ouvertement que la pense scientifique. Inversement, nous montrerons que la science ne peut pas ne pas le violer, tout en s'y conformant plus scrupuleusement que la religion. Entre la science et la religion, il n'y a, sous ce rapport comme sous bien d'autres, que des diffrences de degrs; mais s'il ne faut pas les exagrer, il importe de les noter, car elles sont significatives. Cette hypothse avait t dj mise par les fondateurs de la Vlkerpsychologie. On la trouve notamment indique dans un court article de WINDELBAND intitul Die Erkenntnisslehre unter dem vlkerpsychologischen Gesichtspunkte, in Zeilsch. f. Vlkerpsychologie, VIII, p. 166 et suiv. Cf. une note de STEINTHAL Sur le mme sujet, ibid., p. 178 et suiv. Mme dans la thorie de Spencer, c'est avec l'exprience individuelle que sont construites les catgories. La seule diffrence qu'il y ait, sous ce rapport, entre l'empirisme ordinaire et l'empirisme volutionniste, c'est que, suivant ce dernier, les rsultats de l'exprience individuelle sont consolids par l'hrdit. Mais cette consolidation ne leur ajoute rien d'essentiel; il n'entre dans leur composition aucun lment qui n'ait son origine dans l'exprience de l'individu. Aussi, dans cette thorie, la ncessit avec laquelle les catgories s'imposent actuellement nous est-elle le produit d'une illusion, d'un prjug superstitieux, fortement enracin dans l'organisme, mais sans fondement dans la nature des choses.
13
14
15
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
24
caractristiques. Elles se distinguent, en effet, de toutes les autres connaissances par leur universalit et leur ncessit. Elles sont les concepts les plus gnraux qui soient puisqu'elles s'appliquent tout le rel, et, de mme qu'elles ne sont attaches aucun objet particulier, elles sont indpendantes de tout sujet individuel : elles sont le lieu commun o se rencontrent tous les esprits. De plus, ils s'y rencontrent ncessairement ; car la raison, qui n'est autre chose que l'ensemble des catgories fondamentales, est investie d'une autorit laquelle nous ne pouvons nous drober volont. Quand nous essayons de nous insurger contre elle, de nous affranchir de quelques-unes de ces notions essentielles, nous nous heurtons de vives rsistances. Non seulement donc elles ne dpendent pas de nous, mais elles s'imposent nous. - Or les donnes empiriques prsentent des caractres diamtralement opposs. Une sensation, une image se rapportent toujours un objet dtermin ou une collection d'objets de ce genre et elle exprime l'tat momentan d'une conscience particulire : elle est essentiellement individuelle et subjective. Aussi pouvons-nous disposer, avec une libert relative, des reprsentations qui ont cette origine. Sans doute, quand nos sensations sont actuelles, elles s'imposent nous en lait. Mais, en droit, nous restons matres de les concevoir autrement qu'elles ne sont, de nous les reprsenter comme se droulant dans un ordre diffrent de celui o elles se sont produites. Vis-vis d'elles, rien ne nous lie, tant que des considrations d'un autre genre n'interviennent pas. Voil donc deux sortes de connaissances qui sont comme aux deux ples contraires de l'intelligence. Dans ces conditions, ramener la raison l'exprience, c'est la faire vanouir; car c'est rduire l'universalit et la ncessit qui la caractrisent n'tre que de pures apparences, des illusions qui peuvent tre pratiquement commodes, mais qui ne correspondent rien dans les choses; c'est, par consquent, refuser toute ralit objective la vie logique que les catgories ont pour fonction de rgler et d'organiser. I'empirisme classique aboutit l'irrationalisme; peut-tre mme est-ce par ce dernier nom qu'il conviendrait de le dsigner. Les aprioristes, malgr le sens ordinairement attach aux tiquettes, sont plus respectueux des faits. Parce qu'ils n'admettent pas comme une vrit d'vidence que les catgories sont faites des mmes lments que nos reprsentations sensibles, ils ne sont pas obligs de les appauvrir systmatiquement, de les vider de tout contenu rel, de les rduire n'tre que des artifices verbaux. Ils leur laissent, au contraire, tous leurs caractres spcifiques. Les aprioristes sont des rationalistes ; ils croient que le monde a un aspect logique que la raison exprime minemment. Mais pour cela, il leur faut attribuer l'esprit un certain pouvoir de dpasser l'exprience, d'ajouter ce qui lui est immdiatement donn ; or, de ce pouvoir singulier, ils ne donnent ni explication ni justification. Car ce n'est pas l'expliquer que se borner dire qu'il est inhrent la nature de l'intelligence humaine. Encore faudrait-il faire entrevoir d'o nous tenons cette surprenante prrogative et comment nous pouvons voir, dans les choses, des rapports que le spectacle des choses ne saurait nous rvler. Dire que l'exprience elle-mme n'est possible qu' cette condition, c'est peut-tre dplacer le problme ; ce n'est pas le rsoudre. Car il s'agit prcisment de savoir d'o vient que l'exprience ne se suffit pas, mais suppose des conditions qui lui sont extrieures et antrieures, et comment il se fait que ces conditions sont ralises quand et comme il convient. Pour rpondre ces questions, on a parfois imagin, pardessus les raisons individuelles, une raison suprieure et parfaite dont les premires maneraient et de qui elles tiendraient par une sorte de participation mystique, leur merveilleuse facult : c'est la raison divine. Mais cette hypothse a, tout au moins, le grave inconvnient d'tre Soustraite tout contrle exprimental ; elle ne satisfait donc pas aux
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
25
conditions exigibles d'une hypothse scientifique. De plus, les catgories de la pense humaine ne sont jamais fixes sous une forme dfinie; elles se font, se dfont, se refont sans cesse ; elles changent suivant les lieux et les temps. La raison divine est, au contraire, immuable. Comment cette immutabilit pourrait-elle rendre compte de cette incessante variabilit ? Telles sont les deux conceptions qui se heurtent l'une contre l'autre depuis des sicles ; et, si le dbat s'ternise, c'est qu'en vrit les arguments changs s'quivalent sensiblement. Si la raison n'est qu'une forme de l'exprience individuelle, il n'y a plus de raison. D'autre part, si on lui reconnat les pouvoirs qu'elle s'attribue, mais sans en rendre compte, il semble qu'on la mette en dehors de la nature et de la science. En prsence de ces objections opposes, l'esprit reste incertain. - Mais si l'on admet l'origine sociale des catgories, une nouvelle attitude devient possible qui permettrait, croyons-nous, d'chapper ces difficults contraires. La proposition fondamentale de l'apriorisme, c'est que la connaissance est forme de deux sortes d'lments irrductibles l'un l'autre et comme de deux couches distinctes et superposes . Notre hypothse maintient intgralement ce principe. En effet, les connaissances que l'on appelle empiriques, les seules dont les thoriciens de l'empirisme se soient jamais servi pour construire la raison, sont celles que l'action directe des objets suscite dans nos esprits. Ce sont donc des tats individuels, qui s'expliquent tout entiers par la nature psychique de l'individu. Au contraire, si, comme nous le pensons, les catgories sont des reprsentations essentiellement collectives, elles traduisent avant tout des tats de la collectivit : elles dpendent de la manire dont celle-ci est constitue et organise, de sa morphologie, de ses institutions religieuses, morales, conomiques, etc. Il y a donc entre ces deux espces de reprsentations toute la distance qui spare l'individuel du social, et on ne peut pas plus driver les secondes des premires qu'on ne peut dduire la socit de l'individu, le tout de la partie, le complexe du simple. La socit est une ralit sui generis ; elle a ses caractres propres qu'on ne retrouve pas, ou qu'on ne retrouve pas sous la mme forme, dans le reste de l'univers. Les reprsentations qui l'expriment ont donc un tout autre contenu que les reprsentations purement individuelles et l'on peut tre assur par avance que les premires ajoutent quelque chose aux
16 17 18
16
17
18
On sera peut-tre tonn que nous ne dfinissions pas l'apriorisme par l'hypothse de l'innit. Mais en ralit, cette conception ne joue dans la doctrine qu'un rle secondaire. C'est une manire simpliste de se reprsenter l'irrductibilit des connaissances rationnelles aux donnes empiriques. Dire des premires qu'elles sont innes n'est qu'une faon positive de dire qu'elles ne sont pas un produit de l'exprience telle qu'elle est ordinairement conue. Du moins, dans la mesure o il y a des reprsentations individuelles et, par consquent, intgralement empiriques. Mais, en fait, il n'y en a vraisemblablement pas o ces deux sortes d'lments ne se rencontrent troitement unis. Il ne faut pas entendre, d'ailleurs, cette irrductibilit dans un sens absolu. Nous ne voulons pas dire qu'il n'y ait rien dans les reprsentations empiriques qui annonce les reprsentations rationnelles, ni qu'il n'y ait rien dans l'individu qui puisse tre regard comme l'annonce de la vie sociale. Si l'exprience tait compltement trangre tout ce qui est rationnel, la raison ne pourrait pas s'y appliquer; de mme, si la nature psychique de l'individu tait absolument rfractaire la vie sociale, la socit serait impossible. Une analyse complte des catgories devrait donc rechercher jusque dans la conscience individuelle ces germes de rationalit. Nous aurons d'ailleurs, l'occasion de revenir sur ce point dans notre conclusion. Tout ce que nous voulons tablir ici, c'est que, entre ces germes indistincts de raison et la raison proprement dite, il y a une distance comparable celle qui spare les proprits des lments minraux dont est form le vivant et les attributs caractristiques de la vie, une fois qu'elle est constitue.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
26
secondes. La manire mme dont se forment les unes et les autres achve de les diffrencier. Les reprsentations collectives sont le produit d'une immense coopration qui s'tend non seulement dans l'espace, mais dans le temps; pour les faire, une multitude d'esprits divers ont associ, ml, combin leurs ides et leurs sentiments ; de longues sries de gnrations y ont accumul leur exprience et leur savoir. Une intellectualit trs particulire, infiniment plus riche et plus complexe que celle de l'individu, y est donc comme concentre, On comprend ds lors comment la raison a le pouvoir de dpasser la porte des connaissances empiriques. Elle ne le doit pas je ne sais quelle vertu mystrieuse, mais simplement ce fait que, suivant une formule connue, l'homme est double. En lui, il y a deux tres : un tre individuel qui a sa base dans l'organisme et dont le cercle d'action se trouve, par cela mme, troitement limit, et un tre social qui reprsente en nous la plus haute ralit, dans l'ordre intellectuel et moral, que nous puissions connatre par l'observation, j'entends la socit. Cette dualit de notre nature a pour consquence, dans l'ordre pratique, l'irrductibilit de l'idal moral au mobile utilitaire, et, dans l'ordre de la pense, l'irrductibilit de la raison l'exprience individuelle. Dans la mesure o il participe de la socit, l'individu se dpasse naturellement lui-mme, aussi bien quand il pense que quand il agit. Ce mme caractre social permet de comprendre d'o vient la ncessit des catgories. On dit d'une ide qu'elle est ncessaire quand, par une sorte de vertu interne, elle s'impose l'esprit sans tre accompagne d'aucune preuve. Il y a donc en elle quelque chose qui contraint l'intelligence, qui emporte l'adhsion, sans examen pralable. Cette efficacit singulire, l'apriorisme la postule, mais n'en rend pas compte; car dire que les catgories sont ncessaires parce qu'elles sont indispensables au fonctionnement de la pense, c'est simplement rpter qu'elles sont ncessaires. Mais si elles ont l'origine que nous leur avons attribue, leur ascendant n'a plus rien qui surprenne. En effet, elles expriment les rapports les plus gnraux qui existent entre les choses ; dpassant en extension toutes nos autres notions, elles dominent tout le dtail de notre vie intellectuelle. Si donc, chaque moment du temps, les hommes ne s'entendaient pas sur ces ides essentielles, s'ils n'avaient pas une conception homogne du temps, de l'espace, de la cause, du nombre, etc., tout accord deviendrait impossible entre les intelligences et, par suite, toute vie commune. Aussi la socit ne peut-elle abandonner les catgories au libre arbitre des particuliers sans s'abandonner elle-mme. Pour pouvoir vivre, elle n'a pas seulement besoin d'un suffisant conformisme moral ; il y a un minimum de conformisme logique dont elle ne peut davantage se passer. Pour cette raison, elle pse de toute son autorit sur ses membres afin de prvenir les dissidences. Un esprit droge-t-il ostensiblement ces normes de toute pense ? Elle ne le considre plus comme un esprit humain dans le plein sens du mot, et elle le traite en consquence. C'est pourquoi, quand, mme dans notre for intrieur, nous essayons de nous affranchir de ces notions fondamentales, nous sentons que nous ne sommes pas compltement libres, que quelque chose nous rsiste, en nous et hors de nous. Hors de nous, il y a l'opinion qui nous juge; mais de plus, comme la socit est aussi reprsente en nous, elle s'oppose, du dedans de nous-mmes, ces vellits rvolutionnaires; nous avons l'impression que nous ne pouvons nous y abandonner sans que notre pense cesse d'tre une pense vraiment humaine. Telle parat tre l'origine de l'autorit trs spciale qui est inhrente la raison et qui fait que nous acceptons de confiance ses
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
27
suggestions. C'est l'autorit mme de la socit , se communiquant certaines manires de penser qui sont comme les conditions indispensables de toute action commune. La ncessit avec laquelle les catgories s'imposent nous n'est donc pas l'effet de simples habitudes dont nous pourrions secouer le joug avec un peu d'effort; ce n'est pas davantage une ncessit physique ou mtaphysique, puisque les catgories changent suivant les lieux et les temps ; c'est une sorte particulire de ncessit morale qui est la vie intellectuelle ce que l'obligation morale est la volont .
19 20
Mais si les catgories ne traduisent originellement que des tats sociaux, ne s'ensuit-il pas qu'elles ne peuvent s'appliquer au reste de la nature qu' titre de mtaphores ? Si elles sont faites uniquement pour exprimer des choses sociales, elles ne sauraient, semble-t-il, tre tendues aux autres rgnes que par voie de convention. Ainsi, en tant qu'elles nous servent penser le monde physique ou biologique, elles ne pourraient avoir que la valeur de symboles artificiels, pratiquement utiles peut-tre, mais sans rapport avec la ralit. On reviendrait donc, par une autre voie, au nominalisme et l'empirisme. Mais interprter de cette manire une thorie sociologique de la connaissance, c'est oublier que, si la socit est une ralit spcifique, elle n'est cependant pas un empire dans un empire ; elle fait partie de la nature, elle en est la manifestation la plus haute. Le rgne social est un rgne naturel, qui ne diffre des autres que par sa complexit plus grande. Or il est impossible que la nature, dans ce qu'elle a de plus essentiel, soit radicalement diffrente d'elle-mme, ici et l. Les relations fondamentales qui existent entre les choses - celles-l justement que les catgories ont pour fonction d'exprimer - ne sauraient donc tre essentiellement dissemblables suivant les rgnes. Si, pour des raisons que nous aurons rechercher , elles se dgagent d'une faon plus apparente dans le monde social, il est impossible qu'elles ne se retrouvent pas ailleurs, quoique sous des formes plus enveloppes. La socit les rend plus manifestes, mais elle n'en a pas le privilge. Voil comment des notions qui ont t labores sur le modle des choses sociales peuvent nous aider penser des choses d'une autre nature. Du moins, si, quand elles sont ainsi dtournes de leur signification premire, ces notions jouent, en un sens, le rle de symboles, c'est de symboles bien fonds. Si, par cela seul que ce sont des concepts construits, il y entre de l'artifice, c'est un artifice qui suit de prs la nature et qui s'efforce de s'en rapprocher toujours davantage. De ce que les ides de temps, d'espace, de genre de cause,
21 22
19
20
21 22
On a souvent remarqu que les troubles sociaux avaient pour effet de multiplier les troubles mentaux. C'est une preuve de plus que la discipline logique est un aspect particulier de la discipline sociale. La premire se relche quand la seconde s'affaiblit. Il y a analogie entre cette ncessit logique et l'obligation morale, mais il n'y a pas identit, au moins actuellement. Aujourd'hui, la socit traite les criminels autrement que les sujets dont l'intelligence seule est anormale; c'est la preuve que l'autorit attache aux normes logiques et celle qui est inhrente aux normes morales, malgr d'importantes similitudes, ne sont pas de mme nature. Ce sont deux espces diffrentes d'un mme genre. Il serait intressant de rechercher en quoi consiste et d'o provient cette diffrence qui n'est vraisemblablement pas primitive, car, pendant longtemps, la conscience publique a mal distingu l'alin du dlinquant. Nous nous bornons indiquer la question. on voit, par cet exemple, le nombre de problmes que soulve l'analyse de ces notions qui passent gnralement pour tre lmentaires et simples et qui sont, en ralit, d'une extrme complexit. La question est traite dans la conclusion du livre. Le rationalisme qui est immanent une thorie sociologique de la connaissance est donc intermdiaire entre l'empirisme et l'apriorisme classique. Pour le premier, les catgories sont des constructions purement
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
28
de personnalit sont construites avec des lments sociaux, il ne faut donc pas conclure qu'elles sont dnues de toute valeur objective. Au contraire, leur origine sociale fait plutt prsumer qu'elles ne sont pas sans fondement dans la nature des choses.
23
Ainsi renouvele, la thorie de la connaissance semble donc appele runir les avantages contraires des deux thories rivales, sans en avoir les inconvnients. Elle conserve tous les principes essentiels de l'apriorisme; mais en mme temps, elle s'inspire de cet esprit de positivit auquel l'empirisme s'efforait de satisfaire. Elle laisse la raison son pouvoir spcifique, mais elle en rend compte, et cela sans sortir du monde observable. Elle affirme, comme relle, la dualit de notre vie intellectuelle, mais elle l'explique, et par des causes naturelles. Les catgories cessent d'tre considres comme des faits premiers et inanalysables ; et cependant, elles restent d'une complexit dont des analyses aussi simplistes que celles dont se contentait l'empirisme ne sauraient avoir raison. Car elles apparaissent alors, non plus comme des notions trs simples que le premier venu peut dgager de ses observations personnelles et que l'imagination populaire aurait malencontreusement compliques, mais, au contraire, comme de savants instruments de pense, que les groupes humains ont laborieusement forgs au cours des sicles et o ils ont accumul le meilleur de leur capital intellectuel . Toute une partie de l'histoire de l'humanit y est comme rsume. C'est dire que, pour arriver les comprendre et les juger, il faut recourir d'autres procds que ceux qui ont t jusqu' prsent en usage. Pour savoir de quoi sont faites ces conceptions que nous n'avons pas faites nous-mmes, il ne saurait suffire que nous interrogions notre conscience ; c'est hors de nous qu'il faut regarder, c'est l'histoire qu'il faut observer, c'est toute une science qu'il faut instituer, science complexe, qui ne peut avancer que lentement, par un travail collectif, et laquelle le prsent ouvrage apporte, titre d'essai, quelques fragmentaires contributions. Sans faire de ces questions l'objet direct de notre tude, nous mettrons profit toutes les occasions qui s'offriront nous de saisir leur naissance quelques-unes, tout au moins, de ces notions qui, tout en tant religieuses par leurs origines, devaient cependant rester la base de la mentalit humaine.
24
23
24
artificielles; pour le second, ce sont, au contraire, des donnes naturelles; pour nous, elles sont, en un sens, des oeuvres d'art, mais d'un art qui imite la nature avec une perfection susceptible de crotre sans limite. Par exemple, ce qui est la base de la catgorie de temps, c'est le rythme de la vie sociale; mais s'il y a un rythme de la vie collective, on peut tre assur qu'il y en a un autre dans la vie de l'individuel, plus gnralement, dans celle de l'univers. Le premier est seulement plus marqu et plus apparent que les autres. De mme, nous verrons que la notion de genre s'est forme sur celle de groupe humain. Mais si les hommes forment des groupes naturels, on peut prsumer qu'il existe, entre les choses, des groupes la fois analogues et diffrents. Ce sont ces groupes naturels de choses qui sont les genres et les espces. S'il semble d'assez nombreux esprits que l'on ne puisse attribuer une origine sociale aux catgories sans leur retirer toute valeur spculative, c'est que la socit passe encore trop frquemment pour n'tre pas une chose naturelle ; d'o l'on conclut que les reprsentations qui l'expriment n'expriment rien de la nature. Mais la conclusion ne vaut que ce que vaut le principe. C'est pourquoi il est lgitime de, comparer les catgories des outils; car l'outil, de son ct, est du capital matriel accumul. D'ailleurs entre les trois notions d'outil, de catgorie et d'institution, il y a une troite parent.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
29
LIVRE PREMIER
QUESTIONS PRLIMINAIRES
.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
30
CHAPITRE PREMIER
DFINITION DU PHNOMNE RELIGIEUX ET DE LA RELIGION
25
Pour pouvoir rechercher quelle est la religion la plus primitive et la plus simple que nous fasse connatre l'observation, il nous faut tout d'abord dfinir ce qu'il convient d'entendre par une religion; sans quoi, nous nous exposerions soit appeler religion un systme d'ides et de pratiques qui n'aurait rien de religieux, soit passer ct de faits religieux sans en apercevoir la vritable nature. Ce qui montre bien que le danger n'a rien d'imaginaire et qu'il ne s'agit nullement de sacrifier un vain formalisme mthodologique, c'est que, pour n'avoir pas pris cette prcaution, un savant, auquel la science compare des religions doit pourtant beaucoup, M. Frazer, n'a pas su reconnatre le caractre profondment religieux des croyances et des rites qui seront tudis plus loin et o nous voyons, quant nous, le germe initial de la vie religieuse dans l'humanit. Il y a donc l nue question prjudicielle qui doit tre traite avant toute autre. Non pas que nous puissions songer atteindre ds prsent les caractres profonds et vraiment explicatifs de la religion : on ne peut les dterminer qu'au terme de la recherche. Mais ce qui est ncessaire et possible, c'est d'indiquer un certain nombre de signes extrieurs, facilement perceptibles, qui permettent de reconnatre les phnomnes religieux partout o ils se rencontrent, et qui empchent de les confondre avec d'autres. C'est cette opration prliminaire que nous allons procder. Mais pour qu'elle donne les rsultats qu'on en peut attendre, il faut commencer par librer notre esprit de toute ide prconue. Les hommes ont t obligs de se faire une notion de ce qu'est la religion, bien avant que la science des religions ait pu instituer ses comparaisons mthodiques. Les ncessits de l'existence nous obligent tous, croyants et incrdules, nous
25
Nous avions dj essay de dfinir le phnomne religieux dans un travail qu'a publi l'Anne sociologique (t. III, p. 1 et suiv.). La dfinition que nous en avons donne alors diffre, comme on verra, de celle que nous proposons aujourd'hui. Nous expliquons, la fin de ce chapitre (p. 65, no 1), les raisons qui nous ont dtermin ces modifications qui n'impliquent, d'ailleurs, aucun changement essentiel dans la conception des faits.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
31
reprsenter de quelque manire ces choses au milieu desquelles nous vivons, sur lesquelles nous avons sans cesse des jugements porter et dont il nous faut tenir compte dans notre conduite. Seulement, comme ces prnotions se sont formes sans mthode, suivant les hasards et les rencontres de la vie, elles n'ont droit aucun crdit et doivent tre rigoureusement tenues l'cart de l'examen qui va suivre. Ce n'est pas nos prjugs, nos passions, nos habitudes que doivent tre demands les lments de la dfinition qui nous est ncessaire; c'est la ralit mme qu'il s'agit de dfinir. Mettons-nous donc en face de cette ralit. Laissant de ct toute conception de la religion en gnral, considrons les religions dans leur ralit concrte et tchons de dgager ce qu'elles peuvent avoir de commun; car la religion ne se peut dfinir qu'en fonction des caractres qui se retrouvent partout o il y a religion. Dans cette comparaison, nous ferons donc entrer tous les systmes religieux que nous pouvons connatre, ceux du prsent et ceux du pass, les plus primitifs et les plus simples aussi bien que les plus rcents et les plus raffins; car nous n'avons aucun droit ni aucun moyen logique d'exclure les uns pour ne retenir que les autres. Pour celui qui ne voit dans la religion qu'une manifestation naturelle de l'activit humaine, toutes les religions sont instructives sans exception d'aucune sorte; car toutes expriment l'homme leur manire et peuvent ainsi nous aider mieux comprendre cet aspect de notre nature. Nous avons vu, d'ailleurs, combien il s'en faut que la meilleure faon d'tudier la religion soit de la considrer de prfrence sous la forme qu'elle prsente chez les peuples les plus civiliss .
26
Mais pour aider l'esprit s'affranchir de ces conceptions usuelles qui, par leur prestige, peuvent l'empcher de voir les choses telles qu'elles sont, il convient, avant d'aborder la question pour notre propre compte, d'examiner quelques-unes des dfinitions les plus courantes dans lesquelles ces prjugs sont venus s'exprimer.
I
.
Une notion qui passe gnralement pour caractristique de tout ce qui est religieux est celle de surnaturel. Par l, on entend tout ordre de choses qui dpasse la porte de notre entendement ; le surnaturel, c'est le monde du mystre, de l'inconnaissable, de l'incomprhensible. La religion serait donc une sorte de spculation sur tout ce qui chappe la science et, plus gnralement, la pense distincte. Les religions, dit Spencer, diamtralement opposes par leurs dogmes, s'accordent reconnatre tacitement que le monde, avec tout ce qu'il contient et tout ce qui l'entoure, est un mystre qui veut une explication ; il les fait donc essentiellement
26
Voir plus haut, p. 4. Nous n'insistons pas davantage sur la ncessit de ces dfinitions pralables ni sur la mthode suivre pour y procder. on en verra l'expos dans nos Rgles de la mthode sociologique, p. 43 et suiv. Cf. Le suicide, p. 1 et suiv. (Paris, F. Alcan, puis P.U.F.).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
32
consister dans la croyance l'omniprsence de quelque chose qui passe l'intelligence . De mme, Max Mller voyait dans toute religion un effort pour concevoir l'inconcevable, pour exprimer l'inexprimable, une aspiration vers l'infini .
27 28
Il est certain que le sentiment du mystre n'est pas sans avoir jou un rle important dans certaines religions, notamment dans le christianisme. Encore faut-il ajouter que l'importance de ce rle a singulirement vari aux diffrents moments de l'histoire chrtienne. Il est des priodes o cette notion passe au second plan et s'efface. Pour les hommes du XVIIe sicle, par exemple, le dogme n'avait rien de troublant pour la raison; la foi se conciliait sans peine avec la science et la philosophie, et les penseurs qui, comme Pascal, sentaient vivement ce qu'il y a de profondment obscur dans les choses, taient si peu en harmonie avec leur poque qu'ils sont rests incompris de leurs contemporains. Il pourrait donc bien y avoir quelque prcipitation faire, d'une ide sujette de telles clipses, l'lment essentiel mme de la seule religion chrtienne.
29
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle n'apparat que trs tardivement dans l'histoire des religions; elle est totalement trangre non seulement aux peuples qu'on appelle primitifs, mais encore tous ceux qui n'ont pas atteint un certain degr de culture intellectuelle. Sans doute, quand nous les voyons attribuer des objets insignifiants des vertus extraordinaires, peupler l'univers de principes singuliers, faits des lments les plus disparates, dous d'une sorte d'ubiquit difficilement reprsentable, nous trouvons volontiers ces conceptions un air de mystre. Il nous semble que les hommes n'ont pu se rsigner des ides aussi troublantes pour notre raison moderne que par impuissance en trouver qui fussent plus rationnelles. En ralit, pourtant, ces explications qui nous surprennent paraissent au primitif les Plus simples du Monde. Il n'y voit pas une sorte d'ultima ratio laquelle l'intelligence ne se rsigne qu'en dsespoir de cause, mais la manire la plus immdiate de se reprsenter et de comprendre ce qu'il observe autour de lui. Pour lui, il n'y a rien d'trange ce que l'on puisse, de la voix ou du geste, commander aux lments, arrter ou prcipiter le cours des astres, susciter la pluie ou la suspendre, etc. Les rites qu'il emploie pour assurer la fertilit du sol ou la fcondit des espces animales dont il se nourrit ne sont pas, ses yeux, plus irrationnels que ne le sont, aux ntres, les procds techniques dont nos agronomes se servent pour le mme objet. Les puissances qu'il met en jeu par ces divers moyens ne lui paraissent rien avoir de spcialement mystrieux. Ce sont des forces qui, sans doute, diffrent de celles que le savant moderne conoit et dont il nous apprend l'usage ; elles ont une autre manire de se comporter et ne se laissent pas discipliner par les mmes procds ; mais, pour celui qui y croit, elles ne sont pas plus inintelligibles que ne le sont la pesanteur ou l'lectricit pour le physicien d'aujourd'hui. Nous verrons d'ailleurs, dans le cours mme de cet ouvrage, que la notion de forces naturelles est trs vraisemblablement drive de la notion de forces religieuses ; il ne saurait donc y avoir entre celles-ci et celles-l l'abme qui spare le rationnel de l'irrationnel. Mme le fait que les forces religieuses sont penses souvent sous la forme d'entits spirituelles, de volonts conscientes, n'est nullement une preuve de leur irrationalit. La raison ne rpugne pas a priori admettre
27 28 29
Premiers principes, trad. fr., p. 38-39 (Paris, F. Alcan). Introduction la science des religions, p. 17. Cf. Origine et dveloppement de la religion, p. 21. Le mme esprit se retrouve galement l'poque scolastique, comme en tmoigne la formule par laquelle se dfinit la philosophie de cette priode: Fides quaerens intellectum.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
33
que les corps dits inanims soient, comme les corps humains, mus par des intelligences, bien que la science contemporaine s'accommode difficilement de cette hypothse. Quand Leibniz proposa de concevoir le monde extrieur comme une immense socit d'esprits entre lesquels il n'y avait et ne pouvait y avoir que des relations spirituelles, il entendait faire oeuvre de rationaliste et il ne voyait dans cet animisme universel rien qui pt offenser l'entendement. D'ailleurs, l'ide de surnaturel, telle que nous l'entendons, date d'hier : elle suppose, en effet, l'ide contraire dont elle est la ngation et qui n'a rien de primitif. Pour qu'on pt dire de certains faits qu'ils sont surnaturels, il fallait avoir dj le sentiment qu'il existe un ordre naturel des choses, c'est--dire que les phnomnes de l'univers sont lis entre eux suivant des rapports ncessaires, appels lois. Une fois ce principe acquis, tout ce qui droge ces lois devait ncessairement apparatre comme en dehors de la nature et, par suite, de la raison : car ce qui est naturel en ce sens est aussi rationnel, ces relations ncessaires ne faisant qu'exprimer la manire dont les choses s'enchanent logiquement. Mais cette notion du dterminisme universel est d'origine rcente; mme les plus grands penseurs de l'antiquit classique n'avaient pas russi en prendre pleinement conscience. C'est une conqute des sciences positives ; c'est le postulat sur lequel elles reposent et qu'elles ont dmontr par leurs progrs. Or, tant qu'il faisait dfaut ou n'tait pas assez solidement tabli, les vnements les plus merveilleux n'avaient rien qui ne part parfaitement concevable. Tant qu'on ne savait pas ce que l'ordre des choses a d'immuable et d'inflexible, tant qu'on y voyait luvre de volonts contingentes, on devait trouver naturel que ces volonts ou d'autres pussent le modifier arbitrairement. Voil pour quoi les interventions miraculeuses que les anciens prtaient leurs dieux n'taient pas leurs yeux des miracles, dans l'acception moderne du mot. C'taient pour eux de beaux, de rares ou de terribles spectacles, objets de sur prise et d'merveillement mirabilia, miracula) ; mais ils n'y voyaient nullement des sortes d'chappes sur un monde mystrieux o la raison ne peut pntrer. Nous pouvons d'autant mieux comprendre cette mentalit qu'elle n'a pas compltement disparu du milieu de nous. Si le principe du dterminisme est aujourd'hui solidement tabli dans les sciences physiques et naturelles, il y a seulement un sicle qu'il a commenc s'introduire dans les sciences sociales et son autorit y est encore conteste. Il n'y a qu'un petit nombre d'esprits qui soient fortement pntrs de cette ide que les socits sont soumises des lois ncessaires et constituent un rgne naturel. Il s'ensuit qu'on y croit possibles de vritables miracles. On admet, par exemple, que le lgislateur peut crer une institution de rien par une simple injonction de sa volont, transformer un systme social en un autre, tout comme les croyants de tant de religions admettent que la volont divine a tir le monde du nant ou peut arbitrairement transmuter les tres les lin dans les autres. Pour ce qui concerne les faits sociaux, nous avons encore une mentalit de primitifs. Et cependant, si, en matire de sociologie, tant de contemporains s'attardent encore cette conception suranne, ce n'est pas que la vie des socits leur paraisse obscure et mystrieuse ; au contraire, s'ils se contentent si facilement de ces explications, s'ils s'obstinent dans ces illusions que dment sans cesse l'exprience, c'est que les faits sociaux leur semblent la chose la plus claire du monde; c'est qu'ils n'en sentent pas l'obscurit relle; c'est qu'ils n'ont pas encore reconnu la ncessit de recourir aux procds laborieux des sciences naturelles pour dissiper progressivement ces
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
34
tnbres. Le mme tat d'esprit se retrouve la racine de beaucoup de croyances religieuses qui nous surprennent par leur simplisme. C'est la science, et non la religion, qui a appris aux hommes que les choses sont complexes et malaises comprendre. Mais, rpond Jevons , l'esprit humain n'a pas besoin d'une Culture proprement scientifique pour remarquer qu'il existe entre les faits des squences dtermines, un ordre constant de succession, et pour observer, d'autre part, que cet ordre est souvent troubl. Il arrive que le soleil s'clipse brusquement, que la pluie manque l'poque o elle est attendue, que la lune tarde reparatre aprs sa disparition priodique, etc. Parce que ces vnements sont en dehors du cours ordinaire des choses, on les impute des causes extraordinaires, exceptionnelles, C'est--dire, en somme, extra-naturelles. C'est sous cette forme que l'ide de surnaturel serait ne ds le dbut de l'histoire, et c'est ainsi que, ds ce moment, la pense religieuse se serait trouve munie de son objet propre.
30
Mais, d'abord, le surnaturel ne se ramne nullement l'imprvu. Le nouveau fait partie de la nature tout comme son contraire. Si nous constatons qu'en gnral les phnomnes se succdent dans un ordre dtermin, nous observons galement que cet ordre n'est jamais qu'approch, qu'il n'est pas identique lui-mme d'une fois l'autre, qu'il comporte toutes sortes d'exceptions. Pour peu que nous ayons d'exprience, nous sommes habitus ce que nos tats d'attente soient frquemment dus et ces dceptions reviennent trop souvent pour nous apparatre comme extraordinaires. Une certaine contingence est une donne de l'exprience tout comme une certaine uniformit; nous n'avons donc aucune raison de rapporter l'une des causes et des forces entirement diffrentes de celles dont dpend l'autre. Ainsi, pour que nous ayons l'ide du surnaturel, il ne suffit pas que nous soyons tmoins d'vnements inattendus; il faut encore que ceux-ci soient conus comme impossibles, c'est--dire comme inconciliables avec un ordre qui, tort ou raison, nous parat ncessairement impliqu dans la nature des choses. Or, cette notion d'un ordre ncessaire, ce sont les sciences positives qui l'ont peu peu construite, et, par suite, la notion contraire ne saurait leur tre antrieure. De plus, de quelque manire que les hommes se soient reprsent les nouveauts et les contingences que rvle l'exprience, il n'y a rien dans ces reprsentations qui puisse servir caractriser la religion. Car les conceptions religieuses ont, avant tout, pour objet d'exprimer et d'expliquer, non ce qu'il y a d'exceptionnel et d'anormal dans les choses, mais, au contraire, ce qu'elles ont de constant et de rgulier. Trs gnralement, les dieux servent beaucoup moins rendre compte des monstruosits, des bizarreries, des anomalies, que de la marche habituelle de l'univers, du mouvement des astres, du rythme des saisons, de la pousse annuelle de la vgtation, de la perptuit des espces, etc. Il s'en faut donc que la notion du religieux concide avec celle de l'extraordinaire et de l'imprvu. - Jevons rpond que cette conception des forces religieuses n'est pas primitive. On aurait commenc par les imaginer pour rendre compte des dsordres et des accidents, et c'est seulement ensuite qu'on les aurait utilises pour expliquer les uniformits de la nature . Mais on ne voit pas ce qui aurait pu dterminer les hommes leur attribuer successivement des fonctions aussi manifestement contraires. En
31
30 31
Introduction to the History of Religion, p. 15 et suiv. Jevons, p. 23.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
35
outre, l'hypothse d'aprs laquelle les tres sacrs auraient t d'abord confins dans un rle ngatif de perturbateurs est entirement arbitraire. Nous verrons, en effet, que, ds les religions les plus simples que nous connaissions, ils ont eu pour tche essentielle d'entretenir, d'une manire positive, le cours normal de la vie .
32
Ainsi, l'ide du mystre n'a rien d'originel. Elle n'est pas donne l'homme; c'est l'homme qui l'a forge de ses propres mains en mme temps que l'ide contraire. C'est pourquoi elle ne tient quelque place que dans un petit nombre de religions avances. On ne peut donc en faire la caractristique des phnomnes religieux sans exclure de la dfinition la majorit des faits dfinir.
II
.
Une autre ide par laquelle on a souvent essay de dfinir la religion est celle de divinit. La religion, dit A. Rville, est la dtermination de la vie humaine par le sentiment d'un lien unissant l'esprit humain l'esprit mystrieux dont il reconnat la domination sur le monde et sur lui-mme et auquel il aime se sentir uni . Il est vrai que, si l'on entend le mot de divinit dans un sens prcis et troit, la dfinition laisse en dehors d'elle une multitude de faits manifestement religieux. Les mes des morts, les esprits de toute espce et de tout rang dont l'imagination religieuse de tant de peuples divers a peupl la nature, sont toujours l'objet de rites et parfois mme d'un culte rgulier; et pourtant, ce ne sont pas des dieux au sens propre du mot. Mais pour que la dfinition les comprenne, il suffit de substituer au mot de dieu celui, plus comprhensif, d'tre spirituel. C'est ce qu'a fait Tylor : Le premier point essentiel quand il s'agit d'tudier systmatiquement les religions des races infrieures, c'est, dit-il, de dfinir et de prciser ce qu'on entend par religion. Si l'on tient faire entendre par ce mot la croyance une divinit suprme.... un certain nombre de tribus se trouveront exclues du monde religieux. Mais cette dfinition trop troite a le dfaut d'identifier la religion avec quelques-uns de ses dveloppements particuliers... Mieux vaut, ce semble, poser simplement comme dfinition minimum de la religion la croyance en des tres spirituels . Par tres spirituels, il faut entendre des sujets conscients, dous de pouvoirs suprieurs ceux que possde le commun des hommes; cette qualification convient donc aux mes des morts, aux gnies, aux dmons aussi bien qu'aux divinits proprement dites. - Il importe de noter tout de suite la conception particulire de la religion qui est implique dans cette dfinition. Le seul commerce que nous puissions entretenir avec des tres de cette sorte se trouve dtermin par la nature qui leur est attribue. Ce sont des tres conscients ; nous ne pouvons donc agir sur eux que comme on agit sur des consciences en gnral, c'est--dire par des procds psychologiques, en tchant de les convaincre ou de les mouvoir soit l'aide de paroles (invocations, prires), soit par des
33 34
32 33 34
V. plus bas, liv. Ill, chap. II. Prolgomnes l'histoire des religions, p. 34. La civilisation primitive, I, p. 491.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
36
offrandes et des sacrifices. Et puisque la religion aurait pour objet de rgler nos rapports avec ces tres spciaux, il ne pourrait y avoir religion que l o il y a prires, sacrifices, rites propitiatoires, etc. On aurait ainsi un critre trs simple qui permettrait de distinguer ce qui est religieux de ce qui ne l'est pas. C'est ce critre que se rfre systmatiquement Prazer et, avec lui, plusieurs ethnographes .
35 36
Mais si vidente que puisse paratre cette dfinition par suite d'habitudes d'esprit que nous devons notre ducation religieuse, il y a nombre de faits auxquels elle n'est pas applicable et qui ressortissent pourtant au domaine de la religion. En premier lieu, il existe de grandes religions d'o l'ide de dieux et d'esprits est absente, oh, tout au moins, elle ne joue qu'un rle secondaire et effac. C'est le cas du bouddhisme. Le bouddhisme, dit Burnouf, se place, en opposition au brahmanisme, comme une morale sans dieu et un athisme sans Nature . Il ne reconnat point de dieu dont l'homme dpende, dit M. Barth; sa doctrine est absolument athe , et M. Oldenberg, de son ct, l'appelle une religion sans dieu . En effet, tout l'essentiel du bouddhisme tient dans quatre propositions que les fidles appellent les quatre nobles Vrits . La premire pose l'existence de la douleur comme lie au perptuel coulement des choses; la seconde montre dans le dsir la cause de la douleur; la troisime fait de la suppression du dsir le seul moyen de supprimer la douleur; la quatrime numre les trois tapes par lesquelles il faut passer pour parvenir cette suppression : c'est la droiture, la mditation, enfin la sagesse, la pleine possession de la doctrine. Ces trois tapes traverses, on arrive au terme du chemin, la dlivrance, au salut par le Nirvna.
37 38 39 40
Or, dans aucun de ces principes, il n'est question de divinit. Le bouddhiste ne se proccupe pas de savoir d'o vient ce monde du devenir o il vit et oh il souffre ; il le prend comme un fait et tout son effort est de s'en vader. D'un autre ct, pour cette oeuvre de salut, il ne peut compter que sur lui-mme ; il n'a aucun dieu remercier, de mme que, dans le combat, il n'en appelle aucun son aide . Au lieu de prier, au sens usuel du mot, au lieu de se tourner vers un tre suprieur et d'implorer son assistance, il se replie sur lui-mme et il mdite. Ce n'est pas dire qu'il nie de front l'existence d'tres appels Indra, Agni, Varuna ; mais il estime qu'il ne leur doit rien et qu'il n'a rien faire avec eux , car leur pouvoir ne peut s'tendre que sur les biens de ce monde qui, pour lui, sont Sans valeur. Il est donc athe en ce
41 42 43
35 36 37 38 39 40 41 42 43
Ds la premire dition du Golden Bough, I, pp. 30-32. Notamment Spencer et Gillen et mme Preuss qui appelle magiques toutes les forces religieuses non individualises. BURNOUF, Introduction l'histoire du bouddhisme indien, 2e d., p. 464. Le dernier mot du texte signifie que le bouddhisme n'admet pas mme l'existence d'une Nature ternelle. BARTH, The Religions of India, p. 110. OLDENBERG, Le Bouddha, p. 51 (trad. fr., Paris, F. Alcan, puis P.U.F.). OLDENBERG, ibid., pp. 214, 318. Cf. KERN, Histoire du bouddhisme dans l'Inde, I, p. 389 et suiv. OLDENBERG, p. 258; BARTH, p. 110. OLDENBERG, p. 314. BARTH, p. 109. J'ai la conviction intime, dit galement Burnouf, que si kya n'et pas rencontr autour de lui un Panthon tout peupl des dieux dont j'ai donn les noms, il n'et eu aucun besoin de l'inventer (Introd. l'histoire du bouddhisme indien, p. 119).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
37
sens qu'il se dsintresse de la question de savoir s'il y a ou non des dieux. D'ailleurs, alors mme qu'il y en aurait et de quelque puissance qu'ils fussent arms, le saint, le dlivr, s'estime suprieur eux ; car ce qui fait la dignit des tres, ce n'est pas l'tendue de l'action qu'ils exercent sur les choses, c'est exclusivement le degr de leur avancement sur le chemin du salut .
44
Il est vrai que le Bouddha, au moins dans certaines des divisions de l'glise bouddhique, a fini par tre considr comme une sorte de dieu. Il a ses temples ; il est devenu l'objet d'un culte qui, d'ailleurs, est trs simple, car il se rduit essentiellement l'offrande de quelques fleurs et l'adoration de reliques ou d'images consacres. Ce n'est gure autre chose qu'un culte du souvenir. Mais d'abord, cette divinisation du Bouddha, supposer que l'expression soit exacte, est particulire ce qu'on a appel le bouddhisme septentrional. Les bouddhistes du Sud, dit Kern, et les moins avancs parmi les bouddhistes du Nord, on peut l'affirmer d'aprs les donnes aujourd'hui connues, parlent du fondateur de leur doctrine comme s'il tait un homme . Sans doute, ils attribuent au Bouddha des pouvoirs extraordinaires, suprieurs ceux que possde le commun des mortels ; mais c'tait une croyance trs ancienne dans l'Inde, et d'ailleurs trs gnrale dans une multitude de religions diverses, qu'un grand saint est dou de vertus exceptionnelles ; et cependant, un saint n'est pas un dieu, non plus qu'un prtre ou qu'un magicien, en dpit des facults surhumaines qui leur sont souvent attribues. D'un autre ct, suivant les savants les plus autoriss, cette sorte de thisme et la mythologie complexe qui l'accompagne d'ordinaire ne seraient qu'une forme drive et dvie du bouddhisme. Bouddha n'aurait d'abord t considr que comme le plus sage des hommes . La conception d'un Bouddha qui ne serait pas un homme parvenu au plus haut degr de saintet est , dit Burnouf, hors du cercle des ides qui constituent le fond mme des Stras simples ; et, ajoute ailleurs le mme auteur, son humanit est reste un fait si incontestablement reconnu de tous que les lgendaires, auxquels cotaient si peu les miracles, n'ont pas mme eu la pense d'en faire un dieu aprs sa mort . Aussi est-il permis de se demander s'il est jamais parvenu se dpouiller compltement de ce caractre humain et si l'on est en droit de l'assimiler compltement un dieu ; en tout cas, c'est un dieu d'une nature trs particulire et dont le rle ne ressemble nullement celui des autres personnalits divines. Car un dieu, c'est avant tout un tre vivant avec lequel l'homme doit compter et sur lequel il peut compter; or le Bouddha est mort, il est entr dans le Nirvna, il ne peut plus rien sur la marche des vnements humains .
45 46 47 48 49 50 51
44 45 46
47 48 49 50 51
BURNOUF, Op. cit,, p. 117. KERN, Op. Cit., 1, p. 289. La croyance universellement admise dans l'Inde qu'une grande saintet est ncessairement accompagne de facults surnaturelles, voil le seul appui qu'il (kya) devait trouver dans les esprits (BURNOUF, P. 119). BURNOUF, p. 120. BURNOUF, p. 107. BURNOUF, p. 302. C'est ce que Kern exprime en ces ternies A certains gards, il est un homme; certains gards, il n'est pas un homme; certains gards, il n'est ni l'un ni l'autre (op. cit., I, p. 290). L'ide que le chef divin de la Communaut n'est pas absent du milieu des siens, mais qu'il demeure rellement parmi eux comme leur matre et leur roi, de telle sorte que le culte n'est autre chose que l'expression de la perptuit de cette vie commune, cette ide est tout fait trangre aux bouddhistes. Leur
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
38
Enfin, et quoi qu'on pense de la divinit du Bouddha, il reste que c'est une conception tout fait extrieure ce qu'il y a de vraiment essentiel dans le bouddhisme. Le bouddhisme, en effet, consiste avant tout dans la notion du salut et le salut suppose uniquement que l'on connat la bonne doctrine et qu'on la pratique. Sans doute, elle n'aurait pu tre connue si le Bouddha n'tait venu la rvler ; mais une fois que cette rvlation fut faite, l'uvre du Bouddha tait accomplie. A partir de ce moment, il cessa d'tre un facteur ncessaire de la vie religieuse. La pratique des quatre vrits saintes serait possible, alors mme que le souvenir de celui qui les a fait connatre se serait effac des mmoires . Il en est tout autrement du christianisme qui, sans l'ide toujours prsente et le culte toujours pratiqu du Christ, est inconcevable; car c'est par le Christ toujours vivant et chaque jour immol que la communaut des fidles continue communiquer avec la source suprme de la vie spirituelle .
52 53
Tout ce qui prcde s'applique galement une autre grande religion de l'Inde, au janisme. D'ailleurs, les deux doctrines ont sensiblement la mme conception du monde et de la vie. Comme les bouddhistes, dit M. Barth, les janistes sont athes. Ils n'admettent pas de crateur ; pour eux, le monde est ternel et ils nient explicitement qu'il puisse y avoir un tre parfait de toute ternit. Le Jina est devenu parfait, mais il ne l'tait pas de tout temps . Tout comme les bouddhistes du Nord, les janistes, ou du moins certains d'entre eux, sont nanmoins revenus une sorte de disme; dans les inscriptions du Dekhan il est parl d'un Jinapati, sorte de Jina suprme, qui est appel le premier crateur; mais un tel langage, dit le mme auteur, est en contradiction avec les dclarations les plus explicites de leurs crivains les plus autoriss .
54
Si, d'ailleurs, cette indiffrence pour le divin est ce point dveloppe dans le bouddhisme et le janisme, c'est qu'elle tait dj en germe dans le brahmanisme d'o l'une et l'autre religion sont drives. Au moins sous certaines de ses formes, la spculation brahmanique aboutissait une explication franchement matrialiste et athe de l'univers . Avec le temps, les multiples divinits que les peuples de l'Inde avaient tout d'abord appris adorer taient venues comme se fondre en une sorte de principe un, impersonnel et abstrait, essence de tout ce qui existe. Cette ralit suprme, qui n'a plus rien d'une personnalit divine, l'homme la contient en lui, ou plutt il ne fait qu'un avec elle puisqu'il n'existe rien en dehors d'elle. Pour la trouver et s'unir elle, il n'a donc pas chercher hors de lui-mme quelque appui extrieur ; il suffit qu'il se concentre sur soi et qu'il mdite. Quand, dit Oldenberg, le bouddhisme s'engage dans cette grande entreprise d'imaginer un monde de salut o l'homme se sauve lui-mme, et de crer une religion sans dieu, la spculation brahmanique a dj prpar le terrain pour cette tentative. La notion de divinit a recul pas pas ; les figures des anciens dieux s'effacent ptissantes; le Brahma trne dans son ternelle quitude, trs haut au-dessus du monde terrestre, et il ne reste plus qu'une seule personne prendre une part active la grande oeuvre
55
52
53 54 55
matre eux est dans le Nirvna ; ses fidles crieraient vers lui qu'il ne pourrait les entendre (OLDENBERG, Le Bouddha, p. 368). La doctrine bouddhique, dans tous ses traits essentiels, pourrait exister, telle qu'elle existe en ralit, et la notion du Bouddha lui rester totalement trangre (OLDENBERG, p. 322). - Et ce qui est dit du Bouddha historique s'applique galement tous les Bouddhas mythologiques. Voir dans le mme sens Max MLLER, Natural Religion, p. 103 et suiv. et 190. Op. cit., p. 146. BARTH, in Encyclopdie des sciences religieuses, VI, p. 548.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
39
de la dlivrance : c'est l'homme . Voil donc une portion considrable de l'volution religieuse qui a consist, en somme, dans un recul progressif de l'ide d'tre spirituel et de divinit. Voil de grandes religions o les invocations, les propitiations, les sacrifices, les prires proprement dites sont bien loin de tenir une place prpondrante et qui, par consquent, ne prsentent pas le signe distinctif auquel on prtend reconnatre les manifestations proprement religieuses.
56
Mais mme l'intrieur des religions distes, on trouve un grand nombre de rites qui sont compltement indpendants de toute ide de dieux ou d'tre spirituels. Il y a d'abord une multitude d'interdits. La Bible, par exemple, ordonne la femme de vivre isole chaque mois pendant une priode dtermine ; elle l'oblige un isolement analogue pendant l'accouchement ; elle dfend d'atteler ensemble l'ne et le cheval, de porter un vtement o le chanvre serait ml au lin , sans qu'il soit possible de voir quel rle la croyance en Iahveh peut avoir jou dans ces interdictions ; car il est absent de toutes les relations qui sont ainsi prohibes et ne saurait tre intress par elles. On en peut dire autant de la plupart des interdictions alimentaires. Et ces prohibitions ne sont pas particulires aux Hbreux ; mais, sous des formes diverses, on les retrouve, avec le mme caractre, dans d'innombrables religions.
57 58 59
Il est vrai que ces rites sont purement ngatifs ; mais ils ne laissent pas d'tre religieux. De plus, il en est d'autres qui rclament du fidle des prestations actives et positives et qui, pourtant, sont de mme nature. Ils agissent par eux-mmes, sans que leur efficacit dpende d'aucun pouvoir divin; ils suscitent mcaniquement les effets qui sont leur raison d'tre. Ils ne consistent ni en prires, ni en offrandes adresses un tre la bonne volont duquel le rsultat attendu est subordonn ; mais ce rsultat est obtenu par le jeu automatique de l'opration rituelle. Tel est le cas notamment du sacrifice dans la religion vdique. Le sacrifice, dit M. Bergaigne, exerce une influence directe sur les phnomnes clestes ; il est tout-puissant par lui-mme et sans aucune influence divine. C'est lui, par exemple, qui brisa les portes de la caverne o taient enfermes les aurores et qui fit jaillir la lumire du jour . De mme, ce sont des hymnes appropries qui, par une action directe, ont fait couler sur la terre les eaux du ciel, et cela malgr les dieux . La pratique de certaines austrits a la mme efficacit. Il y a plus : le sacrifice est si bien le principe par excellence qu'on lui rapporte, non seulement l'origine des hommes, mais encore celle des dieux. Une telle conception peut bon droit paratre trange. Elle s'explique cependant comme une des dernires consquences de l'ide de la toutepuissance du sacrifice . Aussi, dans toute la premire partie du travail de M. Bergaigne,
60 61 62 63
56 57 58 59 60 61 62
63
Le Bouddha, p. 51. I, Sam., 21, 6. Lv., XII. Deutr., XXII, 10 et Il. La religion vdique, 1, p. 122. La religion vdique, p. 133. Aucun texte, dit M. Bergaigne, ne tmoigne mieux de la conscience d'une action magique de l'homme sur les eaux du ciel que le vers X, 32, 7, o cette croyance est exprime en termes gnraux, applicables l'homme actuel, aussi bien qu' ses anctres rels ou mythologiques : L'ignorant a interrog le savant; instruit par le savant, il agt a et voici le profit de l'instruction : il obtient l'coulement des rapides (p. 137). Ibid. (p. 139).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
40
n'est-il question que de sacrifices o les divinits ne jouent aucun rle. Le fait n'est pas spcial la religion vdique ; il est, au contraire, d'une trs grande gnralit. Dans tout culte, il y a des pratiques qui agissent par elles-mmes, par une vertu qui leur est propre et sans qu'aucun dieu s'intercale entre l'individu qui excute le rite et le but poursuivi. Quand, la fte dite des Tabernacles, le juif remuait l'air en agitant des branches de saule suivant un certain rythme, c'tait pour provoquer le vent se lever et la pluie tomber; et l'on croyait que le phnomne dsir rsultait automatiquement du rite, pourvu que celui-ci ait t correctement accompli . C'est l, d'ailleurs, ce qui explique l'importance primordiale attache par presque tous les cultes la partie matrielle des crmonies. Ce formalisme religieux, forme premire, trs vraisemblablement, du formalisme juridique, vient de ce que la formule prononcer, les mouvements excuter, ayant en eux-mmes la source de leur efficacit, la perdraient s'ils n'taient pas exactement conformes au type consacr par le succs.
64
Ainsi il y a des rites sans dieux, et mme il y a des rites d'o drivent des dieux. Toutes les vertus religieuses n'manent pas de personnalits divines et il y a des relations cultuelles qui ont un autre objet que d'unir l'homme une divinit. La religion dborde donc l'ide de dieux on d'esprits, et par consquent, ne peut se dfinir exclusivement en fonction de cette dernire.
III
.
Ces dfinitions cartes, mettons-nous nous-mme en face du problme. Remarquons tout d'abord que, dans toutes ces formules, c'est la nature de la religion dans son ensemble que l'on essaie d'exprimer directement. On procde comme si la religion formait une sorte d'entit indivisible, alors qu'elle est un tout form de parties; c'est un systme plus ou moins complexe de mythes, de dogmes, de rites, de crmonies. Or un tout ne peut tre dfini que par rapport aux parties qui le forment. Il est donc plus mthodique de chercher caractriser les phnomnes lmentaires dont toute religion rsulte, avant le systme produit par leur union. Cette mthode s'impose d'autant plus qu'il existe des phnomnes religieux qui ne ressortissent aucune religion dtermine. Tels sont ceux qui constituent la matire du folklore. Ce sont, en gnral, des dbris de religions disparues, des survivances inorganises; mais il en est aussi qui se sont forms spontanment sous l'influence de causes locales. Dans nos pays europens, le christianisme s'est efforc de les absorber et de se les assimiler ; il leur a imprim une couleur chrtienne. Nanmoins, il en est beaucoup qui ont persist jusqu' une date rcente ou qui persistent encore avec une relative autonomie : ftes de l'arbre de mai, du solstice d't, du carnaval, croyances diverses relatives des gnies, des dmons locaux, etc. Si le caractre religieux de ces faits va en s'effaant, leur importance religieuse est pourtant
64
On trouvera d'autres exemples dans HUBERT, art. Magia in Dictionnaire des Antiquits, VI, p. 1509.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
41
telle qu'ils ont permis Mannhardt et son cole de renouveler la science des religions. Une dfinition qui n'en tiendrait pas compte ne comprendrait donc pas tout ce qui est religieux. Les phnomnes religieux se rangent tout naturellement en deux catgories fondamentales : les croyances et les rites. Les premires sont des tats de l'opinion, elles consistent en reprsentations ; les secondes sont des modes d'action dtermins. Entre ces deux classes de faits, il y a toute la diffrence qui spare la pense du mouvement. Les rites ne peuvent tre dfinis et distingus des autres pratiques humaines, notamment des pratiques morales, que par la nature spciale de leur objet. Une rgle morale, en effet, nous prescrit, tout comme un rite, des manires d'agir, niais qui s'adressent des objets d'un genre diffrent. C'est donc l'objet du rite qu'il faudrait caractriser pour pouvoir caractriser le rite lui-mme. Or, c'est dans la croyance que la nature spciale de cet objet est exprime. On ne peut donc dfinir le rite qu'aprs avoir dfini la croyance. Toutes les croyances religieuses connues, qu'elles soient simples ou complexes, prsentent un mme caractre commun : elles supposent une classification des choses, relles ou idales, que se reprsentent les hommes, en deux classes, en deux genres opposs, dsigns gnralement par deux termes distincts que traduisent assez bien les mots de profane et de sacr. La division du monde en deux domaines comprenant., l'un tout ce qui est sacr., l'autre tout ce qui est profane, tel est le trait distinctif de la pense religieuse; les croyances, les mythes, les gnogmes, les lgendes sont ou des reprsentations on des systmes de reprsentations qui expriment la nature des choses sacres, les vertus et les pouvoirs qui leur sont attribus, leur histoire, leurs rapports les unes avec les autres et avec les choses profanes. Mais, par choses sacres, il ne faut pas entendre simplement ces tres personnels que l'on appelle des dieux ou des esprits; un rocher, un arbre, une source, un caillou, une pice de bois, une maison en un mot une chose quelconque peut tre sacre. Un rite peut avoir ce caractre; il n'existe mme pas de rite qui ne l'ait quelque degr. Il y a des mots, des paroles, des formules qui ne peuvent tre prononcs que par la bouche de personnages consacrs; il y a des gestes, des mouvements qui ne peuvent tre excuts par tout le inonde. Si le sacrifice vdique a eu une telle efficacit, si mme, d'aprs la mythologie, il a t gnrateur de dieux loin de n'tre qu'un moyen de gagner leur faveur, c'est qu'il possdait une vertu comparable celle des tres les plus sacrs. Le cercle des objets sacrs ne peut donc tre dtermin une fois pour toutes; l'tendue en est infiniment variable selon les religions. Voil comment le bouddhisme est une religion : c'est que, dfaut de dieux, il admet l'existence de choses sacres, savoir des quatre vrits saintes et des pratiques qui en drivent .
65
Mais nous nous sommes born jusqu'ici numrer, titre d'exemples, un certain nombre de choses sacres : il nous faut maintenant indiquer par quels caractres gnraux elles se distinguent des choses profanes. On pourrait tre tent tout d'abord de les dfinir par la place qui leur est gnralement assigne dans la hirarchie des tres. Elles sont volontiers considres comme suprieures en dignit et en pouvoir aux choses profanes et particulirement l'homme, quand celui-ci n'est
65
Sans parler du sage, du saint qui pratiquent ces vrits et qui sont sacrs pour cette raison.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
42
qu'un homme et n'a, par lui-mme, rien de sacr. On se le reprsente, en effet, comme occupant, par rapport elles, une situation infrieure et dpendante ; et cette reprsentation n'est certainement pas sans vrit. Seulement, il n'y a rien l qui soit vraiment caractristique du sacr. Il ne suffit pas qu'une chose soit subordonne une autre pour que la seconde soit sacre par rapport la premire. Les esclaves dpendent de leurs matres, les sujets de leur roi, les soldats de leurs chefs, les classes infrieures des classes dirigeantes, l'avare de son or, l'ambitieux du pouvoir et des mains qui le dtiennent; or, si l'on dit parfois d'un homme qu'il a la religion des tres ou des choses auxquels il reconnat ainsi une valeur minente et une sorte de supriorit par rapport lui, il est clair que, dans tous ces cas, le mot est pris dans un sens mtaphorique et qu'il n'y a rien dans ces relations qui soit proprement religieux .
66
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des choses sacres de tout degr et qu'il en est vis--vis desquelles l'homme se sent relativement l'aise. Une amulette a un caractre sacr, et pourtant le respect qu'elle inspire n'a rien d'exceptionnel. Mme en face de ses dieux, l'homme n'est pas toujours dans un tat si marqu d'infriorit ; car il arrive trs souvent qu'il exerce sur eux une vritable contrainte physique pour obtenir d'eux ce qu'il dsire. On bat le ftiche dont on n'est pas content, sauf se rconcilier avec lui s'il finit par se montrer plus docile aux vux de son adorateur . Pour avoir de la pluie, on jette des pierres dans la source ou dans le lac sacr o est cens rsider le dieu de la pluie ; on crot, par ce moyen, l'obliger sortir et se montrer . D'ailleurs, s'il est vrai que l'homme dpend de ses dieux, la dpendance est rciproque. Les dieux, eux aussi, ont besoin de l'homme; sans les offrandes et les sacrifices, ils mourraient. Nous aurons mme l'occasion de montrer que cette dpendance des dieux vis-vis de leurs fidles se maintient jusque dans les religions les plus idalistes.
67 68
Mais, si une distinction purement hirarchique est un critre la fois trop gnral et trop imprcis, il ne reste plus pour dfinir le sacr par rapport au profane que leur htrognit. Seulement, ce qui fait que cette htrognit suffit caractriser cette classification des choses et la distinguer de toute autre, c'est qu'elle est trs particulire : elle est absolue. Il n'existe pas dans l'histoire de la pense humaine un autre exemple de deux catgories de choses aussi profondment diffrencies, aussi radicalement opposes l'une l'autre. L'opposition traditionnelle entre le bien et le mal n'est rien ct de celle-l : car le bien et le mal sont deux espces contraires d'un mme genre, savoir le moral, comme la sant et la maladie ne sont que deux aspects diffrents d'un mme ordre de faits, la vie, tandis que le sacr et le profane ont toujours et partout t conus par l'esprit humain comme des genres spars, comme deux mondes entre lesquels il n'y a rien de commun. Les nergies qui jouent dans l'un ne sont pas simplement celles qui se rencontrent dans l'autre, avec quelques degrs en plus; elles sont d'une autre nature. Suivant les religions, cette opposition a t conue de manires diffrentes. Ici, pour sparer ces deux sortes de choses, il a paru suffisant de les localiser en des rgions distinctes de l'univers physique; l, les unes sont rejetes dans un milieu idal et transcendant, tandis que le monde matriel est abandonn aux autres en toute proprit. Mais, si les formes
66 67 68
Ce n'est pas dire que ces relations ne puissent pas prendre un caractre religieux. Mais elles ne l'ont pas ncessairement. SCHULTZE, Fetichismus, p. 129. On trouvera des exemples de ces usages dans FRAZER, Golden Bough, 2e d., 1, p. 81 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
43
du contraste sont variables , le fait mme du contraste est universel.
69
Ce n'est pas dire cependant qu'un tre ne puisse jamais passer d'un de ces mondes dans l'autre : niais la manire dont ce passage se produit, quand il y a lieu, met en vidence la dualit essentielle des deux rgnes. Il implique, en effet, une vritable mtamorphose. C'est ce que dmontrent notamment les rites de l'initiation, tels qu'ils sont pratiqus par une multitude de peuples. L'initiation est une longue srie de crmonies qui ont pour objet d'introduire le jeune homme la vie religieuse : il sort, pour la premire fois, du monde purement profane o S'est coule sa premire enfance pour entrer dans le cercle des choses sacres. Or, ce changement d'tat est conu, non comme le simple et rgulier dveloppement de germes prexistants, mais comme une transformation totius substantiae. On dit qu' ce moment le jeune homme meurt, que la personne dtermine qu'il tait cesse d'exister et qu'une autre, instantanment, se substitue la prcdente. Il renat sous une forme nouvelle. Des crmonies appropries sont censes raliser cette mort et cette renaissance qui ne sont pas entendues dans un sens simplement symbolique, mais qui sont prises la lettre . N'est-ce pas la preuve qu'entre l'tre profane qu'il tait et l'tre religieux qu'il devient il y a solution de continuit ?
70
Cette htrognit est mme telle qu'elle dgnre souvent en un vritable antagonisme. Les deux mondes ne sont pas seulement conus comme spars, mais comme hostiles et jalousement rivaux l'un de l'autre. Puisqu'on ne peut appartenir pleinement l'un qu' condition d'tre entirement sorti de l'autre, l'homme est exhort se retirer totalement du profane, pour mener une vie exclusivement religieuse. De l, le monachisme qui, ct et en dehors du milieu naturel o le commun des hommes vit de la vie du sicle, en organise artificiellement un autre, ferm au premier, et qui tend presque en tre le contre-pied. De l, l'asctisme mystique dont l'objet est d'extirper de l'homme tout ce qui peut y rester d'attachement au monde profane. De l, enfin, toutes les formes du suicide religieux, couronnement logique de cet asctisme ; car la seule manire d'chapper totalement la vie profane est, en dfinitive, de s'vader totalement de la vie. L'opposition de ces deux genres vient, d'ailleurs, se traduire au dehors par un signe visible qui permet de reconnatre aisment cette classification trs spciale, partout o elle existe. Parce que la notion du sacr est, dans la pense des hommes, toujours et partout spare de la notion du profane, parce que nous concevons entre elles une sorte de vide logique, l'esprit rpugne invinciblement ce que les choses correspondantes soient confondues ou simplement mises en contact; car une telle promiscuit ou mme une contigut trop directe contredisent trop violemment l'tat de dissociation o se trouvent ces ides dans les consciences. La chose sacre, c'est, par excellence, celle que le profane ne doit pas, ne peut pas impunment toucher.
69
70
La conception d'aprs laquelle le profane s'oppose au sacr comme l'irrationnel au rationnel, l'intelligible au mystrieux n'est qu'une des formes sous lesquelles s'exprime cette opposition. Une fois la science constitue, elle a pris un caractre profane, surtout au regard des religions chrtiennes; il a paru, par suite, qu'elle ne pouvait s'appliquer aux choses sacres. V. FRAZER, On some Ceremonies of the Central Australian Tribes, in Australasian Association for the Advancement of Science, 1901, p. 313 et suiv. La conception est, d'ailleurs, d'une extrme gnralit. Dans l'Inde, la simple participation l'acte sacrificiel a les mmes effets; le sacrifiant, par cela seul qu'il entre dans le cercle des choses sacres, change de personnalit (v. HUBERT et MAUSS, Essai sur le sacrifice, in Anne sociol., II, p. 101).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
44
Sans doute, cette interdiction ne saurait aller jusqu' rendre impossible toute communication entre les deux mondes ; car, si le profane ne pouvait aucunement entrer en relations avec le sacr, celui-ci ne servirait rien. Mais, outre que cette mise en rapport est toujours, par ellemme, une opration dlicate qui rclame des prcautions et une initiation plus ou moins complique , elle n'est mme pas possible sans que le profane perde ses caractres spcifiques, sans qu'il devienne lui-mme sacr en quelque mesure et quelque degr. Les deux genres ne peuvent se rapprocher et garder en mme temps leur nature propre.
71
Nous avons, cette fois, un premier critre des croyances religieuses. Sans doute, l'intrieur de ces deux genres fondamentaux, il y a des espces secondaires qui, elles aussi, sont plus ou moins incompatibles les unes avec les autres . Mais ce qui est caractristique du phnomne religieux, c'est qu'il suppose toujours une division bipartite de l'univers connu et connaissable en deux genres qui comprennent tout ce qui existe, niais qui s'excluent radicalement. Les choses sacres sont celles que les interdits protgent et isolent ; les choses profanes, celles auxquelles ces interdits s'appliquent et qui doivent rester distance des premires. Les croyances religieuses sont des reprsentations qui expriment la nature des choses sacres et les rapports qu'elles soutiennent soit les unes avec les autres, soit avec les choses profanes. Enfin, les rites sont des rgles de conduite qui prescrivent comment l'homme doit se comporter avec les choses sacres.
72
Quand un certain nombre de choses sacres soutiennent les unes avec les autres des rapports de coordination et de subordination, de manire former un systme d'une certaine unit, mais qui ne rentre lui-mme dans aucun autre systme du mme genre, l'ensemble des croyances et des rites correspondants constitue une religion. On voit par cette dfinition qu'une religion ne tient pas ncessairement dans une seule et mme ide, ne se ramne pas un principe unique qui, tout en se diversifiant suivant les circonstances auxquelles il s'applique, serait, dans son fond, partout identique lui-mme : c'est un tout form de parties distinctes et relativement individualises. Chaque groupe homogne de choses sacres ou mme chaque chose sacre de quelque importance constitue un centre d'organisation autour duquel gravite un groupe de croyances et de rites, un culte particulier ; et il n'est pas de religion si unitaire qu'elle puisse tre, qui ne reconnaisse une pluralit de choses sacres. Mme le christianisme, au moins sous sa forme catholique, admet, outre la personnalit divine, d'ailleurs triple en mme temps qu'une, la Vierge, les anges, les saints, les mes des morts, etc. Aussi une religion ne se rduit-elle gnralement pas un culte unique, mais consiste en un systme de cultes dous d'une certaine autonomie. Cette autonomie est, d'ailleurs, variable. Parfois, ils sont hirarchiss et subordonns quelque culte prdominant dans lequel ils finissent mme par s'absorber ; mais il arrive aussi qu'ils sont simplement juxtaposs et confdrs. La religion que nous allons tudier nous fournira justement un exemple de cette dernire organisation. En mme temps, on s'explique qu'il puisse exister des groupes de phnomnes religieux qui n'appartiennent aucune religion constitue : c'est qu'ils ne sont pas ou ne sont plus intgrs dans un systme religieux. Qu'un des cultes dont il vient d'tre question parvienne se
71 72
V. plus haut ce que nous disons de l'initiation, p. 54. Nous montrerons nous-mme plus loin comment, par exemple, certaines espces de choses sacres entre lesquelles il y a incompatibilit s'excluent comme le sacr exclut le profane (liv. Il, chap. 1er, II).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
45
maintenir pour des raisons spciales alors que l'ensemble dont il faisait partie a disparu, et il ne survivra qu' l'tat dsintgr. C'est ce qui est arriv tant de cultes agraires qui se sont survcu eux-mmes dans le folklore. Dans certains cas, ce n'est mme pas un culte, mais une simple crmonie, un rite particulier qui persiste sous cette forme .
73
Bien que cette dfinition ne soit que prliminaire, elle permet dj d'entrevoir en quels termes doit se poser le problme qui domine ncessairement la science des religions. Quand on croit que les tres sacrs ne se distinguent des autres que par l'intensit plus grande des pouvoirs qui leur sont attribus, la question de savoir comment les hommes ont pu en avoir l'ide est assez simple : il suffit de rechercher quelles sont les forces qui, par leur exceptionnelle nergie, ont pu frapper assez vivement l'esprit humain pour inspirer des sentiments religieux. Mais si, comme nous avons essay de l'tablir, les choses sacres diffrent en nature des choses profanes, si elles sont d'une autre essence, le problme est autrement complexe. Car il faut se demander alors ce qui a pu dterminer l'homme voir dans le monde deux mondes htrognes et incomparables, alors que rien dans l'exprience sensible ne semblait devoir lui suggrer l'ide d'une dualit aussi radicale.
73
C'est le cas de certains rites nuptiaux ou funraires, par exemple.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
46
IV
.
Cependant, cette dfinition n'est pas encore complte car elle convient galement deux ordres de faits qui, tout en tant parents l'un de l'autre, demandent pourtant tre distingus : c'est la magie et la religion. La magie, elle aussi, est faite de croyances et de rites. Elle a comme la religion, ses mythes et ses dogmes ; ils sont seulement plus rudimentaires, sans doute parce que, poursuivant des fins techniques et utilitaires, elle ne perd pas son temps en pures spculations. Elle a galement ses crmonies, ses sacrifices, ses lustrations, ses prires, ses chants et ses danses. Les tres qu'invoque le magicien, les forces qu'il met en oeuvre ne sont pas seulement de mme nature que les forces et les tres auxquels s'adresse la religion ; trs souvent, ce sont identiquement les mmes. Ainsi, ds les socits les plus infrieures, les mes des morts sont choses essentiellement sacres et elles sont l'objet de rites religieux. Mais en mme temps, elles ont jou dans la magie un rle considrable. Aussi bien en Australie qu'en Mlansie , aussi bien en Grce que chez les peuples chrtiens , les mes des morts, leurs ossements, leurs cheveux comptent parmi les intermdiaires dont se sert le plus souvent le magicien. Les dmons sont galement un instrument usuel de l'action magique. Or, les dmons sont, eux aussi, des tres entours d'interdits ; eux aussi sont spars, vivent dans un monde part et mme il est souvent difficile de les distinguer des dieux proprement dits . D'ailleurs, mme dans le christianisme, le diable n'est-il pas un dieu dchu et, en dehors mme de ses origines, n'a-t-il pas un caractre religieux par cela seul que l'enfer auquel il est prpos est un rouage indispensable de la religion chrtienne ? Il y a mme les divinits rgulires et officielles qui sont invoques par le magicien. Tantt, ce sont les dieux d'un peuple tranger ; par exemple, les magiciens grecs faisaient intervenir des dieux gyptiens, assyriens ou juifs. Tantt, ce sont mme des dieux nationaux: Hcate et Diane taient l'objet d'un culte magique; la Vierge, le Christ, les Saints ont t utiliss de la mme manire par nies magiciens chrtiens .
74 75 76 77 78
Faudra-t-il donc dire que la magie ne peut tre distingue avec rigueur de la religion ; que la magie est pleine de religion, comme la religion de magie et qu'il est, par suite, impossible de les sparer et de dfinir l'une sans l'autre ? Mais ce qui rend cette thse difficilement soutenable, c'est la rpugnance marque de la religion pour la magie et, en retour, l'hostilit de
74 75 76 77 78
V. SPENCER et GILLEN, Native Tribes of Central Australia, p. 534 et suiv., Northern Tribes of Central Australia, p. 463; HOWITT, Native Tribes of S. E. Australia, pp. 359-361. V. CODRINGTON, The Melanesians, chap. XII. V. HUBERT, art. Magia , in Dictionnaire des Antiquits. Par exemple, en Mlansie, le tindalo est un esprit tantt religieux et tantt magique (CODRINGTON, P. 125 et suiv., 194 et suiv.). V. HUBERT et MAUSS, Thorie gnrale de la magie, in Anne sociologique, tome VII, pp. 83-84.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
47
la seconde pour la premire. La magie met une sorte de plaisir professionnel profaner les choses saintes ; dans ses rites, elle prend le contre-pied des crmonies religieuses . De son ct, la religion, si elle n'a pas toujours condamn et prohib les rites magiques, les voit, en gnral, avec dfaveur. Comme le font remarquer MM. Hubert et Mauss, il y a, dans les procds du magicien, quelque chose de foncirement antireligieux . Quelques rapports qu'il puisse y avoir entre ces deux sortes d'institutions, il est donc difficile qu'elles ne s'opposent pas par quelque endroit ; et il est d'autant plus ncessaire de trouver par o elles se distinguent que nous entendons limiter notre recherche la religion et nous arrter au point o commence la magie.
79 80 81
Voici comment on peut tracer une ligne de dmarcation entre ces deux domaines. Les croyances proprement religieuses sont toujours communes une collectivit dtermine qui fait profession d'y adhrer et de pratiquer les rites qui en sont solidaires. Elles ne sont pas seulement admises, titre individuel, par tous les membres de cette collectivit ; niais elles sont la chose du groupe et elles en font l'unit. Les individus qui la composent se sentent lis les uns aux autres, par cela seul qu'ils ont une foi commune. Une socit dont les membres sont unis parce qu'ils se reprsentent de la mme manire le monde sacr et ses rapports avec le monde profane, et parce qu'ils traduisent cette reprsentation commune dans des pratiques identiques, c'est ce qu'on appelle une glise. Or, nous ne rencontrons pas, dans l'histoire, de religion sans glise. Tantt l'glise est troitement nationale, tantt elle s'tend par del les frontires ; tantt elle comprend un peuple tout entier (Rome, Athnes, le peuple hbreu), tantt elle n'en comprend qu'une fraction (les socits chrtiennes depuis l'avnement du protestantisme) ; tantt elle est dirige par un corps de prtres, tantt elle est peu prs compltement dnue de tout organe directeur attitr . Mais partout o nous observons une vie religieuse, elle a pour substrat un groupe dfini. Mme les cultes dits privs, comme le culte domestique ou le culte corporatif, satisfont cette condition ; car ils sont toujours clbrs par une collectivit, la famille ou la corporation. Et d'ailleurs, de mme que ces religions particulires ne sont, le plus souvent, que des formes spciales d'une religion plus gnrale qui embrasse la totalit de la vie , ces glises restreintes ne sont, en ralit que des chapelles dans une glise plus vaste et qui, en raison mme de cette tendue, mrite davantage d'tre appele de ce nom .
82 83 84
79 80 81 82
83
84
Par exemple, on profane l'hostie dans la messe noire. On tourne le dos l'autel ou on tourne autour de l'autel en commenant par la gauche au lieu de commencer par la droite. Loc. cit., p. 19. Sans doute, il est rare que chaque crmonie n'ait pas son directeur au moment o elle est clbre; mme dans les socits les plus grossirement organises, il y a gnralement des hommes que l'importance de leur rle social dsigne pour exercer une influence directrice sur la vie religieuse (par exemple, les chefs des groupes locaux dans certaines socits australiennes). Mais cette attribution de fonctions est encore trs flottante. A Athnes, les dieux auxquels s'adresse le culte domestique ne sont que des formes spcialises des dieux de la cit (Zeus stsios, Zeus hephkeis). De mme, au Moyen Age, les patrons des confrries sont des saints du calendrier. Car le nom d'glise ne s'applique d'ordinaire qu' un groupe dont les croyances communes se rapportent un cercle de choses moins spciales.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
48
Il en est tout autrement de la magie. Sans doute, les croyances magiques ne sont jamais sans quelque gnralit; elles sont le plus souvent diffuses dans de larges couches de population et il y a mme bien des peuples o elles ne comptent pas moins de pratiquants que la religion proprement dite. Mais elles n'ont pas pour effet de lier les uns aux autres les hommes qui y adhrent et de les unir en un mme groupe, vivant d'une mme vie. Il n'existe pas d'glise magique. Entre le magicien et les individus qui le consultent, comme entre ces individus eux-mmes, il n'y a pas de liens durables qui en fassent les membres d'un mme corps moral, comparable celui que forment les fidles d'un mme dieu, les observateurs d'un mme culte. Le magicien a une clientle, non une glise, et ses clients peuvent trs bien n'avoir entre eux aucuns rapports, au point de s'ignorer les uns les autres; mme les relations qu'ils ont avec lui sont gnralement accidentelles et passagres ; elles sont tout fait semblables celles d'un malade avec son mdecin. Le caractre officiel et publie dont il est parfois investi ne change rien cette situation ; le fait qu'il fonctionne au grand jour ne l'unit pas d'une manire plus rgulire et plus durable ceux qui recourent ses services. Il est vrai que, dans certains cas, les magiciens forment entre eux des socits : il arrive qu'ils se runissent plus ou moins priodiquement pour clbrer en commun certains rites ; on sait quelle place tiennent les assembles de sorcires dans le folklore europen. Mais tout d'abord, on remarquera que ces associations ne sont nullement indispensables au fonctionnement de la magie; elles sont mme rares et assez exceptionnelles. Le magicien n'a nullement besoin, pour pratiquer son art, de s'unir ses confrres. C'est plutt un isol ; en gnral, loin de chercher la socit, il la fuit. Mme l'gard de ses collgues, il garde toujours son quant soi . Au contraire, la religion est insparable de l'ide d'glise. Sous ce premier rapport, il y a dj entre la magie et la religion une diffrence essentielle. De plus et surtout, ces sortes de socits magiques, quand elles se forment, ne comprennent jamais, il s'en faut, tous les adhrents de la magie, mais les seuls magiciens ; les lacs, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est-dire ceux au profit de qui les rites sont clbrs, ceux, en dfinitive, qui reprsentent les fidles des cultes rguliers, en sont exclus. Or le magicien est la magie ce que le prtre est la religion, et un collge de prtres n'est pas une glise, non plus qu'une congrgation religieuse qui vouerait quelque saint, dans l'ombre du clotre, un culte particulier. Une glise, ce n'est pas simplement une confrrie sacerdotale ; c'est la communaut morale forme par tous les croyants d'une mme foi, les fidles comme les prtres. Toute communaut de ce genre fait normalement dfaut la magie .
85 86
Mais si l'on fait entrer la notion d'glise dans la dfinition de la religion, n'en exclut-on pas du mme coup les religions individuelles que l'individu institue pour lui-mme et clbre pour lui seul ? Or il n'est gure de socit o il ne s'en rencontre. Chaque Ojibway, comme on le verra plus loin, a son manitou personnel qu'il se choisit lui-mme et auquel il rend des devoirs
85 86
Hubert et MAUSS, Loc, cit., p. 18. Robertson SMITH avait dj montr que la magie s'oppose la religion comme l'individuel au social (The Religion of the Semites, 2e d., p. 264-265). D'ailleurs, cri distinguant ainsi la magie de la religion, nous n'entendons pas tablir entre elles une solution de continuit. Les frontires entre les deux domaines sont souvent indcises.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
49
religieux particuliers ; le Mlansien des les Banks a son tamaniu ; le Romain a son genius ; le chrtien a son saint patron et son ange gardien, etc. Tous ces cultes semblent, par dfinition, indpendants de toute ide de groupe. Et non seulement ces religions individuelles sont trs frquentes dans l'histoire, mais certains se demandent aujourd'hui si elles ne sont pas appeles devenir la forme minente de la vie religieuse et si un jour ne viendra pas o il n'y aura plus d'autre culte que celui que chacun se fera librement dans son for intrieur .
87 88 89
Mais si, laissant provisoirement de ct ces spculations sur l'avenir, nous nous bornons considrer les religions telles qu'elles sont dans le prsent et telles qu'elles ont t dans le pass, il apparat avec vidence que ces cultes individuels constituent, non des systmes religieux distincts et autonomes, mais de simples aspects de la religion commune toute l'glise dont les individus font partie. Le saint patron du chrtien est choisi sur la liste officielle des saints reconnus par I'glise catholique, et ce sont galement des rgles canoniques qui prescrivent comment chaque fidle doit s'acquitter de ce culte particulier. De mme, l'ide que chaque homme a ncessairement un gnie protecteur est, sous des formes diffrentes, la base d'un grand nombre de religions amricaines, comme de la religion romaine (pour ne citer que ces deux exemples) ; car elle est, ainsi qu'on le verra plus loin, troitement solidaire de l'ide d'me et l'ide d'me n'est pas de celles qui peuvent tre entirement abandonnes l'arbitraire des particuliers. En un mot, c'est l'glise dont il est membre qui enseigne l'individu ce que sont ces dieux personnels, quel est leur rle, comment il doit entrer en rapports avec eux, comment il doit les honorer. Quand on analyse mthodiquement les doctrines de cette glise, quelle qu'elle soit, un moment arrive o l'on rencontre sur sa route celles qui concernent ces cultes spciaux. Il n'y a donc pas l deux religions de types diffrents et tournes en des sens opposs ; mais ce sont, de part et d'autre, les mmes ides et les mmes principes, appliqus ici, aux circonstances qui intressent la collectivit dans son ensemble, l, la vie de l'individu. La solidarit est mme tellement troite que, chez certains peuples , les crmonies au cours desquelles le fidle entre pour la premire fois en communication avec son gnie protecteur sont mles des rites dont le caractre public est incontestable, savoir aux rites d'initiation .
90 91
Restent les aspirations contemporaines vers une religion qui consisterait tout entire en tats intrieurs et subjectifs et qui serait librement construite par chacun de nous. Mais si relles qu'elles soient, elles ne sauraient affecter notre dfinition ; car celle-ci ne peut s'appliquer qu' des faits acquis et raliss, non d'incertaines virtualits. On peut dfinir les
87 88 89
90 91
CODRINGTON, in Trans. a. Proc. Roy. Soc. of Victoria, XVI, p. 136. NEGRIOLI, Dei Genii preso i Romani. C'est la conclusion laquelle arrive SPENCER dans ses Ecclesiastical Institutions (chap. XVI). C'est aussi celle de M. SABATIER, dans son Esquisse d'une philosophie de la religion d'aprs la psychologie et l'histoire, et de toute l'cole laquelle il appartient. Chez de nombreux peuples indiens de l'Amrique du Nord notamment. Cette constatation de fait ne tranche pas, d'ailleurs, la question de savoir si la religion extrieure et publique n'est que le dveloppement d'une religion intrieure et personnelle qui serait le fait primitif, ou bien si, au contraire, la seconde ne serait pas le prolongement de la premire l'intrieur des consciences individuelles. Le problme sera directement abord plus loin (liv. II, chap. V, II. Cf. mme livre, chap. VI et VII, 1). Pour l'instant nous nous bornons remarquer que le culte individuel se prsente l'observateur comme un lment et une dpendance du culte collectif.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
50
religions telles qu'elles sont ou telles qu'elles ont t, non telles qu'elles tendent plus ou moins vaguement tre. Il est possible que cet individualisme religieux soit appel passer dans les faits ; mais pour pouvoir dire dans quelle mesure, il faudrait dj savoir ce qu'est la religion, de quels lments elle est faite, de quelles causes elle rsulte, quelle fonction elle remplit ; toutes questions dont on ne peut prjuger la solution, tant qu'on n'a pas dpass le seuil de la recherche. C'est seulement au terme de cette tude que nous pourrons tcher d'anticiper l'avenir. Nous arrivons donc la dfinition suivante : Une religion est un systme solidaire de croyances et de Pratiques relatives des choses sacres, c'est--dire spares, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une mme communaut morale, appele glise, tous ceux qui y adhrent. Le second lment qui prend ainsi place dans notre dfinition n'est pas moins essentiel que le premier; car, en montrant que l'ide de religion est insparable de l'ide d'glise, il fait pressentir que la religion doit tre une chose minemment collective .
92
C'est par l que notre dfinition prsente rejoint celle que nous avons propose jadis dans l'Anne sociologique. Dans ce dernier travail, nous dfinissions exclusivement les croyances religieuses par leur caractre obligatoire; mais cette obligation vient videmment, et nous le montrions, de ce que ces croyances sont la chose d'un groupe qui les impose ses membres. Les deux dfinitions se recouvrent donc en partie. Si nous avons cru devoir en proposer une nouvelle, c'est que la premire tait trop formelle et ngligeait trop compltement le contenu des reprsentations religieuses. On verra, dans les discussions qui vont suivre, quel intrt il y avait mettre tout de suite en vidence ce qu'il a de caractristique. De plus, si ce caractre impratif est bien un trait distinctif des croyances religieuses, il comporte des degrs l'infini ; par suite, il y a des cas o il n'est pas aisment perceptible. De l, des difficults et des embarras que l'on s'pargne en substituant ce critre celui que nous employons ci-dessus.
92
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
51
CHAPITRE II
LES PRINCIPALES CONCEPTIONS DE LA RELIGION LMENTAIRE I. - L'animisme
.
Munis de cette dfinition, nous pouvons nous mettre la recherche de la religion lmentaire que nous nous proposons d'atteindre. Les religions mme les plus grossires que nous fassent connatre l'histoire et l'ethnographie sont dj d'une complexit qui s'accorde mal avec l'ide qu'on se fait quelquefois de la mentalit primitive. On y trouve, non seulement un systme touffu de croyances et de rites, mais mme une telle pluralit de principes diffrents, une telle richesse de notions essentielles qu'il a paru impossible d'y voir autre chose que le produit tardif d'une assez longue volution. D'o l'on a conclu que, pour dcouvrir la forme vraiment originelle de la vie religieuse, il tait ncessaire de descendre par l'analyse au del de ces religions observables, de les rsoudre en leurs lments communs et fondamentaux et de chercher si, parmi ces derniers, il n'en est pas un dont les autres sont drivs. Au problme ainsi pos deux solutions contraires ont t donnes. Il n'existe, pour ainsi dire, pas de systme religieux, ancien ou rcent, o, sous des formes diverses, on ne rencontre cte cte comme deux religions, qui, tout en tant troitement unies et en se pntrant mme l'une l'autre; ne laissent pas cependant d'tre distinctes. L'une s'adresse aux choses de la nature, soit aux grandes forces Cosmiques, comme les vents, les fleuves, les astres, le ciel, etc., soit aux objets de toute sorte qui peuplent la surface de la terre plantes, animaux, rochers, etc. ; on lui donne pour cette raison le nom de naturisme. L'autre a pour objet les tres spirituels, les esprits, mes, gnies, dmons, divinits proprement dites, agents anims et conscients comme l'homme, mais qui se distinguent pourtant de lui par la nature des pouvoirs qui leur sont attribus et, notamment, par ce caractre particulier qu'ils n'affectent pas les sens de la mme faon : normalement, ils ne sont pas perceptibles des yeux humains. On
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
52
appelle animisme cette religion des esprits. Or, pour expliquer la coexistence, pour ainsi dire universelle, de ces deux sortes de cultes, deux thories contradictoires ont t proposes. Pour les uns, l'animisme serait la religion primitive, dont le naturisme ne serait qu'une forme secondaire et drive. Pour les autres, au contraire, c'est le culte de la nature qui aurait t le point de dpart de l'volution religieuse ; le culte des esprits n'en serait qu'un cas particulier. Ces deux thories sont, jusqu' prsent, les seules par lesquelles ont ait tent d'expliquer rationnellement les origines de la pense religieuse. Aussi le problme capital que se pose la science des religions se rduit-il le plus souvent savoir laquelle de ces deux solutions il faut choisir, ou s'il ne vaut pas mieux les combiner, et, dans ce cas, quelle place il faut faire chacun de ces deux lments . Mme les savants qui n'admettent ni l'une ni l'autre de ces hypothses sous leur forme systmatique, ne laissent pas de garder telle ou telle des propositions sur lesquelles elles reposent . Il y a donc l un certain nombre de notions toutes faites et d'apparentes vidences qu'il est ncessaire de soumettre la critique avant d'aborder, par nous-mmes, l'tude des faits. On comprendra mieux qu'il est indispensable de tenter une voie nouvelle, quand on aura compris l'insuffisance de ces conceptions traditionnelles.
93 94 95
I
.
C'est Tylor qui a constitu, dans ses traits essentiels, la thorie animiste Spencer, qui l'a reprise ensuite, ne l'a pas reproduite, il est vrai, sans y introduire quelques modifications . Mais en somme, les questions se posent pour l'un comme pour l'autre dans les mmes termes, et les solutions adoptes, sauf une, sont identiquement les mmes. Nous pouvons donc runir ces deux doctrines dans l'expos qui va suivre, sauf marquer, quand le moment sera venu, l'endroit partir duquel elles divergent l'une de l'autre.
96 97
93
94 95
96 97
Nous laissons donc de ct, ici, les thories qui, en totalit ou en partie, font intervenir des donnes supra-exprimentales. C'est le cas de celle notamment qu'Andrew LANG a expose dans son livre The Making of Religion et que le P. SCHMIDT a reprise, avec des variantes de dtail, dans une srie d'articles sur L'origine de l'ide de Dieu (Anthropos, 1908, 1909). Lang se repousse pas compltement l'animisme ni le naturisme, mais, en dernire analyse, il admet un sens, une intuition directe du divin. D'ailleurs, si nous ne croyons pas devoir exposer et discuter cette conception dans le prsent chapitre, nous n'entendons pas la passer sous silence; nous le retrouverons plus loin quand nous aurons nous-mmes, expliquer les faits sur lesquels elle s'appuie (liv. II, Chap. IX, IV). C'est le cas, par exemple, de FUSTEL DE COULANGES qui accepte concurremment les deux conceptions (v. Cit antique, liv. I et III, chap. II). C'est ainsi que Jevons, tout en critiquant l'animisme tel que l'a expos Tylor, accepte ses thories sur la gense de l'ide d'me, sur l'instinct anthropomorphique de l'homme. Inversement, USENER, dans ses Gtternamen, tout en rejetant certaines des hypothses de Max Mller qui seront exposes plus loin, admet les principaux postulats du naturisme. La civilisation primitive, chap. XI-XVIII. V. Principes de sociologie, Part. I et VI.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
53
Pour tre en droit de voir dans les croyances et les pratiques animistes la forme primitive de la vie religieuse, il faut satisfaire un triple desideratum : 1 puisque, sans cette hypothse, l'ide d'me est la notion cardinale de la religion, il faut montrer comment elle s'est forme sans emprunter aucun de ses lments une religion antrieure ; 2 il faut faire voir ensuite comment les mes devinrent l'objet d'un culte et se transformrent en esprits ; 3 enfin, puisque le culte des esprits n'est le tout d'aucune religion, il reste expliquer comment le culte de la nature est driv du premier. L'ide d'me aurait t suggre l'homme par le spectacle, mal compris, de la double vie qu'il mne normalement l'tat de veille, d'une part, pendant le sommeil, de l'autre. En effet, pour le sauvage , les reprsentations qu'il a pendant la veille et celles qu'il peroit dans le rve ont, dit-on, la mme valeur : il objective les secondes comme les premires, c'est--dire qu'il y voit l'image d'objets extrieurs dont elles reproduisent plus ou moins exactement l'aspect. Quand donc il rve qu'il a visit un pays loign, il croit s'y tre rellement rendu. Mais il ne peut y tre all que s'il existe deux tres en lui : l'un, son corps, qui est rest couch sur le sol et qu'il retrouve au rveil dans la mme position; l'autre qui, pendant le mme temps, s'est m travers l'espace. De mme, si, pendant son sommeil, il se voit converser avec quelqu'un de ses compagnons qu'il sait retenu au loin, il en conclut que ce dernier, lui aussi, est compos de deux tres: l'un qui dort quelque distance et l'autre qui est venu se manifester par la voie du rve. De ces expriences rptes se dgage peu peu cette ide qu'il existe en chacun de nous un double, un autre nous-mme qui, dans des conditions dtermines, a le pouvoir de quitter l'organisme o il rside et de s'en aller prgriner au loin.
98
Ce double reproduit naturellement tous les traits essentiels de l'tre Sensible qui lui sert d'enveloppe extrieure ; mais en mme temps, il s'en distingue par plusieurs caractres. Il est plus mobile, puisqu'il peut parcourir en un instant de vastes distances. Il est plus mallable, plus plastique; car, pour sortir du corps, il faut qu'il puisse passer par les orifices de l'organisme, le nez et la bouche notamment. On se le reprsente donc comme fait de matire, sans doute, mais d'une matire beaucoup plus subtile et plus thre que toutes celles que nous connaissons empiriquement. Ce double, c'est l'me. Et il n'est pas douteux, en effet, que, dans une multitude de socits, l'me n'ait t conue comme une image du corps ; on croit mme qu'elle en reproduit les dformations accidentelles, comme celles qui rsultent des blessures ou des mutilations. Certains Australiens, aprs avoir tu leur ennemi, lui coupent le pouce droit afin que son me, prive par contre-coup de son pouce, ne puisse lancer le javelot et se venger. Mais en mme temps, tout en ressemblant au corps, elle a dj quelque chose d' demi spirituel. On dit qu'elle est la partie la plus subtile et la plus arienne du corps , qu'elle n'a ni chair, ni os, ni nerfs ; que, quand on vent la saisir, on ne sent rien ; qu'elle est comme un corps purifi .
99
98
99
C'est le mot dont se sert M. Tyler. Il a l'inconvnient de paratre impliquer qu'il existe des hommes au sens propre du mot, avant qu'il y ait une civilisation. D'ailleurs, il n'y a pas de terme convenable pour rendre l'ide; celui de primitif, dont nous nous servons de prfrence, faute de mieux, est, comme nous l'avons dit, loin d'tre satisfaisant. TYLOR, op. cit., I, p. 529.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
54
D'ailleurs, autour de cette donne fondamentale du rve, d'autres faits d'exprience venaient tout naturellement se grouper qui inclinaient les esprits dans le mme sens : c'est la syncope, l'apoplexie, la catalepsie, l'extase, en un mot tous les cas d'insensibilit temporaire. En effet, ils s'expliquent trs bien dans l'hypothse que le principe de la vie et du sentiment peut quitter momentanment le corps. D'un autre ct, il tait naturel que ce principe ft confondu avec le double, puisque l'absence du double pendant le sommeil a quotidiennement pour effet de suspendre la vie et la pense. Ainsi des observations diverses semblaient se contrler mutuellement et confirmaient l'ide de la dualit constitutionnelle de l'homme .
100
Mais l'me n'est pas un esprit. Elle est attache un corps d'o elle ne sort qu'exceptionnellement ; et, tant qu'elle n'est rien de plus, elle n'est l'objet d'aucun culte. L'esprit, au contraire, tout en ayant gnralement pour rsidence une chose dtermine, peut s'en loigner volont et l'homme ne peut entrer en relations avec lui qu'en observant des prcautions rituelles. L'me ne pouvait donc devenir esprit qu' condition de se transformer : la simple application des ides prcdentes au fait de la mort produisit tout naturellement cette mtamorphose. Pour une intelligence rudimentaire, en effet, la mort ne se distingue pas d'un long vanouissement ou d'un sommeil prolong ; elle en a tous les aspects. Il semble donc qu'elle aussi consiste en une sparation de l'me et du corps, analogue celle qui se produit chaque nuit ; seulement, comme, en pareil cas, on ne voit pas le corps se ranimer, on se fait l'ide d'une sparation sans limite de temps assignable. Mme, une fois que le corps est dtruit - et les rites funraires ont en partie pour objet de hter cette destruction - la sparation passe ncessairement pour dfinitive. Voil donc des esprits dtachs de tout organisme et lchs en libert travers l'espace. Leur nombre augmentant avec le temps, il se forme ainsi, tout autour de la population vivante, une population d'mes. Ces mes d'hommes ont des besoins et des passions d'hommes ; elles cherchent donc se mler la vie de leurs compagnons d'hier, soit pour les aider, soit pour leur nuire, selon les sentiments qu'elles ont gards pour eux. Or leur nature en fait, suivant le cas, ou des auxiliaires trs prcieux ou des adversaires trs redouts. Elles peuvent, en effet, grce leur extrme fluidit, pntrer dans les corps et y causer toute espce de dsordres, ou bien, au contraire, en rehausser la vitalit. Aussi prend-on l'habitude de leur attribuer tous les vnements de la vie qui sortent un peu de l'ordinaire: il n'en est gure dont elles ne puissent rendre compte. Elles constituent donc comme un arsenal de causes toujours disponibles et qui ne laissent jamais dans l'embarras l'esprit en qute d'explications. Un homme parat inspir, il parle avec vhmence, il est comme lev au-dessus de lui-mme et du niveau moyen des hommes ? C'est qu'une me bienfaisante est en lui et l'anime. Un autre est pris par une attaque, saisi par la folie ? C'est qu'un esprit mchant s'est introduit dans son corps et y a apport le trouble. Il n'y a pas de maladie qui ne puisse tre rapporte quelque influence de ce genre. Ainsi, le pouvoir des mes grandit de tout ce qu'on leur attribue, si bien que l'homme finit par se trouver le prisonnier de ce monde imaginaire dont il est cependant l'auteur et le modle. Il tombe sous la dpendance de ces forces spirituelles qu'il a cres de sa propre main et sa propre image. Car si les mes disposent ce point de la sant et de la maladie, des biens et des maux, il est sage de se concilier leur bienveillance ou de les apaiser quand elles sont irrites: de l, les offrandes, les sacrifices, les prires, en un mot tout l'appareil
100
V. SPENCER, Principes de sociologie, I, p. 205 et suiv. (Paris, F. AIcan), et TYLOR, op. cit., I, pp. 509, 517.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
55
des observances religieuses .
101
Voil l'me transforme. De simple principe vital, animant un corps d'homme, elle est devenue un esprit, un gnie, bon on mauvais, une divinit mme, selon l'importance des effets qui lui sont imputs. Mais puisque c'est la mort qui aurait opr cette apothose, c'est, en dfinitive, aux morts, aux mes des anctres que ce serait adress le premier culte qu'ait connu l'humanit. Ainsi, les premiers rites auraient t des rites mortuaires ; les premiers sacrifices auraient t des offrandes alimentaires destines satisfaire aux besoins des dfunts; les premiers autels auraient t des tombeaux .
102
Mais parce que ces esprits taient d'origine humaine, ils ne s'intressaient qu' la vie des hommes et n'taient censs agir que sur les vnements humains. Il reste expliquer comment d'autres esprits furent imagins pour rendre compte des autres phnomnes de l'univers et comment, par suite, ct du culte des anctres, se constitua un culte de la nature. Pour Tylor, cette extension de l'animisme serait due la mentalit particulire du primitif qui, comme l'enfant, ne sait pas distinguer l'anim de l'inanim. Parce que les premiers tres dont l'enfant commence se faire quelque ide sont des hommes, savoir lui-mme et ses proches, c'est sur le modle de la nature humaine qu'il tend se reprsenter toutes choses. Dans les jouets dont il se sert, dans les objets de toute sorte qui affectent ses sens, il voit des tres vivants comme lui. Or le primitif pense comme un enfant. Par suite, il est, lui aussi, enclin doter les choses, mmes inanimes, d'une nature analogue la sienne. Une fois donc que, pour les raisons exposes plus haut, il fut arriv cette ide que l'homme est un corps qu'anime un esprit, il devait ncessairement prter aux corps bruts eux-mmes une dualit du mme genre et des mes semblables la sienne. Toutefois, la sphre d'action des unes et des autres ne pouvait tre la mme. Des mes d'hommes n'ont d'influence directe que sur le monde des hommes : elles ont pour l'organisme humain une sorte de prdilection, alors mme que la mort leur a rendu la libert. Au contraire, les mes des choses rsident avant tout dans les choses et sont regardes comme les causes productrices de tout ce qui s'y passe. Les premires rendent compte de la sant ou de la maladie, de l'adresse ou de la maladresse etc. ; par les secondes, on explique avant tout les phnomnes du monde physique, la marche des cours d'eau on des astres, la germination des plantes, la prolifration des animaux, etc. C'est ainsi que cette premire philosophie de l'homme qui est la base du culte des anctres se complta par une philosophie du monde. Vis--vis de ces esprits cosmiques, l'homme se trouva dans un tat de dpendance encore plus vident que vis--vis des doubles errants de ses anctres. Car, avec ces derniers, il ne pouvait avoir qu'un commerce idal et imaginaire, tandis qu'il dpend rellement des choses ; pour vivre, il a besoin de leur concours ; il crut donc avoir galement besoin des esprits qui passaient pour animer ces choses et en dterminer les manifestations diverses. Il implora leur assistance, il la sollicita par des offrandes, par des prires, et la religion de l'homme s'acheva dans une religion de la nature.
101 102
TYLOR, Il, p. 143 et suiv. TYLOR, I, pp. 326, 555.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
56
Herbert Spencer objecte cette explication que l'hypothse sur laquelle elle repose est contredite par les faits. On admet, dit-il, qu'il y eut un moment o l'homme ne saisit pas les diffrences qui sparent l'anim de l'inanim. Or, mesure qu'on s'lve dans l'chelle animale, on voit grandir l'aptitude faire cette distinction. Les animaux suprieurs ne confondent pas un objet qui se meut de lui-mme et dont les mouvements sont ajusts des fins, avec ceux qui sont mus du dehors et mcaniquement. Quand un chat s'amuse d'une souris qu'il a attrape, s'il la voit demeurer longtemps immobile, il la touche du bout de sa griffe pour la faire courir. videmment, le chat pense qu'un tre vivant qu'on drange cherchera s'chapper . L'homme, mme primitif, ne saurait pourtant avoir une intelligence infrieure celle des animaux qui l'ont prcd dans l'volution ; ce ne peut donc tre par manque de discernement qu'il est pass du culte des anctres au culte des choses.
103
Suivant Spencer qui, sur ce point, mais sur ce point seulement, s'carte de Tylor, ce passage serait bien d une confusion, mais d'une autre sorte. Ce serait, en majeure partie tout au moins, le rsultat d'innombrables amphibologies. Dans beaucoup de socits infrieures, c'est un usage trs rpandu de donner chaque individu, soit au moment de sa naissance soit plus tard, le nom d'un animal, d'une plante, d'un astre, d'un objet naturel quelconque. Mais, par suite de l'extrme imprcision de son langage, il est trs difficile au primitif de distinguer une mtaphore de la ralit. Il aurait donc vite perdu de vue que ces dnominations n'taient que des figures, et, les prenant la lettre, il aurait fini par croire qu'un anctre appel Tigre ou Lion tait rellement un tigre ou un lion. Par suite, le culte dont cet anctre tait jusque-l l'objet se serait report sur l'animal avec lequel il tait dsormais confondu ; et la mme substitution s'oprant pour les plantes, pour les astres, pour tous les phnomnes naturels, la religion de la nature aurait pris la place de la vieille religion des morts. Sans doute, ct de cette confusion fondamentale, Spencer en signale d'autres qui auraient, ici ou l, renforc l'action de la premire. Par exemple, les animaux qui frquentent les environs des tombes ou les maisons des hommes auraient t pris pour des mes rincarnes et on les aurait adors ce titre ; ou bien la montagne dont la tradition faisait le lieu d'origine de la race aurait fini par tre prise pour la souche mme de cette race ; on aurait cru que les hommes en taient les descendants parce que les anctres passaient pour en tre venus et on l'aurait, par suite, traite elle-mme en anctre . Mais, de l'aveu de Spencer, ces causes accessoires n'auraient eu qu'une influence secondaire ; ce qui aurait principalement dtermin l'institution du naturisme, c'est l'interprtation littrale des noms mtaphoriques .
104 105 106
Nous devions rapporter cette thorie afin que notre expos de l'animisme ft complet ; mais elle est trop inadquate aux faits et, aujourd'hui, trop universellement abandonne pour qu'il y ait lieu de s'y arrter davantage. Pour pouvoir expliquer par une illusion un fait aussi gnral que la religion de la nature, encore faudrait-il que l'illusion invoque tnt elle-mme des causes d'une gale gnralit. Or, quand mme des mprises comme celles dont Spencer rapporte quelques rares exemples pourraient expliquer, l o on les constate, la transformation du culte des anctres en culte de la nature, on ne voit pas pour quelle raison elles se seraient
103 104 105 106
Principes de sociologie, I, p. 184. Ibid., p. 447 et suiv. Ibid., p. 504. Ibid., p. 478; cf. p. 528.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
57
produites avec une sorte d'universalit. Aucun mcanisme psychique ne les ncessitait. Sans doute, le mot, par son ambigut, pouvait incliner l'quivoque ; mais d'un autre ct, tous les souvenirs personnels laisss par l'anctre dans la mmoire des hommes devaient s'opposer la confusion. Pourquoi la tradition qui reprsentait l'anctre tel qu'il avait t, c'est--dire comme un homme ayant vcu une vie d'homme, aurait-elle partout cd au prestige du mot ? D'autre part, on devait avoir quelque mal admettre que des hommes aient pu natre d'une montagne ou d'un astre, d'un animal ou d'une plante ; l'ide d'une telle exception aux conditions ordinaires de la gnration ne pouvait pas ne pas soulever de vives rsistances. Ainsi, bien loin que l'erreur trouvt devant elle un chemin tout fray, toutes sortes de raisons semblaient devoir en dfendre les esprits. On ne comprend donc pas comment, en dpit de tant d'obstacles, elle aurait pu triompher aussi gnralement.
II
.
Reste la thorie de Tylor dont l'autorit est toujours grande. Ses hypothses sur le rve, sur la gense des ides d'mes et d'esprit sont encore classiques ; il importe donc d'en prouver la valeur. Tout d'abord, on doit reconnatre que les thoriciens de l'animisme ont rendu un important service la science des religions et mme l'histoire gnrale des ides en soumettant la notion d'me l'analyse historique. Au lieu d'en faire, avec tant de philosophes, une donne simple et immdiate de la conscience, ils y ont vu, beaucoup plus justement, un tout complexe, un produit de l'histoire et de la mythologie. Il n'est pas douteux, en effet, qu'elle ne soit chose essentiellement religieuse par sa nature, ses origines et ses fonctions. C'est de la religion que les philosophes l'ont reue ; aussi ne peut-on comprendre la forme sous laquelle elle se prsente chez les penseurs de l'antiquit, si l'on ne tient pas compte des lments mythiques qui ont servi la former. Mais si Tylor a eu le mrite de poser le problme, la solution qu'il en donne ne laisse pas de soulever de graves difficults. Il y aurait, tout d'abord, des rserves faire sur le principe mme qui est la base de cette thorie. On admet comme une vidence que l'me est entirement distincte du corps, qu'elle en est le double, et qu'en lui on hors de lui elle vit normalement d'une vie propre et autonome. Or, nous verrons que cette conception n'est pas celle du primitif ; du moins, elle n'exprime qu'un aspect de l'ide qu'il se fait de l'me. Pour lui, l'me, tout en tant, sous certains rapports, indpendante de l'organisme qu'elle anime, se confond pourtant, en partie, avec ce dernier, au
107
107
V. plus loin, liv. II, chap. VIII.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
58
point de n'en pouvoir tre radicalement spare : il y a des organes qui en sont, non pas seulement le sige attitr, mais la forme extrieure et la manifestation matrielle. La notion est donc plus complexe que ne le suppose la doctrine et, par suite, il est douteux que les expriences invoques suffisent en rendre compte ; car, mme si elles permettaient de comprendre comment l'homme s'est cru double, elles ne sauraient expliquer comment cette dualit n'exclut pas, mais, au contraire, implique une unit profonde et une pntration intime des deux tres ainsi diffrencis. Mais admettons que l'ide d'me soit rductible l'ide de double et voyons comment se serait forme cette dernire. Elle aurait t suggre l'homme par l'exprience du rve. Pour comprendre comment, alors que son corps restait couch sur le sol, il pouvait voir pendant son sommeil des lieux plus on moins distants, il aurait t amen se concevoir comme form de deux tres : son corps d'une part, et, de l'autre, un second soi, capable de quitter l'organisme dans lequel il habite et de parcourir l'espace. Mais d'abord, pour que cette hypothse d'un double ait pu s'imposer aux hommes avec une sorte de ncessit, il et fallu qu'elle ft la seule possible ou, tout au moins, la plus conomique. Or, en fait, il en est de plus simples dont l'ide, semble-t-il, devait se prsenter tout aussi naturellement aux esprits. Pourquoi, par exemple, le dormeur n'aurait-il pas imagin que, pendant son sommeil, il tait capable de voir distance ? Pour s'attribuer un tel pouvoir, il fallait de moindres frais d'imagination que pour construire cette notion si complexe d'un double, fait d'une substance thre, demi invisible, et dont l'exprience directe n'offrait aucun exemple. En tout cas, supposer que certains rves appellent assez naturellement l'explication animiste, il en est certainement beaucoup d'autres qui y sont absolument rfractaires. Bien souvent, nos rves se rapportent des vnements passs; nous revoyons ce que nous avons vu ou fait, l'tat de veille, hier, avant-hier, pendant notre jeunesse, etc. ; et ces sortes de rves sont frquents et tiennent une place assez considrable dans notre vie nocturne. Or, l'ide du double ne peut en rendre compte. Si le double peut se transporter d'un point l'autre de l'espace, on ne voit pas comment il lui serait possible de remonter le cours du temps. Comment l'homme, si rudimentaire que ft son intelligence, pouvait-il croire, une fois rveill, qu'il venait d'assister rellement ou de prendre part des vnements qu'il savait s'tre passs autrefois ? Comment pouvait-il imaginer qu'il avait vcu pendant son sommeil une vie qu'il savait coule depuis longtemps ? Il tait beaucoup plus naturel qu'il vt dans ces images renouveles ce qu'elles sont rellement, savoir des souvenirs, comme il en a pendant le jour, mais d'une particulire intensit. D'un autre ct, dans les scnes dont nous sommes les acteurs et les tmoins tandis que nous dormons, il arrive sans cesse que quelqu'un de nos contemporains tient quelque rle en mme temps que nous : nous croyons le voir et l'entendre l o nous nous voyons nous-mmes. D'aprs l'animisme, le primitif expliquera ces faits en imaginant que son double a t visit ou rencontr par celui de tel ou tel de ses compagnons. Mais il suffira qu'veill il les interroge pour constater que leur exprience ne concide pas avec la sienne. Pendant le mme temps, eux aussi ont eu des rves, mais tout diffrents. Ils ne se sont pas vus participant la mme scne ; ils croient avoir visit de tout autres lieux. Et puisque, en pareil cas, de telles contradictions doivent tre la rgle, comment n'amneraient-elles pas les hommes se dire qu'il y a eu vraisemblablement erreur, qu'ils ont imagin, qu'ils ont t les dupes de quelque illusion ? Car il y a quelque simplisme dans l'aveugle crdulit qu'on prte au primitif. Il s'en faut qu'il
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
59
objective ncessairement toutes ses sensations. Il n'est pas sans s'apercevoir que, mme l'tat de veille, ses sens le trompent quelquefois. Pourquoi les croirait-il plus infaillibles la nuit que le jour ? Bien des raisons s'opposaient donc ce qu'il prt trop aisment ses rves pour des ralits et ce qu'il les interprtt par un ddoublement de son tre. Mais de plus, alors mme que tout rve s'expliquerait bien par l'hypothse du double et ne pourrait mme s'expliquer autrement, il resterait dire pourquoi l'homme a cherch en donner une explication. Sans doute, le rve constitue la matire d'un problme possible. Mais nous passons sans cesse ct de problmes que nous ne nous posons pas, que nous ne souponnons mme pas tant que quelque circonstance ne nous a pas fait sentir la ncessit de nous les poser. Mme quand le got de la pure spculation est veill, il s'en faut que la rflexion soulve toutes les questions auxquelles elle pourrait ventuellement s'appliquer ; celles-l seules l'attirent qui prsentent un intrt particulier. Surtout quand il s'agit de faits qui se reproduisent toujours de la mme manire, l'accoutumance endort aisment la curiosit et nous ne songeons mme plus nous interroger. Pour secouer cette torpeur, il faut que des exigences pratiques ou, tout au moins, un intrt thorique trs pressant viennent stimuler notre attention et la tourner de ce ct. Voil comment, chaque moment de l'histoire, il y a tant de choses que nous renonons comprendre, sans mme avoir conscience de notre renoncement. jusqu' des temps peu loigns, on a cru que le soleil n'avait que quelques pieds de diamtre. Il y avait quelque chose d'incomprhensible ce qu'un disque lumineux d'une aussi faible tendue pt suffire clairer la terre : et cependant, pendant des sicles, l'humanit n'a pas pens rsoudre cette contradiction. L'hrdit est un fait connu depuis longtemps ; c'est tout rcemment qu'on a essay d'en faire la thorie. Certaines croyances taient mme admises qui la rendaient tout fait inintelligible : c'est ainsi que, pour plusieurs socits australiennes dont nous aurons parler, l'enfant n'est pas physiologiquement le produit de ses parents . Cette paresse intellectuelle est ncessairement son maximum chez le primitif. Cet tre dbile, qui a tant de mal disputer sa vie contre toute les forces qui l'assaillent, n'a pas de quoi faire du luxe en matire de spculation. Il ne doit rflchir que quand il y est incit. Or il est malais d'apercevoir ce qui peut l'avoir amen faire du rve le thme de ses mditations. Qu'est-ce que le rve dans notre vie ? Combien il y tient peu de place, surtout cause des trs vagues impressions qu'il laisse dans la mmoire, de la rapidit mme avec laquelle il s'efface du souvenir, et comme il est surprenant, par suite, qu'un homme d'une intelligence aussi rudimentaire ait dpens tant d'efforts en trouver l'explication ! Des deux existences qu'il mne successivement, l'existence diurne et l'existence nocturne, c'est la premire qui devait l'intresser le plus. N'est-il pas trange que la seconde ait assez captiv son attention pour qu'il en ait fait la base de tout un systme d'ides compliques et appeles avoir sur sa pense et sur sa conduite une si profonde influence ?
108
Tout tend donc prouver que la thorie animiste de l'me, malgr le crdit dont elle jouit encore, doit tre rvise. Sans doute, aujourd'hui, le primitif attribue lui-mme ses rves, ou certains d'entre eux, aux dplacements de son double. Mais ce n'est pas dire que le rve ait effectivement fourni des matriaux avec lesquels l'ide de double ou d'me fut construite ; car elle peut avoir t applique, aprs coup, aux phnomnes du rve, de l'extase et de la
108
V. SPENCER et GILLEN, The Native Tribes of Central Australia, pp. 123-127; STREHLOW, Die Aranda- und Loritja-Stmme in Zentral Australien, II, p. 52 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
60
possession, sans, pourtant, en tre drive. Il est frquent qu'une ide, une fois constitue, soit employe coordonner ou clairer, d'une lumire parfois plus apparente que relle, des faits avec lesquels elle tait primitivement sans rapports et qui ne pouvaient la suggrer d'euxmmes. Aujourd'hui, on prouve couramment Dieu et l'immortalit de l'me en faisant voir que ces croyances sont impliques par les principes fondamentaux de la morale, en ralit, elles ont une tout autre origine. L'histoire de la pense religieuse pourrait fournir de nombreux exemples de ces justifications rtrospectives qui ne peuvent rien nous apprendre sur la faon dont se sont formes les ides ni sur les lments dont elles sont composes. Il est, d'ailleurs, probable que le primitif distingue entre ses rves et qu'il ne les explique pas tous de la mme manire... Dans nos socits europennes, les gens, nombreux encore, pour qui le sommeil est une sorte d'tat magico-religieux, dans lequel l'esprit, allg partiellement du corps, a une acuit de vision dont il ne jouit pas pendant la veille, ne vont pourtant pas jusqu' considrer tous leurs rves comme autant d'intuitions mystiques : tout au contraire, ils ne voient, avec tout le monde, dans la plupart de leurs songes que des tats profanes, de vains jeux d'images, de simples hallucinations. On peut penser que le primitif a toujours fait des distinctions analogues. Codrington dit formellement des Mlansiens qu'ils n'attribuent pas des migrations d'mes tous leurs rves indistinctement, mais ceux-l seuls qui frappent vivement leur imagination : il faut sans doute entendre par l ceux o le dormeur se croit en rapports avec des tres religieux, gnies bienfaisants ou malins, mes des trpasss, etc. De mme, les Dieri distinguent trs nettement les rves ordinaires et les visions nocturnes o se montrent eux quelque ami ou quelque parent dcd. Ils donnent des noms diffrents ces deux sortes d'tats. Dans le premier, ils voient une simple fantaisie de leur imagination ; ils attribuent le second l'action d'un esprit mchant . Tous les faits que Howitt rapporte titre d'exemples pour montrer comment l'Australien attribue l'me le pouvoir de quitter le corps; ont galement un caractre mystique : le dormeur se croit transport dans le pays des morts ou bien il s'entretient avec un compagnon dfunt . Ces rves sont frquents chez les primitifs . C'est vraisemblablement autour de ces faits que s'est forme la thorie. Pour en rendre compte, on admit que les mes des morts venaient retrouver les vivants pendant leur sommeil. L'explication fut d'autant plus facilement accepte qu'aucun fait d'exprience ne pouvait l'infirmer. Seulement, ces rves n'taient possibles que l o l'on avait dj l'ide d'esprits, d'mes, de pays des morts, c'est--dire l o l'volution religieuse tait relativement avance. Bien loin qu'ils aient pu fournir la religion la notion fondamentale sur laquelle elle repose, ils
109 110 111 112
109 110 111 112
The Melanesians, pp. 249-250. HOWITT, The Native Tribes of South-East Australia, p. 358 (d'aprs GASON). HOWITT, Ibid., pp. 434-442. Les ngres de la Guine mridionale, dit TYLOR, ont pendant leur sommeil presque autant de rapports avec les morts qu'ils en ont pendant la veille avec les vivants (Civilisation primitive, I, p. 515). Le mme auteur cite, propos de ces peuples, cette remarque d'un observateur : Ils regardent tous leurs rves comme des visites des esprits de leurs amis dcds (ibid., p. 514). L'expression est certainement exagre; mais c'est une preuve nouvelle de la frquence des songes mystiques chez les primitifs. C'est ce que tend aussi confirmer l'tymoIogie que STREHLOW propose du mot arunta altjirerema qui signifie rver. Il serait compos de altjira que STREHLOW traduit par dieu et de rama qui veut dire voir. Le rve serait donc le moment o l'homme est en rapports avec les tres sacrs (Die Aranda- und Loritja-Stmme, I, p. 2).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
61
supposaient un systme religieux dj constitu et dont ils dpendaient .
113
III
.
Mais arrivons ce qui constitue le cur mme de la doctrine. D'o que vienne l'ide d'un double, elle ne suffit pas, de l'aveu des animistes, expliquer comment s'est form ce culte des anctres dont on a voulu faire le type initial de toutes les religions. Pour que le double devnt l'objet d'un culte, il fallait qu'il cesst d'tre une simple rplique de l'individu et acqut les caractres ncessaires pour tre mis au rang des tres sacrs. C'est, dit-on, la mort qui oprerait cette transformation. Mais d'o peut venir la vertu qu'on lui prte ? Quand mme l'analogie du sommeil et de la mort aurait suffi faire croire que l'me survit au corps (et il y a des rserves faire sur ce point), pourquoi cette me, par cela seul qu'elle est maintenant dtache de l'organisme, changerait-elle compltement de nature ? Si, de son vivant, elle n'tait qu'une chose profane, un principe vital ambulant, comment deviendraitelle tout coup une chose sacre, objet de sentiments religieux ? La mort ne lui ajoute rien d'essentiel, sauf une plus grande libert de mouvements. N'tant plus attache une rsidence attitre, elle peut dsormais faire en tout temps ce que nagure elle ne faisait que de nuit ; mais l'action qu'elle est capable d'exercer est toujours de mme nature. Pourquoi donc les vivants auraient-ils vu dans ce double dracin et vagabond de leur compagnon d'hier, autre chose qu'un semblable ? C'tait un semblable dont le voisinage pouvait tre incommode; ce n'tait pas une divinit .
114
Il semble mme que la mort devrait avoir pour effet d'affaiblir les nergies vitales, loin qu'elle pt les rehausser. C'est en effet, une croyance trs rpandue dans les socits infrieures que l'me participe troitement de la vie du corps. S'il est bless, elle est blesse elle-mme et
113
114
Andrew LANG qui, lui aussi, se refuse admettre que l'ide d'me a t suggre l'homme par l'exprience du rve, a cru pouvoir la driver d'autres donnes exprimentales : ce sont les faits de spiritisme (tlpathie, vision distance, etc.). Nous ne croyons pas devoir discuter sa thorie, telle qu'il l'a expose dans son livre The Making of Religion. Elle repose, en effet, sur cette hypothse que le spiritisme est un fait d'observation constant, que la vision distance est une facult relle de l'homme ou, du moins, de certains hommes, et on sait combien ce postulat est scientifiquement contest. Ce qui est plus contestable encore, c'est que les faits de spiritisme soient assez apparents et d'une suffisante frquence pour avoir pu servir de base toutes les croyances et toutes les pratiques religieuses qui se rapportent aux mes et aux esprits. L'examen de ces questions nous loignerait trop de ce qui est l'objet de notre tude. Il est, d'ailleurs, d'autant moins ncessaire de nous engager dans cet examen que la thorie de Lang reste expose plusieurs des objections que nous allons adresser celle de Tylor dans les paragraphes qui vont suivre. JEVONS fait une remarque analogue. Avec Tylor, il admet que l'ide d'me vient du rve et que, cette ide une fois cre, l'homme la projeta dans les choses. Mais, ajoute-t-il, le fait que la nature ait t conue comme anime l'image de l'homme, n'explique pas qu'elle soit devenue l'objet d'un culte. De ce que l'homme voit dans un arbre qui plie, dans la flamme qui va et vient, un tre vivant comme lui, il ne suit nullement que l'un ou l'autre soient considrs comme des tres surnaturels; tout au contraire, dans la mesure o ils lui ressemblent, ils ne peuvent rien voir de surnaturel ses yeux (Introduction to the History of Religion, p. 55).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
62
l'endroit correspondant. Elle devrait donc vieillir en mme temps que lui. En fait, il est des peuples o l'on ne rend pas de devoirs funraires aux hommes qui sont arrivs la snilit ; on les traite comme si leur me, elle aussi, tait devenue snile . Il arrive mme qu'on mette rgulirement mort, avant qu'ils ne soient parvenus la vieillesse, les personnages privilgis, rois ou prtres, qui passent pour tre les dtenteurs de quelque puissant esprit dont la socit tient conserver la protection. On veut viter ainsi que cet esprit ne soit atteint par la dcadence physique de ceux qui en sont les dpositaires momentans ; pour cela, on le retire de l'organisme o il rside avant que l'ge ne l'ait affaibli, et on le transporte, tandis qu'il n'a encore rien perdu de sa vigueur, dans un corps plus jeune o il pourra garder intacte sa vitalit . Mais alors, quand la mort rsulte de la maladie ou de la vieillesse, il semble que l'me ne puisse conserver que des forces amoindries ; et mme une fois que le corps est dfinitivement dissous, on ne voit pas comment elle pourrait lui survivre, si elle n'en est que le double. L'ide de survivance devient, de ce point de vue, difficilement intelligible. Il y a donc un cart, un vide logique et psychologique entre l'ide d'un double en libert et celle d'un esprit auquel s'adresse un culte. Cet intervalle apparat comme plus considrable encore quand on sait quel abme spare le monde sacr du monde profane ; car il est vident qu'un simple changement de degrs ne saurait suffire faire passer une chose d'une catgorie dans l'autre. Les tres sacrs ne se distinguent pas seulement des profanes par les formes tranges ou dconcertantes qu'ils affectent ou par les pouvoirs plus tendus dont ils jouissent ; mais, entre les uns et les autres, il n'y a pas de commune mesure. Or, il n'y a rien dans la notion d'un double qui puisse rendre compte d'une htrognit aussi radicale. On dit qu'une fois affranchi du corps il peut faire aux vivants on beaucoup de bien ou beaucoup de mal, selon la manire dont il les traite. Mais il ne suffit pas qu'un tre inquite son entourage pour qu'il semble tre d'une autre nature que ceux dont il menace la tranquillit. Sans doute, dans le sentiment que le fidle prouve pour les choses qu'il adore, il entre toujours quelque rserve et quelque crainte; mais c'est une crainte sui generis, faite de respect plus que de frayeur, et o domine cette motion trs particulire qu'inspire l'homme la majest. L'ide de majest est essentiellement religieuse. Aussi n'a-t-on, pour ainsi dire, rien expliqu de la religion, tant qu'on n'a pas trouv d'o vient cette ide, quoi elle correspond et ce qui peut l'avoir veille dans les consciences. De simples mes d'hommes ne sauraient tre investies de ce caractre par cela seul qu'elles sont dsincarnes.
115 116
C'est ce que montre clairement l'exemple de la Mlansie, Les Mlansiens croient que l'homme possde une me qui quitte le corps la mort; elle change alors de nom et devient ce qu'ils appellent un tindalo, un natmat, etc. D'un autre ct, il existe chez eux un culte des mes des morts: on les prie, on les invoque, on leur fait des offrandes et des sacrifices. Mais tout tindalo n'est pas l'objet de ces pratiques rituelles ; ceux-l seuls ont cet honneur qui manent d'hommes auxquels l'opinion publique attribuait, pendant leur vie, cette vertu trs spciale que les Mlansiens appellent le mana. Nous aurons plus tard prciser l'ide que ce mot exprime; provisoirement, il nous suffira de dire que c'est le caractre distinctif de tout tre sacr. Le mana, dit Codrington, c'est ce qui permet de produire des effets qui sont en dehors du pouvoir ordinaire des hommes, en dehors des processus ordinaires de la nature . Un prtre, un
117
115 116 117
V. SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 506 et Nat. Tr., p. 512. C'est ce thme rituel et mythique que FRAZER tudie dans son Golden Bough. The Melanesians, p. 119.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
63
sorcier, une formule rituelle ont le mana aussi bien qu'une pierre sacre ou qu'un esprit. Donc les seuls tindalo auxquels sont rendus des devoirs religieux sont ceux qui, alors que leur propritaire tait vivant, taient dj par eux-mmes des tres sacrs. Quant aux autres mes, celles qui viennent des hommes du commun, de la foule des profanes, elles sont, dit le mme auteur, des riens aprs comme avant la mort . La mort n'a donc, par elle-mme et elle seule, aucune vertu divinisatrice. Parce qu'elle consomme, d'une manire plus complte et plus dfinitive, la sparation de l'me d'avec les choses profanes, elle peut bien renforcer le caractre sacr de l'me, si celle-ci le possde dj, mais elle ne le cre pas.
118
D'ailleurs, si vraiment, comme le suppose l'hypothse animiste, les premiers tres sacrs avaient t les mes des morts et le premier culte celui des anctres, on devrait constater que, plus les socits sont d'un type infrieur, plus aussi ce culte tient de place dans la vie religieuse. Or c'est plutt le contraire qui est la vrit. Le culte ancestral ne prend de dveloppement et mme ne se prsente sous une forme caractrise que dans des socits avances comme la Chine, l'gypte, les cits grecques et latines ; au contraire, il manque aux socits australiennes qui reprsentent, comme nous le verrons, la forme d'organisation sociale la plus basse et la plus simple que nous connaissions. Sans doute, on y trouve des rites funraires et des rites de deuil ; mais ces sortes de pratiques ne constituent pas un culte, bien qu'on leur ait parfois, et tort, donn ce nom. Un culte, en effet, n'est pas simplement un ensemble de prcautions rituelles que l'homme est tenu de prendre dans certaines circonstances ; c'est un systme de rites, de ftes, de crmonies diverses qui prsentent toutes ce caractre qu'elles reviennent priodiquement. Elles rpondent au besoin qu'prouve le fidle de resserrer et de raffermir, des intervalles de temps rguliers, le lien qui l'unit aux tres sacrs dont il dpend. Voil pourquoi on parle de rites nuptiaux, et non d'un culte nuptial ; de rites de la naissance, et non d'un culte du nouveau-n : c'est que les vnements l'occasion desquels ces rites ont lieu n'impliquent aucune priodicit. De mme, il n'y a culte des anctres que quand des sacrifices sont faits de temps en temps sur les tombeaux, quand des libations y sont verses des dates plus ou moins rapproches, quand des ftes sont rgulirement clbres en l'honneur du mort. Mais l'Australien n'entretient avec ses morts aucun commerce de ce genre. Il doit, sans doute, ensevelir leurs restes suivant le rite, les pleurer pendant le temps prescrit de la manire prescrite, les venger s'il y a lieu . Mais une fois qu'il s'est acquitt de ces soins pieux, une fois que les ossements sont desschs, que le deuil est arriv son terme, tout est dit et les survivants n'ont plus de devoirs envers ceux de leurs parents qui ne sont plus. Il y a bien, il est vrai, une forme sous laquelle les morts continuent garder quelque place dans la vie de leurs proches mme aprs que le deuil est termin. Il arrive, en effet, qu'on conserve leurs cheveux ou certains de leurs ossements , cause des vertus spciales qui y sont attaches. Mais ce moment, ils ont cess d'exister comme personnes; ils sont tombs au rang d'amulettes anonymes et impersonnelles. En cet tat, ils ne sont l'objet d'aucun culte; ils ne servent plus qu' des fins magiques.
119 120
118 119
120
Ibid., p. 125. Il y a mme parfois, semble-t-il, des offrandes funraires (v. ROTH, Superstition, Magie a. Medicine, in N. Queensland Ethnog., Bull. no 5, 69, c. et Burial Customs, N. Qu. Ethn., Bull. no 10, in Records of the Australian Museum, VI, no 5, p. 395). Mais ces offrandes ne sont pas priodiques. V. SPENCER et GILLEN, Native Tribes of Central Australia, pp. 538,553, et Northern Tribes, pp. 463, 543, 547.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
64
Il y a cependant des tribus australiennes o sont priodiquement clbrs des rites en l'honneur d'anctres fabuleux que la tradition place l'origine des temps. Ces crmonies consistent gnralement en des sortes de reprsentations dramatiques o sont mims les actes que les mythes attribuent ces hros lgendaires . Seulement, les personnages qui sont ainsi mis en scne ne sont pas des hommes qui, aprs avoir vcu d'une vie d'hommes, auraient t transforms en des sortes de dieux par le fait de la mort. Mais ils sont censs avoir joui, ds leur vivant, de pouvoirs surhumains. On leur rapporte tout ce qui s'est fait de grand dans l'histoire de la tribu et mme dans l'histoire du monde. Ce sont eux qui auraient fait en grande partie la terre telle qu'elle est et les hommes tels qu'ils sont. L'aurole dont ils continuent tre entours ne leur vient donc pas simplement de ce qu'ils sont des anctres, c'est--dire, en somme, de ce qu'ils sont morts, niais de ce qu'un caractre divin leur est et leur a t de tout temps attribu ; pour reprendre l'expression mlansienne, ils sont constitutionnellement dous de mana. Il n'y a, par consquent, rien l qui dmontre que la mort ait le moindre pouvoir de diviniser. On ne peut mme, sans improprit, dire de ces rites qu'ils constituent un culte des anctres, puisqu'ils ne s'adressent pas aux anctres comme tels. Pour qu'il puisse y avoir un vritable culte des morts, il faut que les anctres rels, les parents que les hommes perdent rellement chaque jour, deviennent, une fois morts, l'objet d'un culte; or, encore une fois, d'un culte de ce genre, il n'existe pas de traces en Australie.
121
Ainsi le culte qui, d'aprs l'hypothse, devrait tre prpondrant dans les socits infrieures y est, en ralit, inexistant. En dfinitive, l'Australien n'est occup de ses morts qu'au moment mme du dcs et pendant le temps qui suit immdiatement. Et cependant, ces mmes peuples pratiquent, comme nous le verrons, l'gard d'tres sacrs d'une tout autre nature, un culte complexe, fait de crmonies multiples qui occupent parfois des semaines et mme des mois entiers. Il est inadmissible que les quelques rites que l'Australien accomplit quand il lui arrive de perdre l'un de ses parents aient t l'origine de ces cultes permanents, qui reviennent rgulirement tous les ans et qui remplissent une notable partie de son existence. Le contraste entre les uns et les autres est mme tel qu'on est fond se demander si ce ne sont pas les premiers qui sont drivs des seconds, si les mes des hommes, loin d'avoir t le modle sur lequel furent imagins les dieux, n'ont pas t conues, ds l'origine, comme des manations de la divinit.
IV
.
Du moment que le culte des morts n'est pas primitif, l'animisme manque de base. Il pourrait donc sembler inutile de discuter la troisime thse du systme, celle qui concerne la
121
V. Notamment SPENCER et GILLEN, Northern Tribes, chap. VI, VII, IX.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
65
transformation du culte des morts en culte de la nature. Mais comme le postulat sur lequel elle repose se retrouve mme chez des historiens de la religion qui n'admettent pas l'animisme proprement dit, tels que Brinton , Lang , Rville , Robertson Smith lui-mme , il est ncessaire d'en faire l'examen.
122 123 124 125
Cette extension du culte des morts l'ensemble de la nature viendrait de ce que nous tendons instinctivement nous reprsenter toutes choses notre image, c'est--dire comme des tres vivants et pensants. Nous avons vu que dj Spencer contestait la ralit de ce soi-disant instinct. Puisque l'animal distingue nettement les corps vivants des corps bruts, il lui paraissait impossible que l'homme, en tant qu'hritier de l'animal, n'et pas, ds l'origine, la mme facult de discernement. Mais, si certains que soient les faits cits par Spencer, ils n'ont pas, en l'espce, la valeur dmonstrative qu'il leur attribue. Son raisonnement suppose, en effet, que toutes les facults, les instincts, les aptitudes de l'animal sont passs intgralement l'homme; or, bien des erreurs ont pour origine ce principe qu'on prend tort pour une vrit d'vidence. Par exemple, de ce que la jalousie sexuelle est gnralement trs forte chez les animaux suprieurs, on a conclu qu'elle devait se retrouver chez l'homme, ds le dbut de l'histoire, avec la mme intensit . Or, il est constant aujourd'hui que l'homme peut pratiquer un communisme sexuel qui serait impossible si cette jalousie n'tait pas susceptible de s'attnuer et mme de disparatre quand c'est ncessaire . C'est que, en effet, l'homme n'est pas seulement l'animal avec quelques qualits en plus : c'est autre chose. La nature humaine est due une sorte de refonte de la nature animale, et, au cours des oprations complexes d'o cette refonte est rsulte, des pertes se sont produites en mme temps que des gains. Que d'instincts n'avons-nous pas perdus! La raison en est que l'homme n'est pas seulement en rapports avec un milieu physique, mais aussi avec un milieu social infiniment plus tendu, plus stable et plus agissant que ceux dont les animaux subissent l'influence. Pour vivre, il faut donc qu'il s'y adapte. Or la socit, pour pouvoir se maintenir, a souvent besoin que nous voyions les choses sous un certain angle, que nous les sentions d'une certaine faon; en consquence, elle modifie les ides que nous serions ports nous en faire, les sentiments auxquels nous serions enclins si nous n'obissions qu' notre nature animale; elle les altre mme jusqu' mettre la place des sentiments contraires. Ne va-t-elle pas jusqu' nous faire voir dans notre propre vie une chose de peu de prix, alors que c'est, pour l'animal, le bien par excellence ? C'est donc une vaine entreprise que de chercher infrer la constitution mentale de l'homme primitif d'aprs celle des animaux suprieurs.
126 127 128
Mais si l'objection de Spencer n'a pas la porte dcisive que lui prtait son auteur, en revanche, le postulat animiste ne saurait tirer aucune autorit des confusions que paraissent
122 123 124 125 126 127
128
The Religions of Primitive Peoples, p. 47 et suiv. Mythes, cultes et religions, p. 50. Les religions des peuples non civiliss, II, Conclusion. The Religion of the Semites, 2e d., pp. 126, 132. C'est, par exemple, le raisonnement que fait WESTERMARCK, Origine du mariage dans l'espce humaine, p. 6 (Paris, F. Alcan). Par communisme sexuel, nous n'entendons pas un tat de promiscuit o l'homme n'aurait connu aucune rglementation matrimoniale : nous croyons qu'un tel tat n'a jamais exist. Mais il est arriv frquemment qu'un groupe d'hommes a t uni rgulirement une ou plusieurs femmes. Voir notre Suicide, p. 233 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
66
commettre les enfants. Quand nous entendons un enfant apostropher avec colre un objet qui l'a heurt, nous en concluons qu'il y voit un tre conscient comme lui ; mais c'est mal interprter ses paroles et ses gestes. En ralit, il est tranger au raisonnement trs compliqu qu'on lui attribue. S'il s'en prend la table qui lui a fait du mal, ce n'est pas qu'il la suppose anime et intelligente, mais c'est qu'elle lui a fait du mal. La colre, une fois souleve par la douleur, a besoin de s'pancher au-dehors; elle cherche donc sur quoi se dcharger et se porte naturellement sur la chose mme qui l'a provoque, bien que celle-ci n'y puisse rien. La conduite de l'adulte, en pareil cas, est souvent tout aussi peu raisonne. Quand nous sommes violemment irrits, nous prouvons le besoin d'invectiver, de dtruire, sans que nous prtions pourtant aux objets sur lesquels nous soulageons notre colre je ne sais quelle mauvaise volont consciente. Il y a si peu confusion que, quand l'motion de l'enfant est calme, il sait trs bien distinguer une chaise d'une personne: il ne se comporte pas avec l'une comme avec l'autre. C'est une raison analogue qui explique sa tendance traiter ses jouets, comme s'ils taient des tres vivants. C'est le besoin de jouer, si intense chez lui, qui se cre une matire approprie, comme, dans le cas prcdent, les sentiments violents que la souffrance avait dchans se craient la leur de toutes pices. Pour pouvoir jouer consciencieusement avec son polichinelle, il imagine donc d'y voir une personne vivante. L'illusion lui est, d'ailleurs, d'autant plus facile que chez lui, l'imagination est souveraine matresse; il ne pense gure que par images et on sait combien les images sont choses souples qui se plient docilement toutes les exigences du dsir. Mais il est si peu dupe de sa propre fiction qu'il serait le premier tonn si, tout coup, elle devenait une ralit et si son pantin le mordait .
129
Laissons donc de ct ces douteuses analogies. Pour savoir si l'homme a t primitivement enclin aux confusions qu'on lui impute, ce n'est ni l'animal ni l'enfant d'aujourd'hui qu'il faut considrer; ce sont les croyances primitives elles-mmes. Si les esprits et les dieux de la nature sont rellement construits l'image de l'me humaine, ils doivent porter la marque de leur origine et rappeler les traits essentiels de leur modle. La caractristique, par excellence, de l'me, c'est d'tre conue comme le principe intrieur qui anime l'organisme ; c'est elle qui le ment, qui en fait la vie, si bien que, quand elle s'en retire, la vie s'arrte ou est suspendue. C'est dans le corps qu'elle a sa rsidence naturelle, tant du moins qu'il existe. Or, il n'en est pas ainsi des esprits prposs aux diffrentes choses de la nature. Le dieu du soleil n'est pas ncessairement dans le soleil ni l'esprit de telle pierre dans la pierre qui lui tient lieu d'habitat principal. Un esprit sans doute, soutient des rapports troits avec le corps auquel il est attach; mais on emploie une expression trs inexacte quand on dit qu'il en est l'me. En Mlansie, dit Codrington, il ne semble pas que l'on croie l'existence d'esprits qui animent un objet naturel, tel qu'un arbre, une chute d'eau, une tempte ou un rocher, de manire tre pour cet objet ce que l'me, croit-on, est pour le corps humain. Les Europens, il est vrai, parlent des esprits de la mer, de la tempte ou de la fort ; mais l'ide des indignes qui est ainsi traduite est toute diffrente. Ceux-ci pensent que l'esprit frquente la fort ou la mer et qu'il a le pouvoir de soulever des temptes et de frapper de maladie les voyageurs . Tandis que l'me est essentiellement le dedans du corps, l'esprit passe la majeure partie de son existence en dehors de l'objet qui lui sert de substrat. Voil dj une diffrence qui ne parat pas tmoigner que la seconde ide soit venue de la premire.
130
129 130
SPENCER, Principes de sociologie, I, p. 188. The Melanesians, p. 123.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
67
D'un autre ct, si vraiment l'homme avait t ncessit projeter son image dans les choses, les premiers tres sacrs auraient t conus sa ressemblance. Or, bien loin que l'anthropomorphisme soit primitif, il est plutt la marque d'une civilisation relativement avance. A l'origine, les tres sacrs sont conus sous une forme animale ou vgtale dont la forme humaine ne s'est que lentement dgage. On verra plus loin comment, en Australie, ce sont des animaux et des plantes qui sont au premier plan des choses sacres. Mme chez les Indiens de l'Amrique du Nord, les grandes divinits cosmiques, qui commencent y tre l'objet d'un culte, sont trs souvent reprsentes sous des espces animales . La diffrence entre l'animal, l'homme et l'tre divin, dit Rville qui constate le fait non sans surprise, n'est pas sentie dans cet tat d'esprit et, le plus souvent, on dirait que c'est la /orme animale qui est la forme fondamentale . Pour trouver un dieu construit tout entier avec des lments humains, il faut venir presque jusqu'au christianisme. Ici, le Dieu est un homme, non pas seulement par l'aspect physique sous lequel il s'est manifest temporairement, mais encore par les ides et les sentiments qu'il exprime. Mais mme Rome et en Grce, quoique les dieux y fussent gnralement reprsents avec des traits humains, plusieurs personnages mythiques portaient encore la trace d'une origine animale : c'est Dionysos que l'on rencontre souvent sous la forme d'un taureau ou du moins avec des cornes de taureau; c'est Dmter qui est reprsente avec une crinire de cheval, c'est Pan, c'est Silne, ce sont les Faunes, etc. . Il s'en faut donc que l'homme ait t ce point enclin imposer sa forme aux choses. Il y a plus : il a lui-mme commenc par se concevoir comme participant troitement de la nature animale. C'est en effet, une croyance presque universelle en Australie, encore trs rpandue chez les Indiens de l'Amrique du Nord, que les anctres des hommes ont t des btes ou des plantes, ou, tout au moins, que les premiers hommes avaient soit en totalit soit en partie, les caractres distinctifs de certaines espces animales ou vgtales. Ainsi, loin de ne voir partout que des tres semblables lui, l'homme a commenc par se penser lui-mme l'image d'tres dont il diffrait spcifiquement.
131 132 133
V
.
La thorie animiste implique, d'ailleurs, une consquence qui en est peut-tre la meilleure rfutation. Si elle tait vraie, il faudrait admettre que les croyances religieuses sont autant de
131 132 133
DORSEY, A Study of Siouan Cults, in XIth Annual Report of the Bureau of Amer. Ethnology, p. 431 et suiv. et passim. La religion des peuples non civiliss, I, p. 248. V. W. DE VISSER, De Graecorum diis non referentibus speciem humanam. Cf. P. PERDRIZET, Bulletin de correspondance hellnique, 1889, p. 635.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
68
reprsentations hallucinatoires, sans aucun fondement objectif. on suppose, en effet, quelles sont toutes drives de la notion d'me puisqu'on ne voit dans les esprits et les dieux que des mes sublimes. Mais la notion d'me elle-mme, d'aprs Tylor et ses disciples, est construite tout entire avec les vagues et inconsistantes images qui occupent notre esprit pendant le sommeil ; car l'me, c'est le double, et le double n'est que l'homme tel qu'il s'apparat luimme tandis qu'il dort. Les tres sacrs ne seraient donc, de ce point de vue, que des conceptions imaginaires que l'homme aurait enfantes dans une sorte de dlire qui le saisit rgulirement chaque jour, et sans qu'il soit possible de voir quelles fins utiles elles servent ni quoi elles rpondent dans la ralit. S'il prie, s'il fait des sacrifices et des offrandes, s'il s'astreint aux privations multiples que lui prescrit le rite, c'est qu'une sorte d'aberration constitutionnelle lui a fait prendre ses songes pour des perceptions, la mort pour un sommeil prolong, les corps bruts pour des tres vivants et pensants. Ainsi, non seulement, comme beaucoup sont ports l'admettre, la forme sous laquelle les puissances religieuses sont ou ont t reprsentes aux esprits ne les exprimerait pas exactement ; non seulement les symboles l'aide desquels elles ont t penses en masqueraient partiellement la vritable nature, mais encore, derrire ces images et ces figures, il n'y aurait rien que des cauchemars d'esprits incultes. La religion ne serait, en dfinitive, qu'un rve systmatis et vcu, mais sans fondement dans le rel .
134
Voil d'o vient que les thoriciens de l'animisme, quand ils cherchent les origines de la pense religieuse, se contentent, en somme, peu de frais. Quand ils croient avoir russi expliquer comment l'homme a pu tre induit imaginer des tres aux formes tranges, vaporeuses, comme ceux que nous voyons en songe, le problme leur parat rsolu. En ralit, il n'est mme pas abord. Il est inadmissible, en effet, que des systmes d'ides comme les religions, qui ont tenu dans l'histoire une place si considrable, o les peuples sont venus, de tout temps, puiser l'nergie qui leur tait ncessaire pour vivre, ne soient que des tissus d'illusions. On s'entend aujourd'hui pour reconnatre que le droit, la morale, la pense scientifique elle-mme sont ns dans la religion, se sont, pendant longtemps, confondus avec elle et sont rests pntrs de son esprit. Comment une vaine fantasmagorie aurait-elle pu faonner aussi fortement et d'une manire aussi durable les consciences humaines ? Assurment, ce doit tre pour la science des religions un principe que la religion n'exprime rien qui ne soit dans la nature ; car il n'y a science que de phnomnes naturels. Toute la question est de savoir quel rgne de la nature ressortissent ces ralits et ce qui a pu dterminer les hommes se les reprsenter sous cette forme singulire qui est propre la pense religieuse. Mais pour
134
Suivant SPENCER, cependant, il y aurait, dans la croyance aux esprits, un germe de vrit: c'est cette ide que le pouvoir qui se manifeste dans la conscience est une autre forme du pouvoir qui se manifeste hors de la conscience (Ecclesiastical Institutions, 659). Spencer entend par l que la notion de force en gnral est le sentiment de la force que nous sommes tendu l'univers tout entier; or, c'est ce que l'animisme admet implicitement quand il peuple la nature d'esprits analogues au ntre. Mais quand mme cette hypothse sur la manire dont s'est forme l'ide de force serait vraie, et elle appelle de graves rserves que nous ferons (liv. III, chap. III, III), elle n'a, par elle-mme, rien de religieux; elle n'appelle aucun culte. Il resterait donc que le systme des symboles religieux et des rites, la classification des choses en sacres et en profanes, tout ce qu'il y a de proprement religieux dans la religion ne rpond rien dans le rel. D'ailleurs, ce germe de vrit est aussi, et plus encore, un germe d'erreur ; car s'il est vrai que les forces de la nature et celles de la conscience sont parentes, elles sont aussi profondment distinctes, et c'tait s'exposer de singuliers mcomptes que de les identifier.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
69
que cette question puisse se poser, encore faut-il commencer par admettre que ce sont des choses relles qui sont ainsi reprsentes. Quand les philosophes du XVIIIe sicle faisaient de la religion une vaste erreur imagine par les prtres, ils pouvaient, du moins, en expliquer la persistance par l'intrt que la caste sacerdotale avait tromper les foules. Mais si les peuples eux-mmes ont t les artisans de ces systmes d'ides errones en mme temps qu'ils en taient les dupes, comment cette duperie extraordinaire a-t-elle pu se perptuer sans toute la suite de l'histoire ? On doit mme se demander si, dans ces conditions, le mot de science des religions peut tre employ sans improprit. Une science est une discipline qui, de quelque manire qu'on la conoive, s'applique toujours une ralit donne. La physique et la chimie sont des sciences, parce que les phnomnes physico-chimiques sont rels et d'une ralit qui ne dpend pas des vrits qu'elles dmontrent. Il y a une science psychologique parce qu'il y a rellement des consciences qui ne tiennent pas du psychologue leur droit l'existence. Au contraire, la religion ne saurait survivre la thorie animiste, du jour o celle-ci serait reconnue comme vraie par tous les hommes ; car ils ne pourraient pas ne pas se dprendre des erreurs dont la nature et l'origine leur seraient ainsi rvles. Qu'est-ce qu'une science dont la principale dcouverte consisterait faire vanouir l'objet mme dont elle traite ?
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
70
CHAPITRE III
LES PRINCIPALES CONCEPTIONS DE LA RELIGION LMENTAIRE
(Suite)
II. - Le naturisme
.
Tout autre est l'esprit dont s'inspire l'cole naturiste. Elle se recrute, d'ailleurs, dans des milieux diffrents. Les animistes sont, pour la plupart, des ethnographes ou des anthropologues. Les religions qu'ils ont tudies comptent parmi les plus grossires que l'humanit ait pratiques. De l vient l'importance primordiale qu'ils attribuent aux mes des morts, aux esprits, aux dmons, c'est--dire aux tres spirituels de second ordre : c'est que ces religions n'en connaissent gure qui soient d'un ordre plus lev . Au contraire, les thories que nous allons maintenant exposer sont l'uvre des savants qui se sont surtout occups des grandes civilisations de l'Europe et de l'Asie.
135
Ds que, la suite des frres Grimm, on se fut rendu compte de l'intrt qu'il y avait comparer les unes avec les autres les diffrentes mythologies des peuples indo-europens, on fut vite frapp des remarquables similitudes qu'elles prsentaient. Des personnages mythiques furent identifis qui, sous des noms diffrents, symbolisaient les mmes ides et remplissaient les mmes fonctions; les noms mmes furent rapprochs et l'on crut pouvoir tablir que, parfois, ils n'taient pas sans rapports. De telles ressemblances ne paraissent pouvoir s'expliquer que par une communaut d'origine. On tait donc conduit supposer que ces conceptions, si varies en apparence, provenaient, en ralit, d'un fond commun dont elles n'taient que des formes diversifies et qu'il n'tait pas impossible d'atteindre. Par la mthode
135
C'est aussi, sans doute, ce qui explique la sympathie que semblent avoir prouve pour les ides animistes, des folkloristes comme Mannhardt. Dans les religions populaires, comme dans les religions infrieures, ce sont des tres spirituels de second ordre qui sont au premier plan.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
71
comparative, on devait pouvoir remonter, par del ces grandes religions jusqu' un systme d'ides beaucoup plus ancien, jusqu' une religion vraiment primitive dont les autres seraient drives. Mais ce qui contribua le plus veiller ces ambitions, ce fut la dcouverte des Vedas. Avec les Vedas, en effet, on avait un texte crit dont l'antiquit, sans doute, a pu tre exagre au moment o il fut dcouvert, mais qui ne laisse pas d'tre un des plus anciens dont nous disposions dans une langue indo-europenne. On se trouvait ainsi en tat d'tudier, avec les mthodes ordinaires de la philologie, une littrature aussi ou plus vieille que celle d'Homre, une religion qu'on croyait plus primitive que celle des anciens Germains. Un document d'une telle valeur tait videmment appel jeter une lumire nouvelle sur les dbuts religieux de l'humanit, et la science des religions ne pouvait manquer d'en tre renouvele. La conception qui prit ainsi naissance tait si bien commande par l'tat de la science et la marche gnrale des ides qu'elle se fit jour presque en mme temps dans deux pays diffrents. En 1856, Max Mller en exposait les principes dans ses Oxford Essay . Trois annes plus tard, paraissait le livre d'Adalbert Kuhn sur l'Origine du leu et de la boisson divine qui s'inspire sensiblement du mme esprit. L'ide, une fois mise, se rpandit trs rapidement dans les milieux scientifiques. Au nom de Kuhn est troitement associ celui de son beau-frre Schwartz dont le livre sur l'Origine de la mythologie suivit de prs le prcdent. Steinhal et toute l'cole allemande de la Vlkerpsychologie se rattachent au mme mouvement. En 1863, la thorie fut importe en France par M. Michel Bral . Elle rencontrait si peu de rsistance que, suivant un mot de Gruppe , un temps vint o, en dehors de quelques philologues classiques, trangers aux tudes vdiques, tous les mythologues prenaient comme point de dpart de leurs explications les principes de Max Mller ou de Kuhn . Il importe donc d'examiner en qui ils consistent et ce qu'ils valent.
136 137 138 139 140 141
Comme nul ne les a prsents sous une forme plus systmatique que Max Mller, c'est lui que nous emprunterons de prfrence les lments de l'expos qui va suivre .
142
136 137
138 139
140 141 142
Dans le morceau intitul Comparative Mythology (p. 47 et suiv.). Une traduction franaise en a paru sous ce titre Essai de mythologie compare, Paris-Londres, 1859. Herabkunft des Feuers und Gttertranks, Berlin, 1859 (une nouvelle dition en a t donne par Ernst KUHN en 1886). Cf. Der Schuss des Wilden Jgers auf den Sonnenhirsch, Zeilschrift f. d. Phil., 1, 1869, pp. 89-169; Entwickelungsstufen des Mythus, Abbhandl. d. Berl. Akad., 1873. Der Ursprung der Mythologie, Berlin, 1860. Dans son livre Hercule et Cacus. tude de mythologie compare. L'Essai de mythologie compare de Max MLLER y est signal comme une oeuvre qui marque une poque nouvelle dans l'histoire de la Mythologie (p. 12). Die Griechischen Kulte und Mythen, I, p. 78. Parmi les crivains qui ont adopt cette conception, il faut compter RENAN. V. ses Nouvelles tudes d'histoire religieuse, 1884, p. 31. En dehors de la Comparative Mythology, les travaux de Max MLLER o sont exposes ses thories gnrales sur la religion sont les suivants Hibbert lectures (1878), traduit en franais sous ce titre Origine et dveloppement de la religion. Natural Religion, Londres, 1889. - Physical Religion, Londres, 1898. Anthropological Religion, 1892. - Theosophy or Psychological Religion, 1893. - Nouvelles ludes de mythologie, Paris, F. Alcan, 1898. - Par suite des liens qui unissent les thories mythologiques de Max Mller sa philosophie linguistique, les ouvrages prcdents doivent tre rapprochs de ceux de ses livres
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
72
I
.
Nous avons vu que le postulat sous-entendu de l'animisme est que la religion, son origine tout au moins, n'exprime aucune ralit exprimentale. C'est du principe contraire que part Max Mller. Pour lui, c'est un axiome que la religion repose sur une exprience dont elle tire toute son autorit. La religion, dit-il, pour tenir la place qui lui revient comme lment lgitime de notre conscience, doit, comme toutes nos autres connaissances, commencer par une exprience sensible . Reprenant son compte le vieil adage empirique Nihil est in intellectu quod non ante fuerit in sensu, il l'applique la religion et dclare qu'il ne peut rien y avoir dans la foi qui n'ait t auparavant dans le sens. Voici donc, cette fois, une doctrine qui parat devoir chapper la grave objection que nous adressions l'animisme. Il semble, en effet, que, de ce point de vue, la religion doive ncessairement apparatre, non comme une sorte de vague et confuse rverie, mais comme un systme d'ides et de pratiques bien fondes dans la ralit.
143
Mais quelles sont les sensations gnratrices de la pense religieuse ? Telle est la question que l'tude des Vedas devait aider rsoudre. Les noms qu'y portent les dieux sont gnralement ou des noms communs, encore employs comme tels, ou d'anciens noms communs dont il est possible de retrouver le sens originel. Or, les uns et les autres dsignent les principaux phnomnes de la nature. Ainsi Agni, nom d'une des principales divinits de l'Inde, ne signifiait d'abord que le fait matriel du feu, tel que les sens le peroivent, et sans aucune addition mythologique. Mme dans les Vedas, il est encore employ avec cette acception ; en tout cas, ce qui montre bien que cette signification tait primitive, c'est qu'elle s'est conserve dans d'autres langues indo-europennes : le latin ignis, le lituanien ugnis, l'ancien slave ogny sont videmment proches parents d'Agni. De mme, la parent du sanscrit Dyaus, du Zeus grec, du Jovis latin, du Zio du haut allemand, est aujourd'hui inconteste. Elle prouve que ces mots diffrents dsignent une seule et mme divinit que les diffrents peuples indo-europens reconnaissaient dj comme telle avant leur sparation. Or Dyaus signifie le ciel brillant. Ces faits et d'autres semblables tendent dmontrer que, chez ces peuples, les corps et les forces de la nature furent les premiers objets auxquels se prit le sentiment religieux : ils furent les premires choses divinises. Faisant un pas de plus dans la voie de la gnralisation, Max Mller s'est cru fond conclure que l'volution religieuse de l'humanit en gnral avait eu le mme point de dpart. C'est presque exclusivement par des considrations d'ordre psychologique qu'il justifie cette infrence. Les spectacles varis que la nature offre l'homme lui paraissent remplir toutes
qui sont consacrs au langage ou la logique, notamment Lectures on the Science of Language, traduit en franais sous le titre de Nouvelles leons sur la science du langage, et The Science of Thought. Natural Rel., p. 114.
143
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
73
les conditions ncessaires pour veiller immdiatement dans les esprits l'ide religieuse. Un effet, dit-il, au premier regard que les hommes jetrent sur le monde, rien ne leur parut moins naturel que la nature. La nature tait pour eux la grande surprise, la grande terreur ; c'tait une merveille et un miracle permanent. Ce fut seulement plus tard, quand on dcouvrit leur constance, leur invariabilit, leur retour rgulier, que certains aspects de ce miracle furent appels naturels, en ce sens qu'ils taient prvus, ordinaires, intelligibles... Or c'est ce vaste domaine ouvert aux sentiments de surprise et de crainte, c'est cette merveille, ce miracle, cet immense inconnu oppos ce qui est connu... qui donna la premire impulsion la pense religieuse et au langage religieux .
144
Et, pour illustrer sa pense, il l'applique une force naturelle qui tient une grande place dans la religion vdique, au feu. Essayez, dit-il, de vous transporter par la pense ce stade de la vie primitive o il faut, de toute ncessit, rejeter l'origine et mme les premires phases de la religion de la nature ; vous pourrez aisment vous reprsenter quelle impression dut faire sur l'esprit humain la premire apparition du feu. De quelque manire qu'il se soit manifest l'origine, qu'il soit venu de la foudre, ou qu'on l'ait obtenu en frottant des branches d'arbre les unes contre les autres, ou qu'il ait jailli des pierres sous forme d'tincelles, c'tait quelque chose qui marchait, qui avanait, dont il fallait se prserver, qui portait la destruction avec soi, mais qui, en mme temps, rendait la vie possible pendant l'hiver, qui protgeait pendant la nuit, qui servait la fois d'arme offensive et dfensive. Grce lui, l'homme cessa de dvorer la viande crue et devint un consommateur d'aliments cuits. C'est encore au moyen du feu que, plus tard, se travaillrent les mtaux, que se fabriqurent les instruments et les armes ; il devint ainsi un facteur indispensable de tout progrs technique et artistique. Que serions-nous, mme maintenant, sans le feu ? L'homme, dit le mme auteur dans un autre ouvrage, ne peut pas entrer en rapports avec la nature sans se rendre compte de son immensit, de son infinit. Elle le dborde de toutes parts. Au del des espaces qu'il peroit, il en est d'autres qui s'tendent sans terme ; chacun des moments de la dure est prcd et suivi par un temps auquel aucune limite ne peut tre assigne ; la rivire qui coule manifeste une force infinie, puisque rien ne l'puise . Il n'y a pas d'aspect de la nature qui ne soit apte veiller en nous cette sensation accablante d'un infini qui nous enveloppe et nous domine . Or, c'est de cette sensation que seraient drives les religions .
145 146 147 148
Cependant elles n'y taient qu'en germe . La religion n'est vraiment constitue que quand ces forces naturelles ont cess d'tre reprsentes aux esprits sous la forme abstraite. Il faut qu'elles se transforment en agents personnels, en tres vivants et pensants, en puissances spirituelles, de dieux ; car c'est des tres de ce genre que s'adresse gnralement le culte. On a vu que l'animisme lui-mme est oblig de se poser la question et comment il l'a rsolue : il y
149
144 145 146 147 148 149
Physical Religion, pp. 119-120. Physic. Rel., p. 121 ; cf. p. 304. Natural Religion, p. 121 et suiv., pp, 149-155. The overwhelming pressure of the infinite (Ibid., p. 138). Ibid., pp. 195-196. Max MLLER va jusqu' dire que, tant que la pense n'a pas dpass cette phase, elle n'a que bien peu des caractres que nous attribuons maintenant la religion (Physic. Relig., p. 120).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
74
aurait chez l'homme une sorte d'incapacit native distinguer l'anim de l'inanim et une tendance irrsistible concevoir le second sous la forme du premier. Cette solution, Max Mller la repousse . Suivant lui, c'est le langage qui, par l'action qu'il exerce sur la pense aurait opr cette mtamorphose.
150
On s'explique aisment que, intrigus par ces forces merveilleuses dont ils se sentaient dpendre, les hommes aient t incits y rflchir ; qu'ils se soient demand en quoi elles consistaient et aient fait effort pour substituer, l'obscure sensation qu'ils en avaient primitivement, une ide plus claire, un concept mieux dfini. Mais, dit trs justement notre auteur , l'ide, le concept sont impossibles sans le mot. Le langage n'est pas seulement le revtement extrieur de la pense ; c'en est l'armature interne. Il ne se borne pas la traduire au-dehors une fois qu'elle est forme ; il sert la faire. Cependant, il a une nature qui lui est propre, et, par suite, des lois qui ne sont pas celles de la pense. Puisque donc il contribue l'laborer, il ne peut manquer de lui faire violence en quelque mesure et de la dformer. C'est une dformation de ce genre qui aurait fait le caractre singulier des reprsentations religieuses.
151
Penser, en effet, c'est ordonner nos ides ; c'est, par consquent, classer. Penser le feu, par exemple, c'est le ranger dans telle ou telle catgorie de choses, de manire pourvoir dire qu'il est ceci ou cela, ceci et non cela. Mais, d'un autre ct, classer, c'est nommer; car une ide gnrale n'a d'existence et de ralit que dans et par le mot qui l'exprime et qui fait, lui seul, son individualit. Aussi la langue d'un peuple a-t-elle toujours une influence sur la faon dont sont classes dans les esprits et, par consquent, penses les choses nouvelles qu'il apprend connatre ; car elles sont tenues de s'adapter aux cadres prexistants. Pour cette raison, la langue que parlaient les hommes, quand ils entreprirent de se faire une reprsentation labore de l'univers, marqua le systme d'ides qui prit alors naissance d'une empreinte ineffaable. Nous ne sommes pas sans avoir quelque chose de cette langue au moins pour ce qui regarde les peuples indo-europens. Si lointaine qu'elle soit, il en reste, dans nos langues actuelles, des souvenirs qui nous permettent de nous reprsenter ce qu'elle tait : ce sont les racines. Ces mots-souches, d'o drivent les autres vocables que nous employons et qui se retrouvent la base de tous les idiomes indo-europens, sont considrs par Max Mller comme autant d'chos de la langue que parlaient les peuples correspondants avant leur sparation, c'est--dire au moment o se constitua cette religion de la nature qu'il s'agit prcisment d'expliquer. Or les racines prsentent deux caractres remarquables qui, sans doute, n'ont encore t bien observs que dans ce groupe particulier de langues, mais que notre auteur croit galement vrifiables dans les autres familles linguistiques .
152
D'abord, les racines sont typiques ; c'est--dire qu'elles expriment non des choses particulires, des individus, mais des types et mme des types d'une extrme gnralit. Elles reprsentent les thmes les plus gnraux de la pense ; on y trouve, comme fixes et cristallises, ces catgories fondamentales de l'esprit qui, chaque moment de l'histoire, dominent
150 151 152
Physic. Rel., p. 128. V. The Science of Thought, p. 30. Natural Rel., p. 393 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
75
toute la vie mentale et dont les philosophes ont, bien des fois, tent de reconstituer le systme .
153
En second lieu, les types auxquels elles correspondent sont des types d'action, non d'objets. Ce qu'elles traduisent, ce sont les manires les plus gnrales d'agir que l'on peut observer chez les vivants et, plus spcialement, chez l'homme : c'est l'action de frapper, de pousser, de frotter, de lier, d'lever, de presser, de monter, de descendre, de marcher, etc. En d'autres termes, l'homme a gnralis et nomm ses principaux modes d'action avant de gnraliser et de nommer les phnomnes de la nature .
154
Grce leur extrme gnralit, ces mots pouvaient aisment s'tendre toute sorte d'objets qu'ils ne visaient pas primitivement; c'est d'ailleurs, cette extrme souplesse qui leur a permis de donner naissance aux mots multiples qui en sont drivs. Quand donc l'homme, se tournant vers les choses, entreprit de les nommer afin de pouvoir les penser, il leur appliqua ces vocables bien qu'ils n'eussent pas t faits pour elles. Seulement, en raison de leur origine, ils ne pouvaient dsigner les diffrentes forces de la nature que par celles de leurs manifestations qui ressemblent le plus des actions humaines : la foudre fut appele quelque chose qui creuse le sol en tombant ou qui rpand l'incendie, le vent quelque chose qui gmit ou qui souffle, le soleil quelque chose qui lance travers l'espace des flches dores, la rivire quelque chose qui court, etc. Mais, parce que les phnomnes naturels se trouvaient ainsi assimils des actes humains, ce quelque chose quoi ils taient rapports fut ncessairement conu sous la forme d'agents personnels, plus ou moins semblables l'homme. Ce n'tait qu'une mtaphore, mais qui fut prise la lettre ; l'erreur tait invitable puisque la science qui seule, pouvait dissiper l'illusion, n'existait pas encore. En un mot, parce que le langage tait fait d'lments humains qui traduisaient des tats humains, il ne put s'appliquer la nature sans la transfigurer . Mme aujourd'hui, remarque M. Bral, il nous oblige dans une certaine mesure, nous reprsenter les choses sous cet angle. Nous n'exprimons pas une ide, quand mme elle dsigne une simple qualit, sans lui donner un genre, c'est--dire un sexe ; nous ne pouvons parler d'un objet, qu'il soit considr d'une faon gnrale ou non, sans le dterminer par un article ; tout sujet de la phrase est prsent comme un tre agissant, toute ide comme une action, et chaque acte, qu'il soit transitoire ou permanent, est limit dans sa dure par le temps o nous mettons le verbe . Sans doute, notre culture scientifique nous permet de redresser aisment les erreurs que le langage pourrait nous suggrer ainsi ; mais l'influence du mot dut tre toute-puissante alors qu'elle tait sans contre-poids. Au monde matriel, tel qu'il se rvle nos sens, le langage surajouta donc un monde nouveau, uniquement compos d'tres spirituels qu'il avait crs de toutes pices et qui furent dsormais considrs comme les causes dterminantes des phnomnes physiques.
155 156
153 154 155 156
Physic. Rel., p. 133; The Science of Thought, p. 219; Nouvelles leons sur la science du langage, tome II, p. 1 et suiv. The Science of Thought, p. 272. The Science of Thought, I, p. 327; Physic. Relig., p. 125 et suiv. Mlanges de mythologie et de linguistique, p. 8.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
76
L, d'ailleurs, ne s'arrta pas son action. Une fois que des mots eurent t forgs pour dsigner ces personnalits que l'imagination populaire avait mises derrire les choses, la rflexion s'appliqua ces mots eux-mmes : ils posaient toute sorte d'nigmes et c'est pour rsoudre ces problmes que les mythes furent invents. Il arriva qu'un mme objet reut une pluralit de noms, correspondant la pluralit d'aspects sous lesquels il se prsentait dans l'exprience; c'est ainsi qu'il y a plus de vingt mots dans les Vedas pour dsigner le ciel. Parce que les mots taient diffrents, on crut qu'ils correspondaient autant de personnalits distinctes. Mais en mme temps, on sentait forcment que ces personnalits avaient un air de parent. Pour en rendre compte, on imagina qu'elles formaient une mme famille ; on leur inventa des gnalogies, un tat civil, une histoire. Dans d'autres cas, c'taient des choses diffrentes qui taient dsignes par un mme terme : pour expliquer ces homonymies, on admit que les choses correspondantes taient des transformations les unes des autres, et on forgea de nouvelles fictions pour rendre intelligibles ces mtamorphoses. Ou bien encore un mot qui avait cess d'tre compris fut l'origine de fables destines lui donner un sens. L'uvre cratrice du langage se poursuivit donc en constructions de plus en plus complexes et, mesure que la mythologie vint doter chaque dieu d'une biographie de plus en plus tendue et complte, les personnalits divines, d'abord confondues avec les choses, achevrent de s'en distinguer et de se dterminer. Voil comment se serait constitue la notion du divin. Quant la religion des anctres, elle ne serait qu'un reflet de la prcdente . La notion d'me se serait d'abord forme pour des raisons assez analogues celles que donnait Tylor, sauf que, suivant Max Mller, elle aurait t destine rendre compte de la mort, et non du rve . Puis, sous l'influence de diverses circonstances , en partie accidentelles, les mes des hommes, une fois dgages du corps, auraient t peu peu attires dans le cercle des tres divins et elles auraient ainsi fini par tre elles-mmes divinises. Mais ce nouveau culte ne serait le produit que d'une formation secondaire. C'est ce que prouve, d'ailleurs, le fait que les hommes diviniss ont trs gnralement t des dieux imparfaits, des demi-dieux, que les peuples ont toujours su distinguer des divinits proprement dites .
157 158 159 160
II
.
157 158
159 160
Anthropological Religion, pp. 128-130. L'explication, d'ailleurs, ne vaut pas celle de Tylor. D'aprs Max Mller, l'homme n'aurait pu admettre que la vie s'arrtt avec la mort; d'o il aurait conclu qu'il existe, en lui, deux tres dont l'un survit au corps. On voit mal ce qui pouvait faire croire que la vie continue quand le corps est en pleine dcomposition. V. pour le dtail Anthrop. rel., p. 351 et suiv. Anthrop. rel., p. 130. - Ce qui n'empche pas Max Mller de voir dans le christianisme l'apoge de tout ce dveloppement. La religion des anctres, dit-il, suppose qu'il y a quelque chose de divin dans l'homme. Or, n'est-ce pas l l'ide qui est la base de l'enseignement du Christ ? (ibid., p. 378 et suiv.). Il est inutile d'insister sur ce qu'a d'trange une conception qui fait du christianisme le couronnement du culte des mnes.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
77
Cette doctrine repose, en partie, sur un certain nombre de postulats linguistiques qui ont t et qui sont encore trs discuts. On a contest la ralit de beaucoup de ces concordances que Max Mller croyait observer entre les noms qui dsignent les dieux dans les diffrentes langues europennes. On a surtout mis en doute l'interprtation qu'il en a donne : on s'est demand si, loin d'tre l'indice d'une religion trs primitive, elles ne seraient pas le produit tardif soit d'emprunts directs, soit de rencontres naturelles . D'autre part, on n'admet plus aujourd'hui que les racines aient exist l'tat isol, en qualit de ralits autonomes, ni, par consquent, qu'elles permettent de reconstruire, mme hypothtiquement, la langue primitive des peuples indo-europens . Enfin, des recherches rcentes tendraient prouver que les divinits vdiques n'avaient pas toutes le caractre exclusivement naturiste que leur prtaient Max Mller et son cole . Mais nous laisserons de ct ces questions dont l'examen suppose une comptence trs spciale de linguiste, pour nous en prendre aux principes gnraux du systme. Aussi bien y a-t-il intrt ne pas confondre trop troitement l'ide naturiste avec ces postulats controverss; car elle est admise par nombre de savants qui ne font pas jouer au langage le rle prpondrant que lui attribue Max Mller.
161 162 163
Que l'homme ait intrt connatre le monde qui l'entoure et que, par suite, sa rflexion s'y soit vite applique, c'est ce que tout le monde admettra sans peine. Le concours des choses avec lesquelles il tait immdiatement en rapports lui tait trop ncessaire pour qu'il n'ait pas cherch en scruter la nature. Mais si, comme le prtend le naturisme, c'est de ces rflexions qu'est ne la pense religieuse, il est inexplicable qu'elle ait pu survivre aux premiers essais qui en furent faits et la persistance avec laquelle elle s'est maintenue devient inintelligible. Si, en effet, nous avons besoin de connatre les choses, c'est pour agir d'une manire qui leur soit approprie. Or, la reprsentation que la religion nous donne de l'univers, surtout l'origine, est trop grossirement tronque pour avoir pu susciter des pratiques temporellement utiles. Les choses ne sont rien moins que des tres vivants et pensants, des consciences, des personnalits comme celles dont l'imagination religieuse a fait les agents des phnomnes cosmiques. Ce n'est donc pas en les concevant sous cette forme et en les traitant d'aprs cette conception que l'homme pouvait les faire concourir ses fins. Ce n'est pas en leur adressant des prires, en les clbrant par des ftes ou des sacrifices, en s'imposant des jenes et des privations qu'il pouvait les empcher de lui nuire ou les obliger servir ses desseins. De tels procds ne pouvaient russir que trs exceptionnellement et, pour ainsi dire, miraculeusement. Si donc la raison d'tre de la religion tait de nous donner du monde une reprsentation qui nous guidt dans notre commerce avec lui, elle n'tait pas en tat de s'acquitter de sa fonction et les peuples n'auraient pas tard s'en apercevoir : les checs, infiniment plus frquents que les succs, les eussent bien vite avertis qu'ils faisaient fausse route, et la religion, branle chaque instant par ces dmentis rpts, n'et pu durer.
161 162 163
V. sur ce point la discussion laquelle GRUPPE soumet les hypothses de Max Mller dans Griechische Kulte und Mythen, pp. 79-184. V. MEILLET, Introduction l'tude comparative des langues indo-europennes, 2e d., p. 119. OLDENBERG, La religion du Veda, p. 59 et suiv., MEILLET, Le dieu iranien Mithra, in Journal asiatique, X, no 1, juillet-aot 1907, p. 143 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
78
Sans doute, il arrive parfois qu'une erreur se perptue dans l'histoire ; mais, moins d'un concours de circonstances tout fait exceptionnelles, elle ne peut se maintenir ainsi que si elle se trouve tre Pratiquement vraie, c'est--dire si, sans nous donner des choses auxquelles elle se rapporte une notion thoriquement exacte, elle exprime assez correctement la manire dont elles nous affectent soit en bien, soit en mal. Dans ces conditions, en effet, les mouvements qu'elle dtermine ont toutes chances d'tre, au moins en gros, ceux qui conviennent et, par consquent, on s'explique qu'elle ait pu rsister l'preuve des faits . Mais une erreur et surtout un systme organis d'erreurs qui n'entranent et ne peuvent entraner que des mprises pratiques n'est pas viable. Or, qu'y a-t-il de commun entre les rites par lesquels le fidle essayait d'agir sur la nature, et les procds dont les sciences nous ont appris nous servir et qui, nous le savons maintenant, sont seuls efficaces ? Si c'est l ce que les hommes demandaient la religion, on ne peut comprendre qu'elle ait pu se maintenir, moins que d'habiles artifices ne les aient empchs de reconnatre qu'elle ne leur donnait pas ce qu'ils en attendaient. Il faudrait donc, cette fois encore, en revenir aux explications simplistes du XVIIIe sicle .
164 165
Ainsi, c'est seulement en apparence que le naturisme chappe l'objection que nous adressions nagure l'animisme. Lui aussi fait de la religion un systme d'images hallucinatoires puisqu'il la rduit n'tre qu'une immense mtaphore sans valeur objective. Il lui assigne, sans doute, un point de dpart dans le rel, savoir dans les sensations que provoquent en nous les phnomnes de la nature ; mais, par l'action prestigieuse du langage, cette sensation se transforme en conceptions extravagantes. La pense religieuse n'entre en contact avec la ralit que pour la recouvrir aussitt d'un voile pais qui en dissimule les formes vritables : ce voile, c'est le tissu de croyances fabuleuses qu'ourdit la mythologie. Le croyant vit donc, comme le dlirant, dans un milieu peupl d'tres et de choses qui n'ont qu'une existence verbale. C'est, d'ailleurs, ce que reconnat Max Mller lui-mme, puisqu'il voit dans les mythes le produit d'une maladie de la pense. Primitivement, il les avait attribus une maladie du langage ; mais comme, suivant lui, langage et pense sont sparables, ce qui est vrai de l'un est vrai de l'autre. Lorsque, dit-il, j'ai tent de caractriser brivement la mythologie dans sa nature intime, je l'ai appele maladie du langage plutt que maladie de la pense. Mais, aprs tout ce que j'avais dit, dans mon livre sur La science de la Pense, de l'insparabilit de la pense et du langage et, par consquent, de l'identit absolue d'une maladie du langage et d'une
164 165
Bien des maximes de la sagesse populaire sont dans ce cas. L'argument, il est vrai, n'atteint pas ceux qui voient dans la religion une technique (notamment une hygine), dont les rgles, tout en tant places sous la sanction d'tres imaginaires, ne laissent pas d'tre bien fondes. Mais nous ne nous arrterons pas discuter une conception aussi insoutenable, et qui, en fait, n'a jamais t soutenue d'une manire systmatique par des esprits un peu au courant de l'histoire des religions. Il est difficile de faire voir en quoi les pratiques terribles de l'initiation servent la sant qu'elles compromettent; en quoi les interdictions alimentaires, qui portent trs gnralement sur des animaux parfaitement sains, sont hyginiques ; comment les sacrifices, qui avaient lieu lors de la construction d'une maison, la rendaient plus solide, etc. Sans doute, il y a des prceptes religieux qui se trouvent, en mme temps, avoir une utilit technique ; mais ils sont perdus dans la masse des autres et mme, trs souvent, les services qu'ils rendent ne sont pas sans compensation. S'il y a une prophylaxie religieuse, il y a une salet religieuse qui drive des mmes principes. La rgle qui ordonne d'loigner le mort du camp parce qu'il est le sige d'un esprit redout est pratiquement utile. Mais la mme croyance fait que les parents s'oignent avec les liquides issus du corps en putrfaction, parce qu'ils passent pour avoir des vertus exceptionnelles. Sous le rapport technique, la magie a plus servi que la religion.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
79
maladie de la pense, il semble qu'aucune quivoque n'tait plus possible... Se reprsenter le Dieu suprme comme coupable de tous les crimes, tromp par des hommes, brouill avec sa femme et battant ses enfants, c'est srement un symptme de condition anormale ou maladie de la pense, disons mieux, de folie bien caractrise . Et l'argument ne vaut pas seulement contre Max Mller et sa thorie, mais contre le principe mme du naturisme, de quelque faon qu'on l'applique. Quoi qu'on fasse, si la religion a pour principal objet d'exprimer les forces de la nature, il n'est pas possible d'y voir autre chose qu'un systme de fictions dcevantes dont la survie est incomprhensible.
166
Max Mller, il est vrai, a cru chapper l'objection, dont il sentait la gravit, en distinguant radicalement la mythologie de la religion et en mettant la premire en dehors de la seconde. Il rclame le droit de rserver le nom de religion aux seules croyances qui sont conformes aux prescriptions de la saine morale et aux enseignements d'une thologie rationnelle. Les mythes, au contraire, seraient des dveloppements parasitaires qui, sous l'influence du langage, seraient venus se greffer sur ces reprsentations fondamentales et les dnaturer. Ainsi la croyance Zeus aurait t religieuse dans la mesure o les Grecs voyaient en Zeus le Dieu suprme, pre de l'humanit, protecteur des lois, vengeur des crimes, etc. ; mais tout ce qui concerne la biographie de Zeus, ses mariages, ses aventures, ne serait que mythologie .
167
Mais la distinction est arbitraire. Sans doute, la mythologie intresse l'esthtique en mme temps que la science des religions, mais elle ne laisse pas d'tre un des lments essentiels de la vie religieuse. Si de la religion on retire le mythe, il faut galement en retirer le rite ; car les rites s'adressent le plus gnralement des personnalits dfinies qui ont un nom, un caractre, des attributions dtermines, une histoire, et ils varient suivant la manire dont sont conues ces personnalits. Le culte qu'on rend la divinit dpend de la physionomie qu'on lui attribue : et c'est le mythe qui fixe cette physionomie. Trs souvent mme, le rite n'est pas autre chose que le mythe mis en action; la communion chrtienne est insparable du mythe pascal de qui elle tient tout son sens. Si donc toute mythologie est le produit d'une sorte de dlire verbal, la question que nous posions reste entire : l'existence et surtout la persistance du culte deviennent inexplicables. On ne comprend pas comment, pendant des sicles, les hommes ont pu continuer faire des gestes sans objet. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les traits particuliers des figures divines qui sont ainsi dtermins par les mythes ; l'ide mme qu'il y a des dieux, des tres spirituels, prposs aux divers dpartements de la nature, de quelque manire qu'ils soient reprsents, est essentiellement mythique . Or, si l'on retranche des religions du pass tout ce qui tient la notion des dieux conus comme agents cosmiques, que reste-t-il ? L'ide de la divinit en soi, d'une puissance transcendante dont l'homme dpend et sur laquelle il s'appuie ? Mais c'est l une conception philosophique et abstraite qui ne s'est jamais ralise telle quelle dans aucune religion historique; elle est sans intrt pour la science
168
166 167
168
tudes de mythologie compare, pp. 51-52. V. Nouvelles leons sur la science du langage, II, p. 147, et Physic. Rel., p. 276 et suiv. Dans le mme sens, BRAL, Mlanges, etc., p. 6: Pour apporter dans cette question de l'origine de la mythologie la clart ncessaire, il faut distinguer avec soin les dieux qui sont un produit immdiat de l'intelligence humaine, des fables qui n'en sont qu'un produit indirect et involontaire. C'est ce que reconnat Max MLLER. V. Physic. Rel., p. 132, et Mythologie compare, p. 58 ; les dieux, dit-il, sont nomina et non numina, des noms sans tre et non des tres sans nom .
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
80
des religions . Gardons-nous donc de distinguer entre les croyances religieuses, de retenir les unes parce qu'elles nous paraissent justes et saines, de rejeter les autres comme indignes d'tre appeles religieuses parce qu'elles nous froissent et nous dconcertent. Tous les mythes, mme ceux que nous trouvons le plus draisonnables, ont t des objets de foi . L'homme y a cru, non moins qu' ses propres sensations ; il a rgl d'aprs eux sa conduite. Il est donc impossible, en dpit des apparences, qu'ils soient sans fondement objectif.
169 170
Cependant, dira-t-on, de quelque manire qu'on explique les religions, il est certain qu'elles se sont mprises sur la nature vritable des choses : les sciences en ont fait la preuve. Les modes d'action qu'elles conseillaient ou prescrivaient l'homme ne pouvaient donc avoir que bien rarement des effets utiles : ce n'est pas avec des lustrations qu'on gurit les maladies ni avec des sacrifices ou des chants qu'on fait pousser la moisson. Ainsi l'objection que nous avons faite au naturisme semble s'appliquer tous les systmes d'explication possibles. Il en est un cependant qui y chappe. Supposons que la religion rponde un tout autre besoin que celui de nous adapter aux choses sensibles : elle ne risquera pas d'tre affaiblie par cela seul qu'elle ne satisfait pas ou satisfait mal ce besoin. Si la foi religieuse n'est pas ne pour mettre l'homme en harmonie avec le monde matriel, les fautes qu'elle a pu lui faire commettre dans sa lutte avec le monde, ne l'atteignent pas sa source, parce qu'elle s'alimente une autre source. Si ce n'est pas pour ces raisons qu'on est arriv croire, on devait continuer croire alors mme que ces raisons taient contredites par les faits. On conoit mme que la foi ait pu tre assez forte, non seulement pour supporter ces contradictions, mais pour les nier et pour empcher le croyant d'en apercevoir la porte ; ce qui avait pour effet de les rendre inoffensives pour la religion. Quand le sentiment religieux est vif, il n'admet pas que la religion puisse tre coupable et il suggre facilement des explications qui l'innocentent : si le rite ne produit pas les rsultats attendus, on impute l'chec soit quelque faute d'excution soit l'intervention d'une divinit contraire. Mais pour cela, il faut que les ides religieuses ne tirent pas leur origine d'un sentiment que froissent ces dceptions de l'exprience ; car alors d'o pourrait leur venir leur force de rsistance ?
III
169
170
Max MLLER, il est vrai, soutient que, pour les Grecs, Zeus tait et est rest, malgr tous les obscurcissements mythologiques, le nom de la Divinit suprme (Science du langage, II, p. 173). Nous ne discuterons pas cette assertion, historiquement bien contestable; mais en tout cas, cette conception de Zeus ne put jamais tre qu'une lueur au milieu de toutes les autres croyances religieuses des Grecs. D'ailleurs, dans un ouvrage postrieur, Max MLLER va jusqu' faire de la notion mme de dieu en gnral le produit d'un processus tout verbal et, par consquent, une laboration mythologique (Physic. Rel., P. 138). Sans doute, en dehors des mythes proprement dits, il y a toujours eu des fables qui n'taient pas crues ou, du moins, qui n'taient pas crues de la mme manire et au mme degr, et qui, pour cette raison, n'avaient pas de caractre religieux. La ligne de dmarcation entre contes et mythes est certainement flottante et malaise dterminer. Mais ce n'est pas une raison pour faire de tous les mythes des contes, pas plus que nous ne songeons faire de tous les contes des mythes. Il y a tout au moins un caractre qui, dans nombre de cas, suffit diffrencier le mythe religieux : c'est son rapport avec le culte.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
81
Mais de plus, alors mme que l'homme aurait eu rellement des raisons de s'obstiner, en dpit de tous les mcomptes, exprimer en symboles religieux les phnomnes cosmiques, encore fallait-il que ceux-ci fussent de nature suggrer cette interprtation. Or d'o leur viendrait cette proprit ? Ici encore, nous nous trouvons en prsence d'un de ces postulats qui ne passent pour vidents que parce qu'on n'en a pas fait la critique. On pose comme un axiome qu'il y a dans le jeu naturel des forces physiques tout ce qu'il faut pour veiller en nous l'ide du sacr ; mais quand on examine d'un peu prs les preuves, d'ailleurs sommaires, qui ont t donnes de cette proposition, on constate qu'elle se rduit un prjug. On parle de l'merveillement que devaient ressentir les hommes mesure qu'ils dcouvraient le monde. Mais d'abord, ce qui caractrise la vie de la nature, c'est une rgularit qui va jusqu' la monotonie. Tous les matins, le soleil monte l'horizon, tous les soirs, il se couche ; tous les mois, la lune accomplit le mme cycle ; le fleuve coule d'une manire ininterrompue dans son lit ; les mmes saisons ramnent priodiquement les mmes sensations. Sans doute, ici et l, quelque vnement inattendu se produit : c'est le soleil qui s'clipse, c'est la lune qui disparat derrire les nuages, c'est le fleuve qui dborde, etc. Mais ces perturbations passagres ne peuvent jamais donner naissance qu' des impressions galement passagres, dont le souvenir s'efface au bout d'un temps ; elles ne sauraient donc servir de base ces systmes stables et permanents d'ides et de pratiques qui constituent les religions. Normalement, le cours de la nature est uniforme et l'uniformit ne saurait produire de fortes motions. C'est transporter l'origine de l'histoire des sentiments beaucoup plus rcents que de se reprsenter le sauvage tout rempli d'admiration devant ces merveilles. Il y est trop accoutum pour en tre fortement surpris. Il faut de la culture et de la rflexion pour secouer ce joug de l'accoutumance et dcouvrir tout ce qu'il y a de merveilleux dans cette rgularit mme. D'ailleurs, ainsi que nous en avons fait prcdemment la remarque , il ne suffit pas que nous admirions un objet pour qu'il nous apparaisse comme sacr, c'est--dire pour qu'il soit marqu de ce caractre qui fait apparatre tout contact direct avec lui comme un sacrilge et une profanation. C'est mconnatre ce qu'il y a de spcifique dans le sentiment religieux que de le confondre avec toute impression de surprise admirative.
171
Mais, dit-on, dfaut d'admiration, il y a une impression que l'homme ne peut pas ne pas prouver en prsence de la nature. Il ne peut pas entrer en rapports avec elle sans se rendre compte qu'elle le dborde et le dpasse. Elle l'crase de son immensit. Cette sensation d'un espace infini qui l'entoure, d'un temps infini qui a prcd et qui suivra l'instant prsent, de forces infiniment suprieures celles dont il dispose ne peut manquer, semble-t-il, d'veiller en lui l'ide qu'il existe, hors de lui, une puissance infinie dont il dpend. Or cette ide entre, comme lment essentiel, dans notre conception du divin. Mais rappelons-nous ce qui est en question. Il s'agit de savoir comment l'homme a pu arriver penser qu'il y avait, dans la ralit, deux catgories de choses radicalement htrognes et incomparables entre elles. Comment le spectacle de la nature pourrait-il nous donner l'ide de cette dualit ? La nature est toujours et partout semblable elle-mme. Peu importe
171
V. plus haut, p. 38.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
82
qu'elle s'tende l'infini : au del de la limite extrme o peut parvenir mon regard, elle ne diffre pas de ce qu'elle est en de. L'espace que je conois par del l'horizon est encore de l'espace, identique celui que je vois. Ce temps qui s'coule sans terme est fait de moments identiques ceux que j'ai vcus. L'tendue, comme la dure, se rpte indfiniment; si les portions que j'en atteins n'ont pas, par elles-mmes, de caractre sacr, comment les autres en auraient-elles ? Le fait que je ne les perois pas directement ne suffit pas les transformer . Un monde de choses profanes a beau tre illimit ; il reste un monde profane. On dit que les forces physiques avec lesquelles nous sommes en rapports excdent les ntres ? Mais les forces sacres ne se distinguent pas simplement des profanes par leur grande intensit, elles sont autres ; elles ont des qualits spciales que n'ont pas les secondes. Au contraire, toutes celles qui se manifestent dans l'univers sont de mme nature, celles qui sont en nous comme celles qui sont en dehors de nous. Surtout, il y a aucune raison qui ait pu permettre de prter aux unes une sorte de dignit minente par rapport aux autres. Si donc la religion tait rellement ne du besoin d'assigner des causes aux phnomnes physiques, les forces qui auraient t ainsi imagines ne seraient pas plus sacres que celles que conoit le savant d'aujourd'hui pour rendre compte des mmes faits . C'est dire qu'il n'y aurait pas eu d'tres sacrs ni, par consquent, de religion.
172 173
De plus, supposer mme que cette sensation d'crasement soit rellement suggestive de l'ide religieuse, elle ne pourrait avoir produit cet effet sur le primitif ; car cette sensation, il ne l'a pas. Il n'a nullement conscience que les forces cosmiques soient ce point suprieures aux siennes. Parce que la science n'est pas encore venue lui apprendre la modestie, il s'attribue sur les choses un empire qu'il n'a pas, mais dont l'illusion suffit pour l'empcher de se sentir domin par elles. Il croit pouvoir, comme nous l'avons dit dj, faire la loi aux lments, dchaner le vent, forcer la pluie tomber, arrter le soleil par un geste, etc. . La religion ellemme contribue lui donner cette scurit; car elle est cense l'armer de pouvoirs tendus sur la nature. Les rites sont, en partie, des moyens destins lui permettre d'imposer ses volonts au monde. Loin donc qu'elles soient dues au sentiment que l'homme aurait de sa petitesse en face de l'univers, les religions s'inspirent plutt du sentiment contraire. Mme les plus leves et les plus idalistes ont pour effet de rassurer l'homme dans sa lutte avec les choses : elles professent que la foi est, par elle-mme, capable de soulever les montagnes , c'est--dire de dominer les forces de la nature. Comment pourraient-elles donner cette confiance si elles
174
172
173
174
Il y a, d'ailleurs, dans le langage de Max MLLER, de vritables abus de mots. L'exprience sensible, dit-il, implique, au moins dans certains cas, qu'au del du connu il y a quelque chose d'inconnu, quelque chose que je demande la permission d'appeler infini (Natural Rel., p. 195. Cf. p. 218). L'inconnu n'est pas ncessairement l'infini, pas plus que l'infini n'est ncessairement l'inconnu s'il est, en tous ses points, semblable lui-mme et, par consquent, ce que nous en connaissons. Il faudrait faire la preuve que ce que nous en percevons diffre en nature de ce que nous n'en percevons pas. C'est ce que reconnat involontairement Max MLLER en certains endroits. il confesse voir peu de diffrence entre la notion d'Agni, le dieu du feu, et la notion de l'ther par laquelle le physicien moderne explique la lumire et la chaleur (Physic. Rel., pp. 126-127). Ailleurs, il ramne la notion de divinit celle d'agency (p. 138) ou de causalit qui n'a rien de naturel et de profane. Le fait que la religion reprsente les causes ainsi imagines sous la forme d'agents personnels ne suffit pas expliquer qu'elles aient un caractre sacr. Un agent personnel peut tre profane et, d'ailleurs, bien des forces religieuses sont essentiellement impersonnelles. Nous verrons, en parlant des rites et de la foi en leur efficacit, comment s'expliquent ces illusions (v. liv. II, chap. II).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
83
avaient pour origine une sensation de faiblesse et d'impuissance ? D'ailleurs, si vraiment les choses de la nature taient devenues des tres sacrs en raison de leurs formes imposantes ou de la force qu'elles manifestent, on devrait constater que le soleil, la lune, le ciel, les montagnes, la mer, les vents, en un mot les grandes puissances cosmiques furent les premires tre leves cette dignit ; car il n'en est pas qui soient plus aptes frapper les sens et l'imagination. Or, en fait, elles n'ont t divinises que tardivement. Les premiers tres auxquels s'est adress le culte - on en aura la preuve dans les chapitres qui vont suivre - sont d'humbles vgtaux ou des animaux vis--vis desquels l'homme se trouvait, pour le moins, sur le pied d'galit : c'est le canard, le livre, le kangourou, l'mou, le lzard, la chenille, la grenouille, etc. Leurs qualits objectives ne sauraient videmment tre l'origine des sentiments religieux qu'ils ont inspirs.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
84
CHAPITRE IV
LE TOTMISME COMME RELIGION LMENTAIRE Historique de la question. - Mthode pour la traiter
.
Si opposs, ce qu'il semble, dans leurs conclusions, les deux systmes que nous venons d'tudier concordent cependant sur un point essentiel : ils se posent le problme dans des termes identiques. Tous deux, en effet, entreprennent de construire la notion du divin avec les sensations qu'veillent en nous certains phnomnes naturels, soit physiques soit biologiques. Pour les animistes, c'est le rve, pour les naturistes, ce sont certaines manifestations cosmiques qui auraient t le point de dpart de l'volution religieuse. Mais pour les uns et pour les autres, c'est dans la nature, soit de l'homme soit de l'univers, qu'il faudrait aller chercher le germe de la grande opposition qui spare le profane du sacr. Mais une telle entreprise est impossible : elle suppose une vritable cration ex nihilo. Un fait de l'exprience commune ne peut nous donner l'ide d'une chose qui a pour caractristique d'tre en dehors du monde de l'exprience commune. L'homme, tel qu'il s'apparat lui-mme dans ses songes, n'est pourtant qu'un homme. Les forces naturelles, telles que les peroivent nos sens, ne sont que des forces naturelles, quelle que puisse tre leur intensit. De l vient la commune critique que nous adressions l'une et l'autre doctrine. Pour expliquer comment ces prtendues donnes de la pense religieuse ont pu prendre un caractre sacr que rien ne fonde objectivement, il fallait admettre que tout un mode de reprsentations hallucinatoires est venu s'y superposer, les dnaturer au point de les rendre mconnaissables et substituer la ralit une pure fantasmagorie. Ici, ce sont les illusions du rve qui auraient opr cette transfiguration ; l, c'est le brillant et vain cortge d'images voques par le mot. Mais, dans un cas comme dans l'autre, il fallait en venir voir dans la religion le produit d'une interprtation dlirante.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
85
Une conclusion positive se dgage donc de cet examen critique. Puisque ni l'homme ni la nature n'ont, par eux-mmes de caractre sacr, c'est qu'ils le tiennent d'une autre source. En dehors de l'individu humain et du monde physique, il doit donc y avoir quelque autre ralit par rapport laquelle cette espce de dlire qu'est bien, en un sens, toute religion, prend une signification et une valeur objective. En d'autres termes, par de l ce qu'on a appel le naturisme et l'animisme, il doit y avoir un autre culte, plus fondamental et plus primitif, dont les premiers ne sont vraisemblablement que des formes drives ou des aspects particuliers. Ce culte existe, en effet ; c'est celui auquel les ethnographes ont donn le nom de totmisme.
I
.
C'est seulement la fin du XVIIIe sicle que le mot de totem apparat dans la littrature ethnographique. On le rencontre, pour la premire fois, dans le livre d'un interprte indien. J. Long, qui fut publi Londres en 1791 . Pendant prs d'un demi-sicle, le totmisme ne fut connu que comme une institution exclusivement amricaine . C'est seulement en 1841 que Grey, dans un passage rest clbre , signala l'existence de pratiques tout fait similaires en Australie. On commena ds lors se rendre compte qu'on se trouvait en prsence d'un systme d'une certaine gnralit.
175 176 177
Mais on n'y voyait gure qu'une institution essentiellement archaque, une curiosit ethnographique sans grand intrt pour l'historien. Mac Lennan fut le premier qui ait entrepris de rattacher le totmisme l'histoire gnrale de l'humanit. Dans une srie d'articles, parus dans la Fortnightly Review , il s'effora de montrer, non seulement que le totmisme tait une religion, mais que de cette religion taient drives une multitude de croyances et de pratiques que l'on retrouve dans des systmes religieux beaucoup plus avancs. Il alla mme jusqu' en faire la source de tous les cultes zooltriques et phytoltriques que l'on peut observer chez les peuples anciens. Assurment, cette extension du totmisme tait abusive. Le culte des animaux et des plantes dpend de causes multiples que l'on ne peut sans simplisme, rduire l'unit. Mais ce simplisme, par ses exagrations mmes, avait, du moins, l'avantage de mettre en vidence l'importance historique du totmisme.
178
D'un autre ct les amricanistes s'taient aperus depuis longtemps que le totmisme tait solidaire d'une organisation sociale dtermine : c'est celle qui a pour base la division de la
175 176 177 178
Voyages and Travels of an Indian Interpreter. L'ide tait tellement rpandue que M. RVILLE faisait encore de l'Amrique la terre classique du totmisme (Religions des peuples non civiliss, I, p. 242). Journals of two Expeditions in North-West and Western Australia, II, p. 228. The Worship of Animals and Plants. Totems and Totemism (1869, 1870).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
86
socit en clans . En 1877, dans son Ancient Society , Lewis H. Morgan entreprit d'en faire l'tude, d'en dterminer les caractres distinctifs, en mme temps que d'en faire voir la gnralit dans les tribus indiennes de l'Amrique septentrionale et centrale. Presque au mme moment, et d'ailleurs sous la suggestion directe de Morgan, Fison et Howitt , constataient l'existence du mme systme social en Australie ainsi que ses rapports avec le totmisme.
179 180 181
Sous l'influence de ces ides directrices, les observations purent se poursuivre avec plus de mthode. Les recherches que suscita le Bureau amricain d'ethnologie contriburent, pour une part importante, au progrs de ces tudes . En 1887, les documents taient assez nombreux et assez significatifs pour que Frazer ait jug opportun de les runir et de nous les prsenter dans un tableau systmatique. Tel est l'objet de son petit livre intitul Tolemism o le totmisme est tudi la fois comme religion et comme institution juridique. Mais cette tude tait purement descriptive; aucun effort n'y tait fait soit pour expliquer le totmisme soit pour en approfondir les notions fondamentales.
182 183 184
Robertson Smith est le premier qui ait entrepris ce travail d'laboration. Il sentait plus vivement qu'aucun de ses devanciers combien cette religion grossire et confuse tait riche en germes d'avenir. Sans doute, Me Lennan avait dj rapproch le totmisme des grandes religions de l'antiquit ; mais c'tait uniquement parce qu'il croyait retrouver, ici et l, un culte des animaux et des plantes. Or, rduire le totmisme n'tre qu'une sorte de zooltrie ou de phytoltrie, c'tait n'apercevoir que ce qu'il a de plus superficiel ; c'tait mme en mconnatre la nature vritable. Smith, par del la lettre des croyances totmiques, s'effora d'atteindre les principes profonds dont elles dpendent. Dj, dans son livre sur La parent et le mariage dans l'Arabie primitive , il avait fait voir que le totmisme suppose une consubstantialit, naturelle ou acquise, de l'homme et de l'animal (ou de la plante). Dans sa Religion des Smites , il fit de cette mme ide l'origine premire de tout le systme sacrificiel : c'est au totmisme que l'humanit devrait le principe de la communion alimentaire. Et sans doute, on peut trouver que la thorie de Smith tait unilatrale ; elle n'est plus adquate aux faits actuellement connus ;
185 186
179
180 181 182
183 184
185 186
L'ide se trouve dj exprime trs nettement dans une tude de GALLATIN intitule Synopsis of the Indian Tribes (Archaeologia Americana, II, p. 109 et suiv.), et dans une circulaire de MORGAN, reproduite dans le Cambrian Journal, 1860, p. 149. Ce travail avait, d'ailleurs, t prcd et prpar par deux autres ouvrages du mme auteur : The League of the Iroquois, 1851 et Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, 1871. Kamilaroi and Kurnal, 1880. Ds les premiers tomes de l'Annual Report of the Bureau or American Ethnology, on trouve l'tude de POWELL, Wyandot Government (I, p. 59), celles de CUSHING, Zui Fetisches (Il, p. 9), de SMITH, Myths of the Iroquois (ibid., p. 77), l'important travail de DORSEY, Omaha Sociology, (Ill, p. 211), qui sont autant de contributions l'tude du totmisme. Paru d'abord, sous forme abrge, dans l'Encyclopaedia Britannica. Tylor avait dj, dans sa Primitive Culture, tent une explication du totmisme, sur laquelle nous revenons plus loin, mais que nous ne reproduisons pas ici; car, ramenant le totmisme n'tre qu'un cas particulier du culte des anctres, elle en mconnat totalement l'importance. Nous ne mentionnons dans ce chapitre que les observations ou les thories qui ont fait raliser l'tude du totmisme des progrs importants. Kinship and Marriage in Early Arabia, Cambridge, 1885. The Religion of the Semites, 1re d., 1889. C'est la rdaction d'un cours profess l'Universit d'Aberdeen en 1888. Cf. l'article Sacrifice dans l'Encgclopaedia Britannica.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
87
mais elle ne laissait pas de contenir une vue gniale et elle a exerc, sur la science des religions, la plus fconde influence. C'est de ces mmes conceptions que s'inspire le Golden Bough de Frazer o le totmisme que Me Lennan avait rattach aux religions de l'antiquit classique et Smith celles des socits smitiques, se trouve reli au folklore europen. L'cole de Mc Lennan et celle de Morgan venaient ainsi rejoindre celle de Mannhardt .
187 188
Pendant ce temps, la tradition amricaine continuait se dvelopper avec une indpendance qu'elle a, d'ailleurs, conserve jusqu' des temps tout rcents. Trois groupes de socits furent particulirement l'objet de recherches qui intressent le totmisme. Ce sont, d'abord, les tribus du Nord-Ouest, les Tlinkit, les Haida, les Kwaliutl, les Salish, les Tsimshian; c'est ensuite la grande nation des Sioux; enfin, au centre de l'Amrique, les Indiens des Pueblo. Les premiers furent principalement tudis par Dall, Krause, Boas, Swanton, Hill-Tout ; les seconds par Dorsey ; les derniers par Mindeleff, Mrs. Stevenson, Cushing . Mais, si riche que ft la moisson de faits que l'on recueillait ainsi de toutes parts, les documents dont on disposait restaient fragmentaires. Si les religions amricaines contiennent de nombreuses traces de totmisme, elles ont pourtant dpass la phase proprement totmique. D'autre part, en Australie, les observations n'avaient gure port que sur des croyances parses et des rites isols, rites d'initiation et interdits relatifs au totem. Aussi est-ce avec des faits pris de tous les cts que Frazer avait tent de tracer un tableau d'ensemble du totmisme. Or, quel que soit l'incontestable mrite de cette reconstitution, entreprise dans ces conditions, elle ne pouvait pas ne pas tre incomplte et hypothtique. En dfinitive, on n'avait pas encore vu une religion totmique fonctionner dans son intgralit.
189
C'est seulement dans ces dernires annes que cette grave lacune a t comble. Deux observateurs d'une remarquable sagacit, MM. Baldwin Spencer et F.-J. Gillen, ont, en partie , dcouvert, dans l'intrieur du continent australien, un nombre assez considrable de tribus o ils ont vu pratiquer un systme religieux complet dont les croyances totmiques forment la base et font l'unit. Les rsultats de leur enqute ont t consigns dans deux
190
187 188 189 190
Londres, 1890. Depuis, une seconde dition en trois volumes a paru (1900) et une troisime en cinq volumes est dj en cours de publication. Dans la mme direction, il convient de citer l'intressant ouvrage de Sidney HARTLAND, The Legend of Perseus, 3 vol., 1894-1896. Nous nous bornons donner ici les noms des auteurs; les ouvrages seront indiqus plus tard quand nous les utiliserons. Si Spencer et Gillen ont t les premiers tudier ces tribus d'une manire approfondie, ils ne furent cependant pas les premiers en parler. HOWITT avait signal l'organisation sociale des Wuaramongo (Warlramunga de Spencer et Gillen), ds 1888 dans Further Notes on the Anstralian Classes in Journal of the Anthropological Institute (dsormais J.A.I.), pp. 44-45. Les Arunta avaient dj t sommairement tudis par SCHULZE (The Aborigines of the Upper and Middle Finke River, in Transactions of the Royal Society of South Australia, tome XIV, 2e fasc.) ; l'organisation des Chingalee (les Tjingilli de Spencer et Gillen), des Wombya, etc., par MATHEWS (Wombya Organization of the Australian Aborigines, in American Anthropologist, nouvelle srie, II, p. 494; Divisions of Some West Australian Tribes, ibid., p. 185 ; Proceed. Amer, Philos. Soc., XXXVII, p. 151-152 et Journal Roy. Soc. of N. S. Wales. XXXII, p. 71 et XXXIII, p. 111). Les premiers rsultats de l'enqute faite sur les Arunta avaient, d'ailleurs, t publis dj dans le Report on the Work of the Horn Scientific Expedition to Central Australia, Part. IV (1896). La premire partie de ce Rapport est de STERLIN, la seconde est de GILLEN ; la publication tout entire tait place sous la direction de Baldwin SPENCER.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
88
ouvrages qui ont renouvel l'tude du totmisme. Le premier, The Native Tribes of Central Australia , traite des plus centrales d'entre ces tribus, les Arunta, les Luritcha et, un peu plus au sud, sur le bord occidental du lac Eyre, les Urabunna. Le second, intitul The Northern Tribes of Central Australia , se rapporte aux socits qui sont au nord des Urabunna ; elles occupent le territoire qui va des Macdonnell Ranges jusqu'au golfe de Carpentarie. Ce sont, pour ne citer que les principales, les Unmatjera, les Kaitish, les Warramunga, les Worgaia, les Tjingilli, les Binbinga, les Walpari, les Gnanji et enfin, sur les bords mmes du golfe, les Mara et les Anula .
191 192 193
Plus rcemment, un missionnaire allemand, Carl Strehlow, qui a pass lui aussi de longues annes dans ces mmes socits du centre australien , a commenc publier ses propres observations sur deux de ces tribus, celles des Aranda et des Loritja (Arunda et Luritcha de Spencer et Gillen) . Trs matre de la langue parle par ces peuples , Strehlow a pu nous rapporter un grand nombre de mythes totmiques et de chants religieux qui nous sont donns, pour la plupart, dans leur texte original. Malgr des divergences de dtails qui s'expliquent sans peine et dont l'importance a t grandement exagre , nous verrons que les observations faites par Strehlow, tout en compltant, prcisant, parfois mme rectifiant celles de Spencer et Gillen, les confirment en somme dans tout ce qu'elles ont d'essentiel.
194 195 196 197
Ces dcouvertes suscitrent une abondante littrature sur laquelle nous aurons revenir. Les travaux de Spencer et Gillen surtout exercrent une influence considrable, non seulement parce qu'ils taient les plus anciens, mais parce que les faits y taient prsents sous une forme systmatique qui tait de nature, la fois, orienter les observations ultrieures , et stimuler la spculation. Les rsultats en furent comments, discuts, interprts de toutes les manires. Au mme moment, Howitt, dont les tudes fragmentaires taient disperses dans une multitude
198
191 192 193
194 195
196 197 198
Londres, 1899; dsormais par abrviation, Native Tribes ou Nat. Tr. Londres, 1904; dsormais Northern Tribes ou North. Tr. Nous crivons les Arunta, les Anula, les Tjingilli, etc., sans ajouter ces noms Ils caractristique du pluriel. Il nous parat peu logique d'incorporer, des mots qui ne sont pas franais, un signe grammatical qui n'a de sens que dans notre langue. Nous ne ferons d'exception cette rgle que quand le nom de tribu aura t manifestement francis (les Hurons par exemple). Strehlow est en Australie depuis 1892; il vcut d'abord chez les Dieri; de l, il passa chez les Arunta. Die Aranda- und Loritja-Stmme in Zentral-Australien. Quatre fascicules ont jusqu' prsent t publis; le dernier paraissait au moment o le prsent livre venait d'tre termin. Nous n'avons pu en faire tat. Les deux premiers traitent des mythes et des lgendes, le troisime du culte. Au nom de Strehlow, il est juste d'ajouter celui de von Leonhardi qui a jou dans cette publication un rle important. Non seulement il s'est charg d'diter les manuscrits de Strehlow, mais, sur plus d'un point, par ses questions judicieuses, il a provoqu ce dernier prciser ses observations. On pourra, d'ailleurs, utilement consulter un article que LEONHARDI a donn au Globus et o l'on trouvera de nombreux extraits de sa correspondance avec Strehlow (Ueber einige religise und totemistische Vorstellungen der Aranda und Loritja in Zentral-Australien, in Globus, XCI, p. 285). Cf. sur le mme sujet un article de N.-W. THOMAS paru dans Folk-lore, XVI, p. 428 et suiv. Spencer et Gillen ne l'ignorent pas, mais sont loin de la possder comme Strehlow. Notamment par KLAATSCH, Schlussbericht ber meine Reise nach Australien, in Zeilschrift f. Ethnologie, 1907, p. 635 et suiv. Le livre de K. LANGLOH PARKER, The Euahlayi Tribe, celui d'EYLMANN, Die Eingeborenen der Kolonie Sdaustralien, celui de John MATHEW, Two Representative Tribes of Queensland, certains articles rcents de Mathews tmoignent de l'influence de Spencer et Gillen.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
89
de publications diffrentes , entreprit de faire, pour les tribus du sud, ce que Spencer et Gillen avaient fait pour celles du centre. Dans ses Native Tribes of South-East Australia , il nous donne un tableau d'ensemble de l'organisation sociale des peuples qui occupent l'Australie mridionale, la Nouvelle-Galles du Sud et une bonne partie du Queensland. Les progrs ainsi raliss suggrrent Frazer l'ide de complter son Totemism par une sorte de compendium o l'on trouverait runis tous les documents importants qui se rapportent soit la religion totmique soit l'organisation familiale et matrimoniale dont, tort ou raison, cette religion passe pour tre solidaire. Le but de cet ouvrage n'est pas de nous donner une vue gnrale et systmatique du totmisme, mais plutt de mettre la disposition des travailleurs les matriaux ncessaires pour une construction de ce genre . Les faits y sont disposs dans un ordre strictement ethnographique et gographique : chaque continent et, l'intrieur de chaque continent, chaque tribu ou groupe ethnique sont tudis sparment. Sans doute, une tude aussi tendue, et o tant de peuples divers sont successivement passs en revue, ne pouvait tre galement approfondie dans toutes ses parties ; elle n'en constitue pas moins un brviaire utile consulter et qui peut servir faciliter les recherches.
199 200 201 202
II
.
De ce bref historique il rsulte que l'Australie est le terrain le plus favorable l'tude du totmisme. Nous en ferons, pour cette raison, l'aire principale de notre observation. Dans son Totemism, Frazer s'tait surtout attach relever toutes les traces de totmisme que l'on peut dcouvrir dans l'histoire et dans l'ethnographie. Il fut ainsi amen comprendre dans son tude les socits les plus diffrentes par la nature et le degr de culture : l'ancienne gypte , l'Arabie, la Grce , les Slaves du Sud y figurent ct des tribus de l'Australie et de l'Amrique. Cette manire de procder n'avait rien qui pt surprendre chez un disciple de l'cole anthropologique. Cette cole, en effet, ne cherche pas situer les religions dans les milieux sociaux dont elles font partie et les diffrencier en raison des milieux diffrents
203 204 205 206
199 200
201 202
203 204 205 206
On trouvera la liste de ces publications dans la prface de Nat. Tr., pp. 8 et 9. Londres, 1904. Dsormais, nous citerons ce livre avec l'abrviation Nat. Tr., mais en le faisant toujours prcder du nom de Howitt afin de le distinguer du premier livre de Spencer et Gillen dont nous abrgeons, le titre de la mme manire. Totemism and Exogamy, 4 vol., Londres, 1910. L'ouvrage commence par une rdition de l'opuscule Totemism, reproduit sans changements essentiels. A la fin et au commencement, il est vrai, on trouve des thories gnrales sur le totmisme qui seront exposes et discutes plus loin. Mais ces thories sont relativement indpendantes du recueil de faits qui les accompagne, car elles avaient dj t publies dans diffrents articles de revues, bien avant que l'ouvrage n'ait paru. Ces articles ont t reproduits dans le premier volume (pp. 89-172). Tolemism, p. 12. Ibid., p. 15. Ibid., p. 32. On doit noter que, sous ce rapport, l'ouvrage plus rcent. Totemism and Exogamy marque un progrs
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
90
auxquels elles sont ainsi rapportes. Tout au contraire, comme l'indique le nom mme qu'elle s'est donn, son but est d'atteindre, par del les diffrences nationales et historiques, les bases universelles et vraiment humaines de la vie religieuse. On suppose que l'homme possde de luimme, en vertu de sa constitution propre et indpendamment de toutes conditions sociales, une nature religieuse et on se propose de la terminer .
207
Pour une recherche de ce genre, tous les peuples peuvent tre mis contribution. Sans doute, on interrogera de prfrence les plus primitifs parce que cette nature initiale a plus de chances de s'y montrer nu ; mais puisqu'on peut galement la retrouver chez les plus civiliss, il est naturel qu'ils soient galement appels en tmoignage. A plus forte raison, tous ceux qui passent pour n'tre pas trop loigns des origines, tous ceux que l'on runit confusment sous la rubrique imprcise de sauvages, seront-ils mis sur le mme plan et consults indiffremment. D'autre part, comme, de ce point de vue, les faits n'ont d'intrt que proportionnellement leur degr de gnralit, on se considre comme oblig de les accumuler en aussi grand nombre que possible ; on ne croit pas pouvoir trop tendre le cercle des comparaisons. Telle ne saurait tre notre mthode, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour le sociologue comme pour l'historien, les faits sociaux sont fonction du systme social dont ils font partie; on ne peut donc les comprendre quand on les en dtache. C'est pourquoi deux faits, qui ressortissent deux socits diffrentes, ne peuvent pas tre compars avec fruit par cela seul qu'ils paraissent se ressembler ; mais il faut de plus que ces socits elles-mmes se ressemblent, c'est--dire ne soient que des varits d'une mme espce. La mthode comparative serait impossible s'il n'existait pas de types sociaux, et elle ne peut tre utilement applique qu' l'intrieur d'un mme type. Que d'erreurs n'a-t-on pas commises pour avoir mconnu ce prcepte ! C'est ainsi qu'on a indment rapproch des faits qui, en dpit de ressemblances extrieures, n'avaient ni le mme sens ni la mme porte ; la dmocratie primitive et celle d'aujourd'hui, le collectivisme des socits infrieures et les tendances socialistes actuelles, la monogamie qui est frquente dans les tribus australiennes et celle que sanctionnent nos codes, etc. Dans le livre mme de Frazer on trouve des confusions de ce genre. Il lui est arriv souvent d'assimiler aux pratiques proprement totmiques de simples rites thrioltriques, alors que la distance, parfois norme, qui spare les milieux sociaux correspondants, exclut toute ide d'assimilation. Si donc nous ne voulons pas tomber dans les mmes erreurs, il nous faudra, au lieu de disperser notre recherche sur toutes les socits possibles, la concentrer sur un type nettement dtermin. Il importe mme que cette concentration soit aussi troite que possible. On ne peut comparer utilement que des faits que l'on connat bien. Or, quand on entreprend d'embrasser
important dans la pense et dans la mthode de Frazer. Il s'efforce, toutes les fois o il dcrit les institutions religieuses ou domestiques d'une tribu, de dterminer les conditions gographiques et sociales dans lesquelles cette tribu se trouve place. Si sommaires que soient ces analyses, elles n'en attestent pas moins une rupture avec les vieilles mthodes de l'cole anthropologique. Sans doute, nous aussi nous considrons que l'objet principal de la science des religions est d'arriver saisir ce qui constitue la nature religieuse de l'homme. Seulement, comme nous y voyons, non une donne constitutionnelle, mais un produit de causes sociales, il ne saurait tre question de la dterminer, abstraction faite de tout milieu social.
207
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
91
toutes sortes de socits et de civilisations, on n'en peut connatre aucune avec la comptence qui serait ncessaire ; quand on assemble, pour les rapprocher, des faits de toute provenance, on est oblig de les prendre de toutes mains sans qu'on ait les moyens ni mme le temps d'en faire la critique. Ce sont ces rapprochements tumultueux et sommaires qui ont discrdit la mthode comparative auprs d'un certain nombre de bons esprits. Elle ne peut donner de rsultats srieux que si elle s'applique un nombre assez restreint de socits pour que chacune d'elles puisse tre tudie avec une suffisante prcision. L'essentiel est de choisir celles o l'investigation a le plus de chances d'tre fructueuse. Aussi bien la valeur des faits importe-t-elle beaucoup plus que leur nombre. La question de savoir si le totmisme a t plus ou moins rpandu est, nos yeux, trs secondaire . S'il nous intresse, c'est avant tout parce que, en l'tudiant, nous esprons dcouvrir des rapports de nature mieux nous faire comprendre ce qu'est la religion. Or, pour tablir des rapports, il est ni ncessaire ni toujours utile d'entasser les expriences les unes sur les autres ; il est bien plus important d'en avoir de bien faites et qui soient vraiment significatives. Un fait unique peut mettre une loi en lumire, alors qu'une multitude d'observations imprcises et vagues ne peut produire que confusion. Le savant, dans toute espce de science, serait submerg par les faits qui s'offrent lui s'il ne faisait pas un choix entre eux. Il faut qu'il discerne ceux qui promettent d'tre le plus instructifs, qu'il porte sur eux son attention et se dtourne provisoirement des autres.
208
Voil pourquoi, sous la rserve qui sera ultrieurement indique, nous nous proposons de limiter notre recherche aux socits australiennes. Elles remplissent toutes les conditions qui viennent d'tre numres. Elles sont parfaitement homognes; bien qu'on puisse discerner entre elles des varits, elles ressortissent un mme type. L'homognit en est mme si grande que les cadres de l'organisation sociale non seulement sont les mmes, mais sont dsigns par des noms ou identiques ou quivalents dans une multitude de tribus, parfois trs distantes les unes des autres . D'un autre ct, le totmisme australien est celui sur lequel nous avons les documents les plus complets. Enfin, ce que nous nous proposons avant tout d'tudier dans ce travail, c'est la religion la plus primitive et la plus simple qu'il soit possible d'atteindre. Il est donc naturel que, pour la dcouvrir, nous nous adressions des socits aussi rapproches que possible des origines de l'volution; c'est l videmment que nous avons le plus de chances de la rencontrer et de la bien observer. Or, il n'est pas de socits qui prsentent ce caractre un plus haut degr que les tribus australiennes. Non seulement leur technique est trs rudimentaire, - la maison et mme la hutte y sont encore ignores - mais leur organisation est la plus primitive et la plus simple qui soit connue; c'est celle que nous avons appele ailleurs organisation base de clans. Nous aurons, ds le prochain chapitre, l'occasion d'en rappeler les traits essentiels.
209 210
208 209
210
L'importance que nous attribuons au totmisme est donc tout fait indpendante de la question de savoir s'il a t universel, nous ne saurions trop le rpter. C'est le cas des phratries et des classes matrimoniales; v. sur Ce Point, SPENCER et GILLEN, Northern Tribes, chap. III; HOWITT, Native Tribes of South Australia, p. 109 et 137-142; Thomas, Kinship and Marriage in Australia, chap. VI et VII. Division du travail social, 3e d., p. 150 (Paris, F, Alcan),
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
92
Cependant, tout en faisant de l'Australie l'objet principal de notre recherche, nous croyons utile de ne pas faire compltement abstraction des socits o le totmisme a t dcouvert pour la premire fois, c'est--dire des tribus indiennes de l'Amrique du Nord. Cette extension du champ de la comparaison n'a rien qui ne soit lgitime. Sans doute, ces peuples sont plus avancs que ceux d'Australie. La technique y est devenue beaucoup plus savante : les hommes y vivent dans des maisons ou sous des tentes ; il y a mme des villages fortifis. Le volume de la socit est beaucoup plus considrable et la centralisation, qui fait compltement dfaut en Australie, commence y apparatre ; on y voit de vastes confdrations, comme celle des Iroquois, soumises une autorit centrale. Parfois, on trouve un systme compliqu de classes diffrencies et hirarchises. Cependant, les lignes essentielles de la structure sociale y restent ce qu'elles sont en Australie ; c'est toujours l'organisation base de clans. Nous sommes donc en prsence, non de deux types diffrents, mais de deux varits d'un mme type, et qui sont mme assez proches l'une de l'autre. Ce sont deux moments successifs d'une mme volution ; l'homognit est, par suite, assez grande pour permettre les rapprochements. D'autre part, ces rapprochements peuvent avoir leur utilit. Prcisment parce que la technique des Indiens est bien plus avance que celles des Australiens, certains cts de l'organisation sociale qui leur est commune sont plus aiss tudier chez les premiers que chez les seconds. Tant que les hommes en sont encore faire leurs premiers pas dans l'art d'exprimer leur pense, il n'est pas facile pour l'observateur d'apercevoir ce qui les meut ; car rien ne vient clairement traduire ce qui se passe dans ces consciences obscures qui n'ont d'ellesmmes qu'un sentiment confus et fugace. Les symboles religieux, par exemple, ne consistent alors qu'en informes combinaisons de lignes et de couleurs dont le sens, nous le verrons, n'est pas ais deviner. Il y a bien les gestes, les mouvements par lesquels s'expriment les tats intrieurs ; mais, essentiellement fugitifs, ils se drobent vite l'observation. Voil pourquoi le totmisme a t constat plus tt en Amrique qu'en Australie; c'est parce qu'il y tait plus visible bien qu'il y tnt relativement moins de place dans l'ensemble de la vie religieuse. De plus, l o les croyances et les institutions ne se prennent pas sous une forme matrielle un peu dfinie, elles sont plus exposes changer sous l'influence des moindres circonstances ou s'effacer totalement des mmoires. C'est ainsi que les clans australiens ont quelque chose de flottant et de protimorphe alors que l'organisation correspondante a le plus souvent, en Amrique, une plus grande stabilit et des contours plus nettement arrts. Aussi, bien que le totmisme amricain soit plus loign des origines que celui d'Australie, il y a des particularits importantes dont il nous a mieux conserv le souvenir. En second lieu, pour bien comprendre une institution, il est souvent bon de la suivre jusqu' des phases avances de son volution ; car c'est parfois quand elle est pleine ment dveloppe que sa signification vritable apparat avec le plus de nettet. A ce titre encore, le totmisme amricain, parce qu'il a derrire lui une plus longue histoire, pourra servir clairer
211
211
Bien entendu, il n'en est pas toujours ainsi. Il arrive frquemment, comme nous l'avons dit, que les formes les plus simples aident mieux comprendre les plus complexes. Il n'y pas, sur ce point, de rgle de mthode qui s'applique automatiquement tous les cas possibles.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
93
certains aspects du totmisme australien . En mme temps, il nous mettra mieux en tat d'apercevoir comment le totmisme se relie aux formes religieuses qui ont suivi et de marquer sa place dans l'ensemble du dveloppement historique.
212
Nous ne nous interdirons donc pas d'utiliser, dans les analyses qui vont suivre, certains faits emprunts aux socits indiennes de l'Amrique du Nord. Ce n'est pas qu'il puisse tre question d'tudier ici le totmisme amricain ; une telle tude demande tre faite directement, pour elle-mme, et n'tre pas confondue avec celle que nous allons entreprendre: elle pose d'autres problmes et implique tout un ensemble d'investigations spciales. Nous ne recourrons aux faits amricains qu' titre complmentaire et seulement quand ils nous paratront propres mieux faire comprendre les faits australiens. Ce sont ces derniers qui constituent l'objet vritable et immdiat de notre recherche .
213 214
212 213 214
C'est ainsi que le totmisme individuel d'Amrique nous aidera comprendre le rle et l'importance de celui d'Australie. Comme de dernier est trs rudimentaire, il et probablement pass inaperu. Il n'y a pas, d'ailleurs, en Amrique, un type unique de totmisme, mais des espces diffrentes qu'il serait ncessaire de distinguer. Nous ne sortirons de ce cercle de faits que trs exceptionnellement et quand un rapprochement particulirement instructif nous paratra s'imposer.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
94
LIVRE II
LES CROYANCES LMENTAIRES
.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
95
CHAPITRE PREMIER
LES CROYANCES PROPREMENT TOTMIQUES I. - Le Totem comme nom et comme emblme
.
Notre tude comprendra naturellement deux parties. Puisque toute religion est compose de reprsentations et de pratiques rituelles, nous devrons traiter successivement des croyances et des rites qui sont propres la religion totmique. Sans doute, ces deux lments de la vie religieuse sont trop troitement solidaires pour qu'il soit possible de les sparer radicalement. Bien que, en principe, le culte drive des croyances, il ragit sur elles ; le mythe se modle souvent sur le rite afin d'en rendre compte, surtout quand le sens n'en est pas ou n'en est plus apparent. Inversement, il y a des croyances qui ne se manifestent clairement qu' travers les rites qui les expriment. Les deux parties de l'analyse ne peuvent donc pas ne pas se pntrer. Cependant, ces deux ordres de faits sont trop diffrents pour qu'il ne soit pas indispensable de les tudier sparment. Et comme il est impossible de rien entendre une religion quand on ignore les ides sur lesquelles elle repose, c'est tout d'abord ces dernires qu'il nous faut chercher connatre. Toutefois, notre intention n'est pas de retracer ici toutes les spculations dans lesquelles s'est joue la pense religieuse mme des seuls Australiens. Ce que nous voulons atteindre, ce sont les notions lmentaires qui sont la base de la religion ; mais il ne saurait tre question de les suivre travers tous les dveloppements, parfois si touffus, que leur a donns, ds ces socits, l'imagination mythologique. Certes, nous nous servirons des mythes quand ils pourront nous aider mieux comprendre ces notions fondamentales, mais sans faire de la mythologie elle-mme l'objet de notre tude. D'ailleurs, en tant qu'elle est une uvre d'art, elle ne ressortit pas la seule science des religions. De plus, les processus mentaux dont elle rsulte
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
96
sont d'une trop grande complexit pour qu'ils puissent tre tudis indirectement et de biais. C'est un difficile problme qui demande tre trait en lui-mme, pour lui-mme et d'aprs une mthode qui lui soit spciale. Mais, parmi les croyances sur lesquelles repose la religion totmique, les plus importantes sont naturellement celles qui concernent le totem ; c'est donc par elles qu'il nous faut commencer.
I
.
A la base de la plupart des tribus australiennes, nous trouvons un groupe qui tient dans la vie collective une place prpondrante : c'est le clan. Deux traits essentiels le caractrisent. En premier lieu, les individus qui le composent se considrent comme unis par un lien de parent, mais qui est d'une nature trs spciale. Cette parent ne vient pas de ce qu'ils soutiennent les uns avec les autres des relations dfinies de consanguinit ; ils sont parents par cela seul qu'ils portent un mme nom. Ils ne sont pas pres, mres, fils ou filles, oncles on neveux les uns des autres au sens que nous donnons actuellement ces expressions; et cependant ils se regardent comme formant une mme famille. ou large ou troite suivant les dimensions du clan, par cela seul qu'ils sont collectivement dsigns par le mme mot. Et si nous disons qu'ils se regardent comme d'une mme famille, c'est ce qu'ils se reconnaissent les uns envers les autres des devoirs identiques ceux qui, de tout temps, ont incomb aux parents : devoirs d'assistance, de vendetta, de deuil, obligation de ne pas se marier entre eux, etc. Mais, par ce premier caractre, le clan ne se distingue pas de la gens romaine et du genos grec; car la parent des gentils, elle aussi, venait exclusivement de ce que tous les membres de la gens portaient le mme nom , le nomen gentilicium. Et sans doute, en un sens, la gens est un clan; mais c'est une varit du genre qui ne doit pas tre confondue avec le clan australien . Ce qui diffrencie ce dernier, c'est que le nom qu'il porte est aussi celui d'une espce dtermine de choses matrielles avec lesquelles il croit soutenir des rapports trs particuliers dont nous aurons plus tard dire la nature; ce sont notamment des rapports de parent. L'espce de choses qui sert dsigner collectivement le clan s'appelle son totem. Le totem du clan est aussi celui de chacun de ses membres.
215 216
215 216
C'est la dfinition que Cicron donne de la gentilit : Gentiles surit qui inter se eodem nomine surit (Top. 6). On peut dire, d'une manire gnrale, que le clan est un groupe familial o la parent rsulte uniquement de la communaut du nom; c'est en ce sens que la gens est un clan. Mais, dans le genre ainsi constitu, le clan totmique est une espce particulire.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
97
Chaque clan a son totem qui lui appartient en propre deux clans diffrents d'une mme tribu ne sauraient avoir le mme. En effet, on fait partie d'un clan par cela seul qu'on porte un certain nom. Tous ceux donc qui portent ce nom en sont membres au mme titre; de quelque manire qu'ils soient rpartis sur le territoire tribal, ils soutiennent tous, les uns avec les autres, les mmes rapports de parent . Par consquent, deux groupes qui ont un mme totem ne peuvent tre que deux sections d'un mme clan. Sans doute, il arrive souvent qu'un clan ne rside pas tout entier dans une mme localit, mais compte des reprsentants en des endroits diffrents. Son unit, cependant, ne laisse pas d'tre sentie alors mme qu'elle n'a pas de base gographique.
217
Quant au mot de totem, c'est celui qu'emploient les Ojibway, tribu algonkine, pour dsigner l'espce de choses dont un clan porte le nom . Bien que l'expression n'ait rien d'australien et qu'elle ne se rencontre mme que dans une seule socit d'Amrique, les ethnographes l'ont dfinitivement adopte et s'en servent pour dnommer, d'une manire gnrale, l'institution que nous sommes en train de dcrire. C'est Schoocraft qui, le premier, a ainsi tendu le sens du mot et parl d'un systme totmique . Cette extension, dont il y a d'assez nombreux exemples en ethnographie, n'est assurment pas sans inconvnients. Il n'est pas normal qu'une institution de cette importance porte un nom de fortune, emprunt un idiome troitement local, et qui ne rappelle aucunement les caractres distinctifs de la chose qu'il exprime. Mais aujourd'hui, cette manire d'employer le mot est si universellement accepte qu'il y aurait un excs de purisme s'insurger contre l'usage .
218 219 220 221
Les objets qui servent de totems appartiennent, dans la trs grande gnralit des cas, soit au rgne vgtal soit au rgne animal, mais principalement ce dernier. Quant aux choses inanimes, elles sont beaucoup plus rarement employes. Sur plus de 500 noms totmiques relevs par Howitt parmi les tribus du sud-est australien, il n'y en a gure qu'une quarantaine qui ne soient pas des noms de plantes ou d'animaux : ce sont les nuages, la pluie, la grle, la gele, la lune, le soleil, le vent, l'automne, l't, l'hiver, certaines toiles, le tonnerre, le feu, la fume, l'eau, l'ocre rouge, la mer. On remarquera la place trs restreinte faite aux corps clestes
217
218 219
220 221
Dans une certaine mesure, ces liens de solidarit s'tendent mme par del les frontires de la tribu. Quand des individus de tribus diffrentes ont un mme totem, ils ont les uns envers les autres des devoirs particuliers. Le fait nous est expressment affirm de certaines tribus de l'Amrique du Nord (v. FRAZER, Tolemism and Exogamy, III, pp. 57, 81, 299, 356-357). Les textes relatifs l'Australie sont moins explicites. Il est cependant probable que la prohibition du mariage entre membres d'un mme totem est internationale. MORGAN, Ancient Society, p. 165. En Australie, les mots employs varient suivant les tribus. Dans les rgions observes par Grey, on disait Kobong ; les Dieri disent Murdu (HOWITT, Nat. Tr. of S. E. Aust., p. 91), les Narrinyeri, Mgaitye (TAPLIN, in CURR, Il, p. 244), les Warramunga, Mungai ou Mungaii (North. Tr., p. 754), etc. Indian Tribes of the United States, IV, p. 86. Et cependant cette fortune du mot est d'autant plus regrettable que nous ne savons mme pas avec exactitude comment il s'orthographie. Les uns crivent totam, les autres toodaim, ou dodaim ou ododam, (v. FRAZER, Totemism, p. 1). Le sens mme du terme n'est pas exactement dtermin. Si l'on s'en rapporte au langage tenu par le premier observateur des Ojibway, J. Long, le mot de totam dsignerait le gnie protecteur, le totem individuel dont il sera question plus loin (liv. I, chap. IV) et non le totem de clan. Mais les tmoignages des autres explorateurs sont formellement en sens contraire (v. sur ce point FRAZER, Tolemism and Exogamy, III, pp. 49-52).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
98
et mme, plus gnralement, aux grands phnomnes cosmiques qui, pourtant, taient destins une si grande fortune dans la suite du dveloppement religieux. Parmi tous les clans dont nous parle Howitt, il n'y en a que deux qui aient pour totem la lune , deux le soleil , trois une toile , trois le tonnerre , deux les clairs . La pluie seule fait exception ; elle est, au contraire, trs frquente .
222 223 224 225 226 227
Tels sont les totems que l'on pourrait appeler normaux. Mais le totmisme a ses anomalies. Ainsi, il arrive que le totem est, non pas un objet tout entier, mais une partie d'objet. Le fait parat assez rare en Australie ; Howitt n'en cite qu'un seul exemple . Cependant, il pourrait bien se faire qu'il se rencontrt avec une certaine frquence dans les tribus o les groupes totmiques se sont subdiviss avec excs ; on dirait que les totems eux-mmes ont d se fragmenter pour pouvoir fournir des noms ces multiples divisions. C'est ce qui parat s'tre produit chez les Arunta et les Loritja. Strehlow a relev dans ces deux socits jusqu' 442 totems dont plusieurs dsignent non une espce animale, mais un organe particulier des animaux de cette espce, par exemple, la queue, l'estomac de l'opossum, la graisse du kangourou, etc. .
228 229 230
Nous avons vu que, normalement, le totem n'est pas un individu, mais une espce ou une varit : ce n'est pas tel kangourou, tel corbeau, mais le kangourou ou l'mou en gnral. Parfois, cependant, c'est un objet particulier. Tout d'abord, c'est forcment le cas toutes les fois o c'est une chose unique en son genre qui sert de totem, comme le soleil, la lune, telle constellation, etc. Mais il arrive aussi que des clans tirent leur nom de tel pli ou de telle dpression de terrain, gographiquement dtermins, de telle fourmilire, etc. Nous n'en connaissons, il est vrai, qu'un petit nombre d'exemples en Australie ; Strehlow en cite pourtant quelques-uns . Mais les causes mmes qui ont donn naissance ces totems anormaux dmontrent qu'ils sont d'une origine relativement rcente. En effet, ce qui a fait riger en totems certains emplacements, c'est qu'un anctre mythique passe pour s'y tre arrt ou y avoir accompli quelque acte de sa vie lgendaire . Or ces anctres nous sont, en mme temps,
231 232
222 223 224 225 226 227
228
229 230 231 232
Les Wotjobaluk (p. 121) et les Buandik (p. 123). Les mmes. Les Wolgal (p. 102), les Wotjobaluk et les Buandik. Les Muruburra (p. 177), les Wotjobaluk et les Buandik. Les Buandik et les Kaiabara (p. 116). On remarquera que tous ces exemples sont emprunts cinq tribus seulement. De mme, sur 204 sortes de totems, releves par SPENCER et GILLEN dans un grand nombre de tribus, 188 sont des animaux ou des plantes. Les objets inanims sont le boomerang, l'eau froide, l'obscurit, le feu, l'clair, la lune, l'ocre rouge, la rsine, l'eau sale, l'toile du soir, la pierre, le soleil, l'eau, le tourbillon, le vent, les grlons (North. Tr., p. 773. Cf. FRAZER, Tolemism and Exogamy, I, pp. 253254). FRAZER (Tolemism, pp. 10 et 13) en cite des cas assez nombreux et en fait mme un genre part qu'il appelle split-totems. Mais ces exemples sont emprunts des tribus o le totmisme est profondment altr, comme Samoa ou dans les tribus du Bengale. HOWITT, Nat. Tr., p. 107. V. les tableaux relevs par STREHLOW, Die Aranda-und Loritja-Stmme, II, pp. 61-72 (et. III, p. xiiixvii). Il est remarquable que ces totems fragmentaires soient exclusivement des totems animaux. STREHLOW, Il, pp. 52 et 72. Par exemple, un de ces totems est une cavit o un anctre du totem du Chat sauvage s'est repos; un
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
99
prsents dans les mythes comme appartenant eux-mmes des clans qui avaient des totems parfaitement rguliers, c'est--dire emprunts des espces animales ou vgtales. Les dnominations totmiques qui commmorent les faits et gestes de ces hros ne peuvent donc avoir t primitives, mais elles correspondent une forme de totmisme dj drive et dvie. Il est permis de se demander si les totems mtorologiques n'ont pas la mme origine; car le soleil, la lune, les astres sont souvent identifis avec les anctres de l'poque fabuleuse .
233
Quelquefois, mais non moins exceptionnellement, c'est un anctre ou un groupe d'anctres qui sert directement de totem. Le clan se nomme alors, non d'aprs une chose ou une espce de choses relles, mais d'aprs un tre purement mythique. Spencer et Gillen avaient dj signal deux ou trois totems de ce genre. Chez les Warramunga et chez les Tiingilli, il existe un clan qui porte le nom d'un anctre, appel Thaballa, et qui semble incarner la gaiet . Un autre clan Warramunga porte le nom d'un serpent fabuleux, monstrueux, appel Wollunqua, et dont le clan est cens descendu . Nous devons Strehlow quelques faits similaires . Dans tous les cas, il est assez ais d'entrevoir ce qui a d se passer. Sous l'influence de causes diverses, par le dveloppement mme de la pense mythologique, le totem collectif et impersonnel s'est effac devant certains personnages mythiques qui sont passs au premier rang et qui sont devenus eux-mmes des totems.
234 235 236
Ces diffrentes irrgularits, si intressantes qu'elles puissent tre par ailleurs, n'ont donc rien qui nous oblige modifier notre dfinition du totem. Elles ne constituent pas, comme on l'a cru parfois , autant d'espces de totems plus ou moins irrductibles les unes aux autres et au totem normal, tel que nous l'avons dfini. Ce sont seulement des formes secondaires et parfois aberrantes d'une seule et mme notion qui est, et de beaucoup, la plus gnrale et qu'il y a tout lieu de regarder aussi comme la plus primitive.
237
Quant la manire dont s'acquiert le nom totmique, elle intresse le recrutement et l'organisation du clan plutt que la religion ; elle ressortit donc la sociologie de la famille plus qu' la sociologie religieuse . Aussi nous bornerons-nous indiquer sommairement les
238
233
234
235 236 237 238
autre est une galerie souterraine o un anctre du clan de la souris a creus, etc. (ibid., p. 72). Nat. Tr., p. 561 et suiv. STREHLOW, Il, p. 71, no 12. HOWITT, Nat. Tr., p. 246 et suiv.; On Australian Medicine Mien, J.A.I. XVI, p. 53; Further notes on the Australian Class Systems, J.A.I. XVIII, p. 63 et suiv. Thuballa signifie le garon qui rit, d'aprs la traduction de SPENCER et Gillen. Les membres du clan qui porte son nom croient l'entendre rire dans les rochers qui lui servent de rsidence (North. Tr., p. 207, '215, 227, note). D'aprs le mythe rapport p. 422, il y aurait eu un groupe initial de Thaballa mythiques (cf. p. '208). Le clan des Kati, des hommes pleinement dvelopps, full-grown men comme disent SPENCER et GiLLEN, parat bien tre du mme genre (North. Tr., p. 207). North. Tr., p. 226 et suiv. STREHLOW, II, pp. 71-72. Strehlow cite chez les Loritja et les Arunta un totem qui rappelle de trs prs celui du serpent Wollunqua : c'est le totem du serpent mythique d'eau. C'est le cas de Klaatsch, dans son article dj cit (v. plus haut p. 130, no 3). Ainsi que nous l'avons indiqu dans le chapitre prcdent, le totmisme intresse la fois la question de la religion et la question de la famille, puisque le clan est une famille. Les deux problmes, dans les socits infrieures, sont troitement solidaires. Mais ils sont tous deux trop complexes pour qu'il ne soit
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
100
principes les plus essentiels qui rgissent la matire. Suivant les tribus, trois rgles diffrentes sont en usage. Dans un grand nombre, on peut mme dire le plus grand nombre de socits, l'enfant a pour totem celui de sa mre, par droit de naissance : c'est ce qui arrive chez les Dieri, les Urabunna du centre de l'Australie mridionale : les Wotjobaluk, les Gournditch-Mara de Victoria; les Kamilaroi, le Wiradjuri, les Wonghibon, les Euahlayi de la Nouvelle Galles du Sud; les Wakelbura, les Pitta-Pitta, les Kurnandaburi du Queensland, pour ne citer que les noms les plus importants. Dans ce cas, comme, en vertu de la rgle exogamique, la mre est obligatoirement d'un autre totem que son mari et comme, d'autre part, elle vit dans la localit de ce dernier, les membres d'un mme totem sont ncessairement disperss entre des localits diffrentes suivant les hasards des mariages qui se contractent. Il en rsulte que le groupe totmique manque de base territoriale. Ailleurs, le totem se transmet en ligne paternelle. Cette fois, l'enfant restant auprs de son pre, le groupe local est essentiellement form de gens qui appartiennent au mme totem ; seules les femmes maries y reprsentent des totems trangers. Autrement dit, chaque localit a son totem particulier. Jusqu' des temps rcents, ce mode d'organisation n'avait t rencontr, en Australie, que dans des tribus o le totmisme est en voie de dcadence, par exemple chez les Narrinyeri, o le totem n'a presque plus de caractre religieux . On tait donc fond croire qu'il y avait un rapport troit entre le systme totmique et la filiation en ligne utrine. Mais Spencer et Gillen ont observ, dans la partie septentrionale du centre australien, tout un groupe de tribus o la religion totmique est encore pratique et o pourtant la transmission du totem se fait en ligne paternelle : ce sont les Warramunga, les Gnanji, les Umbaia, les Binbinga, les Mara, et les Anula .
239 240
Enfin, une troisime combinaison est celle que l'on observe chez les Arunta et les Loritja. Ici, le totem de l'enfant n'est ncessairement ni celui de sa mre ni celui de son pre ; c'est celui de l'anctre mythique qui, par des procds que les observateurs nous rapportent de manires diffrentes , est venu fconder mystiquement la mre au moment de la conception. Une technique dtermine permet de reconnatre quel est cet anctre et quel groupe totmique il appartient . Mais, comme c'est le hasard qui fait que tel anctre s'est trouv proximit de la
241 242
239 240
241
242
pas indispensable de les traiter sparment. On ne peut, d'ailleurs, comprendre l'organisation familiale primitive avant de connatre les ides religieuses primitives ; car celles-ci servent de principes celle-l. C'est pourquoi il tait ncessaire d'tudier le totmisme comme religion, avant d'tudier le clan totmique comme groupement familial. V. TAPLIN, The Narrinyeri Tribe, CURR, II, pp. 244-245 ; HOWITT, Nat. Tr., p. 131. North. Tr., pp. 163, 169, 170, 172. Il y a toutefois lieu de noter que dans toutes ces tribus, sauf les Mara et les Anula, la transmission du totem en ligne paternelle ne serait que le fait le plus gnral, mais comporterait des exceptions. Suivant SPENCER et GILLEN (Nat. Tr., p. 123 et suiv.), l'me de l'anctre se rincarnerait dans le corps de la mre et deviendrait l'me de l'enfant; suivant STREHLOW (II, p. 51 et suiv.) la conception, tout en tant l'couvre de l'anctre, n'impliquerait pas une rincarnation; mais, dans l'une et l'autre interprtation, le totem propre de l'enfant ne dpend pas ncessairement de celui de ses parents. Nat. Tr., p. 133; STREHLOW, II, p. 53.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
101
mre plutt que tel autre, le totem de l'enfant se trouve finalement dpendre de circonstances fortuites .
243
En dehors et au-dessus des totems de clans, il y a les totems de phratries qui, sans diffrer en nature des premiers, demandent pourtant en tre distingus. On appelle phratrie un groupe de clans qui sont unis entre eux par des liens particuliers de fraternit. Normalement, une tribu australienne est divise en deux phratries entre lesquelles sont rpartis les diffrents clans. Il y a, sans doute, des socits o cette organisation a disparu ; mais tout fait croire qu'elle a t gnrale. En tout cas, il n'existe pas, en Australie, de tribu o le nombre des phratries soit suprieur deux. Or, dans presque tous les cas o les phratries portent un nom dont le sens a pu tre tabli, ce nom se trouve tre celui d'un animal ; c'est donc, semble-t-il, un totem. C'est ce qu'a bien dmontr A. Lang dans un rcent ouvrage . Ainsi, chez les Gournditch-Mara (Victoria), les phratries s'appellent l'une Krokitch et l'autre Kaputch; le premier de ces mots signifie kakatos blanc, le second, kakatos noir . Les mmes expressions se retrouvent, en totalit ou en partie, chez les Buandik et les Wotjobaluk . Chez les Wurunjerri, les noms employs sont ceux de Bunfil et de Waang qui veulent dire aigle-faucon et corbeau . Les mots de Mukwara et de Kilpara sont usits pour le mme objet dans un grand nombre de tribus de la Nouvelles Galles du Sud ; ils dsignent les mmes animaux . C'est galement l'aigle-faucon et le corbeau qui ont donn leurs noms aux deux phratries des Ngarigo, des Wolgal . Chez les Kuinmurbura, c'est le kakatos blanc et le corbeau . On pourrait citer d'autres exemples. On en vient ainsi voir dans la phratrie un ancien clan qui se serait dmembr; les clans actuels seraient le produit de ce dmembrement, et la solidarit qui les unit, un souvenir de leur primitive unit . Il est vrai que, dans certaines tribus, les phratries n'ont plus, semble-t-il, de noms dtermins ; dans d'autres, o ces noms existent, le sens n'en est plus connu mme des indignes. Mais il n'y a
244 245 246 247 248 249 250 251 252
243
244 245 246 247 248 249 250 251 252
C'est, en grande partie, la localit o la mre croit avoir conu qui dtermine le totem de l'enfant. Chaque totem, comme nous le verrons, a son centre, et les anctres frquentent de prfrence les endroits qui servent de centres leurs totems respectifs. Le totem de l'enfant est donc celui auquel ressortit la localit o la mre croit avoir conu. D'ailleurs, comme celle-ci doit se trouver plus souvent dans le voisinage de l'endroit qui sert de centre totmique son mari, l'enfant doit tre le plus gnralement du mme totem que le pre. C'est ce qui explique, sans doute, comment, dans chaque localit, la majeure partie des habitants appartiennent au mme totem (Nat. Tr., p. 9). The secret of the Totem, p. 159 et suiv. Cf. FISON et HOWITT, Kamilaroi and Kurnai, pp. 40 et 41 ; John MATHEW, Eaglehawk and Crow; THOMAS, Kinship and Marriage in Australia, p. 52 et suiv. HOWITT, Nat. Tr., p. 124. HOWITT, Op. cit., pp. 121, 123, 124. CURR, III, p. 461. HOWITT, p. 126. HOWITT, p. 98 et suiv. CURR, II, p. 165; Brough SMYTH, 1, p. 423; HOWITT, op. cit., p. 429. HOWITT, pp. 101, 102. J. MATHEW, Two Representative Tribes of Queensland, p. 139. On pourrait, l'appui de cette hypothse, donner d'autres raisons; mais il faudrait faire intervenir des considrations relatives l'organisation familiale, et nous tenons sparer les deux tudes. La question, d'ailleurs, n'intresse que secondairement notre sujet.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
102
rien l qui puisse surprendre. Les phratries sont certainement une institution primitive, car elles sont partout en voie de rgression ; ce sont les clans, issus d'elles, qui sont passs au premier plan. Il est donc naturel que les noms qu'elles portaient se soient peu peu effacs des mmoires, ou qu'on ait cess de les comprendre ; car ils devaient appartenir une langue trs archaque qui n'est plus en usage. Ce qui le prouve, c'est que, dans plusieurs cas o nous savons de quel animal la phratrie porte le nom, le mot qui dsigne cet animal dans la langue courante est entirement diffrent de celui qui sert la dnommer .
253
Entre le totem de la phratrie et les totems des clans, il existe comme un rapport de subordination. En effet, chaque clan, en principe, appartient une phratrie et une seule; il est tout fait exceptionnel qu'il compte des reprsentants dans l'autre phratrie. Le cas ne se rencontre gure que dans certaines tribus du centre, notamment chez les Arunta ; encore, mme l o, sous des influences perturbatrices, il se produit des chevauchements de ce genre, le gros du clan est tout entier compris dans une des deux moitis de la tribu; seule, une minorit se trouve de l'autre ct . La rgle est donc que les deux phratries ne se pntrent pas ; par suite, le cercle des totems que peut porter un individu est prdtermin par la phratrie laquelle il appartient. Autrement dit, le totem de la phratrie est comme un genre dont les totems des clans sont des espces. Nous verrons plus loin que ce rapprochement n'est pas purement mtaphorique.
254 255
Outre les phratries et les clans, on trouve souvent dans les socits australiennes un autre groupe secondaire qui n'est pas sans avoir une certaine individualit : ce sont les classes matrimoniales. On appelle de ce nom des subdivisions de la phratrie qui sont en nombre variable suivant les tribus : on en trouve tantt deux et tantt quatre par phratrie . Leur recrutement et leur fonctionnement sont rgls parles deux principes suivants. 1 Dans chaque phratrie, chaque gnration appartient une autre classe que la gnration immdiatement prcdente. Quand donc il n'y a que deux classes par phratrie, elles alternent ncessairement l'une avec l'autre chaque gnration. Les enfants sont de la classe dont leurs parents ne font pas partie ; mais les petits-enfants sont de la mme que leurs grands-parents. Ainsi, chez les Kamilaroi la phratrie
256
253
254
255 256
Par exemple, Mukwara, qui dsigne une phratrie chez les Barkinji, les Paruinji, les Milpulko, signifie, d'aprs Brough Smyth, aigle-faucon; or, parmi les clans compris dans cette phratrie, il en est un qui a pour totem l'aigle-faucon. Mais ici, cet animal est dsign par le mot de Bilyara. On trouvera plusieurs cas du mme genre, cits par LANG, Op. cit., p. 162. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 115. D'aprs HOWITT (Op. cit., pp. 121 et 454), chez les Wotjobaluk, le clan du Plican serait galement reprsent dans les deux phratries. Le fait nous parat douteux. Il serait trs possible que ces deux clans aient pour totems deux espces diffrentes de plicans. C'est ce qui semble ressortir des indications donnes par MATHEWS sur la mme tribu (Aboriginal Tribes of no S. Wales a. Victoria in Journal and Proceedings of the Royal Society of N. S. Wales, 1904, pp. 287288). V. sur cette question notre mmoire sur : Le totmisme, in Anne sociologique, tome V, p. 82 et suiv. V. sur cette, question des classes australiennes en gnral notre mmoire sur La prohibition de l'inceste, in Anne sociol., I, p. 9 et suiv., et plus spcialement sur les tribus huit classes L'organisation matrimoniale des socits australiennes, in Anne sociol., VIII, pp. 118-147.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
103
Kupathin comprend deux classes, Ippai et Kumbo ; la phratrie Dilbi, deux autres qui s'appellent Murri et Kubbi. Comme la filiation se fait en ligne utrine, l'enfant est de la phratrie de sa mre; si elle est une Kupathin, il sera lui-mme un Kupathin. Mais si elle est de la classe Ippai, il sera un Kumbo ; puis ses enfants, s'il est une fille, compteront de nouveau dans la classe Ippai. De mme, les enfants des femmes de la classe Murri seront de la classe Kubbi, et les enfants des femmes de Kubbi seront des Murri de nouveau. Quand il y a quatre classes par phratrie, au lieu de deux, le systme est plus complexe, mais le principe est le mme. Ces quatre classes, en effet, forment deux couples de deux classes chacun, et ces deux classes alternent l'une avec l'autre, chaque gnration, de la manire qui vient d'tre indique. 2 Les membres d'une classe ne peuvent, en principe , contracter mariage que dans une seule des classes de l'autre phratrie. Les Ippai doivent se marier dans la classe Kubbi; les Murri, dans la classe Kumbo. C'est parce que cette organisation affecte profondment les rapports matrimoniaux que nous donnons ces groupements le nom de classes matrimoniales.
257
Or, on s'est demand si ces classes n'avaient pas parfois des totems comme les phratries et comme les clans. Ce qui a pos la question, c'est que, dans certaines tribus du Queensland, chaque classe matrimoniale est soumise des interdictions alimentaires qui lui sont spciales. Les individus qui la composent doivent s'abstenir de la chair de certains animaux que les autres classes peuvent librement consommer . Ces animaux ne seraient-ils pas des totems ?
258
Mais l'interdiction alimentaire n'est pas le signe caractristique du totmisme. Le totem est, d'abord et avant tout, un nom, et comme nous le verrons, un emblme. Or, dans les socits dont il vient d'tre question, il n'existe pas de classe matrimoniale qui porte un nom d'animal ou de plante ou qui se serve d'un emblme . Il est possible, sans doute, que ces prohibitions soient indirectement drives du totmisme. On peut supposer que les animaux que protgent ces interdits servaient primitivement de totems des clans qui auraient disparu, tandis que les classes matrimoniales se seraient maintenues. Il est certain, en effet, qu'elles ont parfois une force de rsistance que n'ont pas les clans. Par suite, les interdictions, destitues de leurs supports primitifs, se seraient gnralises dans l'tendue de chaque classe, puisqu'il n'existait plus d'autres groupements auxquels elles pussent se rattacher. Mais on voit que, si cette rglementation est ne du totmisme, elle n'en reprsente plus qu'une forme affaiblie et
259
257
258 259
Ce principe ne s'est pas maintenu partout avec une gale rigueur. Dans les tribus du centre huit classes, notamment, outre la classe avec laquelle le mariage est rgulirement permis, il en est une autre avec laquelle on a une sorte de connubium secondaire (SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 106). Il en est de mme dans certaines tribus quatre classes. Chaque classe a le choix entre les deux classes de l'autre phratrie. C'est le cas des Kabi (v. MATHEW, in CURR, III, p. 162). V. ROTH, Ethnological Studies among the North- West-Central Queensland Aborigines, p. 56 et suiv.; PALMER, Notes on some Australian Tribes, J.A.I., XIII (1884), p. 302 et suiv. On cite cependant quelques tribus o des classes matrimoniales porteraient des noms d'animaux ou de plantes : c'est le cas des Kabi (MATHEW, Two Representative Tribes, p. 150), des tribus observes par Mrs BATES (The Marriage Laws a. Customs. of the W. Austral. Aborigines, in Victorian Geographical Journal, XXIII-XXIV, p. 47) et peuttre de deux tribus observes par Palmer. Mais ces faits sont trs rares, leur signification mal tablie. D'ailleurs, il n'est pas surprenant que les classes, aussi bien que les groupes sexuels, aient parfois adopt des noms d'animaux. Cette extension exceptionnelle des dnominations totmiques ne modifie en rien notre conception du totmisme.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
104
dnature .
260
Tout ce qui vient d'tre dit du totem dans les socits australiennes S'applique aux tribus indiennes de l'Amrique du Nord. Toute la diffrence est que, chez ces dernires, l'organisation totmique a une fermet de contours et une stabilit qui lui font dfaut en Australie. Les clans australiens ne sont pas simplement trs nombreux ; ils sont, pour une mme tribu, en nombre presque illimit. Les observateurs en citent quelques-uns titre d'exemples, mais sans russir jamais nous en donner une liste complte. C'est qu' aucun moment cette liste n'est dfinitivement arrte. Le mme processus de segmentation qui a dmembr primitivement la phratrie et qui a donn naissance aux clans proprement dits, se continue sans terme l'intrieur de ces derniers ; par suite de cet miettement progressif, un clan n'a souvent qu'un effectif des plus rduits . En Amrique, au contraire, le systme totmique a des formes mieux dfinies. Bien que les tribus y soient, en moyenne, sensiblement plus volumineuses qu'en Australie, les clans y sont moins nombreux. Une mme tribu en compte rarement plus d'une dizaine , et souvent moins ; chacun d'eux constitue donc un groupement beaucoup plus important. Mais surtout le nombre en est mieux dtermin : on sait combien il y en a et on nous le dit .
261 262 263
Cette diffrence tient la supriorit de la technique sociale. Les groupes sociaux, ds le moment o ces tribus ont t observes pour la premire fois, taient fortement enracins dans le sol, par suite, plus capables de rsister aux forces dispersives qui les assaillaient. En mme temps, la socit avait dj un trop vif sentiment de son unit pour rester inconsciente d'ellemme et des parties qui la composaient. L'exemple de l'Amrique nous sert ainsi nous mieux rendre compte de ce qu'est l'organisation base de clans. On se tromperait si l'on ne jugeait de cette dernire que d'aprs l'aspect qu'elle prsente actuellement en Australie. Elle y est, en
260
261
262
263
La mme explication s'applique peut-tre quelques autres tribus du Sud-Est et de l'Est, o, si l'on en croit les informateurs de Howitt, on trouverait galement des totems spcialement affects chaque classe matrimoniale. Ce serait le cas chez les Wiradjuri, les Wakelbura, les Bunta-Murra de la rivire Bulloo (HOWITT, Nat. Tr., pp. 210, 221, 226). Toutefois, les tmoignages qu'il a recueillis sont, de son propre aveu, suspects. En fait, des listes mmes qu'il a dresses, il rsulte que plusieurs totems se retrouvent galement dans les deux classes de la mme phratrie. L'explication que nous proposons d'aprs FRAZER (Totemism and Exogamy, p. 531 et suiv.) soulve, d'ailleurs, une difficult. En principe, chaque clan, et, par consquent, chaque totem sont indiffremment reprsents dans les deux classes d'une mme phratrie, puisque l'une de ces classes est celle des enfants et l'autre celle des parents de qui les premiers tiennent leurs totems. Quand donc, les clans disparurent, les interdictions totmiques qui survivaient auraient d rester communes aux deux classes matrimoniales, tandis que, dans les cas cits, chaque classe a les siennes propres. D'o provient cette diffrenciation ? L'exemple des Kaiabara (tribu du sud du Queensland) permet peut-tre d'entrevoir comment cette diffrenciation s'est produite. Dans cette tribu, les enfants ont le totem de leur mre, mais particularis au moyen d'un signe distinctif. Si la mre a pour totem l'aigle-faucon noir, celui de l'enfant est l'aigle-faucon blanc (HOWITT, Nat. Tr., p. 229). Il y a l comme une premire tendance des totems se diffrencier suivant les classes matrimoniales. Une tribu de quelques centaines de ttes compte parfois jusqu' 50 ou 60 clans et mme beaucoup plus. Voir sur ce point DURKHEIM et Mauss, De quelques formes primitives de classification, in Anne sociologique, tome VI, p. 28 no 1. Sauf chez les Indiens Pueblo du Sud-Ouest o ils sont plus nombreux. V. HODGE, Pueblo Indian Clans, in American Anthropologist, 1re srie, tome IX, p. 345 et suiv. On peut se demander toutefois si les groupes qui portent ces totems sont des clans ou des sous-clans. V. les tableaux dresss par MORGAN dans Ancient Society, pp. 153-185.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
105
effet, dans un tat de flottement et de dissolution qui n'a rien de normal ; il y faut voir bien plutt le produit d'une dgnrescence, imputable aussi bien l'usure naturelle du temps qu' l'action dsorganisatrice des blancs. Sans doute, il est peu probable que les clans australiens aient jamais eu les dimensions et la solide structure des clans amricains. Cependant, il a d y avoir un temps o la distance entre les uns et les autres tait moins considrable qu'aujourd'hui ; car les socits d'Amrique n'auraient jamais russi se faire une aussi solide ossature si le clan avait toujours t fait d'une matire aussi fluide et inconsistante. Cette stabilit plus grande a mme permis au systme archaque des phratries de se maintenir en Amrique avec une nettet et un relief qu'il n'a plus en Australie. Nous venons de voir que, sur ce dernier continent, la phratrie est partout en dcadence ; trs souvent, ce n'est plus qu'un groupement anonyme ; quand elle a un nom, ou il n'est plus compris ou, en tout cas, il ne peut plus dire grand-chose l'esprit de l'indigne, puisqu'il est emprunt une langue trangre ou qui ne se parle plus. Aussi n'avons-nous pu infrer l'existence des totems de phratries que d'aprs quelques survivances, si peu marques, pour la plupart, quelles ont chapp nombre d'observateurs. Au contraire, sur certains points de l'Amrique, ce mme systme est rest au premier plan. Les tribus de la cte du Nord-Ouest, les Tlinkit et les Haida notamment, sont dj parvenues un degr de civilisation relativement avanc ; et cependant, elles sont divises en deux phratries qui se subdivisent leur tour en un certain nombre de clans : phratries du Corbeau et du Loup chez les Tlinkit , de l'Aigle et du Corbeau chez les Haida . Et cette division n'est pas simplement nominale ; elle correspond un tat toujours actuel des murs et marque profondment la vie. La distance morale qui spare les clans est peu de chose ct de celle qui spare les phratries . Le nom que chacune d'elles porte n'est pas seulement un mot dont on a oubli ou dont on ne sait plus que vaguement le sens ; c'est un totem dans toute la force du terme ; il en a tous les attributs essentiels, tels qu'ils seront dcrits plus loin . Sur ce point encore, par consquent, il y avait intrt ne pas ngliger les tribus d'Amrique, puisque nous pouvons y observer directement de ces totems de phratries dont l'Australie ne nous offre plus que d'obscurs vestiges.
264 265 266 267
II
264 265 266
267
KRAUSE, Die Tlinkit-Indianer, p. 112; SWANTON, Social Condition, Beliefs a. Linguistic Relationship of the Tlingit Indians in XXVIth Rep., p. 398. SWANTON, Contributions Io the Ethnology of the Haida, p. 62. The distinction between the two clans is absolute in every respect , dit Swanton, p. 68; il appelle clans ce que nous nommons phratries. Les deux phratries, dit-il ailleurs, sont, l'une par rapport l'autre, comme deux peuples trangers. Le totem des clans proprement dits est mme, au moins chez log Haida, plus altr que le totem des phratries. L'usage, en effet, permettant un clan de donner ou de vendre le droit de porter son totem, il en rsulte que chaque clan a une pluralit de totems dont quelquesuns lui sont communs avec d'autres clans (v. SWANTON, pp. 107 et 268). Parce que Swanton appelle clans les phratries, il est oblig de donner le nom de famille aux clans proprement dits, et de household aux familles vritables. Mais le sens rel de la terminologie qu'il adopte n'est pas douteux.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
106
Mais le totem n'est pas seulement un nom; c'est un emblme, un vritable blason, dont les analogies avec le blason hraldique ont t souvent remarques. Chaque famille, dit Grey en parlant des Australiens, adopte un animal ou un vgtal comme son cusson et sa marque, (as their crest and sign) ; et ce que Grey appelle une famille est incontestablement un clan. L'organisation australienne, disent galement Fison et Howitt, montre que le totem est, avant tout, le blason d'un groupe (the badge of a group) . Schoolcraft s'exprime dans les mmes termes sur les totems des Indiens de l'Amrique du Nord : Le totem, dit-il, est, en fait, un dessin qui correspond aux emblmes hraldiques des nations civilises, et que chaque personne est autorise porter comme preuve de l'identit de la famille laquelle elle appartient. C'est que dmontre l'tymologie vritable du mot lequel est driv de dodaim qui signifie village ou rsidence d'un groupe familial . Aussi, quand les Indiens entrrent en relations avec les Europens et que des contrats se formrent entre les uns et les autres, c'est de son totem que chaque clan scellait les traits ainsi conclus .
268 269 270 271
Les nobles de l'poque fodale sculptaient, gravaient, figuraient de toutes les manires leurs armoiries sur les murs de leurs chteaux, sur leurs armes, sur les objets de toute sorte qui leur appartenaient : les noirs de l'Australie, les Indiens de l'Amrique du Nord font de mme pour leurs totems. Les Indiens qui accompagnaient Samuel Hearne peignaient leurs totems sur leurs boucliers avant d'aller au combat . D'aprs Charlevoix, certaines tribus indiennes avaient, en temps de guerre, de vritables enseignes, faites de morceaux d'corces tenus au bout d'une perche et sur lesquels taient reprsents les totems . Chez les Tlinkit, quand un conflit clate entre deux clans, les champions des deux groupes ennemis portent sur la tte un casque sur lequel se trouvent figurs leurs totems respectifs . Chez les Iroquois, on mettait sur chaque wigwam, comme marque du clan, la peau de l'animal qui servait de totem . D'aprs un autre observateur, c'est l'animal empaill qui tait dress devant la porte . Chez les Wyandot, chaque clan a ses ornements propres et ses peintures distinctives . Chez les Omaha, et plus gnralement chez les Sioux, le totem est peint sur la tente .
272 273 274 275 276 277 278
L o la socit est devenue sdentaire, oh la tente est remplace par la maison, o les arts plastiques sont dj plus dvelopps, c'est sur le bois, c'est sur les murs qu'est grav le totem. C'est ce qui arrive, par exemple, chez les Haida, les Tsimshian, les Salish, les Tlinkit Un
268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
Journals of Iwo Expeditions in no W. and W. Australia, Il, p. 228. Kamilaroi and Kurnai, p. 165. Indian Tribes, I, p. 420. Cf. 1, p. 52. Cette tymologie est d'ailleurs trs contestable. Cf. Handbook of American Indians North of Mexico (Smithsonian Instit., Bur. of. Ethnol., 2e Partie, s. v. Totem, p. 787). SCHOOLCRAFT, Indian Tribes, III, p. 184. Garrick MALLERY, PictureWriting of the American Indians, in Tenth Rep., 1893, p. 377. HEARNE, Journey to the Northern Ocean, p. 148 (cit d'aprs FRAZER, Tolemism, p. 30). CHARLEVOIX, Histoire et description de la Nouvelle France, V, p. 329. KRAUSE, Tlinkit-Indianer, p. 248. Erminnie A. SMITH, Myths of the Iroquois, in Second Rep. of the Bureau of Ethnol., p. 78. DODGE, Our Wild Indians, p. 225. POWELL, Wyandot Government, in I. Annual Report of the Bureau of Ethnology (1881), p. 64. DORSEY, Omaha Sociology, Third Rep., pp. 229, 240, 248.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
107
ornement trs particulier de la maison chez les Tlinkit, dit Krause, ce sont les armoiries du totem. Ce sont des formes animales, combines dans certains cas avec des formes humaines, et sculptes sur des poteaux, qui s'lvent ct de la porte d'entre et qui ont jusqu' 15 mtres de hauteur ; elles sont gnralement peintes avec des couleurs trs voyantes . Cependant, dans un village Tlinkit, ces figurations totmiques ne sont pas trs nombreuses ; on ne les trouve gure que devant les maisons des chefs et des riches. Elles sont beaucoup plus frquentes dans la tribu voisine des Haida, l, il y en a toujours plusieurs par maison . Avec ses multiples poteaux sculpts qui se dressent de tous cts et parfois une grande hauteur, un village Haida donne l'impression d'une ville sainte, toute hrisse de clochers ou de minarets minuscules . Chez les Salish, c'est souvent sur les parois intrieures de la maison qu'est reprsent le totem . On le retrouve, d'ailleurs, sur les canots, sur des ustensiles de toute sorte, et sur les monuments funraires .
279 280 281 282 283
Les exemples qui prcdent sont exclusivement emprunts aux Indiens de l'Amrique du Nord. C'est que ces sculptures, ces gravures, ces figurations permanentes ne sont possibles que l o la technique des arts plastiques est dj parvenue un degr de perfectionnement que les tribus australiennes n'ont pas encore atteint. Par suite, les reprsentations totmiques du genre de celles qui viennent d'tre mentionnes sont plus rares et moins apparentes en Australie qu'en Amrique. Cependant, on en cite des cas. Chez les Warramunga, la fin des crmonies mortuaires, on enterre les ossements du mort, pralablement desschs et rduits en poudre ; ct de l'endroit o ils sont ainsi dposs, une figure reprsentative du totem est trace sur le sol . Chez les Mara et les Anula, le corps est plac dans une pice de bois creuse qui est galement dcore de dessins caractristiques du totem . Dans la Nouvelle Galles du Sud, Oxley a trouv graves sur des arbres, voisins de la tombe o un indigne tait enterr , des figures auxquelles Brough Smyth attribue un caractre totmique. Les indignes du Haut Darling gravent sur leurs boucliers des images totmiques . Suivant Collins, presque tous les ustensiles sont couverts d'ornements qui, vraisemblablement, ont la mme signification; on retrouve des figures du mme genre sur les rochers . Ces dessins totmiques pourraient mme tre plus frquents qu'il ne semble ; car, pour des raisons qui seront exposes plus loin, il n'est pas toujours facile d'apercevoir quel en est le vritable sens.
284 285 286 287 288
279 280 281 282 283
284 285 286 287 288
KRAUSE, Op. cit., pp. 130-131. KRAUSE, p. 308. V. une photographie d'un village Haida dans SWANTON, Op. cit., Pl. IX. Cf. TYLOR, Totem Post of the Haida Village of Masset, J.A.I., nouvelle srie, I, p. 133. Hill TOUT, Report on the Ethnology of the Statlumh of British Columbia, J.A.I., tome XXXV, 1905, p. 155. KRAUSE, op. cit., p. 230; SWANTON, Haida, pp. 129, 135 et suiv. ; SCHOOLCRAFT, Indian Tribes, I, pp. 52-53, 337, 356. Dans ce dernier cas, le totem est reprsent renvers, en signe de deuil. On trouve des usages similaires chez les Creek (C. SWAN, in SCHOOLCRAFT, Indian Tribes of the United States, V, p. 265), chez les Delaware (HECKEWELDER, An Account of the History, Manners a. Customs of the Indian Nations who once inhabited Pennsylvania, pp. 246-247). SPENCER et GILLEN North. Tr., pp. 168, 537, 540. SPENCER et GILLEN: ibid., p. 174. BROUGH SMYTH, The Aborigines of Victoria, I, p. 99. BROUGH SMYTH, I, p. 284. STREHLOW cite un fait du mme genre chez les Arunta (III, p. 68). An Account of the English Colony in N. S. Wales, II, p. 381.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
108
Ces diffrents faits donnent dj le sentiment de la place considrable que le totem tient dans la vie sociale des primitifs. Cependant, jusqu' prsent, il nous est apparu comme relativement extrieur l'homme ; car c'est seulement sur les choses que nous l'avons vu reprsent. Mais les images totmiques ne sont pas seulement reproduites sur les murs des maisons, les parois des canots, les armes, les instruments et les tombeaux; on les retrouve sur le corps mme des hommes. Ceux-ci ne mettent pas seulement leur blason sur les objets qu'ils possdent, ils le portent sur leur personne ; il est empreint dans leur chair, il fait partie d'euxmmes et c'est mme ce mode de reprsentation qui est, et de beaucoup, le plus important. C'est en effet, une rgle trs gnrale que les membres de chaque clan cherchent se donner l'aspect extrieur de leur totem. Chez les Tlinkit, certaines ftes religieuses, le personnage qui est prpos la direction de la crmonie porte un vtement qui reprsente, en totalit ou en partie, le corps de l'animal dont le clan porte le nom . Des masques spciaux sont employs dans ce but. On retrouve les mmes pratiques dans tout le Nord-Ouest amricain . Mme usage chez les Minnitaree quand ils vont au combat , chez les Indiens des Pueblos . Ailleurs, quand le totem est un oiseau, les individus portent sur la tte les plumes de cet oiseau . Chez les Iowa, chaque clan a une manire spciale de se couper les cheveux. Dans le clan de l'Aigle, deux grandes touffes sont mnages sur le devant de la tte, tandis qu'une autre pend par derrire ; dans le clan du Buffle, on les dispose en forme de cornes . Chez les Omaha, on trouve des dispositifs analogues : chaque clan a sa coiffure. Dans le clan de la Tortue, par exemple, les cheveux sont rass sauf six boucles, deux de chaque ct de la tte, une devant et une derrire, de faon imiter les pattes, la tte et la queue de l'animal .
289 290 291 292 293 294 295
Mais le plus souvent, c'est sur le corps lui-mme qu'est imprime la marque totmique : il y a l un mode de reprsentation qui est la porte mme des socits les moins avances. On s'est demand parfois si le rite si frquent qui consiste arracher au jeune homme les deux dents suprieures l'poque de la pubert n'aurait pas pour objet de reproduire la forme du totem. Le fait n'est pas tabli ; mais il est remarquable que, parfois, les indignes eux-mmes expliquent ainsi cet usage. Par exemple, chez les Arunta, l'extraction des dents n'est pratique que dans le clan de la pluie et de l'eau; or, suivant la tradition, cette opration aurait pour but de rendre les physionomies semblables certains nuages noirs, avec des bords clairs, qui passent pour annoncer l'arrive prochaine de la pluie et qui, pour cette raison, sont considrs comme
289 290
291 292 293 294 295
KRAUSE, p. 327. SWANTON, Social Condition, Beliefs a. linguistic Relationship of the Tlingit Indians, in XX-IVth Rep., p. 435 et suiv.; BOAS, The Social Organization and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians, p. 358. FRAZER, Tolemism, p. 26. BOURKE, The Snake Dance of the Moquis of Arizona, p. 229; J. W. FEWKES, The Group of Tusayan Ceremonials called Katcinas, in XVth Rep., 1897, pp. 251-263. MLLER, Geschichte der Amerikanischen Urreligionen, p. 327. SCHOOLCRAFT, Indian Tribes, III, p. 269. DORSEY, Omaha Sociol, Third Rep., pp. 229, 238, 240, 245.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
109
des choses de la mme famille . C'est la preuve que l'indigne lui-mme a conscience que ces dformations ont pour objet de lui donner, au moins conventionnellement, l'aspect de son totem. Chez ces mmes Arunta, au cours des rites de la subincision, des entailles dtermines sont pratiques sur les surs et sur la future femme du novice; il en rsulte des cicatrices dont la forme est galement reprsente sur un objet sacr, dont nous parlerons tout l'heure, et qui est appel le churinga ; or nous verrons que les lignes ainsi dessines sur les churinga sont emblmatiques du totem . Chez les Kaitish, l'euro est considr comme troitement parent de la pluie , les gens du clan de la pluie portent sur les oreilles de petits pendants faits de dents d'euro . Chez les Yerkla, pendant l'initiation, on inflige au jeune homme un certain nombre de balafres qui laissent des cicatrices : le nombre et la forme de ces cicatrices varient suivant les totems . Un des informateurs de Fison signale le mme fait dans les tribus qu'il a observes . D'aprs Howitt, une relation du mme genre existerait, chez les Dieri, entre certaines scarifications et le totem de l'eau . Quant aux Indiens du Nord-Ouest, l'usage de se tatouer le totem est, chez eux, d'une grande gnralit .
296 297 298 299 300 301 302 303
Mais si les tatouages qui sont raliss par voie de mutilations ou de scarifications n'ont pas toujours une signification totmique , il en est autrement des simples dessins effectus sur le corps : ils sont, le plus gnralement, reprsentatifs du totem. L'indigne, il est vrai, ne les porte pas d'une manire quotidienne. Quand il se livre des occupations purement conomiques, quand les petits groupes familiaux se dispersent pour chasser et pour pcher, il ne s'embarrasse pas de ce costume qui ne laisse pas d'tre compliqu. Mais, quand les clans se runissent pour vivre d'une vie commune et vaquer ensemble aux crmonies religieuses, il s'en pare obligatoirement. Chacune de ces crmonies, comme nous le verrons, concerne un totem particulier et, en principe, les rites qui se rapportent un totem ne peuvent tre accomplis que par des gens de ce totem. Or, ceux qui oprent , qui jouent le rle d'officiants, et mme parfois ceux qui assistent comme spectateurs, portent toujours sur le corps des dessins qui figurent le totem . Un des rites principaux de l'initiation, celui qui fait entrer le jeune homme
304 305 306
296 297 298 299 300 301 302 303
304 305 306
SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 451. SPENCER et GILLEN, ibid., p. 257. On verra plus loin (I, I, chap. IV), ce qui signifient ces rapports de parent. SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 296. HOWITT, Nat. Tr., p. 744-746; cf. p. 129. Kamilaroi and Kurnai, p. 66, note. Le fait est, il est vrai, contest par d'autres informateurs. HOWITT, Nat. Tr., p. 744. SWANTON, Contributions Io the Ethnology of the Haida, p. 41 et suiv., Pl. XX et XXI ; BOAS, The Social Organization of the Kwakiutl, p. 318 ; SWANTON, Tlingit, pl. XVI et sq. - Dans un cas, tranger d'ailleurs aux deux rgions ethnographiques que nous tudions plus spcialement, ces tatouages sont pratiqus sur les animaux qui appartiennent au clan. Les Bechuana du sud de l'Afrique sont diviss en un certain nombre de clans : il y a les gens du crocodile, du buffle, du singe, etc. Or, les gens du crocodile, par exemple, font aux oreilles de leurs bestiaux, une incision, qui rappelle par sa forme, la gueule de l'animal (CASALIS, Les Basoulos, p. 221). Suivant Robertson SMITH, le mme usage aurait exist chez les anciens Arabes (Kinship and Marriage in early Arabia, pp. 212-214). Il en est qui, suivant SPENCER et GILLEN, n'auraient aucun sens religieux (v. Nat. Tr., pp. 41-42; North. Tr., pp. 45, 54-56). Chez les Arunta, la rgle comporte des exceptions qui seront expliques plus loin. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 162; North. Tr., pp. 179, 259, 292, 295-296 ; SCHULZE, loc. cit.,
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
110
dans la vie religieuse de la tribu, consiste prcisment lui peindre sur le corps le symbole totmique . Il est vrai que, chez les Arunta, le dessin ainsi trac ne reprsente pas toujours et ncessairement le totem de l'initi ; mais c'est une exception, due sans doute l'tat de perturbation o se trouve l'organisation totmique de cette tribu . Au reste, mme chez les Arunta, au moment le plus solennel de l'initiation, puis qu'il en est le couronnement et la conscration, quand le nophyte est admis pntrer dans le sanctuaire o sont conservs tous les objets sacrs qui appartiennent au clan, on excute sur lui une peinture emblmatique : or cette fois c'est le totem du jeune homme qui est ainsi reprsent . Les liens qui unissent l'individu son totem sont mme tellement troits que, dans les tribus de la cte Nord-Ouest de l'Amrique du Nord, l'emblme du clan est peint non seulement sur les vivants, mais mme sur les morts : avant d'ensevelir le cadavre, on met sur lui la marque totmique .
307 308 309 310 311
307
308 309
310 311
p. 221. Ce qui est ainsi reprsent, ce n'est pas toujours le totem lui-mme, mais un des objets qui, associs ce totem, sont considrs comme choses de la mme famille. C'est le cas, par exemple, chez les Warramunga, les Walpari, les Wulmala, les Tjingilli, les Umbaia, les Unmatjera (North. Tr., pp. 348, 339). Chez les Warramunga, au moment o le dessin est excut, les oprateurs adressent l'initi les paroles suivantes : Cette marque appartient votre localit (your place) : ne portez pas les yeux sur une autre localit. Ce langage signifie, disent SPENCER et GILLEN, que le jeune homme ne doit pas s'ingrer dans d'autres crmonies que celles qui concernent son totem; elles tmoignent galement de l'troite association qui est suppose exister entre un homme, son totem et l'endroit spcialement consacr ce totem (North. Tr., p. 584). Chez les Warramunga, le totem se transmet du pre aux enfants; par suite, chaque localit a le sien. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 215, 241, 376. On se rappelle (v. plus haut, p. 150) que, dans cette tribu, l'enfant peut avoir un autre totem que celui de son pre ou de sa mre et, plus gnralement, de ses proches. Or les proches, d'un ct ou de l'autre, sont les oprateurs dsigns pour les crmonies de l'initiation. Par consquent, comme un homme, en principe, n'a qualit d'oprateur ou d'officiant que pour les crmonies de son totem, il s'ensuit que, dans certains cas, les rites auxquels l'enfant est initi concernent forcment un totem autre que le sien. Voil comment les peintures excutes sur le corps du novice ne reprsentent pas ncessairement le totem de ce dernier: on trouvera des cas de ce genre dans SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 229. Ce qui montre bien, d'ailleurs, qu'il y a l une anomalie, c'est que, nanmoins, les crmonies de la circoncision ressortissent essentiellement au totem qui prdomine dans le groupe local de l'initi, c'est--dire au totem qui serait celui de l'initi lui-mme, si l'organisation totmique n'tait pas perturbe, si elle tait chez les Arunta ce qu'elle est chez les Warramunga (V. SPENCER et GILLEN, ibid., p. 219). La mme perturbation a eu une autre consquence. D'une manire gnrale, elle a pour effet de dtendre quelque peu les liens qui unissent chaque totem un groupe dtermin, puisqu'un mme totem peut compter des membres dans tous les groupes locaux possibles, et mme dans les deux phratries indistinctement. L'ide que les crmonies d'un totem pouvaient tre clbres par un individu d'un totem diffrentide qui est contraire aux principes mme du totmisme, comme nous le verrons mieux encore dans la suite - a pu s'tablir ainsi sans soulever trop de rsistances. On a admis qu'un homme qui un esprit rvlait la formule d'une crmonie avait qualit pour la prsider, alors mme qu'il n'tait pas du totem intress (Nat. Tr., p. 519). Mais ce qui prouve que c'est l une exception la rgle et le produit d'une sorte de tolrance, c'est que le bnficiaire de la formule ainsi rvle n'en a pas la libre disposition; s'il la transmet - et ces transmissions sont frquentes-ce ne peut-tre qu' un membre du totem auquel se rapporte le rite (Nat. Tr., ibid.). Nat. Tr., p. 140. Dans ce cas, le novice conserve la dcoration dont il a t ainsi par jusqu' ce que, par l'effet du temps, elle s'efface d'elle-mme. BOAS, General Report on the Indians of British Columbia, in British Association for the Advancement of Science, Fifth Rep. of the Committee on the N. W. Tribes of the Dominion of Canada, p. 41.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
111
III
.
Dj ces dcorations totmiques permettent de pressentir que le totem n'est pas seulement un nom et un emblme. C'est au cours de crmonies religieuses qu'elles sont le totem, en mme temps qu'il est une tiquette collective, a un caractre religieux. Et en effet, c'est par rapport lui que les choses sont classes en sacres et en profanes. Il est le type mme des choses sacres. Les tribus de l'Australie centrale, principalement les Arunta, les Loritja, les Kaitish, les Unmatjera, les Ilpirra , se servent constamment dans leurs rites de certains instruments qui, chez les Arunta, sont appels suivant Spencer et GILLEN des churinga, et, suivant Strehlow, des tjurunga . Ce sont des pices de bois ou des morceaux de pierre polie, de formes trs varies, mais gnralement ovales ou allonges . Chaque groupe totmique en possde une collection plus ou moins importante. Or, sur chacun d'eux, se trouve grav un dessin qui reprsente le totem de ce mme groupe . Un certain nombre de ces churinga sont percs, l'une de leurs extrmits, d'un trou par lequel passe un fil, fait de cheveux humains ou de poils d'opossum. Ceux de ces objets qui sont en bois et qui sont percs de cette manire servent exactement aux mmes fins que ces instruments du culte auxquels les ethnographes anglais ont donn le nom de bull-roarers. Au moyen du lien auquel ils sont suspendus, on les fait rapidement tournoyer dans l'air de manire produire une sorte de ronflement identique celui que font entendre les diables qui servent encore aujourd'hui de jouets nos enfants ; ce bruit assourdissant a une signification rituelle et accompagne toutes les crmonies de quelque importance. Ces sortes de churinga sont donc de vritables bull-roarers. Mais il en est d'autres qui ne sont pas en bois ou qui ne sont pas percs ; par consquent, ils ne peuvent tre employs de cette manire. Ils inspirent cependant les mmes sentiments de respect religieux.
312 313 314 315
Tout churinga, en effet, quelque fin qu'il soit employ, compte parmi les choses les plus minemment sacres, il n'en est mme aucune qui le dpasse en dignit religieuse. C'est dj ce qu'indique le mot qui sert le dsigner. En mme temps qu'un substantif, c'est aussi un adjectif qui signifie sacr. Ainsi, parmi les noms que porte chaque Arunta, il en est un si sacr qu'il est interdit de le rvler un tranger ; on ne le prononce que rarement, voix basse, dans une sorte de murmure mystrieux. Or, ce nom s'appelle aritna churinga (aritna veut dire nom) .
316
312
313 314 315 316
Il y en a aussi chez les Warramunga, mais en plus petit nombre que chez les Arunta, et ils ne figurent pas dans les crmonies totmiques bien qu'ils tiennent une certaine place dans les mythes (North. Tr., p. 163). D'autres noms sont employs dans les autres tribus. Nous donnons un sens gnrique au terme Arunta parce que c'est dans cette tribu que les churinga tiennent le plus de place et ont t le mieux tudis. STREHLOW, II, p. 81. Il y en a quelques-uns, mais en petit nombre, qui ne portent aucun dessin apparent (v. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 144). Nat. Tr., p. 139 et 648; STREHLOW, II, p. 75.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
112
Plus gnralement, le mot de churinga dsigne tous les actes rituels ; par exemple, ilia churinga signifie le culte de l'mou . Le churinga tout court, employ substantivement, c'est donc la chose qui a pour caractristique essentielle d'tre sacre. Aussi les profanes, c'est--dire les femmes et les jeunes gens non encore initis la vie religieuse, ne peuvent-ils toucher ni mme voir les churinga; il leur est seulement permis de les regarder de loin, et encore est-ce dans de rares circonstances .
317 318
Les churinga sont conservs pieusement dans un lieu spcial qui est appel chez les Arunta l'ertnatunga . C'est une cavit, une sorte de petit souterrain dissimul dans un endroit dsert. L'entre en est soigneusement ferme au moyen de pierres si habilement disposes que l'tranger qui passe ct ne peut pas souponner que, prs de lui, se trouve le trsor religieux du clan. Le caractre sacr des churinga est tel qu'il se communique au lieu o ils sont ainsi dposs : les femmes, les non-initis ne peuvent en approcher. C'est seulement quand l'initiation est compltement termine que les jeunes gens en ont l'accs : encore en est-il qui ne sont jugs dignes de cette faveur qu'aprs plusieurs annes d'preuves . La religiosit du lieu rayonne mme au del et se communique tout l'entourage : tout ce qui s'y trouve participe du mme caractre et, pour cette raison, est soustrait aux atteintes profanes. Un homme est-il poursuivi par un autre ? S'il parvient jusqu' l'ertnatulunga, il est sauv, on ne peut l'y saisir . Mme un animal bless qui s'y rfugie doit tre respect . Les querelles y sont interdites. C'est un lieu de paix, comme on dira dans les socits germaniques, c'est le sanctuaire du groupe totmique, c'est un vritable lieu d'asile.
319 320 321 322
Mais les vertus du churinga ne se manifestent pas seulement par la manire dont il tient le profane distance. S'il est ainsi isol, c'est qu'il est une chose de haute valeur religieuse et dont la perte lserait gravement la collectivit et les individus. Il a toute sorte de proprits merveilleuses : par attouchement, il gurit les blessures, notamment celles qui rsultent de la
317
318 319 320 321 322
Strehlow, qui crit Tjurunga, donne du mot une traduction un peu diffrente. Ce mot, dit-il, signifie ce qui est secret et personnel (der eigene geheime). Tju est un vieux mot qui signifie cach, secret, et runga veut dire ce qui m'est propre. Mais Kempe qui a, en la matire, plus d'autorit que Strehlow, traduit tju par grand, puissant, sacr (KEMPE, Vocabulary of the Tribes inhabiting Macdonnell Ranges, s. v. Tju, in Transactions of the R. Society of Victoria, tome XIII). D'ailleurs, au fond, la traduction de Strehlow ne s'loigne pas de la prcdente autant qu'on pourrait le croire au premier abord ; car ce qui est secret, c'est ce qui est soustrait la connaissance des profanes, c'est--dire ce qui est sacr. Quant la signification attribue au mot runga, elle nous parait trs douteuse. Les crmonies de l'mou appartiennent tous les membres du clan de l'mou ; tous peuvent y participer; elles ne sont donc la chose personnelle d'aucun d'eux. Nat. Tr., pp. 130-132 ; STREHLOW, II, p. 78. Une femme qui a vu churinga et l'homme qui le lui a montr sont galement mis mort. Strehlow appelle cet endroit, dfini exactement dans les termes mmes qu'emploient Spencer et GILLEN, arknanaua au lieu d'ertnatulunga (STREHLOW, II, p. 78). North. Tr., p. 270; Nat. Tr., p. 140. Nat. Tr., p. 135. STREHLOW, II, p. 78. Strehlow dit pourtant qu'un meurtrier qui se rfugie prs d'un ertnatulunga y est impitoyablement poursuivi et mis mort. Nous avons quelque mal concilier ce fait avec le privilge dont jouissent les animaux, et nous nous demandons si la rigueur plus grande avec laquelle le criminel est trait n'est pas rcente et si elle ne doit pas tre attribue un affaiblissement du tabou qui protgeait primitivement l'ertnatulunga.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
113
circoncision ; il a la mme efficacit contre la maladie ; il sert faire pousser la barbe ; il confrre d'importants pouvoirs sur l'espce totmique dont il assure la reproduction normale ; il donne aux hommes force, courage, persvrance, dprime, au contraire, et affaiblit leurs ennemis. Cette dernire croyance est mme si fortement enracine que si, quand deux combattants sont aux prises, l'un d'eux vient s'apercevoir que son adversaire porte des churinga sur lui, il perd aussitt confiance et sa dfaite est certaine . Aussi n'y a-t-il pas d'instrument rituel qui tienne une place plus importante dans les crmonies religieuses . Par des sortes d'onctions, on communique leurs pouvoirs soit aux officiants soit aux assistants ; pour cela aprs les avoir enduits de graisse, on les frotte contre les membres, contre l'estomac des fidles . Ou bien on les recouvre d'un duvet qui s'envole et se disperse dans toutes les directions quand on les fait tournoyer ; c'est une manire de dissminer les vertus qui sont en eux .
323 324 325 326 327 328 329 330
Mais ils ne sont pas seulement utiles aux individus ; le sort du clan tout entier est collectivement li au leur. Leur perte est un dsastre ; c'est le plus grand malheur qui puisse arriver au groupe . Ils quittent quelquefois l'ertnatulunga, par exemple quand ils sont prts quelque groupe tranger . C'est alors un vritable deuil public. Pendant deux semaines, les gens du totem pleurent, se lamentent, le corps enduit de terre d'argile blanche, comme ils font quand ils ont perdu quelqu'un de leurs proches . Aussi les churinga ne sont-ils pas laisss la libre disposition des particuliers; l'ertnatulunga o ils sont conservs est plac sous le contrle du chef du groupe. Sans doute, chaque individu a, sur certains d'entre eux, des droits spciaux ; cependant, bien qu'il en soit, dans une certaine mesure, le propritaire, il ne peut s'en servir qu'avec le consentement et sous la direction du chef. C'est un trsor collectif ; c'est l'arche sainte du clan . La dvotion dont ils sont l'objet montre, d'ailleurs, le haut prix qui y est attach. On ne les manie qu'avec un respect que traduit la solennit des gestes . On les
331 332 333 334 335 336
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332
333 334 335
336
Nat. Tr., p. 248. Ibid., pp. 545-546. STREHLOW, II, p. 79. Par exemple, la poussire dtache par grattage d'un churinga de pierre et dissoute dans de l'eau constitue une potion qui rend la sant aux malades. Nat. Tr., pp. 545-546. STREHLOW (II, p. 79) conteste le fait. Par exemple, un churinga du totem de l'Igname, dpos dans le sol, y fait pousser les ignames (North. Tr., p. 275). Il a le mme pouvoir sur les animaux (STREHLOW, II, p. 76, 78; III, pp. 3, 7). Nat. Tr., p. 135; STREHLOW, II, p. 79. North. Tr., p. 278. Ibid., p. 180. Ibid., pp. 272-273. Nat. Tr., p. 135. Un groupe emprunte un autre ses churinga, dans cette pense que ces derniers lui communiqueront quelque chose des vertus qui sont en eux, que leur prsence rehaussera la vitalit des individus et de la collectivit (Nat. Tr., p. 158 et suiv.). Ibid., p. 136. Chaque individu est uni par un lien particulier d'abord un churinga spcial qui lui sert de gage de vie, puis ceux qu'il a reus de ses parents par voie d'hritage. Nat. Tr., p. 154; North. Tr., p. 193. Les churinga ont si bien une marque collective qu'ils remplacent les btons de messagers dont sont munis, dans d'autres tribus, les individus envoys des groupes trangers pour les convoquer quelque crmonie (Nat. Tr., pp. 141-142). Ibid., p. 326. Il y a lieu de remarquer que les bull-roarers sont employs de la mme manire (MATHEWS, Aboriginal Tribes of N. S. Wales and Victoria, in Journal of Roy. Soc. of N. S. Wales,
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
114
soigne, on les graisse, on les frotte, on les polit, et, quand on les transporte d'une localit dans l'autre, c'est au milieu de crmonies qui tmoignent qu'on voit dans ce dplacement un acte de la plus haute importance .
337
Or, en eux-mmes, les churinga sont des objets de bois et de pierre comme tant d'autres ; ils ne se distinguent des choses profanes du mme genre que par une particularit : c'est que, sur eux, est grave ou dessine la marque totmique. C'est donc cette marque et elle seule qui leur confre le caractre sacr. Il est vrai que, suivant Spencer et GILLEN, le churinga servirait de rsidence une me d'anctre et ce serait la prsidence de cette me qui lui confrerait ses proprits . De son ct, Strehlow, tout en dclarant cette interprtation inexacte, en propose une autre qui ne diffre pas sensiblement de la prcdente : le churinga serait considr comme une image du corps de l'anctre ou comme ce corps lui-mme . Ce seraient donc encore les sentiments inspirs par l'anctre qui se reporteraient sur l'objet matriel et qui en feraient une sorte de ftiche. Mais d'abord, l'une et l'autre conception, - qui, d'ailleurs, ne diffrent gure que dans la lettre du mythe - ont t manifestement forges aprs coup pour rendre intelligible le caractre sacr attribu aux churinga. Dans la constitution de ces pices de bois et de ces morceaux de pierre, dans leur aspect extrieur, il n'y a rien qui les prdestine tre considrs comme le sige d'une me d'anctre on comme l'image de son corps. Si donc les hommes ont imagin ce mythe, c'est pour pouvoir s'expliquer eux-mmes le respect religieux que leur inspiraient ces choses, bien loin que ce respect ft dtermin par le mythe. Cette explication, comme tant d'explications mythiques, ne rsout la question que par la question mme, rpte en des termes lgrement diffrents; car dire que le churinga est sacr et dire qu'il contient tel ou tel rapport avec un tre sacr, c'est noncer de deux faons le mme fait ; ce n'est pas en rendre compte. D'ailleurs, de l'aveu de Spencer et GILLEN, il y a, mme chez les Arunta, des churinga qui sont fabriqus, au su et au vu de tout le monde, par les anciens du groupe ; ceux-l ne viennent videmment pas des grands anctres. Ils ont pourtant, des diffrences de degrs prs, la mme efficacit que les autres et ils sont conservs de la mme manire. Enfin, il y a des tribus tout entires o le churinga n'est nullement conu comme associ un esprit . Sa nature religieuse lui vient donc d'une autre source, et d'o lui pourrait-elle venir sinon de l'empreinte totmique qu'il porte ? Ainsi, c'est cette image que s'adressent en ralit, les dmonstrations du rite ; c'est elle qui sanctifie l'objet sur lequel elle est grave.
338 339 340 341
337 338 339 340
341
XXXVIII, pp. 307-308). Nat. Tr., pp. 161, 250 et suiv. Ibid., p. 138. STREHLOW, I, Vorworet, in fine; II, pp. 76, 77 et 82. Pour les Arunta, c'est le corps mme de l'anctre; pour les Loritja, c'en est seulement une image. Quand un enfant vient de natre, la mre indique au pre o elle croit que l'me de l'anctre a pntr en elle. Le pre, accompagn de quelques parents, se rend cet endroit et l'on y cherche le churinga que l'anctre, croit-on, a laiss tomber au moment o il s'est rincarn. Si on l'y trouve, c'est, sans doute, que quelque ancien du groupe totmique l'y a plac (l'hypothse est de Spencer et GILLEN). Si on ne le dcouvre pas, on fait un churinga nouveau suivant une technique dtermine (Nat. Tr., p. 132. Cf. STREHLOW, II, p. 80). C'est le cas des Warramunga, des Urabunna, des Worgaia, des Umbaia, des Tjingilli, des Grianji (North. Tr., p. 258, 275-276). Alors, disent SPENCER et GILLEN, they were regarded as of especial value because of their association with a totem (ibid., p. 276). Il y a des exemples du mme fait chez les Arunta (Nat. Tr., p. 156).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
115
Mais il existe, chez les Arunta et dans les tribus voisines, deux autres instruments liturgiques nettement rattachs au totem et au churinga lui-mme qui entre ordinairement dans leur composition : c'est le nurtunja et le waninga. Le nurtunja , qui se rencontre chez les Arunta du nord et chez leurs voisins immdiats , est fait essentiellement d'un support vertical qui consiste soit en une lance, soit en plusieurs lances runies en faisceau, soit en une simple perche . Des touffes d'herbes sont maintenues tout autour au moyen de ceintures ou de bandelettes, faites de cheveux. On ajoute par l-dessus du duvet dispos soit en cercles, soit en lignes parallles qui courent du haut en bas du support. Le sommet est dcor au moyen de plumes d'aigle-faucon. Ce n'est l, d'ailleurs, que la forme la plus gnrale et la plus typique ; elle comporte toutes sortes de variantes suivant les cas particuliers .
342 343 344 345
Le waninga, qui se trouve uniquement chez les Arunta du sud, chez les Urabunna, le Loritja, n'est pas davantage d'un seul et unique modle. Rduit ses lments les plus essentiels, il consiste, lui aussi, en un support vertical, qui est form par un bton long de plus d'un pied ou par une lance de plusieurs mtres de haut, et qui est coup tantt par une, tantt par deux pices transversales . Dans le premier cas, il a l'aspect d'une croix. Des cordons faits soit avec ces cheveux humains soit avec de la fourrure d'opossum ou de bandicoot traversent en diagonales l'espace compris entre les bras de la croix et les extrmits de l'axe central ; ils sont serrs les uns contre les autres et constituent ainsi un rseau qui a la forme d'un losange. Quand il y a deux barres transversales, ces cordons vont de l'une l'autre et, de l, au sommet et la base du support. Ils sont quelquefois recouverts d'une couche de duvet assez paisse pour les dissimuler aux regards. Le waninga a ainsi l'aspect d'un vritable drapeau .
346 347
Or le nurtunja et le waninga, qui figurent dans une multitude de rites importants, sont l'objet d'un respect religieux, tout fait semblable celui qu'inspirent les churinga. On procde leur confection et leur rection avec la plus grande solennit. Fixs en terre ou ports par un officiant, ils marquent le point central de la crmonie : c'est autour d'eux qu'ont lieu les danses et que les rites se dveloppent. Au cours de l'initiation, on mne le novice au pied d'un nurtunja qui a t rig pour la circonstance. Voil, lui dit-on, le nurtunja de ton pre ; il a dj servi
342 343 344 345
346 347
STREHLOW crit tnatanja (op. cit., I, pp. 4-5. Les Kaitish, les Ilpirra, les Unmatjera; mais il est rare chez ces derniers. La perche est quelquefois remplace par des churinga trs longs, mis bout bout. Parfois, au sommet du nurtunja, un autre plus petit est suspendu. Dans d'autres cas, le nurtunja a la forme d'une croix ou d'un T. Plus rarement, le support central fait dfaut (Nat. Tr., pp. 298-300, 360-364, 627). Quelquefois, ces barres transversales sont au nombre de trois. Nat. Tr., pp. 231-234, 306-310, 627. Outre le nurtunja et le waninga, SPENCER et GILLEN distinguent une troisime sorte de poteau ou drapeau sacr, c'est le kauaua (Nat. Tr., p. 364,370,629) dont ils avouent franchement, d'ailleurs, n'avoir pu dterminer exactement les fonctions. Ils notent seulement que le kauaua est regard comme quelque chose de commun aux membres de tous les totems . Mais suivant STREHLOW (III, p. 23, no 12), le kauaua dont parlent Spencer et GILLEN, serait simplement le nurtunja du totem du Chat sauvage. Comme cet animal est l'objet d'un culte tribal, on s'explique que la vnration dont est l'objet son nurtunja soit commune tous les clans.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
116
faire bien des jeunes hommes. Aprs quoi, l'initi doit embrasser le nurtunja . Par ce baiser, il entre en relations avec le principe religieux qui est cens y rsider; c'est une vritable communion qui doit donner au jeune homme la force ncessaire pour supporter la terrible opration de la subincision . D'ailleurs, le nurtunja joue un rle considrable dans la mythologie de ces socits. Les mythes rapportent que, au temps fabuleux des grands anctres, le territoire de la tribu tait sillonn dans tous les sens par des compagnies exclusivement composes d'individus d'un mme totem . Chacune de ces troupes avait avec elle un nurtunja. Quand elle s'arrtait pour camper, les gens, avant de se disperser pour chasser, fixaient en terre leur nurtunja au sommet duquel taient suspendus les churinga . C'est dire qu'ils lui confiaient tout ce qu'ils avaient de plus prcieux. C'tait en mme temps une sorte d'tendard qui servait de centre de ralliement au groupe. On ne peut pas n'tre pas frapp des analogies que prsente le nurtunja avec le poteau sacr des Omaha .
348 349 350 351 352
Or, ce caractre sacr ne lui peut venir que d'une cause: c'est qu'il reprsente matriellement le totem. En effet, les lignes verticales ou les anneaux de duvet qui le recouvrent, ou bien encore les cordons, de couleurs galement diffrentes, qui runissent les bras du waninga l'axe central, ne sont pas disposs arbitrairement, au gr des oprateurs; mais ils doivent obligatoirement affecter une forme troitement dtermine par la tradition et qui, dans la pense des indignes, figure le totem . Ici, il n'y a plus se demander, comme dans le cas des churinga, si la vnration dont cet instrument cultuel est l'objet n'est qu'un reflet de celle qu'inspirent les anctres ; car c'est une rgle que chaque nurtunja ou chaque waninga ne dure que pendant la crmonie oh il est utilis. On le confectionne nouveau et de toutes pices chaque fois qu'il est ncessaire, et, une fois le rite accompli, on le dpouille de ses ornements et on disperse les lments dont il est compos . Il n'est donc rien d'autre qu'une image - et mme une image temporaire - du totem et, par consquent, c'est ce titre, et ce titre seul, qu'il joue un rle religieux.
353 354
Ainsi, le churinga, le nurtunja, le waninga doivent uniquement leur nature religieuse ce qu'ils portent sur eux l'emblme totmique. C'est cet emblme qui est sacr. Aussi garde-t-il ce caractre sur quelque objet qu'il soit reprsent. On le peint parfois sur les rochers ; or, ces peintures sont appeles des churinga ilkinia, des dessins sacrs . Les dcorations dont se parent officiants et assistants dans les crmonies religieuses portent le mme nom : il est interdit aux enfants et aux femmes de les voir . Il arrive, au cours de certains rites, que le
355 356
348 349 350 351 352 353 354
355 356
North. Tr., p. 342; Nat. Tr., p. 309. Nat. Tr., p. 255. Ibid., chap. X et XI. Ibid., pp. 138, 144. V. DORSEY, Siouan Cults, XIth Rep., p. 413; Omaha Sociology, IIIrd Rep., p. 234. Il est vrai qu'il n'y a qu'un poteau sacr pour la tribu tandis qu'il y a un nurtunja par clan. Mais le principe est le mme. Nat. Tr., pp. 232, 308, 313, 334, etc. ; Notlh. Tr., pp. 182, 186, etc. Nat. Tr., p. 346. On dit, il est vrai, que le nurtunja reprsente la lance de l'anctre qui, au temps de l'Alcheringa, tait la tte de chaque clan. Mais il n'en est qu'une reprsentation symbolique ; ce n'est pas une sorte de relique, comme le churinga qui est cens maner de l'anctre lui-mme. ici, le caractre secondaire de l'interprtation est particulirement apparent. Nat. Tr., p. 614 et suiv., notamment, p. 617; North. Tr., p. 749. Nat. Tr., p. 624.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
117
totem soit dessin sur le sol. Dj, la technique de l'opration tmoigne des sentiments qu'inspire ce dessin et de la haute valeur qui lui est attribue ; il est, en effet, trac sur un terrain qui a t pralablement arros, satur de sang humain , et nous verrous plus loin que le sang est dj, par lui-mme, un liquide sacr qui ne sert qu' de pieux offices. Puis, une fois que l'image est excute, les fidles restent assis par terre devant elle dans J'attitude de la plus pure dvotion . A condition de donner au mot un sens appropri la mentalit du primitif, on peut dire qu'ils l'adorent. Voil ce qui permet de comprendre comment le blason totmique est rest, pour les Indiens de l'Amrique du Nord, une chose trs prcieuse : il est toujours entour d'une sorte d'aurole religieuse.
357 358
Mais pour comprendre d'o vient que les reprsentations totmiques sont aussi sacres, il n'est pas sans intrt de savoir en quoi elles consistent. Chez les Indiens de l'Amrique du Nord, ce sont des images, peintes, graves ou sculptes, qui s'efforcent de reproduire, aussi fidlement que possible, l'aspect extrieur de l'animal totmique. Les procds employs sont ceux dont nous nous servons encore aujourd'hui dans des cas similaires, sauf qu'ils sont, en gnral, plus grossiers. Mais il n'en est pas de mme en Australie et c'est naturellement dans les socits australiennes qu'il faut aller chercher l'origine de ces figurations. Bien que l'Australien puisse se montrer assez capable d'imiter, au moins d'une manire rudimentaire, les formes des choses , les dcorations sacres semblent, le plus souvent, trangres toute proccupation de ce genre : elles consistent essentiellement en dessins gomtriques excuts soit sur les churinga, soit sur le corps des hommes. Ce sont des lignes, droites ou courbes, peintes de manires diffrentes , et dont l'assemblage n'a et ne peut avoir qu'un sens conventionnel. Le rapport entre la figure, et la chose figure est tellement indirect et lointain qu'on ne peut l'apercevoir quand on n'est pas averti. Seuls, les membres du clan peuvent dire quel est le sens attach par eux telle ou telle combinaison de lignes . Gnralement, hommes et femmes sont reprsents par des demi-cercles, les animaux par des cercles complets ou par des spirales , les traces d'un homme ou d'un animal par des lignes de points, etc. La signification des figures que l'on obtient par ces procds est mme tellement arbitraire qu'un dessin identique peut avoir deux sens diffrents pour les gens de deux totems et reprsenter ici tel animal, ailleurs un autre animal ou une plante. C'est ce qui est peut-tre encore plus apparent dans le cas des nurtunia et des waninga. Chacun d'eux reprsente un totem diffrent. Mais les lments peu nombreux et trs simples qui entrent dans leur composition ne sauraient donner lieu a des combinaisons bien varies. Il en rsulte que deux nurtunja peuvent avoir exactement le mme aspect et exprimer cependant deux choses aussi
359 360 361 362
357 358 359
360 361 362
Ibid., p. 179. Nat. Tr., p. 181. V. des exemples dans SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., fig. 131. On y verra des dessins dont plusieurs ont videmment pour objet de reprsenter des animaux, des plantes, des ttes d'homme, etc., trs schmatiquement bien entendu. Nat. Tr., p. 617; North. Tr., p. 716 et suiv. Nat. Tr., p. 145; STREHLOW, Il, p. 80. Ibid., p. 151.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
118
diffrentes qu'un arbre gomme et un mou . Au moment o l'on confectionne le nurtunja, on lui donne un sens qu'il conserve pendant toute la crmonie, mais qui, en somme, est fix par convention.
363
Ces faits prouvent que, si l'Australien est si fortement enclin figurer son totem, ce n'est pas pour en avoir sous les yeux un portrait qui en renouvelle perptuellement la sensation ; niais c'est simplement parce qu'il sent le besoin de se reprsenter l'ide qu'il s'en fait au moyen d'un signe matriel, extrieur, quel que puisse, d'ailleurs, tre ce signe. Nous ne pouvons encore chercher comprendre ce qui a ainsi ncessit le primitif crire sur sa personne et sur diffrents objets la notion qu'il avait de son totem ; mais il importait de constater tout de suite la nature du besoin qui a donn naissance ces multiples figurations .
364
363 364
Ibid., p. 346. Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que ces dessins et ces peintures n'aient en mme temps un caractre esthtique : c'est une premire forme d'art. Puisque c'est aussi et mme surtout un langage crit, il s'ensuit que les origines du dessin et celles de l'criture se confondent. Il parat bien que l'homme a d commencer dessiner moins pour fixer sur le bois ou la pierre de belles formes qui charmaient ses sens, que pour traduire matriellement sa pense (cf. SCHOOLCRAFT, Indian Tribes, I, p. 405 ; DORSEY, Siouan Cults, p. 394 et suiv.).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
119
CHAPITRE II
LES CROYANCES PROPREMENT TOTMIQUES
(Suite)
II. - L'animal totmique et l'homme
Mais les images totmiques ne sont pas les seules choses sacres. Il existe des tres rels qui, eux aussi, sont l'objet de rites en raison des rapports qu'ils soutiennent avec le totem : ce sont, avant tous autres, les tres de l'espce totmique et les membres du clan.
I
.
Tout d'abord, puisque les dessins qui reprsentent le totem veillent des sentiments religieux, il est naturel que les choses dont ces dessins reproduisent l'aspect aient, en quelque mesure, la mme proprit. Ce sont, pour la plupart, des animaux et des plantes. Le rle profane des vgtaux et mme des animaux, est, d'ordinaire, de servir l'alimentation ; aussi le caractre sacr de l'animal ou de la plante totmique se reconnat-il ce fait qu'il est interdit d'en manger. Sans doute, parce qu'ils sont choses saintes, ils peuvent entrer dans la composition de certains repas mystiques, et nous verrons, en effet, qu'ils servent parfois de vritables sacrements ; mais normalement ils ne peuvent tre utiliss pour la consommation vulgaire. Quiconque passe outre cette dfense s'expose aux plus graves dangers. Ce n'est pas que le groupe intervienne toujours pour rprimer artificiellement l'infraction commise; mais on croit que le sacrilge produit automatiquement la
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
120
mort. Dans la plante ou dans l'animal totmique est cens rsider un principe redoutable qui ne peut pntrer dans un organisme profane sans le dsorganiser ou le dtruire . Seuls, les vieillards sont, au moins dans certaines tribus, affranchis de cette interdiction ; nous en verrons plus loin la raison.
365 366
Cependant, si la prohibition est formelle dans un trs grand nombre de tribus - sous la rserve des exceptions qui seront indiques plus tard - il est incontestable qu'elle tend s'attnuer mesure que la vieille organisation totmique est plus branle. Mais les restrictions mmes qui se maintiennent alors dmontrent que ces attnuations n'ont pas t admises sans difficults, Par exemple, l o il est permis de manger de la plante ou de l'animal qui sert de totem, ce n'est pourtant pas en toute libert ; on ne peut en consommer qu'une petite quantit la fois. Dpasser la mesure constitue une faute rituelle qui a de graves consquences . Ailleurs, la dfense subsiste tout entire pour les parties qui sont regardes comme les plus prcieuses, c'est--dire comme les plus sacres ; par exemple, les oeufs ou la graisse . Ailleurs encore, la consommation n'en est tolre sans rserve que s'il s'agit d'un animal qui n'est pas encore parvenu la pleine maturit . Sans doute, on considre dans ce cas que sa nature sacre n'est pas encore entire. La barrire qui isole et protge l'tre totmique ne cde donc que lentement et non sans de vives rsistances qui tmoignent de ce qu'elle devait tre primitivement.
367 368 369 370
Il est vrai que, suivant Spencer et GILLEN, ces restrictions seraient non les restes d'une prohibition rigoureuse qui irait en s'attnuant, ruais, au contraire, le prlude d'une interdiction qui commencerait seulement s'tablir. D'aprs ces crivains , la libert de consommation aurait t complte l'origine, et les imitations qui y sont prsentement apportes seraient relativement rcentes. Ils croient trouver la preuve de leur thse dans les deux faits suivants. D'abord, comme nous venons de le dire, il y a des occasions solennelles o les gens du clan ou leur chef non seulement peuvent, mais doivent manger de l'animal et de la plante totmique. Ensuite, les mythes rapportent que les grands anctres, fondateurs des clans, mangeaient rgulirement de leur totem : or, dit-on, ces rcits ne peuvent se comprendre que comme l'cho d'un temps o les prohibitions actuelles n'auraient pas exist,
371
Mais le fait que, au cours de certaines solennits religieuses, une consommation, d'ailleurs modre, du totem est rituellement obligatoire, n'implique aucunement qu'il ait jamais servi l'alimentation vulgaire. Tout au contraire, l'aliment que l'on mange au cours de ces repas
365
366 367 368
369 370 371
V. des cas dans TAPLIN, The Narrinyeri, p. 63 ; HOWITT, Nat. Tr., p. 146, 769 ; FISON et HOWITT, Kamilaroi a. Kurnai, p. 169 ; ROTH, Superstition, Magie a. Medicine, 150; WYATT, Adelaide a. Encounter Bay Tribe, in Woods, p. 168; MEYER, ibid., p. 186. C'est le cas chez les Warramunga (Nort. Tr., p. 168). Par exemple, chez les Warramunga, les Urabunna, les Wonghibon, les Yuin, les Wotjobaluk, les Buandik, les Ngeumba, etc. Chez les Kaitish, si un homme du clan mange trop de son totem, les membres de l'autre phratrie ont recours une manoeuvre magique qui est cense le tuer (Nort. Tr., m. 294. Cf. Nat. Tr., p. 1204; Langloh PARKER, The Euahlayi Tribe, p. 20). Nat. Tr., p. 202 et note; STREHLOW, Il, p. 58. North. Tr., p. 173. Nat. Tr., p. 207 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
121
mystiques est essentiellement sacr, et par consquent, interdit aux profanes. Quant aux mythes, c'est procder d'aprs une mthode critique un peu sommaire que de leur attribuer aussi facilement une valeur de documents historiques. En gnral, ils ont pour objet d'interprter des rites existants plutt que de commmorer des vnements passs; il sont une explication du prsent beaucoup plus qu'une histoire. En l'espce, ces traditions d'aprs lesquelles les anctres de l'poque fabuleuse auraient mang de leur totem sont en parfait accord avec des croyances et des rites qui sont toujours en vigueur. Les vieillards, les personnages qui sont parvenus une haute dignit religieuse sont affranchis des interdits auxquels est soumis le commun des hommes : ils peuvent manger de la chose sainte parce qu'ils sont saints euxmmes ; c'est d'ailleurs une rgle qui n'est pas particulire au seul totmisme, mais qu'on retrouve dans les religions les plus diffrentes. Or, les hros ancestraux taient presque des dieux. Il devait donc paratre plus naturel encore qu'ils aient pu se nourrir de l'aliment sacr ; mais ce n'est pas une raison pour que la mme facult ait t accorde aux simples profanes .
372 373 374
Cependant, il n'est ni certain ni mme vraisemblable que la prohibition ait jamais t absolue. Elle parat avoir toujours t suspendue en cas de ncessit, par exemple quand l'indigne est affam et qu'il n'a rien d'autre pour se nourrir . A plus forte raison en est-il ainsi quand le totem est un aliment dont l'homme ne peut se passer. Ainsi, il y a un grand nombre de tribus o il existe un totem de l'eau; une prohibition stricte est, dans l'espce, manifestement impossible. Cependant, mme dans ce cas, la facult concde est soumise des conditions qui en restreignent l'usage et qui montrent bien qu'elle droge un principe reconnu. Chez les Kaitish et les Warramunga, un homme de ce totem ne peut pas boire de l'eau librement ; il lui est dfendu de la puiser lui-mme; il ne peut en recevoir que des mains d'un tiers qui appartient obligatoirement la phratrie dont il n'est pas membre . La complexit de cette procdure et la gne qui en rsulte sont encore une faon de reconnatre que l'accs de la chose sacre n'est pas libre. La mme rgle s'applique, dans certaines tribus du centre, toutes les fois o l'on mange du totem soit par ncessit soit pour tout autre cause. Encore faut-il ajouter que, quand cette formalit elle-mme est inexcutable, c'est--dire quand un individu est seul ou n'est entour que de membres de sa phratrie, il peut, s'il y a urgence, se passer de tout intermdiaire. On voit que l'interdiction est susceptible de tempraments varis.
375 376
372 373
374
375 376
V. plus haut, p. 182. Encore faut-il tenir compte de ce fait que, dans les mythes, jamais les anctres ne nous sont reprsents comme se nourrissant rgulirement de leur totem. Ce genre de consommation est, au contraire, l'exception. Leur alimentation normale, suivant Strehlow, tait la mme que celle de l'animal correspondant (v. STREHLOW, 1, p. 4). Toute cette thorie, d'ailleurs, repose sur une hypothse tout fait arbitraire : Spencer et GILLEN, ainsi que Frazer, admettent que les tribus du centre australien, notamment les Arunta, reprsentent la forme la plus archaque et, par consquent, la plus pure du totmisme. Nous dirons plus loin pourquoi cette conjecture nous parat contraire toutes les vraisemblances. il est mme probable que ces auteurs n'auraient pas si facilement accept la thse qu'ils soutiennent s'ils ne s'taient refuss voir dans le totmisme une religion et si, par suite, ils n'avaient mconnu le caractre sacr du totem. TAPLIN, The Narrinyeri, p. 64; HOWITT, Nat. Tr., pp. 145 et 147; SPENCER et GILLEN. Nat. Tr., p. 202; GREY, loc. cit. ; CURE, Ill, p. 462. North. Tr., pp. 160, 167. Il ne suffit pas que l'intermdiaire soit d'un autre totem : c'est que, comme nous le verrons, un totem quelconque d'une phratrie est, dans une certaine mesure, interdit mme aux autres membres de cette phratrie qui sont d'un totem diffrent.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
122
Nanmoins, elle repose sur des ides si fortement invtres dans les consciences qu'elle survit trs souvent ses premires raisons d'tre. Nous avons vu que, selon toute vraisemblance, les divers clans d'une phratrie ne sont que des subdivisions d'un clan initial qui se serait dmembr. Il y eut donc un moment o tous ces clans fondus ensemble, avaient le mme totem ; par suite, l o le souvenir de cette commune origine ne s'est pas compltement effac, chaque clan continue se sentir solidaire des autres et considrer que leurs totems ne lui sont pas trangers... Pour cette raison, un individu ne peut pas manger en toute libert des totems affects aux diffrents clans de la phratrie dont il n'est pas membre ; il ne peut y toucher que si la plante ou l'animal interdits lui ont t prsents par un membre de l'autre phratrie .
377
Une autre survivance du mme genre est celle qui concerne le totem maternel. Il y a de fortes raisons de croire que, l'origine, le totem se transmettait en ligne utrine. L donc oh la filiation en ligne paternelle est entre en usage, ce ne fut trs probablement qu'aprs une longue priode durant laquelle le principe oppos avait t appliqu : par suite, l'enfant avait alors le totem de sa mre et tait soumis tous les interdits qui y taient attachs, Or, dans certaines tribus, o pourtant l'enfant hrite aujourd'hui du totem paternel, il survit quelque chose des interdictions qui protgeaient primitivement le totem de la mre : on ne peut pas en manger librement . Il n'y a plus rien pourtant, dans l'tat prsent des choses, qui corresponde cette prohibition.
378
A l'interdiction de manger s'ajoute souvent celle de tuer ou, si le totem est une plante, de cueillir . Cependant, ici encore, il y a bien des exceptions et des tolrances. Il y a notamment le cas de ncessit, quand, par exemple, le totem est un animal nuisible ou qu'on n'a rien manger. Il y a mme des tribus o il est dfendu de chasser pour son compte l'animal dont on porte le nom et o pourtant il est permis de le tuer pour le compte d'autrui . Mais en gnral,
379 380 381
377
378
379 380
381
North. Tr., p. 167. On peut mieux s'expliquer maintenant comment il se fait que, quand l'interdiction n'est pas observe, c'est l'autre phratrie qui poursuit la rpression du sacrilge (v. plus haut, p. 182, no 4). C'est qu'elle est la plus intresse ce que la rgle soit respecte. En effet, on croit que, quand cette rgle est viole, l'espce totmique risque de ne pas se reproduire abondamment. Or ce sont les membres de l'autre phratrie qui en sont les consommateurs rguliers; ce sont donc eux qui sont atteints, Voil pourquoi ils se vengent. C'est le cas chez les Loritja (STREHLOW, II, p. 60, 61), les Worgaia, les Warramunga, les Walpari, les Mara, les Anula, les Binbinga (North. Tr., pp. 166, 171, 173). On peut en manger chez les Warramunga, les Walpari, mais seulement si l'offre en est faite par un membre de l'autre phratrie. SPENCER et GILLEN font remarquer (p. 167, ri.) que, sous ce rapport, le totem paternel et le totem maternel sont soumis une rglementation qui parait diffrente. Sans doute, dans l'un et l'autre cas, l'offre doit venir de l'autre phratrie. Mais, quand il s'agit du totem du pre ou totem proprement dit, cette phratrie est celle laquelle le totem ne ressortit pas; c'est le contraire, quand il s'agit du totem de la mre. C'est, sans doute, que le principe fut d'abord tabli pour le premier, puis tendu mcaniquement au second, bien que la situation ft diffrente. Une fois qu'et t institue la rgle en vertu de laquelle on ne pouvait passer outre l'interdiction qui protge le totem que quand la proposition en tait faite par quelqu'un de l'autre phratrie, on l'appliqua sans modifications au cas du totem maternel. Par exemple, chez les Warramunga (North. Tr., p. 166), chez les Wotjobaluk, les Buandik, les Kurnai (HOWITT, P. 146-147), les Narrinyeri (TAPLIN, Narrinyeri, p. 63). Et encore n'est-ce pas dans tous les cas. L'Arunta du totem des Moustiques ne doit pas tuer cet insecte, mme quand il en est incommod; il doit se borner le chasser (STREHLOW, II, p. 58. Cf. TAPLIN, p. 63). Chez les Kaitish, les Unmatjera (Nort. TC., p. 160). Il arrive mme que, dans certains cas, un ancien
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
123
la manire dont l'acte est accompli indique bien qu'il y a quelque chose d'illicite. On s'en excuse, comme d'une faute ; on tmoigne du chagrin que l'on ressent, de la rpugnance que l'on prouve , et on prend les prcautions ncessaires pour que l'animal souffre le moins possible .
382 383
Outre les interdictions fondamentales, on cite quelques cas de prohibition de contact entre l'homme et son totem. Ainsi chez les Omaha, dans le clan de l'lan, nul ne peut toucher une partie quelconque du corps de l'lan mle; dans un sous-clan du Buffle, il n'est pas permis de toucher la tte de cet animal . Chez les Bechuana, nul n'oserait se vtir de la peau de l'animal qu'il a pour totem . Mais ces cas sont rares, et il est naturel qu'ils soient exceptionnels puisque, normalement, l'homme doit porter sur lui l'image de son totem ou quelque chose qui le rappelle. Le tatouage et les costumes totmiques seraient impraticables si tout contact tait interdit. On remarquera, d'ailleurs, que cette dfense ne s'observe pas en Australie, mais seulement dans des socits oh le totmisme est dj bien loign de sa forme originelle; elle est donc vraisemblablement d'origine tardive et due peut-tre l'influence d'ides qui n'ont rien de proprement totmique .
384 385 386
Si maintenant nous rapprochons ces interdictions diverses de celles dont l'emblme totmique est l'objet, il apparat, contrairement ce qu'on pouvait prvoir, que ces dernires sont plus nombreuses, plus strictes, plus svrement impratives que les premires. Les figures de toute sorte qui reprsentent le totem sont entoures d'un respect sensiblement suprieur celui qu'inspire l'tre mme dont ces figurations reproduisent la forme. Les churinga, le nurtunja, la waninga ne doivent jamais tre manis par les femmes ou les non-initis qui ne sont mme autoriss les entrevoir que trs exceptionnellement et distance respectueuse. Au contraire, la
donne un jeune homme d'un totem diffrent un de ses churinga pour permettre au jeune chasseur de tuer plus facilement l'animal qui sert de totem au donateur (ibid., p. 272). HOWITT, Nat. TC., p. 146; GREY, Op. cit., II, p. 228; CASALIS, Basoulos, p. 221. Chez ces derniers, il faut se purifier aprs avoir commis un tel sacrilge . STREHLOW, II, pp. 58, 59, 61. DORSEY, Omaha Sociology, IIIrd Rep., pp. 225, 231. CASALIS, ibid. Mme chez les Omaha, il n'est pas sr que les interdictions de contact dont nous venons de rapporter quelques exemples soient de nature proprement totmique ; car plusieurs d'entre elles n'ont pas de rapports directs avec l'animal qui sert de totem au clan. Ainsi, dans un sous-clan de l'Aigle, l'interdiction caractristique consiste ne pouvoir toucher une tte de buffle (DORSEY, op. cit., p. 239) ; dans un autre sous-clan qui a le mme totem, on ne peut toucher le vert-de-gris, le charbon de bois, etc. (ibid., p. 245). Nous ne parlons pas d'autres interdictions que mentionne Frazer, comme celles de nommer ou de regarder un animal ou une plante, car il est encore moins sr qu'elles soient d'origine totmique, sauf peuttre pour ce qui concerne certains faits observs chez les Bechuana (Totemism, pp. 12-13). Frazer admettait trop facilement alors - et il a eu, sur ce point, des imitateurs - que toute interdiction de manger ou de toucher un animal dpend ncessairement de croyances totmiques. Il y a, cependant, un cas en Australie, o la vue du totem parat prohibe. D'aprs STREHLOW (II, p. 59), chez les Arunta et les Loritja, un homme qui a pour totem la lune ne doit pas la regarder longtemps ; autrement, il s'exposerait mourir de la main d'un ennemi. Mais c'est, croyons-nous, un cas unique. Il ne faut pas perdre de vue, d'ailleurs, que les totems astronomiques ne sont vraisemblablement pas primitifs en Australie ; cette prohibition pourrait donc tre le produit d'une laboration complexe. Ce qui confirme cette hypothse, c'est que, chez les Euahlayi, l'interdiction de regarder la lune s'applique toutes les mres et tous les enfants, quels que soient leurs totems (L. PARKER, The Euahlayi, p. 53).
382 383 384 385 386
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
124
plante ou l'animal dont le clan porte le nom peuvent tre vus et touchs par tout le monde. Les churinga sont conservs dans une sorte de temple, au seuil duquel tous les bruits de la vie profane viennent mourir; c'est le domaine des choses saintes. Au contraire, animaux et plantes totmiques vivent sur le terrain profane et sont mls la vie commune. Et comme le nombre et l'importance des interdictions qui isolent une chose sacre et la retirent de la circulation correspondent au degr de saintet dont elle est investie, on arrive ce remarquable rsultat que les images de l'tre totmique sont plus sacres que l'tre totmique lui-mme. Au reste, dans les crmonies du culte, c'est le churinga, c'est le nurtunja qui tiennent la premire place; l'animal n'y apparat que trs exceptionnellement. Dans un rite, dont nous aurons parler , il sert de matire un repas religieux, mais il ne joue pas de rle actif. Les Arunta dansent autour du nurtunja, ils s'assemblent devant l'image de leur totem et ils l'adorent ; jamais semblable dmonstration ne s'adresse l'tre totmique lui-mme. Si ce dernier tait la chose sainte par excellence, c'est avec lui, c'est avec la plante ou l'animal sacr que le jeune initi devrait communier quand il est introduit dans le cercle de la vie religieuse; nous avons vu, au contraire, que le moment le plus solennel de l'initiation est celui oh le novice pntre dans le sanctuaire des churinga. C'est avec eux, c'est avec le nurtunja qu'il communie. Les reprsentations du totem ont donc une efficacit plus active que le totem lui-mme.
387
II
.
Il nous faut maintenant dterminer la place de l'homme dans le systme des choses religieuses. Nous sommes enclins, par tout un ensemble d'habitudes acquises et par la force mme du langage, concevoir l'homme du commun, le simple fidle comme un tre essentiellement profane. Il pourrait bien se faire que cette conception ne ft vraie la lettre d'aucune religion ; en tout cas, elle ne s'applique pas au totmisme. Chaque membre du clan est investi d'un caractre sacr qui n'est pas sensiblement infrieur celui que nous venons de reconnatre l'animal. La raison de cette saintet personnelle, c'est que l'homme croit tre, en mme temps qu'un homme au sens usuel du mot, un animal ou une plante de l'espce totmique.
388
En effet, il en porte le nom, or l'identit du nom passe alors pour impliquer une identit de nature. La premire n'est pas simplement considre comme l'indice extrieur de la seconde; elle la suppose logiquement, Car le nom, pour le primitif, n'est pas seulement un mot, une combinaison de sons ; c'est quelque chose de l'tre, et mme quelque chose d'essentiel. Un
387 388
V. liv. II, chap. II, II. Il n'y a peut-tre pas de religion qui fasse de l'homme un tre exclusivement profane. Pour le chrtien, l'me que chacun de nous porte en soi, et qui constitue l'essence mme de notre personnalit, a quelque chose de sacr. Nous verrons que cette conception de l'me est aussi vieille que la pense religieuse. Mais la place de l'homme dans la hirarchie des choses sacres est plus ou moins leve.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
125
membre du clan du Kangourou s'appelle lui-mme un kangourou ; il est donc, en un sens, un animal de cette mme espce. Un homme, disent Spencer et GILLEN, regarde l'tre qui lui sert de totem comme tant la mme chose que lui-mme. Un indigne, avec qui nous discutions la question, nous rpondit en nous montrant une photographie que nous venions de prendre de lui : Voil qui est exactement la mme chose que moi. Eh bien! il en est de mme du kangourou. Le kangourou tait son totem . Chaque individu a donc une double nature : en lui coexistent deux tres, un homme et un animal.
389
Pour donner un semblant d'intelligibilit cette dualit, si trange pour nous, le primitif a conu des mythes qui, sans doute, n'expliquent rien et ne font que dplacer la difficult, mais qui, en la dplaant, paraissent du moins en attnuer le scandale logique. Avec des variantes dans le dtail, ils sont tous construits sur le mme plan : ils ont pour objet d'tablir entre l'homme et l'animal totmique des rapports gnalogiques qui fassent du premier le parent du second. Par cette communaut d'origine, que l'on se reprsente, d'ailleurs, de manires diffrentes, on croit rendre compte de leur communaut de nature. Les Narrinyeri, par exemple, ont imagin que, parmi les premiers hommes, certains avaient le pouvoir de se transformer en btes . D'autres socits australiennes placent au dbut de l'humanit soit des animaux tranges, dont les hommes seraient descendus on ne sait trop comment , soit des tres mixtes, intermdiaires entre les deux rgnes , soit encore des cratures informes, peine reprsentables, dpourvues de tout organe dtermin, de tout membre dfini, oh les diffrentes parties du corps taient peine esquisses . Des puissances mythiques, parfois conues sous forme d'animaux, seraient intervenues ensuite, et auraient transform en hommes ces tres ambigus et innommables qui reprsentent, disent Spencer et GILLEN, une phase de transition entre l'tat d'homme et celui d'animal . Ces transformations nous sont prsentes comme le produit d'oprations violentes et quasi chirurgicales. C'est coups de hache ou, quand l'oprateur est un oiseau, coups de bec que l'individu humain aurait t sculpt dans cette masse amorphe, les membres spars les uns des autres, la bouche ouverte, les narines perces . On retrouve en Amrique des lgendes analogues, sauf que, en raison de la mentalit plus dveloppe de ces peuples, les reprsentations qu'elles mettent en oeuvre ne sont pas d'une confusion aussi troublante pour la pense. Tantt, c'est quelque personnage lgendaire qui, par un acte de son pouvoir, aurait mtamorphos en homme l'animal ponyme
390 391 392 393 394 395
389 390 391 392
393 394 395
Nat. Tr., p. 202. TAPLIN, The Narrinyeri, pp. 59-61. Chez certains clans Warramunga par exemple (North. Tr., p. 162). Chez les Urabunna (North. Tr., p. 147). Mme quand on nous dit de ces premiers tres que ce sont des hommes, en ralit, ils ne sont que semi-humains et participent, en mme temps, de la nature animale. C'est le cas de certains Unmatjera (Ibid., p. 153-154). Il y a l des manires de penser dont la confusion nous dconcerte, mais qu'il faut accepter telles quelles. Ce serait les dnaturer que de chercher y introduire une nettet qui leur est trangre (cf. Nat. Tr., p. 119). Chez certains Arunta (Nat. Tr., p. 388 et suiv.) ; chez certains Unmatjora (Nort. Tr., p. 153). Nat. Tr., p. 389. Cf. STREHLOW, I, pp. 2-7. Nat. Tr., p. 389 ; STREHLOW, I, p. 2 et suiv. Il y a, sans doute, dans ce thme mythique, un cho des rites d'initiation. L'initiation, elle aussi, a pour objet de faire du jeune homme un homme complet et, d'autre part, elle implique galement de vritables oprations chirurgicales (circoncision, subincision, extraction de dents, etc.). On devait naturellement concevoir sur le mme modle les procds qui servirent former les premiers hommes.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
126
du clan . Tantt le mythe essaye d'expliquer comment, par une suite d'vnements peu prs naturels et une sorte d'volution spontane, l'animal, de lui-mme, se serait peu peu transform et aurait fini par prendre une forme humaine .
396 397
Il existe, il est vrai, des socits (Haida, Tlinkit, Tsimshian) oh il n'est plus admis que l'homme soit n d'un animal ou d'une plante : l'ide d'une affinit entre les animaux de l'espce totmique et les membres du clan y a, pourtant, survcu, et elle s'exprime en des mythes qui, pour diffrer des prcdents, ne laissent pas de les rappeler dans ce qu'ils ont d'essentiel. Voici, en effet, l'un des thmes fondamentaux. L'anctre ponyme y est prsent comme un tre humain, mais qui, la suite de pripties diverses, aurait t amen vivre pendant un temps plus ou moins long au milieu d'animaux fabuleux de l'espce mme qui a donn son nom au clan. Par suite de ce commerce intime et prolong, il devint tellement semblable ses nouveaux compagnons que, quand il revint parmi les hommes, ceux-ci ne le reconnurent plus. On lui donna donc le nom de l'animal auquel il ressemblait. C'est de son sjour dans ce pays mythique qu'il aurait rapport l'emblme totmique avec les pouvoirs et les vertus qui passent pour y tre attachs . Ainsi, dans ce cas comme dans les prcdents, l'homme est cens participer de la nature de l'animal, bien que cette participation soit conue sous une forme lgrement diffrente .
398 399
396
397
398
399
C'est le cas des neuf clans des Moqui (SCHOOLGRAFT, Indian Tribes, IV, p. 86), du clan de la Grue chez les Ojibway (MORGAN, Ancient Society, p. 180), des clans des Nootka (BOAS, VIth Rep. on the N. W. Tribes of Canada, p. 43), etc. C'est ainsi que se serait form le clan de la Tortue chez les Iroquois. Un groupe de tortues aurait t oblig de quitter le lac o elles vivaient et de chercher un autre habitat. Une d'elles, plus grosse que les autres, supportait avec peine cet exercice cause de la chaleur. Elle fit des efforts si violents qu'elle sortit de sa carapace. Le processus de transformation, une fois commenc, se poursuivit de lui-mme et la tortue devint un homme qui fut l'anctre du clan (Erminnie A. SMITH, The Myths of the Iroquois, IId Rep., p. 77). Le clan de l'crevisse chez les Choctaw se serait form d'une manire analogue. Des hommes auraient surpris un certain nombre d'crevisses qui vivaient dans leur voisinage, les auraient amenes au milieu d'eux, leur auraient appris parler, marcher, et finalement les auraient adoptes dans leur socit (CATLIN, North American Indians, II, p. 128). Voici, par exemple, une lgende de Tsimshian. Au cours d'une chasse, un Indien rencontra un ours noir qui l'emmena chez lui, lui apprit attraper le saumon et construire les canots. Pendant deux annes, l'homme resta avec l'ours; aprs quoi il retourna son village natal. Mais les gens eurent peur de lui parce qu'il ressemblait un ours. Il ne pouvait ni parler, ni manger autre chose que des aliments crus. Alors on le frotta avec des herbes magiques et il reprit graduellement sa forme premire. Dans la suite, quand il tait dans le besoin, il appelait lui ses amis les ours qui venaient l'aider. Il construisit une maison et peignit sur le fronton un ours. Sa sur fit, pour la danse, une couverture sur laquelle un ours tait dessin. C'est pourquoi les descendants de cette soeur avaient l'ours pour emblme (BOAS, Kwakiutl, p. 323. Cf. Vth Report on the N. W. Tribes of Canada, p. 23,129 et suiv. ; Hill TOUT, Report on the Ethnology of the Statlumh of British Columbia, in J.A.I., 1905, XXXV, p. 150). On voit par l l'inconvnient qu'il y a faire de cette parent mystique entre l'homme et l'animal le caractre distinctif du totmisme, comme le propose M. Van GENNEP (Totmisme et mthode comparative, in Revue de l'histoire des religions, tome LVIII, 1908, juillet, p. 55). Cette parent est une expression mythique de faits autrement profonds ; elle peut manquer sans que les traits essentiels du totmisme disparaissent. Sans doute, il y a toujours entre les gens du clan et l'animal totmique des liens troits, mais qui ne sont pas ncessairement de consanguinit, bien qu'ils soient le plus gnralement conus sous cette dernire forme. Il y a, d'ailleurs, des mythes Tlinkit o le rapport de descendance entre l'homme et l'animal est plus particulirement affirm. On dit que le clan est issu d'une union mixte, si l'on peut ainsi parler, c'est-dire
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
127
Il a donc, lui aussi, quelque chose de sacr. Diffus dans tout l'organisme, ce caractre est plus particulirement apparent sur certains points privilgis. Il y a des organes et des tissus qui en sont spcialement marqus: ce sont surtout le sang et les cheveux. Le sang humain, tout d'abord, est chose si sainte que, dans les tribus de l'Australie centrale, il sert trs souvent consacrer les instruments les plus respects du culte. Le nurtunja, par exemple, est, dans certains cas, religieusement oint, de haut en bas, avec du sang d'homme . C'est sur un terrain tout dtremp de sang que les gens de l'mou, chez les Arunta, dessinent l'emblme sacr . Nous verrons plus loin comment les flots de sang sont rpandus sur les rochers qui reprsentent les plantes ou les animaux totmiques . Il n'est pas de crmonie religieuse o le sang n'ait quelque rle jouer . Au cours de l'initiation, il arrive que des adultes s'ouvrent les veines et arrosent de leur sang le novice ; et ce sang est une chose si sacre qu'il est dfendu aux femmes d'tre prsentes tandis qu'il coule ; la vue leur en est interdite, tout comme celle d'un churinga . Le sang que perd le jeune initi pendant les oprations violentes qu'il est tenu de subir a des vertus toutes particulires : il sert diverses communions . Celui qui s'coule pendant la subincision est, chez les Arunta, pieusement recueilli et enterr en un lieu sur lequel on place une pice de bois qui signale aux passants la saintet de l'endroit; aucune femme ne doit en approcher . C'est, d'ailleurs par la nature religieuse du sang que s'explique le rle, galement religieux, de l'ocre rouge qui, lui aussi, est d'un emploi trs frquent dans les crmonies ; on en frotte les churinga ; on s'en sert dans les dcorations rituelles . C'est que, cause de sa couleur, il est considr comme une substance parente du sang. Mme plusieurs dpts d'ocre rouge que l'on trouve sur diffrents points du territoire Arunta passent pour du sang coagul que certaines hrones de l'poque mythique auraient laiss s'couler sur le sol .
400 401 402 403 404 405 406 407 408
La chevelure a des proprits analogues. Les indignes du centre portent des ceintures, faites de cheveux humains, dont nous avons dj signal les fonctions religieuses : elles servent de bandelettes pour envelopper certains objets du culte . Un homme a-t-il prt un autre un
409
400 401 402 403 404 405
406 407 408 409
o soit l'homme, soit la femme tait une bte de l'espce dont le clan porte le nom (V. SWANTON, Social Condition, Beliefs, etc., of the Tlingit Indians, XXVIth Rep., pp. 415-418). Nat. Tr., p. 284. Ibid., p. 179. V. liv. III, chap. Il. Cf. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 184,201. Nat. Tr., pp. 204, 284, 262. Chez les Dieri, les Parnkalla. V. HOWITT, Nat. Tr., pp. 658, 661, 668, 669-671. Chez les Warramunga, le sang de la circoncision est bu par la mre (North. Tr., p. 352). Chez les Binbinga, le sang dont est souill le couteau qui a servi la subincision doit tre suc par l'initi (ibid., p. 368). D'une manire gnrale, le sang qui provient des parties gnitales passe pour exceptionnellement sacr (Nat. Tr., p. 464; North. Tr., p. 598). Nat. Tr., p. 268. Ibid., pp. 144, 568. Nat. Tr., pp. 442, 464. Le mythe est, d'ailleurs, gnral en Australie. Ibid., p. 627.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
128
de ses churinga ? En tmoignage de reconnaissance, le second fait au premier un prsent de cheveux ; ces deux sortes de choses sont donc considres comme de mme ordre et de valeur quivalente . Aussi l'opration de la coupe des cheveux est-elle un acte rituel qui s'accompagne de crmonies dtermines : l'individu qui la subit doit se tenir accroupi par terre, la face tourne dans la direction de l'endroit o sont censs avoir camp les anctres fabuleux de qui le clan de sa mre passe pour tre descendu .
410 411
Pour la mme raison, aussitt qu'un homme est mort, on lui coupe les cheveux, on les dpose dans un endroit cart, car ni les femmes ni les non-initis n'ont le droit de les voir ; et c'est l, loin des yeux profanes, que l'on procde la confection des ceintures .
412
On pourrait signaler d'autres tissus organiques qui, des degrs divers, manifestent des proprits analogues : tels sont les favoris, le prpuce, la graisse du foie, etc. Mais il est inutile de multiplier les exemples. Ceux qui prcdent suffisent prouver qu'il existe chez l'homme quelque chose qui tient le profane distance et qui possde une efficacit religieuse ; en d'autres termes, l'organisme humain recle dans ses profondeurs un principe sacr qui, dans des circonstances dtermines, vient ostensiblement affleurer au dehors. Ce principe ne diffre pas spcifiquement de celui qui fait le caractre religieux du totem. Nous venons de voir, en effet, que les substances diverses dans lesquelles il s'incarne plus minemment entrent dans la composition rituelle des instruments du culte (nurtunja, dessins totmiques), ou servent des onctions dont le but est de revivifier les vertus soit des churinga soit des rochers sacrs ; ce sont donc choses de mme espce.
413
Toutefois, la dignit religieuse qui, ce titre, est inhrente chaque membre du clan n'est pas gale chez tous. Les hommes la possdent un plus haut degr que les femmes ; par rapport eux, elles sont comme des profanes . Aussi, toutes les fois o il y a une assemble soit du groupe totmique soit de la tribu, les hommes forment un camp part, distinct de celui des femmes et ferm ces dernires : ils sont spars . Mais il y a aussi des diffrences dans la manire dont les hommes sont marqus du caractre religieux. Les jeunes gens non initis en sont totalement dpourvus puisqu'ils ne sont pas admis aux crmonies. C'est chez les anciens
414 415
410 411 412 413
414
415
Ibid., p. 466. Ibid. Si toutes ces formalits ne sont pas rigoureusement observes, on croit qu'il en rsultera pour l'individu de graves calamits, Nat. Tr., p. 358 ; North, Tr., p. 604. Le prpuce, une fois dtach par la circoncision, est parfois dissimul aux regards tout comme le sang; il a des vertus spciales; par exemple, il assure la fcondit de certaines espces vgtales et animales (North. Tr., p. 353-354). Les favoris sont assimils aux cheveux et traits comme tels (North. Tr., pp. 544, 604). Ils jouent d'ailleurs un rle dans les mythes (ibid., p. 158). Quant la graisse, son caractre sacr ressort de l'emploi qui en est fait dans certains rites funraires. Ce n'est pas dire que la femme soit absolument profane. Dans les mythes, elle joue, au moins chez les Arunta, un rle religieux beaucoup plus important que celui qu'elle a dans la ralit (Nat. Tr., p. 195-196). Maintenant encore, elle prend part certains rites de l'initiation. Enfin, son sang a des vertus religieuses (v. Nat. Tr., p. 464; cf. La prohibition de l'inceste et ses origines, Anne sociol., I, p. 51 et suiv.). C'est de cette situation complexe de la femme que dpendent les interdits exogamiques. Nous n'en parlons pas ici, parce qu'ils se rattachent plus directement au problme de l'organisation domestique et matrimoniale. Nat. Tr., p. 460.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
129
qu'il atteint son maximum d'intensit. Ils sont tellement sacrs que certaines choses dfendues au vulgaire leur sont permises: ils peuvent plus librement manger de l'animal totmique, et mme, comme nous l'avons vu, il y a des tribus o ils sont librs de toute prohibition alimentaire. Il faut donc se garder de voir dans le totmisme une sorte de zooltrie. L'homme n'a nullement, vis--vis des animaux ou des plantes dont il porte le nom, l'attitude du fidle vis-vis de son dieu, puisqu'il appartient lui-mme au monde sacr. Leurs rapports sont plutt ceux de deux tres qui sont sensiblement au mme niveau et d'gale valeur. Tout au plus peut-on dire que, du moins dans certains cas, l'animal parat occuper une place lgrement plus leve dans la hirarchie des choses sacres. C'est ainsi qu'il est appel quelquefois le pre ou le grand-pre des hommes du clan; ce qui semble indiquer qu'ils se sentent vis--vis de lui dans un certain tat de dpendance morale . Encore arrive-t-il souvent, et peut-tre mme le plus souvent, que les expressions employes dnotent plutt un sentiment d'galit. L'animal totmique est appel l'ami, le frre an de ses congnres humains . En dfinitive, les liens qui existent entre eux et lui ressemblent beaucoup plus ceux qui unissent les membres d'une mme famille ; animaux et hommes sont faits de la mme chair comme disent les Buandik . En raison de cette parent, l'homme voit dans les animaux de l'espce totmique de bienfaisants associs sur l'assistance desquels il croit pouvoir compter. Il les appelle son aide et ils viennent guider ses coups la chasse, l'avertir des dangers qu'il peut courir . En change, il les traite avec gards, il ne les brutalise pas ; mais les soins qu'il leur rend ne ressemblent aucunement un culte.
416 417 418 419 420 421
L'homme parat mme parfois avoir sur son totem une sorte de droit mystique de proprit. L'interdiction de le tuer et de le manger ne s'applique naturellement qu'aux membres du clan; elle ne pourrait s'tendre aux personnes trangres sans rendre la vie matriellement impossible. Si, dans une tribu comme celle des Arunta, o il y a une multitude de totems diffrents, il tait interdit de manger non seulement de l'animal ou de la plante dont on porte le nom, mais encore de tous les animaux et de toutes les plantes qui servent de totems aux autres clans, les ressources alimentaires seraient rduites rien. Il y a cependant des tribus o la consommation de la plante ou de l'animal totmique n'est pas permise sans restrictions, mme
416 417 418 419
420 421
Chez les Wakelbura, d'aprs HOWITT, P. 146; chez les Bechuana, d'aprs CASALIS, Basoutos, p. 221. Chez les Buandik, les Kurnai (HOWITT, Ibid.) ; chez les Arunta (STREHLOW, II, p. 58). HOWITT, ibid. Sur la rivire Tully, dit ROTH (Superstition, Magie and Medicine, in North Queensland Ethnography, no 5, 74), quand un indigne va dormir ou se lve le matin, il prononce voix plus ou moins basse le nom de l'animal d'aprs lequel il est lui-mme nomm. Le but de cette pratique est de rendre l'homme habile ou heureux la chasse ou de prvenir les dangers auxquels il peut tre expos de la part de cet animal. Par exemple, un homme qui a pour totem une espce de serpent, est l'abri des morsures si cette invocation a t rgulirement faite. TAPLIN, Narrinyeri, p. 64; HOWITT, Nat. Tr., p. 147; ROTH, loc. cit. STREHLOW, II, p. 58.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
130
l'tranger. Chez les Wakelbura, elle ne doit pas avoir lieu en prsence des gens du totem . Ailleurs, il faut leur permission. Par exemple, chez les Kaitish et les Unmatjera, quand un homme du totem de l'mou, se trouvant dans une localit occupe par un clan de la Semence de l'herbage (grass seed), cueille quelques-unes de ces graines, il doit, avant d'en manger, aller trouver le chef et lui dire : J'ai cueilli ces grains dans votre pays. A quoi le chef rpond : C'est bien ; vous pouvez les manger. Mais si l'homme de l'mou en mangeait avant d'avoir demand l'autorisation, on croit qu'il tomberait malade et courrait le risque de mourir . Il y a mme des cas o le chef du groupe doit prlever une petite part de l'aliment et la manger luimme : c'est une sorte de redevance qu'on est tenu d'acquitter . Pour la mme raison, le churinga communique au chasseur un certain pouvoir sur l'animal correspondant: par exemple, on a plus de chances de prendre des euros . C'est la preuve que le fait de participer la nature d'un tre totmique confre sur ce dernier une sorte de droit minent. Enfin, il y a, dans le Queensland septentrional, une tribu, les Karingbool, o les gens du totem ont seuls le droit de tuer l'animal totmique ou, si le totem est un arbre, de le dpouiller de son corce. Leur concours est indispensable tout tranger qui veut utiliser pour des fins personnelles la chair de cet animal ou le bois de cet arbre . Ils jouent donc le rle de propritaires, bien qu'videmment il s'agisse ici d'une proprit trs spciale et dont nous avons quelque mal nous faire une ide.
422 423 424 425 426
422 423 424 425 426
Howitt, p. 148. North. Tr., pp. 159-160. Ibid. Ibid., p. 255; Nat. Tr., pp. 202, 203. A. L. P. CAMERON, On Two Queensland Tribes, in Science of Man, Australasian Anthropological Journal, 1904, VII, 28, col. I.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
131
CHAPITRE III
LES CROYANCES PROPREMENT TOTMIQUES
(Suite)
III - Le systme cosmologique du totmisme et la notion de genre
On commence entrevoir que le totmisme est une religion beaucoup plus complexe qu'il n'a pu sembler au premier abord. Dj nous avons distingu trois catgories de choses qu'il reconnat, des degrs divers, comme sacres : l'emblme totmique, la plante on l'animal dont cet emblme reproduit l'aspect, les membres du clan. Cependant, ce tableau n'est pas encore complet. Une religion, en effet, n'est pas simplement une collection de croyances fragmentaires, relatives des objets trs particuliers comme ceux dont il vient d'tre question. Toutes les religions connues ont t plus ou moins des systmes d'ides qui tendaient embrasser l'universalit des choses et nous donner une reprsentation totale du monde. Pour que le totmisme puisse tre considr comme une religion comparable aux autres, il faut donc que lui aussi nous offre une conception de l'univers. Or, il satisfait cette condition.
I
.
Ce qui fait qu'on a gnralement nglig cet aspect du totmisme, c'est qu'on s'est fait du clan une notion trop troite. On n'y voit d'ordinaire qu'un groupe d'tres humains. Simple subdivision de la tribu, il semble que, comme celle-ci, il ne puisse tre compos que d'hommes. Mais, en raisonnant ainsi, nous substituons nos ides europennes
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
132
celles que le primitif se fait du monde et de la socit. Pour l'Australien, les choses ellesmmes, toutes les choses qui peuplent l'univers, font partie de la tribu; elles en sont des lments constitutifs et, pour ainsi dire, des membres rguliers ; elles ont donc, tout comme les hommes, une place dtermine dans les cadres de la socit : Le sauvage de l'Australie du sud, dit M. Fison, considre l'univers comme la grande tribu l'une des divisions de laquelle il appartient, et toutes les choses, animes ou inanimes, qui sont ranges dans le mme groupe que lui, sont des parties du corps dont il est lui-mme membre . En vertu de ce principe, quand la tribu est divise en deux phratries, tous les tres connus sont rpartis entre elles. Toute la nature, dit Palmer propos des tribus de la rivire Bellinger, est divise d'aprs les noms des phratries... Le soleil, la lune et les toiles... appartiennent telle ou telle phratrie tout comme les Noirs eux-mmes . La tribu de Port-Mackay, dans le Queensland, comprend deux phratries qui portent les noms de Yungaroo et de Wootaroo, et il en est de mme des tribus voisines. Or, dit Bridgmann, toutes les choses animes et inanimes sont divises par ces tribus en deux classes appeles Yungaroo et Wootaroo . Mais l ne s'arrte pas cette classification. Les hommes de chaque phratrie sont rpartis entre un certain nombre de clans ; de mme, les choses affectes chaque phratrie sont rparties, leur tour, entre les clans qui la composent. Tel arbre, par exemple, sera attribu au clan du Kangourou et lui seul et aura, par consquent, tout comme les membres humains de ce clan, le Kangourou pour totem ; tel autre ressortira au clan du Serpent ; les nuages seront rangs sous tel totem, le soleil sous tel autre, etc. Tous les tres connus se trouvent ainsi disposs en une sorte de tableau, de classification systmatique qui embrasse la nature tout entire.
427 428 429
Nous avons reproduit ailleurs un certain nombre de ces classifications ; nous nous bornons en rappeler quelques-unes titre d'exemples. L'une des plus connues est celle que l'on a observe dans la tribu du Mont-Gambier. Cette tribu comprend deux phratries qui portent le nom, l'une de Kumite, et l'autre de Kroki ; chacune d'elles son tour est divise en cinq clans. Or, toutes les choses de la nature appartiennent l'un ou l'autre de ces dix clans : Fison et Howitt disent qu'elles y sont incluses . Elles sont, en effet, classes sous ces dix totems comme des espces sous leurs genres respectifs. C'est ce que montre le tableau suivant, construit d'aprs les renseignements recueillis par Curr et par Fison et Howitt .
430 431 432
427 428 429 430 431 432
Kamilaroi and Kurnai, p. 170. Notes on some Australian Tribes, J.A.I., XIII, p. 300. Dans GURR, Australian Race, III, p. 45; BROUGH-SMYTH, The Aborigines of Victoria, I, p. 91; FISON et HOWITT, Kamilaroi and Kurnai, p. 168. DURKHEIM et Mauss, De quelques formes primitives de classification, in Anne sociol., VI, p. 1 et suiv. CURR, III, p. 461. Curr et Fison ont t renseigns par la mme personne, D. S. Stewart.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
133
PHRATRIES
CLANS
CHOSES CLASSES DANS CHAQUE CLAN La fume, le chvrefeuille, certains arbres, etc. L'arbre bois noir, les chiens, le feu, la glace, etc. La pluie, le tonnerre, l'clair, les nuages, la grle, l'hiver, etc. Les toiles, la lune, etc. Le poisson, le phoque, l'anguille les arbres corces fibreuses, etc. Le canard, l'crevisse, le hibou, etc. L'outarde, la caille, une sorte de kangourou, etc. Le kangourou, l't, le soleil, le vent, l'automne, etc.
Le faucon pcheur Le plican Kumite Le corbeau Le kakatos noir Un serpent sans venin
L'arbre th Une racine comestible Kroki Le kakatos blanc sans crte
Sur le 4e et le 5e clan kroki, les dtails manquent.
La liste des choses ainsi rattaches chaque clan est, d'ailleurs, fort incomplte; Curr nous avertit lui-mme qu'il s'est born en numrer quelques-unes. Mais grce aux travaux de Mathews et de Howitt , nous avons aujourd'hui, sur la classification adopte par la tribu des Wotjobaluk, des renseignements plus tendus qui permettent de mieux comprendre comment un systme de ce genre peut embrasser tout l'univers connu des indignes. Les Wotjobaluk sont, eux aussi, diviss en deux phratries appeles l'une Gurogity, l'autre Gumaty (Krokitch et Gamutch selon Howitt) : pour ne pas prolonger cette numration, nous nous contenterons d'indiquer, d'aprs Mathews, les choses classes dans quelques-uns des clans de la phratrie Gurogity.
433 434
433 434
MATHEWS, Aboriginal Tribes of N. S. Wales and Victoria, in Journal and Proceedings of the Royal Society of N. S. Wales, XXXVIII, pp. 287-288; HOWITT, Nat. Tr., p. 121. La forme fminine des noms donns par Mathews est : Gurogigurk et Gamatykurk. Ce sont ces formes que Howitt a reproduites avec une orthographe lgrement diffrente. Ces deux noms sont, d'ailleurs, les quivalents de ceux qui sont en usage dans la tribu du Mont-Gambier (Kumite et Kroki).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
134
Dans le clan de l'Igname sont classs le dindon des plaines, le chat indigne, le mopoke, le hibou dyim-dyim, la poule mallee, le perroquet rosella, le peewee. Dans le clan de la Moule , l'mou gris, le porc-pic, le courlis, le kakatos blanc, le canard des bois, le lzard mallee, la tortue puante, l'cureuil volant, l'opossum la queue en forme d'anneau, le pigeon aux ailes couleur de bronze (bronze-wing), le wijuggla.
435
Dans le clan du Soleil, le bandicoot, la lune, le rat-kangourou, la pie noire et la pie blanche, l'opossum, le faucon ngrt, la chenille du gommier, la chenille u mimoisa (wattle-tree), la plante Vnus. Dans le clan du Vent chaud , l'aigle faucon tte grise, le serpent tapis, le perroquet fumeur, le perroquet cailles (shell), le faucon murrakan, le serpent dikkomur, le perroquet collier, le serpent mirndai, le lzard au dos chin.
436
Si l'on songe qu'il y a bien d'autres clans (Howitt en nomme douze, Mathews quatorze et ce dernier prvient que sa liste est fort incomplte) , on comprendra comment toutes les choses auxquelles s'intresse l'indigne trouvent naturellement place dans ces classifications.
437
On a observ des arrangements similaires sur les points les plus diffrents du continent australien : dans l'Australie du Sud, dans l'tat de Victoria, dans la Nouvelle-Galles du Sud (chez les Euahlayi) ; on en trouve des traces trs apparentes dans les tribus du centre . Dans le Queensland, o les clans paraissent avoir disparu et o les classes matrimoniales sont les seules subdivisions de la phratrie, c'est entre les classes que sont rparties les choses. Ainsi, les Wakelbura sont diviss en deux phratries, Mallera et Wutaru; les classes de la premire sont appeles Kurgilla et Banbe, les classes de la seconde Wungo et Obu. Or, aux Banbe appartiennent l'opossum, le kangourou, le chien, le miel de la petite abeille, etc. Aux Wungo sont attribus l'mou, le bandicoot, le canard noir, le serpent noir, le serpent brun; aux Obu, le serpent tapis, le miel des abeilles piquantes, etc. ; aux Kurgilla, le porc-pic, le dindon des plaines, l'eau, la pluie, le feu, le tonnerre, etc.
438 439 440
On rencontre la mme organisation chez les Indiens de l'Amrique du Nord. Les Zui ont
435
436 437
438 439 440
Le nom indigne de ce clan est DyIup que Mathews ne traduit pas. Mais ce mot parat bien identique celui de Jallup par lequel Howitt dsigne un sous-clan de cette mme tribu et qu'il traduit par mussel, coquillage, moule. C'est pourquoi nous croyons pouvoir risquer cette traduction. C'est la traduction de Howitt, Mathews traduit le mot (Wartwurt) par la chaleur du soleil midi. Le tableau de Mathews et celui de Howitt sont en dsaccord sur plus d'un point important. Il semble mme que les clans attribus par Howitt la phratrie Kroki soient compts par Mathews dans la phratrie Gamutch et inversement. C'est la preuve des trs grandes difficults que prsentent ces observations. Ces discordances sont, d'ailleurs, sans intrt pour la question que nous traitons. Mrs. Langloh PARKER, The Euahlayi Tribe, p. 12 et suiv. On trouvera les faits plus loin. CURR, III, p. 27. Cf. HOWITT, Nat. Tr., p. 112. Nous nous bornons citer les faits les plus caractristiques. Pour le dtail, on pourra se reporter au mmoire dj cit sur Les classifications primitives.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
135
un systme de classification qui, dans ses lignes essentielles, est de tous points comparable ceux que nous venons de dcrire. Celui des Omaha repose sur les mmes principes que celui des Wotjobaltik . Un cho de ces mmes ides persiste jusque dans les socits les plus avances. Chez les Haida, tous les dieux, tous les tres mythiques qui sont prposs aux diffrents phnomnes de la nature sont eux-mmes classs, tout comme les hommes, dans l'une ou l'autre des deux phratries que comprend la tribu ; les uns sont des Aigles, les autres des Corbeaux . Or les dieux des choses ne sont qu'un autre aspect des choses mmes qu'ils gouvernent . Cette classification mythologique n'est donc qu'une autre forme des prcdentes. Nous sommes ainsi assurs que cette faon de concevoir le monde est indpendante de toute particularit ethnique ou gographique; mais en mme temps, il apparat avec vidence qu'elle tient troitement l'ensemble des croyances totmiques.
441 442 443
II
.
Dans le travail auquel nous avons dj fait plusieurs fois allusion, nous avons montr quelle lumire ces faits jettent sur la faon dont s'est forme, dans l'humanit, la notion de genre ou de classe. En effet, ces classifications systmatiques sont les premires que nous rencontrions dans l'histoire ; or, on vient de voir qu'elles se sont modeles sur l'organisation sociale, ou plutt qu'elles ont pris pour cadres les cadres mmes de la socit. Ce sont les phratries qui ont servi de genres, et les clans d'espces. C'est parce que les hommes taient groups qu'ils ont pu grouper les choses ; car pour classer ces dernires, ils se sont borns leur faire place dans les groupes qu'ils formaient eux-mmes. Et si ces diverses classes de choses n'ont pas t simplement juxtaposes les unes aux autres, mais ordonnes suivant un plan unitaire, c'est que les groupes sociaux avec lesquels elles se confondent sont eux-mmes solidaires et forment par leur union un tout organique, la tribu. L'unit de ces premiers systmes logiques ne fait que reproduire l'unit de la socit. Une premire occasion nous est ainsi offerte de vrifier la proposition que nous noncions au dbut de cet ouvrage et de nous assurer que les notions fondamentales de l'esprit, les catgories essentielles de la pense peuvent tre le produit de facteurs sociaux. Ce qui prcde dmontre, en effet, que c'est le cas de la notion mme de catgorie. Ce n'est pas, toutefois, que nous entendions refuser la conscience individuelle, mme rduite ses seules forces, le pouvoir d'apercevoir des ressemblances entre les choses particulires qu'elle se reprsente. Il est clair, au contraire, que les classifications, mme les
441 442 443
Ibid., p. 34 et suiv. SWANTON, The Haida, pp. 13-14, 17, 22. C'est particulirement manifeste chez les Haida. Chez eux, dit Swanton, tout animal a deux aspects. Par un ct, c'est un tre ordinaire, qui peut tre chass et mang; mais en mme temps, c'est un tre surnaturel, qui a la forme extrieure d'un animal, et de qui l'homme dpend. Les tres mythiques, correspondant aux divers phnomnes cosmiques, ont la mme ambigut (SWANTON, ibid., pp. 16, 14, 25).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
136
plus primitives et les plus simples, supposent dj cette facult. Ce n'est pas au hasard que l'Australien range les choses dans un mme clan ou dans des clans diffrents. En lui, comme en nous, les images similaires s'attirent, les images opposes se repoussent et c'est suivant le sentiment de ces affinits et ces rpulsions qu'il classe, ici ou l, les choses correspondantes. Il y a, d'ailleurs, des cas o nous entrevoyons les raisons qui Pont inspir. Les deux phratries ont trs vraisemblablement constitu les cadres initiaux et fondamentaux de ces classifications qui, par consquent, ont commenc par tre dichotomiques. Or, quand une classification se rduit deux genres, ceux-ci sont presque ncessairement conus sous la forme antithtique : on s'en sert avant tout comme d'un moyen pour sparer nettement les choses entre lesquelles le contraste est le plus marqu. On met les unes droite, les autres gauche. Tel est, en effet, le caractre des classifications australiennes. Si le kakatos blanc est class dans une phratrie, le kakatos noir est dans l'autre ; si le soleil est d'un ct, la lune et les astres de la nuit sont du ct oppos . Trs souvent, les tres qui servent de totems aux deux phratries ont des couleurs contraires . On retrouve de ces oppositions mme en dehors de l'Australie. L o l'une des phratries est prpose la paix, l'autre est prpose la guerre ; si l'une a l'eau pour totem, l'autre a pour totem la terre . C'est l, sans doute, ce qui explique que les deux phratries aient t souvent conues comme naturellement antagonistes l'une de l'autre. On admet qu'il y a entre elles une sorte de rivalit et mme d'hostilit constitutionnelle . L'opposition des choses s'est tendue aux personnes ; le contraste logique s'est doubl d'une sorte de conflit social .
444 445 446 447 448 449
D'un autre ct, l'intrieur de chaque phratrie, on a rang dans un mme clan les choses qui semblaient avoir le plus d'affinit avec celle qui servait de totem. Par exemple, on a mis la lune avec le kakatos noir, le soleil, au contraire, ainsi que l'atmosphre et le vent, avec le kakatos blanc. Ou bien encore, on a runi l'animal totmique tout ce qui sert l'alimen-
444 445 446 447
448
449
V. plus haut, p. 202. Il en est ainsi chez les Gourditch-mara (HOWITT, Nat. Tr., p. 124), dans les tribus observes par Cameron prs de Mortlake et chez les Wotjobaluk (HOWITT, Nat. Tr., pp. 125,250). J. MATHEW, Two Repres. Tribes, p. 139; Thomas, Kinship a. Mariage, etc., pp. 53-54. Par exemple chez les Osage (v. Dorsey, Siouan Sociology, in XVth Rep., p. 233 et suiv.). A Mabuiag, le du dtroit de Torrs (HADDON, Head Hanters, p. 132). On trouve d'ailleurs la mme opposition entre les deux phratries des Arunta : l'une comprend les gens de l'eau, l'autre les gens de la terre (STREHLOW, I, p. 6). Chez les Iroquois, il y a des sortes de tournois, entre les deux phratries (MORGAN, Ancient Society, p. 94). Chez les Haida, dit Swanton, les membres des deux phratries de l'Aigle et du Corbeau sont souvent considrs comme des ennemis avrs. Maris et femmes (qui sont obligatoirement de phratries diffrentes) n'hsitent pas se trahir mutuellement (The Haida, p. 62). En Australie, cette hostilit se traduit dans les mythes. Les deux animaux qui servent de totems aux deux phratries sont souvent prsents comme perptuellement en guerre l'un contre l'autre (v. J. MATHEW, Eaglekawk and Crow, a Study of Australian Aborigines, p. 14 et suiv.). Dans les jeux, chaque phratrie est j'mule naturelle de l'autre (HOWITT, Nat. Tr., p. 770). C'est donc tort que M. THOMAS a reproch notre thorie sur la gense des phratries de ne pouvoir expliquer leur opposition (Kinship and Marriage in Australia, p. 69). Nous ne croyons pas toutefois qu'il faille ramener cette opposition celle du profane et du sacr (v. HERTZ, La prminence de l main droite, in Revue phil., 1909, dc., p. 559). Les choses d'une phratrie ne sont pas profanes pour l'autre; les unes et les autres font partie d'un mme systme religieux (v. plus bas, p. 220).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
137
tation , ainsi que les animaux avec lesquels il est le plus troitement en rapports . Sans doute, nous ne pouvons pas toujours comprendre l'obscure psychologie qui a prsid beaucoup de ces rapprochements ou de ces distinctions. Mais les exemples qui prcdent suffisent montrer qu'une certaine intuition des ressemblances ou des diffrences que prsentent les choses a jou un rle dans la gense de ces classifications.
450 451
Mais autre chose est le sentiment des ressemblances, autre chose la notion de genre. Le genre, c'est le cadre extrieur dont des objets perus comme semblables forment, en partie, le contenu. Or le contenu ne peut pas, fournir lui-mme le cadre dans lequel il se dispose. Il est fait d'images vagues et flottantes, dues la superposition et la fusion partielle d'un nombre dtermin d'images individuelles, qui se trouvent avoir des lments communs ; le cadre au contraire, est une forme dfinie, aux contours arrts, mais qui est susceptible de s'appliquer un nombre dtermin de choses, perues ou non, actuelles ou possibles. Tout genre, en effet, a un champ d'extension qui dpasse infiniment le cercle des objets dont nous avons prouv, par exprience directe, la ressemblance. Voil pourquoi toute une cole de penseurs se refuse, non sans raison, identifier l'ide de genre et celle d'image gnrique. L'image gnrique, ce n'est que la reprsentation rsiduelle, aux frontires indcises, que laissent en nous des reprsentations semblables, quand elles sont simultanment prsentes dans la conscience; le genre, c'est un symbole logique grce auquel nous pensons distinctement ces similitudes et d'autres analogues. Au reste, la meilleure preuve de l'cart qui spare ces deux notions, c'est que l'animal est capable de former des images gnriques, tandis qu'il ignore l'art de penser par genres et par espces. L'ide de genre est un instrument de la pense qui a t manifestement construit par les hommes. Mais pour le construire, il nous a, tout au moins, fallu un modle ; car comment cette ide aurait-elle pu natre s'il n'y avait rien eu ni en nous ni en dehors de nous qui ft de nature nous la suggrer ? Rpondre qu'elle nous est donne a priori, ce n'est pas rpondre ; cette solution paresseuse est, comme on a dit, la mort de l'analyse. Or, on ne voit pas o nous aurions pu trouver ce modle indispensable, sinon dans le spectacle de la vie collective. Un genre en effet, c'est un groupement idal, mais nettement dfini, de choses entre lesquelles il existe des liens internes, analogues des liens de parent. Or les seuls groupements de cette sorte que nous fasse connatre l'exprience, sont ceux que forment les hommes en s'associant. Les choses matrielles peuvent former des touts de collection, des amas, des assemblages mcaniques sans unit interne, mais non des groupes au sens que nous venons de donner au mot. Un monceau de sable, un tas de pierres n'a rien de comparable cette espce de socit dfinie et organise qu'est un genre. Suivant toute vraisemblance, nous n'aurions donc jamais pens runir les tres de l'univers en groupes homognes, appels genres, si nous n'avions eu
450
451
Par exemple, le clan de l'arbre th comprend les herbages, par suite les herbivores (v. Kamilaroi and Kurnai, p. 169). C'est l, sans doute, ce qui explique une particularit que Boas signale dans les emblmes totmiques de l'Amrique du Nord. Chez les Tlinkit, dit-il, et dans toutes les autres tribus de la cte, l'emblme d'un groupe comprend les animaux qui servent de nourriture celui dont le groupe porte le nom (Firth Rep. of the Committee, etc., British Association for the Advancement of Science, p. 25). Ainsi, chez les Arunta, les grenouilles sont associes au totem de l'arbre gomme, parce qu'on en trouve souvent dans les cavits de cet arbre; l'eau est rattache la poule d'eau ; au kangourou, une sorte de perroquet que l'on voit frquemment voleter autour de cet animal (Spencer et GILLEN, Nat, Tr., pp. 146147, 448).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
138
sous les yeux l'exemple des socits humaines, si mme nous n'avions commenc par faire des choses elles-mmes des membres de la socit des hommes, si bien que groupements humains et groupements logiques ont d'abord t confondus .
452
D'un autre ct, une classification est un systme dont les parties sont disposes suivant un ordre hirarchique. Il y a des caractres dominateurs et d'autres qui sont subordonns aux premiers ; les espces et leurs proprits distinctives dpendent des genres et des attributs qui les dfinissent; ou bien encore, les diffrentes espces d'un mme genre sont conues comme situes au mme niveau les unes que les autres. Se place-t-on de prfrence au point de vue de la comprhension ? On se reprsente alors les choses suivant un ordre inverse : on met tout en haut les espces les plus particulires et les plus riches en ralit, en bas, les types les plus gnraux et les plus pauvres en qualits. Mais on ne laisse pas de se les reprsenter sous une forme hirarchique. Et il faut se garder de croire que l'expression n'ait ici qu'un sens mtaphorique : ce sont bien rellement des rapports de subordination et de coordination qu'une classification a pour objet d'tablir et l'homme n'aurait mme pas pens ordonner ses connaissances de cette manire, s'il n'avait su, au pralable, ce que c'est qu'une hirarchie. Or, ni le spectacle de la nature physique, ni le mcanisme des associations mentales ne sauraient nous en fournir l'ide. La hirarchie est exclusivement une chose sociale. C'est seulement dans la socit qu'il existe des suprieurs, des infrieurs, des gaux. Par consquent, alors mme que les faits ne seraient pas ce point dmonstratifs, la seule analyse de ces notions suffirait rvler leur origine. C'est la socit que nous les avons empruntes pour les projeter ensuite dans notre reprsentation du monde. C'est la socit qui a fourni le canevas sur lequel a travaill la pense logique.
III
.
Mais ces classifications primitives intressent, non moins directement, la gense de la pense religieuse. Elles impliquent, en effet, que toutes les choses ainsi classes dans un mme clan ou dans une mme phratrie sont troitement parentes et les unes des autres et de celle qui sert de totem cette phratrie ou ce clan. Quand l'Australien de la tribu de Port-Mackay dit du soleil, des
452
Un des signes de cette indistinction primitive, c'est que l'on assigne parfois aux genres une base territoriale, tout comme aux divisions sociales avec lesquelles ils taient d'abord confondus. Ainsi, chez les Wotjobaluk en Australie, chez les Zui en Amrique, les choses sont rparties idalement entre les diffrentes rgions de l'espace, ainsi que les clans. Or la rpartition rgionale des choses et celle des clans concident (v. De quelques formes primitives de classification, p. 34 et suiv.). Les classifications gardent mme quelque chose de ce caractre spatial jusque chez les peuples relativement avancs, par exemple en Chine (ibid., p. 55 et suiv.).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
139
serpents, etc., qu'ils sont de la phratrie Yungaroo, il n'entend pas simplement appliquer tous ces tres disparates une tiquette commune, mais purement conventionnelle ; le mot a pour lui une signification objective. Il croit que, rellement, les alligators sont Yungaroo, et que les kangourous sont Wootaroo. Le soleil est Yungaroo, la lune Wootaroo et ainsi de suite pour les constellations, les arbres, les plantes, etc. . Un lien interne les attache au groupe dans lequel ils sont rangs ; ils en sont membres rguliers. On dit qu'ils appartiennent ce groupe , tout comme les individus humains qui en font partie ; par suite, une relation du mme genre les unit ces derniers. L'homme voit dans les choses de son clan des parents ou des associs ; il les appelle des amis, il les considre comme faits de la mme chair que lui . Aussi y a-t-il entre elles et lui des affinits lectives et des rapports de convenance tout particuliers. Choses et gens s'appellent, en quelque sorte, s'entendent, s'harmonisent naturellement. Par exemple, quand on enterre un Wakelbura de la phratrie Mallera, l'chafaud sur lequel le corps est expos doit tre fait du bois de quelque arbre appartenant la phratrie Mallera . Il en est de mme des branchages qui recouvrent le cadavre. Si le dfunt est de la classe Banbe, on devra employer un arbre Banbe. Dans la mme tribu, un magicien ne peut se servir pour son art que de choses qui ressortissent sa phratrie ; parce que les autres lui sont trangres, il ne saurait s'en faire obir. Un lien de sympathie mystique unit ainsi chaque individu aux tres vivants ou non, qui lui sont associs ; il en rsulte qu'on croit pouvoir induire ce qu'il fera ou ce qu'il a fait d'aprs ce qu'ils font. Chez ces mmes Walkelbura, quand un individu rve qu'il a tu un animal appartenant telle division sociale, il s'attend rencontrer le lendemain un homme de la mme division . Inversement, les choses affectes un clan ou une phratrie ne peuvent servir contre les membres de cette phratrie ou de ce clan. Chez les Wotjobaluk, chaque phratrie a ses arbres qui lui sont propres.
453 454 455 456 457 458
Or, pour chasser un animal de la phratrie Gurogity, on ne peut employer que des armes dont le bois est emprunt aux arbres de l'autre phratrie et inversement ; sinon le chasseur est assur de manquer son coup . L'indigne est convaincu que la flche se dtournerait d'ellemme du but et se refuserait, pour ainsi dire, atteindre un animal parent et ami.
459
Ainsi, les gens du clan et les choses qui y sont classes forment, par leur runion, un systme solidaire dont toutes les parties sont lies et vibrent sympathiquement. Cette organisation qui, tout d'abord, pouvait nous paratre purement logique est, en mme temps, morale. Un mme principe l'anime et en fait l'unit : c'est le totem. De mme qu'un homme qui appartient au clan du Corbeau a en lui quelque chose de cet animal, la pluie, puisqu'elle est du mme clan et qu'elle ressortit au mme totem, est ncessairement considre, elle aussi, comme tant la mme chose qu'un corbeau ; pour la mme raison, la lune est un kakatos noir, le
453 454 455 456 457 458 459
BRIDGMANN, in BROUGH SMYTH, The Aborigines of Victoria, I, p. 91. Fison et HOWITT, Kamilaroi and Kurnai, p. 168; HOWITT, Further Notes on the Australian Class Systems, J.A.I., XVIII, p. 60. CURR, III, p. 461. Il s'agit de la tribu du Mont-Gambier. HOWITT, On some Australian Beliefs, J.A.I., XIII, p. 191, no 1. HOWITT, Notes on Australian Message Sticks, J.A.I., XVIII, p. 326; Further Notes, J.A.I., XVIII, p. 61, no 3. CURR, III, p. 28. MATHEWS, Etnological Notes on the Aboriginal Tribes of N. S. Wales and Victoria, in Journ. and Proc. of the B. Society of N. S. Wales, XXXVIII, p. 294.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
140
soleil un kakatos blanc, tout arbre bois noir un plican, etc. Tous les tres rangs dans un mme clan, hommes, animaux, plantes, objets inanims, sont donc de simples modalits de l'tre totmique. Voil ce que signifie la formule que nous rapportions tout l'heure et qui en fait de vritables congnres : tous sont bien rellement de la mme chair en ce sens qu'ils participent tous de la nature de l'animal totmique. D'ailleurs, les qualificatifs qu'on leur donne sont aussi ceux qu'on donne au totem . Les Wotjobaluk appellent du mme nom Mir et le totem et les choses subsumes sous lui . Chez les Arunta, o, comme nous le verrons, il existe encore des traces visibles de classification, des mots diffrents, il est vrai, dsignent le totem et les tres qui y sont rattachs ; pourtant, le nom qu'on donne ces derniers tmoigne des troits rapports qui les unissent l'animal totmique. On dit qu'ils sont ses intimes, ses associs, ses amis ; on croit qu'ils en sont insparables . On a donc le sentiment que ce sont des choses trs proches parentes.
460 461 462
Mais d'un autre ct, nous savons que l'animal totmique est un tre sacr. Toutes les choses qui sont ranges dans le clan dont il est l'emblme ont donc le mme caractre, puisqu'elles sont, en un sens, des animaux de la mme espce, tout comme l'homme. Elles sont, elles aussi, sacres, et les classifications qui les situent par rapport aux autres choses de l'univers, leur assignent du mme coup une place dans l'ensemble du systme religieux. C'est pourquoi celles d'entre elles qui sont des animaux ou des plantes ne peuvent pas tre librement consommes par les membres humains du clan. Ainsi, dans la tribu du Mont-Gambier, les gens qui ont pour totem un serpent sans venin, ne doivent pas seulement s'abstenir de la chair de ce serpent; celle des phoques, des anguilles, etc., leur est galement interdite . Si, pousss par la ncessit, ils se laissent aller en manger, ils doivent tout au moins attnuer le sacrilge par des rites expiatoires, comme s'il s'agissait de totems proprement dits . Chez les Euahlayi , o il est permis d'user du totem, mais non d'en abuser, la mme rgle s'applique aux autres choses du clan. Chez les Arunta, l'interdiction qui protge l'animal totmique s'tend jusqu'aux animaux associs ; et, en tout cas, on doit ces derniers des gards tout particuliers . Les sentiments que les uns et les autres inspirent sont identiques .
463 464 465 466 467 468
460 461 462 463 464 465 466 467 468
Cf. CURR, III, p. 461, et HOWITT, Nat. Tr., p. 146. Les expressions de Tooman et de Wingo s'appliquent aux uns et aux autres. HOWITT, Nat. Tr., p. 123. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 447 et suiv. ; STREHLOW, III, p. XII et suiv. FISON et HOWITT, Kamilaroi and Kurnai, p. 169. CURR, III, p. 462. Mrs. MARKER, The Euahlayi Tribe, p. 20. SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 151; Nat, Tr., p. 447; STREHLOW, III, p. XII. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 449. Il y a cependant certaines tribus du Queensland o les choses ainsi affectes un groupe social ne sont pas interdites aux membres de ce groupe: telle est notamment celle des Wakelbura. On se rappelle que, dans cette socit, ce sont les classes matrimoniales qui servent de cadres la classification (v. plus haut, p. 204). Or, non seulement les gens d'une classe peuvent manger des animaux attribus cette classe, mais ils ne peuvent en manger d'autres. Toute autre alimentation leur est interdite (HOWITT, Nat. Tr., p. 113; Curr, III, p. 27). Il faut pourtant se garder d'en conclure que ces animaux soient considrs comme profanes. On remarquera, en effet, que l'individu n'a pas simplement la facult d'en manger, mais qu'il y est obligatoirement tenu, puisqu'il lui est dfendu de s'alimenter autrement. Or ce caractre impratif de la prescription est le signe certain que nous sommes en prsence de choses qui ont une nature religieuse.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
141
Mais ce qui montre mieux encore que toutes les choses ainsi rattaches un totem ne sont pas d'une autre nature que celui-ci et, par consquent, qu'elles ont un caractre religieux, c'est qu' l'occasion elles jouent le mme rle. Ce sont des totems accessoires, secondaires, ou, suivant une expression qui est aujourd'hui consacre par l'usage, des sous-totems . Il arrive sans cesse que, dans un clan, il se forme, sous l'influence de sympathies, d'affinits particulires, des groupes plus restreints, des associations plus limites qui tendent vivre d'une vie relativement autonome, et former comme une subdivision nouvelle, comme un sous-clan l'intrieur du premier. Ce sous-clan, pour se distinguer et s'individualiser, a besoin d'un totem particulier, d'un sous-totem par consquent . Or, c'est parmi les choses diverses classes sous le totem principal que sont choisis les totems de ces groupes secondaires. Elles sont donc la lettre, des totems virtuels, et la moindre circonstance suffit les faire passer l'acte. Il y a en elles une nature totmique latente qui se manifeste ds que les conditions le permettent ou l'exigent. Il arrive ainsi qu'un mme individu a deux totems : un totem principal qui est commun au clan tout entier et un sous-totem qui est spcial au sous-clan dont il fait partie. C'est quelque chose d'analogue au nomen et au cognomen des Romains .
469 470 471
Parfois, nous voyons mme un sous-clan s'affranchir totalement et devenir un groupe autonome, un clan indpendant : le sous-totem, de son ct, devient alors un totem proprement dit. Une tribu o ce processus de segmentation a t, pour ainsi dire, port jusqu' son extrme limite est celle des Arunta. Dj les indications contenues dans le premier livre de Spencer et Gillen dmontraient qu'il y avait chez les Arunta une soixantaine de totems ; mais les rcentes recherches de Strehlow ont tabli que le nombre en est beaucoup plus considrable. Il n'en compte pas moins de 442 . Spencer et Gillen ne commettaient donc aucune exagration quand ils disaient que dans le pays occup par les indignes, il n'existe pas un objet, anim ou inanim, qui ne donne son nom quelque groupe totmique d'individus . Or cette multitude de totems, qui est prodigieuse quand on la compare au chiffre de la population, vient de ce que, sous l'influence de circonstances particulires, les clans primitifs se sont diviss et subdiviss l'infini; par suite, presque tous les sous-totems sont passs l'tat de totems.
472 473 474
C'est ce que les observations de Strehlow ont dfinitivement dmontr. Spencer et Gillen
Seulement, la religiosit dont elles sont marques a donn naissance une obligation positive, et non cette obligation ngative qu'est un interdit. Peut-tre mme n'est-il pas impossible d'apercevoir comment a pu se faire cette dviation. Nous avons vu plus haut (v. p. 198) que tout individu est cens avoir une sorte de droit de proprit sur son totem et, par suite, sur les choses qui en dpendent. Que, sous l'influence de circonstances spciales, cet aspect de la relation totmique se soit dvelopp, et l'on en sera venu tout naturellement croire que les membres d'un clan pouvaient seuls disposer de leur totem et de tout ce qui lui est assimil ; que les autres, au contraire, n'avaient pas le droit d'y toucher. Dans ces conditions, un clan ne pouvait se nourrir que des choses qui lui taient affectes. Mrs. Parker se sert de l'expression de multiplex totems. V. comme exemples la tribu des Euahlayi dans le livre de Mrs PARKER (P. 15 et suiv.) et celle des Wotjobaluk (HOWITT, Nat. Tr., p. 121 et suiv.; cf. l'article de Mathews dj cit). V. des exemples dans HOWITT, Nat. Tr., p. 122. V. De quelques formes primitives de classification, p. 28, no 2. STREHLOW, II, pp. 61-72. Nat. Tr., p. 112.
469 470 471 472 473 474
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
142
n'avaient cit que quelques cas isols de totems associs . Strehlow a tabli qu'il s'agissait en ralit d'une organisation absolument gnrale ; il a pu dresser un tableau o peu prs tous les totems des Arunta sont classs d'aprs ce principe : tous sont rattachs, en qualit d'associs ou d'auxiliaires, une soixantaine de totems principaux . Les premiers sont censs tre au service des seconds . Cet tat de dpendance relative est trs vraisemblablement l'cho d'un temps o les allis d'aujourd'hui n'taient que des sous-totems, o par suite, la tribu ne comptait qu'un petit nombre de clans, subdiviss en sous-clans. De nombreuses survivances confirment cette hypothse. Il arrive frquemment que deux groupes qui sont ainsi associs ont le mme emblme totmique : or l'unit de l'emblme n'est explicable que si, primitivement, les deux groupes ne faisaient qu'un . Ailleurs, la parent des deux clans se manifeste par la part et l'intrt que chacun d'eux prend aux rites de l'autre. Les deux cultes ne sont encore qu'imparfaitement spars; c'est, trs probablement, qu'ils ont commenc par tre compltement confondus . La tradition explique le lien qui les unit en imaginant qu'autrefois les deux clans occupaient des habitats tout voisins . Dans d'autres cas, le mythe dit mme expressment que l'un d'eux est driv de l'autre. On raconte que l'animal associ a commenc par appartenir l'espce qui sert encore de totem principal ; il ne s'en serait diffrenci qu' une poque ultrieure. Ainsi, les oiseaux chantunga, qui sont associs aujourd'hui la chenille witchetty, auraient t, aux temps fabuleux, des chenilles witchetty qui se seraient ensuite transformes en oiseaux. Deux espces qui sont rattaches actuellement au totem de la fourmi miel auraient t primitivement des fourmis miel, etc. Cette transformation d'un sous-totem en totem se fait, d'ailleurs, par degrs insensibles, si bien que, dans certains cas, la situation est indcise et il est trs malais de dire si l'on a affaire un totem principal ou un totem secondaire . Il y a, comme dit Howitt propos des Wotjobaluk, des sous-totems qui sont des totems en voie de formation . Ainsi, les diffrentes choses qui sont classes dans un clan
475 476 477 478 479 480 481 482 483
475 476
477
478
479 480 481 482 483
V. notamment Nat. Tr., p. 447, et North. Tr., p. 151. STREHLOW, III, p. xiii-xvii. il arrive que les mmes totems secondaires sont rattachs simultanment deux ou trois totems principaux. C'est, sans doute, que Strehlow n'a pu tablir avec certitude lequel de ces totems tait vritablement le principal. Deux faits intressants, qui ressortent de ce tableau, confirment certaines propositions que nous avons prcdemment nonces. D'abord, les totems principaux sont presque tous des animaux, trs peu d'exceptions prs. Ensuite, les astres ne sont jamais que des totems secondaires ou associs. C'est une preuve nouvelle que ces derniers n'ont t que tardivement promus la dignit de totems et que, primitivement, les totems principaux ont t de prfrence emprunts au rgne animal. Suivant le mythe, les totems associs auraient, pendant les temps fabuleux, servi nourrir les gens du totem principal, ou quand ce sont des arbres, leur auraient prt leur ombrage (STREHLOW, III, p. XII; SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 403). Le fait que le totem associ passe pour avoir t consomm n'implique pas, d'ailleurs, qu'il soit considr comme profane; car, l'poque mythique, le totem principal lui-mme tait, croit-on, consomm par les anctres, fondateurs du clan. Ainsi, dans le clan du Chat sauvage, les dessins gravs sur le churinga reprsente l'arbre fleurs Hakea qui est aujourd'hui un totem distinct (SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 147-148). STREHLOW (III, p. XII, no 4) dit que le fait est frquent. SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 182; Nat. Tr., pp. 151 et 297. Nat. Tr., pp. 151 et 158. Ibid., pp. 447-449. C'est ainsi que SPENCER et GILLEN nous parlent du pigeon appel Inturita tantt comme d'un totem principal (Nul. Tr., p. 410), tantt comme d'un totem associ (ibid., p. 448). HOWITT, Burther notes, pp. 63-64.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
143
constituent comme autant de centres autour desquels peuvent se former de nouveaux cultes totmiques. C'est la meilleure preuve des sentiments religieux qu'elles inspirent. Si elles n'avaient pas un caractre sacr, elles ne pourraient pas tre promues aussi facilement la mme dignit que les choses sacres par excellence, les totems proprement dits. Le cercle des choses religieuses s'tend donc bien au del des limites dans lesquelles il paraissait tout d'abord renferm. Il ne comprend pas seulement les animaux totmiques et les membres humains du clan; mais, puisqu'il n'existe rien de connu qui ne soit class dans un clan et sous un totem, il n'existe galement rien qui ne reoive, des degrs divers, quelque reflet de religiosit. Quand, dans les religions qui se formeront ultrieurement, les dieux proprement dits apparatront, chacun d'eux sera prpos une catgorie spciale de phnomnes naturels, celuici la mer, celui-l l'atmosphre, un autre la moisson ou aux fruits, etc., et chacune de ces provinces de la nature sera considre comme tirant la vie qui est en elle du dieu dont elle dpend. C'est prcisment cette rpartition de la nature entre les diffrentes divinits qui constitue la reprsentation que ces religions nous donnent de l'univers. Or, tant que l'humanit n'a pas dpass la phase du totmisme, les diffrents totems de la tribu jouent exactement le rle qui reviendra plus tard aux personnalits divines. Dans la tribu du Mont-Gambier, que nous avons prise pour principal exemple, il y a dix clans ; par suite, le monde entier est rparti en dix classes, ou plutt en dix familles dont chacune a un totem spcial pour souche. C'est de cette souche que toutes les choses classes dans un clan tiennent leur ralit, puisqu'elles sont conues comme des modes varis de l'tre totmique; pour reprendre notre exemple, la pluie, le tonnerre, l'clair, les nuages, la grle, l'hiver sont regards comme des sortes diffrentes de corbeau. Runies, ces dix familles de choses constituent une reprsentation complte et systmatique du monde ; et cette reprsentation est religieuse, puisque ce sont des notions religieuses qui en fournissent les principes. Loin d'tre born une ou deux catgories d'tres, le domaine de la religion totmique s'tend donc jusqu'aux dernires limites de l'univers connu. Tout comme la religion grecque, elle met du divin partout; la formule clbre panta plr then peut galement lui servir de devise. Seulement, pour pouvoir se reprsenter ainsi le totmisme, il faut modifier, sur un point essentiel, la notion qu'on s'en est longtemps faite. jusqu'aux dcouvertes de ces dernires annes, on le faisait consister tout entier dans le culte d'un totem particulier et on le dfinissait la religion du clan. De ce point de vue, il paraissait y avoir, dans une mme tribu, autant de religions totmiques, indpendantes les unes des autres, qu'il s'y trouve de clans diffrents. Cette conception tait, d'ailleurs, en harmonie avec l'ide qu'on se fait couramment du clan : on y voit, en effet, une socit autonome , plus ou moins ferme aux socits similaires ou n'ayant avec ces dernires que des relations extrieures et superficielles. Mais la ralit est plus complexe. Sans doute, le culte de chaque totem a son foyer dans le clan correspondant ; c'est l et l seulement qu'il est clbr ; ce sont les membres du clan qui en ont la charge ; c'est par eux qu'il se transmet d'une gnration l'autre, ainsi que les croyances qui en sont la base. Mais d'un autre ct, les diffrents cultes totmiques qui sont ainsi pratiqus l'intrieur d'une mme tribu ne se dveloppent pas paralllement et en s'ignorant les uns les autres, comme si
484
484
C'est ainsi que, trs souvent, le clan a t confondu avec la tribu. Cette confusion, qui jette frquemment du trouble sur les descriptions des ethnographes, a t notamment commise par Curr (I, p. 61 et suiv.).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
144
chacun d'eux constituait une religion complte et qui se suffit elle-mme. Au contraire, ils s'impliquent mutuellement; ils ne sont que les parties d'un mme tout, les lments d'une mme religion. Les hommes d'un clan ne considrent nullement les croyances des clans voisins avec l'indiffrence, le scepticisme ou l'hostilit qu'inspire ordinairement une religion laquelle on est tranger ; ils partagent eux-mmes ces croyances. Les gens du Corbeau Sont, eux aussi, convaincus que les gens du Serpent ont un serpent mythique pour anctre et doivent cette origine des vertus spciales et des pouvoirs merveilleux. N'avons-nous pas vu que, dans de certaines conditions tout au moins, un homme ne peut manger d'un totem qui n'est pas le sien qu'aprs avoir observ des formalits rituelles ? Notamment, il en demande l'autorisation aux individus de ce totem s'il en est qui sont prsents. C'est donc que, pour lui aussi, cet aliment n'est pas purement profane ; lui aussi admet qu'entre les membres d'un clan dont il ne fait pas partie et l'animal dont ils portent le nom il existe d'intimes affinits. D'ailleurs, cette communaut de croyances se manifeste parfois dans le culte. Si, en principe, les rites qui concernent un totem ne peuvent tre accomplis que par les gens de ce totem, il est cependant trs frquent que des reprsentants de clans diffrents y assistent. Il arrive mme que leur rle n'est pas celui de simples spectateurs ; sans doute, ce ne sont pas eux qui officient, mais ils dcorent les officiants et prparent le service. Ils sont eux-mmes intresss ce qu'il soit clbr ; c'est pourquoi, dans certaines tribus, ce sont eux qui invitent le clan qualifi procder cette clbration . Il y a mme tout un cycle de rites qui se droule obligatoirement en prsence de la tribu assemble : ce sont les crmonies totmiques de l'initiation .
485 486
Au reste, l'organisation totmique, telle que nous venons de la dcrire, doit manifestement rsulter d'une sorte d'entente entre tous les membres de la tribu indistinctement. Il est impossible que chaque clan se soit fait ses croyances d'une manire absolument indpendante; mais il faut, de toute ncessit, que les cultes des diffrents totems aient t, en quelque sorte, ajusts les uns aux autres puisqu'ils se compltent exactement. Nous avons vu, en effet, que, normalement, un mme totem ne se rptait pas deux fois dans la mme tribu et que l'univers entier tait rparti entre les totems ainsi constitus de manire ce que le mme objet ne se retrouve pas dans deux clans diffrents. Une rpartition aussi mthodique n'aurait pu se faire sans un accord, tacite ou rflchi, auquel toute la tribu a d participer. L'ensemble de croyances qui a ainsi pris naissance est donc, en partie (mais en partie seulement), une chose tribale .
487
En rsum, pour se faire une ide adquate du totmisme, il ne faut pas s'enfermer dans les limites du clan, mais considrer la tribu dans sa totalit. Assurment, le culte particulier de chaque clan jouit d'une trs grande autonomie : on peut mme prvoir ds maintenant que c'est dans le clan que se trouve le ferment actif de la vie religieuse. Mais d'un autre ct, tous ces cultes sont solidaires les uns des autres et la religion totmique est le systme complexe form
485 486 487
C'est le cas notamment chez les Warramunga (North. Tr., p. 298). V. par exemple, SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 380 et passim. On pourrait mme se demander s'il n'existe pas parfois des totems tribaux. C'est ainsi que, chez les Arunta, il y a un animal, le chat sauvage, qui sert de totem un clan particulier, et qui, pourtant, est interdit la tribu tout entire ; mme les gens des autres clans ne peuvent en manger que trs modrment (Nat. Tr., p. 168). Mais nous croyons qu'il y aurait abus parler en cette circonstance d'un totem tribal, car de ce que la libre consommation d'un animal est interdite, il ne suit pas que celui-ci soit un totem. D'autres causes peuvent donner naissance l'interdiction. Sans doute, l'unit religieuse de la tribu est relle, mais c'est l'aide d'autres symboles qu'elle s'affirme. Nous montrerons plus bas quels ils sont (liv. I, chap. IX).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
145
par leur runion, tout comme le polythisme grec tait constitu par la runion de tous les cultes particuliers qui s'adressaient aux diffrentes divinits. Nous venons de montrer qu'ainsi entendu le totmisme, lui aussi, a sa cosmologie.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
146
CHAPITRE IV
LES CROYANCES PROPREMENT TOTMIQUES
(Fin)
IV. - Le totem individuel et le totem sexuel
Dans ce qui prcde, nous n'avons tudi le totmisme que comme une institution publique : les seuls totems dont il ait t jusqu' prsent question taient la chose commune d'un clan, d'une phratrie ou, en un sens, de la tribu ; l'individu n'y avait part que Comme membre du groupe. Mais nous savons qu'il n'y a pas de religion qui n'ait un aspect individuel. Cette observation gnrale s'applique au totmisme. A ct des totems impersonnels et collectifs qui sont au premier plan, il en est d'autres qui sont propres chaque individu, qui expriment sa personnalit et dont il clbre le culte en son particulier.
488
I
.
Dans quelques tribus australiennes et dans la plupart des socits indiennes de l'Amrique du Nord , chaque individu soutient personnellement avec une chose dtermine un rapport comparable celui que chaque clan soutient avec son totem. Cette chose est parfois un tre inanim ou un objet artificiel; mais c'est trs gnralement un animal. Dans certains cas, une portion restreinte de l'organisme, comme la tte, les pieds, le foie, remplit le mme office .
489 490
488 489 490
Les totems sont choses de la tribu en ce sens qu'elle est intresse tout entire au culte que chaque clan doit son totem. FRAZER a fait un relev trs complet des textes relatifs au totmisme individuel dans l'Amrique du Nord (Totemism and Exogamy, III, pp. 370-456). Par exemple, chez les Hurons, les Iroquois, les Algonkins (CHARLEVOIX, Histoire de la Nouvelle France, VI, pp. 67-70; SAGARD, Le grand voyage au pays des Hurons, p. 160), chez les Indiens
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
147
Le nom de la chose sert aussi de nom l'individu. C'est son nom personnel, son prnom qui s'ajoute au totem collectif, comme le praenomen des Romains au nomen gentilicium. Le fait, il est vrai, ne nous est affirm que d'un certain nombre de socits ; mais il est probablement gnral. Nous montrerons, en effet, tout l'heure, qu'il y a identit de nature entre la chose et l'individu ; or, l'identit de nature implique celle du nom. Confr au cours de crmonies religieuses tout particulirement importantes, ce prnom possde un caractre sacr. On ne le prononce pas dans les circonstances ordinaires de la vie profane. Il arrive mme que le mot de la langue usuelle qui sert dsigner la chose est plus ou moins modifi pour pouvoir servir cet emploi particulier . C'est que les termes de la langue usuelle sont exclus de la vie religieuse.
491 492
Au moins dans les tribus amricaines, ce nom est doubl d'un emblme qui appartient chaque individu et qui, sous des formes diverses, reprsente la chose que ce nom dsigne. Chaque Mandan, par exemple, porte la peau de l'animal dont il est l'homonyme . Si c'est un oiseau, on se pare de ses plumes . Les Hurons, les Algonkins s'en tatouaient l'image sur le corps . On le reprsente sur les armes . Dans les tribus du Nord-Ouest, l'emblme individuel est grav on sculpt, tout comme l'emblme collectif du clan, sur les ustensiles, sur les maisons , etc. ; le premier sert de marque de proprit personnelle . Souvent, les deux blasons sont combins ensemble; c'est ce qui explique, en partie, la grande diversit d'aspects que prsentent, chez ces peuples, les cussons totmiques .
493 494 495 496 497 498 499
Entre l'individu et son animal ponyme existent les liens les plus troits. L'homme participe de la nature de l'animal ; il en a les qualits, comme, d'ailleurs, les dfauts. Par exemple, quelqu'un qui a l'aigle pour blason individuel est cens possder le don de voir dans l'avenir; s'il porte le nom de l'ours, on dit qu'il est expos tre bless dans les combats, parce que l'ours est lent et lourd et qu'il se laisse facilement attraper ; si l'animal est mpris, l'homme est l'objet du mme mpris . La parent des deux tres est mme telle que, dans certaines
500 501
491
492 493 494 495 496 497 498 499 500
501
Thompson (TEIT, The Thompson Indians of British Columbia, p. 355). C'est le cas des Yuin (HOWITT, Nat. Tr., p. 133) ; des Kurnai (ibid., p. 135); de plusieurs tribus du Queensland (ROTH, Superstition, Magie and Medicine, North Queensland Ethnography, Bulletin no 5, p. 19; HADDON, Head-hunters, p. 193) ; chez les Delaware (HECKEWELDER, An Account of the History... of the Indian Nations, p. 238) ; chez les Indiens Thompsom (TEIT, Op. cit., p. 355) ; chez les Salish Statlumh (Hill TOUT, Rep. of the Ethnol. of the Statlumh, J.A.I., XXXV, p. 147 et suiv.). Hill TOUT, loc. cit., p. 154. CATLIN, Manners and Customs, etc., Londres, 1876, I, p, 36. Lettres difiantes et curieuses, nouv. d., VI, p. 172 et suiv. CHARLEVOIX, Op. cit., VI, p. 69. DORSEY, Siouan Cults, Xlth Rep., p. 443. BOAS, Kwakiutl, p. 323. Hill TOUT, loc. cit., p. 154. BOAS, Kwakiutl, p. 323. Miss FLETCHER, The Import of the Totem, a Study from the Omaha Tribe (Smithsonian Rep. for 1897, p. 583). - On trouvera des faits similaires dans TEIT, op, cit., pp. 354, 356; Peter JONES, History of the Ojibway Indians, p. 87. C'est le cas, par exemple, du chien chez les Salish Statlumh cause de l'tat de servitude o il vit (Hill TOUT, loc. cit., p. 153).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
148
circonstances, notamment en cas de danger, l'homme, croit-on, peut prendre la forme de l'animal . Inversement, l'animal est considr comme un double de l'homme, comme son aller ego . L'association entre eux est si troite que leurs destines sont souvent considres comme solidaires : rien ne peut atteindre l'un sans que l'autre n'en ressente le contre coup . Si l'animal meurt, la vie de l'homme est menace. Aussi est-ce une rgle trs gnrale que l'on ne doit pas tuer l'animal ni surtout en manger la chair. L'interdiction qui, quand il s'agit du totem de clan, comporte toute sorte d'attnuations et de tempraments, est ici beaucoup plus formelle et absolue .
502 503 504 505
De son ct, l'animal protge l'homme et lui sert, en quelque sorte, de patron. Il l'avertit des dangers possibles et des moyens d'y chapper ; on dit qu'il est son ami . Mme, comme il passe souvent pour possder des pouvoirs merveilleux, il les communique son associ humain. Celui-ci se croit l'preuve des balles, des flches, des coups de toute sorte . La confiance qu'a l'individu dans l'efficacit de son protecteur est mme telle qu'il brave les plus grands dangers et accomplit des prouesses dconcertantes avec une sereine intrpidit : la foi lui donne le courage et la force ncessaires . Toutefois, les relations de l'homme avec son patron ne sont pas de pure et simple dpendance. L'individu, de son ct, peut agir sur l'animal. Il lui donne des ordres ; il a prise sur lui. Un Kurnai qui a le requin pour ami et alli, croit pouvoir, au moyen d'une incantation, disperser les requins qui menacent un bateau . Dans d'autres cas, le lien ainsi contract passe pour confrer l'homme une aptitude particulire chasser l'animal avec succs .
506 507 508 509 510 511
La nature mme de ces relations parat bien impliquer que l'tre auquel chaque individu se trouve ainsi associ ne peut tre lui-mme qu'un individu, et non une classe. On n'a pas une espce pour alter ego. En fait, il est des cas o c'est bien certainement tel arbre, tel rocher, telle
502 503 504
505
506 507 508 509 510 511
Langloh PARKER, Euahlayi, p. 21. L'esprit d'un homme, dit Mrs PARKER (ibid.), est dans son Yunbeai (totem individuel) et son Yunbeai est en lui. Langloh PARKER, op. cit., p. 20. il en est de mme chez certains Salish (Hill TOUT, Ethn. Rep. on the Stseelis and Skaulits Tribes, J.A.I., XXXIV, p. 324). Le fait est gnral chez les Indiens de l'Amrique centrale (BRINTON, Nagualism, a Study in Native American Folklore and History, in Proceedings of the American Philosophical Society, XXXIII, p. 32). PARKER, ibid. ; HOWITT, Nat. Tr., p. 147; DORSEY, Siouan Cults, XIth Rep., p. 443. Frazer a fait, d'ailleurs, le relev des cas amricains et a tabli la gnralit de l'interdiction (Totemism a. Exogamy, III, p. 450). Nous avons vu, il est vrai, que, en Amrique, l'individu devait commencer par tuer l'animal dont la peau servait faire ce que les ethnographes appellent un sac-mdecine. Mais cet usage n'a t observ que dans cinq tribus ; c'est probablement une forme altre et tardive de l'institution. HOWITT, Nat. Tr., pp. 135, 147, 387 ; Austral. Medicine Men, J.A.I., XVI, p. 34; TEIT, The Shuswap, p. 607. MEYER, Manners and Customs of the Aborigines of the Encounter Bay Tribe, in WOODS, p. 197. BOAS, VIth Rep. on the North-West Tribes of Canada, p. 93 ; TEIT, The Thompson Indians, p. 336; BOAS, Kwakiutl, p. 394. On trouvera des faits dans Hill TOUT, Rep. of the Ethnol. of the Statlumh, J.A.I., XXXV, p. 144, 145. Cf. Langloh PARKER, Op. cit., p. 29. D'aprs un renseignement donn par Howitt dans une lettre personnelle FRAZER (Totemism and Exogamy, 1, p. 495 et no 2). Hill TOUT, Ethnol. Hep. on the Stseelis and Skaulits Tribes, J.A.I., XXXIV, p. 324.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
149
pierre dtermine qui joue ce rle . Il en est forcment ainsi toutes les fois o c'est un animal et o l'existence de cet animal et celle de l'homme sont considres comme solidaires. On ne saurait tre uni par une solidarit de ce genre une espce tout entire, car il n'y a pas de jour ni, pour ainsi dire, d'instant o cette espce ne perde quelqu'un d'entre ses membres. Toutefois, il y a chez le primitif une certaine incapacit penser l'individu sparment de l'espce; le lien qui l'unit l'un s'tend tout naturellement l'autre ; il les confond dans le mme sentiment. C'est ainsi que l'espce tout entire lui est sacre .
512 513
Cet tre protecteur est naturellement appel de noms diffrents suivant les socits : nagual, chez les Indiens du Mexique , manitou chez les Algonkins, et okki chez les Hurons , snam chez certains Salish , sulia chez d'autres , budjan, chez les Yuin , yumbeai, chez les Euahlayi , etc. A cause de l'importance qu'ont ces croyances et ces pratiques chez les Indiens de l'Amrique du Nord, on a propos de crer le mot de nagualisme ou manitouisme pour les dsigner . Mais en leur donnant un nom spcial et distinctif, on s'expose mconnatre leur rapport avec le totmisme. Ce sont, en effet, les mmes principes qui sont appliqus ici au clan, l l'individu. De part et d'autres, c'est la mme croyance qu'il existe des liens vitaux entre les choses et les hommes et que les premires sont doues de pouvoirs spciaux dont profitent leurs allis humains. C'est aussi le mme usage de donner l'homme le nom de la chose laquelle il est associ et d'ajouter ce nom un emblme. Le totem est le patron du clan, comme le patron de l'individu sert ce dernier de totem personnel. Il y a donc intrt ce que la terminologie rende sensible cette parent des deux systmes ; c'est pourquoi, avec Frazer, nous appellerons totmisme individuel le culte que chaque individu rend son patron. Cette expression est d'autant plus justifie que, dans certains cas, le primitif lui-mme se sert du mme mot pour dsigner le totem du clan et l'animal protecteur de l'individu . Si Tylor et Powell ont repouss cette dnomination et rclam des termes diffrents pour ces deux sortes d'institutions religieuses, c'est que, suivant eux, le totem collectif n'est qu'un nom, une tiquette
514 515 516 517 518 519 520 521
512
513
514 515 516 517 518 519 520
521
HOWITT, Australian Medicine Men, J.A.I., XVI, p. 34; LAFITAU, Moeurs des Sauvages amricains, I, p. 370; CHARLEVOIX, Histoire de la Nouvelle France, VI, p. 68. Il en est de mme de l'aloi et du tamaniu, Mota (CODRINGTON, The Melanesians, pp. 250-251). Aussi, n'y a-t-il pas, entre ces animaux protecteurs et les ftiches la ligne de dmarcation que FRAZER a cru pouvoir tablir entre les uns et les autres. Suivant lui, le ftichisme commencerait quand l'tre protecteur serait un objet individuel et non une classe (Totemism, p. 56) ; or, ds l'Australie, il arrive qu'un animal dtermin joue ce rle (v. HOWITT, Australian Medicine Men, J.A.I., XVI, p. 34). La vrit est que les notions de ftiche et de ftichisme ne correspondent rien de dfini. BRINTON, Nagualism, Proceedings of the Amer. Philos. Society, XXXIII, p. 32. CHARLEVOIX, VI, p. 67. Hill TOUT, Rep. on the Ethnol. of the Statlumh of British Columbia, J.A.I., XXXV, p. 142. Hill TOUT, Ethnol. Rep. on the Stseelis a. Skaulits Tribes, J.A.I., XXXIV, p. 311 et suiv. HOWITT, Nat. Tr., p. 133. Langloh PARKER, Op. cit., p. 20. J. W. POWELL, An American View of Totemism, in Man, 1902, no 84; TYLOR, ibid., no 1. Andrew Lang a exprim des ides analogues dans Social Origins, p. 133-135. Enfin, FRAZER lui-mme, revenant sur son opinion premire, estime aujourd'hui que, jusqu'au jour o l'on connatra mieux le rapport qui existe entre les totems collectifs et les guardian spirits, il vaut mieux les dsigner par des noms diffrents (Totemism and Exogamy, III, p. 456). C'est le cas en Australie chez les Yuin (HOWITT, Nat. Tr., p. 81), chez les Narrinyeri (MEYER, Manners a. Customs of the Aborigines of the Encounter Bay Tribe, in WOODS, p. 197 et suiv.).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
150
commune, sans caractres religieux . Mais nous savons, au contraire, qu'il est une chose sacre, et mme un plus haut degr que l'animal protecteur. La suite de cette tude montrera, d'ailleurs, combien ces deux sortes de totmisme sont insparables l'une de l'autre .
522 523
Toutefois, si grande que soit la parent de ces deux institutions, il y a entre elles des diffrences importantes. Alors que le clan se considre comme issu de l'animal ou de la plante qui lui sert de totem, l'individu ne croit soutenir aucun rapport de descendance avec son totem personnel. C'est un ami, un associ, un protecteur; ce n'est pas un parent. On profite des vertus qu'il est cens possder ; mais on n'est pas du mme sang. En second lieu, les membres d'un clan permettent aux clans voisins de manger de l'animal dont ils portent collectivement le nom, sous la seule condition que les formalits ncessaires soient observes. Au contraire, non seulement l'individu respecte l'espce laquelle appartient son totem personnel, mais encore il s'efforce de la protger contre les trangers, partout du moins o la destine de l'homme et celle de l'animal passent pour tre connexes. Mais ces deux sortes de totems diffrent surtout par la manire dont ils sont acquis. Le totem collectif fait partie du statut lgal de chaque individu : il est gnralement hrditaire ; en tout cas, c'est la naissance qui le dsigne sans que la volont des hommes y soit pour rien. Tantt l'enfant a le totem de sa mre (Kamilaroi, Dieri, Urabunna, etc.) ; tantt celui de son pre (Narrinyeri, Warramunga, etc.) ; tantt enfin celui qui prdomine l'endroit o sa mre a conu (Arunta, Loritja). Au contraire, le totem individuel est acquis par un acte dlibr : toute une srie d'oprations rituelles est ncessaire pour le dterminer. La mthode la plus gnralement employe chez les Indiens d'Amrique est la suivante. Vers l'poque de la pubert, quand approche le moment de l'initiation, le jeune homme se retire dans un endroit cart, par exemple dans une fort. L, pendant une priode de temps qui varie de quelques jours plusieurs annes, il se soumet toute sorte d'exercices puisants et contre nature. Il jene, il se mortifie, il s'inflige diverses mutilations. Tantt il erre en poussant des cris violents, de vritables hurlements; tantt il reste tendu sur le sol, immobile et se lamentant. Parfois il danse, il prie, il invoque ses divinits ordinaires. Il finit ainsi par se mettre dans un tat d'intense surexcitation tout proche du dlire. Quand il est parvenu ce paroxysme, ses reprsentations prennent facilement un caractre hallucinatoire. Quand, dit Heckewelder, un garon est la veille d'tre initi, il est soumis un rgime alternatif de jene et de traitement
524
522
523 524
Le totem ne ressemble pas plus au patron de l'individu, dit Tylor, qu'un cusson une image de saint. (loc. cit., p. 2). De mme, si FRAZER se rallie aujourd'hui l'opinion de Tylor, c'est qu'il refuse maintenant tout caractre religieux au totem de clan (Totemism and Exogamy, III, p. 452). V. plus bas, mme livre, chap. IX. Cependant, d'aprs un passage de MATHEWS, chez les Wotjobaluk, le totem individuel serait hrditaire. Chaque individu, dit-il, rclame un animal, une plante ou un objet inanim comme son totem spcial et personnel, qu'il hrite de sa mre (J. and Proc. of the R. Society of N. S. Wales, XXXVIII, p. 291). Mais il est vident que, si tous les enfants d'une mme famille avaient pour totem personnel celui de leur mre, ni eux ni leur mre n'auraient, en ralit, de totems personnels. Mathews veut probablement dire que chaque individu choisit son totem individuel dans un cercle de choses affectes au clan de la mre. Nous verrons, en effet, que chaque clan a ses totems individuels qui sont sa proprit exclusive, les membres des autres clans ne peuvent en disposer. En ce sens, la naissance dtermine dans une certaine mesure, mais dans cette mesure seulement, le totem personnel.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
151
mdical ; il s'abstient de toute nourriture, il avale les drogues les plus nergiques et les plus rpugnantes : l'occasion, il boit des dcoctions intoxicantes jusqu' ce que son esprit soit dans un vritable tat d'garement. A ce moment, il a ou croit avoir des visions, des rves extraordinaires auxquels tout cet entranement l'a naturellement prdispos. Il s'imagine voler travers les airs, cheminer sous le sol, sauter d'un sommet l'autre par-dessus les valles, combattre et dompter des gants et des monstres . Dans ces conditions, qu'il voie ou, ce qui revient au mme, qu'il croie voir, en rve ou l'tat de veille, un animal se prsenter lui dans une attitude qui lui parat dmonstrative d'intentions amicales, il s'imaginera avoir dcouvert le patron qu'il attendait .
525 526
Cependant, cette procdure est rarement employe en Australie . Sur ce continent, le totem personnel parat plutt tre impos par un tiers soit la naissance , soit au moment de l'initiation . C'est gnralement un parent qui joue ce rle, ou un personnage investi de pouvoirs spciaux, tel qu'un vieillard ou un magicien. On se sert parfois, dans ce but, de procds divinatoires. Par exemple, la baie Charlotte, au cap Bedford, sur la rivire Proserpine, la grand'mre ou d'autres vieilles femmes prennent une petite portion du cordon ombilical laquelle le placenta est attach et font tourner le tout assez violemment. Pendant ce temps, d'autres vieilles femmes, assises en cercle, proposent successivement diffrents noms. On adopte celui qui est prononc juste au moment o le cordon se brise . Chez les Varraikanna du cap York, aprs que la dent a t arrache au jeune initi, on lui donne un peu d'eau pour se rincer la bouche et on l'invite cracher dans un baquet rempli d'eau. Les vieillards examinent avec soin l'espce de caillot form de sang et de salive qui est ainsi rejet, et l'objet naturel dont il rappelle la forme devient le totem personnel du jeune homme . Dans d'autres cas, le totem est directement transmis d'un individu un autre par exemple du pre au fils, de l'oncle au neveu . Ce procd est galement employ en Amrique. Dans un exemple que rapporte Hill Tout, l'oprateur tait un shamane qui voulait transmettre son totem son neveu. L'oncle
527 528 529 530 531 532 533
525
526
527
528 529 530 531 532 533
HECKEWELDER, An Account of the History, Manners and Customs of the Indian Nations who once inhabited Pennsylvania, in Transactions of the Historical and Literary Committee of the American Philos. Society, I, p. 238. V. DORSEY, Siouan Cults, XIth Rep., p. 507 ; CATLIN, Op. cit., I, p. 37 ; Miss FLETCHER, The Import of the Totem, in Srnithsonian Rep. f., 1897, p. 580 ; TEIT, The Thompson Indians, pp. 317-320 ; Hill TOUT, J.A.I., XXXV, p. 144. On en rencontre pourtant quelques exemples. C'est en rve que les magiciens Kurnai voient leurs totems personnels se rvler eux (HoWITT, Nat. Tr., p. 387 ; On Australian Medicine Men, in J.A.I., XVI, p. 34). Les gens du cap Bedfort croient que, quand un vieillard rve d'une chose au cours de la nuit, cette chose est le totem personnel de la premire personne qu'il rencontrera le lendemain (W. E. ROTH, Superstition, Magie a. Medicine, p. 19). Mais il est probable que l'on n'obtient par cette mthode que des totems personnels complmentaires et accessoires : car, dans cette mme tribu, un autre procd est employ au moment de l'initiation, comme nous le disons dans le texte. Dans certaines tribus dont parle ROTH (ibid.) ; dans certaines tribus voisines de Maryborough (HOWITT, Nat. Tr., p. 147). Chez les Wiradjuri (HOWITT, Nat, Tr., p. 406; On Australian Medicine Men, in J.A.I, XVI, p. 50). ROTH, loc., cit. HADDON, Head Hunters, p. 193 et suiv. Chez les Wiradjuri (mmes rfrences que plus haut, p. 231, no 5). En gnral, il semble bien que ces transmissions de pre fils ne se produisent que quand le pre est un shamane ou un magicien. C'est le cas galement chez les Indiens Thompson (TEIT, The Thompson Indians,
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
152
prit l'emblme symbolique de son snam (totem personnel) ; c'tait, en l'espce, la peau dessche d'un oiseau. Il invita son neveu souffler dessus, puis il en fit autant lui-mme et pronona des paroles mystrieuses. Il sembla alors Paul (c'tait le nom du neveu) que la peau devenait un oiseau vivant qui se mit voltiger autour d'eux pendant quelques moments pour disparatre ensuite. Paul reut pour instructions de se procurer, ce jour mme, la peau d'un oiseau de mme espce et de la porter sur lui ; ce qu'il fit. La nuit suivante, il eut un rve o le snam lui apparut sous la forme d'un tre humain qui lui rvla le nom mystrieux qu'on doit prononcer quand on veut l'invoquer, et qui lui promit sa protection .
534
Non seulement le totem individuel est acquis, et non donn, mais l'acquisition n'en est gnralement pas obligatoire. Tout d'abord, il y a, en Australie une multitude de tribus o cet usage semble entirement inconnu . De plus, l mme o il existe, il est souvent facultatif. Ainsi, chez les Euahlayi, si tous les magiciens ont un totem individuel de qui ils tiennent leurs pouvoirs, il y a un grand nombre de lacs qui en sont dpourvus. C'est une faveur dont le magicien est le dispensateur, mais qu'il rserve surtout ses amis, ses favoris, ceux qui aspirent devenir ses confrres . De mme, chez certains Salish, les individus qui veulent exceller particulirement soit la guerre soit la chasse ou les aspirants la fonction de shamane sont les seuls se munir d'un protecteur de ce genre . Le totem individuel parat donc tre considr, au moins par certains peuples, comme un avantage et une commodit, plutt que comme une ncessit. Il est bon de s'en procurer ; mais on n'y est pas tenu. Inversement, on n'est pas oblig de se contenter d'un seul totem ; si l'on veut tre mieux protg, rien ne s'oppose ce que l'on cherche en acqurir plusieurs et, inversement, si celui que l'on a s'acquitte mal de son rle, on peut en changer .
535 536 537 538 539
Mais en mme temps qu'il a quelque chose de plus facultatif et de plus libre, le totmisme individuel a une force de rsistance laquelle le totmisme de clan est loin d'atteindre. Un des principaux informateurs de Hill Tout tait un Salish baptis ; et cependant, bien qu'il et sincrement abandonn toutes les croyances de ses anctres, bien qu'il ft devenu un catchiste modle, sa foi dans l'efficacit des totems personnels restait inbranlable . De mme, alors qu'il ne reste plus de traces visibles du totmisme collectif dans les pays civiliss, l'ide qu'il existe une solidarit entre chaque individu et un animal, une plante ou un objet extrieur quelconque est la base d'usages qui sont encore observables dans plusieurs pays d'Europe .
540 541
534
535 536 537 538 539 540 541
p. 320) et chez les Wiradjuri dont il vient d'tre question. Hill TOUT (J.A.I., XXXV, p. 146-147). Le rite essentiel est celui qui consiste souffler sur la peau: s'il n'tait pas correctement excut, la transmission n'aurait pas lieu. C'est que, comme nous le verrons plus loin, le souffle, c'est l'me. En soufflant tous deux sur la peau de l'animal, le magicien et le rcipiendaire exhalent quelque chose de leurs mes qui se pntrent, en mme temps, qu'elles communient avec la nature de l'animal, qui lui aussi, prend part la crmonie sous la forme de son symbole. N. W. THOMAS, Further Remarks on Mr. Hill Tout's Views on Totemism, in Man, 1904, p. 85. Langloh PARKER, Op. cit., pp. 20, 29. Hill TOUT, in J.A.I., XXXV, p. 143 et 146; ibid., XXXIV, p. 324. PARKER, Op. cil., p. 30; TEIT, The Thompson Indians, p. 320; Hill TOUT, in J.A.I., XXXV, p. 144. CHARLEVOIX, VI, p. 69. Hill Tout, ibid, p. 145. Ainsi, la naissance d'un enfant, on plante un arbre que l'on entoure de soins pieux ; car on croit que son sort et celui de l'enfant sont solidaires. FRAZER, dans son Golden Bough, a rapport nombre d'usages
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
153
II
.
Entre le totmisme collectif et le totmisme individuel, il existe une forme intermdiaire qui tient de l'un et de l'autre : c'est le totmisme sexuel. On ne le rencontre qu'en Australie et dans un petit nombre de tribus. On le signale surtout dans Victoria et dans la Nouvelle Galles du Sud . Mathews, il est vrai, dclare l'avoir observ dans toutes les parties de l'Australie qu'il a visites, niais sans rapporter de faits prcis l'appui de son affirmation .
542 543
Chez ces diffrents peuples tous les hommes de la tribu, d'une part, toutes les femmes, de l'autre, quelque clan particulier que les uns et les autres appartiennent, forment comme deux socits distinctes et mme antagonistes. Or, chacune de ces deux corporations sexuelles se croit unie par des liens mystiques un animal dtermin. Chez les Kurnai, tous les hommes se considrent comme les frres de l'mou-roitelet (Yeerng), toutes les femmes comme les surs de la superbe fauvette (Djeetgn) ; tous les hommes sont Veerng et toutes les femmes Djeetgn. Chez les Wotjobaluk, les Wurunjerri, c'est la chauve-souris et le nigthjar (sorte de chouette) qui jouent respectivement ce rle. Dans d'autres tribus, le pie est substitu au nigthiar. Chaque sexe voit dans l'animal auquel il est ainsi apparent un protecteur qu'il convient de traiter avec les plus grands gards : aussi est-il interdit de le tuer et de le manger .
544
Ainsi, cet animal protecteur joue, par rapport chaque socit sexuelle, le mme rle que le totem du clan par rapport ce dernier groupe. L'expression de totmisme sexuel, que nous empruntons Frazer , est donc justifie. Ce totem d'un nouveau genre ressemble mme particulirement celui du clan en ce sens qu'il est, lui aussi, collectif ; il appartient indistinctement tous les individus d'un mme sexe. Il y ressemble galement en ce qu'il implique entre l'animal-patron et le sexe correspondant un rapport de descendance et de consanguinit: chez les Kurnai, tous les hommes sont censs tre descendus de Yeerng et toutes les femmes de Djeetgn . Le premier observateur qui ait, ds 1834, signal cette curieuse institution la
545 546
542
543
544
545 546
ou de croyances qui traduisent diffremment la mme ide (cf. HARTLAND, Legend of Perseus, II, pp. 155). HOWITT, Nat. Tr., p. 148 et suiv.; FISON et HOWITT, Kamilaroi and Kurnai, p. 194,1201 et suiv.; DAWSON, Australian Aborigines, p. 52. PETRIE le signale aussi dans le Queensland (Tom Petries Reminiscences of Early Queensland, pp. 62 et 118). Journal a. Proceed. of the R. Society of N. S. Wales, XXXVIII, p. 339. Faut-il voir une trace de totmisme sexuel dans l'usage suivant des Warramunga ? Avant d'ensevelir le mort, on garde un os du bras. Si c'est celui d'une femme, on ajoute l'corce dans laquelle il est envelopp des plumes d'mou; s'il s'agit d'un homme, des plumes de hibou (North. Tr., p. 169). On cite mme un cas o chaque groupe sexuel aurait deux totems sexuels; ainsi les Wurunjerri cumuleraient les totems sexuels des Kurnai (mou-roitelet et superbe fauvette) avec ceux des Wotjobaluk (chauve-souris et hulotte nightjar). V. HOWITT, Nat. Tr., p. 150. Totemism, p. 51. Kamilaroi and Kurnai, p. 215.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
154
dcrivait dans les termes suivants: Tilmun, un petit oiseau de la grandeur d'une grive (c'est une sorte de pie), est considr par les femmes comme ayant t le premier faire des femmes. Ces oiseaux sont tenus en vnration par les femmes seulement . C'tait donc un grand anctre. Mais par un autre ct, ce mme totem se rapproche du totem individuel. On croit, en effet, que chaque membre du groupe sexuel est li personnellement un individu dtermin de l'espce animale correspondante. Les deux vies sont si troitement associes que la mort de l'animal entrane celle de l'homme. La vie d'une chauve-souris, disent les Wotjobaluk, c'est la vie d'un homme . C'est pourquoi non seulement chaque sexe respecte son totem, mais il oblige les membres de l'autre sexe le respecter galement. Toute violation de cet interdit donne lieu, entre hommes et femmes , de vritables et sanglantes batailles.
547 548 549
En dfinitive, ce qu'ont de vraiment original ces totems, c'est qu'ils sont, en un sens, des sortes de totems tribaux. En effet, ils viennent de ce qu'on se reprsente la tribu comme issue tout entire d'un couple d'tres mythique. Une telle croyance semble bien impliquer que le sentiment tribal a pris assez de force pour prvaloir, dans une certaine mesure, contre le particularisme des clans. Quant au fait qu'une origine distincte est assigne aux hommes et aux femmes, il faut, sans doute, en chercher la raison dans l'tat de sparation o vivent les sexes .
550
Il serait intressant de savoir comment, dans la pense de l'Australien, les totems sexuels se rattachent aux totems de clans, quels rapports il y a entre les deux anctres qui sont ainsi placs l'origine de la tribu et ceux dont chaque clan en particulier est cens descendu. Mais les donnes ethnographiques dont nous disposons prsentement ne permettent pas de rsoudre la question. D'ailleurs, si naturelle et mme si ncessaire qu'elle nous paraisse, il est trs possible que les indignes ne se la soient jamais pose. Ils n'prouvent pas, en effet, au mme degr que nous, le besoin de coordonner et de systmatiser leurs croyances .
551
547 548 549
550 551
THRELLDKE, cit par MATHEWS, loc. cit., p. 339. HOWITT, Nat. Tr., pp. 148, 151. Kamilaroi and Kurnai, p. 200-203; HOWITT, Nat. Tr., p. 149; PETRIE op. cit., p. 62. Chez les Kurnai, ces luttes sanglantes, se terminent souvent par des mariages dont elles sont comme le prodrome rituel. Parfois aussi, ces batailles deviennent de simples jeux (PETRIE, loc. cit.). V. sur ce point notre tude sur: La prohibition de l'inceste et ses origines, in Anne sociol., I, p. 44 et suiv. Nous verrons cependant plus bas (chap. IX) qu'il existe un rapport entre les totems sexuels et les grands dieux.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
155
CHAPITRE V
ORIGINES DE CES CROYANCES I. - Examen critique des thories
.
Les croyances que nous venons de passer en revue sont de nature manifestement religieuse, puisqu'elles impliquent une classification des choses en sacres et en profanes. Sans doute, il n'y est pas question d'tres spirituels, et, dans le cours de notre expos, nous n'avons mme pas eu prononcer les mots d'esprits, de gnies, de personnalits divines. Mais si, pour cette raison, quelques crivains, dont nous allons, d'ailleurs, avoir reparler, se sont refuss voir dans le totmisme une religion, c'est qu'ils se sont fait du phnomne religieux une notion inexacte. D'autre part, nous avons l'assurance que cette religion est la plus primitive qui soit actuellement observable, et mme, selon toute vraisemblance, qui ait jamais exist. Elle est, en effet, insparable de l'organisation sociale base de clans. Non seulement, comme nous l'avons montr, on ne peut la dfinir qu'en fonction de cette dernire, mais il ne semble pas que le clan, sous la forme qu'il a dans un trs grand nombre de socits australiennes, ait pu exister sans le totem. Car les membres d'un mme clan ne sont unis les uns aux autres ni par la communaut de l'habitat ni par celle du sang, puisqu'ils ne sont pas ncessairement consanguins et qu'ils sont souvent disperss sur des points diffrents du territoire tribal. Leur unit vient donc uniquement de ce qu'ils ont un mme nom et un mme emblme, de ce qu'ils croient soutenir les mmes rapports avec les mmes catgories de choses, de ce qu'ils pratiquent les mmes rites, c'est--dire en dfinitive de ce qu'ils communient dans le mme culte totmique. Ainsi le totmisme et le clan, tant, du moins, que ce dernier ne se confond pas avec le groupe local, s'impliquent mutuellement. Or l'organisation base de clans est la plus simple que nous connaissions. Elle existe, en effet, avec tous ses lments essentiels, ds que la socit comprend deux clans primaires ; par suite, il ne saurait y en avoir de plus rudimentaire, tant qu'on n'aura pas dcouvert de socits rduites un seul clan, et jusqu' prsent, nous ne croyons pas qu'on en ait trouv de traces. Une religion aussi troitement solidaire du systme social qui dpasse tous les autres en simplicit peut tre regarde comme la plus lmentaire qu'il nous soit donn de connatre. Si donc nous parvenons trouver les origines des croyances
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
156
qui viennent d'tre analyses, nous avons des chances de dcouvrir du mme coup les causes qui firent clore le sentiment religieux dans l'humanit. Mais avant de traiter nous-mme le problme, il convient d'examiner les solutions les plus autorises qui en ont t proposes.
I
.
Nous trouvons tout d'abord un groupe de savants qui ont cru pouvoir expliquer le totmisme en le drivant directement d'une religion antrieure. Pour Tylor et Wilken , le totmisme serait une forme particulire du culte des anctres; c'est la doctrine, certainement trs rpandue de la transmigration des mes qui aurait servi de transitions entre ces deux systmes religieux. Un grand nombre de peuples croient que l'me, aprs la mort, ne reste pas ternellement dsincarne, mais vient animer nouveau quelque corps vivant ; d'autre part, comme la psychologie des races infrieures n'tablit aucune ligne de dmarcation bien dfinie entre l'me des hommes et l'me des btes, elle admet sans grande difficult la transmigration de l'me humaine dans le corps des animaux . Tylor en cite un certain nombre de cas . Dans ces conditions, le respect religieux qu'inspire l'anctre se reporte tout naturellement sur la bte ou sur la plante avec laquelle il est dsormais confondu. L'animal qui sert ainsi de rceptacle un tre vnr devient, pour tous les descendants de l'anctre, c'est--dire pour le clan qui en est issu, une chose sainte, objet d'un culte, en un mot un totem.
552 553 554 555
Des faits signals par Wilken dans les socits de l'archipel malais, tendraient prouver que c'est bien ainsi que les croyances totmiques y ont pris naissance. A Java, Sumatra, les crocodiles sont particulirement honors ; on voit en eux de bienveillants protecteurs qu'il est interdit de tuer ; on leur fait des offrandes. Or le culte qui leur est aussi rendu vient de ce qu'ils passent pour incarner des mes d'anctres. Les Malais des Philippines considrent le crocodile comme leur grand-pre ; le tigre est trait de la mme manire et pour les mmes raisons. Des croyances analogues ont t observes chez les Bantous . En Mlansie, il arrive parfois qu'un homme influent, au moment de mourir, annonce sa volont de se rincarner dans tel animal ou telle plante ; on s'explique que l'objet quelconque, qu'il choisit ainsi pour sa rsidence
556
552 553 554 555 556
Civilisation primitive, I, p. 465, Il, p. 305; Remarks on Totemism, with especial reference to some modern theories concerning it, in J.A.I, XXVIII et I de la nouvelle srie, p. 138. Het Animisme bij den Volken van den indischen Archipel, pp. 69-75. TYLOR, civilisation primitive, II, p. 8. TYLOR, ibid., pp. 8-21. G. McCALL THEAL, Records of South-Eastern Africa, VIL Nous ne connaissons ce travail que par un article de FRAZER, South African Totemism, paru dans Man, 1901, no III.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
157
posthume, devienne ensuite sacr pour toute sa famille . Bien loin donc de constituer un fait primitif, le totmisme ne serait que le produit d'une religion plus complexe qui l'aurait prcd .
557 558
Mais les socits auxquelles ces faits sont emprunts sont dj parvenues une culture assez leve; en tout cas, elles ont dpass la phase du pur totmisme. Il y a chez elle des familles, non des clans totmiques . Mme la plupart des animaux auxquels sont ainsi rendus des honneurs religieux sont vnrs, non par des groupes familiaux dtermins, mais par des tribus tout entires. Si donc ces croyances et ces pratiques peuvent n'tre pas sans rapports avec d'anciens cultes totmiques, elles n'en reprsentent plus maintenant que des formes altres et, par consquent, ne sont gure propres nous en rvler les origines. Ce n'est pas en considrant une institution au moment o elle est en pleine dcadence qu'on peut arriver comprendre comment elle s'est forme. Si l'on veut savoir comment le totmisme a pris naissance, ce n'est ni Java, ni Sumatra, ni la Mlansie qu'il faut observer: c'est l'Australie. Or, ici, il n'existe ni culte des morts ni doctrine de la transmigration. Sans doute, on croit que les hros mythiques, fondateurs du clan, se rincarnent priodiquement; mais c'est exclusivement dans des corps humains ; chaque naissance, comme nous le verrons, est le produit d'une de ces rincarnations. Si donc les animaux de l'espce totmique sont l'objet de rites, ce n'est pas parce que des mes ancestrales sont censes y rsider. Il est vrai que ces premiers anctres sont souvent reprsents sous forme animale, et cette reprsentation, qui est trs frquente, est un fait important dont il nous faudra rendre compte ; mais ce n'est pas la croyance la mtempsycose qui peut y avoir donn naissance, puisqu'elle est inconnue des socits australiennes.
559 560 561
D'ailleurs, bien loin de pouvoir expliquer le totmisme, cette croyance suppose elle-mme un des principes fondamentaux sur lesquels il repose ; c'est--dire qu'elle prend pour accord cela mme qu'il faut expliquer. Tout comme le totmisme, en effet, elle implique que l'homme est conu comme troitement parent de l'animal ; car si ces deux rgnes taient nettement distingus dans les esprits, on ne croirait pas que l'me humaine peut passer de l'un dans l'autre avec cette facilit. Il faut mme que le corps de l'animal soit considr comme sa vritable patrie, puisqu'elle est cense s'y rendre ds qu'elle a repris sa libert. Or, si la doctrine de la transmigration postule cette singulire affinit, elle n'en rend aucunement compte. La seule raison qu'en donne Tylor, c'est que l'homme, parfois, rappelle certains traits de l'anatomie et de la psychologie de l'animal. Le sauvage, dit-il, observe avec un tonnement sympathique les traits demi humains, les actions et le caractre des animaux. L'animal n'est-il pas l'incarnation mme, si nous pouvons nous exprimer ainsi, de qualits familires l'homme ; et quand nous appliquons, comme pithte, certains hommes le nom de lion, d'ours, de renard, de hibou, de
557 558 559
560 561
CODRINGTON, The Melanesians, pp. 32-33, et lettre personnelle du mme auteur cite par TYLOR dans J.A.I., XXVIII, p. 147. Telle est aussi, des nuances prs, la solution adopte Par WUNDT (Mythus und Religion, Il, p. 269). Il est vrai que, pour Tylor, le clan n'est qu'une famille largie; par suite, ce qui se petit dire de l'un de ces groupes s'applique dans sa pense l'autre (J.A.I., XXVIII, p. 157). Mais cette conception est des plus contestables ; le clan seul suppose le totem qui n'a tout son sens que dans et par le clan. Dans le mme sens, A. LANG, Social Origins, p. 150. V. plus haut, p. 89.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
158
perroquet, de vipre, de ver, ne rsumons-nous pas, en un mot, quelques traits caractristiques d'une vie humaine ? . Mais s'il se rencontre, en effet, de ces ressemblances, elles sont incertaines et exceptionnelles ; l'homme ressemble avant tout ses parents, ses compagnons, et non des plantes ou des animaux, Des analogies aussi rares et aussi douteuses ne pouvaient triompher d'vidences aussi concordantes ni induire l'homme se penser lui-mme et penser ses devanciers sous des espces que contredisaient toutes les donnes de l'exprience journalire. La question reste donc entire et tant qu'elle n'est pas rsolue, on ne peut dire que le totmisme soit expliqu .
562 563
Enfin, toute cette thorie repose sur une mprise fondamentale. Pour Tylor comme pour Wundt, le totmisme ne serait qu'un cas particulier du culte des animaux . Nous savons, au contraire, qu'il y faut voir tout autre chose qu'une sorte de zooltrie . L'animal n'y est nullement ador; l'homme est presque son gal et parfois mme on dispose comme de sa chose, loin de lui tre subordonn comme un fidle son dieu. Si vraiment les animaux de l'espce totmique passaient pour incarner des anctres, on ne laisserait pas les membres des clans trangers en consommer librement la chair. En ralit, ce n'est pas l'animal comme tel que s'adresse le culte, c'est l'emblme, c'est l'image du totem. Or, entre cette religion de l'emblme et le culte des anctres, il n'existe aucun rapport.
564 565
Tandis que Tylor ramne le totmisme au culte dans anctres, Jevons le rattache au culte de la nature , et voici comment il l'en drive.
566
Une fois que l'homme, sous l'impression de surprise que lui causaient les irrgularits constates dans le cours des phnomnes, eut peupl le monde d'tres surnaturels , il sentit la
567
562 563
564
565 566 567
Civilisation primitive, II, p. 23. Wundt qui a repris, dans ses lignes essentielles, la thorie de Tylor, a essay d'expliquer autrement cette relation mystrieuse de l'homme et de l'animal; c'est le spectacle donn par le cadavre en dcomposition qui en aurait suggr l'ide. En voyant les vers qui s'chappent du corps, on aurait cru que l'me y tait incarne et s'chappait avec eux. Les vers et, par extension, les reptiles (serpents, lzards, etc.), seraient donc les premiers animaux qui auraient servi de rceptacles aux mes des morts, et, par suite, ils auraient t galement les premiers tre vnrs et jouer le rle de totems. C'est seulement ensuite que d'autres animaux et mme des plantes et des objets inanims auraient t levs la mme dignit. Mais cette hypothse ne repose mme pas sur un commencement de preuve. WUNDT affirme (Mythus und Religion, Il, p. 269) que les reptiles sont des totems beaucoup plus rpandus que les autres animaux; d'o il conclut qu'ils sont les plus primitifs. Mais il nous est impossible d'apercevoir ce qui peut justifier cette assertion l'appui de laquelle l'auteur n'apporte aucun fait. Des listes de totems releves soit en Australie, soit en Amrique, il ne ressort nullement qu'une espce animale quelconque ait jou quelque part un rle prpondrant. Les totems varient d'une rgion l'autre suivant l'tat de la faune et de la flore. Si, d'ailleurs, le cercle originel des totems avait t si troitement limit, on ne voit pas comment le totmisme aurait pu satisfaire au principe fondamental en vertu duquel deux clans ou sous-clans d'une mme tribu doivent avoir deux totems diffrents. On adore parfois certains animaux, dit TYLOR, parce qu'on les regarde comme l'incarnation de l'me divine des anctres; cette croyance constitue une sorte de trait d'union entre le culte rendu aux mnes et le culte rendu aux animaux (Civilisation primitive, Il, p. 305 ; cf. 308 in fine). De Mme, WUNDT prsente le totmisme comme une section de l'animalisme (Il, p. 234). V. plus haut, p. 197. Introduction to the History of Religion, p. 96 et suiv. V. plus haut, p. 38.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
159
ncessit de s'arranger avec les forces redoutables dont il s'tait lui-mme entour. Pour ne pas tre cras par elles, il comprit que le meilleur moyen tait de s'allier quelques-unes d'entre elles et de s'assurer ainsi leur concours. Or, cette phase de l'histoire, on ne connat pas d'autre forme d'alliance et d'association que celle qui rsulte de la parent. Tous les membres d'un mme clan s'assistent mutuellement parce qu'ils sont parents ou, ce qui revient au mme, parce qu'ils se regardent comme tels; au contraire, des clans diffrents se traitent en ennemis parce qu'ils sont de sang diffrent. La seule manire de se mnager l'appui des tres surnaturels tait donc de les adopter comme parents et de se faire adopter par eux en la mme qualit : les procds bien connus du blood-covenant permettaient d'atteindre aisment ce rsultat. Mais comme ce moment, l'individu n'avait pas encore de personnalit propre, comme on ne voyait en lui qu'une partie quelconque de son groupe, c'est--dire de son clan, c'est le clan dans son ensemble, et non l'individu, qui contracta collectivement cette parent. Pour la mme raison, il la contracta, non avec un objet en particulier, mais avec le groupe naturel, c'est--dire avec l'espce, dont cet objet faisait partie; car l'homme pense le monde comme il se pense lui-mme et, de mme qu'il ne se conoit pas alors comme spar de son clan, il ne saurait concevoir une chose comme spare de l'espce laquelle elle ressortit. Or, une espce de choses qui est unie un clan par des liens de parent, c'est, dit Jevons, un totem. Il est certain, en effet, que le totmisme implique une troite association entre un clan et une catgorie dtermine d'objets. Mais que, comme le veut Jevons, cette association ait t contracte de propos dlibr, avec une pleine conscience du but poursuivi, c'est ce qui parat peu d'accord avec ce que nous apprend l'histoire. Les religions sont choses complexes, elles rpondent de trop multiples et de trop obscurs besoins pour qu'elles puissent avoir leur origine dans un acte bien rflchi de la volont. D'ailleurs, en mme temps qu'elle pche par excs de simplisme, cette hypothse est grosse d'invraisemblances. On dit que l'homme aurait cherch s'assurer le concours des tres surnaturels dont les choses dpendent. Mais alors il et d s'adresser de prfrence aux plus puissants d'entre eux, ceux dont la protection promettait d'tre le plus efficace . Or, tout au contraire, les tres avec lesquels il a nou cette parent mystique comptent le plus souvent parmi les plus humbles qui soient. D'autre part, si vraiment il ne s'agissait que de se faire des allis et des dfenseurs, on aurait d chercher en avoir le plus possible ; car on ne saurait tre trop bien dfendu. Cependant, en ralit, chaque clan se contente systmatiquement d'un seul totem, c'est--dire d'un seul protecteur, laissant les autres clans jouir du leur en toute libert : chaque groupe se renferme rigoureusement dans le domaine religieux qui lui est propre sans jamais chercher empiter sur celui des voisins. Cette rserve et cette modration sont inintelligibles dans l'hypothse que nous examinons.
568
II
.
568
C'est ce que Jevons reconnat lui-mme Il y a lieu de prsumer, dit-il, que, dans le choix d'un alli, l'homme devait prfrer... l'espce qui possdait le plus grand pouvoir (p. 101).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
160
Toutes ces thories ont, d'ailleurs, le tort d'omettre une question qui domine toute la matire. Nous avons vu qu'il existe deux sortes de totmisme : celui de l'individu et celui du clan. Entre l'un et l'autre, il y a une trop vidente parent pour qu'il n'existe pas entre eux quelque rapport. Il y a donc lieu de se demander si l'un n'est pas driv de l'autre et, en cas de rponse affirmative, quel est le plus primitif ; suivant la solution qui sera adopte, le problme des origines du totmisme se posera dans des termes diffrents. La question s'impose d'autant plus qu'elle offre un intrt trs gnral. Le totmisme individuel, c'est l'aspect individuel du culte totmique. Si donc il est le fait primitif, il faut dire que la religion est ne dans la conscience de l'individu, qu'elle rpond avant tout des aspirations individuelles, et qu'elle n'a pris que secondairement une forme collective. L'esprit simpliste, dont s'inspirent encore trop souvent ethnographes et sociologues, devait naturellement incliner nombre de savants expliquer, ici comme ailleurs, le complexe par le simple, le totem du groupe par celui de l'individu. Telle est, en effet, la thorie soutenue par Frazer, dans son Golden Bough , par Hill Tout , par Miss Flet cher , par Boas et par Swanton . Elle a, d'ailleurs, l'avantage d'tre d'accord avec la conception qu'on se fait couramment de la religion: on y voit assez gnralement une chose toute intime et personnelle. De ce point de vue, le totem du clan ne peut donc tre qu'un totem individuel qui se serait gnralis. Un homme marquant, aprs avoir prouv la valeur d'un totem qu'il s'tait librement choisi, l'aurait transmis ses descendants ; ceux-ci, en se multipliant avec le temps, auraient fini par former cette famille tendue qu'est le clan, et c'est ainsi que le totem serait devenu collectif.
569 570 571 572 573
Hill Tout a cru trouver une preuve l'appui de cette thorie dans la manire dont le totmisme est entendu par certaines socits du Nord-Ouest amricain, notamment par les Salish et les Indiens de la Rivire Thompson. Chez ces peuples, en effet, on rencontre et le totmisme individuel et le totmisme de clan ; mais ou bien ils ne coexistent pas dans une mme tribu, ou bien, quand ils coexistent, ils sont ingalement dvelopps. Ils varient en raison inverse l'un de l'autre : l o le totem de clan tend tre la rgle gnrale, le totem individuel tend disparatre, et inversement. N'est-ce pas dire que le premier est une forme plus rcente du second qu'il exclut en le remplaant ? La mythologie semble confirmer cette interprtation. Dans ces mmes socits, en effet, l'anctre du clan n'est pas un animal totmique : mais on se reprsente gnralement le fondateur du groupe sous les traits d'un tre humain qui, un moment donn, serait entr en rapports et en commerce familier avec un animal fabuleux de qui il aurait reu son emblme totmique. Cet emblme, avec les pouvoirs
574
569
570
571 572 573 574
2e d., III, p. 416 et suiv.; voir particulirement p. 419, no 5. Dans de plus rcents articles, qui seront analyss plus loin, FRAZER a expos une thorie diffrente qui pourtant, dans sa pense, n'exclut pas compltement celle du Golden Bough. The Origin of the Totemism of the Aborigines of British Columbia, in Proc. and Transac. of the R. Society of Canada, 2e srie, VII, 2e section, p. 3 et suiv. Du mme, Report on the Ethnology of the Statlumh, J.A.I., XXXV, p. 141. Hill TOUT a rpondu diffrentes objections qui avaient t faites sa thorie dans le tome IX des Trans. of the R. Society of Canada, pp. 61-99. Alice C. FLETCHER, The Import of the Totem, in Smithsonian Report for 1897, pp. 577-586. The Kwakiutl Indians, pp. 323 et suiv., 336-338, 393. The Development of the Clan System, in Amer. Anthrop., n. s., 1904, VI, pp. 477-864. J.A.I., XXXV, p. 142.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
161
spciaux qui y sont attachs, serait ensuite pass aux descendants de ce hros mythique par droit d'hritage. Ces peuples semblent donc avoir eux-mmes dans le totem collectif un totem individuel qui se serait perptu dans une mme famille . En fait, d'ailleurs, il arrive encore aujourd'hui qu'un pre transmette son totem propre ses enfants. En imaginant que, d'une manire gnrale, le totem collectif a eu cette mme origine, on ne fait donc qu'affirmer du pass un fait qui est encore prsentement observable .
575 576
Reste expliquer d'o vient le totmisme individuel. La rponse faite cette question varie selon les auteurs. Hill Tout y voit un cas particulier du ftichisme. Se sentant entour de toutes parts d'esprits redouts, l'individu aurait prouv le sentiment que, tout l'heure, Jevons prtait au clan : pour pouvoir se maintenir, il aurait cherch s'assurer dans ce monde mystrieux quelque puissant protecteur. C'est ainsi que l'usage du totem personnel se serait tabli . Pour Frazer, cette mme institution serait plutt un subterfuge, une ruse de guerre invente par les hommes pour chapper certains dangers. On sait que, suivant une croyance trs rpandue dans un grand nombre de socits infrieures, l'me humaine peut, sans inconvnients, quitter temporairement le corps o elle habite ; si loigne qu'elle en puisse tre, elle continue l'animer par une sorte d'action distance. Mais alors, dans certains moments critiques o la vie passe pour tre particulirement menace, il peut y avoir intrt retirer l'me du corps et la dposer dans un lieu ou dans un objet o elle serait plus en sret. Et il existe, en effet, un certain nombre de pratiques qui ont pour objet d'externer l'me en vue de la soustraire quelque pril, rel ou imaginaire. Par exemple, au moment o des gens vont pntrer dans une maison nouvellement construite, un magicien extrait leurs mes et les met dans un sac, sauf les restituer leurs propritaires une fois que le seuil sera franchi. C'est que le moment o l'on entre dans une maison neuve est exceptionnellement critique ; on risque de troubler et, par consquent, d'offenser les esprits qui rsident dans le sol et surtout sous le seuil, et, si l'on ne prenait pas de prcautions, ils pourraient faire payer cher l'homme son audace. Mais une fois que le danger est pass, une fois qu'on a pu prvenir leur colre et mme s'assurer leur appui grce l'accomplissement de certains rites, les mes peuvent, en toute scurit, reprendre leur place accoutume . C'est cette mme croyance qui aurait donn naissance au totem individuel. Pour se mettre l'abri des malfices magiques, les hommes auraient cru sage de cacher leurs mes dans la foule anonyme d'une espce animale ou vgtale. Mais, une fois ce commerce tabli, chaque individu se trouva troitement uni l'animal ou la plante o tait cens rsider son principe vital. Deux tres aussi solidaires finirent mme par tre considrs comme peu prs indistincts : on crut qu'ils participaient la nature l'un de l'autre. Cette croyance, une fois admise, facilita et activa la transformation du totem personnel en totem hrditaire et, par suite, collectif ; car il sembla de toute vidence que cette parent de nature devait se transmettre
577 578
575 576 577 578
Ibid., p. 150. Cf. Vth Rep. on the Physical Characteristics, etc., of the N. W. Tribes of Canada, B.A.A.S., p. 24. Nous avons rapport plus haut un mythe de ce genre. J.A.I., XXXV, p. 147. Proc. a. Transac., etc., VII, 2e section, p. 12. V. The Golden Bough, III, p. 351 et suiv. WILKEN avait dj signal des faits analogues dans De Simsonsage, in De Gids, 1890; De Betrekking tusschen Menschen-Dieren en Plantenleven, in Indische Gids, 1884, 1888; Ueber das Haaropfer, in Revue coloniale internationale, 1886-1887.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
162
hrditairement du pre aux enfants. Nous ne nous arrterons pas discuter longuement ces deux explications du totem individuel : ce sont d'ingnieuses vues de l'esprit, mais qui manquent totalement de preuves positives. Pour pouvoir rduire le totmisme au ftichisme, il faudrait avoir tabli que le second est antrieur au premier ; or, non seulement on n'allgue aucun fait pour dmontrer cette hypothse, mais encore elle est contredite par tout ce que nous savons. L'ensemble, mal dtermin, de rites que l'on appelle ftichisme, semble bien n'apparatre que chez des peuples qui sont dj parvenus un certain degr de civilisation; c'est un genre de culte inconnu en Australie. On a, il est vrai, qualifi le churinga de ftiche ; mais, supposer que cette qualification soit justifie, elle ne saurait prouver l'antriorit qu'on postule. Tout au contraire, le churinga suppose le totmisme, puisqu'il est essentiellement un instrument du culte totmique et qu'il doit aux seules croyances totmiques les vertus qui lui sont attribues.
579
Quant la thorie de Frazer, elle suppose chez le primitif une sorte d'absurdit foncire que les faits connus ne permettent pas de lui prter. Il a une logique, si trange qu'elle puisse parfois nous paratre : or, moins d'en tre totalement dpourvu, il ne pouvait commettre le raisonnement qu'on lui impute. Qu'il ait cru assurer la survie de son me en la dissimulant dans un endroit secret et inaccessible, comme sont censs l'avoir fait tant de hros des mythes et des contes, rien n'tait plus naturel. Mais comment eut-il pu la juger plus en sret dans le corps d'un animal que dans le sien propre ? Sans doute, ainsi perdue dans l'espce, elle pouvait avoir quelques chances d'chapper plus facilement aux sortilges du magicien, mais, en mme temps, elle se trouvait toute dsigne aux coups des chasseurs. C'tait un singulier moyen de la mettre l'abri que de l'envelopper d'une forme matrielle qui l'exposait des risques de tous les instants . Surtout, il est inconcevable que des peuples entiers aient pu se laisser aller une semblable aberration . Enfin dans un trs grand nombre de cas, la fonction du totem individuel est manifestement trs diffrente de celle que lui attribue Frazer : c'est, avant tout, un moyen de confrer des magiciens, des chasseurs, des guerriers, des pouvoirs extraordinaires . Quant la solidarit de l'homme et de la chose, avec tous les inconvnients
580 581 582
579 580 581
582
Par exemple Eylmann dans Die Eingeborenen der Kolonie Sdaustralien, p. 199. Si le Yunbeai, dit Mrs PARKER propos des Euahlayi, confre une force exceptionnelle, il expose aussi des dangers exceptionnels, car tout ce qui lse l'animal blesse l'homme (Euahlayi, p. 29). Dans un travail ultrieur (The origin of Totemism, in The Fortnighlly Review, mai 1899, pp. 844-845), FRAZER se fait lui-mme l'objection : Si, dit-il, j'ai dpos mon me dans le corps d'un livre, et si mon frre John (membre d'un clan tranger) tue ce livre, le fait rtir et le mange, qu'advient-il de mon me ? Pour prvenir ce danger, il est ncessaire que mon frre John connaisse cette situation de mon me et que, par suite, quand il tue un livre, il ait soin d'en extraire cette me et de me la restituer, avant de cuire l'animal et d'en faire son dner. Or, Frazer croit trouver cette pratique en usage dans les tribus de l'Australie Centrale. Tous les ans, au cours d'un rite que nous dcrirons plus loin, quand les animaux de la gnration nouvelle arrivent maturit, le premier gibier tu est prsent aux gens du totem qui en mangent un peu ; et c'est seulement ensuite que les gens des autres clans peuvent en consommer librement. C'est, dit Frazer, un moyen de rendre aux premiers l'me qu'ils peuvent avoir confie ces animaux. Mais, outre que cette interprtation du rite est tout fait arbitraire, il est difficile de ne pas trouver singulier ce moyen de parer au danger. Cette crmonie est annuelle; de longs jours ont pu s'couler depuis le moment o l'animal a t tu. Pendant ce temps, qu'est devenue l'me dont il avait la garde et l'individu dont cette me est le principe de vie ? Mais il est inutile d'insister sur tout ce qu'a d'inconcevable cette explication. PARKER, Op. cit., p. 20 ; HOWITT, Australian Medicine Men, in J.A.I., XVI, pp. 34, 49-50 ; Hill
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
163
qu'elle implique, elle est accepte comme une consquence force du rite; mais elle n'est pas voulue en elle-mme et pour elle-mme. Il y a d'autant moins lieu de nous attarder cette controverse que l n'est pas le vritable problme. Ce qu'il importe avant tout de savoir, c'est si le totem individuel est rellement le fait primitif dont le totem collectif serait driv ; car, suivant la rponse que nous ferons cette question, nous devrons chercher le foyer de la vie religieuse dans deux directions opposes. Or, contre l'hypothse de Hill Tout, de Miss Fletcher, de Boas, de Frazer, il y a un tel concours de faits dcisifs que l'on est surpris qu'elle ait pu tre si facilement et si gnralement accepte. Tout d'abord, nous savons que l'homme a trs souvent un intrt pressant non seulement respecter, mais faire respecter de ses compagnons les animaux de l'espce qui lui sert de totem personnel; il y va de sa propre vie. Si donc le totmisme collectif n'tait que la forme gnralise du totmisme individuel, il devrait reposer sur le mme principe. Non seulement les gens d'un clan devraient s'abstenir de tuer et de manger de leur animal-totem, mais encore ils devraient faire tout ce qui est en eux pour rclamer des trangers la mme abstention. Or, en fait, bien loin d'imposer ce renoncement toute la tribu, chaque clan, au moyen de rites que nous dcrirons plus loin, veille ce que la plante ou l'animal dont il porte le nom croisse et prospre, afin d'assurer aux autres clans une alimentation abondante. Il faudrait donc, tout au moins, admettre qu'en devenant collectif le totmisme individuel s'est profondment transform et il faudrait rendre compte de cette transformation. En second lieu, comment expliquer de ce point de vue que, sauf l o le totmisme est en voie de dcadence, deux clans d'une mme tribu aient toujours des totems diffrents ? Rien n'empchait, semble-t-il, deux ou plusieurs membres d'une mme tribu, alors mme qu'il n'y avait entre eux aucune parent, de choisir leur totem personnel dans la mme espce animale et de le transmettre ensuite leurs descendants. N'arrive-t-il pas aujourd'hui que deux familles distinctes portent le mme nom ? La manire, strictement rglemente, dont totems et soustotems sont rpartis entre les deux phratries d'abord, puis entre les divers clans de chaque phratrie, suppose manifestement une entente sociale, une organisation collective. C'est dire que le totmisme est autre chose qu'une pratique individuelle qui se serait spontanment gnralise. D'ailleurs, on ne peut ramener le totmisme collectif au totmisme individuel qu' condition de mconnatre les diffrences qui les sparent. Le premier est dsign l'enfant par sa naissance; c'est un lment de son tat civil. L'autre est acquis au cours de la vie; il suppose l'accomplissement d'un rite dtermin et un changement d'tat. On croit diminuer la distance en insrant entre eux, comme une sorte de moyen terme, le droit que tout dtenteur d'un totem aurait de le transmettre qui il lui plat. Mais ces transferts, partout oh on les observe, sont des actes rares, relativement exceptionnels; ils ne peuvent tre oprs que par des magiciens ou des personnages investis de pouvoirs spciaux ; en tout cas, ils ne peuvent avoir lieu qu'au moyen
583
583
Tout, J.A.I., XXXV, p. 146. D'aprs Hill TOUT lui-mme. Le don ou la transmission (d'un totem personnel) ne peuvent tre effectus que par certaines personnes telles que des shamanes ou des hommes qui possdent un grand pouvoir mystrieux (J.A.I., XXXV, p. 146). Cf. Langloh PARKER, Op. cit., pp. 29-30.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
164
de crmonies rituelles qui effectuent la mutation. Il faudrait donc expliquer comment ce qui tait la prrogative de quelques-uns est devenu le droit de tous; comment ce qui impliquait tout d'abord un changement profond dans la constitution religieuse et morale de l'individu a pu devenir un lment de cette constitution; comment enfin une transmission qui, primitivement, tait la consquence d'un rite, a t ensuite cense se produire d'elle-mme, par la force des choses et sans l'intervention d'aucune volont humaine. A l'appui de son interprtation, Hill Tout allgue que certains mythes attribuent au totem de clan une origine individuelle : on y raconte que l'emblme totmique fut acquis par un individu dtermin qui l'aurait ensuite transmis ses descendants. Mais tout d'abord, ces mythes sont emprunts aux tribus indiennes de l'Amrique du Nord, c'est--dire des socits qui sont parvenues un assez haut degr de culture. Comment une mythologie aussi loigne des origines permettrait-elle de reconstituer, avec quelque assurance, la forme primitive d'une institution ? Il y a bien des chances pour que des causes intercurrentes aient gravement dfigur le souvenir que les hommes en avaient pu conserver. D'ailleurs, ces mythes, il est trop facile d'en opposer d'autres qui semblent bien tre plus primitifs et dont la signification est toute diffrente. Le totem y est reprsent comme l'tre mme de qui le clan est descendu. C'est donc qu'il constitue la substance du clan; les individus le portent en eux-mmes ds leur naissance ; il fait partie de leur chair et de leur sang, bien loin qu'ils l'aient reu du dehors . Il y a plus : les mythes sur lesquels s'appuie Hill Tout contiennent eux-mmes un cho de cette ancienne conception. Le fondateur ponyme du clan y a bien une figure d'homme ; mais c'est un homme qui, aprs avoir vcu au milieu d'animaux d'une espce dtermine, aurait fini par leur ressembler. C'est sans doute qu'un moment vint o les esprits furent trop cultivs pour continuer admettre, comme par le pass, que des hommes pussent natre d'un animal; ils remplacrent donc l'animal anctre, devenu irreprsentable, par un tre humain ; mais ils imaginrent que cet homme avait acquis par imitation ou par d'autres procds, certains caractres de l'animalit. Ainsi, mme cette mythologie tardive porte la marque d'une poque plus lointaine o le totem du clan n'tait nullement conu comme une sorte de cration individuelle.
584
Mais cette hypothse ne soulve pas seulement de graves difficults logiques ; elle est directement contredite par les faits qui suivent. Si le totmisme individuel tait le fait initial, il devrait tre d'autant plus dvelopp et d'autant plus apparent que les socits elles-mmes sont plus primitives ; inversement, on devrait le voir perdre du terrain et s'effacer devant l'autre chez les peuples plus avancs. Or c'est le contraire qui est la vrit. Les tribus australiennes sont de beaucoup plus arrires que celles de l'Amrique du Nord; et cependant, l'Australie est le terrain de prdilection du totmisme collectif. Dans la grande majorit des tribus, il rgne seul, tandis qu'il n'en est Pas une, notre connaissance, o le totmisme individuel soit seul Pratiqu . On ne trouve ce dernier, sous une forme caractrise, que dans un nombre infime de tribus . L mme o il se
585 586
584 585 586
Cf. HARTLAND, Totemism and some Recent Discoveries, Folk-lore, XI, p. 59 et suiv. Sauf peut-tre chez les Kurnai; et encore, dans cette tribu, y a-t-il, outre les totems personnels, des totems sexuels. Chez les Wotjobaluk, les Buandik, les Wiradjuri, les Yuin et les tribus voisines de Maryborough
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
165
rencontre, ce n'est le plus souvent qu' l'tat rudimentaire. Il consiste alors en pratiques individuelles et facultatives, mais qui n'ont aucun caractre de gnralit. Seuls, les magiciens connaissent l'art de nouer des relations mystrieuses avec des espces animales auxquelles ils ne sont pas naturellement apparents. Les gens du commun ne jouissent pas de ce privilge . Au contraire, en Amrique, le totem collectif est en pleine dcadence ; dans les socits du Nord-Ouest notamment, il n'a plus qu'un caractre religieux assez effac. Inversement, chez ces mmes peuples, le totem individuel joue un rle considrable. On lui attribue une trs grande efficacit ; il est devenu une vritable institution publique. C'est donc qu'il est caractristique d'une civilisation plus avance. Voil, sans doute, comment s'explique l'inversion que Hill Tout croit avoir observe chez les Salish entre ces deux formes de totmisme. Si, l o le totmisme collectif est pleinement dvelopp, l'autre fait presque compltement dfaut, ce n'est pas parce que le second a recul devant le premier ; c'est, au contraire, parce que les conditions ncessaires son existence ne sont pas pleinement ralises.
587
Mais ce qui est plus dmonstratif encore, c'est que le totmisme individuel, loin d'avoir donn naissance au totmisme de clan, suppose ce dernier. C'est dans les cadres du totmisme collectif qu'il a pris naissance et qu'il se meut: il en fait partie intgrante. En effet, dans les socits mmes o il est prpondrant, les novices n'ont pas le droit de prendre pour totem personnel un animal quelconque ; mais chaque clan sont assignes un certain nombre d'espces dtermines en dehors desquelles il n'est pas permis de choisir. En revanche, celles qui lui appartiennent ainsi sont sa proprit exclusive ; les membres d'un clan tranger ne peuvent les usurper . Elles sont conues comme soutenant des rapports d'troite dpendance avec celle qui sert de totem au clan tout entier. Il y a mme des cas o il est possible d'apercevoir ces rapports : le totem individuel reprsente une partie ou un aspect particulier du totem collectif . Chez les Wotjobaluk, chaque membre du clan considre les totems personnels de ses compagnons comme tant un peu les siens ; ce sont donc vraisemblablement des sous-totems. Or le sous-totem suppose le totem comme l'espce suppose le genre. Ainsi, la premire forme de religion individuelle que l'on rencontre dans l'histoire nous apparat, non pas comme le principe actif de la religion publique, mais au contraire, comme un
588 589 590
587 588
589
590
(Queensland). V. HOWITT, Nat. Tr., pp. 114-147; MATHEWS, J. Of R. Soc. of N. S. Wales, XXXVIII, p. 291. Cf. Thomas, Further Notes on M. Hill Tout's Views of Totemism, in Man, 1904, p. 85. C'est le cas des Euahlayi et des faits de totmisme personnel signals par HOWITT dans Australian Medicine Men, in J.A.I., XVI, pp. 34, 45 et 49-50, Miss FLETCHER, A Study of the Omaha Tribe, in Smithsonian Report for 1897, p. 586 ; BOAS, The Kwakiutl, p. 322 ; DU MME, Vth Rep. of the Committee... of the N. W. Tribes of the Dominion of Canada, B.A.A.S., p. 25; Hill TOUT, J.A.I., XXXV, p. 148. Les noms propres des diffrentes gentes, dit BOAS propos des Tlinkit, sont drivs de leurs totems respectifs, chaque gens ayant ses noms spciaux. La connexion entre le nom et le totem (collectif) n'est parfois pas trs apparente, mais elle existe toujours (Vth Rep. of the Committee.... p. 25). Le fait que les prnoms individuels sont la proprit du clan et le caractrisent aussi srement que le totem s'observe galement chez les Iroquois (MORGAN, Ancient Society, p. 78); chez les Wyandot (POWELL, Wyandot Government, in 1st Rep., p. 59) ; chez les Shawnee, les Sauk, les Fox (MORGAN, Ancient Society, p. 72, 76-77) ; chez les Omaha Dorsey, Omaha Sociology, in IIId Rep., p. 227 et suiv.). Or on sait le rapport qu'il y a entre les prnoms et les totems personnels (v. plus haut, p. 224). Par exemple, dit MATHEWS, si vous demandez un homme Wartwurt quel est son totem, il vous dira d'abord son totem personnel, mais, trs probablement, il numrera ensuite les autres totems personnels de son clan (J. of the Roy. Soc. of N. S. Wales, XXXVIII, p. 291).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
166
simple aspect de cette dernire. Le culte que l'individu organise pour soi-mme et, en quelque sorte, dans son for intrieur, loin d'tre le germe du culte collectif, n'est que celui-ci appropri aux besoins de l'individu.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
167
III
.
Dans un plus rcent travail , qui lui a t suggr par les ouvrages de Spencer et Gillen, Frazer a tent de substituer une explication nouvelle du totmisme celle qu'il avait d'abord propose et qui vient d'tre discute. Elle repose sur ce postulat que le totmisme des Arunta est le plus primitif que nous connaissions; Frazer va mme jusqu' dire qu'il diffre peine du type vraiment et absolument originel .
591 592
Ce qu'il a de singulier, c'est que les totems n'y sont attachs ni des personnes ni des groupes de personnes dtermins, mais des localits. Chaque totem a, en effet, son centre en un endroit dfini. C'est l que sont censes rsider de prfrence les mes des premiers anctres qui, l'origine des temps, constituaient le groupe totmique. C'est l que se trouve le sanctuaire o sont conservs les churinga; l que se clbre le culte. C'est aussi cette distribution gographique des totems qui dtermine la manire dont les clans se recrutent. L'enfant, en effet, a pour totem, non celui de son pre ou de sa mre, mais celui qui a son centre l'endroit o sa mre croit avoir senti les premiers symptmes de sa maternit prochaine. Car l'Arunta ignore, dit-on, le rapport prcis qui unit le fait de la gnration l'acte sexuel ; il croit que toute conception est due une sorte de fcondation mystique. Elle implique, suivant lui, qu'une me d'anctre a pntr dans le corps d'une femme et y est devenue le principe d'une vie nouvelle. Au moment donc o la femme peroit les premiers tressaillements de l'enfant, elle s'imagine qu'une des mes qui ont leur rsidence principale l'endroit o elle se trouve vient de pntrer en elle. Et comme l'enfant qui nat ensuite n'est autre chose que cet anctre rincarn, il a ncessairement le mme totem ; c'est--dire que son clan est dtermin par la localit o il passe pour avoir t mystiquement conu.
593
Or, c'est ce totmisme local qui reprsenterait la forme originelle du totmisme; tout au plus en serait-il spar par une trs courte tape. Voici comment Frazer en explique la gense. A l'instant prcis o la femme se sent enceinte, elle doit penser que l'esprit dont elle se croit possde lui est venu des objets qui l'entourent, et surtout d'un de ceux qui, ce moment,
591
592 593
The Beginnings of Religion and Totemism among the Australian Aborigines, in The Fortnightly Review, juillet 1905, p. 162 et suiv., et sept., p. 452. Cf. DU MME AUTEUR, The Origin of Totemism, ibid., avril 1899, p. 648, et mai, p. 835. Ces derniers articles, un peu plus anciens, diffrent sur un point des premiers, mais le fond de la thorie n'est pas essentiellement diffrent. Les uns et les autres sont reproduits dans Totemism a. Exogamy, 1, p. 89-172. V. dans le mme sens, SPENCER et GILLEN, Some Remarks on Totemism as applied to Australian Tribes, in J.A.I., 1899, pp. 275-280, et des remarques de FRAZER, sur le mme sujet, ibid., pp. 281-286. Perhaps we may... say that it is but one remove from the original pattern, the absolutely primitive type of totemism (Fortn. Rev., sept. 1905, p. 455). Sur ce point, le tmoignage de STREHLOW confirme celui de SPENCER et GILLEN (II, p. 52). V. en sens contraire LANG, The Secret of the Totem, p. 190.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
168
attiraient son attention. Si donc elle tait occupe la collecte de quelque plante, ou si elle surveillait un animal, elle croira que l'me de cet animal ou de cette plante est passe en elle. Parmi les choses auxquelles elle sera particulirement porte attribuer sa grossesse, se trouvent, au tout premier rang, les aliments qu'elle vient de prendre. Si elle a mang rcemment de l'mou ou de l'igname, elle ne mettra pas en doute qu'un mou ou qu'une igname a pris naissance en elle et s'y dveloppe. Dans ces conditions, on s'explique que l'enfant, son tour, soit considr comme une sorte d'igname ou d'mou, qu'il se regarde lui-mme comme un congnre des animaux ou des plantes de la mme espce, qu'il leur tmoigne de la sympathie et des gards, qu'il s'interdise d'en manger, etc. Ds lors, le totmisme existe dans ses traits essentiels : c'est la notion que l'indigne se fait de la gnration qui lui aurait donn naissance, et c'est pourquoi Frazer appelle conceptionnel le totmisme primitif.
594
C'est de ce type originel que toutes les autres formes de totmisme seraient drives. Que plusieurs femmes, l'une aprs l'autre, peroivent les signes prmonitoires de la maternit en un mme lieu et dans les mmes circonstances, cet endroit sera regard comme hant par des esprits d'une sorte particulire ; et ainsi, avec le temps, la rgion sera dote de centres totmiques et sera distribue en districts totmiques . Voil comment le totmisme local des Arunta serait n. Pour qu'ensuite les totems se dtachent de leur base territoriale, il suffira de concevoir que les mes ancestrales, au lieu de rester immuablement fixes en un lieu dtermin, puissent se mouvoir librement sur toute la surface du territoire et suivent, dans leurs voyages, les hommes ou les femmes du mme
595
totem qu'elles. De cette faon, une femme pourra tre fconde par un esprit de son propre totem ou du totem de son mari, alors mme qu'elle rsidera dans un district totmique diffrent. Suivant qu'on imaginera que ce sont les anctres du mari ou les anctres de la femme qui suivent ainsi le jeune mnage en piant les occasions de se rincarner, le totem de l'enfant sera ou celui de son pre ou celui de sa mre. En fait, c'est bien ainsi que les Gnanji et les Umbaia, d'une part, les Urabunna, de l'autre, expliquent leurs systmes de filiation. Mais cette thorie, comme celle de Tylor, repose sur une ptition de principe. Pour pouvoir imaginer que les mes humaines sont des mes d'animaux ou de plantes, il fallait dj croire que l'homme emprunte soit au monde animal soit au monde vgtal ce qu'il y a de plus essentiel en lui. Or cette croyance est prcisment une de celles qui sont la base du totmisme. La poser comme une vidence, c'est donc s'accorder ce dont il faudrait rendre compte. D'autre part, de ce point de vue, le caractre religieux du totem est entirement inexplicable ; car la vague croyance en une obscure parent de l'homme et de l'animal ne suffit pas fonder un culte. Cette confusion de rgnes distincts ne saurait avoir pour effet de ddoubler le monde
594
595
Une ide trs voisine avait t dj exprime par HADDON dans son Address to the Anthropological section (B.A.A.S., 1902, p. 8 et suiv.). Il suppose que chaque groupe local avait primitivement un aliment qui lui tait plus spcialement propre. La plante ou l'animal qui servait ainsi de principale matire la consommation serait devenu le totem du groupe. Toutes ces explications impliquent naturellement que l'interdiction de manger de l'animal totmique n'tait pas primitive, et fut mme prcde d'une prescription contraire. Fortn. Rev., sept. 1905, p. 458.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
169
en profane et en sacr. Il est vrai que, consquent avec lui-mme, Frazer se refuse voir dans le totmisme une religion, sous prtexte qu'il ne s'y trouve ni tres spirituels, ni prires, ni invocations, ni offrandes, etc. Suivant lui, ce ne serait qu'un systme magique; il entend par l une sorte de science grossire et errone, un premier effort pour dcouvrir les lois des choses . Mais nous savons ce qu'a d'inexact cette conception et de la religion et de la magie. Il y a religion ds que le sacr est distingu du profane et nous avons vu que le totmisme est un vaste systme de choses sacres. L'expliquer, c'est donc faire voir d'o vient que ces choses ont t marques de ce caractre . Or le problme n'est mme pas pos.
596 597
Mais ce qui achve de ruiner ce systme, c'est que, aujourd'hui, le postulat sur lequel il repose n'est plus soutenable. Toute l'argumentation de Frazer suppose, en effet, que le totmisme local des Arunta est le plus primitif que nous connaissions, et surtout qu'il est sensiblement antrieur au totmisme hrditaire, soit en ligne paternelle, soit en ligne maternelle. Or, dj d'aprs les seuls faits que le premier ouvrage de Spencer et Gillen mettait notre disposition, nous avions pu conjecturer qu'il devait y avoir eu un moment dans l'histoire du peuple Arunta o les totems, au lieu d'tre attachs des localits, se transmettaient hrditairement de la mre aux enfants . Cette conjecture est dfinitivement dmontre par les faits nouveaux qu'a dcouverts Strehlow et qui ne font d'ailleurs que confirmer les observations antrieures de Schulze . En effet, ces deux auteurs nous apprennent que, maintenant encore, chaque Arunta, outre son totem local, en a un autre qui est indpendant de toute condition gographique, mais qui lui appartient par droit de naissance: c'est celui de sa mre. Ce second totem, tout comme le premier, est considr par les indignes comme une puissance amie et protectrice qui pourvoit leur nourriture, qui les avertit des dangers possibles, etc. Ils ont le droit de participer son culte. Quand on les enterre, on dispose le cadavre de manire ce que le visage soit tourn vers la rgion o se trouve le centre totmique de la mre. C'est donc que ce centre est aussi, quelque titre, celui du dfunt. Et en effet, on lui donne le nom de tmara altjira, mot qui veut dire : camp du totem qui m'est associ. Il est donc certain que, chez les Arunta, le totmisme hrditaire en ligne utrine n'est pas postrieur au totmisme local, mais, au contraire, a d le prcder. Car le totem maternel n'a plus aujourd'hui qu'un rle accessoire et complmentaire ; c'est un totem second, et c'est ce qui explique qu'il ait pu chapper des observateurs aussi attentifs et aussi avertis que Spencer et Gillen. Mais pour qu'il ait pu se maintenir ainsi au second plan, faisant double emploi avec le totem local, il faut qu'il y ait eu un temps o c'tait lui qui tenait la premire place dans la vie religieuse. C'est, en partie, un totem dchu, mais qui rappelle une poque o l'organisation totmique des Arunta tait trs diffrente de ce qu'elle est aujourd'hui. Toute la construction de
598 599 600
596 597
598
599 600
Fortn. Rev., mai 1899, p. 835, et juillet 1905, p. 162 et suiv. Tout en ne voyant dans le totmisme qu'un systme magique, FRAZER reconnat qu'on y trouve parfois les premiers germes d'une religion proprement dite (Fortn. Rev., juillet 1905, p. 163). Sur la manire dont, suivant lui, la religion serait sortie de la magie, v. Golden Bough 2, 1, pp. 75-78. Sur le totmisme, in Anne sociol., V, pp. 82-121. Cf. sur cette mme question, HARTLAND, Presidential Address, in Folk-lore, XI, p. 75; A. LANG, A Theory of Arunta Totemism, in Man, 1904, no 44; Conceptional Totemism and Exogamy, ibid., 1907, no 55 ; The Secret of the Totem, chap. IV; N. W. Thomas, Arunta Totemism, in Man, 1904, no 68; P. W. SCHMIDT, Die Stellung der Aranda unter den Australischen Stmmen, in Zeilschrift fr Ethnologie, 1908, p. 866 et suiv. Die Aranda, II, pp. 57-58. SCHULZE, loc. cit., pp. 238-239.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
170
Frazer se trouve ainsi mine sa base .
601
IV
.
Bien qu'Andrew Lang ait vivement combattu cette thorie de Frazer, celle qu'il propose dans ses derniers ouvrages s'en rapproche sur plus d'un point. Comme Frazer, en effet, il fait consister tout le totmisme dans la croyance en une sorte de consubstantialit de l'homme et de l'animal. Mais il l'explique autrement.
602
Il la drive tout entire de ce fait que le totem est un nom. Ds qu'il y eut des groupes humains constitus , chacun d'eux aurait prouv le besoin de distinguer les uns des autres les groupes voisins avec lesquels il tait en rapport et, dans ce but, il leur aurait donn des noms diffrents. Ces noms furent emprunts de prfrence la faune et la flore environnantes parce que des animaux et des plantes peuvent facilement tre dsigns au moyen de gestes ou reprsents par des dessins . Les ressemblances plus ou moins prcises que les hommes pouvaient avoir avec tel ou tel de ces objets dterminrent la faon dont ces dnominations collectives furent distribues entre les groupes .
603 604 605
Or, c'est un fait connu que, pour esprits primitifs, les noms et les choses dsignes par ces noms sont unis par un rapport mystique et transcendantal . Par exemple, le nom que porte un individu n'est pas considr comme un simple mot, comme un signe conventionnel, mais comme une partie essentielle de l'individu lui-mme. Quand donc c'tait un nom d'animal, l'homme qui le portait devait croire ncessairement qu'il avait lui-mme les attributs les plus caractristiques de ce mme animal. Cette croyance s'accrdita d'autant plus facilement que les
606
601
602 603
604
605 606
Dans la conclusion de Totemism a. Exogamy (IV, pp. 58-59), FRAZER dit, il est vrai, qu'il existe un totmisme encore plus ancien que celui des Arunta: c'est celui que Rivers a observ aux les Banks (Totemism in Polynesia and Melanesia, in J.A.I., XXXIX, p. 172). Chez les Arunta, c'est un esprit d'anctre qui est cens fconder la mre ; aux les Banks, c'est un esprit d'animal ou de vgtal, comme le suppose la thorie. Mais comme les esprits ancestraux des Arunta ont une forme animale ou vgtale, la diffrence est tnue. Aussi, n'en avons-nous pas tenu compte dans notre expos. Social Origins, Londres, 1903, particulirement le chapitre VIII intitul The Origin of Totem Names and Beliefs , et The Secret of the Totem, Londres, 1905. Surtout dans ses Social Origins, LANG essaie de reconstituer par voie de conjecture la forme que devaient avoir ces groupes primitifs; il nous parat inutile de reproduire ces hypothses qui n'affectent pas sa thorie du totmisme. Sur ce point, Lang se rapproche de la thorie de Julius Pikler (V. PIKLER et SZOMLO, Der Ursprung des Tolemismus. Ein Beitrag zur materialistischen Geschichtstheorie, Berlin, 36 p. in-8). La diffrence entre les deux hypothses, c'est que Pikler attribue plus d'importance la reprsentation pictographique du nom qu'au nom lui-mme. Social Origins, p. 166. The Secret of the Totem, p. 121 ; cf. pp. 116, 117.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
171
origines historiques de ces dnominations devenaient plus lointaines et s'effaaient davantage des mmoires. Des mythes se formrent pour rendre plus aisment reprsentable aux esprits cette trange ambigut de la nature humaine. Pour l'expliquer, on imagina que l'animal tait l'anctre de l'homme ou qu'ils taient tous deux descendus d'un anctre commun. C'est ainsi qu'auraient t conus les liens de parent qui passent pour unir chaque clan l'espce de choses dont il porte le nom. Or les origines de cette parent fabuleuse une fois expliques, il semble notre auteur que le totmisme n'ait plus de mystre. Mais alors d'o vient le caractre religieux des croyances et des pratiques totmiques ? Car le fait que l'homme se croit un animal de telle espce n'explique pas pourquoi il attribue cette espce des vertus merveilleuses, ni surtout pourquoi il rend aux images qui la symbolisent un vritable culte. - A cette question, Lang fait la mme rponse que Frazer : il nie que le totmisme soit une religion. je ne trouve en Australie, dit-il, aucun exemple de pratiques religieuses telles que celles qui consistent prier, nourrir ou ensevelir le totem . Ce serait seulement une poque ultrieure, et alors qu'il tait dj constitu, que le totmisme aurait t comme attir et envelopp dans un systme de conceptions proprement religieuses. Suivant une remarque de Howitt , quand les indignes entreprennent d'expliquer les institutions totmiques, ils ne les attribuent ni aux totems eux-mmes, ni un homme, mais quelque tre surnaturel, tel que Bunjil ou Baiame. Si, dit Lang, nous acceptons ce tmoignage, une source du caractre religieux du totmisme nous est rvle. Le totmiste obit aux dcrets de Bunjil, comme les Crtois obissaient aux dcrets divins donns par Zeus Minos . Or, la notion de ces grandes divinits s'est forme, suivant Lang, en dehors du systme totmique; celui-ci ne serait donc pas une religion par lui-mme ; il n'aurait fait que se colorer de religiosit au contact d'une religion proprement dite.
607 608
Mais ces mythes mmes vont contre la conception que Lang se fait du totmisme. Si les Australiens n'avaient vu dans le totem qu'une chose humaine et profane, l'ide ne leur serait pas venue d'en faire une institution divine. Si, au contraire, ils ont prouv le besoin de le rapporter une divinit, c'est qu'ils lui reconnaissent un caractre sacr. Ces interprtations mythologiques dmontrent donc la nature religieuse du totmisme, mais ne l'expliquent pas. D'ailleurs, Lang se rend lui-mme compte que cette solution ne saurait suffire. Il reconnat que les choses totmiques sont traites avec un respect religieux ; que, notamment, le sang de l'animal, comme, d'ailleurs, le sang de l'homme, est l'objet de multiples interdits, ou, comme il dit, de tabous que cette mythologie plus ou moins tardive ne peut expliquer . Mais alors d'o viennent-ils ? Voici en quels termes Lang rpond cette question : Aussitt que les groupes noms d'animaux eurent dvelopp les croyances universellement rpandues sur le wakan ou le mana, ou la qualit mystique et sacre du sang, les diffrents tabous totmiques durent galement faire leur apparition . Les mots de wakan et de mana, comme nous le verrons
609 610 611
607 608 609 610 611
The Secret of the Totem, p. 136. J.A.I., aot 1888, pp. 53-54. Cf. Nat. Tr., pp. 89, 488, 498. With reverence , comme dit LANG (The Secret of the Totem, p. 111). ces tabous, Lang ajoute ceux qui sont la base des pratiques exogamiques. Ibid., pp. 136-137.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
172
dans le chapitre suivant, impliquent la notion mme de sacr; l'un est emprunt la langue des Sioux, l'autre celle des peuples mlansiens. Expliquer le caractre sacr des choses totmiques en postulant ce caractre, c'est rpondre la question par la question. Ce qu'il faudrait faire voir c'est d'o vient cette notion de wakan et comment elle s'est applique au totem et tout ce qui en drive. Tant que ces deux questions ne sont pas rsolues, rien n'est expliqu.
V
.
Nous avons pass en revue les principales explications qui ont t donnes des croyances totmiques , en nous efforant de laisser chacune d'elles son individualit. Mais, maintenant que cet examen est termin, nous pouvons constater qu'une critique commune s'adresse indistinctement tous ces systmes.
612
Si l'on s'en tient la lettre des formules, ils semblent se ranger en deux catgories. Les uns (Frazer, Lang) nient le caractre religieux du totmisme ; ce qui revient, d'ailleurs, nier les faits. D'autres le reconnaissent, mais croient pouvoir l'expliquer en le drivant d'une religion antrieure dont le totmisme serait issu. En ralit, cette distinction n'est qu'apparente : la premire catgorie rentre dans la seconde. Ni Frazer ni Lang n'ont pu maintenir leur principe jusqu'au bout et expliquer le totmisme comme s'il n'tait pas une religion. Par la force des choses, ils ont t obligs de glisser dans leurs explications des notions de nature religieuse. Nous venons de voir comment Lang a d faire intervenir l'ide de sacr, c'est--dire l'ide cardinale de toute religion. Frazer, de son ct, dans l'une comme dans l'autre des thories qu'il a successivement proposes, fait ouvertement appel l'ide d'me ou d'esprit; car, suivant lui, le totmisme viendrait ou de ce que les hommes ont cru pouvoir mettre leur me en sret dans un objet extrieur ou de ce qu'ils ont attribu le fait de la conception une sorte de fcondation spirituelle dont un esprit serait l'agent. Or l'me et, plus encore, l'esprit sont des choses sacres, objets de rites ; les notions qui les expriment sont donc essentiellement religieuses, et, par consquent, Frazer a beau faire du totmisme un systme purement magique, lui aussi ne parvient l'expliquer qu'en fonction d'une autre religion. Mais nous avons montr les insuffisances et du naturisme et de l'animisme; on ne peut donc y recourir, comme ont fait Tylor et Jevons, sans s'exposer aux mmes objections. Et cependant
612
Nous n'avons pourtant pas parl de la thorie de Spencer. Mais c'est qu'elle n'est qu'un cas particulier de la thorie gnrale par laquelle il explique la transformation du culte des morts en culte de la nature. Comme nous l'avons expose dj, nous n'aurions pu que nous rpter.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
173
ni Frazer ni Lang ne paraissent entrevoir la possibilit d'une autre hypothse . D'un autre ct, nous savons que le totmisme est troitement li l'organisation sociale la plus primitive que nous connaissions et mme, selon toute vraisemblance, qui soit concevable. Supposer qu'il a t prcd d'une autre religion qui n'en diffrait pas seulement en degrs, c'est donc sortir des donnes de l'observation pour entrer dans le domaine des conjectures arbitraires et invrifiables. Si nous voulons rester d'accord avec les rsultats que nous avons prcdemment obtenus, il faut, tout en affirmant la nature religieuse du totmisme, nous interdire de le ramener une religion diffrente de lui-mme. Ce n'est pas qu'il puisse tre question de lui assigner comme causes des ides qui ne seraient pas religieuses. Mais parmi les reprsentations qui entrent dans la gense dont il est rsult, il peut y en avoir qui appellent par elles-mmes et directement le caractre religieux. Ce sont elles qu'il nous faut rechercher.
613
613
Sauf que Lang drive d'une autre source l'ide des grands dieux: elle serait due, comme nous avons dit, une sorte de rvlation primitive. Mais Lang ne fait pas intervenir cette ide dans son explication du totmisme.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
174
CHAPITRE VI
ORIGINES DE CES CROYANCES
(Suite)
II. - La notion de principe ou mana totmique et l'ide de force
Puisque le totmisme individuel est postrieur au totmisme de clan et parat mme en tre driv, c'est celui-ci que nous devons nous prendre tout d'abord. Mais, comme l'analyse que nous en avons faite l'a rsolu en une multiplicit de croyances qui peuvent paratre htrognes, il est ncessaire avant d'aller plus loin, que nous cherchions apercevoir ce qui en fait l'unit.
I
.
Nous avons vu que le totmisme met au premier rang des choses qu'il reconnat comme sacres les reprsentations figures du totem; ensuite viennent les animaux ou les vgtaux dont le clan porte le nom, et enfin les membres de ce clan. Puisque toutes ces choses sont sacres au mme titre, quoique ingalement, leur caractre religieux ne peut tenir aucun des attributs particuliers qui les distinguent les unes des autres. Si telle espce animale ou vgtale est l'objet d'une crainte rvrentielle, ce n'est pas en raison de ses proprits spcifiques, puisque les membres humains du clan jouissent, quoique un degr lgrement infrieur, du mme privilge, et que la simple image de cette mme plante ou de ce mme animal inspire un respect encore plus prononc. Les sentiments semblables que ces diffrentes sortes de choses veillent dans la conscience du fidle et qui font leur nature sacre, ne peuvent videmment venir que d'un principe qui leur est commun toutes indistinctement, aux emblmes totmiques comme aux gens du clan et aux individus de l'espce qui sert de totem. C'est ce
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
175
principe commun que s'adresse, en ralit, le culte. En d'autres termes, le totmisme est la religion, non de tels animaux, ou de tels hommes, ou de telles images, mais d'une sorte de force anonyme et impersonnelle, qui se retrouve dans chacun de ces tres, sans pourtant se confondre avec aucun d'eux. Nul ne la possde tout entire et tous y participent. Elle est tellement indpendante des sujets particuliers en qui elle s'incarne, qu'elle les prcde comme elle leur survit. Les individus meurent; les gnrations passent et sont remplaces par d'autres ; mais cette force reste toujours actuelle, vivante et semblable elle-mme. Elle anime les gnrations d'aujourd'hui, comme elle animait celles d'hier, comme elle animera celles de demain. A prendre le mot dans un sens trs large, on pourrait dire qu'elle est le dieu qu'adore chaque culte totmique. Seulement, c'est un dieu impersonnel, sans nom, sans histoire, immanent au monde, diffus dans une multitude innombrable de choses. Et encore n'avons-nous ainsi qu'une ide imparfaite de l'ubiquit relle de cette entit quasi divine. Elle n'est pas seulement rpandue dans toute l'espce totmique, dans tout le clan, dans tous les objets qui symbolisent le totem : le cercle de son action s'tend au del. Nous avons vu, en effet, qu'outre ces choses minemment saintes, toutes celles qui sont attribues au clan comme dpendances du totem principal ont, en quelque mesure, le mme caractre. Elles aussi ont quelque chose de religieux, puisque certaines sont protges par des interdits et que d'autres remplissent dans les crmonies du culte des fonctions dtermines. Cette religiosit ne diffre pas en nature de celle qui appartient au totem, sous lequel elles sont classes; elle drive ncessairement du mme principe. C'est donc que le dieu totmique -pour reprendre l'expression mtaphorique dont nous venons de nous servir - est en elles comme il est dans l'espce qui sert de totem et dans les gens du clan. On voit combien il diffre des tres dans lesquels il rside puisqu'il est l'me de tant d'tres diffrents. Mais cette force impersonnelle, l'Australien ne se la reprsente pas sous sa forme abstraite. Sous l'influence de causes que nous aurons rechercher, il a t amen la concevoir sous les espces d'un animal ou d'un vgtal, en un mot d'une chose sensible. Voil en quoi consiste rellement le totem : il n'est que la forme matrielle sous laquelle est reprsente aux imaginations cette substance immatrielle, cette nergie diffuse travers toutes sortes d'tres htrognes, qui est, seule, l'objet vritable du culte. On est ainsi mieux en tat de comprendre ce que veut dire l'indigne quand il affirme que les gens de la phratrie du Corbeau, par exemple, sont des corbeaux. Il n'entend pas prcisment que ce sont des corbeaux au sens vulgaire et empirique du mot, mais qu'en eux tous se trouve un principe, qui constitue ce qu'ils ont de plus essentiel, qui leur est commun avec les animaux du mme nom, et qui est pens sous la forme extrieure du corbeau. Et ainsi l'univers, tel que le conoit le totmisme, est travers, anim par un certain nombre de forces que l'imagination se reprsente sous des figures empruntes, peu d'exceptions prs, soit au rgne animal, soit au rgne vgtal : il y en a autant que de clans dans la tribu et chacune d'elles circule travers certaines catgories de choses dont elle est l'essence et le principe de vie. Quand nous disons de ces principes que ce sont des forces, nous ne prenons pas le mot dans une acception mtaphorique ; ils agissent comme des forces vritables. Ce sont mme, en un sens, des forces matrielles qui engendrent mcaniquement des effets physiques. Un individu entre-t-il en contact avec elles sans avoir pris les prcautions convenables ? Il en reoit un choc
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
176
que l'on a pu comparer l'effet d'une dcharge lectrique. On semble parfois les concevoir comme des sortes de fluides qui s'chappent par les pointes . Quand elles s'introduisent dans un organisme qui n'est pas fait pour les recevoir, elles y produisent la maladie et la mort, par une raction tout automatiques . En dehors de l'homme, elles jouent le rle de principe vital ; c'est en agissant sur elles, nous le verrons , qu'on assure la reproduction des espces. C'est sur elles que repose la vie universelle.
614 615 616
Mais en mme temps qu'un aspect physique, elles ont un caractre moral. Quand on demande l'indigne pourquoi il observe ses rites, il rpond que les anctres les ont toujours observs et qu'il doit suivre leur exemple . Si donc il se comporte de telle ou telle manire avec les tres totmiques, ce n'est pas seulement parce que les forces qui y rsident sont d'un abord physiquement redoutable, c'est qu'il se sent moralement oblig de se comporter ainsi; il a le sentiment qu'il obit une sorte d'impratif, qu'il remplit un devoir. Il n'a pas seulement pour les tres sacrs de la crainte, mais du respect. D'ailleurs, le totem est la source de la vie morale du clan. Tous les tres qui communient dans le mme principe totmique se considrent, par cela mme, comme moralement lis les uns aux autres; ils ont les uns envers les autres des devoirs dfinis d'assistance, de vendetta, etc., et ce sont ces devoirs qui constituent la parent. Le principe totmique est donc, en mme temps qu'une force matrielle, une puissance morale : aussi verrons-nous qu'il se transforme facilement en divinit proprement dite.
617
Il n'y a rien l, d'ailleurs, qui soit spcial au totmisme. Mme dans les religions les plus avances, il n'y a peut-tre pas de dieu qui n'ait gard quelque chose de cette ambigut et qui ne remplisse des fonctions la fois cosmiques et morales. En mme temps qu'une discipline spirituelle, toute religion est une sorte de technique qui permet l'homme d'affronter le monde avec plus de confiance. Mme pour le chrtien, Dieu le Pre n'est-il pas le gardien de l'ordre physique, aussi bien que le lgislateur et le juge de la conduite humaine ?
II
.
On se demandera peut-tre si, en interprtant ainsi le totmisme, nous ne prtons pas au primitif des ides qui dpassent la porte de son esprit. Et sans doute, nous ne sommes pas en mesure d'affirmer qu'il se reprsente ces forces avec la nettet relative que nous avons d mettre dans notre analyse. Nous pouvons bien faire voir que cette notion est implique par l'ensemble de ses croyances et qu'elle les domine ; mais nous ne saurions dire jusqu' quel point elle est expressment consciente, dans quelle mesure, au contraire, elle n'est qu'implicite
614 615 616 617
Dans un mythe kwakiutl, par exemple, un hros anctre perce la tte d'un ennemi en tendant le doigt vers lui (BOAS, Vth Rep. on the North. Tribes of Canada, B.A.A.S., 1889, p. 30). On trouvera les rfrences l'appui de cette assertion, p. 182, no 1, et p. 458, no 1. V. liv. II, chap. IL V. par exemple, HOWITT, Bat. Tr., p. 482; SCRURMANN, The Aboriginal Tribes of Port Lincoln, in WOODS, Nat. Tr. or S. Australia, p. 231.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
177
et confusment sentie. Tout moyen manque pour prciser le degr de clart qu'une ide comme celle-l peut avoir dans ces obscures consciences. Mais ce qui montre bien, en tout cas, qu'elle n'excde en rien la mentalit primitive, ce qui confirme, au contraire, le rsultat auquel nous venons de parvenir, c'est que, soit dans des socits parentes des tribus australiennes, soit mme dans ces dernires, nous trouvons, et sous forme explicite, des conceptions qui ne diffrent de la prcdente qu'en nuances et en degrs. Les religions indignes de Samoa ont certainement dpass la phase totmique. On y trouve de vritables dieux, qui ont des noms propres et, dans une certaine mesure, une physionomie personnelle. Cependant, les traces de totmisme sont difficilement contestables. Chaque dieu, en effet, est attach un groupe, soit local soit domestique, tout comme le totem son clan . Or, chacun de ces dieux est conu comme immanent une espce animale dtermine. Ce n'est pas qu'il rside dans un sujet en particulier : il est dans tous la fois ; il est diffus dans l'espce tout entire. Quand un animal meurt, les gens du groupe qui le vnrent le pleurent et lui rendent de pieux devoirs, parce qu'un dieu habite en lui ; mais le dieu n'est pas mort. Il est ternel comme l'espce. Il ne se confond mme pas avec la gnration prsente ; il tait dj l'me de celle qui a prcd comme il sera l'me de celle qui suivra . Il a donc tous les caractres du principe totmique. C'est un principe totmique que l'imagination a revtu de formes lgrement personnelles. Encore ne faudrait-il pas s'exagrer une personnalit qui n'est gure conciliable avec cette diffusion et cette ubiquit. Si les contours en taient nettement arrts, elle ne pourrait se disperser ainsi et se rpandre travers une multitude de choses.
618 619
Cependant, dans ce cas, il est incontestable que la notion de force religieuse impersonnelle commence s'altrer ; mais il en est d'autres o elle est affirme dans sa puret abstraite et atteint mme un bien plus haut degr de gnralit qu'en Australie. Si les diffrents principes totmiques auxquels s'adressent les divers clans d'une mme tribu sont distincts les uns des autres, ils ne laissent pas d'tre, au fond, comparables entre eux ; car ils jouent tous le mme rle dans leur sphre respective. Or, il est des socits qui ont eu le sentiment de cette communaut de nature et qui se sont leves, par suite, la notion d'une force religieuse unique dont tous les autres principes sacrs ne seraient que des modalits et qui ferait l'unit de l'univers. Et comme ces socits sont encore tout imprgnes de totmisme, comme elles restent engages dans une organisation sociale qui est identique celle des peuples australiens, il est permis de dire que le totmisme portait cette ide dans ses flancs. C'est ce qu'on peut observer chez un grand nombre de tribus amricaines, notamment chez celles qui appartiennent la grande famille des Sioux: Omaha, Ponka, Kansas, Osage, Assiniboin, Dakota, Iowa, Winnebago, Mandan, Hidatsa, etc. Plusieurs de ces socits sont encore organises en clans, comme les Omaha , les Iowa ; d'autres l'taient il n'y a pas longtemps et, dit Dorsey, on retrouve chez elles toutes les fondations du systme totmique
620 621
618
619 620 621
FRAZER emprunte mme Samoa bien des faits qu'il prsente comme proprement totmiques (v. Totemism, p. 6,12-15,24, etc.). Nous avons dit, il est vrai, que Frazer n'apportait pas toujours une critique suffisante aux choix de ses exemples. Mais de si nombreux emprunts n'auraient videmment pas t possibles s'il n'y avait pas rellement Samoa d'importantes survivances de totmisme. V. TURNER, Samoa, p. 21, et chap. IV et V. Alice FLETCHER, A Study of the Omaha Tribe, in Smithsonian Rep. for 1897, pp. 5S2-583. DORSEY, Siouan Sociology, in XVth Rep., p. 238.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
178
comme dans les autres socits des Sioux . Or chez ces peuples, par-dessus tous les dieux particuliers auxquels les hommes rendent un culte, il existe une puissance minente dont toutes les autres sont comme des formes drives et qu'ils appellent wakan . A cause de la situation prpondrante qui est ainsi assigne ce principe dans le panthon siou, on y a vu parfois une sorte de dieu souverain, de Jupiter ou de Jahveh, et les voyageurs ont souvent traduit wakan par grand esprit . C'tait se mprendre gravement sur sa nature vritable. Le wakan n'est, aucun degr, un tre personnel : les indignes ne se le reprsentent pas sous des formes dtermines. Ils disent, rapporte un observateur cit par Dorsey, qu'ils n'ont jamais vu le wakanda; aussi ne peuvent-ils prtendre le personnifier . Il n'est mme pas possible de le dfinir par des attributs et des caractres dtermins. Aucun terme, dit Riggs, ne peut exprimer la signification du mot chez les Dakota. Il comprend tout mystre, tout pouvoir secret, toute divinit . Tous les tres que le Dakota rvre, la terre, les quatre vents, le soleil, la lune, les toiles, sont des manifestations de cette vie mystrieuse et de ce pouvoir qui circule travers toutes choses. Tantt il est reprsent sous la forme du vent, comme un souffle qui a son sige aux quatre points cardinaux et qui meut tout : tantt il est la voix qui se fait entendre quand le tonnerre retentit ; le soleil, la lune, les toiles sont wakan . Mais il n'est pas d'numration qui puisse puiser cette notion infiniment complexe. Ce n'est pas un pouvoir dfini et dfinissable, le pouvoir de faire ceci ou cela ; c'est le pouvoir, d'une manire absolue, sans pithte ni dtermination d'aucune sorte. Les diverses puissances divines n'en sont que des manifestations particulires et des personnifications ; chacune d'elles est ce pouvoir vu sous l'un de ses multiples aspects . C'est ce qui faisait dire un observateur que c'est un dieu essentiellement protimorphe, qui change d'attributs et de fonctions selon les circonstances . Et les dieux ne sont pas les seuls tres qu'il anime : il est le principe de tout ce qui vit, de tout ce qui agit, de tout ce qui se meut. Toute vie est wakan. Et il en est ainsi de tout ce qui manifeste quelque pouvoir, que ce soit sous forme d'action positive, comme les vents et les nuages qui s'amoncellent, ou de rsistance passive, comme le rocher sur le bord du chemin .
622 623 624 625 626 627 628 629 630 631
Chez les Iroquois, dont l'organisation sociale a un caractre totmique encore plus prononc, on retrouve la mme notion : le mot d'orenda qui sert l'exprimer est l'quivalent exact du wakan des Sioux. C'est une puissance mystique, dit Hewitt, que le sauvage conoit
622 623
624
625 626 627 628 629 630 631
Siouan Sociology, p. 221. RIGGS et DORSEY, Dakota English Dictionary, in Contrib. N. Amer. Ethnol., VII, p. 508, Plusieurs des observateurs cits par Dorsey identifient au mot wakan les mots wakanda et wakanta qui en sont drivs, mais qui ont en ralit une signification plus prcise. XIth Rep., p. 372, 21. Miss FLETCHER, tout en reconnaissant non moins nettement le caractre impersonnel du wakanda, ajoute pourtant que, sur cette conception, est venu se greffer un certain anthropomorphisme. Mais cet anthropomorphisme concerne les manifestations diverses du wakanda. On s'adresse au rocher, l'arbre o l'on croit sentir du wakanda, comme s'ils taient des tres personnels. Mais le wakanda lui-mme n'est pas personnifi (Smithsonian Rep. f. 1897, p. 579). RIGGS, Tah-Koo Wah-Kon, pp. 56-57, cit d'aprs DORSEY, XIth Rep., p. 433, 95. XIth Rep., p. 380, 33. Ibid., p. 381, 35. Ibid., p. 376, 28, p. 378, 30. Cf. p. 449, 138. Ibid., p. 432 95. XIth Rep., p. 431, 92. Ibid., p. 433, 95.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
179
comme inhrente tous les corps qui composent le milieu o il vit..., aux rochers, aux cours d'eau, aux plantes et aux arbres, aux animaux et l'homme, aux vents et aux temptes, aux nuages, au tonnerre, aux clairs, etc. . Cette puissance est regarde par l'esprit rudimentaire de l'homme comme la cause efficiente de tous les phnomnes, de toutes les activits qui se manifestent autour de lui . Un sorcier, un shamane a de l'orenda, mais on en dira autant d'un homme qui russit dans ses entreprises. Au fond, il n'est rien dans le monde qui n'ait sa part d'orenda ; seulement les parts sont ingales. Il y a des tres, hommes ou choses, qui sont avantags, d'autres qui sont relativement dshrits, et la vie universelle consiste dans les luttes de ces orenda d'ingale intensit. Les plus intenses se subordonnent les plus faibles. Un homme l'emporte-t-il sur ses concurrents la chasse ou la guerre ? C'est qu'il a plus d'orenda. Si un animal chappe au chasseur qui le poursuit, c'est que l'orenda du premier dpasse celui du second.
632 633
On trouve la mme ide chez les Shoshone sous le nom de pokunt, chez les Algonkins sous le nom de manitou , de nauala chez les Kwakiutl , de yek chez les Tlinkit et de sgna chez les Haida . Mais elle n'est pas particulire aux Indiens de l'Amrique ; c'est en Mlansie qu'elle a t tudie pour la premire fois. Il est vrai que, dans certaines les mlansiennes, l'organisation sociale n'est plus actuellement base totmique ; mais dans toutes le totmisme est encore visible , quoi qu'en ait dit CODRINGTON. Or, on trouve chez ces peuples, sous le nom de mana, une notion qui est l'quivalent exact du wakan des Sioux et de l'orenda iroquois. Voici la dfinition qu'en donne CODRINGTON : Les Mlansiens croient l'existence d'une force absolument distincte de toute force matrielle, qui agit de toutes sortes de faons, soit pour le bien soit pour le mal, et que l'homme a le plus grand avantage mettre sous sa main et dominer. C'est le mana. je crois comprendre le sens que ce mot a pour les indignes... C'est une force, une influence d'ordre immatriel et, en un certain sens, surnaturel ; mais c'est par la force physique qu'elle se rvle, ou bien par toute espce de pouvoir et de supriorit que l'homme possde. Le mana n'est point fix sur un objet dtermin ; il peut tre amen sur toute espce de choses... Toute la religion du Mlansien consiste se procurer du mana soit pour en profiter soi-mme, soit pour en faire profiter autrui . N'est-ce pas la notion mme de force anonyme et diffuse dont nous dcouvrions tout l'heure le germe dans le totmisme australien ? C'est la mme impersonnalit ; car, dit CODRINGTON, il faut se garder d'y voir une sorte d'tre suprme ; une telle ide est absolument trangre la pense mlansienne.
634 635 636 637 638 639
632 633 634 635 636 637 638
639
Orenda and a Definition of Religion, in American Anthropologist, 1902, p. 33. Ibid., p. 36. Tesa Studi del Thavenet, p. 17. BOAS, The Kwakiutl, p. 695. SWANTON, Social Condition, Beliefs a. Linguistic Relationship of the Tlingit Indians, XXVIth Rep., 1905, p. 451, no 3. SWANTON, Contributions to the Ethnology of the Haida, p. 14. Cf. Social Condition, etc., p. 479. Dans certaines socits mlansiennes (Iles Banks, Nouvelles Hbrides du Nord), on retrouve les deux phratries exogamiques. qui caractrisent l'organisation australienne (CODRINGTON, The Melanesians, p. 23 et suiv.). A Florida, il existe, sous le nom de butose de vritables totems (ibid., p. 31). On trouvera une intressante discussion sur ce point dans A. LANG, Social Origins, p. 176 et suiv. Cf. sur le mme sujet, et dans le mme sens, W. H. R. Rivers, Totemism in Polynesia and Melanesia, in J.A.I., XXXIX, p. 156 et suiv. The Melanesians, p. 118, no 1. PARKINSON, Dressig Jahre in der Sdsee, pp. 178, 392, 394, etc.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
180
C'est la mme ubiquit : le mana n'est situ nulle part d'une manire dfinie et il est partout. Toutes les formes de la vie, toutes les efficacits de l'action soit des hommes soit des tres vivants soit des simples minraux sont attribues son influence .
640
Il n'y a donc aucune tmrit prter aux socits australiennes une ide comme celle que nous avons dgage de l'analyse des croyances totmiques, puisque nous la retrouvons, mais porte un plus haut degr d'abstraction et de gnralit, la base de religions qui plongent par leurs racines dans le systme australien et qui en portent visiblement la marque. Les deux conceptions sont manifestement parentes ; elles ne diffrent qu'en degrs. Tandis que le mana est diffus dans tout l'univers, ce que nous avons appel le dieu, ou pour parler plus exactement, le principe totmique, est localis dans un cercle, trs tendu sans doute, mais cependant plus limit, d'tres et de choses d'espces diffrentes. C'est du mana, mais un peu plus spcialis, bien que cette spcialisation ne soit, en somme, que trs relative. Il y a d'ailleurs, le cas o ce rapport de parent est rendu tout particulirement apparent. Chez les Omaha, il existe de totems de toutes sortes, individuels et collectifs ; or les uns et les autres ne sont que des formes particulires du wakan. La foi de l'Indien dans l'efficacit du totem, dit Miss Fletcher, reposait sur sa conception de la nature et de la vie. Cette conception tait complexe et enveloppait deux ides essentielles. La premire, c'est que toutes les choses, soit animes, soit inanimes, sont pntres par un commun principe de vie; la seconde, c'est que cette vie est continue . Or ce commun principe de vie, c'est le wakan. Le totem est le moyen par lequel l'individu est mis en rapports avec cette source d'nergie ; si le totem a des pouvoirs, c'est qu'il incarne du wakan. Si l'homme qui a viol les interdits qui protgent son totem est frapp par la maladie ou par la mort, c'est que la force mystrieuse laquelle il est ainsi venu se heurter, le wakan, ragit contre lui avec une intensit proportionnelle au choc subi . Inversement, de mme que le totem est du wakan, le wakan, son tour, rappelle parfois, par la manire dont il est conu, ses origines totmiques. Say dit en effet que, chez les Dakota, le wahconda , se manifeste sous les espces tantt d'un ours gris, tantt d'un bison, d'un castor ou de quelque autre animal . Sans doute, la formule ne saurait tre accepte sans rserve. Le wakan rpugne toute personnification et, par consquent, il est peu probable qu'il ait jamais t pens dans sa gnralit abstraite l'aide de symboles aussi dfinis. Mais la remarque de Say s'applique vraisemblablement aux formes particulires qu'il prend en se spcialisant dans la ralit concrte la vie. Or, si vraiment il y eut un temps o ces spcialisations du wakan tmoignaient d'une affinit aussi marque pour la forme animale, ce serait une preuve de plus des liens troits qui unissent cette notion aux croyances totmiques .
641 642 643 644 645
640 641 642 643 644 645
On trouvera une analyse de cette notion dans HUBERT et MAUSS, Thorie gnrale de la Magie, in Anne sociol., VII, p. 108. Il y a non seulement des totems de clans, mais aussi de confrries (A. FLETCHER, Smiths. Rep., 1897, p. 581 et suiv.). FLETCHER, op. cit., pp. 578-579. Ibid., p. 583. Chez les Dakota, le totem est appel Wakan. V. RIGGS et DORSEY, Dakota Grammar, Texts a. Ethnog., in Contributions N. Amer. Ethn., 1893, p. 219. James's Account of Long's Exped. Rocky Mountains, I, p. 268 (cit par DORSEY, XIth Rep., p. 431, 92). Nous n'entendons pas soutenir qu'en principe toute reprsentation thriomorphique des forces religieuses soit l'indice d'un totmisme prexistant. Mais quand il s'agit, comme c'est le cas des Dakota, de
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
181
On peut d'ailleurs, expliquer pourquoi, en Australie, l'ide de mana ne pouvait pas atteindre le degr d'abstraction et de gnralit auquel elle est parvenue dans des socits plus avances. Ce n'est pas seulement cause de l'insuffisante aptitude que peut avoir l'Australien abstraire et gnraliser : mais c'est, avant tout, la nature du milieu social qui imposait ce particularisme. En effet, tant que le totmisme reste la base de l'organisation cultuelle, le clan garde, dans la socit religieuse, une autonomie qui, pour n'tre pas absolue, ne laisse pas d'tre trs accuse. Sans doute, en un sens, on peut dire que chaque groupe totmique n'est qu'une chapelle de l'glise tribale; mais c'est une chapelle qui jouit d'une large indpendance. Le culte qui s'y clbre, sans former un tout qui se suffise soi-mme, n'a cependant avec les autres que des rapports extrieurs ; ils se juxtaposent sans se pntrer ; le totem d'un clan n'est pleinement sacr que pour ce clan. Par suite, le groupe des choses qui sont affectes chaque clan, et qui en font partie au mme titre que les hommes, a la mme individualit et la mme autonomie. Chacun d'eux est reprsent comme irrductible aux groupes similaires, comme spar d'eux par une solution de continuit, comme constituant une sorte de rgne distinct. Dans ces conditions, il ne pouvait pas venir l'esprit que ces mondes htrognes ne fussent que des manifestations varies d'une seule et mme force fondamentale ; on devait, au contraire, supposer qu' chacun d'eux correspondait un mana spcifiquement diffrent et dont l'action ne pouvait s'tendre au del du clan et du cercle de choses qui lui taient attribues. La notion d'un mana unique et universel ne pouvait natre qu' partir du moment oh une religion de la tribu se dveloppa par-dessus les cultes de clans et les absorba plus ou moins compltement. C'est avec le sens de l'unit tribale que s'veilla le sens de l'unit substantielle du monde. Sans doute, nous montrerons plus loin que les socits d'Australie connaissent dj un culte commun la tribu tout entire. Mais si ce culte reprsente la forme la plus haute des religions australiennes, il n'a pas russi entamer et modifier les principes sur lesquels elles reposent : le totmisme est essentiellement une religion fdrative qui ne peut dpasser un certain degr de centralisation sans cesser d'tre elle-mme.
646
Un fait caractristique montre bien que telle est la raison profonde qui, en Australie, a maintenu la notion de mana dans cet tat de spcialisation. Les forces proprement religieuses, celles qui sont penses sous la forme des totems, ne sont pas les seules avec lesquelles l'Australien se croit oblig de compter. Il y a aussi celles dont dispose plus particulirement le magicien. Tandis que les premires sont, en principe, considres comme salutaires et bienfaisantes, les secondes ont, avant tout, pour fonction de causer la mort et la maladie. En mme temps que par la nature de leurs effets, elles diffrent aussi par les rapports que les unes et les autres soutiennent avec l'organisation de la socit. Un totem est toujours la chose d'un clan; au contraire, la magie est une institution tribale et mme intertribale. Les forces magiques n'appartiennent en propre aucune portion dtermine de la tribu. Pour s'en servir, il suffit qu'on possde les recettes efficaces. De mme, tout le monde est expos en sentir les effets et doit, par consquent, chercher s'en garantir. Ce sont des forces vagues qui ne sont attaches spcialement aucune division sociale dtermine et qui peuvent mme tendre leur action au
socits o le totmisme est encore apparent, il est naturel de penser qu'il n'est pas tranger ces conceptions. V. plus loin, mme livre chap. IX, , p. 409 et suiv.
646
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
182
del de la tribu. Or il est remarquable que, chez les Arunta et les Loritja, elles sont conues comme de simples aspects et des formes particulires d'une seule et Mme force, appele en Arunta Arungquiltha ou Arunkulta . C'est, disent Spencer et Gillen, Un terme d'une signification un peu vague ; mais, sa base, on trouve toujours l'ide d'un pouvoir surnaturel de nature mauvaise... Le mot s'applique indiffremment ou la mauvaise influence qui se dgage d'un objet ou l'objet mme o elle rside titre temporaire ou permanent . Par arnkulta, dit Strehlow, l'indigne entend une force qui suspend brusquement la vie et amne la mort de celui en qui elle s'est introduite . On donne ce nom aux ossements, aux pices de bois d'o se dgagent des charmes malfaisants, aux poisons animaux ou vgtaux. C'est donc, trs exactement, un mana nocif. Grey signale dans les tribus qu'il a observes une notion tout fait identique . Ainsi, chez ces diffrents peuples, alors que les forces proprement religieuses ne parviennent pas se dfaire d'une certaine htrognit, les forces magiques sont conues comme tant toutes de mme nature; elles sont reprsentes aux esprits dans leur unit gnrique. C'est que, comme elles planent au-dessus de l'organisation sociale, au-dessus de ses divisions et de ses subdivisions, elles se meuvent dans un espace homogne et continu o elles ne rencontrent rien qui les diffrencie. Les autres, au contraire, tant localises dans des cadres sociaux dfinis et distincts, se diversifient et se particularisent l'image des milieux o elles sont situes.
647 648 649 650
On voit par l combien la notion de force religieuse impersonnelle est dans le sens et dans l'esprit du totmisme australien, puisqu'elle se constitue avec nettet ds qu'il n'y a pas de cause contraire qui s'y oppose. Il est vrai que l'arungquiltha est une force purement magique. Mais, entre les forces magiques et les forces religieuses, il n'y a pas de diffrence de nature elles sont mme parfois dsignes par un mme nom en Mlansie, le magicien et ses sortilges ont du mana tout comme les agents et les rites du culte rgulier ; le mot d'orenda, chez les Iroquois , est employ de la mme manire. On peut donc lgitimement infrer la nature des unes d'aprs celle des autres .
651 652 653 654
647 648
649 650 651
652 653 654
La premire orthographe est celle de Spencer et Gillen; la seconde, celle de Strehlow. Nat. Tr., p. 548, no 1. Il est vrai que Spencer et Gillen ajoutent : La meilleure manire de rendre l'ide serait de dire que l'objet arungquiltha est possd par un mauvais esprit. Mais cette libre traduction est une interprtation de Spencer et Gillen, que rien ne justifie. La notion de l'arungquiltha n'implique aucunement l'existence d'tres spirituels. C'est ce qui rsulte du contexte et de la dfinition de Strehlow. Die Aranda, etc., II, p. 76, note. Sous le nom de Boyl-ya (v. BREY, Journals of Two Expeditions of Discovery in N. W. and W. Australia, II, pp. 337-338). V. plus haut p. 58. C'est, d'ailleurs, ce que reconnaissent implicitement Spencer et Gillen quand ils disent que l'arungquiltha est une force surnaturelle . Cf. HUBERT et Mauss, Thorie gnrale de la magie, in Anne sociol., VII, p. 119. CODRINGTON, The Melanesians, p. 191 et suiv. HEWITT, loc. cit., p. 38. On peut mme se demander si tout concept analogue celui de wakan ou de mana manque en Australie. Le mot de churinga ou de tjurunga, comme crit Strehlow, a en effet, chez les Arunta, une signification trs voisine. Ce terme, disent SPENCER et GILLEN, dsigne a tout ce qui est secret ou sacr. Il s'applique aussi bien un objet qu' la qualit qu'il possde - (Nat. Tr., p. 648, s. v. Churinga ). C'est presque la dfinition du mana. Il arrive mme que Spencer et Gillen se servent de cette expression pour dsigner le pouvoir, la force religieuse d'une manire gnrale. En dcrivant une crmonie chez les Kaitish, ils disent que l'officiant est plein de churinga (full of churinga) P c'est--dire, continuent-ils, du
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
183
III
.
Le rsultat auquel nous a conduit l'analyse prcdente n'intresse pas seulement l'histoire du totmisme, mais la gense de la pense religieuse en gnral. Sous prtexte que l'homme, l'origine, est domin par les sens et les reprsentations sensibles, on a souvent soutenu qu'il avait commenc par se reprsenter le divin sous la forme concrte d'tres dfinis et personnels. Les faits ne confirment pas cette prsomption. Nous venons de dcrire un ensemble, systmatiquement li, de croyances religieuses que nous sommes fond considrer comme trs primitif, et cependant nous n'y avons pas rencontr de personnalits de ce genre. Le culte proprement totmique ne s'adresse ni tels animaux ni telles plantes dtermines, ni mme une espce vgtale ou animale, mais une sorte de vague puissance, disperse travers les choses . Mme dans les religions plus leves qui sont sorties du totmisme, comme celles qu'on voit apparatre chez les Indiens de l'Amrique du Nord, cette ide, loin de s'effacer, devient plus consciente d'elle-mme ; elle s'nonce avec une nettet qu'elle n'avait pas auparavant, en mme temps qu'elle parvient une gnralit plus haute. C'est elle qui domine tout le systme religieux.
655
Telle est la matire premire avec laquelle ont t construits les tres de toute sorte que les religions de tous les temps ont consacrs et adors. Les esprits, les dmons, les gnies, les dieux de tout degr ne sont que les formes concrtes qu' prises cette nergie, cette potentialit comme l'appelle Hewitt , en s'individualisant, en se fixant sur tel objet dtermin ou sur tel point de l'espace, en se concentrant autour d'un tre idal et lgendaire, mais conu comme rel par l'imagination populaire. Un Dakota, interrog par Miss Fletcher, exprimait dans un langage plein de relief cette consubstantialit essentielle de toutes les choses sacres. Tout ce qui se meut s'arrte ici ou l, un moment ou un autre. L'oiseau qui vole s'arrte un endroit pour faire son nid, un autre pour se reposer de son vol. L'homme qui marche s'arrte quand il lui plat. Il en est de mme de la divinit. Le soleil, si clatant et si magnifique, est un endroit o elle s'est arrte. Les arbres, les animaux en sont d'autres. L'Indien pense ces endroits et y envoie ses prires afin qu'elles atteignent la place o le dieu a stationn et qu'elles obtiennent assistance et bndiction . Autrement dit, le wakan (car c'est de lui qu'il s'agit) va, vient travers le monde, et les choses sacres sont les points o il s'est
656 657
655
656 657
pouvoir magique qui mane des objets appels churinga , Cependant, il ne semble pas que la notion de churinga soit constitue en Australie avec la nettet et la prcision qu' la notion de mana en Mlansie, ou celle de wakan chez les Sioux. Sans doute, nous verrons plus loin (mme livre, chap. VIII et IX) que le totmisme n'est pas tranger toute ide de personnalit mythique. Mais nous montrerons que ces conceptions sont le produit de formations secondaires : elles drivent des croyances qui viennent d'tre analyses, loin d'en tre la base. Loc. cit., p. 38. Rep. Peabody Museum, Ill, p. 276, note (cit par NORSEY, XIth Rep., p. 435).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
184
pos. Nous voil, cette fois, bien loin du naturisme comme de l'animisme. Si le soleil, la lune, les toiles ont t adors, ils n'ont pas d cet honneur leur nature intrinsque, leurs proprits distinctives, mais ce qu'ils ont t conus comme participant de cette force qui, seule, confre aux choses leur caractre sacr, et qui se retrouve dans une multitude d'autres tres, voire mme les plus infimes. Si les mes des morts ont t l'objet de rites, ce n'est pas parce qu'elles passent pour tre faites d'une sorte de substance fluide et impalpable; ce n'est pas parce qu'elles ressemblent l'ombre projete par un corps ou son reflet sur la surface des eaux. La lgret, la fluidit ne suffisent pas confrer la saintet ; niais elle n'ont t investies de cette dignit que dans la mesure o il y avait en elles quelque chose de cette mme force, source toute de religiosit. On peut mieux comprendre maintenant pourquoi il nous a t impossible de dfinir la religion par l'ide de personnalits mythiques, dieux ou esprits ; c'est que cette manire de se reprsenter les choses religieuses n'est nullement inhrente leur nature. Ce que nous trouvons l'origine et la base de la pense religieuse, ce ne sont pas des objets ou des tres dtermins et distincts qui possdent par eux-mmes un caractre sacr ; mais ce sont des pouvoirs indfinis, des forces anonymes, plus ou moins nombreuses selon les socits, parfois mme ramenes l'unit, et dont l'impersonnalit est strictement comparable celle des forces physiques dont les sciences de la nature tudient les Manifestations. Quant aux choses sacres particulires, elles ne sont que des formes individualises de ce principe essentiel. Il n'est donc pas surprenant que, mme dans les religions o il existe des divinits avres, il y ait des rites qui possdent une vertu efficace par eux-mmes et indpendamment de toute intervention divine. C'est que cette force peut s'attacher aux paroles prononces, aux gestes effectus, aussi bien qu' des substances corporelles ; la voix, les mouvements peuvent lui servir de vhicule, et, par leur intermdiaire, elle peut produire les effets qui sont en elle, sans qu'aucun dieu ni aucun esprit lui prtent leur concours. Mme, qu'elle vienne se concentrer minemment dans un rite, et celui-ci deviendra, par elle, crateur de divinits . Voil aussi pourquoi il n'y a peuttre pas de personnalit divine qui ne garde quelque chose d'impersonnel. Ceux-l mme qui se la reprsentent le plus clairement sous une forme concrte et sensible, la pensent, en mme temps, comme un pouvoir abstrait qui ne peut se dfinir que par la nature de son efficacit, comme une force qui se dploie dans l'espace et qui est, au moins en partie, dans chacun de ses effets. C'est le pouvoir de produire la pluie ou le vent, la moisson ou la lumire du jour; Zeus est dans chacune des gouttes de pluie qui tombent comme Crs dans chacune des gerbes de la moisson . Le plus souvent mme, cette efficacit est si imparfaitement dtermine que le croyant ne peut en avoir qu'une notion trs indcise. C'est, d'ailleurs, cette indcision qui a rendu possibles ces syncrtismes et ces ddoublements au cours desquels les dieux se sont fragments, dmembrs, confondus de toutes les manires. Il n'est peut-tre pas une religion o le mana originel, qu'il soit unique ou plural, se soit rsolu tout entier en un nombre bien dfini d'tres discrets et incommunicables les uns aux autres ; chacun d'eux garde toujours comme un nimbe d'impersonnalisme qui le rend apte entrer dans des combinaisons nouvelles, et cela
658 659
658 659
V. plus haut p. 48. Des expressions comme Zeus huei, comme Ceres succiditur, montrent que cette conception survivait en Grce comme Rome. D'ailleurs, USENER, dans ses Gtternamen, a bien montr que les dieux de la Grce, comme ceux de Rome, taient primitivement des forces impersonnelles qui ne se pensaient qu'en fonction de leurs attributions.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
185
non par suite d'une simple survivance, mais parce qu'il est dans la nature des forces religieuses de ne pouvoir s'individualiser compltement. Cette conception que nous a suggre la seule tude du totmisme a, en outre, pour elle, que plusieurs savants y ont t rcemment conduits au cours de recherches trs diffrentes, et indpendamment les uns des autres. Il tend se produire sur ce point une concordance spontane qui mrite d'tre remarque, car elle est une prsomption d'objectivit. Ds 1899, nous montrions la ncessit de ne faire entrer dans la dfinition du fait religieux aucune notion de personnalit mythique . En 1900, Marrett signalait l'existence d'une phase religieuse qu'il appelait pranimiste, et o les rites se seraient adresss des forces impersonnelles, telles que le mana mlansien ou le wakan des Omaha et des Dakota . Toutefois, Marrett n'allait pas jusqu' soutenir que, toujours et dans tous les cas, la notion d'esprit est logiquement ou chronologiquement postrieure celle de mana et en est drive ; il paraissait mme dispos admettre qu'elle s'est parfois constitue d'une manire indpendante et que, par suite la pense religieuse dcoule d'une double source . D'autre part, il concevait le mana comme une proprit inhrente aux choses, comme un lment de leur physionomie ; car, suivant lui, ce serait tout simplement le caractre que nous attribuons tout ce qui passe l'ordinaire, tout ce qui nous inspire un sentiment de crainte ou d'admiration . C'tait presque revenir la thorie naturiste .
660 661 662 663 664
Peu de temps aprs, MM. Hubert et Mauss, entreprenant de faire une thorie gnrale de la magie, tablissaient que la magie tout entire repose sur la notion de mana . tant donne l'troite parent du rite magique et du rite religieux, on pouvait prvoir que la mme thorie devait tre applicable la religion. C'est ce que soutint Preuss dans une srie d'articles qui parurent dans le Globus la mme anne. S'appuyant sur des faits emprunts de prfrence aux civilisations amricaines, Preuss s'attacha dmontrer que les ides d'me et d'esprit ne se sont constitues qu'aprs celles de pouvoir et de force impersonnelle, que les premires ne sont qu'une transformation des secondes et qu'elles gardent, jusqu' une poque relativement tardive, la marque de leur impersonnalit premire. Il fit voir, en effet, que, mme dans des religions avances, on se les reprsente sous la forme de vagues effluves qui se dgagent automatiquement des choses dans lesquelles elles rsident, qui tendent mme parfois s'en chapper par toutes les voies qui leur sont ouvertes : la bouche, le nez, tous les orifices du
665 666
660 661 662
663 664
665 666
Dfinition du phnomne religieux, in Anne sociol., II, pp. 14-16. Preanimistic Religion, in Folk-lore, 1900, pp. 162-182. Ibid., p. 179. Dans un travail plus rcent, The Conception of Mana (in Transactions of the third International Congress for the History of Religions, 11, p. 54 et suiv.), MARRETT tend subordonner davantage la conception animiste la notion de mana. Cependant, sa pense reste encore, sur ce point, hsitante et trs rserve. Ibid., p. 168. Ce retour du pranimisme au naturisme est encore plus accus dans une communication de CLODD au Ille Congrs de l'Histoire des Religions (Preanimistic Stages in Religion, in Transactions of the third Internat. Congress, etc., I, p. 33). Anne sociologique, tome VII, p. 108 et suiv. Der Ursprung der Religion und Kunst, in Globus, 1904, tome LXXXVI, pp. 321, 355, 376, 389 ; 1905; tome LXXXVII, pp. 333, 347, 380, 394, 413.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
186
corps, l'haleine, le regard, la parole, etc. En mme temps, Preuss montrait tout ce qu'elles ont de protimorphe, l'extrme plasticit qui leur permet de se prter successivement et presque concurremment aux emplois les plus varis . Il est vrai que, si l'on s'en tenait la lettre de la terminologie employe par cet auteur, on pourrait croire que ces forces sont pour lui de nature magique, et non religieuse : il les appelle des charmes (Zauber, Zauberkrfte). Mais il est visible qu'en s'exprimant ainsi il n'entend pas les mettre en dehors de la religion ; car c'est dans des rites essentiellement religieux qu'il les montre agissantes, par exemple dans les grandes crmonies mexicaines . S'il se sert de ces expressions, c'est, sans doute, dfaut d'autres qui marquent mieux l'impersonnalit de ces forces, et l'espce de mcanisme suivant lequel elles oprent.
667 668
Ainsi, de tous cts, la mme ide tend se faire jour . De plus en plus, on a l'impression que les constructions mythologiques, mme les plus lmentaires, sont des produits secondaires et recouvrent un fond de croyances, la fois plus simples et plus obscures, plus vagues et plus essentielles, qui constituent les bases solides sur lesquelles les systmes religieux se sont difis. C'est ce fond primitif que nous a permis d'atteindre l'analyse du totmisme. Les divers crivains dont nous venons de rappeler les recherches n'taient arrivs cette conception qu' travers des faits emprunts des religions trs diverses et dont quelques-unes mme correspondent une civilisation dj fort avance : telles sont, par exemple, les religions du Mexique dont s'est beaucoup servi Preuss. On pouvait donc se demander si la thorie s'appliquait galement aux religions les plus simples. Mais puisqu'on ne peut descendre plus bas que le totmisme, nous ne sommes pas exposs ce risque d'erreur et, en mme temps, nous avons des chances d'avoir trouv la notion initiale dont les ides de wakan et de mana sont drives : c'est la notion du principe totmique .
669 670 671
IV
.
667 668 669
670
671
Globus, LXXXVII, p. 381. Il les oppose nettement toutes les influences de nature profane (Globus, LXXXVI, p. 379, a). On la retrouve mme dans les rcentes thories de Frazer. Car si ce savant refuse au totmisme tout caractre religieux pour en faire une sorte de magie, c'est justement parce que les forces que le culte totmique met en oeuvre sont impersonnelles comme celles que manie le magicien. Frazer reconnat donc le fait fondamental que tous venons d'tablir. Seulement, il en tire une conclusion diffrente de la ntre parce que, suivant lui, il n'y a religion que l o il y a personnalits mythiques. Toutefois, nous ne prenons pas ce mot dans le mme sens que Preuss et Marrett. Suivant eux, il y aurait eu un moment dtermin de l'volution religieuse o les hommes n'auraient connu ni mes ni esprits, une phase pranimiste. L'hypothse est des plus contestables : nous nous expliquons plus loin sur ce point (liv. I, chap. VIII et IX). V. sur la mme question un article d'Alessandro BRUNO, Sui fenomeni magico-religiosi delle communit primitive, in Rivista italiana di Sociologia, XIIe anne, fasc. IV-V, p. 568 et suiv., et une communication, non publie, faite par W. Bogoras au XlVe Congrs des Amricanistes, tenu Stuttgart en 1904. Cette communication est analyse par Preuss dans le Globus, LXXXVI, p. 201.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
187
Mais cette notion n'est pas seulement d'une importance primordiale, cause du rle qu'elle a jou dans le dveloppement des ides religieuses ; elle a aussi un aspect laque par oh elle intresse l'histoire de la pense scientifique. C'est la premire forme de l'a notion de force. Le wakan, en effet, joue dans le monde, tel que se le reprsentent les Sioux, le mme rle que les forces par lesquelles la science explique les divers phnomnes de la nature. Ce n'est pas qu'il soit pens sous la forme d'une nergie exclusivement physique ; nous verrons, au contraire, dans le chapitre suivant que les lments qui servent en former l'ide sont pris aux rgnes les plus diffrents. Mais cette nature composite lui permet prcisment d'tre utilis comme un principe d'explication universelle. C'est de lui que vient toute vie ; toute vie est wakan ; et par ce mot de vie il faut entendre tout ce qui agit et ragit, tout ce qui meut ou est m, aussi bien dans le rgne minral que dans le rgne biologique. Le wakan, c'est la cause de tous les mouvements qui se produisent dans l'univers. Nous avons vu de mme que l'orenda des Iroquois est la cause efficiente de tous les phnomnes, et de toutes les activits qui se manifestent autour de l'homme . C'est un pouvoir inhrent tous les corps, toutes les choses . C'est l'orenda qui fait que le vent souffle, que le soleil claire et chauffe la terre, que les plantes poussent, que les animaux se reproduisent, que l'homme est fort, habile, intelligent. Quand l'Iroquois dit que la vie de la nature tout entire est le produit des conflits qui s'tablissent entre les orenda, ingalement intenses, des diffrents tres, il ne fait qu'exprimer en son langage cette ide moderne que le monde est un systme de forces qui se limitent, se contiennent et se font quilibre.
672 673
Le Mlansien attribue au mana le mme genre d'efficacit. C'est grce son mana qu'un homme russit la chasse on la guerre, que ses jardins ont un bon rendement, que ses troupeaux prosprent. Si la flche atteint son but, c'est qu'elle est charge de mana ; c'est la mme raison qui fait qu'un filet prend bien le poisson, qu'un canot tient bien la mer , etc. Il est vrai que, si l'on prenait la lettre certaines expressions de CODRINGTON, le mana serait la cause laquelle on rapporte spcialement tout ce qui dpasse le pouvoir de l'homme, tout ce qui est en dehors de la marche ordinaire de la nature . Mais des exemples mmes qu'il cite il rsulte que la sphre du mana est bien plus tendue. En ralit, il sert expliquer des phnomnes usuels et courants ; il n'y arien de surhumain ni de surnaturel ce qu'un bateau navigue, ce qu'un chasseur prenne du gibier, etc. Seulement, parmi ces vnements de la vie journalire, il en est de tellement insignifiants et de si familiers qu'ils passent inaperus : on ne les remarque pas et, par consquent, on n'prouve pas le besoin d'en rendre compte. Le concept de mana ne s'applique qu' ceux qui ont assez d'importance pour attirer la rflexion, pour veiller un minimum d'intrt et de curiosit ; mais ils ne sont pas merveilleux pour autant. Et ce qui est vrai du mana comme de l'orenda ou du wakan peut tre dit galement du principe totmique. C'est par lui que se maintient la vie des gens du clan, des animaux ou des plantes de l'espce totmique, comme de toutes les choses qui sont classes sous le totem et qui participent de sa nature.
674 675
672 673 674 675
Toutes choses, dit Miss Fletcher, sont traverses par un principe commun de vie (Smiths. Rep. f. 1897, p. 579). HEWITT, in American Anthropologist, 1902, p. 36. The Melanesians, pp. 118-120. Ibid., p. 119.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
188
La notion de force est donc d'origine religieuse. C'est la religion que la philosophie d'abord, les sciences ensuite l'ont emprunte. C'est dj ce qu'avait pressenti Comte et c'est pourquoi il faisait de la mtaphysique l'hritire de la thologie . Seulement, il en concluait que l'ide de force est destine disparatre de la science ; car, en raison de ses origines mystiques, il lui refusait toute valeur objective. Nous allons montrer, au contraire, que les forces religieuses sont relles, si imparfaits que puissent tre les symboles l'aide desquels elles ont t penses. D'o il suivra qu'il en est de mme du concept de force en gnral.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
189
CHAPITRE VII
ORIGINES DE CES CROYANCES
(Fin)
III. - Gense de la notion de principe ou mana totmique
La proposition tablie dans le chapitre prcdent dtermine les termes dans lesquels doit se poser le problme des origines du totmisme. Puisque le totmisme est domin tout entier par la notion d'un principe quasi divin, immanent certaines catgories d'hommes et de choses et pens sous une forme animale ou vgtale, expliquer cette religion, c'est essentiellement expliquer cette croyance ; c'est chercher comment les hommes ont pu tre dtermins construire cette ide et avec quels matriaux ils l'ont construite.
I
.
Manifestement, ce n'est pas avec les sensations que pouvaient veiller dans les consciences les choses qui servaient de totems ; nous avons montr qu'elles sont souvent insignifiantes. Le lzard, la chenille, le rat, la fourmi, la grenouille, la dinde, la brme, le prunier, le kakatos, etc., pour ne citer que des noms qui reviennent frquemment sur les listes de totems australiens, ne sont pas de nature produire sur l'homme de ces grandes et fortes impressions qui peuvent, sous quelque rapport, ressembler aux motions religieuses et imprimer aux objets qui les suscitent un caractre sacr. Sans doute, il n'en est pas ainsi des astres, des grands phnomnes atmosphriques qui ont, au contraire, tout ce qu'il faut pour frapper vivement les imaginations; mais il se trouve justement qu'ils ne servent que trs exceptionnellement de
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
190
totems ; il est mme probable qu'ils n'ont t appels remplir cet office que tardivement . Ce n'est donc pas la nature intrinsque de la chose dont le clan portait le nom qui la dsignait pour devenir l'objet d'un culte. D'ailleurs, si les sentiments qu'elle inspire taient rellement la cause dterminante des rites et des croyances totmiques, c'est elle aussi qui serait l'tre sacr par excellence ; ce sont les animaux ou les plantes employs comme totems qui joueraient le rle minent dans la vie religieuse. Or nous savons que le centre du culte est ailleurs. Ce sont les reprsentations figuratives de cette plante ou de cet animal, ce sont les emblmes et les symboles totmiques de toute sorte qui possdent le maximum de saintet; c'est donc en eux que se trouve la source de la religiosit dont les objets rels que ces emblmes reprsentent ne reoivent qu'un reflet.
676
Ainsi, le totem est avant tout un symbole, une expression matrielle de quelque autre chose . Mais de quoi ?
677
De l'analyse mme laquelle nous avons procd, il ressort qu'il exprime et symbolise deux sortes de choses diffrentes. D'une part, il est la forme extrieure et sensible de ce que nous avons appel le principe ou le dieu totmique. Mais d'un autre ct, il est aussi le symbole de cette socit dtermine qu'on appelle le clan. C'en est le drapeau ; c'est le signe par lequel chaque clan se distingue des autres, la marque visible de sa personnalit, marque que porte tout ce qui fait partie du clan un titre quelconque, hommes, btes et choses. Si donc il est, la fois, le symbole du dieu et de la socit, n'est-ce pas que le dieu et la socit ne font qu'un ? Comment l'emblme du groupe aurait-il pu devenir la figure de cette quasi divinit, si le groupe et la divinit taient deux ralits distinctes ? Le dieu du clan, le principe totmique, ne peut donc tre autre chose que le clan lui-mme, mais hypostasi et reprsent aux imaginations sous les espces sensibles du vgtal ou de l'animal qui sert de totem. Mais comment cette apothose a-t-elle t possible, et d'o vient qu'elle ait eu lieu de cette faon ?
II
.
D'une manire gnrale, il n'est pas douteux qu'une socit a tout ce qu'il faut pour veiller dans les esprits, par la seule action qu'elle exerce sur eux, la sensation du divin; car elle est ses membres ce qu'un dieu est ses fidles. Un dieu, en effet, c'est d'abord un tre que l'homme se reprsente, par certains cts, comme suprieur soi-mme et dont il croit dpendre. Qu'il s'agisse d'une personnalit consciente, comme Zeus ou Jahveh, ou bien de forces abstraites comme celles qui sont en jeu dans le totmisme, le fidle, dans un cas comme dans l'autre, se croit tenu de certaines manires d'agir qui lui sont imposes par la nature du principe sacr
676 677
Voir plus haut, p. 145. Pikler, dans l'opuscule cit plus haut, avait dj exprim, d'une manire un peu dialectique, le sentiment que c'est l ce qui constitue essentiellement le totem.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
191
avec lequel il se sent en commerce. Or la socit, elle aussi, entretient en nous la sensation d'une perptuelle dpendance. Parce qu'elle a une nature qui lui est propre, diffrente de notre nature d'individu, elle poursuit des fins qui lui sont galement spciales. mais, comme elle ne peut les atteindre que par notre intermdiaire, elle rclame imprieusement notre concours. Elle exige que, oublieux de nos intrts, nous nous fassions ses serviteurs et elle nous astreint toute sorte de gnes, de privations et de sacrifices sans lesquels la vie sociale serait impossible. C'est ainsi qu' chaque instant nous sommes obligs de nous soumettre des rgles de conduite et de pense que nous n'avons ni faites ni voulues, et qui mme sont parfois contraires nos penchants et nos instincts les plus fondamentaux. Toutefois, si la socit n'obtenait de nous ces concessions et ces sacrifices que par une contrainte matrielle, elle ne pourrait veiller en nous que l'ide d'une force physique laquelle il nous faut cder par ncessit, non d'une puissance morale comme celles que les religions adorent. Mais en ralit, l'empire qu'elle exerce sur les consciences tient beaucoup moins la suprmatie physique dont elle a le privilge qu' l'autorit morale dont elle est investie. Si nous dfrons ses ordres, ce n'est pas simplement parce qu'elle est arme de manire triompher de nos rsistances ; c'est, avant tout, parce qu'elle est l'objet d'un vritable respect. On dit d'un sujet, individuel ou collectif, qu'il inspire le respect quand la reprsentation qui l'exprime dans les consciences est doue d'une telle force que, automatiquement, elle suscite ou inhibe des actes, abstraction laite de toute considration relative aux effets utiles ou nuisibles des uns et des autres. Quand nous obissons une personne en raison de l'autorit morale que nous lui reconnaissons, nous suivons ses avis, non parce qu'ils nous semblent sages, mais parce qu' l'ide que nous nous faisons de cette personne une nergie psychique d'un certain genre est immanente, qui fait plier notre volont et l'incline dans le sens indiqu. Le respect est l'motion que nous prouvons quand nous sentons cette pression intrieure et toute spirituelle se produire en nous. Ce qui nous dtermine alors, ce ne sont pas les avantages ou les inconvnients de l'attitude qui nous est prescrite ou recommande ; c'est la faon dont nous nous reprsentons celui qui nous la recommande ou qui nous la prescrit. Voil pourquoi le commandement affecte gnralement des formes brves, tranchantes, qui ne laissent pas de place l'hsitation ; c'est que, dans la mesure o il est lui-mme et agit par ses seules forces, il exclut toute ide de dlibration et de calcul ; il tient son efficacit de l'intensit de l'tat mental dans lequel il est donn. C'est cette intensit qui constitue ce qu'on appelle l'ascendant moral. Or, les manires d'agir auxquelles la socit est assez fortement attache pour les imposer ses membres se trouvent, par cela mme, marques du signe distinctif qui provoque le respect. Parce qu'elles sont labores en commun, la vivacit avec laquelle elles sont penses par chaque esprit particulier retentit dans tous les autres et rciproquement. Les reprsentations qui les expriment en chacun de nous ont donc une intensit laquelle des tats de conscience purement privs ne sauraient atteindre : car elles sont fortes des innombrables reprsentations individuelles qui ont servi former chacune d'elles. C'est la socit qui parle par la bouche de ceux qui les affirment en notre prsence : c'est elle que nous entendons en les entendant et la voix de tous a un accent que ne saurait avoir celle d'un seul . La violence mme avec laquelle la socit ragit, par voie de blme ou bien de rpression matrielle, contre les tentatives de
678
678
V. notre Division du travail social, p. 64 et suiv,
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
192
dissidence, en manifestant avec l'clat l'ardeur de la conviction commune, contribue en renforcer l'empire . En un mot, quand une chose est l'objet d'un tat de l'opinion, la reprsentation qu'en a chaque individu tient de ses origines, des conditions dans lesquelles elle a pris naissance, une puissance d'action que sentent ceux-l mmes qui ne s'y soumettent pas. Elle tend refouler les reprsentations qui la contredisent, elle les tient distance ; elle commande, au contraire, des actes qui la ralisent, et cela, non par une coercition matrielle ou par la perspective d'une coercition de ce genre, mais par le simple rayonnement de l'nergie mentale qui est en elle.
679
Elle a une efficacit qui lui vient uniquement de ses proprits psychiques, et c'est prcisment ce signe que se reconnat l'autorit morale. L'opinion, chose sociale au premier chef, est donc une source d'autorit et l'on peut mme se demander si toute autorit n'est pas fille de l'opinion . On objectera que la science est souvent l'antagoniste de l'opinion dont elle combat et rectifie les erreurs, Mais elle ne peut russir dans cette tche que si elle a une suffisante autorit et elle ne peut tenir cette autorit que de l'opinion elle-mme. Qu'un peuple n'ait pas foi dans la science, et toutes les dmonstrations scientifiques seront sans influence sur les esprits. Mme aujourd'hui, qu'il arrive la science de rsister un courant trs fort de l'opinion publique, et elle risquera d'y laisser son crdit .
680 681
Puisque c'est par des voies mentales que la pression sociale s'exerce, elle ne pouvait manquer de donner l'homme l'ide qu'il existe en dehors de lui une ou plusieurs puissances, morales en mme temps qu'efficaces, dont il dpend. Ces puissances, il devait se les reprsenter, en partie, comme extrieures lui, puisqu'elles lui parlent sur le ton du commandement et que mme elles lui enjoignent parfois de faire violence ses penchants les plus naturels. Sans doute, s'il pouvait voir immdiatement que ces influences qu'il subit manent de la socit, le systme des interprtations mythologiques ne serait pas n. Mais l'action sociale suit des voies trop dtournes et trop obscures, elle emploie des mcanismes psychiques trop complexes pour qu'il soit possible l'observateur vulgaire d'apercevoir d'o elle vient. Tant que l'analyse scientifique n'est pas venue le lui apprendre, il sent bien qu'il est agi, mais non par qui il est agi. Il dut donc construire de toutes pices la notion de ces puissances avec lesquelles il se sentait en rapports, et, par l, on peut entrevoir dj comment il fut amen se les reprsenter
679 680 681
Ibid., p. 76. C'est du moins le cas de toute autorit morale reconnue comme telle par une collectivit. Nous esprons que cette analyse et celles qui suivront mettront un terme une interprtation inexacte de notre pense d'o il est rsult plus d'un malentendu. Parce que nous avons fait de la contrainte le signe extrieur auquel les faits sociaux peuvent le plus aisment se reconnatre et se distinguer des faits de psychologie individuelle, on a cru que, pour nous, la contrainte physique tait tout l'essentiel de la vie sociale. En ralit, nous n'y avons jamais vu que l'expression matrielle et apparente d'un fait intrieur et profond qui, lui, est tout idal; c'est l'autorit morale. Le problme sociologique - si l'on peut dire qu'il y a un problme sociologique - consiste chercher, travers les diffrentes formes de contrainte extrieure, les diffrentes sortes d'autorit morale qui y correspondent, et dcouvrir les causes qui ont dtermin ces dernires. En particulier, la question que nous traitons dans le prsent ouvrage a pour principal objet de trouver sous quelle forme cette espce particulire d'autorit morale qui est inhrente tout ce qui est religieux a pris naissance et se quoi elle est forme. On verra d'ailleurs plus loin que, si nous faisons de la pression sociale un des caractres distinctifs des phnomnes sociologiques, nous n'entendons pas dire que ce soit le seul. Nous montrerons un autre aspect de la vie collective, presque oppos au prcdent, mais non moins rel (v. p. 303).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
193
sous des formes qui leur sont trangres et les transfigurer par la pense. Mais un dieu, ce n'est pas seulement une autorit dont nous dpendons ; c'est aussi une force sur laquelle s'appuie notre force. L'homme qui a obi son dieu et qui, pour cette raison, croit l'avoir avec soi, aborde le monde avec confiance et avec le sentiment d'une nergie accrue. - De mme, l'action sociale ne se borne pas rclamer de nous des sacrifices, des privations et des efforts. Car la force collective ne nous est pas tout entire extrieure ; elle ne nous meut pas toute du dehors ; mais, puisque la socit ne peut exister que dans les consciences individuelles et par elles , il faut bien qu'elle pntre et s'organise en nous ; elle devient ainsi partie intgrante de notre tre et, par cela mme, elle l'lve et le grandit.
682
Il y a des circonstances o cette action rconfortante et vivifiante de la socit est particulirement manifeste. Au sein d'une assemble qu'chauffe une passion commune, nous devenons susceptibles de sentiments et d'actes dont nous sommes incapables quand nous sommes rduits nos seules forces ; et quand l'assemble est dissoute, quand, nous retrouvant seul avec nous-mme, nous retombons notre niveau ordinaire, nous pouvons mesurer alors toute la hauteur dont nous avions t soulev au-dessus de nous-mme. L'histoire abonde en exemples de ce genre. Il suffit de penser la nuit du 4 aot, o une assemble fut tout coup porte un acte de sacrifice et d'abngation auquel chacun de ses membres se refusait la veille et dont tous furent surpris le lendemain . C'est pour cette raison que tous les partis, politiques, conomiques, confessionnels, prennent soin de provoquer priodiquement des runions o leurs adeptes puissent revivifier leur foi commune en la manifestant en commun. Pour raffermir des sentiments qui, abandonns eux-mmes, s'tioleraient, il suffit de rapprocher et de mettre en relations plus troites et plus actives ceux qui les prouvent. Voil aussi ce qui explique l'attitude si particulire de l'homme qui parle une foule, si, du moins, il est parvenu entrer en communion avec elle. Son langage a une sorte de grandiloquence qui serait ridicule dans les circonstances ordinaires; ses gestes ont quelque chose de dominateur; sa pense mme est impatiente de la mesure et se laisse facilement aller toute sorte d'outrances. C'est qu'il sent en lui comme une plthore anormale de forces qui le dbordent et qui tendent se rpandre hors de lui; il a mme parfois l'impression qu'il est domin par une puissance morale qui le dpasse et dont il n'est que l'interprte. C'est ce trait que se reconnat ce qu'on a souvent appel le dmon de l'inspiration oratoire. Or, ce surcrot exceptionnel de forces est bien rel: il lui vient du groupe mme auquel il s'adresse. Les sentiments qu'il provoque par sa parole reviennent vers lui, mais grossis, amplifis, et ils renforcent d'autant son sentiment propre. Les nergies passionnelles qu'il soulve retentissent en lui et relvent son ton vital. Ce n'est plus un simple individu qui parle, c'est un groupe incarn et personnifi.
683
En dehors de ces tats passagers ou intermittents, il en est de plus durables oh cette
682
683
Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que la conscience collective n'ait pas de caractres spcifiques (v. sur ce point Reprsentations individuelles et reprsentations collectives, in Revue de Mtaphysique et de Morale, 1898, p. 273 et suiv.). C'est ce que prouvent la longueur et le caractre passionn des dbats o l'on donna une forme juridique aux rsolutions de principe prises dans un moment d'enthousiasme collectif. Dans le clerg comme dans la noblesse, plus d'un appelait cette nuit clbre la nuit des dupes, ou, avec Rivarol, la SaintBarthlemy des proprits (V. STOLL, Suggestion und Hypnotismus in der Voelkerpsychologie, 2e Aufl., p. 618).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
194
influence roburative de la socit se fait sentir avec plus de suite et souvent mme avec plus d'clat. Il y a des priodes historiques oh, sous l'influence de quelque grand branlement collectif, les inter-actions sociales deviennent beaucoup plus frquentes et plus actives. Les individus se recherchent, s'assemblent davantage. Il en rsulte une effervescence gnrale, caractristique des poques rvolutionnaires ou cratrices. Or, cette suractivit a pour effet une stimulation gnrale des forces individuelles. On vit plus et autrement qu'en temps normal. Les changement ne sont pas seulement de nuances et de degrs ; l'homme devient autre. Les passions qui l'agitent sont d'une telle intensit qu'elles ne peuvent se satisfaire que par des actes violents, dmesurs : actes d'hrosme surhumain ou de barbarie sanguinaire. C'est l ce qui explique, par exemple, les croisades et tant de scnes, ou sublimes ou sauvages, de la Rvolution franaise . Sous l'influence de l'exaltation gnrale, on voit le bourgeois le plus mdiocre ou le plus inoffensif se transformer soit en hros soit en bourreau . Et tous ces processus mentaux sont si bien de ceux qui sont la racine de la religion que les individus euxmmes se sont souvent reprsent, sous une forme expressment religieuse, la pression laquelle ils cdaient ainsi. Les croiss croyaient sentir Dieu prsent au milieu d'eux et leur enjoignant de partir la conqute de la Terre Sainte ; Jeanne d'Arc croyait obir des voix clestes .
684 685 686 687
Mais ce n'est pas seulement dans ces circonstances exceptionnelles que cette action stimulante de la socit se fait sentir; il n'est, pour ainsi dire, pas un instant de notre vie o quelque afflux d'nergie ne nous vienne du dehors. L'homme qui fait son devoir trouve, dans les manifestations de toute sorte par lesquelles s'expriment la sympathie, l'estime, l'affection que ses semblables ont pour lui, une impression de rconfort, dont il ne se rend pas compte le plus souvent, mais qui le soutient. Le sentiment que la socit a de lui, rehausse le sentiment qu'il a de lui-mme. Parce qu'il est en harmonie morale avec ses contemporains, il a plus de confiance, de courage, de hardiesse dans l'action, tout comme le fidle qui croit sentir les regards de son dieu tourns bienveillamment vers lui. Il se produit ainsi comme une sustentation perptuelle de notre tre moral. Comme elle varie suivant une multitude de circonstances extrieures, suivant que nos rapports avec les groupes sociaux qui nous entourent sont plus ou moins actifs, suivant ce que sont ces groupes, nous ne pouvons pas ne pas sentir que ce tonus moral dpend d'une cause externe ; mais nous n'apercevons pas o est cette cause ni ce qu'elle est, Aussi la concevons-nous couramment sous la forme d'une puissance morale qui, tout en nous tant immanente, reprsente en nous autre chose que nous-mme : c'est la conscience morale dont, d'ailleurs, le commun des hommes ne s'est jamais fait une reprsentation un peu distincte qu' l'aide de symboles religieux. Outre ces forces l'tat libre qui viennent sans cesse renouveler les ntres, il y a celles qui sont fixes dans les techniques et traditions de toute sorte que nous utilisons. Nous parlons une langue que nous n'avons pas faite; nous nous servons d'instruments que nous n'avons pas
684 685 686 687
V. STOLL, op. cit., p. 353 et suiv. Ibid., pp. 619, 635. Ibid., p. 622 et suiv. Les sentiments de peur, de tristesse peuvent se dvelopper galement et s'intensifier sous les mmes influences. lis correspondent, comme nous le verrons, tout un aspect de la vie religieuse (v. liv. II, chap. V).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
195
invents nous invoquons des droits que nous n'avons pas institus un trsor de connaissances est transmis chaque gnration qu'elle n'a pas elle-mme amass, etc. C'est la socit que nous devons ces biens varis de la civilisation et si nous ne voyons gnralement pas de quelle source nous les tenons, nous savons, du moins, qu'ils ne sont pas notre oeuvre. Or ce sont eux qui font l'homme sa physionomie personnelle entre tous les tres ; car l'homme n'est un homme que parce qu'il est civilis. Il ne pouvait donc chapper ce sentiment qu'il existe en dehors de lui des causes agissantes d'o lui viennent les attributs caractristiques de sa nature, et comme des puissances bienveillantes qui l'assistent, qui le protgent et qui lui assurent un sort privilgi. Et ces puissances il devait ncessairement assigner une dignit qui ft en rapport avec la haute valeur des biens qu'il leur attribuait .
688
Ainsi, le milieu dans lequel nous vivons nous apparat comme peupl de forces la fois imprieuses et secourables, augustes et bienfaisantes, avec lesquelles nous sommes en rapports. Puisqu'elles exercent sur nous une pression dont nous avons conscience, nous sommes ncessits les localiser hors de nous, comme nous faisons pour les causes objectives de nos sensations. Mais d'un autre ct, les sentiments qu'elles nous inspirent diffrent en nature de ceux que nous avons pour de simples choses sensibles. Tant que celles-ci sont rduites leurs caractres empiriques tels qu'ils se manifestent dans l'exprience vulgaire, tant que l'imagination religieuse n'est pas venue les mtamorphoser, nous n'avons pour elles rien qui ressemble du respect et elles n'ont rien de ce qu'il faut pour nous lever au-dessus de nousmme. Les reprsentations qui les expriment nous apparaissent donc comme trs diffrentes de celles qu'veillent en nous les influences collectives. Les unes et les autres forment dans notre conscience deux cercles d'tats mentaux, distincts et spars, comme les deux formes de vie auxquelles elles correspondent. Par suite, nous avons l'impression que nous sommes en relations avec deux sortes de ralits, distinctes elles-mmes, et qu'une ligne de dmarcation nettement tranche spare l'une de l'autre : c'est, d'un ct, le monde des choses profanes, et de l'autre, celui des choses sacres. Au reste, tant dans le prsent que dans l'histoire, nous voyons sans cesse la socit crer de toutes pices des choses sacres. Qu'elle vienne s'prendre d'un homme, qu'elle croie dcouvrir en lui les principales aspirations qui la travaillent ainsi que les moyens d'y donner satisfaction, et cet homme sera mis hors de pair et comme divinis. Il sera investi par l'opinion d'une majest tout fait analogue celle qui protge les dieux. C'est ce qui est advenu de tant de souverains, en qui leur sicle avait foi : si l'on n'en faisait pas des dieux, on voyait du moins en eux des reprsentants directs de la divinit. Et ce qui montre bien que c'est la socit toute seule qui est l'auteur de ces sortes d'apothoses, c'est qu'il lui est arriv souvent de consacrer ainsi des hommes qui, par leur mrite propre, n'y avaient aucun droit. D'ailleurs, la simple dfrence qu'inspirent les hommes investis de hautes fonctions sociales n'est pas d'une autre nature que le respect religieux. Elle se traduit par les mmes mouvements : on se tient distance d'un haut personnage ; on ne l'aborde qu'avec prcautions ; pour s'entretenir avec lui
688
Tel est l'autre aspect de la socit qui, en mme temps qu'imprative, nous apparat, comme bonne et bienveillante. Elle nous domine et elle nous assiste. Si nous avons dfini le fait social par le premier de ces caractres plutt que par le second, c'est qu'il est plus facilement observable parce qu'il se traduit par des signes extrieurs et visibles; mais il s'en faut que nous ayons jamais song nier la ralit du second (v. Rgles de la mthode sociologique, prface de la seconde dition, p. xx, no 1).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
196
on emploie un autre langage et d'autres gestes que ceux qui servent avec le commun des mortels. Le sentiment que l'on prouve dans ces circonstances est si proche parent du sentiment religieux que bien des peuples les ont confondus. Pour expliquer la considration dont jouissent les princes, les nobles, les chefs politiques, on leur a attribu un caractre sacr. En Mlansie et en Polynsie, par exemple, on dit d'un homme influent qu'il a du mana et c'est ce mana qu'on impute son influence . Il est clair pourtant que sa situation lui vient uniquement de l'importance que l'opinion lui prte. C'est donc que le pouvoir moral que confre l'opinion et celui dont sont investis les tres sacrs ont au fond une mme origine et sont faits des mmes lments. C'est ce qui explique qu'un mme mot puisse servir dsigner l'un et l'autre.
689
Tout aussi bien que des hommes, la socit consacre des choses, notamment des ides. Qu'une croyance soit unanimement partage par un peuple, et, pour les raisons que nous avons exposes plus haut, il est interdit d'y toucher, c'est--dire de la nier ou de la contester. Or l'interdit de la critique est un interdit comme les autres et prouve que l'on est en face de quelque chose de sacr. Mme aujourd'hui, si grande que soit la libert que nous nous accordons les uns aux autres, un homme qui nierait totalement le progrs, qui bafouerait l'idal humain auquel les socits modernes sont attaches, ferait l'effet d'un sacrilge. Il y a, tout au moins, un principe que les peuples les plus pris de libre examen tendent mettre au-dessus de la discussion et regarder comme intangible, c'est--dire comme sacr : c'est le principe mme du libre examen. Cette aptitude de la socit s'riger en dieu ou crer des dieux ne fut nulle part plus visible que pendant les premires annes de la Rvolution. A ce moment, en effet, sous l'influence de l'enthousiasme gnral, des choses, purement laques par nature, furent transformes par l'opinion publique en choses sacres : c'est la Patrie, la Libert, la Raison . Une religion tendit d'elle-mme s'tablir qui avait son dogme , ses symboles , ses autels et ses ftes . C'est ces aspirations spontanes que le culte de la Raison et de l'tre suprme essaya d'apporter une sorte de satisfaction officielle. Cette rnovation religieuse n'eut, il est vrai, qu'une dure phmre. Mais c'est que l'enthousiasme patriotique qui, l'origine, transportait les masses, alla lui-mme en s'affaiblissant . La cause disparaissant, l'effet ne pouvait se maintenir. Mais l'exprience pour avoir t courte, garde tout son intrt sociologique. Il reste que, dans un cas dtermin, on a vu la socit et ses ides essentielles devenir, directement et sans transfiguration d'aucune sorte, l'objet d'un vritable culte.
690 691 692 693 694 695
Tous ces faits permettent dj d'entrevoir comment le clan peut veiller chez ses membres l'ide qu'il existe en dehors d'eux des forces qui les dominent et, en mme temps, les
689
690 691 692 693 694 695
CODRINGTON, The Melanesians, pp. 50, 103, 120. D'ailleurs, on considre gnralement que, dans les langues polynsiennes, le mot mana a primitivement le sens d'autorit (v. TREGEAR, Maori Comparative Dictionary, s. v.). V. Albert Mathiez, Les origines des cultes rvolutionnaires (1789-1792). Ibid., p. 124. Ibid., pp. 29, 32. Ibid., p. 30. Ibid., p. 46. V. Mathiez, La Thophilanthrophie et le culte dcadaire, p. 36.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
197
soutiennent, c'est--dire en somme, des forces religieuses : c'est qu'il n'est pas de socit dont le primitif soit plus directement et plus troitement solidaire. Les liens qui l'attachent la tribu sont plus lches et plus faiblement ressentis. Bien qu'elle ne soit certainement pas pour lui une trangre, c'est avec les gens de son clan qu'il a le plus de choses communes ; c'est l'action de ce groupe qu'il sent le plus immdiatement ; c'est donc elle aussi qui, de prfrence tout autre, devait s'exprimer en symboles religieux. Mais cette premire explication est trop gnrale, puisqu'elle s'applique indiffremment toute espce de socit et, par suite, de religion. Cherchons donc prciser quelle forme particulire cette action collective prend dans le clan, et comment elle y suscite la sensation du sacr. Aussi bien n'est-elle nulle part plus facilement observable ni plus apparente dans ses rsultats.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
198
III
.
La vie des socits australiennes passe alternativement par deux phases diffrentes . Tantt la population est disperse par petits groupes qui vaquent, indpendamment les uns des autres, leurs occupations ; chaque famille vit alors de son ct, chassant, pchant, cherchant en un mot, se procurer la nourriture indispensable par tous les moyens dont elle dispose. Tantt, au contraire, la population se concentre et se condense, pour un temps qui varie de plusieurs jours plusieurs mois, sur des points dtermins. Cette concentration a eu lieu quand un clan ou une portion de tribu est convoqu dans ses assises et que, cette occasion, on clbre une crmonie religieuse ou qu'on tient ce qu'on appelle, dans le langage usuel de l'ethnographie, un corrobbori .
696 697 698
Ces deux phases contrastent l'une avec l'autre de la manire la plus tranche. Dans la premire, l'activit conomique est prpondrante, et elle est gnralement d'une trs mdiocre intensit. La collecte des graines ou des herbes ncessaires l'alimentation, la chasse ou la pche ne sont pas des occupations qui peuvent veiller de bien vives passions . L'tat de dispersion o se trouve alors la socit achve de rendre la vie uniforme, languissante et terne . Mais qu'un corrobbori ait lieu et tout change. Parce que les facults motives et passionnelles du primitif ne sont qu'imparfaitement soumises au contrle de sa raison et de sa volont, il perd aisment la matrise de soi. Un vnement de quelque importance le met tout de suite hors de lui. Reoit-il une heureuse nouvelle ? Ce sont des transports d'enthousiasme. Dans le cas contraire, on le voit courir a et l comme un fou, se livrer toutes sortes de mouvements dsordonns, crier, hurler, ramasser de la poussire, la jeter dans toutes les directions, se mordre, brandir ses armes d'un air furieux, etc. Or, le seul fait de l'agglomration agit comme un excitant exceptionnellement puissant. Une fois les individus assembls il se dgage de leur rapprochement une sorte d'lectricit qui les transporte vite un degr extraordinaire d'exaltation. Chaque sentiment exprim vient retentir, sans rsistance, dans toutes ces consciences largement ouvertes aux impressions extrieures : chacune d'elles fait
699 700 701
696 697
698
699 700 701
V. SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 33. Il est mme des crmonies, notamment celles qui ont lieu propos de l'initiation, o des membres de tribus trangres sont convoqus. Tout un systme de messages et de messagers est organis en vue de ces convocations sans lesquelles il n'y a pas de grandes solennits (v. HOWITT, Notes on Australian MessageSticks and Messengers, in J.A.I., 1889 ; Nat. Tr., p. 83, 678-691 ; SPENCER et GILLEN, Nat. Tr. Le corrobbori se distingue de la crmonie proprement religieuse en ce qu'il est accessible aux femmes et aux non-initis. Mais, si ces deux sortes de manifestations collectives doivent tre distingues, elles ne laissent pas d'tre troitement parentes. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir plus loin sur cette parent et de l'expliquer. Sauf dans le cas de grandes chasses battue. The peaceful monotony of this part of his life , disent SPENCER et GILLEN (North. Tr., p. 33). HOWITT, Nat. Tr., p. 683. Il s'agit, en l'espce, des dmonstrations qui ont lieu quand une ambassade, dpche vers un groupe d'trangers, rentre au camp avec la nouvelle d'un rsultat favorable. Cf. Brough SMYTH, I, p. 138; SCHULZE, loc. cit., p. 222.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
199
cho aux autres et rciproquement. L'impulsion initiale va ainsi s'amplifiant mesure qu'elle se rpercute, comme une avalanche grossit mesure qu'elle avance. Et comme des passions aussi vives et aussi affranchies de tout contrle ne peuvent pas ne pas se rpandre au dehors, ce ne sont, de toutes parts, que gestes violents, que cris, vritables hurlements, bruits assourdissants de toute sorte qui contribuent encore intensifier l'tat qu'ils manifestent. Sans doute, parce qu'un sentiment collectif ne peut s'exprimer collectivement qu' condition d'observer un certain ordre qui permette le concert et les mouvements d'ensemble, ces gestes et ces cris tendent d'eux-mmes se rythmer et se rgulariser ; de l, les chants et les danses. Mais, en prenant une forme plus rgulire, ils ne perdent rien de leur violence naturelle ; le tumulte rgl reste du tumulte. La voix humaine ne suffit mme pas la tche on en renforce l'action au moyen de procds artificiels on frappe les boomerangs les uns contre les autres ; on fait tourner les bullroarers. Il est probable que ces instruments, dont l'emploi est si gnral dans les crmonies religieuses d'Australie, ont, avant tout, servi traduire d'une manire plus adquate l'agitation ressentie. Mais en mme temps qu'ils la traduisent, ils la renforcent. L'effervescence devient souvent telle qu'elle entrane des actes inous. Les passions dchanes sont d'une telle imptuosit qu'elles ne se laissent contenir par rien. On est tellement en dehors des conditions ordinaires de la vie et on en a si bien conscience qu'on prouve comme le besoin de se mettre en dehors et au-dessus de la morale ordinaire. Les sexes s'accouplent contrairement aux rgles qui prsident au commerce sexuel. Les hommes changent leurs femmes. Parfois mme, des unions incestueuses qui, en temps normal, sont juges abominables et sont svrement condamnes, se contractent ostensiblement et impunment . Si l'on ajoute cela que ces crmonies ont gnralement lien la nuit, au milieu de tnbres que perce, et l, la lumire des feux, on se reprsentera aisment quel effet doivent produire de semblables scnes sur l'esprit de tous ceux qui y participent. Elles dterminent une si violente surexcitation de toute la vie physique et mentale qu'elle ne peut tre supporte trs longtemps : l'acteur qui tient le principal rle finit par tomber puis sur le sol .
702 703
Voici au surplus, pour illustrer et prciser ce tableau forcment schmatique, le rcit de quelques scnes que nous empruntons Spencer et Gillen. Une des solennits religieuses les plus importantes chez les Warramunga est celle qui concerne le serpent Wollunqua. C'est une srie de crmonies qui se dveloppent sur plusieurs jours. Au quatrime, a lieu celle que nous allons dcrire. Suivant le crmonial usit chez les Warramunga, des reprsentants des deux phratries y prennent part, les uns en qualit d'officiants, les autres comme prparateurs et assistants. Seuls, des gens de la phratrie Uluuru ont qualit pour clbrer le rite ; mais ce sont des membres de la phratrie Kingilli qui doivent dcorer les acteurs, prparer l'emplacement, les instruments, et jouer le rle de l'assemble. A ce titre, ils sont chargs de confectionner par avance, avec du
702
703
V. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 96-97, North. Tr., p. 137; BROUGH SMYTH, II, p. 319. Cette promiscuit rituelle s'observe notamment dans les crmonies d'initiation (SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 267, 381 ; HOWITT, Nat. Tr., p. 657), dans les crmonies totmiques (SPENCER et GILLEN, North. Tr., pp. 214, 298 et 237). Dans ces dernires, les rgles exogamiques ordinaires sont violes. Toutefois, chez les Arunta, les unions entre pre et fille, fils et mre, frres et surs (il s'agit dans tous ces cas de parent par le sang) restent interdites (Nat. Tr., pp. 96-97). HOWITT, Nat. Tr., pp. 535, 545. Le fait est d'une extrme gnralit.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
200
sable mouill, une sorte de monticule sur lequel est excut, au moyen du duvet rouge, un dessin qui figure le serpent Wollunqua. La crmonie proprement dite, laquelle assistrent Spencer et Gillen, ne commena qu'une fois la nuit arrive. Vers dix ou onze heures du soir, Uluuru et Kingilli arrivrent sur le terrain; ils s'assirent sur le tertre et ils se mirent chanter. Ils taient tous dans un tat d'vidente surexcitation (every one was evidently very excited). Un peu plus tard dans la soire, les Uluuru amenrent leurs femmes et les livrrent aux Kingilli , qui eurent commerce avec elles. On introduisit alors des jeunes gens rcemment initis auxquels toute la crmonie fut explique en dtail et, jusqu' trois heures du matin, les chants se poursuivirent sans interruption. Alors eut lieu une scne d'une frnsie vraiment sauvage (a scene of the wildest excitement). Tandis que les feux, allums de tous les cts, faisaient ressortir violemment la blancheur des gommiers sur le fond des tnbres environnantes, les Uluuru s'agenouillrent les uns derrire les autres ct du tumulus, puis ils en firent le tour en se soulevant de terre, d'un mouvement d'ensemble, les deux mains appuyes sur les cuisses, pour s'agenouiller nouveau un peu plus loin, et ainsi de suite. En mme temps, ils penchaient leurs corps tantt droite, tantt gauche poussant tous la fois, chacun de ces mouvements, un cri retentissant, vritable hurlement, Yrysh ! Yrrsh ! Yrrsh ! Cependant, les Kingilli, dans un grand tat d'exaltation, faisaient rsonner leurs boomerangs et leur chef tait encore plus agit que ses compagnons. Une fois que la procession des Uluuru eut fait deux fois le tour du tumulus, ils quittrent la position agenouille, s'assirent et se remirent chanter ; par moments, le chant tombait, puis reprenait brusquement. Quand le jour commena poindre, tous sautrent sur leurs pieds ; les feux qui s'taient teints, furent rallums, les Uluuru, presss par les Kingilli, attaqurent furieusement le tumulus avec des boomerangs, des lances, des btons, en quelques minutes il fut mis en pices. Les feux moururent et ce fut un profond silence .
704 705
Une scne plus violente encore est celle laquelle les mmes observateurs assistrent pendant les crmonies du feu, chez les Warramunga. Dj, depuis la tombe de la nuit, toute sorte de processions, de danses, de chants avaient eu lieu la lumire des flambeaux ; aussi l'effervescence gnrale allait-elle croissant. A un moment donn, douze assistants prirent chacun en main une sorte de grande torche enflamme et l'un d'eux, tenant la sienne comme une baonnette, chargea un groupe d'indignes. Les coups taient pars au moyen de btons et de lances. Une mle gnrale s'engagea. Les hommes sautaient, se cabraient, poussaient des hurlements sauvages ; les torches brillaient, crpitaient en frappant les ttes et les corps, lanaient des tincelles dans toutes les directions. La fume, les torches toutes flamboyantes, cette pluie d'tincelles, cette masse d'hommes dansant et hurlant, tout cela, disent Spencer et Gillen, formait une scne d'une sauvagerie dont il est impossible de donner une ide avec des mots .
706
On conoit sans peine que, parvenu cet tat d'exaltation, l'homme ne se connaisse plus. Se
704 705 706
Ces femmes taient elles-mmes des Kingilli et, par consquent, ces unions violaient la rgle d'exogamie. North. Tr., p. 237. North. Tr., p. 391. On trouvera d'autres exemples d'effervescence collective au cours de crmonies religieuses dans Nat. Tr., pp. 244-246, 365-366, 374, 509-510 (cette dernire a lieu propos d'un rite funraire). Cf. North. Tr., pp. 213, 351.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
201
sentant domin, entran par une sorte de pouvoir extrieur qui le fait penser et agir autrement qu'en temps normal, il a naturellement l'impression de n'tre plus lui-mme. Il lui semble tre devenu un tre nouveau : les dcorations dont il s'affuble, les sortes de masques dont il se recouvre le visage figurent matriellement cette transformation intrieure, plus encore qu'ils ne contribuent la dterminer. Et comme, au mme moment, tous ses compagnons se sentent transfigurs de la mme manire et traduisent leur sentiment par leurs cris, leurs gestes, leur attitude, tout se passe comme s'il tait rellement transport dans un monde spcial, entirement diffrent de celui o il vit d'ordinaire, dans un milieu tout peupl de forces exceptionnellement intenses, qui l'envahissent et le mtamorphosent. Comment des expriences comme celles-l, surtout quand elles se rptent chaque jour pendant des semaines, ne lui laisseraient-elles pas la conviction qu'il existe effectivement deux mondes htrognes et incomparables entre eux ? L'un est celui o il trane languissamment sa vie quotidienne; au contraire, il ne peut pntrer dans l'autre sans entrer aussitt en rapports avec des puissances extraordinaires qui le galvanisent jusqu' la frnsie. Le premier est le monde profane, le second, celui des choses sacres. C'est donc dans ces milieux sociaux effervescents et de cette effervescence mme que parat tre ne l'ide religieuse. Et ce qui tend confirmer que telle en est bien l'origine, c'est que, en Australie, l'activit proprement religieuse est presque tout entire concentre dans les moments o se tiennent ces assembles. Certes, il n'est pas de peuple o les grandes solennits du culte ne soient plus ou moins priodiques ; mais, dans les socits plus avances, il n'est, pour ainsi dire, pas de jour o l'on n'adresse aux dieux quelque prestation rituelle. En Australie, au contraire, en dehors des ftes du clan et de la tribu, le temps est presque tout entier rempli par des fonctions laques et profanes. Sans doute, il y a des prohibitions qui doivent tre et qui sont observes mme pendant ces priodes d'activit temporelle ; il n'est jamais permis de tuer ou de manger librement de l'animal totmique, l du moins o l'interdiction a conserv sa rigueur premire : mais on ne clbre alors presque aucun rite positif, aucune crmonie de quelque importance. Celles-ci n'ont lieu qu'au sein des groupes assembls. La vie pieuse de l'Australien passe donc par des phases successives de complte atonie et, au contraire, d'hyperexcitation, et la vie sociale oseille suivant le mme rythme. C'est ce qui met en vidence le lien qui les unit l'une l'autre tandis que, chez les peuples dits civiliss, la continuit relative de l'une et de l'autre masque en partie leurs relations. On peut mme se demander si la violence de ce contraste n'tait pas ncessaire pour faire jaillir la sensation du sacr sous sa forme premire. En se ramassant presque tout entire dans des moments dtermins du temps, la vie collective pouvait atteindre, en effet, son maximum d'intensit et d'efficacit et, par suite, donner l'homme un sentiment plus vif de la double existence qu'il mne et de la double nature laquelle il participe. Mais l'explication est encore incomplte. Nous avons bien montr comment le clan, par la manire dont il agit sur ses membres, veille chez eux l'ide de forces extrieures qui le dominent et l'exaltent ; mais il nous reste rechercher comment il se fait que ces forces ont t penses sous les espces du totem, c'est--dire sous la figure d'un animal ou d'une plante. C'est parce que cet animal ou cette plante a donn son nom au clan et lui sert d'emblme. C'est, en effet, une loi connue que les sentiments veills en nous par une chose se
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
202
communiquent spontanment au symbole qui la reprsente. Le noir est pour nous le signe du deuil ; aussi nous suggre-t-il des impressions et des ides tristes. Ce transfert de sentiments vient simplement de ce que l'ide de la chose et l'ide de son symbole sont troitement unies dans nos esprits : il en rsulte que les motions provoques par l'une s'tendent contagieusement l'autre. Mais cette contagion, qui se produit, dans tous les cas, quelque degr, est beaucoup plus complte et plus marque toutes les fois que le symbole est quelque chose de simple, de dfini, d'aisment reprsentable, tandis que la chose est, par ses dimensions, par le nombre de ses parties et la complexit de leur organisation, difficile embrasser par la pense. Car nous ne saurions voir dans une entit abstraite, que nous ne nous reprsentons que laborieusement et d'une vue confuse, le lieu d'origine des sentiments forts que nous prouvons. Nous ne pouvons nous les expliquer nous-mme qu'en les rapportant un objet concret dont nous sentions vivement la ralit. Si donc la chose mme ne remplit pas cette condition, elle ne peut pas servir de point d'attache aux impressions ressenties, bien que ce soit elle qui les ait souleves. C'est le signe alors qui prend sa place ; c'est sur lui qu'on reporte les motions qu'elle suscite. C'est lui qui est aim, craint, respect ; c'est lui qu'on est reconnaissant ; c'est lui qu'on se sacrifie. Le soldat qui meurt pour son drapeau, meurt pour sa patrie; mais en fait, dans sa conscience, c'est l'ide du drapeau qui est au premier plan. Il arrive mme qu'elle dtermine directement l'action. Qu'un tendard isol reste ou non aux mains de l'ennemi, la patrie ne sera pas perdue pour cela, et pourtant le soldat se fait tuer pour le reprendre. On perd de vue que le drapeau n'est qu'un signe, qu'il n'a pas de valeur par lui-mme, mais ne fait que rappeler la ralit qu'il reprsente; on le traite comme s'il tait lui-mme cette ralit. Or le totem est le drapeau du clan. Il est donc naturel que les impressions que le clan veille dans les consciences individuelles - impressions de dpendance et de vitalit accrue - se rattachent beaucoup plus l'ide du totem qu' celle du clan : car le clan est une ralit trop complexe pour que des intelligences aussi rudimentaires puissent se le reprsenter nettement dans son unit concrte. D'ailleurs, le primitif ne voit mme pas que ces impressions lui viennent de la collectivit. Il ne sait pas que le rapprochement d'un certain nombre d'hommes associs dans une mme vie a pour effet de dgager des nergies nouvelles qui transforment chacun d'eux. Tout ce qu'il sent, c'est qu'il est soulev au-dessus de lui-mme et qu'il vit une vie diffrente de celle qu'il mne d'ordinaire. Cependant, il faut bien que ces sensations soient rapportes par lui quelque objet extrieur comme leur cause. Or, que voit-il autour de lui ? De toutes parts, ce qui s'offre ses sens, ce qui frappe sont attention, ce sont les multiples images du totem. C'est le waninga, le nurtunja, qui sont autant de symboles de l'tre sacr. Ce sont les bull-roarers, les churinga sur lesquels sont gnralement graves des combinaisons de lignes qui ont la mme signification. Ce sont les dcorations qui recouvrent les diffrentes parties de son corps et qui sont autant de marques totmiques. Comment cette image, partout rpte et sous toutes les formes, ne prendrait-elle pas dans les esprits un relief exceptionnel ? Ainsi place au centre de la scne, elle en devient reprsentative. C'est sur elle que se fixent les sentiments prouvs, car elle est le seul objet concret auquel ils puissent se rattacher. Elle continue les rappeler et les voquer, alors mme que l'assemble est dissoute ; car elle lui survit, grave sur les instruments du culte, sur les parois des rochers, sur les boucliers, etc. Par elle, les motions ressenties sont perptuellement entretenues et ravives. Tout se passe donc comme si elle les inspirait directement. Il est d'autant plus naturel de les lui attribuer que, comme elles sont communes au groupe, elles ne peuvent tre rapportes qu' une chose qui lui
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
203
soit galement commune. Or l'emblme totmique est seul satisfaire cette condition. Par dfinition, il est commun tous. Pendant la crmonie, il est le point de mire de tous les regards. Tandis que les gnrations changent, il reste identique lui-mme ; il est l'lment permanent de la vie sociale. C'est donc de lui que paraissent maner les forces mystrieuses avec lesquelles les hommes se sentent en rapports, et on s'explique ainsi qu'ils aient t amens se reprsenter ces forces sous les traits de l'tre, anim ou inanim, dont le clan porte le nom. Ceci pos, nous sommes en tat de comprendre tout ce qu'il y a d'essentiel dans les croyances totmiques. Puisque la force religieuse n'est autre chose que la force collective et anonyme du clan, et puisque celle-ci n'est reprsentable aux esprits que sous la forme du totem, l'emblme totmique est comme le corps visible du dieu. C'est donc de lui que paraissent maner les actions, ou bienfaisantes ou redoutes, que le culte a pour objet de provoquer ou de prvenir ; par suite, c'est tout spcialement lui que s'adressent les rites. Ainsi s'explique que, dans la srie des choses sacres, il occupe le premier rang. Mais le clan, comme toute espce de socit, ne peut vivre que dans et par les consciences individuelles qui le composent. Si donc, en tant qu'elle est conue comme incorpore l'emblme totmique, la force religieuse apparat comme extrieure aux individus et comme doue, par rapport eux, d'une sorte de transcendance, d'un autre ct, comme le clan dont elle est le symbole, elle ne peut se raliser qu'en eux et par eux ; en ce sens, elle leur est donc immanente et ils se la reprsentent ncessairement comme telle. Ils la sentent prsente et agissante en eux, puisque c'est elle qui les lve une vie suprieure. Voil comment l'homme a cru qu'il y avait en lui un principe comparable celui qui rside dans le totem ; comment, par suite, il s'est attribu un caractre sacr, mais moins marqu que celui de l'emblme. C'est que l'emblme est la source minente de la vie religieuse ; l'homme n'y participe qu'indirectement et il en a conscience ; il se rend compte que la force qui le transporte dans le cercle des choses sacres ne lui est pas inhrente, mais lui vient du dehors. Pour une autre raison, les animaux ou les vgtaux de l'espce totmique devaient avoir le mme caractre, et mme un plus haut degr. Car si le principe totmique n'est rien autre chose que le clan, c'est le clan pens sous une forme matrielle que l'emblme figure ; or cette forme est aussi celle de ces tres concrets dont le clan porte le nom. En raison de cette ressemblance, ils ne pouvaient pas ne pas veiller des sentiments analogues ceux que suscite l'emblme lui-mme. Puisque ce dernier est l'objet d'un respect religieux, ils devaient inspirer un respect du mme genre et apparatre comme sacrs. Sous des formes extrieures aussi parfaitement identiques, il tait impossible que le fidle ne mt pas des forces de mme nature. Voil comment il est interdit de tuer, de manger l'animal totmique, comment sa chair passe pour avoir des vertus positives que les rites utilisent: c'est qu'il ressemble l'emblme du clan, c'est--dire sa propre image. Et comme il y ressemble naturellement plus que l'homme, il se trouve aussi d'un rang au-dessus dans la hirarchie des choses sacres. Sans doute, il y a entre ces deux tres une troite parent puisqu'ils communient dans la mme essence: tous deux incarnent quelque chose du principe totmique. Seulement, parce que ce principe lui-mme est conu sous une forme animale, l'animal parat l'incarner plus minemment que l'homme. C'est
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
204
pourquoi, si l'homme le considre et le traite comme un frre, c'est, du moins, comme un frre an .
707
Mais si le principe totmique a son sige d'lection dans une espce animale ou vgtale dtermine, il ne pouvait y rester localis. Le caractre sacr est, au plus haut degr, contagieux ; il s'tendit donc de l'tre totmique tout ce qui y tient de prs ou de loin. Les sentiments religieux qu'inspirait l'animal se communiqurent aux substances dont il se nourrit et qui servent faire ou refaire sa chair et son sang, aux choses qui lui ressemblent, aux tres divers avec lesquels il est constamment en rapports. C'est ainsi que peu peu, aux totems se rattachrent les sous-totems et que se constiturent ces systmes cosmologiques que traduisent les classifications primitives. Finalement, le monde entier se trouva partag entre les principes totmiques de la mme tribu.
708
On s'explique maintenant d'o vient l'ambigut que pr sentent les forces religieuses quand elles apparaissent dans l'histoire; comment elles sont physiques en mme temps qu'humaines, morales en mme temps que matrielles. Ce sont des puissances morales, puisqu'elles sont construites tout entires avec les impressions que cet tre moral qu'est la collectivit veille chez ces autres tres moraux que sont les individus ; elles traduisent, non la manire dont les choses physiques affectent nos sens, mais la faon dont la conscience collective agit sur les consciences individuelles. Leur autorit n'est qu'une forme de l'ascendant moral que la socit exerce sur ses membres. Mais d'un autre ct, parce qu'elles sont conues sous des formes matrielles, elles ne peuvent pas n'tre pas regardes comme troitement parentes des choses matrielles . Elles dominent donc les deux mondes. Elles rsident dans les hommes ; mais elles sont, en mme temps, les principes vitaux des choses. Elles vivifient les consciences et les disciplinent ; mais ce sont elles aussi qui font que les plantes poussent et que les animaux se reproduisent. C'est grce cette double nature que la religion a pu tre comme la matrice oh se sont labors tous les principaux germes de la civilisation humaine. Parce qu'elle s'est trouve envelopper en elle la ralit tout entire, l'univers physique aussi bien que l'univers moral, les forces qui meuvent les corps comme celles qui mnent les esprits ont t conues sous forme religieuse. Voil comment les techniques et les pratiques les plus diverses, et celles qui assurent le fonctionnement de la vie morale (droit, morale, beaux-arts) et celles qui servent la vie matrielle (sciences de la nature, techniques, industrielles), sont, directement ou indirectement, drives de la religion .
709 710
707
708 709
710
On voit que cette fraternit est une consquence logique du totmisme, loin d'en tre le principe. Les hommes ne se sont pas cru des devoirs envers les animaux de l'espce totmique, parce qu'ils s'en croyaient parents; mais ils imaginrent cette parent pour s'expliquer eux-mmes la nature des croyances et des rites dont ces animaux taient l'objet. L'animal a t considr comme un congnre de l'homme parce qu'il tait un tre sacr comme l'homme; mais il n'a pas t trait comme un tre sacr parce qu'on voyait en lui un congnre. V. plus bas, liv. III, chap. 1er, III. A la base de cette conception, il y a, d'ailleurs, un sentiment bien fond et qui persiste. La science moderne, elle aussi, tend de plus en plus admettre que la dualit de l'homme et de la nature n'exclut pas leur unit ; que les forces physiques et les forces morales, tout en tant distinctes, sont troitement parentes. De cette unit et de cette parent, nous nous faisons, sans doute, une autre ide que le primitif; mais, sous des symboles diffrents, le fait affirm est le mme de part et d'autre. Nous disons de cette drivation qu'elle est parfois indirecte, cause des techniques industrielles qui, dans le plus grand nombre de cas, semblent bien n'tre drives de la religion que par l'intermdiaire de la
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
205
IV
.
On a souvent attribu les premires conceptions religieuses un sentiment de faiblesse et de dpendance, de crainte et d'angoisse qui aurait saisi l'homme quand il entra en rapports avec le monde. Victime d'une sorte de cauchemar dont il aurait t lui-mme l'artisan, il se serait cru entour de puissances hostiles et redoutables que les rites auraient eu pour objet d'apaiser. Nous venons de montrer que les premires religions ont une tout autre origine. La fameuse formule Primus in orbe deos fecit timor n'est nullement justifie par les faits. Le primitif n'a pas vu dans ses dieux des trangers, des ennemis, des tres foncirement et ncessairement malfaisants dont il tait oblig de se concilier tout prix les faveurs, tout au contraire, ce sont plutt pour lui des amis, des parents, des protecteurs naturels. Ne sont-ce pas l les noms qu'il donne aux tres de l'espce totmique ? La puissance laquelle s'adresse le culte, il ne se la reprsente pas planant trs haut au-dessus de lui et l'crasant de sa supriorit : elle est, au contraire, tout prs de lui et elle lui confre des pouvoirs utiles qu'il ne tient pas de sa nature. jamais, peut-tre, la divinit n'a t plus proche de l'homme qu' ce moment de l'histoire puisqu'elle est prsente dans les choses qui peuplent son milieu immdiat et qu'elle lui est, en partie, immanente luimme. Ce qui est la racine du totmisme, ce sont, en dfinitive, des sentiments de joyeuse confiance plus que de terreur et de compression. Si l'on fait abstraction des rites funraires ct sombre de toute religion - le culte totmique se clbre au milieu de chants, de danses, de reprsentations dramatiques. Les expiations cruelles y sont, nous le verrons, relativement rares ; mme les mutilations obligatoires et douloureuses de l'initiation n'ont pas ce caractre. Les dieux jaloux et terribles n'apparaissent que plus tard dans l'volution religieuse. C'est que les socits primitives ne sont pas des sortes de Leviathan qui accablent l'homme de l'normit de leur pouvoir et le soumettent une dure discipline ; il se donne elles spontanment et sans rsistance. Comme l'me sociale n'est faite alors que d'un petit nombre d'ides et de sentiments, elle s'incarne aisment tout entire dans chaque conscience individuelle. L'individu la porte toute en soi ; elle fait partie de lui-mme, et par suite, quand il cde aux impulsions qu'elle lui imprime, il ne croit pas cder une contrainte, mais aller l o l'appelle sa nature .
711 712
Or cette manire d'entendre la gense de la pense religieuse chappe aux objections que soulvent les thories classiques les plus accrdites. Nous avons vu comment naturistes et animistes prtendaient construire la notion d'tres sacrs avec les sensations provoques en nous par divers phnomnes d'ordre physique ou
magie (voir HUBERT et Mauss, Thorie gnrale de la magie, Anne sociol., VII, p. 144 et suiv.) ; car les forces magiques ne sont, croyons-nous, qu'une forme particulire des forces religieuses. Nous aurons plusieurs fois revenir sur ce point. Une fois, du moins, qu'il est adulte et pleinement initi; car les rites de l'initiation, qui introduisent le jeune homme la vie sociale, constituent, par eux-mmes, une svre discipline. V. sur cette nature particulire des socits primitives, notre Division du travail social, 3e d., pp. 123, 149, 173 et suiv.
711 712
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
206
biologique, et nous avons montr ce que cette entreprise avait d'impossible et mme de contradictoire. Rien ne vient de rien. Les impressions qu'veille en nous le monde physique ne sauraient, par dfinition, rien contenir qui dpasse ce monde. Avec du sensible, on ne peut faire que du sensible ; avec de l'tendu, on ne peut faire de l'intendu. Aussi, pour pouvoir expliquer comment la notion du sacr a pu se former dans ces conditions, la plupart de ces thoriciens taient-ils obligs d'admettre que l'homme a superpos la ralit, telle qu'elle est donne l'observation, un monde irrel, construit tout entier soit avec les images fantasmatiques qui agitent son esprit pendant le rve, soit avec les aberrations, souvent monstrueuses, que l'imagination mythologique aurait enfantes sous l'influence prestigieuse, mais trompeuse, du langage. Mais alors il devenait incomprhensible que l'humanit se ft, pendant des sicles, obstine dans des erreurs dont l'exprience et d trs vite lui donner le sentiment. De notre point de vue, ces difficults disparaissent. La religion cesse d'tre je ne sais quelle inexplicable hallucination pour prendre pied dans la ralit. Nous pouvons dire en effet, que le fidle ne s'abuse pas quand il croit l'existence d'une puissance morale dont il dpend et dont il tient le meilleur de lui-mme : cette puissance existe, c'est la socit. Quand l'Australien est transport au-dessus de lui-mme, quand il sent affluer en lui une vie dont l'intensit le surprend, il n'est pas dupe d'une illusion; cette exaltation est relle et elle est rellement le produit de forces extrieures et suprieures l'individu. Sans doute, il se trompe quand il croit que ce rehaussement de vitalit est luvre d'un pouvoir forme d'animal ou de plante. Mais l'erreur porte uniquement sur la lettre du symbole au moyen duquel cet tre est reprsent aux esprits, sur l'aspect de son existence. Derrire ces figures et ces mtaphores, ou plus grossires on plus raffines, il y a une ralit concrte et vivante. La religion prend ainsi un sens et une raison que le rationaliste le plus intransigeant ne peut pas mconnatre. Son objet principal n'est pas de donner l'homme une reprsentation de l'univers physique; car si c'tait l sa tche essentielle, on ne comprendrait pas comment elle a pu se maintenir puisque, sous ce rapport, elle n'est gure qu'un tissu d'erreurs. Mais elle est avant tout, un systme de notions au moyen desquelles les individus se reprsentent la socit dont ils sont membres, et les rapports, obscurs mais intimes, qu'ils soutiennent avec elle. Tel est son rle primordial ; et, pour tre mtaphorique et symbolique, cette reprsentation n'est pourtant pas infidle. Elle traduit, au contraire, tout ce qu'il y a d'essentiel dans les relations qu'il s'agit d'exprimer : car il est vrai d'une vrit ternelle qu'il existe en dehors de nous quelque chose de plus grand que nous, et avec quoi nous communiquons. C'est pourquoi on peut tre assur par avance que les pratiques du culte, quelles qu'elles puissent tre, sont autre chose que des mouvements sans porte et des gestes sans efficacit. Par cela seul qu'elles ont pour fonction apparente de resserrer les liens qui attachent le fidle son dieu, du mme coup elles resserrent rellement les liens qui unissent l'individu la socit dont il est membre, puisque le dieu n'est que l'expression figure de la socit. On conoit mme que la vrit fondamentale que contenait ainsi la religion ait pu suffire compenser les erreurs secondaires qu'elle impliquait presque ncessairement, et que, par suite, les fidles aient t empchs de s'en dtacher, malgr les mcomptes qui devaient rsulter de ces erreurs. Sans doute, il a d arriver le plus souvent que les recettes qu'elle recommandait l'homme d'employer pour agir sur les choses se sont trouves inefficaces. Mais ces checs ne pouvaient
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
207
avoir d'influence profonde parce qu'ils n'atteignaient pas la religion dans ses principes .
713
On objectera cependant que, mme dans cette hypothse, la religion reste le produit d'un certain dlire. Quel autre nom, en effet, peut-on donner l'clat dans lequel se trouvent les hommes quand, par suite d'une effervescence collective, ils se croient transports dans un monde entirement diffrent de celui qu'ils ont sous les yeux ? Il est bien vrai que la vie religieuse ne peut pas atteindre un certain degr d'intensit sans impliquer une exaltation psychique qui n'est pas sans rapport avec le dlire. C'est pour cette raison que les prophtes, les fondateurs de religions, les grands saints, en un mot les hommes dont la conscience religieuse est exceptionnellement sensible, prsentent trs souvent des signes d'une nervosit excessive et mme proprement pathologique: ces tares physiologiques les prdestinaient aux grands rles religieux. L'emploi rituel des liqueurs intoxicantes s'explique de la mme manire . Ce n'est certainement pas que la foi ardente soit ncessairement un fruit de l'ivresse et des troubles mentaux qui l'accompagnent; mais, comme l'exprience eut vite averti les peuples des analogies qu'il y avait entre la mentalit du dlirant et celle du voyant, on chercha frayer les voies la seconde en suscitant artificiellement la premire. Mais si, pour cette raison, on peut dire que la religion ne va pas sans un certain dlire, il faut ajouter que ce dlire, s'il a les causes que nous lui avons attribues, est bien fond. Les images dont il est fait ne sont pas de pures illusions comme celles que naturistes et animistes mettent la base de la religion ; elles correspondent quelque chose dans le rel. Sans doute, il est dans la nature des forces morales qu'elles expriment de ne pouvoir affecter avec quelque nergie l'esprit humain sans le mettre hors de lui-mme, sans le plonger dans un tat que l'on peut qualifier d'extatique, pourvu que le mot soit pris dans son sens tymologique: mais il ne s'ensuit nullement qu'elles soient imaginaires. Tout au contraire, l'agitation mentale qu'elles suscitent atteste leur ralit. C'est simplement une nouvelle preuve qu'une vie sociale trs intense fait toujours l'organisme, comme la conscience de l'individu, une sorte de violence qui en trouble le fonctionnement normal. Aussi ne peut-elle durer qu'un temps trs limit .
714 715
Au reste, si l'on appelle dlire tout tat dans lequel l'esprit ajoute aux donnes immdiates de l'intuition sensible et projette ses sentiments et ses impressions dans les choses, il n'y a peuttre pas de reprsentation collective qui, en un sens, ne soit dlirante; les croyances religieuses ne sont qu'un cas particulier d'une loi trs gnrale. Le milieu social tout entier nous apparat comme peupl de forces qui, en ralit, n'existent que dans notre esprit. On sait ce que le drapeau est pour le soldat ; en soi, ce n'est qu'un chiffon de toile. Le sang humain n'est qu'un liquide organique; cependant, aujourd'hui encore, nous ne pouvons le voir couler sans prouver une violente motion que ses proprits physico-chimiques ne sauraient expliquer. L'homme n'est rien autre chose, au point de vue physique, qu'un systme de cellules, au point de vue mental, qu'un systme de reprsentations : sous l'un ou l'autre rapport, il ne diffre qu'en degrs de l'animal. Et pourtant, la socit le conoit et nous oblige le concevoir comme investi d'un
713 714 715
Nous nous bornons provisoirement cette indication gnrale; nous reviendrons sur l'ide et nous en ferons plus explicitement la preuve quand nous traiterons des rites (liv. III). V. sur ce point Achelis, Die Ekstase (Berlin), 1902, notamment le chap. 1er. Cf. Mauss, Essai sur les variations saisonnires des socits eskimos, in Anne sociol., IX, p. 127.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
208
caractre sui generis qui l'isole, qui tient distance les empitements tmraires, qui, en un mot, impose le respect. Cette dignit qui le met hors de pair nous apparat comme un de ses attributs distinctifs, bien qu'il soit impossible de rien trouver dans la nature empirique de l'homme qui la fonde. Un timbre-poste oblitr peut valoir une fortune ; il est vident que cette valeur n'est aucunement implique dans ses proprits naturelles. Sans doute, en un sens, notre reprsentation du monde extrieur n'est, elle aussi, qu'un tissu d'hallucinations; car les odeurs, les saveurs, les couleurs que nous mettons dans les corps n'y sont pas, ou, du moins, n'y sont pas telles que nous les percevons. Cependant, nos sensations olfactives, gustatives, visuelles ne laissent pas de correspondre certains tats objectifs des choses reprsentes ; elles expriment leur faon les proprits ou de particules matrielles ou de mouvements de l'ther qui ont bien leur origine dans les corps que nous percevons comme odorants, sapides ou colors. Mais les reprsentations collectives attribuent trs souvent aux choses auxquelles elles se rapportent des proprits qui n'y existent sous aucune forme ni aucun degr. De l'objet le plus vulgaire, elles peuvent faire un tre sacr et trs puissant. Et cependant, bien que purement idaux, les pouvoirs qui lui sont ainsi confrs agissent comme s'ils taient rels ; ils dterminent la conduite de l'homme avec la mme ncessit que des forces physiques. L'Arunta qui s'est correctement frott avec son churinga se sent plus fort ; il est plus fort. S'il a mang de la chair d'un animal qui, tout en tant parfaitement sain, lui est pourtant interdit, il se sentira malade et pourra en mourir. Le soldat qui tombe en dfendant son drapeau ne croit certes pas s'tre sacrifi un morceau d'toffe. C'est que la pense sociale, cause de l'autorit imprative qui est en elle, a une efficacit que ne saurait avoir la pense individuelle; par l'action qu'elle exerce sur nos esprits, elle peut nous faire voir les choses sous le jour qui lui convient; elle ajoute au rel ou elle en retranche, selon les circonstances. Il y a ainsi une rgion de la nature o la formule de l'idalisme s'applique presque la lettre : c'est le rgne social. L'ide y fait, beaucoup plus qu'ailleurs, la ralit. Sans doute, mme dans ce cas, l'idalisme n'est pas vrai sans temprament. Nous ne pouvons jamais chapper la dualit de notre nature et nous affranchir compltement des ncessits physiques : pour nous exprimer nous-mme nos propres ides, nous avons besoin, comme nous le montrerons tout l'heure, de les fixer sur des choses matrielles qui les symbolisent. Mais ici, la part de la matire est rduite au minimum. L'objet qui sert de support l'ide est bien peu de chose, compar la superstructure idale sous laquelle il disparat et, de plus, il n'est pour rien dans cette superstructure. Voil en quoi consiste le pseudo-dlire que l'on rencontre la base de tant de reprsentations collectives : ce n'est qu'une forme de cet idalisme essentiel . Ce n'est donc pas un dlire proprement dit ; car les ides qui s'objectivent ainsi sont fondes, non pas sans doute dans la nature des choses matrielles sur lesquelles elles se greffent, mais dans la nature de la socit.
716
716
On voit tout ce qu'il y a d'erron dans les thories qui, comme le matrialisme gographique de RATZEL (v. notamment sa Politische Geographie) entendent driver toute la vie sociale de son substrat matriel (soit conomique, soit territorial). Elles commettent une erreur tout fait comparable celle qu'a commise Maudsley en psychologie individuelle. Comme ce dernier rduisait la vie psychique de l'individu n'tre qu'un piphnomne de sa base physiologique, elles veulent rduire toute la vie psychique de la collectivit sa base physique. C'est oublier que les ides sont des ralits, des forces, et que les reprsentations collectives sont des forces plus agissantes encore et plus efficaces que les reprsentations individuelles. V. sur ce point notre article Reprsentations individuelles et reprsentations collectives, in Revue de Mtaphysique el de Morale, mai 1898.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
209
On peut maintenant comprendre comment le principe totmique et, plus gnralement, comment toute force religieuse est extrieure aux choses dans lesquelles elle rside . C'est que la notion n'en est nullement construite avec les impressions que cette chose produit directement sur nos sens et sur notre esprit. La force religieuse n'est que le sentiment que la collectivit inspire ses membres, mais projet hors des consciences qui l'prouvent, et objectivit. Pour s'objectiver, il se fixe sur un objet qui devient ainsi sacr ; mais tout objet peut jouer ce rle. En principe, il n'y en a pas qui y soient prdestins par leur nature, l'exclusion des autres; il n'y en a pas davantage qui y soient ncessairement rfractaires . Tout dpend des circonstances qui font que le sentiment gnrateur des ides religieuses se pose ici ou l, sur tel point plutt sur un tel autre. Le caractre sacr que revt une chose n'est donc pas impliqu dans les proprits intrinsques de celle-ci : il y est surajout. Le monde du religieux n'est pas un aspect particulier de la nature empirique ; il y est superpos.
717 718
Cette conception du religieux permet enfin d'expliquer un important principe que nous trouvons la base d'une multitude de mythes et de rites et qui peut s'noncer ainsi: quand un tre sacr se subdivise, il reste tout entier gal lui-mme dans chacune de ses parties. En d'autres termes, au regard de la pense religieuse, la partie vaut le tout ; elle a les mmes pouvoirs, la mme efficacit. Un dbris de relique a les mmes vertus que la relique intgrale. La moindre goutte de sang contient le mme principe actif que le sang tout entier. L'me, comme nous le verrons, peut se fragmenter presque en autant de parties qu'il y a d'organes ou de tissus dans l'organisme; chacune de ces mes partielles quivaut l'me totale. Cette conception serait inexplicable si le caractre sacr tenait aux proprits constitutives de la chose qui lui sert de substrat; car alors il devrait varier comme cette chose, crotre et dcrotre avec elle. Mais si les vertus qu'elle est cense possder ne lui sont pas intrinsques, si elles lui viennent de certains sentiments qu'elle rappelle et qu'elle symbolise bien qu'ils aient leur origine en dehors d'elle, comme, pour remplir ce rle vocateur, elle n'a pas besoin d'avoir des dimensions dtermines, elle aura la mme valeur, qu'elle soit entire ou non. Comme la partie rappelle le tout, elle voque aussi les sentiments que le tout rappelle. Un simple fragment du drapeau reprsente la patrie comme le drapeau lui-mme : aussi est-il sacr au mme titre et au mme degr .
719
V
.
Mais si cette thorie du totmisme nous a permis d'expliquer les croyances les plus caractristiques de cette religion, elle repose elle-mme sur un fait qui n'est pas encore
717 718 719
V. plus haut, pp. 269, 277. Mme les excrta ont un caractre religieux. V. Preuss, Der Ursprung der Religion und Kunst, en particulier le chapitre Il intitul Der Zauber der Defkation (Globus, LXXXVI, p. 325 et suiv.). Le principe est pass de la religion dans la magie : c'est le totum ex parte des alchimistes.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
210
expliqu. tant donne la notion du totem, emblme du clan, tout le reste suit ; mais il reste rechercher comment cette notion s'est constitue. La question est double et peut se subdiviser ainsi : 1 qu'est-ce qui a dtermin le clan se choisir un emblme ? 2 pourquoi ces emblmes ont-ils t emprunts au monde animal et vgtal, mais plus particulirement au premier ? Qu'un emblme soit, pour toute espce de groupe, un utile centre de ralliement, c'est ce qu'il est inutile de dmontrer. En exprimant l'unit sociale sous une forme matrielle, il la rend plus sensible tous et, pour cette raison dj, l'emploi des symboles emblmatiques dut vite se gnraliser une fois que l'ide en fut ne. Mais de plus, cette ide dut jaillir spontanment des conditions de la vie commune; car l'emblme n'est pas seulement un procd commode qui rend plus clair le sentiment que la socit a d'elle-mme: il sert faire ce sentiment; il en est lui-mme un lment constitutif. En effet, par elles-mmes, les consciences individuelles sont fermes les unes aux autres; elles ne peuvent communiquer qu'au moyen de signes oh viennent se traduire leurs tats intrieurs. Pour que le commerce qui s'tablit entre elles puisse aboutir une communion, c'est-dire une fusion de tous les sentiments particuliers en un sentiment commun, il faut donc que les signes qui les manifestent viennent eux-mmes se fondre en une seule et unique rsultante. C'est l'apparition de cette rsultante qui avertit les individus qu'ils sont l'unisson et qui leur fait prendre conscience de leur unit morale. C'est en poussant un mme cri, en prononant une mme parole, en excutant un mme geste concernant un mme objet qu'ils se mettent et se sentent d'accord. Sans doute, les reprsentations individuelles, elles aussi, dterminent dans l'organisme des contrecoups qui ne sont pas sans importance; elles peuvent cependant tre conues, abstraction faite de ces rpercussions physiques qui les accompagnent ou qui les suivent, mais qui ne les constituent pas. Il en va tout autrement des reprsentations collectives. Elles supposent que des consciences agissent et ragissent les unes sur les autres ; elles rsultent de ces actions et de ces ractions qui, elles-mmes ne sont possibles que grce des intermdiaires matriels. Ceux-ci ne se bornent donc pas rvler l'tat mental auquel ils sont associs ; ils contribuent le faire. Les esprits particuliers ne peuvent se rencontrer et communier qu' condition de sortir d'eux-mmes ; mais ils ne peuvent s'extrioriser que sous la forme de mouvements. C'est l'homognit de ces mouvements qui donne au groupe le sentiment de soi et qui, par consquent, le fait tre. Une fois cette homognit tablie, une fois que ces mouvements ont pris une forme une et strotype, ils servent symboliser les reprsentations correspondantes. Mais ils ne les symbolisent que parce qu'ils ont concouru les former. D'ailleurs, sans symboles, les sentiments sociaux ne pourraient avoir qu'une existence prcaire. Trs forts tant que les hommes sont assembls et s'influencent rciproquement, ils ne subsistent, quand l'assemble a pris fin, que sous la forme de souvenirs qui, s'ils sont abandonns eux-mmes, vont de plus en plus en plissant; car, comme le groupe, ce moment, n'est plus prsent et agissant, les tempraments individuels reprennent facilement le dessus. Les passions violentes qui ont pu se dchaner au sein d'une foule tombent et s'teignent une fois qu'elle s'est dissoute, et les individus se demandent avec stupeur comment ils ont pu se laisser emporter ce point hors de leur caractre. Mais si les mouvements par lesquels ces sentiments se sont exprims viennent S'inscrire sur des choses qui durent, ils
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
211
deviennent eux-mmes durables. Ces choses les rappellent sans cesse aux esprits et les tiennent perptuellement en veil; c'est comme si la cause initiale qui les a suscits continuait agir. Ainsi l'emblmatisme, ncessaire pour permettre la socit de prendre conscience de soi, n'est pas moins indispensable pour assurer la continuit de cette conscience. Il faut donc se garder de voir dans ces symboles de simples artifices, des sortes d'tiquettes qui viendraient se surajouter des reprsentations toutes faites pour les rendre plus maniables : ils en sont partie intgrante. Mme le fait que des sentiments collectifs se trouvent ainsi rattachs des choses qui leur sont trangres n'est pas purement conventionnel : il ne fait que figurer sous une forme sensible un caractre rel des faits sociaux, savoir leur transcendance par rapport aux consciences individuelles. On sait, en effet que les phnomnes sociaux prennent naissance, non dans l'individu, mais dans le groupe. Quelque part que nous prenions leur gense, chacun de nous les reoit du dehors . Quand donc nous nous les reprsentons comme manant d'un objet matriel, nous ne nous mprenons pas compltement sur leur nature. Sans doute, ils ne viennent pas de la chose dtermine laquelle nous les rapportons; mais il reste vrai qu'ils ont leur origine hors de nous. Si la force morale qui soutient le fidle ne provient pas de l'idole qu'il adore, de l'emblme qu'il vnre, elle ne laisse pas cependant de lui tre extrieure et il en a le sentiment. L'objectivit du symbole ne fait que traduire cette extriorit.
720
Ainsi, la vie sociale, sous tous ses aspects et tous les moments de son histoire, n'est possible que grce un vaste symbolisme. Les emblmes matriels, les reprsentations figures, dont nous avons plus spcialement nous occuper dans la prsente tude, en sont une forme particulire ; mais il en est bien d'autres. Les sentiments collectifs peuvent galement s'incarner dans des personnes ou dans des formules : il y a des formules qui sont des drapeaux ; il n'y a des personnages, rels ou mythiques, qui sont des symboles. Mais il y a une sorte d'emblme qui dut apparatre trs vite en dehors de tout calcul et de toute rflexion: c'est celuil mme que nous avons vu jouer dans le totmisme un rle considrable ; c'est le tatouage. Des faits connus dmontrent, en effet, qu'il se produit avec une sorte d'automatisme dans des conditions donnes. Quand des hommes de culture infrieure sont associs dans une vie commune, ils sont souvent amens, comme par une tendance instinctive, se peindre ou se graver sur le corps des images qui rappellent cette communaut d'existence. D'aprs un texte de Procope, les premiers chrtiens se faisaient imprimer sur la peau le nom du Christ ou le signe de la croix . Pendant longtemps, les groupes de plerins qui se rendaient en Palestine se faisaient galement tatouer, sur les bras ou sur les poignets, des dessins qui reprsentaient la croix ou le monogramme du Christ . On signale le mme usage dans les plerinages qui se font de certains lieux saints d'Italie . Un curieux cas de tatouage spontan est rapport par Lombroso : vingt jeunes gens d'un collge italien, sur le point de se sparer, se firent dcorer de tatouages qui, sous des formes diverses, rappelaient les annes qu'ils venaient de passer
721 722 723
720 721 722 723
V. sur ce point Les rgles de la mthode sociologique, p. 5 et suiv. Procope de GAZA, Commentarii in Isaiam, 496. V. THBENOT, Voyage au Levant, Paris, 1689, p. 638. Le fait fut encore observ en 1862 : cf. BERCHON, Histoire mdicale du tatouage, 1869, Archives de mdecine navale, XI, p. 377. LACASSAGNE, Les tatouages, p. 10.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
212
ensemble . La mme pratique a t souvent observe chez les soldats d'une mme caserne, chez les marins d'un mme bateau, chez les prisonniers enferms dans une mme maison de dtention .
724 725
On comprend, en effet, que, l surtout o la technique est encore rudimentaire, le tatouage soit le moyen le plus direct et le plus expressif par lequel puisse s'affirmer la communion des consciences. La meilleure manire de s'attester soi-mme et d'attester autrui qu'on fait partie d'un mme groupe, c'est de s'imprimer sur le corps une mme marque distinctive. Et ce qui prouve que telle est bien la raison d'tre de l'image totmique, c'est que, comme nous l'avons montr, elle ne cherche pas reproduire l'aspect de la chose qu'elle est cense reprsenter. Elle est faite de lignes et de points auxquels est attribue une signification toute conventionnelle . Elle n'a pas pour but de figurer et de rappeler un objet dtermin, mais de tmoigner qu'un certain nombre d'individus participent d'une mme vie morale.
726
Le clan est, d'ailleurs, une socit qui peut, moins que toute autre, se passer d'emblme et de symbole, car il n'en est gure qui manque autant de consistance. Le clan ne peut pas se dfinir par son chef ; car, si toute autorit centrale n'en est pas absente, elle y est, du moins, incertaine et instable . Il ne peut davantage se dfinir par le territoire qu'il occupe ; car la population, tant nomade , n'est pas troitement attache une localit dtermine. De plus, en vertu de la loi d'exogamie, le mari et la femme sont obligatoirement de totems diffrents ; l donc o le totem se transmet en ligne maternelle - et ce systme de filiation est encore aujourd'hui le plus gnral les enfants sont d'un autre clan que leur pre, tout en vivant auprs de ce dernier. Pour toutes ces raisons, on trouve l'intrieur d'une mme famille et, plus encore, l'intrieur d'une mme localit, des reprsentants de toute sorte de clans diffrents. L'unit du groupe n'est donc sensible que grce au nom collectif que portent tous ses membres et l'emblme, galement collectif, qui reproduit la chose dsigne par ce nom. Un clan est essentiellement une runion d'individus qui portent un mme nom et qui se rallient autour d'un mme signe. Enlevez le nom et le signe qui le matrialise, et le clan n'est mme plus reprsentable. Puisqu'il n'tait possible qu' cette condition, on s'explique et l'institution de l'emblme et la place prise par cet emblme dans la vie du groupe.
727 728 729
Il reste chercher pourquoi ces noms et ces emblmes furent emprunts, d'une manire
724 725 726 727 728 729
LOMBROSO, L'homme criminel, I, p. 292. Lombroso, ibid., I, pp. 268,285,291-292; Lacassagne, op. cit., p. 97. V. plus haut p. 178. V. sur l'autorit des chefs SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 10; North. Tr., p. 25; HOWITT, Nat. Tr., p. 295 et suiv. Du moins en Australie. En Amrique, la population est le plus gnralement sdentaire : mais le clan amricain reprsente une forme d'organisation relativement avance. Il suffit, pour s'en assurer, de regarder la carte dresse par Thomas dans Kinship and Marriage in Australia, p. 40. Pour apprcier cette carte comme il convient, il faut tenir compte de ce fait que l'auteur a tendu, nous ne savons pourquoi, le systme de la filiation totmique en ligne paternelle jusqu' la cte occidentale de l'Australie, bien que nous n'ayons pour ainsi dire pas de renseignements sur les tribus de cette rgion, qui, d'ailleurs, est en grande partie, dsertique.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
213
presque exclusive, au rgne animal et au rgne vgtal, mais surtout au premier. Il nous parat vraisemblable que l'emblme a jou un rle plus important que le nom. En tout cas, le signe crit tient encore aujourd'hui dans la vie du clan une place plus centrale que le signe parl. Or, la matire de l'image emblmatique ne pouvait tre demande qu' une chose susceptible d'tre figure par un dessin. D'un autre ct, il fallait que ces choses fussent de celles avec lesquelles les hommes du clan taient le plus immdiatement et le plus habituellement en rapports. Les animaux remplissaient au plus haut degr cette condition. Pour ces peuplades de chasseurs et de pcheurs, l'animal constituait, en effet, l'lment essentiel du milieu conomique. Sous ce rapport, les plantes ne venaient qu'ensuite ; car elles ne peuvent tenir qu'une place secondaire dans l'alimentation tant qu'elles ne sont pas cultives. D'ailleurs, l'animal est plus troitement associ la vie de l'homme que la plante, ne serait-ce qu' cause de la parent de nature qui unit entre eux ces deux tres. Au contraire, le soleil, la lune, les astres taient trop loin et faisaient l'effet de ressortir un autre monde . De plus, tant que les constellations n'taient pas distingues et classes, la vote toile n'offrait pas une suffisante diversit de choses assez nettement diffrencies pour pouvoir servir dsigner tous les clans et tous les sous-clans d'une tribu ; au contraire, la varit de la flore et surtout de la faune tait presque inpuisable. Pour ces raisons, les corps clestes, en dpit de leur clat, de la vive impression qu'ils font sur les sens, taient impropres au rle de totems pour lequel, au contraire, animaux et vgtaux taient tout dsigns.
730
Une observation de Strehlow permet mme de prciser la manire dont furent vraisemblablement choisis ces emblmes. Strehlow dit avoir remarqu que les centres totmiques sont le plus souvent situs proximit d'une montagne, d'une source, d'une gorge oh les animaux qui servent de totem au groupe se rencontrent en abondance, et il cite de ce fait un certain nombre d'exemples . Or ces centres totmiques sont certainement les lieux consacrs o le clan tenait ses assises. Il semble donc bien que chaque groupe ait pris pour insigne l'animal ou le vgtal qui tait le plus rpandu dans le voisinage de l'endroit o il avait l'habitude de s'assembler .
731 732
VI
.
Cette thorie du totmisme va nous donner la clef d'un trait curieux de la mentalit humaine qui, s'il tait plus marqu jadis qu'aujourd'hui, n'a pourtant pas disparu et qui, en tout cas, a jou un rle considrable dans l'histoire de la pense. Ce sera une nouvelle occasion de
730
731 732
Les astres sont souvent considrs, mme par les Australiens, comme le pays des mes ou des personnages mythiques, ainsi que nous l'tablirons dans le chapitre suivant: c'est dire qu'ils passent pour constituer un monde trs diffrent de celui des vivants. Op. cit., I, p. 4. Cf. dans le mme sens SCHULZE, loc. cit., p. 243. Bien entendu, comme nous avons eu dj l'occasion de le montrer (v. supra, p. 1221), ce choix ne se fit pas sans une entente plus ou moins concerte entre les diffrents groupes puisque chacun d'eux dut adopter un emblme diffrent de celui des voisins.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
214
constater que l'volution logique est troitement solidaire de l'volution religieuse et dpend, comme cette dernire, de conditions sociales .
733
S'il est une vrit qui nous apparat aujourd'hui comme de toute vidence, c'est que des tres qui diffrent, non seulement par leur apparence extrieure, mais par leurs proprits les plus essentielles, comme les minraux, les plantes, les animaux, les hommes ne sauraient tre considrs comme quivalents et comme directement substituables les uns aux autres. Un long usage, que la culture scientifique a encore plus fortement enracin dans nos esprits, nous a appris tablir entre les divers rgnes de la nature des barrires dont le transformisme luimme ne nie pas l'existence ; car s'il admet que la vie a pu natre de la matire non vivante et l'homme de l'animal, il ne mconnat pas que les vivants, une fois forms, sont autre chose que des minraux, l'homme autre chose qu'un animal. A l'intrieur de chaque rgne, les mmes barrires sparent les diffrentes classes : nous ne concevons pas comment un minral pourrait avoir les caractres distinctifs d'un autre minral, ou une espce animale ceux d'une autre espce. Mais ces distinctions, qui nous semblent si naturelles, n'ont rien de primitif. A l'origine, tous les rgnes sont confondus les uns dans les autres. Les rochers ont un sexe ; ils ont le pouvoir d'engendrer ; le soleil, la lune, les toiles sont des hommes ou des femmes, qui prouvent et qui expriment des sentiments humains, tandis que les hommes, au contraire, sont conus comme des animaux ou des plantes. Cet tat d'indistinction se retrouve la base de toutes les mythologies. De l, le caractre ambigu des tres que les mythes mettent en scne; on ne peut les classer dans aucun genre dfini, car ils participent la fois des genres les plus opposs. Aussi admet-on sans peine qu'ils peuvent se transmuter les uns dans les autres ; et c'est par des transmutations de ce genre que les hommes, pendant longtemps, ont cru pouvoir expliquer la gense des choses. Que l'instinct anthropomorphique dont les animistes ont dot le primitif ne puisse rendre compte de cette mentalit, c'est ce que dmontre la nature des confusions qui la caractrisent. Elles viennent, en effet, non de ce que l'homme a dmesurment tendu le rgne humain au point d'y faire rentrer tous les autres, mais de ce qu'il a ml les rgnes les plus disparates. Il n'a pas plus conu le monde son image qu'il ne s'est conu l'image du monde : il a procd de l'une et de l'autre manires la fois. Dans l'ide qu'il se faisait des choses, il a fait, sans doute, entrer des lments humains ; mais, dans l'ide qu'il se faisait de lui-mme, il a fait entrer des lments qui lui venaient des choses. Cependant, il n'y avait rien dans l'exprience qui pt lui suggrer de ces rapprochements ou de ces mlanges. Au regard de l'observation sensible, tout est divers et discontinu. Nulle part, dans la ralit, nous ne voyons les tres mler leur nature et se mtamorphoser les uns dans les autres. Il faut donc qu'une cause exceptionnellement puissante soit intervenue qui ait transfigur le rel de manire la faire apparatre sous un aspect qui n'est pas le sien.
733
L'tat mental qui est tudi dans ce paragraphe est identique celui que M. LVY-BRUHL appelle loi de participation (Les fonctions mentales dans les socits infrieures, p. 76 et suiv.). Les pages qui suivent taient crites quand parut cet ouvrage ; nous les publions sous leur forme premire sans y rien changer ; nous nous bornons ajouter quelques explications o nous marquons comment nous nous sparons de M. Lvy-Bruhl dans l'apprciation des faits.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
215
C'est la religion qui a t l'agent de cette transfiguration ; ce sont les croyances religieuses qui ont substitu au monde tel que le peroivent les sens, un monde diffrent. C'est ce que montre le cas du totmisme. Ce qu'il y a de fondamental dans cette religion, c'est que les gens du clan et les tres divers dont l'emblme totmique reproduit la forme passent pour tre faits de la mme essence. Or, une fois que cette croyance tait admise, le pont tait jet entre les diffrents rgnes. L'homme tait reprsent comme une sorte d'animal ou de plante : les plantes et les animaux comme des parents de l'homme, ou plutt, tous ces tres, si diffrents pour les sens, taient conus comme participant d'une mme nature. Ainsi, cette remarquable aptitude confondre ce qui nous semble si manifestement distinct vient de ce que les premires forces dont l'intelligence humaine a peupl l'univers ont t labores par la religion. Parce qu'elles taient faites d'lments emprunts aux diffrents rgnes, on en fit le principe commun des choses les plus htrognes, qui se trouvrent ainsi dotes d'une seule et mme essence. Mais nous savons, d'autre part, que ces conceptions religieuses sont le produit de causes sociales dtermines. Parce que le clan ne peut exister sans un nom et sans un emblme, parce que cet emblme est partout prsent aux regards des individus, c'est sur lui et sur les objets dont il est l'image que se reportent les sentiments que la socit veille chez ses membres. Les hommes furent ainsi ncessits se reprsenter la force collective dont ils sentaient l'action, sous les espces de la chose qui servait de drapeau au groupe. Dans la notion de cette force se trouvaient donc confondus les rgnes les plus diffrents : en un sens, elle tait essentiellement humaine puisqu'elle tait faite d'ides et de sentiments humains ; mais en mme temps, elle ne pouvait pas ne pas apparatre comme troitement apparente l'tre anim ou inanim qui lui prtait ses formes extrieures. La cause dont nous saisissons ici l'action n'est pas, d'ailleurs, particulire au seul totmisme; il n'est pas de socit o elle n'agisse. D'une manire gnrale, un sentiment collectif ne peut prendre conscience de soi qu'en se fixant sur un objet matriel ; mais et par cela mme, il participe de la nature de cet objet et rciproquement. Ce sont donc des ncessits sociales qui ont fait fusionner ensemble des notions qui, au premier abord, paraissaient distinctes, et la vie sociale a facilit cette fusion par la grande effervescence mentale qu'elle dtermine . C'est une preuve nouvelle que l'entendement logique est fonction de la socit, puisqu'il prend les formes et les attitudes que celle-ci lui imprime.
734 735
Cette logique, il est vrai, nous dconcerte. Il faut pourtant se garder de la dprcier : si grossire qu'elle puisse nous paratre, elle constituait, pour l'volution intellectuelle de l'humanit, un apport de la plus haute importance. C'est par elle, en effet, qu'a t possible une premire explication du monde. Sans doute, les habitudes mentales qu'elle implique empchaient l'homme de voir la ralit telle que la lui montrent les sens ; mais telles qu'ils la lui montrent, elle a le grave inconvnient d'tre rfractaire toute explication. Car expliquer, c'est rattacher les choses les unes aux autres, c'est tablir entre elles des relations qui nous les fassent apparatre comme fonction les unes des autres, comme vibrant sympathiquement suivant une
734 735
V. plus haut, p. 307. Une autre cause a contribu, pour une large part, cette fusion; c'est l'extrme contagiosit des forces religieuses. Elles envahissent tout objet leur porte, quel qu'il soit. C'est ainsi qu'une mme force religieuse peut animer les choses les plus diffrentes qui, par cela mme, se trouvent troitement rapproches et classes dans un mme genre. Nous reviendrons plus loin sur cette contagiosit en mme temps que nous montrerons qu'elle tient aux origines sociales de la notion de sacr (v. liv. II, chap, III, in fine).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
216
loi intrieure, fonde dans leur nature. Or ces relations et ces liens internes, la sensation, qui ne voit rien que du dehors, ne saurait nous les faire dcouvrir ; l'esprit seul peut en crer la notion. Quand j'apprends que A prcde rgulirement B, ma connaissance s'est enrichie d'un nouveau savoir ; mon intelligence n'est aucunement satisfaite par une constatation qui ne porte pas en elle sa raison. je ne commence comprendre que s'il m'est possible de concevoir B par un biais qui me le fasse apparatre comme n'tant pas tranger A, comme uni A par quelque rapport de parent. Le grand service que les religions ont rendu la pense est d'avoir construit une premire reprsentation de ce que pouvaient tre ces rapports de parent entre les choses. Dans les conditions o elle tait tente, l'entreprise ne pouvait videmment aboutir qu' des rsultats prcaires. Mais d'abord, en produit-elle jamais qui soient dfinitifs et n'est-il pas ncessaire de la reprendre sans cesse ? Et puis, ce qui importait, c'tait moins de la russir que de l'oser. L'essentiel tait de ne pas laisser l'esprit asservi aux apparences sensibles, mais, au contraire, de lui apprendre les dominer et rapprocher ce que les sens sparent ; car du moment o l'homme eut le sentiment qu'il existe des connexions internes entre les choses, la science et la philosophie devenaient possibles. La religion leur a fray la voie. Mais si elle a pu jouer ce rle, c'est parce qu'elle est chose sociale. Pour faire la loi aux impressions des sens et leur substituer une manire nouvelle de se reprsenter le rel, il fallait qu'une pense d'un genre nouveau se constitut : c'est la pense collective. Si seule, elle pouvait avoir cette efficacit, c'est que, pour crer tout un monde d'idaux travers lequel le monde des ralits senties appart transfigur, il fallait une surexcitation des forces intellectuelles qui n'est possible que dans et par la socit. Il s'en faut donc que cette mentalit soit sans rapports avec la ntre. Notre logique est ne de cette logique. Les explications de la science contemporaine sont plus assures d'tre objectives, parce qu'elles sont plus mthodiques, parce qu'elles reposent sur des observations plus svrement contrles, mais elles ne diffrent pas en nature de celles qui satisfont la pense primitive. Aujourd'hui comme autrefois, expliquer, c'est montrer comment une chose participe d'un ou de plusieurs autres. On a dit que les participations dont les mythologies postulent l'existence violent le principe de contradiction et que, par l, elles s'opposent celles qu'impliquent les explications scientifiques . Poser qu'un homme est un kangourou, que le soleil est un oiseau, n'est-ce pas identifier le mme et l'autre ? Mais nous ne pensons pas d'une autre manire quand nous disons de la chaleur qu'elle est un mouvement, de la lumire qu'elle est une vibration de l'ther, etc. Toutes les fois que nous unissons par un lien interne des termes htrognes, nous identifions forcment des contraires. Sans doute, les termes que nous unissons ainsi ne sont pas ceux que rapproche l'Australien; nous les choisissons d'aprs d'autres critres et pour d'autres raisons ; mais la dmarche mme par laquelle l'esprit les met en rapports ne diffre pas essentiellement.
736
Il est vrai que, si la pense primitive avait pour la contradiction l'espce d'indiffrence gnrale et systmatique qu'on lui a prte , elle contrasterait, sur ce point, et d'une manire accuse, avec la pense moderne, toujours soucieuse de rester d'accord avec elle-mme. Mais nous ne croyons pas qu'il soit possible de caractriser la mentalit des socits infrieures par une sorte de penchant unilatral et exclusif pour l'indistinction. Si le primitif confond des
737
736 737
LVY-BRUHL, Op. cit., p. 77 et suiv. Ibid., p. 79.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
217
choses que nous distinguons, inversement, il en distingue d'autres que nous rapprochons et il conoit mme ces distinctions sous la forme d'oppositions violentes et tranches. Entre deux tres qui sont classs dans deux phratries diffrentes, il n'y a pas seulement sparation, mais antagonisme . Pour cette raison, le mme Australien qui confond le soleil et le kakatos blanc, oppose ce dernier au kakatos noir comme son contraire. L'un et l'autre lui paraissent ressortir deux genres spars entre lesquels il n'y a rien de commun. Une opposition encore plus marque est celle qui existe entre choses sacres et choses profanes. Elle se repoussent et se contredisent avec une telle force que l'esprit se refuse les penser en mme temps. Elles se chassent mutuellement de la conscience.
738
Ainsi, entre la logique de la pense religieuse et la logique de la pense scientifique il n'y a pas un abme. L'une et l'autre sont faites des mmes lments essentiels, mais ingalement et diffremment dvelopps. Ce qui parat surtout caractriser la premire, c'est un got naturel aussi bien pour les confusions intemprantes que pour les contrastes heurts. Elle est volontiers excessive dans les deux sens. Quand elle rapproche, elle confond; quand elle distingue, elle oppose. Elle ne connat pas la mesure et les nuances, elle recherche les extrmes ; elle emploie, par suite, les mcanismes logiques avec une sorte de gaucherie, mais elle n'en ignore aucun.
738
V. plus haut, p. 207.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
218
CHAPITRE VIII
LA NOTION D'ME
Nous avons tudi, dans les chapitres qui prcdent, les principes fondamentaux de la religion totmique. On a pu voir que toute ide d'me, d'esprit, de personnage mythique en est absente. Cependant, si la notion d'tres spirituels n'est pas la base du totmisme ni, par consquent, de la pense religieuse en gnral, il n'y a pas de religion o cette notion ne se rencontre. Il importe donc de rechercher comment elle s'est constitue. Pour tre assur qu'elle est le produit d'une formation secondaire, il nous faut tablir de quelle manire elle est drive des conceptions plus essentielles que nous avons prcdemment exposes et expliques. Parmi les tres spirituels, il en est un qui doit tout d'abord retenir notre attention parce qu'il est le prototype d'aprs lequel les autres ont t construits : c'est l'me.
I
.
De mme qu'il n'y a pas de socit connue sans religion, il n'en existe pas, si grossirement organise soit-elle, o l'on ne trouve tout un systme de reprsentations collectives qui se rapportent l'me, son origine, sa destine. Autant qu'on en peut juger d'aprs les donnes de l'ethnographie, l'ide d'me parat avoir t contemporaine de l'humanit, et elle semble bien avoir eu, d'emble, tous, ses caractres essentiels, si bien que luvre des religions plus avances et de la philosophie s'est peu prs borne l'purer, sans y rien ajouter de vraiment fondamental. Toutes les socits australiennes admettent, en effet, que chaque corps humain abrite un tre intrieur, principe de la vie qui l'anime : c'est l'me. Il arrive, il est vrai, que les femmes font exception la rgle gnrale: il y a des tribus o elles passent pour n'avoir point d'me . S'il faut en croire Dawson, il en serait de mme des enfants en bas ge dans les tribus
739
739
C'est le cas des Gnanji; v. North. Tr., p. 170, p. 546; cf. un cas semblable, in BROUGH SMYTH, II, p. 269.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
219
qu'il a observes . Mais ce sont l des cas exceptionnels, vraisemblablement tardifs ; le dernier parat mme suspect et pourrait bien tre d une interprtation errone des faits .
740 741 742
Il est malais de dterminer l'ide que l'Australien se fait de l'me, tant elle est obscure et flottante, et l'on ne saurait s'en tonner. Si l'on demandait nos contemporains ceux mmes qui croient le plus fermement l'existence de l'me, de quelle manire ils se la reprsentent, les rponses que l'on obtiendrait n'auraient pas beaucoup plus de cohrence et de prcision. C'est qu'il s'agit d'une notion trs complexe, o entrent une multitude d'impressions mal analyses dont l'laboration s'est poursuivie pendant des sicles, sans que les hommes en aient eu une claire conscience. Voici pourtant les caractres les plus essentiels, souvent contradictoires d'ailleurs, par lesquels elle se dfinit. Dans un certain nombre de cas, on nous dit qu'elle a l'aspect extrieur du corps . Mais il arrive aussi qu'on se la reprsente comme de la grosseur d'un grain de sable ; elle aurait des dimensions tellement rduites qu'elle pourrait passer par les moindres crevasses et les plus petites fissures . Nous verrons qu'elle est, en mme temps, conue sous des espces animales. C'est dire que la forme en est essentiellement inconsistante et indtermine ; elle se modifie d'un instant l'autre au gr des circonstances, suivant les exigences du mythe et du rite. La substance dont elle est faite n'est pas moins indfinissable. Elle n'est pas sans matire puisqu'elle a une forme, si vague soit-elle. Et en effet, mme pendant cette vie, elle a des besoins physiques : elle mange, et inversement, elle peut tre mange. Il arrive qu'elle sort du corps et, au cours de ses voyages, elle se repat parfois d'mes trangres . Une fois qu'elle est compltement affranchie de l'organisme, elle est cense mener une vie tout fait analogue celle qu'elle menait sur cette terre : elle boit, mange, chasse, etc. Quand elle volette dans les
743 744 745 746 747
740 741
742
743 744 745 746 747
Australian Aborigines, p. 51. Il y eut certainement chez les Gnanji, un temps o les femmes avaient une me; car il existe encore aujourd'hui un grand nombre d'mes de femmes. Seulement, elles ne se rincarnent jamais; et comme, chez ce peuple, l'me qui anime un nouveau-n est une me ancienne qui se rincarne, du fait que les mes de femmes ne se rincarnent pas, il rsulte que les femmes ne peuvent avoir d'me. On peut, d'ailleurs, expliquer d'o vient cette absence de rincarnation. Chez les Gnanji, la filiation, aprs avoir t utrine, se fait aujourd'hui en ligne paternelle : la mre ne transmet pas son totem l'enfant. La femme n'a donc jamais de descendants qui la perptuent; elle est finis familiae suae. Pour expliquer cette situation, il n'y avait que deux hypothses possibles : ou bien les femmes n'ont pas d'mes, ou bien les mes de femmes sont dtruites aprs la mort. Les Gnanji ont adopt la premire de ces deux explications : certains peuples du Queensland ont prfr la seconde (v. ROTH, Superstition, Magie and Medecine, in N. Queensland Ethnog., no 5, 68). Les enfants au-dessous de quatre ou cinq ans, n'ont ni me ni vie future dit Dawson. Mais le fait que traduit ainsi Dawson, c'est tout simplement l'absence de rites funraires pour les enfants en bas ge. Nous en verrons plus loin la signification vritable. Dawson, p. 51 ; PARKER, The Euahlayi, p. 35 ; EYLMANN, p. 188. North. Tr., p. 542; SCHURMANN, The Aboriginal Tribes of Port Lincoln, in WOODS, p. 235. C'est l'expression employe par Dawson, p. 50. STREHLOW, I, p. 15 no 1 ; SCHULZE, loc. cit., p. 246. C'est le thme du mythe du vampire. STREHLOW, I, p. 15 ; SCHULZE, p. 244 ; Dawson, p. 51. Il est vrai qu'il est dit parfois des mes qu'elles n'ont rien de corporel : d'aprs certains tmoignages recueillis par Eylmann (p. 188), elles seraient ohne Fleisch und Blut. Mais ces ngations radicales nous laissent sceptique. Le fait qu'on ne fait pas d'offrande aux mes des morts n'implique nullement, comme le croit ROTH (Superstition, Magie, etc., 65) qu'elles ne mangent pas.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
220
branches des arbres, elle dtermine des bruissements et des craquements que peroivent mme les oreilles profanes . Mais en mme temps, elle passe pour tre invisible au vulgaire . Les magiciens, il est vrai, ou les vieillards ont la facult de voir les mes; mais c'est qu'en vertu de pouvoirs spciaux, qu'ils doivent ou l'ge ou une culture spciale, ils peroivent des choses qui chappent nos sens. Quant aux individus ordinaires, ils ne jouiraient, suivant Dawson, du mme privilge qu' un seul moment de leur existence : c'est quand ils sont la veille de mourir d'une mort prmature. Aussi, cette vision quasi miraculeuse est-elle considre comme un sinistre prsage. Or, l'invisibilit est gnralement regarde comme un des signes de la spiritualit. L'me est donc, dans une certaine mesure, conue comme immatrielle, puisqu'elle n'affecte pas les sens la manire des corps: elle n'a pas d'os, disent les tribus de la rivire Tully . Pour concilier tous ces caractres opposs, on se la reprsente comme faite d'une matire infiniment rare et subtile, comme quelque chose d'thr , comparable l'ombre ou au souffle .
748 749 750 751 752
Elle est distincte et indpendante du corps puisque, ds cette vie, elle en peut sortir momentanment. Elle le quitte pendant le sommeil, pendant l'vanouissement, etc. Elle peut mme en rester absente quelque temps, sans que la mort s'ensuive ; toutefois, pendant ces absences, la vie est amoindrie et elle s'arrte mme si l'me ne rentre pas au gte . Mais c'est surtout la mort que cette distinction et cette indpendance s'accusent avec le plus de nettet. Alors que le corps n'est plus, qu'il n'en reste plus de traces visibles, l'me continue vivre; elle mne, dans un monde part, une existence autonome.
753 754
Mais si relle que soit cette dualit, elle n'a rien d'absolu. Ce serait se mprendre que de se reprsenter le corps comme une sorte d'habitat dans lequel l'me rside, mais avec lequel elle n'a que des rapports extrieurs. Tout au contraire, elle lui est unie par les liens les plus troits; elle n'en est mme que malaisment et imparfaitement sparable Dj nous avons vu qu'elle en a, ou, tout au moins, qu'elle peut en prendre l'aspect extrieur. Par suite, tout ce qui atteint l'un atteint l'autre ; toute blessure du corps se propage jusqu' l'me . Elle est si intimement associe la vie de l'organisme qu'elle grandit avec lui et dprit avec lui. Voil pourquoi l'homme qui est parvenu un certain ge jouit de privilges qui sont refuss aux jeunes gens ; c'est que le principe religieux qui est en lui a pris plus de force et d'efficacit mesure qu'il avanait dans la vie. Mais, quand il y a snilit proprement dite, quand le vieillard est devenu incapable de jouer un rle utile dans les grandes crmonies religieuses o les intrts vitaux de la tribu sont en jeu, on ne lui tmoigne plus d'gards. On considre que la dbilit du corps s'est communique l'me. N'ayant plus les mmes pouvoirs, le sujet n'a plus droit au mme
755
748 749 750 751 752 753 754 755
ROTH, ibid., 65; North. Tr., p. 500. Il arrive ainsi que l'me dgage des odeurs (ROTH, ibid., 68). ROTH, ibid., 67; Dawson, p. 51. ROTH, ibid., 65. SCHRMANN, Aborig. Tr. of Port Lincoln, in WOODS, p. 235. PARKER, The Euahlayi, p. 29, 35; ROTH, ibid., 65, 67, 68. ROTH, Superstition, etc., 65; STREHLOW, I, p. 15. STREHLOW, I, p. 14, no 1. FRAZER, On Certain Burial Customs, as Illustrative of the Primitive Theory of the Soul, in J.A.I., XV, p. 66.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
221
prestige .
756
Il n'y a pas seulement entre l'me et le corps troite solidarit, mais partielle confusion. De mme qu'il y a quelque chose du corps dans l'me, puisqu'elle en reproduit parfois la forme, il y a quelque chose de l'me dans le corps. Certaines rgions, certains produits de l'organisme passent pour avoir avec elle une affinit toute spciale : c'est le coeur, le souffle, le placenta , le sang , l'ombre , le foie, la graisse du foie, les rognons , etc. Ces divers substrats matriels ne sont pas, pour l'me, de simples habitats ; ils sont l'me elle-mme vue du dehors. Quand le sang s'coule, l'me s'chappe avec lui. L'me n'est pas dans le souffle; elle est le souffle. Elle ne fait qu'un avec la partie du corps o elle rside. De l est venue la conception d'aprs laquelle l'homme a une pluralit d'mes. Disperse travers l'organisme, l'me s'est diffrencie et fragmente. Chaque organe a comme individualis la portion d'me qu'il contient et qui est ainsi devenue une entit distincte. Celle du cur ne saurait tre identique celle du souffle ou de l'ombre ou du placenta. Bien qu'elles soient toutes parentes, elles demandent pourtant tre distingues et portent mme des noms diffrents .
757 758 759 760 761
D'ailleurs, si l'me est plus particulirement localise sur certains points de l'organisme, elle n'est pas absente des autres. A des degrs divers, elle est diffuse dans le corps tout entier. C'est ce que montrent bien les rites mortuaires. Une fois que le dernier souffle est expir, que l'me est cense partie, il semble qu'elle devrait aussitt mettre profit la libert ainsi reconquise pour se mouvoir a sa guise et regagner le plus vite possible sa vraie patrie qui est ailleurs. Et cependant, elle reste auprs du cadavre; le lien qui l'y rattache S'est dtendu, il ne s'est pas bris. Il faut tout un appareil de rites spciaux pour la dterminer s'loigner dfinitivement. Par des gestes, par des mouvements significatifs, on l'invite partir . On lui fraye les voies, on lui mnage des issues afin qu'elle puisse s'envoler plus aisment . C'est qu'elle n'est pas sortie tout entire du corps; elle l'imprgnait trop profondment pour pouvoir s'en dgager d'un seul coup. De l vient le rite si frquent de l'anthropophagie funraire ; on consomme les chairs du mort parce qu'un principe sacr est cens y rsider qui n'est autre que l'me . Pour l'extirper dfinitivement, on fait fondre les chairs, en les soumettant soit la
762 763 764
756 757 758 759 760
761
762 763 764
C'est le cas chez les Kaitish et les Unmatjera. V. SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 506 et Nat. Tr., p. 512. BOTH, ibid., 65, 66, 67, 68. ROTH, ibid., 68 ; il est dit dans ce passage que, quand il y a vanouissement la suite d'une perte de sang, c'est que l'me est partie. Cf. PARKER, The Euahlayi, p. 38. PARKER, The Euahlayi, pp. 29 et 35 ; ROTH, ibid., 65. STREHLOW, I, pp. 12, 14. Il est parl dans ces diffrents passages de mauvais esprits qui tuent de petits enfants, dont ils mangent l'me, le foie et la graisse, ou bien l'me, le foie et les rognons. Le fait que l'me est ainsi mise sur le mme pied que des diffrents viscres ou tissus et constitue un aliment du mme genre montre bien l'troit rapport qu'elle soutient avec eux. Cf. Schulze, p. 246. Par exemple, chez les gens de la rivire Pennefather (ROTH, ibid., 68), il y a un nom pour l'me qui rside dans le cur (Ngai), un autre pour celle qui rside dans le placenta (Cho-i), un troisime pour celle qui se confond avec le souffle (Wanji). Chez les Euahlayi, il y a trois et jusqu' quatre mes (PARKER, The Euahlayi, p. 35). V. la description du rite de l'Urpmilchima, chez les Arunta (SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 503 et suiv.). SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 497 et 508. SPENCER et GILLEN, North. Tr., pp. 547, 548.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
222
chaleur du soleil soit l'action d'un feu artificiel . L'me s'en va avec les liquides qui s'coulent. Mais les ossements desschs en gardent encore quelque chose. Aussi les emploie-ton comme objets sacrs ou comme instruments magiques ; ou bien, si l'on veut mettre compltement en libert le principe qu'ils reclent, on les brise .
765 766 767 768
Un moment cependant arrive o la sparation dfinitive est consomme ; l'me libre prend son essor. Mais elle est, par nature, si intimement associe au corps, que cet arrachement ne va pas pour elle sans une grave transformation d'tat. Aussi prend elle alors un autre nom . Bien qu'elle garde tous les traits distinctifs de l'individu qu'elle animait, son humeur, ses qualits bonnes et mauvaises , cependant elle est devenue un tre nouveau. Ds lors, commence pour elle une nouvelle existence.
769 770
Elle se rend au pays des mes. Ce pays est diversement conu suivant les tribus ; on trouve mme parfois des conceptions diffrentes qui coexistent cte cte dans une mme socit. Tantt, il est situ sous terre, et chaque groupe totmique a le sien. C'est l'endroit o les premiers anctres, fondateurs du clan, se sont, un moment donn, enfoncs dans le sol et o ils sont venus vivre aprs leur mort. Il y a ainsi, dans le monde souterrain, une distribution gographique des morts qui correspond celle des vivants. L, brille un soleil perptuel; l coulent des rivires qui ne sont jamais sec. Telle est la conception que Spencer et Gillen attribuent aux tribus du centre, Arunta , Warramunga , etc. On la retrouve chez les Wotjobaluk . Ailleurs, tous les morts, quels que soient leurs totems passent pour vivre ensemble dans un mme lieu, plus ou moins vaguement localis, par del la mer, dans une le , ou sur les bords d'un lac . Parfois, enfin, c'est dans le ciel, au del des nuages, que sont censes se rendre les mes. L, dit Dawson, se trouve une magnifique contre, abondante en kangourous et en gibier de toute sorte, et o il est men joyeuse vie. Les mes s'y retrouvent et s'y reconnaissent . Il est vraisemblable que certains des traits dont est compos ce tableau
771 772 773 774 775 776
765 766 767 768 769
770 771 772 773 774
775 776
Ibid., p. 506, p. 527 et suiv. MEYER, The Encounter Bay Tribe, in WOODS, p. 198. SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 551, 463; Nat. Tr., p. 553. SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 540. Par exemple, chez les Arunta et chez les Loritja (STREHLOW, I, p. 15, no 2 ; II, p. 77). L'me, pendant la vie, s'appelle guruna et Llana aprs la mort. Le Ltana de Strehlow est identique l'ulthana de SPENCER et GILLEN (Nat. Tr., p. 514 et suiv.). De mme chez les gens de la rivire Bloomfield (ROTH, Superstition, etc., 66). EYLMANN, p. 188. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 524, 491, 496. SPENCER et GILLEN, North. Tr., pp. 542, 508. MATHEWS, Ethnol. Notes on the Aboriginal Tribes of N. S. Wales a. Victoria, in Journ. a. Proc. of the B. S. of N. S. Wales, XXXVIII, p. 287. STREHLOW, I, p. 15 et suiv. Ainsi, d'aprs Strehlow, chez les Arunta, les morts vivent dans une le; d'aprs Spencer et Gillen, dans un lieu souterrain. Il est probable que les deux mythes coexistent, et ils ne sont pas les seuls. Nous verrons qu'on en trouve mme un troisime. Sur cette conception de l'le des morts, cf. HOWITT, Nat. Tr., p. 498; SCHRMANN, Aborig. Tr. of Port Lincoln, in WOODS, p. 235; EYLMANN, p. 189. SCHULZE, p. 244. DAWSON, p. 51.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
223
ont t emprunts au paradis des missionnaires chrtiens ; mais l'ide que les mes, ou tout au moins que certaines mes vont au ciel aprs la mort, parat bien tre autochtone; car on la retrouve sur d'autres points du continents .
777 778
En gnral, toutes les mes ont le mme sort et mnent la mme vie. Cependant, il arrive qu'un traitement diffrent leur est appliqu selon la manire dont elles se sont conduites sur terre, et l'on voit apparatre comme un premier dessin de ces compartiments distincts et mme opposs entre lesquels se partagera plus tard le monde de l'au-del. Les mes de ceux qui, pendant leur vie, ont excell comme chasseurs, guerriers, danseurs, etc. ne sont pas confondues avec la foule des autres ; un lieu spcial leur est affect . Parfois, c'est le ciel . Strehlow rapporte mme que, d'aprs un mythe, les mes des mchants sont dvores par des esprits redouts, et ananties . Toutefois, ces conceptions restent toujours trs imprcises en Australie ; elles ne commencent prendre un peu de dtermination et de nettet que dans des socits plus avances comme celles d'Amrique .
779 780 781 782 783
II
.
Telles sont, sous leur forme la plus primitive, et ramenes leurs traits les plus essentiels, les croyances relatives la nature de l'me et sa destine. Il nous faut maintenant essayer d'en rendre compte. Qu'est-ce donc qui a pu amener l'homme penser qu'il y avait en lui deux tres, dont l'un possdait les caractres si spciaux qui viennent d'tre numrs ? Pour rpondre cette question, commenons par rechercher quelle origine le primitif lui-mme attribue au principe spirituel qu'il croit sentir en lui : bien analyse, sa propre conception nous mettra sur la voie de la solution. Suivant la mthode que nous nous efforons de pratiquer, nous tudierons les ides dont il s'agit dans un groupe dtermin de socits o elles ont t observes avec une prcision toute particulire : ce sont les tribus du centre australien. L'aire de notre observation, quoique tendue, sera donc limite. Mais il y a des raisons de croire que ces mmes ides, sous des formes diverses, sont ou ont t d'une grande gnralit, mme en dehors de l'Australie. De plus et surtout, la notion d'me n'est pas, dans ces tribus centrales, spcifiquement diffrente de
777 778 779 780 781 782 783
On trouve dans ces mmes tribus les traces videntes d'un mythe plus ancien, d'aprs lequel les mes vivaient dans un lieu souterrain (Dawson, Ibid.). TAPLIN, The Narrinyeri, pp. 18-19; HOWITT, Nat. Tr., p. 473; STREHLOW, I, p. 16. HOWITT, Nat. Tr., p. 498. STREHLOW, I, p. 16; EYLMANN, p. 189; HOWITT, Nat. Tr., p. 473. Ce sont les esprits des anctres d'un clan spcial, le clan de la poche venin (Giftdrsenmnner). Parfois l'action des missionnaires est manifeste. Dawson nous parle d'un vritable enfer oppos au paradis; lui mme tend voir dans cette conception une importation europenne. V. Dorsey, Siouan Cults, in XIth Rep., pp. 419-420, 422,485; et. MARILLIER, La survivance de l'me et l'ide de justice chez les peuples non civiliss, Rapport de l'cole des Hautes tudes, 1893.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
224
ce qu'elle est dans les autres socits australiennes ; elle a partout les mmes caractres essentiels. Comme un mme effet a toujours une mme cause, il y a lieu de penser que cette notion, partout identique elle-mme, ne rsulte pas, ici et l, d'lments diffrents. L'origine que nous serons amen lui attribuer par l'tude des tribus dont il va tre plus spcialement question, devra donc tre considre comme galement vraie des autres. Les premires nous fourniront l'occasion de faire, en quelque sorte, une exprience dont les rsultats, comme ceux de toute exprience bien faite, seront susceptibles d'tre gnraliss. L'homognit de la Civilisation australienne suffirait, elle seule, justifier cette gnralisation ; mais nous aurons soin de la confirmer ensuite au moyen de faits emprunts d'autres peuples tant d'Australie que d'Amrique. Comme les conceptions qui vont nous fournir la base de notre dmonstration ont t rapportes en des termes diffrents par Spencer et Gillen, d'une part, et par Strehlow, de l'autre, nous devons exposer successivement ces deux versions. On verra que, bien interprtes, elles diffrent dans la forme plus que dans le fond et qu'elles ont, en dfinitive, la mme signification sociologique. Suivant Spencer et Gillen, les mes qui, chaque gnration, viennent animer le corps des nouveau-ns ne sont pas le produit de crations spciales et originales ; toutes ces tribus admettraient qu'il existe un stock dfini d'mes, dont le nombre ne peut tre accru d'une unit et qui se rincarnent priodiquement. Quand un individu meurt, son me quitte le corps o elle rsidait, et une fois que le deuil est accompli, elle se rend au pays des mes ; mais, au bout d'un certain temps, elle revient s'incarner nouveau et ce sont ces rincarnations qui donnent lieu aux conceptions et aux naissances. Ces mes fondamentales, ce sont celles qui, l'origine mme des choses, animaient les anctres, fondateurs du clan. A une poque, au del de laquelle l'imagination ne remonte pas et qui est considre comme le premier commencement des temps, il existait des tres qui ne drivaient d'aucun autre. L'Arunta les appelle, pour cette raison, les Aljirangamitjina , les incrs, ceux qui sont de toute ternit, et, d'aprs Spencer et Gillen, il donnerait le nom d'Alcheringa la priode o ces tres fabuleux sont censs avoir vcu. Organiss en clans totmiques, tout comme les hommes d'aujourd'hui, ils passaient leur temps en voyages aux cours desquels ils accomplirent toute sorte d'actions prodigieuses dont les mythes perptuent le souvenir. Mais un moment vint o cette vie terrestre prit fin : isolment ou par groupes, ils s'enfoncrent dans le sol. Leurs corps se changrent en arbres ou en rocher que l'on voit encore aux endroits o ils passent pour avoir disparu sous terre. Mais leurs mes durent toujours ; elles sont immortelles. Elles continuent mme frquenter les lieux o s'est termine l'existence de leurs premiers htes. Ces lieux ont, d'ailleurs, en raison des souvenirs qui s'y rattachent, un caractre sacr ; c'est l que se trouvent les oknanikilla, ces sortes de sanctuaires o sont conservs les churinga du clan et qui sont comme les centres des diffrents cultes totmiques. Quand une des mes qui errent autour de l'un de ces sanctuaires
784 785 786
784 785 786
Elles peuvent se ddoubler provisoirement, comme nous verrons au chapitre suivant; mais ces ddoublements n'ajoutent pas une unit au nombre des mes susceptibles de se rincarner. STREHLOW, I, p. 2. Nat. Tr., p. 73, no 1.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
225
s'introduit dans le corps d'une femme, il en rsulte une conception et, plus tard, une naissance . Chaque individu est donc considr comme un nouvel avatar d'un anctre dtermin : il est cet anctre mme, rapparu dans un corps nouveau et sous de nouveaux traits. Or qu'taient ces anctres ?
787
Tout d'abord, ils taient dous de pouvoirs infiniment suprieurs ceux que possdent les hommes d'aujourd'hui, mme les vieillards les plus respects et les magiciens les plus rputs. On leur prte des vertus que nous pourrions qualifier de miraculeuses : Ils pouvaient voyager sur le sol, sous le sol, dans les airs : en s'ouvrant une veine, chacun d'eux pouvait inonder des rgions tout entires ou, au contraire, faire merger des terres nouvelles ; dans une muraille de rochers, ils faisaient apparatre un lac ou s'ouvrir une gorge qui leur servirait de passage ; l o ils plantaient leur nurtunja, des rocs ou des arbres sortaient de terre . Ce sont eux qui ont donn au sol la forme qu'il a prsentement. Ils ont cr toutes sortes d'tres, hommes ou animaux. Ce sont presque les dieux. Leurs mes ont donc galement un caractre divin. Et puisque les mes des hommes sont ces mes ancestrales rincarnes dans des corps humains, elles sont elles-mmes des tres sacrs.
788
En second lieu, ces anctres n'taient pas des hommes, au sens propre du mot, mais des animaux ou des vgtaux, ou bien des tres mixtes o l'lment animal ou vgtal prdominait : Les anctres qui vivaient dans ces temps fabuleux, disent Spencer et Gillen, taient, suivant l'opinion des indignes, si troitement associs avec les animaux et les plantes dont ils portaient le nom qu'un personnage de l'Alcheringa qui appartient au totem du kangourou, par exemple, est souvent reprsent dans les mythes comme un homme-kangourou on un kangourou-homme. Sa personnalit humaine est souvent absorbe par celle de la plante ou de l'animal dont il est cens descendu . Leurs mes, qui durent toujours, ont ncessairement la mme nature ; en elles aussi se marient l'lment humain et l'lment animal, avec une certaine tendance du second prdominer sur le premier. Elles sont donc faites de la mme substance que le principe totmique ; car nous savons que ce dernier a prcisment pour caractristique de prsenter ce double aspect, de synthtiser et de confondre en soi les deux rgnes.
789
Puisqu'il n'existe pas d'autres mes que celles-l, nous arrivons cette conclusion que l'me, d'une manire gnrale, n'est pas autre chose que le principe totmique, incarn dans chaque individu. Et il n'y a dans cette drivation rien qui puisse nous surprendre. Dj nous savons que ce principe est immanent chacun des membres du clan. Mais, en pntrant dans les individus, il est invitable qu'il s'individualise lui-mme. Parce que les consciences, dont il devient ainsi un lment intgrant, diffrent les unes des autres, il se diffrencie leur image; parce que chacune a sa physionomie propre, il prend, en chacune, une physionomie distincte. Sans doute, en lui-mme, il reste une force extrieure et trangre l'homme; mais la parcelle
787
788 789
V. sur cet ensemble de conceptions, SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 119, 123-127, 387 et suiv. ; North. Tr., pp. 145-174. Chez les Gnanji, ce n'est pas ncessairement auprs de l'oknanikilla qu'a lieu la conception. mais on croit que chaque couple est accompagn, dans ses prgrinations sur le continent, d'un essaim d'mes du totem du mari. Quand l'occasion est venue, l'une de ces mes pntre dans le corps de la femme et la fconde, o que celle-ci se trouve (North. Tr., p. 169). Nat. Tr., pp. 512-513. Cf. chap. X et XI. Ibid., p. 119.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
226
que chacun est cens en possder ne peut pas ne pas contracter d'troites affinits avec le sujet particulier en qui elle rside : elle participe de sa nature; elle devient sienne en quelque mesure. Elle a ainsi deux caractres contradictoires, mais dont la coexistence est un des traits distinctifs de la notion d'me. Aujourd'hui comme autrefois, l'me est, d'une part, ce qu'il y a de meilleur et de plus profond en nous-mmes, la partie minente de notre tre ; et pourtant, c'est aussi un hte de passage qui nous est venu du dehors, qui vit en nous une existence distincte de celle du corps, et qui doit reprendre un jour sa complte indpendance. En un mot, de mme que la socit n'existe que clans et par les individus, le principe totmique ne vit que dans et par les consciences individuelles dont l'association forme le clan. Si elles ne le sentaient pas en elles, il ne serait pas ; ce sont elles qui le mettent dans les choses. Il est donc ncessit se partager et se fragmenter entre elles. Chacun de ces fragments est une me. Un mythe que nous trouvons dans un assez grand nombre de socits du centre, et qui, d'ailleurs, n'est qu'une forme particulire des prcdents, montre mieux encore que telle est bien la matire dont est faite l'ide d'me. Dans ces tribus, la tradition met l'origine de chaque clan, non pas une pluralit d'anctres, mais deux seulement , ou mme un seul . Cet tre unique, tant qu'il resta ainsi solitaire, contenait en soi l'intgralit du principe totmique, puisque, ce moment, il n'existait encore rien quoi ce principe ait pu se communiquer. Or, suivant la mme tradition, toutes les mes humaines qui existent, et celles qui animent prsentement les corps des hommes et celles qui, actuellement inemployes, sont en rserve pour l'avenir, seraient issues de ce personnage unique ; elles seraient faites de sa substance. En se mouvant sur la surface du sol, en s'agitant, en se secouant, il les aurait fait sortir de son corps et les aurait semes dans les divers lieux qu'il passe pour avoir traverss. N'est-ce pas dire, sous une forme symbolique, que ce sont des parcelles de la divinit totmique ?
790 791
Mais cette conclusion suppose que les tribus dont il vient d'tre question admettent la doctrine de la rincarnation. Or, selon Strehlow, elle serait ignore des Arunta, c'est--dire de la socit que Spencer et Gillen ont le plus longtemps et le mieux tudie. Si, dans ce cas particulier, ces deux observateurs s'taient ce point mpris, tout l'ensemble de leur tmoignage devrait tre considr comme suspect. Il importe donc de dterminer la porte relle de cette divergence. D'aprs Strehlow, l'me, une fois dfinitivement affranchie du corps par les rites du deuil, ne se rincarnerait plus nouveau. Elle s'en irait l'le des morts, o elle passerait les jours dormir et les nuits danser, jusqu' ce qu'il ait plu sur la terre. A ce moment, elle reviendrait au milieu des vivants et jouerait le rle de gnie protecteur auprs des fils en bas ge, ou, leur dfaut, auprs des petits-fils que le mort a laisss derrire lui ; elle s'introduirait dans leurs corps et en faciliterait la croissance. Elle resterait ainsi, au milieu de son ancienne famille, pendant un an ou deux; aprs quoi, elle s'en retournerait au pays des mes. Mais, au bout d'un certain temps, elle le quitterait derechef pour revenir faire sur terre un nouveau sjour qui,
790 791
Chez les Kaitish (North. Tr., p. 154), chez les Urabunna (North. Tr., p. 146). C'est le cas chez les Warramunga et les tribus parentes, Walpari, Wulmala, Worgaia, Tjingilli (North. Tr., p. 161), et aussi chez les Urnbaia et les Gnanji (North. Tr., p. 170).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
227
d'ailleurs, serait le dernier. Un moment viendrait o elle serait oblige de reprendre, et, cette fois, sans esprit de retour, la toute de l'le des morts ; et l, aprs divers incidents dont il est inutile de rapporter le dtail, un orage surviendrait au cours duquel elle serait foudroye par un clair. Sa carrire serait, alors, dfinitivement termine .
792
Elle ne saurait donc se rincarner ; par suite, les conceptions et les naissances ne seraient pas dues la rincarnation d'mes qui, priodiquement, recommenceraient dans des corps nouveaux de nouvelles existences. Sans doute, Strehlow, tout comme Spencer et Gillen, dclare que, pour les Arunta, le commerce des sexes n'est aucunement la condition dterminante de la gnration ; celle-ci serait bien le produit d'oprations mystiques, mais diffrentes de celles que les prcdents observateurs nous avaient fait connatre. Elle aurait lieu par l'un ou l'autre des deux voies suivantes.
793
Partout o un anctre de l'Alcheringa est cens s'tre enfonc dans le sol, se trouve soit un rocher soit un arbre qui reprsente son corps. On appelle nanja, suivant Spencer et Gillen , ngarra, suivant Strehlow , l'arbre ou le rocher qui soutiennent ce rapport mystique avec le hros disparu. Parfois, c'est un trou d'eau qui passe pour s'tre form de cette faon. Or, sur chacun de ces arbres, de ces rochers, dans chacun de ces trous d'eau, vivent des embryons d'enfants, appels ratapa , qui appartiennent exactement au mme totem que l'anctre correspondant. Par exemple, sur un gommier qui reprsente un anctre du clan du Kangourou, se trouvent des ratapa qui ont tous le Kangourou pour totem. Qu'une femme vienne passer, et, si elle est de la classe matrimoniale laquelle doivent rgulirement appartenir les mres de ces ratapa , l'un d'eux pourra s'introduire en elle par la hanche. La femme est avertie de cette prise de possession par des douleurs caractristiques qui sont les premiers symptmes de la grossesse. L'enfant ainsi conu sera naturellement du mme totem que l'anctre sur le corps
794 795 796 797 798
792 793
794 795 796 797
798
STREHLOW, I, pp. 15-16. Pour les Loritja, v. STREHLOW, II, p. 7. STREHLOW va jusqu' dire que les relations sexuelles ne sont mme pas considres comme une condition ncessaire, une sorte de prparation la conception (II, p. 52, no 7). Il ajoute, il est vrai, quelques lignes plus bas, que les vieillards savent parfaitement quel rapport unit le commerce charnel et la gnration et que, pour ce qui regarde les animaux, les enfants eux-mmes sont au courant. Ce qui ne laisse pas d'affaiblir un peu la porte de sa premire affirmation. Nous employons, en gnral, la terminologie de Spencer et Gillen plutt que celle de Strehlow, parce que la premire est, ds prsent, consacre par un long usage. Nat. Tr., pp. 124, 513. I, p. 5. Ngarra, suivant STREHLOW, signifie ternel. Chez les Loritja, il n'y a que des rochers qui jouent ce rle. Strehlow traduit par Kinderkeime (germes d'enfants). Il s'en faut, d'ailleurs, que SPENCER et GILLEN aient ignor le mythe des ratapa et les coutumes qui s'y rattachent. Ils nous en parlent explicitement dans Nat. Tr., p. 366 et suiv. et p. 552. Ils signalent, sur diffrents points du territoire arunta, l'existence de rochers appels Erathipa, d'o se dgagent des spirit children, des mes d'enfants, qui s'introduisent dans le corps des femmes et les fcondent. Suivant SPENCER et GILLEN, EraIhipa signifierait enfant, quoique, ajoutent-ils, ce mot ne soit que rarement employ avec ce sens dans la conversation courante (ibid., p. 338). Les Arunta sont rpartis tantt en quatre, tantt en huit classes matrimoniales. La classe d'un enfant est dtermine par celle de son pre ; inversement, de la premire on peut dduire la seconde. (V. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p.70 et suiv.; STREHLOW, l, p. 6 et suiv.). Reste savoir comment le ratapa a une classe dtermine ; nous revenons plus loin sur ce point.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
228
mystique duquel il rsidait avant de s'incarner .
799
Dans d'autres cas, le procd employ est lgrement diffrent : c'est l'anctre lui-mme qui opre en personne. A un moment donn, il sort de sa retraite souterraine et lance sur une femme qui passe un petit churinga, d'une forme spciale, appel mamatuna . Le churinga pntre dans le corps de la femme et y prend une forme humaine tandis que l'anctre disparat nouveau dans le sol .
800 801
Ces deux modes de conception passent pour tre aussi frquents l'un que l'autre. C'est la forme du visage de l'enfant qui rvlerait la manire dont il a t conu: selon qu'il a la figure ou large ou allonge, on dit qu'il est d l'incarnation d'un ratapa ou d'un namatuna. Cependant, outre ces deux procds de fcondation, Strehlow en signale un troisime, mais qui passe pour tre beaucoup plus rare. L'anctre, aprs que son namatuna a pntr dans le corps de la femme, s'y introduirait lui-mme et se soumettrait volontairement une nouvelle naissance. La conception serait donc due cette fois une vritable rincarnation d'anctre. Seulement, le cas serait trs exceptionnel et, de plus, quand l'homme ainsi conu meurt, l'me ancestrale qui l'animait s'en irait, comme les mes ordinaires, l'le des morts o, aprs les dlais usuels, elle serait dfinitivement anantie. Elle ne subirait donc pas de nouvelles rincarnations .
802
Telle est la version de Strehlow . Dans la pense de cet auteur, elle s'opposerait radicalement celle de Spencer et Gillen. En ralit, elle n'en diffre que par la lettre des formules et des symboles, mais sous des variantes de forme, c'est, de part et d'autre, le mme thme mythique.
803
En premier lieu, tous ces observateurs sont d'accord pour voir dans toute conception le produit d'une incarnation. Seulement, suivant Strehlow, ce qui s'incarne, ce n'est pas une me, mais un ratapa ou un namatuna. Qu'est-ce donc qu'un ratapa ? C'est, dit Strehlow, un embryon complet, fait la fois d'une me et d'un corps. Mais l'me est toujours reprsente sous des formes matrielles ; elle dort, danse, chasse, mange, etc. Elle comprend donc, elle aussi, un lment corporel. Inversement, le ratapa n'est pas visible du vulgaire ; nul ne le voit, quand il s'introduit dans le corps de la femme ; c'est dire qu'il est fait d'une matire trs comparable celle de l'me. Ainsi, sous ce rapport, il ne semble pas qu'il soit possible de les diffrencier nettement l'un de l'autre. Ce sont, en dfinitive, des tres mythiques qui sont sensiblement conus d'aprs le mme modle. Schulze les appelle des mes d'enfants . De plus, tout comme
804 805
799 800 801 802 803 804
805
Strehlow, II, p. 52. Il arrive parfois, mais rarement, que des contestations s'lvent sur la nature du totem de l'enfant, Strehlow en cite un cas (p. 53). C'est le mme mot que namatwinna qu'on trouve chez SPENCER et GILLEN (Nat. Tr., p. 541). STREHLOW, II, p. 53. Ibid., II, p. 56. MATHEWS attribue aux Tjingilli (alias Chingalee) une thorie analogue de la conception (Proc. R. Gegor. Trans. and Soc. Queensland, XXII (1907), pp. 75-76). Il arrive parfois que l'anctre qui est cens avoir lanc le namatuna se montre la femme sous les espces d'un animal ou d'un homme; c'est une preuve de plus de l'affinit de l'me ancestrale pour une forme matrielle. SCHULZE, loc. cit., p. 237.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
229
l'me, le ratapa soutient, avec l'anctre dont l'arbre ou le rocher sacrs sont des formes matrialises, les relations les plus troites. Il est du mme totem que cet anctre, de la mme phratrie, de la mme classe matrimoniale . Sa place dans les cadres sociaux de la tribu est exactement celle que l'anctre est cens y avoir occupe autrefois. Il porte le mme nom . C'est la preuve que ces deux personnalits sont, pour le moins, trs proches parentes l'une de l'autre.
806 807
Il y a plus ; cette parent va jusqu' une complte identit. C'est en effet, sur le corps mystique de l'anctre que le ratapa s'est form ; il en vient ; il est comme une parcelle qui s'en serait dtache. C'est donc, en somme, quelque chose de l'anctre qui pntre dans le sein de la mre et qui devient l'enfant. Et ainsi nous revenons la conception de Spencer et Gillen : la naissance est due l'incarnation d'un personnage ancestral. Sans doute, ce n'est pas ce personnage tout entier qui s'incarne ; ce n'en est qu'une manation. Mais la diffrence est d'un intrt tout fait secondaire, puisque, quand un tre sacr se divise et se ddouble, il se retrouve, avec tous ses caractres essentiels, dans chacun des fragments entre lesquels il s'est partag. L'anctre de l'Alcheringa est donc, au fond, tout entier dans cet lment de lui-mme qui devient un ratapa .
808
Le second mode de conception, distingu par Strehlow, a la mme signification. Le churinga, en effet, et, spcialement, ce churinga particulier qu'on appelle le namatuna, est considr comme un avatar de l'anctre ; c'en est le corps, suivant Strehlow , tout comme l'arbre nanja. En d'autres termes, la personnalit de l'anctre, son churinga, son arbre nanja sont des choses sacres, qui inspirent les mmes sentiments et auxquelles on attribue la mme valeur religieuse. Aussi se transforment-elles les unes dans les autres : l o l'anctre a perdu un churinga, un arbre ou un rocher sacrs sont sortis de terre, tout comme aux endroits o il s'est lui-mme abm dans le sol . Il y a donc une quivalence mythique entre un personnage de l'Alcheringa et son churinga ; par suite, quand le premier lance un namatuna dans le corps d'une femme, c'est Comme S'il y pntrait lui-mme. En fait, nous avons vu qu'il s'y introduit parfois en personne la suite du namatuna ; d'aprs d'autres rcits, il l'y prcde; on dirait qui lui fraye la voie . Le fait que ces thmes coexistent dans un mme mythe achve de montrer
809 810 811
806
807 808
809
810 811
C'est ce qui rsulte de ce fait que le ratapa ne peut s'incarner que dans le corps d'une femme qui appartient la mme classe matrimoniale que la mre de l'anctre mythique. Aussi ne comprenons-nous pas comment STREHLOW a pu dire (I, p. 42. Anmerkung) que, sauf dans un cas, les mythes n'affectent pas les anctres de l'Alcheringa des classes matrimoniales dtermines. Sa propre thorie de la conception suppose tout le contraire (cf. 11, p. 53 et suiv.). STREHLOW, Il, p. 58. La diffrence entre les deux versions s'attnue encore et se rduit presque rien si l'on remarque que, quand SPENCER et GILLEN nous disent que l'me ancestrale s'incarne dans le corps de la femme, les expressions dont ils se servent ne doivent pas tre prises la lettre. Ce n'est pas l'me tout entire qui vient fconder la mre, mais seulement une manation de cette me. En effet, de leur aveu, une me, gale en pouvoirs et mme plutt suprieure celle qui s'est incarne, continue rsider dans l'arbre ou le rocher nanja (V. Nat. Tr., p. 514) ; nous aurons l'occasion de revenir sur ce point (et. plus bas, p. 393). II, p. 76, 81. Suivant SPENCER et GILLEN, le churinga serait non le corps de l'anctre, mais l'objet dans lequel rside l'me de ce dernier. Ces deux interprtations mythiques sont, au fond, identiques et on voit aisment comment on a pu passer de l'une l'autre ; le corps est le lieu o rside l'me. STREHLOW, I, p. 4. STREHLOW, I, pp. 53-54. Dans ces rcits, l'anctre commence par s'introduire lui-mme dans le sein
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
230
que l'un n'est qu'un doublet de l'autre. D'ailleurs, de quelque manire que la conception ait eu lieu, il n'est pas douteux que chaque individu est uni un anctre dtermin de l'Alcheringa, par des liens exceptionnellement intimes. D'abord, chaque homme a son anctre attitr ; deux personnes ne peuvent avoir simultanment le mme. Autrement dit, un tre de l'Alcheringa ne compte jamais qu'un seul reprsentant parmi les vivants . Il y a plus, l'un n'est qu'un aspect de l'autre. En effet, le churinga laiss par l'anctre exprime, comme nous le savons, sa personnalit ; si nous adoptons l'interprtation que rapporte Strehlow, et qui est peut-tre la plus satisfaisante, nous dirons que c'est son corps. Mais ce mme churinga est apparent de la mme manire l'individu qui est sens avoir t conu sous l'influence de l'anctre, c'est--dire qui est le fruit de ses oeuvres mystiques. Quand on introduit le jeune initi dans le sanctuaire du clan, on lui montre le churinga de son anctre en lui disant: Tu es ce corps ; tu es la mme chose que cela . Le churinga est donc, suivant l'expression mme de Strehlow, le corps commun de l'individu et de son anctre .
812 813 814
Pour qu'ils puissent avoir le mme corps, il faut que, par un ct tout au moins, leurs deux personnalits se confondent. C'est d'ailleurs ce que reconnat explicitement Strehlow : Par le tjutunga (churinga), dit-il, l'individu est uni son anctre personnel .
815
Il reste donc que, pour Strehlow comme pour Spencer et Gillen, il y a dans chaque nouveau-n un principe religieux, mystique, qui mane d'un anctre de l'Alcheringa. C'est ce principe qui fait l'essence de chaque individu ; c'en est donc l'me ou, en tout cas, l'me est faite de la mme matire et de la mme substance. Or, c'est uniquement sur ce fait fondamental que nous nous sommes appuy pour dterminer la nature et l'origine de l'ide d'me. Les mtaphores diffrentes au moyen desquelles il a pu tre exprim n'ont pour nous qu'un intrt tout fait secondaire .
816
Loin de contredire les donnes sur lesquelles repose notre thse, les rcentes observations de Strehlow nous apportent des preuves nouvelles qui la confirment. Notre raisonnement consistait infrer la nature totmique de l'me humaine d'aprs la nature totmique de l'me
de la femme et il y produit les troubles caractristiques de la grossesse. Puis il en sort et ne laisse qu'ensuite le namatuna. Strehlow, II, pp. 76. Ibid., p. 81. Voici la traduction mot mot des termes employs telle que nous la donne Strehlow : Dies du Krper bist; dies du der nmliche. Dans un mythe, un hros civilisateur, Mangarkunjerkunja, prsentant chaque homme le churinga de son anctre, lui dit : Tu es n de ce churinga (ibid., p. 76). STREHLOW, II, p. 76. STREHLOW, Ibid. Au fond, la seule divergence relle qu'il y ait entre Strehlow, d'une part, Spencer et Gillen, de l'autre, est la suivante. Pour ces derniers, l'me de l'individu, aprs la mort, revient l'arbre nanja o elle se confond nouveau avec l'me de l'anctre (Nat. Tr., p. 513); pour Strehlow, elle s'en va l'le des morts o elle finit par tre anantie. Dans un mythe comme dans l'autre, elle ne survit pas individuellement. Quant la cause de cette divergence, nous renonons la dterminer. Il est possible qu'il y ait eu une erreur d'observation commise par Spencer et Gillen qui ne nous parlent pas de l'le des morts. Il est possible aussi que le mythe ne soit pas le mme chez les Arunta de l'est que Spencer et Gillen ont surtout observs, et dans d'autres parties de la tribu.
812 813
814 815 816
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
231
ancestrale dont la premire est une manation et une sorte de rplique. Or, quelques-uns des faits nouveaux que nous devons Strehlow dmontrent, plus catgoriquement encore que ceux dont nous disposions jusqu'ici, ce caractre et de l'une et de l'autre. D'abord, tout comme Spencer et Gillen, Strehlow insiste sur les rapports intimes qui unissent chaque anctre un animal, une plante ou un autre objet naturel . Quelques-uns de ces Altjirangamitjina (ce sont les gens de l'Alcheringa de Spencer et Gillen), doivent, dit-il, s'tre directement manifests en qualit d'animaux ; d'autres prenaient la forme animale d'une manire passagre . Maintenant encore, il leur arrive sans cesse de se transformer en animaux . En tout cas, et quel que soit leur aspect extrieur, en chacun d'eux, les qualits propres et distinctives de l'animal ressortent avec vidence . Par exemple, les anctres du clan du Kangourou mangent de l'herbe comme des kangourous vritables et fuient devant le chasseur ; ceux du clan de l'mou courent et se nourrissent comme les mous , etc. Il y a plus : ceux des anctres qui avaient pour totem un vgtal sont devenus, leur mort, ce vgtal lui-mme ! D'ailleurs, cette troite parent de l'anctre et de l'tre totmique est si vivement sentie par l'indigne qu'elle affecte la terminologie. Chez les Arunta, l'enfant appelle altjira le totem de sa mre, qui lui sert de totem secondaire . Comme, primitivement, la filiation se faisait en ligne utrine, il y eut un temps oh chaque individu n'avait pas d'autre totem que celui de sa mre ; il est donc trs vraisemblable que ce terme d'altjira dsignait le totem proprement dit. Or il entre videmment dans la composition du mot qui signifie grand anctre, alljirangamitjina .
817 818 819 820 821 822
L'ide de totem et celle d'anctre sont mme si voisines l'une de l'autre que, parfois, on parat les confondre. Ainsi, aprs nous avoir parl du totem de la mre ou altjira, Strehlow ajoute : Cet altjira apparat aux noirs en rve et leur adresse des avertissements, de mme qu'il apporte des renseignements sur eux leurs amis endormis . Cet altjira qui parle, qui est attach personnellement chaque individu est videmment un anctre ; et pourtant, c'est aussi une incarnation du totem. Un texte de Roth o il est question d'invocations adresses au totem doit, sans doute, tre interprt dans ce sens . Il semble donc bien que le totem soit parfois reprsent dans les esprits sous la forme d'une collection d'tres idaux, de personnages mythiques qui sont plus ou moins indistincts des anctres. En un mot, les anctres, c'est le totem fragment .
823 824 825
Mais si l'anctre se confond ce point avec l'tre totmique, il n'en peut tre autrement de l'me individuelle qui tient de si prs l'me ancestrale. C'est, d'ailleurs, ce qui ressort galement des liens troits qui unissent chaque homme son churinga. Nous savons, en effet,
817 818 819 820 821 822 823 824 825
STREHLOW, II, p. 51. Ibid., Il, p. 56. Ibid., I, pp. 3-4. Ibid., Il, p. 61. V. plus haut, p. 261. STREHLOW, II, p. 57 et I, p. 2. STREHLOW, II, p. 57. ROTH, Superstition, Magie, etc., 74. En d'autres termes, l'espce totmique est beaucoup plus constitue par le groupe des anctres, par l'espce mythique, que par l'espce animale ou vgtale proprement dite.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
232
que le churinga exprime la personnalit de l'individu qui passe pour en tre n ; mais il exprime galement l'animal totmique. Quand le hros civilisateur. Mangarkunjerkunja, prsenta chacun des membres du clan du Kangourou son churinga personnel, il s'exprima en ces termes : Voil le corps d'un kangourou . Ainsi, le churinga est la fois le corps de l'anctre, de l'individu actuel et de l'animal totmique ; ces trois tres forment donc, suivant une forte et juste expression de Strehlow, une unit solidaire . Ce sont des termes en parties quivalents et substituables les uns aux autres. C'est dire qu'ils sont conus comme des aspects diffrents d'une seule et mme ralit, qui se dfinit galement par les attributs distinctifs du totem. C'est le principe totmique qui est leur commune essence. Le langage lui-mme exprime cette identit. Le mot de ratapa et, dans la langue des Loritja, celui de aratapi, dsignent l'embryon mythique qui se dtache de l'anctre et qui devient l'enfant ; or les mmes mots dsignent aussi le totem de ce mme enfant, tel qu'il est dtermin par l'endroit o la mre croit avoir conu .
826 827 828 829
III
.
Dans ce qui prcde, il est vrai, la doctrine de la rincarnation n'a t tudie que dans les tribus de l'Australie centrale ; on pourrait donc juger trop troites les bases sur lesquelles repose notre infrence. Mais d'abord, pour les raisons que nous avons exposes, l'exprience a une porte qui s'tend au del des socits que nous avons directement observes. De plus, les faits abondent qui tablissent que les mmes conceptions ou des conceptions analogues se rencontrent sur les points les plus divers de l'Australie ou y ont, tout au moins, laiss des traces apparentes. On les retrouve jusqu'en Amrique. Dans l'Australie mridionale, Howitt les signale chez les Dieri . Le mot de Mura-mura, que Gason traduisait par Bon-Esprit et oh il croyait voir exprime la croyance en un dieu crateur , est, en ralit, un nom collectif qui dsigne la multitude des anctres que le mythe place l'origine de la tribu. Ils continuent exister aujourd'hui comme autrefois. On croit qu'ils habitent dans des arbres qui, pour cette raison, sont sacrs . Certaines dispositions du sol, des rochers, des sources sont identifies avec ces Muramura qui, par consquent, ressemblent singulirement aux Altjirangamitjina des Arunta. Les Kurnai du Gippsland, bien qu'il n'existe plus chez eux que des vestiges de totmisme, croient galement en l'existence d'anctres appels Muk-Kurnai, et qu'ils conoivent comme des tres intermdiaires entre
830 831 832
826 827 828 829 830 831 832
V. plus haut, p. 363. STREHLOW, II, p. 76. STREHLOW, Ibid. STREHLOW, II, pp. 57, 60, 61. La liste des totems est appele par Strehlow la liste des ratapa. HOWITT, Nat. Tr., p. 475 et suiv. The Manners and Customs of the Dieyerie Tribe of Australian Aborigines, in Curr, II, p. 47. HOWITT, Nat. Tr., p. 482.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
233
l'homme et l'animal . Chez les Nimbaldi, Taplin a observ une thorie de la conception qui rappelle celle que Strehlow prte aux Arunta . Dans l'tat de Victoria, chez les Wotjobaluk, nous trouvons intgralement la croyance en la rincarnation. Les esprits des morts, dit Mathews, s'assemblent dans les miyur de leur clans respectifs ; ils en sortent pour natre nouveau sous forme humaine quand une occasion favorable se prsente . MATHEWS affirme mme que la croyance la rincarnation ou la transmigration des mes est fortement enracine dans toutes les tribus australiennes .
833 834 835 836 837
Si nous passons dans les rgions septentrionales, nous trouvons au nord-ouest, chez les Niol-Niol, la pure doctrine des Arunta : toute naissance est attribue l'incarnation d'une me prexistante qui s'introduit dans un corps de femme . Dans le Queensland du Nord, des mythes, qui ne diffrent des prcdents que dans la forme, traduisent exactement les mmes ides. Dans les tribus de la rivire Pennefather, on croit que tout homme a deux mes: l'une, appele ngai, rside dans le cur, l'autre, choi, reste dans le placenta. Aussitt aprs la naissance, le placenta est enterr en un lieu consacr. Un gnie particulier, nomm Anje-a, qui est prpos au phnomne de la procration, va recueillir ce choi et le conserve jusqu' ce que l'enfant, devenu adulte, se soit mari. Quand le moment est venu de lui donner un fils, Anje-a prlve une parcelle du choi de cet homme, l'insre dans l'embryon qu'il fabrique et qu'il introduit dans le sein de la mre. C'est donc avec l'me du pre qu'est faite celle de l'enfant. Il est vrai que celui-ci ne reoit pas tout d'abord l'intgralit de l'me paternelle, car le ngai continue rester dans le cur du pre tant que ce dernier est en vie. Mais quand il meurt, le ngai, libr, va, lui aussi, s'incarner dans le corps des enfants; il se rpartit galement entre eux s'il y en a plusieurs. Il y a ainsi une parfaite continuit spirituelle entre les gnrations ; c'est la mme me qui se transmet du pre aux enfants et de ceux-ci leurs enfants, et cette me unique, toujours identique elle-mme malgr ses divisions et ses subdivisions successives, c'est celle qui animait l'origine des choses le premier anctre . Entre cette thorie et celle des tribus du centre il n'y a qu'une seule diffrence de quelque importance; c'est qu'ici la rincarnation est luvre non des anctres eux-mmes, mais d'un gnie spcial, professionnellement prpos cette fonction. Mais il semble bien que ce gnie soit le produit d'un syncrtisme qui a fait fusionner en une seule et mme figure les figures multiples des premiers anctres. Ce qui rend cette hypothse au moins vraisemblable, c'est que le mot Anje-a et celui d'Anjir sont videmment trs proches parents; or le second dsigne le premier homme, l'anctre initial de qui tous les hommes seraient issus .
838 839 840
833 834 835 836 837 838 839
840
Ibid., p. 487. TAPLIN, Folklore, Customs, Manners, etc., of South Austral. Aborig., p. 88. Chaque clan d'anctre a, sous terre, son camp spcial; le miyur est ce camp. MATHEWS, in Journal of R. S. of N. S. Wales, XXXVIII, p. 293. MATHEWS signale la mme croyance dans d'autres tribus de Victoria (ibid., p. 197). MATHEWS, ibid., p. 349. J. Bishof, Die Niel-Niol, in Anthropos, III, p. 35. ROTH, Superstition, etc., 68; cf. 69 a, le cas semblable des indignes de la Rivire Proserpine. Pour simplifier l'expos, nous avons laiss de ct la complication qui tient la diffrence des sexes. L'me des filles est faite avec le choi de leur mre, tandis qu'elles partagent avec leurs frres le ngai de leur pre. Cette particularit, qui vient peut-tre de ce que les deux systmes de filiation ont t successivement en usage, n'atteint, pas d'ailleurs, le principe de la perptuit de l'me. Ibid., p. 16.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
234
Les mmes ides se retrouvent dans les tribus indiennes de l'Amrique. Chez les Tlinkit, dit Krause, les mes des trpasss passent pour revenir sur terre et pour s'introduire dans le corps des femmes enceintes de leur famille. Quand donc une femme, pendant sa grossesse, rve de quelque parent dcd, elle croit que l'me de ce dernier a pntr en elle. Si le nouveau-n prsente quelque signe caractristique qu'avait dj le dfunt, on considre qu'il est le dfunt lui-mme, revenu sur terre, et on lui donne le nom de ce dernier . Cette croyance est galement gnrale chez les Haida. C'est la shamane qui rvle quel est le parent qui s'est rincarn dans l'enfant et, par consquent, quel nom ce dernier doit porter . Chez les Kwakiutl, on croit que le dernier mort revient la vie dans la personne du premier enfant qui nat dans la famille . Il en est de mme chez les Hurons, les Iroquois, les Tinneh et dans beaucoup d'autres tribus des tats-Unis .
841 842 843 844
La gnralit de ces conceptions s'tend naturellement la conclusion que nous en avons dduite, c'est--dire l'explication que nous avons propose de l'ide de l'me. La porte gnrale en est, d'ailleurs, confirme par les faits suivants. Nous savons que chaque individu recle en lui quelque chose de la force anonyme qui est diffuse dans l'espce sacre ; il est, lui-mme, membre de cette espce. Mais ce n'est pas en tant qu'tre empirique et sensible ; car, en dpit des dessins et des signes symboliques dont il dcore son corps, il n'a, sous ce rapport, rien qui rappelle la forme d'un animal ou d'une plante. C'est donc qu'il existe en lui un autre tre en qui il ne laisse pas de se reconnatre, mais qu'il se reprsente sous les espces d'un animal ou d'un vgtal. N'est-il pas vident que ce double ne peut tre que l'me, puisque l'me est dj, par elle-mme, un double du sujet qu'elle anime ? Ce qui achve de justifier cette identification, c'est que les organes oh s'incarne plus minemment le fragment de principe totmique que contient chaque individu sont aussi ceux oh l'me rside. C'est le cas du sang. Il y a dans le sang quelque chose de la nature du totem, comme le prouve le rle qu'il joue dans les crmonies totmiques . Mais en mme temps, le sang est un des siges de l'me ; ou plutt c'est l'me mme vue du dehors. Quand le sang fuit, la vie s'coule et, du mme coup, l'me s'chappe. L'me se confond avec le principe sacr qui est immanent au sang.
845 846
D'un autre ct, si notre explication est fonde, le principe totmique, en pntrant, comme nous le supposons, dans l'individu, doit y garder une certaine autonomie puisqu'il est spcifiquement distinct du sui et en qui il s'incarne. Or c'est prcisment ce que Howitt dit avoir observ chez les Yuin : Que, dans ces tribus, dit-il, le totem soit conu comme constituant, en quelque manire, une partie de l'homme, c'est ce que prouve clairement le cas
841 842 843 844 845 846
Die Tlinkit-Indianer, p. 282. SWANTON, Contributions to the Ethnology of the Haida, p. 117 et suiv. Boas, Sixth Rep. of the Committee on the North-Western Tribes of Canada, p. 59. Lafitau, Moeurs des sauvages amricains, Il, p. 434; PETITOT, Monographie des Dn-Dindji, p. 59. V. plus haut, p. 190 et suiv. V. plus haut, p. 194.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
235
du nomm Umbara, dont j'ai dj parl. Celui-ci me raconta que, il y a de cela quelques annes, un individu du clan des lzards dentels (lace-lizards) lui envoya son totem tandis qu'il dormait. Le totem pntra dans la gorge du dormeur dont il mangea presque le totem, lequel rsidait dans la poitrine ; ce qui faillit dterminer la mort . Il est donc bien vrai que le totem se fragmente en s'individualisant et que chacune des parcelles qui se dtachent ainsi joue le rle d'un esprit, d'une me qui rside dans le corps .
847 848
Mais voici des faits plus directement dmonstratifs. Si l'me n'est que le principe totmique individualis, elle doit au moins dans certains cas, soutenir des rapports plus ou moins troits avec l'espce animale ou vgtale dont le totem reproduit la forme. Et en effet, Les GeaweGal (tribu de la Nouvelle-Galles du Sud) croient que chacun a en soi une affinit pour l'esprit de quelque oiseau, bte ou reptile. Non pas que l'individu soit cens tre descendu de cet animal; mais on estime qu'il y a une parent entre l'esprit qui anime l'homme et l'esprit de l'animal .
849
Il y a mme des cas o l'me passe pour maner immdiatement du vgtal ou de l'animal qui sert de totem. Chez les Arunta, d'aprs Strehlow, quand une femme a abondamment mang d'un fruit, on croit qu'elle donnera le jour un enfant qui aura ce fruit pour totem. Si, au moment o elle a senti les premiers tressaillements de l'enfant, elle regardait un kangourou, on croit qu'un ratapa de kangourou a pntr son corps et l'a fconde . H. Basedow a rapport le mme fait des Wogait . Nous savons, d'autre part, que le ratapa et l'me sont choses peu prs indistinctes. Or, on n'aurait pas pu attribuer l'me une telle origine, si l'on ne pensait pas qu'elle est faite de la mme substance que les animaux ou les vgtaux de l'espce totmique.
850 851
Aussi l'me est-elle souvent reprsente sous forme animale. On sait que, dans les socits infrieures, la mort n'est jamais considre comme un vnement naturel, d l'action de causes purement physiques ; on l'attribue gnralement aux malfices de quelque sorcier. Dans un grand nombre de tribus australiennes, pour dterminer quel est l'auteur responsable de ce meurtre, on part de ce principe que, cdant une sorte de ncessit, l'me du meurtrier vient invitablement visiter sa victime. C'est pourquoi on dispose le corps sur un chafaudage; puis, sous le cadavre et tout autour, on aplanit soigneusement la terre de manire ce que la moindre marque y devienne aisment perceptible. On revient le lendemain ; si, dans l'intervalle, un animal a pass par l, on en peut facilement reconnatre les traces. Leur forme rvle l'espce
847 848
849 850
851
Howitt, Nat. Tr., p. 147. Cf. ibid., p. 769. STREHLOW (I, p. 15, no 2), Schulze (loc. cit., p. 246) nous reprsentent l'me, comme Howitt nous reprsente ici le totem, sortant du corps pour aller manger une autre me. De mme, on a vu plus haut l'altjira ou totem maternel se manifester en rve ainsi qu'une me ou un esprit. Fison et HOWITT, Hurnai and Kamilaroi, p. 280. Globus, tome CXI, p. 289. Malgr des objections de Leonhardi, Strehlow a maintenu ses affirmations sur ce point (v. STREHLOW, III, P. Xi). Leonhardi trouve qu'il y a quelque contradiction entre cette assertion et la thorie d'aprs laquelle les ratapa manent d'arbres, de rochers, de churinga. Mais l'animal totmique incarne le totem tout comme l'arbre ou le rocher nanja; il peut donc jouer le mme rle. Ces diffrentes choses sont mythologiquement quivalentes. Notes on the West Coastal Tribes of the Northern Territory of S. Australia, in Trans. R. Soc. South Australia, XXXI (1907), p. 4. Cf. propos des tribus du district de Cairns (Queensland septentrional), Man, 1909, no 86.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
236
laquelle il appartient et, de l, on infre le groupe social dont fait partie le coupable. On dit que c'est un homme de telle classe ou de tel clan selon que l'animal est un totem de ce clan ou de cette classe. C'est donc que l'me est cense tre venue sous la figure de l'animal totmique.
852
Dans d'autres socits, o le totmisme est affaibli ou a disparu, l'me continue cependant tre pense sous forme animale. Les indignes du Cap Bedford (Queensland du Nord), croient que l'enfant, au moment oh il entre dans le corps de la mre, est un courlis si c'est une fille, un serpent si c'est un garon. Il ne prend qu'ensuite forme humaine . Beaucoup d'Indiens de l'Amrique du Nord, dit le prince de Wied, disent qu'ils ont un animal dans le corps . Les Bororo du Brsil se figurent leur me sous l'aspect d'un oiseau et, pour cette raison, ils croient tre des oiseaux de cette mme varit . Ailleurs, elle est conue comme un serpent, un lzard, une mouche, une abeille, etc. .
853 854 855 856
Mais c'est surtout aprs la mort que cette nature animale de l'me se manifeste. Pendant la vie, ce caractre est comme partiellement voil par la forme mme du corps humain. Mais, une fois que la mort l'a mise en libert, elle redevient elle-mme. Chez les Omaha, dans deux au moins des clans du buffle, on croit que les mes des morts s'en vont rejoindre les buffles, leurs anctres . Les Hopi sont diviss en un certain nombre de clans, dont les anctres taient des animaux ou des tres forme animale. Or, rapporte Schoolcraft, ils disent qu' la mort ils reprennent leur forme originelle ; chacun d'eux redevient un ours, un cerf, selon le clan auquel il appartient . Trs souvent, l'me passe pour se rincarner dans un corps d'animal . C'est de l trs vraisemblablement qu'est venue la doctrine, si rpandue, de la mtempsychose. Nous avons vu combien Tylor est embarrass pour en rendre compte . Si l'me est un principe essentiellement humain, quoi de plus singulier, en effet, que cette prdilection marque qu'elle
857 858 859 860
852
853 854 855 856 857 858 859
860
Chez les Wakelvura o, selon Curr et Howitt, chaque classe matrimoniale a ses totems propres, l'animal dit la classe (v. CURR, III, p. 28) ; chez les Buandik, il rvle le clan (Mrs. James S. SMITH, The Booandik Tribes of S. Austral. Aborigines, p. 128). Cf. HOWITT, On Some Austral. Beliefs, in J.A.I., XIII, p. 191 ; XIV, p. 362; THOMAS, An American View of Totemism, in Man, 1902, no 85 ; MATHEWS, Journal Of R. S. Of N. S. Wales, XXXVIII, pp. 347-348; BROUGH SMYTH, I, p. 110; SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 513. ROTH, Superstition, etc., 83. C'est probablement une forme de totmisme sexuel. Prinz ZU WIED, Reise in das innere Nord-Amerika, II, p. 190. K. von den STEINEN, Unter den Nalurvlkern Zentral-Brsiliens, 1894, pp. 511, 512. V. Frazer, Golden Bough 2, I, pp. 250, 253, 256, 257, 258. Third Rep., pp. 229, 233. Indian Tribes, IV, p. 86. Par exemple, chez les Batta de Sumatra (v. Golden Bough 2, III, p. 420), en Mlansie (CODRINGTON, The Melanesians, p. 178), dans l'archipel malais (TYLOR, Remarks on Totemism, in J.A.I., nouvelle srie, I, p. 147). On remarquera que les cas o l'me, aprs la mort, se prsente nettement sous forme animale sont emprunts des socits o le totmisme est plus ou moins entam. C'est que, l o les croyances totmiques sont relativement pures, l'ide d'me est forcment ambigu ; car le totmisme implique qu'elle participe la fois des deux rgnes. Elle ne peut se dterminer dans un sens ou dans l'autre d'une manire exclusive, mais prend tantt un aspect et tantt l'autre suivant les circonstances. Plus le totmisme rgresse, moins cette ambigut devient ncessaire, en mme temps que les esprits ressentent un plus vif besoin de distinction. Alors, les affinits si marques de l'me pour le rgne animal se font sentir, surtout aprs qu'elle est libre du corps humain. V. plus haut, p. 242. Sur la gnralit de la croyance la mtempsycose, v. Tylor, II, p. 8 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
237
manifeste, dans un si grand nombre de socits, pour la forme animale ? Tout s'explique, au contraire, si, par sa constitution mme, l'me est proche parente de l'animal : car alors, en revenant, aprs la vie, au monde de l'animalit, elle ne fait que retourner sa vritable nature. Ainsi, la gnralit de la croyance la mtempsychose est une nouvelle preuve que les lments constitutifs de l'ide d'me ont t principalement emprunts au rgne animal, comme le suppose la thorie que nous venons d'exposer.
IV
.
Ainsi la notion d'me est une application particulire des croyances relatives aux tres sacrs. Par l se trouve expliqu le caractre religieux que cette ide a prsent ds qu'elle est apparue dans l'histoire et qu'elle conserve encore aujourd'hui. L'me, en effet, a toujours t considre comme une chose sacre ; ce titre, elle s'oppose au corps qui, par lui-mme, est profane, Elle ne se distingue pas seulement de son enveloppe matrielle comme le dedans du dehors; on ne se la reprsente pas simplement comme faite d'une matire plus subtile, plus fluide ; mais, de plus, elle inspire quelque chose de ces sentiments qui sont partout rservs ce qui est divin. Si l'on n'en fait pas un dieu, on y voit du moins une tincelle de la divinit, Ce caractre essentiel serait inexplicable si l'ide d'me n'tait qu'une solution prscientifique apporte au problme du rve : car, comme il n'y a rien dans le rve qui puisse veiller l'motion religieuse, la cause par laquelle on en rend compte ne saurait tre d'une autre nature. Mais si l'me est une partie de la substance divine, elle reprsente en nous autre chose que nous-mmes ; si elle est faite de la mme matire mentale que les tres sacrs, il est naturel qu'elle soit l'objet des mmes sentiments. Et le caractre que l'homme s'attribue ainsi n'est pas le produit d'une pure illusion; tout comme la notion de force religieuse et de divinit, la notion d'me n'est pas sans ralit. Il est bien vrai que nous sommes forms de deux parties distinctes qui s'opposent l'une l'autre comme le profane au sacr, et l'on peut dire, en un sens, qu'il y a du divin en nous. Car la socit, cette source unique de tout ce qui est sacr, ne se borne pas nous mouvoir du dehors et nous affecter passagrement; elle s'organise en nous d'une manire durable. Elle y suscite tout un monde d'ides et de sentiments qui l'expriment, mais qui, en mme temps, font partie intgrante et permanente de nous-mmes. Quand l'Australien sort d'une crmonie religieuse, les reprsentations que la vie commune a veilles ou a rveilles en lui ne s'abolissent pas d'un seul coup. Les figures des grands anctres, les exploits hroques dont les rites commmorent le souvenir, les grandes choses de toutes sortes auxquelles le culte l'a fait participer, en un mot les idaux divers qu'il a labors collectivement continuent vivre dans sa conscience et, par les motions qui y sont attaches, par l'ascendant trs spcial qu'ils exercent, ils se distinguent nettement des impressions vulgaires qu'entretient en lui son commerce quotidien avec les choses extrieures. Les ides morales ont le mme caractre. C'est la socit qui les a graves
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
238
en nous, et, comme le respect qu'elle inspire se communique naturellement tout ce qui vient d'elle, les normes impratives de la conduite se trouvent, en raison de leur origine, investies d'une autorit et d'une dignit que n'ont pas nos autres tats intrieurs : aussi leur assignonsnous une place part dans l'ensemble de notre vie psychique. Bien que notre conscience morale fasse partie de notre conscience, nous ne nous sentons pas de plain-pied avec elle. Dans cette voix qui ne se fait entendre que pour nous donner des ordres et pour rendre des arrts, nous ne pouvons reconnatre notre voix ; le ton mme dont elle nous parle nous avertit qu'elle exprime en nous autre chose que nous. Voil ce qu'il y a d'objectif dans l'ide d'me : c'est que les reprsentations dont la trame constitue notre vie intrieure sont de deux espces diffrentes et irrductibles l'une l'autre. Les unes se rapportent au monde extrieur et matriel ; les autres, un monde idal auquel nous attribuons une supriorit morale sur le premier. Nous sommes donc rellement faits de deux tres qui sont orients en des sens divergents et presque contraires, et dont l'un exerce sur l'autre une vritable prminence. Tel est le sens profond de l'antithse que tous les peuples ont plus ou moins clairement conue entre le corps et l'me, entre l'tre sensible et l'tre spirituel qui coexistent en nous. Moralistes et prdicateurs ont souvent soutenu qu'on ne peut nier la ralit du devoir et son caractre sacr sans aboutir au matrialisme. Et en effet, si nous n'avions pas la notion des impratifs moraux et religieux , notre vie psychique serait nivele, tous nos tats de conscience seraient sur le mme plan et tout sentiment de dualit s'vanouirait. Sans doute, pour rendre cette dualit intelligible, il n'est nullement ncessaire d'imaginer, sous le nom d'me, une substance mystrieuse et irreprsentable qui s'opposerait au corps. Mais, ici comme quand il s'est agi de la notion du sacr, l'erreur porte sur la lettre du symbole employ, non sur la ralit du fait symbolis. Il reste vrai que notre nature est double ; il y a vraiment en nous une parcelle de divinit parce qu'il y a en nous une parcelle de ces grands idaux qui sont l'me de la collectivit.
861
L'me individuelle n'est donc qu'une portion de l'me collective du groupe ; c'est la force anonyme qui est la base du culte, mais incarne dans un individu dont elle pouse la personnalit ; c'est du mana individualis. Le rve a bien pu contribuer dterminer certains caractres secondaires de l'ide. L'inconsistance et l'instabilit des images qui occupent notre esprit pendant le sommeil, leur remarquable aptitude se transformer les unes dans les autres ont peut-tre fourni le modle de cette matire subtile, diaphane et protimorphe dont l'me passe pour tre faite. D'autre part, les faits de syncope, de catalepsie, etc. peuvent avoir suggr l'ide que l'me tait mobile et, ds cette vie, quittait temporairement le corps ; ce qui, par contre-coup, a servi expliquer certains rves. Mais toutes ces expriences et ces observations n'ont pu avoir qu'une influence accessoire et complmentaire dont il est mme difficile d'tablir
861
Si les reprsentations religieuses et morales constituent, croyons-nous, les lments essentiels de l'ide d'me, nous n'entendons pas dire cependant que ce soient les seuls. Autour de ce noyau central, d'autres tats de conscience viennent se grouper qui ont, quoique un moindre degr, le mme caractre. C'est le cas de toutes les formes suprieures de la vie intellectuelle, en raison du prix tout particulier et de la dignit que leur attribue la socit. Quand nous vivons de la vie de la science ou de l'art, nous avons l'impression de nous mouvoir dans un cercle de choses suprieures la sensation; c'est ce que nous aurons, d'ailleurs, l'occasion de montrer avec plus de prcision dans notre conclusion. C'est pourquoi les hautes fonctions de l'intelligence ont toujours t considres comme des manifestations spcifiques de l'activit de l'me. mais elles n'eussent vraisemblablement pas suffi en constituer la notion.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
239
l'existence. Ce qu'il y a de vraiment essentiel dans la notion vient d'ailleurs. Mais cette gense de l'ide d'me n'en mconnat-elle pas le caractre essentiel ? Si l'me n'est qu'une forme particulire du principe impersonnel qui est diffus dans le groupe, dans l'espce totmique et dans les choses de toutes sortes qui y sont rattaches, elle est elle-mme impersonnelle sa base. Elle doit donc avoir, des diffrences de degrs prs, les mmes proprits que la force dont elle n'est qu'un mode spcial, et notamment la mme diffusion, la mme aptitude se rpandre contagieusement, la mme ubiquit. Or, tout au contraire, on se reprsente volontiers l'me comme un tre concret, dfini, tout entier ramass sur lui-mme et incommunicable aux autres ; on en fait la base de notre personnalit. Mais cette manire de concevoir l'me est le produit d'une laboration tardive et philosophique. La reprsentation populaire, telle qu'elle s'est spontanment dgage de l'exprience commune, est trs diffrente, surtout l'origine. Pour l'Australien, l'me est une trs vague entit, aux formes indcises et flottantes, rpandue dans tout l'organisme. Bien qu'elle se manifeste plus spcialement sur certains points, il n'en est peut-tre pas d'o elle soit totalement absente. Elle a donc une diffusion, une contagiosit, une omniprsence comparables celles du mana. Comme le mana, elle peut se diviser et se ddoubler l'infini, tout en restant tout entire dans chacune de ses parties ; c'est de ces divisions et de ces ddoublements que rsulte la pluralit des mes. D'autre part, la doctrine de la rincarnation, dont nous avons tabli la gnralit, montre tout ce qu'il entre d'lments impersonnels dans l'ide d'me et combien ils sont essentiels. Car pour qu'une mme me puisse revtir une personnalit nouvelle chaque gnration, il faut que les formes individuelles dans lesquelles elle s'enveloppe successivement lui soient toutes galement extrieures et ne tiennent pas sa nature vraie. C'est une sorte de substance gnrique qui ne s'individualise que secondairement et superficiellement. Il s'en faut, d'ailleurs, que cette conception de l'me ait totalement disparu. Le culte des reliques dmontre que, aujourd'hui encore, pour la foule des croyants, l'me d'un saint continue adhrer ses divers ossements, avec tous ses pouvoirs essentiels ; ce qui implique qu'on se la reprsente comme capable de se diffuser, de se subdiviser, de s'incorporer simultanment toute sorte de choses diffrentes. De mme qu'on retrouve dans l'me les attributs caractristiques du mana, des changements secondaires et superficiels suffisent pour que du mana s'individualise sous forme d'me. On passe de la premire ide la seconde sans solution de continuit. Toute force religieuse qui est attache, d'une manire attitre, un tre dtermin, participe des caractres de cet tre, prend sa physionomie, devient son double spirituel. Tregear, dans son dictionnaire Maori-Polynsien a cru pouvoir rapprocher du mot mana tout un groupe d'autres mots, comme manawa, manamana, etc., qui paraissent tre de la mme famille et qui signifient cur, vie, conscience. N'est-ce pas dire qu'il doit exister galement quelque rapport de parent entre les ides correspondantes, c'est--dire entre les notions de pouvoir impersonnel, et celles de vie intrieure, de force mentale, en un mot, d'me ? Voil pourquoi la question de savoir si le churinga est sacr parce qu'il sert d'habitat une me, comme le croient Spencer et Gillen, ou parce qu'il possde des vertus impersonnelles, comme le pense Strehlow, nous parat de peu d'intrt et sans porte sociologique. Que l'efficacit d'un objet sacr soit reprsente dans les
862
862
F. TREGEAR, The Maori-Polynesian Comparative Dictionary, pp. 203-205.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
240
esprits sous forme abstraite ou attribue quelque agent personnel, cela n'importe pas au fond des choses. Les racines psychologiques de l'une et de l'autre croyance sont identiquement les mmes : une chose est sacre parce qu'elle inspire, un titre quelconque, un sentiment collectif de respect qui la soustrait aux atteintes profanes. Pour s'expliquer ce sentiment, les hommes le rapportent tantt une cause vague et imprcise, tantt un tre spirituel dtermin, dot d'un nom et d'une histoire ; mais ces interprtations diffrentes se surajoutent un processus fondamental qui est le mme dans les deux cas. C'est d'ailleurs, ce qui explique les singulires confusions dont nous avons, chemin faisant, rencontr des exemples. L'individu, l'me d'anctre qu'il rincarne ou dont la sienne est une manation, son churinga, les animaux de l'espce totmique, sont, disions-nous, choses partiellement quivalentes et substituables les unes aux autres. C'est que, sous de certains rapports, elles affectent toutes la conscience collective de la mme manire. Si le churinga est sacr, c'est cause des sentiments collectifs de respect qu'inspire l'emblme totmique, grav sur sa surface ; or le mme sentiment s'attache aux animaux ou aux plantes dont le totem reproduit la forme extrieure, l'me de l'individu puisqu'elle est elle-mme pense sous les espces de l'tre totmique, et enfin l'me ancestrale dont la prcdente n'est qu'un aspect particulier. Ainsi tous ces objets divers, rels ou idaux, ont un ct commun par o ils suscitent dans les consciences un mme tat affectif, et, par l, ils se confondent. Dans la mesure o ils sont exprimes par une seule et mme reprsentation, ils sont indistincts. Voil comment l'Arunta a pu tre amen voir dans le churinga le corps commun de l'individu, de l'anctre, et mme de l'tre totmique. C'est une manire de s'exprimer lui-mme l'identit des sentiments dont ces diffrentes choses sont l'objet. Toutefois, de ce que l'ide d'me drive de l'ide de mana, il ne suit nullement que la premire soit d'une origine relativement tardive ni qu'il ait en une poque de l'histoire oh les hommes n'auraient connu les forces religieuses que sous leurs formes impersonnelles. Quand, par le mot de pranimisme, on entend dsigner une priode historique pendant laquelle l'animisme aurait t totalement ignor, on fait une hypothse arbitraire ; car il n'y a pas de peuple o l'ide d'me et l'ide de mana ne coexistent. On n'est donc pas fond supposer qu'elles se sont formes en deux temps distincts ; mais tout prouve qu'elles sont sensiblement contemporaines. De mme qu'il n'existe pas de socits sans individus, les forces impersonnelles qui se dgagent de la collectivit ne peuvent se constituer sans s'incarner dans des consciences individuelles o elles s'individualisent elles-mmes. En ralit il n'y a pas l deux processus diffrents, mais deux aspects diffrents d'un seul et mme processus. Il est vrai qu'ils n'ont pas une gale importance : l'un d'eux est plus essentiel que l'autre. L'ide de mana ne suppose pas l'ide d'me ; car pour que le mana puisse s'individualiser et se fragmenter en mes particulires, il faut d'abord qu'il soit, et ce qu'il est en lui-mme ne dpend pas des formes qu'il prend en s'individualisant. Au contraire, l'ide d'me ne peut se comprendre que par rapport l'ide de mana. A ce titre, on peut bien dire qu'elle est due une formation secondaire ; mais il s'agit d'une formation secondaire au sens logique, et non chronologique du mot.
863
863
C'est la thse de Preuss dans les articles du Globus que nous avons plusieurs fois cits. Il semble que M. LVY-BRUHL tend lui aussi vers la mme conception (v. Fonctions mentales, etc., pp. 92-93).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
241
V
.
Mais d'o vient que les hommes ont cru que l'me survivait au corps et pouvait mme lui survivre pendant un temps indfini ? De l'analyse laquelle nous avons procd, il rsulte que la croyance l'immortalit ne s'est nullement constitue sous l'influence d'ides morales. L'homme n'a pas imagin de prolonger son existence au del du tombeau afin qu'une juste rtribution des actes moraux pt tre assure dans une autre vie, dfaut de celle-ci ; car nous avons vu que toute considration de ce genre tait trangre la primitive conception de l'au-del. On ne peut davantage s'arrter l'hypothse d'aprs laquelle l'autre vie aurait t conue comme un moyen d'chapper la perspective angoissante de l'anantissement. D'abord, il s'en faut que le besoin de survie personnelle ait t si vif l'origine. Le primitif accepte gnralement l'ide de la mort avec une sorte d'indiffrence, Dress tenir peu de compte de son individualit, habitu exposer sans cesse sa vie, il y renonce assez facilement . De plus, l'immortalit qui lui est promise par les religions qu'il pratique n'a rien de personnel. Dans un grand nombre de cas, l'me n continue pas ou ne continue pas longtemps la personnalit du dfunt, puisque, oublieuse de son existence antrieure, elle s'en va, au bout de quelque temps, animer d'autres corps et devient ainsi le principe vivifiant de personnalits nouvelles. Mme chez des peuples plus avancs, ce n'tait pas la ple et triste existence que les ombres menaient dans la Scheol ou dans l'Erbe, qui pouvait attnuer les regrets que laissait le souvenir de la vie perdue.
864
Une explication plus satisfaisante est celle qui rattache la conception d'une vie posthume aux expriences du rve. Nos parents, nos amis morts nous rapparaissent en song : nous les voyons agir ; nous les entendons parler ; il tait naturel d'en conclure qu'ils continuent exister. Mais si ces observations ont pu servir confirmer l'ide, une fois qu'elle fut ne, elles ne semblent pas de nature l'avoir suscite de toutes pices. Les rves o nous voyons revivre des personnes disparues sont trop rares, trop courts et ne laissent d'eux-mmes que des souvenirs trop vagues pour avoir, eux seuls, suggr aux hommes un aussi important systme de croyances. Il y a une disproportion marque entre l'effet et la cause laquelle il est attribu. Ce qui rend la question embarrassante, c'est que, par elle-mme, la notion d'me n'impliquait pas l'ide de survie, mais semblait plutt l'exclure. Nous avons vu, en effet, que l'me, tout en tant distingue du corps, passe pourtant pour en tre troitement solidaire : elle vieillit quand il vieillit; elle subit le contre-coup de toutes les maladies qui l'atteignent ; il devait donc paratre naturel qu'elle mourt avec lui. Tout au moins, on aurait d croire qu'elle cessait d'exister, partir du moment o il avait dfinitivement perdu sa forme premire o il ne restait
864
V. sur ce point notre Suicide, p. 233 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
242
plus rien de ce qu'il avait t. Cependant, c'est juste partir de ce moment que s'ouvre pour elle une vie nouvelle. Les mythes que nous avons prcdemment rapports nous fournissent la seule explication qui puisse tre donne de cette croyance. Nous avons vu que les mes des nouveau-ns taient ou des manations d'mes ancestrales ou ces mes mmes rincarnes. Mais pour qu'elles pussent soit se rincarner soit dgager priodiquement des manations nouvelles, il fallait qu'elles survcussent leurs premiers dtenteurs. Il semble donc bien qu'on ait admis la survie des morts pour pouvoir expliquer la naissance des vivants. Le primitif n'a pas l'ide d'un dieu tout-puissant qui tire les mes du nant. Il lui semble qu'on ne peut faire des mes qu'avec des mes. Celles qui naissent ne peuvent donc tre que des formes nouvelles de celles qui ont t ; par suite, il faut que celles-ci continuent tre pour que d'autres puissent se former. En dfinitive, la croyance l'immortalit des mes est la seule manire dont l'homme puisse alors s'expliquer lui-mme un fait qui ne peut pas ne pas frapper son attention; c'est la perptuit de la vie du groupe. Les individus meurent; mais le clan survit. Les forces qui font sa vie doivent donc avoir la mme perptuit. Or ces forces, ce sont les mes qui animent les corps individuels ; car c'est en elles et par elles que le groupe se ralise. Pour cette raison, il faut qu'elles durent. Il est mme ncessaire qu'en durant elles restent identiques elles-mmes; car, comme le clan garde toujours sa physionomie caractristique, la substance spirituelle dont il est fait doit tre conue comme qualitativement invariable. Puisque c'est toujours le mme clan avec le mme principe totmique il faut que ce soient les mmes mes, les mes n'tant que le principe totmique fragment et particularis. Il y a ainsi comme un plasma germinatif, d'ordre mystique, qui se transmet de gnration en gnration et qui fait ou, du moins, qui est cens faire l'unit spirituelle du clan travers la dure. Et cette croyance, malgr son caractre symbolique, n'est pas sans vrit objective. Car si le groupe n'est pas immortel au sens absolu du mot, il est vrai cependant qu'il dure pardessus les individus et qu'il renat et se rincarne chaque gnration nouvelle. Un fait confirme cette interprtation. Nous avons vu que, d'aprs le tmoignage de Strehlow, les Arunta distinguent deux sortes d'mes : il y a, d'une part, celles des anctres de l'Alcheringa, et, de l'autre, celles des individus qui, chaque moment de l'histoire, composent rellement l'effectif de la tribu. Les secondes ne survivent au corps que pendant un temps assez court ; elles ne tardent pas tre totalement ananties. Seules, les premires sont immortelles ; de mme qu'elles sont incres, elles ne prissent pas. Or, il est remarquable que ce sont aussi les seules dont l'immortalit soit ncessaire pour expliquer la permanence du groupe ; car c'est elles et elles seules qu'incombe la fonction d'assurer la perptuit du clan, puisque toute conception est leur oeuvre. Les autres n'ont, sous ce rapport, aucun rle jouer. Les mes ne sont donc dites immortelles que dans la mesure o cette immortalit est utile pour rendre intelligible la continuit de la vie collective. Ainsi, les causes qui suscitrent les premires croyances relatives une autre vie furent sans rapports avec les fonctions que les institutions d'outre-tombe devaient remplir plus tard. Mais une fois nes, elles furent vite utilises pour des fins diffrentes de celles qui avaient t leurs premires raisons d'tre. Ds les socits australiennes, nous les voyons qui commencent s'organiser dans ce but. D'ailleurs, elles n'eurent pas besoin pour cela de subir des transfor-
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
243
mations fondamentales. Tant il est vrai qu'une mme institution sociale peut, sans changer de nature, remplir successivement des fonctions diffrentes!
VI
.
L'ide d'me a t pendant longtemps et reste encore en partie la forme populaire de l'ide de personnalit . La gense de la premire de ces ides doit donc nous aider comprendre comment la seconde s'est constitue.
865
Il ressort de ce qui prcde que la notion de personne est le produit de deux sortes de facteurs. L'un est essentiellement impersonnel : c'est le principe spirituel qui sert d'me la collectivit. C'est lui, en effet, qui constitue la substance mme des mes individuelles. Or il n'est la chose de personne en particulier : il fait partie du patrimoine collectif ; en lui et par lui, toutes les consciences communient. Mais d'un autre ct, pour qu'il y ait des personnelits spares, il faut qu'un autre facteur intervienne qui fragmente ce principe et qui le diffrencie : en d'autres termes, il faut un facteur d'individuation. C'est le corps qui joue ce rle. Comme les corps sont distincts les uns des autres, comme ils occupent des points diffrents du temps et de l'espace, chacun d'eux constitue un milieu spcial o les reprsentations collectives viennent se rfracter et se colorer diffremment. Il en rsulte que, si toutes les consciences engages dans ces corps ont vue sur le mme monde, savoir que le monde d'ides et de sentiments qui font l'unit morale du groupe, elles ne le voient pas toutes sous le mme angle ; chacune l'exprime sa faon. De ces deux facteurs, galement indispensables, le premier n'est certes pas le moins important ; car c'est lui qui fournit la matire premire de l'ide d'me. On sera peut-tre tonn de voir attribuer un rle aussi considrable l'lment impersonnel dans la gense de la notion de personnalit. Mais l'analyse philosophique de l'ide de personne, qui a devanc, et de beaucoup, l'analyse sociologique, est arrive sur ce point des rsultats analogues. Entre tous les philosophes, Leibniz est un de ceux qui ont eu le plus vif sentiment de ce qu'est la personnalit ; car la monade est, avant tout, un tre personnel et autonome. Et cependant, pour Leibniz, le contenu de toutes les monades est identique, Toutes, en effet, sont des consciences qui expriment un seul et mme objet, le monde ; et comme le monde lui-mme n'est qu'un
865
On objectera peut-tre que l'unit est la caractristique de la personnalit, alors que l'me a toujours t conue comme multiple, comme susceptible de se diviser et de se subdiviser presque l'infini. Mais nous savons aujourd'hui que l'unit de la personne est galement faite de parties, qu'elle est, elle aussi, susceptible de se diviser et de se dcomposer. Cependant, la notion de personnalit ne s'vanouit pas par cela seul que nous avons cess de la concevoir sous la forme d'un atome mtaphysique et indivisible. Il en est de mme de ces conceptions populaires de la personnalit qui ont trouv leur expression dans l'ide d'me. Elles montrent que les peuples ont toujours eu le sentiment que la personne humaine n'avait pas cette unit absolue que lui ont prte certains mtaphysiciens.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
244
systme de reprsentations, chaque conscience particulire n'est, en somme, qu'un reflet de la conscience universelle. Seulement, chacune l'exprime de son point de vue et sa manire, On sait comment cette diffrence de perspectives vient de ce que les monades sont diversement situes les unes par rapport aux autres et par rapport au systme total qu'elles constituent. Sous une autre forme, Kant exprime le mme sentiment. Pour lui, la clef de vote de la personnalit est la volont. Or, la volont est la facult d'agir conformment la raison, et la raison est ce qu'il y a de plus impersonnel en nous. Car la raison n'est pas ma raison ; c'est la raison humaine en gnral. Elle est le pouvoir qu'a l'esprit de s'lever, au-dessus du particulier, du contingent, de l'individuel, pour penser sous la forme de l'universel. On peut donc dire, de ce point de vue, que ce qui fait de l'homme une personne, c'est ce par quoi il se confond avec les autres hommes, ce qui fait de lui un homme, et non tel homme. Le sens, le corps, en un mot tout ce qui individualise, est, au contraire, considr par Kant comme l'antagoniste de la personnalit. C'est que l'individuation n'est pas la caractristique essentielle de la personne. Une personne, ce n'est pas seulement un sujet singulier, qui se distingue de tous les autres. C'est, en outre et surtout, un tre auquel est attribue une autonomie relative par rapport au milieu avec lequel il est le plus immdiatement en contact. On se le reprsente comme capable, dans une certaine mesure, de se mouvoir de lui-mme : c'est ce que Leibniz exprimait d'une manire outrancire, en disant de la monade qu'elle est compltement ferme au dehors. Or notre analyse permet de concevoir comment s'est forme cette conception et quoi elle rpond. L'me, en effet, expression symbolique de la personnalit, a ce mme caractre. Bien qu'troitement unie au corps, elle passe pour en tre profondment distincte et pour jouir, par rapport lui, d'une large indpendance. Pendant la vie, elle peut le quitter temporairement et elle s'en retire dfinitivement la mort. Bien loin qu'elle en dpende, elle le domine de la dignit plus haute qui est en elle. Elle peut bien lui emprunter la forme extrieure sous laquelle elle s'individualise, mais elle ne lui doit rien d'essentiel. Or, cette autonomie que tous les peuples ont prte l'me n'est pas purement illusoire et nous savons maintenant quel en est le fondement objectif. Il est bien vrai que les lments qui servent former l'ide d'me et ceux qui entrent dans la reprsentation du corps proviennent de deux sources diffrentes et indpendantes l'une de l'autre. Les uns sont faits des impressions et des images qui se dgagent de tous les points de l'organisme; les autres consistent en ides et en sentiments qui viennent de la socit et qui l'expriment. Les premiers ne drivent donc pas des seconds. Ainsi, il y a rellement une partie de nous-mmes qui n'est place sous la dpendance immdiate du facteur organique : c'est tout ce qui, en nous, reprsente la socit. Les ides gnrales que la religion ou la science gravent dans nos esprits, les oprations mentales que ces ides supposent, les croyances et les sentiments qui sont la base de notre vie morale, toutes ces formes suprieures de l'activit psychique que la socit veille et dveloppe en nous ne sont pas la remorque du corps, comme nos sensations et nos tats cnesthsiques. C'est que, comme nous l'avons montr, le monde des reprsentations dans lequel se droule la vie sociale se surajoute son substrat matriel, bien loin qu'il en provienne : le dterminisme qui y rgne est donc beaucoup plus
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
245
souple que celui qui a ses racines dans la constitution de nos tissus et il laisse l'agent une impression justifie de plus grande libert. Le milieu dans lequel nous nous mouvons ainsi a quelque chose de moins opaque et de moins rsistant : nous nous y sentons et nous y sommes plus l'aise. En un mot, le seul moyen que nous ayons de nous librer des forces physiques est de leur opposer les forces collectives. Mais ce que nous tenons de la socit nous est commun avec nos compagnons. Il s'en faut donc que nous soyons d'autant plus personnels que nous sommes plus individualiss. Les deux termes ne sont nullement synonymes : en un sens, ils s'opposent plus qu'ils ne s'impliquent. La passion individualise et, pourtant, elle asservit. Nos sensations sont essentiellement individuelles ; mais nous sommes d'autant plus des personnes que nous sommes plus affranchis des sens, plus capables de penser et d'agir par concepts. Ceux donc qui insistent sur tout ce qu'il y a de social dans l'individu n'entendent pas, pour cela, nier ou rabaisser la personnalit. Ils se refusent seulement la confondre avec le fait de l'individuation .
866
866
Nous ne nions pas, pour cela, l'importance du facteur individuel: il s'explique, de notre point de vue, tout aussi aisment que son contraire. Si l'lment essentiel de la personnalit est ce qu'il y a de social en nous, d'un autre ct, il ne peut y avoir de vie sociale que si des individus distincts sont associs, et elle est d'autant plus riche qu'ils sont plus nombreux et plus diffrents les uns des autres. Le facteur individuel est donc condition du facteur impersonnel. La rciproque n'est pas moins vraie, car la socit elle-mme est une source importante de diffrenciations individuelles (v. Division du travail social, 3e d., p. 627 et suiv.).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
246
CHAPITRE IX
LA NOTION D'ESPRITS ET DE DIEUX
Avec la notion d'me, nous sommes sortis du cercle des forces impersonnelles. Mais dj les religions australiennes reconnaissent, au-dessus de l'me, des personnalits mythiques d'un ordre suprieur : des esprits, des hros civilisateurs et mme des dieux proprement dits. Sans entrer dans le dtail des mythologies, il nous faut, tout au moins, rechercher sous quelle forme ces trois catgories d'tres spirituels se prsentent en Australie et de quelle manire elles se rattachent l'ensemble du systme religieux.
I
.
Une me n'est pas un esprit. En effet, elle est interne dans un organisme dtermin ; quoiqu'elle puisse en sortir de certains moments, normalement, elle en est prisonnire. Elle ne s'en chappe dfinitivement qu' la mort, et encore avons-nous vu avec quelque difficult cette sparation se consomme. L'esprit, au contraire, bien qu'il soit souvent uni par des liens troits un objet particulier, une source, un rocher, un arbre, un astre, etc., bien qu'il y rside de prfrence, peut s'en loigner volont pour mener dans l'espace une existence indpendante. Aussi a-t-il un cercle d'action plus tendu. Il peut agir sur tous les individus qui l'approchent ou dont il s'approche. L'me, au contraire, n'a gure d'influence que sur le corps qu'elle anime ; c'est trs exceptionnellement que, au cours de sa vie terrestre, il lui arrive d'affecter des sujets trangers. Mais si l'me n'a pas les caractres distinctifs de l'esprit, elle les acquiert, au moins en partie, par la mort. En effet, une fois dsincarne, et tant qu'elle n'est pas de nouveau descendue dans un corps, elle a la mme libert de mouvements qu'un esprit. Sans doute, quand les rites du deuil sont accomplis, elle est cense partir aux pays des mes; mais d'abord, elle reste pendant assez longtemps autour du tombeau. De plus, alors mme qu'elle s'en est dfin-
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
247
itivement loigne, on croit qu'elle continue rder autour du camp, dans la brousse . Gnralement, on se la reprsente comme un tre plutt bienfaisant, surtout pour les membres de sa famille qui survivent : nous avons mme vu que l'me du pre vient aider la croissance de ses enfants ou de ses petits-enfants. Mais il arrive aussi qu'elle fait preuve d'une vritable cruaut ; tout dpend de son humeur et de la manire dont elle est traite par les vivants . Aussi est-il recommand, surtout aux femmes et aux enfants, de ne pas s'aventurer hors du camp pendant la nuit, afin de ne pas s'exposer de dangereuses rencontres .
867 868 869
Cependant, un revenant n'est pas un vritable esprit. D'abord, il n'a gnralement qu'une puissance d'action restreinte ; ensuite, il n'a pas d'attributions dfinies. C'est un tre vagabond qui n'incombe aucune tche dtermine ; car la mort a eu justement pour effet de le mettre en dehors de tous les cadres rguliers ; c'est, par rapport aux vivants, une sorte de dclass. Un esprit, au contraire, a toujours une efficacit d'un certain genre et c'est mme par l qu'il se dfinit ; il est prpos un certain ordre de phnomnes, cosmiques ou sociaux; il a une fonction plus ou moins prcise remplir dans le systme du monde. Mais il est des mes qui satisfont cette double condition et qui, par consquent, sont, au sens propre, des esprits. Ce sont les mes de ces personnages mythiques que l'imagination populaire a placs l'origine des temps, les gens de l'Alcheringa ou Altjiranhamitjina des Arunta, les Mura-mura des tribus du lac Eyre, les Muk-Kurnai des Kurnai, etc. En un sens, ce sont bien encore des mes puisqu'elles passent pour avoir jadis anim des corps dont elles se sont spares un moment donn. Mais, alors mme qu'elles vivaient d'une vie terrestre, elles possdaient dj, comme nous l'avons vu, des pouvoirs exceptionnels; elles avaient un mana suprieur celui des hommes ordinaires et elles l'ont conserv. De plus, elles sont charges de fonctions dtermines. En premier lieu, que l'on accepte la version de Spencer et Gillen ou celle de Strehlow, c'est elles que revient le soin d'assurer le recrutement priodique du clan. Elles sont prposes au phnomne de la conception. Une fois que la conception est opre, la tche de l'anctre n'est pas termine. C'est lui qu'il appartient de veiller sur le nouveau-n. Plus tard, quand l'enfant est devenu un homme, il l'accompagne la chasse, rabat vers lui le gibier, l'avertit, par la voie des songes, des dangers qu'il peut courir, le protge contre ses ennemis, etc. Sur ce point, Strehlow est entirement d'accord avec Spencer et Gillen . On se demandera, il est vrai, comment, dans la version de ces derniers, il est possible l'anctre de s'acquitter de cette fonction ; car, puisqu'il se rincarne au moment de la conception, il devrait, semble-t-il, se confondre avec l'me de l'enfant et, par suite, ne saurait le protger du dehors. Mais c'est qu'en ralit il ne se rincarne pas tout entier ; il se ddouble seulement. Une partie de lui-mme pntre dans le corps de la femme et la fconde ; une autre continue exister au dehors et, sous le nom spcial
870
867 868 869 870
ROTH, Superstition, Magic, etc., 65,68; SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 514, 516. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 515, 521; DAWSON, Austral. Aborig., p. 58 ; ROTH, Superstition, etc., 67. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 517. STREHLOW, II, p. 76 et no 1; SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 514,516.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
248
d'Arumburinga, remplit l'office de gnie tutlaire .
871
On voit combien grande est la parent de cet esprit ancestral avec le genius des Latins, et le daimn des Grecs . L'identit fonctionnelle est complte. Le genius, en effet, c'est d'abord celui qui engendre, qui gignit; il exprime et personnifie la puissance gnratrice . Mais en mme temps, c'est le protecteur, le directeur de l'individu particulier la personne duquel il est attach . Enfin, il se confond avec la personnalit mme de cet individu; il reprsente l'ensemble des penchants et des tendances qui le caractrisent et lui font une physionomie distinctive au milieu des autres hommes . C'est de l que viennent les expressions connues indulgere genio, defraudare genium avec le sens de suivre son temprament naturel. Au fond, le genius est une autre forme, un double de l'me mme de l'individu. C'est ce que prouve la synonymie partielle de genius et de manes . Les mnes, c'est le genius aprs la mort ; mais c'est aussi ce qui survit du dfunt, c'est--dire son me. De la mme manire, l'me de l'Arunta et l'esprit ancestral qui lui sert de genius ne sont que deux aspects diffrents d'un seul et mme tre.
872 873 874 875 876
Mais ce n'est pas seulement par rapport aux personnes que l'anctre est situ d'une manire dfinie ; c'est aussi par rapport aux choses. Bien qu'il soit cens avoir sous terre son vritable habitat, on croit qu'il hante sans cesse l'endroit o se trouve l'arbre ou le rocher nanja, le trou d'eau qui S'est form spontanment au point prcis o il a disparu dans le sol, aprs avoir termin sa premire existence. Comme cet arbre ou ce rocher passe pour reprsenter le corps du hros, on imagine que son me elle-mme y revient sans cesse et y habite titre plus ou moins permanent ; c'est par la prsence de cette me qu'on explique le respect religieux que ces endroits inspirent. Nul ne peut casser une branche de l'arbre naja sans s'exposer tomber malade . Autrefois, le fait de l'abattre ou de le dgrader tait puni de mort. Un animal ou un oiseau qui s'y rfugie ne doit pas tre tu. Mme les bosquets environnants doivent tre respects : le gazon ne doit pas tre brl. Les rochers, eux aussi, doivent tre traits avec respect. Il est interdit de les dplacer et de les briser . Comme ce caractre sacr est attribu l'anctre, celui-ci apparat comme l'esprit de cet arbre, de ce rocher, de ce trou d'eau, de cette source . Que la source soit considre comme soutenant quelques rapports avec la pluie , et il deviendra un esprit de la pluie. Ainsi, ces mmes mes qui, par un ct, servent de gnies
877 878 879 880
871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 513. V. sur cette question NEGRIOLI, Dei Genii presso i Romani; les articles Daimon et Genius dans Diction. des Ant.; PRELLER, Roemische Mgthologie, II, P. 195 et suiv NEGRIOLI, p. 4. Ibid., p. 8. Ibid., p. 7. Ibid., p. 11. Cf. SAMTER, Der Ursprung des Larencultus, in Archiv. f. Religionswissenschaft, 1907, pp. 368-393. SCHULZE, loc. cit, p. 237. STREHLOW, I, p. 5. Cf. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 133; GASON, in CURR, II, p. 69. V. dans HOWITT (Nat. Tr., p. 482), le cas d'un Mura-mura qui est considr comme l'esprit de certaines sources thermales. North. Tr., p. 313-314 ; MATHEWS, Journal of B. S. of N. S. Wales, XXXVIII, p. 351. De mme, chez les Dieri, il y a un Mura-mura dont la fonction est de produire de la pluie (HOWITT, Nat. Tr., pp. 798-799).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
249
protecteurs aux hommes, remplissent en mme temps des fonctions cosmiques. C'est sans doute en ce sens qu'il faut entendre un texte de Roth d'aprs lequel, dans le Queensland septentrional, les esprits de la nature seraient des mes de dcds, qui auraient lu domicile dans les forets on dans les cavernes .
881
Voil donc, cette fois, des tres spirituels qui sont autre chose que des mes errantes et sans efficacit dfinie. Strehlow les appelle des dieux ; mais l'expression est impropre, au moins dans la trs grande gnralit des cas. En effet, dans une socit comme celle des Arunta, o chacun a son anctre protecteur, il y aurait autant ou plus de dieux qu'il n'y a d'individus. Ce serait introduire de la confusion dans la terminologie que de donner le nom de dieu un tre sacr qui n'a qu'un fidle. Il peut se faire, il est vrai, que la figure de l'anctre grandisse au point de rappeler celle d'une divinit proprement dite. Chez les Warramunga, comme nous l'avons dit , le clan tout entier est cens descendu d'un seul et unique anctre. On s'explique aisment que, dans de certaines conditions, cet anctre collectif ait pu devenir l'objet d'une dvotion collective. C'est ce qui est arriv notamment au serpent Wollunqua . Cette bte mythique, dont le clan du mme nom passe pour tre issu, continue, croit-on, vivre dans un trou d'eau qu'entoure un respect religieux. Aussi est-elle l'objet d'un culte que le clan clbre collectivement : par des rites dtermins, on s'efforce de lui plaire, de se concilier ses faveurs, on lui adresse des sortes de prires, etc. On peut donc dire qu'elle est comme le dieu du clan. Mais c'est un cas trs exceptionnel, unique mme suivant Spencer et Gillen. Normalement, l'expression d'esprits est la seule qui convienne pour dsigner ces personnages ancestraux.
882 883 884
Quant la manire dont s'est forme cette conception, elle ressort de tout ce qui prcde. Comme nous l'avons montr, l'existence d'mes individuelles, une fois admise, ne se pouvait comprendre si l'on n'imaginait, au principe des choses, un fond originel d'mes fondamentales dont toutes les autres fussent drives. Or ces mes archtypes devaient ncessairement tre conues comme contenant en elles la source de toute efficacit religieuse; car, comme l'imagination ne remonte pas au del, c'est d'elles et d'elles seules que sont censes provenir toutes les choses sacres, les instruments du culte, les membres du clan, les animaux de l'espce totmique. Elles incarnent toute la religiosit diffuse dans la tribu et dans le monde, et voil pourquoi on leur attribue des pouvoirs sensiblement suprieurs ceux dont jouissent de simples mes d'hommes. D'ailleurs, le temps, lui seul, accrot et renforce le caractre sacr des choses. Un churinga trs ancien inspire beaucoup plus de respect qu'un churinga rcent et on lui suppose plus de vertus . Les sentiments de vnration dont il a t l'objet pendant la srie des gnrations successives qui l'ont mani se sont comme accumuls en lui. Pour la mme raison, des personnages qui, depuis des sicles, sont l'objet de mythes qui se transmettent respectueusement de bouche en bouche et que les rites mettent priodequement en action, ne pouvaient manquer de prendre, dans l'imagination populaire, une place tout fait part.
885
881 882 883 884 885
ROTH, Superstition, etc., 67. Cf. DAWSON, p. 58. STREHLOW, 1, p. 2 et suiv. V. plus haut, pp. 356-357. North. Tr., chap. VII. SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 277.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
250
Mais comment se fait-il que, au lieu de rester en dehors des cadres de la socit, ils en soient devenus membres rguliers ? C'est que chaque individu est le double d'un anctre. Or, quand deux tres sont ce point parents, ils sont naturellement conus comme solidaires; puisqu'ils participent d'une mme nature, ce qui affecte l'un doit, semble-t-il, affecter ncessairement l'autre. La troupe des anctres mythiques se trouva ainsi rattache par un lien moral la socit des vivants; on prta aux uns et aux autres les mmes intrts et les mmes passions ; on vit en eux des associs. Seulement, comme les premiers avaient une dignit plus haute que les seconds, cette association prit, dans l'esprit publie, la forme d'un rapport entre suprieurs et infrieurs, entre patrons et clients, entre bienfaiteurs et assists. C'est ainsi que prit naissance cette curieuse notion du gnie tutlaire, attach chaque individu, La question de savoir comment l'anctre fut mis en rapports non seulement avec les hommes, mais aussi avec les choses, peut paratre plus embarrassante ; car on ne voit pas, au premier abord, quelle relation il peut y avoir entre un personnage de ce genre et un arbre ou un rocher, Mais un renseignement que nous devons Strehlow nous fournit de ce problme une solution pour le moins vraisemblable. Ces arbres et ces rochers ne sont pas situs sur des points quelconques du territoire tribal, mais ils sont principalement masss autour de ces sanctuaires, appels ertnatulunga d'aprs Spencer et Gillen, arknanaua d'aprs Strehlow, oh sont dposs les churinga du clan . On sait de quel respect ces endroits sont entours par cela seul que les plus prcieux instruments du culte y sont conservs. Aussi chacun d'eux rayonne-t-il de la saintet tout autour de lui. C'est pour cette raison que les arbres, les rochers voisins apparaissent comme sacrs, qu'il est interdit de les dtruire ou de les dtriorer, que toute violence exerce sur eux est sacrilge. Ce caractre sacr est d, en ralit, un simple phnomne de contagion psychique mais l'indigne, pour s'en rendre compte, est oblig d'admettre que ces diffrents objets sont en rapports avec les tres dans lesquels il voit la source de tout pouvoir religieux, c'est--dire avec les anctres de l'Alcheringa, De l vint le systme de mythes que nous avons rapport. On imagina que chaque ertnatulunga marquait le lieu oh un groupe d'anctres s'tait abm sous terre, Les tumulus, les arbres qui recouvraient le sol furent censs reprsenter leurs corps. Mais, comme l'me, d'une manire gnrale, garde Une sorte d'affinit pour le corps o elle a vcu, on fut naturellement amen croire que ces mes ancestrales continuaient frquenter, de prfrence, ces emplacements o leur enveloppe matrielle subsistait. On les situa donc dans ces arbres, dans ces rochers, dans ces trous d'eau. C'est ainsi que chacune d'elles, tout en restant attache la garde d'un individu dtermin, se trouva transforme en une sorte de genius loci et en remplit la fonction .
886 887
886 887
STREHLOW, I, p. 5. Il y a, il est vrai, des arbres et des rochers nanja qui ne sont pas situs autour de l'ertnatulunga; ils sont pars sur des points diffrents du territoire. On dit qu'ils correspondent des endroits o un anctre isol a disparu dans le sol, a perdu un membre, laiss couler son sang ou oubli un churinga qui s'est transform soit en arbre soit en rocher. Mais ces emplacements totmiques n'ont qu'une importance secondaire ; STREHLOW les appelle des kleinere Totempltze (I, pp. 4-5). On peut donc penser qu'ils n'ont pris ce caractre que par analogie avec les centres totmiques principaux. Les arbres, les rochers qui, pour une
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
251
Ces conceptions, ainsi lucides, nous mettent en mesure de comprendre une forme de totmisme que nous avons d, jusqu' prsent, laisser inexplique : c'est le totmisme individuel. Un totem individuel se dfinit essentiellement par les deux caractres suivants : 1 c'est un tre forme animale ou vgtale, qui a pour fonction de protger un individu; 2 le sort de cet individu et celui de son patron sont troitement lis : tout ce qui atteint le second se communique sympathiquement au premier. Or les esprits ancestraux dont il vient d'tre question rpondent la mme dfinition. Eux aussi ressortissent, au moins en partie, au rgne animal ou vgtal. Eux aussi sont des gnies tutlaires. Enfin un lien sympathique unit chaque individu son anctre protecteur. L'arbre nanja, corps mystique de cet anctre, ne peut, en effet, tre dtruit sans que l'homme se sente menac. La croyance, il est vrai, perd aujourd'hui de la force. Cependant Spencer et Gillen l'ont encore observe et, en tout cas, ils estiment qu'autrefois elle tait gnrale .
888
L'identit se retrouve jusque dans le dtail des deux conceptions. Les mes ancestrales rsident dans des arbres ou des rochers qui sont considrs comme sacrs. De mme, chez les Euahlayi, l'esprit de l'animal qui sert de totem individuel est cens habiter dans un arbre ou dans une pierre . Cet arbre ou cette pierre sont sacrs nul ne peut y toucher, sauf le propritaire du totem et encore, quand c'est une pierre ou un rocher, l'interdiction est-elle absolue . Il en rsulte que ce sont de vrais lieux de refuge.
889 890
Enfin, nous avons vu que l'me individuelle n'est qu'un autre aspect de l'esprit ancestral ; celui-ci, suivant le mot de Stehlow, sert, en quelque sorte, de second moi . De mme, suivant une expression de Mrs. Parker, le totem individuel des Euhalayi, appel (Yunbeai, est un alter ego de l'individu: L'me de l'homme est dans son Yunbeai et l'me de son Yunbeai est en lui . C'est donc, au fond, une mme me en deux corps. La parent de ces deux notions est si grande qu'elles sont parfois exprimes par un seul et mme mot. C'est le cas en Mlansie et en Polynsie : atai l'le Mota, tamaniu l'le Aurore, talegia Motlaw dsignent la fois l'me d'un individu et son totem personnel . Il en est de mme de aitu Samoa .
891 892 893 894
888 889
890 891 892 893 894
raison quelconque, rappelaient ceux que l'on trouvait dans le voisinage de quelques ertnatulunga, inspirrent des sentiments analogues et, par suite, le mythe qui s'tait form propos des seconds s'tendit aux premiers. Nat. Tr., p. 139. PARKER, The Euahlayi, p. 21. Gnralement, l'arbre qui sert cet emploi est un de ceux qui figurent parmi les sous-totems de l'individu. On donne comme raison de ce choix que, tant de la mme famille que cet individu, ils doivent tre plus disposs lui prter assistance (ibid., p 29). Ibid., p. 36. STREHLOW, II, p. 81. PARKER, Op. cit., p. 21. CODRINGTON, The Melanesians, pp. 249-253. TURNER, Samoa, p. 17.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
252
C'est que le totem individuel n'est que la forme extrieure et visible du moi, de la personnalit dont l'me est la forme invisible et intrieure .
895
Ainsi, le totem individuel a tous les caractres essentiels de l'anctre protecteur et il remplit le mme rle; c'est donc qu'il a la mme origine et procde de la mme ide. L'un et l'autre, en effet, consistent dans un ddoublement de l'me. Le totem, comme l'anctre, c'est l'me de l'individu, mais extriorise et investie de pouvoirs suprieurs ceux qu'elle est cense possder l'intrieur de l'organisme. Or, ce ddoublement est le produit d'une ncessit psychologique ; car il ne fait qu'exprimer la nature de l'me qui, comme nous l'avons vu, est double. En un sens, elle est ntre : elle exprime notre personnalit. Mais en mme temps, elle est en dehors de nous puisqu'elle n'est que le prolongement en nous d'une force religieuse qui nous est extrieure. Nous ne pouvons pas nous confondre compltement avec elle, puisque nous lui attribuons une excellence et une dignit par o elle s'lve au-dessus de nous et de notre individualit empirique. Il y a ainsi toute une partie de nous-mmes que nous tendons projeter hors de nous. Cette faon de nous concevoir est si bien fonde dans notre nature que nous ne pouvons pas y chapper, alors mme que nous tentons de nous penser sans recourir aucun symbole religieux. Notre conscience morale est comme le noyau autour duquel s'est forme la notion d'me ; et pourtant, quand elle nous parle, elle nous fait l'effet d'une puissance extrieure et suprieure nous, qui nous fait la loi et qui nous juge, mais qui nous aide aussi et nous soutient. Quand nous l'avons pour nous, nous nous sentons plus forts contre les preuves de la vie, plus assurs d'en triompher, tout comme l'Australien, confiant dans son anctre ou son totem personnel, se sent plus vaillant contre ses ennemis . Il y a donc quelque chose d'objectif la base de ces diffrentes conceptions, qu'il s'agisse du genius romain, du totem individuel ou de l'anctre de l'Alcheringa ; et c'est pourquoi, sous des formes diverses, elles ont survcu jusqu' nos jours. Tout se passe comme si nous avions rellement deux mes ; l'une, qui est en nous, ou plutt qui est nous ; l'autre qui est au-dessus de nous, et dont la fonction est de contrler et d'assister la premire. Frazer avait bien le sentiment que, dans le totem individuel, il y avait une me extrieure ; mais il croyait que cette extriorit tait le produit d'un artifice et d'une ruse magique. En ralit, elle est implique dans la constitution mme de l'ide d'me .
896 897
895 896
897
Ce sont les expressions mmes employes par CODRINGTON (p. 251). Cet troit rapport entre l'me, le gnie protecteur et la conscience morale de l'individu est particulirement apparent chez certaines populations de l'Indonsie. Une des sept mes du Tobabatak est enterre avec le placenta ; tout en rsidant de prfrence en cet endroit, elle peut le quitter pour donner des avertissements l'individu ou lui manifester son approbation quand il se conduit bien. Elle joue donc, en un sens, le rle de conscience morale. Toutefois, ses avertissements ne s'tendent pas seulement au domaine des faits moraux. On l'appelle le plus jeune frre de l'me, comme on appelle le placenta le frre cadet de l'enfant... A la guerre, elle inspire l'homme le courage de marcher contre l'ennemi (WARNECK, Der bataksche Ahnen und Geisterkult, in Allg. Missionszeilschrift, Berlin, 1904, p. 10. Cf. Kruijt, Het Animisme in den indischen Archipel, p. 25). Il resterait rechercher d'o vient que, partir d'un certain moment de l'volution, ce ddoublement de l'me s'est fait sous la forme du totem individuel plutt que sous celle de l'anctre protecteur. La question a peut-tre un intrt plus ethnographique que sociologique. Voici pourtant comment il est possible de reprsenter la manire dont s'est vraisemblablement opre cette substitution. Le totem individuel a d commencer par jouer un rle simplement complmentaire. Les individus qui
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
253
II
.
Les esprits dont il vient d'tre question sont essentiellement bienfaisants. Sans doute il leur arrive de svir si l'homme ne se conduit pas avec eux comme il convient ; mais il n'est pas dans leur fonction de faire du mal.
898
Pourtant, l'esprit, par lui-mme, peut servir au mal comme au bien. C'est pourquoi, en face des esprits auxiliaires et tutlaires, se constitua tout naturellement une classe de gnies malins qui permirent aux hommes de s'expliquer les maux permanents dont ils ont souffrir, les cauchemars , les maladies , les tourbillons et les temptes , etc. Ce n'est pas, sans doute, que toutes ces misres humaines aient paru choses trop anormales pour pouvoir tre expliques autrement que par des forces surnaturelles ; mais c'est que toutes les forces sont alors penses sous forme religieuse. C'est un principe religieux qui est considr comme la source de la vie ; il tait donc logique de rapporter un principe du mme genre tous les vnements qui troublent la vie ou qui la dtruisent.
899 900 901
Ces esprits nuisibles semblent bien avoir t conus sur le mme modle que les gnies bienfaisants dont nous venons de parler. On se les reprsente sous forme animale, ou mi-partie animale et mi-partie humaine ; mais on est naturellement enclin leur prter des dimensions
902
voulaient acqurir des pouvoirs suprieurs ceux du vulgaire ne se contentrent pas, et ne pouvaient pas se contenter, de la seule protection de l'anctre ; ils cherchrent donc se mnager un autre auxiliaire du mme genre. C'est ainsi que, chez les Euahlayi, les magiciens sont les seuls qui aient ou qui puissent procurer des totems individuels. Comme, en outre, chacun d'eux a un totem collectif, il se trouve avoir plusieurs mes. Mais cette pluralit d'mes n'a rien qui puisse surprendre : elle est la condition d'une efficacit suprieure. Seulement, une fois que le totmisme collectif eut perdu du terrain et que, par suite, la conception de l'anctre protecteur commena s'effacer des esprits, il devint ncessaire de se reprsenter d'une autre manire la double nature de l'me qui continuait tre sentie. L'ide subsistait qu'en dehors de l'me individuelle il y en avait une autre charge de veiller sur la premire. Puisque cette puissance protectrice n'tait plus dsigne par le fait mme de la naissance, on trouva naturel d'employer, pour la dcouvrir, des moyens analogues ceux dont les magiciens se servaient pour entrer en commerce avec les forces dont ils s'assuraient le concours.
898 899 900 901 902
V. par exemple STREHLOW, II, p. 82. WYATT, Adelaide and Encounter Bay Tribes, in WOODS, p. 168. TAPLIN, The Narrinyeri, pp. 62-63 ; ROTH, Superstition, etc., 116; HOWITT, Nat. Tr., p. 356, 358 ; STREHLOW, pp. 11-12. STREHLOW, I, pp. 13-14; DAWSON, p. 49. STREHLOW, I, pp. 11-14; EYLMANN, pp. 182,185; SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 211; SCHRMANN, The Aborig. Tr. of Port Lincoln, in WOODS, p. 239.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
254
normes et un aspect repoussant . Tout comme les mes des anctres, ils sont censs habiter des arbres, des rochers, des trous d'eau, des cavernes souterraines . Beaucoup nous sont reprsents comme des mes de personnes qui ont vcu d'une vie terrestre . Pour ce qui est des Arunta en particulier, Spencer et Gillen disent expressment que ces mauvais gnies, connus sous le nom d'Oruncha, sont des tres de l'Alcheringa . Parmi les personnages de l'poque fabuleuse, il y en avait, en effet, de tempraments diffrents : certains avaient des instincts cruels et mchants qu'ils gardent toujours ; d'autres taient naturellement d'une mauvaise constitution ; ils taient maigres et dcharns ; aussi, quand ils s'enfoncrent dans le sol, les rochers nanja auxquels ils donnrent naissance furent-ils considrs comme des foyers de dangereuses influences .
903 904 905 906 907 908
Seulement, ils se distinguent de leurs congnres, les hros de l'Acheringa, par des caractres particuliers. Ils ne se rincarnent pas ; parmi les hommes vivants, il n'y en a jamais qui les reprsentent ; ils sont sans postrit humaine . Quand, certains signes, on croit qu'un enfant est le produit de leurs oeuvres, on le met mort aussitt qu'il est n . D'autre part, ils ne ressortissent aucun centre totmique dtermin ; ils sont en dehors des cadres sociaux . A tous ces traits, on reconnat que ce sont des puissances beaucoup plus magiques que religieuses. Et en effet, c'est surtout avec le magicien qu'ils sont en rapports ; c'est d'eux que, trs souvent, il tient ses pouvoirs . Nous sommes donc parvenus ici au point o finit le monde de la religion et o commence celui de la magie; et comme ce dernier est en dehors de notre recherche, nous n'avons pas pousser plus loin cette tude .
909 910 911 912 913
903 904 905 906
907 908 909 910 911 912 913
EYLMANN, p. 182. MATHEWS, Journ. of R. S. of N. S. Wales, XXXVIII, p. 345; FISON et HOWITT, Kamilaroi a. Kurnai, p. 467; STREHLOW, I, p. 11. ROTH, Superstition, etc., 115; EYLMANN, p. 190. Nat. Tr., p. 390-391. Strehlow appelle Erintja les mauvais esprits; mais ce mot et celui d'Oruncha sont videmment quivalents. Cependant, il y a une diffrence dans la manire dont les uns et les autres nous sont prsents. Les Oruncha, d'aprs Spencer et Gillen, seraient plus malicieux que mchants; mme, suivant ces observateurs (p. 328), les Arunta ne connatraient pas d'esprits foncirement malveillants. Au contraire, les Erintja de Strehlow ont pour fonction rgulire de faire du mal. D'ailleurs, d'aprs certains mythes que SPENCER et GILLEN rapportent eux-mmes (Nat. Tr., p. 390), il semble bien qu'ils aient quelque peu embelli la physionomie des Oruncha : primitivement, c'taient des sortes d'ogres (ibid., p. 331). SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 390-391. Ibid., p. 551. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 326-327. STREHLOW, I, p. 14. Quand il y a deux jumeaux, le premier n passe pour avoir t conu de cette manire. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 327. HOWITT, Nat. Tr., pp. 358, 381, 385; SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 334; North. Tr., pp. 501, 530. Comme le magicien peut ou causer la maladie ou la gurir, ct des esprits magiques dont la fonction est de faire le mal, il y en a parfois d'autres dont le rle est de prvenir ou de neutraliser la mauvaise influence des premiers. On trouvera des cas de ce genre dans North. Tr., p. 501-502. Ce qui montre bien que les seconds sont magiques comme les premiers, c'est que, chez les Arunta, les uns et les autres portent le mme nom. Ce sont donc des aspects diffrents d'une mme puissance magique.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
255
III
.
L'apparition de la notion d'esprit marque un important progrs dans l'individualisation des forces religieuses. Toutefois, les tres spirituels dont il a t jusqu' prsent question ne sont encore que des personnages secondaires. Ou bien ce sont des gnies malfaisants qui relvent de la magie plus que de la religion; ou bien, attachs un individu et un endroit dtermins, ils ne peuvent faire sentir leur influence que dans un cercle de rayon trs limit. Ils ne peuvent donc tre l'objet que de rites privs et locaux. Mais une fois que l'ide d'esprit fut constitue, elle s'tendit naturellement des sphres plus leves de la vie religieuse et des personnalits mythiques d'un ordre suprieur prirent ainsi naissance. Si les crmonies propres chaque clan diffrent les unes des autres, elles ne laissent pas de ressortir une mme religion ; aussi existe-t-il entre elles un certain nombre de similitudes essentielles. Puisque tous les clans ne sont que des parties d'une seule et mme tribu, l'unit de la tribu ne peut pas ne pas se faire sentir travers la diversit des cultes particuliers. Et en effet, il n'y a pas de groupe totmique qui n'ait des churinga, des bull-roarers, lesquels sont partout employs de semblable faon. L'organisation de la tribu en phratries, en classes matrimoniales, en clans, les interdictions exogamiques qui y sont attaches constituent galement de vritables institutions tribales. Les ftes de l'initiation comprennent toutes certaines pratiques fondamentales, extraction de la dent, circoncision, subincision, etc., qui, pour une mme tribu, ne varient pas avec les totems. L'uniformit sur ce point s'est d'autant plus facilement tablie que l'initiation a toujours lieu en prsence de la tribu, ou, tout au moins, devant une assemble laquelle des clans diffrents ont t convoqus. La raison en est que l'initiation a pour objet d'introduire le nophyte dans la vie religieuse, non seulement du clan o il est n, mais de la tribu tout entire ; il est donc ncessaire que les aspects varis de la religion tribale soient reprsents devant lui et passent, en quelque sorte, sous ses yeux. C'est cette occasion que s'affirme le mieux l'unit morale et religieuse de la tribu. Il y a ainsi, dans chaque socit, un certain nombre de rites qui se distinguent de tous les autres par leur homognit et leur gnralit. Une aussi remarquable concordance ne parut pouvoir s'expliquer que par une unit d'origine. On imagina donc que chaque groupe de rites similaires avait t institu par un seul et mme anctre qui tait venu les rvler la tribu tout entire. Ainsi, chez les Arunta, c'est un anctre du clan du Chat-sauvage, nomm Putiaputia , qui passe pour avoir appris aux hommes la manire de fabriquer les churinga et de les employer rituellement ; chez les Warramunga, c'est Murtu-murtu ; chez les Urabunna, c'est
914 915
914
915
STREHLOW, I, p. 9. Putiaputia n'est pas, d'ailleurs, le seul personnage de ce genre dont parlent les mythes Arunta : certaines portions de la tribu donnent un nom diffrent au hros auquel elles attribuent la mme invention. Il ne faut pas oublier que l'tendue du territoire occup par les Arunta ne permet pas la mythologie d'tre parfaitement homogne. SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 493.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
256
Witurna ; c'est Atnatu chez les Kaitish et Tundun chez les Kurnai . De mme, les pratiques de la circoncision sont attribues par les Dieri de l'est et plusieurs autres tribus deux Muramura dtermins, par les Arunta un hros de l'Alcheringa, du totem du Lzard, nomm Mangarkunjerkunja . Au mme personnage sont rapportes l'institution des interdictions matrimoniales et l'organisation sociale qu'elles impliquent, la dcouverte du feu, l'invention de la lance, du bouclier, du boomerang, etc. Il arrive, d'ailleurs, trs souvent que l'inventeur du bull-roarer est aussi considr comme le fondateur des rites de l'initiation .
916 917 918 919 920 921
Ces anctres spciaux ne pouvaient tre mis au mme rang que les autres. D'une part, les sentiments de vnration qu'ils inspiraient n'taient pas limits un clan, mais communs toute la tribu. De plus, c'tait eux que l'on attribuait ce qu'il y avait de plus estim dans la civilisation tribale. Pour cette double raison, ils devinrent l'objet d'une considration toute particulire: On dit, par exemple, d'Atnatu qu'il est n au ciel, une poque antrieure mme aux temps de l'Alcheringa, qu'il s'est fait lui-mme et s'est lui-mme donn le nom qu'il porte. Les toiles sont ses femmes on ses filles. Au del du ciel o il vit, il y en a un autre avec un autre soleil. Son nom est sacr, et ne doit jamais tre prononc devant les femmes ou les noninitis .
922
Cependant, quel que soit le prestige dont jouissent ces personnages, il n'y avait pas lieu d'instituer en leur honneur des rites particuliers ; car ils ne sont eux-mmes que des rites personnifis. Ils n'ont d'autre raison d'tre que d'expliquer des pratiques existantes ; ils n'en sont qu'un autre aspect. Le churinga ne fait qu'un avec l'anctre qui l'inventa ; l'un et l'autre portent parfois le mme nom . Quand on fait rsonner le bull-roarer, on dit que c'est la voix de l'anctre qui se fait entendre . Mais, prcisment parce que chacun de ces hros se confond avec le culte qu'il passe pour avoir institu, on croit qu'il est attentif la manire dont il est clbr. Il n'est satisfait que si les fidles s'acquittent exactement de leurs devoirs ; il punit ceux qui sont ngligents . Il est donc regard comme le gardien du rite en mme temps qu'il en est le fondateur, et, pour cette raison, il se trouve investi d'un vritable rle moral .
923 924 925 926
916 917 918 919 920
921
922 923 924 925 926
Ibid., p. 498. Ibid., pp. 498-499. HOWITT, Nat. Tr., p. 135. Ibid., p. 476 et suiv. STREHLOW, I, pp. 6-8. Luvre de Mangarkunjerkunja dut tre reprise plus tard par d'autres hros; car, suivant une croyance qui n'est pas particulire aux Arunta, un moment vint o les hommes oublirent les enseignements de leurs premiers initiateurs et se corrompirent. C'est le cas, par exemple, d'Atnatu (SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 153), de Witurna (North. Tr., p. 498). Si Tundun n'a pas institu les rites, c'est lui qui est charg d'en diriger la clbration (HOWITT, Nat. Tr., p. 670). North. Tr., p. 499. HOWITT, Nat. Tr., p. 493; Kamilaroi and Kurnai, p. 197 et 267; SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 492. V. par exemple, North. Tr., p. 499. North. Tr., pp. 338, 347, 499. SPENCER et GILLEN, il est vrai, soutiennent que ces tres mythiques ne jouent aucun rle moral (North. Tr., p. 493) ; mais c'est qu'ils donnent au mot un sens plus troit. Les devoirs religieux sont des devoirs : le fait de veiller la manire dont ils sont observs intresse donc la morale, d'autant plus que, ce moment, la morale tout entire a un caractre religieux.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
257
IV
.
Et cependant, cette formation mythologique n'est pas la plus leve que l'on trouve chez les Australiens. Il y a tout au moins un certain nombre de tribus qui sont parvenues la conception d'un dieu, sinon unique, du moins suprme, auquel est attribue une situation prminente par rapport aux autres entits religieuses. L'existence de cette croyance avait t, depuis longtemps, signale par diffrents observateurs ; mais c'est Howitt qui a le plus contribu en tablir la gnralit relative. Il l'a constate, en effet, sur une aire gographique trs tendue qui comprend l'tat de Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud, et qui s'tend mme jusqu'au Queensland . Dans toute cette rgion, un nombre considrable de tribus croient l'existence d'une vritable divinit tribale qui, suivant les rgions, porte des noms diffrents. Les plus frquemment employs sont ceux de Bunjil on Punjil , de Daramulun et de Baiame . Mais on rencontre aussi ceux de Nuralie ou Nurelle , de Kohin , de Mungan-ngaua . On trouve la mme conception plus l'ouest, chez les Narrinyeri o le grand dieu s'appelle Nurunderi ou Ngurrunderi . Chez les Dieri, il est assez vraisemblable que, pardessus les Mura-mura ou anctres ordinaires, il en existe un qui jouit d'une sorte de suprmatie . Enfin, contrairement aux affirmations de Spencer et Gillen qui dclaraient n'avoir observ chez les Arunta aucune croyance une divinit proprement dite , Strehlow assure que, sous le nom d'Altjira, ce peuple, comme celui des Loritja, reconnat un vritable bon dieu .
927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938
927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938
Le fait avait t observ, ds 1845, par Eyre, Journals, etc., II, p. 362, et, avant Eyre, par Henderson, dans ses Observations on the Colonies of N. S. Wales and Van Diemen's Land, p. 147. Nat. Tr., pp. 488-508. Chez les Kulin, les Wotjobaluk, les Woworung (Victoria). Chez les Yuin, les Ngarrigo, les Wolgal (Nouvelle-Galles du Sud). Chez les Kamilaroi, les Euahlayi (partie septentrionale, de la Nouvelle-Galles du Sud) ; plus au centre, dans la mme province, chez les Wonghibon, les Wiradjuri. Chez les Wiimbaoi et les tribus du Bas Murray (RIDLEY, Kamilaroi, p. 137; BROUGH SMYTH, I, p. 423, no 431). Dans les tribus de la rivire Herbert (HOWITT, Nat. Tr., p. 498). Chez les Kurnai. TAPLIN, p. 55; Eylmann, p. 182. C'est sans doute ce mura-mura suprme que Gason fait allusion dans le passage dj Cit (CURR, II, p. 55). Nat. Tr., p. 246. Entre Baiame, Bunjil, Doramalun, d'une part, et Altjira, de l'autre, il y aurait cette diffrence que ce dernier serait tout fait tranger ce qui concerne l'humanit; ce n'est pas lui qui aurait fait les hommes et il ne s'occuperait pas de ce qu'ils font. Les Arunta n'auraient pour lui ni amour ni crainte. Mais, si cette conception a t exactement observe et analyse, il est bien difficile d'admettre qu'elle soit primitive; car si Altjira ne joue aucun rle, n'explique rien, ne sert rien, qu'est-ce qui aurait pu dterminer les Arunta
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
258
Les caractres essentiels de ce personnage sont partout les mmes. C'est un tre immortel, et mme ternel ; car il ne drive d'aucun autre. Aprs avoir habit la terre pendant un temps, il s'leva au ciel ou il y fut enlev , et il continue y vivre entour de sa famille ; car on lui attribue gnralement une ou plusieurs femmes, des enfants, des frres qui, parfois, l'assistent dans ses fonctions. En raison du sjour qui lui est assign, il est souvent identifi, ainsi que tous les siens, avec des toiles dtermines . On lui attribue, d'ailleurs, un pouvoir sur les astres. C'est lui qui a rgl la marche du soleil et de la lune ; il leur donne des ordres . C'est lui qui fait jaillir l'clair de la nue et qui lance la foudre . Parce qu'il est le tonnerre, il est galement en relation avec la pluie : c'est lui qu'on s'adresse quand on manque d'eau ou quand il en est trop tomb .
939 940 941 942 943 944 945 946
On en parle comme d'une sorte de crateur : il est appel le pre des hommes et on dit qu'il les a faits. D'aprs une lgende qui avait cours Melbourne, Bunjil aurait fait le premier homme de la manire suivante. Avec de l'argile, il aurait fabriqu une statuette ; puis il aurait dans tout autour plusieurs fois, lui aurait souffl dans les narines et la statuette se serait anime et se serait mise en marche . D'aprs un autre mythe, il aurait allum le soleil ; la terre se serait alors chauffe et les hommes en seraient sortis . En mme temps que les hommes , ce personnage divin a fait les animaux, les arbres ; c'est lui qu'on doit tous les arts de la vie, les armes, le langage, les rites tribaux . Il est le bienfaiteur de l'humanit. Maintenant encore, il joue pour elle le rle d'une sorte de Providence. C'est lui qui approvisionne ses fidles de tout
947 948 949 950 951
939 940
941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951
l'imaginer ? Peut-tre faut-il y voir une sorte de Baiame qui aurait perdu son ancien prestige, un ancien dieu dont le souvenir irait en s'effaant. Peut-tre aussi Strehlow a-t-il mal interprt les tmoignages qu'il a recueillis. Suivant EYLMANN, qui n'est pas, il est vrai, un observateur comptent ni trs sr, Altjira aurait fait les hommes (op. cit., p. 184). D'ailleurs, chez les Loritja, le personnage qui, sous le nom de Tukura, correspond l'Altjira des Arunta, est cens clbrer lui-mme des crmonies d'initiation. Pour Bunjil, v. Brough SMYTH, I, p. 417; pour Baiame, RIDLEY, Kamilaroi, p. 136; pour Daramulun, HOWITT, Nat. Tr., p. 495. Sur la composition de la famille de Bunjil, par exemple, v. HOWITT, Nat. Tr., pp. 128, 129, 489, 491 ; BROUGH SMYTH, I, pp. 417, 423; pour celle de Baiame, L. PARKER, The Euahlayi, pp. 7, 66, 103; Howitt, Nat. Tr., pp. 502, 585, 407; pour celle de Nurunderi, TAPLIN, The Narrinyeri, pp. 57-58. Bien entendu, d'ailleurs, il y a toute sorte de variantes dans la manire dont sont conues ces familles des grands dieux. Tel personnage qui est ici le frre est ailleurs appel le fils. Le nombre des femmes, leurs noms varient avec les rgions. HOWITT, Nat. Tr., p. 128. BROUGH SMYTH, I, pp. 430, 431. Ibid., I, p. 432. HOWITT, Nat. Tr., p. 498,538; MATHEWS, J. of R. S. of N. S. Wales, XXXVIII, p. 343; RIDLEY, p. 136. HOWITT, Nat. Tr., p. 538; TAPLIN, The Narrinyeri, pp. 57-58. L. PARKER, The Euahlayi, p. 8. BROUGH SMYTH, I, p. 424. HOWITT, Nat. Tr., p. 492. D'aprs certains mythes, il aurait fait les hommes et non les femmes; c'est ce qu'on dit de Bunjil. Mais on attribue alors l'origine des femmes son fils-frre, Pallyan (Brough SMYTH, I, pp. 417 et 423). HOWITT, Nat. Tr., p. 489,492; MATHEWS, J. of R. S. of N. S. Wales. XXXVIII, p. 340. L. PARKER, The Euahlayi, p. 7; HOWITT, Nat. Tr., p. 630.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
259
ce qui est ncessaire leur existence . Il est en communication avec eux soit directement, soit par intermdiaires . Mais en mme temps, gardien de la morale tribale, il svit quand elle est viole . Si mme on s'en rapporte certains observateurs, il remplirait, aprs la vie, l'office de juge ; il distinguerait entre les bons et les mchants et ne traiterait pas les uns comme les autres . En tout cas, il est souvent prsent comme prpos au pays des morts , et comme accueillant les mes quand elles arrivent dans l'au-del .
952 953 954 955 956 957
Comme l'initiation est la forme principale du culte tribal, ce sont les rites de l'initiation qui lui sont le plus spcialement rattachs ; il en est le centre. Trs souvent, il y est reprsent par une image taille dans une corce d'arbre ou moule dans la terre. On danse tout autour ; on chante en son honneur ; on lui adresse mme de vritables prires . On explique aux jeunes gens quel est le personnage que cette image figure ; on leur dit son nom secret, celui que les femmes et les non-initis doivent ignorer ; on leur raconte son histoire, le rle que la tradition lui attribue dans la vie de la tribu. A d'autres moments, on lve les mains vers le ciel o il est cens rsider; ou bien on pointe dans la mme direction soit les armes soit les instruments rituels qu'on manie ; c'est une faon de se mettre en communication avec lui. On le sent partout prsent. Il veille sur le nophyte tandis qu'il est reclus dans la fort . Il est attentif la manire dont les crmonies sont clbres. L'initiation est son culte. Aussi tient-il spcialement la main ce que ces rites, en particulier, soient exactement observs : quand des fautes ou des ngligences sont commises, il les rprime d'une manire terrible .
958 959 960 961
L'autorit de chacun de ces dieux suprmes n'est, d'ailleurs, pas limite une seule tribu ; mais elle est galement reconnue par une pluralit de tribus voisines. Bunjil est ador dans presque tout l'tat de Victoria, Baiame dans une portion notable de la Nouvelle-Galles du Sud, etc. ; c'est ce qui explique que ces dieux soient en si petit nombre pour une aire gographique relativement tendue. Les cultes dont ils sont l'objet ont donc un caractre international. Il arrive mme que ces diffrentes mythologies se mlent, se combinent, se font mutuellement des emprunts. Ainsi, la plupart des tribus qui croient en Baiame admettent aussi l'existence de Daramulun ; seulement elles lui accordent une moindre dignit. Elles en font un fils ou un frre de Baiame, subordonn ce dernier . La foi en Daramulun se trouve ainsi rpandue, sous des formes diverses, dans toute la Nouvelle-Galles du Sud. Il s'en faut donc que l'internationalisme
962
952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962
RIDLEY, Kamilaroi, p. 136; L. PARKER, The Euahlayi, p. 114. L. PARKER, More Austr. Leg. Tales, pp. 84-99, 90-91. HOWITT, Nat. Tr., pp. 495, 498, 543, 563, 564; Brough SMYTH, I, p. 429; L. PARKER, The Euahlayi, p, 79. RIDLEY, p. 137. L. PARKER, The Euahlayi, p. 90-91. HOWITT, Nat. Tr., p. 495; TAPLIN, The Narrinyeri, p. 58. HOWITT, Nat. Tr., p. 588, 543, 553, 555, 556; MATHEWS, loc. cut. p. 318; L. PARKER, The Euahlayi, pp. 6, 79, 80. HOWITT, Nat. Tr., pp. 498, 528. HOWITT, ibid., p. 493; L. PARKER, The Euahlayi, p. 76. L. PARKER, The Euahlayi, p. 76; HOWITT, Nat. Tr., pp. 493, 612. RIDLEY, Kamilaroi, p. 153; L. PARKER, The Euahlayi, p. 67; HOWITT, Nat. Tr., P. 585; MATHEWS, loc. cit., p. 343. Par opposition Baiame, Daramulun est parfois prsent comme un esprit foncirement malveillant (L. PARKER, loc. Cil. ; RIDLEY, in BROUGH SMYTH, II, p. 285)
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
260
religieux soit une particularit des religions les plus rcentes et les plus avances. Ds le dbut de l'histoire, les croyances religieuses manifestent une tendance ne pas se renfermer dans une socit politique troitement dlimite ; il y a en elles comme une aptitude naturelle passer par-dessus les frontires, se diffuser, s'internationaliser. Sans doute, il y a eu des peuples et des temps o cette aptitude spontane a t tenue en chec par des ncessits sociales opposes ; elle ne laisse pas d'tre relle et, comme on voit, trs primitive. Cette conception a paru Tylor d'une thologie tellement leve qu'il s'est refus y voir autre chose que le produit d'une importation europenne : ce serait une ide chrtienne plus ou moins dnature . A. Lang, au contraire , la considre comme autochtone ; mais, admettant, lui aussi, qu'elle contraste avec l'ensemble des croyances australiennes et repose sur de tout autres principes, il conclut que les religions d'Australie sont faites de deux systmes htrognes, superposs l'un l'autre, et drivent, par consquent, d'une double origine. Il y aurait, d'une part, les ides relatives aux totems et aux esprits, qui auraient t suggres l'homme par le spectacle de certains phnomnes naturels. Mais en mme temps, par une sorte d'intuition sur la nature de laquelle on refuse de s'expliquer , l'intelligence humaine serait parvenue d'emble concevoir un dieu unique, crateur du monde, lgislateur de l'ordre moral. Lang estime mme que cette ide tait plus pure de tout lment tranger l'origine, et notamment en Australie, que dans les civilisations qui ont immdiatement suivi. Avec le temps, elle aurait t peu peu recouverte et obscurcie par la masse toujours croissante des superstitions animistes et totmiques. Elle aurait ainsi subi une sorte de dgnrescence progressive jusqu'au jour o, par effet d'une culture privilgie, elle serait parvenue se ressaisir et s'affirmer de nouveau, avec un clat et une nettet qu'elle n'avait pas dans le principe .
963 964 965 966
Mais les faits ne comportent ni l'hypothse sceptique de Tylor ni l'interprtation thologique de Lang. Tout d'abord, il est aujourd'hui certain que les ides relatives au grand dieu tribal sont d'origine indigne. Elles ont t observes alors que l'influence des missionnaires n'avait pas
963 964 965 966
J.A.I., XXI, p. 292 et suiv. The Making of Religion, pp. 187-293. LANG, ibid., p. 331. M. Lang se borne dire que l'hypothse de saint Paul lui parat la moins dfectueuse (the most unsatisfactory). Le P. SCHMIDT a repris la thse de A. Lang dans Anthropos (1908, 1909), Contre Sidney HARTLAND, qui avait critiqu la thorie de Lang dans un article du Folk-lore (tome IX, p. 290 et suiv.), intitul The High Gods of Australia, le P. SCHMIDT entreprend de dmontrer que Baiame, Bunjil, etc., sont des dieux ternels, crateurs, tout-puissants, omniscients, gardiens de l'ordre moral. Nous n'entrerons pas dans cette discussion qui nous parat sans intrt et sans porte. Si l'on donne ces diffrents adjectifs un sens relatif, en harmonie avec la mentalit australienne, nous sommes tout prt les prendre notre compte et nous les avons nous-mme employs. De ce point de vue, tout-puissant veut dire, qui a plus de pouvoir que les autres tres sacrs ; omniscient, qui voit des choses qui chappent au vulgaire et mme aux plus grands magiciens ; gardien de l'ordre moral, qui fait respecter les rgles de la morale australienne, si diffrente qu'elle soit de la ntre. Mais si l'on veut donner ces mots une signification que, seul, un spiritualiste chrtien peut y attacher, il nous parat inutile de discuter une opinion si contraire aux principes de la mthode historique.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
261
encore eu le temps de se faire sentir . Mais il ne s'ensuit pas qu'il faille les attribuer une mystrieuse rvlation. Bien loin qu'elles drivent d'une autre source que les croyances proprement totmiques, elles n'en sont, au contraire, que l'aboutissement logique et la forme la plus haute.
967
Nous avons vu, en effet, que la notion des anctres mythiques est implique dans les principes mmes sur lesquels repose le totmisme ; car chacun d'eux est un tre totmique. Or, si les grands dieux leur sont certainement suprieurs, cependant il n'y a, entre les uns et les autres, que des diffrences de degrs ; on passe des premiers aux seconds sans solution de continuit. Un grand dieu, en effet, est lui-mme un anctre d'une importance particulire. On nous parle souvent de lui comme d'un homme, dou sans doute de pouvoirs plus qu'humains, mais qui a vcu Sur terre d'une vie tout humaine . On le dpeint comme un grand chasseur , un puissant magicien , le fondateur de la tribu . C'est le premier des hommes . Une lgende le reprsente mme sous les traits d'un vieillard fatigu qui peut peine se mouvoir . S'il a exist chez les Dieri un dieu suprme appel Mura-mura, le mot est significatif ; car il sert dsigner la classe des anctres. De mme, Nuralie, nom du grand dieu dans les tribus de la rivire Murray, est parfois employ comme une expression collective qui s'applique l'ensemble des tres mythiques que la tradition place l'origine des choses . Ce sont des personnages tout fait comparables ceux de l'Alcheringa . Dj, nous avons rencontr dans le Queensland un dieu Anjea ou Anjir, qui fait les hommes et qui, pourtant, semble bien n'tre que le premier des humains .
968 969 970 971 972 973 974 975 976
Ce qui a aid la pense des Australiens passer de la pluralit des gnies ancestraux l'ide du dieu tribal, c'est qu'entre ces deux extrmes un moyen terme s'est intercal qui a servi de transition : ce sont les hros civilisateurs. Les tres fabuleux que nous appelons de ce nom sont, en effet, de simples anctres auxquels la mythologie a attribu un rle minent dans l'histoire de la tribu et qu'elle a, pour cette raison, mis au-dessus des autres. Nous avons mme vu qu'ils faisaient rgulirement partie de l'organisation totmique : Mangarkunjerkunja est du totem du Lzard et Putiaputia du totem du Chat sauvage. Mais d'un autre ct, les fonctions qu'ils sont censs remplir ou avoir remplies ressemblent de trs prs celles qui incombent au grand dieu. Lui aussi passe pour avoir initi les hommes aux arts de la civilisation, pour avoir
967
968 969 970 971 972 973 974 975 976
V. sur cette question N. W. Thomas, Baiame and Bell-bird. A note on Australian Religion, in Man, 1905, no 28. Cf. LANG, Magie and Religion, p. 25. WAITZ avait dj soutenu le caractre original de cette conception dans Anthropologie d, Naturvlker, pp. 796-798. DAWSON, p. 49; MEYER, Encounter Bay Tribe, in WOODS, pp. 205, 206; HOWITT, Nat. Tr., pp. 481, 491, 492, 494; RIDLEY, Kamilaroi, p. 136. TAPLIN, The Narrinyeri, pp. 55-56. L. PARKER, More Austr. Leg. Tales, p. 94. TAPLIN, ibid., p. 61. BROUGH SMYTH, I, pp. 425-427. TAPLIN, ibid., p. 60. Le monde fut cr par des tres qu'on appelle des Nuralie; ces tres, qui existaient depuis longtemps, avaient la forme les uns du corbeau, les autres de l'aigle-faucon (BROUGH SMYTH, I, pp. 423-424). Byamee, dit Mrs. L. PARKER, est pour les Euahlayi ce que l'Alcheringa est pour les Arunta (The Euahlayi, p. 6). V. plus haut, p. 369.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
262
t le fondateur des principales institutions sociales, le rvlateur des grandes crmonies religieuses qui restent places sous son contrle. S'il est le pre des hommes, c'est pour les avoir fabriqus plutt qu'engendrs ; mais Mangarkunjerkunja en a fait autant. Avant lui, il n'y avait pas d'hommes, mais seulement des masses de chair informes o les diffrents membres et mme les diffrents individus n'taient pas spars les uns des autres. C'est lui qui a sculpt cette matire premire et qui en a tir des tres proprement humains . Entre ce mode de fabrication et celui que le mythe dont nous avons parl prte Bunjil, il n'y a que des nuances. Ce qui montre bien, d'ailleurs, le lien qui unit l'une l'autre ces deux sortes de figures, c'est qu'un rapport de filiation est parfois tabli entre elles. Chez les Kurnai, Tundun, le hros du bull-roarer, est le fils du grand dieu Mungan-ngaua . De mme, chez les Euahlayi, Daramulun, fils ou frre de Baiame, est identique Gayandi qui est l'quivalent du Tundun des Kurnai .
977 978 979
Assurment, de tous ces faits il ne faut pas conclure que le grand dieu n'est rien de plus qu'un hros civilisateur. Il y a des cas o ces deux personnages sont nettement diffrencis. Mais s'ils ne se confondent pas, ils sont, du moins, parents. Aussi arrive-t-il qu'on a quelque mal les distinguer ; il en est qui peuvent tre galement bien classs dans l'une ou dans l'autre catgorie. Ainsi, nous avons parl d'Atnatu comme d'un hros civilisateur; mais il est bien prs d'tre un grand dieu. La notion du dieu suprme dpend mme si troitement de l'ensemble des croyances totmiques qu'elle en porte encore la marque. Tundun est un divin hros tout proche, comme on vient de le voir, de la divinit tribale ; or le mme mot, chez les Kurnai, veut dire totem . De mme, chez les Arunta, Altjira est le nom du grand dieu ; c'est aussi le nom du totem maternel . Il y a plus ; nombre de grands dieux ont un aspect manifestement totmique. Daramulun est un aigle-faucon ; il a pour mre une mou . C'est sous les traits d'un mou que Baiame est galement reprsent . L'Altjira des Arunta a lui mme des jambes d'mou . Nuralie, avant d'tre le nom d'un grand dieu, dsignait, comme nous avons vu, les anctres fondateurs de la tribu; or ils taient, les uns des corbeaux et les autres des faucons . Bunjil,
980 981 982 983 984 985 986
977 978 979
980 981 982 983 984
985 986
Dans un autre mythe, rapport par SPENCER et GILLEN, un rle tout fait analogue est rempli par deux personnages qui habitent au ciel et qui sont appels Ungambikula (Nat. Tr., p. 388 et suiv.). HOWITT, Nat. Tr., p. 493. L. PARKER, The Euahlayi, p. 67, 62-66. C'est parce que le grand dieu est en troits rapports avec le bull-roarer qu'il est identifi au tonnerre ; car le ronflement que fait entendre cet instrument rituel est assimil au roulement du tonnerre. HOWITT, Nat. Tr., p. 135. Le mot qui signifie totem est crit par Howitt, thundung. STREHLOW, I, p. 1-2 et II, p. 59. On se rappelle que, trs vraisemblablement, chez les Arunta, le totem maternel tait primitivement le totem proprement dit. HOWITT, Nat. Tr., p. 555. Ibid., p. 546, 560. RIDLEY, Kamilaroi, p. 136, 156. Il est reprsent sous cette forme dans les rites d'initiation chez les Kamilaroi. D'aprs une autre lgende, il serait un cygne noir (L. PARKER, More Austral. Leg. Tales, p. 94). STREHLOW, I, p. 1. BROUGH SMYTH, I, pp. 423-424.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
263
d'aprs Howitt , est toujours figur sous une forme humaine ; cependant, le mme mot sert dsigner un totem de phratrie, l'aigle-faucon. Un de ses fils, au moins, est un des totems que comprend la phratrie laquelle il a donn on emprunt son nom . Son frre est Pallyan, la chauve-souris ; or celle-ci sert de totem sexuel aux hommes dans de nombreuses tribus de Victoria .
987 988 989
On peut mme aller plus loin et prciser davantage le rapport que soutiennent les grands dieux avec le systme totmique. Daramulun, comme Bunjil, est un aigle-faucon et l'on sait que cet animal est un totem de phratrie dans un grand nombre de tribus du Sud-Est . Nuralie, avons-nous dit, semble avoir t d'abord un terme collectif qui dsignait indistinctement soit des aigles-faucons soit des corbeaux ; or, dans les tribus o ce mythe a t observ, le corbeau sert de totem l'une des deux phratries, l'aigle-faucon l'autre . D'autre part, l'histoire lgendaire des grands dieux rappelle de trs prs celle des totems de phratrie. Les mythes, et parfois les rites, commmorent les luttes que chacune de ces divinits eut soutenir contre un oiseau carnassier dont elle ne triompha pas sans peine. Bunjil, ou le premier homme, aprs avoir fait le second homme, Karween, entra en conflit avec lui, et, au cours d'une sorte de duel, il le blessa grivement et le transforma en corbeau . Les deux espces de Nuralie sont prsentes comme deux groupes ennemis qui, primitivement, taient sans cesse en guerre . Baiame, de son ct, a lutter contre Mullian, l'aigle-faucon cannibale, qui, d'ailleurs, est identique Daramulun . Or nous avons vu qu'entre les totems de phratrie il y a galement une sorte d'hostilit constitutionnelle. Ce paralllisme achve de prouver que la mythologie des grands dieux et celle de ces totems sont troitement parentes. Cette parent apparatra comme plus vidente encore si l'on remarque que l'mule du dieu est rgulirement ou le corbeau ou l'aigle-faucon qui sont, d'une manire gnrale, des totems de phratrie .
990 991 992 993 994 995
Baiame, Daramulun, Nuralie, Bunjil semblent donc bien tre des totems de phratrie qui ont t diviniss ; et voici comment on peut concevoir que se fit cette apothose. C'est manifestement dans les assembles qui ont lieu propos de l'initiation que s'labora cette conception ; car les grands dieux ne jouent un rle de quelque importance que dans ces rites, tandis qu'ils sont trangers aux autres crmonies religieuses. D'ailleurs, comme l'initiation est la forme principale du culte tribal, c'est seulement cette occasion qu'une mythologie tribale pouvait prendre naissance. Dj nous avons vu comment le rituel de la circoncision et celui de la subincision tendaient spontanment se personnifier sous la forme de hros civilisateurs. Seulement, ces hros n'exeraient aucune suprmatie ; ils taient sur le mme pied que les
987 988 989 990 991 992 993 994 995
Nat. Tr., p. 492. HOWITT, Nat. Tr., p. 128. BROUGH SMYTH, I, pp. 417-423. V. plus haut, p. 151. Ce sont les tribus o les phratries portent les noms de Kilpara (Corbeau) et de Mukwara. C'est ce qui explique le mythe mme rapport par BROUGH SMYTH (I, pp. 423-424). BROUGH SMYTH, I, pp. 125-427. Cf. HOWITT, Nat. Tr., p. 486; dans ce dernier cas, Karween est identifi avec le hron bleu. BROUGH SMYTH, I, p. 423. RIDLEY, Kamilaroi, p. 136; HOWITT, Nat. Tr., p. 585; MATHEWS, J. of R. S. of N. S. Wales, XXVIII (1894), p. 111. V. plus haut, p. 207. Cf. P. SCHMIDT, L'origine de l'ide de Dieu, in Anthropos, 1909.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
264
autres bienfaiteurs lgendaires de la socit. Mais l o la tribu prit un plus vif sentiment d'ellemme, ce sentiment s'incarna tout naturellement dans un personnage qui en devint le symbole. Pour s'expliquer eux-mmes les liens qui les unissaient les uns aux autres, quelque clan qu'ils appartinssent, les hommes imaginrent qu'ils taient issus d'une mme souche, qu'ils taient les enfants d'un mme pre qui ils devaient l'existence sans que lui la dt personne. Le dieu de l'initiation tait tout dsign pour ce rle; car, suivant une expression qui revient souvent sur les lvres des indignes, l'initiation a prcisment pour objet de faire, de fabriquer des hommes. On attribua donc ce dieu un pouvoir crateur et il se trouva, pour toutes ces raisons, investi d'un prestige qui le mit bien au-dessus des autres hros de la mythologie. Ceuxci devinrent ses subordonns, ses auxiliaires ; on fit d'eux ses fils ou ses frres puns comme Tundun, Gayandi, Karween, Pallyan, etc. Mais il existait dj d'autres tres sacres qui occupaient dans le systme religieux de la tribu une place galement minente : ce sont les totems de phratrie. L o ils se sont maintenus, ils passent pour tenir sous leur dpendance les totems des clans. Ils avaient ainsi tout ce qu'il fallait pour devenir eux-mmes des divinits tribales. Il tait donc naturel qu'une confusion partielle s'tablt entre ces deux sortes de figures mythiques ; c'est ainsi que l'un des deux totems fondamentaux de la tribu prta ses traits au grand dieu. Mais comme il fallait expliquer pourquoi, seul, l'un d'eux fut appel cette dignit dont l'autre tait exclu, on supposa que ce dernier, au cours d'une lutte contre son rival, avait eu le dessous et que son exclusion avait t la suite de sa dfaite. L'ide fut d'autant plus facilement admise qu'elle tait d'accord avec l'ensemble de la mythologie, puisque les totems de phratrie sont gnralement considrs comme ennemis l'un de l'autre. Un mythe que Mrs. Parker a observ chez les Euahlayi peut servir confirmer cette explication ; car il ne fait que la traduire sous une forme figure. On raconte que, dans cette tribu, les totems n'taient d'abord que les noms donns aux diffrentes parties du corps de Baiame. Les clans seraient donc, en un sens, comme des fragments du corps divin. N'est-ce pas une autre manire de dire que le grand dieu est la synthse de tous les totems et, par consquent, la personnification de l'unit tribale ?
996
Mais il prit en mme temps un caractre international. En effet, les membres de la tribu laquelle appartiennent les jeunes initis ne sont pas les seuls qui assistent aux crmonies de l'initiation ; des reprsentants des tribus voisines sont spcialement convoqus ces ftes qui sont des sortes de foires internationales, la fois religieuses et laques . Des croyances qui s'laborent dans des milieux sociaux ainsi composs ne peuvent rester le patrimoine exclusif d'une nationalit dtermine. L'tranger qui elles ont t rvles les rapporte dans sa tribu natale, une fois qu'il y est rentr ; et comme, tt ou tard, il est forc d'inviter son tour ses htes de la veille, il se fait, de socit socit, de continuels changes d'ides. C'est ainsi qu'une mythologie internationale se constitua dont le grand dieu se trouva tout naturellement tre l'lment essentiel, puisqu'elle avait son origine dans les rites de l'initiation qu'il a pour
997
996 997
Op. cit., p. 7. Chez le mme peuple, la femme principale de Baiame est galement reprsente comme la mre de tous les totems, sans tre elle-mme d'aucun totem (ibid., p. 7 et 78). V. HOWITT, Nat. Tr., pp. 511-512, 513, 602 et suiv.; MATHEWS, J. of R. S. of N. S. Wales, XXXVIII, p. 270. On invite aux ftes de l'initiation non seulement les tribus avec lesquelles un connubium rgulier est tabli, mais aussi celles avec lesquelles on a des querelles rgler ; des vendetta, demi crmonielles et demi srieuses, ont lieu dans ces occasions.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
265
fonction de personnifier. Son nom passa donc d'une langue dans l'autre avec les reprsentations qui y taient attaches. Le fait que les noms des phratries sont gnralement communs des tribus trs diffrentes ne put que faciliter cette diffusion. L'internationalisme des totems de phratrie fraya les voies celui du grand dieu.
V
.
Nous voici parvenus la conception la plus haute laquelle se soit lev le totmisme. C'est le point o il rejoint et prpare les religions qui suivront, et il nous aide les comprendre. Mais en mme temps, on peut voir que cette notion culminante se relie sans interruption aux croyances plus grossires que nous avons analyses en premier lieu. Le grand dieu tribal, en effet, n'est qu'un esprit ancestral qui a fini par conqurir Une place minente. Les esprits ancestraux ne sont que des entits forges l'image des mes individuelles de la gense desquelles ils sont destins rendre compte. Les mes, leur tour, ne sont que la forme que prennent, en s'individualisant dans des corps particuliers, les forces impersonnelles que nous avons trouves la base du totmisme. L'unit du systme en gale la complexit. Dans ce travail d'laboration, l'ide d'me a, sans doute, jou un rle important : c'est par elle que l'ide de personnalit a t introduite dans le domaine religieux. Mais il s'en faut que, comme le soutiennent les thoriciens de l'animisme, elle contienne toute la religion en germe. D'abord, elle suppose avant elle l. notion de mana ou de principe totmique dont elle n'est qu'un mode particulier. Puis, si les esprits et les dieux ne pouvaient tre conus avant l'me, ils sont pourtant autre chose que de simples mes humaines, libres par la mort; car d'o leur viendraient leurs pouvoirs surhumains ? L'ide d'me a seulement servi orienter l'imagination mythologique dans une nouvelle direction, lui suggrer des constructions d'un genre nouveau. Mais la matire de ces constructions a t emprunte, non la reprsentation de l'me, mais ce rservoir de forces anonymes et diffuses qui constituent le fond primitif des religions. La cration de personnalits mythiques n'a t qu'une autre faon de penser ces forces essentielles. Quant la notion de grand dieu, elle est due tout entire un sentiment dont nous avons dj observ l'action dans la gense des croyances les plus spcifiquement totmiques : c'est le sentiment tribal. Nous avons vu, en effet, que le totmisme n'tait pas luvre isole des clans, mais qu'il s'laborait toujours au sein d'une tribu qui avait, quelque degr, conscience de son unit. C'est pour cette raison que les diffrents cultes particuliers chaque clan se rejoignent et se compltent de manire former un tout solidaire . Or c'est ce mme sentiment de l'unit tribale qui s'exprime dans la conception d'un dieu suprme, commun la tribu tout entire. Ce sont donc bien les mmes causes qui sont agissantes de la base au sommet de ce systme
998
998
V. plus haut pp. 221-222.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
266
religieux. Toutefois, nous avons considr jusqu'ici les reprsentations religieuses comme si elles se suffisaient et pouvaient s'expliquer par elles-mmes. En fait, elles sont insparables des rites, non seulement parce qu'elles s'y manifestent, mais parce qu'elles en subissent, par contre coup, l'influence. Sans doute, le culte dpend des croyances, mais il ragit sur elles. Pour les mieux comprendre, il importe donc de le mieux connatre. Le moment est venu d'en aborder l'tude.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
267
LIVRE III
LES PRINCIPALES ATTITUDES RITUELLES
.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
268
CHAPITRE I
LE CULTE NGATIF ET SES FONCTIONS. LES RITES ASCTIQUES
.
Nous n'avons pas l'intention de tenter, dans ce qui suit, une description complte du culte primitif. Avant tout proccup d'atteindre ce qu'il y a de plus lmentaire et de plus fondamental dans la vie religieuse, nous ne chercherons pas reconstituer dans le dtail la multiplicit, souvent confuse, de tous les gestes rituels. Mais nous voudrions, travers l'extrme diversit des pratiques, tcher de saisir les attitudes les plus caractristiques que le primitif observe dans la clbration de son culte, classer les formes les plus gnrales de ses rites, en dterminer les origines et la signification, afin de contrler et, s'il y a lieu, de prciser les rsultats auxquels nous a conduit l'analyse des croyances .
999
Tout culte prsente un double aspect : l'un ngatif, l'autre positif. Sans doute, dans la ralit, les deux sortes de rites que nous dnommons ainsi sont troitement associs ; nous verrons qu'ils se supposent l'un l'autre. Mais ils ne laissent pas d'tre diffrents et, ne serait-ce que pour comprendre leurs rapports, il est ncessaire de les distinguer.
I
.
Les tres sacrs sont, par dfinition, des tres spars. Ce qui les caractrise, c'est que, entre eux et les tres profanes, il y a une solution de continuit. Normalement, les uns sont en dehors
999
Il y a notamment une forme du rituel que nous laisserons compltement de ct ; c'est le rituel oral qui doit tre tudi dans un volume spcial de la Collection de l'Anne sociologique.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
269
des autres. Tout un ensemble de rites a pour objet de raliser cet tat de sparation qui est essentiel. Puisqu'ils ont pour fonction de prvenir les mlanges et les rapprochements indus, d'empcher qu'un de ces deux domaines n'empite sur l'autre, ils ne peuvent dicter que des abstentions, c'est--dire des actes ngatifs. Pour cette raison, nous proposons d'appeler culte ngatif le systme form par ces rites spciaux. Ils ne prescrivent pas au fidle d'accomplir des prestations effectives, mais se bornent lui interdire certaines faons d'agir ; ils prennent donc tous la forme de l'interdit, ou, comme on dit couramment en ethnographie, du tabou. Ce dernier mot est celui qui est employ dans les langues polynsiennes pour dsigner l'institution en vertu de laquelle certaines choses sont retires de l'usage commun .; c'est aussi un adjectif qui exprime le caractre distinctif de ces sortes de choses. Nous avons eu dj l'occasion de montrer combien il est fcheux de transformer ainsi, en un terme gnrique, une expression troitement locale et dialectale. Il n'y a pas de religion o il n'existe des interdictions et o elles ne jouent un rle considrable ; il est donc regrettable que la terminologie consacre paraisse faire, d'une institution aussi universelle, une particularit propre la Polynsie . L'expression d'interdits ou d'interdictions nous parat de beaucoup prfrable. Cependant, le mot de tabou, comme celui de totem, est tellement usit qu'il y aurait un excs de purisme le prohiber systmatiquement ; les inconvnients qu'il prsente sont, d'ailleurs, attnus une fois qu'on a pris soin d'en prciser le sens et la porte.
1000 1001
Mais il y a des interdits d'espces diffrentes et qu'il importe de distinguer ; car nous n'avons pas traiter, dans le prsent chapitre, de toutes les sortes d'interdits. Tout d'abord, en dehors de ceux qui relvent de la religion, il en est qui ressortissent la magie. Les uns et les autres ont ceci de commun qu'ils dictent des incompatibilits entre certaines choses et prescrivent de sparer les choses ainsi dclares incompatibles. Mais il y a entre eux de trs graves diffrences. D'abord, les sanctions ne sont pas les mmes dans les deux cas. Sans doute, comme nous le dirons plus loin, la violation des interdits religieux passe souvent pour dterminer mcaniquement des dsordres matriels dont le coupable est cens ptir et qui sont considrs comme une sanction de son acte. Mais, alors mme qu'elle se produit rellement, cette sanction spontane et automatique ne reste pas la seule; elle est toujours complte par une autre qui suppose une intervention humaine. Ou bien une peine proprement dite s'y surajoute, quand elle ne l'anticipe pas, et cette peine est dlibrment inflige par les hommes ; ou, tout au moins, il y a blme, rprobation publique. Alors mme que le sacrilge a t comme puni par la maladie ou la mort naturelle de son auteur, il est, de plus, fltri ; il offense l'opinion qui ragit contre lui; il met celui qui l'a commis en tat de faute. Au contraire, l'interdiction magique n'est sanctionne que par les consquences matrielles qu'est cens produire, avec une sorte de ncessit physique, l'acte interdit. En dsobissant, on court des risques, comme ceux auxquels s'expose un malade qui ne suit pas les avis de son mdecin ; mais la dsobissance, dans ce cas, ne constitue pas une faute ; elle n'indigne pas. Il n'y a pas de pch magique. Cette diffrence dans les sanctions tient, d'ailleurs, une
1000 1001
V. l'article Taboo dans l'Encyclopedia Britannica, dont l'auteur est FRAZER. Les faits prouvent la ralit de cet inconvnient. Il ne manque pas d'crivains qui, sur la foi du mot, ont cru que l'institution ainsi dsigne tait spciale ou aux socits primitives en gnral ou mme aux seuls peuples polynsiens (v. RVILLE, Religion des peuples primitifs, Il, p. 55; RICHARD, La femme dans l'histoire, p. 435).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
270
diffrence profonde dans la nature des interdits. L'interdit religieux implique ncessairement la notion du sacr ; il vient du respect que l'objet sacr inspire et il a pour but d'empcher qu'il soit manqu ce respect. Au contraire, les interdits magiques ne supposent que la notion toute laque de proprit. Les choses que le magicien recommande de tenir spares sont celles qui, en raison de leurs proprits caractristiques, ne peuvent tre mles ou rapproches sans dangers. Si mme il lui arrive d'inviter ses clients se tenir distance de certaines choses sacres, ce n'est pas par respect pour elles et de peur qu'elles ne soient profanes, car la magie, nous le savons, vit de profanations ; c'est uniquement pour des raisons d'utilit temporelle. En un mot, les interdits religieux sont des impratifs catgoriques ; les autres sont des maximes utilitaires, premire forme des interdits hyginiques et mdicaux. On ne peut, sans confusion, tudier simultanment et sous un mme nom deux ordres de faits aussi diffrents. Nous n'avons nous occuper ici que des interdictions religieuses .
1002 1003
Mais entre ces dernires elles-mmes, une nouvelle distinction est ncessaire. Il y a des interdits religieux qui ont pour objet de sparer, les unes des autres, des choses sacres d'espces diffrentes. On se rappelle, par exemple, comment, chez les Wakelbura, l'chafaud sur lequel le mort est expos doit tre exclusivement construit avec des matriaux qui ressortissent la phratrie du dfunt ; c'est dire que tout contact est interdit entre le mort, qui est sacr, et les choses de l'autre phratrie, qui sont sacres, elles aussi, mais des titres diffrents. Ailleurs, les armes dont on se sert pour chasser un animal ne doivent pas tre faites d'un bois qui soit class dans le mme groupe social que l'animal lui-mme . Mais les plus importantes de ces interdictions sont celles que nous tudierons dans un prochain chapitre: elles sont destines prvenir toute communication entre le sacr pur et le sacr impur, entre le sacr faste et le sacr nfaste. Tous ces interdits ont une commune caractristique : ils viennent, non de ce qu'il y a des choses sacres et d'autres qui ne le sont pas, mais de ce qu'entre les choses sacres il existe des rapports de disconvenance et d'incompatibilit. Ils ne tiennent donc pas ce qu'il y a d'essentiel dans l'ide du sacr. Aussi l'observance de ces prohibitions ne peut-elle donner lieu qu' des rites isols, particuliers et presque exceptionnels ; mais elle ne saurait constituer un culte proprement dit, car un culte est fait, avant tout, de rapports rguliers entre le profane et le sacr comme tel.
1004
Mais il existe un autre systme d'interdictions religieuses beaucoup plus tendu et plus important : c'est celui qui spare, non des espces diffrentes de choses sacres, mais tout ce qui est sacr d'avec tout ce qui est profane. Il drive donc immdiatement de la notion mme du sacr qu'il se borne exprimer et raliser. Aussi fournit-il la matire d'un vritable culte et mme d'un culte qui est la base de tous les autres ; car l'attitude qu'il prescrit est celle dont le fidle ne doit jamais se dpartir dans ses rapports avec les tres sacrs. C'est ce que nous appelons le culte ngatif. On peut donc dire de ces interdits qu'ils sont les interdits religieux par
1002
V. plus haut, pp. 59-60. Ce n'est pas dire qu'entre les interdits religieux et les interdits magiques il y ait une solution de continuit radicale : il en est, au contraire, dont la nature vraie est indcise. Il y a des interdits du folklore dont il est souvent malais de dire s'ils sont religieux ou magiques. La distinction n'en est pas moins ncessaire ; car les interdits magiques ne peuvent, croyons-nous, tre compris qu'en fonction des interdits religieux. 1004 V. plus haut, p. 212.
1003
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
271
excellence
1005
. C'est d'eux seuls qu'il sera question dans les pages qui vont suivre.
Mais ils prennent les formes multiples. Voici les types principaux que l'on observe en Australie. Avant tout, il y a des interdits de contact : ce sont les tabous primaires dont les autres ne sont gure que des varits particulires. Ils reposent sur ce principe que le profane ne doit pas toucher le sacr. Dj nous avons vu qu'en aucun cas les churinga ou les bull-roarers ne doivent tre manis par des non-initis. Si les adultes en ont le libre usage, c'est que l'initiation leur a confr un caractre sacr. Le sang, et tout particulirement celui qui coule pendant l'initiation, a une vertu religieuse ; il est Soumis au mme interdit . Il en est de mme des chevaux . Le mort est un tre sacr, parce que l'me qui animait le corps adhre au cadavre ; pour cette raison, il est parfois dfendu de porter les ossements du mort autrement qu'envelopps dans une feuille d'corce . Le lieu mme oh s'est produit le dcs doit tre vit ; car on croit que l'me du dfunt continue y sjourner. C'est pourquoi on lve le camp et on le transporte quelque distance ; dans certains cas, on le dtruit avec tout ce qu'il contient , et un temps s'coule avant qu'on puisse revenir au mme endroit . Il arrive que dj le mourant fait comme le vide autour de lui : on l'abandonne, aprs l'avoir install aussi confortablement que possible .
1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013
Un contact exceptionnellement intime est celui qui rsulte de l'absorption d'un aliment. De l vient l'interdiction de manger les animaux ou les vgtaux sacrs, notamment ceux qui servent de totems . Un tel acte apparat comme tellement sacrilge que la prohibition
1014
1005
Beaucoup des interdits entre choses sacres se ramnent, pensons-nous, l'interdiction entre sacr et profane. C'est le cas des interdits d'ge ou de grade. En Australie, par exemple, il y a des aliments sacrs qui sont rservs aux seuls initis. Mais ces aliments ne sont pas tous sacrs au mme degr ; il y a entre eux une hirarchie. De leur ct, les initis ne sont pas tous gaux. Ils ne jouissent pas d'emble de la plnitude de leurs droits religieux, mais n'entrent que pas pas dans le domaine des choses sacres. Ils doivent passer par toute une srie de grades qui leur sont confrs, les uns aprs les autres, la suite d'preuves et de crmonies spciales ; il leur faut des mois, parfois mme des annes pour parvenir au plus lev. Or, chacun de ces grades sont affects des aliments dtermins ; les hommes des grades infrieurs ne peuvent pas toucher aux aliments qui appartiennent de droit aux hommes des grades suprieurs (v. MATHEWS, Ethnol. Notes, etc., loc. cit., p. 262 et suiv.; Langloh PARKER, The Euahlayi, p. 23; SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 611 et suiv. Nat. Tr., p. 470 et suiv.). Le plus sacr repousse donc le moins sacr mais c'est que le second est profane par rapport au premier. En somme, toutes les interdictions religieuses se rangent en deux classes : les interdictions entre le sacr et le profane, celles entre le sacr pur et le sacr impur. 1006 V. plus haut, p. 194. 1007 SPENCER et GiLLEN, Nat. Tr., p. 463. 1008 Nat. Tr., p. 538; North. Tr., p. 604. 1009 North. Tr., p. 531. 1010 North. Tr., p. 518-519; HOWITT, Nat. Tr., p. 449. 1011 SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 498; SCHULZE, loc. cit, p. 231. 1012 SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 449. 1013 HOWITT, Nat. Tr., p. 451. 1014 Si les interdictions alimentaires qui s'appliquent au vgtal ou l'animal totmique sont les plus importantes, il s'en faut que ce soient les seules. Nous avons vu qu'il y a des aliments interdits aux noninitis, parce qu'ils sont considrs comme sacrs; or, des causes trs diverses peuvent leur confrer ce
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
272
s'applique mme aux adultes ou, tout au moins, la plupart d'entre eux; seuls, les vieillards atteignent une suffisante dignit religieuse pour n'tre pas toujours soumis cet interdit. On a parfois expliqu cette dfense par la parent mythique qui unit l'homme aux animaux dont il porte le nom ; ils seraient protgs par le sentiment de sympathie qu'ils inspirent en qualit de parents . Mais ce qui montre bien que l'interdiction n'a pas pour origine une simple rvolte du sentiment de solidarit domestique, c'est que la consommation de la chair prohibe passe pour dterminer automatiquement la maladie et la mort. C'est donc que des forces d'un autre genre sont en jeu, analogues celles qui, dans toutes les religions, sont censes ragir contre les sacrilges.
1015
Si, d'ailleurs, certains aliments sont interdits au profane parce qu'ils sont sacrs, d'autres, au contraire, sont interdits, parce que profanes, aux personnes marques d'un caractre sacr. Ainsi, il est frquent que des animaux dtermins soient affects spcialement l'alimentation des femmes; pour cette raison, on croit qu'ils participent de la nature fminine, et, par consquent, qu'ils sont profanes. Le jeune initi, au contraire, est soumis un ensemble de rites d'une particulire gravit ; pour pouvoir lui communiquer les vertus qui lui permettront de pntrer dans le monde des choses sacres d'o il tait exclu jusqu'alors, on fait converger sur lui un faisceau exceptionnellement puissant de forces religieuses. Il se trouve donc dans un tat de saintet qui repousse au loin tout ce qui est profane. Aussi lui est-il dfendu de manger du gibier qui est cens ressortir aux femmes .
1016
Mais le contact peut s'tablir autrement que par le toucher. On est en relations avec une chose par cela seul qu'on la regarde : le regard est une mise en rapports. C'est pourquoi la vue des choses sacres est, clans certains cas, interdite aux profanes. La femme ne doit jamais voir les instruments du culte ; tout an plus lui est-il permis de les apercevoir de loin . Il en est de mme des peintures totmiques excutes sur le corps des officiants l'occasion de crmonies particulirement importantes . L'exceptionnelle solennit des rites d'initiation fait que, dans certaines tribus, les femmes ne peuvent mme pas voir les lieux o ils ont t clbrs ni le nophyte lui-mme . Le caractre sacr qui est immanent la crmonie tout entire se retrouve naturellement dans la personne de ceux qui la dirigent ou qui y prennent une part quelconque ; il en rsulte que le novice ne peut lever les yeux sur eux, et la dfense survit
1017 1018 1019 1020
caractre. Par exemple, comme nous le verrons plus loin, les animaux qui montent sur le faite des arbres levs sont rputs sacrs parce qu'ils sont voisins du grand dieu qui vit aux cieux. Il est possible aussi que, pour des raisons diffrentes, la chair de certains animaux ait t spcialement rserve aux vieillards et que, par suite, elle ait paru participer du caractre sacr qui est reconnu ces derniers. 1015 V. FRAZER, Totemism, p. 7. 1016 HOWITT, Nat. Tr., p. 674. - Il y a une interdiction de contact dont nous ne disons rien parce que la nature exacte n'en est pas trs facilement dterminable : c'est le contact sexuel. Il y a des priodes religieuses o l'homme ne doit pas avoir commerce avec la femme (North. Tr., pp. 293, 295 ; HOWITT, Nat. Tr., p. 387). Est-ce parce que la femme est profane ou parce que l'acte sexuel est un acte redout ? La question ne peut tre tranche en passant. Nous l'ajournons comme tout ce qui concerne les rites conjugaux et sexuels. lis tiennent trop troitement au problme du mariage et de la famille pour en pouvoir tre spars. 1017 SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 134; HOWITT, Nat. Tr., p. 354. 1018 SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 624. 1019 HOWITT, Nat. Tr., p. 572. 1020 HOWITT, ibid., p. 661.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
273
mme aprs que le rite est accompli . Le mort, lui aussi, est parfois soustrait aux regards: sa face est recouverte de manire ce qu'elle ne puisse tre vue .
1021 1022
La parole est une autre faon d'entrer en relations avec les personnes ou avec les choses. Le souffle expir tablit la communication; c'est quelque chose de nous qui se rpand au dehors. Aussi est-il interdit aux profanes d'adresser la parole aux tres sacrs ou simplement de parler en leur prsence. De mme que le nophyte ne doit regarder ni les oprateurs ni les assistants, il lui est dfendu de converser avec eux autrement que par signes ; et cette interdiction persiste jusqu' ce qu'elle ait t leve au moyen d'un rite spcial . D'une manire gnrale, il y a, chez les Arunta, au cours des grandes crmonies, des moments o le silence est de rigueur . Ds que les churinga sont exposs, on se tait ; ou bien, si l'on parle, c'est voix basse et du bout des lvres .
1023 1024 1025
En dehors des choses sacres, il y a des mots, des sons qui ont le mme caractre : ils ne doivent ni se trouver sur les lvres des profanes ni frapper leurs oreilles. Il y a des chants rituels que les femmes ne doivent pas entendre sous peine de mort . Elles peuvent percevoir le bruit des bull-roarers, mais seulement distance. Tout nom propre est considr comme un lment essentiel de la personne qui le porte ; troitement associ dans les esprits l'ide de cette personne, il participe des sentiments qu'elle inspire. Si donc elle est sacre, il est lui-mme sacr. Aussi ne peut-il tre prononc au cours de la vie profane. Il y a, chez les Warramunga, un totem qui est particulirement vnr ; c'est le serpent mythique appel Wollunqua : son nom est tabou . Il en est de mme de Baiame, de Daramulun, de Bunjil : la forme sotrique de leur nom ne peut tre rvle aux non-initis . Pendant le deuil, le nom du mort ne doit pas tre mentionn, au moins par ses parents, sauf quand il y a absolue ncessit et, mme dans ce cas, on doit se borner le chuchoter . Cette interdiction est souvent perptuelle pour la veuve et pour certains proches . Chez quelques peuples, elle s'tend mme au del de la famille ; tous les individus qui portent le mme nom que le dfunt sont tenus d'en changer temporairement . Il y a plus : les parents et les intimes s'interdisent parfois certains mots de la langue usuelle, sans doute parce qu'ils taient employs par le mort ; on comble ces lacunes au moyen de priphrases ou d'emprunts faits quelque dialecte tranger . Outre leur nom publie et vulgaire, les hommes en portent un autre qui est tenu secret : les femmes et les enfants l'ignorent ; jamais il n'en est fait usage dans la vie ordinaire. C'est qu'il a un caractre
1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032
1021 1022
SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 386; HOWITT, Nat. Tr., pp. 655,665. Chez les Wiimbaio (HOWITT, ibid., p. 451). 1023 HOWITT, ibid., p. 624, 661, 663, 667; SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 221, 382 et suiv.; North., Tr., pp. 335, 344, 353, 369. 1024 SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 221, 262, 288, 303, 367, 378, 380. 1025 Ibid., p. 302. 1026 HOWITT, Nat. Tr., p. 581. 1027 North. Tr., p. 227. 1028 Voir plus haut, p. 412. 1029 SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 498; North. Tr., p. 526; TAPLIN, Narrinyeri, p. 19. 1030 HOWITT, Nat. Tr., pp. 466, 469 et suiv. 1031 WYATT, Adelaide and Encounter Bay Tribes, in WOODS, p. 165. 1032 HOWITT, Nat. Tr., p. 470.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
274
religieux . Il y a mme des crmonies pendant lesquelles on est oblig de parler un langage spcial dont il est dfendu de se servir dans les relations profanes. C'est un commencement de langue sacre .
1033 1034
Non seulement les tres sacrs sont spars des profanes, mais rien de ce qui concerne, directement ou indirectement, la vie profane ne doit se mler la vie religieuse. Une nudit complte est souvent exige de l'indigne comme une condition pralable pour qu'il puisse tre admis participer au rite , il est tenu de se dpouiller de tous ses ornements habituels, mme de ceux auxquels il tient le plus et dont il se spare le moins volontiers cause des vertus protectrices qu'il leur attribue . Si, pour jouer son rle rituel, il est oblig de se dcorer, cette dcoration doit tre faite spcialement pour la circonstance ; c'est un costume crmoniel, un vtement de fte . Parce que ces ornements sont sacrs en raison de l'usage qui en a t fait, il est interdit de s'en servir dans les relations profanes : une fois que la crmonie est close, on les enterre ou on les brle ; les hommes doivent mme se laver de manire n'emporter sur eux aucune trace des dcorations dont ils taient revtus .
1035 1036 1037 1038 1039
Plus gnralement, les actes caractristiques de la vie ordinaire sont interdits tandis que se droulent ceux de la vie religieuse. L'acte de manger est, par lui-mme, profane ; car il a lieu tous les jours, il satisfait des besoins essentiellement utilitaires et matriels, il fait partie de notre existence vulgaire . C'est pourquoi il est prohib en temps religieux. Ainsi, quand un groupe totmique a prt ses churinga un clan tranger, c'est un moment tout fait solennel que celui o ils sont rapports et replacs dans l'ertnatulunga : tous ceux qui prennent part la crmonie doivent rester jeun tant qu'elle dure, et elle dure longtemps . La mme rgle s'observe pendant la clbration des rites dont il sera question au chapitre suivant, ainsi qu' certains moments de l'initiation .
1040 1041 1042 1043
Pour la mme raison, toutes les occupations temporelles sont suspendues quand ont lieu les
1033 1034
HOWITT, Nat. Tr., p. 657; SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 139 ; North. Tr., p. 580 et suiv. HOWITT, Nat. Tr., p. 537. 1035 Ibid., pp. 544, 597, 614, 620. 1036 Par exemple, la ceinture de cheveux qu'il porte d'ordinaire (SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 171). 1037 Ibid., p. 624 et suiv. 1038 HOWITT, Nat. Tr., p. 556, 1039 Ibid., p. 587. 1040 Cet acte prend, il est vrai, un caractre religieux quand l'aliment consomm est sacr. Mais l'acte, par lui-mme, est si bien profane que la consommation d'un aliment sacr constitue toujours une profanation. La profanation peut tre permise ou mme ordonne, mais, comme nous le verrons plus loin, condition que des rites la prcdent ou l'accompagnent qui l'attnuent ou l'expient. L'existence de ces rites montre bien que, par elle-mme, la choses sacre rpugne tre consomme. 1041 North. Tr., p. 263. 1042 Spencer et GiLLEN, Nat. Tr., p. 171. 1043 HOWITT, Nat. Tr., p. 674. Peut-tre la dfense de parler pendant les grandes solennits religieuses tient-elle, en partie, la mme cause, On parle, et surtout on parle voix haute dans la vie courante ; donc, dans la vie religieuse, on doit ou se taire ou parler voix basse. La mme considration n'est pas trangre aux interdictions alimentaires (v. plus haut, p. 181).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
275
grandes solennits religieuses. Suivant une remarque de Spencer et Gillen que nous avons eu dj l'occasion de citer, la vie de l'Australien est faite de deux parts trs distinctes : l'une est employe la chasse, la pche, la guerre ; l'autre est consacre au culte, et ces deux formes d'activit s'excluent et se repoussent mutuellement. C'est sur ce principe que repose l'institution universelle du chmage religieux. Le caractre distinctif des jours de fte, dans toutes les religions connues, c'est l'arrt du travail, la suspension de la vie publique et prive, en tant qu'elle n'a pas d'objectif religieux. Ce repos n'est pas simplement une sorte de relche temporaire que les hommes se seraient accorde pour pouvoir se livrer plus librement aux sentiments d'allgresse qu'veillent gnralement les jours fris ; car il y a des ftes tristes, consacres au deuil et la pnitence, et pendant lesquelles il n'est pas moins obligatoire. Mais c'est que le travail est la forme minente de l'activit profane : il n'a d'autre but apparent que de subvenir aux ncessits temporelles de la vie; il ne nous met en rapport qu'avec des choses vulgaires. Au contraire, aux jours de fte, la vie religieuse atteint un degr d'exceptionnelle intensit. Le contraste entre ces deux sortes d'existence est donc, ce moment, particulirement marqu ; par suite, elles ne peuvent voisiner. L'homme ne peut approcher intimement de son dieu quand il porte encore sur lui les marques de sa vie profane; inversement, il ne peut retourner ses occupations usuelles alors que le rite vient de le sanctifier. Le chmage rituel n'est donc qu'un cas particulier de l'incompatibilit gnrale qui spare le sacr du profane ; c'est le rsultat d'un interdit.
1044
Il ne saurait tre question d'numrer ici toutes les espces d'interdits qui sont observs, mme dans les seules religions australiennes. Comme la notion du sacr sur laquelle il repose, le systme des interdits s'tend aux relations les plus diverses ; on l'utilise mme dlibrment pour des fins utilitaires . Mais, si complexe qu'il puisse tre, il vient finalement aboutir deux interdictions fondamentales qui le rsument et qui le dominent.
1045
En premier lieu, la vie religieuse et la vie profane ne peuvent coexister dans un mme espace. Pour que la premire puisse se dvelopper, il faut donc lui amnager un emplacement spcial d'o la seconde soit exclue. De l vient l'institution des temples et des sanctuaires : ce
1044 1045
North. Tr., p. 33. Parce qu'il y a, l'intrieur de chaque homme, un principe sacr, l'me, l'individu s'est trouv, ds l'origine, entour d'interdits, premire forme des interdits moraux qui isolent et protgent aujourd'hui la personne humaine. C'est ainsi que le corps de sa victime est considr comme dangereux pour le meurtrier (SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 492) et lui est interdit. Or, les interdits qui ont cette origine sont souvent utiliss par les individus comme un moyen de retirer certaines choses de l'usage commun et d'tablir sur elles un droit de proprit. Un homme sort-il du camp en y laissant des armes, des aliments, etc., dit ROTH propos des tribus de la Rivire Palmer (Queensland du Nord?), s'il urine proximit des objets qu'il a ainsi laisss derrire lui, ils deviennent tami (quivalent du mot tabou) et il peut tre assur de les retrouver intacts son retour (North Queensland Ethnography, in Records of the Australian Museum, vol. VII, no 2, p. 75). C'est que l'urine, comme le sang, est cense contenir quelque chose de la force sacre qui est personnelle l'individu. Elle tient donc les trangers distance. La parole, pour les mmes raisons, peut galement servir de vhicule ces mmes influences; c'est pourquoi il est possible d'interdire l'accs d'un objet par simple dclaration verbale. Ce pouvoir de crer des interdits est, d'ailleurs, variable suivant les individus; il est d'autant plus grand qu'ils ont un caractre plus sacr; Les hommes en ont presque le privilge l'exclusion des femmes (Roth cite un seul cas de tabou impos par les femmes) ; il est son maximum chez les chefs, les anciens, qui s'en servent pour monopoliser les choses qui leur conviennent (ROTH, ibid., p. 77). C'est ainsi que l'interdit religieux devient droit de proprit et rglement administratif.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
276
sont des portions d'espace qui sont affectes aux choses et aux tres sacrs et qui leur servent d'habitats ; car ils ne peuvent s'tablir sur le sol qu' condition de se l'approprier totalement dans un rayon dtermin. Ces sortes d'arrangements sont tellement indispensables toute vie religieuse que les religions mme les plus infrieures ne peuvent s'en passer. L'ertnatulunga, cet endroit o sont dposs les churinga, est un vritable sanctuaire. Aussi est-il interdit aux noninitis de s'en approcher. Il est mme dfendu de s'y livrer une occupation profane, quelle qu'elle soit. Nous verrons dans la suite qu'il existe d'autres lieux saints o se clbrent d'importantes crmonies .
1046
De mme, la vie religieuse et la vie profane ne peuvent coexister dans les mmes units de temps. Il est donc ncessaire d'assigner la premire des jours ou des priodes dtermins d'o toutes les occupations profanes soient retires. C'est ainsi qu'ont pris naissance les ftes. Il n'est pas de religion ni, par consquent, de socit qui n'ait connu et pratiqu cette division du temps en deux parties tranches qui alternent l'une avec l'autre suivant une loi variable avec les peuples et les civilisations ; c'est mme trs probablement, comme nous l'avons dit, la ncessit de cette alternance qui a amen les hommes introduire, dans la continuit et l'homognit de la dure, des distinctions et des diffrenciations qu'elle ne comporte pas naturellement . Sans doute, il est peu prs impossible que la vie religieuse arrive jamais se concentrer hermtiquement dans les milieux spatiaux et temporels qui lui sont ainsi attribus ; il est invitable qu'il en filtre quelque peu au dehors. Il y a toujours des choses sacres en dehors des sanctuaires ; il y a des rites qui peuvent tre clbrs les jours ouvrables. Mais ce sont des choses sacres de rang secondaire et des rites de moindre importance. La concentration reste la caractristique dominante de cette organisation. Mme elle est gnralement complte pour tout ce qui concerne le culte public, qui ne peut se clbrer qu'en commun. Le culte priv, individuel, est le seul qui vienne se mler d'assez prs la vie temporelle. Aussi le contraste entre ces deux phases successives de la vie humaine atteint-il son maximum d'intensit dans les socits infrieures, telles que sont les tribus australiennes; car c'est l que le culte individuel est le plus rudimentaire .
1047 1048
II
.
Jusqu' prsent, le culte ngatif ne s'est prsent nous que comme un systme d'abstentions. Il semble donc ne pouvoir servir qu' inhiber l'activit, non la stimuler et la tonifier. Et cependant, par un contre coup inattendu de cet effet inhibitif, il se trouve exercer, sur la nature religieuse et morale de l'individu, une action positive de la plus haute importance.
1046 1047 1048
V. plus bas, mme livre, chap. Il. V. plus haut, p. 14. V. plus haut, p. 313.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
277
En effet, en raison de la barrire qui spare le sacr du profane, l'homme ne peut entrer en rapports intimes avec les choses sacres qu' condition de se dpouiller de ce qu'il y a de profane en lui. Il ne peut vivre d'une vie religieuse un peu intense, que S'il commence par se retirer plus ou moins compltement de la vie temporelle. Le culte ngatif est donc, en un sens, un moyen en vue d'un but : il est la condition d'accs du culte positif. Il ne se borne pas protger les tres sacrs contre les contacts vulgaires ; il agit sur le fidle lui-mme dont il modifie positivement l'tat. L'homme qui s'est soumis aux interdictions prescrites n'est pas aprs ce qu'il tait avant. Avant, c'tait un tre du commun qui, pour cette raison, tait tenu de rester distance des forces religieuses. Aprs, il est davantage de plain-pied avec elles ; car il s'est rapproch du sacr par cela seul qu'il s'est loign du profane ; il s'est pur et sanctifi par cela seul qu'il s'est dtach des choses basses et triviales qui alourdissaient sa nature. Les rites ngatifs confrent donc des pouvoirs efficaces tout comme les rites positifs ; les premiers, comme les seconds, peuvent servir lever le tonus religieux des individus. Suivant une juste remarque qui a t faite, nul ne peut s'engager dans une crmonie religieuse de quelque importance sans se soumettre une sorte d'initiation pralable qui l'introduise progressivement dans le monde sacr . On peut employer pour cela des onctions, des lustrations, des bndictions, toutes oprations essentiellement positives ; mais on arrive au mme rsultat au moyen de jenes, de veilles, par la retraite et le silence, c'est--dire par des abstinences rituelles qui ne sont autre chose que la mise en pratique d'interdits dtermins.
1049
Quand il ne s'agit que de rites ngatifs particuliers et isols, leur action positive est gnralement trop peu marque pour tre aisment perceptible. Mais il y a des circonstances o un systme complet d'interdits est concentr sur une seule tte ; dans ce cas, leurs effets s'accumulent et deviennent ainsi plus manifestes. C'est ce qui se produit, en Australie, lors de l'initiation. Le nophyte est astreint une extrme varit de rites ngatifs. Il doit se retirer de la socit on s'est, jusqu'alors, passe son existence, et presque de toute socit humaine. Non seulement il lui est dfendu de voir des femmes et des non-initis , mais il s'en va vivre dans la brousse, loin de ses semblables, sous la direction de quelques anciens qui lui servent de parrains . La fort est si bien considre comme son milieu naturel que le mot par lequel on dsigne l'initiation dans un certain nombre de tribus signifie ce qui est de la fort . Pour cette mme raison, au cours des crmonies auxquelles il assiste, il est trs souvent dcor de feuillage . Il passe ainsi de longs mois qu'entrecoupent, de temps en temps, les rites auxquels il est tenu de prendre part. Ce temps est pour lui une priode d'abstinences de toutes sortes. Une multitude d'aliments lui sont interdits ; on ne lui permet que la quantit de nourriture strictement indispensable pour entretenir la vie ; mme il est souvent astreint un
1050 1051 1052 1053 1054 1055
1049
V. HUBERT et Mauss, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, in Mlanges d'histoire des religions, p. 22 et suiv. 1050 HOWITT, Nat. Tr., pp. 560, 657, 659, 661. L'ombre d'une femme ne doit mme pas tomber sur lui (ibid,, p. 633). Ce qu'il touche ne peut tre touch par une femme (ibid., p. 621). 1051 Ibid., pp. 561, 563, 670-671 ; SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 223 ; North. Tr., pp. 340, 342. 1052 Le mot de Jeraeil, par exemple, chez les Kurnai; celui de Kuringal chez les Yuin, les Wolgat (HOWITT, Nat. Tr., pp. 581, 617). 1053 SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 348. 1054 HOWITT, p. 561. 1055 Ibid., pp. 633, 538, 560.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
278
jeune rigoureux , ou bien il est tenu de manger une nourriture immonde . Quand il se nourrit, il ne peut pas toucher aux aliments avec ses mains ; ce sont ses parrains qui les lui introduisent dans la bouche . Dans certains cas, il doit aller mendier sa subsistance . De mme, il ne dort que dans la mesure indispensable . Il doit s'abstenir de parler tant qu'on ne lui adresse pas la parole; c'est par signes qu'il manifeste ses besoins . Toute distraction lui est interdite . Il ne peut pas se laver ; parfois il ne peut pas bouger. Il reste tendu par terre, immobile , sans vtement d'aucune sorte . Or le rsultat de ces interdits multiplis est de dterminer chez l'initi un changement d'tat radical. Avant l'initiation, il vivait avec les femmes; il tait exclu du culte. Dsormais, il est admis dans la socit des hommes ; il prend part aux rites, il a acquis un caractre sacr. La mtamorphose est si complte qu'elle est souvent reprsente comme une seconde naissance. On imagine que le personnage profane qu'tait jusqu'alors le jeune homme est mort ; qu'il a t tu et remport par le Dieu de l'initiation, Bunjil, Baiame, ou Daramulun, et qu'un individu tout autre a pris la place de celui qui n'est plus . On saisit donc ici sur le vif les effets positifs que sont susceptibles d'avoir les rites ngatifs. Sans doute nous n'entendons pas soutenir que ces derniers produisent, eux seuls, cette grande transformation ; mais certainement ils y contribuent, et pour une large part.
1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066
A la lumire de ces faits, on peut comprendre ce que c'est que l'asctisme, quelle place il occupe dans la vie religieuse, et d'o viennent les vertus qui lui ont t trs gnralement attribues. Il n'y a pas en effet, d'interdit dont l'observance n'ait, quelque degr, un caractre asctique. S'abstenir d'une chose qui peut tre utile ou d'une forme d'activit qui, puisqu'elle est usuelle, doit rpondre quelque besoin humain, c'est, de toute ncessit, s'imposer des gnes, des renoncements. Pour qu'il y ait asctisme proprement dit, il suffit donc que ces pratiques se dveloppent de manire devenir la base d'un vritable rgime de vie. Normalement, le culte ngatif ne sert gure que d'introduction et de prparation au culte positif. Mais il arrive qu'il s'affranchit de cette subordination et passe au premier plan, que le systme des interdits s'enfle et s'exagre au point d'envahir l'existence tout entire. Ainsi prend naissance l'asctisme systmatique qui, par consquent, n'est pas autre chose qu'une hypertrophie du culte ngatif. Les vertus spciales qu'il est cens confrer ne sont qu'une forme amplifie de celles que confre, un moindre degr, la pratique de tout interdit. Elles ont la mme origine ; car elles reposent galement sur ce principe qu'on se sanctifie par cela seul qu'on fait effort pour se sparer du profane. Le pur ascte est un homme qui s'lve au-dessus des hommes et qui acquiert une saintet particulire par des jenes, des veilles, par la retraite et le silence, en un mot par des privations, plus que par des actes de pit positive (offrandes, sacrifices, prires,
1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066
Ibid., p. 674; Langloh PARKER, Euahlayi, p. 75. RIDLEY, Kamilaroi, p. 154. HOWITT, p. 563. Ibid., p. 611. Ibid., pp. 549, 674. HOWITT, Nat. Tr., pp. 580, 596, 604, 668, 670 ; SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 223, 351. H0WITT, p. 567. Ibid., p. 557. lbid., p. 604; SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 351. HOWITT, p. 611. Ibid., p. 589.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
279
etc.). L'histoire montre, d'autre part, quel haut prestige religieux on peut atteindre par cette voie : le saint bouddhiste est essentiellement un ascte, et il est gal ou suprieur aux dieux. Il suit de l que l'asctisme n'est pas, comme on pourrait le croire, un fruit rare, exceptionnel et presque anormal de la vie religieuse ; c'en est, au contraire, un lment essentiel. Toute religion en contient au moins le germe, car il n'y en a pas o ne se rencontre un systme d'interdits. La seule diffrence qu'il y ait sous ce rapport entre les cultes, c'est que ce germe y est plus ou moins dvelopp. Encore convient-il d'ajouter qu'il n'en existe probablement pas un seul o ce dveloppement ne prenne, au moins titre temporaire, les traits caractristiques de l'asctisme proprement dit. C'est ce qui a lieu gnralement certaines priodes critiques, oh en un temps relativement court, il faut susciter chez un sujet quelque grave changement d'tat. Alors, pour pouvoir l'introduire plus rapidement dans le cercle des choses sacres avec lesquelles il s'agit de le mettre en contact, on le spare violemment du monde profane ; ce qui ne va pas sans abstinences multiplies, sans une recrudescence exceptionnelle du systme des interdits. C'est prcisment ce qui se produit, en Australie, au moment de l'initiation. Pour transformer les jeunes gens en hommes, on leur fait vivre une vritable vie d'asctes. Mrs. Parker les appelle trs justement les moines de Baiame .
1067
Mais abstinences et privations ne vont pas sans souffrances. Nous tenons par toutes les fibres de notre chair au monde profane; notre sensibilit nous y attache ; notre vie en dpend. Il n'est pas seulement le thtre naturel de notre activit ; il nous pntre de toutes parts ; il est partie de nous-mme. Nous ne pouvons donc nous en dtacher sans faire violence notre nature, sans froisser douloureusement nos instincts. En d'autres termes, le culte ngatif ne peut se dvelopper sans faire souffrir. La douleur en est une condition ncessaire. On a t ainsi amen la considrer comme constituant par elle-mme une sorte de rite ; on y a vu un tat de grce qu'il faut rechercher et susciter, mme artificiellement, cause des pouvoirs et des privilges qu'elle confre au mme titre que ces systmes d'interdits dont elle est l'accompagnement naturel. Preuss est le premier, notre connaissance, qui ait eu le sentiment du rle religieux qui est attribu la douleur ds les socits infrieures. Il cite le cas des Arapaho qui, pour s'immuniser contre les dangers des batailles, s'infligent de vritables supplices ; des Indiens Gros-Ventre, qui, la veille des expditions militaires, se soumettent
1068
1067
On peut rapprocher de ces pratiques asctiques celles qui sont en usage lors de l'initiation du magicien. Tout comme le jeune nophyte, l'apprenti magicien est soumis une multitude d'interdits dont l'observance contribue lui faire acqurir ses pouvoirs spcifiques (v. L'origine des pouvoirs magiques, dans Mlanges d'histoire des religions, par Hubert et MAUSS, pp. 171, 173, 176). Il en est de mme pour les poux la veille ou au lendemain du mariage (tabous des fiancs et des jeunes maris) ; c'est que le mariage implique galement un grave changement d'tat. Nous nous bornons mentionner sommairement ces faits, sans nous y arrter ; car les premiers concernent la magie qui n'est pas de notre sujet, et les seconds se rattachent cet ensemble de rgles juridico-religieuses qui se rapportent au commerce des sexes et dont l'tude ne sera possible que conjointement avec les autres prceptes de la morale conjugale primitive. 1068 Preuss, il est vrai, interprte ces faits en disant que la douleur est un moyen d'accrotre la force magique de l'homme (die menschliche Zauberkraft) ; on pourrait croire, d'aprs cette expression, que la souffrance est un rite magique, et non religieux. Mais, comme nous l'avons dj dit, Preuss appelle magiques, sans beaucoup de prcision, toutes les forces anonymes et impersonnelles, qu'elles ressortissent la magie ou la religion. Sans doute, il y a des tortures qui servent faire des magiciens ; mais beaucoup de celles qu'il nous dcrit font partie de crmonies proprement religieuses et, par consquent, c'est l'tat religieux des individus qu'elles ont pour objet de modifier.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
280
de vritable tortures ; des Hupa qui, pour assurer le succs de leurs entreprises, nagent dans des rivires glaces et restent ensuite, le plus longtemps possible, tendus sur le rivage; des Karaya qui, pour affermir leurs muscles, se tirent de temps en temps du sang des bras et des jambes au moyen de grattoirs forms avec des dents de poissons; des gens de Dallmannhafen (Terre de l'Empereur Guillaume en Nouvelle-Guine) qui combattent la strilit de leurs femmes en leur pratiquant des incisions sanglantes dans la partie suprieure de la cuisse .
1069
Mais on trouve des faits analogues sans sortir d'Australie, notamment au cours des crmonies d'initiation. Beaucoup des rites qui sont pratiqus cette occasion consistent prcisment infliger systmatiquement au nophyte des souffrances dtermines, en vue de modifier son tat et de lui faire acqurir les qualits caractristiques de l'homme. Ainsi, chez les Larakia, tandis que les jeunes gens sont en retraite dans la fort, leurs parrains et surveillants leur assnent chaque instant des coups violents, sans avertissement pralable comme sans raison . Chez les Urabunna, un moment donn, le novice est tendu par terre, la face contre le sol. Tous les hommes prsents le frappent rudement ; puis on lui fait dans le dos une srie d'entailles, de quatre huit, disposes de chaque ct de l'pine dorsale, et une dans la ligne mdiane de la nuque . Chez les Arunta, le premier rite de l'initiation consiste berner le sujet; les hommes le lancent en l'air, le rattrapent quand il retombe pour le lancer nouveau . Dans la mme tribu, la clture de cette longue srie de crmonies, le jeune homme vient s'tendre sur un lit de feuillages sous lequel on a dispos des braises ardentes ; il reste couch, immobile au milieu d'une chaleur et d'une fume suffocantes . Chez les Urabunna, on observe un rite similaire ; mais de plus, tandis que le patient est dans cette pnible situation, on le frappe dans le dos . D'une manire gnrale, tous les exercices auxquels il est soumis ont tellement ce caractre que, quand il est admis reprendre la vie commune, il a un aspect pitoyable et parat demi stupfi . Il est vrai que toutes ces pratiques sont souvent prsentes comme des ordalies destines prouver la valeur du nophyte et faire savoir s'il est digne d'tre admis
1070 1071 1072 1073 1074 1075
1069
Preuss, Der Ursprung der Religion und der Kunst, Globus, LXXXVII, p. 309-400. Preuss classe sous la mme rubrique un grand nombre de rites disparates, par exemple des effusions de sang qui agissent en raison des qualits positives attribues au sang, et non cause des souffrances qu'elles impliquent. Nous ne retenons que les faits o la douleur est l'lment essentiel du rite et la cause de son efficacit. 1070 North. Tr., pp. 331-332. 1071 Ibid., p. 335. On trouve une pratique similaire chez les Dier (HOWITT, Nat. Tr., p. 658 et suiv.). 1072 SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 214 et suiv. - On voit par cet exemple que les rites d'initiation ont parfois tous les caractres de la brimade. C'est qu'en effet la brimade est une vritable institution sociale qui prend spontanment naissance toutes les fois que deux groupes, ingaux par leur situation morale et sociale, se trouvent intimement en contact. Dans ce cas, celui qui se considre comme suprieur l'autre rsiste l'intrusion des nouveaux venus : il ragit contre eux de manire leur faire sentir la supriorit dont il a le sentiment. Cette raction, qui se produit automatiquement et qui prend naturellement la forme de svices plus ou moins graves, est destine, en mme temps, plier les individus leur nouvelle existence, les assimiler leur nouveau milieu. Elle constitue donc une sorte d'initiation. On s'explique ainsi que l'initiation, de son ct, constitue une sorte de brimade. C'est que le groupe des anciens est suprieur en dignit religieuse et morale celui des jeunes et que, pourtant, le premier doit s'assimiler le second. Toutes les conditions de la brimade sont donc donnes. 1073 SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 372. 1074 Ibid., p. 335. 1075 HOWITT, Nat. Tr., p. 675.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
281
dans la socit religieuse . Mais en ralit, la fonction probatoire du rite n'est qu'un autre aspect de son efficacit. Car ce que prouve la manire dont il est subi, c'est prcisment qu'il a bien produit son effet, c'est--dire qu'il a confr les qualits qui sont sa premire raison d'tre.
1076
Dans d'autres cas, ces svices rituels sont exercs, non sur l'organisme dans son ensemble, mais sur un organe ou sur un tissu particulier dont ils ont pour objet de stimuler la vitalit. Ainsi, chez les Arunta, les Warramunga et plusieurs autres tribus , un moment donn de l'initiation, des personnages dtermins sont chargs de mordre belles dents dans le cuir chevelu du novice. L'opration est tellement douloureuse que le patient ne peut gnralement pas la supporter sans pousser des cris. Or elle a pour but de faire crotre les cheveux . On applique le mme traitement en vue de faire pousser la barbe. Le rite de l'pilation, que Howitt nous signale dans d'autres tribus, pourrait bien avoir la mme raison d'tre . D'aprs Eylmann, chez les Arunta et les Kaitish, hommes et femmes se font de petites blessures au bras au moyen de btons rougis au feu, afin de devenir habiles faire le feu ou afin d'acqurir la force ncessaire pour porter de lourdes charges de bois . Suivant le mme observateur, les jeunes filles Warramunga s'amputent, une main, la deuxime et la troisime phalange de l'index, dans la pense que le doigt devient ainsi plus apte dcouvrir les ignames .
1077 1078 1079 1080 1081
Il ne serait pas impossible que l'extraction des dents ft parfois destine produire des effets du mme genre. En tout cas, il est certain que les rites si cruels de la circoncision et de la subincision ont pour objet de confrer aux organes gnitaux des pouvoirs particuliers. En effet, le jeune homme n'est admis au mariage qu'aprs s'y tre soumis ; c'est donc qu'il leur doit des vertus spciales. Ce qui rend indispensable cette initiation sui generis, c'est que l'union des sexes est, dans toutes les socits infrieures, marque d'un caractre religieux. Elle est cense mettre en jeu des forces redoutables que l'homme ne peut aborder sans danger, moins d'avoir acquis, par des procds rituels, l'immunit ncessaire : c'est quoi est employe toute une srie de pratiques, positives et ngatives, dont la circoncision et la subincision sont le prodrome. En mutilant douloureusement un organe, on lui donne donc un caractre sacr, puisqu'on le met, par cela mme, en tat de rsister des forces galement sacres, qu'il ne pourrait pas affronter autrement.
1082
Nous disions au dbut de cet ouvrage que tous les lments essentiels de la pense et de la vie religieuse doivent se retrouver, au moins en germe, ds les religions les plus primitives: les faits qui prcdent confirment cette assertion. S'il est une croyance qui passe pour tre spciale aux religions les plus rcentes et les plus idalistes, c'est celle qui attribue la douleur un pouvoir sanctifiant. Or, cette mme croyance est la base des rites qui viennent d'tre
1076 1077
HOWITT, Nat. Tr., pp. 569, 604. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 251; North. Tr., pp. 341, 352. 1078 Aussi chez les Warramunga, l'opration doit-elle tre faite par des sujets qui sont favoriss d'une belle chevelure. 1079 HOWITT, Nat. Tr., p. 675 ; il s'agit des tribus du Darling infrieur. 1080 EYLMANN, Op. cit., p. 212. 1081 Ibid. 1082 On trouvera des indications sur cette question dans notre mmoire sur La prohibition de l'inceste et ses origines (Anne sociologique, I, p. 1 et suiv.), et dans CRAWLEY, Mystic Rose, p. 37 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
282
observs. Sans doute, elle est tendue diffremment suivant les moments de l'histoire o on la considre. Pour le chrtien, c'est surtout sur l'me qu'elle est cense agir : elle l'pure, l'anoblit, la spiritualise. Pour l'Australien, c'est sur le corps qu'elle est efficace ; elle accrot les nergies vitales ; elle fait pousser la barbe et les cheveux, elle endurcit les membres. Mais, de part et d'autre, le principe est le mme. Ici et l, on admet que la douleur est gnratrice de forces exceptionnelles. Et cette croyance n'est pas sans fondement. C'est, en effet, par la manire dont il brave la douleur que se manifeste le mieux la grandeur de l'homme. jamais il ne s'lve avec plus d'clat au-dessus de lui-mme que quand il dompte sa nature au point de lui faire suivre une voie contraire celle qu'elle prendrait spontanment. Par l, il se singularise entre toutes les autres cratures qui, elles, vont aveuglment oh les appelle le plaisir ; par l, il se fait une place part dans le monde. La douleur est le signe que certains des liens qui l'attachent au milieu profane sont rompus ; elle atteste donc qu'il est partiellement affranchi de ce milieu et, par suite, elle est justement considre comme l'instrument de la dlivrance. Aussi celui qui est ainsi dlivr n'est-il pas victime d'une pure illusion quand il se croit investi d'une sorte de matrise sur les choses : il s'est rellement lev au-dessus d'elles, par cela mme qu'il y a renonc ; il est plus fort que la nature puisqu'il la fait taire. Il s'en faut, d'ailleurs, que cette vertu n'ait qu'une valeur esthtique : toute la vie religieuse la suppose. Sacrifices et offrandes ne vont pas sans privations qui cotent au fidle. Alors mme que les rites n'exigent pas de lui des prestations matrielles, ils lui prennent de son temps et de ses forces. Pour servir des dieux, il faut qu'il s'oublie ; pour leur faire dans sa vie la place qui leur revient, il faut qu'il sacrifie de ses intrts profanes. Le culte positif n'est donc possible que si l'homme est entran au renoncement, l'abngation, au dtachement de soi et, par consquent, la souffrance. Il faut qu'il ne la redoute pas : il ne peut mme s'acquitter joyeusement de ses devoirs qu' condition de l'aimer quelque degr. Mais pour cela, il est indispensable qu'il y soit exerc, et c'est quoi tendent les pratiques asctiques. Les douleurs qu'elles imposent ne sont donc pas des cruauts arbitraires et striles ; c'est une cole ncessaire o l'homme se forme et se trempe, o il acquiert les qualits de dsintressement et d'endurance sans lesquelles il n'y a pas de religion. Mme, pour que ce rsultat soit obtenu, il est bon que l'idal asctique vienne s'incarner minemment en des personnages particuliers dont c'est, pour ainsi dire, la spcialit de reprsenter, presque avec excs, cet aspect de la vie rituelle ; car ils sont comme autant de modles vivants qui incitent l'effort. Tel est le rle historique des grands asctes. Quand on analyse dans le dtail leurs faits et leurs gestes, on se demande quelle en peut tre la fin utile. On est frapp de ce qu'il y a d'outr dans le mpris qu'ils professent pour tout ce qui passionne ordinairement les hommes. Mais ces outrances sont ncessaires pour entretenir chez les fidles un suffisant dgot de la vie facile et des plaisirs communs. Il faut qu'une lite mette le but trop haut pour que la foule ne le mette pas trop bas. Il faut que quelques-uns exagrent pour que la moyenne reste au niveau qui convient. Mais l'asctisme ne sert pas seulement des fins religieuses. Ici, comme ailleurs, les intrts religieux ne sont que la forme symbolique d'intrts sociaux et moraux. Les tres idaux auxquels s'adressent les cultes ne sont pas les seuls rclamer de leurs serviteurs un certain mpris de la douleur : la socit, elle aussi, n'est possible qu' ce prix. Tout en exaltant les forces de l'homme, elle est souvent rude aux individus elle exige ncessairement d'eux de perptuels sacrifices elle fait sans cesse violence nos apptits naturels, prcisment parce
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
283
qu'elle nous lve au-dessus de nous-mmes. Pour que nous puissions remplir nos devoirs envers elle, il faut donc que nous soyons dresss violenter parfois nos instincts, remonter, quand il le faut, la pente de la nature. Ainsi, il y a un asctisme qui, inhrent toute vie sociale, est destin survivre toutes les mythologies et tous les dogmes; il fait partie intgrante de toute culture humaine. Et c'est lui, au fond, qui est la raison d'tre et la justification de celui qu'ont enseign les religions de tous les temps.
III
.
Aprs avoir dtermin en quoi consiste le systme des interdits et quelles en sont les fonctions ngatives et positives, il nous faut rechercher quelles causes lui ont donn naissance. En un sens, il est logiquement impliqu dans la notion mme du sacr. Tout ce qui est sacr est objet de respect et tout sentiment de respect se traduit, chez celui qui l'prouve, par des mouvements d'inhibition. Un tre respect, en effet, est toujours exprim dans la conscience par une reprsentation qui, en raison de l'motion qu'il inspire, est charge d'une haute nergie mentale; par suite, elle est arme de manire rejeter loin d'elle tout autre reprsentation qui la nie, soit en totalit soit en partie. Or le monde sacr soutient avec le monde profane un rapport d'antagonisme. Ils rpondent deux formes de vie qui s'excluent, qui, tout au moins, ne peuvent tre vcues au mme moment avec la mme intensit. Nous ne pouvons pas tre, la fois, tout entiers aux tres idaux auxquels le culte, s'adresse, et tout entiers nous-mmes et nos intrts sensibles ; tout entiers la collectivit et tout entiers notre gosme. Il y a l deux systmes d'tats de conscience qui sont orients et qui orientent notre conduite vers deux ples contraires. Celui qui a la plus grande puissance d'action doit donc tendre repousser l'autre hors de la conscience. Quand nous pensons aux choses saintes, l'ide d'un objet profane ne peut se prsenter l'esprit sans se heurter des rsistances ; quelque chose en nous s'oppose ce qu'elle s'y installe. C'est la reprsentation du sacr qui ne tolre pas ce voisinage. Mais cet antagonisme psychique, cette exclusion mutuelle des ides doit naturellement aboutir l'exclusion des choses correspondantes. Pour que les ides ne coexistent pas, il faut que les choses ne se touchent pas, ne soient d'aucune manire en rapports. C'est le principe mme de l'interdit. De plus, le monde du sacr est, par dfinition, un monde part. Puisqu'il s'oppose, par tous les caractres que nous avons dits, au inonde profane, il doit tre trait d'une manire qui lui soit propre : ce serait mconnatre sa nature et le confondre avec ce qui n'est pas lui que d'employer, dans nos rapports avec les choses qui le composent, les gestes, le langage, les attitudes qui nous servent dans nos relations avec les choses profanes. Nous pouvons librement manier ces dernires ; nous parlons librement aux tres vulgaires ; nous ne toucherons donc pas aux tres sacrs, ou nous n'y toucherons qu'avec rserve ; nous ne parlerons pas en leur
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
284
prsence ou nous ne parlerons pas la langue commune. Tout ce qui est en usage dans notre commerce avec les uns doit tre exclu de notre commerce avec les autres. Mais si cette explication n'est pas inexacte, elle est pourtant insuffisante. En effet, il y a bien des tres qui sont objets de respect sans tre protgs par des systmes d'interdictions rigoureuses comme sont celles que nous avons dcrites. Sans doute, il y a une sorte de tendance gnrale de l'esprit localiser dans des milieux diffrents des choses diffrentes, surtout quand elles sont incompatibles les unes avec les autres. Mais le milieu profane et le milieu sacr ne sont pas seulement distincts, ils sont ferms l'un l'autre : entre eux, il y existe un abme. Il doit donc y avoir, dans la nature des tres sacrs, une raison particulire qui rend ncessaire cet tat d'isolement exceptionnel et de mutuelle occlusion. Et en effet, par une sorte de contradiction, le monde sacr est comme enclin, par sa nature mme, se rpandre dans ce mme monde profane qu'il exclut par ailleurs : en mme temps qu'il le repousse, il tend s'y couler ds qu'il s'en laisse seulement approcher. C'est pourquoi il est ncessaire de les tenir distance l'un de l'autre et de faire, en quelque sorte, le vide entre eux. Ce qui oblige ces prcautions, c'est l'extraordinaire contagiosit du caractre sacr. Loin de rester attach aux choses qui en sont marques, il est dou d'une sorte de fugacit. Le contact mme le plus superficiel ou le plus mdiat suffit pour qu'il s'tende d'un objet l'autre. Les forces religieuses sont reprsentes aux esprits de telle sorte qu'elles semblent toujours prtres s'chapper des points o elles rsident pour envahir tout ce qui passe leur porte. L'arbre nanja oit habite l'esprit d'un anctre est sacr pour l'individu qui se considre comme la rincarnation de cet anctre. Mais tout oiseau qui vient se poser sur cet arbre participe du mme caractre : il est galement interdit d'y toucher . Nous avons eu dj l'occasion de montrer comment le simple contact d'un churinga suffit sanctifier gens et choses ; c'est, d'ailleurs, sur ce principe de la contagiosit du sacr que reposent tous les rites de conscration. La saintet des churinga est mme telle qu'elle fait sentir son action distance. On se rappelle comment elle s'tend non seulement la cavit o ils sont conservs, mais toute la rgion avoisinante, aux animaux qui s'y rfugient et qu'il est dfendu de tuer, aux plantes qui y poussent et auxquelles on ne doit pas toucher . Un totem du serpent a son centre en un lieu o se trouve un trou d'eau. Le caractre sacr dit totem se communique l'endroit, au trou d'eau, l'eau elle-mme qui est interdite tous les membres du groupe totmique . L'initi vit dans une atmosphre toute charge de religiosit et il en est lui-mme comme imprgn . Par suite, tout ce qu'il possde, tout ce qu'il touche est interdit aux femmes et soustrait leur contact, mme l'oiseau qu'il a frapp de son bton, le kangourou qu'il a perc de sa lance, le poisson qui a mordu son hameon . Mais d'un autre ct, les rites auxquels il est soumis et les choses qui y jouent un rle sont d'une saintet suprieure la sienne : cette saintet se transmet contagieusement tout ce qui
1083 1084 1085 1086 1087 1088
1083 1084
SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 133. V. plus haut, p. 170. 1085 SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 134-135; STREHLOW, II, p. 78. 1086 SPENCER et GILLEN, North. Tr., pp. 167, 299. 1087 En dehors des rites asctiques dont nous avons parl, il en est de positifs qui ont pour objet de charger, ou, comme dit Howitt, de saturer l'initi de religiosit (HOWITT, Nat. Tr., p. 535). Howitt, il est vrai, au lieu de religiosit, parle de pouvoirs magiques; mais on sait que pour la plupart des ethnographes, ce mot signifie simplement vertus religieuses de nature impersonnelle. 1088 HOWITT, ibid., pp. 674-675.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
285
voque l'ide des unes ou des autres. La dent qui lui a t arrache est considre comme trs sainte . Pour cette raison, il ne peut manger d'animaux qui ont des dents prominentes parce qu'ils font penser la dent extraite. Les crmonies du Kuringal se terminent par un lavage rituel ; les oiseaux aquatiques sont interdits au nophyte parce qu'ils rappellent ce rite. Les animaux qui grimpent au fate des arbres lui sont galement sacrs, parce qu'ils sont trop voisins de Daramulun, dieu de l'initiation, qui vit dans les cieux . L'me du mort est un tre sacr : nous avons vu dj que la mme proprit passe au corps o cette me a rsid, l'endroit o il est enseveli, au camp o le vivant a habit et que l'on dtruit ou que l'on quitte, au nom qu'il a port, sa femme et ses parents . Ils sont comme investis, eux aussi, d'un caractre sacr ; par suite on se tient distance d'eux ; on ne les traite pas comme de simples profanes. Dans les socits observes par Dawson, leurs noms, tout comme celui du mort, ne peuvent tre prononcs durant la priode de deuil . Certains des animaux qu'il mangeait souvent aussi tre prohibs .
1089 1090 1091 1092 1093 1094
Cette contagiosit du sacr est un fait trop connu pour qu'il y ait lieu d'en dmontrer l'existence par de plus nombreux exemples ; nous voulions seulement tablir qu'elle est vraie du totmisme comme des religions plus avances. Une fois constate, elle explique aisment l'extrme rigueur des interdits qui sparent le sacr du profane. Puisque, en vertu de cette extraordinaire puissance d'expansion, le contact le plus lger, la moindre proximit, matrielle ou simplement morale, d'un tre profane suffit entraner les forces religieuses hors de leur domaine, et puisque, d'autre part, elles ne peuvent en sortir sans contredire leur nature, tout un systme de mesures est indispensable pour maintenir les deux mondes distance respectueuse l'un de l'autre. Voil pourquoi il est interdit au vulgaire non seulement de toucher, mais de voir, d'entendre ce qui est sacr; pourquoi ces deux genres de vie ne doivent pas se mler dans les consciences. Il faut d'autant plus de prcautions pour les tenir spars que, tout en s'opposant l'un l'autre, ils tendent se confondre l'un dans l'autre.
1095
En mme temps que la multiplicit de ces interdits, on comprend la manire dont ils fonctionnent et les sanctions qui y sont attaches. Par suite de la contagiosit inhrente tout ce qui est sacr, un tre profane ne peut violer un interdit sans que la force religieuse dont il s'est indment approch ne s'tende jusqu' lui et n'tablisse sur lui son empire. Mais comme, entre elle et lui, il y a antagonisme, il se trouve plac sous la dpendance d'une puissance hostile et dont l'hostilit ne peut manquer de se manifester sous forme de ractions violentes qui tendent le dtruire.
1089 1090
SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 454. Cf. HOWITT, Nat. Tr., p. 561. HOWITT, Nat. Tr., p. 557. 1091 HOWITT, Ibid., p. 560. 1092 V. plus haut, p. 433, 436. Cf. SPENCER et GiLLEN, Nat. Tr., p. 498 ; North. Tr., pp. 506, 507, 518519, 526; HOWITT, Nat. Tr., p. 449, 461, 469; MATHEWS, in Journal R. S. of N. S. Wales, XXXVIII, p. 274; SCHULZE, loc. cit., p. 231 ; WYATT, Adelaide and Encounter Bay Tribes, in WOODS, pp. 165, 198. 1093 Australian Aborigines, p. 42. 1094 HOWITT, Nat. Tr., pp. 470-471. 1095 V. sur cette question Robertson SMITH, The Religion of the Semites, pp. 152 et suiv., 446,481; FRAZER, article Taboo dans l'Encyclopedia Britannica; JEVONS, Introduction to the History of Religion, p. 59 et suiv. ; CRAWLEY, Mystic Rose, chap. Il-IX VAN GENNEP, Tabou et totmisme Madagascar, chap. III.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
286
C'est pourquoi la maladie ou la mort sont considres comme les consquences naturelles de toute transgression de ce genre ; et ce sont des consquences qui passent pour se produire d'elles-mmes, avec une sorte de ncessit physique. Le coupable se sent envahi par une force qui le domine et contre laquelle il est impuissant. A-t-il mang de l'animal totmique ? Il le sent pntrer en lui et lui ronger les entrailles ; il se couche par terre et attend la mort . Toute profanation implique une conscration, mais qui est redoutable au sujet consacr et ceux mmes qui l'approchent. Ce sont les suites de cette conscration qui sanctionnent en partie l'interdit .
1096 1097
On remarquera que cette explication des interdits ne dpend pas des symboles variables l'aide desquels peuvent tre conues les forces religieuses. Peu importe qu'elles soient reprsentes sous la forme d'nergies anonymes et impersonnelles, ou figures par des personnalits doues de conscience et de sentiment. Sans doute, dans le premier cas, elles sont censes ragir contre les transgressions profanatrices d'une manire automatique et inconsciente, tandis. que, dans le second, elles passent pour obir des mouvements passionnels, dtermins par l'offense ressentie. Mais au fond, ces deux conceptions, qui d'ailleurs, ont les mmes effets pratiques, ne font qu'exprimer en deux langues diffrentes un seul et mme mcanisme psychique. Ce qui est la base de l'une et de l'autre, c'est l'antagonisme du sacr et du profane, combin avec la remarquable aptitude du premier contagionner le second ; or, cet antagonisme et cette contagiosit agissent de mme faon, que le caractre sacr soit attribu des forces aveugles ou des consciences. Ainsi, bien loin que la vie proprement religieuse ne commence que l o il existe des personnalits mythiques, on voit que, dans ce cas, le rite reste le mme, que les tres religieux soient ou non personnifis. C'est une constatation que nous aurons rpter dans chacun des chapitres qui vont suivre.
1096
V. les rfrences plus haut, p. 182, no 1. Cf. SPENGER et GILLEN, North. Tr., p. 323, 324; Nat. Tr., p. 168; TAPLIN, The Narrinyeri, p. 16 ; ROTH, North Queensland Ethnography, Bull. 10, in Records of the Australian Museum, VII, p. 76. 1097 Nous rappelons que, quand l'interdit viol est religieux, ces sanctions ne sont pas les seules; il y a, en outre, ou une peine proprement dite ou une fltrissure de l'opinion.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
287
IV
.
Mais si la contagiosit du sacr contribue expliquer le systme des interdits, comment s'explique-t-elle elle-mme ? On a cru pouvoir en rendre compte par les lois, bien connues, de l'association des ides. Les sentiments que nous inspire une personne ou une chose s'tendent contagieusement de l'ide de cette chose ou de cette personne aux reprsentations qui y sont associes et, par suite, aux objets que ces reprsentations expriment. Le respect que nous avons pour un tre sacr se communique donc tout ce qui touche cet tre, tout ce qui lui ressemble et le rappelle. Sans doute, l'homme cultiv n'est pas dupe de ces associations ; il sait que ces motions drives sont dues de simples jeux d'images, des combinaisons toutes mentales et il ne s'abandonne pas aux superstitions que ces illusions, tendent dterminer. Mais, dit-on, le primitif objective navement ses impressions sans les critiquer. Une chose lui inspire-t-elle une crainte rvrentielle ? Il en conclut qu'une force auguste et redoutable y rside rellement ; il se tient doue distance de cette chose et la traite comme si elle tait sacre, alors mme qu'elle n'a aucun droit ce titre .
1098
Mais c'est oublier que les religions les plus primitives ne sont pas les seules qui aient attribu au caractre sacr cette puissance de propagation. Mme dans les cultes les plus rcents, il existe un ensemble de rites qui reposent sur ce principe. Toute conscration par voie d'onction ou de lustration ne consiste-t-elle pas transfrer dans un objet profane les vertus sanctifiantes d'un objet sacr ? Il est pourtant difficile de voir, dans le catholique clair d'aujourd'hui, une sorte de sauvage attard, qui continue tre tromp par ses associations d'ides, sans que rien, dans la nature des choses, explique et justifie ces manires de penser. C'est, d'ailleurs, trs arbitrairement que l'on prte au primitif cette tendance objectiver aveuglment toutes ses motions. Dans sa vie courante, dans le dtail de ses occupations laques, il n'impute pas une chose les proprits de sa voisine ou rciproquement. S'il est moins amoureux que nous de clart et de distinction, il s'en faut cependant qu'il y ait en lui je ne sais quelle dplorable aptitude tout brouiller et tout confondre. Seule, la pense religieuse a un penchant marqu pour ces sortes de confusions. C'est donc bien dans la nature spciale des choses religieuses, et non dans les lois gnrales de l'intelligence humaine, qu'il faut aller chercher l'origine de ces prdispositions. Quand une force ou une proprit nous parat tre une partie intgrante, un lment constitutif du sujet en qui elle rside, on ne peut pas se reprsenter facilement qu'elle s'en
1098
V. Jevons, Introduction to the History of Religion, pp. 67-68. Nous ne dirons rien de la thorie, d'ailleurs peu explicite, de CRAWLEY (Mystic Rose, chap. IV-VII) d'aprs laquelle la contagiosit des tabous serait due une interprtation errone de certains phnomnes de contage. Elle est arbitraire. Comme Jevons en fait trs justement la remarque dans le passage auquel nous renvoyons, le caractre contagieux du sacr est affirm a priori, et non sur la foi d'expriences mal interprtes.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
288
dtache pour se transporter ailleurs. Un corps se dfinit par sa masse et sa composition atomique ; aussi ne concevons-nous pas qu'il puisse communiquer, par voie de contact, aucun de ces caractres distinctifs. Mais, au contraire, s'il s'agit d'une force qui a pntr le corps du dehors, comme rien ne l'y attache, comme elle y est en qualit d'trangre, il n'y a rien d'irrprsentable ce qu'elle puisse s'en chapper. C'est ainsi que la chaleur ou l'lectricit, qu'un objet quelconque a reues d'une source externe, sont transmissibles au milieu ambiant, et l'esprit accepte sans rsistance la possibilit de cette transmission. L'extrme facilit avec laquelle les forces religieuses rayonnent et se diffusent n'a donc rien qui doive surprendre si elles sont gnralement conues comme extrieures aux tres en qui elles rsident. Or c'est bien ce qu'implique la thorie que nous avons propose. Elles ne sont, en effet, que des forces collectives hypostasies, c'est--dire des forces morales; elles sont faites des ides et des sentiments qu'veille en nous le spectacle de la socit, non des sensations qui nous viennent du monde physique. Elles sont donc htrognes aux choses sensibles o nous les situons. Elles peuvent bien emprunter ces choses les formes extrieures et matrielles sous lesquelles elles sont reprsentes ; mais elles ne leur doivent rien de ce qui fait leur efficacit. Elles ne tiennent pas par des liens internes aux supports divers sur lesquels elles viennent se poser ; elles n'y ont pas de racines; suivant un mot que nous avons employ dj et qui peut le mieux servir les caractriser, elles y sont surajoutes. Aussi n'y a-t-il pas d'objets qui soient, l'exclusion de tous autres, prdestins les recevoir ; les plus insignifiants, les plus vulgaires mme peuvent remplir ce rle : ce sont des circonstances adventices qui dcident quels sont les lus. Qu'on se rappelle en quels termes Codrington parle du mana : C'est, dit-il, une force qui n'est Point fixe sur un objet matriel, mais qui peut tre amene sur Presque toute espce d'objet . De mme, le Dakota de Miss Fletcher nous reprsentait le wakan comme une sorte de force ambulante qui va et vient travers le monde, se posant ici ou l sans se fixer dfinitivement nulle part . Mme la religiosit qui est inhrente l'homme n'a pas un autre caractre. Certes, dans le monde de l'exprience, il n'est pas d'tre qui soit plus proche de la source mme de toute vie religieuse; nul n'y participe plus directement puisque c'est dans des consciences humaines qu'elle s'labore. Et cependant, nous savons que le principe religieux qui anime l'homme, savoir l'me, lui est partiellement extrieur.
1099 1100 1101
Mais si les forces religieuses n'ont nulle part de lieu propre, leur mobilit devient aisment explicable. Puisque rien ne les attache aux choses o nous les localisons, il est naturel que, au moindre contact, elles s'en chappent, en dpit d'elles-mmes pour ainsi dire, et qu'elles se propagent plus loin. Leur intensit les incite cette propagation que tout favorise. C'est pourquoi l'me elle-mme, bien qu'elle tienne au corps par des liens tout personnels, menace sans cesse d'en sortir : tous les orifices, tous les pores de l'organisme sont autant de voies par o elle tend se rpandre et se diffuser au dehors .
1102
Mais nous nous rendrons mieux compte encore du phnomne que nous cherchons
1099 1100 1101 1102
V. plus haut, p. 328. V. p. 277. V. plus haut, pp. 284-285. C'est ce qu'a bien montr Preuss dans les articles du Globus que nous avons dj cits.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
289
comprendre si, au lieu de considrer la notion de forces religieuses toute constitue, nous remontons jusqu'au processus mental dont elle rsulte. Nous avons vu, en effet, que le caractre sacr d'un tre ne tenait pas quelqu'un de ses attributs intrinsques. Ce n'est pas parce que l'animal totmique a tel aspect ou telle proprit qu'il inspire des sentiments religieux ; ceux-ci rsultent de causes tout fait trangres la nature de l'objet sur lequel ils viennent se fixer. Ce qui les constitue, ce sont les impressions de rconfort et de dpendance, que l'action de la socit provoque dans les consciences. Par ellesmmes, ces motions ne sont lies l'ide d'aucun objet dtermin ; mais, parce que ce sont des motions et qu'elles sont particulirement intenses, elles sont aussi minemment contagieuses. Elles font donc tache d'huile; elles s'tendent tous les autres tats mentaux qui occupent alors l'esprit ; elles pntrent et contaminent notamment les reprsentations o viennent s'exprimer les divers objets que l'homme, au mme moment, a dans les mains ou sous les yeux : dessins totmiques qui recouvrent son corps, bull-roarers qu'il fait retentir, rochers qui l'entourent, sol qu'il foule sous ses pas, etc. C'est ainsi que ces objets eux-mmes prennent une valeur religieuse qui, en ralit, ne leur est pas inhrente, mais leur est confre du dehors. La contagion n'est donc pas une sorte de procd secondaire par lequel le caractre sacr, une fois acquis, se propage ; c'est le procd mme par lequel il s'acquiert. C'est par contagion qu'il se fixe ; on ne peut s'tonner qu'il se transmette contagieusement. Ce qui en fait la ralit c'est une motion spciale ; s'il s'attache un objet, c'est que cette motion a rencontr cet objet sur sa route. Il est donc naturel que, de celui-ci, elle s'tende tous ceux qu'elle trouve galement proximit, c'est--dire tous ceux qu'une raison quelconque, contigut matrielle ou pure similitude, a rapprochs du premier dans l'esprit. Ainsi la contagiosit du caractre sacr trouve son explication dans la thorie que nous avons propose des forces religieuses, et, par cela mme, sert la confirmer . En mme temps, elle nous aide comprendre un trait de la mentalit primitive sur lequel nous avons prcdemment appel l'attention.
1103
Nous avons vu avec quelle facilit le primitif confond les rgnes et identifie les choses les plus htrognes, hommes, animaux, plantes, astres, etc. Nous apercevons maintenant une des causes qui ont le plus contribu faciliter ces confusions. Parce que les forces religieuses sont minemment contagieuses, il arrive sans cesse qu'un mme principe se trouve animer galement les choses les plus diffrentes : il passe des unes dans les autres par suite soit d'un simple rapprochement matriel soit de similitudes mmes superficielles. C'est ainsi que des hommes, des animaux, des plantes, des roches sont censs participer du mme totem : les hommes, parce qu'ils portent le nom de l'animal ; les animaux, parce qu'ils rappellent l'emblme totmique ; les plantes, parce qu'elles servent nourrir ces animaux; les rochers, parce qu'ils garnissent le lieu o se clbrent les crmonies. Or, les forces religieuses sont alors considres comme la source de toute efficacit; des tres qui avaient un mme principe
1104
1103
Il est vrai que cette contagiosit n'est pas spciale aux forces religieuses; celles qui ressortissent la magie ont la mme proprit, et, cependant, il est vident qu'elles ne correspondent pas des sentiments sociaux objectivs. Mais c'est que les forces magiques ont t conues sur le modle des forces religieuses. Nous revenons plus loin sur ce point (v. p. 516). 1104 V. plus haut p. 336 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
290
religieux devaient donc passer pour avoir la mme essence et pour ne diffrer les uns des autres que par des caractres secondaires. C'est pourquoi il parut tout naturel de les ranger dans une mme catgorie et de ne voir en eux que des varits d'un mme genre, transmutables les unes dans les autres. Ce rapport tabli fait apparatre sous un nouvel aspect les phnomnes de contagion. Pris en eux-mmes, ils semblent tre trangers la vie logique. N'ont-ils pas pour effet de mler et de confondre les tres, en dpit de leurs diffrences naturelles ? Mais nous avons vu que ces confusions et ces participations ont jou un rle logique et d'une haute utilit : elles ont servi relier les choses que la sensation laisse en dehors les unes des autres. Il s'en faut donc que la contagion, source de ces rapprochements et de ces mlanges, soit marque de cette espce d'irrationalit fondamentale qu'on est tout d'abord port lui attribuer. Elle a ouvert la voie aux explications scientifiques de l'avenir.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
291
CHAPITRE II
LE CULTE POSITIF I. - Les lments du sacrifice
.
Quelle que puisse tre l'importance du culte ngatif et bien qu'il ait indirectement des effets positifs, il n'a pas sa raison d'tre en lui-mme ; il introduit la vie religieuse, mais il la suppose plus qu'il ne la constitue. S'il prescrit au fidle de fuir le monde profane, c'est pour le rapprocher du monde sacr. Jamais l'homme n'a conu que ses devoirs envers les forces religieuses pouvaient se rduire une simple abstention de tout commerce, il a toujours considr qu'il soutenait avec elles des rapports positifs et bilatraux qu'un ensemble de pratiques rituelles a pour fonction de rgler et d'organiser. A ce systme spcial de rites, nous donnons le nom de culte positif. Pendant longtemps, nous avons ignor peu prs totalement en quoi pouvait consister le culte positif de la religion totmique. Nous ne connaissions gure que les rites d'initiation, et encore les connaissions-nous insuffisamment. Mais les observations de Spencer et Gillen, prpares par celles de Schulze, confirmes par celles de Strehlow, sur les tribus du centre australien, ont, en partie, combl cette lacune de nos informations. Il y a surtout une fte que ces explorateurs se sont particulirement attachs nous dpeindre et qui, d'ailleurs, parat bien dominer tout le culte totmique : c'est celle que les Arunta, d'aprs Spencer et Gillen, appelleraient l'Intichiuma. Strehlow conteste, il est vrai, que tel soit le sens de ce mot. Suivant lui, intichiuma (ou, comme il crit, intijiuma) voudrait dire instruire et dsignerait les crmonies que l'on reprsente devant le jeune homme pour l'initier aux traditions de la tribu. La fte que nous allons dcrire porterait le nom de mbatjalkatiuma qui signifie fconder, mettre en bon tat . Mais nous ne chercherons pas trancher cette question de vocabulaire qui touche d'autant moins au fond des choses que les rites dont il va tre question sont galement clbrs au cours de l'initiation. D'autre part, comme le mot d'Intichiuma appartient aujourd'hui la langue courante de l'ethnographie, comme il est devenu presque un nom commun, il nous
1105
1105
STREHLOW, I, p. 4.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
292
parat inutile de le remplacer par un autre
1106
La date laquelle a lieu l'Intichiuma dpend, en grande partie, de la saison. Il existe, en Australie centrale, deux saisons nettement tranches : l'une, sche, qui dure longtemps ; l'autre, pluvieuse, qui est, au contraire, trs courte et souvent irrgulire. Ds que les pluies sont arrives, les plantes sortent de terre comme par enchantement, les animaux se multiplient, et des pays qui, la veille, n'taient que dserts striles se recouvrent rapidement d'une faune et d'une flore luxuriantes. C'est juste au moment o la bonne saison parat prochaine que se clbre l'Intichiuma. Seulement, parce que la priode des pluies est trs variable, la date des crmonies ne peut tre fixe une fois pour toutes. Elle varie elle-mme suivant les circonstances climatriques, que le chef du groupe totmique, l'Alatunja, a, seul, qualit pour apprcier : au jour qu'il juge convenable, il fait savoir ses compagnons que le moment est arriv .
1107
Chaque groupe totmique a, en effet, son Intichiuma. Mais si le rite est gnral dans les socits du centre, il n'est pas partout le mme ; il n'est pas chez les Warramunga ce qu'il est chez les Arunta ; il varie, non seulement suivant les tribus, mais, dans une mme tribu, suivant les clans. A vrai dire, les diffrents mcanismes qui sont ainsi en usage sont trop parents les uns des autres pour pouvoir se dissocier compltement. Il n'existe peut-tre pas de crmonies o il ne s'en rencontre plusieurs, mais trs ingalement dvelopps : ce qui, dans un cas, n'existe qu' l'tat de germe, occupe ailleurs toute la place et inversement. Il importe cependant de les distinguer avec soin ; car ils constituent autant de types rituels diffrents qu'il faut dcrire et expliquer sparment, sauf rechercher ensuite s'il y a quelque souche commune dont ils sont drivs. Nous commencerons par ceux que l'on observe plus spcialement chez les Arunta.
I
.
La fte comprend deux phases successives. Les rites qui se succdent dans la premire ont pour objet d'assurer la prosprit de l'espce animale ou vgtale qui sert de totem au clan. Les moyens qui sont employs dans ce but peuvent tre ramens quelques types principaux. On se rappelle que les anctres fabuleux dont chaque clan est cens descendu ont autrefois vcu sur la terre et y ont laiss des traces de leur passage. Ces traces consistent notamment en pierres ou en rochers qu'ils auraient dposs en certains endroits ou qui se seraient forms aux points o ils se sont abms dans le sol. Ces rochers et ces pierres sont considrs comme les
1106
Bien entendu, le mot qui dsigne cette fte change avec les tribus, Les Urabunna l'appellent Pitjinta (North. Tr., p. 284) ; les Warramunga Thalaminta (ibid., p. 297), etc. 1107 Schulze, loc. cit., p. 243; SPENCER et GILLEN, Nat. Tra., pp. 169-170.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
293
corps ou comme des parties du corps des anctres dont ils rappellent le souvenir ; ils les reprsentent. Par suite, ils reprsentent galement les animaux et les plantes qui servaient de totems ces mmes anctres, puisqu'un individu et son totem ne font qu'un. On leur prte donc la mme ralit, les mmes proprits qu'aux animaux ou aux plantes de mme sorte qui vivent actuellement. Mais ils ont sur ces derniers cet avantage d'tre imprissables, de ne pas connatre la maladie et la mort. Ils constituent donc comme une rserve permanente, immuable et toujours disponible de vie animale et vgtale. Aussi, est-ce cette rserve que, dans un certain nombre de cas, on va annuellement puiser pour assurer la reproduction de l'espce. Voici, par exemple, comment, Alice Springs, le clan de la Chenille witchetty procde son Intichiuma .
1108
Au jour fix par le chef, tous les membres du groupe totmique s'assemblent au camp principal. Les hommes des autres totems se retirent quelque distance ; car chez les Arunta, il leur est interdit d'tre prsents la clbration du rite qui a tous les caractres d'une crmonie secrte. Un individu d'un totem diffrent, mais de la mme phratrie, peut bien tre invit, par mesure gracieuse, y assister ; mais c'est seulement en qualit de tmoin. En aucun cas, il n'y peut ajouter un rle actif.
1109
Une fois que les gens du totem sont assembls, ils se mettent en route, ne laissant au camp que deux ou trois d'entre eux. Tout nus, sans armes, sans aucun de leurs ornements habituels, ils s'avancent les uns derrire les autres, dans un profond silence. Leur attitude, leur dmarche sont empreintes d'une gravit religieuse : c'est que l'acte auquel ils prennent part a, leurs yeux, une exceptionnelle importance. Aussi, jusqu' la fin de la crmonie, sont-ils tenus d'observer un jene rigoureux. Le pays qu'ils traversent est tout rempli de souvenirs laisss pas les glorieux anctres. Ils arrivent ainsi un endroit o un gros bloc de quartzite est enfonc dans le sol, avec tout autour, des petites pierres arrondies. Le bloc reprsente la chenille witchetty l'tat adulte. L'Alatunja, le frappe avec une sorte de petite auge en bois appele apmara , en mme temps qu'il psalmodie un chant dont l'objet est d'inviter l'animal pondre. Il procde de mme avec les pierres, qui figurent les oeufs de l'animal, et, avec l'une d'elles, il frotte l'estomac de chaque assistant. Cela fait, ils descendent tous un peu plus bas, au pied d'un rocher, galement clbr dans les mythes de l'Alcheringa, la base duquel se trouve une autre pierre qui, elle aussi, reprsente la chenille witchetty. L'Alatunja la frappe avec son apmara ; les gens qui l'accompagnent en font autant avec des branches de gommier qu'ils ont cueillies en route, le tout au milieu de chants qui renouvellent l'invitation prcdemment adresse l'animal. Prs de dix endroits diffrents sont successivement visits, dont quelques-uns sont parfois situs un mille les uns des autres. Dans chacun d'eux, au fond d'une sorte de cave ou de trou, se trouve quelque pierre qui est cense figurer la chenille witchetty sous l'un de ses aspects ou l'une des phases de son existence, et sur chacune de ces pierres les mmes crmonies sont rptes.
1110
1108 1109 1110
SPENCER et GiLLEN, Nat. Tr., p. 170 et suiv. Bien entendu, les femmes sont soumises la mme obligation. L'Apmara est le seul objet qui ait t emport du camp.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
294
Le sens du rite est apparent. Si l'Alatunja frappe les pierres sacres, c'est pour en dtacher de la poussire. Les grains de cette poussire trs sainte sont considrs comme autant de germes de vie ; chacun d'eux contient un principe spirituel qui, en s'introduisant dans un organisme de la mme espce, y donnera naissance un tre nouveau. Les branches d'arbre dont se sont munis les assistants servent disperser dans toutes les directions cette prcieuse poussire ; elle s'en va, de tous les cts, faire son oeuvre fcondante. Par ce moyen, on croit avoir assur la reproduction abondante de l'espce animale dont le clan a la garde, pour ainsi dire, et dont il dpend. Les indignes eux-mmes donnent du rite, cette interprtation. Ainsi, dans le clan de l'ilpirla (sorte de manne) on procde de la manire suivante. Quand le jour de l'Intichiuma est arriv, le groupe se runit un endroit o se dresse une grande pierre, d'environ cinq pieds de haut ; au-dessus de cette pierre, s'en lve une seconde, qui est trs semblable d'aspect la premire et que d'autres, plus petites, entourent. Les unes et les autres reprsentent des masses de manne. L'Alatunja creuse le sol au pied de ces rocs et met au jour un churinga qui passe pour y avoir t enterr aux temps de l'Alcheringa et qui, lui aussi, constitue comme de la quintessence de manne. Il grimpe ensuite au sommet du rocher le plus lev et le frotte d'abord avec ce churinga, puis avec les pierres les plus petites qui sont tout autour. Enfin, avec des branches d'arbre, il balaye la poussire qui s'est ainsi amasse la surface du rocher : chacun des assistants en fait autant tour de rle. Or, disent Spencer et Gillen, la pense des indignes est que la poussire ainsi disperse va se poser sur les arbres mulga et y produit de la manne . Et en effet, ces oprations sont accompagnes d'un chant que chante l'assistance et o cette ide est exprime .
1111
Avec des variantes, on trouve le mme rite dans d'autres socits. Chez les Urabunna, il y a un rocher qui reprsente un anctre du clan du Lzard; on en dtache des pierres qu'on lance dans tous les sens afin d'obtenir une abondante production de lzards . Dans cette mme tribu, il existe un banc de sable auquel des souvenirs mythologiques associent troitement le totem du pou. Au mme endroit se trouvent deux arbres dont l'un est appel l'arbre pou ordinaire, l'autre, l'arbre pou-crabe. On prend de ce sable, on le frotte contre ces arbres, on le jette de tous les cts et l'on est convaincu que, par ce moyen, les poux natront nombreux . Chez les Mara, c'est en dispersant de la poussire dtache de pierres sacres, qu'on procde l'Intichiuma des abeilles . Pour le kangourou des plaines on emploie une mthode lgrement diffrente. On prend de la bouse de kangourou ; on l'enveloppe dans une certaine herbe dont cet animal est trs friand et qui, pour cette raison, ressortit au totem du Kangourou. On dpose la bouse, ainsi enveloppe, sur le sol entre deux couches de cette mme herbe et on met le feu au tout. Avec la flamme qui se dgage, on allume des branches d'arbres que l'on agite ensuite de manire ce que les tincelles s'en aillent dans toutes les directions. Ces tincelles jouent le mme rle que la poussire dans les cas prcdents .
1112 1113 1114 1115
Dans un certain nombre de clans
1111 1112 1113 1114 1115 1116
1116
, pour rendre le rite plus efficace, les hommes mlent
Nat. Tr., pp. 185-186. North. Tr., p. 288. Ibid. North. Tr., p. 312. Ibid. Nous verrons plus loin que ces clans sont beaucoup plus nombreux que ne le disent Spencer et Gillen.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
295
la substance de la pierre quelque chose de leur propre substance. Des jeunes gens s'ouvrent les veines et laissent leur sang s'couler flots sur le rocher. C'est ce qui arrive notamment dans l'Intichiuma de la fleur Hakea, chez les Arunta. La crmonie a lieu dans un endroit sacr, autour d'une pierre galement sacre, qui reprsente, aux yeux des indignes, des fleurs Hakea. Aprs quelques oprations prliminaires, le vieillard qui dirige l'excution du rite, invite un jeune homme s'ouvrir les veines. Celui-ci obit et laisse son sang se rpandre librement sur la pierre, tandis que les assistants continuent chanter. Le sang coule jusqu' ce que la pierre en soit compltement couverte . L'objet de cette pratique est de revivifier, en quelque sorte, les vertus de la pierre et d'en renforcer l'efficacit. Il ne faut pas oublier, en effet, que les gens du clan sont eux-mmes des parents de la plante ou de l'animal dont ils portent le nom ; en eux, et notamment dans leur sang, rside le mme principe de vie. Il est donc naturel qu'on se serve de ce sang et des germes mystiques qu'il charrie pour assurer la reproduction rgulire de l'espce totmique. Quand un homme est malade ou fatigu, il arrive frquemment chez les Arunta que, pour le ranimer, un de ses jeunes compagnons s'ouvre les veines et l'arrose de son sang . Si le sang peut ainsi rveiller la vie chez un homme, il n'est pas surprenant qu'il puisse galement servir l'veiller dans l'espce animale ou vgtale avec laquelle les hommes du clan se confondent.
1117 1118
Le mme procd est employ dans l'Intichiuma du Kangourou Undiara (Arunta). Le thtre de la crmonie est un trou d'eau surplomb d'un rocher pie. Ce rocher reprsente un animal kangourou de l'Acheringa qui a t tu et dpos cet endroit par un homme-kangourou de la mme poque; aussi de nombreux esprits de kangourous sont-ils censs y rsider. Aprs qu'un certain nombre de pierres sacres ont t frottes les unes contres les autres de la manire que nous avons dcrite, plusieurs des assistants montent sur le rocher le long duquel ils laissent couler leur sang . Le but de la crmonie, d'aprs ce que disent les indignes, est actuellement le suivant. Le sang d'homme-kangourou, ainsi rpandu sur le rocher, est destin en chasser les esprits des kangourous-animaux qui s'y trouvent et les disperser dans toutes les directions ; ce qui doit avoir pour effet d'accrotre le nombre des kangourous .
1119 1120
Il y a mme un cas chez les Arunta o le sang parat tre le principe actif du rite. Dans le groupe de l'mou, on n'emploie pas de pierres sacres ni rien qui y ressemble. L'Alatunja et quelques-uns de ses assistants arrosent le sol de leur sang ; sur la terre ainsi imbibe, on trace des lignes, de diverses couleurs, qui reprsentent les diffrentes parties du corps de l'mou. On s'agenouille autour de ce dessin et l'on chante un chant monotone. C'est de l'mou fictif ainsi
1117 1118
Nat. Tr., pp. 184-185. Nat. Tr., pp. 438, 461, 464; North. Tr., p. 596 et suiv. 1119 Nat. Tr., p. 201. 1120 Ibid., p. 206. Nous employons le langage de Spencer et Gillen et, avec eux, nous disons que ce qui se dgage des rochers, ce sont des esprits de kangourous (spirits ou spirit paris of kangaroo). STREHLOW (III, p. 7), conteste l'exactitude de l'expression, Suivant lui, ce que le rite fait apparatre ce sont des kangourous rels, des corps vivants. Mais la contestation est sans intrt, tout comme celle qui concerne la notion de ratapa (v. plus haut, p. 361). Les germes de kangourous qui s'chappent ainsi des rochers ne sont pas visibles; ils ne sont donc pas faits de la mme substance que les kangourous que peroivent nos sens. C'est tout ce que veulent dire Spencer et Gillen. Il est bien certain, d'ailleurs, que ce ne sont pas de purs esprits comme un chrtien pourrait en concevoir. Tout comme les mes humaines, ils sont des formes matrielles.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
296
incant et, par consquent, du sang qui a servi le faire, que sont censs partir les principes vivants qui, en animant les embryons de la gnration nouvelle, empcheront l'espce de disparatre .
1121
Chez les Wonkgongaru , il y a un clan qui a pour totem une certaine sorte de poisson ; c'est galement le sang qui joue le rle principal dans l'Intichiuma de ce totem. Le chef du groupe, aprs s'tre peint crmoniellement, entre dans un trou d'eau et s'y asseoit. Puis, avec de petits os pointus, il se perce successivement le scrotum et la peau autour du nombril. Le sang qui coule de ces diffrentes blessures se rpand dans l'eau et donne naissance aux poissons .
1122 1123
C'est par une pratique tout fait similaire que les Dieri croient assurer la reproduction de deux de leurs totems, le serpent tapis et le serpent woma (serpent ordinaire). Un Mura-mura appel Minkani est cens rsider sous une dune. Son corps est reprsent par des ossements fossiles d'animaux ou de reptiles comme en contiennent, nous dit Howitt, les deltas des rivires qui se dversent dans le lac Eyre. Quand le jour de la crmonie est venu, les hommes s'assemblent et se rendent l'endroit o se trouve le Minkani. L, ils creusent jusqu' ce qu'ils atteignent une couche de terre humide et ce qu'ils appellent les excrments du Minkani . A partir de ce moment, on continue fouiller le sol avec de grandes prcautions jusqu' ce qu'on mette dcouvert le coude du Minkani . Alors, deux hommes s'ouvrent les veines et laissent leur sang couler sur la pierre sacre. On chante le chant du Minkani tandis que les assistants, emports par une vritable frnsie, se frappent les uns les autres avec leurs armes. La bataille dure jusqu' ce qu'ils soient rentrs au camp, qui est situ une distance d'un mille environ. L, les femmes interviennent et mettent fin au combat. On recueille le sang qui coule des blessures, on le mle aux excrments du Minkani et on sme les produits du mlange sur la dune. Le rite accompli, on est convaincu que les serpents tapis natront en abondance .
1124
Dans quelques cas, on emploie, comme principe vivifiant, la substance mme que l'on cherche produire. Ainsi chez les Kaitish, au cours d'une crmonie qui a pour but de faire de la pluie, on arrose d'eau une pierre sacre, qui reprsente des hros mythiques du clan de l'Eau. Il est vident que, par ce moyen, on croit augmenter les vertus productrices de la pierre tout aussi bien qu'avec du sang, et pour les mmes raisons . Chez les Mara, l'oprateur va puiser de l'eau dans un trou sacr, il en boit et en crache dans toutes les directions . Chez les Worgaia, quand les ignames commencent pousser, le chef du clan de l'Igname envoie les gens de la phratrie laquelle il n'appartient pas lui-mme cueillir de ces plantes; ceux-ci lui en
1125 1126
1121 1122
Nat. Tr., p. 181. Tribu situe l'est du lac Eyre. 1123 North. Tr., pp. 287-288. 1124 HOWITT, Nat. Tr., p. 798. Cf. HOWITT, Legends of the Dieri and Kindred Tribes of Central Australia, in J.A.I., XXIV, p. 124 et suiv. Howitt croit que la crmonie est clbre par les gens du totem, mais n'est pas en mesure de certifier le fait. 1125 North. Tr., p. 295. 1126 Ibid., p. 314.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
297
rapportent quelques-unes et lui demandent d'intervenir pour que l'espce se dveloppe bien. Il en prend une, la mord et jette les morceaux de tous les cts . Chez les Kaitish, quand, aprs des rites varis que nous ne dcrivons pas, une certaine graine d'herbe appele Erlipinna est parvenue son plein dveloppement, le chef du totem en apporte un peu au camp des hommes et la moud entre deux pierres; on recueille pieusement la poussire ainsi obtenue, et on en place quelques grains sur les lvres du chef qui, en soufflant, les disperse dans tous les sens, Ce contact avec la bouche du chef, qui possde une vertu sacramentaire toute spciale, a, sans doute, pour objet de stimuler la vitalit des germes que ces grains contiennent et qui, projets tous les coins de l'horizon, vont communiquer aux plantes les proprits fcondantes qu'ils possdent .
1127 1128
L'efficacit de ces rites ne fait pas de doute pour l'indigne : il est convaincu qu'ils doivent produire les rsultats qu'il en attend, avec une sorte de ncessit. Si l'vnement trompe ses esprances, il en conclut simplement qu'ils ont t contrecarrs par les malfices de quelque groupe hostile. En tout cas, il ne lui vient pas l'esprit qu'un rsultat favorable puisse tre obtenu par d'autres moyens. Si, par hasard, la vgtation pousse ou si les animaux prolifrent avant qu'il n'ait procd lui-mme l'Intichiuma, il suppose qu'un autre Intichiuma a t clbr, sous terre, par les mes des anctres et que les vivants recueillent les bnfices de cette crmonie souterraine .
1129
1127 1128
Ibid., pp. 296-297. Nat. Tr., p. 170. 1129 Ibid., p. 519. - L'analyse des rites qui viennent d'tre tudis a t faite uniquement avec les observations que nous devons Spencer et Gillen. Depuis que notre chapitre a t rdig, Strehlow a publi le troisime fascicule de son ouvrage qui traite prcisment du culte positif, et, notamment, de l'Intichiuma ou, comme il dit, des rites de mbatjalkatiuma. Mais nous n'avons rien trouv dans cette publication qui nous oblige modifier la description qui prcde ni mme la complter par des additions importantes. Ce que Strehlow nous apprend de plus intressant ce sujet, c'est que les effusions et les oblations de sang sont beaucoup plus frquentes qu'on ne pouvait le souponner d'aprs le rcit de Spencer et Gillen (v. STREHLOW, III, pp. 13, 14, 19, 29, 39, 43, 46, 56, 67, 80, 89). Les renseignements de Strehlow sur le culte doivent, d'ailleurs, tre employs avec circonspection, car il n'a pas t tmoin des rites qu'il dcrit ; il s'est born recueillir des tmoignages oraux et qui sont gnralement assez sommaires (v. fasc. Ill, prface de LEONHARDI, p. V). On peut mme se demander s'il n'a pas confondu avec excs les crmonies totmiques de l'initiation avec celles qu'il appelle mbatjalkatiuma. Sans doute, il n'est pas sans avoir fait un louable effort pour les distinguer et il a bien mis en vidence deux de leurs caractristiques diffrentielles. D'abord, l'Intichiuma a toujours lieu en un endroit consacr, auquel se rattache le souvenir de quelque anctre, tandis que les crmonies d'initiation peuvent tre clbres en un lieu quelconque. Ensuite, les oblations de sang sont spciales l'Intichiuma; ce qui prouve qu'elles tiennent ce qu'il y a de plus essentiel dans ce rituel (III, p. 7). Mais, dans la description qu'il nous donne des rites, on trouve confondues des informations qui se rapportent indiffremment l'une et l'autre espce de crmonie. En effet, dans celles qu'il nous dcrit sous le nom de mbatjalkatiuma, les jeunes gens jouent gnralement un rle important (v. par exemple, p. 11, 13, etc.); ce qui est caractristique de l'initiation. De mme, il semble bien que le lieu du rite soit arbitraire : car les acteurs construisent leur scne artificiellement. Ils creusent un trou dans lequel ils se placent ; il n'est gnralement fait aucune allusion aux rochers ou arbres sacrs et leur rle rituel.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
298
II
.
Tel est le premier acte de la fte. Dans la priode qui suit immdiatement, il n'y a pas de crmonie proprement dite. Cependant, la vie religieuse reste intense : elle se manifeste par une aggravation du systme ordinaire des interdits. Le caractre sacr du totem est comme renforc : on ose moins y toucher. Alors que, en temps normal, les Arunta peuvent manger de l'animal ou de la plante qui leur sert de totem pourvu que ce soit avec modration, au lendemain de l'Intichiuma, ce droit est suspendu ; l'interdiction alimentaire est stricte et sans rserve. On croit que toute violation de cet interdit aurait pour rsultat de neutraliser les heureux effets du rite et d'arrter la croissance de l'espce. Les gens des autres totems qui se trouvent dans la mme localit ne sont pas, il est vrai, soumis la mme prohibition. Cependant, ce moment, leur libert est moindre qu' l'ordinaire. Ils ne peuvent consommer l'animal totmique en un lieu quelconque, par exemple dans la brousse ; mais ils sont tenus de l'apporter au camp et c'est l seulement qu'il doit tre cuit .
1130
Une dernire crmonie vient mettre un terme ces interdits extraordinaires et clore dfinitivement cette longue srie de rites. Elle varie quelque peu suivant les clans; mais les lments essentiels en sont partout les mmes. Voici deux des principales formes qu'elle prsente chez les Arunta. L'une se rapporte la Chenille witchetty, l'autre au Kangourou. Une fois que les chenilles sont arrives la pleine maturit et qu'elles se montrent en abondance, les gens du totem, aussi bien que les trangers, vont en ramasser le plus possible ; puis tous rapportent au camp celles qu'ils ont trouves et ils les font cuire jusqu' ce qu'elles deviennent dures et cassantes. Les produits de la cuisson sont conservs dans des espces de vaisseaux de bois appels pitchi. La rcolte des chenilles n'est possible que pendant un temps trs court, car elles n'apparaissent qu'aprs la pluie. Quand elles commencent devenir moins nombreuses, l'Alatunja convoque tout le monde au camp des hommes ; sur son invitation, chacun apporte sa provision. Les trangers dposent la leur devant les gens du totem. L'Alatunja prend un de ces pitchi et, avec l'aide de ses compagnons, en moud le contenu entre deux pierres ; aprs, quoi, il mange un peu de la poudre ainsi obtenue, ses assistants en font autant, et le reste est remis aux gens des autres clans qui peuvent, ds lors, en disposer librement. On procde exactement de la mme manire pour la provision qu'a faite l'Alatunja. A partir de ce moment, les hommes et les femmes du totem peuvent en manger, mais seulement un peu ; car s'ils dpassaient les limites permises, ils perdraient les pouvoirs ncessaires pour clbrer l'Intichiuma et l'espce ne se reproduirait pas. Seulement, s'ils n'en mangeaient pas du tout, et surtout si, dans les circonstances que nous venons de dire, l'Alatunja s'abstenait totalement d'en manger, ils seraient frapps de la mme incapacit. Dans le groupe totmique du Kangourou qui a son centre Undiara, certaines des
1130
Nat. Tr., p. 203. Cf. MEYER, The Encounter Bay Tribe, in WOODS, p. 187.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
299
caractristiques de la crmonie sont marques d'une manire plus apparente. Aprs que les rites que nous avons dcrits sont accomplis sur le rocher sacr, les jeunes gens s'en vont chasser le kangourou et rapportent leur gibier au camp des hommes. L, les anciens, au milieu desquels se tient l'Alatunja, mangent un peu de la chair de l'animal et, oignent avec de la graisse le corps de ceux qui ont pris part l'Intichiuma. Le reste est partag entre les hommes assembls. Ensuite, les gens du totem se dcorent de dessins totmiques et la nuit se passe en chants qui rappellent les exploits accomplis au temps de l'Acheringa par les hommes et les animaux kangourous. Le lendemain, les jeunes gens retournent chasser dans la fort, en rapportent un plus grand nombre de kangourous que la premire fois et la crmonie de la veille recommence .
1131
Avec des variantes de dtails, on trouve le mme rite dans d'autres clans arunta , chez les Urabunna , les Kaitish , les Unmatjera , dans la tribu de la baie de la rencontre . Partout, il est fait des mmes lments essentiels. Quelques spcimens de la plante ou de l'animal totmique sont prsents au chef du clan qui en mange solennellement et qui est tenu d'en manger. S'il ne s'acquittait pas de ce devoir, il perdrait le pouvoir qu'il a de clbrer efficacement l'Intichiuma, c'est--dire de recrer annuellement l'espce. Parfois, la consommation rituelle est suivie d'une onction faite avec la graisse de l'animal ou certaines parties de la plante . Gnralement, le rite est ensuite rpt par les gens du totem ou, tout au moins, par les anciens et, une fois qu'il est accompli, les interdits exceptionnels sont levs.
1132 1133 1134 1135 1136 1137
Dans les tribus situes plus au nord, chez les Warramunga et dans les socits voisines , cette crmonie fait actuellement dfaut. Toutefois, on en trouve encore des traces qui semblent bien tmoigner qu'il fut un temps o elle n'tait pas ignore. jamais, il est vrai, le chef du clan ne mange rituellement et obligatoirement du totem. Mais, dans certains cas, les gens qui ne sont pas du totem dont l'Intichiuma vient d'tre clbr, sont tenus d'apporter l'animal ou la plante au camp et de l'offrir au chef en lui demandant s'il vent en manger. Il refuse et ajoute : J'ai fait ceci pour vous ; vous pouvez en manger librement . L'usage de la prsentation subsiste donc et la question pose au chef parat bien se rapporter une poque o la consommation rituelle tait pratique .
1138 1139 1140
1131 1132
SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 204. Nat. Tr., pp. 205-207. 1133 North. Tr., pp. 286-287. 1134 Ibid., p. 294. 1135 Ibid., p. 296. 1136 MEYER, in WOODS, p. 187. 1137 Nous en avons dj cit un cas; on ne trouvera d'autres dans SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 205; North, Tr., p. 286. 1138 Les Walpari, Wulmala, Tjingilli, Umbaia. 1139 North. Tr., p. 318. 1140 Pour cette seconde partie de la crmonie comme pour la premire, nous avons suivi Spencer et Gillen. Mais le rcent fascicule de Strehlow ne fait, sur ce point, que confirmer les observations de ses devanciers, au moins dans ce qu'elles ont d'essentiel. Il reconnat, en effet, que, aprs la premire crmonie, (deux mois aprs, est-il dit, p. 13), le chef du clan mange rituellement de l'animal ou de la plante totmique et qu'ensuite il est procd la leve des interdits; il appelle cette opration die Freigabe des Totems zum allgemeinen Gebrauch (III, p. 7). Il nous apprend mme que cette opration est assez importante pour tre
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
300
III
.
Ce qui fait l'intrt du systme de rites qui vient d'tre dcrit, c'est qu'on y trouve, sous la forme la plus lmentaire qui soit actuellement connue, tous les principes essentiels d'une grande institution religieuse qui tait appele devenir un des fondements du culte positif dans les religions suprieures : c'est l'institution sacrificielle. On sait quelle rvolution les travaux de Robertson Smith ont dtermine dans la thorie traditionnelle du sacrifice . Jusqu' lui, on ne voyait dans le sacrifice qu'une sorte de tribut ou d'hommage, obligatoire on gracieux, analogue ceux que les sujets doivent leurs princes. Robertson Smith fut le premier faire remarquer que cette explication classique ne tenait pas compte de deux caractres essentiels du rite. Tout d'abord, c'est un repas ; ce sont des aliments qui en sont la matire. De plus, c'est un repas auquel les fidles qui l'offrent prennent part en mme temps que le dieu auquel il est offert. Certaines parties de la victime sont rserves la divinit ; d'autres sont attribues aux sacrifiants qui les consomment ; c'est pourquoi, dans la Bible, le sacrifice est parfois appel un repas fait devant Iahve. Or les repas pris en commun passent, dans une multitude de socits, pour crer entre ceux qui y assistent un lien de parent artificielle. Des parents, en effet, sont des tres qui sont naturellement faits de la mme chair et du mme sang. Mais l'alimentation refait sans cesse la substance de l'organisme. Une commune alimentation peut donc produire les mmes effets qu'une commune origine. Suivant Smith, les banquets sacrificiels auraient prcisment pour objet de faire communier dans une mme chair le fidle et son dieu afin de nouer entre eux un lien de parent. De ce point de vue, le sacrifice
1141
dsigne par un mot spcial dans la langue des Arunta. Il ajoute, il est vrai, que cette consommation rituelle n'est pas la seule, mais que, parfois, le chef et les anciens mangent galement de la plante ou de l'animal sacr avant la crmonie initiale, et que l'acteur du rite, en fait autant aprs la clbration. Le fait n'a rien d'invraisemblable; ces consommations sont autant de moyens employs par les officiants ou les assistants pour se confrer les vertus qu'ils veulent acqurir; il n'est pas tonnant qu'elles soient multiplies. Il n'y a rien l qui infirme le rcit de Spencer et Gillen; car le rite sur lequel ils insistent, et non sans raison, c'est la Freigabe des Totems. Sur deux points seulement, Strehlow conteste les allgations de Spencer et Gillen. Tout d'abord, il dclare que la consommation rituelle n'a pas lieu dans tous les cas. Le fait n'est pas douteux, puisqu'il y a des animaux et des plantes totmiques qui ne sont pas comestibles. Mais il reste que le rite est trs frquent; STREHLOW luimme en cite de nombreux exemples (pp. 13, 14, 19, 23, 33, 36, 50, 59, 67, 68, 71, 75, 80, 84, 89, 93). En second lieu, on a vu que, d'aprs Spencer et Gillen, si le chef du clan ne mangeait pas de l'animal ou de la plante totmique, il perdrait ses pouvoirs. Strehlow assure que les tmoignages des indignes ne confirment pas cette assertion. Mais la question nous parait tout fait secondaire. Le fait certain est que cette consommation rituelle est prescrite ; c'est donc qu'elle est juge utile ou ncessaire. Or, comme toute communion, elle ne peut servir qu' confrer au sujet qui communie les vertus dont il a besoin. De ce que les indignes ou certains d'entre eux ont perdu de vue cette fonction du rite, il ne suit pas qu'elle ne soit pas relle. Est-il ncessaire de rpter que les fidles ignorent le plus souvent les vritables raisons d'tre des pratiques qu'ils accomplissent ? 1141 V. The Religion of the Semites, lectures VI XI, et l'article Sacrifice dans l'Encyclopedia Britannica.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
301
apparaissait sous un aspect tout nouveau. Ce qui le constituait essentiellement, ce n'tait plus, comme on l'avait cru si longtemps, l'acte de renoncement que le mot de sacrifice exprime d'ordinaire ; c'tait, avant tout, un acte de communion alimentaire. Il y aurait, sans doute, quelques rserves faire, dans le dtail, sur cette faon d'expliquer l'efficacit des banquets sacrificiels. Celle-ci ne rsulte pas exclusivement du fait de la commensalit. L'homme ne se sanctifie pas uniquement parce qu'il s'asseoit, en quelque sorte, la mme table que le dieu, mais surtout parce que l'aliment qu'il consomme dans ce repas rituel a un caractre sacr. On a montr, en effet, comment, dans le sacrifice, toute une srie d'oprations prliminaires, lustrations, onctions, prires, etc., transforment l'animal qui doit tre immol en une chose sainte, dont la saintet se communique ensuite au fidle qui en mange . Il n'en reste pas moins que la communion alimentaire est un des lments essentiels du sacrifice. Or, qu'on se reporte au rite par lequel se clturent les crmonies de l'Intichiuma; lui aussi consiste en un acte de ce genre. L'animal totmique une fois tu, l'Alatunja et les anciens en mangent solennellement. Ils communient donc avec le principe sacr qui y rside et ils se l'assimilent. Toute la diffrence, c'est que, ici l'animal est sacr naturellement tandis que, d'ordinaire, il n'acquiert ce caractre qu'artificiellement au cours du sacrifice.
1142
L'objet de cette communion est, d'ailleurs, manifeste. Tout membre d'un clan totmique porte en soi une sorte de substance mystique qui constitue la partie minente de son tre, car c'est d'elle qu'est faite son me. C'est d'elle que lui viennent les pouvoirs qu'il s'attribue et son rle social ; c'est par elle qu'il est une personne. Il a donc un intrt vital la conserver intacte, la maintenir, autant que possible, dans un tat de perptuelle jeunesse. Malheureusement, toutes les forces, mme les plus spirituelles, s'usent par l'effet du temps, si rien ne vient leur rendre l'nergie qu'elles perdent par le cours naturel des choses : il y a l une ncessit primordiale qui, comme nous le verrons, est la raison profonde du culte positif. Les gens d'un totem ne peuvent donc rester eux-mmes que s'ils revivifient priodiquement le principe totmique qui est en eux ; et comme ce principe, ils se le reprsentent sous la forme d'un vgtal ou d'un animal, c'est l'espce animale ou vgtale correspondante qu'ils vont demander les forces supplmentaires dont ils ont besoin pour le renouveler et le rajeunir. Un homme du clan du Kangourou se croit, se sent tre un kangourou ; c'est par cette qualit qu'il se dfinit ; c'est elle qui marque sa place dans la socit. Pour la garder, il fait de temps en temps passer dans sa propre substance un peu de la chair de ce mme animal. Quelques parcelles suffisent d'ailleurs, en vertu de la rgle : la partie vaut le tout .
1143
Mais pour que cette opration puisse produire tous les effets qu'on en attend, il importe qu'elle n'ait pas lieu un moment quelconque. Le plus opportun est celui o la nouvelle gnration vient d'arriver son complet dveloppement ; car c'est aussi le moment o les forces qui animent l'espce totmique atteignent leur plein panouissement. C'est peine si elles viennent d'tre extraites de ces riches rservoirs de vie que sont les arbres et les rochers sacrs. De plus, toute sorte de moyens ont t employs pour accrotre encore leur intensit ; c'est quoi ont servi les rites qui se sont drouls pendant la premire partie de l'Intichiuma.
1142
V. HUBERT et Mauss, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, in Mlanges d'histoire des religions, p. 40 et suiv. 1143 V. pour l'explication de cette rgle supra, p. 328.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
302
Au reste, par leur aspect mme, les premiers produits de la rcolte manifestent l'nergie qu'ils reclent : le dieu totmique s'y affirme dans tout l'clat de la jeunesse. C'est pourquoi, de tout temps, les prmices ont t considrs comme un aliment trs sacr, rserv des tres trs saints. Il est donc naturel que l'Australien s'en serve pour se rgnrer spirituellement. Ainsi s'expliquent et la date et les circonstances de la crmonie. On s'tonnera peut-tre qu'un aliment aussi sacr puisse tre consomm par de simples profanes. Mais d'abord, il n'est pas de culte positif qui ne se meuve dans cette contradiction. Tous les tres sacrs, en raison du caractre dont ils sont marqus, sont soustraits aux atteintes profanes ; mais d'un autre ct, ils ne serviraient rien et manqueraient de toute raison d'tre s'ils n'taient mis en rapports avec ces mmes fidles qui, par ailleurs, doivent en rester respectueusement loigns. Il n'y a pas de rite positif qui, au fond, ne constitue un vritable sacrilge ; car l'homme ne peut commercer avec les tres sacrs sans franchir la barrire qui, normalement, doit l'en tenir spar Tout ce qui importe, c'est que le sacrilge soit accompli avec des prcautions qui l'attnuent. Parmi celles qui sont employes, la plus usuelle consiste mnager la transition et n'engager que lentement et graduellement le fidle dans le cercle des choses sacres. Ainsi fragment et dilu, le sacrilge ne heurte pas violemment la conscience religieuse ; il n'est pas senti comme tel et s'vanouit. Or, c'est ce qui a lieu dans le cas qui nous occupe. Toute la srie de crmonies qui a prcd le moment o le totem est solennellement mang a eu pour effet de sanctifier progressivement ceux qui y ont pris une part active. C'est une priode essentiellement religieuse qu'ils n'ont pu traverser sans que leur tat religieux se soit transform. Les jenes, le contact des rochers sacrs, des churinga , les dcorations totmiques, etc., leur ont peu peu confr un caractre qu'ils n'avaient pas antrieurement et qui leur permet d'affronter, sans profanation choquante et dangereuse, cet aliment dsir et redout qui, en temps ordinaire, leur serait interdit .
1144 1145
Si l'acte par lequel un tre sacr est immol, puis mang par ceux qui l'adorent, peut tre appel un sacrifice, le rite dont il vient d'tre question a droit la mme dnomination. Au reste, ce qui en montre bien la signification, ce sont les analogies frappantes qu'il prsente avec d'autres pratiques que l'on rencontre dans un grand nombre de cultes agraires. C'est, en effet, une rgle trs gnrale, mme chez des peuples parvenus un haut degr de civilisation, que les premiers produits de la rcolte servent de matire des repas rituels dont le banquet pascal est l'exemple le plus connu . Comme, d'autre part, les rites agraires sont la base mme des formes les plus leves du culte, on voit que l'Intichiuma des socits australiennes est plus proche de nous qu'on ne pourrait croire d'aprs son apparente grossiret.
1146
Par une intuition de gnie, Smith, sans connatre ces faits, en avait eu le pressentiment. Par une srie d'ingnieuses dductions - qu'il est inutile de reproduire ici, car elles n'ont plus qu'un
1144 1145
V. STREHLOW, III, p. 3. Il ne faut pas perdre de vue; d'ailleurs, que, chez les Arunta, Il n'est pas compltement interdit de manger de l'animal totmique. 1146 V. d'autres faits dans FRAZER, Golden Bough 2, p. 348 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
303
intrt historique - il crut pouvoir tablir que, l'origine, l'animal immol dans les sacrifices avait d tre considr comme quasi divin et comme proche parent de ceux qui l'immolaient : or ces caractres sont prcisment ceux par lesquels se dfinit l'espce totmique. Smith en vint aussi supposer que le totmisme avait d connatre et pratiquer un rite tout fait analogue celui que nous venons d'tudier ; il penchait mme voir dans cette sorte de sacrifice la souche fondamentale de toute l'institution sacrificielle . Le sacrifice n'aurait pas t institu l'origine pour crer entre l'homme et ses dieux un lien de parent artificielle, mais pour entretenir et renouveler la parent naturelle qui les unissait primitivement. Ici, comme ailleurs, l'artifice ne serait n que pour imiter la nature. Mais cette hypothse ne se prsentait gure dans le livre de Smith que comme une vue de l'esprit, que les faits alors connus ne justifiaient que trs imparfaitement. Les rares cas de sacrifice totmique qu'il cite l'appui de sa thse n'ont pas la signification qu'il leur donne ; les animaux qui y figurent ne sont pas des totems proprement dits . Mais aujourd'hui, il est permis de dire que, sur un point tout au moins, la dmonstration est faite : nous venons de voir, en effet, que, dans un nombre important de socits, le sacrifice totmique, tel que Smith le concevait, est ou a t pratiqu. Sans doute, nous n'avons nullement la preuve que cette pratique soit ncessairement inhrente au totmisme ni qu'elle soit le germe d'o tous les autres types de sacrifice sont sortis. Mais si l'universalit du rite est hypothtique, l'existence n'en est plus contestable. On doit dsormais regarder comme tabli que la forme la plus mystique de la communion alimentaire se rencontre ds la religion la plus rudimentaire qui soit prsentement connue.
1147 1148 1149
IV
.
Mais sur un autre point, les faits nouveaux dont nous disposons infirment les thories de Smith. Suivant lui, en effet, la communion ne serait pas seulement un lment essentiel du sacrifice ; elle en serait, au moins l'origine, l'lment unique. Non seulement on se serait mpris quand on rduisait le sacrifice n'tre qu'un tribut ou une offrande, mais encore l'ide d'offrande en serait primitivement absente ; elle ne serait intervenue que tardivement, sous l'influence de circonstances extrieures, et elle masquerait la nature vritable de ce mcanisme rituel, loin qu'elle pt aider le comprendre. Smith croyait, en effet, apercevoir dans la notion mme d'oblation une absurdit trop rvoltante pour qu'il ft possible d'y voir la raison profonde d'une aussi grande institution. Une des fonctions les plus importantes qui incombent la divinit est d'assurer aux hommes les aliments qui leur sont ncessaires pour vivre ; il parat donc impossible que le sacrifice, son tour, consiste en une prsentation d'aliments la divinit. Il semble contradictoire que les dieux attendent de l'homme leur nourriture, quand
1147 1148 1149
The Religion of the Semites, p. 275 et suiv. Ibid., pp. 318-319. V. sur ce point HUBERT et Mauss, Mlanges d'histoire des religions, prface, p. V et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
304
c'est par eux qu'il est nourri. Comment auraient-ils besoin de son concours pour prlever leur juste part sur les choses qu'il reoit de leur mains ? De ces considrations Smith concluait que l'ide du sacrifice-offrande n'avait pu natre que dans les grandes religions, o les dieux, dgags des choses avec lesquelles ils se confondaient primitivement, furent conus comme des sortes de rois, propritaires minents de la terre et de ses produits. A partir de ce moment, le sacrifice fut assimil au tribut que les sujets payent leur prince, comme prix des droits qui leur sont concds. Mais cette interprtation nouvelle aurait t, en ralit, une altration et mme une corruption de la conception primitive. Car l'ide de proprit matrialise tout ce qu'elle touche ; en s'introduisant dans le sacrifice, elle le dnatura et en fit une sorte de march entre l'homme et la divinit .
1150
Mais les faits que nous avons exposs ruinent cette argumentation. Les rites que nous avons dcrits comptent certainement parmi les plus primitifs qui aient jamais t observs. On n'y voit encore apparatre aucune personnalit mythique dtermine ; il n'y est question ni de dieux ni d'esprits proprement dits ; ils ne mettent en oeuvre que des forces vagues, anonymes et impersonnelles. Et cependant les raisonnements qu'ils supposent sont prcisment ceux que Smith dclarait impossibles en raison de leur absurdit. Reportons-nous, en effet, au premier acte de l'Intichiuma, aux rites qui sont destins assurer la fcondit de l'espce animale ou vgtale qui sert de totem au clan. Cette espce est la chose sacre par excellence ; c'est en elle que s'incarne essentiellement ce que nous avons pu appeler, par mtaphore, la divinit totmique. Nous avons vu cependant que, pour se perptuer, elle a besoin du concours de l'homme. C'est lui qui, chaque anne, dispense la vie la gnration nouvelle; sans lui, elle ne verrait pas le jour. Qu'il cesse de clbrer l'Intichiuma et les tres sacrs disparatront de la surface de la terre. C'est donc de lui, en un sens, qu'ils tiennent l'existence ; et pourtant, sous un autre rapport, c'est d'eux qu'il tient la sienne ; car, une fois qu'ils seront parvenus la maturit, c'est eux qu'il empruntera les forces ncessaires pour entretenir et rparer son tre spirituel. Ainsi, c'est lui qui fait ses dieux, peut-on dire, ou, du moins, c'est lui qui les fait durer ; mais, en mme temps, c'est par eux qu'il dure. Il commet donc rgulirement le cercle qui, suivant Smith, serait impliqu dans la notion mme du tribut sacrificiel : il donne aux tres sacrs un peu de ce qu'il reoit d'eux et il reoit d'eux tout ce qu'il leur donne. Il y a plus : les oblations qu'il est ainsi tenu de faire annuellement ne diffrent pas en nature de celles qui se feront plus tard dans les sacrifices proprement dits. Si le sacrifiant immole une bte, c'est pour que les principes vivants qui sont en elle se dgagent de l'organisme et s'en aillent alimenter la divinit. De mme, les grains de poussire que l'Australien dtache du rocher sacr sont autant de principes qu'il disperse dans l'espace pour qu'ils aillent animer l'espce totmique et en assurer le renouvellement. Le geste par lequel se fait cette dispersion est aussi celui qui accompagne normalement les offrandes. Dans certains cas, la ressemblance entre les deux rites se retrouve jusque dans le dtail des mouvements effectus. Nous avons vu que, pour avoir de la pluie, le Kaitish verse de l'eau sur une pierre sacre ; chez certains peuples, le prtre, dans le mme but, verse de l'eau sur l'autel . Les effusions de sang, qui
1151
1150 1151
The Religion of the Semites, 2e d., p. 390 et suiv, R. SMITH en cite lui-mme des cas dans The Relig. of the Semites, p. 231.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
305
sont usites dans un certain nombre d'Intichiuma, constituent de vritables oblations. De mme que l'Arunta ou le Dieri arrosent de sang le rocher sacr ou le dessin totmique, il arrive souvent, dans des cultes plus avancs, que le sang de la victime sacrifie ou du fidle lui-mme est rpandu soit devant soit sur l'autel . Dans ce cas, il est donn aux dieux dont il est l'aliment prfr ; en Australie, il est donn l'espce sacre. On n'est donc plus fond voir dans l'ide d'oblation un produit tardif de la civilisation.
1152
Un document que nous devons Strehlow met bien en vidence cette parent de l'Intichiuma et du sacrifice. C'est un chant qui accompagne l'Intichiuma du Kangourou ; la crmonie y est dcrite en mme temps que sont exposs les effets qui en sont attendus. Un morceau de la graisse du kangourou a t dpos par le chef sur un support fait de branchages. Or, le texte dit que cette graisse fait crotre la graisse des kangourous . Cette fois, on ne se borne donc pas rpandre de la poussire sacre ou du sang humain ; l'animal lui-mme est immol, sacrifi, peut-on dire, dpos sur une sorte d'autel et offert l'espce dont il doit entretenir la vie.
1153
On voit maintenant en quel sens il est permis de dire de l'Intichiuma qu'il contient les germes du systme sacrificiel. Sous la forme qu'il prsente quand il est pleinement constitu, le sacrifice se compose de deux lments essentiels : un acte de communion et un acte d'oblation. Le fidle communie avec son dieu en ingrant un aliment sacr, et, en mme temps, il fait ce dieu une offrande. Nous retrouvons ces deux actes dans l'Intichiuma, tel qu'il vient d'tre dcrit. Toute la diffrence, c'est que, dans le sacrifice proprement dit , ils se font simultanment ou se suivent immdiatement, tandis que, dans la crmonie australienne, ils sont disjoints. L, ce sont les parties d'un mme rite indivis; ici, ils ont lieu en des temps diffrents et peuvent mme tre spars par un assez long intervalle. Mais le mcanisme est, au fond, le mme. L'Intichiuma, pris dans son ensemble, c'est le sacrifice, mais dont les membres ne sont pas encore articuls et organiss.
1154
Ce rapprochement a le double avantage de nous faire mieux comprendre la nature de l'Intichiuma et celle du sacrifice. Nous comprenons mieux l'Intichiuma. En effet, la conception de Frazer qui en faisait une simple opration magique, dnue de tout caractre religieux , apparat maintenant comme insoutenable. On ne peut songer mettre hors de la religion un rite qui est comme le prodrome d'une aussi grande institution religieuse.
1155
Mais nous comprenons mieux aussi ce qu'est le sacrifice lui-mme. Tout d'abord, l'gale importance des deux lments qui y entrent est dsormais tablie. Si l'Australien fait des offrandes ses tres sacrs, toute raison manque de supposer que l'ide d'oblation tait tran1152
V. par exemple Exode, XXIX, 10-14; Lvitique, IX, 8-11; c'est leur sang mme que versent sur l'autel les prtres de Baal (I, Rois, XVIII, 28). 1153 STREHLOW, III, p. 12, vers. 7. 1154 Du moins, quand il est complet; il peut, dans certains cas, se rduire un seul de ces lments. 1155 Les indignes, dit STREHLOW, considrent ces crmonies comme une sorte de service divin, tout comme le chrtien considre les exercices de sa religion (III, p. 9).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
306
gre l'organisation primitive de l'institution sacrificielle et en troublait l'conomie naturelle. La thorie de Smith est rviser sur ce point . Sans doute, le sacrifice, est, en partie, un procd de communion ; mais c'est aussi, et non moins essentiellement, un don, un acte de renoncement. Il suppose toujours que le fidle abandonne aux dieux quelque chose de sa substance ou de ses biens. Toute tentative pour ramener un de ces lments l'autre est vaine. Peut-tre mme l'oblation est-elle plus permanente que la communion .
1156 1157
En second lieu, il semble gnralement que le sacrifice, et surtout que l'oblation sacrificielle, ne peut s'adresser qu' des tres personnels. Or, les oblations que nous venons de rencontrer en Australie n'impliquent aucune notion de ce genre. C'est dire que le sacrifice est indpendant des formes variables sous lesquelles sont penses les forces religieuses ; il tient des raisons plus profondes que nous aurons rechercher plus loin. Toutefois, il est clair que l'acte d'offrir veille naturellement dans les esprits l'ide d'un sujet moral que cette offrande est destine satisfaire. Les gestes rituels que nous avons dcrits deviennent plus facilement intelligibles, quand on croit qu'ils s'adressent des personnes. Les pratiques de l'Intichiuma, tout en ne mettant en oeuvre que des puissances impersonnelles, frayaient donc la voie une conception diffrente . Assurment, elles n'eussent pas suffi susciter de toutes pices l'ide de personnalits mythiques. Mais une fois que cette ide fut forme, elle fut amene, par la nature mme de ces rites, pntrer dans le culte ; dans la mme mesure, elle devint moins spculative ; mle plus directement l'action et la vie, elle prit, du mme coup, plus de ralit. On peut donc croire que la pratique du culte favorisa, d'une manire secondaire sans doute, mais qui pourtant mrite d'tre note, la personnification des forces religieuses.
1158
V
.
Mais il reste expliquer la contradiction dans laquelle R. Smith voyait un inadmissible scandale logique. Si les tres sacrs manifestaient toujours leurs pouvoirs d'une manire parfaitement gale, il apparatrait, en effet, comme inconcevable que l'homme ait pu songer leur offrir ses services ; car on ne voit pas quel besoin ils en pouvaient avoir. Mais tout d'abord, tant qu'ils se
1156
Il y aurait lieu notamment de se demander si les effusions sanglantes, les offrandes de chevelure dans lesquelles Smith voit des actes de communion ne sont pas des oblations proprement dites (v. SMITH, op. cit., p. 320 et suiv.). 1157 Les sacrifices piaculaires, dont nous parlerons plus spcialement dans le chapitre V de ce mme livre, consistent exclusivement en oblations. Ils ne servent des communions que d'une manire accessoire, 1158 C'est ce qui fait qu'on a souvent parl de ces crmonies comme si elles s'adressaient des divinits personnelles (v. par exemple un texte de Krichauff et un autre de Kempe cits par EYLMANN, pp. 202203).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
307
confondent avec les choses, tant qu'on voit en eux les principes de la vie cosmique, ils sont soumis eux-mmes au rythme de cette vie. Or, elle passe par des oscillations en sens contraires et qui se succdent suivant une loi dtermine. Tantt, elle s'affirme dans tout son clat ; tantt elle faiblit au point qu'on peut se demander si elle ne va pas s'arrter. Tous les ans, les plantes meurent ; renatront-elles ? Les espces animales tendent s'teindre par l'effet de la mort naturelle ou violente ; se renouvelleront-elles temps et comme il convient ? La pluie surtout est capricieuse; il y a de longs moments pendant lesquels elle parat avoir disparu sans retour. Ce dont tmoignent ces flchissements priodiques de la nature, c'est que, aux poques correspondantes, les tres sacrs dont dpendent les animaux, les plantes, la pluie, etc., passent par les mmes tats critiques ; ils ont donc, eux aussi, leurs priodes de dfaillance. Mais l'homme ne saurait assister ces spectacles en tmoin indiffrent. Pour qu'il vive, il faut que la vie universelle continue, et par consquent, que les dieux ne meurent pas. Il cherche donc les soutenir, les aider ; pour cela, il met leur service les forces dont il dispose et qu'il mobilise pour la circonstance. Le sang qui coule dans ses veines a des vertus fcondantes : il le rpandra. Dans les rochers sacrs que possde son clan, il ira puiser les germes de vie qui y sommeillent et il les smera dans l'espace. En un mot, il fera des oblations. Ces crises externes et physiques se doublent, en outre, de crises internes et mentales qui tendent au mme rsultat. Les tres sacrs ne sont que parce qu'ils sont reprsents comme tels dans les esprits. Que nous cessions d'y croire, et ils seront comme s'ils n'taient pas. Mme ceux qui ont une forme matrielle et qui sont donns dans l'exprience sensible dpendent, sous ce rapport, de la pense des fidles qui les adorent ; car le caractre sacr qui en fait des objets de culte n'est pas donn dans leur constitution naturelle ; il leur est surajout par la croyance. Le kangourou n'est qu'un animal comme les autres ; mais, pour les gens du Kangourou, il contient en soi un principe qui le met part au milieu des autres tres, et ce principe n'existe que dans les esprits qui le pensent . Pour que les tres sacrs, une fois conus, n'eussent pas besoin des hommes pour durer, il faudrait donc que les reprsentations qui les expriment, restassent toujours gales elles-mmes. Mais cette stabilit est impossible. En effet, c'est dans la vie en groupe qu'elles se forment, et la vie en groupe est essentiellement intermittente. Elles participent donc ncessairement de la mme intermittence. Elles atteignent leur maximum d'intensit au moment o les individus sont assembls et en rapports immdiats les uns avec les autres, o ils communient tous dans une mme ide ou un mme sentiment. Mais une fois que l'assemble est dissoute et que chacun a repris son existence propre, elles perdent progressivement de leur nergie premire. Peu peu recouvertes par le flot montant des sensations journalires, elles finiraient par s'enfoncer dans l'inconscient, si nous ne trouvions quelque moyen de les rappeler la conscience et de les revivifier. Or elles ne peuvent s'affaiblir sans que les tres sacrs perdent de leur ralit, puisqu'ils n'existent qu'en elles et par elles. Si nous les pensons moins fortement ils comptent moins pour nous et nous comptons moins avec eux; ils sont un moindre degr. Voil donc encore un point de vue par oh les services des hommes leur sont ncessaires. Cette seconde raison de les assister est mme plus importante que la premire ; car elle est de tous les temps. Les intermittences de la vie physique n'affectent les croyances religieuses que quand les religions ne sont pas encore
1159
1159
En un sens philosophique, Il en est de mme de toute chose; car rien n'existe que par la reprsentation. Mais, comme nous l'avons montr (pp. 325-326), la proposition est doublement vraie des forces religieuses, parce que, dans la constitution des choses, il n'y a rien qui corresponde au caractre sacr.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
308
dtaches de leur vase cosmique. Les intermittences de la vie sociale sont, au contraire, invitables ; mais les religions les plus idalistes ne sauraient y chapper. C'est d'ailleurs, grce cet tat de dpendance o sont les dieux par rapport la pense de l'homme que celui-ci peut croire son assistance efficace. La seule faon de rajeunir les reprsentations collectives qui se rapportent aux tres sacrs est de les retremper la source mme de la vie religieuse, c'est--dire dans les groupes assembls. Or, les motions que suscitent les crises priodiques par lesquelles passent les choses extrieures dterminent les hommes qui en sont les tmoins se runir, afin de pouvoir aviser ce qu'il convient de faire Mais par cela seul qu'ils sont assembls, ils se rconfortent mutuellement ; ils trouvent le remde parce qu'ils le cherchent ensemble. La foi commune se ranime tout naturellement au sein de la collectivit reconstitue ; elle renat, parce qu'elle se retrouve dans les conditions mmes o elle tait ne primitivement. Une fois restaure, elle triomphe sans peine de tous les doutes privs qui avaient pu se faire jour dans les esprits. L'image des choses sacres reprend assez de force pour pouvoir rsister aux causes internes on externes qui tendaient l'affaiblir. En dpit de leurs dfaillances apparentes, on ne peut plus croire que les dieux mourront puisqu'on les sent revivre au fond de soi-mme. Les procds employs pour les secourir, quelle qu'en soit la grossiret, ne peuvent paratre vains puisque tout se passe comme s'ils agissaient effectivement. On est plus confiant parce qu'on se sent plus fort ; et l'on est rellement plus fort parce que des forces qui languissaient se sont rveilles dans les consciences. Il faut donc se garder de croire avec Smith que le culte ait t exclusivement institu au bnfice des hommes et que les dieux n'en aient que faire : ils n'en ont pas moins besoin que leurs fidles. Sans doute, sans les dieux, les hommes ne pourraient vivre. Mais, d'un autre ct, les dieux mouraient si le culte ne leur tait pas rendu. Celui-ci n'a donc pas uniquement pour objet de faire communier les sujets profanes avec les tres sacrs, mais aussi d'entretenir ces derniers en vie, de les refaire et de les rgnrer perptuellement. Certes, ce ne sont pas les oblations matrielles qui, par leurs vertus propres, produisent cette rfection ; ce sont les tats mentaux que ces manuvres, vaines par elles-mmes, rveillent ou accompagnent. La raison d'tre vritable des cultes, mme les plus matrialistes en apparence, ne doit pas tre recherche dans les gestes qu'ils prescrivent, mais dans le renouvellement intrieur et moral que ces gestes contribuent dterminer. Ce que le fidle donne rellement son dieu, ce ne sont pas les aliments qu'il dpose sur l'autel, ni le sang qu'il fait couler de ses veines : c'est sa pense. Il n'en reste pas moins qu'entre la divinit et ses adorateurs il y a un change de bons offices qui se conditionnent mutuellement. La rgle do ut des, par laquelle on a parfois dfini le principe du sacrifice, n'est pas une invention tardive de thoriciens utilitaires : elle ne fait que traduire, d'une manire explicite, le mcanisme mme du systme sacrificiel et, plus gnralement, de tout le culte positif. Le cercle signal par Smith est donc bien rel; mais il n'a rien d'humiliant pour la raison. Il vient de ce que les tres sacrs, tout en tant suprieurs aux hommes, ne peuvent vivre que dans des consciences humaines. Mais ce cercle nous apparatra comme le plus naturel encore et nous en comprendrons mieux le sens et la raison d'tre, si, poussant l'analyse plus loin et substituant aux symboles religieux les ralits qu'ils expriment, nous cherchons comment celles-ci se comportent dans le
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
309
rite. Si, comme nous avons essay de l'tablir, le principe sacr n'est autre chose que la socit hypostasie et transfigure, la vie rituelle doit pouvoir s'interprter en termes lacs et sociaux. Et en effet, tout comme cette dernire, la vie sociale se meut dans un cercle. D'une part, l'individu tient de la socit le meilleur de soi-mme, tout ce qui lui fait une physionomie et une place part parmi les autres tres, sa culture intellectuelle et morale. Qu'on retire l'homme le langage, les sciences, les arts, les croyances de la morale, et il tombe au rang de l'animalit. Les attributs caractristiques de la nature humaine nous viennent donc de la socit. Mais d'un autre ct, la socit n'existe et ne vit que dans et par les individus. Que l'ide de la socit s'teigne dans les esprits individuels, que les croyances, les traditions, les aspirations de la collectivit cessent d'tre senties et partages par les particuliers, et la socit mourra. On peut donc rpter d'elle ce qui tait dit plus haut de la divinit : elle n'a de ralit que dans la mesure o elle tient de la place dans les consciences humaines, et cette place, c'est nous qui la lui faisons. Nous entrevoyons maintenant la raison profonde pour laquelle les dieux ne peuvent pas plus se passer de leurs fidles que ceux-ci de leurs dieux ; c'est que la socit, dont les dieux ne sont que l'expression symbolique, ne peut pas plus se passer des individus que ceux-ci de la socit. Nous touchons ici au roc solide sur lequel sont difis tous les cultes et qui fait leur persistance depuis qu'il existe des socits humaines. Quand on voit de quoi sont faits les rites et quoi ils paraissent tendre, on se demande avec tonnement comment les hommes ont pu en avoir l'ide et surtout comment ils y sont rests si fidlement attachs. D'o peut leur tre venue cette illusion qu'avec quelques grains de sable jets au vent, quelques gouttes de sang rpandues sur un rocher ou sur la pierre d'un autel, il tait possible d'entretenir la vie d'une espce animale ou d'un dieu ? Sans doute, nous avons fait dj un pas en avant dans la solution de ce problme quand, sous ces mouvements extrieurs et, en apparence, draisonnables, nous avons dcouvert un mcanisme mental qui leur donne un sens et une porte morale. Mais rien ne nous assure que ce mcanisme lui-mme, ne consiste pas en un simple jeu d'images hallucinatoires. Nous avons bien montr quel processus psychologique dtermine les fidles croire que le rite fait renatre autour d'eux les forces spirituelles dont ils ont besoin ; mais de ce que cette croyance est psychologiquement explicable, il ne suit pas qu'elle ait une valeur objective. Pour que nous soyons fond voir dans l'efficacit attribue aux rites autre chose que le produit d'un dlire chronique dont s'abuserait l'humanit, il faut pouvoir tablir que le culte a rellement pour effet de recrer priodiquement un tre moral dont nous dpendons comme il dpend de nous. Or cet tre existe : c'est la socit. En effet, pour peu que les crmonies religieuses aient d'importance, elles mettent en mouvement la collectivit ; les groupes s'assemblent pour les clbrer. Leur premier effet est donc de rapprocher les individus, de multiplier entre eux les contacts et de les rendre plus intimes. Par cela mme, le contenu des consciences change. Pendant les jours ordinaires, ce sont les proccupations utilitaires et individuelles qui tiennent le plus de place dans les esprits. Chacun vaque de son ct sa tche personnelle ; il s'agit avant tout, pour la plupart des gens, de satisfaire aux exigences de la vie matrielle, et le principal mobile de l'activit conomique a toujours t l'intrt priv. Sans doute, les sentiments sociaux ne sauraient en tre totalement absents. Nous restons en rapports avec nos semblables ; les habitudes, les ides, les tendances que l'ducation a imprimes en nous et qui prsident normalement nos relations avec autrui
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
310
continuent faire sentir leur action. Mais elles sont constamment combattues et tenues en chec par les tendances antagonistes qu'veillent et qu'entretiennent les ncessits de la lutte quotidienne. elles rsistent plus ou moins heureusement selon leur nergie intrinsque ; mais cette nergie n'est pas renouvele. Elles vivent sur leur pass et, par suite, elles s'useraient avec le temps si rien ne venait leur rendre un peu de la force qu'elles perdent par ces conflits et ces frottements incessants. Quand les Australiens, dissmins par petits groupes, chassent ou pchent, ils perdent de vue ce qui concerne leur clan ou leur tribu : ils ne pensent qu' prendre le plus de gibier possible. Aux jours fris, au contraire, ces proccupations s'clipsent obligatoirement ; essentiellement profanes, elles sont exclues des priodes sacres. Ce qui occupe alors la pense, ce sont les croyances communes, les traditions communes, les souvenirs des grands anctres, l'idal collectif dont ils sont l'incarnation ; en un mot, ce sont des choses sociales. Mme les intrts matriels que les grandes crmonies religieuses ont pour objet de satisfaire, sont d'ordre publie, partant social. La socit tout entire est intresse ce que la rcolte soit abondante, ce que la pluie tombe temps et sans excs, ce que les animaux se reproduisent rgulirement. C'est donc elle qui est au premier plan dans les consciences ; c'est elle qui domine et dirige la conduite ; ce qui revient dire qu'elle est alors plus vivante, plus agissante, et, par consquent, plus relle qu'en temps profane. Ainsi, les hommes ne s'abusent pas quand ils sentent ce moment qu'il y a, en dehors d'eux, quelque chose qui renat, des forces qui se raniment, une vie qui se rveille. Ce renouveau n'est nullement imaginaire, et les individus eux-mmes en bnficient. Car la parcelle d'tre social que chacun porte en soi participe ncessairement de cette rnovation collective. L'me individuelle se rgnre, elle aussi, en se retrempant la source mme d'oh elle tient la vie ; par suite, elle se sent plus forte, plus matresse d'elle-mme, moins dpendante des ncessits physiques. On sait que le culte positif tend naturellement prendre des formes priodiques ; c'est un de ses caractres distinctifs. Sans doute, il y a des rites que l'homme clbre occasionnellement, pour faire face des situations passagres. Mais ces pratiques pisodiques ne jouent jamais qu'un rle accessoire, et mme, dans les religions que nous tudions spcialement dans ce livre, elles sont presque exceptionnelles. Ce qui constitue essentiellement le culte, c'est le cycle des ftes qui reviennent rgulirement des poques dtermines. Nous sommes maintenant en tat de comprendre d'oh provient cette tendance la priodicit ; le rythme auquel obit la vie religieuse ne fait qu'exprimer le rythme de la vie sociale, et il en rsulte. La socit ne peut raviver le sentiment qu'elle a d'elle-mme qu' condition de s'assembler. Mais elle ne peut tenir perptuellement ses assises. Les exigences de la vie ne lui permettent pas de rester indfiniment l'tat de congrgation ; elle se disperse donc pour se rassembler nouveau quand, de nouveau, elle en sent le besoin. C'est ces alternances ncessaires que rpond l'alternance rgulire des temps sacrs et des temps profanes. Comme, l'origine, le culte a pour objet, au moins apparent, de rgulariser le cours des phnomnes naturels, le rythme de la vie cosmique a mis sa marque sur le rythme de la vie rituelle. C'est pourquoi les ftes, pendant longtemps, ont t saisonnires ; nous avons vu que tel tait dj le caractre de l'Intichiuma australien. Mais les saisons n'ont fourni que le cadre extrieur de cette organisation, non le principe sur lequel elle repose ; car mme les cultes qui visent des fins exclusivement spirituelles sont rests priodiques. C'est donc que cette pridiocit tient d'autres causes. Comme les changements saisonniers sont, pour la nature, des poques critiques, ils sont une
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
311
occasion naturelle de rassemblements et, par suite, de crmonies religieuses. Mais d'autres vnements pouvaient jouer et ont effectivement jou ce rle de causes occasionnelles. Il faut reconnatre toutefois que ce cadre, quoique purement extrieur, a fait preuve d'une singulire force de rsistance ; car on en trouve la trace jusque dans les religions qui sont le plus dtaches de toute base physique. Plusieurs des ftes chrtiennes se relient, sans solution de continuit, aux ftes pastorales et agraires des anciens Hbreux, bien que, par elles-mmes, elles n'aient plus rien d'agraire ni de pastoral. Ce rythme est, d'ailleurs, susceptible de varier de forme suivant les socits. L o la priode de dispersion est longue et o la dispersion est extrme, la priode de congrgation est, son tour, trs prolonge, et il se produit alors de vritables dbauches de vie collective et religieuse. Les ftes succdent aux ftes pendant des semaines ou des mois et la vie rituelle atteint parfois une sorte de frnsie. C'est le cas des tribus australiennes et de plusieurs socits du nord et du nord-ouest amricain . Ailleurs, au contraire, ces deux phases de la vie sociale se succdent intervalles plus rapprochs et le contraste entre elles est alors moins tranch. Plus les socits se dveloppent, moins elles semblent s'accommoder d'intermittences trop accentues.
1160
1160
V. Mauss, Essai sur les variations saisonnires des socits Eskimos, ln Anne sociol., IX, p. 96 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
312
CHAPITRE III
LE CULTE POSITIF
(Suite)
II. - Les rites mimtiques et le principe de causalit
.
Mais les procds dont il vient d'tre question ne sont pas les seuls qui soient employs pour assurer la fcondit de l'espce totmique. Il en est d'autres qui servent au mme but, soit qu'ils accompagnent les prcdents soit qu'ils les remplacent.
I
Dans les crmonies mmes que nous avons dcrites, ct des oblations, sanglantes ou autres, des rites diffrents sont souvent clbrs qui sont destins complter les premiers et en consolider les effets. Ils consistent en mouvements et en cris qui ont pour objet d'imiter, dans ses diffrentes attitudes ou sous ses diffrents aspects, l'animal dont on souhaite la reproduction; pour cette raison, nous les appelons mimtiques. Ainsi l'Intichiuma de la Chenille witchetty, chez les Arunta, ne comprend pas seulement les rites qui sont accomplis sur les rochers sacrs et dont nous avons prcdemment parl. Lorsqu'ils sont termins, on se met en route pour retourner au camp ; mais quand on n'en est plus loign que d'un mille environ, on fait halte et tout le monde se dcore rituellement; aprs quoi, la marche est reprise. Les dcorations dont on s'est ainsi par annoncent qu'une importante crmonie va avoir lieu. Et, en effet, pendant que la troupe tait absente, un des vieillards qui ont t laisss la garde du camp, a construit un abri de branchages, long et
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
313
troit, appel Umbana, et qui reprsente la chrysalide d'o merge l'insecte. Tous ceux qui ont pris part aux crmonies antrieures s'assemblent prs de l'endroit o cette construction a t leve ; puis ils s'avancent lentement, s'arrtant de temps en temps, jusqu' ce qu'ils parviennent l'Umbana, o ils pntrent. Aussitt, tous les gens qui ne sont pas de la phratrie laquelle ressortit le totem de la Chenille witchetty, et qui assistent, mais de loin, la scne, se couchent par terre, et face contre le sol ; ils doivent rester dans cette position, sans remuer, jusqu' ce qu'il leur soit permis de se relever. Pendant ce temps, un chant s'lve de l'intrieur de l'Umbana, qui raconte les diffrentes phases par lesquelles passe l'animal au cours de son dveloppement et les mythes dont sont l'objet les rochers sacrs. Quand ce chant s'arrte, l'Alatunja, tout en restant accroupi, se glisse hors de l'Umbana et s'avance lentement sur le terrain qui s'tend par devant : il est suivi de tous ses compagnons qui reproduisent ses gestes dont l'objet est videmment de figurer l'insecte quand il sort de sa chrysalide. D'ailleurs, un chant qui se fait entendre au mme moment et qui est comme un commentaire oral du rite, consiste prcisment en une description des mouvements que fait l'animal ce stade de son dveloppement .
1161
Un autre Intichiuma , clbr propos d'une autre sorte de chenille, la chenille unchalka , a plus nettement encore ce caractre. Les acteurs du rite se dcorent de dessins qui reprsentent le buisson unchalka sur lequel cette chenille vit au dbut de son existence; puis ils couvrent un bouclier de cercles concentriques de duvet qui figurent une autre sorte de buisson sur lequel l'insecte, une fois adulte, dpose ses ufs. Quand ces prparatifs sont termins, tous sassoient par terre de manire former un demi-cercle qui fait face l'officiant principal. Celui-ci, alternativement, courbe son corps en deux en l'inclinant vers le sol et se soulve sur les genoux ; en mme temps, il agite ses bras tendus, ce qui est une manire de reprsenter les ailes de l'insecte. De temps en temps, il se penche par-dessus le bouclier, imitant la faon dont le papillon voltige au-dessus des arbres o il pose ses oeufs. Cette crmonie acheve, une autre recommence un endroit diffrent o l'on se rend en silence. Cette fois, on emploie deux boucliers. Sur l'un, sont reprsentes, par des lignes en zig-zag, les traces de la chenille ; sur l'autre, des cercles concentriques, de dimensions ingales, figurent, les uns les oeufs de l'insecte, les autres, les semences du buisson d'Eremophile sur lequel il se nourrit. Comme dans la premire crmonie, tout le monde s'asseoit en silence tandis que l'officiant s'agite, imitant les mouvements de l'animal quand il quitte sa chrysalide et qu'il s'efforce de prendre son vol.
1162 1163
Spencer et GILLEN signalent encore, chez les Arunta, quelques faits analogues quoique de moindre importance : par exemple, dans l'Intichiuma de l'mou, les acteurs, un moment donn, cherchent reproduire par leur attitude l'air et l'aspect de cet oiseau ; dans un Intichiuma de l'eau, les gens du totem font entendre le cri caractristique du pluvier, cri qui est naturellement associ dans les esprits avec la saison des pluies . Mais en somme, les cas de rites mimtiques qu'ont nots ces deux explorateurs sont assez peu nombreux. Seulement, il est
1164 1165
1161 1162
Nat. Tr., p. 176. North. Tr., p. 179. SPENCER et GILLEN, il est vrai, ne disent pas expressment que la crmonie soit un Intichiuma. Mais le contexte ne laisse pas de doute sur le sens du rite. 1163 A l'index des noms de totems, SPENCER et GILLEN crivent Untjalka (North. Tr., p. 772). 1164 Nat. Tr., p. 182. 1165 Ibid., p. 193.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
314
certain que leur silence relatif sur ce point vient on de ce qu'ils n'ont pas observ suffisamment d'Intichiuma on de ce qu'ils ont nglig ce ct des crmonies. Schulze, au contraire, avait t frapp du caractre essentiellement mimtique des rites arunta. Les corrobbori sacrs, dit-il, sont, pour la plupart, des crmonies reprsentatives d'animaux ; il les appelle des animal tjurunga et son tmoignage est aujourd'hui confirm par les documents qu'a runis Strehlow. Chez ce dernier auteur, les exemples sont tellement nombreux qu'il est impossible de les citer tous : il n'y a gure de crmonies o quelque geste imitatif ne nous soit signal. Suivant la nature des totems dont on clbre la fte, on saute la manire des kangourous, on imite les mouvements qu'ils font en mangeant, le vol des fourmis ailes, le bruit caractristique que fait la chauve-souris, le cri du dindon sauvage, celui de l'aigle, le sifflement du serpent, le coassement de la grenouille, etc. Quand le totem est une plante, on fait le geste d'en cueillir , ou d'en manger , etc.
1166 1167 1168 1169
Chez les Warramunga, l'Intichiuma affecte, en gnral, une forme trs particulire que nous dcrirons dans le prochain chapitre et qui diffre de celles que nous avons, jusqu' prsent, tudies. Il existe pourtant chez ce peuple un cas typique d'Intichiuma purement mimtique ; c'est celui du kakatos blanc. La crmonie que dcrivent Spencer et GILLEN commena dix heures du soir. Pendant toute la dure de la nuit, le chef du clan imita le cri de l'oiseau avec une monotonie dsesprante. Il ne s'arrtait que quand il tait bout de forces et il tait alors remplac par son fils ; puis il recommenait aussitt qu'il se sentait un peu repos. Ces exercices puisants se continurent jusqu'au matin sans interruption
1170
Les tres vivants ne sont pas les seuls que l'on cherche imiter. Dans un grand nombre de tribus, l'Intichiuma de la pluie consiste essentiellement en rites imitatifs. Un des plus simples est celui qui est clbr chez les Urabunna. Le chef du clan est assis par terre, tout dcor de duvet blanc et tenant dans ses mains une lance. Il s'agite de toutes les manires, sans doute pour dtacher de son corps le duvet qui y est fix et qui, rpandu dans l'air, reprsente les nuages. Il imite ainsi les hommes-nuages de l'Alcheringa qui, d'aprs la lgende, avaient l'habitude de monter au ciel pour y former des nuages d'o la pluie retombait ensuite. En un mot, tout le rite a pour objet de figurer la formation et l'ascension des nuages, porteurs de pluie .
1171
Chez les Kaitish, la crmonie est beaucoup plus complique. Dj, nous avons parl d'un des moyens employs : l'officiant verse de l'eau sur les pierres sacres et sur lui-mme. Mais l'action de cette sorte d'oblation est renforce par d'autres rites. L'arc-en-ciel est considr comme troitement en rapports avec la pluie : on dit qu'il en est le fils et qu'il est toujours press de paratre pour la faire cesser. Pour qu'elle puisse tomber, il faut donc qu'il ne se montre pas ; on croit obtenir ce rsultat en procdant de la manire suivante. Sur un bouclier, on excute un dessin qui reprsente l'arc-en-ciel. On emporte ce bouclier au camp en ayant soin
1166 1167 1168 1169 1170 1171
Schulze, loc. cit., pp. 12, 21 ; cf. p. 243. STREHLOW, III, pp. 11, 84, 31, 36, 37, 68, 72. Ibid., p. 100. Ibid., pp. 81, 100, 112, 115. North. Tr., p. 310. Ibid., pp. 285-286. Peut-tre les mouvements de la lance ont-ils pour objet de percer les nuages.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
315
de le tenir dissimul tous les regards. On est convaincu qu'en rendant invisible cette image de l'arc-en-ciel, on empche l'arc-en-ciel lui-mme de se manifester. Entre temps, le chef du clan, ayant ses cts un pitchi plein d'eau, jette dans toutes les directions des flocons de duvet blanc qui reprsentent les nuages. Des imitations rptes du cri de pluvier viennent complter la crmonie qui parat avoir une gravit toute particulire ; car, pendant qu'elle dure, ceux qui y participent, comme acteurs ou comme assistants, ne peuvent avoir aucun rapport avec leurs femmes ; ils ne peuvent mme pas leur parler .
1172
Chez les Dieri, les procds de figuration sont diffrents. La pluie est reprsente non par de l'eau, mais par du sang que des hommes font couler de leurs veines sur l'assistance . En mme temps, ils lancent des poignes de duvet blanc qui symbolise les nuages. Antrieurement, une hutte a t construite. On y dpose deux larges pierres qui figurent des amoncellements de nuages, prsage de la pluie. Aprs les y avoir laisses quelque temps, on les transporte une certaine distance de l et on les place aussi haut que possible sur l'arbre le plus lev qu'on peut trouver ; c'est une manire de dterminer les nuages monter au ciel. Du gypse, rduit en poudre, est jet dans un trou d'eau; ce que voyant, l'esprit de la pluie fait apparatre aussitt les nuages. Enfin, tous, jeunes et vieux, se runissent autour de la hutte, et, tte baisse, se prcipitent sur elle ; ils passent violemment au travers, recommencent le mouvement plusieurs fois, jusqu' ce que, de toute la construction, il ne reste plus debout que les poutres qui la supportent. Alors, on s'en prend ces dernires, on les branle, on les arrache jusqu' ce que tout s'croule dfinitivement. L'opration qui consiste percer la hutte de part en part est destine reprsenter les nuages qui sentrouvrent, et l'croulement de la construction, la chute de la pluie .
1173 1174
Dans les tribus du Nord-Ouest qu'a tudies Clement et qui occupent le territoire compris entre la rivire Forteseue et la rivire Fitzroy, des crmonies sont clbres qui ont exactement le mme objet que l'Intichiuma des Arunta, et qui semblent tre, pour la plupart, essentiellement mimtiques.
1175
On appelle tarlow, chez ces peuples, des tas de pierres videmment sacres, puisque, comme nous allons le voir, elles sont l'objet de rites importants. Chaque animal, chaque plante, c'est--dire, en somme, chaque totem ou sous-totem , est reprsent par un tarlow dont un clan dtermin la garde. On voit aisment l'analogie qu'il y a entre ces tarlow et les pierres
1176 1177
1172
North. Tr., pp. 294-296. Il est curieux que, chez les Anula, l'arc-en-ciel soit, au contraire, considr comme producteur de la pluie (ibid., p. 314). 1173 Le mme procd est employ chez les Arunta (STREHLOW, III, p. 132). On peut se demander, il est vrai, si cette effusion de sang ne serait pas une oblation destine dgager des principes producteurs de pluie. Cependant Gason dit formellement que c'est un moyen d'imiter l'eau qui tombe. 1174 GASON, The Dieyerie Tribe, in Curr, II, pp. 66-68. HOWITT (Nat. Tr., pp. 798-900) mentionne un autre rite des Dieri pour obtenir de la pluie. 1175 Ethnographical Notes on the Western-Australian Aborigines, in Internationales Archiv. f. Ethnographie, XVI, pp. 6-7. Cf. WITHNAL, Marriage Rites and Relationship, in Science of Man, 1903, p. 42. 1176 Nous supposons qu'un sous-totem peut avoir un tarlow parce que, suivant Clement, certains clans ont plusieurs totems. 1177 Clement dit a tribal-family.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
316
sacres des Arunta. Quand les kangourous, par exemple, deviennent rares, le chef du clan auquel appartient le tarlow des kangourous, s'y rend avec un certain nombre de ses compagnons. L, on excute diffrents rites dont les principaux consistent sauter, autour du tarlow, comme sautent les kangourous, boire comme ils boivent, en un mot, imiter leurs mouvements les plus caractristiques. Les armes qui servent la chasse de l'animal jouent un rle important dans ces rites. On les brandit, on les lance contre les pierres, etc. Quand il s'agit des mous, on va au tarlow de l'mou ; on marche, on court comme font ces oiseaux. L'habilet dont font preuve les indignes dans ces imitations est, parat-il, tout fait remarquable. D'autres tarlow sont consacrs des plantes, des graines d'herbe par exemple. Dans ce cas, ce qu'on imite, ce sont les oprations qui servent vanner ces graines ou les moudre. Et comme, dans la vie ordinaire, ce sont les femmes qui sont normalement charges de ces soins, ce sont elles aussi qui s'acquittent du rite au milieu des chants et des danses.
II
.
Tous ces rites ressortissent au mme type. Le principe sur lequel ils reposent est un de ceux qui sont la base de ce qu'on appelle communment, et improprement , la magie sympathique.
1178
Ces principes se ramnent ordinairement deux
1179
Le premier peut s'noncer ainsi : ce qui atteint un objet atteint aussi tout ce qui soutient avec cet objet un rapport de Proximit ou de solidarit quelconque. Ainsi, ce qui affecte la partie affecte le tout ; toute action exerce sur un individu se transmet ses voisins, ses parents, tous ceux dont il est solidaire quelque titre que ce soit. Tous ces cas sont de simples applications de la loi de contagion que nous avons prcdemment tudie. Un tat, une qualit bonne ou mauvaise se communiquent contagieusement d'un sujet un sujet diffrent qui soutient quelque rapport avec le premier. Le second principe se rsume d'ordinaire dans la formule : le semblable produit le semblable. La figuration d'un tre ou d'un tat produit cet tre ou cet tat. C'est cette maxime que mettent en uvre les rites qui viennent d'tre dcrits, et c'est leur occasion que l'on peut le mieux saisir ce qu'elle a de caractristique. L'exemple classique de l'envotement, que l'on prsente gnralement comme l'application typique de ce mme prcepte, est beaucoup moins
1178 1179
Nous expliquerons plus bas (p. 517) en quoi consiste cette improprit. Voir sur cette classification FRAZER, Lectures on the Early History of Kingship, p. 37 et suiv.; HUBERT et Mauss, Thorie gnrale de la magie, p. 61 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
317
significatif. Dans l'envotement, en effet, il y a, en grande partie, un simple phnomne de transfert. L'ide de l'image est associe dans les esprits celle du modle ; par suite, les effets de l'action exerce sur la statuette se communiquent contagieusement la personne dont elle reproduit les traits. L'image joue, par rapport l'original, le rle de la partie par rapport au tout : c'est un agent de transmission. Aussi croit-on pouvoir obtenir le mme rsultat en brlant les cheveux de la personne qu'on veut atteindre : la seule diffrence qu'il y ait entre ces deux sortes d'oprations, c'est que, dans l'une, la communication se fait par la voie de la similarit, dans l'autre, par le moyen de la contigut. Il en est autrement des rites qui nous occupent. Ils ne supposent pas seulement le dplacement d'un tat ou d'une qualit donns qui passent d'un objet dans un autre, mais la cration de quelque chose d'entirement nouveau. Le seul fait de reprsenter l'animal donne naissance cet animal et le cre; en imitant le bruit du vent on de l'eau qui tombe, on dtermine les nuages se former et se rsoudre en pluie, etc. Sans doute, la ressemblance joue un rle dans les deux cas, mais trs diffrent. Dans l'envotement, elle ne fait qu'imprimer une direction dtermine l'action exerce ; elle oriente dans un certain sens une efficacit qui ne vient pas d'elle. Dans les rites dont il vient d'tre question, elle est agissante par elle-mme et directement efficace. Aussi, contrairement aux dfinitions usuelles, ce qui diffrencie vraiment les deux principes de la magie dite sympathique et les pratiques correspondantes, ce n'est pas que la contigut agit dans les unes et la ressemblance dans les autres ; mais c'est que, dans les premires, il y a simple communication contagieuse, dans les secondes, production et cration .
1180
Expliquer les rites mimtiques, c'est donc expliquer le second de ces principes et rciproquement. Nous ne nous arrterons pas longtemps discuter l'explication qu'en a propose l'cole anthropologique, Tylor et Frazer notamment. Tout comme pour rendre compte de la contagiosit du caractre sacr, ils invoquent les proprits de l'association des ides. La magie homopathique, dit Frazer qui prfre cette expression celle de magie mimtique, repose sur l'association des ides par similarit, comme la magie contagieuse (contagious magic) sur l'association des ides par contigut. La magie homopathique commet la mprise de prendre pour identiques des choses qui se ressemblent . Mais c'est mconnatre le caractre spcifique des pratiques qui sont en cause. Par un ct, la formule de Frazer pourrait s'appliquer, avec quelque convenance, au cas de l'envotement ; l, en effet, deux choses distinctes sont assimiles l'une l'autre en raison de leur ressemblance partielle : c'est l'image et le modle qu'elle reprsente plus ou moins schmatiquement. Mais, dans les rites mimtiques que nous venons d'observer, l'image seule est donne ; quant au modle, il n'est pas, puisque la nouvelle gnration de l'espce totmique n'est encore qu'une esprance et mme une esprance incertaine. Il ne saurait donc tre question d'assimilation, errone ou non :
1181 1182
1180
Nous ne disons rien de ce qu'on a appel la loi de contrarit; car, comme l'ont montr MM. HUBERT et MAUSS, le contraire ne produit son contraire que par l'intermdiaire du semblable (Thorie gnrale de la magie, p. 70). 1181 Lectures on the Early History of Kingship, p. 39. 1182 Elle s'y applique en ce sens qu'il y a rellement assimilation de la statuette et de la personne envote. Mais il s'en faut que cette assimilation soit un simple produit de l'association des ides par similarit. La vraie cause dterminante du phnomne, c'est la contagiosit propre aux forces religieuses, ainsi que nous l'avons montr.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
318
il y a cration proprement dite et on ne voit pas comment l'association des ides pourrait faire croire cette cration. Comment le seul fait de figurer les mouvements d'un animal pourrait-il donner la certitude que cet animal va renatre en abondance ? Les proprits gnrales de la nature humaine ne sauraient expliquer des pratiques aussi spciales. Au lieu donc de considrer le principe sur lequel elles reposent sous sa forme gnrale et abstraite, replaons-le dans le milieu moral dont il fait partie et o nous venons de l'observer, rattachons-le l'ensemble d'ides et de sentiments dont procdent les rites o il est appliqu, et nous pourrons mieux apercevoir les causes dont il rsulte. Les hommes qui se runissent l'occasion de ces rites croient rellement tre des animaux ou des plantes de l'espce dont ils portent le nom. Ils se sentent une nature ou vgtale ou animale, et c'est elle qui constitue, leurs yeux, ce qu'il y a de plus essentiel et de plus excellent en eux. Une fois assembls, leur premier mouvement doit donc tre de s'affirmer les uns aux autres cette qualit qu'ils s'attribuent et par laquelle ils se dfinissent. Le totem est leur signe de ralliement : pour cette raison, comme nous l'avons vu, ils le dessinent sur leur corps ; mais il est non moins naturel qu'ils cherchent lui ressembler par leurs gestes, leurs cris, leur attitude. Puisqu'ils sont des mous ou des kangourous, ils se comporteront donc comme des animaux du mme nom. Par ce moyen, ils se tmoignent mutuellement qu'ils sont membres de la mme communaut morale et ils prennent conscience de la parent qui les unit. Cette parent, le rite ne se borne pas l'exprimer; il la fait ou la refait. Car elle n'est qu'autant qu'elle est crue et toutes ces dmonstrations collectives ont pour effet d'entretenir les croyances sur lesquelles elle repose. Ainsi, ces sauts, ces cris, ces mouvements de toute sorte, bizarres et grotesques en apparence, ont, en ralit, une signification humaine et profonde. L'Australien cherche ressembler son totem comme le fidle des religions plus avances chercher ressembler son Dieu. C'est, pour l'un comme pour l'autre, un moyen de communier avec l'tre sacr, c'est--dire avec l'idal collectif que ce dernier symbolise. C'est une premire forme de lhomoisis t the. Toutefois, comme cette premire raison tient ce qu'il y a de plus spcial dans les croyances totmiques, si elle tait seule, le principe d'aprs lequel le semblable produit le semblable n'aurait pas d survivre au totmisme. Or il n'est peut-tre pas de religion o l'on ne trouve des rites qui en drivent. Il faut donc qu'une autre raison soit venue se joindre la prcdente. Et, en effet, les crmonies o nous l'avons vu appliqu n'ont pas seulement l'objet trs gnral que nous venons de rappeler, si essentiel qu'il soit; mais elles visent, en outre, un but plus prochain et plus conscient qui est d'assurer la reproduction de l'espce totmique. L'ide de cette reproduction ncessaire hante donc l'esprit des fidles : c'est sur elle que se concentrent les forces de leur attention et de leur volont. Or, une mme proccupation ne peut pas obsder ce point tout un groupe d'hommes sans s'extrioriser sous une forme matrielle. Puisque tous pensent l'animal ou au vgtal des destines duquel le clan est solidaire, il est invitable que cette pense commune vienne se manifester extrieurement par des gestes, et les plus dsigns pour ce rle sont ceux qui reprsentent cet animal ou cette plante par un de ses aspects les plus caractristiques ; car, il n'est pas de mouvements qui tiennent d'aussi prs l'ide qui remplit alors les consciences, puisqu'ils en sont la traduction immdiate et presque automatique. On
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
319
s'efforce donc d'imiter l'animal; on crie comme lui ; on saute comme lui ; on reproduit les scnes o la plante est quotidiennement utilise. Tous ces procds de figuration sont autant de moyens de marquer ostensiblement le but vers lequel tous les esprits sont tendus, de dire la chose qu'on veut raliser, de l'appeler, de l'voquer . Et ce besoin n'est pas d'un temps, il ne dpend pas des croyances de telle ou telle religion ; il est essentiellement humain. Voil pourquoi, mme dans des religions trs diffrentes de celle que nous tudions, les fidles, runis pour solliciter (le leurs dieux un vnement qu'ils souhaitent ardemment, sont comme ncessits la figurer. Sans doute, la parole est aussi un moyen de l'exprimer ; mais le geste n'est pas moins naturel ; il jaillit tout aussi spontanment de l'organisme ; il devance mme la parole ou, en tout cas, l'accompagne.
1183
Mais si l'on peut comprendre ainsi comment ces gestes ont pris place dans la crmonie, il reste expliquer l'efficacit qui leur est attribue. Si l'Australien les rpte rgulirement chaque saison nouvelle, c'est qu'il les croit ncessaires au succs du rite. D'o peut lui tre venue cette ide qu'en imitant un animal on le dtermine se reproduire ? Une erreur aussi manifeste semble difficilement intelligible tant qu'on ne voit dans le rite que le but matriel o il parat tendre. Mais nous savons qu'outre l'effet qu'il est cens avoir sur l'espce totmique, il exerce une action profonde sur l'me des fidles qui y prennent part. Ceux-ci en rapportent une impression de bien-tre dont ils ne voient pas clairement les causes, mais qui est bien fonde. Ils ont conscience que la crmonie leur est salutaire ; et en effet, ils y refont leur tre moral. Comment cette sorte d'euphorie ne leur donnerait-elle pas le sentiment que le rite a russi, qu'il a t ce qu'il se proposait d'tre, qu'il a atteint le but o il visait ? Et comme le seul but qui soit consciemment poursuivi, c'est la reproduction de l'espce totmique, celle-ci parat tre assure par les moyens employs, dont l'efficacit se trouve ainsi dmontre. C'est ainsi que les hommes en sont venus attribuer des gestes, vains par eux-mmes, des vertus cratrices. L'efficacit morale du rite, qui est relle, a fait croire son efficacit physique, qui est imaginaire ; celle du tout, celle de chaque partie, prise part. Les effets vraiment utiles que produit l'ensemble de la crmonie sont comme une justification exprimentale des pratiques lmentaires dont elle est faite, bien que, en ralit, toutes ces pratiques ne soient nullement indispensables au succs. Ce qui prouve bien, d'ailleurs, qu'elles n'agissent pas par elles-mmes, C'est qu'elles peuvent tre remplaces par d'autres, de nature trs diffrente, sans que le rsultat final soit modifi. Il semble bien y avoir des Intichiuma qui ne comprennent que des oblations sans rites mimtiques ; d'autres sont purement mimtiques et ne comportent pas d'oblations. Cependant, les uns et les autres passent pour avoir la mme efficacit. Si donc on attache du prix ces diffrentes manuvres, ce n'est pas cause de leur valeur intrinsque ; mais c'est qu'elles font partie d'un rite complexe dont on sent l'utilit globale. Il nous est d'autant plus facile de comprendre cet tat d'esprit que nous pouvons l'observer autour de nous. Surtout chez les peuples et dans les milieux les plus cultivs, il se rencontre frquemment des croyants qui, tout en ayant des doutes sur l'efficacit spciale que le dogme attribue chaque rite considr sparment, continuent pourtant pratiquer le culte. Ils ne sont pas certains que le dtail des observances prescrites soit rationnellement justifiable ; mais ils
1183
Sur les causes qui dterminent cette manifestation extrieure, v. plus haut, p. 329 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
320
sentent qu'il leur serait impossible de s'en affranchir sans tomber dans un dsarroi moral devant lequel ils reculent. Le fait mme que la foi a perdu chez eux ses racines intellectuelles met ainsi en vidence les raisons profondes sur lesquelles elle repose. Voil pourquoi les critiques faciles, auxquelles un rationalisme simpliste a parfois soumis les prescriptions rituelles, laissent en gnral le fidle indiffrent : c'est que la vraie justification des pratiques religieuses n'est pas dans les fins apparentes qu'elles poursuivent, mais dans l'action invisible qu'elles exercent sur les consciences, dans la faon dont elles affectent notre niveau mental. De mme, quand les prdicateurs entreprennent de convaincre, ils s'attachent beaucoup moins tablir directement et par des preuves mthodiques la vrit de telle proposition particulire ou l'utilit de telle ou telle observance, qu' veiller ou rveiller le sentiment de rconfort moral que procure la clbration rgulire du culte. Ils crent ainsi une prdisposition croire, qui devance les preuves, qui entrane l'intelligence passer par-dessus l'insuffisance des raisons logiques, et qui la porte aller, comme d'elle-mme, au-devant des propositions qu'on lui veut faire accepter. Ce prjug favorable, cet lan croire, c'est prcisment ce qui constitue la foi ; et c'est la foi qui fait l'autorit des rites auprs du croyant, quel qu'il soit, du chrtien comme de l'Australien. Toute la supriorit du premier, c'est qu'il se rend mieux compte du processus psychique d'o rsulte sa croyance ; il sait que c'est la foi qui sauve . C'est parce que la foi a cette origine qu'elle est, en un sens, impermable l'exprience . Si les checs intermittents de l'Intichiuma n'branlent pas la confiance que l'Australien a dans son rite, c'est qu'il tient de toutes les forces de son me ces pratiques o il vient se refaire priodiquement; il ne saurait donc en nier le principe sans qu'il en rsulte un vritable bouleversement de tout son tre qui rsiste. Mais si grande que soit cette force de rsistance, elle ne distingue pas radicalement la mentalit religieuse des autres formes de la mentalit humaine, mmes de celles qu'on a le plus l'habitude lui de opposer. Sous ce rapport, celle du savant ne diffre de la prcdente qu'en degrs. Quand une loi scientifique a pour elle l'autorit d'expriences nombreuses et varies, il est contraire toute mthode d'y renoncer trop facilement sur la dcouverte d'un fait qui parat la contredire. Encore faut-il tre assur que ce fait ne comporte qu'une seule interprtation et qu'il n'est pas possible d'en rendre compte sans abandonner la proposition qu'il semble infirmer. Or, l'Australien ne procde pas autrement quand il attribue l'insuccs d'un Intichiuma quelque malfice, on l'abondance d'une rcolte prmature quelque Intichiuma mystique clbr dans l'au-del. Il est d'autant plus fond ne pas douter de son rite sur la foi d'un fait contraire que la valeur en est ou en parat tablie par un nombre plus considrable de faits concordants. D'abord, l'efficacit morale de la crmonie est relle et elle est directement prouve par tous ceux qui y participent ; il y a l une exprience, constamment renouvele, et dont aucune exprience contradictoire ne vient affaiblir la porte. De plus, l'efficacit physique elle-mme n'est pas sans trouver dans les donnes de l'observation objective une confirmation au moins apparente. Il est normal, en effet, que l'espce totmique se reproduise rgulirement ; tout se passe donc, dans la trs grande gnralit des cas, comme si les gestes rituels avaient rellement produit les effets qu'on en attendait. Les checs sont l'exception. Comme les rites, surtout ceux qui sont priodiques, ne demandent rien d'autre la nature que de suivre son cours rgulier, il n'est pas surprenant que, le plus souvent, elle ait l'air de leur obir. Ainsi, s'il arrive au croyant de se montrer indocile certaines leons de l'exprience, c'est en se fondant sur d'autres expriences qui lui paraissent
1184
1184
Lucien Lvy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les socits infrieures, pp. 61-68.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
321
plus dmonstratives. Le savant ne fait pas autrement; il y met plus de mthode. La Magie n'est donc pas, comme l'a soutenu Frazer , un fait premier dont la religion ne serait qu'une forme drive. Tout au contraire, c'est sous l'influence d'ides religieuses que se sont constitus les prceptes sur lesquels repose l'art du magicien, et c'est seulement par une extension secondaire qu'ils ont t appliqus des relations purement laques. Parce que toutes les forces de l'univers ont t conues sur le modle des forces sacres, la contagiosit inhrente aux secondes fut tendue aux premires et l'on crut que, dans des conditions dtermines, toutes les proprits des corps pouvaient se transmettre contagieusement. De mme, une fois que le principe d'aprs lequel le semblable produit le semblable se fut constitu pour satisfaire des besoins religieux dtermins, il se dtacha de ses origines rituelles pour devenir, par une sorte de gnralisation spontane, une loi de la nature . Mais pour comprendre ces axiomes fondamentaux de la magie, il est ncessaire de les replacer dans les milieux religieux o ils ont pris naissance et qui, seuls, permettent d'en rendre compte. Quand on y voit luvre d'individus isols, de magiciens solitaires, on se demande comment des esprits humains ont pu en avoir l'ide, puisque rien, dans l'exprience, ne pouvait ni les suggrer ni les vrifier ; surtout on ne s'explique pas comment un art aussi dcevant a pu s'imposer, et pendant si longtemps, la confiance des hommes. Mais le problme disparat si la foi qu'inspire la magie n'est qu'un cas particulier de la foi religieuse en gnral, si elle est ellemme le produit, au moins indirect, d'une effervescence collective. C'est dire que l'expression de magie sympathique pour dsigner l'ensemble de pratiques dont il vient d'tre question n'est pas sans improprit. Il y a des rites sympathiques, mais ils ne sont pas particuliers la magie ; non seulement on les retrouve dans la religion, mais c'est de la religion que la magie les a reus. On ne peut donc que s'exposer des confusions en ayant l'air d'en faire, par le nom qu'on leur donne, quelque chose de spcifiquement magique.
1185 1186
Les rsultats de notre analyse viennent ainsi rejoindre et confirmer ceux auxquels sont arrivs MM. Hubert et Mauss quand ils ont tudi directement la magie . Ils ont montr que celle-ci tait tout autre chose qu'une industrie grossire, fonde sur une science tronque. Derrire les mcanismes, purement lacs en apparence, qu'emploie le magicien, ils ont fait voir tout un arrire-fond de conceptions religieuses, tout un monde de forces dont la magie a emprunt l'ide la religion. Nous pouvons maintenant comprendre d'o vient qu'elle est ainsi toute pleine d'lments religieux : c'est qu'elle est ne de la religion.
1187
III
1185 1186
Golden Bough 2, I, pp. 69-75. Nous n'entendons pas dire qu'il y ait eu un temps o la religion aurait exist sans la magie. Vraisemblablement, au fur et mesure que la religion s'est forme, certains de ses principes ont t tendus des relations non religieuses et elle s'est ainsi complte par une magie plus ou moins dveloppe. Mais si ces deux systmes d'ides et de pratiques ne correspondent pas des phases historiques distinctes, il ne laisse pas d'y avoir entre elles un rapport de drivation dfini. C'est tout ce que nous nous sommes propos d'tablir. 1187 Loc. cit., p. 108 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
322
Mais le principe qui vient d'tre expliqu n'a pas seulement une fonction rituelle ; il intresse directement la thorie de la connaissance. C'est, en effet, un nonc concret de la loi de causalit et, selon toute vraisemblance, un des noncs les plus primitifs qui aient exist. Toute une conception de la relation causale est implique dans le pouvoir qui est ainsi attribu au semblable de produire son semblable ; et cette conception domine la pense primitive, puisqu'elle sert de base, la fois, aux pratiques du culte et la technique du magicien. Les origines du prcepte sur lequel reposent les rites mimtiques sont donc de nature clairer celles du principe de causalit. La gense de l'un doit nous aider comprendre la gense de l'autre. Or, on vient de faire voir que le premier est un produit de causes sociales : ce sont des groupes qui l'ont labor en vue de fins collectives et ce sont des sentiments collectifs qu'il traduit. On peut donc prsumer qu'il en est de mme du second. Il suffit, en effet, d'analyser le principe de causalit pour s'assurer que les divers lments dont il est compos ont bien cette origine. Ce qui est tout d'abord impliqu dans la notion de relation causale, c'est l'ide d'efficacit, de pouvoir producteur, de force active. On entend communment par cause ce qui est susceptible de produire un changement dtermin. La cause, c'est la force avant qu'elle n'ait manifest le pouvoir qui est en elle ; l'effet, c'est le mme pouvoir, mais actualis. L'humanit s'est toujours reprsent la causalit en termes dynamiques. Sans doute, certains philosophes refusent cette conception toute valeur objective ; ils n'y voient qu'une construction arbitraire de l'imagination qui ne correspondrait rien dans les choses. Mais nous n'avons pas nous demander pour l'instant si elle est fonde ou non dans la ralit : il nous suffit de constater qu'elle existe, qu'elle constitue et qu'elle a toujours constitu un lment de la mentalit commune ; et c'est ce que reconnaissent ceux-l mmes qui la critiquent. Notre but immdiat est de chercher non ce qu'elle peut valoir logiquement, mais comment elle s'explique. Or elle dpend de causes sociales. Dj l'analyse des faits nous a permis de faire voir que le prototype de l'ide de force avait t le mana, le wakan, l'orenda, le principe totmique, noms divers donns la force collective, objective et projete dans les choses . Le premier pouvoir que les hommes se sont reprsent comme tel semble donc bien avoir t celui que la socit exerce sur ses membres. Le raisonnement vient confirmer ce rsultat de l'observation ; il est possible, en effet, d'tablir pourquoi cette notion de pouvoir, d'efficacit, de force agissante ne peut nous tre venue d'une autre source.
1188
Il est tout d'abord vident et reconnu de tous qu'elle ne saurait nous tre fournie par l'exprience externe. Les sens ne nous font voir que des phnomnes qui coexistent ou qui se suivent, mais rien de ce qu'ils peroivent ne peut nous donner l'ide de cette action contraignante et dterminante qui est caractristique de ce qu'on appelle un pouvoir ou une force. Ils n'atteignent que des tats raliss, acquis, extrieurs les uns aux autres ; mais le processus interne qui relie ces tats leur chappe. Rien de ce qu'ils nous apprennent ne saurait nous
1188
V. plus haut, pp. 290-292.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
323
suggrer l'ide de ce qu'est une influence ou une efficacit. C'est prcisment pour cette raison que les philosophes de l'empirisme ont vu dans ces diffrentes conceptions autant d'aberrations mythologiques. Mais supposer mme qu'il n'y ait en tout ceci que des hallucinations, encore faut-il dire comment elles sont nes. Si l'exprience externe n'est pour rien dans la gense de ces ides, comme, d'autre part, il est inadmissible qu'elles nous soient donnes toutes faites, on doit supposer qu'elles nous viennent de l'exprience intrieure. En fait, la notion de force est manifestement grosse d'lments spirituels qui ne peuvent avoir t emprunts qu' notre vie psychique. On a cru souvent que l'acte par lequel notre volont clt une dlibration, contient nos penchants, commande nos organes, avait pu servir de modle cette construction. Dans la volition, a-t-on dit, nous nous saisissons directement comme un pouvoir en acte. Une fois donc que l'homme eut cette ide, il n'eut, semble-t-il, qu' l'tendre aux choses pour que le concept de force ft constitu. Tant que la thorie animiste passait pour une vrit dmontre, cette explication pouvait paratre confirme par l'histoire. Si les forces dont la pense humaine a primitivement peupl le monde avait rellement t des esprits, c'est--dire des tres personnels et conscients, plus ou moins semblables l'homme, on pourrait croire, en effet, que notre exprience individuelle a suffi nous fournir les lments constitutifs de la notion de force. Mais nous savons que les premires forces qu'ont imagines les hommes sont, au contraire, des puissances anonymes, vagues, diffuses, qui ressemblent par leur impersonnalit aux forces cosmiques et qui contrastent, par consquent, de la manire la plus tranche, avec ce pouvoir minemment personnel qu'est la volont humaine. Il est donc impossible qu'elles aient t conues l'image de cette dernire. Il y a d'ailleurs, un caractre essentiel des forces impersonnelles qui serait inexplicable dans cette hypothse : c'est leur communicabilit. Les forces de la nature ont toujours t conues comme susceptibles de passer d'un objet dans un autre, de se mler, de se combiner, de se transformer les unes dans les autres. C'est mme cette proprit qui fait leur valeur explicative; car c'est grce elle que les effets peuvent tre relis leurs causes sans solution de continuit. Or, le moi a un caractre prcisment oppos: il est incommunicable. Il ne peut pas changer de substrat, s'tendre de l'un l'autre; il ne se rpand que par mtaphore. La manire dont il se dcide et excute ses dcisions ne saurait donc nous suggrer l'ide d'une nergie qui se communique, qui peut mme se confondre avec d'autres et, par ces combinaisons et ces mlanges, donner naissance des effets nouveaux. Ainsi, l'ide de force, telle que l'implique le concept de relation causale, doit prsenter un double caractre. En premier lieu, elle ne peut nous venir que de notre exprience intrieure ; les seules forces que nous puissions directement atteindre sont ncessairement des forces morales. Mais en mme temps, il faut qu'elles soient impersonnelles, puisque la notion de pouvoir impersonnel s'est constitue la premire. Or, les seules qui satisfassent cette double condition sont celles qui se dgagent de la vie en commun : ce sont les forces collectives. En effet, d'une part, elles sont tout entires psychiques ; elles sont faites exclusivement d'ides et
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
324
de sentiments objectivs. Mais d'un autre ct, elles sont impersonnelles par dfinition, puisqu'elles sont le produit d'une coopration. oeuvre de tous, elles ne sont la chose de personne en particulier. Elles tiennent si peu la personnalit des sujets en qui elles rsident, qu'elles n'y sont jamais fixes. De mme qu'elles les pntrent du dehors, elles sont toujours prtes s'en dtacher. Elles tendent d'elles-mmes se rpandre plus loin et envahir de nouveaux domaines : il n'en est pas, nous le savons, qui soient plus contagieuses, par consquent plus communicables. Sans doute, les forces physiques ont la mme proprit ; mais nous ne pouvons en avoir directement conscience; nous ne pouvons mme les apprhender comme telles, parce qu'elles nous sont extrieures. Quand je me heurte un obstacle, j'prouve une sensation de gne et de malaise ; mais la force qui cause cette sensation n'est pas en moi, elle est dans l'obstacle et, par suite, elle est en dehors du cercle de ma perception. Nous en apercevons les effets, nous ne l'atteignons pas en elle-mme. Il en est autrement des forces sociales : elles font partie de notre vie intrieure et, par consquent, nous ne connaissons pas seulement les produits de leur action ; nous les voyons agir. La force qui isole l'tre sacr et qui tient les profanes distance n'est pas, en ralit, dans cet tre ; elle vit dans la conscience des fidles. Aussi ceux-ci la sentent-ils au moment mme o elle agit sur leur volont pour inhiber certains mouvements ou en commander d'autres. En un mot, cette action contraignante et ncessitante qui nous chappe quand elle vient d'une chose extrieure, nous la saisissons ici sur le vif parce qu'elle se passe tout entire en nous. Sans doute, nous ne l'interprtons pas toujours d'une manire adquate, mais du moins, nous ne pouvons pas ne pas en avoir conscience. Au surplus, l'ide de force porte, d'une manire apparente, la marque de son origine. Elle implique, en effet, l'ide de pouvoir qui, son tour, ne va pas sans celles d'ascendant de matrise, de domination, et corrlativement, de dpendance et de subordination ; or, les relations que toutes ces ides expriment sont minemment sociales. C'est la socit qui a class les tres en suprieurs et en infrieurs, en matres qui commandent et en sujets qui obissent ; c'est elle qui a confr aux premiers cette proprit singulire qui rend le commandement efficace et qui constitue le pouvoir. Tout tend donc prouver que les premiers pouvoirs dont l'esprit humain ait eu la notion sont ceux que les socits ont institus en s'organisant : c'est leur image que les puissances du monde physique ont t conues. Aussi l'homme n'a-t-il pu arriver se concevoir comme une force matresse du corps o elle rside qu' condition d'introduire, dans l'ide qu'il se faisait de lui-mme, des concepts emprunts la vie sociale. Il fallait, en effet, qu'il se distingut de son double physique et qu'il s'attribut, par rapport ce dernier, une sorte de dignit suprieure ; en un mot, il fallait qu'il se penst comme une me. En fait, c'est bien sous la forme de l'me qu'il s'est toujours reprsent la force qu'il croit tre. Mais nous savons que l'me est tout autre chose qu'un nom donn la facult abstraite de se mouvoir, de penser ou de sentir ; c'est, avant tout, un principe religieux, un aspect particulier de la force collective. En dfinitive, l'homme se sent une me et, par consquent, une force parce qu'il est un tre social. Bien que l'animal meuve ses membres tout comme nous, bien qu'il ait la mme action que nous sur ses muscles, rien ne nous autorise supposer qu'il ait conscience de luimme comme d'une cause active et efficace. C'est qu'il n'a pas, ou, pour parler plus exactement, c'est qu'il ne s'attribue pas d'me. Mais s'il ne s'attribue pas d'me, c'est qu'il ne participe pas une vie sociale qui soit comparable celle des hommes. Il n'existe, chez les
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
325
animaux, rien qui ressemble une civilisation
1189
Mais la notion de force n'est pas tout le principe de causalit. Celui-ci consiste dans un jugement qui nonce que toute force se dveloppe d'une manire dfinie, que l'tat o elle se trouve chaque moment de son devenir prdtermine l'tat conscutif. On appelle le premier cause, le second effet, et le jugement causal affirme entre ces deux moments de toute force, l'existence d'un lien ncessaire. Ce rapport, l'esprit le pose avant toutes preuves, sous l'empire d'une sorte de contrainte dont il ne peut s'affranchir ; il le postule, comme on dit, a priori. De cet apriorisme et de cette ncessit, l'empirisme n'a jamais russi rendre compte. Jamais les philosophes de cette cole n'ont pu expliquer comment une association d'ides, renforce par l'habitude, pouvait produire autre chose qu'un tat d'attente, une prdisposition, plus ou moins forte, des ides s'voquer suivant un ordre dtermin. Or le principe de causalit a un tout autre caractre. Ce n'est pas simplement une tendance immanente de notre pense se drouler d'une certaine manire ; c'est une norme extrieure et suprieure au cours de nos reprsentations qu'elle domine et qu'elle rgle imprativement. elle est investie d'une autorit qui lie l'esprit et le dpasse ; c'est--dire que l'esprit n'en est pas l'artisan. Sous ce rapport, il ne sert rien de substituer, l'habitude individuelle, l'habitude hrditaire; car l'habitude ne change pas de nature parce quelle dure plus d'une vie d'homme; elle est seulement plus forte. Un instinct n'est pas une rgle. Les rites qui viennent d'tre tudis permettent d'entrevoir une source, jusqu' prsent peu souponne, de cette autorit. Rappelons-nous, en effet, comment est ne la loi causale que les rites imitatifs mettent en pratique. Sous l'empire d'une mme proccupation le groupe s'assemble : si l'espce dont il porte le nom ne se reproduit pas, c'en est fait du clan. Le sentiment commun qui anime ainsi tous ses membres se traduit au dehors sous forme de gestes dtermins qui reviennent toujours les mmes dans les mmes circonstances, et, une fois la crmonie accomplie, il se trouve, pour les raisons exposes, que le rsultat dsir parat obtenu. Une association se forme donc entre l'ide de ce rsultat et celle des gestes qui le prcdent ; et cette association ne varie pas d'un sujet l'autre ; elle est la mme pour tous les acteurs du rite, puisqu'elle est le produit d'une exprience collective. Toutefois, si aucun autre facteur n'intervenait, il ne se produirait qu'un tat collectif d'attente ; une fois les gestes mimtiques accomplis, tout le monde s'attendrait, avec plus ou moins de confiance, voir prochainement apparatre l'vnement souhait; une rgle imprative de la pense ne se constituerait pas pour autant. Mais, comme un intrt social de premire importance est en jeu, la socit ne peut laisser les choses suivre leur cours au gr des circonstances ; elle intervient donc activement de manire en rgler la marche conformment ses besoins. Elle exige que cette crmonie, dont elle ne peut se passer soit rpte toutes les fois que c'est ncessaire, et, par consquent, que les mouvements, condition du succs, soient rgulirement excuts : elle les impose obligatoirement. Or, ils impliquent une attitude dfinie de l'esprit qui, par contrecoup, participe de ce mme caractre d'obligation. Prescrire qu'on doit imiter l'animal ou la plante pour les dterminer renatre, c'est poser comme un axiome qui ne doit pas tre mis en
1189
Sans doute, il existe des socits animales. Toutefois, le mot n'a pas tout fait le mme sens selon qu'il s'applique aux hommes ou aux animaux. L'institution est le fait caractristique des socits humaines; il n'existe pas d'institutions dans les socits animales.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
326
doute, que le semblable produit le semblable. L'opinion ne peut pas permettre aux individus de nier thoriquement ce principe, sans leur permettre en mme temps de le violer dans leur conduite. Elle l'impose donc, tout comme les pratiques qui en drivent, et ainsi le prcepte rituel se double d'un prcepte logique qui n'est que l'aspect intellectuel du premier. L'autorit de l'un et celle de l'autre drivent de la mme source la socit. Le respect que celle-ci inspire se communique aux manires de penser comme aux manires d'agir auxquelles elle attache du prix. On ne peut s'carter des unes comme des autres sans se heurter aux rsistances de l'opinion ambiante. Voil pourquoi les premires ncessitent, avant tout examen, l'adhsion de l'intelligence, comme les secondes dterminent immdiatement la soumission de la volont. On peut vrifier nouveau sur cet exemple comment une thorie sociologique de la notion de causalit et, plus gnralement, des catgories, s'carte des doctrines classiques sur la question, tout en les conciliant. Avec l'apriorisme, elle maintient le caractre prjudiciel et ncessaire de la relation causale ; mais elle ne se borne pas l'affirmer ; elle en rend compte, sans pourtant le faire vanouir sous prtexte de l'expliquer, comme il arrive l'empirisme. Au reste, il ne saurait tre question de nier la part qui revient l'exprience individuelle. Il n'est pas douteux que, de lui-mme, l'individu constate des successions rgulires de phnomnes et acquiert ainsi une certaine sensation de rgularit. Seulement, cette sensation n'est pas la catgorie de causalit. La premire est individuelle, subjective, incommunicable ; nous la faisons nous-mmes avec nos observations personnelles. La seconde est l'uvre de la collectivit, elle nous est donne toute faite. C'est un cadre dans lequel viennent se disposer nos constatations empiriques et qui nous permet de les penser, c'est--dire de les voir par un biais grce auquel nous pouvons nous entendre leur sujet avec autrui. Sans doute, si le cadre s'applique au contenu, c'est qu'il n'est pas sans rapport avec la matire qu'il contient; mais il ne se confond pas avec elle. Il la dpasse et la domine. C'est qu'il a une autre origine. Ce n'est pas un simple rsum de souvenirs individuels ; il est, avant tout, fait pour rpondre des exigences de la vie commune. En dfinitive l'erreur de l'empirisme a t de ne voir dans le lien causal qu'une construction savante de la pense spculative et le produit d'une gnralisation plus ou moins mthodique. Or, elle seule, la pure spculation ne peut donner naissance qu' des vues provisoires, hypothtiques, plus ou moins plausibles, mais qui doivent toujours tre tenues en suspicion : car on ne sait pas si, dans l'avenir, quelque observation nouvelle ne viendra pas les infirmer. Un axiome que l'esprit accepte et est tenu d'accepter, sans contrle comme sans rserves, ne saurait donc nous venir de cette source. Seules, les ncessits de l'action et surtout de l'action collective peuvent et doivent s'exprimer en formules catgoriques, premptoires et tranchantes, qui n'admettent pas la contradiction ; car les mouvements collectifs ne sont possibles qu' condition d'tre concerts, par consquent rgls et dfinis. Ils excluent les ttonnements, source d'anarchie ; ils tendent d'eux-mmes vers une organisation qui, une fois tablie, s'impose aux individus. Et comme l'activit ne peut se passer de l'intelligence, il arrive que celle-ci est entrane dans la mme voie et adopte, sans discussion, les postulats thoriques de la pratique rclame. Les impratifs de la pense ne sont vraisemblablement qu'une autre face des impratifs de la volont. Il s'en faut d'ailleurs, que nous songions prsenter les observations qui prcdent comme
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
327
une thorie complte du concept de causalit. La question est trop complexe pour pouvoir tre ainsi rsolue. Le principe de cause a t entendu de manires diffrentes suivant les temps et les pays ; dans une mme socit, il varie avec les milieux sociaux, avec les rgnes de la nature auxquels il est appliqu . On ne saurait donc, aprs la considration d'une seule des formes qu'il a prsentes dans l'histoire, dterminer avec une suffisante prcision les causes et les conditions dont il dpend. Les vues qui viennent d'tre exposes ne doivent tre regardes que comme des indications qu'il sera ncessaire de contrler et de complter. Cependant, comme la loi causale qui vient de nous arrter est certainement une des plus primitives qui soient et comme elle a jou un rle considrable dans le dveloppement de la pense et de l'industrie humaine, elle constitue une exprience privilgie et, par suite, il est prsumable que les remarques dont elle nous a fourni l'occasion sont susceptibles d'tre, dans une certaine mesure, gnralises.
1190
1190
L'ide de cause n'est pas la mme pour un savant et pour un homme dpourvu (le toute culture scientifique. D'autre part, beaucoup de nos contemporains entendent diffremment le principe de causalit suivant qu'ils l'appliquent des faits sociaux ou des faits physicochimiques. On a souvent, de la causalit, dans l'ordre social, une conception qui rappelle singulirement celle qui fut, pendant si longtemps, la base de la magie. On peut mme se demander si un physicien et un biologiste se reprsentent le rapport causal de la mme faon.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
328
CHAPITRE IV
LE CULTE POSITIF
(Suite)
III. - Les rites reprsentatifs ou commmoratifs
.
L'explication que nous avons donne des rites positifs dont il vient d'tre question dans les deux chapitres prcdents leur attribue une signification, avant tout, morale et sociale. L'efficacit physique que leur prte le fidle serait le produit d'une interprtation qui dissimulerait leur raison d'tre essentielle : c'est parce qu'ils servent refaire moralement les individus et les groupes qu'ils passent pour avoir une action sur les choses. Mais si cette hypothse nous a permis de rendre compte des faits, on ne peut dire qu'elle ait t directement dmontre ; elle semble mme, au premier abord, se concilier assez mal avec la nature des mcanismes rituels que nous avons analyss. Qu'ils consistent en oblations ou en pratiques imitatives, les gestes dont ils sont faits visent des fins purement matrielles ; ils ont ou semblent avoir uniquement pour objet de provoquer l'espce totmique renatre. Dans ces conditions, n'est-il pas surprenant que leur vritable rle soit de servir des fins morales ? Il est vrai que leur fonction physique pourrait bien avoir t exagre par Spencer et Gillen, mme dans les cas o elle est le plus incontestable. Suivant ces auteurs, chaque clan clbrerait son Intichiuma en vue d'assurer aux autres clans un aliment utile, et tout le culte consisterait en une sorte de coopration conomique des diffrents groupes totmiques ; chacun travaillerait pour tous les autres. Mais, d'aprs Strehlow, cette conception du totmisme australien serait tout fait trangre la mentalit indigne. Si, dit-il, les membres d'un groupe totmique, en s'efforant de multiplier les animaux ou les plantes de l'espce consacre, paraissent travailler pour leurs compagnons des autres totems, il faut se garder de voir dans cette collaboration le principe fondamental du totmisme arunta ou loritja. jamais les noirs ne m'ont dit d'eux-mmes que tel tait l'objet de leurs crmonies. Sans doute, quand je leur en suggrais l'ide et que je
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
329
la leur exposais, ils la comprenaient et y acquiesaient. Mais on ne me blmera pas d'avoir quelque mfiance pour des rponses obtenues dans ces conditions. Strehlow fait, d'ailleurs, remarquer que cette manire d'interprter le rite est contredite par ce fait que les animaux ou les vgtaux totmiques ne sont pas tous comestibles ou utiles ; il en est qui ne servent rien ; il y en a mme de dangereux. Les crmonies qui les concernent ne sauraient donc avoir des fins alimentaires .
1191
Quand, conclut notre auteur, on demande aux indignes quelle est la raison dterminante de ces crmonies, ils sont unanimes pour rpondre : C'est que les anctres ont institu les choses ainsi. Voil pourquoi nous agissons de cette manire, et non pas autrement . Mais dire que le rite est observ parce qu'il vient des anctres, c'est reconnatre que son autorit se confond avec l'autorit de la tradition, chose sociale au premier chef. On le clbre pour rester fidle au pass, pour garder la collectivit sa physionomie morale, et non cause des effets physiques qu'il peut produire. Ainsi, la manire mme dont les fidles l'expliquent laisse dj transpirer les raisons profondes dont il procde.
1192
Mais il y a des cas o cet aspect de crmonies est immdiatement apparent.
I
.
C'est chez les Warramunga qu'on peut le mieux l'observer
1193
Chez ce peuple, chaque clan est cens descendre d'un seul et unique anctre qui, n en un endroit dtermin, aurait pass son existence terrestre parcourir la contre dans tous les sens. C'est lui qui, au cours de ses voyages, aurait donn au pays la forme qu'il prsente actuellement; c'est lui qui aurait fait les montagnes et les plaines, les trous d'eau et les ruisseaux, etc. En mme temps, il semait sur sa route des germes vivants qui se dgageaient de son corps et qui sont devenus, par suite de rincarnations successives, les membres actuels du clan. Or, la crmonie qui, chez les Warramunga, correspond exactement l'Intichiuma des Arunta, a pour objet de commmorer et de reprsenter l'histoire mythique de l'anctre. Il n'est question ni d'oblation, ni, sauf dans un cas unique , de pratiques mimtiques. Le rite consiste uniquement rappeler le pass et le rendre, en quelque sorte, prsent au moyen d'une vritable reprsentation dramatique. Le mot est d'autant plus de circonstance que l'officiant, en
1194
1191
Ces crmonies ne sont naturellement pas suivies d'une communion alimentaire. D'aprs Strehlow, elles portent, au moins quand il s'agit de plantes non comestibles, un nom gnrique distinct : on les appelle, non mbatjalkatiuma, mais knujilelama (STREHLOW, III, p. 96). 1192 STREHLOW, III, p. 8. 1193 Les Warramunga ne sont pas les seuls o l'Intichiuma prsente la forme que nous allons dcrire. On l'observe galement chez les Tjingilli, les Umbaia, les Wulmala, les Walpari et mme chez les Kaitish, bien que le rituel de ces derniers rappelle, par certains cts, celui des Arunta (North. Tr., pp. 291, 309, 311, 317). Si nous prenons les Warramunga comme type, c'est qu'ils ont t mieux tudis par Spencer et Gillen. 1194 C'est le cas de l'Intichiuma du kakatos blanc ; v. plus haut, p. 504.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
330
ce cas, n'est aucunement considr comme une incarnation de l'anctre qu'il reprsente ; c'est un acteur qui joue un rle. Voici, titre d'exemple, en quoi consiste l'Intichiuma du Serpent noir, tel que l'ont observ Spencer et Gillet .
1195
Une premire crmonie ne semble pas se rfrer au pass ; du moins, la description qu'on nous en donne n'autorise pas l'interprter dans ce sens. Elle consiste en courses et en sauts qu'excutent deux officiants , dcors de dessins qui reprsentent le serpent noir. Quand, enfin, ils tombent puiss sur le sol, les assistants passent doucement la main sur les dessins emblmatiques dont le dos des deux acteurs est recouvert. On dit que ce geste plat au serpent noir. - C'est seulement ensuite que commence la srie des crmonies commmoratives.
1196
Elles mettent en action l'histoire mythique de l'anctre Thalaualla, depuis qu'il est sorti du sol jusqu'au moment o il y est dfinitivement rentr. Elles le suivent travers tous ses voyages. Dans chacune des localits o il a sjourn, il a, d'aprs le mythe, clbr des crmonies totmiques; on les rpte dans l'ordre mme o elles passent pour s'tre succd l'origine. Le mouvement qui revient le plus frquemment consiste en une sorte de trmoussement rythm et violent du corps tout entier ; c'est que l'anctre s'agitait ainsi aux temps mythiques pour faire sortit de lui les germes de vie qui y taient inclus. Les acteurs ont la peau couverte d'un duvet qui, par suite de ces secousses, se dtache et s'envole; c'est une manire de figurer l'envole de ces germes mystiques et leur dispersion dans l'espace. On se rappelle que, chez les Arunta, la place o se droule la crmonie est rituellement dtermine : c'est l'endroit o se trouvent les rochers les arbres, les trous d'eau sacrs, et il faut que les fidles s'y transportent pour clbrer le culte. Chez les Warramunga, au contraire, le terrain crmoniel est choisi arbitrairement pour des raisons d'opportunit. C'est une scne conventionnelle. Seulement, le lieu oh se sont passs les vnements dont la reproduction constitue le thme du rite est lui-mme reprsent au moyen de dessins. Parfois, ces dessins sont excuts sur le corps mme des acteurs. Par exemple, un petit cercle color en rouge, peint sur le dos et sur l'estomac, reprsente un trou d'eau . Dans d'autres cas, c'est sur le sol que l'image est trace. Sur la terre, pralablement dtrempe et recouverte d'ocre rouge, on dessine des lignes courbes, formes par des sries de points blancs, qui symbolisent un ruisseau ou une montagne. C'est un commencement de dcor.
1197
Outre les crmonies proprement religieuses que l'anctre passe pour avoir clbres autrefois, on reprsente de simples pisodes, ou piques ou comiques, de sa carrire terrestre. Ainsi, un moment donn, tandis que trois acteurs sont en scne, occups un rite important, un autre se dissimule derrire un bouquet d'arbres, situ quelque distance. Autour de son cou est attach un paquet de duvet qui figure un wallaby. Ds que la crmonie principale a pris fin, un vieillard trace sur le sol une ligne qui se dirige vers l'endroit o se cache le quatrime
1195 1196
North. Tr., p. 300 et suiv. Un des deux acteurs appartient non au clan du Serpent noir, mais celui du Corbeau. C'est que le Corbeau est considr comme un associ du Serpent noir; autrement dit, c'en est un sous-totem. 1197 North. Tr., p. 302.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
331
acteur. Les autres marchent derrire, les yeux baisss et fixs sur cette ligne, comme s'ils suivaient une piste. En dcouvrant l'homme, ils prennent un air stupfait et l'un d'eux le frappe d'un bton. Toute cette mimique reprsente un incident de la vie du grand serpent noir. Un jour, son fils s'en alla seul la chasse, prit un wallaby et le mangea sans en rien donner son pre. Ce dernier suivit ses traces, le surprit et lui fit rendre gorge de force ; c'est quoi fait allusion la bastonnade qui termine la reprsentation .
1198
Nous ne dirons pas ici tous les vnements mythiques qui sont successivement reprsents. Les exemples qui prcdent suffisent montrer quel est le caractre de ces crmonies : ce sont des drames, niais d'un genre tout particulier : ils agissent, ou, du moins, on croit qu'ils agissent sur le cours de la nature. Quand la commmoration du Thalaualla est termine, les Warramunga sont convaincus que les serpents noirs ne peuvent manquer de crotre et de se multiplier. Ces drames sont donc des rites, et mme des rites comparables de tout point, par la nature de leur efficacit, ceux qui constituent l'Intichiuma des Arunta. Aussi les uns et les autres sont-ils de nature s'clairer mutuellement. Il est mme d'autant plus lgitime de les rapprocher qu'il n'y a pas entre eux de solution de continuit. Non seulement le but poursuivi est le mme dans les deux cas, mais ce qu'a de plus caractristique le rituel warramunga se trouve dj dans l'autre l'tat de germe. L'Intichiuma, tel que le pratiquent gnralement les Arunta, contient, en effet, en soi une sorte de commmoration implicite. Les lieux o il est clbr sont, obligatoirement, ceux qu'ont illustrs les anctres. Les chemins par lesquels passent les fidles au cours de leurs pieux plerinages sont ceux qu'ont parcourus les hros de l'Alcheringa ; les endroits o l'on s'arrte pour procder aux rites sont ceux o les aeux eux-mmes ont sjourn, o ils se sont vanouis dans le sol, etc. Tout rappelle donc leur souvenir l'esprit des assistants. D'ailleurs, aux rites manuels s'ajoutent trs souvent des chants qui racontent les exploits ancestraux . Que ces rcits, au lieu d'tre dits, soient mims, que, sous cette forme nouvelle, ils se dveloppent de manire devenir la partie essentielle de la crmonie, et l'on aura la crmonie des Warramunga. Il y a plus ; par un ct, l'Intichiuma arunta est dj une sorte de reprsentation. L'officiant, en effet, ne fait qu'un avec l'anctre dont il est descendu et qu'il rincarne . Les gestes qu'il fait sont ceux que faisait cet anctre dans les mmes circonstances. Sans doute, parler exactement, il ne joue pas le personnage ancestral, comme pourrait le faire un acteur ; il est ce personnage mme. Il n'en reste pas moins que, en un sens c'est le hros qui occupe la scne. Pour que le caractre reprsentatif du rite s'accentue, il suffira que la dualit de l'anctre et de l'officiant s'accuse davantage ; c'est prcisment ce qui arrive chez les Warramunga . Mme chez les Arunta, on
1199 1200 1201
1198 1199
Ibid., p. 305. V. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 188 ; STREHLOW, III, p. 5. 1200 C'est ce que reconnat Strehlow lui-mme : L'anctre totmique et son descendant, c'est--dire celui qui le reprsente (der Darsteller), sont prsents dans ces chants sacrs comme ne faisant qu'un (III, p. 6). Comme ce fait incontestable contredit la thse d'aprs laquelle les mes ancestrales ne se rincarneraient pas, Strehlow, il est vrai, ajoute en note que, , au cours de la crmonie, il n'y a pas incarnation proprement dite de l'anctre dans la personne qui le reprsente . Si Strehlow veut dire que l'incarnation n'a pas lieu l'occasion de la crmonie, rien n'est plus certain. Mais s'il entend qu'il n'y a pas l'incarnation du tout, nous ne comprenons pas comment l'officiant et l'anctre peuvent se confondre. 1201 Peut-tre cette diffrence vient-elle en partie de ce que, chez les Warramunga, chaque clan est cens descendre d'un seul et unique anctre autour duquel l'histoire lgendaire du clan est venue se concentrer.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
332
cite au moins un Intichiuma o certaines personnes sont charges de reprsenter des anctres avec lesquels elles n'ont aucun rapport de filiation mythique, et o, par suite, il y a reprsentation dramatique proprement dite : c'est l'Intichiuma de l'mou . Dans ce cas galement, contrairement ce qui se passe d'ordinaire chez ce peuple, il semble bien que le thtre de la crmonie soit artificiellement amnag .
1202 1203
De ce que ces deux sortes de crmonies, malgr les diffrences qui les sparent, ont ainsi comme un air de parent, il ne suit pas qu'il y ait entre elles un rapport dfini de succession, que l'une soit une transformation de l'autre. Il peut trs bien se faire que les ressemblances signales viennent de ce qu'elles sont toutes deux issues d'une mme souche, c'est--dire d'une mme crmonie originelle dont elles seraient des modalits divergentes : nous verrons mme que cette hypothse est la plus vraisemblable. Mais, sans qu'il soit ncessaire de prendre un parti sur cette question, ce qui prcde suffit tablir que ce sont des rites de mme nature. Nous sommes donc fonds les comparer et nous servir de l'un pour nous aider mieux comprendre l'autre. Or, ce qu'ont de particulier les crmonies Warramunga dont nous venons de parler, c'est qu'il n'y est pas fait un geste dont l'objet soit d'aider ou de provoquer directement l'espce totmique renatre . Si l'on analyse les mouvements effectus comme les paroles prononces, on n'y trouve gnralement rien qui dcle aucune intention de ce genre. Tout se passe en reprsentations qui ne peuvent tre destines qu' rendre prsent aux esprits le pass mythique du clan. Mais la mythologie d'un groupe, c'est l'ensemble des croyances communes ce groupe. Ce qu'expriment les traditions dont elle perptue le souvenir, c'est la manire dont la socit se reprsente l'homme et le monde ; c'est une morale et une cosmologie en mme temps qu'une histoire. Le rite ne sert donc et ne peut servir qu' entretenir la vitalit de ces croyances, empcher qu'elles ne s'effacent des mmoires, c'est--dire, en somme, revivifier les lments les plus essentiels de la conscience collective. Par lui, le groupe ranime priodiquement le sentiment qu'il a de lui-mme et de son unit ; en mme temps, les individus sont raffermis dans leur nature d'tres sociaux. Les glorieux souvenirs qu'on fait revivre sous leurs yeux et dont ils se sentent solidaires leur donnent une impression de force et de confiance : on est plus assur dans sa foi quand on voit quel pass lointain elle remonte et les grandes choses qu'elle a inspires. C'est ce caractre de la crmonie qui la rend instructive. Elle tend tout entire agir sur les consciences et sur elles seules. Si donc on croit cependant qu'elle agit sur les choses, qu'elle assure la prosprit de l'espce, ce ne peut tre que par un contrecoup de l'action morale qu'elle exerce et qui, de toute vidence, est la seule qui soit relle. Ainsi, l'hypothse que nous avons propose se trouve vrifie par une exprience
1204
C'est cet anctre que le rite commmore ; or, l'officiant n'en descend pas ncessairement. On peut mme se demander si ces chefs mythiques, sorte de demi-dieux, sont soumis la rincarnation. 1202 Dans cet Intichiuma, trois assistants reprsentent des anctre$ d'une considrable antiquit ; ils jouent un vritable rle (Nat. Tr., pp. 181-1812). SPENCER et GILLEN ajoutent, il est vrai, qu'il s'agit d'anctres postrieurs l'poque de l'Alcheringa. Mais ils ne laissent pas d'tre des personnages mythiques, reprsents au cours d'un rite. 1203 On ne nous parle pas, en effet, de rochers ou de trous d'eau sacrs.. Le centre de la crmonie est une image de l'mou qui est dessine sur le sol et qui petit tre excute en un endroit quelconque. 1204 Nous n'entendons pas dire, d'ailleurs, que toutes les crmonies des Warramunga soient de ce type. L'exemple du kakatos blanc, dont il a t question plus haut, prouve qu'il y a des exceptions.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
333
significative, et la vrification est d'autant plus probante que, comme nous venons de l'tablir, entre le systme rituel des Warramunga et celui des Arunta il n'y a pas de diffrence de nature. L'un ne fait que mettre plus clairement en vidence ce que nous avions dj conjectur de l'autre.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
334
II
.
Mais il existe des crmonies o ce caractre reprsentatif et idaliste est encore plus accentu. Dans celles dont il vient d'tre question, la reprsentation dramatique n'tait pas l pour elle-mme : elle n'tait qu'un moyen en vue d'une fin toute matrielle, la reproduction de l'espce totmique. Mais il en est d'autres qui ne diffrent pas spcifiquement des prcdentes et d'o, pourtant, toute proccupation de ce genre est absente. On y reprsente le pass dans le seul but de le reprsenter, de le graver plus profondment dans les esprits, sans qu'on attende du rite aucune action dtermine sur la nature. Tout au moins, les effets physiques qui lui sont parfois imputs sont tout fait au second plan et sans rapport avec l'importance liturgique qui lui est attribue. C'est le cas notamment des ftes que les Warramunga clbrent en l'honneur du serpent Wollunqua .
1205
Le Wollunqua est, comme nous l'avons dj dit, un totem d'un genre trs particulier. Ce n'est pas une espce animale ou vgtale, mais un tre unique : il n'existe qu'un Wollunqua. De plus, cet tre est purement mythique. Les indignes se le reprsentent comme une sorte de serpent colossal dont la taille est telle que, quand il se dresse sur la queue, sa tte se perd dans les nuages. 11 rside, croit-on, dans un trou d'eau, appel Thapauerlu, qui est cach au fond d'une valle solitaire. Mais s'il diffre par certains cts des totems ordinaires, il en a cependant tous les caractres distinctifs. Il sert de nom collectif et d'emblme tout un groupe d'individus qui voient en lui leur commun anctre, et les rapports qu'ils soutiennent avec cette bte mythique sont identiques ceux que les membres des autres totems croient soutenir avec les fondateurs de leurs clans respectifs. Au temps de l'Alcheringa , le Wollunqua parcourait en tous sens le pays. Dans les diffrentes localits o il s'arrtait, il essaimait des spirit-children, des principes spirituels, qui servent encore d'mes aux vivants d'aujourd'hui. Le Wollunqua est mme considr comme une sorte de totem minent. Les Warramunga sont diviss en deux phratries appeles l'une Uluuru, et l'autre Kingilli. Presque tous les totems de la premire sont des serpents d'espces diffrentes. Or ils passent tous pour tre descendus du Wollunqua : on dit qu'il est leur grand-pre . On peut entrevoir par l comment, selon toute vraisemblance, le
1206 1207
1205
North, Tr., p, 226 et suiv, Cf, sur le mme sujet quelques passages de EYLMANN qui se rapportent videmment au mme tre mythique (Die Eingeborenen, etc., p. 185). Strehlow nous signale galement chez les Arunta un serpent mythique (Kulaia, serpent d'eau) qui pourrait bien n'tre pas trs diffrent du Wollunqua (STREHLOW, I, p. 78; cf. II, p. 71 o le Kulala figure sur la liste des totems). 1206 Pour ne pas compliquer la terminologie, nous nous servons du mot arunta : chez les Warramunga, on appelle Wingara cette priode mythique. 1207 Il n'est pas ais, disent SPENCER et GILLEN, d'exprimer avec des mots ce qui est plutt chez les indignes un vague sentiment. Mais aprs avoir observ attentivement les diffrentes' crmonies, nous
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
335
mythe du Wollunqua a pris naissance. Pour expliquer la prsence, dans une mme phratrie, de tant de totems similaires, on a imagin qu'ils taient tous drivs d'un seul et mme totem; seulement, on dut ncessairement lui prter des formes gigantesques afin que, par son aspect mme, il ft en rapport avec le rle considrable qui lui tait assign dans l'histoire de la tribu. Or le Wollunqua est l'objet de crmonies qui ne diffrent pas en nature de celles que nous avons prcdemment tudies : ce sont des reprsentations o sont figurs les principaux vnements de sa vie fabuleuse. On le montre sortant de terre, passant d'une localit dans l'autre ; on reprsente les divers pisodes de ses voyages, etc. Spencer et GILLEN ont assist quinze crmonies de ce genre qui se sont succd du 27 juillet au 23 aot, s'enchanant les unes aux autres suivant un ordre dtermin, de manire former un vritable cycle . Par le dtail des rites qui la constituent, cette longue fte est donc indistincte de l'Intichiuma ordinaire des Warramunga; c'est ce que reconnaissent les auteurs qui nous l'ont dcrite . Mais, d'un autre ct, c'est un Intichiuma qui ne saurait avoir pour objet d'assurer la fcondit d'une espce animale ou vgtale, puisque le Wollunqua est, lui seul, sa propre espce et qu'il ne se reproduit pas. Il est; et les indignes ne paraissent pas avoir le sentiment qu'il ait besoin d'un culte pour persvrer dans son tre. Non seulement ces crmonies n'ont pas l'efficacit de l'Intichiuma classique, mais il ne semble pas qu'elles aient une efficacit matrielle d'aucune sorte. Le Wollunqua n'est pas une divinit prpose un ordre dtermin de phnomnes naturels et, par suite, on n'attend de lui, en change du culte, aucun service dfini. On dit bien que, si les prescriptions rituelles sont mal observes, le Wollunqua se fche, sort de sa retraite et vient se venger sur ses fidles de leurs ngligences. Inversement, quand tout s'est rgulirement pass, on est port croire qu'on s'en trouvera bien et que quelque vnement heureux se produira. Mais l'ide de ces sanctions possibles n'est videmment ne qu'aprs coup, pour rendre compte du rite. Une fois la crmonie institue, il parut naturel qu'elle servt quelque chose et, par suite, que l'omission des observances prescrites expost quelque danger. Mais on ne l'a pas institue pour prvenir ces dangers mythiques ou pour s'assurer des avantages particuliers. Ceux-ci d'ailleurs, ne sont reprsents dans les esprits que de la manire la plus imprcise. Les anciens, par exemple, annoncent, quand tout est termin, que le Wollunqua, s'il est satisfait, enverra de la pluie. Mais ce n'est pas pour avoir de la pluie qu'on clbre la fte . On la clbre parce que les anctres l'ont clbre, parce qu'on y est attach
1208 1209 1210
avons eu trs nettement l'impression que, dans l'esprit des indignes, le Wollunqua rpondait l'ide d'un totem dominant (North. Tr., p, 248). 1208 L'une des plus solennelles de ces crmonies est celle que nous avons eu l'occasion de dcrire plus haut (pp. 311-312), au cours de laquelle une image du Wollunqua est dessine sur une sorte de tumulus qui est ensuite mis en pices an milieu d'une effervescence gnrale. 1209 North, Tr., pp. 227, 248. 1210 Voici en quels termes s'expriment SPENCER et GILLEN dans le seul passage o il soit question d'un rapport possible entre le Wollunqua et le phnomne de la pluie. Quelques jours aprs le rite clbr autour du tumulus, les vieillards dclarrent qu'ils avaient entendu parler le Wollunqua, qu'il tait satisfait de ce qui s'tait pass et qu'il allait envoyer de la pluie. La raison de cette prophtie, c'est qu'ils avaient entendu, comme nous-mmes, le tonnerre retentir quelque distance de l . La production de la pluie est si peu l'objet immdiat de la crmonie qu'on ne l'imputa au Wollunqua que plusieurs jours aprs la clbration du rite et la suite de circonstances accidentelles. Un autre fait montre combien les ides des indignes sont vagues sur ce point. Quelques lignes plus loin, le tonnerre est prsent comme un signe, non de la satisfaction du Wollunqua, mais de son mcontentement. Malgr les pronostics, continuent nos auteurs, la pluie ne tomba point. Mais quelques jours aprs, on entendit de nouveau la tonnerre retentir au loin. Les
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
336
comme une tradition trs respecte et parce qu'on en sort avec une impression de bien-tre moral. Quant aux autres considrations, elles n'ont qu'un rle complmentaire ; elles peuvent servir confirmer les fidles dans l'attitude que le rite leur prescrit ; elles ne sont pas la raison d'tre de cette attitude. Voil donc tout un ensemble de crmonies qui se proposent uniquement de rveiller certaines ides et certains sentiments, de rattacher le prsent au pass, l'individu la collectivit. Non seulement, en fait, elles ne peuvent servir d'autres fins, mais les fidles euxmmes ne leur demandent rien de plus. C'est une preuve nouvelle que l'tat psychique dans lequel se trouve le groupe assembl constitue bien la seule base, solide et stable, de ce qu'on pourrait appeler la mentalit rituelle. Quant aux croyances qui attribuent aux rites telle ou telle efficacit physique, elles sont choses accessoires et contingentes, puisqu'elles peuvent manquer sans que le rite soit altr dans ce qu'il a d'essentiel. Ainsi, les crmonies du Wollunqua, mieux encore que les prcdentes, mettent nu, pour ainsi dire, la fonction fondamentale du culte positif. Si d'ailleurs, nous avons spcialement insist sur ces solennits, c'est cause de leur exceptionnelle importance. Mais il en est d'autres qui ont exactement le mme caractre. Ainsi, il existe chez les Warramunga un totem du garon qui rit . Le clan qui porte ce nom a, disent Spencer et Gillen, la mme organisation que les autres groupes totmiques. Comme eux, il a ses lieux sacrs (mungai) o l'anctre fondateur a clbr des crmonies aux temps fabuleux, o il a laiss, derrire lui, des spirit-children qui sont devenus les hommes du clan; et les rites qui se rattachent ce totem sont indiscernables de ceux qui se rapportent aux totems animaux ou vgtaux . Il est pourtant vident qu'ils ne sauraient avoir d'efficacit physique. Ils consistent en une srie de quatre crmonies qui se rptent plus ou moins les unes les autres, mais qui sont uniquement destines amuser, provoquer le rire par le rire, c'est--dire, en somme, entretenir la gat et la bonne humeur dans le groupe qui a comme la spcialit de ces dispositions morales .
1211 1212
On trouve chez les Arunta eux-mmes plus d'un totem qui ne comporte pas d'autre Intichiuma. Nous avons vu en effet que, chez ce peuple, les plis ou les dpressions de terrains
anciens dirent que le Wollunqua grondait parce qu'il n'tait pas content de la manire dont le rite avait t accompli. Ainsi, un mme phnomne, le bruit du tonnerre, est tantt interprt comme un signe de dispositions favorables, tantt comme un indice d'intentions malveillantes. Il y a cependant un dtail rituel qui, si l'on acceptait l'explication qu'en proposent Spencer et Gillen, serait directement efficace. Suivant eux, la destruction du tumulus serait destine effrayer le Wollunqua et l'empcher, par une contrainte magique, de quitter sa retraite. Mais cette interprtation nous parat trs suspecte. En effet, dans la circonstance dont il vient d'tre question et o l'on annona que le Wollunqua tait mcontent, ce mcontentement tait attribu ce que l'on avait nglig de faire disparatre les dbris du tumulus. Cette disparition est donc rclame par le Wollunqua lui-mme, bien loin qu'elle soit destine l'intimider et exercer sur lui une influence coercitive. Ce n'est probablement qu'un cas particulier d'une rgle plus gnrale qui est en vigueur chez les Warramunga : les instruments du culte doivent tre dtruits aprs chaque crmonie. C'est ainsi que les ornements rituels dont sont revtus les officiants leur sont violemment arrachs, une fois que le rite est dtermin (North. Tr., p. 205). 1211 North. Tr., pp. 207-208. 1212 Ibid., p. 210.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
337
qui marquent l'endroit o quelque anctre a sjourn servent parfois de totems . A ces totems sont attaches des crmonies qui, manifestement, ne peuvent avoir d'effets physiques d'aucune sorte. Elles ne peuvent consister qu'en reprsentations dont l'objet est de commmorer le pass et elles ne peuvent viser aucun but, en dehors de cette commmoration .
1213 1214
En mme temps qu'elles nous font mieux comprendre la nature du culte, ces reprsentations rituelles mettent en vidence un important lment de la religion : c'est l'lment rcratif et esthtique. Dj nous avons eu l'occasion de montrer qu'elles sont proches parentes des reprsentations dramatiques . Cette parent apparat encore avec plus d'vidence dans les dernires crmonies dont il vient d'tre parl. Non seulement, en effet, elles emploient les mmes procds que le drame proprement dit, mais elles poursuivent un but de mme genre : trangres toute fin utilitaire, elles font oublier aux hommes le monde rel, pour les transporter dans un autre o leur imagination est plus l'aise ; elles distraient. Il arrive mme qu'elles aient jusqu' l'aspect extrieur d'une rcration : on voit les assistants rire et s'amuser ouvertement .
1215 1216
Les rites reprsentatifs et les rcrations collectives sont mme des choses tellement voisines qu'on passe d'un genre l'autre sans solution de continuit. Ce que les crmonies proprement religieuses ont de caractristique, c'est qu'elles doivent tre clbres sur un terrain consacr d'o les femmes et les non-initis sont exclus . Mais il en est d'autres o ce caractre religieux s'efface quelque peu sans disparatre compltement. Elles ont lieu en dehors du terrain crmoniel, ce qui prouve qu'elles sont dj laques quelque degr ; et cependant, les profanes, femmes et enfants, n'y sont pas encore admis. Elles sont donc sur la limite des deux domaines. En gnral, elles se rapportent des personnages lgendaires, mais qui n'ont pas de place rgulire dans les cadres de la religion totmique. Ce sont des esprits, le plus souvent malfaisants, qui sont plutt en rapports avec les magiciens qu'avec le commun des fidles, sortes de croquemitaines auxquels on ne croit pas avec le mme degr de srieux et la mme fermet de conviction qu'aux tres et aux choses proprement totmique . A mesure que se relche le lien qui rattache l'histoire de la tribu les vnements et les personnages reprsents, mesure aussi les uns et les autres prennent un air plus irrel et les crmonies correspondantes changent de nature. C'est ainsi qu'on entre progressivement dans le domaine de la pure fantaisie et qu'on passe du rite commmoratif au corrobbori vulgaire, simple rjouissance publique qui n'a plus rien de religieux et laquelle tout le monde peut indiffremment prendre part. Peut-tre mme certaines de ces reprsentations, dont l'unique
1217 1218
1213
V. dans la liste des totems dresse par STREHLOW, les nos 432-442 (II, p. 72). V. STREHLOW, III, p. 8. Il y a galement chez les Arunta un totem Worra qui ressemble beaucoup au totem du garon qui rit chez les Warramunga (ibid. et Ill, p. 124). Worra signifie jeunes gens. La crmonie a pour objet de faire en sorte que les jeunes gens prennent plus de plaisir au jeu de labara (v. sur ce jeu STREHLOW, I, p. 55, no 1). 1215 V. plus haut, p. 534. 1216 On trouvera un cas de ce genre dans North. Tr., p. 204. 1217 Nat. Tr., p. 118 et no 2, p. 618 et suiv.; North. Tr., p. 716 et suiv. Il y a toutefois des crmonies sacres dont les femmes ne sont pas totalement exclues (v. par exemple, North. Tr., p. 375 et suiv.); mais c'est l'exception. 1218 V. Nat. Tr., p. 329 et suiv.; North. Tr., p. 210 et suiv.
1214
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
338
objet est actuellement de distraire, sont-elles d'anciens rites qui ont chang de qualification. En fait, les frontires sont tellement flottantes entre ces deux sortes de crmonies qu'il en est dont il est impossible de dire avec prcision auquel des deux genres elles ressortissent .
1219
C'est un fait connu que les jeux et les principales formes de l'art semblent tre nes de la religion et qu'elles ont, pendant longtemps, gard un caractre religieux . On voit quelles en sont les raisons : c'est que le culte, tout en visant directement d'autres fins, a t en mme temps pour les hommes une sorte de rcration. Ce rle, la religion ne l'a pas jou par hasard, grce une heureuse rencontre, mais par une ncessit de sa nature. En effet, bien que, comme nous l'avons tabli, la pense religieuse soit tout autre chose qu'un systme de fictions, les ralits auxquelles elle correspond ne parviennent cependant s'exprimer religieusement que si l'imagination les transfigure. Entre la socit telle qu'elle est objectivement et les choses sacres qui la reprsentent symboliquement, la distance est considrable. Il a fallu que les impressions rellement ressenties par les hommes et qui ont servi de matire premire cette construction aient t interprtes, labores, transformes jusqu' devenir mconnaissables. Le monde des choses religieuses est donc, mais seulement dans sa forme extrieure, un monde partiellement imaginaire et qui, pour cette raison, se prte plus docilement aux libres crations de l'esprit. D'ailleurs, parce que les forces intellectuelles qui servent le faire sont intenses et tumultueuses, l'unique tche qui consiste exprimer le rel l'aide de symboles convenables ne suffit pas les occuper. Un surplus reste gnralement disponible qui cherche s'employer en oeuvres supplmentaires, superflues et de luxe, c'est--dire en oeuvres d'art. Il en est des pratiques comme des croyances. L'tat d'effervescence o se trouvent les fidles assembls se traduit ncessairement au dehors par des mouvements exubrants qui ne se laissent pas facilement assujettir des fins trop troitement dfinies. Ils s'chappent, en partie, sans but, se dploient pour le seul plaisir de se dployer, se complaisent en des sortes de jeux. Au reste, dans la mesure o les tres auxquels s'adresse le culte sont imaginaires, ils sont impropres contenir et rgler cette exubrance ; il faut la pression de ralits tangibles et rsistantes pour astreindre l'activit des adaptations exactes et conomiques. Aussi s'expose-t-on des mcomptes quand, pour expliquer les rites, on croit devoir assigner chaque geste un objet prcis et une raison d'tre dtermine. Il en est qui ne servent rien; ils rpondent simplement au besoin d'agir, de se mouvoir, de gesticuler que ressentent les fidles. On voit ceux-ci sauter, tourner, danser, crier, chanter, sans qu'il soit toujours possible de donner un sens cette agitation.
1220
Ainsi, la religion ne serait pas elle-mme si elle ne faisait pas quelque place aux libres combinaisons de la pense et de l'activit, au jeu, l'art, tout ce qui recre l'esprit fatigu parce qu'il y a de trop assujettissant dans le labeur quotidien : les causes mmes qui l'ont appele l'existence lui en font une ncessit. L'art n'est pas simplement un ornement extrieur dont le culte se parerait pour dissimuler ce qu'il peut avoir de trop austre et de trop rude :
1219
C'est le cas, par exemple, du corrobbori du Molonga chez les Pitta-Pitta du Queensland et les tribus voisines (v. ROTH, Ethnog. Studies among the N. W. Central Queensland Aborigines, p. 120 et suiv.). - On trouvera sur les corrobbori ordinaires des renseignements dans STIRLING, Rep. of the Horn Expedition Io Central Australia, Part. IV, p. 72 et dans ROTH, Op. cit., p. 117 et suiv. 1220 Voir notamment sur cette question le beau travail de CULIN, Games of the North American Indians (XXIVth Rep. of the Bureau of Amer. Ethnol.).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
339
mais, par lui-mme, le culte a quelque chose d'esthtique. A cause des rapports bien connus que la mythologie soutient avec la posie, on a voulu parfois mettre la premire en dehors de la religion , la vrit est qu'il y a une posie inhrente toute religion. Les crmonies reprsentatives qui viennent d'tre tudies rendent sensible cet aspect de la vie religieuse; mais il n'est gure de rites qui ne le prsentent quelque degr.
1221
Assurment, on commettrait la plus grave erreur si l'on ne voyait de la religion que cet unique aspect ou si mme on en exagrait l'importance. Quand un rite ne sert plus qu' distraire, ce n'est plus un rite. Les forces morales qu'expriment les symboles religieux sont des forces relles, avec lesquelles il nous faut compter et dont nous ne pouvons faire ce qu'il nous plat. Alors mme que le culte ne vise pas produire des effets physiques, niais se borne dlibrment agir sur les esprits, son action s'exerce dans un autre sens qu'une pure oeuvre d'art. Les reprsentations qu'il a pour fonction d'veiller et d'entretenir en nous ne sont pas de vaines images qui ne rpondent rien dans la ralit, que nous voquons sans but, pour la seule satisfaction de les voir apparatre et se combiner sous nos yeux. Elles sont aussi ncessaires au bon fonctionnement de notre vie morale que les aliments l'entretien de notre vit physique ; car c'est par elles que le groupe s'affirme et se maintient, et nous savons quel point il est indispensable l'individu. Un rite est donc autre chose qu'un jeu; il est de la vie srieuse. Mais, si l'lment irrel et imaginaire n'est pas essentiel, il ne laisse pas de jouer un rle qui n'est pas ngligeable. Il entre pour une part dans ce sentiment de rconfort que le fidle retire du rite accompli ; car la rcration est une des formes de cette rfection morale qui est l'objet principal du culte positif. Une fois que nous nous sommes acquitts de nos devoirs rituels, nous rentrons dans la vie profane avec plus de courage et d'ardeur, non seulement parce que nous nous sommes mis en rapports avec une source suprieure d'nergie, mais aussi parce que nos forces se sont retrempes vivre, pendant quelques instants, d'une vie moins tendue, plus aise et plus libre. Par l, la religion a un charme qui n'est pas un de ses moindres attraits. C'est pourquoi l'ide mme d'une crmonie religieuse de quelque importance veille naturellement l'ide de fte. Inversement, toute fte, alors mme qu'elle est purement laque par ses origines, a certains caractres de la crmonie religieuse, car, dans tous les cas, elle a pour effet de rapprocher les individus, de mettre en mouvement les masses et de susciter ainsi un tat d'effervescence, parfois mme de dlire, qui n'est pas sans parent avec l'tat religieux. L'homme est transport hors de lui, distrait de ses occupations et de ses proccupations ordinaires. Aussi observe-t-on de part et d'autre les mmes manifestations : cris, chants, musique, mouvements violents, danses, recherche d'excitants qui remontent le niveau vital, etc. On a souvent remarqu que les ftes populaires entranent aux excs, font perdre de vue la limite qui spare le licite et l'illicite ; il est galement des crmonies religieuses qui dterminent comme un besoin de violer les rgles ordinairement les plus respectes . Ce n'est
1222 1223
1221 1222
V. plus haut, p. 115. Notamment en matire sexuelle. Dans les corrobbori ordinaires, les licences sexuelles sont frquentes (v. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., pp. 96-97 et North. Tr., pp. 136-137). Sur les licences sexuelles dans les ttes populaires en gnral, v. HAGELSTANGE, Sddeutsches Bauernleben im Mittelalter, p. 221 et suiv. 1223 C'est ainsi que les rgles de l'exogamie sont violes obligatoirement au cours de certaines crmonies religieuses (v. plus haut, p. 309). Il ne faut probablement pas chercher ces licences un sens rituel prcis. C'est simplement une consquence mcanique de l'tat de surexcitation provoqu par la crmonie. C'est un
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
340
pas, certes, qu'il n'y ait pas lieu de diffrencier les deux formes de l'activit publique. La simple rjouissance, le corrobbori profane n'a pas d'objet srieux, tandis que, dans son ensemble, une crmonie rituelle a toujours un but grave. Encore faut-il observer qu'il n'y a peut-tre pas de rjouissance o la vie srieuse n'ait quelque cho. Au fond, la diffrence est plutt dans la proportion ingale suivant laquelle ces deux lments sont combins.
III
.
Un fait plus gnral vient confirmer les vues qui prcdent. Dans leur premier ouvrage, Spencer et Gillen prsentaient l'Intichiuma comme une entit rituelle parfaitement dfinie : ils en parlaient comme d'une opration exclusivement destine assurer la reproduction de l'espce totmique et il semblait qu'elle dt ncessairement perdre toute espce de sens en dehors de cette unique fonction. Mais dans leurs Northern Tribes of Central Australia, les mmes auteurs, sans peut-tre y prendre garde, tiennent un langage diffrent. Ils reconnaissent que les mmes crmonies peuvent indiffremment prendre place dans les Intichiuma proprement dits ou dans les rites d'initiation . Elles servent donc galement ou faire des animaux et des plantes de l'espce totmique, ou confrer aux novices les qualits ncessaires pour qu'ils deviennent membres rguliers de la socit des hommes . De ce point de vue, l'Intichiuma apparat sous un aspect nouveau. Ce n'est plus un mcanisme rituel distinct, reposant sur des principes qui lui sont propres, mais une application particulire de crmonies plus gnrales et qui peuvent tre utilises en vue de fins trs diffrentes. C'est pourquoi, dans leur nouvel ouvrage, avant de parler de l'Intichiuma et de l'initiation, ils consacrent un chapitre spcial aux crmonies totmiques en gnral, abstraction faite des formes diverses qu'elles peuvent prendre suivant les fins pour lesquelles elles sont employes .
1224 1225 1226
Cette indtermination foncire des crmonies totmiques n'avait t qu'indique par Spencer et Gillen et d'une manire assez indirecte ; mais elle vient d'tre confirme par Strehlow dans les termes les plus explicites. Quand, dit-il, on fait passer les jeunes novices par les diffrentes ftes de l'initiation, on excute devant eux une srie de crmonies qui, tout
exemple de ces rites qui n'ont pas, par eux-mmes, d'objet dfini, qui sont de simples dcharges d'activit (v. plus haut, p. 545). L'indigne lui-mme ne lui assigne pas de fin dtermine : on dit seulement que, si ces licences ne sont pas commises, le rite ne produira pas ses effets; la crmonie sera manque. 1224 Voici les expressions mmes dont se servent SPENCER et GILLEN : Elles (les crmonies qui se rapportent aux totems) sont souvent, mais non toujours, associes celles qui concernent l'initiation des jeunes gens, ou bien elles font partie des Intichiuma (North. Tr., p. 178). 1225 Nous laissons de ct la question de savoir en quoi ce caractre consiste. C'est un problme qui nous entranerait dans des dveloppements trs longs et trs techniques et qui, pour cette raison, demanderait tre trait part. Il n'intresse pas, d'ailleurs, les propositions qui sont tablies au cours du prsent ouvrage. 1226 C'est le chapitre VI intitul Ceremonies connected with the totems.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
341
en reproduisant jusque dans leurs dtails les plus caractristiques, les rites du culte proprement dit (entendez les rites que Spencer et Gillen appellent Intichiuma) n'ont cependant pas pour but de multiplier et de faire prosprer le totem correspondant . C'est donc la mme crmonie qui sert dans les deux cas; le nom seul n'est pas le mme. Quand elle a spcialement pour objet la reproduction de l'espce, on l'appelle mbatjalkatiuma et c'est seulement quand elle constitue un procd d'initiation qu'on lui donnerait le nom d'Intichiuma .
1227 1228
Encore, chez les Arunta, ces deux sortes de crmonies se distinguent-elles l'une de l'autre par certains caractres secondaires. Si la contexture du rite est la mme dans les deux cas, nous savons pourtant que les effusions de sang et, plus gnralement, les oblations caractristiques de l'Intichiuma arunta, manquent aux crmonies d'initiation. De plus, tandis que, chez ce mme peuple, l'Intichiuma a lieu un endroit que la tradition fixe rglementairement et o l'on est oblig de se rendre en plerinage, la scne sur laquelle ont lieu les crmonies de l'initiation est purement conventionnelle . Mais quand, comme c'est le cas chez les Warramunga, l'Intichiuma consiste en une simple reprsentation dramatique, l'indistinction est complte entre les deux rites. Dans l'un comme dans l'autre, on commmore le pass, on met le mythe en action, on le joue et on ne peut pas le jouer de deux manires sensiblement diffrentes. Une seule et mme crmonie sert donc, suivant les circonstances, deux fonctions distinctes .
1229 1230
Gillen d'avoir commise: ils auraient appliqu l'une des modalits du rite le terme qui convient plus spcialement l'autre. Mais, dans ces conditions, l'erreur ne semble pas avoir la gravit que lui attribue Strehlow. Elle peut mme se prter bien d'autres emplois. On sait que, le sang tant chose sacre, les femmes, ne doivent pas le voir couler. Il arrive pourtant qu'une querelle clate en leur prsence et, finalement, se termine par une effusion de sang. Une infraction rituelle se trouve ainsi commise. Or, chez les Arunta, l'homme dont le sang a coul le premier, doit, pour rparer cette faute, clbrer une crmonie qui se rapporte soit au totem de son pre soit celui de sa mre ; cette crmonie porte un nom spcial, Alua uparilima, qui signifie l'effacement du
1231
1227 1228
STREHLOW, III, pp. 1-2. Ainsi s'expliquerait l'erreur que Strehlow reproche Spencer et 1229 Elle ne peut mme pas avoir un autre caractre. En effet, comme l'initiation est une fte tribale, des novices de totems diffrents sont initis au mme moment. Les crmonies qui se succdent ainsi en un mme endroit se rapportent donc toujours plusieurs totems, et, par consquent, il faut bien qu'elles aient lieu en dehors des localits auxquelles elles se rattachent d'aprs le mythe. 1230 On peut s'expliquer maintenant d'o vient que nous n'ayons, nulle part, tudi les rites d'initiation en eux-mmes : c'est qu'ils ne constituent pas une entit rituelle, mais sont forms par un conglomrat de rites d'espces diffrentes. Il y a notamment des interdits, des rites asctiques, et des crmonies reprsentatives qui sont indistinctes de celles qui se clbrent lors de l'Intichiuma. Nous avons donc d dmembrer ce systme composite et traiter sparment de chacun des rites lmentaires qui le composent, en les classant avec les rites similaires dont il est ncessaire de les rapprocher. D'autre part, nous avons vu (p. 409 et suiv.), que l'initiation a servi de point de dpart une religion nouvelle qui tend dpasser le totmisme. Mais de cette religion il nous a suffi. de montrer que le totmisme contenait le germe ; nous n'avions pas en suivre le dveloppement. L'objet de ce livre est d'tudier les croyances et les pratiques lmentaires ; nous devons donc nous arrter au moment o elles donnent naissance des formes plus complexes. 1231 Nat. Tr., p. 463. Si l'individu peut, son choix, clbrer une crmonie soit du totem paternel soit du totem maternel, c'est que, pour les raisons exposes plus haut (p. 261), il participe de l'un et de l'autre.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
342
sang. Mais, en elle-mme, elle ne diffre pas de celles que l'on clbre lors de l'initiation ou dans les Intichiuma : elle reprsente un vnement de l'histoire ancestrale. Elle peut donc galement servir soit initier, soit agir sur l'espce animale, soit expier un sacrilge. Nous verrons plus loin qu'une crmonie totmique peut aussi tenir lieu de rite funraire .
1232
MM. Hubert et Mauss ont dj signal une ambigut fonctionnelle du mme genre dans le cas du sacrifice et, plus spcialement, du sacrifice hindou . Ils ont montr comment le sacrifice communiel, le sacrifice expiatoire, le sacrifice-vu, le sacrifice-contrat, n'taient que de simples variantes d'un seul et mme mcanisme, Nous voyons maintenant que le fait est beaucoup plus primitif et qu'il n'est nullement limit l'institution sacrificielle. Il n'existe peuttre pas de rite qui ne prsente une semblable indtermination. La messe sert aux mariages comme aux enterrements ; elle rachte les fautes des morts, elle assure aux vivants les faveurs de la divinit, etc. Le jene est une expiation et une pnitence ; mais c'est aussi une prparation la communion; il confre mme des vertus positives. Cette ambigut dmontre que la fonction relle d'un rite consiste, non dans les effets particuliers et dfinis qu'il parat viser et par lesquels on le caractrise d'ordinaire, mais d'une action gnrale qui, tout en restant toujours et partout semblable elle-mme, est cependant susceptible de prendre des formes diffrentes suivant les circonstances. Or, c'est prcisment ce que suppose la thorie que nous avons propose. Si le vritable rle du culte est d'veiller chez les fidles un certain tat d'me, fait de force morale et de confiance, si les effets divers qui sont imputs aux rites ne sont dus qu' une dtermination secondaire et variable de cet tat fondamental, il n'est pas surprenant qu'un mme rite, tout en gardant la mme composition et la mme structure, paraisse produire de multiples effets. Car les dispositions mentales qu'il a pour fonction permanente de susciter restent les mmes dans tous les cas; elles dpendent du fait que le groupe est assembl, non des raisons spciales pour lesquelles il s'est assembl. Mais d'un autre ct, elles sont interprtes diffremment suivant les circonstances auxquelles elles s'appliquent. Est-ce un rsultat physique qu'on veut obtenir ? La confiance ressentie fera croire que ce rsultat est ou sera obtenu par les moyens employs. A-t-on commis quelque faute que l'on veut effacer ? Le mme tat d'assurance morale fera prter aux mmes gestes rituels des vertus expiatoires. Ainsi, l'efficacit apparente semblera changer alors que l'efficacit relle reste invariable, et le rite paratra remplir des fonctions diverses bien qu'en fait il n'en ait qu'une, toujours la mme.
1233
Inversement, de mme qu'un seul rite peut servir plusieurs fins, plusieurs rites peuvent produire le mme effet et se remplacer mutuellement. Pour assurer la reproduction de l'espce totmique, on peut galement recourir des oblations, des pratiques initiatives ou des reprsentations commmoratives. Cette aptitude des rites se substituer les uns aux autres prouve nouveau, tout comme leur plasticit, l'extrme gnralit de l'action utile qu'ils exercent. Ce qui est essentiel, c'est que des individus soient runis, que des sentiments communs soient ressentis et qu'ils s'expriment par des actes communs ; mais quant la nature particulire de ces sentiments et de ces actes, c'est chose relativement secondaire et contingente. Pour prendre conscience de soi, le groupe n'a pas besoin de produire tels gestes plutt que tels autres. Il faut qu'il communie dans une mme pense et dans une mme action; mais peu importent les espces sensibles sous lesquelles a lieu cette communion. Sans doute, ce n'est
1232 1233
V. plus bas, chap. V, p. 565. V. Essai sur le sacrifice, in Mlanges d'histoire des religions, p, 83.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
343
pas au hasard que se dterminent ces formes extrieures ; elles ont leurs raisons ; mais ces raisons ne tiennent pas ce qu'il y a d'essentiel dans le culte. Tout nous ramne donc la mme ide : c'est que les rites sont, avant tout, les moyens par lesquels le groupe social se raffirme priodiquement. Et par l, peut-tre, pouvons-nous arriver reconstruire hypothtiquement la manire dont le culte totmique a d, primitivement, prendre naissance. Des hommes qui se sentent unis, en partie par les liens du sang, mais plus encore par une communaut d'intrts et de traditions, s'assemblent et prennent conscience de leur unit morale. Pour les raisons que nous avons exposes, ils sont amens se reprsenter cette unit sous la forme d'une sorte trs spciale de consubstantialit : ils se considrent comme participant tous de la nature d'un animal dtermin. Dans ces conditions, il n'y aura pour eux qu'une manire d'affirmer leur existence collective : c'est de s'affirmer eux-mmes comme des animaux de cette mme espce, et cela non pas seulement dans le silence de la conscience, mais par des actes matriels. Ce sont ces actes qui constitueront le culte, et ils ne peuvent videmment consister qu'en mouvements par lesquels l'homme imite l'animal avec lequel il s'identifie. Ainsi entendus, les rites imitatifs apparaissent comme la forme premire du culte. On trouvera que c'est attribuer un rle historique bien considrable des pratiques qui, au premier abord, font l'effet de jeux enfantins. Mais, comme nous l'avons montr, ces gestes nafs et gauches, ces procds grossiers de figuration, traduisent et entretiennent un sentiment de fiert, de confiance et de vnration tout fait comparable celui qu'expriment les fidles de religions les plus idalistes quand, assembls, ils se proclament les enfants du Dieu toutpuissant. Car, dans un cas comme dans l'autre, ce sentiment est fait des mmes impressions de scurit et de respect qu'veille, dans les consciences individuelles, cette grande force morale qui les domine et qui les soutient, et qui est la force collective. Les autres rites dont nous avons fait l'tude ne sont vraisemblablement que des modalits de ce rite essentiel. Une fois admise l'troite solidarit de l'animal et de l'homme, on sentit vivement la ncessit d'assurer la reproduction rgulire de l'espce totmique et on fit de cette reproduction l'objet principal du culte. Ces pratiques imitatives qui, l'origine, n'avaient, sans doute, qu'un but moral, se trouvrent donc subordonnes une fin utilitaire et matrielle et on les conut comme des moyens de produire le rsultat dsir. Mais, mesure que, par suite du dveloppement de la mythologie le hros ancestral, primitivement confondu avec l'animal totmique, s'en distingua davantage, mesure qu'il se fit une figure plus personnelle, l'imitation de l'anctre se substitua l'imitation de l'animal on s'y juxtaposa, et les crmonies reprsentatives remplacrent ou compltrent les rites mimtiques. Enfin, pour atteindre plus srement le but o l'on tendait, on prouva le besoin de mettre en oeuvre tous les moyens dont on disposait. On avait sous la main les rserves de forces vives qui taient accumules dans les rochers sacrs, on les, utilisa ; puisque le sang de l'homme tait de mme nature que celui de l'animal, on s'en servit dans, le mme but et on le rpandit. Inversement, en raison de cette mme parent, l'homme employa la chair de l'animal pour refaire sa propre substance. De l, les rites d'oblation et de communion. Mais, en dfinitive, toutes ces pratiques diverses ne sont que des variantes d'un seul et mme thme: partout, la base, on retrouve le mme tat d'esprit interprt diffremment suivant les situations, les moments de l'histoire et les dispositions des fidles.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
344
CHAPITRE V
LES RITES PIACULAIRES ET L'AMBIGUT DE LA NOTION DU SACR
.
Si diffrents qu'ils soient les uns des autres par la nature des gestes qu'ils impliquent, les divers rites positifs que nous venons de passer en revue ont un caractre commun : tous sont accomplis dans un tat de confiance, d'allgresse et mme d'enthousiasme. Bien que l'attente d'un vnement futur et contingent n'aille pas sans quelque incertitude, il est cependant normal que la pluie tombe quand la saison est venue, que les espces animales et vgtales se reproduisent rgulirement. Une exprience, bien des fois rpte, a dmontr que, en principe, les rites produisent l'effet qu'on en espre et qui est leur raison d'tre. On les clbre avec scurit, en jouissant par avance de l'heureux vnement qu'ils prparent et qu'ils annoncent. Les mouvements que l'on excute participent de cet tat d'esprit : ils sont, sans doute, empreints de la gravit que suppose toujours une solennit religieuse, mais cette gravit n'exclut ni l'entrain ni la joie. Ce sont des ftes joyeuses. Mais il existe aussi des ftes tristes qui ont pour objet ou de faire face une calamit ou, tout simplement, de la rappeler et de la dplorer. Ces rites ont une physionomie trs particulire que nous allons chercher caractriser et expliquer. Il est d'autant plus ncessaire de les tudier part qu'ils vont nous rvler un aspect nouveau de la vie religieuse. Nous proposons d'appeler piaculaires les crmonies de ce genre. Le terme de piaculum a, en effet, cet avantage que, tout en veillant l'ide d'expiation, il a pourtant une signification beaucoup plus tendue. Tout malheur, tout ce qui est de mauvais augure, tout ce qui inspire des sentiments d'angoisse ou de crainte ncessite un piaculum et, par consquent, est appel piaculaire . Le mot parat donc trs propre dsigner des rites qui se clbrent dans l'inquitude ou dans la tristesse.
1234
1234
Piacularia auspicia appellabant quae sacrificantibus tristia portendebant (Paul ex Fest., p. 244, d. Muller). Le mot de piaculum est mme employ comme synonyme de malheur. Vetonica herba, dit Pline, tantum gloriae habet ut domus in qua sala sit tula existimetur a piaculis omnibus (XXV, 8, 46).
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
345
I
.
Le deuil nous offre un premier et important exemple de rites piaculaires. Toutefois, entre les diffrents rites qui constituent le deuil une distinction est ncessaire. Il en est qui consistent en de pures abstentions : il est interdit de prononcer le nom du mort , de sjourner l'endroit o le dcs a eu lieu ; les parents, surtout ceux du sexe fminin, doivent s'abstenir de toute communication avec les trangers ; les occupations ordinaires de la vie sont suspendues, de mme qu'en temps de fte , etc. Toutes ces pratiques ressortissent au culte ngatif, s'expliquent comme les rites du mme genre et, par consquent, n'ont pas nous occuper ici. Elles viennent de ce que le mort est un tre sacr. Par suite, tout ce qui est ou a t en rapports avec lui se trouve, par contagion, dans un tat religieux qui exclut tout contact avec les choses de la vie profane.
1235 1236 1237 1238
Mais le deuil n'est pas fait uniquement d'interdits observer. Des actes positifs sont exigs dont les parents sont la fois, les agents et les patients. Trs souvent, ces rites commencent ds le moment o la mort parait imminente. Voici une scne dont Spencer et Gillen ont t les tmoins chez les Warramunga. Une crmonie totmique venait d'tre clbre et la troupe des acteurs et des spectateurs quittait le terrain consacr quand, tout coup, un cri perant s'leva du campement: un homme tait en train d'y mourir. Aussitt, toute la compagnie se mit courir aussi vite que possible et la plupart, tout en courant, commenaient dj pousser des cris. Entre nous et le camp, racontent ces observateurs, il y avait un ruisseau profond sur les bords duquel plusieurs hommes taient assis ; dissmins et l, la tte penche entre les genoux, ils pleuraient et gmissaient. En traversant le ruisseau, nous trouvmes, suivant l'usage, le camp mis en pices. Des femmes, venues de toutes les directions, taient couches sur le corps du mourant, tandis que d'autres, qui se tenaient tout autour, debout ou agenouilles, s'enfonaient dans le sommet de la tte la pointe de leurs btons dterrer les ignames, se faisant ainsi des blessures d'o le sang coulait flots sur leur visage. En mme temps, elles faisaient entendre une plainte ininterrompue. Sur ces entrefaites, des hommes accourent ; eux aussi se jettent sur le corps tandis que les femmes se relvent ; au bout de quelques instants, on ne voit plus qu'une masse grouillante de corps entrelacs. A ct, trois hommes de la classe Thapungarti, qui portaient encore leurs dcorations crmonielles, taient assis, et, le dos tourn au mourant, poussaient des gmissements aigus. Au bout d'une minute ou deux, un autre homme de la mme classe se prcipite sur le terrain, hurlant de douleur et brandissant un couteau de pierre. Aussitt qu'il a atteint le camp, il se fait des incisions profondes travers les cuisses, dans les muscles, si bien
1235 1236 1237 1238
North. Tr., p. 526; EYLMANN, p. 239. Cf. plus haut, p. 436. BROUGH SMYTH, I, p. 106; DAWSON, p. 64; EYLMANN, p. 239. DAWSON, p. 66; EYLMANN, p. 241. Nat. Tr., p. 502; DAWSON, p. 67.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
346
que, incapable de se tenir, il finit par tomber par terre au milieu d'un groupe ; deux ou trois femmes de ses parentes l'en retirent et appliquent leurs lvres sur ses blessures bantes, tandis qu'il gt inanim sur le sol . Le malade ne mourut que tard dans la soire. Aussitt qu'il eut rendu le dernier soupir, la mme scne recommena nouveaux frais. Seulement, cette fois, les gmissements taient encore plus perants. Hommes et femmes, saisis par une vritable frnsie, couraient, s'agitaient, se faisaient des blessures avec des couteaux, avec des btons pointus ; les femmes se frappaient les unes les autres sans qu'aucune chercht se garantir d'es coups. Enfin, au bout d'une heure, une procession se droula, la lueur des torches, travers la plaine, jusqu' l'arbre dans les branches duquel le corps fut dpos .
1239
Quelle que soit la violence de ces manifestations, elles sont troitement rgles par l'tiquette. Les individus qui se font des incisions sanglantes sont dsigns par l'usage : ils doivent soutenir avec le mort des rapports de parent dtermins. Ainsi, chez les Warramunga, dans le cas observ par Spencer et Gillen, ceux qui se tailladaient les cuisses taient le grand-pre maternel du dfunt, son oncle maternel, l'oncle maternel et le frre de sa femme . D'autres sont tenus de se couper les favoris et les cheveux et de se couvrir ensuite le cuir chevelu de terre de pipe. Les femmes ont des obligations particulirement svres. Elles doivent se couper les cheveux, s'enduire de terre de pipe le corps tout entier ; de plus, un silence absolu leur est impos pendant tout le temps du deuil qui peut durer jusqu' deux ans. Par suite de cette interdiction, il n'est pas rare que, chez les Warramunga, toutes les femmes d'un campement soient condamnes au silence le plus complet. Elles en prennent si bien l'habitude que, mme aprs l'expiration de la priode de deuil, elles renoncent volontairement au langage parl et emploient de prfrence le langage par gestes qu'elles manient, d'ailleurs, avec une remarquable habilet. Spencer et Gillen ont connu une vieille femme qui tait reste sans parler pendant plus de vingt-quatre ans .
1240 1241
La crmonie que nous avons dcrite ouvre une longue srie de rites qui se succdent pendant des semaines et des mois. On la renouvelle les jours suivants, sous des formes diverses. Des groupes d'hommes et de femmes se tiennent assis par terre, pleurant, se lamentant, s'embrassant des moments dtermins. Ces embrassements rituels se rptent frquemment pendant la dure du deuil. Les individus prouvent, semble-t-il, le besoin de se rapprocher et de communier plus troitement; on les voit serrs les uns contre les autres et entrelacs au point de former une seule et mme masse d'o s'chappent de bruyants gmissements . Entre temps, les femmes recommencent se lacrer la tte, et, pour exasprer les blessures qu'elles se font, elles vont jusqu' y appliquer des pointes de btons rougies au feu .
1242 1243
1239
North. Tt.,pp. 516-517. Ibid., pp. 520-521. Les auteurs ne nous disent pas s'il s'agit de parents tribaux ou de parents de sang. La premire hypothse est la plus vraisemblable. 1241 North. Tr., pp. 525-526. Cette interdiction de parler, spciale aux femmes, bien qu'elle consiste en une simple abstention, a tout l'air d'un rite piaculaire : c'est une manire de se gner. C'est pourquoi nous le mentionnons ici. Le jene galement peut, selon les circonstances, constituer un rite piaculaire ou un rite asctique. Tout dpend des conditions dans lesquelles il a lieu et du but poursuivi (v. sur la diffrence entre ces deux sortes de rites, plus bas, p. 567). 1242 On trouvera dans North. Tr., p. 525, une gravure trs expressive o ce rite est reprsent. 1243 Ibid., p. 522.
1240
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
347
Ces sortes de pratiques sont gnrales dans toute l'Australie. Les rites funraires, c'est-dire les soins rituels donns au cadavre, la manire dont il est enseveli, etc., changent avec les tribus , et, dans une mme tribu, ils varient avec l'ge, le sexe, la valeur sociale des individus . Mais les crmonies du deuil proprement dit reproduisent partout le mme thme; les variantes ne sont que de dtail. Partout, c'est le mme silence entrecoup de gmissements , la mme obligation de se couper les cheveux ou la barbe , de s'enduire la tte de terre de pipe, ou de se la couvrir de cendres, voire mme d'excrments ; partout, enfin, c'est la mme fureur se frapper, se lacrer, se brler. Dans le centre de Victoria, quand un cas de mort survient, les femmes pleurent, se lamentent, se dchirent la peau de tempes avec leurs ongles. Les parents du dfunt se lacrent avec rage, spcialement si c'est un fils qu'ils ont perdu. Le pre se frappe la tte avec un tomahawk et pousse d'amers gmissements. La mre, assise prs du feu, se brle la poitrine et le ventre avec un bton rougi au feu... Parfois, ces brlures sont si cruelles que la mort en rsulte . D'aprs un rcit de Broug Smyth, voici ce qui se passe dans les tribus mridionales du mme tat. Une fois que le corps est descendu dans la fosse, la veuve commence ses funbres crmonies. Elle se coupe les cheveux sur le devant de la tte et, parvenue un vritable tat de frnsie, elle saisit des btons rougis au feu et se les applique sur la poitrine, sur les bras, les jambes, les cuisses. Elle semble se dlecter aux tortures qu'elle s'inflige. Il serait tmraire et, d'ailleurs, inutile de chercher l'arrter. Quand, puise, elle ne peut plus marcher, elle s'efforce encore de donner des coups de pieds dans les cendres du foyer et de les lancer dans toutes les directions.
1244 1245 1246 1247 1248 1249
Tombe par terre, elle prend les cendres dans ses mains et en frotte ses blessures ; puis elle S'gratigne la figure (la seule partie du corps que les btons passs au feu n'aient pas touche). Le sang qui coule vient se mler aux cendres qui recouvrent ses plaies et, tout en s'gratignant, elle pousse des cris et des lamentations .
1250
La description que nous donne Howitt des rtes du deuil chez les Kurnai ressemble singulirement aux prcdentes. Une fois que le corps a t envelopp dans des peaux d'opossum et enferm dans un linceul d'corce, une hutte est construite o les parents se runissent. L, tendus par terre, ils se lamentent sur leur sort, disant par exemple : Pourquoi nous as-tu laisss? De temps en temps, leur douleur est exaspre par les gmissements perants que pousse l'un d'eux : la femme du dfunt crie mon mari est mort, ou la mre, mon enfant est mort. Chacun des assistants rpte le mme cri : les mots seuls changent suivant le lien de parent qui les unit au mort. Avec des pierres tranchantes ou des
1244
V. sur les principales sortes de rites funraires HOWITT, Nat. Tr., p. 446-508, pour les tribus du SudEst; SPENCER et GILLEN, North. Tr., p. 505 et Nat. Tr., p. 497 et suiv., pour les tribus du centre ; ROTH, North Queensland Ethnog., Bull. no 9, in Records of the Australian Museum, VI, ne 5, p. 365 et suiv. (Burial Ceremonies and Disposal of the Dead). 1245 V. notamment ROTH, loc. cit., p. 368; EYRE, Journals of Exped. into Central Australia, 11, pp. 344345, 347. 1246 SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 500; North. Tr., pp. 507, 508; EYLMANN, p. 241; Langloh PARKER, The Euahlayi, p. 83 et suiv. ; BROUGH SMYTH, I, p. 118. 1247 Dawson, p. 66; HOWITT, Nat. Tr., p. 466; EYLMANN, pp. 239-240. 1248 BROUGH SMYTH, I, p. 113. 1249 W. E. STANBRIDGE, Trans. Ethnological Society of London, n. s., tome I, p. 286. 1250 BROUGH SMYTH, I, p. 104.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
348
tomahawks, ils se frappent et se dchirent jusqu' ce que leurs ttes et leurs corps ruissellent de sang. Les pleurs et les gmissements continuent toute la nuit .
1251
La tristesse n'est pas le seul sentiment qui s'exprime au cours de ces crmonies ; une sorte de colre vient gnralement s'y mler. Les parents ont comme un besoin de venger, par un moyen quelconque, la mort survenue. On les voit se prcipiter les uns sur les autres et chercher se blesser mutuellement. Quelquefois l'attaque est relle ; quelquefois, elle est feinte . Il y a mme des cas o des sortes de combats singuliers sont rgulirement organiss. Chez les Kaitish, la chevelure du dfunt revient de droit son gendre. Celui-ci, en retour, est tenu de s'en aller, accompagn par une troupe de parents et d'amis, provoquer un de ses frres tribaux, c'est--dire un homme qui appartient la mme classe matrimoniale que lui et qui, ce titre, aurait pu pouser galement la fille du mort. La provocation ne peut tre refuse et les deux combattants s'infligent de srieuses blessures aux paules et aux cuisses. Le duel termin, le provocateur remet son adversaire la chevelure dont il avait provisoirement hrit. Ce dernier s'en va, son tour, provoquer et combattre un autre de ses frres tribaux qui la prcieuse relique est ensuite transmise, mais toujours titre provisoire ; elle passe ainsi de mains en mains et circule de groupe en groupe . D'ailleurs, dans l'espce de rage avec laquelle chaque parent se frappe, se brle ou se taillade, il entre dj quelque chose de ces mmes sentiments : une douleur qui atteint ce paroxysme ne va pas sans colre. On ne peut pas n'tre pas frapp des ressemblances que reprsentent ces pratiques avec celles de la vendetta. Les unes et les autres procdent de ce mme principe que la mort appelle des effusions de sang. Toute la diffrence est que, dans un cas, les victimes sont des parents et, dans l'autre, des trangers. Nous n'avons pas traiter spcialement de la vendetta qui ressortit plutt l'tude des institutions juridiques ; il convenait pourtant de montrer comment elle se rattache aux rites du deuil dont elle annonce la fin .
1252 1253 1254
Dans certaines socits, le deuil se termine par une crmonie dont l'effervescence atteint ou dpasse encore celle qui se produit lors des crmonies inaugurales. Chez les Arunta, ce rite de clture est appel Urpmilchima. Spencer et GILLEN ont assist deux de ces rites. L'un tait clbr en l'honneur d'un homme, l'autre, d'une femme. Voici la description qu'ils nous donnent du dernier .
1255
On commence par fabriquer des ornements d'un genre trs particulier, nomms Chimurilia par les hommes et Aramurilia par les femmes. Avec une sorte de rsine, on fixe de petits os d'animaux, antrieurement recueillis et mis de ct, des boucles de cheveux que des parentes de la morte ont fournies. On attache ces sortes de pendentifs un de ces bandeaux de tte que les femmes portent communment et on y ajoute des plumes de kakatos blanc et de perroquet. Ces prparatifs termins, les femmes s'assemblent dans leur camp. Elles se peignent le corps de couleurs diffrentes suivant leur degr de parent avec la dfunte. Aprs s'tre tenues
1251
HOWITT, Nat. Tr., p. 459. On trouvera des scnes analogues dans EYRE, op. cit., II, p. 255 n. et p. 347 ; ROTH, loc. cit., pp. 394, 395, notamment ; GREY, II, p. 320 et suiv. 1252 BROUGH SMYTH, I, pp. 104, 112; Roth, loc. cit., p. 382. 1253 North. Tr., pp. 511-512. 1254 DAWSON, p. 67 ; ROTH, loc. cit., pp. 366-367. 1255 Nat. Tr., pp. 508-510.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
349
embrasses les unes les autres pendant une dizaine de minutes, tout en faisant entendre un gmissement ininterrompu, elles se mettent en marche pour le tombeau. A une certaine distance, elles rencontrent un frre de sang de la morte, qu'accompagnent quelques-uns de ses frres tribaux. Tout le monde s'assied par terre et les lamentations recommencent. Un pitchi qui contient les Chimurilia est alors prsent au frre an qui le serre contre son estomac ; on dit que c'est un moyen d'apaiser sa douleur. On sort un de ces Chimurilia et la mre de la morte s'en coiffe pendant quelques instants; puis, il est remis dans le pitchi que les autres hommes serrent, tour de rle, contre leur poitrine. Enfin, le frre met les Chimurilia sur la tte des deux surs anes et on reprend le chemin du tombeau. En route, la mre se jette plusieurs reprises par terre, cherchant se taillader la tte avec un bton pointu. A chaque fois, les autres femmes la relvent et semblent proccupes de l'empcher de se faire du mal. Une fois parvenue au tombeau, elle se prcipite sur le tertre, s'efforce de le dtruire avec ses mains, tandis que les autres femmes dansent littralement sur elle. Les mres tribales et les tantes (surs du pre de la morte) suivent son exemple ; elles aussi se jettent sur le sol, se frappent, se dchirent mutuellement ; leur corps finit par tre tout ruisselant de sang. Au bout d'un certain temps, on les entrane l'cart. Les surs anes font alors dans la terre du tombeau un trou o elles dposent les Chimurilia, pralablement mis en pices. Une fois de plus, les mres tribales se jettent par terre et se tailladent la tte les unes des autres. A ce moment, les pleurs et les gmissements des femmes qui se tenaient tout autour semblaient les porter au dernier degr de l'excitation. Le sang qui coulait tout le long de leur corps par-dessus la terre de pipe dont il tait enduit leur donnait un air de spectres. A la fin, la vieille mre resta seule couche sur le tombeau, compltement puise et gmissant faiblement. Alors les autres la relevrent, la dbarrassrent de la terre de pipe dont elle tait recouverte ; ce fut la fin de la crmonie et du deuil .
1256 1257
Chez les Warramunga, le rite final prsente des caractres assez particuliers. Les effusions de sang ne semblent pas y tenir de place ; mais l'effervescence collective se traduit d'une autre manire. Chez ce peuple, le corps avant d'tre dfinitivement enterr, est expos sur une sorte de plate-forme que l'on place dans les branches d'un arbre ; on le laisse s'y dcomposer lentement jusqu' ce qu'il ne reste plus que les os. On les recueille alors, et, l'exception d'un humrus, on les dpose l'intrieur d'une fourmilire. L'humrus est envelopp dans un tui d'corce que l'on orne de diffrentes manires. L'tui est apport au camp au milieu des cris et des gmissements des femmes. Pendant les jours qui suivent, on clbre une srie de crmonies totmiques qui se rapportent au totem du dfunt et l'histoire mythique des anctres dont le clan est descendu. C'est quand toutes ces crmonies sont termines qu'on procde au rite de clture. Une tranche, profonde d'un pied et longue de quinze, est pratique sur le terrain crmoniel. Auparavant, on a excut sur le sol, quelque distance de l, un dessin totmique qui reprsente le totem du mort et certains des endroits o l'anctre a sjourn. Tout prs de ce
1256 1257
Petit vaisseau en bois dont il a dj t question plus haut, p. 477. Nat. Tr., pp. 508-510. L'autre rite final auquel assistrent Spencer et GILLEN est dcrit aux pp. 503508 du mme ouvrage. Il ne diffre pas essentiellement de celui que nous venons d'analyser.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
350
dessin, une petite fosse a t creuse dans la terre. Dix hommes dcors s'avancent alors les uns derrire les autres et, les mains croises derrire la tte, les jambes cartes, ils se tiennent audessus de la tranche. A un signal donn, les femmes accourent du camp dans le plus profond silence ; une fois proximit, elles se mettent en file indienne, la dernire tenant entre ses mains l'tui qui contient l'humrus. Puis, toutes se jettent par terre et, marchant sur les mains et sur les genoux, elles passent, tout le long de la tranche, entre les jambes cartes des hommes. La scne dnote un grand tat d'excitation sexuelle. Aussitt que la dernire femme a pass, on lui enlve l'tui, on le porte vers la fosse auprs de laquelle se tient un vieillard; celui-ci, d'un coup sec, brise l'os et on enterre prcipitamment les dbris. Pendant ce temps, les femmes sont restes plus loin, le dos tourn la scne qu'il leur est interdit de regarder. Mais quand elles entendent le coup de hache, elles s'enfuient en poussant des cris et des gmissements. Le rite est accompli; le deuil est termin .
1258
II
.
Ces rites ressortissent un type trs diffrent de ceux que nous avons prcdemment constitus. Ce n'est pas dire que l'on ne puisse trouver entre les uns et les autres des ressemblances importantes que nous aurons noter ; mais les diffrences sont peut-tre plus apparentes. Au lieu de danses joyeuses, de chants, de reprsentations dramatiques qui distraient et qui dtendent les esprits, ce sont des pleurs, des gmissements, en un mot, les manifestations les plus varies de la tristesse angoisse et d'une sorte de piti mutuelle, qui tiennent toute la scne. Sans doute, il y a galement, au cours de l'Intichiuma, des effusions de sang ; mais ce sont des oblations faites dans un mouvement de pieux enthousiasme. Si les gestes se ressemblent, les sentiments qu'ils expriment sont diffrents et mme opposs. De mme, les rites asctiques impliquent bien des privations, des abstinences, des mutilations, mais qui doivent tre supportes avec une fermet impassible et une sorte de srnit. Ici, au contraire, l'abattement, les cris, les pleurs sont de rgle. L'ascte se torture pour attester, ses yeux et aux yeux de ses semblables, qu'il est au-dessus de la souffrance. Dans le deuil, on se fait du mal pour prouver que l'on souffre. On reconnat tous ces signes les traits caractristiques des rites piaculaires. Comment donc s'expliquent-ils ? Un premier fait est constant : c'est que le deuil n'est pas l'expression spontane d'motions individuelles . Si les parents pleurent, se lamentent, se meurtrissent, ce n'est pas qu'ils se sentent personnellement atteints par la mort de leur proche. Sans doute, il peut se faire, dans des cas particuliers, que le chagrin exprim soit rellement ressenti . Mais, le plus gnrale1259 1260
1258
North. Tr., pp. 531-540. Contrairement ce que dit JEVONS, Introd. to the History of Relig., p. 46 et suiv. 1260 C'est ce qui fait dire DAWSON que le deuil est sincrement port (p. 66). Mais EYLMANN assure n'avoir connu qu'un seul cas o il y ait en blessure par chagrin rellement ressenti (op. cit., p. 113).
1259
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
351
ment, il n'y a aucun rapport entre les sentiments prouvs et les gestes excuts par les acteurs du rite . Si. au moment mme o les pleureurs paraissent le plus accabls par la douleur, on leur adresse la parole pour les entretenir de quelque intrt temporel, il arrive souvent qu'ils changent aussitt de visage et de ton, prennent un air riant et causent le plus gaiement du monde . Le deuil n'est pas un mouvement naturel de la sensibilit prive, froisse par une perte cruelle ; c'est un devoir impos par le groupe. On se lamente, non pas simplement parce qu'on est triste, mais parce qu'on est tenu de se lamenter. C'est une attitude rituelle qu'on est oblig d'adopter par respect pour l'usage, mais qui est, dans une large mesure, indpendante de l'tat affectif des individus. Cette obligation est, d'ailleurs, sanctionne par des peines ou mythiques ou sociales. On croit, par exemple, que quand un parent ne porte pas le deuil comme il convient, l'me du mort s'attache ses pas et le tue . Dans d'autres cas, la socit ne s'en remet pas aux forces religieuses du soin de punir les ngligents ; elle intervient elle-mme et rprime les fautes rituelles. Si un gendre ne rend pas son beau-pre les devoirs funraires qu'il lui doit, s'il ne se fait pas les incisions prescrites, ses beaux-pres tribaux lui reprennent sa femme et la donnent un autre . Aussi, pour se mettre en rgle avec l'usage, force-t-on parfois les larmes couler par des moyens artificiels .
1261 1262 1263 1264 1265
D'o vient cette obligation ? Ethnographes et sociologues se sont gnralement contents de la rponse que les indignes eux-mmes font cette question. On dit que le mort veut tre pleur, qu'en lui refusant le tribut de regrets auxquels il a droit, on l'offense, et que le seul moyen de prvenir sa colre est de se conformer ses volonts .
1266
Mais cette explication mythologique ne fait que modifier les termes du problme, sans le rsoudre; car encore faudrait-il savoir pourquoi le mort rclame imprativement le deuil. On dira qu'il est dans la nature de l'homme de vouloir tre plaint et regrett. Mais expliquer par ce sentiment l'appareil complexe de rites qui constitue le deuil, c'est prter l'Australien des exigences affectives dont le civilis lui-mme ne fait pas preuve. Admettons - ce qui n'est pas vident a priori - que l'ide de n'tre pas oubli trop vite soit naturellement douce l'homme qui pense l'avenir. Il resterait tablir qu'elle a jamais tenu assez de place dans le cur des vivants pour qu'on ait pu raisonnablement attribuer aux morts une mentalit qui procderait presque tout entire de cette proccupation. Surtout, il parat invraisemblable qu'un tel sentiment ait pu obsder et passionner ce point des hommes qui ne sont gure habitus penser au del de l'heure prsente. Loin que le dsir de se survivre dans la mmoire de ceux qui restent en vie doive tre considr comme l'origine du deuil, on en vient bien plutt se demander si ce ne serait pas le deuil lui-mme qui, une fois institu, aurait veill l'ide et le got des regrets posthumes.
1261 1262 1263 1264 1265 1266
Nat. Tr., p. 510. EYLMANN, pp. 238-239. North. Tr., p. 507; Nat. Tr., p. 498. Nat. Tr., p. 500; Eylmann, p. 227. BROUGH SMYTH, I, p. 114. Nat. Tr., p. 510.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
352
L'interprtation classique apparat comme plus insoutenable encore quand on sait ce qui constitue le deuil primitif. Il n'est pas fait simplement de pieux regrets accords celui qui n'est plus, mais de dures abstinences et de cruels sacrifices. Le rite n'exige pas seulement qu'on pense mlancoliquement au dfunt, mais qu'on se frappe, qu'on se meurtrisse, qu'on se lacre, qu'on se brle. Nous avons mme vu que les gens en deuil mettent se torturer un tel emportement que, parfois, ils ne survivent pas leurs blessures. Quelle raison le mort a-t-il de leur imposer ces supplices ? Une telle cruaut dnote de sa part autre chose que le dsir de n'tre pas oubli. Pour qu'il trouve du plaisir voir souffrir les siens, il faut qu'il les hasse, qu'il soit avide de leur sang. Cette frocit paratra, sans doute, naturelle ceux pour qui tout esprit est ncessairement une puissance malfaisante et redoute. Mais nous savons qu'il y a des esprits de toute sorte ; comment se fait-il que l'me du mort soit ncessairement un esprit mauvais ? Tant que l'homme est en vie, il aime ses parents, il change avec eux des services. N'est-il pas trange que son me, aussitt qu'elle est libre du corps, se dpouille instantanment de ses sentiments anciens pour devenir un gnie mchant et tourmenteur ? C'est pourtant une rgle gnrale que le mort continue la personnalit du vivant, qu'il a le mme caractre, les mmes haines et les mmes affections. Il s'en faut donc que la mtamorphose se comprenne d'elle-mme. Il est vrai que les indignes l'admettent implicitement, quand ils expliquent le rite par les exigences du mort; mais il s'agit prcisment de savoir d'o leur est venue cette conception. Bien loin qu'elle puisse tre regarde comme un truisme, elle est aussi obscure que le rite lui-mme et, par suite, elle ne peut suffire en rendre compte. Enfin, alors mme qu'on aurait trouv les raisons de cette surprenante transformation, il resterait expliquer pourquoi elle n'est que temporaire. Car elle ne dure pas au del du deuil; une fois les rites accomplis, le mort redevient ce qu'il tait de son vivant, un parent affectueux et dvou. Il met au service des siens les pouvoirs nouveaux qu'il tient de sa nouvelle condition . Dsormais, on voit en lui un bon gnie, toujours prt assister ceux que nagure il tourmentait. D'o peuvent venir ces revirements successifs ? Si les mauvais sentiments que l'on prte l'me viennent uniquement de ce qu'elle n'est plus en vie, ils devraient rester invariables et, si le deuil en drive, il devrait tre sans terme.
1267
Ces explications mythiques expriment l'ide que l'indigne se fait du rite, non le rite luimme. Nous pouvons donc les carter pour nous mettre en face de la ralit qu'elles traduisent, niais en la dfigurant. Si le deuil diffre des autres formes du culte positif, il est un ct par o il leur ressemble : lui aussi est fait de crmonies collectives qui dterminent, chez ceux qui y participent, un tat d'effervescence. Les sentiments surexcits sont diffrents; mais la surexcitation est la mme. Il est donc prsumable que l'explication des rites joyeux est susceptible de s'appliquer aux rites tristes, condition que les termes en soient transports. Quand un individu meurt, le groupe familial auquel il appartient se sent amoindri et, pour ragir contre cet amoindrissement, il s'assemble. Un commun malheur a les mmes effets que l'approche d'un vnement heureux : il avive les sentiments collectifs qui, par suite, inclinent les individus se rechercher et se rapprocher. Nous avons mme vu ce besoin de concentration s'affirmer parfois avec une nergie particulire : on s'embrasse, on s'enlace, on se serre
1267
On trouve plusieurs exemples de cette croyance dans HOWITT, Nat, p. 435. Cf. Strehlow, I, pp. l5-16 et II, p. 7.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
353
le plus possible les uns contre les autres. Mais l'tat affectif dans lequel se trouve alors le groupe reflte les circonstances qu'il traverse. Non seulement les proches le plus directement atteints apportent l'assemble leur douleur personnelle, mais la socit exerce sur ses membres une pression morale pour qu'ils mettent leurs sentiments en harmonie avec la situation. Permettre qu'ils restent indiffrents au coup qui la frappe et la diminue, ce serait proclamer qu'elle ne tient pas dans leurs curs la place laquelle elle a droit ; ce serait la nier elle-mme. Une famille qui tolre qu'un des siens puisse mourir sans tre pleur tmoigne par l qu'elle manque d'unit morale et de cohsion : elle abdique ; elle renonce tre. De son ct, l'individu, quand il est fermement attach la socit dont il fait partie, se sent moralement tenu de participer ses tristesses et ses joies ; s'en dsintresser, ce serait rompre les liens qui l'unissent la collectivit ; ce serait renoncer la vouloir, et se contredire. Si le chrtien, pendant les ftes commmoratives de la Passion, si le juif, au jour anniversaire de la chute de Jrusalem, jenent et se mortifient, ce n'est pas pour donner cours une tristesse spontanment prouve. Dans ces circonstances, l'tat intrieur du croyant est hors de proportions avec les dures abstinences auxquelles il se soumet. S'il est triste, c'est, avant tout, parce qu'il s'astreint tre triste et il s'y astreint pour affirmer sa foi. L'attitude de l'Australien pendant le deuil s'explique de la mme manire. S'il pleure, s'il gmit, ce n'est pas simplement pour traduire un chagrin individuel ; c'est pour remplir un devoir au sentiment duquel la socit ambiante ne manque pas de le rappeler l'occasion. On sait d'autre part comment les sentiments humains s'intensifient quand ils s'affirment collectivement. La tristesse, comme la joie, s'exalte, s'amplifie en se rpercutant de conscience en conscience et vient, par suite, s'exprimer au dehors sous forme de mouvements exubrants et violents. Ce n'est plus l'agitation joyeuse que nous observions nagure ; ce sont des cris, des hurlements de douleur. Chacun est entran par tous ; il se produit comme une panique de tristesse. Quand la douleur en arrive ce degr d'intensit, il s'y mle une sorte de colre et d'exaspration. On prouve le besoin de briser, de dtruire quelque chose. On s'en prend soimme ou aux autres, On se frappe, on se blesse, on se brle, ou bien on se jette sur autrui pour le frapper, le blesser et le brler. Ainsi s'est tabli l'usage de se livrer, pendant le deuil, de vritables orgies de tortures. Il nous parat trs vraisemblable que la vendetta et la chasse aux ttes n'ont pas d'autre origine. Si tout dcs est attribu quelque sortilge magique et si, pour cette raison, on croit que le mort doit tre veng, c'est qu'on prouve le besoin de trouver, tout prix, une victime sur laquelle puissent se dcharger la douleur et la colre collectives. Cette victime, on va naturellement la chercher au dehors ; car un tranger est un sujet minoris resistentiae ; comme il n'est Pas protg par les sentiments de sympathie qui s'attachent un parent ou un voisin, il n'y a rien en lui qui repousse et neutralise les sentiments mauvais et destructifs que la mort a veills. C'est, sans doute, pour la mme raison que la femme sert, plus souvent que l'homme, d'objet passif aux rites les plus cruels du deuil; parce qu'elle a une moindre valeur sociale, elle est plus directement dsigne pour l'office de boue missaire. On voit que cette explication du deuil fait compltement abstraction de la notion d'me ou d'esprit. Les seules forces qui sont rellement en jeu sont de nature tout impersonnelle : ce sont les motions que soulve dans le groupe la mort d'un de ses membres. Mais le primitif ignore le mcanisme psychique d'o rsultent toutes ces pratiques. Quand donc il essaie de s'en rendre compte, il est oblig de s'en forger une tout autre explication. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
354
tenu de se mortifier douloureusement. Comme toute obligation veille l'ide d'une volont qui oblige, il cherche autour de lui d'o peut provenir la contrainte qu'il subit. Or, il est une puissance morale dont la ralit lui parat certaine et qui semble tout indique pour ce rle : c'est l'me que la mort a mise en libert. Car, qui peut s'intresser plus qu'elle aux contrecoups que sa propre mort peut avoir sur les vivants ? On imagine donc que, si ces derniers s'infligent un traitement contre nature, c'est pour se conformer ses exigences. C'est ainsi que l'ide d'me a d intervenir aprs coup dans la mythologie du deuil. D'autre part, comme on lui prte, ce titre, des exigences inhumaines, il faut bien supposer qu'en quittant le corps qu'elle animait, elle a dpouill tout sentiment humain. Ainsi s'explique la mtamorphose qui fait du parent d'hier un ennemi redout. Cette transformation n'est pas l'origine du deuil ; c'en est plutt la consquence. Elle traduit le changement qui est survenu dans l'tat affectif du groupe : on ne pleure pas le mort parce qu'on le craint ; on le craint parce qu'on le pleure. Mais ce changement de l'tat affectif ne peut tre que temporaire ; car les crmonies du deuil, en mme temps qu'elles en rsultent, y mettent un terme. Elles neutralisent peu peu les causes mmes qui leur ont donn naissance. Ce qui est l'origine du deuil, c'est l'impression d'affaiblissement que ressent le groupe quand il perd un de ses membres. Mais cette impression mme a pour effet de rapprocher les individus les uns des autres, de les mettre plus troitement en rapports, de les associer dans un mme tat d'me, et, de tout cela, se dgage une sensation de rconfort qui compense l'affaiblissement initial. Puisqu'on pleure en commun, c'est qu'on tient toujours les uns aux autres et que la collectivit, en dpit du coup qui l'a frappe, n'est pas entame. Sans doute, on ne met alors en commun que des motions tristes ; mais communier dans la tristesse, c'est encore communier, et toute communion des consciences, sous quelques espces qu'elle se fasse, rehausse la vitalit sociale. La violence exceptionnelle des manifestations par lesquelles s'exprime ncessairement et obligatoirement la douleur commune atteste mme que la socit est, ce moment, plus vivante et plus agissante que jamais. En fait, quand le sentiment social est froiss douloureusement, il ragit avec plus de force qu' l'ordinaire : on ne tient jamais autant sa famille que quand elle vient d'tre prouve. Ce surcrot d'nergie efface d'autant plus compltement les effets du dsemparment qui s'tait produit l'origine, et ainsi se dissipe la sensation de froid que la mort apporte partout avec elle. Le groupe sent que les forces lui reviennent progressivement; il se reprend esprer et vivre. On sort du deuil et on en sort grce au deuil lui-mme. Mais, puisque l'ide qu'on se fait de l'me reflte l'tat moral de la socit, cette ide doit changer quand cet tat change. Quand on tait dans la priode d'abattement et d'angoisse, on se reprsentait l'me sous les traits d'un tre malfaisant, tout occup perscuter les hommes. Maintenant qu'on se sent de nouveau en confiance et en scurit, on doit admettre qu'elle a repris sa nature premire et ses premiers sentiments de tendresse et de solidarit. Ainsi peut S'expliquer la manire trs diffrente dont elle est conue aux diffrents moments de son existence .
1268
Non seulement les rites du deuil dterminent certains des caractres secondaires qui sont
1268
On se demandera peut-tre pourquoi des crmonies rptes sont ncessaires pour produire l'apaisement qui suit le deuil. Mais c'est, d'abord, que les funrailles sont souvent trs longues; elles comprennent des oprations multiples qui s'chelonnent sur de longs mois. Elles prolongent et entretiennent ainsi le trouble moral dtermin par la mort (cf, Hertz, La reprsentation collective de la mort, in Anne sociol., X, p. 48 et suiv.). D'une manire gnrale, la mort est un changement d'tat grave qui a, dans le groupe, des rpercussions tendues et durables. Il faut du temps pour en neutraliser les effets.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
355
attribus l'me, mais ils ne sont peut-tre pas trangers l'ide qu'elle survit au corps. Pour pouvoir comprendre les pratiques auxquelles il se soumet la mort d'un parent, l'homme est oblig de croire qu'elles ne sont pas indiffrentes au dfunt. Les effusions de sang qui se pratiquent si largement pendant le deuil sont de vritables sacrifices offerts au mort . C'est donc que, du mort, il survit quelque chose; et comme ce n'est pas le corps, qui, manifestement, est immobile et se dcompose, ce ne peut tre que l'me. Sans doute, il est impossible de dire avec exactitude quelle a t la part de ces considrations dans la gense de l'ide de survie. Mais il est vraisemblable que l'influence du culte a t ici ce qu'elle est ailleurs. Les rites sont plus aisment explicables quand on s'imagine qu'ils s'adressent des tres personnels ; les hommes ont donc t induits tendre l'influence des personnalits mythiques dans la vie religieuse. Pour pouvoir rendre compte du deuil, ils ont prolong l'existence de l'me au del du tombeau. C'est un nouvel exemple de la manire dont les rites ragissent sur les croyances.
1269
III
.
Mais la mort n'est pas le seul vnement qui puisse troubler une communaut. Il y a, pour les hommes, bien d'autres occasions de s'attrister ou de s'angoisser, et, par consquent, on peut prvoir que mme les Australiens connaissent et pratiquent d'autres rites piaculaires que le deuil. Il est, cependant, remarquable qu'on n'en trouve, dans les rcits des observateurs, qu'un petit nombre d'exemples. Un premier rite de ce genre ressemble de trs prs ceux qui viennent d'tre tudis. On se rappelle comment, chez les Arunta, chaque groupe local attribue des vertus exceptionnellement importantes sa collection de churinga : c'est un palladium collectif au sort duquel le sort mme de la collectivit passe pour tre li. Aussi, quand des ennemis ou des blancs russissent drober un de ces trsors religieux, cette perte est-elle considre comme une calamit publique. Or ce malheur est l'occasion d'un rite qui a tous les caractres d'un deuil : on s'enduit le corps de terre de pipe blanche et on reste au camp pendant deux semaines pleurer et se lamenter . C'est une preuve nouvelle que le deuil est dtermin non par la manire dont est conue l'me du mort, mais par des causes impersonnelles, par l'tat moral du groupe. Voil, en effet, un rite qui, par sa structure, est indistinct du deuil proprement dit et qui, pourtant, est indpendant de toute notion d'esprit ou de dmon malfaisant .
1270 1271
1269
Dans un cas que rapporte Grey d'aprs une observation de Bussel, le rite a tout l'aspect du sacrifice: le sang est rpandu sur le corps mme du mort (GREY, 11, P. 330). Dans d'autres cas, il y a comme une offrande de la barbe : les gens en deuil coupent une partie de leur barbe qu'ils jettent sur le cadavre (ibid., p. 335). 1270 Nat. Tr., pp. 135-136. 1271 Sans doute, chaque churinga passe pour tre en rapports avec un anctre. Mais ce n'est pas pour apaiser les esprits des anctres qu'on porte le deuil des churinga perdus. Nous avons montr d'ailleurs (p. 173) que l'ide d'anctre n'est intervenue que secondairement et aprs coup dans la notion du churinga..
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
356
Une autre circonstance qui donne lieu des crmonies de mme nature est l'tat de dtresse o se trouve la socit la suite de rcoltes insuffisantes. Les indignes qui habitent les environs du lac Eyre, dit Eylmann, cherchent galement conjurer l'insuffisance des ressources alimentaires au moyen de crmonies secrtes. Mais plusieurs des pratiques rituelles qu'on observe dans cette rgion se distinguent de celles dont il a t prcdemment question : ce n'est pas par des danses symboliques, par des mouvements mimtiques ni par des dcorations blouissantes que l'on cherche agir sur les puissances religieuses ou sur les forces de la nature, mais au moyen de souffrances que les individus s'infligent eux-mmes. Dans les territoires du nord, c'est aussi par des tortures, telles que jenes prolongs, veilles, danses poursuivies jusqu' l'puisement des danseurs, douleurs physiques de toute sorte, que l'on s'efforce d'apaiser les puissances qui sont mal disposes pour les hommes . les supplices auxquels les indignes se soumettent dans ce but les laissent parfois dans un tel tat de fatigue qu'ils sont, pendant de longs jours, incapables d'aller la chasse .
1272 1273
C'est surtout pour lutter contre la scheresse que ces pratiques sont employes. C'est que le manque d'eau a pour consquence une disette gnrale. Pour remdier au mal, on recourt aux moyens violents. Un de ceux qui sont en usage est l'extraction d'une dent. Chez les Kaitsh, par exemple, on arrache un individu une incisive que l'on suspend un arbre . Chez les Dieri, l'ide de la pluie est troitement associe celle d'incisions sanglantes qui sont pratiques dans la peau du thorax et des bras . Chez ce mme peuple, quand la scheresse est trs grande, le grand conseil se runit et convoque toute la tribu. C'est un vritable vnement tribal. Des femmes sont envoyes dans toutes les directions pour avertir les gens de se runir un endroit et un moment dtermins. Une fois qu'ils sont assembls, ils font entendre des gmissements, ils crient d'une voix perante l'tat misrable de la contre et ils demandent aux Mura-mura (anctres mythiques) de leur confrer le pouvoir de faire tomber une pluie abondante . Dans les cas, trs rares d'ailleurs, o il y a eu excs d'humidit, une crmonie analogue a lieu pour arrter la pluie. Les vieillards entrent alors dans un vritable tat de frnsie et les cris que pousse la foule sont pnibles entendre .
1274 1275 1276 1277 1278
Spencer et GILLEN nous dcrivent, sous le nom d'Intichiuma, une crmonie qui pourrait bien avoir le mme objet et la mme origine que les prcdentes : une torture physique est employe pour dterminer une espce animale se multiplier. Il y a, chez les Urabanna, un clan qui a pour totem une sorte de serpent appel wadnungadni. Voici comment procde le chef du clan pour empcher que cet animal ne vienne manquer. Aprs s'tre dcor, il s'agenouille par terre, les bras tendus dans toute leur longueur. Un assistant pince entre ses doigts la peau du bras droit et l'oprateur enfonce, travers le pli ainsi form, un os pointu, de cinq pouces de long. On traite de mme le bras gauche. Cette auto-mutilation est cense
1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278
Op. cit., p. 207 ; cf. p. 116. EYLMANN, p. 208. Ibid., p. 211. HOWITT, The Dieri, in J.A.I., XX (1891), p. 93. HOWITT, Nat. Tr., p. 394. HOWITT, ibid., p. 396. Communication de Gason, in J.A.I., XXIV (1895), p. 175.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
357
produire le rsultat dsir . Chez les Dieri, un rite analogue est employ pour dterminer les poules sauvages poudre : les oprateurs se percent le scrotum . Dans certaines autres tribus du lac Eyre, on se perce l'oreille pour amener les ignames se produire .
1279 1280 1281
Mais les disettes totales et partielles ne sont pas les seuls flaux qui puissent s'abattre sur une tribu. D'autres vnements se produisent, plus ou moins priodiquement, qui menacent on paraissent menacer l'existence collective. C'est le cas, par exemple, de l'aurore australe. Les Kurnai croient que c'est un feu allum dans le ciel par le grand dieu Mungan-ngaua; c'est pourquoi, quand ils l'aperoivent, ils ont peur que l'incendie ne s'tende la terre et ne les dvore. Il en rsulte une grande effervescence dans le camp. On agite une main dessche de mort laquelle les Kurnai attribuent des vertus varies, et on pousse des cris tels que : Renvoie-le ; ne nous laisse pas brler . En mme temps, ont lieu, sur l'ordre des vieillards, des changes de femmes, ce qui est toujours l'indice d'une grande excitation . Les mmes licences sexuelles sont signales chez les Wiimbaio, toutes les fois qu'un flau parat imminent, et notamment en temps d'pidmie .
1282 1283
Sous l'influence de ces ides, les mutilations ou effusions de sang sont parfois considres comme un moyen efficace pour gurir les maladies. Chez les Dieri, quand il arrive un accident un enfant, ses proches se donnent des coups sur la tte soit avec un bton soit avec un boomerang, jusqu' ce que le sang coule sur leur visage. On croit, par ce procd, soulager l'enfant de son mal . Ailleurs, on s'imagine obtenir le mme rsultat au moyen d'une crmonie totmique supplmentaire . On peut rapprocher de ces faits l'exemple, cit plus haut, d'une crmonie spcialement clbre pour effacer les effets d'une faute rituelle . Sans doute, dans ces deux derniers cas, il n'y a ni blessures, ni coups, ni souffrances physiques d'aucune sorte ; cependant, le rite ne diffre pas en nature des prcdents : il s'agit toujours de dtourner un mal ou d'expier une faute au moyen d'une prestation rituelle extraordinaire.
1284 1285 1286
Tels sont, en dehors du deuil, les seuls cas de rites piaculaires que nous ayons russi relever en Australie. Il est probable, il est vrai, que certains ont d nous chapper et on peut prsumer galement que d'autres sont rests inaperus des observateurs. Cependant, si les seuls que l'on ait dcouverts jusqu' prsent sont en petit nombre, c'est vraisemblablement qu'ils ne tiennent pas une grande place dans le culte. On voit combien il s'en faut que les religions primitives soient filles de l'angoisse et de la crainte, puisque les rites qui traduisent des motions douloureuses y sont relativement rares. C'est, sans doute, que, si l'Australien mne une existence misrable, compare celle des peuples plus civiliss, en revanche, il demande si
1279
North Tr., p. 286. GASON, The Dieyerie Tribe, in Curr, II, p. 68. 1281 GASON, ibid. ; EYLMANN, p. 208. 1282 HOWITT, Nat. Tr., pp. 277 et 430. 1283 Ibid., p. 195. 1284 GASON, The Dieyerie Tribe, in Curr, II, p. 69. Le mme procd est employ pour expier un ridicule. Quand une personne, par sa maladresse ou autrement, a excit le rire des assistants, elle demande l'un d'eux de la frapper sur la tte jusqu' ce que le sang coule. A ce moment, les choses sont remises en tat et la personne dont on se moquait participe elle-mme la gaiet de son entourage (ibid., p. 70). 1285 EYLMANN, pp. 212 et 447. 1286 V. plus haut, p. 551.
1280
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
358
peu de choses la vie qu'il se contente peu de frais. Tout ce qu'il lui faut, c'est que la nature suive son cours normal, que les saisons se succdent rgulirement, que la pluie tombe, l'poque ordinaire, en abondance et sans excs ; or les grandes perturbations dans l'ordre cosmique sont toujours exceptionnelles. Aussi a-t-on pu remarquer que la plupart des rites piaculaires rguliers dont nous avons plus haut rapport des exemples ont t observs dans les tribus du centre o les scheresses sont frquentes et constituent de vritables dsastres. Il reste, il est vrai, surprenant que les rites piaculaires qui sont spcialement destins expier le pch semblent faire presque compltement dfaut. Cependant l'Australien, comme tout homme, doit commettre des fautes rituelles qu'il a intrt racheter ; on peut donc se demander si le silence des textes sur ce point n'est pas imputable aux insuffisances de l'observation. Mais, si peu nombreux que soient les faits qu'il nous a t possible de recueillir, ils ne laissent pas d'tre instructifs. Quand on tudie les rites piaculaires dans les religions plus avances, o les forces religieuses sont individualises, ils paraissent tre troitement solidaires de conceptions anthropomorphiques. Si le fidle s'impose des privations, se soumet des svices, c'est pour dsarmer la malveillance qu'il prte certains des tres sacrs dont il croit dpendre. Pour apaiser leur haine ou leur colre, il va au-devant de leurs exigences ; il se frappe lui-mme pour n'tre pas frapp par eux. Il semble donc que ces pratiques n'ont pu prendre naissance qu' partir du moment o dieux et esprits furent conus comme des personnes morales, capables de passions analogues celles des humains. C'est pour cette raison que Robertson Smith crut pouvoir reporter une date relativement rcente les sacrifices expiatoires, tout comme les oblations sacrificielles. Suivant lui, les effusions de sang qui caractrisent ces rites auraient t d'abord de simples procds de communion : l'homme aurait rpandu son sang sur l'autel pour resserrer les liens qui l'unissaient son dieu. Le rite n'aurait pris un caractre piaculaire et pnal que quand sa signification premire fut oublie et quand l'ide nouvelle qu'on se faisait des tres sacrs permit de lui attribuer une autre fonction .
1287
Mais, puisque l'on rencontre des rites piaculaires ds les socits australiennes, il est impossible de leur assigner une origine aussi tardive. D'ailleurs, tous ceux que nous venons d'observer, sauf un , sont indpendants de toute conception anthropomorphique : il n'y est question ni de dieux ni d'esprits. C'est par elles-mmes et directement que les abstinences et les effusions de sang arrtent les disettes et gurissent les maladies. Entre le rite et les effets qu'il est cens produire aucun tre spirituel ne vient insrer son action. Les personnalits mythiques n'y sont donc intervenues qu'ultrieurement. Une fois que le mcanisme rituel fut tabli, elles ont servi le rendre plus commodment reprsentable aux intelligences ; mais elles ne sont pas conditions de son existence. C'est pour d'autres raisons qu'il s'est institu ; c'est une autre cause qu'il doit son efficacit.
1288
Il agit par les forces collectives qu'il met en jeu. Un malheur parat-il imminent qui menace la collectivit ? Celle-ci se runit, comme la suite d'un deuil, et c'est naturellement une impression d'inquitude et d'angoisse qui domine le groupe assembl. La mise en commun de
1287 1288
The Religion of the Semites, lect. XI. C'est le cas des Dieri invoquant, d'aprs Gason, les Mura-Mura de l'eau, en temps de scheresse.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
359
ces sentiments a, comme toujours, pour effet de les intensifier. En s'affirmant, ils s'exaltent, s'enfivrent, atteignent un degr de violence qui se traduit par la violence correspondante des gestes qui les expriment. Comme la mort d'un proche, on pousse des cris terribles, on s'emporte, on sent le besoin de dchirer et de dtruire ; c'est pour satisfaire ce besoin qu'on se frappe, qu'on se blesse, qu'on fait couler le sang. Mais quand des motions ont cette vivacit, elles ont beau tre douloureuses, elles n'ont rien de dprimant; elles dnotent, au contraire, un tat d'effervescence qui implique une mobilisation de toutes nos forces actives et mme un afflux d'nergies extrieures. Peu importe que cette exaltation ait t provoque par un vnement triste, elle ne laisse pas d'tre relle et elle ne diffre pas spcifiquement de celle qu'on observe dans les ftes joyeuses. Parfois mme, elle se manifeste par des mouvements de mme nature : c'est la mme frnsie qui saisit les fidles, c'est le mme penchant aux dbauches sexuelles, signe certain d'une grande surexcitation nerveuse. Dj Robertson Smith avait remarqu cette curieuse influence des rites tristes dans les cultes smitiques : Dans les temps difficiles, dit-il, alors que les penses des hommes taient habituellement sombres, ils recouraient aux excitations physiques de la religion, comme, maintenant, ils se rfugient dans le vin. En rgle gnrale, quand, chez les Smites, le culte commenait par des pleurs et des lamentations - comme dans le deuil d'Adonis ou comme dans les grands rites expiatoires qui devinrent frquents pendant les derniers temps - une brusque rvolution faisait succder, au service funbre par lequel s'tait ouverte la crmonie, une explosion de gat et de rjouissances . En un mot, alors mme que les crmonies religieuses ont pour point de dpart un fait inquitant on attristant, elles gardent, sur l'tat affectif du groupe et des individus, leur pouvoir stimulant. Par cela seul qu'elles sont collectives, elles lvent le ton vital. Or, quand on sent en soi de la vie - que ce soit sous forme d'irritation pnible ou de joyeux enthousiasme - on ne croit pas la mort ; on se rassure donc, on reprend courage et, subjectivement, tout se passe comme si le rite avait rellement cart le danger que l'on redoutait. Voil comment on attribue aux mouvements dont il est fait, aux cris pousss, au sang vers, aux blessures qu'on s'inflige ou qu'on inflige d'autres, des vertus curatives ou prventives ; et, comme ces diffrents svices font ncessairement souffrir, la souffrance, par elle-mme, finit par tre considre comme un moyen de conjurer le mal, de gurir la maladie . Plus tard, quand la plupart des forces religieuses eurent pris la forme de personnalits morales, on expliqua l'efficacit de ces pratiques en imaginant qu'elles avaient pour objet d'apaiser un dieu malfaisant ou irrit. Mais ces conceptions ne font que reflter le rite et les sentiments qu'il suscite ; elles en sont une interprtation, et non la cause dterminante.
1289 1290
Un manquement rituel n'agit pas d'une autre manire. Lui aussi est une menace pour la collectivit ; il l'atteint dans son existence morale, puisqu'il l'atteint dans ses croyances. Mais que la colre qu'il dtermine s'affirme ostensiblement et avec nergie, et elle compense le mal qui l'a cause. Car si elle est vivement ressentie par tous, c'est que l'infraction commise est une exception et que la foi commune reste entire. L'unit morale du groupe n'est donc pas en danger. Or la peine inflige titre d'expiation n'est que la manifestation de cette colre
1289 1290
Op. cit., p. 262. Il est d'ailleurs possible que la croyance aux vertus moralement tonifiantes de la souffrance (v. plus haut, p. 446) ait ici jou quelque rle. Puisque la douleur sanctifie, puisqu'elle lve le niveau religieux du fidle, elle peut aussi le relever quand il est tomb au-dessous de la normale.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
360
publique, la preuve matrielle de son unanimit. Elle a donc rellement l'effet rparateur qu'on lui attribue. Au fond, le sentiment qui est la racine des rites proprement expiatoires ne diffre pas en nature de celui que nous avons trouv la base des autres rites piaculaires : c'est une sorte de douleur irrite qui tend se manifester par des actes de destruction. Tantt elle se soulage au dtriment de celui-l mme qui l'prouve; tantt, c'est aux dpens d'un tiers tranger. Mais dans les deux cas, le mcanisme psychique est essentiellement le mme .
1291
IV
.
Un des plus grands services que Robertson Smith ait rendus la science des religions est d'avoir mis en lumire l'ambigut de la notion du sacr. Les forces religieuses sont de deux sortes. Les unes sont bienfaisantes, gardiennes de l'ordre physique et moral, dispensatrices de la vie, de la sant, de toutes les qualits que les hommes estiment : c'est le cas du principe totmique, pars dans toute l'espce, de l'anctre mythique, de l'animal-protecteur, des hros civilisateurs, des dieux tutlaires de toute espce et de tout degr. Peu importe qu'elles soient conues comme des personnalits distinctes ou comme des nergies diffuses; sous l'une et sous l'autre forme, elles jouent le mme rle et affectent de la mme manire la conscience des fidles : le respect qu'elles inspirent est ml d'amour et de reconnaissance. les choses et les personnes qui sont normalement en rapports avec elles participent des mmes sentiments et du mme caractre : ce sont les choses et les personnes saintes. Tels sont les lieux consacrs au culte, les objets qui servent dans les rites rguliers, les prtres, les asctes, etc. - Il y a, d'autre part, les puissances mauvaises et impures, productrices de dsordres, causes de mort, de maladies, instigatrices de sacrilges. Les seuls sentiments que l'homme ait pour elles sont une crainte o il entre gnralement de l'horreur. Telles sont les forces sur lesquelles et par lesquelles agit le sorcier, celles qui se dgagent des cadavres, du sang des menstrues, celles que dchane toute profanation des choses saintes, etc. Les esprits des morts, les gnies malins de toute sorte en sont des formes personnifies. Entre ces deux catgories de forces et d'tres, le contraste est aussi complet que possible et va mme jusqu' l'antagonisme le plus radical. Les puissances bonnes et salutaires repoussent loin d'elles les autres qui les nient et les contredisent. Aussi les premires sont-elles interdites aux secondes : tout contact entre elles est considr comme la pire des profanations. C'est le type, par excellence, de ces interdits entre choses sacres d'espces diffrentes dont nous avons, chemin faisant, signal l'existence . Les femmes pendant la menstruation, et surtout la premire apparition des menstrues, sont impures ; aussi sont-elles, ce moment, rigoureusement squestres; les hommes ne doivent avoir avec elles aucun rapport . Les bull1292 1293
1291 1292 1293
Cf. ce que nous avons dit sur l'expiation dans notre Division du travail social, 3e d., p. 64 et suiv. V. plus haut, pp. 430-431. SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 460; North. Tr., p. 601; ROTH, North Queensland Ethnography,
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
361
roarers, les churinga ne sont jamais en contact avec le mort . Le sacrilge est exclu de la socit des fidles ; l'accs du culte lui est interdit. Ainsi toute vie religieuse gravite autour de deux ples contraires entre lesquels il y a la mme opposition qu'entre le pur et l'impur, le saint et le sacrilge, le divin et le diabolique.
1294
Mais en mme temps que ces deux aspects de la vie religieuse s'opposent l'un l'autre, il existe entre eux une troite parent. D'abord, ils soutiennent tous deux le mme rapport avec les tres profanes : ceux-ci doivent s'abstenir de tout rapport avec les choses impures comme avec les choses trs saintes. Les premires ne sont pas moins interdites que les secondes ; elles sont galement retires de la circulation. C'est dire qu'elles aussi sont sacres. Sans doute, les sentiments qu'inspirent les unes et les autres ne sont pas identiques : autre chose est le respect, autre chose le dgot et l'horreur. Cependant, pour que les gestes soient les mmes dans les deux cas, il faut que les sentiments exprims ne diffrent pas en nature. Et en effet, il y a de l'horreur dans le respect religieux, surtout quand il est trs intense, et la crainte qu'inspirent les puissances malignes n'est gnralement pas sans avoir quelque caractre rvrentiel. Les nuances par lesquelles se diffrencient ces deux attitudes sont mme parfois si fugitives qu'il n'est pas toujours facile de dire dans quel tat d'esprit se trouvent, au juste, les fidles. Chez certains peuples smitiques, la viande de porc tait interdite ; mais on ne savait pas toujours avec prcision si c'tait titre de chose impure ou bien de chose sainte et la mme remarque peut s'appliquer un trs grand nombre d'interdictions alimentaires.
1295
Il y a plus ; il arrive trs souvent qu'une chose impure ou une puissance malfaisante devienne, sans changer de nature, mais par une simple modification des circonstances extrieures, une chose sainte ou une puissance tutlaire, et inversement. Nous avons vu comment l'me du mort, qui est d'abord un principe redout, se transforme en gnie protecteur, une fois que le deuil est termin. De mme, le cadavre, qui commence par n'inspirer que terreur et loignement, est trait plus tard comme une relique vnre : l'anthropophagie funraire, qui est frquemment pratique dans les socits australiennes, est la preuve de cette transformation . L'animal totmique est l'tre saint par excellence ; niais il est, pour celui qui en consomme indment la chair, un principe de mort. D'une manire gnrale, le sacrilge est simplement un profane qui a t contagionn par une force religieuse bienfaisante. Celle-ci change de nature en changeant d'habitat ; elle souille au lieu de sanctifier . Le sang qui provient des organes gnitaux de la femme, bien qu'il soit videmment impur comme celui des menstrues, est souvent employ comme un remde contre la maladie . La victime immole dans les sacrifices expiatoires est charge d'impuret, puisqu'on a concentr sur elle les pchs qu'il s'agit d'expier. Cependant, une fois qu'elle est abattue, sa chair et son sang sont employs
1296 1297 1298
Bulletin no 5, p. 24. Il est inutile de multiplier les rfrences l'appui d'un fait aussi connu. SPENCER et GILLEN citent cependant un cas o des churinga seraient placs sous la tte du mort (Nat. Tr., p. 156). Mais, de leur aveu, le fait est unique, anormal (ibid., p. 157), et il est nergiquement ni par STREHLOW (II, p. 79). 1295 Robertson SMITH, Rel. of Semites, p. 153, cf. p. 446, la note additionnelle intitule Holiness, Uncleanness and Taboo. 1296 HOWITT, Nat. Tr., p. 448-450; BROUGH SMYTH, I, pp. 118,120; Dawson, p. 67 ; EYRE, II, p. 257; ROTH, North Queensland Ethn., Bull. no 9, in Rec. of the Australian Museum, VI, no 5, p. 367. 1297 V. plus haut, pp. 457-458. 1298 SPENCER et GILLEN, Nat. Tr., p. 464; North. Tr., p. 599.
1294
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
362
aux plus pieux usages . Au contraire, quoique la communion soit une opration religieuse qui a normalement pour fonction de consacrer, elle produit parfois les mmes effets qu'un sacrilge. Des individus qui ont communi sont, dans certains cas, obligs de se fuir comme des pestifrs. On dirait qu'ils sont devenus l'un pour l'autre une source de dangereuse contamination : le lien sacr qui les unit, en mme temps les spare. Les exemples de ces sortes de communions sont nombreux en Australie. Un des plus typiques est celui que l'on observe chez les Narrinyeri et dans les tribus voisines. Quand un enfant vient au monde, ses parents conservent avec soin son cordon ombilical qui est cens receler quelque chose de son me. Deux individus qui changent leur cordon ainsi conserv, communient ensemble par le fait mme de cet change; car c'est comme s'ils changeaient leur me. Mais du mme coup, il leur est interdit de se toucher, de se parler, mme de se voir. Tout se passe comme s'ils taient l'un pour l'autre un objet d'horreur .
1299 1300
Le pur et l'impur ne sont donc pas deux genres spars, mais deux varits d'un mme genre qui comprend toutes les choses sacres. Il y a deux sortes de sacr, l'un faste, l'autre nfaste, et non seulement entre les deux formes opposes il n'y a pas de solution de continuit, mais un mme objet peut passer de l'une l'autre sans changer de nature. Avec du pur, on fait de l'impur, et rciproquement. C'est dans la possibilit de ces transmutations que consiste l'ambigut du sacr. Mais si Robertson Smith a eu un vif sentiment de cette ambigut, il n'en a jamais donn d'explication expresse. Il se borne faire remarquer que, comme toutes les forces religieuses sont indistinctement intenses et contagieuses, il est sage de ne les aborder qu'avec de respectueuses prcautions, quel que soit le sens dans lequel s'exerce leur action. Il lui semblait qu'on pouvait ainsi rendre compte de l'air de parent qu'elles prsentent toutes en dpit des contrastes qui les opposent par ailleurs. Mais d'abord, la question n'tait que dplace ; il restait faire voir d'o vient que les puissances de mal ont l'intensit et la contagiosit des autres. En d'autres termes, comment se fait-il qu'elles soient, elles aussi, de nature religieuse ? Ensuite, l'nergie et la force d'expansion qui leur sont communes ne permettent pas de comprendre comment, malgr le conflit qui les divise, elles peuvent se transformer les unes dans les autres ou se substituer les unes aux autres dans leurs fonctions respectives, comment le pur peut contaminer tandis que l'impur sert parfois sanctifier .
1301
1299
Par exemple, chez les Hbreux, avec le sang de la victime expiatoire on lustre l'autel (Lvitique, IV, 5 et suiv.) ; on brle les chairs et les produits de la combustion servent faire une eau de purification (Nombres, XIX). 1300 TAPLIN, The Narrinyeri Tribe, pp. 32-34. Quand les deux individus qui ont ainsi chang leurs cordons ombilicaux appartiennent des tribus diffrentes, ils sont employs comme agents du commerce intertribal. Dans ce cas, l'change des cordons a lieu peu de temps aprs leur naissance et par l'intermdiaire de leurs parents respectifs. 1301 SMITH, il est vrai, n'admet pas la ralit de ces substitutions et de ces transformations. Suivant lui, si la victime expiatoire servait purifier, c'est que, par elle-mme, elle n'avait rien d'impur. Primitivement, c'tait une chose sainte ; elle tait destine rtablir, par le moyen d'une communion, les liens de parent qui unissaient le fidle son dieu quand un manquement rituel les avait dtendus ou briss. On choisissait mme, pour cette opration, un animal exceptionnellement saint afin que la communion ft plus efficace et effat plus compltement les effets de la faute. C'est seulement quand on eut cess de comprendre le sens du rite que l'animal sacro-saint fut considr comme impur (op. cit., p. 347 et suiv.). Mais il est inadmissible que des croyances et des pratiques aussi universelles que celles que nous trouvons la base du
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
363
L'explication que nous avons prcdemment propose des rites piaculaires permet de rpondre cette double question. Nous avons vu, en effet, que les puissances mauvaises sont un produit de ces rites et les symbolisent. Quand la socit traverse des circonstances qui l'attristent, l'angoissent ou l'irritent, elle exerce sur ses membres une pression pour qu'ils tmoignent, par des actes significatifs, de leur tristesse, de leur angoisse on de leur colre. Elle leur impose comme un devoir de pleurer, de gmir, de s'infliger des blessures ou d'en infliger autrui, car ces manifestations collectives et la communion morale qu'elles attestent et qu'elles renforcent restituent au groupe l'nergie que les vnements menaaient de lui soustraire, et elles lui permettent ainsi de se ressaisir. C'est cette exprience que l'homme interprte, quand il imagine, en dehors de lui, des tres malfaisants dont l'hostilit, constitutionnelle ou temporaire, ne peut tre dsarme que par des souffrances humaines. Ces tres ne sont donc autre chose que des tats collectifs objectivs ; ils sont la socit elle-mme vue sous un de ses aspects. Mais nous savons, d'autre part, que les puissances bienfaisantes ne se sont pas constitues d'une autre manire ; elles aussi rsultent de la vie collective et l'expriment; elles aussi reprsentent la socit, mais saisie dans une attitude trs diffrente, savoir au moment o elle s'affirme avec confiance et presse avec ardeur les choses de concourir la ralisation des fins qu'elle poursuit. Puisque ces deux sortes de forces ont une commune origine, il n'est pas surprenant que, tout en tant diriges dans des sens opposs, elles aient une mme nature, qu'elles soient galement intenses et contagieuses, par consquent interdites et sacres. Par cela mme on peut comprendre comment elles se transforment les unes dans les autres. Puisqu'elles refltent l'tat affectif dans lequel se trouve le groupe, il suffit que cet tat change pour qu'elles changent elles-mmes de sens. Une fois que le deuil est termin, la socit domestique est rassrne par le deuil lui-mme ; elle reprend confiance; les individus sont allgs de la pression pnible qui s'exerait sur eux; ils se sentent plus l'aise. Il leur semble donc que l'esprit du mort a dpos ses sentiments hostiles pour devenir un protecteur bienveillant. Les autres transmutations dont nous avons cit des exemples s'expliquent de la mme manire. Ce qui fait la saintet d'une chose, c'est, comme nous l'avons montr, le sentiment collectif dont elle est l'objet. Que, en violation des interdits qui l'isolent, elle entre en contact avec une personne profane, ce mme sentiment s'tendra contagieusement cette dernire et lui imprimera un caractre spcial. Seulement, quand il y parvient, il se trouve dans un tat trs diffrent de celui o il tait l'origine. Froiss, irrit par la profanation qu'implique cette extension abusive et contre nature, il est devenu agressif et enclin aux violences destructives ; il tend se venger de l'offense subie. Pour cette raison, le sujet contagionn apparat comme envahi par une force virulente et novice, qui menace tout ce qui l'approche ; par suite, il n'inspire qu'loignement et rpugnance ; il est comme marqu d'une tare, d'une souillure. Et cependant, cette souillure a pour cause ce mme tat psychique qui, dans d'autres circonstances, consacrait et sanctifiait. Mais que la colre ainsi souleve soit satisfaite par un
sacrifice expiatoire soient le produit d'une simple erreur d'interprtation. En fait, il n'est pas douteux que la victime expiatoire ne soit charge de l'impuret du pch. D'ailleurs, nous venons de voir que ces transformations du pur ou impur ou inversement se rencontrent ds les socits les plus infrieures que nous connaissions.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
364
rite expiatoire et, soulage, elle tombe ; le sentiment offens s'apaise et revient son tat initial. Il agit donc, de nouveau, comme il agissait dans le principe ; au lieu de contaminer, il sanctifie. Comme il continue contagionner l'objet auquel il s'est attach, celui-ci ne saurait redevenir profane et religieusement indiffrent. Mais le sens de la force religieuse qui parat l'occuper s'est transform : d'impur, il est devenu pur et instrument de purification. En rsum, les deux ples de la vie religieuse correspondent aux deux tats opposs par lesquels passe toute vie sociale. Il y a entre le sacr faste et le sacr nfaste le mme contraste qu'entre les tats d'euphorie et de dysphorie collective. Mais parce que les uns et les autres sont galement collectifs, il y a, entre les constructions mythologiques qui les symbolisent, une intime parent de nature. Les sentiments mis en commun varient de l'extrme abattement l'extrme allgresse, de l'irritation douloureuse l'enthousiasme extatique; mais, dans tous les cas, il y a communion des consciences et rconfort mutuel par suite de cette communion. Le processus fondamental est toujours le mme ; seules, les circonstances le colorent diffremment. C'est donc, en dfinitive, l'unit et la diversit de la vie sociale qui font, la fois, l'unit et la diversit des tres et des choses sacres. Cette ambigut, d'ailleurs, n'est pas particulire la seule notion du sacr ; on trouve quelque chose de ce mme caractre dans tous les rites qui viennent d'tre tudis. Certes, il tait essentiel de les distinguer ; les confondre et t mconnatre les multiples aspects de la vie religieuse. Mais d'un autre ct, si diffrents qu'ils puissent tre, il n'y a pas entre eux de solution de continuit. Tout au contraire, ils chevauchent les uns sur les autres et peuvent mme se remplacer mutuellement. Nous avons dj montr que rites d'oblation et de communion, rites mimtiques, rites commmoratifs remplissent souvent les mmes fonctions. On pourrait croire que le culte ngatif, tout au moins, est plus nettement spar du culte positif ; et cependant, nous avons vu que le premier peut produire des effets positifs, identiques ceux que produit le second. Avec des jenes, des abstinences, des auto-mutilations, on obtient les mmes rsultats qu'avec des communions, des oblations, des commmorations. Inversement, les offrandes, les sacrifices impliquent des privations et des renoncements de toute sorte. Entre les rites asctiques et les rites piaculaires, la continuit est encore plus apparente : les uns et les autres sont faits de souffrances, acceptes ou subies, et auxquelles est attribue une efficacit analogue. Ainsi, les pratiques, tout comme les croyances, ne se rangent pas en des genres spars. Si complexes que soient les manifestations extrieures de la vie religieuse, elle est, dans son fond, une et simple. Elle rpond partout un mme besoin et drive partout d'un mme tat d'esprit. Sous toutes ses formes, elle a pour objet d'lever l'homme au-dessus de lui-mme et de lui faire vivre une vie suprieure celle qu'il mnerait s'il obissait uniquement ses spontanits individuelles : les croyances expriment cette vie en termes de reprsentations ; les rites l'organisent et en rglent le fonctionnement.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
365
CONCLUSION
.
Nous annoncions au dbut de cet ouvrage que la religion dont nous entreprenions l'tude contenait en elle les lments les plus caractristiques de la vie religieuse. On peut vrifier maintenant l'exactitude de cette proposition. Si simple que soit le systme que nous avons tudi, nous y avons retrouv toutes les grandes ides et toutes les principales attitudes rituelles qui sont la base des religions mme les plus avances : distinction des choses en sacres et en profanes, notion d'me, d'esprit, de personnalit mythique, de divinit nationale et mme internationale, culte ngatif avec les pratiques asctiques qui en sont la forme exaspre, rites d'oblation et de communion, rites imitatifs, rites commmoratifs, rites piaculaires, rien n'y manque d'essentiel. Nous sommes donc fond esprer que les rsultats auxquels nous sommes parvenu ne sont pas particuliers au seul totmisme, mais peuvent nous aider comprendre ce qu'est la religion en gnral. On objectera qu'une seule religion, quelle que puisse tre son aire d'extension, constitue une base troite pour une telle induction. Nous ne songeons pas mconnatre ce qu'une vrification tendue peut ajouter d'autorit une thorie. Mais il n'est pas moins vrai que, quand une loi a t prouve par une exprience bien faite, cette preuve est valable universellement. Si, dans un cas mme unique, un savant parvenait surprendre le secret de la vie, ce cas ft-il celui de l'tre protoplasmique le plus simple qu'on pt concevoir, les vrits ainsi obtenues seraient applicables tous les vivants, mme aux plus levs. Si donc, dans les trs humbles socits qui viennent d'tre tudies, nous avons rellement russi apercevoir quelques-uns des lments dont sont faites les notions religieuses les plus fondamentales, il n'y a pas de raison pour ne pas tendre aux autres religions les rsultats les plus gnraux de notre recherche. Il n'est pas concevable, en effet, que, suivant les circonstances, un mme effet puisse tre d tantt une cause, tantt une autre, moins que, au fond, les deux causes n'en fassent qu'une. Une mme ide ne peut pas exprimer ici une ralit, et l une ralit diffrente, moins que cette dualit soit simplement apparente. Si, chez certains peuples, les ides de sacr, d'me, de dieux s'expliquent sociologiquement, on doit scientifiquement prsumer que, en principe, la mme explication vaut pour tous les peuples o les mmes ides se retrouvent avec les mmes caractres essentiels. A supposer donc que nous ne nous soyons pas tromp, certaines, tout au moins, de nos conclusions peuvent lgitimement tre gnralises. Le moment est venu de les dgager. Et une induction de cette nature, ayant pour base une exprience bien dfinie, est moins tmraire que tant de gnralisations sommaires qui, en essayant d'atteindre d'un coup l'essence de la religion sans s'appuyer sur l'analyse d'aucune religion en particulier, risquent fort de se perdre dans le vide.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
366
I
.
Le plus souvent, les thoriciens qui ont entrepris d'exprimer la religion en termes rationnels, y ont vu, avant tout, un systme d'ides, rpondant un objet dtermin, Cet objet a t conu de manires diffrentes : nature, infini, inconnaissable, idal, etc. ; mais ces diffrences importent peu. Dans tous les cas, c'taient les reprsentations, les croyances qui taient considres comme l'lment essentiel de la religion. Quant aux rites, ils n'apparaissaient, de ce point de vue, que comme une traduction extrieure, contingente et matrielle, de ces tats internes qui, seuls, passaient pour avoir une valeur intrinsque. Cette conception est tellement rpandue que la plupart du temps, les dbats dont la religion est le thme tournent autour de la question de savoir si elle peut ou non se concilier avec la science, c'est--dire si, ct de la connaissance scientifique, il y a place pour une autre forme de pense qui serait spcifiquement religieuse. Mais les croyants, les hommes qui, vivant de la vie religieuse, ont la sensation directe de ce qui la constitue, objectent cette manire de voir qu'elle ne rpond pas leur exprience journalire. Ils sentent, en effet, que la vraie fonction de la religion n'est pas de nous faire penser, d'enrichir notre connaissance, d'ajouter aux reprsentations que nous devons la science des reprsentations d'une autre origine et d'un autre caractre, mais de nous faire agir, de nous aider vivre. Le fidle qui a communi avec son dieu n'est pas seulement un homme qui voit des vrits nouvelles que l'incroyant ignore ; c'est un homme qui peut davantage. 11 sent en lui plus de force soit pour supporter les difficults de l'existence soit pour les vaincre. Il est comme lev au-dessus des misres humaines parce qu'il est lev au-dessus de sa condition d'homme ; il se croit sauv du mal, sous quelque forme, d'ailleurs, qu'il conoive le mal. Le premier article de toute foi, c'est la croyance au salut par la foi. Or, on ne voit pas comment une simple ide pourrait avoir cette efficacit. Une ide, en effet, n'est qu'un lment de nous-mmes ; comment pourrait-elle nous confrer des pouvoirs suprieurs ceux que nous tenons de notre nature ? Si riche qu'elle soit en vertus affectives elle ne saurait rien ajouter notre vitalit naturelle ; car elle ne peut que dclencher les forces motives qui sont en nous, non les crer ni les accrotre. De ce que nous nous reprsentons un objet comme digne d'tre aim et recherch, il ne suit pas que nous nous sentions plus forts; niais il faut que de cet objet se dgagent des nergies suprieures celles dont nous disposons et, de plus, que nous ayons quelque moyen de les faire pntrer en nous et de les mler notre vie intrieure. Or, pour cela, il ne suffit pas que nous les pensions, mais il est indispensable que nous nous placions dans leur sphre d'action, que nous nous tournions du ct par o nous pouvons le mieux ressentir leur influence ; en un mot, il faut que nous agissions et que nous rptions les actes qui sont ainsi ncessaires, toutes les fois que c'est utile pour en renouveler les effets. On entrevoit comment, de ce point de vue, cet ensemble d'actes rgulirement rpts qui constitue le culte reprend toute son importance. En fait, quiconque a rellement pratiqu une religion sait bien
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
367
que c'est le culte qui suscite ces impressions de joie, de paix intrieure, de srnit, d'enthousiasme qui sont, pour le fidle, comme la preuve exprimentale de ses croyances. Le culte n'est pas simplement un systme de signes par lesquels la foi se traduit au dehors, c'est la collection des moyens par lesquels elle se cre et se recre priodiquement. Qu'il consiste en manuvres matrielles ou en oprations mentales, c'est toujours lui qui est efficace. Toute notre tude repose sur ce postulat que ce sentiment unanime des croyants de tous les temps ne peut pas tre purement illusoire. Tout comme un rcent apologiste de la foi , nous admettons donc que les croyances religieuses reposent sur une exprience spcifique dont la valeur dmonstrative, en un sens, n'est pas infrieure celle des expriences scientifiques, tout en tant diffrente. Nous aussi nous pensons qu'un arbre se connat ses fruits et que sa fcondit est la meilleure preuve de ce que valent ses racines. Mais de ce qu'il existe, si l'on veut, une exprience religieuse et de ce qu'elle est fonde en quelque manire - est-il, d'ailleurs, une exprience qui ne le soit pas ? - il ne suit aucunement que la ralit qui la fonde soit objectivement conforme l'ide que s'en font les croyants. Le fait mme que la faon dont elle a t conue a infiniment vari suivant les temps suffit prouver qu'aucune de ces conceptions ne l'exprime adquatement. Si le savant pose comme un axiome que les sensations de chaleur, de lumire, qu'prouvent les hommes, rpondent quelque cause objective, il n'en conclut pas que celle-ci soit telle qu'elle apparat aux sens. De mme, si les impressions que ressentent les fidles ne sont pas imaginaires, cependant elles ne constituent pas des intuitions privilgies ; il n'y a aucune raison de penser qu'elles nous renseignent mieux sur la nature de leur objet que les sensations vulgaires sur la nature des corps et de leurs proprits. Pour dcouvrir en quoi cet objet consiste, il faut donc leur faire subir une laboration analogue celle qui a substitu la reprsentation sensible du monde une reprsentation scientifique et conceptuelle.
1302 1303
Or c'est prcisment ce que nous avons tent de faire et nous avons vu que cette ralit, que les mythologies se sont reprsentes sous tant de formes diffrentes, mais qui est la cause objective, universelle et ternelle de ces sensations sui generis dont est faite l'exprience religieuse, c'est la socit. Nous avons montr quelles forces morales elle dveloppe et comment elle veille ce sentiment d'appui, de sauvegarde, de dpendance tutlaire qui attache le fidle son culte. C'est elle qui l'lve au-dessus de lui-mme : c'est mme elle qui le fait. Car ce qui fait l'homme, c'est cet ensemble de biens intellectuels qui constitue la civilisation, et la civilisation est luvre de la socit. Et ainsi s'explique le rle prpondrant du culte dans toutes les religions, quelles qu'elles soient. C'est que la socit ne peut faire sentir son influence que si elle est un acte, et elle n'est un acte que si les individus qui la composent sont assembls et agissent en commun. C'est par l'action commune qu'elle prend conscience de soi et se pose ; elle est avant tout une coopration active. Mme les ides et les sentiments collectifs ne sont possibles que grce des mouvements extrieurs qui les symbolisent, ainsi que nous l'avons tabli . C'est donc l'action qui domine la vie religieuse par cela seul que c'est la socit qui en est la source.
1304
1302 1303 1304
William James, The Varieties or Religious Experience. James, op. cit. (p. 19 de la traduction franaise). V. plus haut, p. 329 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
368
A toutes les raisons qui ont t donnes pour justifier cette conception, une dernire peut tre ajoute qui se dgage de tout cet ouvrage. Nous avons tabli chemin faisant que les catgories fondamentales de la pense et, par consquent la science, ont des origines religieuses. Nous avons vu qu'il en est de mme de la magie et, par suite, des diverses techniques qui en sont drives. D'autre part, on sait depuis longtemps que, jusqu' un moment relativement avanc de l'volution, les rgles de la morale et du droit ont t indistinctes des prescriptions rituelles. On peut donc dire, en rsum, que presque toutes les grandes institutions sociales sont nes de la religion . Or, pour que les principaux aspects de la vie collective aient commenc par n'tre que des aspects varis de la vie religieuse, il faut videmment que la vie religieuse soit la forme minente et comme une expression raccourcie de la vie collective tout entire. Si la religion a engendr tout ce qu'il y a d'essentiel dans la socit, c'est que l'ide de la socit est l'me de la religion.
1305
Les forces religieuses sont donc des forces humaines, des forces morales. Sans doute, parce que les sentiments collectifs ne peuvent prendre conscience d'eux-mmes qu'en se fixant sur des objets extrieurs, elles n'ont pu elles-mmes se constituer sans prendre aux choses quelques-uns de leurs caractres : elles ont acquis ainsi une sorte de nature physique ; ce titre, elles sont venues se mler la vie du monde matriel et c'est par elles qu'on a cru pouvoir expliquer ce qui s'y passe. Mais quand on ne les considre que par ce ct et dans ce rle, on ne voit que ce qu'elles ont de plus superficiel. En ralit, c'est la conscience que sont emprunts les lments essentiels dont elles sont faites. Il semble d'ordinaire qu'elles n'aient un caractre humain que quand elles sont penses sous forme humaine ; mais mme les plus impersonnelles et les plus anonymes ne sont autre chose que des sentiments objectivs.
1306
C'est condition de voir les religions par ce biais qu'il est possible d'apercevoir leur vritable signification. A s'en tenir aux apparences, les rites font souvent l'effet d'oprations purement manuelles : ce sont des onctions, des lavages, des repas. Pour consacrer une chose, on la met en contact avec une source d'nergie religieuse, tout comme, aujourd'hui, pour chauffer un corps ou pour l'lectriser, on le met en rapports avec une source de chaleur ou d'lectricit ; les procds employs de part et d'autre ne sont pas essentiellement diffrents. Ainsi entendue, la technique religieuse semble tre une sorte de mcanique mystique. Mais ces manuvres matrielles ne sont que l'enveloppe extrieure sous laquelle se dissimulent des oprations mentales. Finalement, il s'agit, non pas d'exercer une sorte de contrainte physique sur des forces aveugles et, d'ailleurs, imaginaires, mais d'atteindre des consciences, de les tonifier, de les discipliner. On a dit parfois des religions infrieures qu'elles taient matrialistes. L'expression est inexacte. Toutes les religions, mme les plus grossires, sont, en un sens, spiritualistes: car les puissances qu'elles mettent en jeu sont, avant tout, spirituelles et, d'autre part, c'est sur la vie morale qu'elles ont pour principale fonction d'agir. On comprend
1305
Une seule forme de l'activit sociale n'a pas encore t expressment rattache la religion: c'est l'activit conomique. Toutefois les techniques qui drivent de la magie se trouvent, par cela mme, avoir des origines indirectement religieuses. De plus, la valeur conomique est une sorte de pouvoir, d'efficacit, et nous savons les origines religieuses de l'ide de pouvoir. La richesse peut confrer du mana; c'est donc qu'elle en a. Par l, on entrevoit que l'ide de valeur conomique et celle de valeur religieuse ne doivent pas tre sans rapports. Mais la question de savoir quelle est la nature de ces rapports n'a pas encore t tudie. 1306 C'est pour cette raison que Frazer et mme Preuss mettent les forces religieuses impersonnelles en dehors ou, tout au plus, sur le seuil de la religion, pour les rattacher la magie.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
369
ainsi que ce qui a t fait au nom de la religion ne saurait avoir t fait en vain : car c'est ncessairement la socit des hommes, c'est l'humanit qui en a recueilli les fruits. Mais, dit-on, quelle est au juste la socit dont on fait ainsi le substrat de la vie religieuse ? Est-ce la socit relle, telle qu'elle existe et fonctionne sous nos yeux, avec l'organisation morale, juridique, qu'elle s'est laborieusement faonne au cours de l'histoire ? Mais elle est pleine de tares et d'imperfections. Le mal y ctoie le bien, l'injustice y rgne souvent en matresse, la vrit y est chaque instant obscurcie par l'erreur. Comment un tre aussi grossirement constitu pourrait-il inspirer les sentiments d'amour, l'enthousiasme ardent, l'esprit d'abngation que toutes les religions rclament de leurs fidles ? Ces tres parfaits que sont les dieux ne peuvent avoir emprunt leurs traits une ralit aussi mdiocre, parfois mme aussi basse. S'agit-il, au contraire, de la socit parfaite, o la justice et la vrit seraient souveraines, d'o le mal, sous toutes ses formes, serait extirp ? On ne conteste pas qu'elle ne soit en rapport troit avec le sentiment religieux ; car, diton, c'est la raliser que tendent les religions. Seulement, cette socit-l n'est pas une donne empirique, dfinie et observable ; c'est une chimre, c'est un rve dont les hommes ont berc leurs misres, mais qu'ils n'ont jamais vcu dans la ralit. C'est une simple ide qui vient traduire dans la conscience nos aspirations plus ou moins obscures vers le bien, le beau, l'idal. Or, ces aspirations ont en nous leurs racines ; elles viennent des profondeurs mmes de notre tre ; il n'y a donc rien hors de nous qui puisse en rendre compte. D'ailleurs, elles sont dj religieuses par elles-mmes ; la socit idale suppose donc la religion, loin de pouvoir l'expliquer .
1307
Mais tout d'abord, c'est simplifier arbitrairement les choses que de ne voir la religion que par son ct idaliste: elle est raliste sa manire. Il n'y a pas de laideur physique ou morale, il n'y a pas de vices, pas de maux qui n'aient t diviniss. Il y a en des dieux du vol et de la ruse, de la luxure et de la guerre, de la maladie et de la mort. Le christianisme lui-mme, si haute que soit l'ide qu'il se fait de la divinit, a t oblig de faire l'esprit du mal une place dans sa mythologie. Satan est une pice essentielle du systme chrtien ; or, si c'est un tre impur, ce n'est pas un tre profane. L'anti-dieu est un dieu, infrieur et subordonn, il est vrai, dou pourtant de pouvoirs tendus ; il est mme l'objet de rites, tout au moins ngatifs. Loin donc que la religion ignore la socit relle et en fasse abstraction, elle en est l'image ; elle en reflte tous les aspects, mme les plus vulgaires et les plus repoussants. Tout s'y retrouve et si, le plus souvent, on y voit le bien l'emporter sur le mal, la vie sur la mort, les puissances de lumire sur les puissances de tnbres, c'est qu'il n'en est pas autrement dans la ralit. Car si le rapport entre ces forces contraires tait renvers, la vie serait impossible; or, en fait, elle se maintient et tend mme se dvelopper. Mais si, travers les mythologies et les thologies, on voit clairement transparatre la ralit, il est bien vrai qu'elle ne s'y retrouve qu'agrandie, transforme, idalise. Sous ce rapport, les religions les plus primitives ne diffrent pas des plus rcentes et des plus raffines. Nous avons vu, par exemple, comment les Arunta placent l'origine des temps une socit mythique dont l'organisation reproduit exactement celle qui existe encore aujourd'hui; elle
1307
BOUTROUX, Science et religion, pp. 206-207.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
370
comprend les mmes clans et les mmes phratries, elle est soumise la mme rglementation matrimoniale, elle pratique les mmes rites. Mais les personnages qui la composent sont des tres idaux, dous de pouvoirs et de vertus auxquels ne peut prtendre le commun des mortels. Leur nature n'est pas seulement plus haute, elle est diffrente, puisqu'elle tient la foi de l'animalit et de l'humanit. Les puissances mauvaises y subissent une mtamorphose analogue : le mal lui-mme est comme sublim et idalis. La question qui se pose est de savoir d'o vient cette idalisation. On rpond que l'homme a une facult naturelle d'idaliser, c'est--dire de substituer au monde de la ralit un monde diffrent o il se transporte par la pense. Mais c'est changer les termes du problme ; ce n'est pas le rsoudre ni mme le faire avancer. Cette idalisation systmatique est une caractristique essentielle des religions Les expliquer par un pouvoir inn d'idaliser, c'est donc tout simplement remplacer un mot par un autre qui est l'quivalent du premier; c'est comme si l'on disait que l'homme a cr la religion parce qu'il avait une nature religieuse. Pourtant, l'animal lie connat qu'un seul monde : c'est celui qu'il peroit par l'exprience tant interne qu'externe. Seul, l'homme a la facult de concevoir l'idal et d'ajouter au rel. D'o lui vient donc ce singulier privilge ? Avant d'en faire un fait premier, une vertu mystrieuse qui chappe la science, encore faut-il s'tre assur qu'il ne dpend pas de conditions empiriquement dterminables. L'explication que nous avons propose de la religion a prcisment cet avantage d'apporter une rponse cette question. Car ce qui dfinit le sacr, c'est qu'il est surajout au rel ; or l'idal rpond la mme dfinition : on ne peut donc expliquer l'un sans expliquer l'autre. Nous avons vu, en effet, que si la vie collective, quand elle atteint un certain degr d'intensit, donne l'veil la pense religieuse, c'est parce qu'elle dtermine un tat d'effervescence qui change les conditions de l'activit psychique. Les nergies vitales sont surexcites, les passions plus vives, les sensations plus fortes ; il en est mme qui ne se produisent qu' ce moment. L'homme ne se reconnat pas ; il se sent comme transform et, par suite, il transforme le milieu qui l'entoure. Pour se rendre compte des impressions trs particulires qu'il ressent, il prte aux choses avec lesquelles il est le plus directement en rapport des proprits qu'elles n'ont pas, des pouvoirs exceptionnels, des vertus que ne possdent pas les objets de l'exprience vulgaire. En un mot, au monde rel o s'coule sa vie profane il en superpose un autre qui, en un sens, n'existe que dans sa pense, mais auquel il attribue, par rapport au premier, une sorte de dignit plus haute. C'est donc, ce double titre, un monde idal. Ainsi, la formation d'un idal ne constitue pas un fait irrductible, qui chappe la science; il dpend de conditions que l'observation peut atteindre ; c'est un produit naturel de la vie sociale. Pour que la socit puisse prendre conscience de soi et entretenir, au degr d'intensit ncessaire, le sentiment qu'elle a d'elle-mme, il faut qu'elle s'assemble et se concentre. Or, cette concentration dtermine une exaltation de la vie morale qui se traduit par un ensemble de conceptions idales o vient se peindre la vie nouvelle qui s'est ainsi veille ; elles correspondent cet afflux de forces psychiques qui se surajoutent alors celles dont nous disposons pour les tches quotidiennes de l'existence. Une socit ne peut ni se crer ni se recrer sans, du mme coup, crer de l'idal. Cette cration n'est pas pour elle une sorte d'acte surgatoire, par lequel elle se complterait, une fois forme ; c'est l'acte par lequel elle se fait et
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
371
se refait priodiquement. Aussi, quand on oppose la socit idale la socit relle comme deux antagonistes qui nous entraneraient en des sens contraires, on ralise et on oppose des abstractions. La socit idale n'est pas en dehors de la socit relle ; elle en fait partie. Bien loin que nous soyons partags entre elles comme entre deux ples qui se repoussent, on ne peut pas tenir l'une sans tenir l'autre. Car une socit n'est pas simplement constitue par la masse des individus qui la composent, par le sol qu'ils occupent, par les choses dont ils se servent, par les mouvements qu'ils accomplissent, mais, avant tout, par l'ide qu'elle se fait d'elle-mme. Et sans doute, il arrive qu'elle hsite sur la manire dont elle doit se concevoir : elle se sent tiraille en des sens divergents. Mais ces conflits, quand ils clatent, ont lieu non entre l'idal et la ralit, mais entre idaux diffrents, entre celui d'hier et celui d'aujourd'hui, entre celui qui a pour lui l'autorit de la tradition et celui qui est seulement en voie de devenir. Il y a assurment lieu de rechercher d'o vient que les idaux voluent; mais quelque solution qu'on donne ce problme, il n'en reste pas moins que tout se passe dans le monde de l'idal. Loin donc que l'idal collectif que la religion exprime soit d je ne sais quel pouvoir inn de l'individu, c'est bien plutt l'cole de la vie collective que l'individu a appris idaliser. C'est en s'assimilant les idaux labors par la socit qu'il est devenu capable de concevoir l'idal. C'est la socit qui, en l'entranant dans sa sphre d'action, lui a fait contracter le besoin de se hausser au-dessus du monde de l'exprience et lui a, en mme temps, fourni les moyens d'en concevoir un autre. Car ce monde nouveau, c'est elle qui l'a construit en se construisant elle-mme, puisque c'est elle qu'il exprime. Ainsi, aussi bien chez l'individu que dans le groupe, la facult d'idaliser n'a rien de mystrieux. Elle n'est pas une sorte de luxe dont l'homme pourrait se passer, mais une condition de son existence. Il ne serait pas un tre social, c'est--dire qu'il ne serait pas un homme, s'il ne l'avait acquise. Sans doute, en s'incarnant chez les individus, les idaux collectifs tendent s'individualiser. Chacun les entend sa faon, les marque de son empreinte ; on en retranche des lments, on en ajoute d'autres. L'idal personnel se dgage ainsi de l'idal social, a mesure que la personnalit individuelle se dveloppe et devient une source autonome d'action. Mais si l'on veut comprendre cette aptitude, si singulire en apparence, vivre en dehors du rel, il suffit de la rattacher aux conditions sociales dont elle dpend. Il faut donc se garder de voir dans cette thorie de la religion un simple rajeunissement du matrialisme historique : ce serait se mprendre singulirement sur notre pense. En montrant dans la religion une chose essentiellement sociale, nous n'entendons nullement dire qu'elle se borne traduire, en un autre langage, les formes matrielles de la socit et ses ncessits vitales immdiates. Sans doute, nous considrons comme une vidence que la vie sociale dpend de son substrat et en porte la marque, de mme que la vie mentale de l'individu dpend de l'encphale et mme de l'organisme tout entier. Mais la conscience collective est autre chose qu'un simple piphnomne de sa base morphologique, tout comme la conscience individuelle est autre chose qu'une simple efflorescence du systme nerveux. Pour que la premire apparaisse, il faut que se produise une synthse sui generis des consciences particulires. Or, cette synthse a pour effet de dgager tout un monde de sentiments, d'ides, d'images qui, une fois ns, obissent des lois qui leur sont propres. Ils s'appellent, se repoussent, fusionnent, se segmentent, prolifrent sans que toutes ces combinaisons soient directement commandes et ncessites par l'tat de la ralit sous-jacente. La vie ainsi souleve jouit mme d'une assez
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
372
grande indpendance pour qu'elle se joue parfois en des manifestations sans but, sans utilit d'aucune sorte, pour le seul plaisir de s'affirmer. Nous avons prcisment montr que c'est souvent le cas de l'activit rituelle et de la pense mythologique .
1308
Mais si la religion est un produit de causes sociales, comment expliquer le culte individuel et le caractre universaliste de certaines religions. Si elle est ne in foro externo, comment a-telle pu passer dans le for intrieur de l'individu et s'y engager de plus en plus profondment ? Si elle est luvre de socits dfinies et individualises, comment a-t-elle pu s'en dtacher jusqu' tre conue comme la chose commune de l'humanit ? Nous avons rencontr au cours de notre recherche les premiers germes de la religion individuelle et du cosmopolitisme religieux, et nous avons vu comment ils se sont forms ; nous possdons ainsi les lments les plus gnraux de la rponse qui peut tre faite cette double question. Nous avons montr, en effet, comment la force religieuse qui anime le clan, en s'incarnant dans les consciences particulires, se particularise elle-mme. Ainsi se forment des tres sacrs secondaires ; chaque individu a les siens, faits son image, associs sa vie intime, solidaires de sa destine : c'est l'me, le totem individuel, l'anctre protecteur, etc. Ces tres sont l'objet de rites que le fidle peut clbrer seul, en dehors de tout groupement ; c'est donc bien une premire forme de culte individuel. Assurment, ce n'est pas encore qu'un culte trs rudimentaire ; mais c'est que, comme la personnalit individuelle est alors trs peu marque, comme on lui attribue peu de valeur, le culte qui l'exprime ne pouvait tre encore trs dvelopp. Mais mesure que les individus se sont diffrencis davantage et que la valeur de la personne s'est accrue, le culte correspondant a pris lui-mme plus de place dans l'ensemble de la vie religieuse, en mme temps qu'il s'est clos plus hermtiquement au dehors. L'existence de cultes individuels n'implique donc rien qui contredise ou qui embarrasse une explication sociologique de la religion ; car les forces religieuses auxquelles ils s'adressent ne sont que des formes individualises de forces collectives. Ainsi, alors mme que la religion semble tenir tout entire dans le for intrieur de l'individu, c'est encore dans la socit que se trouve la source vive laquelle elle s'alimente. Nous pouvons maintenant apprcier ce que vaut cet individualisme radical qui voudrait faire de la religion une chose purement individuelle : il mconnat les conditions fondamentales de la vie religieuse. S'il est rest jusqu' prsent l'tat d'aspirations thoriques qui ne se sont jamais ralises, c'est qu'il est irralisable. Une philosophie peut bien s'laborer dans le silence de la mditation intrieure, mais non une foi. Car une foi est, avant tout, chaleur, vie, enthousiasme, exaltation de toute l'activit mentale, transport de l'individu au-dessus de lui-mme. Or, comment pourrait-il, sans sortir de soi, ajouter aux nergies qu'il possde ? Comment pourrait-il se dpasser par ses seules forces ? Le seul foyer de chaleur auquel nous puissions nous rchauffer moralement est celui que forme la socit de nos semblables ; les seules forces morales dont nous puissions sustenter et accrotre les ntres sont celles que nous prte autrui. Admettons mme qu'il existe rellement des tres plus ou moins analogues ceux que nous reprsentent les mythologies. Pour qu'ils puissent
1308
V. plus haut, p. 542 et suiv. Cf. sur cette mme question notre article: Reprsentations individuelles et reprsentations collectives, in Revue de Mtaphysique, mai 1898.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
373
avoir sur les mes l'action utile qui est leur raison d'tre, il faut qu'on croie en eux. Or les croyances ne sont actives que quand elles sont partages. On peut bien les entretenir quelque temps par un effort tout personnel ; mais ce n'est pas ainsi qu'elles naissent ni qu'elles s'acquirent; il est mme douteux qu'elles puissent se conserver dans ces conditions. En fait, l'homme qui a une vritable foi prouve invinciblement le besoin de la rpandre ; pour cela; il sort de son isolement, il se rapproche des autres, il cherche les convaincre et c'est l'ardeur des convictions qu'il suscite qui vient rconforter la sienne. Elle s'tiolerait vite si elle restait seule. Il en est de l'universalisme religieux comme de l'individualisme. Bien loin que ce soit un attribut exclusif de quelques trs grandes religions, nous l'avons trouv, non pas sans doute la base, mais au sommet du systme australien. Bunjil, Daramulun, Baiame ne sont pas de simples dieux tribaux; chacun d'eux est reconnu par une pluralit de tribus diffrentes. Leur culte est, en un sens, international. Cette conception est donc toute proche de celle qu'on retrouve dans les thologies les plus rcentes. Aussi certains crivains ont-ils cru devoir, pour cette raison, en nier l'authenticit, si incontestable qu'elle soit. Or nous avons pu montrer comment elle s'est forme. Des tribus voisines et de mme civilisation ne peuvent pas ne pas tre en rapports constants les unes avec les autres. Toutes sortes de circonstances leur en fournissent l'occasion : en dehors du commerce, qui est alors rudimentaire, il y a les mariages ; car les mariages internationaux sont trs frquents en Australie. Au cours de ces rencontres, les hommes prennent naturellement conscience de la parent morale qui les unit. Ils ont la mme organisation sociale, la mme division en phratries, clans, classes matrimoniales ; ils pratiquent les mmes rites d'initiation ou des rites tout fait similaires. Des emprunts mutuels ou des conventions achvent de renforcer ces ressemblances spontanes. Les dieux auxquels taient rattaches des institutions aussi manifestement identiques pouvaient difficilement rester distincts dans les esprits. Tout les rapprochait et, par suite, supposer mme que chaque tribu en ait labor la notion d'une manire indpendante, ils devaient ncessairement tendre se confondre les uns dans les autres. Il est, d'ailleurs, probable que c'est dans des assembles inter-tribales qu'ils furent primitivement conus. Car ce sont, avant tout, des dieux de l'initiation et, dans les crmonies d'initiation, des tribus diffrentes sont gnralement reprsentes. Si donc des tres sacrs se sont forms qui ne se rattachent aucune socit, gographiquement dtermine, ce n'est pas qu'ils aient une origine extra-sociale. Mais c'est que, par-dessus ces groupements gographiques, il en existe dj d'autres dont les contours sont plus indcis : ils n'ont pas de frontires arrtes, mais comprennent toute sorte de tribus plus ou moins voisines et parentes. La vie sociale trs particulire qui s'en dgage tend donc se rpandre sur une aire d'extension sans limites dfinies. Tout naturellement, les personnages mythologiques qui y correspondent ont le mme caractre; leur sphre d'influence n'est pas dlimite ; ils planent par-dessus les tribus particulires et par-dessus l'espace. Ce sont les grands dieux internationaux. Or il n'y a rien dans cette situation qui soit spcial aux socits australiennes. Il n'est pas de peuple, pas d'tat qui ne soit engag dans une autre socit, plus ou moins illimite, qui comprend tous les peuples, tous les tats avec lesquels le premier est directement ou indirectement en rapports ; il n'y a pas de vie nationale qui ne soit domine par une vie
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
374
collective de nature internationale. A mesure qu'on avance dans l'histoire, ces groupements internationaux prennent plus d'importance et d'tendue. On entrevoit ainsi comment, dans certains cas, la tendance universaliste a pu se dvelopper au point d'affecter, non plus seulement les ides les plus hautes du systme religieux, mais les principes mmes sur lesquels il repose.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
375
II
.
Il y a donc dans la religion quelque chose d'ternel qui est destin survivre tous les symboles particuliers dans lesquels la pense religieuse s'est successivement enveloppe. Il ne peut pas y avoir de socit qui ne sente le besoin d'entretenir et de raffermir, intervalles rguliers, les sentiments collectifs et les ides collectives qui font son unit et sa personnalit. Or, cette rfection morale ne peut tre obtenue qu'au moyen de runions, d'assembles, de congrgations o les individus, troitement rapprochs les uns des autres, raffirment en commun leurs communs sentiments ; de l, des crmonies qui, par leur objet, par les rsultats qu'elles produisent, par les procds qui y sont employs, ne diffrent pas en nature des crmonies proprement religieuses. Quelle diffrence essentielle y a-t-il entre une assemble de chrtiens clbrant les principales dates de la vie du Christ, ou de juifs ftant soit la sortie d'gypte soit la promulgation du dcalogue, et une runion de citoyens commmorant l'institution d'une nouvelle charte morale ou quelque grand vnement de la vie nationale ? Si nous avons peut-tre quelque mal aujourd'hui nous reprsenter en quoi pourront consister ces ftes et ces crmonies de l'avenir, c'est que nous traversons une phase de transition et de mdiocrit morale. Les grandes choses du pass, celles qui enthousiasmaient nos pres, n'excitent plus chez nous la mme ardeur, soit parce qu'elles sont entres dans l'usage commun au point de nous devenir inconscientes, soit parce qu'elles ne rpondent plus nos aspirations actuelles ; et cependant, il ne s'est encore rien fait qui les remplace. Nous ne pouvons plus nous passionner pour les principes au nom desquels le christianisme recommandait aux matres de traiter humainement leurs esclaves, et, d'autre part, l'ide qu'il se fait de l'galit et de la fraternit humaine nous parat aujourd'hui laisser trop de place d'injustes ingalits. Sa piti pour les humbles nous semble trop platonique; nous en voudrions une qui ft plus efficace; mais nous ne voyons pas encore clairement ce qu'elle doit tre ni comment elle pourra se raliser dans les faits. En un mot, les anciens dieux vieillissent on meurent, et d'autres ne sont pas ns. C'est ce qui a rendu vaine la tentative de Comte en vue d'organiser une religion avec de vieux souvenirs historiques, artificiellement rveills : c'est de la vie elle-mme, et non d'un pass mort que peut sortir un culte vivant. Mais cet tat d'incertitude et d'agitation confuse ne saurait durer ternellement. Un jour viendra o nos socits connatront nouveau des heures d'effervescence cratrice au cours desquelles de nouveaux idaux surgiront, de nouvelles formules se dgageront qui serviront, pendant un temps, de guide l'humanit ; et ces heures une fois vcues, les hommes prouveront spontanment le besoin de les revivre de temps en temps par la pense, c'est--dire d'en entretenir le souvenir au moyen de ftes qui en revivifient rgulirement les fruits. Dj nous avons vu comment la Rvolution institua tout un cycle de ftes pour tenir dans un tat de perptuelle jeunesse les principes dont elle s'inspirait. Si l'institution priclita vite, c'est que la foi rvolutionnaire ne dura qu'un temps; c'est que les dceptions et le dcouragement succ-
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
376
drent rapidement au premier moment d'enthousiasme. Mais, quoique l'uvre ait avort, elle nous permet de nous reprsenter ce qu'elle aurait pu tre dans d'autres conditions ; et tout fait penser qu'elle sera tt ou tard reprise. Il n'y a pas d'vangiles qui soient immortels et il n'y a pas de raison de croire que l'humanit soit dsormais incapable d'en concevoir de nouveaux. Quant savoir ce que seront les symboles o viendra s'exprimer la foi nouvelle, s'ils ressembleront ou non ceux du pass, s'ils seront plus adquats la ralit qu'ils auront pour objet de traduire, c'est l une question qui dpasse les facults humaines de prcision et qui, d'ailleurs, ne tient pas au fond des choses. Mais les ftes, les rites, le culte en un mot, ne sont pas toute la religion. Celle-ci n'est pas seulement un systme de pratiques ; c'est aussi un systme d'ides dont l'objet est d'exprimer le mode; nous avons vu que mme les plus humbles ont leur cosmologie. Quelque rapport qu'il puisse y avoir entre ces deux lments de la vie religieuse, ils ne laissent pas d'tre trs diffrents. L'un est tourn du ct de l'action qu'il sollicite et qu'il rgle; l'autre du ct de la pense qu'il enrichit et qu'il organise. Ils ne dpendent donc pas des mmes conditions et, par suite, il y a lieu de se demander si le second rpond des ncessits aussi universelles et aussi permanentes que le premier. Quand on attribue la pense religieuse des caractres spcifiques, quand on croit qu'elle a pour fonction d'exprimer, par des mthodes qui lui sont propres, tout un aspect du rel qui chappe la connaissance vulgaire comme la science, on se refuse naturellement admettre que la religion puisse jamais tre dchue de son rle spculatif. Mais l'analyse des faits ne nous a pas paru dmontrer cette spcificit. La religion que nous venons d'tudier est une de celles o les symboles employs sont le plus dconcertants pour la raison. Tout y parat mystrieux. Ces tres qui participent la fois des rgnes les plus htrognes, qui se multiplient sans cesser d'tre uns, qui se fragmentent sans se diminuer, semblent, au premier abord, appartenir un monde entirement diffrent de celui o nous vivons; on a mme t jusqu' dire que la pense qui l'a construit ignorait totalement les lois de la logique. jamais, peut-tre, le contraste entre la raison et la foi n'a t plus accus. Si donc il y eut un moment dans l'histoire o leur htrognit devrait ressortir avec vidence, c'est bien celui-l. Or, contrairement aux apparences, nous avons constat que les ralits auxquelles s'applique alors la spculation religieuse sont celles-l mmes qui serviront plus tard d'objets la rflexion des savants : c'est la nature, l'homme, la socit. Le mystre qui parat les entourer est tout superficiel et se dissipe devant une observation plus approfondie : il suffit d'carter le voile dont l'imagination mythologique les a recouvertes pour qu'elles apparaissent telles qu'elles sont. Ces ralits, la religion s'efforce de les traduire en un langage intelligible qui ne diffre pas en nature de celui que la science emploie ; de part et d'autre il s'agit de rattacher les choses les unes aux autres, d'tablir entre elles des relations internes, de les classer, de les systmatiser. Nous avons mme vu que les notions essentielles de la logique scientifique sont d'origine religieuse. Sans doute, la science, pour les utiliser, les soumet une laboration nouvelle ; elle les pure de toute sorte d'lments adventices; d'une manire gnrale elle apporte, dans toutes ses dmarches, un esprit critique qu'ignore la religion ; elle s'entoure de prcautions pour viter la prcipitation et la prvention , pour tenir l'cart les passions, les prjugs et toutes les influences subjectives. Mais ces perfectionnements mthodologiques ne suffisent pas la diffrencier de la religion. L'une et l'autre, sous ce rapport, poursuivent le mme but ; la pense scientifique
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
377
n'est qu'une forme plus parfaite de la pense religieuse. Il semble donc naturel que la seconde s'efface progressivement devant la premire, mesure que celle-ci devient plus apte s'acquitter de la tche. Et il n'est pas douteux, en effet, que cette rgression ne se soit produite au cours de l'histoire. Issue de la religion, la science tend se substituer cette dernire pour tout ce qui concerne les fonctions cognitives et intellectuelles. Dj le christianisme a consacre dfinitivement cette substitution dans l'ordre des phnomnes matriels. Voyant dans la matire la chose profane par excellence, il en a facilement abandonn la connaissance une discipline trangre, tradidit mundum hominum disputationi ; c'est ainsi que les sciences de la nature ont pu s'tablir et faire reconnatre leur autorit sans de trop grandes difficults. Mais il ne pouvait se dessaisir aussi aisment du monde des mes ; car c'est sur les mes que le dieu des chrtiens aspire avant tout rgner. C'est pourquoi, pendant longtemps, l'ide de soumettre la vie psychique la science faisait l'effet d'une sorte de profanation; mme aujourd'hui, elle rpugne encore nombre d'esprits. Cependant, la psychologie exprimentale et comparative s'est constitue et il faut aujourd'hui compter avec elle. Mais le monde de la vie religieuse et morale reste encore interdit. La grande majorit des hommes continue croire qu'il y a l un ordre de choses o l'esprit ne peut pntrer que par des voies trs spciales. De l, les vives rsistances que l'on rencontre toutes les fois que l'on essaie de traiter scientifiquement les phnomnes religieux et moraux. Mais, en dpit des oppositions, ces tentatives se rptent et cette persistance mme permet de prvoir que cette dernire barrire finira par cder et que la science s'tablira en matresse mme dans cette rgion rserve. Voil en quoi consiste le conflit de la science et de la religion. On s'en fait souvent une ide inexacte. On dit que la science nie la religion en principe. Mais la religion existe ; c'est un systme de faits donns ; en un mot, c'est une ralit. Comment la science pourrait-elle nier une ralit ? De plus, en tant que la religion est action, en tant qu'elle est un moyen de faire vivre les hommes, la science ne saurait en tenir lieu, car si elle exprime la vie, elle ne la cre pas ; elle peut bien chercher expliquer la foi, mais, par cela mme, elle la suppose. Il n'y a donc de conflit que sur un point limit. Des deux fonctions que remplissait primitivement la religion, il en existe une, mais une seule, qui tend de plus en plus lui chapper : c'est la fonction spculative. Ce que la science conteste la religion, ce n'est pas le droit d'tre, c'est le droit de dogmatiser sur la nature des choses, c'est l'espce de comptence spciale qu'elle s'attribuait pour connatre de l'homme et du monde. En fait, elle ne se connat pas elle-mme. Elle ne sait ni de quoi elle est faite ni quels besoins elle rpond. Elle est elle-mme objet de science ; tant s'en faut qu'elle puisse faire la loi la science! Et comme, d'un autre ct, en dehors du rel quoi s'applique la rflexion scientifique, il n'existe pas d'objet propre sur lequel porte la spculation religieuse, il est vident que celle-ci ne saurait jouer dans l'avenir le mme rle que dans le pass. Cependant, elle parat appele se transformer plutt qu' disparatre. Nous avons dit qu'il y a dans la religion quelque chose d'ternel ; c'est le culte, la foi. Mais les hommes ne peuvent clbrer des crmonies auxquelles ils ne verraient pas de raison d'tre, ni accepter une foi qu'ils ne comprendraient d'aucune manire. Pour la rpandre ou simplement
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
378
pour l'entretenir, il faut la justifier, c'est--dire en faire la thorie. Une thorie de ce genre est, sans doute, tenue de s'appuyer sur les diffrentes sciences, partir du moment o elles existent ; sciences sociales d'abord, puisque la foi religieuse a ses origines dans la socit ; psychologie, puisque la socit est une synthse de consciences humaines ; sciences de la nature enfin, puisque l'homme et la socit sont fonction de l'univers et n'en peuvent tre abstraits qu'artificiellement. Mais si importants que puissent tre les emprunts faits aux sciences constitues, ils ne sauraient suffire ; car la foi est avant tout un lan agir et la science, si loin qu'on la pousse, reste toujours distance de l'action. La science est fragmentaire, incomplte ; elle n'avance que lentement et n'est jamais acheve ; la vie, elle, ne peut attendre. Des thories qui sont destines faire vivre, faire agir, sont donc obliges de devancer la science et de la complter prmaturment. Elles ne sont possibles que si les exigences de la pratique et les ncessits vitales, telles que nous les sentons sans les concevoir distinctement, poussent la pense en avant, par-del ce que la science nous permet d'affirmer. Ainsi, les religions, mme les plus rationnelles et les plus lacises, ne peuvent pas et ne pourront jamais se passer d'une sorte trs particulire de spculation qui, tout en ayant les mmes objets que la science elle-mme, ne saurait pourtant tre proprement scientifique : les intuitions obscures de la sensation et du sentiment y tiennent souvent lieu de raisons logiques. Par un ct, cette spculation ressemble donc celle que nous rencontrons dans les religions du pass ; mais, par un autre, elle s'en distingue. Tout en s'accordant le droit de dpasser la science, elle doit commencer par la connatre et par s'en inspirer. Ds que l'autorit de la science est tablie, il faut en tenir compte; on peut aller plus loin qu'elle sous la pression de la ncessit, mais c'est d'elle qu'il faut partir. On ne peut rien affirmer qu'elle nie, rien nier qu'elle affirme, rien tablir qui ne s'appuie, directement ou indirectement, sur des principes qu'on lui emprunte. Ds lors, la loi n'exerce plus, sur le systme des reprsentations que l'on peut continuer appeler religieuses, la mme hgmonie qu'autrefois. En face d'elle, se dresse une puissance rivale qui, ne d'elle, la soumet dsormais sa critique et son contrle. Et tout fait prvoir que ce contrle deviendra toujours plus tendu et plus efficace, sans qu'il soit possible d'assigner de limite son influence future.
III
.
Mais si les notions fondamentales de la science sont d'origine religieuse, comment la religion a-t-elle pu les engendrer ? On n'aperoit pas au premier abord quels rapports il peut y avoir entre la logique et la religion. Mme, puisque la ralit qu'exprime la pense religieuse est la socit, la question peut se poser dans les termes suivants qui en font mieux apparatre encore toute la difficult : qu'est-ce qui a pu faire de la vie sociale une source aussi importante de vie logique ? Rien, semble-t-il, ne la prdestinait ce rle ; car ce n'est videmment pas pour satisfaire des besoins spculatifs que les hommes se sont associs.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
379
On nous trouvera peut-tre tmraire d'aborder ici un problme d'une telle complexit. Pour pouvoir le traiter comme il conviendrait, il faudrait que les conditions sociologiques de la connaissance fussent mieux connues qu'elles ne sont ; nous commenons seulement entrevoir quelques-unes d'entre elles. Cependant, la question est si grave et elle est si directement implique par tout ce qui prcde que nous devons faire effort pour ne pas la laisser sans rponse. Peut-tre, d'ailleurs, n'est-il pas impossible de poser ds prsent quelques principes gnraux qui sont tout au moins de nature clairer la solution. La matire de la pense logique est faite de concepts. Chercher comment la socit peut avoir jou un rle dans la gense de la pense logique revient donc se demander comment elle peut avoir pris part la formation des concepts. Si, comme il arrive le plus ordinairement, on ne voit dans le concept qu'une ide gnrale, le problme parat insoluble. L'individu, en effet, peut, par ses moyens propres, comparer ses perceptions ou ses images, dgager ce qu'elles ont de commun, en un mot gnraliser. Il est donc malais d'apercevoir pourquoi la gnralisation ne serait possible que dans et par la socit. Mais d'abord, il est inadmissible que la pense logique se caractrise exclusivement par la plus grande extension des reprsentations qui la constituent. Si les ides particulires n'ont rien de logique, pourquoi en serait-il autrement des ides gnrales ? Le gnral n'existe que dans le particulier ; c'est le particulier simplifi et appauvri. Le premier ne saurait donc avoir des vertus et des privilges que n'a pas le second. Inversement, si la pense conceptuelle peut s'appliquer au genre, l'espce, la varit, si restreinte que celle-ci puisse tre, pourquoi ne pourrait-elle pas s'tendre l'individu, c'est--dire la limite vers laquelle tend la reprsentation mesure que son extension diminue ? En fait, il existe bien des concepts qui ont des individus pour objets. Dans toute espce de religion, les dieux sont des individualits distinctes les unes des autres ; pourtant, ils sont conus, non perus. Chaque peuple se reprsente d'une certaine faon, variable suivant les temps, ses hros historiques ou lgendaires ; ces reprsentations sont conceptuelles. Enfin, chacun de nous se fait une certaine notion des individus avec lesquels il est en rapport, de leur caractre, de leur physionomie, des traits distinctifs de leur temprament physique et moral : ces notions sont de vritables concepts. Sans doute, ils sont, en gnral, assez grossirement forms ; mais mme parmi les concepts scientifiques, en est-il beaucoup qui soient parfaitement adquats leur objet ? Sous ce rapport, il n'y a, entre les uns et les autres, que des diffrences de degrs. C'est donc par d'autres caractres qu'il faut dfinir le concept. Il s'oppose aux reprsentations sensibles de tout ordre - sensations, perceptions ou images - par les proprits suivantes. Les reprsentations sensibles sont dans un flux perptuel; elles se poussent les unes les autres comme les flots d'un fleuve et, mme pendant le temps qu'elles durent, elles ne restent pas semblables elles-mmes. Chacune d'elles est fonction de l'instant prcis o elle a lieu. Nous ne sommes jamais assurs de retrouver une perception telle que nous l'avons prouve une premire fois ; car si la chose perue n'a pas chang, c'est nous qui ne sommes plus le mme homme. Le concept, au contraire, est comme en dehors du temps et du devenir ; il est soustrait toute cette agitation ; on dirait qu'il est situ dans une rgion diffrente de l'esprit, plus sereine et plus calme. Il ne se meut pas de lui-mme, par une volution interne et
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
380
spontane ; au contraire, il rsiste au changement. C'est une manire de penser qui, chaque moment du temps, est fixe et cristallise . Dans la mesure o il est ce qu'il doit tre, il est immuable. S'il change, ce n'est pas qu'il soit dans sa nature de changer ; c'est que nous avons dcouvert en lui quelque imperfection; c'est qu'il a besoin d'tre rectifi. Le systme de concepts avec lequel nous pensons dans la vie courante est celui qu'exprime le vocabulaire de notre langue maternelle car chaque mot traduit un concept. Or la langue est fixe elle ne change que trs lentement et, par consquent, il en est de mme de l'organisation conceptuelle qu'elle exprime. Le savant se trouve dans la mme situation vis--vis de la terminologie spciale qu'emploie la science laquelle il se consacre, et, par consquent, vis--vis du systme spcial de concepts auquel cette terminologie correspond. Sans doute, il peut innover, mais ses innovations sont toujours des sortes de violences faites des manires de penser institues.
1309
En mme temps qu'il est relativement immuable, le concept est, sinon universel, du moins universalisable. Un concept n'est pas mon concept ; il m'est commun avec d'autres hommes ou, en tout cas, il peut leur tre communiqu. Il m'est impossible de faire passer une sensation de ma conscience dans la conscience d'autrui; elle tient troitement mon organisme et ma personnalit et elle n'en peut tre dtache. Tout ce que je puis faire est d'inviter autrui se mettre en face du mme objet que moi et s'ouvrir son action. Au contraire, la conversation, le commerce intellectuel entre les hommes consiste dans un change de concepts. Le concept est une reprsentation essentiellement impersonnelle : c'est par lui que les intelligences humaines communient .
1310
La nature du concept, ainsi dfini, dit ses origines. S'il est commun tous, c'est qu'il est l'uvre de la communaut. Puisqu'il ne porte l'empreinte d'aucune intelligence particulire, c'est qu'il est labor par une intelligence unique o toutes les autres se rencontrent et viennent, en quelque sorte, S'alimenter. S'il a plus de stabilit que les sensations ou que les images, c'est que les reprsentations collectives sont plus stables que les reprsentations individuelles ; car, tandis que l'individu est sensible mme de faibles changements qui se produisent dans son milieu interne ou externe, seuls, des vnements d'une suffisante gravit peuvent russir affecter l'assiette mentale de la socit. Toutes les fois que nous sommes en prsence d'un type de pense ou d'action, qui s'impose uniformment aux volonts ou aux intelligences particulires, cette pression exerce sur l'individu dcle l'intervention de la collectivit. D'ailleurs, nous disions prcdemment que les concepts avec lesquels nous pensons
1311
1309 1310
William James, The Principles or Psychology, I, p. 464. Cette universalit du concept ne doit pas tre confondue avec sa gnralit : ce sont choses trs diffrentes. Ce que nous appelons universalit, c'est la proprit qu'a le concept d'tre communiqu une pluralit d'esprits, et mme, en principe, tous les esprits ; or cette communicabilit est tout fait indpendante de son degr d'extension. Uri concept qui ne s'applique qu' un seul objet, dont l'extension, par suite, est minima, peut tre universel en ce sens qu'il est le mme pour tous les entendements ; tel, le concept d'une divinit. 1311 On objectera que souvent, chez l'individu, par le seul effet de la rptition, des manires d'agir ou de penser se fixent et se cristallisent sous forme d'habitudes qui rsistent au changement. Mais l'habitude n'est qu'une tendance rpter automatiquement un acte ou une ide 1 toutes les fois que les mmes circonstances la rveillent ; elle n'implique pas que l'ide ou l'acte soient constitus l'tat de types exemplaires, proposs ou imposs J'esprit on la volont. C'est seulement quand un type de ce genre est prtabli, c'est--dire quand une rgle, une norme est institue, que l'action sociale peut et doit tre prsume.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
381
couramment sont ceux qui sont consigns dans le vocabulaire. Or il n'est pas douteux que le langage et, par consquent, le systme de concepts qu'il traduit, est le produit d'une laboration collective. Ce qu'il exprime, c'est la manire dont la socit dans son ensemble se reprsente les objets de l'exprience. Les notions qui correspondent aux divers lments de la langue sont donc des reprsentations collectives. Le contenu mme de ces notions tmoigne dans le mme sens. Il n'est gure de mots, en effet, mme parmi ceux que nous employons usuellement, dont l'acception ne dpasse plus ou moins largement les limites de notre exprience personnelle. Souvent un terme exprime des choses que nous n'avons jamais perues, des expriences que nous n'avons jamais faites ou dont nous n'avons jamais t les tmoins. Mme quand nous connaissons quelques-uns des objets auxquels il se rapporte, ce n'est qu' titre d'exemples particuliers qui viennent illustrer l'ide, mais qui, eux seuls, n'auraient jamais suffi la constituer. Dans le mot, se trouve donc condense toute une science laquelle je n'ai pas collabor, une science plus qu'individuelle ; et elle me dborde un tel point que je ne puis mme pas m'en approprier compltement tous les rsultats. Qui de nous connat tous les mots de la langue qu'il parle et la signification intgrale de chaque mot ? Cette remarque permet de dterminer en quel sens nous entendons dire que les concepts sont des reprsentations collectives. S'ils sont communs un groupe social tout entier, ce n'est pas qu'ils reprsentent une simple moyenne entre les reprsentations individuelles correspondantes ; car alors ils seraient plus pauvres que ces dernires en contenu intellectuel, tandis qu'en ralit ils sont gros d'un savoir qui dpasse celui de l'individu moyen. Ce sont, non des abstraits qui n'auraient de ralit que dans les consciences particulires, mais des reprsentations tout aussi concrtes que celles que l'individu peut se faire de son milieu personnel : elles correspondent la manire dont cet tre spcial qu'est la socit pense les choses de son exprience propre. Si, en fait, les concepts sont le plus souvent des ides gnrales, s'ils expriment des catgories et des classes plutt que des objets particuliers, c'est que les caractres singuliers et variables des tres n'intressent que rarement la socit ; en raison mme de son tendue, elle ne peut gure tre affecte que par leurs proprits gnrales et permanentes, C'est donc de ce ct que se porte son attention : il est dans sa nature de voir le plus souvent les choses par grandes masses et sous l'aspect qu'elles ont le plus gnralement. Mais il n'y a pas cela de ncessit; et, en tout cas, mme quand ces reprsentations ont le caractre gnrique qui leur est le plus habituel, elles sont luvre de la socit, et elles sont riches de son exprience. C'est l, d'ailleurs, ce qui fait le prix que la pense conceptuelle a pour nous. Si les concepts n'taient que des ides gnrales, ils n'enrichiraient pas beaucoup la connaissance ; car le gnral, comme nous l'avons dj dit, ne contient rien de plus que le particulier. Mais si ce sont, avant tout, des reprsentations collectives, ils ajoutent, ce que peut nous apprendre notre exprience personnelle, tout ce que la collectivit a accumul de sagesse et de science au cours des sicles. Penser par concepts, ce n'est pas simplement voir le rel par le ct le plus gnral ; c'est projeter sur la sensation une lumire qui l'claire, la pntre et la transforme. Concevoir une chose, c'est en mme temps qu'en mieux apprhender les lments essentiels, la situer dans un ensemble ; car chaque civilisation a son systme organis de concepts qui la caractrise. En
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
382
face de ce systme de notions, l'esprit individuel est dans la mme situation que le nous de Platon en face du monde des Ides. Il s'efforce de se les assimiler, car il en a besoin pour pouvoir commercer avec ses semblables ; mais l'assimilation est toujours imparfaite. Chacun de nous les voit sa faon. Il en est qui nous chappent compltement, qui restent en dehors de notre cercle de vision; d'autres, dont nous n'apercevons que certains aspects. Il en est mme, et beaucoup, que nous dnaturons en les pensant ; car, comme elles sont collectives par nature, elles ne peuvent s'individualiser sans tre retouches, modifies et, par consquent, fausses. De l vient que nous avons tant de mal nous entendre, que, souvent mme, nous nous mentons, sans le vouloir, les uns aux autres : c'est que nous employons tous les mmes mots sans leur donner tous le mme sens. On peut maintenant entrevoir quelle est la part de la socit dans la gense de la pense logique. Celle-ci n'est possible qu' partir du moment oh, au-dessus des reprsentations fugitives qu'il doit l'exprience sensible, l'homme est arriv concevoir tout un monde d'idaux stables, lieu commun des intelligences. Penser logiquement, en effet, c'est toujours, en quelque mesure, penser d'une manire impersonnelle, c'est aussi penser sub specie aeternitatis. Impersonnalit, stabilit, telles sont les deux caractristiques de la vrit. Or la vie logique suppose videmment que l'homme sait, tout au moins confusment, qu'il y a une vrit, distincte des apparences sensibles. Mais comment a-t-il pu parvenir cette conception ? On raisonne le plus souvent comme si elle avait d se prsenter spontanment lui ds qu'il ouvrit les yeux sur le monde. Cependant, il n'y a rien dans l'exprience immdiate qui puisse la suggrer; tout mme la contredit. Aussi l'enfant et l'animal n'en ont-ils mme pas le soupon. L'histoire montre, d'ailleurs, qu'elle a mis des sicles se dgager et se constituer. Dans notre monde occidental, c'est avec les grands penseurs de la Grce qu'elle a pris, pour la premire fois, une claire conscience d'elle-mme et des consquences qu'elle implique ; et, quand la dcouverte se fit, ce fut un merveillement, que Platon a traduit en un langage magnifique. Mais si c'est seulement cette poque que l'ide s'est exprime en formules philosophiques, elle prexistait ncessairement l'tat de sentiment obscur. Ce sentiment, les philosophes ont cherch l'lucider; ils ne l'ont pas cr. Pour qu'ils pussent le rflchir et l'analyser, il fallait qu'il leur ft donn et il s'agit de savoir d'o il venait, c'est--dire dans quelle exprience il tait fond. C'est dans l'exprience collective. C'est sous la forme de la pense collective que la pense impersonnelle s'est, pour la premire fois, rvle l'humanit ; et on ne voit pas par quelle autre voie aurait pu se faire cette rvlation. Par cela seul que la socit existe, il existe aussi, en dehors des sensations et des images individuelles, tout un systme de reprsentations qui jouissent de proprits merveilleuses. Par elles, les hommes se comprennent, les intelligences se pntrent les unes les autres. Elles ont en elles une sorte de force, d'ascendant moral en vertu duquel elles s'imposent aux esprits particuliers. Ds lors l'individu se rend compte, au moins obscurment, qu'au-dessus de ses reprsentations prives il existe un monde de notions-types d'aprs lesquelles il est tenu de rgler ses ides ; il entrevoit tout un rgne intellectuel auquel il participe, mais qui le dpasse. C'est une premire intuition du rgne de la vrit. Sans doute, partir du moment o il eut ainsi conscience de cette plus haute intellectualit, il s'appliqua en scruter la nature ; il chercha d'o ces reprsentations minentes tenaient leurs prrogatives et, dans la mesure o il crut en avoir dcouvert les causes, il entreprit de mettre lui-mme ces causes en oeuvre pour en tirer, par ses propres forces, les effets qu'elles impliquent ; c'est--dire qu'il s'accorda lui-mme le droit de faire des concepts.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
383
Ainsi, la facult de concevoir s'individualisa. Mais, pour bien comprendre les origines de la fonction, il faut la rapporter aux conditions sociales dont elle dpend. On objectera que nous ne montrons le concept que par un de ses aspects, qu'il n'a pas uniquement pour rle d'assurer l'accord des esprits les uns avec les autres, mais aussi, et plus encore, leur accord avec la nature des choses. Il semble qu'il n'ait toute sa raison d'tre qu' condition d'tre vrai, c'est--dire objectif, et que son impersonnalit doive n'tre qu'une consquence de son objectivit. C'est dans les choses, penses aussi adquatement que possible, que les esprits devraient communier. Nous ne nions pas que l'volution conceptuelle ne se fasse en partie dans ce sens. Le concept qui, primitivement, est tenu pour vrai parce qu'il est collectif tend ne devenir collectif qu' condition d'tre tenu pour vrai : nous lui demandons ses titres avant de lui accorder notre crance. Mais tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui encore la trs grande gnralit des concepts dont nous nous servons ne sont pas mthodiquement constitus ; nous les tenons du langage, c'est--dire de l'exprience commune, sans qu'ils aient t soumis aucune critique pralable. Les concepts scientifiquement labors et critiqus sont toujours en trs faible minorit. De plus, entre eux et ceux qui tirent toute leur autorit de cela seul qu'ils sont collectifs, il n'y a que des diffrences de degrs. Une reprsentation collective, parce qu'elle est collective, prsente dj des garanties d'objectivit ; car ce n'est pas sans raison qu'elle a pu se gnraliser et se maintenir avec une suffisante persistance. Si elle tait en dsaccord avec la nature des choses, elle n'aurait pu acqurir un empire tendu et prolong sur les esprits. Au fond, ce qui fait la confiance qu'inspirent les concepts scientifiques, c'est qu'ils sont susceptibles d'tre mthodiquement contrls. Or, une reprsentation collective est ncessairement soumise un contrle indfiniment rpt : les hommes qui y adhrent la vrifient par leur exprience propre. Elle ne saurait donc tre compltement inadquate son objet. Elle peut l'exprimer, sans doute, l'aide de symboles imparfaits ; mais les symboles scientifiques eux-mmes ne sont jamais qu'approchs. C'est prcisment ce principe qui est la base de la mthode que nous suivons dans l'tude des phnomnes religieux : nous regardons comme un axiome que les croyances religieuses, si tranges qu'elles soient parfois en apparence, ont leur vrit qu'il faut dcouvrir .
1312
Inversement, il s'en faut que les concepts, mme quand ils sont construits suivant toutes les rgles de la science, tirent uniquement leur autorit de leur valeur objective. Il ne suffit pas qu'ils soient vrais pour tre crus. S'ils ne sont pas en harmonie avec les autres croyances, les autres opinions, en un mot avec l'ensemble des reprsentations collectives, ils seront nis ; les esprits leur seront ferms ; ils seront, par suite, comme s'ils n'taient pas. Si, aujourd'hui, il suffit en gnral qu'ils portent l'estampille de la science pour rencontrer une sorte de crdit privilgi, c'est que nous avons foi dans la science. Mais cette foi ne diffre pas essentiellement de la foi religieuse. La valeur que nous attribuons la science dpend en somme de l'ide que nous nous faisons collectivement de sa nature et de son rle dans la vie; c'est dire qu'elle exprime un tat d'opinion. C'est qu'en effet, tout dans la vie sociale, la science elle-mme, repose sur l'opinion. Sans doute, on peut prendre l'opinion comme objet d'tude et en faire la science ; c'est en cela que consiste principalement la sociologie. Mais la science de l'opinion ne fait pas l'opinion; elle ne peut que l'clairer, la rendre plus consciente de soi. Par l, il est vrai,
1312
On voit combien il s'en faut qu'une reprsentation manque de valeur objective par cela seul qu'elle a une origine sociale.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
384
elle peut l'amener changer ; mais la science continue dpendre de l'opinion au moment o elle parat lui faire la loi; car, comme nous l'avons montr, c'est de l'opinion qu'elle tient la force ncessaire pour agir sur l'opinion .
1313
Dire que les concepts expriment la manire dont la socit se reprsente les choses, c'est dire aussi que la pense conceptuelle est contemporaine de l'humanit. Nous nous refusons donc y voir le produit d'une culture plus on moins tardive. Un homme qui ne penserait pas par concepts ne serait pas un homme ; car ce ne serait pas un tre social. Rduit aux seuls percepts individuels, il serait indistinct de l'animal. Si la thse contraire a pu tre soutenue, c'est qu'on a dfini le concept par des caractres qui ne lui sont pas essentiels. On l'a identifi avec l'ide gnrale et avec une ide gnrale nettement dlimite et circonscrite . Dans ces conditions, il a pu sembler que les socits infrieures ne connaissent pas le concept proprement dit : car elles n'ont que des procds de gnralisation rudimentaires et les notions dont elles se servent ne sont gnralement pas dfinies. Mais la plupart de nos concepts actuels ont la mme indtermination ; nous ne nous astreignons gure les dfinir que dans les discussions et quand nous faisons oeuvre de savants. D'un autre ct, nous avons vu que concevoir n'est pas gnraliser. Penser conceptuellement, ce n'est pas simplement isoler et grouper ensemble les caractres communs un certain nombre d'objets ; c'est subsumer le variable sous le permanent, l'individuel sous le social. Et puisque la pense logique commence avec le concept, il suit qu'elle a toujours exist ; il n'y a pas eu de priode historique pendant laquelle les hommes auraient vcu, d'une manire chronique, dans la confusion et la contradiction. Certes, on ne saurait trop insister sur les caractres diffrentiels que prsente la logique aux divers moments de l'histoire; elle volue comme les socits elles-mmes. Mais si relles que soient les diffrences, elles ne doivent pas faire mconnatre les similitudes qui ne sont pas moins essentielles.
1314 1315
IV
.
Nous pouvons maintenant aborder une dernire question que posait dj notre introduction et qui est reste comme sous-entendue dans toute la suite de cet ouvrage. Nous avons vu que certaines, tout au moins, des catgories, sont choses sociales, Il s'agit de savoir d'o leur vient ce caractre.
1316
Sans doute, puisqu'elles sont elles-mmes des concepts, on comprend sans peine qu'elles soient luvre de la collectivit. Il n'est mme pas de concepts qui prsentent au mme degr les signes auxquels se reconnat une reprsentation collective. En effet, leur stabilit et leur
1313 1314 1315 1316
Cf. plus haut, p. 298. Les fonctions mentales dans les socits infrieures, pp. 131-138. Ibid., p. 446. V. plus haut, p. 26.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
385
impersonnalit sont telles qu'elles ont souvent pass pour tre absolument universelles et immuables. D'ailleurs, comme elles expriment les conditions fondamentales de l'entente entre les esprits, il parat vident qu'elles n'ont pu tre labores que par la socit. Mais, en ce qui les concerne, le problme est plus complexe : car elles sont sociales en un autre sens et comme au second degr. Non seulement elles viennent de la socit, mais les choses mmes qu'elles expriment sont sociales. Non seulement c'est la socit qui les a institues, mais ce sont des aspects diffrents de l'tre social qui leur servent de contenu : la catgorie de genre a commenc par tre indistincte du concept de groupe humain; c'est le rythme de la vie sociale qui est la base de la catgorie de temps ; c'est l'espace occup par la socit qui a fourni la matire de la catgorie d'espace ; c'est la force collective qui a t le prototype du concept de force efficace, lment essentiel de la catgorie de causalit. Cependant, les catgories ne sont pas faites pour s'appliquer uniquement au rgne social; elles s'tendent la ralit tout entire. Comment donc est-ce la socit qu'ont t emprunts les modles sur lesquels elles ont t construites. C'est que ce sont des concepts minents qui jouent dans la connaissance un rle prpondrant. Les catgories ont, en effet, pour fonction de dominer et d'envelopper tous les autres concepts : ce sont les cadres permanents de la vie mentale. Or, pour qu'elles puissent embrasser un tel objet, il faut qu'elles se soient formes sur une ralit d'une gale ampleur. Sans doute, les relations qu'elles expriment existent, d'une manire implicite, dans les consciences individuelles. L'individu vit dans le temps et il a, comme nous l'avons dit, un certain sens de l'orientation temporelle. Il est situ un point dtermin de l'espace et on a pu soutenir, avec de bonnes raisons, que toutes ses sensations ont quelque chose de spatial . Il a le sentiment des ressemblances ; en lui, les reprsentations similaires s'appellent, se rapprochent et la reprsentation nouvelle, forme par leur rapprochement, a dj quelque caractre gnrique. Nous avons galement la sensation d'une certaine rgularit dans l'ordre de succession des phnomnes; l'animal lui-mme n'en est pas incapable. Seulement, toutes ces relations sont personnelles l'individu qui y est engag et, par suite, la notion qu'il en peut acqurir ne peut, en aucun cas, s'tendre au del de son troit horizon. Les images gnriques qui se forment dans ma conscience par la fusion d'images similaires ne reprsentent que les objets que j'ai directement perus ; il n'y a rien l qui puisse me donner l'ide d'une classe, c'est--dire d'un cadre capable de comprendre le groupe total de tous les objets possibles qui satisfont la mme condition. Encore faudrait-il avoir au pralable l'ide de groupe, que le seul spectacle de notre vie intrieure ne saurait suffire veiller en nous. Mais surtout il n'y a pas d'exprience individuelle, si tendue et si prolonge soit-elle, qui puisse nous faire mme souponner l'existence d'un genre total, qui embrasserait l'universalit des tres, et dont les autres genres ne seraient que des espces coordonnes entre elles ou subordonnes les unes aux autres. Cette notion du tout, qui est la base des classifications que nous avons rapportes, ne peut nous venir de l'individu qui n'est lui-mme qu'une partie par rapport au tout et qui n'atteint jamais qu'une fraction infime de la ralit. Et pourtant, il n'est peut-tre pas de catgorie plus essentielle ; car comme le rle des catgories est d'envelopper tous les autres concepts, la catgorie par excellence parat bien devoir tre le concept mme de totalit. Les thoriciens de
1317
1317
William James, Principes of Psychology, I, p. 134.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
386
la connaissance le postulent d'ordinaire comme s'il allait de soi, alors qu'il dpasse infiniment le contenu de chaque conscience individuelle prise part. Pour les mmes raisons, l'espace que je connais par mes sens, dont je suis le centre et o tout est dispos par rapport moi ne saurait tre l'espace total, qui contient toutes les tendues particulires, et o, de plus, elles sont coordonnes par rapport des points de repre impersonnels, communs tous les individus. De mme, la dure concrte que je sens s'couler en moi et avec moi ne saurait me donner l'ide du temps total : la premire n'exprime que le rythme de ma vie individuelle ; le second doit correspondre au rythme d'une vie qui n'est celle d'aucun individu en particulier, mais laquelle tous participent . De mme, enfin, les rgularits que je puis percevoir dans la manire dont mes sensations se succdent peuvent bien avoir de la valeur pour moi; elles expliquent comment, quand l'antcdent d'un couple de phnomnes dont j'ai expriment la constance m'est donn, je tends attendre le consquent. Mais cet tat d'attente personnel ne saurait tre confondu avec la conception d'un ordre universel de succession que s'impose la totalit des esprits et des vnements.
1318
Puisque le monde qu'exprime le systme total des concepts est celui que se reprsente la socit, la socit seule peut nous fournir les notions les plus gnrales suivant lesquelles il doit tre reprsent. Seul, un sujet, qui enveloppe tous les sujets particuliers est capable d'embrasser un tel objet. Puisque l'univers n'existe qu'autant qu'il est pens et puisqu'il n'est pens totalement que par la socit, il prend place en elle ; il devient un lment de sa vie intrieure, et ainsi elle est elle-mme le genre total en dehors duquel il n'existe rien. Le concept de totalit n'est que la forme abstraite du concept de socit : elle est le tout qui comprend toutes choses, la classe suprme qui renferme toutes les autres classes. Tel est le principe profond sur lequel reposent ces classifications primitives o les tres de tous les rgnes sont situs et classs dans les cadres sociaux au mme titre que les hommes . Mais si le monde est dans la socit, l'espace qu'elle occupe se confond avec l'espace total. Nous avons vu, en effet, comment chaque chose a sa place assigne sur l'espace social; et ce qui montre bien quel point cet espace total diffre des tendues concrtes que nous font percevoir les sens, c'est que cette localisation est tout idale et ne ressemble en rien ce qu'elle serait si elle ne nous tait dicte que par l'exprience sensible . Pour la mme raison, le rythme de la vie collective domine et embrasse les rythmes varis de toutes les vies lmentaires dont il rsulte ; par suite, le temps qui l'exprime domine et embrasse toutes les dures particulires. C'est le temps total. L'histoire du monde n'a t pendant longtemps qu'un autre aspect de l'histoire de la socit. L'une commence avec l'autre ; les priodes de la premire sont dtermines par les priodes de la seconde. Ce qui mesure cette dure impersonnelle et globale, ce qui fixe les points de repre par rapport auxquels elle est divise et organise, ce sont les mouvements de concentration ou de dispersion de la socit ; plus gnralement, ce sont les ncessits priodiques de la rfection collective. Si ces instants critiques se rattachent le plus souvent quelque phnomne
1319 1320
1318
On parle souvent de l'espace et du temps comme s'ils n'taient que l'tendue et la dure concrtes, telles que peut les sentir la conscience individuelle, mais appauvries par l'abstraction. En ralit, ce sont des reprsentations d'un tout autre genre, construites avec d'autres lments, suivant un plan trs diffrent, et en vue de fins galement diffrentes. 1319 Au fond, concept de totalit, concept de socit, concept de divinit ne sont vraisemblablement que des aspects diffrents d'une seule et mme notion. 1320 V. Classifications primitives, toc. cil., p. 40 et suiv.
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
387
matriel, comme la rcurrence rgulire de tel astre ou l'alternance des saisons, c'est parce que des signes objectifs sont ncessaires pour rendre sensible tous cette organisation essentiellement sociale. De mme, enfin, la relation causale, du moment o elle est pose collectivement par le groupe, se trouve indpendante de toute conscience individuelle ; elle plane au-dessus de tous les esprits et de tous les vnements particuliers, C'est une loi d'une valeur impersonnelle. Nous avons montr que c'est bien ainsi qu'elle parat avoir pris naissance. Une autre raison explique que les lments constitutifs des catgories aient d tre emprunts la vie sociale : c'est que les relations qu'elles expriment ne pouvaient devenir conscientes que dans et par la socit. Si, en un sens, elles sont immanentes la vie de l'individu, celui-ci n'avait aucune raison ni aucun moyen de les apprhender, de les rflchir, de les expliciter et de les riger en notions distinctes. Pour s'orienter personnellement dans l'tendue, pour savoir quels moments il devait satisfaire aux diffrentes ncessits organiques, il n'avait nul besoin de se faire, une fois pour toutes, une reprsentation conceptuelle du temps ou de l'espace. Bien des animaux savent retrouver le chemin qui les mne aux endroits qui leur sont familiers; ils y reviennent au moment convenable, sans qu'ils aient pourtant aucune catgorie ; des sensations suffisent les diriger automatiquement. Elles suffiraient galement l'homme si ses mouvements n'avaient satisfaire qu' des besoins individuels. Pour reconnatre qu'une chose ressemble d'autres dont nous avons dj l'exprience, il n'est nullement ncessaire que nous rangions les unes et les autres en genres et en espces : la manire dont les images semblables s'appellent et fusionnent suffit donner le sentiment de la ressemblance. L'impression du dj vu, du dj prouv, n'implique aucune classification. Pour discerner les choses que nous devons rechercher de celles que nous devons fuir, nous n'avons que faire de rattacher les effets des unes et des autres leurs causes par un lien logique, lorsque des convenances individuelles sont seules en jeu. Des conscutions purement empiriques, de fortes connexions entre des reprsentations concrtes sont, pour la volont, des guides tout aussi srs. Non seulement l'animal n'en a pas d'autres, mais trs souvent notre pratique prive ne suppose rien de plus. L'homme avis est celui qui a, de ce qu'il faut faire, une sensation trs nette, mais qu'il serait, le plus souvent, incapable de traduire en loi. Il en est autrement de la socit. Celle-ci n'est possible que si les individus et les choses qui la composent sont rpartis entre diffrents groupes, c'est--dire classs, et si ces groupes euxmmes sont classs les uns par rapport aux autres. La socit suppose donc une organisation consciente de soi qui n'est autre chose qu'une classification. Cette organisation de la socit se communique naturellement l'espace qu'elle occupe. Pour prvenir tout heurt, il faut que chaque groupe particulier, une portion dtermine d'espace soit affecte : en d'autres termes, il faut que l'espace total soit divis, diffrenci, orient, et que ces divisions et ces orientations soient connues de tous les esprits. D'autre part, toute convocation une fte, une chasse, une expdition militaire implique que des dates sont fixes, convenues et, par consquent, qu'un temps commun est tabli que tout le monde conoit de la mme faon. Enfin, le concours de plusieurs en vue de poursuivre une fin commune n'est possible que si l'on s'entend sur le rapport qui existe entre cette fin et les moyens qui permettent de l'atteindre, c'est--dire si une mme relation causale est admise par tous les cooprateurs de la mme entreprise. Il n'est donc pas tonnant que le temps social, l'espace social, les classes sociales, la causalit collective
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
388
soient la base des catgories correspondantes, puisque c'est sous leurs formes sociales que des diffrentes relations ont, pour la premire fois, t apprhendes avec une certaine clart par la conscience humaine. En rsum, la socit n'est nullement l'tre illogique ou alogique, incohrent et fantasque qu'on se plat trop souvent voir en elle. Tout au contraire, la conscience collective est la forme la plus haute de la vie psychique, puisque c'est une conscience de consciences. Place en dehors et au-dessus des contingences individuelles et locales, elle ne voit les choses que par leur aspect permanent et essentiel qu'elle fixe en des notions communicables. En mme temps qu'elle voit de haut, elle voit au loin; chaque moment du temps, elle embrasse toute la ralit connue ; c'est pourquoi elle seule peut fournir l'esprit des cadres qui s'appliquent la totalit des tres et qui permettent de les penser. Ces cadres, elle ne les cre pas artificiellement ; elle les trouve en elle ; elle ne fait qu'en prendre conscience. Ils traduisent des manires d'tre qui se rencontrent tous les degrs du rel, mais qui n'apparaissent en pleine clart qu'au sommet, parce que l'extrme complexit de la vie psychique qui s'y droule ncessite un plus grand dveloppement de la conscience. Attribuer la pense logique des origines sociales, ce n'est donc pas la rabaisser, en diminuer la valeur, la rduire n'tre qu'un systme de combinaisons artificielles ; c'est, au contraire, la rapporter une cause qui l'implique naturellement. Ce n'est pas dire assurment que des notions labores de cette manire puissent se trouver immdiatement adquates leurs objets. Si la socit est quelque chose d'universel par rapport l'individu, elle ne laisse pas d'tre elle-mme une individualit qui a sa physionomie personnelle, son idiosyncrasie ; c'est un sujet particulier et qui, par suite, particularise ce qu'il pense. Les reprsentations collectives contiennent donc, elles aussi, des lments subjectifs et il est ncessaire qu'elles soient progressivement pures pour devenir plus proches des choses. Mais, si grossires qu'elles puissent tre l'origine, il reste qu'avec elles le germe d'une mentalit nouvelle tait donn laquelle l'individu n'aurait jamais pu s'lever par ses seules forces : ds lors, la voie tait ouverte la pense stable, impersonnelle et organise qui n'avait plus ensuite qu' dvelopper sa nature. D'ailleurs, les causes qui ont dtermin ce dveloppement semblent bien ne pas diffrer spcifiquement de celles qui en sont suscit le germe initial. Si la pense logique tend de plus en plus se dbarrasser des lments subjectifs et personnels qu'elle charrie encore l'origine, ce n'est pas parce que des facteurs extra-sociaux sont intervenus; c'est beaucoup plutt parce qu'une vie sociale d'un genre nouveau s'est de plus en plus dveloppe. Il s'agit de cette vie internationale qui a dj pour effet d'universaliser les croyances religieuses. A mesure qu'elle s'tend, l'horizon collectif s'largit; la socit cesse d'apparatre comme le tout par excellence, pour devenir la partie d'un tout beaucoup plus vaste, aux frontires indtermines et susceptibles de reculer indfiniment. Par suite, les choses ne peuvent plus tenir dans les cadres sociaux o elles taient primitivement classes ; elles demandent tre organises d'aprs des principes qui leur soient propres et, ainsi, l'organisation logique se diffrencie de l'organisation sociale et devient autonome. Voila, semble-t-il, comment le lien qui rattachait tout d'abord la pense des individualits collectives dtermines va de plus en plus en se dtachant ; comment, par suite, elle devient toujours impersonnelle et s'universalise. La pense vraiment et proprement humaine n'est pas une donne primitive ; c'est un produit de l'histoire ; c'est une limite idale dont nous nous rapprochons toujours davantage, mais que, selon toute
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
389
vraisemblance, nous ne parviendrons jamais atteindre. Ainsi, bien loin qu'il y ait entre la science d'une part, la morale et la religion de l'autre, l'espce d'antinomie qu'on a si souvent admise, ces diffrents modes de l'activit humaine drivent, en ralit, d'une seule et mme source. C'est ce qu'avait bien compris Kant, et c'est pourquoi il a fait de la raison spculative et de la raison pratique deux aspects diffrents de la mme facult. Ce qui, suivant lui, fait leur unit, c'est qu'elles sont toutes deux orientes vers l'universel. Penser rationnellement, c'est penser suivant des lois qui s'imposent l'universalit des tres raisonnables ; agir moralement, c'est se conduire suivant des maximes qui puissent, sans contradictions, tre tendues l'universalit des volonts. En d'autres termes, la science et la morale impliquent que l'individu est capable de s'lever au-dessus de son point de vue propre et de vivre d'une vie impersonnelle. Et il n'est pas douteux, en effet, que ce ne soit l un trait commun toutes les formes suprieures de la pense et de l'action. Seulement, ce que le kantisme n'explique pas, c'est d'o vient l'espce de contradiction que l'homme se trouve ainsi raliser. Pourquoi est-il contraint de se faire violence pour dpasser sa nature d'individu, et inversement, pourquoi la loi impersonnelle est-elle oblige de dchoir en s'incarnant dans des individus ? Dira-t-on qu'il existe deux mondes antagonistes auxquels nous participons galement : le monde de la matire et des sens d'une part, le monde de la raison pure et impersonnelle de l'autre ? Mais c'est rpter la question dans des termes peine diffrents ; car il s'agit prcisment de savoir pourquoi il nous fait mener concurremment ces deux existences. Pourquoi ces deux mondes, qui semblent se contredire, ne restent-ils pas en dehors l'un de l'autre et qu'est-ce qui les ncessite se pntrer mutuellement en dpit de leur antagonisme ? La seule explication qui ait jamais t donne de cette ncessit singulire est l'hypothse de la chute, avec toutes les difficults qu'elle implique et qu'il est inutile de rappeler ici. Au contraire, tout mystre disparat du moment oh l'on a reconnu que la raison impersonnelle n'est qu'un autre nom donn la pense collective. Car celle-ci n'est possible que par le groupement des individus ; elle les suppose donc et, leur tour, ils la supposent parce qu'ils ne peuvent se maintenir qu'en se groupant. Le rgne des fins et des vrits impersonnelles ne peut se raliser que par le concours des volonts et des sensibilits particulires, et les raisons pour lesquelles celles-ci y participent sont les raisons mmes pour lesquelles elles concourent. En un mot, il y a de l'impersonnel en nous parce qu'il y a du social en nous et, comme la vie sociale comprend la fois des reprsentations et des pratiques, cette impersonnalit s'tend tout naturellement aux ides comme aux actes. On s'tonnera peut-tre de nous voir rapporter la socit les formes les plus leves de la mentalit humaine : la cause parat bien humble, eu gard la valeur que nous prtons l'effet. Entre le monde des sens et des apptits d'une part, celui de la raison et de la morale de l'autre, la distance est si considrable que le second semble n'avoir pu se surajouter au premier que par un acte crateur. - Mais attribuer la socit ce rle prpondrant dans la gense de notre nature, ce n'est pas nier cette cration; car la socit dispose prcisment d'une puissance cratrice qu'aucun tre observable ne peut galer. Toute cration, en effet, moins d'tre une opration mystique qui chappe la science et l'intelligence, est le produit d'une synthse. Or, si les synthses de reprsentations particulires qui se produisent au sein de chaque conscience individuelle sont dj, par elles-mmes, productrices de nouveauts, combien sont plus efficaces ces vastes synthses de consciences compltes que les socits ! Une socit, c'est le
mile Durkheim , Les formes lmentaires de la vie religieuse : livre premier
390
plus puissant faisceau de forces physiques et morales dont la nature nous offre le spectacle. Nulle part, on ne trouve une telle richesse de matriaux divers, ports un tel degr de concentration. Il n'est donc pas surprenant qu'une vie plus haute s'en dgage, qui, ragissant sur les lments dont elle rsulte, les lve une forme suprieure d'existence et les transforme. Ainsi, la sociologie parat appele ouvrir une voie nouvelle la science de l'homme. jusqu'ici, on tait plac en face de cette alternative : ou bien expliquer les facults suprieures et spcifiques de l'homme en les ramenant aux formes infrieures de l'tre, la raison aux sens, l'esprit la matire, ce qui revenait nier leur spcificit ; ou bien les rattacher quelque ralit supra-exprimentale que l'on postulait, mais dont aucune observation ne peut tablir l'existence. Ce qui mettait l'esprit dans cet embarras, c'est que l'individu passait pour tre finis naturae : il semblait qu'au del il n'y et plus rien, du moins rien que la science put atteindre. Mais du moment o l'on a reconnu qu'au-dessus de l'individu il y a la socit et, que celle-ci n'est pas un tre nominal et de raison, mais un systme de forces agissantes, une nouvelle manire d'expliquer l'homme devient possible. Pour lui conserver ses attributs distinctifs, il n'est plus ncessaire de les mettre en dehors de l'exprience. Tout au moins, avant d'en venir cette extrmit, il convient de rechercher si ce qui, dans l'individu, dpasse l'individu ne lui viendrait pas de cette ralit supra-individuelle, mais donne dans l'exprience, qu'est la socit. Certes, on ne saurait dire ds maintenant jusqu'o ces explications peuvent s'tendre et si elles sont de nature supprimer tous les problmes. Mais il est tout aussi impossible de marquer par avance une limite qu'elles ne sauraient dpasser. Ce qu'il faut, c'est essayer l'hypothse, la soumettre aussi mthodiquement qu'on peut au contrle des faits. C'est ce que nous avons essay de raliser.
Vous aimerez peut-être aussi
- Formes Elementaires 2Document185 pagesFormes Elementaires 2Doncheu WilliamPas encore d'évaluation
- Émile Durkheim: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandÉmile Durkheim: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Probleme ReligieuxDocument31 pagesProbleme Religieuxlynmur2908Pas encore d'évaluation
- Des profondeurs de l'être: Marie-Magdeleine Davy, itinéraire d'une philosophe absolueD'EverandDes profondeurs de l'être: Marie-Magdeleine Davy, itinéraire d'une philosophe absoluePas encore d'évaluation
- Cours Sur Les Origines de La Vie Religieuse DURKHEIM-EmileDocument49 pagesCours Sur Les Origines de La Vie Religieuse DURKHEIM-EmileMohamed Akdime100% (1)
- Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandTractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- R Bastide Anthropologie Religieuse PDFDocument10 pagesR Bastide Anthropologie Religieuse PDFFernando Silveira RosaPas encore d'évaluation
- Quelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustD'EverandQuelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustPas encore d'évaluation
- INTRODUCTION Selon Jean Pierre Vernant La Question de L Origine de La Philosophie PeutDocument2 pagesINTRODUCTION Selon Jean Pierre Vernant La Question de L Origine de La Philosophie PeutArdy NsemiPas encore d'évaluation
- Durkheim Le SocialismeDocument159 pagesDurkheim Le SocialismesoufianePas encore d'évaluation
- L'Animal L'homme La Fonction SymboliqueDocument265 pagesL'Animal L'homme La Fonction Symboliqueglandaf100% (1)
- Le Paradigme de L Interpretation Chez Schleiermacher Et DiltheyDocument43 pagesLe Paradigme de L Interpretation Chez Schleiermacher Et Diltheyamine1331Pas encore d'évaluation
- DumezilDocument34 pagesDumezilMitoGriegoPas encore d'évaluation
- (15 - 16) LÉVINAS Emmanuel (La Compréhension de La Spiritualité Dans Les Cultures Française Et Allemande)Document13 pages(15 - 16) LÉVINAS Emmanuel (La Compréhension de La Spiritualité Dans Les Cultures Française Et Allemande)johncarlouy2945Pas encore d'évaluation
- Andre Gide Et Rene GenonDocument14 pagesAndre Gide Et Rene GenonLudovic NEYRINCKPas encore d'évaluation
- Vers DoresDocument346 pagesVers DoresJules VernePas encore d'évaluation
- Gilbert DurandDocument5 pagesGilbert Durandsalim bachiPas encore d'évaluation
- Mésologiques - La Chôra Chez Platon - Augustin BerqueDocument6 pagesMésologiques - La Chôra Chez Platon - Augustin BerquemaxiPas encore d'évaluation
- Petit Abécédaire de La Pensée Spiralaire de René Barbier Sur L'Édudacion (Work in Progress)Document44 pagesPetit Abécédaire de La Pensée Spiralaire de René Barbier Sur L'Édudacion (Work in Progress)Joop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Ananda Kentish Coomaraswamy - L'Illusion de L'instructionDocument9 pagesAnanda Kentish Coomaraswamy - L'Illusion de L'instructionmnour_allahPas encore d'évaluation
- Debray Fiche de Lecture MédiologieDocument4 pagesDebray Fiche de Lecture MédiologieObjectif ComprendrePas encore d'évaluation
- Sociologie Bourdieu, Le Corps Et Le SacréDocument2 pagesSociologie Bourdieu, Le Corps Et Le Sacrékirouvert6480100% (1)
- E LliadeDocument24 pagesE LliadeRadouane Slimani100% (1)
- Proust de Bergson Proust de BrouwerDocument4 pagesProust de Bergson Proust de BrouwerEmmanuel GleveauPas encore d'évaluation
- Actualité de La MythocritiqueDocument267 pagesActualité de La MythocritiqueGeorges J-f BertinPas encore d'évaluation
- Durand Gilbert, Gilbert-L'imaginaire Durandien - Enracinements Et Envols en Terre D'amerique-Presses de L'université Laval (2014)Document288 pagesDurand Gilbert, Gilbert-L'imaginaire Durandien - Enracinements Et Envols en Terre D'amerique-Presses de L'université Laval (2014)Bruno Paes100% (1)
- Lapensee Hermeneutique - 1Document14 pagesLapensee Hermeneutique - 1amine1331Pas encore d'évaluation
- Auroux, Sylvain - Le Paradigme NaturalisteDocument11 pagesAuroux, Sylvain - Le Paradigme NaturalisteVictoria GarcíaPas encore d'évaluation
- BARTHES Elements de SemiologieDocument46 pagesBARTHES Elements de SemiologieLucia Veste100% (4)
- Brisson, L. - Platon, Pithagore Et Les Pithagoriciens - (2007)Document28 pagesBrisson, L. - Platon, Pithagore Et Les Pithagoriciens - (2007)Karol KourotrophaPas encore d'évaluation
- Bitbol ANTICIPER - LUNITE - Une - Methode - de - Connaiss PDFDocument34 pagesBitbol ANTICIPER - LUNITE - Une - Methode - de - Connaiss PDFAHC1952Pas encore d'évaluation
- BARTHES, Roland. L'empire Des Signes PDFDocument152 pagesBARTHES, Roland. L'empire Des Signes PDFGabriela Jaquet100% (2)
- La Philosophie Du LangageDocument162 pagesLa Philosophie Du LangageHacerMellalPas encore d'évaluation
- La Peur Dans L'oeuvre de MaupassantDocument7 pagesLa Peur Dans L'oeuvre de MaupassantalienistasPas encore d'évaluation
- La Mort Aux TroussesDocument15 pagesLa Mort Aux TroussesEwerton M. LunaPas encore d'évaluation
- Goffman Cadres de La ConversationDocument34 pagesGoffman Cadres de La ConversationcamillePas encore d'évaluation
- Le Symbolique Chez Lévi-Strauss Et Chez Lacan - Revue Du Mauss PermanenteDocument7 pagesLe Symbolique Chez Lévi-Strauss Et Chez Lacan - Revue Du Mauss PermanentejorgecceballosPas encore d'évaluation
- Hommes Domestiques, Hommes SauvagesDocument280 pagesHommes Domestiques, Hommes SauvagesNoël Pécout100% (1)
- IshmaelDocument326 pagesIshmaelmampub2036Pas encore d'évaluation
- Choresie (Augustin Berque) (CGQ) PDFDocument12 pagesChoresie (Augustin Berque) (CGQ) PDFRodrigo BuenaventuraPas encore d'évaluation
- Durkheim 1950Document157 pagesDurkheim 1950EL MOUHIB EL MAHDIPas encore d'évaluation
- Et Pourtant Ils LisentDocument238 pagesEt Pourtant Ils LisentKamel FellahiPas encore d'évaluation
- Jean Borella - Des Sciences InhumainesDocument10 pagesJean Borella - Des Sciences InhumainesRaphael888Pas encore d'évaluation
- L Empire Du Traumatisme PDFDocument22 pagesL Empire Du Traumatisme PDFarribaquemandoelsolPas encore d'évaluation
- Sommaire Des Numéros de TotalitéDocument5 pagesSommaire Des Numéros de TotalitémarceemansPas encore d'évaluation
- Krishnamurti Et Le Yoga de L'attention, Par Michel JourdanDocument2 pagesKrishnamurti Et Le Yoga de L'attention, Par Michel JourdanJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- La Sculpture de SoiDocument9 pagesLa Sculpture de SoimaxiPas encore d'évaluation
- Ésotérisme Et InitiationDocument5 pagesÉsotérisme Et Initiationplessiosaurus100% (1)
- Note Sur Plotin Et La Pensée Indienne - LacombeDocument16 pagesNote Sur Plotin Et La Pensée Indienne - LacombevordevanPas encore d'évaluation
- L'intraduisibleDocument14 pagesL'intraduisiblemarvin75100% (1)
- Rites Funèbres Et Sciences Humaines Synthèse Et HypothèsesDocument80 pagesRites Funèbres Et Sciences Humaines Synthèse Et HypothèsespedroPas encore d'évaluation
- Problème de L'ame Moderne CGJ - IIDocument330 pagesProblème de L'ame Moderne CGJ - IIzordzema100% (4)
- R. Guardini, L'Essence Du ChristianismeDocument41 pagesR. Guardini, L'Essence Du ChristianismeJeanjean DespruniéePas encore d'évaluation
- Giordano Bruno HeuresthésieDocument6 pagesGiordano Bruno HeuresthésieVincent Mignerot100% (1)
- Intelligence Avant Le LangageDocument166 pagesIntelligence Avant Le Langagetadjoura1Pas encore d'évaluation
- Simondon - Le Temps, Père de Toutes Choses . Chronos - Kronos PDFDocument11 pagesSimondon - Le Temps, Père de Toutes Choses . Chronos - Kronos PDFTiago da Costa GuterresPas encore d'évaluation
- Abdelmadjid Aboura, Le Concept de Wihdat El Wujud Chez Ibn Tophaïl Et Moïse de NarbonneDocument24 pagesAbdelmadjid Aboura, Le Concept de Wihdat El Wujud Chez Ibn Tophaïl Et Moïse de NarbonneAnnalesPas encore d'évaluation
- J.p.vernant, Oedipe Avec Et Sans ComplexeDocument2 pagesJ.p.vernant, Oedipe Avec Et Sans ComplexeEvangelos KaposPas encore d'évaluation
- Martuccelli. Qu'est-Ce Qu'une Sociologie de L'individu Moderne? PDFDocument20 pagesMartuccelli. Qu'est-Ce Qu'une Sociologie de L'individu Moderne? PDFrubenhd_22Pas encore d'évaluation
- La PerceptionDocument69 pagesLa PerceptionFrançois Jourde88% (8)
- Le Moine Qui Vendit Sa FerrariDocument4 pagesLe Moine Qui Vendit Sa FerrariLuca DI TomassoPas encore d'évaluation
- Jean Carteret La Conquête de La MortDocument7 pagesJean Carteret La Conquête de La MortJean-Marie Suc100% (1)
- La Poétique de L EspaceDocument4 pagesLa Poétique de L Espacedrmartens4822Pas encore d'évaluation
- One Pager - Programme Pays de l'UNICEF 2017-2020Document1 pageOne Pager - Programme Pays de l'UNICEF 2017-2020Lalaina Fatratra AndriamasinoroPas encore d'évaluation
- Cas SOMACDocument7 pagesCas SOMACapi-26768792Pas encore d'évaluation
- Les Interferences Des Grandes Puissances Dans Les Initiatives Diplomatico - Strategiques de La RDCDocument92 pagesLes Interferences Des Grandes Puissances Dans Les Initiatives Diplomatico - Strategiques de La RDCNEEMA B. AtoshaPas encore d'évaluation
- Questionnaire BP 5M v6Document66 pagesQuestionnaire BP 5M v6adam_3000Pas encore d'évaluation
- Recherches Sur La Religion Des Berberes 1910 PDFDocument54 pagesRecherches Sur La Religion Des Berberes 1910 PDFBlanca AmorPas encore d'évaluation
- Mbom PDFDocument10 pagesMbom PDFDaniel Franção StanchiPas encore d'évaluation
- Champs Culturels N°23 (Numéro Spécial)Document64 pagesChamps Culturels N°23 (Numéro Spécial)Centre D'art RurartPas encore d'évaluation
- Formation - Projet de Fin D - EtudesDocument56 pagesFormation - Projet de Fin D - EtudesAmine ZahouaniPas encore d'évaluation
- Cadre de Reference1 1Document8 pagesCadre de Reference1 1dtopppePas encore d'évaluation
- Crise RpztationDocument10 pagesCrise RpztationMelissa OrtegaPas encore d'évaluation
- Alléger La Charge: ReikiDocument4 pagesAlléger La Charge: ReikiAhlem LahidhebPas encore d'évaluation
- Meditation Is For You French PDFDocument289 pagesMeditation Is For You French PDFnicolasPas encore d'évaluation
- Responsable de La Presse Et de La Communication de L IfalDocument1 pageResponsable de La Presse Et de La Communication de L IfalHelena LópezPas encore d'évaluation
- Cours de GRH (Gestion Des Ressources Humaines) Partie 2Document7 pagesCours de GRH (Gestion Des Ressources Humaines) Partie 2bourovPas encore d'évaluation
- Chevaliers, Vous Voici Armés Pour Le Combat . - Hauts GradesDocument9 pagesChevaliers, Vous Voici Armés Pour Le Combat . - Hauts GradesSmooth Bigmack100% (3)
- Collection Que Sais-Je, 100 EbookDocument3 pagesCollection Que Sais-Je, 100 EbookabdelbarrPas encore d'évaluation
- L'orthographe Du PulaarDocument6 pagesL'orthographe Du Pulaarabaye2013Pas encore d'évaluation
- HTTPS://FR - scribd.com/document/384763743/BERMAN Antione L Epreuve de L Etranger PDFDocument127 pagesHTTPS://FR - scribd.com/document/384763743/BERMAN Antione L Epreuve de L Etranger PDFmedPas encore d'évaluation