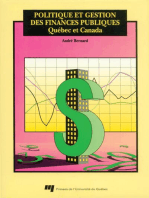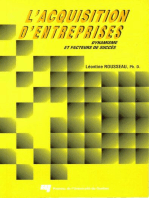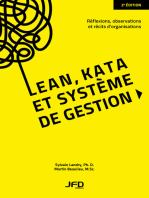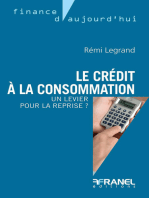Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
9126 - Note - Presentation Projet de La Loi de Finance
9126 - Note - Presentation Projet de La Loi de Finance
Transféré par
zakich01Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
9126 - Note - Presentation Projet de La Loi de Finance
9126 - Note - Presentation Projet de La Loi de Finance
Transféré par
zakich01Droits d'auteur :
Formats disponibles
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La consolidation de la justice sociale et territoriale, que Nous appelons de nos Vux, passe invitablement par le renforcement des politiques sociales de lutte contre la pauvret, l'exclusion et la marginalisation, et par l'largissement de la base de la classe moyenne et la promotion de l'galit entre l'homme et la femme. Elle requiert galement d'accorder une attention particulire au monde rural et aux rgions montagneuses recules et enclaves, et d'laborer une charte sociale avance. Face des besoins sociaux aussi pressants et en constante croissance, et compte tenu des contraintes lies la disponibilit des ressources financires, il est impratif d'intensifier les efforts pour hisser l'conomie nationale un palier suprieur de modernisation, d'ouverture, de comptitivit et de croissance forte et durable. Voil un pari majeur en matire de dveloppement qu'il est indispensable de gagner si l'on veut que le Maroc accde au rang des nations avances. C'est dire l'importance d'une gouvernance cohrente en matire de dveloppement pour assurer la mise en uvre optimale des plans sectoriels et la poursuite des chantiers structurants. Pour ce faire, il faut non seulement prserver les grands quilibres macro-conomiques et financiers, devenus une rgle constitutionnelle, mais aussi conforter les quilibres sociaux, qui constituent l'essence mme du progrs, de la stabilit et de la cohsion de la socit. Extrait du Discours de SA MAJESTE LE ROI loccasion de louverture de la premire session de la 5me anne lgislative de la 8me lgislature, le 14 octobre 2011.
NOTE DE PRESENTATION
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
NOTE DE PRESENTATION
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
SOMMAIRE
PREAMBULE .......................................................................................................................................... 1 TITRE I : CADRE DE REFERENCE ET AXES PRIORITAIRES DU PROJET DE LOI DE FINANCES 3 I. CADRE DE REFERENCE .......................................................................................................................... 3 I.1. Les Hautes Orientations Royales ............................................................................................................ 3 I.1.1. Discours Royaux du 09 mars et du 17 juin 2011 ............................................................................. 3 I.1.2. Discours du Trne du 30 Juillet 2011 .............................................................................................. 4 I.1.3. Discours du 20 Aot 2011 ............................................................................................................... 4 I.2. Le programme du Gouvernement............................................................................................................ 4 II. AXES PRIORITAIRES DU PROJET DE LOI DE FINANCES ............................................................ 5 II.1. La consolidation de lEtat de droit et le renforcement des principes et des instruments de la bonne gouvernance .......................................................................................................................................... 5 II.1.1. Rgionalisation avance ................................................................................................................. 5 II.1.2. Dconcentration administrative...................................................................................................... 6 II.1.3. Renforcement de la bonne gouvernance de la gestion publique..................................................... 7 II.1.4. Rforme de la justice ...................................................................................................................... 8 II.1.5. Modernisation de lAdministration Publique ................................................................................. 9 II.2. Consolidation des bases dune croissance forte et durable et rtablissement des quilibres macroconomiques........................................................................................................................................ 14 II.2.1. Consolidation de la croissance conomique ................................................................................. 14 II.2.2. Le rtablissement des quilibres macro-conomiques ................................................................. 59 II.3. La garantie dun accs quitable des citoyens aux services et aux quipements de base dans le respect des principes de solidarit et dgalit des chances ............................................................................. 69 II.3.1 Valorisation des ressources humaines ........................................................................................... 69 II.3.2. Amlioration des conditions de vie des populations .................................................................... 84 TITRE II - DONNEES CHIFFREES ....................................................................................................... 92 I - BUDGET GENERAL ............................................................................................................................... 92 I.1 Dpenses ............................................................................................................................................. 92 I.1.1- Dpenses de fonctionnement ......................................................................................................... 92 I.1.2. Dpenses d'investissement............................................................................................................. 94 I.1.3- Dpenses de la dette flottante et de la dette amortissable .............................................................. 95 I.2- Recettes ................................................................................................................................................. 95 I.2.1- Impts directs et taxes assimiles.................................................................................................. 96 I.2.2- Droits de douane ........................................................................................................................... 96 I.2.3- Impts indirects ............................................................................................................................. 96 I.2.4- Droits d'enregistrement et de timbre ............................................................................................. 97 I.2.5- Produits et revenus du domaine .................................................................................................... 97 I.2.6- Monopoles et exploitations ........................................................................................................... 98 I.2.7- Recettes d'emprunt ........................................................................................................................ 98 I.2.8- Autres recettes ............................................................................................................................... 98 II- SERVICES DE L'ETAT GRS DE MANIRE AUTONOME ....................................................... 98 III- COMPTES SPCIAUX DU TRSOR ................................................................................................. 99 TITRE III : PROGRAMME DACTION DES MINISTERES ................................................................. 100 I - SECTEURS SOCIAUX........................................................................................................................... 100 I.1- Education Nationale, Lutte contre lAnalphabtisme et Education Non Formelle ............................. 100 I.1.1- Dpartement de lEducation Nationale ....................................................................................... 100 I.1.2- Domaine de la lutte contre lanalphabtisme et lducation non formelle .................................. 101 I.2- Enseignement Suprieur, Recherche Scientifique et Formation des Cadres ....................................... 103 I.2.1. Amlioration de loffre denseignement suprieur ...................................................................... 103 I.2.2. Promotion de la recherche scientifique et technique ................................................................... 105 I.3. Emploi et Formation Professionnelle .................................................................................................. 107 I.3.1. Domaine de lEmploi .................................................................................................................. 107 I.3.2.Domaine de la Formation Professionnelle .................................................................................... 109 I.4- Solidarit, Femme, Famille et Dveloppement Social ........................................................................ 111 I.5. Sant .................................................................................................................................................... 112 I.6. Habitat, Urbanisme et Politique de la ville .......................................................................................... 114 I.6.1- Domaine de lHabitat .................................................................................................................. 115 I.6.2-Domaine de lUrbanisme ............................................................................................................. 117 I.6.3- Domaine du dveloppement territorial ........................................................................................ 118 NOTE DE PRESENTATION
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012 I.7- Culture ................................................................................................................................................ 118 I.8- Habous et Affaires Islamiques ............................................................................................................ 120 I.9- Haut Commissariat aux Anciens Rsistants et Anciens Membres de lArme de Libration ............. 121 I.10- Jeunesse et Sports ............................................................................................................................. 122 I.10.1. Domaine de la Jeunesse, de lEnfance et des Affaires Fminines ............................................. 123 I.10.2- Domaine des Sports................................................................................................................... 124 I.11 - Conseil Economique et Social ......................................................................................................... 124 II- SECTEURS DINFRASTRUCTURE .................................................................................................. 125 II.1. Equipement et Transport .................................................................................................................... 125 II.1.1. Domaine Routier et Autoroutier ................................................................................................. 126 II.1.2. Domaine portuaire et transport maritime ................................................................................... 128 II.1.3. Domaine du transport ferroviaire et routier ................................................................................ 128 II.2- Energie, Mines, Eau et Environnement ............................................................................................. 129 II.2.1. Energie et Mines ........................................................................................................................ 129 II.2.2. Domaine de lEau ....................................................................................................................... 133 II.2.3. Domaine de lEnvironnement .................................................................................................... 138 III.SECTEURS PRODUCTIFS .................................................................................................................. 140 III.1. Agriculture et Pche Maritime.......................................................................................................... 140 III.1.1. Domaine de lAgriculture ......................................................................................................... 140 III.1.2. Domaine de la Pche Maritime ................................................................................................. 148 III.2- Haut commissariat aux Eaux et Forts et la Lutte contre la Dsertification .................................. 150 III.3. Industrie, Commerce et Nouvelles Technologies ............................................................................. 152 III.3.1. Industrie et Commerce .............................................................................................................. 153 III.3.2- Nouvelles Technologies ........................................................................................................... 162 III.3.3- Commerce Extrieur ................................................................................................................. 162 III.4- Tourisme .......................................................................................................................................... 166 III.5- Artisanat ........................................................................................................................................... 170 III.6- Affaires Gnrales et Gouvernance .................................................................................................. 171 III.7- Haut Commissariat au Plan ............................................................................................................. 174 IV- SECTEURS ADMINISTRATIFS ........................................................................................................ 177 IV.1. Intrieur ........................................................................................................................................... 177 IV.2- Economie et Finances ...................................................................................................................... 180 IV.3- Justice et Liberts ............................................................................................................................. 184 IV.4- Administration Pnitentiaire et Rinsertion ..................................................................................... 185 IV.5 - Dlgation Interministrielle aux Droits de l'Homme ..................................................................... 187 IV.6- Affaires Etrangres et Coopration .................................................................................................. 188 IV.7. Marocains Rsidants lEtranger .................................................................................................... 190 IV.8- Communication ............................................................................................................................... 192 IV.9- Fonction Publique et Modernisation de lAdministration ............................................................... 195 IV.10- Secrtariat Gnral du Gouvernement ........................................................................................... 196 IV.11- Juridictions Financires.................................................................................................................. 197 IV.12- Relations avec le Parlement et la Socit Civile ........................................................................... 198 IV-13- Charges Communes ....................................................................................................................... 198 IV-13-1- Fonctionnement ..................................................................................................................... 198 IV-13-2. Investissement ........................................................................................................................ 199
Annexe : Dispositions proposes dans le cadre du projet de Loi de Finances.201
NOTE DE PRESENTATION
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
NOTE DE PRESENTATION
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
PREAMBULE
La prparation du projet de Loi de Finances pour lanne 2012 intervient dans un contexte national marqu par la rforme constitutionnelle profonde sous la conduite claire de Sa Majest le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, et qui constitue un tournant historique et dterminant dans le processus de parachvement de la construction de l'Etat de droit et des institutions dmocratiques. Cette rforme, labore selon une mthodologie dmocratique, inclusive et transparente, instaure un modle constitutionnel marocain original prservant les fondements de lidentit marocaine plurielle, ouverte et garantissant la sparation, l'indpendance et l'quilibre des pouvoirs et le respect des droits de lhomme dans le cadre dune monarchie constitutionnelle, dmocratique, parlementaire et sociale. Le prsent projet de Loi de Finances, qui constitue le premier projet de loi de finances de lactuelle lgislature, sinscrit, par ailleurs, dans un environnement international caractris par la persistance dincertitudes sur la croissance mondiale du fait essentiellement des tensions inflationnistes lies aux cours mondiaux levs du ptrole et des matires premires, de laggravation des dsquilibres budgtaires dans la zone euro et aux Etats-Unis et des tensions sociopolitiques dans la rgion MENA. Il convient, ce propos, de souligner la justesse des rformes menes au cours des dernires annes sur les plans conomique et financier et des stratgies sectorielles mises en uvre permettant une mutation structurelle de notre conomie et une rsilience aux alas de la conjoncture internationale. La dynamique de dveloppement, ainsi enregistre, est appele tre consolide par le projet de Loi de Finances pour lanne 2012 labor sur la base des hypothses suivantes: une croissance du PIB de 4,2 %; un taux dinflation de 2,5 % ; un cours moyen du ptrole de 100 $ le baril.
* * *
La prsente note de prsentation du projet de loi de finances pour lanne 2012 est scinde en trois titres : le premier titre constitue une introduction gnrale prsentant le cadre de rfrence dans lequel ledit projet a t prpar et ses axes prioritaires; le second titre expose, dans leurs grandes composantes, les donnes chiffres dudit projet ;
NOTE DE PRESENTATION 1
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
le troisime titre dcrit les programmes daction des diffrents dpartements ministriels. Les principales dispositions du prsent projet de loi de finances sont prsentes dans lannexe ci-jointe.
NOTE DE PRESENTATION
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
TITRE I : CADRE DE REFERENCE ET AXES PRIORITAIRES DU PROJET DE LOI DE FINANCES I. CADRE DE REFERENCE
Llaboration du projet de loi de finances pour lanne 2012 dcoule dun cadre de rfrence constitu essentiellement par:
I.1. Les Hautes Orientations Royales
Il sagit en particulier des Hautes Instructions Royales contenues dans les Discours Historiques prononcs par Sa Majest le Roi les 09 mars et 17 juin 2011, ainsi qu loccasion de la Fte du Trne et de lanniversaire de la Rvolution du Roi et du Peuple. I.1.1. Discours Royaux du 09 mars et du 17 juin 2011 Dans son Discours du 17 Juin 2011, Sa Majest le Roi a prsent les contours du projet de la nouvelle Constitution dont la rvision a t annonce auparavant dans le Discours Royal Historique du 09 mars 2011, en mettant laccent sur les dix axes majeurs de la nouvelle Constitution savoir: la conscration constitutionnelle de la Monarchie citoyenne et du Roi citoyen ; la constitutionnalisation de l'Amazighe comme langue officielle du Royaume, ct de la langue arabe ; la constitutionnalisation de tous les droits de l'Homme tels qu'ils sont reconnus universellement, avec tous les mcanismes ncessaires pour assurer leur protection et garantir leur exercice ; l'mergence dmocratique du Pouvoir excutif sous la conduite du Chef de Gouvernement ; linstauration d'un Pouvoir parlementaire exerant substantielles en matire de lgislation et de contrle ; des comptences
loctroi l'opposition d'un statut spcial et de mcanismes efficients ; la conscration d'un Pouvoir judiciaire indpendant vis--vis des Pouvoirs excutif et lgislatif ; la constitutionnalisation de certaines institutions fondamentales, en maintenant la possibilit de crer par des textes lgislatifs ou rglementaires d'autres instances et mcanismes, susceptibles de renforcer la citoyennet et la participation dmocratique ; le renforcement des mcanismes de bonne gouvernance, de moralisation de la vie publique et de lutte contre la corruption ; et la conscration constitutionnelle de la rgionalisation avance.
NOTE DE PRESENTATION
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
I.1.2. Discours du Trne du 30 Juillet 2011 Dans son Discours du Trne du 30 Juillet 2011, Sa Majest le Roi a mis laccent sur les principaux points suivants: la ncessit dassurer la mise en uvre optimale, dans sa lettre et dans son esprit, de la nouvelle Constitution adopte et la mise en place des institutions constitutionnelles, dans les plus brefs dlais et dans de bonnes conditions ; laccompagnement du nouveau pacte constitutionnel et politique par un contrat social et conomique solidaire et lintensification des efforts pour relever les dfis de la lutte contre le chmage, la pauvret, la prcarit et l'analphabtisme ; et le lancement dune nouvelle gnration de rformes profondes et dun nouveau pacte conomique en accord avec l'esprit de la nouvelle Constitution qui consacre l'Etat de droit dans le domaine des affaires et institue un certain nombre d'instances conomiques. I.1.3. Discours du 20 Aot 2011 Dans son Discours du 20 Aot 2011 loccasion de lanniversaire de la Rvolution du Roi et du Peuple, Sa Majest le Roi a mis en exergue les principales priorits suivantes: la mise en uvre optimale de la nouvelle Constitution ; et l'laboration de la loi organique affrente la rgionalisation avance et lacclration du processus d'oprationnalisation des Fonds de mise niveau sociale et de solidarit interrgionale.
I.2. Le programme du Gouvernement
Outre les Hautes Orientations Royales prcites, le projet de loi de finances pour lanne 2012 a t prpar sur la base des engagements contenus dans le programme du Gouvernement qui est articul autour de cinq axes : la conscration de lidentit nationale unifiante et la prservation de sa pluralit et son ouverture sur les diffrentes cultures et civilisations; la consolidation de lEtat de droit, de la rgionalisation avance et de la bonne gouvernance garantissant la dignit des citoyens, leurs droits et liberts et leur suret; la poursuite de ldification dune conomie nationale solide, diversifie, comptitive, cratrice de lemploi et des richesses rparties quitablement; le dveloppement et loprationnalisation des programmes sociaux bass sur lquit et la solidarit entre les diffrentes couches sociales, gnrations et rgions et qui assurent aux citoyens un accs quitable aux prestations sociales particulirement en matire denseignement, de sant et dhabitat; et
NOTE DE PRESENTATION
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
ladoption dune dmarche proactive vis--vis de lenvironnement rgional et mondial et lamlioration des services publics offerts aux marocains rsidant ltranger.
II. AXES PRIORITAIRES DU PROJET DE LOI DE FINANCES
Laction mene par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour lanne 2012 est articule autour des trois axes prioritaires suivants: La consolidation de lEtat de droit et le renforcement des principes et des instruments de la bonne gouvernance; la consolidation des bases dune croissance forte et durable et le rtablissement des quilibres macro-conomiques; et la garantie dun accs quitable des citoyens aux services et aux quipements de base dans le respect des principes de solidarit et dgalit des chances.
II.1. La consolidation de lEtat de droit et le renforcement des principes et des instruments de la bonne gouvernance
Fidle son choix irrversible de construire un Etat de droit dmocratique, le Maroc poursuit rsolument, depuis laccession de Sa Majest le Roi Mohammed VI que Dieu lAssiste au Trne, le processus de rforme politique et institutionnelle qui a t couronn par ladoption de la nouvelle Constitution. Dans le cadre du projet de loi de finances pour lanne 2012, et conformment aux Hautes Orientations Royales, le Gouvernement sattachera acclrer lesdites rformes et oprationnaliser les principes et les mcanismes de bonne gouvernance, et ce travers, notamment : loprationnalisation du chantier de la rgionalisation avance; le renforcement de la dconcentration ; le renforcement de la bonne gouvernance de la gestion publique; la rforme de la justice ; et la modernisation de ladministration publique. II.1.1. Rgionalisation avance La conscration de la rgionalisation avance constitue un des leviers majeurs pour le renforcement de la dmocratie, la modernisation des structures de lEtat et le dveloppement conomique et social intgr. A cet effet, les efforts seront dploys pour llaboration dune loi organique instituant une gestion dmocratique des affaires de la rgion et des autres collectivits territoriales et renforant leurs pouvoirs tout en assurant un transfert progressif des responsabilits vers les rgions cadr par la loi et sur une base contractuelle.
NOTE DE PRESENTATION 5
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La rgion sera dote dun organe excutif fort bnficiant dattributions largies et des ressources financires et humaines adquates. La rgulation tatique sera modernise et assouplie en limitant les contrles a priori et dopportunit, en renforant les contrles et les valuations a posteriori et en maintenant les contrles juridictionnels de lgalit. Le transfert des responsabilits vers la rgion sera accompagn par le renforcement progressif de leurs ressources financires et ce, par le biais de : la cration, pour une priode dtermine, dun Fonds de mise niveau sociale, destin mettre niveau les rgions et rsorber les dficits en matire de dveloppement humain et dinfrastructures et dquipements ; la cration dun Fonds de solidarit interrgionale, visant une rpartition quitable des ressources en vue de rduire les disparits entre les rgions ; laccroissement des produits des impts et taxes de lEtat affects aux collectivits territoriales et le dveloppement de leurs ressources propres travers, notamment, la rforme de la fiscalit locale et la dfinition des modalits de rpartition entre les collectivits territoriales des ressources financires affectes. II.1.2. Dconcentration administrative La politique de dconcentration administrative, troitement lie au chantier de la rgionalisation avance, vise rationaliser la rpartition des tches entre les directions centrales des ministres et leurs services extrieurs dans le respect du principe de subsidiarit dans lobjectif doffrir aux citoyens un service public de qualit. Les efforts consentis jusqu prsent ont port sur le dveloppement de la contractualisation des rapports entre les services centraux des administrations publiques et leurs services dconcentrs et ce, dans le cadre de rfrence moyen terme dfini par la programmation pluriannuelle. Ainsi, titre illustratif, le Ministre de la Sant a sign six (6) contrats de performance avec ses services rgionaux pour la priode 2007-2009 et le dpartement de lEnseignement Suprieur a sign dix sept (17) contrats de dveloppement avec quinze (15) universits et deux tablissements publics sous sa tutelle pour la priode 2009-2012. En matire de dconcentration budgtaire, ladjonction de la dimension rgionale aux classifications administrative, fonctionnelle et conomique, dj en vigueur partir de 2006, a consacr une avance qualitative dans ce sens en permettant une prsentation rgionalise des budgets des ministres. Ces diffrentes informations facilitent linstauration de relations de contractualisation contribuant fortement au renforcement de la dconcentration et sa mise en uvre grande chelle. Par ailleurs, depuis 2005, les rgles dorganisation des dpartements ministriels et de la dconcentration administrative ont t fixes de faon renforcer les comptences des services dconcentrs. La rpartition des attributions
NOTE DE PRESENTATION
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
entre les services centraux et les services dconcentrs est ainsi ralise dans le respect du principe de subsidiarit. Notons, galement, llaboration par les dpartements ministriels des schmas directeurs de dconcentration administrative sur une priode allant de deux cinq ans. Ces schmas comprennent notamment les attributions transfrer aux services dconcentrs, leffectif des fonctionnaires faisant lobjet de redploiement au profit de ces services et les moyens allous ces services. Ces efforts seront poursuivis travers, notamment, lacclration de llaboration dune Charte Nationale de Dconcentration Administrative, la rorganisation de ladministration territoriale de manire assurer lintgration et la complmentarit des diffrentes politiques sectorielles, ladoption de lapproche spatiale en matire de programmation budgtaire et dans la mise en uvre des politiques publiques ainsi que la gnralisation de la dmarche participative et contractuelle axe sur les rsultats dans les rapports entre ladministration centrale et ses services dconcentrs. II.1.3. Renforcement de la bonne gouvernance de la gestion publique La nouvelle Constitution a considr, dans son prambule, la bonne gouvernance comme un fondement de lEtat dmocratique et lui a consacr un titre entier. Ainsi, des principes forts en matire de bonne gouvernance, de moralisation de la vie publique et dEtat de droit conomique ont t consacrs notamment les principes de lgal accs des citoyens au service public soumis aux normes de qualit, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilit, de corrlation entre lexercice de responsabilits et de mandats publics et la reddition des comptes, de libert dentreprendre, de libre concurrence et de linterdiction des conflits dintrts, des dlits diniti et des pratiques contraires aux principes de la concurrence libre et loyale dans les relations conomiques. En outre, la nouvelle Constitution consacre lindpendance des institutions fondamentales charges de la bonne gouvernance notamment le Conseil de la Concurrence, l'Instance Nationale de la Probit et de Lutte contre la Corruption, le Mdiateur, la Haute Autorit de la Communication Audiovisuelle et le Conseil National des Droits de l'Homme. De mme, les comptences du Conseil Economique et Social ont t largies pour englober les questions environnementales et le Conseil Suprieur de lEnseignement dispose dsormais de prrogatives qui couvrent galement la formation et la recherche scientifique. Rappelons que le paysage institutionnel marocain en matire de bonne gouvernance a connu une volution positive au cours des dernires annes. En atteste, ladoption dun plan daction gouvernemental en matire de lutte contre la corruption mis jour en 2010, la mise en uvre effective du dispositif juridique concernant la dclaration obligatoire du patrimoine, la cration de la Dlgation Interministrielle aux Droits de l'Homme, la cration et loprationnalisation de lInstance Centrale de Prvention de la Corruption, du Mdiateur (Al wassite), du Conseil de la Concurrence et de lUnit de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) comptente en matire de lutte contre le blanchiment dargent et du Comit National pour le Climat des Affaires ainsi que plusieurs instances de rgulation
NOTE DE PRESENTATION 7
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
notamment lAgence Nationale de la Rglementation des Tlcommunications et la Haute Autorit de la Communication Audiovisuelle. Les entits ainsi cres sont venues complter les actions menes par la Cour des Comptes, les Cours Rgionales des Comptes, lInspection Gnrale des Finances, lInspection Gnrale de lAdministration Territoriale et les Inspections Gnrales des Ministres. Le gouvernement sest fix comme priorit de son programme la consolidation de la bonne gouvernance et la moralisation de laction publique et ce, travers loprationnalisation et la dynamisation des diffrentes institutions prcites. Il sera procd, dans ce cadre, au renforcement desdites institutions de contrle, la rnovation de leur cadre juridique, la conscration de leur indpendance et au renforcement de la coordination de leur action. En outre, le Gouvernement procdera (i) la modernisation de larsenal lgislatif et rglementaire relatif la dclaration du patrimoine et la sauvegarde des deniers publics et la lutte contre lenrichissement illicite, (ii) la mise en place dun pacte national pour la lutte contre toute forme de prvarication lie l'activit des administrations et des organismes publics, l'usage des fonds dont ils disposent, la passation et la gestion des marchs publics, (iii) loprationnalisation de l'Instance Nationale de la Probit et de Lutte contre la Corruption prvue par la Constitution, (iv) ladoption dun programme national de probit, ainsi qu (v) lencouragement de limplication des citoyens dans la protection des deniers publics et la lutte contre la corruption. II.1.4. Rforme de la justice La rforme de la Justice constitue lun des axes prioritaires du programme gouvernemental visant conforter la confiance et la crdibilit en une justice efficace et quitable, en tant que garant de lEtat de droit, fondement de la scurit judiciaire et de la bonne gouvernance et incitateur au dveloppement conomique et social du pays. La rforme constitutionnelle qui a rig le Pouvoir Judiciaire Indpendant, a, par ailleurs, consacr en son sein les droits des justiciables et les rgles du fonctionnement de la Justice et a renforc le paysage judiciaire par linstitution du Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire et la Cour Constitutionnelle en remplacement du Conseil Suprieur de la Magistrature et du Conseil Constitutionnel actuels. Rappelons que les Discours Royaux du 20 aot 2009 et du 08 octobre 2010 ont trac une feuille de route claire et prcise, mettant en vidence six axes prioritaires pour cette rforme, savoir la consolidation des garanties de lindpendance de la justice, la modernisation de son cadre normatif, la mise niveau des structures judiciaires et administratives, la mise niveau des ressources humaines, lamlioration de lefficience judiciaire et lancrage des rgles de moralisation de la Justice. Soulignons, galement, quau cours des deux dernires annes, plusieurs avances ont t ralises notamment linstitution du Mdiateur charg dassister
NOTE DE PRESENTATION 8
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
les justiciables dans les diffrentes procdures devant les juridictions, la mise en place dun service e-plainte, lintensification de linspection gnrale interne et hirarchique, la gnralisation des cellules de lutte contre la violence lgard de la femme et de lenfant au niveau du parquet de 65 Tribunaux de Premire Instance, la mise en place dassistantes sociales dans les sections de la justice de la famille, lquipement de 21 Cours dAppel et de 60 tribunaux de Premire Instance en guichets daccueil et linstallation, au sige du Ministre de la Justice et des Liberts, de deux centres daccueil dont lun est ddi aux Marocains Rsidant lEtranger. Sur le plan lgislatif, vingt-sept (27) projets de lois ont t labors. Lesdits projets portent notamment sur, le renforcement de la lutte contre le blanchiment dargent, la protection des tmoins et des dnonciateurs dans les affaires de corruption, linstitution de la justice de proximit, lassistance juridique et judicaire, lorganisation judiciaire du Royaume, le statut de la magistrature et la rvision du code pnal et du code de la procdure civile. Ces efforts seront poursuivis tout en mettant laccent sur loprationnalisation et la concrtisation des avances constitutionnelles majeures et ce travers, notamment, llaboration des lois organiques relatives au statut des magistrats, lorganisation et au fonctionnement du Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire ainsi que les critres relatifs la gestion de la carrire des magistrats et les rgles de la procdure disciplinaire. Il sera galement procd la rvision du dispositif lgislatif relatif la justice de manire concrtiser les dispositions constitutionnelles notamment en matire dindpendance du magistrat, des droits des justiciables, des rgles de fonctionnement de la justice et de rparation du prjudice judiciaire. Le Gouvernement poursuivra, galement, la rforme du dispositif juridique relatif la garantie des liberts notamment le droit pnal pour ladapter aux engagements internationaux du pays en matire des droits de lhomme. Une attention particulire sera accorde la mise niveau des structures judiciaires et au renforcement de leurs ressources humaines, linformatisation des diffrentes juridictions, la simplification des procdures judiciaires, la facilitation de laccs des justiciables aux juridictions, la rduction des dlais de traitement des dossiers et dexcution des jugements, lamlioration des conditions de travail et daccueil, au renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance de ladministration judiciaire, lamlioration de la formation du personnel judiciaire et administratif et lamlioration de la qualit des jugements prononcs. II.1.5. Modernisation de lAdministration Publique La rforme de ladministration publique se situe au centre des rformes qui seront engages par le Gouvernement pour assurer le dveloppement conomique et social du pays. Cette rforme prend une nouvelle envergure suite la rforme constitutionnelle qui a mis le citoyen au centre de laction publique et a soumis les services publics aux normes de qualit et aux obligations douverture et dcoute des usagers et de suivi de leurs observations, propositions et dolances et a prvu
NOTE DE PRESENTATION 9
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
llaboration dune charte des services publics qui fixe lensemble des rgles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques. Les efforts qui seront entrepris par le Gouvernement dans ce cadre portent sur lamlioration des relations administration-usagers du secteur public et la modernisation de la gestion des ressources humaines. II.1.5.1. Amlioration des relations administration-usagers du service public Lamlioration des relations administration-usagers du service public sera effectue par le biais de deux principaux leviers savoir (i) la simplification des procdures et le dveloppement de ladministration lectronique et (ii) lamlioration de laccueil des usagers du service public. II.1.5.1.1. Simplification des procdures et dveloppement de ladministration lectronique Pour lusager du service public, la complexit des procdures administratives contribue la perception que ladministration est davantage porte sur le contrle et la rgularit procdurale que sur la facilitation de laccs aux services. En outre, cette complexit gnre souvent de lopacit et de la discrtion dans lapplication des rgles, pouvant conduire la corruption et des dcisions arbitraires. La multitude des tapes et des intervenants tend diluer les responsabilits et compliquer les possibilits de suivi et de recours. Linitiative de standardisation et de simplification des procdures et des formulaires administratifs rpond cette problmatique. Lexprience participative, conduite pour une premire liste de 30 procdures ayant un impact important sur lenvironnement des affaires, est positive et sera tendue d'autres dmarches administratives. Ainsi, un processus didentification de services publics souvent utiliss par les citoyens et o la rduction de la complexit des rgles et procdures permettrait des gains potentiels importants en termes de simplification et de rduction de la discrtion a t lanc. Sur la base de cette analyse, les procdures seront simplifies, standardises et certifies et deviendront opposables ladministration. Le programme de rforme de ladministration publique sappuie, par ailleurs, sur ladministration lectronique comme instrument pour simplifier les procdures et amliorer ainsi lefficacit et la transparence de ladministration. En effet, le programme e-gouvernement a t mis en place pour permettre dexploiter les technologies de linformation et de la communication pour reconfigurer en profondeur les processus administratifs, les rendre efficaces et efficients et totalement orients vers le service du citoyen et de lentreprise. Les efforts entrepris en la matire ont, ainsi, permis la mise en service de 28 services publics lectroniques orients vers les citoyens. Il sagit notamment : des services pour les citoyens, principalement, le Passeport biomtrique, la Carte Nationale dIdentit Electronique, la gestion des retraites dans le secteur
NOTE DE PRESENTATION 10
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
public et priv, le portail fdrateur de services e-finances, les dclarations sociales pour les employs de la CNSS, le portail web du Ministre du Dveloppement Social, de la Famille et de la Solidarit, le Rfrentiel des Emplois et *des Comptences REC en ligne, le service de paiement des taxes locales en ligne, le portail de le-intermdiation sur le march de lemploi, le portail e-justice, la prise de rendez vous en ligne (4 Hpitaux), le Portail de suivi de remboursements institu par la CNOPS et le Portail de services d'accueil des trangers ; des services pour lentreprise, notamment, le Simpl IS (service des impts en ligne de l'IS), le Simpl TVA (service des impts en ligne de la TVA), BADR (Base Automatise des Douanes en Rseau), le Cadastre (accs aux titres de proprit pour les notaires), le portail Investir au Maroc et la plateforme d'oprateur de certification lectronique et du Visa scuris ; des services pour les administrations publiques notamment le Portail de la Gestion Intgre de la Dpense Publique, le Systme de paie, le e-budget et la gestion des ressources. Par ailleurs, dans le but dencourager les efforts et les initiatives russies dans le domaine de l'administration lectronique et dinstaurer les principes de concurrence positive entre les diffrentes composantes du secteur public dans ce domaine, le Prix National de l'Administration Electronique (e-mtiaz) a t mis en place depuis 2005 et constitue une reconnaissance et un hommage aux administrations qui ont dvelopp les meilleurs e-services publics. Notons, galement, la mise en place de 190 procdures administratives sur les sites service public.ma et e-gov.ma . Au cours des deux prochaines annes, les efforts seront poursuivis pour atteindre les objectifs tracs en matire de dveloppement de ladministration lectronique, savoir : un indice ONU de le-gouvernement de 0,8 en 2013 contre 0,2 en 2008 ; un nombre de projets et de services e-gouvernement raliss de 89 en 2013 contre 16 en 2008 ; lutilisation des e-services transactionnels, en 2013, par la totalit des entreprises ralisant un chiffre daffaires de plus de 20 millions de dirhams contre moins de 1% en 2008 ; et un nombre de cinq sites e-gouvernement classs dans les 100 sites .ma contre un seulement en 2008. Une attention particulire est, par ailleurs, accorde lautomatisation des services administratifs, notamment : la formulation en ligne par les citoyens de leurs demandes de documents administratifs notamment les pices de ltat civil, le certificat de rsidence, etc.
NOTE DE PRESENTATION 11
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la gnralisation de la prise de rendez vous en ligne notamment pour les hpitaux, les tribunaux, les arrondissements, les commissariats (CIN), etc. la certification lectronique de la conformit des copies des pices leurs originaux; la prise en charge et le suivi en ligne des rclamations des citoyens relatives la qualit du service public (collecte des dchets, lectricit publique, etc.) ; linscription en ligne au tirage au sort pour le plerinage ; la mise en place dune base dinterconnexion entre les administrations permettant de crer les synergies ncessaires qui dispenseraient les citoyens de prsenter une administration quelconque des pices administratives dlivres par une autre administration. II.1.5.1.2. Amlioration de laccueil des usagers des services publics Une attention particulire est accorde au renforcement de la transparence et de laccessibilit de ladministration pour les usagers et lamlioration des conditions de leur accueil et de leur orientation. Les mesures prvues cet effet portent notamment sur (i) la publicit des procdures administratives et des adresses et horaires de travail sur les diffrents supports possibles, (ii) la motivation des dcisions administratives conformment la loi n 03-01 relative l'obligation de la motivation des dcisions administratives manant des administrations publiques, des collectivits locales et des tablissements publics, (iii) lacclration de llaboration de la loi relative au droit daccs linformation conformment larticle 27 de la constitution, (iv) le port obligatoire du badge par les agents en relation directe avec les usagers et (v) la mise en place, au sein des dpartements ministriels, de cellules daccueil et dorientation des usagers, dune ligne tlphonique bleue ddie aux usagers et de systme de gestion des files dattente. II.1.5.2. Modernisation de la gestion des ressources humaines La modernisation de la gestion des ressources humaines seffectue suivant trois orientations majeures savoir ladaptation du systme actuel de gestion du personnel de la fonction publique, le dveloppement dune nouvelle culture de gestion des ressources humaines et la rforme du systme de rmunration. La rforme de la gestion des ressources humaines a pour objectif de placer les comptences et la performance au centre du nouveau systme de Gestion des Ressources Humaines (GRH) tout en modernisant le systme de carrire. Elle favorise lintroduction doutils modernes afin de grer le personnel de ladministration de faon plus efficace. Le dispositif mis en place porte sur : le dveloppement dune Gestion Prvisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Comptences (GPEEC) dans chaque ministre pour amliorer ladquation entre le personnel et les missions en crant un nouveau systme de classification des emplois et en conduisant une analyse solide pour arrter
NOTE DE PRESENTATION 12
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
des principes convenus en vue dune rforme du systme de rmunration actuel ; et lamlioration du systme actuel de gestion du personnel de la fonction publique. II.1.5.2.1. Gestion Prvisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Comptences (GPEEC) Une rforme structurelle de la gestion des ressources humaines est entreprise travers llaboration dune nomenclature des emplois communs aux administrations publiques et lintroduction de la Gestion Prvisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Comptences (GPEEC) de faon installer une nouvelle conception managriale des ressources humaines axe essentiellement sur les emplois et les comptences et passer dune gestion administrative du personnel une gestion qualitative et prvisionnelle des ressources humaines permettant ainsi danticiper les volutions stratgiques des mtiers de ladministration et didentifier les besoins rels en ressources humaines. Les objectifs recherchs consistent en la substitution de la notion demploi la notion de grade tout en dfinissant les profils et les comptences requis pour chaque emploi, lidentification et la description des emplois et leur classification par secteur dactivit, par famille professionnelle et par niveau de difficult, la mise en place des schmas de formation continue et le renforcement de la mobilit des fonctionnaires en tenant compte de ladquation poste/profil. A cet effet, des Rfrentiels des Emplois et des Comptences (REC) ont t labors au niveau de lensemble des dpartements ministriels ligibles leur permettant dapprcier objectivement leurs besoins en emplois sur les plans quantitatif et qualitatif ainsi que leur volution future et de sorganiser en consquence pour adapter les comptences aux volutions prvues et amliorer leur visibilit court et moyen termes en matire de ressources humaines. II.1.5.2.2. Rforme du systme de rmunration Lobjectif recherch, ce niveau, consiste en ladoption dun nouveau systme de rmunration plus quitable et plus transparent bas sur le mrite, le rendement et lefficacit. Rappelons que ltude lance pour la mise en place dun nouveau systme de rmunration est en cours de finalisation. Ses deux premires phases acheves ont permis didentifier et danalyser les principaux dysfonctionnements du systme actuel de rmunration et de proposer deux axes de rforme. Le premier axe relatif au traitement de base et la grille indiciaire, prvoit, dune part, la rvision et llargissement des grilles indiciaires et la rvision des valeurs des points dindice pour une intgration maximale des indemnits statutaires dans le traitement de base, et dautre part, la cration dchelles de rmunration intermdiaires entre les chelles 10 et 11 et entre lchelle 11 et la hors chelle. Le second axe qui porte sur lindemnit de rsidence, prvoit la conception dun nouveau dcoupage bas sur la commune au lieu de la province ou la
NOTE DE PRESENTATION 13
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
prfecture et le classement, en cinq zones, des communes sur la base de paramtres lis au milieu (urbain ou rural), la population et la nature du relief. La troisime et dernire phase de ltude susvise, en cours de finalisation, prvoit la conception dun nouveau systme de rmunration bas sur lemploi ainsi que des mcanismes de rvision salariale. II.1.5.2.3. Amlioration du systme de gestion du personnel de la fonction publique Dans ce cadre, les efforts sont axs sur ladoption de procds modernes en matire dvaluation des performances, de formation continue et le respect des principes d'galit des chances, de mrite, de comptence et de transparence pour laccs aux postes de responsabilit. Une attention particulire est, en outre, accorde lamlioration des prestations des uvres sociales des administrations, au respect du principe de parit hommes-femmes pour encourager laccs des femmes aux postes de responsabilit et loprationnalisation de la mobilit des responsables de ladministration publique. Enfin, une valuation globale de la politique de formation administrative sera effectue dans lobjectif damliorer la formation des hauts fonctionnaires de lEtat travers, notamment, la rforme profonde de lEcole Nationale de lAdministration et de lInstitut Suprieur de lAdministration dans la perspective de leur fusion.
II.2. Consolidation des bases dune croissance forte et durable et rtablissement des quilibres macro-conomiques
Le Gouvernement se fixe, comme objectif stratgique, la ralisation dune croissance conomique forte, durable, solidaire et cratrice de lemploi ainsi que le rtablissement des quilibres macro-conomiques. II.2.1. Consolidation de la croissance conomique Les efforts entrepris dans ce sens visent accder un nouveau palier de croissance du PIB et du PIB non agricole respectivement de 5,5% et de 6% en moyenne sur la priode 2012-2016, et ce en sappuyant sur trois leviers savoir le soutien de la demande interne, la dynamisation du secteur priv et la poursuite de la ralisation des rformes et des stratgies sectorielles. II.2.1.1. Soutien la demande Le soutien la demande est assur travers le renforcement des investissements publics et privs, la relance de la consommation et lencouragement des exportations. II.2.1.1.1. Renforcement des investissements II.2.1.1.1.1 Renforcement des investissements publics Le Gouvernement adopte une politique volontariste de renforcement de linvestissement public en tant que principal levier de la croissance conomique. Pour
NOTE DE PRESENTATION 14
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
lanne 2012, leffort dinvestissement global du secteur public dans toutes ses composantes, savoir le Budget Gnral, les Comptes Spciaux du Trsor, les SEGMA, les Collectivits Locales et les Entreprises et Etablissements Publics se chiffre 188,30 milliards de dirhams, en hausse de 21 milliards de dirhams par rapport 2011. Ce montant global est ventil comme suit: 53,46 milliards de dirhams pour le Budget Gnral de lEtat, les Comptes Spciaux du Trsor et les SEGMA en neutralisant les transferts; 122,84 milliards de dirhams pour les Entreprises et Etablissements Publics, et 12 milliards de dirhams pour les Collectivits Locales. Cet effort consacre, par ailleurs, la poursuite un rythme acclr de la politique des grands chantiers dont les plus importants se rsument comme suit : Programme autoroutier Le Contrat Programme entre lEtat et la Socit Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) pour la priode 2008 2015, sign le 2 Juillet 2008 sous la Haute Prsidence de Sa Majest le Roi, a pour objectif de doter le Maroc, lhorizon 2015, dun linaire de 1 800 Km dautoroutes reliant toutes les villes de plus de 400 000 habitants et ce, par lachvement du premier schma darmature autoroutier et la ralisation dun programme complmentaire de 383 Km (Berrechid-Beni-Mellal, contournement de Rabat, Tit Mellil-Berrechid et El Jadida-Safi). Le montant des investissements prvus sur la priode dudit contrat slve 31,66 Milliards de dirhams. Dans ce cadre, lanne 2011 a t marque par linauguration de la liaison Fs-Oujda dune longueur de 320 km pour un investissement de 10,8 milliards de dirhams, ramenant la dure dudit trajet de 7 heures 4 heures ce qui a permis de porter le linaire des autoroutes en exploitation, fin juillet 2011, 1.417 km. Maillon important du rseau autoroutier national, cette liaison prolonge l'autoroute RabatMekns-Fs pour former un grand axe structurant Est-Ouest qui s'intgre avec le rseau existant et les grands projets routiers (Taza-Al Hoceima et Oujda-Nador) et constitue un tronon important de l'autoroute Maghrbine. Il convient, galement, de signaler les travaux de construction dune troisime voie pour lautoroute Rabat-Casablanca sur une distance de 57,3 km pour un cot de 1,16 milliard de dirhams, de lautoroute priphrique de contournement de Rabat sur une longueur de 41,1 km pour un cot de 2,8 milliards de dirhams et du tronon Berrechid - Beni Mellal sur une longueur de 173 km pour un cot de prs de 6,1 milliards de dirhams. A lhorizon 2015, la longueur du rseau autoroutier devrait atteindre 1 800 km. Programme routier Paralllement au programme autoroutier, le processus de dsenclavement du monde rural se poursuit un rythme acclr dans le cadre du deuxime Programme National de Routes Rurales avec le passage du linaire ralis de 1 500
NOTE DE PRESENTATION
15
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
km par an 2 000 km par an. Le taux dinterconnexion des populations rurales au rseau routier est, ainsi, pass de 54 % en 2005 73 % fin 2011. Les efforts sont, galement, poursuivis pour ladaptation du rseau routier national au rseau autoroutier travers la mise en place dun programme important de voies expresses dune longueur de 1.028 km dont 697,7 km ont t acheves et mises en service. Parmi les principaux tronons de voies expresses ouverts la circulation au cours des deux dernires annes figurent : le tronon Marrakech-Essaouira: dune longueur de 113 km pour un cot de 700 millions de dirhams; le tronon Tanger-Ttouan: dune longueur de 52 km pour un cot de 420 millions de dirhams; le tronon Port Tanger Med - Fnideq: dune longueur de 18 km pour un cot de 183,6 millions de dirhams; le tronon Oujda-saidia: dune longueur de 37 km pour un cot de 122,2 millions de dirhams. Un accent particulier est mis sur les zones enclaves, notamment dans le nord avec la rocade mditerranenne dune longueur de 550 km destine relier les deux grands ples conomiques de Tanger et de Nador-Oujda. Une partie importante de la rocade mditerranenne dune longueur de 430 km a t ouverte la circulation. Infrastructures ferroviaires Conscient du rle capital que jouent les infrastructures ferroviaires dans lamlioration de la comptitivit de lconomie nationale et le dveloppement conomique et social du pays, le Gouvernement veillera la poursuite des efforts de modernisation du secteur ferroviaire. Aussi, dimportants projets ont-ils t raliss dans le cadre du contrat programme 2005-2009 entre lEtat et lONCF. Il sagit, notamment, de lamnagement dune quarantaine de gares, de la mise en service des nouvelles liaisons Taourirt Nador et Gare de Tanger-Ville Port Tanger Med, ainsi que de lachvement du doublement de la voie Mekns - Fs et du projet de modernisation de la ligne Tanger-Rabat. Le 1er fvrier 2010, un nouveau contrat-programme 2010-2015 a t sign entre lEtat et lONCF ainsi quune Convention entre le Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et Social et lONCF pour le financement partiel du cot de ralisation du projet de Train Grande Vitesse (TGV) entre Tanger et Casablanca. Le montant global des investissements couverts par ce Contrat-Programme est estim 33 milliards de dirhams dont 20 milliards de dirhams pour le TGV et 13 milliards de dirhams pour les autres investissements destins assurer la
NOTE DE PRESENTATION 16
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
modernisation du rseau ferroviaire actuel et, notamment, la mise niveau des axes Knitra-Casablanca avec triplement des voies, l'lectrification de la ligne Fs-Oujda, la mise niveau de l'axe Settat-Marrakech, la poursuite de la modernisation des gares et la mise en place de gares logistiques ainsi que l'acquisition et le renforcement du matriel roulant. La ligne TGV Tanger-Casablanca, dont lentre en service est prvue pour fin 2015, devrait ramener la dure du trajet entre les deux villes de 5 heures actuellement 2 heures 10 min. Infrastructures portuaires Vu limportance primordiale du transport maritime qui reprsente 97% des changes commerciaux extrieurs du Maroc et le rle crucial que jouent les ports dans ce cadre, une politique de dveloppement des infrastructures portuaires a t adopte dans le cadre du Plan Directeur 2010-2030 en vue de permettre au pays de profiter pleinement du dveloppement des changes internationaux induits par la mondialisation, la conclusion daccords de libre change avec un grand nombre de pays ainsi que le positionnement gostratgique du Maroc. Dans ce cadre, les travaux sont poursuivis au niveau du grand chantier du Port de Tanger Med II qui permettra dlever la capacit du complexe Tanger-Med 8 millions units. Situ sur le flanc ouest de Tanger Med I, l'extension "Tanger-Med II" renforcera les capacits des premires installations avec deux terminaux conteneurs en eaux profondes qui offriront une capacit supplmentaire de 5 millions de conteneurs. Infrastructures hydrauliques Le programme de construction des grands barrages, qui a t marqu par le lancement dune vingtaine de chantiers, a t renforc par le programme de construction des petits et moyens barrages ayant un intrt local. Composante essentielle de la politique de mobilisation des ressources hydriques, les petits barrages se sont rvls efficace en matire de dveloppement local notamment travers leur contribution lirrigation des petits primtres et au dveloppement de llevage en alimentant des points deau prennes pour labreuvement du cheptel. Le nombre de petits barrages raliss ce jour slve une centaine douvrages hydrauliques. Prcisons galement que les efforts de mobilisation des eaux de surface ont permis de doter le pays dimportantes infrastructures hydrauliques constitues de 130 grands barrages totalisant une capacit de prs de 17 Milliards de m3. Transport arien Entr en vigueur compter de lanne 2006, laccord du ciel ouvert (Open Sky) consacrant la libralisation du transport arien avec lUnion Europenne a permis damliorer les liaisons ariennes du Royaume (environ 1.320 vols internationaux hebdomadaires actuellement contre 560 vols en 2003) et daccrotre le flux du trafic international qui est pass de 5,2 millions de passagers en 2003 15,67 millions fin 2011.
NOTE DE PRESENTATION
17
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
En vue daccompagner cette volution, dimportants projets dextension et de mise niveau dinfrastructures aroportuaires ont t raliss dont, notamment, lextension et la mise niveau des aroports de Casablanca, de Marrakech, de Tanger, dOujda, dAl Hoceima, dEssaouira et de Dakhla, ainsi que lextension et le ramnagement du terminal 1 de laroport de Rabat-Sal. En outre, de nouveaux projets sont lancs dont, en particulier, le ramnagement du terminal 1 de laroport de Casablanca, la ralisation du terminal 3 de laroport de Marrakech, ainsi que lextension des installations terminales de laroport de Fs. II.2.1.1.1.2. Promotion des investissements privs Paralllement lintensification des efforts de lEtat en matire dinvestissement, la politique gouvernementale vise faire du secteur priv un acteur essentiel dans le processus de cration de richesses et demplois. A cet effet, les pouvoirs publics sattachent au renforcement de lattractivit du pays lgard des capitaux et des investissements privs nationaux et trangers. Cette attractivit, qui sest dailleurs confirme, comme le dmontre lvolution des investissements privs au cours des dernires annes, sera renforce travers le renforcement de la bonne gouvernance conomique et lappui au financement des investissements privs. II.2.1.1.1.2.1. Ralisations en matire dattraction des investissements privs Ladmission du Maroc au statut avanc au sein de lUnion Europenne est de nature donner une nouvelle impulsion la dynamique dinvestissement au pays en ouvrant de nouvelles perspectives lentreprise marocaine, notamment de partenariat, dappui linnovation et dlargissement des dbouchs. Aprs deux annes de repli en relation avec la crise conomique et financire mondiale, les entres dinvestissements directs trangers au Maroc ont enregistr une hausse de 28% par rapport 2009, pour stablir 32,3 milliards de dirhams. Il convient, ce propos, de noter que le Financial Times a class en 2011 le Maroc en tant que premier pays africain en termes dinvestissements trangers directs et que le Maroc a t lu Pays Africain de l'Avenir pour l'anne 2011-2012 par la FDI Intelligence sur la base de ses performances en matire dattraction des investissements trangers directs. Sagissant de la Commission des investissements, elle a procd au cours de lanne 2010 lapprobation de 90 projets reprsentant un investissement global de 60,17 milliards de dirhams devant crer prs de 22.000 emplois directs et stables, contre 56 projets dun montant global de 45 milliards de dirhams en 2009, soit une progression, par rapport 2009, de 61% en termes de conventions valides, de 34% en terme de volume dinvestissement et de 9% en terme de cration demplois.
NOTE DE PRESENTATION
18
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Lesdits investissements ont concern en premier lieu le secteur de lnergie qui a attir 22,2 milliards de dirhams dinvestissements, suivi du tourisme (17 milliards de dirhams) et des infrastructures (11,27 milliards de dirhams). Les investissements raliss par les nationaux reprsentent 71% du total des montants. Ils enregistrent une progression de prs de 18 % passant de 19,74 milliards de dirhams en 2009 plus de 43 milliards de dirhams en 2010. Les investissements dorigine arabe constituent la deuxime source dinvestissement destination du Maroc avec 6 milliards de dirhams, soit 10% du total des investissements. Avec cinq projets, les investissements directs trangers dorigine europenne ont lgrement dpass cinq milliards de dirhams. En 2011, la Commission des Investissements a approuv 89 projets d'un montant global de prs de 92 milliards de dirhams pour une cration prvisible de 10.000 emplois stables et directs. Ces projets d'investissement concernent les secteurs des infrastructures, de la distribution commerciale, de l'nergie, de l'industrie, du tourisme, des services et des loisirs et seront raliss principalement dans les rgions de Mekns-Tafilalet, Souss-Massa-Dra, Doukkala-Abda, TangerTtouan, Chaouia-Ourdigha, Marrakech-Tensift-Al Haouz et du Grand Casablanca. II.2.1.1.1.2.2. Renforcement de la gouvernance conomique bonne
La bonne gouvernance conomique constitue lune des conditions ncessaires au renforcement de la confiance et partant de lattractivit du pays pour les investissements directs et les capitaux trangers. Aussi, le Gouvernement mettra-t-il en uvre les mesures suivantes: La conscration des principes de la concurrence et dgalit des chances dans laccs la commande et laide publiques ; la rvision et la normalisation du dispositif juridique encadrant la passation des marchs publics et sa gnralisation aux collectivits territoriales et aux tablissements et aux entreprises publics ; la modernisation du dispositif juridique encadrant les autorits de contrle du secteur financier ; le renforcement de lefficacit de linvestissement public ainsi que le suivi et lvaluation des contrats dinvestissement et des engagements des investisseurs bnficiant des incitations publiques ; ladoption des cahiers des charges et des contrats programmes afin de lutter contre lconomie de rente ; le renforcement des prrogatives du Conseil de la Concurrence et de ses moyens daction ; la modernisation et lunification du dispositif statistique national ;
NOTE DE PRESENTATION 19
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la refonte de la gouvernance des tablissements et entreprises publics et du dispositif juridique encadrant leur contrle. Par ailleurs, les efforts seront dploys pour le renforcement de la gestion dconcentre de linvestissement travers lactualisation et la modernisation de son arsenal juridique et institutionnel, llargissement des prrogatives des Centres Rgionaux dInvestissement et le renforcement de leurs moyens humains et matriels. Enfin, des mesures cibles seront mises en uvre pour lamlioration du climat des affaires travers notamment llaboration dune nouvelle charte de linvestissement, lactualisation du cadre juridique et des mesures incitatives au profit des exportations, la rforme du secteur immobilier, la simplification des procdures dinvestissement et denregistrement de la proprit, la mise en place dun cadre lgal pour les entreprises en difficult et la rduction des dlais de traitement des dossiers au niveau des tribunaux de commerce. II.2.1.1.1.2.3. Mise contribution du Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et Social Le Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et Social joue un rle de levier pour linvestissement. Il intervient en particulier dans les secteurs du textile habillement, des quipements pour les industries automobile, aronautique et spatiale et pour laccompagnement des stratgies agricole et nergtique. Les programmes et projets bnficiant dun financement partiel ou intgral dans le cadre du Fonds Hassan II font systmatiquement lobjet de conventions qui prcisent notamment les objectifs, la consistance et le cot desdits programmes ou projets, les engagements respectifs des diffrents intervenants dans leur ralisation et leurs chanciers de ralisation. Il convient de rappeler que la loi de finances pour lanne 2010 a prvu une disposition garantissant ce fonds un revenu minimal annuel de 3,5 milliards de dirhams et ce, par le biais dun complment lui verser dans le cas o les ressources de lanne provenant des oprations de privatisation affectes au fonds seraient infrieures au seuil de 3,5 milliards de dirhams. Ce versement est imput sur les dotations des charges communes au titre de lanne suivante. II.2.1.1.1.2.4. Financement des projets denvergure Pour les projets dune certaine envergure, reprsentant un investissement gal ou suprieur 200 millions de dirhams, qui crent au moins 250 emplois et qui offrent un intrt particulier en matire de transfert de technologie et de protection de lenvironnement, un dispositif conventionnel spcifique est mis en place dans le cadre de larticle 17 de la Charte dInvestissement. Ainsi, dans le cadre de Conventions dinvestissement conclues avec les promoteurs, le Fonds de Promotion des Investissements contribue la prise en charge du cot dacquisition des terrains dans la limite de 20 % et du cot des infrastructures hors site hauteur de 5 %. Ce pourcentage peut tre port 10 %
NOTE DE PRESENTATION 20
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
quand le projet concern porte sur le secteur du tissage, de la filature et de lennoblissement des textiles ainsi que la prise en charge des cots de formation dans la limite de 20 %. Ces avantages peuvent tre cumuls hauteur de 5 % du cot global de linvestissement. Ledit pourcentage peut tre port 10% en cas dimplantation du projet en zone rurale ou suburbaine. Ces projets bnficient galement de lexonration des droits dimportation et de la TVA sur les biens dquipement, le matriel et les outillages ncessaires la ralisation des projets. II.2.1.1.2. Soutien la consommation Le soutien la consommation intrieure, qui constitue le deuxime volet de laction des pouvoirs publics pour le soutien la demande est assur travers le relvement des revenus et la prservation du pouvoir dachat des citoyens. II.2.1.1.2.1. Relvement des revenus Le relvement des revenus est recherch travers deux principaux canaux: lamlioration des rmunrations et lencouragement la cration demplois. II.2.1.1.2.1.1. Augmentation des rmunrations Les dcisions concernant l'amlioration des rmunrations des fonctionnaires et des salaris, interviennent dans le cadre du dialogue social que les pouvoirs publics tiennent institutionnaliser en tant que cadre de concertation entre l'administration et les diffrents partenaires conomiques et sociaux. Rappelons que dans le cadre du dialogue social 2008-2010 une srie de mesures ont t prises permettant notamment l'amlioration des revenus des fonctionnaires, lencouragement de ces derniers la mobilit par la motivation matrielle du personnel enseignant et du personnel paramdical affect dans les zones rurales excentres, le relvement des possibilits de promotion de grade au profit des fonctionnaires et le renforcement de la couverture mdicale et de la protection sociale. Le cot global annuel de ces mesures est de 19 milliards de dirhams. En 2011, les principales mesures prises dans le cadre du dialogue social, se prsentent comme suit : Mesures concernant le secteur public : La revalorisation gnrale, compter du 1er mai 2011, des salaires du personnel de lEtat, des collectivits locales et des tablissements publics caractre administratif dun montant mensuel net de 600 dirhams. Le cot budgtaire annuel de cette mesure est estim 8,7 milliards de dirhams; Le relvement du quota annuel pour la promotion de grade : De 28% 30% compter du 1er janvier 2011; De 30% 33% compter du 1er janvier 2012. Cette mesure va crer environ 6.000 nouvelles possibilits de promotion pour un cot budgtaire annuel estim 283 millions de dirhams ;
NOTE DE PRESENTATION 21
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La fixation du plafond dattente pour la promotion de grade quatre annes compter du 1er janvier 2012. Lincidence financire annuelle est estime en 2012 1.120 millions de dirhams pour se stabiliser 125 millions de dirhams annuellement pour les annes suivantes; La cration dun grade supplmentaire pour le personnel dont le droulement de carrire se limite une ou deux possibilits de promotion de grade. Le cot budgtaire annuel moyen dcoulant de cette mesure est estim prs de 700 millions de dirhams. Cette mesure sera conditionne par le relvement de lge rglementaire la retraite; La revalorisation des pensions minimales de 600 dirhams/mois 1.000 dirhams /mois pour un impact budgtaire annuel de 168 millions de dirhams; En outre, dautres mesures ont t prises, dans le cadre du dialogue social sectoriel, au profit du personnel des dpartements de lEducation Nationale, de la Sant, de la Justice, de lEnseignement Suprieur et du corps des Ingnieurs et du personnel militaire et ce, pour un impact annuel global de prs de 2,8 milliards de dirhams. Le cot budgtaire annuel dcoulant de lensemble des mesures prcites slve 13,2 milliards de dirhams. Mesures concernant le secteur priv : Le relvement du salaire minimum de 15% dans les secteurs de lindustrie, du commerce et de services et de 15% pour le secteur agricole et forestier sur deux tranches : 10% partir du 1er juillet 2011 et 5% partir du 1er juillet 2012. Ainsi, le SMIG va voluer dun salaire horaire de 10,64 dirhams 11,7 dirhams compter du 1er juillet 2011 et atteindra 12,24 dirhams partir du 1er juillet 2012. Un talement particulier de cette augmentation a t, toutefois, accord au secteur du textile et de lhabillement de faon ce que le SMIG natteigne la valeur de 12,24 dirhams /h quau 1er dcembre 2013. Sagissant du SMAG, le taux journalier est pass de 55,12 dirhams 60,63 dirhams en juillet 2011 et atteindra 63,39 dirhams en juillet 2012. II.2.1.1.2.1.2. Promotion de lemploi La promotion de lemploi constitue lune des priorits de laction gouvernementale et ce, dans lobjectif de rduire le taux de chmage 8% lhorizon 2016. Les mesures spcifiques mises en place actuellement pour la promotion de lemploi concernent notamment les programmes IDMAJ, TAEHIL et MOUKAWALATI. Les ralisations au titre de ces programmes se prsentent comme suit:
NOTE DE PRESENTATION
22
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
le programme IDMAJ a pu insrer 58.740 en 2011 portant le nombre total des bnficiaires au titre de la priode allant de 2007 2011 254.074, avec lobjectif datteindre prs de 300.000 en 2012 ; le programme TAEHIL a bnfici en 2011 18.136 jeunes qui ont suivi un cycle de formation pour faciliter leur insertion dans le march du travail portant le nombre total des bnficiaires au titre de la priode allant de 2007 2011 68.753; et le programme MOUKAWALATI, destin dvelopper les capacits entreprenariales des jeunes promoteurs par un accompagnement la cration et la gestion de leurs propres entreprises. Ce programme a t renforc par llargissement de son champ dapplication aux non diplms pour mieux rpondre aux besoins du march. Ainsi le nombre de projets financs et autofinancs de 2007 2011 sest lev prs de 3.800. Ces diffrents programmes seront soumis une valuation globale en vue de remdier aux insuffisances et amliorer leur fonctionnement. Paralllement, de nouveaux programmes seront lancs, savoir : le Programme Moubadara portant sur lencouragement de lemploi au sein des associations ayant une action de proximit et uvrant notamment dans le domaine social et ducatif ; le Programme Taater destin aux diplms chmeurs de longue dure et visant loctroi dune aide mensuelle dans la limite dune anne de stage. Ce programme vise lencadrement de 50.000 stagiaires par an ; le Programme Istiabe de nature provisoire et destin promouvoir lintgration du secteur informel dans lconomie nationale de manire assurer la stabilit de lemploi et lamlioration des conditions de travail. Le Gouvernement sattachera, par ailleurs, promouvoir lauto-emploi travers laccompagnement des nouvelles entreprises et la facilitation de leur accs la commande publique. En matire doutils dobservation et dintermdiation, le Gouvernement procdera progressivement la mise en uvre des actions suivantes : la cration dun observatoire national de lemploi ; la mise en place dun systme dinformation national permettant lanalyse prcise du march de lemploi ; lamlioration du systme dintermdiation et le renforcement de sa capacit assurer le lien entre les besoins du march et le dispositif de formation ; llargissement de la reprsentativit au sein du Conseil dAdministration de lAgence Nationale de Promotion de lEmploi et des Comptences ; et
NOTE DE PRESENTATION
23
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
loprationnalisation du Conseil Suprieur et des Conseils Rgionaux de lEmploi prvus par le code de travail. Le Gouvernement veillera galement complter progressivement le dispositif juridique du code de travail travers la production des textes relatifs notamment lexercice du droit la grve, aux syndicats professionnels, la sant et la suret professionnelle. Par ailleurs, une attention particulire sera accorde au (i) respect du dispositif juridique de lemploi, (ii) loprationnalisation de lindemnit pour perte de lemploi et la mise en place dun Fonds ddi, lamlioration des conditions de travail, (iii) la promotion des ngociations et des conventions collectives, (iv) lamlioration du contrle en matire de protection sociale, de couverture mdicale et des accidents de travail, (v) ainsi quau renforcement des liberts syndicales travers ladaptation de la lgislation nationale aux conventions internationales. Il convient, enfin, de noter que le projet de loi de finances pour lanne 2012 prvoit la cration de 26.204 nouveaux postes budgtaires contre une moyenne de 17 860 postes demploi entre 2008 et 2011. La cration de ces nouveaux postes dmontre leffort financier considrable dploy dans ce domaine et ce dans le but daccompagner les stratgies sectorielles et les besoins urgents de certains dpartements en ressources humaines. II.2.1.1.2.2. Prservation du pouvoir dachat La prservation du pouvoir dachat est assure travers un programme daction comportant lamont, la matrise de linflation et la mise en place dun cadre institutionnel et juridique appropri pour garantir la qualit des produits et des prestations et laval, le soutien des prix par le biais du systme de compensation. II.2.1.1.2.2.1. Matrise de linflation Le Gouvernement poursuivra la mise en uvre dune politique budgtaire et montaire saine permettant la matrise de linflation dans la limite de 2% en moyenne sur la priode 2012-2016. II.2.1.1.2.2.2. Soutien des prix LEtat poursuit ses efforts de soutien des prix intrieurs des produits de base, en loccurrence la farine nationale de bl tendre, le sucre et les produits ptroliers et ce, par le biais de la compensation qui constitue pour le Budget de lEtat une charge de plus en plus lourde. En effet, les dpenses de lEtat au titre de la compensation se sont leves prs de 90 milliards de dirhams sur la priode 2007- 2010. En 2011, la charge de compensation a atteint prs de 48,8 milliards de dirhams en raison notamment du renchrissement des cours des produits ptroliers et du sucre brut sur le march international.
NOTE DE PRESENTATION
24
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
II.2.1.1.2.2.3. Dfense des intrts des consommateurs En ligne avec lvolution structurelle de lconomie nationale marque notamment par le renforcement du pouvoir dachat et des dpenses de consommation de la population, la loi n 31-08, relative la protection du consommateur a t adopte. Cette loi a pour finalit la protection des consommateurs contre des risques susceptibles daffecter leur sant, leur scurit ou leurs intrts ainsi que la mise leur disposition des voies et des moyens de dfense de leurs droits conomiques et sociaux tels quils sont universellement reconnus travers des associations ad-hoc lgalement constitues. Les dispositions de ladite loi permettent en effet : dassurer une information approprie et claire pour le consommateur sur les produits, biens ou services quil acquiert ou utilise ; de garantir la protection du consommateur quant aux clauses des contrats de consommation, notamment les clauses abusives et celles relatives aux services financiers, aux crdits la consommation et aux crdits immobiliers, aux ventes distance et aux dmarchages ; de fixer les garanties lgales et conventionnelles des dfauts de la chose vendue aprs vente, ainsi que les conditions et les procdures relatives lindemnisation ou la rparation des dommages ou prjudices touchant le consommateur ; et dassurer la reprsentation et la dfense des intrts des consommateurs travers les associations de consommateurs. Le Gouvernement poursuivra les efforts consentis pour la protection du consommateur travers la production des textes dapplication de la loi n31-08 prcite et la cration future d'un fonds national pour la protection du consommateur. II.2.1.1.3. Promotion des exportations II.2.1.1.3.1. Amlioration de loffre exportable Le premier pilier de la politique de promotion des exportations consiste amliorer loffre exportable sur les plans quantitatif et qualitatif. Il sagit de diversifier loffre dexportation des produits marocains tout en leur assurant la qualit requise conformment aux normes internationales. Un accent particulier est mis sur les secteurs prioritaires offrant une forte valeur ajoute. Il sagit en particulier des secteurs de laronautique, de lautomobile, de llectronique, des articles lectriques, des produits pharmaceutiques, des matriaux de construction, de la mcanique mtallurgie, de lagroalimentaire, des produits de la mer, du textile et du cuir, outre les services dans les domaines de loffshoring, des technologies de linformation et de la communication, du BTP et de lingnierie. Paralllement, lamlioration de la qualit est assure travers la normalisation des produits marocains et la mise en place de centres techniques et de laboratoires danalyses chargs de sassurer du respect des normes.
NOTE DE PRESENTATION 25
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
II.2.1.1.3.2. Elargissement des dbouchs Lobjectif recherch en matire de dbouchs aux exportations consiste en la consolidation des acquis dans les marchs traditionnels et le renforcement progressif de la position des produits marocains dans de nouveaux marchs dans la perspective de multiplier par deux les exportations lhorizon 2015 et par trois lhorizon 2018 de manire les porter 327 milliards de dirhams en 2018. A cet effet, trois catgories de marchs sont cibles : les marchs stratgiques appels recevoir en grande quantit une vaste gamme de produits marocains. Ces marchs concernent nos principaux partenaires commerciaux constitus notamment par les pays de lUnion Europenne et les Etats-Unis dAmrique sur lesquels seront concentrs hauteur de 60 % 65 % les efforts promotionnels ; les marchs dits adjacents notamment les pays dAfrique de lOuest et de lAfrique Subsaharienne, dans lesquels les exportateurs nationaux bnficient davantages comparatifs mais dont les capacits dabsorption des produits et dactivits marocains sont relativement limites tant en volume quen gamme de produits; les marchs dits de niche dans lesquels les produits marocains sont peu ou pas du tout implants mais qui sont susceptibles de constituer des dbouchs prometteurs pour un nombre limit de produits tels que les produits de terroir. La politique de diversification des produits exportables et des dbouchs est fortement soutenue par la conclusion des Accords de Libre Echange avec un nombre croissant de pays et de groupements rgionaux, ce qui se traduit par llargissement des marchs potentiels pour lcoulement des produits nationaux. II.2.1.1.3.3. Accompagnement des acteurs dans le secteur des exportations II.2.1.1.3.3.1. Adaptation et renforcement du cadre institutionnel Les principales mesures prises dans ce cadre portent sur : lachvement de ltude visant la transformation du Conseil National du Commerce Extrieur en Observatoire du Commerce Extrieur pour un meilleur suivi et une plus grande matrise de la politique nationale en matire de commerce extrieur ; lintensification des actions promotionnelles menes par le Centre Marocain de Promotion des Exportations et le changement de son identit institutionnelle devenue Maroc Export . Le Gouvernement renforcera, par ailleurs, la coordination entre les diffrents acteurs dans les ngociations commerciales bilatrales et multilatrales de manire renforcer la position du ngociateur marocain.
NOTE DE PRESENTATION 26
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Enfin, lintervention des diffrentes institutions qui oprent dans le domaine de la promotion des exportations sera renforce et rationnalise tout en dveloppant une logique de complmentarit entre celles-ci et les missions diplomatiques conomiques et commerciales et ce suivant une vision intgre. II.2.1.1.3.3.2. Etablissement de zones franches Outre le dveloppement de la Zone Franche Export de Tanger, des zones franches industrielles sont cres Laayoune, Dakhla, Knitra et Bettouya Nador. Paralllement, la lgislation relative aux zones franches dexportation a t assouplie dans le cadre de la mise en uvre du Plan Emergence de lIndustrie afin de tirer profit, dans les meilleures conditions, des opportunits dinvestissement et dacclrer la ralisation de ces zones. II.2.1.2. Dynamisation du secteur priv Les efforts consentis pour la dynamisation du secteur priv portent, essentiellement, sur la mise en place des structures daccueil des investissements, lencouragement la cration et la mise niveau des entreprises et la mise en place de moyens de financement adapts leurs besoins. II.2.1.2.1. Mise en place des structures daccueil des investissements Le dveloppement industriel et la promotion des investissements restent conditionns par la disponibilit dune infrastructure de qualit et des prix comptitifs, considre comme lun des facteurs les plus importants pour lattraction des investissements nationaux et trangers. Une approche visant le dveloppement de projets dinfrastructures daccueil de nouvelle gnration, qui rpondent aux besoins des investisseurs et des dfis de la concurrence internationale et avec des prix de commercialisation comptitifs a t mise en place. L'Etat a mobilis le foncier ncessaire et met en place progressivement un rseau de 16 plateformes industrielles intgres (P2I), dont certaines sont oprationnelles. Il sagit de : Neuf P2I sectorielles dont six sont ddies lOffshoring (Casanearshore, Rabat Technopolis, Fs Shore, Ttouan Shore, Oujda Shore et Marrakech Shore), deux sont ddies lautomobile bnficiant du statut de zone franche (Tanger Automotive City et Knitra Automotive City) et une P2I ddie laronautique (Nouasser Aerospace City). Cinq P2I gnralistes Casablanca, Tanger Free Zone, Fs, Layoune et Dakhla. Deux P2I quartier national/rgional.
NOTE DE PRESENTATION
27
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
II.2.1.2.2. Encouragement la cration et la mise niveau de lentreprise Le renforcement de la comptitivit des entreprises constitue un des objectifs essentiels du Pacte National pour lEmergence Industrielle travers la mise en place des principaux dispositifs suivants : IMTIAZ, MOUSSANADA et INMAA. II.2.1.2.2.1. Programme IMTIAZ Ce programme cible les entreprises fort potentiel de croissance et porteuses de projets de dveloppement innovants leur permettant daccder un palier suprieur au niveau de la production, de la valeur ajoute nationale ou de la cration demplois ou dentraner un impact structurel significatif dans leur domaine dactivit. LEtat sengage soutenir ces entreprises dans leurs efforts de modernisation et damlioration de leur comptitivit sur la base dun contrat de croissance prcisant les obligations et les droits respectifs des parties contractantes pour la ralisation des objectifs convenus. Un concours de lEtat, reprsentant 20 % des investissements raliss, est prvu au profit des entreprises engages dans ce processus dans la limite dun plafond de 5 millions de dirhams. Lapport en fonds propres des entreprises doit tre de 20 %, le reliquat de 60 % devant consister en des crdits bancaires. Une cinquantaine dentreprises devraient tre retenues en moyenne annuellement pour bnficier de ce programme. Trois ditions du programme Imtiaz ont t organises donnant lieu 64 entreprises bnficiaires et un investissement global induit terme de 1.295 MDH pour une contribution de lEtat de prs de 226 MDH. Lappel manifestation dintrt de la quatrime dition dImtiaz a t lanc sur la base de critres de slection radapts pour mieux rpondre aux objectifs du programme et aux besoins des entreprises marocaines. II.2.1.2.2.2. Programme MOUSSANADA Ce programme est destin accompagner la mise niveau des autres entreprises en voie de modernisation disposant dun fort potentiel de croissance pour leur permettre de russir leurs projets. Ce programme met la disposition de la PME : Une offre transverse doptimisation des fonctions support ; Une offre sectorielle cur de mtier, visant dvelopper les comptences mtiers des PME, tels que les processus de production et dapprovisionnement ; Une offre Technologies de lInformation (TI) transverse et sectorielle, ayant pour objectif dacclrer lintgration des technologies de linformation au sein des PME (progiciels mtiers adapts chaque secteur). Concernant les offres transverse et sectorielle, lEtat finance 60% du cot de la prestation dans la limite de 600 000 dirhams par entreprise. Sagissant de loffre Technologies de lInformation transverse et sectorielle, lEtat finance lacquisition des
NOTE DE PRESENTATION 28
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
systmes dinformation et leur implmentation hauteur de 60% du cot de la prestation dans la limite de 400 000 dirhams par entreprise. A fin 2011, 390 actions dappui ont t ralises dans le cadre de ce programme, au profit de 299 entreprises pour une contribution financire de lEtat de 38 MDH. II.2.1.2.2.3. Programme INMAA Ce programme, lanc en 2011, a pour vocation de promouvoir les principes de lexcellence, travers la transformation oprationnelle effective de 800 entreprises marocaines cibles sur les cinq annes futures. Dans ce contexte, des experts de la transformation oprationnelle, recruts par INMAA et forms par McKinsey, sont chargs de dispenser les prestations relatives audit programme et accompagnent des promotions dentreprises dans leur initiative de transformation oprationnelle sur une dure de six mois. Ce programme est oprationnel depuis linauguration, en mai 2011, de lusine modle INMAA Bouskoura. Lobjectif pour les entreprises bnficiaires tant daugmenter leur productivit de 25 %, de diminuer leurs cots de 20 % et de rduire leur dlai de fabrication de 50%. II.2.1.2.3. Autres dispositifs de financement et de promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (PME) Des dispositifs spcifiques sont mis en place pour faciliter laccs des PME aux moyens de financement adapts leurs besoins. Il sagit notamment de : Lignes de crdits extrieures ouvertes par les pays partenaires notamment la France, lEspagne, le Portugal, lItalie et la Belgique; et Programme ATTAHFIZ destin financer les projets dinvestissement par le systme bancaire hauteur de 80% avec une garantie de Dar Ad Damane couvrant 50% des crdits bancaires correspondants ; De mme, plusieurs instruments de garantie et/ou de cofinancement ont t introduits en vue daccompagner les programmes de dveloppement sectoriel tels que ceux du tourisme, de lenseignement et de la formation privs, des nouvelles technologies de linformation et de la communication, du dveloppement agricole rgional et de la pche. Il sagit notamment du RENOVOTEL 2010 qui sinsre dans le cadre des mesures volontaristes daccompagnement du secteur du tourisme, du fonds MDM INVEST incitatif aux projets dinvestissement des Marocains Rsidents lEtranger au Maroc et du fonds FOPEP destin financer les projets de cration ou dextension d'tablissements de lenseignement et de la formation privs. De plus, les pouvoirs publics ont mis en place en 2009 des mesures de soutien aux entreprises impactes par la crise conomique internationale travers le produit Damane exploitation qui garantit le financement du besoin en fonds de roulement. De plus, des conditions favorables de la garantie au titre de Damane Exploitation ont t accordes aux entreprises exportatrices de certains secteurs. Une enveloppe de 50 millions de dirhams a t mobilise ce titre.
NOTE DE PRESENTATION 29
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Par ailleurs, et en vue de faire bnficier le plus grand nombre de PME des programmes dappui mis en place par lEtat, une nouvelle dfinition de la PME a t adopte avec comme critre un chiffre daffaires infrieur 175 millions de dirhams. Les efforts de promotion des PME se poursuivront dans le futur travers la mise en place dune fiscalit incitative et simplifie et le dveloppement de nouveaux dispositifs et instruments de financement spcifiques notamment le capital risque et la mise en place dun systme de garantie spcifique aux PME. Enfin, le rle attribu aux institutions nationales en charge de la promotion des PME sera renforc et leurs ressources seront amliores. II.2.1.2.4. Dveloppement du paysage financier du pays II.2.1.2.4.1. Dveloppement du march des capitaux Les principales actions futures envisages par le Gouvernement pour la dynamisation du march des capitaux consistent en la rvision de lencadrement juridique du march boursier et le renforcement de sa transparence ainsi que llaboration dune loi sur les marchs des capitaux couvrant les instruments financiers, les institutions du march financier ainsi que les outils et institutions dagrment et de contrle de manire offrir une meilleure visibilit aux diffrents intervenants et faciliter lintroduction de nouveaux produits financiers. Une politique volontariste dencouragement de lintroduction en bourse et de dveloppement de nouveaux instruments boursiers sera galement adopte au profit notamment des Petites et Moyennes Entreprises. Par ailleurs, le Gouvernement veillera la modernisation de la gouvernance de la bourse, lamlioration de sa gestion, au durcissement du dispositif de sanction des infractions et au renforcement de la transparence des oprations et des informations financires. II.2.1.2.4.2. Enrichissement du paysage financier du pays La promulgation de la loi n 44-10 relative au statut de Casablanca Finance City en tant que place rgionale sinscrit dans le cadre de la stratgie mise en uvre par le Maroc pour renforcer sa position comptitive sur les plans rgional et international. Les objectifs assigns cette institution consistent principalement dans laccompagnement des investisseurs, lattraction des grands investisseurs trangers et le dveloppement de nouveaux mtiers financiers. Un rgime fiscal attractif a t mis en place en faveur des socits disposant dun agrment pour exercer dans le cadre de cette place financire. Laction du Gouvernement dans ce domaine portera notamment sur la rsorption des retards enregistrs dans llaboration des projets de lois ncessaires pour accompagner le dveloppement de la place financire, ainsi que sur la ralisation des rformes daccompagnement ncessaires relatives au secteur financier et au climat des affaires.
NOTE DE PRESENTATION 30
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
En outre, une attention particulire sera accorde la poursuite de la rforme du secteur banquier dans lobjectif de professionnaliser davantage la gestion des risques et de permettre le dveloppement de nouvelles institutions et de nouveaux produits. Enfin, le gouvernement veillera assurer une plus grande ouverture du secteur des assurances et amliorer sa comptitivit. Dans ce cadre, il sera procd notamment lamlioration du dispositif de contrle travers ladoption des rgles prudentielles alignes aux normes internationales, la mise en place dun contrle bas sur lanalyse des risques et le renforcement de la gouvernance et de la transparence du secteur. II.2.1.3. Poursuite de la mise en uvre des stratgies sectorielles Le Gouvernement poursuivra la mise en uvre des diffrentes stratgies sectorielles. Celles-ci feront lobjet dune valuation globale dans lobjectif de dvelopper une vision conomique intgre redfinissant les priorits et rexaminant les objectifs fixs et les indicateurs de suivi des ralisations. Une attention particulire sera accorde la cohrence desdites stratgies, lacclration de leur mise en uvre, leur complmentarit avec les plans stratgiques rgionaux et la prise en compte de la dimension territoriale dans leur conception et leur mise en uvre. II.2.1.3.1. Plan Maroc Vert Dans la lettre Royale adresse le 26 avril 2011, aux participants aux Quatrimes Assises Nationales de lAgriculture, Sa Majest le Roi a mis laccent sur limportance de la modernisation du secteur agricole en tant que ple stratgique pour raliser un dveloppement conomique et humain fort, soutenu et durable. Le secteur agricole, qui reprsente en moyenne 14 20 % du PIB national en fonction des conditions climatiques avec des rpercussions importantes sur le taux de croissance et les exportations du pays, constitue la principale source de revenu pour 80 % de la population rurale et offre prs de quatre millions demplois agricoles aux ruraux. Le Plan Maroc Vert vise le dveloppement dune agriculture comptitive, moderne, intgre et haute valeur ajoute et donc capable daffronter le dfi de la mondialisation et de louverture. A lhorizon 2020, ledit plan vise le relvement de la part du secteur agricole dans le PIB de 74 milliards de dirhams en moyenne un niveau se situant entre 100 et 174 milliards de dirhams, la cration de 1 500 000 emplois nouveaux, le doublement des revenus pour prs de 1,5 millions de ruraux et la multiplication par 2,5 des quantits exportes par les filires telles que les agrumes, les olives, et les produits marachers o le Maroc dispose davantages comparatifs.
NOTE DE PRESENTATION
31
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
II.2.1.3.1.1.
Consistance du Plan investissements prvus
Maroc
Vert
et
Le plan daction mis au point cet effet, sur la base dune approche de dveloppement intgr, sorganise autour de deux piliers : Pilier I : le dveloppement dune agriculture haute valeur ajoute et haute productivit tourne principalement vers lexportation. Il sera procd dans ce cadre au lancement de 961 projets rpartis entre 560 000 exploitations cibles pour un investissement de lordre de 121,2 milliards de dirhams ; Pilier II : la mise niveau solidaire du tissu de production au profit de 840 000 exploitants cibls travers 545 projets pour un investissement de lordre de 19,25 milliards de dirhams. Le volume total des investissements requis pour la priode 2009-2018 porte sur prs de 193 milliards de dirhams dont 121 milliards de dirhams au titre du Pilier I et 20 milliards de dirhams au titre du pilier II. Le reliquat, soit 53 milliards de dirhams concernera les actions de conversion collective en irrigation localise et les diverses actions dappui. La part revenant lEtat dans cet effort dinvestissement est estime 68,6 milliards de dirhams, soit prs de 35,5 %. II.2.1.3.1.2. Principales ralisations II.2.1.3.1.2.1. Adaptation du cadre institutionnel rgissant le secteur agricole
Dans ce cadre, il a t procd notamment : la refonte du systme daides et dincitations accordes aux agriculteurs dans le cadre du Fonds de Dveloppement Agricole en vue den faire un vritable levier de promotion de linvestissement au niveau de toutes les filires de production; la cration sur Hautes instructions Royales de lAgence Nationale de Dveloppement des Zones Oasiennes et de lArganier avec pour mission la mise en place de programmes concerts dintervention conciliant la fois les impratifs de dveloppement durable et les intrts des populations au niveau des zones oasiennes et de larganier ; la cration de lAgence de Dveloppement Agricole (ADA) appele superviser la mise en uvre du Plan Maroc Vert ; la cration de lOffice National charg de la Scurit Sanitaire des Produits Alimentaires charg des prrogatives de la protection de la sant du consommateur et de prservation de la sant des animaux et des vgtaux; la restructuration des Chambres dAgriculture et la mise en place dinstances interprofessionnelles devant constituer de vritables interlocuteurs pour la mise en place de la nouvelle stratgie;
NOTE DE PRESENTATION
32
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la rorganisation du Ministre de lAgriculture aux niveaux central, rgional et local avec la cration notamment, de structures rgionales de planification et dexcution afin de permettre un encadrement et un suivi rgulier de lexcution des projets. II.2.1.3.1.2.2. Mise en uvre dactions visant le renforcement de la productivit Il sagit principalement de la mise en uvre de la nouvelle stratgie du conseil agricole et de transfert de technologie, le lancement dun vaste programme de dveloppement et de promotion des produits de terroir et le dveloppement de la recherche scientifique et de la formation professionnelle agricole. II.2.1.3.1.2.3. Mise en place doffres de financements adaptes Il sagit de laccompagnement bancaire du Plan Maroc Vert travers la mise en uvre doffres de financements adaptes aux spcificits des projets agricoles. A cet effet, des conventions ont t conclues avec certaines institutions financires notamment la Socit Gnrale Marocaine des Banques, le Crdit Agricole du Maroc, la Banque Centrale Populaire et Attijariwafa Bank pour la mobilisation des financements ncessaires au profit des projets Pilier I et Pilier II. II.2.1.3.1.2.4. Mobilisation des terres domaniales Cette opration est ralise dans le cadre dun Partenariat Public Priv (PPP) autour des terres agricoles du domaine priv de lEtat avec pour principal objectif la mise en uvre de projets dinvestissement intgrs susceptibles dassurer la valorisation de ces terres. Dans ce cadre, les trois premires tranches du programme, portant sur une superficie de lordre de 100.000 ha ont t dclines en 356 projets reprsentant un investissement de prs de 17 milliards de dirhams et la cration de 60 000 emplois. La quatrime tranche portant sur une superficie de 20.000 ha relevant du domaine priv de lEtat sera lance en 2012. En outre, des concertations sont en cours avec le ministre de lintrieur pour examiner les possibilits de mobilisation du foncier des collectifs. II.2.1.3.1.2.5. Ancrage territorial de la stratgie Une attention particulire est rserve lancrage territorial de la stratgie nationale du Plan Maroc Vert travers ltablissement de Plans Agricoles Rgionaux et la conclusion de partenariat de qualit entre les diffrents oprateurs publics et privs avec une implication substantielle de lappareil bancaire national et les bailleurs de fonds internationaux pour la mobilisation des moyens de financement ncessaires. Dans ce cadre, il a t procd le 14 Avril 2009 la signature, sous la Haute Prsidence de Sa Majest le Roi, de conventions entre le Gouvernement et chacune des seize Rgions du Royaume portant sur la ralisation de 1 400 projets visant le dveloppement et lamlioration notamment de la craliculture, de lhorticulture, de larboriculture fruitire, des lgumineuses, des cultures industrielles, de llevage
NOTE DE PRESENTATION 33
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
ovin, caprin, bovin et camelin ainsi que de laviculture et de lapiculture selon des spcificits et des potentialits locales. II.2.1.3.1.2.6. Lancement du Programme National dEconomie dEau dIrrigation (PNEEI) De par son ancrage territorial important et ses retombes indniables sur la structuration de lespace agricole et rural en termes de mise en valeur et de dveloppement, le PNEEI constitue un axe fondamental du Plan Maroc Vert. Il consiste en la conversion massive en irrigation localise dune superficie de 550.000 ha sur une priode de 10 ans pour un cot de lordre de 37 milliards de dirhams. II.2.1.3.1.2.7. Mise en place des conditions favorables pour la dynamisation de linvestissement priv Lobjectif recherch est datteindre 10 milliards de dirhams dinvestissement priv par anne, et ce travers : la matrise d'uvre par l'ADA des projets pilier I et pilier II et du concept d'agrgation; la revalorisation des montants de subventions accordes par lEtat dans le cadre du Fonds de Dveloppement Agricole, la cration de nouvelles subventions, la mise en place dun systme daide spcifique aux projets dagrgation et la simplification des procdures de leur octroi; et la mise en uvre du projet de loi sur lagrgation devant tracer les lignes directrices des relations entre lagrgateur et lagrg. II.2.1.3.1.2.8. Dmarrage dun lot de projets Pilier I relatif lagriculture haute valeur ajoute Ce lot comporte 64 projets pour un investissement de prs de 17 milliards de dirhams et dont prs des deux tiers sont organiss autour de lagrgation. Ces projets concernent une superficie denviron 132.000 hectares et prs de 135 000 bnficiaires. La rpartition rgionale de ces projets fait ressortir que 58% des projets sont valids et 74% des investissements projets sont concentrs dans quatre principales rgions en loccurrence, les rgions de Marrakech-Tensift-El Haouz, Souss-Massa-Draa, Tadla-Azilal et Gharb-Chrarda-Bni Hssen. Les impacts socio-conomiques attendus pour les 64 projets, lhorizon 2020, portent notamment sur la cration de 87430 emplois permanents, lamlioration des revenus de 26 440 47 160 dh/ ha agrg pour la filire vgtale et de 32 000 59 700 dh/leveur pour la filire animale et la valorisation de leau de 4,8 11,7 dh/m3.
NOTE DE PRESENTATION
34
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
II.2.1.3.1.2.9. Lancement dimportants projets du Pilier II relatif lagriculture solidaire Initie depuis 2010, la mise en uvre des projets Pilier II a port sur le lancement de 224 projets au niveau national totalisant un investissement total terme de prs de 9 milliards de dirhams. La superficie couverte par ces projets slve plus de 615000 hectares au profit de prs de 402 000 bnficiaires. Ces projets ont t choisis en adoptant les principes de viabilit et de durabilit, du respect de lapproche filire observe dans llaboration des Plans Agricoles Rgionaux, de ladhsion et lorganisation professionnelle de la population bnficiaire et de la construction de projets intgrs amont-aval. La filire vgtale couvre 64% de ces projets avec une dominance de lolivier, suivis de lamandier, du palmier dattier et de larboriculture fruitire. Quant la filire animale, elle reprsente 33% des projets lancs avec une prdominance des viandes rouges et de lapiculture. Sagissant de la rpartition rgionale, 50% des projets lancs sont localiss dans les rgions de Tanger-Ttouan (15%), Taza-Al Hoceima-Taounate (13%), Souss-Massa-Draa (12%) et Mekns-Tafilalet (10%). II.2.1.3.1.3. Actions futures Le Gouvernement poursuivra la mise en uvre du plan Maroc Vert tout en apportant les ajustements suivants: un meilleur quilibre entre les deux piliers du plan Maroc Vert ; le renforcement du principe de la scurit alimentaire ; le dveloppement des instruments et outils de dclinaison et de mise en uvre du plan Maroc vert notamment, lagrgation. A cet effet, le Gouvernement mettra en uvre progressivement les principales actions suivantes : le dveloppement du capital humain travers le renforcement de la formation dans les mtiers agricoles, lencadrement technique des agriculteurs et lamlioration du systme de formation professionnelle dans les mtiers agricoles ; le dveloppement de nouveaux instruments de financement des petits agriculteurs notamment un fonds de garantie ddi; la maitrise des circuits et des procds de distribution du produit agricole de manire assurer la justesse des prix garantissant lagriculteur la continuit et le dveloppement de sa production; lactualisation des plans agricoles rgionaux et des contrats programmes conclus avec les diffrentes chaines de production ;
NOTE DE PRESENTATION 35
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
lamlioration de lappui accord dans le cadre du Fonds de Dveloppement Agricole ; lachvement du processus de cration de lOffice National du Conseil Agricole ; la modernisation des modes de distribution des produits agricoles en recherchant lefficacit des services logistiques et lamlioration des marges bnficiaires ; le soutien des exportations des produits agricoles et le dveloppement de lagriculture biologique ; et lapprovisionnement des agriculteurs en intrants agricoles et en facteurs de production suffisants et la facilitation de leur accs aux sources de financement et lassurance agricole. II.2.1.3.2. Eau et assainissement Le Gouvernement poursuit une politique de gestion efficace de leau base sur la matrise de la demande en eau et lamlioration de loffre et la diversification de ses ressources. A cet effet, les efforts seront dploys pour, dune part, la rorganisation du secteur selon une dmarche participative et intgre et, dautre part, la consolidation des acquis travers lamlioration des ressources mobilises et lentretien des infrastructures hydrauliques et des quipements de redistribution de leau. Ainsi, les principales actions envisages portent sur loprationnalisation du Conseil Suprieur de lEau, lacclration de llaboration et de la mise en uvre du plan national de leau et la poursuite de la mise en uvre de la stratgie nationale de leau. II.2.1.3.2.1. Consistance de la stratgie Conformment aux Hautes Orientations Royales, la stratgie adopte par le Maroc dans le secteur de leau vise assurer la matrise de lensemble du processus de production, de distribution, dutilisation et de rutilisation, le cas chant, des eaux uses dans un contexte marqu, dune part, par la raret des eaux douces en raison des occurrences frquentes et prolonges des priodes de scheresse et dautre part, par laugmentation constante des besoins en raison du dveloppement conomique et de laccroissement dmographique. II.2.1.3.2.2. Objectifs de la stratgie Les objectifs assigns cette stratgie consistent principalement dans : la garantie de lapprovisionnement du pays en eau pour les besoins des populations en gnralisant laccs leau potable en milieux urbain et rural, pour les besoins des cultures irrigues et pour les besoins des autres secteurs productifs notamment lindustrie et les mines par la mobilisation, dans les meilleures conditions possibles, des ressources disponibles y compris celles
NOTE DE PRESENTATION 36
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
susceptibles dtre procures par le dessalement des eaux de mer. Paralllement, le recours aux eaux souterraines considres comme rserves stratgiques sera limit au strict minimum; la garantie dune meilleure valorisation des eaux notamment celles utilises dans le domaine agricole ; la prservation de la qualit des eaux par la lutte contre les diffrentes formes de pollution et le traitement des eaux uses ; lamlioration de la gestion de la demande par la lutte contre le gaspillage des eaux chez les diffrents usagers ; la protection des zones dhabitat et des infrastructures de base et des units de production contre les risques dinondations souvent dvastatrices pour les personnes et les biens comme cela a t le cas au cours des dernires annes marques par une pluviomtrie exceptionnelle. II.2.1.3.2.3. Plan daction La stratgie de leau est dcline en plan daction prcis qui sarticule autour des programmes suivants: le programme national dassainissement qui vise porter le taux de raccordement au rseau dassainissement urbain 80 % lhorizon 2020 en vue de la rutilisation des eaux traites pour les besoins de lirrigation, de lindustrie ou de la ralimentation des nappes phratiques. Sur les 700 millions de m3 deaux uses produites annuellement, seuls 10 % sont traits lheure actuelle ; le Programme de valorisation des ressources en eau notamment celles usage agricole qui reprsentent actuellement 90 % des eaux mobilises. A cet effet, il sera procd dune part, au rattrapage, dans le cadre du Plan Maroc Vert, des retards accumuls en matire dquipement des zones domines par les eaux des barrages et, dautre part, la ralisation dconomies dans les consommations deau par ladoption de techniques dirrigation appropries consistant dans le remplacement progressif des systmes actuels bass sur le gravitaire et laspersion par les systmes de micro-irrigation et le goutte goutte. Cette reconversion permettra de couvrir par lirrigation localise une superficie de 670 000 ha lhorizon 2020 contre 150 000 ha actuellement. Dans ce cadre, il a t procd au lancement du Programme National dEconomie dEau en Irrigation (PNEEI) en juin 2010 ; le programme de mobilisation des eaux de surface par la poursuite un rythme soutenu de la politique des barrages. Les ralisations concrtes dans ce domaine sont dtailles dans le Titre III de la prsente note consacr aux programmes daction des dpartements ministriels ; le programme damnagement des bassins versants qui vise rduire lrosion des sols lamont des barrages afin de rduire leur envasement et sauvegarder ainsi leurs capacits de stockage des eaux ;
NOTE DE PRESENTATION
37
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
le programme de prservation des quipements hydrauliques pour maintenir la qualit de leurs services et prolonger leurs dures de vie ; le programme de prvention et de lutte contre les risques dinondation. Il a t procd cet effet la cration du Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles, la promulgation de la loi relative aux catastrophes naturelles et ltablissement dun programme de protection contre les inondations. Il convient de relever ce propos que le Maroc est en train de dpasser les Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement (OMD) en matire de gestion du secteur de leau et de lenvironnement avec notamment les avances constates dans laccs leau potable en milieu rural et dans le raccordement aux rseaux dassainissement des quartiers pri-urbains. En particulier, le taux daccs leau potable en milieu rural est pass de 62 % en 2004 92 % en 2011. Par ailleurs, de nouvelles alternatives consistant dans le dessalement de leau de mer et le traitement et la rutilisation des eaux uses, la matrise de la demande et ladaptation de la gestion des ressources hydriques aux changements climatiques sont en cours de dveloppement. II.2.1.3.2.4. Territorialisation de la stratgie Paralllement la signature des conventions concernant la mise en uvre du Plan Maroc Vert sur le plan rgional, il a t procd, le 14 Avril 2009, lors dune crmonie prside par Sa Majest le Roi, la signature de seize Conventions entre le Gouvernement et les diffrentes Rgions du Royaume pour la concrtisation sur le plan local, de la stratgie nationale par le biais de projets intgrs dans les secteurs de leau et de lenvironnement concernant notamment, la prservation des espaces naturels et de la biodiversit et la dpollution et la gestion des dchets solides et liquides. II.2.1.3.3. Environnement et gestion des risques majeurs II.2.1.3.3.1. Objectifs et axes principaux Les objectifs assigns la politique environnementale consistent essentiellement dans la rsorption des grands dficits dans ce domaine, la mise en place dun systme de protection durable de lenvironnement sous forme de Charte Nationale tablie en concertation avec lensemble des acteurs, la sauvegarde de la biodiversit et de la qualit du patrimoine naturel et historique et le dveloppement quilibr et lamlioration de la qualit de la vie et des conditions sanitaires des citoyens. La politique environnementale est mene selon les trois approches ci-aprs : une approche territoriale dans le cadre dune gestion solidaire des ressources naturelles mettant contribution lensemble des rgions, des provinces et des prfectures du Royaume ;
NOTE DE PRESENTATION
38
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
une approche partenariale sollicitant lensemble des acteurs conomiques et les ONG ; une approche programmatique matrialise par des projets dintrt primordial pour le pays tels que le Programme National dAssainissement dun cot total de 43 milliards de dirhams (horizon 2020), le Programme National des Dchets Mnagers dun cot de 37 milliards de dirhams (horizon 2023), le Programme National de Lutte contre la Pollution Atmosphrique et le Programme National pour la Prvention des Risques Industriels. II.2.1.3.3.2. Ralisations Leffort financier consenti par lEtat au profit du secteur de lenvironnement, depuis 2007 a permis la ralisation de plus de 690 projets totalisant 25.879 MDH dans les domaines de lassainissement liquide et de lpuration des eaux uses, de la gestion des dchets solides, de lamlioration de la qualit de lair, de la mise niveau environnementale des coles rurales, des coles coraniques et des mosques ainsi que la ralisation des observatoires rgionaux de lenvironnement et du dveloppement durable(OREDD) . Lesdits projets ont port, particulirement, sur : la ralisation de plusieurs stations de traitement et dpuration des eaux uses (STEP) avec une capacit de traitement de 352 millions de m3 par an soit 51% des eaux uses produites au Maroc (700 millions de m3 par an), ce qui permettra la rutilisation de 31% de ces eaux traites pour lirrigation et le prtraitement de 30% avant rejet en mer rduisant ainsi la pollution des eaux marines et la protection des plages et la rgnration des ressources halieutiques ; la ralisation de dcharges contrles dune capacit totale de 1,53 millions de tonnes par an (35% des dchets mnagers et assimils produits annuellement au niveau national) et la rhabilitation et la fermeture des dcharges spontanes ; la lutte contre la pollution industrielle par le soutien public aux entreprises industrielles pour les inciter changer leurs modes de production et de comportement vis--vis de lenvironnement ; lintgration de la dimension environnementale dans les projets conomiques par le biais des tudes dimpact environnemental comme condition pralable de conformit environnementale ; la rduction de la pression sur le couvert vgtal prurbain en lamnageant en aires de loisirs ; et le ramassage et llimination des sacs de plastiques en partenariat avec le Ministre de lIntrieur. II.2.1.3.4. Energie Elabore selon les Hautes Orientations Royales et adopte aux Premires Assises de lEnergie tenues le 06 mars 2009, la Stratgie nergtique Nationale
NOTE DE PRESENTATION 39
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
considre le dveloppement durable comme un concept global et intgr dans ses multiples dimensions humaines, sociales, conomiques, technologiques et environnementales. II.2.1.3.4.1. Objectifs et plan daction La nouvelle stratgie nergtique a pour principaux objectifs de scuriser lapprovisionnement national en diverses formes dnergie, den assurer la disponibilit et laccessibilit des prix raisonnables et de rationaliser leur utilisation tout en prservant lenvironnement. Ladite stratgie est ralise travers la mise en uvre de trois plans daction : Plan daction court terme couvrant la priode 2009-2012 et ayant pour objectif dassurer lquilibre entre loffre et la demande dnergie et lancer les premires mesures defficacit nergtique; Plan daction moyen terme portant sur la priode 2013-2020 bas sur les schmas de production avec un ciblage accentu du charbon, du gaz et des sources dnergie renouvelables au dtriment du ptrole ; et Plan daction long terme couvrant la priode 2020-2030 o sont envisages des options alternatives consistant dans le recours llectronuclaire, les schistes bitumineux et les biocarburants et le renforcement des interconnexions lectriques avec les pays voisins. En termes dimpacts projets, la mise en uvre des plans de dveloppement des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique crera 50 000 postes de travail directs permanents lhorizon 2020 dont 12 000 dans le solaire et lolien. Sur la priode 2008 2020, la totalit de la puissance lectrique additionnelle de toutes origines serait de 9246 MW et linvestissement total dans les diffrents projets lectriques et ptroliers serait de prs 200 milliards de dirhams. II.2.1.3.4.2. Bilan de la stratgie II.2.1.3.4.2.1. Adaptation du cadre institutionnel, lgislatif et rglementaire
Ladaptation du cadre institutionnel, lgislatif et rglementaire a t marque par la promulgation des lois et dcrets dapplication relatifs aux Energies Renouvelables, lAgence de Dveloppement des Energies Renouvelables et de lEfficacit Energtique (ADEREE), lAgence Marocaine pour lEnergie Solaire : la Moroccan Agency For Solar Energy (MASEN), la Socit dInvestissements Energtiques (SIE) et ladoption de la Loi sur lEfficacit Energtique. II.2.1.3.4.2.2. Dveloppement des nergies vertes Le Maroc a adopt avec dtermination une politique volontariste de dveloppement de lconomie verte travers les Plans Solaire et Eolien de 2000 MW chacun raliser dici 2020. Le programme solaire intgr devant permettre la production annuelle de 4 500 GWH pour un cot estim neuf milliards de dollars sera matrialis par la
NOTE DE PRESENTATION 40
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
construction de cinq centrales Ouarzazate (500 MW), An Beni Mathar prs dOujda (400 MW), Sebkha Tah (500 MW), Foum El Oued (500 MW) et Boujdour (100 MW). Dans la continuit de ce programme, le dveloppement de la filire olienne est acclr, avec la mise en uvre du Programme Eolien Marocain intgr de production lectrique dune puissance de 2000 MW raliser dici 2020. A lachvement de tous ces programmes, 42% de la puissance lectrique totale installe au Maroc proviendra de sources renouvelables dnergie. II.2.1.3.4.2.3. Renforcement de loffre lectrique Des ralisations importantes sont enregistres dans le cadre du Plan National des Actions Prioritaires (PNAP), qui prvoit le renforcement de loffre lectrique pour assurer lquilibre avec la demande et la mise en place des premires mesures defficacit nergtique. Ainsi, 1084 MW de capacit nouvelle de production lectrique prvue dans le programme lectrique durgence, a t ralise et ce, travers la ralisation des installations suivantes: la centrale thermo-solaire cycle combin intgr dAin Bni Mathar d'une puissance totale de 472 MW, dont 20 MW partir de la composante solaire, la premire en son genre dans la rgion MENA ; la centrale de turbines gaz de Mohammedia compose de trois tranches de 100 MW chacune ; les Groupes Diesel de Tan-Tan dune puissance de 116 MW. Ce programme sera galement renforc pour rpondre la demande et crer une marge de rserve lectrique plus confortable avec la ralisation et la mise en service prochaine de la Centrale de Turbines gaz Knitra de 300 MW, du parc olien de Tarfaya de 300 MW raliser en production concessionnelle et du groupe Diesel de Tiznit de 72 MW. Ces installations sont renforces par la rnovation des centrales charbon de Mohammadia et de Jerada, de 6 turbines gaz et 26 usines hydrolectriques, soit au total prs de 2350 MW concerns par cette rhabilitation. Ainsi de 2008 2012, 1756 MW de puissance nouvelle et diffrents ramnagements lectriques auront t installs avec un investissement de plus de 24 milliards de dirhams. Par ailleurs, dans le domaine de la matrise de la demande, plusieurs mesures defficacit nergtique ont t mises en application, notamment, linstallation des Lampes Basse Consommation (LBC), lintroduction, depuis 2008, de lhoraire dt GMT+1, la mise en place de tarifications incitatives pour diffrentes catgories de consommateurs, la conclusion de conventions et de contrats-programmes signs avec diffrents dpartements ministriels et oprateurs pour mettre en uvre les dispositifs defficacit nergtique. Entre 2013 et 2015, de nouvelles grandes centrales seront mises en production, il sagit en loccurrence des centrales lectriques charbon propre comprenant lextension de la centrale de Jorf Lasfar de 2X330 MW, de la centrale solaire dOuarzazate de 500 MW qui constitue le premier projet raliser dans le cadre du Programme Solaire Marocain, de diffrents parcs oliens de 570 MW
NOTE DE PRESENTATION 41
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
entrant dans le Programme Eolien Marocain dont 420 MW seront mis en place par le secteur priv et de deux projets hydrolectriques, le complexe dEl Menzel-Mdez et la STEP d Abdelmoumen totalisant 550 MW de puissance. Ces projets seront accompagns par le renforcement du rseau de transport lectrique avec ladjonction dune troisime liaison de 700 MW linterconnexion avec lEspagne et la ralisation de 5500 km de lignes nouvelles de transport. Ainsi, fin 2015, une puissance nouvelle de 3640 MW sera installe exigeant un investissement de prs de 73 milliards de dirhams. II.2.1.3.5. Industrie : Pacte Industrielle (PNEI) National dEmergence
A la lumire des avances enregistres au titre du Plan Emergence, un nouveau pas a t franchi sur la voie de la consolidation de la position du pays en tant que plateforme de production et dexportation avec la signature, le 13 Fvrier 2009, au cours dune crmonie prside par Sa Majest le Roi, du Pacte National dEmergence Industrielle portant sur la priode 2009-2015. Ce pacte, qui consacre lapprofondissement de la dmarche de partenariat entre le secteur public et priv pour une meilleure coordination de leurs interventions respectives dans un souci defficacit et de transparence, a t sign par dune part lEtat, reprsent par les Ministres concerns et dautre part, le secteur priv, reprsent par la CGEM et le GPBM. II.2.1.3.5.1. Objectifs du Pacte Au-del de la crise actuelle, le pacte vise positionner le Maroc sur une vision long terme dans les domaines de lindustrie et des services en mettant laccent sur les activits haute valeur ajoute et sur les nouvelles technologies. Par ailleurs, les objectifs assigns la nouvelle stratgie, qui impliquent la ralisation de plus de 50 milliards de dirhams dinvestissements, consistent dans la rduction du chmage par la cration de 220 000 postes de travail lhorizon 2015, lamlioration de lquilibre de la balance commerciale par le relvement du chiffre daffaires des exportations de 95 milliards de dirhams et laugmentation de la valeur ajoute du secteur industriel de 50 milliards de dirhams. Lenveloppe consacre au PNEI se chiffre 12,4 milliards de dirhams dont 34% consacrs la formation et la mise niveau des ressources humaines et 24 % lincitation linvestissement. II.2.1.3.5.2. Mise en uvre Afin de donner le maximum de visibilit pour la mise en uvre du Pacte, il a t procd la dfinition, pour chaque secteur, des incitations spcifiques mettre en place, des besoins de formation, de la nature des Plateformes Industrielles Intgres (P2I) raliser et de la liste des entreprises trangres relevant du domaine concern dmarcher en priorit en vue de fonder avec elles des relations de partenariat.
NOTE DE PRESENTATION
42
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Ainsi, le Pacte est dclin en 111 mesures engageant aussi bien lEtat que le secteur priv articules autour de trois axes savoir le dveloppement des Mtiers Mondiaux du Maroc (MMM), le renforcement des capacits comptitives des entreprises et lapplication des rgles de bonne gouvernance. Afin de garantir la mise en uvre du Pacte, les initiatives et mesures du Pacte ont t dclines en plans dactions oprationnels avec des objectifs prcis en terme de dlais, de partenaires impliquer, de livrables produire, de moyens mobiliser et de dmarche adopter. Ces plans dactions raliss avec une frquence annuelle, ainsi que lavancement de leur mise en uvre tant rgulirement prsents et valids au niveau du Comit de pilotage et des diffrents Comits de suivi. Par ailleurs, pour la premire fois pour le secteur de lIndustrie, des assises ont t organises en 2010 et 2011, sous la prsidence effective de Sa Majest le Roi, permettant aux signataires de rendre compte en prsentant un tat davancement des ralisations du Pacte Emergence. II.2.1.3.6. Maroc Numeric 2013 La stratgie Maroc Numeric 2013 vise positionner le Maroc parmi les pays mergents dynamiques dans les Technologies de lInformation (TI), en tant que hub technologique rgional et de faire du secteur des TI un vecteur du dveloppement humain, une source de productivit et de valeur ajoute pour les autres secteurs conomiques et pour lAdministration Publique et un des piliers de lconomie nationale. Ladite stratgie sarticule autour des quatre axes suivants : Transformation sociale : visant rendre accessible aux citoyens lInternet Haut Dbit et favoriser laccs aux changes et la connaissance travers : le ciblage dun taux de connexion des foyers lInternet de 33% contre 10% en 2008. Ainsi, le programme Pacte visant la gnralisation de laccs aux tlcommunications 9263 localits dpourvues de moyens de tlcommunications a connu un taux de ralisation de 78% ; lquipement de tous les tablissements scolaires publics : en 2011, 3000 tablissements scolaires sont connects internet et 107 centres rgionaux de formation sont quips en ressources multimdia ; la cration de 400 centres daccs communautaires (CAC) publics dans des zones enclaves et dfavorises : Les ralisations en 2011 slvent 100 CAC ; lquipement de tous les ingnieurs ou assimils en sciences et Technologies de lInformation (TI) en ordinateurs personnels avec connexion Internet : 26.260 tudiants, dont 2.120 doctorants, ont bnfici de laccs internet haut dbit et/ou ordinateur portable ;
NOTE DE PRESENTATION
43
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Instauration des services publics orients usagers : en mettant en uvre un programme e-gouvernement pour rapprocher ladministration des besoins des usagers en terme defficacit. Lambition est de combler le retard du Maroc en btissant une administration efficace au service de lusager et promotrice des nouvelles technologies. Lobjectif tant, comme soulign prcdemment, de porter lindice ONU e-gouvernement de 0,2 en 2008 0,8 en 2013, de mettre en place 89 services e-gouvernement (contre 16 en 2008) ainsi que de gnraliser lutilisation des services transactionnels pour toutes les entreprises ralisant un chiffre daffaires de plus de 20 millions de dirhams. A noter que 28 services publics orients vers les citoyens sont dores et dj oprationnels. Informatisation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) pour accrotre leur productivit et amliorer leur comptitivit. Le but est de gnrer des gains de productivit de lordre de 20 milliards de dirhams du PIB additionnel indirect et de 7 milliards de dirhams du PIB additionnel direct ainsi que lquipement en solutions mtier de 3.000 PME des secteurs fort potentiel. A ce jour, 135 entreprises ont bnfici de loffre Moussanada TI ; Dveloppement de lindustrie des TI : il sagit de dvelopper la filire locale des TI en favorisant lmergence de ples dexcellence fort potentiel lexport. Lambition est de crer 58.000 emplois, de gnrer 7 Milliards de dirhams du PIB additionnel direct et de porter le CA de la filire offshoring TI 6 milliards de dirhams en 2013 (contre 0,8 Milliards de dirhams en 2008). Les ralisations, ce titre, ont concern la cration des technopoles de Rabat et dOujda ainsi que ltude pour la cration dune technopole Agadir. Le Plan Maroc Numeric 2013 comprend galement deux actions daccompagnement, savoir : le dveloppement des comptences humaines pour rpondre aux besoins du secteur et ce, travers la formation de 33.000 profils en TI en partenariat avec le secteur priv ; la mise en uvre des conditions de la confiance numrique, notamment la mise en place des structures organisationnelles appropries et la promulgation des lois lies la scurisation des rseaux et systmes dinformation, la protection des consommateurs et la protection des donnes personnelles. Il convient de noter ladoption de la loi 09-08 relative la protection des personnes physiques lgard des traitements des donnes caractre personnel et ladoption des textes dapplication de la loi 53-05 relative lchange lectronique des donnes juridiques fixant les conditions de cryptographie et de la certification lectronique.
NOTE DE PRESENTATION
44
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
II.2.1.3.7. RAWAJ vision 2020 II.2.1.3.7.1. Objectifs de la stratgie Le plan RAWAJ vise amliorer la comptitivit des commerants, faire merger de nouveaux modles de commerce et assurer une offre en produits et en espaces commerciaux rpondant aux besoins des consommateurs. Pour ce faire, il contribue au financement de projets lis la modernisation du commerce de proximit, laccompagnement des champions nationaux, aux zones dactivits commerciales et aux tudes et plans de dveloppement rgionaux avec pour objectif, lhorizon 2012, de porter le PIB du commerce de 68,5 milliards de dirhams en 2007 98 milliards de dirhams et de crer plus de 200.000 emplois additionnels pour un cot valu, dans le cadre de la convention signe le 11 juin 2008, 900 MDH pour la priode 2008-2012 dont 100 MDH au titre de 2008 et 200 MDH par an pour la priode 2009-2012. II.2.1.3.7.2. Ralisations Les principales ralisations, par programme, se prsentent comme suit : II.2.1.3.7.2.1. Modernisation du commerce de proximit Pour rappel, ce programme ambitionne, travers loctroi dun appui financier pouvant atteindre 37.000 dirhams par commerant, dinciter les commerants moderniser leurs mthodes de gestion et mettre niveau leurs locaux commerciaux, de faon amliorer la comptitivit et la rentabilit des commerces de proximit et de dvelopper leurs activits au regard dun niveau de standard qualit mme de rpondre aux attentes et exigences des consommateurs. A fin 2011, les points de vente moderniss slvent 7.900, ce qui reprsente 31% de lobjectif fix pour 2012 sachant que 5.030 points de vente ont t moderniss durant le premier semestre 2011 contre 2.870 points de vente moderniss entre 2008-2010. Compte tenu de la forte augmentation de la cadence mensuelle moyenne de modernisation qui est passe de 130 points de vente moderniss en 2010 833 en 2011, lambition affiche par le programme est dassurer, au titre de 2012, la modernisation de 12.500 commerces de proximit contre 10.000 escompts en 2011. Par ailleurs, dans le cadre de la composante tude du plan RAWAJ, il a t procd au lancement dune tude visant tablir ltat des lieux du commerce ambulant au Maroc, valuer les diffrentes expriences entreprises au niveau national portant sur lorganisation de cette activit et dfinir une nouvelle approche permettant la structuration et la mise niveau de ce secteur non organis qui compterait plus de 441.000 units de commerce ambulant dont 238.000 exerant en milieu urbain.
NOTE DE PRESENTATION
45
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
II.2.1.3.7.2.2. Dveloppement de la moyenne et grande distribution et de la franchise Le secteur de la moyenne et grande distribution a connu une croissance soutenue au cours des dernires annes. Leur nombre devrait passer de 22 en 2009 38 en 2012 pour atteindre 300 lhorizon 2020 avec plus de 2 000 points de vente dont une quarantaine de rseaux marocains. Par ailleurs, le secteur de la franchise a connu une forte croissance au cours des quatre dernires annes et, paralllement, des enseignes marocaines ont connu des dveloppements remarquables au-del des frontires nationales. Dans le cadre du programme prioritaire 2008-2012, le nombre des rseaux devrait passer de 500 en 2009 650 en 2012, le nombre des points de vente de 3 500 5 500 et le nombre des crations demplois de 23 000 38 500. Pour ce qui est des marchs de gros, il a t procd au lancement dune tude en vue de llaboration dun Schma National dOrientation des marchs de gros de fruits et lgumes pour la reconfiguration du circuit de distribution de ces produits et la rduction du nombre dintermdiaires. II.2.1.3.7.2.3. Amnagement commerciale de zones dactivit
Dans le cadre de ce programme, il a t procd : la mise en place des zones daccueil de nouvelle gnration destines accueillir des activits commerciales susceptibles de rpondre aux besoins de consommation de masse et offrant des possibilits dachat, de divertissement et de dtente. A ce titre, douze zones dactivits commerciales ont t identifies sur le territoire national ncessitant un investissement de 2 milliards de dirhams et permettront de crer plus de 5.000 emplois ; la ralisation du masterplan des zones dactivits commerciales dfinissant la cartographie des rgions pouvant abriter ces zones. A lhorizon 2015, sept de ces zones seront ralises sur une superficie de 175.000 m2 Casablanca, Oujda, Rabat, Tanger, Fs, Agadir et Marrakech. Dans une seconde tape, cinq autres zones seront cres, lhorizon 2020, sur une superficie de 88.000 m2 Kenitra, Ttouan, Mekns, Safi et Layoune ; la ralisation de trois schmas rgionaux de dveloppement du commerce et de distribution au niveau de lOriental, de Chaouia Ourdigha et de Ttouan. II.2.1.3.7.2.4. Accompagnement nationaux des champions
Pour rappel, dans le cadre de cette composante, le fonds RAWAJ contribue la mobilisation des expertises ncessaires au dveloppement des rseaux de commerce, hauteur de 4 millions de dirhams dans la limite de 70% du cot de ces expertises.
NOTE DE PRESENTATION
46
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Cet accompagnement favorise lmergence doprateurs champions nationaux et des concepts commerciaux marocains lchelle nationale et internationale et ce, via lappui technique du Fonds RAWAJ aux entreprises marocaines. A ce jour, 16 entreprises marocaines sont accompagnes pour dvelopper leurs rseaux commerciaux aux niveaux national et international, soit 64% du total des entreprises accompagner dici 2012 avec 145 ouvertures ltranger dans plus de 40 pays viss notamment, en France, en Espagne, en Arabie Saoudite, en Grce et en Algrie. II.2.1.3.8. Maroc Export Plus Dans lobjectif de dvelopper une offre nationale exportable comptitive permettant un meilleur positionnement sur les marchs cibles, le Gouvernement poursuivra la mise en uvre de la stratgie Maroc export plus, formalise dans le cadre dun contrat programme 2011-2015. II.2.1.3.8.1. Consistance de la stratgie Cette stratgie vise le dveloppement et la promotion des exportations, la rgulation des changes et la facilitation des procdures, llaboration dun nouveau cadre rglementaire rgissant le systme de dfense commerciale, la consolidation et la diversification des relations commerciales et la rorganisation du cadre institutionnel. Elle ambitionne de doubler les exportations des biens et services, hors phosphate et tourisme, lhorizon 2015 et de les tripler, lhorizon 2018, pour stablir prs de 327 milliards de dirhams, ce qui permettra de gnrer un PIB additionnel de prs de 85 milliards de dirhams lhorizon 2018 et la cration de 380.000 emplois additionnels. Cette stratgie dfinit un cadre gnral de dveloppement des exportations nationales de biens et de services, lexception de biens et services dont les exportations relvent directement de la responsabilit spcifique d'un ministre ou d'un organisme ddi, notamment les phosphates et leurs drivs, le tourisme, le transport et les services de voyage. Elle vise accompagner le dveloppement dune offre nationale exportable comptitive pour un meilleur positionnement sur les marchs cibles et cherche inciter davantage dentreprises sinscrire dans une dmarche de dveloppement par lexportation et amliorer lefficacit des entreprises exportatrices dans la commercialisation de leur production sur les marchs internationaux. A ce titre, Maroc Export Plus cible progressivement un ensemble de marchs prioritaires, lesquels devraient recevoir l'essentiel des produits exportables et concentrer 60 65% des efforts promotionnels, le reste tant rserv aux marchs adjacents qui sont des marchs ayant une proximit gographique et/ou culturelle avec les marchs stratgiques.
NOTE DE PRESENTATION
47
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Pour focaliser les ressources nationales sur le primtre le plus adapt au dveloppement rapide et forte valeur ajoute des exportations, cette stratgie a cibl, sur la base de la comptitivit de leur offre exportable et de leur impact potentiel sur laccroissement des exportations, les mtiers mondiaux du Maroc (Textile & cuir, industries agro-alimentaires, transformation des produits de la mer, industries lectriques et lectroniques, automobile, aronautique, offshoring et les TIC), les produits agricoles dvelopps dans le cadre du Plan Maroc Vert, le mobilier de maison, certains produits chimiques et pharmaceutiques et les services BTP. II.2.1.3.8.2. Ralisations La mise en uvre de la stratgie Maroc Export Plus, qui requiert la mobilisation dune enveloppe de plus de trois milliards de dirhams sur la priode 2011-2015, dans le cadre dun partenariat entre lEtat et les oprateurs conomiques, a t entame par la ralisation des principales actions suivantes : En matire de promotion des exportations, il a t procd : la mise en place du dispositif affrent au programme daudit lexport dont lobjectif majeur est daider les entreprises bnficiaires prendre conscience de leurs forces lexportation et de pallier leurs faiblesses en utilisant bon escient les moyens dappui mis leur disposition. Ce dispositif, mis en place dans le cadre du programme de renforcement des capacits commerciales des pays arabes en partenariat avec le Centre du Commerce International, vise la ralisation entre 2011 et 2015, de 1000 audits lexport au profit des entreprises exportatrices marocaines, tous secteurs confondus. Le cot de ces audits sera pris en charge hauteur de 80 % par lEtat avec un plafond de 20.000 dirhams, travers le Fonds accompagnement lexport cr cet effet ; la finalisation de ltude sur lamlioration de lenvironnement juridique et incitatif des consortiums dexportation au Maroc ayant notamment pour objet la dfinition des modalits oprationnelles visant favoriser la constitution et le dveloppement de consortiums lexport, lobjectif tant de mettre en place un dispositif renforc daccompagnement permettant lEtat, dans un cadre conventionnel, de soutenir la cration par les entreprises de consortiums dexportation ; la poursuite des travaux affrents la mise en place du dispositif relatif aux contrats de croissance l'export dans lobjectif dinciter les entreprises acclrer le dveloppement de leurs exportations, renforcer leur positionnement sur les marchs cibles moyennant un accompagnement et un soutien financier de lEtat durant trois annes sur une base conventionnelle dfinissant des objectifs clairs lexport, la ralisation d'un plan daction et d'un plan d'affaires l'export par les entreprises bnficiaires retenues aprs appel projets. Ce programme ambitionne daccompagner 375 entreprises sur les cinq prochaines annes dans leur dmarche de promotion lexport ; au parachvement du dispositif permettant, travers lOffice des Foires et Expositions de Casablanca, linternationalisation des salons professionnels
NOTE DE PRESENTATION 48
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
des secteurs de loffshoring, des mdicaments, des produits du terroir et llectricit de lautomobile moyennant un appui financier de lEtat pour prendre en charge les cots dorganisation de ces salons ; lintensification des activits de dmarchage direct des donneurs dordre travers des missions B to B, des incoming missions et des rencontres daffaires et le renforcement des actions de communication linternational; lorganisation de la 4me dition de la caravane de lexport en Afrique du 19 au 25 juin 2011. Cette tourne a concern le Ghana, le Bnin, le Togo et lAngola. La dlgation marocaine comprenait 90 responsables dentreprises la recherche de partenariats commerciaux et dinvestissements dans le continent. Pour rappel, les trois premires ditions de cette caravane ont couvert respectivement le Sngal, la Cte dIvoire et le Mali en dcembre 2009, le Cameroun, le Gabon et la Guine Equatoriale en mai 2010 et enfin la Mauritanie, la Gambie, le Burkina Faso et la Rpublique Dmocratique du Congo en dcembre 2010 ; et la finalisation du traitement des dossiers de remboursements affrents au dispositif du plan de soutien la promotion commerciale, mis en place par le Gouvernement, en fvrier 2009, pour faire face la crise conomique mondiale. Ce dispositif a bnfici plus de 500 entreprises exportatrices avec une contribution de lEtat de lordre de 50 millions de dirhams ; En matire de refonte du cadre rglementaire du commerce extrieur, le dpartement a poursuivi le parachvement du cadre lgislatif et rglementaire avec ladoption de la loi n 15-09 du 30 juin 2011 relative aux mesures de dfense commerciale et le lancement du chantier de la refonte de la loi n13-89 relative au commerce extrieur et de ses textes dapplication. En matire de consolidation et de diversification des relations commerciales, on note : le lancement dune tude sur lvaluation du potentiel du march africain et la mise en uvre dune stratgie de pntration de ce march pour les produits marocains. Cette tude a notamment pour objet de diagnostiquer et danalyser le potentiel du march africain afin didentifier les marchs les plus prometteurs en termes de potentiel de ventes et d'accessibilit et sur lesquels le Maroc concentrera ses efforts de prospection et de promotion ; et la poursuite de la mise en uvre de lensemble des accords de libre change conclus en multipliant les actions de promotion et de sensibilisation des exportateurs tels que le suivi de la mise en uvre de lAccord de Libre Echange entre le Maroc et les Etats-Unis, la Turquie et autres partenaires commerciaux ; En matire de facilitation des changes, il a t procd : au lancement dune tude de faisabilit et de mise en place du guichet unique des formalits du commerce extrieur visant la ralisation et le
NOTE DE PRESENTATION 49
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
dveloppement dune plateforme technique dhbergement informatique destine la dmatrialisation des titres dimportation et dexportation. Lobjectif de ce projet est la simplification des procdures en vue de la rduction du cot des dlais des oprations du commerce extrieur afin damliorer la comptitivit du Maroc sur les marchs trangers; la ralisation et la mise jour du "Guide des Exportateurs" et du "Guide aux clients importateurs". Lobjectif tant de mettre, la disposition des entreprises exportatrices, un recueil des meilleures pratiques et des tapes ncessaires en matire dexportation et doffrir aux clients importateurs un document dfinissant les tapes suivre et les cueils viter afin de russir des oprations dimportations du march du Maroc. En matire de renforcement des outils de veille et de communication, il a t procd : au dveloppement et la mise en place doutils informatiques et de veille pour le traitement des chiffres et llaboration des statistiques et de donnes sur le commerce extrieur et ce, pour la simplification de laccs linformation et daide la dcision ; et la ralisation dun portail ddi au commerce extrieur pour permettre dassurer une communication institutionnelle, informationnelle et promotionnelle conforme ses objectifs stratgiques. II.2.1.3.9. Tourisme : vision 2020 La vision 2020 ambitionne de hisser le Maroc parmi les 20 premires destinations touristiques mondiales tout en simposant comme une destination de rfrence en matire de dveloppement durable sur le pourtour mditerranen. A cette fin, cette nouvelle stratgie tout en confortant les acquis de la vision 2010 pour construire une offre touristique solide, diversifie et quilibre, a pour objectif essentiel de repositionner la destination Maroc selon un modle touristique unique, combinant une croissance soutenue avec une gestion responsable de lenvironnement et le respect de notre authenticit socioculturelle. Ainsi, il sagit de doubler la taille du secteur travers la multiplication par deux de la capacit dhbergement touristique avec la cration de 200.000 lits additionnels, le doublement du nombre darrives aux frontires pour les porter 20 millions de touristes, le triplement du nombre de voyages domestiques, la cration de 470.000 nouveaux emplois directs sur lensemble du territoire national, pour aboutir la fin de la dcennie prs dun million demplois dans le secteur, laccroissement des recettes touristiques hauteur de 140 milliards de dirhams en 2020, soit une somme cumule sur la dcennie de 1.000 milliards de dirhams et enfin, le relvement de deux points de la part du PIB touristique dans le PIB national pour atteindre prs de 150 milliards de dirhams contre 55,9 milliards de dirhams en 2009. A cet effet, la mise en uvre de cette vision 2020 sarticule autour des trois axes fondateurs majeurs suivants:
NOTE DE PRESENTATION
50
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Une politique damnagement territorial de loffre touristique, garante de la diffusion des bnfices du tourisme et du dveloppement socio-conomique de toutes nos rgions ; Une nouvelle structure de gouvernance, mme dapporter la dynamique et le leadership ncessaires travers la mise en place dun dispositif efficace de planification, de coordination et de pilotage simultan de tous les paramtres de lquation touristique, de faon garantir lutilisation rationnelle et optimale des ressources et scuriser lacte dinvestir dans une industrie trs capitalistique ; Une dmarche intgre de dveloppement durable, respectueuse de notre environnement et de notre authenticit socioculturelle prenant en compte lensemble des contraintes environnementales et sociales et intgrant un programme spcifique mettant en exergue des produits vitrines du dveloppement touristique durable. La mise en uvre efficiente de cette vision requiert un dispositif stratgique daccompagnement articul autour des six plans transverses suivants et mme de rpondre aux dfis identifis, lvolution de la demande internationale et lenvironnement concurrentiel : (i) une stratgie Produit constitue de programmes structurants visant diversifier le portefeuille produits, (ii) une stratgie Promotion et commercialisation adapte, (iii) une stratgie intgre en matire de dveloppement et tourisme durable, (iv) une comptitivit du tissu dacteurs, (v) une stratgie ressources humaines et formation dexcellence et (vi) des mesures de soutien pour une dynamique dinvestissement soutenue et durable notamment par la cration du Fonds Marocain de Dveloppement Touristique. II.2.1.3.10. Artisanat : Vision 2015 II.2.1.3.10.1. Objectifs La Vision 2015 pour lArtisanat, matrialise par le contrat programme sign le 20 fvrier 2007, se propose de mettre en place les conditions ncessaires pour assurer un dveloppement harmonieux du secteur dans le cadre dune approche volontariste. Ledit Contrat-programme sign sous la Prsidence de Sa Majest le Roi entre le Gouvernement et les reprsentants du secteur priv concerns vise la ralisation de trois objectifs principaux, savoir : lencouragement de lmergence dune vingtaine doprateurs de rfrence, le soutien la cration de quelques 300 PME structures pour lamlioration du tissu du secteur et lappui efficace aux mono artisans urbains et ruraux. Les objectifs chiffrs assigns cette stratgie consistent essentiellement (i) la cration de 115 000 emplois additionnels, (ii) la multiplication par dix du chiffre daffaires des exportations formelles pour atteindre 7 milliards de dirhams dexportations en 2015, (iii) laugmentation du chiffre daffaires du secteur pour atteindre 24 milliards de dirhams en 2015 avec une amlioration de loffre des produits artisanaux contenu culturel, de leur distribution et de leur promotion, (iv) lmergence dun tissu dentreprises dynamiques travers la cration de 15 20 acteurs de rfrences, de 200 300 PME et de 15.000 17.000 TPE et (v) la
NOTE DE PRESENTATION 51
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
formation artisanale de 60.000 laurats sur dix ans dont 10.000 laurats au niveau de la formation rsidentielle et 50.000 laurats au niveau de la formation par apprentissage. II.2.1.3.10.2. Plan daction Le plan daction mis en uvre cet effet, dun cot global de 2.800 millions de dirhams, sorganise autour de trois axes principaux : la restructuration des petites et moyennes entreprises artisanales en vue den faire merger des acteurs de rfrence capables de livrer au march des produits de qualit des prix comptitifs. Le nombre des PME devrait passer de 90 actuellement 300 ; le relvement du revenu des mono artisans en largissant leur accs au financement auprs du systme bancaire ou du micro crdit, lamlioration du circuit de commercialisation et lamnagement des espaces de vente appropris et lamlioration de leurs conditions de vie par la mise en place dune couverture mdicale en leur faveur ; la mise en uvre de mesures caractre horizontal destines favoriser la modernisation et la comptitivit du secteur, notamment la certification, la normalisation et la labellisation des produits afin den garantir la qualit et la conformit aux exigences du march, la promotion des activits de recherche et dveloppement et de design afin de rehausser la valeur esthtique et commerciale des produits, le renforcement des actions de formation et la mise niveau du cadre institutionnel avec en particulier la rvision des statuts de la Maison de lArtisan et des Chambres Professionnelles artisanales. II.2.1.3.10.3. Ralisations Au vu des objectifs assigns la stratgie, plusieurs chantiers ont enregistr des avances trs importantes illustres travers les chiffres et indicateurs ci-aprs : Le chiffre daffaires global du secteur est pass de 12,2 milliards de dirhams en 2008 prs de 16 milliards de dirhams en 2010, soit un taux de croissance annuel moyen dpassant les 14%. Trois filires participent hauteur de 50% dans la constitution de ce chiffre daffaires savoir le bois (21%), les vtements (18%) et la bijouterie (11%) ; En matire demploi, le secteur comptait plus de 371.000 personnes en 2010, soit une volution de 4,6% en milieu urbain et prs de 4% en milieu rural par rapport 2009. Prs de 70% de lemploi du secteur se concentre dans le milieu urbain. Les cinq principaux ples dartisanat (Casablanca, Fs, Marrakech, Tanger-Ttouan, et Rabat-Sal) emploient 60% des effectifs en milieu urbain et 32% des effectifs sont employs en milieu rural, soit 118.500 mono artisans ; lmergence de sept acteurs de rfrence et la cration de 600 petites et moyennes entreprises entre 2007 et 2010 ;
NOTE DE PRESENTATION
52
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
llaboration en cours de seize plans de dveloppement rgionaux de lartisanat (PDRA) sachant que lobjectif initial retenu tait de six. Sur ces PDRA, cinq sont oprationnels et les onze restants sont en cours de validation ou en phase dtude avance ; la mise en place de 124 normes par le comit technique des produits artisanaux dont 52 normes relatives au cuir, 37 au textile, 21 aux mtaux, 7 la poterie, 3 aux bougies et une la coiffure ; le dveloppement, en matire de design, de quinze nouvelles collections mises la disposition des artisans; lintensification des efforts en matire de dveloppement et de rhabilitation des infrastructures de production et de commercialisation travers : la cration de dix villages dartisans et la programmation de treize villages et la ralisation en cours de treize autres ; la cration de deux nouveaux ensembles dartisanat, lachvement de la mise niveau de 17 autres et lamnagement en cours de 16 ensembles supplmentaires ; le dveloppement de la formation travers : laugmentation de la capacit des centres de formation par apprentissage rsultant de la cration de cinq nouveaux centres, la mise niveau de 23 centres et de lextension de cinq centres ce qui a permis de porter le nombre de laurats 2.346 dont 1.050 filles ; laccroissement du nombre dartisans bnficiaires de la formation continue, de 716 en 2009 839 en 2010. II.2.1.3.11. Stratgie Nationale de Dveloppement de la Logistique 2010-2015 La stratgie nationale de comptitivit logistique prsente devant Sa Majest le Roi le 19 Avril 2010 constitue un accompagnement et un appui aux stratgies sectorielles mises en uvre par le Gouvernement. Elle consiste en la rationalisation et la simplification de la gestion des flux de marchandises par la mise en place dune chane adapte pour le transport, le stockage, lacheminement, la distribution interne et le transfert vers les points dexportation des marchandises et des produits nationaux. Elle se situe dans le prolongement des rformes entreprises dans le secteur des transports et qui ont t marques notamment par la libralisation du transport routier des marchandises et celle du secteur portuaire et la rationalisation du trafic maritime outre les grands chantiers lancs dans le domaine des infrastructures portuaires, routires, autoroutires, ferroviaires et aroportuaires. Ce secteur, qui contribue actuellement au PIB hauteur de 5 %, prsente un potentiel de dveloppement important au niveau de laugmentation de loffre de service et de la rduction des cots et des dlais.
NOTE DE PRESENTATION 53
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Les investissements ncessaires la mise en uvre de la stratgie logistique sont estims 63,2 milliards de dirhams lhorizon 2015 et 116 milliards de dirhams lhorizon 2030, sachant que lEtat prend en charge le cot des infrastructures hors sites des zones, les quipements internes restant la charge des investisseurs. La nouvelle stratgie devrait permettre la cration dune valeur ajoute supplmentaire directe de 3 5 points du PIB, soit 20 milliards de dirhams et 20 autres milliards de dirhams de valeur ajoute indirecte. Elle devrait galement permettre de gnrer 36 000 emplois lhorizon 2015 et 96 000 emplois lhorizon 2030, outre la rduction des nuisances occasionnes par les missions de gaz effets de serre et par la congestion des villes et des routes. La nouvelle stratgie devrait ainsi contribuer au renforcement de la comptitivit de lconomie nationale et au confortement de la position du Maroc en tant que ple dattraction des investissements II.2.1.3.12. Stratgie Halieutis La Stratgie Halieutis adopte lors dune crmonie prside par Sa Majest le Roi le 29 Septembre 2009 se propose datteindre deux objectifs principaux savoir la prservation des ressources halieutiques et la mise niveau du secteur et le renforcement de sa contribution au dveloppement conomique et social du pays. En termes chiffrs, les objectifs assigns la stratgie lhorizon 2020 se rsument comme suit: Tripler le PIB du secteur pour le porter de 8,3 milliards de dirhams en 2007 prs de 22 milliards de dirhams et ramener la part de linformel dans le chiffre daffaires du secteur de 50 % actuellement 15 % ; multiplier par 2,6 par rapport lanne 2007 les exportations du secteur pour les porter de 1,2 milliards de dollars 3,1 milliards de dollars, relever la part du Maroc dans le march mondial de 3,3 % 5,4 % et occuper la position de leader mondial dans le domaine de la sardine ; porter la production 1,6 million de tonnes et relever la consommation domestique du poisson de lordre de 10 kg actuellement 16 kg par habitant et par an. II.2.1.3.12.1. Mise uvre de la stratgie La mise en uvre de la stratgie se dcline en trois axes majeurs : La prennisation de la ressource assure travers lamlioration de la connaissance scientifique au niveau de linventaire des stocks et de leur volution, la modernisation et ladaptation des efforts de pche pour permettre la reconstitution des stocks et la stabilisation du seuil de rentabilit des navires de pche avec lquipement de la totalit des navires de pche de cales rfrigres et lamlioration des conditions de vie et de travail des pcheurs et le dveloppement de laquaculture. Lamlioration des performances du secteur travers, notamment, le renforcement des infrastructures et des quipements de dbarquement, la mise en place au sein des espaces portuaires de zones ddies la pche
NOTE DE PRESENTATION 54
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
accompagns dune gestion efficace, lamlioration de lattractivit des halles mares, llargissement de la dfinition de la grille dvaluation de la qualit des produits, la structuration et lorganisation du march intrieur autour des marchs de gros et de dtail, lamlioration de laccs des industriels aux matires premires et leur orientation vers les marchs les plus porteurs et la cration de ples de comptitivit travers le Royaume. La mise en place des instruments ncessaires pour assurer le succs de la stratgie, travers linstitution de lOffice National des Pches comme gestionnaire unique de lensemble des ports de pche, le renforcement du cadre institutionnel avec la cration du Comit National des Pches pour la dfinition des politiques mener dans ce domaine, en assurer le suivi et en valuer limpact, la cration de lAgence Nationale pour le Dveloppement de lAquaculture et de lObservatoire de lEmploi du secteur, le renforcement des comptences et de lattractivit des mtiers du secteur par une formation approprie et lamlioration de laccompagnement des pcheurs par la mise niveau de lorganisation et de la reprsentation des professionnels du secteur. II.2.1.3.12.2. Ralisations Au regard de la stratgie ainsi dcline, lanne 2011 a t marque par lacclration de la mise en uvre des diffrentes mesures prconises, notamment : la poursuite du Plan National de Dveloppement du littoral, pour un montant total de 113 millions de dirhams, travers notamment : le parachvement de la ralisation dun foyer de marins Al Hoceima et de lamnagement dune cale de halage dans les points de dbarquements amnags de Sidi Boulfdaile et Rkount ; la poursuite des travaux de construction des points de dbarquements amnags (PDA) au niveau des ports dEl Jadida, dInouaren et doued Laou et du village de pcheurs de Chmaala ; le lancement de la construction et de lquipement dune unit de valorisation des produits de mer dans le PDA de Sidi Boulfdaile ; lachvement des tudes affrentes la construction du village de pcheurs de Beddouzza ; lacclration des efforts de construction et damnagement des dlgations des pches Maritimes, par : lachvement des travaux damnagement et de construction des dlgations des Pches Maritimes de Tanger, dAgadir, dAsilah, de Sidi Ifni et de Layoune ainsi que la ralisation de la construction des sous dlgations des Pches Maritimes de Tarfaya, Tan-Tan, Imessouane, Nador, Ras Kebdana, Mohammedia, Casablanca, Safi et Al Hoceima ; la ralisation de lantenne mdicale et des garderies maritimes Dakhla, Essaouira et Mdiq ;
NOTE DE PRESENTATION 55
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
le renforcement des moyens de sauvetage des vies humaines en mer, via lacquisition dune vedette de sauvetage et lamnagement des aires de pose pour le sauvetage ; la consolidation de la protection de la ressource halieutique et de la recherche scientifique par le biais dactions qui rpondent aux besoins stratgiques de prserver et de valoriser la ressource halieutique et de contribuer la dynamique de dveloppement des zones concernes. Parmi les principales actions entames, il y a lieu de citer : la mise en place du plan plagique qui concerne cinq espces savoir la sardine, la sardinelle, le maquereau, le chinchard et les anchois ; la consolidation des tudes dimpact relatives aux mesures de gestion et de dveloppement de lvaluation des stocks des captures ; la ralisation dun laboratoire de rfrence Tanger et la poursuite de la mise en tat du navire ACHARIF AL IDRISSI de recherche, ainsi que lquipement du navire HASSANI ; le lancement des travaux de construction du Centre Rgional de lINRH Agadir ainsi que le renforcement des moyens dinvestigation et dobservation en mer ; lquipement du Laboratoire de Recherche en Pathologie des Animaux Aquatiques et le renforcement des diffrents laboratoires en quipement scientifique ainsi que lquipement en matriel et mobilier et en appareil audiovisuel de bureau du bloc administratif des laboratoires centraux de Casablanca. laccompagnement de la mise en uvre du contrat performance conclu entre lEtat et lOffice National des Pches prvoyant, pour la priode 2009-2012, un investissement global de lordre de 4 milliards de dirhams financ principalement comme suit : 759 MDH par un investissement propre de lONP, 1,7 milliard de dirhams par lEtat, 891 MDH par le MCC et 407 MDH par lUnion Europenne. Ce programme dinvestissement touchera lorganisation de la commercialisation, le dveloppement du secteur et la modernisation de lentreprise ; le renforcement des comptences et des qualifications des ressources humaines du secteur travers lamlioration des formations professionnelles proposes par les tablissements de formation maritime ; le lancement du programme -IBHAR II- travers la signature de lavenant n1 la convention relative la Mise en uvre du Programme de Mise Niveau et de Modernisation de la pche Ctire et Artisanale. Ce nouveau programme, portant sur un montant de 5 milliards de dirhams, permettra de remdier aux multiples contraintes qui psent sur les diffrents maillons de la chane de valeur du secteur halieutique, auxquelles se heurtait le programme IBHAR lanc en 2008. Ce nouveau programme ambitionne, pour la priode 2011-2014, de :
NOTE DE PRESENTATION 56
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
quiper prs de 10.600 barques de pche artisanale en installations de stockage, de conservation, de communication et de motorisation hors bord ; pourvoir 1.270 navires en matriels de prservation et de valorisation de la qualit des produits ainsi que lamlioration des conditions dhabitabilit, de vie et de travail bord de ces navires ; moderniser la flotte ctire travers le remplacement de 389 navires vtustes par des units de nouvelle gnration construites en bois, en acier ou en polyester. la promotion de la durabilit des ressources halieutiques, travers la signature de lavenant n1 la convention relative la mise en uvre du plan daction pour labandon des filets maillants drivants, sinscrivant dans le cadre des orientations de la commission internationale pour la conservation des Thonids de lAtlantique tendant, dune part, interdire, compter du 1er janvier 2012, lutilisation desdits filets pour le Maroc et ,dautre part, assurer la prservation de la biodiversit en mer en vue de contribuer lquilibre biologique des ressources halieutiques et leur durabilit. Le cot de ce plan daction slve 256 millions de dirhams ; lamlioration des conditions de repeuplement des stocks de poissons via la conclusion dun avenant la convention initiale relative la ralisation des rcifs artificiels dans les baies de Martil et dAgadir pour un cot de 75 millions de dirhams. Ce projet a pour principaux objectifs daugmenter la production et doper les revenus des pcheurs dans les zones concernes. Il prsente galement, une dimension environnementale indniable, via la prservation des pcheries artisanales contre le chalutage illicite et la promotion dune gestion durable des ressources de la pche travers l'augmentation de la production des espces dmersales et la lutte contre la dgradation des milieux marins prcits ; linsertion des jeunes chercheurs demploi dans les mtiers de la pche maritime au niveau des rgions Sud du Royaume travers la signature dune convention visant linsertion de 250 jeunes chercheurs demploi dans le mtier de la pche, pour un cot global de 34,4 millions de dirhams, travers : la ralisation de formations thoriques et pratiques adaptes au mtier de la pche artisanale ; lacquisition de 250 barques quipes et loctroi de 250 licences de pche artisanale permettant lexploitation des espces halieutiques autres que le poulpe ; la cration de coopratives davitaillement des barques et commercialisation des produits de la pche. la prservation de la qualit des produits de la mer, par la poursuite du programme de mise en place de deux millions de contenants normaliss pour un cot de 163 millions de dirhams. Ce programme, vise galement
NOTE DE PRESENTATION
57
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
l'amlioration de la comptitivit et de la performance du secteur, ainsi que la protection du consommateur ; la consolidation du systme de contrle de lexploitation de la ressource halieutique par la mise en place du systme de positionnement et de suivi continu des navires de pche par satellites, pour un montant de 82 millions de dirhams. Ce projet cible l'quipement de l'ensemble des flottes ctire et hauturire en balise de suivi par satellite. Il vise, ainsi, la prservation des ressources halieutiques et de l'cosystme marin, et le renforcement de la scurit des pcheurs notamment grce l'optimisation du temps d'intervention lors des oprations de sauvetage et de contrle. Ce systme permettra galement la surveillance des navires trangers oprant dans le cadre des accords de pche et contribuera de manire gnrale assurer le suivi des navires en temps rel ; La promotion de la valorisation des produits de la mer par la ralisation dun parc industriel de transformation des produits de la mer Parc HALIOPOLIS dAgadir, moyennant un investissement de 656 millions de dirhams. Ce projet permettra la cration de 20.000 nouveaux emplois et la ralisation des investissements dans le domaine de la valorisation des produits de la mer hauteur de 6 milliards de dirhams. Actuellement le taux de commercialisation de la superficie rserve la transformation a atteint 96% ; le dveloppement de laquaculture travers le dmarrage de lactivit de lAgence Nationale de Dveloppement de lAquaculture suite sa cration en vertu de la loi 52.90. Cette agence a pour principales missions de : faire le suivi de la mise en uvre de la stratgie nationale dans le domaine de l'aquaculture marine au Maroc et d'valuer son efficacit ; proposer des programmes d'action conformment aux orientations stratgiques nationales dans le secteur de la pche ainsi que le cadre rglementaire et lgislatif y affrent ; promouvoir les activits de laquaculture et dvelopper les changes des produits aquacoles tant au niveau du march intrieur quau niveau des exportations ; la promotion de la communication autour du secteur de la pche, par lorganisation, sous le Haut Patronage de Sa Majest le Roi Mohammed VI, de la 1re dition du Salon de la Pche Maritime Halieutis , ddi aux mtiers de la pche maritime, de laquaculture et de la valorisation des produits de la mer, du 26 au 29 janvier 2011 Agadir. Ce salon a constitu une plateforme dchange et de rencontre entre les acteurs du secteur halieutique et un espace riche en opportunits daffaires pour les entreprises marocaines et trangres ainsi quune vitrine reprsentative du potentiel du secteur halieutique marocain ; le renforcement de laction sociale du Dpartement de la pche par le lancement de lopration de mise en place dune couverture sociale au profit de 155.000 artisans pcheurs et leurs familles travers la mise en uvre
NOTE DE PRESENTATION 58
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
dune exprience pilote au niveau du village de pcheurs de Souiria Kdima au profit de 100 artisans pcheurs au niveau de cette zone ; loprationnalisation des villages de pcheurs construits au niveau de la zone sud du Royaume, travers la conclusion dune convention cadre entre lEtat et lOffice National des Pches visant la gestion par cet office, durant la priode 2011-2015, des zones de pches au niveau de dix villages de pcheurs pour un cot de 90,6 millions de dirhams. II.2.2. Le rtablissement des quilibres macro-conomiques La stabilit du cadre macroconomique, constitue une condition essentielle dune croissance conomique durable. Elle est tributaire, en grande partie, de la matrise des finances publiques. Aussi, le Gouvernement sest-il fix comme objectif le retour progressif un dficit budgtaire ne dpassant pas les 3% du PIB. A cet effet, les efforts seront dploys pour une meilleure matrise des dpenses et loptimisation des recettes. II.2.2.1. Matrise des dpenses La matrise des dpenses publiques est recherche travers la rationalisation des dpenses et lamlioration de leur efficacit travers la rforme de la loi organique relative la loi de finances. II.2.2.1.1. Rationalisation des dpenses II.2.2.1.1.1. Dpenses de personnel La matrise de lvolution de la masse salariale constitue un facteur essentiel pour la matrise du dficit budgtaire et la consolidation de lquilibre des finances publiques dans leur ensemble. Une attention particulire est accorde dans ce cadre la matrise de lvolution des effectifs et de la part de la masse salariale dans le PIB dont le ratio est pass de 11,7% en 2005 10,9% en 2011. Dans ce contexte, les mesures daccompagnement visant la matrise de lvolution des effectifs seront poursuivies. Il sagit, notamment, de: 1. la limitation des crations de nouveaux postes budgtaires aux besoins incompressibles des secteurs prioritaires en tenant compte des rsultats du dialogue social; 2. la suppression, pour chaque anne budgtaire, des postes vacants non utiliss au 30 juin de lanne qui suit celle de la loi de finances concerne, qui nont pas fait lobjet dactes viss par les services de la Trsorerie Gnrale du Royaume; et 3. lencouragement du redploiement du personnel pour faire face au dficit en effectifs dans certains services publics sur les plans sectoriel ou gographique.
NOTE DE PRESENTATION
59
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
II.2.2.1.1.2. Dpenses de matriel et dpenses diverses Les dpenses de matriel et les dpenses diverses qui constituent le support principal du train de vie de lAdministration ont galement fait lobjet dune attention particulire en vue den matriser lvolution. Cest ainsi quil a t procd, au cours de lanne 2011, : la ralisation dconomies sur les dpenses de fonctionnement non essentielles; un sursis lachat de vhicules et la construction des btiments administratifs; et la rationalisation des transferts budgtaires aux Etablissements et Entreprises Publics ayant des excdents importants de trsorerie tout en sauvegardant leur capacit dexcution de la dpense. Les efforts de rationalisation seront poursuivis en 2012, travers : la rduction de 50% des dpenses relatives lhbergement, la restauration, aux frais de rception et lorganisation de diverses manifestations officielles ; la mise en place de normes unifies pour les dpenses relatives lacquisition des vhicules, la construction des btiments administratifs et ce en les limitant au strict minimum ncessaire et en rationalisant les dpenses de fonctionnement y affrentes. Le Gouvernement procdera, par ailleurs, une rvision de la politique de la commande publique dans lobjectif de maitriser les cots et rduire les dpenses. Ces diffrentes mesures renforceront les efforts mens pour rduire le train de vie de lEtat et la matrise des dpenses courantes de fonctionnement. Ainsi, la dotation prvue au titre des dpenses de matriel et dpenses diverses dans le projet de loi de finances pour lanne 2012 slve 29,04 milliards de dirhams. II.2.2.1.1.3. Dpenses de compensation Les dpenses de la compensation continuent peser lourdement sur le budget de lEtat. Ainsi, entre 2007 et 2010, leffort budgtaire fourni en matire de compensation des prix sest lev prs de 90 milliards de dirhams. Pour la seule anne 2011, la charge de compensation a atteint prs de 48,8 milliards de dirhams. Ceci dit, le systme de compensation en vigueur fournit un soutien uniforme pour le maintien des prix abstraction faite du revenu des consommateurs. Il en rsulte que les subventions verses bnficient davantage aux riches quaux pauvres. Aussi, est-il prconis d'acclrer la cadence du processus de rforme globale dudit systme pour garantir lquilibre du budget de lEtat et maintenir le rythme dinvestissement public et ce, en sappuyant sur les principes suivants :
NOTE DE PRESENTATION 60
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
linsertion du systme de soutien des prix dans une logique de solidarit nationale, de dveloppement social et de rduction des ingalits ; la fixation dun plafond des charges totales de la compensation un niveau soutenable du PIB; le ciblage des catgories de population concernes par loctroi daides frontales destines favoriser la scolarisation des enfants des couches dfavorises, laccs des femmes enceintes et des enfants aux vaccins et aux soins de base et la gnralisation du Rgime dAssistance Mdicale en vue de contribuer lamlioration des indicateurs de dveloppement humain. II.2.2.1.1.4. Dpenses de la dette Les efforts de modernisation de la gestion de la dette publique se sont poursuivis au cours des quatre dernires annes. Ainsi, les principales actions ralises ou inities au cours de cette priode sarticulent autour des piliers suivants : la redfinition de la stratgie de financement du Trsor base dsormais sur larbitrage entre les sources de financement internes et externes. En effet, lanne 2010 a t caractrise par la leve de 1 milliard deuros sur le march financier international pour financer et ce, pour la premire fois, une partie du dficit budgtaire au lieu de son financement exclusif sur le march intrieur. Cet arbitrage a permis dattnuer la ponction sur les ressources domestiques, viter un effet dviction sur le secteur priv et conforter le niveau des rserves de change; la modernisation de lenvironnement institutionnel et fonctionnel de la gestion de la dette travers la cration du Ple Dette regroupant les structures charges de la dette intrieure, de la dette extrieure et du march financier international en vue de faciliter la mise en uvre de la nouvelle stratgie de financement base sur larbitrage et la mise en place dun cadre de gestion de la dette conforme aux standards internationaux (systme dinformation, procdures de gestion et de dcision, etc.); lintroduction de mesures visant accrotre la liquidit et amliorer la transparence du march des valeurs du Trsor travers notamment la cration de lignes benchmarks avec des gisements consquents pouvant aller jusqu 10 milliards de dirhams. La prvisibilit de la politique dmission a t galement amliore travers lannonce ponctuelle et rgulire du besoin de financement mensuel du Trsor; la poursuite de la gestion active de la dette extrieure et son extension la dette intrieure. Pour la premire fois en 2011, le Trsor a recouru des oprations dchange des bons du Trsor sur le march intrieur pour un montant total de plus de 800 millions de dirhams; et lintroduction dune gestion active de la trsorerie publique dans le but dassurer une gestion optimale des disponibilits du compte courant du Trsor travers notamment le recours des oprations de placement des excdents de trsorerie sur le march montaire.
NOTE DE PRESENTATION 61
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Par ailleurs, et en dpit dun contexte national et international difficile et au moment o les notes de plusieurs pays europens et mergents ont t rtrogrades par les agences de notation, le Maroc a vu son rating rehauss, la catgorie Investment Grade par lagence de notation Standard & Poor's qui a soulign leffort considrable dploy par notre pays, au cours des dix dernires annes, en matire de rduction du poids de la dette publique. En 2012, les actions prvues pour une meilleure matrise de la dette publique se rapportent, notamment, : la rorganisation du Ple Dette dans lobjectif de cration de la future salle des marchs de la Direction du Trsor; la poursuite des actions pour le renforcement de lefficience et de la transparence sur le march des valeurs du Trsor avec comme action phare le dmarrage du projet de mise en place dun systme de cotation lectronique des bons du Trsor; et la poursuite de la gestion active de la dette travers la mise en place de nouvelles oprations de rachat et dchange de bons du Trsor ainsi que les oprations de conversion de la dette en investissements publics pour les projets engags dans le cadre des Accords avec lItalie et lEspagne. Pour ce qui est de la gestion des risques lis au portefeuille de la dette extrieure du Trsor, et afin de faire converger davantage la structure du portefeuille de la dette extrieure vers celle du portefeuille benchmark , dautres oprations de swap pourraient tre mises en place au cours de lanne 2012 si les conditions de march sont favorables. II.2.2.1.2. Rforme de la loi organique relative la loi de finances II.2.2.1.2.1. Objectifs de la rforme de la loi organique relative la loi de finances Le projet de nouvelle loi organique relative la loi de finances, qui sinspire des meilleures pratiques internationales en matire de bonne gouvernance financire en les adaptant aux spcificits de notre pays et dans le respect des dispositions de la nouvelle Constitution, sassigne comme principaux objectifs de : Renforcer la performance de laction publique. En effet, la rforme de la loi organique relative la loi de finances se veut une rforme en profondeur de la gestion budgtaire favorisant une meilleure allocation des ressources budgtaires, une plus grande efficacit de la dpense publique et une rpartition territoriale quilibre des fruits de la croissance. Elle vise, ainsi, amliorer la qualit des prestations du service public pour une meilleure satisfaction des besoins du citoyen et un meilleur impact des politiques publiques sur les populations bnficiaires.
NOTE DE PRESENTATION
62
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Enrichir linformation communique au Parlement et orienter le dbat parlementaire davantage vers lefficacit et lefficience de la dpense publique et la qualit du service public. Renforcer la transparence budgtaire et amliorer la lisibilit de linformation budgtaire mise la disposition du Parlement et du citoyen. II.2.2.1.2.2. Principaux axes du projet de rforme Les propositions de rforme de la loi organique relative la loi de finances sarticulent autour de trois grands axes, savoir : lamlioration de la performance de la gestion publique, le renforcement de la transparence et de la soutenabilit des finances publiques et laccroissement du rle du Parlement dans le dbat budgtaire. Premier axe : lamlioration de la performance de la gestion publique Pour amliorer le cadre de pilotage des finances publiques et renforcer la cohrence des stratgies sectorielles, il est propos dinstituer lobligation dlaborer la loi de finances en rfrence une programmation pluriannuelle glissante devant servir de cadre gnral pour la dfinition des besoins et la justification des propositions de rpartition des ressources. Le projet de la nouvelle loi organique relative la loi de finances introduit, galement, le principe selon lequel la loi de finances sinscrit dans une logique dobjectifs et de rsultats. Linstitution de cette nouvelle logique requiert la refonte de la nomenclature budgtaire leffet de passer dune logique de prsentation des crdits par nature une nouvelle logique darticulation du budget autour de programmes dclins par rgions en tant que cadre dautorisation et de gestion des actions publiques. Dans le but dorienter le dispositif budgtaire vers la performance, il est ainsi propos dadosser aux programmes des objectifs atteindre mesurables par des indicateurs de performance. En contrepartie, les gestionnaires bnficieront dune plus grande marge de manuvre dans le redploiement de leurs crdits. Par ailleurs, les dpartements ministriels seront soumis un audit de performance portant sur un examen de la mise en place de la dmarche de performance leur niveau et permettant dapprcier les performances ralises par les gestionnaires au regard des objectifs fixs au pralable mesurables par des indicateurs de performance. Les rapports daudit de performance seront communiqus au Parlement en vue denrichir le dbat parlementaire en le portant davantage sur lexamen de la performance de laction publique. Enfin, le projet de la nouvelle loi organique prvoit que chaque ministre labore son Projet Ministriel de Performance (PMP) qui accompagne le projet de loi de finances de lanne et renseigne sur la stratgie, les programmes, les objectifs et les indicateurs de performance pour lanne suivante. Les dpartements ministriels laboreront, galement, un Rapport Ministriel de Performance (RMP), accompagnant le projet de loi de rglement, et qui rendra compte, pour chaque programme, des performances ralises au regard des objectifs retenus. Un Rapport Annuel de Performance qui consolide les Rapports Ministriels de Performance
NOTE DE PRESENTATION 63
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
tablis par les dpartements ministriels et institutions sera, alors, labor par le ministre charg des finances et accompagnera le projet de loi de rglement. Deuxime axe : le renforcement publiques de la transparence des finances
Pour renforcer la transparence budgtaire par rfrence aux meilleurs standards internationaux, le projet de rforme de la loi organique relative la loi de finances consacre le principe de sincrit budgtaire et comptable et ce, dans lobjectif de conforter la fiabilit des informations comptables, la pertinence des hypothses qui prsident la prparation de la loi de finances et la qualit de ses prvisions de ressources et de charges compte tenu des informations disponibles au moment de leur tablissement. De plus, la comptabilit budgtaire sera enrichie par linstitution des comptabilits gnrale et analytique afin de mieux apprhender le patrimoine de lEtat et le cot global des services publics et de suivre les efforts mens pour la matrise de lensemble des dpenses y affrentes. En outre, de nouvelles rgles financires seront introduites pour renforcer la soutenabilit budgtaire. Il sagit, titre dexemple, de confrer le caractre limitatif aux crdits de personnel et de limiter le recours la dette moyen et long termes de faon exclusive au financement des dpenses dinvestissement. Enfin, le projet de rforme de la loi organique relative la loi de finances prvoit damliorer la lisibilit des documents budgtaires et de renforcer le contrle parlementaire des Etablissements et Entreprises Publics subventionns ou bnficiant de taxes affectes. Troisime axe : laccroissement du rle du Parlement dans le dbat budgtaire Il sagit dassocier le Parlement de faon mieux affermie ds les premires phases la prparation du projet de loi de finances et de le doter dinformations pertinentes et de qualit lui permettant de jouer de manire adquate son rle de contrle des politiques publiques et des conditions de leur mise en uvre. A cet effet, il est prvu de rviser les calendriers dexamen de la loi de finances et dadoption de la loi de rglement et de rhabiliter la loi de finances rectificative dans le respect du principe de sincrit. Par ailleurs, les informations communiques au Parlement seront enrichies afin damliorer la qualit du dbat sur la loi de finances. En effet, outre les Projets Ministriels de Performance prcits, qui accompagneront les budgets des ministres qui seront communiqus au Parlement l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, les rapports et les documents communiqus au Parlement seront enrichis par linstitution de lobligation de faire accompagner le projet de loi de finances de rapports affrents respectivement la prsentation de la loi de finances, aux comptes spciaux du Trsor, aux services de lEtat grs de manire autonome, au secteur des Etablissements et Entreprises Publics, aux dpenses fiscales, au genre, au cadre conomique et financier dans lequel la loi de finances
NOTE DE PRESENTATION
64
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
est prpare, la dette du Trsor, aux aides publiques linvestissement, la compensation, la masse salariale et aux finances des collectivits territoriales. De plus, la procdure de vote des dpenses sera simplifie en vue de ladapter la dmarche globale de performance et le droit damendement parlementaire sera assoupli. II.2.2.1.2.3. Mise en uvre de la rforme Pour tenir compte de la capacit de gestion des dpartements ministriels, la mise en uvre de la nouvelle loi organique relative la loi de finances sera tale sur une priode de cinq annes suivant lanne de sa promulgation au Bulletin Officiel. II.2.2.2. Optimisation des recettes Paralllement la matrise des dpenses, un effort particulier est men en vue de renforcer la mobilisation des ressources internes et particulirement, les ressources fiscales et douanires. II.2.2.2.1. Recettes fiscales La politique suivie dans le domaine de la fiscalit est marque par le double souci dviter une aggravation de la pression fiscale, afin de renforcer la rentabilit et la comptitivit des entreprises et dassurer davantage dquit dans la rpartition des charges fiscales, en fonction des capacits contributives des assujettis conformment aux dispositions constitutionnelles en la matire, ce qui ne pourra que renforcer ladhsion limpt et favoriser le dveloppement du civisme fiscal. Les efforts dploys dans ce sens sont focaliss sur la modernisation du systme fiscal, la restructuration de ladministration fiscale et la rationalisation de ses mthodes de travail. Les actions entreprises ont trouv leur couronnement dans la promulgation du Code de lEnregistrement et du Timbre dans le cadre de la Loi de Finances pour lanne 2004 et la promulgation du Code Gnral des Impts dans le cadre de la loi de finances pour lanne 2007 qui a codifi les dispositions du Livre des Procdures Fiscales et celles du Livre dAssiette et de Recouvrement prvues respectivement par les lois de finances pour les annes 2005 et 2006. Par ailleurs, dans le but dassurer un relvement substantiel du niveau des recettes fiscales, diverses initiatives ont t prises, au cours des quatre dernires annes. Il sagit principalement, des mesures suivantes : Concernant lImpt sur les Socits (IS) : la poursuite de la rforme fiscale des socits en rduisant les cots et les exonrations non justifies ;
NOTE DE PRESENTATION
65
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
ltablissement dun systme d'incitation fiscale pour crer un ple financier Casablanca ; et la rduction du taux fiscal 15% au profit des socits soumises lIS et qui ralisent un chiffre daffaires ne dpassant pas 3.000.000 de dirhams hors TVA. Concernant lImpt sur le Revenu (IR): lexonration des revenus et des bnfices raliss dans le cadre des plans d'pargne pour le logement et pour l'ducation ; la dduction des intrts sur les prts accords par les associations des uvres sociales pour dterminer la marge imposable ; la contribution la divulgation financire d'une ou plusieurs personnes physiques dans une socit soumise l'IS; lextension de la tranche exonre de 28.000 30.000 dirhams ; la rduction du taux appliqu la tranche suprieure de 40 38%; la rvision des taux appliqus sur les tranches moyennes; et laugmentation du plafond des rductions professionnelles de 28.000 30.000 dirhams. Concernant la Taxe sur la Valeur Ajoute (TVA) : lapplication du taux de 10% certains produits ptroliers ; ladaptation de lapplication de la valeur ajoute sur les oprations et intrts relatifs aux emprunts et crdits accords des groupes locaux ; la clarification et lamlioration du concept du commencement de lexercice dune activit ; et la prolongation de la priode dexonration sur les oprations effectues par les associations de microcrdit. Concernant les Droits dEnregistrement et de Timbre : la dmatrialisation de la procdure denregistrement ; limposition des titres de certification de la proprit un droit denregistrement de 3% au lieu de 6% ; le remplacement des timbres mobiles coller sur les contrats notariaux par un simple visa ; et lexonration des enfants des MRE, gs de moins de 18 ans, des frais de timbre des passeports.
NOTE DE PRESENTATION 66
au
titre
de
dpenses
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Concernant lAdministration Fiscale : la cration de la charte du contribuable ; la mise en place des E-Services pour procder aux dclarations et paiements dimpts ; la restructuration des services fiscaux sur une base fonctionnelle; la redistribution des rles entre lAdministration Centrale devant focaliser ses efforts sur les missions stratgiques et ses services extrieurs chargs plus directement des tches oprationnelles; lintensification de la lutte contre la fraude et lvasion fiscales; et le dveloppement des actions de communication et de vulgarisation. Les rformes fiscales opres seront poursuivis et ce travers la mise en uvre au cours des prochaines annes des mesures suivantes: lamlioration du rendement fiscal travers llargissement de lassiette et la rduction de la pression fiscale ; lamlioration de la performance de ladministration fiscale ; le renforcement de la confiance entre lassujetti et ladministration fiscale ; la rduction progressive des drogations et des exonrations fiscales lexception de celles encourageant linvestissement productif ou renforant la justice sociale ; le renforcement des efforts de lutte contre la fraude et lvasion fiscale travers le renforcement des ressources humaines et le dveloppement du systme de contrle ; le lancement du dbat sur lexonration fiscale du secteur agricole dans lobjectif dassurer lquit fiscale tout en maintenant le bnfice de cette exonration au profit des petits agriculteurs. Dans le cadre du projet de loi de finances pour lanne 2012, les principales dispositions proposes en matire fiscale sont reprises dans lannexe ci-jointe. II.2.2.2.2. Recettes douanires Du fait de laccroissement constant des changes dans un contexte marqu par louverture des marchs et le dveloppement des flux touristiques, lAdministration des Douanes et Impts Indirects se trouve investie de missions essentielles telles que la dfense et la protection de lconomie nationale et la facilitation de la chane logistique pour les entreprises oprant dans le domaine des changes extrieurs.
NOTE DE PRESENTATION
67
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La politique adopte en matire douanire au cours des quatre dernires annes a t marque par les principales actions suivantes : En matire de rforme tarifaire, la dispersion des quotits tarifaires est passe de 11 en 2007, 6 en 2009 et 4 en 2011, contribuant ainsi lamlioration du pouvoir dachat des citoyens et la cration dun environnement propice aux affaires. En matire de simplification et de dmatrialisation des procdures, les efforts entrepris ont port sur le ramnagement du circuit de ddouanement limportation, la ringnierie de certains processus suite leur informatisation, la dynamisation des rgimes conomiques en douane, laccompagnement du dveloppement des zones franches, des plates-formes industrielles intgres et des grands projets ainsi que la participation active la mise en uvre du guichet unique portuaire des formalits du commerce extrieur (PortNet). En matire de modernisation de ladministration douanire, le systme de ddouanement sur internet compltement intgr et couvrant lensemble du circuit de ddouanement (BADR) a t lanc dans sa version complte le 5 janvier 2009. Ledit systme sadresse une population de prs de 5 000 utilisateurs dont 3 500 dclarants. Grce ce systme, 100% des dclarations en douane sont lectroniques et plus de 90% des procdures douanires sont informatises. Par ailleurs, un nouveau Portail internet de lAdministration des Douanes et Impts Indirects a t mis en place en fvrier 2011 et une nouvelle version du Portail Internet structur par cible et dispensant une information structure, pratique, intgre et complte, ainsi quun espace de questions-rponses a t lance en faveur du public. En matire de lutte contre la fraude, la valeur des stupfiants et des marchandises saisies a atteint, entre 2007 et 2010 respectivement, 2 631,1 MDH et 2 651,6 MDH. Il convient de noter, galement, lacquisition de scanners et de matriels de transmission et la signature, en 2007, du programme intitul Programme SECURE pour la lutte contre la contrefaon et la piraterie. En matire de soutien aux secteurs touchs par la crise financire internationale, une convention a t signe entre le Gouvernement, la CGEM et le GPBM accordant des facilits douanires au profit des secteurs du textile, du cuir et des quipements automobiles et ce, en termes, notamment, de prorogation du dlai de sjour des marchandises places sous les rgimes suspensifs de lAdmission Temporaire ou de lAdmission Temporaire pour Perfectionnement Actif, dexportation hors dlai ou de mise la consommation de 15% des quantits importes sous lAdmission Temporaire pour Perfectionnement Actif. En matire de soutien aux Marocains Rsidant lEtranger, un abattement de 85% pour le ddouanement dun vhicule automobile personnel est
NOTE DE PRESENTATION
68
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
accord, partir de mars 2008, aux marocains rsidant ltranger gs de plus de 60 ans. En matire de renforcement de lthique, un Observatoire de lEthique Douane/Secteur Priv a t mis en place le 19 janvier 2010 avec pour missions de recueillir les informations sur la corruption, didentifier ses niches et dmettre des propositions de rforme en la matire. De plus, le systme des sanctions des transitaires a t renforc et harmonis, les audits des intermdiaires agrs ont t multiplis, les modalits dagrment des transitaires ont fait lobjet dune refonte globale et les contrles de cohrence du systme informatique de ddouanement des marchandises ont t renforcs. Dans le cadre du projet de loi de finances pour lanne 2012, les principales dispositions proposes en matire douanire sont reprises dans lannexe ci-jointe.
II.3. La garantie dun accs quitable des citoyens aux services et aux quipements de base dans le respect des principes de solidarit et dgalit des chances
Dans le cadre du Projet de Loi de Finances pour lanne 2012, les efforts seront poursuivis pour garantir laccs quitable des citoyens aux services et aux quipements de base dans le respect des principes de solidarit et dgalit des chances. II.3.1 Valorisation des ressources humaines La valorisation des ressources humaines est assure travers le renforcement de lducation, de la formation, de la couverture sanitaire, de la protection sociale et de la lutte contre la pauvret ainsi que lamlioration des prestations sociales au profit des populations dmunies. II.3.1.1. Secteur de lEducation Formation II.3.1.1.1 Education Nationale Faisant suite aux Hautes Instructions de Sa Majest le Roi Mohammed VI, dans son discours prononc loccasion de louverture de la session parlementaire de lautomne 2007, un programme durgence couvrant la priode 2009-2012 a t labor. Partant des priorits identifies par le premier rapport national 2008 du Conseil Suprieur de lEnseignement (CSE) sur ltat de lcole et ses perspectives, le Programme dUrgence sarticule autour de 26 projets rpondant quatre objectifs fondamentaux, savoir : rendre effective lobligation de scolarisation des enfants jusqu lge de 15 ans en atteignant en 2012 des taux de scolarisation de 95% au primaire, de 90% au collgial et en aboutissant, en 2015, un taux de scolarisation de 100% au prscolaire ;
NOTE DE PRESENTATION
69
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
stimuler la russite au sein des lyces travers, notamment, la qualification de loffre pdagogique, la promotion de la culture de lexcellence et lamlioration de loffre denseignement ; mettre en uvre les projets mme dapporter une solution aux problmes transversaux du systme ducatif, particulirement au niveau des ressources humaines, par lamlioration de la comptence des cadres pdagogiques et le renforcement du rle des directeurs et des inspecteurs en leur qualit dencadreurs principaux de laction ducative ; disposer des ressources financires et humaines ncessaires la russite du programme en mettant laccent sur le fonctionnement du systme ducatif et sa continuit travers des outils adquats de planification et de gestion. A cet effet, vingt-six projets structurs autour de quatre ples (le ple de la gnralisation, le ple pdagogique, le ple de la gouvernance et le ple des ressources humaines) ont t programms. Les efforts dploys, depuis 2009, dans le cadre du programme durgence dducation et de formation, ont permis lamlioration de la performance du systme ducatif. En effet, il y a lieu de noter : des progrs significatifs en matire de ralisation de lobligation de scolarit pour la tranche dge 6 15 ans. En effet, entre 2007-2008 et 2010-2011, le taux de scolarisation pour la tranche d'ge 6 11 ans est pass de 91,4% 97,5% et celui de la tranche dge 12 14 ans est pass de 71,3% 79,1%. En outre, le taux dabandon est pass de 5,4% en 2006-2007 3,1% en 2009-2010 pour lenseignement primaire et de 13,4% 10,8% pour le secondaire collgial au cours de la mme priode ; lamlioration du taux spcifique de scolarisation au niveau de lenseignement secondaire qualifiant qui a connu une augmentation notoire entre les annes 2007-2008 et 2010-2011 en passant de 48,1% 52,8%. Aussi le taux d'abandon pour ce cycle denseignement a-t-il connu une baisse entre l'anne 2006-2007 et 2009-2010 en passant de 14,5% 9,2% ; lamlioration de lefficacit interne du systme ducatif comme en tmoigne lvolution du taux d'achvement qui est pass, entre 2006-2007 et 2009-2010, de 73% 86,5% pour lenseignement primaire et de 48% 64,6% pour lenseignement collgial et de 24% 36,2% pour le secondaire qualifiant ; le renforcement de lgalit des chances dont le taux a atteint 98% au primaire, 94% au secondaire collgial et 81% au secondaire qualifiant. L'indice de l'galit des chances entre les deux milieux a, pour sa part, atteint prs de *100% dans lenseignement primaire. De plus, le taux de couverture des communes rurales en collges est pass de 49,7% 56% entre les annes scolaires 2007-2008 et 2010-2011 ; lamlioration de la qualit de lenseignement. En effet, le taux des lves inscrits dans les filires scientifiques et techniques est pass de 55,1% en
NOTE DE PRESENTATION 70
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
2007-2008 60,6% en 2010-2011, le taux de russite aux examens du baccalaurat est pass de 41,8 % en 2007-2008 58,2% en 2010-2011 et le taux global de russite est pass de 44,80 % 55,30 % entre juillet 2008 et juillet 2011. Les acquis raliss dans la mise en uvre du plan urgence seront consolids et les efforts du Gouvernement seront davantage orients vers le renforcement de la gouvernance et de la qualit du systme ducatif ainsi que lamlioration des conditions du personnel ducatif et ce dans le cadre dune dmarche contractuelle. En effet, la politique ducative qui sera mise en oeuvre par le Gouvernement est articule autour des axes suivants : Le renforcement de linstitution ducative travers, notamment, le renforcement de son autonomie de gestion, lvaluation priodique de la performance des institutions ducatives, louverture institutionnelle sur lenvironnement ducatif, administratif et social et le renforcement des capacits de gestion. Lamlioration de la gouvernance du secteur ducatif en sappuyant sur la planification, la dfinition des objectifs atteindre et le calendrier de mise en uvre ainsi que les instruments de suivi et dvaluation. Les prrogatives des structures administratives extrieures charges de lducation et de la formation seront galement largies et leurs capacits de gestion seront renforces. Les rapports entre lesdites structures administratives et lEtat feront lobjet de contrats dfinissant les objectifs atteindre en matire notamment de gnralisation de la scolarisation, de lutte contre labandon et lchec scolaire, damlioration du modle pdagogique et de rehaussement du niveau dencadrement. Le renforcement des fonctions de lcole et de son rle travers, notamment, le suivi et la rvision priodiques des modules enseigns, le renforcement du systme des valeurs, lamlioration de lenseignement des langues nationales et trangres, des sciences et des nouvelles technologies, lvaluation priodique, lamlioration des outils de communication et dorientation, le renforcement de lencadrement des enseignants et des cadres administratifs, le renforcement du programme Tayssir , la cration de rseaux scolaires et le renforcement du rle du secteur priv et lamlioration de sa qualit. Notons, enfin, quil sera procd loprationnalisation optimale et rapide du Conseil Suprieur de lEducation et de la Formation. II.3.1.1.2. Lutte contre lanalphabtisme Le nombre de bnficiaires des programmes d'alphabtisation est pass de 286.000 en 2002-2003 668.000 en 2010-2011. Le cumul des bnficiaires pendant les huit dernires annes a atteint plus de cinq millions de personnes, soit plus que le double du cumul des bnficiaires entre 1982 et 2002. Il est noter que 80% de la population bnficiaire sont des femmes et 50% sont issus du milieu rural.
NOTE DE PRESENTATION 71
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Laugmentation du rythme de ralisation desdits programmes s'est traduite par une baisse significative du taux d'analphabtisme qui est pass de 43% en 2004 prs de 30% actuellement. Une attention particulire est accorde lamlioration de la qualit de lintervention et la diversification des approches pour toucher un maximum du public cible. En effet, de nouveaux intervenants sont mobiliss dans le domaine de lalphabtisation tels que le Ministre de lIntrieur et le Conseil National des Droits de lHomme et des leviers de la qualit ont t mis en place notamment, la formation des intervenants et le renforcement de leurs capacits, la rvision des manuels et la diversification des outils didactiques ainsi que le lancement de cours tlviss dalphabtisation et dune exprience dalphabtisation par la radio dans la rgion de Souss Massa Dra. Le Gouvernement sest fix comme objectif lacclration de la lutte contre lanalphabtisme pour atteindre un million de bnficiaires annuellement et porter, ainsi, le taux danalphabtisme 20% lhorizon 2016. A cet effet, il est prvu doprationnaliser la loi n38.09 portant cration de lAgence National de la Lutte contre lAnalphabtisme, damliorer les instruments de formation, de renforcer la culture de suivi et dvaluation continue et de diversifier loffre ducative en intgrant les mosques, les espaces publics, les institutions de la socit civile, les initiatives du secteur priv et les collectivits territoriales. II.3.1.1.3. Education non formelle Les efforts seront poursuivis en matire de promotion de lducation non formelle qui constitue un levier important pour lamlioration de lenseignement. La politique de promotion de lEducation Non Formelle se dcline en deux principaux programmes, savoir (i) le programme de lcole de la deuxime chance (E2C), articul autour de deux composantes, savoir Partenariat et Istidrak et (ii) le programme de l'accompagnement scolaire, compos de deux sousprogrammes, savoir Idmaj Moubachir et suivi des insrs . La mise en uvre des programmes prcits au titre de lanne 2010-2011 a permis datteindre 69 015 bnficiaires dont 45 861 au titre du programme de lcole de la deuxime chance et 23 154 au titre du programme de laccompagnement scolaire. II.3.1.1.4. Enseignement suprieur et recherche scientifique Le programme durgence pour le secteur de lenseignement suprieur universitaire pour la priode 2009-2012, sarticule autour de trois axes prioritaires, savoir: Axe 1 : Stimuler linitiative et lexcellence luniversit travers le renforcement de loffre de lenseignement suprieur et lencouragement de lemployabilit des laurats; Axe 2 : Affronter les problmatiques transversales du systme dont la rsolution simpose pour faire aboutir la rforme;
NOTE DE PRESENTATION 72
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Axe 3 : Se donner les moyens de russir travers loptimisation et la prennisation des ressources financires ainsi que la mobilisation et la communication autour de luniversit. Ces axes sont dclins en douze projets visant lamlioration du rendement interne du systme, de la qualit des enseignements et de lemployabilit des laurats. A cet effet, dix-sept Contrats de Dveloppement alliant lUniversit, le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) et lOffice National des uvres Universitaires, Sociales et Culturelles (ONOUSC) ont t signs le 6 octobre 2009 devant Sa Majest le Roi Mohammed VI Agadir. Les diffrents actions ralises ont notamment permis damliorer le rendement interne et externe de l'enseignement suprieur comme en atteste les indicateurs suivants: la rduction du taux dabandon en 1re anne de Licence des tudes fondamentales pour atteindre 18% en 2009-2010 contre 22% en 2007-2008. lamlioration du rendement interne des tablissements universitaires accs ouvert pour atteindre 37% en 2009-2010 contre 30% en 2008-2009. laccroissement du taux de diplmation dans les tablissements de lenseignement suprieur qui a dpass, en 2009-2010, le seuil de 50% fix dans le programme durgence pour tous les champs disciplinaires. lorientation plus prononce des tudiants nouvellement inscrits vers les filires de formation scientifique et technique dont leffectif est pass de 8.336 en 2006-2007 18.154 en 2010-2011, soit une hausse de 118%. Concernant la promotion de la recherche scientifique, il y a lieu de relever une augmentation notamment : de la part du PIB consacre la recherche scientifique de 0,64% en 2006-2007 0,8% actuellement; de 54% du nombre de publications dans les revues internationales indexes durant la priode 2006-2010 passant de 1 450 2 250; et du nombre de brevets dinvention enregistrs au nom des universits de 2 en 2006 41 en 2010. Les diffrentes actions entreprises dans le cadre du programme Urgence seront consolides tout en orientant, prsent, la politique de lenseignement suprieur vers latteinte des cinq objectifs suivants: ladaptation de la formation travers la modernisation du systme denseignement suprieur, llargissement de ses capacits daccueil et lamlioration de sa qualit ; lamlioration de la gouvernance du secteur travers le renforcement de lautonomie des universits et la contractualisation de leurs rapports avec
NOTE DE PRESENTATION
73
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
lEtat, le renforcement du taux dencadrement, lamlioration des conditions de travail et la rvision du statut particulier du corps des enseignants chercheurs; la modernisation de la recherche scientifique travers, principalement, le regroupement des units de recherche dans des ples homognes, lactualisation de la stratgie nationale de la recherche scientifique et technologique, le renforcement du financement de la recherche scientifique en portant lappui tatique 1% du PIB et la mise en place de mesures fiscales incitatives pour encourager la recherche dans lentreprise et lencouragement de la publication des articles de recherche ; le renforcement des prestations sociales au profit des tudiants travers, notamment, laugmentation future de la valeur des bourses et du nombre de boursiers, la gnralisation de la couverture mdicale des tudiants, la gnralisation des restaurants universitaires et laugmentation de la capacit daccueil des cits universitaires ; et la rvision de larsenal juridique rgissant le secteur de lenseignement suprieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres. II.3.1.1.5. Formation professionnelle Paralllement la rforme du secteur ducatif, les efforts sont poursuivis pour assurer la promotion du secteur de la formation professionnelle travers la poursuite du programme de mise niveau du systme de formation et du plan dUrgence Formation. II.3.1.1.5.1. Mise niveau de la formation professionnelle Lingnierie du systme de formation professionnelle est tablie selon une approche par comptences qui permet de prciser les enjeux et didentifier les domaines prioritaires dintervention sur le plan gnral et sur le plan sectoriel. La politique mise en uvre ce titre vise un quadruple objectif : satisfaire les besoins de lconomie nationale en gnral et des entreprises en particulier en cadres qualifis pour leur permettre de faire face aux dfis de la productivit et de la comptitivit ; procurer aux jeunes, par une formation initiale adquate, les comptences ncessaires pour leur permettre de sintgrer dans la vie active ; renforcer les comptences des salaris en activit en leur dispensant des formations en cours demploi pour leur permettre dacqurir des comptences nouvelles et voluer dans leurs carrires avec une attention particulire lalphabtisation fonctionnelle du personnel des entreprises ; renforcer les relations entre le systme de formation et les entreprises par la promotion de la formation en milieu professionnel par le biais de la formation en alternance et par apprentissage. Par ailleurs et conformment la Charte de lEducation et de la Formation, la mise en uvre du systme de formation en cours demploi est effectue selon une
NOTE DE PRESENTATION 74
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
dmarche contractualise, professionnelle travers :
adapte
aux
spcificits
de
chaque
branche
soit les Groupements Interprofessionnels dAide au Conseil (GIAC) ddis la promotion de la formation auprs de leurs adhrents et lidentification et lexpression de leurs besoins en comptences ; soit des contrats spciaux de formation permettant aux entreprises de rcuprer les charges engages pour la ralisation des programmes de formation de leurs salaris. II.3.1.1.5.2. Plan durgence Formation Conformment aux Hautes Instructions Royales, un plan durgence a t tabli pour la priode 2008-2012 pour le secteur de la formation professionnelle sur la base de huit tudes finances par le Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et Social. Quatre conventions encadrant la mise en uvre de ce plan ont t signes le 14 Juillet 2008 sous la Haute Prsidence de Sa Majest le Roi. Lesdites conventions portent sur: la formation par apprentissage dans le domaine de lagriculture de 60.000 jeunes ruraux pour un cot total de 340 millions de dirhams ; la formation par apprentissage de 60.000 artisans pour accompagner la Vision 2015 du secteur de lartisanat pour un cot de 451 millions de dirhams ; la cration de licences professionnelles en partenariat entre les universits et les tablissements de formation professionnelle dans le domaine de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies ; et le soutien la formation des ressources humaines ncessaires pour laccompagnement du dveloppement intgr du secteur industriel au niveau des branches automobile, aronautique, lectronique, Offshoring, textile/cuir et agroalimentaire. Ce soutien est effectu sous forme de cration de structures de formation, doctroi dune aide directe aux entreprises pour appuyer leurs efforts de formation et daccompagnement du dveloppement des plateformes industrielles intgres par la cration dtablissements de formation spcialiss en leur sein. II.3.1.2. Politique sanitaire La stratgie nationale 2008-2012 pour la sant a t articule autour des principaux axes suivants: Axe 1 : Le repositionnement stratgique des diffrents intervenants dans le secteur de la sant travers notamment le recentrage du rle de lEtat autour du financement, de lencadrement, de la planification, du contrle et de la scurit sanitaire, ainsi que le dveloppement du partenariat avec le secteur priv, la socit civile et les Organisations Non Gouvernementales afin dassurer une cohrence dans loffre de soins et la complmentarit entre les
NOTE DE PRESENTATION 75
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
deux secteurs, public et priv et de renforcer limplication de la socit civile dans la ralisation des objectifs de sant ; Axe 2 : La gnralisation dune offre de soins accessible, suffisante, de qualit et rpartie quitablement sur lensemble du territoire travers lamlioration des services rendus par les hpitaux publics, la garantie dun meilleur accs de la population aux services de soins, lamlioration du dispositif relatif la sant en milieu rural, la mise en place dune politique concerte du mdicament qui permet un usage rationnel des mdicaments et le renforcement des ressources humaines par le dveloppement des comptences notamment par le biais de la formation continue ; Axe 3 : La mise en uvre de plans nationaux spcifiques de sant dans le cadre de la rduction de la mortalit maternelle et nonatale, et pour faire face certaines maladies chroniques telles que le diabte, les maladies cardio-vasculaires, les diffrents types de cancer, linsuffisance rnale et les maladies mentales ; Axe 4 : Le renforcement des dispositifs relatifs la scurit sanitaire moyennant la mise en uvre des actions susceptibles de relever les dfis que posent le changement de la structure dmographique de la population, limportance de la part des maladies non transmissibles dans la charge globale de morbidit ainsi que la prvalence des comportements facteurs de risques sanitaires chez la population. Les diffrents programmes entrepris dans le cadre de cette stratgie ont eu un impact positif sur les indicateurs de la sant. En effet: Concernant la sant maternelle et infantile, les efforts entrepris ont permis la rduction des taux de mortalit maternelle et infantile. En effet, le taux de mortalit infantile se situe 30 pour 1.000 naissances vivantes en 2010 au lieu de 40 pour 1.000 naissances vivantes en 2004, celui de la mortalit maternelle est pass de 227 pour 100.000 naissances vivantes en 2004 112 pour 100.000 naissances vivantes en 2010. La proportion des accouchements assists par un personnel qualifi, est, pour sa part, passe de 63 % en 2004 74% en 2010. En outre, la poursuite des activits du Programme National dImmunisation (PNI), a permis datteindre des taux de couverture vaccinale trs satisfaisants (96% pour le BCG, 95% pour le VAR et 95% pour le HB3). La vaccination des femmes a, en outre, permis la protection de 87% des nouvelles naissances. Sagissant de la sant rurale, une amlioration sensible a t enregistre en matire de sant maternelle et infantile en milieu rural. En effet, le taux de mortalit maternelle en milieu rural a atteint 148 pour 100.000 naissances vivantes contre 267 pour 100.000 naissances vivantes en 2004 et le taux daccouchement en milieu surveill est pass de 38% en 2004 57% en 2010.
NOTE DE PRESENTATION
76
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
En matire de mise en uvre de la couverture mdicale, lobjectif de renforcement des capacits des hpitaux fournir des soins aux populations bnficiaires a t en partie ralis, notamment, en matire de renforcement des ressources humaines suite lattribution de 600 postes budgtaires (mdecins et infirmiers) aux quatre Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) au titre de lexercice 2011. Concernant le rgime dassistance mdicale (RAMED), fin 2011, il a t procd limmatriculation de plus de 238.100 bnficiaires. Concernant la prvention et la lutte contre les maladies, il convient de noter la prise en charge de 29.966 malades en 2010 au niveau des centres doncologie, soit une augmentation de 23% par rapport lanne 2009. De plus, le nombre de malades souffrant de linsuffisance rnale chronique terminale pris en charge dans le secteur public, est pass de 2.800 personnes en 2007 plus de 5.500 personnes en 2011 soit une hausse de 96 %. Les acquis de la stratgie nationale 2008-2012 susmentionns seront consolids tout en mettant laccent dans le futur sur la mise en place des mesures suivantes : La gnralisation dune offre de soins de qualit, accessible pour tous avec quit et lamlioration des conditions daccueil notamment dans les structures daccouchement et les services durgences. Ladoption dune politique du mdicament assurant l'approvisionnement du march en produits de qualit des prix justes et accessibles. A cet effet, il sera procd lamlioration du processus dachat public du mdicament et des dispositifs mdicaux et lamlioration des modes de gestion des mdicaments au niveau des hpitaux publics. Le dveloppement des services de sant de proximit travers le renforcement du rseau des soins de base en sappuyant sur les units mdicales mobiles, particulirement dans le monde rural, et la matrise des dterminants sociaux de la sant en collaboration avec les diffrents dpartements ministriels. Lencadrement et la consolidation du systme de sant travers la mise en place dune carte sanitaire base sur la rpartition quitable entre les rgions et les territoires, laccroissement du nombre des professionnels de sant, la mise en place de mesures incitatives encourageant la contractualisation avec les mdecins du secteur priv pour remdier au dficit enregistr dans certaines zones et lactivation de la production dune loi organisant lassociation stratgique entre le ministre de la sant et le secteur priv permettant la mobilisation des moyens et des ressources pour le dveloppement du secteur de sant. La mise en place dun systme efficace de veille sanitaire pour faire face aux pidmies et aux maladies contagieuses et le renforcement des dispositifs mis en place pour les maladies chroniques.
NOTE DE PRESENTATION
77
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La modernisation de loffre hospitalire travers notamment le renforcement de lautonomie administrative et financire des structures hospitalires rgionales et provinciales, la mise en place sur le plan national dun dispositif efficace pour les secours et les urgences , la rhabilitation des hpitaux provinciaux et rgionaux, lentretien des quipements sanitaires des hpitaux, la rhabilitation de la mdecine gnrale, le respect de la hirarchie des soins et lorganisation des transferts des patients entre le rseau des soins de base et le rseau des hpitaux. Laccroissement du nombre des professionnels de sant forms pour faire face la demande croissante pour les services de sant. Ces diffrentes mesures permettront damliorer les indicateurs de la sant notamment les taux de mortalit infanto-juvnile et maternelle en les rduisant, respectivement, 20 pour 1000 naissances vivantes et 50 pour 100.000 naissances vivantes lhorizon 2016. II.3.1.3. Rgime dAssistance Mdicale L'une des priorits de l'Etat en matire de sant est d'assurer toute la population l'galit et l'quit dans l'accs aux soins. Cette priorit a fait l'objet de signature de la charte de mise en uvre du code de couverture mdicale de base, en janvier 2005, devant Sa majest le Roi, entre le Gouvernement et les partenaires sociaux. La loi 65-00 portant code de la couverture mdicale de base a institu un systme obligatoire de couverture mdicale de base qui doit tre progressivement mis en place avec deux composantes. Dune part, un rgime dassurance maladie obligatoire de base (AMO) et, dautre part, un rgime d'assistance mdicale (RAMED) au profit des populations dmunies. Le rgime dassistance mdicale constitue, en vertu du dahir n 1.02.296 du 03 octobre 2002 promulguant la loi n 65-00 portant code de couverture maladie de base, un des volets de la couverture mdicale de base. Il est fond sur les principes de l'assistance sociale et de la solidarit nationale au profit de la population dmunie qui est constitue par les personnes conomiquement faibles et qui ne sont pas ligibles au rgime de lassurance maladie obligatoire. Les conditions du bnfice des prestations du RAMED ainsi que les modalits didentification des personnes ligibles au RAMED sont fixes par le dcret n 2-08-177 du 29 septembre 2008. La mise en place du RAMED dans une premire phase a dmarr au dernier trimestre 2008 dans la rgion de Tadla Azilal dont la population ligible au RAMED est estime 420.000 personnes. Aprs cette exprience pilote, le gouvernement sest engag gnraliser le RAMED aux autres rgions du Royaume en 2012 pour atteindre environ 8,5 millions de bnficiaires. La concrtisation de cet engagement sest traduite par la signature, en dcembre 2010, de larrt conjoint de gnralisation par les dpartements concerns (Intrieur, Finances et Sant). La gnralisation du RAMED a exig une srie de mesures et de procdures, y compris celles lies larsenal juridique qui encadrent ce rgime, laspect organisationnel et les ressources humaines et logistiques ncessaires la russite
NOTE DE PRESENTATION 78
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
de cet atelier social important. Ainsi, un effort budgtaire important a t consentit partir de 2008 afin de renforcer son budget en crdits. Les dotations budgtaires additionnelles ont permis notamment de renforcer les allocations des hpitaux en mdicaments, fongibles mdicaux ainsi quen services de kits dhmodialyse. Par ailleurs, plusieurs actions ont t ralises pour assurer la gnralisation du RAMED, il sagit en loccurrence de : la publication dans le bulletin officiel en date du 24 janvier 2011 de larrt n10-3349 du 30 dcembre 2010 relatif la gnralisation du RAMED ; ladaptation et la simplification du formulaire des personnes ayant droit de bnficier du RAMED ; ladaptation du systme dinformation et llaboration dun manuel de mise en uvre du RAMED ; la mise en place dun programme de formation destin 5000 professionnels de sant qui a dmarr le mois de mars 2011 avec une enveloppe budgtaire de 9 MDH dont 6,3 MDH du budget du Ministre de la Sant ; la mise en place dune stratgie de communication afin de sensibiliser et informer les professionnels de sant et les bnficiaires de ce rgime ; llaboration et la dispension dun module de formation destin aux cadres chargs du processus didentification au niveau du ministre de lintrieur ; la mise en place dun systme informatique de suivi et dvaluation de lopration de gnralisation du RAMED. II.3.1.4. Protection sociale En raison des mutations dmographiques de la population marocaine marques notamment par laugmentation continue de lesprance de vie, la baisse du taux de mortalit et la dgradation sensible du rapport numrique salaris / pensionns, et en raison galement de la faiblesse relative aux rserves constitues pour faire face aux engagements, des risques srieux de dficit dans quelques annes sont apparus pour certains rgimes de retraite. Pour remdier cette situation dans le court terme, des mesures urgentes ont t prises au cours des dernires annes. Il sagit, dune part, du relvement des taux des cotisations salariales et patronales, du prolongement de la dure dactivit des militaires et, dautre part, de la poursuite du processus dexternalisation des caisses de retraite internes des entreprises publiques et des services concds entam en 2002 avec lOffice National des Chemins de Fer (ONCF) et qui a touch successivement la Rgie des Tabacs, lOffice dExploitation des Ports (ODEP), la LYDEC, la Socit des Eaux de lOum Er Rabii, la Jorf Lasfar Electric Company (JLEC) et lOffice Chrifien des Phosphates (OCP). Les tractations sont en cours pour lintgration au sein du Rgime Collectif des Allocations de Retraite (RCAR) des caisses internes de lOffice National de lElectricit (ONE) et des Rgies de distribution.
NOTE DE PRESENTATION 79
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Paralllement, une rforme en profondeur des diffrents rgimes de retraite est en cours de mise au point afin den garantir lquilibre et la viabilit dans une perspective long terme. II.3.1.5 Renforcement du ciblage des populations dmunies et lutte contre la pauvret Les cartes tablies pour donner une image aussi exacte que possible de la rpartition de la pauvret lchelle communale, provinciale et rgionale permettent aux pouvoirs publics didentifier les zones les plus touches et de mieux cibler les programmes et les actions de lutte contre la pauvret et la vulnrabilit en milieux urbain, pri urbain et rural. Les actions engages cet effet concernent, en addition aux programmes dj voqus prcdemment TAYSSIR et RAMED destins largir laccs des populations dmunies lenseignement et aux soins de sant, la mise en uvre de lInitiative Nationale pour le Dveloppement Humain, la promotion de lconomie sociale et du micro crdit, la mise en place du Fonds dEntraide Familiale, la ralisation du programme du Compte de Dfi du Millnaire et le renforcement des filets de scurit. II.3.1.5.1. Initiative Nationale Humain (INDH) pour le Dveloppement
LINDH est un chantier de Rgne lanc le 18 mai 2005 par Sa Majest le Roi Mohammed VI dans une perspective dassurer un dveloppement humain durable. Cette initiative a pour objectif de rduire la pauvret, la prcarit et lexclusion sociale, travers des actions de soutien aux activits gnratrices de revenus, de dveloppement des capacits locales, damlioration des conditions d'accs aux services et infrastructures de base (ducation, sant, culte, route, eau et assainissement, protection de lenvironnement, etc.) et apporte de laide aux personnes en grande vulnrabilit. LINDH est conue pour renforcer laction de lEtat et des collectivits locales. Elle ne se substitue pas aux programmes sectoriels ou aux plans de dveloppement conomiques et sociaux dj engags par le gouvernement et les collectivits locales. Elle repose sur le ciblage des zones et des catgories les plus dmunies ainsi que la participation des populations dans le choix des projets et privilgie lapproche contractuelle et le partenariat avec le tissu associatif et les acteurs du dveloppement local et de proximit. LINDH est mise en uvre travers quatre programmes : i) la lutte contre la pauvret en milieu rural, ii) la lutte contre lexclusion sociale en milieu urbain, iii) la lutte contre la prcarit et iv) le programme transversal. Les deux premiers programmes sont cibls gographiquement alors que les deux autres couvrent lensemble des provinces et prfectures du Royaume. Le programme rural vise apporter un appui aux 403 communes rurales parmi les plus pauvres, rparties sur 44 provinces. Il a pour objectifs la rduction du taux de pauvret en milieu rural ainsi que la convergence des programmes sectoriels et des programmes de dveloppement rural intgrs.
NOTE DE PRESENTATION
80
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La premire phase de l'INDH (2005-2010) a t marque par la concrtisation de plus de 23.000 projets et actions de dveloppement, dont 3.700 activits gnratrices de revenus, au profit de prs de 5,7 millions de bnficiaires. Le montant d'investissement global s'lve 14,1 milliards de dirhams avec une contribution de l'INDH hauteur de 8,4 milliards de dirhams, do un effet de levier de lordre de 41%. Les programmes lancs sont classs selon quatre catgories : Lutte contre la prcarit dcline en 2.360 projets au profit de plus de 590.000 bnficiaires ; Lutte contre la pauvret en milieu rural travers plus de 7.073 projets bnficiant de 1.700.000 bnficiaires ; Lutte contre lexclusion sociale en milieu urbain avec 4.351 projets au profit de plus de 1.700.000 personnes; Programme transversal comprenant 9.937 projets bnficiant prs de 1.700.000 personnes. La premire phase de l'INDH a galement contribu la promotion des droits des personnes en situation de prcarit en termes de construction, de mise niveau et d'quipement de centres d'accueil et de protection sociale (1.755 projets), l'intgration dans le circuit conomique de la population pauvre avec plus de 3.700 projets ports par des associations et coopratives et gnrant plus de 40.000 emplois, ainsi qu' la redynamisation du tissu associatif matrialise par la cration de plus de 3.800 associations. La mise en uvre de lINDH au titre de la 2me phase 2011-2015 puise ses fondements dans les Hautes Orientations Royales contenues dans les Discours du Trne de 2009 et de 2010. Cette seconde phase sarticule autour de trois principes fondamentaux, savoir le renforcement de l'ancrage de la philosophie de l'Initiative, le maintien des quatre programmes de la phase 2005-2010 et l'adoption d'un ambitieux programme ddi la mise niveau territoriale au profit des populations des zones montagneuses enclaves. Elle bnficie dune enveloppe budgtaire globale de 17 milliards de dirhams rpartie entre le Budget gnral (9,4 MMDH), les collectivits locales (5,6 MMDH), les Etablissements Publics (1 MMDH) et la coopration internationale (1 MMDH), pour la mise en uvre des cinq programmes suivants: Le programme de lutte contre la pauvret en milieu rural, qui cible 701 communes rurales; Le programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain, qui couvre 530 quartiers urbains;
NOTE DE PRESENTATION
81
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Le programme de lutte contre la prcarit qui vise amliorer la prise en charge et favoriser la rinsertion familiale et sociale ; Le programme transversal qui a pour objet l'accompagnement des acteurs en charge du dveloppement humain par le soutien des actions de formation, de renforcement de capacits et de communication ; Le programme de mise niveau territoriale qui profitera directement un million de bnficiaires habitant 3.300 douars relevant de 22 provinces. Ce nouveau programme vise l'amlioration des conditions de vie des populations de certaines zones montagneuses ou enclaves et la rduction des disparits en matire d'accs aux infrastructures de base, d'quipements et de services de proximit. Il convient de souligner que, pour la mise en uvre de cette deuxime phase de lINDH, une attention particulire sera accorde par le Gouvernement aux actions cratrices de richesses et demploi, lacclration du dveloppement des zones montagneuses, llargissement de la participation des femmes, des jeunes et des personnes aux besoins spcifiques, au renforcement du contrle et de lvaluation de la mise en uvre des projets et la convergence avec les politiques publiques sectorielles. II.3.1.5.2. Renforcement de lconomie solidaire Paralllement, les pouvoirs publics sattachent au renforcement de lconomie solidaire et sociale travers la promotion des coopratives pour la valorisation des produits et des services. Un accent particulier est mis dans ce cadre sur la rsorption des insuffisances dont souffrent ces entits au niveau de lorganisation, de lencadrement et de laccs aux marchs. Un projet de loi rorganisant le secteur des coopratives a t adopt par le conseil de Gouvernement. Par ailleurs, afin de donner plus de visibilit aux oprateurs, des plans rgionaux pour le dveloppement de lconomie sociale prenant en compte les potentialits de chaque rgion sont progressivement mis en place pour couvrir lensemble du territoire national. Un projet dappui institutionnel au secteur coopratif a t galement mis en place pour la priode 2010-2012 afin de faire de ce secteur un levier de dveloppement durable, de cration demplois et damlioration des conditions de vie des populations vulnrables, dans le cadre dune vision intgre de lconomie sociale et solidaire. Une attention particulire est porte cet effet lamlioration du climat des coopratives et des modalits de lencadrement assur par lOffice de Dveloppement de la Coopration. II.3.1.5.3. Dveloppement du micro crdit En permettant aux populations non bancarises daccder aux ressources financires ncessaires la mise en uvre dactions gnratrices de revenus, le
NOTE DE PRESENTATION
82
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
micro crdit constitue un instrument privilgi pour la lutte contre la pauvret et pour linsertion dune large frange de la population dans le circuit conomique. Lencours de crdit des douze associations oprant dans le secteur de microcrdit a totalis un montant de 4,7 milliards de dirhams fin 2010, bnficiant prs de 900.000 clients actifs. En vue de soutenir le dveloppement scuris du secteur du microcrdit, des rgles relatives la classification et au provisionnement des crances de la clientle des associations de microcrdits ont t mises en place. Afin de consolider larsenal juridique national rgissant les microcrdits et assurer leur volution progressive, le projet de loi n 53-10, modifiant et compltant la loi 18-97 a t approuv par le Conseil des Ministres du 1er avril 2011. II.3.1.5.4. Fonds dEntraide Familiale Pour remdier la situation de prcarit que vit une frange non ngligeable de la population suite la dissolution des liens du mariage, il a t procd dans la Loi de Finances pour lanne 2010, la mise en place dun compte daffectation spcial intitul Fonds dentraide Familiale. Le projet de loi dfinissant les bnficiaires des avances de ce fonds, savoir les femmes divorces et les enfants ayants droit la pension alimentaire ainsi que des modalits de recours ces avances est adopt et promulgu. II.3.1.5.5. Programme du dfi du Millnaire La ralisation du Programme du dfi du Millnaire, bnficiant dun financement du Gouvernement des Etats-Unis dAmrique dun montant de lordre de 700 millions de dollars sur une priode de cinq ans, se poursuit un rythme soutenu. La Convention correspondante est entre en vigueur le 15 Septembre 2008 et les premires actions sur le terrain sont intervenues en Mai 2009 avec le lancement des travaux de plantation doliviers dans la Province de Larache dans le cadre du programme darboriculture fruitire sous la supervision de lAgence du Partenariat pour le Progrs dont le Conseil dOrientations Stratgiques est prsid par le Chef du Gouvernement. Afin dassurer les meilleures chances de succs ce programme, les projets correspondants sont slectionns et mis en uvre sur la base des principes de bonne gouvernance, avec une large consultation des populations bnficiaires en attachant une attention particulire aux oprations de suivi et dvaluation des performances et de leur impact au niveau de la dimension genre . II.3.1.5.6. Filets de scurit La lutte contre la pauvret et la prcarit seffectue galement travers le renforcement des actions mises en uvre dans le cadre des filets de scurit et de la dynamisation des instruments de laction sociale de proximit. Il sagit en particulier du systme de compensation destin soutenir le prix des denres de
NOTE DE PRESENTATION
83
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
base et des interventions dvolues lEntraide Nationale, la Promotion Nationale et lAgence de Dveloppement Social. II.3.2. Amlioration des conditions de vie des populations Lamlioration des conditions de vie des populations est assure travers des actions portant notamment, sur la mise en uvre de politiques appropries en matire dhabitat et de politique de la ville, sur la mise niveau du monde rural et des zones de montagne ainsi que sur llargissement de laccs aux infrastructures culturelles et sportives pour favoriser lpanouissement de la jeunesse. II.3.2.1. Habitat Le secteur de lhabitat constitue, la fois, une vritable locomotive de croissance du fait de ses effets dentranement sur les autres secteurs et un facteur de progrs social contribuant lamlioration des conditions de vie des populations. Les axes prioritaires des programmes dhabitat consistent en : la lutte contre lhabitat insalubre notamment, les bidonvilles, les quartiers sous quips et lhabitat menaant ruine ; le renforcement et la diversification de loffre dhabitat, notamment au profit des classes moyennes et des populations conomiquement faibles ; la promotion de la qualit des produits sur les plans de larchitecture, du respect de lenvironnement avec un accent particulier sur le renouvellement urbain, lamnagement et la rhabilitation des mdinas ; lamlioration de lencadrement du secteur sur les plans technique et institutionnel par une action de formation pertinente des diffrents acteurs du secteur ; et la stabilit du cadre fiscal pour donner une visibilit suffisante aux oprateurs du secteur sur le long terme. Ltat davancement dans la mise en uvre des diffrents programmes dhabitat se prsente comme suit : Programme Villes Sans Bidonvilles Lanc en 2004, ce programme qui constitue un levier de lutte contre la pauvret et lexclusion urbaine au Maroc concerne les villes chefs-lieux de rgion ou de province et les centres urbains. Il est ralis dans le cadre de contrats de ville conclus avec les autorits rgionales et locales, sachant que lobjectif arrt est dradiquer lensemble des bidonvilles recenss au niveau de 85 villes et centres au profit de 348.400 mnages. Le cot global de ce programme slve 25 milliards de dirhams dont 10 milliards de dirhams au titre de la contribution de lEtat. Programme dhabitat social dans les provinces du sud de Royaume Ce programme a connu durant lanne 2011, la signature dun avenant N2 la convention de 2008 conclue entre lEtat dune part, lAPDS et la Socit
NOTE DE PRESENTATION 84
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Al Omrane Al Janoub dautre part. Le cot global de ce programme qui stale sur la priode 2008-2014, est de 4.096 MDH financ par le budget de lEtat. Lobjectif principal de ce programme est, dune part, de rsoudre dfinitivement la problmatique de lhabitat insalubre dans les centres urbains des provinces concernes pour un besoin total de 20.686 units, et dautre part, de mettre la disposition des diffrentes catgories sociales des lots de terrain adapts leurs besoins et permettre aux familles dmunies ou faibles revenus daccder des conditions de logement amliores et ce pour un besoin global de 26 000 units. A fin Dcembre 2011, les dblocages au profit dudit programme ont cumul environ 2.270 MDH. Programme de construction de logements militaires Lanc en 2007, le programme de logements militaires vise amliorer les conditions dhabitation du personnel militaire et civil de lAdministration de la Dfense Nationale. Ce programme a pour objectif la construction dans un dlai de 6 ans de 80.000 units avec un cot global de 16.000 MDH dont une subvention de 600 MDH partir du Fonds Solidarit Habitat. A fin Dcembre 2011, les dblocages au profit dudit programme ont cumul environ 400 MDH. Programme de mise niveau urbaine Le programme de restructuration des quartiers dhabitat non rglementaire et de mise niveau urbaine consiste essentiellement en lintroduction des infrastructures manquantes et lamlioration de laspect architectural du cadre bti existant. Ce programme est mis en uvre pour faire face la prolifration de lhabitat insalubre et non rglementaire. Parmi les principaux projets engags, il y a lieu de citer les programmes de dveloppement urbain des villes de Tanger et de Ttouan, de mise niveau urbaine de la ville de Fs et de requalification urbaine de la ville de Benguerir. Programme des villes nouvelles et des ples urbains Ce programme est mis en place afin de rpondre la stratgie de dveloppement urbain base sur les actions suivantes : Procder des amnagements fonciers et des quipements de terrains pour accrotre loffre destine la promotion de lhabitat social ; Orienter la production vers lhabitat social faible cot travers le dveloppement dune politique conventionnelle et de partenariat entre secteur public et secteur priv ; Mettre en uvre des programmes spcifiques mme de rpondre la politique des villes sans bidonvilles . Ainsi, la ralisation de plusieurs villes nouvelles est dj lance savoir : Tamnsourt 14 km de Marrakech sur 1.172 ha, dun cot global de 24,5 MMDH et pour une population de 450.000 habitants;
NOTE DE PRESENTATION
85
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Tamesna situe proximit de Rabat sur 840 ha, dun cot de 22 MMDH pour un population de 250.000 habitants; Nouveau ple urbain Al Aroui dans la rgion de Nador dune superficie de 400 ha devant contenir 21.000 units de logement; Chrafat proximit de Tanger sur 770 ha, dun cot de 18,5 MMDH et pour une population de 150.000 habitants ; Lakhyayta dans la rgion de Chaouia Ouardigha proximit de Casablanca sur une superficie de 1.560 ha dun cot de 35 MMDH et pour une population de 300.000 habitants. Programme de logements faible cot Ce programme de logements faible cot intervient dans le cadre du dveloppement du partenariat public-priv afin de mettre en synergie les secteurs public et priv de lhabitat, dassocier leurs moyens et leurs efforts pour raliser les objectifs de production fixs. Ainsi, dans le cadre des dispositions de larticle 19 de la loi de Finances 1999/2000 tel qu'il a t modifi et complt par l'article 16 bis de la loi de Finances 2001 et en vue dencourager les promoteurs immobiliers accrotre loffre en logements sociaux, lEtat a accord une exonration fiscale totale (TVA, IS, IR et tous les taxes et droits caractre national et local) aux promoteurs immobiliers qui sengagent raliser des programmes conventionns de 2.500 logements, ramens plus tard 1.500 logements, sur une priode de 5 annes. En 2008, un nouveau dispositif dencouragement est accord au profit de ces promoteurs immobiliers qui sengagent raliser des programmes de construction de 500 logements de faible Valeur Immobilire Totale en milieu urbain ou 100 logements en milieu rural. Ce logement dont la superficie couverte est comprise entre 50 et 60 m a une Valeur Immobilire Totale plafonne 140.000 DH est destin aux mnages faibles revenus. La loi des finances 2010 a institu un nouveau dispositif de relance du logement social portant sur les programmes de construction de 500 logements sociaux au minimum. Dans ce dispositif, le logement social est dfini par une superficie variant entre 50 et 100 m et un prix de cession variable avec un maximum de 250.000 DH hors TVA. Sagissant des ralisations au titre de ce programme, elles se prsentent comme suit : logement 140.000 DH : Le nombre des units construites au 15 Dcembre 2011 slve 15.900 units ; logement 200.000 DH : Le nombre des units ralises pendant la priode 2008-2011 slve 65.000 units; logement 250.000 DH : Lautorisation est accorde aux promoteurs immobiliers pour la construction denviron 155.000 units.
NOTE DE PRESENTATION 86
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Les avances ralises au titre des diffrents programmes susviss seront consolides tout en poursuivant, dans le futur, les objectifs suivants : le renforcement de loffre dhabitat pour rduire le dficit en logements lhorizon 2016 400.000 units contre 840.000 actuellement. Une attention particulire est accorde lacclration du rythme de production du logement social et lencadrement de lauto-construction ; la diversification de loffre dhabitat travers notamment : (i) la mise en place dun nouveau produit dhabitat dune valeur ne dpassant pas 800.000 DH destin la classe moyenne notamment dans les moyennes et grandes villes, (ii) la mise en place dun nouveau produit destin aux jeunes et aux familles nouvellement constitues (iii) la conception et la mise en uvre de nouveaux projets intgrs dhabitat au profit des centres ruraux mergents; la promotion de la qualit des produits sur les plans techniques et architecturales tout en assurant lintgration urbaine; lacclration du rythme de ralisation des projets villes sans bidonvilles et la mise en place dun nouveau cadre permettant leur intgration urbaine et sociale ; et ladoption dune dmarche participative, incluant les autorits locales, les collectivits territoriales et la population concerne, pour la mise en uvre des projets relatifs aux quartiers sous quips, lhabitat menaant ruine et la rhabilitation des villes historiques et anciennes mdinas et du patrimoine architectural tout en prenant soin de dfinir les mcanismes de financement et de contractualisation ncessaires. Afin de russir latteinte de ces objectifs, la politique dhabitat sappuiera sur cinq principaux leviers, savoir : lorientation de lintervention des oprateurs publics vers le logement social et la lutte contre lhabitat insalubre et ce travers des contrats programmes et le partenariat public-priv ; lencadrement du secteur immobilier et la mise en place de contratsprogrammes avec le secteur priv et les corps professionnels ; la poursuite de la mobilisation du foncier public hauteur de 20.000 hectares sur cinq ans suivant une approche transparente ; le renforcement des ressources et des instruments de financement, la modernisation de lintervention des institutions bancaires, le dveloppement des fonds de garantie existants et la modernisation de leurs modes de gestion afin dassurer le logement au maximum de citoyens faible revenu ainsi que le renforcement de lintervention du secteur bancaire selon une dmarche participative; et la cration dun observatoire national et des observatoires rgionaux et locaux pour lencadrement et le suivi du secteur dhabitat.
NOTE DE PRESENTATION 87
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
II.3.2.2. Politique de la ville Le Gouvernement mettra en uvre une nouvelle politique publique volontariste intgre et participative suivant une approche horizontale visant le renforcement du rle de la ville en matire de dveloppement conomique, la rduction des signes de vulnrabilit et dexclusion sociale au niveau des zones urbaines sensibles marques par la forte pression sociale et des dficits dquipement et daccs aux services publics. Cette nouvelle politique sera mise en uvre selon une dmarche de contractualisation et de proximit assurant la convergence des diffrentes politiques sectorielles. Dans ce cadre, une stratgie nationale de la politique de la ville sera mise en uvre dans le respect des principes de la bonne gouvernance et en concertation avec les diffrents oprateurs institutionnels, conomiques, sociaux et la socit civile et ce dans lobjectif de redresser les dysfonctionnements, dassurer un dveloppement harmonieux et cohrent des villes et daccompagner la cration des nouvelles villes. II.3.2.3. Amlioration de la situation de la famille, de la femme et de lenfant Concernant la protection de la famille, laction gouvernementale sappuiera, dans le futur, sur les principaux leviers suivants : la mise en place dune politique intgre de la famille prservant la stabilit de la famille et renforant son rle prventif ; le dveloppement des services dintermdiation lencouragement de laction associative de proximit ; familiale travers
le suivi des impacts sociaux de la mise en uvre de la modawana de la famille ; le soutien aux familles en difficult prises en charges par des femmes ; lappui aux familles prenant soin des personnes handicapes ou ges ; lvaluation des effets sociaux du Fonds dEntraide Familiale. Sagissant de la femme, la politique gouvernementale sera oriente vers latteinte des principaux objectifs suivants : loprationnalisation du Fonds dEntraide Familiale, la consolidation de la stabilit familiale et lamlioration de la situation des femmes veuves et celles en situation difficile ; la mise en place dun systme provisoire de discrimination positive au profit de la femme en matire daccs aux postes de responsabilit ;
NOTE DE PRESENTATION
88
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
lencouragement de la participation de la femme aux structures de la socit civile et dans les partis politiques ; loprationnalisation des dispositions constitutionnelles relatives lgalit entre les femmes et les hommes en matire des droits et liberts caractre civil, politique, conomique, social, culturel et environnemental, ainsi qu la parit entre les hommes et les femmes ; le renforcement institutionnel et gographique des centres dcoute, de soutien juridique et psychologique des femmes violentes ; le renforcement de la lutte contre la violence lgard des femmes ; la mise en place des dispositifs et des mesures ncessaires pour la lutte contre la discrimination envers la femme ; la mise niveau des structures daccouchement dans le monde rural et la couverture des besoins mdicaux de la femme enceinte ; la mise en place des institutions constitutionnelles en relation avec la femme, la famille et lenfant ; et lappui aux associations prenant en charge ou soutenant les femmes en situation difficile. II.3.2.4. Mise niveau du monde rural et des zones de montagne La mise niveau du monde rural vise rduire les insuffisances dont souffrent les habitants concerns, plus particulirement dans les zones montagneuses, au niveau du revenu, de laccs aux quipements et aux services de base dans les domaines de lenseignement et de la sant, de lenclavement et de lloignement par rapport aux centres conomiques vitaux du pays. Grce aux efforts dploys jusqu prsent, des avances sensibles ont t enregistres. Ainsi, des programmes sont mis en uvre pour amliorer les performances du secteur agricole et diversifier les sources de revenus des populations rurales, pour relever les taux de scolarisation en milieu rural particulirement parmi les filles grce notamment la densification du rseau des tablissements denseignement fondamental et des logements correspondants pour les enseignants, la multiplication des internats et des cantines scolaires, lquipement des coles en installations sanitaires et en rseaux dassainissement et limplantation des infrastructures de soins de sant. Par ailleurs les programmes dadduction deau potable et dlectrification rurale ont enregistr des rsultats tangibles. Alors que le taux dlectrification ne dpassait pas 18 % en 1995, il a atteint 96,8 % en 2010. Le taux daccs leau potable, qui tait de 89 % en 2009 a t port 92 % en 2011 contre 14 % en 1994. Le rythme de ralisation du deuxime Programme National de Routes Rurales a t
NOTE DE PRESENTATION 89
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
acclr pour porter le linaire annuel ralis de 1 500 2 000 km en vue darriver dsenclaver le monde rural hauteur de 80 % en 2012 au lieu de lhorizon 2015 prvu initialement. Le taux de dsenclavement des populations rurales a atteint 73% fin 2011. Notons galement quun programme PACTE , est mis en place pour la couverture en moyens de tlcommunications de 9 263 localits. Ces localits sont situes dans 15 rgions, 55 provinces et 841 communes rurales et reprsentent 2 millions dhabitants, soit 17% de la population rurale et 7% de la population totale du Maroc. A fin juin 2011, ce programme a permis la desserte de 7269 localits soit 78%, ainsi que lamnagement des sites en vue de couvrir 1472 localits, soit 16% des localits cibles. Prcisons enfin, que pour atteindre les objectifs de la stratgie nationale de dveloppement intgr des zones de montagne et activer le rythme de ralisation des diffrentes interventions sectorielles tout en garantissant leur intgration, le Gouvernement procdera, dune part, la modification des dispositions rgissant le compte daffectation spciale intitul Fonds pour le Dveloppement Rural pour y intgrer les zones de montagne et, dautre part, laffectation audit compte dune enveloppe budgtaire dun milliard de dirhams pour la ralisation dactions au profit des zones rurales et montagneuses. II.3.2.5. Elargissement de laccs culturelles et sportives aux infrastructures
Llargissement de laccs des populations aux infrastructures culturelles et sportives rpond au souci de favoriser lpanouissement individuel et collectif des citoyens. Il sagit de favoriser laccs des populations, notamment les plus dfavorises, aux structures de loisir, danimation et de distraction avec le dveloppement des espaces verts, des salles omnisport, des piscines, des complexes socio ducatifs et des espaces de sport et danimation. Pour ce qui est des activits culturelles, les efforts ont t axs sur la gnralisation de limplantation des tablissements de proximit tels que les maisons de la culture, les thtres et les bibliothques et mdiathques publics et les conservatoires de musique qui sont raliss en partenariat entre lEtat et les collectivits locales, paralllement la poursuite de la ralisation des projets caractre national tels que le muse National des Arts contemporains Rabat et le Muse National de lArchologie et des Sciences de la Terre qui sont pris en charge par le Budget Gnral de lEtat avec le concours du Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et Social. Par ailleurs, et dans le cadre du dveloppement de linfrastructure culturelle, les travaux de ralisation du projet du grand thtre de Rabat ont t lancs dans la zone damnagement du Bouregreg sur une superficie couverte de 27.100 m2. Le cot global dudit projet est estim 1.350 MDH dont 400 MDH seront pris en charge par le Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et Social.
NOTE DE PRESENTATION
90
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
De mme, les travaux de ralisation du projet du grand thtre de Casablanca ont t lancs dans la place Mohammed V sur une superficie couverte de 24.000 m2.Le cot global de ce projet est valu 1.440 MDH dont 400 MDH seront pris en charge par le Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et Social et 280 MDH par la Rgion et la Commune urbaine de Casablanca. Pour ce qui est des activits sportives, une nouvelle feuille de route a t mise au point pour donner un contenu concret aux Hautes Orientations Royales contenues dans le Message adress par Sa Majest le Roi aux participants aux Assises Nationales du Sport tenues les 24 et 25 Octobre 2008, pour asseoir les bases dune bonne gouvernance du sport et imprimer un nouvel lan au sport national. Le dveloppement et lextension des infrastructures sportives du Ministre de la Jeunesse et des Sports vise la ralisation dune part, des installations sportives principales ou de premier ordre tels que les grands stades afin de permettre lorganisation de manifestations denvergure et le rayonnement du Maroc linternational et dautre part la ralisation des infrastructures sportives de proximit tels que les Centres sportifs de proximits (CSP), permettant laccs quitable une pratique sportive encadre pour lensemble des citoyens. A ce titre, le Ministre de la Jeunesse et du Sport vise dans son plan daction de raliser la construction de 1.000 CSP lhorizon 2016 dans le cadre de partenariat avec les collectivits locales. Le renforcement des infrastructures sportives sera poursuivi un rythme acclr. Il sagit dachever le stade dAgadir sur une superficie de 60 ha pour un cot de lordre dun milliard de dirhams dont lentre en service est prvue en 2012, et de lancer les travaux du grand stade de Casablanca sur une superficie de 100 ha pour un cot de lordre de 2 milliards de dirhams. Par ailleurs, il sera procd la poursuite de la rhabilitation des centres sportifs existants et llargissement de limplantation des espaces sportifs de proximit tels que les stades de quartiers et les salles couvertes dans le but dassurer la dissmination de la pratique des sports travers tout le pays. Cette opration sera mme de favoriser lmergence dquipes nationales performantes et de champions de demain dans les diffrentes disciplines sportives. Il convient de souligner galement la ralisation de lAcadmie Internationale dAthltisme Mohammed VI Ifrane et la construction de cinq centres rgionaux de formation.
NOTE DE PRESENTATION
91
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
TITRE II - DONNEES CHIFFREES
Les donnes chiffres du projet de loi de Finances pour l'anne 2012, comparativement celles de la loi de finances 2011, se prsentent comme suit: Le montant total des charges stablit 346 769 698 000 dirhams dont: 289 716 255 000 dirhams pour le budget gnral ; 2 649 359 000 dirhams pour les services de l'Etat grs de manire autonome (SEGMA) ; 54 404 084 000 dirhams pour les comptes spciaux du Trsor. Le montant total des ressources s'tablit 314 511 871 000 dirhams dont : 255 961 625 000 dirhams pour le budget gnral ; 2 649 359 000 dirhams pour les services de l'Etat grs de manire autonome (SEGMA) ; 55 900 887 000 dirhams pour les comptes spciaux du Trsor. Il ressort des chiffres ci-dessus un excdent des charges sur les ressources de 32 257 827 000 dirhams. La ventilation des charges et des ressources pour chacune des quatre composantes du tableau d'quilibre du projet de loi de Finances se prsente comme suit:
I - BUDGET GENERAL
I.1 Dpenses
Les dpenses du budget gnral sont ainsi rparties : Dpenses de fonctionnement Dpenses dinvestissement Dpenses de la dette amortissable et de la dette flottante Total I.1.1- Dpenses de fonctionnement Le montant des crdits ouverts au titre des dpenses de fonctionnement s'tablit 187 840 480 000 dirhams contre 151 993 796 000 dirhams pour l'anne 2011, soit une augmentation de 23,58 %. 187 840 480 000 DH 59 132 672 000 DH 42 743 103 000 DH 289 716 255 000 DH
NOTE DE PRESENTATION
92
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Ces crdits sont ainsi ventils : Dpenses de personnel : Les dpenses de personnel slvent 93 508 300 000 dirhams soit une augmentation de 8,68 %. Dpenses de matriel et dpenses diverses : Le montant des crdits ouverts au titre des dpenses de matriel et dpenses diverses slve 29 048 650 000 dirhams. Ces crdits se ventilent comme suit : Dsignation Redevances deau, dlectricit et de tlcommunications . Subventions aux tablissements publics et aux services de lEtat grs de manire autonome Autres dpenses de matriel. Charges communes-Fonctionnement : Le montant des crdits prvus au titre des charges communesfonctionnement s'lve 62 617 530 000 dirhams contre 36 456 400 000 dirhams pour l'anne 2011, soit une augmentation de 26 161 130 000 dirhams ou 71,76 % par rapport 2011 . Ces crdits sont destins essentiellement couvrir les charges de compensation des prix des denres de base et financer la contribution patronale de l'Etat la caisse Marocaine des Retraites. Dpenses imprvues et dotations provisionnelles : Le montant des crdits ouverts au titre de ce chapitre s'lve 2 666 millions de dirhams. Ces crdits couvrent : les dpenses exceptionnelles et les dpenses imprvues pouvant apparatre en cours d'anne ; le programme d'apurement des arrirs. Crdits 2012 (en dirhams) 1 434 211 068 10 702 352 370 16 912 086 562
NOTE DE PRESENTATION
93
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
I.1.2. Dpenses d'investissement Budget Gnral : Le montant des crdits de paiement prvus au titre des dpenses d'investissement s'lve 59,13 milliards de dirhams. A ces crdits de paiement s'ajoutent : les crdits d'engagement sur l'anne budgtaire 2013 et suivantes pour un montant s'levant 33,34 milliards de dirhams ; les crdits de report correspondant aux crdits engags dans le cadre de la loi de finances 2011 mais non ordonnancs au 31 Dcembre 2011, pour un montant estim 13,50 milliards de dirhams. Le montant total des crdits mis la disposition des administrations au titre des dpenses d'investissement s'lve ainsi 105,97 milliards de dirhams. Aux dpenses d'investissement du budget Comptes Spciaux du Trsor, des Collectivits Etablissements Publics et des Services de l'Etat (SEGMA). Le volume global des investissements milliards de dirhams en 2012. Comptes Spciaux du Trsor : Les programmes d'investissement financs dans le cadre des comptes spciaux du Trsor et non couverts par des transferts du Budget gnral s'lvent 10,16 milliards de dirhams et portent principalement sur le renforcement du rseau routier national, le soutien d'actions relevant des secteurs de l'agriculture, des eaux et forts, de l'levage, de l'audio-visuel, de l'habitat, de la justice, de la culture, des sports, de l'aide aux jeunes promoteurs et le financement de programmes socioducatifs. Collectivits Locales : Les budgets d'investissement des Collectivits Locales sont consacrs principalement la mise en place des infrastructures destines amliorer les conditions de vie des populations. Les efforts seront concentrs sur l'extension et le renforcement des rseaux de voirie et d'assainissement, les constructions d'infrastructures culturelles, sportives et de loisirs, de marchs et d'difices publics ainsi que les amnagements de jardins et d'espaces verts. Les dpenses y affrentes s'lvent globalement 12 milliards de dirhams environ. Entreprises et Etablissements Publics : Les programmes d'investissement des Entreprises et Etablissements Publics y compris ceux du Fonds Hassan II s'lvent globalement, pour l'anne 2012, 122,84 milliards de dirhams environ, couvrant principalement les secteurs suivants : l'nergie, les tlcommunications, l'habitat, l'agriculture, l'lectricit, l'eau potable, les phosphates et leurs drivs, les autoroutes et les transports ariens, maritimes et ferroviaires.
NOTE DE PRESENTATION 94
gnral, s'ajoutent celles des Locales, des Entreprises et Grs de Manire Autonome publics s'lve ainsi 188,30
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La consistance de ces programmes est dtaille dans le rapport spcifique tabli sur le secteur des Etablissements et Entreprises Publics. Services de l'Etat Grs de Manire Autonome : Les programmes d'investissement relevant des SEGMA s'lvent prs de 0,74 milliard de dirhams. Les dtails correspondants sont exposs dans le rapport consacr aux SEGMA. I.1.3- Dpenses de la dette flottante et de la dette amortissable Les crdits inscrits au titre du service de la dette publique comprenant le remboursement du capital et le rglement des intrts et commissions s'lvent 42 743 103 000 dirhams contre 36 534 258 000 dirhams pour l'anne 2011, soit une augmentation de 6 208 845 000 dirhams ou 17 %. Ces crdits se rpartissent comme suit : Dette extrieure : Les charges de la dette extrieure qui s'lvent globalement 7 623 090 000 dirhams, soit une augmentation de 3,10 % par rapport l'anne 2011,se rpartissent comme suit : 4 734 669 000 dirhams pour le capital, en augmentation de 1,61 % ; 2 888 421 000 dirhams pour les intrts et commissions, soit une augmentation de 5,64 %. Dette intrieure : Les charges de la dette intrieure qui s'lvent globalement 35 120 013 000 dirhams, soit une augmentation de 20,52 % , sont ainsi ventiles: 17 763 639 000 dirhams pour le capital, en augmentation de 30,19 %; 17 356 374 000 dirhams pour augmentation de 12,01 % . les intrts et commissions, en
I.2- Recettes
Le montant global des ressources du budget de l'Etat s'lve 314 511 871 000 dirhams. Ces recettes se rpartissent comme suit : (En Dirhams) Budget gnral .... SEGMA ........ Comptes spciaux du Trsor 255 961 625 000 2 649 359 000 55 900 887 000
NOTE DE PRESENTATION
95
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Le tableau ci-aprs rcapitule l'volution des recettes du Budget gnral par grandes catgories : (En dirhams) Projet de Loi de Loi de Finances Variation Dsignation Finances 2011 % 2012 (1) 1 - Impts directs et taxes assimiles 2 - Droits de douane 3 - Impts indirects 4 - Droits denregistrement et de timbre 5 - Produits et revenus du domaine 6 - Produits des monopoles et exploitations et des participations financires de lEtat 7 - Recettes demprunt, dons et legs 8 Produits de cession des participations de lEtat 9 - Autres recettes Total 71 480 000 000 12 070 500 000 75 623 500 000 13 690 000 000 464 500 000 (2) 66 928 000 000 12 778 000 000 67 677 000 000 12 283 000 000 348 500 000 (1-2)/2 6,80 -5,54 11,74 11,45 33,29
11 380 430 000 65 700 000 000
10 227 000 000 54 202 000 000
11,28 21,21 0,00 13,13 13,00
3 200 000 000 0 2 352 695 000 2 079 608 000 255 961 625 000 226 523 108 000
I.2.1- Impts directs et taxes assimiles le produit de l'impt sur le revenu s'lve 28 959 000 000 de dirhams contre 26 790 000 000 de dirhams en 2011, soit une augmentation de 8,10 %; le produit de l'impt sur les socits s'lve 41 543 000 000 de dirhams contre 39 245 000 000 de dirhams en 2011, soit une augmentation de 5,86 %. I.2.2- Droits de douane Les variations les plus importantes concernent : les droits d'importation dont les recettes s'lvent 9 890 000 000 de dirhams contre 11 200 000 000 de dirhams en 2011, soit une baisse de 11,70 %; le montant de la redevance du gazoduc slve 2 067 000 000 de dirhams. I.2.3- Impts indirects Les postes les plus importants connaissent les volutions ci-aprs: le produit de la TVA l'intrieur prise en charge par la Direction Gnrale des Impts s'lve 20 867 000 000 de dirhams contre 19 866 000 000 de dirhams en 2011, soit une augmentation de 5,04 %;
NOTE DE PRESENTATION
96
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
le produit de la TVA l'intrieur confie l'Administration des Douanes et Impts Indirects s'lve 782 000 000 de dirhams contre 809 000 000 de dirhams en 2011, soit une baisse de 3,34 %; le produit de la TVA l'importation s'lve 31 808 000 000 de dirhams contre 26 210 000 000 de dirhams en 2011, soit une augmentation de 21,36%; les recettes de la taxe sur les produits nergtiques s'lvent 13 200 000 000 de dirhams contre 12 305 000 000 de dirhams en 2011, soit une augmentation de 7,27 % ; la taxe sur les tabacs et les succdans de tabacs manufacturs s'lve 7 500 000 000 de dirhams ; la taxe intrieure de consommation sur les bires s'lve 750 000 000 de dirhams contre 738 000 000 de dirhams en 2011, soit une augmentation de 1,63% . I.2.4- Droits d'enregistrement et de timbre Les variations principalement : constates au niveau des prvisions concernent
les droits sur les mutations dont les recettes s'lvent 5 863 000 000 de dirhams contre 5 750 000 000 de dirhams en 2011, soit une augmentation de 1,97 %; les droits de timbre et le papier de dimension qui se chiffrent 510 000 000 de dirhams contre 490 000 000 de dirhams en 2011 , soit une augmentation de 4,08 %; la taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles dont les recettes s'lvent 1 510 000 000 de dirhams contre 1 445 000 000 de dirhams en 2011, soit une augmentation de 4,50 %; la taxe sur les assurances dont le produit s'lve 790 000 000 de dirhams contre 750 000 000 de dirhams en 2011, soit une augmentation de 5,33 % ; le timbre sur les documents automobiles dont les recettes s'lvent 770 000 000 de dirhams contre 730 000 000 de dirhams en 2011, soit une augmentation de 5,48 %. I.2.5- Produits et revenus du domaine Le produit des Domaines s'lve globalement 464 500 000 de dirhams dont: Le produit des ventes d'immeubles domaniaux ruraux s'lve 25 000 000 de dirhams; Les revenus des immeubles domaniaux s'lvent 435 500 000 de dirhams.
NOTE DE PRESENTATION 97
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
I.2.6- Monopoles et exploitations Les principales recettes prvues ce titre sont les suivantes : les produits provenir de Bank Al Maghrib s'tablissent 830 000 000 de dirhams ; les produits provenir de l'Office Chrifien des Phosphates s'tablissent 4 000 000 000 de dirhams ; les produits provenir de l'Agence Nationale de la Conservation Foncire, du Cadastre et de la Cartographie s'levant 2 000 000 000 de dirhams ; les produits provenir de la Caisse de Dpts et de Gestion s'lvent 500 000 000 de dirhams ; les dividendes provenir des participations financires de l 'Etat MarocTlcom s'lvent 2 141 000 000 de dirhams ; les dividendes provenir de la Socit Nationale du Transport et de la Logistique se montent 40 000 000 de dirhams. I.2.7- Recettes d'emprunt Les prvisions de recettes au titre des emprunts intrieurs passent de 33 645 000 000 de dirhams en 2011 44 500 000 000 de dirhams en 2012 soit une augmentation de 32,26 % ; Les prvisions de recettes au titre des emprunts extrieurs passent de 18 057 000 000 de dirhams en 2011 20 000 000 000 de dirhams en 2012 soit une augmentation de 10,76 %. I.2.8- Autres recettes Les autres recettes passent de 2 079 608 000 dirhams en 2011 2 352 695 000 dirhams en 2012, soit une augmentation de 13,13 %.
II- SERVICES DE L'ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME
Les ressources prvisionnelles des services de l'Etat grs de manire autonome pour l'anne 2012 s'tablissent 2 649 359 000 dirhams. Leurs dpenses se prsentent comme suit : Dpenses dexploitation .. Dpenses dinvestissement Total. 1 907 649 000 DH 741 710 000 DH 2 649 359 000 DH
NOTE DE PRESENTATION
98
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
III- COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Les prvisions des charges et des ressources des comptes spciaux du Trsor, pour lanne 2012 et leur volution par rapport l'anne 2011 se prsentent conformment au tableau ci-aprs : (en dirhams) Comptes Ressources Variation Plafond des Variation % Charges % 1- Comptes daffectation spciale 44 559 584 000 7,19 43 559 584 000 15,94 2- Comptes dadhsion aux organismes 494 000 000 55,84 internationaux 3- Comptes doprations montaires 1 000 000 000 0 0 4- Comptes de Prts 60 470 000 -16,43 70 000 000 250,00 5- Comptes davances 333 000 0 0 6-Comptes de dpenses sur dotations 10 280 500 000 10 280 500 000 0 Total. 55 900 887 000 7,66 54 404 084 000 12,90
NOTE DE PRESENTATION
99
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
TITRE III : PROGRAMME DACTION DES MINISTERES I - SECTEURS SOCIAUX
I.1- Education Nationale, Lutte contre lAnalphabtisme et Education Non Formelle
I.1.1- Dpartement de lEducation Nationale L'enveloppe budgtaire alloue au dpartement de lEducation Nationale au titre de l'anne 2012, s'lve 42 245 217 000 dirhams ventile comme suit : Dpenses de personnel... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 34 808 317 000 DH 4 436 900 000 DH 3 000 000 000 DH
Le plan daction du dpartement de lEducation Nationale pour lanne 2012 sinscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en uvre du programme durgence. Les principales actions prvues dans ce cadre pour lanne 2012 concernent lextension de loffre ducative, la leve des obstacles socio-conomiques ainsi que lamlioration du dispositif pdagogique. Sagissant de lextension de loffre ducative, les actions prvues sont : La cration de 290 nouveaux tablissements scolaires afin daugmenter le nombre total des tablissements de 9 705 en 2010-2011 9 995 en 2011-2012 rpartis entre 7 349 coles primaires, 1 706 collges et 940 lyces; La cration de 153 nouveaux tablissements en milieu rural, comprenant 89 coles primaires, 38 collges et 26 lyces; La construction de 4 466 nouvelles salles de classe, permettant daugmenter le nombre total des salles de classe de 136 760 en 2010-2011 141 326 en 2011-2012 rparties en 88 801 salles au primaire, 31 448 salles au secondaire collgial et 21 077 salles en secondaire qualifiant ; La construction de 112 nouveaux internats, ce qui permettra datteindre un nombre total de 594 internats ventils en 296 pour le secondaire collgial et 298 pour le secondaire qualifiant. Concernant la leve des obstacles socio-conomiques, les actions encourageant la demande de scolarisation seront poursuivies, notamment travers : Laugmentation du nombre de bnficiaires des cantines scolaires qui est pass de 1 163 896 en 2010-2011 1 295 430 bnficiaires en 2011-2012, dont 1.248.618 au primaire et 46.812 au secondaire collgial, soit un accroissement de 11,3%;
NOTE DE PRESENTATION
100
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Lextension de loffre en matire dinternats qui a permis daugmenter le nombre de bnficiaires qui est pass de 102 460 en 2010-2011 112 706 rpartis entre 56 035 internes en secondaire collgial et 56 671 internes en secondaire qualifiant ; Le relvement du nombre de bnficiaires de lInitiative Royale 1 million de cartables qui est pass en 2011-2012 4 102 377 bnficiaires, soit 52.805 bnficiaires additionnels par rapport 2010-2011; Le dveloppement du transport scolaire dont le nombre de bnficiaires a t port en 2011-2012 31 542, contre 30 995 en 2010-2011; Llargissement du champ des bnficiaires de luniforme scolaire 692 832 bnficiaires dont 74% au niveau de lenseignement primaire et 26% au niveau du secondaire collgial. Sagissant de lamlioration du dispositif pdagogique, les efforts dploys dans le cadre du programme durgence seront poursuivis travers un ensemble dactions relatives lamlioration de la qualit du systme ducatif, notamment : Le renforcement de lenseignement des sciences et technologies et de lorientation vers ces filires qui repose sur lexprimentation de la mise en place dune mthodologie de suivi dans le cycle primaire et le collgial et llaboration du dispositif pdagogique de mise en place dapprentissage de lveil dans le cycle qualifiant. De plus, le dpartement de lEN prvoit en 2012 la ralisation dune tude sur la situation de lenseignement des sciences et de la technologie et de lorientation vers ces filires ; La modernisation des outils pdagogiques qui se poursuivra travers la mise en place du laboratoire national des tudes et dexprimentation des outils pdagogiques, la poursuite de la mise en place des Centres Rgionaux des Technologies Educatives (CRTE) ainsi que par lexprimentation tendue des productions audio-visuelles d'enseignement des langues ; Lamlioration de la qualit du systme ducatif qui sera acclre en 2012 travers lexprimentation du systme national de qualit dans les centres de formation, le dveloppement du systme national d'valuation de la qualit et le lancement de l'exprimentation y affrente et la mise en uvre de la stratgie nationale du projet dtablissement dans tous les tablissements scolaires. I.1.2- Domaine de la lutte contre lanalphabtisme et lducation non formelle Lenveloppe budgtaire consacre, au titre de l'anne 2012, au domaine de la lutte contre lanalphabtisme et lducation non formelle s'lve 188 047 000 dirhams rpartie comme suit : Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 19 719 000 DH 168 328 000 DH
NOTE DE PRESENTATION
101
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Cette enveloppe permettra de poursuivre les efforts dploys au cours de lanne 2009-2010 pour latteinte les objectifs de la stratgie nationale de lalphabtisation et de lducation non formelle. I.1.2.1- Alphabtisation En 2012, les actions prvues portent sur : lacclration du rythme des ralisations en vue datteindre un rythme annuel dau moins 800.000 bnficiaires ; llargissement du champ dintervention travers le passage progressif de la logique de loffre la logique de la demande et linstauration des conditions de convergence entre les programmes dalphabtisation, les diffrents programmes de formation et de qualification et les diffrents projets sectoriels de lutte contre la pauvret ; lamlioration de la qualit des services travers la diversification des approches, des programmes et des outils en fonction des besoins exprims par les bnficiaires, lamlioration du professionnalisme dans la ralisation des programmes, la diversification des mcanismes de suivi et dvaluation et linstauration dun systme de certification et des passerelles pour linsertion. la mise en place des programmes de post-alphabtisation dans le but dviter le retour des no-alphabtes lanalphabtisme. I.1.2.2- Education Non Formelle Llaboration et la conduite du plan daction de lducation non formelle pour lanne 2011-2012 reposent principalement sur lavis mis par le Conseil Suprieur de lEnseignement concernant les programmes de lducation non formelle. Ainsi, quatre objectifs majeurs sont poursuivis, savoir: lextension de loffre de lducation non formelle pour atteindre 55.000 bnficiaires de lcole de la 2me chance (E2C); llargissement du programme daccompagnement scolaire pour les lves de lE2C insrs pour profiter 10.000 personnes et le suivi des lves insrs dans le cadre du sous-programme dinsertion immdiate des dcrocheurs devant profiter 30.000 bnficiaires ; laugmentation du taux dinsertion des bnficiaires de la rescolarisation pour atteindre 34% ; et lamlioration de la qualit de lintervention et de la bonne gouvernance du programme.
NOTE DE PRESENTATION
102
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
I.2-
Enseignement Suprieur, Formation des Cadres
Recherche
Scientifique
et
Lenveloppe prvue, au titre de lexercice 2012, pour le Ministre de lEnseignement Suprieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres slve un montant global de 8 803 980 000 dirhams rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 5 704 980 000 DH 2 099 000 000 DH 1 000 000 000 DH
Les mesures mettre en uvre dans le cadre du programme durgence pour lanne 2012 visent essentiellement lamlioration de loffre et de la qualit de lenseignement suprieur, la promotion de la recherche scientifique et la rsolution des problmatiques transverses du systme denseignement suprieur. I.2.1. Amlioration de loffre denseignement suprieur En matire dextension de loffre denseignement suprieur, les actions prvues portent notamment sur : la ralisation des travaux dextension des tablissements universitaires existants dont notamment les tablissements vocation scientifique et technique; le lancement des travaux de construction de cinq nouveaux tablissements : une facult des sciences et techniques Nador, une cole nationale de commerce et de gestion Bni Mellal, deux coles suprieures de technologies Kelaa des Sraghna et Khnifra et une cole suprieure darts appliqus Casablanca ; et la mise en uvre des travaux de rhabilitation et de maintenance systmatique de l'ensemble des tablissements universitaires existants. En matire de dveloppement, de diversification et de professionnalisation des offres de formation dans les universits, les mesures envisages se prsentent comme suit : laugmentation de 18% des effectifs des tudiants au niveau des universits pour passer de 350.820 tudiants contre 413.970 tudiants au titre de lanne 2011-2012; lorientation de prs 21% des tudiants du cycle licence vers les licences professionnelles et de plus de 51% des tudiants du cycle master vers les masters spcialiss; et le lancement des Filires Universitaires dEducation (FUE) suite au rattachement des Ecoles Normales Suprieures (ENS) et des Ecoles Normales Suprieures de lEnseignement Technique (ENSET) aux universits partir de 2009. Dans ce cadre, seize Filires Universitaires
NOTE DE PRESENTATION 103
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
dEducation seront accrdites sous forme de licence professionnelle ou master spcialis avec des modules disciplinaires, pdagogiques et didactiques. En matire damlioration du rendement interne et externe de l'enseignement suprieur, les mesures envisages portent sur : lamlioration du rendement interne de lenseignement suprieur et de lemployabilit des laurats; le lancement de nouvelles filires dans les tablissements accs ouvert avec des modules professionnalisants aux cinquime et sixime semestres de licence fondamentale et ce, dans lobjectif damliorer lemployabilit des laurats. Lesdits modules concernent un effectif de 56.000 tudiants; la mise en place, dans chaque tablissement, dun systme de tutorat par les enseignants et les tudiants doctorants devant profiter 56.195 tudiants; et la poursuite de la lutte contre le redoublement et le dcrochage universitaire travers notamment la rduction du taux dabandon en 1re anne de licence et laugmentation du taux de diplmation pendant la dure lgale du cycle de formation. En matire de formation du capital humain, il est prvu, dune part, de poursuivre loptimisation et lextension des facults de Mdecine pour atteindre les objectifs de linitiative de formation de 3.300 mdecins lhorizon 2020 et, dautre part, dadapter loffre de formation dispense par les universits aux besoins en ressources humaines ncessaires pour accompagner la mise en uvre des diffrentes stratgies sectorielles. En matire dmulation de lexcellence et de stimulation de linnovation, les actions envisages portent sur la distribution des prix dexcellence 3.900 tudiants au niveau des quinze universits et sur la gnralisation du programme INJAZ tous les tudiants de Master-Doctorat toutes filires confondues, inscrits dans les tablissements publics denseignement suprieur soit prs de 45.000 tudiants. En matire damlioration continue des services sociaux aux tudiants, le dpartement poursuivra ses efforts pour faciliter laccs lenseignement suprieur, et ce travers: laugmentation du nombre total de boursiers en le portant 177.000 en 2011-2012 contre 147.633 en 2010-2011; loctroi de bourses de mrite 50% des tudiants inscrits au Master et 70% des tudiants doctorants soit un total de 12.950 bnficiaires; laccroissement du nombre de rsidents dans les cits universitaires en le portant 44.000 en 2011-2012 contre 37.300 en 2010-2011;
NOTE DE PRESENTATION
104
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
laccroissement du nombre de repas servis aux tudiants de 4.078.000 repas pour atteindre un objectif de 11.480.000 repas en 2011-2012; le lancement des travaux de construction de nouvelles cits universitaires permettant daugmenter la capacit dhbergement de 19.000 lits, dont 7.000 lits pour la rentre universitaire 2011-2012 et 12.000 lits pour la rentre universitaire 2012-2013; et le lancement des travaux de construction de neuf nouveaux restaurants universitaires permettant daugmenter la capacit de restauration de 150%. I.2.2. Promotion de la recherche scientifique et technique Les mesures envisages pour la promotion de la recherche scientifique visent latteinte des objectifs quantitatifs spcifiques suivants: la production en 2012 de 3 079 publications dans des revues internationales indexes contre 1 990 en 2008; laccrditation de 83% des structures de recherche en 2012 contre 69% en 2008; la soutenance de prs de 1 975 thses en 2012 contre 820 en 2008; le dpt de 94 brevets au niveau des universits au titre de lanne 2011-2012 contre 70 en 2009-2010; le lancement de 475 projets de recherche applique en partenariat avec les entreprises; laugmentation du nombre danalyses ralises par les Units dAppui Technique la Recherche Scientifique (UATRS) dans lobjectif datteindre 15 000 analyses en 2012 contre 9 000 en 2009; la mobilisation de 110 experts marocains rsidents ltranger en 2012 contre moins de 70 en 2009. Sur le plan du renforcement des quipements et des infrastructures scientifiques, lanne 2012 sera caractrise par la poursuite de la ralisation des projets suivants: lquipement de lInstitut Marocain de lInformation Scientifique et Technique, des laboratoires de recherche et des units dappui la recherche scientifique et technique; la construction du nouveau sige de lInstitut National de Gophysique et des centres et laboratoires de recherche dans les domaines de leau et de lnergie; et la cration du rseau des sciences de lenvironnement et du centre dtudes et de recherches sahariennes.
NOTE DE PRESENTATION 105
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Concernant les actions prvues en 2012 dans le cadre du Fonds National de Soutien la Recherche Scientifique et au Dveloppement Technologique, le dpartement charg de lenseignement suprieur compte, dune part, lancer les premiers appels projets dans des domaines de recherche prioritaires autres que le domaine des technologies de linformation et de communication et, dautre part, financer une tude dorientation stratgique portant sur le lancement, le choix et le suivi des projets de recherche et de dveloppement dans le domaine des technologies de linformation et de la communication. Concernant loptimisation de la gestion des ressources humaines et le renforcement des comptences du personnel de l'enseignement suprieur, les actions prvues consistent en: le renforcement des mcanismes dencadrement, de suivi et dvaluation du personnel; la valorisation et la responsabilisation du personnel et linstitution dune meilleure gestion prvisionnelle du personnel de manire optimiser la gestion des ressources humaines; le dmarrage, au niveau de lensemble des universits, du programme de formation continue au profit du personnel pdagogique, administratif et technique permettant le renforcement de leurs comptences. A cette fin, un programme a t prpar pour assurer la formation continue de 11.158 enseignants des universits et de 7 233 cadres et agents administratifs et techniques relevant de ces tablissements. Les indicateurs chiffrs atteindre, dans ce cadre, en 2012 se prsentent comme suit : 3 251 enseignants bnficiaires de la formation continue ltranger, soit 29% de leffectif global ; 784 nouveaux enseignants bnficiaires de la formation pdagogique; 3 663 enseignants titulaires bnficiaires de la formation pdagogique ; et 2 921 administratifs et techniciens bnficiaires de la formation continue soit 40% de leffectif global. Sagissant de lamlioration de la gouvernance du systme, le ministre de lenseignement suprieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres projette de mettre en place, dune part, les mcanismes ncessaires lamlioration de la gouvernance et la rationalisation de lutilisation des ressources humaines et matrielles des universits, du CNRST et de lONOUSC et dautre part, un systme de pilotage, de suivi et dvaluation des diffrents projets inscrits au programme durgence.
NOTE DE PRESENTATION
106
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
I.3. Emploi et Formation Professionnelle
L'enveloppe budgtaire alloue au Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, au titre de lanne 2012, slve 1 065 612 000 dirhams. Elle est ventile comme suit : Dpenses de personnel....... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement. 215 512 000 DH 358 400 000 DH 491 700 000 DH
I.3.1. Domaine de lEmploi Les crdits inscrits pour lanne 2012 au profit du domaine de lEmploi slvent 394 018 000 dirhams, rpartis comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement. 164 668 000 DH 84 650 000 DH 144 700 000 DH
Les principales actions programmes en 2012 par le Dpartement de lEmploi portent : Concernant le domaine de la protection sociale des travailleurs, sur: la poursuite de la rforme des rgimes de protection sociale et des travaux visant le maintien de lquilibre financier des caisses de protection sociale et de la mise en uvre des recommandations formules par les tudes actuarielles ; la mise en uvre de lIndemnit pour Perte de lEmploi au profit des travailleurs ; lorganisation de campagnes de sensibilisation et dinformation au profit des partenaires socio-conomiques en vue de vulgariser les nouvelles dispositions lgislatives et rglementaires relatives aux rgimes de protection sociale. Concernant le domaine du travail, sur: la poursuite de la mise en uvre de la fonction du contrle de lapplication de la lgislation du travail et le parachvement du cadre juridique de la relation et des conditions du travail ; la promotion de lgalit au travail et linstitutionnalisation du genre dans le milieu du travail;
NOTE DE PRESENTATION 107
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la gestion du dialogue social thmatique dans le cadre des institutions consultatives tripartites; la poursuite du suivi de la mise en place des institutions reprsentatives du personnel par les entreprises; la ratification de nouvelles conventions internationales et arabes du travail; la structuration de larbitrage en tant que mode de rsolution des conflits au travail; la promotion et la vulgarisation des droits fondamentaux au travail; et lexcution des engagements rsultant du statut avanc avec lUnion Europenne. Concernant le domaine de la promotion demploi, sur: la poursuite du programme doctroi des aides pour la formation des jeunes en vue de leur insertion dans la vie active travers la contribution de lEtat dans le cadre des dispositifs grs par lAgence Nationale de Promotion de lEmploi et des Comptences; la mise en place de deux mesures pour la promotion de lemploi dcent dans le cadre dune convention de partenariat entre lEtat et la Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc, visant linsertion de 275 000 chercheurs demploi durant la priode 2012-2016 savoir : la formation insertion, contrat premier emploi amlior, ayant pour objectif dassurer la couverture sociale aux bnficiaires des contrats de formation insertion ; le contrat dintgration professionnelle visant assurer, aux jeunes diplms en difficult dinsertion, une formation intgration pendant une priode de 6 9 mois dbouchant sur un contrat dembauche. le suivi de la mise en uvre du programme Moukawalati par : lamlioration continue de la qualit des services offerts aux porteurs de projet travers la formation continue des jeunes slectionns; le dveloppement du partenariat local pour encourager lauto-emploi et les activits gnratrices de revenus ; et le dveloppement des synergies entre le programme Moukawalati et dautres programmes notamment lINDH. la poursuite de la ralisation du programme dtudes et denqutes sur lvolution du march de lemploi.
NOTE DE PRESENTATION
108
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Par ailleurs, le programme de lAgence Nationale de Promotion de lEmploi et des Comptences (ANAPEC), au titre de lanne 2012, comprend les principales mesures suivantes : La poursuite de la mise en uvre de la politique de promotion de lemploi travers les programmes MOUKAWALATI, TAEHIL et IDMAJ : Le programme IDMAJ permettra linsertion de 60.000 chercheurs demploi dans le cadre du contrat Insertion Amlior (CIAM) et du Contrat dIntgration Professionnelle (CIP); Le programme TAEHIL prvoit lidentification de la formation pour insertion au profit de 20.000 chercheurs demploi. Ladite formation prendra deux formes : la formation contractualise pour lemploi et la formation qualifiante principalement dans les domaines de la communication, de linformatique et de la mthodologie de recherche dun emploi ; Le programme MOUKAWALATI ambitionne daccompagner 2 000 bnficiaires en 2012 et de renforcer la cration des petites entreprises principalement dans les secteurs du tourisme rural et de lenseignement primaire. La mise en uvre des dispositifs de promotion de lemploi dcent. Il sagit, en loccurrence, des dispositifs de formation insertion amliors et dintgration professionnelle ; Le dveloppement du placement linternational par la prospection dopportunits demploi ltranger. Le financement de ces diffrentes mesures est imput sur le compte daffectation spciale Fonds pour la Promotion de lEmploi des Jeunes . I.3.2.Domaine de la Formation Professionnelle Lenveloppe budgtaire alloue au dpartement de la Formation Professionnelle, pour lanne 2012, slve 671 594 000 dirhams et se rpartit comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement. 50 844 000 DH 273 750 000 DH 347 000 000 DH
Les principales actions prvues au titre de lexercice 2012 portent sur la concrtisation du Plan dUrgence dans le domaine de la formation professionnelle, laccompagnement de la mise en uvre du pacte national pour lmergence industrielle, de la stratgie nationale des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique, ainsi que sur dautres oprations hors plan durgence et des actions continues du Dpartement de la Formation Professionnelle.
NOTE DE PRESENTATION 109
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Concernant le Plan dUrgence dans le domaine de la formation professionnelle, les actions prvues se prsentent comme suit : le lancement de la ralisation dun Centre de Formation par Apprentissage (CFA) agricole au niveau de la commune rurale Lakhsasse, lextension de cinq CFA situs dans les communes rurales Oulad Bougrine, Attaouia, Khmiss Mettouh, Jma Sham et Oued Amlil et lquipement des CFA de Kalat Mgouna, Azilal, Larache et Lakhsasse pour le secteur agricole ; lachvement de la construction et lquipement de trois CFA (Ttouan, Taourirte et Oujda) pour le secteur de lartisanat ; la poursuite de llaboration de 14 programmes de formation par apprentissage selon lapproche par comptences, des guides dappui correspondant ainsi que limplantation de 17 programmes dans trois CFA ; la poursuite de leffort de contribution aux frais de formation dans les tablissements privs accrdits afin de renforcer la capacit de soutien du secteur priv laction publique en matire dducation et de formation ; loctroi de subventions dapprentissage pour la ralisation des programmes de formation dans le cadre de conventions avec les dpartements formateurs, notamment lArtisanat et lAgriculture ainsi que certaines ONG; et le renforcement du rle de la formation professionnelle travers la synergie et la convergence avec lInitiative Nationale pour le Dveloppement Humain (INDH). Concernant laccompagnement de la mise en uvre du pacte national pour lmergence industrielle, les actions prvues en 2012 portent sur la poursuite de la ralisation du rseau dInstituts de Formation dans les Mtiers de lIndustrie Automobile (IFMIA) travers la construction des trois IFMIA Casablanca, Tanger TFZ et Knitra, la construction de linternat de lIFMIA / Tanger et le dveloppement et la mise en place du dispositif de formation professionnelle dans le secteur de lautomobile. Sagissant de laccompagnement de la stratgie nationale des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique, il est prvu de raliser trois Instituts de Formation aux Mtiers des Energies Renouvelables et de lEfficacit Energtique (IFMEREE). Les autres oprations hors plan durgence, prvues en 2012 consistent en la ralisation du CFA maritime Boujdour et du CFA multisectoriel la commune de Had Oulad Fraj dans le cadre de la convergence des programmes dapprentissage avec lINDH en partenariat avec lassociation Projet Aide . Les actions continues du Dpartement de la Formation Professionnelle, prvues en 2012 portent sur le lancement dune tude de suivi de linsertion des laurats, lassistance technique pour la mise en uvre de la qualification des organismes de conseil et de formation en cours d'emploi, le lancement dune tude d'valuation et d'audit pour la qualification des filires de
NOTE DE PRESENTATION 110
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
formation et lassistance technique pour la validation des acquis de lexprience professionnelle dans le secteur de lhtellerie. Pour sa part, l'OFPPT continuera l'accompagnement des programmes de dveloppement conomique et social lancs par l'Etat notamment le Pacte National pour l'Emergence Industrielle et les politiques intgres pour le dveloppement des mtiers mondiaux du Maroc et autres secteurs stratgiques. A cet effet, l'OFPPT procdera, en 2012, la consolidation des projets entams, l'tude et la ralisation de nouveaux tablissements et internats, la restructuration et la cration de nouvelles filires porteuses, la rhabilitation des anciens tablissements et internats et l'acquisition dquipements nouveaux. Ainsi, lOFPPT a accueilli pour la rentre 2011-2012, un effectif de 280.000 stagiaires, soit une augmentation de 12 % par rapport 2010-2011. Enfin, lEcole Suprieure de Cration et de Mode Casablanca sera quipe en 2012 en matriel didactique et pdagogique.
I.4- Solidarit, Femme, Famille et Dveloppement Social
L'enveloppe budgtaire globale alloue au Ministre de la solidarit, de la femme, de la famille et du dveloppement social au titre de lanne 2 012, slve 637 199 000 dirhams, ventile comme suit : Dpenses de personnel..... Dpenses de matriel et dpenses diverses.. Dpenses d'investissement 39 849 000 DH 418 850 000 DH 178 500 000 DH
Le plan dintervention du Ministre charg de la solidarit de la femme, de la famille et du dveloppement social pour lanne 2012 prvoit la ralisation des principales actions suivantes : Premier volet : rduction de la pauvret la mise en uvre du Cadre Stratgique national de rduction de la pauvret en partenariat avec les ministres concerns aprs validation du plan daction ; llargissement du Programme de lutte contre la mendicit ; la poursuite du suivi de lapplication de la loi n14-05 relative aux conditions douverture et de gestion des tablissements de protection sociale travers la contribution la mise niveau desdits tablissements et lvaluation de limpact de ladite loi.
NOTE DE PRESENTATION
111
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Deuxime volet : promotion de la famille, de lenfance et des personnes ges et handicapes lamlioration de la coordination nationale pour la promotion des droits de lenfant; le renforcement des structures de proximit de protection de lenfance; le lancement et la mise en uvre des programmes de convergence territoriale pour lEnfance PACTE Casablanca, Tanger, Marrakech et Sal; la promotion des droits des personnes ges et llaboration dune vritable politique familiale; la mise en uvre de la stratgie nationale de dveloppement inclusif des personnes handicapes et lamlioration de leur assistance ; le dveloppement dune politique familiale intgre qui permet le renforcement de la solidarit familiale ainsi que la promotion des services de mdiation familiale ; le suivi des effets sociaux de lapplication du code de la famille ; le soutien des familles en situation prcaire et celles prenant en charge les personnes ges ou handicapes. Troisime volet : promotion des droits des femmes la promotion de laccs des femmes aux postes de responsabilit et de dcision; la dynamisation des mcanismes de lutte contre la violence lgard des femmes; la promotion de lgalit entre les femmes et les hommes en matire des droits politiques, socio-conomiques et culturels ; lamlioration de la qualit de prise en charge des femmes enceintes au sein des tablissements de soin de base ; lappui aux associations qui prennent en charge les femmes en situation prcaire ; le renforcement des institutions et des structures ddies la femme et lextension des espaces multifonctionnels.
I.5. Sant
Le montant des crdits inscrits au profit du Ministre de la Sant s'lve, au titre de lanne 2012, 11 880 384 000 dirhams se rpartissant comme suit :
NOTE DE PRESENTATION 112
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Dpenses de personnel... Dpenses de matriel et dpenses diverses... Dpenses d'investissement.
6 652 384 000 DH 3 428 000 000 DH 1 800 000 000 DH
Le plan dintervention du Ministre de la Sant pour lanne 2012 se dcline, par axe, comme suit : Axe 1 : dveloppement dune offre de soins de qualit et rpartie correctement. Dans ce cadre, il est prvu: dtendre le rseau hospitalier, et ce travers la mise niveau des hpitaux prvus dans le cadre du Projet Sant Maroc III , la poursuite des travaux de construction des hpitaux rgionaux, provinciaux et locaux ainsi que la modernisation des quipements du rseau hospitalier, des centres dappareillage pour les handicaps et la cration de SAMU; dadopter une politique de mdicament dont lobjectif est dassurer la disponibilit des mdicaments et des produits pharmaceutiques qualit soutenable et tarifs rduits. Cette politique pourra notamment tre concrtise travers la rvision du processus dachat des mdicaments et dispositifs mdicaux ainsi que lamlioration de la gestion des acquisitions des mdicaments dans les hpitaux publics ; damliorer le dispositif relatif la sant en milieu rural travers le renforcement de la couverture sanitaire mobile et lamlioration de laccs de la population rurale des soins de sant essentiels de qualit ; damliorer les indicateurs de la sant notamment ceux lis la sant de la mre et de lenfant travers la rduction de la mortalit maternelle; de renforcer les ressources humaines moyennant le dveloppement de la formation continue et de la formation de base des paramdicaux et lamlioration de la gestion des ressources humaines et ce dans lobjectif de renforcer leurs comptences et de rduire les disparits en terme de rpartition territoriale ;et daugmenter les crdits destins la poursuite de la modernisation des quipements des formations hospitalires travers notamment les travaux de maintenance des quipements et de lentretien des btiments et installations techniques. Axe 2 : la mise en uvre de plans nationaux spcifiques de prvention et de lutte contre les maladies Le Ministre de la Sant continuera dployer les efforts ncessaires pour mettre en uvre les plans nationaux spcifiques de prvention et de lutte contre les maladies. Ainsi, il est prvu la programmation des actions suivantes :
NOTE DE PRESENTATION 113
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La poursuite des efforts de prvention et de lutte contre le cancer travers la cration de centres doncologie rgionaux et de centres doncologie de proximit. A cet effet, les dotations budgtaires alloues la mise en uvre du plan national de lutte contre le cancer seront renforces pour atteindre 80 MDH contre 47,9 MDH en 2011 soit une augmentation de 67 %; La poursuite des efforts de prise en charge de linsuffisance rnale chronique terminale travers la cration de centres de dialyse, la location du matriel ncessaire et le renforcement des programmes de greffes dorganes; La rduction de la mortalit maternelle et infantile travers la consolidation de la gratuit des soins obsttricaux et nonataux, la mise niveau des maternits hospitalires et maisons daccouchement et la cration des services rgionaux de nonatologie et de SAMU obsttricaux. Lenveloppe budgtaire ncessaire la ralisation de ces actions slve 87,9 MDH en 2012 contre 48,6 MDH en 2011 soit une hausse de prs de 81%. Axe 3 : le repositionnement stratgique des diffrents intervenants dans le domaine de la sant. Dans le cadre de cet axe, qui consiste consacrer une place privilgie aux rgions sanitaires, il est prvu de donner une acclration au processus de rgionalisation par la consolidation de la mise en place de la nouvelle organisation rgionale la lumire des nouvelles attributions des rgions sanitaires. Axe 4 : la poursuite de laccompagnement de la gnralisation du RAMED. Aprs lexprience pilote, le Gouvernement sest engag gnraliser le RAMED aux autres rgions du Royaume en 2012 pour atteindre environ 8,5 millions de bnficiaires.
I.6. Habitat, Urbanisme et Politique de la ville
Le montant total des crdits programms au titre de lanne 2012 au profit du Ministre de lHabitat, de lUrbanisme et de la Politique de la ville slve 3 592 567 000 dirhams rpartis comme suit:
Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. Fonds Solidarit Habitat et Intgration Urbaine..
251 677 000 DH 338 390 000 DH 1 002 500 000 DH 2 000 000 000 DH
La ventilation de ces crdits par domaine dintervention se prsente comme suit:
NOTE DE PRESENTATION 114
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
I.6.1- Domaine de lHabitat Lenveloppe budgtaire prvue au profit du domaine de lHabitat au titre de lanne 2012, slve 3 051 918 000 dirhams rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement Fonds Solidarit Habitat et Intgration Urbaine.. 157 273 000 DH 24 915 000 DH 869 730 000 DH 2 000 000 000 DH
Cette enveloppe permettra de poursuivre la mise en uvre de la stratgie du dpartement visant rpondre, de manire plus approprie, aux besoins de rsorption et de prvention de lhabitat insalubre, de promotion de lhabitat social et danticipation du dveloppement urbain. Les actions prvues en 2012 portent sur la poursuite de la ralisation des programmes suivants : Programme Villes Sans Bidonvilles qui vise radiquer lensemble des bidonvilles recenss au niveau de 85 villes et centres au profit de 348.400 mnages. A fin Septembre 2011, 178.900 mnages ont bnfici des units ralises. Le poids dmographique des bidonvilles par rapport la population urbaine est ainsi pass 4% en 2010 contre 8% en 2004. Pour sa part, le nombre de villes dclares sans bidonvilles slve actuellement 44. Il y a lieu de noter que les efforts seront poursuivis pour lacclration du rythme de ralisation des projets de lutte contre lhabitat insalubre au niveau du Grand Casablanca abritant le tiers des bidonvilles recenss au niveau du Royaume. Lesdits projets ont dj bnfici 43.000 mnages. Programme dhabitat social dans les provinces du sud de Royaume dont les principales actions portent sur : la mise niveau urbaine avec un cot de 462,16 MDH ; lappui la construction avec un cot de 508,52 MDH; laccompagnement technique et social avec un cot de 291 MDH ; lachvement des oprations damnagement de lots dj engags dans le cadre de lancien programme avec un cot de 344,06 MDH ; la viabilisation de 36.496 lots de terrain un cot de 2.369,63 MDH ; la construction de 650 logements pour un cot de 97,8 MDH ; le dveloppement de lhabitat dans le monde rural et certains centres dfavoriss avec un cot de 22,55 MDH.
NOTE DE PRESENTATION 115
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Programme de construction de logements militaires qui vise la construction de 80.000 units avec un cot global de 16.000 MDH dont une subvention de 600 MDH provenant du Fonds Solidarit Habitat. Programme de mise niveau urbaine A fin Dcembre 2011, ce programme compte 432 conventions en cours de ralisation pour un cot global de 14.160 MDH. La participation de lEtat est de 7.860 MDH dont 4.700 MDH ont t dj dbloqus. Parmi les principaux projets engags, il y a lieu de citer : le programme de dveloppement urbain de la ville de Tanger, au titre de la priode 2009-2013, avec une contribution du dpartement de lhabitat de 350 MDH ; le programme de dveloppement urbain de la ville de Ttouan, au titre de la priode 2009-2012, avec une contribution du dpartement de lhabitat de 300 MDH ; le programme de mise niveau de la ville de Fs avec un cot global de 756 MDH dont une participation du Fonds Solidarit Habitat de 250 MDH ; la requalification urbaine de la ville de Benguerir avec un cot global de 166 MDH ; la requalification urbaine de la ville dOujda pour un cot de 130 MDH; la mise niveau des quartiers sous quips de la ville d'El Kala pour un cot de 123 MDH ; et la requalification urbaine de la ville de Nador moyennant un cot de 100 MDH. Programme des villes nouvelles et des ples urbains. Les travaux seront poursuivis au niveau de deux nouveaux projets : Chrafat proximit de Tanger sur 770 ha avec un investissement de 18,5 MMDH ; Lakhyayta dans la rgion de Chaouia Ouardigha proximit de Casablanca sur 1.560 ha. Programme de logements faible cot. Pour rappel, laccent est mis sur la dynamisation des projets de logement faible cot qui se rpartissent en trois catgories de logement en fonction de leur valeur: 140.000 DH, 200.000 DH et 250.000 DH. A noter que les autorisations ont t accordes aux promoteurs immobiliers pour la ralisation de 155.000 units 250.000 DH.
NOTE DE PRESENTATION 116
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
I.6.2-Domaine de lUrbanisme Les crdits consentis au domaine de lUrbanisme, au titre de lanne 2012, slvent 450 098 000 dirhams rpartis, comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 40 233 000 DH 290 865 000 DH 119 000 000 DH
Cette enveloppe budgtaire vise principalement laccompagnement des Agences Urbaines dans les missions qui leur sont dvolues notamment en ce qui concerne la gnralisation de la couverture du territoire en documents durbanisme ainsi que la ralisation des objectifs suivants : soutenir la politique de lhabitat par louverture de nouvelles zones lurbanisation; planifier et organiser lextension des zones bties et amnages; acclrer ltablissement des documents durbanisme ou le renouvellement des documents arrivs chance; renouveler rgulirement la couverture des zones urbaines et pri-urbaines en photos restitution ; poursuivre la ralisation des tudes relatives aux projets de territoires comme outil de dveloppement local; accompagner le programme Villes sans bidonvilles et les projets de mise niveau urbaine ; laborer des chartes architecturales identifiant les rfrences en matire darchitecture locale ; simplifier les procdures dautorisation, notamment par la mise en place de guichets uniques ; instituer une procdure de drogation au profit des projets dinvestissement et des projets ayant un impact socio-conomique et urbanistique important ; et mettre niveau larsenal juridique et rglementaire de lurbanisme. Ainsi, les enveloppes budgtaires annuelles accordes ce dpartement ont permis la gnralisation des agences urbaines lensemble des rgions du Maroc, la dynamisation et la rorientation de leurs activits afin de les riger en outils de dveloppement urbain et de mise niveau des agglomrations.
NOTE DE PRESENTATION
117
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
I.6.3- Domaine du dveloppement territorial Lenveloppe budgtaire prvue au profit du domaine du dveloppement territorial, au titre de lanne budgtaire 2012, s'tablit 90 551 000 dirhams, ventile comme suit: Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 54 171 000 DH 22 610 000 DH 13 770 000 DH
En matire de dveloppement territorial, lanne 2012 sera notamment marque par la poursuite de la ralisation des tudes rgionales, des actions de lutte contre la dsertification et la pauvret par la sauvegarde et la valorisation des oasis ainsi que les actions menes en partenariat avec le PNUD tel que le programme de mise en place de lagenda 21 national. Enfin, en 2012, et conformment au programme gouvernemental approuv par le Parlement, le Ministre de lHabitat, de lUrbanisme et de la Politique de la Ville prvoit la ralisation de quelques projets et programmes affrents la Politique de la Ville dans le cadre dune stratgie volontariste, inclusive et participative, fonde sur une approche intgre et partenariale, et qui vise le renforcement du rle de la ville en matire de dveloppement conomique, la rduction des signes de vulnrabilit et dexclusion sociale au niveau des zones urbaines sensibles marques par la forte pression sociale et des dficits dquipement et daccs aux services publics.
I.7- Culture
Lenveloppe prvue au titre de lexercice 2 012, pour le Ministre de la Culture, slve un montant global de 573 974 000 dirhams, rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 199 574 000 DH 139 400 000 DH 235 000 000 DH
Dans ce cadre, les projets programms portent sur les axes suivants: Axe1 : Le dveloppement de linfrastructure culturelle par la ralisation des grands projets culturels, dont notamment : lachvement des travaux de construction de deux grands projets culturels dont la ralisation est prvue pour fin 2012 savoir le Muse National des Arts Contemporains dune superficie construite de 6.813 m2 pour un cot de 200 MDH et lInstitut National de Musique et des Arts Chorgraphiques dune superficie couverte de 17.400 m2 pour un cot de 193 MDH ;et
NOTE DE PRESENTATION
118
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la ralisation des travaux dtudes architecturales du Muse National de larchologie et des Sciences de la Terre qui sera situ dans la zone damnagement du Bouregreg pour un cot global de 160 MDH dont 70 MDH seront pris en charge par le Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et Social. Axe2 : La modernisation de l'administration et la consolidation de la gouvernance, travers: la ralisation des travaux de restauration, damnagement et dquipement des locaux de ladministration centrale et la poursuite de la construction des siges au profit des seize directions rgionales ; lquipement de ladministration centrale et des directions rgionales en moyens bureautiques et informatiques ; et la poursuite des efforts visant doter lensemble du territoire national de maisons de culture et de complexes culturels pour atteindre un rseau de 80 maisons de culture. Axe3 : La promotion du livre et de la lecture publique travers notamment: la poursuite des efforts visant lextension et le renforcement de linfrastructure bibliothcaire et des mdiathques par la ralisation doprations de construction, de rhabilitation et dquipement au profit de 120 bibliothques publiques et espaces de lecture ; lencouragement de la lecture publique par la cration despaces de lecture et lorganisation de salons du livre dont la 18me dition du salon international de ldition et du livre; et la poursuite de lencouragement de ldition par le soutien la publication et la diffusion du livre, lencouragement des publications des jeunes auteurs et loctroi du prix du Maroc du livre. Axe4 : La promotion des arts thtraux, musicaux et graphiques par : lamnagement sur le territoire national despaces ddis la prsentation des uvres thtrales et loctroi dun soutien financier pour la production de quinze pices thtrales slectionnes ; et la ralisation dun nouveau sige pour le conservatoire de musique de Rabat pour un cot de 11 MDH, lachvement de la construction du conservatoire de musique dOujda pour un cot de 7,5 MDH et lexcution des travaux de restauration et dquipement en instruments de musique au profit du rseau des conservatoires de musique et de danse existants. Axe5 : La conservation et la promotion du patrimoine monumental, archologique et ethnographique travers la ralisation en 2012 des actions suivantes :
NOTE DE PRESENTATION 119
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la restauration des murailles des villes de Sefrou, Demnate, Taza, Taroudant, Essaouira, Tiznit et Sal; et la poursuite du projet de rhabilitation de la mdina de Ttouan dont le cot est estim 10 MDH et des travaux de prservation, de restauration et de mise en valeur de neuf sites archologiques, cinq monuments historiques, cinq bibliothques anciennes, cinq kasbas et deux medersas. Par ailleurs, le Ministre de la Culture mobilisera, par le biais du Fonds National pour lAction Culturelle , des fonds additionnels provenant du partenariat et des ressources propres gnrs par les droits dentres aux diffrents difices culturels, aux monuments et sites historiques, et ce dans lobjectif de contribuer la promotion de la lecture publique et ldition et la diffusion du livre, lappui aux activits thtrales notamment au niveau rgional, lorganisation de divers festivals culturels et artistiques, au soutien aux associations culturelles et artistiques, la couverture mdicale des artistes ainsi qu la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine monumental et musographique.
I.8- Habous et Affaires Islamiques
Les crdits allous au Ministre des Habous et des Affaires Islamiques, pour lanne 2012, slvent 3 212 709 000 dirhams, ventils comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 268 709 000 DH 1 734 000 000 DH 1 210 000 000 DH
Depuis 2004, le Gouvernement a engag une profonde refonte du champ religieux travers le renfoncement de lencadrement religieux de la population, lamlioration des rtributions matrielles des prposs religieux, la valorisation de lenseignement traditionnel, llaboration dun plan national pour la construction et la mise niveau des mosques. Ces actions ont t accompagnes dune rorganisation administrative ainsi que dune politique soutenue de dconcentration. Pour lanne 2012, les projets prvus consistent notamment en : la revalorisation des indemnits des imams des mosques et la prise en charge par le budget de lEtat de leur couverture mdicale ainsi que celle de leurs ayants droit ; lencadrement et la formation continue de plus de 50.000 imams des mosques ; la poursuite du programme de formation des imams et morchidates (environ 200/an) appels exercer dans les diffrentes mosques du Royaume; le renforcement de la politique de proximit travers les conseils locaux des oulmas et du conseil marocain des oulmas pour lEurope ;
NOTE DE PRESENTATION 120
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
le renforcement des services sociaux au profit des prposs religieux travers la Fondation Mohammed VI pour la Promotion des Oeuvres Sociales des Prposs Religieux ; la promotion et le dveloppement du secteur des habous publics en collaboration avec le Conseil Suprieur pour le contrle des finances des habous publics ; ldition par la Fondation Mohammed VI pour lEdition du Saint Coran dun million dexemplaires du Livre Saint et sa diffusion aux diffrentes provinces du Royaume ainsi quaux pays amis notamment en Afrique ; lorganisation de crmonies religieuses et loctroi des prix et rcompenses dans divers domaines de la recherche et de la pense islamiques ; le renforcement du programme de lutte contre lanalphabtisme dans les mosques du Royaume ; la mise en uvre de la 1re tranche du programme national de mise niveau des mosques menaant ruine dans les diffrentes provinces et prfectures du Royaume aprs lachvement de la phase dexpertise, de diagnostic et dtudes ayant concern plus de 19.000 mosques ; ldification des mosques dans les quartiers dfavoriss des grandes villes et la construction de petites mosques en milieu rural ainsi que la poursuite du programme damnagement, de rfection et dquipements des mosques ; la poursuite de la construction des complexes culturels et administratifs dans les principales villes du Royaume ; la restauration du patrimoine historique ; et la mise niveau des tablissements de lenseignement traditionnel et la mise en uvre du programme de formation de son personnel enseignant et administratif.
I.9- Haut Commissariat aux Anciens Rsistants et Anciens Membres de lArme de Libration
Lenveloppe budgtaire prvue au profit du Haut Commissariat aux Anciens Rsistants et Anciens Membres de lArme de Libration, pour lanne 2012, slve 126 128 000 dirhams, rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 48 224 000 DH 67 973 000 DH 9 931 000 DH
Ces crdits sont destins notamment la ralisation des principales actions suivantes :
NOTE DE PRESENTATION 121
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Actions caractre conomique et social, il sagit notamment de: la prise en charge de lassurance mdicale de base et complmentaire des anciens rsistants et anciens membres de lArme de Libration et leurs ayants droit ; la contribution lacquisition de terrains ou de logements au profit des anciens rsistants et anciens membres de lArme de Libration; lquipement des centres de formation professionnelle ddis la formation des enfants des anciens rsistants ; et laide la cration ou lextension des coopratives et la ralisation de projets conomiques au profit de la famille de la rsistance. Paralllement, le Haut commissariat continuera apporter son soutien aux plus ncessiteux de la famille de la rsistance, en leur octroyant des secours directs et en accordant des aides pour frais de spulture aux ayants droit des anciens rsistants dcds. Actions relatives la mise en relief de lhistoire de la rsistance, consistant, notamment, en : la poursuite du programme de rapatriement, de ltranger, des archives nationales de lre coloniale (1912 1956) ayant trait la rsistance ; la contribution la production des uvres cinmatographiques et audiovisuelles relatives lhistoire de la rsistance ; la contribution la construction et lquipement des complexes socioculturels de la rsistance dans plusieurs provinces du Royaume en partenariat avec les collectivits locales ; la poursuite de ldition de lencyclopdie du mouvement de la rsistance ; la clbration des vnements nationaux de la rsistance ; la construction de monuments commmoratifs et lamnagement des cimetires des martyrs pour faire connatre les symboles de la rsistance nationale ; lorganisation de sminaires, de colloques et de rencontres portant sur le mouvement de la rsistance.
I.10- Jeunesse et Sports
Les crdits allous au Ministre de la Jeunesse et des Sports, au titre de l'anne 2012, slvent 1 656 564 000 dirhams rpartis comme suit :
NOTE DE PRESENTATION
122
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Dpenses de personnel............ Dpenses de matriel et dpenses diverses...... Dpenses d'investissement...
435 564 000 DH 170 000 000 DH 1 051 000 000 DH
La stratgie du Ministre de la Jeunesse et des Sports au titre de la priode 2010-2016 vise faire de lencadrement de la jeunesse un levier de dveloppement humain travers un contenu ducatif inculquant aux enfants et aux jeunes la culture de la citoyennet et louverture sur les valeurs universelles. Cette stratgie se veut galement une chane de valeurs intgre allant du sport de masse jusqu la prparation des lites sportives de haut niveau, en faisant de laccs aux infrastructures de proximit un levier de promotion de la culture et de la comptition sportive. Ladite stratgie sarticule autour des axes suivants : le dveloppement du rseau des infrastructures sportives, daccueil et des tablissements de jeunesse de proximit ; la promotion de la mise en rseau et de linteraction entre les jeunes pour favoriser la crativit et lexpression artistique travers les forums de communication, festivals, workshops artistiques, les voyages et les loisirs ; le dveloppement de la pratique du sport structure et le renforcement du dispositif du sport dlite et des sports de haut niveau ; et la mise en place dun systme de formation et dencadrement performant au profit des diffrents intervenants dans le domaine de la jeunesse et du sport. I.10.1. Domaine de la Jeunesse, de lEnfance et des Affaires Fminines Le plan daction 2012 de la Direction de la Jeunesse, de lEnfance et des Affaires Fminines prvoit notamment la mise en uvre des actions suivantes : la poursuite du programme colonies de vacances au profit de 300.000 enfants ; la poursuite du programme de festivits de la jeunesse pour plus de 3.000.000 de bnficiaires. la mise niveau des maisons de jeunes, des colonies de vacances, des clubs d'enfants, des garderies/ crches, des foyers fminins et des centres d'accueil existants; et lquipement des nouvelles maisons de jeunes, des nouvelles colonies de vacances et des foyers fminins nouvellement cres ;
NOTE DE PRESENTATION
123
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
ladoption dune stratgie nationale intgre pour les jeunes par lextension des rseaux despaces des jeunes, notamment les institutions et les tablissements de lEducation, et le soutien des associations uvrant dans le domaine rural. Par ailleurs, des projets dorganisation de la caravane de la citoyennet et de soutien au programme touristique, culturel et politique au profit des jeunes lintrieur et lextrieur du Maroc seront lancs. I.10.2- Domaine des Sports Le plan daction du Ministre de la Jeunesse et des Sports, dans le domaine des Sports, au titre de lanne 2012, porte sur les principales actions suivantes : la ralisation du programme dinfrastructures sportives de proximit en partenariat avec les collectivits locales et le secteur priv portant sur 125 clubs socio-sportifs de proximit, deux petits stades, quinze salles omnisports, deux centres dexcellence, trois pistes dathltisme, trois piscines couvertes et 30 terrains en gazon synthtique ; la poursuite des travaux dachvement du stade dAgadir avec la contribution du Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et Social ; la poursuite des tudes relatives la ralisation du grand stade de Casablanca dune capacit denviron 80.000 places et dot de lensemble des infrastructures, des locaux et des quipements lui permettant daccueillir des manifestations sportives de grande ampleur ; le soutien au Comit National Olympique Marocain et aux Fdrations Marocaines Sportives pour permettre aux jeunes de bnficier dun service public performant et de qualit et datteindre les objectifs en matire de licencis, de pratiquants, de formateurs et de managers sportifs ; la construction et lquipement dun centre co-cit sportif et administratif Rabat destin principalement servir comme sige pour les fdrations sportives nationales et lhbergement et la restauration des sportifs ; la cration dune rgie publicitaire permettant de gnrer des recettes provenant de la publicit au sein des infrastructures sportives; et le renforcement de la formation dans le domaine du sport par la mise niveau de lInstitut Royal de Formation des Cadres et du Centre de Bourgogne de Casablanca et la cration des centres dexcellence bass sur le concept sporttudes pour la formation des sportifs dlite.
I.11 - Conseil Economique et Social
Les crdits allous au Conseil conomique et social pour lanne 2012 slvent 110 681 000 dirhams ventils comme suit :
NOTE DE PRESENTATION
124
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement..
70 681 000 DH 35 000 000 DH 5 000 000 DH
Ces crdits sont mobiliss pour doter cette institution nouvellement cre des moyens humains et logistiques ncessaires pour raliser les missions qui lui sont fixes par le lgislateur savoir : donner son avis sur les orientations gnrales de lconomie nationale ; analyser la conjoncture et assurer le suivi des politiques conomiques et sociales nationale, rgionale et internationale ; formuler des propositions dans les divers domaines conomiques, sociaux et culturels; et favoriser et consolider la consultation et la coopration entre les partenaires conomiques et sociaux et contribuer llaboration dune charte sociale. A noter quen 2011, le Conseil Economique et Social a publi deux rapports, savoir : le rapport dtape sur lemploi des jeunes qui tablit un diagnostic du chmage des jeunes et esquisse les pistes de rforme; et Le rapport dtape sur la Charte Sociale qui reprsente une plateforme pour enrichir la discussion sur les objectifs de la Charte , son articulation avec les rfrentiels nationaux et internationaux, sa structuration, les modalits de son laboration et de suivi de sa mise en uvre .
II- SECTEURS DINFRASTRUCTURE
II.1. Equipement et Transport
Les crdits allous au Ministre de lEquipement et du Transport, au titre de lanne 2012, slvent 8 887 714 000 dirhams, rpartis comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses. Dpenses d'investissement.. Fonds Spcial Routier ... Fonds de Dlimitation du Domaine Public Maritime et Portuaire 717 934 000 DH 100 580 000 DH 5 853 200 000 DH 2 200 000 000 DH 16 000 000 DH
NOTE DE PRESENTATION
125
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
A ces crdits, sajoutent les dotations qui seront mobilises par la Caisse pour le Financement Routier (CFR) sous forme demprunts auprs des bailleurs de fonds et de versements des Collectivits Locales et ce, pour le financement du deuxime programme national des routes rurales (PNRR2). Les ressources budgtaires affectes ce dpartement concourent la poursuite de la ralisation des grands chantiers dinfrastructure, de la mise en uvre de la stratgie nationale pour le dveloppement de la comptitivit logistique et de lamlioration de la mobilit et de dveloppement du transport durable. II.1.1. Domaine Routier et Autoroutier
1) Autoroutes
Aux termes du contrat-programme conclu entre lEtat et la Socit Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) pour la priode 2008-2015, lEtat contribuera au programme dinvestissement de la socit ADM au titre de lanne 2012 pour un montant de 1.140 MDH qui sera vers ladite socit sous forme de dotations en capital. Par ailleurs, lanne 2012 sera marque par lachvement des travaux dlargissement 2 x 3 voies de lautoroute Casablanca Rabat (1,16 milliard de dirhams) et la poursuite des travaux sur lautoroute liant Berrechid Bni Mellal dont le cot est estim 6 Milliards de dirhams, de lautoroute de contournement de Rabat dun cot de 2,8 Milliards de dirhams. De plus, les travaux sur lautoroute reliant El Jadida Safi dun cot de 4,2 milliards de dirhams et sur le tronon Tit Mellil- Berrechid dun cot de 1,29 milliard de dirhams seront lancs en 2012.
2) Routes
i- Maintenance du rseau routier : En 2012, la conservation du patrimoine routier portera sur les actions suivantes : la ralisation des travaux dentretien et de maintenance des routes et ce, avec une cadence annuelle de 2.000 Km de chausse traiter par des actions de renforcement, de revtement et dlargissement et 50 ouvrages dart reconstruire ou rhabiliter; la rparation des dgts des crues survenus sur les routes et les ouvrages dart affects par les inondations ; le traitement des points noirs sur le rseau routier national ; et le renouvellement des engins de travaux publics en vue damliorer leur productivit. ii- Programme dextension du rseau routier : Rocade Mditerranenne : Le projet de la rocade mditerranenne consiste relier les villes de Tanger et
NOTE DE PRESENTATION 126
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Saidia sur 550 km en rduisant le temps de trajet de 11 7 heures et en amliorant les conditions de confort et de scurit des usagers de cette route. A ce jour, les tronons de ladite rocade reliant respectivement Ajdir Ras Afrou et Ras Afrou Kebdana et Jebha Ajdir, ont t achevs. Au cours de lanne 2012, les travaux de ralisation du dernier tronon de la rocade Mditerranenne entre Ttouan et Jebha seront poursuivis sur un linaire de 120 Km pour un cot de 2.550 MDH. Deuxime Programme National des Routes Rurales (PNRR2) : Les projets raliser en 2012 dans le cadre du PNRR 2 permettront de porter le taux daccessibilit des populations rurales la route 76 % fin 2012 contre 70,1% ralis fin 2010 et 73% fin 2011. Composante Routes et Ouvrages dArt du Plan de Dveloppement Territorial 2011 - 2015 : Le cot de ce plan intressant 503 communes rparties sur 22 provinces est estim 4,9 milliards de dirhams dont 2.500 MDH pour les routes, 1.162 MDH pour llectrification rurale, 725 MDH pour ladduction en eau potable, 75 MDH pour la sant et 450 MDH pour les logements de fonctions destins aux enseignants. Sagissant de la composante routes, elle concerne la construction et lamnagement de 2.313 km de routes et pistes rurales et la ralisation de 90 ouvrages darts. Ddoublement de la route reliant Taza Al Hoceima : En 2012, les tudes et les travaux de ddoublement de laxe routier Taza -Al Hoceima seront poursuivis sur 148,5 Km pour un cot valu 2,5 milliards de dirhams dont 1,8 Milliard de dirhams inscrire au Budget Gnral et 700 MDH mobiliser par la Direction Gnrale des Collectivits Locales. Ce projet structurant a pour objectif de relier la ville dAl Hoceima et sa rgion au rseau autoroutier national tout en amliorant les conditions de confort et de scurit. Au cours de lanne 2012, les travaux dj lancs sur le lot 1 (Ajdir Beni Bouayach sur 16 km) et le lot 6 (6 Km partir de la ville de Taza) seront poursuivis. Les autres lots seront lancs en fonction de lavancement des tudes les concernant. La poursuite dautres projets de voies expresses sur les axes qui drainent un important trafic ou qui permettent de relier au rseau autoroutier les villes desservir par lesdites voies expresses. Il sagit en particulier de la liaison entre Bouknadel et lautoroute RabatKnitra, de laxe Selouane-Ahfir, des pntrantes de Bni-Mellal et du lot n1 de la section Bourse des Primeurs Tiznit sur la route nationale RN1 ;
NOTE DE PRESENTATION
127
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
iii- Route liant la zone Logistique de Zenata au port de Casablanca : Ce projet consiste en la ralisation dune voie expresse liant le port de Casablanca la zone logistique de Zenata sur un linaire de 21,5 Km dont 4,5 Km gagner sur la mer. La composante maritime de cette route dont le cot est valu 700 MDH est confie lAgence Nationale des Ports avec une participation du Budget Gnral de lEtat de 300 MDH dont 200 MDH ont t dj dbloqus. II.1.2. Domaine portuaire et transport maritime Les actions prvues en 2012 dans ce domaine portent sur : le lancement effectif des travaux de ralisation du nouveau port de Safi pour permettre limportation du charbon destin la nouvelle station thermique dont la mise en service progressive est prvue compter de 2015; la poursuite des travaux de ralisation dun pi darrt de sable au niveau du port de Tarfaya et ce, en vue de lamlioration des conditions de son exploitation dont le cot est valu 480 MDH ; la poursuite des travaux dextension du port de Dakhla vou aux activits de pche maritime et dont le cot slve 400 MDH; et laccompagnement de la ralisation du projet Tanger Med II devant porter les capacits annuelles de transbordement du complexe portuaire Tanger Med 8 Millions dEquivalent Vingt Pieds (EVP) par an dont 5 Millions dEVP au niveau du port Tanger Med II seulement. A cet effet, et en vertu de la convention conclue entre lEtat et lAgence Spciale Tanger Med (TMSA) en juin 2009, lEtat contribue au financement de la premire phase de ce projet pour un montant de 2 Milliards de dirhams dont 900 MDH ont t dbloqus en 2010, 400 MDH en 2011 et 400 MDH et 300 MDH seront dbloqus respectivement en 2012 et 2013. Le cot de ce projet est valu 13,5 milliards de dirhams dont 8,9 milliards de dirhams pour la premire phase qui consiste en la construction des ouvrages de protection et dun quai de 1.200 mtres linaires dune capacit annuelle de deux millions dEVP. La deuxime phase consistera en la ralisation du second quai dune longueur de 1.600 mtres linaires et dune capacit de trois millions dEVP par an. II.1.3. Domaine du transport ferroviaire et routier Les actions prvues dans ce domaine portent sur lappui lOffice National des Chemins de Fer, la contribution au renforcement de la Scurit Routire, la poursuite de la mise en uvre du mcanisme de renouvellement du parc de transport routier et laccompagnement des rformes du transport routier. 1- Lappui lOffice National des Chemins de Fer (ONCF) conformment au contrat programme liant cet office lEtat sur la priode 2010 2015 et ce, sous forme de dotations en capital pour:
NOTE DE PRESENTATION
128
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
le remboursement des emprunts contracts par lONCF, dont 523 MDH au titre de la voie ferre reliant la ville de Tanger au complexe portuaire Tanger Med; et la ralisation du projet de ligne grande vitesse entre Tanger et Casablanca.
2- La contribution au renforcement de la Scurit Routire notamment par le biais de la mise en uvre : (i) du troisime Plan Stratgique Intgr dUrgence (PSIU III) pour la priode 2011 - 2013 ayant pour objectifs dinverser la tendance la hausse du nombre annuel des tus et blesss graves et de rduire dune manire durable et continue le nombre de tus et blesss graves ; et (ii) du Plan National de Contrle (PNC) 2011 2013 rconciliant les actions du MET et celles de la Gendarmerie Royale et de la Suret Nationale dans lobjectif de faire respecter le code de la route ses usagers ; 3- La poursuite de la mise en uvre du mcanisme de renouvellement du parc de transport routier de marchandises pour le compte dautrui et de transport mixte en milieu rural ayant pour objectifs de renforcer la scurit routire, damliorer lefficacit nergtique des vhicules et de rduire leur impact sur lenvironnement ; 4- Laccompagnement des rformes du transport routier inter urbain dans le cadre du Fonds daccompagnement des rformes de transport urbain et inter- urbain. Les actions prises en charge par ce fonds ont trait principalement la ralisation des tudes de dveloppement du transport routier et laccompagnement de la mise en uvre du code de la route notamment travers le renforcement des outils de contrle et la mise en place et le dploiement de systmes dinformation auprs des diffrents organes de contrle et des tribunaux.
II.2- Energie, Mines, Eau et Environnement
Lenveloppe budgtaire globale mise la disposition du Ministre de lEnergie, des Mines, de lEau et de lEnvironnement, au titre de lanne 2012, slve 4 620 597 000 dirhams, ventile comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. Cette enveloppe est rpartie, par domaine, comme suit : II.2.1. Energie et Mines Lenveloppe budgtaire mise la disposition du domaine de lEnergie et des Mines, au titre de lanne 2 012, slve 645 579 000 dirhams. Elle est ventile comme suit :
NOTE DE PRESENTATION
493 986 000 DH 324 611 000 DH 3 802 000 000 DH
129
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Dpenses de personnel....... Dpenses de matriel et dpenses diverses.. Dpenses d'investissement....
131 547 000 DH 180 032 000 DH 334 000 000 DH
II.2.1.1. Domaine de lEnergie Sinscrivant dans la continuit de la stratgie nergtique nationale, lanne 2012 sera consacre principalement : a. lachvement du Plan National dActions Prioritaires dans le domaine de llectricit. travers la mise en service de 3500 MW de puissance lectrique supplmentaire, la gnralisation de 22 millions de lampes basse consommation et lachvement du systme de tarification incitative -20/-20 ; b. la poursuite du programme marocain de lnergie solaire par : le dmarrage effectif des travaux de construction de la 1re phase du complexe solaire dOuarzazate compter de juillet 2012 et le lancement du processus de ralisation de la seconde phase dudit complexe dans loptique dune mise en service de la totalit du complexe dOuarzazate dune capacit de 500 MW en 2015 ; la poursuite des travaux dtudes concernant les autres sites concerns par le programme marocain solaire savoir Ain Beni Mathar, Foum Al Oued, Boujdour et Sebkhat Tah dans lobjectif de mettre en place en 2020 une capacit de production lectrique partir de l'nergie solaire de 2 000 MW sur les cinq sites prcits ; c. la consolidation du programme olien par lacclration des travaux de dveloppement des sites de Jbel Kheladi 1 (120 MW), Taza (150 MW), Al Haouma (50 MW), Akhfenir (200 MW), Tarfaya (300 MW) et Bab El ouad (50 MW) ainsi que le lancement des tudes affrentes aux sites de Sendouk Tanger (150 MW), Koudia Al Baida (300 MW), Tiskrad (300 MW) et Boujdour (100 MW). La ralisation de ces nouveaux parcs oliens portera la puissance lectrique installe dorigine olienne de 280 MW actuellement 2000 MW en 2020. d. la poursuite du plan national de lefficacit nergtique par notamment : la mise en place dquipements defficacit nergtique tels que les stabilisateurs, conomiseurs et lampe basse consommation pour lclairage public ; la gnralisation des chauffes eau solaires pour atteindre 440 000 m2 2012 et 1,7 million m2 en 2020; en
lintgration des normes de qualit de performance nergtique au niveau du secteur de lindustrie ;
NOTE DE PRESENTATION
130
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la poursuite de la distribution de 22 millions de lampes LBC ainsi que linstauration des premires mesures defficacit nergtique ; la mise en place des mesures spcifiques pour les clients THT-HT ; et la mise en place du plan national de bassins de rtention chez les agriculteurs par le dcouplement du systme de turbinage dans les barrages de celui de lirrigation.
e. La finalisation de ltude nationale pour la dfinition dun schma de rgulation du secteur lectrique par la dfinition des missions, des structures, de lorganisation ainsi que du plan de dveloppement des comptences de lautorit nationale charge de la rgulation dudit secteur. II.2.1.2. Domaine Minier et Gologique Lanne 2012 sera consacre la poursuite de la ralisation : du Plan National de Cartographie Gologique travers la continuation des travaux sur les cartes engages durant les exercices antrieurs visant llaboration de la cartographie gologique de l'ensemble du territoire, la gnralisation de la couverture gophysique et gochimique d'infrastructure, la conception et linstallation dun systme national d'informations gologiques et minires ; de ltude sur le secteur minier permettant de redfinir la stratgie minire nationale, dont les termes de rfrence ont t tablis en concertation avec la profession minire ; du Programme National du Dveloppement de la Petite Mine par la programmation de nouveaux thmes de formation se rapportant des cas pratiques, ayant pour objet la mise niveau des petits exploitants miniers ; de la protection et la mise en valeur du patrimoine gologique par llaboration dun texte rglementaire relatif la sauvegarde et la protection des sites gologiques ; du Muse de Rabat, du Muse Rgional du Moyen Atlas dAzrou, du Muse dAzilal, du Goparc MGoun, du Muse Palontologique de lOCP Khouribga, du Muse Minier de Jerada et du Muse de Tazouda dans la rgion dOuarzazate ; de procdures amliores lies aux actes miniers et au dveloppement de la base de donnes du patrimoine minier et ptrolier de faon assurer une bonne gestion du patrimoine minier et ptrolier ; et du renforcement de linspection du travail dans les mines par lorganisation de journes de formation et de sensibilisation sur les aspects rglementaires intressants les accidents de travail, les maladies professionnelles et la soustraitance dans les mines.
NOTE DE PRESENTATION
131
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
-Transferts aux tablissements publics Au titre de lanne 2012, il est prvu de poursuivre loctroi de subventions aux principaux tablissements publics oprant dans le secteur en vue de leur permettre de raliser leurs programmes daction. Il sagit des tablissements suivants : Office National des Hydrocarbures et des Mines : la dotation en capital dun montant de 180 MDH prvue au profit de cet office servira assurer le financement des missions qui lui sont assignes dans le domaine de la recherche minire, de lexploration de nouveaux gisements et de la promotion du sous-sol national ainsi qu la mise en place de la nouvelle stratgie dexploration des bassins sdimentaires. Agence de Dveloppement des Energies Renouvelables et de lEfficacit Energtique : la dotation budgtaire dun montant de 27.337.000 DH rserve cet organisme est destine lui permettre de raliser son programme dinvestissement prioritaire ayant pour principaux objectifs : lvaluation des ressources nergtiques renouvelables dans les domaines de lolien, solaire, biomasse et petite hydraulique ; le dveloppement des actions defficacit nergtique inities dans les secteurs du btiment, de lindustrie et du transport ; et la consolidation des outils daccompagnement du dveloppement des secteurs des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique par la poursuite de la mise en place dinstruments de contrle de qualit, dencadrement rglementaire, de renforcement de capacits et de communication. Centrale dAchat et de Dveloppement de la Rgion Minire de Tafilalet et de Figuig: la dotation budgtaire dun montant dun million de dirhams rserve cet organisme est destine poursuivre la mise en uvre du plan de restructuration des exploitations minires artisanales visant privilgier leur ouverture linitiative prive tout en prservant les droits acquis des artisans agissant actuellement sous la tutelle de cet tablissement. Ecole Nationale de lIndustrie Minrale : la subvention dun montant de 3.637.000 DH alloue cet tablissement pour cette anne lui permettra de contribuer au dveloppement de la recherche scientifique dans le domaine de lindustrie minrale, lamlioration de la formation des lves ingnieurs ainsi qu la mise en place des filires de formation dans le domaine des nergies renouvelables. Centre National de lEnergie, des Sciences et des Techniques Nuclaires : une subvention de 76 MDH est alloue cet tablissement au titre de cette anne en vue de lui permettre de poursuivre son programme dinvestissement affrent lquipement des laboratoires et sa dotation en technologies nuclaires pour rpondre dans les meilleures conditions aux besoins de ses partenaires dans les domaines de la sant, des ressources hydriques, de lagriculture, de lindustrie, de lenvironnement et des ressources minires.
NOTE DE PRESENTATION
132
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
II.2.2. Domaine de lEau L'enveloppe budgtaire affecte au domaine de lEau, au titre de l'anne 2 012, s'lve 3 096 965 000 dirhams rpartis comme suit: Dpenses de personnel.. Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement. 323 501 000 DH 133 464 000 DH 2 640 000 000 DH
Le plan daction du dpartement de lEau, pour lanne 2012, se prsente comme suit : II.2.2.1. Amnagement hydraulique 1. Recherche et Planification de l'Eau Cette action vise renforcer la stratgie du secteur de leau par la ralisation des documents et tudes suivants : le Plan National de lEau, document stratgique de rfrence pour tous les intervenants dans le secteur, dans la mesure o il arrte les grandes orientations et les objectifs long terme et dfinit les modalits de leur ralisation ; le Plan National de Protection de la Qualit des Ressources en Eau qui vise la dfinition des objectifs de la qualit de leau, lidentification des actions entreprendre et la mise en place des structures et des mcanismes adquats pour la concrtisation des projets et dispositions prconiss ; le Plan National de protection contre les inondations qui permet didentifier les sites exposs aux risques lis aux fortes crues, de dfinir les niveaux de priorit et durgence, de recommander les remdes appropris et de planifier leur mise en uvre. Un plan daction de lutte contre ce phnomne a t tabli, visant la protection de 20 sites inondables par an ; les tudes gnrales relatives lvaluation conomique et dimpact des barrages sur lenvironnement ; ltude des projets de transfert des eaux vers lEst et le Sud ; ltude relative au dessalement des eaux de mer ; et les tudes de rutilisation des eaux uses traites. 2. Extension du patrimoine hydraulique Les principales actions programmes en 2012 portent sur la poursuite des travaux de construction des ouvrages suivants : le barrage Ouljet Es Soltane sur lOued Beht dans la Province de Khmisset. Dun cot estim 1.210 MDH, cet ouvrage hydraulique permettra de
NOTE DE PRESENTATION 133
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
rgulariser, au moyen dun volume supplmentaire de 47 Mm3, les apports de lOued Beht en vue dirriguer le primtre de Sidi Slimane et dalimenter en eau potable les villes de Khmisset et de Tifelt. Lachvement des travaux de ce barrage est prvu pour lanne 2015 ; le Complexe Mdez -Ain Timedrine- Azghar sur le Haut Sebou dans la province de Sefrou. Compos de trois grands barrages, ce complexe dun cot estim 1.975 MDH, permettra la protection de zones situes laval contre les inondations, la production moyenne annuelle de lnergie lectrique hauteur de 332 Gwh et lamlioration du volume rgularis au niveau du Haut Sebou pour le dveloppement de lirrigation dans le bassin. Lachvement des travaux de ce complexe est prvu pour lanne 2015 ; le barrage Moulay Bouchta devant permettre de scuriser lapprovisionnement en eau potable de la ville de Chefchaouen alimente actuellement partir de la source Ras El Ma dont le dbit est fortement influenc par la scheresse, dirriguer les primtres agricoles situs laval et de protger le barrage Ali Thailat. Le cot de cet ouvrage est estim 440 MDH. La date dachvement des travaux de cet ouvrage est prvue pour 2013 ; le barrage Martil situ sur l'Oued Mhijrate 15 Km de la ville de Ttouan. Ce barrage dont le cot est estim 1.240 MDH disposera d'une capacit de stockage de 120 Mm3 et permettra la rgularisation de 60 Mm3 par an. Il est destin scuriser l'alimentation en eau potable de la ville de Ttouan au-del de l'horizon 2030, irriguer la petite et moyenne hydraulique situes l'aval sur une superficie de plus de 1000 ha et contribuer la protection de la ville de Ttouan et de la valle de Martil contre les inondations rcurrentes. La date prvue pour l'achvement de ce projet est fixe pour 2013; le barrage Taskourt dans la Province de Chichaoua. Cet ouvrage, dont le cot de construction valu 710 MDH, est destin rgulariser 24 Mm3 deaux pour lirrigation des primtres Assif El Mal et Mjjat dont la superficie est estime 6.000 ha, alimenter en eau potable les douars et centres avoisinants et renforcer lalimentation en eau potable de la ville de Chichaoua. La date d'achvement des travaux de ce barrage est fixe pour l'anne 2011; le barrage Tamalout dans la province de Khnifra permettra de rgulariser les apports de loued Ansgmir dans le haut bassin de la Moulouya en vue dirriguer un primtre de 5.000 ha, dalimenter en eau potable des agglomrations avoisinantes et de protger contre les inondations les primtres situs laval de louvrage. Son cot est estim 580 MDH. La date prvue pour la mise en service est fixe pour 2012 ; le barrage Tiouine sur lOued Iriri dans la Province de Ouarzazate. Sur une hauteur de 84 m, cet ouvrage dont le cot slve 580 MDH permettra lalimentation en eau potable de la Province, lirrigation des terres laval du barrage, lcrtement des crues et la protection du barrage Mansour Eddahbi contre lenvasement. Cet ouvrage sera achev en 2013 ;
NOTE DE PRESENTATION
134
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
le barrage Zerrar sur oued Ksob dans la province dEssaouira, dun cot valu 955 MDH, aura pour objectifs de rgulariser les apports de lOued Ksob pour alimenter en eau potable et industrielle la ville dEssaouira, les centres avoisinants et la future station balnaire, dirriguer le primtre de Ksob qui stend sur une superficie de 1.500 ha et de protger la baie et la plage dEssaouira contre les inondations et la pollution dues aux crues. La date dachvement des travaux de cet ouvrage est prvu pour lanne 2014 ; le barrage Timikt sur lOued Assif NIfer dans la Province dErrachidia permettra dalimenter en eau potable la population des douars avoisinants et dirriguer les primtres situs laval et la recharge de la nappe phratique de Tinjdad. Le cot de cette infrastructure slve 415 MDH. La date prvue pour lachvement de ce barrage est fixe pour 2012 ; le barrage Sidi Abdellah sur lOued Ouaar dans la Province de Taroudant, dont le cot est estim 703 MDH permettra de contribuer la recharge de la nappe du Souss, labreuvement du cheptel, la protection des zones situes en aval contre les crues ainsi qu la rgularisation dun volume deau de 8,5 Mm3 pour lirrigation des primtres situs laval. La date dachvement des travaux de ce barrage est prvue pour lanne 2014 ; le barrage Guenfouda dans la Wilaya dOujda devra permettre de protger la ville dOujda et les centres avoisinants contre les inondations causes par les crues de lOued Isly. Dun cot estim 100 MDH, cet ouvrage sera achev en 2011 ; le barrage Dar Khrofa sur lOued Makhazine dans la Province de Larache, dont le cot est estim 852 MDH, assurera, au moyen dun volume rgularis de 140 Mm3, lirrigation des primtres de la zone nord du bas Loukkos, la protection de la valle de lOued Makhazine contre les crues, lalimentation en eau potable des communes rurales situes prs du barrage et la contribution au transfert des eaux vers le Sud. Les travaux staleront sur une priode de trois annes et sachveront en 2014 ; le barrage An ksob dans la province de Ben Slimane dont le cot est estim 265 MDH. Avec une capacit de retenue de 20 Mm3, cet ouvrage permettra lirrigation dun primtre de 800 ha, la protection des riverains et des terres agricoles contre les inondations, labreuvement du cheptel, lalimentation en eau potable et la rgularisation de presque 15 Mm3. la date dachvement des travaux est prvue fin 2013 ; les petits barrages et lacs collinaires : le nombre de petits barrages raliss nos jours slve une centaine douvrages hydrauliques. Composante essentielle de la politique de mobilisation des ressources hydriques, les petits barrages ont mis en vidence leur efficacit dans le dveloppement local notamment par leur contribution lirrigation des petits primtres et au dveloppement de llevage en alimentant des points deau prennes pour labreuvement du cheptel. A signaler quen 2012, sera lance la construction du barrage Kharroub sur le bassin versant du Loukkouss sur loued Kharroub qui servira au renforcement de
NOTE DE PRESENTATION 135
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
lalimentation en eau potable de la zone Tanger-Asilah. Le cot de ce barrage est estim 1.300 MDH sur quatre ans avec une capacit de retenue de 200 Mm3. 3. Protection contre les inondations Lintervention du dpartement de lEau dans le domaine de protection contre les inondations a connu un changement radical ces dernires annes, suite aux changements climatiques. Cette intervention est passe dune simple assistance aux autorits locales une prise dinitiative pour protger les zones touches par les inondations. Dans ce cadre, un plan national de protection contre les inondations a t labor, faisant ressortir 390 zones susceptibles et nvralgiques aux inondations. Ainsi, et paralllement lamlioration de la performance des systmes et moyens dalerte et de prvention des crues, le dpartement de lEau a continu la ralisation de plusieurs projets structurants travers des canaux, des digues et des amnagements hydrauliques, en plus de la construction des grands, petits et moyens barrages qui jouent un rle crucial dans la protection contre les inondations. Les villes et centres dont les travaux de protection contre les inondations ont t achevs sont Mohammedia, Settat, Ben Ahmed, Berrechid, Tan Tan, Zao, Oued Zem, Chichaoua, Guelmim, Saidia, Beni Mellal, Khnifra, Mrirt et Al Hoceima. Les travaux de protection sont en cours pour les villes de Tanger, Boulemane, Oujda, Kela des Sraghna, MDiq-Findeq, Nador, Sidi Kacem, Chefchaouen, Guelmim et Agadir. Il convient de noter que les oprations sont arrtes en concertation avec le Ministre de l'Intrieur et les collectivits territoriales concernes et excutes en partenariat et avec le concours financier de ces entits. Dans ce cadre, le Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et Social, a mobilis, via le compte daffectation spciale intitul Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles , une enveloppe financire de 218,45 MDH, au profit du dpartement de lEau, destine au financement du projet de protection de la zone industrielle de Mghogha dans la Province de Tanger. 4. Alimentation en eau potable des populations rurales En vue dacclrer la gnralisation de laccs leau potable des populations rurales, le programme d'action pour l'anne 2012 portera sur la poursuite des travaux d'alimentation en eau potable des populations rurales par lapprovisionnement dune population additionnelle de 135.000 habitants. Ce programme bnficie dune subvention de lEtat de 150 MDH par an. 5. Maintenance et entretien des ouvrages hydrauliques Dans le domaine de la conservation du patrimoine hydraulique, en plus des actions courantes de maintenance et d'auscultation des ouvrages, une dizaine de barrages souffrant de vieillissement ont fait l'objet d'oprations consistantes d'entretien de leurs ouvrages de gnie civil ou de leurs quipements lectromcaniques, hydromcaniques et de tlcommunications, notamment les travaux de renforcement du barrage Abdelmoumen et le dsenvasement du barrage Mechra Hamadi.
NOTE DE PRESENTATION
136
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
6. Soutien aux Agences de Bassins hydrauliques LEtat continue son appui aux neuf Agences de Bassins Hydrauliques par le renforcement de leurs capacits en vue de leur permettre d'accomplir les missions qui leur sont assignes par la loi n 10-95 sur l'eau. Les contributions financires et l'assistance technique apportes ces tablissements permettront de poursuivre les tudes pour l'actualisation des Plans Directeurs d'Amnagement Intgr des Ressources en Eau (PDAIRE) et de cofinancer des projets concernant la prservation de la qualit des ressources en eau ainsi que la protection contre les inondations. 7. Autres Actions Outre les actions d'envergure ci-dessus indiques, le dpartement de lEau continue raliser ses activits courantes en mettant l'accent sur: la poursuite des travaux damlioration et de renforcement du rseau des mesures hydrologiques et hydrogologiques ; le dveloppement de loffre par la ralisation de travaux de forages et puits pour l'alimentation en eau potable, industrielle et d'irrigation ainsi que la reconnaissance et l'valuation des ressources en eaux souterraines particulirement dans les rgions dficitaires ; la mobilisation, la reconnaissance et l'valuation des ressources en eaux souterraines dans les provinces du Sud du Royaume par le creusement de forages et puits pour l'alimentation en eau potable et d'irrigation via des partenariats avec le Ministre de l'Intrieur et l'Agence de Dveloppement Economique et Social des Provinces du Sud ; la poursuite des travaux et tudes de protection des ressources en eau, du milieu naturel, des zones fragiles, des berges, de calibrage des cours d'eau, de lutte contre l'envasement, de la qualit de l'eau et de prvention de la pollution ; la ralisation des travaux dapprovisionnement en eau potable et dassainissement au profit des coles rurales, des coles de lenseignement traditionnel et des mosques ; les travaux de recharge artificielle des nappes et prservation des lacs naturels ; et la contribution aux projets de recherche et de dveloppement. II.2.2.2. Mtorologie Les efforts poursuivis par la Direction de la Mtorologie Nationale (DMN), au titre de l'anne 2012, visent adapter ses prestations aux besoins de ses utilisateurs en matire de scurit mtorologique, d'optimisation des activits conomiques ou d'information du grand public. Elle vise donc consolider les progrs acquis dans le domaine mtorologique notamment par l'installation au niveau de son rseau
NOTE DE PRESENTATION 137
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
mtorologique, d'quipements de tlmesure et de tldtection en vue de disposer d'informations et donnes climatologiques, agro-mtorologiques et ariennes en temps rel. Par ailleurs, la Direction de la Mtorologie Nationale poursuit ses efforts de recherche travers les principaux programmes suivants: le programme "Al Moubarak" par la prvision trois mois de la tendance pluviomtrique sur le Royaume ; le programme "Al Ghat" qui vise augmenter les prcipitations par la modification artificielle du temps ; le programme "Al Bachir" pour le dveloppement de la prvision numrique du temps ; les programmes d'application sectorielle de la mtorologie relatifs l'agromtorologie, la biomtorologie et lhydromtorologie. Pour rpondre au souci du Gouvernement limiter les effets ngatifs des changements climatiques sur les diffrents secteurs socio-conomiques du pays, la DMN a men des recherches en la matire dont les axes principaux se prsentent comme suit : Suivi-dtection-attribution qui consiste reprer, quantifier, suivre et attribuer les volutions et changements ventuels pouvant intresser le climat au Maroc. Modlisation des scnarios de changements climatiques par la ralisation de simulations haute rsolution. Participation aux tudes dimpacts en collaboration avec les diffrents organismes et institutions reprsentant des secteurs socio-conomiques vulnrables aux changements climatiques. Participation aux tudes dvaluation de la vulnrabilit des secteurs socioconomiques aux alas climatiques avec comme base le climat pass et prsent. II.2.3. Domaine de lEnvironnement Lenveloppe budgtaire alloue au domaine de lEnvironnement, au titre de lanne 2 012, slve 878 053 000 dirhams rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement 38 938 000 DH 11 115 000 DH 828 000 000 DH
NOTE DE PRESENTATION
138
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Lenveloppe budgtaire prvue pour linvestissement, au titre de 2012, concerne principalement les actions et programmes suivants : Programme National dAssainissement Liquide (PNAL) dot dune enveloppe de 400 MDH qui a pour objectif premier de rsorber le retard enregistr dans le secteur de lassainissement liquide, de restaurer la qualit des eaux, datteindre un taux de raccordement global au rseau dassainissement de 80% et de rabattre la pollution de 60% en 2015, 80% en 2020 et 90% en 2030. Programme National de Gestion des Dchets Mnagers et Assimils (PNDM) avec une enveloppe de 200 MDH, ayant pour objectifs, durant les quinze prochaines annes, (i) dassurer la collecte et le nettoiement des dchets mnagers dans les agglomrations et atteindre un taux de collecte de 90% au lieu de 70% actuellement, (ii) de raliser des dcharges contrles des dchets mnagers et assimils au profit de toutes les communes et centres urbains (100%), (iii) de rhabiliter toutes les dcharges existantes et (iv) de professionnaliser la gestion de ce secteur dans les agglomrations prsentant un intrt conomique pour les oprateurs privs. La poursuite du Programme National de mise niveau Environnementale des Ecoles Rurales, au profit denviron 2 millions dcoliers. Ce programme dont la convention cadre a t signe entre les dpartements de lEducation Nationale et de lEnvironnement, stalera sur une priode de 10 ans (2006-2015) et il est mis en uvre en troite collaboration avec lONEP et le Ministre de lIntrieur pour le volet eau potable-assainissement. Le cot global dudit programme est estim 985 MDH rparti entre la composante ducation pour 105 MDH, la composante eau potable pour 270 MDH et la composante assainissement pour 610 MDH. La contribution aux projets de dpollution des rejets hydriques, notamment, les projets raliss dans le cadre du mcanisme volontaire de dpollution industrielle dot dune enveloppe budgtaire de 100 MDH sur 3 ans (20112013). La mise en uvre du programme Economie sociale au service de lenvironnement pour un cot de 70 MDH. Ce programme a pour objectif la promotion des sacs en fibre naturelle et dautres alternatives de substitution aux sacs en plastique. La mise en uvre du programme de mise niveau environnementale des mosques et des coles coraniques en collaboration avec le Ministre des Habous et des Affaires Islamiques, travers des actions dassainissement, dapprovisionnement en eau potable, dducation environnementale et de sensibilisation. La poursuite des travaux des projets pilotes en matire de protection de lenvironnement et des ressources naturelles. Llaboration des programmes de lutte contre la pollution atmosphrique au niveau des grandes villes.
NOTE DE PRESENTATION
139
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Le lancement dObservatoires Rgionaux de lEnvironnement et du Dveloppement Durable (OREDD) au niveau de toutes les rgions en vue de les doter dinstruments techniques dobservation, de suivi et dvaluation de ltat de lenvironnement.
III.SECTEURS PRODUCTIFS
III.1. Agriculture et Pche Maritime
Le Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime bnficie, au titre de lanne 2 012, dune enveloppe budgtaire de 10 624 302 000 dirhams se rpartissant comme suit : Dpenses de personnel... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement Comptes Spciaux du Trsor III.1.1. Domaine de lAgriculture Au titre de lanne 2 012, lenveloppe budgtaire alloue au domaine de lagriculture atteint 10 004 733 000 dirhams rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. Comptes Spciaux du Trsor.. 562 152 000 DH 1 398 581 000 DH 7 500 000 000 DH 544 000 000 DH 729 300 000 DH 1 530 952 000 DH 7 820 050 000 DH 544 000 000 DH
Le programme dintervention arrt au titre de lanne 2012 sera marqu par la poursuite des actions de redynamisation, de modernisation et de mise niveau de lagriculture marocaine conformment aux orientations de la stratgie Plan Maroc Vert. Dans le domaine de lirrigation et de lamnagement de lespace agricole, les principaux programmes prvus au titre de 2012 concernent : Le Programme National dEconomie dEau en Irrigation (PNEEI) : Dun cot estim 37 milliards de dirhams, ce programme qui stale sur 10 annes est compos de 2 volets : la reconversion collective (secteurs de la grande hydraulique) sur plus de 337 000 ha et la reconversion individuelle (irrigation prive) sur 218 000 ha. Ce programme prvoit au titre de lanne 2012 :
NOTE DE PRESENTATION
140
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Au niveau des tudes :
la poursuite et/ou lachvement des tudes de faisabilit et dexcution pour la reconversion collective sur 137.196 ha, au niveau des ORMVA du Tadla, des Doukkala, du Haouz, du Loukkos, de la Moulouya, du Gharb et du Souss Massa ; et le lancement des tudes sur 80.720 ha pour la reconversion collective au niveau des ORMVA du Haouz, des Doukkala et du Gharb ; ce qui portera la superficie totale engage en tudes de reconversion collective 175.751 ha, soit 81 % de la superficie totale prvue initialement en reconversion collective dans le cadre du PNEEI.
Au niveau des Travaux :
la poursuite des travaux de modernisation des rseaux sur 42.186 ha, au niveau des ORMVA du Tadla, des Doukkala, du Haouz, du Gharb, du Loukkos, de la Moulouya et du Souss Massa ; et le lancement des travaux sur 13.790 ha, au niveau des ORMVA des Doukkala, du Loukkos, de la Moulouya et du Gharb ; ce qui portera la superficie totale engage en travaux de reconversion collective 55.977 ha, soit 18 % de la superficie totale prvue initialement en reconversion collective dans le cadre du PNEEI.
Le Programme de rsorption du dcalage : Ce programme, qui sinscrit galement dans le cadre du plan Maroc Vert, a pour objectif la rsorption du dcalage entre les superficies domines par des barrages existants ou en cours de ralisation et celles qui ont fait lobjet damnagements hydro-agricoles, soit une superficie globale de 140 000 ha. Cet axe dintervention sera caractris, durant lanne 2012, par la ralisation des principales actions suivantes : la poursuite des tudes damnagement hydro-agricole, sur une superficie de 138.550 ha (108.800 ha en Grande Hydraulique et 36.100 ha en Petite et Moyenne Hydraulique), inscrites dans le cadre du Programme dExtension de lIrrigation (PEI) laval des barrages et lamnagement hydro-agricole. Lesdites tudes concernent les principaux primtres suivants : TTI du Gharb (87.500 ha), Dar Khrofa (21.000 ha), Ouergha aval (11.000 ha), Moyen Sebou (4.600 ha secteurs IV et V) et Ouergha Amont (4.300 ha). Les travaux dextension de lirrigation sur une superficie de 36.150 ha concernant :
le projet de grande irrigation Dar Khrofa avec la poursuite des travaux damnagement du 1er tronon de ladducteur Nord, la poursuite des travaux de remembrement et les prestations dassistance technique et le dmarrage des travaux damnagement de ladducteur sud ;
NOTE DE PRESENTATION
141
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
les projets de Petite et Moyenne Hydraulique en particulier le projet Moyen Sebou (deuxime tranche), le projet damnagement hydroagricole du primtre Bouhouda, le projet damnagement hydroagricole du primtre dAnsegmir et les projets damnagement hydroagricole des primtres Mhajrat-Ajras, Dar Aqouba, Assif El Mal, Chbika et Ksob.
Programme de Partenariat-Public-Priv (PPP) pour la gestion dlgue du service de leau dans les primtres dirrigation : La premire phase relative ltude de faisabilit et doptions stratgiques de PPP concernant dune part, les primtres du Loukkos, du Tadla, des Doukkala, du Gharb (irrigation) et dautre part, le primtre de Chtouka Ait Baha (dessalementirrigation) ont t acheves en 2011. Celle du primtre de la Moulouya est en cours dachvement, alors quelle est en cours de mise en uvre pour les primtres du Haouz et de Azemmour-Bir Jdid. Lexercice 2012 connatra : Lachvement de la premire phase de ltude de PPP pour les primtres du Haouz et de Azemmour-Bir Jdid ; Le lancement de la seconde phase affrente lexcution dappel doffres pour la dsignation des partenaires privs ainsi que ltablissement des documents contractuels des diffrents primtres en projets, en fonction des dcisions stratgiques appeles tre prises par lEtat, notamment au sujet de la contribution publique au financement des investissements requis pour la mise en uvre de la gestion dlgue. Programme damnagement de lespace agricole et rural et de parcours : Les principales actions inscrites au titre de 2012 portent sur : Les travaux de rhabilitation des primtres dirrigation :
Projet Guigou : situ dans la Commune Rurale de Guigou, Cercle de Boulemane. Ce primtre couvre une superficie totale de 3.380 ha et touche quelques 2.669 exploitations agricoles (population denviron 13.920 habitants). Il sera marqu par la poursuite des travaux de construction de louvrage de tte, des pistes et les sguias du rseau dirrigation ainsi que les prestations de lassistance technique ; Projet PMH III : financ par la KFW, ce projet concerne la rhabilitation de 7.235 ha rpartis sur 62 primtres dirrigation situs dans les provinces de Taroudant, Agadir Ida Outanane et Chtouka-At Baha. Il sera marqu par la poursuite des travaux damnagement hydroagricoles et des prestations dassistance ; Programme de sauvegarde de la PMH : comprenant un ensemble doprations de travaux ponctuels de rhabilitation des primtres de
142
NOTE DE PRESENTATION
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
PMH (hors zones daction des ORMVA) au niveau de plusieurs provinces du Royaume. Il sagira en 2012 du dmarrage et de lachvement des travaux de rhabilitation des ouvrages dirrigation et la construction de prs de 250 km de sguias et les seuils et ouvrages de drivation dans les primtres irrigus, sur une superficie de prs de 16.000 ha rpartis sur 12 rgions et 30 provinces. Actions et projets de dveloppement agricole et rural intgr et de mise en valeur en bour comportant notamment:
Le programme de dveloppement des filires agricoles dans les zones de montagne de Taza : ce programme du Pilier II qui a dmarr en 2011 avec lappui financier du FIDA pour un cot de 337 MDH, bnficie une population qui slve 180.953 habitants, sur une superficie denviron 326.444 ha dont 5.366 ha de SAU irrigue et rpartie sur 15 communes. Lanne 2012 connatra la poursuite du programme, notamment travers les tudes des filires de production et lassistance technique ; Le projet de dveloppement de la filire amandier (primtre dpandage des eaux de crues de loued isly), dont le cot global est de 77 MDH, concernera les Communes Rurales de Sidi Moussa Lamhaya, Isly et Labssara dans la province de Oujda Angad ; Le projet de dveloppement de la filire dattes dans les palmeraies de Figuig : dont le cot global est de 174 MDH, concerne les communes rurales de Figuig et Abou lakhal dans la province de Figuig. Lanne 2012 connatra la ralisation des travaux de la conduite dadduction, lintensification et la densification des plantations du palmier, lentretien des plantations du palmier dans l'ancienne palmeraie et la construction et quipement d'une unit de conditionnement des dattes d'une capacit de 500 tonnes.
En plus, il est prvu la poursuite du projet de dveloppement du Moyen Atlas Oriental pour un cot de 306 MDH et le projet de dveloppement intgr des zones montagneuses de la province dErrachidia pour un cot de 230 MDH. Fonds de Dveloppement Agricole : Concernant le soutien linvestissement agricole priv, le programme du Dpartement se focalise sur la mise en uvre des contrats-programmes signs avec les professionnels entre 2008 et 2011. A travers le Fonds de Dveloppement Agricole, le soutien de lEtat interviendra, outre pour lencouragement de lquipement en irrigation localise, au niveau des principaux axes suivants : la poursuite de lamlioration de la mcanisation des exploitations agricoles; lappui lintensification de la production animale, travers le soutien lacquisition des gnisses importes et la production des veaux issus de croisement industriel;
NOTE DE PRESENTATION 143
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
le renforcement des disponibilits en semences slectionnes de crales; lextension et le renouvellement des plantations sur une superficie globale de 37 000 ha rpartie entre lolivier (20.000 ha), les agrumes (10.000 ha) et les autres arbres fruitiers (7.000 ha); la valorisation de la production agricole par le soutien aux units de conditionnement, de stockage et de transformation des produits agricoles; la diversification des dbouchs extrieurs pour accroitre les exportations des agrumes, de la tomate, de la fraise et de lhuile dolive sur les marchs lointains; et lappui aux interprofessions travers le financement des programmes de formation, de recherche-dveloppement et dencadrement des producteurs. Par ailleurs, et dans le but de scuriser la production agricole des crales et lgumineuses contre les alas climatiques, la campagne agricole 2011/2012 verra la mise en uvre du nouveau produit dassurance multirisque climatique lanc en partenariat avec la Mutuelle Agricole Marocaine dAssurance. Ce nouveau produit couvrira les principaux risques climatiques et notamment la scheresse, la grle, lexcs deau et les vents violents et de sables et bnficiera du soutien financier de lEtat comportant notamment la subvention aux cotisations des taux variant de 53% 90%. Projets Pilier II : Le programme daction au titre de 2012 portera sur un portefeuille de 280 projets, dont 108 nouveaux projets et 172 projets initis en 2010 et 2011 dont les travaux affrents sont poursuivis. Les 108 projets nouveaux couvrent lensemble des rgions du Royaume pour un investissement global de plus de 2 milliards de dirhams au profit de 87.000 bnficiaires. Globalement, ces projets intressent les principales filires de production vgtales et animales avec une prdominance de lolivier, de lamandier, de la viande rouge et de lapiculture. Actions transverses : La professionnalisation des Chambres dAgriculture : En vue de consolider la rforme institutionnelle et organisationnelle des Chambres dAgriculture et leur permettre daccomplir les missions qui leur ont t dvolues dans de bonnes conditions, il est prvu de renforcer les actions de dveloppement agricole ralises par ces institutions et de poursuivre la construction de leurs siges lance avant 2011. Les agropoles : Dans le cadre de la mise en uvre du Plan Maroc Vert et du Pacte National pour lEmergence Industrielle, et dans lobjectif daccompagner le dveloppement du secteur de lagrobusiness, il est prvu de raliser six agropoles dans les rgions de
NOTE DE PRESENTATION 144
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Mekns-Tafilalet, lOriental, Tadla-Azilal, Souss-Massa-Draa, Marrakech-TensiftAl Haouz et El Gharb Chrarda-Beni Hssen, durant la priode 2010-2015. Dans ce cadre, le Dpartement de lAgriculture financera les travaux de construction affrents aux Ples de Recherche Dveloppement et Contrle de Qualit (PRDCQ) qui seront constitus de laboratoires de contrle des produits agricoles, dune entit de recherche-dveloppement et de formation relevant de lINRA, ainsi que dautres espaces communs. Lexercice 2012 sera marqu par lachvement des travaux de construction de deux ples au niveau des agropoles de Mekns-Tafilalet et de lOriental, ainsi que par le lancement des travaux de construction des ples de Tadla, de Marrakech et dAgadir. Le dveloppement des produits de terroir et la labellisation : Il est prvu de mettre en uvre la nouvelle stratgie de dveloppement des produits de terroirs, dont les axes prioritaires pour 2012 portent sur lappui aux producteurs, la communication et la construction de deux plateformes logistiques pilotes Mekns et Agadir. Il est prvu galement la promotion des produits labelliss. Le conseil agricole : Lanne 2012 sera marque par la mise en uvre effective de la nouvelle stratgie de conseil agricole. A ce titre, il est prvu notamment : la construction et la reconstruction de 33 centres de conseil agricole ; lquipement de 33 centres de conseil agricole en matriel bureautique et audio-visuel ; lquipement des conseillers publics en moyens adquats ; la cration de la profession du conseiller agricole en perspective dassurer lexternalisation des prestations au profit du priv ; la mise en place de nouveaux supports et canaux de communication. La scurit sanitaire des produits alimentaires et des vgtaux : Concernant les filires vgtales, le programme de lexercice 2012 portera essentiellement sur : la protection du patrimoine vgtal, travers la lutte contre les ennemies des cultures, notamment le feu bactrien, la Tristza, la mineuse des feuilles de tomate Tuta absoluta et le charanon rouge du palmier ; le contrle des produits dorigine vgtale dans le cadre de la rpression des fraudes, afin de prserver la sant des consommateurs, assurer la loyaut des transactions commerciales et la qualit des produits ;
NOTE DE PRESENTATION 145
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la ralisation du programme des grandes luttes contre les moineaux et les rongeurs nuisibles lagriculture par la prospection, la surveillance et le traitement chimique et la lutte contre les maladies des forts ; et la ralisation du programme de contrle des semences et plants par lhomologation des varits et la protection des obtentions varitales. Sagissant des filires animales, les actions prvues portent sur : La scurisation sanitaire du cheptel national vis--vis des maladies contagieuses en assurant la vaccination des ovins contre la Clavele et la Blue Tongue, la poursuite du programme dassainissement de la tuberculose et de la brucellose bovines au niveau des levages adhrents aux coopratives et associations professionnelles dans le cadre de conventions avec lOffice National de la Scurit Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA). Il est prvu galement la vaccination des ruminants contre le charbon bactridien et des dromadaires dans les rgions du Sud ; Lidentification gnralise du cheptel bovin, qui reprsente loutil indispensable la gestion sanitaire et zootechnique du cheptel et linstrument majeur du suivi de ses mouvements et de la traabilit de ses produits. Elle concernera en 2012 un effectif de 150.000 ttes bovines et de 50.000 ttes camelines; Le renforcement des activits de veille sanitaire, dpidmio-surveillance et de contrle sanitaire au niveau des frontires, ainsi que le contrle sanitaire des lieux de restauration collective. Concernant les laboratoires, il est prvu au titre de lanne 2012 : dachever les travaux de construction des laboratoires dAin Jemaa et de Laayoune et le lancement de la construction du laboratoire de Bouznika ; de poursuivre la mise niveau et la modernisation des laboratoires qui constituent aussi bien un pralable la reconnaissance internationale du statut sanitaire du cheptel national et de la qualit de ses produits, quun outil de dveloppement, de scurisation de llevage et de la protection du consommateur. La recherche, formation et enseignement : Les principaux programmes prvus en 2012 se prsentent comme suit : En matire de Recherche agronomique, il est prvu notamment la ralisation des programmes de recherche fondamentale et de recherchedveloppement. A ce titre, le programme daction portera sur : La ralisation de 12 projets de recherche-dveloppement dans le cadre du mcanisme comptitif de recherche-dveloppement et vulgarisation visant mettre contribution les organismes nationaux de recherche dans le domaine agricole ;
NOTE DE PRESENTATION
146
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La poursuite des programmes nationaux de recherche long terme, focaliss notamment sur la gestion et lamlioration des ressources gntiques et sur la gestion et la conservation des eaux et des sols ; Le lancement de lappel candidature pour la huitime dition du Grand Prix Hassan II pour linvention et la recherche dans le domaine agricole. Sagissant de la formation professionnelle agricole, elle sera axe sur les principaux programmes suivants : En matire de formation professionnelle diplmante, il est prvu de former prs de 4.804 stagiaires et damliorer les conditions et la capacit daccueil et dhbergement des tablissements de formation professionnelle agricole; Lacclration du programme de formation par apprentissage des jeunes ruraux, avec pour objectif de former 10.200 apprentis au cours de lexercice 2012 dans le cadre de la convention signe entre les Dpartements de lAgriculture et de la Formation Professionnelle ; La poursuite de limplantation de lapproche par comptence dans les tablissements de formation, travers le renforcement de lquipement des tablissements en matriel didactique, pdagogique et en matriel agricole et outillage technique. Concernant lenseignement suprieur, il est prvu linscription de 2.570 tudiants au titre de lanne universitaire 2011-2012. Les actions prvues cet effet, visent notamment, satisfaire leurs besoins en matriels scientifiques et pdagogiques et poursuivre leffort de mise niveau des infrastructures et quipements des tablissements denseignement. Les principales oprations inscrites au titre de lanne 2012 sont les suivantes : La poursuite du programme de construction de nouveaux btiments pour faire face laugmentation des effectifs des tudiants induite par linitiative 10.000 ingnieurs et le lancement de programmes nouveaux de master. Ainsi, il est prvu la ralisation de la 2me tranche du projet de construction du sige de lAPESA lInstitut Agronomique et Vtrinaire Hassan II, dun bloc pdagogique comprenant, notamment, quatre amphithtres et une salle dexamens lEcole Nationale dAgriculture de Mekns; Lamnagement des structures actuelles daccueil des tudiants, des locaux pdagogiques et des laboratoires de recherche ; La mise niveau des quipements scientifiques, audiovisuels et de laboratoires ; Loprationnalisation du Centre de Ressources spcifiques lagriculture solidaire, appel Centre de Ressources dAppui au Pilier II (CRP2) et qui est rig en Groupement dIntrt Public pour accompagner la mise en uvre des actions concernant le Pilier II du Plan Maroc Vert.
NOTE DE PRESENTATION
147
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La modernisation des services de ladministration : Afin daccompagner les diverses structures du dpartement dans la ralisation des programmes daction dont elles sont charges, il est prvu de: poursuivre lquipement des services en matriel notamment Informatique et bureautique; consolider les marchs de construction en cours de ralisation et la programmation de la construction de nouveaux siges au niveau de cinq Directions Rgionales de lAgriculture ; et poursuivre la ralisation du programme de formation continue au profit du personnel du Dpartement aussi bien au niveau central que rgional. III.1.2. Domaine de la Pche Maritime Lenveloppe budgtaire globale alloue au domaine de la Pche Maritime, au titre de lanne budgtaire 2 012, slve 619 569 000 dirhams ventile comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 167 148 000 DH 132 371 000 DH 320 050 000 DH
Lanne 2012 sera caractrise essentiellement par la poursuite des actions entames et le lancement dactions nouvelles sinscrivant dans le cadre de la mise en uvre de la stratgie Halieutis et qui concernent les domaines dintervention ci-aprs : le renforcement des comptences et des qualifications des ressources humaines du secteur travers, notamment, lamlioration des programmes de formation dispenss par les tablissements de formation maritime et leur harmonisation avec les orientations de la stratgie Halieutis ainsi que laugmentation des capacits de formation par le dveloppement du nombre dtablissements de formation maritime. A cet gard, lanne 2012 verra la cration de quatre nouveaux centres de qualification des pches maritimes Tanger, Agadir, Sidi-Ifni et Boujdour portant ainsi leur nombre quatorze tablissements de formation; la consolidation de la politique de proximit en procdant dune part, la poursuite des chantiers de construction et damnagement des dlgations des pches maritimes au niveau des villes d'Agadir, Mohammedia et M'diq et dautre part, au lancement de la ralisation de nouvelles dlgations Casablanca et Boujdour ; la mise en uvre du programme dAppui la Pche Ctire et Artisanale a travers la mobilisation dun montant de 35 MDH destins la poursuite de la construction du Point de Dbarquement Amnag (PDA) dInouaren ainsi que
NOTE DE PRESENTATION
148
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
des travaux damnagement des PDA de Sidi Boulfdaile, Aglou et Moulay Bousselham ; le lancement effectif des travaux de construction des Villages de Pcheurs (VDP) au niveau de Beddouzza (province dEl Jadida) et Al Koudia Oued Ikem ; la construction de lpi d'arrt de sable au VDP de Chmala ainsi quun mur de clture pour la fabrique de glace au VDP de Souiria Kdima ; lappui aux programmes visant la prservation des ressources halieutiques. A cet gard, lanne 2012 connatra la poursuite de la mise en place des plans damnagement et de gestion par quotas des pcheries, en vue de prserver les pcheries vulnrables et permettre des conditions propices de repeuplement ; et la consolidation des efforts dploys pour une meilleure gestion des ressources halieutiques, en partenariat avec lInstitut National de la Recherche Halieutique (INRH). Cette consolidation tend renforcer les capacits dvaluation des potentialits des ressources halieutiques travers lintensification des campagnes de prospection, lamlioration des connaissances sur la biologie et lcologie des ressources et de la dynamique de leurs cosystmes et la diversification des tudes dimpact des mesures de gestion et de dveloppement sur lvolution des stocks et des captures ainsi que des essais piscicoles. A cette fin, un contrat plan triennal liant lINRH lEtat, en cours de finalisation pour la priode 2012-2014, devrait formaliser laccompagnement de lEtat pour permettre cet Institut la ralisation des objectifs de la stratgie Halieutis moyennant un processus de planification et de programmation des activits de recherche prioritaires. Par ailleurs, lanne 2012 connatra lacclration des ngociations avec les bailleurs de fonds internationaux pour lacquisition dun nouveau navire de recherche halieutique de faon permettre lINRH de renforcer ses moyens dintervention et de prospection. La consolidation des efforts visant la valorisation des produits de la pche travers le renforcement du programme national de matrise de la qualit, tous les stades de la filire pche pour assurer lassistance, le contrle et le suivi des diffrentes activits de la filire par le lancement dune tude pour la conception d'un dispositif de promotion de la qualit et de la consommation et ldition de supports crits, audio-visuels et multimdia de promotion des industries. Le lancement du plan damnagement du stock c , visant accorder de nouvelles licences de pche pour lexploitation du stock valu 1 million de tonnes de petits plagiques. Les exploitants potentiels de ce stock sengageront raliser des investissements sur terre permettant de valoriser les produits de la mer et de crer des emplois supplmentaires.
NOTE DE PRESENTATION
149
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Lanne 2012 connaitra galement la poursuite des diffrents programmes structurants du secteur de la pche initis ces dernires annes notamment le programme IBHAR II, lopration de gestion dlgue des villages de pcheurs par lOffice National des Pches, le plan daction pour labandon des filets maillants drivants, le projet dimmersion des rcifs artificiels au niveau des baies dAgadir et de Martil et la mise en uvre de la gnralisation effective et progressive de la couverture sociale au profit de 155.000 artisans pcheurs et de leurs familles.
III.2- Haut commissariat aux Eaux et Forts et la Lutte contre la Dsertification
Les crdits budgtaires allous au Haut Commissariat aux Eaux et Forts et la Lutte Contre la Dsertification, au titre de lanne 2012, slvent 974 532 000 dirhams, rpartis comme suit : Dpenses de personnel... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement Fonds National Forestier Fonds de la Chasse et de la Pche Continentale 417 742 000 DH 42 790 000 DH 200 000 000 DH 300 000 000 DH 14 000 000 DH
Cette enveloppe est destine poursuivre les efforts engags par ledit Haut Commissariat en matire de dveloppement durable des cosystmes, de prservation des ressources naturelles et de contribution du secteur de la fort lamlioration des conditions de vie des populations des zones forestires et priforestires. Le programme de lexercice 2012 qui adopte une dmarche base sur la concertation avec les partenaires locaux et la contractualisation des actions avec les services extrieurs de ce dpartement sarticule autour des principaux axes suivants : La conservation et le dveloppement des cosystmes forestiers : Afin de rattraper le retard enregistr en matire de reconstitution des cosystmes forestiers et dinverser les tendances de dforestation, le Haut Commissariat prvoit : La poursuite des actions de reboisement, de rgnration et damlioration sylvo -pastorale, sur une superficie de 50.000 ha contre 46.000 ha en 2010, soit une augmentation de 8,7%. Ces actions seront ralises au niveau des diffrentes rgions du Royaume retenues dans le Plan Directeur de Reboisement ; La consolidation et lentretien des plantations anciennes sur une superficie de prs de 40.000 ha, contre 39.000 ha en 2011 ;
NOTE DE PRESENTATION
150
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La production de plus de 50 millions de plants destins satisfaire les besoins des actions de reboisement, de rgnration, damlioration sylvo pastorale et dentretien des plantations anciennes en plants forestiers ; Loctroi de compensation pour la mise en dfens dune superficie de lordre de 85.000 ha au profit des populations usagres des parcours forestiers en vue dassurer la russite des oprations de reboisement et de reconstitution du couvert vgtal ; La ralisation de travaux de sylviculture et de conduite des peuplements qui concerneront une superficie de 17.000 ha. La lutte contre la dsertification et la protection de la nature : A ce titre, les actions suivantes sont prvues : la ralisation de travaux damnagement des bassins versants et de traitement de lrosion en vue de la conservation et la protection des cosystmes fragiles, la protection des agglomrations et des infrastructures contre les inondations et la rduction des taux denvasement des retenues des barrages. Ces travaux concerneront 22 bassins versants prioritaires et comporteront notamment la correction mcanique des ravins ; la ralisation dactions diverses comportant lquipement des points deau, la construction de postes vigie, le renforcement de la surveillance et lentretien de tranches pare feu dans le cadre de lutte contre les incendies de forts. Cette opration dintrt national qui est mene avec lappui de la Gendarmerie Royale sera accompagne dun vaste programme de sensibilisation des populations sur les dangers des feux. la poursuite du projet d'amnagement anti rosif des Bassins Versants d'Allal El Fassi et de lOued Mellah raliss avec le concours financier de lAgence Japonaise pour la Coopration Internationale. Dun cot global de 355 MDH, ce projet qui concerne neuf communes rurales dans les provinces de Boulmane et Sefrou et huit communes rurales dans les provinces de Khouribga et Ben Slimane a pour objectifs principaux: le contrle de lrosion en vue de prvenir la sdimentation des retenues des barrages et de rduire le risque dinondation; la prservation et la reconstitution des ressources forestires; la contribution la rduction de la pauvret et la rduction de la pression sur les ressources forestires. le dmarrage dun programme de rhabilitation de 200.000 ha darganier comportant des actions de densification et de regarni ainsi que des travaux damnagement foncier et de conservation des eaux et des sols en concertation avec lAgence Nationale de Dveloppement des Zones Oasiennes et de lArganier. Ce programme qui sinscrit dans le cadre du contrat programme sign entre le Gouvernement et la Fdration
NOTE DE PRESENTATION 151
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Interprofessionnelle Marocaine de lArgane, loccasion des 4me assises de lagriculture tenues en avril 2011, a pour but damliorer les performances et la comptitivit de la filire de larganier tout en sauvegardant son rle cologique et environnemental au niveau des zones dimplantation ; la poursuite des programmes damnagement et de gestion des ressources naturelles et de conservation de la diversit biologique dans le rseau daires protges, au niveau des dix parcs nationaux existants et de six sites dintrt biologique et cologique prioritaires et ce dans lobjectif de sauvegarder les sites dintrt cologique et biologique ainsi que la biodiversit qui leur est associe; et lintensification des oprations de repeuplement des zones de chasse et de pche continentale et leur valorisation travers des amnagements cyngtiques au niveau de 12 rserves de chasse sur une superficie de 40.000 ha, de 10 lots didactiques sur une superficie de 40.000 ha et de deux lots de chasse de la grande faune sur 3.000 ha ainsi que la production et le dversement de 7 millions d'alevins pour le repeuplement de 14 cours d'eau, 12 lacs naturels et 15 retenues de barrages. La Scurisation du Domaine Forestier et Infrastructures, travers : la poursuite de leffort dassainissement de la situation foncire du domaine forestier par la ralisation des oprations de dlimitation et de prparation des dossiers techniques pour limmatriculation ; la mise niveau des infrastructures dencadrement et de gestion des ressources forestires par la ralisation des actions prioritaires dans le domaine des constructions et de rhabilitation des maisons forestires et des btiments administratifs ; et la rhabilitation et lentretien de prs de 1.751 Km de pistes forestires intgres dans des projets de reforestation, de rgnration et damnagement des bassins versants dans le but de contribuer la surveillance des forts contre les incendies, faciliter lexploitation des ressources et participer au dsenclavement des populations des zones forestires et pri-forestires. La recherche forestire : Le programme de recherche devant accompagner les diffrentes actions du Haut Commissariat se concentrera essentiellement sur ladaptation des cosystmes forestiers aux changements climatiques, la matrise de litinraire technique de rgnration et damlioration de la production des espces forestires, de valorisation des produits forestiers et notamment les plantes aromatiques et mdicinales.
III.3. Industrie, Commerce et Nouvelles Technologies
Lenveloppe budgtaire globale alloue au Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, au titre de lanne 2012, slve 1 292 436 000 dirhams, rpartie comme suit :
NOTE DE PRESENTATION 152
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement..
176 383 000 DH 145 628 000 DH 970 425 000 DH
III.3.1. Industrie et Commerce Lenveloppe budgtaire alloue au domaine de lIndustrie et du Commerce, au titre de lanne 2012, slve 988 674 000 dirhams, rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 144 261 000 DH 126 988 000 DH 717 425 000 DH
Ces crdits sont destins la poursuite de la ralisation des diffrents chantiers inscrits dans le cadre du Plan National pour lEmergence Industrielle, du Plan RAWAJ pour le dveloppement et la modernisation du commerce et de la distribution et de la nouvelle stratgie de linnovation ciblant le dveloppement des technologies avances et des secteurs technologiques de pointe et forte croissance tels que la microlectronique, la nanotechnologie et la biotechnologie. Le plan daction du dpartement de lIndustrie et du Commerce, par domaine, pour lanne 2012 se prsente comme suit :
1. Mtiers Mondiaux du Maroc
Le dveloppement des secteurs de loffshoring, de lautomobile, de laronautique et du spatial et de llectronique, revt un caractre stratgique dans la politique industrielle nationale. A cette fin, et en vue d'attirer les investisseurs, lEtat a dvelopp une offre attractive assurant la comptitivit de la destination Maroc et articul autour de quatre volets : (i) un cadre incitatif fiscal trs attractif, (ii) un dispositif de dveloppement des ressources humaines qualifies comprenant un systme daide aux oprateurs dans leurs efforts de formation lembauche et de formation continue et un plan de formation adapt leurs besoins, (iii) une offre dinfrastructures et de services aux investisseurs aux meilleurs standards internationaux travers le dveloppement de plateformes Industrielles Intgres ddies et (iv) la mise en uvre dun programme cibl de promotion et de commercialisation. Offshoring Loffre Maroc a permis au pays de se positionner en tant que destination leader dans ce secteur, faisant doubler le montant des exportations du secteur de 3 milliards de dirhams en 2006 plus de 6 milliards de dirhams en 2010 et en gnrant une hausse importante des emplois qui passe de 23.000 en 2007 et de 46 000 personnes en 2010.
NOTE DE PRESENTATION 153
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Sur les six plateformes Industrielles Intgres (P2I) ddies lOffshoring prvues par le Pacte Emergence, cinq sont en cours de ralisation ou dextension savoir : Casanearshore Cette P2I dont lamnagement est confi MEDZ porte sur une superficie de 270 000 m et devrait gnrer terme la cration de 12 000 emplois. Les deux premires tranches de 103 000 m, dj oprationnelles, connaissent linstallation de 47 entreprises. La livraison des deux tranches restantes, reprsentant 167 000 m a dbut au courant du second semestre 2011 et se poursuivra en 2012. Rabat Technopolis Sur les 205 000 m prvus terme, une 1re tranche de 44 000 m est oprationnelle et abrite ce jour 19 entreprises. Lamnageur MEDZ prvoit lachvement de la ralisation et de la commercialisation dune deuxime tranche portant sur 24 000 m au courant de 2012. Ce projet devrait gnrer la cration de 18 000 emplois. Fs Shore La ralisation de cette P2I portant sur une superficie de 140 000 m permettra la cration de 12 000 emplois. Lamnageur MEDZ prvoit la livraison dune premire tranche de 16 000 m au cours de 2012. Ttouan Shore Confis TMSA, les travaux damnagement de cette P2I, lancs le 30 juin 2010, portent dans une premire phase sur 22 000 m sur une superficie globale de 20 ha. La livraison de cette premire tranche est prvue en 2012. Ce projet devrait gnrer terme la cration de 10 000 emplois. Oujda Shore Les travaux de ralisation par MEDZ de cette P2I, intgre au sein de la Technopole dOujda, sur une superficie de 5 000 m2, ont t lancs en 2011. Sagissant de Marrakech Shore le lancement des travaux de ralisation par MEDZ est programm pour la fin de cette anne et porte sur une superficie de 50.000 m2. Automobile Le secteur Automobile a connu, lors de ces dernires annes, un fort dveloppement au Maroc sur les deux fronts Equipementiers et Constructeurs caractris par l'implantation d'un site d'assemblage majeur par Renault Tanger Melloussa, dquipementiers de rang 2 et 3 ainsi que linstallation dassembleurs de spcialit avec lambition dattirer terme un second constructeur majeur. A noter que ce dveloppement sest traduit par la hausse du montant des exportations du secteur de 3,6 milliards de dirhams en 2004 18,3 milliards de
NOTE DE PRESENTATION
154
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
dirhams en 2010 ainsi que du nombre des emplois qui a atteint 51.800 personnes en 2010 contre 30.000 en 2004. Pour accompagner ce dveloppement, deux P2I intgres ddies au secteur sont en cours de ralisation Knitra et Tanger avec un statut de zones franches. Knitra Automotive City Cette P2I, qui devrait gnrer terme 12 MMDH dinvestissement et la cration de 30.000 emplois, est en cours de ralisation sur 345 ha, dont 190 ha en zone franche. Lamnagement, la promotion, la commercialisation et la gestion de sa 1re tranche portant sur 192 ha ont t confis au groupement constitu de CDG Dveloppement et de la socit espagnole Edonia World. La livraison de cette tranche est prvue en 2012 et celle de la seconde tranche pour 2015. Tanger Automotive City Assise sur une superficie de 260 ha, dont 178 ha en zone franche, cette P2I permettra dattirer terme 8 MMDH dinvestissement et de crer 30.000 emplois. Son amnageur TMSA prvoit lachvement dune premire tranche de 47 ha pour fin 2012. Par ailleurs, lanne 2011 est marque par lachvement de la ralisation du complexe industriel Renault Tanger-Mditerrane, situ sur un terrain de 314 ha. Ce complexe, qui constitue une composante majeure pour lmergence dune industrie automobile intgre au Maroc, produira ses premires voitures en 2012 avec une capacit de 170.000 vhicules/an. Lachvement de lextension de ce complexe est prvu, deux annes plus tard, avec pour objectif de relever la production terme 400.000 units par anne destine hauteur de 90% lexportation. Cet investissement, de lordre dun milliard dEuros, permettra de crer au dmarrage 36.000 emplois directs et indirects. Aronautique et Spatial Afin de capter le plein potentiel du Maroc dans l'Aronautique et le Spatial, le dveloppement du secteur sest focalis sur la mise en place dune vritable plateforme ciblant huit filires mtiers forte valeur ajoute savoir les matriaux composites, le travail des mtaux, lassemblage, lingnierie et la conception, les systmes lectriques et le cblage, la rparation des moteurs, pices et quipements, la maintenance et enfin la transformation et modification davions. A noter que la mise en uvre de cette stratgie a permis daugmenter le montant des exportations du secteur de 800 MDH de dirhams en 2004 5,2 milliards de dirhams en 2011 ainsi que le nombre des emplois qui passe pour la mme priode de 2.500 prs de 7.369 personnes. Par ailleurs, Nouasser Aerospace City, une P2I ddie ce secteur, dote dune superficie de 141 hectares est en cours de ralisation par MEDZ. Lachvement dune 1re tranche de 78 ha est prvu pour 2012.
NOTE DE PRESENTATION
155
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Electronique Cinq quartiers ddis ce mtier au sein des P2I seront raliss avec lobjectif datteindre 2,5 milliards de dirhams de PIB additionnels et la cration de 9.000 emplois directs lhorizon 2015. Il sagit des sites suivants : le quartier Mcatronique/lectronique industrielle sur une superficie de 40 50 ha, dans la rgion de Casablanca au niveau du corridor Zenata Nouaceur ; trois quartiers ddis llectronique embarqus dans les P2I Automobile de Tanger et Knitra et dans la P2I Nouasser Aerospace City sur une superficie de 5 10 ha ; le Cluster lectronique de Mohammedia dune superficie de 40 ha. Il est signaler que le secteur a connu une hausse importante de ses exportations qui passent de 1,2 milliard de dirhams en 2004 6,6 milliards de dirhams en 2011 sachant que le nombre des emplois est pass pour la mme priode de 6.300 9.000 personnes. Textile et Cuir Secteur de premire importance pour l'industrie nationale avec un poids majeur dans les emplois et une contribution importante au PIB et aux exportations industriels, il a bnfici depuis 2006 d'une opportunit stratgique, grce la rinstauration des quotas sur les produits chinois, et au positionnement russi du Maroc sur le segment du fast fashion, travers le dveloppement de la soustraitance pour un acteur de rfrence de ce segment. Ainsi, et en particulier dans une conjoncture internationale en pleine mutation, lEtat a mis en place un programme volontariste pour le secteur Textile et Cuir, lui permettant de raliser pleinement son potentiel par la mise en place dun plan de dveloppement des dbouchs lexport, le relev de potentiel des entreprises, lintensification de la lutte contre les pratiques de sous-facturation et le lancement de la mise en uvre dun plan de Formation pour les mtiers du Textile et du Cuir touchant 32 000 personnes. Dans ce cadre, des oprateurs internationaux de renom ont fait confiance au Maroc pour dvelopper leur activit de sourcing tels le groupe Inditex qui envisage daugmenter de 15% ses achats en vtements en provenance du Maroc dune manire graduelle sur les trois annes venir partir de lanne 2011 ainsi que le groupe Li&Fung, qui ralise actuellement un chiffre daffaires dans le domaine de lhabillement de 20 Milliards de dirhams lchelle internationale et qui compte dvelopper une plateforme de sourcing dans le pays. Par ailleurs, la rflexion est engage actuellement sur ladaptation du tissu des acteurs locaux au plan de dveloppement des dbouchs lexport et destination du march local travers la mise en place dun dispositif pour faciliter lmergence de nouveaux business models travers la slection dun ensemble de projets dune grande valeur ajoute pour le secteur textile. Cette approche vise renforcer nos exportations travers une meilleure intgration industrielle du secteur, un
NOTE DE PRESENTATION 156
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
dveloppement soutenu de la distribution moderne et lmergence de convecteurs, dagrgateurs et distributeurs disposant de projets de croissance fonds sur une vision claire et des objectifs cibls pour pouvoir prtendre un accompagnement financier de lEtat sur une base conventionnelle. A noter que le secteur du Textile et Cuir a connu, entre 2008 et 2010, une augmentation des exportations des secteurs de lHabillement et de la fabrication de la chaussure respectivement de 5,1% et de 6,3%. Les zones ddies au dveloppement des mtiers mondiaux du Maroc sont renforces par la ralisation de P2I gnralistes et de zones industrielles. P2I gnralistes La Technopole dOujda, en cours de ralisation par MEDZ sur une superficie de 496 ha, dont une superficie de 223 ha environ est concerne par la 1re tranche du projet. Le programme de ralisation de cette 1re tranche, dont lachvement est prvu pour 2012, porte notamment sur la ralisation dun parc industriel Cleantech , ddi aux activits de fabrication des quipements pour le dveloppement durable, en particulier ceux relatifs aux nergies renouvelables et lefficacit nergtique, sur une superficie de 96 ha et dun retail Park, espace ddi laccueil dactivits commerciales et des grandes enseignes sur une superficie de 20 ha. Ce projet devrait gnrer terme 5 Milliards de dirhams dinvestissement et la cration de 15 000 emplois. La P2I Fs Ras El Maa, qui couvre une superficie de 420 ha, permettra terme la cration de 30 000 emplois. La P2I Tanger Free Zone dont les travaux dextension portant sur une superficie additionnelle terme de 110 ha ont t lancs pour une premire tranche de 30 ha, en fvrier 2011. Les tudes pour la mise en place des P2I de Settat et de Casablanca sont en cours de ralisation. Plan de dveloppement et damlioration des zones industrielles locales Il est rappeler que le Pacte Emergence a prvu la mise en uvre dun programme de ralisation de zones dactivits conomiques et de rhabilitation des zones industrielles pour permettre aux rgions de renforcer leur potentiel industriel. Pour les projets de zones industrielles et de parcs industriels, financs par le budget de lEtat ou par le Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et Social, un ensemble de projets structurants vocation locale ou rgionale sont en cours de ralisation et concernent la cration et la rhabilitation des parcs industriels de Jorf Lasfar (500 ha) Ouled Saleh Casablanca (32 ha), Slouane (142 ha) et dAit Qamra Al Hoceima (40 ha). Le Ministre a galement poursuivi la ralisation des zones industrielles de Sidi Bernoussi (600 ha), dAit Melloul (354 ha), de Tassila Agadir (284 ha), de Dakhla (45 ha), de Tabriquet Sal (23,5 ha), de Takkadoum Rabat (12 ha) et de Ttouan (47 ha).
NOTE DE PRESENTATION 157
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
2. Formation
Ce chantier a t marqu par la cration dun ensemble dInstituts Spcialiss, le renforcement de loffre de formation qualifiante et/ou de reconversion effectue par les tablissements privs ainsi que le lancement attendu en 2012 des travaux de ralisation de lEcole Centrale de Casablanca en partenariat avec lEcole Centrale de Paris. Pour rappel, afin d'accompagner la forte croissance des secteurs lies aux mtiers mondiaux du Maroc, lEtat a mis en place un dispositif de formation complet, au service des entreprises du secteur automobile, et ceci en collaboration avec la CGEM et les associations professionnelles concernes. Cration de quatre Instituts Spcialiss en Automobile Sur les quatre instituts de formation spcialiss ddies lautomobile devant tre mis en place, il y a lieu de relever : linauguration, le 21 mars 2011, de lInstitut de Formation aux mtiers de lAutomobile de Tanger Mditerranen, rserv Renault Tanger Mditerranen et ses quipementiers, dont le cot de ralisation avoisine les 7,8 millions deuros ; le lancement des travaux de ralisation des trois instituts de formation spcialiss en automobile de Knitra, de Tanger et de Casablanca avec lobjectif de leur oprationnalisation en octobre 2012, pour rpondre rapidement aux besoins des quipementiers installs dans les diffrentes rgions concernes. Ces instituts permettront, horizon 2013, la formation de 31.500 dingnieurs, cadres, techniciens et oprateurs. Cration de lInstitut des Mtiers de lAronautique Linauguration de lInstitut des Mtiers de lAronautique de Casablanca, le 06 mai 2011, constitue un vnement majeur pour le secteur de laronautique et spatial dans la mesure o il permettra ds cette anne la formation de 800 ingnieurs, cadres, techniciens et oprateurs par an dans les mtiers de laronautique, pour atteindre 4.500 personnes lhorizon 2015. Projet de cration de lEcole Centrale de Casablanca Le lancement des travaux de ralisation de cette cole dingnieurs au Maroc, en partenariat avec lEcole Centrale de Paris, est prvu pour lanne 2012 pour un investissement estim plus de 100 MDH.
3. Initiative Maroc Innovation
Dans le cadre de la mise en uvre de la stratgie nationale de lInnovation et des technologies avances, trois dispositifs de promotion de linnovation au sein de lentreprise marocaine ont t mis en place en 2011 avec les objectifs lhorizon 2014 de produire 1.000 brevets et de favoriser la cration de 200 Startups innovantes.
NOTE DE PRESENTATION
158
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Programme dappui la mise en place des clusters marocains Ce programme prvoit un appui financier, plafonn 2 MDH/an pour chaque cluster et pour une dure maximale de 5 ans, comme contribution au financement des oprations lies au fonctionnement de la structure danimation du Cluster (frais du personnel, tudes dintrt collectif et frais divers de gestion lis aux actions de communication, de promotion, de conseil et de formation). Pour le financement de ce programme, un fonds dappui aux clusters a t cr, dot dune enveloppe de 62 millions de dirhams sur trois ans, pour permettre le soutien, sur la priode 2011-2013, de 15 clusters, soit 5 par an. Le premier appel projets lanc en 2011 pour slectionner les meilleurs clusters oprant dans les secteurs industriels et technologiques a permis la slection de quatre clusters pour bnficier de lappui de ce fonds dans les secteurs des technologies de linformation et de communication, de la microlectronique, de la mcatronique et de la valorisation des produits de la mer. Programme de soutien linnovation Dans le cadre de ce programme, trois instruments de financement de linnovation ont t mis en place pour rpondre, sur la base dappels projets, aux besoins des startups et entreprises exerant dans le secteur industriel, des TIC ou des technologies avances. Il sagit de: INTILAK , Soutien la startup, qui cible les startups en phase de dmarrage, ayant moins de deux ans dexistence et fort potentiel de dveloppement, porteuses de projets de valorisation des rsultats de recherche et de projets innovants orients march. Lappui envisag couvre hauteur de 90 % des dpenses lies au projet de dveloppement dans la phase post cration, dans la limite dun plafond de 1 MDH. Prestation Technologique Rseau , qui cible les entreprises ou consortia ou groupements constitus dentreprises ligibles relevant des secteurs susviss, visant le financement des diagnostics technologiques ou de prestations relevant dune dmarche dinnovation ou contenu technologique. Lappui envisag couvre hauteur de 75% et dans la limite dun plafond de 100.000 dirhams, les dpenses affrentes aux prestations dexpertise. TATWIR , Soutien au dveloppement, qui couvre, dans la limite de quatre millions de dirhams, 50 % des dpenses engages dans le cadre dun projet de dveloppement de R&D ports par des entreprises exerant dans les secteurs susviss et en phase de dveloppement ou par des consortium ou groupements dentreprises ligibles agissant dans le cadre dun cluster. Pour le financement de ce programme, un fonds de soutien linnovation a t cr, dot dune enveloppe de 380 millions de dirhams sur trois ans, pour permettre le soutien, sur la priode 2011-2014, de 800 projets dinnovation. Par ailleurs, pour un accompagnement efficient du programme susvis, le Centre Marocain de lInnovation cr, en juillet 2011, en tant que filiale de Moroccan
NOTE DE PRESENTATION 159
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Information Technopark Company, et dot dun budget de gestion de dix millions de dirhams lhorizon 2014, a t charg notamment de lexamen et de lvaluation des projets soumis dans le cadre des appels projets affrents aux instruments de financement de linnovation. Programme de Financement de la R&D Oriente March dans le Secteur des Technologies Avances Ce programme vise, sur la priode 2011-2013, le financement de 50 projets de R&D prsents conjointement par une entreprise associe un laboratoire public de recherche ou un consortium de laboratoires publics pour un cot global de 50 millions de dirhams. Lappui couvre hauteur de 50% et dans la limite de deux millions de dirhams, les dpenses lies au projet de recherche et dveloppement dans le secteur des Technologies Avances. 4. Modernisation du commerce de proximit : Le plan RAWAJ vise amliorer la comptitivit des commerants, faire merger de nouveaux modles de commerce et assurer une offre en produits et en espaces commerciaux rpondant aux besoins des consommateurs. Pour ce faire, il contribue au financement de projets lis la modernisation du commerce de proximit, laccompagnement des champions nationaux, aux zones dactivits commerciales et aux tudes et plans de dveloppement rgionaux avec pour objectif, de porter le PIB du commerce de 68,5 milliards de dirhams en 2007 98 milliards de dirhams en 2012 et de crer plus de 200.000 emplois additionnels pour un cot valu, dans le cadre de la convention signe le 11 juin 2008, 900 MDH pour la priode 2008-2012 dont 100 MDH au titre de 2008 et 200 MDH par an pour la priode 2009-2012. Compte tenu de la forte augmentation de la cadence mensuelle moyenne de modernisation, qui est passe de 130 points de vente moderniss en 2010 833 en juin 2011, lambition affiche par le programme est dassurer, au titre de 2012, la modernisation de 12.500 commerces de proximit. Par ailleurs, dans le cadre de la composante tude du plan RAWAJ, il a t procd au lancement dune tude visant tablir ltat des lieux du commerce ambulant au Maroc, valuer les diffrentes expriences entreprises au niveau national portant sur lorganisation de cette activit, qui compte plus de 441.000 units de commerce ambulant dont 238.000 exerant en milieu urbain, et dfinir une nouvelle approche permettant sa structuration et sa mise niveau. 5. Promotion des investissements Au titre de lanne 2012, lAgence Marocaine de Dveloppement des Investissements prvoit la poursuite de la mise en uvre des actions de promotion et de commercialisation de loffre Maroc en matire dinvestissement articule autour des axes suivants :
NOTE DE PRESENTATION
160
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la poursuite de llargissement de sa prsence en dehors du territoire national par louverture de deux nouveaux bureaux de reprsentation permanente Londres et AbuDhabi ; lintensification des campagnes de communication multi-supports et cibles dans les pays prioritaires notamment la France, lEspagne, lItalie, lAllemagne et le Golfe; lorganisation et la participation des salons incontournables pour chaque Mtier Mondial du Maroc et le renforcement du dmarchage direct des entreprises ; et lamlioration des conditions daccompagnement des investisseurs dans la ralisation de leurs projets au Maroc. 6. Promotion de la scurit et de la sant au travail Lanne 2012 constitue une tape charnire dans la mise en place de lInstitut National des Conditions de Vie au Travail et du dveloppement de son activit. En application de la convention portant cadre pour la promotion de la scurit et de la sant au travail, pour la priode 2011-2014, signe en mai 2011, entre lEtat et la CGEM, il est prvu la mise en place dun fonds pour la promotion de la scurit et de la sant au travail, dot de 252,5 MDH financs par le Budget de lEtat hauteur de 162,5 MDH et par une contribution du Fonds de Solidarit des Assurances de 90 MDH. Cette enveloppe financire est destine au financement de : la construction et lquipement de lInstitut National des Conditions de Vie au Travail ainsi que ses charges de fonctionnement pour un cot de 165 MDH ; un programme de mise niveau de 5.900 entreprises de moins de 50 salaris, tous secteurs confondus, dans leur dmarche de mise niveau en matire de scurit et de sant au travail, pour un cot global de 45,5 MDH, dont 800 entreprises relevant du Grand Casablanca ds 2011 et 1.500 entreprises au niveau national en 2012 ; une campagne de sensibilisation ayant pour objet de rpondre aux deux enjeux prioritaires dinformation autour de la sant et la scurit au travail et de communication autour du programme susvis de mise niveau des entreprises, pour un cot de 42 MDH. 7. Appui aux Chambres de Commerce, dIndustrie et de Services A titre de rappel, un fonds dappui pour le financement des projets dintrt conomique promus par les Chambres de Commerce, dIndustrie et de Services, dot de 80 millions de dirhams pour la priode 2009- 2012, a t cr en vertu de la convention du 9 juillet 2008, signe entre lEtat et la Fdration des Chambres de Commerce dIndustrie et des Services. Ce fonds a permis, dans le cadre de partenariat avec lesdites chambres et les Collectivits locales, lamorage de projets dintrt conomique et gnrateurs de revenu visant la dynamisation de lconomie rgionale et la cration demplois.
NOTE DE PRESENTATION 161
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
A fin 2011, cinq Chambres ont bnfici dun montant global de 72 MDH comme contribution du fonds la ralisation du Complexe multiservices des entreprises dAgadir, du Centre international des foires et expositions de Marrakech, du Parc International dexpositions de Fs, du Centre daffaire et dincubation des entreprises de Nador et du Palais de la foire de Taza. III.3.2- Nouvelles Technologies Lenveloppe budgtaire mise la disposition du secteur des Nouvelles Technologies, au titre de lanne 2012, slve 42 400 000 dirhams, rpartie comme suit : Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 5 400 000 DH 37 000 000 DH
Les crdits prvus au profit du Ministre du Commerce, de lIndustrie et des Nouvelles Technologies en 2012 dans le cadre de la mise en uvre du plan Maroc Numeric 2013 concernent principalement les oprations suivantes : i. Le pilotage de la stratgie travers le Programme Management Office (PMO) pour la gestion du plan Maroc Numeric 2013 et des PMO au niveau de chaque programme national ; Lexploitation des synergies entre les administrations dans le programme egov en vue damliorer le service rendu par ladministration au citoyen. A cet effet, le Ministre pilote lexcution de ce programme raliser par diffrents dpartements et organismes concerns; Lincitation linformatisation de la PME par la poursuite de la mise en uvre du programme Moussanada TI destin aux technologies de linformation ; Le dveloppement de lindustrie des TI travers la poursuite de la mise en place du Centre de Documentation Numrique des TIC et la poursuite du projet de cration de la plateforme lectronique marchande ; Linstauration de la confiance numrique principalement par la mise en uvre des rsultats de ltude relative la mise niveau du cadre lgislatif et rglementaire, la mise en uvre de la campagne de communication, la gnralisation de la formation et le dveloppement dun site de backup dans le cadre dun partenariat public priv.
ii.
iii.
iv.
v.
Par ailleurs, le dpartement laborera un projet de loi sur la rforme postale et mettra en place une stratgie postale. III.3.3- Commerce Extrieur Lenveloppe budgtaire globale mise la disposition du dpartement du Commerce Extrieur, au titre de lanne 2012, slve 261 362 000 dirhams, rpartie comme suit :
NOTE DE PRESENTATION 162
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement..
32 122 000 DH 13 240 000 DH 216 000 000 DH
Dans le cadre de la poursuite de la mise en uvre de la stratgie nationale de dveloppement et de promotion des exportations Maroc Export Plus , le programme daction du dpartement, pour lanne 2012, prvoit la ralisation des actions ci-aprs, rparties selon les axes de ladite stratgie comme suit : Le renforcement de la promotion des exportations travers lengagement des trois types dactions dordre transversal, sectoriel et organisationnel dsignes ci-aprs : Sagissant des actions dordre transversal portant sur le renforcement du tissu exportateur, elles concernent : loprationnalisation du dispositif daudit lexport auprs des entreprises marocaines exportatrices afin damliorer leur capacit lexport ; llaboration et la ralisation dun programme de dveloppement des consortia lexport ; la mise en place du programme affrent aux contrats de croissance lexport visant soutenir les entreprises fort potentiel dexportation dans leurs dmarches marketing de dveloppement l'international ; la mise en place dun dispositif de veille destination des exportateurs ; lamlioration du dispositif daccompagnement et de suivi des activits promotionnelles des entreprises ; la production dun rfrentiel fiable et exhaustif des produits exportables ; la modernisation du systme dassurance lexportation pour ladapter aux besoins des exportateurs et aux standards internationaux ; la concrtisation des contrats programmes pour accompagner les associations professionnelles dans leurs plans dactions promotionnelles. En ce qui concerne les actions sectorielles, qui ciblent les secteurs et les produits pour orienter les efforts de promotion en priorit vers les produits dont loffre est disponible puis ceux issus des plans sectoriels en cours, les actions spcifiques de promotion toucheront particulirement les secteurs de lautomobile, lIT et loffshoring, llectrique, lagroalimentaire et les produits de la mer, le textile et le cuir ainsi que la pharmacie. Sagissant des actions organisationnelles, il est prvu essentiellement la poursuite de :
NOTE DE PRESENTATION
163
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la rorganisation du Centre Marocain de Promotion des Exportations en vue dadapter sa structure organisationnelle ses nouvelles missions ; la mise en place des dispositions relatives la transformation du Conseil National du Commerce Extrieur en Observatoire Marocain du Commerce Extrieur. La poursuite de lidentification et du dveloppement de loffre exportable rgionale par llaboration et la mise en uvre des plans dactions spcifiques chaque rgion du Royaume. Ces plans dactions portent principalement sur ladaptation des actions promotionnelles aux spcificits rgionales, la sensibilisation et laccompagnement des entreprises exportatrices par rgion, linstitutionnalisation des comits rgionaux de lexportation et lengagement des tudes sur loffre exportable rgionale. Lvaluation des mesures de soutien la promotion commerciale par : la ralisation dune enqute auprs des entreprises bnficiaires pour mesurer limpact rel du soutien en termes de rsultats et de performances commerciales ralises ; le lancement dune tude sur la refonte du systme dencouragement lexport. Il sagit didentifier les actions prendre en vue dadapter le systme dencouragement des exportations au nouveau contexte comptitif marocain et aux engagements internationaux du Maroc, notamment les accords de lOrganisation Mondiale du Commerce, et ce travers la dfinition dun systme intgr dencouragement des exportations et loptimisation de lorganisation des intervenants en matire dencouragement des exportations. La rgulation et la facilitation des changes, notamment, par le biais de : laccompagnement de la mise en place de la loi n 13-89 relative au commerce extrieur et ses textes dapplication ; la facilitation des changes et la conformment au programme de Doha ; simplification des procdures
la signature et la ratification dun ensemble daccords et de conventions internationaux relatifs aux produits double usage et le renforcement du contrle stratgique de leur importation et exportation ; la ralisation dune tude sur loptimisation des dlais et des cots daccs aux marchs cibles pour faire ressortir les mesures mettre en uvre pour optimiser les dlais et les cots d'accs aux marchs cibles, notamment en incitant les transporteurs ariens maritimes et routiers renforcer leurs lignes vers les pays cibles. Lamlioration du contrle des importations et des exportations par la mise en place dun systme appropri de contrle bas sur le recours aux licences dimportation et dexportation, aux contingents tarifaires et aux
NOTE DE PRESENTATION 164
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
franchises douanires conformment la loi sur le commerce extrieur sus-mentionne et aux engagements souscrits au titre des accords commerciaux bilatraux et multilatraux. Le renforcement des mesures de dfense commerciale pour la protection de lconomie nationale notamment les mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde en sappuyant sur des enqutes publiques, des sminaires et ateliers, des actions de formation et lachvement du cadre lgislatif et rglementaire favorisant la dfense commerciale conformment aux rgles de lOrganisation Mondiale du Commerce. Llargissement et la diversification des relations commerciales par la poursuite de louverture de lconomie marocaine et la conclusion dun certain nombre daccords de libre change avec les diffrents partenaires commerciaux tant au niveau bilatral que rgional, et qui sinscrivent dans leur majorit dans le cadre de lintgration conomique rgionale. Ces accords contribuent pleinement latteinte des objectifs de libralisation des changes et douverture de notre pays sur le reste du monde, notamment travers : La contribution la consolidation du systme commercial multilatral travers la poursuite en 2012 des actions engages en ce domaine important pour les relations commerciales du Maroc avec lOMC; Lengagement de la rflexion sur ladhsion du Maroc au Systme Global des Prfrences Commerciales travers le lancement dune tude pour mesurer limpact de cette adhsion sur les changes commerciaux et sur son conomie. Ce systme sert de cadre aux concessions tarifaires prfrentielles et autres mesures de coopration destines stimuler le commerce entre pays en dveloppement ; Le renforcement des relations avec les pays europens par la poursuite des ngociations visant linstauration dun accord de libre change approfondi et global avec lUE suite aux avances enregistres dans les ngociations sur le commerce des services et le droit dtablissement ; La dynamisation des relations sud-sud travers : lamlioration et lharmonisation du cadre rglementaire et administratif ainsi que llimination des barrires non tarifaires ; la dynamisation de la promotion commerciale par laccroissement de la prsence du pays sur ces marchs en vue dlargir nos parts de march travers ladaptation de loffre exportable la demande et aux normes des marchs et le dveloppement des relations directes entre les milieux des affaires ; la consolidation de la prsence du Maroc sur les marchs prometteurs des pays africains non arabes pour une plus forte diversification de nos exportations ainsi que le dveloppement de nouvelles opportunits commerciales travers la mobilisation des bailleurs de fonds internationaux et des actions de sensibilisation des oprateurs marocains ;et
NOTE DE PRESENTATION 165
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la poursuite de la mise en uvre de laccord de libre change Maroc-USA en ciblant davantage les opportunits quoffre ce vaste march aux exportateurs marocains. Le dveloppement des formations au commerce international adaptes aux entreprises exportatrices dans lobjectif de mettre niveau les comptences marocaines dans le domaine du commerce international. Il sagit de poursuivre les efforts visant mettre en place un programme de formation au commerce international comprenant des formations acadmiques spcialises et des formations de mise niveau destines aux employs des entreprises exportatrices.
III.4- Tourisme
Lenveloppe budgtaire alloue au Ministre du Tourisme, au titre de lanne 2 012, slve globalement 616 970 000 dirhams, rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 156 030 000 DH 65 620 000 DH 395 320 000 DH
Au titre de lanne 2012, le plan daction du Ministre du Tourisme sarticule autour des axes suivants : 1. En matire de produit, laction dudit ministre portera sur la prservation de la dynamique dinvestissement travers dune part, la poursuite des mesures de soutien aux projets touristiques accordes sous la forme davantages et dincitations aux amnageurs dveloppeurs en termes de contribution pour la ralisation des infrastructures hors-sites, de mobilisation du domaine priv de lEtat, dexonrations fiscales et douanires ou daides la formation professionnelle et dautre part, par la poursuite de la ralisation des plans Azur, Biladi et des Pays dAccueil Touristiques, des programmes relatifs lEco/dveloppement durable, la rhabilitation et reconversion des monuments historiques du pays, au dveloppement de lanimation, des sports et des loisirs et du tourisme de niches. Sagissant du Plan Azur, qui sinscrit dans la continuit de la vision 2010 moyennant quelques repositionnements a pour objectif de rquilibrer loffre au profit du balnaire dans loptique de construire une offre balnaire Maroc comptitive au niveau international. Durant lanne 2012, laction sera focalise sur : le parachvement des diffrents projets de stations balnaires de Sadia, Lixus et Mogador et leur repositionnement en vue de renforcer loffre animation et loisirs et intgrer davantage les diffrents aspects cologiques ; lextension de certains projets structurants lancs partiellement au cours de la dernire dcennie notamment le projet Plage Blanche.
NOTE DE PRESENTATION 166
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
En ce qui concerne le programme Eco/ Dveloppement Durable; qui vise la valorisation et la prservation des ressources naturelles et rurales, le respect de l'authenticit socioculturelle des communauts d'accueil et loctroi en leur faveur davantages socioconomiques ; les actions programmes durant lanne 2012 portent sur : la diffusion au niveau des territoires touristiques de nouvelles structures touristiques haut de gamme, respectueuses de lenvironnement et intgres dans leur environnement socioculturel, sous forme dco-stations, dcoressorts, de stations vertes, de ressorts du dsert et de bivouacs de luxe ; lamnagement du Golf du dsert et la mise en place dun bivouac de luxe, ltude des Ecolodges et circuits au mont Benissen, la ralisation des colodges au niveau du SIBE de Tamga, Douar de Taghia, la cration dune ferme dcouverte Bni Moussa, dun jardin botanique Ain Asserdoune, lappui au festival du grenadier Fkih Ben Salah, la mise en place de lobservatoire du ciel Ait Mhmed, la rhabilitation des greniers dAoujgal, la rorganisation des hbergements dans la valle de lOurika , le lancement de la mise en place dune station verte avec base nautique au barrage Ait Aadel, le dveloppement dun htel clat Ouarzazate-Zagora , Ecolodge Mhamid Ghizlane et lorganisation de randonnes dans le dsert saharien ; la consolidation et la revalorisation des Pays dAccueil Touristiques par la mise en place de structures dhbergements de petite taille telles que les gtes pour les touristes la recherche de dpaysement et de mode de vie alternatif et le dveloppement dactivits danimation travers lquipement et lhabillage de la MPAT de Khnifra, la mise en fonction de la MPAT dErrachidia, la mise en place de jardin botanique et dun espace dexposition des produits au niveau du site historique de Oualili, et laccompagnement des associations des PAT dErrachidia, Zagora, Al Haouz, Ida Outanane, Al Hoceima, Chefchaouen ; le dveloppement de la premire destination africaine carbone neutre au niveau du site de Ouarzazate en prenant appui sur la plateforme de production d'nergies prvue pour compenser les missions de CO2 gnres par toutes les activits conomiques et touristiques locales. En matire de sauvegarde du patrimoine et de lhritage, laction de ce dpartement vise la rhabilitation et la reconversion des monuments historiques du pays et la prservation de leur identit architecturale travers : la conception de circuits dinterprtation parcourant les mdinas des grandes villes impriales du Royaume. Les tudes concernant plusieurs mdinas sont en phase de lancement particulirement celles de Casablanca, Rabat, Ttouan et Oujda ; la dynamisation de laction de la socit de revalorisation touristique du patrimoine cre en juillet 2011 pour mettre profit lhritage architectural du Royaume (kasbahs, ksours, ryads, fondouks, palais dhte et greniers) par sa transformation en hbergement haut de gamme authentique caractris par un fort cachet culturel ;
NOTE DE PRESENTATION 167
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la mise en place de grands muses de classe internationale permettant doffrir aux touristes une dcouverte et une interprtation du patrimoine historique et culturel du Royaume. Dans un premier temps, deux grands muses seront mis en place savoir le muse de lAfrique de Tanger et le muse de lHistoire du Maroc de Mekns ; lessaimage dune offre danimation fonde sur les arts et sur le patrimoine immatriel comprenant de nombreux festivals de traditions des diffrentes rgions du Maroc ; la mise en place dun programme National MEDINTI pour la valorisation des mdinas. Les mdinas prvues pour 2012 sont Casablanca, Rabat, Oujda, Ttouan, Sal et Chefchaouen. Sagissant du Programme Animation, Sports et Loisirs , le dpartement prvoit dengager la ralisation des projets suivants : la construction de parcs dattraction inspirs des plus grandes rfrences mondiales du secteur ludique et proposant un large panel dactivits et danimations diurnes et nocturnes ; la mise en place de cits de loisirs intgres aux stations balnaires dAgadir et de Sadia, accessibles un large public et totalement intgres leur environnement; la cration de centres sportifs et de loisirs de grande envergure, pour renforcer la visibilit de certains sites au niveau international notamment Sadia et Ifrane. Le programme 2012 prvoit notamment le dveloppement de plusieurs centres sportifs notamment Bni Znassen, Zaouit Ahensal, Saidia, Ksar Sghir, Al Haouzia et Tinghir. En ce qui concerne le dveloppement du tourisme de niches forte valeur ajoute - Affaires, Bien-tre et Sant, les actions programmes portent essentiellement sur limpulsion de nouveaux concepts de bien-tre et de dtente reposant sur une approche cologique et mettant profit les richesses du terroir marocain (argan, cactus, sable et argile, spas de luxe, hammams authentiques et centres balno-ludiques). Dans ce cadre, lintervention du dpartement consistera en la normalisation des centres de SPA et bien-tre au niveau national et la ralisation des tudes affrentes au repositionnement de la station thermale de Moulay Yacoub et limplantation dun centre balno-ludique Ifrane. Quant au Plan Biladi qui vise le dveloppement du tourisme interne tenant compte des attentes des marocains, les actions programmes pour lanne 2012 portent essentiellement sur louverture de la Station dImi Ouaddar Agadir. 2. En matire de promotion et de commercialisation du produit, laction du dpartement du Tourisme vise essentiellement la consolidation de nos marchs traditionnels, la diversification des marchs, lintensification des partenariats avec les Tours Oprateurs et laccompagnement du lancement des diffrentes stations.
NOTE DE PRESENTATION 168
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Dans ce cadre, lintervention du Ministre sopre essentiellement travers lOffice National Marocain du Tourisme (ONMT). En 2012, lONMT, entamera une stratgie de reconqute dynamique des marchs prioritaires, avec une consolidation acclre des marchs forts potentiels. Dans ce cadre, les principales actions programmes concernent : la mise en place dune stratgie agressive de reconqute des grands tours oprateurs; le lancement dun programme de dmarchage efficace de nouveaux tours oprateurs et des agences de voyage, avec un focus sur les Experts du Maroc ; le dveloppement des marques balnaires (Saidia, Lixus, Mazagan, Mogador et Agadir) et le renforcement de la communication institutionnelle travers la consolidation des marques Maroc et destinations; lamlioration des performances de la promotion via Internet avec le lancement dun systme dinformation et de rservation des hbergements pour les e-touristes, de contact de nouveaux tours oprateurs en ligne et dorganisation de sminaires de promotion on-line ; et la ralisation dun plan daction intgr pour la promotion du tourisme interne visant notamment laccompagnement de louverture des nouvelles stations touristiques du Plan Biladi et le renforcement de loffre Kounouz Biladi. Paralllement, des actions caractre transversal seront entreprises en 2012 notamment la conclusion de partenariats avec les compagnies ariennes qui vise des programmes de co-marketing efficace, la fidlisation des points de vente et des agences de voyage, lintensification de la prospection travers le dmarchage et les visites des principales agences de voyage des pays metteurs. Le plan daction projette des augmentations consquentes des arrives touristiques par march metteur, en 2012, savoir +5% pour la France, +10% pour le Canada, +60% pour la Scandinavie, +35% pour les pays de lEurope de lEst et +50% pour la Russie. 3. En matire de rgulation du secteur et de la comptitivit du tissu dacteurs, le dpartement du tourisme amorcera un ensemble de chantiers dans le cadre de ses efforts visant la modernisation de la chane de valeur touristique, il sagit notamment de : La poursuite des rformes rglementaires notamment celles de lhbergement touristique o il est question dintroduire les textes rglementaires labors dans le circuit dadoption et de prparer la mise en uvre de la rforme du systme de classement des tablissements dhbergement touristique dans le cadre de la convention relative laccompagnement par lOrganisation Mondiale du Tourisme ;
NOTE DE PRESENTATION
169
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La modernisation de lencadrement de lactivit touristique, par le lancement dune tude portant sur la mise en place dun systme dinformation et des applicatifs mtiers de gestion et dencadrement de lactivit touristique. 4. En matire de dveloppement durable, le dpartement du tourisme place le concept de dveloppement durable au cur de sa stratgie dcennale Vision 2020 et amorcera : La mise en uvre dun dispositif de formation et daccompagnement des oprateurs touristiques pour lintgration des principes de durabilit ; La mise en place dun ensemble dindicateurs de la durabilit pour le secteur et la mise en uvre dun dispositif de veille au niveau national et rgional pour en assurer lvolution. 5. En matire de formation, outre la poursuite des actions entames en 2011 et visant le repositionnement de linstitut Suprieur de Tourisme de Tanger, la rhabilitation des tablissements de formation, le renforcement et le perfectionnement des ressources humaines ainsi que la mise niveau de loutil informatique et technologique, deux actions phares seront mises en uvre en 2012, savoir : laccompagnement du projet de repositionnement stratgique des tablissements de formation htelire et touristique la lumire des recommandations de ltude initie en 2011 ; la mise en place dun systme de Gestion Prvisionnelle des Emplois et des Comptences.
III.5- Artisanat
Lenveloppe budgtaire mise la disposition du Ministre de lArtisanat, au titre de lanne 2 012, slve 464 743 000 dirhams, rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 119 295 000 DH 45 448 000 DH 300 000 000 DH
Considre comme tant une anne charnire dans la mise en uvre de la vision 2015 pour le dveloppement du secteur de lartisanat, lanne 2012 sera consacre principalement la poursuite de : la mise en uvre des Plans de Dveloppement Rgionaux de lArtisanat oprationnels et la finalisation de llaboration de ceux en cours de ralisation; lacclration du rythme de ralisation des infrastructures de production et de commercialisation. Lanne 2012 devrait connatre :
NOTE DE PRESENTATION
170
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la cration de douze villages dartisans Taourirt, Berkane, Nador, Khnifra, Boujdour,Dakhla, Demnate, Bzou, Taza, Ouazzane, Oued Laou et Mdiq ainsi que la rhabilitation de celui dOujda; la mise en place dun complexe dartisanat Chichaoua et la rhabilitation de 17 autres Azrou, Tanger, Bijaad, Settat, Casablanca, Essaouira, Azilal, Mekns, Tiznit, Sal, Azemmour, Ouarzazate, Essmara, Khouribga, Layoune, Guelmim et Asilah; lachvement des travaux de ralisation de la tannerie de An Nokbi de Fs, la rhabilitation de la tannerie artisanale de Khnifra et de la colline des potiers de Safi, et la cration de la zone dactivit artisanale Rmika Mekns et de deux espaces de production et de commercialisation Oujda ; le renforcement de lappui aux mono artisans travers la poursuite de la modernisation des techniques et outils de production. A cet effet, des tudes et expertises seront ralises et du matriel technique sera acquis au profit des groupements dartisans; la poursuite de laccompagnement des acteurs de rfrence et de lensemble des chantiers en relation avec lenvironnement, lhygine, la scurit, la sauvegarde des mtiers en voie de disparition, la qualit, la normalisation et linnovation ; la modernisation de ladministration par le dveloppement des comptences, lintensification de lexcution des plans de formation du personnel, lamlioration de la gestion des ressources financires et loprationnalisation du systme de contrle de gestion.
III.6- Affaires Gnrales et Gouvernance
Lenveloppe budgtaire globale prvue, au profit du Ministre Charg des Affaires Gnrales et de la Gouvernance, au titre de lanne 2012, slve 103 867 000 dirhams rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 29 473 000 DH 60 894 000 DH 13 500 000 DH
Pour rappel, depuis 2008, le Ministre charg des Affaires Gnrales et de la Gouvernance poursuit la mise en uvre de sa stratgie 2008-2012 visant impulser une dynamique de dveloppement durable axe sur lamlioration de la gouvernance conomique, la protection du pouvoir dachat, la promotion de lconomie sociale et solidaire et laccompagnement des rformes structurelles et des programmes stratgiques du pays. Inspire des Hautes Directives Royales exhortant le Gouvernement promouvoir une conomie librale visage humain et social, cette stratgie a
NOTE DE PRESENTATION 171
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
enregistr dans son excution des rsultats encourageants qui portent sur lensemble des axes et chantiers mens par ce Dpartement. Lanne 2012 sera consacre la poursuite des projets initis et la concrtisation des rformes engages. En effet, les actions planifies durant cet exercice sinscrivent dans la continuit des interventions engages au cours de lanne prcdente et constituent une tape cruciale dans la ralisation du plan daction du Ministre en harmonie avec les objectifs fixs par la stratgie. Dans ce cadre, les crdits allous ce Ministre sont destins financer les principales actions ci-aprs : Lamlioration de la gouvernance conomique comme moyen de promotion de l'conomie de l'entreprise. Les actions programmes en 2012, au titre de ce chantier fondateur, portent principalement sur lamlioration du climat des affaires et la promotion de lentreprise et de la trs petite entreprise (TPE). Ce chantier stratgique sera renforc davantage par les projets structurants et forte valeur ajoute suivants : La contribution dynamique du Maroc au centre de dveloppement de lOCDE, interface entre ses pays membres et les conomies mergentes, permettra dengager un dialogue permanent avec les autres pays membres sur les politiques de dveloppement, de peser et faire valoir le point de vue du Maroc en matire de conception et de mise en uvre de ces politiques et davoir accs toute la production de lOCDE en la matire; La ralisation des engagements du Maroc au titre de la dclaration de lOCDE sur linvestissement international et les entreprises multinationales visant amliorer le climat des investissements trangers et favoriser la contribution positive que les entreprises multinationales peuvent apporter au progrs conomique et social ; La mise en uvre de la Stratgie Nationale pour le Dveloppement des TPE , lance en 2011, constitue un chantier important du Ministre et ncessite la mobilisation de mcanismes institutionnels importants et une mise en uvre graduelle, rpondant une logique de rgionalisation de ses actions ; Le soutien au dveloppement de lInstitut Marocain des Administrateurs travers sa contribution la diffusion des bonnes pratiques de gouvernance entreprise au niveau national et ce travers sa contribution lorganisation de colloques, de sminaires, de sessions de formations et dditions de publications ; La protection du pouvoir dachat qui reprsentera un chantier privilgi pour le Ministre. Dans ce cadre, laction sera focalise sur : La poursuite de la procdure relative ladoption du projet de loi modifiant la loi n06-99 sur la libert des prix et la concurrence et la prparation des textes rglementaires y affrents;
NOTE DE PRESENTATION
172
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La ralisation, en concertation avec les dpartements concerns, dactions cibles en matire de rglementation des prix et de suivi de la politique de compensation du Gouvernement; La poursuite du processus de ralisation des enqutes inities en 2011 notamment celles concernant les secteurs de la distribution automobile, des produits laitiers et des eaux minrales ainsi que les travaux dinvestigation dans dautres secteurs qui prsentent des dysfonctionnements ds des pratiques anticoncurrentielles; Le renforcement du dispositif informationnel de la concurrence et des prix travers la consolidation et la gnralisation du systme dinformation dcisionnel sur les prix pour la prise en compte des donnes manant dautres sources dinformations ainsi que la mise en place dune base de donnes spcifique en matire de concurrence permettant de faciliter la ralisation des tudes conomiques et des enqutes sur la concurrence travers la fourniture dinformations et dindicateurs pertinents et actualiss. La promotion du secteur de lEconomie Sociale et Solidaire. Dans le cadre de sa stratgie nationale 2010-2020 pour le dveloppement de lconomie sociale et solidaire, le Ministre envisage la ralisation de projets structurants conformment aux axes identifis. Il sagit principalement de : La poursuite de la mise en uvre du programme Mourafaka dappui post cration des coopratives qui permet aux coopratives ligibles de bnficier des diffrentes prestations relatives ce programme. Une enveloppe budgtaire de 105 MDH est alloue au financement de ce programme sur la priode 2011-2015, finance hauteur de 100 MDH par lEtat raison de 20 MDH par anne et 5 MDH par lODECO. Ce programme vise accompagner 2.500 nouvelles coopratives sur la priode prcite; Lappui la commercialisation et la promotion des produits de lconomie sociale et solidaire travers des actions prouves et russies notamment le salon national ECOSS, les salons rgionaux, llargissement des marchs itinrants dautres rgions du Royaume et lextension des oprations de commercialisation des produits au niveau des aroports et des grandes surfaces. En 2012, les rgions de Rabat-Sal-Zemmour-Zar, ChaouiaOuardigha, Marrakech-Tansift-El Haouz et Tadla-Azilal seront particulirement cibles ; Lappui aux initiatives locales dconomie sociale et solidaire, dans le cadre des Plans Rgionaux pour le Dveloppement de lEconomie Sociale et Solidaire (PRDESS) dj existants. Cette action concerne la contribution la mise en ouvre des PRDESS des rgions disposant de contrat programme; Le renforcement du dispositif de linformation et de la communication travers la mise en place dun observatoire de lconomie sociale et solidaire et dun portail Web ddi; Linstauration dun cadre propice pour le dveloppement du commerce quitable travers la poursuite de la procdure dadoption du projet de loi
NOTE DE PRESENTATION 173
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
rglementant ses activits et la mise en place de lorgane administratif en charge de lencadrement de ce type de commerce au Maroc ; La mise en uvre des rsultats de ltude relative la mise en place de filires bio dexportation des produits des coopratives ; La ralisation dune tude visant la prparation du projet de loi pour lencadrement du secteur de lconomie sociale au Maroc ; Lanimation de rencontres de vulgarisation pour la mise en application des dispositions de la nouvelle loi rgissant le secteur coopratif aprs son approbation par le Conseil du Gouvernement du 07 septembre 2011; La constitution dun vivier de formateurs en entreprenariat coopratif par la formation de 100 formateurs pour la vulgarisation du guide de gestion pour les petites coopratives. La poursuite de laccompagnement des rformes et chantiers stratgiques et sectoriels, notamment dans le cadre de la coordination des relations avec la Banque Mondiale, en sorientant de plus en plus vers lintgration des programmes de rformes sectorielles et en se basant sur les principaux axes dintervention retenus par le Cadre de Partenariat Stratgique tabli avec la Banque Mondiale pour la priode 2010-2013. Dans ce cadre, les projets dappuis planifis pour 2012, concernent principalement les secteurs de la Sant, de la Justice, de lEducation, de lAgriculture ainsi que le secteur financier ; la seconde phase de lINDH ; un projet en relation avec le changement climatique ; le programme national des dchets mnagers et le projet Comptences/Emploi.
III.7- Haut Commissariat au Plan
Lenveloppe budgtaire alloue au Haut Commissariat au Plan, pour lanne 2012, slve 411 790 000 dirhams, rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 253 195 000 DH 78 825 000 DH 79 770 000 DH
Cette enveloppe sera consacre la poursuite de la mise en uvre de la stratgie du Haut Commissariat au Plan dcline selon les domaines dintervention ci-aprs : En matire de planification du dveloppement, de prvision et de prospective, base sur une approche rnove de la planification moyen terme, fonde sur une dmarche prospective et sur llaboration des prvisions court terme dans le cadre des budgets conomiques qui constituent des instruments de prvision et de suivi des actions de dveloppement court terme, le dpartement envisage de :
NOTE DE PRESENTATION 174
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
raliser des tudes de simulation dimpact de mesures et actions de politique publique, pour lorientation de la prise de dcision ; assurer lanalyse et le suivi des actions de dveloppement conomique et social sur les plans sectoriel et global ainsi que la dissmination de la pratique de la planification participative locale en faveur des provinces et des communes, et le suivi et lvaluation des objectifs du Millnaire pour le Dveloppement en produisant rgulirement des rapports dtape et des rapports sur le dveloppement humain ; dvelopper des techniques de traitement des sries des effets saisonniers, ainsi que le renforcement des modles de prvisions conomiques et macro-conomiques travers lamlioration des indicateurs synthtiques dynamiques et composites en collaboration avec lexpertise franaise dans ce domaine. En matire dtudes dmographiques et socio-conomiques, le Haut Commissariat procdera : lactualisation des projections et des estimations des paramtres dmographiques la lumire des rsultats de lEnqute Nationale Dmographique (2009-2010) rendus publics en 2011 ainsi qu ltablissement de la situation dmographique du pays aux niveaux national et rgional ; la ralisation des tudes et analyses sociodmographiques pour alimenter les dossiers techniques en appui la politique de population et lanimation des sminaires et rencontres scientifiques en matire danalyse dmographique ; lanalyse des rsultats des enqutes ralises en 2011 sur lanthropomtrie et la mobilit sociale de faon valuer et cartographier ltat nutritionnel de la population et diagnostiquer le processus de mobilit sociale ascendante. En matire de ralisation des enqutes statistiques, lanne 2012 sera caractrise par le dbut de la prparation du Recensement Gnral de la Population et de lHabitat de 2014. Ainsi, laction du dpartement sarticulera autour des axes suivants : la ralisation des enqutes habituelles portant notamment sur lactivit et le chmage, la conjoncture auprs des mnages, les entreprises du BTP, commerce et services, linvestissement du secteur des administrations publiques, le systme des indices statistiques, les statistiques des autorisations de construire, les statistiques de lEtat Civil, la coordination de la formation, ainsi que la collecte des statistiques administratives et le traitement, la publication et la diffusion de linformation statistique ; la poursuite de la ralisation de lenqute nationale sur lemploi du temps, dont lobjectif est de disposer de donnes prcieuses sur les activits
NOTE DE PRESENTATION
175
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
de la population et sa qualit de vie et dvaluer de faon exhaustive la production des mnages ; le lancement dune enqute nationale sur la consommation et les dpenses des mnages 2012/2013 visant le recueil des donnes renseignant sur les niveaux et les conditions de vie des mnages, en particulier le niveau et la structure des dpenses des mnages. Ces donnes sont indispensables llaboration et lvaluation des politiques de dveloppement et servent lactualisation des indicateurs de pauvret et le panier de rfrence de lindice des prix la consommation. Lchantillon de cette enqute est de lordre de 18.000 mnages permettant de produire des rsultats dtaills au niveau rgional ; lintensification des travaux prparatoires pour le Recensement Gnral de la Population et de lHabitat de 2014. Conformment aux Hautes Instructions Royales et aux orientations de lorganisation des Nations Unies recommandant aux pays de raliser priodiquement leur recensement. Les travaux cartographiques prparatoires ce recensement gnral seront poursuivis et mobiliseront des moyens humains et matriels importants, sur une priode de deux ans. En matire de renouvellement des annes de base des comptes nationaux et de mise en place dun dispositif dlaboration et de publication rgulire des comptes rgionaux, ledit dpartement focalisera son action sur : la poursuite de llaboration de la srie des comptes nationaux et des tableaux de synthses de base 1998, conformment au systme de comptabilit nationale 1993 des Nations Unies; le dveloppement des statistiques rgionales par la mise en place dun dispositif permanent de production des comptes rgionaux; le dveloppement des comptes trimestriels et dun certain nombre de comptes satellites sectoriels. En matire dadaptation de la formation des cadres au sein de lInstitut National de la Statistique et dEconomie Applique (INSEA) et lEcole des Sciences de lInformation (ESI) aux exigences de la rforme de lenseignement suprieur, il y a lieu de signaler que le Haut Commissariat au Plan veillera la mise en uvre effective de la nouvelle rforme pdagogique et institutionnelle, et ce conformment aux dispositions de la loi n 01.00 portant organisation de lenseignement suprieur, et ce travers : la mise en place, au sein de lINSEA, des formations doctorales en statistique, conomie applique, dmographie, recherche oprationnelle, informatique et actuariat finance ; lextension des classes de cours et des laboratoires et la ralisation dune bibliothque au sein de lESI ainsi que le renforcement de son personnel enseignant.
NOTE DE PRESENTATION 176
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
En matire de modernisation du traitement et de laccs linformation documentaire, lanne 2012, constituera lanne de dmarrage de la troisime phase de la vision 2015 relative la transformation ventuelle du Centre National de Documentation (CND) en un centre dintelligence documentaire et sera marque par le lancement de ltude portant sur la Gestion lectronique de documents et ses valeurs ajoutes et le E-marketing des services dudit centre. En matire de modernisation de la gestion des services du plan, le dpartement procdera : lachvement de la construction du futur sige de la Direction de la Statistique devant abriter galement les Directions de la Planification, de la Comptabilit Nationale et du CERED ; la mise en uvre du rfrentiel des emplois et des comptences, de la gestion prvisionnelle des effectifs des emplois et des comptences et du plan quinquennal de formation continue ; la mise en pratique des recommandations de ltude du contrle interne du processus de la dpense ralise en 2011.
IV- SECTEURS ADMINISTRATIFS
IV.1. Intrieur
Lenveloppe budgtaire globale alloue au Ministre de lIntrieur, au titre de lanne 2 012, slve 21 183 965 000 dirhams repartie comme suit :
Dpenses de personnel..... Dpenses de matriel et dpenses diverses.. Dpenses d'investissement. Fonds spcial pour la promotion et le soutien de la protection civile Fonds de soutien la Sret Nationale.. Fonds pour la mise en place des titres identitaires lectroniques et des titres de voyage. Financement des dpenses dquipement et de la lutte contre le chmage..
14 209 765 000 DH 3 300 700 000 DH 3 047 000 000 DH 200 000 000 DH 30 000 000 DH 170 000 000 DH 226 500 000 DH
Le budget du Ministre de lIntrieur retenu pour lanne 2012 correspond la ralisation de la dernire tranche du plan quinquennal de renforcement de ladministration territoriale et des services de scurit (2008-2012).
NOTE DE PRESENTATION
177
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
I- Administration Gnrale : Les crdits budgtaires inscrits au profit de lAdministration Gnrale de ce dpartement, au titre de lanne 2012, visent dynamiser les services dconcentrs pour une plus grande efficacit de leur action et une meilleure adaptation de leurs missions aux mutations politiques, conomiques, sociales et scuritaires. Ces crdits visent aussi le renforcement des capacits dintervention du dpartement en raison de la multiplication des catastrophes naturelles. Ainsi, les actions programmes dans ce cadre, portent sur le niveau central et territorial, la Protection Civile et la Promotion Nationale. 1. Au niveau central et territorial: Les actions raliser concernent essentiellement la modernisation des structures du ministre notamment au niveau territorial, lamlioration du fonctionnement de ladministration centrale et territoriale et le renforcement de lautonomie logistique et financire de ladministration territoriale par rapport aux ressources des collectivits locales. Ces actions sintressent galement au renforcement des capacits logistiques et techniques des services dconcentrs en termes de moyens de mobilit, doutils de communication et de systmes dinformation pour assurer la proximit et lefficacit de laction de lautorit locale. 2- Protection civile : Lenveloppe budgtaire alloue, au titre de lanne 2012, la Direction Gnrale de la Protection Civile sinscrit dans le cadre de son plan daction, qui porte essentiellement sur la ralisation des axes suivants : la construction de 10 nouveaux centres de secours; la construction de remises pour les vhicules de secours et des locaux pour le personnel des casernes et des Units Mobiles dIntervention Rgionales (Oued-Eddahab-Lagouira, Chaouia-Ouardigha et Rabat-Sal-Zemmour-Zaer); lachvement des projets de construction des casernes de la Protection Civile;et lamnagement des nouveaux centres de secours et des casernes. En addition ces actions finances dans le cadre des crdits inscrits au Budget Gnral, dautres projets sont programms au titre du compte daffectation spcial intitul Fonds spcial pour la promotion et le soutien de la protection civile . Ces projets concernent principalement lquipement des dpts rgionaux, lachat de vhicules de secours et de lutte contre lincendie ainsi que lachvement des travaux damnagement de lEcole de la Protection Civile.
NOTE DE PRESENTATION
178
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
3- Promotion Nationale : Les principaux chantiers inscrits au niveau de la Promotion Nationale sont financs partir du compte daffectation spciale intitul Financement des dpenses dquipement et de la lutte contre le chmage , et ont pour principal objectif la lutte contre la pauvret et lexclusion et ce, travers le dveloppement des infrastructures locales et lquipement des zones urbaines, la dfense et la restauration des sols, le reboisement des espaces verts, le creusement de puits, lamnagement des pistes ainsi que le nettoiement et lentretien des espaces verts pour amliorer le cadre de vie des citoyens et le dveloppement des rgions sahariennes en mobilisant la force de travail disponible au niveau local et la ralisation de projets locaux de construction et dquipement. II - Administrations de scurit : Les crdits inscrits au niveau des administrations de scurit du Ministre de lIntrieur permettront lamlioration des dispositifs scuritaires travers notamment le renforcement des services de police, le relvement des dfis dicts par la conjoncture scuritaire et la poursuite de la mise en uvre du plan de rorganisation et de modernisation du corps des Forces Auxiliaires.
1- Sret Nationale :
Dans le cadre du renforcement des services de police et de lutte contre la criminalit travers le Royaume, les crdits inscrits au niveau du budget de la Direction Gnrale de la Sret Nationale, pour lanne 2012, ont pour principal objet: la poursuite de lextension du systme de transmission numrique (TETRA) au niveau de certaines villes du Royaume ; la gnralisation du systme de vido-protection au niveau de certaines entits extrieures dans le but de lutter contre la criminalit sous toutes ses formes ; le renforcement des ressources humaines et des moyens de mobilit et dintervention ; la construction de btiments administratifs et des locaux de police dont notamment deux prfectures de police Oujda et Agadir ; et lquipement des services de police en moyens de technologies dinformation et de communication.
2- Forces Auxiliaires :
Sinscrivant dans le cadre des orientations du plan quinquennal susmentionn, lenveloppe budgtaire inscrite, au titre de lanne 2012, au niveau du budget des Inspections des Forces Auxiliaires pour les zones Nord et Sud, portera notamment sur les actions suivantes :
NOTE DE PRESENTATION
179
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
2.1- Zone Nord : La consolidation et lachvement des projets en cours ; la ralisation des moyens matriels et dinfrastructure ncessaires la mise en place des nouvelles units des Forces Auxiliaires dans le cadre du programme de rorganisation et de modernisation du corps des Forces Auxiliaires. 2.2- Zone Sud : lachvement de la construction du sige de lEtat Major et de ses dpendances ; lachvement de la construction des magasins, ateliers techniques et abris pour les vhicules au niveau de la caserne dAit Melloul ; la ralisation des tudes relatives aux projets inscrits dans la 4me et 5me phase du plan de restructuration des Forces Auxiliaires ; et le renouvellement dune partie des moyens matriels des units des Forces Auxiliaires dployes avec les Forces Armes Royales.
3- Surveillance du territoire :
Dans le but de faire face aux dfis scuritaires notamment en matire de lutte contre le terrorisme et la prservation de lordre public, le programme daction de la Direction de la Surveillance du Territoire, au titre de lanne 2012, sarticule autour des actions ci-aprs : la poursuite des ralisations des programmes de construction des btiments administratifs ; le renforcement du rseau et des installations informatiques et techniques; la dotation des services en moyens de mobilit et dintervention ; et lquipement des diffrentes structures notamment les nouveaux btiments en matriel et mobilier de bureau.
IV.2- Economie et Finances
Les crdits budgtaires mis la disposition du Ministre de lEconomie et des Finances, au titre de lanne 2 012, slvent globalement 2 558 230 000 dirhams, rpartis comme suit : Dpenses de personnel....... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement. 1 958 230 000 DH 240 000 000 DH 360 000 000 DH
NOTE DE PRESENTATION
180
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Ces crdits sont destins renforcer les efforts entrepris par le Ministre de lEconomie et des Finances pour moderniser la gouvernance des finances publiques, lamlioration des conditions de promotion de linvestissement et de lemploi et laffermissement des systmes de contrle des finances publiques. Dans cette perspective, lintervention du Ministre de lEconomie et des Finances portera, au titre de lanne 2012, sur les principaux axes stratgiques ci-aprs : Lencouragement de linvestissement travers la poursuite des efforts de modernisation des systmes fiscal et douanier et daccompagnement des rformes sectorielles engages par les autres ministres travers la rgulation de linvestissement foncier et la poursuite, en 2012, des efforts volontaristes en matire de mobilisation du foncier priv de lEtat pour la promotion de linvestissement au profit des oprateurs publics et privs afin de rpondre aux besoins lis au dveloppement des stratgies sectorielles dans les domaines notamment du logement social, de lindustrie et du tourisme. La consolidation de linfrastructure informatique travers la ralisation des principales actions ci-aprs : le parachvement de la mise en place du systme de Gestion Intgre de la Dpense GID qui a permis lunification de la base de donnes des ordonnateurs et des comptables publics et la rduction de lutilisation du support papier. Ce systme est aujourdhui utilis au niveau de 1.830 services ordonnateurs et exploit par 11.000 utilisateurs. En 2012, les dveloppements futurs des applicatifs vont concerner essentiellement la maintenance, et les supports matriels et logiciels et laccompagnement dans l'laboration des outils pour la formation et le dploiement du programme GID ainsi que la prparation du processus de gnralisation du systme GID aux collectivits locales ; la mise en place du systme de Gestion Intgr des Recettes GIR . Ce systme dinformation budgtaire et comptable permettra une gestion efficace et efficiente de la recette travers la rationalisation et la simplification des circuits et des procdures dexcution de la recette et une meilleure communication entre les systmes dinformation des diffrents intervenants ; la poursuite de la mise en uvre des schmas directeurs informatiques de la Direction du Trsor et des Finances extrieures, de la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation et de la Direction des Domaines de lEtat ainsi que le lancement des tudes pour llaboration dun schma directeur de lAgence Judiciaire du Royaume ; le parachvement des premires phases de dveloppement dun systme dinformation gographique, domicili auprs de la Direction du Budget, permettant de prsenter lensemble des informations et donnes affrentes aux projets financs dans le cadre de la coopration Internationale.
NOTE DE PRESENTATION
181
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Par ailleurs, et dans lobjectif de la scurisation des donnes et informations produites par le Ministre dEconomie et des Finances, deux grands projets seront poursuivis pour lexercice 2012, savoir : la poursuite du Plan de Continuit des Activits du Ministre qui se dfinit comme tant lensemble des actions contribuant garantir la continuit de lactivit de lAdministration ; la mise en place dun Datacenter pour lAdministration Centrale, dont lobjectif est le regroupement des bases de donnes des directions relevant de lAdministration Centrale de faon permettre lamlioration de la qualit, la disponibilit des services informatiques, la scurit des infrastructures et la continuit de service tout en optimisant lutilisation et la gestion des infrastructures informatiques des directions centrales ; la modernisation de lAdministration et lamlioration de la qualit des services rendus aux citoyens travers notamment : la poursuite des efforts de construction et damnagement des locaux des services extrieurs du Ministre, lobjectif tant de rapprocher ladministration des usagers du service public et damliorer les conditions daccueil des contribuables travers le renforcement des infrastructures de base des services extrieurs ncessaires la mise en uvre des orientations gouvernementales visant la consolidation du processus de dconcentration et loptimisation du rseau des services dconcentrs pour ladapter au dcoupage rgional et local ; la simplification des procdures travers la poursuite de la mise en place de ladministration lectronique (Simpl TVA, Simpl IS, Simpl IR et CREOL), la moralisation de la vie publique et lamlioration de la gouvernance. A cet gard, le dpartement adoptera une dmarche de mutualisation de ses bonnes pratiques de management et de gestion ainsi que de ses systmes intgrs de gestion avec les autres dpartements, que ce soit par le biais de conventions de partenariat ou travers son action au sein du comit e-gov ; ladoption de la contractualisation au sein du Ministre travers la gnralisation de la contractualisation avec les diffrentes Directions et avec les services extrieurs qui constitue un outil de pilotage compltant la Lettre dOrientation Gnrale et le Cadre des Dpenses Moyen Terme. Les Contrats Pluriannuels de Performance permettront en 2012 de suivre laction des Directions travers des indicateurs de performance convenus dun commun accord, dans le cadre dune participation active des directions dans la formulation de la stratgie du Ministre ; la poursuite de la dconcentration des mtiers au sein du ministre dans le cadre dune dmarche intgre visant l'implication et la responsabilisation des services aux niveaux rgional et local, ainsi quune redfinition des missions, des pouvoirs et des moyens de manire fournir aux usagers et aux clients des prestations de proximit, de qualit et moindre cot. La mise en uvre de ce chantier s'est traduite par : un dploiement effectif des structures oprationnelles pour assurer une couverture approprie du territoire national et la cration de services
NOTE DE PRESENTATION 182
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
dconcentrs correspondant aux besoins rels du dveloppement conomique et social. Ainsi, 71% du personnel du ministre est aujourdhui affect aux services extrieurs contre 29 % au niveau central ; une dconcentration dattributions et de pouvoirs, en particulier, la fiscalit, le recouvrement, la gestion de la dpense, la gestion du domaine priv de lEtat, lactivit douanire et le contrle. Lacclration de la modernisation de la gestion des finances publiques. Dans le cadre de ce volet stratgique, qui vise lamlioration de lexcution des dpenses de lEtat, du recouvrement des impts et taxes et du traitement des donnes et dolances des citoyens, il est prvu : le lancement du processus de rforme de la loi Organique relative la Loi de Finances de faon consacrer lgalement la performance dans la gestion des deniers publics et le renforcement de la programmation budgtaire ainsi que le dveloppement de laudit des politiques publiques. Elle visera plus defficience en matire de dpense publique et une meilleure convergence des politiques publiques ; la poursuite de la rforme du Plan Comptable de lEtat qui consiste en llaboration dun systme informatique centralis permettant la gnration et lintgration des critures comptables partir des informations issues des diffrentes bases de donnes, lobjectif tant la prise en charge de l'ensemble des processus comptables et budgtaires englobant la comptabilit budgtaire, la comptabilit administrative, la comptabilit gnrale, la comptabilit analytique, le suivi des immobilisations, la gestion de la trsorerie, le reporting comptable, lanalyse financire en plus de la consolidation des comptes. La dynamisation du secteur financier travers la restructuration des Institutions Financires Publiques et laccompagnement du secteur du microcrdit en vue dlargir son champ dintervention, notamment en relation avec la mise en uvre de lINDH. En ce qui concerne les instruments de financement, dans lobjectif de dynamiser laction gouvernementale en matire dappui aux PME, le systme national de garantie sera rationalis et son intervention sera largie et amliore, en termes dintervenants, dinstruments daccompagnement financier et technique et en termes de dploiement rgional. Sagissant du march des capitaux, plusieurs actions seront prises en vue de poursuivre le processus de scurisation du march et de mettre en uvre de nouvelles rformes structurantes comme la rforme du statut de la socit gestionnaire de la Bourse de Casablanca, la mise en place dun code montaire et financier, la codification et le lancement de la rflexion sur la convergence du systme de contrle et de supervision du secteur financier. La poursuite de la restructuration du secteur public et de llargissement du champ du priv travers notamment le dveloppement des investissements des entreprises publiques dans lobjectif damliorer la
NOTE DE PRESENTATION 183
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
balance commerciale, la restructuration de certains secteurs forte valeur ajoute dans le but dintroduire plus de concurrence et enfin, lamlioration de la gouvernance des entreprises publiques travers la mise en place dun code de bonne gouvernance et le renforcement de la contractualisation des rapports Etat/Entreprises publiques. Dans ce cadre, des actions seront menes pour faciliter : la mobilisation des financements alternatifs ncessaires au dveloppement des investissements dans les services publics dpassant les capacits du budget gnral de lEtat dans le cadre du partenariat public priv; le renforcement des investissements des Etablissements Publics, notamment ceux agissant dans les services publics, particulirement, travers les garanties de lEtat mobilises loccasion des projets programms, les dotations en capital et les subventions dquipement.
IV.3- Justice et Liberts
Lenveloppe budgtaire globale alloue au Ministre de la Justice et des Liberts, au titre de lanne 2012, slve 3 886 673 000 dirhams rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. Fonds spcial pour le soutien des juridictions. Fonds dEntraide Familiale 2 810 673 000 DH 312 000 000 DH 324 000 000 DH 280 000 000 DH 160 000 000 DH
Le budget de ce ministre sinscrit dans le cadre de la poursuite du programme de rforme de la justice conformment aux Hautes Orientations Royales. Ainsi, les principales actions programmes par le Ministre de la Justice et des Liberts portent sur : la poursuite des oprations de redploiement des ressources humaines et laugmentation du nombre de magistrats et des personnels des juridictions ; la promotion de la formation de base et de la formation continue des personnels magistrat et greffe ainsi que lensemble des auxiliaires de la justice et ce, travers le rle jou par lInstitut Suprieur de la Magistrature ; lamlioration des infrastructures et des quipements techniques par le biais de la continuation du programme de rhabilitation des tribunaux et la mise en place dun rseau de communication globale destin faciliter laccs des justiciables linformation ;
NOTE DE PRESENTATION
184
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
la poursuite de la mise jour des lois et rglementations notamment le renforcement des mcanismes de la justice pnale en vue de lutter contre la corruption et la consolidation du rle de la justice pour protger linvestissement et combattre le blanchiment dargent ; la continuation de la modernisation des juridictions moyennant la conservation de documents judiciaires, la mise en place dun systme de gestion des dossiers et des bibliothques ainsi que la cration des guichets dinformation judiciaires ; la poursuite du programme damnagement et dquipement au sein des tribunaux de premire instance des sections dites tribunaux de famille travers le lancement des projets de construction des tribunaux de famille de Ben Slimane et de Fkih Ben Saleh. La ralisation de ce programme permettra de prserver la justice de famille ainsi que lquilibre de la vie conjugale ; le lancement des travaux de construction des tribunaux de premire instance de Sidi Ifni, Zagora, Tinghir, Mekns, Youssoufia, Berrechid et Ben Ahmed. Le but tant la mise en uvre de la stratgie de proximit de la justice moyennant la cration dun tribunal de premire instance au niveau de chaque province ; lachvement des travaux damnagement et dextension des cours dappel de Safi et Knitra et des tribunaux de premire instance dAnfa et Oued Zem ; le lancement des travaux de construction des centres de juges rsidents Guelmima, Kelaa Magouna, Agdz, Sebt Gzoula, Tarfaya et Targuist, ainsi que lextension des centres de juges rsidents de Argana, Anzi, Ouled Frej, Arfoud et Rissani ; le lancement des travaux de construction du nouveau sige de lInstitut Suprieur de la Magistrature et des palais de justice des villes de Rabat, Fs et Marrakech ; la mise en uvre du Fonds dentraide familiale visant le renforcement des principes du Code de la famille dont notamment la consolidation de la cellule familiale, de sa cohsion et de sa prennit et lancrage du principe de la solidarit travers le soutien de la femme divorce et les enfants ayant droit la pension alimentaire ou Nafaqa ; et le renforcement de lassistance judiciaire visant la prservation du droit de la dfense au profit des citoyens situation matrielle difficile.
IV.4- Administration Pnitentiaire et Rinsertion
Les crdits rservs la Dlgation Gnrale lAdministration Pnitentiaire et la Rinsertion, au titre de la loi de finances pour lanne 2 012, slvent 1 796 844 000 dirhams, rpartis comme suit :
NOTE DE PRESENTATION
185
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. Fonds spcial pour le soutien des tablissements pnitentiaires...
745 344 000 DH 556 500 000 DH 375 000 000 DH 120 000 000 DH
Ces crdits permettront dassurer le financement du plan daction stratgique de la Dlgation Gnrale lAdministration Pnitentiaire et la Rinsertion qui sarticule autour des axes ci-aprs : La poursuite de la mise niveau des conditions de vie et dhbergement de la population carcrale travers, notamment, lamlioration des indicateurs suivants : les conditions dhbergement de la population carcrale par laugmentation de la surface moyenne rserve chaque dtenu qui atteindra 2,80 m en 2012 contre 2,64 m en 2011 et 2,17 m en 2010 , soit + 29% (par rapport 2010) ; le niveau dalimentation marqu par le soutien en 2012 du taux journalier qui atteindra 16 DH / jour en 2012 contre 15DH /jour en 2011 et 14DH/jour en 2010 et en 2009 et 5 DH/jour en 2008, soit + 220% (par rapport 2008) ; les conditions dhygine et des soins mdicaux qui atteindra 1,35 DH/jour en 2012 contre 0,7 DH/jour en 2008, soit +92,85%. Lamlioration en 2012 de lespace par dtenu grce : Lacclration du rythme de ralisation des projets de construction des prisons locales en cours dachvement dans les villes de Toulal - Mekns, de lOudaya - Marrakech et dAzrou ; La traduction de la stratgie de proximit des tablissements pnitenciers, devant permettre le maintien des liens familiaux des dtenus et le remplacement progressif des tablissements enclavs et vtustes qui ne rpondent plus aux normes de scurit, de fiabilit et de fonctionnalit et ce, travers le lancement des travaux de construction des prisons locales de Guelmim, Assilah, Fs Ras El Ma, Oujda 2, Sefrou, Layoune, Dakhla et Ait Melloul 2 ; Le renforcement des moyens ncessaires la rinsertion sociale des dtenus travers le dveloppement des programmes denseignement, de formation professionnelle et dactivits socio-culturelles, lamlioration de la rmunration journalire alloue aux dtenus exerant une activit rmunre au sein des tablissements pnitentiaires et lamlioration du taux dencadrement travers le renforcement des effectifs affects lassistance
NOTE DE PRESENTATION 186
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
sociale des dtenus. Lobjectif est datteindre le taux dun agent pour 120 dtenus contre 200 dtenus en 2010 ; Le renforcement de la scurit des tablissements pnitentiaires travers la mise en place dans ces tablissements dun systme de scurit permettant de prvenir les risques dvasion et de prserver la scurit des dtenus moyennant le relvement des effectifs du personnel de surveillance ; lobjectif est datteindre un taux dun agent pour 10 dtenus contre 12 dtenus en 2010 ; Lamlioration du rendement du personnel exerant lintrieur des tablissements pnitentiaires travers la mise en uvre dun guide pratique dcrivant les tches accomplir par chaque catgorie de personnel au niveau des diffrents postes de travail et le renforcement de la scurit des prisons par la poursuite de la construction de logements administratifs pour permettre de loger certaines catgories de personnel pnitentiaire proximit des prisons; La modernisation de la gestion et le dveloppement des capacits des ressources humaines travers : la gnralisation de linformatisation au niveau des services centraux et des tablissements pnitentiaires ; la poursuite du programme de la formation de base et de la formation continue des cadres pnitentiaires au niveau dun tablissement de formation pnitentiaire, dont la construction est en cours dachvement, proximit de la prison locale de Tiflet pour dispenser aux stagiaires un enseignement la fois thorique et pratique ; llaboration de conventions de partenariat avec les partenaires externes pour la formation du personnel administratif de la dlgation notamment en matire de la comptabilit et des marchs publics. La poursuite du programme de formation objet de la convention signe en 2011 avec la Fondation Mohammed VI pour la Rinsertion SocioProfessionnelle des Dtenus et lOffice de lEmploi et de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail et qui porte sur la formation des dtenus.
IV.5 - Dlgation Interministrielle aux Droits de l'Homme
Les crdits allous la Dlgation Interministrielle charge des Droits de lHomme, pour lanne 2012, slvent 22 149 000 dirhams, ventils comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 2 149 000 DH 10 000 000 DH 10 000 000 DH
NOTE DE PRESENTATION
187
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Ce nouveau dpartement est charg dlaborer et de mettre en uvre la politique gouvernementale en matire de dfense, de respect, de protection et de promotion des droits de lhomme et du droit international humanitaire. En outre, et dans le respect des attributions dvolues aux diffrents dpartements et organismes concerns, ladite Dlgation est charge dentreprendre au niveau national ou international toute action et initiative de nature favoriser le respect des droits de lhomme dans la mise en uvre des politiques publiques. A ce titre, le plan daction de la Dlgation Interministrielle charge des Droits de lHomme, pour lanne 2012, vise la mise en uvre dune stratgie qui sarticule autours des trois axes ci-aprs : linteraction avec les acteurs internationaux notamment le systme onusien des droits de lhomme, la coopration avec les institutions europennes, les ONG internationales et les associations trangres ainsi que la participation aux manifestations ayant trait aux droits de lhomme et au droit international humanitaire ; la mise en uvre dun plan daction en matire de coordination et dharmonisation de la lgislation nationale avec les normes internationales des droits de lhomme et du droit international humanitaire ; et le dveloppement du partenariat et du dialogue avec les ONG et organismes nationaux en vue dappuyer, de soutenir et de renforcer leurs capacits dans le domaine des droits de lHomme et du droit international humanitaire.
IV.6- Affaires Etrangres et Coopration
Les crdits budgtaires allous au Ministre des Affaires Etrangres et de la Coopration, au titre de lanne 2012, slvent globalement 1 966 391 000 dirhams, rpartis comme suit : Dpenses de personnel. Dpenses de matriel et dpenses diverses... Dpenses d'investissement 1 320 617 000 DH 535 774 000 DH 110 000 000 DH
Ces crdits doivent permettre, conformment au plan daction retenu par ce dpartement pour lanne 2012, la poursuite des efforts de mise en uvre de laction de lEtat, la modernisation de lappareil diplomatique marocain pour lui permettre dassurer la prservation des intrts de notre pays, la promotion de son rayonnement culturel et spirituel, le drainage des investissements trangers et la promotion des exportations des produits nationaux ltranger ainsi que la mise niveau des reprsentations diplomatiques ltranger. Outre ces crdits, sajouteront les recettes propres du service de lEtat gr de manire autonome de la Direction des Affaires Consulaires et Sociales destines notamment au renforcement des moyens des reprsentations diplomatiques et
NOTE DE PRESENTATION 188
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
consulaires pour leur permettre damliorer la qualit de leurs prestations dispenses ltranger, en particulier, la mise en uvre progressive des prestations consulaires distance et la mise en place de la carte didentit lectronique nationale et du passeport biomtrique. Les principales actions et oprations programmes au titre de lanne 2012, portent sur : la continuation du programme des ralisations immobilires ltranger travers notamment : lachvement des travaux de construction dun complexe diplomatique Islamabad ; la restauration du btiment abritant la chancellerie du Maroc Paris ; la ralisation dun complexe diplomatique Nouakchott ; la construction dune chancellerie Lille et Rennes ; la ralisation dun complexe diplomatique Abou Dhabi, Libreville et Malabo ; le lancement des travaux de construction dun complexe diplomatique Washington. Par ailleurs, et dans le cadre de la gestion active du patrimoine immobilier de lEtat ltranger, un programme prvisionnel pour la priode 2009-2012 relatif aux acquisitions et constructions dimmeubles ltranger a t tabli par ledit dpartement tenant compte la fois des priorits concernant les acquisitions raliser et des critres objectifs y affrents se rapportant notamment au montant annuel du loyer, limportance de la communaut marocaine dans le pays daccueil et lopportunit offerte par la baisse de la valeur vnale de limmobilier dans certains pays daccrditation. Cette action permet lEtat de devenir propritaire et partant allger le poids de la charge locative qui grve lourdement le budget de fonctionnement dudit ministre. Le dveloppement des actions de rhabilitation, damnagement et dentretien du patrimoine immobilier au niveau central et ltranger ainsi que de leurs quipements ; Le renforcement du programme de formation continue assur notamment aux diplomates en poste ltranger appuy par le dmarrage de lAcadmie Royale des Etudes Diplomatiques en 2011 et qui a pour mission la formation du personnel diplomatique et consulaire en vue de relever leur comptence pour permettre damliorer les services rendus aux usagers et duniformiser les procdures et les formalits accomplies dans ce domaine ; La ralisation de la troisime phase du programme dappui laccord dassociation MEDA visant le soutien des efforts de l'administration marocaine et des institutions publiques pour assurer la mise en uvre de l'Accord d'Association dans tous ses volets, en apportant celles-ci
NOTE DE PRESENTATION 189
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
l'expertise, l'assistance technique et les outils de travail ncessaires et ce, en vue de faciliter le rapprochement de la lgislation et la rglementation marocaines de celles de lUnion Europenne, et ce travers la mise en uvre de nouveaux domaines de coopration conomique, social et technique, le renforcement du partenariat entre les institutions marocaines et europennes et lamlioration de la capacit administrative des institutions publiques marocaines.
IV.7. Marocains Rsidants lEtranger
Lenveloppe budgtaire alloue au Ministre Dlgu auprs du Chef du Gouvernement charg des Marocains Rsidants lEtranger, au titre de lanne 2 012, slve globalement 429 351 000 dirhams, rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement. 18 491 000 DH 224 860 000 DH 186 000 000 DH
Le projet de budget dudit ministre sinscrit dans la poursuite de la mise en uvre de sa stratgie moyen terme, en concertation avec les parties prenantes, qui vise une rvision profonde de la politique dimmigration et une rflexion renouvele et rationnelle mettant fin au chevauchement des rles et la multiplicit des intervenants afin daccompagner les mutations que connat la Communaut Marocaine et rpondre ses besoins notamment en cette priode de crise. Elle porte essentiellement sur : la prservation de lidentit nationale, dans sa dimension culturelle, des nouvelles gnrations des MRE et le renforcement de leur attachement leur pays dorigine; limplication des MRE dans la gestion de la chose publique et la promotion du dveloppement conomique et social de leur pays dorigine ; la mise en place des moyens et des mcanismes pour consolider le tissu associatif et sa mobilisation dans laction sociale et dans les chantiers du dveloppement humain. A cet effet, le plan daction stratgique dudit ministre moyen terme a t dclin en trois programmes, savoir: Programme culturel et ducatif qui a pour objectifs de renforcer le systme denseignement de la langue arabe dans les pays daccueil et son adaptation aux nouveaux besoins de la Communaut Marocaine Rsidant lEtranger et lvolution de son environnement, de valoriser le patrimoine culturel et civilisationnel du Maroc dans les pays daccueil et daccompagner lenracinement des jeunes MRE dans les pays daccueil sans dracinement par rapport leur pays dorigine ; Programme Social qui uvre pour une coexistence et une intgration positive des MRE dans les pays daccueil et vise la dfense des intrts des
NOTE DE PRESENTATION 190
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
marocains du monde et la consolidation de la prsence de lEtat marocain auprs des MRE travers laccueil, lcoute, linformation, lorientation, laide et le conseil moyennant le renforcement des services sociaux existant au niveau des consulats en ressources humaines et moyens matriels, lamlioration des capacits desdits services, lencadrement et lorientation des MRE , le rapatriement au Maroc de dpouilles mortelles des MRE en situation de prcarit et le dveloppement du partenariat avec les associations uvrant dans le domaine ; Programme dappui aux associations qui a pour but le renforcement des capacits des associations pour permettre la dfense des droits et des intrts des MRE et la participation au dveloppement du Maroc (co-dveloppement) travers essentiellement la formation de lquipe de pilotage du programme et des formateurs ainsi que la consolidation des capacits dinterventions des associations marocaines. Dans ce cadre, le plan daction retenu, au titre de lanne 2012, porte essentiellement sur : Le renforcement des moyens daction du ministre travers notamment la poursuite des efforts de modernisation et de rationalisation ; La promotion des tudes, des recherches et du dialogue sur la migration marocaine internationale notamment ltude dune stratgie nationale prospective et intgre en matire dimmigration et, les tudes thmatiques sur les nouvelles gnrations des marocains rsidant ltranger; La poursuite des actions socio-culturelles au Maroc telles que la journe nationale des RME, lorganisation des colonies de vacances et de luniversit dt ; Le renforcement des services sociaux dans les consulats ltranger et le dveloppement du partenariat avec les associations nationales oeuvrant dans le domaine des RME; la poursuite de la mise en place du programme de cration de centres culturels dans les pays daccueil; la concrtisation des mesures prises par le gouvernement en faveur de la Communaut Marocaine Rsidant ltranger pour promouvoir les investissements au Maroc, contribuer au dveloppement du pays et anticiper les rpercussions de la crise conomique mondiale. Ces mesures portent essentiellement sur : la cration dun fonds pour la promotion des investissements des marocains du monde dont la gestion est confie la Caisse Centrale de Garantie; la mise en place dun guichet unique pour accompagner et orienter les MRE dans leurs dmarches de cration dentreprises ; lextension de la garantie du fonds Damane Assakane en faveur des MRE, aux mmes conditions que les rsidents ;
NOTE DE PRESENTATION
191
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
le lancement en coopration avec lAgence Franaise de Dveloppement dun projet technique la cration de petites et moyennes entreprises en faveur de la diaspora marocaine rsidant ltranger ; llaboration dune convention de partenariat, entre le Ministre Charg de la Communaut Marocaine Rsidant lEtranger, lAgence du Sud et le Programme des Nations Unis pour le dveloppement, relative limplication stratgique des marocains du monde dans le programme de dveloppement territorial durable des provinces de Guelmim, Tata, Assa, Zag et Tarfaya. la rduction du cot des transferts bancaires. Lenveloppe alloue ce dpartement comprend galement la subvention rserve la Fondation Hassan II pour les Marocains Rsidants lEtranger qui uvre pour le maintien des liens fondamentaux que ces derniers entretiennent avec leur patrie. Cette subvention est destine contribuer au financement des actions multiformes en faveur de la communaut marocaine ltranger notamment dans les domaines ducatif, socio-culturel et religieux.
IV.8- Communication
Les crdits prvus au profit du Ministre de la Communication au titre du projet de loi de finances, pour lanne 2 012, slvent 1 665 838 000 dirhams, rpartis comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 64 208 000 DH 328 000 000 DH 903 630 000 DH
Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel 370 000 000 DH national
Le projet de budget de ce dpartement sinscrit dans le cadre de la continuation de la mise en uvre de la rforme du paysage audiovisuel national, marque par linstauration dun cadre juridique pour la libralisation du secteur de la communication travers la promulgation du dcret-loi n2-02-663 du 10 septembre 2002 ayant mis fin au monopole de lEtat en matire de radiodiffusion, la mise en place dune instance de rgulation en vertu du Dahir n 1-02-212 du 31 aot 2002 portant cration de la Haute Autorit de la Communication Audiovisuelle (HACA), et enfin la publication de la loi n 77-03 relative la communication audiovisuelle en fvrier 2005 qui vient achever tout le processus de libralisation du champ audiovisuel marocain dont les principaux objectifs se rsument comme suit : La garantie des liberts dexpression, dopinions et de communication, individuelle et collective; La contribution au dveloppement culturel et informationnel, tant au niveau national que rgional et local ;
NOTE DE PRESENTATION
192
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Le soutien du secteur public de la communication audiovisuelle et sa dotation en moyens ncessaires pour faire face aux dfis de la qualit et de la comptition et pour sacquitter de ses missions de service public ; Lincitation linvestissement priv et au dveloppement dune industrie de production audiovisuelle dans ledit secteur. Dans ce cadre, le ministre focalise son programme sur les principales actions ci-aprs : Dans le domaine audiovisuel, laccompagnement, dune part, de la Socit Nationale de Radiodiffusion et de Tlvision (SNRT) dans le lancement du projet de son 3me Contrat-programme avec lEtat pour la priode 2012-2014 et dautre part, la poursuite de lexcution du 1er Contrat-programme entre lEtat et la Socit dEtudes et de Ralisation Audiovisuelles (SOREAD-2M) pour la priode 2010-2012, lesquels contrats dfinissent les objectifs raliser et les moyens mettre en uvre pour les atteindre. Pour ce qui est de la SNRT, le projet du Contrat-programme pour la priode 2012-2014, en cours de prparation, vise la ralisation des objectifs ci-aprs : La consolidation des projets initis dans le cadre du Contrat-programme 2009-2011, notamment le renforcement de la grille des programmes ; Lamlioration de la qualit de la production nationale; Le renforcement de la production de la fiction Amazigh ; Lamlioration du positionnement et de limage de marque de la SNRT dans le champ audiovisuel national ; La consolidation de lensemble des avances ditoriales, technologiques et organisationnelles. Sagissant de la socit SOREAD-2M, cette dernire a conclu avec lEtat un Contrat-programme pour la priode 2010-2012 aux termes duquel lEtat contribue au financement de son programme dassainissement triennal au titre de la priode prcite moyennant le respect des engagements ci-aprs : La couverture nationale travers son apport au dveloppement du rseau de tlvision numrique terrestre ; La ralisation de linvestissement ncessaire dans les moyens de captation, de post-production, de transmission et de diffusion des programmes afin de garantir la continuit et la qualit technique de service aux tlspectateurs conformment aux standards technologiques internationaux ; Lamlioration de la programmation de tlvision en offrant aux tlspectateurs le plus large choix de programmes de tlvision gnraliste et diversifie;
NOTE DE PRESENTATION
193
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Le respect de la diversit culturelle et linguistique en consacrant en moyenne au moins 70% de son temps dantenne annuel aux programmes diffuss en langue arabe, en amazighe ou en dialectes marocains ; La modernisation et la rationalisation des outils et des procdures de gestion travers notamment le dveloppement de toutes formes de synergie et dactions de mutualisation des moyens entre la SNRT et SOREAD-2M dans le cadre de conventions conclure entre ces deux socits. Dans le domaine du cinma, la mise en uvre dune stratgie cinmatographique base sur : Le dveloppement de lindustrie de la production, du traitement, de la distribution et de lexploitation cinmatographique moyennant lattraction des investissements trangers directs dans les tournages au Maroc ; La consolidation et le renforcement du rle social, culturel et ducatif du cinma. Ainsi, lappui au secteur cinmatographique est marqu notamment par la continuation du soutien des producteurs de films travers le rle jou par le Fonds daide la production cinmatographique , ainsi que la mise niveau des quipements du laboratoire du Centre Cinmatographique Marocain en vue dexcuter les travaux de tournages cinmatographiques dans le respect des normes requises par les ralisateurs de films marocains et trangers. En vue de consolider la formation des ressources humaines dans le domaine du cinma, il est programm lachvement des travaux de construction de lInstitut Suprieur des Mtiers de lAudiovisuel et du Cinma (ISMAC), dont le dmarrage est prvu pour la rentre universitaire 2012. Ainsi, et dans le cadre dune convention de financement signe entre le Maroc et lAgence Franaise de Dveloppement, les cadres forms au sein de cet Institut sont destins rpondre aux besoins en comptences des secteurs de laudiovisuel et du Cinma et dautres secteurs artistiques connexes. Dans le domaine de la presse, laccompagnement du dveloppement de la presse nationale crite visant : La diversification de loffre de service en termes de contenu, de supports et de thmatiques travers la modernisation du systme dinformation, le renforcement de la formation et la mise niveau des quipements de lAgence Maghreb Arabe Presse (MAP), ainsi que la poursuite de lextension de ses reprsentations au niveau national et international afin dassurer une large couverture des vnements nationaux et internationaux. Dans ce cadre, la MAP a opt pour une spcialisation et une rpartition des tches et des moyens mme de garantir un produit de qualit rpondant au mieux aux normes exiges, ce qui lui permettra de confirmer sa reprsentativit dans toutes les villes du Royaume et de renforcer son rseau de bureaux internationaux.
NOTE DE PRESENTATION
194
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
La poursuite de la contribution de lEtat la mise niveau des entreprises de presse vocation nationale, rgionale et locale, dans le cadre de la conclusion dun nouveau Contrat-programme en cours dlaboration liant lEtat et la Fdration marocaine des diteurs de journaux qui consolide le dveloppement du secteur de la presse linstar du premier Contratprogramme sign le 11 mars 2005. Dans le domaine de la formation des journalistes, le soutien de lInstitut Suprieur de lInformation et de la Communication par la rnovation de ses quipements, notamment ceux de nature didactique en vue dadapter les profils des laurats dudit Institut aux besoins du march du travail et aux exigences de mutations des secteurs audiovisuel et de la presse ; Dans le domaine de la coopration, la poursuite des efforts de coopration avec les partenaires nationaux et trangers visant le renforcement des capacits des entits du Ministre de la Communication, qui oprent dans les domaines de laudiovisuel, du cinma et de la presse. En outre, il est prvu la poursuite du dveloppement de la communication institutionnelle devant participer au rayonnement du Maroc ltranger et la promotion de son image institutionnelle et partant lamlioration du climat de linvestissement.
IV.9- Fonction Publique et Modernisation de lAdministration
Lenveloppe prvue au profit du dpartement charg de la Fonction Publique et de la Modernisation de lAdministration, au titre de lanne 2012, slve globalement 94 215 000 dirhams, rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 54 265 000 DH 15 450 000 DH 24 500 000 DH
Outre lquipement des services dudit Ministre et de lEcole Nationale dAdministration, les crdits dinvestissement permettront la poursuite des actions engages dans le cadre de la rforme administrative et de la modernisation des secteurs publics. Le programme daction envisag par ce dpartement au titre de lanne 2012, porte sur les principaux axes suivants : La poursuite du processus de modernisation de ladministration publique travers la ralisation des tudes et des actions programmes dans le cadre de la stratgie de modernisation des secteurs publics en application des orientations gouvernementales. La valorisation des ressources humaines travers notamment la simplification des procdures de gestion du personnel et la rvision des techniques
NOTE DE PRESENTATION 195
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
dvaluation et de notation ainsi que lamlioration des capacits et des comptences au moyen de la gnralisation de la gestion prvisionnelle des fonctions et des comptences. Lamlioration de la gouvernance publique et la moralisation de ladministration travers llaboration dun projet de charte nationale pour la dconcentration et la mise jour du programme national de moralisation de la vie publique, ainsi que la prparation dun programme de lutte contre la corruption. Le dveloppement de ladministration numrique travers lamlioration du contenu du portail " service-public.ma ", lacquisition et la mise en uvre dune solution de messagerie lectronique, la ralisation dactions de communication autour du centre dappel et de messagerie ainsi que lorganisation du prix national de lAdministration lectronique E-mtiaz ; Lachvement du projet de construction, damnagement et dquipement du Centre Africain de Recherche Administrative pour le Dveloppement devant contribuer lembellissement de limage du Maroc en Afrique ainsi quau renforcement des relations stratgiques et politiques entre notre pays et les Etats africains. La poursuite de lappui et de laccompagnement des diffrents ministres dans le processus de rforme administrative et de modernisation des secteurs publics travers : le Fonds de modernisation de ladministration publique (FOMAP) qui continuera galement tre mobilis en 2012 pour financer, cot partag, des projets engags par les diffrents dpartements ministriels en matire de modernisation de ladministration publique ; le soutien des comptences de ladministration au moyen de la formation distance en tant quinstrument de la formation continue.
IV.10- Secrtariat Gnral du Gouvernement
Lenveloppe budgtaire alloue au Secrtariat Gnral du Gouvernement, au titre de lanne 2012, slve 68 286 000 dirhams rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement. 47 916 000 DH 14 370 000 DH 6 000 000 DH
Les crdits dinvestissement sont destins essentiellement la poursuite des actions stratgiques suivantes : Le renforcement des quipements informatiques visant lamlioration de la qualit des services rendus en matire de traduction officielle des projets de textes lgislatifs et rglementaires manant des administrations publiques,
NOTE DE PRESENTATION 196
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
ainsi que lactualisation de la codification des bases de donnes lgislatives et rglementaires; La continuation du renforcement des actions de communication du SGG travers la diffusion sur le site de tous les bulletins officiels parus depuis 1912; La modernisation de lImprimerie Officielle travers ladoption de techniques managriales, de nouvelles applications et logiciels qui permettront la bonne gestion des ressources, la commercialisation de ses produits, le dveloppement de ses capacits dans le domaine des travaux dimpression, la diffusion de linformation juridique sur supports numriques et le renforcement de ses ressources humaines par un personnel qualifi disposant de grandes capacits professionnelles.
IV.11- Juridictions Financires
Les crdits prvus au profit des Juridictions Financires, au titre de lanne 2 012, slvent 165 845 000 dirhams, rpartis comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 71 536 000 DH 38 309 000 DH 56 000 000 DH
Ces crdits visent doter les Juridictions Financires de moyens humains et logistiques pour atteindre les objectifs fixs en matire de contrle des finances publiques, de la gestion des dossiers de la dclaration obligatoire du patrimoine et de contrle des subventions accordes aux partis politiques et les dpenses affrentes aux diffrentes campagnes lectorales, notamment par : Le parachvement de la structuration de la Cour des Comptes et des Cours Rgionales des Comptes pour atteindre le rythme de croisire du processus de redynamisation des Juridictions Financires engag depuis 2003 ; La mise en place progressive de la logistique adquate en matire darchivage et de scurit pour permettre linstallation des structures charges de lexercice des nouvelles missions notamment en matire de la dclaration obligatoire du patrimoine; Louverture des juridictions financires sur leur environnement national et international par le dveloppement des liens de coopration et de partenariat au niveau national et international avec les institutions et les corps de contrle des finances publiques nationaux et trangers. Dans ce cadre, le plan dactions de la Cour des Comptes, pour lanne 2012, porte principalement sur: La poursuite des programmes dinvestissement visant la ralisation des siges des Juridictions Financires par lachvement et lquipement du sige de la
NOTE DE PRESENTATION
197
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Cour des Comptes et la poursuite des travaux de construction des siges des Cours Rgionales des Comptes dAgadir , Marrakech , Tanger et Oujda ; Le renforcement de lefficacit de lintervention des juridictions financires par le dveloppement des moyens logistiques pour la mise en place des structures charges de lexercice des nouvelles missions dvolues aux juridictions; La poursuite du dveloppement des liens de Coopration avec les institutions et les corps de contrle des finances publiques nationaux et trangers (INTOSAI, GAO, NAO, Cour suprme, Ordre National des experts...).
IV.12- Relations avec le Parlement et la Socit Civile
Lenveloppe budgtaire alloue au profit du Ministre charg des Relations avec le Parlement et la Socit Civile, au titre de lanne 2 012, slve 27 769 000 dirhams rpartie comme suit : Dpenses de personnel.... Dpenses de matriel et dpenses diverses Dpenses d'investissement.. 19 888 000 DH 6 481 000 DH 1 400 000 DH
Ces crdits visent la ralisation des actions stratgiques du dpartement qui sarticulent autour des objectifs suivants : coordonner les relations entre les deux Chambres du Parlement et les structures gouvernementales; assurer le suivi du processus dexamen et dadoption des projets de textes caractre lgislatif ; contribuer lenrichissement desdits projets de textes et lactualisation des lois en vigueur ; et dvelopper les relations et les rapports avec les membres du Parlement et les groupes parlementaires. Dans ce cadre, le plan daction retenu par ce ministre, pour lanne 2012, porte essentiellement sur lachvement de lextension du sige, le dveloppement et la modernisation de son parc informatique et des moyens de travail et de communication de ses services afin daccomplir les missions prcites.
IV-13- Charges Communes
IV-13-1- Fonctionnement Le montant des crdits prvus au titre du budget de fonctionnement des charges communes pour lanne 2012 s'lve 62.617.530.000 dirhams, en
NOTE DE PRESENTATION 198
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
augmentation de 26.161.130.000 dirhams ou 71,76% par rapport aux crdits ouverts au titre de lanne budgtaire 2011. Cette hausse est due principalement laugmentation des prvisions relatives la charge de compensation des prix des produits ptroliers. Les principales rubriques de ce chapitre sont constitues par les transferts en faveur de : La Caisse de Compensation et lONICL.........45.525 MDH Ces crdits sont destins la couverture des charges de compensation des prix des produits ptroliers et des denres alimentaires de base pour un montant de 31.525 MDH, ainsi qu lapurement des arrirs de compensation au titre de lanne 2011, valus 14.000 MDH. La Caisse Marocaine des Retraites..10.842,504 MDH Cette enveloppe couvre la charge normale de lexercice et tient compte de la couverture du dficit du rgime des pensions militaires pour lanne 2012, ainsi que la prise en charge de limpact des mesures prises dans le cadre du dialogue social. La Prvoyance Sociale.2.217,75 dont : Contribution de lEtat lassurance maladie obligatoire de base du secteur public : 1.692,75 MDH MDH
Cette enveloppe est destine au financement de la contribution patronale de lEtat lassurance maladie obligatoire de base du secteur public. Mutuelle des Forces Armes Royales : Contribution de lEtat la couverture mdicale de base au profit des personnes victimes de violations des droits de lHomme IV-13-2. Investissement Le montant des crdits prvus au titre du budget dinvestissement des charges communes pour lanne 2012 s'lve 18.528.310.000 dirhams, en augmentation de 2.463.010.000 dirhams, soit 15,33% par rapport lanne budgtaire 2011. Les principales composantes de ce chapitre sont les suivantes : Participations et concours divers.....10.041,31 MDH Cette rubrique qui reprsente globalement 54,19% des crdits inscrits au budget d'investissement des charges communes, comprend principalement des transferts destins au financement des oprations suivantes : Versement au Fonds Hassan II pour le Dveloppement
NOTE DE PRESENTATION 199
480 MDH
45 MDH
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Economique et Social (pour lapurement des arrirs au titre de lanne 2011).....2.000 MDH Dotations en capital...........................................................949,508 MDH Projet de Renault Tanger (subvention dinvestissement)..690 MDH Mise en uvre des stratgies du sport et de la jeunesse...........660 MDH Contribution la ralisation du Tramway de Casablanca.600 MDH Contribution de lEtat la ralisation du port Tanger MED II (Phase I)..400 MDH Versement au profit de lAgence pour lAmnagement du Site de la Lagune de Marchica......................300 MDH Promotion de lemploi et de loffshoring...250 MDH Travaux hors site relatifs au port TANGER MED I (complment).... 250 MDH Subventions aux Agences pour la Promotion et le Dveloppement Economique et Social ...240 MDH Contribution la ralisation du projet damnagement de la Valle du Bouregreg.....200 MDH Pacte National pour lEmergence industrielle (Aides la formation et participation de lEtat au financement de fonds public-priv).200 MDH Financement du programme dhabitat dans les Provinces du Sud..200 MDH Ralisation de grands projets par lONEP......200 MDH Versements au profit des comptes spciaux du Trsor ci-aprs : Fonds de soutien linitiative Nationale pour le Dveloppement Humain....... Fonds pour la promotion de lemploi des jeunes Fonds de promotion des investissements.. Ristournes d'intrts.................................................................... Couverture des risques de change sur emprunts extrieurs dans le cadre du soutien de l'Etat certaines institutions financires...
1.500 MDH 500 MDH 100 MDH 300 MDH
40 MDH
NOTE DE PRESENTATION
200
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
NOTE DE PRESENTATION
201
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Les dispositions contenues dans le projet de loi de finances pour l'anne budgtaire 2012 portent sur des mesures d'ordre fiscal et diverses.
I- DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL
A- DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS 1- Habilitation et ratification
1.1- Habilitation
En vertu des dispositions combines des articles 5 et 183 du code des douanes et impts indirects relevant de lAdministration des Douanes et Impts Indirects, approuv par le dahir portant loi n 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), les quotits tarifaires et les autres droits et taxes perus limportation ou lexportation ainsi que les taxes intrieures de consommation peuvent, conformment aux dispositions de larticle 70 de la Constitution, tre modifis ou suspendus par le gouvernement, en vertu dune habilitation lgislative. Dans ce cadre, le paragraphe I de larticle 2 du projet de loi de finances pour lanne 2012 prvoit lhabilitation du gouvernement de prendre pendant la priode allant de la date de publication de la prsente loi de finances au bulletin officiel et jusquau 31 dcembre 2012, des mesures visant : a) modifier ou suspendre par dcret lexclusion de la taxe sur la valeur ajoute, les quotits tarifaires et les autres droits et taxes perus limportation et lexportation ainsi que les taxes intrieures de consommation ; et b) modifier ou complter galement par dcret les listes des produits originaires et en provenance de certains pays dAfrique, bnficiant de lexonration du droit dimportation ainsi que la liste de ces pays. 1.2- Ratification : Les dcrets pris en vertu de lhabilitation vise ci-dessus, doivent tre, conformment aux dispositions de larticle 70 de la Constitution, soumis la ratification du parlement lexpiration du dlai fix par la loi dhabilitation. Aussi, le paragraphe II de larticle 2 du projet de loi de finances pour lanne 2012 vise t-il la ratification des dcrets ci-aprs pris durant lanne 2011 : 1- Dcret n 2- 10-524 du 23 joumada II 1432 (27 mai 2011) portant modification des quotits du droit dimportation applicable certains produits agroalimentaires. Ce dcret a pour objet :
NOTE DE PRESENTATION
202
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
a - La mise en uvre des engagements de lEtat dans le cadre du Pacte National pour lEmergence Industrielle : La filire agro-alimentaire est une composante primordiale de lindustrie nationale, mais qui souffre actuellement dune stagnation globale due, notamment, la faible comptitivit des units agro-industrielles. Afin de soutenir cette filire et relancer sa croissance en mettant profit ses fondamentaux exceptionnels (cots de main duvre, matires premires agricoles, position logistique, etc...), lEtat sest engag, dans le cadre du Pacte National pour lEmergence Industrielle, amliorer les performances des filires intermdiaires (chocolaterie-confiserie, biscuiterie, etc...) travers : La mise en place de quotas sur les intrants ncessaires pour renforcer la comptitivit de la production locale face aux produits finis imports dans le cadre des accords de libre change conclus par le Maroc ; et La rduction du droit dimportation applicable, dans le cadre du droit commun, aux produits finis utilisant ces intrants.
Aussi, a t-il t dcid : dappliquer un droit dimportation minimum de 2,5% sur les importations du sucre raffin, du lait en poudre entier ou crm et du bl tendre biscuitier, ralises dans la limite dun contingent quantitatif et destines aux units industrielles des filires confiserie, biscuiterie et chocolaterie ; et de rduire, trois mois aprs la mise en place des quotas sus mentionns, les quotits du droit dimportation appliqu aux produits finis utilisant ces intrants : de 49% 25% pour les produits finis des filires confiserie et biscuiterie ; et de 32,5% 20% pour les produits finis de la filire chocolaterie b - Lamlioration de la comptitivit de certaines branches dactivit : En vue de renforcer la comptitivit des units agro-industrielles marocaines non concernes par les mesures prconises par le Pacte National pour lEmergence Industrielle, il a t estim opportun de rduire le droit dimportation de : 10% 2,5% sur les graines de moutarde ; et de 32,5% 17,5% sur le glucose. 2- Dcret n 2-11-256 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) portant modification du droit dimportation applicable certains produits. Ce dcret a pour objet :
NOTE DE PRESENTATION
203
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
a - Le renforcement de la comptitivit de lindustrie sidrurgique : Un investissement denvergure a t ralis afin de doter le Maroc dun complexe de laminage produisant des tles lamines chaud utilises, essentiellement, par lindustrie sidrurgique et les secteurs de la construction, du btiment et des grands travaux dinfrastructure. Afin daccompagner cet investissement stratgique et de renforcer la comptitivit des socits oprant dans les secteurs sidrurgique et mtallurgique, il a t jug ncessaire de relever le droit dimportation appliqu aux tles lamines chaud de 2,5% 10%. b - La rvision de la structure tarifaire de certains produits : Dans le cadre de la poursuite des actions visant le renforcement de la comptitivit des branches dactivit nationales, il a t estim opportun de rviser la structure tarifaire des produits suivants : Les compteurs deau : Application du droit dimportation aux taux de : 2,5% sur les compteurs deau imports ltat dmont et sans bche ; 2,5% sur les autres parties et accessoires de compteurs deau. 10% sur les bches pour compteurs deau ; et 25% sur les compteurs deau imports ltat dmont et avec bche. La robinetterie : Application du droit dimportation aux taux de : 2,5% sur les inputs utiliss dans la fabrication des articles de robinetterie. 10% sur certaines bauches de la robinetterie ; et 25% sur les produits fabriqus localement. c- La rforme tarifaire des bois et ouvrages en bois: Afin de permettre lindustrie nationale du bois de disposer moindre cot des intrants ncessaires son dveloppement, tout en prservant le patrimoine forestier national, il a t jug ncessaire de rduire le droit dimportation de : 10% 2,5% sur le bois non sci, simplement arrondi ou dgrossi. 10%, 25% et 30% 2,5% sur les feuilles pour placage de bois. 30% 25% sur les panneaux et les contre-plaqus de bois.
NOTE DE PRESENTATION 204
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
d- Llimination des distorsions tarifaires portant sur certains produits : Il sagit de lapplication du droit dimportation minimum de 2,5% aux produits suivants : Le savon cru en pellets et les flacons en verre, non produits localement, utiliss dans la fabrication de certains articles cosmtiques soumis au droit dimportation de 2,5%. Les voitures hybrides dont le moteur thermique est dune cylindre suprieure 3.000 cm3 et fonctionne lessence par analogie celles moteur diesel. 3 - Dcret n 2-11-574 du 5 kaada 1432 (3 octobre 2011) portant suspension de la perception du droit dimportation applicable au bl dur et au bl tendre. Lexamen du bilan mondial du bl dur pour la compagne 2011/2012, fait ressortir une dprciation des stocks mondiaux denviron 10%, soit leur plus bas niveau enregistr depuis trois ans. Cette situation tendue du march mondial du bl dur se traduit par des prix internationaux extrmement levs, se situant actuellement plus de 660 $/tonne contre 300 $/tonne la mme priode de lanne 2010, ce qui induit un prix de revient limportation au Maroc de lordre de 552 DH/QL largement au dessus du prix dquilibre de 320 DH/QL permettant dassurer un approvisionnement normal des semouleries industrielles. Dans un souci dassurer un approvisionnement normal du march intrieur en cette denre, il a t jug ncessaire de suspendre la perception du droit dimportation applicable au bl dur et ce, pour la priode du 1er Octobre au 31 Dcembre 2011. Pour ce qui est du bl tendre, les cours internationaux restent volatiles cause des incertitudes lies aux craintes de ralentissement de la demande suite la crise financire. Lestimation du prix de revient limportation du bl tendre la fin du mois de Septembre 2011, a atteint 400 DH/QL ce qui se situe largement au dessus du prix cibl de 260 DH/QL. Afin de permettre un approvisionnement normal du march intrieur en bl tendre et ses drivs, il a t estim opportun de suspendre la perception du droit dimportation applicable au bl tendre et ce, pour la priode du 15 Novembre au 31 Dcembre 2011. 4- Dcret n 2-11-747 du 6 safar 1433 (31 dcembre 2011) modifiant le dcret n 2-11-574 du 05 kaada 1432 (3 octobre 2011) portant suspension de la perception du droit dimportation applicable au bl dur et au bl tendre. Le contexte actuel se caractrise par linstabilit des cours internationaux des crales et la faiblesse de la pluviomtrie en ce dbut danne agricole. Dans un souci dassurer un approvisionnement rgulier et dans des conditions normales du
NOTE DE PRESENTATION 205
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
march national en bl tendre et bl dur, il a t jug ncessaire de proroger la suspension du droit dimportation applicable ces crales jusquau 28 fvrier 2012. 2 Code des douanes et impts indirects Alignement des dispositions des articles 5 et 183 sur les dispositions de la nouvelle constitution Les articles 5 et 183 actuels prvoient respectivement la modification par le gouvernement des quotits tarifaires et des autres droits et taxes perus limportation et lexportation ainsi que les taxes intrieures de consommation et ce, dans le cadre de lhabilitation prvue par larticle 45 de la constitution. Or, cette habilitation est dornavant prvue par larticle 70 de la nouvelle constitution. Aussi, est-il estim opportun dactualiser lesdits articles 5 et 183 du code des douanes et impts indirects pour tenir compte de cette modification. Articles 49-1 et 57-1 : Obligation du dpt de la dclaration sommaire par anticipation dans le cadre du transport maritime et arien Conformment aux dispositions de larticle 49 du code des douanes et impts indirects, le capitaine du navire ou son reprsentant dispose de 24 heures aprs larrive du navire pour dposer au bureau de douane une dclaration sommaire. Le dpt de la dclaration sommaire dans ce dlai est galement prvu par larticle 57 dudit code pour le transport par voie arienne aprs larrive de laronef. Les deux articles autorisent galement le dpt de ladite dclaration sommaire avant mme larrive du navire ou de laronef. Il savre donc que le dpt de la dclaration sommaire par anticipation nest pas une obligation mais une facult. Dans le cadre de la stratgie de ladministration qui vise amliorer le contrle, il est propos de rendre obligatoire le dpt de la dclaration sommaire pralablement larrive des marchandises et ce, dans le but danticiper lanalyse du risque et partant, assurer la fluidit des oprations de ddouanement. Il y a lieu de signaler que cette mme mesure est mise en place par lunion europenne depuis le premier janvier 2011.
NOTE DE PRESENTATION
206
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Article 65- La simplification des procdures de circulation des conteneurs. La libre circulation des conteneurs simpose en raison du nombre considrable de conteneurs qui franchissent les frontires chaque jour. De mme, les formalits douanires relatives ladmission temporaire des conteneurs constituent la fois une contrainte aux exploitants et un surcot de travail administratif pour le service. A cela sajoute le faible risque de la non rexportation puisque la plupart des conteneurs appartiennent des socits trangres. Ainsi et afin dallger la procdure pratique actuellement, il est propos que ladmission temporaire des conteneurs soit effectue sans dpt de la dclaration douanire. Article 215- Institution de la rgle du non cumul des condamnations pcuniaires. Dans un souci dharmonisation avec les autres lgislations du droit commun et afin de faciliter le recouvrement des condamnations pcuniaires, il est propos dabandonner la rgle du cumul en faveur de la sanction la plus grave sous rserve que les infractions commises portent sur le mme objet litigieux. 3 - Tarif des droits de douane 3-1- Motocycles lectriques : La promotion des nergies moins polluantes sinscrit dans le cadre de la politique de dveloppement durable. La substitution de lnergie lectrique aux carburants utiliss par certains moyens de transport rpond cet objectif. Aussi, estil propos de faire bnficier du droit dimportation minimum de 2,5% les motocycles fonctionnant lnergie lectrique. 3-2- Produits obtenus dans les zones franches dexportation : Les produits obtenus dans les zones franches dexportation sont soumis lors de leur mise la consommation dans le territoire assujetti au rgime de droit commun. Or, les mmes produits originaires de pays avec lesquels le Maroc a sign des accords de libre change bnficient dun rgime tarifaire prfrentiel. Dans un souci doptimisation du processus de production et de flexibilit commerciale des entreprises installes dans les zones franches dexportation, il est propos de faire bnficier leurs produits du taux minimum du droit dimportation, soit 2,5%. La
NOTE DE PRESENTATION 207
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
proportion des marchandises ligibles ce taux minimum ne peut dpasser 30% du chiffre daffaires annuel lexportation. Bien entendu, les conditions doctroi de cet avantage tarifaire sont fixes par voie rglementaire. 4-Taxes intrieures de consommation 4-1- Harmonisation de la taxe intrieure de consommation sur certaines huiles et prparation lubrifiantes : Larticle 5 de la loi de finances pour lanne 2011 a prvu de soumettre toutes les prparations lubrifiantes, quelle que soit leur teneur en huile de ptrole ou de minraux bitumineux, la taxe intrieure de consommation de 154 dirhams les 100 kilogrammes. Toutefois, lapplication de cette mesure a fait ressortir que les huiles de base produites localement et servant dintrant pour lobtention des huiles lubrifiantes sus vises, sont soumises la taxe intrieure de consommation de 228 dirhams les 100 kilogrammes. Cette distorsion pnalise lindustrie nationale des drivs des produits ptroliers. Afin de remdier cette situation, il est propos de soumettre les prparations lubrifiantes la taxe intrieure de consommation de 228 dhs les 100 kgs, soit au mme titre que les huiles de base. 4-2- Tabacs manufacturs : En attendant la rforme globale de la compensation, le projet de loi de finances pour lanne 2012 prvoit la cration dun compte intitul Fonds dappui la cohsion sociale pour financer certains programmes sociaux destins directement aux familles dmunies pour assurer la scolarisation de leurs enfants et leur accs au systme de soins. Considrant que la taxation du tabac permet, entre autres, de couvrir les externalits lies sa consommation, notamment les cots de sant, et de financer les programmes sociaux en direction des plus dmunis, le financement de ce fonds est assur en partie par un prlvement de 1,6% du prix de vente public des cigarettes (hors TVA) sans affecter les recettes gnres par la quotit actuelle de la TIC. Aussi, est-il propos daugmenter le taux de la TIC applicable aux cigarettes et certains tabacs manufacturs de 59,4% respectivement 61% et 65%. Cette mesure occasionnerait une recette value 400 millions de dirhams. 5 - Taxe sur les bois imports : La taxe sur les bois imports, cre en application de larticle 10 de la loi de finances pour lanne 1986 tel que modifi par larticle 28 de la loi de finances pour lanne budgtaire 1999-2000, sapplique au taux de 12% ad-valorem sur les importations des bois et ouvrages en bois relevant du chapitre 44 du tarif des droits de douane limportation. Le produit de cette taxe est affect au Fonds national forestier.
NOTE DE PRESENTATION 208
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Cependant, les ouvrages en bois relevant du chapitre 94 du tarif des droits de douane limportation (meubles et articles similaires) ne sont pas soumis cette taxe, ce qui pnalise lactivit nationale de transformation du bois et, particulirement, les ateliers dartisanat. Afin de remdier cette distorsion et permettre une harmonisation de lapplication de cette taxe sur tous les ouvrages en bois, il est propos den tendre lapplication aux articles en bois relevant du chapitre 94 du tarif des droits de douane limportation. Par ailleurs et afin de renforcer la comptitivit des units de transformation du bois, il est, galement, propos de rduire cette taxe 6% sur les feuilles pour placage et aux autres produits relevant de la position 44.08 du tarif des droits de douane limportation.
B - IMPOTS, TAXES ET DIVERSES MESURES FISCALES
1 - Mesures spcifiques limpt sur le revenu 1-1- Dispense de la dclaration du revenu global pour les contribuables soumis lIR selon des taux libratoires Actuellement, les dispositions de larticle 86 du C.G.I prvoient la dispense de la dclaration du revenu global pour certains contribuables soumis lIR. Afin de clarifier lapplication des dispositions de cet article, il est propos de le complter, en prcisant que les contribuables soumis lIR selon des taux libratoires prvus au dernier alina de larticle 73-II du C.G.I, sont galement dispenss du dpt de la dclaration annuelle du revenu global. 1-2- Etendre le bnfice du dlai de 8 ans institu par la loi de finances 2009 aux contrats individuels ou collectifs dassurance retraite et aux contrats dassurance sur la vie ou de capitalisation souscrits avant le 1er janvier 2009 Avant le 1er janvier 2009, des avantages fiscaux ont t accords aux cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs dassurance retraite dune dure gale au moins 10 ans, ainsi quaux prestations servies au terme dun contrat dassurance sur la vie ou dun contrat de capitalisation de la mme dure. A compter du 1er janvier 2009, les dispositions de la loi de finances n 40-08 pour lanne 2009 ont ramen la condition de dure des contrats susviss de 10 8 ans. Toutefois, cette mesure n'a concern que les contrats conclus compter du 1er janvier 2009, conformment au VI (2 et 5) de l'article 7 de la LF pour lanne 2009 susvise. Afin de faire bnficier tous les contribuables ayant conclu les contrats prcits avant le 1er janvier 2009 de l'avantage fiscal lorsque le dlai de 8 ans est respect, il est propos de modifier les dispositions relatives la date deffet prvue par la loi de finances pour lanne 2009 pour lesdits contrats.
NOTE DE PRESENTATION 209
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
2- Mesures spcifiques la taxe sur la valeur ajoute 2-1- Imposition du secteur cinmatographique Actuellement, bnficient de lexonration de la TVA sans droit dduction, les films cinmatographiques et leurs distributions ainsi que les recettes brutes provenant des spectacles cinmatographiques. Dans le cadre de la rforme de la TVA visant la suppression des exonrations, llargissement de lassiette fiscale et afin de rpondre aux dolances du secteur, il est propos dappliquer le taux de 20% auxdites oprations. De mme, et dans le cadre de lharmonisation du traitement fiscal applicable lintrieur et limportation, il est propos dappliquer le taux normal de 20% limportation des films cinmatographiques. 2-2- Exonration de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des uvres sociales des prposs religieux Bnficient actuellement de lexonration de la TVA sans droit dduction, les prestations fournies par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des uvres sociales des prposs religieux, en tant quassociation sans but lucratif reconnue dutilit publique. Dans le but dencourager la Fondation prcite et afin de promouvoir ses actions dans le cadre des missions qui lui sont dvolues, il est propos dexonrer avec droit dduction, aussi bien l'intrieur qu' l'importation, lacquisition de ses biens, matriels, marchandises et services ainsi que les services effectus par elle. 2-3- Dductibilit du gasoil et du krosne utiliss pour les besoins du transport arien Ouvre droit dduction, la taxe sur la valeur ajoute ayant grev le gasoil utilis pour les besoins dexploitation des vhicules de transport collectif routier ou ferroviaire des personnes et des marchandises ainsi que le gasoil utilis pour les besoins du transport routier des marchandises par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens. Dans un souci dquit fiscale, il est propos dadmettre la dductibilit de la TVA ayant grev le gasoil et le krosne utiliss pour les besoins du transport arien. 2-4- Suppression des formalits d'achat en exonration de la TVA des appareillages spcialiss destins exclusivement aux handicaps Les appareillages spcialiss destins exclusivement aux handicaps sont exonrs de la TVA, sous rserve de laccomplissement des formalits prvues cet effet. Dans la pratique, il a t constat que l'accomplissement de ces formalits cause des difficults lies aux allers-retours entre le fournisseur, se trouvant
NOTE DE PRESENTATION
210
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
gnralement Rabat ou Casablanca et le service local des impts dont dpend le lieu de rsidence de l'intress. Pour remdier cette situation, il est propos de supprimer lobligation daccomplir ces formalits, sachant que lesdits appareillages ne peuvent tre utiliss que par la personne handicape. 3 - Mesures spcifiques aux droits denregistrement 3-1- Suppression de la condition dexonration des droits denregistrement pour les acquisitions de terrains dans les zones franches dexportation Actuellement, les entreprises installes dans les zones franches dexportation bnficient de lexonration des droits denregistrement relatifs lacquisition des terrains ncessaires la ralisation de leurs projets dinvestissement, condition que ces terrains demeurent leur actif pendant au moins dix (10) ans. Toutefois, cette condition reste contraignante pour les entreprises installes dans lesdites zones, dont lactivit principale consiste en lamnagement des terrains pour les cder aux investisseurs, et qui ne peuvent maintenir lesdits terrains dans leur actif immobilis pendant la dure de dix (10) ans prcite. Pour permettre ces entreprises de bnficier de lexonration des droits denregistrement relatifs lacquisition des terrains susviss, il est propos de supprimer la condition de maintenir lesdits terrains dans leur actif immobilis pendant la dure de dix (10) ans. 3-2- Relvement du taux rduit denregistrement de 3 4% pour les acquisitions de locaux construits et de terrains lotir ou construire Actuellement, les actes dacquisition de locaux construits et de terrains lotir ou construire sont soumis au taux rduit de 3 %. Dans le cadre de la politique du Gouvernement visant la diminution des dpenses fiscales et la suppression progressive des taux rduits, il est propos de soumettre ces acquisitions au taux rduit de 4% au lieu de 3%, lexclusion des acquisitions de logements sociaux (250.000 DH hors TVA) et des logements faible valeur immobilire (140.000 DH) qui restent soumises au taux de 3%. 3-3- Perception des droits denregistrement sur les actes notaris au vu dune expdition au lieu de la minute Actuellement, les notaires doivent prsenter lenregistrement les minutes des actes, sur lesquelles sont portes les mentions denregistrement. Les rfrences de cet enregistrement sont, par la suite, transcrites par le notaire sur les expditions quil dlivre aux parties ou qu'il prsente aux administrations concernes. Laccomplissement de cette formalit ncessite souvent la rtention des minutes par certains bureaux, avec le risque de perte des documents quelle comporte, et par consquent, lengagement de la responsabilit de ladministration.
NOTE DE PRESENTATION
211
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Il est donc propos de permettre aux notaires denregistrer leurs actes au vu dune expdition, au lieu de la minute. 4 - Mesure spcifique aux Droits de Timbre Il est propos de relever le tarif sur la premire immatriculation des vhicules automobiles comme suit : vhicules de puissance fiscale infrieure 8 C.V. vhicules de puissance fiscale de 8 10 C.V. inclus vhicules de puissance fiscale de 11 14 C.V. inclus : de 1.000 3.000 DH ; : de 2.000 6.000 DH ; : de 3.000 10.000 DH ;
vhicules de puissance fiscale gale ou suprieure 15 C.V.: de 4.000 20.000 DH. Cette mesure sinscrit dans le cadre de la politique de consolidation des recettes fiscales pour le financement des dpenses caractre social, dans la perspective de la rforme globale du systme de la compensation.
5 - Mesures spcifiques la taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles 5-1- Supprimer lexonration de la vignette automobile pour les vhicules ayant plus de 25 ans dge et la limiter aux vhicules de collection Actuellement, les vhicules ayant plus de 25 ans dge sont exonrs de la taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles. Il est propos de supprimer cette exonration et de laccorder uniquement aux vhicules de collection dont la carte grise porte cette mention et ce, pour les raisons suivantes : lexonration actuelle encourage lutilisation des vhicules polluants ; les vhicules concerns utilisent linfrastructure publique ; la proposition de taxation de ces vhicules est en cohrence avec la mesure rcente interdisant limportation des vhicules de plus de 5 ans dge. Cette mesure entre en vigueur en 2013. 5-2- Relever le tarif pour la catgorie de vhicules de plus de 11 chevaux de puissance fiscale Il est propos de relever le tarif de la taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles de plus de 11 chevaux de puissance fiscale comme suit : Puissance fiscale de 11 14 C.V. : vhicules moteur essence : vhicules moteur gasoil :
NOTE DE PRESENTATION
de 2.000 3.000 DH ; de 5.000 6.000 DH ;
212
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Puissance fiscale gale ou suprieure 15 C.V. vhicules moteur essence : vhicules moteur gasoil :
de 4.000 8.000 DH ; de 10.000 20.000 DH.
Cette mesure sinscrit dans le cadre de lquit fiscale dans lapplication de la taxe, en rehaussant le tarif pour les vhicules forte puissance fiscale et dont la valeur est leve. Cette mesure entre en vigueur en 2013. 6 - Mesures communes 6-1- Octroi des avantages fiscaux aux oprations effectues entre les entreprises installes dans une mme zone franche dexportation ou dans diffrentes zones franches d'exportation Pour encourager les entreprises installes dans les zones franches dexportation raliser leurs oprations avec des entreprises installes dans une mme zone franche dexportation et avec des entreprises installes dans des zones franches diffrentes, il est propos dappliquer auxdites oprations le mme rgime fiscal prvu en matire dimpt sur les socits, dimpt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoute.
6-2- Instauration de lobligation de joindre un tat explicatif toute dclaration de rsultat nul ou dficitaire Actuellement, limpt sur les socits et limpt sur le revenu sont tablis, daprs les lments fournis par les contribuables dans leurs dclarations. Or, la majorit des dclarations dposes par les personnes morales et les personnes physiques disposant de revenus professionnels accusent un rsultat nul ou un dficit. A ce titre, il est propos d'instaurer lobligation de joindre toute dclaration de rsultat nul ou dficitaire un tat explicatif de lorigine dudit rsultat. 6-3- Encouragement du secteur sportif En vue dencourager les socits sportives, constitues conformment aux dispositions de la loi n 30-09 relative lducation physique et aux sports, adopter les rgles de transparence et de bonne gouvernance et afin daccompagner la rforme du secteur sportif et assurer la russite de passage de ce secteur au stade du professionnalisme, surtout pour le football, il est propos de : - appliquer aux socits sportives, le taux rduit de lImpt sur les socits de 17,5% durant les cinq premiers exercices ; - soumettre les revenus salariaux perus par les sportifs un taux libratoire de 30% aprs application dun abattement de 40%.
NOTE DE PRESENTATION 213
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
6-4- Encouragement des programmes de lhabitat social affect la location Il est propos dinstituer des mesures dincitations fiscales pour lhabitat social affect la location. Ce segment constitue un complment au dispositif actuel visant lencouragement laccs la proprit. Il tend rpondre aux attentes des citoyens pour bnficier dun logement dcent un prix raisonnable. Ces incitations fiscales profitent pendant une dure maximum de 20 ans, aux personnes morales ou physiques qui affectent dans le cadre dune convention conclue avec lEtat, au moins 25 logements sociaux la location pendant une dure de 8 ans au minimum. Ces incitations consistent en lexonration : - de limpt sur les socits ou de limpt sur le revenu affrent lactivit de location des logements sociaux ; - des plus-values rsultant de la cession desdits logements au-del dune priode de 8 ans. 6-5- Encouragement des promoteurs immobiliers la production des logements faible valeur immobilire Pour acclrer le rythme de production des logements faible valeur immobilire et augmenter leur nombre, il est propos des mesures en faveur des promoteurs immobiliers, qui consistent : affecter ces logements aux citoyens dont le revenu mensuel ne dpasse pas deux fois (2) le salaire minimum interprofessionnel garanti, au lieu dune fois et demi (1,5) ledit salaire pour permettre un grand nombre de citoyens dacqurir lesdits logements ; raliser lesdits logements conformment la lgislation et la rglementation en vigueur en matire durbanisme, au lieu de limiter les constructions au rezde-chausse et trois (3) niveaux ; fixer la valeur dudit logement uniquement dans le prix de vente qui ne doit pas dpasser 140 000 DH, hors taxe sur la valeur ajoute, au lieu de la fixer la fois dans ledit prix et la valeur immobilire totale qui ne doit pas dpasser galement 140 000 DH.
6-6- Exonration du transfert des proprits immobilires et ses actifs au profit dun parti politique Les dispositions de larticle 31 de la loi organique n29-11 relative aux partis politiques prvoient que les exonrations des impts, droits et taxes en cas de transfert des proprits immobilires ainsi que les actifs y affrents enregistrs au nom dune personne physique au profit dun parti politique seront prvues par une loi de finances. Ainsi et afin de mettre en uvre les dispositions prcites, il est propos de permettre le transfert susvis, titre gratuit, en exonration de tout impt, droits et
NOTE DE PRESENTATION 214
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
taxes condition que ce transfert soit ralis dans les deux annes conscutives suivant la date de publication de la loi de finances pour lanne 2012. 7- Mesures de procdures fiscales 7-1- Possibilit pour ladministration de contester par voie judiciaire, les dcisions dfinitives des commissions locales de taxation Actuellement, les dcisions des commissions locales de taxation (C.L.T.) devenues dfinitives, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont dclares incomptentes, peuvent tre contestes, par voie judiciaire, uniquement par le contribuable. Pour garantir un traitement harmonieux des parties, il est propos de permettre lAdministration galement, de contester lesdites dcisions devant le tribunal, linstar de ce qui est prvu pour le contribuable. 7-2- Notification de la dcision de la commission locale de taxation Actuellement le recours de ladministration devant la commission nationale du recours fiscal doit se faire dans un dlai maximum de soixante (60) jours suivant la date de la notification au contribuable de la dcision de la commission locale de taxation. Or, depuis le 1er janvier 2011, la dcision de la C.L.T. est notifie aussi bien l'administration qu'au contribuable. Aussi, est-il propos de permettre ladministration de prsenter son recours partir de la date o la dcision de la C.L.T. lui a t notifie, au mme titre que le contribuable.
II Dispositions diverses
A - REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION DES BONS DEQUIPEMENT SUR RESERVE DINVESTISSEMENT
La rserve dinvestissement institue par larticle 37 du dcret Royal du 31 dcembre 1965 portant loi de finances de lanne 1966 et supprime par larticle 58 de la loi n 24-86 portant institution de lImpt sur les socits, donne lieu, en cas de non affectation par les contribuables concerns de ladite rserve lacquisition de bons dquipement, lmission dtats de produits pris en charge pour recouvrement par les comptables du Trsor. Ce dispositif est non seulement coteux pour lEtat en raison de limportance du taux dintrt appliqu slevant 8% par rapport celui offert sur le march des adjudications pour la mme maturit qui est de 4,3%, mais gnre, de surcrot, une surcharge de travail et de suivi trs importante pouvant staler sur les 25 ans venir pour un encours insignifiant.
NOTE DE PRESENTATION
215
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Pour assainir la gestion desdits bons, il est propos de procder leur remboursement par anticipation en principal et intrt.
B CONTRIBUTION POUR LAPPUI A LA COHESION SOCIALE
En vue dassurer des ressources suffisantes au compte daffectation spciale intitul Fonds dappui la cohsion sociale cr par le projet de loi de finances pour lanne 2012, il est propos dinstituer, pour lanne 2012, une contribution pour lappui la cohsion sociale la charge des socits soumises limpt sur les socits au taux de 1,5 % du bnfice net de lexercice comptable gal ou suprieur 200 MDH dclar au titre de limpt sur les socits en 2012.
C TAXE SPECIALE SUR LE CIMENT 1- Augmentation du taux de la taxe :
Afin dacclrer le rythme de ralisation des programmes de rsorption de lhabitat insalubre, notamment le programme villes sans bidonvilles , il est propos, dans le cadre du projet de loi de finances 2012, daugmenter le taux de la taxe spciale sur le ciment de 0,05 DH/kg pour le porter 0,15 DH/kg. Il convient de souligner que ledit programme a atteint un taux de ralisation la fin du mois de septembre 2011 de 70 % et a profit 243.280 mnages compte tenu des units ralises ou celles en cours de ralisation.
2- Modification des exonrations en faveur du logement social :
Larticle 7 bis de la loi de finances pour lanne 2010 a accord aux promoteurs immobiliers plusieurs exonrations dont notamment lexonration de la taxe spciale sur le ciment durant la priode 2010-2020, pour ceux qui ralisent un programme de construction de 500 logements sociaux. En concertation avec les professionnels du secteur, il a t dcid de supprimer lexonration de la taxe spciale sur le ciment prcite. Cette mesure ne sapplique pas aux conventions conclues entre lEtat et les promoteurs immobiliers avant la date de publication de la prsente loi de finances.
D - SUPPRESSION DES POSTES VACANTS NON UTILISES
Ce projet de mesure stipule quau 30 juin de lanne qui suit celle de la loi de finances concerne, les emplois vacants non utiliss qui nont pas fait lobjet dactes viss par les services de la Trsorerie Gnrale du Royaume sont supprims. Le dlai de suppression des postes vacants a t tendu de six mois supplmentaires et gnralis lensemble des ministres et institutions. Cette suppression ne sapplique pas aux postes viss larticle 32 de la loi de finances 2011 ainsi quaux postes de chargs de mission auprs du Chef du gouvernement.
NOTE DE PRESENTATION 216
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
E - ANNULATION DES CREDITS DINVESTISSEMENT REPORTES QUI NONT PAS DONNE LIEU A ORDONNANCEMENT
Les crdits dinvestissement reports danne en anne et les reliquats dengagement correspondant englobent des montants relatifs des oprations anciennes qui ne peuvent tre apures comptablement pour des raisons administratives ou procdurales. Afin de permettre lapurement de cette situation, il est propos dinsrer dans le projet de loi de finances 2012, une mesure visant annuler de droit, les crdits dinvestissement reports des exercices 2008 et antrieurs sur les exercices 2009 et ultrieurs affrents des oprations de dpenses qui nont pas donn lieu des ordonnancements durant la priode allant du 1er janvier 2009 au 31 dcembre 2011. Ces annulations ne concernent que les oprations de dpenses au titre desquelles aucune procdure de litige judiciaire na t entame. Par ailleurs, lorsque les crdits dinvestissement reports correspondent des marchs achevs, lesdits crdits et les engagements y affrents sont annuls de droit. Cette mesure dannulation est tendue galement aux oprations et engagements relatifs aux comptes daffectation spciale.
F - HABILITATION ET RATIFICATION 1 Habilitation 1-1- En matire d'ouverture de crdits en cours d'anne budgtaire
En vertu de la loi organique des finances, les dpenses ne peuvent tre engages, ordonnances et payes que dans la limite des crdits ouverts par la loi de finances. Par drogation ce principe, l'article 43 de ladite loi organique dispose qu'en cas de ncessit imprieuse d'intrt national, des crdits supplmentaires peuvent tre ouverts par dcrets en cours d'anne, en application de l'article 70 de la Constitution. L'habilitation propose dans le cadre des dispositions du prsent projet de loi de finances vise autoriser le gouvernement ouvrir par dcrets, pendant l'anne budgtaire 2012, des crdits supplmentaires en vue d'assurer la couverture des besoins imprieux et non prvus lors de l'tablissement du budget. Ces dcrets, qui selon les dispositions de la Constitution doivent tre soumis la ratification du parlement, seront repris dans la plus prochaine loi de finances.
NOTE DE PRESENTATION
217
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
1-2- En matire de cration de comptes spciaux du Trsor en cours d'anne budgtaire
La loi organique relative la loi de finances prvoit la cration de comptes spciaux du Trsor par la loi de finances. Par drogation ce principe, l'article 18 de ladite loi organique dispose qu'en cas d'urgence et de ncessit imprieuse, de nouveaux comptes spciaux du Trsor peuvent tre crs en cours d'anne budgtaire. L'habilitation propose vise autoriser le gouvernement, en vertu de l'article 18 prcit crer, par dcrets, de nouveaux comptes spciaux du Trsor pendant l'anne budgtaire 2012. Ces dcrets, qui doivent tre soumis la ratification du parlement, conformment aux dispositions de la Constitution, seront repris dans la plus prochaine loi de finances.
1-3- En matire de cration de SEGMA en cours danne budgtaire
En vertu des dispositions de l'article 70 de la Constitution, le gouvernement est autoris crer, par dcrets, des services de l'Etat grs de manire autonome pendant lanne budgtaire 2012. Les dcrets viss ci-dessous doivent tre soumis la ratification du Parlement dans la plus prochaine loi de finances.
2 Ratification
Au cours de lanne budgtaire 2011, un seul dcret a t pris en vertu de lhabilitation lgislative prvue larticle 29 de la loi de finances de ladite anne. Il sagit du dcret portant ouverture dun crdit supplmentaire dun montant de 18 milliards de dirhams au profit du budget de fonctionnement, et ce pour faire face laugmentation des dpenses de la compensation. Les prvisions de la loi de finances pour lanne 2011 reposaient sur lhypothse du prix de baril de ptrole 75 $ et 600 $ pour la tonne du gaz butane, or au premier semestre 2011, la moyenne des prix a atteint pour ces deux produits respectivement 111 $ et 885 $. Par consquent, lallocation au cours de lanne budgtaire 2011, de ressources supplmentaires la caisse de compensation sest avre ncessaire.
G - SERVICES DE L'ETAT GERES DE MANIERE AUTONOME a- Cration
NOTE DE PRESENTATION
218
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Service de lEtat Gr de Manire Autonome intitul Centre mdico-chirurgical des Forces Armes Royales Es-Smara En application des Hautes Instructions Royales, le centre mdico-chirurgical de la ville de Es-Smara relevant de lAdministration de la Dfense Nationale est rig en service de lEtat gr de manire autonome. Service de lEtat Gr de Manire Autonome intitul Unit de fabrication de masques de la Gendarmerie Royale En vue dassurer lapprovisionnement des Forces Armes Royales, de la Gendarmerie Royale et des tablissements publics et privs en masques de protection respiratoire et chirurgicaux, il est propos driger cette unit en service de lEtat gr de manire autonome. Service de lEtat gr de manire autonome intitul Institut suprieur des mtiers de laudiovisuel et du Cinma En vue de combler le vide en matire de formation dans les mtiers de laudiovisuel et du cinma et daccompagner lvolution desdits mtiers ainsi que la demande de plus en plus grande de spcialistes dans ces domaines au moment o le Maroc est devenu un lieu privilgi de tournage de dimension internationale, un institut spcialis dans les mtiers de laudiovisuel et du cinma est cr. Il est propos driger en SEGMA, ledit institut en vue de lui permettre dassurer des prestations rmunres.
b- Modification
Modification de lintitul du SEGMA Centre de qualification professionnelle des arts traditionnels de Mekns en Institut des arts traditionnels de Mekns Cette modification devra permettre audit service dassurer les missions confres lancien SEGMA et de relever le niveau de formation assure par ledit SEGMA de certificat de qualification professionnelle au diplme de techniciens des mtiers dartisanat.
c- Suppression
Suppression de la Division des accidents du travail Dans le cadre de lamlioration de la gestion des prestations servies aux victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles, il est propos de proroger lchance de la suppression du service de lEtat gr de manire autonome intitul Division des accidents du travail au 1er juillet 2013 afin de permettre le transfert de la gestion du fonds de majoration des rentes daccidents de travail, du fonds de garantie et du fonds de solidarit des employeurs la Caisse Nationale de Retraites et dAssurances dans les meilleures conditions.
NOTE DE PRESENTATION
219
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Concernant le personnel exerant dans cette division, il sera, soit redploy dans ladministration publique soit admis bnficier du dpart volontaire la retraite. Il convient de rappeler cet effet que ledit SEGMA a t cr dans le cadre de la loi de finances pour lanne budgtaire 2006 en vue dassurer provisoirement la gestion administrative des fonds du travail prcits.
H - COMPTES SPECIAUX DU TRESOR a Cration
Fonds dappui la cohsion sociale Dans le cadre du renforcement des mcanismes de la cohsion sociale en faveur des populations vulnrables et dans lattente dune rforme globale du systme actuel de compensation, il est propos la cration dun compte daffectation spciale intitul Fonds dappui la cohsion sociale destin financer et renforcer les actions sociales ciblant les populations dmunies travers notamment : La contribution au financement des dpenses affrentes la mise en uvre du rgime dassistance mdicale (RAMED) et lextension de ce rgime lensemble du pays ; Lassistance aux personnes en situation de handicap par lacquisition dappareillages spcifiques, lamlioration des conditions de scolarisation des enfants en situation de handicap, lincitation linsertion professionnelle et la promotion des activits gnratrices de revenus et aussi par la contribution la mise en place et au fonctionnement des structures daccueil ; La lutte contre labandon scolaire par loctroi de manuels et de fournitures scolaires ainsi que loctroi daides financires directes au profit des lves scolariss issus de familles dmunies.
Les ressources de ce compte se composent essentiellement de : Une contribution pour lappui la cohsion sociale la charge des socits soumises limpt sur les socits propose dans le cadre de la prsente loi de finances ; Une contribution du Fonds de solidarit des assurances devant tre verse au budget gnral afin dtre reverse au compte bnficiaire; 1,6% du prix de vente public des cigarettes (hors TVA). Il convient de souligner que le montant prvisionnel des ressources du Fonds dappui la cohsion sociale, au titre de lanne budgtaire 2012, est estim 2.000 millions de dirhams.
NOTE DE PRESENTATION
220
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Compte de prts intitul "Prts la socit de financement JADA " Ce compte permettra de retracer les oprations relatives un prt dun montant global de 6 millions dEuros rtrocd par le Trsor la Socit JADA spcialise dans le financement des institutions de micro-crdit.
b Modification
Fonds pour le dveloppement rural Lobjectif principal de cette modification peut tre rsum comme suit : intgrer dans le dbit de ce compte daffectation spciale les dpenses affrentes la stratgie du dveloppement des zones de montagne ayant fait lobjet dun programme de dveloppement intgr agr par le gouvernement ; modifier lintitul du compte qui devient Fonds pour le dveloppement rural et des zones de montagne . Initiative nationale pour le dveloppement humain La modification propose consiste tendre le domaine dintervention dudit compte, au programme de mise niveau territoriale visant lamlioration des conditions de vie des populations de certaines zones montagneuses ou enclaves et la rduction des disparits en matire daccs aux infrastructures de base, dquipements et de services de proximit. Elle vise galement instituer les sous ordonnateurs actuels du compte et leurs supplants comme sous ordonnateurs des dpenses et des recettes. Fonds spcial pour le soutien des juridictions Le projet de modification propos consiste prvoir au niveau du dbit du compte, une ligne de dpenses relative la construction de btiments de formation. Il sagit en loccurrence de lInstitut Suprieur de la Magistrature dont la construction est finance par un don de lAgence Nationale de la Conservation Foncire du Cadastre et de la Cartographie. Fonds dentraide familiale La modification propose tend conformer le compte daffectation spciale intitul Fonds dentraide familiale aux mcanismes de mise en oeuvre du dispositif de lentraide familiale institu par la loi n 41-10 fixant les conditions et procdures pour bnficier des prestations du Fonds dentraide familiale.
NOTE DE PRESENTATION
221
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national La modification propose tend permettre ce fonds de prendre en charge les dpenses affrentes aux : Avances sur recettes octroyes aux socits de production duvres audiovisuelles et du cinma ; Aides relatives la numrisation, la modernisation et la construction de salles de cinma ; Aides aux festivals de cinma.
Cette modification tend renforcer la gouvernance de laide publique adresse au secteur de laudiovisuel et du cinma en nonant les dpenses affrentes aux avances sur recettes octroyes aux socits de production des uvres audiovisuelles et cinmatographiques, les aides la numrisation, la modernisation et la construction des salles de cinma, ainsi que les aides aux festivals de cinma, parmi les charges dudit compte. Ladite modification vise par ailleurs, conformer les modalits de gestion de ce compte aux objectifs de la gouvernance noncs dans le programme gouvernemental, et dans les cahiers de charges et les contrats programmes. Fonds de remploi domanial Ce compte est destin retracer les recettes et les dpenses lies aux oprations immobilires. Cependant, le crdit du compte fait apparatre des recettes provenant du produit de la vente de meubles, paves et matriels rforms, ce qui va lencontre de la vocation immobilire dudit compte. A cet effet, il est propos la suppression de cette ligne de recettes du compte et son intgration au budget gnral. Fonds spcial de surveillance et de contrle des assureurs et des socits dassurances Il est propos de modifier lintitul du compte daffectation spciale en Fonds de rmunration des services rendus par le ministre charg des finances au titre des frais de surveillance et de contrle des entreprises dassurances et de rassurance afin de lharmoniser avec les dispositions du dcret n 2-99-1082 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) instituant une rmunration des services rendus par le ministre charg des finances pour la surveillance et le contrle des entreprises dassurances et de rassurance. Fonds de solidarit des assurances Suite lengagement pris par le gouvernement lors de la deuxime dition des assises de lindustrie pour la promotion de la sant et la scurit au travail, il a t
NOTE DE PRESENTATION 222
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR LANNEE 2012
convenu de prendre en charge le financement des investissements et des actions du groupement dintrt public dnomm Institut national des conditions de vie au travail partiellement par le fonds de solidarit des assurances. Ledit compte est sollicit, par ailleurs, pour contribuer au financement du Fonds dappui la cohsion sociale. Afin de permettre la prise en charge des dpenses affrentes auxdites oprations il est propos de complter les emplois dudit compte. Fonds solidarit habitat En relation avec la proposition daugmenter le taux de la taxe spciale sur le ciment de 0,05 DH/Kg au titre du projet de loi de finances pour lanne 2012 et en vue daffecter le produit de ce surplus aux programmes de rsorption des bidonvilles, il est propos de rserver 65% du produit de cette taxe ces programmes, y compris le programme du Sud, au lieu de 45% environ actuellement. Par ailleurs, et suite la proposition dannulation de lexonration de la taxe spciale sur le ciment accorde aux promoteurs immobiliers en vertu de larticle 7 bis de la loi de finances pour lanne 2010, il est suggr de prvoir au dbit dudit compte la restitution des sommes perues au titre de la taxe prcite pour les promoteurs immobiliers ayant dj conclu des conventions avec lEtat avant lannulation de cette exonration. En outre, il est propos de conformer ce compte au programme gouvernemental relatif la politique de la ville, travers la modification de lintitul du compte en Fonds solidarit habitat et intgration urbaine et lintroduction de la possibilit, pour ledit compte, de prendre en charge galement quelques dpenses affrentes la politique de la ville. Fonds spcial pnitentiaires pour le soutien des tablissements
La modification propose vise permettre la Dlgation Gnrale lAdministration Pnitentiaire et la Rinsertion de pouvoir financer les dpenses relatives la rparation et lentretien des quipements des tablissements pnitentiaires partir de ce compte, vu que la dotation budgtaire annelle consacre cette opration savre insuffisante.
NOTE DE PRESENTATION
223
Vous aimerez peut-être aussi
- Rapport de Stage Sur Le Contrôle Fiscal Au MarocDocument48 pagesRapport de Stage Sur Le Contrôle Fiscal Au MarocFatimazahra Bouaouda100% (23)
- Laboratoire #21 - L'oscilloscope Numérique I-318409Document14 pagesLaboratoire #21 - L'oscilloscope Numérique I-318409Ibrahima MANGAPas encore d'évaluation
- Cash Management - Fondamentaux Et Offres Bancaires PDFDocument114 pagesCash Management - Fondamentaux Et Offres Bancaires PDFCarlos Mounda100% (2)
- Rapport de Diagnostic Économique Et FinancierDocument38 pagesRapport de Diagnostic Économique Et FinancierMohamed DIOPPas encore d'évaluation
- Pfe Audit FiscalDocument67 pagesPfe Audit Fiscalyoussef kharchachPas encore d'évaluation
- Les Différences Et Les Similitudes Entre Les Référentiels Comptables Normes Marocaines, IAS, UDocument86 pagesLes Différences Et Les Similitudes Entre Les Référentiels Comptables Normes Marocaines, IAS, USouhair Bouallala89% (9)
- Stage Eveil ConseilDocument55 pagesStage Eveil ConseilAbdo ZguitPas encore d'évaluation
- Evaluation Et Choix D'un Projet D'investissement CO.G.B PDFDocument101 pagesEvaluation Et Choix D'un Projet D'investissement CO.G.B PDFmanel lùnePas encore d'évaluation
- CEB Version Impression 13 - 01 - 2020Document144 pagesCEB Version Impression 13 - 01 - 2020Toni LiPas encore d'évaluation
- CM TQG TC Bacpro SceDocument82 pagesCM TQG TC Bacpro SceAymanePas encore d'évaluation
- L'Accompagnement Des Très Petite Entreprise WordDocument28 pagesL'Accompagnement Des Très Petite Entreprise WordAnas Pope100% (1)
- Star Rapport Annuel 2012 (FR)Document69 pagesStar Rapport Annuel 2012 (FR)Wael TrabelsiPas encore d'évaluation
- Circulaire 2015Document212 pagesCirculaire 2015Matio ZaraPas encore d'évaluation
- Rapport Dactivite 2020 BiatDocument117 pagesRapport Dactivite 2020 Biathakim ghannemPas encore d'évaluation
- CourseDocument266 pagesCoursemustapha_005100% (1)
- Rapport ComptaDocument27 pagesRapport ComptaXwalGamingPas encore d'évaluation
- Rapport de Gestion 2020 BIATDocument270 pagesRapport de Gestion 2020 BIATMaryem HosniPas encore d'évaluation
- M1038Document151 pagesM1038SoufianePas encore d'évaluation
- Rapport de Diagnostic Économique Et FinancierDocument36 pagesRapport de Diagnostic Économique Et FinancierMohamed DIOPPas encore d'évaluation
- Comptabilité CommercialeDocument47 pagesComptabilité CommercialeAbdoulaye BA100% (1)
- DédicaceDocument138 pagesDédicaceZaid SoufianePas encore d'évaluation
- Guide Delaboration de Projet de Transformation de Lait VF PDFDocument20 pagesGuide Delaboration de Projet de Transformation de Lait VF PDFOnguene Syntia100% (2)
- Al Maliya SLF2018Document90 pagesAl Maliya SLF2018hindPas encore d'évaluation
- Cours de Compabilite Generale COMPTABLE ASSOCIE ET CONSEIL SAR L Corrigé PDFDocument36 pagesCours de Compabilite Generale COMPTABLE ASSOCIE ET CONSEIL SAR L Corrigé PDFPepe Orcel lamahPas encore d'évaluation
- Sonelgaz AcgDocument38 pagesSonelgaz AcgAsma BenabdallahPas encore d'évaluation
- Guide D'elaboration de Projet Poulets de Chair VFDocument20 pagesGuide D'elaboration de Projet Poulets de Chair VFsakho360Pas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Khaoula LOUTFI VFDocument35 pagesRapport de Stage Khaoula LOUTFI VFlk.loutfi.encgPas encore d'évaluation
- Financement Des PME PDFDocument58 pagesFinancement Des PME PDFzouhair95% (21)
- Senelec - Rapport Annuel 2016Document84 pagesSenelec - Rapport Annuel 2016Taj NioukyPas encore d'évaluation
- Universite de LomeDocument89 pagesUniversite de Lomerouki SALAMIPas encore d'évaluation
- PMFP Document 12-2012Document135 pagesPMFP Document 12-2012rollinpeguyPas encore d'évaluation
- SRDEII - Auvergne-Rhone-Alpes 0Document62 pagesSRDEII - Auvergne-Rhone-Alpes 0fraPas encore d'évaluation
- FY22 DPEF Lacoste OperationsDocument46 pagesFY22 DPEF Lacoste Operationskhouloudmejri512Pas encore d'évaluation
- Rapport de Stage VsDocument67 pagesRapport de Stage VsHafsa AmarhlifPas encore d'évaluation
- I D H E C D C: Rapport de Gestion Et Diligences Du Commissaire Aux ComptesDocument195 pagesI D H E C D C: Rapport de Gestion Et Diligences Du Commissaire Aux ComptesAsma BouchekouaPas encore d'évaluation
- Audit Comptable Et Financier Des Projets de DéveloppementDocument84 pagesAudit Comptable Et Financier Des Projets de DéveloppementEssam SemmarPas encore d'évaluation
- Rapport Annuel Société Générale 2023Document109 pagesRapport Annuel Société Générale 2023leimiPas encore d'évaluation
- Le Financement Des PME Innovantes Marocaines PDFDocument86 pagesLe Financement Des PME Innovantes Marocaines PDFIssam MellaliPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage (1) RRDocument73 pagesRapport de Stage (1) RRabdelhakelkadi55Pas encore d'évaluation
- Marché Ivoirien Des Assurances - Rapport D'activité 2017Document62 pagesMarché Ivoirien Des Assurances - Rapport D'activité 2017Antoine AdjiriPas encore d'évaluation
- Rapport ZwinDocument28 pagesRapport ZwinGhizlan YassinPas encore d'évaluation
- Mauritania 2016 Formulation External BudgetFramework MinFin UMACEN-SAD FrenchDocument31 pagesMauritania 2016 Formulation External BudgetFramework MinFin UMACEN-SAD FrenchMyn SdhmdPas encore d'évaluation
- 3 Optimisation Fiscale ISDocument48 pages3 Optimisation Fiscale ISAmi HassanPas encore d'évaluation
- File 42629Document72 pagesFile 42629bencharkiPas encore d'évaluation
- Support Cours Compta 2021-2022Document63 pagesSupport Cours Compta 2021-202299bcw94gv6100% (1)
- PND 2012-2015Document120 pagesPND 2012-2015Bassan DjabouetPas encore d'évaluation
- BiPEN 2013 Définitif Bon PDFDocument134 pagesBiPEN 2013 Définitif Bon PDFAurèle ChabiPas encore d'évaluation
- Cours de Comptabilite Des Societes Desc3 Fico Annee 2022 - 2023Document45 pagesCours de Comptabilite Des Societes Desc3 Fico Annee 2022 - 2023famille ngoePas encore d'évaluation
- Glossaire Analyse FinanciereDocument24 pagesGlossaire Analyse FinanciereGhita IsmailiPas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument21 pagesRapport de StageImane ZaidiPas encore d'évaluation
- Memo FRDocument82 pagesMemo FRnohaylaPas encore d'évaluation
- LEROY Florent Rapport PDFDocument57 pagesLEROY Florent Rapport PDFRaouf ChPas encore d'évaluation
- Politique et gestion des finances publiques: Québec et CanadaD'EverandPolitique et gestion des finances publiques: Québec et CanadaPas encore d'évaluation
- Lean, kata et système de gestion: Réflexions, observations et récits d'organisationsD'EverandLean, kata et système de gestion: Réflexions, observations et récits d'organisationsPas encore d'évaluation
- Le crédit à la consommation: Un levier pour la reprise ?D'EverandLe crédit à la consommation: Un levier pour la reprise ?Pas encore d'évaluation
- 19 01 Tas 07Document2 pages19 01 Tas 07pgel2023Pas encore d'évaluation
- Ec2 Bac Sujetv PDFDocument4 pagesEc2 Bac Sujetv PDFsevda cvrPas encore d'évaluation
- Houl - Mourad CVDocument1 pageHoul - Mourad CVFouad LaamiriPas encore d'évaluation
- Correction LegoDocument2 pagesCorrection LegoZeynoxPas encore d'évaluation
- Brisures Mep PJDocument164 pagesBrisures Mep PJPretre Matrae CréationPas encore d'évaluation
- Compétences de Fallout 4 - L'Abri - FandomDocument23 pagesCompétences de Fallout 4 - L'Abri - FandomSygfried BibardPas encore d'évaluation
- Nettoyage Fusil ChasseDocument3 pagesNettoyage Fusil ChasseericPas encore d'évaluation
- VISION PLUS FICHE DOCUMENTAIRE ETUDES FRANCE 230519aaDocument8 pagesVISION PLUS FICHE DOCUMENTAIRE ETUDES FRANCE 230519aaMouhamed GUEYEPas encore d'évaluation
- Fiche Geographie Ce2Document30 pagesFiche Geographie Ce2Bi Jean Martial BahPas encore d'évaluation
- Communication Professionnelle 3Document2 pagesCommunication Professionnelle 3aicha zorqanePas encore d'évaluation
- Régler Les Organes de Régulation Cours-21-26Document6 pagesRégler Les Organes de Régulation Cours-21-26Khaled MimounPas encore d'évaluation
- Buanderie - Preparation Des Solutions Pour L Experimentation Durete de L EauDocument1 pageBuanderie - Preparation Des Solutions Pour L Experimentation Durete de L Eaumagloire amivaPas encore d'évaluation
- Spéctroscopie Démission AtomiqueDocument6 pagesSpéctroscopie Démission AtomiqueAbd El AdimPas encore d'évaluation
- Train CarlaDocument1 pageTrain CarlafjejbePas encore d'évaluation
- Guide PowerPoint 2013 (Version Débutante)Document22 pagesGuide PowerPoint 2013 (Version Débutante)coolsvp100% (1)
- Étude de CasDocument10 pagesÉtude de CasmlkPas encore d'évaluation
- 32 - Labo - SIC 32-23-9-1 - Generatrice Shunt Ou IndDocument23 pages32 - Labo - SIC 32-23-9-1 - Generatrice Shunt Ou Indمحمد الأمين سنوساويPas encore d'évaluation
- JBL Tuner2 Spec Sheet FrenchDocument2 pagesJBL Tuner2 Spec Sheet Frenchcondor25hPas encore d'évaluation
- L'entrepreneuriat en AlgérieDocument17 pagesL'entrepreneuriat en AlgériehindPas encore d'évaluation
- TP3 Mef V S PDFDocument6 pagesTP3 Mef V S PDFVatimetou EL BECHIRPas encore d'évaluation
- TP Ems PDFDocument12 pagesTP Ems PDFabigael ilungaPas encore d'évaluation
- Controle Numero2 Gravitation Sanscorr 3eDocument5 pagesControle Numero2 Gravitation Sanscorr 3ehelene.helene5656Pas encore d'évaluation
- TP ExtractionDocument13 pagesTP ExtractionKrim Issam Eddine100% (15)
- Soutenance de Stage-2Document12 pagesSoutenance de Stage-2asma BenghmidPas encore d'évaluation
- InventorR3 PDFDocument17 pagesInventorR3 PDFamrPas encore d'évaluation
- Neutralisation D'un Puits: Préparer L'opération de Neutralisation Du Puits Défini Ci-Après Dans Les Cas SuivantsDocument15 pagesNeutralisation D'un Puits: Préparer L'opération de Neutralisation Du Puits Défini Ci-Après Dans Les Cas Suivantssalah eddinePas encore d'évaluation
- TD 16 Corrigé - Liaisons - Schéma CinématiqueDocument5 pagesTD 16 Corrigé - Liaisons - Schéma Cinématiquelfadli67% (3)
- Odoo Business Game PR EtdDocument22 pagesOdoo Business Game PR Etdahmed aguezPas encore d'évaluation