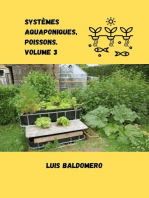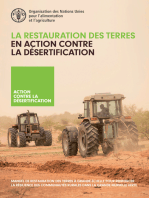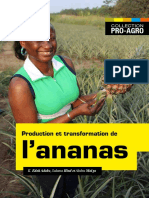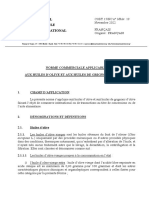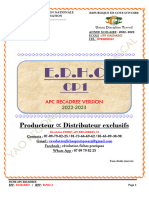Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Multiplication Végétative PDF
Transféré par
Mimoun KandoussiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Multiplication Végétative PDF
Transféré par
Mimoun KandoussiDroits d'auteur :
Formats disponibles
BOIS ET FORTS DES TROPIQUES, 2010, N 304 (2)
MULTIPLICATION DARGANIA SPINOSA / LE P OIN T SUR
Ronald Bellefontaine1
Abderrahim Ferradous2
Mohamed Alifriqui3
Olivier Monteuuis4
1
Cirad
Upr Gntique forestire
F-34398 Montpellier
France
Centre Rgional
de Recherche Forestire
4000 Marrakech
Maroc
Multiplication vgtative
de larganier, Argania spinosa,
au Maroc:le projet John Goelet
Universit Caddi Ayyad
Facult des Sciences Semlalia
Laboratoire dcologie
et denvironnement
4000 Marrakech
Maroc
Cirad
Umr Dap 1098
F-34398 Montpellier
France
Photo 1.
Arganeraie de montagne dgrade dans le secteur dArgana.
Photo O. Monteuuis.
47
48
BOIS ET FORTS DES TROPIQUES, 2010, N 304 (2)
R. Bellefontaine, A. Ferradous,
M. Alifriqui, O. Monteuuis
FOC US / PROPAGATION OF A R G A N I A S P I N O S A
RSUM
ABSTRACT
RESUMEN
MULTIPLICATION VGTATIVE
DE LARGANIER, ARGANIA SPINOSA,
AU MAROC :LE PROJET JOHN GOELET
VEGETATIVE PROPAGATION OF ARGAN
TREE, ARGANIA SPINOSA IN MOROCCO:
THE JOHN GOELET PROJECT
MULTIPLICACIN VEGETATIVA
DEL ARGN, ARGANIA SPINOSA,
EN MARRUECOS: EL PROYECTO
JOHN GOELET
Larganier est un arbre usages multiples
de grand intrt socio-conomique pour
le Sud-Ouest marocain. Il est utilis pour
lalimentation des hommes et du btail,
en mdecine, en cosmtique, tout en permettant de lutter contre la dsertification
et lrosion en produisant du bois diverses finalits. Les peuplements naturels,
en constante diminution depuis le XIXe
sicle, sont menacs par diverses pressions
anthropiques, de plus en plus fortes, rduisant les capacits de rgnration naturelle de lespce. Dans ce contexte, le
Cirad a t sollicit en 2006 afin duvrer
concrtement la rhabilitation de larganeraie, sous la forme dun projet financ
pour une dure de trois ans. Le but de ce
projet est damliorer, par la recherche
applique, la qualit de larganeraie travers la production darganiers de qualit
suprieure issus dindividus slectionns.
Ceux-ci seront multiplis en masse au
moyen des techniques de clonage les plus
adaptes, en tirant profit pour les slections
de la grande variabilit existant entre les
plants issus de graines, pour produire
des populations clonales plus homognes.
Aprs deux ans de collaboration avec le
Centre Rgional de Recherche Forestire
de Marrakech et lUniversit de Marrakech,
plus dun millier de boutures de jeunes
arganiers ont pu tre produites dans le
cadre dessais de mise au point de la
technique de bouturage de lespce. Ce
matriel sera utilis comme pieds-mres
exprimentaux et pour des tests de comportement au champ, en comparaison
des semis traditionnels. Par ailleurs, sur
les quatorze ttes de clones slectionnes
par les populations locales, huit ont pu
tre mobilises pour amorcer la propagation en masse par bouturage, avant les
tests au champ. Les techniques de multiplication vgtative dveloppes pourront
galement tre mises profit pour la production en quantit de plants partir des
semis issus des fruits rcolts sur les
ttes de clones prcites, prsumes de
qualit suprieure.
Argan tree is a multipurpose arborescent
species of great socio-economical interest
for south-west Morocco. It is utilized for nutrition of people and livestock, as well as
in medicine and in cosmetics. It protects
against desertification and erosion while
producing wood for various end-uses. The
natural stands, in constant reduction since
the 19th century, are more and more threatened by anthropomorphic pressures, hampering the natural regeneration of the
species. Given this situation, Cirad was
asked in 2006 to take part in a practical
project, that was to be financially supported
for 3 years, with a view to restoring argan
tree natural stands. The goal of this project
is to improve, through applied research approaches, the quality of the current argan
tree stands. Taking advantage of the variation within the species, superior mother
trees (plus trees) will be selected. These
latter will be mass propagated using the
most suitable cloning techniques to produce ultimately better adapted and more
homogeneous clonal populations. After 2
years of close collaboration with the Centre
Rgional de Recherches Forestires de Marrakech and the Universit de Marrakech,
on testing different rooting conditions, one
thousand rooted cuttings have been produced from juvenile argan tree seedlings.
This material will be used as experimental
stock plants and for field tests, in comparison with traditional seedlings. In addition,
out of the 14 plus trees selected by the local people to be mass clonally produced,
8 have already been successfully mobilized
in an ex situ clone bank for initiating their
mass clonal propagation by rooted cuttings, prior to field testing and identification
of superior clones for plantation establishment. The vegetative propagation techniques developed can also be used for
large scale production of rooted cuttings
from the seedlings derived from the fruits
collected from the plus-trees, presumably
of superior quality.
El argn es un rbol multipropsito de
gran inters socioeconmico para el sudoeste marroqu. Se utiliza para la alimentacin de los hombres y el ganado, en la
medicina y la cosmtica, al tiempo que
permite luchar contra la desertificacin y
la erosin produciendo madera para distintos usos. Las masas naturales, en constante disminucin desde el s. XIX, estn
amenazadas por diversas presiones antrpicas, cada vez ms fuertes, que reducen
la capacidad de regeneracin natural de
la especie. En este contexto, se solicit en
2006 la intervencin del CIRAD para trabajar
especficamente en la rehabilitacin del
arganal a travs de un proyecto financiado
por un perodo de tiempo de tres aos. El
objetivo de este proyecto es mejorar, mediante la investigacin aplicada, la calidad
del arganal a travs de la produccin de
arganes de calidad superior resultando
de individuos seleccionados. stos se multiplicarn masivamente mediante las tcnicas de clonacin ms adaptadas, sacando
provecho para las selecciones de la gran
variabilidad existente entre las plantas resultantes de semillas para lograr producir
poblaciones clonales ms homogneas.
Tras dos aos de colaboracin con el Centre
Rgional de Recherche Forestire de Marrakech y la Universidad de Marrakech, se
pudieron producir ms de mil estacas de
arganes jvenes en los ensayos de puesta
a punto de la tcnica de estaquillado de
la especie. Este material se utilizar como
plantas madre experimentales y para las
pruebas de comportamiento en campo,
comparndolo con los materiales tradicionales. Por otra parte, de las 14 cabezas
de clones seleccionadas por las poblaciones
locales, se pudieron movilizar 8 para empezar la propagacin en masa por estaquillado, antes de las pruebas en campo.
Las tcnicas de multiplicacin vegetativa
desarrolladas tambin podrn aprovecharse
para la produccin cuantitativa de plantas
a partir de semillas procedentes de frutos
cosechados en las cabezas de clones antes
mencionadas y que se supone que son de
calidad superior.
Mots-cls: Argania spinosa, arganeraie,
amlioration, clone, greffage, bouturage,
slection, agroforesterie.
Keywords: Argania spinosa, argan tree
stands, clone, improvement, grafting,
propagation by cuttings, selection, agroforestry.
Palabras clave: Argania spinosa, arganal,
mejora, clon, injerto, estaquillado, seleccin, agroforestera.
BOIS ET FORTS DES TROPIQUES, 2010, N 304 (2)
MULTIPLICATION DARGANIA SPINOSA / LE P OIN T SUR
Introduction
La gestion raisonne de leau devient une proccupation
majeure lchelle plantaire et les cultures conomes en eau
suscitent un intrt croissant. Les zones arides et semi-arides
sont plus particulirement concernes. Cette situation a incit
le Maroc instaurer un Plan Maroc Vert 2008 visant remplacer lagriculture extensive traditionnelle par des cultures
meilleur rendement et plus conomes en eau dans lesdites
zones (Ministre de lAgriculture et des Pches maritimes,
2008). Laccent est mis sur lagroforesterie en mlange avec
des espces arborescentes forte valeur ajoute telles que
lolivier (Olea europaea L.) et larganier (Argania spinosa
L. Skeels). Cette dernire connat un intrt croissant depuis
quelques annes en raison notamment dun engouement international pour lhuile dargan, au point dinitier un projet sur
sa multiplication vgtative, prsent dans cet article.
Larganier et la situation
de larganeraie au Maroc
Photo 2.
Vieil arganier illustrant la propension naturelle marcotter
partir de branches matresses basses.
Photo O. Monteuuis.
Larganier, seul reprsentant de la famille des Sapotaces en Afrique du Nord, est une espce arborescente endmique du Sud-Ouest marocain, du bord de mer 1 6001700 mtres daltitude sur les versants sud du Haut Atlas
occidental et sur lAnti-Atlas (Alifriqui, 2004). Des peuplements relictuels existent aussi dans le Rif (Boudy, 1950 ;
MHirit et al., 1998). Les arganiers sont des arbres pineux
pour leur grande majorit, troncs tortueux pouvant atteindre
8 10 m de haut, avec une longvit de 300 350 ans
(Boudy, 1950). Une propension naturelle rejeter de souche
et produire dans certaines situations des marcottes, voire
de rares drageons (photos 1, 2, 3 et 4), incitent penser que
certains gnotypes ont pu se perptuer depuis bien plus
longtemps. La cime plus ou moins grande et tale peut prsenter un port en parasol, plus rarement pleureur. Les feuilles
alternes, simples ou regroupes sous forme de rosettes, sont
persistantes et ne tombent quen cas de scheresse prononce. Les fruits (photos 5) ont un noyau trs dur qui contient
les amandes (encore appeles localement amandons )
do est extraite lhuile dargan.
La forte variabilit phnotypique observe reflte la
grande diversit gntique de lespce (Ferradous et al.,
1997) qui lui permet de rsister des conditions cologiques
trs contraignantes, notamment du point de vue de la scheresse du sol. Cette essence thermophile et xrophile exige un
climat doux, sans grande amplitude thermique, mais avec un
degr hygromtrique relativement lev qui caractrise la faade atlantique du Sud-Ouest marocain (Alifriqui, 2004).
Larganier est un arbre usages multiples, et par l
mme de grand intrt socio-conomique pour le Sud-Ouest
marocain. Il est utilis pour lalimentation des hommes (huile)
et du btail (feuilles, fleurs, pulpe du fruit, tourteau), en cosmtique (fruits, huile, feuilles vertes), et il permet de lutter
contre la dsertification et lrosion tout en produisant du
bois diverses fins.
Photos 3.
Dtails de marcottes naturelles plus jeunes montrant les
racines adventives dveloppes au contact du sol (flches).
Photo O. Monteuuis.
49
50
BOIS ET FORTS DES TROPIQUES, 2010, N 304 (2)
FOC US / PROPAGATION OF A R G A N I A S P I N O S A
Photos 4
Certains individus peuvent mettre des drageons (flches) partir de racines mises nu notamment.
Photo O. Monteuuis.
Larganeraie est un cosystme dans lequel larganier
occupe une place prpondrante. Elle constitue en superficie
lune des principales formations forestires du Maroc, couvrant, selon les sources, de 700 000 (Boudy, 1950)
828000 hectares (MHirit et al., 1998), voire 870000 ha
(Kenny, 2007), principalement localiss dans un triangle gographique limit sommairement au nord par Safi, louest
par les massifs du Haut Atlas et le Djebel Sirroua et au sud par
une ligne longeant lOued Noua au sud de Guelmim (figure 1).
Larganeraie de plaine, avec une densit moyenne de 100
souches lhectare, reprsente environ 10 15 % de la
superficie totale couverte par larganier, le reste correspondant larganeraie de montagne dont la densit peut
atteindre 700 800 souches par hectare et qui monte jusqu
une altitude de 1400 m (MHirit et al., 1998). Larganeraie
de plaine, surtout, est de plus en plus altre par les pressions anthropiques lies lessor dmographique, ce qui
incite certains spcialistes prfrer la distinction entre larganeraie-verger et larganeraie-fort (Alifriqui, 2004).
Larganeraie-verger, avec une densit moyenne de 100
souches par hectare, se rencontre gnralement dans les
zones de plaine, peu accidentes, fortement mises profit
pour lagriculture, la craliculture plus spcialement (photo
6), et llevage responsable de surpturage par le cheptel
local, majoritairement reprsent par les chvres.
Larganeraie-fort subsiste dans les parties non cultivables du littoral atlantique (Essaouira, Agadir, Guelmim) et
sur les contreforts montagneux au relief plus accident. Ces
peuplements, dont la densit peut atteindre 500 souches
par hectare, conservent une diversit infraspcifique plus
leve que larganeraie-verger.
Depuis le XIXe sicle, larganeraie subit une rgression
de plus en plus proccupante sous les effets conjugus de
plusieurs facteurs.
Ainsi, lintensification de la production de charbon durant les annes 1917-1924 pour lapprovisionnement des
grands centres urbains de Marrakech, Safi et Casablanca a
conduit la destruction de 200 000 ha. Quelques annes
plus tard, pour les besoins de la Seconde Guerre Mondiale,
40 000 ha supplmentaires ont t exploits (Alifriqui,
2004). Depuis lors, lexploitation des arganiers comme source
de bois de feu ou de service perdure, mme parfois partir
de sujets vivants, en toute illgalit.
Lintensification de la craliculture, la mise en eau
des primtres irrigus du Souss et du Massa notamment,
ainsi que lintroduction du marachage ont trs fortement
accentu les dfriches, surtout en zones de plaine, plus accessibles et exploitables.
La surexploitation rgulire du sous-bois des arganeraies, notamment des plantes accompagnatrices fixatrices
dazote, dont des Papillionaces, a entran une perte de
fertilit des sols. Les pratiques aratoires en plein dune
agriculture en pleine expansion et les chvres dtruisent les
rares germinations spontanes.
Llevage caprin prdomine dans la rgion de larganeraie et les chvres, de plus en plus nombreuses, ont la facult
de grimper dans les houppiers des arganiers pour brouter
entre autres les jeunes pousses tendres et les fleurs (photo
7), le cas chant aides par les bergers (El Aich et al., 2005).
Elles peuvent tre relayes par les troupeaux de dromadaires
en provenance du Sud.
La diminution de larganeraie sest acclre avec la
croissance dmographique, lexpansion des villes et des terrains constructibles. Lexploitation des ressources halieutiques et le dveloppement des sites touristiques de la zone
littorale, surtout dans la priphrie dAgadir, ont galement
contribu la disparition de nombreux espaces arganiers.
Depuis plusieurs annes, lengouement croissant
lchelle internationale pour lhuile dargan des fins alimentaires, cosmtiques ou mdicinales a entran, sous lemprise
de mouvements coopratifs et associatifs locaux, une trs forte
augmentation des rcoltes de fruits. Ceux-ci sont pratiquement
tous ramasss et il nen subsiste donc au bout du compte que
trs peu susceptibles dassurer la rgnration naturelle des
arganiers, phnomne rare au demeurant (MHirit et al., 1998).
Enfin, la diminution constante des pluies depuis plusieurs annes dans la zone de larganeraie, comme dans bon
nombre dautres rgions du globe, contribue au dprissement des arganiers en rduisant leur capacit se rgnrer
naturellement par graines (photo 8).
BOIS ET FORTS DES TROPIQUES, 2010, N 304 (2)
MULTIPLICATION DARGANIA SPINOSA / LE P OIN T SUR
b
Photos 5.
Rameaux darganier portant des fruits do sont extraits les amandons (a) et fruits darganier de la varit Tablouht (b).
Photos O. Monteuuis (a), R. Bellefontaine (b).
Photo 6.
Exemple darganeraie-verger avec culture de crale (bl
dans le cas prsent) entre les rares arganiers subsistant.
Photo R. Bellefontaine.
Photo 7.
Broutage des arganiers par les chvres.
Photo A. Galiana.
Figure 1.
Carte de laire de rpartition de larganier dans le Sud-Ouest
marocain (MHirit et al., 1998).
51
52
BOIS ET FORTS DES TROPIQUES, 2010, N 304 (2)
FOC US / PROPAGATION OF A R G A N I A S P I N O S A
Rhabilitation de larganeraie
La rhabilitation de larganeraie se justifie donc par rapport des fins cologiques, notamment pour contrer la dsertification, conomiques et socioculturelles videntes. Actuellement, les oprations de reboisement et de protection
de larganier se heurtent une opposition quasi systmatique
de la part des populations qui nacceptent pas facilement la
ncessit des mises en dfens dune dizaine dannes, voire
plus, qui accompagnent ces oprations. Les essais de plantations dbuts il y a une trentaine dannes sous lgide de
la recherche forestire et des services forestiers (Platteborze,
1977) se sont solds pour la plupart par des checs (MHirit
et al., 1998; Ferradous, 2008). Jusquen 2002-2003, la rgnration de larganeraie de plaine sest faite une cadence
trop lente pour compenser les pertes annuelles estimes en
moyenne 600 ha (El Yousfi, 1988). Le bilan reste donc
trs largement dficitaire. Plus rcemment, les techniques
de semis en ppinire et de plantation ont t quelque peu
amliores (Alouani, 2003; Alouani, Bani-Aameur, 2004;
Nouaim, 2005 ; Ferradous, 2010), mais de srieuses lacunes persistent.
Entre Tiznit et Tafraoute, dans le secteur de Tifadine, caractris par une pluviomtrie infrieure 200 millimtres
par an, des semis issus de graines non slectionnes (tout
venant) sont produits dans des ppinires administratives
locales en repiquant les jeunes germinations ralises en
planches dans des sacs de polythylne de 25 centimtres
de haut, remplis de terre superficielle, technique quelque peu
obsolte. Aprs 5 6 mois dducation-levage au minimum,
ces plants de 15 20 cm de haut sont plants au champ en
novembre-dcembre, parfois en fvrier-mars pour les annes
plus sches. Mais trop souvent un chignon racinaire induit
par les conteneurs en polythylne condamne leur avenir
plus ou moins longue chance (Falconnet et al., 2007). La
densit est gnralement de 200 individus par hectare (7 m
par 7 m). Les trous de plantation, de 60 70 cm de profondeur
en moyenne, sont raliss mcaniquement, laide dun trac-
Photo 8.
Rare cas de rgnration naturelle Tifadine, dans la rgion
de Tiznit, sous environ 175 mm de pluies par an.
Photo R. Bellefontaine.
teur quip dun godet, ou manuellement le plus souvent. Le
plant dbarrass de son sachet est plac au sein dune cuvette
destine rcolter le maximum deau de pluie, et dont le
bord sud est plus haut de faon protger partiellement le
jeune arganier du vent. Les plants sont arross deux trois
fois entre fvrier et juin lors de la premire anne suivant la
plantation, raison de 10 litres par plant et par arrosage.
Dans ce secteur de Tifadine, plus de 300 ha ont t ainsi reboiss depuis 2002. Le taux de reprise un an est de 98 %
(photos 9). Il chute lgrement aprs la premire anne, mais
en mai 2008 il tait encore de lordre de 70 80 % pour la
plupart des parcelles. Les arganiers gs de 4 5 ans atteignaient alors en moyenne 0,8 1,2 m de haut et le plus grand
dpassait 2 m (Bouiche, 2008).
Dautres primtres de replantation darganiers tout
venant ont t raliss sur plusieurs centaines dhectares
entre 2002 et 2008 (tableau I) dans les provinces dpendant
b
Photos 9.
Rhabilitation de larganeraie de plaine par plantation de semis en cuvette dans le secteur de Tifadine.
Photos O. Monteuuis (a), R. Bellefontaine (b).
BOIS ET FORTS DES TROPIQUES, 2010, N 304 (2)
MULTIPLICATION DARGANIA SPINOSA / LE P OIN T SUR
des Directions rgionales des
Eaux et Forts du Sud-Ouest et
du Haut Atlas, avec des rsultats
variables et globalement infrieurs ceux obtenus pour le
secteur prcit de Tifadine (selon un certain nombre dobservations des auteurs et de techniciens des Eaux et Forts). Les
techniques de ppinire, notamment du point de vue des conteneurs et substrats utiliss, ainsi
que les phases dducation-levage destines bien prparer
les plants au transfert au champ
dans des conditions bien plus
prouvantes quen ppinire,
devraient tre amliores. De
mme, les arrosages effectus
individuellement et de faon rpte pour chaque arganier nouvellement plant favorisent nettement la reprise.
Photo 10.
Le Plan daction du
Les installations de bouturage du Centre rgional
HCEFLCD1 de dcembre 2007
de recherches forestires de Marrakech.
Photo O. Monteuuis.
mais surtout le tout rcent Plan
Maroc Vert prsent le 23 avril
2008 insistent sur la stratgie
Objectifs et mise en place du projet
agricole et les nouvelles directives adopter pour lutter contre
la dsertification (Ministre de lAgriculture et des Pches
Maritimes, 2008). Une restructuration profonde de lconoLe but du projet financ par Monsieur John Goelet est
mie agricole a t lance dbut 2008. Ainsi, les cultures qui
damliorer, par la recherche applique, la qualit de largarapportent peu, au premier rang desquelles figurent notamneraie travers la production darganiers de qualit suprieure
ment les crales avec 2 000 dirhams, soit environ 180 euros
issus de ttes de clone (arbres plus), slectionnes, ges
par hectare et par an, encore prpondrantes bien que trs
et multiplies en masse au moyen des techniques de clonage
sensibles aux alas de la scheresse, doivent tre remplaces
les plus adaptes. linstar de nombreuses espces et varits
par des cultures revenu moins alatoire. Les espces
fruitires, plus spcifiquement lolivier dans le contexte local,
grande valeur ajoute comme larganier sont judicieusement
le clonage de larganier peut se concevoir pour tirer profit de
prconises pour les rgions arides.
la grande variabilit existant entre les plants issus de graines,
tout en produisant des populations clonales plus homognes.
Les principaux bnficiaires doivent tre les populations
Prsentation du projet
locales vivant de larganeraie sous ses diverses formes, mais
surtout de la production dhuile dargan forte valeur ajoute.
Les plantations rsultantes contribueront rajeunir et rDans ce contexte, le Cirad2 a t sollicit en 2006 par
habiliter larganeraie, tout en luttant contre la dsertification,
Monsieur John Goelet afin duvrer concrtement, sous la
au profit de lensemble des habitants.
forme dun projet financ pour une dure de trois ans, la
rhabilitation de larganeraie, avec ses effets bnfiques tant
1
Haut Commissariat aux Eaux et Forts et la Lutte Contre la Dsertification.
au plan cologique, quconomique et socioculturel.
2
Centre de coopration internationale en recherche agronomique
pour le dveloppement.
Tableau I.
Superficies reboises en arganier dans la zone de la DREF-SO*.
Annes
Superficies (ha)
Campagnes
antrieures
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
Total
233
150
230
500
984
378
2505
4980
* Donnes de la Direction rgionale des eaux et forts du Sud-Ouest (Dref-SO).
53
54
BOIS ET FORTS DES TROPIQUES, 2010, N 304 (2)
FOC US / PROPAGATION OF A R G A N I A S P I N O S A
Concrtement, la ralisation de ce projet repose sur le
choix des partenaires et acteurs marocains, principaux concerns, sur la slection des ttes de clone et la mise au point
des itinraires techniques les plus adapts aux objectifs.
LUniversit de Marrakech et lAAMHNM3 sont charges
du choix des terrains et des terroirs o sont slectionnes
les ttes de clone par les populations locales.
Le CRRFM4 a sign une convention avec lUniversit afin
de bnficier des comptences disponibles dans le cadre de
la mise en uvre de projets communs. Par ailleurs, le CRRFM
prsente un certain nombre datouts justifiant son choix
comme partenaire privilgi pour mettre en uvre ce projet:
spcificit, culture et comptences forestires, localisation
pas trop loigne des arganeraies naturelles en dpit de
conditions climatiques bien diffrentes, motivation des responsables bien introduits au sein des communauts vivant
de larganier et de ses produits drivs. Le CRRFM dispose
en outre de terrains, locaux, main-duvre, moyens de communication ainsi que de lapprovisionnement permanent en
eau et lectricit avec des dbits suffisants pouvant tre mis
profit pour le projet.
La premire tche a t de conseiller et doter ce centre
des quipements ncessaires au bouturage de larganier,
pouvant aussi tre utiliss pour dautres espces. Il sagit en
tout premier lieu dinstallations de brumisation ou mist
system de qualit. Le CRRFM a pu bnficier rapidement
dinstallations de bouturage trs satisfaisantes, avec un mist
system diffusant, grce des automatismes programmables,
de trs fines gouttelettes deau qui restent quelque temps
en suspension dans lair. Cette qualit de laspersion permet
daugmenter les pulvrisations tant en dure quen frquence, sans risquer des excs deau prjudiciables au
substrat de bouturage. Ce systme a t install sous une
ombrire 60 % dombrage. Les boutures sont places en
barquettes garnies de substrat de bouturage directement
sous cemist, ou protges par un tunnel plastique refroidi
par le mme mist (photo 10). Les programmateurs permettent
de maintenir lhumidit relative requise en fonction des
phases denracinement et de sevrage des boutures.
Le bouturage semble tre en effet la technique la plus
adapte pour produire en quantit et moindre cot des
plants clons grande chelle, mme sil peut tre ncessaire
davoir recours des techniques alternatives telles que le
greffage et le marcottage arien en aval pour mobiliser et rajeunir les ttes de clone slectionnes ges (Monteuuis,
1985, 1993; Bellefontaine, 2005; Saya et al., 2008). Il importe malgr tout de tester ds que possible le comportement
au champ de plants produits par bouturage par comparaison des semis, en tenant compte des diffrences fondamentales dappareil racinaire entre les deux origines, de type
adventif pour les boutures contrairement aux semis.
La slection des ttes de clone pour la production industrielle de plants darganiers clons de qualit suprieure requiert un certain nombre de pralables. Il convient notamment
de dterminer quels critres de slection doivent tre privilgis, parmi plusieurs qui viennent tout naturellement lesprit:
rusticit et adaptabilit suffisantes des gnotypes slectionns
comme ttes de clone, donc terme des clones produits;
vigueur vgtative assurant une croissance rapide durant
les premires annes du plant de faon rduire la dure de
mise en dfens;
prcocit dentre en fructification;
haute productivit annuelle en fruits, en tenant compte des variations possibles en fonction des annes pour un mme pied;
caractristiques des fruits, noix, amandes et feuilles susceptibles doptimiser leur utilisation pour lhomme et ventuellement le btail, certains arganiers produisant des noix
avec une coque qui se casse plus facilement, ce qui facilite
le concassage (Kaaya, 1998);
bons rendements en huile produite, en labsence dinformations
ce jour quant linfluence du gnotype sur sa qualit.
Lidal serait bien entendu de slectionner comme ttes
de clone les individus satisfaisant au mieux lensemble de
ces critres. Depuis quelques annes, le principal attrait financier
pour les populations locales reste la production dhuile dargan,
de grande valeur alimentaire et prise galement en cosmtique.
En cohrence avec lesprit et la finalit du projet, lavis des exploitants a t privilgi quant au choix des meilleurs arganiers
cloner au sein de deux terroirs assez distants. Cette slection
sest faite dabord sur treize ttes de clone dans les rgions
dArgana et de Smimou, en concertation avec les populations
locales, sur la base initiale de la facilit de concassage manuel,
des rendements en amandes et de la qualit de lhuile.
La rgion dArgana est situe moins de 100 kilomtres
(km) au nord dAgadir (figure 1). Du point de vue forestier, elle
est gre par le SPEF5 de Taroudant, qui dpend de la DREF6
du Sud-Ouest, dont le sige est situ Agadir. Dans ce secteur,
huit ttes de clone ont t slectionnes dans des terrains
privs sur la base de critres tels que la facilit de concassage
des noix, le nombre damandes par fruit ou encore la qualit
3
Association des Amis du Musum dHistoire Naturelle de Marrakech.
Centre Rgional de Recherche Forestire de Marrakech.
5
Service provincial des eaux et forts de Taroudant.
6
Direction Rgionale des Raux et Forts.
4
Photo11.
Les rejets de base constituent un matriel prdestin
pour le bouturage.
Photo R. Bellefontaine.
BOIS ET FORTS DES TROPIQUES, 2010, N 304 (2)
MULTIPLICATION DARGANIA SPINOSA / LE P OIN T SUR
fourragre des fruits. Ces arbresplus ont la particularit de
prsenter de gros fruits les annes suffisamment pluvieuses,
avec une coque qui se casse aisment. Cette varit darganier,
localement appele amrag en berbre, est beaucoup plus
prise que la varit adrdour qui produit des noix coque
beaucoup plus difficile casser et qui est dlaisse lors des
annes trs productives. Faute damrag, les rcoltants les
plus dmunis se rabattent sur les adrdour. Chacune des
huit ttes de clone slectionnes a t identifie par un numro
de 1 8 peint en rouge sur deux faces du tronc, photographi
et scrupuleusement localis sur une carte avec les relevs de
la position gographique laide dun appareil Gps (Global
Positioning System). Des rcoltes de pousses destines la
multiplication vgtative ont t effectues plusieurs reprises
et priodes de lanne sur chacun de ces arganiers slectionns, prfrentiellement dans la partie basale (photo 11), la
plus accessible et prsume la plus apte au bouturage (Monteuuis, 1985, 1998). Les fruits encore prsents sur certaines
de ces ttes de clone ont galement t rcolts. Lidentit et
lorigine de ces matriels ont t scrupuleusement notes lors
des rcoltes, avant acheminement dans les plus brefs dlais
au CRRFM des fins de multiplication.
Le second peuplement naturel darganiers retenu est situ
45 km au sud dEssaouira, dans la rgion de Smimou (SPEF
dEssaouira, voir figure 1). La prsence de plusieurs varits
qui intressent trs directement les femmes charges du concassage des noix, mais aussi les populations propritaires de caprins, a t repre. En plus des varits qui se cassent facilement, appeles ici tamrkhout , il existe des varits prcoces,
tamnzout , qui produisent des fruits bien avant les autres,
au moment o loffre est faible, pour un meilleur prix de vente
de lhuile. La varit coque trs dure ou tamaghlout est ici
aussi la moins prise. Un arganier tamrkhout porte un second
nom, tablouht, quand il prsente la particularit de fournir
des fruits dont la chair (lpicarpe et le msocarpe) peut se dtacher aisment, une fois sche, en un ou deux morceaux et
tre conserve plus dun an (photos 5). Contrairement la plupart des fruits dont la chair sche se fissure, puis se dsagrge
rapidement en petits morceaux et qui ne peut donc tre rcolte,
ces tablouht peuvent gnrer des rserves alimentaires pour
le btail en cas de disette.
Des rameaux et des fruits ont t rcolts selon la mme
procdure sur cinq nouvelles ttes de clone de ce second
site, identifies et numrotes de 9 13, toutes de la varit
tamrkhout et de type prcoce tamnzout pour les numros 10 et 11, et tablouht pour la tte de clone n13.
Une dernire tte de clone, n 14, a t slectionne
beaucoup plus rcemment (dbut 2009) au sud dAgadir, car
prsentant une vigueur et une productivit en noix remarquables
avec deux fructifications par an. En sus dtre remontant,
cet arganier est inerme et produit des noix coque fine, qui
se cassent aisment pour extraire de grosses amandes.
Il nous a paru judicieux de limiter notre projet ces 14
ttes de clone, effectif largement suffisant pour tudier srieusement les capacits au clonage de larganier dans le
cadre exprimental fix.
tat davancement
aprs deux annes
et perspectives
Ds que les installations de ppinire et plus particulirement le mist system ont t oprationnels, des jeunes
semis non slectionns darganier ont t utiliss pour dfinir les meilleures conditions de bouturage, encore
mconnues pour cette espce. Les paramtres tudis ont
t classiquement : les substrats de bouturage, les traitements auxiniques exognes (hormones) de la base des
boutures, les ambiances de bouturage, savoir sous confinement ou en plein air sous ombrire, et les effets
saisonniers. Ces derniers, trop souvent sous-estims (Monteuuis, 1985 ; Teklehaimanot et al., 2004), sont
susceptibles dinfluencer trs fortement laptitude au bouturage du matriel vgtal au moment de la rcolte partir de
la tte de clone ou du pied-mre, puis tout au long de la
phase denracinement dans les conditions du CRRFM.
De nombreux essais ont t rpts depuis dcembre
2007 de faon optimiser les conditions de bouturage, du
moins en ce qui concerne les facteurs exognes prcits,
sans sous-estimer leurs interactions. Ces essais ont port
sur les semis tout venant voqus prcdemment, disponibles au sein du CRRFM, mais aussi sur lensemble des
14 ttes de clone slectionnes in situ. Ils ont permis, lissue des deux premires annes, de dresser le bilan suivant :
sur un total de 2 490 boutures de semis tout venant
mises en place pour tester les diffrentes modalits de bouturage, 1467 ont pu tre enracines et 1020 sevres, ce qui
correspond des taux moyens denracinement et de sevrage
de 58,9 % et de 69,5 % respectivement, et un taux de
russite global de 41 % (photo 12); cest la premire fois
que des boutures darganier, actuellement en phase dlevage-ducation au CRRFM, sont produites en si grand nombre;
Photo 12.
Boutures enracines de jeunes plants darganier.
Photo A. Ferradous.
55
56
BOIS ET FORTS DES TROPIQUES, 2010, N 304 (2)
FOC US / PROPAGATION OF A R G A N I A S P I N O S A
Tableau II.
Inventaire en septembre 2009 des clones darganier slectionns gs.
Clones
Nombre de
boutures effectues
Nombre de
boutures russies
Nombre de
greffes effectues
Nombre de
greffes russies
Effectif encore en vie
en septembre 2009
10
11
12
13
14
183
186
234
120
217
41
119
246
377
306
342
307
317
69
29
77
72
72
72
72
77
77
72
92
97
97
92
97
25
19
le matriel plus g prlev sur les individus plusieurs fois
centenaires slectionns sest montr, sans surprise (Monteuuis, 1985, 1993), beaucoup moins ractif (tableau II), et
le greffage a t pratiqu conjointement au bouturage pour
chacune des 12 rcoltes effectues jusqualors. La technique
en tte a t prfre (photos 13), parfois couple la
technique en lanire, encore appele en placage, de
faon conomiser les porte-greffes de semis (Champagnat,
1980; Monteuuis, 1985; Hartmann et al., 1997).
Linventaire ralis en septembre 2009 dnombrait,
tous prlvements et clones confondus, 3 064 boutures
mises enraciner et 1 091 greffes effectues depuis le dbut
du projet. La faible ractivit au bouturage constate
confirme pour larganier, comme pour la plupart des espces
arborescentes, que laptitude noformer des racines
adventives dcrot considrablement avec lge des sujets
(Monteuuis, 1985, 1993 ; Saya et al., 2008). En ce qui
concerne le greffage, linstar dautres espces, une faible
aptitude spcifique au type de greffe pratiqu, voire au greffage plus gnralement, peut tre la cause de ces rsultats
jusqu prsent dcevants (Monteuuis, 1995). Les carts climatiques trs contrasts (spcialement en hiver) entre
Marrakech et les sites dorigine peuvent entraner des incompatibilits physiologiques entre lactivit des porte-greffes et
celle des greffons (Champagnat, 1980; Hartmann et al.,
1997), difficiles dterminer de visu. Par ailleurs, les types
de pousses utilisables comme greffons varient considrablement dune tte de clone une autre, de mme que lactivit
physiologique de ces pousses au sein dun mme arbre.
Ainsi, lcussonnage, dj tent avec succs mais sur un
chantillon trop restreint ce jour pour tre significatif, a pu
tre pratiqu plus grande chelle seulement lors de la dernire rcolte, partir du seul individu prsentant les
prdispositions requises pour ce type particulier de greffe
(photos 13).
Photos 13.
Mobilisation de gnotypes slectionns gs par greffage en cusson avant et aprs ligature (a et b), et en fente terminale (c).
Photo O. Monteuuis.
BOIS ET FORTS DES TROPIQUES, 2010, N 304 (2)
MULTIPLICATION DARGANIA SPINOSA / LE P OIN T SUR
Par ailleurs, des pertes parfois srieuses, notamment durant la saison chaude, sont dplorer lissue du rempotage,
aprs un sevrage russi, donnant lieu linventaire dtaill
dans le tableau II, toutes saisons
confondues.
Des effets clonaux semblent
se dgager, au profit notamment
du dernier clone slectionn
sous le numro 14. Dores et
dj, nous disposons en ppinire de huit gnotypes issus des
trois zones de slection in situ.
Les efforts pour mobiliser les
ttes de clone rcalcitrantes se
poursuivent, en envisageant le
recours dautres techniques de
mobilisation telles que le marcottage arien (Monteuuis, 1985;
Hartmann et al., 1997; Meunier
et al., 2008 ; photos 14), alors
que des premires boutures plus
ractives sont rcoltes partir
des pieds-mres des clones 4, 5,
10 et 14, dj mobiliss.
Les boutures de semis
tout venant russies seront
utilises deux fins (figure 2) :
pieds-mres grs de faon intensive en conteneurs hors-sol
afin dacqurir le savoir- faire
ncessaire pour bouturer avec
la meilleure efficience possible
les premires boutures ou greffes
russies partir des clones slectionns, conformment aux
pratiques ayant fait leurs preuves
sur de nombreuses autres espces arborescentes (Monteuuis,
1985, 1993 ; SAYA et al., 2008);
plantations en tests comparatifs
avec des semis tout venant,
de mme dveloppement ou ge,
de faon observer le comportement au champ de ces premires boutures darganier, en
ce qui concerne la stabilit, la
conformit de croissance tant racinaire quarienne, la productivit en fruits, etc. Autant dinformations inconnues jusqu prsent et pourtant dterminantes
pour lavenir commercial des boutures clones darganier.
b
Photos 14.
Marcotte arienne juste aprs la mise en place afin de mobiliser un sujet Plus g (a)
et quelques mois plus tard avec lapparition des premires racines (b, flche).
Photos O. Monteuuis (a) et A. Ferradous (b).
Mise au point de la technique de bouturage
et validation au champ
Production de materiel amlior
pour les populations locales et les reboisements
Semis juvniles tout venant
Ttes de clones slectionnes
ges par les populations
Mise au point
de la technique de bouturage
Pousses vgtatives
(ramets)
Descendances
de semis
Boutures
Mobilisation des
gnotypes slectionns
Tests comparatifs
de comportement au champ
boutures versus semis
Pied mres rajeunis
Tests de descendances
Boutures clones
Tests clonaux
Clones de production
Figure 2.
Rcapitulatif des diffrentes composantes du projet.
Vergers
graines
Graines amliores
pour reboisements
57
58
BOIS ET FORTS DES TROPIQUES, 2010, N 304 (2)
FOC US / PROPAGATION OF A R G A N I A S P I N O S A
Photos 15.
Greffe en tte russie (dtail du point de greffe indiqu par la flche dans lencadr) dune tte
de clone ge destine servir de pied-mre pour commencer le bouturage en cascade .
Photos O. Monteuuis.
Les premiers reprsentants clonaux obtenus par greffage
ou bouturage des 14 ttes de clone slectionnes (photos 15)
seront eux exclusivement destins un usage de pieds-mres
grs le plus judicieusement possible, en tirant enseignement
de lexprience acquise sur les boutures de semis tout venant
et sur dautres espces (Monteuuis, 1993; Saya et al., 2008).
Le but est de parvenir le plus rapidement possible au rajeunissement physiologique requis pour obtenir des taux denracinement des boutures compatibles avec une production industrielle.
cette fin, le bouturage en cascade parat tre prconis (Monteuuis, 1993; Saya et al., 2008), en saffranchissant le plus tt
possible des pieds-mres obtenus par greffage, en raison des
risques de bouturer les pousses illgitimes issues des portegreffes de semis non slectionns (et non du greffon).
Les premires boutures rajeunies obtenues seront fournies aux propritaires des ttes de clone, bien lgitimement,
pour observation, avant de considrer les modalits dune
diffusion commerciale plus grande chelle si ncessaire
ou dun verger graines (figure 2).
Lintrt des semis issus des fruits rcolts sur les ttes
de clone slectionnes se justifie plusieurs titres:
mise en place sur le terrain selon des dispositifs appropris
pour estimer le dterminisme gntique (hritabilit) des caractres les plus priss chez larganier ; ces essais pourront
ensuite tre convertis en vergers graines destins produire
en grandes quantits des semis darganier de qualit suprieure
pour les reboisements, en tirant profit de la bonne facult de
germination de lespce (Alouani, 2003; Nouaim, 2005);
production de pieds-mres juvniles pour comparer le comportement au bouturage et au champ des boutures produites
partir de ces derniers et des arbres-mres slectionns gs
troitement apparents, donc en minimisant les biais dordre
gntique. Ces pieds-mres pourront tre utiliss pour la production de boutures clones ou en mlange (bulk), de faon
pallier linsuffisance ventuelle de semis de la mme origine
pour les plantations de rapport. Ce matriel peut permettre
galement dapprofondir les connaissances quant lhritabilit
des caractres de larganier, galement mconnue.
BOIS ET FORTS DES TROPIQUES, 2010, N 304 (2)
MULTIPLICATION DARGANIA SPINOSA / LE P OIN T SUR
Rfrences bibliographiques
ALIFRIQUI M., 2004. Lcosystme de larganier. tude ralise
pour le Programme des Nations unies pour le dveloppement
(Pnud-Maroc), 126 p.
KAAYA M., 1998. Contribution la domestication de larganier:
slection et multiplication. Thse, Universit Ibn Zohr, Agadir,
Maroc, 175 p.
ALOUANI M., 2003. Rgnration de larganier (Argania
spinosa (L.) Skeels): protocole de production de plants par
semis et par bouturage et russite de la transplantation.
Thse, Universit Ibn Zohr, Facult des sciences, Agadir,
Maroc, 188 p.
KENNY L., 2007. Atlas de larganier et de larganeraie. Agadir,
Maroc, Institut agronomique et vtrinaire Hassan II, 191 p.
ALOUANI M., BANI-AAMEUR F., 2004. Argan (Argania spinosa
(L.) Skeels) seed germination under nursery conditions :
effect of cold storage, gibberellic acid and mother-tree genotype. Annals of Forest Science, 61 (2): 191-194.
BELLEFONTAINE R., 2005. Pour de nombreux ligneux, la reproduction sexue nest pas la seule voie: analyse de 875
cas.Scheresse, 16 (4): 315-317.
MEUNIER Q., BELLEFONTAINE R., MONTEUUIS O., 2008. La
multiplication vgtative darbres et arbustes mdicinaux
au bnfice des communauts rurales dOuganda. Bois et
forts des tropiques, 295: 71-82.
MHIRIT O., BENZYANE M., BENCHEKROUN F., EL YOUSFI S.
M., BENDAANOUN M., 1998. Larganier. Une espce fruitire-forestire usages multiples. Sprimont, Belgique,
ditions Mardaga, 151 p.
MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DES PCHES MARITIMES,
2008. Le Plan Maroc Vert 2008. Rabat, Maroc.
BOUDY P., 1950. Monographie et traitement de larganier.
Dans Monographie et traitements des essences forestires.
Paris, France, d. Larose, tome II, fascicule I, p. 382-416.
MONTEUUIS O., 1985. La multiplication vgtative du squoia
gant en vue du clonage. Annales de recherches sylvicoles
1984 (Afocel), p. 139-171.
BOUICHE L., 2008. tude des modes de rgnration faible
cot de Iarganier (Argania spinosa) au Maroc. Master II
Bioressources en rgions tropicales et mditerranennes,
Universit Paris XII, France, 60 p.
MONTEUUIS O., 1993. Current advances in clonal propagation
methods of some indigenous timber species in Sabah (Malaysia). In: Davidson J. (d.). Recent advances in mass clonal
multiplication of forest trees for plantation programmes. Proc.
UNDP/FAO Regional Project on improved productivity of manmade forests through application of technological advances
in tree breeding and propagation (FORTIP), Cisarua, Bogor,
Indonesia, 1-8 Dec. 1992. Rome, Italie, Fao, p. 168-193.
CHAMPAGNAT P., 1980. La greffe vgtale. Dans Chaussat
R., Bigot C. (d.). La multiplication vgtative des plantes
suprieures. Paris, France, Gauthier-Villars, p. 99-114.
EL AICH A., BOURBOUZE A., MORAND-FEHR P., 2005. La chvre
dans larganeraie. Rabat, Maroc, Actes ditions, 126 p.
EL YOUSFI S. M., 1988. Dgradation forestire dans le SudOuest, exemple de larganeraie dAdmine entre 1969 et
1986. Mmoire de 3e cycle, Institut agronomique et vtrinaire
Hassan II, Rabat, Maroc, 117 p.
FALCONNET G., HELDERL C., BADINIER C., FERNANDEZ OSUNA
J., 2007. tude de lincidence de la qualit des plants
forestiers sur la prennit des boisements et reboisements
en Alsace. Installation de placettes permanentes et premire
srie de mesures. Ministre de lAgriculture et de la Pche et
Engref (France), 42 p. et annexes.
FERRADOUS A., BANI-AAMEUR F., DUPUIS P., 1997. Diversit
gntique du fruit et de la graine de larganier. Dans Birouk
A., Rejdali M. (d.). Actes du sminaire sur les ressources
phytogntiques et le dveloppement durable organis
Rabat par le Comit national des ressources phytogntiques.
Rabat, Maroc, Actes ditions, p. 319-324.
FERRADOUS A., 2008. Essais de provenances et tests de
descendances chez larganier. Dans Actes des Premires Assises de la recherche forestire sur larganier, Essaouira,
Maroc, 23-24 mars 2006. Rabat, Maroc, ditions du Centre
de la recherche forestire, p. 92-105.
FERRADOUS A., 2010. Production de plants darganier en
ppinire. Fiche technique. Rabat, Maroc, ditions du Centre
de recherche forestire, 23 p. (sous presse).
HARTMANN H. T., KESTER D. E., DAVIES Jr F. T., GENEVE R. L.,
1997. Plant propagation : principles and practices. Sixth
edition. Upper Saddle River, New Jersey, tats-Unis, Prentice
Hall International, 770 p.
MONTEUUIS O., 1995. In vivo grafting and in vitro micrografting
of Acacia mangium: impact of ortet age. Silvae Genetica, 44
(4): 190-193.
MONTEUUIS O., 1998. Influence de la position in situ de la
bouture sur son enracinement et son dveloppement ultrieur :
synthse de travaux publis. Dans Verger M., Le Pichon C., Le
Bouler H. (d.). Multiplication des ligneux forestiers, fruitiers
et ornementaux. Antony, France, Cemagref, p. 183-191.
NOUAIM R., 2005. Larganier au Maroc : entre mythes et
ralits. Une civilisation ne dun arbre. Paris, France, LHarmattan, 229 p.
PLATTEBORZE A., 1977. Le bouturage des arbres forestiers
au Maroc. Bilan des essais raliss en 1975 et 1976. Annales
de la recherche forestire au Maroc, 17: 145-190.
SAYA R. A., MANKESSI F., TOTO M., MARIEN J. N., MONTEUUIS
O., 2008. Advances in mass clonal propagation of Eucalyptus
urophylla x E. grandis in Congo. Bois et forts des tropiques,
297: 15-25.
TEKLEHAIMANOT Z., MWANGINGO P. L., MUGASHA A. G.,
RUFFO C. K., 2004. Influence of the origin of stem cutting,
season of collection and auxin application on the vegetative
propagation of African Sandalwood (Osyris lanceolata) in
Tanzania. Southern African Forestry Journal, 201: 13-24.
59
Vous aimerez peut-être aussi
- La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2020: La durabilité an actionD'EverandLa situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2020: La durabilité an actionPas encore d'évaluation
- Systèmes Aquaponiques, Poissons. Volume 3: Sistemas de acuaponíaD'EverandSystèmes Aquaponiques, Poissons. Volume 3: Sistemas de acuaponíaPas encore d'évaluation
- Arganier Colloque Avril2007 Rabat Partie1 PDFDocument35 pagesArganier Colloque Avril2007 Rabat Partie1 PDFhiaiglePas encore d'évaluation
- La restauration des terres en action contre la désertification: Manuel de restauration des terres à grande échelle pour renforcer la résilience des communautés rurales dans la Grande Muraille VerteD'EverandLa restauration des terres en action contre la désertification: Manuel de restauration des terres à grande échelle pour renforcer la résilience des communautés rurales dans la Grande Muraille VertePas encore d'évaluation
- Directives d’application volontaire pour la conservation et l’utilisation durable des variétés des agriculteurs/variétés localesD'EverandDirectives d’application volontaire pour la conservation et l’utilisation durable des variétés des agriculteurs/variétés localesPas encore d'évaluation
- Systèmes Aquaponiques, Plantes. Volume 3: Sistemas de acuaponíaD'EverandSystèmes Aquaponiques, Plantes. Volume 3: Sistemas de acuaponíaPas encore d'évaluation
- Cahier de Charge PépinièreDocument11 pagesCahier de Charge PépinièreRamzi MazhoudiPas encore d'évaluation
- Projet Piment12Document66 pagesProjet Piment12Espérant NDRIAMANANTENAPas encore d'évaluation
- La Culture Des Champignons ExposéDocument5 pagesLa Culture Des Champignons Exposéblue heartPas encore d'évaluation
- Rapport Final Filière MaïsDocument70 pagesRapport Final Filière MaïsMaurice CoulibalyPas encore d'évaluation
- ST0519 CacaoDocument44 pagesST0519 CacaoPatis Alaoui Moulay HafidPas encore d'évaluation
- Projet de Production Hui Lear GaneDocument34 pagesProjet de Production Hui Lear Ganeanir0013100Pas encore d'évaluation
- Tle G2 - Les Secteurs Dactivités Économiques de La Côte DIvoireDocument15 pagesTle G2 - Les Secteurs Dactivités Économiques de La Côte DIvoireDaniel christ BakaryPas encore d'évaluation
- Fiche de Projet 207 BELDocument3 pagesFiche de Projet 207 BELMo100% (1)
- CameroonDocument109 pagesCameroonRomaric Sougla100% (2)
- Etude Filiére FruitiéreDocument81 pagesEtude Filiére FruitiéreAkim MaïzoumbouPas encore d'évaluation
- Projet ApicultureDocument5 pagesProjet ApiculturekassbiPas encore d'évaluation
- Filiere Papaye 1Document3 pagesFiliere Papaye 1Hervé N'guessanPas encore d'évaluation
- Synthèse Filière Miel Madagascar 2007 PDFDocument20 pagesSynthèse Filière Miel Madagascar 2007 PDFluna phenitraPas encore d'évaluation
- Palmier DattierDocument16 pagesPalmier DattierbichaPas encore d'évaluation
- Developper Une Activite de Valorisation de Legumes Et Petits Fruits en Circuit Court-Ilovepdf-Compressed 1Document24 pagesDevelopper Une Activite de Valorisation de Legumes Et Petits Fruits en Circuit Court-Ilovepdf-Compressed 1Mike MetzPas encore d'évaluation
- BrochureTransoBléFerme PDFDocument9 pagesBrochureTransoBléFerme PDFنورPas encore d'évaluation
- Elévage Des Poules Pondeuses en Milieu TropicaleDocument16 pagesElévage Des Poules Pondeuses en Milieu TropicaleNoe NgoulouPas encore d'évaluation
- Revue Ezzaitouna Revue Ezzaitouna Revue Ezzaitouna Revue EzzaitounaDocument13 pagesRevue Ezzaitouna Revue Ezzaitouna Revue Ezzaitouna Revue EzzaitounaKamel HebbachePas encore d'évaluation
- PepiniereDocument21 pagesPepinieremohamedadjeb2001Pas encore d'évaluation
- Desmas - Memoire TomateDocument75 pagesDesmas - Memoire Tomateyoussef naboltanePas encore d'évaluation
- Pde TerreDocument26 pagesPde TerreAmi BennounaPas encore d'évaluation
- Credit Tahhadi 2015Document2 pagesCredit Tahhadi 2015Abouabderahmane YadPas encore d'évaluation
- Filiere Oignon Groupe 09Document24 pagesFiliere Oignon Groupe 09Abraham Kalba100% (2)
- Guide Pratique de La Culture de La Pomme de Terre en Afrique de L Ouest PDFDocument76 pagesGuide Pratique de La Culture de La Pomme de Terre en Afrique de L Ouest PDFJean-Joel LEKANGAPas encore d'évaluation
- 1938 PDFDocument44 pages1938 PDFnuitPas encore d'évaluation
- Huiile OlivrrDocument7 pagesHuiile OlivrrmarhforPas encore d'évaluation
- Fiche Technique: Bonne Pratique de Production de Farine Du Maïs Decortique Et Degerme (Gambari-Lifin Au Benin)Document12 pagesFiche Technique: Bonne Pratique de Production de Farine Du Maïs Decortique Et Degerme (Gambari-Lifin Au Benin)sakhraouiPas encore d'évaluation
- Filiere Des CapresDocument7 pagesFiliere Des CapresAyoub AzPas encore d'évaluation
- Rã©glement - Semi NationalDocument6 pagesRã©glement - Semi NationalcharronPas encore d'évaluation
- Btta 132Document6 pagesBtta 132Said MaananPas encore d'évaluation
- Colza: Culture Et Débouchées (Aficar)Document3 pagesColza: Culture Et Débouchées (Aficar)benefredPas encore d'évaluation
- Catalogue Des Etudes Realisees Par Le MIPMEPI PDFDocument55 pagesCatalogue Des Etudes Realisees Par Le MIPMEPI PDFAbdelaziz El-MohriPas encore d'évaluation
- Projet Maraicher Final4Document26 pagesProjet Maraicher Final4Hamidou Traoré100% (1)
- Bovins Viande Lait Afrique. BibliograpDocument11 pagesBovins Viande Lait Afrique. Bibliograpsaidou sannaPas encore d'évaluation
- FILIERE GIROFLE CLOU - FormattedDocument13 pagesFILIERE GIROFLE CLOU - Formatted177425Pas encore d'évaluation
- Plan Strategique Filiere ApicultureDocument8 pagesPlan Strategique Filiere ApicultureErnstPas encore d'évaluation
- Abdelghani f03 MDFDocument39 pagesAbdelghani f03 MDFAchraf rajawiPas encore d'évaluation
- Amandier PDFDocument3 pagesAmandier PDFKhaled BenPas encore d'évaluation
- Fiche Olive de TableDocument6 pagesFiche Olive de TableMed MoussaouiPas encore d'évaluation
- Le Circuit de La Crevette CalédonienneDocument9 pagesLe Circuit de La Crevette CalédonienneMartel SPas encore d'évaluation
- Avicole PDFDocument33 pagesAvicole PDFCopernic ConseilPas encore d'évaluation
- Mangues 3Document11 pagesMangues 3Rai AwakePas encore d'évaluation
- M0230mpgeo14 PDFDocument84 pagesM0230mpgeo14 PDFWaly SowPas encore d'évaluation
- Fiche Technique NiébéDocument8 pagesFiche Technique NiébéMaréchal AmiralPas encore d'évaluation
- Etude Olive BanqueDocument28 pagesEtude Olive Banquechadlikamal1315Pas encore d'évaluation
- Etude de Faisabilite Engraissement Des CaprinsDocument14 pagesEtude de Faisabilite Engraissement Des CaprinsTariqBoukhlik100% (1)
- Delarue, 2013 - Etude de Faisabilité D'un Projet de Compostage de La Jacinthe D'eau Dans La Comunauté de Sô-Ava Au BéninDocument131 pagesDelarue, 2013 - Etude de Faisabilité D'un Projet de Compostage de La Jacinthe D'eau Dans La Comunauté de Sô-Ava Au BéninfranciscaPas encore d'évaluation
- 2021-SWM Gabon - Rapport Consolidé Des Diagnostics (CRB) - V1Document197 pages2021-SWM Gabon - Rapport Consolidé Des Diagnostics (CRB) - V1Victorine ChrptPas encore d'évaluation
- PDF 207 Filiere Aviculture TraditionnelleDocument9 pagesPDF 207 Filiere Aviculture TraditionnelleMameno Tanjonasoa RalaivaoPas encore d'évaluation
- Fiches de Projet ManiocDocument18 pagesFiches de Projet ManiocIslah GsmPas encore d'évaluation
- Enquete Producteurs Agricoles - QuestionnaireDocument14 pagesEnquete Producteurs Agricoles - QuestionnaireSidy Mohamed Coulibaly100% (1)
- Visitez CoursExercices - Com FICHES de PROJETS 2.PDF 331Document307 pagesVisitez CoursExercices - Com FICHES de PROJETS 2.PDF 331Hassène EL FALLEHPas encore d'évaluation
- L'aviculture en Republique Du Cameroun - TheseDocument202 pagesL'aviculture en Republique Du Cameroun - TheseCollins DjikePas encore d'évaluation
- Bisuness Plan Michou PDFDocument6 pagesBisuness Plan Michou PDFJinny Pierre OnanaPas encore d'évaluation
- Manager Son Équipe Au Quotidien PDFDocument28 pagesManager Son Équipe Au Quotidien PDFMimoun Kandoussi67% (3)
- L'Organisation de L'activité Du Vendeur PDFDocument14 pagesL'Organisation de L'activité Du Vendeur PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- L'organisation Du Travail Au Restaurant - DJJ PROF PDFDocument7 pagesL'organisation Du Travail Au Restaurant - DJJ PROF PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- Les Techniques de Vente PDFDocument59 pagesLes Techniques de Vente PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- Formation Motivation Force de Vente PDFDocument1 pageFormation Motivation Force de Vente PDFMimoun Kandoussi100% (1)
- Creer Reprendre Mettre en Place Une Strategie Commerciale PDFDocument4 pagesCreer Reprendre Mettre en Place Une Strategie Commerciale PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- Tajine de Kefta Aux Pruneaux PDFDocument19 pagesTajine de Kefta Aux Pruneaux PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- La ProspectionDocument64 pagesLa ProspectionCharaf EddinePas encore d'évaluation
- Senegal PDFDocument56 pagesSenegal PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- Guide de Projets ADSDocument53 pagesGuide de Projets ADSannour_sdass100% (1)
- Les Questions Qui Font Vendre PDFDocument59 pagesLes Questions Qui Font Vendre PDFMimoun Kandoussi100% (1)
- Guide de Projets ADSDocument53 pagesGuide de Projets ADSannour_sdass100% (1)
- Excel Avance PDFDocument1 pageExcel Avance PDFMimoun Kandoussi100% (1)
- Rapport Cascades Ouzoud 2009 PDFDocument60 pagesRapport Cascades Ouzoud 2009 PDFMimoun Kandoussi100% (3)
- Commerciaux Statuts PDFDocument6 pagesCommerciaux Statuts PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- Developpement de La Filiere Olive PDFDocument50 pagesDeveloppement de La Filiere Olive PDFMimoun Kandoussi67% (3)
- Businessplan Modele PDFDocument16 pagesBusinessplan Modele PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- Developpement de La Filiere Olive PDFDocument50 pagesDeveloppement de La Filiere Olive PDFMimoun Kandoussi67% (3)
- Guide de Projets ADSDocument53 pagesGuide de Projets ADSannour_sdass100% (1)
- Savoir Si Un Mail Envoyé A Été Ouvert PDFDocument5 pagesSavoir Si Un Mail Envoyé A Été Ouvert PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- La ProspectionDocument64 pagesLa ProspectionCharaf EddinePas encore d'évaluation
- LeManifesteDuPartenariatStrategiqueReussi1 PDFDocument65 pagesLeManifesteDuPartenariatStrategiqueReussi1 PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- Réussir Son Étude de Marché en 5 Jours PDFDocument27 pagesRéussir Son Étude de Marché en 5 Jours PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- Geomarketing Explique PDFDocument8 pagesGeomarketing Explique PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- Etude de MarcheDocument41 pagesEtude de MarcheAmine BentallebPas encore d'évaluation
- Pouvoir Des Images Sur Prospects PDFDocument7 pagesPouvoir Des Images Sur Prospects PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- Guide de Projets ADSDocument53 pagesGuide de Projets ADSannour_sdass100% (1)
- Pouvoir Des Images Sur Prospects PDFDocument7 pagesPouvoir Des Images Sur Prospects PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- Bi PDFDocument1 pageBi PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- Norme Commerciale REV 19 FRDocument16 pagesNorme Commerciale REV 19 FRBilalElBattahPas encore d'évaluation
- Commerciale Stabiliner TPDocument3 pagesCommerciale Stabiliner TPbroukoPas encore d'évaluation
- Biologie Animale Cours 02Document24 pagesBiologie Animale Cours 02Rudina PrevalPas encore d'évaluation
- Exercice 1: Eléments Vivants Eléments Non VivantsDocument8 pagesExercice 1: Eléments Vivants Eléments Non Vivantsmalick senePas encore d'évaluation
- Cas Cliniques3eme Kine Epaule SyntheseDocument41 pagesCas Cliniques3eme Kine Epaule SyntheseSouleima JerbiPas encore d'évaluation
- Regime Alimentaire de L'enfant - Des 1 - Esso - CorrigéDocument45 pagesRegime Alimentaire de L'enfant - Des 1 - Esso - CorrigéBalakibawi ESSOPas encore d'évaluation
- Ehdc CP1Document71 pagesEhdc CP1diomandemouchoPas encore d'évaluation
- Geologie Ouest Congolien PDFDocument4 pagesGeologie Ouest Congolien PDFSeferi KakesaPas encore d'évaluation
- Rapport Stage IMHE M2 Bouchali Rayan 2018 FinalDocument60 pagesRapport Stage IMHE M2 Bouchali Rayan 2018 Finalimaneabdelli1997Pas encore d'évaluation
- Conception Architecturale D'un Cabinet DentaireDocument4 pagesConception Architecturale D'un Cabinet Dentaireimene100% (1)
- Process ConditionnementDocument12 pagesProcess ConditionnementpdmredacPas encore d'évaluation
- TD Methodologie de RechercheDocument2 pagesTD Methodologie de RechercheMamadou Gueye50% (2)
- Physiopathologie de L'athérosclérose - Mécanismes Et Prévention de L'athérothromboseDocument23 pagesPhysiopathologie de L'athérosclérose - Mécanismes Et Prévention de L'athérothromboseAbdelhedi Amir100% (1)
- La Toile Du DestinDocument5 pagesLa Toile Du DestinPierre LenandelPas encore d'évaluation
- Fiche Technique NidaroofDocument2 pagesFiche Technique NidaroofDupirePas encore d'évaluation
- Manya 2Document11 pagesManya 2Jonas lumbuPas encore d'évaluation
- Test Des Composants ÉlectroniqueDocument208 pagesTest Des Composants ÉlectroniqueArounan DembelePas encore d'évaluation
- Implémentation D'un Système D'information Pour La Surveillance Épidémiologique Au Burkina Faso: Expérience Du District Sanitaire de BaskuyDocument2 pagesImplémentation D'un Système D'information Pour La Surveillance Épidémiologique Au Burkina Faso: Expérience Du District Sanitaire de BaskuyBabacar NgomPas encore d'évaluation
- Dispositif National Et Pma Des Soins Et Soutien VF 23-03-2022 v2 1Document88 pagesDispositif National Et Pma Des Soins Et Soutien VF 23-03-2022 v2 1Dechi RenaudPas encore d'évaluation
- Cours de Planification FinancièreDocument98 pagesCours de Planification FinancièreAmine Adel BENGHERABI100% (1)
- Symboles Eleclectriques IndustrielsDocument11 pagesSymboles Eleclectriques IndustrielsAbdelKarim dergoulPas encore d'évaluation
- Atelier Mémoire Hiver 4Document11 pagesAtelier Mémoire Hiver 4psychologuesihmPas encore d'évaluation
- Questions de Synthèse Génétique Et SNDocument2 pagesQuestions de Synthèse Génétique Et SNYoram JdlPas encore d'évaluation
- VRD FinalDocument5 pagesVRD Finalrami ouerghiPas encore d'évaluation
- Priere Pour Un Revielle PersonnelDocument8 pagesPriere Pour Un Revielle Personnelpradier kip100% (1)