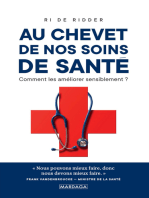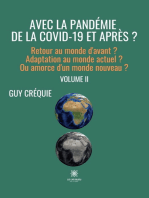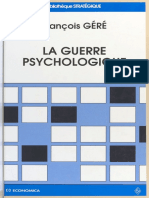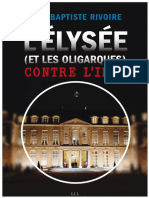Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Anglade, Georges (1983) Elogé de La Pauvreté PDF
Anglade, Georges (1983) Elogé de La Pauvreté PDF
Transféré par
Felipe SilvaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Anglade, Georges (1983) Elogé de La Pauvreté PDF
Anglade, Georges (1983) Elogé de La Pauvreté PDF
Transféré par
Felipe SilvaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Georges ANGLADE
[ 1944-2010]
Docteur en gographie et Licenci en Lettre, en Droit et en Sciences sociales
de lUniversit de Strasbourg
Fondateur du dpartement de gographie de lUQM.
(1983)
LOGE DE
LA PAUVRET
Le titre "loge de la pauvret" s'entend comme Ochan pou malere.
Un document produit en version numrique par Jean-Marie Tremblay, bnvole,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Courriel: jean-marie_tremblay@uqac.ca
Site web pdagogique : http://www.uqac.ca/jmt-sociologue/
Dans le cadre de: "Les classiques des sciences sociales"
Une bibliothque numrique fonde et dirige par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Site web: http://classiques.uqac.ca/
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.ca/
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
Politique d'utilisation
de la bibliothque des Classiques
Toute reproduction et rediffusion de nos fichiers est interdite,
mme avec la mention de leur provenance, sans lautorisation formelle, crite, du fondateur des Classiques des sciences sociales,
Jean-Marie Tremblay, sociologue.
Les fichiers des Classiques des sciences sociales ne peuvent
sans autorisation formelle:
- tre hbergs (en fichier ou page web, en totalit ou en partie)
sur un serveur autre que celui des Classiques.
- servir de base de travail un autre fichier modifi ensuite par
tout autre moyen (couleur, police, mise en page, extraits, support,
etc...),
Les fichiers (.html, .doc, .pdf, .rtf, .jpg, .gif) disponibles sur le site
Les Classiques des sciences sociales sont la proprit des Classiques des sciences sociales, un organisme but non lucratif compos exclusivement de bnvoles.
Ils sont disponibles pour une utilisation intellectuelle et personnelle et, en aucun cas, commerciale. Toute utilisation des fins commerciales des fichiers sur ce site est strictement interdite et toute
rediffusion est galement strictement interdite.
L'accs notre travail est libre et gratuit tous les utilisateurs. C'est notre mission.
Jean-Marie Tremblay, sociologue
Fondateur et Prsident-directeur gnral,
LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES.
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Marie Tremblay, bnvole, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi partir de :
Georges ANGLADE
LOGE DE LA PAUVRET.
Montral : Les ditions ERCE, tudes et Recherches Critiques dEspace,
1983, 63 pp.
[Autorisation formelle accorde par lauteur le 12 octobre 2009 de diffuser
toutes ses publications dans Les Classiques des sciences sociales.]
Courriel : anglade.georges@uqam.ca
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Comic Sans MS, 12 points.
Pour les citations : Times New Roman, 12 points.
Pour les notes de bas de page : Times New Roman, 12 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word
2008 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format : LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition numrique ralise le 2 mars 2010 Chicoutimi, Ville
de Saguenay, province de Qubec, Canada.
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
Georges ANGLADE
[ 1944-2010]
Docteur en gographie et Licenci en Lettre, en Droit et en Sciences sociales
de lUniversit de Strasbourg
Fondateur du dpartement de gographie de lUQM.
LOGE DE LA PAUVRET
Montral : Les ditions ERCE, tudes et Recherches Critiques dEspace,
1983, 63 pp.
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
Le graphisme de la couverture est de Rene COHEN.
Le lettrage et le montage sont de Andr PARENT.
La typographie est de Composition F enr.
Nous sommes reconnaissants au rectorat de l'Universit du Qubec
Montral de l'aide fournie pour la publication de cet opuscule.
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
Un contresens viter : "pauvre" ne se traduit pas en crole par
pv mais par malere. Etre pv c'est l'extrme misre avilissante, celle
du mendiant. Le titre "loge de la pauvret" s'entend comme Ochan
pou malere.
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
Par Georges Anglade
CONTRIBUTION LTUDE DE LA POPULATION DHATI
volution dmographique, rpartition gographique. Centre de Gographie
applique, Strasbourg, France, Service des thses. 247 pages, 6 cartes hors texte
1 : 500 000, 2e trimestre 1969.
L'ESPACE HATIEN
Les Presses de l'Universit du Qubec, Montral, x + 222 pages, 23 cartes, 54
figures, 148 illustrations, 40 tableaux, 3e trimestre 1974, 4e dition, Port-auPrince, Hati, 2e trimestre 1981. ISBN 0-7770-0115-2.
LA GOGRAPHIE ET SON ENSEIGNEMENT
Lettre ouverte aux professeurs, Les Presses de l'Universit du Qubec, Montral, xiii + 66 pages, 12 tableaux, 4e trimestre 1976. ISBN 0-7770-0163-2.
MON PA YS D'HATI
Les Presses de l'Universit du Qubec, Montral, Les ditions de l'Action Sociale, Port-au-Prince, xiii + 112 pages, 20 tableaux, 28 cartes, 18 figures, 3e trimestre 1977. ISBN 0-7770-0197-7.
ESPACE ET LIBERT EN HATI
tudes et recherches critiques d'espace et Centre de recherches carabes, 144
pages, tableaux, figures et carte, 4e trimestre 1982. ISBN 2-920418-0-7
ATLAS CRITIQUE D'HATI
tudes et recherches critiques d'espace et Centre de recherches carabes, 18
cartes en quadrichromie, 80 pages de format 10 X 13 pouces, 4e trimestre 1982.
ISBN 2-920418-00-9
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
HISPANIOLA
Lecturas sobre un mapa mural/Les lectures d'une carte murale. En collaboration avec R.E. Yunn et D. Audette. tudes et recherches critiques d'espace et
Universidad catlica Madre y Maestra en Santiago, R.D., carte murale en quadrichromie, l m x 1.40 m., 4e trimestre 1982. ISBN 2-920418-02-5.
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
Le discours
par l'loge
que voudra bien faire
le rcipiendaire
en savoir un peu plus
de son itinraire
et de la gense
de ses proccupations
pour finalement
juger
de leur applicabilit
Proccupations
Itinraire/gense
Applicabilit
Retour la table des matires
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
10
Je remercie les quipes de recherche et les corps de
mtier qui ont assum les diffrentes tapes de ralisation de ces travaux. Je voudrais que tous, et chacun en
particulier, sachent que c'est en notre nom collectif
que je reois cette distinction de la catgorie "Atlas et
Cartes" de la International association of printing
house craftsmen pour la murale Hispaniola, bilan
d'tape et synthse de l'ensemble de mes proccupations. Que l'Universit du Qubec Montral recueille
ici l'hommage qui lui revient pour les moyens mis
ma disposition depuis 15 ans et que le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada agre mes
considrations pour sa subvention spcifique (no :
410-81-0499) au travail prim.
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
11
Rafael Emilio Yunn et Denis Audette avec lesquels j'ai travaill Hispaniola de juillet 1981 juin
1982 partagent pleinement avec moi cette distinction
la murale qui n'aurait jamais t ce qu'elle est sans les
ressources matrielles et humaines de l'Universidad
catlica Madre y Maestra de Santiago de los caballeros et de l'Atelier de cartographie de l'UQAM, particulirement l'amicale disponibilit de Andr Parent,
l'engagement de Michel Harnois, les changes toujours fructueux lors des visites de Michel Dufault, de
Jean Carrire et de tous ceux qui plusieurs fois sont
venus discuter les tapes de recherche et de ralisation.
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
Nous serons unis dans la preuve ds que nous
aurons la garantie d'avoir pos le mme problme
Bachelard
12
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
13
loge de la pauvret
1. Proccupations
Retour la table des matires
J'appartiens une discipline dans laquelle les distinctions
ne sont pas pratique courante ; aussi me suis-je trouv un
peu pris au dpourvu, moi qui m'tais habitu l'ide d'une
certaine marginalit que viennent maintenant branler ces
attentions.
J'ai eu connaissance de l'existence de ce prix quand il a
t dcern, en 1981, la Carte du monde de la projection
d'Arno Peters, projection dont je me suis d'ailleurs explicitement servi pour l'encadr de localisation de la murale
d'Hispaniola ; car ce coup de gnie de Peters Brme, en
Allemagne, en 1976, restera unique dans nos annales pour sa
restitution au tiers monde de l'image de ses superficies relles qu'escamotait encore la tradition des projections cartographiques. Bien que les cartes soient en bonne place dans
ma mthode de travail, je dis, sans aucun jeu d'aucune sorte, que je suis encore songeur, en cette deuxime fois que
j'entends parler de ce prix, de le voir ainsi dcern.
Il m'a fallu assez vite, dans le laps de temps qui spare
l'annonce du prix de sa crmonie de remise, la fois me
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
14
forger une ligne de conduite face un tel accident (dans le
sens d'une chose qui survient de manire fortuite) et la
fois choisir la manire de meubler l'heure du discours pour
la rception de ce Prix international 1983.
Pour la ligne de conduite, il m'a t assez facile de la
formuler : ne jamais solliciter de distinctions, mais toujours
en tirer le meilleur parti pour souligner l'urgence du moment. Pour le discours ce me fut moins facile, car l'on s'attend, en cette tradition, trois choses : par l'loge que vou-
dra bien faire le rcipiendaire, en savoir un peu plus de son
itinraire et de la gense de ses proccupations, pour finalement juger de leur applicabilit.
Je ne drogerai pas ces attentes lgitimes en commenant par dire que, je ne sais trop pourquoi, le genre de l'loge est chez moi reli l'oraison funbre ; et je ne compte
enterrer rien ni personne ce soir, encore moins moi-mme. je
n'ai trouv dignes d'loges ni les nations gorges de revenus, ni la puissance des armes, et pas plus ce clinquant des
honneurs que la russite au service des pouvoirs. Tout au
fond de ma qute, et au mitan du chemin de mon mtier, je
n'ai trouv digne d'loge que la pauvret ; pas la misre repoussante et abjecte, inacceptable dans sa ngation de la
dignit humaine, mais la pauvret, celle-l mme dont l'omniprsence semble tre la manire la plus sre de se cacher.
Avec acharnement, on a voulu la transformer sans jamais
questionner ce qu'elle pouvait receler de savoir-faire dans la
survie, ce qu'elle pouvait avoir accumul de pratiques dignes
d'tre le point de nouveaux dparts. On a su la dcrire sans
la comprendre, la plaindre sans la respecter, et surtout
l'amalgamer la misre pour mieux dsamorcer l'alternative
dont elle est pleine, alors qu'il fallait tout simplement lui
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
15
demander les voies et les moyens du dsenveloppement des
opprims pour une dmocratisation qui ne tarde que trop.
C'est ce parti pris qui a t le ntre, la rupture d'avec le
misrabilisme et la folklorisation des approches de la pauvret pour fermement souscrire l'effort d'habiter cet objet d'tude de la dignit pistmologique encore rserve
aux grandes questions des grands de cette terre. Si la misre persiste et se colle toujours a nous, c'est que nous
n'avons pas choisi de partir de la pauvret, mais des mthodes de travail et des modes de penser de la richesse ; c'est
l'envers oblige de ce mythe fondateur de la modernit d'une
richesse possible pour tous et chacun alors que cette illusion
se heurte partout au rel ttu.
Ce que je cherche, c'est la concrte dmonstration des
potentiels de la pauvret, les concrtes indications du passage de sortie de l'outre-misre vers le niveau des exigences d'une vie dans laquelle personne ne manque du ncessaire ; et cette ambition n'est, hlas, autre que la dfinition de
la pauvret ! Ce que je cherche par-del les pratiques gmissantes des clauses de style et des ptitions de principe, des
appels priodiques la solidarit et la gnrosit des nantis, toutes ces incantations pour que, comme dirait un ami
historien, "le tigre devienne vgtarien", ce que je cherche
au-del de tout cela, ce sont ces voies concrtes et ces
moyens concrets dont est grosse une situation concrte. Ce
que je cherche, plus loin que les pratiques agissantes de
l'engagement missionnaire et de l'amlioration ponctuelle de
l'inconcevable pour que "la misre soit moins pnible au soleil", ce sont les lments d'un projet de socit qui ose demander la pauvret d'tre son point d'appui pour soulever
pays.
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
16
Paradoxe d'un temps de dsesprance, me dira-t-on ;
mais la richesse n'est-elle pas l'apanage d'un petit nombre
au prix de la misre du plus grand nombre ? Pourquoi alors
s'obstiner sur la richesse, ses techniques, ses mthodes et
ses modes, pour radiquer son corollaire qu'est la misre
quand il est notre porte une pauvret fconde dans ses
techniques amliorer, ses mthodes d'acclimatation et
d'organisation des techniques et ses modes d'approche des
problmes ? Pourquoi s'interdire ce "reCours aux sources" ?
Soit, me concdera-t-on, mais alors comment faire pour que
ce ne soit pas un nouveau prt--porter dangereux qui dguiserait la misre en un habit d'Arlequin de morceaux disparates et sans cohsion, bref, une macaquerie de plus ?
Vous vous doutez bien que je n'ai pas en main ce projet
tout fait de socit, loin de l, mais la pauvret est une problmatique qui traverse de plus en plus mes travaux dans
leur souci de rejeter la croissance du superflu, pour le dveloppement du ncessaire. Aussi fournirai-je ce soir des lments utiles leur mise en situation et leur lecture dans
cette perspective, puisque c'est cette dmarche qui me vaut
d'tre ici, avec vous.
J'ai donc livrer la marchandise, comme il se dit au Qubec ; mais o ? et qui ?. Pour le o ? je ne manquerai pas
mon choix habituel, je livre d'abord au lieu dont je parle.
Que l'on m'entende qu'il ne s'est jamais agi d'une quelconque troitesse me coupant d'autres ralits. Bien au
contraire, c'est l'ouverture au monde de mes lieux de vie et
d'exprience de gographe de l'UQAM qui m'a amen,
l'approfondissement d'un cas comme contribution l'universel. De plus, si j'ai grande estime pour les efforts d'une solidarit internationale indispensable, je crois cependant pro-
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
17
fondment que c'est au niveau du cas que nous vivrons les
ruptures, et que chaque socit doit d'abord voir, ellemme, ses propres changements. "Le temps de nous-mmes
est arriv" disait un caraben, et pour moi c'est vouloir
participer la transformation d'une situation concrtement
localise qui, pour tre actuellement la plus dcrie des dpressions de nos Amriques, n'en serait que plus exemplaire
dans sa diffrence si, un jour, une voie alternative est prise.
C'est donc chacun d'entre vous que j'interpelle quand je
tiens parole d'Hati ; je ne cherche pas dans cette salle des
tmoins, mais des gens avec qui partager.
La marchandise sera donc livre, mais qui ? C'est une
question qui pour moi a toujours t d'une extrme importance, car vouloir viser tout le monde on n'atteint plus
personne. Nous savons tous reconnatre l'errance de ces
adresses vertueuses qui n'ont pas de destinataires. Je garde de ma pratique d'enseignant ce souci des cibles. Je
m'adresse, et donc j'adapte mon discours, la relve. Professeur je suis et professeur je mourrai dans ma croyance
que la tranche qui va des classes terminales de premire et
de philosophie (le niveau collgial) la fin des tudes de
premier cycle reprsente cinq annes de formation d'une
relve qui vaille la peine d'une interpellation. Ils seront quelque quinze mille aux prochaines preuves des baccalaurats
en Hati et l'on n'a pas dnombr les plusieurs milliers
d'tudiants de tous ges aux tudes au pays et en diaspora.
Je choisis de leur dire, eux qui sont au principal carrefour
de la diffusion de la question hatienne, les lments d'un
dbat qu'ils reproduiront en amont et en aval d'eux. Cette
pratique de la diffusion des ides, jusqu' leur appropriation
et leur transformation en force de changement, est la seule
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
18
excuse que je puisse vous offrir, ce soir, de me trouver trop
souvent jouant de la gamme didactique de l'expos celle du
sminaire de recherches. L encore, je ne voudrais pas que
vous vous imaginiez que je vous prends tmoin de paroles
qui vous sont trangres, je vous convie plutt, dans cette
logique autre de la pauvret, n'tre au-dessus d'aucun
homme et d'aucune femme, mais simplement avec eux et
avec toutes les relves -de nos socits.
Je vous laisse aussi entrevoir ce que sera ma conclusion :
l'optimisme de la volont de construction d'un devenir qui
devra d'abord aux ressources de la pauvret les bquilles de
son avance et le sens de sa route, jusqu'au dpassement de
la pauvret dans le long terme ; et le pessimisme de l'intelligence qui dit l'puisante splendeur de ce combat toujours
recommencer. C'est que je n'ai peut-tre appris qu'une seule chose de cette familiarisation avec les handicaps, c'est
qu'il est largement suffisant d'tre en situation de pauvret
pour ne pas en plus se priver d'en faire sa force. Cette
perspective n'est pas nouvelle. Dans une relecture de l'Histoire de mon pays, cela va faire deux sicles qu' chaque
crise, on limine d'abord et avant tout cette ventualit.
Des marrons qui triomphent s'acharneront contre le marronnage, et la place--vivres de leur rsistance sera combattue au nom des plantations frachement accapares. Mose, le plus populaire des gnraux de la rvolution, fut limin, 29 ans, en octobre 1801, un peu avant l'indpendance,
pour avoir t l'coute de la valorisation des savoir-faire
des masses dans l'agriculture ; et l'empereur Dessalines,
celui-l mme qui conduisit la fortune de nos armes, connut
le mme sort, peu aprs l'indpendance en octobre 1806,
pour avoir voqu les premires dispositions prendre pour
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
19
empcher l'tranglement de ces mmes attentes des masses. Mais que nous propose-t-on depuis deux sicles si ce
n'est de revoir priodiquement le mode de redistribution de
la richesse nationale, avec les avatars que nous connaissons ;
ou, au mieux, de changer les matres d'une richesse nationale mmement produite pour une meilleure redistribution,
avec les avatars que nous connaissons ? Et s'il tait enfin
possible (en donnant ceux-l mmes qui l'on veut tant
"redistribuer" ce qu'ils produisent d'ailleurs, les moyens de
garder directement leur part) d'essayer autrement dans un
"raccourci" qui troquerait le faire de richesse de l'impossible dveloppement contre le faire de pauvret du possible
dsenveloppement, mettant ainsi fin cette misre misrable ? De ressources, nous n'avons plus qu'un peuple aux trois
sicles de mmoires de sa sueur fcondant nos sillons, plus
que six millions d'hommes, de femmes et d'enfants aux trois
sicles d'archives dans la gestion de la survie. Il est inutile
de se rver autre, ceci est notre lot ; aussi faut-il rclamer
bien haut notre droit la pauvret et un terme cette
mendicit et cette indignit.
J'ai promis une prise de distance de ces travaux chelonns sur 15 ans pour souligner les positions nouvelles que j'ai
cr devoir adopter tout en les prolongeant jusqu'aux points
ultimes o je crois pouvoir les dfendre. Cette prise de distance suppose d'abord la mise en question d'une pratique
scientifique, bien des gards singulire, par la recherche
de l'imbrication du qui parle ?, de quoi ? et pourquoi ?. Ce
serait dvoiler le vcu presque quotidien d'un cheminement
pour accder aux codes souterrains des discours, quoique
l'pistmologie ne se soit que rarement arrte ce niveau
de la relation aux lieux, aux hommes et aux outils. J'ai pour-
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
20
tant l'impression, sinon la certitude, que c'est ce niveau
qu'ont pris corps les problmes qui se sont imposs moi,
les questions que j'en ai tires et les rponses que j'ai pu
baucher. Il n'est donc pas insignifiant de livrer ma propre
lecture de ce contexte, ne serait-ce que pour situer les
manquements aux dogmes de toutes sortes et l'obligation de
diffrer d'analyses tablies.
Dvoiler cette relation entre le sujet, l'objet et le projet
c'est restituer ce qu'carte toute analyse dans son obligatoire simplification. Il y a un impossible remplissage du vcu
par le dire, une impossible saisie de la totalit ; aussi faut-il
dborder par le sensible les servitudes de la mthode pour
restituer ce qu'un modle ne rend que difficilement : la pesance des combats le dos la pauvret. Gographe, c'est
souvent par le romancier, le chroniqueur, le pote que j'arrive saisir aux dtours la charge d'un thme. Je connais ainsi une grande monographie de village, c'est "Cent ans de solitude" de Gabriel Garcia Marquez ; je connais aussi une
grande chronique de dpossession, la dernire d'un archipel
qui compte cinq sicles de chroniques, c'est "Le discours antillais" d'douard Glissant ; et je connais encore certains
vers d'Anthony Phelps qui sonnent comme une synthse de
sciences humaines. Alors, je me demande si le refus de disqualifier la relation au sensible, ce dvoilement bien dans la
manire de la Carabe, ne pouvait se rclamer d'autant de
porte pistmologique que certains regards froids sur de
chaudes conjonctures.
En ce dbut des annes 1980, la gographie est en train
de raliser sa mutation la plus profonde. Suite aux annes
1960 caractrises par la monte de la gographie nouvelle
d'origine anglo-saxonne et la dcennie 1970-1980 qui a t
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
21
marque parle face--face de l'ancienne manire franaise
et de la nouvelle manire tasunienne, on peut dire que la
conjoncture actuelle, fruit des vingt dernires annes, annonce une possible rupture d'avec l'empirisme, le nopositivisme et l'idalisme encore tenaces dans les gographies. Et l, il faut quand mme reconnatre l'apport d'un
questionnement de plus en plus autonome du tiers monde sur
lui-mme. Cette rupture en marche dans les trois grands
courants pr-cits doit beaucoup aux pratiques antrieures,
mais c'est de son rapprochement des problmatiques des
sciences humaines que lui est venu l'essentiel de son cadre
d'analyse. Le concept d'espace et l'arbre terminologique
d'espace ne renverraient plus du visible et du palpable, le
spatial (qui n'est pas le paysage) n'tant pas plus accessible
aux sens que l'conomique, le politique ou l'idologique, et un
concept de l'analyse d'espace n'ayant pas plus de matrialit (ou a autant de matrialit) qu'une lutte de classes ou un
groupe de pression. Personne n'a Jamais vu l'espace, et cette proposition nous semble l'horizon du travail thorique en
cours en gographie.
Ces exigences de conceptualisation sont conduites dans
une mise en relation de l'Espace la Socit, avec pour fil
conducteur les processus de la formation de l'tat. D'o le
titre de mon travail en cours L'tat, l'Espace et la Socit.
Quant au sous-titre, L'apport du cas une problmatisation
de la gographie sociale, il renvoie la question suivante :
une thorie gnrale de ce qui serait identifiable dans chaque cas est-elle actuellement possible ? la base de cette
interrogation, il est d'abord une situation, celle d'Hati,
laquelle j'ai consacr l'essentiel de mes efforts, car il est
connu que ce qui a surtout marqu la gographie vient de la
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
22
longue pratique d'un cas, enrichie plus tard par les comparaisons et les gnralisations des avances thoriques et
mthodologiques ; il est ensuite une certitude, lentement
mrie, que le problme n'est pas de l'ordre de l'accumulation empirique de donnes mais plutt d'une thorisation capable de construire, de manire acceptable, les concepts
d'espace et leur mise en relation la socit totale.
Me voil donc rendu, du point de vue disciplinaire, l'tape de cette gnralisation. En fin d'approfondissement pour
une thorie du cas (le prtexte hatien) et d'une premire
comparaison (Hispaniola), je tente de vrifier la pertinence
des avances thoriques et mthodologiques aux trois paliers du contexte de nos Amriques : du Qubec dans les
Amriques des centres principaux, au Venezuela dans les
Amriques des centres secondaires, jusqu'aux creuses dpressions de type hispaniolien. Je postule que l'on peut
construire la gographie de chaque socit par la mise en
relation de l'espace la formation de l'tat et de la Nation.
Deux processus sont la base de cette liaison : les tapes
de la construction d'un march (les formes du contrle conomique), et l'volution des modalits de l'exercice des pouvoirs (les formes de la gestion politique et sociale). Ces deux
formes premires s'articulent de manire diffrente dans
le temps sous l'influence de la dynamique interne d'une socit qui, elle, rpond des conditions de son insertion dans
un ordre politique et conomique englobant. chacun des
trois principaux moments des cinq sicles de nos Amriques,
une structure dominante d'espace livre passage une organisation particulire des formes. Les structures dominantes
d'espace ayant la caractristique d'voluer (la relation Espace/Temps), se pose alors la question de ce qui fait spci-
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
23
fiquement la dynamique d'espace et son autonomie relative
dans le tout social. chacun des trois moments, c'est au niveau d'une entit structurante d'espace que se dploient les
contradictions de base de la socit. La dynamique d'espace
dit ainsi le mode d'existence des rapports sociaux tels que
mdiatiss en spatialits.
Tels sont les chanons et tel est leur enchanement au
point o j'en tais aux dernires publications et telle est ma
manire de rendre gravide mon anne sabbatique en cours.
L'mergence des courants du tiers monde, dans ce champ
fortement domin par les pratiques et les intrts des coles nord -atlantiques, ne va pas sans un certain nombre de
contraintes. D'un strict point de vue pistmologique, la
construction d'un rel de sous-dveloppement a toujours livr le regard des centres sur leurs priphries, des dominants sur leurs domins. tait-il possible de procder autrement, de parvenir une lecture qui serait propre aux dfavoriss sur eux-mmes et sur les autres, une sorte de
double renversement dans les discours dont les points d'ancrage passeraient des centres aux priphries, et dans les
priphries des nantis aux dmunis ? Depuis deux dcennies,
cette aventure toute nouvelle de la science est en cours et
elle est porteuse d'une nouvelle problmatisation de la gographie sociale. C'est de la spcificit de cette conjoncture
que je tmoigne.
revoir le chemin suivi et les jalons poss, j'ai t habit
par le souci de dire l'espace hatien dans une dmarche capable de coller aux aspirations d'hommes et de femmes objectivement en situation inacceptable. Il fallait "rinventer" le pass, offrir une autre lecture du prsent et de
son potentiel pour baucher les grandes lignes d'un futur
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
24
acceptable, mais susceptible d'tre atteint en un temps relativement court. Vingt annes de productions collectives
ont t ncessaires pour construire ce qui n'est simplement
qu'un cadre directeur de ces vises. Vingt annes qui ont
aussi t celles de la conqute d'une bien triste renomme
par Hati au plan international et d'un vigoureux tournant de
la gographie comme discipline. Il s'est trouv que les hasards de ma propre trajectoire m'ont conduit dans les lieux
privilgis pour l'observation de cette double dynamique, au
plus fort des moments de critiques et de crises. Hatien et
gographe, je portais donc cette double bullition de laquelle est sortie une coule unique, cette gographie d'Hati,
aux contours tellement personnels (on me l'a beaucoup fait
remarquer, risette ou rictus ? qu'importe !) que je me sens
accul en dire la gense et le degr de reprsentativit.
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
25
loge de la pauvret
2. Itinraire/gense
Retour la table des matires
Mon histoire dfinitivement consciente commence en
1960 par l'veil, en fin de la seconde, la perception d'tre
citoyen. J'allais avoir seize ans et j'allais devoir quitter ce
collge de Frres pour faire rhto et philo dans "la vraie
vie", comme disait mon pre. Je l'entends encore me prparer ce passage initiatique : "a commence au bac et a
s'apprend au lyce". Il avait souhait que ses fils fassent le
mme circuit que lui, le bac au lyce, "pour l'apprentissage
de la vie d'homme". C'est qu'il avait gard le souvenir imprenable des matres hatiens qui firent le lyce Ption des
annes 1935. De 1960 nos jours, c'est, pour moi, vingt et
quelques annes d'entrecroisements multiples dont deux relvent, ici, d'intrt : ma relation la discipline (le gographique) et ma relation au terrain d'tude (Hati).
Cela peut donc commencer la rentre de 1960, en classe
de premire. Personne ne s'aventure la lgre dans cette
classe qui a ses histoires et ses mythes. Ne disait-on pas
que la jeunesse estudiantine, bacheliers et universitaires,
avait renvers le gouvernement de Lescot en 1946 ? La grve qui s'annonait ds octobre porterait-elle aussi fruits ?
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
26
Ils n'taient que quelque 500 et nous tions prs de 4 000...
Toutes les coles du pays furent fermes trois mois pour
rouvrir dans un ordre muscl, vers Pques. L'agitation fut
fbrile et il y eut de la casse. C'est au lyce Firmin que j'ai
vcu le rattrapage forcen qui devait nous conduire
l'preuve de juin. Je fus proche du directeur mile Chrispin
qui m'avait invit chez lui comme porteur des couleurs du
lyce dans un concours national qu'avait organis l'UNESCO.
Pendant trois ans, j'allais voir de prs cet homme, devenu le
grand patron des baccalaurats, se battre pour que quelque
chose change ; il ne sauva de peu que sa vie. Je compris ainsi
la leon que mon pre voulait que j'apprenne du commerce de
certains ans.
La terminale me rapprocha de trois professeurs, nationalistes chacun sa faon : Rmy Zamor en histoire, Roger
Gaillard en philosophie et Fritz Pierre-Louis en sciences de
la terre et de la nature. Dix ans plus tard, Zamor et PierreLouis devaient encore m'accompagner pour le terrain qui
conduisait "L'espace hatien" et me faire profiter de leur
exprience d'auteurs de manuels ; et vingt ans plus tard, ma
ddicace de "L'atlas critique d'Hati" devait tre un hommage en ricochet aux travaux de Gaillard sur la rsistance, de
1915 1921, du peuple hatien l'occupation tasunienne.
J'ai aussi rencontr, dans cette classe de philosophie, celle
qui devait devenir ma compagne, Mireille Neptune, de pre
aquinois comme moi, et c'est encore l'un de ces professeurs,
devenu un ami, qui fut notre tmoin dans cette petite chapelle de la Cit universitaire de Paris en 1967.
Cela se continue avec l'cole Normale Suprieure de
1962, l'anne aussi o "Le paysan hatien" de Paul Moral nous
rvle un pays concret, et l'on chuchote que Jacques Alexis
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
27
est mort. C'est un temps de violence omniprsente qui
n'pargne rien ni personne. L'examen d'entre en Facult de
mdecine est une formalit qui ne cherche mme plus cacher, cette anne-l, que la liste des admis est vulgairement
tripote. La Normale, par la rudesse de ses slections et
l'animation politico-culturelle qui en est la marque, est le
dernier lot encore submerger. En trois ans, elle sera deux
fois ferme, dmnage, et ses rangs clairsems par de successives arrestations. En tout, de 1962 1965, pour six sections et trois promotions, une cinquantaine de jeunes gens et
de jeunes filles venus de villes, d'coles, de factions politiques, de milieux divers, mais se ctoyant dans la complaisance d'appartenir au plus notoire des groupes estudiantins.
Deux proccupations majeures ont fait l'intrt de cet apprentissage : le politique et le scientifique (et les tenaces
ambiguts de leur conciliation). En politique, la "Rpublique
hrditaire" s'installe, le discours dmocratique est englu
dans un robuste dogme marxiste, la rpression bt chaud,
les embryons de partis sont trips, les foyers de rsistance anantis et les exemples tracs par le pouvoir, lugubres.
Le savoir dispens est prudemment dcoll du rel. Dans ma
section des sciences sociales, l'Histoire semble s'tre arrte tout net en 1804, l'indpendance. Un sicle et demi de
cach par une prestidigitation qui n'avait rien envier aux
acrobaties de la trentaine de cours au programme pour se
maintenir hors de porte de la conjoncture. Notre culture
gnrale cependant devenait enviable, et je terminai cette
course d'obstacles par l'preuve, en plein bord-de-mer de
ce Port-au-Prince-l, d'une question de gographie urbaine
sur "Sparte au Ve sicle avant Jsus-Christ" ! Je fis l'effet
attendu en commenant par citer Homre, "La creuse Lac-
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
28
d-mone... On ne pouvait sortir de l qu'avec la ferme dtermination d'atterrir un jour en plein dans le rel hatien.
Mon intrt tait aussi ailleurs, au point que je n'ai jamais plus connu de priode d'activits aussi dbordantes.
J'entrais dans la vie avec une fougue qui me fit enseigner
une dizaine d'heures/semaine au collge Saint-Pierre, m'occuper d'expditions de sisal et, un temps, d'levage, consacrer toutes mes soires la facult de Droit et m'acquitter
d'un monitorat de sport que m'avait valu le titre de "Meilleur athlte" de ma catgorie aux jeux scolaires de 1957.
J'aimais bien cette dispersion laquelle je dois d'avoir pu
observer toutes les couches d'une coupe transversale de notre socit, de la paysannerie aux exportateurs du bord-demer, des cnacles littraires et artistiques au corps professoral. L'envers est que, dans chaque groupe, j'tais toujours
un peu l'autre : les tudiants me voyaient travailleur, et dans
le travail on me savait professeur. Cette ouverture, loin de
gner mes tudes me permit au contraire d'y conserver mon
efficacit par l'exprience et les nombreux dplacements
que j'tais amen faire dans les provinces. De l aussi,
peut-tre, cette rticence me laisser embarquer par des
analyses qui violaient si outrageusement ce que je savais
d'exprience des hommes et des choses dans ce rseau de
relations hors des frontires familiales. Je garde de ces
cinq annes d'mergence une conscience historique en Hati, la certitude que l s'est parachev l'enracinement au
pays qui allait me condamner toujours tre en exil hors de
cette terre. je leur dois de n'avoir jamais eu de crise
d'identit ou d'orientation de mon travail.
Le Blitz en cours ne laissait pas beaucoup de choix : il fallait se terrer ou s'enfuir. Le plus grand nombre saisit au vol
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
29
l'offre du Zare que sa rcente indpendance avait laiss
sans cadres enseignants. Un second groupe put gagner la
France avec projet de continuer les tudes. Bien qu'il
n'tait, la Normale, de France que Paris, j'optais pour
Strasbourg attir par le Centre de gographie applique et
son meneur d'alors Jean Tricart. De longues heures passes
la bibliothque de l'Institut Franais d'Hati m'avaient
fait dcouvrir la rigueur des "Travaux pratiques de gographie", le potentiel d'utilisation de "L'piderme de la terre"
et la beaut plastique d'un "Relief de ctes". Il n'y avait pas
plus "terre --terre" pour se dmarquer des voltiges de nos
grilles d'analyses dans lesquelles, en cinq ans, l'aspect principal de la contradiction secondaire devenait immanquablement la contradiction principale la moindre divergence
avec l'interlocuteur... bref, que la gographie me paraissait,
lors, robuste de certitudes !
Je fis route pour Strasbourg, boursier de la France sur
rendement pour parchemin de l'cole Normale Suprieure,
heureux d'en dcoudre enfin et de prendre du recul. L'euphorie ne dura pas, le mythe s'estompa et la militance hatienne me rattrapa. Une intense activit politique des tudiants hatiens en Europe devait marquer mes quatre ans
passs en Alsace. Les factions politiques avaient fusionn
une fois le souffle repris l'extrieur. D'un bout l'autre
de l'Europe tous les noyaux d'tudiants s'agitaient en associations culturelles, et certains se prparaient activement
au retour clandestin au pays. La fin en fut tragique : 1969
marque l'hcatombe en Hati de toute la tentative de soulvement. Le centre d'intrt politique allait dfinitivement
quitter l'Europe pour Montral au moment o nous nous ap-
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
30
prtions y vivre dans l'attente d'un temps meilleur au retour.
C'taient aussi les belles annes de la gographie de
Strasbourg. Nous tions une bonne vingtaine d'trangers et
de "Franais-de-l'intrieur" avoir fait le voyage pour cette
renomme. Chacun tait ses tudes au point que mai 1968
m'a toujours paru quelque peu parachut dans ce petit monde qui s'accommodait bien de la gendarmisation. De certificats en scolarits de cycles je bouclai le circuit non sans
m'tre distanc de la physique de Tricart pour entendre
Juillard, magistral, sur son "Europe rhnane", Rimbert, capable de vous donner le got de la vraie cartographie, Gallais, suspectant toutes envoles, enseigner le corps corps
avec le touffu de la vie tropicale, dans la tradition de Gourou. L'amiti bonhomme de Claude Rgnier me retenait
l'Institut de dmographie o il me confia, en 1968-1969, un
enseignement d'analyse dmographique et de gographie de
population. Je terminai l'anne en juin par la soutenance du
troisime cycle sur "Contribution l'tude de la population
d'Hati, volution dmographique et rpartition gographique."
Cette thse doctorale n'innova pas en ce qu'elle tait
d'abord utile moi-mme. L'ampleur du sujet m'tait prtexte, dans "l'volution dmographique", initiation aux cinq
sicles de notre histoire en couvrant l'essentiel de la littrature qui lui tait consacre et, dans "la rpartition gographique", prtexte pour me pencher sur l'espace de chacune des paroisses de la colonie et de chacune des sections
rurales contemporaines. Le point de vue de population adopt comme fil conducteur avait l'avantage de prendre assise
sur ce qui tait, somme toute, le plus probable dans les don-
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
31
nes de ce pays. Mon mmoire de 1967 sur "L'tablissement
et l'interprtation des cartes de population" m'y prparait,
mais m'avait jet dans le trouble de la dcouverte des travaux amricains qui justement partaient des statistiques de
population pour prendre le dpart quantitatif qui allait dominer les annes 1970-1975. je me mis immdiatement en qute d'un post-doctorat McGill en finalisant les dpouillements de Moreau de Saint-Mry, la signification des densits aux diffrentes priodes tudies, un modle de la dynamique de diffusion de la population... le travail requis pour
ce niveau. Je devais en tirer deux articles plus tard, en faire
la base d'accumulation qui sous-tendra "L'espace hatien" en
1974, et les cartes fond de population de "L'atlas critique
d'Hati" en 1982. Quant aux grilles de l'analyse du changement socital, il y avait divorce entre les tudes et la pratique. Aucune jonction ne s'annonait et il semblait bien
l'poque que la gographie n'tait pas faite comme l'conomie ou la sociologie pour ce genre de considrations. Un gographe engag tait clairement un homme en deux morceaux
et ma conclusion qui tenta de les rapprocher a plutt donn
lieu ce morceau de bravoure qui n'chappa pas tienne
Juillard dans la soutenance.
Arriv ce point de la rdaction du discours de ce soir,
j'ai dcid de m'arrter pour relire d'une traite cette thse, ce que je n'avais pas fait depuis plus de dix ans. J'ai devant ce travail, en 1983, les mmes ractions que j'avais
eues la lecture du premier schma d'amnagement du territoire hatien publi par la DATPE (Division de l'amnagement du territoire et de la protection de l'environnement)
en mars 1981. Le Schma donne voir dans ses six parties le
potentiel d'analyse de cette nouvelle fourne de jeunes di-
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
32
plms, mais les assises thoriques, les objets d'tudes
choisis et les mthodes retenues pour chacune de ces parties ne sont pas articuls entre eux. Cette absence d'une
mme perspective directrice ancre dans les spcificits de
l'espace hatien renvoie, de faon gnrale, aux problmes
d'une premire gnration de chercheurs. Je dis souvent
que nous n'avons pas d'ans dans ce mtier de dire l'amnagement de notre territoire, d'o une trs nette difficult
nous brancher sur une manire ntre, lentement issue de la
confrontation collective des ides, d'aborder les particularits d'une situation puissamment originale. Les vrits de
manuels sont actuellement incapables de donner accs la
centralit des marchs hatiens ou aux virtualits des
bourgsjardins par exemple. Or, travailler en ce lieu du terrain, c'est d'abord accder aux mcanismes concrets de la
survie de pauvret chacune des chelles d'analyse dans
l'urbain, le rural, le rgional ; et s'carter de plus en plus du
survol des trop nombreuses expertises dont le pays fait
l'objet depuis l'aprs-guerre. Il faut oser pour tre nousmmes et pour animer un dbat d'orientation ! Cette publication, dont n'ont pas rougir les auteurs mme sous une
critique fermement contradictoire, aurait d faire l'objet
d'une discussion publique au pays et en diaspora, n'tait-ce
ce tirage d'une ou deux centaines d'exemplaires qui, toutes fins pratiques, en fait un indit. C'est aussi malheureusement le sort de la trentaine de thses que je connais sur
le thme, ou des thmes proches de l'amnagement du territoire hatien. Il faudrait que quelque chose change !
Je dbarque du Pouchkine Montral le 24 juin 1969,
jour de la Saint Jean-Baptiste, aprs une semaine en mer
faire le point : j'allais avoir 25 ans, parti pour tre gogra-
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
33
phe, comme il se dit au Qubec, viscralement accroch au
pays d'Hati, contraint une tape supplmentaire que nous
croyions passagre, sans emploi. La veille du dpart pour Le
Havre, une note de McGill me notifiait leur impossibilit de
donner suite aux engagements, pour cause, je l'apprendrai
vite, de graves incidents foments par des francophones,
des trangers, des noirs et des antillais. L'immigrant francophone noir hatien que j'tais relevait la fois de toutes
ces catgories. De l'apprendre, en ces termes, de la bouche
mme d'un gographe responsable de recherche McGill me
mit de plain-pied dans ce style direct du scholar des Amriques du nord. Je passais d'un monde de fleuret mouchet
un monde de sabre d'abordage.
L'Universit du Qubec Montral ouvrait ses portes
pour septembre. Le dpartement de gographie, mont de
toutes pices, se cherchait un gographe de la population
pour combler son treizime poste. J'y entrai. Le noyau
d'Hatiens m'accueillit dans un pique-nique o il fut question,
aprs les retrouvailles des anciens compagnons, de la dbcle sur le terrain et du projet de revue "Nouvelle Optique".
Sur Montral, certains d'Afrique taient revenus, d'autres
des Amriques taient monts, en rponse aux possibilits
d'enseigner dans un Qubec qui, depuis dix ans, dveloppait
avec vigueur un systme d'enseignement moderne.
Les universits du Qubec furent un champ clos privilgi
pour l'affrontement entre gographes "quantitatifs et qualitatifs" (sic) des annes 1970-1975, et un poste de vigie de
la parole diffrente des Amriques latines. C'tait, pour un
quinquennat, une place centrale du brassage des littratures
anglaise, franaise et espagnole, et un lieu de passage oblig
des participants aux dbats qui agitaient la premire moiti
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
34
de la dcennie. Fbrilement, l'UQAM fit trois ou quatre
ajustements de son programme de gographie, comme une
girouette en milieu de turbulence. C'tait la fte. Quelques
jeunes europens s'taient tablis dans la Province, et certains n'avaient d'yeux que pour le triomphalisme de l'analyse
multivarie ramener comme trophe d'un long voyage.
L'cole franaise de gographie, prise de court, eut un moment de dsarroi. La voix des radicaux tasuniens qui tonnait divergente tait encore couverte par le bruit de fond
de la vague dominante. Et les Amriques contestataires se
mobilisaient contre la guerre au Vietnam, pour le Chili de
Salvatore Allende. La socit qubcoise tint sa place dans
l'effervescence gnrale par la monte rgulire du parti
indpendantiste vers le pouvoir, les crtes d'octobre 1970,
et la focalisation des crits sur la question nationale. Le
dualisme battait de l'aile, la thorie de la dpendance s'affirmait et les analyses centre-priphries, leur dbut,
portaient promesse d'un dgel du marxisme.
Duvalier mourait en 1971, non sans avoir achev l'mondage qui rendait possible la succession de son fils mineur. Une
nouvelle optique se cherchait dans la critique radicale de "la
longue marche des dmocrates". L'action patriotique ne
semblait pas pouvoir dpasser la bruyante camaraderie des
assembles du dimanche pour s'inscrire dans le changement
souhait. La prsence internationale reprenait au pays aprs
le glacis ombrageux du pre. tudes de faisabilits, projets
de recherches, rapports d'expertise se culbutent pendant
que s'organisent les filires d'un sauvetage de masse qui
crera la diaspora et que se profile l'imperceptible dbut
d'un mouvement de retour de jeunes cadres. Montral, o se
fait battage de dnonciations internationales de la situation
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
35
qui dverse les boatpeople, est un temps, dans ce Qubec
rceptif, le ple de cristallisation. Autant pour Hati que
pour la gographie, 1975 est un tournant qui laisse le milieu,
essouffl, revenir au rythme d'avant les chauffoures.
C'est en carrefour de ces influences que se posait pour
moi le problme de faire gographie. Un temps d'accommodement devait me permettre de clarifier les positions de
chaque groupe d'intervenants. J'ai eu du mal saisir immdiatement les fondements de la nouvelle gographie ; le clinquant des techniques masquait tout en 1970, quand ce
n'tait pas une de ces nombreuses mises en application aux
prmisses incertaines et aux rsultats nafs. J'tais trop
habitu l'analyse sociale pour tre autrement que perplexe, et cependant assez conscient des ravages et de la
sclrose des dogmes pour ne pas faire tandem avec un collgue de l'autre formation. Une subvention conjointe pour
l'tude d'une tranche de population de Montral favorisa
cet apprentissage qui se fit soutenu jusqu'au dbut de 1972,
au moment o il me devint clair que la comprhension de la
dmarche descriptive formelle devait, par del les outils de
mesure, atteindre la thorie de la relation entre les phnomnes observs, ce qui en tait le fondement, et la capacit de dmonter les mcanismes de l'organisation d'un
espace, ce qui en tait la force. Je pouvais ds lors la rendre
opratoire tout en me dgageant des fausses querelles qui
ne pouvaient durer indfiniment ; en fait, seule la faiblesse
d'une thorie de l'espace gographique, donc la carence
d'un travail de dfinition du concept d'espace, alimentait
cette chicane des concepts drivs.
Il restait encore ces pauvres, ces priphriques, ces
sous-dvelopps, ces dpendants... de toutes les analyses de
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
36
changement socital pour qui l'espace n'existait pas, ou si
peu que rien, et seulement dans son sens commun. La jonction avait toujours du mal se faire ; les diffrentes manires de gographie critique se rclamant de la relation de
l'espace la socit comme proccupation premire commenaient peine. Ce champ particulier tait explorer.
C'est alors que rompant les attaches avec ce qui tait attendu d'un gographe devant faire carrire coups d'articles dans les revues jury, ou mme en m'exposant la grogne d'un certain nationalisme du cru, je fis option de prendre prtexte du cas hatien pour une descente la plus profonde en gographie sociale et pris prtexte de la gographie sociale pour atteindre au pays profond hatien. Les dix
annes qui allaient suivre auront t verses ce pari susceptible de rassembler mes diffrents morceaux parpills
sur des fronts diffrents. Il fallait commencer par rentrer
au pays. J'exposai, serein, mon projet en prenant cong des
proches, et je gardai prcieusement cette image prmonitoire d'mile Ollivier qui, lui, voyait dj la tribu dansant autour d'un bouillon -chercheur, comme dans les vieilles imageries coloniales.
L'insertion sur le terrain se fit naturellement dans le
monde enseignant o j'avais milit. je retrouvai anciens professeurs et collgues prts reprendre routes et sentiers
autrefois parcourus ensemble. On me fit place immdiatement, et c'est au Collge Saint-Pierre, o j'avais enseign,
que se tinrent les runions entre une quinzaine des professeurs de sciences sociales. Le travail tait la refonte des
manuels d'histoire, je promis d'en faire autant pour la gographie. Il faut dire qu'en Hati, l'enseignement est un canal
privilgi de la diffusion. L'animation culturelle d'une cer-
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
37
taine ampleur se faisait gnralement autour du matriel
scolaire. Je pressentais dj la difficult que j'aurais ici
faire comprendre qu'en Hati, un manuel tait le support
quivalant celui d'une revue, d'un essai, d'un reader par sa
porte et sa signification. Vouloir travailler en natif sur une
ralit de sous-dveloppement n'allait pas de soi ; c'tait
nouveau dans la communaut des "experts". Imbus des voies
royales de leur socit d'origine, tel me suggra une srie
d'articles dans de grandes revues, puis la direction de reader ; tel autre de tout privatiser pour une thse d'tat un
dixime de sicle plus tard... J'en fis la tte des miens,
proccup tout de mme de la lgitime attente du contexte
international.
Hubert de Ronceray devait grandement faciliter mes accs au terrain. Nous avions en estime ce jeune professeur,
de la Normale de 1962, qui, sans protection particulire en
ce temps, avait eu le simple courage d'une oreille favorable
des problmes d'organisation de notre vie estudiantine,
tranchant ainsi de la tremblote ou de l'indiffrence qui gagnaient du terrain. C'est naturellement vers lui que je me
tournai en 1972 et 1974 pour utiliser la logistique de son
centre de recherches. Encore une fois, mes expectatives ne
furent pas dues.
L'immersion en didactique m'amena, aux E.U.A., voir ce
qui se faisait dans le moment. "L'espace hatien", "Mon pays
d'Hati" et le guide du matre "La gographie et son enseignement" devaient essayer de tmoigner de ce point d'quilibre entre les attentes de l'intrieur et les exigences de
l'extrieur. Ces publications s'chelonnrent sur trois ans,
de 1974 1977, accompagnes de toute une gamme d'outils
que les mdias modernes rendaient possibles pour favoriser
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
38
leur implantation. La gnrosit de la critique internationale
me soulagea de l'inquitude d'avoir os ne pas prendre les
chemins classiques et l'effervescence de leur mise en application concrte attnua mes craintes d'tre trop en dcalage de la ralit hatienne. Il me restait faire face de redoutables problmes thoriques auxquels je n'avais apport
que des rponses incompltes sous l'apparente simplicit
pdagogique du discours.
En 1978, les temps avaient chang. La campagne des
droits de l'homme du dmocrate Carter allait obliger la dictature une rpression moins aveugle. Dans cet entrebillement devait s'engouffrer une prise de parole publique des
mdias qui redonnait l'initiative la militance au pays. Les
manuels taient de plus en plus utiliss d'autres fins que
pdagogiques et leur systmatique traduction et adaptation
en crole leur ouvrait d'autres perspectives. Contraint cependant ne plus rentrer en Hati, je courais les lieux de
notre diaspora pour reconstruire, avec l'aide des diffrentes strates sociales, les lments et conditions de leur vcu.
Cette contrainte de dpart se rvla d'une fcondit inattendue par la leve des obstacles de communication. Le marronnage permanent de la parole s'estompait une fois hors de
porte du caporalisme et de la macoutisation des campagnes
et des bidonvilles. Il devenait possible d'accder ainsi, et
bien mieux qu'au pays, aux rapports qu'entretenait chaque
classe avec l'espace. De rentrer plus profondment en Amrique latine et dans la Carabe, de passer par l'Afrique et
l'Ocan Indien et surtout de progressivement affiner mon
observation du Qubec dans mon enseignement et la direction de mmoires, j'ai trouv confirmation que la construc-
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
39
tion d'espace varie toujours d'une classe l'autre ; ce qui a
fini par d-naturaliser l'objet d'tude. C'tait peut-tre la
bonne voie que de continuer questionner la gographie
d'Hati jusqu' dboucher sur l'abstraction qu'est l'espace.
Aux difficults normales de toutes investigations, s'ajoutent, pour ma gnration de chercheurs, des embarras ns
d'une situation toute nouvelle. Beaucoup de conflits, aux
formes les plus inattendues, sont replacer dans le cadre
global de la fin d'une hgmonie. La Carabe, Hati, jusqu'aux
annes 1960, avaient donn lieu des travaux d'experts
trangers dont chacun, dans sa socit d'origine, tait devenu le spcialiste de son champ. Une transformation s'est
opre par l'accs d'un assez grand nombre d'originaires de
ces socits aux tudes suprieures dans pratiquement tous
les centres trangers des Europes et des Amriques. Ces
natifs commencent alors parler aussi, leur ralit n'est plus
exclusivement dite par l'autre. Les jeunes spcialistes
trangers n'ont plus vraiment, comme leurs ans, la possibilit de s'adjuger exclusivement la reprsentation d'un domaine, ni mme de s'assurer facilement une voix dterminante. la suite de plusieurs pays des Amriques, des antagonismes s'exacerbent actuellement dans pratiquement toutes les les et dans tous les champs d'tudes des sciences
humaines, au point que depuis les annes 1980, nous assistons, de colloques en colloques, des prises de positions qui
renverraient, dans la formulation motive des premiers moments de tout conflit n d'une conjoncture nouvelle, des
pratiques scientifiques natives qui seraient opposer des
pratiques scientifiques trangres. Il apparatra probablement assez vite que l'affirmation d'une diffrence dans la
manire de dfinir l'objet d'tude, la mthode de sa
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
40
connaissance, les concepts de son expression dpendent de
l'option de construire le rel par l'coute des multiples formes et structures, de rsistances et de survie, de la pauvret, ou du dploiement d'un construit qui n'en tient pas
compte. Dans ce dernier cas, le verbe peut tre aussi gnreux ou dnonciateur qu'il le veut, il renvoie une inefficacit d'oprationnalisation dmocratique. La coupure ne serait donc pas entre trangers et natifs, quoique la nouvelle
perspective soit plutt ne du travail des seconds dans la
Carabe.
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
41
loge de la pauvret
3. Applicabilit
Retour la table des matires
Le moment est venu de dire ce qu'il y a dans la pauvret
qui puisse nous amener au dsenveloppement, rpondant ainsi
la dernire attente, celle de l'applicabilit de mes proccupations. Il me faut la fois dborder mes dernires publications en y extrayant ce qui permet de proposer une manire de penser l'alternative d'un projet de socit, et la fois
m'appuyer fermement sur l'ensemble de mes publications
(dans l'esquisse de construction) pour tre en prise sur le
rel. L'applicabilit serait en somme l'expos d'un mode
d'utilisation possible des travaux. Mais avant, je vous dois
aussi, puisque la carte est au centre de la fte de ce soir, un
abrg de mon itinraire sur la carte.
La forme d'atlas que je voulais donner aux discours allait
tre longue prparer, mais il tait intressant de tenter
une rnovation de la carte, l'outil par excellence du gographe. J'avais, comme tout le monde, toujours t impressionn par la dmesure des forces matrielles et humaines jetes dans la confection d'atlas et la difficult pour la discipline d'habiter ce support d'hypothses et de dmonstrations d'hypothses. Mon intrt pour la smiologie graphique
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
42
tait rest constant dans une qute pour dborder le dessin
et la transcription descriptive des donnes. Le dveloppement d'envergure auquel j'assistais en Amrique me parut
surtout d'ordre technique ; c'tait celui d'une plus grande
automatisation, d'un raffinement de la thmatisation et
d'un esthtisme de l'excution. L encore, les termes employs jouaient d'obstacles et la cartographie thorique
n'tait pas plus la thorie de la cartographie que la gographie thorique n'tait la thorie de la gographie. La carte,
pouvait-elle rendre compte des hypothses et des thses et
raliser leurs dmonstration et vrification ? En somme,
nouvelle conception d'espace, nouvelles cartes !
"L'atlas critique d'Hati" parat en 1982 en tant qu'essai
la croise des proccupations disciplinaires de la gographie contemporaine et du questionnement sur une possible
alternative hatienne de dsenveloppement. Cette publication s'accompagnait de "Espace et libert en Hati", un ensemble d'interventions ralises de 1977 1981 pour situer
le travail en faisant accder aux tapes de sa maturation et
"Hispaniola", la murale de validation des thses (nes de
l'approfondissement du cas hatien) par leur mise l'preuve en Rpublique Dominicaine. Cette triade nous permettait
de formuler une perspective de dsenveloppement base
prioritairement sur les savoir-faire et les structures locales
de la pauvret en prenant distance des transferts de tous
ordres prns par les conceptions actuelles. Ce "raccourci",
comme nous l'avons appel, fait au concept d'espace de la
gographie une place aussi dterminante que les concepts
centraux des autres sciences humaines pour la libration de
l'homme hatien et l'enrichissement des rapports sociaux.
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
43
Depuis plus de dix ans je trane la mme question : Comment expliquer que 80% de cette population soit encore en
vie ? Ma rponse de ce soir est qu'il n'est d'autres ressources de ce peuple que le peuple lui-mme. Offrons donc une
mise en application de cette reconnaissance de l'Homme et
de la Femme comme fondements minents du devenir. La
premire tape de la reconqute de la dignit perdue est
l'autonomie alimentaire, en quantit et en qualit suffisantes, pour tous en gnral et pour chacun en particulier. C'est
elle qui mettra fin la dgradante mendicit actuelle, d'un
pays l'chelle internationale et des dmunis l'chelle nationale. Que ce soit avec lgance ou vulgarit, de manire
directe ou symbolique, la main tendue le kwi (la sbile) au
bout s'est superpose nos armoiries d'autrefois qui disaient quand mme la libert conquise ! Y revenir est
concrtement notre porte.
la base il y a le compagnonnage, cette mthode pour tirer parti d'une exploitation par l'utilisation optimale des
conditions matrielles et humaines de la vie paysanne. La notion de compagnonnage recouvre d'abord les multiples combinaisons de plantes concurremment en croissance pour tre
capables de fournir le flux le plus rgulier possible de produits tout au long de l'anne. La notion recouvre ensuite
cette complmentarit entre ressources animales (le porc
rustique et prolifique est essentiel au systme par sa triple
fonction de conservation du bois fruitier, d'apport nutritionnel et de capitalisation) et la production d'autres parcelles diffremment utilises pour atteindre l'objectif de garantir des alas du march et de la nature par la minimisation des risques et le renforcement de la scurit, au ras
des seuils de survie. Cela fait dix ans que l'on s'est mis
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
44
dcouvrir la logique profonde de cette mthode qui a travers, avec les adaptations ncessaires, l'Histoire, de la place--vivres de l'esclave aux jardins actuels. Mais, la pauvret a fait place la misre quand la prcarit du rapport la
terre n'a pu garantir la reproduction du systme. Ce n'est
donc pas au niveau des techniques, certes amliorer, que
se place le goulot d'tranglement, ni dans un remembrement
du parcellaire assurment sans objet, mais au niveau du
droit la terre.
La stabilisation du foncier doit resurgir des spcificits
du compagnonnage comme pattern aux nombreuses variations d'application dans les diffrentes niches cologiques
et sociales. Le droit la terre, et l'imprescriptible garantie
de ce droit la terre, serait ainsi pens partir d'un systme toujours/dj matris, le compagnonnage. Ce repositionnement de la question agraire doit s'appliquer quatre
situations diffrentes : le parcellaire des mornes, le domaine de l'tat reconstituer et viabiliser, les grandes proprits de zones irrigues et les localits affranchies Au
pluvial (la gestion de l'eau est tout aussi fondamentale que le
foncier dans une rforme agraire). Il faut clairement que le
travailleur de la terre en soit le premier bnficiaire ou par
statut de propritaire, ou par quote-part prpondrante,
dans des units viables que son savoir-faire peut faire valoir.
Les fermes paysannes de base ne sont pas et n'ont jamais
t isoles. Les dveloppements de la notion de bourg-jardin
essayent de rendre justice leurs modalits particulires
d'articulation. C'est le premier niveau d'agrgation au pays,
celui de la prise en main du rural (qui n'est pas seulement
l'agricole) par lui-mme ; et donc le niveau privilgi pour
penser l'intervention des services, l'animation d'changes
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
45
de services galitaires (et non plus d'exploitation) dans les
associations de travail, de la participation la chose publique, de la mobilisation pour des ouvrages productifs d'intrt collectif. Le bourg-jardin est le noyau de base, agglomration de moins de mille personnes lies par le classique rseau des relations de communaut. Le symbolique et l'imaginaire, le politique et l'conomique tissent les entrelacs de ce
noyau capable de fonctionner la rsistance aux prlvements de rentes, de profits, d'usures, pour la couverture
d'un pourcentage lev de l'alimentaire national, tout en dgageant l'pargne ncessaire au relvement du niveau de vie
et au besoin de liquidit pour la culture des espces haute
valeur marchande et forte valeur nutritive comme le pois et
les ignames.
Le bourg-jardin a un centre, c'est le march pour lequel
les efforts actuels tendent dbroussailler la complexit
des dimensions de centralit. C'est le carrefour (en crole
carrefour renvoie un sens fort du vodou) d'une dizaine de
bourgs-jardins qui convergent une ou deux fois par semaine
pour habiter ce centre d'changes et de communications
multiples. La notion de madan sara (ou celle de spculateur)
ne renvoie pas seulement l'agent de la circulation des produits mais encore la hirarchie des agents et aux mcanismes des prix, ce qui permet d'accder l'organisation
structurelle des circuits que compltent l'analyse de la finalit des types de prlvements et l'organisation spatiale des
circuits ; c'est cela la logique des graphiques qui flanquent
chaque carte pour donner un sens reli au pays profond hatien ; j'en ai abondamment dvelopp les fondements dans
mes textes. Les quelque 500 marchs sont ainsi tous en articulation par un systme de commercialisation, tout aussi
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
46
endogne que le compagnonnage ou le bourgjardin, secrt
par trois sicles d'adaptations de pauvret.
Ce que nous rvle en somme cette lecture concrte
d'une situation concrte et originale de la Carabe, c'est la
logique du systme des savoir-faire de la ferme de base, de
son mode d'agglomration en bourg-jardin et du march, pivot de son articulation l'ensemble national englobant. Ces
trois lments permettent de penser la politique agraire
dans sa totalit d'une rforme imprieuse aux finalits
d'auto-suffisance alimentaire, avec le statut de priorit
l'agraire et au rural comme moteur du dsenveloppement.
Les techniques, les mthodes et les modes sont dj matriss par ceux qui devront en assumer la marche.
Une civilisation de la pauvret est en train de mourir par
sa rgression dans la misre, mais son accumulation de trois
sicles de savoir-faire de dernire paysannerie de la Carabe
est encore l, rsistant au gnocide et prte s'activer
pleinement ; mais pour combien de temps encore ? C'est ce
potentiel qu'analysent longuement textes et cartes de dcembre 1982.
Et tout le reste ? me dira-t-on. Il y est aussi, mais dcoulant de la priorit de faire du monde actuel des marginaliss
du rural et de l'urbain l'intersection de toutes les pratiques
sociales, politiques et conomiques d'une phase de transition
vers la pauvret, et, plus tard, par del la pauvret. C'est le
mode de penser l'alternative qui fournit les outils conceptuels et matriels du positionnement d'une industrialisation
au service des priorits agricoles (l'actuelle industrie d'assemblage ne sera jamais qu'un substitut de saupoudrage salarial de zones franches, aux effets d'entranement faibles
(trs faibles !), malgr ses 50 000 emplois urbains), d'une
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
47
urbanisation drive des modalits de consolidation des
bourgs-jardins, d'une rgionalisation rendre obsde par
son projet d'articulation des marchs aux bourgs et villes,
d'une dcentralisation de la prise en charge du local par luimme, d'une dmocratisation de l'autonomie retrouve de
ces noyaux urbains et ruraux, d'un service de travaux publics rorienter, plus sur les liaisons internes des rgions
que sur les grands axes routiers, sur l'hydraulique des
bourgsjardins et la rfection des chevelus d'eau, sur le cadre bti des services publics aux bourgs-jardins, marchs,
bourgs, petites villes des provinces, etc.
Je parle d'un pays de cinq cents marchs, de cinq mille
bourgs-jardins, de cinq millions de marginaliss, et aux trois
paliers de cet ordonnancement, j'ai vu, avec beaucoup d'autres (car nous sommes nombreux avancer maintenant dans
le mme sens), les savoir-faire de pauvret de tout un peuple prt se prendre en main ; j'ai vu le potentiel de complmentarit d'une diaspora dont les possibles liaisons sont
encore creuser par del la mobilisation des normes transferts des fins productives et de rserves de devises (je
continue plaider pour l'imagination et la crativit ncessaires l'utilisation intelligente, un jour, du potentiel des
comptences de la diaspora) ; j'ai vu un tat qui est un rapport de force a crer pour que soit possible un renversement de sens dans les changes d'importation et d'exportation, les faisant passer de lieux d'extorsions en lieux de ngocia tion internationale du ncessaire pour le prioritaire.
L'indispensable intervention de l'tat doit garantir les rgulations d'une conomie politique du rural en charge de luimme, et d'une conomie politique de l'urbain au service du
premier. L'tat du dsenveloppement de pauvret n'est pas
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
48
une sincure (fonction publique repenser en termes de
services rellement ncessaires et gratuits d'arpentage, de
notariat, de sant, d'coles...), mais l'outil du contrle politique et de la gestion conomique de l'alternative, avec son
train de mesures drastiques, incitatives ou coercitives ; le
principe de 1 alignement de la taxation des hauts revenus,
des profits et de l'immobilier sur les niveaux des prlvements subis par les producteurs de caf conscientiserait
immdiatement !
Le dsenveloppement je crois l'avoir suffisamment illustr pour chercher maintenant cerner sa formulation. Je la
relierais d'abord aux ressources de la pauvret par la technique dj matrise, par la prise en charge de soi, puisque
non dpendant de transferts d'un quelconque ordre, par la
dmystification des capitaux qui ne sont plus l'essentiel, par
l'activation d'institutions locales puisque le pouvoir symbolique et bien rel du savoir comment faire est domestiqu depuis longtemps. Et l'on voit clairement le statut btir au
crole, langue du dsenveloppement, aux coutumes, la musique locale, aux croyances, aux arts et aux autres sdimentations qui sortent du mme creuset qui nous a donn la cl
de la chane qui relie le campagnonnage des exploitations aux
bourgsjardins de communaut, aux marchs centres, la
commercialisation de madan sara et de spculateurs (
contrler), la distribution des produits manufacturs, aux
artisanats de valorisation et de substitution locale (et non
plus de tourisme), au dgagement de l'pargne pour l'investissement et les services, etc. Je fais simplement remarquer
le statut dj primordial de la femme dans la matrise de
ces savoir-faire de la production, de la commercialisation, de
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
49
la distribution. L'originalit en puissance de cette condition
fminine de la pauvret me semble un des points forts du
dsenveloppement. On ne se dveloppe jamais d'en haut par
l'impossible transplantation de capitaux, de technologies,
d'institutions d'un autre monde, mais on se dsenveloppe de
tout cela par soi, par ses institutions, sa technologie, ses capitaux, quitte acclimater ce qui, venant d'ailleurs, parat
ncessaire. Le dsenveloppement ne serait-il pas finalement
ce "reCours aux sources" par le bon usage des richesses de
la pauvret ? Et, pour serrer encore plus la formulation : le
dsenveloppement c'est le processus d'accs de chacun la
pauvret du ncessaire pour construire la richesse nationale
collective. Je n'ai pas oubli qui j'avais livrer la marchandise. cette relve aux tudes, ou en tout dbut de
pratiques, il me semble enthousiasmant de proposer que l'on
se mette au travail pour redfinir contenus de cours et
orientations de travaux, dans une "r-invention" de nos mtiers, pour qu'ils soient au service de ce possible, en situation de dialogue avec les marginaliss porteurs des savoirfaire et non plus en position d'autorit traditionnelle. Ce serait la prise en compte de toutes les pratiques urbaines et
rurales de rsistance et de survie de la pauvret pour en
extraire les savoir-faire et les accumulations qui serviront
au nouveau dpart. Il ne faut pas que la pratique du terrain
soit dvoye par un faire de colonies de vacances ; c'est la
charnire des mtiers, celle qui permet le dpassement de
ces compilations de bribes pour atteindre fermement au primat de la thorisation, de la problmatique construite sans
complaisance, pour fabriquer, par les concepts et la mthode, ce levier indispensable, spcifiquement et concrtement
coll au rel. Tous nos bacheliers en savent assez d'Archimde disant : "Donnez-moi un point d'appui et je soulverai
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
50
le monde" pour comprendre que le ntre pourrait tre les
ressources de la pauvret.
Que la fte de la collaboration avec l'autre souscrivant
nos priorits, soit aussi ! Il est probable que l'on doive
compter avec des solidarits agissantes et il est dj certain que notre long "ctoiement" de la prsence trangre
nous arme pour dpartager les compagnons de route du dsenveloppement des sous-dveloppeurs. Personne ne peut
nous faire cadeau d'une alternative, mais plusieurs peuvent
nous aider y parvenir, en prenant garde, quand mme, que
les actions caritatives ne dpriment le march intrieur (
protger) comme les "PL.480" et autres "food for work".
Nous n'avons, de plus, personne rattraper ou imiter dans
cette Carabe, mais nous, femmes et hommes d'Hati, pouvons marcher ensemble avec eux, dans la mme direction
d'une qute d'alternatives, en suivant notre propre chemin
de dsenveloppement, notre propre rythme.
Je ne ferai pas semblant d'ignorer que de violents rejets
de cette parole ne soient, ou ne seront pas. Puis-je dire que
je crois mme que rien n'annonce l'imminence d'un temps
nouveau. Et qu'importe finalement la longueur du chemin et
ses risques, si c'est la bonne direction ! Suis-je vraiment sr
que ce soit le bon cap ? En toute honntet je rpondrais
"peut-tre" (et c'est cela le pessimisme de l'intelligence),
mais il vaudrait vraiment la peine de le tenir jusqu'au bout
(et c'est cela l'optimisme de la volont).
J'ai commenc ce discours en citant Bachelard : "Nous
serons unis dans la preuve, ds que nous aurons la garantie
d'avoir pos le mme problme." C'tait en hommage Yves
Montas qui passa les dernires annes de sa vie dsesp-
Georges Anglade, LOGE DE LA PAUVRET (1983)
51
rment me traquer pour que j'arrive "poser le problme"
pour qu'il devienne enfin le "mme problme" d'un nombre
croissant de personnes. notre dernire rencontre, justement la fin de l'anne dernire, il m'a dit, en me quittant,
quelque chose d'une chanson brsilienne " fredonner tout le
temps, tout le temps" : si l'on est seul rver, on reste dans
le rve, si nous rvons ensemble, peut-tre arriverons-nous
nous rveiller !
Fin du texte
Vous aimerez peut-être aussi
- Dider AdjectifDocument13 pagesDider AdjectifAnonymous MlhE2sa33% (3)
- Chapitre 6 Comment Devenons-Nous Des Acteurs SociauxDocument8 pagesChapitre 6 Comment Devenons-Nous Des Acteurs SociauxmayaPas encore d'évaluation
- LVA N°21 - Le Dynamisme Associatif: Un Atout Pour Les TerritoiresDocument36 pagesLVA N°21 - Le Dynamisme Associatif: Un Atout Pour Les TerritoiresLe Mouvement associatifPas encore d'évaluation
- Comprendreautrecultl PDFDocument5 pagesComprendreautrecultl PDFAriëlle RakotoarimananaPas encore d'évaluation
- Aider Les Élèves en DifficultéDocument194 pagesAider Les Élèves en Difficultécamli kamlicius100% (2)
- La Communication Non ViolenteDocument1 pageLa Communication Non Violentenatacha DeerPas encore d'évaluation
- Le Controle Des RumeursDocument21 pagesLe Controle Des RumeursAlainzhuPas encore d'évaluation
- Dieu Cet Archetype Inconnu - RiviereDocument6 pagesDieu Cet Archetype Inconnu - RiviereDavide DelbonoPas encore d'évaluation
- 136 DUBAR Et GADÉADocument12 pages136 DUBAR Et GADÉAHerbert MeadPas encore d'évaluation
- L'engagement Associatif PDFDocument4 pagesL'engagement Associatif PDFLe Mouvement associatifPas encore d'évaluation
- Culte Du CorpsDocument2 pagesCulte Du CorpsNguyễn Văn ToànPas encore d'évaluation
- Zaina Myriam UccDocument67 pagesZaina Myriam UccEmmanuel100% (1)
- Au chevet de nos soins de santé: Comment les améliorer sensiblement ?D'EverandAu chevet de nos soins de santé: Comment les améliorer sensiblement ?Pas encore d'évaluation
- Un projet de décroissance: Manifestation pour une Dotation Inconditionnelle d'AutonomieD'EverandUn projet de décroissance: Manifestation pour une Dotation Inconditionnelle d'AutonomiePas encore d'évaluation
- Avec la pandémie de la Covid-19 et après ? - Volume 2: Retour au monde d’avant ? Adaptation au monde actuel ? Ou amorce d’un monde nouveau ?D'EverandAvec la pandémie de la Covid-19 et après ? - Volume 2: Retour au monde d’avant ? Adaptation au monde actuel ? Ou amorce d’un monde nouveau ?Pas encore d'évaluation
- Euthanasie Et Religion PDFDocument2 pagesEuthanasie Et Religion PDFJeremyPas encore d'évaluation
- 9782717832310Document84 pages9782717832310Emmanuel SiePas encore d'évaluation
- Onze défis à relever pour mieux vivre dans le monde d'aujourd'huiD'EverandOnze défis à relever pour mieux vivre dans le monde d'aujourd'huiPas encore d'évaluation
- Le Concept de Généalogie de NZDocument18 pagesLe Concept de Généalogie de NZDavid Antonio BastidasPas encore d'évaluation
- (Dés)équilibres: L'informatisation du travail social en justiceD'Everand(Dés)équilibres: L'informatisation du travail social en justicePas encore d'évaluation
- Directives Anticipées Pour La Fin de VieDocument11 pagesDirectives Anticipées Pour La Fin de VieMarina CabitenPas encore d'évaluation
- Projet Miriam Cpas de La LouviereDocument31 pagesProjet Miriam Cpas de La LouviereJaphet AnafakPas encore d'évaluation
- Croyances Et MaladiesDocument13 pagesCroyances Et MaladiesJodel PierrePas encore d'évaluation
- Serge Mbarga Owona - Quel Cameroun Pour Nos Enfants?Document102 pagesSerge Mbarga Owona - Quel Cameroun Pour Nos Enfants?Serge Mbarga OwonaPas encore d'évaluation
- Pourquoi Les Monnaies Complémentaires Sont-Elles Nécessaires À La Stabilité Économique ? La Preuve Scientifique.Document23 pagesPourquoi Les Monnaies Complémentaires Sont-Elles Nécessaires À La Stabilité Économique ? La Preuve Scientifique.user909Pas encore d'évaluation
- Le Concept de Problème SocialDocument12 pagesLe Concept de Problème SocialChrisline Petit-FrerePas encore d'évaluation
- Divers PoèmesDocument102 pagesDivers PoèmesPaskytorPas encore d'évaluation
- AlzheimerDocument77 pagesAlzheimerErns Jean-baptiste100% (1)
- Sexualite Cancer FemmeDocument28 pagesSexualite Cancer FemmeAnouar Aleya0% (1)
- La Mort Présentée Aux Enfants Dans Les Albums de JeunesseDocument147 pagesLa Mort Présentée Aux Enfants Dans Les Albums de Jeunessemag92_Pas encore d'évaluation
- Séance 9 L'accompagnement Des Personnes en Fin de VieDocument22 pagesSéance 9 L'accompagnement Des Personnes en Fin de VieKERARMICHAIMAEPas encore d'évaluation
- HAE Cours 2Document63 pagesHAE Cours 2PierreEustachePas encore d'évaluation
- Déclaration universelle des droits de l'humanité: Commentaire article par articleD'EverandDéclaration universelle des droits de l'humanité: Commentaire article par articlePas encore d'évaluation
- Le Créatorat: Un nouveau paradigme pour la vie en sociétéD'EverandLe Créatorat: Un nouveau paradigme pour la vie en sociétéPas encore d'évaluation
- La Revanche Des Contextes Des MesaventurDocument31 pagesLa Revanche Des Contextes Des MesaventurpvanycPas encore d'évaluation
- Le Migrant Connecté - POUR UN MANIFESTE É PIST MOLOGIQUEDocument15 pagesLe Migrant Connecté - POUR UN MANIFESTE É PIST MOLOGIQUEBianca ChizzoliniPas encore d'évaluation
- AcculturationDocument5 pagesAcculturationArno PatyPas encore d'évaluation
- Covid-19: La Réponse Des Plateformes en Ligne Face À L'ultradroiteDocument68 pagesCovid-19: La Réponse Des Plateformes en Ligne Face À L'ultradroiteFondapolPas encore d'évaluation
- Les Règles de la méthode sociologique d'Émile Durkheim: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLes Règles de la méthode sociologique d'Émile Durkheim: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Approche Critique Et ConstructivisteDocument13 pagesApproche Critique Et ConstructivisteSalih SaddekPas encore d'évaluation
- Enjeux Et Défis Des Migrations InternationalesDocument30 pagesEnjeux Et Défis Des Migrations InternationalesCheck Jean Patrice SyllaPas encore d'évaluation
- Le droit à la paresse - Réfutation du «droit au travail» de 1848D'EverandLe droit à la paresse - Réfutation du «droit au travail» de 1848Pas encore d'évaluation
- Cultures Et InterculturelDocument12 pagesCultures Et Interculturelcoopinteragri5962Pas encore d'évaluation
- Lidéologie Managériale Comme Perversion Sociale Gaulejac VincentDocument19 pagesLidéologie Managériale Comme Perversion Sociale Gaulejac VincentnouhaPas encore d'évaluation
- L’innéité aujourd’hui: Connaissances scientifiques et problèmes philosophiquesD'EverandL’innéité aujourd’hui: Connaissances scientifiques et problèmes philosophiquesPas encore d'évaluation
- Antiéconomie - André Gorz Et La Critique de La ValeurDocument5 pagesAntiéconomie - André Gorz Et La Critique de La Valeurnope100% (1)
- These Laila Salah Ed DineDocument479 pagesThese Laila Salah Ed DineJoshua CarrPas encore d'évaluation
- Au Larmes CitoyensDocument4 pagesAu Larmes CitoyensKimaali6100% (1)
- Individu Et CommunauteDocument11 pagesIndividu Et CommunautemokurenPas encore d'évaluation
- La morale humaine et les sciences: Sciences et philosophieD'EverandLa morale humaine et les sciences: Sciences et philosophiePas encore d'évaluation
- Le travail et nous: Historiette et textes courts pour relativiser la valeur "Travail"D'EverandLe travail et nous: Historiette et textes courts pour relativiser la valeur "Travail"Pas encore d'évaluation
- Émile Durkheim - Origine Du Mariage Dans L'espèce Humaine D'après Westermarck (1895)Document22 pagesÉmile Durkheim - Origine Du Mariage Dans L'espèce Humaine D'après Westermarck (1895)RockandoperaPas encore d'évaluation
- Réponses À Badiou (2022)Document17 pagesRéponses À Badiou (2022)LIB TROPIQUESPas encore d'évaluation
- Jean BaptisteRivoire LElyseeetlesoligarquescontrelinfoDocument136 pagesJean BaptisteRivoire LElyseeetlesoligarquescontrelinfoMichael Arx100% (1)
- Rapport Sur La Reforme de L'asile PDFDocument394 pagesRapport Sur La Reforme de L'asile PDFLui Président0% (1)
- Cours - de La Societe Industrielle A La Societe de CommunicationDocument5 pagesCours - de La Societe Industrielle A La Societe de Communicationtiffanylaux7622Pas encore d'évaluation
- Mémoire Anjelo Maindelson JOSEPH - Les Petites CantinesDocument90 pagesMémoire Anjelo Maindelson JOSEPH - Les Petites CantinesMendhelson JosephPas encore d'évaluation
- Guide Pratique de La Procedure D'Asile en BelgiqueDocument72 pagesGuide Pratique de La Procedure D'Asile en BelgiqueDavid OrozcoPas encore d'évaluation
- 12 - Andriamialymasiharivlo - SOCIO - M2 - 13Document122 pages12 - Andriamialymasiharivlo - SOCIO - M2 - 13Andry RijaPas encore d'évaluation
- Secret Professionnel Et Travail Social (Extrait)Document3 pagesSecret Professionnel Et Travail Social (Extrait)CéliaCarpayePas encore d'évaluation
- Corpus ConformismeDocument5 pagesCorpus Conformismestanic jeremyPas encore d'évaluation
- Cheminer Avec Le ConflitDocument201 pagesCheminer Avec Le Conflitzao1020004497Pas encore d'évaluation
- Edification de La Paix - Manuel Caritas PDFDocument264 pagesEdification de La Paix - Manuel Caritas PDFMadouces100% (1)
- Etude de Cas Ferme AgricoleDocument41 pagesEtude de Cas Ferme Agricolezao1020004497Pas encore d'évaluation
- Comprendre Le Développement HumainDocument64 pagesComprendre Le Développement Humainzao1020004497Pas encore d'évaluation
- 15 La Resolution de ConflitsDocument24 pages15 La Resolution de Conflitsopaze45Pas encore d'évaluation
- Formulaire Demande Code Barre GS1 SénégalDocument4 pagesFormulaire Demande Code Barre GS1 Sénégalzao10200044970% (1)
- Rôle de La Société Civile Dans La Prévention Des Conflits, Les Expériences Ouest-AfricainesDocument10 pagesRôle de La Société Civile Dans La Prévention Des Conflits, Les Expériences Ouest-Africaineszao1020004497Pas encore d'évaluation
- Marketing en Environnement IslamiqueDocument233 pagesMarketing en Environnement Islamiquezao1020004497Pas encore d'évaluation
- Gestion Des StocksDocument55 pagesGestion Des Stockszao1020004497100% (1)
- Route UrsDocument270 pagesRoute Urszao1020004497Pas encore d'évaluation
- SCMDocument65 pagesSCMzao1020004497Pas encore d'évaluation
- Jus Post BellumDocument16 pagesJus Post Bellumzao1020004497Pas encore d'évaluation
- Guide Redaction V2004Document73 pagesGuide Redaction V2004Guettafi NassimPas encore d'évaluation
- Enseigner Le Français Du Tourisme Sem 2 V2Document1 pageEnseigner Le Français Du Tourisme Sem 2 V2DjamilDjimiPas encore d'évaluation
- UFR SEN - EC Libres 2013-2014 - 5eme SemestreDocument4 pagesUFR SEN - EC Libres 2013-2014 - 5eme SemestreUniversité des AntillesPas encore d'évaluation
- Guide Mes Rituels en Lecture Niveau 6Document168 pagesGuide Mes Rituels en Lecture Niveau 6youssef chadimiPas encore d'évaluation
- Plaquette Petite EnfanceDocument3 pagesPlaquette Petite EnfancebkajjiPas encore d'évaluation
- 9789953312699 (1)Document19 pages9789953312699 (1)Miha KhPas encore d'évaluation
- Les Enjeux de La Patrimonialisation Entre Discours Et RéalitéDocument16 pagesLes Enjeux de La Patrimonialisation Entre Discours Et RéalitéOuahid AbdouhPas encore d'évaluation
- Aires (5ème)Document3 pagesAires (5ème)MATHS - VIDEOSPas encore d'évaluation
- Global Politics Paper 1 HLSLDocument7 pagesGlobal Politics Paper 1 HLSLNehir TükenmezPas encore d'évaluation
- Heidegger Kierkegaard PinatDocument7 pagesHeidegger Kierkegaard PinatEtienne PinatPas encore d'évaluation
- S1 Ecrits TechniquesDocument785 pagesS1 Ecrits TechniquesJaime Iván Hernández España100% (2)
- Calendrier Universitaire UT2J 2022-2023 Adopté en CFVU Et CADocument1 pageCalendrier Universitaire UT2J 2022-2023 Adopté en CFVU Et CAnine oarfishesPas encore d'évaluation
- Fiche de DictéeDocument1 pageFiche de DictéemimiPas encore d'évaluation
- Rapport Tap DefDocument301 pagesRapport Tap DefMarc SatuPas encore d'évaluation