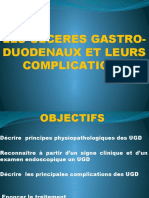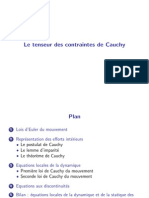Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Astra 12005 Tirantsdancrage2007v311 PDF
Astra 12005 Tirantsdancrage2007v311 PDF
Transféré par
SalimTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Astra 12005 Tirantsdancrage2007v311 PDF
Astra 12005 Tirantsdancrage2007v311 PDF
Transféré par
SalimDroits d'auteur :
Formats disponibles
Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des routes OFROU
Directive Édition 2007 V3.11
Tirants d'ancrage
ASTRA 12005 ASTRA OFROU USTRA UVIAS
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
Impressum
Auteurs / groupe de travail
Jeanneret Alain (OFROU N-SFS, président)
Schuler Willy (OFROU N-SFS)
Matt Peter (Ingénieur-conseil)
von Matt Ueli (Bureau d'ingénieurs, élaboration)
Sous-groupe tremblements de terre
Wenk Thomas (Bureau d'ingénieurs)
Laue Dr. Jan (EPFZ, IGT)
von Matt Ueli (Bureau d'ingénieurs, élaboration)
Traduction
Hennemann Maurice (OFROU N-SFS)
(révision de la traduction française de la version V 3.13)
Éditeur
Office fédéral des routes OFROU
Division réseaux routiers
Standards, recherche, sécurité
3003 Berne
Diffusion
La directive est téléchargeable gratuitement sur le site www.astra.admin.ch.
© ASTRA 2007
Reproduction à usage non commercial autorisée avec indication de la source.
2 Édition 2007 | V3.11 F083-0076
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
Avant-propos
La présente révision de la directive « Tirants d'ancrage » publiée par l'OFROU en 1999
est justifiée à la fois pour des raisons de forme et de fond.
La validité de cette directive avait été limitée au 31 décembre 2004, avant d'être prolon-
gée au 31 décembre 2006 par une lettre communiquée aux cantons le 12 juillet 2005. La
directive révisée devait être adaptée aux nouvelles normes de la SIA (Swisscodes et
Swissconditions). Cette adaptation nécessitait l'introduction de dispositions supplémentai-
res pour différentes raisons: la norme SIA 267:2003 « Géotechnique » est plus concise
que la recommandation SIA V191:1995 « Tirants d'ancrage précontraints ». La norme
SIA 267:2003 porte essentiellement sur la sécurité lors du dimensionnement des structu-
res porteuses. Les thèmes importants que sont la surveillance et l’entretien des ouvrages
sont plutôt traités de manière générale. L'OFROU a considéré qu'il était nécessaire de
préciser comment améliorer les possibilités de surveillance, d'en abaisser les coûts et de
diminuer les frais d’entretien. En outre et du point de vue du maître de l'ouvrage, les
Swissconditions SIA 118/267:2004 présentent d'importantes lacunes en ce qui concerne
la responsabilité quant aux défauts. La directive révisée comble ces lacunes.
L'emploi de tirants passifs pour assurer la sécurité permanente d'ouvrages a récemment
augmenté. On a souvent constaté dans la pratique, que la différence de comportement
entre des tirants passifs et des tirants précontraints étaient peu claire dans l'esprit des
représentants du maître de l'ouvrage et des projeteurs. La directive révisée a dès lors été
complétée par des précisions sur les tirants passifs.
Conduite par un canton et soutenue par l'OFROU, une recherche consacrée à l'effet des
séismes sur les ouvrages ancrés a montré la nécessité de compléter la norme SIA
267:2003. Élaborée par un groupe de travail ad hoc, la directive révisée contient des in-
dications et des précisions de dimensionnement aux séismes des ouvrages ancrés.
Le phénomène de la réaction alcaline des agrégats du béton (RAG), particulièrement im-
portant pour les ouvrages de soutènement, est également évoqué afin de sensibiliser les
responsables de projet. Des projets de recherche sur ce sujet sont encore en cours et
l'OFROU en communiquera les résultats le moment venu.
Édition 2007 de la directive « Tirants d'ancrage », actualisée et étendue, rendra les ou-
vrages ancrés encore plus sûrs et plus durables, et ceci sans coûts supplémentaires no-
tables.
Office fédéral des routes
Rudolf Dieterle, dr ès sc.
Directeur
Édition 2007 | V3.11 3
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
Table des matières
Avant-propos ..................................................................................................................... 3
0 Introduction ....................................................................................................................... 7
0.1 Organisation du contenu de la directive .............................................................................. 7
0.2 Entrée en vigueur et modifications ...................................................................................... 7
1 PARTIE 1 Utilisation de tirants d'ancrage précontraints .............................................. 8
1.1 Domaine d'application et but ............................................................................................... 8
1.2 Principes .............................................................................................................................. 8
1.3 Conditions techniques générales ........................................................................................ 8
1.4 Précisions et compléments au chiffre 10 de la norme SIA 267:2003 [9] ............................ 8
1.4.1 Construction et protection contre la corrosion .................................................................... 8
1.4.2 Exécution............................................................................................................................. 9
1.4.3 Tirants pourvus d'une protection poussée contre la corrosion ........................................... 9
1.4.4 Protection réduite contre la corrosion (tirant avec une période d'utilisation de moins de 2
ans) (10.6.3) ........................................................................................................................ 9
1.4.5 Surveillance ....................................................................................................................... 10
1.4.6 Responsabilité pour les défauts ........................................................................................ 10
2 PARTIE 2 Utilisation de tirants passifs ......................................................................... 11
2.1 Domaine d'application et but ............................................................................................. 11
2.2 Principes ............................................................................................................................ 11
2.3 Conditions techniques générales ...................................................................................... 11
2.4 Précisions et compléments au chiffre 11 de la norme SIA 267 [9] ................................... 12
2.4.1 Concept d'ancrage et dimensionnement ........................................................................... 12
2.4.2 Protection contre la corrosion ........................................................................................... 12
2.4.3 Exécution et essais ........................................................................................................... 12
2.4.4 Surveillance ....................................................................................................................... 13
2.4.5 Responsabilité pour les défauts ........................................................................................ 13
3 PARTIE 3 Entretien des ouvrages ancrés .................................................................... 14
3.1 Domaine d'application et but ............................................................................................. 14
3.2 Principes ............................................................................................................................ 14
3.3 Compléments spécifiques aux tirants ............................................................................... 14
3.3.1 Généralités ........................................................................................................................ 14
3.3.2 Ouvrages ancrés avec des tirants précontraints ............................................................... 14
3.3.3 Ouvrages ancrés avec des tirants passifs ........................................................................ 15
4 PARTIE 4 Aspects particuliers des ouvrages ancrés ................................................. 16
4.1 Ouvrages ancrés en cas de séisme .................................................................................. 16
4.1.1 Domaine d'application et but ............................................................................................. 16
4.1.2 Principes ............................................................................................................................ 16
4.1.3 Vérification sismique des nouveaux ouvrages ancrés ...................................................... 16
4.1.4 Vérification sismique des ouvrages ancrés existants ....................................................... 18
4.2 Réaction alcali-granulats du béton (RAG) ........................................................................ 18
Annexes ........................................................................................................................... 19
Bibliographie ................................................................................................................... 35
Liste des modifications .................................................................................................. 37
Édition 2007 | V3.11 5
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
0 Introduction
0.1 Organisation du contenu de la directive
PARTIE 1 Utilisation de tirants d'ancrage précontraints
traite de l'utilisation des tirants d'ancrage précontraints pour les nouveaux ouvrages ou
lors du renforcement d'ouvrages existants. Elle correspond à la Partie I de la directive de
1999 et a été complétée et adaptée aux nouvelles normes.
PARTIE 2 Utilisation de tirants passifs
traite de l'utilisation des tirants passifs pour les nouveaux ouvrages ou lors de renforce-
ment d'ouvrages existants. C'est un nouveau chapitre de la directive. Dans la pratique
les différences de comportement entre les tirants passifs et les tirants précontraints
étaient peu claires. L'annexe I donne des explications relatives à la Partie 2.
PARTIE 3 Entretien des ouvrages ancrés
traite de l’entretien d'ouvrages ancrés au moyen de tirants précontraints ou passifs, cons-
truits, resp. remis en état selon les normes et directives les plus récentes (à partir de
1995). L’entretien d'ouvrages ancrés plus anciens, qui était traitée de manière exhaustive
dans la Partie II de la directive de 1999, fait désormais l'objet de l'annexe II. En effet, tous
les anciens ouvrages ancrés n'ont pas encore été inspectés et remis en état selon la di-
rective de 1999. L'annexe II est une version raccourcie et légèrement retravaillée de la
Partie II de la directive de 1999.
PARTIE 4 Aspects particuliers des ouvrages ancrés
traite d'aspects particuliers des ouvrages ancrés, à savoir l'effet des séismes et de la ré-
action alcaline des agrégats du béton (RAG). Le traitement du problème des séismes est
un complément nécessaire à la norme SIA 267 [9]. Quant au phénomène RAG, il est en-
core peu connu et n'est réglé dans aucune norme.
0.2 Entrée en vigueur et modifications
La présente directive entre en vigueur le 01.08.2007. La « Liste des modifications » se
trouve à la page 37.
Édition 2007 | V3.11 7
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
1 PARTIE 1 Utilisation de tirants d'ancrage pré-
contraints
1.1 Domaine d'application et but
La Partie 1 de la présente directive est applicable à tous les ouvrages ancrés des routes
cofinancés par la Confédération. Elle doit contribuer à une application des mêmes critè-
res d'utilisation des tirants précontraints par tous les responsables des maîtres d'ouvrage.
1.2 Principes
L'utilisation de tirants permanents est limitée aux cas où celle-ci apporte des avantages
par rapport à d'autres solutions.
L'appréciation des variantes possibles sera basée sur une étude comparative. Elle tien-
dra compte de la convention d'utilisation, des bases du projet, ainsi que d'un concept de
surveillance et d'entretien. En règle générale, la durée d'utilisation admise pour les ou-
vrages ancrés sera de 100 ans.
La comparaison des variantes fera l'objet d'un rapport technique. Sur cette base, le maî-
tre d'ouvrage et l’OFROU choisiront, d'un commun accord, la variante dont l'étude sera
poursuivie en vue de l'exécution.
1.3 Conditions techniques générales
L'étude des projets, l'exécution, le contrôle et le entretien de tirants précontraints seront
basés sur la norme SIA 267 [9], chiffre 10.
Les ouvrages ancrés seront dimensionnés selon les normes SIA 260 [5], SIA 261 [6], SIA
262 [7], SIA 263 [8] et SIA 267 [9].
Seuls sont autorisés les systèmes d'ancrage dont l'aptitude a été prouvée par un agré-
ment technique suisse (STA) et un certificat de conformité. Les fournisseurs des tirants
et les entreprises de forage doivent disposer d'un système de gestion de la qualité certifié
selon ISO 9001 (2000).
1.4 Précisions et compléments au chiffre 10 de la norme
SIA 267:2003 [9]
Les paragraphes correspondants à la norme SIA 267 [9] sont donnés entre parenthèses.
1.4.1 Construction et protection contre la corrosion
Les tirants pour lesquels des pertes de précontrainte sont à craindre, allant jusqu'à des
valeurs inférieures à la force d'ancrage minimale nécessaire, seront conçus de manière à
permettre une remise en tension (10.5.1.2).
Les tirants placés dans des zones de glissement ou dans des roches gonflantes doivent
pouvoir être relâchés d'au moins 100 mm (10.5.1.2).
Les tirants précontraints dont la durée d'utilisation dépasse 2 ans seront pourvus d'une
protection poussée contre la corrosion.
STA = Swiss Technical Approval
8 Édition 2007 | V3.11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
1.4.2 Exécution
Chaque tirant sera équipé d'un dispositif de réinjection multiple (10.6.4.4).
Le délai d'attente entre la dernière injection et l'essai de traction sera déterminé en tenant
compte du délai correspondant prévu entre l’injection et les épreuves de mise en tension
des tirants de l'ouvrage Il sera en règle générale d'au moins 7 jours et d'au moins 10
jours dans des terrains argileux. Le programme des travaux réservera assez de temps
pour la réalisation des tirants d'essai, appuis compris, et pour l'exécution et l'évaluation
des essais de traction (10.7.2).
La force de blocage effective de chaque tirant doit être déterminée par décollement de la
tête d'ancrage. Cette règle est également applicable pour les tirants de mesure (contrôle
de la cellule de mesure) (10.6.4.5).
Dans le cas où un tirant bloqué au moyen de clavettes doit être à nouveau détendu, par
exemple pour améliorer la protection anticorrosion derrière la tête, on veillera à ce que le
blocage, lors de la remise en tension, ne se fasse pas au même endroit des armatures.
Un second blocage n'est admissible que si la nouvelle morsure des clavettes débute au
moins 15 mm avant l'ancienne (coté terre) ou se trouve entièrement après la première
(vers l'extérieur).
1.4.3 Tirants pourvus d'une protection poussée contre la corrosion
La résistance électrique I de tous les tirants ayant une protection poussée contre la cor-
rosion doit être mesurée et les valeurs consignées lors des phases de construction sui-
vantes (10.7.4.1).
A après l'injection primaire
B après chaque réinjection
C avant l’épreuve de mise en tension
D après l’épreuve de mise en tension, tirant détendu
E après la mise en tension à P0
F après la mise en tension à P0 et après injection de la tête d'ancrage
G après le raccord du câble à l'appareil de mesure (pour les tirants de mesure)
La mesure pour la phase F sera effectuée en présence de la direction des travaux (ré-
ception des travaux).
Remarque : En cas de différences significatives entre les mesures précédentes, il est re-
commandé de répéter la mesure pour la phase F lors de conditions météorologiques fa-
vorables. Si les mesures sont exécutées correctement, on admettra le meilleur résultat.
Les tirants dont la tête est cachetée doivent être conçus de manière à permettre, à titre
exceptionnel (après démolition du béton de cachetage), la détermination de la force d'an-
crage existante par décollement de la tête au moyen d'un vérin de mise en tension (tête
d'ancrage de contrôle ou dépassement suffisant des armatures de traction). Les têtes de
tirants cachetées doivent bine entendu être également isolées électriquement de l'ouvra-
ge.
Lorsque les têtes d'ancrage sont cachetées, on veillera à garantir un recouvrement de
béton de 40 mm au moins, le béton de cachetage présentera une bonne étanchéité, un
retrait minimal et une adhérence parfaite avec celui de la structure porteuse.
1.4.4 Protection réduite contre la corrosion (tirant avec une période d'utili-
sation de moins de 2 ans) (10.6.3)
L'armature de traction doit être enrobée d'au moins 20 mm de coulis de ciment dans la
zone de la longueur de scellement. Cette exigence sera assurée au moyen d’écarteurs.
L'armature de traction doit être protégée sur sa longueur libre au moyen d'une gaine syn-
thétique, jusqu'à l'arrière de la tête d'ancrage, remplie d'une masse anticorrosion dont la
Édition 2007 | V3.11 9
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
plasticité est garantie.
Dans la zone de la tête d'ancrage, l'armature de traction, les éléments d'ancrage et la
plaque d'ancrage doivent être protégés par un produit anticorrosion, hydrofuge et résis-
tant à la température, offrant une bonne adhérence.
1.4.5 Surveillance
Tous les ouvrages ancrés seront équipés de tirants de mesure. Le nombre de tirants de
mesure sera d'au moins 5 % du nombre total de tirants. Des trois tirants de mesure ou de
contrôle exigés au moins par partie d'ouvrage ancrée selon (10.7.5.4), deux au moins se-
ront équipés comme tirant de mesure.
Pour chaque ouvrage ancré, Les déformations seront surveillées, pour chaque ouvrage
ancré, par des dispositifs de surveillance fournissant des informations pertinentes sur son
comportement. (10.7.5.1).
1.4.6 Responsabilité pour les défauts
La responsabilité quant aux défauts des tirants réalisés doit être réglée dans le contrat
d'entreprise.
Capacité portante du tirant
La capacité portante à atteindre par panneau de terrain, respectivement la force de blo-
cage admise, doit être convenue sur la base de tirants d'essais représentatifs (10.7.2).
La façon de déterminer la moins-value pour les tirants ayants une capacité portante in-
suffisante doit être définie. Si des ancrages complémentaires sont nécessaires pour as-
surer la capacité portante selon les normes, leur rémunération doit être réglée.
Protection contre la corrosion
Le nombre de tirants dont la résistance électrique, lors de la réception, peut être inférieu-
re à la valeur limite RI = 0.1 M doit être défini (10.7.4.2). Si le taux de défaillance autori-
sé est dépassé, l'entrepreneur devra poser des tirants de remplacement à ses frais. Leur
position sera déterminée par le représentant du maître de l'ouvrage en fonction de la sé-
curité structurale à long terme de l'ouvrage.
10 Édition 2007 | V3.11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
2 PARTIE 2 Utilisation de tirants passifs
2.1 Domaine d'application et but
La Partie 2 de la présente directive est applicable à tous les ouvrages ancrés des routes
cofinancés par la Confédération. Elle doit contribuer à une application des mêmes critè-
res d'utilisation des tirants passifs par tous les responsables des maîtres d'ouvrage.
2.2 Principes
Le mode d’action, les essais et la surveillance des tirants passifs diffèrent de ceux des ti-
rants précontraints. L'utilisation de tirants passifs est limitée aux cas où celle-ci apporte
des avantages par rapport aux tirants précontraints et à d'autres solutions techniques
(annexe I).
L'appréciation des variantes techniques possibles sera fondée sur une étude comparati-
ve. Elle tiendra compte de la convention d'utilisation, des bases du projet, ainsi que d'un
concept de surveillance et d'entretien. En règle générale, la durée d'utilisation admise
pour les ouvrages ancrés sera de 100 ans.
La comparaison des variantes fera l'objet d'un rapport technique dans lequel les avanta-
ges par rapport à une solution « tirants précontraints » seront largement justifiés. Sur cet-
te base, le maître d'ouvrage et l’OFROU choisiront, d'un commun accord, la variante dont
l'étude sera poursuivie en vue de l'exécution.
2.3 Conditions techniques générales
L'étude des projets, l'exécution, le contrôle et l’entretien de tirants passifs seront basés
sur la norme SIA 267 [9], chiffre 11.
Les ouvrages ancrés seront dimensionnés selon les normes SIA 260 [5], SIA 261 [6], SIA
262 [7], SIA 263 [8] et SIA 267 [9].
Seuls sont autorisés les systèmes d'ancrage qui remplissent les exigences du chiffre 11
de la norme SIA 267 [9] et qui sont documentés de façon détaillée (11.6.1.2). Les four-
nisseurs des tirants et les entreprises de forage doivent disposer d'un système de gestion
de la qualité certifié selon ISO 9001 (2000).
Seuls les tirants en acier sont en principe autorisés pour des emplois permanents. Les
ancrages permanents avec des tirants composés de matériaux composites renforcés à
l'aide de fibres, par ex. des fibres de verre, ou d'autres matériaux, nécessitent des vérifi-
cations particulières de leur durabilité ainsi qu'une autorisation de l'OFROU.
2
Les tirants constitué d’acier normal d'armatures à béton (fsk < 750 N/mm ) ne doivent ni
avoir de longueur libre ni être utilisés comme tirants précontraints. Pour les tirants pré-
contraints les exigences formulées pour les armatures de traction, la protection contre la
corrosion et les essais sont fixés au chiffre 10 de la norme SIA 267 [9].
Si des tirants passifs à adhérence totale doivent être mis en tension pour réduire les dé-
formations dans la zone de la tête d'ancrage, la force de mise en tension ne doit pas dé-
passer 0,2 Fsk.
Édition 2007 | V3.11 11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
2.4 Précisions et compléments au chiffre 11 de la norme
SIA 267 [9]
Les paragraphes correspondants aux explications de l'annexe I, resp. à la norme SIA 267
[9], sont donnés entre parenthèses.
2.4.1 Concept d'ancrage et dimensionnement
La spécificité des tirants passifs par rapport aux tirants précontraints sera prise en comp-
te lors du choix du concept d'ancrage (annexe I.1).
Si des tirants passifs et précontraints sont utilisés dans le même ouvrage, leur compor-
tement spécifique sera pris en compte lors des vérifications de la sécurité structurale et
de l'aptitude au service (annexe I.2).
Les tirants passifs ne sont en principe pas appropriés pour stabiliser les glissements de
terrain actifs (annexe I.3).
La longueur requise des tirants passifs sera déterminée pour le modèle de terrain dans
lequel la nappe phréatique est à son niveau maximal. En cas d'ancrage de coteaux et de
tranchées, il faut en principe toujours tenir compte d'une certaine pression hydrostatique,
resp. d'une pression d'écoulement (annexe I.4).
L'effet des charges variables sur la capacité portante à long terme des tirants sera pris en
compte (annexe I.5).
L'emploi de tirants lors de reprise en sous-œuvre (« paroi clouée ») nécessite l'examen
de toutes les phases critiques de construction (annexe I.6).
2.4.2 Protection contre la corrosion
Le degré de protection 2 (11.6.3) est requis pour les tirants permanents en acier sans al-
liage placés dans un sol meuble ou dans un massif rocheux fissuré. Le degré de protec-
tion 3 s'impose dans les zones soumises aux sels de déverglaçage, par ex. du côté aval
d'une route. Le degré de protection 1 ne suffit que lors de l'emploi d'aciers inoxydables du
type Cr-Ni-Mo, par ex. aciers 1.4462 ou 1.4429. Un enrobage de mortier de 40 mm est
nécessaire lorsque le degré de protection 3 est requis.
La résistance à la diffusion exigée pour la gaine en plastique selon (11.6.3.4) est égale-
ment valable dans la zone de couplage des tirants ainsi que pour tous les raccords de
gaine. Dans le cas de tirants pré injectés en usine, ladite résistance à la diffusion doit être
vérifiée sur demande au moyen de mesures de la résistance électrique I, selon le chiffre
(10.7.4). La valeur limite à atteindre est RI ≥ 1.0 M.
La gaine de protection synthétique doit pénétrer de 100 mm au moins dans le béton de la
structure ancrée. Des mesures constructives doivent éviter que les têtes d'ancrage tou-
chent les armatures de la structure ancrée (pas de contact métallique, annexe I.1).
2.4.3 Exécution et essais
Les tirants pré injectés en usine seront transportés, entreposés et mis en place de maniè-
re soigneuse afin de ne pas endommager leur gaine de protection synthétique.
Des forages tubés sont exigés pour les tirants permanents en terrain meuble et dans la
roche fracturée. L'injection primaire sera réalisée avant et pendant le retrait du tubage.
L'injection s'effectue « de bas en haut » au moyen d'un tube d'injection. Pour les tirants
en terrain meuble l'injection peut aussi être effectuée sous pression par le tubage.
Dans le cas de tirants permanents, trois essais d'arrachement au minimum seront effec-
tués par type de sol ayant des caractéristiques géotechniques similaires (11.7.2.7).
12 Édition 2007 | V3.11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
10% de tous les tirants permanents seront testés en traction pour vérifier la qualité de
leur exécution (11.7.5.1).
Des mesures de résistance électrique seront effectuées au minimum sur 10% de tous les
tirants permanents ayant un degré de protection 2 et 3. Les mesures de résistance élec-
trique seront effectuées au minimum sur 20% des tirants dotés de couplages fabriqués
sur le chantier. Cette dernière doit atteindre la valeur RI ≥ 0.1 M après la pose du tirant
et RII ≥ 100 juste avant le bétonnage de la tête d'ancrage (armature de la structure por-
teuse posée). La définition de RI et de RII est donnée au chiffre (10.7.4).
2.4.4 Surveillance
Pour chaque ouvrage ancré, les déformations seront surveillées par des dispositifs de
surveillance fournissant des informations pertinentes sur le comportement du sol et de
l'ouvrage. (10.7.6.2).
2.4.5 Responsabilité pour les défauts
La responsabilité quant aux défauts des tirants réalisés doit être réglée dans le contrat
d'entreprise. Il faut en particulier définir combien d'ancrages testés peuvent ne pas rem-
plir les exigences données dans le paragraphe 2.4.3 quant à la protection contre la cor-
rosion. Si le taux de défaillance autorisé est dépassé, l'entrepreneur devra procéder à
des essais supplémentaires et poser des ancrages de remplacement
Édition 2007 | V3.11 13
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
3 PARTIE 3 Entretien des ouvrages ancrés
3.1 Domaine d'application et but
La Partie 3 de la présente directive s'applique aux ouvrages ancrés dimensionnés et
exécutés sur la base de la recommandation SIA V 191 [11], de la prénorme SIA
191/1:2001 ou de la norme SIA 267 [9]. La Partie 3 s'applique aussi aux ouvrages ancrés
plus anciens vérifiés et remis en état selon la directive ASTRA 12005 « Tirants d'ancra-
ge » (1999) [3]. La Partie 3 contribue de la sorte à un entretien et une surveillance de
tous les ouvrages ancrés des routes nationales selon les mêmes critères.
Indication : l’entretien des ouvrages ancrés plus anciens qui n'ont pas encore été vérifiés
selon la directive ASTRA 12005 (1999) [3] est traité dans l'annexe II.
3.2 Principes
La directive ASTRA 12002 « Surveillance et entretien des ouvrages d'art des routes na-
tionales » [1] doit être appliquée pour l’entretien des ouvrages ancrés.
Les actions importantes d’entretien des ouvrages ancrés sont, au sens de cette directive,
les inspections principales quinquennales, les inspections intermédiaires et les inspec-
tions spéciales dues à des événements particuliers.
3.3 Compléments spécifiques aux tirants
3.3.1 Généralités
L'évolution des forces d'ancrage dans le temps, des déformations et des déplacements
de l'ouvrage sont les indicateurs principaux qui permettent de juger du comportement des
ouvrages ancrés. Les valeurs mesurées doivent non seulement être comparées avec les
seuils d'alerte et d'alarme fixés dans le plan de surveillance, mais il faut représenter gra-
phiquement leur évolution dans temps. Dès qu'une tendance semble se dessiner, les
causes doivent être recherchées et les conséquences potentielles pour l'ouvrage éva-
luées (pronostic).
L'efficacité de fonctionnement des dispositifs de surveillance sera également vérifiée lors
des inspections principales.
3.3.2 Ouvrages ancrés avec des tirants précontraints
Les forces d'ancrage des tirants de mesure doivent être mesurées au moins une fois par
année afin d’identifier les variations significatives dans le temps.
En cas de variations sensibles des forces, on vérifiera l'efficacité de fonctionnement de
l'appareil de mesure (batteries etc.) et des cellules dynamométriques en décollant la tête
d'ancrage avant de prendre toute autre disposition.
Lors des inspections principales, la résistance électrique RI de toutes les têtes d'ancrage
inspectées dotées d’une protection poussée contre la corrosion sera également mesu-
rée. Outre les valeurs mesurées, les conditions météorologiques et la température seront
relevées.
Un abaissement de la résistance électrique en dessous de la valeur limite RI = 0,1 M pour
quelques tirants isolés ne signifie pas qu'il faut absolument les remplacer. On détermine-
ra par des mesures supplémentaires si RI se situe durablement plus bas que la limite (ré-
pétition des mesures dans d'autres conditions climatiques, inspection et mesure directe-
ment sur la tête d'ancrage). Si l'abaissement de la résistance électrique est confirmé, on
prêtera une attention particulière à ces tirants lors des inspections suivantes, par ex. en
inspectant la tête d'ancrage lors de chaque inspection principale. En cas de chute dura-
14 Édition 2007 | V3.11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
ble de RI en dessous de la valeur limite pour de nombreux tirants on fera appel à des
spécialistes pour en déterminer la cause et en juger les conséquences.
Lors des inspections principales, on décidera d'un éventuel besoin en entretien des têtes
d'ancrage (protection de la tête d'ancrage, capots de protection des têtes, joints, fixations,
drainage des niches des tirants de mesure, présence de végétation, etc.). On relèvera en
outre, les modifications d'état significatives comme des venues d'eau ou la formation de
fissures.
3.3.3 Ouvrages ancrés avec des tirants passifs
Comme les forces d'ancrage des tirants passifs à adhérence totale ne peuvent pas être
surveillées, on mesurera les déformations et les déplacements de l'ouvrage au moins une
fois entre deux inspections principales. Si cette règle n’est pas appliquée, il faut en justi-
fier la raison dans le plan de surveillance.
Lors de chaque inspection d'ouvrages ancrés avec des tirants passifs, on examinera tou-
tes les modifications d'état, en particulier les formations de fissures, les venues d'eau, les
obturations de drainages, les déformations locales, etc.
Édition 2007 | V3.11 15
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
4 PARTIE 4 Aspects particuliers des ouvrages
ancrés
4.1 Ouvrages ancrés en cas de séisme
4.1.1 Domaine d'application et but
La Partie 4 est applicable à tous les ouvrages ancrés des routes cofinancés par la
Confédération. Elle doit contribuer à une application similaire de la vérification de la sécu-
rité sismique des ouvrages ancrés par tous les responsables des maîtres d'ouvrage.
4.1.2 Principes
La sécurité structurale de chaque ouvrage ancré en cas de séisme doit être vérifiée au
sens du chiffre 16.1.5 de la norme SIA 261 [6] et en complément au chiffre 7.2.2 de la
norme SIA 267 [9].
Remarque : selon le chiffre 7.2.2 de la norme SIA 267 [9], il n'est pas nécessaire d'effec-
tuer une vérification sismique pour les « classes d'ouvrages » I et II en zone 1 et la
« classe d'ouvrage » I en zone 2, cette vérification n'étant pas déterminante à l'état limite
de type 2 car l'effet du séisme est compensé par un facteur de charge réduit à 1,0. Ce
n'est toutefois pas le cas à l'état limite de type 3.
Lors de la vérification de la sécurité sismique, on distinguera le dimensionnement de
nouvelles constructions de la vérification d'ouvrages existants.
La procédure décrite au paragraphe 4.1.3 vaut pour le dimensionnement de nouveaux
ouvrages ancrés. Elle contient diverses précisions et compléments au chiffre 7 de la
norme SIA 267 [9]
Le paragraphe 4.1.4 contient les indications complémentaires nécessaires à la vérifica-
tion des ouvrages existants.
4.1.3 Vérification sismique des nouveaux ouvrages ancrés
Vérification de l'état limite de type 2
La résistance requise lors du dimensionnement des ancrages est obtenue avec les hypo-
thèses suivantes :
Actions
Actions durables selon les normes SIA 261 [6] et SIA 267 [9] sur la base des données ca-
ractéristiques du sol, des grandeurs géométriques et du niveau moyen de la nappe
phréatique (facteur de charge 1,0).
Actions sismiques
La formule de la force de remplacement horizontale donnée au chiffre (7.5.2.1) de la
norme SIA 267 [9] est complétée par l’introduction du paramètre S dépendant des clas-
ses de terrain :
agd · S
Ah,d = f · g · q · GK
a
f, agd et S selon le chiffre 16 de la norme SIA 261 [6]
qa = 1,0 à 2,0 (dépend du déplacement admissible du mur, complément au tableau 2 chif-
fre 7.5.2.1 de la norme SIA 267 [9], voir ci-dessous).
Le déplacement admissible du mur sadm est calculé à l'aide l'allongement du tirant entre
sa force effective, P et sa résistance. Ce ne sont pas les valeurs globales du tableau 2 de
la norme SIA 267 [9] qui doivent être utilisées pour le rapport entre le déplacement ad-
missible du mur sadm et la valeur qa, mais les formules données au tableau 7.1 de la nor-
me EN 1998-5 [10].
16 Édition 2007 | V3.11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
agd
qa = 1,0 sadm < 200 · g · S (mm)
pour
agd agd
qa = 1,5 pour 200 · g · S ≤ sadm < 300 · g · S (mm)
agd
qa = 2,0 pour sadm ≥ 300 · g · S (mm)
La poussée des terres et la pression hydrostatique, toutes deux augmentées de l'effet
sismique, resp. la résistance amoindrie du terrain (poussée des terres passive), peuvent
être calculées avec les formules de Mononobe-Okabe (voir norme EN 1998-5, annexe E)
[10].
Les hypothèses suivantes sont alors prises en considération:
L'accélération verticale n'est pas appliquée des deux côtés avec une action négative
(pas plausible). Du côté actif, elle est admise dirigée vers le bas et du côté passif éga-
le à zéro. Comme alternative, on peut également l'admettre dirigée vers le haut du cô-
té passif et égale à zéro du côté actif.
L'action dynamique de la pression interstitielle est prise en compte selon le chiffre
7.3.2.3 (8) de la norme EN 1998-5 [10] et de l'annexe E.6 (valable pour les sols ayant
une perméabilité k < 5 ∙ 10-4 m/s).
L'effet des pressions additionnelles (= à la différence entre les pressions accrues et
les pressions statiques) est admise égale à 0,6 H (H = hauteur du mur).
Résistances
Valeur de dimensionnement de la résistance du sol
selon chiffres 7.5.3.1 et 5.3.5.5 (M = 1,4) de la norme SIA 267 [9].
Valeur de dimensionnement de la résistance du tirant
Pour la vérification de l’état limite type 2, la valeur de dimensionnement de la résistance
du tirant peut être admise égale à Rd = Py = Ap ∙ fp 0.1k
Indication : le calcul sera effectué de façon appropriée par étapes, tout d'abord avec
qa = 1,0 (mur rigide) et GK selon chiffre 7.4.2 de la norme SIA 267 [9]. Aucun examen
complémentaire n'est nécessaire si cette vérification n'est pas déterminante (on se trouve
du côté de la sécurité). En revanche, si la vérification est déterminante, on peut utiliser
une valeur plus élevée pour qa en fonction du déplacement admissible du mur et on peut
déterminer la poussée des terres et la pression hydrostatique avec les formules de Mo-
nonobe-Okabe. Dans le cas de murs de plus de 10 m de hauteur, on peut en outre effec-
tuer une analyse monodimensionnelle de propagation des ondes en champs libre, selon
la norme EN 1998-5 [10], annexe E.2, pour les ondes se propageant verticalement, afin
d’obtenir une valeur moyenne de l'accélération horizontale du sol.
Vérification de l'état limite de type 3, stabilité globale
Données caractéristiques du sol Xd selon le chiffre 5.3.2 de la norme SIA 267 [9] (valeurs
de dimensionnement).
Effet sismique
La formule de la force de remplacement horizontale applicable pour l’état limite de type 2
est complétée par le facteur qh :
a ·S
Ah,d = f · g ·gdqa· qh · GK
Comme pour l’état limite de type 2, qa tient compte de la capacité du mur de soutènement
à se déplacer :
qa = 1,0 à 2,0.
qh tient compte du fait que l'accélération maximale n'agit pas simultanément sur tout le
massif de glissement, sa valeur variant de qh = 1,0 à 2,5. La valeur 1,0 vaut pour de pe-
tits massifs de glissement qui correspondent environ au cône actif (poussée des terres).
qh = 1,5 sera utilisé pour les calculs de cercles de glissement usuels, alors que qh = 2,0 à
2,5 sera utilisé pour les massifs de glissement plus grands, d'une taille supérieure à 10 m
Édition 2007 | V3.11 17
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
et/ou ayant une étendue de plus de 30 m.
Si un problème exige un examen plus poussé, l'accélération déterminante peut être dé-
terminée par un calcul dynamique non linéaire de sa propagation horizontale et verticale
dans le massif de glissement (phénomène ondulatoire)
Comme son effet se compense souvent globalement, l'accélération verticale ne doit en
général pas être prise en compte lors de cette vérification.
Valeur de dimensionnement de la résistance du tirant
Rd = Py peut être admis pour les ancrages sollicités principalement en traction lors d'un
séisme, ce pour autant que l'ouvrage ancré puisse à la fois suivre et supporter les dépla-
cements induits de la sorte et que le tirant soit assez long et ancré dans un terrain stable.
Dans le cas de tirants n'étant sollicités que partiellement par une tension supplémentaire
lors d’un séisme (axe du tirant fortement en biais par rapport à la direction de déplace-
ment), il convient de fixer de cas en cas un coefficient de correction de la force d'ancrage
A approprié au sens du chiffre (10.5.2.2.3) de la norme SIA 267 [9].
Remarque : le processus décrit ci-dessus ne tient pas compte du fait que la résistance au
cisaillement du terrain est en général plus grande avec une haute vitesse de mise en
charge qu'avec une charge statique, ce aussi longtemps qu'aucune formation de pres-
sions interstitielles n'est à craindre. Ceci ne vaut pas pour les sols décrits au chiffre 7.3.3
de la norme SIA 267 [9]qui nécessitent des études particulières.
4.1.4 Vérification sismique des ouvrages ancrés existants
L'accélération du terrain agd peut être fixée à l'aide de la carte des iso lignes du Service
sismologique suisse SED (SED-EPFZ 9/02 SSL) plutôt que selon le chiffre (16.2.1.2) de
la norme SIA 261 [6] et de l'annexe F (voir documentation SIA D 0181, p. 60).
L'accélération déterminante du sol peut en général être déterminée par des analyses dy-
namiques non linéaires.
Lorsque la vérification d'un ouvrage existant sans action sismique ne nécessite aucun
renforcement, on peut admettre une réduction de 20% de la force supplémentaire
d’ancrage nécessaire pour assurer la résistance aux séismes (facteur de conformité 0,8).
Si un renforcement est nécessaire sans tenir compte des effets sismiques, on doit alors
dimensionner le projet d’ancrage en ajoutant l'effet sismique à 100%.
4.2 Réaction alcali-granulats du béton (RAG)
Les ouvrages ancrés, comme les murs de soutènement par exemple, sont souvent expo-
sés à l‘humidité sur leurs deux faces (terrain et intempéries). On a constaté depuis quel-
ques années, pour quelques-uns d’entre eux, des dégâts dus à la RAG.
Les règles et les mesures à respecter pour les constructions nouvelles et existantes figu-
rent dans la documentation ASTRA 82013 « Réaction alcali-granulats du béton (RAG) »
[2].
18 Édition 2007 | V3.11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
Annexes
I Explications à propos des recommandations de la PARTIE 2 Utilisation de
tirants passifs .................................................................................................................. 21
I.1 Différences principales entre les tirants passifs et les tirants précontraints ..................... 21
I.2 Évolution des forces et déplacement des ouvrages ......................................................... 21
I.3 Glissements actifs ............................................................................................................. 22
I.4 Effets dus à la présence de nappes .................................................................................. 22
I.5 Sollicitations alternées ...................................................................................................... 22
I.6 Étapes de construction ...................................................................................................... 22
I.7 Protection contre la corrosion ........................................................................................... 22
II Entretien d'anciens ouvrages ancrés ........................................................................... 23
II.1 Généralités ........................................................................................................................ 23
II.1.1 Domaine d'application ....................................................................................................... 23
II.1.2 But ..................................................................................................................................... 23
II.1.3 Principes ............................................................................................................................ 23
II.1.4 Manière générale de procéder .......................................................................................... 23
II.2 Mode opératoire, instructions détaillées ........................................................................... 27
II.2.1 Phase 1 : Inventaire et évaluation des ouvrages ancrés .................................................. 27
II.2.2 Phase 2 : Vérification et remise en état des ouvrages...................................................... 29
II.3 Projet d'intervention ........................................................................................................... 34
II.4 Exécution des interventions et établissement des documents relatifs à l'ouvrage ........... 34
Édition 2007 | V3.11 19
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
I Explications à propos des recommandations
de la PARTIE 2 Utilisation de tirants passifs
I.1 Différences principales entre les tirants passifs et les ti-
rants précontraints
Fig. I.1 : Tableau de comparaison entre tirants passifs et précontraints
Tirants passifs Tirants précontraints
Résistance · n'est pas vérifiée pour les tirants d'ouvrage (les · est vérifiée pour chaque tirant
tests de traction ne donnent aucun renseigne-
ment quant à la résistance des tirants)
· peut aussi être contrôlée pendant la durée
d'utilisation
· ne peut pas être contrôlée pendant la durée
d'utilisation
Force · se développe seulement lors de déplacements · agit tout de suite pleinement dès le
d'ancrage de l'ouvrage (passive) blocage de la tête du tirant (active)
· sa grandeur n'est pas connue et ne peut pas · peut être mesurée à l’aide des tirants de
être mesurée contrôle et de mesure durant la durée d'uti-
lisation
· peut être réglée si nécessaire (détendre,
retendre)
Déplacements · sont nécessaires pour que la force d'ancrage · sont selon les cas sensiblement réduits ou
de l'ouvrage apparaisse largement empêchés ou même dirigés
contre le terrain
· se composent de l'allongement du tirant et des
déformations de tout l'ouvrage
Surveillance · les tirants ne peuvent pas être surveillés indivi- · les tirants de contrôle et de mesure peu-
duellement vent être surveillés pendant toute leur du-
rée d'utilisation (force et protection contre
· le massif d'ancrage complet ne peut être
la corrosion)
surveillé qu'en mesurant les déformations de
l'ouvrage · la surveillance est complétée par une
mesure des déformations de l'ouvrage
Des différences énumérées ci-dessus, on déduira la règle générale que les tirants passifs
peuvent être mis en œuvre lorsqu'un tirant isolé ne contribue pas de manière déterminan-
te à la résistance de l'ouvrage et de parties d'ouvrage isolées (≤ 3 à 5%) et que les dé-
placements d'ouvrage inhérents au système sont tolérables.
I.2 Évolution des forces et déplacement des ouvrages
Pour les tirants précontraints, la force de blocage P0 agit immédiatement après leur blo-
cage. Elle ne varie que peu par la suite, avant tout en raison de déplacements de l'ouvra-
ge (principe de la précontrainte). Les tirants passifs à adhérence totale nécessitent, pour
développer leur force, des déplacements entre leur longueur de scellement et leur tête
d'ancrage. Selon la nature du sol et la longueur du tirant, les déplacements de l'ouvrage
qui en résultent peuvent être considérables. En cas d'utilisation simultanée de tirants pré-
contraints et de tirants passifs, il faut tenir compte de leurs différence de comportements
tant au niveau de la force que des déformations. On vérifiera, lors de l'examen de la sé-
curité structurale et de l'aptitude au service, la compatibilité entre les déformations, les
forces d'ancrage et la résistance des tirants.
Édition 2007 | V3.11 21
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
I.3 Glissements actifs
La résistance à l'arrachement des tirants passifs à adhérence totale évolue en fonction
de la prise du mortier d'injection et de la consolidation de la paroi du forage. Si des dé-
placements importants se produisent entre la zone d'ancrage et l'ouvrage ancré durant la
période de prise, la résistance du scellement dans le sol peut être durablement altérée ou
même largement détruite. Suivant la nature du terrain et la longueur du tirant, ce proces-
sus peut mener à une rupture du scellement dans la zone d'ancrage, ceci avant même le
montage de la tête d'ancrage.
I.4 Effets dus à la présence de nappes
Dans des conditions géométriques et géotechniques identiques, le cône de glissement
critique sera en général plus grand en présence d'une nappe phréatique que dans un ter-
rain sec. Pour les tirants passifs, seule la longueur de scellement située à l’arrière de la
surface de glissement à un effet stabilisant. Les tirants dimensionnés pour des terrains
secs peuvent par conséquent devenir trop courts et donc inefficaces en cas d'apparition
d'une nappe dans le versant.
I.5 Sollicitations alternées
La force d'ancrage des tirants précontraints ne varie pas tant que la précontrainte est
plus grande que les sollicitations extérieures. Les tirants passifs réagissent par contre di-
rectement aux sollicitations externes. C'est la raison pour laquelle il faut tenir compte de
l'effet de charges variables sur la résistance à long terme des tirants passifs, ce par ana-
logie avec le chiffre (9.5.3.5) de la norme SIA 267 [9].
I.6 Étapes de construction
Pour les parois clouées qui ne sont pas construites par étape en damier, les différentes
étapes de construction sont en général déterminantes pour le dimensionnement des ti-
rants. On évitera dans le programme des travaux que les ancrages déjà posés ne soient
sollicités trop tôt (perte de résistance, voir I.3).
I.7 Protection contre la corrosion
Lorsque la gaine de protection synthétique présente un défaut et que la tête d'ancrage
est en contact électrique avec l’armature de l’ouvrage, un macroélément très efficace se
forme avec ladite armature comme cathode. Cela peut induire une forte corrosion du ti-
rant par piqûres à l'endroit du défaut.
22 Édition 2007 | V3.11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
II Entretien d'anciens ouvrages ancrés
II.1 Généralités
II.1.1 Domaine d'application
L'annexe II est applicable aux ouvrages ancrés dont l'exécution n'a pas été réalisée selon
les normes, directives et recommandations listées ci-après, et qui n'ont pas encore été
vérifiés et remis en état selon la directive « Tirants d'ancrage » de l'OFROU de 1999 [3]:
Directive ASTRA « Tirants d'ancrage permanents en terrain meuble et en rocher »
(1993) [4].
Recommandation SIA V 191 « Tirants d'ancrage précontraints » (1995) [11].
Directive ASTRA « Tirants d'ancrage » (1999)[3].
Norme SIA 267 « Géotechnique » (2003) [9]
II.1.2 But
Les ouvrages ancrés plus anciens doivent satisfaire à un niveau suffisant de sécurité
structurale et d'aptitude au service au sens de la norme SIA 267 [9]. Si tel n'est pas le
cas, ces exigences seront remplacées par des mesures constructives et/ou de surveil-
lance.
Lors du choix de ces mesures on tiendra compte de la durée d'utilisation résiduelle exi-
gée pour l'ouvrage.
II.1.3 Principes
Chaque ouvrage ancré doit être suivi dans le cadre d'un plan de surveillance et d'entre-
tien qui fournit des informations suffisantes sur l'état et à l'efficacité des tirants d'ancrage.
Si tel n'est pas le cas, on déterminera l'état des tirants et on établira un plan de surveil-
lance et d'entretien sur la base d'une convention d'utilisation. Le cas échéant, si des me-
sures constructives devaient être prises, on établira les bases du projet.
Si plusieurs ouvrages ancrés doivent être examinés, l'ordre dans lequel ils seront traités
tiendra compte des risques potentiels inhérents à chacun d'eux.
Les indications sur l'état de l'ouvrage ancré, sur les mesures prises et celles qui restent à
prendre, seront consignées dans KUBA-DB.
II.1.4 Manière générale de procéder
(Voir schéma d'intervention fig. II.1 et II.2)
Phase 1 : Inventaire et évaluation des anciens ouvrages ancrés
1. Réunion et examen des dossiers de tous les anciens ouvrages ancrés.
2. Évaluation de chaque ouvrage, en tenant compte du mécanisme de rupture possible
de la structure, de l'état présumé des ancrages et des possibilités de surveillance.
De cette réflexion résulte une évaluation provisoire de l'état de l'ouvrage.
3. Classement des ouvrages par catégories selon l'évaluation provisoire et l'importance
des dégâts potentiels dus à une défaillance. De ce classement résulte leur potentiel
de risque.
4. Saisie des données dans KUBA-DB.
Remarque : Pour certains ouvrages, cette première évaluation est susceptible de faire
apparaître des risques nécessitant des mesures urgentes, telles que des restrictions
d'utilisation, des travaux de consolidation ou une surveillance accrue.
Édition 2007 | V3.11 23
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
Entretien d'anciens ouvrages ancrés
Étape
Activité Intervention Compétence
d'intervention
Phase 1 Inventaire et appréciation de l'état des ouvrages ancrés
Constitution de dossiers Maître d'ouvrage, assisté
1
des ouvrages ancrés éventuellement par un expert
Évaluation provisoire Maître d'ouvrage, assisté
2
des ouvrages éventuellement par un expert
Première évaluation des risques Mesures d'urgence éventuelles,
Maître d'ouvrage, assisté
3 et classement des ouvrages en telles que restrictions d'utilisation
éventuellement par un expert
catégories ou travaux de consolidation
4 Saisie des données dans KUBA-DB Maître d'ouvrage
Passage à la phase 2
Fig. II.1: Schéma d'intervention.
Phase 2 : Vérification et remise en état des parties d'ouvrages
Chaque ancien ouvrage ancré fera l'objet, en règle générale, des études et travaux sui-
vants :
5. Vérification générale de l'ouvrage ancré comprenant un relevé général et une éva-
luation globale de l'état. Outre le relevé effectué sur place, on procédera à une véri-
fication statique approximative du rôle de l’ancrage et de leur effet sur la stabilité de
l'ouvrage.
Si cela est nécessaire pour l'évaluation et pour autant que des investigations com-
plémentaires soient techniquement possibles, on élaborera un projet d'investigation
et de vérification détaillée des tirants d'ancrage. On remettra un rapport intermédiai-
re au maître d'ouvrage. Il servira de base pour l'extension du mandat. Le projet d'in-
vestigation inclura également les travaux d'entretien à entreprendre simultanément
sur les têtes d'ancrage ainsi qu'une proposition pour un concept de surveillance
adapté.
6. Examen des tirants selon le projet d'investigation. Exécution simultanée des travaux
d'entretien nécessaires et mise en place des éléments du dispositif de surveillance.
Remarque : Si une vérification détaillée des tirants n'est pas possible, par ex. dans le cas
de tirants à adhérence totale ou de têtes d'ancrage non accessibles, on effectuera, sur la
base des dangers existants et de sondages, une analyse de risques de l'ouvrage ancré
7. Évaluation des résultats de la vérification générale et de la vérification détaillée des
tirants, respectivement de l'analyse des risques. Présentation des résultats dans un
rapport de vérification.
Sur la base de cette nouvelle évaluation plus détaillée des risques, on jugera de
l'opportunité et de l'urgence d'interventions constructives ou de surveillance supplé-
mentaires.
Une proposition d’intervention, dite « concept d'intervention », accompagnée d'un
devis estimatif sera présentée au maître d'ouvrage. Ce dernier discutera des mesu-
res proposées avec l'OFROU et décidera avec l’Office de la suite à leur donner.
Remarque : En fonction des résultats de l'évaluation détaillée des risques, le concept
d'intervention peut comprendre une remise en état suffisante pour toute la durée de vie
résiduelle de l'ouvrage. Il est également possible d'imaginer, grâce à un mode de surveil-
lance adapté, des mesures minimales et suffisantes pour une période limitée, qui pour-
ront être vérifiées et à complétées plus tard le cas échéant.
24 Édition 2007 | V3.11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
8. Saisie des données dans KUBA-DB.
9. Établissement du projet de remise en état et/ou de surveillance nécessaire, avec
devis (projet d'intervention).
10. Réalisation des interventions constructives ou de surveillance décidées. On établira
ou complétera simultanément les documents suivants :
convention d'utilisation ;
base de projet (si des interventions constructives sont réalisées) ;
plan de surveillance ;
plan d'entretien ;
documents relatifs au projet ;
rapports techniques.
11. Saisie des données dans KUBA-DB.
Remarque : Toutes les opérations des phases 1 et 2 rentrent dans la catégorie du gros
entretien.
Édition 2007 | V3.11 25
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
Étape d'intervention Activité Intervention Compétence
Phase 2 Vérification et remise en état des parties d’ouvrages
Mandat pour la vérification
de l'ouvrage Maître d'ouvrage
Vérification générale Bureau d'ingé-
5 des ancrages nieurs qualifié
Ingenieurbüro
Les tirants sont
non nécessaires à la
sécurité structurale
de l’ouvrage
oui
Un examen des
tirants est non
possible et Maître d’ouvrage
opportun
(Extension de man-
dat)
oui Bureau d'ingé-
5 Analyse
Projet d'investigation nieurs qualifié
de
risques
6 Examen des tirants
Entreprise quali-
fiée
7 Bureau d'ingé-
Rapport de vérification
nieurs qualifié
Une intervention
non
est nécessaire
oui
Bureau d'ingé-
7 Concept d'intervention
nieurs qualifié
Décision relative à la proposition
8 d'intervention et saisie des Maître d'ouvrage
données dans KUBA-DB
Bureau d'ingé-
9 Projet d'intervention
nieurs qualifié
Mise à exécution des
Entreprise quali-
interventions décidées
fiée
10 Mise à jour des documents de
Bureau d'ingé-
l'ouvrage, en particulier les plans nieurs qualifié
de surveillance et d'entretien
11 Saisie des données dans KUBA-
Maître d'ouvrage
DB
Fig. II.2: Schéma d'intervention.
26 Édition 2007 | V3.11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
II.2 Mode opératoire, instructions détaillées
II.2.1 Phase 1 : Inventaire et évaluation des ouvrages ancrés
Dossiers des ouvrages ancrés
Les documents existants de tous les ouvrages concernés seront réunis dans des dos-
siers d'ouvrage. En principe, ces dossiers doivent donner les informations suivantes :
désignation de l'ouvrage, date de construction et intervenants;
fonction de l'ouvrage et infrastructures susceptibles d'être touchées en cas de défail-
lance (transports, constructions);
situation géologique;
type de construction et esquisses de l'ouvrage;
rôle des tirants, importance relative des différents tirants;
caractéristiques sur les tirants;
facteurs de risques particuliers aux tirants;
données relatives à l'ouvrage;
dispositifs de surveillance existants et résultats obtenus;
vérifications et travaux d'entretien exécutés;
état actuel des ancrages et de l'ouvrage.
Évaluation provisoire des ouvrages ancrés
Les ouvrages feront l'objet d'une évaluation provisoire basée sur le dossier existant et sur
une inspection spéciale. Au cours de l'inspection on démontera si possible, quelques ca-
pots de protection des têtes de tirant à titre de sondage, afin de se faire une meilleure
idée de l'état des ancrages. L'appréciation provisoire sera réalisées selon les critères du
tableau ci-dessous:
Fig. II.3 : Schéma d'appréciation provisoire des ouvrages
Critère / Points d'appréciation bon défectueux mauvais
Comportement lors d’une défaillance 0 1 2
État présumé des ancrages 0 1 2
Possibilité de vérification des tirants 0 1 2
La somme des points attribués donne la mesure de l'état de l'ouvrage.
Remarque : Le schéma d'appréciation est fortement simplifié. On vérifiera dans chaque
cas la plausibilité du résultat. Si plusieurs ouvrages obtiennent le même nombre de
points, on les différenciera en affinant le schéma d'appréciation.
Fig. II.4 : Classes d'état correspondantes pour la saisie dans KUBA-DB
État présumé de l'ancrage Classe d'état dans KUBA-DB
bon (0) 1 ou 2
défectueux (1) 3
mauvais (2) 4 ou 5
Édition 2007 | V3.11 27
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
Explications relatives aux différents critères :
Comportement lors d’une défaillance
Le comportement d'un ouvrage ancré lors d’une défaillance sera taxé de « bon » dans les
cas suivants:
La défaillance d'un tirant isolé ne met pas en cause la stabilité de la structure et ne
conduit pas à la défaillance d'une partie d'ouvrage;
La structure porteuse est capable de réagir à des sollicitations plus élevées par des
déformations élastiques et plastiques avant de céder (pas de rupture fragile).
État présumé de l'ancrage
L'état de l'ancrage sera taxé de « bon » si:
Les tirants ont été soumis à une force d'épreuve suffisamment élevée, sans que la
résistance ultime externe ait été atteinte (Pp 1.25 Po);
Les tirants sont protégés contre la corrosion;
Les zones des têtes de tirants ne présentent ni dégradations dues à la corrosion et
au vieillissement, ni détériorations mécaniques, ni dégradation importante due à
l'eau, ni encrassement anormal ou présence de végétation;
L'ouvrage ancré ne présente ni fissures, ni déformations, ni déplacements, ni autres
dégradations inadmissibles.
Possibilité de vérification des tirants
La possibilité de vérification des tirants sera taxée de « bonne »:
Pour des ouvrages dont le comportement peut être apprécié sur la base de mesures
de déformations et de mesures représentatives des forces d'ancrage, à condition que
5 à 10% des tirants soient conçus comme tirants de contrôle et à condition que des
dispositifs de mesure des déplacements de l'ouvrage et du terrain soient disponibles;
Pour des ouvrages dont le comportement ne peut pas être apprécié sur la base de
mesures de déformation, si tous les tirants sont conçus comme tirants de contrôle;
Remarque : Le niveau de sécurité inhérent à l'ouvrage (hypothèses pour le dimension-
nement, niveau de précontrainte, sécurité au glissement ou au renversement etc.) est un
facteur important de l'évaluation des risques. Mais ce niveau de sécurité n'est souvent
pas encore connu à ce stade des investigations.
Classement des ouvrages par catégories
Le classement des ouvrages par catégories se fera sur la base de l’évaluation provisoire
et en fonction de leur importance (dégâts potentiels) au sens du chiffre 16.3 de la norme
SIA 261, tableau 26 [6]. On procède au classement en 4 catégories de A à D selon le ta-
bleau suivant :
Fig. II.5 : Tableau pour la classification des ouvrages par catégories A à D
Appréciation provisoire de l'ouvrage
CO Importance de l'ouvrage
0 1 2 3 4 5 6
I dégâts potentiels petits D D D C C B B
II dégâts potentiels moyens D D C C B B A
III dégâts potentiels importants D C C B B A A
Le risque potentiel est défini par la catégorie de l'ouvrage:
A L'étude et la vérification doivent débuter sans délai. La possibilité de mesu-
res d'urgence (restrictions d'utilisation, travaux de consolidation ou surveil-
lance accrue) doit être envisagée.
B/C/D Étude et vérification à effectuer selon la suite logique prévue.
28 Édition 2007 | V3.11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
II.2.2 Phase 2 : Vérification et remise en état des ouvrages
Vérification générale des ancrages
Le relevé général de l'état des ancrages et l’estimation, par le calcul, de leur rôle et de
leur capacité (nombre de tirants, force d'ancrage) doivent permettre une évaluation de la
sécurité structurale, de l'aptitude au service et de la durabilité de l'ouvrage ancré. On en
déduira la marche à suivre : si une vérification détaillée comprenant des examens sup-
plémentaires est nécessaire, opportune et techniquement réalisable ou, lorsque la vérifi-
cation des tirants n'est pas possible, si une analyse de risques doit être effectuée.
Relevé général de l'état
But
Relever l'état général de l'ouvrage ancré et les possibilités de vérification.
Marche à suivre
1. Étude approfondie des documents existants de l'ouvrage, en particulier l'historique
de sa construction et les données sur les tirants. Cette étude donnera une des-
cription détaillée des tirants existants, de leurs points faibles quant à leur durabilité
et de leur aptitude à être vérifiés.
2. Inspection de l'ouvrage ancré. La marche à suivre dépend des informations dis-
ponibles sur les tirants d'ancrage, ainsi que des possibilités d'accès et d'observa-
tion directe des têtes de tirants. Il suffit souvent de procéder à une inspection pu-
rement visuelle de l'ouvrage et de son environnement, ainsi que des têtes de ti-
rants. Dans d'autres cas il sera opportun de choisir quelques tirants au hasard
d'en examiner les têtes et de déterminer la force d'ancrage par décollement.
3. Récapitulation des informations disponibles ou manquantes sur l'état des ancra-
ges. On en déduira l'état général probable, en précisant le degré de fiabilité de
l'appréciation. On décrira en complément, pour autant que cela soit possible, les
moyens permettant de réunir les informations manquantes.
Calcul de vérification
But
Fournir, grâce à un calcul théorique, des indications sur la sécurité structurale nomina-
le de l'ouvrage et sur l'importance de la contribution des ancrages.
Marche à suivre
Vérification globale de l'ouvrage ancré dans une ou deux sections représentatives, à
l'aide des normes SIA 260 à 267 par exemple. En admettant que les tirants existants
sont intacts et offrent la capacité prévue, ce calcul permet d'obtenir la valeur nominale
de la sécurité structurale de l'ouvrage ancré.
Évaluation de l'état de l'ouvrage
But
Fournir des indications générales sur la sécurité structurale, l'aptitude au service et la
durabilité de l'ouvrage ancré.
Marche à suivre
Déterminer tout d'abord si la valeur nominale de la sécurité structurale calculée est
suffisante. Cette démarche fera apparaître l'importance de la contribution des ancra-
ges existants à la stabilité de l'ouvrage. Évaluer ensuite les conséquences de la défail-
lance de tirants isolés sur la stabilité de l'ouvrage. Sur la base des résultats et du rele-
vé de l’état de l'ouvrage, on décidera si une appréciation générale de la sécurité struc-
turale et de l’aptitude au service actuelle, ainsi que de leur évolution peut être effec-
tuée.
Les résultats de la vérification générale sont contenus dans un rapport de vérification.
Il formulera des recommandations pour la suite à donner à la vérification. Un devis es-
timatif et un programme seront établis pour toute proposition d'examens ou d'interven-
tions ultérieurs.
Édition 2007 | V3.11 29
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
Remarque : La vérification générale d'un ancien ouvrage ancré peut aboutir à des
conclusions qualitatives très différentes. Par exemple :
La contribution des ancrages à la sécurité structurale et à l'aptitude au service de
l'ouvrage est indispensable / n'est pas indispensable ;
Les tirants présentent des dégâts étendus dus à la corrosion, considérés comme ir-
réparables / réparables ;
Le contrôle de l'aptitude au service des ancrages existants au moyen d'une vérifica-
tion détaillée est possible / n'est pas possible ;
La défaillance d'un tirant isolé a des conséquences graves / négligeables ;
Les dispositifs de surveillance permettent / ne permettent pas de constater la défail-
lance d'un tirant isolé en temps utile.
Suivant les cas, la vérification générale permet soit une évaluation claire de l'état de
l’ouvrage (rapport de vérification proprement dit) ou elle n'aboutit qu'à des conjectures,
dont la vérification exige des examens supplémentaires (rapport intermédiaire).
Vérification détaillée des travaux d’entretien et des dispositifs de surveillance
Si les résultats de la vérification générale démontrent qu'il est possible et opportun d'ef-
fectuer des vérifications complémentaires pour établir l'état des ancrages, un projet d'in-
vestigation avec descriptif des prestations sera mis au point. Le maître d'ouvrage attribue
le mandat correspondant sur la base du rapport intermédiaire. Le projet comprendra éga-
lement les travaux d'entretien à exécuter opportunément en même temps que les investi-
gations ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance (instrumentation) né-
cessaires.
Vérification des tirants
But
La vérification des tirants doit fournir des informations sur l'état des ancrages et sur
les forces d'ancrage existantes.
Marche à suivre
On procédera en général de la façon suivante :
1. Examen visuel de toutes les têtes de tirant accessibles, tout d'abord sans démon-
tage des capots. On prendra note des détériorations mécaniques, des dégrada-
tions dues à la corrosion, de venues d'eau, etc.
2. Détermination des déformations de l'ouvrage et du terrain. L'ensemble des dispo-
sitifs de mesure existants feront l'objet d'une lecture de contrôle. On procédera de
plus à une inspection de l'ouvrage et de ses alentours.
3. Investigation approfondie d'un nombre représentatif de tirants
a. Démontage des capots ou enlèvement du béton d'enrobage et examen de
l'état des têtes de tirant, en particulier de la protection contre la corrosion. Si
des ouvertures existent dans la tête du tirant, l'inspection sera étendue à
l’arrière de la tête au moyen d'un endoscope.
b. Détermination de la force d'ancrage effective par décollement de la tête, pour
autant que cela soit possible. Dans le cas de tirants équipés de cellules dy-
namométriques on fera simultanément une lecture de ces dernières (contrôle
de fonctionnement).
c. Examen d'une partie de ces tirants, spécialement ceux présentant des pertes
de précontrainte supérieures à la moyenne. L'examen consistera générale-
ment en une épreuve spéciale de mise en tension, en 3 paliers, jusqu'à la for-
ce d'épreuve Pp ≥ 1.25 P0. On admettra comme taux de fluage kadm =
0.50 mm. Ces épreuves de mise en tension doivent fournir des renseigne-
ments sur la capacité du corps d'ancrage et permettre la détection d'éventuel-
les défaillances des armatures d’acier dues à la corrosion.
4. Examen de l'état de la structure ancrée, en particulier des parties d'ouvrage desti-
nées à reprendre les forces de précontrainte des tirants. On se contentera géné-
ralement d'un examen visuel détaillé. Dans des cas critiques uniquement, on pro-
cédera à des examens supplémentaires tels que la détermination du recouvre-
30 Édition 2007 | V3.11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
ment des armatures, des mesures de potentiel, la détermination du degré de car-
bonatation ou de dégâts dus aux sels ou par la RAG, etc.
Travaux d'entretien
But
Le but est de profiter de l'examen des ancrages pour exécuter parallèlement les tra-
vaux d'entretien manifestement nécessaires.
Marche à suivre
1. Corrections de la précontrainte des tirants
II est quelquefois opportun de procéder à un réglage de la précontrainte pour la
ramener au niveau prévu. Le projet précisera l'ampleur des variations de pré-
contraints tolérables (en %), au delà desquelles un réglage doit avoir lieu.
2. Injections complémentaires, drainages
Si l'on découvre des vides derrière la tête du tirant, à l'intérieur ou à l'extérieur de
la gaine entourant les armatures, on procédera à l'injection d'un coulis de ciment
ou d'une masse anticorrosion adéquate. On tentera d'arrêter les venues d'eau se
produisant dans la zone de la tête du tirant, par injection ou par d'autres mesures
adéquates, ou encore de les capter en dehors de cette zone au moyen de forages
de drainage.
3. Protection contre la corrosion de la tête du tirant
Après examen du tirant, il convient de renouveler la protection contre la corrosion.
On effectuera généralement les travaux suivants :
Nettoyage de la plaque d'appui par sablage ou polissage, puis application
d'une peinture de protection ;
Nettoyage de la tête et des sur-longueurs de l'armature (à la main ou à la va-
peur), puis enrobage au moyen d'une masse anticorrosion adéquate ;
Nettoyage et couche de protection, ou remplacement des capots de protec-
tion, joints compris ;
Perçage d'un trou d'aération de 6 mm au point le plus bas du capot de pro-
tection pour empêcher l'accumulation d'eau de condensation.
4. Autres travaux d'entretien
Selon le type d'ouvrage, d'autres travaux d'entretien peuvent être nécessaires, par
exemple :
Remise en état des drainages des puits d’accès pour tirants de mesure ;
Montage de toits de protection contre la chute de pierres ;
Amélioration de l'accessibilité des tirants de contrôle par des échelles et des
estrades ;
Injection de fissures dans le béton ;
Réparations superficielles ou enduit sur le béton ;
Nettoyage du rocher ;
Remplacement de tirants passifs ;
Forage ou remise en état de drainages ;
Travaux d'étanchement ;
Plantations ou élimination d'arbres et d'arbustes.
Édition 2007 | V3.11 31
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
Dispositifs de surveillance
But
Équiper l'ouvrage ancré d'un dispositif de surveillance performant.
Marche à suivre
A partir des dispositifs éventuellement existants on établira un projet adapté à l'ouvra-
ge et aux conditions géologiques.
Les dispositifs existants ne seront intégrés dans le système de mesure qu'après vérifi-
cation de leur fonctionnement.
La mise en place des dispositifs de surveillance supplémentaires aura lieu aussi tôt
que possible. Une mesure initiale sera effectuée après leur installation.
Exécution du projet d'investigation
Les travaux seront surveillés par un spécialiste disposant de connaissances approfondies
de la technique des tirants. Les travaux seront confiés à une entreprise de tirants quali-
fiée qui peut mais ne doit pas forcément être celle qui a livré les tirants mis en place. Le
projet d'investigation sera régulièrement adapté par son auteur en fonction des résultats
obtenus.
Les armatures rompues, découvertes durant les investigations, seront extraites et livrées
sans délai pour analyse à un laboratoire d'essai qualifié dans les problèmes de corrosion.
Analyse de risques
Une analyse de risques de l'ancrage est effectuée si la vérification générale rend des
études complémentaires nécessaires, mais que ces dernières ne sont pas possibles d'un
point de vue technico-économique (tirants à adhérence totale, têtes d'ancrage non ac-
cessibles).
But
L'analyse de risques fournira des indications sur les mesures minimales à prendre,
nécessaires pour assurer la sécurité structurale et l'aptitude au service de l'ouvrage
pendant une durée à convenir (par ex. 25 ans). Les mesures seront élaborées de ma-
nière à fournir des informations suffisantes à l'issue de la durée convenue afin de
pouvoir juger de la nécessité de mesures complémentaires (méthode observationnel-
le).
Marche à suivre
1. Appréciation des risques
Les facteurs suivants, propres à l'ouvrage et affectant sa sécurité, seront appré-
ciés et pondérés, par ex. au moyen d'un système de points:
Risques inhérents à chaque tirant;
Par ex. type de tirant, sa construction, venue d'eau, action des chlorides, capa-
cité portante, niveau de tension.
Fonction de la structure porteuse;
Par ex. stabilisation de glissement de terrain, sécurisation de tranchée, revête-
ment de rocher, ancrage de forces de traction externes.
Importance de chaque tirant;
Par ex. nombre de tirants, redondance du système porteur, conséquence de la
rupture d’un tirant.
Type et conséquence d'une défaillance de la structure porteuse.
Par ex. rupture fragile ou défaillance avec déformations mesurables, mise en
danger d'infrastructures de transport importantes et de bâtiments.
2. Examens supplémentaires
Il faut souvent procéder à des examens supplémentaires pour améliorer la fiabilité
de l'appréciation des risques, comme par ex. :
Vérification du calcul statique;
Sondages;
Examens chimiques de l'eau;
32 Édition 2007 | V3.11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
Mise à nu de têtes d'ancrage isolées.
3. Interprétation de l'appréciation des risques
Lorsque l'appréciation des risques effectuée, on en déduit les mesures constructi-
ves et/ou les mesures de surveillance à prendre pour atteindre le but fixé dans
l'analyse. Des variantes devraient également être présentées.
Rapport de vérification et concept d'intervention
Un rapport de vérification documenté et complet sur les examens effectués, resp. sur
l'analyse de risques sera établi.
Le rapport formulera un jugement global sur l'état des ancrages et de l'ouvrage ainsi
qu'un pronostic d'évolution. On en déduira, le cas échéant, quelles mesures sont néces-
saires pour assurer la sécurité structurale et l'aptitude au service pendant la durée d'utili-
sation restante, resp. pour une période déterminée. Le comportement de l'ouvrage jus-
qu'à la vérification sera pris en compte pour évaluer les mesures d'assainissement et leur
ampleur.
Les mesures suivantes, seules ou combinées, peuvent être mises en œuvre:
Intensification de la surveillance;
Mise en place de dispositifs de surveillance supplémentaires;
Restriction d’utilisation;
Mise en place de tirants supplémentaires ou de remplacement;
Modification du système porteur.
Le rapport de vérification concrétisera ses propositions par des indications pratiques
(concept d'intervention) et par des considérations sur les délais acceptables pour leur ré-
alisation. De plus il traitera de la possibilité d'une réalisation par étapes.
Accompagné d'un devis estimatif pour les mesures proposées, le rapport de vérification
sera remis au maître d'ouvrage pour décision.
Édition 2007 | V3.11 33
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
II.3 Projet d'intervention
Les interventions permettant de garantir une sécurité structurale suffisante de l’ouvrage
ancré, décidées par le maître d'ouvrage sur la base du rapport de vérification, feront l'ob-
jet d'un projet et d'un devis, puis d’un appel d’offre auprès d’entreprises qualifiées. La
proposition d'adjudication tiendra particulièrement compte de la qualité de l'entreprise et
de l'expérience des personnes clés dans la technique des tirants.
II.4 Exécution des interventions et établissement des docu-
ments relatifs à l'ouvrage
La surveillance des travaux sera confiée à un ingénieur disposant de connaissances ap-
profondies de la technique des tirants et pouvant faire état de l'expérience correspondan-
te. La direction des travaux, ou du moins le suivi technique des travaux, sera assuré de
préférence par l'auteur du projet.
Si des tirants supplémentaires ou de remplacement doivent être mis en place, ils seront
réalisés et contrôlés selon les règles figurant dans la Partie I de cette directive.
Si de nouveaux éléments importants influençant la sécurité structurale viennent à être
connus durant l'exécution des travaux, la direction des travaux en avisera sans tarder
l'auteur du projet. Sur ces bases, ce dernier effectuera une revue de projet dans des dé-
lais qui permettent d’inclure les décisions qui en résultent dans les travaux en cours.
Les documents relatifs à l'ouvrage seront établis, reps. complétés, à la fin des travaux.
Les données correspondantes seront en outre saisies dans KUBA-DB.
34 Édition 2007 | V3.11
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
Bibliographie
Directives de l’OFROU
[1] Office fédéral des routes OFROU (2005), « Surveillance et entretien des ouvrages d'art des routes
nationales», directive ASTRA 12002, www.astra.admin.ch.
[2] Office fédéral des routes OFROU (2007), « Réaction alcali-granulats du béton, Données de base et
mesures pour les ouvrages d’art nouveaux et existants », documentation ASTRA 82013, V1.01,
www.astra.admin.ch.
[3] Office fédéral des routes OFROU (1999), « Tirants d’ancrages», directive ASTRA 12005 (ancienne
version V2.00)
[4] Office fédéral des routes OFROU (1993), « Tirants d'ancrage permanents en terrain meuble et en
rocher » directive ASTRA 12005 (ancienne version V1.00)
Normes
[5] Société suisse des ingénieurs et architectes SIA (2003), « Bases pour l’élaboration des projets de
structures porteuses », norme SIA 260.
[6] Société suisse des ingénieurs et architectes SIA (2003), « Actions sur les structures porteuses»,
norme SIA 261.
[7] Société suisse des ingénieurs et architectes SIA (2003), « Construction en béton », norme SIA 262.
[8] Société suisse des ingénieurs et architectes SIA (2003), « Construction en acier », norme SIA 263.
[9] Société suisse des ingénieurs et architectes SIA (2003), « Géotechnique », norme SIA 267.
[10] Comité européen de normalisation CEN (2004), „Eurocode 8. Design of structures for earthquake
resistance. Foundations, retaining structures and geotechnical aspects“, EN 1998-5 :2004
[11] Société suisse des ingénieurs et architectes SIA (1995), « Tirants d'ancrage précontraints » Re-
commandation SIA V 191.
Publications
[12] F. Hunkeler, P. Matt, U. von Matt und R. Werner (août 2005), « Câbles de précontrainte, haubans et
tirants d'ancrage - Description des systèmes et leçons tirées des dégâts dus à la corrosion »,
Office fédéral des routes OFROU, Projet de recherche AGB 2000/470, Rapport VSS No. 588.
[13] U. von Matt und M. Büchler (février 2007), « Tirants d'ancrage précontraints en sol et en rocher :
Fluctuations de la résistance électrique », Office fédéral des routes OFROU, Projet de recherche
AGB 2001/489, Rapport VSS No. 612.
Édition 2007 | V3.11 35
ASTRA 12005 | Tirants d'ancrage
Liste des modifications
Édition Version Date Modifications
2007 3.11 13.02.2012 Modifications formelles en français et en allemand. Examen complet et
révision de la traduction française
2007 3.10 01.10.2007 Modifications formelles.
2007 3.00 01.08.2007 Entrée en vigueur de l’édition 2007.
Précisions et complément à la norme SIA 267:2003 « Geotechnique », à la
norme SIA 118 / 267:2004 « Conditions générales pour la construction en
géotechnique », l'extension pour les ancrages non tendus, l'influence des
tremblements de terre sur les édifices ancrés et la réaction alcalis-granulats
du béton (RAG).
1999 2.00 1999 Entrée en vigueur de l’édition 1999.
Précisions et complément à la norme SIA V 191:1995.
1993 1.00 1993 Entrée en vigueur de l’édition 1993
Édition 2007 | V3.11 37
Vous aimerez peut-être aussi
- Inspection Selon NfpaDocument24 pagesInspection Selon NfpaAnonymous 1FzIK5h100% (3)
- L' Ingénieur et le développement durableD'EverandL' Ingénieur et le développement durableÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Référentiels BFUPDocument26 pagesRéférentiels BFUPMax0055Pas encore d'évaluation
- Manuel Cazenove 017Document4 pagesManuel Cazenove 017amine ayariPas encore d'évaluation
- DTU 13.11 - Fondations SuperficiellesDocument11 pagesDTU 13.11 - Fondations Superficiellescris5001Pas encore d'évaluation
- 107 - Dtu13 3anxc v9Document23 pages107 - Dtu13 3anxc v9Redouane MendilPas encore d'évaluation
- 01 - FlambementDocument10 pages01 - Flambementsmile4latifPas encore d'évaluation
- Tirants D'ancrageDocument1 pageTirants D'ancrage何旭Pas encore d'évaluation
- D GC BESSEGHIER AbderrahmaneDocument85 pagesD GC BESSEGHIER AbderrahmaneAhmed BouamoudPas encore d'évaluation
- Les Pathologies Des OuvragesDocument4 pagesLes Pathologies Des OuvragesWalidBenHamidouche0% (1)
- InstabilitéDocument78 pagesInstabilitéBlaise Pascal Mondouji SpikehardkaisPas encore d'évaluation
- TP 03&04 Le Béton À L'état DurciDocument11 pagesTP 03&04 Le Béton À L'état DurciAbdelhak MahdiPas encore d'évaluation
- Influence de La Carbonatation Sur La Porosité Et La Permeabilité Des Béton PDFDocument56 pagesInfluence de La Carbonatation Sur La Porosité Et La Permeabilité Des Béton PDFLahcenLakdim0% (1)
- 36 Colas PDFDocument1 page36 Colas PDFAnonymous 4BoZQ0Pas encore d'évaluation
- TD2, Pied de PoteauDocument3 pagesTD2, Pied de PoteauDark MatePas encore d'évaluation
- PFE - Mémoire - DaudibertièresDocument52 pagesPFE - Mémoire - DaudibertièresEng. NKURUNZIZA ApollinairePas encore d'évaluation
- Voile Note de Calcul 00212522154lmDocument4 pagesVoile Note de Calcul 00212522154lmSoufiane HakimPas encore d'évaluation
- Fondations ProfondesDocument6 pagesFondations ProfondesBabacar MbayePas encore d'évaluation
- Note de Calcul Charpente Metallique 1Document66 pagesNote de Calcul Charpente Metallique 1Brahim Mouhcine100% (2)
- Fondation SuperficielleDocument5 pagesFondation SuperficielleSaid EssahriPas encore d'évaluation
- Join de Rupture Et Join de DelatationDocument1 pageJoin de Rupture Et Join de DelatationElJanousSoumayaPas encore d'évaluation
- TreillisDocument17 pagesTreillisameg15Pas encore d'évaluation
- 09 Précontrainte 2017 Mode de CompatibilitéDocument29 pages09 Précontrainte 2017 Mode de CompatibilitéAly OUEDRAOGOPas encore d'évaluation
- Cours Fondation l3gc - Fada 2021Document229 pagesCours Fondation l3gc - Fada 2021resilience multiservice100% (1)
- Chap.5 Pertes de PrécontrainteDocument11 pagesChap.5 Pertes de Précontraintebenlarbi zahirPas encore d'évaluation
- RankineDocument11 pagesRankineFias AnuobPas encore d'évaluation
- Eurocode 8 - Partie 5: Fondations, Ouvrages de Soutènement Et Aspects Ouvrages de Soutènement Et Aspects GéotechniquesDocument55 pagesEurocode 8 - Partie 5: Fondations, Ouvrages de Soutènement Et Aspects Ouvrages de Soutènement Et Aspects GéotechniquesDY SAXPas encore d'évaluation
- Projet HangarDocument23 pagesProjet HangarkhalidPas encore d'évaluation
- Idees Recues Sur L'Injection Des RochesDocument18 pagesIdees Recues Sur L'Injection Des RochesJonas Vera100% (1)
- 1 - MEMOIRE (Version Corrigée1)Document59 pages1 - MEMOIRE (Version Corrigée1)lando de chancePas encore d'évaluation
- Eurocod 7 Essais in SituDocument146 pagesEurocod 7 Essais in SitughiliPas encore d'évaluation
- CourN - 1-Fondations SuperficielleDocument98 pagesCourN - 1-Fondations SuperficielleBelmabkhout Yassine100% (1)
- Etude Des Performances D'un Béton Autoplaçant À Base Des Sables Binaires PDFDocument57 pagesEtude Des Performances D'un Béton Autoplaçant À Base Des Sables Binaires PDFIlyes BenhacenePas encore d'évaluation
- Mission GeotechniqueDocument40 pagesMission GeotechniqueLahcen LakdimPas encore d'évaluation
- Extrait 42231210Document86 pagesExtrait 42231210OMAR MEZGHANNIPas encore d'évaluation
- XPP94 444Document11 pagesXPP94 444Gorille GorillePas encore d'évaluation
- NA5282 Sols - Reconnaissance Et Essais - Coefficient de Fragmentabilité Des Matériaux RocheuxDocument5 pagesNA5282 Sols - Reconnaissance Et Essais - Coefficient de Fragmentabilité Des Matériaux RocheuxsamiPas encore d'évaluation
- Défauts de Ponts PDFDocument58 pagesDéfauts de Ponts PDFKarim ZazaPas encore d'évaluation
- Fondations Prof SyntheseDocument29 pagesFondations Prof SynthesehzoualidPas encore d'évaluation
- III 1 AcrotersDocument4 pagesIII 1 AcrotersPenamaPas encore d'évaluation
- PFA2 FinalDocument29 pagesPFA2 Finalloumed16Pas encore d'évaluation
- Pathologie TassementDocument26 pagesPathologie TassementfqjhfqkPas encore d'évaluation
- NA427Document5 pagesNA427Lsp Ergosot Khemis-khechnaPas encore d'évaluation
- Mur de SoutenementDocument57 pagesMur de SoutenementCharaf KhelifiPas encore d'évaluation
- AT442 - Houda LAMRANI - Montée en Cohésion Des Émulsions de Bitume en Couches D'accrochage PDFDocument19 pagesAT442 - Houda LAMRANI - Montée en Cohésion Des Émulsions de Bitume en Couches D'accrochage PDFsaid100% (1)
- 2 - Construction 1 - 2122 - PredimensionnementDocument15 pages2 - Construction 1 - 2122 - PredimensionnementAbdellah Belhadj100% (1)
- Dtu EtancheiteDocument146 pagesDtu EtancheiteAEMPas encore d'évaluation
- ArticleDocument42 pagesArticleMohcine RouessiPas encore d'évaluation
- TD5 RDM2Document3 pagesTD5 RDM2MilanoPas encore d'évaluation
- Technqiues InjectionDocument34 pagesTechnqiues InjectionMongi Ben Ouezdou100% (1)
- Caniveaux A Grilles HRI PDFDocument14 pagesCaniveaux A Grilles HRI PDFKalil DaoPas encore d'évaluation
- Directive - Tirant D'ancrage, Suisse, 2007Document38 pagesDirective - Tirant D'ancrage, Suisse, 2007Sebih DjilaliPas encore d'évaluation
- Norma Suiza - Túneles FalsosDocument22 pagesNorma Suiza - Túneles FalsosDaniel DiazPas encore d'évaluation
- Structure Et Désignation Des Équipements D'Exploitation Et de Sécurité (Aks-Ch)Document84 pagesStructure Et Désignation Des Équipements D'Exploitation Et de Sécurité (Aks-Ch)Paride UboldiPas encore d'évaluation
- Technique de L'ingenieur-Murs RideauxDocument23 pagesTechnique de L'ingenieur-Murs Rideauxdonadelpaolo.87Pas encore d'évaluation
- ASTRA+16050+Sécurité+opérationnelle+pour+l'exploitation+ (2011+V1 02)Document32 pagesASTRA+16050+Sécurité+opérationnelle+pour+l'exploitation+ (2011+V1 02)babel_stanPas encore d'évaluation
- Astra 86022 Gestiondesurgencessurleschantiers2015v301Document46 pagesAstra 86022 Gestiondesurgencessurleschantiers2015v301ABADI NAHIDPas encore d'évaluation
- Notice D Utilisation Et de Maintenance Des Convoyeurs A Bandes ElcomDocument37 pagesNotice D Utilisation Et de Maintenance Des Convoyeurs A Bandes ElcomBilal MasaoudiPas encore d'évaluation
- VSL STA-02-002 VSL Système de Tirants précontraints-FRDocument65 pagesVSL STA-02-002 VSL Système de Tirants précontraints-FRRamiro TiconaPas encore d'évaluation
- Calcul Des Structures Maâ©talliques Selon L Eurocode 3Document168 pagesCalcul Des Structures Maâ©talliques Selon L Eurocode 3YO Batia Bii100% (8)
- Richard MeierDocument31 pagesRichard MeierAymen Areslen100% (1)
- Aventures en Terre Du Milieu 5e Cultures Naines FRDocument15 pagesAventures en Terre Du Milieu 5e Cultures Naines FREmmanuel PicardatPas encore d'évaluation
- مستند Microsoft Word جديدDocument18 pagesمستند Microsoft Word جديدyacine didaPas encore d'évaluation
- HTTP://WWW - France Examen - Com/annales Bac Terminale Generale Scientifiq...Document3 pagesHTTP://WWW - France Examen - Com/annales Bac Terminale Generale Scientifiq...la physique selon le programme FrançaisPas encore d'évaluation
- Prévalence Du Staphylococcus Aureus Isolé À Partir de La Viande de Poulet Commercialisée Au Niveau de Rabat, MarocDocument6 pagesPrévalence Du Staphylococcus Aureus Isolé À Partir de La Viande de Poulet Commercialisée Au Niveau de Rabat, MarocSalma BelabbasPas encore d'évaluation
- Manual Servicio Nx125transcityDocument148 pagesManual Servicio Nx125transcityIvan EliPas encore d'évaluation
- Exercices Supplementaires Masses Volumiques Et DensiteDocument2 pagesExercices Supplementaires Masses Volumiques Et Densiteمحمدلمين سيداحمدPas encore d'évaluation
- Extraits TroislumieresDocument15 pagesExtraits TroislumieresBruno GervalPas encore d'évaluation
- Les Ulceres Gastro-Duodenaux Et Leurs ComplicationsDocument32 pagesLes Ulceres Gastro-Duodenaux Et Leurs ComplicationsBertrand EssobiyouPas encore d'évaluation
- Product Sheet Me F FR WebDocument16 pagesProduct Sheet Me F FR WebzanazePas encore d'évaluation
- Lexique Des Acronymes SNCFDocument627 pagesLexique Des Acronymes SNCFlasse konePas encore d'évaluation
- TATSAMBON - Rapport Méthodes ÉnergétiquesDocument15 pagesTATSAMBON - Rapport Méthodes Énergétiqueslando de chancePas encore d'évaluation
- MODELISATION DES BIOPROCEDES - Cours - 11 - 2018 - 19Document9 pagesMODELISATION DES BIOPROCEDES - Cours - 11 - 2018 - 19Maissa BoucifPas encore d'évaluation
- Le Tenseur Des Contraintes de CauchyDocument59 pagesLe Tenseur Des Contraintes de CauchyKhireddine MimouniPas encore d'évaluation
- Agencement Des Espaces PrivesDocument99 pagesAgencement Des Espaces PrivesPremières PerspectivesPas encore d'évaluation
- TD 3 2023Document2 pagesTD 3 2023Jamel Ben AmmarPas encore d'évaluation
- Les CanauxDocument3 pagesLes CanauxStéphanie Dolheguy100% (1)
- Pharmacologie Des Anti UlcéreuxDocument5 pagesPharmacologie Des Anti UlcéreuxNada KarachiPas encore d'évaluation
- Cours Aérodrome 2Document4 pagesCours Aérodrome 2RHB GHASSAN100% (1)
- Chez Le Ouagalais HarmattanDocument142 pagesChez Le Ouagalais HarmattanAustine AUYOMAPas encore d'évaluation
- Walter Benjamin Theses Sur Le Concept D'histoireDocument20 pagesWalter Benjamin Theses Sur Le Concept D'histoireThiago FerreiraPas encore d'évaluation
- Corrigé - Réactions Chimiques + Acide:BaseDocument12 pagesCorrigé - Réactions Chimiques + Acide:BaseThierryPas encore d'évaluation
- Aspirateur À Copeaux de Bois Leman ASP152 - 150 Litres en StockDocument1 pageAspirateur À Copeaux de Bois Leman ASP152 - 150 Litres en StockAli KhadraouiPas encore d'évaluation
- 7 Introduction GénéraleDocument3 pages7 Introduction GénéraleDjelita BelkheirPas encore d'évaluation
- TP TransfertDocument2 pagesTP TransfertAbdelwahab.gfPas encore d'évaluation
- Moi SoutenanceDocument60 pagesMoi SoutenanceJames TamkoPas encore d'évaluation
- Blyton Enid Nos Amis Les OiseauxDocument24 pagesBlyton Enid Nos Amis Les Oiseauxgerbotteau100% (1)
- Massifs de ButeeDocument2 pagesMassifs de Buteelimmoud2jPas encore d'évaluation
- Ce Qu'Il Faut D'air Pour Voler by Sandrine Roudeix (Roudeix, Sandrine)Document150 pagesCe Qu'Il Faut D'air Pour Voler by Sandrine Roudeix (Roudeix, Sandrine)Isabelle BKAPas encore d'évaluation