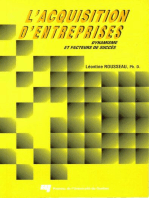Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Original PDF
Transféré par
Achref BenyoussefTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Original PDF
Transféré par
Achref BenyoussefDroits d'auteur :
Formats disponibles
Etude et conception d’une table élévatrice
SOMMAIRE
TABLE DES FIGURES ......................................................................................................... 4
LISTE DES TABLEAUX ...................................................................................................... 5
Introduction générale.............................................................................................................. 6
CHAPITRE I : ............................................................................................................................ 7
PRESENTATION DE L’ORGANISME D’ACCEUIL ............................................................. 7
Introduction ............................................................................................................................ 8
1. Présentation de l’entreprise d’accueil : ........................................................................... 8
2. Activité : .......................................................................................................................... 9
3. Organisations des ressources humaines de la société :.................................................... 9
3.1. Effectif : ................................................................................................................... 9
3.2. Organigramme de la société :................................................................................. 10
4. Les procédés de fabrication : ......................................................................................... 11
4.1. La préparation : ...................................................................................................... 11
4.2. La ligne de production : ......................................................................................... 12
4.3. La lyophilisation : .................................................................................................. 12
4.4. L’inspection : ......................................................................................................... 12
4.5. L’emballage : ......................................................................................................... 13
5. Problématique : ............................................................................................................. 13
5.1. Description des problèmes existe :......................................................................... 13
5.2. Données à propos la table : .................................................................................... 14
CHAPITRE II : ......................................................................................................................... 16
ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE ............................................................................................... 16
Introduction .......................................................................................................................... 17
1. Fonctionnement du système : ........................................................................................ 17
2. Les différents types des tables élévatrices : .................................................................. 17
2.1. Chariot élévatrice :..................................................................................................... 17
2.2. Monte charge ............................................................................................................. 19
3. L'alimentation : .............................................................................................................. 21
4. Avantage d’utilisation des Tables élévatrices : ............................................................. 21
5. Domaines d’utilisation : ................................................................................................ 22
6. Accouplements : ............................................................................................................ 22
ISET Nabeul Page 1 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
CHAPITRE III : ....................................................................................................................... 25
ANALYSE FONCTIONNELLE ............................................................................................. 25
Introduction .......................................................................................................................... 26
1. Modélisation du système : ............................................................................................. 26
2. Analyse de besoin : ....................................................................................................... 26
2.1. Saisir les besoin : ................................................................................................... 27
2.2. Enoncer le besoin : ................................................................................................. 27
2.3. Validation de besoin : ............................................................................................ 28
3. Analyse fonctionnelle externe : étude de la faisabilité :................................................ 28
3.1. Identifier les fonctions de services : ....................................................................... 29
3.2. Validation des fonctions de service : ..................................................................... 30
3.3. Caractériser les fonctions de service : .................................................................... 32
4. Hiérarchiser les fonctions de services : ......................................................................... 34
CHAPITRE IV: ........................................................................................................................ 36
ANALYSE FONCTIONNELLE TECHNIQUE ET CHOIX DES SOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES .............................................................................................................. 36
1. Analyse fonctionnelle technique : ................................................................................. 37
1.1 Présentation de la méthode FAST : ....................................................................... 37
1.2 FAST créatif : « séquence d’utilisation » : ............................................................ 38
2. Choix des solutions technologique :.............................................................................. 40
2.1. Critère de choix : .................................................................................................... 40
CHAPITRE V : ........................................................................................................................ 46
DIMENSIONNEMENT DE PROJET ..................................................................................... 46
1. Schéma de la table élévatrice : ...................................................................................... 47
2. Calcule des réactions appliquées sur la table supérieure (plateforme) : ................ 47
2.1. Interprétation : ........................................................................................................ 50
3. Calcul des réactions appliquées sur les ciseaux : ................................................... 53
3.2. Simulation solidworks et interprétation : ............................................................... 56
4. Chapes aux extrémités du plateau et du châssis :................................................... 57
4.1. Dimensionnement des chapes : .............................................................................. 57
5.1. Calcule de durée de vie de roulement de palier : ................................................... 58
(Voir annexe 4)................................................................................................................. 58
5.2. Calcule des boulons au cisaillement : .................................................................... 58
6. Choix motoréducteur : ................................................................................................... 60
6.1. Sélection de l’actionneur mécanique : ................................................................... 60
7. Table en 3D : ................................................................................................................. 61
ISET Nabeul Page 2 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
CHAPITRE VI : ....................................................................................................................... 63
DOSSIER TECHNIQUE ......................................................................................................... 63
Introduction .......................................................................................................................... 64
1. Les dessins des définitions : .......................................................................................... 64
Conclusion :.......................................................................................................................... 74
ISET Nabeul Page 3 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
TABLE DES FIGURES
Figure 1 : Vue externe de Médis ................................................................................................ 8
Figure 2 : organigramme de la société Médis .......................................................................... 10
Figure 3 : procédé de fabrication au sein de Médis .................................................................. 11
Figure 4 : la table ancienne....................................................................................................... 14
Figure 5 : Table élévatrice simple ciseaux ............................................................................... 17
Figure 6 : Table élévatrice double ciseaux ............................................................................... 18
Figure 7 : Table élévatrice triple ciseaux ................................................................................. 18
Figure 8 : Table élévatrice mobile............................................................................................ 19
Figure 9 : Table élévatrice à soufflet ........................................................................................ 19
Figure 10 : Monte-charge à colonnes ....................................................................................... 20
Figure 11 : Nacelle élévatrice ................................................................................................... 20
Figure 12 : bloc d'alimentation ................................................................................................. 21
Figure 13 : Accouplement ........................................................................................................ 23
Figure 14 : description globale d'un produit............................................................................. 26
Figure 15 : Diagramme bête à cornes ....................................................................................... 28
Figure 16 : Diagramme PIEUVRE........................................................................................... 29
Figure 17 : matrice d'hiérarchisation ........................................................................................ 34
Figure 18 : Graphe d'hiérarchisation ........................................................................................ 35
Figure 19 : Diagramme FAST .................................................................................................. 45
Figure 20 : structure de la table élévatrice ............................................................................... 47
Figure 21 : les réactions au niveau de la plateforme ................................................................ 47
Figure 22 : diagramme de l'effort tranchant ............................................................................. 50
Figure 23 : diagramme de moment fléchissant ........................................................................ 50
Figure 24 : profil de la poutre................................................................................................... 51
Figure 25 : les ractions appliquées sur les ciseaux ................................................................... 53
Figure 26 : palier ...................................................................................................................... 57
Figure 27 : Table au niveau haute ............................................................................................ 62
Figure 28 : table au niveau bas ................................................................................................. 62
Figure 29 : liaison plateforme et ciseau ................................................................................... 62
ISET Nabeul Page 4 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Ressources humaines de Médis ................................................................................ 9
Tableau 2 : degrés de flexibilité ............................................................................................... 32
Tableau 3 : Caractéristiques des fonctions des services ........................................................... 33
Tableau 4 : valorisation d'interet .............................................................................................. 40
Tableau 5 : Valorisation globale .............................................................................................. 41
Tableau 6 : les expresions des reactions appliquées aux ciseaux ............................................. 55
ISET Nabeul Page 5 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Introduction générale
Le projet de fin d’étude marque la fin de notre formation en tant que techniciens supérieurs à
l’ISET. Donc, il représente la possibilité de mettre en œuvre toutes nos connaissances
théoriques requises durant les trois dernières années d’études à l’institut puisqu’il offre une
meilleure confrontation avec le milieu de travail avant de s’intégrer réellement dans la vie
professionnelle.
Ce projet de fin d’étude a été réalisé dans la société Médis dans le but d’étudier et concevoir
une table élévatrice.
Dans cette perspective, notre projet parait comme une solution répondant à ces besoins.
Pour se faire, nous avons concentré notre recherche sur cinque axes différents pour obtenir le
besoin. En effet la premier chapitre de ce rapport est réservé à la présentation de la société et à
la mise en situation du projet. A la fin de ce chapitre la problématique sera exposée.
L’étude bibliographique se traite dans le deuxième chapitre ou nous mentionnons une idée
générale sur les tables élévatrices.
Ensuite une analyse fonctionnelle du besoin fera l’objet d’un troisième chapitre, dans lequel
nous identifions les fonctions de service validées et caractériser qui seront la base de
l’élaboration de cahier de charges fonctionnelle “C.D.C.F“ pour chaque sous ensemble du
table.
La recherche des solutions technologiques pour chacune des fonctions des services établit le
quatrième chapitre qu’est l’analyse fonctionnelle technique et pour aboutir à une meilleure
solution, il est nécessaire de faire une recherche progressive et descendante des fonctions
technique a partir de chacun chapitre des services qui répondent aux exigences du “CDCF“
Au niveau de cinquième chapitre, nous étudions le dimensionnement et la validation de la
solution retenue dont la modélisation de la station est réalisée par SOLIDWORKS 2016.
Finalement nous finissons par une conclusion générale.
ISET Nabeul Page 6 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
CHAPITRE I :
PRESENTATION DE L’ORGANISME
D’ACCEUIL
ISET Nabeul Page 7 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Introduction
Dans ce chapitre, nous allons présenter la société dans laquelle s’est déroulé notre projet.
Nous identifions, le profil de la société ainsi que ses activités et nous illustrons son
organigramme.
1. Présentation de l’entreprise d’accueil :
- Raison sociale : Les Laboratoires Médis sont une société anonyme de droit tunisien
ayant le mandat de fabriquer et commercialiser divers médicaments génériques qui a
été Fondée en 1995 par l’entrepreneur Lassaad Boujbal.
- Adresse et localisation : L’entreprise se situe à Nabeul au kilomètre 7 sur la route de
Tunis, dans une zone forestière .Le choix du site a été fait pour éviter tout risque de
pollution de l’air, de l’eau et du sol.
- Historique : La création de l’entreprise a connu quatre phases :
❖ Entre 1995 et 1996 est une phase d’étude et de détermination des cahiers de charges
du matériel.
❖ Entre 1996 et 1998 est une phase d’installation et d’implantation du matériel
❖ Entre 1998 et 1999 est une phase de qualification et mise en marche des
équipements.
❖ De 1999 une phase d’obtention des AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) et
de production et vente.
Grâce à ces compétences et l’expertise de son personnel, les laboratoires Médis a pu
afficher rapidement un taux de croissance assez élevé et lance sur le marché Tunisien une
gamme de produits pharmaceutiques relativement variées surtout dans le domaine des
injectables. De ce fait, la compagnie enregistre aujourd’hui un capital plus de 7.777.130 TND.
Figure 1 : Vue externe de Médis
ISET Nabeul Page 8 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
2. Activité :
L’activité principale de "Médis" est la production des médicaments stériles à usage
parentérale, qui ne sont pas encore couvertes par la production locale en Tunisie.
Les types pharmaceutiques qui seront produites sont les suivantes :
▪ Les solutions d’anesthésiques locaux injectables dans des crapulés en verre.
▪ Les flacons de collyres.
▪ Les ampoules.
▪ Les formes sèches.
❖ Ces produits sont groupés en trois gammes :
▪ Produits à grand volume de consommation.
▪ Produits à grande valeur et à petit volume de consommation.
▪ Produits destinés à l’exportation.
3. Organisations des ressources humaines de la société :
3.1. Effectif :
La société "Médis" possède une ressource humaine très qualifiée et très expérimentée, qui
peut mener les activités de l’entreprise conformément.
Tableau 1: Ressources humaines de Médis
Département ou service Effectif
Direction Générale 11
Département Développent 12
Département Logistique 15
Département de Production 61
Département Contrôle Qualité 20
Département Assurance Qualité 6
Département Maintenance 48
ISET Nabeul Page 9 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
3.2. Organigramme de la société :
Direction
Générale
Département Département Département Département Département Département de Département de
Administratif Logistique de Production Contrôle Assurance Recherche et de Maintenance et
Centrale Qualité Qualité Développement de Sécurité
Service contrôle Service contrôle
biologique physico-chimique
Direction des Direction des Direction
formes sèches formes stériles d’emballage
Service d’achat Service marketing Service vente
Direction d’économie et Direction financière Direction des Direction commerciale Direction du service
gestion ressources humaines et marketing informatique
Figure 2 : organigramme de la société Médis
ISET Nabeul Page 10 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
4. Les procédés de fabrication :
Le processus de fabrication dans "Médis" peut être décrit en utilisant la figure suivante :
➢ Schéma du procédé
Préparation
Ligne de Ligne de Ligne de Ligne de Ligne de
remplissage production de remplissage remplissage production
des carpules et seringue d’ampoules des flacons forme sèche
collyres
Lyophilisation
Inspection
Emballage
Figure 3 : procédé de fabrication au sein de Médis
4.1. La préparation :
4.1.1. Préparation du matériel :
Tout le matériel destiné à la production, ainsi que les contenants du médicament, doivent
être exempts des fibres ou des particules, et apyrogènes ne contenant pas d’éléments pouvant
provoquer de la fièvre. Le lavage des pièces de machine ainsi que des contenants se fait avec
de l’eau pour préparation injectable, dans des locaux dont l’air est contrôlé.
ISET Nabeul Page 11 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
La stérilisation a lieu dans des autoclaves, des fours ou des tunnels, à des températures
élevées. Une date de péremption fixe le laps de temps pendant lequel le matériel peut être
utilisé pour la production d’un prochain lot de médicaments injectables.
4.1.2. Préparation du produit (formulation) :
La préparation des médicaments se fait dans un centre de pesée avec un niveau de
stérilité propre. Les matières premières substance active et substances excipient, seront
pesées grâce à des balances très sophistiquées puis dissoutes dans des désolateurs munis
d’agitateurs magnétiques. Une fois la molécule active ainsi « formulée», il faut la rendre
stérile pour qu’elle puisse être injectable.
4.2. La ligne de production :
La ligne de production comporte plusieurs équipements permettant le remplissage de
médicaments dans les meilleures conditions, chaque ligne contient quatre types
d’équipements, qui sont les suivants :
Des laveuses permettant le lavage et le rinçage des carpules et des flacons avec de
l’eau purifié.
Des tunnels de stérilisation permettant la stérilisation sèche des carpules et des
ampoules.
Machines de remplissage permettant le remplissage des solutions des ampoules, des
carpules et des flacons de collyres.
Machine de capsulage permettant le capsulage des carpules et des flacons.
4.3. La lyophilisation :
La lyophilisation repose sur le principe physique de la sublimation : l’eau contenue
dans une solution passe directement de l’état solide (glace) à l’état gazeux (vapeur) sans
passage par l’état liquide (l’extraction de la poudre stérile à partir de la solution préparée).
4.4. L’inspection :
Après le remplissage, les médicaments à usage parentéral doivent subir un contrôle
individuel destiné à détecter toute contamination ou autre défaut. Lorsque ce contrôle est
effectué visuellement, il doit être fait dans des conditions convenables. Les opérateurs
ISET Nabeul Page 12 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
effectuant ces contrôles doivent subir des examens oculaires réguliers, avec leurs verres
correcteurs s‘ils en portent, et avoir droit à des pauses répétées.
4.5. L’emballage :
Une fois le remplissage est achevés, les produits seront transportés grâce à des
chariots vers une chaîne d’emballage ou ils seront encartonnés et emballés. Enfin les produits
finis seront transportés vers le magasin de stockage ou ils seront stockés...
5. Problématique :
5.1. Description des problèmes existe :
Photo Problèmes Causes Conséquences
Inversement de La surface d’appui Accident de travail
tourelle et de table entre tourelle et
porte tourelle est
petite
La charge est plus
grande par rapport
à la porte tourelle
Inversement de Tourelle n’est pas Accident de travail
tourelle en équilibre
Entretien de Entretien et lavage Perdre de temps de
tourelle sur sa de matrice et production
place poinçon sur même
place
ISET Nabeul Page 13 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Inversement de la Déformation de sol Un travailleur
table avec la cause le devenir handicapé
tourelle basculement de Il perd l’utilisation
table et tourelle de son pied de 85%
5.2. Données à propos la table :
1- Charge à élever 2 tonne
2- Des roues pivotantes (l’ancienne roue)
3- Hauteur maximale Hmax = 1180 mm
Figure 4 : la table ancienne
Vu les accidents que les travailleurs peuvent recouvrir au cours de transportation même lors
de leur service autour de la tourelle et vu que le temps de nettoyage de tourelle est long la
société pense à un système assurant le changement et la transportation facile de tourelle par
ISET Nabeul Page 14 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
une autre en tout sécurité pour faciliter la tâche de l’équipe de service et éviter de faire un
encombrement dans une zone un peu limitée.
Alors notre groupe de projet va chercher une solution conforme avec le cahier de charge de
client.
ISET Nabeul Page 15 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
CHAPITRE II :
ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
ISET Nabeul Page 16 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Introduction
Notre projet consiste à faire l’étude et la conception d'une table élévatrice.
Une table élévatrice, encore appelée table à ciseaux, est un matériel de manutention
permettant de lever ou de baisser une charge. Le mouvement d'élévation est assuré par un
vérin hydraulique ; il est manuel pour les faibles charges et automatique pour les grandes
charges. La course du vérin est amplifiée par des ciseaux, en application du principe de levier.
Les tables élévatrices sont très souvent utilisées pour travailler dans une position la plus
ergonomique possible.
1. Fonctionnement du système :
Le mouvement de levage est générée lorsque le package de ciseaux est ouvert par l'action des
cylindres dans le bloc hydraulique, et le mouvement de descente lorsque l'huile dans le
cylindre est retourné vers le réservoir, le paquet de ciseaux se ferme.
2. Les différents types des tables élévatrices :
2.1. Chariot élévatrice :
➢ Table élévatrice simple ciseaux
Figure 5 : Table élévatrice simple ciseaux
ISET Nabeul Page 17 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
C’est un modèle de table élévatrice qui contient un seul ciseau, elle est utilisée pour l’élevage
de courte hauteur.
➢ Table élévatrice double ciseaux
Figure 6 : Table élévatrice double ciseaux
C’est un modèle de table élévatrice qui contient 2 ciseaux, elle est utilisée pour l’élevage de
moyenne hauteur.
➢ Table élévatrice triple ciseaux
Figure 7 : Table élévatrice triple ciseaux
ISET Nabeul Page 18 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
C’est un modèle de table élévatrice qui contient 3 ciseaux, elle est utilisée pour l’élevage de
grande hauteur.
2.2. Monte charge
➢ Table élévatrice mobile
Figure 8 : Table élévatrice mobile
Forte et maniable, optimal pour lever et transporter des charges de tous genres jusqu'à 400
kg ou des levées jusqu'à 1,2 m. Le châssis stable, comprenant 2 galets fixes et 2 roues
pivotantes ainsi qu'un frein à pied, assure un positionnement sûr. La construction robuste à
cadre chromé et tige de piston chromée dur promet une longue fiabilité.
➢ Table élévatrice à soufflet
Figure 9 : Table élévatrice à soufflet
ISET Nabeul Page 19 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Cette table élévatrice permettant à l'opérateur de gérer lui-même sa hauteur de plateau de
manière à régler sa propre hauteur ergonomique. Le soufflet de protection en toile polyester
fixé sous le plateau et comporte des plis renforcés par des lamelles de PVC.
➢ Monte-charge à colonnes
Figure 10 : Monte-charge à colonnes
Le plateau est une plate-forme en tôle lisse ou antidérapante, guidée verticalement par des
galets bidirectionnels. Elle comporte des rambardes normalisées sur les faces sans accès. Le
vérin hydraulique est placé en vertical, il assure la course totale ; équipé d'un moulage il
permet de multiplier cette course.
➢ Nacelle élévatrice
Figure 11 : Nacelle élévatrice
ISET Nabeul Page 20 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Cette nacelle permet d'évoluer en intérieur et extérieur et d'accéder à des zones très confinées
grâce à un faible encombrement au sol. Elle garde néanmoins une zone de travail importante
grâce à un bras pendulaire. Des mouvements d'élévation et de translation proportionnelle et
précise permettront d'améliorer l’efficacité et d'évoluer en toute sécurité lors d'opération de
maintenance ou d'entretien de sites industriels.
3. L'alimentation :
L'alimentation (en général électro-hydraulique) consiste en un moteur électrique, une pompe
hydraulique, un réservoir hydraulique, tuyauterie, robinetterie et système de contrôle
électrique.
Figure 12 : bloc d'alimentation
4. Avantage d’utilisation des Tables élévatrices :
➢ Plateforme stable
À la différence des treuils, grues ou manipulateurs, les tables élévatrices à ciseaux disposent
d’une plateforme stable pour le levage et l’abaissement de matériel. La probabilité de laisser
tomber une pièce de manière accidentelle est plus faible et le danger de voir une charge
suspendue se balancer et causer des blessures au personnel est éliminé.
➢ Réglage infini de la hauteur
Une table élévatrice est conçue pour se déplacer doucement vers le haut ou vers le bas jusqu’à
la hauteur désirée et pour maintenir cette hauteur même en cas de panne de courant.
➢ Polyvalence
Les tables élévatrices peuvent être fournies avec une large gamme d’accessoires, tels que
convoyeurs à rouleaux, plateaux tournants, rampes, abatants... ainsi qu'avec des plateformes
ISET Nabeul Page 21 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
munies d'installations spéciales telles qu'étaux et autres dispositifs de positionnement
automatique. Les tables élévatrices peuvent être livrées avec des socles sur roulettes ou avec
des châssis de manutention.
➢ Mouvement programmable
Le mouvement peut être programmé, et les tables peuvent être intégrées à des systèmes
spéciaux de manutention et des lignes de production.
➢ Course de levage verticale importante
Une table élévatrice peut être installée dans une fosse pour obtenir une hauteur d’abaissement
de zéro absolu ou sur des versions à hauteur du plancher ou montées au sol, ou équipée de
multiples articulations en ciseaux pour un levage extrêmement haut. Une autre option est la
table élévatrice extra-plate. En raison de sa faible hauteur en position rétractée, la table
élévatrice extra-plate ne nécessite pas l’installation dans une fosse puisqu’elle peut être
directement installée au sol.
➢ Faible maintenance
Les tables élévatrices sont des machines robustes et résistantes, conçues pour des années
d’utilisation avec un niveau minimal de maintenance.
5. Domaines d’utilisation :
Les tables élévatrices sont utilisées dans tous les secteurs industriels où des levées de charges
sont nécessaires. Elles sont également intégrées dans des chaines de montage et d'assemblage.
Elles représentent également une alternative économique dans des projets d'élévateurs et de
monte charges. Les tables élévatrices sont utilisées dans la construction de bâtiments publics
et privés, dans l'implémentation d'équipements favorisant l'accessibilité des personnes à
mobilité réduite ainsi que dans des solutions sur mesures pour le traitement des ordures
ménagères. Enfin, les tables élévatrices sont souvent un élément clef de la politique
ergonomique des entreprises.
6. Accouplements :
Les accouplements sont utilisés pour transmettre la vitesse et le couple, ou la puissance, entre
deux arbres de transmission en prolongement l'un de l'autre comportant éventuellement des
défauts d'alignement.
ISET Nabeul Page 22 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Figure 13 : Accouplement
➢ Accouplements rigides
Ils doivent être utilisés lorsque les arbres sont correctement alignés (ou parfaitement
coaxiaux).
Leur emploi exige des précautions et une étude rigoureuse de l'ensemble monté, car un
mauvais alignement des arbres amène un écrasement des portées, des ruptures par fatigue et
des destructions prématurées du système de fixation.
➢ Accouplements à plateaux
Ce dernier est très utilisés, précis, résistants, assez légers, encombrants radialement, ils sont
souvent frettés ou montés à la presse.
La transmission du couple est en général obtenue par une série de boulons ajustés. En cas de
surcharge, le cisaillement des boulons offre une certaine sécurité.
➢ Puissance et couple transmissibles par les accouplements
Ils sont liés par la formule :
P : puissance transmise en watts ω : vitesse de rotation en rad/s
C : couple transmis en N.m N : vitesse de rotation en tr/m
ISET Nabeul Page 23 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Conclusion :
Afin de déterminer la recherche bibliographique à propos les tables élévatrices on a trouvé
beaucoup de model multi commande et parmi ces dernier on va fait un choix sur trois tables
différents qui on va les traiter dans le chapitre suivante.
ISET Nabeul Page 24 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
CHAPITRE III :
ANALYSE FONCTIONNELLE
ISET Nabeul Page 25 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Introduction
Chaque produit industriel passe par un cycle de vie dès l’idée jusqu’à l’utilisation et
pour assurer le fonctionnement correcte de notre projet il faut bien étudier l’analyse
fonctionnelle, c’est un outil performant, caractériser, ordonner, hiérarchiser et valoriser les
fonctions d’un produit. Elle permet d’avoir une vision claire des exigences attendues du
produit. Ceci permet :
- D’aboutir à un cahier des charges précis du produit attendu.
- Répondre au besoin d’utilisateur satisfait.
1. Modélisation du système :
- Fonction globale : Manutention des charges.
- Matière d’œuvre entrante(MOE) : charge en position initiale.
- Matière d’œuvre sortante(MOS) : charge en position finale.
- Donnés de contrôle : énergie électrique(WE), énergie hydraulique(WH), Réglage,
Tourelle, opérateur.
- Processeur : Table élévatrice mobile.
-
Opérateur WE, W H Réglage Tourelle
Charge en position Manutention des Charge en position
initiale final
charges
A-0
Table élévatrice mobile
Figure 14 : description globale d'un produit
2. Analyse de besoin :
Il convient dans un premier temps de rechercher l’information nécessaire pour identifier
les différentes phases du cycle de vie du produit depuis son stockage jusqu’à son retrait de
ISET Nabeul Page 26 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
service, en passant par son utilisation “pure“. Pour chaque situation, il est recommandé de
lister les éléments, personne, matériels, matières qui constituent l’environnement du produit.
Les activités qui suivent vont être réalisées pour chacune des phases du cycle de vie de
produit au sein du groupe de travail qui a été mis en place.
2.1. Saisir les besoin :
Cette phase du cycle de vie d’un produit industriel concerne plus particulièrement les
services qualité et service commerciale.
Les activités des Laboratoires Médis sont attachées directement aux médicaments, pour
préparer ces derniers la société utilise des machines avec des tourelles poisseux “1.5 tonne“,
mais le problème apparaisse lors de transporter une tourelle sur un table avec des roues
spéciaux, de l’atelier production à l’atelier de lavage, ou le risque de basculement s’existe qui
provoque l’inversement de tourelle a cause de difficulté au niveau de la méthode de transport.
Pour cela la société décide d’améliorer la table ou de fabriquer une autre qui facilite le
déplacement et supporte la charge en toute sécurité sans causer des accidents.
L’outil considéré est une table élévatrice mobile.
2.2. Enoncer le besoin :
Pour justifier la conception de notre projet, il faut expliciter l’exigence fondamentale qui
exprime avec rigueur le but et les limites de l’étude.
Afin d’énoncer le besoin, il faut poser les trois questions suivantes concernant notre projet :
ISET Nabeul Page 27 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
A quoi ou à qui rend-il service ? Sur quoi ou sur qui agit-il ?
L’utilisateur La Tourelle
Produit :
Table élévatrice
mobile
Dans quel but ?
Manutention des charges
Figure 15 : Diagramme bête à cornes
2.3. Validation de besoin :
Afin de bien déterminer le besoin que la table doit satisfaire, il faut vérifier que le niveau de
satisfaction de notre produit reste assez élevé, pour se faire, on doit répondre aux questions
suivantes :
1- Pourquoi ce besoin existe-t-il ?
➢ Pour aider les techniciens à soulever les charges.
2- Pensez-vous que les risques de voir disparaitre ou évoluer ce besoin sont réels
dans un proche avenir ?
➢ D’après l’évolution conçue dans le domaine de l’industrie le produit ne
peut pas disparaitre.
Conclusion
Le besoin existe, il ne va pas disparaitre à moyen terme, donc le besoin est validé.
3. Analyse fonctionnelle externe : étude de la faisabilité :
Cette étude consiste à traduire, tous les éléments que nous venons de réunir et à vérifier la
viabilité de notre projet.
ISET Nabeul Page 28 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
3.1. Identifier les fonctions de services :
Il s’agit pour chaque phase de cycle de vie de produit de dresser les inters acteurs qui se
trouvent en situation d’interagir avec le système.
On utilise pour cela un outil de la méthode APTE c’est la Pieuvre.
3.1.1. Éléments d’environnement :
✓ Tourelle ;
✓ Opérateur ;
✓ Normes de sécurité ;
✓ Techniques de commande ;
✓ Milieu de travail ;
✓ Prix ;
✓ Énergie de commande ;
3.1.2. Diagramme pieuvre :
Tourelle Opérateur
FP1 Norms de
Technique de
FP2 sécurité
commande
Fc6
Table élévatrice Fc1
Fc5
Fc2
Prix
Énergie Fc4 Fc3
Encombrement Milieu de
travail
Figure 16 : Diagramme PIEUVRE
ISET Nabeul Page 29 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
3.1.3. Identification des fonctions de service :
Les fonctions principales :
FP1 : Permettre à l’opérateur de transporter la tourelle vers l’atelier de lavage.
FP2 : Protéger l’opérateur de danger.
Les fonctions contraintes :
FC1 : Respecter les normes de sécurité.
FC2 : Avoir un prix acceptable
FC3 : protéger le milieu de travail.
FC4 : occuper un petit espace de rangement.
FC5 : s’adapter aux énergies disponibles.
FC6 : commander la table.
3.2. Validation des fonctions de service :
La validation des fonctions de service identifiées se fait en rependant aux quatre questions
suivantes :
➢ Q1 : dans quel but la fonction existe-t-elle ?
➢ Q2 : pour quel raison la fonction existe-t-elle ?
➢ Q3 : Qu’est-ce qui pourrait la faire disparaitre ou la faire évoluer ?
➢ Q4 : quelle est la probabilité de disparition ou d’évolution ?
FP1 : Permettre a l’opérateur de transporter la tourelle vers l’atelier de lavage.
R1 pour minimise le temps de maintenance et le temps d’arrêt de production.
R2 Parce que la manipulation de ces grands charges est dangereuse.
R3 Tourelle ne tombe pas en panne par l’incessant de manutention
R4 Probabilité faible
Validation Fonction validée.
FP2 : Protéger l’opérateur de danger.
R1 Pour éviter les accidents de travail.
R2 Parce qu’un ouvrier a été blessé durant la manipulation de la tourelle
R3 La maintenance fait sur place.
R4 L’évolution des normes et réglementations sur la sécurité des usagers
Validation Fonction validée.
ISET Nabeul Page 30 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
FC1 : Respecter les normes de sécurité.
R1 Pour protéger la vie des utilisateurs.
R2 Par ce que pas des signes d’avertissement de danger sur la table.
R3 Incompréhension des normes de sécurité.
R4 Probabilité Nulle
Validation Fonction validée.
FC2 : Avoir un prix acceptable.
R1 Pour facilité le vende
R2 Par ce que l’ancien table est très chers
R3 S’il est obligatoire d’acheter une table sans discuter à propos le prix.
R4 Probabilité faible
Validation Fonction validée.
FC3 : Résister au milieu de travail
R1 Pour un bon déroulement de l’opération de transport de tourelle
R2 Par ce que la forme de milieu peut être n’est pas plane
R3 S’il existe une fuite ou une déformation de terrain
R4 Probabilité Nulle
Validation Fonction validée.
FC4 : occuper un petit espace de rangement.
R1 Pour éviter les accidents de travail
R2 Parce que la manipulation de ce genre de bobines est dangereuse.
R3 Existence d’une autre table plus praticable
R4 Probabilité faible
Validation Fonction validée.
FC5 : s’adapter aux énergies disponibles.
R1 Pour l’alimentation du mécanisme l’énergie électrique.
R2 Car c’est la seule énergie autorisée dans le cahier de charge.
R3 La présence d’une autre source d’énergie
R4 Probabilité Nulle
Validation Fonction validée.
ISET Nabeul Page 31 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
FC6 : commander la table.
R1 Pour minimiser l’erreur humaine
R2 Par ce que l’opérateur ne peut pas transporter la tourelle
R3 L’évaluation de produit
R4 Probabilité Nulle
Validation Fonction validée.
3.3. Caractériser les fonctions de service :
Le processus de conception induit de fréquentes prises de décisions afin de valider une
solution par rapport au CDCF. On établie une base d’évaluation du niveau de satisfaction des
fonctions de service afin de prendre des décisions objectives. Donc, chaque fonction de service est
caractérisée par des critères d’appréciation dont chacun est associé à un niveau et à une flexibilité.
Tableau 2 : degrés de flexibilité
Flexibilité Classe de flexibilité Niveau de flexibilité
Nulle F0 Imperative
Très faible F1 Non Négociable
Faible F2 Peu Négociable
Bonne F3 Négociable
Forte F4 Trèsnégociable
ISET Nabeul Page 32 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Tableau 3 : Caractéristiques des fonctions des services
Fonction de service Critère Niveau Flexibilité
Classes Limites d’acceptation
FP1 : Permettre a l’opérateur de • Vitesse d’élever ou de baisser la Touelle. • 1m/min • F1 • 0.1m / min
transporter la tourelle vers l’atelier de lavage. • Hauteur de levage • 1.08m • F2 • -0.05m
• Poids • 1.5 tonne • F1 • ±0.5 tonne
FP2 : Protéger l’opérateur de danger • Distance minimale de l’opérateur par • 0.5m • F0 • ± 0.2m
rapport à la table en court de fonctionnement • 1700 kg • F0 • ±100 kg
• Charge maximale supporté
FC1 : Respecter les normes de sécurité. • Norme relative à la manutention • Vrai • F1
• Validation des spécifications des normes • Vrai • F1
FC2 : Avoir un prix acceptable • Cout totale • 10.000 DT • F3 • ±1000 DT
FC3 : Résister au milieu de travail • Traitement pour ambiance agressive • Sablage et peinture • F3
adaptée
FC4 : Occupé un petit espace de rangement. • Forme • être la moins • F2
volumineuse
possible
FC5 : s’adapter aux énergies disponibles. • Energie électrique • ~ 3 ph–380 V– • F0
50 Hz
FC6 : commander la table • Réglage et asservissement • Contrôle et suivie de • F0
fonctionnement
ISET Nabeul Page 33 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Importance relative Note
Equivalence 0
Légèrement supérieur 1
Moyennement supérieur 2
Nettement supérieur 3
4. Hiérarchiser les fonctions de services :
FP2 FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6 moyen %
FP1 FP2 FP1 FP1 FP1 FP1 FP1 FP1 11 27.5
2 2 1 1 3 1 1
FP2 0 FP2 FP2 FP2 FP2 FP2 12 30
2 2 3 2 1
FC1 FC1 FC1 FC1 FC1 FC6 7 17.5
2 2 2 1 1
FC2 FC2 0 FC5 FC6 1 2.5
1 1 0
FC3 0 FC5 FC6 0 -
1 2
FC4 FC5 FC6 0 -
1 1
FC5 FC6 3 7.5
FC6 6 15
Totale 40 100
Figure 17 : matrice d'hiérarchisation
ISET Nabeul Page 34 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
30
25
20
30
15 27.5
10 17.5
15
5 7.5
2.5
0 0
0
FP2 FP1 FC1 FC6 FC5 FC2 FC3 FC4
Pourcentage %
Figure 18 : Graphe d'hiérarchisation
Conclusion
L’analyse fonctionnelle permet :
- De mieux définir le besoin
- De mieux adapter le produit au besoin
- De ne rien oublier au moment de la conception
- D’innover
- De diminuer les modifications de mise au point
- La synergie du travail de groupe
➢ La combinaison de la rigueur et de la créativité
ISET Nabeul Page 35 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
CHAPITRE IV:
ANALYSE FONCTIONNELLE TECHNIQUE
ET CHOIX DES SOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES
ISET Nabeul Page 36 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Introduction
Pour concrétiser les fonctions de services dégagées dans le chapitre précédent, nous allons
effectuer une analyse fonctionnelle technique qui devra nous conduire au choix des solutions
technologiques. Nous utiliserons dans ce cas la méthode FAST.
1. Analyse fonctionnelle technique :
L’analyse fonctionnelle technique a pour objectif d’observer la manière selon laquelle un
produit rend les services attendus, elle doit conduire à travers l’analyse intérieure du produit, à
la définition des fonctions techniques dont leur conjugaison conduit à la réalisation des
fonctions de service lors de l’A.F.B.
1.1 Présentation de la méthode FAST :
On profite de la méthode FAST: « Function Analysis System Technic », cet outil
établie le lien entre le besoin fondamental et l’architecture d’un produit tout en passant
par les fonctions de services et les fonctions techniques.
Selon le cas dans lequel existe notre projet : préconception d’un produit existant ou
conception d’un nouveau produit, on parle de FAST descriptif ou créatif.
En ce qui concerne notre projet on utilise le FAST créatif.
ISET Nabeul Page 37 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
1.2 FAST créatif : « séquence d’utilisation » :
FP1 : Permettre a l’opérateur de transporter la tourelle vers l’atelier de lavage
Plate fixe
Goupille
Etau Plate mobile
Maintenir en
position
Butée de serrage Système vis
écrou
Forme conique
Monte Deux vérins
charge hydrauliques
Système
d’entrainement
Deux
Lever et Profilé
FP1 ciseaux
baisser la
tourelle
Guidage en
rotation des Articulation
liaisons + coussinet
pivots
Les
ciseaux
Guidage en
Galets
translation de
l’extrémité
des ciseaux
avec la plate
Rails
forme et le
châssis
Déplacement Roue
de la table
ISET Nabeul Page 38 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
FP2 : protéger l’operateur de danger
Se protéger contre les aléas de la
commande et du fonctionnement
FP2
Respecter le code de travail de
Médis
FC1 : Respecter les normes de sécurité.
Faire des conjectures pour
l’opérateur
FC1
Appliquer les règles de sécurité
FC3 : Résister au milieu de travail.
Utilisation des joints et des
couvercles
Assurer l’étanchéité du
FC3 système
Utilisation de composants
lubrifiés à vie
ISET Nabeul Page 39 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
FC5 : s’adapter aux énergies disponibles
se connecter au
reseau R1: Prise
Énergie électrique
transforme le type
de courant R2:transformateur
FC5
R3:Centrale
hydraulique
Énergie
hydraulique
R4:Vérin
hydraulique
FC6 : commander la table
S1:Carte elecronique
FC6 commande de la table
S2: sercuite electrique
2. Choix des solutions technologique :
2.1. Critère de choix :
Tableau 4 : valorisation d'interet
Note Intérêt de la solution
1 Douteuse
2 Moyenne
3 Bien adapté
ISET Nabeul Page 40 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Tableau 5 : Valorisation globale
K l’importance de la fonction
1 Utile
2 Nécessaire
3 Importante
4 Très importante
5 Vitale
S1:Goupille Pate fixe
S2:Etau Pate mobile
Maintenir en position
S3:Butée de serrage systeme vis ecrou
S4:Forme conique
S1 S2 S3 S4
Critère Coefficient α Note Total Note Total Note Total Note Total
fonctionnalité 4 2 8 3 12 3 12 2 8
fiabilité 3 2 6 2 9 3 6 1 3
réalisabilité 2 1 4 2 6 3 4 1 2
Coût 3 2 6 3 9 3 9 2 6
montabilité 2 1 4 2 6 3 6 1 2
Total pondéré 28 42 37 21
➢ La solution 2 est la plus adéquate
ISET Nabeul Page 41 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
S1:galets
Guidage en translation de l'extrémité des
ciseaux avec le plate forme et le chassis
S2:rails
S1 S2
Critère Coefficient α Note Total Note Total
fonctionnalité 4 3 12 3 12
fiabilité 3 3 9 2 6
réalisabilité 2 3 6 2 4
Coût 3 3 9 2 6
montabilité 2 3 6 2 4
Total pondéré 42 32
➢ La solution 1 est le meilleur
S1:Carte elecronique
commande de la table
S2:sécurité électrique
ISET Nabeul Page 42 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
S1 S2
Critère Coefficient α Note Total Note Total
fonctionnalité 4 3 12 3 12
fiabilité 3 2 6 3 9
réalisabilité 2 2 4 3 6
Coût 3 2 6 3 9
montabilité 2 2 4 3 6
Total pondéré 32 42
➢ La solution 2 est le meilleur
se connecter au
S1: Prise
reseau
Electrique
transforme le type
S2:transformateur
Energie de courant
Hydraulique S3: Vérin hydraulique
S1 S2 S3
Critère Coefficient α Note Total Note Total Note Total
fonctionnalité 4 3 12 3 12 1 2
Fiabilité 3 3 9 2 6 2 6
Réalisabilité 2 2 4 2 4 4 8
Coût 3 3 9 2 6 2 6
Montabilité 2 3 9 2 4 2 4
Total pondéré 43 32 26
➢ La solution 1 est le meilleur
ISET Nabeul Page 43 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Fonction Solution convenable
Maintien en position S3 : Butée de serrage
Guidage en translation de l'extrémité des ciseaux S1 : galets
avec le plateforme et le châssis
Commande de la table S2 : sécurité électrique
Énergie électrique S1 : Prise
ISET Nabeul Page 44 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Maintenir en Système vis
Etau
position écrou
Monte Deux vérins
charge hydrauliques
Lever et baisser
FP1 Système d’entrainement
la tourelle
Deux ciseaux Profilé
Les
ciseaux Guidage en rotation des Articulation +
liaisons pivots coussinet
Guidage en translation
Déplacement de Roue
Transporter de l’extrémité des Galets
la table
ciseaux avec la plate
la tourelle
forme et le châssis
FC6 Commende de la Sécurité électrique
table
FC5 Energie électrique Se connecter au réseau
Prise
Figure 19 : Diagramme FAST
ISET Nabeul Page 45 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
CHAPITRE V :
DIMENSIONNEMENT DE PROJET
ISET Nabeul Page 46 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Introduction
Cette étude consiste à effectuer un calcul géométrique aboutissant au dimensionnement de la
table suivie de calcul des réactions aux différentes articulations afin de pouvoir caractériser le
système vis écrou et le moteur électrique.
1. Schéma de la table élévatrice :
D= 1600
B C
A Y
My
4
d= 1200
Mx
E
H= 900
X
3 Mz
1
Ө
2 D F
Z
Figure 20 : structure de la table élévatrice
Composant quantité Désignation D : longueur de la table (mm).
1 1 Châssis H : hauteur de la table en positon haute (mm).
2 4 ciseaux h : hauteur de la table en positon basse (mm).
3 4 galets θ : Angle du ciseau avec l’horizontale (degré).
4 1 plateforme d : longueur des ciseaux (mm).
2. Calcule des réactions appliquées sur la table
supérieure (plateforme) :
Charge W/2
A B C
D= 1600
Ra Rc
Figure 21 : les réactions au niveau de la plateforme
ISET Nabeul Page 47 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
𝑤
: Force appliquée par la charge
2
W = 20000 N
AC =D ; AB+ D/2 avec D=1600 mm
0 0 0 0 0 0
{𝜏}𝐴 = {𝑅𝑎|0} ; {𝜏}𝐵 = {−𝑅𝑏|0} ; {𝜏}𝐶 = {𝑅𝑐 |0} ;
0 0𝐴 0 0𝐵 0 0 𝐶
Transfert vers le point A :
0 0 0 0
{𝜏}𝐴 = {−𝑅𝑏| 0 } ; {𝜏}𝐴 = {𝑅𝑐 | 0 } ;
0 −800 ∗ 𝑅𝑏 𝐴 0 1600 ∗ 𝑅𝑐 𝐴
➢ On applique le PFS :
1 ∑ 𝐹 𝑒𝑥𝑡 = 𝑅𝑎 − 𝑅𝑏 + 𝑅𝑐 = 0
𝑅𝑏∗800
2∑ 𝑀𝑓𝑡 𝑒𝑥𝑡/𝐴 = −𝑅𝑏 ∗ 800 + 1600 ∗ 𝑅𝑐 𝑅𝑐 = 1600
𝑊 10000∗800
Or 𝑅𝑏 = = 10000 𝑁 alors 𝑅𝑐 = = 5000 𝑁
2 1600
L’équation 1 donne : Ra =Rb - Rc Ra = 10000 – 5000 = 5000 N
Ra = 5000 N
Rb= 10000 N
Rc=5000 N
ISET Nabeul Page 48 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
➢ Torseur de cohésion :
• Coupure entre A et B : 0≤ x ≤800
G
A B
x =AG
0 0
{𝜏𝑐𝑜ℎ }𝐺 = −{𝜏𝐴 }𝐺 = {−𝑅𝑎| 0 }
0 𝑥 ∗ 𝑅𝑎 𝐺
𝑇 = −𝑅𝑎 = −5000 𝑁
𝑆𝑖 𝑥 = 0 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 { ;
𝑀𝑓𝑔𝑧 = 0 ∗ 𝑅𝑎 = 0 𝑁. 𝑚𝑚
𝑇 = −𝑅𝑎 = −5000 𝑁
𝑆𝑖 𝑥 = 800 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 {
𝑀𝑓𝑔𝑧 = 800 ∗ 𝑅𝑎 = 4 ∗ 106 𝑁. 𝑚𝑚
• Coupure entre B et C : 800≤ x ≤1600
G
B C
1600-x =GC
0 0
{𝜏𝑐𝑜ℎ }𝐺 = +{𝜏𝐶 }𝐺 = {𝑅𝑐| 0 }
0 (1600 − 𝑥) ∗ 𝑅𝑐 𝐺
𝑇 = 𝑅𝑐 = 5000 𝑁
𝑆𝑖 𝑥 = 800 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 { ;
𝑀𝑓𝑔𝑧 = (1600 − 800) ∗ 𝑅𝑐 = 4 ∗ 106 𝑁. 𝑚𝑚
𝑇 = 𝑅𝑐 = 5000 𝑁
𝑆𝑖 𝑥 = 1600 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 {
𝑀𝑓𝑔𝑧 = (1600 − 1600) ∗ 𝑅𝑐 = 0 𝑁. 𝑚𝑚
ISET Nabeul Page 49 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Figure 22 : diagramme de l'effort tranchant
Figure 23 : diagramme de moment fléchissant
2.1. Interprétation :
On interprète avec une bref démonstration que les valeurs obtenue sont identique avec celle
qui sont afficher par le logiciel “RDM6“.
2.2. Condition de résistance à la flexion :
𝑀𝑓𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑚𝑎𝑥 = ≤ 𝑅𝑝𝑒
𝜇𝑧
Avec :
𝑅𝑒
𝑅𝑝𝑒 = : Résistance pratique à l’extension ; s=2 : coefficient de sécurité
𝑠
𝐼𝐺𝑍
𝜇𝑧 = 𝑣
: Module de flexion
ISET Nabeul Page 50 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
𝐵𝐻 3 −𝑏ℎ3
𝐼𝐺𝑍 = 12
Figure 24 : profil de la poutre
Le matériau utilisé est X2CrNi 19-11 (Acier Inoxydables) 𝑅𝑒 = 300 𝑀𝑃𝑎(Voir annexe 1)
300
Alors A.N : 𝑅𝑝𝑒 = = 150 MPa
2
𝑀𝑓𝑚𝑎𝑥 𝑀𝑓𝑚𝑎𝑥 4000000
≤ 𝑅𝑝𝑒 𝜇𝑧 = A.N: 𝜇𝑧 = = 26666.66𝑚𝑚4
𝜇𝑧 𝑅𝑝𝑒 150
𝜇𝑧 ≥ 26666.66 𝑚𝑚4 = 2.666 𝑐𝑚4
D’après l’abaque on prend 𝜇𝑧 = 2.73 𝑐𝑚4 (voir annexe 2)
H=40 mm
B=27 mm
e=2 mm
Vérification :
𝑀𝑓𝑚𝑎𝑥 𝑅𝑝𝑒
𝑏ℎ3
≤ 2
12
A.N:
4000000 300
×10−4 =146.5 ≤ = 150
2.73 2
Donc , Condition vérifié.
ISET Nabeul Page 51 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
2.3.Simulation solidworks :
D’après la simulation numérique, la contrainte de Von Mises atteint un maximum de 11.74 MPa au
niveau de center de plateforme.
Le déplacement maximal atteint 0.01 mm à l’extrémité supérieure de la structure. Pour les autres
extrémités, le déplacement est plus important..
ISET Nabeul Page 52 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
3. Calcul des réactions appliquées sur les ciseaux :
A C
E E
ө F D ө
Figure 25 : les ractions appliquées sur les ciseaux
W
❖ 1 M F 0
4
2 L cos( ) FY L cos( ) FX L sin( )
❖ 2 F X FX RX 1 0
W
❖ 3 F Y
4
FY RY 1 0
W
❖ 4 M D
4
2 L COS ( ) FY L COS ( ) FX L SIN ( ) 0
❖ 5 F X FX RX 2 0
W
❖ 6 F Y
4
FY RY 2 0
On a 6 equations et 6 inconus
➢ L’équation 1 donne :
W
2 L cos( ) FY L cos( ) FX L sin( ) 0
4
W
2 L cos( )
F L sin( )
FY 4 X
L cos( ) L cos( )
W
FY FX tan( )
2
➢ L’équation 4 donne :
ISET Nabeul Page 53 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
W
2 L cos( ) FY L cos( ) FX L sin( ) 0
4
W
2 L cos( )
F L cos( )
FX 4 Y
L sin( ) L sin( )
W
2 FY
FX
tan( ) tan( )
On a l’expression de Fy alors :
W W F tan( )
FX X
2 tan( ) 2 tan( ) tan( )
W
2
FX 2 F
tan( )
X
W
FX
2 tan( )
Alors on calcule Fy :
W W
Fy ( ) tan( )
2 2 tan( )
W W
Fy 0
2 2
➢ L’équation 2 donne :
RX 1 FX 0
Alors RX 1 FX
➢ L’équation 5 donne :
RX 2 FX 0
Alors RX 2 FX
W
Donc : FX RX 1 RX 2
2 tan( )
ISET Nabeul Page 54 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
➢ L’équation 3 donne :
W
Fy Ry1 0
2
Avec Fy = 0
W
Ry1
4
L’équation 6 donne :
W
Fy Ry2 0
2
W
Ry2
4
W
Donc : Ry1 Ry2
4
Tableau 6 : les expresions des reactions appliquées aux ciseaux
Force Expression
FX W
2 tan( )
Fy 0
RX 1 W
2 tan( )
RX 2 W
2 tan( )
Ry1 W
4
Ry2 W
4
3.1.Calcule de l’angle :
ℎ
L’angle min= sin−1(𝑑) avec d=1200 mm
200
Alors min = sin−1 (1200) = 9.59 °
900
Et max = sin−1 (1200) = 48.59 °
ISET Nabeul Page 55 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Le basculement de la table se fait la plus part au niveau haute alors on prend max pour
calculer les inconnus.
3.2.Simulation solidworks et interprétation :
D’après la simulation numérique, la contrainte de Von Mises atteint un maximum de
7.03*10^6 MPa au niveau de l’arrondie puisque l’effort distribué sur la totalité de la structure
se transforme en un moment fléchissant concentré à la base.
Le déplacement maximal atteint 8.22*10^-4 mm à l’extrémité supérieure de la structure. Pour
les autres extrémités, le déplacement est plus important, c’est due à la différence entre les
raidisseurs de base et les raidisseurs supérieurs qui sont plus petits.
ISET Nabeul Page 56 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
4. Chapes aux extrémités du plateau et du châssis :
4.1.Dimensionnement des chapes :
P adm (Glissant sous charge, conditions de fonctionnement moyennes).
4 F 4 5000
e e 6.63mm
d Padm 50 20
5. Dimensionnement des boulons de fixation du (palier +
plateforme) :
(Voir annexe 3)
Figure 26 : palier
|T |
| | ;
d2
4
ISET Nabeul Page 57 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
|T |
| | Rpg ; Rpg Avec | T | 10000 N
d2
4
4. T 4. T 4 5000
d2 ;d ; d 12.11mm
.Rpg .Rpg 43.4
On prend un Vis M16 pour garantir une résistance suffisante au cisaillement et en particulier
éviter le maximum de matage et des trous au niveau du tube rectangulaire à cause de la faible
épaisseur de ses parois (vaut 2 mm).
5.1.Calcule de durée de vie de roulement de palier :
(Voir annexe 4)
Fa 5000 F
e=1.14 4.2 donc a e soit X=0.35 et Y=57
Fr 21050 Fr
P X Fr Y Fa
P 0.35 5000 0.35 21000 12880 N
n 3
C 24500
L10 6.88 10 tours
6
P 5000
L10
Lh
60 n
6.15 106
Lh 25481 h
60 4.5
5.2.Calcule des boulons au cisaillement :
La vis de diamètre d = 30 mm Avec dmoy = d - 0,5. Pas et dmoy = d - Pas -2a
• Filet carré
• Pas=6mm
• Résistance pratique en traction : Rpe = 5 0 daN/mm2
• Coefficient de frottement : f= 0,1
• Ecrou de hauteur : H= 72 mm
• Résistance pratique au cisaillement : Rpg = 10 daN/mm2
• Pression maximal admissible : Padm = 12N lmm2
• A=0.5mm
ISET Nabeul Page 58 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
• D1=d-Pas
• Pour faire monter une charge Q = 1800 daN
5.2.1.Réversibilité de system vis –écrou :
tan f tan 1 f 5.71
Angle d’inclinaison de l’hélice
ta
p d2 dmoy d 0.5 p 30 (0.5 6) 27 mm
d2
6
tan 1 4.046
27
Moment moteur le système est irréversible
5.2.2.Couple nécessaire par déplacement charge :
Vis progresse contre la charge axiale
Dmoy Dmoy
C Ft Fa tan( ) (Fa=Q)
2 2
103
30 0.5
AN C 18000 tan(5.71 4.046)
2
C 41.781N.m
5.2.3.Calculer le rendement du système vis écrou :
tan tan(4.046)
0.41138
tan( ) tan(5.71 4.046)
5.2.4.Résistance de la vis :
La vis est sollicitée à (la compression +torsion)
Rpe
K eq Rep eq K / Rpe
1.3
ISET Nabeul Page 59 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Q 4 18000 50
4.33daN / mm2 38.46daN / mm2
d moy (30 6 2)
2
1.5
4
Rpe
la vis résiste
1.3
Résistance de filet au cisaillement
Q
Rpe avec
dmoy H
1800
0.345daN / mm2 10
23 72
Le filet et résiste au cisaillement
Vérifier la résistance des filets au matage
Fa
P Padm
(d D 2 ) n
2
h 72
n 12
pas 6
4 18000 D1 d pas
12 N / mm2
(30 24 ) 12
2 2
D1 30 6 24
La vis résiste au matage
6. Choix motoréducteur :
On a la force maximale dans hauteur max=1m donc on choisira un moteur-réducteur plus
proche de notre calcule en choisir un moteur-réducteur :
6.1.Sélection de l’actionneur mécanique :
L’actionneur mécanique est une vis sans fin hélicoïdale.
La machine est programmée pour lever le produit jusqu’à la hauteur désirée si et seulement si
la commande reçoit un signal du capteur de position indiquant que les galets se situe .
• La vitesse de la table est fixée pour VT= 0,1 m/min.
• Une charge axial F= 21050N = 21,05 KN
ISET Nabeul Page 60 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
• La hauteur de la charge maximale est 1180 mm
D’après le fournisseur allemand, on a choisi un vérin à vis en matériaux inoxydable qui a les
caractéristiques suivantes :
Charge axiale admissible 10 KN
Course 1800 mm
Diamètre primitif de la vis 40 mm
Pas 5 mm
Rapport de réduction : i 5
Rendement statique de roue vis 0,603
sans fin: ηs
Rendement dynamique de roue vis 0,618
sans fin : ηd
7. Table en 3D :
ISET Nabeul Page 61 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Figure 27 : Table au niveau haute
Figure 28 : table au niveau bas
Figure 29 : liaison plateforme et ciseau
ISET Nabeul Page 62 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
CHAPITRE VI :
DOSSIER TECHNIQUE
ISET Nabeul Page 63 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Introduction
Dans ce chapitre on va présenter les dessins des définitions des différentes pièces
1. Les dessins des définitions :
ISET Nabeul Page 64 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
ISET Nabeul Page 65 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
ISET Nabeul Page 66 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
ISET Nabeul Page 67 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
ISET Nabeul Page 68 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
ISET Nabeul Page 69 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
ISET Nabeul Page 70 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
ISET Nabeul Page 71 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
ISET Nabeul Page 72 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
ISET Nabeul Page 73 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Conclusion :
Dans ce chapitre, nous avons déterminée les dessins de définitions des différentes pièces et
nous avons précisé leurs nomenclatures à travers SOLIDWORKS.
ISET Nabeul Page 74 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Conclusion générale
D’un point de vue personnel, ce stage nous a apporté des satisfactions tant au niveau
relationnel que professionnel, et a répondu presque à tout ce que nous en attendons. Les
employés nous ont offert un encadrement de grande qualité qui est un critère très important
pour un stagiaire. La compétence de ceux qui nous supervisaient s’est retrouvée pas
seulement dans le travail mais également dans les échanges et les discussions où chacun a mis
ses connaissances, son savoir et son expérience à notre service, n’hésitent pas à prendre sur
leur temps. Nous avons ainsi appris au cours de ce stage de nouvelles façon de travailler tout
en mettant en application ce que nous avons été enseigné à l’université tant au niveau pratique
que théorique.
S’adapter à une ambiance de travail où le personnel a déjà ses habitudes n’est pas une
démarche facile mais toute l’équipe a su nous mettre à l’aise en nous intégrant pleinement à
son quotidien. Nous ne sommes jamais sentis exclus, ayant meme l’impression d’etre partie
prenante de la société. De plus, intégrer une entreprise avec le statut comme celui d’un
stagiaire peut entrainer de la part du personnel une certaine réticence et un manque de
confiance compréhensibles, dus à une absence évidence de pratique, mais cela n’a pas été le
cas en ce qui nous concerne car toute l’équipe nous a accordé sa confiance et permis d’avoir
des responsabilités, dont nous lui avons reconnaissant.
Le projet que nous avons mené nous a permis d’utiliser des logiciels de calcul et de
conception, outils devenus indispensables pour l’étude des constructions mécaniques. Grace
aux logiciels solides Works et RDM6, nous avons effectué des calculs, des
conceptions et des modélisations en 2D de différents éléments du produit.
Cependant, nous avons rencontrés quelques difficultés lors de l’achat de différentes
composantes de produit car le marché local en Tunisie ne contient plus de variétés de
composants. C’est pour cela, l’entreprise les a recommandées de l’étranger. Pour d’autres
pièces, nous avons utilisé des composants du magasin de l’entreprise et les adaptés avec notre
besoin. La suite du composant à était retrouvée de façon normale.
Nous nous sommes également rendu compte que l’emploi de l’information impose au
technicien de formuler un certain nombre d’hypothèses et de vérifications pour rendre les
résultats convenablement exploitables pour son travail. Par conséquent, nous avons été
amenés à exploiter, moyennant certaines vérifications, des résultats pour le dimensionnement
ISET Nabeul Page 75 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
des éléments du produit. Nous nous sommes également familiarisés avec les règlements et les
règles de construction mécanique.
ISET Nabeul Page 76 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
ANNEXES
ISET Nabeul Page 77 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Annexe 1
ISET Nabeul Page 78 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Annexe 2
ISET Nabeul Page 79 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Annexe 3
ISET Nabeul Page 80 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
Annexe 4
ISET Nabeul Page 81 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
ISET Nabeul Page 82 MEDIS
Etude et conception d’une table élévatrice
ISET Nabeul Page 83 MEDIS
Vous aimerez peut-être aussi
- La Convention collective: Savoir la négocier, l'interpréter, l'appliquerD'EverandLa Convention collective: Savoir la négocier, l'interpréter, l'appliquerÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Master en Electromécanique Option: Maintenance IndustrielleDocument61 pagesMaster en Electromécanique Option: Maintenance Industriellebouslimane idirPas encore d'évaluation
- Rapport Du Projet Pre Ingenieur Magne LeaDocument46 pagesRapport Du Projet Pre Ingenieur Magne LeaarcPas encore d'évaluation
- Rapport PFE FinaleDocument63 pagesRapport PFE FinaleBouba BoixosPas encore d'évaluation
- Rapprt de Stage PFFDocument85 pagesRapprt de Stage PFFHajar ZohayrPas encore d'évaluation
- Pfe Enit2020.3agm1.Abidi - SafoueneDocument156 pagesPfe Enit2020.3agm1.Abidi - SafoueneKais MansourPas encore d'évaluation
- Table ElevatriceDocument12 pagesTable Elevatricesalhi zied0% (1)
- Rapport de Pfe Finale (1) - ConvertiDocument63 pagesRapport de Pfe Finale (1) - ConvertiKhalîl ÐkhílíPas encore d'évaluation
- PFE Rapport de Projet de Fin D'étude 6 CopieDocument44 pagesPFE Rapport de Projet de Fin D'étude 6 CopieMensi EyaPas encore d'évaluation
- PFE Corrigé Final GhofraneDocument126 pagesPFE Corrigé Final Ghofranechaima100% (1)
- Amdec PDFDocument39 pagesAmdec PDFNadhirBenHamzaPas encore d'évaluation
- Conception D Un Systeme de Decoupe Dimensionnement Et Conception Sur CATIA V5 R20 Realise Par Barhourhe Elmahdi Et Elhlaba M HammedDocument81 pagesConception D Un Systeme de Decoupe Dimensionnement Et Conception Sur CATIA V5 R20 Realise Par Barhourhe Elmahdi Et Elhlaba M HammedSALIM BELGACEM0% (1)
- Amélioration de La Prod LEAN ManufacturingDocument111 pagesAmélioration de La Prod LEAN ManufacturingHamzaEL-HajriPas encore d'évaluation
- N PDFDocument48 pagesN PDFAnass Cherrafi0% (1)
- Rapport Pro Dca FinacDocument124 pagesRapport Pro Dca FinacSara LmariniPas encore d'évaluation
- Pfe 171205105453 PDFDocument86 pagesPfe 171205105453 PDFSyrine BenalayaPas encore d'évaluation
- TD3 - Amélioration BDDocument2 pagesTD3 - Amélioration BDImane LamdainePas encore d'évaluation
- Raed AchrefDocument73 pagesRaed AchrefOussama LaouayenPas encore d'évaluation
- Rapport-Stage-Copie Final-Mbg-2018Document59 pagesRapport-Stage-Copie Final-Mbg-2018Eya Belhaj Sghaier100% (1)
- CV Dut2-Gim - 2020 - 2021Document22 pagesCV Dut2-Gim - 2020 - 2021Greig El MagoPas encore d'évaluation
- Conception Et Réalisation D'une Application de Gestion Des Interventions Liées Au Parc Informatique de Marjane FES - Mohammed BEDocument59 pagesConception Et Réalisation D'une Application de Gestion Des Interventions Liées Au Parc Informatique de Marjane FES - Mohammed BEMehdi BahraouiPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Houas Aziz SagemcomDocument13 pagesRapport de Stage Houas Aziz SagemcomAmine GuiratPas encore d'évaluation
- 4 PalettiseurDocument4 pages4 PalettiseurmimoutesPas encore d'évaluation
- Mémoire de Fin D'étude: Étude Et Conception D'une Application de Gestion de Maintenance Assistée Par Ordinateur GmaoDocument83 pagesMémoire de Fin D'étude: Étude Et Conception D'une Application de Gestion de Maintenance Assistée Par Ordinateur GmaoHatim AbPas encore d'évaluation
- Rapport FiniDocument20 pagesRapport FiniWannes AhmedPas encore d'évaluation
- Frad Mohamed AliDocument72 pagesFrad Mohamed AliFajjeri HadilPas encore d'évaluation
- Rapport Projet Tutore 3Document35 pagesRapport Projet Tutore 3JeanPas encore d'évaluation
- Etude Et Amelioration de La ST - BELKHOU Jihane - 2654Document50 pagesEtude Et Amelioration de La ST - BELKHOU Jihane - 2654Ibtihel MechleouiPas encore d'évaluation
- Pfe Uas Souhail New1Document69 pagesPfe Uas Souhail New1saif eddine msiliniPas encore d'évaluation
- Rapport PfeDocument75 pagesRapport Pfeadnane raisPas encore d'évaluation
- Rapport PFE IMITech Soukayna&OumniaDocument82 pagesRapport PFE IMITech Soukayna&OumniaOussama UskPas encore d'évaluation
- Belkherraz AbdessamadDocument94 pagesBelkherraz AbdessamadBill Kalisto100% (2)
- Rapport de Stage D IntiationDocument31 pagesRapport de Stage D Intiationmehdi kouchiPas encore d'évaluation
- rappFGAT Ghassen SaidDocument68 pagesrappFGAT Ghassen Saidibtissem samaaliPas encore d'évaluation
- Projet Maintenance Des Systèmes Électromécaniques Exemple de MR ALEMDocument36 pagesProjet Maintenance Des Systèmes Électromécaniques Exemple de MR ALEMmoussouni ayoub100% (1)
- Stage 2èmeDocument41 pagesStage 2èmeHana HosniPas encore d'évaluation
- RAPPORT DE STAGE PFE (4) - Inconnu (E)Document67 pagesRAPPORT DE STAGE PFE (4) - Inconnu (E)assia bPas encore d'évaluation
- Plan D'affaire Chariot IntelligentDocument29 pagesPlan D'affaire Chariot IntelligentSalah ELOUAERPas encore d'évaluation
- Model Rapport Projet CDIO FinalDocument58 pagesModel Rapport Projet CDIO FinalMokhtar Alerte100% (1)
- Pfe Af AfDocument45 pagesPfe Af AfSaâd RoudanePas encore d'évaluation
- Rapport Version Finale - Safa KAABDocument82 pagesRapport Version Finale - Safa KAABEya Belhaj Sghaier100% (1)
- MemoireDocument108 pagesMemoirewael frajPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Amira HamzaDocument38 pagesRapport de Stage Amira HamzaAmiira HAMZAPas encore d'évaluation
- Elaboration D'un Plan de Maintenance - AmdecDocument53 pagesElaboration D'un Plan de Maintenance - AmdecAmina RehhaliPas encore d'évaluation
- Projet Rapport Etude ChariotDocument10 pagesProjet Rapport Etude ChariotAyoub Daif allahPas encore d'évaluation
- BC 7 CBC 57Document34 pagesBC 7 CBC 57Bougaalech Med AminePas encore d'évaluation
- Soussa Abdelbasset PDFDocument95 pagesSoussa Abdelbasset PDFJawher SalemPas encore d'évaluation
- Implantation D'un Poste de Tra - MESTOUR Soufiane - 474 PDFDocument111 pagesImplantation D'un Poste de Tra - MESTOUR Soufiane - 474 PDFCristy MitchellPas encore d'évaluation
- Projet de Fin D'Etudes: Amélioration de La Zone de Fabrication Des Joints D'étanchéitéDocument79 pagesProjet de Fin D'Etudes: Amélioration de La Zone de Fabrication Des Joints D'étanchéitéMa HdiPas encore d'évaluation
- PharmDocument67 pagesPharmDhaouadi CharfedinePas encore d'évaluation
- Rapport 5S SMEDDocument59 pagesRapport 5S SMEDMohamed Ben NasserPas encore d'évaluation
- Rapportdestagehindrbiguizinebkarma 121012192543 Phpapp02Document72 pagesRapportdestagehindrbiguizinebkarma 121012192543 Phpapp02Ayoub0% (2)
- Rapport 2021-V4Document43 pagesRapport 2021-V4abdellaoui talelPas encore d'évaluation
- Implémentation Et Développement D'une Plateforme Pour La Gestion Du Back-Office D'une Solution SFADocument66 pagesImplémentation Et Développement D'une Plateforme Pour La Gestion Du Back-Office D'une Solution SFA007Pas encore d'évaluation
- Rapport MouradDocument43 pagesRapport MouradA. HPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage D'observationDocument14 pagesRapport de Stage D'observationFatima Zahra Abdoussi100% (1)
- Fiabilité, maintenance prédictive et vibration des machinesD'EverandFiabilité, maintenance prédictive et vibration des machinesPas encore d'évaluation
- TD Sig Ig3 - Part3Document3 pagesTD Sig Ig3 - Part3sifer mohamedPas encore d'évaluation
- Brochure or D'investissementDocument12 pagesBrochure or D'investissementSamPas encore d'évaluation
- ELECTRONIQUEDocument2 pagesELECTRONIQUEMEHDI BR100% (1)
- DCG 7 Management Manuel Et Application 2020Document420 pagesDCG 7 Management Manuel Et Application 2020badr rahiouiPas encore d'évaluation
- CatalogoNagares2011 PDFDocument46 pagesCatalogoNagares2011 PDFRanieri BenčićPas encore d'évaluation
- Tenseur de Contraintes PDFDocument31 pagesTenseur de Contraintes PDFDeghboudj Samir88% (8)
- Astérisque 1 Évaluation Unité 7 PhotocopiableDocument3 pagesAstérisque 1 Évaluation Unité 7 PhotocopiablekaterinanikolopoulouPas encore d'évaluation
- Relevee 1689005694140Document1 pageRelevee 1689005694140Med yahyaPas encore d'évaluation
- 3 Institutions Judiciairespartie2Document71 pages3 Institutions Judiciairespartie2zineb lemhainiPas encore d'évaluation
- Les Types de Coffrage en Génie CivilDocument12 pagesLes Types de Coffrage en Génie CivilMeryeme M'HouhPas encore d'évaluation
- Matrices Et Déterminants - Commutation de MatricesDocument3 pagesMatrices Et Déterminants - Commutation de MatricesHamza PrintoOsPas encore d'évaluation
- Questionnaire CpamDocument2 pagesQuestionnaire CpamRemus CiutacuPas encore d'évaluation
- Notice Why EvoDocument2 pagesNotice Why EvoA. XPOWERPas encore d'évaluation
- BTS EXERCICES 11 12 Et 13 MOYENS DE REGLEMENTDocument4 pagesBTS EXERCICES 11 12 Et 13 MOYENS DE REGLEMENTHosna NaqabiPas encore d'évaluation
- Fiche Candidature Occitanie LRDocument8 pagesFiche Candidature Occitanie LRagulhonPas encore d'évaluation
- Programme de Formation Approches Agile Et ScrumDocument5 pagesProgramme de Formation Approches Agile Et ScrumMohamed Anouar FarsiPas encore d'évaluation
- Axa PFE AfafDocument44 pagesAxa PFE AfafSeif Eddine El FaitePas encore d'évaluation
- Production de Documents Audio-NumériquesDocument15 pagesProduction de Documents Audio-NumériquesBelalia100% (1)
- Zagame CFE Dec 08Document37 pagesZagame CFE Dec 08Idelphonse SALIOUPas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document15 pagesChapitre 2Septime Romarik TagnonPas encore d'évaluation
- Ebook Christelle Taraud - La Prostitution Coloniale Algerie Tunisie Maroc 1830-1962Document246 pagesEbook Christelle Taraud - La Prostitution Coloniale Algerie Tunisie Maroc 1830-1962leibelka77Pas encore d'évaluation
- Brochure ESGF Octobre 2015Document24 pagesBrochure ESGF Octobre 2015Cricri AduPas encore d'évaluation
- s1-A1-Compléter Une Carte Mentale Et Texte À TrousDocument3 pagess1-A1-Compléter Une Carte Mentale Et Texte À TrouspapoumsPas encore d'évaluation
- ICVSuppliersDocument498 pagesICVSuppliersMohd Abdul Mujeeb100% (1)
- Anglais Chez À Domicile Tradexpert TeamDocument13 pagesAnglais Chez À Domicile Tradexpert TeamTradexpert TeamPas encore d'évaluation
- Application Coût TransportDocument1 pageApplication Coût TransportFatima-Ezzahrae BAZPas encore d'évaluation
- HTTPSWWW - Sbb.chfracheterbelegbillett WebonlineTicket PDFDocument2 pagesHTTPSWWW - Sbb.chfracheterbelegbillett WebonlineTicket PDFISMAIL ISMAIL.ALMDGPas encore d'évaluation
- Ooreka Fiche Evaluation StagiaireDocument5 pagesOoreka Fiche Evaluation StagiaireZiad MerjanePas encore d'évaluation
- Fiches Dorganisation Semestrielle Des Enseignements de La Specialite Master 1 Ressources Hydrauliques s2 2018 2019Document24 pagesFiches Dorganisation Semestrielle Des Enseignements de La Specialite Master 1 Ressources Hydrauliques s2 2018 2019Rie NaPas encore d'évaluation
- Marketing Mix Travail A FaireDocument10 pagesMarketing Mix Travail A FaireLyna BouattouraPas encore d'évaluation