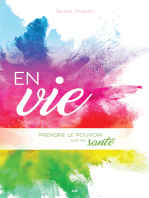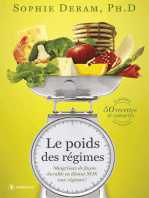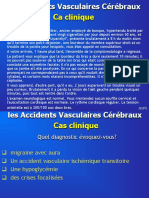Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Etude Du Traitement Traditionnel de L'Hypertension Arterielle Au Mali
Etude Du Traitement Traditionnel de L'Hypertension Arterielle Au Mali
Transféré par
Général KeithTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Etude Du Traitement Traditionnel de L'Hypertension Arterielle Au Mali
Etude Du Traitement Traditionnel de L'Hypertension Arterielle Au Mali
Transféré par
Général KeithDroits d'auteur :
Formats disponibles
REPUBLIQUE DUThèse de Pharmacie
MALI
MINISTERE DE L’EDUCATION Un Peuple - Un But - Une Foi
NATIONALE
……………… ………………………….
UNIVERSITE DE BAMAKO
………………
FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE
ET D’ODONTO-STOMATOLOGIE
Année académique : 2005 – 2006 N°……………
TITRE:
ETUDE DU TRAITEMENT
TRADITIONNEL DE
L’HYPERTENSION ARTERIELLE
AU MALI
THESE
Présentée et soutenue publiquement le…janvier 2006
devant la Faculté de Médecine, de Pharmacie
et d’Odonto-Stomatologie du Mali
Par
Monsieur Issiaka GUINDO
Pour obtenir le Grade de Docteur en Pharmacie
(DIPLÔME D’ETAT)
Jury :
Président : Professeur Moussa HARAMA
Membres : Professeur Elimane MARIKO
Docteur Kassoum SANOGO
Directeur de thèse : Professeur Drissa DIALLO
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 1
Thèse de Pharmacie
Hommages :
Je rends hommage aux parents décédés :
A mes grands-parents à Yélé : Seydou Guindo, Yagninè Guindo, Oumbon Guindo et Dôgui ;
A ma mère Assa Bintou Arama et mon grand frère Adama Guindo à Yélé ;
A mon oncle Sini Victorien Guindo et sa femme Thérèse Sogho à Yélé ;
A mes amis et frères Seydou Anou Guindo et Amadou Kallè Lougué à Bankass et Kani-
Bonzon ;
A mes logeurs Bocari Togo et Bayin Guindo à Sévaré et Bankass ;
A ma grande sœur Céline Gninè Doho à Sévaré ;
Vous nous avez quitté avec une grande surprise mais c’est avec la volonté d’ALLAH. Nous
avons reçu vos conseils, vos encouragements et vos bénédictions tout au long de mes études.
Aujourd’hui j’ai souhaité partager la joie avec vous mais Dieu a décidé autrement.
Dormez en paix!.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 2
Thèse de Pharmacie
DEDICACES
A ALLAH le Tout Puissant : Le Miséricordieux et le très Miséricordieux ;
Mon Seigneur ; Vous êtes l’Omniscient, l’Omnipotent et le prophète MOHAMED « Paix et
Salut sur Lui ». Je cite : « Gloire et louange à ALLAH, il n’y a pas d’autre Dieu à part ALLAH.
Il n’y a aucune force, aucune puissance comparable à la grandeur et la majesté d’ALLAH ».
Merci de m’avoir permis de voir le jour, de grandir et de terminer mes études ; puisse qu’ALLAH
le Tout Puissant me guide et repend Sa miséricorde.
A mon père Erè Sibiri GUINDO :
La patience et la tolérance, la bonté et le courage ne t’ont jamais fait défaut, acceptes cet insigne
de bonheur en reconnaissance de tout ce que tu as fait et continues à faire pour ton fils qui ne te
facilite pas toujours la tâche.
A ma mère Assa Bintou ARAMA : in merorium
La mort t’a arraché très tôt à mon affection, mais cependant ton oeuvre restera graver dans mon
esprit. Du fond de mon cœur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi.
Dort en paix maman!.
Chers parents, sans vos conseils, vos sacrifices, vos encouragements, vos prières et vos
bénédictions ; ce travail n’aurait jamais pu être réalisé.
A ma tante : Minata ARAMA,
Vous avez été ma maman, je vous remercie pour vos conseils, vos critiques, vos encouragements
vos prières et vos bénédictions tout au long de mes études.
Trouvez ici toute ma gratitude et ma reconnaissance!.
A mon oncle feu Sini Victorien DJOUNDO et ses épouses feu Thérèse SOGHO
et Sini Djénéba FONGORO :
Vous avez été un véritable père et mamans, vous m’avez donné toutes les portes
d’entrées et de sorties de la famille. J’étais comme le fils aîné de la famille. C’est vous qui avez
pris mes études en charge. J’ai reçu avec satisfaction l’éducation, des conseils, des critiques, des
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 3
Thèse de Pharmacie
encouragements, des douas et des prières tout au long de mes études. Qu’ALLAH le tout puissant
vous récompense!.
Chère tante, soyez assurée de ma gratitude et de ma reconnaissance!. Dormez papa et tanti en
paix!.
A mes frères : Laya, Moussa, Seydou, Daouda, Drissa, Aili, Gaigolo, Ousmane, Youssouf,
Adama, Feu Adama, Abdoulaye, Salif et Bocari. Merci pour les efforts consentis pendant mes
études. Soignons unis toujours pour renforcer la cohésion familiale!.
A mes sœurs : Alice, Michelle, Florence, Irène, Hawa, Kadia, Sata, Yaoumou, djénéba, Chantal,
Toumata dite Yélin et Yadjémè ;
Soignons unis pour sauvegarder la cohésion familiale!.
A mes cousins et cousines : Hélène Arama, Sabiné Arama, Emile Arama, Hassimou,
Vous avez été toujours à mes cotés. Je vous remercie pour l’aide spirituelle et matérielle.
A la famille DEMBELE : Madame DEMBELE Sira DIARRA, son époux et ses fils : Mohamed,
Adja, Atou, Oumou et Ismaïl ;
Nous avons reçu aisément les cours de mathématiques, biologies et statistiques en première année
de Pharmacie à la FMPOS. Mes camarades m’appelaient « Papou de Tanti ». Vous m’avez
toujours reçu avec des sourires et à bras ouverts. J’ai reçu aussi beaucoup de vos cadeaux en
genre et / ou en espèce. Je dirai que vous avez été plus qu’une maman, d’ailleurs les gens m’ont
toujours posé cette question au bureau, à la faculté et au domicile « Est-ce que Madame est votre
maman adoptive ? ».
Grâce à vous, ce travail a vu le jour. Je n’ai vraiment pas de mots pour vous remercier et votre
famille, puisse qu’ALLAH vous paye et bénisse ainsi votre famille. Que Dieu nous guide dans
cette fraternité!.
A mon ami Louis de Gongeague SANGALA et ses épouses Mah COULIBALY et Félicité
ARAMA Je n’ai pas de mots pour exprimer ici l’estime que je porte pour vous. Veuillez trouver
dans ce travail, toute ma reconnaissance et ma gratitude.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 4
Thèse de Pharmacie
REMERCIEMENTS
Aux familles : Arama, Cissé, Coulibaly, Diané, Dogo, Doucouré, Doumbia, Djiguiba, Fongoro,
Guindo, Lougué, Sangala, Somboro, Togo à Banconi, Bankass, Boulkassoumbougou,
Diallassogou , Kalaban-Coura, Kalaban-Coro, Kani-Bonzon, Kani-Kombélé, Kati, Point
G, Sama, Ségué, Sévaré et Yélé.
Votre humanisme, votre fraternité, vos conseils et votre soutien matériel et spirituel m’ont
beaucoup encouragé tout au long de mes études. Ce travail est le vôtre. Soignez toujours rassurer
de ma reconnaissance et ma gratitude.
A Moumouni Guindo, son épouse Hawa Guindo et sa fille Fatim :
Merci pour la réception chaleureuse que vous m’accordez pendant mes visites.
A mes aînés de la LIEEMA de la FMPOS : Amadou Abathiana, Dr Saibou Diarra, Dr Diadié
Maiga, Dr Daouda Tolo, Karimou Diarra, Dr Seydou Diakité, Dr Bilali Dicko, Boubou
Coulibaly, Dicko Mohamed, Recteur Traoré, Bayo, Dr Aly Issabré, Dr Bassirou Diarra,
Almamy Cissé…
Aux membres de l’association islamique « AMAC & ISESCO » : Alpha Boubacar Koréissi,
Abdramane Dicko, Seny Koréissi, Amadou Maiga, Alpha Cissé, Haidara, Koné, Cheik Oumar
Bagayoko, Allassane Diakité, mon parent Guindo, Mr le photographe et Chaka Traoré ;
A mes logeurs Abdramane Niagaly, feu Bayin Guindo, feu Bocari Togo et familles ;
Merci pour votre hospitalité et soyez assurer toute ma reconnaissance.
A la famille Lougué : Bouréima, Assétou Sagara, Talata, Madou, Moussa et Mariam ;
Je vous remercie pour votre soutien moral, vos conseils et vos encouragements.
A mes amis de Boulkassoumbougou : Kantara Kantako, Yacouba Sanogo, Lamine Dem, Madou
Sidibé, Aly Togo, Ousmane Togo, Souleymane Togo, Hamidou Togo.
Merci pour votre courtoisie, que Dieu nous donne longue vie et plein succès dans activités!.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 5
Thèse de Pharmacie
A mes frères et mes amis : Mohamed Fongoro, Amadou Antandou Lougué, Modeste Somboro,
Ankounidji Djiguiba, Seydou Fongoro, Abdoulaye Togo et Abdoulaye Togo.
Je pense à vous, ce que nous avons fait pendant l’enfance.
A mes parents et amies à la faculté : Djimdé, Kadidiatou Diallo et Halida Korotimi Dako
Merci pour votre amitié et plein succès dans vos foyers et dans vos études.
A mon jeune frère Bouréima Anou Guindo :
Ta compréhension, ta gentillesse, ton courage et tes prières m’ont beaucoup aidé tout au long de
mes études.
Je te remercie fraternellement, puisse qu’ALLAH te récompense et du courage pour tes études!
A la famille Togo et Traoré à Boulkassoumbougou : Seydou, Kadia, Djénéba Diarra,
Dougoutigui, Ousmane, Dislam, Kadi, Lassina, Sabiné, Hawa, Ina, Amadou.
Je me sens bien dans ces deux familles. Vous m’avez donné à boire et à manger sans cesse. Je
suis très content de la vie des deux familles et vous êtes devenues des parents. Soyez toujours
unis de la sorte!
Je vous remercie pour votre gentillesse, votre mode de vie, vos encouragements et vos prières
pendant les examens. Soyez assurer de ma gratitude et toute ma reconnaissance!.
A la famille Sossigué : Abdoulaye, Hawa, Moussa, Abdramane, Djénéba.
Vous m’avez pris à bras ouvert lors de mon arrivée à Bamako. Vous avez guidé mes pas dans
cette ville et à la faculté. Merci pour vos conseils et vos encouragements.
A René Togo et sa famille ; merci pour votre soutien moral et spirituel.
A mes amis : Mathieu Z Samaké, Youssouf, Mory Mariko appelés le triplet et Mariam Ina
Coulibaly dite My Colove ;
Merci pour votre amitié et du courage pour les études!.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 6
Thèse de Pharmacie
Aux aînés Jacques Somboro Dr Charles Arama, Dr Honoré Somboro et Dr Bocari Somboro,
Merci pour vos conseils et vos encouragements.
A mes frères « TOMON » de la FMPOS : Georges Uro-ogon, Pierre Sinali Sodio, Moise
Somboro, Moise Arama, Bouréima Anou Guindo, Bouréima Guindo, Jean Paul Somboro,
Seydou Arama, Moumini Guindo, Tolofoudié, Bouréima Arè Guindo, Youssouf Guindo ;
Beaucoup de courage et de succès chers frères!
Aux membres du groupe « M » à Segué :
A la Pharmacie « Lassana Samaké » à Boulkassoumbougou : Dr Abdou Doumbia, Dr Eve
Tangara, Mamou Doumbia, Zoumana Doumbia, Adjaratou Doumbia, Daouda Témé, Abdoulaye
Témé ; merci pour la formation, la collaboration, le soutien matériel et financier reçus tout au
long de mes stages.
Aux docteurs : Ousmane Maiga, Ousmane Traoré, Aissata , Cheick Traoré, Atou Traoré, Zanké
Diarra, Gaston, Ballo, Wade, Ousmane Coulibaly, Mounkoro, Guida Landouré, Alain, Deidia
Diallo, Issa Mallé, Dinding Diallo et Dramane Koné.
Merci pour vos précieux conseils.
A mon ami Issiaka Guindo et son épouse Fatoumata dite Adja Yossi ;
Nous avons célébré avec éclat le 25 Août passé, votre mariage. Je vous souhaite bon mariage et
heureux ménage. Merci pour votre amitié.
A Ina Mariam Guindo;
Tu m’as toujours reçu avec un très grand sourire. Tes conseils et tes encouragements ne m’ont
pas manqué. Merci pour ton admiration et ta courtoisie.
Du courage pour tes études!.
A mon ami Dr Nasser Elmedy :
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 7
Thèse de Pharmacie
Nous avons été des compagnons de travail. Nos veillées à l’approche des examens n’ont pas été
inutiles. Tu as été plus qu’un ami puisse que tu as toujours trouvé une solution à mes caprices
et problèmes. Et tu as toujours songé à mes problèmes. Merci pour tout et je te souhaite une
bonne carrière.
A mes frères : Lassine Togo, Digui Togo, Mohamed dit Idal Togo, Ali Togo, Kola Togo, Yaya
Togo, Seydou Fongoro, Mahamane Touré, Kodio, Hassana Togo
Je souhaite bon vent au « grin ».
Au personnel du Département de Médecine Traditionnelle (DMT) de l’Institut National de
Recherche en Santé Publique (INRSP) :
A mon ami, mon chef et surveillant général du DMT, Mme Diarra Fatoumata Diarra,
A tonton Fagna Sanogo, tonton Famolo Diarra, tanti Tapa, tonton Kassim, Seydou Dembélé,
L’équipe de production : Adama Camara, Fousséiny Koné, Mme Dicko, Mme Gada,
Aux manœuvres et aux gardiens du Département ;
Je n’ai pas de mots pour vous remercier. Qu’ALLAH vous récompense!.
A mes camarades internes du DMT :
Dominique Patomo Arama, Yacouba Diarra, Oumar Sidibé, Mamou Diabaté, Mariam Cheick
Traoré, Aminata Niaré, Sira Yaya Bah, Saadatou Dady, Halima Sambo, Abdoulaye Siabana, Ali
Khalilou, Mariam Coumbo Tall et Fati Souley.
Nous venons de passer toute une année ensemble. Nous allons beaucoup nous souvenir de ce
temps fort. Je vous souhaite courage et bonne carrière à tous!.
A mes anciens camarades: Dr Ramata Oumar Cissé, Dr Laya M Guindo, Dr Yaya Togora, Dr
Farga Maiga, Dr Djénéba Dabitao, Dr Fatoumata dite Badiè Diarra, Idrissa Zibo Diawara, Dr
Boubacar Souley, Dr Idrissa Awami, Dr Moustapha Taihirou, Dr Oumar Tangara, Dr Wadjou
Diakité, , Dr Soulemane Dama, Dr Moctar Djiguiba, Dr Soumaila Guindo, Dr Binta Timbo, Salif
Sissoko, Amadou Dama, Jojeph Togo, Agnès Guindo…
Merci pour les moments passés et bonne carrière à tous.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 8
Thèse de Pharmacie
MENTION SPECIALE
Au peuple malien
A l’Université d’Oslo (Norvège) pour son soutien matériel à travers le projet CNRST – NUFU
Plantes médicinales
Au Professeur Drissa Diallo pour la formation reçue
Au Dr Ené Augustin Arama et sa famille
Aux Professeurs Moussa Harama et Amadou Diallo
Au Dr Saharè Fongoro et sa famille
Au Dr Rokia Sanogo pour ses conseils et critiques
Au personnel du Département de Médecine Traditionnelle (DMT) de l’Institut National de
Recherche en Santé Publique (INRSP) :
Au Dr Traoré Aminata au laboratoire de biochimie à l’INRSP
Au personnel du laboratoire national de la santé (LNS) ; plus particulièrement au Directeur
Général Pr Gaoussou Kanouté, mon parent Dolo, Dr Sindé, Dr Koné, Mme Koné Adeye, Mme
Dembélé Mariam
A Mme Dembélé Sira Diarra et sa famille
A la famille feu Sini Victorien Djoundo à Yélé et Bankass
A la Pharmacie « Lassana Samaké » à Boulkassoumbougou
A la Pharmacie « les Hirondelles »
A mes logeurs de Bankass, Koro, Sévaré et Bamako,
A mes camarades de promotion Professeur Gaoussou Kanouté
A mes camarades internes au DMT
A Louis De Gonzague Sangala
Au comité LIEEMA de la FMPOS
A l’association islamique « ISESCO »
A l’association « GUINADOGON » la cellule de la FMPOS
A tous mes enseignants du fondamental, du lycée et de l’université
A Michelle Djoundo, Dr Dominique Patomo Arama, Drissa Guindo, Bouréima Anou Guindo et
Abdramane Togo.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 9
Thèse de Pharmacie
A monsieur le Président du Jury, Professeur Moussa Harama
Professeur de chimie organique et de chimie analytique à la Faculté de
Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie (FMPOS),
Responsable de l’enseignement de la chimie organique à la FMPOS.
Honorable maître, vous nous faites ce jour, un honneur en acceptant de juger ce travail malgré
vos multiples occupations.
La chaleur humaine avec laquelle vous nous avez accueilli, votre grande sagesse, vos qualités
humaines font de vous un éminent homme de science reconnu de tous.
Veuillez trouver ici l’expression de notre profonde gratitude et de notre respect.
A notre maître et juge, Professeur Colonel Elimane Mariko
Maître de conférence en pharmacologie,
Responsable de l’enseignement de Pharmacologie à la FMPOS,
Chargé de mission au Ministère de la Défense et des Anciens Combattants.
La spontanéité avec laquelle vous avez accepté de participer à l’amélioration de la qualité de ce
travail, nous honore.
Nous avons bénéficé aussi de votre riche enseignement, votre sympathie, votre disponibilité,
votre humilité, toutes choses font de vous un réputable auprès de vos collègues et vos étudiants.
Trouvez ici cher maître le témoignage de notre haute reconnaissance.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 10
Thèse de Pharmacie
A notre maître et juge, Docteur Kassoum Sanogo
Spécialiste en maladies cardiovasculaires,
Assistant chef de clinique en cardiologie,
Chargé de l’enseignement de cardiologie à la FMPOS,
Chef du service de cardiologie de l’Hôpital Gabriel Touré (HGT),
Directeur médical de l’HGT.
Cher maître, votre simplicité et votre humanisme m’ont beaucoup impressionné.
Vous nous avez particulièrement marqué par la qualité de votre travail.
C’est un grand honneur que vous nous faites en acceptant de juger ce travail.
Cher maître, trouvez ici l’expression de notre profonde reconnaissance.
A notre maître et Directeur de thèse Professeur Drissa Diallo
Professeur agrégé en pharmacognosie à la FMPOS,
Responsable de l’enseignement de la pharmacognosie et de phytothérapie à la FMPOS,
Chef du Département de Médecine Traditionnelle (DMT) de l’Institut National de
Recherche en Santé Publique (INRSP).
C’est un grand honneur que vous nous avez fait en acceptant de diriger ce travail malgré vos
multiples occupations.
Votre grande valeur humaine, vos éminentes connaissances scientifiques et votre souci du travail
bien fait nous ont beaucoup marqué.
Cher maître, veuillez trouver ici l’expression de notre reconnaissance infinie et de notre profond
respect.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 11
Thèse de Pharmacie
LISTES DES ABREVIATIONS ET DES FORMULES CHIMIQUES
ACTH : Adreno-corticotrophine
ADH : Hormone anti diurétique
AHC : Anti hypertenseurs centraux
AINS : Anti Inflammatoire Non-Stéroïdiens
AVC : Accident Vasculaire Cérébral
BAW : Butanol-Acide acétique-Eau
CCM : Chromatographie en couche mince
ECG : Electrocardiogramme
ED : Eau distillée
ES : Effets secondaires
EUV : Excrétion urinaire volumétrique
DC : Débit Cardiaque
DO : Densité optique
DCM : Dichlorométhane
DMT : Département de médecine traditionnelle
DPPH : 1, 1’ diphenyl-2 picrylhydrazyle
FAO : organisation des fonds alimentaires
H : Heure
HNPG : Hôpital National du Point G
HTA : Hypertension artérielle
IC : Inhibiteur calcique
IEC : Inhibiteur de l’enzyme conversion
INRSP : Institut National de Recherche en Santé Publique
IR : Insuffisance rénale
MeOH : Méthanol
mn : Minute
MTA : Médicament traditionnel amélioré
nm : Nanomètre
n° : Numéro
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 12
Thèse de Pharmacie
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONU : Organisation des Nations Unies
P° : Pression
PA : Pression artérielle
PAD : Pression artérielle diastolique
PAS : Pression artérielle systolique
PH : Potentiel d’hydrogène
PS : Pression sanguine
Q : Débit de fluide
R : Résistance
Rf : Facteur de rétention
RP : Résistance périphérique
RPT : Résistance périphérique totale
RVT : Résistance vasculaire totale
TA : Tension artérielle
UV : Ultra violet
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 13
Thèse de Pharmacie
INTRODUCTION :
L’hypertension artérielle (HTA) est une affection très fréquente actuellement mais elle
était considérée pendant longtemps comme une pathologie rare et voire même inexistante en
Afrique.
L’HTA constitue aujourd’hui un véritable problème en santé publique, elle désigne une
élévation non transitoire de la pression sanguine dans les artères qui reposent sur deux points ;
l’élévation de la tension et sa persistance (ARAMA, 1988).
Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), l’HTA chez l’adulte est arbitrairement
définie par une pression artérielle systolique (PAS) supérieure ou égale à 140 mm de Hg et / ou
une pression artérielle diastolique (PAD) supérieure à 90 mm de Hg. Ces définitions sont
imparfaites car la tension artérielle varie en fonction de l’âge et du sexe.
L’OMS a classé l’HTA en trois classes ou grades ;
Grade 1 : HTA légère ; PAS = 140-159 mm de Hg avec PAD = 90-99mm de Hg.
Grade 2 : HTA modérée ; PAS = 160-179 mm de Hg avec PAD = 100-109mm
de Hg.
Grade 3 : HTA sévère ; PAS >180 mm de Hg, PAD >110mm de Hg.
Nous avons deux groupes d’H.T.A.
L’H.T.A. essentielle : représente 95 % des cas d’hypertendus. Elle constitue l’un des
éléments du risque cardiovasculaire justifiant sa prise en charge thérapeutique. Elle est liée à des
facteurs naturels, génétiques, rénaux, endocriniens, psychosociaux (émotion, stress),
environnementaux (bruit, air, eau), diététiques (aliments sodés et la prise du poids).
L’HTA secondaire : concerne 5 % des hypertendus ; sa cause est surrénale, rénale et
toxique. Elle est liée à des facteurs d’origine médicamenteuse, maladie organique et l’HTA
gravidique (grossesse). L’élévation permanente de la tension dans les artères va donner les
atteintes organiques plus ou moins graves. Les complications sont d’ordre : cardiaque, cérébral,
rénal, oculaire et vasculaire.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 14
Thèse de Pharmacie
La prévalence augmente avec l’âge jusqu’à 85 ans avec cause variable :
L’augmentation des résistances périphériques par une moindre sensibilité ; la diminution
de la sensibilité des barorécepteurs sinocarotidiens et la capacité de pression artérielle
(PA).
L’HTA constitue l’une des prémières causes de mortalité chez les deux sexes. Face à ces
complications, nous avons besoin d’un traitement. L’objectif du traitement de l’HTA est
d’assurer la prévention des complications cardiovasculaires en particulier : l’accident vasculaire
cérébral et l’infarctus du myocarde (CHAMONTIN B., 1997).
Le traitement antihypertenseur fait toujours appel aux mesures hygiéno-diététiques ; la
correction des anomalies métaboliques associées (hypercholestérolémie, diabète) à différentes
classes de médicaments.
Mais pourquoi un traitement traditionnel à côté de cette pléthore de produits pharmaceutiques
dont l’efficacité est confirmée depuis longtemps? Nous allons donner des réponses à cette
question, ce qui a permis d’orienter les chercheurs dans ce domaine surtout dans nos pays en voie
de développement.
Les infrastructures et le personnel sanitaires sont insuffisants. La médécine conventionnelle
n’est accessible qu’à une catégorie privilégiée de la population. Les médicaments modernes de
même que les frais d’hospitalisation sont chers et leur approvisionnement reste insuffisant.
Vu le revenu modeste de la population surtout en milieu rural, le salaire bas des
fonctionnaires, un pays pauvre comme le Mali. Dans ces conditions plus de 80 % de nos
populations font recours à la médécine traditionnelle depuis des temps réculés. Au Mali, les
tradipraticiens assurent la couverture sanitaire de la population surtout au niveau rural.
La médécine traditionnelle répond mieux à nos besoins puisse qu’elle a l’accès plus facile
de nos populations (OMS, 2002). C’est donc un patrimoine culturel qui mérite d’être consolidé.
Si non il serait regrettable au moment où les pays développés font recours à la phytothérapie que
les pays africains se détournent de ce qui constitue pour eux un acquis.
C’est dans cette optique que nous apporterons une contribution à l’étude du traitement
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 15
Thèse de Pharmacie
traditionnel de l’hypertension artérielle à partir d’une plante: Spondias mombin L. et d’une recette
utilisée dans le traitement traditionnel de l’HTA. Pour cela nous identifierons les groupes
chimiques présents dans les poudres de la drogue et de la recette et nous procéderons aux tests
biologiques des extraits de la drogue et de la recette de l’HTA à savoir l’activité antioxydante et
diurétique.
Motivations :
Notre travail a été motivé par :
La revalorisation des plantes médicinales utilisées en médecine traditionnelle ;
Les complications cardiovaslaires chez les hypertendus ;
La mise au point d’un médicament traditionnel amélioré (MTA) utilisé dans le
traitement de l’HTA ;
Le coût élevé de la prise en charge des hypertendus par le traitement
conventionnel.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 16
Thèse de Pharmacie
Objectifs :
Objectif général :
Etudier le traitement traditionnel de l’HTA.
Objectifs spécifiques :
Recenser les recettes utilisées dans le traitement de l’HTA ;
Identifier les groupes chimiques de la poudre des écorces de Spondias mombin et
d’une recette utilisée dans le traitement de l’HTA ;
Déterminer la teneur en éléments minéraux de la poudre des écorces de Spondias mombin,
de la recette de l’HTA et de l’excrétion urinaire des souris.
Déterminer l’activité anti oxydante des extraits des écorces de tronc de Spondias mombin
et de la recette de l’HTA ;
Déterminer l’activité diurétique des extraits aqueux de Spondias mombin.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 17
Thèse de Pharmacie
1 Rappels sur l’hypertension artérielle :
1-1 Définition :
L’hypertension artérielle est définie par la pression artérielle trop élevée. L'élévation de la
tension artérielle se traduit par une augmentation des risques de morbidité (risque des
complications) et de mortalité (risque de décès ) surtout en raison de ses complications cardio-
vasculaires, neurologiques et rénales ; ce risque peut être réduit par un traitement
antihypertenseur adapté et prévenu par le respect de certaines règles hygiéno-diététiques.
1-2 Epidémiologie :
HTA est une affection qui devient de plus en plus fréquente. Cette pathologie n’épargne
ni les pays développés, ni les pays sous développés. Les études épidémiologiques des dernières
décennies ont montré l’extraordinaire fréquence de l’HTA dans les populations des pays
industriels. Elle atteint de façon patente les adultes, mais aussi semble -t-il les enfants, plus que
nous le pensons naguère (ARAMA, 1988).
Le pourcentage d’adulte atteint de l’HTA est de 15 à 20 % ; chez les enfants, les études
épidémiologiques ont été retardées par la difficulté de mesurer la PA avec les très jeunes enfants
(PAS > 140 - 130 mm de Hg et PAD < 90 - 85 mm de Hg) (MEYER, 1978).
Aux Etats-Unis (USA), les chiffres fournis par le National Health and Nutrition
Examination Survey montrent que de 1976 à 1980 la prévalence était de 51 % d’hypertension
artérielle dans la population générale tandis que de 1991 à 1994, elle était de 68 % (TINDAKIR,
2004).
L’étude du service national de santé estimait qu’en 1960, les complications de l’HTA ont été
responsables de 7300 000 de jours d’arrêt de travail, de 26000000 de jours d’alitements et
82 000 000 de journées pendant laquelle l’activité professionnelle était perturbée. Ces quelques
exemples montrent clairement que l’HTA constitue un des plus grands fléaux de l’humanité.
(Meyer, 1978). Dans ces états américains, nous avons 20 % de l’H.T.A. qui est deux fois plus
fréquentes des sujets de race noire 30 % et 15 % des sujets de race blanche.
En France, l’H.T.A. représente 20 % selon les études de NGHONGUIA en 2001.
La fréquence hospitalière de l’HTA est estimée à 13,90 % en Afrique (TINDAKIR,
2004).
En Afrique centrale, au Cameroun selon l’étude faite par Youmbissi en 1989, la fréquence de
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 18
Thèse de Pharmacie
l’HTA était de 31 % ; TINDAKIR a rapporté en 2000, une fréquence de 38,50 % à Douala et
38,60 % à Yaoundé. Au Congo Brazzaville, la fréquence de l’HTA était de 14,96 % (Arama,
1988). Au Tchad en 1995, elle était de 58 % (TINDAKIR, 2004).
En Afrique de l’Ouest : au Bénin, la fréquence est estimée à 13,75 % , 13,78 % au
Ghana ; 13,88 % en Côte d’Ivoire; 19,30 % au Burkina Faso (ARAMA, 1988).
Au Mali, 38 % de cas d’HTA ont été notés au service de cardiologie et 30,80 % au service de
néphrologie de l’hôpital national du Point G (HNPG). En 1993-1994, la prévalence de l’ HTA
était de 4,03 - 6,80 % en milieu rural et 13,97 % à Bamako (NGHONGUIA, 2001).
L’hypertension artérielle est aujourd’hui au premier rang des groupes nosologiques en
cardiologie et constitue la première cause d’admission hospitalière avec une fréquence de
52,60 % dans le service de cardiologie de l’hôpital National du Point G (HNPG). Elle représente
11,10 % des causes de la mortalité hospitalière (TINDAKIR, 2004). L’HTA touche plus de 40 %
de la population, généralement la tranche d’âge comprise entre 35 et 65 ans (DIALLO
S., 2005). La fréquence de la maladie hypertensive reste relativement élevée tant au niveau des
personnes âgées qu’au niveau des jeunes.
2 Physiopathologie de l’HTA : (Pattes D et al, 1981; Delbarre, 1993 ; OMS, 1983;
ARAMA, 1988 CHAMONTIN B., 1997).
L’expression «hypertension artérielle» doit toujours s’entendre comme désignant une
élévation chronique de la tension artérielle systolique et / ou diastolique. Chez l’adulte,
l’hypertension est définie arbitrairement par l’existence d’une tension artérielle systolique
supérieure ou égale à 95 mm de Hg.
L’HTA est établie sur la base de la nouvelle classification donnée par l’OMS dans le
tableau suivant :
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 19
Thèse de Pharmacie
Tableau n0 I : Classification de l’HTA selon l’OMS (CHAMONTIN B., 2001)
Catégories de HTA Systolique (mm de Hg) Diastolique (mm de Hg)
PA optimale < 120 et < 80
PA normale < 130 et < 85
PA normale haute 130 à 139 ou 85 à 89
HTA stade 1 140 à 159 ou 89 à 99
HTA stade 2 140 à 159 ou 100 à 109
HTA stade 3 > 180 ou > 110
HTA systolique > 140 et < 90
Les limites physiologiques de la tension artérielle sont mal définies et comportent une
large part d’arbitraire (TINDAKIR, 2004).
L’HTA est due à l’augmentation du débit cardiaque et le volume sanguin circulant. C’est
l’augmentation des résistances qui déterminent une élevation durable de la pression dans les
vaisseaux sanguins. Nous avons deux facteurs essentiels permettant d’expliquer ce système:
- Au début de la maladie, la résistance augmente par suite d’une vasoconstriction
fonctionnelle réversible dont les causes essentielles sont l’élévation du tonus sympathique et
de la réactivité des vaisseaux.
- Au stade chronique de la maladie, il y a une apparition des lésions artérioscléroses ou une
hyper plagie, une fibrose ensuite une nécrose des tissus artériolaires.
L’augmentation de la tension au niveau des artères va entraîner des atteintes organiques plus
ou moins graves. Les complications de l’HTA sont d’ordre : cardiaque, rénal, cérébral, oculaire,
vasculaire.
• Le cœur : nous avons une insuffisance cardiaque, une cardiopathie ischémique,
l’hypertrophie ventriculaire gauche, l’angine de poitrine et l’infarctus de myocarde.
• Le rein : nous avons une créatinémie ( > 20 mg / l), une insuffisance rénale, une
néphro-angiosclérose, les néphropathies parenchymateuses et une sténose de l’artère
rénale.
• Le cerveau : nous avons une thrombose cérébrale qui est accompagnée des lésions
athéroscléreuses, les accidents cérébraux; les encéphalopathies hypertensives
accompagnées aussi de coma, les convulsions, les céphalées, les nausées et les
vomissements.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 20
Thèse de Pharmacie
• Les yeux : nous avons l’hémorragie et les exudats rétiniens avec œdème de la pupille.
• Les vaisseaux sanguins : nous avons un anévrisme et l’athériopathie périphérique.
2-1 Les bases des données de la physiopathologie:
Hémodynamique cardiovasculaire :
La PA est définie comme le produit du débit par les résistances périphériques (PA = Q x
RPT). On conçoit qu’une élévation de PA puisse résulter d’une augmentation de débit (soit par
l’augmentation du volume sanguin) ou d’une augmentation des résistances périphériques à la
faveur d’agents vasoconstricteurs.
Données rénales :
Le rein joue un rôle déterminant dans la relation PA-natriurèse. Cette aptitude du rein à
corriger l’augmentation de la natriurèse possède un gain infini ; l’apparition d’une HTA
supposerait une altération de ce phénomène de régulation avec un déficit de l’excrétion sodée.
Il s’y associe des modifications hémodynamiques rénales avec une perte de l’aptitude à la
vasodilatation et une augmentation des résistances rénales.
2-2 Les avenues physiopathologiques :
Activation initiale des phénomènes de la PA.
Une modification d’origine génétique du système rénine angiotensine pourrait conduire à
la maladie hypertensive par l’intermédiaire d’une activation du système hormonal et de
modifications tissulaires, vasculaires et myocardiques.
On peut concevoir le rôle des catécholamines ; adrénaline et noradrénaline. L’HTA
hyperkinétique du jeune avec l’élévation du débit cardiaque constitue l’illustration la mieux
comprise avec une hyperactivité des centres presseurs relayés par le sympathique et le système
rénine angiotensine. Chez ces jeunes patients, le niveau des résistances périphériques est
inadapté, toujours trop élevé au regard du débit cardiaque « primitivement » majoré.
A l’inverse l’HTA peut avoir une origine volodépendante :
La déficience du rein à excréter le sodium est à l’origine de la sécrétion hypothalamique d’un
facteur natriurétique et vasoconstricteur. Celui-ci est capable de bloquer la pompe à sodium Na-K
dépendante favorisant ainsi l’entrée du sodium dans la fibre lisse vasculaire, associée à une entrée
du calcium, à l’origine de l’hypertonie vasculaire. On comprend ainsi qu’un modèle
volodépendant d’HTA pourrait s’accompagner d’une élévation des résistances périphériques.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 21
Thèse de Pharmacie
L’artère cible convergente des hypothèses physiologiques :
L’ensemble des mécanismes physiopathologiques évoqués dans l’HTA conduit à des
altérations artérielles, concernant les artérioles dites artères résistives, mais aussi les grosses
artères élastiques avec perte de leur fonction d’amortissement, et réduction de leur compliance. Il
existe à ce niveau des modifications structurales avec au niveau artériolaire une augmentation du
rapport épaisseur par rayon (hypertrophie de la média par diamètre interne de l’artériole) et au
niveau du gros vaisseaux, hypertrophie du muscle lisse artériel avec inversion du rapport élastine
par collagène.
2-3 Les modifications cardiovasculaires et neuro-humorales liées au stress :
Le stress est la réponse biologique, mentale et/ou psychologique d’adaptation de
l’organisme à l’action d’un agent physique, psychologique et/ou social. Le stress joue un rôle
important dans la pathologie de l’HTA : celle-ci est beaucoup plus fréquente dans les sociétés
industrielles primitives.
En effet certains individus, soumis à des événements stressants caractérisés par leur répétition,
leur intensité, leur durée et leur fréquence, subissent des modifications physiologiques,
cardiaques et rénales importantes ainsi que des modifications neuro-endocriniennes.
Cardiaques : les modifications cardiovasculaires sont dues à l’action du stimulus
psychique sur le système nerveux sympathique. Le débit cardiaque (DC) augmente
du fait d’un effet α sur les veines, provocant une diminution de la capacitance. La
fréquence cardiaque (FC) augmente du fait de l’effet β sur le cœur.
Les PAS et PAD augmentent du fait de l’élévation des RPT et d’un effet β sur le cœur,
accroissant la contractilité.
Des études récentes montrent que les barorécepteurs, lors du stress, n’ont qu’un rôle mineur sur
la FC et la PA.
Rénales : on observe une augmentation du flux rénal lors du stress, due à l’action du
sympathique rénal, et une augmentation de l’excrétion urinaire du sodium.
Au niveau du système nerveux sympathique : la mesure de l’activité du nerf
sympathique chez l’homme montre que celle-ci augmente, à la fois lors du stress au
froid.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 22
Thèse de Pharmacie
Neuro-endocriniennes : les modifications se font dans deux cas suivants :
• Taux des catécholamines : on observe une augmentation de la noradrénaline
plasmine et de la dopamine β-hydroxylase.
• ACTH et glucocorticoïdes : de nombreuses études ont montré que, dans
différentes situations de stress (examen oral, entretien, exposition au froid…), on
observe une augmentation de l’ACTH et, plus tardivement, une libération de
cortisol par le cortex surrénalien.
2-4 Régulation de la tension artérielle (PA) : (Delbarre, 1993; ARAMA, 1988)
Selon la loi de Poiseuille, la pression (P) dans un système hydraulique est égale au produit du
débit de fluide (Q) par la résistance à l’écoulement (R).
P= QXR
Cette loi permet d’aborder deux aspects de l’hémodynamique de la PA qui sont le DC et
la résistance vasculaire totale (RVT). Elle est trop simpliste pour être appliquée à un système
aussi complexe que la circulation.
2-4-1 Mécanisme de la régulation :
La régulation de la circulation sanguine s’effectue suivant deux mécanismes :
2-4-1-1 Mécanisme de régulation immédiate par la voie réflexe :
Le DC et la RP déterminent une pression sanguine (PS) adaptée aux besoins périphériques
en nutriments et en oxygène. En cas de variation brusque de la PS dans les vaisseaux, un axe
réflexe permet de normaliser la PA. Cet axe comprend :
2-4-1-1-1 Les récepteurs :
•
Les barorécepteurs situés au niveau de la crosse de l’aorte et du sinus carotidien sont
stimulés par une augmentation brusque de la pression. Ils amortissent 60 à 80 % d’une
élévation soudaine de la TA. Cependant, leur sensibilité baisse progressivement si la
hausse tensionelle se maintient assez longtemps. A la longue aucun signal ne part de
ces récepteurs vers les centres nerveux quand bien même la tension reste élevée.
• Les chémorécepteurs sont situés au niveau du glomus carotidien sont sensibles aux variations
de gaz carbonique (CO2), de l’oxygène (O2) et du pH. Ils deviennent très sensibles quand la
PA s’abaisse au-dessous de 80 mm de Hg.
• Les récepteurs imidazoliniques situés dans la région ventrolatérale du bulbe rachidien
incluant le noyau réticulaire latéral. C’est à ce niveau qu’agissent les substances de type
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 23
Thèse de Pharmacie
clonidine à l’exclusion des catécholamines. Le clonidine displacing substance (CDS) a une
affinité importante pour les récepteurs imidazoliniques. Injecté au niveau du noyau réticulaire
latéral, il provoque une hypertension.
Il existe d’autres récepteurs (viscéraux et corticaux) qui restent sensibles à des stimulus divers
(douleurs, froid, émotion…).
2-4-1-1-2 Les voies et les centres nerveux :
Les voies afférentes sont constituées par les nerfs IX et X; les voies sensitives de la
moelle, la chaîne sympathique et les voies cervicales. Le reste de la chaîne est constitué par les
centres vasomoteurs et cardiomodérateurs de la moelle.
En cas d’hypotension, les récepteurs émettent des signaux qui alertent les centres
vasomoteurs et cardiaques. Les catécholamines libérées par le plexus sympathique cardiaque, la
capacité de la pompe cardiaque peut varier du simple au double. Ces variations se font par
l’intermédiaire de l’élévation de la fréquence cardiaque et/ ou du volume d’éjection systolique.
Parallèlement les centres périphériques engendrent une vasoconstriction par l’intermédiaire de la
noradrénaline. Il en résulte donc une élévation de la TA par l’augmentation du volume sanguin
circulant et une diminution du calibre des vaisseaux.
2-4-1-2 Mécanisme de régulation à long terme :
Le rein par l’intermédiaire de l’appareil juxta-glomérulaire assure en grande partie la
régulation de la tension artérielle à long terme. Il sécrète une enzyme clé dans la régulation de la
pression artérielle et du métabolisme hydrosodé puis qu’elle est commandée à la fois d’un
système vasoconstricteur et d’un système vasodilatateur.
2-4-1-2-1 Le système vasoconstricteur :
• Le système rénine-angiotensine :
La rénine, l’enzyme fabriquée par le rein, est secrétée dans l’appareil juxta-glomérulaire au
niveau de la macula densa (située entre le tube distal et la cellulo-conjonctive) ou elle dégrade
une protéine fabriquée par le foie. L’angiotensine est transformée en angiotensine I qui est
convertie en angiotensine II (enzyme de conversion), dont l’activité hypertensive est très
importante.
• L’endothéline :
C’est un polypeptide vasoconstricteur qui provient de la pro-endothéline fabriquée par les
cellules endothéliales.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 24
Thèse de Pharmacie
• L’hormone natriurétique atriale :
C’est un stéroïde ou un peptide d’origine centrale digitoxine-like, sécrétée par l’hypothalamus.
• La vasopressine ou l’hormone antidiurétique (ADH) :
L’ADH est un polypeptide cyclique sécrété par l’hypophyse postérieure. Il existe deux
types de récepteurs à la vasopressine : V1 répond aux effets de l’ADH et V2 provoque une
mobilisation de Ca intracellulaire via du système inositol-phosphate.
• Les thromboxanes et les leucotriènes :
Les thromboxanes ont la même origine que les prostaglandines. Les leucotriènes sont des
produits issus de la voie de lipo-oxygénase.
• La sérotonine :
La sérotonine est un neurotransmetteur du groupe des indolamines.
• Le neuropeptide Y :
C’est un nouveau neuropeptide endogène qui se comporte comme un co-transmetteur de
la noradrénaline. Il est présent au niveau du système nerveux central et du système nerveux
sympathique.
• L’aldostérone :
C’est un minéralo-corticoide synthétisé principalement dans la zone glomérulaire du
cortex surrénalien dont la sécrétion est contrôlée par le système rénine angiotensine.
2-4-1-2-2 Les vasodilatateurs :
Les facteurs natriurétiques atriales ou auriculaires (ANF) :
L’ANF est un polypeptide secrété par les oreillettes en réponse à leur distension. C’est un agent
natriurétique extrêmement puissant provoquant une natriurèse et une diurèse importante.
L’ANF est un vasodilatateur et s’oppose aux effets vasoconstricteurs de la noradrénaline
et de l’angiotensine II. L’ANF inhibe :
- la libération de rénine par action directe sur le rein ;
- la sécrétion d’aldostérone par action sur la surrénale ;
- la sécrétion de vasopressine.
Les prostaglandines E2 et I2 :
Ce sont des métabolites de certains acides gras poly insaturés, en particulier les acides
arachidoniques et eicosatétraénoiques (cyclo-oxygénase).
Les prostaglandines sont reparties en quatre classes désignées par les lettres correspondant
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 25
Thèse de Pharmacie
chacune à des radicaux différents, ces classes étant subdivisées par les chiffres pour le nombre de
double liaison sur la chaîne latérale.
Le facteur de relaxations :
Ce facteur, dont le principal a été identique au radical NO, serait formé à partir de l’arginine. Il
diffuse dans les cellules musculaires lisse en activant la guanylate-cyclase avec conséquence,
l’accélération de la production de la GMP-cyclique et la relaxation des fibres musculaires lisses.
Kallicréine par kinine :
Les kinines sont des enzymes qui libèrent, à partir des substances d’origine hépatique
(kininogènes), des peptides possédant des propriétés vasodilatatrices (bradykinines)
Les bradykinines :
Ce sont des polypeptides vasodilatateurs qui sont dégradés par la kinase II (enzyme de
conversion).
La dopamine :
Elle est un neurotransmetteur du groupe des catécholamines.
L’action sur les récepteurs DA1 :
La stimulation provoque une relaxation du muscle lisse (territoires vasculaires rénaux
mésentériques, coronaires, cérébraux).
L’action sur les récepteurs DA2 :
La stimulation de ces récepteurs provoque une inhibition de la noradrénaline et provoque
ainsi une hypotension. La stimulation des récepteurs DA2 provoque également le vomissement et
la sécrétion de prolactine.
Il existe d’autres mécanismes d’ordre secondaire qui interviennent dans la régulation immédiate
de la TA telles les modifications de la répartition liquidienne entre les secteurs intra et
extracellulaire, la variation du volume résiduel veineux etc.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 26
Thèse de Pharmacie
Angiotensinogène Prorénine Kininogène
Renine Kallicréine Synthèse
plasmatique plasmatique prostsglandines
Angiotensine I
Kinines
IEC Actives
Salarasine
losartan IEC
Enzyme de conversion
Angiotensine II Fragments
Active inactifs
Recepteur de
l'angiotensine II Angiotensinases
Angiotensine III
et fragments inactifs Vasodilatation
Vasoconctriction Sécrétion
aldostérone
Résistance vasculaire
périphérique
Résistance Rétension
périphérique vasculaire Na+, H2O
PA PA
Figure n0 1 : Mécanisme d’action des inhibiteurs de l’enzyme de conversion (Delbarre, 1993)
3- Etiologie : (Delbarre, 1993; ARAMA, 1988; TINDAKIR, 2004).
Nous distinguons deux types d’HTA : l’HTA secondaire et l’HTA essentielle.
Epidémiologiquement, les pays riches ont respectivement de l’HTA essentielle et de l’HTA
secondaire chez l’adulte est 95 % et 5 %, cette même fréquence de l’HTA adulte africain est de
64 % et 36 % (TINDAKIR, 2004).
3-1 L’hypertension artérielle essentielle :
3-1-1 Facteurs renaux:
Le rein est l’un des organes principaux de la régulation de la pression artérielle en raison
du contrôle hydrosodé et dans le tonus vasomoteur par l’intermédiaire du système rénine-
angiotensine. En théorie, l’HTA ne peut survenir que sur un rein pathologique ne pouvant
excréter normalement le sodium, même si la plus part des malades hypertendus essentiels n’ont
pas de lésions rénales ou de dysfonctionnement rénal évident, au moins dans la phrase précoce de
leur hypertension.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 27
Thèse de Pharmacie
La démonstration du rôle du rein dans l’HTA essentielle a bénéficié de plusieurs
expériences dont celle d’une transplantation. Greffer le rein d’un animal ou d’un homme
normotendu à un animal ou à un homme hypertendu que l’on binephrectonise, normalise la PA.
L’inverse étant vrai avec l’HTA apparaissant après greffe, chez un sujet initialement normotendu
à partir d’un donneur hypertendu.
Une fonction rénale normale entraîne une natriurèse appelée « natriurèse de pression »
lors d’une augmentation de la PA. On note une installation de l’HTA lorsque la relation
PA / natriurèse est altérée. Ce phénomène montre le mécanisme rénal de la pression rénale
artérielle. L’origine de l’HTA serait donc un défaut rénal primitif ou acquis de l’excrétion sodée.
Les mécanismes responsables de la natriurèse de pression ne sont pas connus. Par ailleurs, on sait
que les systèmes neuro-humoraux peuvent modifier cette régulation.
3-1-2 Facteurs génétiques :
Beaucoup d’auteurs disent que le facteur héréditaire est l’une des composantes de la
pathogénie de l’HTA essentielle. Une prédisposition génétique à l’HTA est empirique, présumée
en pratique du fait de la fréquence des antécédents familiaux. L’héritabilité génétique de la PA
estimée par l’ensemble des études familiales est remarquablement constante, voisine de 30 %.
Les facteurs héréditaires de divers auteurs et peuvent être neurogènes, neuro-humoraux ou
rénaux. L’HTA d’origine génétique est en faite établie bien que les modalités de la transmission
restent encore discutables : autosomales monogéniques ou polygéniques. Les preuves d’un
déterminisme génétique de la TA ont conduit à rechercher des marqueurs génétiques de la
sensibilité à l’hypertension. Ces marqueurs peuvent consister :
• Soit dans un paramètre intervenant dans la régulation physiologique de la TA;
• Soit dans une caractéristique associée, qui exprime le polymorphisme génétique
sans savoir le lien avec la valeur effective de la TA.
Diverses anomalies ont été décrites chez les normotendus originaires d’une famille
d’hypertendus, mais la plus part de ces observations devront être confirmées par des études plus
poussées :
Anomalies de la fonction rénale ;
Anomalies du système nerveux sympathique ;
Anomalies du transport transmembranaire des électrolytes (Na+ et K+ ; Na+ et Li+) ;
Sensibilité d’origine génétique aux facteurs environnementaux ;
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 28
Thèse de Pharmacie
Polymorphismes particuliers sans lien avec les mécanismes physiopathologiques.
3-1-3 Facteurs diététiques : (OMS, 1983 ; Delbarre, 1993)
3-1-3-1 L’obésité :
L’obésité est un excès de poids du à une inflammation des réserves énergétiques ; c’est à
dire de masse grasse.
L’HTA est plus fréquente chez les sujets obèses. On note que l’effet du poids se manifeste
pour les surcharges pondérales minimales, et prédomine dans les obésités à distribution
abdominales. Presque tous les sujets obèses « androides » de plus de 50 ans sont hypertendus. Le
risque de développer l’HTA est triplé à partir de 20 % d’excès pondérales. Il existe un
parallélisme évolutif entre le poids et la PA : un gain de poids de 10 % à l’âge adulte entraîne en
moyenne une élévation de 6 mm de Hg de la pression systolique.
Le mécanisme expliquant la corrélation entre la tension artérielle et l’obésité n’est pas
connu. Nous allons évoquer l’augmentation de la ration sodée, l’accroissement de la réabsorption
tubulaire du sodium par suite d’une élévation des taux d’insuline, la hausse des taux d’œstrogène,
la disproportion entre la masse et la dimension du rein, la disproportion entre l’hypervolémie et la
capacité vasculaire et le renforcement de l’activité sympathique du fait de l’augmentation de la
consommation d’énergie. L’idée que la rétention sodée serait accrue les personnes obèses
gagnent du terrain depuis qu’on a récemment mis en évidence chez eux une altération de la
pompe à sodium. En outre, il se peut que les obèses consomment plus de sel que les autres.
3-1-3-2 Sels et autres facteurs alimentaires :
Le rôle de l’alimentation est maintenant connu pour être un facteur prédisposant de l’HTA.
Les sels :
L’HTA essentielle est surtout observée dans les pays ou la consommation de sodium est
élevée (>100 mmol / j). Dans la population primitive ou la consommation sodée est faible, la
prévalence de l’HTA est également faible. Il a été démontré chez les différentes ethnies qu’il
existait une relation significative entre la PA et la natriurèse. L’hypertension est en coopération
avec une forte natriurèse ; par contre un régime alimentaire hyposodé entraîne une diminution
importante de la PA.
Selon Slaustein, ce mécanisme s’expliquerait par la présence d’inhibiteur de transport de
sodium retrouvé chez les hypertendus qui provoquerait l’hypertension. Mais il a été démontré par
la suite que cet inhibiteur était secondaire à une capacité du rein à excréter le sodium.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 29
Thèse de Pharmacie
Les principaux ions : (Patte D. et al, 1981 ; Delbarre, 1993) ; Bouvenot G. et al, 1994 ;
TORTORA G.J. et GRABOWSKI S.R., 1994;).
• L’ion sodium (Na+) :
C’est le cation le plus abondant des liquides extracellulaires, il est secrété dans l’urine et
la sueur.
Le sodium est fortement influencé dans la distribution de l’eau par l’osmose. Il joue un rôle
important dans l’équilibre acido-basique, dans les sucs digestifs, dans la conduction des influx
nerveux et la conduction des potentiels d’action musculaires. Sur le plan intracellulaire, le sodium
joue un rôle essentiel pour le potentiel membranaire des parois cellulaires de même que co-
facteurs de plusieurs enzymes.
La carence en Na+ peut entraîner les troubles liés à l’excès, de l’HTA, de la rétention d’eau
(avec une prise de poids) et d’ulcères d’estomac.
Il faut consommer du sel marin et éviter les conserves et les cacahuètes.
L’apport quotidien minimal est 550 à 1000 mg de Na+ par jour.
• L’ion potassium (K+) :
Il est présent dans les liquides extracellulaire et intracellulaire. Un apport alimentaire
normal fournit la quantité nécessaire de K+.
Le potassium joue un rôle important dans l’équilibre de l’eau dans les tissus. C’est un
tonique cardiaque et musculaire. Il et aussi utilisé dans la fabrication des sucres et des protéines.
La carence en potassium peut donner la soif, les troubles de rythmes cardiaques, les
crampes, la grande fatigue rhumatisme, la polyarthrite chronique, les affections pulmonaires et le
retentissement du transit.
Les principales sources sont : les légumes secs, les céréales, les noix, le lait, les fruits
secs, les algues, le blé.
La quantité moyenne de K+ d’un adulte est inférieure à 1g par jour.
• L’ion calcium (Ca2+) :
Le calcium est un régulateur cardiaque, il améliore l’endormissement et il favorise la
tension musculaire. C’est un élément essentiel à la croissance et à l’entretien des os.
Chez l’hypertendu le taux de Ca2+ cytoplasmique est élevé dans les plaquettes sanguines,
les mécanismes qui jouent un rôle dans la répartition du Ca2+ cytoplasmique peuvent être altérés.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 30
Thèse de Pharmacie
Ces anomalies ont été mises en évidence chez le rat :
Au niveau des récepteurs couplés à un canal ionique et des récepteurs couplés à une
pompe ionique, une augmentation de l’influx du calcium dans les cellules musculaires
lisses. Chez l’homme, il a été démontré in vitro que les artères de l’hypertendu se
contractent de façon plus intense que celles des normotendus sous l’action de la
noradrénaline et de l’angiotensine II.
Les mécanismes de sortie du Ca2+ peuvent être également altérés : l’activité de
l’ATPase / Ca2+ dépendante est diminuée dans les maladies d’hypertension
expérimentales. Il en est de même dans les plaquettes sanguines des patients hypertendus.
La pompe Na+ / Ca2+ peut être également perturbée par le facteur endogène digitoxine (ANH).
La carence en Ca2+ peut provoquer certaines pathologies telles que : la névrosité,
l’agitation, la dépression, le rachitisme, la carie dentaire, l’eczéma et l’insomnie.
Les principales sources de calcium sont : les produits laitiers, les fruits secs, les graines de
sésame et soja. Il se trouve également dans la vitamine D et dans le pollen.
La quantité moyenne de Ca2+ est de 500 à 1000 mg par jour pour un adulte.
• L’ion magnésium (Mg2+) :
Le magnésium joue un rôle dans l’équilibre nerveux et le stress. Il joue aussi un rôle dans
la formation des anticorps, dans la décontraction musculaire, dans la croissance des os et des
dents.
L’absence de cet élément minéral peut provoquer la fatigue, l’asthme, la dépression,
l’hyperémotivité, l’insomnie, l’anxiété, les crampes, les tremblements, les accidents
cardiovasculaires (ACV), la goutte, l’arthrose et les troubles digestifs.
Le Mg2+ se trouve dans les céréales, le cacao, la noix, les lentilles cuites, le haricot vert, les
légumes verts, le chocolat noir, les fruits secs, le ginseng et dans le blé.
La quantité moyenne de Mg2+ est de 5 à 7 mg par jour pour un adulte.
• L’ion ferreux (Fe2+) :
Le fer joue un rôle important dans la formation des globules rouges et il renforce
l’immunité. C’est un défatiguant et un antioxydant (radicaux libres).
Leur carence peut provoquer une anémie, la pâleur, l’anorexie, la sensibilité aux germes, une
diminution des capacités physiques et des performances mentales.
Les principales sources de fer sont: les légumes à feuilles vert-foncées, les fruits secs, les
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 31
Thèse de Pharmacie
lentilles, les légumineuses, les viandes rouges, les amandes, la gelée royale, les jaunes d’œufs…
La quantité moyenne de Fe2+ est de 1 à 2 g par jour pour un adulte.
• L’ion chlorure (Cl-) :
C’est un anion principal du liquide extracellulaire, il est secrété dans l’urine.
Du point de vue physiologique, les éléments de sel de cuisine sont les plus fréquents dans le
liquide extracellulaire. Le chlore et le sodium déterminent une large mesure de volume et de
pression osmotique.
Une quantité normale de chlorure de sodium fournit les quantités requises de Cl-.
• L’ion chrome (Cr3+) :
Le chrome joue un rôle important dans l’assimilation des glucides, il diminue aussi les
mauvais cholestérols et augmente les bons cholestérols. Le chrome associé à l’insuline, est réduit
pour produire l’énergie provenant des glucoses.
Sa carence peut provoquer le diabète, l’intolérance aux glucoses, l’artériosclérose et
l’hyperlipidémie.
Les principales sources de chrome sont : la pomme de terre, le ginseng, la levure de bière, les
matières grasses, l’huile végétale et les aliments non raffinés.
Il y a d’autres ions qui interviennent dans l’alimentation comme facteurs prédisposant de
l’HTA: le cobalt, le cuivre, le fluor, l’iode, le manganèse, le phosphore, le soufre, le zinc, le
silicium, le sélénium…
L’alcool :
De nombreuses études transversales effectuées dans diverses populations ont récapitulé des
effets aigus de l’alcool chez l’homme. Selon les cas, on observe une augmentation de la TA.
D’autres ont signalé une baisse de tension après l’arrêt de la consommation, ce qui permet
d’envisager la possibilité de réduire ou de cesser le traitement par les antihypertenseurs chez des
alcooliques hypertendus s’ils s’arrêtent de boire. La consommation excessive d’alcool est un
facteur de risque d’HTA et de cause classique de résistance au traitement.
Plusieurs mécanismes peuvent intervenir :
L’augmentation des taux sanguins de cortisol, l’élévation des concentrations des
catécholamines et des effets au niveau du système rénine-angiotensine ou d’une hormone
antidiurétique.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 32
Thèse de Pharmacie
La désintoxication entraîne une décharge adrénergique excessive, d’où une hausse
transitoire de TA. Le retour de la TA à la normale en cas d’abstinence donne à penser que son
élévation sous l’effet de l’alcool n’est pas définitive et ne conduit pas nécessairement à une
hausse continue sur une longue période.
Tabac :
L’hypertension artérielle est plus fréquente chez les ex-fumeurs, surtout après 50 ans ;
l’écart est alors voisin de 5 à 6 %. Après 50 ans, la fréquence minimale est observée chez les
fumeurs.
Fumer une cigarette (tabagisme aigu) peut provoquer une augmentation modérée de la PAS.
Le tabagisme potentialise l’HTA et est un risque artériel.
Diabète :
L’hypertension artérielle atteint 50 à 75 % des diabétiques. Son mécanisme est différent
selon le type du diabète. Dans le diabète du type 1, elle est essentiellement secondaire à la
néphropathie qui ne devient apparente qu'à partir d'une dizaine d'années d'évolution. Dans le
diabète de type 2, elle est liée à l'insulino-résistance et elle précède souvent l'apparition de
l'hyperglycémie. Quel qu'en soit le mécanisme, l'HTA augmente la morbidité et la mortalité liées
au diabète, tout particulièrement la néphropathie, la rétinopathie et les accidents
cardiovasculaires.
3-2 Hypertension artérielle secondaire :
Elle concerne 5 % des hypertendus. L’étiologie est surrénalienne, rénale ou toxique ; sa mise
en évidence autorise un traitement spécifique pouvant permettre la cure de l’HTA.
3-2-1 L’HTA due aux produits médicamenteux ou non médicamenteux :
De nombreux produits médicamenteux ou non sont à l’origine d’une élévation de la
tension artérielle ; nous pouvons citer les médicaments tels que : les contraceptifs hormonaux, les
vasoconstricteurs nasaux, la carbénoxolone, les corticoïdes, les anti-inflammatoires non
stéroïdiens, l’éphédrine, les amphétamines, les inhibiteurs de la mono-amine-oxydase
(IMAO) et les antidépresseurs tricycliques ; et les produits non médicamenteux tels que : la
réglisse, les pastis sans alcool. En général, ces élévations tensionnelles sont le plus souvent
transitoires réversibles dès l’arrêt de la médication.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 33
Thèse de Pharmacie
3-2-2 L’HTA due à une maladie organique :
3-2-2-1 L’HTA due aux maladies du rein :
Une HTA renovasculaire est liée à une maladie des deux artères rénales à l’origine d’une
ischémie du rein situé en aval. La disparition ou l’amélioration de l’HTA avec la cure de la lésion
sténosante de l’artère rénale apporte la preuve formelle de la responsabilité de la sténose.
L’HTA est alors d’installation rapide et peut s’aggraver brutalement. L’HTA est en
rapport avec une importante stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone.
3-2-2-2 L’HTA par néphropathies parenchymateuses :
Les néphropathies bilatérales :
C’ est la plus grande cause rénale de l’HTA. Toutes les néphropathies parenchymateuses
bilatérales, aiguës ou chroniques peuvent être à l’origine d’HTA. Il s’agit :
D’une glomérulonéphrite chronique primitive ou secondaire,
D’une néphropathie tubulo-interstitielle chronique,
D’une polykystose rénale.
L’origine de HTA est principalement liée à l’hypervolémie induite par la baisse du débit de
filtration glomérulaire. L’HTA chez le diabétique peut s’inscrire dans le cadre des néphropathies
diabétiques. Il s’agit d’une néphropathie glomérulaire.
Les néphropathies unilatérales :
Elles sont beaucoup plus rarement en cause. Il peut s’agir d’une pyélonéphrite chronique
sur obstacle ou reflux ; d’une atrophie rénale unilatérale (hypoplasie rénale congénitale).
3-2-3 Causes endocriniennes :
Elles sont plus rares que les causes précédentes.
3-2-3-1 Hyperaldostérolisme ou syndrome de Conn :
Il est lié à un adénome surrénalien ou à une hyperplasie bilatérale des surrénales. Dans ce
cas, l’HTA est due à une rétention sodée induite par l’aldostérone sécrété en grande quantité.
3-2-3-2 Hypercorticisme ou syndrome de Cushing :
L’HTA au cours du syndrome de cushing est estimé à 80 % des cas et concerne plus
volontiers le carcinome surrénalien ou la sécrétion ectopique d’ACTH. L’HTA s’explique par
l’augmentation de la réabsorption du sodium à l’origine d’une augmentation du volume
plasmatique.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 34
Thèse de Pharmacie
3-2-3-3 Le phéochromocytome :
Il s’agit d’une maladie très rare mais potentiellement mortelle. C’est une tumeur de la
médullosurrénale secrétant des catécholamines en excès. On observe en général une hypertension
labile avec alternance de poussées tensionnelles et de tension normale.
3-2-3-4 La coarctation de l’aorte :
Elle correspond au rétrécissement congénital de l’aorte après le départ de la sous-clavière
gauche. Elle peut être responsable d’HTA caractérisée par le fait qu’elle est limitée aux membres
supérieurs.
3-3 HTA gravidique :
Au cours d’une grossesse normale, la pression artérielle (PA) baisse. Cette baisse
s’explique par une réduction des résistances vasculaires périphériques. Mais dans certains cas
pathologiques, la PA tend à s’élever entraînant une hypertension gravidique. L’HTA représente
8 à 10 % de toutes les grossesses chez les jeunes primipares et 40 à 50 % des grossesses
gémellaires. Ces grossesses s’accompagnent d’un risque accru de complications graves pour la
mère (éclampsie, atteint rénale ou hépatique, hémorragie cérébrale, coagulation intra-vasculaire
disséminée, hématome retro-placentaire, voire décès) que pour l’enfant (prématurité, retard de
croissance intra-utérine, mort in-utéro). Ces complications sont essentiellement liées à
l’apparition d’une pré-éclampsie, ce qui multiplie le risque d’hypotrophie et de mort fœtale par
vingt, mettant cette pathologie au premier rang de la morbidité et de la mortalité périnatale.
La pré-éclampsie est l’HTA survenant après la vingtième semaine d’aménorrhée chez une
jeune femme primipare sans antécédent d’HTA et s’accompagne d’une protéinurie et œdème
généralisé. Cette pré-éclampsie peut progresser rapidement et se compliquer de convulsions
(éclampsie) parfois précédées de céphalées, d’épigastralgie, d’une hyper-reflexivité et
d’anomalies visuelles. Toutes ces complications entraînent une nécessité ultime d’un bilan
clinique et para clinique chez les sujets hypertendus.
4 Diagnostic: (CHAMONTIN B., 1997; TINDAKIR, 2004).
4-1 Reconnaissance de l’HTA :
Le diagnostic repose sur la prise de la PA lors d’un examen systématique ou d’une consultation
pour des manifestations neurosensorielles ou à l’occasion d’une complication.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 35
Thèse de Pharmacie
• Les conditions de mesure de la PA :
Elles doivent être déterminées et respectées les recommandations établies par l’OMS. La
mesure de la PA est effectuée en position couchée ou assise depuis 10 mn, en utilisant un
manomètre (méthode de référence) avec un brassard adapté à la taille du bras ; il doit entourer les
deux tiers de la longueur du bras. Un brassard trop étroit peut induire une surestimation
importante des chiffres de la PA chez l’obèse.
La mise en évidence de chiffres de PA élevés doit justifier une mesure au manomètre de
mercure, plus fiable, dans les conditions du cabinet médical. On prendra soin de gonfler le
brassard 30 mm de Hg au-dessus de la disparition du pouls et de dégonfler le brassard assez
lentement de 2 mm en 2 mm pour ne pas estimer la systolique ou surestimer la diastolique.
Autant que possible la PA doit être mesurée à distance d’une émotion, d’une prise de café,
d’alcool ou de tabac ; enfin elle sera mesurée en couchée puis debout de façon à déceler une
hypotension orthostatique spontanée , et aux deux bras de façon à ne pas méconnaître une
asymétrie tensionelle.
Trois mesures doivent être réalisées et on conseille de retenir la moitié la moyenne des
deux dernières. Une répétition des mesures sera indispensable pour affirmer le diagnostic d’HTA
du fait de la fiabilité déjà évoquée. L’OMS requiert trois mesures à deux consultations différentes
au moins pour affirmer ce diagnostic et six mesures en cas d’HTA sévère. La qualité de la mesure
de la PA est indispensable au diagnostic d’HTA.
4-2 Etude du retentissement de l’HTA :
4-2-1 Bilan étiologique de l’HTA :
Le bilan minimum recommandé par l’OMS comprend :
4-2-1-1 Un examen de sang avec dosage de :
• La créatinémie : permet d’apprécier la fonction rénale ;
• La kaliémie : permet de mettre en évidence une hypersécrétion d’aldostérone primaire ou
secondaire ;
• La glycémie : permet de dépister le diabète ;
• Le cholestérol total : a pour but de rechercher une hyperlipidémie associée.
• L’uricémie : permet de dépister une hyper-uricémie.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 36
Thèse de Pharmacie
4-2-1-2 Un examen d’urine :
Il se fait à la bandelette, la protéinurie, l’hématurie et la glycosurie pour dépister une éventuelle
néphropathie ou un diabète.
4-2-1-3 Un électrocardiogramme (ECG) :
Ce bilan doit être effectué sous régime normo-sodé et avant tout traitement. Il doit être
complété lorsqu’il existe une anomalie par le dosage :
• D’une protéinurie de 24 heures (H) si la bandelette est positive ;
• D’un ionogramme urinaire pour une recherche de fuite urinaire de K+ si la kaliémie est
basse ;
• L’ECG apprécie le retentissement cardiaque ;
• Le fond d’œil utile dans l’HTA sévère.
4-2-2 Atteinte viscérale associée :
4-2-2-1 Retentissement cardiaque :
On recherche les signes d’insuffisance cardiaque ou d’insuffisance coronaire. L’ECG doit
être effectué à la recherche d’une hypertrophie auriculaire, d’une hypertrophie ventriculaire
gauche. Une radiographie du thorax peut préciser le volume cardiaque.
L’échographie plus sensible que l’ECG peut apporter des renseignements d’un grand intérêt ;
son usage ne peut être préconisé de façon systématique, mais elle sera souvent effectuée dans les
populations à risque et chez l’hypertendu systématique.
4-2-2-2 Retentissement cérébral :
Une complication peut avoir été la circonstance révélatrice de l’HTA ; mais il faut savoir
rechercher un accident ischémique transitoire, des signes neurosensoriels. L’étude d’œil est
classique (stades I et II : artères fines, irrégulières voire spasmées avec signes du croisement,
stade III : hémorragies exsudats ; stade IV : œdème papillaire).
4-2-2-3 Retentissement rénal :
Il comprend le dépistage urinaire par bandelette de la protéinurie, d’une hématurie complétée,
s’il y a lieu de culot urinaire, du compte du dosage de la protéinurie des 24 heures. La
détermination de la fonction rénale par la créatininémie est systématique.
La recherche de la microalbuminurie par réactif pourrait s’avérer un bon marqueur rénal
du risque cardiovasculaire, cela est déjà validé chez l’hypertendu diabétique non insulino-
dépendant et l’intérêt est à affirmer dans l’HTA essentielle.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 37
Thèse de Pharmacie
4-2-3 Le dépistage de l’athérosclérose :
Le dépistage de l’athérosclérose est évidemment clinique à la recherche de manifestations
angineuses, d’une claudication des membres inférieurs ; la palpation des pouls, et l’auscultation
des axes vasculaires : l’aorte, des artères rénales, fémoro-iliaques et carotides. Une anomalie
clinique et / ou un contexte multirisque peuvent conduire au dépistage de plaques athéromateuses
par échographie vasculaire.
4-2-4 Evaluation du risque cardiovasculaire absolue :
Après avoir établi un diagnostic d’HTA, il est nécessaire de situer l’ensemble de risques
cardiovasculaires associés. On individualise les facteurs du risque non modifiables (l’âge, le sexe,
la prédisposition génétique) et les facteurs de risque modifiables (l’HTA elle-même,
l’hypercholestérolémie, l’obésité, le diabète, la sédentarité).
Des grilles ont été établies, issues d’études épidémiologiques permettant en fonction de
l’âge, du sexe, du niveau de cholestérolémie et du niveau de PAS, d’évaluer le risque
cardiovasculaire du patient. Ainsi, on peut opposer l’homme de la cinquantaine, fumeur,
hypercholestérolémie, hypertendu à haut risque cardiovasculaire et la femme ayant l’HTA légère
isolée, en l’absence de tout autre facteur de risque dont le risque cardiovasculaire est faible.
4-2-5 Dépistage de l’HTA secondaire :
L’interrogatoire est un élément essentiel de l’approche clinique de l’HTA. Il permet de
situer les antécédents familiaux d’HTA et de complications cardiovasculaires chez les parents,
mais également dans la fratrie en faveur d’une éventuelle origine génétique. Il permet d’éliminer
une cause toxique : réglisse, vasoconstricteurs nasaux, contraception œstroprogestative et
l’alcool.
Il permet d’orienter vers une cause uronéphrologique de suspecter une origine
rénovasculaire athéromateuse devant l’HTA récente chez un homme de la cinquantaine ou par
la fibroplasie de l’artère rénale chez une femme jeune avec l’HTA persistante à l’arrêt du
contraceptif et en l’absence d’antécédents familiaux.
On s’assure de l’absence de signes d’hypercorticisme, de paroxysmes tensionnels, de la
triade céphalée-tachycardie-sueurs. Enfin il est essentiel de disposer d’une détermination de la
kaliémie effectuée au laboratoire sans garrot avec une ponction franche pour ne pas méconnaître
une hypokaliémie, susceptible d’évoquer l’HTA secondaire. Le bilan de l’hypertendu peut aller
du plus simple au plus compliqué et l’ensemble de ces examens ne saurait être systématique.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 38
Thèse de Pharmacie
5 Conséquences de l’HTA : (TINDAKIR, 2004).
5-1 Conséquences cardiaques :
La conséquence cardiaque majeure de l’HTA est l’hypertrophie ventriculaire gauche
( HVG ) qui constitue un marqueur de gravité de cette pathologie. Environ un quart des
hypertendus présentent une HVG. Cette HVG est initialement réversible et au début permet de
maintenir la fonction d’éjection du ventricule gauche. Toutefois, cette adaptation devient néfaste
à la longue et entraîne trois conséquences :
• L’œdème pulmonaire,
• L’insuffisance coronaire fonctionnelle,
• Les troubles du rythme cardiaque avec un risque élevé de mort subite.
5-2 Conséquences vasculaires :
L’HTA même non compliquée s’accompagne des modifications structurales et
fonctionnelles des artères de gros et moyens calibres. Au niveau des gros vaisseaux, l’altération
la plus constante est la diminution de la compliance. L’artériosclérose est fréquente chez les
sujets hypertendus. Pour les petits vaisseaux, les lésions sont moins fréquentes mais plus
spécifiques et se produisent dans les reins, la rétine et le cerveau.
5-3 Conséquences cérébrales :
L’HTA est le facteur de risque majeur de toute pathologie vasculo-cérébrale. Un AVC sur
deux survient chez un hypertendu. On dispose deux types de troubles cérébraux :
Les troubles mineurs : céphalées, bourdonnement d’oreilles, scotome et
vertige.
Les troubles majeurs : encéphalopathie hypertensive, infarctus cervicaux,
accident thrombolytique et hémorragie méningée.
5-4 Conséquences rénales :
Il existe trois types d’atteintes rénales au cours de l’HTA :
• La néphro-angiosclérose : c’est une atteinte des artérioles rénales qui prédomine sur les
vaisseaux pré-glomerulaires. L’importance de ces lésions est correlée à la sévérité et à la
durée de l’HTA, et peut, lorsqu’elle est sévère, aggraver cette dernière.
• L’athérome des artères rénales : c’est une atteinte des gros vaisseaux qui peut compliquer
l’HTA ancienne et peut s’aggraver quand la sténose devient significative. Ces sténoses sont
très évolutives et peuvent aboutir à une atrophie rénale qui peut aboutir à une insuffisance
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 39
Thèse de Pharmacie
rénale.
• La glomérulosclérose : elle n’est pas spécifique à l’HTA mais très impliquée dans la
progression des lésions rénales. Au cours de l’HTA, l’atteinte glomérulaire peut être aussi
bien une résultante de l’ischémie secondaire à la réduction du calibre des vaisseaux pré-
glomérulaires que la résultante directe de l’hyper perfusion et de l’hypertension capillaire
glomérulaire. En effet la sclérose progressive des glomérules qui est responsable de la
réduction nephronique et de la diminution de la fonction rénale aggrave à son tour l’HTA du
fait de l’incapacité du rein à excréter suffisamment l’eau et le sel. Le cercle vicieux ainsi crée
aboutit à l’insuffisance rénale chronique (IRC) terminale.
6 Traitement de l’HTA:
6-1 Traitements conventionnels:
6-1-1 Bases et objectifs de traitement :
L’HTA est le premier motif de prescription. Le traitement de l’HTA essentiel mériterait
un chapitre à part entière. Nous nous intéressons aux questions relatives aux diurétiques, aux
bêta-bloquants, aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) aux inhibiteurs de calcium (IC)
ainsi qu’aux références bibliographiques.
La prise en charge thérapeutique de l’HTA a subi une nette évolution aucours des
dernières années. L’objectif essentiel est d’assurer la prévention des complications
cardiovasculaires en particulier l’accident vasculaire cérébral et l’infarctus du myocarde. Le
traitement doit être efficace et en mesure d’abaisser le niveau est de PAS de 140 de mm de Hg et
de 90 mm Hg. C’est le seuil retenu par les recommandations (CHAMONTIN B., 2001).
C’est ainsi que l’organisation mondiale de la santé (OMS) a proposé une PAS < 130 mm
de Hg et une PAD < 85 mm de Hg à un sujet hypertendu. Il existe des arguments pour abaisser
d’avantage encore la PA chez les patients à haut risque cardiovasculaire comme les diabétiques
et les insuffisants rénaux.
Le traitement ne doit pas s’arrêter aux chiffres de pression artérielle. La diminution de la
PA est bien évidemment nécessaire, mais il convient de prendre aussi les anomalies structurelles
cardiovasculaires de l’HTA et de ne pas exercer d’effet métabolique néfaste de façon à assurer
une prévention efficace de l’athérosclérose.
Le traitement de l’HTA à inscrire dans le cadre d’une prévention cardiaque vasculaire
globale. Sa prise en charge ne doit pas être dissociée du traitement d’une hypercholestérolémie,
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 40
Thèse de Pharmacie
d’un tabagisme, d’un diabète; sans lesquels, il ne sera possible d’obtenir et de retenir la réduction
de l’incidence de l’athérosclérose.
Enfin, pour une bonne observance et tolérance, ce traitement doit être simple, administré
en monoprise matinale avec un médicament dépourvu d’effet secondaire. Les contraintes
économiques justifient d’invoquer le coût.
6-1-2 Bénéfice du traitement de l’HTA :
Le bénéfice du traitement de HTA a été démontré par les essais thérapeutiques menés
dans les années 1990 chez l’hypertendu âgé. Ce bénéfice a été établi avec les bêta-bloquants et
les diurétiques en référence soit au placebo, soit en les comparant et voire même en les associant.
Nous disposons des meta-analyses permettant d’enregistrer une réduction d’AVC de 42 %
et d’insuffisance coronaire de 15 %. Il attribue à la PA et à l’heure actuelle, aucune classe
antihypertenseur n’a montré réellement de supériorité par rapport à une autre. C’est à dire que si
les études épidémiologiques plaident pour le maintien de l’usage des bêta-bloquants et
diurétiques et les nouvelles classes antihypertenseurs tels que : les IEC, les EC et les antagonistes
des récepteurs de l’angiotensine II.
La diversité des classes antihypertenseurs dont nous disposons doit permettre de
répondre à un traitement de l’hypertension en situation prenant en compte le contexte
métabolique d’un patient, son âge, l’existence d’une cardiopathie hypertensive, d’une
insuffisance coronaire associée d’une artériopathie des membres inférieurs, d’un asthme….
6-1-3 Moyens thérapeutiques :
6-1-3-1 Mesures hygiéno-diététiques :
Il s’agit de la réduction pondérale et de la limitation des apports sodés. Selon ce contexte
métabolique, elles doivent privilégier soit l’exclusion des graisses saturées et d’aliments riches en
cholestérols en cas d’hypercholestérolémie. Nous considérons la ration glucidique ou fractionner
les repas en cas d’intolérance aux hydrates de carbone ou de diabète. Le tabagisme devra être
interrompu, les excès de boissons alcoolisées supprimées.
6-1-3-2 Les antihypertenseurs :
Les antihypertenseurs sont des médicaments symptomatiques qui font baisser la tension
artérielle sans toucher à la cause de la maladie. L’objectif principal essentiel du traitement est,
grâce à la normalisation des chiffres tensionnels, la prévention des complications cardio-
vasculaires, en particulier l’accident vasculaire cérébral et l’infarctus du myocarde. Les
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 41
Thèse de Pharmacie
médicaments antihypertenseurs doivent être administrés au long cours et à doses suffisantes pour
ramener les chiffres tensionnels à la normale. On a souvent recours à l’association de plusieurs
antihypertenseurs.
Le traitement de HTA comporte :
Le repos physique et moral ;
Les médicaments tranquillisants pour calmer le malade ;
Les médicaments antihypertenseurs ;
Le régime hyposodé plus ou moins rigoureux selon le cas. Seulement
30 % des hypertendus sont sensibles au sel, c’est à dire que la
réduction de leur consommation en sel diminue la PA. Pour les 70 %
restants, un régime hyposodé est inutile.
6-1-3-2-1 Les diurétiques :
Seuls, ils sont capables de contrôler environ 20 % des HTA essentielles. Ils agissent en
entraînant une déplétion hydrosodée puis ils diminuent la réactivité vasculaire. Ils sont souvent
utilisés avec d’autres antihypertenseurs dont ils potentialisent l’action. On utilise les thiazidiques
et les anti aldostérones.
6-1-3-2-1-1- Rappels physiologiques
Figure n° 2 : Schéma du néphron (TORTORA G.J. et GRABOWSKI S.R., 1994)
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 42
Thèse de Pharmacie
Le rein est constitué d’une succession d’organites élémentaires : les néphrons, réunis par
un tissu interstitiel. Chaque rein contient environ 1000000 de néphrons. Chaque néphron
comporte deux parties :
Le glomérule de filtration ;
Le tube urinifère constitué de deux parties : la partie proximale ou tube contourné et la
partie distale.
Le tube proximal permet la réabsorption iso-osmotique de sodium et de bicarbonate des 2/3
du volume filtré au niveau des glomérules. Le Cl- et le Na+ sont absorbés de façon active au
niveau de la branche ascendante de l’anse de Henlé. La partie terminale du tube distal, sous
l’action de l’aldostérone, permet une réabsorption active de Na+.
La formation de l’urine comporte trois phases :
• La filtration glomérulaire : le glomérule laisse filtrer les petites molécules comme l’eau, les
sels, le glucose et retient les grosses molécules comme les protéines. La filtration dépend de
la pression artérielle : une hypotension réduit la diurèse, une hypertension l’augmente.
• La réabsorption tubulaire : c’est un phénomène actif se produisant au niveau du tube
séminifère et qui porte sur l’eau et les matières dissoutes : le glucose, le sodium, le
potassium, les chlorures, etc…
Avec certaines pathologies (la glycémie, la glycosurie et le diabète rénale), le rein ne peut
pas réabsorber certaines substances quand celles-ci se trouvent dans le sang en trop grande
quantité ; il y a un seuil de réabsorption de ses substances c’est à dire une concentration limite au-
delà de laquelle le rein n’intervient plus. Ces substances se retrouvent alors dans l’urine.
• L’excrétion tubulaire : les tubes urinifères synthétisent certaines substances qui sont
déversées dans l’urine. La formation est conditionnée par trois phases : la filtration
glomérulaire, la réabsorption et la sécrétion tubulaire.
La filtration glomérulaire et la réabsorption tubulaire sont contrôlées par trois facteurs :
La pression artérielle au niveau du glomérule dirige la filtration glomérulaire ;
L’aldostérone et l’hormone corticosurrénalienne favorisent la réabsorption
tubulaire du sodium ;
L’hormone antidiurétique ou ADH, secrétée par l’hypothalamus et stockée dans la
post-hypophyse, agit au niveau du tube urinifère.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 43
Thèse de Pharmacie
6-1-3-2-1-2 Définition et classification :
Les diurétiques sont des substances capables d’augmenter la diurèse en provoquant une
élimination rénale accrue du sodium. L’indication majeure des diurétiques est le traitement des
oedèmes (cardiaque, trophique, orthostatique, néphrétique) et la phase initiale du traitement de
l’hypertension.
L’eau et les sucres:
• L’eau : il est facile d’observer que plus on absorbe d’eau, plus le volume urinaire est
important (si le rein est normal) ; on peut donc considérer l’eau comme le premier et le plus
simple des diurétiques.
• Le glucose : en soluté hypertonique à 300 pour mille et le mannitol, par voie intraveineuse,
le saccharose et le lactose par la voie intraveineuse ou buccale ont également un effet
diuretique. Ces produits agissent en provoquant un appel de l’eau tissulaire vers le plasma
pour pallier l’hyper osmolarité qu’ils déterminent.
Les diurétiques proximaux :
• Osmotiques :
Ce sont des électrolytes ou non-électrolytes qui doivent être excrétés par la voie rénale et qui
élimine l’eau : ce sont les agents qui réclament de l’eau pour se dissoudre. Ils agissent au niveau
proximal en maintenant l’osmolarité de l’urine en n’étant pas réabsorbée. Le mannitol n’est pas
du tout absorbé et constitue une substance diurétique. L’urée n’est pas toxique donc elle présente
les même propriétés. Ces traitements ont été proposés en mélange (mannitol-urée) dans le
démarrage des diurétiques forcés.
• Les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique :
Ce sont des premiers médicaments diurétiques efficaces à avoir pu être utilisés par la voie
orale. Ce sont des substances des dérivés des sulfamides, le seul à avoir être utilisé étant
l’acétazolamide dont l’administration est suivie d’une alcanisation des urines et d’une
augmentation de l’excrétion de bicarbonate. L’anhydrase carbonique facilite le transfert en ion
bicarbonate de HCO3- et de H2 (équation de Henderson-Hasselbach) au niveau de la cellule du
type proximal ; l’ion bicarbonate ainsi formé favorise la réabsorption de Na+ de l’urine dans la
cellule, l’inhibition de l’anhydrase carbonique diminue la formation de bicarbonate et donc
l’urine fait baisser la réabsorption de Na+ au niveau du tube proximal.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 44
Thèse de Pharmacie
Chez l’animal normal, nous observons une élimination de Na+, K+, Ca2+, une augmentation du
débit cardiaque, une diminution de NH4+. Ceux-ci conduisent à une acidose métabolique
hyperchloremique, par diminution de la quantité de bicarbonate réabsorbée.
Les thiazidiques: Ce sont des dérivés sulfamides.
Leur administration se fait par la voie orale.
Leur action s’effectue au niveau du segment cortical de dilution de la branche ascendante
de l’anse de Henlé par l’inhibition de la réabsorption de Na+. La durée d’action est longue (12 à
24) heures.
A cette natriurèse s’associe une importante kaliurèse dont il faudra se méfier aucours des
traitements chroniques.
Un autre effet à ne pas méconnaître, est l’hyper -uricémie qui peut provoquer des crises
de goûtes chez le sujet exposé.
L’effet natriurétique est moins important que celui des diurétiques de l’anse de Henlé.
Ils sont inefficaces en cas d’insuffisance rénale.
Exemple :
hydrochlorothiazide (EsidexR),
hydrochlorothiazide + amiloride (ModuréticR),
amlodipine (AmlorR),
indapamide (FludexR).
Les diurétiques de l’anse :
Le chef de fil est le furosémide. C’est une molécule des sulfamides. L’administration se
fait par la voie orale ou intraveineuse.
Son action s’exerce par inhibition de la réabsorption de Na+ et de Cl- au niveau de la totalité de la
branche ascendante de l’anse de Henlé. La durée d’action est de 6 heures.
Il possède également une action vasculaire périphérique et indépendante de l’action
rénale. Chez le patient d’insuffisance cardiaque, et qui semblerait faire intervenir le système des
prostaglandines. Son action est une dose indépendante, elle est puissante et persiste même en cas
d’insuffisance rénale.
L’effet apparaît 2 mn après l’injection par la voie intraveineuse (IV), 15 mn après
absorption orale. L’effet maximal est obtenu 15 à 30 mn après IV et 2 heures après la voie
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 45
Thèse de Pharmacie
cutanée.
L’importance de la perte de la courbe explique qu’une faible augmentation de la
posologie peut entraîner une très forte dose de l’effet.
Exemple:
furosémide : LasilixR,
bumetamide : BurimexR,
piretanide : EurelixR LP (libération prolongée) ; il est surtout indiqué
dans le traitement de l’HTA.
Les dérivés d’épargne potassique :
Les anti aldostérones :
La spironolactone en est le chef de file. C’est un stéroïde analogue structural de
l’aldostérone, exerçant donc un antagoniste compétitif au niveau du tube distal. Il provoque donc
une diurèse avec l’échange par le potassium qui absorbé, mettant à l’abri des hypokaliémies.
Cette forme est disponible par voie orale et injectable. Elle est douée d’une rémanence longue.
Mais cet effet natriurétique est faible, et la spironolactone n’est pas utilisée pour cet effet,
en débit d’une relation nette entre la dose et l’effet. Elle perd son efficacité chez l’insuffisance
rénale et son utilisation devient même dangereuse par le risque d’hyperkaliémie.
Exemple:
Spironolactone : AldactoneR,
Canrénone: PhanuraneR,
Canrénoate de potassium : SoludactonR
Les pseudo-anti-aldostérones :
Le triamtérène est le chef de file.
Le mécanisme d’action s’exerce au même niveau que la spironolactone, mais il n’agit pas par
compétition.
Ils ont un délai d’action de 2 à 3 heures, avec une durée d’action de 7 à 8 heures.
Ils sont souvent associés à des diurétiques thiazidiques.
Exemple:
triamtérène : TeriamR;
amiloride : ModamideR, utilisé en association avec Moduretic et Logirène.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 46
Thèse de Pharmacie
5-1-3-2-1-2 Complications des traitements de diurétiques :
• Hypokaliémie :
Elle s’accompagne d’une asthénie, d’une diminution de la force musculaire et des réflexes
ostéotendineuses, d’une sous décalage de ST à l’ECG, avec l’onde T plate et l’apparition d’une
onde U.
Le risque de sa survenue motive d’associer au traitement des diurétiques thiazidiques ou de
l’anse, un épargneur potassique, nous pouvons également avoir recours à une supplementation
potassique (Diffu-KR et KaleoridR ) ; l’association aux IEC permettant également de prévenir ces
hypokaliémies.
• Hyperkaliémie :
Elle est le fait des diurétiques épargneurs potassiques auxquels nous pouvons associer les IEC
ou potassium ; elle survient également en cas d’insuffisance rénale, de diabète avec la
néphropathie.
• Alcalose métabolique :
Elle est dangereuse chez l’insuffisance respiratoire chronique.
• Déshydratation excessive :
Les facteurs favorisant sont : l’âge, un régime désodé strict, la dose de diurétique reçue et
les pertes extra-rénales de Na+. Une asthénie inhabituelle, une soif intense, un pli sous cutané ou
sécheresse de la bouche doivent alerter.
• Hyperglycémie :
Ceci concerne principalement les thiazidiques.
• Hyper-uricémie :
Elle concerne les thiazidiques mais aussi les diurétiques.
• Allergies :
Elles sont rares et peuvent être croisées avec d’autres produits des dérivés de sulfamides.
• Ototoxicité :
Elle est fréquente avec le furosémide à forte dose.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 47
Thèse de Pharmacie
6-1-3-2-1-4 Indications :
Insuffisance cardiaque :
Le traitement des diurétiques doit être accompagné par un régime désodé, celui-ci ne doit
pas être strict mais doit amené un minimum de 2 g de sel par jour. Les diurétiques sont indiqués
en cas d’IC dès qu’il existe une rétention hydrosodée, donc dans les stades IV de la NYHA, et
probablement dans les stades III, en association avec la digitaline et les vasodilatateurs.
En revanche, leur utilité n’a jamais été formellement démontrée dans les IC au stade II.
De même, en absence de volemie augmentée, leur indication dans les IC congestives est très
limitée (CMH). Dans les obstacles à l’éjection ventriculaire gauche, précisément dans le
rétrécissement aortique, leur effet peut conduire à une diminution du débit cardiaque, plus
particulièrement chez le sujet âgé, et un traitement diurétique très puissant prolongé peut dépasser
son but.
En cas de IC chronique, les diurétiques de l’anse sont indiqués de façon préférentielle ;
nous pourrons leur adjoindre un diurétique épargneur potassique ayant pour but de diminuer les
risques d’hypokaliémie et de lutter contre l’hyperaldostéronisme fréquent en cas de IC.
En cas de IC aiguë, c’est à dire si elle est accompagnée d’œdème pulmonaire, les diurétiques de
l’anse par la voie IV sont indiqués, permettant de diminuer rapidement la volémie et
profondément un effet sur le système vasculaire capacitif.
HTA :
Les diurétiques représentent la classe médicamenteuse la plus prescrite dans cette
indication. Ils sont plus particulièrement efficaces dans les HTA à rénine basse, donc plus
particulièrement chez le sujet de 60 ans. En cas d’inefficacité, dépendant de la susceptibilité de
chaque individu, nous pourrons leur adjoindre une autre classe thérapeutique habituellement
prescrite en cas de l’HTA (les bêta bloquants, les IEC). Nous ferons appel dans cette indication,
les thiazidiques et plus particulièrement en association avec les épargnes potassiques.
Ascite sur l’hépathopathie cirrhotique :
Le traitement fait appel à un traitement désodé strict et à l’utilisation des anti-aldostérones.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 48
Thèse de Pharmacie
6-1-3-2-1-5 Surveillance du traitement des diurétiques :
Il faut réaliser:
Un bilan biologique avant le traitement ;
Un ionogramme sanguin ;
Un ionogramme de l’urée ;
Un ionogramme de créatinine sanguine.
La réalisation du bilan se fait un mois après introduction puis tous les 2 mois. La
surveillance du poids doit se faire 2 fois par semaine qui permettra de dépister précocement les
déshydratations, particulièrement dans les situations à risque. La prise de la TA doit être faite
debout et couché, à la recherche d’une hypotension.
6-1-3-2-2 Les bêta-bloquants (Touitou, 1997) :
Ce sont des molécules qui agissent par antagoniste des catécholamines au niveau des
récepteurs orthostatiques. Ces molécules occupent les récepteurs bêta-adrénergiques et
empêchent la noradrénaline de s’y fixer. Les bêta-bloquants et les inhibiteurs bêta-adrenergiques
sont efficaces dans toutes les formes d’hypertension essentielle.
Les principaux bêta-bloquants sont : propranolol, aténolol, timolol, pindolol, oxprénolol.
Le chef de file des bêta-bloquants est le propranolol (AvlocardylR) administré aux doses
quotidiennes de 40 à 80 mg per os au début et pouvant atteindre 320 mg / 24 h.
Les bêta-bloquants sont utilisés dans le traitement des HTA labiles et des HTA à taux de
rénine élevé à des doses progressives et reparties dans la journée, dans l’insuffisance
coronarienne et les troubles du rythme. La prescription systématique d’un agent bêta-bloquant au
décours d’un infarctus du myocarde réduit 20 à 30 % la mortalité, la fréquence de récidives et la
fréquence des morts subites.
Les effets secondaires sont constitués par des troubles de la conduction, une diminution de
l’adaptation à l’effort, l’asthénie et même des tendances dépressives. Les contre-indications sont
d’asthme, l’insuffisance cardiaque et respiratoire, les antécédents d’ulcère gastro-duodenal, le
diabète mal équilibré, la grossesse.
La surveillance portera sur la tension artérielle et le rythme cardiaque (bradycardie
fréquente), l’ECG (trouble de la conduction), l’état respiratoire, la tolérance digestive.
Certains médicaments ne doivent pas être associés (anesthésiques, neuroleptiques, insulines…).
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 49
Thèse de Pharmacie
6-1-3-2-3 Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion :
C’est une classe de médicaments importants dans le traitement de l’HTA et de
l’insuffisance cardiaque. L’enzyme de conversion permet la transformation de l’angiotensine I en
angiotensine II active. Celle-ci est hypertensive par son action vasoconstrictive et par la libération
d’aldostérone qu’elle induit. Son blocage entraîne :
• Sur le plan clinique : la suppression des effets hypertenseurs de l’angiotensine II et la
potentialisation des effets vasodilatateurs et natriurétiques de la bradykinine ;
• Sur le plan biologique : La diminution de l’activité de l’enzyme de conversion.
l’augmentation de l’activité rénine plasmatique et du taux d’angiotensine I, la baisse des taux
d’angiotensine II et d’aldostérone.
Ces médicaments sont utilisés dans le traitement de l’insuffisance cardiaque, de l’HTA
essentielle et renovasculaire par sténose d’une artère rénale. Il existe une contre-indication
absolue : la sténose bilatérale de l’artère rénale. Les principaux inhibiteurs de l’enzyme de
conversion sont :
Captopril (LoprilR) : il est utilisé aux doses quotidiennes de 50 mg per os dans le
traitement de l’hypertension grave en cas d’échec des thérapeutiques habituelles et dans le
traitement de l’insuffisance cardiaque répondant mal aux digitaliques et aux diurétiques.
Son usage peut entraîner de la toux, des troubles du goût réversibles, une protéinurie et
une neutropénie.
Enalapril (RénitecR) : il est utilisé per os aux doses quotidiennes de 10 à 20 mg dans
l’hypertension renovasculaire, l’insuffisance cardiaque congestive. Il peut être associé à
l’hydrochlorthiazide (Co-Rénitec). Son usage peut entraîner la toux, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles de la fonction rénale (augmentation de l’urée de la créatinine
plasmatique).
6-1-3-2-4 Les inhibiteurs calciques(IC) :
Nous pouvons citer: diltiazem (TildiemR), vérapamil (IsoptineR), nifedipine (AdalateR) et
nicardipine (LoxenR) qui sont les principaux IC. L’inhibition de l’entrée du calcium dans la fibre
lisse vasculaire entraîne une vasodilatation et une chute de la PA. L’utilisation des IC est très
intéressante dans les hypertensions sévères, dans les HTA à prédominance systolique, fréquente
chez le vieillard, enfin de contre-indication aux bêta-bloquants et aux diurétiques. La nifédipine
en administration sublinguale est rapidement efficace dans le traitement des poussées
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 50
Thèse de Pharmacie
hypertensives paroxystiques.
6-1-3-2-5 Les antihypertenseurs centraux (AHC) (Touitou, 1997 ; TINDAKIR, 2004) :
Ils s’agissent sur les centres nerveux régulateurs de la PA. Ils ont peu ou pas d’effet sur le
flux sanguin rénal, sur la filtration glomérulaire et ils diminuent les résistances vasculaires intra
rénales. Ils sont éliminés par voie rénale et peuvent s’accumuler dans l’organisme en cas
d’insuffisance importante. Il convient de diminuer leurs posologies lorsque la filtration
glomérulaire est inférieure à 30 ml / mn.
Leur prescription est moins fréquente à cause de leurs effets secondaires (ES) mal tolérés
(sédation, sécheresse buccale, hypotension orthostatique, l’impuissance).
Les principaux AHC sont : le methyldopa, la clonidine et la guanéthidine.
6-1-3-2-5-1 Le méthyldopa (AldometR) :
C’est un antihypertenseur majeur, efficace sur toutes les formes de l’hypertension
permanente, utilisé à des doses orales de 250mg à 1g par jour. On observe parfois des troubles
d’hypotension orthostatique (vertiges, éblouissements) qui disparaissent en diminuant la
posologie. Bien toléré, ce médicament est intéressant en cas d’insuffisance rénale associée. Les
dépressions et l’insuffisance hépatique sont des contre-indications. Elle figure sur la liste des
médicaments de l’OMS.
6-1-3-2-5-2 La clonidine (CatapressanR) :
Elle déprime l’activité des centres sympathiques, ce qui entraîne une inhibition du tonus
sympathique en particulier au niveau du cœur. Les effets antihypertenseurs apparaissent
rapidement lors de l’administration par la voie intramusculaire ou buccale aux doses quotidiennes
de 150 à 300 μg. La voie intraveineuse est à proscrire à raison de l’hypertension initiale qu’elle
entraîne par effet vasoconstricteur direct immédiat.
Les ES sont faits de somnolence, asthénie, bradycardie, larmoiements, congestion nasale,
réactivation d’ulcères gastro-intestinaux. Les antécédents de psychose dépressive grave sont une
contre-indication. La surveillance du traitement comporte la prise régulière de la TA et la
recherche des ES.
5-1-3-2-5-3 La guanéthidine (IsmélineR) :
Son action est proche de celle des ganglioplégiques dont elle présente des inconvénients. Elle
diminue le flux sanguin et la filtration glomérulaire. C’est pourquoi elle est très souvent
déconseillée. Ses indications doivent donc être limitées aux HTA sévères ou malignes des sujets
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 51
Thèse de Pharmacie
jeunes à des doses quotidiennes de 10 à 20 mg pour atteindre 50 à 75 mg.
L’insuffisance vasculaire cérébrale et l’insuffisance rénale (IR) sont contre-indiquées ; on ne
doit pas associer la clonidine et la guanéthidine. De même en prévision d’une anesthésie
générale, le traitement par la guanéthidine doit être arrêté depuis 3 semaines. L’EsimilR est un
hypertenseur associant la guanéthidine et un diuretique, le chlorothiazide. La surveillance porte
sur les fonctions hépatiques, rénales et l’équilibre hydro-électrique.
Figure n° 3 : Effets des médicaments antihypertenseurs sur les mécanismes contrôlant la
sécrétion de rénine (Delbarre, 1993).
Structure chimique de quelques molécules utilisées dans le traitement de l’HTA :(Calam
D.H.et al , 2001 ; Brater C. et al, 2002).
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 52
Thèse de Pharmacie
Les diurétiques :
O O
O O S COOH
S COOH H2N
H
H 2N
N CH 3
N O
Cl
H
O
Acide 4-chloro-2-(furan-2-yl methyl) Acide 3-(butyl amino)-4-phenoxy-5-
amine-5- sulfamoylbenzoique
sulfamoylbenzoique
Furosémide
Bumétanide
O O O
O
S
S O H
NH
H 2N O N
S CH 3
H 2N
N O
Cl
N N
H N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2yl)acétamide
6chloro-3,4 dihydro 2H-1,2,4-benzothiazine
-7-sulfonamide Acétazolamide
Hydrochlorothiazide
O
O
S COOH
O O O H 2N
O S
S
NH
H 2N O
N
Cl N
1,1-dioxyde 6-chloro-2H-1,2,4
benzothiazide-7-sulfonamide
Acide4-phenoxy-3-(pyrrolidin-1-yl)-5-
Chlorothiazide sulfamoyl benzoique
Pirétanide
H O
OH H CH 3
O O OH OH
O HO
S
H 2N
OH H
H H
Cl
O
2-chloro-5-(1RS-1-hydroxy-3-oxo-2,3-dihydro-1H-
iso indol-1-yl) benzène sulfonamide 11β,17,21-trihydroxyprégn-4-ène-3,20-dione
Chlortalidone Hydrocortisone
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 53
Thèse de Pharmacie
Les antihypertenseurs centraux :
COOH Cl
NH 2 NH
CH 3
N
OH N
H
OH Cl
Acide 2S-2-amino-3-(3,4-dihydroxy phenyl) - 2,6-dichloro-N(imidazolidin-2-ylidène) aniline
2-méthyl propanoique
Méthyldopa Clonidine
NH
N
N NH 2
1-[2-(hexahydroazocin-1(2H)-yl) éthyl] guanidine
Guanéthidine
Les inhibiteurs calciques
CH 3 O OCH 3
CH 3
N
S N
CH 3
NH
H 3 CO O
H H O CH 3
NO 2 O
CH 3 OCH 3
O
Diméthyl 1,4-dihydro-2,6-diméthyl-4-(O
-5-[2-(Diméthylamino) éthyl]-cis-2,3-dihydro-3-hydroxy-2- nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboylate
(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one acétate
Nifédipine
Diltriazem
N OCH 3
CH 3
H 3 CO OCH 3
N
CH 3
CH 3
H 3 CO
-5-[(3,4-Dimethoxyphenéthyl) methylamino -2-(3,4-dimethophenyl-2-
isopropylvaleronitrile
Vérapamil
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 54
Thèse de Pharmacie
Les bêta-bloquants :
H
OH
H C 2H 5
H OH CH 3 N O N
H H
S
O C C C N C H CH 3
N CH 3
H H H CH 3
N
-1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthydroxy)-2- 1-[(1,1-dimethyl ethyl)amino]-3-[4-morpholin-4-yl)
propanol -1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy] propan-2-ol
Propanolol Timolol
H OH
H CH 3
O N
CH 3
NH 2
2-[4-[(2SR)-2 hydroxy-3-[(1-methylethyl)
amino] propoxy] phenyl acétamide
Aténolol
Les vasodilatateurs :
N N N NH2
NH2
N
N N H N
O
NH2 H
NH2
P h ta la z in e -1 ,4 (2 H , 3 H ) -d iy lid è n e
d ih y d ra la z in e O x y d e 6 - (p ip é rid in -1 -y l) p y rim id in e 2 ,4 -d ia m in e
D ih y d ra la z in e M in o xid il
O
H 3C O N N O
N
H 3C O
NH2
1 -(4 -a m in o -6 ,7 -d im é th o x y q u in a z o lin -2 -y l -4 -
(fu ra n -2 -y l c a rb o n y l) p ip é ra z in e
P ra z is in e
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 55
Thèse de Pharmacie
Les inhibiteurs d’enzyme de conversion :
H CO 2H
H O
O CO 2 H H
N
N
CH 3
HS H H
H CH 3 O O
H 3C
Acide (2S) -1-[(2S)-2- méthyl-3-sulfanylpropanyl] Acide -1-[ (2S) -2-[[(1S) -1-(éthoxycarbonyl)
pyrrolidine-2-carboxilique -3-phényl propyl] propanoyl] pyrrolidine
-2- caboxylique
Captopril Enalapril
Figure no 4 : Structures chimiques de quelques médicaments utilisés dans le traitement de l’HTA
6-2 Traitement traditionnel:
6-2-1 Notions sur la médecine traditionnelle:
6-2-1-1 Définitions de la médecine traditionnelle :
La médecine traditionnelle (MT) est un terme global utilisé à la fois en relation avec les
systèmes de MT tels que la médecine chinoise, l’ayurvéda indien et l’unani arabe
(médecine asiatique musulmane) et avec diverses formes de médecine indigène.
Dans les pays dont le système de santé prédominant est basé sur l’allopathie ou bien la
MT n’a pas été incorporée au système de santé national, la MT est souvent appelée médecine
« complémentaire », « alternative » ou « non conventionnelle ».
Selon l’OMS, la MT est définie comme diverses pratiques, approches, connaissances et
croyances sanitaires intégrant des médicaments à base de plantes, d’animaux et / ou de minéraux,
des traitements spirituels, des techniques manuelles et exercices, appliqués seuls ou en
association afin de maintenir le bien-être et traiter, diagnostiquer ou prévenir la maladie.
(OMS, 2002). Quant au comité régional d’expert de l’OMS : « la MT est l’ensemble des
connaissances et pratiques explicables ou non utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer
un déséquilibre physique, mental ou social en s’appuyant exclusivement sur l’expérience vécue
et l’observation transmise de génération en génération oralement ou par écrit » (Arama, 1988).
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 56
Thèse de Pharmacie
6-2-1-2 Usage répandu et croissant de la MT :
Les thérapies de MT englobent les thérapies médicamenteuses qui impliquent l’usage de
médicaments à de plantes, des parties d’animaux et / ou minéraux. Les thérapies non
médicamenteuses sont administrées principalement sans usage de médicaments, comme le cas de
l’acupuncture, des thérapies spirituelles.
L’usage de la MT est très répandu et revêt une importance sanitaire et économique
croissante. En Afrique, jusqu’à 80 % de la population utilise la MT pour répondre à ses besoins
de soins de santé.
En Asie et en Amérique latine, les populations continuent d’utiliser la MT en raison de
circonstances historiques et convictions culturelles. En Chine, la MT représente 40 % des soins
de santé administrés.
Dans de nombreux pays développés, la médecine complémentaire et parallèle (MCP) gagne
en popularité. Le pourcentage de population ayant utilisé la MCP au moins une fois se chiffre à
38 en Belgique, 42 aux Etats-Unis, 48 aux en Australie, 70 au Canada et 75 en France.
Il est impératif de reconnaître le rôle essentiel de la médecine conventionnelle, sa capacité à
satisfaire de manière compétente aux besoins de traitement des maladies et traumatismes graves,
ses innovations techniques en matière de diagnostic, de traitement et les applications cliniques
croissantes de découvertes scientifiques élémentaires. Néanmoins, dans les domaines des soins
complets et de la gestion des maladies chroniques, la médecine conventionnelle plus réductrice,
mécanique et spécifique aux organes peut être insuffisante.
6-2-2 La pharmacopée traditionnelle africaine et la mondialisation :
Le Mali à l’instar des autres pays africains est à la croisée de la mondialisation
caractérisée par le modernisme ou la suprématie des valeurs occidentales. Apportera-il des
pratiques médicinales ancestrales à la civilisation universelle ? .
En tant que tel, cela signifierait une promotion des produits et des savoirs locaux africains.
La collaboration entre la MT et la médecine moderne favorise un tel élan par la promotion des
MTA qui enrichissent la gamme des médicaments scientifiquement acceptés ou reconnus par les
principes cartésiens.
Sur le plan social, la médecine conventionnelle reste tributaire du savoir être des
thérapeutes traditionnels et herboristes en particulier, créant toute une ambiance, une chaleur
affective autour du monde. C’est là que le métissage entre ces deux pratiques pourra avoir tout
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 57
Thèse de Pharmacie
son sens. Les limites et les insuffisantes de part et d’autre pourront se corriger mutuellement.
Malgré la volonté du gouvernement malien à s’asseoir une politique sectorielle de santé
pour satisfaire les populations, les pratiques médicinales ancestrales demeurent dans un conteste
de pluralité et de diversité de pratiques médicinales en dépit d’une responsabilité du citoyen pour
la prise en charge du système sanitaire et social.
6-2-3 La phytothérapie : médecine de toute la famille (Romart, 1997) :
6-2-3-1 Notions sur la phytothérapie :
Il aura fallu des siècles d’évolutions, de connaissances et de progrès techniques pour que
l’homme redécouvre un jour la nature. Cette redécouverte s’appelle la phytothérapie, grâce à
elle, nous avons retrouvé nos plantes et la santé au naturel.
La phytothérapie est une science qui a pu analyser avec précision les principes actifs
majeurs contenus dans les plantes et faire définitivement la preuve de leur efficacité réelle à
travers de nombreuses études cliniques. Les médicaments recommandés en phytothérapie sont
tous tirés en principe actif, ce qui signifie en d’autres termes, qu’ils contiennent en concentration
plus ou moins forte mais toujours connues comme des substances actives.
Cette médecine connaît un engouement extraordinaire à travers le monde. Notre époque
est profondément marquée par la recherche d’une vie saine, d’un retour à la nature et aux valeurs
essentielles.
Le succès de la phytothérapie s’explique avant tout par le niveau de la maîtrise technique
et scientifique. La pharmacognosie, la chimie, la pharmacologie, l’agronomie et la botanique ont
permis, en progressant, de mettre au point des formes thérapeutiques et galéniques plus sûres,
plus adaptées et plus efficaces.
Par son action en douceur, leur absence d’effet secondaire ou de contre-indication, la
phytothérapie apparaît en d’autre part comme la réponse idéale aux « maladies du siècle » qui
caractérisent nos sociétés, comme les maladies cardiovasculaires, le stress, l’insomnie, la prise du
poids…
6-2-3-2 Les médicaments modernes face à la phytothérapie :
On oppose souvent les médicaments modernes dits « médicaments classiques » ou
« médicaments chimiques » à la phytothérapie. Il y’a pourtant une place pour chacun d’eux dans
l’arsenal thérapeutique dont nous disposons aujourd’hui. S’il est vrai que la pharmacie a occupé
pendant près d’un siècle des excellents résultats qu’elle a permis d’obtenir dans de nombreux
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 58
Thèse de Pharmacie
domaines. Elle a pourtant laissé apparaître des effets secondaires indésirables, parfois néfastes
qui incitent aujourd’hui à la prudence.
Les médicaments de « santé », fruits de la phytothérapie, proposent des traitements de
fond dont l’action plus douce nous aiderons à prévenir et à traiter les maladies telles que les
maladies cardiovasculaires, le diabète, le paludisme, l’insomnie par exemple.
Pour cela, la phytothérapie agit en profondeur, sans agresser l’organisme et en stimulant ses
bonnes réactions. Le traitement aboutit à un résultat d’action plus efficace, durable et surtout
dépourvu d’effets secondaires.
6-2-4 Traitement de l’HTA par les thérapeutes traditionnels :
Le traitement ne peut pas être codifié sous forme de schémas thérapeutiques applicables.
Le thérapeute associe plusieurs recettes dirigées contre les différents signes cliniques. On assiste
alors à un traitement par élimination successive des symptômes. Les recettes utilisées varient
d’un sujet à un autre, d’un thérapeute à un autre. Cependant, certaines recettes se retrouvent dans
plusieurs schémas thérapeutiques, soit qu’elles soient indiquées contre plusieurs signes cliniques
à la fois, soit qu’elles agissent sur un seul symptôme qui revient dans tous les cas.
Le traitement est généralement à base des plantes administrées sous forme d’infusé, de
décocté ou de macéré que le patient boit ou utilise sous forme de bains. Toutes les parties des
plantes sont proposées : les feuilles, les écorces de racine ou de tronc, les racines entières et
parfois la plante entière. Le thérapeute se charge le plus souvent de la récolte des recettes.
Cependant, dans le cadre de l’automédication, certains patients utilisent les plantes sans
consultation des thérapeutes.
Les signes cliniques observés par les thérapeutes traditionnels pour un sujet hypertendu
sont : les vertiges, les bourdonnements d’oreille, les douleurs thoraciques et les œdèmes. Ces
recettes ont une activité au moins pour deux signes cliniques. Ces plantes proposées sont
reconnues pour les propriétés antihypertensives dans la littérature.
Autre fois, les thérapeutes allaient du simple cauris (l’ancienne monnaie) aux petits bétails mais
ils utilisent de plus en plus leur art à des fins lucratifs. Certains d’entre eux perçoivent des
sommes substancielles pour des services rendus. D’autres vont même jusqu’à lier la guérison du
patient à l’acquittement total de la somme exigée.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 59
Thèse de Pharmacie
6-2-5 Traitement de l’HTA par les médicaments traditionnels améliorés (MTA) au
Département de Médécine Traditionnelle (DMT) :
Le DMT est une structure de l’Institut National de Recherche en Santé Publique
(NRSP) qui a mis sept MTA sur le marché. C’est ainsi que le DMT a fabriqué la Diurotisane.
6-2-5-1 Composition et présentation du Diurotisane :
Cette recette est composée de deux plantes : 50g de feuilles de Vepris heterophylla R Let
ou Teclea sudanica A. Chev (Rutaceae) et 50g d’inflorescences de Cymbopogon giganteus
Chiov (Poaceae). Elle est présentée en sachet multidose de 20g.
6-2-5-2 Indication et mode d’emploi du Diurotisane (ARAMA, 1988) :
La Diurotisane est utilisée pour ses propriétés diurétiques, azoturiques, pour ses effets
anti-œdémateux et son action antihypertensive. Elle est absorbée sous forme de décoction : faire
bouillir dans un récipient couvert avec un demi-litre d’eau pendant 10 mn (à partir du début
d’ébullition) le contenu du sachet unidose. Boire le décocté après filtration à midi et le soir après
le repas. Dans le cadre de l’amélioration des formes galéniques de ses recettes, le DMT va
entreprendre des travaux de recherches qui permettront d’obtenir la Diurotisane sous forme de
comprimé.
5-2-5-3 Description botanique pour la préparation du Diurotisane (Koumaré et al,
1986 ; Kéita, 1986 ;ARAMA, 1988 ; Boullard, 2001) :
5-2-5-3-1 Vepris heterophylla R. Let (Koumaré M. et al, 1986 ; Malgras, 1992; Boullard,
2001) :
Nous l’appelons également Teclea soudanica en Bambara ; le kinkéliba de Kita
appartenant dans la famille des Rutacées.
Malgras, (1992) présente succinctement cet arbuste d’Afrique tropicale, à la distribution
irrégulière, peu commun, mais mieux représente en bordure des torrents. Ce petit ligneux, à cime
arrondie, à écorce grise assez lisse, possède des feuilles trifoliolées, dont les folioles lancéolées à
consistance de cuir, sont ″ criblées de grandes translucides qui les ponctuent.
La population de Kita et ses environs connaissent de façon précise le cycle végétatif de ce
kinkéliba. Ils prennent les feuilles entre le mois de novembre et décembre et les vendent dans le
mois mars - avril.
La floraison s’explique sous la forme de panicules jaunes, et les fruits de kinkéliba sont
des drupes globuleuses (d’environ 1,5 cm de diamètre) jaunes, renfermant une seule graine.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 60
Thèse de Pharmacie
Dans la pharmacopée traditionnelle, les feuilles de cette rutacée sont réputées comme
diurétiques et fébrifuges. On y a recours au Mali pour soigner les accès de paludisme.
D’une manière générale, le kinkéliba de Kita se trouve en vente dans les marchés, en
bottes de feuilles sèches.
Tableau n˚ II : Principales molécules isolées à partir de Vepris heterophylla
Plante Drogue Substances extraites Références
Feuilles 2 génines flavoniques : le kaempférol et la ARAMA,
Vepris quercétol ; 1988
heterophylla 1 alcaloide : la flindesiamine
4 composés glycosylflavones : la vitexine, Kéita, 1986
l’isovitexine, l’orientine et l’iso orientine ;
5 furoquinoléines : la kokusaginine,
l’évolatine, la técléaverdoornine, la
métoxy-6-isopentonyloxy-7 dictanine
3 furoquinoléines : la flindersiamine, la
masculine, la skimianine ;
Ecorces 1 amine quaternaire : la cancidine ;
de tige 1 triterpène pentacyclique : le lupéol ;
1 acridone: l’arborinine
6-2-5-3-2 Cymbopognon giganteus Chov (Kéita A., 1986 ; Koumaré et al, 1986) :
C’est une plante rencontrée sur des vastes de vieilles friches, dans les savanes soudano-
zambéziennes, depuis la vallée du fleuve Sénégal jusqu’au Soudan. C’est une herbacée de grande
taille pouvant atteindre 2 à 2,5 m de haut. Elle est vivace par sa souche rhizomateuse d’où partent
de nombreux chaumes.
Les feuilles sont planes et longuement acuminées : celles de la base peuvent atteindre 4
cm de large et 30 à 40 cm de long. Les bords sont rudes au toucher. Les plus jeunes sont
recouvertes d’une pubescence blanchâtre, qualifiée par certains auteurs de farineuse (Kerharo et
Adam, 1974). L’unité de base de l’inflorescence comprend deux épis entourés d’une partie
foliacée acumée dénommée « spathe » (Roberty, 1960). Ces unités sont regroupées en grappes
compactes ou racèmes.
Ces derniers constituent une panicule pouvant atteindre plus de 50 cm de long. A chaque
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 61
Thèse de Pharmacie
ramification se situe une feuille ou une bractée foliacée. Chaque épi comprend 6 à 8 épillets
mesurant environ 2 à 3,5 mm de long.
Les épillets sont de deux types :
Les uns, hermaphrodites, aristés, comprennent deux glumes striées longitudinalement et deux
glumelles très distranslucides, port une longue arête, codée, environ 5 cm. La glumelle interne,
oblonge, aiguë au sommet, présente un aspect de parchemin et mesure environ 2,5 mm de long.
Les étamines, au nombre de 3, entraînent l’ovaire muni de deux styles surmontés de deux
stigmates plumeux.
Les autres staminés, mutiques, comprennent deux glumes striées longitudinalement et deux
glumelles oblonges aiguës, à aspect parcheminé dont la marge est velue.
Tableau no III : Principales molécules isolées à partir de Cymbopognon giganteus
Plante Drogue Substances extraites Références
Sommités 1 à 1,5% d’essence soluble dans l’eau ARAMA,
fleuries 1988
Cymbopogon Inflorescences Lipides, stérols, peptides Kéita, 1986
giganteus des feuilles Composés flavoniques (flavones,
flavonols, dérivés O-substitués, tricine
7-O- glucoside, monoterpènes,
benzoxalinones, rutoside, quercetide,
kaempférol)
Les oses : D-glucose, galactose, L-
rhamnose, D-xylose, L-arabinose et
acide glucuronique.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 62
Thèse de Pharmacie
6-2-6 Quelques plantes médécinales utilisées par les thérapeutes dans le traitement de
HTA :
Tableau no IV : Quelques recettes utilisées dans le traite ment traditionnel de l’HTA
Familles & Noms scientifiques Drogues Références
Alliaceae
Allium sativum L. Bulbe ARAMA, 1988 ; Boullard, 2001
Anacardiaceae
Anacardium occidentale L. Ecorces du tronc ARAMA, 1988
Heeria insignis O. Kuntze Feuilles Kerharo et Adam, 1974
Malgras, 1992
Sclerocarya birrea Hochst. Racines, fruits Koumaré et al, 1986
Fomba, 2001
Apocynaceae
Catharantus roseus G. Don Parties aériennes Bernard, 2001
Rauvolfia vomitoria -Afzel Racines, Parties Koumaré et al, 1986 ; Duez et al,
aériennes 1987 ; Boullard, 2001
Voacanga africana Strept Graines sèches Kerharo et Adam, 1974
Asteraceae
Tridax procumbens Plantes entières Boullard, 2001
Cesalpiniaceae
Cassia alata L. Feuilles Koumaré et al, 1986 ; ARAMA,
1988
Cassia occidentalis L. Feuilles Koumaré et al, 1986 ;
Boullard, 2001
Combretaceae
Combretum glutinosum Perr.ex DC Feuilles Koumaré et al, 1986 ;
Boubacar, 2004
Combretum micranthum G Don Feuilles Koumaré et al, 1986 ;
Boullard, 2001; Malgras, 1992
Guiera senegalensis J.F.G.mel Feuilles Koumaré et al, 1986 ;
ARAMA, 1988
Euphorbiaceae
Uapaca sp Racines Koumaré et al, 1986
Malgras, 1992
Fabaceae
Phaseolus vulgaris Ktze Gousses sans graines Koumaré et al, 1986
Ginkgoaceae
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 63
Thèse de Pharmacie
Ginkgo biloba L. Feuilles Boullard, 2001
Graminaceae
Cynodon dactylon Rich Racines Boullard, 2001
Grossulariaceae
Ribes nigrum L. Feuilles Bernard, 2001
Loranthaceae
Viscum album L. Feuilles Boullard, 2001
Malaceae
Cratagu spp. Sommités fleuries Boullard, 2001
Malvaceae
Hibiscus sabdariffa L. Feuilles et calices Koumaré et al 1986 ;
ARAMA, 1988
Meliaceae
Trichilia emetica Vahl Feuilles Malgras D., 1992
Boullard, 2001
Mimosaceae
Prosopis africana (Guill. et Perr.) Racines Kerharo et Adam, 1974
Taub. Malgras D., 1992
Moringaceae
Moringa oleifera Lam. Racines, feuilles Chetima, 2003
Oleaceae
Olea europeae L. Feuilles Boullard, 2001
Opiliaceae
Opilia celtidifolia Guill. et Perr. Racines Koumaré M. et al, 1986 ;
Boullard, 2001
Rubiaceae
Crossopteryx febrifuga Benth. Ecorces de tronc, Malgras, 1992
racines
Gardenia sokotensis Hutch Feuilles ARAMA, 1988
Mitragyna inermis (Will.d.) O.Ktze Feuilles Kerharo et Adam, 1974
Morinda lucida Racines Kerharo et Adam, 1974
Rutaceae
Zanthoxylum zanthoxyloїdes Water Racines Malgras D., 1992
Solanaceae
Solanum lycopersicum L. Feuilles Kerharo et Adam, 1974
Ulmaceae
Trema guineensis (Schum et Thom) Feuilles Kerharo et Adam, 1974
Ficaho
Verbenaceae
Lantana camara L. Feuilles Yao Koffi, 1985
Koumaré et al, 1986
Lippia chevalieri Moldenke Feuilles ARAMA, 1988
Lippia multiflora Moldenke Feuilles et sommités Kerharo et Adam, 1974
fleuries
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 64
Thèse de Pharmacie
7 Monographie de Spondias mombin Linn. :
Figure n° 5 : Spondias mombin
Figure n° 6 : Ecorces de tronc de Spondias mombin Figure n° 7 : Tronc de Spondias mombin
7 –1 Synonymes: (Fougue A,1973 ; Kerharo et Adam, 1974 ; FAO,1982)
Spondias aurantiaca Schum et Thonn ;
Spondias brasiliensis Mart,
Spondias lucida Salisd,
Spondias lutea T,
Spondias myrobalanus L,
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 65
Thèse de Pharmacie
Spondias oghibee G. Don,
Spondias pseudomyrobalanus L.Tuss,
Mauria juglandifolia Benth,
Myrobalanus lutea Maef ;
7-2 Position dans la systématique (Kerharo et Adam, 1974 ; Guignard, 1974)
Règne : Végétal ;
Embranchement: Spermaphyte ; Phanérogames ;
Sous embranchement: Angiosperme ;
Classe: Dicotyledones ;
Ordre: Rutales ;
Famille: Anacardiaceae ;
Genre: Spondias ;
Espèces: mombin ;
7-3 Noms locaux de Spondias mombin (Malgras, 1992 ; Burkill, 1985 ; Guignard, 1996)
Français : Mombin, Prune mombin ou Prune Myrobolan;
Barbara: minko, mingo; ninkom, ningô, nemkôô.
Malinké: Minko, minko;
Peul : Talé, tali;
Diola: bueta, fogny, bulila;
Dogon : énye Vevey ; c’est à dire la maladie de la poule;
Wolof: sob; ninkôm;
Minianka: minkwo;
Senoufo: minkòsun.
7-4 Propriétés botaniques de la plante :
7-4-1 Cycle végétatif :
7-4-1-1 Origine et aire de distribution (Malgras, 1992 ; Kerharo et Adam,1974)
C’est une espèce originaire des Antilles et de l’Amérique tropicale centrale, se trouvant
surtout dans les jardins et les terrains de culture ou elle est introduite pour ses fruits en zone
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 66
Thèse de Pharmacie
soudano-guinéenne. Elle est maintenant naturalisée en Afrique occidentale surtout à la limite de
la forêt dense : Sénégal, Guinée Conakry, Gambie, Mali, Sierra Leone, Libéria, Côte d’Ivoire,
Ghana, Togo, Niger, Nigeria, Cameroun, Gabon, Centrafrique, Angola.
7-4-1-2- Ecologie (Fougue,1973 ; FAO, 1982)
Elle se rencontre dans les recrûts forestiers en savane, sous des climats variant de type
guinéen. Il pousse bien dans les régions chaudes et dans une grande variété de sols. Le caractère
de sol ne pourrait pas être important. Nous pouvons trouver de bons arbres croissant sur une terre
sablonneuse peu profonde, dans du gravier ou dans une terre lourde et argileuse. Un sol riche,
humide, relativement lourd, leur convient le mieux.
7-4-1-3- Caractères botaniques (Fougue, 1973 ; FAO, 1982)
• Les écorces :
C’est un arbre qui peut atteindre 15 à 25 m de haut avec une écorce remarquable très claire,
striée, crevassée, rugueuse et épaisse. Les écorces sont généralement armées de gros piquants et
laissant exsuder de la résine par ses blessures.
• Le fût :
Il est épaissi à la base, et peut atteindre 0,75 m de diamètre.
• Les branches :
Elles sont évases et la frondaison est ample et équilibrée.
• Les feuilles :
Elle a des feuilles composées, imparipennées, mesurant 50 cm de longueur avec 5-8
paires de folioles 7 cm de long sur 3,5 cm de large, inégale à la base courtement acuminée, une
nervure courte au bord du limbe en unissant les nervures latérales. Les pétioles sont courts
d’environ 5 mm, oblongues lancéolées, asymétriques (excepté la terminale). Elles sont
obtusémement cuspidées ou acuminées à l’apex inéquilatérales et obtuses à la base, entières,
glabres, nervures médianes et latérales saillantes dessous. Spondias mombin est complètement
défeuillée en saison sèche. C’est une plante melliforme intéressante.
• Les fleurs:
Spondias mombin a des petites fleurs blanches, odorantes avec des grandes panicules
terminales apparaissant en saison sèche pendant la defeuillation. Les inflorescences sont
disposées en panicules terminales pyramidales, de 20 à 40 cm de long, couvertes de poils courts
principalement. Sur les pédicelles, les bractées et les bractéoles; les fleurs sont polygames, blanc-
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 67
Thèse de Pharmacie
jaunâtres, odorantes ; calices à 5 segments largement triangulaires, aigus, de 5 mm, portant des
poils courts à l’extérieur ; 5 pétales plus ou moins valvés de 2,5 à 3 mm de log, elliptiques,
subaigus, pubescents extérieurement ; 8 à 10 étamines à peu près de la longueur des pétales. Cela
nous donne la formule florale : 5 calices + 5 corolles + 5 pétales + 3 à 5 carpelles + 8 à 10
étamines (Crété, 1965).
• Les fruits :
Les fruits sont sous forme de prune à chaire astringente sucrée plus ou moins acidulée et
agréable. Ils ont des drupes ovoïdes de 2,5 à 4 cm de long et de 2 à 2,5 cm de large, jaunes dorées
à pulpe acide. Ils sont comestibles. L’épicarpe est mince de couleur jaune ou jaune orangée
glabre ; noyau ligneux, ridé, ovale, de 2 à 2,5 cm de long, très épais dans une pulpe molle et très
juteuse.
• Drogue :
La partie utilisée est l’écorce de tronc.
7-5- Culture et traitement : (Fougue,1973 ; FAO, 1982).
La multiplication se fait par des graines ou par des boutures. Les graines demandent 35 à
75 jours pour l’enlever. P. J.Werter recommande des boutures aoûtées de 50 à 70 cm de long
(bois de la saison précédente ou même plus vieux), mises dans le sol à une profondeur d’environ
30 cm à l’écartement définitif. La distance des plantations est de 7,5 à 9 m en tout sens.
Le mombin est assez adaptable en saison sèche et pluvieuse. Les fruits étant souvent
attaqués par les larves d’insectes dans nos nombreux pays, des traitements phytochimiques sont à
prévoir.
• Bois :
L’aubier est blanchâtre ou crème. Le bois parfait, à l’état frais a la même couleur que l’aubier,
mais il vire au brin doré au moment du séchage. Il est particulièrement sensible aux attaques des
insectes, surtout les termites et les champignons. Nous ne pouvons l’utiliser dans les ouvrages
permanents, même en situation privilégiée sans qu’il ait reçu au préalable une protection efficace
contre les agents destructeurs.
Dépourvu de cachet, le bois est tout au plus qualifié pour la ménisierie d’intérieur. Tendre,
poreux et léger, il se prête bien au déroulage et peut être ensuite converti en panneaux de contre
plaque, soit en panneaux de fibres ou de particules. Il est utilisé en caisserie ou dans l’industrie
allumettière. Sa durée, sa densité et sa coloration peu foncée en font au bon bois de pâte. Le
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 68
Thèse de Pharmacie
papier obtenu témoigne d’une bonne résistance à la traction, à l’éclatement et à la déchirure,
mais une faible résistance au pliage.
7-6 Utilisations de la plante en médecine traditionnelle et autres usages :
La plante est utilisée dans l’alimentation, la médecine traditionnelle et dans l’artisanat.
Au Mali, cette plante est utilisée pour combattre les caries dentaires, elle est également utilisée
comme diurétique, laxative et même purgative ; nous lui attribuons aussi une propriété fébrifuge
(Adjanohoun EJ et al, 1979).
Le mombin est surtout connu pour ses fruits comestibles a goût de prune mais ses utilisations
médicinales sont peu fréquentes.
7-6-1 Les racines :
Le décocté de bourgeons de racines est prescrit en tisanes contre la diarrhée et la
dysenterie ; en gargarisme contre les angines ; en collyres dans les ophtalmies.
Les racines soigneraient la conjonctivite (Boullard, 2001).
Le macéré de racines est utilisé pour les coliques douloureuses (Kerharo & Adam, 1974).
7-6-2 Les écorces de tronc:
Spondias mombin a une gomme limpide comme la gomme arabique de l’écorce qui est
utilisée dans les arts. L’écorce contient une quantité de tanin, l’infusé est utilisé en bain de
bouche contre les maux de dents usage externe comme vermifuge. L’écorce sèche pulvérisée
s’emploie comme passement sur les plaies fraîches de la circoncision. La partie subéreuse de
l’écorce est utilisée comme des bouchons, des tabatières et des petites cassettes. L’écorce de
tronc s’emploierait contre les abcès ou en tisane à l’intention des femmes enceintes (Boullard,
2001).
7-6-3 Les feuilles : (Fougue, 1973 ; Kerharo et Adam, 1974 ; FAO,1982)
Le suc obtenu par expression des feuilles fraîches est couramment utilisé en Casamance
pour le traitement des maladies oculaires tandis que le décocté des feuilles est prescrit pour des
diarrhées dysentériques et le macéré pour les coliques douloureuses (Kerharo et Adam, 1974). La
décoction des feuilles additionnée de sel de cuisine passe pour ses propriétés diurétiques et
laxatives voire même purgatives suivant la quantité de sel et des feuilles (Adjanohoun EJ et al,
1979).
La décoction des feuilles serait aussi un anti odontalgique, efficace contre les caries, les
abcès dentaires, les coliques, diverses maladies des yeux ou les maux de dents
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 69
Thèse de Pharmacie
(Boullard, 2001). Pour combattre les caries dentaires, le suc des jeunes feuilles préalablement
passées à la flamme est exprimé en quantité suffisante après pulpation pour faire de bain de
bouche répétée (Adjanohoun EJ et al, 1979).
La pulpe aromatique est de saveur variable, un peu astringente et plus ou moins acidulée.
Elle peut être consommée crue mais elle est surtout utilisée pour la confection des sirops et des
boissons ou encore des gelées.
7-6-4 Les fleurs :
Les fleurs, en infusions apaiseraient les maux de gorges (Boullard, 2001).
7-6-5 Les fruits :
Les jus de fruits sont fréquemment mangés en se désaltérant. Ils sont utilisés
occasionnellement pour aromatiser les boissons et de la glace. D’autres variétés sont aigrelettes
à peu de chair et sont utilisées pour l’alimentation des porcs et de bétails.
Les fruits se révèleraient astringents, ils ont des propriétés fébrifuges en Océanie et en
Polynésie. En médecine antillaise, les fruits verts fortifient les gencives et soignent l’urémie. Ce
sont ses fruits, sources de vitamines A et C, laxatifs (comme non pruneaux) qui confèrent à
l’espèce un intérêt thérapeutique (Boullard, 2001). Les meilleurs fruits ont une saveur agréable et
à peu près la même quantité de chair et de graines qu’une très grande olive. C’est également une
plante mellifère intéressante.
7-7 Pharmacologie de Spondias mombin :
7-7-1 Activité anxiolytique :
Cette activité a été étudiée par les extraits aqueux à la dose comprise entre 1,36 – 1,42 g /
kg, les extraits méthanolique (1,08 – 1,10 g / kg) et les extraits éthanoliques (0,48 – 0,62 g / kg)
par la voie intrapéritoriale. Ces extraits hydroalcooliques des feuilles sont utilisés pour soigner la
convulsion et l’anxiété dans le domaine de la neuropharmacologie.
(www.africanethnomedicines.net).
7-7-2 Activité antibactérienne et antimicrobienne :
Les feuilles de Spondias mombin présentent par ailleurs un pouvoir antimicrobien
remarquable puisque leur extrait inhibe Staphylococcus aureus mais surtout Candida albicans
ainsi que les levures (Adjanohoum E.J., 1985).
Le décocté des feuilles et des racines de Spondias mombin est utilisé dans le traitement des
diarrhées, dysenteries, gonorrhées, et des leucorrhées (Adjanohoun EJ et al, 1979 ; Ayoka AO et
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 70
Thèse de Pharmacie
al, 2005).
7-7-3 Activité diurétique :
Lé décocté des fruits est communément utilisé comme diurétique dans la médecine
traditionnelle nigériane (Ayoka AO et al, 2005).
7-7-4 Autres activités :
Le décocté des feuilles et des racines de Spondias mombin est utilisé dans le traitement de
vomissement et de l’hémorroïde. Les fleurs et les feuilles sont utilisées pour soigner les maux de
ventres. Les fruits ont des propriétés antitussives, laxatives et fébrifuges (Ayoka AO et al, 2005).
Le décocté de tronc d’écorces de cette plante est employé dans les toux violentes avec
symptômes inflammatoires, vomissement (Boullard, 2001).
7-7-5 Toxicité :
L’administration par la voie intrapéritoniale aux doses de 1600 et 3200 mg / Kg des décoctés
aqueux des feuilles de Spondias mombin a entraîné des tremblements chez les rats à la 12ème
heure (ayokaabiodun@ yahoo.com).
7-7-6 Données phytochimiques :
Les études préliminaires phytochimiques des feuilles de Spondias mombin d’origine
nigériane ont donné la présence des tanins, des anthraquinones, des saponosides et des
hétérosides cardiotoniques. La recherche des alcaloïdes a été négative (Ayoka AO et al, 2005).
Le fruit frais d’origine sénégalaise étudié à Dakar par Toury a la composition selon le
tableau suivant:
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 71
Thèse de Pharmacie
Tableau n° V : Composition des fruits de Spondias mombin (Kerharo et Adam, 1974)
Substances isolées En grammes pour 100 En milligrammes En microgrammes
de Spondias mombin (g %) pour 100 (mg %) pour 100 (μg %)
Eau 82,2 - -
Glucides 10,20 - -
Protéines 0,90 - -
Cendres 0,50 - -
Celluloses 0,33 - -
Lipides 0,20 - -
Phosphore - 39,00 -
Calcium - 24,00 -
Vitamine C - 12,00 -
Niacine - 1,40 -
Fer - 1,00 -
Thiamine - 0,04 -
Riboflavine - 0,03 -
Vitamine A - - 500
7-7-7 Structure chimique synthétisée à partir de Spondias mombin : (Benson D.A. et al,
2005)
O O
CO2H
H3C
CH3
Dioxolane
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 72
Thèse de Pharmacie
8 Les antioxydants :
8-1 Définition :
Un antioxydant est toute substance qui lorsqu’elle est présente en faible concentration par
rapport à celle du substrat oxydable, retarde ou prévient de manière significative l’oxydation de
ce substrat.
8-2 Les différentes espèces réactives de l’oxygène :
Les radicaux superoxydes :
Les radicaux libres :
Les radicaux hydroxyles :
Les radicaux alkoxyles et peroxyles :
Le peroxyde d’oxygène :
L’oxygène singulet :
Ces espèces sont utilisées pour l’organisme afin de combattre les agents infectieux
8-3 Origine des antioxydants :
Nous trouvons beaucoup d’antioxydants dans notre nourriture, tels que: la vitamine E, C,
B, les caroténoïdes, les polyphénols (les flavonols). Il semblerait que ces derniers contribuent de
manière significative à la prévention et le risque des maladies telles que le cancer et les maladies
cardiaques :
Les maladies cardio-vasculaires : l’infarctus de myocarde, les thromboses,
l’artériosclérose.
Les cancers: c’est particulièrement vrai pour ceux qui sont induits par le tabac (poumon,
pancréas, bouche, œsophage, larynx, rein, vessie).
Les accidents vasculaires cérébraux : les antioxydants ont une action thrombotique (thé).
8-4 Rôle des antioxydants :
Un intérêt croissant existe pour les antioxydants car il semblerait que les formes réactives
de l’oxygène soient à l’origine de nombreuses maladies comme par exemple : la maladie de
Parkinson, la maladie d’Alzheimer, l’athérosclérose, la polyarthrite chronique, le mongolisme ou
encore le cancer (Chevalley, 2000).
Les antioxydants jouent également un rôle clé dans la régulation de l’oxygène, la
réduction du stress oxydatif du tabac, la réduction du taux de cholestérol, la régulation des
signaux cellulaires, ils ont aussi une action anti-infectieuse et hémostatique. La régulation de
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 73
Thèse de Pharmacie
l’apoptose qui met en jeu des enzymatiques (caspases), des protéines régulatrices (P53, BCl2, NF
KB…) et des multiples interactions avec les facteurs de contrôle du cycle cellulaire.
Le glutathion réduit, joue un rôle très complexe dans la régulation de l’apoptose mais
aussi dans la transcription de gènes pro et anti-inflammatoires ou de gènes codant pour
l’expression d’enzymes antioxydantes (Princemail, 2002).
8-5 Mécanismes physiologiques de la défense antioxydante :
L’oxygène, étant une molécule indispensable pour la vie, peut entraîner des dommages
cellulaires importants par la formation des dérivés oxygénés activés (radicaux libres).
De nombreuses études épidémiologiques et cliniques ont suggéré le rôle des espèces
réactives de l’oxygène (ERO) dans de nombreux processus pathologiques comme
l’athérosclérose et la cancérogenèse. Face à ces maladies, l’organisme a besoin des systèmes de
défense antioxydants composés d’enzymes (le glutathion peroxydases, peroxyrédoxine, hème
oxygénase…), des vitamines (A, C, E), des protéines (la ferritine), des molécules antioxydantes
de petite taille (les caroténoïdes, le glutathion, l’acide urique, la bilirubine...) qui préviennent ou
luttent contre les différentes agressions de l’organisme. Ces composés maintiennent aussi les
métaux de transitions dans un état inactif pour la formation d’ERO. Certains oligo-éléments
comme le cuivre, le zinc, le sélénium sont indispensables pour l’activité des enzymes
antioxydantes. Il faut signaler que les ERO peuvent jouer un rôle physiologique important
comme la phagocytose des bactéries par les cellules polymorphonucléaires. Le stress oxydant
peut résulter d’un dysfonctionnement de la chaîne mitochondriale, d’une activation de systèmes
enzymatiques (NADPH oxydase, glucose oxydase), d’une libération de fer libre à partir des
protéines chelatrices (ferritine) ou d’une oxydation de certaines molécules (glucose,
hémoglobine, catécholamines,…)
Toutes ces défenses peuvent être renforcées par les apports exogènes en flavonoïdes
(quercétine, rutine, resvératrol, pycnogénol) qui se retrouvent en grande quantité dans le vin
rouge, le thé vert, les légumes et dans les extraits de Guigko biloba, de Vaccinum myrtillus et
d’algues marines (Pincemail, 2002).
8-6 Le stress oxydant et les antioxydants comme agents de prévention :
De nombreux travaux indiquent que le stress oxydant est impliqué dans le développement
de plus d’une centaine de pathologies (maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, arthrite
rhumatoïde, …). D’autres études épidémiologiques et cliniques indiquent que des personnes
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 74
Thèse de Pharmacie
présentant des concentrations sanguines faibles en antioxydants sont plus à risque de développer
des maladies cardiovasculaires que des sujets ayant un bilan antioxydant bien équilibré.
Les scientifiques accordent de plus en plus d’importance à une alimentation riche en fruits
et légumes et/ou à la prise d’antioxydants en terme sur la prévention de l’incidence des maladies
cardiovasculaires. La prise d’un cocktail d’antioxydants (effet de synergie) à des doses
physiologiques pendant une longue durée est une piste privilégiée par rapport à l’ingestion d’un
antioxydant pris à des mégadoses (effet pro oxydant). Dans cette optique, une étude française
SUVIMAX est en cours sur l’impact de la prise pendant huit ans d’un mélange d’antioxydants à
des doses physiologiques (30 mg de vitamine E, 120 mg de vitamine C, 6 mg de β-carotène,
100μg de sélénium et 20 mg de zinc) sur l’incidence de l’apparition des maladies
cardiovasculaires et du cancer. Les antioxydants pris à des doses importantes pendant une courte
durée, peuvent avoir des effets positifs. L’amélioration des fonctions vasomotrices des cellules
endothéliales de l’artère radiale observée chez les patients présentant de problèmes coronariens et
prenant 2 g de vitamine C pendant 4 semaines ( Pincemail, 2002).
8-7 Sources des antioxydants :
8-7-1 Les médicaments:
• Le probucol est un médicament qui fait baisser le taux sanguin de cholestérol et
prévenir l’arthérogénèse en agissant comme antioxydant et en supprimant la
modification oxydative des lipoprotéines de basse densité.
• N- acétyl cystéine agit en régulant les systèmes de défense d’antioxydants comme une
enzyme principale: le glutathion peroxydase.
Le glutathion réduit, joue un rôle très complexe dans la régulation de l’apoptose
mais aussi dans la transcription de gènes pro et anti-inflammatoires ou de gènes codant
pour l’expression d’enzymes antioxydantes (Princemail, 2000).
• D’autres médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les
antihyperlipoprotéinémiques, les antihypertenseurs (les bêta-bloquants) ont des
propriétés antioxydantes (MOGODE D. J., 2005).
8-7-2 Les aliments :
• Acide ascorbique ( vitamine C ) :
La vitamine C est un puissant réducteur et joue un rôle important dans la régulation de la
vitamine E. Elle se trouve dans les légumes, les agrumes et les fruits.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 75
Thèse de Pharmacie
OH OH
H
C C H 2O H
O
O OH
Acide ascorbique
• La vitamine E (tocophérol):
Le tocophérol est un antioxydant soluble dans les lipides. C’est la vitamine C de la
reproduction qui prévient dans la peroxydation des lipides membranaires par capture des
radicaux. On les rencontre dans les fruits et légumes à feuilles vertes, le lait et les graines.
CH3
HO
H3C O CH2 (CH2 CH2 CH2)3
Tocophérol
• Les bêta-carotènes :
Les bêta-carotènes sont reconnus par l’importance de leur précurseurs. Ils ont la capacité de
capter l’oxygène singulet. Selon Diallo S. en 2005, ces bêta-carotènes contribuent à la coloration
jaune, rouge ou orange des fruits et des légumes.
Ils se trouvent dans les légumes, les fromages, le lait, la carotte, le melon, le papaye et les fruits
jaunes.
ß-carotène
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 76
Thèse de Pharmacie
• Sélénium
C’est un oligo-élément réputé pour ses propriétés antioxydantes. Jadis connu comme
toxique, les effets bénéfiques du sélénium sur l’organisme ne sont connus que depuis un quart de
siècle. Il neutralise les métaux toxiques (plomb, mercure) et prévient le vieillissement. Il aurait
aussi une action préventive sur certains cancers ( DIALLO S., 2004).
8-7-3 Autres sources des antioxydants:
Les plantes sont sources de nombreux composés à propriétés antioxydantes. Ainsi nous
pouvons citer entre autres composés :
• Les flavonoïdes:
Ils ont un groupe d’antioxydants polyphénoliques présents dans les fruits, les légumes, le
thé et le vin rouge.
Les flavonoïdes se rencontrent dans presque toutes les parties de la plante. Ils jouent un
rôle important dans le système de défense comme antioxydant.
La consommation en grande partie du thé vert par les chinois et les japonais serait la
cause de leur faible taux de mortalité dû aux maladies coronariennes (Chetima, 2003).
• Les tanins:
Toutes les plantes en contiennent en degré plus ou moins élevé, ils ont des propriétés
antioxydantes. Ces tanins sont de donneurs de protons aux radicaux libres lipidiques produits au
cours de la peroxydation. Des radicaux sont très soudés et très stables, ce qui leur permet de
stopper la réaction d’auto oxydation des lipides (Cavin, 1999).
Les tanins sont des composés présentant des propriétés antioxydantes significatives. Deux
grands groupes peuvent être distincts :
Les tanins hydrosolubles : sont des esters d’un sucre (polyol apparenté)
et d’un nombre variable de molécules d’acide phénol.
Les tanins condensés ou proanthocyanidols sont des polymères
flavoniques. Ils ont été isolés ou identifiés dans tous les groupes de
végétaux, Gymnospermes et Fougères compris (DIALLO S., 2004).
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 77
Thèse de Pharmacie
COOH
HO OH
OH
Acide gallique
• Les coumarines :
Les coumarines ont aussi des antioxydants car ils préviennent la peroxydation des lipides
membranaires et captent les des radicaux hydroxyles et des superoxydes (Chetima, 2004).
O O O
H3C
O C CH3
CH3 O
O H
O C C CH2CH3
CH3
Visnadine
• Les xanthones:
Ce sont des polyphénols possédant également des propriétés d’inhibition par la peroxydation
lipidique ainsi que des propriétés des capteurs de radicaux libres contre les anions superoxydes.
• Les lignames:
La résistance à l’oxydation de l’huile de sésame. Les lignames d’arylfuranofuraniques tels
que le sésaminol contenu dans cette huile ont des propriétés antioxydantes; Ceux qui expliquent
leurs stabilités.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 78
Thèse de Pharmacie
O
O
OH
Sésaminol
• Les dérivés d’acides phénoliques et divers composés phénoliques:
La plupart de ces composés sont les dérivés d’acides para-coumarinique, caféinique, férulique
et chlorogénique. Ils possèdent des propriétés antioxydantes et antiradicalaires. ils possèdent
aussi des propriétés antitumorales.
Ces composés se rencontrent dans le café, le myrtille, les pommes, les fruits et les légumes.
Exemples :
Verbascoside :
Il inhibe l’auto oxydation de l’acide linoléique et la peroxydation lipidique microsomale.
Resveratrol :
Isolé du raisin, il inhibe le développement des lésions pré néoplasiques de la souris et possède
un certain intérêt en tant qu’agent chimiopréventif chez l’être humain.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 79
Thèse de Pharmacie
8-8 Quelques plantes anti oxydantes:
Tableau n° V : Quelques plantes à activité antioxydante étudiées au DMT
Noms scientifiques et familles Parties utilisées Références
Moringa oleifera LAM. (Moringaceae) Racines, feuilles Chetima, 2003
Trichilia emetica Vahl. (Meliaceae) Feuilles Timbo, 2003
Combretum micranthum G.D. (Combretaceae) Feuilles MALGRAS, 1992
Lannea velutina A. Rich. (Anacardiaceae) Feuilles, écorces DIALLO S., 2005
Combretum glutinosum Perr. Ex DC Ecorces de tronc et de Souley B., 2004
(Combretaceae) racines
Maerua angolensis DC. Capparidaceae Feuilles, fruits, écorces FOTSING, 2005
8-9 Méthodes d’étude des antioxydants :
8-9-1 Test mesurant l’activité antioxydante contre le lysosome
• Principe :
Ce test consiste en la détection de l’activité antioxydante d’une substance par oxydation des
lysosomes par le 2, 2’-azobis, 2-amidinopropane
8-9-2 Réduction du radical 1,1’-diphényl-2-picrylhydrazyle (DPPH)
• Test sur CCM :
Le principe consiste à déposer les produits à tester sur des plaques de CCM en aluminium
recouvertes de gel de silice GF254 et à les développer dans des systèmes de solvants appropriés.
Après séchage, les plaques sont révélées avec une solution méthanoïque de DPPH à 2mg / ml.
Les activités antiradicalaires apparaissent sous forme de spots de couleur jaune-blanc sur fond
violet (Cavin, 1999).
7-9-3 Test mesurant l’activité antioxydante au moyen des caroténoïdes
• Test sur CCM :
Principe :
Les plaques CCM sont préparées de la même manière que pour le test du DPPH, puis
giclées avec une solution chloroformique à 0,5 mg/ml de ß - carotène. La plaque CCM est ensuite
exposée sous une lampe UV à 254 nm jusqu’à décoloration de la plaque. Les zones antioxydantes
apparaissent en jaune sur fond blanc. Il faut faire particulièrement attention aux substances déjà
colorées en jaune, car elles peuvent donner de faux positifs (Cavin, 1999).
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 80
Thèse de Pharmacie
METHODOLOGIE :
1 Matériels :
1-1 Choix de la plante d’étude :
Nous avons passé en revue des enquêtes ethnobotaniques déjà effectuées en Afrique et
ailleurs. Nous nous sommes basés sur les recettes et les préparations utilisées en médecine
traditionnelle dans le traitement de HTA de la littérature suivante :
La pharmacopée sénégalaise (Kerharo et Adams, 1974)
Médecine et Magie africaine (Traoré D., 1983);
The useful plants of West tropical Africa Volume 1,2,3 et 4 (Burkill H.M., 1985, 1993, 1995
et 1997) ;
Arbres et arbustes guérisseurs des savanes maliennes (Malgras, 1992) ;
Médecine traditionnelle et pharmacopée : Bulletin Volume 1 ( Adjanohoun E.J et al, 1987) ;
A.B.C. des plantes : guide pratique de phytothérapie (Rowart T. , 1997) ;
Espèces fruitières forestières ONU pour l’alimentation et l’agriculture Rome (FAO, 1982) ;
Spondias mombin fruits ,Volume 28 Volume 2, Paris (Fougue A, 1973) ;
1-2 Matériel végétal :
Nous avons analysé les données sur des plantes citées, c’est ainsi que nous avons choisi
Spondias mombin L. (Anacardiaceae) puisqu’il n’y a pas eu d’études approfondies et réalisées
sur cette plante. La drogue est l’écorce de tronc de Spondias mombin récoltée le 31/ 12 / 2004 à
Blendio qui est un village situé dans la préfecture de Sikasso (3ème région du Mali), à 320
kilomètres de Bamako. Un spécimen est déposé à l’herbier du DMT sous le numéro 0279.
1-3 Préparation de la drogue :
Cette drogue a été bien séchée à la température ambiante du laboratoire du Département
de Médicine Traditionnelle (DMT) de l’Institut National de Recherche en Santé Publique
(INRSP). Ensuite les écorces ont été broyées à l’aide d’un pulvérisateur de type Retsch SM 2000
(1430 UPM) pour l’obtention des poudres très fines.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 81
Thèse de Pharmacie
1-4 Matériel animal :
Le matériel animal est constitué par des souris mâles de masse comprise entre 20,60 g et
28,79 g.
C’est une souche non consanguine qui a été sélectionnée à partir d’une lignée de souris présentant
des caractéristiques de vigueur et de réproductivité appelée CF1 (Carworth Farms Souche1) et
qui a pris le nom de OF1 (Oncins France Souche 1).
Elles ont été fournies par le Centre National d’Appui à la lutte contre la Maladie (CNAM).
2 Etudes phytochimiques :
2-1 Matériels utilisés :
• Becher, ballons, fioles, erlenmeyer, éprouvettes graduées, spatule, entonnoirs, Pipettes,
poire; tubes à essai;
• Coton, papier filtre;
• Agitateur et baguette magnétique de type GS Tuv Bayern;
• Balance de précision de type MFD ; AND EK – 400;
• Bain-Marie heating bath BM490;
• Rotavapor de type Bûchi-200;
• Lyophilisateur de type Heto DRYWINER;
• Dessicateur;
• Verre de montre, creuset en silice;
• Four électrique réglé à 800° C et Etuve réglable de type Karl Rolb MEMMERT;
• Spectrophotomètre UV 254-366nm de type abnehmbar renovable;
• Congélateur de type ZANKER;
2-2 Solvants utilisés :
Eau distillée, dichlorométhane, éther de pétrole, méthanol, éthanol, butanol, éther, thymol.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 82
Thèse de Pharmacie
2-3 Réactions de caractérisation :
2-3-1 Réactions en tubes :
2-3-1-1 Recherche des alcaloïdes :
A 20 g de poudre est additionné de l'acide sulfurique dilué au 1/ 20. L'ensemble est laissé en
macération pendant 24 heures puis filtré.
Dans un tube à essai, introduire 1 ml de filtrat et ajouter 5 gouttes de réactif de Mayer dans le
premier tube et 5 gouttes de réactif de Dragendorff dans le second tube. S'il y a apparition d'un
précipité, la présence d'alcaloïdes est confirmée par leur extraction.
2-3-1-2 Recherche des composés polyphénoliques :
La solution à analyser est un infusé à 5 % préparé avec 100 ml d'eau distillée bouillante et
5 g de poudre de drogue.
2-3-1-2-1 Tanins :
Dans un tube à essai contenant 1 ml de l'infusé, ajouter 1 ml d'une solution aqueuse diluée
de FeCl3 à 1%. En présence de tanins, il se développe une coloration verdâtre ou bleu noirâtre.
2-3-1-2-1-1 Tanins catéchiques :
Ajouter à 5 ml d’infusé, 1 ml d’alcool chlorhydrique (5 ml d’alcool 95° alcoolique, 5 ml
d’eau distillée, 5 ml d’HCl concentré) concentré, le tout porté à ébullition pendant 15 minutes. En
présence de tanins catéchiques, il y a formation d’un précipité rouge soluble dans l’alcool
amylique.
2-3-1-2-1-2 Tanins galliques :
Introduire 30 ml d’infusé à 5 % dans un ballon, ajouter 15 ml de réactif de Stiany (10 ml
de formol à 40 %, 15 ml d’acide chlorhydrique concentré). Chauffer au bain-marie à 90°C
pendant 15 minutes. Filtrer le précipité et saturer le filtrat de 5 g d’acétate de sodium pulvérisé.
Ajouter 1 ml goutte à goutte d’une solution de FeCl3 à 1 %. L’obtention de précipité montre la
présence de tanins catéchiques.
Filtrer et saturer 10 ml de filtrat d’acétate de sodium. Ajouter quelques gouttes de FeCl3 à 1 %.
Le développement d’une teinte bleue noirâtre indique la présence de tanins galliques non
précipités par le réactif de Stiany.
2-3-1-2-2 Flavonoïdes :
A l'infusé à 5 % présentant une coloration plus ou moins foncée, ajouter un acide (5 ml de
H2SO4) puis une base (5ml de NH4OH). Si la coloration s'accentue par acidification puis vire au
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 83
Thèse de Pharmacie
bleu-violacée en milieu basique, on peut conclure à la présence d'anthocyanes.
2-3-1-2-2-1 Réaction à la cyanidine :
Introduire dans un tube à essai 5 ml de l’infusé, ajouter 5 ml d’alcool chlorhydrique
(éthanol à 95 %, eau distillée, HCl concentré à parties égales en volumes) ; puis quelques
copeaux de magnésium et 1 ml d’alcool isoamylique.
L’apparition d’une coloration rose orangée (flavones) ou rose violacée (flavonones) ou
rouge (flavonols, flavanonols) rassemblée dans la couche surnageante d’alcool isoamylique
indique la présence d’un flavonoïde libre (génine). Les colorations sont moins intenses avec les
hétérosides flavoniques. La réaction est négative avec les chalcones, les dihydrochalcones, les
aurones, les catéchines et les isoflavones.
2-3-1-2-2-2 Leucoanthocyanes :
Effectuer la réaction à la cyanidine sans ajouter les copeaux de magnésium et chauffer
pendant 15 mn au bain-marie. En présence de leucoanthocyanes, il se développe une coloration
rouge cerise ou violacée.
Les catéchols donnent une teinte brune rouge.
2-3-1-3 Dérivés anthracéniques :
2-3-1-3-1 Anthraquinones libres :
A 1 g de poudre, ajouter 10 ml de chloroforme et chauffez pendant 3 minutes. Filtrer à chaud et
compléter à 10 ml si nécessaire. A 1 ml de l’extrait chloroformique obtenu ajouter 1 ml de
NH4OH dilué et agiter. La coloration plus ou moins rouge indique la présence d’anthraquinones
libres.
2-3-1-3-2 Anthracéniques combinés :
• O-hétérosides :
Préparer un hydrolysat à partir du résidu de la drogue épuisée par le chloroforme auquel
il faut ajouter 10 ml d’eau, 1 ml d’acide chlorhydrique concentré puis maintenir le tube à essai
au bain-marie bouillant pendant 15 minutes, 5 ml de l’hydrolysat sont agités avec 5 ml de
chloroforme. A la phase organique, ajouter 1 ml de NH4OH dilué. Une coloration rouge plus ou
moins intense indique la présence de génines O-hétérosides.
• C-hétérosides :
La solution à analyser est la phase aqueuse obtenue avec la solution à analyser des
O-hétérosides. A cette solution ajouter 10 ml d’eau et 1 ml de FeCl3. Chauffer au bain-marie
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 84
Thèse de Pharmacie
pendant 30 mn. Refroidir sous un courant d’eau. Agiter avec 5 ml de CHCl3. Soutirer la phase
chloroformique. Y ajouter 1 ml de NH4OH dilué. L’apparition d’une coloration rouge plus ou
moins intense indique la présence de génines de C-hétérosides.
Différenciation des Quinones :
A 1 g de poudre humectée avec H2SO4 10 % sont ajoutés 20 ml d’un mélange à volume égal
d’éther et de chloroforme. Après une macération de 24 heures, 5 ml du filtrat obtenu sont
évaporés à l’air, puis le résidu est repris par quelques gouttes d’éthanol à 95 %. Ajouter goutte à
goutte une solution aqueuse d’acétate de nickel à 5 %. La réaction positive se caractérise par une
coloration rouge.
2-3-1-4 Stérols et terpènes :
L’extrait à tester est obtenu à partir de 1 g de poudre et 20 ml d’éther laissé en macération
pendant 24 heures, filtré et complété à 20 ml. Evaporer jusqu’à sec dans une capsule de 10 ml
d’extrait, puis dissoudre le résidu dans 1 ml d’anhydride acétique puis 1 ml de chloroforme.
Partager dans deux tubes à essai, l’un servant de témoin. Mettre dans le fond du second tube à
l’aide d’une pipette 1 à 2 ml de H2SO4 concentré. A la zone de contact des deux liquides il y a
formation d’un anneau rouge brunâtre ou violet, la couche surnageant devenant verte ou violette
révèle la présence de stérols et triterpènes.
2-3-1-5 Caroténoïdes :
Après évaporation jusqu’à sec de 5 ml d’extrait, ajouter 2 à 3 gouttes d’une solution
saturée de trichlorure d’antimoine dans le chloroforme. Il se développe en présence de
caroténoïdes une coloration bleue devenant rouge par la suite.
2-3-1-6 Hétérosides cardiotoniques :
La solution à analyser est obtenue par addition de 1 g de poudre de 10 ml d’éthanol à
60 % et 5 ml d’une solution d’acétate neutre de plomb à 10 %, le tout porté au bain-marie
bouillant pendant 10 minutes. La phase chloroformique obtenue après agitation du filtrat avec 10
ml de chloroforme est partagée entre 3 tubes à essais et évaporée au bain-marie bouillant jusqu’à
sec. Les résidus sont repris avec 0,4 ml d’isopropanol et dans les 3 tubes sont ajoutés
respectivement 1 ml de réactif de Baljet, 1 ml de réactif de Kedde, 1 ml de réactif de Raymond-
Marthoud. Introduire dans chaque tube 2 gouttes de KOH à 5 % dans l’éthanol et observer après
10 minutes environ. En présence de caroténoïdes, les colorations suivantes se développent :
tube 1 : orangé ; tube 2 : rouge violacé ; tube 3 : violet fugace.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 85
Thèse de Pharmacie
2-3-1-7 Saponosides :
Nous avons reparti le décocté à 1 % dans 10 tubes à essai numérotés de 1 à 10 de manière
que chaque volume soit égal au numéro du tube et nous avons ajusté le volume de chacun des 9
tubes à 10 ml avec de l’eau distillée. Chaque tube est agité pendant 15 secondes dans le sens de la
longueur puis laissé au repos pendant 15 minutes, puis la hauteur de la mousse est mesurée.
L’indice de mousse ( I.M) est calculé à partir du tube dans lequel la hauteur de la mousse est de 1
cm.
1
I.M =
Dilution du tube
2-3-1-8 Composés réducteurs :
5 ml de décocté aqueux à 10 % sont évaporés au bain-marie jusqu’à sec. Ajouter au résidu
1 ml de réactif de Fehling (0,5 ml réactif A + 0,5 ml réactif B, mélange extemporané).
L’obtention d’un précipité rouge brique indique la présence de composés réducteurs.
2-3-1-9 Oses et holosides :
A 5 ml de décocté aqueux à 10 % évaporé à sec ajouter 2 à 3 gouttes de H2SO4 concentré,
puis après 5 minutes 3 à 5 gouttes d’alcool saturé avec du thymol. Le développement d’une
coloration rouge révèle la présence d’oses et holosides.
2-3-1-10 Mucilages :
A 1 ml de décocté à 10 % ajouter 5 ml d’éthanol absolu. L’obtention d’un précipité
floconneux, par mélange, indique la présence de mucilages.
2-3-1-11- Coumarines :
5 ml d’extrait éthérique obtenu après une macération de 24 heures sont évaporés à l’air libre,
puis repris avec 2 ml d’eau chaude. La solution est partagée entre deux tubes à essai. La présence
de coumarines est manifestée après ajout dans l’un des tubes de 0,5 ml de NH4OH à 25 % et
observation de la fluorescence sous UV 366 nm. Une fluorescence bleue intense dans le tube où il
a été ajouté de l’ammoniaque indique la présence de coumarines.
2-3-1-12 Hétérosides cyanogénétiques :
5ml d’un mélange à volume égal d’eau de toluène sont ajoutés à 1 g de poudre. Bien
agiter, nettoyer la partie supérieure du tube à essai et y fixer à l’aide d’un bouchon le papier
picrosodé fraîchement préparé. La présence d’hétérosides cyanogénétiques est indiquée par la
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 86
Thèse de Pharmacie
coloration rouge plus ou moins rapide du papier picrosodé.
2-4 Extractions :
2-4-1 Principe : La détermination des extraits est une méthode destinée à mesurer la quantité
des composés ou substances pouvant être extraites par un solvant dans des conditions spécifiques.
2-4-2 Matériels : Ballon de 3000 ml, erlenmeyer, entonnoirs, éprouvette, baguettes
magnétiques, agitateurs, thermomètre, ballons, papier filtre, tissu percale.
2-4-3 Appareillage : balance de précision type Sartorius, bain-marie, Rotavapor de type Büchi
R-200, congélateur.
2-4-3-1 Types : Nous avons utilisé des méthodes d’extraction à froid et des méthodes
d’extraction à chaud.
2-4-3-1-1 Méthodes d’extraction à chaud :
Décoction à 10 % :
Nous avons introduit 310 g de poudre d’écorces de tronc de Spondias mombin dans un ballon
contenant 3100ml d’eau distillée. Ensuite nous avons mis 50 g de poudre de la recette dans un
ballon de 500 ml d’eau distillée. Elle a été maintenue en ébullition au bain-marie pendant trois
heures. Après refroidissement, nous avons filtré sur une compresse puis concentré le filtrat à
l’aide du rotavapor sous vide à la température de 55°C. Nous avons ensuite lyophilisé l’extrait
concentré après 72 heures de congélation. La lyophilisation nous a permis d’obtenir des poudres
qui ont été conservées dans les flacons en verres, stériles et hermétiquement fermées.
310g de poudre
Spondias mombin
3100 ml H2O,
Macéré
Marc
aqueux
Figure n° 8 : Schéma de décoction a 10 % de la poudre de Spondias mombin
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 87
Thèse de Pharmacie
50g de poudre
de la recette
500 ml H2O
Décocté
aqueux Marc
Figure n° 9 : Schéma de décoction a 10 % de la poudre de la recette de l’HTA
Infusion à l’eau ( 5 et 10 % ):
A 5 et 10 g de la poudre de la recette, nous avons ajouté 100 ml d’eau bouillante. Après 10 à
15 mn de contact, nous avons filtré et le filtrat a été concentré et lyophilisé.
Infusion à l’eau selon les tradipraticiens :
Nous avons pesé 10 prises avec une cuillerée à café de la poudre de la recette par 10
personnes et nous avons fait la moyenne. Cette moyenne correspondait à 4,16 g auquel nous
avons ajouté 100 ml d’eau bouillante. Après 15 mn de contact, nous avons filtré et le filtrat a été
concentré et lyophilisé.
2-4-3-1-2 Méthodes d’extraction à froid :
Macération par l’eau :
A 50 g de poudre de la drogue, nous avons ajouté 500 ml d’eau distillée. Nous avons laissé
sous agitation magnétique, pendant 24 heures. Après nous avons filtré et le marc a été repris de
nouveau avec 500 ml d’eau distillée. Le filtrat a été concentré et lyophilisé.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 88
Thèse de Pharmacie
50g de poudre de
Spondias mombin
500 ml H2O,
Macéré
Marc
aqueux
Figure n° 10 : Schéma de macération par l’eau de la poudre d’écorces de tronc de Spondias
mombin.
Macération par l’éthanol 80 %:
Le procédé est le même que pour la macération avec de l’eau. Le solvant utilisé a été
l’éthanol à 80 %.
20g de poudre de
Spondias mombin
Ethanol à 80%
Extrait
Marc
éthanolique
Figure n° 11 : Schéma de macération par l’éthanol à 80 % de poudre d’écorces de tronc de
Spondias mombin
2-4-3-2 Extraction par les solvants organiques à polarité croissante:
Elle a été réalisée au Soxhlet.
2-4-3-2-1 Principe :
L’extraction au soxhlet consiste en un épuisement continu de la drogue par un solvant
donné à l’aide d’un dispositif de Soxhlet.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 89
Thèse de Pharmacie
2-4-3-2-2 Matériel et Solvants :
Chauffe ballon,
Balance analytique de type SARTORIUS,
Ballon de 1000 ml,
Cartouche en tissu tergal,
Eprouvette graduée de 500 ml,
Réfrigérateur,
Solvants : éther de pétrole, dichlorométhane (DCM), méthanol, eau distillée (ED).
2-4-3-2-2 Mode opératoire :
Montage du dispositif :
Le soxhlet a été utilisé pour l’extraction à polarité croissante. Une quantité de 10g de la poudre
à analyser a été introduite dans une cartouche placée dans le soxhlet surmonté d’un réfrigérant et
porté par un ballon contenant le solvant d’extraction ( 100 - 140 ml ). Une série de siphonnages
permet l’extraction jusqu’à épuisement de la poudre par chacun des solvants utilisés.
Le marc (résidu) a été séché et utilisé pour une digestion puis une décoction. Les extraits
polaires ont été évaporés au Rotavapor, récupérés dans des ballons préalablement tarés en vue
d’une lyophilisation. Les extraits apolaires ont été évaporés à l’air libre dans des flacons tarés.
Les extraits secs obtenus ont été pesés par la suite afin de déduire le rendement de l’extraction ;
ils ont ensuite été conservés dans des flacons en verre hermétiquement fermés.
Poudre 10g
DCM
Extrait DCM Marc DCM
MeOH
Extrait MeOH Marc MeOH
Figure n° 12 : Schéma de l’extraction avec les solvants à polarité croissante des écorces de tronc
de Spondias mombin.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 90
Thèse de Pharmacie
10g de
poudre
Ether de pétrole (EP)
Extrait Marc
EP
DCM
Extrait Marc
DCM
Méthanol
Extrait Marc
MeOH épuisé
Figure n° 13 : Schéma de l’extraction avec les solvants à polarité croissante de la recette de
l’HTA
2-5 Dosages de certaines substances :
2-5-1 Dosage en eau :
Les plantes fraîches renferment 60 à 80 % d’eau. Pour assurer une bonne conservation, la
teneur en eau doit être inférieure ou égale à 10 % (Paris R.R. et Moyse H., 1965). Nous avons
utilisé deux méthodes de dosage : la méthode gravimétrique ou pondérale et la méthode par
entraînement azéotropique.
2-5-1-1 Méthode gravimétrique ou pondérale :
C’est la détermination de la perte de masse par dessiccation à l’étuve pendant 24 H. Celle-ci
concerne l’échantillon broyé et se déroule dans des conditions bien définies.
Matériel :
- Une balance analytique de précision, type Sartorius,
- Une étuve MEMMENT à la température de 105°C plus ou moins 2°C,
- Une spatule et une pince métallique,
- Cinq capsules en verre,
- Un dessiccateur.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 91
Thèse de Pharmacie
Mode opératoire :
Opérer en utilisant cinq verres de montre préalablement chauffés et les peser après
refroidissement. La masse du verre de montre vide représente la tare. Peser 5 g de poudre qui sont
placés dans les différents verres.
Peser les verres de montre pour obtenir la masse totale avant l’étuvage. Placer les cinq verres de
montre dans l’étuve à 105°C pendant 24 heures. Peser ensuite pour obtenir la masse après
étuvage. Calculer donc à l’aide de ces données, le pourcentage d’eau en sachant que :
Masse drogue essai = Masse totale avant étuvage – tare
Masse eau = Masse totale avant étuvage – Masse totale après étuvage
Masse eau x 100
Pourcentage d’eau =
Masse drogue essai
Nous avons considéré la moyenne des cinq prises d’essai pour déterminer la teneur en eau de
notre échantillon par la méthode pondérale.
2-5-1-2 Méthode par entraînement azéotropique :
Dans ce cas, l’eau est entraînée, par distillation dans un solvant non miscible mais qui
forme avec elle un mélange azéotrope à une température d’ébullition constante. Après
condensation par réfrigération des vapeurs de l’azéotrope, l’eau se sépare et est mesurée en
volume.
• Matériel et Réactif :
L’appareillage nécessite un ballon de 250 ml, un réfrigérateur à reflux et un tube gradué
relié au réfrigérant. Nous avons utilisé 100 ml de toluène comme solvant et 1 ml d’eau distillée.
• Mode opératoire :
Faire bouillir cet ensemble
2-5-2-2 Dosage des cendres :
2-5-2-1 Cendres totales :
• Matériels :
Balance analytique de précision type Sartorius,
Etuve MEMENT,
Pince et spatule métallique,
Creuset en quartz,
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 92
Thèse de Pharmacie
Four électrique réglé à 600°C.
• Mode opératoire :
C’est une méthode pour mesurer la quantité de substances résiduelles non volatilisées
lorsque l’échantillon de drogue est complètement calciné.
Introduire une prise d’essai de 1 à 5 g de poudre dans un creuset de quartz préalablement taré.
Calciner à 600°C au four à moufle, laisser refroidir et peser.
• Calcul
Masse drogue essai = masse avant calcination - tare
Masse cendres = masse après calcination – tare
Masse cendre x 100
Pourcentage cendres totales =
Masse drogue essai
2-5-2-2 Cendres insolubles dans HCl à 10% :
Ce sont les résidus obtenus après traitement des cendres totales par HCl, c’est à dire les
sables qui peuvent souiller les drogues mal lavées ou mal triées.
Ajouter dans un creuset en silice, 20 ml d’HCl à 10% aux cendres totales obtenues. Les mélanger
dans un erlenmeyer, puis chauffer au bain-marie pendant 10 mn. Filtrer sur un papier filtre sans
cendres. Laver le résidu insoluble à l’eau très chaude. Incinérer le filtre séché et le résidu
insoluble dans un four à 600°C jusqu’à poids constant. Laisser refroidir et peser. Les calculs se
font comme pour les cendres totales.
Masse cendres x100
Pourcentage des cendres =
Masse de la Prise d’essai
2-5-2-3 Cendres sulfuriques :
C’est une méthode d’évaluation des substances inorganiques de la drogue végétale. Les
cendres sulfuriques sont obtenues après une attaque de la drogue par H2SO4. La teneur est
déterminée par dosage pondéral des sulfates non volatils obtenus par calcination de la matière
végétale préalablement traitée avec H2SO4 dilué à 50%. Les sulfates résultent de la conversion
des sels organiques.
Nous avons introduit la prise d’essai (PE) dans un creuset en platine préalablement taré. La
prise d’essai est mouillée avec une quantité suffisante de H2SO4 dilué au demi, triturée avec une
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 93
Thèse de Pharmacie
baguette. Nous avons placé le creuset dans l’étuve jusqu’à évaporation à sec puis au four jusqu’à
l'obtention des cendres. Il est refroidi dans un dessiccateur, sa masse est déterminée (P’).
La masse de cendre sulfurique de la prise d’essai est : S = P’ - T
S x 100
La teneur en cendre sulfurique =
P
S = masse de cendre sulfurique de la prise d’essai,
P = masse en g de la prise d’essai,
T = tare du creuset,
P’ = masse en gramme du creuset après calcination
2-5-2-4 Dosages des substances extractibles :
2-5-2-4-1 Substances extractibles par l’éthanol à 80 % :
Introduire dans un erlenmeyer 1 g de poudre puis 20 ml d’éthanol à 80 % ; laisser macérer
pendant 24 heures à la température du laboratoire du DMT après avoir fermer à l’aide d’un verre
de montre. Filtrer avec du papier filtre. Peser un bêcher vide (n).
Mettre le filtrat dans ce bêcher, évaporer à sec et peser le bêcher avec le résidu (n’).
( n’ – n ) x 100
Substance extractible par l’éthanol à 80 % =
PE (Prise d’Essai)
2-5-2-4-2 Substances extractibles par l’eau :
Introduire dans un ballon 1 g de poudre et 20 ml d’eau distillée. Faire une décoction pendant
15 mn.
Laisser refroidir pendant 20 mn. Filtrer sur du papier filtre.
Peser une capsule vide (n)
Mettre le filtrat dans cette capsule. Evaporer à sec.
Peser la capsule avec le résidu (n’)
(n’ – n) x 100
Substances extractives par l’eau =
PE (Prise d’Essai)
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 94
Thèse de Pharmacie
2-6 Détermination de la teneur des éléments minéraux :
Cette détermination a été réalisée au laboratoire de biochimie à l’Institut National de Recherche
en Santé Publique (INRSP)
2-6-1 Détermination du sodium et potassium :
Elle est réalisée à l’aide d’un photomètre à flamme à dilution automatique.
Principe
La nébulisation d’un échantillon à travers une flamme entraîne une excitation des atomes
et provoque le passage des électrons d’une couche (ou sous-couche) à une sous-couche
immédiatement supérieure. L’électron en revenant à son niveau d’énergie initiale restitue cette
énergie sous forme de photon. Les photons émis par les atomes donnent un flux de lumière qui
passe au travers d’un filtre interférentiel et qui est ensuite mesuré par un photomultiplicateur.
Le principe de la photométrie de flamme repose sur le fait que lorsque les atomes d’un
élément sont excités par une flamme, ils émettent les radiations de longueur d’onde déterminée
dont l’intensité peut être mesurée par un photomètre à ionisation de flamme.
Les résultats sont exprimés en mEq / l, convertibles en mg ou en μg.
L’excrétion urinaire volumétrique (EUV) est donnée par la formule suivante :
Volume recueilli
EUV = x 100
Volume administré
Mode opératoire
L’échantillon doit se présenter sous forme d’un aérosol de façon à ce que le solvant
s’évapore instantanément dans la flamme
Les photons émis par l’étalon interne de potassium ou de sodium vaporisé dans la flamme
sont envoyés au travers d’un filtre interférentiel sur un photomultiplicateur générant ainsi une
tension de référence.
Les photons émis par l’échantillon à doser selon le même procédé génèrent une tension de
mesure.
Les concentrations en sodium ou potassium sont affichées en temps réel sur l’appareil.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 95
Thèse de Pharmacie
2-6-2 Dosage de calcium (Ca2+) :
Principe :
Le Ca-Kit permet le dosage colorimétrique du calcium total, sans déprotéinisation, dans
les solutions à analyser.
L’ion calcium réagit avec l’indicateur bleu de méthylthymol (BMT) en milieu alcalin.
Ca++ + BMT complexe Ca-BMT
L’intensité de la concentration du complexe Ca-BMT, mesurée à 612 nm, est proportionnelle
à la quantité du calcium présente dans l’échantillon.
Préparation des réactifs:
Nous avons préparé trois types de réactifs :
Réactif 1 (R1) : nous avons utilisé l’étalon (1x 3 ml) et du Ca2+ (2,50 mmol / l) ;
Réactif 2 (R2) : nous avons mélangé un réactif de coloration (2x 80 ml) avec du bleu de
méthylthymol (0,092 mmol / l) ;
Réactif 3 ( R3) : nous avons utilisé un réactif alcalin (2x 80 ml), un monoéthanolamine
(200 ml / l) et un pH > 11.
Pour la solution de travail, mettre la poudre du flacon R1 dans le flacon vide et la dissoudre
avec 5 ml d’eau distillée.
Après dissolution complète, ajouter le flacon R2, puis mélanger en agitant et attendre 24
heures à 20 – 250 C.
Mode opératoire :
Il est résumé par le tableau suivant :
Tableau n0 VIII : Protocole opératoire de dosage du calcium
Blanc réactif Etalon Dosage
Etalon - 10 μl -
Echantillon - - 10 μl
Solution de travail 1 ml 1 ml 1 ml
Après agitation, mettre les échantillons dans le photomètre et attendre 1 mn
La coloration est stable une heure à 20 – 250 C, puis effectuer un étalonnage à chaque série de
dosages.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 96
Thèse de Pharmacie
Calcul :
Avec le spectrophotomètre, les calculs sont effectués comme suit :
DO échantillon x N
Concentration de l’échantillon =
DO étalon
N = concentration de l’étalon
2-6-3 Dosage du magnésium (Mg2+) :
Principe :
Le Mg-Kit permet le dosage colorimétrique du magnésium total, sans déprotéinisation,
dans les solutions à analyser.
L’ion magnésium réagit avec la calmagite en milieu alcalin pour donner un complexe de
couleur rose
Préparation des réactifs :
Pour cela, nous allons préparer trois réactifs :
Réactif 1 : c’est l’étalon (5ml) puis 25 mg/l de sulfate de magnésium que nous avons utilisé
comme le blanc de l’échantillon;
Réactif 2 : nous avons utilisé le calmagite (160 mg / l) et un réactif de coloration (2 x 80 ml) ;
Réactif 3 : nous avons utilisé un alcalin (2 x 80 ml) et un réactif à pH 11 ;
La densité optimale (DO) de la solution de travail doit être comprise entre 0,77 et 1,125 à 520
nm.
Le test a été réalisé avec de l’eau distillée (20μl), une longueur d’onde (520 nm), l’étalon
(20μl), l’échantillon (20μl) et 1ml comme la solution de travail.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 97
Thèse de Pharmacie
Mode opératoire :
Tableau n0 IX : Protocole opératoire de dosage du magnésium
Blanc réactif Etalon Dosage
Eau distillée 20 μl - -
Etalon - 20 μl -
Echantillon - - 20 μl
Solution de travail 1 ml 1 ml 1 ml
On mélange l’échantillon avec les différents réactifs, puis on attend 1 mn à 20 - 250 C.
Après, on met le tout dans le photomètre déjà réglé et effectuer un étalonnage à chaque série de
dosages.
L’interprétation des résultats du test doit être faite en tenant compte du contexte clinique
et éventuellement des résultats d’autres tests.
La concentration de l’échantillon s’effectue au produit de DO de l’échantillon et la concentration
de l’étalon par le rapport de la DO de l’étalon.
DO échantillon x N
CE =
DO étalon
CE : concentration de l’échantillon ;
DO : densité optique ;
N : concentration de l’étalon.
2-6-4 Dosage du fer (Fe2+) :
Principe :
Le Ferrimat-Kit permet le dosage colorimétrique du fer dans les solutions à analyser, en
présence de guanidine et en milieu acide, avec l’hydroxylamine comme réducteur et la ferrozine
comme indicateur.
Le chlorhydrate de guanidine dénature les protéines transporteuses et les maintient en solution
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 98
Thèse de Pharmacie
de pH acide. Le fer ferrique est réduit en fer ferreux par l’hydroxylamine. L’ion Fe2+ se chélate à
la ferrozine pour donner un complexe coloré.
Le fer présent dans l’échantillon a été dosé par les réactions suivantes :
Guanidine-HC
Fe+++ - transferrine Fe+++
Hydroxylamine
+++
Fe Fe++
Ferrozine
++
Fe complexe coloré
Ferrozine : (pyridyl-2) –3 bis-(phenyl-4 acide sulfonique) –5, 6 di-acide sulfonique-5’, 5’’,
triazine-1, 2, 4, sel monosodique.
Préparation des réactifs:
Nous avons utilisé également trois types de réactifs :
Réactif 1 (R1) : c’est l’étalon (1 x 20 ml) et le fer (35,5μmol/l ou 2mg/l) que nous avons utilisé
comme le blanc de l’échantillon;
Réactif 2 (R2) : nous avons pris la guanidine (2 x 80 ml), l’hydroxylamine (230mmol/l), le
chlorhydrate de guanidine (4,5 mol/l) et un tampon acétate à pH 5 ;
Réactif 3 (R3) : nous avons utilisé un réactif de coloration (1x 14 ml), le ferrozine (44,4 mmol / l)
et un tampon acétate à pH 5.
Le test a été réalisé avec 40 ml de réactif 2 ; 1,5 ml de R3, le blanc d’échantillon (200μl et
1ml de R1) ; le blanc de réactif (300 μl), ED (200 μl). Le dosage a été fait par 200 μl de R2 et 1ml
de la solution de travail.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 99
Thèse de Pharmacie
Mode opératoire :
Il est résumé par le tableau suivant :
Tableau n0 X : Protocole opératoire de dosage du fer
Blanc réactif Etalon Blanc échantillon Dosage
Eau distillée 200 μl - - -
Etalon - 200 μl - -
Echantillon - - 200 μl 200 μl
Réactif 2 - - 1 ml -
Solution de travail 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml
Comme la méthode précédente, on mélange l’échantillon avec les différents réactifs, puis
on attend 1 mn à 20 - 250 C.
Après, on met le tout dans le photomètre déjà réglé et on effectue un étalonnage à chaque série de
dosages.
L’interprétation des résultats du test doit être faite en tenant compte du contexte clinique
et éventuellement des résultats d’autres tests.
La concentration de l’échantillon s’effectue au produit de DO de l’échantillon ; la densité
optimale du blanc de l’échantillon (DOBE) et la concentration de l’étalon par le rapport de la DO
de l’étalon.
DO échantillon x DOBE x N
CE =
DO étalon
CE : concentration de l’échantillon ;
DOBE : densité optimale du blanc de l’échantillon ;
DO : densité optique ;
N : concentration de l’étalon.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 100
Thèse de Pharmacie
2-7 Chromatographie sur couche mince :
2-7-1 Principe :
La chromatographie sur couche mince est une méthode physico-chimique rapide de
contrôle dont l’absorbant ou phase stationnaire est constituée d’une couche mince et uniforme
de mm d’épaisseur, d’une substance séchée et finement pulvérisée, appliquée sur un support
approprié (dans notre cas, nous avons utilisé une feuille d’aluminium). La phase mobile ou
éluant migre à la surface de la plaque par capillarité. C’est une méthode analytique de contrôle
qui, à chaque stade de séparation permet de:
Suivre l’efficacité des extractions avec différents solvants,
Suivre la composition des différentes fractions obtenues au cours des séparations,
Faire le meilleur choix des solvants d’élution des colonnes,
Vérifier la pureté des produits isolés.
Les techniques chromatographiques ne sont pas suffisantes pour identifier un produit mais
elles apportent des renseignements susceptibles d’orienter vers une hypothèse de structures, par
exemple: fluorescence, coloration, Realising factor « Rf = facteur de rétention).
2-7-2 Matériels:
Une balance analytique de précision de type Sartorius,
Une cuve avec couvercle,
Un solvant de migration,
Un révélateur,
Une lampe à Ultra Violet,
Un crayon de papier,
Des éprouvettes graduées,
Micro pipettes,
Une pince,
Plaque de silicagel 60F254,
Pulvérisateur,
Une règle graduée,
Un séchoir.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 101
Thèse de Pharmacie
2-7-3 Technique :
2-7-3-1 Solution à analyser :
Nous avons dissous 10 mg des extraits aqueux et hydro-alcoolique dans 1 ml d’un mélange
de solution méthanol– eau (1-1) et 10 ml des extraits organiques dans 1 ml d’acétate d’éthyle.
2-7-3-2 Dépôt :
Nous avons déposé 10 μl de chaque solution à l’aide d’une micro pipette sur une plaque de
CCM.
2-7-3-3 Migration :
Nous avons placé des plaques dans les cuves de développement dans lesquelles se trouvait un
système de solvants appropriés appelés phase mobile, à environ 0,5 cm de hauteur, pour chacun.
Pour la migration, nous avons choisi le système butanol acide acétique eau (BAW) dans les
proportions (60 : 15 : 25) pour les extraits aqueux, hydro-alcoolique et pour l’extrait
dichlorométhane nous avons choisi le système ligroïne-acétate d’éthyle (1 : 1).
2-7-3-3 Révélation :
L’observation a été faite à l’UV 254 et 366 nm et la révélation a été faite avec le réactif de
Godin ou AlCl3. Nous avons déterminé le facteur de rétention (Rf) pour chaque extrait.
Distance parcourue par la substance
Rf =
Distance parcourue par le solvant
La migration se fait dans un solvant de migration approprié.
3 Etudes pharmacologiques :.
3-1 Détermination de l’activité antioxydante :
Ce test a été réalisé par la réduction du radical 1,1’diphényl-2 picrylhydrazyle (DPPH)
Principe:
Ce test consiste à déposer les produits à tester sur des plaques de CCM en aluminium recouvertes
de gel de silice GF254 et à les développer dans des systèmes de solvants appropriés. Après
séchage, les plaques sont révélées avec une solution méthanolique de DPPH à 2mg / ml. Les
activités antiradicalaires apparaissent sous forme de spots de couleur jaune-blanc sur fond violet
(Souley B., 2004).
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 102
Thèse de Pharmacie
3-2 Détermination de l’activité diurétique :
3-2-1 Matériels :
Souris blanche pesant 20 à 28g ;
Cage métabolique ;
Eprouvettes graduées ;
Balance de type Satorius ;
Fiole ;
Entonnoir en polyéthylène,
Seringue ;
Pipette 5 ml.
Figure n°14 : Cage métabolique
3-2-2 Méthode :
Les souris par groupe de 5 sont soumises à un régime alimentaire normal. L’extrait du
décocté aqueux de Spondias mombin est administré par voie intragastrique, immédiatement après
administration par la même voie, de 50 mg / kg d’une solution de NaCl à 1,8 %. Un lot témoin
servant de contrôle ne reçoit que NaCl et de l’eau distillée. Tous les animaux d’un même lot sont
placés dans la cage métabolique et les urines ont été recueillies dans une fiole pendant six
heures.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 103
Thèse de Pharmacie
Lot d’essai nº 1 : Les animaux reçoivent de décocté aqueux immédiatement après la
surcharge sodée soit 50 mg / kg. Le décocté est préparé de façon à ce que chaque animal
reçoive 150 mg / kg de poids de souris.
Lot d’essai nº 2 : Les animaux reçoivent 0,50 ml de décocté aqueux immédiatement
après la surcharge soit 50 mg / kg. Le décocté est préparé à la dose de 300 mg / kg de poids de
souris.
Lot de Furosémide : Les animaux reçoivent 20 mg / kg de poids de furosémide
immédiatement après la surcharge.
L’urine excrétée par chaque lot est recueillie pendant 6 heures après le gavage. Le volume
d’urine a été mesuré et nous avons noté le pH.
Les concentrations urinaires en Na+ et K+ sont déterminées par photométrie de flamme et
on en déduit le rapport Na+ / K+.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 104
Thèse de Pharmacie
1 Résultats de la phytochimie
1-2 Résultats des réactions de caractérisation :
1-2-1 Résultats des réactions en tubes :
Tableau n° XI : Résultats des réactions en tube réalisées sur des écorces de Spondias mombin
Recherches Colorations Résultats
Coumarines (fluorescence UV 360 nm ) Fluorescence intense +++
Tanins (FeCl3 à 1%) Bleu-noirâtre +++
Tanins (HCl concentré) Précipite rouge +++
Tanins galliques (réactif de Stiasny ) Bleu-noirâtre +++
Stérols et triterpènes (réactif de Liebermann) Anneau violet +++
Oses et holosides Rouge +++
Leucoanthocyanes Rouge cerise +++
Hétérosides cardiotoniques (réactif de Bal jet) Orangée ++
Saponosides Présence de mousses ++
+++ : Réaction très positive ;
++ : Réaction moyennement positive ;
+ : Réaction faiblement positive
Les tanins, les coumarines, les stérols et les triterpènes ont donné des réactions franchement
positives. Par contre, les alcaloïdes, les anthocyanes, les hétérosides cardiotoniques (Kedde et
Raymond-Marthoud), les anthracénosides et les caroténoïdes ont été absents dans l’échantillon
analysé.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 105
Thèse de Pharmacie
Tableau n° XII : Résultats des réactions en tube réalisées sur la recette de l’HTA
Recherches Colorations Résultats
Flavonoïdes : genines flavoniques Rose orangée +++
Flavonoïdes : hétérosides flavoniques Teinte brun-rouge +++
Tanins : réaction avec FeCl3 1% Bleu-noirâtre +++
Tanins : réaction avec HCl concentré Précipité +++
Stérols et triterpènes Violette en surface + +
Leucoanthocyanes Rose orangée +++
Saponosides Très peu de mousse +
Mucilages Précipité floconneux +++
Les réactions en tube de la recette de l’HTA ont montré l’absence des alcaloïdes, hétérosides
cyanogénétiques et cardiotoniques, coumarines, caroténoïdes, anthracénosides, composés
réducteurs, oses et holosides et des anthocyanes.
1-2-2 Extractions :
La masse, le rendement, l’aspect et la couleur des extraits et fractions obtenus à partir des écorces
de tronc de Spondias mombin et de la recette de l’HTA sont rapportés dans le tableau n° XIII.
Tableau no XIII : Résultats du rendement, de l’aspect et de la couleur des extraits de la recette et
de Spondias mombin
Extraits Rendement (%) Couleur Aspect
Ecorces de tronc Spondias mombin
Décocté à 10 % 9,10 Noirâtre Brillant
Macéré aqueux 4,38 Noirâtre Floconneux
Macéré éthanolique à 80 % 21,75 Noirâtre Paillette
Dichlorométhane 10,00 Noirâtre Floconneux
Méthanol 25,00 Noir grisâtre Collant
Digesté après épuisement 15,88 Grisâtre Paillette
Décocté après épuisement 17,65 Carmin très foncé Floconneux
Recette de l’HTA
Décocté à 10 % 26,90 Marron Floconneux
Infusé à 5 % 30,20 Marron Floconneux
Éther de pétrôle 10,00 Noirâtre Collant
Dichlorométhane 14,00 Noirâtre Collant
Méthanol 13,70 Noir grisâtre Collant
Digesté après épuisement 14,00 Ocre foncé Floconneux
Décocté après épuisement 4,50 Grisâtre Floconneux
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 106
Thèse de Pharmacie
Nous constatons que l’extrait de l’infusé à 5 % de la recette a donné le rendement le plus élevé
avec 30,20 % alors que l’extrait du macéré aqueux de Spondias mombin a le plus faible
rendement avec 4,38 %.
1-2-3 Dosages :
1-2-3-1 Substances extractibles par l’eau :
La teneur des substances extractibles par l’eau est de 25,40 % pour Spondias mombin et
11,50 % pour la recette de l’HTA.
1-2-3-2 Substances extractibles par l’éthanol 80 % :
6,65 % des substances contenues dans la poudre d’écorces de tronc de Spondias mombin et 27 %
pour la recette ont été extraites par l’éthanol 80 % dans l’eau.
1-2-3-3 Dosages de l’eau :
1-2-3-3-1 Méthode gravimétrique :
Tableau n° XIV : Teneur en eau de la poudre des écorces de tronc de Spondias mombin
N° de Tare Masse avant Masse après Masse prise Masse en Pourcentage
creuset (g) le four ( g ) le four ( g ) d’essai ( g ) eau ( g ) eau ( % )
1 8,2900 10,9350 10,7690 2,6450 0,1660 6,2759
2 9,2960 12,2530 12,0610 2,9570 0,1920 6,4930
3 9,3740 12,3350 12,1308 2,9610 0,2042 6,8963
4 9,3490 112,500 12,2670 3,1510 0,2330 7,3944
5 8,2750 11,1120 10,9370 2,8370 0,1750 6,1684
6,2759 + 6,4930 + 6,8963 + 7,3944 + 6,1684
La teneur moyenne en eau = = 6,65 %
5
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 107
Thèse de Pharmacie
Tableau n° XV : Teneur en eau de la recette de l’HTA
N° de Tare Masse avant Masse après Masse prise Masse en Pourcentage
creuset (g) le four ( g ) le four ( g ) d’essai ( g ) eau ( g ) eau ( % )
A 10,4140 13,1140 12,9520 2,7000 0,1620 6,0000
B 9,8120 13,3242 13,1130 3,5122 0,2112 6,0133
C 8,3100 11,2112 11,0430 2,9012 0,1682 5,7976
D 9,2130 12,2650 12,0860 3,0520 0,1790 5,8650
E 8,9861 12,0914 11,9000 3,1053 0,1914 6,1636
6,0000 + 6,0133 + 5,7976 + 5,8650 + 6,1636
La teneur moyenne en eau = = 5,96 %
5
La teneur moyenne en eau est inférieure à 10 % pour Spondias mombin et la recette de l’HTA, ce
qui signifie que notre poudre peut être conservée sans altération des principes actifs.
1-2-3-3-2 Méthode azéotropique :
Par cette méthode, nous avons obtenu une teneur en eau de 6 % pour Spondias mombin et 4 %
pour la recette de l’HTA.
1-2-3-4 Dosage des cendres :
1-2-3-4-1 Cendres totales :
Tableau n° XVI : Teneur en cendres totales de la poudre d’écorces de tronc de Spondias
mombin
N° du Tare Masse avant Masse après Masse prise Masse en Masse des
creuset (g) le four ( g ) le four ( g ) d’essai ( g ) eau ( g ) cendres ( g )
1 17,5614 20,1028 17,7520 2,5414 2,5508 20,4351
2 17,1630 20,0468 17,8983 2,8838 2,1485 17,2080
3 15,3428 18,2752 15,7350 2,9324 2,5402 20,3502
4 25,8360 29,1572 26,2843 3,3212 2,8729 23,0156
5 24,1700 26,9178 24,5411 2,7478 2,3700 18,9867
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 108
Thèse de Pharmacie
20,4351 + 17,2080 + 20,3502 + 23,0156 + 18,9867
La teneur moyenne en cendre = = 20 %
5
Tableau n° XVII : Teneur en cendres totales de la recette de l’HTA
n° du Tare Masse avant Masse après Masse prise Masse en Masse des
creuset (g) le four ( g ) le four ( g ) d’essai ( g ) eau ( g ) cendres ( g )
A 17,1610 19,7310 17,4218 2,5760 2,3152 16,5660
B 17,5578 20,4354 17,8630 2,8776 2,5724 18,3999
C 24,1610 27,0200 24,4660 2,8590 2,5540 18,2683
D 25,8260 28,8870 26,1270 3,0610 2,7600 19,7917
E 14,9161 17,5230 15,1720 2,6069 2,3510 16,8162
16,5660 + 18,3999 + 18,2683 + 19,7917 + 16,8162
La teneur moyenne en cendre = = 18,57 %
5
1-2-3-4-2 Cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique à 10 % :
La teneur des cendres insolubles dans HCl à 10 % a été de 4,25 % pour Spondias mombin
et 5,75 % pour la recette de l’HTA des cendres totales.
1-2-3-4-3 Cendres sulfuriques ( H2SO4 à 50% ) :
La teneur des cendres insolubles dans H2SO4 à 50 % a été de 16,88 % pour Spondias
mombin et 14,19 % pour la recette de l’HTA.
Le tableau n° XVIII présente les résultats de la teneur en eau, substances extractibles par
l’eau, par l’éthanol et les teneurs des cendres des écorces de tronc de Spondias mombin et de la
recette de l’HTA.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 109
Thèse de Pharmacie
Tableau n° XVIII : Résultats des dosages des écorces de Spondias mombin et de la recette
Dosage en Pourcentage (%) Ecorces de tronc de Recette de
Spondias mombin l’HTA
Teneur en eau (méthode gravimétrique) 6,65 5,97
Teneur en eau (méthode azéotropique) 6,00 4,00
Substances extractibles par EtOH à 80o alcoolique 6,65 27,00
Substances extractibles par H2O 25,40 11,50
Cendres totales 20,00 18,57
Cendres chlorhydriques à 10 % 4,25 5,75
Cendres sulfuriques à 50 % 16,88 14,19
Indices de mousse 100 0
La majorité des substances est extractible par l’éthanol à 80 % avec une teneur de 27 %. La
teneur en eau est inférieure à 10 % par les deux méthodes.
1-3 Résultats de la teneur en éléments minéraux:
Nous avons dosé huit échantillons en double dans 16 séries différentes
Tableau no XIX : Résultats de dosage des ions de la poudre des extraits de Spondias mombin et
de la recette
Extraits Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fe2+
mEq / l mEq / l mEq / l mEq / l mEq / l
Spondias mombin décocté 10 % 2 4 ,39 0 ,57 0,30 4
Spondias mombin macéré ED 6 3,56 0,26 - 3
Spondias mombin EtOH 80 % 2 126 1,21 0,10 2
Recette infusé traditionnelle 3 224 0,62 0,07 2
Recette digesté après épuisement 3 72 0,54 0,12 2
Recette extrait méthanolique 16 79 0,63 0 2
Poudre de la recette de l’HTA 4 296 1,06 - 4
Poudre de Spondias mombin 3 211 3,61 0,51 2
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 110
Thèse de Pharmacie
Tableau n° XX : Résultats de dosage des ions de Ca2+, Mg2+ et de Fe2+ dans 100 g d’extraits de
la poudre de Spondias mombin et de la recette de l’HTA
Extraits Ca2+(μg) Mg2+(μg) Fe2+(μg)
Spondias mombin décocté à 10 % 48,13 42,03 242,67
Spondias mombin macéré à ED 29,04 - 239,92
Spondias mombin EtOH 80 % 131,60 18,41 156,52
Recette de l’infusé traditionnel 94,66 12,68 220,06
Recette digesté après épuisement 159,64 58,90 426,50
Recette extrait méthanolique 114,87 0 261,93
Poudre de la recette de l’HTA 142,70 - 387,03
Poudre de Spondias mombin 899,00 210,12 358,00
Tableau n° XXI : Résultats de dosage des ions de Na+ et de K+ dans 100 g d’extraits de la
poudre de Spondias mombin et de la recette de l’HTA
Extraits Na+ (mg) K+ (mg)
Spondias mombin décocté 10 % 1,56 5,80
Spondia mombin macéré ED 6,17 6,20
Spondias mombin EtOH 800 2,01 214,85
Recette de l’infusé traditionnel 4,24 584,95
Recette digesté après épuisement 8,22 334,52
Recette extrait méthanolique 26,92 225,42
Poudre de la recette de l’HTA 4,97 624,00
Poudre de Spondias mombin 6,90 822,90
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 111
Thèse de Pharmacie
Tableau n° XXII : Résultats de l’excrétion urinaire par le décocté aqueux de Spondias mombin
Ions Lot n° 1 Lot n° 2 Furosémide Témoin 1 Témoin 2
Na+ (mEq / l) 154 151 193 136 176
K+ (mEq / l) 19 20 34 25 27
La teneur en Na+ est le plus élevée dans le volume urinaire de nos échantillons.
250
200 150 mg
P o u rcen tag e
300 mg
150
Furosémide
100
Témoin 1
50
Témoin 2
0
Na+ K+
Dose des ions en mEq / l
Figure n° 16 : Diagramme de l’indices diurétiques par des ions (Na+ et K+)
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 112
Thèse de Pharmacie
2 Résultats de CCM :
Tableau n° XXIII : Résultats de CCM des extraits polaires d’écorces de troncs de Spondias
mombin et de la recette dans le système BAW (60 : 15 : 25)
Extraits 254 nm 366 nm Godin Rf
Spondias mombin macéré EtOH à 80 % Grisâtre Gris sur fond noir Blanc 0,05
,, Grisâtre Gris sur fond noir Blanc 0,27
,, Grisâtre Grisâtre Blanc 0,43
,, Grisâtre Grisâtre - 0,52
,, Grisâtre - - 0,74
Spondias mombin digesté après épuis. Grisâtre Grisâtre Blanc 0,16
,, Grisâtre Grisâtre - 0,26
,, Grisâtre Grisâtre - 0,32
,, Grisâtre - - 0,42
,, Grisâtre - - 0,48
,, Grisâtre - - 0,53
,, Grisâtre - - 0,76
Spondias mombin extrait MeOH Grisâtre Gris Marro 0,27
n
,, Jaunâtre Bleu Marro 0,60
n
Spondias mombin extrait MeOH Grisâtre Bleu Noirâtr 0,75
e
,, - - Gris 0,23
,, - - Gris 0,27
,, - - Marro 0,34
n
Spondias mombin macéré à H2O - - - 0,43
,, - - - 0,77
Spondias mombin décocté 10 %. Grisâtre Neutre Marro 0,17
n
- - Gris 0,27
- - Marro 0,32
n
- - Marro 0,43
n
- - Marro 0,49
n
- - - 0,57
- - - 0,78
A 254 nm, les extraits sont apparus en couleur grise. A 366 nm, la majorité des taches est grise.
Après révélation au Godin, les taches grises et bleues sont apparues en marron et gris.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 113
Thèse de Pharmacie
Tableau no XXIV : Résultats de CCM des extraits polaires d’écorces de troncs de Spondias
mombin et de la recette dans le système BAW (60 : 15 : 25)
Extraits 254 nm 366 nm Godin Rf
Recette de l’HTA décocté 10% Grisâtre Bleuâtre Jaunâtre 0,17
,, - Bleuâtre Jaunâtre 0,30
,, - - - 0,45
,, - - - 0,47
,, - - - 0,73
,, - - - 0,84
Recette de l’HTA extrait MeOH Grisâtre Rouge Orange 0,42
,, - - Jaune 0,45
,, - - Violet 0,75
,, - - - 0,85
Recette de l’HTA infusé du trad. Grisâtre Bleuâtre Jaune 0,27
,, - - Jaune 0,41
,, - - Jaune 0,50
,, - - - 0,73
,, - - - 0,83
Recette de l’HTA infusé à 5 % Grisâtre Bleuâtre Jaunâtre 0,27
,, - - - 0,40
,, - - - 0,49
,, - - Jaune 0,73
orangée
,, - - - 0,84
Recette de l’HTA infusé à 10 % Grisâtre Bleuâtre Jaunâtre 0,27
,, - - Jaunâtre 0,49
,, - - - 0,66
,, - - - 0,73
,, - - - 0,82
A 254 nm, les extraits sont apparus en couleur grise. Nous avons eu des taches bleuâtres et rouges
à 366 nm. Ces taches sont devenues jaunes, vertes et orangées après révélation au Godin.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 114
Thèse de Pharmacie
Tableau no XXV : Résultats de CCM des extraits polaires d’écorces de troncs de Spondias
mombin et de la recette dans le système BAW (60 : 15 : 25) (suite)
Extraits 254 nm 366 nm Godin Rf
Recette de l’HTA digesté après épuis. Noirâtre Noir Gris 0,38
,, ,, Bleu clair Jaune claire 0,43
,, ,, Noirâtre ,, 0,43
,, ,, Noirâtre Gris 0,50
,, ,, Noirâtre ,, 0,50
,, ,, Bleuâtre ,, 0,50
,, ,, Noirâtre ,, 0,62
Spondias mombin décocté après épuis. ,, Bleu clair Gris 0,43
,, ,, Noirâtre ,, 0,50
,, ,, Noirâtre Gris 0,50
,, Noirâtre Noirâtre ,, 0,50
,, ,, Noirâtre ,, 0,62
Recette de l’HTA décocté après épuis. ,, Noir Gris 0,38
,, ,, Bleu clair Jaune 0,43
,, ,, Bleu clair Gris 0,43
,, ,, Noirâtre Gris 0,50
,, ,, Bleu clair Gris 0,50
,, ,, Noirâtre Gris 0,50
,, ,, Bleu Jaune claire 0,56
,, ,, Noir Gris 0,75
Support : plaque de Silicagel 60 FG254
Dépôt : 10 μl
Eluant : BAW (60 ; 15 ; 25)
Révélateur : Godin
Les taches jaunes apparaissant après révélation pourraient être des flavonoïdes.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 115
Thèse de Pharmacie
Tableau no XXVI : Résultats de CCM des extraits apolaires d’écorces de tronc de Spondias
mombin et de la recette dans le système Ligroïne – Acétate d’Ethyle (1 : 1)
Extraits 254 nm 366 nm Godin Rf
Spondias mombin extrait DCM Blanc Jaune clair sur fond rouge Blanc 0.63
,, - Jaunâtre - 0,74
,, - Jaunâtre - 0,83
,, - Jaunâtre - 0,88
Recette de l’HTA extrait DCM Blanc Brune sur fond rouge Blanc 0,05
,, - - Blanc 0,21
,, - Rouge Vert 0,44
,, - Rouge Vert 0,50
,, - Rouge Noirâtre 0,68
,, - - - 0,75
,, - - - 0,79
,, - - - 0,83
,, - - - 0,88
,, - - - 0,96
,, Blanc Jaune sur fond rouge Blanc 0,50
Recette de l’HTA extrait éther - Jaune sur fond rouge Vert 0,66
de Pétrole
,, - Rouge Noir 0,74
Recette de l’HTA extrait éther de - Rouge Noir 0,83
Pétrole
,, - Rouge Noir 0,88
,, - Rouge Noir O,94
La révélation à 254 nm n’a pas donné de coloration. A 366 nm, la présence des colorations
jaunes et rouges pourrait être des flavonoides. La révélation au Godin a donné les taches vertes et
noires qui pourraient être des tanins.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 116
Thèse de Pharmacie
1 2
Figure n° 15 : CCM d’extraits polaires (1) et d’extraits apolaires (2) après révélation au Godin
Les colorations jaunes pourraient être des flavonoïdes.
Front du solvant : 8 cm
Support : Plaque de silice G60f264
Dépôt : 4 μl
Eluant : BAW : Butanol – Acide acétique – Eau (60 : 15 : 25)
Révélateur : Réactif de Godin
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 117
Thèse de Pharmacie
3 Pharmacologie :
3-1 Détermination de l’activité antioxydante :
Nous avons fait le chromatogramme des extraits d’écorces de tronc de Spondias mombin et de la
recette de l’HTA dans le système BAW (60 : 15 : 25) pour les extraits polaires et ligroine-Acétate
d’Ethyle (1 : 1) pour les extraits polaires. Ils ont été revélés par une solution de DPPH à 2 mg /
ml dans l’alcool méthylique. L’apparition de taches jaune-blanc sur fond violet nous a permis de
mettre en évidence la présence de substances à activité antioxydante.
Tableau no XXVII : Résultats du test antioxydant sur CCM réalisés sur les extraits polaires
d’écorces de tronc de Spondias mombin et de la recette dans le système BAW (60 : 15 : 25) après
révélation par le DPPH
Révélation Extraits Taches Rf
DPPH S. mombin macéré EtOH 80 % Jaune sur fond violet 0,52
,, ,, 0,91
,, ,, 0,97
S. mombin digesté après épuisement Jaune sur fond violet 0,03
,, ,, 0,48
,, ,, 0,97
Spondias mombin extrait MeOH Jaune sur fond violet 0,08
,, ,, 0,38
,, ,, 0,45
DPPH ,, ,, 0,53
,, ,, 0,91
,, ,, 0,97
Spondias mombin macéré aqueux Jaune sur fond violet 0,31
,, ,, 0,43
,, ,, 0,52
,, ,, 0,57
,, ,, 0,96
Spondias mombin décocté 10 % Jaune sur fond violet 0,32
,, ,, 0,43
,, ,, 0,57
,, ,, 0,50
,, ,, 0,97
Recette de l’HTA du décocté 10 % Jaune sur fond violet 0,40
,, ,, 0,49
,, ,, 0,56
,, ,, 0,65
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 118
Thèse de Pharmacie
,, ,, 0,74
,, ,, 0,79
,, ,, 0,85
,, ,, 0,97
Recette de l’HTA extrait MeOH Jaune sur fond violet 0,40
,, ,, 0,44
,, ,, 0,54
,, ,, 0,62
DPPH ,, ,, 0,69
,, ,, 0,71
,, ,, 0,81
,, ,, 0,87
,, ,, 0,97
Recette de l’HTA infusé traditionnel Jaune sur fond violet 0,27
,, ,, 0,40
,, ,, 0,49
,, ,, 0,65
,, ,, 0,65
,, ,, 0,75
,, ,, 0,84
,, ,, 0,92
Recette de l’HTA infusé à 5 % Jaune sur fond violet 0,28
,, ,, 0,41
,, ,, 0,49
,, ,, 0,57
,, ,, 0,66
,, ,, 0,73
,, ,, 0,84
,, ,, 0,92
Recette de l’HTA de l’infusé à 10 % Jaune sur fond violet 0,27
,, ,, 0,41
,, ,, 0,49
,, ,, 0,58
,, ,, 0,73
,, ,, 0,82
,, ,, 0,92
Tous les extraits ont donné des taches jaunes sur fond violet. Ceux qui caractérisent leur activité
antiradicalaire.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 119
Thèse de Pharmacie
Tableau no XXVIII : Résultats du test antioxydant sur CCM réalisés sur les extraits polaires
d’écorces de tronc de Spondias mombin et de la recette dans le système BAW (60 : 15 : 25) après
révélation par le DPPH (suite)
Révélation Extraits Tâches Rf
Recette de l’HTA digesté après épuisement Jaune 0,50
,, Jaune 0,50
,, ,, 0,56
,, ,, 0,50
,, ,, 0,62
,, ,, 0,50
,, ,, 0,56
DPPH ,, ,, 0,38
,, ,, 0,50
Spondias mombin décocté après épuisement Jaune foncé 0,62
,, Jaune 0,50
,, ,, 0,38
,, ,, 0,43
,, ,, 0,38
,, Jaune 0,50
,, Jaune foncé 0,50
Recette de l’HTA décocté après épuisement Jaune 0,50
,, ,, 0,56
,, ,, 0,62
DPPH ,, ,, 0,50
,, ,, 0,43
,, ,, 0,50
,, Jaune foncé 0,38
,, Jaune foncé 0,38
,, Jaune 0,43
,, Jaune foncé 0,50
La majorité des extraits a donné la coloration jaune, cela explique que les extraits épuisés
réduisent l’activité antiradicalaire.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 120
Thèse de Pharmacie
Figure n°17 : Plaque de CCM des extraits polaires Figure n° 18 : Plaque de CCM
des extraits révelée avec le DPPH apolaires révelée avec le
DPPH
Front du solvant : 8 cm
Support : Plaque de silice G60f264
Dépôt : 4 μl
Eluant : BAW : Butanol – Acide acétique – Eau (60 : 15 : 25)
Révélateur : Réactif de DPPH
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 121
Thèse de Pharmacie
3-2 Détermination de l’activité diurétique :
Tableau n° XXIX : Test diurétique par le décocté 10 % de Spondias mombin et de Furosémide
Traitement Doses Vol. adm. Vol. excrété EUV Activité diurétique
(mg / kg) NaCl (ml) pdt 6 H (ml) (%)
Lot n° 1 150 5,90 11,00 186,84 Importante activité
Lot n° 2 300 6,26 9,50 151,75 Importante activité
Furosémide 20 6,52 12,00 184,05 Importante activité
Eau distillée 1 25 6,84 8,00 116,95 Activité modérée
Eau distillée 2 25 6,52* 7,00 107,36 Pas d’activité
Vol. adm. : volume administré ;
Vol. excrété pdt 6 H : volume excrété pendant six heures ;
EUV : excrétion urinaire volumétrique.
Le lot n° 1 et le Furosémide ont donné la plus importante activité diurétique
Le pH des urines recueillies de chaque test est égal à 7.
200
Doses
EUV en %
150
150 mg
100
300 mg
50
Furosémide
0 Témoin 1
1 Témoin 2
Dose des échantillons en mg
ou ml / kg
Figure n° 19 : Diagramme de l’activité diurétique du décocté de Spondias mombin chez les
souris en surcharge sodée.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 122
Thèse de Pharmacie
COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS :
Notre travail a porté sur l’étude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle.
Le criblage phytochimique nous a permis de mettre en évidence la richesse de la plante et
de la recette en tanins, leucoanthocyanes, saponosides, stérols et triterpènes. Les flavonoïdes et
les mucilages présents en grande quantité dans la recette n’ont pas été détectés dans la plante. Des
coumarines, hétérosides cardiotoniques, oses et holosides ont été trouvés dans la plante.
Les tanins retrouvés en grande quantité dans les écorces de tronc de Spondias mombin par
Boullard en 2001, ont des propriétés vasoconstrictives sur les petits vaisseaux. Les tanins et les
flavonoïdes ont été retrouvés en grande quantité dans la recette. Ces substances sont reconnues
pour leurs propriétés d’augmentation de la résistance capillaire, du tonus veineux et de la stabilité
du collagène. Elles ont des activités inhibitrices sur la décarboxylase, l’élastase et l’enzyme de
conversion d’angiotensine. Toutes choses qui pourraient être bénéfiques dans le traitement de
l’HTA (Bruneton, 1993).
Les coumarines quant à elles, ont été abondantes dans la poudre des écorces de tronc de
Spondias mombin. Elles ont un facteur « intravitaminique P » et des propriétés veinotoniques et
vasculoprotectrices. Elles pourraient être utiles dans l’établissement des régimes restrictifs
destinés au traitement de l’obésité et le risque de complications de l’HTA.
Au cours de nos extractions, les meilleurs rendements ont été obtenus avec l’infusé 5 %
de la recette (30,20 %) suivi de l’infusé selon la méthode du tradipraticien de la recette (28,80 %)
et de l’extrait méthanonique de Spondias mombin (25,00 %). L’extrait du macéré aqueux de
Spondias mombin a donné le plus faible rendement avec 4,38 %.
La teneur en eau aussi bien par la méthode gravimétrique qu’azéotropique a été inférieure
à 10 %, ce qui permet d’éviter la fermentation et l’attaque des moisissures.
Les taux des substances extractibles par l’eau ont été de 25,40 % pour Spondias mombin
et 11,50 % pour la recette.
Le taux en cendres totales a été de 20,00 % pour Spondias mombin et 18,57 % de la
recette, ce qui pourrait expliquer la richesse en éléments minéraux de nos échantillons.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 123
Thèse de Pharmacie
Les teneurs en cendres chlorhydriques sont de 4,25 % pour Spondias mombin et 5,75 %
pour la recette, ces taux indiquent les teneurs en éléments siliceux.
Le décocté de la recette après épuisement au soxhlet a présenté le plus grand nombre de
substances anti-radicalaires. L’activité antioxydante de Spondias mombin pourrait s’expliquer par
la présence des tanins, des flavonoïdes et des coumarines (Bruneton, 1993 ; Cavin, 1999).
La présence dans la recette de l’HTA des tanins, des flavonoïdes et des leucoanthocyanes
pourrait expliquer aussi son action antioxydante. Ces substances antioxydantes rentrent dans
l’arsenal thérapeutique de la lutte contre l’artériosclérose et les cancers qui constituent les
facteurs favorisants de l’HTA (Chevaly, 2000).
Les flavonoïdes sont particulièrement des substances antioxydantes actives dans le
maintien de la circulation sanguine. Ils contribueraient à l’augmentation de la production de
l’oxyde nitrique des plaquettes sanguines qui limite la formation des caillots en empêchant les
plaquettes de s’agglutiner, donc ils permettront de prévenir l’athérosclérose (DIALLO S., 2005).
L’ionogramme nous a permis de constater que nos extraits avaient une charge importante
en éléments minéraux (sodium, potassium, calcium, magnésium et fer). La présence de ces ions
en proportion élevée dans nos extraits a un rapport considérable dans la prévention des maladies
cardiovasculaires en général et l’hypertension artérielle en particulier (Delbarre, 1993).
La présence de sodium dans nos extraits pourrait avoir un effet natriurèse, un reflet de
l’état d’hydratation intracellulaire et un rôle dans l’équilibre acido-basique. Les observations
montrent qu’il existerait une relation significative entre la pression artérielle et la natriurèse.
L’hypertension est en corrélation avec une forte natriurèse (Hamburger J. et al, 1966 ; Delbarre,
1993).
Le potassium est le principal cation intracellulaire, il intervient dans la polarisation des
membres cellulaires, le potentiel neuromusculaire, l’automatisme cardiaque et certaines activités
enzymatiques. Les auteurs montrent que l’HTA est plus fréquente chez l’individu en
hypokaliémie. L’administration du supplément de potassium entraînerait une diminution de la
pression artérielle. Donc il existe une relation inversement proportionnelle entre l’hypertension et
le taux de potassium (Delbarre, 1993).
Le même auteur a rapporté que toute augmentation du calcium intracellulaire provoquerait
la contraction du muscle lisse vasculaire et entraînerait une augmentation de la résistance
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 124
Thèse de Pharmacie
périphérique totale. Le taux élevé du calcium cytoplasmique dans les plaquettes sanguines
pourrait être altéré chez l’hypertendu.
Beaucoup d’auteurs montrent que l’HTA est fréquente et grave chez l’individu en
hypokaliémie. Par contre l’administration du supplément potassique entraîne une diminution de
la pression artérielle. Ainsi le potassium aurait un effet natriurèse sur le système kallicréine /
kinine (vasodilatation) ou augmenterait la dégradation des catécholamines
(Delbarre, 1993).
Ces données pourraient justifier l’utilisation traditionnelle de Spondias mombin et de la
recette préparée par les tradipraticiens dans le traitement de l’HTA.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 125
Thèse de Pharmacie
CONCLUSION
Notre travail a porté sur l’étude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle par
une plante : Spondias mombin et une recette.
Nous avons fait la recherche phytochimique et le dosage des ions. Les activités
antioxydantes et diurétiques ainsi que l’excrétion urinaire ont été appréciées. Le criblage
phytochimique a permis de révéler la présence des tanins, des flavonoïdes, des leucoanthocyanes,
des saponosides, des coumarines, des mucilages, des stérols et triterpènes.
Le dosage de certaines substances et des éléments minéraux dans nos extraits et dans nos
poudres a été réalisé.
Tous les extraits contenaient des substances à activité antioxydante.
Nous avons obtenu une importante activité diurétique avec le décocté de Spondias
mombin aux doses de 150 et 300 mg / kg.
Les résultats obtenus au cours de cette étude pourraient justifier l’utilisation de Spondias
mombin et de la recette pour le traitement traditionnel de l’hypertension artérielle.
Notre travail constitue un grand pas dans l’étude du traitement traditionnel de l’HTA. Il
serait important de poursuivre les travaux sur Spondias mombin qui posséderait beaucoup
d’activités : antipaludiques, microbiennes, anxiolytiques, laxatives, antitussives et
salidiurétiques.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 126
Thèse de Pharmacie
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES:
1 – Adjanohoun E.J. , Ake Assit L., Floret J.J., Guinko S., Koumaré M., Ahyi AMR, Raynal
J., (1979) ;
Médecine traditionnelle (MT) et pharmacopée, contribution aux études ethnobotaniques et
floristiques au Mali. ACCT. Paris ; 291p.
2 - Adjanohoum E.J., , Ake Assit L., Floret J.J., Guinko S., Koumaré M., Ahyi AMR,
Raynal J., (1981) ;
Contribution aux études botaniques et floristiques au Mali.
Bulletin : médecine traditionnelle et pharmacopée, ACCT 3 ème Edition, Vol.2, Paris ; 289 p.
3 – Adjanohoun, E. J., Dramane K. L., Fouraste I., Lo Issa, Keita A, Le Bras M, Le Joly
M., (1987) ;
Zanthoxylum zanthoxyloïdes Watern. ( Rutaceae ).
Bulletin de liaison de la médecine traditionnelle et Pharmacopée, Vol.1 ; 33320 EYSINES.
France ; 105 p.
4 - ARAMA Remi Erè, (1988) ;
Contribution au traitement traditionnel de l’HTA. Thèse de Pharmacie, Bamako, 88 p.
5 – Ayoka AO, Akomolafe RO, Lwalewa EO and Ukponmwan OE, (2005) ;
Studies on the anxiolytic effect of Spondias mombin L. (Anacardiaceae). African Journal of
traditional, complementary and alternative medecine Vol 2, N° 2, Nigéria ; 165 p.
6 - Boullard Bernard, (2001) ;
Dictionnaire des plantes médicinales du monde. Réalités et croyances ; Edition ESTEM, Paris,
636 p.
7 - Bouvenot G., Devulder B., Guillevin L., Queneau P., Schaeffer A., (1994) ;
Abrégés de Pathologie médicale, Pneumologie, Néphrologie, Cancérologie, Nutrition ;
Edition Masson, Paris ; 506 p,
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 127
Thèse de Pharmacie
8– Brater C., Calam D.H., Kristensen H.G., Ebel S., McGuinn T.A., Cignitti M.,
Baldursdottir F., Vardulaki A., Fournier JP., Ludwig H., Sevon N. (2002) ;
Pharmacopée européenne, the United States Pharm (USP) et the National Formulary (FN),
4eme édition, Strasbourg, France ; 2623 p.
9 – Bruneton Jean, (1993) ;
Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes médicinales, 2 ème édition TEC, Paris ; 915 p.
10 – Bruneton Jean, (1999) ;
Plantes toxiques végétaux dangereux pour l’homme et les animaux, 3 eme édition ; Paris France ;
87 P.
11 - Bruneton J., (2002) ;
Pharmacognosie, phytochimie des plantes médicinales, édition 3, Lavoisier, Paris ; 242 p.
12 - Burkill H.M., (1985) ;
The useful plants of West Tropical Africa Vol. 1
The trustess of Royal Botanic Gardens Kew, Singapore ; 960 p. .
13 - Burkill H.M., (1993) ;
The useful plants of West Tropical Africa Vol.2
The trustess of Royal Botanic Gardens Kew, Singapore ; 960 p. .
14 - Burkill H.M., (1995) ;
The useful plants of West Tropical Africa Vol.3 ;
The trustess of Royal Botanic Gardens Kew, Singapore ; 960 p.
15- Burkill H.M., (1997) ;
The useful plants of West Tropical Africa Vol.4
The trustess of Royal Botanic Gardens Kew, Singapore ; 969 p.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 128
Thèse de Pharmacie
16 – Calam D.H., Goldsmith J.A., Andrews A.H., Begg D.I.R., Fell A.F., Fenton-May V.,
Lee A.M.T., Midgley J.M., Moffat A.C., Hutton R.C., Randall N., (2001) ;
Bristish Pharmacopoeia Commision, the Stationery Office, 25 eme édition Vol. 1, ; London
Angleterre ; 1744 p.
17 – Cavin, (1999) ;
Investigation phytochimique de trois plantes indonésiennes aux propriétés antioxydante et
antiradicalaire : Tinospora crispa ( Menispermaceae), Merremia emerginata (Convolvulaceae) et
Orophea enneandra (Annonacceae). Thèse de Doctorat : Lausanne ; 241 p.
18 –CHAMONTIN Bernard, (1997) ;
HTA de l’adulte : Epidemiologie, étiologie, physiopathologie, diagnostic, évolution, pronostic,
traitement de l’hypertension essentielle.
Revue du praticien Paris France ; 122 - 132 p.
19– CHAMONTIN Bernard, (2001) ;
HTA de l’adulte: Epidémiologie, étiologie, physiopathologie, diagnostic, évolution, pronostic et
traitement de HTA essentielle.
Revue du praticien, Vol 51, Paris France ; 123 p.
20 - Chetima Nana Mariama, (2003) ;
Moringa oleifera LAM. ( Moringaceae): Utilisations dans l’alimentation et la médecine, études
des antioxydants et antihypercholestérolemiante. Thèse de Pharmacie : Bamako ; 126 p.
21 - Chevalley Isabelle, (2000) ;
Contribution à l’étude phytochimique des Saxifragacées: isolement d’antioxydants à partir de
Saxifraga stellaris L. et Saxifraga cuncifolia L. et d’un composé antifongique de Ribes rubum L.
Thèse de Doctorat, Lausanne, 175 p.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 129
Thèse de Pharmacie
22 - Coulibaly Ousmane Moussa, (2001) ;
L’HTA et sa prise en charge thérapeutique dans le service de cardiologie A de l’Hôpital National
du Point « G » (HNPG). Thèse de Médecine, Bamako ; 65 p.
23 – Cissé Amadou Alassane, (1993) ;
Approche diagnostic et thérapeutique de l’HTA chez les sujets âgés (5ans et plus) au Mali.
Thèse de Médecine : Bamako, 84 p.
24 - Crété P., (1965) ;
Précis de Botanique: Systématiques des angiospermes, 2ème édition, Tome 2; faculté de
Pharmacie ; Masson Paris ; 429 p.
25 - Delbarre B. et G. Delbarre, (1993) ;
Abrégé de l’HTA : Physiopathologie et pharmacologie. Edition Masson PARIS, 103 p.
26- DIALLO A., (2005) ;
Etude de la phytochimie et des activités biologiques de Syzynum guinense WILLD.
(Myrtaceae). Thèse de Pharmacie : Bamako, 99 p.
27– DIALLO D., (2000) ;
Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Mali and phytochemical study of four of
them: Glinus oppisitifolius ( aizoaceae ), Diospyros abyssinica ( Ebenaceae ), Entada africana
( Minosaceae ), Trichilia emetica ( Meliaceae ). Thèse de Doctorat, Lausanne 221 p.
28 - DIALLO S., (2005) ;
Etude des propriétés antioxydantes et antiplasmodium des Lannea couramment rencontrés au
Mali. Thèse de Pharmacie, Bamako ; 85 p.
29 – Duez P., Chamart S., Lejoly J., Hanocq M., Zeba B., Sawadogo M., Guissou P. (1987) ;
Potentialités d’utilisation rationnelle de Rauwolfia vomitoria en médecine traditionnelle.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 130
Thèse de Pharmacie
Bulletin : Médecine Traditionnelle et Pharmacognosie Vol. 1, Ouagadougou, Burkina- Faso ;
32 p.
30 – FAO, (1982) ;
Espèces fruitières forestières ONU pour l’alimentation et l’agriculture, No 34, Rome, Italie ;
201 p.
31 - FOTSING, M. S., (2005) ;
Etude phytochimique et des activités biologiques de Maerua angolensis DC. (Capparidaceae)
Thèse Pharmacie, Bamako, 103p.
32 - Fougue A., (1973) ;
Spondias mombin ; fruits Tome 2. Vol. 28, Paris ; 102 p.
33 - Hamburger J., Grünfeld J. P., Auvert J., Lhermitte F. et Pascal V.R., (1966) ;
Collection médico-chirurgicale : Néphrologie et urologie
3ème édition Vol. 7, Flammarion Médecine Sciences ; 20 Rue de Vaugirard Paris ; 669 p.
34 - Jean P. et I.P., (1981) ;
Recherche thérapeutique et médecine de demain ; les actualités pharmaceutiques Vol. 193,
Paris France ; 21 p.
35 – JOLY Dominique, (2002) ;
Département de néphrologie et Inserm U 507 ; Collection Internat Médecine 3ème édition ; Paris
France ; 562 p.
36 - Kau S.T, Keddie J.R. and Andrews D., (1984) ;
A method for screening Diuretic Agents in the rat.
Journal of Pharmacological methods, Dhaka Bengladesh ; 75 p.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 131
Thèse de Pharmacie
37 - Kéita A., (1986) ;
Recherches phytochimiques et pharmacologiques sur une préparation utilisant Vepris
heterophylla Rets. (Rutaceae) et Cympobogon giganteus Chiov. (Poaceae) comme
antihypertenseur en médecine traditionnelle au Mali. Doctorat du 3eme cycle Toulouse III France,
216 p.
38 - Kerharo J. et Adam J. G., (1974) ;
Pharmacopée sénégalaise traditionnelle : Plantes médicinales et toxiques
Edition Vigot et Frères, Paris ; 1011 p.
39 - Koumaré M., Touré M.K., Koïta N., Diallo D., Koumaré A. et Yehiha A., (1986) ;
Santé pour tous. Bulletin semestriel de médecine traditionnelle du Mali, Vol. 6, Bamako ; 26 p.
40 - Malgras D., (1992) ;
Arbres et Arbustes guérisseurs des savanes africaines. Edition Karthala et ACCT, Paris ; 346 p.
41 - Meyer Philippe, (1978) ;
HTA : mécanismes, cliniques et traitement, Edition Flammarion, Paris France ; 174 p.
42 – Michel P., Fleurentin J., (1989) ;
Recensement du savoir traditionnel : recherche et valorisation des plantes médicinales de la
caraïbe. Bulletin : 1eres journées d’ethnopharmacologies, Metz France ; 75 p.
43 – MOGODE. Debete Judith, (2005) ;
Etude phytochimique et des activités biologiques de Cassia nigricans Vahl
( Caesalpinaceae). Thèse Pharmacie : Bamako, 141 p.
44 – NGHONGUIA Madeleine épouse PODJO, (2001) ;
Exploration de HTA maligne chez les insuffisants rénaux chroniques dans le service de
néphrologie de l’Hôpital National de Point « G » (HNPG).Thèse de Médecine : Bamako, 66 p.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 132
Thèse de Pharmacie
45 ; OMS, (1983) ;
Prévention primaire de l’hypertension essentielle.
OMS Rapport d’un groupe scientifique
Bulletin de l’OMS : Série des rapports techniques N0 683 Genève ; 45 p.
46 – OMS, (2002) ;
Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2002 – 2005 ;
Genève ; 135 p.
47 – Paris R.R. et Moyse H., (1965) ;
Collection de précis de Pharmacie,
Tome 1, Edition 2, Paris; 420 p.
48 – Patte D, Nolen P, Pourrat O, Richard F, Touchad G, (1981) ;
Maladies des reins et des voies respiratoires
Abrégé illustré; Masson Paris France, 126 p.
49- Pincemail J, Bonjean K., Cayeux K., Defraigne J., Jean Olivier D., (2002) ;
Nutrition clinique et métabolisme; Université de Liège, Belgique, 239 p.
50 - Romart Tovemun, (1997) ;
ABC des plantes : Guide pratique de phytothérapie
Edition Romart, Nice France ; 64 p.
51–Seidemann J., Potsdam G., Fluessiges O., (2001) ;
Selected fruits of Spondias mombin, from central and South America ;
Journal: General Review in German, 68 ème Edition Vol. 12 , 35 p.
52 – Souley Boubacar, (2004) ;
Etude de la phytochimique et des activités biologiques de Combretum glutinosum
(Combretaceae). Thèse de Pharmacie : Bamako ; 124 p.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 133
Thèse de Pharmacie
53 - Timbo Binta, (2003) ;
Etude phytochimique et des activités biologiques de Trichilia emetica VAHL ( Meliaceae )
Thèse Pharmacie, Bamako ; 108 p.
54 - TINDANKIR Nathalie Am- mying, (2004) ;
Evaluation de l’utilisation des antihypertenseurs chez les insuffisants rénaux chroniques
(IRC) dans le service de néphrologie et d’hémodialyse de l’HNPG. Thèse de Pharmacie :
Bamako ; 84 p.
55 - TORTORA G.J. et GRABOWSKI S.R., (1994) ;
Principes d’anatomie et de physiologie ; 2ème édition Québec- Canada, 945 p.
56 - Touitou Yvan, (1997) ;
Pharmacologie Diplôme d’état d’infirmier et professionnels, 8ème édition, Masson Paris ; 388 p.
57 – Traoré D., (1983) ;
Médecine et magie africaine, édition Présence africaine, Paris ; 89 p.
58 – Traoré I., Nebout M., (1983) ;
Formules et techniques à partir des matières premières locales concernant la nourriture des souris
d’expérimentation en pays tropicaux, Acta Leprologoca ; 253 p.
59 - Yao Koffi, (1985) ;
Recherches phytochimiques et pharmacologiques sur trois Verbénacées utilisées comme
antihypertenseur en médecine traditionnelle : Lippia multiflora Moldenke, Lantana camara L. et
Gmelina arborea Roxb. Thèse de Doctorat 3eme cycle- Spécialité : Production et traitement des
matières premières végétales. Toulouse III France ; 80 p.
ayokaabiodun@ yahoo.com
www.africanethnomedicines.net
www nephrohus schema
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 134
Thèse de Pharmacie
Annexe 1 : Composition des réactifs
Réactif de MAYER
Iodure de potassium ……………………………………………………………………: 25 g
Chlorure mercurique ………………………………………...………………………....: 6,77 g
Eau distillée qsp …………………………………………………………………….….: 500 ml
Réactif de DRAGENDORFF
Nitrate de bismuth pulvérisé ………………………………………..…………………: 20,80 g
Iode……………………………………………………………………...……………...: 38,10 g
Iodure de sodium anhydre …………………………………………………..…………: 200 g
Eau distillée qsp ……………………………………………………………………….: 1000 ml
Agiter pendant 30 mn.
Réactif de GUIGNARD ( papier picrosodé )
Acide picrique ……………………………………………………………………...…..: 1 g
Carbonate de Sodium ………………………………………………………………..…: 10 g
Eau distillée …………………………………….……………………………………....: 100 ml
Réactif de KEEDE
Acide dinitro 3, 5 benzoïque …………………………………………………………...: 1 g
Ethanol à 95° qsp………………………………………….……………………………: 100ml
Réactif de RAYMOND MARTHOUD
1-3dinitrobenzène ……………………………………………..………………………..: 1 g
Ethanol à 96° qsp………………………………………………….…………………...: 100 ml
Réactif de BALJET
Acide picrique …………………………………………………………………………: 1 g
Ethanol 50° qsp …………………………………………………………….…………: 100 ml
Réactif de FEHLING
Solution A: CuSO4 …………………………………………………………………….: 35 g
Eau distillée: ………………………………………………………… ….: 500 ml
H2SO4…………………………………………………………………….: 5 ml
Laisser refroidir et compléter à un litre avec l´eau distillée.
Solution B: Sel de Seignette ……………………………………………...……………: 150 g
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 135
Thèse de Pharmacie
Eau distillée ……………………………………………………..………...: 500 ml
Refroidir et ajouter 300 ml de lessive non carbonaté et compléter à un litre avec l´ eau distillée.
NB: mélanger les deux solutions à volume égale au moment de l´emploi.
Réactif de GODIN
Solution A: Vanilline…………………………………………………………….……..: 1 g
Ethanol à 95 %…………………………………………………………..…: 1000 ml
Solution B: Acide perchlorique………………………………………………………...: 3 ml
Eau distillée………………………………………………………………… .: 100 ml
Mélanger les deux solutions au moment de l´emploi ensuite pulvériser les plaques avec une
solution de H2SO4 à 10%.
Réactif de DPPH
1-1 diphényle 2 picril hydrazyle 2 mg par ml de méthanol
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 136
Thèse de Pharmacie
Annexe 2 : Alimentation des souris
Formule nutritionnelle des souris (Traoré I., Nabout M.,1983)
Farine de maïs…………………………………………………………………………….: 50 kg
Pâte d’arachide……………………………………………………………………………: 20 kg
Son de mil…………………………………………………………………………………: 1705 kg
Lait en poudre………………………………………………………………………….….: 7 kg
Poudre de poisson…………………………………………………………………………: 3 kg
Feuilles de salade pilées……………………………………………………………………: 2 kg
Sel de cuisine……………………………………………………………………………….: 0,5 kg
Eau qsp / 100 kg…………………………………………………………………………. ..: 38 l
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 137
Thèse de Pharmacie
FICHE SIGNALETIQUE:
Prénom : Issiaka
Nom : GUINDO
Titre de thèse : Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali
Année de soutenance : 2005 - 2006
Ville de soutenance : Bamako
Pays d’origine : Mali
Lieu de dépôt : Bibliothèque de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-
Stomatologie (FMPOS)
Secteur d’intérêt : Médecine Traditionnelle, Hypertension artérielle
Résumé :
Notre travail a porté sur l’étude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle
(HTA) par une plante, Spondias mombin, et une recette.
Après un rappel sur l’HTA, nous avons recensé quelques plantes indiquées dans le
traitement traditionnel de l’HTA au Mali.
Les études phytochimiques de la poudre d’écorces de tronc de Spondias mombin et de la
recette ont montré la présence des tanins, des leucoanthocyanes, des saponosides, des stérols et
triterpènes. Les coumarines ont été retrouvées dans la plante, les mucilages et les flavonoïdes
dans la recette.
L’activité antioxydante a été observée avec tous les extraits.
L’activité diurétique a été observée avec les extraits aqueux des écorces de tronc de
Spondias mombin à partir de l’excrétion urinaire des souris. L’activité diurétique la plus élevée a
été obtenue avec le décocté de Spondias mombin aux doses de 150 et 300 mg / kg.
Enfin, nous avons fait le dosage des ions des poudres des écorces de tronc de Spondias
mombin, de la recette de l’HTA et de leurs extraits aqueux. Le sodium, le potassium, le calcium,
le magnésium et le fer ont été retrouvés dans tous les échantillons.
Mots clés : Traitement traditionnel, HTA, Spondias mombin, recette de l’HTA, antioxydants
ions, diurétique.
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 138
Thèse de Pharmacie
SERMENT DE GALIEN
Je jure, en présence des maîtres de la faculté, des conseillers de l’ordre
des pharmaciens et de mes condisciples :
D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur
témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement ;
D’exercer dans l’intérêt de la santé publique, ma profession avec conscience et
de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de
l’honneur, de la probité et du désintéressement.
De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et de
sa dignité humaine.
En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour
corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels.
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
Que je sois couvert d’opprobres et méprisé de mes confrères si j’y manque.
Je le jure!
Etude du traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Mali 139
Vous aimerez peut-être aussi
- Comment Maintenir Son Érection Plus LongtempsDocument26 pagesComment Maintenir Son Érection Plus LongtempsDiallo SafaiouPas encore d'évaluation
- Comment SeduireDocument40 pagesComment SeduireDiallo SafaiouPas encore d'évaluation
- Fabrication de Savons Et Savonnettes - FicheDocument7 pagesFabrication de Savons Et Savonnettes - FicheDiallo Safaiou100% (2)
- Atlas de Poche EchocardiographieDocument241 pagesAtlas de Poche EchocardiographieLudovic VERCHELPas encore d'évaluation
- Flore et végétation: Plantes médicinales et éléments de gestion du Conservatoire botanique M. Adanson (Mbour-Sénégal)D'EverandFlore et végétation: Plantes médicinales et éléments de gestion du Conservatoire botanique M. Adanson (Mbour-Sénégal)Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Comment Intensifier Vos Plaisirs SolosDocument20 pagesComment Intensifier Vos Plaisirs SolosDiallo SafaiouPas encore d'évaluation
- Hypertension ArtérielleDocument10 pagesHypertension ArtérielleNizar AkidPas encore d'évaluation
- Fabrication Du SavonDocument11 pagesFabrication Du SavonDiallo Safaiou100% (2)
- Urgences PDFDocument192 pagesUrgences PDFAffifa Aissani100% (1)
- QCM LAB EN CardioDocument5 pagesQCM LAB EN CardioIslam HidoubPas encore d'évaluation
- Le poids des régimes: Maigrissez de façon durable en disant NON aux régimes !D'EverandLe poids des régimes: Maigrissez de façon durable en disant NON aux régimes !Pas encore d'évaluation
- Comment Renforcer Le Muscle Pubo CoccygienDocument12 pagesComment Renforcer Le Muscle Pubo CoccygienDiallo SafaiouPas encore d'évaluation
- La Noix de Kola AphrodisiaqueDocument4 pagesLa Noix de Kola AphrodisiaqueDiallo SafaiouPas encore d'évaluation
- L'Ecg Facile 2023Document194 pagesL'Ecg Facile 2023mojdin.danPas encore d'évaluation
- 12M167 PDFDocument95 pages12M167 PDFKalabatakaraPas encore d'évaluation
- M Bintou CoulibalyDocument120 pagesM Bintou Coulibalyabdoukt01Pas encore d'évaluation
- Aspects Epidemiologiques de La Retinopathie Diabetique Au Centre de Sante de Reference de La Commune Iv Du District de BamakoDocument101 pagesAspects Epidemiologiques de La Retinopathie Diabetique Au Centre de Sante de Reference de La Commune Iv Du District de BamakoZaki RakiaPas encore d'évaluation
- 06P49Document103 pages06P49Mahamoudou TouréPas encore d'évaluation
- Etude Epidemiologique, Clinique Et Therapeutique de L'Anemie Sur Grossesse Au Csref de KadioloDocument93 pagesEtude Epidemiologique, Clinique Et Therapeutique de L'Anemie Sur Grossesse Au Csref de KadioloEngwataPas encore d'évaluation
- Evaluation de La Pratique de La Transfusion Sanguine Au Service D'accueil Des Urgences Du CHU Gabriel ToureDocument89 pagesEvaluation de La Pratique de La Transfusion Sanguine Au Service D'accueil Des Urgences Du CHU Gabriel ToureNoussaiba ElhaskouriPas encore d'évaluation
- 15M20Document86 pages15M20nathan mutonji kanongePas encore d'évaluation
- Contribution A L'Étude de La Gynécomastie en Pratique Hospitalière A Bamako Au MaliDocument82 pagesContribution A L'Étude de La Gynécomastie en Pratique Hospitalière A Bamako Au MaliIbrahimPas encore d'évaluation
- 185 BRAVO - CopieDocument99 pages185 BRAVO - CopieAmurukuch N TimmuzghaPas encore d'évaluation
- Etude DES Accouchements: Au Centre de Sante Communautaire de SanghaDocument132 pagesEtude DES Accouchements: Au Centre de Sante Communautaire de SanghaAugustin Kazadi (Augustin docta)Pas encore d'évaluation
- Gestion Du Frein Labial Maxillaire - 2Document128 pagesGestion Du Frein Labial Maxillaire - 2nessyPas encore d'évaluation
- Toxicité Des PlantesDocument153 pagesToxicité Des PlantesphildkonanPas encore d'évaluation
- Thèse Etude Phytochimie Et Activités BioDocument141 pagesThèse Etude Phytochimie Et Activités BioJosianny Joseph100% (1)
- 12M337 PDFDocument116 pages12M337 PDFAllebarim MonaPas encore d'évaluation
- 05P25Document198 pages05P25kalaouiPas encore d'évaluation
- Etude de L'Alimentation Des Basketteurs Au Cours Des Preparations PrecompetitivesDocument86 pagesEtude de L'Alimentation Des Basketteurs Au Cours Des Preparations PrecompetitivesMomo SyllaPas encore d'évaluation
- M. Ibrahima CISSE: Titre de ThèseDocument91 pagesM. Ibrahima CISSE: Titre de Thèsekatimere GastonPas encore d'évaluation
- These: Appendicite Aiguë, Aspects Diagnostic Et Thérapeutique Au CS Réf de OuéléssébougouDocument81 pagesThese: Appendicite Aiguë, Aspects Diagnostic Et Thérapeutique Au CS Réf de OuéléssébougouNasrallah AhlamPas encore d'évaluation
- 18M199Document110 pages18M199ayalefradaPas encore d'évaluation
- Evaluation Des Infections Parasitaires Dans Le Village de Kalifabougou: MaliDocument102 pagesEvaluation Des Infections Parasitaires Dans Le Village de Kalifabougou: Maliawafaye0310Pas encore d'évaluation
- Thèse de Docteur en MédecineDocument102 pagesThèse de Docteur en MédecineYacouba DembelePas encore d'évaluation
- Memoire Des DR Fatoumata MaigaDocument66 pagesMemoire Des DR Fatoumata MaigaDalila Miloud-AbidPas encore d'évaluation
- 15M147 PDFDocument139 pages15M147 PDFWilson BentoPas encore d'évaluation
- Faculté de Médecine, Et: d'Odonto-Stomatologie (FMOS)Document81 pagesFaculté de Médecine, Et: d'Odonto-Stomatologie (FMOS)monijeviaPas encore d'évaluation
- THESE CHEICKNA Corrige 18-10-23.Document125 pagesTHESE CHEICKNA Corrige 18-10-23.cheicknadoukara87Pas encore d'évaluation
- UntitledDocument121 pagesUntitledMahefa Serge RakotozafyPas encore d'évaluation
- These de Medecine These de MedecineDocument81 pagesThese de Medecine These de Medecineedgar kaderPas encore d'évaluation
- Memoire Fini Le 02.10.22Document176 pagesMemoire Fini Le 02.10.22Aya ZemaliPas encore d'évaluation
- Les Etiologies Des Adenopathies Dans Le Service de Medecine Interne Du Chu Point GDocument81 pagesLes Etiologies Des Adenopathies Dans Le Service de Medecine Interne Du Chu Point GKoké Lamine TraoréPas encore d'évaluation
- Etude de Facteurs Influençant La Qualite de La PDFDocument96 pagesEtude de Facteurs Influençant La Qualite de La PDFAndré SOMEPas encore d'évaluation
- Seroprevalence Et Caracteristiques Immuno-Virologiques Du VHB Chez Des Personnes Vivant Avec Le Vih Au Cesac de BamakoDocument91 pagesSeroprevalence Et Caracteristiques Immuno-Virologiques Du VHB Chez Des Personnes Vivant Avec Le Vih Au Cesac de BamakoCliff Daniel DIANZOLE MOUNKANAPas encore d'évaluation
- Approvisionnement, Consommation de L'eau Potable Et Assainissement en Commune I Du District de Bamako: Le Cas de Bankoni Et de DjélibougouDocument80 pagesApprovisionnement, Consommation de L'eau Potable Et Assainissement en Commune I Du District de Bamako: Le Cas de Bankoni Et de DjélibougourabaatliliPas encore d'évaluation
- Etude de La Coinfection Vih - BK Au CentreDocument101 pagesEtude de La Coinfection Vih - BK Au Centretaty mintaPas encore d'évaluation
- Par M. Adama KONE: Présentée Et Soutenue Publiquement Le... / / 2018 Devant La Faculté de Pharmacie Du MaliDocument99 pagesPar M. Adama KONE: Présentée Et Soutenue Publiquement Le... / / 2018 Devant La Faculté de Pharmacie Du MaliAminata DoumbiaPas encore d'évaluation
- 14P32 PDFDocument69 pages14P32 PDFAnonymous KasgItFPas encore d'évaluation
- Faye ThesisDocument155 pagesFaye ThesisDaouda FirstPas encore d'évaluation
- 05M68Document78 pages05M68Audric-aiméZambiPas encore d'évaluation
- 06M295Document85 pages06M295amédée junior wawaPas encore d'évaluation
- Président: Professeur Mamadou Souncalo TRAORE Membres: Professeur Alassane DICKO Professeur Mouctar DIALLO Directeur: Professeur Abdoulaye DABODocument103 pagesPrésident: Professeur Mamadou Souncalo TRAORE Membres: Professeur Alassane DICKO Professeur Mouctar DIALLO Directeur: Professeur Abdoulaye DABOKantéPas encore d'évaluation
- These: Faculte de Medecine, de Pharmacie Et D'Odonto-StomatologieDocument82 pagesThese: Faculte de Medecine, de Pharmacie Et D'Odonto-Stomatologieangenicanor7Pas encore d'évaluation
- Propriété Cicatrisante Des Feuilles de Opilia: Celtidifolia (Document109 pagesPropriété Cicatrisante Des Feuilles de Opilia: Celtidifolia (Aminata DoumbiaPas encore d'évaluation
- Contrôle de Qualité Et Dissolution Comparée de Combinaisons À Doses Fixes D'artemether Lumefantrine Commercialisées Au BeninDocument165 pagesContrôle de Qualité Et Dissolution Comparée de Combinaisons À Doses Fixes D'artemether Lumefantrine Commercialisées Au BeninMakiath ADEBOPas encore d'évaluation
- Etude Phytochimique PDFDocument112 pagesEtude Phytochimique PDFRmjulienPas encore d'évaluation
- 19P66 PDFDocument113 pages19P66 PDFMarc Tokou LabitePas encore d'évaluation
- D Sidibé, Palu Kalifabg CscomDocument70 pagesD Sidibé, Palu Kalifabg CscomYacouba DembelePas encore d'évaluation
- Insuffisance Renale Aigue en Reanimation: Facteurs Etiologiques Et PronostiquesDocument98 pagesInsuffisance Renale Aigue en Reanimation: Facteurs Etiologiques Et PronostiquesNoadia RafararisonPas encore d'évaluation
- Evaluation Des Activités D'hématologie Au Service de Médecine Et D'endocrinologie de L'hôpital Du MaliDocument78 pagesEvaluation Des Activités D'hématologie Au Service de Médecine Et D'endocrinologie de L'hôpital Du MaliBalayira Bakary100% (1)
- UntitledDocument304 pagesUntitledSo KadPas encore d'évaluation
- Memoire - Evaluation de La Technique ELISADocument174 pagesMemoire - Evaluation de La Technique ELISASofiane GHEFFARPas encore d'évaluation
- 10M355Document67 pages10M355Mahmoud Mohamed IbrahimPas encore d'évaluation
- Cap PF BamakoDocument86 pagesCap PF Bamakodamien cyrPas encore d'évaluation
- MaliDocument140 pagesMaliYa-Dioubane GuèyePas encore d'évaluation
- Rupture Uterine A L'Hopital Somine Dolo de Mopti de Janvier 2006 - Decembre 2007Document118 pagesRupture Uterine A L'Hopital Somine Dolo de Mopti de Janvier 2006 - Decembre 2007Stand KaswingkawelPas encore d'évaluation
- DR A.Mekkid Mlle Mericha Chaimaa Mr. Amarouche Yuva Mlle Oumahammed Fatma Mlle Si Ahmed GhaniaDocument159 pagesDR A.Mekkid Mlle Mericha Chaimaa Mr. Amarouche Yuva Mlle Oumahammed Fatma Mlle Si Ahmed GhaniaProducteur ShowPas encore d'évaluation
- Du drame à la résilience: Justice pour mon père, Vérité pour les citoyensD'EverandDu drame à la résilience: Justice pour mon père, Vérité pour les citoyensPas encore d'évaluation
- Exercice D 'Entrainement: Diagramme MGFDocument2 pagesExercice D 'Entrainement: Diagramme MGFDiallo SafaiouPas encore d'évaluation
- Examen smc3 - 2016-17 NormalDocument2 pagesExamen smc3 - 2016-17 NormalDiallo SafaiouPas encore d'évaluation
- G. Composé Ionique:: AboutisDocument5 pagesG. Composé Ionique:: AboutisDiallo SafaiouPas encore d'évaluation
- LC13 - Acides Et Bases (Lycée) : Niveau: TS BibliographieDocument13 pagesLC13 - Acides Et Bases (Lycée) : Niveau: TS BibliographieDiallo SafaiouPas encore d'évaluation
- Et Si Je Vous Disais Que Vous Pourriez Récupérer Votre Copine Ou Votre Femme en 30 JoursDocument8 pagesEt Si Je Vous Disais Que Vous Pourriez Récupérer Votre Copine Ou Votre Femme en 30 JoursDiallo SafaiouPas encore d'évaluation
- Binder Brochure CHIM 2018 19Document61 pagesBinder Brochure CHIM 2018 19Diallo SafaiouPas encore d'évaluation
- Ch3 Relation Entre QP QVDocument2 pagesCh3 Relation Entre QP QVDiallo Safaiou100% (1)
- Bourses Ambassade de France 2019Document2 pagesBourses Ambassade de France 2019Diallo SafaiouPas encore d'évaluation
- Ces Doux HaiDocument26 pagesCes Doux HaiDiallo SafaiouPas encore d'évaluation
- IMM5690FDocument4 pagesIMM5690FDiallo SafaiouPas encore d'évaluation
- 7 Infos Insoupçonnées Sur Le PénisDocument7 pages7 Infos Insoupçonnées Sur Le PénisDiallo SafaiouPas encore d'évaluation
- Chapitre II - Tension Alternative Périodique - Physique-Chimie Au CollègeDocument17 pagesChapitre II - Tension Alternative Périodique - Physique-Chimie Au CollègeDiallo Safaiou100% (1)
- Syndrome Coronarien Aigu ST+ (Infarctus Du Myocarde)Document9 pagesSyndrome Coronarien Aigu ST+ (Infarctus Du Myocarde)Mahefa Serge RakotozafyPas encore d'évaluation
- Pression Artt Rielle Et R GulationDocument2 pagesPression Artt Rielle Et R GulationBabacar NdiayePas encore d'évaluation
- Cas CliniqueDocument10 pagesCas CliniqueLuc TiendrebeogoPas encore d'évaluation
- Élévation Baisse: Au Moins SupérieureDocument29 pagesÉlévation Baisse: Au Moins SupérieureNour El HoudaPas encore d'évaluation
- Fms 2018 03329Document8 pagesFms 2018 03329Michaël KlattPas encore d'évaluation
- Cours Ecg.Document107 pagesCours Ecg.Aliou MaigaPas encore d'évaluation
- La Tension Artérielle Et Ses Valeurs Expliquées Simplement HirslandenDocument1 pageLa Tension Artérielle Et Ses Valeurs Expliquées Simplement HirslandenAlexandros GiPas encore d'évaluation
- Choc Hypovolémique Et Hémorragique PDFDocument9 pagesChoc Hypovolémique Et Hémorragique PDFJulien CoguicPas encore d'évaluation
- 01-02 2020 Les Séquences FLAIR Et T2gre en 90 MinutesDocument107 pages01-02 2020 Les Séquences FLAIR Et T2gre en 90 MinutesImounan FatimaPas encore d'évaluation
- Critères D'arret D'une Épreuve D'effortDocument9 pagesCritères D'arret D'une Épreuve D'effortazdimamalPas encore d'évaluation
- 7 - Les Antihypertenseurs CentrauxDocument7 pages7 - Les Antihypertenseurs CentrauxandriePas encore d'évaluation
- Hypertension ArterielleDocument24 pagesHypertension ArterielleCarlaPas encore d'évaluation
- Mazoit 2013Document7 pagesMazoit 2013dana40018256Pas encore d'évaluation
- 228 Douleur Thoracique Aiguë Et Chronique - 0Document2 pages228 Douleur Thoracique Aiguë Et Chronique - 0Abderraouf BenzianePas encore d'évaluation
- Les Gènes Codant Les Mécanismes Pour La Morphogénèse Du CoeurDocument2 pagesLes Gènes Codant Les Mécanismes Pour La Morphogénèse Du CoeurJerry Cliff Paillant100% (1)
- Cœur Artificiel: Lycée: Naimi Naimi Année Scolaire: 2022/2023Document3 pagesCœur Artificiel: Lycée: Naimi Naimi Année Scolaire: 2022/2023Sinaa KristinePas encore d'évaluation
- 1-Regulation Du Débit CardiaqueDocument4 pages1-Regulation Du Débit CardiaqueSedar DioufPas encore d'évaluation
- ECG NormalDocument2 pagesECG NormalNådjeet Mouñïâ100% (1)
- Sysmteme AdrenergiqueDocument8 pagesSysmteme AdrenergiqueDaouda BoréPas encore d'évaluation
- 44.ineas Hta - 2021Document120 pages44.ineas Hta - 2021Malek AmriPas encore d'évaluation
- Plaie Du CoeurDocument31 pagesPlaie Du CoeurWilfried AboPas encore d'évaluation
- Formation RC - DEADocument29 pagesFormation RC - DEAishak gmPas encore d'évaluation
- Antiangineux - Les Points EssentielsDocument7 pagesAntiangineux - Les Points EssentielsAYOUB BAYADDIPas encore d'évaluation
- Examen Cardio VasculaireDocument38 pagesExamen Cardio VasculaireDabija NataliaPas encore d'évaluation
- Ca CliniqueDocument10 pagesCa CliniqueGabrielle NnomoPas encore d'évaluation