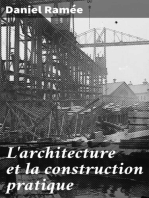Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Fondations 12
Fondations 12
Transféré par
Hamza AbidiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Fondations 12
Fondations 12
Transféré par
Hamza AbidiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chapitre 12 Les fondations
LES FONDATIONS
I. Définition
Les fondations d’une construction sont constituées par les parties de l’ouvrage qui sont en contact avec le
sol auquel elles transmettent les charges de la superstructure ; elles constituent donc la partie essentielle de
l’ouvrage. Puisque de leurs bonnes conception et réalisation découle la bonne tenue de l’ensemble
Les éléments de fondations transmettent les charges au sol, soit directement (cas des semelles
reposant sur le sol ou cas des radiers), soit par l’intermédiaire d’autres organes (cas des semelles sur pieux).
Lorsque les couches de terrain susceptibles de supporter l’ouvrage sont à une faible profondeur, on
réalise des fondations superficielles (le sujet de notre leçon); Lorsque ces couches sont à une grande
profondeur, on réalise des fondations profondes.
Fondations superficielles
Les fondations superficielles sont des fondations dont la profondeur n’excède pas en général 2 à 3 mètres ;
on distingue :
Les fondations fonctionnelles, constituées des semelles isolées sous poteaux. Les fondations
linéaires, constitués par des semelles filantes sous poteaux ou murs. Les fondations surfaciques,
constituées par des radiers sous poteaux ou murs.
1 .Le radier général
C’est une dalle épaisse en maçonnerie ou en béton posée sur le sol. Les fondations en radier sont
employées lorsque les charges du bâtiment sont si importantes et la résistance du sol est si faible que
semelles superficielles couvriraient plus de la moitié de la surface de construction. Un radier est une
dalle en béton, armée fortement avec de l'acier, qui supporte les charges unitaires des poteaux et des
murs. Ainsi la charge transmise par unité de surface au sol sous-jacent reste faible et se répartit sur
toute la surface. Dans le cas de grands radiers supportant de lourdes structures, les charges sont
distribuées de manière encore plus uniforme, grâce à des fondations supplémentaires et des murs de
refend, qui renforcent le radier.
Figure 1 : Radier général
Cours béton armé 103 Mohsen Ati
Mohamed Issam Affes
Chapitre 12 Les fondations
2.Les semelles superficielles
Ce sont les fondations les plus répandues dans le bâtiment. Il existe les semelles filantes (sous les
murs porteurs et les voiles) et les semelles isolées (sous poteau).
On associe généralement du gros béton (dosé à 250 kg/m3) de résistance supérieure au sol, aux
semelles pour réduire le coffrage ce celles-ci (gain de matériaux). Pour éviter la pollution du béton de la
fondation par le sol et pour offrir une bonne surface d’appui, on met une couche de béton maigre de
dosage minimal de 150 kg/m3 qui sera appelé béton de propreté. Eventuellement on dispose d’une
couche de sable au fond de la fouille.
Le dimensionnement des semelles dépend de la contrainte admissible du sol calculée par la compagne
géotechnique.
On a qu = valeur ultime de la réaction du sol = ; la contrainte de calcul q = ½ qu
Nature du sol q en [MPa]
Roches peu fissurées saines non désagrégée et
0,75 4,5
stratification favorable
Terrains non cohérents à bonne compacité 0,35 0,75
Terrains non cohérents à compacité moyenne 0,2 0,4
Argiles 0,1 0,3
Tableau 1 : contrainte de calcul en fonction de la nature du sol
Pour le dimensionnement des semelles, il faut qu’elles soient rigides
Une semelle est considérée comme rigide si
On ne prend jamais une hauteur inférieure à 15 cm. Les petites semelles sur terrain très résistant ou peu
chargé auront une hauteur de 15 cm.
La hauteur de rive h’ des semelles trapézoïdales est de 10 à 20 cm.
Dans le cas ou le mur qui surmonte la semelle est en béton banché, il est bon de réserver en tête de la
semelle une sur largeur de 5 cm pour faciliter la pose des coffrages.
Les semelles reposent toujours sur une couche de béton de propreté de 5 à 10 cm d’épaisseur
dosé à 150 Kg/m3.
Cours béton armé 104 Mohsen Ati
Mohamed Issam Affes
Chapitre 12 Les fondations
Le diagramme de répartition des contraintes normales (pressions) au contact sol semelle dépend à la fois
de la rigidité de la semelle et de la nature du sol (pulvérulent , cohérent, non rocheux ou rocheux).
Diverses études ont été réalisées , par des moyens théoriques et expérimentaux , on peut admettre dans les
calculs les répartitions suivantes :
Sols rocheux semelle rigide : diagramme bi-triangulaire qu=2.P/B
semelle flexible : diagramme rectangulaire qu =P/B
Sols cohérents dans tous les cas diagramme rectangulaire q u =P/B
Sols pulvérulents semelle rigide : : diagramme rectangulaire qu =P/B
semelle flexible diagramme triangulaire qu =2.P/B
P : charge totale par mètre linéaire.
qu : Contrainte admissible au sol.
B : grande côté de la semelle.
II. SEMELLE SOUMISE À UN EFFORT NORMAL CENTRE
a) Semelle isolée
Avec :
Nu = Effort normal ultime agissant sur la semelle
= 1.35NG+1.5NQ
NG = Charges permanentes ; NQ = Charges Variables
PPS = poids propre de la semelle de fondation
S = Surface de contact entre la fondation et le sol
Figure 2
Cours béton armé 105 Mohsen Ati
Mohamed Issam Affes
Chapitre 12 Les fondations
Charges des semelles
L’état limite ultime de résistance vis-à-vis du sol est satisfait si :
p≤q
Méthode des bielles (pour un effort centré) :
Figure 3 : Dimensions et armatures d’une semelle
On en déduit l’expression de la surface minimale de la semelle :
Smin = Nu/ q ; Smin = Amin x Bmin et a/b = Amin/Bmin
Amin = Bmin x a/b
Smin = Bmin² x a/b
D’où :
La hauteur de la semelle :
avec : d = h - 5cm
Cours béton armé 106 Mohsen Ati
Mohamed Issam Affes
Chapitre 12 Les fondations
avec : poids volumique du béton = 25 kN/m 3
Si qeffective n’est pas vérifiée (qeffective>q) il faut redimensionner la semelle afin qu’elle puisse être supportée
par le sol support (augmenter A et B).
Les dimensions des armatures sont :
da=h-c-Æ/2 ; db =h-c-Æ-Æ/2
Ces armatures s’étendent, dans chaque direction jusqu’aux extrémités de la semelle et sont ou non munies
de crochets en comparant les longueurs de scellement à A et B. Pour déterminer la longueur des barres et
leur mode d'ancrage , on calcule la longueur de scellement .
Longueurs de scellement : Valeurs de ls/Æ
Fc28(MPa) 16 18 20 22 25 30 40 50 60
FeE215 57.4 53.3 49.8 46.7 42.7 37.3 29.9 28.9 21.3
FeE400 47.5 44.1 41.2 38.6 35.3 30.9 24.7 20.6 17.6
avec :
tsu=0.6Ys².ft28 ; Ys=1(RL) ; Ys=1.5(HA) ; ft28=0.6+0.06fc28 .
Si Ls > B/4 , toutes les barres doivent être prolongées jusqu’aux extrémités de la semelle et comporter des
ancrages courbes.
Si B/8< Ls £ B/4 , toutes les barres doivent être prolongées jusqu’aux extrémités de la semelle , mais
peuvent ne pas comporter de crochets.
Si Ls £ B/8 , les barres ne comportent pas de crochets et on peut arrêter une barre sur deux à 0.71 B ou
alterner des barres de 0.86 B
Cours béton armé 107 Mohsen Ati
Mohamed Issam Affes
Chapitre 12 Les fondations
0.86 B
0.71 B
L’enrobage minimal des aciers doit vérifier les conditions suivantes :
Figure 4 : Enrobage
minimal des armatures
Ensuite il faut vérifier la condition de non poinçonnement de la semelle :
Figure 5 : poinçonnement d’une semelle
h’ = épaisseur de la semelle à h/2 du nu du poteau
Cours béton armé 108 Mohsen Ati
Mohamed Issam Affes
Chapitre 12 Les fondations
b) Les semelles continues :
La semelle peut être plus ou moins rigide, pleine ou évidée. Elle est surmontée par une poutre de rigidité qui
répartit les efforts concentrés transmis par les poteaux.
La poutre peut être de hauteur constante ou munies de goussets. L’exécution des goussets rend la semelle
plus économique en matériaux mais plus coûteuse en coffrage.
Le dimensionnement se fait de la même manière qu’une semelle isolée de dimension (B X 1mètre de
largeur).
;
ACIERS DE REPARTITION (Ar) :
Les armatures principales seront complétées par des aciers longitudinaux de répartition dont la section totale
sur la largeur B sera Ar= As .B/4
Lorsqu’on utilise la méthode des bielles il n’y a pas lieu de vérifier la compression du béton, ni de prévoir
d’armatures transversales pour équilibrer l’effort tranchant.
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Le pourcentage minimal d’armatures est As=b.h.ftj/fe
Remarque : dans le cas d’une répartition bi-triangulaire des contraintes (sur rocher ou béton).
Cours béton armé 109 Mohsen Ati
Mohamed Issam Affes
Vous aimerez peut-être aussi
- 1generalites Fonctionnement Chaussees Cours Routes Procedes Generaux de ConstructionDocument8 pages1generalites Fonctionnement Chaussees Cours Routes Procedes Generaux de Construction김희수100% (1)
- Cours Sur Les Fondations PDF 1711892097Document7 pagesCours Sur Les Fondations PDF 1711892097Mamadou NdongoPas encore d'évaluation
- 4 Cours Ccsba Fondation SuperficielleDocument16 pages4 Cours Ccsba Fondation SuperficielleRami ZekriPas encore d'évaluation
- Les Fondations SuperficiellesDocument12 pagesLes Fondations SuperficiellesAmani MansarPas encore d'évaluation
- semellesFONDATIONS L3Document32 pagessemellesFONDATIONS L3maevayao22425Pas encore d'évaluation
- Chap.1 Fond - SuperficiellesDocument38 pagesChap.1 Fond - Superficiellesimad ArsPas encore d'évaluation
- Structure en BA II (M1 Structure) S2 - Les FondationsDocument26 pagesStructure en BA II (M1 Structure) S2 - Les FondationsBousselba lidya malakPas encore d'évaluation
- Les Fondations Partie1Document8 pagesLes Fondations Partie1Zikows ChakirPas encore d'évaluation
- Fondation 1 SEMELLE FILANTE Sous MurDocument9 pagesFondation 1 SEMELLE FILANTE Sous MurChiraz hanane Kebaili100% (1)
- Polycopié BAEL 2 Chap 4Document13 pagesPolycopié BAEL 2 Chap 4anass benzPas encore d'évaluation
- Cours BAEL 21Document33 pagesCours BAEL 21rokiPas encore d'évaluation
- Cours Fondations CARRIAT Radiers Procedes Generaux de ConstructionDocument11 pagesCours Fondations CARRIAT Radiers Procedes Generaux de ConstructionAhmed BenabdelkaderPas encore d'évaluation
- Power PointDocument51 pagesPower PointGROUPE 4 GEGMPas encore d'évaluation
- 2 Calcul Des Fondations ISOLEEDocument50 pages2 Calcul Des Fondations ISOLEEaminePas encore d'évaluation
- Fondations SuperficiellesDocument74 pagesFondations Superficiellesbahahmed199Pas encore d'évaluation
- Résumé Sur Les Murs de RetenueDocument6 pagesRésumé Sur Les Murs de RetenueAbd Errahmane OuainiPas encore d'évaluation
- Tassements Immediat Et de ConsolidationDocument10 pagesTassements Immediat Et de ConsolidationTa RekPas encore d'évaluation
- 04 - Planchers Et DallesDocument22 pages04 - Planchers Et Dallesimad ArsPas encore d'évaluation
- Chapitre Iii Les FondationsDocument23 pagesChapitre Iii Les FondationshansdevisdjimelinawaPas encore d'évaluation
- Fondations01 130909033342Document58 pagesFondations01 130909033342عثمان البريشيPas encore d'évaluation
- Fondations Superficielles - NSDocument130 pagesFondations Superficielles - NSAly Ouedry100% (1)
- CH4 Fondapro 1Document28 pagesCH4 Fondapro 1cyril ASSYPas encore d'évaluation
- FondationsDocument25 pagesFondationskhalifa sbaiPas encore d'évaluation
- PORTANCE DU SOLpdf2 PDFDocument27 pagesPORTANCE DU SOLpdf2 PDFOlga Mugangu100% (1)
- Chapitre XIII Etude de L'infrastructureDocument44 pagesChapitre XIII Etude de L'infrastructureAmin ZawiPas encore d'évaluation
- Murs de Soutenement 20-21Document7 pagesMurs de Soutenement 20-21Djojo SmilePas encore d'évaluation
- Le CoursDocument12 pagesLe CoursZemali OmarPas encore d'évaluation
- Les Fondations 2Document47 pagesLes Fondations 2Ly ricsPas encore d'évaluation
- Fondations 130514073639 Phpapp01Document58 pagesFondations 130514073639 Phpapp01Mohamed BensoulaPas encore d'évaluation
- 4 Cours Ccsba Fondation SuperficielleDocument16 pages4 Cours Ccsba Fondation SuperficielleQuentin Bindzi100% (1)
- Les Fondations en Beton ArmeDocument12 pagesLes Fondations en Beton ArmeAkym DalisienPas encore d'évaluation
- Chap2 ROUTE IIDocument45 pagesChap2 ROUTE IIMoussa Toe100% (1)
- MV - Chapitre 8 FondationsDocument56 pagesMV - Chapitre 8 FondationsPierre MonchaninPas encore d'évaluation
- Projet MeftehDocument15 pagesProjet Meftehabdikamel1998Pas encore d'évaluation
- Calcul Des Fondations SuperficiellesDocument23 pagesCalcul Des Fondations Superficielleshudson100% (1)
- Synthèse - Semelle FilantesDocument7 pagesSynthèse - Semelle FilantesBensmain HamzaPas encore d'évaluation
- 03 Corrige 3Document7 pages03 Corrige 3حمزة شافيPas encore d'évaluation
- FondationsDocument9 pagesFondationskjPas encore d'évaluation
- Ch5 Semelles de FondationsDocument16 pagesCh5 Semelles de Fondationssouka100% (1)
- PieuxDocument5 pagesPieuxmtssofienePas encore d'évaluation
- 6-Fondations SuperficiellesDocument26 pages6-Fondations SuperficiellesSerigne Abdoul Aziz MbodjPas encore d'évaluation
- Les PieuxDocument15 pagesLes PieuxREDA100% (1)
- 2 Calcul Des Fondations ISOLEEDocument48 pages2 Calcul Des Fondations ISOLEEaminePas encore d'évaluation
- Chapitre I - Les Fondations PDFDocument13 pagesChapitre I - Les Fondations PDFsoltanePas encore d'évaluation
- Les RadiersDocument9 pagesLes RadiersCivil AbdouPas encore d'évaluation
- Dokumen - Tips Fondations-SuiteDocument42 pagesDokumen - Tips Fondations-SuiteHaithem NessPas encore d'évaluation
- Cours - Fondations SuperficiellesDocument5 pagesCours - Fondations SuperficiellesAhlam RAPas encore d'évaluation
- Fondations Des BâtimentsDocument25 pagesFondations Des BâtimentsKerby Pierre LouisPas encore d'évaluation
- Cours 2 FonctionnementDocument47 pagesCours 2 FonctionnementAhmadPas encore d'évaluation
- Chapitre 02 - Caractéristiques Des ChausséesDocument13 pagesChapitre 02 - Caractéristiques Des Chausséessami nasrPas encore d'évaluation
- Chapitre 6Document12 pagesChapitre 6bn000010Pas encore d'évaluation
- Fondation SuperficielleDocument8 pagesFondation SuperficiellechaymaPas encore d'évaluation
- Ferraillage Et Etude VoileDocument10 pagesFerraillage Et Etude VoileHammadi TaharPas encore d'évaluation
- 1generalites Fonctionnement ChausseesDocument8 pages1generalites Fonctionnement ChausseesThierry TchallaPas encore d'évaluation
- Fondations Superficielles Dimensionnement PDFDocument4 pagesFondations Superficielles Dimensionnement PDFGuillaumeHNOPas encore d'évaluation
- L'architecture et la construction pratique: Mise à la portée des gens du monde, des élèves et de tous ceux qui veulent faire bâtirD'EverandL'architecture et la construction pratique: Mise à la portée des gens du monde, des élèves et de tous ceux qui veulent faire bâtirPas encore d'évaluation
- Flexion Simple8Document22 pagesFlexion Simple8Hamza AbidiPas encore d'évaluation
- Caract - Ristique Des Mat - Riaux 2Document8 pagesCaract - Ristique Des Mat - Riaux 2Hamza AbidiPas encore d'évaluation
- Association Acier4Document9 pagesAssociation Acier4Hamza AbidiPas encore d'évaluation
- Semelle Sur 3 PieuxDocument3 pagesSemelle Sur 3 PieuxHamza AbidiPas encore d'évaluation
- Chap2 BAI Bases Calcul BAELDocument48 pagesChap2 BAI Bases Calcul BAELHamza AbidiPas encore d'évaluation
- Journal 0932022Document14 pagesJournal 0932022Hamza AbidiPas encore d'évaluation
- Exemple Corrig+® - Chap4Document10 pagesExemple Corrig+® - Chap4mahdouchfkiPas encore d'évaluation
- TP RouteDocument37 pagesTP RouteHamza AbidiPas encore d'évaluation
- Les Dalles Rectangulaires13Document8 pagesLes Dalles Rectangulaires13Hamza AbidiPas encore d'évaluation
- l1 Seg Math II Serie Corrigee N 1 Calcul MatricielDocument8 pagesl1 Seg Math II Serie Corrigee N 1 Calcul MatricielHamza Abidi100% (1)
- Methode de CaquotDocument7 pagesMethode de CaquotHamza Abidi75% (4)
- 4x (4x3)Document12 pages4x (4x3)Mohamed BayoudhPas encore d'évaluation
- Cahier Des Charges PDFDocument59 pagesCahier Des Charges PDFToto Hamimid88% (8)
- GILVA Catalogo - 2009 PDFDocument32 pagesGILVA Catalogo - 2009 PDFJuan Manuel LandeoPas encore d'évaluation
- Dimensionnement de La Dalle Hypothèses: Mode de Calcul: Plancher CollaborantDocument6 pagesDimensionnement de La Dalle Hypothèses: Mode de Calcul: Plancher CollaborantAbdellah ChougraniPas encore d'évaluation
- Conduite de Projet - Myriam Migliore - 2eme Partie PDFDocument53 pagesConduite de Projet - Myriam Migliore - 2eme Partie PDFMariem Trojette100% (1)
- NervureDocument1 pageNervureSAVE ALGERIAPas encore d'évaluation
- Agrement 05 2007Document16 pagesAgrement 05 2007Mostapha Genie CivilPas encore d'évaluation
- Aodex 2 22022024-163350Document2 pagesAodex 2 22022024-163350jacques martial ndindjockPas encore d'évaluation
- Calcul Des Structures - EC2Document5 pagesCalcul Des Structures - EC2AvoPas encore d'évaluation
- EUIBP454377087Document8 pagesEUIBP454377087bkeutchayaPas encore d'évaluation
- Dimensionner Une Poutrefff04101Document4 pagesDimensionner Une Poutrefff04101amanita27Pas encore d'évaluation
- 04 Pont Endommagement Modele NumeriqueDocument35 pages04 Pont Endommagement Modele NumeriqueFouad KehilaPas encore d'évaluation
- Aa Tsti2d3Document28 pagesAa Tsti2d3gPas encore d'évaluation
- Cour Connaissance Des Matériaux 3 Ème Année Maco GCDocument11 pagesCour Connaissance Des Matériaux 3 Ème Année Maco GCBayi100% (2)
- Rapport de Stage - Amani - MansarDocument24 pagesRapport de Stage - Amani - MansarAmani MansarPas encore d'évaluation
- BEL5452Document115 pagesBEL5452benben35Pas encore d'évaluation
- RDM Chap 5Document21 pagesRDM Chap 5Thony LikengPas encore d'évaluation
- Differences Ec2/baelDocument19 pagesDifferences Ec2/baelMoctar IdoumouPas encore d'évaluation
- Esdep: Construction MixteDocument21 pagesEsdep: Construction MixteThouleija AyachiPas encore d'évaluation
- Projet de Topographie 2009Document19 pagesProjet de Topographie 2009Hanane BenGamraPas encore d'évaluation
- PFE - Réalisation D'une Adduction GravitaireDocument121 pagesPFE - Réalisation D'une Adduction GravitaireLmahfoudPas encore d'évaluation
- Rapports SDFDocument19 pagesRapports SDFAmouhane MohamedPas encore d'évaluation
- 9 La Surete de FonctionnementDocument46 pages9 La Surete de FonctionnementKadri MongiPas encore d'évaluation
- Exposamdec 151213175143Document33 pagesExposamdec 151213175143YounessElkarkouriPas encore d'évaluation
- Nikiema Wilfried Nicaise Natabzanga Armel PDFDocument91 pagesNikiema Wilfried Nicaise Natabzanga Armel PDFclaudePas encore d'évaluation
- Programmation de Commande Numérique - WikipédiaDocument14 pagesProgrammation de Commande Numérique - WikipédianonoPas encore d'évaluation
- Mecanique Applique2Document1 pageMecanique Applique2Loïc Tchouyandja100% (1)
- cv-TAHRAOUI Ahmed AmineDocument1 pagecv-TAHRAOUI Ahmed Amineahmed tahraouiPas encore d'évaluation
- Défauts Apparents Des Ouvrages D'art en BétonDocument72 pagesDéfauts Apparents Des Ouvrages D'art en BétonweuzscribdPas encore d'évaluation
- 52 ESO SGE GEN 0005 C Robinetterie Et AccessoiresDocument36 pages52 ESO SGE GEN 0005 C Robinetterie Et Accessoirescedric sohierPas encore d'évaluation