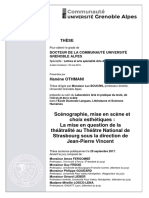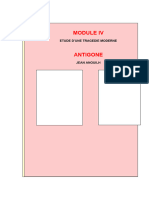Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
3 Les Fonctions de La Tragédie
3 Les Fonctions de La Tragédie
Transféré par
hindTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
3 Les Fonctions de La Tragédie
3 Les Fonctions de La Tragédie
Transféré par
hindDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les fonctions de la tragédie1
a) Fonction religieuse :
La représentation théâtrale, et en particulier tragique, était liée à la vie
religieuse : même si la tragédie n’est pas issue du culte de Dionysos, il y a été
très tôt associé. Les représentations avaient lieu pendant les fêtes en l’honneur
de Dionysos, les Lénéennes en janvier et surtout les grandes Dionysies en mars ;
elles avaient lieu près du Lénéon, le sanctuaire de Dionysos, en présence de la
statue du dieu. D’autre part, la source d’inspiration est bien souvent religieuse,
les grands mythes, et les poètes, selon leur sensibilité, montrent la puissance
redoutable des dieux, ou la réconciliation entre les hommes et les divinités.
b) Fonction cathartique :
Selon Aristote, la tragédie provoque une catharsis, une purification ou
purgation des passions. En assistant à un spectacle, l’individu ressentirait une
sympathie (au sens de souffrir avec) avec le personnage, sympathie qui ferait
naître pitié et peur, mais qui en extériorisant les sentiments permettrait de s’en
purifier, de s’en débarrasser. L’homme serait alors libre de se consacrer à la cité.
c) Fonction civique :
Le théâtre athénien n’est pas un divertissement : c’est une véritable
institution publique, qui implique toute la cité collectivement.
L’organisation était faite par l’archonte, magistrat élu à la cité, et le financement
des pièces ou chorégie était assuré par les chorèges, à la façon d’un impôt. Les
citoyens pauvres qui assistaient aux représentations percevaient une indemnité,
le théorikon, leur permettant de payer leur jeton d’entrée : le théâtre était
l’affaire de tous, riches ou pauvres. Citoyens, métèques, étrangers étaient
présents, et il est vraisemblable que les femmes elles aussi assistaient aux
représentation ; seuls les esclaves n’avaient pas leur place au théâtre.
11
Gilliane Verhulst, étude sur Sophocle Antigone. Coll. Résonnances. Paris. 2002. Ellipses. PP.5-6.
Vous aimerez peut-être aussi
- Jacqueline de Romilly Sur La TragédieDocument1 pageJacqueline de Romilly Sur La TragédieΣωτήρης ΜαλικέντζοςPas encore d'évaluation
- Chap 4Document9 pagesChap 4BoulayPas encore d'évaluation
- Oedipe RoiDocument4 pagesOedipe RoiHenri SerradellPas encore d'évaluation
- 22-23 - 5ga - THT Antique - Questions Des ÉlèvesDocument5 pages22-23 - 5ga - THT Antique - Questions Des ÉlèveslolPas encore d'évaluation
- UrielDocument25 pagesUrielNTMPas encore d'évaluation
- Textes Essentiels GrecquesDocument35 pagesTextes Essentiels GrecquesGuillaume CastellaPas encore d'évaluation
- Theatre OccidentaleDocument7 pagesTheatre OccidentaleVictoria FerreiraPas encore d'évaluation
- 27 Le Theatre AntiqueDocument7 pages27 Le Theatre AntiqueAlexandre SchaffhauserPas encore d'évaluation
- Théâtre Grec AntiqueDocument5 pagesThéâtre Grec AntiqueGhislainPas encore d'évaluation
- Antigone Dossier D'etudes DouaeDocument25 pagesAntigone Dossier D'etudes Douaeayahemmich945Pas encore d'évaluation
- Histoire Du TheatreDocument4 pagesHistoire Du TheatrePhilippe BialadePas encore d'évaluation
- Introduction À L'art DramatiqueDocument5 pagesIntroduction À L'art DramatiqueAILAC Centre de FormationPas encore d'évaluation
- La Poesía Épica.Document3 pagesLa Poesía Épica.Choque Condori Lesly DanielaPas encore d'évaluation
- Le Théâtre - 2Document77 pagesLe Théâtre - 2manel kenafPas encore d'évaluation
- 1.SEMAINE 1-COURS 1 - Théâtre, Définitions, Origines, Évolution Et Caractéristiques - PR - fellAHIDocument6 pages1.SEMAINE 1-COURS 1 - Théâtre, Définitions, Origines, Évolution Et Caractéristiques - PR - fellAHIWissal Edf100% (1)
- Compte-Rendu HélèneDocument15 pagesCompte-Rendu HélèneAlice dlbPas encore d'évaluation
- TragédieDocument4 pagesTragédieYoussef Ait-ousarrahPas encore d'évaluation
- Brisson 'Origines'Document5 pagesBrisson 'Origines'Le ChartierPas encore d'évaluation
- TragédieDocument2 pagesTragédieoscar.mischPas encore d'évaluation
- Theatre - Fin Du Moyen ÂgeDocument31 pagesTheatre - Fin Du Moyen ÂgeEtidorfaPas encore d'évaluation
- Possession Ethiopiens GondarDocument111 pagesPossession Ethiopiens Gondarn-bannierPas encore d'évaluation
- Antigone ParatexteDocument2 pagesAntigone Paratexten2jw22n2jw271% (7)
- Theatre Et HistoireDocument20 pagesTheatre Et HistoirepascarucarmenflorinaPas encore d'évaluation
- 1 La Naissance de La Tragédie GrecqueDocument3 pages1 La Naissance de La Tragédie GrecquehindPas encore d'évaluation
- SatyrDocument1 pageSatyrolivierPas encore d'évaluation
- Les Muses Et La Poesie LyriqueDocument4 pagesLes Muses Et La Poesie LyriqueNouMPas encore d'évaluation
- SCENOGRAPHIEDocument526 pagesSCENOGRAPHIENathanaël OKITOPas encore d'évaluation
- Jean-Pierre Vernant - Aux Racines de L'homme Tragique (PDF)Document7 pagesJean-Pierre Vernant - Aux Racines de L'homme Tragique (PDF)api-3837574Pas encore d'évaluation
- 1925 Focillon - MagiciensDocument32 pages1925 Focillon - MagiciensLorennaFonsecaPas encore d'évaluation
- Le ThéâtreDocument15 pagesLe Théâtrezekrisoukaina815Pas encore d'évaluation
- Travantigonedalaahouda 240219211215 F36ea105Document6 pagesTravantigonedalaahouda 240219211215 F36ea105fatimazahrachamlal23Pas encore d'évaluation
- Fiche 1Document2 pagesFiche 1sarraMPas encore d'évaluation
- Bude 0004-5527 2009 Num 1 2 2341Document28 pagesBude 0004-5527 2009 Num 1 2 2341abdellahzineelabidine.prPas encore d'évaluation
- Fiche Pédagogique ANTIGONE NewDocument20 pagesFiche Pédagogique ANTIGONE NewJenani Mustapha0% (1)
- Definition MytheDocument6 pagesDefinition MytheprotesilauPas encore d'évaluation
- Exposé D'esthétique Sur L'artDocument4 pagesExposé D'esthétique Sur L'arthonoredebalzack1950Pas encore d'évaluation
- Conspecte - 2,3Document5 pagesConspecte - 2,3paul popPas encore d'évaluation
- Le Mythe de Vénus Par M. H. HignardDocument11 pagesLe Mythe de Vénus Par M. H. HignardNelson Dias CorrêaPas encore d'évaluation
- HadilDocument18 pagesHadildoha witPas encore d'évaluation
- Histoire Du Théâtre de Lantiquité Au XXème SiècleDocument4 pagesHistoire Du Théâtre de Lantiquité Au XXème SiècleAymane SemmidPas encore d'évaluation
- Scénographie CoursDocument11 pagesScénographie CoursJulien BourgoisPas encore d'évaluation
- Cours Sur Le ThéâtreDocument12 pagesCours Sur Le ThéâtreJulesPas encore d'évaluation
- Biancofiore, Médée, La Vengeance Du SacréDocument12 pagesBiancofiore, Médée, La Vengeance Du SacrépinoPas encore d'évaluation
- Mythologie GrecqueDocument55 pagesMythologie Grecquekankoumous009Pas encore d'évaluation
- Hakim Bey - L'Esthetique TongDocument5 pagesHakim Bey - L'Esthetique TonglaspheredenoosPas encore d'évaluation
- Antigone Analyse Projet Parfait KhalidDocument89 pagesAntigone Analyse Projet Parfait KhalidAzedine AchettouhPas encore d'évaluation
- Jouanno Mythe Et Allégorie Dans L Oeuvre de LucienDocument43 pagesJouanno Mythe Et Allégorie Dans L Oeuvre de LucienEzequiel RivasPas encore d'évaluation
- Book Reviews Vol 13Document49 pagesBook Reviews Vol 13SaidEtebbaiPas encore d'évaluation
- Tragédie (Séance À Vidéoprojeter)Document30 pagesTragédie (Séance À Vidéoprojeter)abramannabellePas encore d'évaluation
- 04-Le Recentrage Pornographique.Document8 pages04-Le Recentrage Pornographique.Aurélien MarionPas encore d'évaluation
- Initiation Aux Genres Dramatiques 2020-2021Document8 pagesInitiation Aux Genres Dramatiques 2020-2021inspiration by faty100% (2)
- CM Et TD 1 Le Théâtre Dans LantiquitéDocument4 pagesCM Et TD 1 Le Théâtre Dans LantiquitéChéryl RaffinPas encore d'évaluation
- Grands Mythes1Document2 pagesGrands Mythes1AdilKnight100% (1)
- Dossier TragedieDocument11 pagesDossier TragedieMilena TarziaPas encore d'évaluation
- Anagnorese & Catharsis Chez RacineDocument5 pagesAnagnorese & Catharsis Chez RacineEvaPas encore d'évaluation
- Oedipe BordelDocument199 pagesOedipe BordelConstantin LoukosPas encore d'évaluation
- Foulard Rouge Et Inquiã©tant Panier 2Document23 pagesFoulard Rouge Et Inquiã©tant Panier 2kongo serge kevinPas encore d'évaluation
- Entrée A L'oeuvre D'antigone BadrDocument3 pagesEntrée A L'oeuvre D'antigone BadrouerdjaaliPas encore d'évaluation
- Fiche Notion La TragedieDocument3 pagesFiche Notion La Tragediezenabumana19Pas encore d'évaluation