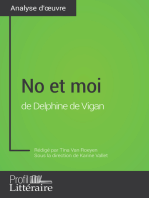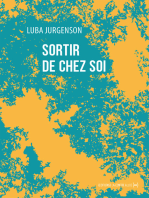Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Juste La Fin Du Monde
Juste La Fin Du Monde
Transféré par
cnvzf2xzj8Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Juste La Fin Du Monde
Juste La Fin Du Monde
Transféré par
cnvzf2xzj8Droits d'auteur :
Formats disponibles
“Juste la fin du monde” : quand taire, c’est faire aussi
En adaptant Juste la fin du monde, Xavier Dolan réussit le tour de force d’adapter au cinéma le style du
dramaturge Jean-Luc Lagarce et de montrer combien ne rien dire, c’est agir aussi.
« Il n’y a pas de parole perdue. » Répétée à l’envi, cette croyance a valeur de mantra. Xavier Dolan a-t-il
lui aussi cet adage en tête ? Après le dramaturge français Jean-Luc Lagarce, le cinéaste canadien prend à
son tour et à cœur cette conviction dont il ausculte la part maudite, le revers sombre : que se dit-il dans le
silence, mieux, dans l’absence ? Le réalisateur adapte Juste la fin du monde en montrant les effets de la seule
parole littéralement perdue : celle qui n’est pas dite, parce qu’elle est indicible. Qu’en conclure ? Que dire
ou ne pas dire, c’est toujours faire.
Jean-Luc Lagarce écrit cette pièce en 1990, alors qu’il se sait déjà atteint du sida. Son personnage
principal, Louis, est également dramaturge. À 34 ans, il retrouve sa famille après des années d’absence pour,
croit-il, annoncer sa mort prochaine. Mais sait-il lui-même vraiment la raison de ce retour ? Espère-t-il
solder ce qui reste de liens avec ses proches ? Ni Jean-Luc Lagarce ni Xavier Dolan dans l’adaptation de
cette pièce, n’en décident, attentifs à ménager plutôt l’espace vide qui permet ces « silences performatifs »,
comme on dit parfois des paroles.
On doit la théorie des performatifs – du verbe anglais to perform, « accomplir » – au britannique John L.
Austin. Avant lui, les philosophes considéraient globalement que toutes les propositions du langage
servaient à décrire un état du monde, de façon vraie ou erronée. Austin développe, dans l’essai posthume
intitulé en français Quand dire, c’est faire (Seuil, 1991), l’idée selon laquelle en prononçant certaines
formules (« je déclare la séance ouverte », par exemple) une action est accomplie. Il dresse la liste de ces
actions commises en parlant. Et en se taisant ? Austin ne s’aventure pas sur ce terrain, qui n’est pas le sien.
D’ailleurs, peut-on imaginer décrire analytiquement des qualités de silences ? Difficilement, sinon dans la
fiction. Telle est précisément l’hypothèse explorée, sans psychologisme, par Jean-Luc Lagarce et suivie par
Xavier Dolan : quand taire, c’est faire aussi.
Ni la mère, ni la sœur, ni le frère, ni la belle-sœur de Louis ne comprennent au juste ce qu’il fait là.
Parviendra-t-il à leur dire ? Toute l’attente de la pièce repose sur ce drame de la parole empêchée ou
impossible. Nathalie Baye, en mère qui bavasse par peur du silence, ou plutôt par crainte de laisser une
parole destructrice se répandre, est impayable. Gaspard Ulliel, en fils prodigue avare de ses mots, bien
qu’écrivant – Jules Renard ne notait-il pas dans ses carnets qu’écrire « c’est parler sans être
interrompu » ? – n’est pas moins éloquent dans ses silences. Et Léa Seydoux, qui interprète sa sœur,
Marion Cotillard, sa belle-sœur, et même Vincent Cassel, son frère taciturne, hantés par le risque de mal
dire, sont saisissants. Xavier Dolan, lauréat du Grand prix du Festival du Cannes pour ce film, réussit le tour
de force d’adapter le style inimitable de Jean-Luc Lagarce sans en altérer la fragilité, toute contenue dans
cette suspension de la parole, dans des répliques qui disent tout, sans en dire jamais assez.
Vous aimerez peut-être aussi
- Japonais PDFDocument64 pagesJaponais PDFFlorence SculierPas encore d'évaluation
- Le Scaphandre Et Le Papillon LivretDocument24 pagesLe Scaphandre Et Le Papillon LivretAdon Role IdoPas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de LectureDocument6 pagesJuste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de LectureMohamed AlhegagiPas encore d'évaluation
- No et moi de Delphine de Vigan (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)D'EverandNo et moi de Delphine de Vigan (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)Pas encore d'évaluation
- SYNTH-Parole-Dire-Ne Pas Dire-Comment dire-JusteLaFinDuMondeDocument5 pagesSYNTH-Parole-Dire-Ne Pas Dire-Comment dire-JusteLaFinDuMondenatalia100% (1)
- Dissertation Juste La Fin Du MondeDocument6 pagesDissertation Juste La Fin Du MondeAya K100% (1)
- 3-Enseigner L'expression OraleDocument7 pages3-Enseigner L'expression OraleRassouma AdouPas encore d'évaluation
- FICHE DE LECTURE Juste La Fin Du MondeDocument2 pagesFICHE DE LECTURE Juste La Fin Du Mondepwhydbsjdc100% (1)
- Le Mot TOUT Exercices Et CorrigeDocument6 pagesLe Mot TOUT Exercices Et CorrigeJohn BoumtchePas encore d'évaluation
- Jean-Luc LagarceDocument3 pagesJean-Luc Lagarcetiméo tonnelierPas encore d'évaluation
- Jean-Luc Lagarce - Juste La Fin Du MondeDocument1 pageJean-Luc Lagarce - Juste La Fin Du MondeR.k. DeangPas encore d'évaluation
- J L LagarceDocument3 pagesJ L LagarceBernadettePas encore d'évaluation
- TP N°2: Exploiter Une Base de Données AccessDocument7 pagesTP N°2: Exploiter Une Base de Données Accesszouhour souleiman100% (1)
- Je Veux Le BacDocument30 pagesJe Veux Le BacSarah BendahmanePas encore d'évaluation
- Prépartation Dissert #4 Crise Personnelle, Crise FamilialeDocument5 pagesPrépartation Dissert #4 Crise Personnelle, Crise Familialefranzettililia100% (1)
- Parcours:: Jean-Luc LAGARCE, Juste La Fin Du Monde (1990)Document9 pagesParcours:: Jean-Luc LAGARCE, Juste La Fin Du Monde (1990)Chim Chim My Little FairyPas encore d'évaluation
- Fiche Juste La Fin Du MondeDocument3 pagesFiche Juste La Fin Du Mondewaxifix224Pas encore d'évaluation
- Questions JFMDocument8 pagesQuestions JFMDamla AktaşPas encore d'évaluation
- Crise Du LangageDocument3 pagesCrise Du LangagepalomabaronPas encore d'évaluation
- La Fin Du Monde LagarceDocument5 pagesLa Fin Du Monde LagarceSriPas encore d'évaluation
- Exemples Intro Dissert - ComDocument2 pagesExemples Intro Dissert - Comamir.beaunePas encore d'évaluation
- JLFDM1Document8 pagesJLFDM1juju.lesgourguesPas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du Monde Thèmes Écriture Et ParcoursDocument3 pagesJuste La Fin Du Monde Thèmes Écriture Et ParcoursNitroshellPas encore d'évaluation
- Dissert Lagarce - France Juin2021Document7 pagesDissert Lagarce - France Juin2021MOHAMED-TAHAR CHATTIPas encore d'évaluation
- 1re Francais Jean Luc Lagarce Juste La Fin Du Monde DissertationDocument2 pages1re Francais Jean Luc Lagarce Juste La Fin Du Monde Dissertationmixscha personnePas encore d'évaluation
- Dissert Exemple Crise PersonnelleDocument4 pagesDissert Exemple Crise Personnellelucieramos9Pas encore d'évaluation
- Le Schizo Et Les Langues, Point Final À Une Planète Infernale - ArtishocDocument30 pagesLe Schizo Et Les Langues, Point Final À Une Planète Infernale - ArtishocDulce DedinoPas encore d'évaluation
- Prologue 2Document5 pagesPrologue 2aairouche11Pas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de LectureDocument6 pagesJuste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de Lecturebensaidyassine94Pas encore d'évaluation
- Oral BlancDocument3 pagesOral BlancDeyan HussonPas encore d'évaluation
- LL13 Lagarce - PrologueDocument6 pagesLL13 Lagarce - PrologueRadwah KAICHOUHPas encore d'évaluation
- Corrige Dissertation Drame Qui N Advient PasDocument4 pagesCorrige Dissertation Drame Qui N Advient PasgeoffroyleleuPas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du Monde - Fiche de LectureDocument3 pagesJuste La Fin Du Monde - Fiche de Lecturevpq5phjh6nPas encore d'évaluation
- LL FrancaisDocument2 pagesLL Francaispierroz.oscarPas encore d'évaluation
- Ob 85db24 Corrige Tres Important A Lire AbsolDocument11 pagesOb 85db24 Corrige Tres Important A Lire AbsolgeoffroyleleuPas encore d'évaluation
- Eleve - JL Lagarce - JLFMDocument112 pagesEleve - JL Lagarce - JLFMAriday CorlettoPas encore d'évaluation
- Séance 3 Juste La Fin Du MondeDocument2 pagesSéance 3 Juste La Fin Du MondeelinecochereauPas encore d'évaluation
- Derrida - Ulysse Gramophone PDFDocument141 pagesDerrida - Ulysse Gramophone PDFFranciscoelhoPas encore d'évaluation
- Prologue JLFMDocument5 pagesPrologue JLFMGil CohPas encore d'évaluation
- Commentaire Kolt S BB2Document7 pagesCommentaire Kolt S BB2noahdebugnyPas encore d'évaluation
- Corrigé Dissertation - Un Drame IntimeDocument7 pagesCorrigé Dissertation - Un Drame Intimeghalia.mesfiouiPas encore d'évaluation
- Texte 15Document4 pagesTexte 15augustedantin75Pas encore d'évaluation
- Fiche LagarceDocument4 pagesFiche LagarcegeoffroyleleuPas encore d'évaluation
- Fiche LagarceDocument4 pagesFiche LagarcegeoffroyleleuPas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du Monde DissertationDocument9 pagesJuste La Fin Du Monde Dissertationleni.martin2007Pas encore d'évaluation
- Ob 406538 Notes de Cours Ll3 JLFDMDocument3 pagesOb 406538 Notes de Cours Ll3 JLFDMeva.scistri10014Pas encore d'évaluation
- Explication Linéaire 2 Juste La Fin Du MondeDocument5 pagesExplication Linéaire 2 Juste La Fin Du Mondeenora.legrandPas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du Monde, Lagarce, Partie 1 Scène 8: AnalyseDocument1 pageJuste La Fin Du Monde, Lagarce, Partie 1 Scène 8: Analyselucie rolliPas encore d'évaluation
- Entree Dans LoeuvreDocument8 pagesEntree Dans LoeuvreYasmine HamandiPas encore d'évaluation
- EL 1 - JLFM - Support ÉlèvesDocument4 pagesEL 1 - JLFM - Support Élèvesanriahmed01Pas encore d'évaluation
- Jean-Luc Lagarce, Juste La Fin Du Monde, 1990. Parcours: Crise Personnelle, Crise Familiale. Objet D'Étude: Le Théâtre Du Xviie Siècle Au Xxie SiècleDocument2 pagesJean-Luc Lagarce, Juste La Fin Du Monde, 1990. Parcours: Crise Personnelle, Crise Familiale. Objet D'Étude: Le Théâtre Du Xviie Siècle Au Xxie SiècleLouPas encore d'évaluation
- Academie de Nice Collège VILLENEUVEDocument6 pagesAcademie de Nice Collège VILLENEUVEbousbousPas encore d'évaluation
- Aide Pour Réfléchir Au Texte 5Document2 pagesAide Pour Réfléchir Au Texte 5Baboul BmPas encore d'évaluation
- Jean Luc LagarceDocument3 pagesJean Luc Lagarceb4jrntcnvpPas encore d'évaluation
- Préparation À La Dissertation Sur ŒuvreDocument1 pagePréparation À La Dissertation Sur ŒuvrelyblancPas encore d'évaluation
- Carnet de Lecture Lagarce 22Document4 pagesCarnet de Lecture Lagarce 22jhxsnnpf9gPas encore d'évaluation
- LL6 Prologue Juste La Fin Du MondeDocument2 pagesLL6 Prologue Juste La Fin Du Mondelouise.lemeur1Pas encore d'évaluation
- La Fièvre Dans Le Sang - PUP - 2019Document22 pagesLa Fièvre Dans Le Sang - PUP - 2019rominuPas encore d'évaluation
- Oral FrancaisDocument3 pagesOral FrancaisLuck StainPas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du MondeDocument4 pagesJuste La Fin Du MondeLudly C.E. SylvestrePas encore d'évaluation
- Lagarce PresentationDocument2 pagesLagarce Presentationsarah.zougariPas encore d'évaluation
- F 8f1 5a549f4a5f67eDocument15 pagesF 8f1 5a549f4a5f67eiimene.labidii27Pas encore d'évaluation
- JLFDM Scene 5 p1Document3 pagesJLFDM Scene 5 p1daomasln.15Pas encore d'évaluation
- LéditorialDocument3 pagesLéditorialElizabeth Ramírez NietoPas encore d'évaluation
- Controle Heritage Decembre 2014 Correction PDFDocument7 pagesControle Heritage Decembre 2014 Correction PDFNabil BikriPas encore d'évaluation
- Capes-1as (La Lettre Ouverte)Document21 pagesCapes-1as (La Lettre Ouverte)bellasenoraPas encore d'évaluation
- RACONTER UNE JOURNEE A - Quoi - Ca - SertDocument4 pagesRACONTER UNE JOURNEE A - Quoi - Ca - SertGina GheorghițăPas encore d'évaluation
- Du Locuteur Au Sujet Énonciateur-LocuteurDocument24 pagesDu Locuteur Au Sujet Énonciateur-LocuteurSami MabrakPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire 3 DVPT 4Document2 pagesLecture Linéaire 3 DVPT 4k64pmbr2p5Pas encore d'évaluation
- Et Verbum Caro Factum EstDocument82 pagesEt Verbum Caro Factum EstRaquel Se PPas encore d'évaluation
- Limites Et TransitivitéDocument18 pagesLimites Et TransitivitébunburydeluxPas encore d'évaluation
- Leçon Augmentée Sur Limparfait 2015 CE2Document4 pagesLeçon Augmentée Sur Limparfait 2015 CE2Kehrli VanessaPas encore d'évaluation
- Les Differentes DicteesDocument17 pagesLes Differentes DicteesMariel SoviPas encore d'évaluation
- Les Figures de StyleDocument5 pagesLes Figures de StyleChimène SmithPas encore d'évaluation
- 2) Grammaire - Le SubjonctifDocument1 page2) Grammaire - Le SubjonctifCristela FrancésPas encore d'évaluation
- Extrait PDFDocument20 pagesExtrait PDFdimitri sandjoPas encore d'évaluation
- TEST NIVEAU A1..cl-6Document2 pagesTEST NIVEAU A1..cl-6Iabanji NataliaPas encore d'évaluation
- 6.LES VERBES EN Ier Uer Ouer YerDocument2 pages6.LES VERBES EN Ier Uer Ouer YerMalak Ouali AlamiPas encore d'évaluation
- 2020, Judet, Franceza 9B VarDocument2 pages2020, Judet, Franceza 9B VarȘtefan LefterPas encore d'évaluation
- Les Arabes Du Maghreb Sont Bel Et Bien Des ArabesDocument7 pagesLes Arabes Du Maghreb Sont Bel Et Bien Des Arabesprince mirouPas encore d'évaluation
- Exploitation de Texte 1-2Document3 pagesExploitation de Texte 1-2KoulPas encore d'évaluation
- E Non Finisce Mica Il CieloDocument1 pageE Non Finisce Mica Il CieloValentina CalicchiaPas encore d'évaluation
- La Là L A L As Homonyme LeconDocument2 pagesLa Là L A L As Homonyme LeconYoussef Amid100% (1)
- Méthodologie de L'essai ArgumenteDocument3 pagesMéthodologie de L'essai ArgumenteFrancisco Javier Sancho PueblaPas encore d'évaluation
- 02 TrigonometrieHyperboliqueDocument2 pages02 TrigonometrieHyperboliqueibouPas encore d'évaluation
- Drao (Gil Pavao)Document1 pageDrao (Gil Pavao)Mila ChaubahPas encore d'évaluation
- Esi Program CpiDocument71 pagesEsi Program CpiwalidrelupoPas encore d'évaluation
- 6 - Les Pays Et Leurs Nationalités (Avec Corrigés)Document4 pages6 - Les Pays Et Leurs Nationalités (Avec Corrigés)Naomi NicolauPas encore d'évaluation
- Parlant Julien - Théâtre Et Verbo-Tonale: Vers Une Approche Intégrée de La ProsodieDocument9 pagesParlant Julien - Théâtre Et Verbo-Tonale: Vers Une Approche Intégrée de La ProsodieJulien ParlantPas encore d'évaluation