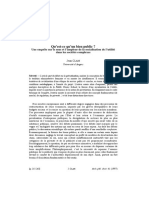Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Capture D'écran . 2023-05-26 À 02.40.47
Transféré par
cheikhdioufatTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Capture D'écran . 2023-05-26 À 02.40.47
Transféré par
cheikhdioufatDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vos mots-clés
Revues Ouvrages Que sais-je ? / Repères Magazines Mon cairn.info
Accueil / Ouvrages / Leçons d'Introduction à la Science... / Leçon 12. Les transformations...
Leçon 12. Les transformations de la démocratie
contemporaine
Rémi Lefebvre
Dans Leçons d'Introduction à la Science politique (2017),
pages 82 à 94
Plan Bibliographie Auteur Sur un sujet proche
Chapitre
D ’innombrables labels démocratiques circulent depuis quelques années dans
le monde savant, militant, politique : démocratie participative, dialogique,
délibérative, de proximité, d’opinion… Cette inflation de dénominations se
1
produit dans une grande confusion sémantique (la démocratie est devenue
« bavarde » selon Sandrine Rui). Un effort de clarification conceptuelle s’impose
même si, en la matière, la rationalité poursuivie par la recherche est différente de
celle qui gouverne les acteurs. Les nouveaux concepts « démocratiques » existent
principalement à travers leurs usages pratiques et le plus souvent pragmatiques.
Les acteurs qui mobilisent ces notions ne cherchent pas forcément à les clarifier
et souvent entretiennent un flou opportuniste.
Cette inflation sémantique se développe dans un contexte de « crise de la 2
représentation » qu’il faut prendre en compte tant il constitue un cadre cognitif
structurant. Le lien représentatif semble s’affaiblir dans les démocraties
contemporaines (il est fondé sur une relation de confiance qui tend à s’éroder).
Une partie croissante des citoyens s’estime mal représentée et la défiance à
l’égard des hommes politiques semble progresser. Il convient au personnel
politique de réagir à cette désaffection et à « réenchanter » le jeu représentatif (au
risque de « donner le change sans changer la donne »). Une partie des citoyens,
très minoritaire, aspire à plus de participation et conteste le principe même de la
représentation. La « démocratisation de la démocratie » semble être à l’ordre du
jour.
Selon une analyse répandue, l’élection n’est plus la seule source de légitimité – 3
quand bien même reste-telle le principal moyen d’organiser la dévolution du
pouvoir. La vie démocratique s’élargit de plus en plus au-delà de la sphère
électorale et des mécanismes de représentation. « L’élection a dorénavant une
fonction plus réduite : elle ne fait que valider un mode de désignation des
gouvernants. Elle n’implique plus une légitimation a priori des politiques qui
seront ensuite menées » (Pierre Rosanvallon). De nombreux acteurs sont appelés
à contribuer continûment à l’élaboration des choix collectifs. Le vocable de
« gouvernance » se substitue à celui de « gouvernement ». La gouvernance repose
sur un mode d’exercice du pouvoir moins unilatéral, plus partenarial, plus ouvert
sur les intérêts privés et la « société civile » et plus délibératif. De nouveaux modes
d’expression débordent en conséquence les dispositifs traditionnels de
représentation.
La « démocratie du public » semble réintroduire le citoyen, à travers les sondages 4
notamment, dans le jeu politique entre deux élections. La démocratie
participative propose de renforcer la portée de la participation citoyenne. Le
modèle délibératif propose une confrontation permanente et élargie des intérêts
sociaux. Il élargit le cercle des acteurs légitimes et crée de nouveaux espaces
d’échange, tournés essentiellement vers « la société civile ». Il convient
néanmoins de ne pas confondre les nouveaux discours sur la démocratie et ses
transformations effectives, les pratiques démocratiques et ses nouvelles
rhétoriques. Dans quelle mesure la démocratie représentative traditionnelle est-
elle affectée par les changements en cours ? Ne revêtent-ils pas une dimension
rhétorique forte ?
I. « La crise de la représentation »
La thèse de la « crise de la représentation », ou celle, plus large, d’une « crise du 5
politique », rencontre un grand succès et suscite une inflation d’analyses, souvent
pressées. Ses manifestations, multiformes et souvent mal articulées, seraient les
suivantes : défiance croissante des citoyens à l’égard de leurs représentants,
discrédit du personnel politique jugé inefficace, corrompu, augmentation de
l’abstention (leçon 22) et des votes blancs (deux millions au deuxième tour de
l’élection présidentielle en 2012), multiplication des alternances, crise des partis
et déclin du militantisme, « volatilité électorale », émiettement électoral, montée
de l’extrême droite et du « populisme », perception d’une moindre efficacité de
l’action politique et d’une impuissance des élites à peser sur le cours des choses…
Le terme de «crise» est problématique : il suppose un état transitoire. Or ce qui est
appelé «crise» renvoie souvent à des mécanismes structurels.
Les scandales politiques, récurrents dans l’agenda politique (affaire « Cahuzac » 6
en mars 2013, Fillon lors de la campagne présidentielle de 2017…) sont aussi vieux
que la démocratie parlementaire. Ils prennent une résonance très forte dans les
années de crise économique, comme ce fut le cas dans les années 1930 ou dans la
période contemporaine. On peut penser que la corruption politique a baissé dans
la société avec les lois sur le financement de la vie politique ou la plus grande
rigueur de la justice mais le seuil de tolérance de la société a lui aussi baissé. Les
citoyens tolèrent d’autant moins les atteintes à la moralité publique qu’ils jugent
leurs élites incapables de résoudre leurs problèmes et impuissants face à des
phénomènes économiques qui les dépassent. Les représentations sociales de la
corruption sont néanmoins ambivalentes (les Français jugent très
majoritairement les élus corrompus mais peuvent réélire des responsables
politiques condamnés pour abus de fonction, voir les travaux de Pierre
Lascoumes sur les « zones grises » de la corruption).
La crise des médiations partisanes (dans un contexte de «désintermédiation» 7
politique plus large) ne permet plus d’articuler et de porter les « demandes » du
corps social. Dans une société où les lignes de forces sociologiques sont peu
lisibles et les clivages en apparence moins marqués, les mécanismes
représentatifs (représenter quoi ?) se sont grippés (Pierre Rosanvallon). Les
sociétés contemporaines sont marquées par une érosion générale de la confiance
selon Pierre Rosanvallon (La Contre-Démocratie). Dans « la société du risque » (au
sens d’Ulrich Beck), la dépendance par rapport aux spécialistes oblige
paradoxalement à les contrôler davantage. Dans « une société d’éloignement »
(Michael Walzer), les individus se fient moins les uns aux autres parce qu’ils ne se
connaissent plus assez (érosion du capital social selon Robert Putnam). L’idée de
« société » s’affaiblit (elle est de plus en plus perçue comme une addition
d’individualités). L’affaiblissement de la confiance politique s’inscrit dans ce
contexte. Marcel Gauchet analyse « un individualisme de déliaison » où domine
une « exigence d’authenticité antagoniste de l’inscription dans un collectif ».
Dans une économie mondialisée, les acteurs sont moins prévisibles et les 8
interdépendances sont plus fortes (le sentiment d’une vulnérabilité généralisée se
développe). La mondialisation remet en cause l’État-nation et sa souveraineté sur
lequel s’est construit le lien politique alimentant un sentiment de dépossession et
de moindre protection. En France, elle est d’autant plus mal « vécue » qu’elle
remet en cause la tradition d’interventionnisme étatique et le rôle de l’État,
« instituteur du social » (Pierre Rosanvallon) et volontariste. Des déclarations
comme « l’État ne peut pas tout » (L. Jospin) choquent l’opinion. La dramaturgie
électorale qui exalte périodiquement la puissance du politique (inflation de
promesses, « tout est possible » pour Nicolas Sarkozy en 2007, « Le changement
c’est maintenant » pour François Hollande en 2012) apparaît d’autant plus
artificielle que le pouvoir apparaît impuissant face à des forces économiques qui
le dépassent ou des contraintes (européennes notamment) qui limitent
fortement ses possibilités d’action. La mondialisation affecte les marges de
manœuvre des gouvernants et réduit sans doute l’espace des « possibles »
politiques, ce qui altère la légitimité des gouvernants. Ceux-ci, pour maintenir
l’enchantement du jeu politique, doivent eux-mêmes sans cesse réaffirmer la
capacité du jeu politique à peser sur le monde social (d’où des cycles de
désillusion et de réenchantement, cf. la rhétorique de « rupture » de Nicolas
Sarkozy en 2007). La domination du néolibéralisme affecte quant à elle le champ
du pensable dans le sens d’un rétrécissement des alternatives (leçons 37 et 38).
L’existence d’une telle « crise » de la représentation et sa nouveauté apparaissent 9
discutables. Les prophètes de la « crise », prompts à révéler des changements
incessants, pèchent souvent par « excès de vitesse » (Passeron). Le diagnostic de
« crise » prospère sur un imaginaire « crisologique » qu’il faut interroger. Les
symptômes de la « crise » renvoient à des phénomènes de natures très différentes
et qu’il n’est pas forcément possible ni nécessaire de penser ensemble. Cette
« crise » n’est pas véritablement nouvelle et le thème paraît aussi ancien que la
représentation politique elle-même. « L’état de crise est le régime normal de
l’obéissance dans l’ordre démocratique qui se fonde sur une critique de l’autorité
et qui se perpétue en perpétuant la critique » (Pascal Perrineau, Le
Désenchantement démocratique). Du fait de son « indétermination » fondamentale,
le sens de la démocratie est toujours flottant, soumis au doute, exposé à la
critique (Pierre Rosanvallon). La défiance à l’égard des hommes politiques est
aussi vieille que la démocratie délégative (antiparlementarisme à la fin du
XIXe siècle, boulangisme, crise des années 1930, poujadisme dans les années
1950…). L’homme politique a toujours été « mal aimé » (le terme « politicien » est
péjoratif).
Ce sont sans doute les médias qui donnent une résonance plus grande à la « crise 10
du politique ». Les discours sur la crise de la représentation doivent à des logiques
proprement journalistiques d’appréhension du politique. Le discours critique à
l’égard des hommes politiques est surtout porté par les journalistes et renforcé
par leur tendance à « stratégiser » le jeu politique et à faire prévaloir le jeu sur les
enjeux (leçon 45) (ce qui peut conduire à dévaluer et à désacraliser la politique
auprès des citoyens, Daniel Gaxie).
Le discours sur la crise de la représentation est de plus en plus mobilisé par les 11
élus eux-mêmes (qui restent très attachés à l’onction démocratique qu’est censé
leur donner le vote). Pour Bernard Lacroix, si les hommes politiques se sont saisis
du thème de la crise de la représentation et l’ont même promu, c’est pour mieux
réaffirmer la fonctionnalité et la nécessité de la représentation et donc maîtriser
les solutions à la dite « crise ». Cette crise de la représentation ne serait qu’« un
avatar conjoncturel du travail de légitimation, jamais organisé ni explicitement
comme tel, de la justification élective de la délégation ». On peut aussi émettre
l’hypothèse qu’une partie des citoyens, plus critique car plus diplômée ou moins
politisée, est portée à développer une vision plus désenchantée des hommes
politiques (il y a, dans une mesure limitée, une démocratisation de la réflexivité
démocratique). Les différentes marques de défiance à l’égard des hommes
politiques sont aussi l’expression d’une exigence démocratique (peut-être plus
grande pour une partie des citoyens) et de la tolérance moins grande à l’égard de
certaines pratiques (corruption). Enfin, « la crise de la représentation » peut
s’analyser comme un effet du déclin de la représentativité sociale des élites
(recrutement de plus en plus endogamique). Au sens de la représentation comme
« miroir », les élites politiques sont de moins en moins représentatives (leçon 49).
C’est un fait sociologique indiscutable. D’où une première stratégie de
relégitimation de la démocratie représentative.
II. La démocratie de proximité
Cette crise de la représentation est le plus sou-vent interprétée sur le mode de la 12
distance qui s’accuse entre gouvernés et gouvernants, du fossé qui se creuse entre
les citoyens et les élites, de la fracture qui s’élargit entre le peuple et ses élus, de la
déconnection entre la base et le sommet. D’où la rhétorique de la « proximité » qui
est développée par les responsables politiques. Être en prise avec les Français, au
plus proche de leurs préoccupations et de leurs attentes, renouer le contact et
l’écoute et ce faisant résorber le fossé qui s’est creusé entre les citoyens et les élus,
les mandants et leurs mandataires : ces mots d’ordre sont sans cesse mis en
avant. La démocratie de contact sous toutes ces formes (que l’on songe à la
démocratie locale) semble par là même parée de toutes les vertus. Elle est célébrée
en ce qu’elle trace la voie d’une « réconciliation » entre les citoyens et leurs
représentants et de relations établies sur de nouvelles bases. La fortune du thème
de la « proximité » apparaît donc à la mesure de celle de la crise de la
représentation telle qu’elle est symboliquement définie et qualifiée.
Plus généralement et au-delà de la conjoncture de discrédit politique où elle 13
s’inscrit, la proximité est inhérente au principe de légitimation du lien
représentatif. Certes c’est la distance aux mandants qui légitime la délégation et
le mandatement. L’élu est un « citoyen distingué » et l’élection fait obstacle à la
proximité en ce qu’elle distingue irréductiblement celui qui représente de celui
qui est représenté. Mais tout représentant est tenu pour justifier son ministère de
marquer les signes (communauté de vie géographique, sociale…) qui le
rapprochent des représentés. Tout comme le discours oblatif du don de soi tenu
par l’élu à la communauté des citoyens, la rhétorique de la proximité est
consubstantielle au lien représentatif en ce qu’elle vise à la fois à le dépasser et à le
légitimer. Gage de représentativité, la proximité rend crédible et autorise l’acte de
magie sociale, le principe de la délégation politique, par lequel le représentant
parle au nom et à la place du représenté.
Les professionnels de la politique cherchent à conjurer la distance sociale 14
croissante avec leurs mandants, liée à l’uniformisation sociale du personnel
politique, par une proximité physique plus grande. La proximité est conçue
comme un antidote à ce que Bourdieu appelle « la clôture » du champ politique,
cette fermeture de la politique sur ses jeux et enjeux propres. Elle est d’autant
plus invoquée et mobilisée que la différenciation sociale et politique entre
gouvernants et gouvernés apparaît tangible. Il s’agit moins d’être proche que de
se rapprocher (par le travail sur le « terrain », en apparaissant à la télévision dans
des émissions de variétés ou de divertissement…). Le discours sur la proximité
permet en somme d’encoder de la sollicitude et de relégitimer un lien
représentatif corrodé. Il s’agit en somme d’accréditer le dialogue et l’ouverture
sans pour autant remettre en cause la division des rôles politiques (Christian Le
Bart et Rémi Lefebvre). À cet égard, la démocratie de proximité, réduite au face-à-
face élus-citoyens, permet d’empêcher l’approfondissement d’une véritable
démocratie locale, construite sur des bases collectives et délibératives (ce qui
amène à la question de la démocratie participative).
III. La démocratie participative
La démocratie de proximité (de contact, de face à face…) est à distinguer de la 15
démocratie participative qui suppose une plus large autonomie donnée au
citoyen. Une réflexion intellectuelle et politique se développe depuis un certain
nombre d’années autour de la « démocratie participative », conçue comme une
des réponses possibles à « la crise de la représentation ». La démocratie est le
régime qui remet en cause régulièrement ses propres procédures mais aussi les
frontières qui qualifient les êtres participant à ces procédures (Michael Walzer).
Elle doit rester ouverte aux acteurs qui ne possèdent aucun titre traditionnel de
représentation comme le sang, le savoir et l’argent (Jacques Rancière). La
démocratie participative, actuellement en vogue, est une nouvelle manière de
prendre en compte ceux que Dominique Boullier appelle des êtres invisibles ou
« inouïs », ceux qui n’ont pas voix au chapitre, interdits de parole (notons qu’elle
peut conduire aussi à redoubler leur exclusion). Pour Arthur Jobert, « le projet
participatif vise à suturer deux grandes coupures introduites tant par la science
que par le gouvernement représentatif ».
Des dispositifs, de plus en plus divers et nombreux, s’inventent aujourd’hui dans 16
les démocraties occidentales qui visent à associer les citoyens ordinaires à la
discussion des affaires publiques et à l’élaboration des choix collectifs… Le
discours participatif, fondé sur l’idée d’une ouverture du pouvoir et d’une plus
grande porosité de l’État à l’égard de la société civile, est devenu un parangon de
modernité. La valorisation de la participation politique serait au principe de
profondes transformations et deviendrait une véritable contrainte axiologique
dans le champ politique. C’est le processus même de fabrication de l’intérêt
général et la définition des intérêts légitimes qui semblent être affectés. La
conception aujourd’hui dominante de l’intérêt général tend à se séculariser en se
situant non plus en rupture avec les intérêts particuliers, comme le prescrivait en
France l’idéologie de l’intérêt général, mais dans leur prolongement.
Les formes d’« association » des citoyens à la décision et aux débats publics se 17
multiplient. Tout se passe comme s’il n’était plus envisageable de ne pas les
associer à l’activité politique entre deux échéances électorales en appelant à la
patience civique, au pouvoir « souverain » des représentants désignés au suffrage
universel ou encore en arguant de l’incompétence des « masses » (la France est
marquée par un long refus de la participation des citoyens aux affaires de la cité
hors du suffrage universel). La légitimité électorale conférée par l’onction du
suffrage universel, expression de la volonté générale, a longtemps été considérée
comme centrale. La montée de l’abstention, l’apparition d’un abstentionnisme
« dans le jeu » c’est-à-dire « politisé », la multiplication des alternances,
symptômes d’« une crise du politique » ont érodé cette légitimité. La mise en
débat ou la « discutabilité » d’un certain nombre d’enjeux, auparavant réservés
aux experts ou aux élus, s’élargissent de manière significative, dessinant la
perspective d’une démocratie « dialogique ». Les dispositifs – comités,
commissions, conférences citoyennes… – se multiplient visant à permettre la
confrontation de points de vue entre individus d’horizons très différents, ce que
Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe appellent des « forums
hybrides ». Dans ces cadres, sont sollicités des citoyens sélectionnés non pas
forcément pour leur connaissance du sujet débattu mais dans le souci de restituer
la diversité la plus grande des opinions.
Sur des terrains multiples et autour d’enjeux divers, des dispositifs sont 18
aujourd’hui promus et expérimentés dans le but affiché de renforcer l’implication
des citoyens dans l’espace public et de prendre en compte leur jugement
politique : les sondages délibératifs visent à recueillir une opinion éclairée en
fournissant des informations communes aux individus interrogés et en les
invitant à débattre les uns avec les autres ; les conférences de consensus et les
jurys citoyens mettent des profanes en rapport avec des experts et organisent des
échanges d’arguments censés déboucher sur la formulation de propositions
avisées (Yves Sintomer) ; les comités de quartiers sont supposés permettre aux
« habitants » de confronter publiquement leurs points de vue sur les problèmes
gérés à l’échelle locale et de prendre une part plus ou moins active à la prise de
décision…
Force est de constater que cette démocratie participative se développe surtout au 19
niveau local voire micro-local (le quartier), ce qui doit amener à ne pas en
surestimer la portée (on observe parallèlement de plus en plus un décalage entre
les territoires de la décision et ceux de la représentation, voir Fabien Desage). Le
local est présenté de manière générale comme le creuset et le laboratoire de ce
nouvel horizon démocratique. L’idéologie participationniste trouve son plein
accomplissement à cette échelle qui cristallise de nombreuses croyances et la
plupart des nouvelles utopies démocratiques. Le local est perçu comme un lieu de
participation en lui-même mais aussi, de manière générale, comme l’échelle la
plus pertinente pour entreprendre une « reconquête citoyenne » et une
réconciliation entre les citoyens et la politique sur fonds de « crise de la
représentation ».
Le local a peu à peu été (re)constitué socialement comme le niveau privilégié de la 20
politisation ordinaire des citoyens, de l’efficacité, de la mise en cohérence de
l’action publique et le foyer d’une socialité renouvelée (Le Bart, Lefebvre). Dans le
contexte de la mondialisation et de « la crise du lien social », il est construit, par
les élus notamment, comme la configuration territoriale qui permet d’envisager
la reconquête d’une maîtrise sur les choses et une reconstruction des repères
identitaires.
La redynamisation actuelle de la démocratie locale s’adosse à ces croyances. Elle 21
se traduit par la multiplication des procédures ou pratiques visant à associer les
citoyens aux décisions politiques en dehors des seules élections et la mise en
œuvre de nouvelles dynamiques participatives qui tendent à se développer dans
le cadre d’une concurrence positive entre les collectivités locales. Sur le plan local,
l’expression « démocratie participative » désigne un ensemble disparate de
techniques, de procédures, de démarches aussi diverses que les enquêtes d’utilité
publique, le référendum local, les procédures de concertation en matière
d’urbanisme ou d’aménagement, les conseils d’enfants, de jeunes, de sages,
d’immigrés, de quartier, les forums internet, les comités d’usagers, les conseils de
développement…
Sur le plan des objectifs, on peut dégager quatre approches des dispositifs 22
participatifs. Ce ne sont pas seulement des fondements « démocratiques » qui
servent à justifier et légitimer les dispositifs participatifs. Le premier est
fonctionnel et managérial. Il vise l’amélioration de la gestion urbaine avec l’idée
que « mieux gérer, c’est gérer plus près et gérer avec ». C’est une approche
d’« incorporation » des aspirations et des énergies des habitants dont la visée est
la plus grande efficacité des processus décisionnels et la gestion des conflits
potentiels. L’échange entre habitants permet d’optimiser la rationalité des
solutions proposées et des décisions, d’anticiper les conflits et de les désamorcer,
de construire l’indiscutabilité des projets. C’est l’acceptabilité des décisions que la
participation renforce dans ce registre. Le New Public Managment s’appuie
fortement sur la participation des usagers, leur expertise d’usage. Ce premier
objectif permet d’« infirmer les présupposés élitistes qui opposent démocratie et
efficacité » (Bacqué, Rey, Sintomer). Le second objectif est social. Il s’agit à travers
l’implication des habitants d’améliorer la cohésion sociale à l’échelle d’un
territoire donné voire de maintenir « la paix sociale ». Le rôle de la démocratie
locale est alors de retisser du « lien social », de reconstruire une confiance
mutuelle, de reconstituer une sociabilité même minimale. La démocratie locale
devient le support d’une communication interpersonnelle retrouvée et une
manière d’inclure les « exclus ». Les dispositifs de la politique de la ville
s’intègrent dans ce type d’objectifs. Le troisième objectif est politique. Il est latent
et implicite même s’il est de plus en plus assumé par les élus à mesure que
chemine la réflexion critique sur la démocratie participative : il s’agit de réassurer
la légitimité des représentants. Les élus font feu de tout bois pour susciter de
l’assentiment, de la loyauté, de la légitimité. La démocratie participative par le
style qu’elle imprime à l’action publique et les signes qu’elle permet d’adresser à la
population participe de cet activisme symbolique. Les rituels participatifs
relèvent d’un nouvel événementiel politique et d’une mise en scène recomposée
du pouvoir politique. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la relance de la
démocratie participative relève le plus souvent des élus et de l’offre
institutionnelle de participation qu’ils créent, parfois en l’absence de toute
revendication sociale. Ce qui différencie ainsi les conseils de quartier des années
1990 des comités de quartier des années 1970 c’est que l’initiative est désormais
essentiellement « descendante » et provient des élus eux-mêmes. Le quatrième
objectif est « démocratique ». Il s’agit de renouveler et d’approfondir la
participation dans une perspective de « démocratisation de la démocratie ». « La
participation est alors censée ne pas se cantonner à de l’ingénierie gestionnaire
ou sociale et déboucher sur une transformation des relations civiques » (Bacqué,
Rey, Sintomer).
Au final, si l’on cherche à caractériser la redynamisation de la démocratie 23
participative, une seule certitude domine véritablement dans ce flou général : ce
renouveau ne s’inscrit pas dans un au-delà de la démocratie représentative. Rien
dans les modalités juridiques nouvelles de la démocratie locale ne sort du registre
de la représentation. L’intégration éventuelle du public à divers niveaux n’y
change rien : la décision est toujours pensée par le droit comme une affaire
exclusive des élus. La participation des habitants ne constitue qu’en apparence un
dispositif de dé-légitimation du gouvernement représentatif. La démocratie
participative ne saurait être conçue comme un substitut mais comme un
adjuvant à la démocratie représentative classique. On peut douter par ailleurs de
l’existence d’une « demande sociale de participation ». La « délégation-abandon »
prime toujours sur la « délégation retenue » (Daniel Gaxie). À trop parler de
« démocratie participative » le risque est grand de perdre de vue que la
démocratie reste surtout représentative.
La légitimation par le flou de la démocratie participative
La norme participative s’institutionnalise d’autant plus qu’elle demeure
floue, que son contenu reste vague, ses objectifs multiples et que le cadre
juridique est particulièrement peu contraignant (Lefebvre 2007). La loi
« démocratie de proximité » de 2002 ne contraint que les villes de plus de 80
000 habitants à mettre en place des conseils de quartier, et ce dans les
formes qui leur semblent les plus ajustées au territoire. Les conseils de
développement sont obligatoires depuis la loi Voynet d’orientation pour
l’aménagement et le développement durable du territoire de 1999, mais, là
encore, les structures intercommunales peuvent les organiser à leur guise.
La dernière réforme territoriale de 2010, votée sous le gouvernement Fillon,
a, quant à elle, complètement évacué la problématique de la citoyenneté
locale. De fait, le design organisationnel des dispositifs est laissé à la
discrétion des autorités locales. La participation est le plus souvent conçue
par les élus en fonction de leurs objectifs propres et de leurs stratégies
locales (Gourgues 2012). Elle relève d’une «politique d’offre». Les élus sont
d’autant plus libres d’organiser l’offre participative que les mobilisations
sociales et politiques en faveur de la participation sont assez limitées. Un
des paradoxes de la démocratie participative est, d’ailleurs, qu’elle se
développe alors qu’on peut mettre en doute l’existence d’une réelle demande
sociale de participation, laquelle est le plus souvent construite par les élus
pour légitimer leurs dispositifs que véritablement portée par les citoyens. Le
succès social de la démocratie participative tient dans une large mesure à
l’indétermination de ses objectifs, à l’hétérogénéité et à la plasticité des
univers de sens qu’elle mobilise, mais aussi au rapport ambigu que la
participation entretient avec la décision. Tout se passe comme si on
célébrait « l’avènement d’un droit à la participation sans qu’il soit précisé ce
à quoi il est désormais permis de participer » (Blatrix 2009). Sous le label
« démocratie participative » coexistent des procédures, des techniques et
des démarches d’inégale importance dont l’objectif commun est
d’« associer » les citoyens à la prise de décision politique. Le mot
« participation » subsume ainsi des logiques diverses : communication,
information, consultation, concertation, implication, co-décision,
délibération, etc. La frontière entre ces diverses approches se révèle poreuse
et le lien avec la décision reste souvent obscur. On peut, par exemple, faire
de la simple information sous couvert de participation. Les élus cherchent,
d’ailleurs, à entretenir cette confusion et ces ambiguïtés, tout en tirant les
profits symboliques attachés à la « participation » (Alice Mazeaud).
IV. La démocratie délibérative
Une autre notion se développe conjointement, la démocratie délibérative. Dans ce 24
modèle « la décision légitime n’est pas la volonté de tous mais celle qui résulte de
la délibération de tous. C’est le processus de formation des volontés qui confère
sa légitimité au résultat, non la volonté déjà formée » (Bernard Manin). Les
procédures délibératives sont conçues comme un moyen de promouvoir un
échange public d’arguments entre des individus intéressés par une même
question ; plutôt que de viser à un compromis entre des points de vue déjà
arrêtés, l’interaction est supposée permettre une évolution – et éventuellement
une convergence – des avis initialement formulés.
L’accent est alors mis sur trois séries de principes : 25
– les principes d’argumentation (échange et évolution des points de vue,
confrontation raisonnée : le débat doit consister en un échange de raisons) ;
– les principes d’inclusion (ouverture de la discussion au plus grand nombre,
formation au débat) ;
– les principes de publicité et de transparence (ils distinguent la délibération
du marchandage).
Au lieu de faire de la délibération une dimension qui caractérise d’abord l’activité 27
des représentants et qui est toujours susceptible d’être opposée à l’opinion
publique « irrationnelle » de la masse ou du peuple, il s’agit de l’ancrer dans les
discussions ordinaires des simples citoyens. « Le moment décisif, du coup, n’est
plus l’élection mais la formation de l’opinion publique : l’élection ne représente
qu’un moment particulier dans un débat ininterrompu » (Yves Sintomer). La
représentation devrait, si la démarche était poussée jusqu’à son terme logique,
« se dissoudre dans la délibération » (Loïc Blondiaux). Le rôle des représentants se
limiterait alors à avaliser et à traduire en mesures concrètes les propositions
consensuelles qui auraient émergé des forums et espaces de discussion mis en
place.
Ainsi conçu, le modèle délibératif ne saurait être confondu avec celui que 28
cherchent à promouvoir les théoriciens américains du pluralisme (David Truman,
voir leçon 43) : il appelle à un dialogue évolutif plutôt qu’à des marchandages et
des compromis entre des intérêts intangibles ; l’échange d’arguments y prévaut
sur le rapport de force. Un écart peut également être marqué avec le schéma de la
démocratie participative dont les contours sont moins strictement délimités : la
participation est appuyée sur divers dispositifs qui n’exigent pas tous une
délibération à proprement parler. Celle-ci peut néanmoins être conçue comme un
moyen de favoriser celle-là : de ce point de vue, « la démocratie participative se
doit d’être aussi une démocratie délibérative car l’efficacité et la légitimité de la
participation dépendent pour une large part de la qualité des délibérations
menées » (Yves Sintomer).
Les promoteurs du modèle délibératif forment le pari que les citoyens peuvent 29
être éclairés par le débat. Il s’agit dès lors de créer les conditions théoriques et
pratiques d’un échange ouvert et informé. Cette démarche se heurte néanmoins à
plusieurs difficultés. Force est tout d’abord de constater que le concept de
« délibération » relève davantage de la pensée politique que du discours et des
pratiques des agents. Le risque est grand de céder à une forme d’idéalisme et de
plaquer sur la réalité une problématique encore peu intégrée par les enquêtés en
confondant – selon la formule de Marx – « la logique des choses » avec « les choses
de la logique ». Les dispositifs mis en place sont très inégalement « délibératifs »
ensuite, quand bien même ce label est-il revendiqué. Nombreuses sont les études
empiriques qui évaluent leur fonctionnement concret et qui mesurent des écarts
significatifs avec le schéma de référence (Rémi Lefebvre, Antoine Roger).
Pierre Bourdieu développe dans ses Méditations pascaliennes une critique sans 30
concession d’Habermas (un des philosophes de la démocratie délibérative) qui,
selon lui, « refoule la question des conditions économiques et sociales qui
devraient être remplies pour que s’instaure la délibération publique propre à
conduire à un consensus rationnel ». Le philosophe de l’agir communicationnel
tend à réduire les rapports de force politiques à des rapports de communication
régis par des normes de rationalité argumentative et délibérative. Il sous-évalue
l’inégalité de l’accès à l’opinion dite personnelle.
L’institutionnalisation de la participation et de la délibération est-elle compatible 31
avec l’expression des conflits traversant la société ? Les dispositifs délibératifs
recherchent le plus souvent un consensus rationnel. Certains auteurs comme
Chantal Mouffe ont dénoncé cette finalité souvent assignée à la délibération. La
philosophe conteste la possibilité même d’un consensus rationnel au nom de la
dimension intrinsèquement agonistique de la politique démocratique (on ne
discute pas avec une opinion radicalement différente de la sienne, on peut tout au
plus la combattre). La dimension conflictuelle de la politique et le rôle que le
conflit joue dans la production des identités collectives sont en quelque sorte
déniés par la philosophie délibérative. Faut-il pour autant renoncer à la
délibération et se limiter aux dispositifs représentatifs traditionnels (vote,
agrégation des volontés, principe majoritaire) de ce que Jane Manbridge appelle
« la démocratie adversariale » ? Peut-on concevoir des dispositifs de délibération
ou de participation qui ne chercheraient pas à abolir les conflits mais en
favoriseraient l’expression ? (Loïc Blondiaux).
Au final on peut dire avec Bernard Manin que « la démocratie s’est assurément 32
étendue mais il est au mieux incertain qu’elle se soit approfondie ».
V. La démocratie d’opinion ou démocratie du public
L’expression « démocratie d’opinion » fait florès. Elle est devenue un lieu 33
commun médiatico-politique qui sert à désigner et donner cohérence à des
évolutions aussi diverses que le triomphe d’une nouvelle force (l’opinion
publique), l’omniprésence des sondages et leur médiatisation croissante, la
personnalisation de la vie politique ou encore l’affaiblissement des partis
politiques. L’avènement de la démocratie d’opinion est le plus souvent déploré
dans un registre d’analyse qui relève plus de l’essayisme journalistique (Julliard,
2008) que de la démonstration scientifique.
Elle entraînerait en effet une détérioration du débat public soumis au règne de 34
l’émotion, de l’immédiateté, de l’électoralisme ou de la démagogie. Pour ses
détracteurs, la démocratie d’opinion serait ainsi impropre à créer un jugement
public éclairé. Les gouvernants se soumettraient sans cesse aux verdicts d’une
opinion publique versatile mesurée par les sondages et disséquée par les médias.
La démocratie d’opinion remettrait en cause la démocratie représentative
traditionnelle en instaurant un tête à tête permanent entre l’opinion et les
gouvernants. Elle délégitimerait les corps intermédiaires et tout particulièrement
ces médiations représentatives qu’ont longtemps constituées les partis politiques
dont la capacité à structurer le débat public semble s’éroder.
Le concept de démocratie d’opinion est séduisant mais souvent normatif, flou et 35
attrape-tout. Si l’opinion publique telle qu’elle est mesurée par les sondages
exerce des effets puissants sur le jeu politique, notamment à travers sa mise en
forme médiatique, son emprise ne saurait être surestimée. Elle est souvent
postulée plus que réellement démontrée. Les mécanismes représentatifs
traditionnels n’ont pas disparu. Les partis politiques restent centraux dans la
démocratie française même si les transformations qui les affectent doivent sans
doute au poids des sondages et à la médiatisation croissante de la vie politique
(leçon 42).
Bernard Manin a offert une des analyses les plus stimulantes du concept de 36
« démocratie du public » (notion qu’il préfère à celle de démocratie d’opinion).
Dans son ouvrage Principes du gouvernement représentatif (Manin, 1996), il cherche à
caractériser l’évolution historique des relations entre représentants et
représentés. Son analyse, d’ordre plus philosophique que socio-historique,
l’amène à dégager trois séquences, conçues comme des idéaux types, qui
organisent le gouvernement représentatif depuis son avènement aux XVIIIe et
XIXe siècles. Il nomme « démocratie des notables » la première configuration de
rapport représentésreprésentants qui marque le XIXe siècle, âge d’or du
parlementarisme. Les élus, fortement ancrés dans les territoires d’une société
encore rurale, entretiennent alors des liens locaux et personnels avec les citoyens
qui fondent leur notabilité. L’ère de la « démocratie des partis » s’impose à la fin
du XIXe siècle. Les partis politiques qui émergent à cette période contribuent à
une collectivisation de la vie politique. La discipline partisane s’impose peu à peu
dans le fonctionnement parlementaire. La relation politique tend à se
dépersonnaliser. La vie politique s’idéologise et devient affaire de labels partisans.
On vote moins pour une personnalité locale qu’en fonction de la fidélité à un parti
auquel on s’identifie. La liberté de l’élu et le choix de l’électeur sont cadrés par les
partis à travers les programmes qui servent désormais de base à la transaction
électorale. L’identification partisane se reproduit par sa transmission via la
socialisation familiale. Les partis politiques porteurs d’intérêts sociaux bien
définis deviennent une médiation essentielle entre représentants et représentés.
Cette médiation est « représentative » dans la mesure où les partis sont le reflet,
plus ou moins fidèle, des classes sociales sur lesquels ils s’appuient. Les
organisations partisanes structurent à la fois la compétition électorale (ils
investissent les candidats et produisent des programmes) et organisent
l’expression de l’opinion publique par le militantisme, l’activisme, la mobilisation
sociale.
Cette domination des partis est remise en cause à partir des années 1970 par le 37
développement d’une « démocratie du public », lié selon l’auteur au déclin des
identifications partisanes et l’emprise des médias et des sondages. Le choix
politique se « re-personnalise ». Le marketing politique s’impose comme
ressource essentielle visant à rationaliser les stratégies d’image des candidats. Les
partis ne parviennent plus à peser sur l’opinion et à structurer le débat public qui
se déplace vers les arènes médiatiques. « L’âge des militants est passé », assène
l’auteur. Les partis politiques ne sont plus porteurs de clivages sociaux tranchés et
d’offres politiques réellement discriminantes. L’électorat ou les citoyens
apparaissent comme un « public » qui réagit aux propositions qui lui sont faites
sur la scène publique (essentiellement médiatique) et construites en fonction de
leurs préférences mesurées par les sondages. La télévision ressuscite et
renouvelle en somme le face-à-face entre représentants et représentés qui
marquait la première séquence historique. En d’autres termes, dans la
« démocratie du public », le peuple est moins représenté par les parlementaires ou
par les partis que par l’opinion publique, devenue une instance tutélaire et
omniprésente. Le développement des primaires ouvertes en France qui
affaiblissent en première analyse les partis et donnent plus de pouvoir à un
«public» élargi nouveau (les sympathisants) semble aussi marquer des évolutions
qui vont dans le sens de la «démocratie du public». Bernard Manin définit ainsi
« la démocratie du public » par des caractéristiques très larges : la
personnalisation du choix électoral et sa volatilité croissante, le poids des
logiques de communication, d’opinion et de médiatisation. Son analyse est
fondée sur une vision fortement contestable et contestée du choix électoral. Il
écrit ainsi : « l’électorat flottant dont on note aujourd’hui le rôle croissant est un
électorat informé, intéressé par la politique et relativement instruit » (Manin,
1996, page 298). Une large partie de la sociologie électorale contemporaine
démontre plutôt le phénomène inverse. La volatilité se manifeste rarement par
un glissement de gauche à droite ou inversement (Lehingue, 2012). Si la fresque
historique est stimulante, Bernard Manin stylise les traits de séquences qui dans
les faits se superposent plus qu’elles ne se succèdent les unes aux autres de
manière linéaire.
De nombreux travaux publiés sur les sondages d’opinion et leurs usages amènent 38
à nuancer et affiner l’analyse de Bernard Manin. Les sondages ont certes imposé
un quasi-monopole sur la production de l’opinion (ou, dans une vision critique
sur son « extraction »). L’opinion publique est bien devenue ce que mesurent les
Vous aimerez peut-être aussi
- Une Démocratie CorruptibleDocument3 pagesUne Démocratie CorruptibleFlorence DauryPas encore d'évaluation
- UN MONDE DESENCHANTE: Essai sur la crise sociale et politiqueD'EverandUN MONDE DESENCHANTE: Essai sur la crise sociale et politiquePas encore d'évaluation
- La Contre Democratie La Politique A L Age de La DefianceDocument3 pagesLa Contre Democratie La Politique A L Age de La DefianceGuilherme MARINHO DE MIRANDAPas encore d'évaluation
- De La Démocratie en France - Loïc Blondiaux - Revue EspritDocument7 pagesDe La Démocratie en France - Loïc Blondiaux - Revue Espritskyy 69Pas encore d'évaluation
- Pierre Rosanvallon Le Siecle Du Populisme Histoire Theorie CritiqueDocument2 pagesPierre Rosanvallon Le Siecle Du Populisme Histoire Theorie CritiqueKasey VaughanPas encore d'évaluation
- Comite Invisible Ingenierie Sociale Et MondiDocument117 pagesComite Invisible Ingenierie Sociale Et MondiromanprodPas encore d'évaluation
- Réinventer la démocratie: De la participation à l’intelligence collectiveD'EverandRéinventer la démocratie: De la participation à l’intelligence collectivePas encore d'évaluation
- Médias Et Opinion Publique - Arnaud MercierDocument143 pagesMédias Et Opinion Publique - Arnaud MercierSilgaPas encore d'évaluation
- Sociologie PolitiqueDocument7 pagesSociologie PolitiqueMatio ZaraPas encore d'évaluation
- Ethique L1 - Chap 2Document15 pagesEthique L1 - Chap 2PharellePas encore d'évaluation
- Entre peuple et élite, le populisme de droiteD'EverandEntre peuple et élite, le populisme de droitePas encore d'évaluation
- Plan PopulsimesDocument6 pagesPlan PopulsimesjoseignacerezoPas encore d'évaluation
- Faut-Il Haïr La Démocratie? Par Yves CussetDocument13 pagesFaut-Il Haïr La Démocratie? Par Yves CussetLeonardo David HdezPas encore d'évaluation
- PopulismeDocument5 pagesPopulismeAnonymous cfc0YgPas encore d'évaluation
- À Propos de Quelques Travaux de Lazarsfeld Et de Son ÉcoleDocument7 pagesÀ Propos de Quelques Travaux de Lazarsfeld Et de Son Écolealvarez-duran.jesus6752Pas encore d'évaluation
- Introduction R La Politique PDFDocument19 pagesIntroduction R La Politique PDFNeniita Sheyla TroyaPas encore d'évaluation
- BOURDIEU - La Représentation PolitiqueDocument25 pagesBOURDIEU - La Représentation Politiquebillmoore69Pas encore d'évaluation
- Le Politique Et La Dynamique Des Passions - Chantal MouffeDocument13 pagesLe Politique Et La Dynamique Des Passions - Chantal MouffeSamuel AlexandrePas encore d'évaluation
- Les Régimes PolitiquesDocument19 pagesLes Régimes PolitiquesAbbé gondoPas encore d'évaluation
- Domaines de Recherche Sociologie de La DécisionDocument6 pagesDomaines de Recherche Sociologie de La DécisionAmin OvidusPas encore d'évaluation
- Ingénierie Sociale Et MondialisationDocument33 pagesIngénierie Sociale Et Mondialisationfat ctrla100% (4)
- Démocratie Et Citoyenneté Cairn - InfoDocument88 pagesDémocratie Et Citoyenneté Cairn - InfoChris IproPas encore d'évaluation
- Ispfinal Kutlu Yarenyesim S2Document6 pagesIspfinal Kutlu Yarenyesim S2Yaren Yesim KutluPas encore d'évaluation
- Cours de Sociologie Politique Licence 1Document10 pagesCours de Sociologie Politique Licence 1farmapene9Pas encore d'évaluation
- Les Acteurs Principaux de La Vie PolitiqueDocument20 pagesLes Acteurs Principaux de La Vie Politiquehayatmahi42Pas encore d'évaluation
- Désobéissance CivileDocument31 pagesDésobéissance Civilemounir57Pas encore d'évaluation
- Renouveler la citoyenneté: Un impératif démocratiqueD'EverandRenouveler la citoyenneté: Un impératif démocratiquePas encore d'évaluation
- SC - Po BouzoubaaDocument27 pagesSC - Po Bouzoubaadriss cherradPas encore d'évaluation
- Ce Que Pierre Rosanvallon Ne Comprend Pas, Par Chantal Mouffe (Le Monde Diplomatique, Mai 2020)Document4 pagesCe Que Pierre Rosanvallon Ne Comprend Pas, Par Chantal Mouffe (Le Monde Diplomatique, Mai 2020)Charlotte Schablinsky100% (1)
- La Mise en Scène de La Passion Par Les Professionnels de La PolitiqueDocument9 pagesLa Mise en Scène de La Passion Par Les Professionnels de La Politiquejotige1390Pas encore d'évaluation
- ART - Décision Publique Et Participation Citoyenne en EuropeDocument5 pagesART - Décision Publique Et Participation Citoyenne en EuropeFrédéric HottiauxPas encore d'évaluation
- Opinion Publique Et SondagesDocument2 pagesOpinion Publique Et SondagesBenjamin HébrasPas encore d'évaluation
- Jacques ChevallierDocument12 pagesJacques ChevallierFabien LarroquePas encore d'évaluation
- Qu'est-Ce Qu'un Bien Public ?Document52 pagesQu'est-Ce Qu'un Bien Public ?Paulo AlvesPas encore d'évaluation
- Sociologie de La ComDocument5 pagesSociologie de La Comdylanales99Pas encore d'évaluation
- ExtraitDocument8 pagesExtraitZou DialloPas encore d'évaluation
- Cours 4 DEWEY-L1-202Document10 pagesCours 4 DEWEY-L1-202zedPas encore d'évaluation
- La tentation de l'extrémisme: Djihadistes, suprématistes blancs et activistes de l'extrême gaucheD'EverandLa tentation de l'extrémisme: Djihadistes, suprématistes blancs et activistes de l'extrême gauchePas encore d'évaluation
- Dissertation Sur Document À Propos de L'opinion PubliqueDocument6 pagesDissertation Sur Document À Propos de L'opinion PubliqueOussama cr97Pas encore d'évaluation
- LyceeGT Ressources ECJS 1 03 OpinionPub 182759 PDFDocument3 pagesLyceeGT Ressources ECJS 1 03 OpinionPub 182759 PDFMekhmoukh NourhanePas encore d'évaluation
- Document 39Document20 pagesDocument 39nelle barnouttPas encore d'évaluation
- Une Lecture Postmoderne de La DémocratieDocument17 pagesUne Lecture Postmoderne de La DémocratieThierrytradePas encore d'évaluation
- FICHIR_ARTICLE_1774Document19 pagesFICHIR_ARTICLE_1774Adyl GhandourPas encore d'évaluation
- L'univers des marques politiques: Stratégies médiatiques et techniques de mobilisationD'EverandL'univers des marques politiques: Stratégies médiatiques et techniques de mobilisationPas encore d'évaluation
- Démocratie Bruno BernardiDocument14 pagesDémocratie Bruno BernardiveraPas encore d'évaluation
- La Myopie Des DémocratiesDocument4 pagesLa Myopie Des Démocratiesngong ernestPas encore d'évaluation
- La Politique en questionsD'EverandLa Politique en questionsPas encore d'évaluation
- Cours 4 Dewey l1 2022Document10 pagesCours 4 Dewey l1 2022zedPas encore d'évaluation
- Faire Collectif de La Constitution A LaDocument29 pagesFaire Collectif de La Constitution A LaetiemblePas encore d'évaluation
- Full CoursDocument54 pagesFull CoursThomas DappePas encore d'évaluation
- Science PolitiqueDocument122 pagesScience PolitiqueBadr fkPas encore d'évaluation
- Barraut StellaDocument3 pagesBarraut Stellastella.bejaninPas encore d'évaluation
- De La Démocratie Sans Le Peuple À La Démocratie Avec Le PeupleDocument16 pagesDe La Démocratie Sans Le Peuple À La Démocratie Avec Le Peupledelatoure pierrePas encore d'évaluation
- CE-B2 - 2.1 Jeunes Et DémocratieDocument11 pagesCE-B2 - 2.1 Jeunes Et DémocratieCésar MartínezPas encore d'évaluation
- Chapitre 10 E&S CorrectionDocument34 pagesChapitre 10 E&S Correction5jh6669tncPas encore d'évaluation
- TD Covid ECM 3eDocument2 pagesTD Covid ECM 3eSerge NoumbaPas encore d'évaluation
- La Démocratie Et Les ÉlectionsDocument29 pagesLa Démocratie Et Les ÉlectionsjustinevousemmerdePas encore d'évaluation
- Histoire Pensée Politique Questions Réponses PDF 1Document13 pagesHistoire Pensée Politique Questions Réponses PDF 1Mamadou Sanogo100% (2)
- 5) La DemocratieDocument2 pages5) La DemocratieJihaneJijiKamaraPas encore d'évaluation
- Sujet 1 Citoyens ÉvolutionDocument3 pagesSujet 1 Citoyens Évolutionmamaevazainap3Pas encore d'évaluation
- Introduction Au Droit Public - Capsules 1 À 8 (2022)Document91 pagesIntroduction Au Droit Public - Capsules 1 À 8 (2022)Simon DelanayePas encore d'évaluation
- 6 - La DémocratieDocument2 pages6 - La DémocratieAbdyouFNPas encore d'évaluation
- Les Régimes PolitiquesDocument3 pagesLes Régimes Politiquesromaissaa.zaghratPas encore d'évaluation
- Grands Problèmes Politiques ContemporainsDocument91 pagesGrands Problèmes Politiques ContemporainsYouness Ian Rams100% (13)
- Dissertation de SC JurDocument3 pagesDissertation de SC JurAya BougrinePas encore d'évaluation
- Souverainet Populaire Et Souveraint NationaleDocument7 pagesSouverainet Populaire Et Souveraint NationaleAudrey SzymanowiczPas encore d'évaluation
- Diapo SES DémocratieDocument18 pagesDiapo SES DémocratieKessingersIneoPas encore d'évaluation
- Copie de Droit de Vote Final-1Document8 pagesCopie de Droit de Vote Final-1Marie BoturynPas encore d'évaluation
- Pouvoirs07 p7-16 Critique RepresentationDocument10 pagesPouvoirs07 p7-16 Critique RepresentationSylvie PavaPas encore d'évaluation
- TD Introduction À La Science Politique 2Document27 pagesTD Introduction À La Science Politique 2romaisae.ma82Pas encore d'évaluation
- LyceeGT Ressources ECJS 1 03 OpinionPub 182759 PDFDocument3 pagesLyceeGT Ressources ECJS 1 03 OpinionPub 182759 PDFMekhmoukh NourhanePas encore d'évaluation
- Citoyenneté Et Démocratie Participative Au Maroc, Les Conditions de La Construction D'un ModèleDocument10 pagesCitoyenneté Et Démocratie Participative Au Maroc, Les Conditions de La Construction D'un ModèleoumaimaPas encore d'évaluation
- Droit Constitutionnel V RepDocument30 pagesDroit Constitutionnel V RepAminePas encore d'évaluation
- Chapitre 7 Opinion PubliqueDocument6 pagesChapitre 7 Opinion PubliqueREDACTEDPas encore d'évaluation
- Jacques GerstleDocument11 pagesJacques GerstlePaulo MotaPas encore d'évaluation
- Sciences Politiques Et Droit ConstitutionnelDocument24 pagesSciences Politiques Et Droit Constitutionnelclement17100% (9)
- 2009 - 02Document184 pages2009 - 02khouasPas encore d'évaluation
- Droit Constitutionnel L1Document78 pagesDroit Constitutionnel L1Sara Loudyi100% (1)
- P31 QR Science Politique PlumeMNGDocument16 pagesP31 QR Science Politique PlumeMNGMarie Ala Sarr SowPas encore d'évaluation
- Egocratie Et DémocratieDocument41 pagesEgocratie Et Démocratiefyp_éditions100% (1)
- Chapitre 4 RésuméDocument3 pagesChapitre 4 RésuméStéphPas encore d'évaluation
- Internews JED DR Congo Press Offences Legal Framework FRDocument21 pagesInternews JED DR Congo Press Offences Legal Framework FRYoyo Du congoPas encore d'évaluation
- Citoyenneté Française Et Citoyenneté EuropéenneDocument6 pagesCitoyenneté Française Et Citoyenneté EuropéenneRoselyne BourlaPas encore d'évaluation
- Manifeste Du Mouvement Pour La Démocratie Et La Citoyenneté (MDC)Document23 pagesManifeste Du Mouvement Pour La Démocratie Et La Citoyenneté (MDC)L'EchoPas encore d'évaluation