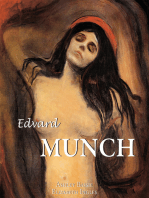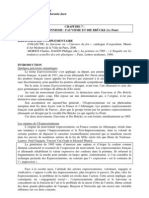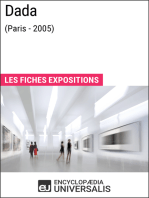Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Alexandre Mare - "Atlas Et Autres Expériences Intérieures"
Transféré par
xuaoqunTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Alexandre Mare - "Atlas Et Autres Expériences Intérieures"
Transféré par
xuaoqunDroits d'auteur :
Formats disponibles
expositions | critiques
E XPO S IT IO N S
Atlas et autres expériences
intérieures
› Alexandre Mare
G
eorges Didi-Huberman, philosophe et histo-
rien de l’art, enseignant à l’École des hautes
études en sciences sociales, ne cesse depuis ses
premières publications d’interroger non pas l’immédiate
visibilité de l’image mais bien plutôt son symptôme. Un
espace où évolueraient signes, gestes et formes, créant un
montage de temps hétérogène. En ce sens, permettant de
faire surgir une généalogie en replaçant l’image dans le
champ de l’Histoire et de la mémoire – et, de ce fait, en
l’extrayant des strictes limites de l’histoire de l’art. Mais,
pour un historien des images tel que Georges Didi-Huber-
man, est-ce si étonnant de passer de l’autre côté ? En somme,
de ne plus être seulement un commentateur, un exégète
de l’image et de ses apparitions et disparitions éventuelles,
mais d’en être un manipulateur. De passer de la fonction de
chercheur solitaire, comme il se définit lui-même dans un
texte qui accompagne l’exposition « Nouvelles histoires de
fantômes » au Palais de Tokyo à Paris (1), à celle de com-
missaire d’exposition. Bien sûr, il s’agit toujours d’ordon-
ner les images, de les mettre en dialogue, en tension, mais
avec cette proposition, le philosophe met en œuvre, si l’on
peut dire, la démonstration qu’il explicite dans la majeure
partie de sa production écrite. Le résultat est bouleversant.
Saisissant, plutôt, tant il en surgit une force évocatrice où,
comme l’écrit Georges Bataille – dont Didi-Huberman est
un lecteur attentif –, « il doit y avoir un contact direct avec
ce qui vous fait face ». Une rencontre « qui vous ouvre le
dedans » de manière immédiate. Résumons, Georges Didi-
JUIN 2014 151
critiques | expositions
Huberman et son complice le photographe Arno Gisinger
permettent à l’image de nous dévoiler le trouble qui les
habite, qui nous habite ; et bien sûr, cela est une « expé-
rience intérieure ».
La salle est grande. Le visiteur est d’abord accueilli par
une gigantesque image. Pareille à une porte qu’il faut non
pas franchir mais contourner. Il s’agit d’une image projetée,
comme toutes celles mises en œuvre par Didi-Huberman
dans cette installation. Cette image est une reproduction de
la planche 42 de l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg réalisé
entre 1921 et 1929. Cet historien de l’art hambourgeois
(1866-1929) a, sur de grandes planches « mises en contact »,
placé des images qui font ressortir les survivances à travers
le temps (et donc l’histoire de l’art) de l’Antiquité jusqu’à
l’époque contemporaine. Positions des corps, drapés, édi-
fices qui, côte à côte, dialoguent, se répondent. Warburg
développe à partir de ces observations l’idée de pathos for-
mel, ou comment le monde existe entre deux tensions : celle
du Bien (la tension apollinienne) et celle du Mal, du laid (la
tension dionysiaque) qui se confrontent, se croisent, répon-
dant ainsi à la vision de l’Antiquité que l’on retrouve chez
deux autres penseurs contemporains de Warburg, Nietzsche
et Freud. La planche 42 de l’Atlas Mnémosyne est consa-
crée aux gestes de lamentation. De fait, répondant à cette
image introductive, Didi-Huberman a réalisé une planche
« géante » de plus de 1 000 mètres carrés, « posée », pour
reprendre le terme que le philosophe emploie, sur le sol et
que l’on regarde du haut d’une coursive, comme celle du
pont d’un bateau parti en haute mer. Là aussi il est question
de lamentation. Le philosophe a non seulement convoqué
des images de l’Antiquité, des gravures de Goya (les Désastres
de la guerre) mais les a surtout « mises en contact » avec des
extraits de films (des images en mouvement, donc) anciens
ou contemporains tels que l’Évangile selon saint Matthieu de
Pasolini (1964), le Regard d’Ulysse d’Angelopoulos (1995),
152 JUIN 2014
expositions | critiques
le Cuirassé Potemkine d’Eisenstein (1925)…, des photogra-
phies de presse, d’archives ou de reportage ethnographique
donnant lieu à une profusion de signes, de mouvements qui
s’interpellent. Tous ont en commun un geste de la lamen-
tation, ou plus exactement un geste de survivants à l’égard
de leurs morts : l’installation, écrit Georges Didi-Huber-
man, « aboutit même à une interprétation politique de la
planche 42 en montrant comment les “peuples en larmes”
sont susceptibles, dans certaines conditions, de s’engager
dans un geste d’émancipation capable de faire d’eux des
“peuples en armes” ».
L’expérience des images comme exposition n’est cepen-
dant pas une nouveauté pour le philosophe, qui a plusieurs
fois présenté des versions de son « Atlas ». La première
exposition a eu lieu en 2010, à Madrid, au Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, une autre en 2011 à Ham-
bourg, puis à Rio et Beyrouth. Cependant, l’installation
proposée au Palais de Tokyo cohabite avec une autre ins-
tallation, une installation fantôme pourrions-nous dire. En
effet, Georges Didi-Huberman a proposé au photographe
Arno Gisinger de témoigner d’accrochages précédents, de
prendre des photographies des accrochages, ou de ce que
l’on appelle le montage – c’est-à-dire le moment où les
œuvres sont accrochées les unes à côté des autres –, « Atlas »
est confronté avec un atlas d’« Atlas » : si l’installation de
Didi-Huberman est au sol, celle de Gisinger est aux murs.
Ce sont 40 photographies, reproduites en grand format,
pareilles à de grandes affiches, collées au mur, qui proposent
une autre vision de l’exposition. Ou plus exactement l’expo-
sition de l’exposition, des photographies de tableaux au sol
qui ne sont pas encore accrochés, des emballages vides, des
carnets, des photographies de photographies, une repro-
duction de la planche 42 avec un Post-it jaune. À ne pas
oublier, en somme. À garder en mémoire comme ces fan-
tômes, ces fiches sur les rayonnages des bibliothèques qui
JUIN 2014 153
critiques | expositions
indiquent lorsqu’un livre est sorti. Et l’on comprendra alors
que les photos aux murs sont bien des fantômes, sont des
reproductions de photographies d’œuvres qui, emballées
le plus souvent, n’atteignent pas encore, aux yeux du visi-
teur, le statut d’œuvre d’art. Surtout parce que ce sont des
reproductions agrandies, collées sur le mur, ce n’est pas tant
l’œuvre photographiée sur laquelle on s’arrête, mais bien
plutôt sur sa reproduction. « Ce travail propose une expo-
sition à l’époque de sa reproductibilité technique », écrit
Gisinger. Il ne faudrait pas oublier que Walter Benjamin
fut un lecteur de Warburg, comme Didi-Huberman est un
lecteur de Benjamin. C’est donc un travail sur le médium
photographique même et sur les rapports complexes entre
les œuvres et leurs différentes possibilités de reproduction,
de représentation. Comme l’explique le philosophe : « C’est
moins la partition des tableaux d’une exposition donc, qu’une
suite de fantômes d’une exposition. »
Bien sûr, c’est un dialogue, et Arno Gisinger semble être
le témoin attentif de la mise en place de l’exposition. En
somme, si Didi-Huberman capte et agence les généalogies
de gestes, de mouvements, de pleurs, de vies à travers l’his-
toire de l’art et du cinéma, Gisinger se fait, lui, le témoin
de cet agencement et participe activement à garder trace,
à garder mémoire. Mnémosyne, donc. Atlas de l’« Atlas »
qui porte le monde sur ses épaules. Un monde d’images
qui, de l’Antiquité à aujourd’hui, dessine une généalogie
de la lamentation, de l’émancipation, de la fureur, de la
révolte. Si les images d’œuvres à peine visibles, emballées
et non exposées sur leurs cimaises, ne semblent pas avoir la
valeur qu’on leur prête, renvoyées à leur statut d’objet, le
montage d’images projetées de Didi-Huberman nous dit le
contraire. Associer les deux formes semble vouloir absolu-
ment nous démontrer que la vraie valeur de l’image ne peut
être ni dans sa valeur marchande ni dans sa valeur affective
mais bien, à l’image de celles qui sont au sol, dans ce qu’elle
154 JUIN 2014
expositions | critiques
« projette ». Et, de fait, on comprendra que la double ins-
tallation va à l’encontre de ce qui est généralement présenté
dans les musées : il n’y a ici ni tableaux originaux, ni tirages
photographiques d’époque, ni manuscrits, rien de tout cela.
Juste des reproductions. Bref, une exposition à l’époque de
sa reproductibilité technique : une table de montage où l’on
peut encore tout ordonner pour faire sens ou, plus exac-
tement, où il est possible de « donner » sens. Un monde
d’image en mouvement.
1. « Nouvelles histoires de fantômes », Georges Didi-Huberman et Arno
Gisinger, Palais de Tokyo, Paris XVIe, jusqu’au 7 septembre 2014.
JUIN 2014 155
Vous aimerez peut-être aussi
- To My Angels Piano - Vocal by Lourds LaneDocument5 pagesTo My Angels Piano - Vocal by Lourds LaneJanie Hornstein100% (1)
- Test On Chapter 11Document5 pagesTest On Chapter 11Jerome ManningPas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire N°2 La Peau de ChagrinDocument2 pagesAnalyse Linéaire N°2 La Peau de ChagrinGabin SerfatiPas encore d'évaluation
- Talguen Cecile - On A Vole Mona LisaDocument48 pagesTalguen Cecile - On A Vole Mona LisaCarina PeraldiPas encore d'évaluation
- Vincent Delerm - Les Piqûres D'araignéesDocument72 pagesVincent Delerm - Les Piqûres D'araignéesadimitrim100% (3)
- Didi-Huberman, G. - L Album de L Art À L Époque Du Musée ImaginaireDocument7 pagesDidi-Huberman, G. - L Album de L Art À L Époque Du Musée ImaginaireMaringuiPas encore d'évaluation
- AGAMBEN Giorgio - Image Et MémoireDocument48 pagesAGAMBEN Giorgio - Image Et Mémoireeduardosterzi100% (5)
- Images Relues - La Méthode de Georges Didi-HubermanDocument18 pagesImages Relues - La Méthode de Georges Didi-HubermanrodrigoielpoPas encore d'évaluation
- Chapitre 7 - Expressionnisme Fauvisme Et Die BruckeDocument3 pagesChapitre 7 - Expressionnisme Fauvisme Et Die Bruckecelineta100% (1)
- Mellerio Et Al. - 1900 - L'Exposition de 1900 Et L'impressionnismeDocument60 pagesMellerio Et Al. - 1900 - L'Exposition de 1900 Et L'impressionnismeGabriel Almeida BarojaPas encore d'évaluation
- Georges Didi Huberman La Ressemblance Par Contact Archéologie Anachronisme Et Modernité de LempreinteDocument193 pagesGeorges Didi Huberman La Ressemblance Par Contact Archéologie Anachronisme Et Modernité de LempreinteSamia GallahPas encore d'évaluation
- Cleopatra e Cesare PDFDocument52 pagesCleopatra e Cesare PDFBons plans ClassiquePas encore d'évaluation
- Critica - L'Image Ouverte. Motifs de L'incarnation Dans Les Arts VisuelsDocument3 pagesCritica - L'Image Ouverte. Motifs de L'incarnation Dans Les Arts VisuelscodillosPas encore d'évaluation
- Press Release FR Huberman - GissingerDocument6 pagesPress Release FR Huberman - GissingerjoacimsprungPas encore d'évaluation
- Devant Le Temps. Didi-HubermanDocument5 pagesDevant Le Temps. Didi-Hubermanmorgan385Pas encore d'évaluation
- Didi-Huberman, Devant Le Temps (Fiche)Document3 pagesDidi-Huberman, Devant Le Temps (Fiche)sarrrPas encore d'évaluation
- Histoire de L'art 06 Sixieme Partie L'Art ContemporainDocument192 pagesHistoire de L'art 06 Sixieme Partie L'Art ContemporainroropopoPas encore d'évaluation
- Quel Est Le Sujet de L Autoportrait MoiDocument4 pagesQuel Est Le Sujet de L Autoportrait MoiLiinda TounsyPas encore d'évaluation
- Dossier Habiter Poetiquement Le Monde WebDocument11 pagesDossier Habiter Poetiquement Le Monde WebSéb Leut100% (1)
- BROGOWSKI Pages de PUBLIEREXPOSER-14-2Document13 pagesBROGOWSKI Pages de PUBLIEREXPOSER-14-2pigeonsdijonPas encore d'évaluation
- Guylaine Massoutre - "Élégie Pour Un Passant. Nouvelles Histoires de Fantômes de Georges Didi-Huberman Et Arno Gisinger"Document4 pagesGuylaine Massoutre - "Élégie Pour Un Passant. Nouvelles Histoires de Fantômes de Georges Didi-Huberman Et Arno Gisinger"xuaoqunPas encore d'évaluation
- Commentaire D'ouvrageDocument5 pagesCommentaire D'ouvrageClemPas encore d'évaluation
- Schubert La Mort Dans La Tranchee La Mort Du Portrait 2010Document23 pagesSchubert La Mort Dans La Tranchee La Mort Du Portrait 2010ΤιάγκοΜόριPas encore d'évaluation
- EXPRESSIONNISMEDocument3 pagesEXPRESSIONNISMEbeebac2009Pas encore d'évaluation
- Le Complexe de GradivaDocument14 pagesLe Complexe de GradivaCaravagePas encore d'évaluation
- Georges Didi Huberman Devant Le Temps Histoire de L Art Et Anachronisme Des ImagesDocument3 pagesGeorges Didi Huberman Devant Le Temps Histoire de L Art Et Anachronisme Des ImagesjaviercanoramosPas encore d'évaluation
- Dossier Expo Web v2Document24 pagesDossier Expo Web v2gabemkaphotoPas encore d'évaluation
- Michel Guérin - Walter BenjaminDocument4 pagesMichel Guérin - Walter BenjaminGökçe BayerPas encore d'évaluation
- Cours Art PDFDocument16 pagesCours Art PDFAhmedCommunistePas encore d'évaluation
- Les Cahiers dessinés (Paris - 2015): Les Fiches Exposition d'UniversalisD'EverandLes Cahiers dessinés (Paris - 2015): Les Fiches Exposition d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Histoire Des Arts Temps Moderne Et Contemporain Partie 2Document11 pagesHistoire Des Arts Temps Moderne Et Contemporain Partie 2nanak972Pas encore d'évaluation
- Art C'est La VieDocument15 pagesArt C'est La VieBleue BleuePas encore d'évaluation
- Questions-Réponses ACDocument4 pagesQuestions-Réponses ACMickael VatinPas encore d'évaluation
- Heidegger M. - Schelling Le Traité de 1809 Sur L'essence de La Liberté HumaineDocument24 pagesHeidegger M. - Schelling Le Traité de 1809 Sur L'essence de La Liberté HumaineuiqPas encore d'évaluation
- Dada (Paris - 2005): Les Fiches Exposition d'UniversalisD'EverandDada (Paris - 2005): Les Fiches Exposition d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Lexique Arts PlastiquesDocument8 pagesLexique Arts Plastiquesabir attallahPas encore d'évaluation
- Realites NouvellesDocument80 pagesRealites Nouvellesnaas8469100% (1)
- Jang Object DuchampienDocument106 pagesJang Object Duchampienjalves_826930Pas encore d'évaluation
- Le Corps Comme Garant Du RéelDocument11 pagesLe Corps Comme Garant Du Réelhassan_hamoPas encore d'évaluation
- Bibliographie - Théorie de L'art ComtemporainDocument23 pagesBibliographie - Théorie de L'art ComtemporainAhmed KabilPas encore d'évaluation
- La Banane ScotchéDocument3 pagesLa Banane Scotchékamal achikePas encore d'évaluation
- Les Écrivains devant l'impressionnisme de Denys Riout: Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandLes Écrivains devant l'impressionnisme de Denys Riout: Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Passage Walter Benjamin - Michel GuérinDocument5 pagesPassage Walter Benjamin - Michel GuérinProfesorecononiaPas encore d'évaluation
- EXTRËME Esthétique de La Limite DépasséeDocument22 pagesEXTRËME Esthétique de La Limite DépasséeTerra VedaPas encore d'évaluation
- Archéologie Des Images Et Logique RétrospectiveDocument18 pagesArchéologie Des Images Et Logique Rétrospectivezalulé zanzibarPas encore d'évaluation
- Duchamp Transparencia La Maison de VerreDocument12 pagesDuchamp Transparencia La Maison de VerreJavier LongobardoPas encore d'évaluation
- Dubois Le FiguralDocument1 pageDubois Le FiguralSandro de OliveiraPas encore d'évaluation
- Art BrutDocument6 pagesArt BrutMc TefryPas encore d'évaluation
- Quest 08Document3 pagesQuest 08FetuePas encore d'évaluation
- Ecume 15 10 22Document4 pagesEcume 15 10 22Derridj MeriemPas encore d'évaluation
- Iconologie Nostalgique - DURAFOURDocument20 pagesIconologie Nostalgique - DURAFOURJojoPas encore d'évaluation
- Copie de Copie de Copie de Sujet D'argu FRDocument3 pagesCopie de Copie de Copie de Sujet D'argu FRViolette 1Pas encore d'évaluation
- Fiche Chapitre 2 Reconfigurations Artistiques InternationalesDocument53 pagesFiche Chapitre 2 Reconfigurations Artistiques Internationalesje jfzckv’Pas encore d'évaluation
- Implication de L Artiste Dans L Espace PublicDocument8 pagesImplication de L Artiste Dans L Espace Publicتوفيق مفتاحPas encore d'évaluation
- Emil Nolde (Paris - 2008): Les Fiches Exposition d'UniversalisD'EverandEmil Nolde (Paris - 2008): Les Fiches Exposition d'UniversalisPas encore d'évaluation
- MALDINEY ESCOUBAS L'Esthétique D'henry Maldiney. Le Phénomène Et Le Rythme (Phainomenon)Document10 pagesMALDINEY ESCOUBAS L'Esthétique D'henry Maldiney. Le Phénomène Et Le Rythme (Phainomenon)lectordigitalisPas encore d'évaluation
- 21 MR Journal Olbricht OK 0.1Document13 pages21 MR Journal Olbricht OK 0.1puppe03Pas encore d'évaluation
- 'Comprendre' de Pierre Bourdieu in 'Mot À Mot' de Daniel BurenDocument9 pages'Comprendre' de Pierre Bourdieu in 'Mot À Mot' de Daniel BurenSandy ClawsPas encore d'évaluation
- Effacer Paradoxe D Un Geste Artistique DDocument7 pagesEffacer Paradoxe D Un Geste Artistique DThomas FerreiraPas encore d'évaluation
- Pierre Wat PérégrinationsDocument12 pagesPierre Wat PérégrinationsAnne PescePas encore d'évaluation
- Expressionnisme - CopieDocument2 pagesExpressionnisme - CopieAhmed El abdellaouiPas encore d'évaluation
- Joseph Beuys Et Le Mouvement FluxusDocument9 pagesJoseph Beuys Et Le Mouvement FluxusIrène BlancPas encore d'évaluation
- Forum de L e Ducation Artistique Et Culturelle - Art de L Image - Image de L ArtDocument8 pagesForum de L e Ducation Artistique Et Culturelle - Art de L Image - Image de L ArtSamia GallahPas encore d'évaluation
- Jean-Louis Comolli - "Lessive Spectaculaire Des Images Passées"Document6 pagesJean-Louis Comolli - "Lessive Spectaculaire Des Images Passées"xuaoqunPas encore d'évaluation
- Samuel Beckett - Quad Et Autres Pièces Pour La Télévision Suivi de Deleuze, L'épuiséDocument79 pagesSamuel Beckett - Quad Et Autres Pièces Pour La Télévision Suivi de Deleuze, L'épuiséFábio LucasPas encore d'évaluation
- Jean-Christophe Bailly - "Connaissance Par Les Traces. Pour Une Ichnologie Généralisée"Document14 pagesJean-Christophe Bailly - "Connaissance Par Les Traces. Pour Une Ichnologie Généralisée"xuaoqunPas encore d'évaluation
- André S. Labarthe - "Transfusion. L'œil Du Cinéaste"Document3 pagesAndré S. Labarthe - "Transfusion. L'œil Du Cinéaste"xuaoqunPas encore d'évaluation
- Catherine Paoletti - "Derrida Fantôme"Document11 pagesCatherine Paoletti - "Derrida Fantôme"xuaoqunPas encore d'évaluation
- Georges Didi-Huberman - "La Condition Des Images Entretien Avec Frédéric Lambert Et François Niney"Document12 pagesGeorges Didi-Huberman - "La Condition Des Images Entretien Avec Frédéric Lambert Et François Niney"xuaoqunPas encore d'évaluation
- Serge Daney - "La Remise en Scène (Notes) "Document6 pagesSerge Daney - "La Remise en Scène (Notes) "xuaoqunPas encore d'évaluation
- Pierre Zaoui, Mathieu Potte-Bonneville - "S'inquiéter Devant Chaque Image. Entretien Avec Georges Didi-Huberman"Document10 pagesPierre Zaoui, Mathieu Potte-Bonneville - "S'inquiéter Devant Chaque Image. Entretien Avec Georges Didi-Huberman"xuaoqunPas encore d'évaluation
- Alexis Lussier, Guylaine Massoutre Et Manon Plante - "Imaginer Atlas. Entretien Avec Georges Didi-Huberman"Document5 pagesAlexis Lussier, Guylaine Massoutre Et Manon Plante - "Imaginer Atlas. Entretien Avec Georges Didi-Huberman"xuaoqunPas encore d'évaluation
- Georges Didi-Huberman - "Soulèvements Poétiques (Poésie, Savoir, Imagination) "Document6 pagesGeorges Didi-Huberman - "Soulèvements Poétiques (Poésie, Savoir, Imagination) "xuaoqunPas encore d'évaluation
- La RenaissanceDocument14 pagesLa RenaissanceКристияна КърпачеваPas encore d'évaluation
- P 1-Poesies Rentree-2Document14 pagesP 1-Poesies Rentree-2Celia sara FardounPas encore d'évaluation
- 1 5 Anish Kapoor PDFDocument3 pages1 5 Anish Kapoor PDFsaïd DebladjiPas encore d'évaluation
- Leo - Delibes Messe - Breve Coro - Organo 1 3Document3 pagesLeo - Delibes Messe - Breve Coro - Organo 1 3Camila ContrerasPas encore d'évaluation
- Bic - Trad PDFDocument176 pagesBic - Trad PDFMollan&fils0% (1)
- Stendhal Racine Et ShakesDocument1 pageStendhal Racine Et Shakesdoriscka ducastelle2Pas encore d'évaluation
- Pipoca DM - AraketuDocument4 pagesPipoca DM - AraketuBruno CabralPas encore d'évaluation
- Paul GauguinDocument18 pagesPaul GauguinViktor ZeljPas encore d'évaluation
- 3 Srednjovekovno Staklo Na Balkanu KV PDFDocument296 pages3 Srednjovekovno Staklo Na Balkanu KV PDFGajevic Slaven100% (1)
- Ma Liberte Contre La Tienne With TranslationDocument1 pageMa Liberte Contre La Tienne With TranslationMary-Clare de EchevarriaPas encore d'évaluation
- Tableaux DoubleDocument4 pagesTableaux DoublelotusetjasminPas encore d'évaluation
- Your Grace Still Amazes Me-ChoirDocument3 pagesYour Grace Still Amazes Me-ChoirRosalio Celestino AguilarPas encore d'évaluation
- Dittersdorf KonzertKadenzenDocument8 pagesDittersdorf KonzertKadenzenVirgil Florin PrisacariuPas encore d'évaluation
- GenerosoDocument1 pageGenerosoCarlinhos MullerPas encore d'évaluation
- SerranoJose (LosClaveles) QueTeImporta (Violin1)Document2 pagesSerranoJose (LosClaveles) QueTeImporta (Violin1)Sumer remus matsPas encore d'évaluation
- Selena Quintanilla PartesDocument52 pagesSelena Quintanilla PartesIsmael Carrillo MendozaPas encore d'évaluation
- Ecriture Ce1 OkDocument77 pagesEcriture Ce1 OkKoulPas encore d'évaluation
- Candice Renoir Avec ExercicesDocument2 pagesCandice Renoir Avec ExercicesKhoảng LặngPas encore d'évaluation
- F5e Livreduprofesseur Chap05Document19 pagesF5e Livreduprofesseur Chap05h944m7sbvvPas encore d'évaluation
- SagesseDocument4 pagesSagesseKhaoula Sghaier Ep KastouriPas encore d'évaluation
- Devoir Musée Mural de Diego RiveraDocument7 pagesDevoir Musée Mural de Diego RiveraJESSICA MUÑOZPas encore d'évaluation
- Ctivités D'arts Plastiques À L'école: Tome 1Document18 pagesCtivités D'arts Plastiques À L'école: Tome 1Wiktoria Wik Matylda LalPas encore d'évaluation
- Dossier UNE JEUNESSE EN ETE Simon Roth v280921Document16 pagesDossier UNE JEUNESSE EN ETE Simon Roth v280921JING HONGPas encore d'évaluation
- Danzon n2 Trompeta 1 PDFDocument6 pagesDanzon n2 Trompeta 1 PDFTrp Carlos100% (1)