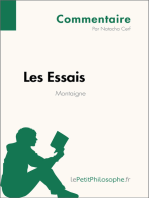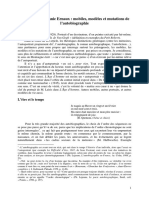Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Montaigne - Les Essais - Présentation
Montaigne - Les Essais - Présentation
Transféré par
eleveyoussef.shalabyCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Montaigne - Les Essais - Présentation
Montaigne - Les Essais - Présentation
Transféré par
eleveyoussef.shalabyDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Essais : présentation
Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) peut être défini comme un philosophe et moraliste français.
Il ne faut néanmoins pas négliger sa carrière politique et juridique : il a en effet été magistrat, maire de
Bordeaux, mais également ami proche d’Henri de Navarre, futur Henri IV. L’un des faits marquants de son
existence reste sans nul doute sa rencontre avec Étienne de la Boétie, au Parlement de Bordeaux, avec lequel il
noua une amitié profonde, restée célèbre. La Boétie mourut quatre ans plus tard, emporté par la maladie. Il est
l’auteur d’un texte saisissant sur l’obéissance à la tyrannie, qui reste d’actualité encore aujourd’hui et qu’il
rédigea alors qu’il avait à peine dix-huit ans, le Discours de la servitude volontaire. Montaigne lui rendit
hommage dans son ouvrage, notamment dans l’essai intitulé « De l’Amitié ».
Les Essais, auxquels Montaigne a travaillé de 1572 à sa mort, sont un recueil de textes épars, dont les
sujets peuvent être très différents, allant des plus graves, comme la mort, aux plus futiles, tels que les chevaux,
les coches, les pouces, en passant par des sujets que l’on peut caractériser comme « sérieux » : l’amitié, la
solitude, l’éducation. Dans son adresse au lecteur, Montaigne prend soin de souligner la modestie de son
entreprise en limitant son public à son cercle familial ; d’ailleurs, il ne cessera, au fil de la rédaction, de rappeler
son insuffisance et ses défauts. Cet état d’esprit est d’ores et déjà affirmé par le titre même de son projet : un
essai est avant tout un exercice par lequel l’auteur éprouve ses capacités, ses ressources sur un sujet précis, mais
sans jamais prétendre apporter une vérité définitive. Et, ici, cette mise à l’épreuve est finalement révélatrice du
caractère, de la personnalité, du tempérament de son auteur qui, en se confrontant à une matière précise, se
confronte également à lui-même. Les Essais sont donc une image kaléidoscopique de celui qui les a élaborés.
Si Les Essais sont hétéroclites par leurs sujets, ils le sont aussi par leur forme même : au début conçus
comme de simples leçons, ils sont peu à peu devenus des textes partagés entre la réflexion et l’introspection ou
encore la confession, de telle sorte qu’ils tiennent à la fois de la philosophie et de l’autobiographie. Montaigne
s’y peint dans sa nudité mais, bien loin de n’être qu’un manifeste d’égotisme, ils constituent une peinture de la
condition humaine : les qualités, les défauts, la réalité du quotidien, qu’elle soit particulièrement significative ou
au contraire dérisoire, sont tour à tour abordés, et en exposant son « Moi », l’auteur ne dévoile rien d’autre que
l’essence de l’homme, qui se révèle autant par ses passions (la peur, la colère, le courage) que par ses
comportements et ses « travers » (le mensonge, l’oisiveté, l’ivrognerie, la prévision de l’avenir). Recueil
inclassable, Les Essais nous livrent en quelque sorte le parcours d’une pensée à travers celui d’une vie. Dans
cette mesure, ils s’apparentent à un journal ou encore à une chronique qui serait chargée de collecter diverses
pensées ; et ces dernières peuvent s’avérer contradictoires sur un même sujet, d’un essai à un autre, sans que
Montaigne ne cherche à se justifier ni même à masquer ce que d’autres considéreraient peut-être comme la
preuve d’une pensée sans principes véritables.
Ayant parlé et écrit exclusivement en latin jusqu’à l’âge de six ans, Montaigne s’est résolu à utiliser le
français pour ses essais, du moins le français du XVIe siècle, ce qui rend leur compréhension parfois ardue. C’est
pourquoi il est habituel de trouver des éditions qui en modernisent l’orthographe ou qui se chargent même de les
retranscrire en français moderne. Leur auteur souhaitait un style simple et direct : le lecteur peut ainsi avoir
l’impression que celui-ci écrit comme il parle, et cela d’autant plus que ses réflexions se situent parfois à la
limité de la causerie familière, accumulant les anecdotes et parfois même les histoires surnaturelles. La langue de
Montaigne est donc « naturelle », expressive, imagée, et cherche avant tout la proximité avec le lecteur ; il n’est
donc pas rare d’y trouver des expressions issues du patois périgourdin.
Le texte de Montaigne est jonché de citations issues des écrivains de l’Antiquité, lesquelles ont
plusieurs fonctions : elles peuvent servir d’ornements, d’illustrations, d’arguments d’autorité, mais sont
également susceptibles de contribuer à élaborer la substance même de la réflexion. Il faut également noter que
Montaigne reprend souvent, sans les nommer, des pensées des écrivains évoqués plus hauts, pratique qui était
courante à l’époque de la rédaction des Essais, tout comme l’était celle des citations. Néanmoins, chez
Montaigne, ces pratiques ne relèvent pas de l’érudition, ni du pédantisme, qu’il combat expressément dans l’un
de ses essais ; elles sont bien plutôt les instruments d’une pensée qui, bien que sous influence, n’en est pas moins
originale et libre, parfois même à l’excès. Ses nombreuses digressions, qui font parfois perdre le fil d’un sujet
précis, en témoignent largement. Parmi les sources principales d’inspiration de l’auteur, on peut évoquer les
Épicuriens (Épicure, Lucrèce), le stoïcisme (plus précisément Sénèque), ou encore Platon, Socrate, Xénophon,
Plutarque, Cicéron. La pensée de Montaigne se rapproche donc beaucoup des éthiques de l’Antiquité ; par
conséquent, elle est conçue comme une philosophie pratique, visant avant toute chose le bien-vivre. Elle n’a pas
pour objectif d’étaler un savoir théorique, abstrait, d’élargir le champ de la connaissance, mais bien plutôt
d’œuvrer à une sagesse par laquelle chacun puisse devenir pleinement homme. Cet objectif, allié à la foi en la
raison, font de cette pensée un humanisme.
Vous aimerez peut-être aussi
- TP ProbabilitéDocument3 pagesTP ProbabilitéAbouZakariaPas encore d'évaluation
- Fascicule Francais. Mamadou Lamine DANFADocument52 pagesFascicule Francais. Mamadou Lamine DANFAgorguy95% (110)
- Exemple de Dissertation RédigéeDocument3 pagesExemple de Dissertation RédigéeAymeric100% (2)
- Jean Starobinski - Montaigne en Mouvement (1993, Gallimard) - Libgen - LiDocument606 pagesJean Starobinski - Montaigne en Mouvement (1993, Gallimard) - Libgen - LiJuanPabloMontoyaPepinosaPas encore d'évaluation
- PFE TOUZANI & SAIDIimpriméDocument49 pagesPFE TOUZANI & SAIDIimprimérachidsaidi0100% (1)
- Les Essais de Montaigne (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandLes Essais de Montaigne (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- MontaigneDocument2 pagesMontaigneAni IgnatPas encore d'évaluation
- Essais de Michel Eyquem de Montaigne: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandEssais de Michel Eyquem de Montaigne: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Trabalho para Acabar (Eugéenio)Document5 pagesTrabalho para Acabar (Eugéenio)Luciano AndréPas encore d'évaluation
- M.B. TALEB-KHYAR.c'Est de MontaigneDocument9 pagesM.B. TALEB-KHYAR.c'Est de MontaigneMark CohenPas encore d'évaluation
- Textes Autobio 1Document9 pagesTextes Autobio 1BrechtPas encore d'évaluation
- MONTAIGNEDocument17 pagesMONTAIGNEsalmaaitraho01Pas encore d'évaluation
- 1 5080212898257567895 PDFDocument49 pages1 5080212898257567895 PDFyaopierre jeanPas encore d'évaluation
- Littérature Du XVIèmeDocument7 pagesLittérature Du XVIèmeredsavarin76Pas encore d'évaluation
- Ecrire La Vie Conférence Compagnon College de FranceDocument5 pagesEcrire La Vie Conférence Compagnon College de FranceRosalie de SainsPas encore d'évaluation
- La Représentation Du Monologue Dans Les Romans de StendhalDocument7 pagesLa Représentation Du Monologue Dans Les Romans de StendhalayouzyouftnPas encore d'évaluation
- 1re Francais La Reflexion Sur L Homme A Travers Les Textes ArgumentatifsDocument3 pages1re Francais La Reflexion Sur L Homme A Travers Les Textes Argumentatifsessafiimane2788Pas encore d'évaluation
- BlanchotDocument34 pagesBlanchotchantal tcheterianPas encore d'évaluation
- Henri Meschonnic Pour Le Poetique EssaiDocument4 pagesHenri Meschonnic Pour Le Poetique Essaidriss hilaliPas encore d'évaluation
- Analyse de L'essai - Sur La Peur - de Michel de MontaigneDocument3 pagesAnalyse de L'essai - Sur La Peur - de Michel de MontaigneRoxana BinascoPas encore d'évaluation
- Souchier L'image Du Texte Pour Une Theorie de L'énonciation ÉditorialeDocument9 pagesSouchier L'image Du Texte Pour Une Theorie de L'énonciation ÉditorialeGABANIGABANI100% (1)
- Carnet de LectureDocument3 pagesCarnet de LectureJujuPas encore d'évaluation
- Je Suis Moi-Même La Matière de Mon Livre PensDocument3 pagesJe Suis Moi-Même La Matière de Mon Livre PensMbaye DiakhoumpaPas encore d'évaluation
- Cours Autobiographie RefaitDocument37 pagesCours Autobiographie RefaitAlina Alina100% (1)
- Roger Chartier, MontaigneDocument3 pagesRoger Chartier, MontaigneValeriu GherghelPas encore d'évaluation
- JJR Montaigne PDFDocument20 pagesJJR Montaigne PDFlouise antheaumePas encore d'évaluation
- Antoine Compagnon, Littérature Française ModerneDocument22 pagesAntoine Compagnon, Littérature Française ModerneValeriu GherghelPas encore d'évaluation
- FOUCAULT L'écriture de SoiDocument11 pagesFOUCAULT L'écriture de SoiMélissa Le Yaouanq50% (2)
- Expose Approche TextuelleDocument14 pagesExpose Approche TextuelleJalilMarsPas encore d'évaluation
- Narratologie 499Document12 pagesNarratologie 499Marti LelisPas encore d'évaluation
- Repertóire - Michel ButorDocument14 pagesRepertóire - Michel ButorEitan EfraimPas encore d'évaluation
- Andre Comte-Sponville - Montaigne Philosophie VivanteDocument10 pagesAndre Comte-Sponville - Montaigne Philosophie VivanteMark CohenPas encore d'évaluation
- Pierre Pachet /// Habilitation À Diriger Des RecherchesDocument32 pagesPierre Pachet /// Habilitation À Diriger Des RecherchesPierrePachetPas encore d'évaluation
- Qu'est-ce que la littérature ? de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandQu'est-ce que la littérature ? de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le Linguiste Et L'inconscient-2008Document193 pagesLe Linguiste Et L'inconscient-2008KouadioPas encore d'évaluation
- Esquisse Biographique by Rosset, Clément (Rosset, Clément)Document82 pagesEsquisse Biographique by Rosset, Clément (Rosset, Clément)MatyiPas encore d'évaluation
- Hillen - de Sartre À Houellebecp PDFDocument152 pagesHillen - de Sartre À Houellebecp PDFiroviro50% (4)
- Paul Imbs, de La Fin'amorDocument22 pagesPaul Imbs, de La Fin'amorValeriu GherghelPas encore d'évaluation
- Avertissement D'incendieDocument159 pagesAvertissement D'incendiefalaPas encore d'évaluation
- Panet FDocument78 pagesPanet FNicolasAPas encore d'évaluation
- 1517-Article Text-3039-1-10-20211129Document22 pages1517-Article Text-3039-1-10-20211129manu BobPas encore d'évaluation
- L'idealismeDocument10 pagesL'idealismeFabio Prado de FreitasPas encore d'évaluation
- Pour Une Sociocritique Ou Variation Sur Un Incipit: Mme BovaryDocument11 pagesPour Une Sociocritique Ou Variation Sur Un Incipit: Mme BovaryStéphane RosellierPas encore d'évaluation
- De La PhilosophieDocument11 pagesDe La PhilosophieAlain KayumbaPas encore d'évaluation
- H. J. Janssen - Montaigne Fidéiste 1930Document79 pagesH. J. Janssen - Montaigne Fidéiste 1930cohenmaPas encore d'évaluation
- THESE HoetDocument351 pagesTHESE HoetBrahim QazzouPas encore d'évaluation
- Argumentation Les Différents Types de Raisonnement Et de GenresDocument3 pagesArgumentation Les Différents Types de Raisonnement Et de GenresAymar BFDPas encore d'évaluation
- Qu Est Ce Qu Un EssaiDocument5 pagesQu Est Ce Qu Un EssaiSilvia CorolencoPas encore d'évaluation
- Couturier M. Postface A La Figure de L'auteur 2008Document10 pagesCouturier M. Postface A La Figure de L'auteur 2008anon_750073837100% (1)
- ARMAND MÜLLER - MontaigneDocument50 pagesARMAND MÜLLER - MontaigneMark CohenPas encore d'évaluation
- Canac Philosophie MontDocument83 pagesCanac Philosophie MonthilladeclackPas encore d'évaluation
- De Rousseau À Annie Ernaux: Mobiles, Modèles Et Mutations de L'autobiographieDocument33 pagesDe Rousseau À Annie Ernaux: Mobiles, Modèles Et Mutations de L'autobiographieTiti SuruPas encore d'évaluation
- Ecrits Sur Les Materialistes Le Travail La Nature Et LartDocument288 pagesEcrits Sur Les Materialistes Le Travail La Nature Et LartmarcelloluchiniPas encore d'évaluation
- Angenot Marc La Parole PamphlétaireDocument7 pagesAngenot Marc La Parole PamphlétaireLaraPas encore d'évaluation
- Argumentation Livre Prof c04 - LDP - Empreintes-Litt-1reDocument73 pagesArgumentation Livre Prof c04 - LDP - Empreintes-Litt-1receline100% (1)
- Dissertation IntroDocument2 pagesDissertation IntroMavoungou100% (1)
- Le Pamphlet Genre en Liberté Ou Concentré D'idéologieDocument9 pagesLe Pamphlet Genre en Liberté Ou Concentré D'idéologieFrédéric DautremerPas encore d'évaluation
- Plinio PRADO - Un Poète Égaré Au Sein de L'universitéDocument28 pagesPlinio PRADO - Un Poète Égaré Au Sein de L'universitéJoãoCamilloPennaPas encore d'évaluation
- Alain (Emile Chartier) - Lettres À Sergio Solmi (1946)Document47 pagesAlain (Emile Chartier) - Lettres À Sergio Solmi (1946)rebecca.geo1789Pas encore d'évaluation
- Article - Sens Et Structure D'un Essai de Montaigne. Sur Des Vers de VirgileDocument13 pagesArticle - Sens Et Structure D'un Essai de Montaigne. Sur Des Vers de VirgileAriciePas encore d'évaluation
- Les Mots de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLes Mots de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Tshibanda Wamuela Bujitu: Pays: Langue: Sexe: Note: Autres Formes Du NomDocument3 pagesTshibanda Wamuela Bujitu: Pays: Langue: Sexe: Note: Autres Formes Du NomAbraham NikunaPas encore d'évaluation
- L'analyse Genre Du Secteur de L'éducation. Rapport. Larbi Wafi. Consultant. Improving Training For Quality Advancement in National Education. Mai 2010 ...Document46 pagesL'analyse Genre Du Secteur de L'éducation. Rapport. Larbi Wafi. Consultant. Improving Training For Quality Advancement in National Education. Mai 2010 ...Abdelkrim MokhikaPas encore d'évaluation
- Séquence Passerelle. Mourad Maoui PDFDocument5 pagesSéquence Passerelle. Mourad Maoui PDFAhlem AichiPas encore d'évaluation
- Tutorat Et Autonomie de L Apprenant en Foad Par InternetDocument12 pagesTutorat Et Autonomie de L Apprenant en Foad Par InternetmonkaratPas encore d'évaluation
- Cours de Sédimentologie ITA LP GPG-MIN 2020Document96 pagesCours de Sédimentologie ITA LP GPG-MIN 2020Emmanuel NguiletPas encore d'évaluation
- D2 4 VO (4) Ondes Intro PDFDocument20 pagesD2 4 VO (4) Ondes Intro PDFBoudjema SoudedPas encore d'évaluation
- HB Réseaux de Communication M2MDocument98 pagesHB Réseaux de Communication M2Mp4 ifmia100% (1)
- 3-30 AO UT 2020: Articles D' Etude PourDocument32 pages3-30 AO UT 2020: Articles D' Etude PourWADJOPas encore d'évaluation
- .Exercices p.4-7Document4 pages.Exercices p.4-7Dorota PoziemskaPas encore d'évaluation
- CirculateurDocument11 pagesCirculateursalPas encore d'évaluation
- Cours 9-Conception bioclimatique-CUADDocument7 pagesCours 9-Conception bioclimatique-CUADToure AliouPas encore d'évaluation
- Spagirie 37-48Document81 pagesSpagirie 37-48franck atlaniPas encore d'évaluation
- 4TE41TEWB0023U05 CoursTechnologie-U05Document40 pages4TE41TEWB0023U05 CoursTechnologie-U05sunshineneko3Pas encore d'évaluation
- CI 2021 Question ContemporaineDocument4 pagesCI 2021 Question ContemporaineN GPas encore d'évaluation
- 12 Test La ComparaisonDocument1 page12 Test La ComparaisonNatali ScerbacovaPas encore d'évaluation
- Saint Saëns Cello Concerto - PartesDocument2 pagesSaint Saëns Cello Concerto - PartesDavid Ruiz LlanosPas encore d'évaluation
- Maroc-Projet de Cimenterie de Tekcim-Resume EIES-10 2017Document40 pagesMaroc-Projet de Cimenterie de Tekcim-Resume EIES-10 2017EMOPas encore d'évaluation
- Etudes Theme 3 - SCDocument2 pagesEtudes Theme 3 - SCMohamed KABLYPas encore d'évaluation
- Chapitre I-Généralités Sur Les Solutions 26-SEP2023Document12 pagesChapitre I-Généralités Sur Les Solutions 26-SEP2023fatmazahraboucettaPas encore d'évaluation
- Mon MémoireDocument124 pagesMon MémoireIkram rsPas encore d'évaluation
- Planilha Eventos RarosDocument132 pagesPlanilha Eventos RarosGustavo RibeiroPas encore d'évaluation
- La Linguistique Dans Tous Les Sens by Françoise Sullet-Nylander, Hugues Engel, Gunnel Engwall PDFDocument241 pagesLa Linguistique Dans Tous Les Sens by Françoise Sullet-Nylander, Hugues Engel, Gunnel Engwall PDFMosbah Said100% (1)
- Algebre 6Document33 pagesAlgebre 6Let us DancePas encore d'évaluation
- Ezine - Laser de Lune T025Document114 pagesEzine - Laser de Lune T025Frédéric Le GarsPas encore d'évaluation
- 3 - Suspension Et Rupture Du Contrat de TravailDocument42 pages3 - Suspension Et Rupture Du Contrat de Travaillahrach.yasmine1Pas encore d'évaluation
- Candle Lighting Prayer Card FrenchDocument2 pagesCandle Lighting Prayer Card FrenchJean Ernest JohannaPas encore d'évaluation
- Guide Sur Le Prélèvement D'un Échantillon ReprésentatifDocument36 pagesGuide Sur Le Prélèvement D'un Échantillon ReprésentatifInfographie MarketingPas encore d'évaluation
- Les FARC Et Internet: Fabrique D'une Guérilla VirtuelleDocument150 pagesLes FARC Et Internet: Fabrique D'une Guérilla Virtuellenobr_Pas encore d'évaluation