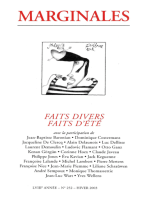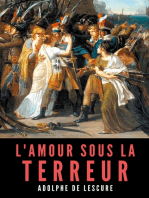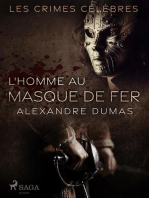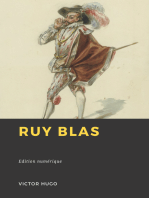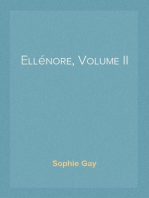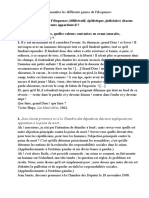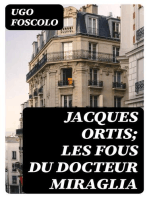Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ebm2024 8552
Ebm2024 8552
Transféré par
ruth.greene8260 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
2 vues22 pagesTitre original
ebm2024_8552
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Télécharger au format pdf ou txt
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
2 vues22 pagesEbm2024 8552
Ebm2024 8552
Transféré par
ruth.greene826Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Télécharger au format pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 22
A Lady's Stardust Passion: A Historical
Regency Romance Novel Meghan Sloan
Visit to download the full and correct content document:
https://ebookmass.com/product/a-ladys-stardust-passion-a-historical-regency-romanc
e-novel-meghan-sloan/
Another random document with
no related content on Scribd:
Du reste, cette donnée de la Folie est loin d’avoir été négligée de
notre théâtre ! Shakespeare notamment n’a guère mis en scène,
dans ses drames les plus personnels, que des fous : lady Macbeth
est somnambule et meurt d’hystérie, son époux est halluciné, de
même qu’Hamlet, celui-ci lypémaniaque en sus, Timon aussi,
Othello est épileptique et le roi Lear complètement insensé. C’est
par là que le grand William est un modèle si dangereux (Gœthe ne
voulait pas le lire plus d’une fois par an). Ç’a été un peu le même
rôle que celui de Michel-Ange : exagération des ressorts jusqu’aux
dernières limites du réel, au-delà desquelles les disciples tombent,
immédiatement, dans une affectation très ridicule. Au contraire, si
j’excepte le prétexte à étudier la folie en elle-même, que fournit Ajax
depuis Astydamas jusqu’à Ennius et depuis Ennius jusqu’à
l’empereur Auguste, je n’aperçois de « shakespearien » dans
l’antiquité qu’Oreste. Tous les autres personnages jouissent de leur
bon sens, et n’en deviennent pas moins (précieux encouragement)
pathétiques. Seul même, Œdipe montre, à défaut d’anormal dans la
constitution psychologique du héros, l’extraordinaire dans les
événements extérieurs (ressource dont usèrent si largement depuis
les romantiques de 1830). Mais le reste des types dramatiques
évoluait selon de normales passions, dans des conditions intimes et
objectives relativement fréquentes.
XVII e SITUATION
Imprudence fatale
(L’Imprudent — La Victime ou l’Objet perdu)
auxquels s’ajoutent, à l’occasion, « le Conseiller » sage qui s’oppose
à l’imprudence, « l’Instigateur » mauvais, intéressé ou irréfléchi, puis
la kyrielle des Témoins, Victimes secondaires, Instruments, etc.
A 1 — Par imprudence causer son propre malheur : —
Eumèle de Sophocle, Phaéton d’Euripide (où le Conseiller se fond
avec le personnage Instrumental, et où, lié par un serment trop hâtif,
il se voit dans la Situation XXIIIe A 2 : Devoir sacrifier un proche
pour tenir un serment.), Le constructeur Solness.
2 — Par imprudence causer son propre déshonneur : — La
Banque de l’Univers (M. Grenet-Dancourt, 1886). Ex. roman. :
l’Argent de Zola. Ex. hist. : Ferdinand de Lesseps.
B 1 — Par curiosité causer son propre malheur : —
Sémélè d’Eschyle. Ex. historiques (s’élevant à la XXe, « Sacrifices à
l’Idéal ») : morts de tant de savants.
2 — Par curiosité perdre la possession d’un être aimé : —
Psyché (empruntée au récit que La Fontaine tira d’Apulée, —
débiteur lui-même, comme on sait, de Lucius de Patras, — et mise à
la scène par Corneille, Molière et Quinault), Esclarmonde (M.
Massenet, 1889). Ex. légendaire : Orphée ramenant Eurydice. Cette
nuance s’étend dans la direction des XXXIIe et XXXIIIe données
(Jalousie erronée et Erreur judiciaire), car elle fait aussi un vigoureux
appel à la foi, dans sa plus absolue imperturbabilité.
C 1 — Par curiosité causer la mort, les maux des hommes :
— Les Pandores de Voltaire et de Gœthe ; le Canard sauvage
d’Ibsen (partie théorique, morale), avec A 1 comme dénouement et
comme exemple pratique. Ex. légendaire : Ève.
2 — Par imprudence causer la mort d’un proche : — Renée
Mauperin des de Goncourt. Ex. ord. : Soins maladroits donnés à un
malade. Louise Leclercq de Verlaine.
3 — Par imprudence causer la mort de son amant : —
Samson de Voltaire, la Belle aux cheveux d’or (M. Arnould, 1882).
4 — Par crédulité causer la mort d’un proche : — Pélias
de Sophocle et les Péliades d’Euripide. Ex. rom. (par crédulité
causer le malheur de ses concitoyens) : Port-Tarascon.
Établissez, dans chacune des nuances qui précèdent, des
symétriques aux cas qui ne se sont présentés, isolés, que dans une
seulement, et vous avez les sujets suivants : Par imprudence
(j’entends par pure imprudence, sans alliage de curiosité ni de
crédulité, c’est-à-dire d’intérêt personnel ou extérieur), causer le
malheur des hommes, — perdre la possession d’un être aimé
(amant ou amante, époux ou épouse, ami ou amie, bienfaiteur,
protégé, allié, etc.), — causer la mort d’un proche (ici, tous les
degrés de parenté), — d’un être aimé ; — par curiosité (sans
mélange d’imprudence ni de crédulité, c’est-à-dire d’une façon
parfaitement volontaire, encore que sottement) causer le
déshonneur d’un proche (il y a des variétés assez nombreuses de
déshonneur, selon qu’il touche à la probité, à la bravoure, à la
pudeur, à la loyauté), — causer celui d’un être aimé, — causer son
propre déshonneur ; — causer ces déshonneurs par crédulité pure
(c’est-à-dire de la manière la plus innocente, puisqu’il ne s’y trouve
ni imprudence ni curiosité ; quant aux ressources dont la Ruse
dispose pour gagner cette crédulité, on en a une première idée par
l’examen de la XIIe Obtenir) ; par crédulité aussi, causer son propre
malheur, — ou perdre la possession d’un être aimé, — ou causer le
malheur des hommes, — ou causer la mort d’un être aimé.
Passez, à présent, aux raisons pour lesquelles se précipitent, —
aussitôt que la curiosité, la crédulité ou l’imprudence pures ont agi,
— les catastrophes jusque-là suspendues. Ces raisons sont : une
infraction à la défense préalable articulée par une divinité ; le
caractère mortel de l’action pour qui l’accomplit (caractère dû à des
causes soit mécaniques, soit biologiques, soit juridiques, soit
guerrières, soit autres encore) ; les conséquences mortelles de
l’action pour le proche ou l’aimé de qui doit l’accomplir ; une faute
antérieurement commise (avec ou sans conscience) et qui va être
révélée et punie, etc.
En sus de la curiosité et de la crédulité, d’autres mobiles
déterminent l’imprudence : les Trachiniennes nous montrent la
jalousie. Nous pouvons donner le même rôle à toutes les passions,
toutes les émotions, tous les désirs, tous les besoins, tous les goûts
sensuels, toutes les faiblesses vitales : sommeil, faim,
développement de l’activité musculaire, évasion, gourmandise,
luxure, tendresse, coquetterie, vanité des dons physiques, des
prérogatives sociales ou des supériorités psychiques, loquacité,
inconscience enfantine.
Quant au malheur final, il affectera bien des aspects, puisqu’il
frappe, tour à tour, en notre personne ou dans celles que nous
aimons, l’être physique, moral ou social, que ce soit en détruisant les
plaisirs ou les biens, la puissance ou l’honneur.
Dans cette situation, l’Instigateur, qui n’est pourtant pas essentiel,
peut devenir digne de figurer même le protagoniste : telle était
Médée dans Pélias. C’est peut-être la plus belle attitude qu’on
puisse donner au « traître » ; qu’on se figure Iago devenu d’un drame
le principal personnage ! (comme Satan l’est du monde). Ce qui
devient difficile à lui trouver, c’est un mobile suffisant : l’ambition (un
peu le cas de Richard III) ne paraît pas toujours vraisemblable à
cause de sa façon a priori de procéder, — non plus que ne le
paraîtrait une foi caïniste ou shivaïte ; la jalousie et la vengeance
sont un peu sentimentales pour cette figure démoniaque ; la
misanthropie, trop honorable et philosophique ; l’intérêt (cas du
Pélias) vaut mieux. Mais l’envie, — l’envie, qui devant la sollicitude
amicale ne sent que sa blessure rendue plus cuisante, — l’envie
étudiée dans l’anonymat d’obscures et basses tentatives, et puis
sous la honte des défaites et de sa lâcheté, pour aboutir enfin au
crime, — voilà, ce me semble, le motif idéal.
XVIII e SITUATION
Involontaire crime d’amour
(L’Amant — l’Aimé — le Révélateur)
Celle-ci et la suivante profilent, sur notre horizon dramatique,
entre toutes les silhouettes, les plus invraisemblables à coup sûr, et
pourtant elles sont, en elles-mêmes, fort admissibles, et pour le
moins aussi peu rares qu’aux temps héroïques aujourd’hui, de par
l’adultère et la prostitution, lesquelles oncques mieux ne florirent :
c’est la découverte qui en est plus rare. Encore non ! — car chacun
de nous a vu de ces mariages, très naturels en apparence et comme
préparés par les relations anciennes des familles, obstinément
éloignés, repoussés et désespérément brisés par des parents,
bizarres semblait-il, mais en réalité trop certains de la consanguinité
des deux épris… De telles révélations ont donc lieu souvent encore,
quoique sans l’antique et shocking éclat, — grâce à la prudente
pruderie actuelle, et à l’habitude.
Sa réputation de fabuleuse monstruosité fut léguée en réalité à
notre XVIIIe par la célébrité sans égale du thème d’Œdipe, arrangé
d’une façon à dessein romanesque, — sphyngiaque pour tout dire,
— par Sophocle, et que ses imitateurs ont toujours été surchargeant
d’arabesques de plus en plus chimériques et extraordinaires.
Cette Situation et la suivante, comme un peu toutes les 36
d’ailleurs, sera représentée, au choix, sous deux jours : 1o la fatale
erreur ne se révélera simultanément au spectateur et au personnage
qu’une fois irréparable (A), et alors l’état d’esprit rappellera
beaucoup la XVIe ; ou, 2o le spectateur, informé, voit le personnage
aller en aveugle vers le crime, comme en un sinistre colin-maillard
(B, C, D).
A 1 — Apprendre qu’on a épousé sa mère : — Les Œdipes
d’Eschyle, de Sophocle, de Sénèque, de Corneille, de Voltaire, sans
parler de ceux d’Achæus, de Philoclès, de Mélitus, de Xénoclès, de
Nicomaque, de Carcinus, de Diogène, de Théodecte, de Jules
César, ni de ceux de Jean Prévost, de Nicolas de Sainte-Marthe, de
Lamothe, de Ducis, de M.-J. Chénier, etc. Le plus grand éloge de
Sophocle, c’est l’étonnement qu’on éprouve de ce que ni tant
d’imitations, ni la légende romanesque trop connue de l’abandon sur
le Cythéron, ni le mythe, peu moderne, du Sphynx, ni la différence
d’âge entre les deux époux (question capitale pour notre temps, où
les actes d’état-civil remplacent peu à peu les primordiaux
sentiments humains !), rien de tout cela, dis-je, n’ait fait paraître
l’œuvre dénuée de tout naturel au public.
2 — Apprendre qu’on a eu pour maîtresse sa sœur : — La
fiancée de Messine de Schiller. Ce cas, évidemment plus fréquent,
prend de l’invraisemblance à être combiné avec la XIXe dans ce
drame. Ex. roman. : les Enfants naturels de Sue.
B 1 — Apprendre qu’on a épousé et qu’on allait posséder
sa sœur : — Le mariage d’André (MM. Lemaire et de Rouvre, 1882 ;
selon le procédé comique, il ne s’agit que d’une erreur ; et le drame
« finit bien »). Abufar de Ducis rentre dans une catégorie voisine.
2 — Même cas, où le crime avait été machiavéliquement
préparé par un tiers : — Héraclius ; cela donne, nécessairement
et malgré tout le génie possible, plutôt la sensation d’un cauchemar
que de la réalité terrible.
3 — Être sur le point de prendre sa sœur inconnue pour
maîtresse. Et la mère, témoin, hésite à révéler le danger, de peur
de porter un coup fatal à son fils : — les Revenants d’Ibsen.
C — Être sur le point de violer sa fille inconnue. — Ex.
fragm. : la Dame au domino rose de Bouvier (1882).
D 1 — Sur le point de commettre un adultère par
ignorance (les seuls cas que je sache au théâtre) : — le Roi cerf et
l’Amour des trois oranges, de Gozzi l’un et l’autre.
Cependant, le subterfuge qui souvent sert d’origine à cette
aventure et à la suivante a dû être mainte fois employé par l’adultère
pour triompher de la fidélité conjugale.
2 — Être adultère sans le savoir : — peut-être l’Alcmène
d’Eschyle. Roman : la fin du Titan de Jean-Paul.
Les diverses modifications de l’inceste et les autres amours
interdites, qu’on trouvera à la XXVIe, s’accommoderont très bien de la
même manière que les œuvres ci-dessus classées.
Nous venons de voir l’adultère commis avec erreur par la
femme ; il peut l’être par le mari. Surtout, cette erreur pourra se
produire du côté de celui des deux adultères qui n’est pas marié :
quoi de plus banal, par exemple, dans la vie de plaisir, que
d’apprendre — un peu tard — sa maîtresse en puissance d’époux ?
Sur l’ignorance du sexe de l’objet aimé roule également, dans
ses deux parties, Mademoiselle de Maupin ; il y a d’abord erreur
(système comique), sur laquelle s’échafaudent des luttes
obsidionales d’une âme (héroï-comédie), d’où sort enfin, par
incidence, une fois la vérité dévoilée, un bref dénouement tragique.
XIX e SITUATION
Tuer un des siens inconnu
(Le Meurtrier — la Victime non reconnue)
Tandis que la XVIIIe atteignait son plus haut degré d’émotion
après l’acte accompli (sans doute parce que là, tous les acteurs du
drame lui survivent et que l’horreur en gît surtout dans les
conséquences), la XIXe, au contraire, où une victime doit périr et où
l’intérêt croît en raison directe de l’aveugle préméditation, se montre
plus pathétique dans les préparatifs du crime que dans les suites ;
ceci permet de donner un dénouement heureux sans avoir recours,
comme pour la XVIIIe, au procédé comique de l’erreur. Il suffira, en
effet, de l’agnition aristotélicienne (reconnaissance d’un personnage
par l’autre), — de laquelle notre situation XIX n’est du reste, à bien
l’examiner, qu’un développement.
A 1 — Être sur le point de tuer sa fille inconnue, par
nécessité divine ou oracle : — Démophon de Métastase ;
l’ignorance de la parenté provient d’une substitution d’enfants ;
l’interprétation de l’oracle est erronée ; autre quiproquo : la jeune
première se croit, à un moment de l’action, la sœur de son fiancé.
Cet enchaînement de trois ou quatre erreurs (parenté inconnue,
sous le jour spécial à la donnée que nous étudions, — croyance à
un danger d’inceste comme B 1 de la précédente, — enfin ambiguïté
trompeuse des mots ainsi que dans la plupart des comédies), voilà
qui suffit à constituer ce qu’on nomme une pièce « mouvementée »,
une de ces intrigues remises en vogue par le second Empire et
devant l’enchevêtrement desquelles nous voyons nos chroniqueurs
naïvement s’affoler.
2 — Par nécessité politique : — Les Guèbres et Les lois de
Minos de Voltaire.
3 — Par rivalité d’amour : — La petite Mionne (M. Richebourg,
1890).
4 — Par haine contre l’amant de cette fille point
reconnue : — Le roi s’amuse (la découverte a lieu après le
meurtre).
B 1 — Être sur le point de tuer son fils inconnu : — Les
Télèphes d’Eschyle et de Sophocle (avec alternative entre ce crime
et l’inceste), Cresphonte d’Euripide, les Méropes de Maffei, de
Voltaire et d’Alfieri, Créuse de Sophocle, Ion d’Euripide. Dans
l’Olympiade de Métastase, ce sujet se complique de Rivalité d’amis.
— Tuer son fils sans le savoir (ex. fragm.) : 3e acte de Lucrèce
Borgia ; le 24 février de Werner.
2 — Identique à B 1, avec instigations machiavéliques servant
de contreforts : — Euryale de Sophocle, Égée d’Euripide.
3 — Identique à B 2, doublée par une haine de proches (aïeul
contre son petit-fils) : — Cyrus de Métastase.
C — Sur le point de tuer un frère inconnu : — 1, frères
meurtriers par colère : — les Alexandres de Sophocle et
d’Euripide. — 2, sœur meurtrière par nécessité
professionnelle : — Les Prêtresses d’Eschyle, les Iphigénies en
Tauride d’Euripide, de Gœthe et projetée par Racine.
D — Tuer sa mère inconnue : — Sémiramis de Voltaire ; ex.
fragm. : dénouement de Lucrèce Borgia.
E — Tuer son père sans le savoir d’après des conseils
machiavéliques : — (voir XVIIe) Pélias de Sophocle et les Péliades
d’Euripide ; Mahomet de Voltaire (où le héros est de plus sur le point
d’épouser sa sœur inconnue). — Simplement, tuer son père
inconnu : — Ex. légendaire : le meurtre de Laïus ; ex. rom. : La
légende de St Julien l’Hospitalier. — Même cas réduit des
proportions du meurtre à celle de l’insulte : — Le pain d’autrui,
d’après Tourguéneff, par MM. Ephraïm et Schutz (1890).
F 1 — Tuer son aïeul inconnu, d’après les instigations
machiavéliques de la vengeance : — les Burgraves.
2 — Le tuer involontairement : — Polydectes d’Eschyle.
3 — Tuer involontairement son beau-père : — Amphitryon
de Sophocle.
G 1 — Tuer involontairement celle qu’on aime : — Procris
de Sophocle. Ex. épique : Tancrède et Clorinde, dans la Jérusalem
délivrée. Ex. légend. (avec changement dans le sexe de l’être
aimé) : Hyacinthe.
2 — Être sur le point de tuer son amant sans le
reconnaître : — Le monstre bleu de Gozzi.
Remarquable est la bizarre affection de Hugo (et — par
conséquent — de ses imitateurs) pour cette situation, assez rare en
somme. Chacun des 10 drames du vieux Romantique nous la
montre : en 2 (Hernani et Torquemada) elle figure, d’une façon
accessoire à la XVIIe (Imprudence), fatale au héros aussi ; dans 4
(Marion Delorme, Angelo, La Esmeralda, Ruy Blas), ce fait de
frapper involontairement qui l’on aime forme toute l’action et fournit
les meilleurs épisodes ; et aux 4 autres (le Roi s’amuse, Marie Tudor,
Lucrèce Borgia, les Burgraves), elle sert, en plus, de dénouement. Il
semble, en vérité, que pour Hugo le drame ait consisté en cela : être
la cause involontaire, soit directe, soit indirecte, de la mort de qui l’on
aime ; et dans l’ouvrage où il a accumulé le plus de coups de
théâtre, dans Lucrèce Borgia, nous voyons revenir jusqu’à cinq fois
la même situation : dès la 1re partie du 1er acte, Gennaro « laisse
insulter sa mère inconnue » ; à la 2e partie, il « l’insulte lui-même
sans la savoir sa mère » ; au IIe acte, elle « demande et obtient sans
le savoir la mort de son propre fils », puis n’a plus comme ressource
que de « l’exécuter elle-même », et, toujours inconnue, « est insultée
encore par lui » ; au IIIe acte enfin, elle « empoisonne son fils sans le
vouloir » et « inconnue, est insultée, menacée, puis tuée par lui ».
Notez maintenant que Shakespeare, dont l’Opinion actuelle s’entête
à confondre l’art avec celui de 1830, son opposé (ensemble
d’ailleurs, elle jette pêle-mêle sous la même rubrique la Bible, les
Nibelungen, l’Orientalisme des tapis turcs, l’Inde brahmanique, les
Japoneries et l’Architecture Ogivale), — Shakespeare, dis-je, n’a pas
une seule fois employé cette donnée XIX, tout accidentelle et sans
aucun rapport avec ses fortes études de Volontés.
XX e SITUATION
Se sacrifier à l’Idéal
(Le Héros — l’Idéal — le « Créancier » ou la Partie sacrifiée)
Les quatre thèmes de l’Immolation, dont voici le premier,
amènent devant nous trois cortèges : les Dieux (XXe et XXIIIe), les
Proches (XXIe et XXIIIe), les Désirs (XXIIe). Des luttes qui vont se
livrer, le champ ne sera plus le monde visible, mais une Ame.
Aucun de ces quatre sujets n’est plus fier que notre donnée
Vingtième : tout pour l’idéal ! Que celui-ci soit (n’importe) politique ou
religieux, qu’on l’appelle honneur ou piété domestique, il exige le
sacrifice de tous liens : intérêt, vie, passion, — bien mieux, idéal
même, sous telle autre forme voisine, pour peu qu’elle paraisse
entachée du moindre encore que du plus sublime égotisme ! Telle
est la loi.
A 1 — Sacrifier sa vie à sa parole : — Les Régulus de Pradon
et de Métastase et la fin d’Hernani ; (Carthage et don Ruy Gomez
sont les « Créanciers »). N’est-il pas étonnant qu’un plus grand
nombre d’exemples ne s’offre pas aussitôt à nous ? Cette fatalité, —
œuvre de la victime elle-même et dont la victoire n’est que celle du
vaincu volontaire, grande comme la conception stoïcienne du
monde, — n’était-elle pas digne d’illuminer la scène par ses
holocaustes ? Rien n’obligeait, cependant, à choisir un héros
presque trop parfait peut-être, comme Régulus, — puisqu’il n’est pas
jusqu’à nos fautes qui ne paraissent courir, comme douées d’une
volonté propre et trahissant la nôtre, à un suicide analogue.
2 — Sacrifier sa vie au succès des siens : — Les Femmes de
chambre d’Eschyle, Protésilas d’Euripide, Thémistocle de
Métastase. Ex. fragm. : partie des Iphigénies à Aulis d’Euripide et de
Racine. Ex. histor. : Codrus, Curtius, la Tour d’Auvergne. — Au
bonheur des siens : — Le Christ souffrant de Saint Grégoire de
Nazianze.
3 — Sacrifier sa vie à la piété familiale : — Les
Phéniciennes d’Eschyle, les Antigones de Sophocle, d’Euripide et
d’Alfieri.
4 — Sacrifier sa vie à sa foi : — Le Prince constant de
Calderon, Luther de Werner. Ex. ord. : tous les martyrs, religieux et
missionnaires, savants et philosophes. Ex. roman. : L’Œuvre de
Zola.
B 1 — Sacrifier, avec sa vie, son amour à sa foi : —
Polyeucte. Roman (sacrifier, avec son avenir, sa famille à sa foi) :
l’Évangéliste.
2 — Sacrifier, avec sa vie, son amour à sa cause : — Les
Fils de Jahel (Mme Armand, 1886).
3 — Sacrifier son amour à l’intérêt d’état : — C’est le motif
cornélien : Othon, Sertorius, Sophonisbe, Pulchérie, Tite et
Bérénice. Ajoutez-y la Bérénice de Racine et la Sophonisbe d’Alfieri,
celle de Mairet, puis Achille à Scyros de Métastase, ainsi que sa
Didon et les Troyens de Berlioz (la meilleure tragédie de ce siècle).
Le « Créancier », dans cette sous-nuance, reste abstrait, se confond
avec l’Idéal et le Héros ; les « Parties sacrifiées », au contraire,
deviennent visibles : ce sont Plautine, Viriate, Syphax et Massinisse,
Bérénice, Déidamie.
C — Sacrifier l’idéal « honneur » à l’idéal « foi » : — Deux
exemples léonins, mais qui n’ont pas atteint le succès pour des
raisons secondaires (à cause de la faiblesse du tympan public,
incapable de saisir une harmonie aussi élevée sur les gammes des
sentiments) : Théodore de Corneille et la Vierge martyre de
Massinger. Un peu le cas aussi du bon ermite Abraham dans
Hroswitha.
XXI e SITUATION
Se sacrifier aux Proches
(Le Héros — le Proche — le « Créancier » ou la Partie
sacrifiée)
A 1 — Sacrifier sa vie à celle d’un parent ou d’un aimé : —
Les Alcestes de Sophocle, d’Euripide, de Buchanan, de Hardy, de
Racine (projet), de Quinault, de Lagrange-Chancel, de Boissy, de
Coypel, de Sainte-Foix, de Dorat, de Glück, d’H. Lucas, de
Vauzelles, etc.
2 — Sacrifier sa vie au bonheur d’un parent ou d’un aimé :
— L’Ancien de Richepin (1889) ; deux œuvres symétriques : Smilis
(Aicard, 1884 ; le mari se sacrifie), et le Divorce de Sarah Moore
(MM. Rozier, Paton et (dit-on) A. Dumas fils, 1885 ; la femme se
sacrifie). Ex. roman. analogues à ces deux drames : les Grandes
Espérances de Dickens, la Joie de Vivre de Zola. Ex. banal : le
travail d’un ouvrier verrier ou miroitier.
B 1 — Sacrifier son ambition au bonheur d’un parent : —
Les Frères Zemganno (Edm. de Goncourt, 1890) ; cela aboutit par
conséquent à un dénouement inverse de celui de l’Œuvre.
2 — Sacrifier son ambition à la vie d’un parent : — Mme de
Maintenon (Coppée, 1881).
C — Sacrifier son amour à la vie d’un parent : — Diane
d’Augier, Martyre (M. Dennery, 1886).
D 1 — Sacrifier son honneur et sa vie à la vie d’un parent
ou d’un aimé : — Le Petit Jacques. — Cas où l’aimé est coupable :
la Charbonnière (M. Crémieux (1884), le Frère d’armes (M. Garaud,
1887), le Chien de garde (Richepin, 1889). — Même sacrifice, fait,
cette fois à l’honneur d’un être aimé : Pierre Vaux (M. Jonathan,
1882).
2 — Sacrifier sa pudeur à la vie d’un proche ou d’un aimé
(avec A 1, le cas le plus net et le plus beau) : — Mesure pour
Mesure de Shakespeare, Andromaque d’Euripide et de Racine,
Pertharite de Corneille ; la Tosca (M. Sardou, 1889). Ex.
romanesque du dernier genre : le Huron de Voltaire. Ex. historique :
en septembre 1793, Mlle de Sombreuil (sacrifice de la pudeur
remplacé par celui d’une répugnance).
XXII e SITUATION
Tout sacrifier à la Passion
(L’Épris — l’Objet de la fatale passion — la Partie sacrifiée)
A 1 — Une passion détruisant le vœu de chasteté
religieuse : — Jocelyn (Godard, 1888). Roman : La Faute de l’abbé
Mouret. Comédie : Dhourtta narttaka, et force fabliaux.
2 — Détruisant le vœu de pureté : — Tannhäuser. —
Détruisant le respect pour le prêtre : — un côté de la
Conquête de Plassans.
3 — Ruinant l’avenir : — Manon (M. Massenet, 1884), Sapho
(Daudet, 1885).
4 — Ruinant la puissance : — Antoine et Cléopâtre de
Shakespeare, Cléopâtre (M. Sardou, 1890).
5 — Ruinant la santé, l’intelligence et la vie : — la Glu
(Richepin, 1883), l’Arlésienne (Daudet et Bizet). Roman (voir C) : le
Possédé de Lemonnier. — Passion assouvie au prix de la vie : —
Une nuit de Cléopâtre (Gautier et V. Massé, 1885).
6 — Ruinant les fortunes, les honneurs et les
existences : — Nana (1881).
B — Tentations (Voir XIIe) abolissant le sentiment du
devoir, celui de la pitié, etc. — Salomé (Oscar Wilde, 1893).
Roman : Hérodias et les assauts (repoussés) de la Tentation de
saint Antoine.
C 1 — Le vice érotique détruisant la vie, l’honneur, la
fortune : — Germinie Lacerteux (de Goncourt, 1888), Rolande
(Gramont, 1888). Roman : la Cousine Bette, le Capitaine Burle.
2 — Un vice quelconque faisant le même effet : — 30 ans
ou la Vie d’un Joueur, l’Assommoir. Roman : l’Opium, de M.
Bonnetain. Réalités : nos champs de courses, nos débits de vin, nos
cafés, nos cercles, nos brasseries à femmes, etc.
Peu de situations, on le voit, ont été traitées avec un aussi
constant bonheur par notre siècle, aux lâchetés duquel la XXIIe
offrait, en effet, un miroir très approprié, de par son amalgame
érotico-saturnien, — en même temps que les plus intéressantes
études de pathologie nerveuse.
XXIII e SITUATION
Devoir sacrifier les siens
(Le Héros — le Proche désigné — la Nécessité du sacrifice)
Symétrique aux trois que nous venons de voir, cette Situation
rappelle, par un côté, cette destruction du sens naturel qui fait les
« Haines de proches » (XIIIe). A vrai dire, les sentiments que nous
allons rencontrer chez le protagoniste seront d’une nature bien
différente, mais, — de par l’intrusion de la Nécessité dans le drame,
— le point de perspective où celui-ci va courir ne sera-t-il pas,
exactement, le même ?
A 1 — Devoir sacrifier sa fille à l’intérêt public : —
Iphigénies d’Eschyle et de Sophocle, Iphigénies à Aulis d’Euripide et
de Racine, Érechtée d’Euripide.
2 — Devoir la sacrifier par suite d’un serment à Dieu : —
les Idoménées de Crébillon, de Lemierre, de Cienfuegos, les
Jephtés de Buchanan, de Boyer. Cette nuance s’étend d’abord vers
le XVIIe (Imprudence) ; mais les luttes psychologiques lui donnent
bientôt un tour très divergent.
3 — Devoir sacrifier des êtres chers, des bienfaiteurs à
sa foi : — Torquemada, Quatre-vingt-treize. Histoire : Philippe II ;
Abraham et Isaac.
Vous aimerez peut-être aussi
- Le MisanthropeDocument20 pagesLe MisanthropemayAPas encore d'évaluation
- Cours Danalyse Du Roman Cette Folle de RenéeDocument6 pagesCours Danalyse Du Roman Cette Folle de RenéeDELTANETO SLIMANEPas encore d'évaluation
- Études Sur Flaubert Inédit - Fischer, Wilhelm, 1876 PDFDocument156 pagesÉtudes Sur Flaubert Inédit - Fischer, Wilhelm, 1876 PDFAnonymous WE5dIf7BHPas encore d'évaluation
- Introduction To Creativity and Innovation For Engineers 1St Edition Walesh Solutions Manual Download PDF 2024Document25 pagesIntroduction To Creativity and Innovation For Engineers 1St Edition Walesh Solutions Manual Download PDF 2024robert.lewis920100% (19)
- Cloud Computing Law 2Nd Edition Christopher Millard Editor Download 2024 Full ChapterDocument23 pagesCloud Computing Law 2Nd Edition Christopher Millard Editor Download 2024 Full Chaptervito.lyons426100% (9)
- Chardin Artículo 1996Document18 pagesChardin Artículo 1996Juli Videla MartínezPas encore d'évaluation
- Pierre Michel, Le Cas Octave Mirbeau: Entre "Gynécophobie" Et FéminismeDocument9 pagesPierre Michel, Le Cas Octave Mirbeau: Entre "Gynécophobie" Et FéminismeAnonymous 5r2Qv8aonf100% (1)
- Les Trois Visages de NanaDocument13 pagesLes Trois Visages de NanaChaeyoung LeePas encore d'évaluation
- Revision Bac de Francais DissertationDocument6 pagesRevision Bac de Francais DissertationMOUSSA SaraPas encore d'évaluation
- Cotations FrancaisDocument3 pagesCotations Francaissamgadois319Pas encore d'évaluation
- La Fêlure Dans La Bete Humaine ExplicationDocument6 pagesLa Fêlure Dans La Bete Humaine ExplicationBrechtPas encore d'évaluation
- Cours 4 - Theatre - Absurde2Document8 pagesCours 4 - Theatre - Absurde2Geo.Pas encore d'évaluation
- 042Document84 pages042gabriela_dcsm783Pas encore d'évaluation
- Voltaire, Histoire Des Voyages de ScarmentadoDocument3 pagesVoltaire, Histoire Des Voyages de ScarmentadoMaxime AernoutsPas encore d'évaluation
- Article - L'homme Qui RitDocument12 pagesArticle - L'homme Qui RitCallipoPas encore d'évaluation
- La Rage Dimpuissance Et Lesthetique RomaDocument10 pagesLa Rage Dimpuissance Et Lesthetique RomaMohamed EnnouriPas encore d'évaluation
- L'amour sous la Terreur: La société française pendant la RévolutionD'EverandL'amour sous la Terreur: La société française pendant la RévolutionPas encore d'évaluation
- Fernando Cipriani, Cruauté, Monstruosité Et Folie Dans Les Contes de Mirbeau Et de VilliersDocument15 pagesFernando Cipriani, Cruauté, Monstruosité Et Folie Dans Les Contes de Mirbeau Et de VilliersAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Website Hosting and Migration With Amazon Web Services: A Practical Guide To Moving Your Website To AWS 1st Edition Jason Nadon (Auth.)Document25 pagesWebsite Hosting and Migration With Amazon Web Services: A Practical Guide To Moving Your Website To AWS 1st Edition Jason Nadon (Auth.)pearl.rodrigue288100% (2)
- Une vraie jeune fille: Nouvelles suivies de Trois contes pour aujourd’huiD'EverandUne vraie jeune fille: Nouvelles suivies de Trois contes pour aujourd’huiPas encore d'évaluation
- Aignan PolyxeneDocument38 pagesAignan PolyxeneGinger PonyPas encore d'évaluation
- Le Drame: SéquencesDocument5 pagesLe Drame: SéquencesMazmaz FourehPas encore d'évaluation
- FC Analyse Voltaire Ingenu Xiiiaxvv2Document7 pagesFC Analyse Voltaire Ingenu Xiiiaxvv2Maira CanashinPas encore d'évaluation
- Demian Hermann HesseDocument8 pagesDemian Hermann HesseestellePas encore d'évaluation
- Les criminels dans l'art et la littérature: Les représentations artistiques et littéraires des serial killers, tueurs et assassins en série, psychopathes et autres criminelsD'EverandLes criminels dans l'art et la littérature: Les représentations artistiques et littéraires des serial killers, tueurs et assassins en série, psychopathes et autres criminelsPas encore d'évaluation
- PDF of L Oeuvre de Napoleon French Edition Laroque Full Chapter EbookDocument69 pagesPDF of L Oeuvre de Napoleon French Edition Laroque Full Chapter Ebookevangelinamethyst786100% (6)
- Critiques LittérairesDocument307 pagesCritiques Littérairessocrate nomoPas encore d'évaluation
- Dissertation LittéraireDocument5 pagesDissertation Littérairenils.gautheyPas encore d'évaluation
- 《La Case de l'Oncle Tom》(汤姆叔叔的小屋)Document458 pages《La Case de l'Oncle Tom》(汤姆叔叔的小屋)samuel chenPas encore d'évaluation
- 04 La Tragedie A Lage ClassiqueDocument4 pages04 La Tragedie A Lage Classiquecharbel.boulangerPas encore d'évaluation
- PDF of Proust Roman Familial 1St Edition Laure Murat Full Chapter EbookDocument69 pagesPDF of Proust Roman Familial 1St Edition Laure Murat Full Chapter Ebookbesswcttercng120100% (6)
- ET Peau de Cha REALISME ET SOCIETE Ssss Mars 23Document6 pagesET Peau de Cha REALISME ET SOCIETE Ssss Mars 23JLPas encore d'évaluation
- EL N°9 Candide Le Nègre de Surinam VoltaireDocument2 pagesEL N°9 Candide Le Nègre de Surinam VoltaireMylo Saint-eloiPas encore d'évaluation
- La Colère Chez Julien SorelDocument14 pagesLa Colère Chez Julien SorelayouzyouftnPas encore d'évaluation
- Partie - Pratique - GenresDocument2 pagesPartie - Pratique - GenresN KPas encore d'évaluation
- Manon Lescaut Partagez Vous L'opinion de Flaubert DissertationDocument4 pagesManon Lescaut Partagez Vous L'opinion de Flaubert DissertationmaelinehugotPas encore d'évaluation
- Pierre Jamet-L'érotomanieDocument7 pagesPierre Jamet-L'érotomanieFengPas encore d'évaluation
- Roman 0048-8593 1971 Num 1 1 5387Document11 pagesRoman 0048-8593 1971 Num 1 1 5387nicetchiPas encore d'évaluation
- Correction Sujet Type Bac p224 PDFDocument5 pagesCorrection Sujet Type Bac p224 PDFPapa Sarr100% (1)
- Folie Et Deraison.. Fréderic GROS PDFDocument2 pagesFolie Et Deraison.. Fréderic GROS PDFRafael Ignacio Farias BecerraPas encore d'évaluation
- Les Tonalites Ou RegistresDocument2 pagesLes Tonalites Ou RegistresMohamed NejibPas encore d'évaluation
- Voltaire CandideDocument4 pagesVoltaire CandideleaPas encore d'évaluation
- Roman XIXeDocument22 pagesRoman XIXeFerda GiumadinPas encore d'évaluation
- Cours Familier de Littérature (Volume 21) Un entretien par moisD'EverandCours Familier de Littérature (Volume 21) Un entretien par moisPas encore d'évaluation
- Octave Mirbeau, Un FouDocument5 pagesOctave Mirbeau, Un FouAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Du Plaisir Féminin Dans Le RomantismeDocument6 pagesDu Plaisir Féminin Dans Le RomantismeSimo LaachabiPas encore d'évaluation
- Parcours AssociéDocument5 pagesParcours AssociéNour LahlouPas encore d'évaluation
- Dissertation Baccalauréat 2024Document4 pagesDissertation Baccalauréat 2024Adam TonsiPas encore d'évaluation
- BACCHANTES - DP DefDocument22 pagesBACCHANTES - DP DefmoussaouiPas encore d'évaluation
- Tragedie GrecqueDocument2 pagesTragedie GrecquevoltronePas encore d'évaluation
- Belis-La Legende de MedeeDocument4 pagesBelis-La Legende de MedeeBogdan Stefan AvramPas encore d'évaluation
- A W Schlegel, Cours de Littérature Dramatique, IDocument2 pagesA W Schlegel, Cours de Littérature Dramatique, IlanuitdestempsPas encore d'évaluation
- Arnaud Sorosina - Le Statut Des Sophistes Chez NietzscheDocument25 pagesArnaud Sorosina - Le Statut Des Sophistes Chez NietzscheCahijosPas encore d'évaluation
- Jan Maarten Bremer, Hamartia. Tragic Error in The Poetics of Aristotle and in Greek TragedyDocument3 pagesJan Maarten Bremer, Hamartia. Tragic Error in The Poetics of Aristotle and in Greek TragedyPABLO ROUSSEPas encore d'évaluation
- J2 Sem 1999-2000Document49 pagesJ2 Sem 1999-2000fullymoonPas encore d'évaluation
- Bakhtine - Prehistoire Du Roman PDFDocument38 pagesBakhtine - Prehistoire Du Roman PDFjeanmariepaulPas encore d'évaluation
- Litterature Latine Et GrecqueDocument6 pagesLitterature Latine Et GrecquegfvilaPas encore d'évaluation
- La Morale Et La Culture Dans La Tragédie ClassiqueDocument14 pagesLa Morale Et La Culture Dans La Tragédie ClassiqueAndré Constantino YazbekPas encore d'évaluation
- CM Et TD 1 Le Théâtre Dans LantiquitéDocument4 pagesCM Et TD 1 Le Théâtre Dans LantiquitéChéryl RaffinPas encore d'évaluation
- EURIPIDE - LE PHILOSOPHE DE LA TRAGEDIE (5 Pages - 168 Ko)Document5 pagesEURIPIDE - LE PHILOSOPHE DE LA TRAGEDIE (5 Pages - 168 Ko)José luiz Pinho gralatoPas encore d'évaluation
- Oeuvres Complètes de J Racine (... ) Racine Jean Bpt6k5809950qDocument532 pagesOeuvres Complètes de J Racine (... ) Racine Jean Bpt6k5809950qmanuel.grisaceoPas encore d'évaluation
- Lhomme 21122 187 188 Jean Bollack Dionysos Et La Tragedie Le Dieu Homme Dans Les Bacchantes D EuripideDocument6 pagesLhomme 21122 187 188 Jean Bollack Dionysos Et La Tragedie Le Dieu Homme Dans Les Bacchantes D EuripideClaudeWelscherPas encore d'évaluation
- Athénée de Naucratis Livre XDocument72 pagesAthénée de Naucratis Livre Xgustavog1956Pas encore d'évaluation
- Travail Médée 2Document1 pageTravail Médée 2Aurélia BrièrePas encore d'évaluation
- Le PrésentDocument10 pagesLe PrésentKalou6Pas encore d'évaluation
- La Musique Antique Redecouverte The Revi PDFDocument7 pagesLa Musique Antique Redecouverte The Revi PDFSaaj Alfred JarryPas encore d'évaluation
- Iphigenie SylvianeDocument12 pagesIphigenie SylvianeMihaela41Pas encore d'évaluation
- Cloud Computing Law 2Nd Edition Christopher Millard Editor Download 2024 Full ChapterDocument23 pagesCloud Computing Law 2Nd Edition Christopher Millard Editor Download 2024 Full Chaptervito.lyons426100% (9)
- Dionysos Chez Homere Ou La Folie DivineDocument23 pagesDionysos Chez Homere Ou La Folie Divinemegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Aristote Et Euripide: Mary-Anne ZagdounDocument12 pagesAristote Et Euripide: Mary-Anne ZagdounjebaclePas encore d'évaluation
- Raymond Trousson Thèmes Et Mytes...Document152 pagesRaymond Trousson Thèmes Et Mytes...Draupadí De Mora100% (2)
- Texte Antique 2Document28 pagesTexte Antique 2Guillaume CastellaPas encore d'évaluation
- Dossier MédéeDocument7 pagesDossier MédéeKatia MakédonskiPas encore d'évaluation
- BOROWSK .Le Theatre Politique DeuripideDocument201 pagesBOROWSK .Le Theatre Politique DeuripideEvangelos KaposPas encore d'évaluation
- Rémy de Gourmont - Problème Du StyleDocument286 pagesRémy de Gourmont - Problème Du StyleLucreciaR100% (1)
- Dupont - Significance de Double AmphitryonDocument12 pagesDupont - Significance de Double AmphitryonSamuel SigerPas encore d'évaluation
- Dossier TragedieDocument11 pagesDossier TragedieMilena TarziaPas encore d'évaluation
- Initiation Au Genre Dramatique (Cours)Document9 pagesInitiation Au Genre Dramatique (Cours)Youness RouanePas encore d'évaluation