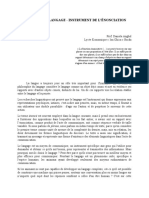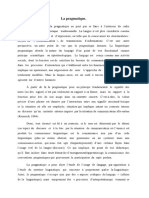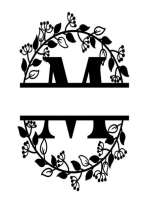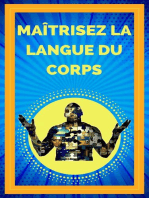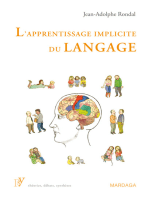Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours N°03 Actes de Langage-Converti
Cours N°03 Actes de Langage-Converti
Transféré par
Gojō SatoruTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours N°03 Actes de Langage-Converti
Cours N°03 Actes de Langage-Converti
Transféré par
Gojō SatoruDroits d'auteur :
Formats disponibles
Module d’Analyse de discours, Cours n° 03, actes de langage, destiné aux étudiants de M1,
SDL, Semestre 1, assuré par Dr ZEBIRI Abderrazek, Département de français, Université de
Msila
Cours n° 03 : les actes de langage
Intitulé du Master : Sciences du langage
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la matière : Analyse du discours et pragmatique
Crédits : 6
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement :
A la fin du semestre, l'étudiant est censé, avoir découvert :
➢ la théorie des actes de langage ;
➢ la distinction entre l'acte locutoire, illocutoire et perlocutoire ;
➢ la définition du présupposé et du sous-entendu ;
➢ la détermination de l'importance du contexte de communication ;
➢ la détermination des lois de discours.
Connaissances préalables recommandées
Pour ce module l'étudiant doit savoir :
➢ la différence entre langue et parole
➢ le schéma de communication
Objectifs du cours : permettre aux étudiants inscrits en master 1 SDL de savoir ce
que signifient les de langage et leurs différents emplois dans la spécialité.
Introduction
Les actes de langage
➢ La pragmatique linguistique s’ʼest développée à partir de la théorie des actes de
langage.
➢ Cette théorie montre que la fonction du langage n'est pas essentiellement de décrire le
monde, mais aussi d'accomplir des actions.
➢ L'initiateur de cette théorie est le philosophe britannique Austin dans son ouvrage : How
to do things with words (1962), elle est développée par J.-R. Searle dans deux ouvrages
Les Actes de Langage (1972), et Sens et expression, 1982.
➢ Le développement le plus récent de la pragmatique linguistique est la pragmatique
cognitive (issue de la théorie de la pertinence de Sperber et Wilson) qui réduit
l'importance des actes de langage et qui simplifie la théorie.
1. Les actes de langage (A. L.) :
➢ La théorie des actes de langage s'oppose à la conception descriptive du langage qui veut
que :
o la fonction première du langage est de décrire la réalité : nommer les objets du monde.
o les énoncés déclaratifs sont toujours vrais ou faux. Austin défend l'idée que
▪ la fonction du langage est aussi d'agir sur la réalité.
o les énoncés déclaratifs ne sont ni vrais ni faux, mais réussis ou non.
➢ Austin distingue donc :
o les énoncés constatifs qui décrivent le monde : ex. le soleil brille.
Module d’Analyse de discours, Cours n° 03, actes de langage, destiné aux étudiants de M1,
SDL, Semestre 1, assuré par Dr ZEBIRI Abderrazek, Département de français, Université de
Msila
o les énoncés performatifs qui accomplissent une action : je te promets que je
viendrai.
Les constatifs sont vrais ou faux (le soleil brille ou non),
les performatifs sont réussis ou non.
Un énoncé performatif est réussi :
si l'énoncé s'adresse à quelqu'un.
si l'énoncé est compris du récepteur, c’est-à-dire s'il y a correspondance entre ce qui est dit
et ce qui est fait.
Ex. dire « je ne suis pas content » en colère / en riant.
NB : Austin travaille sur des énoncés déclaratifs, affirmatifs, de 1ère pers. Sg, à
l'indicatif présent, voix active, non descriptifs.
2. Les types d'actes de langage :
À l'examen, Austin constate qu'il est difficile d'opposer strictement constatifs et
performatifs.
En effet :
un énoncé peut être implicitement performatif : je viendrai demain.
un énoncé constatif correspond la plupart du temps à un acte de langage implicite :
l'assertion.
Ex. je dis la vérité quand je dis que le soleil brille ;
Donc, pour Austin, l'énonciation est le fruit de trois activités complémentaires :
➢ l'acte locutoire (= que dit-il ?) : production d'une suite de sons ayant un sens dans une
langue
➢ l'acte iIIocutoire (que fait-il ?) : production d'un énoncé auquel est attaché
conventionnellement une certaine« force ». (déclarer, promettre, s'engager…).
➢ l'acte perlocutoire (pour quoi faire ?) : cet acte sort du cadre linguistique. L'énoncé
provoque des effets (perturbations, changements) dans la situation de communication.
Ex. une question peut servir à interrompre, embarrasser, montrer qu'on est là …
Remarque 1 : à chaque niveau, l'acte peut être direct ou dérivé.
Locutoire : sens littéral→ sens dérivé. Ex : j'ai mal au cœur = estomac.
Illocutoire : acte primitif → acte dérivé.
Ex. il fait chaud ici = requête pour ouvrir la fenêtre.
Perlocutoire : la dérivation dépend de l'interprétation qu'en fait le destinataire.
Remarque 2 : la réussite ou l'échec de l'énoncé.
➢ L'énoncé est réussi si le destinataire reconnaît l'intention conventionnellement associée à
son énonciation.
➢ Pour ce faire, le destinataire s'aide de marqueurs non ambigus (univoques), de
l'intonation et du contexte.
➢ À l'inverse, l'émetteur - pour réussir - doit se soumettre aux lois du discours que l'on
peut résumer ainsi : « n'importe qui ne peut pas dire n'importe quoi, en n'importe quelles
Module d’Analyse de discours, Cours n° 03, actes de langage, destiné aux étudiants de M1,
SDL, Semestre 1, assuré par Dr ZEBIRI Abderrazek, Département de français, Université de
Msila
circonstances ».
À RETENIR
Acte de langage / acte de parole (speech act) : Selon Austin, en énonçant une
phrase
quelconque, on accomplit trois actes
simultanés
– un acte :locutoire (on articule et combine des sons, on évoque et relie
syntaxiquement les notions représentées par les mots) ;
– un acte illocutoire (l'énonciation de la phrase transforme les rapports entre les
interlocuteurs ;
: j'accomplis l'acte de promettre en disant "je promets…", celui d'interroger en
disant "est-ce que…?") ;
– et un acte perlocutoire (l'énonciation vise des effets plus lointains : en
interrogeant quelqu'un, je peux avoir pour but de lui rendre service, de lui faire
croire que j'estime son opinion, ou de l'embarrasser, etc.). (Ducrot)
Vous aimerez peut-être aussi
- Actes de LangageDocument1 pageActes de LangageStefanescu EugenPas encore d'évaluation
- Les Actes de LangageDocument38 pagesLes Actes de LangageMacrii100% (4)
- Emile Benveniste Presentation SonDocument14 pagesEmile Benveniste Presentation Sonfrancophile86Pas encore d'évaluation
- Les Actes Du Langage 3Document3 pagesLes Actes Du Langage 3Khaoula BousbaPas encore d'évaluation
- La Pragmatique-1Document4 pagesLa Pragmatique-1sahnounethiziriPas encore d'évaluation
- Les Énoncés Constatifs: Ces Énoncés Décrivent Le Monde Et Peuvent ÊtreDocument4 pagesLes Énoncés Constatifs: Ces Énoncés Décrivent Le Monde Et Peuvent ÊtreHarchi AbdoPas encore d'évaluation
- Formes Discursives - Cours Master LFPC 2015Document124 pagesFormes Discursives - Cours Master LFPC 2015Otilia SimionPas encore d'évaluation
- Cour Pragmatique Complet PFDocument7 pagesCour Pragmatique Complet PFTraceurPas encore d'évaluation
- Etude Provisoire Sur Le Cadre Théorique de Mon MémoireDocument3 pagesEtude Provisoire Sur Le Cadre Théorique de Mon Mémoirehafidi hadile.ghadaPas encore d'évaluation
- Actes de LangageDocument13 pagesActes de Langagekk100% (1)
- Résumé Du Cours de La Pragmatique Du ContenuDocument4 pagesRésumé Du Cours de La Pragmatique Du ContenuKhadija EL FAHLI100% (1)
- Acte de Langage PDFDocument10 pagesActe de Langage PDFMarinușa ConstantinPas encore d'évaluation
- Pragmatique Note Et DéfinitionsDocument7 pagesPragmatique Note Et Définitionsfranck atlaniPas encore d'évaluation
- Culioli 83 84 PDFDocument109 pagesCulioli 83 84 PDFClaudiene DinizPas encore d'évaluation
- Examen L3 Correction-ConvertiDocument3 pagesExamen L3 Correction-ConvertiRima HafPas encore d'évaluation
- John AustinDocument54 pagesJohn AustinPinar SezerPas encore d'évaluation
- Théorie John Searle PragmatiqueDocument16 pagesThéorie John Searle PragmatiqueStyloPlume忍Pas encore d'évaluation
- Cours N°04 Actes Locutoire, Illocutoire Et PerlocutoireDocument1 pageCours N°04 Actes Locutoire, Illocutoire Et Perlocutoiremihoubinadine7Pas encore d'évaluation
- Actes de Paroles Dans La Didactique Des Langues Conceptualisation Et StructurationDocument24 pagesActes de Paroles Dans La Didactique Des Langues Conceptualisation Et StructurationAura AirineiPas encore d'évaluation
- Le Langage Instrument de L'énonciationDocument13 pagesLe Langage Instrument de L'énonciationDaniela AnghelPas encore d'évaluation
- PragmatiqueDocument16 pagesPragmatiqueTiffany RasandisonPas encore d'évaluation
- Linguistique TextuelleDocument45 pagesLinguistique Textuellekamy-g100% (1)
- Chapitre 3 Théories Des Actes de Langage PDFDocument8 pagesChapitre 3 Théories Des Actes de Langage PDFËlLina L'ionëssPas encore d'évaluation
- Enonciation Et Pragmatique m2Document26 pagesEnonciation Et Pragmatique m2gherab ayaPas encore d'évaluation
- PragmatiqueDocument16 pagesPragmatiqueAbderrahim ElkhaliliPas encore d'évaluation
- TFG FernándezDocument34 pagesTFG FernándezМарина КостюкPas encore d'évaluation
- U1 - PRAGMATIQUE - ThéorieDocument22 pagesU1 - PRAGMATIQUE - ThéorieMiranda Ceballos ScoponiPas encore d'évaluation
- Daniel VANDERVEKEN PDFDocument54 pagesDaniel VANDERVEKEN PDFMannrastaPas encore d'évaluation
- TD2 PragmatiqueDocument21 pagesTD2 PragmatiqueKahina Nina Rose BellilPas encore d'évaluation
- Les Actes de ParoleDocument2 pagesLes Actes de ParoleAna GheorghitaPas encore d'évaluation
- Anscombre Delocutivite Benvistinienne Performatif Article LFR 0023-8368 1979 Num 42-1-6156Document17 pagesAnscombre Delocutivite Benvistinienne Performatif Article LFR 0023-8368 1979 Num 42-1-6156Adrian OrtizPas encore d'évaluation
- Techniques Pratiques D'expression OraleDocument6 pagesTechniques Pratiques D'expression OraleMohamed OumlabatPas encore d'évaluation
- Cours Pragmatique MR CHIKARDocument9 pagesCours Pragmatique MR CHIKARmark ToupsPas encore d'évaluation
- L2 Ling BramkiDocument7 pagesL2 Ling BramkiSAHRA YOUPas encore d'évaluation
- La PragmatiqueDocument4 pagesLa PragmatiqueËlLina L'ionëssPas encore d'évaluation
- Acte de LangageDocument4 pagesActe de LangageDudewitz100% (1)
- Culioli - Notes de Séminaire (1983)Document57 pagesCulioli - Notes de Séminaire (1983)Timuche80% (5)
- Bases LinguistiqueDocument16 pagesBases LinguistiqueKii raPas encore d'évaluation
- Actes de Langages-Version de SearleDocument25 pagesActes de Langages-Version de SearleAna Claudia100% (1)
- Cours 9 - 10 Renforcement Ling S-L S2Document17 pagesCours 9 - 10 Renforcement Ling S-L S2Mi NaPas encore d'évaluation
- ENONCIATIONDocument8 pagesENONCIATIONx6f6rvjf7x100% (2)
- Actes de LangageDocument8 pagesActes de Langageezzinesalma03Pas encore d'évaluation
- Mini Memoire de WilfriedDocument28 pagesMini Memoire de WilfriedTougma WilfriedPas encore d'évaluation
- Les Actes de LangageDocument11 pagesLes Actes de LangageMorariu Emil Toma100% (2)
- Scene D Enonciation PDFDocument13 pagesScene D Enonciation PDFThibério Arruda50% (2)
- Cours N°04Document7 pagesCours N°04Ch õùch100% (1)
- Enonciation Et Actes de Langage Dans Le PDFDocument46 pagesEnonciation Et Actes de Langage Dans Le PDFYassine SammoudPas encore d'évaluation
- Techniques de Communication S1Document16 pagesTechniques de Communication S1Ridha Ennajem HarrathiPas encore d'évaluation
- Hirtle 2010 PDFDocument18 pagesHirtle 2010 PDFCharlotte MackiePas encore d'évaluation
- F. Lapproche PragmatiqueDocument11 pagesF. Lapproche PragmatiqueJihad El haririPas encore d'évaluation
- Dictionnaire des Idées & Notions en Sciences humaines: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire des Idées & Notions en Sciences humaines: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Pragmatique Suport de Curs Pragamtica FrancezaDocument17 pagesPragmatique Suport de Curs Pragamtica FrancezaDiana TreastinPas encore d'évaluation
- Le Champ Sémantique Et Les Différents SensDocument6 pagesLe Champ Sémantique Et Les Différents Sensnada benPas encore d'évaluation
- Le Savant de la langue française au second cycleD'EverandLe Savant de la langue française au second cyclePas encore d'évaluation
- Au delà des mots: Interpréter le Langage Corporel pour Mieux Comprendre les Autres.D'EverandAu delà des mots: Interpréter le Langage Corporel pour Mieux Comprendre les Autres.Pas encore d'évaluation
- L'apprentissage implicite du langage: Étude des liens entre facteurs psycholinguistiques et langageD'EverandL'apprentissage implicite du langage: Étude des liens entre facteurs psycholinguistiques et langagePas encore d'évaluation
- Le langage corporel : interpréter les signes non verbauxD'EverandLe langage corporel : interpréter les signes non verbauxÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3)
- Mon Support AnimationDocument17 pagesMon Support AnimationKhaled LaichePas encore d'évaluation
- Cours de GRH - Part III (Animation Des Équipes)Document6 pagesCours de GRH - Part III (Animation Des Équipes)Abdelouadoud KerarmiPas encore d'évaluation
- Cours - La Vérité Se Discute-T-ElleDocument16 pagesCours - La Vérité Se Discute-T-ElleNoah Saint-albinPas encore d'évaluation
- Rapport de L'évaluation DiagnostiqueDocument22 pagesRapport de L'évaluation Diagnostiqueboutaina jamaldinePas encore d'évaluation
- 221 4 Revuepraticien PDFDocument5 pages221 4 Revuepraticien PDFAli KabPas encore d'évaluation
- Redaction Sur La BeauteDocument3 pagesRedaction Sur La BeautekhadijaPas encore d'évaluation
- Correction TXT Kant-Mineurs Et MajeursDocument3 pagesCorrection TXT Kant-Mineurs Et MajeursOusseni abdallahPas encore d'évaluation
- PV EnactusDocument2 pagesPV EnactusAzziz HaydarPas encore d'évaluation
- Halleluha Duo Violin - Partitura Completa PDFDocument1 pageHalleluha Duo Violin - Partitura Completa PDFLucas PortosPas encore d'évaluation
- 10 - Maladies MentalesDocument2 pages10 - Maladies MentalesLaurtte llPas encore d'évaluation
- Grille Evaluation Prof 2Document2 pagesGrille Evaluation Prof 2Elias KhouryPas encore d'évaluation
- Lettre de Motivation Stagiaire Support ApprovisonnementDocument2 pagesLettre de Motivation Stagiaire Support ApprovisonnementMauricia AkwaPas encore d'évaluation
- Devenir PhilosopheDocument1 pageDevenir PhilosophezakariakhatibPas encore d'évaluation
- Mon Projet Professionnel EXEMPLE REDIGE (PDF - Io)Document9 pagesMon Projet Professionnel EXEMPLE REDIGE (PDF - Io)kaoutarPas encore d'évaluation
- Motivations - SisemDocument7 pagesMotivations - Sisemtkemkeng10Pas encore d'évaluation
- Mise en PratiqueDocument2 pagesMise en PratiquePierre Frantz PetitPas encore d'évaluation
- Thérapie NarrativeDocument5 pagesThérapie NarrativejacquetthezePas encore d'évaluation
- 14 - Le Message Visuel PublicitaireDocument8 pages14 - Le Message Visuel PublicitaireEugénie KleinPas encore d'évaluation
- Les Livres Noirs 1913-1932. Carnets de TransformationDocument5 pagesLes Livres Noirs 1913-1932. Carnets de TransformationBouquetPas encore d'évaluation
- Apprentissage Par Le JeuDocument7 pagesApprentissage Par Le JeuVeronica RaspontiPas encore d'évaluation
- Guide Entretien de Recrutement 09102012 1Document9 pagesGuide Entretien de Recrutement 09102012 1Ouattara Mana AwaPas encore d'évaluation
- LCP 062 0022Document9 pagesLCP 062 0022SalmaPas encore d'évaluation
- Docteure Annick Leca Psychiatre Psychothérapeute Méthode VittozDocument9 pagesDocteure Annick Leca Psychiatre Psychothérapeute Méthode VittozHarold SassePas encore d'évaluation
- LivretdestageDocument8 pagesLivretdestageDavid TshilerPas encore d'évaluation