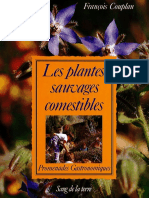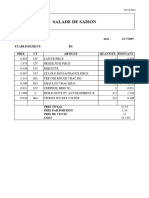Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Systématique Des Cotonniers Cultivés Ou Ayant Été Cultivés - Anciennement en Afrique Tropicale
Systématique Des Cotonniers Cultivés Ou Ayant Été Cultivés - Anciennement en Afrique Tropicale
Transféré par
Elie ZRATitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Systématique Des Cotonniers Cultivés Ou Ayant Été Cultivés - Anciennement en Afrique Tropicale
Systématique Des Cotonniers Cultivés Ou Ayant Été Cultivés - Anciennement en Afrique Tropicale
Transféré par
Elie ZRADroits d'auteur :
Formats disponibles
Revue internationale de
botanique appliquée et
d'agriculture tropicale
Systématique des Cotonniers cultivés ou ayant été cultivés
anciennement en Afrique tropicale
Auguste Chevalier
Citer ce document / Cite this document :
Chevalier Auguste. Systématique des Cotonniers cultivés ou ayant été cultivés anciennement en Afrique tropicale. In: Revue
internationale de botanique appliquée et d'agriculture tropicale, 28ᵉ année, bulletin n°307-308, Mai-juin 1948. pp. 228-241;
doi : https://doi.org/10.3406/jatba.1948.6156
https://www.persee.fr/doc/jatba_0370-5412_1948_num_28_307_6156
Fichier pdf généré le 03/05/2018
— 228 —
maison et village assainis, attention ^médicale et baisse de là
mortalité infantile, développement du goût pour les choses européennes,
y compris les vêtements, la quincaillerie et les ornements personnels,
le Noir est engagé à produire davantage et à prendre une place
importante dans les affaires mondiales. Il s'agit de savoir si,
sagement guidé, il répondra à cette hâte de progrès, car l'indigène est
de caractère docile, bon imitateur, observateur avisé et excellent
linguiste. Mais sa capacité d'organisation industrielle et politique
est limitée et peut être complétée par l'Européen dans le but de
civiliser un peuple arriéré.
On peut dire en conclusion sur l'avenir de la culture cotônnière
en Afrique Occidentale Française que : v
1° Le problème de l'amélioration des variétés a été résolu
suffisamment pour justifier les développements industriels sur une
grande échelle. Des études détaillées, pour la région des pluies
intermédiaires, sont prêtes; elles servent déjà un des traits du programme
général;
2° Les méthodes culturales, la rotation des récoltes et les moyens
de maintenir la fertilité du sol ont été aperçus et sont prêts à être
appliqués
3° Des progrès
à l'agriculture
administratifs
stabiliséeconvaincants
de l'avenir; ont été faits en vue
de l'organisation industrielle des indigènes pour l'accroissement de
la production du coton et d'autres récoltes agricoles.
Avec cet état favorable de l'heure présente nous devons être
satisfaits. L'avenir, sauf ces interruptions auxquelles les affaires
mondiales sont sujettes, dépend des progrès scientifiques et de
l'ingéniosité et de la sympathie de l'Administration.
Systématique des Cotonniers cultivés
ou ayant été cultivés anciennement en Afrique tropicale»
Par Aug. CHEVALIER.
La connaissance du genre Gossypium a fait de grands progrès
depuis quelques années, grâce aux travaux de nombreux
généticiens, en particulier ceux de Denham, Skovsted, G. S. Zaitzev,
Kearney, S. C. Harland et de J. B. Hutchinson et leurs
collaborateurs, puis Webber, Longley, Davies, Silow, Stephens. Pour les
espèces cultivées on revient à la conception de Parlatore qui ne
distinguait que six ou sept espèces. Plus tard Todaro porta le
nombre des espèces à une quarantaine. En 1907 G. Watt (The Wild and
cultivated Cotton Plant of the World) consacra au genre Gossypium
une monographie de 400 pages, remarquablement illustrée. C'est la
classification la plus détaillée et la plus complète du genre, mais
elle contient un assez grand nombre d'erreurs. Il indique
notamment un certain nombre de formes cultivées comme africaines,
alors qu'elles ont certainement été importées d'Asie ou d'Amérique;
— 229 —
par contre une espèce certainement africaine, mais non cultivée,.
G. anomalum Kotschy et Peyrisch est exclue du genre.
L'ouvrage de Watt n'était pas paru quand commencèrent en
1898 nos recherches sur la flore de l'Afrique tropicale et, nous
occupant plus spécialement des plantes cultivées ou de leurs
parents, notre attention s'était portée très spécialement sur les Gossy-
pium dont on voulait dès cette époque répandre la culture en
Afrique Occidentale.
Les résultats de nos herborisations ne furent connus qu'en 1910-
1911 par la publication des listes de Sudania. Aidé par Hochreu-
tiner le spécialiste des Malvacées, nous avions rattaché les Gossy-
pium que nous avions collectées en A. 0. F. et dans l'Oubangui-
Chari aux cinq espèces : G. hirsutum, G. barbadense, G. punctatum,
G. herbaceum, G. arboreum. En 1925, nous avons montré qu'il
fallait aussi rattacher au g. Gossypium le Cienfuegosia anomale
Gurke.
En 1913, avait été publié le travail suivant des plus intéressants :
Annet (Em.), Observations sur les Cotonniers de l'Afrique
tropicale française, Bull. Soc. Bot. France, t. LX, pp. 161-166 et 231-236,
publication qui a sans doute échappé à G. Watt pour ses
suppléments et à Roberty. Dans cette étude Annet, qui avait compulsé
notre Herbier et celui du Muséum de Paris, sous la direction de
M. J. Poisson, aide-naturaliste à l'Herbier, avait vu assez clair dans
les documents rassemblés mais il s'était laissé influencer aussi par
le livre de Watt. Le travail contient une bonne clef des espèces et
variétés. Outre les formes trouvées par nous, l'A avait examiné aussi
un matériel relatif aux indications faites par l'Association coton-
nière à partir de 1903 : il avait rassemblé lui-même des spécimens
de ces plantes au Dahomey. Il signalait notamment p. 165-166 des
formes cultivées au Soudan et au Dahomey appartenant au G.
hirsutum, « espèce qui varie considérablement suivant les conditions
de climat, de terrain et de culture ». Plusieurs, ajoute-t-il, se sont
modifiées... cependant certaines formes ont persisté dans les
cultures. « Ces variétés introduites sous le nom de Dickson, Cluster,
Peterkin corresppndent à des formes hybrides entre G. mexicanum
Todaro et le G. hirsutum L. Certaines d'entre elles se rapprochent
davantage de la première par les feuilles plus grandes, leur glabres-
cence très accentuée, leurs fleurs petites dépassant à peine Jies
bractées, entièrement jaunes et leurs graines à feutrage
imparfaitement formé. » Et à la suite Annet signale un G. mexicanum x G.
hirsutum que nous avions récolté au Dahomey. Il ajoute qu'à côté
des variétés pures de G. hirsutum (Géorgie, etc.), l'espèce par
hybridation avec d'autres espèces d'Amérique forme la série des Upland
d'Amérique et dans la liste des formes introduites en Afrique
figurent déjà les Cluster, King, Big Boll « formes aussi peu stables
que possible aussitôt qu'elles sont sorties de leur milieu culturel
d'origine ».
A propos du G. punctatum Schum. il écrit : « cette espèce peut
être considérée comme une forme dégénérée du G. hirsutum... sous-
l'influence du milieu elle est devenue essentiellement africaine. La
plupart des cultures cotonnières pratiquées par les indigènes en
A. 0. F. pour leurs besoins sont faites avec cette espèce, sauf au
— 230 —
Dahomey où G. peruvianum, G. barbadense et G. brasiliense
représentent les 2/3 ou les 3/4 des plantations. »
L'introduction de nouveaux Cotonniers en Afrique Occidentale
fut reprise en 1925 par le Service des Textiles. On introduisit outre
l'Allen et le Triumph (du groupe des Upland) un Cotonnier de
l'Inde, le Budi probablement hybride de formes herbacées du
G. arboreum et G. herbaceum, forme qui nous semble appartenir
au groupe des G. indicum Lamk.
La question en était là lorsque G. Roberty entreprit, au Soudan,
à partir de 1936, des recherches sur les Gossypium. Sans tenir
aucunement compte de ce qu'avaient fait déjà les botanistes africains
avant lui, mais en s'appuyant surtout, au moins au début, sur
l'ouvrage de Watt, il a publié successivement de 1938 à 1946 les
mémoires suivants :
1. Hypothèses sur l'origine et les migrations des Cotonniers
cultivés et notes sur les Cotonniers sauvages. Cahdollea, vol. VII (avril
1938), p. 297-360.
2. Gossypiorum revisionis Tentamen, Parties I à IIL Candollea IX
(août 1942), p. 19-103.
3. Gossypiorum revisionis... IV. Les Gossypia insculpta. Candollea,
X (oct. 1946).
4. Notes sur les Cotonniers cultivés au Soudan français. Annales
Musée colonial Marseille, 6e Sle, 3° vol. (1945), p. 5-63.
Pour comprendre l'étrange nomenclature adoptée par G. Roberty
il faut lire en outre ses « Propositions des Groupements de végétaux
du rang inférieur à l'espèce », éditées aussi dans Candollea.
L'A qualifie lui-même son Tentamen : « un travail extrêmement
complexe et par cela même très intéressant. » Complexe il l'est
.certainement. Est-il intéressant? C'est une autre affaire. Il n'a guère
■de chances sans doute d'être approuvé ni par les botanistes, ni par
les agronomes. Roberty a créé une nomenclature à lui et pour lui,
sans se préoccuper de savoir si on le suivait. Cette nomenclature
est en continuelle évolution. Pendant les années écoulées ses vues
se sont transformées. Ses combinaisons de nomenclature avec
d'innombrables formes signées « Roberty » se sont modifiées et rien ne
dit qu'il ne changera pas encore. A l'origine (en 1Ô38 et en 1942) il
suit en partie, pour les noms spécifiques G. Watt, ensuite (en 1946)
il s'en détache. Il crée dans l'espèce des subdivisions factices dans
lesquelles entrent soit des hybrides instables, soit des formes
climatiques ou saisonnières non fixées. C'est pourtant lui qui a dit avec
raison qu'il suffirait de deux générations pour transformer un G. hir-
sutum en G. punctatum. Dans les herbiers, dans les publications il
ne prend que ce qui lui plaît et l'arrange à sa manière. Il interprète
les vieux types des anciens auteurs, même s'ils sont incomplets et
-complètement indéterminables. Il montre un absolu dédain pour les
travaux des génétistes et à propos du remarquable et récent travail
de J. B. Hutchinson, il écrit :
« Du point de vue purement théorique nous estimons que cette
conception (celle des génétistes) est fausse métaphysiquement et
pragmatiquement, nuisible au développement matériel des sciences
biologiques aussi bien qu'au développement moral de l'humanité. »
•Comprenne qui pourra!
— 231 —
II va jusqu'à parler d'espèces métaphysiques. Pour caractériser
certaines formes il échafaude des formules mathématiques. Par
ailleurs il écrit : « un type pur de Cotonnier n'a le choix qu'entre
deux solutions : être fidèle à son type ou mourir! » En vérité nous
n'arrivons pas à saisir sa pensée. De même nous le comprenons
encore moins quand il écrit que l'espèce est au delà du monde
physique dans un univers à quatre dimensions!
Pourtant les notes de Roberty fourmillent aussi parfois
d'observations judicieuses. Il a vu des Cotonniers, beaucoup de Cotonniers
vivants et les a étudiés dans un jardin expérimental qu'il avait
organisé à Sonincoura sur les bords du Niger en 1938. Il a beaucoup
observé mais il a travaillé complètement isolé scientifiquement
pendant des années et c'est probablement cet isolement qui explique
ses affirmations- déconcertantes.
Il a écrit lui-même quelque part dans son Tentamen :
« Dans les recherches de Botanique Appliquée la rapidité doit
être évitée. » Cela est vrai, mais pourquoi n'a-t-il pas appliqué lui-
même ce principe dans ses publications de 1938 à 1946? Cela lui eût
évité de suivre d'abord presque à la lettre dans sa nomenclature
l'ouvrage de G. Watt et d'écrire quelques années plus tard à propos
de ce livre : « Ouvrage somptueux mais tout aussi « erroné » que
celui de Gammie. » En vérité cette critique est déplacée : il ne
fallait pas le suivre à la lettre!
De l'importante besogne accomplie par Roberty sur les Gossy-
pium, à l'aide surtout des spécimens qu'il a rassemblés à l'Herbier
de Genève, les botanistes, je le crains, pas plus que les
sélectionneurs ne tireront grand profit. Le grand désordre dans la
nomenclature des Gossypium que G. Watt avait déjà ébauché a été encore
aggravé par lui. Il l'a fait de bonne foi, par manque de documents
et aussi par sa manie de travailler dans l'isolement. L'Afrique
tropicale occidentale qui fut son principal champ d'études (1) ne se
prêtait guère à des recherches sur l'origine des Cotonniers cultivés.
Les seules plantes de ce groupe qui ont leur patrie en Afrique :
Gossypium anomalum Kotschy et Peyr., de même que quelques
espèces affines ainsi que Kirkii Mast, (devenu Gossypioides Kirkii
J. Hutch.), ne sont à l'origine d'aucune espèce cultivée.
D'autre part, G. arboreum L. var. sanguineum Watt que Roberty
indique comme originaire des Monts Atacora au Dahomey et G. afri-
canum Watt (forme vivace de G. herbaceum) ne sont en réalité que
de très faibles variations d'origine culturale de Cotonniers
asiatiques.
Tous les Cotonniers cultivés en Afrique sont venus les uns
d'Amérique (Cotonniers à 26 chromosomes : G. hirsutum et G. barba-
dense), les autres d'Asie (Cotonniers à 13 chromosomes : G.
arboreum et G. herbaceum) et on ne les connaît plus à l'état sauvage.
Ceci étant dit — et il fallait le dire pour établir le bilan de nos
connaissances actuelles par rapport à un passé tout récent — il
(1) On pourrait appliquer à Roberty les critiques qu'il adressait en
1943 à la taxonomie de Todaro : « Ses analyses et descriptions sont bien
faites : elles reposent sur des cultures très riches de plantes vivantes,
mais on se refuse à le suivre dans ses tentatives désordonnées et prolixes
•de synthèse et de classement. »
— 232 —
nous reste à examiner comment se présente à l'heure actuelle le
classement des Cotonniers cultivés en Afrique tropicale ou qui l'ont
été dans le passé, d'après les travaux les plus récents.
1 Cotonniers d'origine asiatique à 13 chromosomes.
Watt distinguait dans ce groupe quatre espèces G. arboreum L.r
G. herbaceum L., G. nanking Mey. (= G. indicum Lamk), G. obtusi-
folium Roxb.
Aujourd'hui les deux derniers, le vrai obtusifolium de l'Inde et
Yindicum de l'Inde, l'Indochine et le S de la Chine sont considérés
comme de simples variétés de Varboreum. Quant à Y obtusifolium
d'Afrique (G. africanum Watt) c'est tout simplement un herbaceum
frutescent vivace. Cela simplifie beaucoup la systématique de ce
groupe qui ne comprend en réalité que deux espèces G. arboreum
et G. herbaceum. ■
G. arboreum L. — Arbustes vivaces ou plantes herbacées
annuelles; feuilles profondément découpées à 5-7 (rarement 3) lobes.
Bractéoles pointues, entières ou avec 3-7 dents, recouvrant
étroitement le bouton, la fleur et la capsule celle-ci étant cachée, sauf
chez la var. sudanense Watt chez qui les bractées sont recourbées.
La patrie de l'espèce est inconnue, c'est probablement l'Asie
centrale, J. B. Hutchinson distingue diverses variétés géographiques
qui se nomment, d'après la région où on la cultive : race burma-
nicum (Birmanie et Indochine), race indicum (péninsule indienne),
race bengalaise (Nord et centre de l'Inde), race cernuum (Assam
et Bengale oriental), race sinense (Chine, Japon, Formose).
Enfin une race vivace a pénétré très anciennement en Afrique
tropicale probablement avant l'ère chrétienne. C'est la race soudanense
(= var. sanguineum Watt) que l'on observe encore depuis l'Arabie
jusqu'au Dahomey. C'est un grand arbuste monopodique haut de
2 à 3 m., à fleurs ordinairement rouges. Presque partout,
spécialement au Dahomey, on ne le voit plus que comme plante fétiche
autour des villages, mais en 1902-1903 nous l'avons encore vu
cultivé comme plante textile dans le bassin du Chari, surtout au
Baguirmi.
G. herbaceum L. — Arbustes vivaces ou plantes herbacées
annuelles. Feuilles découpées seulement jusqu'à la moitié, à lobes
pointus ou obtus, constrictés à la base. Bractéoles ovales acuminées.
avec 10-15 dents, laissant voir le bouton et toujours la capsule.
Fleurs jaunes avec une tache pourpre au centre. Surface de la
capsule lisse. La patrie de l'espèce serait le Turkestan chinois mais elle
n'y a pas été trouvée à l'état sauvage. On peut distinguer trois
variétés principales :
Var. euherbaceum comb. nov. — Port sympodique; plante
ordinairement annuelle; feuilles grandes, coriaces unies et pas très
fortement constrictées à la base des lobes. Bractéoles ovales, rondes,
retournées sur la capsule mûre. Capsule vert pâle, souvent s'ouvrant
très faiblement. /
— 233 —
Inde, Asie centrale et Asie mineure, S de l'Europe, Chypre. Cultivé
en Afrique du Nord à l'époque du voyage de Desfontaines.
Deux variétés se rencontrent en Afrique tropicale à l'état cultivé
et souvent naturalisées dans les jachères et les champs abandonnés.
Var. africanum (Watt) Hutchinson et Ghose. A aussi comme
synonymes : G. transvaalense, G. simpsoni, G. abyssinicum de Watt.
Arbuste souvent monopodique et vivace. Branches et feuilles
ordinairement glabres ou faiblement velues. Feuilles minces, plates,
avec lobes arrondis, profondément constrictés à la base; des sinus
entre les lobes. Capsule petite, arrondie s'ouvrant à maturité.
Variété importée d'Asie très anciennement, répandue" en Afrique
du Sud, au Mozambique, au Chari dans la colonie du Niger, en
Nigeria, dans les oasis du Sahara.
N'est plus que rarement cultivée, mais vit comme adventice dans
les anciennes cultures. On la cultivait encore au Daguirmi en 1903.
Var. acerifolium (Guill. et Perr.) Chev. = G. punctatum var. ace-
rifolium Guill. et Perr. = G. herbaceum var. frutescens Delile no-
men nudum, G. Wightianum Todaro, G. obtusïfolium var. Wightia-
num Watt.
Arbuste ordinairement sympodique. Tiges, pétioles, pédicelles et
feuilles densément velus. Feuilles à lobes chevauchant les uns sur
les autres, légèrement constrictés à la base. Capsules plus grosses
que dans la forme précédente, s'ouvrant ordinairement à maturité.
Coton très blanc et soyeux.
Cultivé encore dans l'Inde (Gugérat, Deccan, Madras). Etait
répandu encore en Afrique tropicale avant l'introduction des
Cotonniers américains. Lors du voyage d'ADANSON (1750) c'était le plus
cultivé au Sénégal. L'espèce est encore parfois cultivée au Soudan
„ français.
Cotonniers d'origine américaine à 26 chromosomes.
Dans ce groupe Watt distinguait plusieurs espèces :
G. punctatum Schum. et Thonn. (qu'il regardait surtout comme
africain) , G. hirsutum L., G. microcarpum Tod., G. pemvianum Cav.,
G. mexicanum Tod., G. purpurascens Poir., G. vitifolium Lamk.,
G. barbadense L., G. brasiliense.
Ces huit espèces sont ramenées à deux par J. B. Hutchinson :
G. hirsutum L. et G. barbadense. Harland distingue encore outre
ces deux espèces : G. punctatum Sch. et G. purpurascens. Il
rattache le vitifolium, le brasiliense et le peruvianum au barbadense. Le
mexicanum ne serait pas distinct des hirsutum (Upland). La
classification de Watt a dû être remaniée, comme l'explique Harland,
parce que ce savant avait pris comme base l'assemblage des brac-
téoles et la présence ou l'absence de fuzz sur les graines. Or, il est
maintenant connu que diverses espèces de Gossypium du Nouveau
Monde sont des formes présentant ensemble des bractéoles libres
et unies et aussi des graines à fuzz et des graines nues ou
partiellement nues. Toute la classification est donc à refaire. Celle des
formes américaines est particulièrement difficile car elles présentent
des variations climatiques innombrables et elles se sont
vraisemblablement hybridées à l'infini. Il n'est guère possible de faire des
— 234 —
études sur le genre avec des échantillons d'herbier et c'est ce qui
explique que tant d'erreurs aient été commises. « Comme dans
d'autres genres, écrit Harland, les études de génétique et de cytologie
ont graduellement débrouillé les difficultés taxonomiques et il est
maintenant possible de présenter un schéma plus ou moins cohérent
de la classification... Par les études de parentée portant sur les
croisements, le greffage et le comportement des gènes dans des
croisements intra ou interspécifiques, il est devenu possible non
seulement de diviser le genre en un nombre d'espèces naturelles, mais
aussi, dans beaucoup de cas, d'indiquer grosso modo le degré de
divergence génétique existant entre elles. »
Harland qui a une connaissance approfondie des espèces
cultivées ou subspontanées dans le Nouveau Monde, les ayant étudiées
sur place dans les deux Amériques et aux Antilles, propose pour
les espèces à 26 chromosomes les rapprochements suivants :
Sont à réunir :
1. G. hirsutum L. et G. mexicanum Tod.
2. G. purpurascens Poir., G. Schottii Watt forme laciniée, G. mo-
relli Cook.
3. G. punctatum Sch. et Thonn., G. eckmannianum "Wittmack,,
G. hopi Lewton.
4. G. barbadense L., G. mustelinum Miers, G. microcarpum Tod.,
G. peruvianum Cav., G. uitifolium Lamk., G. lapideum Tussac (= G.
brasiliense M&cf.) (1).
Deux plantes africaines qui semblaient autrefois appartenir à ce
groupe en ont été éliminées et ont formé le nouveau genre Gossy-
pioides Harl. Ce sont G. Kirkii Masters (= Gossypioides Kirkii
Harland) de l'Afrique orientale et G. brevilanatum Hochr. (=
Gossypioides brevilanatum Hutch.) de Madagascar.
Comme conclusion Harland n'admet que quatre groupes
spécifiques dans la série américaine : groupe Upland avec G. hirsutum L.
comme type, groupe Bourbon avec G. purpurascens Poir. comme
type, groupe Punctatum type G. punctatum Schum. et Thonn.
(= G. hopi Lewton), groupe péruvien (G. barbadense L. comme
type). J. B. Hutchinson va encore plus loin et n'admet plus que
deux espèces G. hirsutum L. auquel il rattache G. punctatum et
■ (1) Une intéressante hypothèse a été émise récemment sur l'origine
des Cotonniers américains à 26 chromosomes. Harland avait déjà suggéré
qu'ils pouvaient dériver d'une hybridation spontanée produite au
tertiaire quand les Gossypium actuels à 13 chromoses, les uns d'Asie, les
autres de la région pacifico-brésilienne, étaient en contact.
S.-G. Stephens suggère aujourd'hui que ce croisement serait plus récent.
Selon lui des Cotonniers furent apportés en Amérique par des civilisations
précolombiennes; ils furent ainsi en contact avec des Cotonniers
indigènes également à 13 chromosomes et s'hybridèrent. La faible diversification
des espèces nées de ce croisement milite en faveur de cette dernière théorie.
Les travaux que poursuit J.-B. Hutchinson semblent appuyer cette
hypothèse. Le G. raimondii Uhlrich du N du Pérou est une espèce sauvage
américaine qui a 13 chromosomes. Il s'acclimate parfaitement en Afrique
tropicale et à la station de l'I.R.C.T. à Bouaké (Côte d'Ivoire) il en
existe des plants robustes non attaqués par les insectes. Le G. tomentosnm
Nutt. des Hawaï est un Cotonnier à 26 chromosomes distinct des
Cotonniers diploïdes américains. Comme le montrent ces travaux la génétique
semble ouvrir aujourd'hui de nouvelles possibilités à l'amélioration des
Cotonniers. /
— 235 —
G. purpurascens comme variétés (ce dernier étant regardé comme
synonyme de G. Marie-Galante Watt, nom qu'il préfère garder pour
désigner la variété Bourbon) .
Il nous paraît que dans l'état actuel de la science, c'est cette
classification qui doit prévaloir. Nous résumons ci-après l'état de
nos connaissances sur ces deux groupes.
G. hirsutum L. (Cotonniers Upland) . D'après Harland : Port sym-
podique. Capsules vert pâle avec des glandes enfoncées en dessous^
de la surface (en creux). Feuilles légèrement pointues, avec 3-
5 lobes. Corolle ordinairement largement ouverte, couleur crème,
ordinairement dépourvue de tache à la base des pétales, mais
tachetée dans quelques formes. Les régions de culture de cette espèce
sont : Etats-Unis du Sud, Turkestan, Brésil Sud, Queensland,
Mésopotamie, S de la Chine, Indes et Mandchourie, Afrique tropicale.
La grande majorité des Cotonniers cultivés dans le monde
appartient à cette espèce. C'est celle qui semble avoir, en Afrique
Occidentale, le plus grand avenir.
Selon Vavilov (1926-1928), et Harland est d'accord avec lui,,
cette espèce a son origine dans l'Ainérique centrale et probablement
dans le S du Mexique. C'est un Cotonnier annuel, fleurissant sou*
des conditions optimum 7 à 8 semaines après le semis. A l'état
sauvage il ne pourrait probablement pas vivre en compétition avec
d'autres espèces. Il est donc une espèce essentiellement cultivée.
Abandonné à lui-même dans les régions semi-arides ses descendants
évoluent soit vers G. punctatum (= G. hopi), soit, dans les régions
plus humides, vers G. purpurascens et G. marie-galante dans les
pays d'Amérique tropicale et d'Afrique à longue saison des pluies*
L'espèce hirsutum présente un grand nombre de formes ou
d'hybrides avec G. barbadense. Pour la description de beaucoup
d'entre elles, il faut se reporter à l'ouvrage de Tyler (1910). Elle
est actuellement adaptée à la culture annuelle dans les régions
subtropicales pour lesquelles elle a été sélectionnée par l'homme à
partir de quelques souches plus primitives. Physiologiquement elh^
se caractérise par sa faible sensibilité a,u photopériodisme et à cet
égard elle diffère grandement du barbadense plus méridional. La
longueur dû" lint varie de 25 à 35 mm.
A la suite de cette espèce Harland décrit les Cotonniers du
groupe Bourbon (type G. purpurascens) dont la culture s'étend du
N du Brésil à la Floride, les uns à fleurs petites, les autres à grandes
fleurs, à grosses capsules et à graines subvelues ou nues.
Il est cultivé aux Antilles en culture bisannuelle ou pluriannuelle»
A l'exception de quelques lignées supérieures il n'a pas beaucoup
d'avenir. On le trouve parfois en Afrique tropicale à' travers les
plantations, mais il est toujours disséminé.
La variété marie-galante (Watt) Hutchinson, paraît correspondre
en partie' à la race purpurascens Poir. (non G. purpurascens Poir.).
Elle paraît spéciale aux Antilles et à l'Amérique centrale. Les
hybrides entre hirsutum, marie-galante et punctatum sont très,
fréquents; ils sont fertiles.
Enfin Harland cite comme espèce G. punctatum Schum. et
Thonn. (pour Hutchinson c'est simplement G. hirsutum var. punc-
tatum). C'est une forme monopodique parfois sympodique, habi-
— 236 —
tuellement vivace ; .elle ne produit des capsules en quantité qu'à
partir de la 2e année. Parfois c'est un arbuste qui s'élève à 2 ou
3 ni. de haut : il diffère de Vhirsutum par ses feuilles presque
glabres, ses glandes rouges sur les tiges, pétioles et pédoncules, ses
fleurs jaunes et non blanc-jaune jamais tachées de pourpre à la
base, ses petites capsules, et par son port. C'était il y a 50 ans la
forme la plus répandue (et même presque exclusive) en Afrique
dans les zones semi-arides (zone soudanaise, oasis du Sahara, S de
l'Afrique du Nord).
Le centre d'origine du groupe punctatum, d'après Harland, est
probablement le S du Mexique et il ne semble pas connu au S de
Costa-Rica.
Le G. hopi Lewton (1912) complètement identique au punctatum
d'Afrique occidentale (nous nous en sommes assuré en comparant
des spécimens authentiques) a été trouvé aux Etats-Unis, cultivé
par les Indiens de l'Arizona et de la Californie. On observe aussi
des formes du même groupe cultivées en Colombie, en Equateur et
au Brésil (Harland).
Rorerty a montré, ainsi que nous l'avons vu plus haut, que des
semis naturels de G. hirsutum, abandonnés à eux-mêmes devenaient
à la 2° génération des G. punctatum dans les régions semi-arides
du Soudan.
D'après la plupart des génétistes le G. punctatum n'a pas
beaucoup d'avenir. Cependant il est remarquablement adapté aux
climats soudanais et semi-arides. Il est très résistant aux maladies
cryptogamiques et aux insectes, tels le Ver rose qui semble ne pas
l'attaquer.qu'en"Ses soies sont courtes. Il ne donne des rendements
appréciables culture bisannuelle ou pérenne. Semé parmi les
Sorghos et les Pénicillaires la première année il ne donne pour
ainsi dire pas de récolte, mais la 2e année, si les champs sont
entretenus, on l'a vu produire au Soudan jusqu'à 100 ou 150 kg. de fibre
de valeur commerciale. Selon nous il n'a pas dit encore son dernier
mot, mais la technique de sa culture par les Africains n'est pas au
point.
G. barbadense L. — II faut comprendre cette espèce au sens
large, englobant les G. vitifolium, G. peruvianum, G. brasiliense (ou
lapideum). Plante extrêmement variable : port sympodique chez les
Cotonniers cultivés annuels {Egyptien et Sea-Island), semi-sympo-
dique chez quelques formes de Ishan (Nigeria et Dahomey) et
monopodique dans les Cotonniers arborescents sauvages ou cultivés
pouvant atteindre 5 à 6 m. de hauteur.
. Feuilles ordinairement profondément découpées. Corolle
ordinairement d'un beau jaune d'or avec une tache pourpre au fond,
non étalée mais formant une coupe longue et étroite; anthères à
déhiscence précoce; filets courts plus longs au milieu de la» colonne;
pollen jaune ou crème foncé.
Les types arborescents pérennes sont sensibles au photopé-
riodisme et avec G. purpurascens ils répondent aux jours de
9 heures par un port devenant sympodique.
Ces types étaient très répandus dans l'Amérique du Sud avant
qu'on y cultive les Upland. On les nomme Aspéro au Pérou, Vergera
— 237 —
en Colombie centrale, Carriacou aux Antilles et dans le Brésil Nord.
Ce sont les Cotonniers nommés Pérou ou Ishan en Afrique
occidental* (Harland) . Certaines variétés à graines nues, autrefois
cultivées dans les vieilles colonies des Antilles et dans les pays
tropicaux à longue saison des pluies, sont rapportées à G. vitifolium.
C'est la forme du G. barbadense adaptée au climat equatorial.
Ajoutons que récemment, d'après J. B. Hutchinson, le PT Boza a
découvert au N du Pérou un G. barbadense sauvage qui ressemble
étonnamment au G. darwini Watt des îles Galapogos. Du type
sauvage sont dérivées un grand nombre de formes cultivées.
Au Pérou existent dans les plantations des Péruviens à graines
lisses et des Péruviens rugueux ainsi que la variété Tanguis, à lint
long, très blanc, mais plutôt grossier et qui est utilisé dans les
mêmes buts que les Upland longue soie.
Il est probable que ces types primitifs pourraient jouer un grand
rôle dans l'amélioration des Cotonniers du groupe Ishan.
Le Cotonnier égyptien appartient aussi à ce groupe. Il en est de
même du Sea Island. Ces deux variétés sont caractérisées par un
lint très long pouvant atteindre 35 à 45 mm. de longueur. Ecologi-
quement l'Egyptien est adapté pour des conditions d'irrigation dans
les régions subtropicales, tandis que le Sea Island atteint son plus
beau développement dans les Basses Antilles et à Fidji où il croît
dans des conditions rassemblant une température uniforme mais
modérément haute ainsi qu'une chute de pluie allant de 1 m. à
1 m. 50 et une saison sèche assez longue pour que les capsules
puissent mûrir.
Il a été introduit dans le Bas Togo sur les bords du golfe de
Guinée où il se maintient à condition d'être fréquemment
sélectionné.
Enfin Hutchinson rattache aux Péruviens le Kidney Cotton et en
fait le G. barbadense var. brasiliense (Macfadyen) Hutch. = G. la-
pideum Tussac (1818), remarquable par ses graines en parties
soudées entre elles (parfois pas dans toutes les capsules). Arbuste de
2 à 3 m. de haut; vivace; jeunes tiges et feuilles ordinairement
glabres; fleurs très larges avec une tache pourpre au fond de la
corolle. Capsules très longues et étroites, pointues à l'extrémité,
atténuées à la base.
Depuis la découverte de l'Amérique et le commerce des esclaves
cette race a été introduite sur la côte occidentale d'Afrique. Elle se
rencontre dans les plantations cotières souvent en mélange avec
l'Ishan avec lequel elle s'hybride fréquemment de sorte qu'on trouve
souvent dans les plantations indigènes des termes de passage.
VARIETES ET SORTES DE GOSSYPIUM
ACTUELLEMENT CULTIVEES OU SUBSPONTANEES
EN AFRIQUE OCCIDENTALE
G. Boberty a publié en 1945 (Bulletin du Musée colonial de
Marseille) une liste des variétés de Cotonniers qu'il avait eu l'occasion
d'observer en Afrique Occidentale de 1935 à 1939, ou qu'il avait
cultivées au Jardin de Sonincoura. La liste qui suit, basée sur une
Rev. de Bot. Appl. , 16
— 238 —
classification différente, donne un aperçu sur les formes que l'on
rencontre actuellement dans les jardins ou les plantations de
i Ouest africain.
Gossypium arboreum. — Espèce presque disparue dans les
cultures d'Afrique Occidentale. Sa soie très courte n'est plus utilisée
par les Africains. Il en subsiste quelques plants autour des villages
dans le Haut et le Moyen Dahomey conservés comme plantes
magiques ou plantes à teinture.
G. herbaceum L. — On cultive encore en quelques rares villages
du Soudan français et de la Haute-Volta la var. acerifolia. Elle était
encore très cultivée il y a deux siècles au Sénégal et sans doute
dans une grande partie de l'Ouest africain. C'est cette variété qui
était connue au Sénégal il y a une cinquantaine d'années sous le
nom de Mokho. On la nomme Nouna au Soudan du nom d'un village
où elle a été trouvée. On la cultive dans le triangle San-Nouna-
Tougan.
La variété africanum est subspontanée dans la zone sahélienne et
dans quelques oasis du Sahara; «Ile est d'introduction très
ancienne et sa soie en général n'est pas récoltée.
Le Budi introduit au Soudan vers 1930 et dont la culture a été
répandue dans les régions subarides du Soudan, de la Volta, du
Haut Togo est une hybride de G. herbaceum X arboreum ou plutôt
Garo Hills X Karangani (G. cernuum X indicum). Bien que
d'introduction récente il est déjà très répandu. Malgré ses soies courtes
il a une grande popularité chez les indigènes.
G. hirsutum L. (Upland). — II semble que c'est le Cotonnier
d'avenir du Soudan (culture irriguée), de la Haute Côte d'Ivoire et
du Togo-Dahomey (culture sèche) , mais on est encore à la recherche
des meilleures variétés. Les premiers Upland furent introduits en
A. 0. F. en 1897. Ils furent répandus d'abord dans la vallée du
Niger, au Dahomey, dans la région de Sikasso. On a perdu trace des
premières variétés introduites.
Vers 1925, l'attention se porta sur l'Allen, un Upland très
caractéristique qui avait été introduit en Nigeria par Lamb en 1912. Il
venait de l'Ouganda où on l'avait probablement reçu des Etats-
Unis. Il fut ensemencé à la station de Maigena au S de Kano et il fut
adopté en 1918 pour être ensemencé dans les plantations indigènes.
Les premières sélections commencèrent en 1924. La première
introduction de graines au Soudan français eût lieu en 1925 ou 1926. Des
sélections se firent les années suivantes aux stations de M'Pesoba
et de Ségou. En 1938, Y Allen était cultivé au Soudan et dans le N de
la Côte d'Ivoire sur une assez vaste échelle. On en était
généralement satisfait. Il est en fort déclin aujourd'hui et tend même à
disparaître en A. O. F. par suite des attaques des insectes et en
particulier du Ver rose.
On tend à lui substituer le N'Kourala, autre variété de Upland
connue depuis une vingtaine d'années.
Le N'Kourala dont on connaît mal la genèse a été rencontré dans
un champ indigène au Soudan. On le trouva vers 1920 au village de
— 239 —
N'Kourala, chef-lieu du Kapondougou, dans la région de Sikasso.
Pour certains il proviendrait du croisement de Cotonniers locaux
(punctatum) avec des Cotonniers américains (Mississipi) introduits
par l'Association cotonnière ou par le Service d'Agriculture depuis
1904. A notre avis c'est un pur Upland descendant direct (sans
hybridation avec punctatum) de quelque forme introduite. Il fut
répandu à partir de 1930 par la station de M'Pesoba et l'Office du
Niger. C'est un Upland bien caractérisé : feuilles assez velues à 3-
5 lobes. Les fleurs sont presque blanches (les jaunes rares). Jamais
de taches rouges sur l'onglet, mais chaque pétale en se fanant
devient rose. Le lint est de 28 à 30 mm. Capsules grosses et
arrondies, valves ordinairement 4 (76 %); 16 % sont à 3 valves et 8 %
en ont 5 (d'après J. Miège) . Le N'Kourala est stabilisé autour de 4
ou 5 valves; le punctatum en a 3.
Le N'Kourala est encore très- polymorphe par la forme et la taille
des capsules. Au Soudan il existe encore des « pieds de cuve » que
l'on suit entre N'Kourala et Nongoni. Le service d'Agriculture et les
chefs de canton les surveillent.
Le N'Kourala fut soumis à une première sélection à M'Pesoba vers
1930. Il se montra d'abord très hétérogène. On en tenta aussi la
multiplication au Baoulé en 1938. La sélection massale commença
à la Station cotonnière de Bouaké en 1943. En 1945 a commencé la
sélection génétique par les lignées pures. Elle se poursuit en ce •
moment. On cherche à obtenir un type semi-précoce pour le Baoulé
Nous avons vu en 1948 une belle descendance, à peine attaquée
par les parasites.
D'autres Upland ont été essayés dans ces dernières années. Citons
le Triumph cultivé en grand au Congo belge et dans l'Oubangui-
Chari. Il est très attaqué par les insectes à Bouaké. A la station de
Soninkoura, près du Niger (abandonnée aujourd'hui), on a essayé
un Webber U. S. A. (hirsutum typicum d'après Roberty) et une
lignée venant de Soukarou, près Bandiagara qui serait un G.
punctatum prostratum. Ajoutons qu'il existe encore çà et là dans les
champs des Africains, en Afrique Occidentale, des Upland tout
venant faisant retour au punctatum et ayant perdu les caractères
des premières variétés introduites; divers plants opt encore des
pétales maculés de rose à la base (mexicanum) .
G. punctatum. — Ce Cotonnier était le seul cultivé il y a
cinquante ans dans les zones sahélienne et soudanaise, il était aussi le
plus répandu dans la zone guinéenne. Dans les pays bordant le
golfe de Guinée : Dahomey, Togo, Gold Coast, Côte d'Ivoire il
représentait encore plus de 30 % des cultures cotonnières. Vivace,
remarquablement adapté aux sols et aux climats de ces pays, mais
donnant de faibles rendements et des soies très courtes (15 à
25 mm.) il suffisait aux besoins des indigènes. Ce Gossypium
produit rarement plus de 50 kg. de fibres à l'ha., mais comme il
occupait les terrains abandonnés après la récolte du Sorgho, on s'en
contentait. Les Européens ont estimé depuis une vingtaine d'années
que le Cotonnier dit indigène ne convenait pas pour l'exportation
et pour l'industrie d'Europe. On en a proscrit la culture.
Néanmoins chez presque toutes les peuplades (en dehors de la forêt) il
— 240 —
erst toujours cultivé pour les besoins familiaux. On le connaît sous
les noms de N'dargau au Sénégal, Coroniba chez les Bambaras. On
n'a pas réussi encore à l'améliorer. Une autre forme qui vit plus
au S (à la Gold Coast et au Dahomey) et se présente sous forme
d'arbustes bas, souvent annuels, à rameaux retombants, à feuilles
velues et molles, à petites capsules rondes et à soies courtes souvent
rousses est le G. hirsutum var. prostrata (Schum. et Thonn.) Watt,
C'est le Coronini des Bambaras.
G. barbadense L. — Le Cotonnier Egyptien a été cultivé en
irrigation il y a une quinzaine d'années à Dire dans la région de Tom-
bouctou à la suite des essais de J. Vuillet et Vitalis, il y a donné
des résultats intéressants. On l'a cultivé aussi dans la région de
Ségou au N du 14° de lat. Nord (essais de l'Office du Niger).
Le Sea Island est toujours cultivé dans le Moyen Togo mais c'est
une forme dégénérée. Il faudrait en réimporter des graines.
C'est au groupe des Péruviens (G. barbadense var. peruvianum)
qu'appartient VIshan. Ce Cotonnier existait dans les cultures
indigènes de tous les pays bordant le golfe de Guinée et jusqu'au Nord
de la Côte d'Ivoire, ainsi que dans la Nigeria à l'arrivée des
Européens vers 1895. Il fut sélectionné dans ce dernier pays par les
Anglais et on en obtint Ylshan A qui donna des rendements
intéressants et montra des qualités techniques satisfaisantes. Des lignées
sélectionnées d'Ishan sont toujours cultivées à la Nigeria, mais au
Baoulé et au Dahomey les graines n'ont plus été sélectionnées. En
1944, on fit une nouvelle introduction d'Ishan d'Ibadan à Bouaké
en vue de remplacer celui tout venant par une forme homogène de
précocité moyenne et en recherchant une forme avec des capsules
à 4 loges (au lieu de 3). Ces- essais ont été abandonnés. La plante
est très attaquée par les parasites et principalement le ver rose
depuis quelque temps et c'est la raison pour laquelle on cherche à
en proscrire la culture et à lui substituer un N'Kourala épuré et
amélioré.
Il reste à dire un mot du Cotonnier rognon ou Kidney Cotton
(G. lapideum). On le trouve par petites plantations de quelques
arbustes vivaces près des villages de la forêt dense et de sa lisière
à la Côte d'Ivoire comme je l'ai constaté encore en 1948. Les peu-
, plades forestières le cultivent pour des usages familiaux mais il
n'est pas mis sur les marchés.
Suivant Harland, les Cotonniers demi-sauvages qui existent dans
un pays peuvent être un jour très utiles pour créer de nouvelles
races intéressantes. Roberty remarque aussi qu'on a détruit en
A. O. F. avec une hâte excessive les espèces vraiment indigènes ou
naturalisées. En réalité elles ne sont pas disparues. Il existe bien
des règlements qui en proscrivent la culture, mais les indigènes
sont parfois plus intelligents que les Européens. Ils détruisent peut-
être parfois certains plants visibles mais ils savent aussi en
conserver çà et là dans leurs champs dispersés et peu visités par les
contrôleurs-moniteurs. .
— 241 —
Le punctatum du Soudan, par exemple, n'est pas prêt de
disparaître des lougans africains. Avec des soins culturaux appropriés
on pourra peut-être un jour lui faire produire une soie qui soit
suffisamment rentable. Quant aux Upland ils sont certes supérieurs*
mais on peut se demander si le paysan africain saura donner à sa
culture les soins qu'elle requiert et s'il consentira à détruire
périodiquement les plants anciens afin de maintenir dans ses champs
exclusivement des variétés améliorées. Enfin cette culture de types
améliorés qui demande plus de soins sera-t-elle payante. C'est ce
problème que nous examinerons dans une prochaine étude.
Nouvelles recherches
sur l'Arbre à beurre du Soudan
Butyrospermum Parkii
Par Aug. CHEVALIER.
Dans une note publiée en 19b6 (Oléagineux, /, p. 7) nous avions
été amené à conseiller la culture du Karité ou Arbre à beurre du
Soudan dans des vergers composés de plants améliorés en utilisant
de bons sujets sélectionnés de cet arbre spontané sur de vastes
étendues et en éliminant progressivement les sujets médiocres.
Les constatations que nous venons de faire au cours d'un nouveau
voyage en Afrique, les renseignements nouveaux que nous avons
recueillis sur place dans une région particulièrement riche en
Karités sauvages et où vit depuis quelques années un observateur
remarquable du Karité M. A. Halff nous obligent à revenir sur cette
question et à modifier notre manière de voir. L'importance du Karité
dans la vie des Soudanais n'est pas douteuse, mais, en vérité, c'est
un produit de cueillette et il est à craindre qu'il le reste longtemps»
Est-il désirable qu'on s'attelle à son amélioration? Ce ne peut être,
comme on le verra, qu'une œuvre de très longue haleine. On peut se
demander s'il y a intérêt à l'entreprendre surtout à l'heure actuelle
au moment où l'Afrique noire est en pleine transformation. Il est
plus urgent à notre avis de perfectionner l'agriculture soudanaise,
d'aménager des champs rationnellement cultivés en plantes
herbacées et fumés soumis à des assolements (Mils et autres cultures vi-
vrières, Arachides et Cotonniers). Quant aux vergers projetés ils
doivent être l'accessoire de chaque petite ferme soudanaise. Le
Karité n'est du reste pas le seul arbre qui doive entrer dans la
composition des vergers. Une foule d'arbres utiles à des points de vue
divers : Faidherbia à gousses recherchées du bétail, Ficus fourra-
gers, Roniers à vin de palme (et éventuellement plus tard exploités
pour la production du sucre), arbres à fruits utilisables sur place
(Baobabs, Nérés, Finzans, Cordia, Prosopis, Orangers, etc.), sont tout
aussi intéressants pour les- services qu'ils rendent aux Africains.
Enfin beaucoup de ces arbres portent des ruches d'Abeilles et le mieT
Vous aimerez peut-être aussi
- Diversite Des Abeilles Sauvages en Guadeloupe Et Leur Contribution A La Flore ButineeDocument65 pagesDiversite Des Abeilles Sauvages en Guadeloupe Et Leur Contribution A La Flore ButineeKevin BartPas encore d'évaluation
- Flore de GuinéeDocument198 pagesFlore de GuinéeGbapolite LenoirPas encore d'évaluation
- Amélioration Du SojaDocument17 pagesAmélioration Du Sojajaizoz80% (5)
- Le Guide: Résumé Et Traduction Par FabsDocument15 pagesLe Guide: Résumé Et Traduction Par FabsMohamed Taieb BakouchePas encore d'évaluation
- Bex - 1969 - Le Jardin Gillet, KisantuDocument8 pagesBex - 1969 - Le Jardin Gillet, KisantuTomás Motta TassinariPas encore d'évaluation
- Les Plantes Utiles Du Gabon Journal D'agriculture Tropicale Etde Botanique AppliquéeDocument32 pagesLes Plantes Utiles Du Gabon Journal D'agriculture Tropicale Etde Botanique AppliquéekalyPas encore d'évaluation
- Bibliographie 6 - 56Document12 pagesBibliographie 6 - 56LordnikoPas encore d'évaluation
- Jatba 0370-5412 1948 Num 28 303 2098Document26 pagesJatba 0370-5412 1948 Num 28 303 2098EL Hassania EL HERRADIPas encore d'évaluation
- Les Haricots PDFDocument30 pagesLes Haricots PDFcoucou0505Pas encore d'évaluation
- Histoire DharicotsDocument9 pagesHistoire DharicotsnuitPas encore d'évaluation
- Initiation A L'agroforesterie PDFDocument234 pagesInitiation A L'agroforesterie PDFVitam NoelPas encore d'évaluation
- Biblio HC 32 CarriereDocument70 pagesBiblio HC 32 CarriereHamed SOARAPas encore d'évaluation
- Introduction Du TFCDocument2 pagesIntroduction Du TFCVicky MwilambwePas encore d'évaluation
- Extrait Les Allium Alimentaires Reproduits Par VoieDocument20 pagesExtrait Les Allium Alimentaires Reproduits Par Voietasnime haninePas encore d'évaluation
- Les Nitraria, Plantes Utiles Des Déserts SalésDocument8 pagesLes Nitraria, Plantes Utiles Des Déserts SalésAnonymous e34JgdPqoDPas encore d'évaluation
- Les Legumineuses Alimentaires Du Cameroun Premiers RésultatsDocument44 pagesLes Legumineuses Alimentaires Du Cameroun Premiers RésultatsLawinPas encore d'évaluation
- Les Plantes en Pays Lobi (Burkina Et Côte-d'Ivoire) - Lexique Des Noms Lobi-Latin Et Latin-LobiDocument163 pagesLes Plantes en Pays Lobi (Burkina Et Côte-d'Ivoire) - Lexique Des Noms Lobi-Latin Et Latin-LobiModeste Darj100% (1)
- Nguinambaye Et al2015.Distribution-AmpelocissusDocument14 pagesNguinambaye Et al2015.Distribution-AmpelocissusElisée MbayngonePas encore d'évaluation
- André Haudricourt. Domestication Des Animaux, Culture Des Plantes Et Traitement D'autruiDocument12 pagesAndré Haudricourt. Domestication Des Animaux, Culture Des Plantes Et Traitement D'autruiericooal100% (1)
- Les Insectes Ravageurs Des Cultures en AmazonieDocument6 pagesLes Insectes Ravageurs Des Cultures en AmazonieVan FoliviPas encore d'évaluation
- Correction 1e Du Memoire KomesseDocument22 pagesCorrection 1e Du Memoire KomessecharissosthenekomesselaouePas encore d'évaluation
- Taxonomania 15Document18 pagesTaxonomania 15vinca32Pas encore d'évaluation
- Eucalyptus Jardin EssaiDocument9 pagesEucalyptus Jardin EssaievePas encore d'évaluation
- BF 06 FloraDocument100 pagesBF 06 FloraOuedraogoPas encore d'évaluation
- Haudricourt DomesticationDocument12 pagesHaudricourt DomesticationSoledadPas encore d'évaluation
- Notions d'agriculture et d'horticulture: premières notions d'agricultureD'EverandNotions d'agriculture et d'horticulture: premières notions d'agriculturePas encore d'évaluation
- Domestication Des Animaux, Culture Des Plantes Et Traitement D'autruiDocument12 pagesDomestication Des Animaux, Culture Des Plantes Et Traitement D'autruiMiguel Vázquez AngelesPas encore d'évaluation
- 2019 01 23 EbeznoufellaDocument8 pages2019 01 23 EbeznoufellalyndaPas encore d'évaluation
- NéréEtude Valeur NutritionnelleDocument39 pagesNéréEtude Valeur NutritionnellePierre PatricPas encore d'évaluation
- La Productivité de L'herbeDocument55 pagesLa Productivité de L'herbendeloofPas encore d'évaluation
- Plantessauvagescomestibles Ocr PDFDocument170 pagesPlantessauvagescomestibles Ocr PDFJeanPas encore d'évaluation
- CIRADjournals,+document 457200Document6 pagesCIRADjournals,+document 457200Nizar GarzounPas encore d'évaluation
- Flore TunisieDocument317 pagesFlore Tunisiecmoline180% (5)
- 1Document8 pages1moukhePas encore d'évaluation
- EBOOK Francois Couplan Guide Nutritionnel Des Plantes Sauvages Et CultiveesDocument257 pagesEBOOK Francois Couplan Guide Nutritionnel Des Plantes Sauvages Et CultiveesMalik Tigzirt100% (1)
- WeingartiaDocument26 pagesWeingartialoonaPas encore d'évaluation
- Jatba 0370-5412 1952 Num 32 357 6513Document48 pagesJatba 0370-5412 1952 Num 32 357 6513sfsfsfssdsdsPas encore d'évaluation
- Taxonomania 23Document14 pagesTaxonomania 23vinca32Pas encore d'évaluation
- Devoir MercelineDocument17 pagesDevoir MercelineKeniel TerveusPas encore d'évaluation
- RC42h Genres Cantharoidea GuyaneDocument16 pagesRC42h Genres Cantharoidea GuyaneRobert ConstantinPas encore d'évaluation
- La Culture Du Cherimolier en France - 1925Document4 pagesLa Culture Du Cherimolier en France - 1925Dory YanickPas encore d'évaluation
- Bibliographie 192Document36 pagesBibliographie 192LordnikoPas encore d'évaluation
- L'Essentiel en AulacodicultureDocument167 pagesL'Essentiel en AulacodicultureJeezPas encore d'évaluation
- Adventices TropicalesDocument491 pagesAdventices TropicalesaxelzorlPas encore d'évaluation
- A Propos Du ChiaDocument3 pagesA Propos Du ChiaLordnikoPas encore d'évaluation
- 7th Symposium Proceedings 0013Document20 pages7th Symposium Proceedings 0013GERARD NGUEMALIEU HSSIPas encore d'évaluation
- Botanique Guide Fleurs AlpesDocument104 pagesBotanique Guide Fleurs AlpesRosalie FernandesPas encore d'évaluation
- Les Techniques de L'agriculture Indigène en Afrique Noire.: Auguste ChevalierDocument10 pagesLes Techniques de L'agriculture Indigène en Afrique Noire.: Auguste ChevalierSerge AnthonyPas encore d'évaluation
- A Propos Du ThéierDocument8 pagesA Propos Du ThéierLordnikoPas encore d'évaluation
- Serpents - Guyane FrançaisesDocument167 pagesSerpents - Guyane FrançaisesKhalid Ben KaddourPas encore d'évaluation
- Cueillette: Encyclopédie BerbèreDocument7 pagesCueillette: Encyclopédie BerbèreAymen Chbihi KaddouriPas encore d'évaluation
- Histoire - Introduction Du Genre Actinidia Au MuseumDocument16 pagesHistoire - Introduction Du Genre Actinidia Au MuseumZirselsabilPas encore d'évaluation
- Forets Comestibles PapierDocument64 pagesForets Comestibles PapierflamPas encore d'évaluation
- Les Haricots: de 272 Figures)Document187 pagesLes Haricots: de 272 Figures)Walker ButeressPas encore d'évaluation
- Le Sarrasin Un Passe Consequent Des Atouts Pour LavenirDocument4 pagesLe Sarrasin Un Passe Consequent Des Atouts Pour LavenirPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Pratiques Et Enjeux de La Culture Du Karite ButyroDocument17 pagesPratiques Et Enjeux de La Culture Du Karite Butyrolunaalpha282Pas encore d'évaluation
- Plantes Du Hoggar R Colt Es Par M. Chudeau en 1905Document23 pagesPlantes Du Hoggar R Colt Es Par M. Chudeau en 1905redsemPas encore d'évaluation
- Jaume de Saint HilaireDocument302 pagesJaume de Saint Hilairemarais bourges100% (1)
- Report-Guedje ChaungueuDocument19 pagesReport-Guedje ChaungueuUziel CHIMIPas encore d'évaluation
- Monographie des greffes: Les diverses sortes de greffes employées pour la multiplication des végétauxD'EverandMonographie des greffes: Les diverses sortes de greffes employées pour la multiplication des végétauxPas encore d'évaluation
- Mise en Evidence Chimie Du VivantDocument1 pageMise en Evidence Chimie Du VivantElie ZRAPas encore d'évaluation
- Power Point Youssoufa CorrigéDocument28 pagesPower Point Youssoufa CorrigéElie ZRAPas encore d'évaluation
- Gastro Digest FraDocument34 pagesGastro Digest FraElie ZRAPas encore d'évaluation
- Homeostasie ReinsDocument24 pagesHomeostasie ReinsElie ZRAPas encore d'évaluation
- 86 InfectionBP UMVFDocument11 pages86 InfectionBP UMVFElie ZRAPas encore d'évaluation
- Fiche-Prof-Mise-En-Evidence-Des-Sucres 2Document3 pagesFiche-Prof-Mise-En-Evidence-Des-Sucres 2Elie ZRAPas encore d'évaluation
- Minesec Epreuve de Maths Probatoire Blanc: Mai 2015 Classe de PD Coef: 4 Durée: 3heures Exercice 1: 4pointsDocument4 pagesMinesec Epreuve de Maths Probatoire Blanc: Mai 2015 Classe de PD Coef: 4 Durée: 3heures Exercice 1: 4pointsElie ZRAPas encore d'évaluation
- Etat de Besoin Labo Lymid 2021 2022Document2 pagesEtat de Besoin Labo Lymid 2021 2022Elie ZRAPas encore d'évaluation
- Fiche Repere Accueil 2Document2 pagesFiche Repere Accueil 2Elie ZRAPas encore d'évaluation
- Sbstta 22 10 FRDocument21 pagesSbstta 22 10 FRElie ZRAPas encore d'évaluation
- CamScanner 01-21-2022 13.48Document2 pagesCamScanner 01-21-2022 13.48Elie ZRAPas encore d'évaluation
- Les Valvulopathies - BouzidiDocument41 pagesLes Valvulopathies - BouzidiElie ZRAPas encore d'évaluation
- Épreuve de Sciences de La Vie Et de La Terre: I. Maîtrise Des Connaissances (5 Points)Document3 pagesÉpreuve de Sciences de La Vie Et de La Terre: I. Maîtrise Des Connaissances (5 Points)Elie ZRAPas encore d'évaluation
- Epreuve de Svteehb 3 Tled Prepa Exam 2022 2023 1Document8 pagesEpreuve de Svteehb 3 Tled Prepa Exam 2022 2023 1Elie ZRAPas encore d'évaluation
- Cahiers de l'ENS-Bongor'': ISSN 2708-2342Document17 pagesCahiers de l'ENS-Bongor'': ISSN 2708-2342Elie ZRAPas encore d'évaluation
- 3e Séq. 2021 2022 La VisionDocument3 pages3e Séq. 2021 2022 La VisionElie ZRAPas encore d'évaluation
- Classe de CinquièmeDocument11 pagesClasse de CinquièmeElie ZRAPas encore d'évaluation
- Caneva Ce Fin AnneeDocument4 pagesCaneva Ce Fin AnneeElie ZRAPas encore d'évaluation
- Caneva Redaction de RapportDocument3 pagesCaneva Redaction de RapportElie ZRAPas encore d'évaluation
- 3e Leçon UNESCODocument8 pages3e Leçon UNESCOElie ZRAPas encore d'évaluation
- EPREUVE DE SVTEEHB Tle D Eval N°3Document7 pagesEPREUVE DE SVTEEHB Tle D Eval N°3Elie ZRAPas encore d'évaluation
- 2e Leçon UNESCODocument13 pages2e Leçon UNESCOElie ZRAPas encore d'évaluation
- 3E 5e EvaluationDocument2 pages3E 5e EvaluationElie ZRAPas encore d'évaluation
- TD Seq 3 Tle DDocument4 pagesTD Seq 3 Tle DElie ZRAPas encore d'évaluation
- CamScanner 12-21-2022 10.47Document1 pageCamScanner 12-21-2022 10.47Elie ZRAPas encore d'évaluation
- 3e Evaluation SVTEEHB TleDDocument6 pages3e Evaluation SVTEEHB TleDElie ZRAPas encore d'évaluation
- EVAL N°2 SVTEEHB BAKASSA Tle D - CopieDocument8 pagesEVAL N°2 SVTEEHB BAKASSA Tle D - CopieElie ZRAPas encore d'évaluation
- Zra Elie - Fiche - PreinscriptionDocument2 pagesZra Elie - Fiche - PreinscriptionElie ZRAPas encore d'évaluation
- Emploi IndividuelDocument1 pageEmploi IndividuelElie ZRAPas encore d'évaluation
- TD SIC IdeDocument8 pagesTD SIC IdeElie ZRAPas encore d'évaluation
- 2021-2022 Div ViV Bio Veg Cours 3 M - LALOI-7Document40 pages2021-2022 Div ViV Bio Veg Cours 3 M - LALOI-7Paulin BILLAUDPas encore d'évaluation
- Rapport+Stage+2016+ +C.+AuvinetDocument80 pagesRapport+Stage+2016+ +C.+Auvinet5qdg47jydyPas encore d'évaluation
- 4 Fiche MABD Biodynamie Viti - Cuivre1Document4 pages4 Fiche MABD Biodynamie Viti - Cuivre1Omiao NguyenPas encore d'évaluation
- Bouturage de Feuille - Multiplier Vos Plantes Simplement PDFDocument3 pagesBouturage de Feuille - Multiplier Vos Plantes Simplement PDFTarek Ezzat100% (1)
- Conception ArrosageDocument34 pagesConception ArrosageStukinePas encore d'évaluation
- Fiche Technique Vierge Pour Calculer Prix de RevientDocument34 pagesFiche Technique Vierge Pour Calculer Prix de RevientJean-Noël AubertPas encore d'évaluation
- Cours Biologie Vegetale L1 PrintDocument9 pagesCours Biologie Vegetale L1 PrintJulie DelPas encore d'évaluation
- TD Phytotechnie Generale ExoDocument2 pagesTD Phytotechnie Generale Exovalydagnogo11Pas encore d'évaluation
- L Outillage Du PaysagisteDocument29 pagesL Outillage Du PaysagisteHamidPas encore d'évaluation
- Comment Être Négatif Au Test Par Prélèvement Salivaire Du Cannabis 2012.20130317.194559Document2 pagesComment Être Négatif Au Test Par Prélèvement Salivaire Du Cannabis 2012.20130317.194559north3bongoPas encore d'évaluation
- Le Grand Pin Et Le Bouleau - Conte QuébécoisDocument3 pagesLe Grand Pin Et Le Bouleau - Conte QuébécoisKlairey LemeriéPas encore d'évaluation
- Cultures Sucrières Mag 2 FRDocument25 pagesCultures Sucrières Mag 2 FRErenjäger CedricPas encore d'évaluation
- تغذية و معالجة الحبوب في الشمال-06-10-2022Document2 pagesتغذية و معالجة الحبوب في الشمال-06-10-2022الشامل للمعرفةPas encore d'évaluation
- Examen SV2 Ecrit2010Document2 pagesExamen SV2 Ecrit2010Dori Ri100% (1)
- OwniesDocument258 pagesOwniesAriana Pazzini92% (13)
- Comparaisons de Varietes Des Cultures Maraicheres AminataDocument16 pagesComparaisons de Varietes Des Cultures Maraicheres AminataAsmae EL IdrissiPas encore d'évaluation
- Au Maroc L'aubépine Croit Dans Les Forêts Du Moyen AtlasDocument1 pageAu Maroc L'aubépine Croit Dans Les Forêts Du Moyen AtlasMouadBtkPas encore d'évaluation
- Marchebranche Tables Aléatoires - Version Du 24-02-17Document43 pagesMarchebranche Tables Aléatoires - Version Du 24-02-17pascal.westhoekPas encore d'évaluation
- Tuberculose de L'olivier P.savastanoi PV SavastanoiDocument7 pagesTuberculose de L'olivier P.savastanoi PV SavastanoihindPas encore d'évaluation
- La Culture de MéristèmesDocument4 pagesLa Culture de Méristèmesmahdi hamzaouiPas encore d'évaluation
- Le Rejet de L'autoritéDocument20 pagesLe Rejet de L'autoritéJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Recette de Karantika (Specialité Algerienne Oranaise)Document12 pagesRecette de Karantika (Specialité Algerienne Oranaise)Ismail Negrovic100% (1)
- Seringe. Memoires de La Société de Physique Et D'histoire Naturelle de GenèveDocument586 pagesSeringe. Memoires de La Société de Physique Et D'histoire Naturelle de GenèveCristián Olivares AcuñaPas encore d'évaluation
- Cours PDFDocument31 pagesCours PDFAmine Riadhi100% (1)
- Planter Du GazonDocument90 pagesPlanter Du GazonproutaaaPas encore d'évaluation
- Catalog Aroma Zone PDFDocument56 pagesCatalog Aroma Zone PDFCristinaPas encore d'évaluation
- Bonnes Pratiques Pour L'entretien Dune OliverieDocument63 pagesBonnes Pratiques Pour L'entretien Dune Oliverieredha dekhil100% (1)
- Inventaire Des Plantes 14511Document100 pagesInventaire Des Plantes 14511Volatiana Nambinina RASOANAIVOPas encore d'évaluation
- POIVRONDocument7 pagesPOIVRONAziz Kabore100% (1)