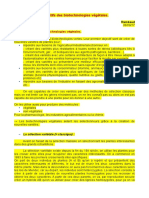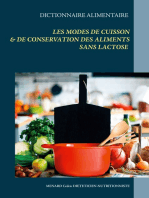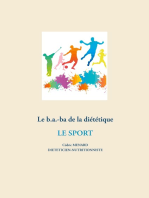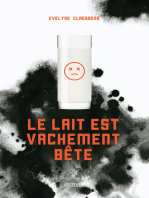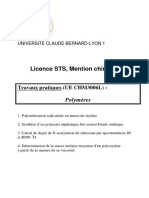Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Additifs Alimentaires
Additifs Alimentaires
Transféré par
Abdessamad LabouidiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Additifs Alimentaires
Additifs Alimentaires
Transféré par
Abdessamad LabouidiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Additifs et armes alimentaires
Les consommateurs sont de plus en plus exigeants en matire gustative. Ils cherchent des produits bnfiques pour la sant mais aussi des aliments qui ont du got , qui aient une couleur attirante, qui se conservent longtemps... Les consommateurs se dirigent galement vers des produits dpaysants : saveurs exotiques, tex-mex , croles, mditerranennes Ainsi, des armes et des additifs sont fabriqus pour rpondre ces demandes. Ces substances sont ajoutes intentionnellement et en petite quantit un aliment au cours de sa prparation afin dassurer une meilleure conservation ou de compenser la perte de qualits sensorielles. Elles peuvent tre dorigine naturelle (minrale, vgtale ou animale), issues de la transformation de substances naturelles ou obtenues par synthse. Gnralement, les molcules naturelles sont souvent trop fragiles ou trop coteuses pour une production industrielle. Elles laissent donc leur place aux produits de synthse.
1 Un peu dhistoire
Les additifs alimentaires ont trs tt t utiliss pour la conservation dune nourriture souvent rare et difficile acqurir. Ainsi, on peut citer le cas du sel utilis ds la plus haute antiquit afin dassurer la conservation de la viande. En Egypte, les colorants et les pices ont trs vite t utiliss pour amliorer laspect de certains mets. Les plantes aromatiques sont utilises dans lalimentation, mais elles sont aussi employes comme remdes ou brles lors des crmonies religieuses. Lhistoire des aromates et des armes est indissociable de celle de la parfumerie, car une plante aromatique peut tout aussi bien servir aromatiser un aliment qu parfumer un produit destin la toilette. Aujourdhui, lindustrie agroalimentaire a largement recours aux armes et additifs alimentaires.
2 Les additifs alimentaires
2.1 Intrt des additifs
Les additifs alimentaires sont intgrs aux aliments dans des buts prcis : But technologique : ils permettent alors de faciliter la fabrication de laliment But sanitaire : ils assurent la conservation des produits But organoleptique : ils maintiennent ou amliorent les qualits sensorielles (consistance, texture, couleur, got) de laliment But nutritionnel : les additifs ont alors pour objectif de confrer de nouvelles valeurs nutritives laliment
2.2 Origines des additifs
Les additifs alimentaires ont des origines varies. Ils peuvent tre dorigine naturelle : dans ce cas, ils sont extraits de vgtaux au moyen de solvants chimiques. Cest le cas de certaines substances issues de graines de plantes ou darbres, dalgues ou de fruits. On peut ainsi citer le cas de la chlorophylle. Les additifs peuvent galement provenir de la modification chimique de ces produits naturels : lextrait naturel est modifi chimiquement pour amliorer ses proprits. Cest le cas des mulsifiants produits partir des huiles vgtales, ou des dulcorants issus des fruits. Lorsque lextraction des substances naturelles est coteuse, ces dernires peuvent tre reconstitues par synthse chimique. Les additifs ainsi fabriqus sont identiques aux substances naturelles. On peut citer lexemple de lacide ascorbique que lon trouve dans les fruits sous la forme de la vitamine C. Enfin, la dernire catgorie dadditifs est celle des additifs synthtiques : ils sont entirement artificiels et obtenus par synthse chimique.
2.3 Les diffrents additifs utiliss
Il est possible de regrouper les additifs en fonction de leurs actions sur les aliments : Action sur la couleur : cest le rle des colorants
Les colorants ont pour but d'amliorer l'aspect des aliments. Ils permettent de pallier une perte de coloration survenue pendant la production, de colorer des aliments incolores et de renforcer une ide gustative spcifique (comme dans la confiserie, le vert ou le jaune pour le got citron...). Ils compensent galement les variations saisonnires : par exemple, le beurre n'est jaune qu'en t, alors qu'en hiver, il est jug trop ple par les industriels qui lui ajoutent un colorant jaune, le -carotne. Il existe des colorants alimentaires synthtiques ou naturels. Les colorants synthtiques ont des avantages sur les colorants naturels car ils ont une dure de vie plus longue, et donnent des couleurs plus intenses, ils sont donc utiliss en plus petite quantit et sont moins onreux que les colorants naturels sensibles la lumire, loxygne ou laction des bactries.
Action sur la conservation : ceci est permis par les conservateurs et les antioxydants.
Les conservateurs, naturels ou chimiques, sont utiliss afin de protger les aliments contre les attaques des micro-organismes et en freiner la dtrioration. Les antioxydants permettent de protger les aliments du rancissement, cest--dire de la dgradation des graisses. Certains oxydants sont naturellement prsents dans les aliments : cest le cas de la
vitamine E de lhuile dolive ou lacide ascorbique du citron par exemple. Afin dallonger la dure de consommation des produits, lindustrie agroalimentaire initialement utiliss ces composs naturels activit antioxydante puis a cherch en synthtiser de nouveaux. Le rancissement consiste en lauto-oxydation des acides gras, constituants de base des graisses. Cette raction a lieu lorsque la lumire coupe les liaisons C-H dun lipide en formant des radicaux libres instables, les C. Ces composs fragiles vont tout faire pour se stabiliser : ainsi, ils ragissent avec loxygne de lair pour former dautres radicaux libres instables, les COO. Ceux-ci ragissent avec dautres liaisons C-H pour crer un nouveau radical C, lequel peut alors propager loxydation, ce qui conduit au rancissement. Les antioxydants utiliss par lindustrie agroalimentaire sont des drivs du phnol. Ces derniers deviennent des radicaux libres stables aprs raction avec les C : la raction de propagation est alors bloque.
Acide carnosique : antioxygne puissant
Action sur la texture : cest le rle des mulsifiants, des glifiants, des paississants, des stabilisants, des correcteurs dacidit Les mulsifiants sont des substances qui permettent dobtenir ou de maintenir un mlange homogne de plusieurs phases non miscibles. Les paississants et les glifiants, gnralement dorigine vgtale, permettent de retenir leau et facilitent le maintien en suspension de particules solides dans les liquides. Action sur le got : grce aux exhausteurs de got, aux dulcorants, aux armes (nentrent pas dans la lgislation des additifs) Les exhausteurs de got sont des substances utilises afin de renforcer la flaveur (sensation gustative et olfactive) originale des aliments. Les dulcorants sont des substances capables dadoucir les aliments, et par extension, des molcules de substitution du saccharose prsentant une saveur sucre. Ainsi, les dulcorants intenses possdent un pouvoir sucrant variant de dizaines quelques milliers de fois celui du sucre ordinaire. Les dulcorants peuvent tre naturels ou de synthse. Certains peuvent driver des sucres, mais la plupart
sont des composs chimiques tout fait diffrents. Ainsi, on trouve beaucoup de peptides forms de deux ou trois acides amins. Dans le cas des dulcorants synthtiques, on peut par exemple citer le cas de laspartame qui apporte un got sucr sans les calories nutritionnelles correspondantes. Ces substances sont lorigine des produits allgs, telles que les boissons gazeuses. Dautres additifs peuvent tre utiliss : on peut citer les humectants (utiliss pour prvenir le desschement de certains aliments, les affermissants, les anti-moussants, les amidons modifis (permettent notamment de stabiliser la viscosit aux hautes et basses tempratures)
3 Les armes
Un arme est un ensemble de composs volatils perus par les organes lorigine du got. Il peut sagir de mlanges trs complexes. Ainsi, on note plus de 300 composs entrants en jeu dans larme de fraise, 250 pour la menthe, et plus de 500 pour le caf Tous ces composs odorants doivent pouvoir passer dune phase liquide en phase gazeuse afin datteindre les rcepteurs la surface des cellules olfactives, dans le nez. Ils doivent galement tre de faible poids molculaire.
3.1 Les armes naturels
3.1.1 Origine
Les armes peuvent tre dorigine vgtale : les aromates (cannelle, vanille, menthe), les fruits, les lgumes, les crales, etc. renferment des armes. On peut galement citer les huiles (essences de citronnelle, lavande) comme sources darmes. Les armes peuvent aussi tre dorigine animale : on en trouve dans les viandes, le lait, les poissons
3.1.2 Analyse des armes
Afin de dterminer tous les composants intervenant dans larme, les chimistes utilisent la technique du Headspace . Cette technique permet daspirer les effluves aromatiques dun produit au moyen dune pompe vide. Ces effluves sont ensuite pigs afin dtre concentres puis analyses. Lanalyse est gnralement effectue par un chromatographe en phase gazeuse coupl un spectromtre de masse. La chromatographie est une technique qui permet de sparer les diffrents constituants dun mlange : les effluves sont dgags des moments diffrents (du fait de leur composition chimique, de leur taille, de leurs proprits physico-chimiques) appels temps de rtention. La dtection de ces molcules est matrialise par des pics. Ensuite, la nature chimique de ces pics est dtermine par un spectromtre de masse : cest un appareil qui permet de dterminer la masse des composs et qui aide dterminer leur formule chimique.
Il est ainsi possible de dterminer l empreinte digitale dun arme. Une fois identifie, les composs volatils lorigine de larme doivent tre rcuprs et donc spars du vgtal dorigine : ceci constitue lextraction.
3.1.3 Extraction des armes
Les produits dorigine naturelle ont la cte auprs des consommateurs. Ainsi, il est intressant dextraire les armes. Lindustrie agroalimentaire utilise diffrentes mthodes dextraction : Lextraction par lentranement la vapeur : cette technique utilise un alambic dans lequel les matires vgtales mlanges leau sont distilles. La vapeur deau entrane les constituants volatils des vgtaux, et, aprs condensation, il est possible disoler les molcules aromatiques.
Lextraction par expression froid : cette mthode est notamment utilise dans le cas des agrumes. Des machines permettent de rompre les sacs olifres qui contiennent les essences de fruits. Lextraction par infusion : cette technique implique la macration des composs naturels dans lalcool.
Dautres techniques peuvent tre utilises selon larme en question.
3.2 Les armes de synthse
On distingue deux classes darmes de synthse : Les armes identiques au naturel : ces composs sont strictement identiques aux constituants des armes trouvs dans la nature. Ils sont produits par voie synthtique partir de produits chimiques issus de produits naturels. La synthse des armes est de plus en plus frquence. Elle consiste en la fabrication artificielle, par voie chimique, de diverses molcules. Ainsi, il est possible de synthtiser la vanilline, composant essentiel de la vanille, partir de clous de girofle.
Les armes artificiels : ce sont des substances aromatisantes fabriques par voie de synthse et qui nexistent pas dans la nature. Cest cette catgorie qui inquite le plus le consommateur.
La synthse artificielle darmes est invitable. En effet, lextraction de produits naturels ne serait pas suffisante pour satisfaire les besoins dun march trs important. De plus, la synthse chimique des armes est souvent moins coteuse que lextraction des substances naturelles. Il faut souligner que, mme si lappellation arme de synthse fait peur au consommateur, un arme naturel nest pas forcment meilleur pour la sant quun arme synthtique Pourtant, une partie de ces additifs a pour but de protger notre sant ! Les conservateurs empchent ainsi les contaminations bactriennes : ils permettent dviter les toxi-infections alimentaires (salmonelles, listeria). Ils vont galement viter la dgradation des vitamines. Le seul vritable risque est celui dallergies ou dintolrances. Des intolrances certains colorants ou conservateurs peuvent galement exister. Mais moins de 1 % des personnes seraient allergiques ou auraient une intolrance ces substances. Les additifs alimentaires sont ainsi priori sans danger. Inutile donc de leur jeter la pierre!
Sources utilises : Science et vie n961, octobre 1997 Casseroles & prouvettes, H.This, Belin Pour la science, 2002 www.palais-decouverte.fr/discip/chimie.arome.htm www.synpa.org
Vous aimerez peut-être aussi
- Histoire Des Additifs AlimentairesDocument5 pagesHistoire Des Additifs AlimentairesBio ecoPas encore d'évaluation
- Réactions de BrunissementsDocument51 pagesRéactions de BrunissementsLobna TaakchatPas encore d'évaluation
- Techno Bât Inp HBDocument265 pagesTechno Bât Inp HBKouadio Kouadio SéverinPas encore d'évaluation
- Correction TD Chimie de Coordination SMC S6 Serie 1 2021-12-18T135818.675Document5 pagesCorrection TD Chimie de Coordination SMC S6 Serie 1 2021-12-18T135818.675Htyiej100% (3)
- ADDITIFS ALIMENTAIRES & AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES: Colorants, Conservateurs Et Stabilisateurs de ColorationDocument40 pagesADDITIFS ALIMENTAIRES & AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES: Colorants, Conservateurs Et Stabilisateurs de ColorationPeti' Pou100% (6)
- TD ADDITFS. Les Colorants Alimentaires M1 (NP) PDFDocument18 pagesTD ADDITFS. Les Colorants Alimentaires M1 (NP) PDFAmirou Baby Mixico0% (1)
- Clasification - 2019-014 PDFDocument61 pagesClasification - 2019-014 PDFAmirou Baby MixicoPas encore d'évaluation
- Chapitre 01 PDFDocument6 pagesChapitre 01 PDFNadjmo Ben Messaoud100% (1)
- Altérations Alimentaires 1Document9 pagesAltérations Alimentaires 1phoenix021100% (3)
- Maison Rustique Du XIXe Siècle Tome 1Document536 pagesMaison Rustique Du XIXe Siècle Tome 1cain3923100% (2)
- Bored Tunnelling in The Urban Environment, Theme Lecture by Mair & TaylorDocument33 pagesBored Tunnelling in The Urban Environment, Theme Lecture by Mair & Taylorsandip0002Pas encore d'évaluation
- Les Additifs AlimentairesDocument12 pagesLes Additifs AlimentairesJad Haydar Mohamed BouanguaPas encore d'évaluation
- Les Additifs AlimentairesDocument70 pagesLes Additifs AlimentairesAnass DraPas encore d'évaluation
- Additifs AlimentairesDocument6 pagesAdditifs AlimentairesRajae RajouaPas encore d'évaluation
- Additif AlimentaireDocument13 pagesAdditif Alimentaireyamna100% (1)
- Additifs AlimentairesDocument29 pagesAdditifs AlimentairesAmirou Baby Mixico100% (1)
- Les Additifs Alimentaires 1 PDFDocument8 pagesLes Additifs Alimentaires 1 PDFAmirou Baby MixicoPas encore d'évaluation
- Les Additifs AlimentairesDocument25 pagesLes Additifs AlimentairesChaoukiMatimatic100% (1)
- Frély Rachel - Guide Des Additifs Alimentaires Inoffensif Ou DangereuxDocument46 pagesFrély Rachel - Guide Des Additifs Alimentaires Inoffensif Ou DangereuxNatalia Rosa100% (1)
- Les Additifs AlimentairesDocument3 pagesLes Additifs AlimentairesجعدبندرهمPas encore d'évaluation
- Les AdditifsDocument45 pagesLes AdditifsSlimane Louzir100% (1)
- Additife TarekDocument22 pagesAdditife TarekSunchine Tarek100% (1)
- Additifs Alimentaires PDFDocument24 pagesAdditifs Alimentaires PDFLouiza DjerdjarPas encore d'évaluation
- Additifs AlimentairesDocument56 pagesAdditifs AlimentairesI. Ez100% (3)
- Présentation Additifs Alimentaires PDFDocument19 pagesPrésentation Additifs Alimentaires PDFSidah Bensefia100% (1)
- Les Additifs AlimentaireDocument14 pagesLes Additifs Alimentairehoriya100% (2)
- La Recherche Des Additifs Alimentaires Dans Les Boissons Non AlcooliseesDocument54 pagesLa Recherche Des Additifs Alimentaires Dans Les Boissons Non AlcooliseesYassir El Aouadi100% (4)
- Additifs Alimentaires - DangerDocument42 pagesAdditifs Alimentaires - Dangersara50% (2)
- Additifs Alimentaires Theme de Soutenance..Document24 pagesAdditifs Alimentaires Theme de Soutenance..JoëlPas encore d'évaluation
- BIOCHIMIE Alimentaire TSDocument51 pagesBIOCHIMIE Alimentaire TSAbdelhakim MhdaouiPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage-Candia Apres EntretienDocument81 pagesRapport de Stage-Candia Apres EntretienAiicHa Azzamouk100% (2)
- Additifs Alimentaires IT3 IAA 19 V 04 - ESA PDFDocument41 pagesAdditifs Alimentaires IT3 IAA 19 V 04 - ESA PDFSerge Kouassi100% (1)
- Cours Additifs Alimentaires Et Auxiliaires PDFDocument33 pagesCours Additifs Alimentaires Et Auxiliaires PDFOusmane MBENGUE100% (2)
- Chimie - Les Corps GrasDocument11 pagesChimie - Les Corps GrasVirginie Cabrol0% (1)
- Additifs AlimentairesDocument11 pagesAdditifs AlimentairesHanson FelixPas encore d'évaluation
- Le LaitDocument11 pagesLe LaitMaria Bobeica100% (1)
- Systemes Alim Chap. 2 Proprietes Sensorielles Aliments 2021Document131 pagesSystemes Alim Chap. 2 Proprietes Sensorielles Aliments 2021HorizonHooves DdkPas encore d'évaluation
- Analyse Des Protéines, Minéraux, VitDocument11 pagesAnalyse Des Protéines, Minéraux, VitMLAN HesnaPas encore d'évaluation
- annexe1MINISTERECOMMERCE Algérie Additifs FRDocument24 pagesannexe1MINISTERECOMMERCE Algérie Additifs FRYacine BoumetlouaPas encore d'évaluation
- Additifs Alimentaires ToxiquesDocument20 pagesAdditifs Alimentaires ToxiquesabdenourPas encore d'évaluation
- Les Acides OrganiquesDocument45 pagesLes Acides OrganiquesNUTRI ADVANCE100% (8)
- 1 Objectifs-Des-Biotechnologies-VégétalesDocument18 pages1 Objectifs-Des-Biotechnologies-VégétaleshenniPas encore d'évaluation
- Lait SuiteDocument45 pagesLait Suitebio-nettePas encore d'évaluation
- Additifs Alimentaires 2020 Complet PDFDocument94 pagesAdditifs Alimentaires 2020 Complet PDFAyonne Gerald Mekilick67% (3)
- Extraction de Gélatine À Partir Des Pattes de Vollaille Exemple Les PouletsDocument97 pagesExtraction de Gélatine À Partir Des Pattes de Vollaille Exemple Les PouletsKenza SahelPas encore d'évaluation
- Appréciation de Stabilité Du Lait UHT (Candia) À 37°C Et À 55°C PDFDocument60 pagesAppréciation de Stabilité Du Lait UHT (Candia) À 37°C Et À 55°C PDFOlfa Ben Moussa100% (1)
- Pfe 14 55Document47 pagesPfe 14 55amal meddachPas encore d'évaluation
- Support Cours Laiterie Seq 1 2021Document77 pagesSupport Cours Laiterie Seq 1 2021Hana MallekPas encore d'évaluation
- Les Colloides AlimentairesDocument6 pagesLes Colloides Alimentairesmesmail_8100% (1)
- Contrôle Microbiologique Du Lait Cru Et Lait Pasteurisé de L'unité de ZELFANADocument43 pagesContrôle Microbiologique Du Lait Cru Et Lait Pasteurisé de L'unité de ZELFANAAbdenour SenoussiPas encore d'évaluation
- Teneur en Eau Dans Les Fruits Secs PDFDocument39 pagesTeneur en Eau Dans Les Fruits Secs PDFkokoPas encore d'évaluation
- Lait Et dérivésDocument69 pagesLait Et dérivésbio-nette100% (2)
- Fiche 35 Le Point Sur Les ConfituresDocument3 pagesFiche 35 Le Point Sur Les ConfitureslayesaxoPas encore d'évaluation
- Les Principales Réactions Chimiques de Dégradation Des AlimentsDocument65 pagesLes Principales Réactions Chimiques de Dégradation Des Alimentsderbo100% (2)
- Résumé LaitDocument26 pagesRésumé LaitMidouri Djaffer0% (2)
- 10 SA-boissonsDocument30 pages10 SA-boissonsClaire du Pacifique100% (2)
- TD N°2 Oxydation Des LipidesDocument5 pagesTD N°2 Oxydation Des LipidesZakariae BennacerPas encore d'évaluation
- Commission du Codex Alimentarius: Manuel de Procédure Vingt-sixième editionD'EverandCommission du Codex Alimentarius: Manuel de Procédure Vingt-sixième editionÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Dictionnaire alimentaire des modes de cuisson et de conservation des aliments sans lactoseD'EverandDictionnaire alimentaire des modes de cuisson et de conservation des aliments sans lactosePas encore d'évaluation
- Bulletin Clarifie: Farsy Sas - Autodistribution - AubagneDocument1 pageBulletin Clarifie: Farsy Sas - Autodistribution - AubagneyoussefkhodaiPas encore d'évaluation
- Zaki Ibrahim PfeDocument32 pagesZaki Ibrahim PfeSimo BounaPas encore d'évaluation
- Avant - en Même Temps - AprèsDocument2 pagesAvant - en Même Temps - Aprèscheikh tidianePas encore d'évaluation
- Principes - Base V3Document3 pagesPrincipes - Base V3thierryPas encore d'évaluation
- Les Chaudiere A Vaporisation SimoDocument2 pagesLes Chaudiere A Vaporisation SimoCHOUKRI KamalPas encore d'évaluation
- Devoir de Synthèse N°1 2022 2023Document4 pagesDevoir de Synthèse N°1 2022 2023Mohamed Hamdene100% (2)
- c2 Les AminesDocument4 pagesc2 Les AminesComan SakoPas encore d'évaluation
- J'Aplic Introduction OkDocument2 pagesJ'Aplic Introduction OkkademPas encore d'évaluation
- Fiche IdentificationDocument4 pagesFiche Identificationsalimcc50% (2)
- 783257.10 - Matriel Dport Adressable MD4LDocument1 page783257.10 - Matriel Dport Adressable MD4Llogetil602Pas encore d'évaluation
- Brochure Off ReformationDocument81 pagesBrochure Off ReformationHuy PhamPas encore d'évaluation
- Cours Réseaux Électriques 02Document9 pagesCours Réseaux Électriques 02Oussama BouachaPas encore d'évaluation
- Fascicule2022 2023Document18 pagesFascicule2022 2023Lucien NegloPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Acoustique Bâtiment - 3IB - 2022Document44 pagesChapitre 2 - Acoustique Bâtiment - 3IB - 2022Imane SabiriPas encore d'évaluation
- Iconographie MédecineDocument2 pagesIconographie MédecineDeniz EmrePas encore d'évaluation
- TP Cdma 1Document3 pagesTP Cdma 1sam samoPas encore d'évaluation
- 96 Celine Voyage Au Bout de La NuitDocument67 pages96 Celine Voyage Au Bout de La NuitKornelia NitaPas encore d'évaluation
- Tp4 Montage Prise de Courant Interphone Gache ElectriqueDocument7 pagesTp4 Montage Prise de Courant Interphone Gache ElectriqueNoMercyPas encore d'évaluation
- AgrumesDocument4 pagesAgrumesNACIRIPas encore d'évaluation
- Bulletin PDFDocument1 pageBulletin PDFMouhamet Lamine AïdaraPas encore d'évaluation
- Vessie Neurologique DR MeyerDocument50 pagesVessie Neurologique DR MeyerDadis BenabouraPas encore d'évaluation
- Acm TP 01Document2 pagesAcm TP 01mezghichePas encore d'évaluation
- Scénario Maléfices - Rendez Vous Avec Une OmbreDocument15 pagesScénario Maléfices - Rendez Vous Avec Une OmbreThierry OdièvrePas encore d'évaluation
- Luxation Gléno-HuméraleDocument3 pagesLuxation Gléno-HuméraleAsmae OuissadenPas encore d'évaluation
- Poster 05 BLS 01 01 FRDocument1 pagePoster 05 BLS 01 01 FRangelologrilloPas encore d'évaluation
- Boules de Can On PDFDocument15 pagesBoules de Can On PDFKenan MAUS (sytael)Pas encore d'évaluation