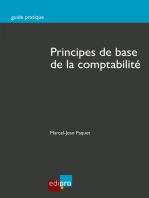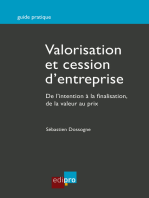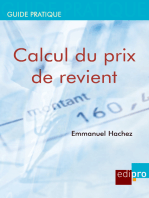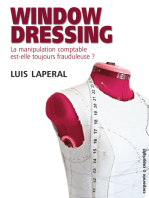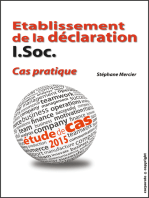Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Feuilletage 130814120353 Phpapp02
Feuilletage 130814120353 Phpapp02
Transféré par
Mariam BouhsinaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vous aimerez peut-être aussi
- Comptabilite de Gestion 7 Ed ManuelDocument497 pagesComptabilite de Gestion 7 Ed ManuelWarren67% (3)
- Les Zooms. Analyse Financière 2014-2015 - 18e Édition by Béatrice GRANDGUILLOT, Francis GRANDGUILLOTDocument242 pagesLes Zooms. Analyse Financière 2014-2015 - 18e Édition by Béatrice GRANDGUILLOT, Francis GRANDGUILLOTAbdoulaye Bakayoko100% (21)
- L - ESSENTIEL DU DIAGNOSTIC FINANCIER Béatrice Rocher-Meunier PDFDocument240 pagesL - ESSENTIEL DU DIAGNOSTIC FINANCIER Béatrice Rocher-Meunier PDFGBOHOU100% (4)
- Cas SL EDocument1 pageCas SL EWarren0% (1)
- Diagnostic FinancierDocument42 pagesDiagnostic FinancierAlpha PILO60% (10)
- Nouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiqueD'EverandNouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiquePas encore d'évaluation
- Gestion financière des PME : théories et pratiques, 2e éditionD'EverandGestion financière des PME : théories et pratiques, 2e éditionÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)
- Projet de Creation D'Une Provenderie Dans La Ville de SangmelimaDocument26 pagesProjet de Creation D'Une Provenderie Dans La Ville de SangmelimaRobert BibongPas encore d'évaluation
- Principes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgeD'EverandPrincipes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgePas encore d'évaluation
- Comptabilité de Gestion VuibertDocument16 pagesComptabilité de Gestion Vuibertmouahi186267% (3)
- Offre ServicesDocument5 pagesOffre ServicesDjim Noubara100% (1)
- Finance D'EntrepriseDocument25 pagesFinance D'EntrepriseKevin Rajohnson33% (3)
- Bilan 2019Document28 pagesBilan 2019Lou Bna IIPas encore d'évaluation
- Valorisation et cession d'entreprise: Opérations de fusions et acquisitions d'entreprisesD'EverandValorisation et cession d'entreprise: Opérations de fusions et acquisitions d'entreprisesPas encore d'évaluation
- La comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreD'EverandLa comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Calcul du prix de revient: Rentabiliser les coûts de production et de distribution pour les chefs d'entreprises belgesD'EverandCalcul du prix de revient: Rentabiliser les coûts de production et de distribution pour les chefs d'entreprises belgesPas encore d'évaluation
- Les tableaux de bord et business plan: Gérer la comptabilité de son entrepriseD'EverandLes tableaux de bord et business plan: Gérer la comptabilité de son entrepriseÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3)
- L Essentiel Du Diagnostic Financier PDFDocument240 pagesL Essentiel Du Diagnostic Financier PDFHassan Younhous Traore Koné100% (3)
- Analyse Financière 2Document62 pagesAnalyse Financière 2Tchoffo Raoul100% (4)
- Exercice Analyse FinancierDocument20 pagesExercice Analyse FinancierHajjej Yasser100% (2)
- Les Risques Liés À L'internationalDocument5 pagesLes Risques Liés À L'internationalChoUbii AliPas encore d'évaluation
- Votre argent Chaque décision compte: Comptabilité pour tousD'EverandVotre argent Chaque décision compte: Comptabilité pour tousPas encore d'évaluation
- La consolidation: Contrôler les comptes d'entreprisesD'EverandLa consolidation: Contrôler les comptes d'entreprisesPas encore d'évaluation
- Le tableau de bord prospectif et les 4 piliers d'une organisation: Quels signaux prendre en compte pour une gestion efficace ?D'EverandLe tableau de bord prospectif et les 4 piliers d'une organisation: Quels signaux prendre en compte pour une gestion efficace ?Pas encore d'évaluation
- Window dressing: La manipulation comptable est-elle toujours frauduleuse ?D'EverandWindow dressing: La manipulation comptable est-elle toujours frauduleuse ?Pas encore d'évaluation
- Comprenez votre comptable: Découvrez les bases de la comptabilité belgeD'EverandComprenez votre comptable: Découvrez les bases de la comptabilité belgePas encore d'évaluation
- Mémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)D'EverandMémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)Pas encore d'évaluation
- Etablissement de la déclaration I.Soc. - Cas pratique: Etude de cas 2015 (Belgique)D'EverandEtablissement de la déclaration I.Soc. - Cas pratique: Etude de cas 2015 (Belgique)Pas encore d'évaluation
- Finance D'entreprise 2Document104 pagesFinance D'entreprise 2alybale100% (2)
- Comptabilité de GestionDocument71 pagesComptabilité de GestionFrancklin Bagui50% (2)
- Comptabilité de GestionDocument128 pagesComptabilité de Gestionissoufou AmadouPas encore d'évaluation
- Finance D'entrepriseDocument92 pagesFinance D'entreprisealybale100% (1)
- Charlotte Disle-DCG 9 - Introduction À La Comptabilité 2015 - 2016 - L'Essentiel en Fiches-Dunod (2015)Document160 pagesCharlotte Disle-DCG 9 - Introduction À La Comptabilité 2015 - 2016 - L'Essentiel en Fiches-Dunod (2015)Anas ElKhallas100% (1)
- Comptabilité Générale PDF WWW - Economie Gestion - Com - PDFDocument228 pagesComptabilité Générale PDF WWW - Economie Gestion - Com - PDFMoussa Coulibaly100% (2)
- Cours Diagnostic Financier PDFDocument37 pagesCours Diagnostic Financier PDFBen TanfousPas encore d'évaluation
- Gestion Comptable Gestion FinanciereDocument53 pagesGestion Comptable Gestion FinancieremouhcinebaPas encore d'évaluation
- Livre INTEC CompletDocument152 pagesLivre INTEC Completxav79Pas encore d'évaluation
- Les Zooms Exercices de Comptabilité de Gestion - 2e Édition by Eric MatonDocument226 pagesLes Zooms Exercices de Comptabilité de Gestion - 2e Édition by Eric Matonamine ghitaPas encore d'évaluation
- FINANCE D'entrepriseDocument40 pagesFINANCE D'entrepriseRoosvelt TalabertPas encore d'évaluation
- DCG 6 - Finance Dentreprise - 5e Éd.Document160 pagesDCG 6 - Finance Dentreprise - 5e Éd.David Pickering100% (3)
- Lessentiel de Lanalyse Financiã Re - 13e édition 2015-2016 by Béatrice GRANDGUILLOT Francis GRANDGUILLOT Z-LiborgDocument138 pagesLessentiel de Lanalyse Financiã Re - 13e édition 2015-2016 by Béatrice GRANDGUILLOT Francis GRANDGUILLOT Z-LiborgManou Lorou100% (2)
- Gestion Financiere Par (WWW - Heights Book - Blogspot.com)Document241 pagesGestion Financiere Par (WWW - Heights Book - Blogspot.com)Najib GzoulyPas encore d'évaluation
- 9782311400489Document14 pages9782311400489lakhdar2821100% (1)
- Les Carrés DSCG 2 Exercices Corrigés Finance - 9782297076920Document20 pagesLes Carrés DSCG 2 Exercices Corrigés Finance - 9782297076920YOZIEU67% (6)
- DCG 6 Finance D'entreprise Annales 2008 Jusqu'Au 2018Document220 pagesDCG 6 Finance D'entreprise Annales 2008 Jusqu'Au 2018Azer Aze100% (6)
- Contrôle de GestionDocument180 pagesContrôle de GestionMarcia WilliamsPas encore d'évaluation
- Finance D'eseDocument20 pagesFinance D'eseMeryam Lou83% (6)
- Guide Etudes Expertise comptable-DUNOD PDFDocument40 pagesGuide Etudes Expertise comptable-DUNOD PDFDorcas Ouattara100% (1)
- L'Analyse FinancièreDocument20 pagesL'Analyse Financièrealaa eddine azzouz100% (1)
- Aide-Mémoire Danalyse Financière - 4e ÉditionDocument260 pagesAide-Mémoire Danalyse Financière - 4e Éditionhakim100% (8)
- Comptabilite de GestionDocument33 pagesComptabilite de Gestionmunib1966100% (3)
- 7954 ControleGestionDocument222 pages7954 ControleGestionussef89100% (6)
- DCG 9 - Introduction À La Comptabilité 2013-2014 en 27 FichesDocument160 pagesDCG 9 - Introduction À La Comptabilité 2013-2014 en 27 Fichesissoufou Amadou100% (1)
- Choix Investissement PDFDocument106 pagesChoix Investissement PDFfascicolaPas encore d'évaluation
- DCG 6 Finance D - EntrepriseDocument326 pagesDCG 6 Finance D - Entreprisehachem100% (3)
- Série 1 FinanceDocument112 pagesSérie 1 FinanceBlessed Son100% (2)
- Analyse Financiere 1Document34 pagesAnalyse Financiere 1ndt100% (1)
- Feuilletage PDFDocument16 pagesFeuilletage PDFouPas encore d'évaluation
- Analyse FinanciereDocument202 pagesAnalyse FinanciereTresor Comptable Ngouana100% (1)
- Aspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleD'EverandAspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Cours 3 Et 4 PDFDocument40 pagesCours 3 Et 4 PDFChoUbii Ali100% (1)
- Geopolitique PDFDocument93 pagesGeopolitique PDFChoUbii Ali100% (1)
- Ob - 472c1b - CM Droit Du Commerce International PDFDocument23 pagesOb - 472c1b - CM Droit Du Commerce International PDFChoUbii Ali100% (2)
- Dans Le Secteur Des Transports MaritimesDocument3 pagesDans Le Secteur Des Transports MaritimesChoUbii AliPas encore d'évaluation
- Matières À Préparer Pour CCA. SEBKIDocument6 pagesMatières À Préparer Pour CCA. SEBKISalah-Eddine TourabiPas encore d'évaluation
- Partiel 2022-2023 (Corrigé 1)Document6 pagesPartiel 2022-2023 (Corrigé 1)Tess OpoczynskiPas encore d'évaluation
- CH 7 - La FacturationDocument10 pagesCH 7 - La FacturationAyoub Fakir100% (2)
- Programme Cours Eco 2018 2019Document122 pagesProgramme Cours Eco 2018 2019Yves BrasseleurPas encore d'évaluation
- Cours de Service Social Des Entreprises en Dev...Document34 pagesCours de Service Social Des Entreprises en Dev...Mbiya Mwanza Sinclair100% (1)
- Série #5 Et 6 Comptabilité ApprofondieDocument3 pagesSérie #5 Et 6 Comptabilité ApprofondieSami MilianiPas encore d'évaluation
- 1er Constat:: CNC: Les Charges Et Produits Hors Exploitation Et 75/78Document5 pages1er Constat:: CNC: Les Charges Et Produits Hors Exploitation Et 75/78layanePas encore d'évaluation
- 022+Questions+Et+Réponses ++Le+Contentieux+FiscalDocument136 pages022+Questions+Et+Réponses ++Le+Contentieux+Fiscalمحمد بن الجيلاليPas encore d'évaluation
- Memoire de BTSDocument38 pagesMemoire de BTSEzechiel Koumako100% (1)
- CA TD N°3 Inconvénients CG Et Avantages CADocument1 pageCA TD N°3 Inconvénients CG Et Avantages CASara GriguerPas encore d'évaluation
- Seance 1Document21 pagesSeance 1عبداللهبنزنوPas encore d'évaluation
- Exercice de Comptabilit2e Generale Itecom l2Document3 pagesExercice de Comptabilit2e Generale Itecom l2abdourahmane diengPas encore d'évaluation
- Responsable Administratif Et FinancierDocument3 pagesResponsable Administratif Et FinancierAnge Yohan Desvallees Ndri100% (1)
- Tarifs Et Scolarités 2019 2020Document3 pagesTarifs Et Scolarités 2019 2020Ta Gamïne TëtuëPas encore d'évaluation
- TD N°1 Bilan - ÉléveDocument2 pagesTD N°1 Bilan - ÉléveMeriam AkhroufPas encore d'évaluation
- Bilan Comptable (Cours + Exercices)Document18 pagesBilan Comptable (Cours + Exercices)charmarkeh fanasaraPas encore d'évaluation
- Cas CoutsDocument2 pagesCas CoutsHamid TalaiPas encore d'évaluation
- 06 Aout 2021Document3 pages06 Aout 2021Ahmed TAMOUPas encore d'évaluation
- Fiche-Produit ManufacturingDocument20 pagesFiche-Produit ManufacturingmohamedPas encore d'évaluation
- Directive #06 97 CM UEMOADocument23 pagesDirective #06 97 CM UEMOAmaxuya2001Pas encore d'évaluation
- Cours Audit Financier-M1Fin-M Adlouni 2Document62 pagesCours Audit Financier-M1Fin-M Adlouni 2Ama BenPas encore d'évaluation
- Etude de Cas n4 Corrigé PDFDocument7 pagesEtude de Cas n4 Corrigé PDFImane Megzari100% (1)
- AVIS CPS Inventaire Immobilisation '2022 30.01.2023Document18 pagesAVIS CPS Inventaire Immobilisation '2022 30.01.2023Moulay RachidPas encore d'évaluation
- Calculer Le Fonds de Roulement Net Global (FRNG)Document3 pagesCalculer Le Fonds de Roulement Net Global (FRNG)Dieudonné GBEMENOUPas encore d'évaluation
- Cours de Bureau Comptable Et Fiscal - 081411Document61 pagesCours de Bureau Comptable Et Fiscal - 081411YEBOU jeremiePas encore d'évaluation
- CV ComptableDocument2 pagesCV ComptableSteve IriePas encore d'évaluation
- 21DSCG-UE4 CorrigeDocument15 pages21DSCG-UE4 CorrigegilleratPas encore d'évaluation
Feuilletage 130814120353 Phpapp02
Feuilletage 130814120353 Phpapp02
Transféré par
Mariam BouhsinaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Feuilletage 130814120353 Phpapp02
Feuilletage 130814120353 Phpapp02
Transféré par
Mariam BouhsinaDroits d'auteur :
Formats disponibles
www.dunod.
com
Georges Legros
Diplm expert-
comptable, il est
professeur de nance
et enseigne lESG,
au CNAM-INTEC
et lIPESUP.
Public :
L1/L2
conomie-
gestion, IUT
coles de
commerce
M
i
n
i
M
a
n
u
e
l
d
e
F
i
n
a
n
c
e
d
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
G
.
L
E
G
R
O
S
MINI MANUEL
Comment aller lessentiel, comprendre les
mthodes et les dmarches avant de les mettre
en application ?
Conus pour faciliter aussi bien lapprentissage que
la rvision, les Mini Manuels proposent un cours
concis et richement illustr pour vous accompagner
jusqu lexamen. Des exemples, des mises en
gardes et des mthodes pour viter les piges
et connatre les astuces, enn des exercices tous
corrigs compltent les cours.
Ce Mini Manuel de Finance dentreprise prsente
lessentiel savoir, comprendre et matriser pour
tout tudiant en cole de commerce ou en 1
er
cycle
universitaire dconomie et de gestion.
Aperu du contenu :
La construction de linformation comptable
Lanalyse du compte de rsultat
Lanalyse du bilan
Lanalyse des ux nanciers
La stratgie dinvestissement
La politique de nancement
Le fonds de roulement normatif
Mini Manuel
de Finance dentreprise
Georges LEGROS
Finance
dentreprise
Georges Legros
Analyse
nancire
Stratgie
nancire
C
o
u
r
s
+
E
x
o
s
de
manuel
m
i
n
i
6690507
ISBN 978-2-10-054736-4
Partie 1
Lanalyse financire
1 La construction de linformation comptable 3
1.1 Le circuit financier interne lentreprise : les flux 3
1.2 La transcription des flux : linformation comptable 5
1.3 Lanalyse de linformation comptable 8
Points clefs 9
Exercices 9
Solutions 11
2 Analyse de lexploitation : le compte de rsultat 15
2.1 Les soldes intermdiaires de gestion (SIG) 15
2.2 lments danalyse du compte de rsultat 22
2.3 Les principaux ratios issus du compte de rsultat 28
Points clefs 28
Exercices 29
Solutions 32
3 Analyse du bilan 39
3.1 Prsentation succincte du bilan 39
3.2 Lanalyse fonctionnelle du bilan 40
Points clefs 63
Exercices 64
Solutions 70
Table des matires
9782100547364-legros-tdm.qxd 7/04/10 9:59 Page III
4 Analyse des flux financiers 79
4.1 Les diffrents outils de lanalyse des flux financiers 79
4.2 Analyse des flux de financement 80
4.3 Analyse des flux de trsorerie 90
Points clefs 96
Exercices 97
Solutions 111
Partie 2
La gestion financire
5 La stratgie dinvestissement 127
5.1 Lanalyse des investissements 127
5.2 Les critres de choix des investissements 137
Points clefs 144
Exercices 144
Solutions 153
6 La politique de financement 163
6.1 Les moyens de financement des investissements 163
6.2 Le choix des modes de financement 170
6.3 Le plan de financement 176
Points clefs 181
Exercices 181
Solutions 191
7 Le fonds de roulement normatif 207
7.1 Objectifs et dfinitions 207
7.2 Les ratios dcoulement 209
7.3 Les ratios de structure 209
Points clefs 209
Exercice 210
Solution 212
Index 215
IV Table des matires
9782100547364-legros-tdm.qxd 7/04/10 9:59 Page IV
La page dentre de chapitre
Elle donne le plan du cours,
ainsi quun rappel des objectifs
pdagogiques du chapitre.
Le cours
Le cours, concis et structur,
expose les notions importantes
du programme.
Les rubriques
Une erreur viter
Un peu de mthode
Les points clefs retenir
Les exercices
Ils sont proposs en fin de chapitre,
avec leur solution, pour se tester tout
au long de lanne.
Comment utiliser le Mini Manuel ?
9782100547364-legros-tdm.qxd 7/04/10 9:59 Page V
La construction de linformation comptable .......... 3
Analyse de lexploitation : le compte de rsultat ...15
Analyse du bilan ........................................................... 39
Analyse des flux financiers ........................................ 79
1
P
A
R
T
I
E
Lanalyse
financire
Lanalyse financire est une faon de transcrire la ralit conomique
de lentreprise en un langage universel permettant le dveloppement
doutils de suivi de lactivit.
Pour matriser ces outils, il importe de dfinir certains des concepts sur
lesquels se basent les techniques financires.
En partant de lactivit conomique pour aller vers les outils de la finan-
ce dentreprise, on peut distinguer trois tapes principales : la dcom-
position des flux dans lentreprise, la transcription de ces flux dans les
documents comptables et lanalyse de ces flux.
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
9782100547364-legros-part1.qxd 7/04/10 9:29 Page 1
Le bilan est un document de synthse qui dcrit un moment donn la
situation de lentreprise dans une approche de stock. Il sapparente une
photographie de lentreprise un instant donn et rend compte de la pro-
venance des ressources (passif) et de leur affectation (actif). Par dfini-
tion, les emplois et ressources ne peuvent qutre quilibrs.
3.1 PRSENTATION SUCCINCTE DU BILAN
a) Lactif
Lactif du bilan reprsente lensemble des biens et des droits constituant
le patrimoine de lentreprise. Il est compos de lactif immobilis
(emplois durables dans lentreprise) et de lactif circulant (lments qui
ne font que transiter dans lentreprise et qui se renouvellent) auxquels on
ajoutera les comptes de rgularisation.
Au sein des actifs immobiliss, on distingue les immobilisations incor-
porelles (marques, brevets, fonds de commerce), corporelles (terrain,
3
C
H
A
P
I
T
R
E
Analyse du bilan
3.1 Prsentation succincte du bilan
3.2 Lanalyse fonctionnelle du bilan
P
L
A
N
Comprendre lapproche stock inhrente au bilan.
Apprcier la provenance des ressources (le passif ).
Comprendre laffectation des ressources (lactif ).
O
B
J
E
C
T
I
F
S
9782100547364-legros-C03.qxd 7/04/10 9:16 Page 39
machines, btiments) et les immobilisations financires (titres dtenus
sur une autre entreprise par exemple).
Parmi lactif circulant, signalons dune part lexistence dactifs tem-
poraires (stocks, crances clients) et dautre part la prsence de place-
ments financiers et largent disponible.
Les biens sont inscrits lactif du bilan pour leur valeur dorigine. Les
immobilisations sont ainsi comptabilises pour leur cot dachat ou de
production, les stocks pour leur cot de production ou dachat, les cran-
ces sur les clients pour leur valeur facture. Cependant, pour donner une
image fidle du patrimoine de lentreprise, la comptabilit prvoit
dvaluer la dprciation de ces actifs en amortissant dans le temps les
immobilisations et en dprciant ventuellement les montants des cran-
ces ou des stocks.
Actif net = Actif brut amortissements cumuls et dprciations
La prsentation de lactif du bilan est donc organise selon le schma
suivant.
40 Chapitre 3 Analyse du bilan
Anne N Anne N1
Brut Amortissements Net Net
/ dprciations anne N anne N1
Actif immobilis
Actif circulant
Comtes de rgularisation
TOTAL ACTIF
b) Le passif
Le passif du bilan reprsente lensemble des ressources la disposition
des entreprises. Il est compos des capitaux propres (capital social,
rserves et rsultat), des provisions pour risques et charges (destines
couvrir un risque probable mais non certain), des dettes classes sui-
vant leur origine (financire, fournisseurs...) ainsi que des comptes de
rgularisation passif (produits constats davance, carts de conversion
passif).
3.2 LANALYSE FONCTIONNELLE DU BILAN
Pour analyser le bilan dune entreprise lanalyse fonctionnelle vise
tudier la structure financire de lentreprise en distinguant les
9782100547364-legros-C03.qxd 7/04/10 9:16 Page 40
oprations selon le cycle auquel elles sont rattaches (exploitation, finan-
cement ou investissement). Son objectif est de porter un jugement sur la
solidit financire de lentreprise, dans une optique de continuation de
lactivit. Dans cette approche, le bilan est donc analys en fonction des
cycles de lentreprise.
a) Prsentation et construction du bilan fonctionnel
Lapproche fonctionnelle est la plus utilise dans la mesure o elle adop-
te une perspective de poursuite de lexploitation et offre un clairage per-
tinent sur les quilibres financiers fondamentaux de lentreprise.
Principes et structure du bilan fonctionnel
Le bilan fonctionnel repose sur une approche conomique des flux de
ressources et demplois accumuls par lentreprise, en retenant deux
principes gnraux : lvaluation la valeur dorigine et le classement
des emplois et ressources selon leur nature ou leur destination.
valuation la valeur dorigine
Les flux de ressources proviennent concrtement des ventes et autres
produits encaissables, des apports en capital, des subventions dinvestis-
sement, des emprunts ou encore des dettes fournisseurs, fiscales et socia-
les. Elles ont pour effet daugmenter la trsorerie disponible. Cest en
prlevant sur cette trsorerie que lentreprise finance les emplois. Parmi
les emplois, nous retrouvons par exemple les charges dcaissables, les
acquisitions dimmobilisations, les remboursements demprunts, les
stocks ou les crances clients. Le bilan fonctionnel prsente le cumul de
ces flux de ressources et demplois changs depuis la cration de len-
treprise.
Pour rendre compte de ces changes, le premier principe qui prside la
construction du bilan fonctionnel est lvaluation la valeur dorigine
des flux de ressources et demplois.
Classement en trois cycles
Dans cette perspective conomique, le bilan fonctionnel prend en consi-
dration la place des emplois et des ressources de lentreprise dans le
fonctionnement de lentreprise. Il distingue ainsi :
les oprations qui ont un effet court terme, cest--dire celles qui rel-
vent du cycle de production ou dexploitation (achat, production, vente) ;
les oprations qui engagent lentreprise plus dun an savoir linves-
tissement (acquisitions, cessions et crations dimmobilisations) et le
financement (oprations visant procurer des capitaux lentreprise).
3.2 Lanalyse fonctionnelle du bilan 41
L
a
n
a
l
y
s
e
f
i
n
a
n
c
i
r
e
1
9782100547364-legros-C03.qxd 7/04/10 9:16 Page 41
Le second principe prendre en compte pour laborer un bilan fonc-
tionnel est donc le classement des emplois et des ressources en trois
cycles : investissement, financement, exploitation.
Le cycle de trsorerie opre lajustement entre le cycle dexploitation et
les cycles dinvestissement et de financement.
Prsentation synthtique du bilan fonctionnel
Lactif et le passif du bilan fonctionnel sont spars en deux grandes
masses : la partie stable (long terme) et la partie circulante (court terme)
dont les lments se renouvellent au fur et mesure de la vie de lentre-
prise. La logique danalyse du bilan fonctionnel considre que les res-
sources stables doivent financer au minimum les emplois stables ( haut
de bilan ), puis que les ressources stables excdentaires et les ressour-
ces circulantes financent les emplois circulants (cycle dexploitation,
bas de bilan ).
Pour ce faire, lanalyse fonctionnelle classe les lments du bilan (actif et passif )
selon leur nature ou leur destination.
Plus prcisment, on retrouve lactif :
les emplois stables qui rsultent des dcisions dinvestissement et
correspondent lactif immobilis brut ;
lactif circulant qui rsulte du cycle dexploitation et correspond au
montant brut des stocks, crances et disponibilits. Cette masse peut
tre spare entre une partie exploitation, une partie hors exploitation
et la trsorerie active.
Le passif est lui compos :
des ressources stables qui rsultent des dcisions de financement et
comprennent les capitaux propres, les amortissements, provisions et
dprciations, les dettes financires. Les amortissements et dprcia-
tions sont assimils des ressources de financement. car ils rendent
compte dune dprciation de lactif permettant den assurer le renou-
vellement ;
des dettes circulantes qui rsultent du cycle dexploitation et com-
prennent les dettes du passif qui ne sont pas financires (dettes four-
nisseurs, dettes diverses...). Comme pour lactif, cette masse peut tre
spare entre une partie exploitation, une partie hors exploitation et la
trsorerie passive.
42 Chapitre 3 Analyse du bilan
9782100547364-legros-C03.qxd 7/04/10 9:16 Page 42
b) Dtails des retraitements et reclassements
La construction du bilan fonctionnel se ralise partir du bilan compta-
ble de type PCG en oprant des reclassements et retraitements au sein
du bilan mais galement dlments hors bilan.
Ces retraitements et reclassements dcoulent prcisment des deux prin-
cipes de lapproche fonctionnelle que nous avons voqus prcdem-
ment : lvaluation la valeur dorigine et le classement selon les trois
cycles.
Les consquences de lvaluation la valeur dorigine
De manire gnrale, il sagit dvaluer les diffrents lments de lactif
du bilan leur valeur brute dorigine. Cette exigence implique des
3.2 Lanalyse fonctionnelle du bilan 43
L
a
n
a
l
y
s
e
f
i
n
a
n
c
i
r
e
1
Actif Passif
Emplois stables Ressources stables
Actif immobilis brut Capitaux propres
Charges rpartir
Provisions pour risques et charges
Primes de remboursement Amortissements et dprciations
des obligations
Dettes financires stables
Actif circulant Dettes circulantes
Actif circulant dexploitation Dettes dexploitation
Stocks bruts Avances et acomptes reus
Avances et acomptes bruts Dettes fournisseurs
Crances clients brutes Dettes fiscales et sociales
Crances fiscales Produits constats davance
Charges constates davance
Actif circulant hors exploitation Dettes hors exploitation
Crances diverses Dettes diverses
Intrts courus Intrts courus
Crances dIS Dettes dIS
Crances sur immobilisations Dettes sur immobilisation
Trsorerie active Trsorerie passive
Disponibilits et assimils Concours bancaires courants
Soldes crditeurs de banque
9782100547364-legros-C03.qxd 7/04/10 9:16 Page 43
reclassements et retraitements au sein du bilan mais galement pour cer-
tains lments hors bilan, tels que les effets escompts non chus.
Au sein du bilan
Le capital souscrit non appel (CSNA, compte 109)
De manire gnrale, tant que ces sommes nont pas t libres, elles ne repr-
sentent pas une ressource pour financer un emploi. Ce poste sera donc limin de
lactif et soustrait des capitaux propres pour le mme montant.
Les carts de conversion actifs et passifs (ECA et ECP, comptes
476 et 477)
Un cart de conversion actif est le constat dune perte de change latente
(dprciation dune crance ou apprciation dune dette). Un cart de
conversion passif est le constat dun gain de change latent (apprciation
dune crance ou dprciation dune dette). Pour rendre pertinente au
plan conomique lanalyse des emplois et ressources en respectant le
principe de la valeur dorigine, les carts de conversion sont donc limi-
ns et rintgrs dans les postes correspondants (dettes fournisseurs ou
crances clients le plus souvent). Les carts de conversion actif relatifs
des crances clients seront ainsi ajouts aux crances clients tandis que
les carts de conversion actif relatifs des dettes fournisseurs seront
soustraits des dettes fournisseurs.
lments hors bilan
Les effets escompts non chus (EENE)
Pratiquement et juridiquement, lentreprise reste responsable du paiement des
effets escompts non chus en cas de dfaillance du dbiteur. Les EENE peuvent
tre assimils un crdit bancaire. Ils doivent donc tre rintgrs dans le bilan,
au passif au niveau des concours bancaires courants et lactif dans la partie cir-
culante dexploitation avec les crances clients.
Les consquences du classement cyclique
Au sein du bilan
Les charges rpartir sur plusieurs exercices (CAR, compte 481)
Le montant lev confre un caractre dinvestissement aux charges
rpartir sur plusieurs exercices qui ont une incidence sur lavenir de len-
treprise. Elles doivent donc tre reclasses en emplois stables. Le mon-
tant figurant lactif du bilan PCG (dans les comptes de rgularisation)
est le montant net.
44 Chapitre 3 Analyse du bilan
9782100547364-legros-C03.qxd 7/04/10 9:16 Page 44
Les primes de remboursement des obligations (PRO, compte 169)
De manire gnrale, ces primes (figurant initialement lactif) sont
considres comme des non valeurs. Elles sont donc retires de lactif et
soustraites du montant des emprunts obligataires au passif (ressources
stables).
Les amortissements et dprciations
Les amortissements et dprciations reprsentent des capitaux pargns pour
financer le renouvellement des immobilisations ou de possibles dprciations.
ce titre ils constituent des ressources de financement. Ils sont donc limins de
lactif (lactif immobilis et circulant tant pris en compte pour sa valeur brute) et
ajouts aux ressources stables du passif (avec les provisions pour risques et char-
ges).
Les comptes courants dassocis crditeurs (C/C, compte 455)
Si les C/C reprsentent des fonds bloqus dans lentreprise, ils seront rat-
tachs aux dettes financires stables.
Dans le cas de dpts temporaires, les C/C seront assimils des dettes
hors exploitation.
Les intrts courus non chus sur emprunts (ICNE, compte 1688)
Les ICNE doivent tre passs du long terme au court terme hors exploitation,
quils concernent des crances (immobilisations) ou des dettes (emprunts). Ils
sont donc retranchs des dettes financires et ajouts aux dettes hors exploita-
tion (pour les intrts courus sur emprunts) ou retranchs des immobilisations
financires et ajouts aux crances hors exploitation (pour les intrts sur cran-
ces immobilises).
Les comptes bancaires courants et soldes crditeurs de banque
(CBC, compte 519)
Ils ne constituent pas une ressource stable et doivent donc tre retirs des
dettes financires pour tre replacs dans la trsorerie passive.
Les charges et produits constats davance
En labsence dinformation spcifique, il est courant de considrer quils
relvent de lexploitation et donc de les classer dans lactif circulant
dexploitation (CCA) ou dans les dettes dexploitation (PCA).
Les valeurs mobilires de placement
Selon leur nature, elles seront considres comme un lment de lactif
hors exploitation (en cas de risque de perte, par exemple des actions, ou
3.2 Lanalyse fonctionnelle du bilan 45
L
a
n
a
l
y
s
e
f
i
n
a
n
c
i
r
e
1
9782100547364-legros-C03.qxd 7/04/10 9:16 Page 45
Formule mathmatique dveloppe de leffet de levier
RF = RE + (RE t) D/C
RF = rentabilit financire (rsultat net/capitaux propres)
RE = rentabilit conomique (rsultat dexploitation/capitaux propres + dettes
fnancires)
t = cot de lendettement (peut tre calcul grce au ratio frais financiers/dettes
financires)
D : dettes financires
C : capitaux propres
Ce phnomne prend le nom deffet de levier de la dette. Il se pro-
duit si le cot de lendettement t est infrieur au taux de rentabilit co-
nomique RE. Dans ce cas, leffet levier sera dautant plus important
que :
le diffrentiel entre le taux de rentabilit conomique et le cot de len-
dettement sera grand ;
le bras de levier D/C sera lev.
Lanalyse de leffet de levier permet de comprendre les effets sur la ren-
tabilit financire de loutil industriel et commercial (taux de rentabilit
conomique) et de la stratgie financire (endettement et bras de levier).
Lorsque le cot de la dette t est suprieur aux taux de rentabilit cono-
mique RE, on constate quun surcrot dendettement dgrade la rentabi-
lit financire de lentreprise. On parle dans ce cas deffet de massue de
la dette.
g) Tableau de synthse :
les principaux ratios issus du bilan
pour dcrire la structure financire de lentreprise
Ce tableau nest pas limitatif. Dautres ratios peuvent tre crs en met-
tant en rapport deux lments du compte de rsultat ou un lment du
compte de rsultat une autre donne comptable ou financire.
62 Chapitre 3 Analyse du bilan
9782100547364-legros-C03.qxd 7/04/10 9:16 Page 62
Points clefs 63
L
a
n
a
l
y
s
e
f
i
n
a
n
c
i
r
e
1
Nature du ratio Mode de calcul Interprtation
BFRE/chiffres daffaires hors taxes Poids du BFRE
(Stocks moyens/cot annuel Temps de stockage
des achats ou de la production) ou ratio de rotation
Analyse du BFR
360 des stocks
(Moyenne des crances clients/ Dlai de rotation
ventes annuelle TTC) 360 des clients
(Dettes fournisseurs/achats et Dlai de rotation
services extrieurs TTC) 360 des fournisseurs
Actifs moins dun an Ratio de liquidit
/passifs moins dun an gnrale
Analyse Actifs moins dun an hors stocks Ratio de liquidit rduite
de lendettement
/passifs moins dun an
Disponibilits + VMP/ Ratio de liquidit
passifs moins dun an immdiate
Dettes financires/ Taux dendettement
capitaux propres (levier financier)
POINTS CLEFS
Leffet de levier financier positif est lamlioration de la rentabilit
financire grce un endettement supplmentaire.
La liquidit dun bien est son aptitude tre transform en moyen de
paiement sans perte de valeur.
La rentabilit est le rapport entre laccroissement de richesse et les
moyens mis en uvre pour lobtenir.
Le fonds de roulement est lexcdent des ressources durables aprs
financement des emplois stables.
9782100547364-legros-C03.qxd 7/04/10 9:16 Page 63
3.1 Mallorca
La socit Mallorca vous demande de mener une tude sur lventuel
effet de levier quelle pourrait retirer dun financement partiel de son
investissement par la dette.
Travail faire :
1) En compltant le tableau propos en annexe vous montrerez lvolu-
tion de la rentabilit financire en fonction des combinaisons retenues et
valuerez leffet de levier.
2) Vous montrerez ce que deviendrait la rentabilit financire si le taux
de rentabilit conomique passait 10 %.
3) Vous montrerez lvolution de la rentabilit financire si le taux de
rentabilit conomique passait 5 %.
4) Vous calculerez lcart type de la rentabilit conomique, puis lcart
type de la rentabilit financire pour les diffrentes hypothses de levier
financier. Vous en dduirez un lien entre lcart type de la rentabilit
financire et lcart type de la rentabilit conomique au regard du levier
financier.
5) Vous commenterez vos rsultats.
Annexe
Pour raliser un investissement de 1 000 k, on peut envisager des
combinaisons de fonds propres et dendettement pouvant varier entre C1
(1 000 ; 0) et C5 (200 ; 800).
Le rsultat dexploitation est suppos de 200 k, le cot de lendette-
ment de 6 % avant IS et le taux dimposition de 33 1/3 %.
64 Chapitre 3 Analyse du bilan
EXERCICES
C1 C2 C3 C4 C5
Capitaux propres (k) 1 000 800 600 400 200
Endettements (k) 0 200 400 600 800
Investissement (k) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Rsultat dexploitation (k) 200 200 200 200 200
Frais financiers (k)
Rsultat avant impt (k)
Impt sur les socits (k)
Rsultat net (k)
Rentabilit conomique nette (%)
Rentabilit financire nette (%)
9782100547364-legros-C03.qxd 7/04/10 9:16 Page 64
www.dunod.com
Georges Legros
Diplm expert-
comptable, il est
professeur de nance
et enseigne lESG,
au CNAM-INTEC
et lIPESUP.
Public :
L1/L2
conomie-
gestion, IUT
coles de
commerce
M
i
n
i
M
a
n
u
e
l
d
e
F
i
n
a
n
c
e
d
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
G
.
L
E
G
R
O
S
MINI MANUEL
Comment aller lessentiel, comprendre les
mthodes et les dmarches avant de les mettre
en application ?
Conus pour faciliter aussi bien lapprentissage que
la rvision, les Mini Manuels proposent un cours
concis et richement illustr pour vous accompagner
jusqu lexamen. Des exemples, des mises en
gardes et des mthodes pour viter les piges
et connatre les astuces, enn des exercices tous
corrigs compltent les cours.
Ce Mini Manuel de Finance dentreprise prsente
lessentiel savoir, comprendre et matriser pour
tout tudiant en cole de commerce ou en 1
er
cycle
universitaire dconomie et de gestion.
Aperu du contenu :
La construction de linformation comptable
Lanalyse du compte de rsultat
Lanalyse du bilan
Lanalyse des ux nanciers
La stratgie dinvestissement
La politique de nancement
Le fonds de roulement normatif
Mini Manuel
de Finance dentreprise
Georges LEGROS
Finance
dentreprise
Georges Legros
Analyse
nancire
Stratgie
nancire
C
o
u
r
s
+
E
x
o
s
de
manuel
m
i
n
i
6690507
ISBN 978-2-10-054736-4
Vous aimerez peut-être aussi
- Comptabilite de Gestion 7 Ed ManuelDocument497 pagesComptabilite de Gestion 7 Ed ManuelWarren67% (3)
- Les Zooms. Analyse Financière 2014-2015 - 18e Édition by Béatrice GRANDGUILLOT, Francis GRANDGUILLOTDocument242 pagesLes Zooms. Analyse Financière 2014-2015 - 18e Édition by Béatrice GRANDGUILLOT, Francis GRANDGUILLOTAbdoulaye Bakayoko100% (21)
- L - ESSENTIEL DU DIAGNOSTIC FINANCIER Béatrice Rocher-Meunier PDFDocument240 pagesL - ESSENTIEL DU DIAGNOSTIC FINANCIER Béatrice Rocher-Meunier PDFGBOHOU100% (4)
- Cas SL EDocument1 pageCas SL EWarren0% (1)
- Diagnostic FinancierDocument42 pagesDiagnostic FinancierAlpha PILO60% (10)
- Nouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiqueD'EverandNouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiquePas encore d'évaluation
- Gestion financière des PME : théories et pratiques, 2e éditionD'EverandGestion financière des PME : théories et pratiques, 2e éditionÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)
- Projet de Creation D'Une Provenderie Dans La Ville de SangmelimaDocument26 pagesProjet de Creation D'Une Provenderie Dans La Ville de SangmelimaRobert BibongPas encore d'évaluation
- Principes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgeD'EverandPrincipes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgePas encore d'évaluation
- Comptabilité de Gestion VuibertDocument16 pagesComptabilité de Gestion Vuibertmouahi186267% (3)
- Offre ServicesDocument5 pagesOffre ServicesDjim Noubara100% (1)
- Finance D'EntrepriseDocument25 pagesFinance D'EntrepriseKevin Rajohnson33% (3)
- Bilan 2019Document28 pagesBilan 2019Lou Bna IIPas encore d'évaluation
- Valorisation et cession d'entreprise: Opérations de fusions et acquisitions d'entreprisesD'EverandValorisation et cession d'entreprise: Opérations de fusions et acquisitions d'entreprisesPas encore d'évaluation
- La comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreD'EverandLa comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Calcul du prix de revient: Rentabiliser les coûts de production et de distribution pour les chefs d'entreprises belgesD'EverandCalcul du prix de revient: Rentabiliser les coûts de production et de distribution pour les chefs d'entreprises belgesPas encore d'évaluation
- Les tableaux de bord et business plan: Gérer la comptabilité de son entrepriseD'EverandLes tableaux de bord et business plan: Gérer la comptabilité de son entrepriseÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3)
- L Essentiel Du Diagnostic Financier PDFDocument240 pagesL Essentiel Du Diagnostic Financier PDFHassan Younhous Traore Koné100% (3)
- Analyse Financière 2Document62 pagesAnalyse Financière 2Tchoffo Raoul100% (4)
- Exercice Analyse FinancierDocument20 pagesExercice Analyse FinancierHajjej Yasser100% (2)
- Les Risques Liés À L'internationalDocument5 pagesLes Risques Liés À L'internationalChoUbii AliPas encore d'évaluation
- Votre argent Chaque décision compte: Comptabilité pour tousD'EverandVotre argent Chaque décision compte: Comptabilité pour tousPas encore d'évaluation
- La consolidation: Contrôler les comptes d'entreprisesD'EverandLa consolidation: Contrôler les comptes d'entreprisesPas encore d'évaluation
- Le tableau de bord prospectif et les 4 piliers d'une organisation: Quels signaux prendre en compte pour une gestion efficace ?D'EverandLe tableau de bord prospectif et les 4 piliers d'une organisation: Quels signaux prendre en compte pour une gestion efficace ?Pas encore d'évaluation
- Window dressing: La manipulation comptable est-elle toujours frauduleuse ?D'EverandWindow dressing: La manipulation comptable est-elle toujours frauduleuse ?Pas encore d'évaluation
- Comprenez votre comptable: Découvrez les bases de la comptabilité belgeD'EverandComprenez votre comptable: Découvrez les bases de la comptabilité belgePas encore d'évaluation
- Mémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)D'EverandMémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)Pas encore d'évaluation
- Etablissement de la déclaration I.Soc. - Cas pratique: Etude de cas 2015 (Belgique)D'EverandEtablissement de la déclaration I.Soc. - Cas pratique: Etude de cas 2015 (Belgique)Pas encore d'évaluation
- Finance D'entreprise 2Document104 pagesFinance D'entreprise 2alybale100% (2)
- Comptabilité de GestionDocument71 pagesComptabilité de GestionFrancklin Bagui50% (2)
- Comptabilité de GestionDocument128 pagesComptabilité de Gestionissoufou AmadouPas encore d'évaluation
- Finance D'entrepriseDocument92 pagesFinance D'entreprisealybale100% (1)
- Charlotte Disle-DCG 9 - Introduction À La Comptabilité 2015 - 2016 - L'Essentiel en Fiches-Dunod (2015)Document160 pagesCharlotte Disle-DCG 9 - Introduction À La Comptabilité 2015 - 2016 - L'Essentiel en Fiches-Dunod (2015)Anas ElKhallas100% (1)
- Comptabilité Générale PDF WWW - Economie Gestion - Com - PDFDocument228 pagesComptabilité Générale PDF WWW - Economie Gestion - Com - PDFMoussa Coulibaly100% (2)
- Cours Diagnostic Financier PDFDocument37 pagesCours Diagnostic Financier PDFBen TanfousPas encore d'évaluation
- Gestion Comptable Gestion FinanciereDocument53 pagesGestion Comptable Gestion FinancieremouhcinebaPas encore d'évaluation
- Livre INTEC CompletDocument152 pagesLivre INTEC Completxav79Pas encore d'évaluation
- Les Zooms Exercices de Comptabilité de Gestion - 2e Édition by Eric MatonDocument226 pagesLes Zooms Exercices de Comptabilité de Gestion - 2e Édition by Eric Matonamine ghitaPas encore d'évaluation
- FINANCE D'entrepriseDocument40 pagesFINANCE D'entrepriseRoosvelt TalabertPas encore d'évaluation
- DCG 6 - Finance Dentreprise - 5e Éd.Document160 pagesDCG 6 - Finance Dentreprise - 5e Éd.David Pickering100% (3)
- Lessentiel de Lanalyse Financiã Re - 13e édition 2015-2016 by Béatrice GRANDGUILLOT Francis GRANDGUILLOT Z-LiborgDocument138 pagesLessentiel de Lanalyse Financiã Re - 13e édition 2015-2016 by Béatrice GRANDGUILLOT Francis GRANDGUILLOT Z-LiborgManou Lorou100% (2)
- Gestion Financiere Par (WWW - Heights Book - Blogspot.com)Document241 pagesGestion Financiere Par (WWW - Heights Book - Blogspot.com)Najib GzoulyPas encore d'évaluation
- 9782311400489Document14 pages9782311400489lakhdar2821100% (1)
- Les Carrés DSCG 2 Exercices Corrigés Finance - 9782297076920Document20 pagesLes Carrés DSCG 2 Exercices Corrigés Finance - 9782297076920YOZIEU67% (6)
- DCG 6 Finance D'entreprise Annales 2008 Jusqu'Au 2018Document220 pagesDCG 6 Finance D'entreprise Annales 2008 Jusqu'Au 2018Azer Aze100% (6)
- Contrôle de GestionDocument180 pagesContrôle de GestionMarcia WilliamsPas encore d'évaluation
- Finance D'eseDocument20 pagesFinance D'eseMeryam Lou83% (6)
- Guide Etudes Expertise comptable-DUNOD PDFDocument40 pagesGuide Etudes Expertise comptable-DUNOD PDFDorcas Ouattara100% (1)
- L'Analyse FinancièreDocument20 pagesL'Analyse Financièrealaa eddine azzouz100% (1)
- Aide-Mémoire Danalyse Financière - 4e ÉditionDocument260 pagesAide-Mémoire Danalyse Financière - 4e Éditionhakim100% (8)
- Comptabilite de GestionDocument33 pagesComptabilite de Gestionmunib1966100% (3)
- 7954 ControleGestionDocument222 pages7954 ControleGestionussef89100% (6)
- DCG 9 - Introduction À La Comptabilité 2013-2014 en 27 FichesDocument160 pagesDCG 9 - Introduction À La Comptabilité 2013-2014 en 27 Fichesissoufou Amadou100% (1)
- Choix Investissement PDFDocument106 pagesChoix Investissement PDFfascicolaPas encore d'évaluation
- DCG 6 Finance D - EntrepriseDocument326 pagesDCG 6 Finance D - Entreprisehachem100% (3)
- Série 1 FinanceDocument112 pagesSérie 1 FinanceBlessed Son100% (2)
- Analyse Financiere 1Document34 pagesAnalyse Financiere 1ndt100% (1)
- Feuilletage PDFDocument16 pagesFeuilletage PDFouPas encore d'évaluation
- Analyse FinanciereDocument202 pagesAnalyse FinanciereTresor Comptable Ngouana100% (1)
- Aspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleD'EverandAspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Cours 3 Et 4 PDFDocument40 pagesCours 3 Et 4 PDFChoUbii Ali100% (1)
- Geopolitique PDFDocument93 pagesGeopolitique PDFChoUbii Ali100% (1)
- Ob - 472c1b - CM Droit Du Commerce International PDFDocument23 pagesOb - 472c1b - CM Droit Du Commerce International PDFChoUbii Ali100% (2)
- Dans Le Secteur Des Transports MaritimesDocument3 pagesDans Le Secteur Des Transports MaritimesChoUbii AliPas encore d'évaluation
- Matières À Préparer Pour CCA. SEBKIDocument6 pagesMatières À Préparer Pour CCA. SEBKISalah-Eddine TourabiPas encore d'évaluation
- Partiel 2022-2023 (Corrigé 1)Document6 pagesPartiel 2022-2023 (Corrigé 1)Tess OpoczynskiPas encore d'évaluation
- CH 7 - La FacturationDocument10 pagesCH 7 - La FacturationAyoub Fakir100% (2)
- Programme Cours Eco 2018 2019Document122 pagesProgramme Cours Eco 2018 2019Yves BrasseleurPas encore d'évaluation
- Cours de Service Social Des Entreprises en Dev...Document34 pagesCours de Service Social Des Entreprises en Dev...Mbiya Mwanza Sinclair100% (1)
- Série #5 Et 6 Comptabilité ApprofondieDocument3 pagesSérie #5 Et 6 Comptabilité ApprofondieSami MilianiPas encore d'évaluation
- 1er Constat:: CNC: Les Charges Et Produits Hors Exploitation Et 75/78Document5 pages1er Constat:: CNC: Les Charges Et Produits Hors Exploitation Et 75/78layanePas encore d'évaluation
- 022+Questions+Et+Réponses ++Le+Contentieux+FiscalDocument136 pages022+Questions+Et+Réponses ++Le+Contentieux+Fiscalمحمد بن الجيلاليPas encore d'évaluation
- Memoire de BTSDocument38 pagesMemoire de BTSEzechiel Koumako100% (1)
- CA TD N°3 Inconvénients CG Et Avantages CADocument1 pageCA TD N°3 Inconvénients CG Et Avantages CASara GriguerPas encore d'évaluation
- Seance 1Document21 pagesSeance 1عبداللهبنزنوPas encore d'évaluation
- Exercice de Comptabilit2e Generale Itecom l2Document3 pagesExercice de Comptabilit2e Generale Itecom l2abdourahmane diengPas encore d'évaluation
- Responsable Administratif Et FinancierDocument3 pagesResponsable Administratif Et FinancierAnge Yohan Desvallees Ndri100% (1)
- Tarifs Et Scolarités 2019 2020Document3 pagesTarifs Et Scolarités 2019 2020Ta Gamïne TëtuëPas encore d'évaluation
- TD N°1 Bilan - ÉléveDocument2 pagesTD N°1 Bilan - ÉléveMeriam AkhroufPas encore d'évaluation
- Bilan Comptable (Cours + Exercices)Document18 pagesBilan Comptable (Cours + Exercices)charmarkeh fanasaraPas encore d'évaluation
- Cas CoutsDocument2 pagesCas CoutsHamid TalaiPas encore d'évaluation
- 06 Aout 2021Document3 pages06 Aout 2021Ahmed TAMOUPas encore d'évaluation
- Fiche-Produit ManufacturingDocument20 pagesFiche-Produit ManufacturingmohamedPas encore d'évaluation
- Directive #06 97 CM UEMOADocument23 pagesDirective #06 97 CM UEMOAmaxuya2001Pas encore d'évaluation
- Cours Audit Financier-M1Fin-M Adlouni 2Document62 pagesCours Audit Financier-M1Fin-M Adlouni 2Ama BenPas encore d'évaluation
- Etude de Cas n4 Corrigé PDFDocument7 pagesEtude de Cas n4 Corrigé PDFImane Megzari100% (1)
- AVIS CPS Inventaire Immobilisation '2022 30.01.2023Document18 pagesAVIS CPS Inventaire Immobilisation '2022 30.01.2023Moulay RachidPas encore d'évaluation
- Calculer Le Fonds de Roulement Net Global (FRNG)Document3 pagesCalculer Le Fonds de Roulement Net Global (FRNG)Dieudonné GBEMENOUPas encore d'évaluation
- Cours de Bureau Comptable Et Fiscal - 081411Document61 pagesCours de Bureau Comptable Et Fiscal - 081411YEBOU jeremiePas encore d'évaluation
- CV ComptableDocument2 pagesCV ComptableSteve IriePas encore d'évaluation
- 21DSCG-UE4 CorrigeDocument15 pages21DSCG-UE4 CorrigegilleratPas encore d'évaluation