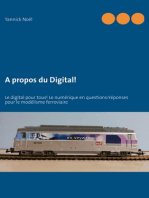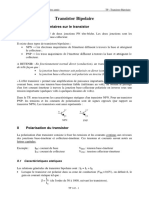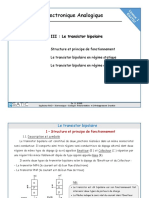Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
4 Transistor Bip
4 Transistor Bip
Transféré par
AbdelrrahimDeghmaniCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
4 Transistor Bip
4 Transistor Bip
Transféré par
AbdelrrahimDeghmaniDroits d'auteur :
Formats disponibles
Polytech Elec3 C. PETER V 3.
0
1
TRANSISTOR BIPOLAIRE
I Introduction
I.1 Constitution
Pour polariser correctement un transistor, il faut que :
la jonction entre B et E soit polarise dans le sens direct,
la jonction entre C et B soit polarise dans le sens inverse.
I Introduction
I.1 Constitution
Pour polariser correctement un transistor, il faut que :
la jonction entre B et E soit polarise dans le sens direct,
la jonction entre C et B soit polarise dans le sens inverse.
p
n
n
p
n
p
metteur
base
collecteur
p
n
n
Le transistor bipolaire est
ralis dans un monocristal
comportant trois zones de
dopage diffrentes.
On reconnat deux jonctions PN
que l'on peut considrer comme
deux diodes lorsque le transistor
n'est pas polaris.
C
B
E
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
2
TRANSISTOR BIPOLAIRE
I.2 Symboles, tensions et courants
NPN PNP
grandeurs positives grandeurs ngatives
Loi de Kirchhoff applique au transistor bipolaire : I
E
= I
C
+ I
B
I.2 Symboles, tensions et courants
NPN PNP
grandeurs positives grandeurs ngatives
Loi de Kirchhoff applique au transistor bipolaire : I
E
= I
C
+ I
B
C
B
E
I
E
I
B
I
C
V
CE
V
BE
L'metteur est repr
par la flche qui
symbolise le sens
rel du courant
C
B
E
I
E
I
B
I
C
V
CE
V
BE
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
3
TRANSISTOR BIPOLAIRE
I.3 Le transistor NPN polaris I.3 Le transistor NPN polaris
Remarques :
- la base est faiblement dope
- la base est trs fine
0 < V
1
< V
seuil
de la jonction PN
La jonction BE est polarise en directe
mais n'est pas passante I
B
= 0 .
Il faut V
2
> V
1
pour polariser correctement
le transistor.
la jonction BC est polarise en inverse,
I
C
= courant inverse = I
CEo
0.
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
4
TRANSISTOR BIPOLAIRE
I.3 Le transistor NPN polaris I.3 Le transistor NPN polaris
V
1
> V
seuil
de la jonction PN
La jonction BE est passante
I
B
> 0, et V
BE
0,6 V.
Ce courant est constitu d'un flux
d'lectrons allant de l'metteur vers la
base.
Les lectrons arrivant dans la base peuvent
rester libres longtemps avant d'tre pigs.
La base tant fine, ils arrivent la 2
me
jonction et passent dans le collecteur.
La majorit des lectrons injects par
l'metteur traversent la base et se
retrouvent dans le collecteur.
Remarques :
- la base est faiblement dope
- la base est trs fine
Il en rsulte un courant positif I
C
de valeur bien suprieure I
B
.
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
5
TRANSISTOR BIPOLAIRE
Lorsque le transistor est polaris correctement, on peut dfinir plusieurs rapports de
courants statiques (courants continus), notamment :
alpha statique
bta statique
DC
est aussi appel gain en courant du transistor.
Ce gain est l'origine de nombreuses applications
Lorsque le transistor est polaris correctement, on peut dfinir plusieurs rapports de
courants statiques (courants continus), notamment :
alpha statique
bta statique
DC
est aussi appel gain en courant du transistor.
Ce gain est l'origine de nombreuses applications
o
DC
=
I
C
I
E
=
I
C
I
C
+I
B
1car I
B
I
C
o
DC
>
0,99transitors classiques
0,95transistors de puissance
DC
=
I
C
I
B
100
DC
300transitors classiques
20
DC
100 transistors de puissance
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
6
TRANSISTOR BIPOLAIRE
I.4 Le transistor considr comme un quadriple
EC CC BC
I.4 Le transistor considr comme un quadriple
EC CC BC
T
v
1
1
i
2
i
v
2
e
n
t
r
e
s
o
r
t
i
e
Le transistor ayant trois lectrodes, l'une
d'elles sera commune l'entre et la
sortie. Il en rsulte trois montages
principaux.
Montage entre sortie
metteur commun base collecteur
collecteur commun base metteur
base commune metteur collecteur
Les montages correspondant
une permutation entre-
sortie sont sans intrt car ils
ne permettent pas de gain.
V
BE
V
CE
I
B
I
C
V
BC
V
EC
I
B
I
E
V
EB
V
CB
I
E
I
C
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
7
TRANSISTOR BIPOLAIRE
I.5 Rseau de caractristiques (montage metteur commun) I.5 Rseau de caractristiques (montage metteur commun)
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
8
TRANSISTOR BIPOLAIRE
Remarques :
NPN grandeurs positives ; PNP grandeurs ngatives.
V
BE
ne dpend pratiquement pas de V
CE
, le rseau d'entre ne comporte qu'une
seule courbe.
I
C
dpend faiblement de V
CE
, le rseau de transfert ne comporte souvent qu'une
seule courbe.
La puissance dissipe par un transistor est limite P
max
.
Le rseau de caractristiques est donn pour une temprature dfinie.
Il existe une dispersion des caractristiques pour des transistors de mmes
rfrences.
Ordres de grandeurs : V
BE
: 0.2 0,7 V ; V
CE
: 1 qq 100 V ; I
C
: mA A ; I
B
: A.
Le point de fonctionnement peut tre port sur le rseau.
Remarques :
NPN grandeurs positives ; PNP grandeurs ngatives.
V
BE
ne dpend pratiquement pas de V
CE
, le rseau d'entre ne comporte qu'une
seule courbe.
I
C
dpend faiblement de V
CE
, le rseau de transfert ne comporte souvent qu'une
seule courbe.
La puissance dissipe par un transistor est limite P
max
.
Le rseau de caractristiques est donn pour une temprature dfinie.
Il existe une dispersion des caractristiques pour des transistors de mmes
rfrences.
Ordres de grandeurs : V
BE
: 0.2 0,7 V ; V
CE
: 1 qq 100 V ; I
C
: mA A ; I
B
: A.
Le point de fonctionnement peut tre port sur le rseau.
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
9
TRANSISTOR BIPOLAIRE
II Le transistor en commutation
II.1 Rgion de blocage
Pour V
B
= 0, V
BE
= 0 et I
B
= 0 I
C
=
I
B
= 0
La jonction CB est polarise en inverse.
Il existe donc un faible courant de fuite I
CEo
.
En pratique ce courant est nglig et on considre le transistor comme un circuit
ouvert.
On dit que le transistor est bloqu.
II Le transistor en commutation
II.1 Rgion de blocage
Pour V
B
= 0, V
BE
= 0 et I
B
= 0 I
C
=
I
B
= 0
La jonction CB est polarise en inverse.
Il existe donc un faible courant de fuite I
CEo
.
En pratique ce courant est nglig et on considre le transistor comme un circuit
ouvert.
On dit que le transistor est bloqu.
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
10
TRANSISTOR BIPOLAIRE
II.3 Rgion de saturation
Pour V
B
> V
seuil
de la jonction PN, on a :
Lorsque V
B
>> V
BE
, on peut ngliger V
BE
, d'o :
Par ailleurs, E = R
C
I
C +
V
CE
, d'o :
Si R
B
, I
B
donc I
C
et V
CE
. Lorsque V
CE
= 0 ,
Si R
B
encore, I
C
= I
Cmax
mais et la relation I
C
= I
B
n'est plus vrifie.
Le transistor est satur : V
CE
= V
CEsat
= 0,2 0,4 V et I
C
E / R
C
.
II.3 Rgion de saturation
Pour V
B
> V
seuil
de la jonction PN, on a :
Lorsque V
B
>> V
BE
, on peut ngliger V
BE
, d'o :
Par ailleurs, E = R
C
I
C +
V
CE
, d'o :
Si R
B
, I
B
donc I
C
et V
CE
. Lorsque V
CE
= 0 ,
Si R
B
encore, I
C
= I
Cmax
mais et la relation I
C
= I
B
n'est plus vrifie.
Le transistor est satur : V
CE
= V
CEsat
= 0,2 0,4 V et I
C
E / R
C
.
V
B
=R
B
I
B
+V
BE
I
B
=
V
B
V
BE
R
B
I
B
=
V
B
R
B
I
C
=I
B
=
V
B
R
B
I
C
=
EV
CE
R
C
=
V
B
R
B
I
C
=
E
R
C
=I
Cmax
I
B
=
V
B
R
B
>
I
Cmax
Si I
B
>> I
C
, le transistor est satur.
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
11
TRANSISTOR BIPOLAIRE
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
12
TRANSISTOR BIPOLAIRE
III Polarisation du transistor (zone linaire)
Polariser un transistor consiste dfinir son tat de fonctionnement par
l'adjonction de sources de tension continues et de rsistances .
Cet tat de conduction est caractris par un point dans chacun des quadrants du
rseau de caractristiques, ce point est appel poi nt de f onct i onnement ou
poi nt de r epos.
III Polarisation du transistor (zone linaire)
Polariser un transistor consiste dfinir son tat de fonctionnement par
l'adjonction de sources de tension continues et de rsistances .
Cet tat de conduction est caractris par un point dans chacun des quadrants du
rseau de caractristiques, ce point est appel poi nt de f onct i onnement ou
poi nt de r epos.
Le point de fonctionnement
caractrise deux variables
indpendantes du transistor : I
C
et V
CE
. Il doit tre choisi dans la
zone linaire, mais en dehors des
zones interdites et doit tre peut
sensible aux variations de
temprature.
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
13
TRANSISTOR BIPOLAIRE
III.1 Polarisation deux sources de tension
C'est un montage peu utilis car il
ncessite deux sources.
III.2 Polarisation une source de tension
III.1 Polarisation deux sources de tension
C'est un montage peu utilis car il
ncessite deux sources.
III.2 Polarisation une source de tension
E=R
B
I
B
+V
BE
(1)
E=R
C
I
C
+V
CE
(2)
I
C
=I
B
(3)
(1)I
B
=
EV
BE
R
B
(3)I
C
=I
B
=
EV
BE
R
B
(2) V
CE
=ER
C
I
C
=ER
C
EV
BE
R
B
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
14
TRANSISTOR BIPOLAIRE
III.1 Polarisation deux sources de tension
C'est un montage peu utilis car il
ncessite deux sources.
III.2 Polarisation une source de tension
III.1 Polarisation deux sources de tension
C'est un montage peu utilis car il
ncessite deux sources.
III.2 Polarisation une source de tension
E=R
B
I
B
+V
BE
(1)
E=R
C
I
C
+V
CE
(2)
I
C
=I
B
(3)
(1)I
B
=
EV
BE
R
B
(3)I
C
=I
B
=
EV
BE
R
B
(2) V
CE
=ER
C
I
C
=ER
C
EV
BE
R
B
Montage instable
en temprature
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
15
TRANSISTOR BIPOLAIRE
III.3 Polarisation par pont et rsistance d'metteur
III.3.1 Dtermination approche du point de fonctionnement
On considre I
1
, I
2
>> I
B
I
1
= I
2
>> I
B
.
On en dduit :
On a V
BM
= V
BE
+ R
E
I
E
= V
BE
+ R
E
(I
C
+ I
B
)
Si est grand, I
C
>> I
B
et V
BM
V
BE
+ R
E
I
C
d'o :
On a E = R
C
I
C
+ V
CE
+ R
E
I
E
= R
C
I
C
+ V
CE
+ R
E
(I
C
+ I
B
) R
C
I
C
+ V
CE
+ R
E
I
C
et on en dduit
III.3 Polarisation par pont et rsistance d'metteur
III.3.1 Dtermination approche du point de fonctionnement
On considre I
1
, I
2
>> I
B
I
1
= I
2
>> I
B
.
On en dduit :
On a V
BM
= V
BE
+ R
E
I
E
= V
BE
+ R
E
(I
C
+ I
B
)
Si est grand, I
C
>> I
B
et V
BM
V
BE
+ R
E
I
C
d'o :
On a E = R
C
I
C
+ V
CE
+ R
E
I
E
= R
C
I
C
+ V
CE
+ R
E
(I
C
+ I
B
) R
C
I
C
+ V
CE
+ R
E
I
C
et on en dduit
V
BM
=
R
2
R
1
+R
2
E
I
C
=
V
BM
V
BE
R
E
=
ER
2
( R
1
+R
2
) R
E
V
BE
R
E
V
CE
=E( R
C
+R
E
) I
C
=EE
( R
C
+R
E
) R
2
( R
1
+R
2
) R
E
( R
C
+R
E
)V
BE
R
E
Stabilit en temprature : si I
C
,V
E
donc V
BE
I
B
I
C
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
16
TRANSISTOR BIPOLAIRE
III.3.2 Dtermination rigoureuse du point de fonctionnement III.3.2 Dtermination rigoureuse du point de fonctionnement
R
B
=
R
1
R
2
R
1
+R
2
V
B
=
ER
2
R
1
+R
2
E=R
C
I
C
+V
CE
+R
E
( I
C
+I
B
)
V
B
=R
B
I
B
+V
BE
+R
E
( I
C
+I
B
)
I
C
=I
B
V
BE
=valeur moyenne
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
17
TRANSISTOR BIPOLAIRE
III.3.3 Dtermination graphique du point de fonctionnement
En ngligeant I
B
devant I
C
, on a E = R
C
I
C
+ V
CE
+ R
E
I
C .
On en dduit l'quation de la droite de charge :
III.3.3 Dtermination graphique du point de fonctionnement
En ngligeant I
B
devant I
C
, on a E = R
C
I
C
+ V
CE
+ R
E
I
C .
On en dduit l'quation de la droite de charge :
Connaissant l'un des paramtres, on
peut en dduire les autres.
I
C
=
EV
CE
R
C
+R
E
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
18
TRANSISTOR BIPOLAIRE
IV Le transistor en rgime dynamique
L'tude en rgime dynamique consiste analyser le fonctionnement d'un transistor polaris
lorsqu'on applique de petites variations l'une des grandeurs lectriques.
IV.1 Analyse d'un montage EC
montage EC entre : base, sortie : collecteur
IV.1.1 Polarisation
En continu (transistor polaris), le point de repos est dfini par les points P
0
, Q
0
et R
0
, de
coordonnes V
CEo
, Ico, I
bo
et V
BEo
.
IV Le transistor en rgime dynamique
L'tude en rgime dynamique consiste analyser le fonctionnement d'un transistor polaris
lorsqu'on applique de petites variations l'une des grandeurs lectriques.
IV.1 Analyse d'un montage EC
montage EC entre : base, sortie : collecteur
IV.1.1 Polarisation
En continu (transistor polaris), le point de repos est dfini par les points P
0
, Q
0
et R
0
, de
coordonnes V
CEo
, Ico, I
bo
et V
BEo
.
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
19
Z
C
=
1
jCo
pour o=0 , Z
C
-, circuit ouvert
pour o0 , Z
C
0 si C est grand, court circuit
TRANSISTOR BIPOLAIRE
IV.1.2 Petits signaux
C
LE
, C
LS
: condensateurs de liaison.
IV.1.2 Petits signaux
C
LE
, C
LS
: condensateurs de liaison.
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
20
Z
C
=
1
jCo
pour o=0 , Z
C
-, circuit ouvert
pour o0 , Z
C
0 si C est grand, court circuit
TRANSISTOR BIPOLAIRE
IV.1.2 Petits signaux
C
LE
, C
LS
: condensateurs de liaison.
IV.1.2 Petits signaux
C
LE
, C
LS
: condensateurs de liaison.
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
21
TRANSISTOR BIPOLAIRE
On considre la charge infinie. Le point de fonctionnement se dplace alors entre
R
1
et R
2
, Q
1
et Q
2
et P
1
et P
2
.
On considre la charge infinie. Le point de fonctionnement se dplace alors entre
R
1
et R
2
, Q
1
et Q
2
et P
1
et P
2
.
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
22
TRANSISTOR BIPOLAIRE
Remarques :
Quand V
BE
, I
B
donc I
C
et V
CE
.
AV
BE
= V
BE1
V
BE2
<< AV
CE
= V
CE1
V
CE2
amplification de tension mais en opposition de phase.
Les grandeurs lectriques comportent une composante continue et une composante
alternative.
On peut donc dcomposer l'analyse du montage en :
une tude en continu (statique) pour calculer le point de repos,
une tude en dynamique pour calculer les gains.
Remarques :
Quand V
BE
, I
B
donc I
C
et V
CE
.
AV
BE
= V
BE1
V
BE2
<< AV
CE
= V
CE1
V
CE2
amplification de tension mais en opposition de phase.
Les grandeurs lectriques comportent une composante continue et une composante
alternative.
On peut donc dcomposer l'analyse du montage en :
une tude en continu (statique) pour calculer le point de repos,
une tude en dynamique pour calculer les gains.
V
BE
(t )=V
BEo
+v
be
(t )
I
B
(t ) =I
Bo
+i
b
(t )
V
CE
(t )=V
CEo
+v
ce
(t )
I
C
(t ) =I
Co
+i
c
(t )
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
23
TRANSISTOR BIPOLAIRE
Ainsi en appliquant le thorme de superposition :
Ainsi en appliquant le thorme de superposition :
Q
Q : quadriple quivalent
au transistor en rgime
dynamique.
Statique Dynamique
Si la source E est de bonne qualit, r
0
= 0 :
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
24
TRANSISTOR BIPOLAIRE
IV.2 Modle en rgime dynamique
En rgime dynamique, le transistor peut tre considr comme le quadriple
suivant :
En utilisant les paramtres hybrides :
IV.2 Modle en rgime dynamique
En rgime dynamique, le transistor peut tre considr comme le quadriple
suivant :
En utilisant les paramtres hybrides :
v
be
b
i
c
i
v
ce
v
be
=h
11
i
b
+h
12
v
ce
i
c
=h
21
i
b
+h
22
v
ce
h
11
=
v
be
i
b
v
ce
=0
h
22
=
i
c
v
ce
i
b
=0
h
21
=
i
c
i
b
v
ce
=0
h
12
=
v
be
v
ce
i
b
=0
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
25
TRANSISTOR BIPOLAIRE
Schma quivalent : Schma quivalent :
i
b
v
be
h
11
h
12
.v
ce
i
c
v
ce
h
22
h
21
.i
b
h
11
=
v
be
i
b
v
ce
=0
=
d V
BE
d I
B
V
CE
=cste
h
12
=
d V
BE
d V
CE
I
B
=cste
h
21
=
d I
C
d I
B
V
CE
=cste
h
22
=
d I
C
d V
CE
I
B
=cste
Sur un rseau de caractristiques
: les valeurs des paramtres dpendent du pt de polarisation
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
26
TRANSISTOR BIPOLAIRE
Remarques :
0 = 0 tan(0) = 0 donc h
12
= 0.
pour de faibles valeurs de I
C
, est trs faible tan() est trs faible donc h
22
0 on peut donc
simplifier le schma quivalent :
On suppose que les paramtres sont rels. Ceci n'est vrai qu'aux basses frquences. Pour les
hautes frquences, les capacits parasites qui existent dans le transistor conduisent des
expressions complexes pour les paramtres.
Les valeurs des paramtres varient avec le point de polarisation du transistor.
Remarques :
0 = 0 tan(0) = 0 donc h
12
= 0.
pour de faibles valeurs de I
C
, est trs faible tan() est trs faible donc h
22
0 on peut donc
simplifier le schma quivalent :
On suppose que les paramtres sont rels. Ceci n'est vrai qu'aux basses frquences. Pour les
hautes frquences, les capacits parasites qui existent dans le transistor conduisent des
expressions complexes pour les paramtres.
Les valeurs des paramtres varient avec le point de polarisation du transistor.
i
b
v
be
h
11
i
c
v
ce
h
21
.i
b
donc i
c
= h
21
i
b
sachant que I
C
= I
B
, on a h
21
=
Si I
C
augmente, les caractristiques
I
C
= f(V
CE
) ne sont plus horizontales
et h
22
n'est plus ngligeable.
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
27
TRANSISTOR BIPOLAIRE
IV.3 Montages fondamentaux
On considre que l'impdance des condensateurs utiliss est trs faible la
frquence de travail. Ces condensateurs seront donc remplacs par des court-
circuits en rgime dynamique.
IV.3.1 Montage metteur commun
IV.3 Montages fondamentaux
On considre que l'impdance des condensateurs utiliss est trs faible la
frquence de travail. Ces condensateurs seront donc remplacs par des court-
circuits en rgime dynamique.
IV.3.1 Montage metteur commun
La rsistance R
E
est indispensable
pour obtenir un point de fonctionnement
(point de repos) stable en temprature
Le condensateur C
E
s'oppose aux variations de potentiel de l'metteur. Du point de
vue des petits signaux , l'metteur est donc connect la masse.
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
28
TRANSISTOR BIPOLAIRE
On considre que l'impdance interne de la source est nulle. En remplaant les
condensateurs par des court-circuit et le transistor par un quadriple quivalent, on obtient
le schma en rgime dynamique suivant :
En rgime dynamique, l'metteur est bien l'lectrode commune l'entre et la sortie.
En ngligeant les paramtres h
12
et h
22
, le schma devient :
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
29
v
s
= v
ce
= - R
C
i
c
i
c
=
1
R
C
v
ce
Droite de charge dynamique : lieu des variations
du point de fonctionnement en dynamique. Il
s'agit d'une droite de pente -1/R
C
.
I
C
V
CE
E
droite de charge dynamique
de pente
1
R
C
E
1
R
B
= R
1
// R
2
E
R
C
+R
E
TRANSISTOR BIPOLAIRE
Etude statique et dynamique dans le plan I
C
, V
CE
E = R
C
I
C
+ V
CE
+ R
E
I
C
Droite de charge statique : lieu des
points de fonctionnement en statique.
I
C
V
CE
E
E
R
C
+R
E
droite de pente
1
R
C
+R
E
point de
repos
I
C
=
EV
CE
R
C
+R
E
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
30
en charge, on a : v
s
= v
ce
= - (R
C
// R
ch
) i
c
i
c
=
R
C
+R
ch
R
C
. R
ch
v
ce
I
C
E
E
R
C
+R
E
droite de charge dynamique
vide de pente
1/ R
C
R
B
= R
1
// R
2
TRANSISTOR BIPOLAIRE
Etude dynamique en charge dans le plan I
C
, V
CE
droite de charge dynamique
en charge de pente
1
R
C
// R
ch
v
ce
E
1ch
E
1v
L'excursion maximale de v
ce
est infrieure E
0
.
Elle est limite par le droite de charge dynamique
(point E
1
) et par la zone de saturation.
V
CEsat
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
31
IV.3.2 Montage collecteur commun
schma quivalent en dynamique
IV.3.2 Montage collecteur commun
schma quivalent en dynamique
TRANSISTOR BIPOLAIRE
R
B
= R
1
// R
2
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
32
IV.3.3 Montage base commune
schma quivalent en dynamique
IV.3.3 Montage base commune
schma quivalent en dynamique
TRANSISTOR BIPOLAIRE
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
33
TRANSISTOR BIPOLAIRE
IV.4 Caractristiques des montages
On considre le montage comme un quadriple aliment par un gnrateur de Thvenin
e
g
, r
g
et charg par une impdance Z
ch
.
IV.4.1 Dfinitions
IV.4 Caractristiques des montages
On considre le montage comme un quadriple aliment par un gnrateur de Thvenin
e
g
, r
g
et charg par une impdance Z
ch
.
IV.4.1 Dfinitions
Q
R
g
e
g
R
ch
v
1
v
2
i
2
i
1
Z
E
=
v
1
i
1
A
v
=
v
2
v
1
A
i
=
i
2
i
1
A
vg
=
v
2
e
g
=A
v
Z
E
Z
E
+R
g
Z
s
=
v
2
i
2
e
g
=0
ou
v
2
i
2
v
1
=0
si r
g
=0
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
34
TRANSISTOR BIPOLAIRE
IV.4.2 Proprits des montages fondamentaux
Applications :
EC : montage amplificateur (tension courant).
CC : montage adaptateur d'impdance (Z
E
fort, Z
S
faible), tage de sparation
entre deux tages dont les impdances sont inadaptes (Z
S1
>> Z
E2
).
BC : montage amplificateur de tension forte impdance de sortie (qualit parfois
recherche en HF).
IV.4.2 Proprits des montages fondamentaux
Applications :
EC : montage amplificateur (tension courant).
CC : montage adaptateur d'impdance (Z
E
fort, Z
S
faible), tage de sparation
entre deux tages dont les impdances sont inadaptes (Z
S1
>> Z
E2
).
BC : montage amplificateur de tension forte impdance de sortie (qualit parfois
recherche en HF).
EC CC BC
ngatif fort (-100) positif (1) positif fort (100)
positif fort (50) ngatif fort (-50) ngatif faible
Z
E
moyenne (1k) forte (100k) faible (20)
Z
moyenne (50k) faible (100) tr!s forte (1")
#
$
#
i
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
35
TRANSISTOR BIPOLAIRE
IV.4.3 Association de montages
L'association de plusieurs tages est ncessaire :
soit quand le gain d'un seul tage est insuffisant,
soit quand les impdances d'entre ou de sortie sont inadaptes.
On associe gnralement :
EC + EC : pour obtenir un gain lev
CC + EC : si l'impdance interne du gnrateur d'entre est trop leve
EC + CC : si l'impdance de la charge est faible.
CC + CC : pour obtenir un fort gain en courant.
IV.4.3 Association de montages
L'association de plusieurs tages est ncessaire :
soit quand le gain d'un seul tage est insuffisant,
soit quand les impdances d'entre ou de sortie sont inadaptes.
On associe gnralement :
EC + EC : pour obtenir un gain lev
CC + EC : si l'impdance interne du gnrateur d'entre est trop leve
EC + CC : si l'impdance de la charge est faible.
CC + CC : pour obtenir un fort gain en courant.
tage
1
R
g
e
g
R
ch
v
1
v
2
i
2
i
1
tage
2
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
36
TRANSISTOR BIPOLAIRE
IV.5 Etude des montages transistors PNP
En statique, le signe des courants et tensions du transistor est invers.
En dynamique, l'tude est identique l'tude des transistors NPN.
IV.5 Etude des montages transistors PNP
En statique, le signe des courants et tensions du transistor est invers.
En dynamique, l'tude est identique l'tude des transistors NPN.
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
37
TRANSISTOR BIPOLAIRE
V La rtroaction
La rtroaction est un procd qui consiste renvoyer vers l'entre d'un
amplificateur une partie de la tension de sortie. Le rseau lectrique permettant de
prlever une fraction de la tension de sortie et de la rinjecter vers l'entre se
nomme boucle de rtroaction.
Dans le cas o la rtroaction a tendance augmenter l'amplification du montage
initial, on parle de rtroaction positive ou de raction.
Dans le cas contraire o la rtroaction a tendance diminuer l'amplification, on
parle de rtroaction ngative ou de contre-raction.
V La rtroaction
La rtroaction est un procd qui consiste renvoyer vers l'entre d'un
amplificateur une partie de la tension de sortie. Le rseau lectrique permettant de
prlever une fraction de la tension de sortie et de la rinjecter vers l'entre se
nomme boucle de rtroaction.
Dans le cas o la rtroaction a tendance augmenter l'amplification du montage
initial, on parle de rtroaction positive ou de raction.
Dans le cas contraire o la rtroaction a tendance diminuer l'amplification, on
parle de rtroaction ngative ou de contre-raction.
boucle de rtroaction
amplificateur V
E
V
s
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
38
TRANSISTOR BIPOLAIRE
Principaux effets de la contre raction :
diminution de l'amplification par rapport au montage en boucle ouverte.
grande indpendance des tensions de polarisation et de l'amplification vis vis
de la dispersion des paramtres des transistors.
amlioration de la linarit.
limitation les oscillations spontanes.
Exemples de rtroaction :
Principaux effets de la contre raction :
diminution de l'amplification par rapport au montage en boucle ouverte.
grande indpendance des tensions de polarisation et de l'amplification vis vis
de la dispersion des paramtres des transistors.
amlioration de la linarit.
limitation les oscillations spontanes.
Exemples de rtroaction :
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
39
TRANSISTOR BIPOLAIRE
Exemples de rtroaction : Exemples de rtroaction :
Polytech Elec3 C. PETER V 3.0
40
TRANSISTOR BIPOLAIRE
Thorme de Miller :
On considre un ampli inverseur (V
S
est en opposition de phase avec V
E
) de gain
A. L'impdance Z est une impdance de contre-raction.
D'aprs le thorme de Miller :
Thorme de Miller :
On considre un ampli inverseur (V
S
est en opposition de phase avec V
E
) de gain
A. L'impdance Z est une impdance de contre-raction.
D'aprs le thorme de Miller :
Z
amplificateur
inverseur
V
E
V
s
amplificateur
inverseur
V
E
V
s
Z
IN
Z
OUT
Z
IN
=Z( A+1)
Z
OUT
=Z
A+1
A
Vous aimerez peut-être aussi
- Exercices d'optique et d'électromagnétismeD'EverandExercices d'optique et d'électromagnétismeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- A propos du Digital!: Le digital pour tous! Le numérique en questions/réponses pour le modélisme ferroviaireD'EverandA propos du Digital!: Le digital pour tous! Le numérique en questions/réponses pour le modélisme ferroviaireÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (3)
- Chekroun StatistiquesDocument89 pagesChekroun Statistiquesotmane100% (1)
- TP 01 Transistors BipolairesDocument4 pagesTP 01 Transistors Bipolairesnourelhouda7171% (7)
- CHP 4 PDFDocument5 pagesCHP 4 PDFdrissPas encore d'évaluation
- Transistor BipolaireDocument16 pagesTransistor BipolaireAkabouch AimadPas encore d'évaluation
- Chapitre Transistor Bip 16-17Document18 pagesChapitre Transistor Bip 16-17abdelkanPas encore d'évaluation
- Transistor BipolaireDocument26 pagesTransistor BipolaireBoubaker Asaadi100% (1)
- TP TransistorDocument2 pagesTP TransistordzmaigaPas encore d'évaluation
- Chap3 Transistors BipolairesDocument17 pagesChap3 Transistors Bipolairesmoez youssefPas encore d'évaluation
- CHAP II - TRANSISTOR BIPOLAIRE 2 OK (10p) PDFDocument10 pagesCHAP II - TRANSISTOR BIPOLAIRE 2 OK (10p) PDFAli OuattaraPas encore d'évaluation
- TP02 Pratique Part01Document4 pagesTP02 Pratique Part01Zain GaradiPas encore d'évaluation
- Transistor BipolaireDocument40 pagesTransistor Bipolairepapemangalli206Pas encore d'évaluation
- 5 Transistor BipDocument45 pages5 Transistor BipfadwanatachPas encore d'évaluation
- Transistors BipolairesDocument22 pagesTransistors Bipolairesanisohn985123Pas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Composants ElectroniquesDocument11 pagesChapitre 3 Composants ElectroniquesRamos KekePas encore d'évaluation
- Enonce BipolaireDocument7 pagesEnonce BipolaireAmina GhardallouPas encore d'évaluation
- Chap5-Transistor Bipolaire 18Document13 pagesChap5-Transistor Bipolaire 18Roland koumanPas encore d'évaluation
- Transistors BipolairesDocument17 pagesTransistors Bipolaireskouassinehemie320Pas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document24 pagesChapitre 1wafa wafaPas encore d'évaluation
- Chap3-Transistor BipolaireDocument13 pagesChap3-Transistor BipolaireRaphael DjaaPas encore d'évaluation
- FCEE TransistorDocument27 pagesFCEE TransistorSakhir GayePas encore d'évaluation
- Chapitre III Transistor Bipolaire 2020 2021Document11 pagesChapitre III Transistor Bipolaire 2020 2021Douae BerdeiPas encore d'évaluation
- chapitreIIIEF1 (MCIL2)Document7 pageschapitreIIIEF1 (MCIL2)Ãčĥ ŖăfPas encore d'évaluation
- TP3 PDFDocument6 pagesTP3 PDFAmira SabPas encore d'évaluation
- 2 Rappel Cours Transistor Bipolaire 2023Document58 pages2 Rappel Cours Transistor Bipolaire 2023Nøuhãilã BlbchírPas encore d'évaluation
- Cour Sur Les TransistorDocument8 pagesCour Sur Les Transistorharouna souley hegaPas encore d'évaluation
- Chapitre II NadjiDocument21 pagesChapitre II NadjiMaroua BennouiouaPas encore d'évaluation
- TransistorsDocument11 pagesTransistorsMohamed SeyidPas encore d'évaluation
- Tpe Transistor BipolaireDocument20 pagesTpe Transistor BipolairewilliamndongoatoPas encore d'évaluation
- Seance #9Document13 pagesSeance #9Mazama-Esso Moddoh OclooPas encore d'évaluation
- Cours #5 Le Transistor Bipolaire (1er Partie) 2 Me InfoDocument6 pagesCours #5 Le Transistor Bipolaire (1er Partie) 2 Me InfoyassinePas encore d'évaluation
- Transistor GIDocument68 pagesTransistor GIeden edenPas encore d'évaluation
- Transistor Bipolaire1Document23 pagesTransistor Bipolaire1MARYAM ACHIKPas encore d'évaluation
- Ef1 2014 2015 CH4Document6 pagesEf1 2014 2015 CH4Fox BenPas encore d'évaluation
- Transistor Pemière Partie 1Document14 pagesTransistor Pemière Partie 1Mohamed FoudalPas encore d'évaluation
- TP02 Pratique Part02Document8 pagesTP02 Pratique Part02Zain GaradiPas encore d'évaluation
- Le Transistor BipolaireDocument12 pagesLe Transistor Bipolairelassaad khanchouchPas encore d'évaluation
- Montages A Transistor M1 Glen 2019-2020Document12 pagesMontages A Transistor M1 Glen 2019-2020Amadou TraoréPas encore d'évaluation
- Chap3 - Transistor BipolaireDocument31 pagesChap3 - Transistor BipolaireKERY LABAYE Iyan DarielPas encore d'évaluation
- Grain 5.2 - Réseau de CaractéristiquesDocument3 pagesGrain 5.2 - Réseau de CaractéristiquesAYOUB BENHAMOUPas encore d'évaluation
- Chapitre II: Le Transistor Bipolaire: Y.Menchafou Année Universitaire 2022/2023Document60 pagesChapitre II: Le Transistor Bipolaire: Y.Menchafou Année Universitaire 2022/2023Salma SmkPas encore d'évaluation
- TransistorDocument29 pagesTransistorKhaoula ChetouanPas encore d'évaluation
- Le TRANSISTOR BIPOLAIREDocument3 pagesLe TRANSISTOR BIPOLAIREMouhamed KanePas encore d'évaluation
- Electronique Fondamentale2 Chap1Document12 pagesElectronique Fondamentale2 Chap1Nardjes BenPas encore d'évaluation
- Transistors Bipolaires - en Ligne PDFDocument28 pagesTransistors Bipolaires - en Ligne PDFThouraya Haj HssanPas encore d'évaluation
- Transistor Bipolaire: Le Transistor L'élément "Clef" de L'électroniqueDocument119 pagesTransistor Bipolaire: Le Transistor L'élément "Clef" de L'électroniqueNdeye Rokhaya NDOYEPas encore d'évaluation
- Chapitre3 TansistorsDocument13 pagesChapitre3 TansistorsFatimazahrae ABPas encore d'évaluation
- Ab CoursTR PIC EnvoyDocument74 pagesAb CoursTR PIC EnvoyLghazi OumssadPas encore d'évaluation
- ChapIII - Le Transistor Bipolaire - L1 EsaticDocument24 pagesChapIII - Le Transistor Bipolaire - L1 EsaticYynn FerdinandPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Transistor BipolaireDocument11 pagesChapitre 4 Transistor BipolaireMc R-OnePas encore d'évaluation
- Cours TransistorsDocument84 pagesCours Transistorsmael.lemouroux2002Pas encore d'évaluation
- Le Transistor Bipolaire 2 Me InfoDocument5 pagesLe Transistor Bipolaire 2 Me InfoRiadh MarouaniPas encore d'évaluation
- Annexes Chapitre 3Document5 pagesAnnexes Chapitre 3bsamatrbsPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Transistors en R. StatiqueDocument28 pagesChapitre 3 Transistors en R. Statiquelmons saroutPas encore d'évaluation
- Cours Transistor Bipolaire en Statique - Ea - 2a Ge s3 - 2020-21Document33 pagesCours Transistor Bipolaire en Statique - Ea - 2a Ge s3 - 2020-21Mbarek CherPas encore d'évaluation
- Les Transistors BipolairesDocument12 pagesLes Transistors Bipolairesfād wãPas encore d'évaluation
- Circuits Courant Alternatif Monophase 21 PDFDocument7 pagesCircuits Courant Alternatif Monophase 21 PDFEchafai0% (1)
- Association Des Impedances 22Document5 pagesAssociation Des Impedances 22otmanePas encore d'évaluation
- Kirachof Cor1Document4 pagesKirachof Cor1otmanePas encore d'évaluation
- C - Kirchhoff Corigeee PDFDocument4 pagesC - Kirchhoff Corigeee PDFotmanePas encore d'évaluation
- C Thevenin Corigee.Document6 pagesC Thevenin Corigee.otmanePas encore d'évaluation