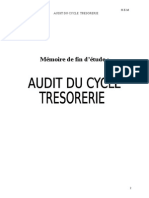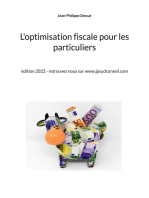Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Audit Comptable Et Financier
Audit Comptable Et Financier
Transféré par
monouche02Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Audit Comptable Et Financier
Audit Comptable Et Financier
Transféré par
monouche02Droits d'auteur :
Formats disponibles
Cours daudit comptable et financier
Audit comptable et financier (Cours partiel)
I.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Lobjectif de ce cours est de Permettre aux tudiants de:
Comprendre la dfinition et les objectifs de laudit;
Comprendre la dmarche de lauditeur charg dmettre une opinion motive sur la
qualit de linformation, lefficacit des systmes dorganisation et de contrle;
Acqurir une mthodologie daudit oprationnel et en matriser les techniques
spcifiques;
Analyser les problmes de fonds et de formes poss par llaboration de la dmarche
daudit comptable et financier.
Identifier les caractristiques de contrle des principaux cycles comptables de
lentreprise.
Evaluer synthtiquement les objectifs de laudit comptable et financier.
II.
CONTENU PEDAGOGIQUES
Descriptif :
1. Audit financier : concepts
2. Evaluation du contrle interne
3. Mthodologie de laudit des comptes
4. Commissariat aux comptes
5. Audit des diffrents modules et cycles (ventes, achat, charges du
personnel, )
Chapitre prliminaire : Prsentation gnrale de laudit
I.
Dfinition du concept daudit
II.
Caractristiques de laudit
III.
Les diffrents types daudit
IV.
La mission daudit et ses diffrentes phases
V.
VI.
Laudit comptable et financier : un instrument de performance
Laudit financier
Cours daudit comptable et financier
VII.
VIII.
IX.
Laudit comptable
Prsentation gnrale de laudit
LAudit : Dmarche comptable et financire
Travail faire : Quelle diffrence y a-t-il entre un auditeur et un commissaire au
compte?
Travaux datelier : Commentez les procdures daudit comptable et financier
En vous appuyant sur les procdures utilises dans ce type daudit (voir
documents distribus) savoir:
Contrles gnraux
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles (Premire sance de travaux dateliers)
Immobilisations financires
Stocks (Deuxime sance de travaux dateliers)
Clients, ventes et autres produits
Personnel et comptes rattachs (Troisime sance de travaux dateliers)
Impts et taxes
Disponibilits(quatrime sance de travaux dateliers)
Valeurs mobilires de placement
Capitaux propres(Cinquime sance de travaux dateliers)
Prvisions pour risques et charges
Emprunts et dettes assimiles(Sixime sance de travaux dateliers)
Fournisseurs achats charges externes et autres charges
Groupe et associs(Septime sance de travaux dateliers)
Autres comptes non traits par ailleurs
Engagements(Huitime sance de travaux dateliers)
Rsultat dexploitation
Rsultat financier
Rsultat exceptionnel
Commissariat aux comptes (Neuvime sance de travaux dateliers)
Cours daudit comptable et financier
Chapitre 2 : Caractristiques de laudit financier et comptable
I.
Dfinition de laudit financier et comptable
II.
Les objectifs de laudit financier
Linformation financire
La fiabilisation de linformation comptable et financire
Principe de rgularit
Principe de la sincrit
Principe du respect limage fidle
III.
Nature et rle de laudit financier
IV.
Les normes de laudit financier
Les normes de travail
Les normes de comportement
Disposition de la loi 17/95
Chapitre 3 : La mthodologie de laudit comptable et financier
I.
Approches mthodologiques : Approches par les risques
II.
Orientation de la mission
a. La dtermination du seuil de signification
b. Identification des domaines significatifs
c. Lorganisation et la planification de la mission
III.
Evaluation du niveau du contrle interne
Objectifs du CI
Principes du CI (principe dorganisation, dautocontrle )
Principaux
outils
(les
notes
descriptives,
les
diagrammes
de
circulation...)
Questionnaire du CI
Application n1
Chapitre 4 : Les techniques et outils de contrle des comptes
I.
II.
Programmes de contrle des comptes
Techniques de contrle (inspection physique et lobservation, la confirmation
directe )
III.
Observations physiques
IV.
Les outils de contrle des comptes
Cours daudit comptable et financier
a. Dossiers de travail : dossier permanent et dossier annuel
b. Feuil de travail, organisation et indexation
c. Documentation des travaux de lauditeur
Chapitre 5 : Lapproche du contrle par cycle
I. Audit du cycle dimmobilisation
a. Les procdures daudit de limmobilisation en non valeurs et incorporelles
b. Procdures daudit des immobilisations corporelles
c. Procdures de contrle des immobilisations financires
Cas pratique n 1
II. Audit du cycle : Achat /approvisionnement
a. La fonction achat/appt
b. Finalits et objectifs
c. Contrle des phases du cycle dachat
Cas pratique n2
III. Audit du cycle vente/client
a. Les diffrents types de ventes
b. Services intervenants
Cas pratique n3
IV.
Audit des stocks
a. Les tapes fondamentales de la mission daudit des stocks
b. Mthodologie daudit de linventaire par observation physique
Cas pratique n4
V. Audit du cycle personnel : audit social
a. Dfinition et rle
b. Structures et domaines dactions
c. Dmarches et axes de laudit social
Cas pratique n5
VI.
Audit des oprations de trsorerie de lentreprise
a. Aperu sur le CI de la trsorerie
b. Les conditions dexercice de laudit de trsorerie
c. Exemples de techniques de dtournement
d. Procdures et examens particuliers
Cours daudit comptable et financier
e. Vrification finale de cohrence
Cas pratique n6
Chapitre 6 : Le rapport daudit (Cas daudit dans un organisme bancaire)
I.
Formulation et recommandation
II.
Proposition dactions correctives
III.
Suivi des recommandations
Chapitre 7 : Etude de cas de la Socit ALPHA, valuation des objectifs daudit
et Questionnaire du Contrle Interne (selon lapproche risques systmes)
Cours daudit comptable et financier
Chapitre prliminaire : Prsentation gnrale de laudit
I. Dfinition du concept daudit
Laudit interne est une fonction dassistance au management. Issue du contrle comptable et
financier, la fonction audit interne recouvre de nos jours une conception beaucoup plus large et
plus riche, rpondant aux exigences croissantes de la gestion de plus en plus complexe des
entreprises : nouvelles mthodes de direction (dlgation, dcentralisation, motivation), .
Le mot audit est un mot qui vient de langlais. Il est prononc en latin Audio-Audire qui
signifie couter entendre et par extension donner audience .
Dans le domaine de la comptabilit et de la gestion financire cest le sens de vrification et
contrle par une observation attentive et minutieuse qui dominait ds le XIXme sicle.
Lauditeur est dans ce cas un commissaire aux comptes qui par des procdures adquates
sassure du caractre complet, sincre et rgulier des comptes dune entreprise, et sen porte
garant auprs des divers partenaires intresss et, plus gnralement, porte un jugement sur la
qualit et la rigueur de sa gestion (Dictionnaire Larousse en cinq volumes).
La dclaration des responsabilits laudit interne de lI.I.A (The Institute of International
Auditors) indique Laudit interne est lintrieur dune entreprise (ou dun organisme), une
activit indpendante dapprciation du contrle des oprations ; il est au service de lentreprise
(ou de lorganisme). Cest, dans ce domaine, un contrle qui a pour objet destimer et dvaluer
lefficacit des autres contrles.
Son objectif est dassister les membres de lentreprise (ou de lorganisme) dans lexercice
efficace de leurs responsabilits. Dans ce but, laudit interne fournit des analyses, des
apprciations, des recommandations, des avis et des informations concernant les activits
examines. Ceci inclut la promotion du contrle efficace un cot raisonnable.
Laudit interne apporte sa contribution lensemble des activits de lentreprise car dans
chaque domaine quil sagisse des aspects financiers, administratifs, informatiques,
Cours daudit comptable et financier
industriels, commerciaux ou sociaux daprs Larry Sawyer, diriger cest toujours planifier les
tches, organiser les responsabilits, conduire les oprations et en contrler la marche. Le
management est devenu une profession, faisant lobjet dun enseignement ; laudit interne, outil
de management, laccompagne et lclaire.
Selon Larry Sawyer, la tche de dirigeant est difficile. Laide dont il a besoin nest pas celle
dun vrificateur qui pointe des chiffres, ou mme signaler la violation des rgles et des
procdures, ou montre quelles sont prims, inapplicables ou inefficaces ; cest celle de
quelquun qui peut comprendre ses problmes et lui donner des avis sur la faon de les
rsoudre en se fondant sur les principes prouvs du management .
Laudit interne intervient mandat par la direction pour aller examiner un point ou une activit
de lorganisation une filiale, une fonction, un processus et tablir un diagnostic attestant de
son plus ou moins bon fonctionnement, un diagnostic alertant les responsables et la direction, et
une thrapeutique visant la scurit des actifs et la fiabilit des informations, lefficacit des
oprations, la comptitivit de lorganisation , mais pas plus que le mdecin lauditeur met en
uvre la prescription quil recommande.
Lauditeur est gnralement envoy des missions de terrain peu connu, dans une filiale ou sur
un sujet quil dcouvre sur le tas, muni dinformations partielles et approximatives et sans
connaissances techniques approfondies sur les oprations examiner, lauditeur doit dceler
leurs principales faiblesses, en dterminer les causes, en valuer les consquences leur trouver
un remde et convaincre les responsables dagir.
Cours daudit comptable et financier
II. Caractristiques de laudit
Laudit est une activit indpendante ;
Laudit est un examen qui repose sur une mthodologie, des normes professionnelles de
travail garantissant lobjectivit de son opinion ;
Laudit nvalue pas les hommes mais les systmes et les actions menes par une
organisation : il est tendu vers la recherche damliorations et de progrs ;
Laudit conduit des recommandations par :
Lidentification des risques en prvoir leur rcurrence
la correction des dysfonctionnements
IV. La mission daudit et ses diffrentes phases
1. Dfinition de la mission
La mission daudit est bien ce travail temporaire quil sera charg daccomplir dans lintention
de la direction gnrale . Les missions daudit sont apprcies selon deux critres : le champ
dapplication et la dure.
2. Le champ dapplication
Le champ dapplication dune mission daudit peut varier de faon significative de deux
lments : lobjet et la fonction.
2.1.
Lobjet
Va permettre de distinguer les missions particulires des missions gnrales .
Ou bien, cas le plus frquent, on a faire une mission particulire, c'est--dire portant
sur un point prcis en un lieu dtermin. Ainsi en est-il si la mission a pour objet
laudit du magasin de lusine ou encore laudit des ventes du secteur ou encore
laudit de la scurit du sige social , ou encore laudit du centre informatique dune
succursales .
Par opposition ces missions particulires on peut dfinir des missions gnrales
qui ne vont connatre aucune limite gographique. Les missions gnrales daudit
concerneront toutes les structures de lentreprise o il y a pour reprendre les exemples
Cours daudit comptable et financier
prcdents- un magasin, une activit de vente, une fonction scurit ou un centre
informatique.
2.2.
La fonction
Autre critre qui peut, bien videmment, se marier avec le prcdent, on parle alors de missions
uni fonctionnelles ou de missions pluri fonctionnelles.
La mission uni fonctionnelle quelle soit particulire ou gnrale, ne va concerner quune
seule fonction. Par habitude, on rserve ce terme aux missions gnrales , mais on
peroit bien quil ny a l aucune exigence logique : laudit du magasin de lusine, ou
laudit des magasins de lentreprise sont toutes des missions uni fonctionnelles car ne
concernant que la fonction gestion des magasins .Il en sera de mme pour laudit des
achats ou laudit de la scurit ou laudit du recrutement .
La mission pluri fonctionnelles, celle o lauditeur est concern par plusieurs fonctions
au cours dune mme mission, se rencontre en gnral dans deux cas :
Le premier cas, et le plus courant, est celui des filiales. Lorsque les auditeurs internes se
dplacent pour aller auditer une filiale, au Maroc ou ltranger, ils auditent en gnral
tout ou partie des activits de la filiale sans se limiter une seule fonction. Ils peuvent
ainsi la fois avoir une vue de synthse sur la socit et une apprciation globale sur la
qualit de sa gestion. Cette approche nest en gnral pas retenue pour les filiales de
grande importance, sauf faire une mission longue (second critre qui sera examin au
paragraphe suivant). Cette approche pluri fonctionnelle de la filiale sapplique galement
et pour les mmes raisons, aux usines dune certaine importance. Dans un cas comme
dans lautre, les frontires entre lapproche uni fonctionnelle et pluri fonctionnelle ne
sont pas strictes : tout est affaire de pratique, dhabitude et de culture (Jacques
RENARD, Thorie et pratique de laudit interne, les Editions dorganisation, 1994, page
192-193).
Le second cas, en dehors des filiales et usines, dans lequel on trouve trs souvent une
approche multifonctionnelle, est celui des audits informatiques : auditer les systmes
informatiques dun secteur, dune filiale ou dune usine na en gnral que les
apparences dune approche uni fonctionnelle (linformatique), car les systmes
informatiques en question vont bien videmment couvrir et concerner plusieurs
fonctions. Par contre, on vite cette qualification lorsque la mission est dfinie comme
laudit dun systme informatique particulier et spcifique.
Cours daudit comptable et financier
Ce critre de distinction nest pas seulement de pur intrt pdagogique ou logique ou logique :
il entrane des consquences pratiques importantes au plan de lorganisation du service daudit
lui-mme. A noter que la pratique daudits multi fonctionnels exige une certaine
pluridisciplinarit au sein de lquipe daudit interne.
En sus du champ dapplication, la dure de la mission est galement un critre intressant
apprcier.
2.3.
La dure
Cest une question habituelle de la part des tudiants (nous dit Jacques RENARD : quelle est
la dure dune mission ? A cette question, il ny a pas de rponse, ou plutt il y a une infinit
de rponses, ce qui revient au mme. Une mission daudit peut durer 10 jours ou 10 semaines, il
ny a pas de rgle en la matire et tout est fonction de limportance du sujet auditer.
Il faut prciser que lorsquon parle de 10 jours ou de 10 semaines, linstrument de mesure est ici
insuffisant. Il faut galement retenir dans le calcul le nombre dauditeur affects la mission.
Selon le niveau de dtail auquel sont tenues les statistiques, on sexprime donc en
heures/auditeur, ou en jours/auditeurs, ou en semaines/auditeur. Pour illustrer le propos, on
dira quun auditeur durant 10 semaines reprsente une dure de mission identique celle de 10
auditeurs durant une semaine. Par simplification lorsquon parle de mission de 2 semaines ou
de 4 semaines, il faut lire pour un auditeur au travail , la dure relle de la mission tant
diviser par deux sil y a deux auditeurs, par trois sil y en a trois, etc.
A partir de cette observation, on peut distinguer les missions courtes (infrieures ou gales
quatre semaines) et les missions longues (plus dun mois). Outre les consquences de la dure
sur lorganisation de la mission, sa logistique et son budget, la longueur a galement des
consquences mthodologiques.
Les missions longues sont des missions dans lesquelles on droule tout le processus
mthodologique de laudit interne ; on utilise une quantit et une diversit importante
doutils daudit, on constitue des dossiers volumineux et documents et on conclut par
un Rapport dAudit riche de recommandations nombreuses et constructives.
Cours daudit comptable et financier
En dautres termes, la mission logue est la parfaite illustration de la mthodologie
daudit applique par lquipe daudit interne en charge de la mission. Il en va tout
autrement dune mission courte .
La mission courte, en effet, exige une condensation des actions pour parvenir au rsultat.
Cette condensation est dautant plus naturelle que, si la mission est courte , cest en
gnrales quelle est simple, que le thme en est bien connu des auditeurs et que les
investigations raliser sont peu nombreuses. Dans la plupart des cas, le Rapport daudit
en rsultat est bref, ce qui ne veut pas dire que les questions soul eves sont sans
importance.
Mais ce qui veut dire que la mthodologie ci-aprs dcrite voit sa mise en uvre parfois
tasse, comprime, rduite dans certaines de ses phases sans pour autant tre nie ou
carte.
Enfin, la diffrence de la mission longue, la mission courte bnficie dune logistique
rduite et dun budget plus fable. Dans la pratique, la mission courte, unifonctionnelle et
particulire, se rencontre souvent dans le cas de missions spcifiques, sur un sujet prcis,
demandes par la Direction Gnrale en dehors du plan dAudit, parce que lon souhaite
rsoudre un problme urgent et imprvu.
Deux observations restent toutefois communes aux missions daudit quelle que soit leur dure :
Une mission daudit nest jamais lavance catalogue courte ou longue . Bien
videmment, il y a une prvision de dure, exige par la planification et la ncessit
dune estimation budgtaire. Mais lauditeur narrte jamais une mission non acheve au
motif quil a atteint le dlai prvu, pas plus quil ne poursuit une trop large. On adapte
planning et budget au fur et mesure des ralisations mais lachvement des objectifs
conditionne seul la dure relle de la mission.
La mthodologie, applique dans ses moindres dtails ou plus ou moins condense, es t
nanmoins toujours respecte dans ses principes et en particulier dans ses trois phases
fondamentales : La phase prparatoire, la phase de ralisation et la phase de conclusion.
Chacune dentre elles se dcoupe en un certain nombre de priodes, mais au -del de
cette analyse, on peut dire quelles toutes exiger des auditeurs des comptences
spcifiques, qui ne sont pas toujours lapanage dun seul, et qui permettent daffirmer
que la meilleure mission est toujours celle qui est ralise plusieurs.
Cours daudit comptable et financier
3. Les trois phases fondamentales dune mission daudit
3.1.
La phase prparatoire
Qui couvre la mission daudit, exige des auditeurs une capacit importante de lecture,
dattention et dapprentissage. En dehors de toute routine, elle sollicite laptitude appre ndre et
comprendre, elle exige galement une bonne connaissance de lentreprise car il faut savoir o
trouver la bonne information et qui la demander. Cest au cours de cette phase que lauditeur
doit faire preuve de qualit de synthse et dimagination. Elle peut se dfinir comme la priode
au cours de laquelle vont tre raliss tous les travaux prparatoires avant de passer laction.
Cest tout la fois le dfrichage, les labours et les semailles de la mission daudit.
3.2. La phase de ralisation
Fait beaucoup plus appel aux capacits dobservation, de dialogue et de communication. Se
faire accept est le premier impratif de lauditeur, se faire dsir est le critre dune intgration
russie. Cest ce stade que lon fait plus appel aux capacits danalyse et au sens de la
dduction. Cest, en effet, ce moment que lauditeur va procder aux tests qui vont lui
permettre dlaborer la thrapeutique. Poursuivant notre image bucolique, nous pouvons dire
que se ralise alors la moisson de la mission daudit.
3.3. La phase de conclusion
Elle exige galement et avant tout une grande facult de synthse et une aptitude certaine la
rdaction, encore que le dialogue ne soit pas absent de cette dernire priode. Lauditeur va
cette fois laborer et prsenter son produit aprs avoir rassembl les lments de sa rcolte :
cest le temps des engrangements et de la planification.
Rapport
Cours daudit comptable et financier
V. Laudit comptable et financier : Un instrument de
performance de lentreprise
Les analyses financires consistent formuler des apprciations sur la situation dune
entreprise en oprant sur ses comptes un certain nombre de traitements (slection, dcoupages,
regroupements, rapprochement, etc).
Leur validit est conditionne, dune part, par la scurit et la fixit
des descriptions
comptables, dautre part, par la sincrit et le ralisme conomique des comptes.
Les instruments de lanalyse financire sont soit des indicateurs soit des ratios. Les indicateurs
sont obtenus en additionnant ou en soustrayant diverses rubriques comptables en vue dobtenir
des chiffres significatifs sur la gestion : excdent brut dexploitation, valeur ajoute, fonds de
roulement, marge brute dautofinancement, structure de financement.
Ces indicateurs et ratios sont dun intrt accru sils sont adquatement choisis et si leur
volution est suivie dans le temps et des comparaisons peuvent tre faites entre entreprises, ce
qui pourrait tre facilit par les banques de donnes.
Mais lanalyse financire classique rencontre dans les entreprises publiques un problme
inconnu ou accessoire dans les entreprises prives : la prsence de contributions de lEtat
extrmement diverses quil faut isoler et dont il faut tenir compte, sinon les indicateurs et les
ratios sont fausss.
Lattribution par exemple de subventions dquipement, de prts publics des conditions
prfrentielles ou de bonifications dintrt et toutes les contributions publiques doivent tre
repres, values, justifies par des sujtions imposes par lEtat, et aboutir le cas chant des
redressements des indicateurs et ratios financiers.
Les instruments de lanalyse financire sont essentiellement :
-
La comptabilit gnrale la fois comme instrument dinformation financire et outil de
gestion
Cours daudit comptable et financier
-
La comptabilit analytique,
Le systme dinformation.
A. Instrument dinformation financire
1. La comptabilit gnrale
La comptabilit gnrale : Elle sert beaucoup de choses. Si lon simplifie maximum, on
peut dire que la comptabilit est la fois un instrument dinformation financire et un outil de
gestion.
Elle permet dassurer la mission dinformation financire lgard des partenaires de
lentreprises (salaris, bailleurs de fonds, clients, fournisseurs et lEtat) ; les documents
comptables essentiels sont cet gard le Bilan, le Compte de produits et Charges, lEtat des
Soldes de Gestion, le tableau de financement et lEtat des Informations complmentaires.
Le bilan est une photographie du patrimoine, de la forme de lentreprise, avec ce qui lui
appartient (actif) et ce quelle doit (le passif) ;
Le compte de produits et charges est tabli partir des comptes de gestion , produits et
charges, tenus durant lexercice et corrigs, en fin dexercice, par les diverses critures
dinventaire. Son solde crditeur (excdent des produits sur les charges) exprime un rsultat
bnficiaire (bnfice net), et son solde dbiteur (excdent des charges sur les produits) un
rsultat dficitaire (perte nette) ;
Ltat des soldes de gestion dcrit en deux tableaux la formation du rsultat net et celle de
lautofinancement ;
Le tableau de financement est ltat de synthse qui met en vidence lvolution financire
de lentreprise au cours de lexercice, en dcrivant les ressources dont elle a dispos et les
emplois quelle en a effectus.
Ltat des informations complmentaires comporte tous complments et prcisions
ncessaires lobtention dune image fidle du patrimoine, de la situation financire et des
rsultats de lentreprise, travers les tats de synthse fournis.
B. Outil de gestion
Cours daudit comptable et financier
Si lon met de plus en plus laccent sur la comptabilit en tant quinstrument
dinformation financire destin clairer les divers partenaires de lentreprise, il ne
faudrait tout de mme pas oublier quelle a dabord t et quelle demeure un ou til de
gestion destin clairer les dirigeants de lentreprise. A cet gard, la comptabilit
gnrale est une sorte de tableau de bord compos de toute une srie dinstruments de
mesure, grce auquel les dirigeants peuvent piloter lentreprise et en mesu rer les
performances.
2. La comptabilit analytique
Lobjectif de la comptabilit analytique est de calculer les cots grce une analyse approprie
des charges.
3. Le systme dinformation
H.C. Lucas analyse le systme dinformation comme lensemble des procdures organises
qui permettent de fournir linformation ncessaire la prise de dcision et/ou au contrle de
lorganisation .
Une dfinition simple est donne par C. Dumoulin : Ensemble des informations circulant
dans lentreprise ainsi que les procdures de traitement et les moyens octroys ces
traitements .
Les qualits dun bon systme dinformation, cest--dire oprationnel pour la prise de dcision
sont :
Le systme dinformation doit permettre de :
-
Connatre le prsent,
Prvoir,
Comprendre,
Informer rapidement.
Le systme dinformation doit tre:
Cours daudit comptable et financier
-
Adapt la nature (taille, structure) de lorganisation,
Efficace (rapport qualit /cot).
VI. Laudit financier
La dfinition de laudit financier peut tre tire des publications des diverses organisations
professionnelles, ainsi :
En France, dans les normes de lOECCA (Ordre des Experts Comptables et Comptables agrs)
laudit a pour objectifs de permettre lexpert comptable dattester de la rgularit et de la
sincrit annuels et de limage fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de
lentreprise .
Au plan europen, dans les normes de lUEC (Union Europenne des Experts comptables)
lobjet de laudit des comptes annuels est dexprimer une opinion sur le fait de savoir si ceuxci traduisent fidlement la situation de la socit la date du bilan et de ses rsultats pour
lexercice examin, en tenant compte du droit et des usages du pays o lentreprise a son
sige .
Au plan international, dans les normes de lIFAC (International Federation of Accountants)
Contrle de linformation financire manant dune entit juridique (le but lucratif ou non
lucratif de lorganisation, sa taille et sa forme juridique nentrent pas en l igne de compte),
effectu en vue dexprimer une opinion sur cette information .
La dfinition synthtique suivante est retenue :
Laudit financier est lexamen auquel procde un professionnel comptent et indpendant en
vue dexprimer une opinion motive sur la fidlit avec laquelle les comptes annuels dune
entit traduisent sa situation la date de clture et ses rsultats pour lexercice considr, en
tenant compte du droit et des usages o lentreprise a son sige .
Laudit financier ne peut soprer isolment de laudit oprationnel :
Cours daudit comptable et financier
La dfinition mme de laudit suppose la possibilit dapprcier une ralit par comparaison
des normes.
Traditionnellement on distingue deux grands domaines daudit, pour lesquels lexistence de
rfrences gnrales est ingale :
-
Laudit financier, intresse les actions ayant une incidence sur la prservation du
patrimoine, les saisies et traitements comptables, linformation financire publie par
lentreprise, il ne nglige pas les actions qui ne sont pas engages par les comptables euxmmes, mais ne sy intresse quen tant qulments dterminant la fiabilit, la rgularit et
la sincrit de linformation comptable et financire, sur laquelle il doit formuler un
jugement ;
Laudit oprationnel, qui sapplique toutes actions, sans privilgier leur incidence sur l
tenue et la prsentation des comptes. Son objet consiste juger la manire dont les objectifs
sont fixs et atteints ainsi que les risques qui psent ventuellement sur la capacit de
lentrepreneur ou dune entit dfinir des objectifs pertinents et les atteindre.
Au contraire, laudit financier et laudit interne ont des objectifs spcifiques :
-
Laudit financier a un objectif spcifique que na pas laudit interne : la certification des
comptes vis--vis des tiers.
Laudit interne a notamment comme objectif de sassurer, pour la direction uniquement, de
la qualit du fonctionnement comptable, des documents mis.
Laudit est une fonction part entire, qui mrite ses spcialistes, qui a se s crneaux, ce
que dnotent les termes daudit de management, daudit social, daudit total, etc.
Dans un environnement changeant, lauditeur peut jouer un rle dpassant largement celui
de contrleur pour devenir un catalyseur encourageant les dirigeants dentreprise
agir.
Du rle de simple contrleur jusqu celui de consultant lventail est large et les
situations rencontres trs variables dune entreprise lautre.
Cours daudit comptable et financier
Quoi quil en soit, lexistence dune structure daudit interne au sein dun organisme ou
dune entreprise traduit la volont affirme de la part de ses instances dirigeantes de se
doter dun outil en vue de limiter les risques, de rendre les organisations existantes plus
performantes, plus gnralement daccrotre lefficacit.
Encore sagit-il de sassurer que loutil mis en place est bien apte accomplir la mission
quon lui a assigne.
Nous abordons le problme des conditions remplir pour que laudit ici laudit comptable
et financier- puisse tre un vritable outil defficacit, ainsi que les limites en la matire.
OBJECTIFS DE LAUDIT FINANCIER :
La fiabilisation de linformation comptable et financire :
La rgularit ;
La sincrit ;
Le respect limage fidle ;
Le respect dun rfrentiel comptable prdfini :
Le dispositif de forme (organisation comptable et liste des comptes) ;
Le dispositif de fond (principes comptables et mthodes dvaluation).
VII. Laudit comptable
-
Un examen auquel procde un professionnel comptent et indpendant en vue d exprimer
une opinion motive sur la rgularit et la sincrit du bilan et le compte de rsultat
LOECCA
Un contrle de linformation financire manant dune entit juridique effectu en vue
dexprimer une opinion sur cette information LIFAC
Un examen, par sondages, des lments probants justifiant les donnes contenues dans les
comptes. Il consiste galement apprcier les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour larrt des comptes et apprcier leur prsentation
densembles La CNCAC
Cours daudit comptable et financier
VII. Prsentation gnrale de laudit
Laudit est un examen critique qui permet de vrifier les informations donnes par lentreprise
et dapprcier les oprations et les systmes mis en place pour les traduire.
Laudit est lactivit qui applique, en toute indpendance, des procdures cohrentes et des
normes dexamen en vue dvaluer ladquation, la pertinence, la scurit du fonctionnement
de tout ou dune partie des actions menes dans une organisation, par rfrence des normes.
(Voir la suite du cours dans les sances prochaines INCHAALLAH)
VIII. LAudit interne : une dmarche comptable et
financire
1. Contrle interne dun point de vue comptable
(Voir la suite du cours dans les sances prochaines INCHAALLAH)
Vous aimerez peut-être aussi
- MACG - Audit Comptable Et Financier Chap 1Document50 pagesMACG - Audit Comptable Et Financier Chap 1Kamal Moufdi100% (3)
- Techniques D'audit Financier Et ComptableDocument24 pagesTechniques D'audit Financier Et Comptableotmaaaan77% (13)
- Audit Comptable Et Financier - Diapo Mme MENZHIDocument163 pagesAudit Comptable Et Financier - Diapo Mme MENZHIkarimjaw100% (14)
- MACG - Audit Comptable Et Financier Chap 1 PDFDocument50 pagesMACG - Audit Comptable Et Financier Chap 1 PDFismail yousfiPas encore d'évaluation
- Cours Techniques D'audit - Chap 2 Fondamentaux de L'audit ComptableDocument31 pagesCours Techniques D'audit - Chap 2 Fondamentaux de L'audit Comptableyassir baihai100% (1)
- Audit Financier Et ComptableDocument46 pagesAudit Financier Et Comptableadldey123100% (1)
- Audit - Comptable Et FinancierDocument100 pagesAudit - Comptable Et FinancierKacem Benlabsir100% (1)
- Audit Comptable Et Financier - Support de CoursDocument63 pagesAudit Comptable Et Financier - Support de CoursNiyi Ademosu100% (1)
- Audit FinancierDocument58 pagesAudit Financierhihoim50% (4)
- Audit Comptable Et FinancierDocument53 pagesAudit Comptable Et Financierzoonis86% (35)
- Audit Comptable Et FinancierDocument90 pagesAudit Comptable Et FinancierAzer Aze100% (1)
- Audit Comptable Et Financier Chap 2 PDFDocument47 pagesAudit Comptable Et Financier Chap 2 PDFFinance Comptabilité100% (2)
- Les Normes de L'audit FinancierDocument23 pagesLes Normes de L'audit FinancierHani Wassim83% (6)
- Synthese Audit Financier Et ComptableDocument24 pagesSynthese Audit Financier Et ComptableEnseignant UniversiatairePas encore d'évaluation
- Audit Comptable Et FinancierDocument90 pagesAudit Comptable Et FinancierIsmailTouijiltPas encore d'évaluation
- Audit Comptable Et FinancierDocument14 pagesAudit Comptable Et Financierfaresjoel100% (1)
- Audit Comptable & Financier - ENCGDocument36 pagesAudit Comptable & Financier - ENCGWalid Farid50% (2)
- Audit Financier Et ComptableDocument46 pagesAudit Financier Et ComptableSoulaiman HarrakPas encore d'évaluation
- Audit Comptable Et FinancierDocument95 pagesAudit Comptable Et FinancierHicham Messid0% (1)
- Présentation Audit Comptable Et Financier VDDocument63 pagesPrésentation Audit Comptable Et Financier VDsoulal2005Pas encore d'évaluation
- Qualite Et Fiabilite de L Information FinanciereDocument3 pagesQualite Et Fiabilite de L Information Financierebelkataa100% (1)
- PFE Final Audit Comptable Et FinancierDocument38 pagesPFE Final Audit Comptable Et FinancierShaimae Tabri43% (7)
- Cours - Méthodologie de L'audit Comptable Et Financière PDFDocument85 pagesCours - Méthodologie de L'audit Comptable Et Financière PDFTaha Can100% (30)
- Audit Comptable Et FinancierDocument25 pagesAudit Comptable Et FinancierB.I98% (41)
- Audit Et Contrôle Des ComptesDocument43 pagesAudit Et Contrôle Des Comptescattttt100% (3)
- Quelle Est La Différence Entre Audit Comptable Et Audit FinancierDocument12 pagesQuelle Est La Différence Entre Audit Comptable Et Audit FinancierSalahddin KhalilPas encore d'évaluation
- Seuil de SignificationDocument20 pagesSeuil de SignificationAtoui Jihed67% (3)
- Audit FinancierDocument63 pagesAudit FinancierAyoub HarfachPas encore d'évaluation
- Audit de TrésierurerueDocument64 pagesAudit de TrésierurerueMyriam Essaidi100% (2)
- Audit Des StocksDocument17 pagesAudit Des Stocksmoussaid soukaina100% (1)
- Audit Comptable Et Financier Encg Settat Par Mlle. Oufqir NajiaDocument23 pagesAudit Comptable Et Financier Encg Settat Par Mlle. Oufqir NajiaanouackPas encore d'évaluation
- Audit Et Revision Des ComptesDocument62 pagesAudit Et Revision Des ComptesMamadou DjirePas encore d'évaluation
- Audit Comptable Et FinancierDocument189 pagesAudit Comptable Et FinancierHassan ESSAFI100% (1)
- Cours D'audit Et Finances ComptabilitéDocument34 pagesCours D'audit Et Finances Comptabilitémadnezo60% (5)
- Cours Audit FinancierDocument53 pagesCours Audit FinancierAsmaâ ZaâraouiPas encore d'évaluation
- Audit Des CyclesDocument29 pagesAudit Des CyclesZahra Zizo100% (1)
- 1 - Introduction À L'auditDocument35 pages1 - Introduction À L'auditaadell97% (29)
- Nouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiqueD'EverandNouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiquePas encore d'évaluation
- Le Système d'information comptable au milieu automatiséD'EverandLe Système d'information comptable au milieu automatiséÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)
- Nouvelle méthode d'interprétation des états financiers - Guide d'accompagnement: Une approche socio-économiqueD'EverandNouvelle méthode d'interprétation des états financiers - Guide d'accompagnement: Une approche socio-économiquePas encore d'évaluation
- Manuel du système comptable OHADA: Théorie et pratiqueD'EverandManuel du système comptable OHADA: Théorie et pratiqueÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- L'optimisation fiscale pour les particuliers: édition 2022 - retrouvez nous sur www.jpsudconseil.comD'EverandL'optimisation fiscale pour les particuliers: édition 2022 - retrouvez nous sur www.jpsudconseil.comPas encore d'évaluation
- IntéressantDocument18 pagesIntéressantlamoma389Pas encore d'évaluation
- Initiation L Audit Comptable Et FinancierDocument72 pagesInitiation L Audit Comptable Et FinanciersidyPas encore d'évaluation
- Audit Comptable Et FinancierDocument72 pagesAudit Comptable Et FinancierkhaledbedyPas encore d'évaluation
- auditKPMG PDFDocument171 pagesauditKPMG PDFEl ouadiPas encore d'évaluation
- Cours Techniques D'audit - Chap 3-Démarche D'auditDocument37 pagesCours Techniques D'audit - Chap 3-Démarche D'audityassir baihaiPas encore d'évaluation
- auditKPMG PDFDocument171 pagesauditKPMG PDFRiadh AssouakPas encore d'évaluation
- Cours Audit Comptable Et FinancierDocument3 pagesCours Audit Comptable Et FinancierAmineChadiPas encore d'évaluation
- Audit Comptable - Audit Financier Et Fiscale PDFDocument98 pagesAudit Comptable - Audit Financier Et Fiscale PDFHamza El MissouabPas encore d'évaluation
- Cours Techniques D'audit - Chap 2 Fondamentaux de L'audit ComptableDocument31 pagesCours Techniques D'audit - Chap 2 Fondamentaux de L'audit ComptableKhalid EDIANIPas encore d'évaluation
- Exposé Sur Les Missions de L'auditeurDocument29 pagesExposé Sur Les Missions de L'auditeurEl HamdiPas encore d'évaluation
- Cours D'auditDocument77 pagesCours D'auditEpiphane Romeo HOUNGBADJI100% (1)
- Audit Comptable Et Financier 2Document50 pagesAudit Comptable Et Financier 2Ayoub BahariPas encore d'évaluation
- Cours D'audit (1) KorDocument61 pagesCours D'audit (1) KorMarc-Rémy N'driPas encore d'évaluation
- Audit Des Cycles de L'entrepriseDocument55 pagesAudit Des Cycles de L'entrepriseB.I98% (149)
- Cours-Audit Comptable Et FinancierDocument108 pagesCours-Audit Comptable Et FinancierMessa Boualem100% (1)
- 2010 01 13 Audit Et Controle Interne Des ProjetsDocument1 page2010 01 13 Audit Et Controle Interne Des ProjetsAboubacar OuattaraPas encore d'évaluation
- Audit Financier MMF Octbre 2018Document210 pagesAudit Financier MMF Octbre 2018hamza MAAROUFI8i9îoolopkii7Pas encore d'évaluation
- Audit General PDocument38 pagesAudit General Pahpatsum19Pas encore d'évaluation
- Soumission 18 04 2017 - 17 31 41 PDFDocument32 pagesSoumission 18 04 2017 - 17 31 41 PDFbhz othmanePas encore d'évaluation
- Ethique Et Audit InterneDocument6 pagesEthique Et Audit InterneKenza NafidPas encore d'évaluation
- 01-23 Sup 01 RV-BCDocument64 pages01-23 Sup 01 RV-BCDjou ManaPas encore d'évaluation
- Guide de Bonnes Pratiques Destiné Aux Entreprises Pour L'application Du Volet Anti-Corruption de La Loi Sapin IIDocument121 pagesGuide de Bonnes Pratiques Destiné Aux Entreprises Pour L'application Du Volet Anti-Corruption de La Loi Sapin IIArnaud Dumourier100% (2)
- 03-26 Doc01 RV-BC V5.0Document1 page03-26 Doc01 RV-BC V5.0ʚïɞ Fi Fi ʚïɞPas encore d'évaluation
- Cat Form 2020 IIA MarocDocument14 pagesCat Form 2020 IIA MarocRegiminis SarlPas encore d'évaluation
- L'audit Légal Et Contractuel: Animé Par: Docteur en Sciences de Gestion-ENCG SETTATDocument195 pagesL'audit Légal Et Contractuel: Animé Par: Docteur en Sciences de Gestion-ENCG SETTATAbdelmajid SaouPas encore d'évaluation
- Fiduciare 1Document148 pagesFiduciare 1fatiPas encore d'évaluation
- La Contribution Du Contrôle de Gestion À La Performance de L'administration Publique Cas Du MEF-convertiDocument79 pagesLa Contribution Du Contrôle de Gestion À La Performance de L'administration Publique Cas Du MEF-convertizineb elhamdiPas encore d'évaluation
- 1ere Partie Audit InterneDocument9 pages1ere Partie Audit Internefadali aminePas encore d'évaluation
- Audit InterneDocument34 pagesAudit InterneOumnia Zekri100% (2)
- Formulaire D Adhesion IiaciDocument3 pagesFormulaire D Adhesion Iiacikadams225Pas encore d'évaluation
- Code de Bonnes Pratiques de Gouvernance D'entrepriseDocument54 pagesCode de Bonnes Pratiques de Gouvernance D'entrepriseHani WassimPas encore d'évaluation
- Sample Audit Committee Charter - FRDocument11 pagesSample Audit Committee Charter - FRYacine ChallabPas encore d'évaluation
- MEMO FARDOUSSA SAID ROBLEH M2 ACG - PréfiniDocument101 pagesMEMO FARDOUSSA SAID ROBLEH M2 ACG - Préfinirohega likibi100% (1)
- AUDIT ET Assurance 1707422288Document37 pagesAUDIT ET Assurance 1707422288arolykumbuPas encore d'évaluation
- 2017 06 21 - Rapport Annuel - AI 2016 - FR PDFDocument27 pages2017 06 21 - Rapport Annuel - AI 2016 - FR PDFIslamo BianconeroPas encore d'évaluation
- Les Acteurs Du Management de La QualitéDocument17 pagesLes Acteurs Du Management de La QualitéRania El yacoubiPas encore d'évaluation
- CorT Projet de Fin D'étude ChapT1Document32 pagesCorT Projet de Fin D'étude ChapT1ibtissam ben el rhadbanePas encore d'évaluation
- TD 1 Corrigé 1Document3 pagesTD 1 Corrigé 1Sahar Fekih100% (2)
- Study Viewer PDFDocument24 pagesStudy Viewer PDFSerge DjoumssiePas encore d'évaluation
- Audit InterneDocument69 pagesAudit InterneIdtaleb RachidaPas encore d'évaluation
- 2.cadre de Réference de L'audit Interne CRIPPDocument98 pages2.cadre de Réference de L'audit Interne CRIPPasdubal100% (1)
- Master Controle de Gestion Et Systeme DIDocument10 pagesMaster Controle de Gestion Et Systeme DIFatoumata MaigaPas encore d'évaluation
- AD Pocket Guide Coso Juillet2013 Draft3Document36 pagesAD Pocket Guide Coso Juillet2013 Draft3Riadh Assouak100% (1)
- Rapport Annuel Sur Les Activites D'audit 2024 VFDocument7 pagesRapport Annuel Sur Les Activites D'audit 2024 VFmoustadmedPas encore d'évaluation
- Charte Du Comite D'audiDocument6 pagesCharte Du Comite D'audisosoPas encore d'évaluation
- Organisation D'un Service D'audit InterneDocument49 pagesOrganisation D'un Service D'audit InterneSouha Layane100% (46)
- Procédure D'audit Interne Groupe GEICADocument9 pagesProcédure D'audit Interne Groupe GEICAsabri rabiePas encore d'évaluation
- CRIPP 2017 Version Finale Amende e 31052017 PDFDocument269 pagesCRIPP 2017 Version Finale Amende e 31052017 PDFmisokel100% (1)