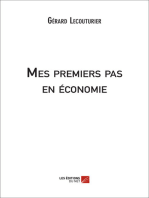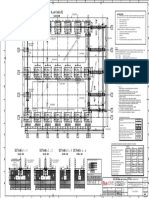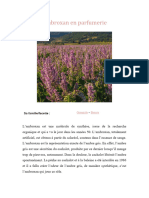Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours Demographie L3 AES
Cours Demographie L3 AES
Transféré par
Enimie Le PortTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours Demographie L3 AES
Cours Demographie L3 AES
Transféré par
Enimie Le PortDroits d'auteur :
Formats disponibles
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
Dmographie
Examen : deux questions, dure de 2 heures. 1 question de cours, 1 question exercice Complment de cours : cours de Monsieur Maserole (taper dmographie conomique sur google)
Partie I : Prsentation gnrale de la dmographie et les outils mthodologiques Partie II : Les doctrines de population Dbat entre Malthus (quantit de population) et Marx (problme de sous consommation) Partie III : Dmographie et dveloppement
Page | 1
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
Chapitre 1 : Prsentation gnrale de la dmographie et les outils mthodologiques
ILa dmographie
1- Prsentation gnrale a- Origine de la dmographie Daprs les lectures le mot dmographie aurait t employ pour la premire fois au 19e sicle par Achille Guillard en 1855 dans un ouvrage intitul Elments de statistiques humaines ou dmographie compare . Ce que lauteur dit : la dmographie tudie les variations quantitatives des populations vivant sur un territoire donn sous linfluence des naissances, des dcs, des dplacements gographiques de population ou mouvements migratoires . Quest-ce que lEtat ? Quest-ce que la nation ? Quest-ce que lEtat nation ? La notion de territoire est une notion didentit. La dmographie fait partie des sciences humaines. Jean Bodin : Il ny a de richesse que dhomme . Cest la culture ou le souci du nombre, soucis quantitatif. Derrire toute naissance, tout tre humain il y a des bras. Tout accroissement de la population permet dapporter sa contribution la croissance conomique. La monnaie joue galement un rle dans la reconnaissance du pays. b- La dmographie et ses liens avec les autres sciences
La dmographie et les liens avec les sciences sociales
Elle fournit des statistiques ses autres sciences, exemple : lhistoire, et cela est intressant pour connaitre leffectif militaire lpoque Napolonienne. Lhistorien a besoin des donnes quantitatives. Autre lien avec la sociologie. Le dmographe est utile pour le sociologue. Exemple : les phnomnes de consommation chez les jeunes et les phnomnes de consommation chez les personnes ges. La masse accentue les phnomnes de consommation collective. La sociologue est trs intress pour aborder les phnomnes de consommation selon que se soit des jeunes, des moins jeunes, des femmes ou des hommes, dans tel pays Le sociologue utilise le dmographe galement pour aborder la question du mariage. Les mariages sont tout sauf du hasard, sauf de lamour, cest lhomogamie. Ils se font lintrieur des mmes CSP. Pour cela le sociologue a besoin de donnes spatiales, de donnes dmographiques. La dmographie a des liens avec lconomie. Exemple : des donnes dmographiques pour aborder le financement des retraites. Dans les annes 1960, il y a avait quatre actifs pour un inactif. Un inactif est quelquun qui ne travaille pas et qui nest pas au chmage. On y trouve les retraits, les enfants / lves, les femmes/mres au foyer, services militaires. Aujourdhui 1,5 actifs pour 1 inactif. Page | 2
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
De facto la dmographie a un lien avec la politique, les politiques conomiques. Exemple je peux mettre en place une politique ou non des retraites, cest un choix politique. Enfin, il y a un lien entre dmographie, population actif et population au chmage. Les chmeurs font parti des actifs, ce sont des actifs inoccups. Lconomiste est intresse par la croissance dmographique. Plus la croissance dmographique est faible plus le nombre de demandeurs demplois le sera galement. A partir de 2020 la pression pour trouver un emploi sera plus faible. Derrire cela on peut penser que la dmographie est au cur dun ensemble pluri disciplinaire. La dmographie est au cur des sciences humaines. Cette discipline, en lien avec les autres, influence les politiques de population. c- Les principales statistiques de la population mondiale
Anne
An 0 An 1000 1800 1950 2000 2050
Nombre dhabitants
250 millions 257 millions 1 milliard 2,5 milliards Plus de 6 milliards 9 milliards
Lindice de fcondit diminue. Pour quune population se renouvelle lindice de fcondit est de 2,1. En moyenne 100 femmes ont 100 filles la naissance, et 100 femmes ont 105 garons. Sur les 205 enfants, il y a un taux de mortalit infantile. Il faut un peu plus de deux naissances, donc 2,1. La perspective de 9 milliards habitants est un scnario avec pour hypothse un indice de fcondit de 2,1. Or il y a aujourdhui des pays dont lindice de fcondit nest pas gal 2,1 mais, notamment dans les pays en dveloppement, de 3, 4 voire 6. Au Niger, il nest pas rare quune femme ait entre 5 ou 6 enfants. Si les taux de fcondit sont maintenus, en 2080 la population de ces pays dpasserait 35 milliards dhabitants. En 2300, lAfrique compterait 115 milliards dhabitants. A la mme priode, lEurope compterait 90 millions dhabitants. Et entre 90 et 100 millions aux USA. Y-aurait-il assez de ressources pour faire face une telle population ? Autre problme : les disparits entre continents. LEurope bascule dans une forme dextrmisme, de populisme. Il y a un phnomne de rejet, la question de migration nest pas simple. Il faut remettre en perspective les scnarios avec les difficults de pouvoir combler un manque dmographique avec le besoin dmigration. Dans les questions relatives ces projections, il y a deux phnomnes. Le fait que la mortalit recule avec beaucoup dinterrogations. Face lesprance de vie, il y a des craintes dun phnomne de pauprisation.
Page | 3
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
Les indicateurs sur la problmatique du vieillissement : GE MEDIAN PAR REGION DU MONDE : 1950 23,6 19 22 2000 26,4 18,3 26,1 2050 36,8 27,5 38,7 39,8 47,7 40,2
TOTAL MONDIAL AFRIQUE ASIE AMERIQUE LATINE / 20,1 24,2 CARAIBES EUROPE 29,2 37,7 AMERIQUE DU 29,8 35,4 NORD La question migratoire est prsente. Soit on lorganise, soit on la repousse.
VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION FRANAISE : AGE AGE DONT 75 < 20 ANS [20,59] 60 ET + MOYEN MEDIAN ET + 1901 32,4 29 34,4 53 12,7 2,5 1950 35,3 34 30,2 53,6 16,2 3,8 1990 36,9 34 27,8 53,2 19 6,8 2000 38,7 37 25,6 53,8 20,6 7,2 2008 39,9 39 24,6 53,6 21,8 8,6 Un franais sur quatre moins de 20 ans mais un franais sur 6 plus de 75 ans. Et ce chiffre va continuer croitre. ANNEE
LA POPULATION DU MONDE PAR CONTINENT EN 2008 : Continents Afrique Amriques Asie Europe Ocanie TOTAL Populations 945 millions 913 millions 3 995 millions 727 millions 33,8 millions 6 615 millions % de la population mondiale 14,29 % 13,81 % 60,40 % 11 % 0,5 % 100 %
Page | 4
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
LES PAYS LES PLUS PEUPLES EN 2008 : Pays Chine Inde UE 27 Etats-Unis Indonsie Brsil Pakistan Bangladesh Nigria Russie Japon Mexique Populations 1 336 millions 1 186 millions 495 millions 309 millions 234 millions 194 millions 167 millions 161 millions 151 millions 142 millions 128 millions 108 millions % de la population mondiale 20,2 % 18 % 7,5 % 4,7 % 3,5 %
2- Les mthodes de lanalyse dmographique a- Les sources statistiques Dans la mthodologie du dmographe, il a besoin de statistiques. Il y a les statistiques de ltat civil supposer que ce soit bien recens, que linstitut soit officiel, reconnu, non corrompu. Ensuite, les enqutes par sondage. En ce qui concerne la France, il y a lINSEE avec son tableau de lconomie franaise (TEF). Il y a aussi des dpliants que lINSEE publie dont dmographie socit. Institut National des Etudes Dmographiques (INED). b- Le classement des donnes dmographiques Lobservation via le recensement. Ensuite on a le classement des statistiques travers le temps qui est lanalyse longitudinale, lanalyse transversale exemple : analyse de statistiques sur une seule anne (situe sur une priode trs limit). Quelles sont les variables qui nous intressent ? La naissance Le dcs Mariage Mouvement migratoire A partir de l on peut calculer le taux de natalit, le taux de mortalit Quand on a des taux, il faut distinguer les taux bruts et les taux nets. c- Lanalyse de la fcondit Il faut se proccuper des naissances vivantes et le mariage avec les naissances lgitimes. Les naissances vivantes et les naissances lgitimes permettaient de calculer un indice de fcondit.
Page | 5
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
Le taux brut de natalit pour lanne N = naissances vivantes en N / (population au 1er janvier N + population au 1er janvier N+1 / 2) France 14,9 (pour 1 000 habitants) 13,2 Allemagne 10 (en 1999) [Brsil = 21]
1980 2000
La fcondit : femme en ge davoir des enfants, cet ge doit avoir des limites : 15 49 ans. Il y a le taux de fcondit gnral, le taux de fcondit lgitime et le taux de fcondit hors mariage. Taux de fcondit lanne N = naissances vivantes / (population fminine 15-49 ans au 1er janvier N + population fminine 15-49 ans au 1er janvier N+1 / 2) La notion de fertilit est oppose la notion de strilit. Cest une capacit physiologique pour une femme davoir un enfant. Quelles sont les tendances des indices de fcondit dans les pays occidentaux ? Ces taux sont la baisse. Cela est d la contraception, interruption volontaire de grossesse. d- Lanalyse de la mortalit Taux brut de mortalit = dcs durant lanne N / (population au 1er janvier N + population anne N+1 / 2) En France, le taux brut de mortalit en 2000 est de 9,1 pour 1 000 habitants. On peut calculer le taux de mortalit infantile. Taux de mortalit infantile en 1998 = dcs 0 an en 1998 / 0,8 N1998 + 0,2 N1997 Les dmographes considrent que 80 % des dcs lge 0 an appartiennent la gnration de la mme anne et 20 % des dcs appartiennent la gnration prcdente. A ct de cela il y a lindicateur de lesprance de vie. Souvent lesprance de vie est donne la naissance et cest un excellent indicateur de ltat de la mortalit dun pays. Les critres qui jouent sur la mortalit sont lge, le lieu dhabitat, le mtier, qualit de vie et la nationalit. e- LEsprance de vie Ea = EW.Dx.x /Sa +0.5
x=a
W : lge ultime o la gnration est treinte Ea : lesprance de vie lge a Sa : survivants lge dans la table de mortalit pour la population tudie Page | 6
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
Dx : dcs lge X dans la table de mortalit pour la population tudie Le calcul de lesprance de vie, Ea, se fait grce au quotient de mortalit. Cest la probabilit de dcds chaque ge. (Exemple : quotient de mortalit 10 ans sera calcul par rapport au nombre de personne dans une gnration donn (exemple : gnration de 2005). Encore vivante 10 ans. On voit donc que plus la probabilit de dcds est faible plus lesprance de vie est lev. Si les facteurs de mortalit sont les mmes ou pas ? Donc lesprance de vie est-elle le mme ? Il existe des diffrences desprance de vie entre chaque pays. En France, il y a des catgories socio professionnelles qui vivent plus longtemps que dautres. Autres facteurs : le sexe (femme>homme), les rgions, lenvironnement (ville-campagne). La premire cause de dcs en France est les maladies cardio vasculaire. Aprs viennent les maladies professionnelles (maladie reconnue ou pas), les maladies infectieuses, parasitaires (exemple : SIDA). Ensuite les maladies mentales (la France est le premier pays consommateur de tranquillisant). PIGOU conomiste sest intress a la thorie du bien tre. Les suicides sont aussi une cause de dcs en France notamment chez les jeunes. Pour la priode 1982-1996 un cadre de la fonction publique (profession intellectuelle ou artistique) 35 ans, lesprance de vie tait de 46 ans (environ 81 ans), les cadres dentreprises 43.5 ans, les ouvriers qualifis 37 ans, le personnel qui accorde des soins aux particuliers 36.5 ans. Et pour lensemble de la population 40 ans. Il existe des causes endognes et exognes. f- Analyse de la nuptialit et divortialit Taux brut de nuptialit en N = Mariages clbrs en N / pop au 1.1.N + pop au 1.1.N+1 / 2 Taux brut de divortialit en N = nombre de divorce prononc lanne n / pop au 1.1.N + pop 1.1.N+1 / 2 En 1998, on avait un taux de 384.7 pour 1000. Les raisons du divorce sont les plus souvent des raisons financires, culturelles et religieux ou encore sociales. Aujourdhui les femmes sont plus autonomes car elles travaillent.
Page | 7
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
g- La pyramide des ges Cest un histogramme.
Il y a aussi une pyramide en forme de parasol :
Une base large, c'est--dire un taux de natalit lev, plus on avance plus la natalit est leve. On trouve ce modle dans les pays en dveloppement.
Page | 8
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
Pyramide en forme de Toupie :
La base est troite, la mortalit est moins leve. On trouve ce modle dans les pays dvelopps. La vie en couple reste la norme mais on peut constater quil y a de plus en plus de personnes isoles ou monoparentales. Les personnes vivant seules (clibataire ou personne gs). Il y a une forte augmentation des familles monoparentales, cest le plus souvent la mre qui reste avec lenfant et ils vivent sous le seuil de rentabilit. Il y a de la solitude voulu ou subit. La 2me grande rvolution est le nombre de familles recomposs. La 3me rvolution est la diminution du nombre de mariage dans les annes 1990-2000 mais maintenant le nombre semble repartir la hausse. Il semble que face la monte de lindividualisme, le dernier refuge est la famille (solidarit conomique, social). Les familles nuclaires vont-ils exploser ? Actif permanent ou autres = mobilit sociale / conomique. 3- Les mouvements migratoires Yves COPPENS a dit Il ny a quune seule race, la race Humaine . Un dmographe analyse les flux migratoires et se demande pourquoi ce flux ? Il cherche des explications. A lhorizon des 30 ou 40 annes, on ne peut passer cot du problme de limmigration. Deux questions se posent alors : la taille dmographique ? La question du flux est un rapport entre actif et inactif. Et le vieillissement dmographique ? Il y a aussi des questions de flux migratoire intrieur. Il nest pas sr que ce que lon vit lheure actuelle en France nait pas un lien avec les lections venir ? a- Les indicateurs de migration Le taux dimmigration : nombre dimmigr entrant / population moyenne total.
Page | 9
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
Taux dmigration : nombre dmigr sortant / population moyenne. Taux dimmigration net : entrant sortant/ population moyenne total. Taux dmigration net : sortant entrant / population moyenne total. Le taux dmigrer en France est denviron 8%. b- Les facteurs de migration Les migrations internes Lexode rural est un facteur rural. Les raisons sont souvent des raisons gographiques par rapport au climat ou a des raisons conomiques. Les migrations internationales Il existe 3 facteurs : - Facteurs traditionnels : cest tout sauf une vie sdentaire, reprsente lattrait de la ville. Les excdents dmographiques, la colonisation a eu des effets trs importants sur les flux de migration. - Facteurs dordre politiques, militaires et religieux : nouvelle migration. Aujourdhui engendre des phnomnes migratoires. - Facteurs socio culturels : laccs la sant, cadre de vie, les infrastructures, larchitecture, la culture Franaise.
II-
Analyse conomique des migrations
Une dmarche qui peut tre microconomique ou macroconomique. La dmarche microconomique est de lordre de lindividu, la raison est la migration. Le problme qui se pose est quon peut avoir une perception limite de ces migrations. Dun point de vue macroconomique cest limpact tant sur le pays dorigine que sur le pays daccueil. Dans la frontire entre lanalyse conomique il y a des questions politiques et conomiques. On peut facilement imaginer que pour lindividu comme pour les pays dorigines et daccueil il y a des interrogations qui tournent autour du chmage. Le pays qui mettra en place une politique migratoire est un pays qui na pas de taux de chmage lev priori. Il y a galement lide dun vieillissement dmographique. Face cela on va plutt demander une migration jeune qui peut tre une migration de main duvre. Il y a galement des questions propos des perscutions politiques. Il y a galement des questions qui touchent la souverainet nationale. 1- Lapproche microconomique des migrations Soit la migration est un choix, soit cest une contrainte. Pour un certains nombre dconomistes, ceux qui relvent de la thorie standard, no classique ou la nouvelle cole classique, ce qui Page | 10
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
prdomine cest le comportement individuel quon ramne lhomo economicus1. Il y a lide que dans tous les actes il y a un calcul cot-avantage. La migration est un comportement individuel. Il y a des incitations montaires ou non montaires mais on doit faire face des contraintes. Une des contraintes est de quitter son pays, sa famille. Il y a un cot linguistique galement. Au-del de cela il y a le mode de vie, de consommation. On doit faire un calcul entre le cot et les avantages de la migration. Ce calcul est fait par un tre rationnel. Chacun dentre nous est rationnel (pauvre ou riche). Cela veut dire que selon linformation dont on dispose on fait un choix. Aujourdhui, nous navons pas forcment toutes les informations. On peut avoir un calcul rationnel qui nest pas forcment bon. Lessentiel est dobtenir le maximum dinformation et surtout la bonne information. Il ny a pas de fait migratoire qui soit d au hasard. La touche politique est que lindividu est responsable de ses actes et on ne peut pas rejeter la responsabilit lEtat, il ny a pas de place pour ltat. Il y a de la place pour chaque individu. On est dans une dimension o lindividu prend du poids. Il faut que chacun puisse agir dans un espace libre condition que cette libert soit respecte. Tout problme qui vient troubler cet ordre doit tre sanctionn. Ltat doit soccuper du cadre dans lequel lindividu fait son choix. 2- Lapproche macroconomique des migrations Lun des points essentiel est linfluence sur le pays dorigine. Si on prend deux pays X et Y. si le pays X voit une partie de sa population partir vers le pays Y. La main duvre disponible diminue dans le pays X. Les salaires du pays X vont augmenter. Le mouvement migratoire doit tre important. Sur ce march dorigine il faut voir qui part. Quand ce sont les plus jeunes qui partent on a plus de chances quils soient alphabtiss. Derrire les jeunes qui partent il peut y avoir des jeunes qui partent dots dun capital humain qualifi. Cest une perte pour le pays dorigine. Mais un avantage pour le pays daccueil. Nous sommes au cur de la fuite des cerveaux. Il y a des questions qui relvent du cercle vicieux de la pauvret. Il y a un pillage du capital humain. Pour les pays daccueil le point de dpart des migrations est loffre du travail, de main duvre suprieure. Les salaires tirent vers le bas. On a une dnonciation politique mais on est content davoir une main duvre moins cher. Qui dit formation au salari clandestin dit manque de contrat. 3- Dmographie europenne et politique dimmigration On est dans un cadre europen qui confirme un vieillissement de la population. La part des 60 ans augmente. Derrire la baisse de la population comme en Allemagne il y a un vieillissement dmographique. Comment cette tendance va rejaillir sur le march du travail ? A lheure actuelle le march du travail est dsquilibr du fait du chmage notamment avec le chmage des jeunes et des sniors. En 2020 le march du travail va se retrouver en dsquilibre car on va se retrouver en
1
Dans toute situation on essaye de maximiser la situation, obtenir le plus possible dans tous les domaines.
Page | 11
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
pnurie de main duvre. Il y a plusieurs solutions pour rsoudre ce problme : augmenter le dpart la retraite des sniors, agir sur les taux dactivit et en loccurrence le taux dactivit fminin. Inciter les femmes travailler, a va inciter les femmes ne pas avoir denfants. Le problme se pose au niveau national. L o les taux dactivits sont levs a ne peut pas tre mis en place. Il reste la variable de limmigration. Il faut chercher lextrieur des frontires la main duvre dont on a besoin. Si aucune des variables nest suffisante, en terme conomique on aura des externalits ngatives. Tout dabord, le cot de la main duvre augmenterait. Le cot de production aussi. 4- Vieillissement dmographique : retraite et protection sociales En ce qui concerne les retraites. Il faut regarder du ct du financement des retraites. Aujourdhui chaque franais actif doit financer beaucoup plus dinactifs quil y a 30 ans. Combien peut-on sur les paules dun actif financer les inactifs ? Il faut renvoyer aux inactifs leur propre financement de leur retraite. Cest le principe dune retraite par capitalisation. A lheure actuelle nous sommes dans un systme de rpartition mais depuis quelques annes il y a des tentatives de cofinancement. On incite les franais cotiser au-del des cotisations obligatoires (Plan dEpargne Retraite). Une population qui vieillit cot plus cher la scurit sociale. Deux nouvelles dpenses : dpenses dautonomie. Il faut une politique daide domicile. a devient une dpendance on passe donc dune autonomie une dpendance. La question des dpenses de sant, la branche maladie et ct les dpenses de dpendances et dautonomies vont exploser. Les conseils rgionaux financent les dpenses dautonomies. Cela explose, ils se demandent comment ils vont continuer financer. Ils vont donc chercher des financements dans la taxe dhabitation et la taxe foncire. Si lon devait se diriger vers un systme de retraite par capitalisation, est-ce que la mme question peut tre pose pour financer la sant ? La question est lgitime. Il nest pas interdit de penser quil y ait des volutions. Faut-il une efficacit ou une quit des dpenses publiques ?
BOURDIEU, Ce que parler veut dire / Les hritiers
Il y a environ 50, 55 % douvriers employs. A lassemble nationale, il y a moins de 5 % issus douvriers - employs. Rfrence thorique sur la question du financement : Pour pouvoir financer, il faut pargner. La thorie du cycle de vie de Modigliani, approche dveloppe dans les annes 1950. Le comportement dpargne dpend de lge ou de la position de lindividu dans son cycle de vie. Save S => ge => Position de lindividu dans son cycle de vie Cycle de vie : 3 priodes Jeune => pargne ngative Age adule => pargne positive Page | 12
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
Vieillesse => dspargner
En termes de comportements, est-ce que les pauvres npargnent pas ? Si, ils pargnent. Les trs pauvres peuvent pargner. Keynes considrait que le revenu se dcompos entre pargne et consommation. Y = C + S | 1000 = 800 + 200 Y = C + S | 2 000 = 1 000 + 1 000 Propension moyenne : C/Y = 800 / 1 000 | S/Y = 200 / 1 000 C = 0, 8 | S = 0,2 C+S=1 Propension marginale : Yx2 C = 0,5 | S = 0,5 Toute augmentation de revenu va entrainer une augmentation proportionnelle de mon pargne.
Page | 13
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
Chapitre 2 : Les doctrines de population
Deux doctrines sopposent : thse populationniste et les thses anti populationnistes. Dans les premires, cest lapproche malthusienne de lauteur Malthus. Dans la seconde il sagit de lapproche de Marx.
I-
Les thses populationnistes
Formule de Boden : il ny a de richesse que dhomme , 1568. Argument la fois conomique parce que plus il y a dhomme plus de capacit de production mais aussi darguments politiques. A lpoque de lAntiquit Romaine, puissance militaire de Rome => nombre dhommes. Arguments religieux : 1224 1274, Saint Thomas dAquin cest une conception morale de respect de la vie et une conception morale qui fait penser Christine Boutin. Il condamne linfanticide, lavortement et toute autre action qui diminue les naissances. 1- Lapproche Malthusienne Pasteur britannique, professeur, crit en 1798 un essai sur le principe de population. Il dveloppe la misre humaine. Cela est d une population trop nombreuse en raison dune croissance gomtrique suprieure aux subsistances dont la croissance est arithmtique. Population croissance gomtrique r = 2 | 1 2 4 16 196 Subsistance arithmtique 12345 Il est dans ltat desprit u 18me sicle des auteurs classiques libraux. Smith considre que le problme est un problme de capacit productif face la croissance dmographique. Il reprend une ide de Ricardo de ltat stationnaire. Si on aide les plus pauvres, le risque cest quils fassent des enfants. Compte tenu que par ailleurs, il nest pas pour limiter les naissances (mdicalement), il va dvelopper lappel la chastet avant et aprs le mariage. Lauteur conclu quil ne faut pas encourager les pauvres. Aggravation des conditions de vie. 2- Les prolongements de luvre de Malthus Le peuple de Rome a publi un ouvrage Halte la croissance en 1972. Plus la population augmente plus elle pse sur les ressources naturelles. Conviction de ltat stationnaire. Les institutions internationales sont-elles lgitimes pour nous donner des ordres sur les questions dmographiques ? Objet du dbat malthusien et anti malthusien : il faut considrer que si il y a moins denfants, ils se feraient plus plaisir.
Page | 14
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
II-
Les thses anti populationniste et marxistes
1- Les thses anti populationnistes
Platon (428-347 avant J-C), Aristote (385-322 avant J-C), Thomas More (16me sicle) Il y a un souci de lquilibre leffectif dune cit tait fix avec un effectif idal. Cest la conception de la rpublique de Platon. On retrouve la problmatique des hommes, des femmes, des enfants et des esclaves. Aristote reprend cela et considre que la population doit tre contenue dans certaines limites. Thomas More considre que le nombre denfants doit tre limit par famille. Hobbes nhsite pas voquer le fait que la guerre pourrait tre un moyen de limiter la taille de la population quand celle-ci est trop grande. Celui qui tente de mettre plat toutes ces approches est Marx. 2- La thorie marxiste Il y a un apport dans la problmatique marxiste. Lauteur constate un excs de population. La question est de savoir si cest une loi naturelle ou sil y a dautres variables qui peuvent expliquer cela. La problmatique est responsable de la pauprisation ou de la misre. La question de la population doit tre aborde sous son angle quantitatif mais aussi de laspect qualitatif (derrire lexcs de la population ce qui importe le plus cest quune partie soit confront soit la pauvret soit la misre). On retrouve chez Marx un concept essentiel qui est dune part le matrialisme historique et dautre part le matrialisme dialectique. Matrialisme : ce qui compte se sont les conditions matrielles dans lesquelles on vit. Matrialisme historique : pour comprendre les socits on ne peut pas chapper lHistoire. Dans toute socit il y a plusieurs classes sociales mais il y en a deux essentiellement qui sont antagonistes. Il y a la bourgeoisie et le proltariat. Lobjectif du patron est de maximiser son taux de profit. La cration de valeur est le profit. Lorigine mme du profit est lhumain. Or qui reoit la valeur de lhumain ? Une partie de ce qui est cr revient au salari sous forme de salaires, lautre partie aux bourgeois sous forme de profit. Lobjectif de la classe bourgeoise est daccaparer le plus de profits. L o cest injuste cest que ceux qui sont bourgeois font des enfants qui seront bourgeois et les proltaires feront des enfants qui seront eux aussi des proltaires. Il y a du dterminisme et a sinscrit dans lhistoire. Taux de profit p : p = Plus Value / Capital fixe + Capital Variable Plus Value/Capital Variable / Capital fixe/Capital Variable + Capital Variable/Capital Variable => Plus Value/Capital Variable / Capital fixe/Capital Variable + 1 Pour augmenter leurs profits, la bourgeoisie cherche accroitre le numrateur. Au numrateur cest la composition organique du capital (Capital fixe/Capital Variable). Si lobjectif est daugmenter la plus valeur ou le numrateur, a va se faire au dtriment du capital variable. Les salaris au lieu de senrichir vont sappauvrir et les plus pauvres dentre eux peuvent donc tomber dans la pauprisation. Le capitalisme nest pas un systme qui permet de rduire nant la pauprisation, cest un systme qui saccompagne de la pauprisation. Le chmage Page | 15
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
permet davoir une pression tirer la baisse les salaires. Il faut que les ouvriers soient interchangeables. Larme industrielle de rserve (chmeurs) est une caractristique cl du systme. Au lieu de penser que la population est trop importante, la vraie question est le fait que la distribution des revenus est ingalitaire. Il faut revoir le rgime de la proprit prive. Prix Nobel dconomie, Amarcia Sen, conomiste du Bungal. Sans tre marxiste il reconnait travers ltude ralise sur la famine il revient considrer que la famine nest pas un problme de production alimentaire. La production existe. Le problme de la famine cest que soit on a accs la nourriture soit on ny a pas accs. On ny a pas accs car il y a des problmes de rpartition. Le modle de dveloppement que lauteur propose est un modle qui se voudrait tre plus juste.
Page | 16
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
Chapitre 3 : Dmographie et dveloppement
En quoi il y a des liens, des corrlations entre dmographie et dveloppement ? La majorit de la population habite dans les villes en dveloppement. On peut mesurer le dveloppement travers lindicateur de dveloppement humain. Pour Malthus et loppos pour Marx, la question dmographique ne se pose pas dans les mmes termes. Est-ce que la taille dune population peut tre un facteur de sous dveloppement ou est-ce que cest un facteur de dveloppement ?
I-
La croissance dmographique dans les pays en dveloppement
1- Projection de la population mondiale
Projection ralise par linstitut national des tudes dmographiques. 1950 1990 MONDE 2,158 5292 Groupe 1 : 752 millions 1,089 Europe Amrique du Nord Ocanie Ex URSS Groupe 2 : 1,766 4,203 Afrique 222 millions 642 millions Amrique Latine 166 millions 448 millions Chine 555 millions 1,139 Inde 358 millions 853 millions Asie, Autres 465 millions 1,121 pays Un habitant sur deux est un habitant dorigine asiatique.
En milliard
2000 6261 1,143
2050 + 10 000 1,233
5,118 867 millions 538 millions 1,299 1,042 1,372
8,786 2,2265 922 millions 1,521 1,699 2,379
2- La transition dmographique dans les pays en dveloppement Derrire un pays en dveloppement on pense que cest une situation o les taux de natalit, taux de fcondit sont trs levs sans quil y ait de contre tendance. Cela a volu. Il y a une transition dmographique : un pays passe des taux de natalit et de mortalit lev des taux plus faibles. Landry : on peut distinguer trois rgimes quil appelle rgime primitif, priode intermdiaire (transition dmographique) puis un rgime dmographique de maturit. Dans le rgime primitif, il y a une forte fcondit, proche de la fcondit naturelle et forte mortalit d des conditions de vie difficiles plus des problmes dhygine plus des guerres plus des pidmies. Page | 17
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
La priode intermdiaire : il existe des progrs techniques, dveloppement conomique, amlioration des conditions de vie et des conditions dhygine. Tout cela permet de faire baisser la mortalit. Ensuite les mentalits voluent vers un nombre denfants plus limits. La somme de ces deux phnomnes (baisse de la mortalit puis moindre fcondit) aboutie une forte croissance dmographique. Ce schma est le schma europen jusquau dbut du 20me sicle. Rgime dmographique de maturit : ce sont les pays industrialiss ou dvelopps daujourdhui. Taux de mortalit qui a continu de baisser mais un taux de natalit qui lui aussi chute au point o dans certains pays lindice de fcondit nest plus gal 2,1. Il y a une croissance dmographique faible voire ngative. Cela abouti au vieillissement dmographique. Les pays en dveloppement sont entrs dans la phase 2. Il reste toutefois des disparits notamment du fait que certains pays ont un taux dalphabtisation diffrent et un recours la contraception plus ou moins important. En Afrique il y a encore un nombre lev denfant par femme. On est encore aux alentours de 7 au Niger. 1 % des femmes utilisent les moyens de contraceptions. Il y a des contre exemples : 1950-1955 1990-1995 2002-2009 Algrie 7,28 3,85 2,1 Egypte 6,56 3,88 2,1 Maroc 7,17 3,75 2,1 Tunisie 6,87 3,15 2,1 Vieillissement dmographique : Au dbut du 20me les plus de 60 ans reprsentaient 8 % de la population totale des pays en dveloppement. En 2050 se sera 20 % c'est--dire le taux actuel des pays industrialis. Cela tient au faite que la mortalit va continuer, sauf indicateurs contraires2, baisser mais on va aussi constater la poursuite de la baisse de la fcondit. Cest en Afrique que le vieillissement reste le moins fort parce que la fcondit reste encore leve. On doit sattendre des migrations de dizaines dindividus. Il nest pas impossible que les personnes ges migrent. Ce qui est craindre cest une nouvelle forme de pauprisation. Doit-on craindre une population de nouveau trop nombreuse ? Oui et cest des personnes ges. Pour viter cela il faut de la natalit.
II-
Lanalyse compare de la Chine et de lInde
1- La politique de lenfant unique en Chine
Le premier recensement moderne en Chine se fait en 1953 c'est--dire quatre ans aprs la rvolution de Mao Zeitung. La Chine est peuple de 582 millions dhabitants. Le premier ministre Chou En Lai dcide de mettre en place la politique de lenfant unique. Un couple qui dcide davoir un enfant doit avertir les autorits. Il faut quil y ait un accord. Si on donne un
2
Le SIDA, les conflits arms
Page | 18
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
accord positif on sengage ne pas avoir de deuxime enfant. Si jamais on a dautres enfants, on supprime les allocations dont on peut bnficier et on abaisse les salaires, on nous appauvris. Il y a donc une augmentation du nombre davortements. Il y a un infanticide vis--vis des filles. Aujourdhui, il y a un dsquilibre entre les garons et les filles. Cela pose des questions sur les mariages. Ce dsquilibre a eu des consquences sur lhomosexualit. Lindice de fcondit est pass de 5,8 en 1970 2,2 en 1992 et 1,8 en 2000. Il y a une augmentation rgulire de lesprance de vie. Lesprance de vie en Chine 1950-1955 1990-1995 39,9 66,7 42,3 73,9
Homme Femme
2020-2025 72,6 79,4
Les consquences du vieillissement en Chine : Il y a des problmes de lemploi. Cela va poser un problme de croissance conomique. Il y a aussi la question du vieillissement de la population dans les zones rurales. Il y a donc une problmatique alimentaire, agricole. La question qui se pose cest le financement des retraites. Financement des dpenses de sant. Enfin, plus la Chine importe, plus elle pse sur les rserves mondiales. 2- Le cas de lInde LInde a une tradition dmocratique. Elle est indpendante depuis 1948. Il y a de nombreux tats autonomes. Il y a un rgime de multipartismes. Ds les annes 1960 il y a des premires mthodes de contraception proposes, notamment la strilisation chez les femmes et chez les hommes. Lutilisation de la contraception est en partie lie lducation. La baisse de la fcondit est plus lente en Inde quen Chine. Indice de fcondit 1990-1995 3,75 Lesprance de vie en Inde 1950-1955 1990-1995 39,4 60,3 38 60,4
1950-1955 5,97
2020-2025 2,1
Homme Femme
2020-2025 70,5 70,3
Daprs les projections dmographiques, la stabilisation de la population est fixe dans la deuxime moiti du 20me sicle.
Page | 19
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
III-
Croissance dmographique et problme denvironnement
1- La question des ressources naturelles Il y a deux problmes qui se posent : Va-t-on ou non vers un puisement des ressources naturelles ? a comprend la terre, leau, latmosphre, toutes les ressources dans les sous sols ou sous les mers La concentration des richesses et la concentration des populations. Quelle est la probabilit davoir accs ces ressources ? Va-t-il y avoir des problmes propos de la faim ?
Page | 20
A.Closse
Dmographie Ressources Humaines
L3 AES
Le graphique de Lexis
Diagramme qui permet de classer les phnomnes dmographiques dans le temps. En abscisse, on a le temps reprsent par sa dure calendaire. En ordonn, lge de lindividu ou du groupe dindividus. Il y a des lignes horizontales qui reprsentent les anniversaires. Le diagramme a pour avantage de pouvoir analyser lvolution dune gnration c'est--dire en telle anne est ne telle personne. On peut ainsi faire une approche comparative entre ces gnrations successives.
Page | 21
A.Closse
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours Sociologie Du Travail L3 AESDocument29 pagesCours Sociologie Du Travail L3 AESPitchoune6289100% (17)
- Cours Demog PPT - CopieDocument104 pagesCours Demog PPT - CopieAbdou RouaniPas encore d'évaluation
- Cours D'economie - 11e Ses - CorrigeDocument83 pagesCours D'economie - 11e Ses - CorrigeAdams KouribaPas encore d'évaluation
- Cours Contentieux Administratif, Licence AESDocument69 pagesCours Contentieux Administratif, Licence AESPitchoune6289100% (8)
- Cours Économie Internationale, Licence 3 AESDocument31 pagesCours Économie Internationale, Licence 3 AESPitchoune628993% (15)
- Cours Économie D'entreprise, L2 AESDocument54 pagesCours Économie D'entreprise, L2 AESPitchoune6289100% (9)
- Cours Sociologie, L2 AESDocument21 pagesCours Sociologie, L2 AESPitchoune6289100% (3)
- Rapport de StageDocument36 pagesRapport de StageMaryem Hamed100% (3)
- Exercices Corrigs Demographie PDFDocument2 pagesExercices Corrigs Demographie PDFManny100% (1)
- L3 AES, Cours ECONOMIE REGIONALEDocument37 pagesL3 AES, Cours ECONOMIE REGIONALEPitchoune628971% (7)
- Cours Croissance Et Développement, Licence AESDocument30 pagesCours Croissance Et Développement, Licence AESPitchoune6289100% (6)
- Cours Economie Du Travail, L3 AESDocument26 pagesCours Economie Du Travail, L3 AESPitchoune6289100% (8)
- Cours Droit Des Contrats Publics, L2 AESDocument22 pagesCours Droit Des Contrats Publics, L2 AESPitchoune6289100% (1)
- Cours Création D'entreprise, L2 Administration Economique Et SocialeDocument37 pagesCours Création D'entreprise, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (18)
- Cours Droit Administratif, L2 Administration Economique Et SocialeDocument22 pagesCours Droit Administratif, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (3)
- Demographie l1 Correction TD 2021Document7 pagesDemographie l1 Correction TD 2021Ornel DJEUDJI NGASSAM100% (1)
- Correction Du TD de Demographie Licence1 Ua BouakeDocument3 pagesCorrection Du TD de Demographie Licence1 Ua BouakeKouakou aimé Yao100% (1)
- Polycope - Cours DémographieDocument53 pagesPolycope - Cours DémographieAchille DidierPas encore d'évaluation
- Demographie L1 Correction Complete 2021Document25 pagesDemographie L1 Correction Complete 2021Ornel DJEUDJI NGASSAMPas encore d'évaluation
- Exercice Corriges de Demographie PDFDocument2 pagesExercice Corriges de Demographie PDFSandra67% (6)
- Examen Demographie Session 1 2022-2023Document2 pagesExamen Demographie Session 1 2022-2023Kouakou aimé Yao100% (2)
- Leçon 27 - Définitions Et Calcul Des Indicateurs DémographiquesDocument3 pagesLeçon 27 - Définitions Et Calcul Des Indicateurs DémographiquesSébastien ONDO MINKOPas encore d'évaluation
- Cours DémographieDocument35 pagesCours Démographiejonathankowogbia100% (1)
- Exercices Corriges de Demographie Sur La Fecondite PDFDocument2 pagesExercices Corriges de Demographie Sur La Fecondite PDFRosie100% (2)
- Chapitre-3 Démographie L1Document8 pagesChapitre-3 Démographie L1Khalil ByPas encore d'évaluation
- DémographieDocument4 pagesDémographieabdoulaye cissePas encore d'évaluation
- Chap 1 Vocabulaire Et Tableaux de La StatistiqueDocument16 pagesChap 1 Vocabulaire Et Tableaux de La StatistiqueOsmän Abdøu Ibr100% (1)
- 2005 Corriges TD1-3 PDFDocument11 pages2005 Corriges TD1-3 PDFMouhamadou Lamine Sy100% (1)
- Dossier 5 - CorrigeDocument9 pagesDossier 5 - CorrigeCadeau BiteghePas encore d'évaluation
- TD 2corr Demo1000Document6 pagesTD 2corr Demo1000yves rocherPas encore d'évaluation
- DemographieDocument65 pagesDemographieGnaba AlanePas encore d'évaluation
- Demographie QLQ Exercices D'applicationDocument3 pagesDemographie QLQ Exercices D'applicationetogo.nyagaPas encore d'évaluation
- Exercice Demographie PDFDocument2 pagesExercice Demographie PDFDemiah50% (2)
- Cours de Politique Economique Licence de Sciences EconomiquesDocument48 pagesCours de Politique Economique Licence de Sciences EconomiquesAli Safia BaldePas encore d'évaluation
- Correction Calcul TD 1 2 3Document37 pagesCorrection Calcul TD 1 2 3Margot DelarbeyrettePas encore d'évaluation
- Hfe Cours PDFDocument15 pagesHfe Cours PDFa b y s s e ?Pas encore d'évaluation
- Demographie PDFDocument28 pagesDemographie PDFHamid ZEROUALIPas encore d'évaluation
- Macroeconomie TD Corriges 2023Document147 pagesMacroeconomie TD Corriges 2023CAM10 télévision100% (1)
- DemographieDocument5 pagesDemographiemehdiPas encore d'évaluation
- Comptabilité Nationale Exercice & Correction td1Document10 pagesComptabilité Nationale Exercice & Correction td1Essoulahi Essoulahi50% (4)
- NAIRU Et AnticipationsDocument29 pagesNAIRU Et AnticipationsYosra BaazizPas encore d'évaluation
- Examen D'économétrie Maîtrise D'économétrieDocument9 pagesExamen D'économétrie Maîtrise D'économétrieMarco Polo100% (1)
- TDmacroéconomieS2Série N °1 (Pr. AZIZ)Document2 pagesTDmacroéconomieS2Série N °1 (Pr. AZIZ)Nassim AbdousPas encore d'évaluation
- Cours DemographieDocument30 pagesCours DemographieSECRETARIAT IISSPas encore d'évaluation
- Economie Générale ECS 1 INPHB (Enregistré Automatiquement)Document262 pagesEconomie Générale ECS 1 INPHB (Enregistré Automatiquement)marc100% (1)
- Statistique SanitaireDocument32 pagesStatistique SanitaireJoseph DYCKOBAPas encore d'évaluation
- Examen D'econométrie IDocument8 pagesExamen D'econométrie ITaiebi Amine100% (1)
- MACRO Corrigé Examen Final 2018-2019 CopieDocument6 pagesMACRO Corrigé Examen Final 2018-2019 CopieGhazi Ben Jaballah100% (1)
- Exercice Corrigé 20 Distribution ConjointeDocument5 pagesExercice Corrigé 20 Distribution ConjointeElmehdi0% (1)
- Examen 1 Ère Session Statistiques Descriptives 2018 2019 UPGC L1 Sces ÉcoDocument2 pagesExamen 1 Ère Session Statistiques Descriptives 2018 2019 UPGC L1 Sces Écowadanhan100% (2)
- Effets Des Depenses Publiques D'éducation Sur L'économie CamerounaiseDocument41 pagesEffets Des Depenses Publiques D'éducation Sur L'économie CamerounaiseBennaceur ThamiPas encore d'évaluation
- Cours Statistiques-DemographieDocument202 pagesCours Statistiques-DemographieHans HermanPas encore d'évaluation
- Polycopié Exercices de MacroéconomieDocument23 pagesPolycopié Exercices de MacroéconomieSimo MnhPas encore d'évaluation
- 5BMacroe CC 81conomie 5D 20examen 20n C2 B01 20et 20correctionDocument11 pages5BMacroe CC 81conomie 5D 20examen 20n C2 B01 20et 20correctionYsfPas encore d'évaluation
- Macroéconomie - Introduction À L'économieDocument16 pagesMacroéconomie - Introduction À L'économieOverDoc100% (3)
- Cours de Macroeconomie Du DeveloppementDocument45 pagesCours de Macroeconomie Du DeveloppementGuillaume KOUASSI100% (1)
- Doc Leçon 1 Inégalités de DéveloppementDocument1 pageDoc Leçon 1 Inégalités de DéveloppementMoctar Wade100% (1)
- Cours DemographieDocument48 pagesCours DemographieMarc Christ GNALIPas encore d'évaluation
- Statistiques DescriptivesDocument22 pagesStatistiques DescriptivesYassine Kadri100% (3)
- 1 - Définition Et Objet de La Science ÉconomiqueDocument11 pages1 - Définition Et Objet de La Science ÉconomiqueAbdenbiBelghitiPas encore d'évaluation
- TD Redistribution 2010Document4 pagesTD Redistribution 2010mokademaminaPas encore d'évaluation
- Exercise Sur La Pyramide Des Age PDFDocument2 pagesExercise Sur La Pyramide Des Age PDFSandraPas encore d'évaluation
- CORRECTION EXAMEN HFE Session 1 2022-2023Document2 pagesCORRECTION EXAMEN HFE Session 1 2022-2023Kouakou aimé YaoPas encore d'évaluation
- Corrigé Evaluation 1 Economie Du TravailDocument3 pagesCorrigé Evaluation 1 Economie Du Travailchérif hadaminePas encore d'évaluation
- Exercices de RévisionDocument3 pagesExercices de RévisionMalek Sendessni100% (1)
- Dissertation Investissement 2007-2008Document6 pagesDissertation Investissement 2007-2008Mme et Mr Lafon100% (6)
- Cours Économétrie Licence3 2023Document99 pagesCours Économétrie Licence3 2023Souleymane YeoPas encore d'évaluation
- TD 1 - MonnaieDocument2 pagesTD 1 - MonnaieBrahim Tebbaâ100% (2)
- Cours D'économie TSECO - Doc-1Document38 pagesCours D'économie TSECO - Doc-1konatesidy599100% (2)
- Ch2. Fonction de ConsommationDocument14 pagesCh2. Fonction de ConsommationSalim Mejri100% (1)
- Cours Sociologie, L3 AESDocument27 pagesCours Sociologie, L3 AESPitchoune6289100% (1)
- L3 AES, Finances PubliquesDocument74 pagesL3 AES, Finances PubliquesPitchoune628967% (3)
- Cours Villes Et Territoires Urbains, L2 AESDocument20 pagesCours Villes Et Territoires Urbains, L2 AESPitchoune6289Pas encore d'évaluation
- Cours Politiques Économiques, L2 Administration Economique Et SocialeDocument35 pagesCours Politiques Économiques, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (9)
- Cours Droit Pénal, L2 AESDocument43 pagesCours Droit Pénal, L2 AESPitchoune62890% (1)
- Cours Droit Commercial, L2 Administration Economiqueet SocialeDocument69 pagesCours Droit Commercial, L2 Administration Economiqueet SocialePitchoune628950% (2)
- WPS Spécimen CSC ASME IXDocument5 pagesWPS Spécimen CSC ASME IXMenad SalahPas encore d'évaluation
- Calcul de Pont Type - Ponts CadreDocument37 pagesCalcul de Pont Type - Ponts CadreMansour LassouedPas encore d'évaluation
- 1876 20151205 PDFDocument25 pages1876 20151205 PDFelmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- Fr-esr-Descriptif Ed Historique AnnuelDocument2 pagesFr-esr-Descriptif Ed Historique AnnuelOrnella ANAGONOU-ZODJIPas encore d'évaluation
- Ileus Biliaire Avec Evacuation Spontanee Dun Gros Calcul: A Propos Dun CasDocument3 pagesIleus Biliaire Avec Evacuation Spontanee Dun Gros Calcul: A Propos Dun CasIJAR JOURNALPas encore d'évaluation
- Le Chemin de La Baie N 7Document4 pagesLe Chemin de La Baie N 7ecenarroPas encore d'évaluation
- Plan Fundatie 1 3: Sectiunea 1 - 1 Sectiunea 2 - 2 Sectiunea 3 - 3 Sectiunea 4 - 4Document1 pagePlan Fundatie 1 3: Sectiunea 1 - 1 Sectiunea 2 - 2 Sectiunea 3 - 3 Sectiunea 4 - 4Proiectare constructii BucurestiPas encore d'évaluation
- GuideTechnique LCPC GTINPONTDocument128 pagesGuideTechnique LCPC GTINPONTYacine NadirPas encore d'évaluation
- Formation Du Subjonctif PDFDocument1 pageFormation Du Subjonctif PDFEkaterina TsarkovaPas encore d'évaluation
- La Ruine Presque Cocasse D'un PolichinelleDocument140 pagesLa Ruine Presque Cocasse D'un PolichinelleandrePas encore d'évaluation
- TransForce Transverse Arch Developing AppliancesDocument2 pagesTransForce Transverse Arch Developing AppliancesOrtho OrganizersPas encore d'évaluation
- Le Commerce InternationaleDocument98 pagesLe Commerce Internationaleabderrahim.elmastour1Pas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document3 pagesChapitre 3Amal Bouaziz Ep BakloutiPas encore d'évaluation
- Traffic PlaybookDocument12 pagesTraffic Playbooksylvain NYETAMPas encore d'évaluation
- Tele-Immatriculation CNPSDocument2 pagesTele-Immatriculation CNPSlegende androidePas encore d'évaluation
- Patrimoine Bâti - À Chacun Sa Pierre - Parc Naturel Régional de ...Document24 pagesPatrimoine Bâti - À Chacun Sa Pierre - Parc Naturel Régional de ...Camelia SmahanPas encore d'évaluation
- CoursDocument35 pagesCourschahrazed youtubePas encore d'évaluation
- LogDocument3 pagesLogZakaria El KhiyatiPas encore d'évaluation
- WHJDR Magie ElfiqueDocument3 pagesWHJDR Magie ElfiqueRyu OsakiPas encore d'évaluation
- Le Choix de La PureteDocument4 pagesLe Choix de La PureteOlivier KangoPas encore d'évaluation
- Flux GpaoDocument1 pageFlux GpaoAbdessalem BachaPas encore d'évaluation
- 01 Lima Action Plan FR FinalDocument13 pages01 Lima Action Plan FR FinalSalomé DahanPas encore d'évaluation
- Alimentation D Un Moteur DieselDocument128 pagesAlimentation D Un Moteur DieselJdd Kas100% (4)
- Évaluation SDEDocument4 pagesÉvaluation SDEnc9qg6jmh7Pas encore d'évaluation
- 2018-Chap4-Application Du Premier PrincipeDocument54 pages2018-Chap4-Application Du Premier PrincipeOthMane TaPas encore d'évaluation
- La Lettre Des Militants Socialistes de VilleurbanneDocument4 pagesLa Lettre Des Militants Socialistes de VilleurbanneParti Socialiste VilleurbannePas encore d'évaluation
- AmbroxanDocument3 pagesAmbroxanmohamedtounsi2012Pas encore d'évaluation
- RapportPFE HouyemDocument79 pagesRapportPFE HouyemSebastian MessiPas encore d'évaluation
- Transformateur MonophaséDocument10 pagesTransformateur MonophaséYASSINE ALMOUTAOUAKILPas encore d'évaluation