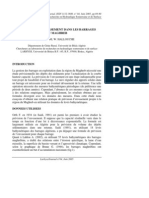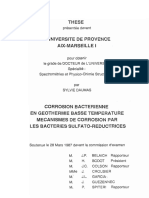Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
GE5E - 2015 - CADART - Mémoire PDF
Transféré par
AbouZakariaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
GE5E - 2015 - CADART - Mémoire PDF
Transféré par
AbouZakariaDroits d'auteur :
Formats disponibles
PROJET DE FIN D’ÉTUDES
Mise en place d’une méthodologie pour l’élaboration
des SChémas d’Orientation du Réseau Électrique
Priscille Cadart
2 Février – 31 Juillet 2015
Tuteur en entreprise Professeur responsable
Sylvain JOSSERON Natacha NGO
ERDF INSA de Strasbourg
57, rue Bersot 24, boulevard de la Victoire
25000 BESANCON 67084 STRASBOURG
03 81 83 81 57 03 88 14 47 00
Spécialité Génie Électrique
Option Énergie, Septembre 2015
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier tout d’abord l’entreprise ERDF de m’avoir donné cette occasion de découvrir
les métiers de la distribution électrique. J’ai beaucoup appris grâce à ce stage, autant du point de
vue technique que sur le plan humain et organisationnel.
Je souhaite également remercier les personnes qui m’ont accompagnée durant ce stage :
Sylvain Josseron, mon tuteur de stage, pour son suivi assidu, ainsi que pour la confiance et l’aide
qu’il m’a apportées.
Quentin André et Fouad El Mansouri, mes voisins de bureau, pour avoir eu la patience de
répondre à toutes mes questions et pour m’avoir guidée dans le fonctionnement du service.
Toute l’équipe de l’agence MOAD pour leur accueil, pour la bonne ambiance et l’entraide qui
règne dans le service.
Je tiens enfin à remercier Loïc Ausset et Alice Sher, pour m’avoir accompagnée dans la découverte
de la ville de Besançon, ainsi que ma sœur Lucie et Arthur pour leur présence et leur soutien.
GE5E 2015 CADART Priscille
FICHE D’OBJECTIFS
Ce projet de fin d’études consiste en la conception d’une méthodologie d’élaboration des
SChémas d’Orientation du Réseau électrique (SCORE), documents permettant l’optimisation et la
planification à moyen et long terme de la structure du réseau de distribution électrique.
Le stage s’inscrit dans une démarche de mise en application locale de notes nationales ERDF
publiés récemment sur les SCORE, et de facilitation du travail des membres du Bureau d’Etude
Régional Electricité (BERE) de la Direction Régionale Alsace-Franche-Comté (AFC).
L’objectif est de dégager des outils et une méthode simplifiée pour que les chargés d’études
puissent mettre à jour les documents existants (appelés Schémas Directeurs) en vue de les
transformer en SCORE. Pour ce faire, les objectifs suivants ont été fixés :
1. Lister les différences entre les deux versions (2007 et 2014) des documents nationaux.
2. Etudier le travail déjà réalisé au niveau du BERE AFC, ainsi que les modes opératoires et les
outils de calcul et de mise en forme existants chez ERDF (BERE d’autres régions, national,
etc.)
3. Rechercher les informations externes à utiliser (documents des collectivités, schémas
directeurs pour la production décentralisée, etc.) et proposer une méthode d’intégration
des données.
4. Développer des notices pour mettre à profit les fonctionnalités spécifiques à l’élaboration
des SCORE du logiciel de calcul de réseau ERABLE. Développer également des outils
d’affichage cartographique sur le logiciel QGIS.
5. Etablir un mode opératoire de réalisation et de mise à jour des SCORE pour le BERE.
6. Elaborer et mettre à jour les outils de synthèse des SCORE selon les différents acteurs (outil
pour le planificateur, outil pour le chargé d’études, outil de communication externe).
7. Tester la pertinence de la méthodologie sur des cas concrets : réaliser un ou deux
SCORE (ex : zone urbaine, zone rurale), si possible dans une zone nécessitant la création
d’un Poste Source.
8. Présenter les différents outils méthodologiques aux membres du BERE.
GE5E 2015 CADART Priscille 1
RESUME
Auteur : CADART Priscille Promotion : 2015 – Génie Electrique Option
Energie
Titre : Mise en place d’une méthodologie Soutenance : Septembre 2015
d’élaboration des SChémas d’Orientation du Réseau Tuteur école : NGO Natacha
Electrique
Structure d’accueil : ERDF – Direction Régionale Alsace Franche-Comté
57 rue BERSOT – 25000 BESANCON
Tuteur entreprise : JOSSERON Sylvain
Nb de volume(s) : 1 Nb de pages : 51
Nb de références bibliographiques : 8
Résumé :
ERDF est le gestionnaire du réseau de distribution (moyenne et basse tension) sur 95% du
territoire Français. Le Bureau d’Etudes Régional Electricité de Besançon est chargé d’étudier les
affaires de renouvellement, renforcement et développement du réseau sur le territoire de la
Direction Régionale Alsace Franche-Comté. Les ouvrages construits ayant une durée
d’amortissement minimum de 30 ans, il est nécessaire d’anticiper la structure du réseau sur cette
durée afin d’optimiser les investissements. C’est l’objectif des SChémas d’Orientation du Réseau
Electrique (SCORE). Dans le cadre de mon Projet de Fin d’Etudes, j’ai établi une méthodologie
pratique d’élaboration de ces documents et développé des outils pour optimiser le temps de
travail, tout en permettant de compléter l’étude par des problématiques émergeantes. J’ai
également développé des outils de synthèse mettant à profit les résultats des SCORE pour l’aide à
la décision des investissements.
Mots clés : Distribution électrique / Développement du réseau / Maîtrise d’ouvrage / Planification/
Optimisation des investissements
Abstract :
ERDF is the Distribution System Operator on 95% of the French electric grid. The regional design
office of Besancon is responsible for studying renewal, reinforcement and development projects
for the Alsace Franche-Comté medium voltage power network. As network facilities have a
depreciation period of 30 years as a minimum, it is necessary to anticipate the network structure
over the longer term. This is the goal of the electrical grid blueprints, called SCORE. My final year
project consisted in establishing a practical methodology to draw up these plans. I developed tools
to optimize the working hours, thus freeing up time to study emerging technical issues. I also
developed decision support tools that synthesize the blueprints in order to optimize the
investments.
GE5E 2015 CADART Priscille 2
SOMMAIRE
Fiche d’objectifs ................................................................................................................................... 1
Résumé................................................................................................................................................. 2
Table des illustrations .......................................................................................................................... 5
Introduction ......................................................................................................................................... 6
Contexte de l’étude.............................................................................................................................. 7
1 Fonctionnement du secteur et de l’entreprise ............................................................................ 7
1.1 Organisation du secteur de l’énergie électrique ................................................................... 7
1.2 Contexte de la distribution électrique .................................................................................. 7
1.3 Fonctionnement de l’entreprise [1] ...................................................................................... 8
2 Le Bureau d’Etudes de l’agence Maîtrise d’Ouvrage de Décision .............................................. 10
2.1 Activités et missions ............................................................................................................ 11
2.1.1 Traitement des finalités ............................................................................................... 11
2.1.2 Etudes complémentaires ............................................................................................. 13
2.2 Fonctionnement .................................................................................................................. 15
2.2.1 Réalisation d’une étude ............................................................................................... 15
2.2.2 Outils informatiques utilisés ........................................................................................ 16
Projet réalisé ...................................................................................................................................... 17
1 Présentation du sujet et de la démarche ................................................................................... 17
2 Etude Bibliographique ................................................................................................................ 18
2.1 Structure du SCORE [4] ........................................................................................................ 18
2.2 Analyse des schémas directeurs existants .......................................................................... 22
3 Nouvelles Problématiques .......................................................................................................... 25
3.1 Développement du territoire .............................................................................................. 25
3.1.1 Agence Raccordement Marché d’Affaires (ARMA)...................................................... 25
3.1.2 Collectivités territoriales .............................................................................................. 26
3.1.3 Directions Territoriales ................................................................................................ 28
3.2 Analyse de la qualité de fourniture ..................................................................................... 29
GE5E 2015 CADART Priscille 3
3.3 Intégration de la production décentralisée ........................................................................ 30
3.3.1 Le SRRRER (Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables) ........................................................................................................................... 30
3.3.2 Le BE Producteurs ........................................................................................................ 31
3.4 Prise en compte du courant capacitif ................................................................................. 33
4 Planning Réalisé et Difficultés rencontrées ................................................................................ 35
Résultats ............................................................................................................................................. 37
1 Restitutions du SCORE ................................................................................................................ 37
1.1 Rapport de synthèse ........................................................................................................... 37
1.2 Restitutions cartographiques .............................................................................................. 39
2 Macro de mise en forme ............................................................................................................ 42
2.1 Analyse du besoin................................................................................................................ 42
2.2 Mise en place des solutions techniques.............................................................................. 43
2.3 Apports et limites ................................................................................................................ 46
3 Outils d’Aide à la décision ........................................................................................................... 47
Conclusion .......................................................................................................................................... 50
Bibliographie ...................................................................................................................................... 51
GE5E 2015 CADART Priscille 4
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Figure 1 - Organisation du secteur de l'énergie électrique ................................................................. 7
Figure 2 – Organisation de l’entreprise en DIR puis DR ....................................................................... 8
Figure 3 - Organigramme fonctionnel de la DR AFC ............................................................................ 9
Figure 4 - Organigramme de l'agence MOAD .................................................................................... 10
Figure 5 - Répartition des finalités selon les axes .............................................................................. 11
Figure 6 - Technologie CPI .................................................................................................................. 12
Figure 7 - Principe de réalimentation par dichotomie ....................................................................... 13
Figure 8 - Schéma simplifié du réseau HTA........................................................................................ 14
Figure 9 - Eléments constitutifs d'un poste source............................................................................ 14
Figure 10 - Planning prévisionnel ....................................................................................................... 17
Figure 11 - Courbes d'évolution des puissances données par CRISTINA ........................................... 19
Figure 12 - Tableau des seuils d’optimisation du réseau ................................................................... 21
Figure 13 - Carte de découpage du centre ALSACE (063) autour de Mulhouse ................................ 22
Figure 14 - Planification du raccordement des Zones d'Aménagements Concerté .......................... 23
Figure 15 - Exemple de diagnostic par départs.................................................................................. 24
Figure 16 - Exemple de diagnostic qualité ......................................................................................... 24
Figure 17 - Vue de l'outil MOA-Pilot .................................................................................................. 26
Figure 18 - Carte issue du SCoT de l'agglomération Bisontine .......................................................... 27
Figure 19- Eléments de développement économique du secteur Bas-Rhin ..................................... 28
Figure 20 - Seuils issus de l'arrêté qualité du 18/02/2010 ................................................................ 29
Figure 21 - Exemples de projets réseau engagés par RTE dans des zones saturées par la production
décentralisée ...................................................................................................................................... 31
Figure 22 - Impact de la production sur les profils de tension .......................................................... 32
Figure 23 - Courants capacitifs en régime normal (équilibré) ........................................................... 34
Figure 24 - Courants capacitif lors d'un défaut monophasé à la terre (déséquilibre) ....................... 34
Figure 25 - Tableau des contraintes de 3I0 par transformateur........................................................ 34
Figure 26 - Seuils de 3I0 par départ selon le régime de neutre du transformateur .......................... 35
Figure 27 - Planning réalisé ................................................................................................................ 36
Figure 28 - Plan du rapport SCORE .................................................................................................... 37
Figure 29 - Légende de la carte des taux d'accroissement et des clients importants ....................... 39
Figure 30 - Légende de la carte de diagnostic des ouvrages ............................................................. 40
Figure 31 - Légende de la carte des résultats électriques sur réseau initial...................................... 40
Figure 32 - Liste des restitutions à fournir à l'aide du logiciel ERABLE .............................................. 42
Figure 33 - Diagramme "Bête à cornes" de la macro......................................................................... 42
Figure 34 - Diagramme "Pieuvre" de la macro .................................................................................. 43
Figure 35 - Menus d'importation ....................................................................................................... 43
Figure 36 - Présentation des résultats électriques par départs......................................................... 44
Figure 37 - Seuils de la mise en forme conditionnelle pour l'analyse des résultats par départ ........ 44
Figure 38 - Interface de l'outil ............................................................................................................ 45
Figure 39 - Exemple de restitution ERABLE ....................................................................................... 46
Figure 40 - Tableau de paramétrage .................................................................................................. 46
Figure 41- Estimations des coûts de main d'œuvre ........................................................................... 46
Figure 42 - Tableau de résumé du SCORE par départs ...................................................................... 48
Figure 43 - Numéros à renseigner selon les types de travaux ........................................................... 48
Figure 44 - Tableau récapitulatif de tous les Schémas Directeurs ..................................................... 49
GE5E 2015 CADART Priscille 5
INTRODUCTION
Dans le cadre de mon Projet de Fin d’Etudes à l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de
Strasbourg, j’ai intégré ERDF (Electricité Réseau Distribution France) pour un stage de 6 mois, du 2
février au 31 juillet 2015.
J’ai rejoint le Bureau d’Etudes Régional Electricité de la Direction Régionale d’Alsace Franche-
Comté à Besançon. Ce service est chargé de réaliser les études pour la conception, l’amélioration
et la modernisation du réseau de distribution électrique.
Ce rapport présente le travail effectué et la réflexion menée pour l’établissement d’une
méthodologie d’élaboration des SChémas d’Orientation du Réseau Electrique (SCORE). Ces
documents permettent l’optimisation et la planification à moyen et long terme de la structure du
réseau de distribution électrique. Ils sont essentiels au fonctionnement du BERE car tous les
ouvrages électriques posés le sont pour 30 ans minimum.
Dans un premier temps, je présenterai le contexte du sujet en expliquant le fonctionnement du
secteur, de l’entreprise et du service puisque les SCORE recouvrent toutes les activités de ce
dernier. Dans une deuxième partie j’aborderai le projet réalisé et présenterai les différentes
problématiques traitées. Enfin, j’exposerai les résultats du travail et les apports pour l’entreprise.
GE5E 2015 CADART Priscille 6
CONTEXTE DE L’ETUDE
1 FONCTIONNEMENT DU SECTEUR ET DE L’ENTREPRISE
1.1 Organisation du secteur de l’énergie électrique
Production Transport Distribution Fourniture
BT (400V)
HTB (400, 225, 90, 63kV) HTA (20kV) Facture
Marché concurrentiel Marché régulé Marché régulé Marché concurrentiel
dérégulé dérégulé
Figure 1 - Organisation du secteur de l'énergie électrique
La Figure 1 présente le secteur de l’énergie électrique tel qu’il est organisé aujourd’hui en
France, pour respecter les directives européennes liées au marché de l’énergie [1].
Le monopole structurel est assuré pour les secteurs du transport et de la distribution de
l’énergie. Ce monopole permet une gestion optimisée du réseau, pour un coût d’acheminement
uniformisé. On parle de marché régulé. En effet, les entreprises opérant sur ces secteurs sont
soumises à des lois et des décrets de fonctionnement et sont contrôlées par la Commission de
Régulation de l’Energie (CRE).
Les réseaux de transport et de distribution sont deux réseaux électriques qui se distinguent
par leur niveau de tension : HTB pour le transport et HTA/BT pour la distribution. Le transport est
assuré par RTE (Réseau de Transport d’Electricité), la distribution par ERDF, deux sociétés filiales
d’EDF.
1.2 Contexte de la distribution électrique
Le contexte économique du secteur de la distribution d’électricité est lié à des paramètres
historiques [2]. Depuis la fin du 19e siècle, ce sont les communes qui sont responsables de
l’électrification (réseau moyenne et basse tension : HTA et BT) de leur territoire. Celles-ci sont
propriétaires des ouvrages du réseau et ont alors le choix entre deux modes de gestion pour
l’exploitation, la maintenance et le développement de celui-ci. En se regroupant et en s’organisant
en syndicats, elles peuvent confier ces tâches sous la forme d’une concession de service public à
une entreprise privée (qui devient concessionnaire), ou alors transmettre leurs compétences de
maîtrise d’ouvrage à un organisme public, appelé Entreprise Locale de Distribution (ELD, ex :
Régie, SICAE, etc.).
A l’issue de la seconde guerre mondiale, l’électrification devient une priorité nationale pour
le développement économique et la loi de 1946 prévoit la nationalisation de toutes les entreprises
privées d’électricité : c’est la création d’EDF, qui devient alors concessionnaire unique du réseau.
Cette loi exclut cependant les ELD qui restent indépendantes et conservent le monopole sur leurs
territoires. Il subsiste en France environ 170 entreprises de ce type, qui ont été privatisées depuis.
En 2000, les directives européennes imposant l’indépendance des Gestionnaires de Réseau
de Distribution (GRD) entrent en droit français. La distribution est alors filialisée au sein d’EDF par
la création d’ERDF (Electricité Réseau Distribution France), effective en 2008.
GE5E 2015 CADART Priscille 7
1.3 Fonctionnement de l’entreprise [1]
C’est dans ce contexte qu’ERDF assure aujourd’hui la maintenance, l’exploitation, le
dépannage et le développement de plus de 95% du réseau de distribution français, pour le compte
des autorités concédantes [2]. Son rayon d’action s’étend des postes sources, points frontières
avec RTE, jusqu’aux compteurs basse tension de ses 35 millions de clients. Pour remplir ses
missions, ERDF est rémunérée par les fournisseurs d’électricité via le mécanisme du TURPE (Tarif
d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité).
L’entreprise est organisée en 8 Directions InterRégionales (DIR), comme présentées sur la
Figure 2. Chacune de ces DIR est divisée en plusieurs Directions Régionales (DR). J’ai intégré pour
ma part, la DR Alsace-Franche Comté (AFC) au sein de la DIR EST.
DR Alsace
Franche-Comté
DIR EST DR Lorraine
DR Champagne-
Ardenne
Figure 2 – Organisation de l’entreprise en DIR puis DR
Cette dernière est chargée de la gestion du réseau de distribution sur toute la région
Franche-Comté ainsi que la région Alsace, à l’exception des ELD (nombreuses sur la DR : Electricité
de Strasbourg, SICAE Est à Vesoul, Régie de Colmar, etc.). La DR AFC recouvre 6 départements : le
Doubs, le Jura, la partie Sud du Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône et le territoire de Belfort.
Cela représente, d’un point de vue réseau : 79 Postes Sources, 156 transformateurs HTB/HTA et
811 départs HTA.
La DR est organisée en 3 fonctions principales : Opérations, Service Client et enfin
Patrimoine et Raccordement, qui sont complétées par les fonctions support (RH, Contrôle de
Gestion, Prévention) ventilées dans l’organigramme présenté Figure 3.
GE5E 2015 CADART Priscille 8
Figure 3 - Organigramme fonctionnel de la DR AFC
La fonction "Opérations" regroupe quatre Agences d’Exploitation (AE) réparties par site
(Franche Comté Nord, Franche Comté Centre, Jura et Alsace) comprenant 60 à 80 personnes
chacune. Elles assurent principalement le dépannage et la maintenance du réseau sur leurs zones.
Elle comporte également une Agence spécialisée dans la Maintenance et l’Exploitation des Postes
Sources (AMEPS) et une unité spécialisée dans les Travaux Sous Tension HTA. Elle est dotée par
ailleurs d’un pôle Réseau, chargé de la centralisation et de la coordination des opérations de
maintenance (Fiabilisation), de conduite (ACR) et de gestion des accès au réseau (BEX).
La fonction "Patrimoine et Raccordement" est organisée en 5 services : deux agences
Raccordement, une agence Maîtrise d’Ouvrage de Décision, une Agence Ingénierie et Travaux, et
une agence de Cartographie.
L’agence Cartographie est chargé de mettre à jour les Systèmes d’Information
Géographiques (SIG) grande et moyenne échelle, ainsi que la base de description physique et
électrique des ouvrages du réseau. C’est sur cette dernière que s’appuient les différents progiciels
de calcul électrique utilisés au sein d’ERDF.
Les deux agences Raccordement se partagent l’étude (dimensionnement, chiffrage) du
raccordement des clients selon leur type : marché d’affaires ou marché grand public et
professionnel. On différencie ces types de clients car ils impliquent des puissances souscrites et
des adaptations de réseau différentes.
L’agence Maîtrise d’Ouvrage de Décision (MOAD) est chargée de la phase d’étude des
projets de modernisation, développement et renouvellement du réseau. L’agence Ingénierie et
Travaux (également appelée MOAR, pour Maîtrise d’Ouvrage de Réalisation) est chargée, comme
son nom l’indique, de la gestion et de la supervision des affaires (qu’elles soient issues du
raccordement ou de la MOAD) lorsqu’elles passent de la phase d’étude à la phase de réalisation
(mission mixte de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre).
D’autres éléments importants du réseau de distribution, les Postes Sources (PS) et les
producteurs HTA, sont gérés au niveau de la DIR EST par la MOAD PS, le Bureau Régional
Ingénierie Postes Sources et le Bureau d’Etudes Producteurs.
GE5E 2015 CADART Priscille 9
2 LE BUREAU D’ETUDES DE L’AGENCE MAITRISE D’OUVRAGE DE DECISION
J’ai intégré le Bureau d’Etudes Régional Electricité (BERE) de l’agence MOAD pour effectuer
mon stage de fin d’études. L’agence est récemment issue d’une fusion de plusieurs services : la
MOAD HTA, qui incluait le BERE, et la MOAD BT, qui incluait le service Déplacements d’Ouvrage
(DO) et le service Electrification Rurale (ER). Son organisation est décrite par l’organigramme de la
Figure 4.
Figure 4 - Organigramme de l'agence MOAD
Le service Electrification Rurale est lié au régime de concession à l’œuvre en zone rurale. En
effet, dans ces zones, les syndicats départementaux d’énergie (concédants) ont la maîtrise
d’ouvrage pour la majorité des types de travaux sur le réseau BT (raccordement, renforcement et
esthétique), c’est-à-dire que ce sont eux qui réalisent les investissements. Ce n’est pas le cas en
régime urbain, où ils n’ont la responsabilité des investissements que sur les travaux d’esthétique
sur le réseau BT. Ils n’ont cependant pas toutes les compétences pour le dimensionnement des
affaires à réaliser, c’est pourquoi ils transmettent leurs projets à ERDF pour validation technique.
J’ai intégré plus précisément l’équipe des chargés d’études spécialisés en HTA. Ceux-ci se
répartissent les études de la région AFC par zone : Franche-Comté Nord, Franche-Comté Centre,
Jura, Alsace Nord (67-68) et Alsace Sud (68).
GE5E 2015 CADART Priscille 10
2.1 Activités et missions
Les missions du BERE s’articulent autour :
- d’études pour la MOAD délibéré (amélioration, développement et renouvellement du
réseau)
- d’activités électriques complémentaires.
La MOAD réalise ses investissements sur le réseau selon une stratégie ayant pour objectif
l’amélioration (a minima le maintien) de la qualité de fourniture. Les politiques d’investissement
sont définies au niveau national et sont réparties selon 3 axes majeurs : fiabilité, réactivité et
structure. Différentes finalités relatives à ces axes sont mises en place, selon le tableau de la
Figure 5. Le BERE se charge de constituer un portefeuille d’affaires répondant à ces finalités et les
transmet ensuite à la MOAD pour qu’elle rende sa décision d’investissement. Les méthodologies
et les actions à entreprendre pour réaliser les études techniques sont définies au niveau national
sous forme de documents appelés Prescription du Réseau de Distribution Electrique (PRDE).
Axe Finalités
Plan Aléas Climatiques (PAC)
Plan de Renouvellement de Câbles (PRC)
Fiabilité Prolongation de la Durée de Vie (PDV)
Renouvellement partiel des réseaux aériens
Sécurité
Plan d’Amélioration de la Réactivité (PAR)
Réactivité
Sécurisation des zones urbaines denses
Structure Plan d’Accompagnement du Développement du Territoire
(PADT)
Figure 5 - Répartition des finalités selon les axes
Le BERE se charge également d’études complémentaires pour d’autres services :
- Etudes de reprise (N-1, effacement, report de charges) pour l’Agence de Conduite
Régionale
- Etudes sources pour la MOAD Postes Sources
- Plans de protection à destination de l’AMEPS (Agence de Maintenance et
d’exploitation des Postes Sources)
- SChémas d’Orientation du Réseau Electrique (SCORE) pour la planification
2.1.1 Traitement des finalités
Fiabilité
Le PAC (Plan Aléas Climatiques) a été mis en place suite à la tempête de 1999 durant
laquelle la faiblesse des ouvrages lors d’incidents climatiques exceptionnels a été mise en
évidence. Sur le territoire Français, 100 000km [3] de réseau ont ainsi été référencés comme situés
dans des zones dites « à risque avéré » d’incidents d’origine climatique (neige collante, vent, bois).
Les études PAC consistent à étudier les solutions de réduction de la vulnérabilité de ces ouvrages
aux évènements climatiques exceptionnels (mise en souterrain, nouveau tracé, etc.). La mise en
souterrain correspondant à un coût d’environ 100€ par mètre, et les tracés souterrains étant
généralement plus longs que les tracés aériens, il est nécessaire de prioriser les affaires selon leur
pertinence. On traite ainsi en priorité les tronçons situés sur l’artère principale d’un départ. Sur
GE5E 2015 CADART Priscille 11
AFC, cela représente environ 640km de réseau, à traiter au fur et à mesure des dotations
financières. On prend en compte pour la priorisation la réalité du nombre d’incidents, les temps
de coupures occasionnés ainsi que la charge impactée.
Les autres portions de réseau aérien requérant un renouvellement (pour cause de vétusté
par exemple), mais dont l’enfouissement n’est pas jugé pertinent, sont traitées en renouvellement
partiel des réseaux aériens.
Les études PRC (Plan de Renouvellement de Câbles) correspondent à l’étude du
remplacement des câbles souterrains utilisant la technologie d’isolation Papier Imprégné (appelés
CPI, voir Figure 6). Cette technologie des années 60-70 est obsolète et particulièrement
incidentogène. Elle équipe principalement les réseaux urbains, à majorité souterrains. Or, ces
réseaux sont caractérisés par une densité de clients importante, ce qui donne beaucoup d’impact
aux incidents. De la même manière que pour le PAC, les 580 km de câbles papier de la Direction
Régionale ne peuvent pas être tous traités simultanément. Des indicateurs de priorisation sont
donc mis en place, et prennent en compte les taux d’incidents au km, les longueurs impactées ou
encore la puissance desservie.
1 – Ame câblée circulaire en aluminium
2 – Ecran semi-conducteur
3 - Papier imprégné de matière non migrante
4 – Ecran métallisé
5 – Gaine d’étanchéité au plomb
6 – Gaine extérieure en polychlorure de vinyle (PVC)
Figure 6 - Technologie CPI
Les études PDV (Prolongation de la Durée de Vie) sont des études situées entre la
maintenance et la remise à neuf complète de l’ouvrage. Demandant un financement trop lourd
pour être réalisé sur le budget de fonctionnement (OPEX, pour OPerating EXpenditure), les projets
passent sur le budget d’investissement (CAPEX, pour CAPital EXpenditure) et visent une
prolongation de 15 ans de la durée de vie des ouvrages. Comme les ouvrages neufs sont posés en
général pour une durée cible de 40 ans, seuls les ouvrages de plus de 25 ans sont éligibles à ces
études qui impliquent un diagnostic complet des défaillances du matériel (réalisé par le service
Fiabilisation et les exploitants du réseau sur le terrain).
La finalité Sécurité rassemble les études permettant la remise aux normes de certains
réseaux et également celles qui répondent à des demandes spécifiques des collectivités locales.
Réactivité
La réactivité caractérise la capacité du réseau à permettre la réalimentation le plus
rapidement possible du plus grand nombre de clients lors d’un incident. Agissant sur un marché
public, le distributeur se doit de remplir des objectifs de qualité de fourniture chiffrés dans un
décret. Plusieurs critères permettent d’évaluer la qualité de fourniture, ils seront développés en
partie II.
Les études PAR (Plan d’Amélioration de la Réactivité) correspondent à la mise en place de
solutions pour respecter le décret. L’apparition d’un défaut sur un tronçon entraîne
automatiquement l’ouverture du disjoncteur du départ correspondant, et donc la coupure de tous
les clients du départ (jusqu’à 5000). On réfléchit donc à la mise en place de moyens permettant
d’identifier les tronçons sains, de tronçonner et de boucler des départs entre eux pour permettre
la réalimentation rapide (avant dépannage) du plus grand nombre de clients possible. Les
matériels à disposer en conséquence sont les Organes de Manœuvre Télécommandés (OMT), les
Indicateurs Lumineux de Défauts (ILD) et les Points de Première Intervention (PPI).
GE5E 2015 CADART Priscille 12
Les ILD sont des détecteurs de défaut associés à un voyant. Ils sont couplés à un organe de
manœuvre (manuel ou télécommandé). Les OMT et les ILD sont reliés avec le centre de conduite
par radio ou connexion de type téléphonique pour permettre respectivement leur fonctionnement
et leur lecture par des automatismes ou par les agents de conduite à distance. Une fois l’analyse et
les manœuvres à distance opérées, c’est à l’agent d’exploitation d’intervenir, en commençant par
les PPI. Ceux-ci permettent d’accélérer la réalimentation des portions de réseau saines, grâce au
principe de dichotomie, comme illustré Figure 7. Le Bureau d’Etudes positionne ceux-ci au milieu
d’une poche de charge et les prévoit équipés d’Organes de Manœuvre Manuels (OMM) et d’ILD
dans une (ou plusieurs) direction. Grâce aux ILD, l’agent peut voir de quel côté venait le défaut et
réalimenter le côté sain en actionnant l’OMM avant d’aller intervenir au deuxième PPI.
Le BERE, ayant la vision électrique du réseau et de ses charges (contrairement à l’agence de
conduite et aux agences d’exploitation), est chargé d’optimiser la position de tous ces éléments, et
de les réajuster en fonction de l’évolution du réseau (modification des poches de puissance ou des
schémas d’exploitation).
La sécurisation des zones urbaines denses (ZUD) consiste en une étude des éléments de
réactivité nécessaires pour assurer la reprise d’un poste source lors d’une perte totale de celui-ci
(incident sur les lignes HTB, incendie sur le poste source, etc.). On doit atteindre des taux de
reprise du réseau spécifiques aux zones urbaines (66% par télécommande, 100% par tout organe).
Celles-ci sont particulièrement sensibles du fait de la densité de clients : plus le nombre de clients
coupés est important, plus les indicateurs de qualité de fourniture vont baisser rapidement et plus
l’impact sur l’image du Gestionnaire du Réseau de Distribution est fort.
Figure 7 - Principe de réalimentation par dichotomie
Structure
Les études PADT (Plan d’Accompagnement du Développement du Territoire) regroupent
les travaux de renforcement des réseaux (changement de section, mutation de transformateur,
etc.). Ceux-ci sont nécessaires pour lever les contraintes électriques (chutes de tensions trop
importantes, courant maximal admissible atteint) lorsqu’elles apparaissent sur le réseau. Celles-ci
sont la plupart du temps liées à une évolution de la charge, ou au raccordement de nouveaux
clients.
2.1.2 Etudes complémentaires
Les études de schéma de reprise ou de secours (N-1 pour schéma Normal dégradé) sont
demandées par l’ACR qui doit savoir quelles manœuvres (ouverture/fermeture des interrupteurs)
sont possibles sur le réseau.
GE5E 2015 CADART Priscille 13
Lors d’un incident, d’un défaut ou de travaux, on cherche à couper le moins de clients
possible. Pour cela, le tronçon du réseau directement concerné par le problème est isolé et on
étudie les possibilités de reprise du reste du réseau par d’autres voies. Ces manœuvres de reprise,
d’effacement ou de report de charge, ne doivent pas créer de contraintes électriques (chute de
tension, surcharge des transformateurs, etc.) ni déclencher intempestivement les mécanismes de
protection. Les caractéristiques électriques des schémas de secours sont simulés grâce à un outil
informatique appelé ERABLE. Les organes utilisés pour les reprises et les différents éléments du
réseau sont illustrés en Figure 8.
Figure 8 - Schéma simplifié du réseau HTA
Les études de dimensionnement des plans de protection des biens et des tiers consistent à
transmettre à l’AMEPS une description du réseau suffisante pour lui permettre de choisir les types
de systèmes de protections et calculer les réglages permettant une bonne sélectivité sur défaut
des organes de coupures mis en place sur le Poste Source. Deux types de défauts sont possibles
(une phase à la terre, ou plusieurs phases en court-circuit), donc deux types de protections sont
mis en place. Ces études sont dépendantes de l’étude des schémas de secours, car la longueur et
le type des circuits va influer sur les courants de défaut.
Les études source sont des études de renforcement ou de création d’un nouveau poste
source. Il faut dimensionner et chiffrer les éléments constitutifs, représentés Figure 9, pour
ensuite transmettre l’étude à l’agence MOAD Postes Sources. Celle-ci se charge de gérer les
investissements issus d’un budget distinct de celui de la MOAD Réseau.
TT
Disjoncteur débrochable
TSA : Transformateur [pour alimenter les] Systèmes Auxiliaires
TT : Transformateur de Tension (pour la mesure)
TCI : Transformateur de Courant d’Injection (pour les signaux tarifaires)
RPN : Resistance de Point Neutre HTA
GE5E 2015 Figure 9 - Eléments constitutifs
CADART d'un poste source
Priscille 14
Les chargés d’études sont également responsables de l’élaboration et la mise à jour
régulière des SChémas d’Orientation du Réseau Electrique (SCORE) de leurs zones. Ceux-ci sont
des documents représentant la forme et la structure du réseau qui sont visées à moyen et long
terme (10 et 30 ans). Ils permettent d’optimiser les investissements et sont essentiels à un
développement rationalisé du réseau. En effet, si on laisse celui-ci se développer au gré des
raccordements, la structure perd en cohérence et la conduite et l’exploitation du réseau
deviennent plus complexes à gérer.
L’étude porte généralement sur une zone de taille variable selon le type (urbain, rural) ou la
géographie du réseau. Le découpage sert à limiter les calculs et les travaux à étudier. Ces zones
peuvent représenter de 300 à 1500km de réseau et alimenter entre 22 000 et 150 000 clients pour
une charge totale à la pointe de consommation entre 55 et 280 MVA (ce qui représente de 4 à 10
postes sources, pour 20 à 50 départs HTA). L’étude comprend une réflexion sur l’évolution des
charges, complétée par une analyse globale des besoins du réseau étudié en terme de PADT, PAC,
PRC, PAR et sécurisation des ZUD projetés sur les 30 années à venir. Les projets décidés année
après année devront faire tendre la structure et les équipements du réseau vers la cible décidée
dans le SCORE. C’est sur cette mission du BERE que mon stage a porté.
2.2 Fonctionnement
2.2.1 Réalisation d’une étude
Les études sont généralement traitées par les agents d’études selon les étapes ci-dessous.
1. Une fiche problème, un rapport d’incident ou une demande particulière est remontée au
BERE par une des agences de la fonction Opérations (ACR, AE, etc.) ou d’autres services.
Elle est ensuite renvoyée au chargé d’études responsable de la zone. Certaines études sont
directement motivées par le BERE à partir d’éléments renseignés dans la base de données
techniques (ex : PADT, SCORE).
2. Une étude et un chiffrage des travaux à effectuer sont réalisés, en fonction du matériel
nécessaire, du type de travaux, de l’accessibilité (estimation brute).
3. Une étude technico-économique est effectuée sur la base d’une analyse du Bilan Actualisé
(BA) et du Ratio Bénéfice-Coût (RBC). Le BA consiste en la simulation des coûts liés au
réseau sur 30 ans si on suit plusieurs scénarios : ne rien faire ou réaliser un investissement
(qui peut se décliner en plusieurs stratégies). Les calculs technico-économiques prennent
en compte le coût de l’Energie Non Distribuée (END), les pertes Joules, l’amortissement et
les coûts d’exploitation. Ces outils d’aide à la décision permettent d’optimiser les dépenses
en choisissant la meilleure stratégie (BA) et en priorisant les affaires entre elles par ordre
de rentabilité (RBC).
4. L’affaire est ensuite transmise aux responsables MOAD. Ceux-ci centralisent les études de
la DR AFC et les inscrivent au programme travaux en fonction de l’allocation budgétaire
(20,4M€ pour le réseau HTA pour l’année 2014, 18,7 M€ pour l’année 2015) et selon une
stratégie définie plus globalement : répartition selon le département et l’importance
relative du réseau (nombre de clients, critères de qualité, etc.), selon des objectifs chiffrés
nationaux, régionaux ou locaux (pourcentage de réduction du réseau aérien, temps de
coupures, temps de réalimentations, taux de reprise).
5. Une fois les affaires choisies pour l’année, elles sont transmises à la MOAR pour réalisation.
Celle-ci transmet à un Bureau d’Etude externe pour l’étude détaillée (mécanique, plan de
réalisation détaillé, etc.). Elle gère également les dossiers administratifs et lance l’Appel
d’Offre pour choisir un prestataire et le suivre jusqu’à la réalisation complète du chantier.
GE5E 2015 CADART Priscille 15
Enfin, elle transmet les informations à la Cartographie pour mise à jour des caractéristiques
électriques et des outils d’exploitation et de repérage des ouvrages.
2.2.2 Outils informatiques utilisés
Pour réaliser leurs études, les chargés d’études sont aidés de plusieurs outils informatiques.
Certains sont spécialisés dans les calculs électriques, d’autres dans l’analyse géospatiale
(cartographique) et dans le référencement des ouvrages. Les logiciels utilisés sont les suivants :
- ERABLE : outil de calcul électrique, développé par ERDF sur la base du logiciel Power
Factory, vendu à divers distributeurs dans le monde par DIgSILENT GmbH. Il est utilisé pour
la simulation des travaux et l’affichage cartographique des résultats électriques. C’est un
logiciel récent, intégré par ERDF en octobre 2013, mais réellement utilisé par le BERE à
partir de juillet 2014. Il remplace l’ancien outil appelé PRAO. ERABLE prend en compte plus
de paramètres et de variables dans ses calculs, pour une modélisation plus précise mais
une utilisation plus complexe. De ce fait, les résultats de calculs peuvent parfois être
différents de l’ancien logiciel. Toutes les fonctionnalités n’ont pas encore été explorées par
tous les chargés d’études.
- DIRAC HTA : outil Excel permettant la génération d’un fichier récapitulatif d’un grand
nombre d’informations renseignées pour chaque départ d’un centre (la DR AFC en compte
3).
- SIG-Elec : outil de cartographie du réseau électrique développé par General Electric. Utilise
une base de données très complète et permet de réaliser des exports de certaines
informations (géographiques ou électriques). ERABLE puise beaucoup de ses paramètres
de calcul dans cette base.
- QGIS : outil de cartographie développé en open source. Permet de nombreux affichages et
analyses graphiques. Généralement alimenté par des exports de SIG (l’outil n’est pas
connecté à la base de donné donc il est à mettre à jour manuellement). Il devrait être
progressivement abandonné au profit de CARAIBE.
- CARAIBE : outil de cartographie développé en interne, mais plus spécialisé dans les cartes à
grande échelle. Sa base de données source est différente du SIG et il peut y parfois y avoir
des incohérences.
- OSCAR : outil de consultation et de requête de bases de données. Le réseau de distribution
électrique nécessite la manipulation d’un très grand nombre de données. Celles-ci sont
stockées dans de nombreuses bases, selon le service producteur de la donnée ou le thème
abordé par celle-ci. Cet outil permet d’accéder à toutes les bases en même temps, et de
construire des requêtes d’informations en combinant les sources.
GE5E 2015 CADART Priscille 16
PROJET REALISE
1 PRESENTATION DU SUJET ET DE LA DEMARCHE
Le sujet du stage concerne une des missions du BERE qui est l’élaboration des SChémas
d’Orientation du Réseau Electrique (SCORE). Ces schémas doivent prendre en compte des
informations externes (évolution du réseau de transport de RTE, aménagement des territoires,
développement économique et démographique, etc.). Ils doivent également servir en interne à
assurer une bonne communication et une cohérence entre les décisions prises par les différents
services (raccordement, création de Postes Sources, déplacement d’ouvrages). Ils constituent par
ailleurs un outil de planification à moyen et long-terme pour la MOAD HTA. En effet, le SCORE doit
permettre au décideur d’avoir une idée globale des évolutions prioritaires de chaque zone.
La méthodologie d’élaboration de ces SCORE est publiée au niveau national via une note
interne (Prescription du Réseau de Distribution Electrique : PRDE). Les chargés d’études suivaient
jusqu’à présent la version 2007 de cette note, portant sur les « Schémas Directeurs ». Une
nouvelle note a cependant été publiée en 2014 et renomme ceux-ci en « SCORE ». Elle prescrit la
prise en compte de nouveaux paramètres, comme l’intégration de la production décentralisée, ou
encore les problématiques d’augmentation du courant capacitif liées à l’enfouissement des
réseaux.
La démarche adoptée est décrite par le planning prévisionnel de la Figure 10.
Semaines de stage
Planning prévisionnel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Formation - Montée en compétences
Organisation (fonctionnement, découverte du métier)
Technique (électrotechnique, 3I0, etc.)
Montée en compétences ERABLE
Etude bibliographique
Appropriation de la PRDE SCORE et des PRDE associées
Identifier les différences entre les deux versions
Analyse des Schémas Directeurs existants (benchmark)
Choix des restitutions
Restitutions tableur
Modèle de rapport
Restitutions cartographiques
Conception et développement des outils
Macro de diagnostic automatique et de mise en forme
Rédaction des fiches méthodes
Synthèse destinée à la décision et la communication
Informations et interlocuteurs externes
Internes (D12, raccordement)
Externes (SRRRER, SCOT, INSEE)
Présentation et accompagnement des chargés d'études
Présentation des outils
Accompagnement des chargés d'études
Etude de cas concrets
SCORE zone rurale (producteurs HTA : Baume les
SCORE zone urbaine (création de PS : Besançon)
Figure 10 - Planning prévisionnel
GE5E 2015 CADART Priscille 17
2 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
La première étape du sujet était d’étudier les divers documents disponibles abordant
l’élaboration des schémas directeurs. Dans un premier temps, j’ai étudié les deux versions de la
PRDE 1.4-0, intitulée « Méthodologie d’élaboration des SCORE moyen et long-terme », afin
d’identifier les évolutions de la prescription.
En parallèle, j’ai étudié la note méthodologique locale (rédigée en 2013 au sein du BERE de la
DR Alsace Franche-Comté) consistant en une mise en application de la version 2007 de la PRDE.
Chaque région ayant des spécificités locales et le prescrit national restant un document assez
abstrait, il est nécessaire à chaque BERE d’adapter celui-ci pour l’appliquer de façon pratique à
leurs zones d’études.
J’ai pu tout d’abord observer que, pour l’élaboration des SCORE, de nouvelles problématiques
étaient à prendre en compte. Parmi celles qui auront le plus d’impact sur la réflexion, on note les
problématiques suivantes :
- Augmentation du courant capacitif, liée à l’enfouissement des réseaux ruraux
- Sécurisation des postes sources en zone urbaine dense (ZUD)
- Prévision des puissances injectées par la production décentralisée
L’analyse des 3 documents m’a permis de comprendre la structure et les objectifs généraux
des schémas directeurs et des SCORE.
L’intérêt des SCORE sera principalement de donner une vision globale d’une zone, de ses
points faibles et des schémas de distribution à viser pour optimiser le réseau. Il permettra
également d’évaluer la pertinence des affaires traitées au jour le jour, selon leur degré de
cohérence avec la cible.
En s’appuyant sur la cible théorique à 10 ans, il sera possible de déterminer un programme
travaux pratique. Par ailleurs, on pourra utiliser la cible moyen-terme lors des études de
raccordement et de déplacement d’ouvrage (client HTA, nouveau poste de distribution, etc.), pour
choisir les solutions techniques (sections des câbles, parcours, etc.) qui s’inscrivent le mieux dans
la cible et ainsi optimiser les investissements.
Le plan général de la méthode d’élaboration de ces documents se décompose comme suit.
2.1 Structure du SCORE [4]
1. Définition de la zone et de la durée d’étude
Pour répartir le travail, le réseau de la Direction Régionale d’Alsace Franche-Comté a été
divisé 5 zones d’études (une par chargé d’études). Ces zones d’études restent cependant étendues
pour une réflexion aussi complète que l’analyse menée dans les SCORE. Ainsi, pour des raisons
pratiques, il est prescrit de définir des zones d’études plus petites en fonction de la densité du
réseau, du dynamisme économique ou du nombre de problématiques rencontrées. Sur AFC, le
découpage pratiqué donne une liste de 21 zones de schémas directeurs.
Les pratiques des différents BERE limitaient l’étude à des zones de 5 postes sources. Cette
pratique découlait des limitations du logiciel de calcul de l’époque. Cependant, certaines zones
urbaines peuvent contenir plus de 5 postes sources, et nécessiter d’en étudier jusqu’à 10 à la fois
pour assurer la cohérence géographique du SCORE. Cela a été rendu possible par le nouveau
logiciel de calcul.
La période d’étude, fixée à 30 ans, permet d’observer une rupture suffisante entre l’état
initial et la cible long terme en ce qui concerne l’âge des réseaux et l’évolution des charges. Cette
GE5E 2015 CADART Priscille 18
durée est cohérente avec les durées d’amortissement des ouvrages, de 30 à 40 ans. Ainsi, on
pourra justifier les investissements important en observant leur impact sur le développement du
réseau.
2. Prévision des puissances
Puissances soutirées
Cette étape est la base de tout schéma directeur. Elle permet de déterminer le taux
d’accroissement des charges, qui va prédisposer de l’apparition ou non de contraintes sur le
réseau. Les notes nationales précisent une méthode et des outils pour la détermination de celui-ci.
L’analyse porte tout d’abord sur le passé proche, via l’étude des données internes. Ces
données sont rassemblées dans des documents appelés Doc 12 qui permettent de calculer le Taux
de Croissance Moyen Annuel (TCMA).
Pour faciliter la démarche, CRISTINA, un outil de calcul, a été développé au niveau national
et permet de corriger les différentes données des 5 dernières années (variations des puissances
souscrites, des puissances consommées, etc.) à l’aide d’outils statistiques, comme illustré par le
graphique de la Figure 11. Dans ce graphique sont représentées la puissance souscrite à RTE sur le
Poste Source (PS), les puissances souscrites par les clients ERDF selon leur contrat (Psous TV, TB, TJ
pour Tarif Vert, Bleu et Jaune), et également la pointe de consommation à température normale
(P*max) du poste source. Ces différentes puissances sont pondérées puis corrigées des pointes et
des écarts importants pour donner la Ppond corrigée.
Figure 11 - Courbes d'évolution des puissances données par CRISTINA
A ces informations internes se rajouteront les projets de raccordement en file d’attente ou
à l’étude, permettant d’évaluer le dynamisme à court-terme d’une zone.
Ces données internes limitent la prévision au futur proche. Pour compléter l’analyse à plus
long-terme, des informations externes sont à utiliser. Des échanges avec les collectivités
territoriales, par exemple, permettront d’évaluer la dynamique potentielle de développement des
territoires sur 30 ans. Les données disponibles seront détaillées ultérieurement.
Pour ne pas trop surestimer l’augmentation des charges dans la prévision à long terme, il
est prescrit de déterminer deux taux d’accroissement différents : un pour les 10 premières années
GE5E 2015 CADART Priscille 19
et un, plus faible, pour la période de 11 à 30 ans. Ce principe permet de prendre notamment en
compte l’impact des actions menées par le programme national de Maîtrise de la Demande en
Energie.
Afin de garantir l’efficacité des SCORE, ceux-ci sont à mettre à jour tous les 5 ans. Cette
actualisation régulière permet de vérifier la cohérence des prévisions de cette analyse avec les
évolutions réelles observées sur le territoire. Si les taux d’accroissement réellement rencontrés
s’avèrent trop faibles ou trop élevés par rapport aux prévisions, il faudra décaler dans le temps les
investissements préconisés.
Puissances injectées
Une des nouveautés du SCORE est la prévision des puissances également injectées. Il
faudra pour cela se référer aux documents pour la planification de la production décentralisée
existants : les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
(SRRRER), publiés par RTE. On pourra également échanger avec les Bureaux d’Etudes spécialisés
dans le raccordement des producteurs d’électricité au réseau HTA. Les enjeux de cette nouvelle
problématique seront détaillés dans une partie ultérieure.
3. Etat des lieux
L’état des lieux permet de mettre en évidence les contraintes observables sur le réseau.
Cette analyse est un dossier conséquent, qu’il est prescrit de mettre à jour tous les ans. On
effectue les calculs sur le réseau à l’état initial (celui référencé dans les bases de données de la
maîtrise d’ouvrage), que l’on complète par les travaux décidés au moment de l’étude.
On préconise également des outils informatiques pour le diagnostic électrique : dans la
version 2007, on utilise le logiciel de calcul PRAO qui a été remplacé en octobre 2013 par ERABLE.
Il est à noter que les schémas directeurs établis entre 2013 et 2014 par le BERE ont tous été
réalisés sur PRAO et que certains résultats électriques peuvent être différents. Cette
problématique constitue un des enjeux de l’efficacité de la méthodologie développée au cours de
ce stage.
Les restitutions demandées pour ce diagnostic seront de plusieurs natures. On demande
généralement des restitutions tableur (ex : tableau des résultats électriques des éléments de
réseau) et des restitutions cartographiques (visualisation géographique des ouvrages et des
contraintes connues).
4. Construction de la cible long-terme
Les méthodes de construction de la cible à long-terme ne diffèrent pas beaucoup entre les
deux versions. Il est demandé de restructurer et d’améliorer le réseau pour lever les contraintes
électriques (surcharge des transformateurs, chutes de tension, etc.) mais également en prenant en
compte des seuils permettant la simplification de la conduite et de l’exploitation des réseaux.
Ceux-ci sont donnés dans le tableau de la Figure 12.
Pour pouvoir visualiser les apports de la cible, on demande les mêmes restitutions que
pour l’état des lieux. Cela permettra ainsi de comparer l’état initial avec l’état final. Les travaux
nécessaires pour atteindre la cible seront décrits et justifiés technico économiquement.
GE5E 2015 CADART Priscille 20
Figure 12 - Tableau des seuils d’optimisation du réseau
Une nouvelle contrainte à prendre en compte dans le SCORE est la contrainte de courant
capacitif généré par les lignes et les câbles HTA et visible au niveau du neutre du transformateur
HTB/HTA lors de défauts à la terre (créant un déséquilibre entre les phases et donc un courant
homopolaire), également appelé 3I0. Celui-ci va particulièrement dimensionner les réseaux ruraux,
qui ont tendance à être longs et de plus en plus enterrés dans le cadre du programme PAC. Il va
également agir sur le type de mise à la terre du neutre HTA. Il faudra l’évaluer en schéma normal,
mais également en schéma de secours (schémas dégradés, adoptés lors d’incidents ou de travaux :
la charge du départ est reprise par les départs avoisinants), car ce sont les schémas généralement
les plus longs, et donc les plus capacitifs. Les mesures à adopter pour résoudre cette contrainte
seront abordées dans une partie ultérieure.
5. Stratégies de développement des ouvrages (cible ou coupe moyen terme)
Une fois la cible long-terme établie, il est nécessaire de déterminer une stratégie et des
étapes progressives pour atteindre cette cible. On doit préciser les travaux nécessaires et les
regrouper en tranches travaux. Une étude technico-économique permettra de prioriser les travaux
pour les étaler sur 30 ans.
La cible moyen-terme est la coupe à 10 ans de cette stratégie. Elle présentera les travaux :
- permettant de lever toutes les contraintes électriques (imposées par les normes et
la sécurité des biens et tiers) présentes sur le réseau à l’année n et n+10
- résorbant les écarts du réseau aux seuils d’optimisation les plus importants
- permettant d’atteindre les objectifs liés aux finalités : PAC (Plan Aléas Climatiques),
PRC (Plan de Renouvellement des Câbles) et sécurisation ZUD
- justifiés entre 0 et 10 ans à l’aide des outils technico-économiques
6. Analyse de la qualité de fourniture
Comme ERDF est une entreprise sous contrat de service public et agissant sur un marché
régulé, les niveaux de qualité à atteindre sont déterminés par un décret et un arrêté. Deux
paramètres permettront d’évaluer ces niveaux : la continuité de fourniture et la tenue en tension.
Les indicateurs à calculer pour l’analyse seront détaillés ultérieurement.
La qualité de fourniture est à évaluer tout d’abord sur le réseau initial, mais on peut
également l’estimer sur le réseau à 10 ans. On observera ainsi l’évolution de celle-ci, suivant si on
réalise les travaux décidés par la cible ou si aucune modification n’est effectuée sur le réseau.
L’analyse de la qualité de fourniture constitue ainsi un bilan de la structure cible choisie. On
observe son impact sur les indicateurs de qualité et on peut conclure quant à sa pertinence.
GE5E 2015 CADART Priscille 21
2.2 Analyse des schémas directeurs existants
1. Schémas directeurs du BERE AFC
En plus d’étudier les notes méthodologiques, j’ai pu étudier les schémas directeurs du BERE
AFC, qui ont été établis selon les anciennes versions de celle-ci. J’ai ainsi identifié les
problématiques et les réflexions supplémentaires qui seront à mener pour la mise à jour des
documents existants.
Dans les documents existants, la méthode de détermination des taux d’accroissement était
peu rigoureuse, trois taux seulement étaient appliqués (0.5, 1 et 1.5%), sans observation
particulière du dynamisme réel des zones (passé ou futur).
Par ailleurs, par volonté de simplification, l’analyse de la qualité de fourniture et des
contraintes en schéma de secours n’avait pas été réalisée, les schémas directeurs devant être mis
à jour rapidement. Certains éléments manquaient donc à la réflexion sur la restructuration, même
si une analyse des taux de reprise des postes sources en ZUD avait quand même été réalisée.
En analysant les documents de découpage cartographique, j’ai observé qu’une mise à jour
était nécessaire car ceux-ci dataient déjà de 2 ans auparavant (le réseau évoluant régulièrement).
Un manque d’information était présent, notamment sur le nom et le nombre de départs à prendre
en compte par zone. En effet, cela a occasionné quelques oublis dans les études. J’ai également
remarqué que la limitation à 5 postes source avait créé, lors du découpage, deux zones peu
cohérentes géographiquement autour de Mulhouse au lieu d’une regroupant tous les postes
sources alimentant l’agglomération (voir Figure 13).
Figure 13 - Carte de découpage du centre ALSACE (063) autour de Mulhouse
Enfin, une harmonisation des restitutions était nécessaire. En effet, la fiche méthode locale
n’explicitant pas ou très peu les restitutions tableur ou cartographique à construire, chaque chargé
d’études a choisi lui-même les résultats à présenter. Les rendus diffèrent donc d’un chargé
d’études à l’autre, et rendent le travail du valideur plus délicat. Un tableau et des cartes de
synthèse ont ainsi dû être construits manuellement, ce qui représente une charge de travail
importante.
GE5E 2015 CADART Priscille 22
2. Schémas directeurs des autres BERE de France
Par ailleurs, j’ai pu accéder à des exemples de schémas directeurs venant de toutes les
régions. Ils avaient été rassemblés par le groupe de travail national pour la rédaction de la
nouvelle PRDE sur les SCORE. Ceux-ci ayant servi à l’élaboration de la note, j’ai pu les analyser
pour en retirer les exemples de restitutions les plus pertinents pour la DR AFC.
La note nationale restant très abstraite, chaque BERE détermine la mise en forme et le choix
des restitutions de manière indépendante et en fonction des contraintes spécifiques de leur
région. Par exemple, le BERE Méditerranée aura tendance à étudier le réseau en « contrainte été »
(forte production des producteurs basse tension) plus souvent que les BERE de la DIR EST. C’est
pourquoi il était intéressant d’étudier des exemples de Schémas Directeurs venant de tous les
BERE.
J’ai procédé à une compilation de toutes les restitutions tableur, pour effectuer une analyse
de type benchmarking et ainsi choisir, en concertation avec mon tuteur de stage, les informations
les plus pertinentes pour les SCORE selon les besoins de la DR AFC. Après avoir extrait tous les
exemples de tableau des 10 BERE ayant participé au groupe de travail, je les ai triés selon 7 types
d’analyses. Ces analyses se différencient sur le point de vue adopté et le type d’information
affiché.
Tout d’abord, certains SD présentent une analyse géographique des zones et de leur
évolution, en termes de population et de projets de raccordements. Celle-ci comporte, par
exemple, des tableaux listant les communes importantes de chaque zone, ou encore des tableaux
affichant les projets de raccordement des clients HTA. Cette analyse permet de diagnostiquer de
manière quantitative le dynamisme d’une zone. Un exemple est donné Figure 14.
Figure 14 - Planification du raccordement des Zones d'Aménagements Concerté
Une deuxième analyse est réalisée par la majorité des SD : le diagnostic des ouvrages de la
zone. Celui-ci implique par exemple une liste des ouvrages situés en zone PAC (Plan Aléas
Climatiques) et une liste des ouvrages à renouveler au titre du PRC (Plan de Renouvellement des
Câbles). Une analyse de l’ancienneté des réseaux est souvent réalisée également. Cette analyse
permet d’identifier les faiblesses physiques du réseau, et pourra permettre de prioriser les
restructurations nécessaires et de les étaler sur 30 ans.
Les restitutions suivantes consistent en la présentation de divers résultats électriques selon
3 points de vue : un diagnostic par transformateurs, un diagnostic par postes-sources et un
diagnostic par départs HTA. Les résultats électriques présentés diffèrent d’un BERE à l’autre. On
peut visualiser par exemple la puissance apparente à P*max (charge à la pointe de consommation
de l’année précédente, considérée comme atteinte à la température du jour le plus froid de
l’année), ou encore la marge représentant la différence entre le transit à température minimale de
base Ptmb (charge maximum absolue théoriquement atteignable utilisée pour le
dimensionnement du réseau et calculée à partir de la P*max et des minimums de température sur
les 30 dernières années) et la puissance installée ou admissible. Un exemple des restitutions est
GE5E 2015 CADART Priscille 23
présenté Figure 15. Ce diagnostic permet de repérer toutes les contraintes électriques qui peuvent
apparaître sur le réseau (ex : une marge négative, une chute de tension supérieure à la norme,
etc.) et ainsi de visualiser rapidement les besoins en travaux de renforcement ou de
restructuration.
Code GDO Nom du Transformateur Longueur Longueur Nb Nb Psous 3I0 DU/U Transit PxL à
Départ Départ HTB/HTA (km) Aérien Clients Clients HTA (A) Max. Ptmb P*max
(km) BT HTA (kW) (%) (kVA) (kVA.km)
RUEYRC1414 VENZAC 'RUEYRY0311 46.6 36.0 384 1 55 35.1 1.0 527.8 18.4
Figure 15 - Exemple de diagnostic par départs
Une autre analyse faite par une partie des BERE présente le diagnostic en schéma de
secours. Sur cette analyse, les types de présentation varient fortement d’un BERE à l’autre. Parfois
le diagnostic est réalisé du point de vue des transformateurs, parfois du point de vue des départs.
On vérifie ainsi la garantie transformateur (capacité d’un poste-source à reprendre toute sa
puissance par lui-même dans le cas de la perte d’un transformateur). Lorsque l’analyse est faite du
point de vue des départs, on vérifie l’état des contraintes électriques en cas de reprise (marge de
transit et chute de tension, le 3I0 en régime secours n’étant pas encore évalué sur les anciens
Schémas Directeurs). Cette analyse affiche ainsi les faiblesses du réseau lorsqu’il y a nécessité de
reprendre celui-ci par des schémas alternatifs. En superposant cette analyse aux diagnostics en
schéma normal, il est ainsi possible d’identifier les points prioritaires qui nécessitent une
restructuration.
La dernière analyse réalisée est l’analyse de la qualité de fourniture. Celle-ci affiche
généralement les indicateurs classiques de qualité : nombre de coupures brèves, longues, temps
moyen de coupure réel et estimé. Certains affichent en supplément les nombre d’incidents et/ou
les taux d’incidents par départ. Un exemple de cette analyse est donné Figure 16. On réalise de
cette manière un bilan du réseau actuel en termes de continuité de fourniture, et une
comparaison est possible avec le réseau futur avant et après les travaux choisis.
Figure 16 - Exemple de diagnostic qualité
L’avantage de toutes ces analyses est qu’elles se complètent les unes les autres et
permettent de combiner le plus de paramètres possible pour orienter la réflexion. Elles présentent
cependant un inconvénient majeur. En effet, les outils informatiques utilisés pour récupérer les
données nécessaires sont multiples et les données renvoyées peuvent être difficiles à traiter de
par leur quantité. Il a fallu ainsi prêter attention au fait que plus la quantité d’information affichée
est importante, plus cela prend du temps de récupérer l’information, mais également de la traiter.
Il a donc été nécessaire de procéder à un arbitrage entre les différentes données pour gagner en
pertinence et en efficacité.
GE5E 2015 CADART Priscille 24
3 NOUVELLES PROBLEMATIQUES
Après avoir identifié les différences entre les deux versions de la note nationale prescrivant
l’élaboration des SCORE et ayant étudié des exemples des anciens schémas directeurs, j’ai pu
déterminer les réflexions supplémentaires à mener pour l’actualisation des SCORE de la Direction
Régionale Alsace Franche-Comté.
Trois éléments ont été identifiés : une réflexion sur le développement du territoire, une
analyse de la qualité de fourniture, et enfin les nouvelles problématiques d’intégration de la
production décentralisée et de maîtrise de l’augmentation du courant capacitif.
3.1 Développement du territoire
Une part importante de la planification consistant en l’étude du développement de la zone,
il a fallu réfléchir aux sources d’informations disponibles. Deux éléments indispensables à
l’élaboration des SCORE découlent de cette étude :
- la recherche des taux d’accroissements des charges dites « de fond » car réparties sur
toute une zone. Une analyse à la fois sur le moyen-terme et sur le long-terme est à
réaliser.
- la recherche des futures charges ponctuelles importantes, dites charges « de surface »,
car localisées (zone industrielle, augmentation de puissance souscrite d’un client
important, etc.). Seule une analyse sur le moyen-terme est possible dans le cas de ces
charges. En effet, il serait trop ambitieux de chercher à prévoir l’implantation de clients
importants au-delà de 10 ans.
Plus les informations seront complètes et diverses, plus la réflexion sera proche du
développement réel des territoires. Le taux d’accroissement des charges est une grandeur
fondamentalement dimensionnante des SCORE, puisqu’il impacte tous les calculs électriques
réalisés sur la période d’étude. On peut également tirer de cette réflexion des éléments pour la
prévision de la structure géographique du réseau.
J’ai ainsi identifié trois sources d’informations à notre disposition : les données de l’agence
de raccordement marché d’affaires concernant les clients importants nécessitant une modification
du réseau, les données des acteurs externes de l’aménagement du territoire, mais également
celles collectées par les Directions Territoriales au sein d’ERDF.
3.1.1 Agence Raccordement Marché d’Affaires (ARMA)
Pour la planification à court-terme, les agences raccordement possèdent les informations
des dernières demandes actuellement à l’étude, inscrites en file d’attente ou déjà prévues au
programme travaux. Ces informations sont essentielles pour que le BERE ait une représentation de
l’évolution future des charges.
GE5E 2015 CADART Priscille 25
Toutes ces informations sont disponibles via l’application MOA-Pilot qui permet le suivi des
affaires au sein de la fonction « Patrimoine et Raccordement » d’ERDF (voir Figure 17). Cependant,
l’outil souffre d’un manque d’harmonisation des renseignements sur les affaires. En effet, de par
la quantité importante de rubriques à compléter, chaque chargé d’affaires remplira selon ses
besoins et les demandes des utilisateurs. Même si toutes les informations sont présentes pour
chaque affaire, celles-ci ne seront pas à aller chercher au même endroit, ce qui rendra difficile le
tri automatisé des données.
Figure 17 - Vue de l'outil MOA-Pilot
Pour faciliter la planification, le national prescrit une valeur limite de la puissance des
affaires à prendre en compte dans les calculs (charges qu’il faudra insérer dans le logiciel ERABLE)
au titre des charges ponctuelles. Celle-ci est fixée soit à 1MVA, soit à 5% de la puissance de
consommation maximum du poste source appelée P*max. Le nombre des plus petites affaires
servira ensuite à évaluer la croissance diffuse (taux de croissance moyen annuel) de la zone.
3.1.2 Collectivités territoriales
Pour élargir la vision à plus long terme, il était nécessaire de rechercher les informations
mises à disposition par les collectivités territoriales et les institutions en charge du développement
économique. J’ai commencé mon travail par rechercher les organismes et les documents utiles
pour récupérer ces informations.
Depuis la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000, les
collectivités sont tenues de rédiger des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) [5]. Ce sont des
documents qui visent à planifier l’aménagement du territoire. Ils permettent ainsi d’assurer une
cohérence des aménagements sur le long terme. Ils sont la plupart du temps élaborés par un
groupement de communes, selon un découpage réalisé par la préfecture. Ils sont compatibles
avec d’autres documents d’urbanisme, comme les PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou PLUi (i pour
intercommunal).
D’un point de vue plus économique, les Chambres de Commerce et d’Industrie collaborent
avec les Agences de Développement Economique pour faire la prospection des projets
d’entreprises. Celles-ci peuvent ainsi fournir une liste des projets de développement à l’étude.
GE5E 2015 CADART Priscille 26
En ce qui concerne les informations démographiques, l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE) répertorie sur son site internet les dernières données du
recensement des communes et des entreprises ainsi que certaines données de prévision.
Malgré leur intérêt pour une planification au plus proche des territoires, l’extraction de ces
informations représente une charge de travail non négligeable pour un bureau d’études orienté
technique. Après avoir parcouru les diverses sources, j’ai établi une liste des informations qui
seraient utiles au BERE, pour rendre la recherche plus efficace :
- Représentation tableur ou cartographique de l’évolution démographique et
économique passée et prévisionnelle. En effet, les courbes d’évolution de la
consommation électrique suivent généralement les indicateurs de démographie et de
PIB.
- Carte des réserves foncières des communes de la zone (représentant les surfaces à
vocation économique ou à vocation résidentielle) : si la commune est saturée, cela peut
indiquer que le développement, si développement il y a, va devoir se délocaliser sur
une autre zone.
- Carte des structures urbaines visées à long-terme, dans le cas d’agglomérations (voir
Figure 18). Cette information permettra d’orienter la réflexion sur la géographie du
réseau cible.
Figure 18 - Carte issue du SCoT de l'agglomération Bisontine
GE5E 2015 CADART Priscille 27
- Tableau des projets structurants actuellement en réflexion sur le moyen et long-terme,
avec estimation de la surface visée et de son utilisation (tertiaire, industrielle,
logement), ce qui pourra permettre d’estimer la puissance de raccordement prévue.
Une première version de ce tableau est montrée Figure 19.
Secteur Bas-Rhin
Echéance des projets : Court : 2 à 3 ans - Moyen : 5 à 10 ans – long : plus de 10 ans
Zone Projet Echéance Distributeur
électricité
DAMBACH Développement de la zone industrielle. Zone dédiée aux activités court ERDF
industrielles, logistiques et tertiaires. Plateforme Centre Alsace
SELESTAT Projet Cuisine Schmidt + développement de la zone industrielle Court ERDF
MARCKOLSHEIM Zone portuaire en attente. Court et ERDF
moyen
Figure 19- Eléments de développement économique du secteur Bas-Rhin
3.1.3 Directions Territoriales
Pour faciliter cette recherche d’information, j’ai également contacté les Directions
Territoriales d’ERDF. Ce sont des services spécialisés dans la représentation du distributeur auprès
des collectivités. Sur la DR Alsace Franche-Comté, il en existe 3 : une pour le Doubs et le Territoire
de Belfort, une pour le Jura et la Haute-Saône, et une pour l’Alsace. Elles sont constituées d’un
Directeur Territorial (DT) et de plusieurs Interlocuteurs Privilégiés (IP) associés à différentes zones
géographiques.
Actuellement les échanges entre le BERE et les DT ne sont pas formalisés. Les informations
circulent pourtant dans les deux sens : les DT ont besoin de communiquer des programmes
travaux, des indicateurs de qualité de fourniture et d’autres éléments techniques. Par ailleurs, les
informations sur les projets importants et les programmes travaux des collectivités, mais
également des Syndicats d’Energie, doivent être transmis au BERE. La circulation de ces
informations est importante pour assurer la meilleure coordination possible. Celle-ci est facilitée
par la rédaction, à la maille départementale, de documents appelés Programmes Coordonnés de
Développement et de Modernisation des Réseaux (PCDMR). Malgré une différence d’échelle, il
pourra être utile de se référer à ces documents dans le cadre de l’élaboration des SCORE.
Pour réfléchir à mettre en place un fonctionnement standardisé, il m’a fallu organiser des
réunions avec différents représentants. Au cours de ces réunions, il a été établi que si une
standardisation n’existait pas aujourd’hui c’est tout d’abord parce que les 3 DT n’ont pas les
mêmes profils d’équipe et donc ne fonctionnent pas de la même manière. Par ailleurs, si peu
d’informations sur les projets structurants sont aujourd’hui transmises au BERE, c’est que le
nombre de projets d’aménagements a très nettement diminué depuis la loi SRUH (Solidarité et
Renouvellement Urbain des Habitats, mise à jour de la loi SRU) qui pousse les collectivités à
réutiliser des ressources en place plutôt qu’à construire de nouvelles infrastructures.
Le besoin d’une harmonisation a cependant été mis en évidence, ainsi que l’affectation
d’une mission de collecte des informations nécessaires au BERE à un interlocuteur privilégié. Cette
tâche s’étendait cependant au-delà de la seule élaboration des SCORE et restera donc à la
GE5E 2015 CADART Priscille 28
responsabilité des Directeurs Territoriaux et des responsables de l’agence MOAD pour une
application possible dans tous les aspects de la communication entre les DT et le BERE.
3.2 Analyse de la qualité de fourniture
Pour permettre de réaliser un bilan de l’efficacité du réseau cible choisi, l’analyse de la
qualité de fourniture est un outil intéressant. Cependant, il a fallu choisir les indicateurs à calculer
et la manière de les présenter.
Les indicateurs de qualité classiques sont à évaluer pour chaque départ HTA, c'est-à-dire :
la variation de tension maximum, le nombre de coupures brèves (inférieures à 3 min), le nombre
de coupures longues (supérieures à 3 min) et le critère B (temps moyen de coupure par client).
∑N T
Le critère B est un indicateur calculé selon la formule : Ni i. Avec Ni le nombre de clients
coupés pendant un temps Ti pour chaque incident (en considérant un indice i par manœuvre de
réalimentation), et N le nombre total de clients alimentés sur la zone où l’on souhaite calculer le
critère B. On le calcule par un cumul annuel. L’objectif national à atteindre pour le critère B hors
incident exceptionnel est de 55 min. Sur AFC, qui comporte 1 million de compteurs, le critère B
atteignait 52 minutes en 2014.
Pour le calcul des indicateurs en nombre de coupures, les communes sont réparties en
zone qualité selon leur population. Des seuils à respecter pour chaque zone sont fixés par décret
pour le nombre de coupures brèves et longues, ainsi que pour le temps cumulé de coupure,
comme indiqué Figure 20.
Figure 20 - Seuils issus de l'arrêté qualité du 18/02/2010
Les zones qualité A et B regroupent les communes présentant respectivement plus de
100 000 habitants et entre 10 000 et 100 000 habitants. Les communes en zone de base, ou
encore en zone C, possèdent moins de 10 000 habitants.
D’après le décret qualité imposé à ERDF, la variation de tension en tout point du réseau ne
doit jamais dépasser ±10% de la tension d’exploitation. Pour le réseau HTA, la variation de tension
maximum possible sur un départ ne devra pas dépasser 5% en schéma normal et 8% en schéma
secours. On laisse ainsi une marge pour les variations de tensions générées par le réseau BT.
Pour déterminer la variation de tension, des outils mathématiques sont utilisés par le
logiciel de calcul ERABLE. Aujourd’hui, seul le courant transité en tête de départ peut être mesuré ;
ceci, tant que les compteurs intelligents ne sont pas encore mis en place chez les clients basse et
moyenne tension. Les flux de puissance doivent donc être reconstitués pour répartir celle-ci tout
le long des points de distribution d’un départ et permettre ainsi d’estimer la chute de tension en
chaque point du réseau HTA.
GE5E 2015 CADART Priscille 29
Pour faciliter les comparaisons, on calculera ces indicateurs à l’aide du logiciel ERABLE sur 3
réseaux : le réseau initial avec les charges initiales à l’année 0, le réseau initial avec les charges de
l’année 10 et le réseau prévu par le schéma cible moyen-terme (prenant donc on compte les
travaux de renforcements et les restructurations préconisés) avec les charges de l’année 10. Ainsi,
en comparant ces résultats, on pourra évaluer l’impact des travaux sur la qualité de fourniture.
Pour estimer les indicateurs, les calculs sont à la fois statistiques et probabilistes. Les 3
indicateurs de continuité de fourniture pourront être évalués selon deux points de vue : la qualité
réelle et la qualité potentielle.
La qualité réelle est calculée à partir des observations du passé : à l’aide des informations
référencées dans les bases de données, on comptabilise le nombre d’incidents et les temps de
coupure par départ sur les 5 dernières années. On peut ensuite calculer une moyenne annuelle
par départ HTA des nombre de coupures brèves et longues et du critère B. On filtre les coupures
liées à des incidents exceptionnels (aléas climatiques) et celles liées à des travaux car ils ne
dépendent pas directement des ouvrages.
Cette analyse n’est à faire qu’une fois par an, car une fois l’année clôturée, toutes les
informations restent fixes. J’ai conçu pour cette analyse des tableaux de calcul à l’aide des
données référencées dans l’outil DIRAC HTA, complétées par des données requêtées à l’aide
d’OSCAR.
La qualité potentielle est quant à elle calculée par le logiciel ERABLE à partir d’outils
probabilistes. Chaque technologie d’ouvrage possède un taux d’incidents propre qui est renseigné
en nombre d’incidents par an et par kilomètre dans la base de données de travail du logiciel. Celui-
ci peut ainsi estimer un nombre de coupures brèves et longues sur une période de calcul donnée.
Le logiciel simule également le tronçonnement et la reprise du réseau lors d’un défaut, il estime
ainsi les différents temps de coupures pour chaque incident et peut ensuite calculer le critère B.
Cependant, le logiciel souffre d’un manque de renseignement des bases de données qui
l’empêche de réaliser des calculs plus proches de la réalité. En effet, les taux d’incident par
technologie étaient calculés jusqu’en 2009 sur la base de nombre d’incidents réels rencontrés
dans chaque région. Cela permettait de prendre en compte les spécificités géographiques et
climatiques pour afficher une qualité potentielle plus réaliste : taux d’incident plus important sur
les faibles sections dans les régions sujettes à la neige par exemple, ou sur les câbles papiers
imprégnés dans les régions sujettes aux fortes chaleurs. Mais depuis 2009, le tronçon sur lequel
l’incident apparaît n’est plus suffisamment décrit dans les bases de données pour permettre une
distinction suivant la technologie. Un groupe de travail national mène cependant une réflexion
pour palier à ce manque d’information qui empêche de justifier correctement les investissements.
3.3 Intégration de la production décentralisée
Le grenelle de l’environnement a fixé comme objectif d’atteindre 20% de production
d’électricité par des énergies renouvelables d’ici à 2020. L’intégration de celle-ci devient donc une
problématique à ne pas négliger par le distributeur. Deux approches pourront être utilisées :
l’utilisation des documents de planification régionaux et la consultation du Bureau d’Etudes
spécialisé dans le raccordement des producteurs HTA.
3.3.1 Le SRRRER (Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables)
Pour faciliter l’implantation des énergies renouvelables, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010
[6] oblige les institutions et les entreprises concernées à rédiger des documents de planification.
Ainsi, les régions doivent fixer leur ambition de production d’origine renouvelable par le biais des
GE5E 2015 CADART Priscille 30
Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Par ailleurs, en s’appuyant sur ce
document et en consultation avec les gestionnaires du réseau de distribution (GRD), RTE est
chargé de rédiger des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables (SRRRER).
Ces derniers permettent de planifier l’intégration de la production décentralisée et d’éviter
la saturation des postes sources. Ils comportent les travaux et nouveaux ouvrages (voir Figure 21
[7]) nécessaires pour atteindre les objectifs, ainsi que des tableaux représentant les « capacités
d’accueil » et les « capacités réservées » par poste source en terme de puissance. Une fois tous les
travaux référencés et chiffrés, on divise leur coût global par la puissance de production prévue. Il
est ainsi possible de mutualiser les coûts de raccordement au réseau de distribution et d’afficher
ces informations pour inciter les éventuels producteurs à s’installer.
Figure 21 - Exemples de projets réseau engagés par RTE dans des zones saturées par la production décentralisée
Cependant, ces documents présentent une ambition très élevée en termes de puissances
réservées pour les énergies renouvelables. Il est risqué de considérer que toutes ces capacités
seront utilisées et de les insérer directement dans les calculs de réseau. Après consultation de la
Direction Technique à Paris, il a été suggéré de ne prendre en compte que les projets de
raccordement d’installations de production actuellement à l’étude. Il a par ailleurs été
recommandé de se mettre en relation avec le Bureau d’Etudes spécialisé dans le raccordement
des producteurs au réseau HTA. Pour la DR AFC, ce service est centralisé à la Direction
Interrégionale (DIR EST) et basé à Nancy.
3.3.2 Le BE Producteurs
Le BE Producteurs est chargé du dimensionnement du réseau pour l’accueil des projets de
production décentralisée. Malgré une complémentarité des études réalisées, le BERE et le BE
Producteurs ne se concertaient pas fréquemment, ce qui rendait difficile la planification. J’ai donc
contacté des membres de ce service pour comprendre les problématiques associées à l’intégration
de la production décentralisée, et réfléchir à un moyen d’échange entre les deux services. Deux
points ont été abordés : l’utilisation des documents du SRRRER et les contraintes apportées par
le raccordement de producteurs sur le réseau moyenne tension.
GE5E 2015 CADART Priscille 31
Les chargés d’études du BE Producteurs sont les premiers utilisateurs des tableaux issus des
SRRRER et tiennent à jour la file d’attente des raccordements. Ils mettent également à disposition,
via l’application MOA-Pilot, un document récapitulant les dernières modifications du SRRRER en
termes de capacité réservée et utilisée, et de travaux prévus par poste source. Il a rapidement été
constaté que la localisation des demandes de raccordement ne suivait pas toujours la répartition
décidée par les gestionnaires de réseau. C’est pourquoi il a été prévu des transferts de capacités et
de travaux (le montant global ne devant pas changer) entre postes sources d’un même SRRRER. Il
faudra ainsi prendre en compte la dernière version du tableau, disponible via l’application MOA-
Pilot. L’affichage de ces informations servira à visualiser les éléments de réseau qui seront rajoutés
(nouveau transformateur, nouvelle cellule départ, etc.) et ainsi permettre de mieux coordonner
les travaux. Par ailleurs, l’application MOA-Pilot recense tous les futurs projets de raccordement,
traités ou en cours de traitement. Cet outil sera donc le principal moyen d’échange entre les deux
bureaux d’études.
En ce qui concerne les contraintes dues au raccordement de producteurs, elles sont liées au
fait qu’un raccordement ne doit en aucun cas impacter la qualité de fourniture du distributeur,
autant du point de vue de la continuité de fourniture que du point de vue de la tenue en tension.
Par manque de temps et par souci de simplification, nous n’avons pu aborder que les
problématiques de tenue en tension.
Les contraintes de ce type apparaissant sur le réseau sont dépendantes des sections de
conducteur choisies mais également du taux d’accroissement des charges estimé. Ces données
influent sur le profil de tension des départs HTA, lui-même dépendant de la consigne de tension
imposée au niveau du transformateur. Lorsqu’un transformateur HTB/HTA n’alimente que des
consommateurs, la consigne est fixée à +4% de la tension d’exploitation car, lorsque les départs
sont longs (zone rurale), une chute de tension trop importante sera constatée pour les
consommateurs les plus éloignés. Cette consigne permet ainsi de respecter les normes fixant à
±5% la variation de tension sur le réseau moyenne tension, comme illustré par le profil de tension
en bleu sur la Figure 22.
Figure 22 - Impact de la production sur les profils de tension
GE5E 2015 CADART Priscille 32
Or, lorsqu’un producteur HTA est raccordé à un transformateur HTB/HTA, il est nécessaire
de régler à la fois la consigne du transformateur et la tension de sortie du générateur de sorte que
la différence de potentiel lui permette de refouler sa production en direction du transformateur,
lorsque la consommation en aval du producteur est trop faible. Cela est permis par un réglage
haut du producteur et un abaissement de la consigne de tension du transformateur de +4% vers
+2% de la tension d’exploitation (20kV). Cela permet également de respecter les normes.
Cependant, cela pose des problèmes lorsque des départs consommateurs et producteurs
cohabitent sur un même transformateur, comme le montrent les courbes en trait plein de la
Figure 22. Ces situations apparaissent lorsque les départs HTA sont longs, que la puissance
produite est comparable à la puissance consommée sur la totalité du départ et qu’il n’est pas
possible de raccorder le producteur plus près du poste source, ou encore lorsque la puissance du
producteur n’est pas suffisante (inférieure à 5MW) pour justifier la création d’un transformateur
dédié.
Des mesures sont prévues pour palier à ces contraintes, comme le renforcement du réseau
via l’adaptation des sections des conducteurs, ou encore l’installation de compensateur d’énergie
réactive. Le choix et le dimensionnement de ces mesures est réalisé par le BE Producteurs. Il n’est
donc pas nécessaire de refaire l’étude de l’accueil des projets sur le réseau initial. Cependant, la
réflexion sur les taux d’accroissement des charges qui est menée en profondeur dans les SCORE
doit pouvoir compléter la réflexion et peut parfois faire varier les prévisions d’apparition de
contrainte sur 30 ans. Cela nécessitera parfois d’anticiper ou de décaler certains travaux prévus
par les deux bureaux d’études. Il faudra donc afficher le poste source et le départ prévu pour le
raccordement afin d’alimenter la réflexion.
3.4 Prise en compte du courant capacitif
Le courant capacitif est un courant triphasé qui circule dans les réseaux dès leur mise sous
tension. Il est normalement équilibré et on lui donne pour norme I 0 dans chaque phase (voir
Figure 23). Lors de l’apparition d’un défaut monophasé, communément appelé défaut
homopolaire (ex : branche d’arbre, conducteur à terre, arrachage de câble souterrain, etc.), un
déséquilibre se crée (voir Figure 24) et le courant capacitif, ayant alors pour norme 3I0, vient
s’ajouter aux autres composantes du courant de défaut retournant à sa source via le neutre du
transformateur HTB/HTA. De nature capacitif et circulant dans la terre, il génère des montées en
potentiel importantes. Pour le distributeur, la réglementation impose de maîtriser ces
phénomènes pour assurer la sécurité des biens et des tiers.
GE5E 2015 CADART Priscille 33
Figure 24 - Courants capacitif lors d'un défaut
Figure 23 - Courants capacitifs en régime normal monophasé à la terre (déséquilibre)
(équilibré)
Le neutre HTA n’étant pas distribué en France, il est possible de limiter le courant en
mettant en place au niveau des transformateurs HTB/HTA des régimes de neutre adaptés appelés
Neutre Impédant (NI) ou Neutre Compensé (NC). A ces régimes de neutre sont associés des
systèmes de protections par départ, qui permettront une bonne sélectivité des disjoncteurs lors
de l’apparition d’un défaut.
Lorsqu’une nette séparation des réseaux souterrains (urbains) et aériens (ruraux) était en
place, l’influence du courant capacitif sur les montées en potentiel était négligeable. En effet, les
réseaux aériens sont faiblement capacitifs (cent fois moins que les réseaux souterrains à section et
longueur équivalente) et l’architecture des réseaux purement souterrains permet de "diriger" le
parcours du courant de défaut grâce à l’interconnexion des circuits de terre. Cependant, dans le
cadre du Plan Aléas Climatiques, une grande quantité de réseau aérien a été enfouie. Cela a
engendré une augmentation des courants capacitifs sur des réseaux mixtes occasionnant des
problématiques de détection de défauts et de montées en potentiel. C’est pourquoi la nouvelle
PRDE prescrit la limitation de celui-ci par départ, selon le régime de neutre du transformateur
alimentant le départ. Pour vérifier si le réseau n’est pas en contrainte, plusieurs analyses sont à
réaliser.
Tout d’abord, l’état de contrainte du régime de neutre du transformateur est à évaluer. En
me basant sur les prescriptions du national [8], j’ai établi le tableau de la Figure 25. Celui-ci fixe
des seuils de 3I0 en schéma normal à respecter par transformateur, selon la longueur de réseau
aérien ou souterrain raccordée au transformateur, et le régime de neutre choisi. Les contraintes
prennent en compte la possibilité pour un transformateur de reprendre le réseau alimenté par un
autre transformateur du même poste source en schéma secours (on prévoit une marge de 50% du
3I0 limite). Lorsque les limites sont atteintes, il faut soit changer le régime de neutre, soit
restructurer le réseau.
3I0 normal > Consignes des notes SCORE et
Type de réseau Neutre
(en A) MALTEN
rural ou péri-urbain NI 100 => passage en NC
(longueur 300 => limite du NC 600A atteinte
NC
aérien>5km) 500 => limite du NC 1000A atteinte
urbain (longueur NI 300 300 => passage en NI 1000A
aérien<5km) NI 1000 500 => limite du NI 1000A atteinte
Figure 25 - Tableau des contraintes de 3I0 par transformateur
GE5E 2015 CADART Priscille 34
Dans un second temps, il est nécessaire d’évaluer les contraintes par départ, en schéma
secours. Ces régimes de fonctionnement vont impliquer les réseaux les plus longs, donc les plus
capacitifs et il faudra toujours assurer une bonne détection et une bonne sélectivité sur défaut.
Plusieurs appuis existent entre départs, impliquant plusieurs régimes secours possibles. On
évaluera le 3I0 du régime secours le plus contraignant, c’est-à-dire le plus long. J’ai développé une
macro permettant de déterminer automatiquement le 3I0 maximum (fonctionnalité manquante au
logiciel de calcul ERABLE).
Les contraintes par départ dépendent du régime de neutre du transformateur et des
limites des systèmes de protection associés. Pour assurer la sélectivité, ces systèmes doivent
empêcher le déclenchement « par sympathie ». En effet, lors d’un défaut, chaque départ sain du
transformateur va voir circuler son propre 3I0, l’apparition de ce courant homopolaire ne doit pas
faire déclencher les protections car le défaut ne se situe pas sur ces départs. C’est pourquoi on
impose une limite de 3I0 maximum, comme indiqué sur le tableau de la Figure 26, construit à
partir des informations de la PRDE sur l’élaboration des SCORE [4].
Régime de 3I0 secours max
neutre par départ (en A)
NI 150A
80
(80 ou 40+j40)
NC 160
NC 200
NI 300A
120
(40 ou 40+j12)
NI 12+j12 185
1000A 12 230
Figure 26 - Seuils de 3I0 par départ selon le régime de neutre du transformateur
Lorsque les limites sont atteintes, la restructuration consiste en la création d’un nouveau
Poste Source. Cependant, cela impose la proximité d’une ligne HTB pour éviter d’importants coûts
de raccordement. Si cette solution n’est pas envisageable, l’idée de créer des postes de répartition
équipés d’autotransformateurs bénéficiant d’un régime de neutre a été proposée. La gestion de
ces postes du point de vue de l’exploitation et de la maîtrise d’ouvrage reste cependant complexe
et difficile à mettre en œuvre.
4 PLANNING REALISE ET DIFFICULTES RENCONTREES
Au fur et à mesure de l’avancement du stage, les priorités ont évolué et certaines difficultés
rencontrées ont engendré des modifications du planning. Le planning effectivement réalisé est
montré Figure 27.
La montée en compétences sur les éléments techniques a pris plus de temps que prévu, car
était finalement visée la compréhension en profondeur des problématiques liées au 3I 0 dans un
objectif d’explication aux chargés d’études pour une application quotidienne. Par ailleurs, le
logiciel ERABLE évoluant très rapidement (une montée de configuration tous les deux mois
environ) et les chargés d’études ne le maîtrisant pas encore complètement, cette formation s’est
étalée au fur et à mesure des utilisations du logiciel.
GE5E 2015 CADART Priscille 35
Le choix des restitutions cartographiques et tableur a pris également plus de temps que
prévu car plus de restitutions ont été autorisées par l’automatisation de rendus supplémentaires.
Par ailleurs, il a fallu monter en compétences sur le logiciel QGIS pour mettre à jour les cartes et
redécouper les zones, ce qui n’était pas prévu dans les objectifs initiaux. Au fur et à mesure du
développement de l’outil Excel, de nouvelles fonctions se sont ajoutées aux besoins initiaux, c’est
pourquoi son développement s’est étalé dans le temps.
Semaines de stage
Planning réel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Formation - Montée en compétences
Organisation (fonctionnement, découverte du métier)
Technique (électrotechnique, 3I0, régimes de neutre, etc.)
Montée en compétences ERABLE
Etude bibliographique
Appropriation de la PRDE SCORE et des PRDE associées
Identifier les différences entre les versions
Analyse des Schémas Directeurs existants (benchmark)
Choix des restitutions
Restitutions tableur
Modèle de rapport
Redécoupage des zones et restitutions cartographiques
Conception et développement des outils
Macro de diagnostic automatique et de mise en forme
Rédaction des fiches méthodes
Synthèse destinée à la décision et la communication
Informations et interlocuteurs externes
Internes (D12, raccordement)
Externes (SRRRER, SCOT, INSEE)
Prise de contact avec les Directions Territoriales
Présentation et accompagnement des chargés d'études
Présentation des outils
Debogage de la macro
Accompagnement des chargés d'études
Etude d'un cas concret : SCORE MAICHE
Etat des lieux (récupération des projets en cours)
Analyse du SRRRER (zone producteurs)
Figure 27 - Planning réalisé
L’analyse des informations et des interlocuteurs externes a été réalisée plus en profondeur
que ce que les objectifs prévoyaient initialement, notamment via l’organisation de réunions avec
les divers représentants des directions territoriales.
La première réunion de présentation des outils aux chargés d’études a été avancée pour
permettre à tous d’être présents (et ainsi éviter les congés). Par ailleurs, une étape de débogage
de la macro s’est ajoutée, permise par les tests réalisés par les différents utilisateurs.
L’étude de deux cas concrets s’est réduite à l’étude d’un seul car la zone finalement choisie
présentait plus de problématiques que deux zones SCORE. Cependant, cette étude n’a pas pu être
terminée, car la maîtrise des fonctionnalités ERABLE nécessaires aurait pris trop de temps.
GE5E 2015 CADART Priscille 36
RESULTATS
Les résultats de l’étude sont formés des outils que j’ai développés pour répondre aux
objectifs du stage. Tout d’abord un modèle de rapport qui constitue la méthodologie pratique
d’élaboration des SCORE. Les rapports à rédiger seront complétés par des cartes, dont j’ai
construit les légendes. J’ai également développé une macro de mise en forme des résultats
électriques en Visual Basic sous Excel. Enfin, j’ai conçu un outil d’aide à la décision sous forme d’un
fichier Excel de synthèse des SCORE. Dans chaque partie, je présenterai l’outil puis les apports et
les limites que celui-ci comporte.
1 RESTITUTIONS DU SCORE
1.1 Rapport de synthèse
En m’appuyant sur les résultats de l’étude bibliographique, j’ai rédigé la méthodologie
détaillée d’élaboration des SCORE. Pour réduire le nombre de documents auxquels se référer, j’ai
présenté la méthodologie sous la forme d’un modèle de rapport au format Word. Le plan est
présenté Figure 28. Chaque partie contient un paragraphe explicatif des recherches et des calculs
à effectuer pour trouver le plus rapidement possible les informations à compléter.
Figure 28 - Plan du rapport SCORE
Ce rapport est complété par des liens vers des outils et des fiches méthodes
complémentaires, à savoir :
GE5E 2015 CADART Priscille 37
- un fichier Excel permettant de construire le tableau des communes importantes de la
zone (plus de 1500 habitants) décrivant les clients BT et HTA.
- une fiche méthode explicitant comment construire les cartes à annexer au rapport
- plusieurs notices d’utilisations des fonctionnalités ERABLE spécifiques à l’élaboration
des SCORE (application des taux d’accroissement, export des dessins de travaux, etc.)
- le fichier Excel CRISTINA permettant la récupération des Taux de Croissance Moyen
Annuels (TCMA) par poste source
- deux tableaux des coûts permettant le chiffrage des travaux (réseau et postes sources)
Apports techniques et financiers
Cette méthodologie détaillée permettra d’accélérer le temps de production des résultats
par les chargés d’études. Les rapports seront rapidement mis en forme et standardisés. La mise en
place d’un seul document contenant des liens vers les diverses sources d’informations et vers des
fiches méthodes ciblées pour les divers outils à utiliser (QGIS, ERABLE, Excel) permettra de réduire
significativement le temps de recherche et de manipulation. Cela impliquera une réduction non
négligeable des coûts de main d’œuvre.
Par ailleurs, via ce rapport et la méthodologie associée, l’étude s’enrichit de données
externes, pour augmenter encore la cohérence et la fiabilité de la planification. On peut supposer
que le besoin en mises à jour partielles du réseau cible, prescrites lors de l’occurrence
« d’évènements importants conduisant à un écart par rapport au SCORE » [4], sera ainsi diminué.
Limites et suites éventuelles
Pour rédiger ce modèle, je me suis appuyé sur l’étude du cas concret de la zone de Maiche,
dont j’ai pu compléter les parties « Présentation de la zone » et « Etat des lieux ». En revanche,
n’ayant pas pu tester la réalisation des travaux résolvant les contraintes, j’ai eu plus de mal à
évaluer la pertinence des deux dernières parties.
Il m’a cependant été possible d’évaluer les limites de l’étude technico-économique
prescrite. En effet, le calcul du bilan actualisé est réalisé par l’outil ERABLE. Il prend en compte,
entre autres, les pertes Joules, le coût de l’Energie Non Distribuée, les coûts d’exploitation. Or, le
BERE n’a pas aujourd’hui la vision des coûts d’exploitation générés par le réseau selon la zone. Le
logiciel réalise donc le calcul sans cette donnée, et l’intérêt du Bilan Actualisé s’en trouve diminué.
Même si un outil va être mis en place avec le service Fiabilisation (fonction Opérations) pour faire
remonter au BERE les coûts d’exploitation par départ, il sera délicat, voire impossible, d’estimer
les coûts d’exploitation après travaux. La possibilité de comparaison restera donc limitée.
Il sera donc nécessaire de choisir la stratégie en complétant par une comparaison des
résultats électriques. Il pourra être intéressant d’ajouter également comme argument un nouveau
calcul des pourcentages de reprise du poste source lors de la perte HTB. Ce chiffre pourra être un
élément de comparaison de l’apport de chaque stratégie (nouvelles sources ou nouveaux départs)
pour que la justification du choix soit la plus complète possible. Il faudra cependant prendre en
compte le temps de production de ce chiffre par le logiciel ERABLE, qui est aujourd’hui
considérable (jusqu’à plusieurs heures de calcul).
GE5E 2015 CADART Priscille 38
1.2 Restitutions cartographiques
Le rapport sera complété par des cartes à ajouter en annexe. Une notice détaille comment
construire ces cartes en utilisant les outils informatiques appropriés.
J’ai construit 3 fichiers QGIS (un par centre : Alsace, Franche-Comté Centre et Franche-
Comté Sud) incluant des bases de données géographiques pour le réseau (tronçons, nœuds,
postes sources, etc.) et pour les communes. Ces bases sont découpées par zone SCORE.
J’ai également construit des fichiers de configuration du « Style », c’est-à-dire de la légende
des cartes. Ces fichiers permettent de paramétrer automatiquement les symboles (symboles
ponctuels, linéaires ou surfaciques) à utiliser pour faire apparaître les informations choisies sur la
carte.
Par ailleurs, j’ai développé une petite macro Excel pour mettre en forme les résultats de
calculs d’ERABLE et ainsi permettre une intégration en format .csv sur le logiciel QGIS. En utilisant
un attribut commun, il est possible de joindre les bases de données géographiques avec les
tableaux de résultats. On peut ainsi afficher ces derniers de manière graphique.
Pour la présentation de la zone, la production de nombreuses cartes était prescrite. Pour limiter la
charge de travail et n’afficher que les informations les plus pertinentes, j’ai choisi 3 cartes :
- La carte de situation géographique permet de visualiser les villes importantes de la zone
positionnées sur une carte IGN. La carte IGN autorise également l’affichage des reliefs qui
peuvent s’avérer déterminants dans le choix de certains tracés du réseau.
- La carte du dynamisme de la zone permet d’apprécier la géographie des projets connus,
des communes et des clients importants sur la zone, et ainsi vérifier la cohérence avec les
taux d’accroissement choisis. Sa légende est montrée Figure 29.
Figure 29 - Légende de la carte des taux d'accroissement et des clients importants
- La carte de diagnostic des ouvrages de la zone offre un diagnostic complet des zones
prioritaires de travaux. Comme illustré sur la Figure 30, elle affiche les zones impactées par
le Plan Aléas Climatiques, les tronçons en technologie Câble Papier Imprégné ainsi que
l’âge des réseaux.
GE5E 2015 CADART Priscille 39
Figure 30 - Légende de la carte de diagnostic des ouvrages
Quatre catégories d’âges sont représentées, en fonction de la Valeur Nette Comptable
(VNC, équivalent de l’amortissement) des tronçons aux différentes années d’études. Les
ouvrages réseaux étant amortis sur 40 ans, leur VNC devient nulle lorsqu’ils atteignent cet
âge. Si on supprime du réseau n’ayant pas atteint cet âge, la VNC résiduelle des ouvrages
est un coût supplémentaire à prendre en compte dans le chiffrage des travaux. J’ai ainsi
choisi de représenter les ouvrages ayant une VNC nulle dès l’année 0 (> 40 ans), ceux ayant
une VNC nulle à l’horizon 10 ans (entre 30 et 40 ans), ceux ayant une VNC nulle à l’année
30 (entre 10 et 30 ans) et ceux n’annulant jamais leur VNC sur la période d’étude (< 10
ans).
Pour l’état des lieux électrique du réseau, j’ai limité la restitution à une seule carte. Celle-ci
représente 2 types d’informations, comme l’indique la légende de la Figure 31.
Figure 31 - Légende de la carte des résultats électriques sur réseau initial
Tout d’abord, on affiche les résultats électriques sur le réseau HTA : l’évolution des « Trous
PL » et les chutes de tension à l’année initiale.
Le PL est le produit P*max (puissance apparente en tête de départ, à la pointe de consommation)
fois la longueur développée du départ. Cet indicateur représente ainsi à la fois l’étalement des
charges (longueur) et la quantité de charges (puissance).
La fonction « TrousPL » du logiciel ERABLE calcule les nœuds limites où le PL du départ commence
à dépasser la valeur idéale de 100 MVA.km et la simulation cesse d’alimenter les portions de
GE5E 2015 CADART Priscille 40
réseau à partir de ces points. On distingue ainsi des "Trous" localisés qu’il faudra chercher à
résorber soit en créant une nouvelle source, soit en divisant les départs pour les décharger.
On affiche par ailleurs le réseau HTB, pour identifier les endroits où l’implantation d’un
nouveau poste source serait possible.
Apports techniques et financiers
Ces visualisations cartographiques, et surtout la notice détaillée de construction de ces
cartes à l’aide de l’outil QGIS, permettront de standardiser les restitutions. Cela accélèrera le
travail de rendu, et facilitera le travail de validation.
ERABLE présente un affichage graphique des résultats qui permet déjà une visualisation
des trous PL ou des chutes de tension. Cependant, les fonctionnalités graphiques étant peu
flexibles, il est impossible d’afficher sur une même carte, en les différenciant, les trous PL de
plusieurs années, et les chutes de tension. La macro Excel « QGIS_ERABLE » offre la possibilité de
joindre tous les résultats ERABLE à la base de données géographiques déjà intégrée à l’outil. On
passe ainsi de la production de 4 cartes de résultats électriques à une seule.
La représentation cartographique dans le cadre des analyses de réseau est indispensable.
Elle permet d’apprécier la géographie du réseau et d’orienter la réflexion sur la restructuration. En
effet, la visualisation des tronçons prioritaires (en terme de PRC, de PAC ou d’âge) nous indique les
endroits où il est le plus rentable d’effectuer des travaux. Dans la réflexion, on pourra combiner
ces informations avec les informations électriques décrivant les besoins en restructuration. En
affichant ainsi les Trous PL, on pourra rapidement identifier les zones ayant besoin d’un nouveau
poste source, et choisir sa position idéale grâce aux données du réseau HTB.
Limites et suites éventuelles
Les limites de la visualisation cartographique sont liées à des problèmes de bases de
données. La source des informations géographiques qu’on peut afficher sur QGIS est la même que
pour ERABLE : le SIG-Elec. Cependant, pour plus de rapidité, les deux outils fonctionnent en « hors-
ligne », c’est-à-dire qu’ils utilisent des extractions du SIG. Or, ces extractions sont réalisées à des
dates différentes. Le réseau évoluant mois après mois, au fur et à mesure des travaux effectués, il
peut y avoir des différences entre les tronçons affichés par les deux outils. Selon le type
d’informations manquantes, l’affichage réalisé par les fichiers de paramétrage du « Style » pourra
ne plus être totalement cohérent.
Par ailleurs, le logiciel QGIS est un outil développé en open-source et sur lequel ERDF n’a
pas la maîtrise. Le national prescrit l’utilisation du logiciel développé en interne CARAIBE,
cependant celui-ci fonctionne aujourd’hui avec des données au format image, et non vectoriel. Il
ne permet donc aucun des affichages personnalisés décrits ci-dessus. Cet outil est en phase de
développement à l’heure actuelle, et de nouvelles fonctionnalités pourraient permettre ces
affichages. Les outils libres choisis localement comme QGIS, ArcGIS ou FGIS sont ainsi voués à
disparaître. Cela rendrait obsolètes les outils que j’ai développé.
GE5E 2015 CADART Priscille 41
2 MACRO DE MISE EN FORME
2.1 Analyse du besoin
Après avoir choisi les informations les plus pertinentes à afficher, il est apparu que les
résultats électriques permettant de compléter ces tableaux étaient nombreux, de par la structure
du logiciel ERABLE. En effet, pour chaque diagnostic un certain nombre de restitutions sont à
produire, selon le tableau de la Figure 32.
Source Fichiers Utilité
Résultats Transfos à Ptmb, année 0
Résultats Transfos à Ptmb, année 10
Résultats Transfos à Ptmb, année 30 Résultats électriques de la stratégie "Ne
Restitutions
Résultats Transfos à Pmax, année 0 Rien Faire"
ERABLE pour
Résultats Transfos à Pmax, année 10
l'état des
Résultats Transfos à Pmax, année 30
lieux
Résultats Diagnostic Rapide Départs (fichier CSV) Ptmb + P*max Résultats 0-10-30 ans sur l'état initial
Résultats Départs à Ptmb, année 0 Tension, longueurs
Résultats Secours Pmax, année 0 Analyse 3I0 secours
Résultats Transfos après travaux, à Ptmb, année 10
Résultats Transfos après travaux, à Ptmb, année 30 Résultats électriques de la stratégie
Résultats Transfos après travaux, à Pmax, année 10 choisie
Restitutions
Résultats Transfos après travaux, à Pmax, année 30
ERABLE après
Résultats Diagnostic Rapide Départs (fichier CSV) Ptmb + P*max Résultats 0-10-30 sur réseau avec travaux
dessin des
Résultats Départs à Ptmb, année 10
travaux Tension, longueurs
Résultats Départs à Ptmb, année 30
Résultats Secours à Pmax, année 10
Analyse 3I0 secours
Résultats Secours à Pmax, année 30
Restitutions Traitement Départs sur réseau initial Qualité potentielle (taux d'incidents)
ERABLE Traitement Départs à 10 ans sur réseau initial
qualité Traitement Départs à 10 ans avec travaux
Figure 32 - Liste des restitutions à fournir à l'aide du logiciel ERABLE
Par ailleurs, cette quantité d’informations rend l’interprétation délicate, si une mise en
forme adaptée n’est pas mise en place. ERABLE produisant des restitutions sous forme de tableaux
Excel, l’initiative avait été prise par le BERE de Champagne-Ardenne de développer une macro en
Visual Basic sur Excel et de la transmettre aux autres BERE. Les restitutions issues d’ERABLE
comprennent à chaque fois un nombre important de colonnes d’informations qui n’ont pas toutes
été choisies pour l’affichage, c’est pourquoi l’automatisation de la mise en forme était souhaitée.
Cependant, la macro manquant de flexibilité et de robustesse, j’ai travaillé à sa
reconception. L’analyse du besoin fondamental est représentée Figure 33.
Figure 33 - Diagramme "Bête à cornes" de la macro
GE5E 2015 CADART Priscille 42
L’analyse du besoin a permis de dégager deux fonctions principales, comme indiqué Figure
34. D’autre part, au fur et à mesure de l’avancement du développement, des fonctions contraintes
se sont rajoutées, pour rendre l’outil le plus exhaustif, le plus adaptable et le plus robuste
possible.
Figure 34 - Diagramme "Pieuvre" de la macro
2.2 Mise en place des solutions techniques
Pour répondre aux fonctions principales et aux fonctions contraintes, j’ai mis en place
plusieurs systèmes.
Fonctions principales
Tout d’abord, la mise en forme rapide est réalisée via deux fonctionnalités de l’outil :
l’import des restitutions issues d’ERABLE à l’aide de menus déroulants (Figure 35), et la copie des
colonnes de résultat choisies via un bouton « Mise en forme » pour chaque diagnostic (un onglet
par point de vue).
2. Importation des données à mettre en forme :
Restitutions ERABLE sur réseau initial : Transfos à Ptmb, année 0
Restitutions ERABLE sur réseau cible Moyen-Terme et Long-Terme :
Diagnostic Rapide Départs (fichier CSV)
Restitutions qualité : Traitement Départs sur réseau initial
Figure 35 - Menus d'importation
GE5E 2015 CADART Priscille 43
Pour la fonction d’interprétation des résultats, j’ai choisi une forme spécifique de
présentation des résultats facilitant la réflexion : pour chaque élément de calcul évoluant avec les
charges, 3 colonnes seront représentées, une pour chaque année d’observation (année 0, année
10, année 30), comme illustré sur la Figure 36. On observe ainsi l’aggravation des contraintes au fil
du temps et on peut estimer la période de réalisation des travaux nécessaires (avant 10 ans ou
après 10 ans).
Marge Min Chute de tension P*max Produit P*L
Code Libellé Type U Ltot
(MVA) (%) (MVA) (MVA.km)
Départ Départ U/R (kV) (km)
2015 2025 2045 2015 2025 2045 2015 2025 2045 2015 2025 2045
MAICHC2004 CONSOL R 20 71,70 2,75 2,24 1,20 2,79 3,16 3,91 3,55 3,99 4,88 254,33 285,96 349,82
I.DOUC1006 COLOMB Figure
R 2036 -50,16
Présentation
3,99 3,71des 3,09
résultats
4,15électriques
4,40 4,93par4,51
départs
4,76 5,30 226,29 238,71 265,65
P.ROIC1002 ESSART R 20 40,87 2,81 2,59 2,12 3,11 3,26 3,57 4,91 5,10 5,51 200,73 208,42 225,06
Par ailleurs,
I.DOUC2002 ANTEUI j’ai Rutilisé20 l’outil « Mise
66,12 3,94 3,78en3,42
forme
2,12 conditionnelle
2,28 2,64 2,95» 3,09 déjà 3,40
intégré
194,79à 204,06
Excel.224,49
J’ai
FINS C0010
résumé RUSSEY seuils Rde la20PRDE
les divers 59,16en3,76 3,44 2,73
plusieurs 3,15 (Figure
tableaux 3,43 4,08 37),3,19 3,47a permis
ce qui 4,11 188,80 205,31 242,89
d’appliquer, à
MAICHC2006 PT-NEU R 20 75,99 4,56 4,27 3,68 1,84 2,10 2,64 2,34 2,58 3,09
l’aide de formules conditionnelles, une mise en couleur aux cellules dépassant ces seuils, selon des 177,62 196,24 234,51
B.DAMC2009 ROCHE R 20 69,24 4,39 4,25 3,94 3,71 3,93 4,41 2,28 2,40 2,66 157,86 166,08 184,09
conditions respectées par
P.ROIC1006 S-HIPP R
le 20
départ.
39,54 4,11 3,96 3,63 2,30 2,38 2,57 3,52 3,65 3,93 138,99 144,17 155,38
MAICHC1001 CHARQU R 20 42,01 3,77 3,33 2,45 1,70 1,91 2,33 3,11 3,49 4,25 130,65 146,57 178,53
ABBENC2008 CLERVA R
Legende
20 43,22 4,65 4,30 3,63 2,52 2,80 3,35 2,82 3,12 3,69 122,05 134,79 159,55
B.DAMC3003 VAUDRI R 20 65,18 4,50 4,38 4,12 2,92 3,13 3,58 1,87 Rural1,97 2,19Urbain
121,94 128,57 142,99
Repères SCORE
FINS C0009 NARBIELegende R 20 62,16 3,23 3,05 2,63 4,47 4,87 5,7920 1,91 kV 15 kV 20 kV
2,07 2,44 15 kV
118,69 128,72 151,59
MAICHC1005 INDEVI
Marge (MVA) R < 200 62,87 3,77 3,54 3,07 3,27 3,60 4,27 1,88 2,07 2,48 117,91 130,31 155,70
P*max (MVA) > 5 3,75 6 4,5
P.ROIC1009 SANCEY R 20 55,96 4,91 4,79 4,53 2,36 2,50 2,81 1,91 2,01 2,23 106,69 112,46 124,95
I.DOUC1010 SANTOC DU/U (%) P*L (MVA.km)
U > 205 13,17 4,51 4,46 4,36 4,20 4,22 4,27 100
> 7,24 7,2855 7,37 95,32 95,85 96,99
Non calculé
MAICHC2009 BRESEU DU/U (%)
R > 3 Longueur totale (km) > 55
20 51,90 4,27 4,00 3,46 2,58 2,96 3,70 1,79 2,02 2,48 92,76 104,68 128,88
MAICHC1008Figure 37 - Seuils
DESSOU R de la
20mise en forme
66,10 conditionnelle
4,25 4,10 3,77 2,18pour l'analyse
2,51 3,16 des
1,35résultats par départ
1,48 1,75 89,42 97,65 115,35
P.ROIC1003 BREMON R 20 62,62 4,67 4,60 4,45 0,70 0,78 0,95 1,32 1,38 1,50 82,78 86,27 94,09
Fonctions contraintes
Pour faciliter la prise en main, et après un bêta-test auprès d’un chargé d’études, j’ai mis
en place plusieurs solutions d’ergonomie. Tout d’abord, comme visible sur la Figure 32, un code
couleur a été instauré pour différencier les étapes de l’analyse : l’état des lieux, le réseau cible, et
la qualité de fourniture. Un deuxième code couleur permet de dissocier les points de vue adoptés
pour le diagnostic : transformateurs et postes sources, départs, schéma secourant et qualité. Il est
appliqué aux onglets correspondants. Par ailleurs, j’ai inséré des commentaires explicatifs sur les
fonctions importantes, un sommaire comportant des liens hypertextes pour faciliter la navigation
dans les onglets et un menu de suppression des fichiers. La Figure 38 présente l’interface de la
page d’accueil de la macro.
GE5E 2015 CADART Priscille 44
Sommaire Mise en forme SCORE
1- Affaires MOA-Pilot 1. Intro (à remplir avant d'éditer le rapport) :
2- Diagnostic Transfos Année du SCORE : 2016 Région : 0
3- Diagnostic PS 2026 N+10 Zone d'étude : 0
4- Diagnostic Départs 2046 N+30
5- Bilan Départs Editer Rapport Word Auteur :
6- Diagnostic 3I0
7- Diagnostic Qualité Lien document :
Donnees 2. Importation des données à mettre en forme :
Parametres
Restitutions ERABLE sur réseau initial : Transfos à Ptmb, année 0
Restitutions ERABLE sur réseau cible Moyen-Terme et Long-Terme :
Diagnostic Rapide Départs (fichier CSV)
Restitutions qualité : Traitement Départs sur réseau initial
Onglets Fichiers
Fichiers
Supprimer
Tout supprimer
Fonctions supplémentaires :
Purger la mise
en forme
Figure 38 - Interface de l'outil
Pour faciliter la mise à jour, un menu déroulant permet l’insertion ou la suppression des
fichiers annuels, en permettant le choix du chemin d’accès. Ceux-ci sont insérés dans des onglets
permanents et la plupart des informations nécessaires sont liées aux onglets de restitution par des
formules. Un onglet « Données » recense tous les départs et les postes sources de la plaque Alsace
Franche-Comté, avec les informations spécifiques à actualiser.
En ce qui concerne l’adaptation aux changements des outils de calculs, j’ai utilisé un
onglet de paramétrage modifiable à la main. Le logiciel ERABLE évoluant au gré des besoins
remontés par les utilisateurs, les restitutions peuvent changer de configuration (nouvelles
colonnes, ou changement de position voir l’exemple de la Figure 39). Il m’a donc fallu rendre le
code dynamique via la création de nouveaux types de variables. J’ai créé une classe de variable par
type de restitution, chaque classe ayant pour attributs les entêtes des colonnes de la restitution
correspondante. Dans l’onglet de paramétrage, un tableau par classe permet de modifier ces
valeurs dans des cellules associées à des noms de variable, comme montré Figure 40. Les attributs
sont ainsi mis à jour à chaque exécution du code.
GE5E 2015 CADART Priscille 45
Figure 40 - Tableau de paramétrage
Figure 39 - Exemple de restitution ERABLE
Le rendu standardisé est permis par des fonctions permettant la création d’un fichier Word
à partir du modèle de rapport de synthèse. Ce modèle contient les explications relatives aux
tableaux à insérer. Les tableaux mis en forme sont verrouillés mais il est possible de masquer des
lignes ou des colonnes.
L’intégration de données manuelles est également rendu possible car les cellules de
données ne sont pas verrouillées. De plus, lorsque la macro ne trouve pas certaines données
(comme le régime de neutre d’un transformateur n’appartenant pas à la DR), un message
d’information est affiché, mais celui-ci ne bloque pas l’exécution du code. C’est ensuite à
l’utilisateur de rentrer les données manquantes. Un onglet supplémentaire permet d’intégrer
manuellement des données issues de MOA-Pilot, en n’imposant que la mise en forme du tableau.
2.3 Apports et limites
Apports techniques et financiers
Sur la base des retours des chargés d’études, j’ai estimé le temps d’élaboration d’un schéma
directeur détaillé, comme indiqué sur le tableau de la Figure 41. Cette estimation est réalisée
d’après l’expérience des chargés d’études qui suivaient la méthodologie locale mise en place en
2013. Celle-ci ne prenait pas en compte l’analyse de la qualité de fourniture, ni n’impliquait la
recherche d’informations extérieures au BERE. A ce jour, en utilisant les outils que j’ai développés,
seul l’état des lieux des SCORE a été réalisé aujourd’hui par un chargé d’études. Sur ce dossier,
assez conséquent, celui-ci a passé 1 semaine en s’impliquant sur cette tâche pendant 100% de son
temps. On peut estimer qu’il faudrait 5 semaines supplémentaires pour réaliser le choix de la
cible, dessiner les travaux puis utiliser ERABLE pour produire les résultats électriques après
travaux.
Réalisation SD avec la méthodologie locale SCORE avec les
outils développés
Durée de réalisation 3 mois (13 semaines de 35h) 6 semaines de 35h
Implication sur la tâche 2/3 du temps 100% du temps
Temps de travail total 303h 210h
Taux horaire brut d’un CE expérimenté 20,13€/h (Source : grille de salaire ERDF-GRDF)
Coût de la main d’œuvre 26,2€/h (Source : URSSAF)
Coût total d’une zone 7947 € 5502 €
Total des 20 SCORE 158 947 € 110 040 €
Figure 41- Estimations des coûts de main d'œuvre
GE5E 2015 CADART Priscille 46
D’après les estimations de la Figure 41, on observe un gain en coût de main d’œuvre de
près de 30%. Les outils développés permettent par ailleurs d’étudier les problématiques
techniques supplémentaires des SCORE, ainsi que les notions importantes qui avaient été mises de
côté par soucis de simplification lors de l’élaboration de la précédente méthodologie locale.
Limites et suites éventuelles
Cet outil est limité par les fichiers à mettre à jour. En effet, il repose en partie sur des
données annuelles issues d’autres services comme le SRRRER issu du BE Producteurs, ou un
tableau récapitulatif des technologies utilisées par les Postes-Sources issu de l’AMEPS (Agence de
Maintenance et d’Exploitation des Postes Sources). Si ces fichiers venaient à ne plus être mis à
jour, une partie de l’automatisation ne serait plus possible.
Par ailleurs, certaines macros de l’outil sont quelques fois longues à s’exécuter. En effet, le
code peut ne pas être totalement optimisé en termes de temps d’exécution, car ayant appris la
programmation en VBA avant de savoir utiliser toutes les formules d’Excel, je n’ai pas mis à profit
toutes les possibilités de ces dernières. L’utilisation de formules permettrait pourtant de diminuer
la quantité de code à exécuter.
L’outil va être mis en ligne sur un serveur recensant toutes les « innovations » réalisées par
les salariés d’ERDF. De par son adaptabilité, il pourra ainsi être utilisé par d’autres BERE et leur
permettre de gagner du temps dans la production des résultats.
3 OUTILS D’AIDE A LA DECISION
Considérant que les ouvrages réseau sont posés pour 30 à 40 ans, les SCORE sont des
documents indispensables pour planifier les investissements. Ils doivent permettre de mettre en
cohérence ces derniers et de justifier la réalisation de travaux. Au sein de l’agence MOAD, tous les
chargés d’études n’ont pas la compétence "Maîtrise d’Ouvrage". C’est-à-dire qu’une fois l’étude
réalisée, ils n’ont pas la responsabilité de décider si et quand l’investissement sera réalisé.
Il est ainsi prescrit que les SCORE soient systématiquement validés par les agents et
managers ayant la compétence maîtrise d’ouvrage. Pour simplifier le travail du valideur, un fichier
Excel de synthèse avait été construit par la précédente adjointe au chef d’agence. Chaque mesure
prise dans le schéma cible est liée aux caractéristiques électriques des départs (marge, chute de
tension, produit PxL, etc.). C’est donc en visualisant l’évolution des caractéristiques que le valideur
peut apprécier les apports du schéma cible et donner son approbation ou non. La synthèse doit
donc rassembler tous les résultats électriques de chaque zone, ainsi que tous les travaux choisis
par le chargé d’études pour résoudre les contraintes existantes.
Cependant, le fichier actuel présentait quelques inconvénients :
- Contenant de nombreux onglets (un par zone SCORE, 4 résumés à la maille d’un
centre et 1 résumé à la maille de la DR AFC, pour un total de 26 onglets), la
navigation entre ceux-ci était compliquée
- Les tableaux résumés répétant les informations des onglets détaillés avaient été
construits à la main et ne s’actualisaient pas automatiquement
- L’alimentation des tableaux détaillés (environ 40 colonnes) à partir des restitutions
tableurs de chaque zone et des descriptions des travaux par les chargés d’études
avait été faite à la main et représentait une charge de travail très importante.
GE5E 2015 CADART Priscille 47
Par ailleurs, les informations relatives aux problématiques non traitées ou aux nouvelles
problématiques des SCORE étaient à rajouter à ce fichier (une vingtaine de colonnes). Pour les
onglets à la maille d’une zone SCORE, j’ai donc reconstruit un tableau reprenant l’ensemble des
résultats électriques, que j’ai ensuite fait valider par mon tuteur. La structure du tableau est
présentée Figure 42.
Réseau initial
Caractéristiques structurelles Caractéristiques clients Qualité de fourniture Caractéristiques Electriques
Long Long Long Régime de Nb Nb Clients Réelle Potentielle Marge DU/U
Urbain- 3I0 Ps HTA P*max PL
U (kV) tot Aérien Sout neutre Clients Clients HTA > CRIT CRIT Min. Max
Rural normal (kW) CB CL CB CL (KVA) (MVA.km)
(km) (km) (km) Type Lim BT HTA 1MVA B B (kVA) (%)
Réseau à 10 ans
Marge Min 3I0 secours PL (MVA x Qualité potentielle
DU/U Max (%) P*max (KVA) Synthèse des Travaux
(kVA) max (A) Km) CB CL CRIT B
Travaux Decision
sans tvx. avec tvx. sans tvx. avec tvx. sans tvx. avec tvx. sans tvx. avec tvx. sans tvx. avec tvx. sans tvx. avec tvx. sans tvx. avec tvx. sans tvx. avec tvx. Commentaires
Type Précisions MOAD-HTA
Réseau à 30 ans
Marge Min 3I0 secours
DU/U Max (%) P*max (KVA) PL (MVA.km) Synthèse des Travaux
(kVA) max (A)
Travaux Decision
sans tvx. avec tvx. sans tvx. avec tvx. sans tvx. avec tvx. sans tvx. avec tvx. sans tvx. avec tvx. Commentaires
Type Précisions MOAD-HTA
Figure 42 - Tableau de résumé du SCORE par départs
Cette restitution n’a pas la même fonction que pour le chargé d’études et n’a donc pas la
même structure. En effet, les restitutions tableur du SCORE étaient données tout d’abord à 0, 10
et 30 ans sans travaux pour le diagnostic, puis à 0, 10 et 30 ans après travaux pour le bilan du
schéma cible. Cela permet au chargé d’études de visualiser dans un premier temps les contraintes
à résoudre, selon plusieurs points de vues (contraintes électriques, seuils d’optimisation), puis
d’apprécier l’intérêt de la stratégie choisie selon ces mêmes points de vues. Ici, le valideur
souhaite voir, une fois les travaux choisis, l’impact de ceux-ci sur les résultats électriques ainsi que
leur étalement dans le temps. C’est pourquoi on visualise tout d’abord le réseau initial, puis à
chaque année d’observation, l’état des caractéristiques électriques avec et sans les travaux.
Le tableau étant large (c’est en réalité un seul tableau découpé en trois parties), j’ai ajouté
un sommaire et des liens hypertextes pour rejoindre facilement la partie souhaitée. J’ai également
mis en place la même mise en forme conditionnelle que dans la macro, permettant de visualiser
les contraintes existantes, résolues par des travaux ou non. J’ai ajouté un tableau des taux de
croissance appliqués par poste-source, pour permettre au valideur de vérifier les taux choisis par
les chargés d’études. Par ailleurs, pour faciliter l’implémentation de formules Excel, j’ai instauré
une standardisation des travaux renseignés via une numérotation, comme illustré sur le tableau
de la Figure 43.
Type de travaux :
1 Bouclage
2 Création départ
3 Modification du schéma d'exploitation
4 Restructuration départ
5 Autres
Figure 43 - Numéros à renseigner selon les types de travaux
GE5E 2015 CADART Priscille 48
Une fois les onglets à la maille d’une zone SCORE établis, j’ai reconstruit les tableaux de
résumés, en utilisant exclusivement des formules pour que l’actualisation soit automatique. Des
liens hypertextes viennent faciliter la navigation entre les onglets.
A la maille du centre, on reprend simplement les synthèses des travaux à 10 et 30 ans, par
départ et par poste source, et on visualise le nombre de départs par zone ainsi que la date de la
dernière mise à jour. Cela permet de réaliser le suivi des SCORE, en évitant les oublis de départs et
en prévoyant le travail à réaliser (planning de mise à jour).
A la maille de la DR, on va compter les travaux par type (bouclage, création départ, etc.) et
par poste source en regroupant ces derniers par zone. Cela permettra d’anticiper les
investissements en visualisant l’ampleur des travaux sur chaque poste source. Un exemple est
donné Figure 44.
TCMA
Travaux à 10 ans Travaux à 30 ans
NB de appliqués
ZONE
NOM PS départ Non Modification Modification Non
D'ETUDE 0-10 11-30 Création Non Non Restructuratio Non Non Non Création Non Restructuratio Non Non
s Bouclage valid schéma Autres Bouclage schéma valid Autres
ans ans de départ validé validé n départ validé validé validé de départ validé n départ validé validé
é d'exploitation d'exploitation é
ALSACE-063
ENSIS 11 1,0% 1,0% 1 1
GUEBW 11 1,0% 1,0%
Z063-E-
LOGEL 17 1,0% 1,0% 1 5
LOGEL
SSPLA 6 1,0% 1,0% 2 2 1
COLMA 1 1,0% 1,0% 1 1
Total Z063-E-LOGEL 46 1,0% 1,0% 1 1 1 6
LAPOU 7 0,5% 0,5% 3 1
Z063-O-
MUNST 8 0,5% 0,5% 1 1 2 2 1 1
MUNSTER
AMARI 7 0,5% 0,5% 1 1 2 2
Total Z063-O- 22 0,5% 0,5% 2
Figure 44 - Tableau récapitulatif de tous les Schémas Directeurs
Enfin, j’ai développé une petite macro permettant de copier-coller les colonnes voulues
d’un fichier Excel à l’autre pour faciliter l’alimentation des tableaux. Les tableaux construits par les
chargés d’études n’ayant pas la même structure que le tableau de synthèse, le travail aurait été
conséquent sans cet outil.
Apports techniques et financiers
Ce tableau permettra en un seul fichier de résumer une grande quantité d’informations
concernant les départs de la Direction Régionale Alsace Franche-Comté. Le planificateur pourra
ainsi s’y référer régulièrement pour établir un plan d’investissement moyen-terme. Il sera utile
pour anticiper et hiérarchiser les choix d’investissement, et ainsi investir en cohérence avec la
vision long-terme proposée par les chargés d’études dans les SCORE. Par ailleurs, il permettra
d’échanger avec la MOAD Postes Sources, notamment pour justifier les créations de nouvelles
sources.
Limites et suites éventuelles
Une information manque cependant à cet outil. En effet, l’analyse des résultats électriques
des transformateurs HTB/HTA (156 sur la DR) n’est pas affichée dans l’outil, alors qu’elle est
réalisée dans les Schémas Directeurs et dans les SCORE. La visualisation des contraintes sur les
transformateurs s’en trouve donc limitée.
Par ailleurs, les colonnes ajoutées par suite de la transformation des schémas directeurs en
SCORE sont pour le moment vides car aucun schéma directeur n’a encore été actualisé (sauf le
diagnostic de la zone de Maiche). L’outil ne représente donc pas toutes les contraintes à l’heure
actuelle.
GE5E 2015 CADART Priscille 49
CONCLUSION
Les objectifs du stage ont globalement pu être remplis. En effet, la méthodologie
développée a permis de mettre en application les demandes du document de prescription
national relatif à l’élaboration des SChémas d’Orientation du Réseau Electrique au sein des Bureau
d’Etudes Régionaux Electricité d’ERDF. Les outils, développés grâce à une analyse rigoureuse des
documents existants, permettront aux chargés d’études de rédiger un SCORE en moins de 2 mois,
tout en prenant en compte des problématiques supplémentaires :
- l’analyse du développement des territoires
- l’évolution de la qualité de fourniture en fonction des travaux réalisés
- l’évolution du courant capacitif en schéma le plus contraignant
- l’implantation de la production décentralisée
Les restitutions, sous la forme de tableaux, de cartes et d’un rapport, permettront de bien
cerner les enjeux techniques et économiques propres au réseau de chaque zone, et ainsi faciliter
la réflexion sur la structure du réseau et l’orientation à lui donner sur 30 ans. La production des
résultats sera accélérée, par rapport aux anciens Schémas Directeurs, à l’aide d’outils logiciels
robustes et adaptables. L’intérêt de ce stage ira même au-delà de la Direction Régionale, puisque
les outils seront transmis pour être proposés à d’autres BERE.
D’un point de vue plus personnel, ce stage m’a permis d’apprendre beaucoup sur l’aspect
organisationnel d’un bureau d’étude et d’une agence de maîtrise d’ouvrage. J’ai pu découvrir les
métiers de la distribution électrique et les enjeux du développement du réseau en lien avec le
territoire, ainsi que la problématique des stratégies d’investissement. La présentation puis la
transmission de mon travail auprès des chargés d’études m’a donné l’occasion de développer des
compétences managériales. J’ai également pu approfondir mes compétences en gestion d’un
projet de développement logiciel ainsi que mes connaissances de l’outil informatique Excel.
Par ailleurs, ce stage m’a sensibilisé à l’importance de la communication pour assurer un
bon travail d’équipe au sein d’un service, mais également entre différents services pour permettre
la cohésion de l’entreprise. Cette expérience m’a également permis de confirmer que je souhaitais
m’orienter plutôt vers un métier de terrain qu’un métier sédentaire, en me dirigeant plutôt vers le
management que vers l’expertise technique.
GE5E 2015 CADART Priscille 50
BIBLIOGRAPHIE
[1] ERDF, Livret d'accueil du jeune embauché, 2014.
[2] Cour des comptes, «Rapport public annuel. 1. Les concessions de distribution d'électricité : une
organisation à simplifier, des investissements à financer,» Paris, Février 2013.
[3] ERDF, PRDE B4-02 - Mise en oeuvre du plan aléas climatiques, Paris, 2011.
[4] ERDF, Frédéric Gorgette, Méthode d'élaboration des SChémas d'Orientation des Réseaux
Electriques moyen et long termes, Paris, 2014.
[5] Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, «Schémas de Cohérence
territoriale,» 14 Mai 2014. [En ligne]. Available: http://www.territoires.gouv.fr/schema-de-
coherence-territoriale-scot. [Accès le 06 03 2015].
[6] RTE France, «Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables :
des outils stratégiques,» [En ligne]. Available: http://www.rte-france.com/fr/article/les-
schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-des-outils#Map.
[Accès le 6 Mai 2015].
[7] RTE France, Les schémas régionaux - Etat des lieux au 31 mars 2014, Paris, 2014.
[8] ERDF, «PRDE D 5.4 - 01 - V1 - Mise A La Terre du Neutre HTA : Politique et réalisation,» Paris,
2006.
GE5E 2015 CADART Priscille 51
Vous aimerez peut-être aussi
- Schémas Directeurs de Développement Des Réseaux Électricité de DistributionDocument29 pagesSchémas Directeurs de Développement Des Réseaux Électricité de DistributionFadoua KhlijiPas encore d'évaluation
- Réseaux mobiles et satellitaires: Principes, calculs et simulationsD'EverandRéseaux mobiles et satellitaires: Principes, calculs et simulationsPas encore d'évaluation
- Issam ELHAMOUDANI Vehicle Functional Safety DesignerDocument2 pagesIssam ELHAMOUDANI Vehicle Functional Safety DesignerFadelBennisPas encore d'évaluation
- Integration Des Enrs Dans Le ReseauDocument15 pagesIntegration Des Enrs Dans Le ReseauEl Mime MohamedPas encore d'évaluation
- Formation Habilitation ELECTRIQUE (ENTREPRISE MARS 2017)Document101 pagesFormation Habilitation ELECTRIQUE (ENTREPRISE MARS 2017)hamza berkouchPas encore d'évaluation
- Charpente SDocument54 pagesCharpente SCHAHLI Younes100% (1)
- Pompage Solaire ErfoudDocument56 pagesPompage Solaire ErfoudMarwa LitePas encore d'évaluation
- Conditions Raccordements Éoliennes Mis À Jour Avril 2014Document6 pagesConditions Raccordements Éoliennes Mis À Jour Avril 2014Lhoussayne Ben MoulaPas encore d'évaluation
- Universite Sidi Mohammed Ben Abdellah Fa PDFDocument43 pagesUniversite Sidi Mohammed Ben Abdellah Fa PDFAbdo AbdoPas encore d'évaluation
- L'habilitation ÉlectriqueDocument14 pagesL'habilitation Électriqueapi-530069050Pas encore d'évaluation
- Travail 1Document17 pagesTravail 1aminePas encore d'évaluation
- Note de Calcul Off Grid (SAISA)Document10 pagesNote de Calcul Off Grid (SAISA)Abdou Elmokhtary100% (1)
- Intégration Du PV Au RéseauDocument16 pagesIntégration Du PV Au RéseauDominique KomeyPas encore d'évaluation
- EnersysDocument27 pagesEnersystewngom-1Pas encore d'évaluation
- Rapport Du Stage ONEE (Enregistré Automatiquement) (Enregistré Automatiquement) (Enregistré Automatiquement) (Enregistré Automatiquement)Document33 pagesRapport Du Stage ONEE (Enregistré Automatiquement) (Enregistré Automatiquement) (Enregistré Automatiquement) (Enregistré Automatiquement)JaghoutPas encore d'évaluation
- Sources Et Postes ÉlectriquesDocument45 pagesSources Et Postes ÉlectriquesSalma BourakkadiPas encore d'évaluation
- HaddadiEssaid BoussadFDocument101 pagesHaddadiEssaid BoussadFAfef NejiPas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument34 pagesRapport de StageRida LamhidriPas encore d'évaluation
- Tfe Oh PDFDocument142 pagesTfe Oh PDFmilanovsdPas encore d'évaluation
- DPostes À Haute Et Très Haute Tensions - Postes Sous EnveloDocument2 pagesDPostes À Haute Et Très Haute Tensions - Postes Sous EnveloYounis MolayPas encore d'évaluation
- Portable Power Solutions (PPS) Postes Électriques Haute Tension Pré-Assemblés Sur Remorque, Sur Skid Ou en Bâtiment Préfabriqué Jusqu À 420 KVDocument8 pagesPortable Power Solutions (PPS) Postes Électriques Haute Tension Pré-Assemblés Sur Remorque, Sur Skid Ou en Bâtiment Préfabriqué Jusqu À 420 KVSamir SassiPas encore d'évaluation
- Ba 188-2 A (FR) 2007 02 05 (Rte)Document60 pagesBa 188-2 A (FR) 2007 02 05 (Rte)SnTCrashPas encore d'évaluation
- Mémoire de Projet de Fin D'Etudes: Electronique IndustrielDocument53 pagesMémoire de Projet de Fin D'Etudes: Electronique Industrielbenkhlifalatifa2Pas encore d'évaluation
- Présentation Postes SourcesDocument31 pagesPrésentation Postes SourcesFadoua KhlijiPas encore d'évaluation
- RapportDocument45 pagesRapportamine ouallalPas encore d'évaluation
- Ademe Transfo WEBDocument26 pagesAdeme Transfo WEBlksqjfpoPas encore d'évaluation
- Calcul Ligne Aerienne MTDocument12 pagesCalcul Ligne Aerienne MTaminePas encore d'évaluation
- DESS CONGO Amelioration Rapport - CopieDocument53 pagesDESS CONGO Amelioration Rapport - CopiescribidoPas encore d'évaluation
- Multinational - Projet D'interconnexion Des Réseaux Électriques - Côte D'ivoire - Libéria - Sierra Leone Et Guinée CLSG - Rapport D ÉvaluationDocument40 pagesMultinational - Projet D'interconnexion Des Réseaux Électriques - Côte D'ivoire - Libéria - Sierra Leone Et Guinée CLSG - Rapport D ÉvaluationLIGHT 2020Pas encore d'évaluation
- Rapport PFE OUARDI BILAL - Inconnu (E)Document56 pagesRapport PFE OUARDI BILAL - Inconnu (E)anas naboussiPas encore d'évaluation
- Revue Trimestrielle N02Document13 pagesRevue Trimestrielle N02cheraziziPas encore d'évaluation
- Postes Pour Reseaux AeriensDocument4 pagesPostes Pour Reseaux AeriensAnonymous 1AAjd0Pas encore d'évaluation
- PMB 714 - 0Document15 pagesPMB 714 - 0fayssal salvadorPas encore d'évaluation
- Gamme EssailecDocument24 pagesGamme EssailecAnonymous xBi2FsBxPas encore d'évaluation
- Reseaudistripublique TycoDocument78 pagesReseaudistripublique TycoDavid ALVESPas encore d'évaluation
- 1 Formation TPUDocument26 pages1 Formation TPUfayssal salvadorPas encore d'évaluation
- PROTECTION D'UNE LIGNE MOYENNE TENSION 30Kv Année Universitaire - 2021 - 2022Document117 pagesPROTECTION D'UNE LIGNE MOYENNE TENSION 30Kv Année Universitaire - 2021 - 2022Fayçal LouahalaPas encore d'évaluation
- LesyservicesyauxiliairesydansylesypostesyHT PDFDocument24 pagesLesyservicesyauxiliairesydansylesypostesyHT PDFHassan OuikhalfenPas encore d'évaluation
- DF478269 Insertion Des Postes MT BT DP TAZADocument46 pagesDF478269 Insertion Des Postes MT BT DP TAZACharaf BelPas encore d'évaluation
- ST C60-L60 Isolateurs CompositeDocument8 pagesST C60-L60 Isolateurs CompositechahbounnabilPas encore d'évaluation
- Schéma 3 KWCDocument1 pageSchéma 3 KWCHaifa MabroukPas encore d'évaluation
- Oussaman AZENNOUDDocument96 pagesOussaman AZENNOUDMouad ImzouraPas encore d'évaluation
- Fiche Technique Du CuivreDocument3 pagesFiche Technique Du CuivreDonadi BadisPas encore d'évaluation
- Les Cables HTA C 33226Document14 pagesLes Cables HTA C 33226Anonymous 24lnhhPas encore d'évaluation
- Catalogue Formation 1er Semestre 2015 Ifeg - CbaDocument14 pagesCatalogue Formation 1er Semestre 2015 Ifeg - CbaDerouich2019Pas encore d'évaluation
- 05 Web SF1 User Manu FRDocument52 pages05 Web SF1 User Manu FRCharaf BelPas encore d'évaluation
- Chargeur ENERISDocument2 pagesChargeur ENERISAnonymous xBi2FsBxPas encore d'évaluation
- Présentation Du Sujet PFEDocument35 pagesPrésentation Du Sujet PFEYoussef RadefPas encore d'évaluation
- Ch1 CbleSouterraineDocument100 pagesCh1 CbleSouterraineعلاء الدين بوجلخة100% (1)
- Arrêté Conception Et Réali Sation - Annexe 4 - PostesDocument29 pagesArrêté Conception Et Réali Sation - Annexe 4 - PostesMed NaimPas encore d'évaluation
- Catalogue BT NexansDocument31 pagesCatalogue BT NexansLionel Atangana EdzisnaPas encore d'évaluation
- CCN ErdfDocument31 pagesCCN ErdfSalvador FayssalPas encore d'évaluation
- Mémoire YAYA NADJO Isdeen - CompressedDocument166 pagesMémoire YAYA NADJO Isdeen - CompressedAllamine Oum's100% (1)
- Raccordement Réseau - Cre - Prescriptions TechniquesDocument3 pagesRaccordement Réseau - Cre - Prescriptions Techniqueschris100% (1)
- ITI TransfixDocument4 pagesITI TransfixTaj NioukyPas encore d'évaluation
- S711 DSFR Rev1 062013Document2 pagesS711 DSFR Rev1 062013Greg Morris100% (1)
- Rte-Leaflet Cigre 2022Document106 pagesRte-Leaflet Cigre 2022AbouZakariaPas encore d'évaluation
- CX 2000-4Document3 pagesCX 2000-4Fouad NadjiPas encore d'évaluation
- Ge5s 2011 Meunier MémoireDocument57 pagesGe5s 2011 Meunier MémoireYasser BenioualPas encore d'évaluation
- Pfe Salah Eddine BaheddaDocument101 pagesPfe Salah Eddine BaheddaMed Mohamed100% (3)
- Guide Promoteur La RadeejDocument50 pagesGuide Promoteur La RadeejAnasAnas0% (1)
- TP ProbabilitéDocument3 pagesTP ProbabilitéAbouZakariaPas encore d'évaluation
- NF C11 201 Reseaux de Distribution Publique D EnergieDocument134 pagesNF C11 201 Reseaux de Distribution Publique D Energiebadrezzamane93% (15)
- Specification Technique: Conducteurs Nus Pour Réseaux MT, HT Et THTDocument29 pagesSpecification Technique: Conducteurs Nus Pour Réseaux MT, HT Et THTKaoutar El-ghazouiPas encore d'évaluation
- Enedis PRO RES - 50E PDFDocument35 pagesEnedis PRO RES - 50E PDFCakpo Eric AgbangbatinPas encore d'évaluation
- CABLES Section Amont Aval Transfo HTABThtKP077Document1 pageCABLES Section Amont Aval Transfo HTABThtKP077Abdessamad0% (1)
- Chapitre5 Calcul Sections Cables MT PDFDocument11 pagesChapitre5 Calcul Sections Cables MT PDFMed Habib Ait100% (2)
- ICC Et PDCDocument41 pagesICC Et PDCAhmed MarzoukPas encore d'évaluation
- Critère PHTDocument4 pagesCritère PHTAbouZakariaPas encore d'évaluation
- Pfe AscenceurDocument90 pagesPfe AscenceurMARDOUMA64% (14)
- Catalogue CCV NexansDocument13 pagesCatalogue CCV NexansIbrahim BahloulPas encore d'évaluation
- Mémoire BOSSOU Constant Maximilien Kuakou - CompressedDocument81 pagesMémoire BOSSOU Constant Maximilien Kuakou - CompressedAbouZakariaPas encore d'évaluation
- Belaidene HichemDocument101 pagesBelaidene HichemAbouZakariaPas encore d'évaluation
- Poste Préfabriqué Béton MET PDFDocument4 pagesPoste Préfabriqué Béton MET PDFELHAOURI YASSINEPas encore d'évaluation
- Marechal PF Range FRDocument10 pagesMarechal PF Range FRAbouZakariaPas encore d'évaluation
- UTE C13-205 (Conducteurs Et Protections)Document56 pagesUTE C13-205 (Conducteurs Et Protections)Tirshea100% (1)
- Chapitre 1 GrafcetDocument6 pagesChapitre 1 GrafcetdarknightPas encore d'évaluation
- Critère CCPDocument3 pagesCritère CCPAbouZakariaPas encore d'évaluation
- Cahier Des Charges Ain JohraDocument50 pagesCahier Des Charges Ain JohraThierno DiopPas encore d'évaluation
- Critère LHTDocument3 pagesCritère LHTAbouZakariaPas encore d'évaluation
- Critère P225Document4 pagesCritère P225AbouZakariaPas encore d'évaluation
- Modèle Lettre MutationDocument3 pagesModèle Lettre MutationMina Mint Chighali100% (1)
- Critère L225Document3 pagesCritère L225AbouZakariaPas encore d'évaluation
- Rte-Leaflet Cigre 2022Document106 pagesRte-Leaflet Cigre 2022AbouZakariaPas encore d'évaluation
- Planification Des Réseaux ÉlectriquesDocument99 pagesPlanification Des Réseaux ÉlectriquesAbouZakariaPas encore d'évaluation
- Moteurs de Recherche en Sciences Technique 5585e2cd4bbb7Document58 pagesMoteurs de Recherche en Sciences Technique 5585e2cd4bbb7AbouZakariaPas encore d'évaluation
- Critère HTA BT3Document4 pagesCritère HTA BT3AbouZakariaPas encore d'évaluation
- Charte GraphiqueDocument28 pagesCharte GraphiqueAchraf FettouhiPas encore d'évaluation
- Charte GraphiqueDocument28 pagesCharte GraphiqueAchraf FettouhiPas encore d'évaluation
- 2010 PhilippeJuniorOssoucahDocument182 pages2010 PhilippeJuniorOssoucahSara SaraPas encore d'évaluation
- Capture D'écran . 2023-01-17 À 08.20.59Document32 pagesCapture D'écran . 2023-01-17 À 08.20.59Jeey-K YzPas encore d'évaluation
- Support Provisoir OgppDocument42 pagesSupport Provisoir Ogppnguettiachristelle8Pas encore d'évaluation
- Cours RessortsDocument44 pagesCours RessortsYou MajPas encore d'évaluation
- Tables Utiles en BiophysiqueDocument2 pagesTables Utiles en BiophysiqueecosysPas encore d'évaluation
- Chap I INTRODCUTION A LA THERMODYNAMIQUE APPLIQUEE - GC - GE FSTDocument24 pagesChap I INTRODCUTION A LA THERMODYNAMIQUE APPLIQUEE - GC - GE FSTMomo SonyiPas encore d'évaluation
- 3 Phase Production Separator C-321Document51 pages3 Phase Production Separator C-321Tengku Nizarul Aslami100% (1)
- Commande Du Moteur AsynchroneDocument78 pagesCommande Du Moteur AsynchroneTHONYPas encore d'évaluation
- Previson de L'envasement Dans Les Barrages Du MaghrebDocument12 pagesPrevison de L'envasement Dans Les Barrages Du MaghrebCHEL TAK100% (1)
- Cables Conducteurs AccessoiresDocument386 pagesCables Conducteurs AccessoiresABELWALIDPas encore d'évaluation
- Compartiment SolDocument64 pagesCompartiment SolJohn BasicPas encore d'évaluation
- CH 02 Règles de Schéma ÉlectriqueDocument3 pagesCH 02 Règles de Schéma ÉlectriqueNabilBouabanaPas encore d'évaluation
- L'éoliénné VESTAS V52: Analyse Fonctionnelle D'Une EolienneDocument21 pagesL'éoliénné VESTAS V52: Analyse Fonctionnelle D'Une EolienneGaspard Du ReauPas encore d'évaluation
- Catalogue Comelec Mars 2015 PDFDocument76 pagesCatalogue Comelec Mars 2015 PDFHyeong-Ho KimPas encore d'évaluation
- Bond GraphsDocument77 pagesBond Graphszaid oumaimaPas encore d'évaluation
- Rapport Sur Les Marchés Africains Du Classement Doing BusinessDocument15 pagesRapport Sur Les Marchés Africains Du Classement Doing BusinessMiki MPas encore d'évaluation
- Marche PublicDocument39 pagesMarche PublicSalah-Eddine BahraPas encore d'évaluation
- Zakaria MESSAOUDI PDFDocument3 pagesZakaria MESSAOUDI PDFibrahimPas encore d'évaluation
- Alcenes - Chimie, UniversitéDocument39 pagesAlcenes - Chimie, UniversitéGeorgeAzmirPas encore d'évaluation
- Iso 50001Document2 pagesIso 50001awatef100% (1)
- Grundfosliterature-4822157 17833041Document68 pagesGrundfosliterature-4822157 17833041picartPas encore d'évaluation
- These: M.: J.L. MDocument201 pagesThese: M.: J.L. Madal algersPas encore d'évaluation
- Plan de Maitenance Systematique Et Introduction Devoir DS Orga3-1Document5 pagesPlan de Maitenance Systematique Et Introduction Devoir DS Orga3-1Pramod RathoaPas encore d'évaluation
- 1.4 TsiDocument64 pages1.4 Tsithierry_boudet1100% (12)
- Cours D'economieDocument36 pagesCours D'economieYounes KaderPas encore d'évaluation
- Économie Circulaire - Les Bases Pour ComprendreDocument61 pagesÉconomie Circulaire - Les Bases Pour ComprendreMaCoPas encore d'évaluation
- Ecoclim ConvertiDocument33 pagesEcoclim Convertisig-hanaPas encore d'évaluation
- Sigles - Acronymes - AbreviationsDocument39 pagesSigles - Acronymes - AbreviationsMtr Sanni EmckaPas encore d'évaluation
- Gaine Technique GazDocument8 pagesGaine Technique GazmohabentrPas encore d'évaluation
- Agence Qualité Construction - Désordres Dans Les Voiries Et Réseaux DiversDocument4 pagesAgence Qualité Construction - Désordres Dans Les Voiries Et Réseaux Diversajalil2000Pas encore d'évaluation
- Guide Etiquetage Nutritionnel PDFDocument47 pagesGuide Etiquetage Nutritionnel PDFAnous AlamiPas encore d'évaluation