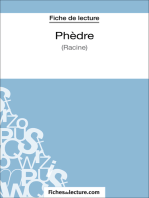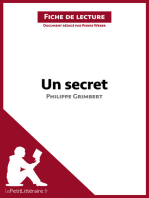Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Pdfslide - Tips No Et Moi Delphine de Vigan Pdfeditions No Et Moi Delphine de Vigan
Transféré par
hafien-mokhtar 02Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Pdfslide - Tips No Et Moi Delphine de Vigan Pdfeditions No Et Moi Delphine de Vigan
Transféré par
hafien-mokhtar 02Droits d'auteur :
Formats disponibles
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
No et moi, Delphine de Vigan
GUIDE PÉDAGOGIQUE
Par Aubert Drolent
POURQUOI NO ET MOI ?
QUE PROPOSE CETTE ÉDITION ?
SOURCES ET ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES
LE TABLEAU DE LA SÉQUENCE
LE GUIDE DES SÉ ANCES
Séance 1. Entrer dans le livre
Le travail en classe
Corrigé de la fiche d’activité
Séance 2. Comprendre le contexte
Le travail en classe
Corrigé de la fiche d’évaluation n° 1
Séance 3. Découvrir le début du roman
Le travail en classe
Corrigé du questionnaire n° 1
Séance 4. Analyser la rencontre avec No
Le travail en classe
Corrigé du questionnaire n°2
Séance 5. Analyser l'épisode de la mort de Thaïs
Le travail en classe
Corrigé du questionnaire n° 3
Séance 6. Faire le point sur le genre du récit
Le travail en classe
Corrigé de l'évaluation n°2
Séance 7. Analyser le thème de l'exclusion
© Éditions Hatier, 2013 1
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
Le travail en classe
Corrigé du questionnaire n° 4
Séance 8. Caractériser les personnages
Le travail en classe
Corrigé du questionnaire n° 5
Séance 9. Exploiter l'enquête, réfléchir au discours de l'art sur les exclus
Le travail en classe
Corrigé des questionnaires Histoire des arts
Séance 10. Analyser la portée argumentative du roman
Le travail en classe
Corrigé du questionnaire n° 6
Séance 11. Étudier la fin du roman : une fin de récit d'adolescence et de formation
Le travail en classe
Corrigé du questionnaire n° 7
Séance 12. Étudier un groupement de documents sur le sujet l'adolescence, une
période de révolte
Le travail en classe
Corrigé du questionnaire « Textes et images »
Séance 13. Faire le bilan de la lecture de l’œuvre
Le travail en classe
Corrigé de la fiche d’évaluation n° 3
LES FICHES PHOTOCOPIABLES
Fiche d’activité Découvrir le livre
Évaluation n°1 Connaître les personnages, l’histoire, l’auteur et le contexte historique de
No et moi
Évaluation n°2 Étudier un extrait de No et moi
Évaluation n°3 Faire le bilan de la lecture de l’œuvre
© Éditions Hatier, 2013 2
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
POURQUOI NO ET MOI ?
QUE PROPOSE CETTE ÉDITION ?
Une œuvre inscrite dans les nouveaux programmes
La lecture de No et moi de Delphine de Vigan s’inscrit dans le droit fil des nouveaux
programmes :
– l’œuvre correspond au programme de 3 e dont l’un des objets d’étude est un roman « des XXe
et XXIe siècles porteur d’un regard sur une question de société » ;
– No et moi est un roman d'adolescence et un roman engagé qui peut parfaitement ouvrir ou
poursuivre une séquence sur la poésie engagée.
L’ouvrage élève : le texte annoté, un dossier littéraire et une enquête
documentaire
Composition générale de l’ouvrage
• L’ouvrage comprend quatre éléments clés, disposés dans cet ordre :
– un avant-texte qui contient les éléments indispensables de contexte et d’exposition ;
– le texte illustré et annoté ;
– un dossier littéraire, avec une proposition de parcours de l’œuvre, intitulé « Un récit
d'adolescence sur une question de société » et un groupement de trois documents sur le thème
de l'adolescence ;
– une enquête documentaire sous forme de dossier d'histoire des arts, « Regards sur les
exclus ».
• Spécialement conçu pour des élèves de 3e, l’ouvrage est volontairement varié, attractif
dans sa forme et facile d’accès. On a choisi d’y privilégier l’étude des éléments du genre (les
personnages et la construction du roman : incipit, organisation du récit, dénouement) et les
approches thématiques (le quotidien d'une SDF, la révolte de Lou et son engagement), ainsi
que la portée argumentative du roman.
L’avant-texte
L’avant-texte permet à l’élève d’entrer facilement dans la lecture de l'œuvre en en précisant
le contexte.
Ainsi, il lui permet de se familiariser avec les personnages du récit (sur lesquels il pourra
revenir au cours de sa lecture), de comprendre l’intrigue principale (la rencontre d'une jeune
élève de seconde avec une SDF) et les circonstances particulières de l’écriture (la situation
récente de crise en France qui rend très présente la question de l'exclusion). L’ensemble est
complété par un entretien avec Delphine de Vigan.
Une représentation imagée aide en outre à mémoriser plus facilement le nom des personnages.
Le texte de l’œuvre
Dans cet ouvrage, le texte du roman, constitué d’extraits choisis, est donné d’un seul tenant :
ainsi le plaisir de la lecture n’est pas interrompu par des éléments pédagogiques, tous
regroupés dans le dossier littéraire qui suit.
Cependant, s’il bute sur un mot, une construction ou la compréhension d’un passage difficile,
l’élève peut recourir aux notes et explications disposées en bas de page.
© Éditions Hatier, 2013 3
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
Des illustrations inédites ou des photos extraites du film de Zabou Breitman agrémentent la
lecture.
Le dossier littéraire
Le dossier littéraire est articulé autour d’un axe principal : « Un récit d'adolescence sur une
question de société ». Il s’ouvre par la rubrique « Repères » qui fournit quelques éléments de
cours sur les multiples facettes de ce roman, à la fois récit d'adolescence par une adolescente
et récit engagé qui interroge sur une question de société. De plus, les repères abordent plus
généralement la notion d’engagement d’un point de vue historique, de ses origines jusqu’à sa
postérité.
Le dossier littéraire propose également un parcours de lecture en 7 étapes, avec des lectures
analytiques et des questionnaires de synthèse sur l’œuvre. Chaque étape correspond à un
objectif clair et se termine par un bilan permettant à l’élève de récapituler ses acquis.
L’enquête documentaire
L’enquête est consacrée à un thème majeur issu de l’œuvre, les exclus, et permet de
confronter le discours littéraire avec un savoir documentaire sur le thème.
Il s’agit ici de faire connaître aux élèves quelques unes des grandes représentations des exclus
dans l'art à travers des sculptures, peintures et films.
Les élèves pourront ainsi confronter leur image de l'exclusion (à travers les personnages du
roman) à ses représentations par les artistes.
Le guide pédagogique : tous les outils pour étudier l’œuvre avec les élèves
• Ce guide complète l’ouvrage de l’élève. Il est destiné à vous aider à préparer votre parcours
de lecture de No et moi avec vos élèves.
• Il s’articule autour d’une proposition de séquence pédagogique, que l’on peut suivre
entièrement, ou dans laquelle on peut prélever des éléments, en fonction de sa classe. Voir le
tableau de la séquence.
• Cette séquence est complétée par 4 fiches téléchargeables et photocopiables : une fiche
d’activité en classe et trois fiches d’évaluation.
• Les corrigés précis des questionnaires de l’ouvrage élève et des fiches photocopiables
sont intégrés dans le guide des séances.
© Éditions Hatier, 2013 4
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
SOURCES ET ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES
Les sources de l’œuvre
Pour Delphine de Vigan, l'exclusion et la question des sans domicile fixe n’est pas seulement
un sujet d’écriture mais un acte d'engagement personnel en prise avec son expérience
quotidienne, comme elle l'explique dans l'entretien paru dans le livre élève.
Elle décide d'aborder cette question à travers le prisme de l'adolescence, tissant un parallèle
entre cette période de la vie qu'elle analyse comme un moment de marginalité intérieure et la
marginalité des SDF dépeints dans son roman.
Éléments bibliographiques
• Romans
Albert Cossery, Mendiants et orgueilleux, Joëlle Losfeld, 1993.
Delphine de Vigan, Les heures souterraines, Lattès, 2009.
• Sur l'exclusion et la crise
Günter Wallraff, Tête de turc, Éditions de La découverte, 1986.
Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, Éditions de l'Olivier, 2010.
© Éditions Hatier, 2013 5
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
LE TABLEAU DE LA SÉQUENCE
N° Objectif général Travail en classe À la maison
Dominante 1 : le contexte
1 Entrer dans le livre • Fiche d’activité • Relire attentivement les
pages 4 à 9.
2 Connaître et comprendre • Explications sur • Lire le repère p. 146-
le contexte historique l’époque, l’auteur. 149
• Évaluation n° 1
(1 heure)
Dominante 2 : les caractéristiques d'un récit d'adolescence
3 Comprendre l’incipit • Questionnaire n° 1 • Faire le sujet d’écriture
« À toi de jouer ».
• Préparer le « As-tu bien
lu ? » De l'étape 2.
4 Analyser la rencontre avec No • Questionnaire n° 2 • Rédiger le bilan de
l'étape 2.
Préparer le « As-tu bien
lu ? » de l'étape 3.
5 Analyser l'épisode de la mort de • Questionnaire n° 3 • Rédaction : question 18
Thaïs. Comprendre ce qu'est un p. 155.
retour en arrière • Revoir l'ensemble des
notions des étapes
précédentes.
6 Faire le point • Évaluation n° 2 • Préparer le « As-tu bien
sur le genre du récit (1 heure) lu ? » du questionnaire 4.
Dominante 3 : un récit engagé sur le thème de l'exclusion
7 Analyser le thème de l'exclusion • Questionnaire n° 4 • Préparer le « As-tu bien
lu ? », du questionnaire 5.
Rédaction : question 14
du questionnaire 4.
8 Comprendre • Questionnaire n° 5 • Préparer le « As-tu bien
les personnages lu ? » du questionnaire 6.
Lire l'enquête (p. 171) en
entier et préparer trois
questions sur chaque
œuvre.
9 Exploiter l'enquête, réfléchir au Étude des documents de • Préparer le « as-tu bien
discours de l'art sur les exclus l'enquête lu ? » du questionnaire 6.
10 Analyser la portée argumentative du • Questionnaire n° 6 • Prépare le « as-tu bien
roman lu ? » du questionnaire 7.
11 Étudier la fin du roman : une fin de • Questionnaire n°7 Lire le dossier « Textes et
récit d'adolescence et de formation. images » (p. 164-167).
© Éditions Hatier, 2013 6
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
12 Étudier un groupement de documents • Questionnaire « Textes • Revoir les thèmes
sur le sujet l'adolescence, une et image » étudiés et les procédés
période de révolte d’écriture employés dans
le roman.
13 Faire le bilan • Évaluation n° 3
de la lecture de l’œuvre (1 heure)
Mode d’emploi du tableau
• Pour accéder aux corrigés des questionnaires et aux informations complémentaires
correspondant à chaque séance, cliquez sur les numéros soulignés.
• Les intitulés en couleur correspondent à des fiches au format A4 que vous pouvez imprimer
et reproduire librement dans le cadre de votre enseignement.
LE GUIDE DES SÉ ANCES
Séance 1. Entrer dans le livre
Le travail en classe
• Voir la fiche d’activité.
• Cette fiche est le support d’un travail de première découverte de l’ouvrage.
L’objectif est d’apprendre aux élèves à se repérer dans le livre et à en distinguer les
différentes composantes : texte, dossier, enquête, lexique, bibliographie…
Cet exercice préalable est très important car, au cours de l’étude, les élèves devront s’appuyer
sur toutes ces ressources.
Corrigé de la fiche d’activité
Observer la couverture du livre
1. Dans la colonne de gauche on trouve, de haut en bas, la citation, l’accroche, la biographie
et la 4e de couverture. Dans celle de droite, on trouve l’auteur, le titre, la collection, l’éditeur
et la 1re de couverture.
2. Au premier plan on voit deux jeunes filles, dont l'une porte des vêtements abîmés, assises
sur des marches. Le regard de cette dernière est triste et presque accablé. Sa posture semble
indiquer qu'elle est résignée.
À l’arrière plan, on aperçoit les jambes d'une foule indifférente, ce qui indique que ces jeunes
filles se trouvent dans un lieu public et qu'elles sont assises au niveau du sol.
On pourra également faire réfléchir les élèves sur le choix des contrastes entre les
personnages en couleur et la foule en gris, afin d’attirer l'attention sur les deux personnages
principaux. La couverture illustre bien le titre.
© Éditions Hatier, 2013 7
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
Analyser le sommaire
3.
Nom de la partie Contenu
L’ouverture Présentation des personnages et de l’action du récit ;
éléments biographiques sur l’auteur et le contexte historique
de son époque.
Le texte Texte littéraire (extraits choisis).
de No et Moi
Le dossier Repères sur le genre du roman ; parcours de l’œuvre en
6 étapes ; groupement de textes et d’image sur le thème de
l’adolescence.
L’enquête Regards sur les exclus : sélection et études d'œuvres en rapport
avec le thème du livre.
4. Tu peux les chercher dans la section « À lire et à voir ».
5. Ces définitions se trouvent dans le « Petit lexique du récit » à la fin de l’ouvrage.
Séance 2. Comprendre le contexte
Le travail en classe
• Cette séance est consacrée à la découverte du contexte de production de l’œuvre.
S’appuyer sur les pages « Qui est l’auteur ? » et « Que se passe-t-il à l’époque ? » (p. 8
et 9) du livre élève, en les complétant par des explications.
• Ce travail fait l’objet d’une première évaluation. Voir l’évaluation n°1.
Pour s’entraîner, on pourra proposer aux élèves un travail facultatif : rédiger dix questions
simples, avec leurs réponses, portant sur les pages 4 à 9 qui mentionneront les personnages,
l’action principale, l’auteur et l’époque.
Voir l’évaluation 1
Corrigé de la fiche d’évaluation n° 1
Les personnages et l’histoire de No et moi
1. Les noms des personnages sont les suivants :
Lou Bertignac, Nolwenn (diminutif “No”) et Lucas.
Lou Bertignac et Lucas sont lycéens en seconde. Nolwenn est sans-abri et vit dans la rue.
2. Lou fait la connaissance de No (Nolwenn) à la gare d’Austerlitz lorsqu’elle lui demande
une cigarette.
3. Elle doit faire un exposé sur les sans domicile fixe et pour cela réaliser une interview de
SDF.
4. Lucas aide Lou en hébergeant No chez lui dans son appartement où il vit presque seul.
© Éditions Hatier, 2013 8
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
L’auteur
5. Elle naît à Boulogne-Billancourt en 1966.
6. Elle lit beaucoup de bandes dessinées : Astérix, Lucky Luke et Gaston Lagaffe.
7. Pour payer ses études, elle a été démonstratrice, scripte et hôtesse d'accueil. Elle travaille
ensuite dans la communication.
8. Elle écrit la nuit car elle travaille le jour.
Le contexte historique
9. Les étudiants et les ouvriers se révoltent contre la société de consommation et les bas
salaires en 1968.
10. C'est la crise pétrolière en 1973. Les pays producteurs se mettent d'accord pour contrôler
les prix qui sont multipliés par trois, ce qui freine le développement des économies
occidentales.
11. Coluche crée les « Restos du cœur » en 1985.
12. Agnès Varda tourne Sans toit ni loi, film qui raconte la vie et la mort d'une jeune SDF, en
1985.
13. En 1957, des auteurs comme Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute créent le Nouveau
Roman.
Rédaction personnelle
14. Avant l’évaluation, on pourra prévenir les élèves et leur dire qu’ils devront rédiger un bref
texte en rapport avec la période actuelle. On leur demandera à l’oral de faire un rappel des
faits importants précisés dans la chronologie. Puis, on leur demandera ce qu’est un argument,
afin de s’assurer que tout le monde en maîtrise le sens.
Le texte employant le passé composé, on pourra, lors de la correction du sujet d’écriture,
rappeler les règles d’accord du participe passé, qui posent souvent problème, même en classe
de troisième.
Séance 3. Découvrir le début du roman
Le travail en classe
• On insistera sur la place de cet extrait dans le roman pour amener les élèves à définir
l’incipit et à en comprendre les fonctions essentielles : présentation des personnages, du
sujet et des enjeux de l'œuvre. Mise en place d'un pacte de lecture.
• Avant d’aborder le questionnaire, on leur demandera ce qu’il est utile de savoir au début
d’un récit, afin d’insister sur les caractéristiques de l’incipit :
– présentation des personnages principaux ;
– présentation du cadre spatio-temporel ;
– présentation de l’intrigue ;
– nécessité d’intégrer du suspense à la fin de l’extrait.
© Éditions Hatier, 2013 9
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
Corrigé du questionnaire n° 1
As-tu bien lu ?
1. L’action est située dans une classe.
2. Le narrateur est Lou Bertignac.
3. Le sujet de l’exposé de Lou portera sur les sans-abri. Elle le traitera en réalisant l’interview
d’une jeune femme SDF.
Un début « in medias res »
4. La première phrase est interrogative, au présent et au discours direct. Elle introduit
directement le lecteur dans l'action car elle le place dans une situation qui a commencé avant
cette phrase et que le lecteur doit deviner (un exposé avait été demandé…). C'est ce qu'on
appelle un début « in medias res ».
5. Le narrateur est Lou Bertignac. Son nom complet n’apparaît qu’à la fin du premier
paragraphe qui est un long monologue intérieur. Le lecteur est ainsi plongé dans son for
intérieur, avant de savoir qui elle est.
Des personnages bien caractérisés
6.
Personnages qui apparaissent Personnages cités
Lou Une jeune femme SDF
Lucas La mère et le père de Lou
Monsieur Marin
Axelle Vernoux et Léa Germain
7. Cette première page donne de nombreuses indications sur ces deux personnages :
Lou est de « petite hauteur » (l. 15), a peur de prendre la parole en public (inaptitude
pathologique aux exposés), est asociale et muette. On la surnomme « le cerveau » (l. 7), ses
parents sont déprimés et elle semble amoureuse de Lucas.
Lucas a des « yeux immenses » (l. 23), il tient tête aux professeurs (il sort sans un mot et avec
défi) et il soutient Lou. Il y a comme une complicité entre ces deux personnages.
Le sujet de l’exposé et le sujet du roman
8. Le sujet de Lou (les sans-abri) est un sujet social et économique qui porte sur une question
d’actualité brûlante et préoccupante comme le souligne le professeur Marin, professeur de
sciences économiques : « on recense chaque année de plus en plus de femmes en errance, et
de plus en plus jeunes » (l. 44-45). Il pose dès l’entrée du livre une question embarrassante :
comment dans un pays riche peut-il y avoir des gens aussi pauvres ? L’embarras est exprimé
par les réactions de la classe (le silence, puis ça frémit, ça chuchote).
9. Lou se propose de traiter son sujet à travers une interview. Elle aborde donc le sujet à
travers une relation humaine et personnelle (une jeune femme qu’elle a rencontrée) et sous
l’angle d’un témoignage. Elle ne répond donc pas tout à fait à la demande du professeur car
au lieu de proposer une démarche académique et livresque, elle propose une démarche
intuitive et personnelle.
© Éditions Hatier, 2013 10
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
10. Le récit étant écrit à la première personne, « moi » est Lou Bertignac. On peut faire
l'hypothèse que No est la jeune femme qu’elle va interviewer. À travers ces personnages, le
début pose clairement le sujet : les SDF et la rencontre entre deux adolescentes de milieux très
divers.
La langue et le style
11. « Si je pouvais m’enfoncer cent kilomètres sous terre… » : exagération.
« je suis une minuscule poussière, une particule invisible » : métaphore.
« je suis légère comme un soupir » : comparaison.
On fera remarquer que ces trois images sont toutes hyperboliques.
12. Le présent de l’indicatif domine dans ce passage. C’est un présent de narration. Ce n’est
pas le temps attendu dans un récit puisqu’en principe on attend le passé simple et l’imparfait,
mais le présent de narration rend ici le récit plus actuel et immédiat.
Faire le bilan
13. Complète ce texte avec les mots suivants.
La première phrase du livre place le lecteur au cœur d’une action déjà commencée. Ce début
in medias res et l’écriture de l’incipit au présent de narration et à la première personne
rendent le récit actuel et dynamique. Les éléments essentiels sont mis en place : la narratrice
et personnage principal, Lou Bertignac, apparaît rapidement. Un second personnage Lucas
est aussi présenté. Ce dernier et la narratrice apparaissent complices. Le cadre de l’action : un
lycée et des lycéens est posé par la situation d’énonciation (une classe, un exposé).
Le sujet d’exposé choisi par la narratrice, les sans-abri, annonce le thème du récit et son
enjeu : poser la question de l’exclusion ; la méthode du témoignage et de l’interview prépare
l’arrivée d’un nouveau personnage, une jeune femme SDF. On comprend ainsi le titre et le
lecteur dispose des informations essentielles pour entrer dans le roman.
À toi de jouer
14. On insistera sur l'emploi du présent de narration et on aidera les élèves à construire des
images hyperboliques à la manière de Lou, éventuellement en leur proposant de reprendre du
vocabulaire d'autres disciplines comme elle le fait.
Séance 4. Analyser la rencontre avec No
Le travail en classe
• On pourra commencer par situer l’extrait dans le roman en demandant à un élève de
rappeler ce qui s’est passé avant. On fera remarquer que l'on est encore tout au début de récit
et on insistera sur la dimension informative du passage qui permet de mettre en situation le
personnage de No que l'on découvre ici pour la première fois.
• Les questions As-tu bien lu ? ayant été faites à la maison, on pourra insister sur la manière
dont le roman présente les personnages de manière active et non en en proposant de longues
descriptions comme dans le roman classique.
On pourra leur demander de caractériser le registre réaliste de ce passage.
Corrigé du questionnaire n° 2
As-tu bien lu ?
© Éditions Hatier, 2013 11
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
1. La rencontre à lieu à la gare d’Austerlitz.
2. Lou regarde les trains et les gens.
3. No tape sur l’épaule de Lou pour lui demander une cigarette.
Une situation inversée
4.
Ce qu’elle fait à la gare elle regarde les gens
Son âge 13 ans
Sa classe Seconde
Pourquoi est-elle en avance ? Elle a sauté deux classes
Pourquoi l’a-t-on changée de classe en Elle s’ennuyait au point de s’arracher les
CM1 ? cheveux
5. On apprend presque rien sur No au cours de ce dialogue, seulement son surnom, qu’elle
donne dès le début, car Lou est « trop intimidée » (l. 168) pour lui poser des questions. Mais
comme elle demande tout le temps de l’argent, on comprend qu’elle est SDF.
6. Tout au long du dialogue No pose des questions à Lou et non l’inverse. C’est inattendu car
on aurait pu penser, d’après le début du roman, à ce que ce soit l’inverse qui se produise. No
demeure à ce stade un personnage énigmatique, presque insaisissable.
No : un personnage complexe
7. No est décrite l. 117 à 119 et l. 206 à 212. Ses vêtements sont décrits comme étant
« sale[s] », « vieux », « troué[s] » (l. 117), dépareillés et démodés (elle porte une écharpe que
sa mère aurait pu porter). Au niveau de son physique, on apprend qu’elle est pâle et maigre,
mais aussi qu’il lui manque une dent (l. 177). Toutes ces caractéristiques lui donnent
l'apparence vestimentaire caractéristique des gens qui vivent dans la rue.
8. No ne répond à aucune question et soumet Lou à un feu roulant de questions. Elle
s’intéresse à son interlocutrice et se dissimule elle-même. Elle est directe (elle n’hésite pas à
poser des questions déstabilisantes « C’est pas l’âge normal, ça ? », l. 152), va au bout de ses
intentions lorsque la réponse ne la satisfait pas « J’ai bien compris, mais comment ça se fait,
Lou, que t’as sauté des classes ? » (l. 156-157) et montre qu’elle est attentive à ce que lui dit
Lou « Ça va mieux quoi les cheveux ou l’ennui ? » (l. 175). Elle apparaît donc comme ayant
du caractère, de la personnalité et de l’intelligence.
9. Lou déduit de son regard « vide » (l. 198) qu’elle est seule et que personne ne l’attend,
qu’elle n’a « pas de maison, pas d’ordinateur et peut-être nulle part où aller » (l. 199-200).
Elle imagine avant de s’endormir qu’elle a « un secret planté dans son cœur comme une
épine » (l. 209). Dès ce début de roman, de nombreux indices anticipent donc sur ce que nous
apprendrons par la suite.
Une rencontre
10. Tout d’abord No manifeste son intérêt et sa curiosité pour Lou, qu’elle a déjà vu plusieurs
fois, par les multiples questions qu’elle lui pose. On peut ensuite penser que la demande de
cigarettes est un prétexte (elle en demande ensuite à un homme qu’elle abandonne
immédiatement) et on peut remarquer que le dialogue se poursuit alors que No a obtenu ce
© Éditions Hatier, 2013 12
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
qu’elle demandait. Il y a donc bien autre chose qui se joue, une relation qui se crée. Lou de
son côté engage un vrai dialogue avec elle malgré son apparence repoussante.
11. Paradoxalement la narratrice se sent « exclue » et décalée par rapport aux autres mais ce
n’est pas le cas avec No, avec qui elle a l’impression d’être à l’intérieur du même « cercle »
(l. 187). Il s’agit donc d’une vraie rencontre, à l’image des multiples scènes de
retrouvailles/séparations qui ouvrent la scène. Il y a ici une complicité entre les deux jeunes
filles, l’une exclue car elle est plus petite que les autres, l’autre parce qu’elle est à la rue.
12.
Personnages Ce qu’ils font
Des amoureux qui se quittent.
Des mamies qui repartent.
Des dames avec des grands manteaux qui abandonnent des hommes au col relevé.
a. Ces personnes sont toutes en train de se séparer ou de se retrouver.
b. Le thème de la séparation est ensuite développé dans ce même passage, lorsque la
narratrice parle de « vraie séparation » qui dure longtemps. Il est ensuite central dans le
roman : ces rencontres fugaces dans la gare préfigurent la rencontre entre No et la narratrice,
puis leur séparation. La gare d'Austerlitz apparaît ainsi comme une métaphore de la vie et de
la situation des personnages.
La langue et le style
13. No utilise un langage familier et tutoie immédiatement Lou (« T’as pas un clope », l. 116)
qui la vouvoie (l. 121).
Elle élide les pronoms et mutile la négation « T’as pas » (l. 116), « y’en a pas » (l. 141) au
lieu de « Tu n’as pas » et « il n’y en n’a pas ».
Elle emploie des tournures populaires « par chez toi » (l. 141), « comment ça se fait que t'as »
(l. 156-157) au lieu de « près de chez toi » et « comment se fait-il que tu aies ».
Faire le bilan
14. Ce passage est la première apparition de No. Lou devrait l’interroger pour son exposé,
pourtant c’est l’inverse qui se produit. Le monologue de No permet de la décrire - ses
vêtements et son allure dévoilent sa situation de SDF - et de comprendre qu’elle a un
« secret » qui est peut-être à l’origine de sa situation. Lou, qui se sent exclue par sa petite
taille et le fait d’être en avance en classe, trouve en No une compagne, une amie, avec qui elle
a pour la première fois le sentiment de partager le même « cercle ».
À toi de jouer
15. On rappellera les règles d'écriture du dialogue (ponctuation, propositions, incises au passé
simple) et le principe de l'insertion du discours direct dans un récit. On insistera aussi sur la
notion d'énonciation et sur la manière dont le langage (familier, courant, soutenu) permet de
caractériser un personnage (question 13).
16. On fera remarquer qu’un certain nombre de questions de Lou sont formulées à la fin du
passage, p. 26-27. On les invitera cependant à en imaginer d’autres.
Séance 5. Analyser l'épisode de la mort de Thaïs
Le travail en classe
© Éditions Hatier, 2013 13
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
• À l’oral, on demandera aux élèves de résumer les informations factuelles essentielles
(époque, événement, situation des personnages) pour vérifier que le « As-tu bien lu ? » a bien
été préparé.
• Avant la correction du questionnaire, on insistera sur l’objectif principal de la séance :
comprendre le rôle explicatif du retour en arrière dans le roman.
• Au fur et à mesure de la correction des questions, on pourra conserver au tableau une trace écrite
comportant les éléments principaux qui permettent de caractériser le retour en arrière : temporalité,
ellipse, temps verbaux utilisés.
Corrigé du questionnaire n° 3
As-tu bien lu ?
1. Lou avait huit ans à la naissance de Thaïs. (l. 656)
2. Elle cherche des réponses dans « l'encyclopédie des mammifères » (l. 660).
3. Elle part 4 ans dans un collège spécialisé pour enfants surdoués à Nantes (l. 753).
4. Après cette tragédie la mère de Lou ne parle plus.
Du bonheur…
5. La narratrice commence par la formule « ma mère est tombée enceinte » (l. 656) puis
ajoute la formule « cela faisait longtemps qu’ils essayaient » (l. 656) et raconte les difficultés
éprouvées pour obtenir cette grossesse : les « médicaments », les « piqûres » et le recours à
une aide médicale à la procréation, « la fécondation in vitro » (l. 659-664).
6.
On boit le champagne l. 668
On organise la maison pour accueillir le bébé. l. 676-678
Portrait de la mère en vacances, joyeuse, ce qui l. 680-683.
tranche avec la mère mutique et maladive du
début.
7. Lou utilise un vocabulaire appréciatif et hyperbolique « je trouvais ça incroyable
d’imaginer » (l. 685-686), des comparaisons hyperboliques (l. 698-703) et une énumération
pour décrire le bébé (l. 705-706).
…à la tragédie familiale
8. a. Dans le premier passage, Lou consulte les photos lorsqu’elle est seule, avec le « cœur qui
bat très fort » (l. 718), et craint d’être surprise par sa mère. Dans le second passage elle
indique que les moments vécus sur les photos ne leur « appartiennent plus » (l. 727), qu’ils
sont « figés » et « interdits » (l. 729 et 731), « enfermés » et « enfouis » (l. 727 et 728). Tout
indique donc que ces souvenirs font l’objet d’un interdit, presque d’un tabou.
b. Le temps employé dans ces passages est le présent, alors que le reste de l’extrait est à
l’imparfait et au passé composé. Ces passages sont ceux d’un regard présent sur un
événement passé qu’on tente d’enfouir, d’oublier, ce qui lui confère une grande intensité
dramatique.
© Éditions Hatier, 2013 14
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
9. Lou entend le cri de sa mère, qui est gravé en elle, ses pleurs et la manière désespérée dont
elle psalmodie « non, non, non » (l. 743). Elle voit, comme en un songe, sa mère en petite
tenue, l’arrivée de l’équipe du SAMU puis son père, pâle et tremblant qui l’emmène à l’écart.
10. Non, Lou semble ne pas comprendre immédiatement comme le montre la manière dont
elle commente la scène avec des remarques comme « je me suis dit que ce n’était pas une
tenue pour recevoir des gens », qui montre qu'elle juge les événements comme s'il s'agissait
d'un moment normal. Le lecteur saisit que Lou comprend progressivement et avec retard que
quelque chose « d’irrémédiable est en train de se passer ». Cela rend la scène particulièrement
dramatique car il y a un écart entre ce que perçoit le lecteur, qui comprend tout de suite la
mort tragique du bébé, la narratrice qui ne s’en rend pas tout de suite compte et la mère qui
refuse d’y croire jusqu’à ce qu’elle le lise dans le regard du médecin (l. 749).
11. Le champ lexical dominant est celui de la normalité « lycée normal », « élèves normaux »,
« simple », « rien ne nous distingue », « comme les autres », comme pour montrer que cette
tragédie est le point de départ qui fait de Lou une enfant « anormale », à part.
12. La mère de Lou (l. 777 à 801) est bouleversée. Elle est totalement silencieuse, inerte et se
comporte comme un automate. Elle n’a plus de geste de tendresse envers Lou.
Un long retour en arrière
13. L’action de ce passage est située cinq ans avant l’époque du récit principal. Cela est
sensible grâce à plusieurs formules temporelles : « Quand j’avais huit ans » (l. 656) ; « ces
moments sont figés […] dans la mémoire » (l. 729-731) ; « un dimanche matin » opposé à
« encore aujourd’hui » (l. 732, 734), et « j’ai fini par revenir pour de bon » (l. 755), qui
opposent bien passé et présent.
Les verbes de ce passage sont majoritairement à l’imparfait et au passé composé,
contrairement au reste du récit qui est écrit au présent. Le présent est utilisé à deux reprises,
lorsque la narratrice revient à la période actuelle du récit (l. 727-721 et 734-737).
Le passage est donc bien un retour en arrière.
14. Ce retour en arrière nous permet de comprendre la cause de l’atmosphère qui règne au
sein de la famille de Lou qui a été détruite par le drame de la mort de Thaïs. La comparaison
entre Lou et sa sœur (l. 763-766) permet aussi de comprendre sa personnalité et d’où lui vient
ce sentiment d’isolement, de différence et de décalage par rapport aux autres.
La langue et le style
15. Elle compare la naissance d'un bébé avec les avions et les fusées, l’identification d’un
criminel avec un indice minuscule, les tomates imputrescibles, le fait de stocker des
informations dans un très faible volume. Elle oppose ainsi des prouesses technologiqu es avec
la conception d'un bébé grâce à un comparatif de supériorité (« rien […] ne me paraîtra plus
incroyable, plus spectaculaire que ça » (l. 703-704), pour montrer le caractère extraordinaire
de la conception d’un bébé.
Faire le bilan
16. Un retour en arrière (ou analepse) consiste à raconter des faits antérieurs à l’époque du
récit. Ainsi dans l’extrait étudié, la narratrice, Lou, rapporte des faits qui se sont produits
lorsqu’elle avait huit ans, tandis que l’action principale du roman se déroule alors qu’elle a
treize ans. Elle fait donc un retour cinq ans auparavant.
© Éditions Hatier, 2013 15
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
Elle rapporte un épisode très traumatisant pour elle-même et sa famille, celui de la mort de sa
petite sœur, qui permet de comprendre sa situation, le sentiment de solitude et de décalage
qu’elle éprouve, le mutisme et la dépression de sa mère, et qui éclaire de nombreuses
formules énigmatiques qui émaillent le récit, comme par exemple lorsqu’elle explique que sa
mère ne parle plus et que son père s’isole pour pleurer au début du roman (l. 75-76).
À toi de jouer
17. 18. On se fondera sur les réponses des élèves.
Séance 6. Faire le point sur le genre du récit
Le travail en classe
• L’extrait proposé, issu de No et Moi, permet de revenir sur les questions d'analyse du
récit : mise en place des personnages, du sujet et du cadre du récit d'adolescence et sur
la notion de retour en arrière.
• Les objectifs des questions sont les suivants : repérer et analyser les caractéristiques
romanesques de No et moi avec l’étude :
– de la narration.
– du retour en arrière.
– des caractéristiques du récit adolescent (langage, situation).
Voir l’évaluation n°2
Corrigé de la fiche d’évaluation n°2
Fais le point sur tes connaissances
1. Un début « in medias res » est un début dans lequel le lecteur est immédiatement plongé,
sans prologue ni description liminaire dans l'action du récit (cf questionnaire numéro 1)
2. Un retour en arrière est un passage dans lequel le narrateur raconte un événement passé
antérieur à l'époque du récit principal. Dans ce passage la narratrice Lou revient ainsi sur la
rentrée (l. 215 à 238).
3. La narratrice du roman est Lou. À ce stade de l'étude on sait qu'elle a deux ans d'avance,
qu'elle est plus petite que les autres, très cultivée et bonne élève et qu'elle se sent en décalage
par rapport aux autres, ce qui est perceptible dans ce passage (« je ne connaissais personne et
j'avais peur. » (l. 224)
Analyse le texte et montre ce qu’est un récit d’adolescence
4. Le champ lexical de l’école est en effet très présent : dernier rang, table, sac, rentrée,
Monsieur Marin, fiches, nom, prénom, profession des parents, stylo, allée centrale, matériel,
année.
5. La situation (une salle de classe, le jour de la rentrée) est fixée par le champ lexical de la
question précédente. Elle est typique de l'adolescence. Le récit est fait à la première personne
(comme le soulignent de nombreuses marques) par une narratrice adolescente qui brosse, sous
© Éditions Hatier, 2013 16
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
la forme d'un monologue intérieur, le portrait de Lucas, un autre élève par qui elle semble
séduite. Ces éléments (l'école, un langage simple, le récit à la première personne, les
sentiments et la séduction) plongent le lecteur dans l'univers de l'adolescence.
6. Le retour en arrière permet de revenir sur le moment de la rentrée alors qu'à ce stade du
roman l'année scolaire est déjà bien entamée. Il intervient de la ligne 222 à la fin du passage.
Il est introduit par la formule « je me souviens de lui le jour de la rentrée ». On peut
remarquer que l'ensemble du texte est au présent de narration « je peux voir », « je
l'observe », tandis que le retour en arrière est entièrement rédigé au passé (plus que parfait :
« je m'étais installée » ; imparfait : « distribuait » ; passé composé : « je lui ai tendu »). Ce
retour en arrière permet de situer la personnalité de Lucas, dont l'attitude de complicité envers
Lou (« il m'a souri ») et de refus vis-à-vis de l'école (il n'a pas son matériel) se manifestent dès
le premier jour.
7. Le portrait donne à voir une silhouette adolescente. La narratrice décrit d'abord ses
vêtements : chemise ouverte, jean trop large, baskets, qui manifeste une certaine désinvolture,
confirmée par son attitude. Il a en effet un « air de bagarre », se tient « renversé sur sa
chaise » et « croise les bras », comme avec un air de défi. L'ensemble est complété par un sac
qui « semble vide ».
La remarque finale du professeur, sarcastique et au discours direct, vient compléter le portrait
du personnage qui apparaît comme un adolescent en pleine révolte contre l'autorité et l'école.
Rédaction personnelle
8. On attirera l'attention des élèves sur le portrait de Lou qui n'a pas les mêmes
caractéristiques que celui de Lucas : petite, première de sa classe, elle est plutôt effacée et
discrète mais déclenche l'attendrissement de Lucas.
Séance 7. Analyser le thème de l'exclusion
Le travail en classe
• L'objectif de la séance est de comprendre la dimension presque documentaire de l'ouvrage,
qui donne une vision très complète des conditions de vie des SDF à Paris à travers la relation
d'amitié des deux jeunes filles. Pour vérifier la lecture, on fera intervenir les élèves à l'oral sur
les questions préparées à la maison (« As-tu bien lu ? »).
• Avant de commencer le questionnaire proprement dit, on resituera avec eux le passage dans
le roman : après plusieurs rencontres où No a fait parler Lou (le contraire de ce à quoi on
s'attendait) elle finit par accepter de répondre aux questions précises de Lou.
Corrigé du questionnaire n°4 : étudier la description du quotidien de No
As-tu bien lu ?
1. No a 18 ans.
© Éditions Hatier, 2013 17
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
2. Lou et No se retrouvent au café Le Relais d’Auvergne.
3. Les endroits invisibles où No se réfugie sont des caves, parkings, entrepôts, bâtiments
techniques, chantiers abandonnés, hangars.
4. Pour Lou le récit de No est un cadeau.
La première préoccupation : où dormir ?
5. Cette question est omniprésente et occupe la quasi-totalité des paragraphes de l’extrait, ce
qui montre que c'est la première et la plus grave des difficultés qu'elle doit affronter. De plus,
elle se réfugie dans de très nombreux endroits mais ne peut s’installer nulle part.
6. Elle est soit hébergée chez des amis (l. 819 à 827), accueillie dans des centres d’accueil
d’urgence (l. 827-829 et 854-862) où se terre dans des « lieux invisibles » (l. 848-851). Ces
lieux forment comme les trois cercles d’une déchéance de plus en plus grande.
7. Des lignes 854 à 864, ces centres sont décrits comme étant sales (« salle d’eau
dégueulassée par les autres » ; « couvertures infestées de puces ou de poux » ; collectifs
puisque les lits sont placés dans des « dortoirs », ce qui exclut toute intimité ; le plus souvent
complets, « ils n’ont plus de place », ce qui implique que les personnes ne sont même pas
certaines d’y être accueillies. De plus la violence y occupe une place importante, comme le
montre le passage relatant la bagarre pour un mégot à la soupe St-Eustache. C’est pour ces
raisons que No n’y va qu’en dernier recours si elle n’a pas trouvé d’autre endroit où passer la
nuit.
Une vie difficile et dangereuse
8. No consomme beaucoup de bière lorsqu’elle est avec Lou, car cette dernière l’invite. Cela
montre qu’elle boit pour supporter la dureté de sa situation. Mais lorsqu’elle est seule elle ne
prend qu’un café, pour pouvoir rester au chaud le plus longtemps possible pour le prix le plus
modique.
9. La vie de No est marquée par :
La fatigue « Je vois la fatigue sur son visage, c’est comme un
voile gris qui la recouvre » (l. 837-838).
La violence et la peur « la violence » (l. 845) et « la peur » (l. 844) ; « la peur
de la nuit » (l. 853).
L’errance, l’ennui « Les allers-retours en métro sur la même ligne pour
tuer le temps » (l. 845-846) ; « les heures passées dans
des cafés devant une tasse vide » (l. 846-847) ; « les
heures passées à attendre » (l. 852).
La honte et la volonté de rester digne « elle vit dans la rue mais elle n’aime pas qu’on le
dise » (l. 811-812) ; « ses hésitations et sa pudeur » (l.
835-836) ; « parfois […] elle raconte pour de vrai, les
yeux baissés, les mains sous la table » (l. 844-845)
La langue et le style
10. Il s’agit d’un GN composé d’un nom (une valise) complété par un complément du nom (à
roulettes) et une proposition subordonnée relative (qui contient toute sa vie). Les personnes
sans logis sont obligées de conserver leurs affaires avec elles et de les transporter. Elles ne
possèdent rien d’autre, ce qu’indique la relative sous la forme d’une métonymie (sa vie, pour
© Éditions Hatier, 2013 18
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
tous les souvenirs de sa vie). L’expression imagée montre que la valise de No est ce qui lui
tient lieu de maison, de refuge.
11. Ce passage est majoritairement écrit à la troisième personne, « elle vit dans la rue »
(l. 812) ou « elle raconte » (l. 844-852), et au présent. Ce passage est le récit de No, rapporté
par Lou, d’où l’emploi de la troisième personne qui fait entendre sa voix.
12. [Le passage à relever se situe hors de l’extrait, p. 58] La scène est le récit de la bagarre à
la soupe Saint-Eustache. Le reste du passage est traité sous forme de sommaire, listant des
actions (chercher où dormir, faire passer le temps…), ce qui met en avant le caractère répétitif
jusqu’au lancinant de la vie des SDF.
Faire le bilan
13. Le quotidien d'une SDF est occupé par la nécessité de trouver de quoi se nourrir et un lieu
où dormir. Il est marqué par la violence, la précarité et l'ennui.
À toi de jouer
14. Introduction : on demandera aux élèves de présenter la question posée et de soulever les
avantages (présentation attrayante dans laquelle les lecteurs peuvent s'impliquer) et les
inconvénients (imprécision, risque d'incompréhension et d'ambiguïté) du roman pour traiter
une question.
Développement : on les incitera à employer des citations précises du passage à l'appui de leurs
arguments, en faisant un rappel de la ponctuation spécifique (utilisation des deux points,
guillemets). On insistera sur la nécessité d'assortir chaque citation d'un commentaire ou d'une
explication.
15. Je dors ici ou là, chez une copine que j'ai rencontrée à Auchan et qui travaille au rayon
charcuterie du Auchan de la Porte de Bagnolet, chez un contrôleur SNCF qui m'héberge de
temps en temps, je squatte à droite ou à gauche, au gré de mes rencontres, je connais un
garçon qui a réussi à récupérer une tente Médecins du Monde et dort dehors, une fois ou
deux il m'a recueillie, sans rien me demander, si tu passes rue de Charenton en face du vingt-
neuf, tu verras sa tente, c'est son coin.
Séance 8. Caractériser les personnages
Le travail en classe
• Le questionnaire portant sur la totalité du roman, on n'attendra pas des élèves un relevé aussi
précis que dans les questionnaires précédents.
• L’objectif principal de cette séance est de comprendre la construction des personnages
dans le roman. Pour cela, on sera attentif :
– aux différentes manières de les présenter (descriptions, actes, dialogues) ;
– aux groupes présents (les adolescents, les adultes) ;
– à la succession des narrateurs ;
– aux parallélismes ou oppositions entre les personnages.
Corrigé du questionnaire n° 5
As-tu bien lu ?
© Éditions Hatier, 2013 19
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
1. Lou s’appelle Lou Bertignac.
2. Les deux amis de No sont Geneviève et Loïc.
3. Les parents de Lucas sont séparés.
Trois adolescents en miroir
4.
Lou Lucas No
Âge 13 17 18
Quelle est la relation Parents présents mais Parents absents : le Abandonnée par sa
avec les parents ? peu attentifs depuis la père est au Brésil, la mère, recueillie par
mort de leur enfant. mère dans un autre ses grands-parents,
Relation plutôt bonne appartement. en foyer depuis le
mais superficielle. Aucune relation décès de sa grand-
avec les parents. mère.
Rejetée par sa mère
qui boit et refuse de
la voir.
A-t-il des frères et Aucun depuis la Aucun. Aucun.
sœurs ? mort de sa petite
sœur.
Où en est-il de sa Elle est précoce et Intelligent mais A quitté l’école
scolarité très bonne élève. A mauvais élève. Ne Âtrès tôt. Ne fait
deux ans d’avance. fait rien, est en retard. plus d’études.
A-t-il des amis ? Non très peu. Beaucoup mais pour Geneviève et Loïc
des relations rencontrés en foyer.
superficielles.
Quelle est son A perdu sa petite Famille disloquée Elle est conçue lors
histoire familiale sœur lorsqu’elle avait depuis le départ du d’un viol et sa mère
huit ans. Depuis sa père. Lucas vit seul ne s’occupe jamais
famille est brisée et sa dans un grand d’elle. C’est
mère ne lui témoigne appartement. pourquoi elle est
plus que de brisée.
l’indifférence.
Où est son domicile ? Chez ses parents. Seul dans un À la rue.
appartement.
5. Aucun des trois personnages n’est à sa place : Lou ne cesse de se plaindre d’être toujours la
plus petite et de ne jamais avoir d’amis, d’être à part ; sa situation de très bonne élève la met
aussi dans une position marginale par rapport aux autres élèves. Enfin, elle vit dans une
famille disloquée par la mort d'un bébé et ne peut recevoir personne chez elle en raison de la
maladie de sa mère.
Lucas est plus âgé, fréquente tout le monde mais n’a pas de vrais amis ; scolairement il est
aussi marginal car il est en perdition. Enfin ses parents séparés le laissent vivre seul ce qui est
anormal à son âge.
No est rejetée et sans domicile. Elle ne va plus à l'école mais de foyer en foyer ; sa scolarité a
dû être chaotique. Enfin, conçue lors d'un viol, elle est rejetée par sa mère et n'a donc pas de
famille sur qui compter.
© Éditions Hatier, 2013 20
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
Ils ont chacun une faille personnelle provoquée par une histoire familiale douloureuse. Ils sont
chacun, pour des raisons différentes, délaissés par leurs parents.
Des personnages d’adultes
6. Le père et la mère de Lou, Monsieur Marin, le directeur de l’hôtel sont les adultes du
roman. D'une manière générale ce sont des adultes de référence (les parents, le professeur).
7. Tous les personnages d’adultes sont nommés par leur fonction (père, mère, directeur) - à
l’exception de la mère dont le prénom, Anouk, apparaît une fois au détour d’une conversation
- ou leur nom de famille (Monsieur Marin). Par opposition, les adolescents sont désignés par
leur prénom et ont à peine un nom de famille.
8. Les adultes et les adolescents sont désignés différemment pour indiquer que les premier s
correspondent à des fonctions et sont donc moins individualisés que les seconds qui ont
chacun un prénom.
9. Lou et Lucas réagissent par des positions de principe. Ils apparaissent comme étant
intransigeants, d'une seule pièce. Rien ne leur paraît impossible et ils agissent vis-à-vis de No
selon une position éthique (il faut aider), sans tenir compte des contraintes sociales et en
refusant tout compromis, ce que pourrait résumer la formule : « Je crois qu’il faut garder les
yeux ouverts ». Inversement les adultes montrent plus de réserves : Monsieur Marin
recommande de faire attention, d’en parler aux parents. Le père de Lou passe un « contrat »
avec No et lorsqu’elle ne s’y tient pas – lorsqu’elle se remet à boire – il la met à la porte.
Les adultes sont raisonnables, résignés, tandis que les adolescents refusent le monde tel qu’il
est, comme l'indique bien la formule de Lou : « si on décidait que les choses peuvent être
autrement ».
La langue et le style
10. No : « Je sais pas ce que je vais faire, tu vois, je sais plus du tout. »
Monsieur Marin : « Votre matériel est resté sur la plage ? »
Lucas : « Les peignes, c’est comme les brosses à dents, ça ne se prête pas. »
La Mère de Lou : « Tu as passé une bonne journée, tu as beaucoup de travail aujourd’hui, tu
n’as pas eu froid avec ton blouson. »
Lou : « Alors j’ai pensé que la grammaire a tout prévu, les désenchantements, les défaites et
les emmerdements en général. »
Le père de Lou : « Avant on y arrivait pas mal, tous les deux, on se racontait des choses, on
se parlait. Qu’est-ce qui ne va pas ? »
Faire le bilan
11. Complète le texte suivant
Le roman met en scènes trois personnages d’adolescents, Lou, No et Lucas. Ils sont très
différents : Lou est très en avance à l’école et bonne élève, No vit dans la rue et ne va plus à
l’école, Lucas est le dernier de sa classe. Pourtant ils ont en commun d’avoir chacun vécu un
drame familial ce qui les isole et les place dans une situation de décalage par rapport aux
autres jeunes gens de leur âge. Tous trois expriment l’adolescence, ce moment de la vie où on
se sent seul.
À toi de jouer
12. On rappellera à nouveau les règles d'écriture du dialogue (ponctuation, temps présent).
© Éditions Hatier, 2013 21
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
On pourra orienter les élèves en leur proposant de prendre pour modèle les échanges entre
Lucas et Monsieur Marin : d'un côté « un air de bagarre », l'insubordination et la révolte de
Lucas, de l'autre au contraire une vision pondérée et raisonnable de la situation.
On les incitera aussi à s'appuyer sur l'argumentation de Lou lorsqu'elle demande à ses parents
d'accueillir No chez eux.
Séance 9. Exploiter l'enquête, réfléchir au discours de l'art sur les exclus
Le travail en classe
• Avant d’étudier les quatre œuvres présentées, on travaillera à l'oral sur la mise en place des
techniques artistiques et de périodes considérées (la peinture, la gravure, le film et la
sculpture, avec des œuvres allant du XVe au XXe).
• On vérifiera que les notions de culture artistique présentes dans l'enquête sont connues
(connaissance des artistes, des mouvements présentés).
• On corrigera ensuite les questionnaires de l'enquête.
Corrigé du questionnaire p. 174
1. Présentation et contexte des œuvres
a. Les deux œuvres sont :
– un bas-relief (sculpture) en marbre de Pierre Puget datant de 1693 intitulé Alexandre le
Grand rencontre le philosophe grec Diogène le cynique dans son tonneau. (environ 4m x 3m)
– une peinture de Nicolas André Monsiau de 1818 intitulée Diogène et Alexandre.
b. Les deux œuvres représentent la rencontre de Diogène et Alexandre et illustrent une
légende importante de la vie du philosophe.
c. La peinture est du XIXe siècle. La sculpture du XVIIe siècle.
2. Observation des œuvres
a. Dans les deux cas la scène se passe dans la Grèce antique. La peinture est située dans un
paysage de campagne, tandis que la sculpture est située aux abords d'une ville (on aperçoit un
temple dans le fond).
b. Dans les deux œuvres on reconnaît le tonneau où vit Diogène, qui symbolise sa frugalité et
la simplicité de ses conditions d'existence. Sur la peinture, il possède aussi un bâton et une
écuelle, symboles à nouveau de sa simplicité et fréquents dans l'iconographie de cette scène
(cf. enquête p. 172).
3. Interprétation
a. Les deux œuvres représentent la rencontre entre Alexandre le Grand et Diogène, qui donne
lieu à l'une des anecdotes les plus célèbres de la vie du philosophe, et qui symbolise sa
simplicité.
b. Dans les deux œuvres le philosophe est assis par terre, tandis que le roi est debout (à cheval
sur la sculpture). Le philosophe est presque nu, tête nue, tandis que le roi est richement vêtu,
porte une cuirasse et un casque à plumets qui symbolisent sa richesse et sa puissance. On
perçoit donc d’un côté le roi qui représente la richesse et de l’autre le philosophe qui incarne
la pauvreté.
c. Ces deux images ont une dimension argumentative et donnent Diogène en exemple afin
d’inciter le spectateur à la même simplicité et au même détachement des biens matériels.
© Éditions Hatier, 2013 22
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
d. Diogène tend sa main face à Alexandre comme pour le repousser. Son geste et son expression
signifient qu'il refuse les richesses de ce monde qu’Alexandre lui apporte.
4. Composition
On peut remarquer que le philosophe et le roi sont placés sur la diagonale du tableau au centre
duquel se trouvent leurs mains. L'œil du spectateur est ainsi invité à aller de l'un à l'autre et à
s'interroger sur le geste des personnages : supplication, offrande, rejet… Le tableau, par sa
composition, est ainsi dynamique.
Corrigé du questionnaire p. 177
1. Présentation et contexte des œuvres
a. Les deux gravures datent du début du XVII e siècle, l'artiste les réalisant entre 1623 et 1624.
b. La première gravure (p. 176), sur laquelle on voit plusieurs diseuses de bonne aventure, est
une illustration des deux vers du poème de Callot Les Bohémiens « Vous qui prenez plaisir en
leurs paroles / Gardez vos blancs, vos testons, vos pistoles ». Tandis que la deuxième,
représentant le mouvement de la « tribu », pourrait illustrer les premiers vers du poème de
Callot ou de Baudelaire. On remarque d'ailleurs que les vers correspondant du poème de
Callot sont reproduits sur les gravures.
2. Observation des œuvres
a. Ces deux œuvres sont des gravures, d'où la précision du dessin. La série des Bohémiens se
compose de quatre gravures de 24 cm par 12 cm. Mises bout à bout elles constituent une
bande de 1m.
b. Les gravures comportent un grand nombre de personnages difficiles à dénombrer
précisément (plus d'une quinzaine sur chaque œuvre). Ce fourmillement donne une
impression d'abondance et de vie.
c. L'impression de mouvement est donnée par :
- l'abondance des personnages ;
- la composition horizontale (en particulier dans la seconde gravure) ;
- la présence d'éléments mobiles symbolisant le voyage (chariots, chevaux) ;
- dans la seconde gravure, la présence d'objets en suspension (le fouet, les gaffes) car saisis en
plein élan.
3. Interprétation
a. Callot donne une image positive des Bohémiens qui sont présentés de manière valorisante,
non comme des misérables errants, mais comme une troupe d'aventuriers libres.
b. L'image de Callot ne se veut pas réaliste mais symbolique, ce que confirme le poème
imprimé sur sa série de gravure comme une légende et l'interprétation qu'en donne Baudelaire
au XIXe siècle. Les Bohémiens ne sont pas présentés comme des nomades miséreux, mais
comme des voyageurs qui, par leur nomadisme, symbolisent la destinée humaine et la quête
infinie de la vérité et de l'avenir qu'est la vie.
Correction du questionnaire p. 180
1. Présentation et contexte de l'œuvre
© Éditions Hatier, 2013 23
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
a. Il s'agit d'un film muet et burlesque, en noir et blanc, de Charlie Chaplin. Le caractère muet
est perceptible dans la dimension expressive des visages des personnages (les mimiques
remplaçant la parole), qui disparaît au cinéma avec l'apparition du parlant.
b. Il est tourné en 1921 aux États-Unis.
c. Le pays traverse une grave crise qui provoque chômage et misère, perceptible dans le film à
travers le caractère délabré des rues et les costumes qui sont des haillons.
2. Observation de l'œuvre
a. Les deux images représentent des scènes d'extérieur : l’action de la première photo est
située au pied de l'immeuble où Charlot à recueilli l'enfant ; la seconde dans une rue du
quartier.
b. La première photo met en scène le clochard (Charlot) et l'enfant, tout comme la seconde à
laquelle se rajoute un policier. Ces trois personnages sont symboliques. Le personnage du
clochard n'est en effet pas sans rappeler les personnages de pauvres généreux et moraux qui
peuplent les contes, souvent opposés à de méchants seigneurs, ici représentés par le policier.
Ainsi, comme dans les contes, alors même qu'il est le personnage le plus pauvre du film, il
adopte un enfant abandonné qui symbolise ce qu'il y a de plus fragile, ce qu'il faut protéger à
tout prix. Le policier représente l'ordre, l'autorité. Ici cette autorité est injuste, au service des
puissants et opposée aux honnêtes miséreux.
c. Les décors représentent des rues délabrées et pauvres. Les costumes sont des vêtements
usagés, sauf pour le policier qui porte un uniforme.
3. Interprétation
a. La première image correspond au moment où les services sociaux retirent l'enfant à
Charlot, qui échange avec lui une dernière accolade. La seconde montre les deux personnages
surpris par le policier au moment où ils font alliance pour survivre avec des moyens à la
limite de l'honnêteté : l'enfant casse les vitres, Charlot les répare.
b. Les costumes sont représentatifs de la misère des personnages et permettent de mettre en
place des oppositions simples (entre les haillons de Charlot et de l'enfant et l'uniforme du
policier par exemple) qui ont pour but de comprendre immédiatement la position sociale des
personnages.
c. Les décors dépeignent un quartier populaire, voir pauvre, et nous montrent la situation de
grave crise que traverse le pays car tout y est triste et délabré. Comme pour les costumes,
l'image oppose de manière très lisible les quartiers riches (fleuris, colorés, propres et
entretenus) et les quartiers pauvres.
d. La première image est pathétique et provoque notre émotion. La souffrance des deu x
personnages est immédiatement perceptible.
La seconde au contraire est comique : Charlot et le Kid sont surpris par le policier comme le
montre la position des personnages, étagés les uns au dessus des autres. Le regard des
personnages est aussi éloquent : Charlot et le Kid sont cachés derrière le mur mais le danger
est derrière eux, d'où un effet comique.
4. Analyse de l'image filmée
© Éditions Hatier, 2013 24
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
a. La première image est perçue selon un plan moyen (on peut voir les bustes des
personnages) tandis que la seconde est un plan d’ensemble (le décor et les personnages en
pieds sont visibles)
b. L'expressivité des visages dans les deux images, la construction très théâtrale (le policier
qui apparaît dans le dos des personnages, les trois visages comme superposés) témoignent de
l'esthétique propre au cinéma muet.
Corrigé du questionnaire p. 183
1. Présentation et contexte des œuvres
a. Les deux œuvres sont des sculptures hyperréalistes.
b. L'artiste emploie de la résine et de la fibre de verre pour reproduire les moindres détails du
corps ainsi que d'autres matériaux comme des vêtements, un caddie, des produits de
consommation pour obtenir l'effet hyperréaliste.
2. Observation des œuvres
a. Chaque sculpture est hors situation, exposée dans un musée. Mais on pourrait imaginer la
femme de la page 182 allongée sur un trottoir et celle de la couverture dans les rayons d'un
supermarché.
b. Duane Hanson représente une vagabonde ivre et une ménagère, autrement dit des individus
choisis dans la vie quotidienne.
c. Les costumes sont ici des vêtements de la vie courante utilisés pour vêtir les sculptures
comme s'il s'agissait de véritables personnes.
3. Interprétation
a. Chacune des sculptures produit un effet dépaysant car les personnages sont saisis dans des
poses de la vie quotidienne, inhabituelles dans un musée. De plus elles imitent à la perfection
la réalité, ce qui crée un effet insolite, troublant et dérangeant pour le spectateur.
b. Derelict woman (« femme abandonnée ») dénonce la présence de la misère dans des
sociétés très riches.
c. Supermarket woman dénonce la société de consommation en montrant une femme obèse,
avec des bigoudis, poussant un caddie surchargé comme pour créer un rapport de cause à effet
entre son obésité et le caddie rempli de nourritures industrielles.
4. Analyse de la sculpture
a. Le modèle est couché mais dans une pose d'abandon qui donne l’impression qu’elle est
tombée.
b. Le modèle est debout et pousse un caddie tout en fumant une cigarette.
c. Ces poses sont très inhabituelles pour des sculptures. Il suffit pour s'en convaincre de les
comparer avec celles de la statue de Puget (Diogène). Ici tout se passe comme si Duane
Hanson avait souhaité représenter ses modèles dans des moments vides (courses, sommeil de
l'ivresse ou de l'épuisement, attente), contrairement à ce qui se fait habituellement.
d. L'artiste veut montrer la misère de la condition humaine dans la société de consommation :
les personnages sont en effet réduits à des consommateurs vivant une suite de moments vides
© Éditions Hatier, 2013 25
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
et sans intérêts. Le seul moyen d'échapper à cette spirale serait la misère, tout aussi horrible.
Les statues dénoncent ainsi la société de consommation.
Séance 10. Analyser la portée argumentative du roman
Le travail en classe
• Les élèves auront fait à l’avance le questionnaire « As-tu bien lu ? ». Pour les préparer on
leur aura demandé de relire les pages de contexte (p. 8-9), l'entretien avec l'auteur (p. 10) et le
repère sur le récit engagé (p. 148-149)
• L’objectif principal de ce questionnaire est d’analyser la portée argumentative du roman,
c’est-à-dire comprendre comment ce texte narratif se met au service d’une cause :
changer le regard sur les exclus. Pour cela, il nous faudra :
– revenir sur la simultanéité entre les faits racontés dans le récit et le moment de
l’écriture ;
– analyser la révolte de Lou ;
– comprendre et justifier le choix du titre No et Moi ;
– déterminer la visée de l’auteur à partir de l’étude de l’ensemble du roman : quels sont les
objectifs de D. de Vigan ?
Corrigé du questionnaire n° 6 : analyser la révolte de Lou
As-tu bien lu ?
1. Après l'exposé de Lou la classe applaudit.
2. Lou retrouve No dans la queue d'un foyer d'urgence.
3. No la repousses en lui disant que sa situation ne la concerne pas (« c'est pas ta vie »
l. 1144).
4. Lou décide d'accueillir No chez elle.
5. Lou s'inspire de la méthode de la dissertation enseignée par Mme Rivery sa professeur de
français.
De la prise de conscience à l'action
6. On relève dans ce passage le champ lexical de la vision : « invisible » (l. 967), « les voir »
(l. 971), « se cachent » (l. 973), « on repère » (l. 973), « les yeux grands ouverts » (l. 979-
980).
7. Il marque une prise de conscience, la fin de l'indifférence, qui permet de commencer à agir.
Cette rupture est marquée par les mots « un jour » et « pour commencer ».
8. La recherche de No : page 64, lignes 995 à 1018.
La discussion sur l'existence de « mondes qui ne communiqueraient pas entre eux » : page 64,
lignes 1006 à 1018.
La comparaison de son monde et de celui de No : page 66, lignes 1049 à 1053.
© Éditions Hatier, 2013 26
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
Les retrouvailles ratées avec No : page 68-69, lignes 1012 à 1144.
Refuser de vivre dans deux mondes différents : page 66-67, 1070-1085.
Le retour de No : pages 73-74, lignes 1205-1243.
L'idée d'accueillir No chez elle : p. 77, lignes 1290-1305.
La construction d'une argumentation : p. 78-79, lignes 1320-1355.
9. Les trois formules qui montrent que Lou propose de se révolter contre le monde tel qu'il va
sont :
– « Je pense à l'égalité, à la fraternité, à tous ces trucs qu'on apprend à l'école et qui n'existent
pas ».
– « Moi je m’en fous pas mal qu’il y ait plusieurs mondes dans le même monde et qu’il faille
rester dans le sien. Je ne veux pas que mon monde soit un sous-ensemble A qui ne possède
aucune intersection avec d’autres (B, C, ou D), que mon monde soit une patate étanche tracée
sur une ardoise, un ensemble vide. Moi je préférerais être ailleurs, suivre une droite qui
mènerait dans un endroit où les mondes communiquent entre eux".
– « si on décidait que les choses peuvent être autrement ».
La première expression montre que les discours officiels sur le monde sont mensongers
puisqu'ils affirment des valeurs qui ne sont pas respectées.
Les deux suivantes rejettent un discours de résignation (les choses sont telles qu'elles sont, les
gens vivent dans des mondes séparés) pour lui opposer un discours actif et volontaire (« je
m'en fous », « je ne veux pas », « je préférerais »…) afin d’agir face à une situation au lieu de
la subir.
Argumenter pour que « les choses soient autrement »
10. Lou hésite entre imaginer des mensonges farfelus (l. 1306-1319) pour inciter ses parents à
accueillir No (des « mises en scène », des « stratagèmes ») ou raconter la vérité « brute». Elle
choisit finalement de dire la vérité et d'argumenter.
11. Elle choisit la vérité parce que No est incapable de jouer un rôle (l. 1317-1318).
12.
Parties Fonction Contenu
Introduction Poser le sujet. J'ai rencontré une jeune
fille qui vit dehors et qui a
besoin d'aide.
Première partie : Exprimer son idée principale. Elle pourrait s'installer chez
thèse nous.
Deuxième partie On donne soi-même les Il y a des organismes
antithèse contre-arguments pour spécialisés, ce n'est pas à nous
mieux les désintégrer. de le faire.
Troisième partie Intégrer les contre- Il y a plus de deux cent-
synthèse arguments à son mille sans-abri en France
raisonnement.
Conclusion Ouvrir sur une nouvelle Qu'est-ce qui nous empêche
perspective. d'essayer ?
13. Les parents acceptent de rencontrer No. Oui elle s'est engagée car elle a défendu une idée
et à conduit une action en faveur de celle-ci.
© Éditions Hatier, 2013 27
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
La langue et le style
14. La métaphore employée par Lou pour montrer qu’elle et No vivent dans des mondes
différent est : « Je ne veux pas que mon monde soit un sous-ensemble […] une patate étanche
tracée sur une ardoise, un ensemble vide » (l. 1074-1077). Cette métaphore est empruntée aux
mathématiques.
15. No emploie le registre familier voir grossier, « barre-toi […] Tu me fais chier », qui traduit
son agressivité et sa colère.
Faire le bilan
16. Plusieurs questions montrent que le roman prend parti en faveur de la nécessité de prêter
assistance aux exclus et aux sans-abri et de s'engager personnellement dans cette cause (on
peut identifier la mise en scène de la prise de conscience de la nécessité de s'engager pour
cette cause par la narratrice). Les questions 12 et 13 permettent de développer des arguments
dans ce sens : les services sociaux sont débordés et nous vivons tous dans le même monde,
par conséquent il est anormal que des personnes en soient exclues.
À toi de jouer
17. Ce travail sera l'occasion de présenter ce qu'est un plan dialectique aux élèves (thèse,
antithèse, synthèse) et de les initier à cette forme de raisonnement.
Séance 11. Étudier la fin du roman : en quoi est-ce une fin de récit
d'adolescence et de formation ?
Le travail en classe
• Les élèves ayant préparé les questions du « As-tu bien lu ? », on vérifiera que le passage est
bien maîtrisé avant d'entamer le questionnaire.
• L'objectif de la séance est de bien comprendre la notion de récit de formation et celle de
récit d'adolescence. On montrera aussi en quoi ce passage est conclusif et marque bien la fin
des différentes histoires mises en place au début du roman (on pourra faire un rappel de la
séance 3 sur le questionnaire 1).
Corrigé du questionnaire n° 7 : étudier une fin de roman
As-tu bien lu ?
1. No lui téléphone de chez Lucas et lui demande de venir la chercher.
2. Lou décide de partir sur un coup de tête parce qu’elle ne peut pas abandonner No et la
laisser partir seule.
3. No et Lou partent pour l'Irlande.
4. No espère retrouver Loïc.
La fin de l'histoire
5. Elle lui offre une paire de Converse rouges, d'une valeur de 56 €, ce qui est énorme pour
No. Ce cadeau a une valeur symbolique : No veut à son tour offrir quelque chose à Lou avant
de disparaître et de la quitter définitivement.
© Éditions Hatier, 2013 28
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
6.
Lignes Événements
L'histoire de No et Lou l. 2544-2559 No lui offre un cadeau de
départ et s'esquive
discrètement.
La relation entre Lou et ses l. 2595-2604 No retourne chez elle. Sa
parents mère l'accueille et lui
pardonne sa fugue.
L'histoire de No et Loïc l. 2604-2625 No et Lucas vont voir
Geneviève. Ils apprennent
que, comme les autres, Loïc a
abandonné No.
L'histoire de Lou et Lucas l. 2651-2658 Lou et Lucas s'embrassent.
Le rôle de Monsieur Marin l. 2630-2650 Il offre un livre et prononce
une phrase morale.
7. En effet, le roman montre une adolescente qui vit une histoire qui mélange, un problème de
relations familiales (avec la mère dépressive et le père silencieux), une amitié (avec No), un
amour adolescent (avec Lucas) et une aventure intellectuelle (avec l'exposé). La fin du roman
apporte bien une conclusion à toutes les questions soulevées par le roman.
La fin d’un récit de formation
8. Lou emploie des verbes liés à la connaissance (comprendre, prendre la mesure), des
formules définitives (pour toute la vie, qui m'a fait grandir) et insiste sur le fait que "quelque
chose lui est arrivé" (l'expression est répétée trois fois). Cet épisode la change car elle
abandonne ses manies de petite fille surdouée (je n'ai pas compté, je n'ai pas fait…). On a
donc bien un épisode de formation.
9. Monsieur Marin apparaît comme un formateur et une conscience morale : il lui offre un
livre signalé comme « très important », c'est un cadeau éminemment symbolique du savoir, de
l'apprentissage et de la formation. Il prononce un ordre formulé à l'impératif : « ne renoncez
pas » l. 2650, qui ressemble à une conclusion de fable et qui est une sorte de leçon de vie. Il
joue donc un rôle presque paternel vis-à-vis de Lou.
10. Cette formule insiste sur un détail qui paraît futile et trivial (le sens de rotation de la
langue lors d'un baiser amoureux), mais en même temps la phrase comporte le verbe
« comprendre » (« j’ai compris » l. 2657), qui désigne une opération d'apprentissage. Ce
moment est donc très important : au delà de l'apprentissage humain et intellectuel, Lou fait
aussi l'expérience de l'amour. Il s'agit donc, sous une forme légère et en apparence comique,
d'une phrase finale de roman d'éducation.
La langue et le style
11. Les paroles de No (l. 2469-2475) sont rapportées au discours indirect libre par Lou qui
retranscrit leur conversation téléphonique. Cela confère au passage une plus grande vitalité et
permet de mettre en avant les supplications de No.
Faire le bilan
© Éditions Hatier, 2013 29
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
12. On invitera les élèves à s'appuyer sur les réponses des questions 6 et 7 en particulier pour
rédiger leur paragraphe.
13. C'est un comportement maternel. Il suggère que la mère a pris conscience de ce qui est
arrivé, que Lou a mûri, mais surtout de son rôle de mère, qu’elle a si longtemps négligé.
14. Elle est intimidée et ne sait pas quoi dire car sans bien le comprendre, elle perçoit que le
moment est important et qu'il l’aidera dans sa construction personnelle.
15. On invitera les élèves à s'appuyer sur les questions 10, 13 et 14, pour montrer qu'à l'issue
du récit, Lou a en effet mûri sur le plan affectif et intellectuel.
À toi de jouer
16. 17. Pour ces deux questions on peut imaginer plusieurs hypothèses de fin. On s'attachera à
faire débattre les élèves sur le sens que la fin donne à un récit. Ici, elle est « réaliste » et
indique que le monde n'est pas simple et qu'on ne peut le changer d'un coup de baguette
magique. Qu'aurait signifié un roman dans lequel No serait finalement revenue au domicile
des Bertignac ?
Séance 12. Étudier un groupement de documents sur le sujet « l'adolescence,
une période de révolte »
Le travail en classe
• Il s’agit de repérer les différences et les points communs dans un groupe de textes et de
documents.
• On commencera par vérifier si les élèves on bien lu et identifié les genres de chaque
document avant d'effectuer le questionnaire en classe.
Corrigé du questionnaire
As-tu bien lu ?
1. Rimbaud a assis la Beauté sur ses genoux et il l'a injuriée.
2. Le dieu de Rimbaud est le malheur.
3. La narratrice du Bal se plaint de sa mère et de ses parents.
4. Elle cite son oncle comme exemple des mensonges du régime.
Un thème : l’adolescence
5. Les trois narrateurs des documents ont entre quatorze et dix-neuf ans. Ils sont à la période
de l'adolescence.
6. Le personnage du Bal, Antoinette, s'oppose à ses parents et à sa gouvernante, tandis que
celui de Persépolis, Marjane Satrapi, s’oppose à son professeur et, à travers elle, au régime
islamique iranien.
7. Ils sont d'abord interloqués, puis sourient et l'applaudissent. On peut en conclure qu'ils sont
d'accord avec Marjane et seraient prêts à se révolter.
© Éditions Hatier, 2013 30
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
8. « Jadis » renvoie à la période de l'adolescence puisque Rimbaud écrit ce texte à l'âge de 19
ans.
9. Dans l'extrait du Bal on remarque que la narratrice souligne constamment le fait qu'elle
semble transparente et invisible pour ses parents : « ils n'avaient rien vu », « ils ne daignaient
rien voir », indifférence qu'elle interprète comme le fait d'être considérée par eux comme
quantité négligeable « une gamine c'est quelque chose de méprisable, et de bas comme un
chien ». Dans le document 3, les adolescentes sont présentées comme un groupe dans lequel il
est difficile de distinguer des individus. Ainsi dès que Marjane s'individualise, elle s'attire les
foudres de l'institutrice.
Trois scènes de révolte
10. Rimbaud rejette : la Beauté, la justice, l'espérance, le bonheur et la vie (qu’il appelle « les
bourreaux »). Son poème témoigne bien d'un état d'esprit de révolte absolue, de refus de
toutes les valeurs classiques et traditionnelles, ce qui est une forme de révolte caractéristique
de l'adolescence.
11. Dans Le Bal, la jeune narratrice veut aussi mourir pour punir ses parents. Elle en vient à
rejeter la religion et à voir en elle une sottise bonne pour les enfants. C'est aussi un
mouvement de révolte.
12. La révolte de Satrapi s'exprime par un raisonnement qui remet en question l'autorité,
appuyé sur l'exemple de l'oncle, qui montre que ce que disent les professeurs est faux. Le
dessin montre d'ailleurs des gestes oratoires (doigt tendu et levé, geste démonstratif…).
13. C’est un mélange de profonde tristesse, d’indignation et de colère qui empêche Antoinette
de finir ses phrases.
Lire l’image
14. La scène a lieu dans une salle de classe comme le montre le décor (pupitres) et la
situation : un groupe d'élèves face au professeur.
15. La tenue des jeunes filles et du professeur qui portent le voile évoque la Révolution
islamique.
16. D'abord souriante, elle est ensuite pincée puis en colère.
17. Les adolescents sont représentés sous la forme d'une masse informe dans laquelle les
visages apparaissent à peine, cette impression est accrue par les voiles qui couvrent
complètement les jeunes filles et contribuent à les désindividualiser.
18. Marjane lève le doigt et se met debout pour se faire remarquer et entendre. D'abord
montrée dans le groupe (vignette 2) elle est ensuite montrée seule (vignettes 4 et 5). Enfin, et
surtout, elle prend la parole, contrairement aux autres.
À toi de jouer
19. On se fondera sur les propositions des élèves.
© Éditions Hatier, 2013 31
Classiques & Cie collège GUIDE PÉDAGOGIQUE
Séance 13. Faire le bilan de la lecture de l'œuvre
Le travail en classe
• Il s’agit de la dernière évaluation notée qui vérifie l’acquisition des notions principales et
la compréhension globale du roman.
Voir l’évaluation n°3
Corrigé de la fiche d’évaluation n°3
Fais le point sur tes connaissances
1. Le titre No et moi désigne les deux personnages principaux : Nolwenn, jeune SDF, et Lou
Bertignac, la narratrice. Ce titre énigmatique devient explicite dès les premières pages du
roman, en particulier lorsque Lou rencontre la jeune SDF qui lui dit alors son prénom. Lou
souhaite rencontrer une SDF pour réaliser un exposé en classe.
2. Lors de cette première rencontre c'est plutôt No qui va interroger Lou sur elle et une amitié
va naître entre les deux jeunes filles. Ces deux événements sont inattendus et vont lancer la
narration.
3. On se fondera sur les réponses données au questionnaire de l’étape 6. On pourra ainsi citer
comme exemple la difficulté éprouvée par les sans-abri pour trouver un endroit où dormir,
l’errance qui est la leur tout au long de la journée, la violence et la peur auxquelles ils sont
soumis…
4. Narrateur : instance ou personnage qui raconte l'histoire dans un récit. Dans No et moi, le
narrateur est Lou Bertignac.
Témoignage : récit que fait une personne d’événements auxquels elle a assisté. Dans No et
moi, Lou témoigne de la situation des sans-abri.
Roman engagé : roman qui défend un point de vue sur une question politique ou de société
de manière à intervenir dans le débat pour faire changer les choses. À ce titre No et moi est un
roman engagé qui vise à transformer le regard du lecteur sur les sans-abri.
Récit de formation : récit ou roman qui raconte les différentes étapes de la formation d'un
personnage dans différents domaines (intellectuel, social, sentimental, politique…). On peut
dire que No et moi est un roman de formation car la jeune héroïne évolue au cours du récit :
elle apprend la dureté de la vie, à prendre parti et à s'engager, et fait avec Lucas son éducation
sentimentale.
Rédige des questions de synthèse
5. 6. On se fondera sur les réponses des élèves.
© Éditions Hatier, 2013 32
Vous aimerez peut-être aussi
- No Et MoiDocument4 pagesNo Et Moijopasbou25% (4)
- Plan Detaille Petit PaysDocument3 pagesPlan Detaille Petit PaysDemichel Olivia63% (8)
- Delphine de Vigan No Et MoiDocument10 pagesDelphine de Vigan No Et MoiGeorgiana GattinaPas encore d'évaluation
- Un Secret PH Grimbert PDFDocument2 pagesUn Secret PH Grimbert PDFmaccPas encore d'évaluation
- Guide Pedagogique Complet Shine Bright Terminale-1Document406 pagesGuide Pedagogique Complet Shine Bright Terminale-1sophie delliou100% (1)
- Chevaliers SubjonctifDocument6 pagesChevaliers SubjonctifSite Commune Langue100% (1)
- Questionnaire de Lecture Le Horla de MaupassantDocument4 pagesQuestionnaire de Lecture Le Horla de Maupassantlolitadz75% (4)
- Corrigé René - ChateaubriandDocument2 pagesCorrigé René - ChateaubriandPikolechatPas encore d'évaluation
- Fiche Francais Les Figures de Style - Le CoursDocument4 pagesFiche Francais Les Figures de Style - Le CoursSara Battiloro AraujosaxPas encore d'évaluation
- CyranoDocument17 pagesCyranoyasmine100% (1)
- CTRL Lecture Les Miserables Ecole Des LoisirsDocument2 pagesCTRL Lecture Les Miserables Ecole Des LoisirsSTEPHANIE SATTI100% (2)
- Les Fourberies de Scapin ProgressionDocument19 pagesLes Fourberies de Scapin ProgressionChahdae Bakhat100% (2)
- Shine Bright LLCE Guide PédaDocument452 pagesShine Bright LLCE Guide PédaDianaAchimPas encore d'évaluation
- Missa Ioannis Pauli SecundiDocument16 pagesMissa Ioannis Pauli SecundiSanDomenicoSavioRibera. Parrocchia100% (2)
- 2 Monsieur Ibrahim Textfragen Erw - HorizontDocument13 pages2 Monsieur Ibrahim Textfragen Erw - HorizontRosario Galeote SorianoPas encore d'évaluation
- Phèdre de Racine (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandPhèdre de Racine (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Fiche Pédagogique Bel-AmiDocument32 pagesFiche Pédagogique Bel-AmiHope Naidu100% (2)
- Bel-Ami Maupassant Excipit CommentaireDocument6 pagesBel-Ami Maupassant Excipit CommentaireHarchi Abdo100% (2)
- Tableau Valeur Des Temps PDFDocument1 pageTableau Valeur Des Temps PDFlakriai anass100% (1)
- AvareDocument48 pagesAvareionika0% (1)
- Carnet de Lecture MI Fiche ÉlèveDocument11 pagesCarnet de Lecture MI Fiche ÉlèveTaroPas encore d'évaluation
- Subjonctif Activite Petits Problemes Entre AmisDocument1 pageSubjonctif Activite Petits Problemes Entre AmisJosé Armando100% (1)
- No et moi de Delphine de Vigan (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandNo et moi de Delphine de Vigan (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Evangile de ThomasDocument210 pagesEvangile de ThomasJean-Marie Bertrand100% (4)
- L'approche ÉnonciativeDocument23 pagesL'approche Énonciativeredouaneslh.ga100% (1)
- Laguna Veneta - Texier PDFDocument2 pagesLaguna Veneta - Texier PDFVladan MilenkovicPas encore d'évaluation
- La Prise de Parole en PublicDocument5 pagesLa Prise de Parole en PublicCAROLE CHRISTOPHER100% (3)
- CINEFETE13 Dossier No-Et-Moi PDFDocument27 pagesCINEFETE13 Dossier No-Et-Moi PDFTecnologia InstitutPas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de LectureDocument6 pagesJuste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de LectureMohamed AlhegagiPas encore d'évaluation
- La Princesse de Clèves - Séance LiminaireDocument21 pagesLa Princesse de Clèves - Séance LiminairelyblancPas encore d'évaluation
- La nuit de Valognes d'Eric-Emmanuel Schmitt (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLa nuit de Valognes d'Eric-Emmanuel Schmitt (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Stupeur Et TremblementsDocument25 pagesStupeur Et TremblementsasukittaPas encore d'évaluation
- Un secret de Philippe Grimbert (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandUn secret de Philippe Grimbert (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- La Princesse de Cleves Fiche de LectureDocument8 pagesLa Princesse de Cleves Fiche de Lecturepompier18100% (3)
- Explication de Texte - Du Bellay Heureux Qui Comme UlysseDocument3 pagesExplication de Texte - Du Bellay Heureux Qui Comme Ulyssebeebac2009100% (3)
- No Et Moi - Une AnalyseDocument36 pagesNo Et Moi - Une AnalyseMukadzi MukaPas encore d'évaluation
- KNOCK Jules RomainsDocument40 pagesKNOCK Jules Romainsalicemartha75% (4)
- Correction Du Questionnaire Sur La Guerre de Troie N Aura Pas LieuDocument2 pagesCorrection Du Questionnaire Sur La Guerre de Troie N Aura Pas LieuRAHMA rahmouna0% (1)
- Le Dernier Jour d'un condamné de Victor Hugo (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)D'EverandLe Dernier Jour d'un condamné de Victor Hugo (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)Pas encore d'évaluation
- Yasmina Reza - Le Dieu Du Carnage - Extrait N°3Document3 pagesYasmina Reza - Le Dieu Du Carnage - Extrait N°3Kévin Dumanoir100% (1)
- L'Ile des esclaves de Marivaux (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandL'Ile des esclaves de Marivaux (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Le HorlaDocument5 pagesLe HorlaJhohan Daniel RestrepoPas encore d'évaluation
- Molière - Dossier PédagogiqueDocument22 pagesMolière - Dossier PédagogiqueoperamassyPas encore d'évaluation
- Seq TartuffeDocument10 pagesSeq TartuffeMoraruElenaPas encore d'évaluation
- Demain Dès Laube Victor Hugo AnalyseDocument6 pagesDemain Dès Laube Victor Hugo Analyserguib100% (1)
- Les Conjonctions de Coordination Et de SubordinationDocument3 pagesLes Conjonctions de Coordination Et de Subordinationgisela_alves1605Pas encore d'évaluation
- No Et Moi - Delphine de Vigan - Juin 2015 - Mots Liés - Luc Comeau-MontasseDocument40 pagesNo Et Moi - Delphine de Vigan - Juin 2015 - Mots Liés - Luc Comeau-MontasseLesmotsLiés50% (2)
- Le Tartuffe Est Une Oeuvre de MolièreDocument10 pagesLe Tartuffe Est Une Oeuvre de MolièreHerPas encore d'évaluation
- Demain de L'aubeDocument2 pagesDemain de L'aubeSimona Pavel100% (1)
- La Chanson de Roland (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandLa Chanson de Roland (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- NRPL Sept21 1re Gouges RomanDocument10 pagesNRPL Sept21 1re Gouges Romannora100% (1)
- Fiche de Lecture - No Et MoiDocument9 pagesFiche de Lecture - No Et MoiJi SabaterPas encore d'évaluation
- La Mise en ReliefDocument4 pagesLa Mise en ReliefDudewitzPas encore d'évaluation
- Monsieur IbrahimDocument18 pagesMonsieur IbrahimFarid BouPas encore d'évaluation
- No Et Moi: Delphine DE ViganDocument64 pagesNo Et Moi: Delphine DE ViganManon.maxence lovePas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire 1 AndromaqueDocument9 pagesLecture Linéaire 1 Andromaquelyblanc100% (1)
- LeHorla PDFDocument15 pagesLeHorla PDFadiloadelalgerPas encore d'évaluation
- Analyse Stylistique Du Poéme "Demain Des Aubes"Document3 pagesAnalyse Stylistique Du Poéme "Demain Des Aubes"Beatrice Morlotti100% (3)
- Le Malade Imaginaire FINALDocument11 pagesLe Malade Imaginaire FINALNCECPas encore d'évaluation
- Calligrammes Corrige PDFDocument15 pagesCalligrammes Corrige PDFSidhoum Sid50% (2)
- Negation Carte MentaleDocument1 pageNegation Carte MentaleDaniel QUILCA100% (1)
- Guide - Le Medecin Malgre LuiDocument21 pagesGuide - Le Medecin Malgre LuiLaetitiaChaignaultPas encore d'évaluation
- Guide Daccompagnement Les Fourberies de ScapinDocument39 pagesGuide Daccompagnement Les Fourberies de ScapinWalter Romero100% (2)
- Therese Raquin ResumeDocument2 pagesTherese Raquin Resumejeremyu95100% (1)
- Theatre Tartuffe ProfDocument7 pagesTheatre Tartuffe ProfCoformation intergenerationnellePas encore d'évaluation
- Vers L Ethique de Spinoza - Gilles Louise PDFDocument227 pagesVers L Ethique de Spinoza - Gilles Louise PDFGelu StoiaPas encore d'évaluation
- Livret Correcteur Delf Pro b1Document2 pagesLivret Correcteur Delf Pro b1Manuel Romero GarciaPas encore d'évaluation
- Tuesday, May 5: Mardi 5 Mai 2020Document6 pagesTuesday, May 5: Mardi 5 Mai 2020mamangelyPas encore d'évaluation
- Points Et Modes DarticulationDocument17 pagesPoints Et Modes DarticulationRenata BravoPas encore d'évaluation
- ATELIER Phonétique Enchaînement VocaliqueDocument3 pagesATELIER Phonétique Enchaînement VocaliqueAlexandra OcampoPas encore d'évaluation
- Bilan Periodique PALANQUE Kelyan 2018 2019 T3 PDFDocument3 pagesBilan Periodique PALANQUE Kelyan 2018 2019 T3 PDFOverkill YtPas encore d'évaluation
- CUnit PrésentationDocument21 pagesCUnit PrésentationЮсеф БадазPas encore d'évaluation
- Didactique Cours 4Document2 pagesDidactique Cours 4Kim Hye RinPas encore d'évaluation
- Fola 40023 Im French 2Document57 pagesFola 40023 Im French 2Mae RodriguezPas encore d'évaluation
- 1Document2 pages1Anton HolovinskyiPas encore d'évaluation
- AnglaisDocument142 pagesAnglaisrolandkouame100% (2)
- Picot TI Periode2Document5 pagesPicot TI Periode2Moha ElcasawiPas encore d'évaluation
- A La Découverte de La LECTURE. Premiers Apprentissages .. Pratiques Et Théories - Françoise Boulanger 2010 (Lire Éducation)Document184 pagesA La Découverte de La LECTURE. Premiers Apprentissages .. Pratiques Et Théories - Françoise Boulanger 2010 (Lire Éducation)Udei DonPas encore d'évaluation
- Dzexams 3am Francais 621217Document3 pagesDzexams 3am Francais 621217Rima Mima CheboubPas encore d'évaluation
- Résumé Mémoire PFE FinalDocument4 pagesRésumé Mémoire PFE FinalAhmedEzzaytouniPas encore d'évaluation
- Arthur Christensen - La Légende Du Sage BuzurjmihrDocument48 pagesArthur Christensen - La Légende Du Sage Buzurjmihrvohouman2586Pas encore d'évaluation
- Hist CongoDocument422 pagesHist CongoFortunaPas encore d'évaluation
- L - Emploi Des PronomsDocument7 pagesL - Emploi Des PronomsSid ahmed Zerrouki sbaPas encore d'évaluation
- Devoir 5emeDocument2 pagesDevoir 5emebuggsy kraPas encore d'évaluation
- Procédés Stylistiques - SyntaxiquesDocument6 pagesProcédés Stylistiques - SyntaxiquesMaeva BollouPas encore d'évaluation
- Attribut Du Sujet Cm1 Cm2Document4 pagesAttribut Du Sujet Cm1 Cm2Yassine JazairiPas encore d'évaluation
- TVB 2 U5-6Document62 pagesTVB 2 U5-6João Vitor SouzaPas encore d'évaluation
- Exercices Grammaire 2023 cm1Document21 pagesExercices Grammaire 2023 cm1Ilaf JoudPas encore d'évaluation
- Forte, Bruno - L'HumiliteDocument15 pagesForte, Bruno - L'HumiliteMatias JuradoPas encore d'évaluation
- JLFDM Scene 1 p1Document3 pagesJLFDM Scene 1 p1daomasln.15Pas encore d'évaluation