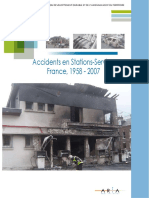Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Etude D Impact Sur Une Station de Service
Transféré par
dqfqfqfqTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Etude D Impact Sur Une Station de Service
Transféré par
dqfqfqfqDroits d'auteur :
Formats disponibles
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
PREAMBULE
Dans le cadre de la politique initiée par le Ministère délégué auprès du Ministère de
l’énergie, des Mines, de l’eau et de l’environnement, chargé de l’environnement, pour la protection
et la prévention de l’environnement ainsi que la sauvegarde des ressources naturelles tout en
encourageant l’investissement.
Le promoteur Mohammed Taif a confié au bureau d’études Dream Engineering l’étude
d’impact du projet de construction d’une Station-service et des unités annexes en vue d’obtenir
l’acceptabilité environnementale auprès du comité Régional des études d’impact institué à cet effet.
1 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
SOMMAIRE
PREAMBULE....................................................................................................................................1
SOMMAIRE.......................................................................................................................................2
Liste des figures..................................................................................................................................5
Liste des Tableaux..............................................................................................................................5
I. SYNTHESE EIE..........................................................................................................................6
II. CADRE REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL..............................................................7
II.1- Cadre réglementaire.............................................................................................................7
II.2- Cadre institutionnel..............................................................................................................9
III. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET...................................................................9
IV. DESCRIPTION DU PROJET................................................................................................10
IV.1- INVESTISSEMENTS......................................................................................................10
IV.2- Constructions projetées....................................................................................................10
IV.3- Equipements.....................................................................................................................11
IV.4- Moyens humains..............................................................................................................11
- Effectif de la station-service...............................................................................................11
- Espace de vidange /lavage..................................................................................................11
- Café.....................................................................................................................................11
- Restaurant...........................................................................................................................11
IV.5- Conception des Stations-service......................................................................................12
IV.6- Caractéristiques de la future station-service....................................................................13
IV.6.1 Citernes.........................................................................................................................13
IV.6.2 Tuyauterie.....................................................................................................................14
IV.6.3 Local pour vidange des véhicules................................................................................14
IV.6.4 Locaux de mécaniques, d’entretien et lavage des véhicules........................................14
IV.6.5 Dépôts...........................................................................................................................14
IV.6.6 Aire service...................................................................................................................14
IV.6.7 Type de distributeurs....................................................................................................15
IV.6.8 Dispositif du point de vente..........................................................................................15
IV.6.9 La méthode de remplissage rapide...............................................................................15
IV.6.10 Dispositif de stockage...............................................................................................15
IV.6.11 Air comprimé............................................................................................................16
IV.6.12 Mesures de sécurité...................................................................................................16
IV.7- Assainissement liquide.....................................................................................................17
IV.8- Alimentation en eau potable............................................................................................17
IV.9- Assainissement solide......................................................................................................17
IV.10- Energie électrique............................................................................................................18
V. DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE.............................................................................18
V.1- Localisation du site du projet.............................................................................................18
V.2- La zone de l’étude..............................................................................................................18
VI. ANALYSE DESCRIPTIVE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU..........................................19
VI.1- Situation géographique....................................................................................................19
VI.2- Cadre naturel....................................................................................................................19
VI.2.1 Relief............................................................................................................................19
VI.2.2 Aperçu géologique.......................................................................................................20
VI.2.3 Hydrologie....................................................................................................................22
VI.2.1 Hydrogéologie..............................................................................................................22
2 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
VI.2.2 Climatologie.................................................................................................................26
VI.2.2.1 Climat....................................................................................................................26
VI.2.2.2 Pluviométrie..........................................................................................................26
VI.2.2.3 Température..........................................................................................................26
VI.2.2.4 Régime des vents..................................................................................................27
VI.3- Eléments biologiques (faune et flore)..............................................................................27
VI.3.1 La flore.........................................................................................................................27
VI.3.2 La faune........................................................................................................................27
VI.4- Eléments humains............................................................................................................27
VI.4.1 Démographie................................................................................................................27
VI.4.1.1 Les secteurs économiques.....................................................................................27
a- Agriculture................................................................................................................27
b- Elevage.....................................................................................................................28
c- Industrie....................................................................................................................28
VI.4.1.2 Infrastructures de base..........................................................................................29
a- L’eau potable.............................................................................................................29
b- Réseau électrique......................................................................................................29
c- Réseau routier...........................................................................................................29
VI.4.1.3 Equipement administratifs et socio-économique..................................................30
VII. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT.......................31
VII.1- Méthodes d’évaluation des impacts.................................................................................31
VII.2- Evaluation des Impacts....................................................................................................31
VII.2.1 Phases susceptibles de produire des impacts sur l’environnement...........................31
VII.2.2 Impacts positifs.........................................................................................................31
VII.2.2.1 Création des postes d’emploi...............................................................................31
VII.2.2.2 Développement économique et socio-économique..............................................31
VII.2.3 Impacts négatifs........................................................................................................32
VII.2.3.1 Impacts en phase d’aménagement et de mise en place des équipements et
infrastructures.........................................................................................................................32
a- Impacts sur la qualité de l’air....................................................................................32
b- Impacts liés au bruit..................................................................................................33
c- Impact sur les ressources en eau superficielles.........................................................33
d- Impact sur la circulation routière..............................................................................33
e- Impact sur le sol........................................................................................................33
f- Impact sur le paysage................................................................................................34
VII.2.3.2 Impact en phase d’exploitation du projet.............................................................34
a- Impact sur les ressources en eau superficielles.........................................................34
b- Impact d’émission de bruit.......................................................................................35
c- Impacts sur le paysage..............................................................................................35
d- Impact des déchets....................................................................................................35
a- Impact sur la circulation routière...................................................................................36
e- Impact sur l’air/atmosphère......................................................................................36
f- Impact sur le sol........................................................................................................37
VIII. MESURE D’ATTENUATION...............................................................................................39
VIII.1- Mesures relatives à la protection des ressources en eau...............................................39
VIII.2- Mesures relatives à la protection du sol.......................................................................39
VIII.3- Mesures relatives à la protection de l’air......................................................................40
VIII.4- Mesures relatives au bruit.............................................................................................42
VIII.5- Mesures relatives à la gestion des déchets...................................................................43
3 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
VIII.6- Mesures relatives au risque d’incendie........................................................................43
IX. Gestion des risques d’accidents..............................................................................................43
IX.1- Scénario d'accidents.........................................................................................................43
IX.2- Plan d'urgence..................................................................................................................44
IX.3- Mesures relatives à la sécurité du personnel....................................................................45
IX.4- Mesures d'information en cas d'incident ou d'accident....................................................45
X. SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL............................................................46
XI. CONCLUSION......................................................................................................................47
XII. RESUME DE L’EIE...............................................................................................................48
Phase de construction.......................................................................................................................48
Phase d’exploitation.........................................................................................................................49
Phase de construction.......................................................................................................................49
Références bibliographiques..............................................................................................................50
ANNEXES.........................................................................................................................................51
4 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Liste des figures
Figure 1: Description d’une citerne à carburant.................................................................................13
Figure 2: Schéma d’installation des citernes......................................................................................14
Figure 3: Découpage de la province de My Yaacoub.........................................................................19
Figure 5: Coupe N-S interprétative, montrant la variation d’épaisseur de la série plio quaternaire du
bassin de Saïs......................................................................................................................................21
Figure 4: Carte du toit du lias de la plaine de Saïs.............................................................................20
Figure 6: Carte des isopaques de la formation plio-quaternaire du bassin de Saïs............................21
Figure 7: Cartes du niveau statique de la nappe phréatique de la plaine de Fès pour l’année 2003. A :
mois de janvier, B : mois de juin........................................................................................................24
Figure 8: Coupe N-S montrant le toit du réservoir liasique du bassin de saïs...................................24
Figure 9: Extrait de la carte des nappes du bassin du Sebou..............................................................25
Figure 10: Illustrations comparatives entre une installation sans système de récupération des COV
et une installation avec système de récupération des COV Stage I- cas de remplissage des réservoirs
de la station.........................................................................................................................................41
Figure 11: Illustrations comparatives entre une installation sans système de récupération des COV et
une installation avec système de récupération des COV Stage II- cas de remplissage des réservoirs
des véhicules.......................................................................................................................................42
Liste des Tableaux
Tableau 1: Investissement du projet...................................................................................................10
Tableau 2: Répartition des constructions projetées............................................................................10
Tableau 3: Caractéristiques du relief de la commune d’Ain Chkef (Monographie de la commune
rurale d’Aïn Chkef 2008)...................................................................................................................20
Tableau 4: Tableau 1: Cumul mensuel des précipitations annuelles enregistrées au niveau des
stations de Fès entre 2000 et 2009 (en millimètre) (Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef
2008)...................................................................................................................................................26
Tableau 5: Données mensuelles des températures moyennes enregistrées au niveau des stations de
Fès entre 2000 et 2009 (en degrés °C) (Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008)....26
Tableau 6: Répartition de la superficie agricole utile au niveau de la commune d’Ain Chkef
(Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008)..................................................................27
Tableau 7: Structure de l’exploitation agricole au niveau de la commune d’Ain Chkef (Monographie
de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008)..........................................................................................28
Tableau 8: Répartition du cheptel de la commune rurale d’Ain Chkef (Monographie de la commune
rurale d’Aïn Chkef 2008)...................................................................................................................28
Tableau 9: les différentes unités industrielles de la commune d’Ain Chkef (Monographie de la
commune rurale d’Aïn Chkef 2008)..................................................................................................28
Tableau 10: Réseau routier de la commune d'Aïn Chkef...................................................................30
Tableau 11: Inventaire du milieu et évaluation des impacts...............................................................38
5 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
I. SYNTHESE EIE
Une station-service est une infrastructure destinée principalement à fournir du carburant aux
automobilistes, avec une éventuelle activité d'entretien des véhicules (vente d'accessoires automobiles,
gonflage des pneumatiques, petite mécanique et dépannage).
Aujourd’hui, les stations les plus équipées offrent aussi des services à destination des routiers. En
effet, celles-ci disposent de tous les services nécessaires pour une pause détente en toute sécurité : toilettes,
épicerie, restauration, téléphone public, jeux pour enfants et point d’information.
Cependant, certaines activités se déroulant dans le cadre de l’exploitation d'une station-service
peuvent être à l’origine d’impacts environnementaux, tels la dégradation de la qualité de l’eau, du sol et de
l’atmosphère, ou peuvent contribuer à la dégradation de la qualité de vie de l’entourage par l’émission
d'odeurs, de gaz et de bruit.
Tenant compte des exigences environnementales qui s’imposent pour assurer une meilleure gestion
de ces plateformes, le promoteur Mohammed Taif a mobilisé un montant d’investissement de 8.050.000,00
Dhs pour la création d’une station service et de ses annexes, à la commune rurale d’Ain Chkef, Province de
My Yaacoub.
Les différentes entités projetées se présentent comme suit :
Une station service ;
Un Café ;
Un Restaurant ;
Une Terrasse couverte ;
Des toilettes ;
Une Mosquée.
Le présent document est le rapport de l’étude d’impact environnemental du projet que le promoteur a
confié au bureau d’études techniques ‘’Dream Engineering‘’. La réalisation d’une telle étude se fait
conformément à la réglementation marocaine sur l’évaluation environnementale.
Cette étude comporte une description du projet et de l’état initial du site, ainsi qu’une présentation
concise sur le cadre juridique et institutionnel afférent au projet.
La dite étude décèle par la suite, les impacts positifs et négatifs induits par le projet (que ce soit
pendant la phase des travaux de réalisation ou celle d’exploitation) quant à leur origine (sources de polluants)
et leur importance. Finalement les mesures de prévention de pollution seront décrites (sous la forme de
recommandations et de mesures pratiques) en fonction des meilleures techniques disponibles, dont
l’applicabilité et la disponibilité n’entraînent pas de coûts excessifs.
6 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
II. CADRE REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL
II.1-Cadre réglementaire
Le projet de création d’une station services et annexes initié par le promoteur Mohammed Taif doit se
conformer aux lois et textes législatifs et réglementaires régissant son activité et la protection de
l’environnement notamment :
Dahir N°1-03-59 du 12 Mai 2003 portant promulgation de la loi 11-03 relative à la protection et à la
mise en valeur de l’environnement ;
Dahir N° 1-03-60 du 12 Mai 2003 portant promulgation de la loi 12-03 relative aux études d’impact
sur l’environnement;
Décret n° 2-04-563 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif aux attributions et au fonctionnement
du comité national et des comités régionaux des études d'impact sur l'environnement ;
Décret N°2-04-564 du 4 novembre 2008 fixant les modalités d’organisation et du déroulement de
l’enquête publique ;
Dahir N°1-03-61 du 12 Mai 2003 portant promulgation de la loi 13-03 relative à la lutte contre la
pollution de l’air ;
Décret N° 2-09-286 du 20 Hija 1430 (08 décembre 2009) fixant les normes de qualité de l’air et les
modalités de surveillance de l’air ;
Décret N° 2-09-631 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les valeurs limites de dégagement,
d’émission ou de rejet de polluant dans l’air émanant de sources de pollution fixes et les modalités
de leur contrôle.
Loi N° 10-95 sur l’eau (Dahir N° 1-95-154 du 18 Rabii 1, 1416 du 16 Août 1995) portant
promulgation de cette loi (BO N° 4325 du 29/09/1995) et qui prévoit entre autre la création des
agences de bassins et ses textes d’application ;
décret N°2-04-553 du 24 janvier 2005 relatif aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs
ou indirects dans les eaux superficielles et souterraines ;
Arrêté n° 1607-06 du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) portant fixation des valeurs limites
spécifiques de rejet domestique.
L’arrêté N°1180 du 12.06.06 fixant le taux de redevance applicable au déversement des eaux usées et
l’unité pollution.
L’arrêté N°1277 du 17.10.02 fixant les normes de qualité des eaux superficielles utilisées pour la
production de l’eau potable ;
L’arrêté N°1275-01du 17.10.02 portant définition grille de qualité des eaux de surface ;
Décret du 25/7/2006 relatif à l’utilisation des eaux à usage alimentaire ;
Dahir N°1-06-153 du 3 Choual 1427 (22 Novembre 2006) portant promulgation de la loi N° 28-00
7 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
relative à la gestion des déchets et à leur élimination ;
Décret N° 2-07-253 du 14 rejeb 1429 (18 Juillet 2008) portant classification des déchets et fixant la
liste des déchets dangereux ;
Dahir n° 1-92-31 (15 hija 1412) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme
(B.O. 15 juillet 1992) ;
décret N°2-92-832 pris pour l’application de la loi N°12-90 relative à l’urbanisme ;
Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative
au Code du Travail.
Dahir N°1-08-153 du 22 Safar 1430, (18 févier 2009) portant promulgation de la loi 17-08 modifiant
et complétant la loi N°78-00 portant charte communal telle que modifiée et complétée.
Au dahir N°1-69-170 du 10 Joumada1 1389 (25 Juillet 1969) relatif à la défense et la restauration
des sols ;
La loi cadre N°18-95 formant charte de l’investissement promulguée par Dahir N° 1-95- 213 du 14
Joumada II 1416 (8 novembre 1995) ;
Décret N°2-00-895 du 6 Kaada 1421 (31 janvier 2001) pris pour l’application des articles 17 et 19 de
la loi cadre N° 18-95 formant charte de l’investissement ;
Loi 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellement ;
décret N°2-92-833 pris pour l’application de la loi N°25-90 relative aux lotissements, groupes
d’habitations et morcellements ;
Dahir 1-60-063 du 25 juin 1960 relatif au développement des agglomérations rurales ;
Dahir du 3 Choual 1332 (25 Août 1914) portant réglementation des établissements insalubres,
incommodes ou dangereux (B.O N°7 du Septembre 1914, page 703) ;
Arrêté Viziriel du 13 Octobre 1933 portant classement des établissements insalubres, incommodes ou
dangereux tel que modifié par le décret du 18 Décembre 1959 ;
Dahir portant loi N°1-72-255 du 18 Moharrem 1393 (22 Février 1973) sur l’importation,
l’exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution
des hydrocarbures ;
Dahir portant loi n° 1.72.255 du 22 février 1973 (B.O. n° 3151 du 21 mars 1973) sur l’importation,
l’exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution
des hydrocarbures, modifié et complété par le dahir n°1-95-141 du 4 août 1995 (B.O. n° 4323 du 06
septembre 1995);
Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 1546-07 du 3 août 2007 relatif aux caractéristiques
des grands produits pétroliers.
8 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
II.2-Cadre institutionnel
De nombreux institutions et départements techniques marocains s’occupent directement et/ou
indirectement de la gestion et de la protection de l’environnement.
Le Ministère délégué auprès du ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement,
chargé de l’Environnement, est le principal acteur. Il est responsable de la coordination des activités de
gestion de l’environnement en relation avec les départements ministériels concernés.
En vue d’assurer le suivi permanent de l’état de l’environnement régional et local, le ministère
délégué chargé de l’environnement a également des représentations régionales : les Services extérieurs de
l’environnement et les Observatoires Régionaux de l'Environnement et du Développement Durable
(OREDD) mis en place dans le cadre des conventions conclues avec les partenaires régionaux (Wilaya,
Conseil régional, etc.).
D’autres ministères ont des responsabilités au niveau de la protection et de la conservation de
l’environnement. Ces ministères sont les suivants :
Ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique;
Ministère de l’intérieur ;
Ministère de la santé ;
Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime ;
Ministère du tourisme ;
Ministère de l’Urbanisme et de l'Aménagement du territoire national;
Ministère de l'Habitat et de la Politique de la ville ;
Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique;
Ministère de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire ;
Ministère de l’économie et des finances ;
Ministère délégué auprès du ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement,
chargé de l’eau ;
Ministère de la Justice et des libertés.
Il existe également des organismes ayant un rôle dans la protection de l’environnement :
Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire (CSAT) ;
Le Conseil supérieur de l’eau et du climat (CSEC) ;
Le Conseil national de l’environnement (CNE) ;
Le conseil supérieur de la chasse (CSC) ;
Le conseil supérieur pour la sauvegarde et l’exploitation du patrimoine (CSSEP) ;
Le Comité national des études d’impact (CNEIE) et les Comités régionaux des études d’impact
(CREIE) ;
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) ;
Les Agences de Bassin Hydraulique.
III. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET
L’implantation du projet de création d’une station service et annexes dans la commune rurale d’Ain
Chkef est justifiée pour les raisons suivantes :
Créer l’emploi ;
Combler le manque de stations services dans la commune rurale d’Ain Chkef ;
Répondre aux besoins de la population et des routiers en matière de carburants ;
Mettre à la disposition des automobilistes un espace convivial pour se restaurer et se
reposer ;
Mettre à la disposition des automobilistes des locaux techniques où ils peuvent faire la
vidange et le lavage de leur véhicule avec des contrôles de sécurité.
9 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Promouvoir l’investissement dans le milieu rural.
IV. DESCRIPTION DU PROJET
IV.1- INVESTISSEMENTS
Le montant de l’investissement projeté s’élève à 8.050.000,00 Dhs répartit comme suit :
Tableau 1: Investissement du projet.
DESIGNATION MONTANT EN Dhs
Terrassement de la piste et l’auvent 900.000
Construction de l’espace vidange /lavage et café 1.000.000
Equipement de la station 2.000.000
Travaux électriques, assainissement et traitement des eaux 400.000
Images et siognalisation 400.000
Construction et équipement du restaurant 2.500.000
Equipement de sécurité Incendie 150.000
Informatisation de la station 200.000
Divers et imprévus 500.000
TOTAL 8.050.000
Le financement de ce projet va se faire à partir des fonds propres du promoteur et des crédits bancaires .
IV.2- Constructions projetées
Le projet est constitué de :
Une station service ;
Un espace lavage-vidange ;
Un Café ;
Un Restaurant ;
Une Terrasse couverte ;
Une Mosquée ;
Des Sanitaires et un poste de Gardiennage ;
Espace Vert.
Pour des raisons de financement, le projet va être réalisé en deux phases :
- la première phase sera réalisée au cours de la premières année après l’obtention de l’autorisation ;
- La deuxième phase : sera réalisé à partir de la troisième année après l’obtention de l’autorisation ;
Le tableau suivant montre la répartition des différentes constructions projetées (voir plan de masse et de
construction en annexe) :
Tableau 2: Répartition des constructions projetées.
Constructions projetées superficie Phase de réalisation
Une station service 1750 m² 1
Un Café 190 m² 1
Un espace lavage-vidange 213 m² 1
Un Restaurant 615 m² 2
Une Terrasse couverte 620 m² 2
Une Mosquée 80 m² 1
Des Sanitaires et un poste de Gardiennage 155 m2 1
Espace Vert 746 m2 1
10 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
IV.3- Equipements
La future station-service sera munie des équipements suivants :
4 cuves souterraines de combustibles de capacités différentes :
o 1 Cuve de capacité 30 m³ : pour le produit Gasoil 50 PPM ;
o 2 Cuve de capacité 20 m³ : pour le produit Gasoil 50 PPM ;
o 1 Cuve de capacité 20 m³ : pour le produit Super sans plomb ;
La fréquence du ravitaillement de ces cuves est de trois fois par mois pour le gasoil soit un volume
mensuel de 210 m3, et de trois fois par mois pour le Super sans Plomb soit un volume mensuel de 60m 3.
2 Volucompteurs pour 2 produits (Euro diesel, Super sans plomb) avec deux pistolets pour
distribution de Carburant pour véhicules légers;
1 Volucompteurs pour l’Euro diesel avec un pistolet pour distribution de Carburant pour véhicules
légers;
1 Volucompteurs Grand débit avec deux Pistolets pour distribution de Carburant pour véhicules
légers ;
Une cuve de capacité de 2m3 pour le stockage des huiles usées.
IV.4- Moyens humains
L’effectif nécessaire pour la conduite de ce projet est arrêté à 40 personnes réparties comme suit :
- Effectif de la station-service
01 gérant ;
01 Chef de station ;
02 mécaniciens ;
09 pompistes ;
01 dépanneur.
- Espace de vidange /lavage
05 employés pour lavage ;
04 employés pour équilibrage et vidange.
- Café
01 Caissier ;
02 serveurs ;
02 Préparateur.
- Restaurant
01 Chef de restaurant;
03 serveurs;
01 Boucher ;
02 grilleurs ;
02 préparateurs de « Tajine » ;
02 personnes chargées de l’entretien ;
01 Caissier.
11 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
IV.5- Conception des Stations-service
Une station-service est constituée de trois zones principales, à savoir :
la zone de distribution.
la zone de dépotage.
et la zone de boutique et de caisse.
La zone de distribution : correspond à une zone de roulage où les usagers viennent s’approvisionner en
carburant et est composée de différentes bornes de distribution permettant le service de carburant en
simultané.
La zone de dépotage : quant à elle, permet d’effectuer le remplissage des cuves de carburant par camion
citerne. Dans certains cas, cette zone de dépotage peut se retrouver confondue à la zone de distribution, c’est-
à-dire que le dépotage de camions citerne se fait au même endroit que le remplissage du réservoir de
l’usager.
Ces deux zones sont soumises à une certaine pente et sont équipées de caniveaux récupérant tous les
effluents (eaux de pluie et hydrocarbures en particulier).
Les cuves contenant le carburant sont enterrées et reliées par des canalisations d’une part, aux postes de
dépotage et d’autre part, aux différentes bornes de distribution. Chaque cuve (ou sous-réservoir) possède une
évacuation sous forme d’évents situés à l’air libre et en partie haute. Chaque évent est propre à un seul et
même type de carburant.
Concernant la distribution de carburant, les bornes sont équipées soit de pompes à aspiration situées dans
la borne, soit de pompes à refoulement immergées dans les cuves.
Les bornes avec pompe à refoulement sont obligatoirement munies à leur base de clapets de sécurité qui
sont sensés se fermer en cas d’arrachement de l’appareil de distribution.
Les pompes à aspiration fonctionnent seulement par actionnement du pistolet de distribution.
En cas d’accident, ce système est plus fiable que celui avec pompe à immersion.
Les plates formes de ces deux zones doivent être étanchéifié en mettant en œuvre un corps des plates
formes suivant les indications suivantes :
compactage du fond de forme ;
étalage et compactage d’une couche de GNF de 20cm ;
mise en œuvre d’un fil polyène ;
réalisation d’un dallage reflué en béton hydrofuge légèrement armé.
12 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
IV.6- Caractéristiques de la future station-service
Citernes
Les citernes seront à doubles parois dotées de système de détection des fuites. Elles se composent d’un
réservoir intérieur sur lequel se fixe se fixe une enveloppe partielle extérieure. Un espace libre est laissé entre
les différents réservoirs permettant le remplissage d’un fluide utilisé pour le contrôle d’étanchéité et la
détection permanente de fuite pouvant survenir de l’intérieur ou de l’extérieur du réservoir. Les citernes
auront un système de plombage et seront enterrées selon le schéma de principe donné dans la figure ci-
dessous :
Figure 1: Description d’une citerne à carburant.
Figure 2: Schéma d’installation des citernes.
Tuyauterie
La tuyauterie carburant qui sera utilisée au projet sera de la tuyauterie en polyéthylène pour éviter les
problèmes de corrosion et de fuites. Les tuyaux seront équipés de clapets anti-retour et stop écoulement en
cas d’accident. Ils ont un revêtement qui empêche le carburant de pénétrer à travers les parois du tuyau. Ce
revêtement est chimiquement lié au tuyau sans collage et sans risque de pelage. Ils sont munis d’une couche
conductrice qui dissipe l’électricité statique. Les risques de décharges électrostatiques sont éliminés lors de la
circulation du carburant.
Local pour vidange des véhicules
Le local pour vidange des véhicules sera équipé d’un système pour la récupération directe des huiles
usées vers une citerne dédiée à cet effet, elle sera vidangée régulièrement. Ce local sera muni d’une fosse de
récupération des eaux usées d’entretien branchée directement vers le séparateur d’hydrocarbure.
13 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Locaux de mécaniques, d’entretien et lavage des véhicules
Ces locaux seront munis de fossés ou caniveaux pour la récupération des eaux de lavage et
d’entretien et leurs évacuations vers le séparateur d’hydrocarbure.
Dépôts
Les dépôts seront munis d’une plateforme étanche aux infiltrations.
Aire service
L’aire de service sera construite en dalle de béton dimensionnée pour supporter la circulation sans se
fissurer et s’affaisser. Cette dalle sera posée sur une couche en grave drainante et géo-membrane. La couche
drainante doit être munie de drains pour récupérer les eaux d’infiltration et les évacuer vers le réseau
d’assainissement de la station de service.
Type de distributeurs
Il s’agit de distributeurs électroniques sophistiqués et capables d’être compensés en pression et en
températures, ce qui permet de délivrer une quantité très précise de carburant quelque soit le fonctionnement
ou les conditions climatiques.
Ils ont également l’avantage d’être verrouillés jusqu’à ce qu’ils soient débloqués par une carte
d’accès ou un quelconque dispositif d’autorisation.
Dispositif du point de vente
Le dispositif de remplissage et les heures de fonctionnement du site sont établis avec prudence entre
la taille du compresseur et celle du stockage. Le compresseur fonctionne entre 12 et 20 heures par jour, pour
maximiser la quantité de gaz comprimé et donc améliorer la rentabilité, mais également pour permettre un
entretien et une maintenance indispensables sur le compresseur à l’arrêt.
La méthode de remplissage rapide
Le remplissage rapide consiste à ravitailler un véhicule à partir d’un volume de carburant stocké qui
a été rempli par le compresseur au préalable. La vitesse de remplissage est comparable à un remplissage
d’essence ou de diesel qu’on effectue habituellement dans les stations service publiques. C’est la seule
méthode possible pour ravitailler les véhicules publics ou lorsque le paiement est effectué immédiatement,
car la quantité de carburant fournie doit être connue.
Dispositif de stockage
Les citernes de stockage sont au nombre de 4. Ce besoin en termes de stockage a été évalué en
fonction de carburant nécessaire ainsi que l’appoint de compression disponible dans le compresseur.
Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité de rigidité, de stabilité et
d’étanchéité. Ils doivent être à double paroi comme ils doivent résister à la pression statique du liquide, aux
surpressions et sous pressions résultant de l’exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi les
parois d’un réservoir doivent résister aux actions d’ordre mécanique, thermique et chimique, être
imperméables et résistants aux liquides inflammables, aux gaz ainsi qu’au vieillissement.
Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauterie et accessoires
contre la corrosion interne ou externe.
14 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Les réservoirs doivent être muni de dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le
volume du liquide y contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des
opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le
remplissage du réservoir. Pour les réservoirs d’essence, le jaugeage doit se faire par des moyens
électroniques.
Les réservoirs doivent être munis d’un limiteur de remplissage, le limiteur de remplissage doit
interrompre automatiquement l’opération de dépotage avant que le niveau maximal d’utilisation ne soit
atteint.
Tous les réservoirs doivent être munis d’un ou plusieurs évents qui soient à disposer de façon à ce
que tout débordement de liquides puisse être recueilli.
Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les
garanties désirables d’étanchéité. Elles doivent être à doubles paroi, concentriques et continues, comme elles
doivent être équipées d’un dispositif de détection de fuite approprié.
Les installations et équipement des systèmes de distribution et de récupération d’hydrocarbures et de
produits chimiques liquides doivent être aménagés de sorte à ce qu’aucun de ces produits ne puisse s’écouler
dans le sous sol.
Air comprimé
L’usage de l’air comprimé devient de plus en plus fréquent en stations-service. En effet,
plusieurs activités requièrent son utilisation, telles :
Le nettoyage de structures pneumatiques ;
Le décolmatage de filtres ;
Le nettoyage de certaines machines et équipement comportant des recoins et des
cavités (ceux-ci rendent le nettoyage difficile) ;
Etc.
L’alimentation en air comprimé de la station service objet de cette étude, est assurée grâce à
des compresseurs fournis par la société distributrice du carburant « Vivo Energy Maroc, SA. » (Voir
protocole d’accord en annexes).
Mesures de sécurité
Une attention particulière a été portée lors de la définition de ces équipements à savoir l’alimentation
de cette station par de nombreux dispositifs de sécurité à savoir :
- Des valves solénoïdes d’admission.
- Des valves d’admission anti-retour.
- Convertisseur de pulsation d’entrée.
- Des pressostats de haute et faible pression.
- Un filtre d’entrée de gaz.
- Des valves solénoïdes auto purgeantes.
- Conduites d’aspiration des conduites de purge.
- Un filtre à huile étanche au gaz
15 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
- Un manifold de colonnes de ventilation.
- Un clapet anti retour sur le compresseur.
- Un pressostat au niveau de la commande du démarreur.
- Un robinet d’incendie armé (RIA).
- Des extincteurs.
- Des bacs à sable anti incendie.
L’important est de garantir un bon service par le maintien d’un entretien périodique conforme et
spécifié.
Ces entretiens devront respecter les spécifications du carnet de contrôle ou de la garantie du
constructeur.
IV.7- Assainissement liquide
L’assainissement liquide du projet sera de type assainissement autonome et sera scindé en trois phases:
1- Collecte : l’ensemble des eaux usées, des eaux pluviales de la zone de dépotage et de la zone de
distribution sera collecté par des conduites en PVC série 1, type assainissement, de diamètre variant
entre 200 et 315mm et dirigé avec une pente vers le prétraitement. Quant aux eaux pluviales des
autres parties de ce projet, elles seront drainées par la voirie.
2- prétraitement : il sera effectué à l’aide d’un dégrilleur manuel, un déshuileur et un séparateur des
hydrocarbures installés en série à l’amont de chaque fosse septique afin d’éviter l’entraînement des
hydrocarbures et des matières solides dans le système de traitement.
Lorsque les effluents arrivent jusqu’au décanteur/séparateur, les hydrocarbures et les matières en
suspension sont séparées des eaux collectées, celles-ci repartant dans le réseau prévu à cet effet. Les
hydrocarbures et autres matières sont conservés dans un réservoir qui doit être vidangé
régulièrement. Si celui-ci venait à être plein, un obturateur d’afflux s’actionnerait automatiquement
bloquant tous les effluents. Ceux-ci se déverseraient alors dans la cuvette de rétention si elle existe
ou resteraient dans les tuyauteries et en surface au niveau de la zone de distribution et de dépotage si
l’afflux est trop important.
3- traitement- évacuation : cette phase sera assurée par le réseau d’assainissement de la RADEEF
(Voir devis RADEEF des travaux d’assainissement en annexes).
Les eaux traitées répondront aux normes de rejets directs, à savoir :
DCO : 250 mg /l ;
DBO5 : 120 mg/L ;
MES : 50 mg/l.
Les rejets liquides de la boucherie seront également traités via le réseau d’assainissement collectif de
la RADEEF.
Quant aux autres déchets liquides issus des différentes activités de la station-service (hydrocarbures,
huiles usées, matières chimiques, boues issue du système du traitement), ils seront récupérés par le
promoteur de distribution.
16 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
IV.8- Alimentation en eau potable
Le promoteur a déposé, auprès du service de l’eau potable de Fès, une demande d’autorisation de
creusement d’un puits qu’il pourra exploiter pour l’arrosage des espaces verts et le lavage des véhicules (Voir
demande d’autorisation du puits en annexes).
La RADEEF assurera l’alimentation en eau potable pour d’autres utilisations éventuelles (Voir les
devis RADEEF des travaux eau et électricité en annexes).
Les besoins en eau sont estimés sur la base d’une dotation de l’ordre de 50l /personne/jr pour les
employés, 20 l/personne/ jr pour les clients, 50 l /jr pour le lavage des voitures.
Donc la consommation journalière globale est de l’ordre de 5.2 m3/j.
IV.9- Assainissement solide
La quantité des déchets solides qui sera produite est de l’ordre de 64 Kg/jr à base d’un ratio de
1Kg/jr pour les employés et de 0.25Kg/jr pour les visiteurs de la station-service.
En effet, ces déchets domestiques seront stockés dans des containers et seront évacués à chaque fois
qu’il est nécessaire vers la décharge publique la plus proche ou vers un lieu approprié et autorisé par la
commune.
Les déchets inertes constitués par les stériles et le sol du décapage seront stockés au niveau des sites
adéquats pour être utilisés progressivement lors de la remise en état des lieux.
Les rejets solides de la boucherie seront collectés dans des bennes étanches et convoyés avec les
déchets domestiques vers la décharge publique la plus proche ou vers un lieu approprié et autorisé par la
commune. Il s’agit des déchets issus des opérations de découpe, de désossage et de parage des viandes
(pieds, têtes, os, déchets de viandes), et qui ne sont pas considérés comme des déchets dangereux.
IV.10- Energie électrique
L’électricité du projet proviendra du réseau de la RADEEF.
V. DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE
V.1- Localisation du site du projet
Le projet est situé à la commune rurale d’Ain Chkef, sur la route de Ras El Ma, Province My
Yaacoub, région Fès-Boulemane (Voir carte de situation du site en annexe).
Le site d’implantation du futur projet, dont le titre foncier N°119183/07, est une propriété privée
d’une superficie de 00Ha41A56Ca, dite « Melk 22 ». Ce site fait l’objet d’un contrat de bail désignant le
promoteur TAIF Mohammed en tant que locataire (voir contrat de Bail en annexes).
Ses coordonnées Lambert moyennes sont comme suit :
X = 527687 Y = 375573
V.2- La zone de l’étude
La délimitation du périmètre de l’étude est établie tenant compte des composantes
environnementales suivantes :
les ressources en eau de surface et souterraines ;
17 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
les éspèces faunistiques et floristiques ;
les activités économiques ;
les infrastructures et les équipements de base;
les aggolomérations les plus proches ;
La zone de ce projet d’ouverture d’une station services et annexes et annexes, ne peut être
circonscrite qu’aux alentours du site du projet.
Cette délimitation a été faite de façon à couvrir la zone susceptible d’être affecter directement ou
indirectement par la création de ce projet, de ce fait, nous avons considéré un domaine qui s’étend sur un
rayon de 500 m de chaque coté de l’emprise du projet . ce pendant pour l’analyse et la recherche
bibliographique, nous avons étudié un territoire bien plus grand, ce qui permet d’obtenir une description plus
globale de la structure du milieu, qui n’est pas toujours bien présentée dans un territoire étroit.(voir la carte
du périmètre de l’étude en annexe).
VI. ANALYSE DESCRIPTIVE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU
VI.1- Situation géographique
Le site objet de cette étude est situé à la commune rurale d’Ain Chkef, Province My Yaacoub, région
Fès-Boulemane.
La commune rurale d’Ain Chkef est d’une superficie de 153 km² est délimitée par :
- la Préfecture de Fès et la commune rurale Sebaa Rouadi du coté Nord ;
- la province de Sefrou du coté Sud ;
- la Préfecture de Fès du coté Est ;
- la préfecture de Meknès du coté Ouest (Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
PROJET
18 BET | DreamFigure 3: Découpage de la province de My Yaacoub.
engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
VI.2- Cadre naturel
Relief
Le site du projet relève de la province de My Yaacoub qui se situe à une altitude de 563,33m du
niveau de la mer, elle se caractérise par un relief accidenté composé de plateaux et collines d’altitudes variant
entre 350m et 500m et de plaines extrêmement riches sur le plan agricole, Ainsi que de montagnes dont le
point culminant atteint environ 910 m (Zalagh et Tghat ).
On distingue deux unités géologiques dans la Province :
La plaine de Sais au Sud et à l’Ouest, renfermant les aquifères du bassin Fès-
Méknès.
Les collines prérifaines dans toute la zone Nord, qui se caractérise par l’absence des
ressources en eau souterraines.
La commune d’AIN CHKEF se situe dans la plaine de Saïs à une altitude variant de 380m au Nord à 600m
au Sud (Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
Tableau 3: Caractéristiques du relief de la commune d’Ain Chkef (Monographie de la commune
rurale d’Aïn Chkef 2008).
Relief Superficie (en ha) Pourcentage %
Plaines et plateaux 14240 98%
Collines 250 02%
Total 14490 100%
Aperçu géologique
La zone d’étude est caractérisée par des dépôts essentiellement calcaires et conglomérats d’âge Plio-
quaternaire alternant, par endroit, avec des dépôts limono-sableux. Ces dépôts plioquaternaires présentent
une grande variation de faciès. Cette variation touche aussi la puissance de ces dépôts, qui peut aller de
quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. Cette variation est due à la présence des anticlinaux et des
synclinaux au sein du bassin lacustre (Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
19 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Figure 5: Coupe N-S interprétative, montrant la variation d’épaisseur de la série plio quaternaire
du bassin de Saïs.
Figure 4: Carte du toit du lias de la plaine de Saïs.
Figure 6: Carte des isopaques de la formation plio-quaternaire du bassin
de Saïs.
20 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Hydrologie
(Voir carte réseau hydrographique ci-dessous)
La plaine de Sais est drainée par l’Oued Fès et les affluents rive droite du Mikkès. Dans la zone de la
ville de Fès, c’est principalement l’Oued Fès et ses affluents qui constituent le réseau hydrographique.
Le bassin versant de l’Oued Fès a une superficie totale de 700 km² dont 375 km² dans le Sais. Il est
limité au Nord par la ligne des crêtes correspondant aux rides prérifaines, au Sud par les falaises du causse
Moyen Atlasique d’Immouzer du Kandar, à l’Ouest par le bassin de l’Oued Nja et à l’Est par le bassin de
Sebou.
On distingue l’Oued Fès Amont, l’Oued Mahréz et l’Oued Boufekrane.
- Oued Fès Amont :
Le bassin de l’Oued Fès Amont a une superficie de 129km². L’Oued prend origine à partir de la
source Ain Ras El Ma et reçoit des émergences et sources qui augmentent son débit.
Les eaux de l’Oued Fès se partagent, à l’entrée de la médina, au niveau du jardin de la marche verte.
Après avoir transité dans le réseau de la médina, elles rejoignent les Oueds Zitoune et Boukhrareb.
- Oued Mahrez :
Il est réputé par ses crues violentes et brusques et constitue le collecteur principal de la nappe
phréatique et fait en plus office de collecteur d’égouts.
Cependant, en dehors des périodes pluvieuses, l’Oued est presque sans écoulement notable.
- Oued Boufekrane :
Au site dit « Bled El Gaada », un barrage colinéaire sur l’Oued Boufekrane est conçu pour renforcer
le débit de l’Oued Boukhrareb en été.
Les ressources en eau superficielles dans le périmètre de l’étude sont représentées par :
Oued Bourkaïz, distant de 1.7km à vol d’oiseau du côté sud de la station.
Chaabas distantes respectivement de 874m et 1.3km à vol d’oiseau des côtés Est et Sud de la station.
Seguias publiques :
Deux seguias sont distantes respectivement de 818m et 973m du côté Sud-ouest de la
station.
Deux seguias mitoyennes à la station des côtés Sud-est et Sud-ouest de la station.
Hydrogéologie
La plaine de Fès est caractérisée par l’existence de deux nappes, l’une superficielle et l’autre
profonde, qui ont placé la région d’étude dans des zones qui ont une potentialité hydrique importante.
L’étude hydrogéologique de La nappe phréatique, qui schématise la fonction conduite du réservoir et
le comportement hydrodynamique de l’aquifère, montre un écoulement général de SE vers le NW.
L’alimentation de cette nappe s’effectue par les zones de recharge d’affinité moyenne atlasique.
Le comportement de cette nappe est influencé par la variation climatique à l’échelle d’une année
(2003):
- Au janvier, la configuration piézométrique, montre une nappe divergente avec un écoulement de SE vers
NW. Les courbes isopièzes sont espacées, marquant un gradient hydraulique très faible dans la partie aval de
la nappe.
21 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Par contre, pour le mois de juin, les courbes isopièzes dans cette zone, caractérisent une nappe
convergente, où à l’Ouest les lignes d’écoulement montrent un écoulement vers l’Est.
- La distribution des courbes d’égale profondeur montre que la profondeur varie entre 54m à 5m. Dans la
partie méridionale de bassin lacustre, où le niveau statique de la nappe atteint une valeur maximale de l’ordre
de 52m en janvier et 54m dans le mois de juin. A la bordure Nord de la nappe, où le domaine urbain de la
ville nouvelle de Fès, on a une chute du niveau de l’eau qui devient égale à 5m à 14m au mois de janvier et
6m à 24m au mois de juin.
22 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Légende :
Figure 7: Cartes du niveau statique de la nappe phréatique de la plaine de Fès pour l’année 2003. A
: mois de janvier, B : mois de juin.
Figure 8: Coupe N-S montrant le toit du réservoir liasique du bassin de saïs.
23 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UNE STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée)
2014
Figure 9: Extrait de la carte des nappes du bassin du Sebou.
24 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UNE STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée)
2014
Climatologie
VI.2.2.1 Climat
Le climat de la région est de type continental, le régime de pluie est marqué par deux saisons tranchées,
l’une humide et l’autre sèche (Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
VI.2.2.2 Pluviométrie
Pour l’ensemble des bassins de Saïs .les régimes des pluies sont les mêmes. En effet, de fortes pluies sont
observées en automne et au printemps, mais en Hiver la pluie devient faible pour être presque nulle en Eté
(Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
Tableau 4: Tableau 1: Cumul mensuel des précipitations annuelles enregistrées au niveau des stations
de Fès entre 2000 et 2009 (en millimètre) (Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
févrie juille
année janvier r mars avril mai juin t août septem octob novemb décemb
2000 18.8 0 0.1 69.9 42.1 0.6 0 1.5 2.7 106.9 63.2 88.1
2001 81.7 21.4 18.1 4 23.3 0 0 5.4 10.1 1.2 9.1 125
2002 6.8 3.9 44.1 128 17.4 0.3 0 0.7 0 76.1 140.8 45
2003 84.3 53.3 72 49.1 18.7 11.5 4 5.4 0 125.1 103.6 124.5
2004 32.8 31.9 36.2 71.1 41.2 0.2 2.1 0 0.5 113.2 40 58.6
2005 5.2 48.7 23.4 2.2 1.7 5.2 0 0 1.9 61.4 119.5 44.3
2006 112.2 104.3 65.2 47.4 48.3 18.9 0 0 5.8 21.5 40.7 71.2
2007 29 27.6 39.4 178.4 11.1 0.1 0.1 0.1 19.2 56.4 46.6 14.2
2008 78.5 81.9 20 40 32.8 0 0.1 1.7 111.2 123.8 123 167.8
2009 136.1 118.8 78.8 14.1 9.1 21.1 0 0 79.1 5.6 41.4 114.2
VI.2.2.3 Température
L’écart entre les valeurs extrêmes de température est très important. En effet pendant l’hiver, la
température est douce alors qu’en été on assiste à des températures très élevées pouvant atteindre 40°C à
l’ombre.
Les moyennes les plus élevées sont enregistrées pendant les mois de Juillet et Aout (Monographie de la
commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
Tableau 5: Données mensuelles des températures moyennes enregistrées au niveau des stations de Fès
entre 2000 et 2009 (en degrés °C) (Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
févrie juille
année janvier r mars avril mai juin t août septem octob novemb décemb
2000 8.35 12.4 14.4 13.95 18.65 24.5 26.45 27.25 23.45 16.55 13.2 11.8
2001 10.1 10.1 14.6 14.75 18.05 24.5 24.6 25.85 21.8 21.3 13.1 12.4
2002 11.55 12.6 13.85 15 18.45 22.85 25.8 24.05 22.6 20.05 14.75 12.7
2003 9.85 10.1 14.75 15.2 20.25 25.2 27.1 27.8 23.7 18.95 13.85 11.25
2004 10.95 11.95 12.65 14.95 16.4 24.95 27.6 27.2 24.3 20.55 14.05 10
2005 8.2 8.45 14.25 15.7 21 25.8 26.35 27.65 23 20.45 13.5 10.2
2006 8.4 9.8 13.3 16.1 20.6 23.1 27.85 26.7 23.85 21.4 16.25 10.15
2007 10.25 12.5 12.3 14.1 17.85 21.85 26.85 26.45 22.7 19.5 14.6 10.95
2008 10.9 12.15 13.15 16.65 17.5 24 26.45 26.45 22.55 17.25 11.15 9.6
2009 9.05 10.8 13.9 13.5 19.55 24.25 27.45 26.95 21.75 21.4 16.65 13.1
25 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
VI.2.2.4 Régime des vents
La région de Fès présente le même régime des vents commun à la partie septentrionale Nord-
Atlasique : le Gharbi ou vent d’Ouest apporte la pluie et caractérise la saison humide alors que le chergui ou
vent d’Est souffle parfois en été.les vents qui prédominent pendant l’été sont ceux du NW (Monographie de
la commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
VI.3- Eléments biologiques (faune et flore)
La description de ce milieu a pour objectif d’identifier les éléments environnementaux en lien avec la
faune et la flore se trouvant dans le périmètre de l’étude.
La flore
Etant une zone agricole où le sol est labouré au moins une fois par an, la zone de l’étude n’est plus
un lieu où différentes herbes poussent. Seuls des arbustes sont observés avec une densité très faible, et les
cultures semées ou plantées couvrent le sol.
Par ailleurs, aucune autre espèce végétale en voie de disparition ou protégée n’est signalée dans la
zone de l’étude (Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
La faune
La zone de l’étude se présente comme une zone agricole où la faune est réduite aux insectes
prépondérants dans la région, mais aucune présence d’espèce protégée n’a été signalée dans la zone de
l’étude (Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
VI.4- Eléments humains
Démographie
Selon le recensement de la population humaine du Maroc en 2004, la commune d’Ain Chkef compte
36368 habitants avec un taux d’accroissement de 6.4 %.
Les habitations les plus proches du projet sont distant de :
- 277m à vol d’oiseau du coté Nord du projet ;
- 107m et 177m à vol d’oiseau du coté Nord-Ouest du projet ;
- 254m à vol d’oiseau du coté Sud-ouest du projet ;
VI.4.1.1 Les secteurs économiques
a- Agriculture
La superficie agricole utile est de 11.783 Ha, répartie comme suit :
Tableau 6: Répartition de la superficie agricole utile au niveau de la commune d’Ain Chkef
(Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
Espèces Superficie en ha
Terres cultivées en BOUR 10037
Parcours inculte 2643
Terres irriguées 1746
Forets 64
L’activité agricole constitue l’activité économique principale de la commune.
26 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
L’activité agricole est diversifiée : cultures céréalières, cultures légumineuses, cultures maraîchères,
arboriculture, élevage.
Les cultures céréalières occupent la première place dans la structure de la production agricole suivie de
l’arboriculture. Elles constituent les secteurs traditionnels dans l’activité agricole de la commune et qui sont
pratiquées souvent en ensemble par la plupart des agriculteurs (Monographie de la commune rurale d’Aïn
Chkef 2008).
La structure de l’exploitation agricole est récapitulée dans le tableau suivant :
Tableau 7: Structure de l’exploitation agricole au niveau de la commune d’Ain Chkef (Monographie
de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
Espèces Superficie en ha %
Céréales 8700 62
Légumineuses 225 02
Fourrages 1300 09
Cultures industrielles - -
Maraîchage 1200 09
Câprier - -
Arboriculture 2077 15
Jachère 350 03
Total 13852() 100%
b- Elevage
Concernant l’élevage, l’effectif du cheptel de la commune se présente comme suit :
Tableau 8: Répartition du cheptel de la commune rurale d’Ain Chkef (Monographie de la commune
rurale d’Aïn Chkef 2008).
Espèces Nombre de têtes
Bovins 5635
Ovins 22615
Caprins 174
Equidés 120
Volailles
-Poulet de chair 117000
-Pondeuse 24000
c- Industrie
L’industrie est l’une des principales activités de la commune d’Ain Chkef, en effet la commune
englobe un nombre considérable d’unité industrielle à savoir :
Tableau 9: les différentes unités industrielles de la commune d’Ain Chkef (Monographie de la
commune rurale d’Aïn Chkef 2008).
Dénomination Effectif
Localisation Nature de l’activité
Ou raison sociale employés
27 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Holcim Ras El Ma Cimenterie 133
Cosuni Ras El Ma Produits d’esthétique 50
Commercialisation des céréales
Société Légumineuse Atlas Bled Marrakech 40
et légumineuses
CIOCAP Ouled Khlifa Conserverie 10
Sté de Fabrication des Caisses
Ouled khlifa Caisses en plastique 07
en Plastique
Ste de production de Ferme Mellouki Ras Fabrication des produits
03
désinfectants polyvalents El Ma d’hygiène
Ste de Production du Coton Ras El Ma Production du coton 07
Œufs de Fès Ras El Ma Production des œufs 50
ARBONOR Ras El Ma Jraidia Entrepôt frigorifique 15
Ste de Fabrication des Pistons
Route Oued Fès Fabrication de Pistons 10
pour Motocycles
Fonderie fassie Ras El Ma Gare Fonderie 10
VI.4.1.2 Infrastructures de base
a- L’eau potable
Les besoins en eau des douars sont assurés, essentiellement à partir d’adduction RADEEF qui assure
la desserte de 22 Douars dont :
20 sont desservis via 28 bornes fontaines.
2 sont desservis par le réseau de la RADEEF avec un taux de branchement de 72%.
le centre zlelig est desservi par le réseau de l’ONEP (Monographie de la commune rurale
d’Aïn Chkef 2008).
b- Réseau électrique
Les besoins en électricité sont assurés par le réseau de la RADEEF, desservant 32 douars soit 3854
foyers desservis, avec un taux d’électrification de 95% (Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef
2008).
c- Réseau routier
Le réseau routier de la commune de Ain Chkef se compose de :
Tableau 10: Réseau routier de la commune d'Aïn Chkef.
Route Nombre Longueur en km
28 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Autoroute 01 14
Route régionale 01 12
Routes provinciales 04 39
Pistes 13 49.2
VI.4.1.3 Equipement administratifs et socio-économique
La commune d’Ain Chkef est dotée de plusieurs établissements à caractère social et administratif
dont on cite :
7 écoles primaires ;
1 collège ;
3 terrains de sport ;
1 foyer féminin ;
37 mosquées ;
1 centre de santé (Monographie de la commune rurale d’Aïn Chkef 2008) .
29 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
VII. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Ce chapitre porte sur l’identification et l’évaluation des impacts environnementaux du projet de
construction d’une station services et annexes et ses unités annexes de la commune d’Ain Chkef au cours
des différentes phases.
VII.1- Méthodes d’évaluation des impacts
(Voir annexes).
VII.2- Evaluation des Impacts
Cette section porte sur l’évaluation des impacts anticipés du projet sur le milieu humain et naturel et
ses éléments.
Les éléments touchés inventoriés et les impacts anticipés sont représentés sur une matrice
d’évaluation des impacts.
L'identification des impacts sera abordée distinctement pour les différentes phases du projet.
Phases susceptibles de produire des impacts sur l’environnement
Le projet d’implantation d’une station services et ses annexes à la commune rurale d’Ain Chkef est
susceptible de produire des impacts ou des altérations sur l’environnement en deux phases, à savoir :
Phase 1 : cette phase est dédiée à la construction des bâtiments de la station ainsi qu’à
l’aménagement des différentes unités annexes, à savoir : le café, l’espace de lavage-vidange, la salle de
prières, restaurant, etc.
Phase 2 : c’est la phase d’exploitation de la station services et annexes.
Impacts positifs
VII.2.2.1 Création des postes d’emploi
Ce projet est générateur d’emplois temporaires pendant la période des travaux et de mise en place
des équipements nécessaires à l’exploitation de la station services et ses annexes, ainsi que des postes
permanents, direct et indirects, pendant le fonctionnement du projet ce qui aura des retombées directes sur le
marché de l’emploi local et régional.
De plus, il y’aura un effet positif indirect sur l’économie locale induit par l’augmentation du pouvoir
d’achat des nouveaux employés sans omettre la participation du projet dans la limitation de l’exode rurale.
La sensibilité de l’impact est forte car il concerne la population, son intensité est forte vu
l’amélioration des conditions de vie des familles concernées. La durée de l’impact est moyenne pour les
postes temporaires et longues pour les postes permanents. L’importance globale de l’impact est majeure.
VII.2.2.2 Développement économique et socio-économique
L’exploitation de la station services et annexes permettra à la commune rurale concernée de
bénéficier d’une redevance annuelle fixée. Les contributions du projet permettront d’améliorer, d’une
manière significative, les recettes de cette commune et par conséquent aider à financer des projets de
développement socio-économique au profit des populations locales. Ce projet permettra également
l’intégration des petites et moyennes entreprises dans le milieu rural induisant ainsi la dynamisation de la
30 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
région par la création de l’emploi et l’émergence d’un pole de développement rural et un rouage
économique;
Impacts négatifs
Les travaux du projet sont généralement transitoires et limités dans le temps et dans l’espace, mais
les nuisances susceptibles d’être engendrés ne sont pas toujours provisoires et leurs effets peuvent persister
après la fin du chantier. Alors les impacts ne devront pas être négligés et peuvent être importants dans
certains cas.
A cet effet, une analyse de ces impacts a été effectuée distinctement pour toutes les composantes
environnementales et pendant toutes les étapes de réalisation du projet.
VII.2.3.1 Impacts en phase d’aménagement et de mise en place des
équipements et infrastructures
La réalisation du projet d’implantation d’une station services et annexes passe par les travaux de
construction, d’aménagement du site et de la mise en place des équipements. Ce qui nécessite le passage par
plusieurs étapes qui seront incontestablement des sources de nuisances susceptibles de porter atteinte à
l’environnement. Les impacts susceptibles d’être générés lors de cette phase sont variables en termes
d'importance.
Les principales étapes de cette phase sont distinguées comme suit :
Installation du chantier : cette étape consiste à la mise en place du bâtiment de chantier et son
approvisionnement par tous les matériels et outillages nécessaires
préparation du site : déboisement, viabilisation et divers travaux d’aménagement, de terrassement
et d’excavation (déblais- remblais).
travaux de génie civil et autres aménagements : à savoir, la construction des différents locaux et
composantes du projet et sa clôture.
Ces travaux pourront avoir des impacts négatifs pour le milieu naturel ainsi que pour la population.
a- Impacts sur la qualité de l’air
Les travaux de préparation du site et de construction sont à l’origine des nuisances atmosphériques
suivantes :
Émission des gaz d’échappement par les véhicules de transport des matériaux de
construction et par les engins du chantier;
Émissions des poussières dues à la manipulation du sol et des matériaux de
construction et aux mouvements in situ et sur les pistes amenant au site, des véhicules de
transport du personnel et des matériaux de construction.
Emission des produits chimiques volatils contenus dans les solvants, colles……..
31 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Vu la localité de la zone d’impact des émissions atmosphériques, l’aspect temporaire des travaux et
le caractère rural du site du projet, l’importance des impacts négatifs des travaux de construction sur la
qualité de l’air ambiant est considérée comme étant faible.
b- Impacts liés au bruit
L’ouverture d’un chantier implique inévitablement du bruit qui provient essentiellement du
fonctionnement des engins et des travaux de terrassement.
Les personnes touchées :
-les travailleurs
-les habitants du voisinage,
-les animaux domestiques
-l’environnement en général.
En tenant compte de la période limitée des travaux, le caractère rural du site, l’éloignement
relatif des habitations et l’étendue locale de l’impact, son importance est : faible
c- Impact sur les ressources en eau superficielles
Les eaux superficielles dans le périmètre de l’étude sont représentées par Oued Bourkaïz distant
d’environ 1.7Km à vol d’oiseau du site du projet.
Les travaux de réalisation du projet nécessitent la présence et la circulation des engins dans le
chantier ce qui implique le déversement des hydrocarbures (fuel, huiles).
Les travaux de construction nécessitent également l’utilisation des produits chimiques tels que les
peintures, solvant, vernis, bitume…
La présence et la manipulation de ces équipements et produits in situ risque d’affecter la qualité des
eaux superficielles.
L’impact est jugé faible par la combinaison des facteurs suivant :
-La sensibilité de l’Oued Bourkaïz est moyenne ;
-L’intensité de l’impact est moyenne ;
-L’étendue est locale pour une durée moyenne (celle des travaux).
d- Impact sur la circulation routière
Les travaux de réalisation de ce projet entraîneront une augmentation de la circulation, au niveau de
la route provinciale N°5013 jouxtant le projet, liée au transport des matériaux de construction, des déchets et
des déblais vers la décharge ainsi que les déplacements des ouvriers.
En tenant compte de la période limitée des travaux, l’étendue locale de l’impact, son intensité
qui est jugée moyenne, son importance est donc : moyenne
e- Impact sur le sol
Les travaux de réalisation de ce projet risquent de contaminer le sol par les hydrocarbures déversés
pendant la circulation des engins ainsi que par les différents types des déchets du chantier.
32 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
L’intensité de l’impact est jugée moyenne vu la superficie du projet, l’étendue est ponctuelle pour
une durée courte qui est celle des travaux.
Par la combinaison de ces différents indicateurs, l’importance de l’impact est faible.
f- Impact sur le paysage
Les travaux de réalisation de ce projet d’une station services et annexes auront un impact négatif
sur le paysage se manifestant dans la modification de l’occupation du sol et du champ visuel par la présence
des bâtiments du chantier, des équipements, des déblais….
L’importance de l’impact est jugée faible par la combinaison des indicateurs suivant :
- la sensibilité du paysage est faible car il s’agit d’un terrain agricole entouré des
champs de culture des céréales et d’oliviers ;
- l’intensité est faible vu la courte durée des travaux ;
- l’étendue de l’impact est ponctuelle.
VII.2.3.2 Impact en phase d’exploitation du projet
Certaines activités se déroulant dans le cadre de l’exploitation de la station services peuvent être à
l’origine d’impacts environnementaux, tels la dégradation de la qualité de l’eau (p.ex. par le déversement
d’hydrocarbures), de l’atmosphère (p.ex. par des émanations de composés organiques volatils) ou peuvent
contribuer à la dégradation de la qualité de vie de l’entourage par l’émission d'odeurs (odeurs
d'hydrocarbures, de produits de lavage) et des émissions de bruit (bruits des clients arrivant et partant, bruits
des compresseurs, etc.).
Dans la suite de ce chapitre, ces impacts sont brièvement décrits quant à leur origine (sources de
polluants) et leurs effets sur les différents compartiments environnementaux (eau, sol, …).
a- Impact sur les ressources en eau superficielles
Lors du fonctionnement normal des stations-service, l’eau est souvent utilisée comme moyen
d’évacuation de divers polluants qui proviennent d’une part des installations sanitaires (toilettes, lavabo,
etc…) et d’autre part de l’utilisation de l’eau pour des activités de nettoyage, notamment dans l’installation
de lavage pour voitures.
Le premier type d’eaux usées génère des eaux usées de type eaux sanitaires ou domestiques qui
contiennent des matières fécales, ainsi que toutes sortes de matières contenues dans l’eau utilisée pour
l’hygiène corporelle et le nettoyage.
Le deuxième type d’eaux usées est les eaux résultant du lavage de voitures ou du nettoyage de
l’atelier et des surfaces de circulation, ainsi que les eaux de pluie lessivant des surfaces susceptibles d’être
polluées (aires de service, parking, distribution de carburants, etc.) ou des détergents.
L’impact majeur sur les eaux superficielles, lors de l’exploitation d’une station service est la
contamination des eaux par d’autres liquides classés comme des substances dangereuses, couramment
utilisés dans la station-service (gasoil, essence, liquides de freins, liquides de refroidissement, acides de
batteries ou solvant) et cela potentiellement en quantités importantes (fuites de réservoirs souterrains).
L’importance de l’impact est moyenne par la combinaison des facteurs suivants :
33 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
- la sensibilité des ressources en eau est moyenne vu l’éloignement relatif du cours d’eau le plus
proche, notamment Oued Bourkaïz ;
- l’intensité de l’impact est moyenne;
- l’étendue est ponctuelle pour une longue durée
b- Impact d’émission de bruit
Les émissions de bruit proviennent de la circulation des véhicules sur les aires de la station, des
claquements des portes et démarrages, des pompes, des compresseurs, outils pneumatiques, aspirateurs, etc.
Outre des effets directement gênants pour le personnel (traumatisme sonore), le bruit peut également
avoir des effets négatifs sur l’environnement et notamment le voisinage. Les effets causés par des émissions
de bruit excessives peuvent causer la perte de la capacité de concentration ou trouble de la vigilance ainsi
qu’une augmentation de la fatigue. Ces effets dépendent entre autres de l’intensité du bruit et de la durée de
l’exposition.
- La sensibilité des personnes touchées est moyenne vu le caractère rural du site du projet ;
- L’intensité est moyenne ;
- l’étendue de l’impact est ponctuelle vu la superficie du projet et le caractère rural du site.
Donc par la combinaison de ces différents facteurs l’importance de l’impact est moyenne.
c- Impacts sur le paysage
L’impact du projet sur le milieu consistera en un changement dans la physionomie du paysage suite
à l’ouverture de la station services et annexes.
L’importance de l’impact est jugée moyenne par la combinaison des indicateurs suivant :
- la sensibilité du paysage est faible car il s’agit d’un terrain agricole;
- l’intensité est forte vu la longue durée du projet ;
- l’étendue de l’impact est ponctuelle.
d- Impact des déchets
Les principales sources de déchets étant :
les aires de ravitaillement et de circulation (chiffons, huiles usagées, boues des séparateurs,
etc.) ;
l’administration (déchets résultants des activités bureautiques comme papiers) ;
café-restaurant, qui va générer des déchets assimilables aux déchets ménagers (emballages,
déchets alimentaires, huile alimentaires usagées, déchets verts, etc.).
Le projet peut générer des déchets dangereux pouvant nuire à l’environnement :
Les tubes fluorescents et les lampes spéciales, les batteries et les piles, les filtres de
ventilation, les médicaments, etc. ;
Les solvants, les pots de peinture, les pesticides et insecticides, etc.
34 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Une gestion inappropriée peut mener à des impacts très sévères sur l’air, l’eau et le sol. La gravité
des effets des déchets dépend aussi bien de leur nature (dangereux ou non) que de leur type de traitement.
L’importance de l’impact est moyenne par la combinaison des facteurs suivants :
- la sensibilité du milieu est moyenne ;
- l’intensité de l’impact est moyenne ;
- l’étendue est ponctuelle pour une longue durée.
a- Impact sur la circulation routière
Le fonctionnement du projet impliquera l’augmentation des mouvements de véhicules pour le
déplacement du personnel du projet, des clients, ainsi que pour le transport des marchandises pour le projet et
le transport des hydrocarbures ce qui risque de perturber la circulation au niveau de la route provinciale
N°5013.
L’importance de l’impact est jugée faible pour les raisons suivantes :
- La sensibilité du réseau routier est faible ;
- L’intensité de l’impact est moyenne ;
- L’étendue est locale pour une longue durée.
e- Impact sur l’air/atmosphère
Les impacts d’exploitation sur l’air sont essentiellement dus aux activités suivantes :
Stockage et transvasement de gasoil : engendrant l’émission de fortes odeurs ;
Stockage et transvasement d’essence : engendrant l’émission des composés organiques
volatils (COV) notamment le benzène, lors du transvasement de l’essence. Le benzène agit sur
le système nerveux central, entraînant par exemple des états de somnolence et des maux de tête.
Des expositions prolongées peuvent altérer les capacités de mémoire et psychiques. Il présente
une grande toxicité pour les cellules sanguines ainsi que pour les organes producteurs de celles-
ci. La concentration des globules rouges et blancs ainsi que celle des plaquettes diminue en
fonction de la durée d'exposition.
Moteurs en marche (fonctionnement de véhicules) : entraînant l’émission des Gaz
d’échappement contenant majoritairement du monoxyde de carbone, des hydrocarbures
imbrûlés, du dioxyde de carbone, mais également des oxydes d’azote (NOx), et des particules,
selon le type de moteur. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et très toxique pour les
êtres vivants s’il est inhalé. Les hydrocarbures imbrûlés sont potentiellement cancérigènes et
contribuent- en réagissant avec les oxydes d’azote - à la formation d’ozone troposphérique
(smog estival). Le dioxyde de carbone est un des gaz responsables du changement climatique
(effet de serre). Les particules peuvent induire des maladies pulmonaires.
L’importance de l’impact est forte par la combinaison des facteurs suivant :
- la sensibilité de l’environnement dans la région est moyenne ;
- l’intensité est forte car les rejets gazeux dus au projet sont assez importants ;
35 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
- l’étendue de l’impact est locale pour une longue durée ;
f- Impact sur le sol
Dans le domaine de l’exploitation des stations services et annexes, notamment des stations services,
les principales sources de pollution sont liées à des déversements accidentels (égouttages lors du remplissage
des réservoirs et du ravitaillement des voitures, fuites de tuyauterie, fuites des réservoirs, accidents ou
incendies pour l’environnement (carburants, huiles de moteur, liquides de frein, liquides de refroidissement,
acides de batteries, etc.).
Tout site pollué par des substances nuisibles représente une menace potentielle pour les écosystèmes
telluriens, aquatiques et pour la santé humaine ; des pollutions ponctuelles ou diffuses, souvent toxiques pour
les êtres vivants en cas d’inhalation ou d’ingestion, mettent en péril la qualité des sols, du sous-sol.
L’ampleur de ces contaminations est directement liée aux propriétés physico-chimiques des polluants et aux
quantités déversées.
L’importance de l’impact est jugée moyenne par la combinaison des indicateurs suivant :
- la sensibilité du sol est faible ;
- l’intensité est moyenne ;
- l’étendue de l’impact est ponctuelle.
36 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UNE STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée)
2014
Tableau 11: Inventaire du milieu et évaluation des impacts.
Source d'impact
Phase d’aménagement Phase d’exploitation
terrainB- Acquisition de l’emprises/décapage du
L- entretien des véhicules et des équipements
E- Mise en dépôt des déchets de construction
G- remplissage des réservoirs de véhicules
K- gestion des déchets et eaux usées
+ : impact positif
D- construction des bâtiments
I- activités du café -restaurant
C- excavation et terrassement
A- aménagement des voies d’accès
X : Impact négatif mineur
H- dépotage de carburant
J- transport et circulation
M- lavage des voitures
O : Impact négatif moyen
* : Impact négatif fort
Eléments environnementaux
1. Cours d’eau X X O O O O
Eaux
2. Nappe phréatique
Milieu naturel
3. Qualité du Sol X X X X X X X X
Sol
4. Zones d’érosion
5. Ambiance sonore X X X X X
Air
6. Qualité de l’air poussière, gaz X X X X X X X
Faune 7. Faune X
et flore 8. Flore X
Milieu humain
9. Espace urbain
10. Infrastructures et routes X X
Social
11.Sécurité X X X X
12. Qualité de vie X *
Econo 13. Espace agricole et forestier X X X *
mie 14. Activité économique + + + + + + + + +
37 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
15. Marché de l’emploi + + + + + + + + +
Santé 16. Hygiène publique *
Cultur 17. Paysage X X X X
el 18. Tourisme +
38 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UNE STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée)
2014
VIII. MESURE D’ATTENUATION
Ce chapitre décrit les mesures qui seront prises pour supprimer, réduire ou compenser les impacts
environnementaux du projet jugés sévères ou critiques lors de l’évaluation précédente.
Ces mesures tiennent compte des répercussions temporaires des travaux d’aménagement, et des et
d’exploitation.
VIII.1- Mesures relatives à la protection des ressources en eau
Plusieurs mesures s’avèrent impératives pour la protection des ressources en eau à savoir :
Interdire l’entretien et la maintenance des véhicules du chantier in situ, cette opération devra se faire
au niveau d’un local habilité ;
Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures (les eaux de surface
en provenance des aires de service, d’entretien ou de lavage de voiture) doivent être traitées dans une
installation de séparation d’hydrocarbures avant d’être raccordées au système de traitement des eaux
usées du projet ;
Un dispositif d’alarme vérifiant la hauteur d’accumulation de la couche des hydrocarbures doit être
installé sur le séparateur ;
Le lavage des véhicules est interdit sur les aires de service de la station, de distribution d’essence et
de gasoil. Le lavage de véhicules ne peut se faire que sur l’unité spécialement aménagée à cet effet ;
Collecter les huiles de vidange dans des citernes et les revendre aux utilisateurs potentiels ;
Assurer l’étanchéité da la zone de remplissage, l’équiper d’un système de rétention pour les fuites de
liquides et drainer les eaux de pluie par des collecteurs vers le séparateur d’hydrocarbures ;
Assurer l’étanchéité des emplacements d’approvisionnement.
Economiser les produits détergent en respectant les règles de dilution indiquées par le
producteur ;
Favoriser l’utilisation des eaux de pluie récupérées par exp, des toitures pour le rinçage des
toilettes, le nettoyage des surfaces ou encore pour l’arrosage. le système de récupération des eaux est
composé d’un réservoir de collecte, d’une pompe et d’autres équipements facilitant l’utilisation de l’eau
récupérée ;
Installer un séparateur d’hydrocarbures pour séparer l’eau résiduaire et les liquides plus légers que
l’eau (huiles, carburant, solvant) qui flotte à la surface de l’eau.
VIII.2- Mesures relatives à la protection du sol
La protection du sol va être assurée par l’adoption de plusieurs mesures, à savoir :
39 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Les sols de l’aire de l’entretien, de l’aire de service, de l’aire de dépotage et l’aire de lavage doivent
être étanche, ainsi une protection efficace contre l’infiltration d’hydrocarbures dans le sol doit être
garantie à l’aide d’un matériau vérifié et agrée ;
L’exploitant doit contrôler avant chaque remplissage du réservoir, par jaugeage, que ce réservoir est
capable d’admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer ;
L’exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixant ou absorbants appropriés
permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être
stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les
moyens nécessaires à leur mise en œuvre ;
Le remplissage d’un réservoir doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d’hydrocarbures. Par
ailleurs, toutes opérations de transvasement d’hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable ;
Des contrôles périodiques doivent être effectué, comme la vérification de l’étanchéité des cuves et
des dispositifs des aires de dépotage et de distribution de carburants ;
Contrôle du bon fonctionnement de la protection anti-débordement et des systèmes de détection de
fuites disposant d’une alarme auditive, et ce, au niveau des réservoirs souterrains ;
Protection des conduites non visibles contre la corrosion et les équiper d’un système de détection de
fuites.
VIII.3- Mesures relatives à la protection de l’air
Plusieurs mesures de prévention s’avèrent nécessaires pour diminuer les impacts potentiels des
émissions d’une station-service sur l’air, à savoir:
Il faut mettre en place un système de récupération des COV (composés organique volatils)
issues des pistolets de distribution lors du remplissage des véhicules et issues des camions
citernes lors du dépotage dans les cuves de stockage de la station de façon à ce qu’ils soient
aspirés et retournés dans ces camions citerne.
40 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Sans installation de récupération de gaz, les vapeurs Avec une installation de récupération, les vapeurs
d’essence s’échappent par l’évent lors du d’essence sont retournés dans le camion- citerne
remplissage du réservoir de la station par le camion lors du remplissage du réservoir de la station
citerne
Figure 10: Illustrations comparatives entre une installation sans système de récupération des COV
et une installation avec système de récupération des COV Stage I- cas de remplissage des
réservoirs de la station.
41 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Sans installation de récupération de gaz, les vapeurs l’installation de récupération des gaz fonctionne
d’essence s’échappent par un couplage fermé, les pistolets sont équipés
de manchettes élastiques qui permettent un
raccordement pratiquement étanche du pistolet à
l’orifice de remplissage du réservoir du véhicule.
Figure 11: Illustrations comparatives entre une installation sans système de récupération des COV
et une installation avec système de récupération des COV Stage II- cas de remplissage des
réservoirs des véhicules.
Les opérations de chargement doivent être interrompues immédiatement en cas de fuite de
vapeurs ou gaz ;
La manutention des tuyaux flexibles servant au transvasement des essences et des vapeurs
d’essence doit se faire de sorte à éviter toute émission dans l’air de composés organiques
volatils ;
Les tuyaux d’aération doivent être munis de valves de surpression et de sous pression ;
Il faut interdire de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d’un véhicule
immobilisé pendant un temps prolongé, l’exploitant devra apposer devant le bâtiment un
panneau indiquant ou symbolisant l’interdiction de faire marcher le moteur en cas d’arrêt.
VIII.4- Mesures relatives au bruit
D’une façon générale, les installations et leurs annexes seront construites, équipées et exploitées de
façon à ce que le fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations susceptibles de
compromettre la santé et la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc.…) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention
ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
42 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Les travaux d’entretien mécanique et le lavage de voitures doivent se faire à l’intérieur des
bâtiments.
VIII.5- Mesures relatives à la gestion des déchets
Les déchets doivent être stockés dans des récipients spécialement prévus à cet effet. Ces récipients
doivent être adaptés au type de déchets qu’ils contiennent. Ils doivent être placés en un endroit désigné et
aménagé à cet effet. Ainsi, l’établissement doit être équipé de poubelles spécialement destinées à recevoir
des déchets contaminés par des hydrocarbures (chiffons, bidons, etc.). Leur contenu doit être évacué vers une
décharge désignée par la commune.
L’exploitant est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les déchets soient emportés,
entraînés, dilués ou modifiés par des intempéries.
Les déchets dangereux, à savoir : solvants organiques, solvants chlorés (dégraisseurs), solvants
cycliques ou halogénés, acides, fonds de cuve et liquides de nettoyage, huiles usagées, huiles de fritures,
liquides de freins, bombes aérosols, batterie et piles etc., doivent être stockés de façon séparée dans des
récipients spécialement conçus à cet effet et les revendre aux utilisateurs potentiels.
Les ordures ménagères sont à évacuer à la décharge publique la plus proche ou dans un lieu
approprié et autorisé par la commune.
VIII.6- Mesures relatives au risque d’incendie
Il faut mettre en place des prescriptions permettant de limiter la probabilité d’apparition ou
d’extension d’un incendie (détection, report d’alarme, extincteurs, bacs à sable…), comme il faut respecter
les distances d’éloignement des appareils de distribution par rapport au tiers, pour éviter une propagation du
feu hors de l’installation en cas d’incendie.
Les systèmes de prévention et de protection contre l’incendie à mettre en place au niveau de ce projet
sont les suivants :
- arrêt de la distribution par système manuel dit « arrêt coup de poing »,
- robinets d’incendie armés RIA ;
- extincteurs P P 9kg ;
- extincteurs P P sur roues 50kg ;
- bacs à sable.
IX. Gestion des risques d’accidents
IX.1- Scénario d'accidents
Le principal risque de l’exploitation d’une station-service est l’incendie qui peut entraîner des dégâts
matériels importants et même humains. A noter également que ces incendies peuvent être succédés par des
explosions rendant ainsi les dégâts encore plus lourds.
Les accidents peuvent se produire aussi bien sur les zones de dépotage, sur les zones de distribution,
dans les cuves de stockage durant leur maintenance que dans les cabines de caisse des stations.
Dans ces cabines, des remontées de gaz inflammables par les gaines électrique peuvent être à
l’origine de formation d’atmosphères explosibles qui peuvent s’enflammer en raison d’étincelles électriques
(allumage d’un radiateur électrique, …).
43 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Concernant toujours l’explosion de vapeurs d’essence, lors des opérations de maintenance des cuves
de stockage, des accidents peuvent se produire suite à l’imprudence des ouvriers (non vérification des
explosimètres). Cette maintenance consiste en général au dégazage et au nettoyage des cuves ou encore à la
pose de revêtement en fibre de verre.
Sur les zones de dépotage, les accidents peuvent avoir lieu exclusivement lors du remplissage des
cuves par les camions citerne soit par imprudence, soit par défaillance du matériel tel que :
- sur-remplissage,
- accident de camion,
- flexible arraché,
- rupture d’une bride,
- rupture de la vanne de la citerne,
-défaillance de la vanne de sécurité du camion
Lors de ces accidents, des explosions et des incendies peuvent survenir et il en résulte souvent
qu’une très grande quantité de carburant se répand sur le sol et se consume.
Sur les zones de distribution, les accidents peuvent se produire par des actes d’imprudence. Ces actes
d’imprudence peuvent se caractériser par différents évènements tels que:
- Percussion des pompes de distribution par des véhicules,
- Vidange volontaire du réservoir sur le sol,
- Remplissage de jerricanes,
-Remplissage de réservoir (source d’inflammation présumée : cigarette ou téléphone portable)
- Arrachement du flexible à cause du pistolet qui peut rester dans le réservoir.
Il est important de noter que des incidents peuvent se produire lors des phases de remplissage des
réservoirs de véhicules. De tels incidents qui peuvent conduire au plus à des brûlures pour l’usager procédant
au remplissage du réservoir de son véhicule, sont principalement dus à la formation d’une atmosphère
explosible au niveau du bouchon de remplissage et à une inflammation de cette atmosphère par une décharge
d’origine électrostatique (mauvaise continuité électrique entre le pistolet et le tuyau, différence de potentiel
entre le pistolet et le véhicule, …).
IX.2- Plan d'urgence
Le promoteur doit prendre les mesures appropriées pour organiser la préparation aux situations
d'urgence et maintenir un état de préparation satisfaisant afin de pouvoir faire face aux accidents. Des
mesures de préparation doivent être prises pour atténuer les effets des accidents sur l'environnement.
A ces fins, un plan d'urgence doit être établi avant la mise en exploitation de l’établissement.
Ce plan d'urgence doit notamment :
- fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour évaluer les risques,
- indiquer les quantités et propriétés des substances pouvant altérer l'environnement présentes sur le site,
- contenir, à l'intention du personnel travaillant sur le site, des précisions sur la marche à suivre, tant sur le
plan technique qu'en ce qui concerne l'organisation, pour faire face à un accident susceptible d'avoir des
effets sur l'environnement,
- indiquer les attributions et responsabilités organisationnelles sur le site en cas de situation d'urgence.
44 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
IX.3- Mesures relatives à la sécurité du personnel
Le promoteur doit veiller à ce que toutes les personnes participant à l'exploitation de l'établissement
soient formées de façon appropriée afin de prévenir les accidents en situation normale et afin de savoir
intervenir en cas d'un incident ou accident.
Le personnel doit être muni de tous les équipements nécessaires aux conditions de travail ou il
sera affecté.
Le promoteur doit effectuer un suivi médical régulier du personnel de la station. Les employés exposés
peuvent requérir une surveillance médicale renforcés.
Le Pétitionnaire est tenu de disposer en permanence dans l’unité d’une trousse de premiers secours
remplie régulièrement et maintenue en l’état. Cette trousse doit être facilement accessible et prête à
l’emploi à tout moment quand les personnes sont au travail. De même, le Pétitionnaire est tenu de
disposer d’un véhicule destiné à l’évacuation d’urgence du personnel en cas d’accident.
IX.4- Mesures d'information en cas d'incident ou d'accident
En cas d'incident ou d'accident mettant en jeu l'intégrité de l'environnement, le promoteur doit avertir
sans délai la Protection Civile. Il doit avertir dans les meilleurs délais, par des moyens appropriés
(téléfax, etc.) l'Administration de l'Environnement. Elle fournira aux autorités compétentes un rapport
circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier
à ces dernières et celles prises pour éviter qu'elles ne se reproduisent.
En cas de constat d'une pollution du sol, du sous-sol ou d'un cours d'eau, toutes dispositions doivent
immédiatement être prises pour faire cesser le trouble constaté. La Protection Civile doit être appelée sans
délai.
45 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
X. SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Malgré les impacts modérés et les effets négligeables sur l’environnement ainsi que le caractère
propre de l’activité que le promoteur Mohammed Taif envisage d’entreprendre, des opérations de contrôle et
d’évaluation de ces impacts seront effectuées de façon périodique dans la zone d’étude du projet.
Les opérations à mener se rapportent au suivi de l’évolution de certains paramètres à savoir : la
qualité de l’air, la qualité des eaux et la qualité du sol.
Pour l’air, on prévoit de :
Prélever et analyser des échantillons d’air de la zone de distribution et de la zone de dépotage
semestriellement ;
Les paramètres à contrôler sont : le benzène, le monoxyde de carbone, le dioxyde d’azote,
dioxines, dioxyde de soufre ;
Les valeurs imites de ces polluants sont fixés par le décret 2-09-286 du 20 Hijja 1430
(08/12/09) fixant les normes de qualité de l’air et les modalités de surveillance de l’air (voir
tableau des valeurs limites en annexes).
Pour les eaux, on prévoit de :
Prévoir des analyses bactériologiques et physicochimiques pour l’eau du puits qui va être
creusé dans le site ;
Prélever et analyser des échantillons d’eau en sortie des séparateurs d’hydrocarbures
semestriellement ;
Réaliser des analyses semestrielles de la teneur en hydrocarbures totaux, BTEX (benzène,
toluène, Ethyle, et Xylènes), pH, conductibilité électrique, MES, DBO5, DCO, NTK, P total,
coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques fécaux de la nappe phréatique au niveau
du puits qui sera creusé in situ.
Pour les sols, on prévoit de :
Réaliser des analyses chaque six mois de la teneur en hydrocarbures totaux et BTEX (benzène,
toluène, Ethyle, et Xylènes) sur les sols de la zone du projet.
La totalité de ces analyses doivent également être fait avant le démarrage des travaux du projet, et ce,
pour définir l’état initial.
Par ailleurs, le promoteur doit engager un laboratoire agréé pour la réalisation de ces contrôles.
Les rapports relatifs à ces contrôles seront soumis aux autorités compétentes pour en examiner la
teneur et éventuellement procéder à des mesures correctives.
46 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
XI. CONCLUSION
Le projet d’ouverture d’une station services et annexes dans la commune Rurale d’Ain Chkef,
Province de My Yaacoub, est un projet qui participera au développement économique et social de la région
par la création d’importants postes d’emplois et par l’offre d’un service de qualité.
Du point de vue environnemental, les différents impacts éventuels ont été recensés. Les effets de ces
nuisances sur la commodité du milieu et de son voisinage ont été ainsi examinés et des mesures d’atténuation
qui reflètent les pratiques, les procédures et les normes environnementales en vigueur pour les projets de ce
genre ont été définies. Avec le respect des recommandations de cette étude, le projet du promoteur
Mohammed Taif ne peut être que bénéfique pour son environnement.
Avec le respect strict des mesures précitées, nous confirmons que le projet n’aura pas d’impacts
négatifs sur l’environnement local et régional.
47 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
XII. RESUME DE L’EIE
Le projet de construction et d’exploitation d’une station services et annexes à la commune rurale
d’Ain Chkef, province de My Yaacoub est inscrit dans le cadre de la promotion et du développement durable
de la province, et ce par l’amélioration des infrastructures de base moyennant une approche respectueuse de
l’environnement.
Le terrain devront accueillir ce projet est une propriété privée du promoteur TAIF Mohammed, il est
d’une superficie de 00Ha41A56Ca.
Ce projet va nécessiter un investissement s’élevant à 8.050.000,00 Dhs et va permettre la création de
39 poste d’emploi permanent.
Les différentes entités projetées se présentent comme suit :
Une station service
Un Café
Un espace lavage vidange
Un Restaurant
Une Terrasse couverte
Une Mosquée
Les matériaux utilisés seront choisis de sorte à garantir un édifice répondant aux normes en cours et à
en faciliter l’entretien.
Le climat de la zone d’étude est de type continental, la moyenne des précipitations annuelles est de
l’ordre de 618.3 mm alors que La moyenne des températures annuelles est de l’ordre de 16.3°C .
La zone d’étude est caractérisée par des dépôts essentiellement calcaires et conglomérats d’âge Plio-
quaternaire alternant, par endroit, avec des dépôts limono-sableux. Ces dépôts plioquaternaires présentent
une grande variation de faciès.
Il y a lieu de noter que les ressources en eau dans la région de l’étude sont représentées par Oued
Bourkaïz distant d’environ 1.8Km à vol d’oiseau du site du projet.
La zone d’étude est équipée d’infrastructures de fonctionnement telles que le branchement au réseau
d’électricité, l’alimentation en eau potable et les voies de communications.
D’un point de vue socio économique le projet va créer de nouvelles opportunités génératrices de
revenu liées à la création de postes de travail pendant la réalisation des travaux et l’exploitation du station
services et annexes ce qui réduira le taux de chômage de la région.
Les impacts causés par la construction et l’exploitation peuvent être résumé comme suit :
Phase de construction
- bruits émis par les travaux de terrassement et génie civil qui doivent être peu perceptible par les
habitations avoisinantes ;
- déversement accidentels d’hydrocarbures et rejets d’eaux usées qui peuvent contaminer les ressources en
eau superficielles;
- changement de la structure du sol du site du projet et changement de l’occupation du sol.
48 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Phase d’exploitation
- pollution des eaux par les activités de la station services et annexes notamment les eaux domestiques
et les eaux provenant des aires de lavage, de nettoyage et de la zone de dépotage ;
- dégradation de la qualité de l’air par les émissions de gaz d’échappement des véhicules ;
- dégagement de bruits générés par la circulation des voitures au niveau de la station services et
annexes ;
- génération de déchets dangereux : chiffons, bidons, huiles usées nécessitant une bonne gestion ;
- pollution du sol par des éventuelles fuites provenant des tuyauteries et des réservoirs ;
- risque d’incendie et d’accident.
Les mesures d’atténuation proposées par la présente étude sont comme suit :
Phase de construction
- interdiction de l’entretien des véhicules du chantier in situ, les opérations d’entretien se feront au
niveau d’un local habilité ;
- collecte des déchets du chantier au fur et mesure de l’avancement des travaux ;
- Phase d’exploitation :
- étancheification de la zone du projet pour empêcher la contamination du sol ;
- mise en place d’une double paroi rigide sur les réservoirs d’hydrocarbures pour empêcher le
déversement de toute sorte d’hydrocarbures dans la nature ;
- mise en place d’un système d’alarme d’incendie, d’extincteurs et d’une réserve de produits
absorbants (sable ou autre) devant chaque zone stratégiques de la station service ;
- prévoir une formation des employés de la station-service qui porte sur les procédures d’urgence en
cas d’incendie.
Avec le respect strict des mesures précitées, le projet n’aura pas répercussions néfastes sur
l’environnement local et régional.
49 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
Références bibliographiques
(2008) : monographie de la commune rurale d’Ain Chkef ;
(2004) : Annuaire des Statistiques du Maroc, publication du Haut Commissariat au Plan ;
(2004) : Le Maroc en chiffres, publication du Haut Commissariat au Plan ;
(2001) : Recueil des volets juridiques et réglementaires, département de l’environnement ;
(2002) : Etude de scénarios dangereux en stations-service, INRERIS (Institut national de
l’environnement industriel et des risques) ;
(2000) : Evaluation des impacts, guide de l’ONEP ;
(1975) : Manuel d’environnement à l’usage des industries ;
(2009) : Situation hydrologique du bassin de Sebou, année hydrologique 2008-2009.
50 BET | Dream engineering
OUVERTURE D’UN E STATION SERVICE ET ANNEXES (Version modifiée) 2014
ANNEXES
Demande d’autorisation du puits qui sera exploité par le projet ;
Devis RADEEF des travaux d’électricité ;
Devis RADEEF des travaux d’eau ;
Contrat de bail ;
Devis RADEEF des travaux d’assainissement ;
Plan de masse (avec réseau d’assainissement) ;
Plan des contraintes ;
Plan côté ;
Plan de situation du projet sur carte routière ;
Plan d’aménagement et Fiche de renseignement ;
Protocole d’accord ;
Plan cadastral du projet.
51 BET | Dream engineering
Vous aimerez peut-être aussi
- Etude D'impact Sur Une Station de ServiceDocument51 pagesEtude D'impact Sur Une Station de Servicemjid90% (68)
- EIE Station de ServiceDocument77 pagesEIE Station de ServiceFatima Ezzahra100% (1)
- Etude Impact Sur L Environnement Boulangerie de L'europe FranceDocument65 pagesEtude Impact Sur L Environnement Boulangerie de L'europe Franceabjadi100% (4)
- Etude Impact Sur L Environnement Boulangerie de L Europe France PDFDocument65 pagesEtude Impact Sur L Environnement Boulangerie de L Europe France PDFIbtiPas encore d'évaluation
- Station de ServiceDocument50 pagesStation de ServiceFatima EzzahraPas encore d'évaluation
- Station de Service PDFDocument7 pagesStation de Service PDFKhabtane Abdelhamid100% (7)
- Etude Technico-Économique de La Station de Stockage de BitumeDocument20 pagesEtude Technico-Économique de La Station de Stockage de Bitumemostfaoui lakhderPas encore d'évaluation
- Etude D'impactDocument53 pagesEtude D'impactLalla Fatma Tbeur100% (2)
- Cahiers Charges Station de Services PDFDocument73 pagesCahiers Charges Station de Services PDFGaddour TelmoudiPas encore d'évaluation
- Les Standards Du Station de ServiceDocument18 pagesLes Standards Du Station de ServiceMouad KhammaliPas encore d'évaluation
- (Guideline) Manuel HSE - Stations Services - V2.0 - FRDocument60 pages(Guideline) Manuel HSE - Stations Services - V2.0 - FRSONE Boris100% (4)
- 02 Station ServiceDocument36 pages02 Station ServiceMEULAJE86% (7)
- Etude D'impact Environnemental Plate Forme PDFDocument135 pagesEtude D'impact Environnemental Plate Forme PDFSaber Amira100% (1)
- Etude Station EssenceDocument44 pagesEtude Station EssenceAghiles Koriche94% (18)
- Évaluation de La Mise Du PGES Des Travaux de Désenclavement BAO PDFDocument95 pagesÉvaluation de La Mise Du PGES Des Travaux de Désenclavement BAO PDFDavid Laforme100% (5)
- Impact Environnemental Du Dépôt D'hydrocarbures de La SONABHY de BingoDocument31 pagesImpact Environnemental Du Dépôt D'hydrocarbures de La SONABHY de BingoBarthélemy Bawar Dit WarbiPas encore d'évaluation
- RSPD Unite Lavage BougeurraDocument29 pagesRSPD Unite Lavage BougeurraMohamed Lamrani100% (1)
- Rapport Sur Produits Dangereux Meziane SamiaDocument26 pagesRapport Sur Produits Dangereux Meziane SamiaChems Doghmani88% (8)
- Etude D'impact Sur L'environnement de La Station de Service Total ImzourenDocument34 pagesEtude D'impact Sur L'environnement de La Station de Service Total ImzourenSami MrqPas encore d'évaluation
- MEMOIRE 125 BDN - TrOW PDFDocument62 pagesMEMOIRE 125 BDN - TrOW PDFJordan TADONBOUPas encore d'évaluation
- 126 BTOI Autorisation Centrale D Enrobage ST Pierre EDDocument44 pages126 BTOI Autorisation Centrale D Enrobage ST Pierre EDkamalPas encore d'évaluation
- Exposé HSEDocument22 pagesExposé HSEAdim azeddine100% (1)
- BKA - HSE - PGES - ENS - 3001 - A-Plan de Gestion Environnementale Et SocialDocument84 pagesBKA - HSE - PGES - ENS - 3001 - A-Plan de Gestion Environnementale Et Socialtiote moussaPas encore d'évaluation
- Surveillance Et Suivi Environnemental1Document16 pagesSurveillance Et Suivi Environnemental1IssifouHamdaneAdamPas encore d'évaluation
- 3-Superviseur HseDocument5 pages3-Superviseur Hseentreprise.tgctp2015100% (5)
- Etude de Dangers Depot LogistiqueDocument181 pagesEtude de Dangers Depot LogistiqueImed MarroukiPas encore d'évaluation
- 1 - CCC - Code de Conduite Eshs - V001Document10 pages1 - CCC - Code de Conduite Eshs - V001Willy18 Mboko100% (7)
- Etude D Impact Environnemental Et Social Pour Creation Du Poste Injecteur de Guediawaye Environ 5 43 KMDocument310 pagesEtude D Impact Environnemental Et Social Pour Creation Du Poste Injecteur de Guediawaye Environ 5 43 KMM8R-fsx9faPas encore d'évaluation
- Audit Environnemental MinierDocument40 pagesAudit Environnemental MinierScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- EIES Carriere de Laterite ESSASSADocument55 pagesEIES Carriere de Laterite ESSASSAAhmed Raissouni100% (6)
- Questionnaire Aux Personnels D'appuiDocument2 pagesQuestionnaire Aux Personnels D'appuiMarlene Lemogo100% (2)
- Livraison Des Carburants en Station ServicesDocument5 pagesLivraison Des Carburants en Station ServicesRégis OngolloPas encore d'évaluation
- Plan de Gestion Des DechetsDocument25 pagesPlan de Gestion Des DechetshhPas encore d'évaluation
- Diagnostic Global D'une Station ServicesDocument101 pagesDiagnostic Global D'une Station ServicesHabib DjelloulPas encore d'évaluation
- PPES Base-Vie Lot 2 FinalDocument11 pagesPPES Base-Vie Lot 2 FinalMélissa Raharijaona80% (5)
- CTS 3.5Document34 pagesCTS 3.5AFFOUET CHARLENE N'GUESSANPas encore d'évaluation
- PGES ExempleDocument94 pagesPGES ExempleSadokPas encore d'évaluation
- 1 - Projet PGES-EDocument53 pages1 - Projet PGES-EWilly18 Mboko100% (3)
- 3.1. Avant Projet Sommaire - MadagascarDocument49 pages3.1. Avant Projet Sommaire - MadagascarAbdoul Fatré Kienou100% (4)
- Manuel de Procédures de Gestion Des Déchets BiomédicauxDocument33 pagesManuel de Procédures de Gestion Des Déchets BiomédicauxAdama KONE100% (2)
- Dao 14 ForagesDocument51 pagesDao 14 ForagesEmony Trading CompanyPas encore d'évaluation
- Rapport Station ServiceDocument35 pagesRapport Station Servicemasseau100% (1)
- Rapport Journalier Magil 20180525Document2 pagesRapport Journalier Magil 20180525Pascal Nzomo100% (1)
- Étude D'impact Environnemental D'osisko (Résumé)Document66 pagesÉtude D'impact Environnemental D'osisko (Résumé)Blog de Malartic100% (9)
- Rapport de DémarragePULCIDocument18 pagesRapport de DémarragePULCIACID100% (1)
- Etude - D'impact - Environnementale - Et - Sociale - de - L'implantation - de - L'usine - Hydro-Métallurgique - STL - SOLDocument72 pagesEtude - D'impact - Environnementale - Et - Sociale - de - L'implantation - de - L'usine - Hydro-Métallurgique - STL - SOLSerginho Kabulo100% (1)
- 1373977733SY Station ServiceDocument18 pages1373977733SY Station ServiceKhabtane AbdelhamidPas encore d'évaluation
- 1059-4-Les Sols D Emprunt Et Les Gites de MatériauxDocument1 page1059-4-Les Sols D Emprunt Et Les Gites de MatériauxpompelargeurPas encore d'évaluation
- Hygiène Et Sécurité Exploitation2017Document43 pagesHygiène Et Sécurité Exploitation2017NAHOUI ABDELOUAHAB100% (1)
- Rapport Final Stage SONABHYDocument36 pagesRapport Final Stage SONABHYKader ILBOUDO100% (2)
- 3 - ETUDE DANGERS Briqueterie Lamour RoucourtDocument28 pages3 - ETUDE DANGERS Briqueterie Lamour RoucourtSanaPas encore d'évaluation
- 1 - Stratégies de Management Et Plans de Mise en Œuvre de Gestion Des Risques ESHS - V001Document9 pages1 - Stratégies de Management Et Plans de Mise en Œuvre de Gestion Des Risques ESHS - V001Willy18 Mboko94% (18)
- Guide d'EIE Du Projet D'exploitation Miniere À Ciel OuvertDocument67 pagesGuide d'EIE Du Projet D'exploitation Miniere À Ciel Ouvertjohn ngandouPas encore d'évaluation
- Etude Impact Sur L Environnement de Port de NadorDocument26 pagesEtude Impact Sur L Environnement de Port de Nadorabjadi100% (1)
- 3-1 Plan D'opération InterneDocument131 pages3-1 Plan D'opération Interneismailines100% (2)
- Guercif Plan Directeur Mission1 Tome1Document46 pagesGuercif Plan Directeur Mission1 Tome1Med AssiouiPas encore d'évaluation
- Etude D'impactDocument13 pagesEtude D'impactAbdel Hakim M. NadjibPas encore d'évaluation
- Maroc Ra FR WebDocument57 pagesMaroc Ra FR WebBadra Ali Sanogo100% (1)
- EIE-STEP Chichaoua-DEF-2018Document135 pagesEIE-STEP Chichaoua-DEF-2018hajar daoudiPas encore d'évaluation
- Logistique PERT MPM GANT Cours de Plannification 0 - WatermarkDocument16 pagesLogistique PERT MPM GANT Cours de Plannification 0 - WatermarkHamZa ChaFiPas encore d'évaluation
- Pathologies Des Bâtiments-3-2 PDFDocument82 pagesPathologies Des Bâtiments-3-2 PDFing100% (2)
- Pathologie de Bâtiment Cours Partie 1Document60 pagesPathologie de Bâtiment Cours Partie 1dqfqfqfq100% (1)
- Pathologie TassementDocument26 pagesPathologie TassementfqjhfqkPas encore d'évaluation
- واقع السكن في الجزائر - السكن الكولونيالي الفردي نموذجا -دراسة ميدانية ببلدية الذرعان - ولاية الطارفDocument21 pagesواقع السكن في الجزائر - السكن الكولونيالي الفردي نموذجا -دراسة ميدانية ببلدية الذرعان - ولاية الطارفNour MhiriPas encore d'évaluation
- Cours RDM 2023Document138 pagesCours RDM 2023Chancelle Aurélie ZangaPas encore d'évaluation
- CV Mohamed Karimi Charte EntrepriseDocument5 pagesCV Mohamed Karimi Charte EntreprisemayssaePas encore d'évaluation
- Programme Du Module Math 1Document3 pagesProgramme Du Module Math 1Yacine BEPas encore d'évaluation
- TD4TMCDocument3 pagesTD4TMCFarhi OussamaPas encore d'évaluation
- Le Champ Magnetique Cree Par Un Courant Electrique Cours 1 2Document4 pagesLe Champ Magnetique Cree Par Un Courant Electrique Cours 1 2Mohsine LazreqPas encore d'évaluation
- Thomas-Antérion - Le Bilan Neuropsychologique, Comment Le LireDocument12 pagesThomas-Antérion - Le Bilan Neuropsychologique, Comment Le LireEccoPas encore d'évaluation
- Lecon - Physique Pour L'agregation Externe - MarchettiDocument389 pagesLecon - Physique Pour L'agregation Externe - MarchettiNicolas Hounto HotegbePas encore d'évaluation
- Instituto Nacional para La Investigación AgronomicaDocument8 pagesInstituto Nacional para La Investigación AgronomicaErb WHPas encore d'évaluation
- Litterature Et ScienceDocument2 pagesLitterature Et ScienceTraPas encore d'évaluation
- k4121c - EnglishDocument4 pagesk4121c - Englishfta123Pas encore d'évaluation
- AnalyseDocument19 pagesAnalyseMehdi KallaPas encore d'évaluation
- Activité MsculaireDocument7 pagesActivité MsculaireameniPas encore d'évaluation
- Guide Des Ascendances Des Prédictions PerduesDocument146 pagesGuide Des Ascendances Des Prédictions Perduesjean-luc LopezPas encore d'évaluation
- Compo 11è SES Philo 2014-2015Document1 pageCompo 11è SES Philo 2014-2015fguindo177Pas encore d'évaluation
- Droit Bancaire: Introduction GénéraleDocument10 pagesDroit Bancaire: Introduction Généraleloubna ouzineb100% (1)
- Exam 0108Document2 pagesExam 0108Amine XGhost MidoPas encore d'évaluation
- Relations Grandeurs Mecaniques CorrectionDocument4 pagesRelations Grandeurs Mecaniques Correctionyvan mondesirPas encore d'évaluation
- A Propos de La PsychopedagogieDocument12 pagesA Propos de La PsychopedagogieChristian BisimwaPas encore d'évaluation
- Produits en Fin de Serie Du Catal 2022Document5 pagesProduits en Fin de Serie Du Catal 2022LaFée KikiPas encore d'évaluation
- HistoplasmosesDocument6 pagesHistoplasmosesfifi fifiPas encore d'évaluation
- Adl (Katz)Document1 pageAdl (Katz)HAFIDA BENYOUCEFMOSBAHPas encore d'évaluation
- Travaux Dirigeees de Materiaux Composites1Document6 pagesTravaux Dirigeees de Materiaux Composites1Francis Sonkeng100% (1)
- Rapport de Sensibilisation - DéfinitifDocument51 pagesRapport de Sensibilisation - DéfinitifLova AndriamanampisoaPas encore d'évaluation
- Logique Serie SM FRDocument2 pagesLogique Serie SM FRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE100% (1)
- Mathematics FrenchDocument78 pagesMathematics FrenchEirini MelianouPas encore d'évaluation
- TD MasterDocument13 pagesTD MasterabdellahmorPas encore d'évaluation
- Exploration MinièreDocument35 pagesExploration MinièreTjrKoffi80% (5)
- Exposé 01 Elaboration Des Programmes Selon l'APC FFDocument66 pagesExposé 01 Elaboration Des Programmes Selon l'APC FFEbou Mo7amedPas encore d'évaluation
- Psy4190 - Notes de CoursDocument39 pagesPsy4190 - Notes de CoursMissaoui LamiaaPas encore d'évaluation