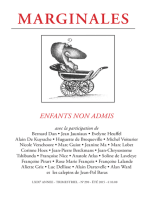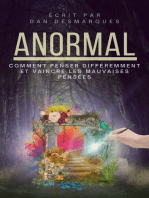Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Texte Graeber Niveau Explication Sciences Sociales
Transféré par
Richert Hugo0%(1)0% ont trouvé ce document utile (1 vote)
17 vues2 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0%(1)0% ont trouvé ce document utile (1 vote)
17 vues2 pagesTexte Graeber Niveau Explication Sciences Sociales
Transféré par
Richert HugoDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 2
Texte de David Graeber sur les différents niveaux d’explication en sciences sociales.
Nous voici confrontés à un problème classique en sciences sociales : les niveaux de
causalité. Dans le monde réel, à tout événement donné il existe un certain nombre de causes, qu’il
est possible de classer en différentes catégories. Mettons que je tombe dans une bouche d’égout. On
peut attribuer cela à ma distraction. Maintenant, si l’on découvre que, dans ma ville, le nombre de
personnes tombées dans les bouches d’égout par distraction est brusquement monté en flèche, on
doit chercher une explication d’un autre ordre – essayer de comprendre pourquoi tout le monde est
soudainement devenu si distrait dans cette ville, ou (plus plausible) pourquoi on y trouve tant de
bouches d’égout ouvertes.
J’ai volontairement choisi un exemple farfelu, mais examinons-en un autre plus sérieux. Au
chapitre précédent Meena soulignait que, si bien des sans-abri ont une histoire marquée par des
addictions – à l’alcool, à la drogue… - ou par diverses formes de fragilité personnelle, beaucoup
d’autres sont simplement des adolescents abandonnés par leurs parents, d’anciens combattants
souffrant de stress post-traumatique ou encore de femmes qui fuient un mari violent. Parmi les gens
qui dorment dans la rue ou dans les centres d’hébergement d’urgence prenez quelqu’un au hasard et
regardez son parcours de vie : vous y verrez sans doute converger plusieurs de ces facteurs,
généralement combinés à une bonne dose de malchance. Par conséquent on ne devrait jamais
pouvoir dire qu’un SDF se retrouve dans cette situation parce qu’il est dépravé. Et quand bien
même un SDF serait effectivement dépravé, quoi que l’on entende par-là, cela n’expliquerait en
rien les fluctuations du taux de sans-abri dans le temps, ni d’un pays à un autre à l’instant t.
C’est là un point crucial. Prenons le problème dans l’autre sens. A toutes les époques, il s’est
trouvé des moralistes pour affirmer que les pauvres doivent leur condition à leur comportement
immoral. Après tout, nous rappelle t-on souvent, on voit des gens nés pauvres devenir riches grâce
à leur courage, à leur détermination et à leur esprit d’initiative ; cela veut bien dire que d’autres
restent pauvres faute d’avoir fait un effort qu’ils auraient pu faire. Cet argument paraît convaincant
quand on ne regarde que des cas individuels ; il l’est beaucoup moins au vu des statistiques
comparatives, qui soulignent des variations spectaculaires du taux d’ascension sociale dans le
temps. Les Américains pauvres étaient-ils moins dynamiques dans les années 30 que dans les
décennies précédentes, ou cela avait-il à voir avec la Grande Dépression ? Il est encore plus
difficile de s’en tenir à cette approche exclusivement morale quand on considère les différences
criantes de taux de mobilité sociale entre les pays. Un enfant né en Suède de parents pauvres a
beaucoup plus de chances de s’enrichir qu’un enfant né dans des conditions similaires aux Etats-
Unis. Est-ce à dire que les suédois ont globalement plus de courage et plus d’esprit d’initiative que
les Américains ? Je doute que la plupart des moralistes conservateurs contemporains soient prêts à
soutenir une telle opinion.
Il nous faut donc chercher un autre type d’explication – peut-être l’accès à l’éducation ou
bien le fait que les plus pauvres des enfants suédois sont loin de l’être autant que les plus pauvres
des enfants américains. Cela ne signifie pas que les qualités personnelles n’entrent pas en ligne de
compte, puisque certains enfants suédois pauvres réussissent et d’autres non. Mais ce sont des
problèmes et des niveaux d’analyse distincts. Il en va de même dans un jeu : tenter de déterminer
les raisons pour lesquelles un joueur particulier a gagné une partie, ce n’est pas la même chose que
s’intéresser au degré de difficulté du jeu.
Ni que se demander pourquoi les gens y jouent, d’ailleurs. C’est là un troisième type de
question. De fait, quand on étudie des changements sociaux de grande envergure, il convient
d’envisager non pas deux mais trois niveaux d’explication. Dans ce cas précis ce serait 1) les motifs
particuliers pour lesquels un individu donné se retrouve à la rue ; 2) les forces économiques et
sociales plus profondes qui conduisent à l’accroissement de la population des sans-abri
(augmentation des loyers, mutation des structures familiales, etc.) ; 3) les raisons pour lesquelles
personne n’intervient. On peut qualifier ce dernier niveau de politico-culturel. C’est le plus facile à
omettre, car il renvoie souvent à ce que les gens ne font pas.
Je me souviens très bien de la première fois où à Madagascar j’ai discuté avec des amis du
phénomène des sans-abri en Amérique. Ils étaient abasourdis d’apprendre que les gens dormaient
dans la rue dans le pays le plus riche et le plus puissant du monde. « Mais les Américains n’ont pas
honte ?! M’a demandé l’un d’eux. Ils sont tellement riches ! Ça ne leur pose pas de problème que le
monde entier va y voir un déshonneur national ? ».
Il l’a bien fallu reconnaître que c’était une bonne question. Pourquoi les Américains, eux, ne
voient-ils pas comme un déshonneur national le fait que des gens dorment dehors ? A coup sûr,
ç’aurait été le cas à d’autres moments de leur histoire. Si l’on avait vu tant de gens dans les grandes
villes au cours des années 1820, ou même des années 1940, il y aurait eu un tollé général et des
mesures auraient été prises. Oh, peut-être pas des mesures très reluisantes – à certaines périodes on
aurait raflé les vagabonds pour les mettre au travail dans des hospices, à d’autres on aurait construit
des logements sociaux probablement. Mais, au moins, on n’aurait pas laissé ces gens dépérir sur
leurs cartons au beau milieu des trottoirs. Depuis les années 1980, les Américains tendent à réagir à
cette situation non pas en s’insurgeant contre les conditions sociales qui la créent, mais en recourant
à des explications de premier niveau, c’est-à-dire en décrétant que le problème des sans-abri est une
conséquence inévitable de la faiblesse humaine. Les humains sont des êtres capricieux. Ils l’ont
toujours été. Il n’y a rien qu’on puisse faire pour y remédier.
Voilà pourquoi j’insiste sur la dimension à la fois politique et culturelle de ce troisième
niveau d’explication : il repose sur nos présupposés de base concernant nos semblables, ce que l’on
peut attendre d’eux et ce qu’ils sont en droit d’exiger les uns des autres. En retour, c’est en vertu de
ces présupposés que nous décidons de ce qui constitue ou non un problème politique. Non pas que
les attitudes populaires soient l’unique facteur en la matière. La preuve : les autorités politiques font
souvent fi de la volonté générale. Régulièrement des sondages rappellent qu’environ deux tiers des
Américains sont favorables à un système de soins nationalisé ; pourtant aucun grand parti n’a
jamais soutenu cette idée aux Etats-Unis. De même les enquêtes montrent que la majorité des
britanniques souhaitent les réintroduction de la peine de mort, or aucune formation politique
importante ne la défend.
Bullshit Jobs, David Graeber pp.234-238.
Vous aimerez peut-être aussi
- Liberté, Autodiscipline, Intégration: Politique et religionD'EverandLiberté, Autodiscipline, Intégration: Politique et religionPas encore d'évaluation
- Les Lois Fondamentales de La Stupidite humaine-MC Cipolla PDFDocument31 pagesLes Lois Fondamentales de La Stupidite humaine-MC Cipolla PDFRenzo Delma100% (7)
- Chim AmandaDocument2 pagesChim AmandaYasmine yassouPas encore d'évaluation
- On Ne Naît Pas RacisteDocument8 pagesOn Ne Naît Pas RacisteLaurence TidyPas encore d'évaluation
- Fre oDocument45 pagesFre odaniel danyPas encore d'évaluation
- RHInfo 238Document4 pagesRHInfo 238Alban BUREAUPas encore d'évaluation
- Fre Sub g13 Notes Conflit de Generation Mrs JuggessurDocument6 pagesFre Sub g13 Notes Conflit de Generation Mrs Juggessurndiayemoise92Pas encore d'évaluation
- Les Sciences Sociales - Sorcellerie Des Temps Modernes - Stanislav AndreskiDocument179 pagesLes Sciences Sociales - Sorcellerie Des Temps Modernes - Stanislav AndreskiBelkadi TahirPas encore d'évaluation
- Fiche20 LejeuneDocument6 pagesFiche20 LejeunedalekossaPas encore d'évaluation
- Discours DharvardDocument6 pagesDiscours DharvardFilippo ValeroPas encore d'évaluation
- Discours DharvardDocument7 pagesDiscours DharvardskitocPas encore d'évaluation
- Moi, Christiane F., 13 Ans, Droguée, Prostituée...Document270 pagesMoi, Christiane F., 13 Ans, Droguée, Prostituée...Mihnea Rusu92% (12)
- Peter Singer, Lenfant Qui Se Noie Et Le Cercle Qui SélargitDocument6 pagesPeter Singer, Lenfant Qui Se Noie Et Le Cercle Qui Sélargitmatteo.blr974Pas encore d'évaluation
- SOWELL, Thomas. Race, Politique Et Économie - Une Approche InternationaleDocument318 pagesSOWELL, Thomas. Race, Politique Et Économie - Une Approche InternationaleYo_CaraPas encore d'évaluation
- Repenser La Pauvreté (French Edition) - NodrmDocument421 pagesRepenser La Pauvreté (French Edition) - NodrmEco Tv Abdel100% (2)
- Réagis Au ReportageDocument2 pagesRéagis Au ReportageTharsa SeevaratnamPas encore d'évaluation
- De Quelques Apprentis Sorciers - Gandhi, Jean XXIII, Teilhard de Chardin, Lecomte Du Noüy, C. G. Jung - , Par Carlo SuarèsDocument92 pagesDe Quelques Apprentis Sorciers - Gandhi, Jean XXIII, Teilhard de Chardin, Lecomte Du Noüy, C. G. Jung - , Par Carlo SuarèsJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Philosophie MondialisationDocument7 pagesPhilosophie MondialisationbeckangelaPas encore d'évaluation
- Antoine Bayet Les Réseaux Sociaux Sont Ils DangereuxDocument157 pagesAntoine Bayet Les Réseaux Sociaux Sont Ils DangereuxAmadou BoussoPas encore d'évaluation
- Dorronsoro (2019) - Le Reniement Démocratique. Néolibéralisme Et Injustice SocialeDocument120 pagesDorronsoro (2019) - Le Reniement Démocratique. Néolibéralisme Et Injustice SocialealbirezPas encore d'évaluation
- Abélès - Pour Une Anthropologie de La GlobalisationDocument6 pagesAbélès - Pour Une Anthropologie de La GlobalisationAle LerenaPas encore d'évaluation
- 120303-Chomsly 10 ManipulationsDocument3 pages120303-Chomsly 10 ManipulationsFabrice MinierPas encore d'évaluation
- 120303-Chomsly 10 Manipulations PDFDocument3 pages120303-Chomsly 10 Manipulations PDFrobinPas encore d'évaluation
- Journal de Pensées Semaine 5Document7 pagesJournal de Pensées Semaine 5Jean-Christophe DubéPas encore d'évaluation
- Correction Devoir Reflexion 3 SolidariteDocument2 pagesCorrection Devoir Reflexion 3 Solidaritesamih.khorchafPas encore d'évaluation
- La Dictature Des IdentitésDocument129 pagesLa Dictature Des IdentitésRfleurant2002Pas encore d'évaluation
- Défaire Le Radicalisme RigideDocument8 pagesDéfaire Le Radicalisme RigidePoluiPas encore d'évaluation
- Reset The WorldDocument133 pagesReset The WorldIggdrazyl ErsatzPas encore d'évaluation
- Radicalisme RigideDocument6 pagesRadicalisme RigideNadïé GoramPas encore d'évaluation
- Négatifs, …que négatifs !: Pourquoi et comment réagirD'EverandNégatifs, …que négatifs !: Pourquoi et comment réagirPas encore d'évaluation
- Marcel Gauchet La Question Migratoire Supplante La Question Sociale - L'Obs 2018 06 28Document3 pagesMarcel Gauchet La Question Migratoire Supplante La Question Sociale - L'Obs 2018 06 28Laurence Driouch100% (2)
- 1999 06 0255v2Document56 pages1999 06 0255v2Isabelle GatemboPas encore d'évaluation
- Passer Des Epreuves (Boltanski)Document4 pagesPasser Des Epreuves (Boltanski)Filip Tripp100% (1)
- Citoyennete Questions 2021Document8 pagesCitoyennete Questions 2021dofaultPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Synthèse IIDocument4 pagesChapitre 1 - Synthèse IIThibaut MonbelPas encore d'évaluation
- Albert Einstein & Sigmund Freud - Pourquoi La GuerreDocument30 pagesAlbert Einstein & Sigmund Freud - Pourquoi La GuerreThierno Mamadou Aliou DIALLOPas encore d'évaluation
- 37-les-prejugesDocument15 pages37-les-prejugesMarie SonsPas encore d'évaluation
- Soyez Vous-Meme ! - Gilles AZZOPARDIDocument112 pagesSoyez Vous-Meme ! - Gilles AZZOPARDIKalan Dorem100% (2)
- Grand OralDocument5 pagesGrand Oralapi-633171223Pas encore d'évaluation
- Introduction Droit Naturel Et Histoire de StraussDocument6 pagesIntroduction Droit Naturel Et Histoire de StraussNICOMAQUE IIPas encore d'évaluation
- Bianco, Jean-Louis - Bouzar, Lylia - Grzybowski, Samuel-L'Après-Charlie - Vingt Questions Pour en Débattre Sans Tabou-Canopé (2015)Document112 pagesBianco, Jean-Louis - Bouzar, Lylia - Grzybowski, Samuel-L'Après-Charlie - Vingt Questions Pour en Débattre Sans Tabou-Canopé (2015)Arturo Manuel Garza Ramos MonroyPas encore d'évaluation
- 96 Day French PaperDocument17 pages96 Day French Paperjiangmeixin676Pas encore d'évaluation
- Un Monde Sans Argent - Stop MensongesDocument7 pagesUn Monde Sans Argent - Stop MensongesSandrine KamedjuPas encore d'évaluation
- Bourdieu Contre FeuxDocument125 pagesBourdieu Contre FeuxMiquel Figueras Moreu100% (1)
- Les Enjeux Contemporains de L Action HumanitaireDocument11 pagesLes Enjeux Contemporains de L Action HumanitaireKarelle TikiPas encore d'évaluation
- Politique(s) de la décroissance: Propositions pour penser et faire la transitionD'EverandPolitique(s) de la décroissance: Propositions pour penser et faire la transitionPas encore d'évaluation
- Anormal:: Comment Penser Différemment et Vaincre les Mauvaises PenséesD'EverandAnormal:: Comment Penser Différemment et Vaincre les Mauvaises PenséesPas encore d'évaluation
- SMM Manipulation de MasseDocument3 pagesSMM Manipulation de MassejacobPas encore d'évaluation
- Judith Butler Déconstruire, Ce N'est Pas DétruireDocument8 pagesJudith Butler Déconstruire, Ce N'est Pas DétruireHammadi AbidPas encore d'évaluation
- Corrigés Tests TEF - Docx Version 1Document8 pagesCorrigés Tests TEF - Docx Version 1Imene LoucifPas encore d'évaluation
- Voyage Du Jeune - Tome 3Document568 pagesVoyage Du Jeune - Tome 3Paula AranhaPas encore d'évaluation
- Chapitre 2-2Document15 pagesChapitre 2-2Reda BachnouPas encore d'évaluation
- Exercices Correction Théorème de Pythagore 4èmeDocument3 pagesExercices Correction Théorème de Pythagore 4èmehaquenne.laurentPas encore d'évaluation
- Evaluation Des Gains Dans Les Systèmes de Communication OptiqueDocument35 pagesEvaluation Des Gains Dans Les Systèmes de Communication OptiqueMichel GwosPas encore d'évaluation
- Exercices D'algorithmique CorrigésDocument7 pagesExercices D'algorithmique Corrigésmaroua meskinePas encore d'évaluation
- Inbound MarketingDocument13 pagesInbound MarketingPaweł SajdekPas encore d'évaluation
- EXA AutoDocument6 pagesEXA Autoقرين لطفيPas encore d'évaluation
- Le Zodiaque de Dendérah (Réparé)Document40 pagesLe Zodiaque de Dendérah (Réparé)marion100% (1)
- Weber Le Savant Et Le Politique (Annotations)Document1 pageWeber Le Savant Et Le Politique (Annotations)bilou11070% (1)
- NCT Memento Rinaldo v2Document15 pagesNCT Memento Rinaldo v2Manmzel RaphaPas encore d'évaluation
- Draft Charte Graphique Pdl-145Document22 pagesDraft Charte Graphique Pdl-145damien batobaPas encore d'évaluation
- MCC Ing Cycle Preparatoire IntegreeDocument2 pagesMCC Ing Cycle Preparatoire IntegreeNadia Ait AhmedPas encore d'évaluation
- Elasticité Chapitre 6Document21 pagesElasticité Chapitre 6Anis LepicPas encore d'évaluation
- Uca2 1 1aDocument3 pagesUca2 1 1aMariePas encore d'évaluation
- Que Faut - Il Retenir Sur Les Nombres Complexes PDFDocument2 pagesQue Faut - Il Retenir Sur Les Nombres Complexes PDFMichaël Ronio BezandryPas encore d'évaluation
- Devoir M1 MathDocument1 pageDevoir M1 MathSolene TsinaPas encore d'évaluation
- Iec 60372Document46 pagesIec 60372Luis Andres Pradenas FuentesPas encore d'évaluation
- Armorial Et Nobiliaire de L'ancien (... ) Foras Amédée Bpt6k65767241Document377 pagesArmorial Et Nobiliaire de L'ancien (... ) Foras Amédée Bpt6k65767241maza_poulppyPas encore d'évaluation
- Fiche EnseignantDocument4 pagesFiche EnseignantWulfaPas encore d'évaluation
- MC1.06 Metallurgie Generale Et Choix Des Materiaux 3jDocument1 pageMC1.06 Metallurgie Generale Et Choix Des Materiaux 3jGuillaumePas encore d'évaluation
- 03 Vocabulaire MetrologiqueDocument14 pages03 Vocabulaire MetrologiqueBouchedda YassinePas encore d'évaluation
- Programme Séminaire UCESIF Bucarest, 13 - 14 Mai 2013Document24 pagesProgramme Séminaire UCESIF Bucarest, 13 - 14 Mai 2013Victor CozmeiPas encore d'évaluation
- Etude Et Conception D'une Centrale A BetonDocument60 pagesEtude Et Conception D'une Centrale A Betonjihenk100% (14)
- TS 019m 184 (OA4 ROUHIA TE2S 2ID)Document69 pagesTS 019m 184 (OA4 ROUHIA TE2S 2ID)jawhar eddine boukhrisPas encore d'évaluation
- Annexe I Construction Hangar Chambre FroideDocument51 pagesAnnexe I Construction Hangar Chambre FroideAL DialloPas encore d'évaluation
- Ajp Jphyscol198142c119Document16 pagesAjp Jphyscol198142c119Wassini BensPas encore d'évaluation
- Communiquer Communiquer: Figure 1: Deux Décompositions de La Tâche TDocument12 pagesCommuniquer Communiquer: Figure 1: Deux Décompositions de La Tâche The200gab100% (1)
- Correction Emd MR 2017 2018Document4 pagesCorrection Emd MR 2017 2018Benlouanas KamelPas encore d'évaluation
- 293 Conception de La Commande de Processus PopescuDocument295 pages293 Conception de La Commande de Processus PopescuSteve DemirelPas encore d'évaluation
- Cours TGDocument45 pagesCours TGRadia GanaPas encore d'évaluation