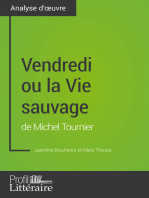Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
LIVRE-ALAIN MILON (Dir.) - Maurice Blanchot, Entre Roman Et Récit
Transféré par
sdoreau001Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
LIVRE-ALAIN MILON (Dir.) - Maurice Blanchot, Entre Roman Et Récit
Transféré par
sdoreau001Droits d'auteur :
Formats disponibles
Presses universitaires de Paris Nanterre
Maurice Blanchot, entre roman et récit
Alain Milon (dir.)
DOI : 10.4000/books.pupo.3135
Éditeur : Presses universitaires de Paris Nanterre
Lieu d’édition : Nanterre
Année d’édition : 2014
Date de mise en ligne : 9 juillet 2021
Collection : Résonances de Maurice Blanchot
EAN électronique : 9782821851030
https://books.openedition.org
Édition imprimée
EAN (Édition imprimée) : 9782840161738
Nombre de pages : 305
Ce document vous est offert par Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier
Référence électronique
MILON, Alain (dir.). Maurice Blanchot, entre roman et récit. Nouvelle édition [en ligne]. Nanterre : Presses
universitaires de Paris Nanterre, 2014 (généré le 17 avril 2023). Disponible sur Internet : <http://
books.openedition.org/pupo/3135>. ISBN : 9782821851030. DOI : https://doi.org/10.4000/
books.pupo.3135.
© Presses universitaires de Paris Nanterre, 2014
Licence OpenEdition Books
RÉSUMÉS
Le 14 septembre 2011, dans l’émission de Laure Adler Hors champ sur France Culture, Jean-Luc
Godard tenait les propos suivants : « Question : Expliquez-nous la différence entre du cinéma vrai
et des films, faire des films. Réponse : Les films on peut les voir, le cinéma on ne peut pas le voir.
On peut juste voir ce qu’on ne peut pas voir… de l’inconnu ou des choses comme cela… Question :
C’est cela que vous tentez de faire ? approcher de l’invisible… Réponse : Ce qu’on fait
naturellement, ce que font beaucoup d’écrivains à leur manière. Quand j’étais adolescent, l’un des
premiers livres qui m’avaient touché, c’est un livre de Maurice Blanchot… je ne connaissais rien à
la philosophie et à toute cette école… c’était un livre qui s’appelait Thomas l’Obscur… voilà c’est
Thomas l’Obscur… »
Le 28 janvier 1942, à la sortie de Thomas l’Obscur, Thierry Maulnier faisait le commentaire suivant
dans sa chronique littéraire : « Le premier roman de M. Maurice Blanchot constitue à n’en pas
douter une des expériences les plus subtiles et les plus audacieuses qui aient été faites depuis
longtemps pour faire dire aux mots plus ou autre chose que ce qu’ils ont coutume de dire dans
leur emploi habituel. » Deux témoignages différents mais la même intuition sur un auteur à part
qui a marqué toute une génération d’écrivains. L’intention de cet ouvrage collectif sur les romans
et récits de Maurice Blanchot est justement de creuser cet informulé dans le connu du mot ,
autrement dit la manière dont l’écriture de Blanchot pose la question de l’invention du langage à
travers l’acte de nomination : comprendre le combat que livre Thomas avec, pour ou contre le
mot.
sous la direction
L e 14 septembre 2011, dans l’émission de Laure Adler Hors d’Alain Milon dans la même collection :
champ sur France Culture, Jean-Luc Godard tenait les propos
suivants : « Question : Expliquez-nous la différence entre du Emmanuel Lévinas-Maurice Blanchot :
cinéma vrai et des films, faire des films. Réponse : Les films on penser la différence
sous la direction
d’Alain Milon
peut les voir, le cinéma on ne peut pas le voir. On peut juste voir Maurice Blanchot et la philosophie
ce qu’on ne peut pas voir… de l’inconnu ou des choses comme
cela… Question : C’est cela que vous tentez de faire ? approcher
de l’invisible… Réponse : Ce qu’on fait naturellement, ce que font
beaucoup d’écrivains à leur manière. Quand j’étais adolescent, l’un
des premiers livres qui m’avaient touché, c’est un livre de Maurice
Maurice Blanchot
Blanchot… je ne connaissais rien à la philosophie et à toute cette
école… c’était un livre qui s’appelait Thomas l’Obscur… voilà
c’est Thomas l’Obscur… »
entre roman et récit
Le 28 janvier 1942, à la sortie de Thomas l’Obscur, Thierry
Maulnier faisait le commentaire suivant dans sa chronique
littéraire : « Le premier roman de M. Maurice Blanchot constitue
à n’en pas douter une des expériences les plus subtiles et les plus
audacieuses qui aient été faites depuis longtemps pour faire dire
entre roman et récit
aux mots plus ou autre chose que ce qu’ils ont coutume de dire
dans leur emploi habituel. »
Maurice Blanchot
Deux témoignages différents mais la même intuition sur un
auteur à part qui a marqué toute une génération d’écrivains.
L’intention de cet ouvrage collectif sur les romans et récits de
Maurice Blanchot est justement de creuser cet informulé dans
Photo de couverture © Anne-Lise Large
le connu du mot, autrement dit la manière dont l’écriture de
Blanchot pose la question de l’invention du langage à travers l’acte
de nomination : comprendre le combat que livre Thomas avec,
pour ou contre le mot.
23 €
www.pressesparisouest.fr isbn : 978-2-84016-173-8
presses universitaires de paris ouest presses universitaires de paris ouest
CouvBlanchotRoman.indd 1 29/11/13 11:46
sous la direction
L e 14 septembre 2011, dans l’émission de Laure Adler Hors d’Alain Milon dans la même collection :
champ sur France Culture, Jean-Luc Godard tenait les propos
suivants : « Question : Expliquez-nous la différence entre du Emmanuel Lévinas-Maurice Blanchot :
cinéma vrai et des films, faire des films. Réponse : Les films on penser la différence
sous la direction
d’Alain Milon
peut les voir, le cinéma on ne peut pas le voir. On peut juste voir Maurice Blanchot et la philosophie
ce qu’on ne peut pas voir… de l’inconnu ou des choses comme
cela… Question : C’est cela que vous tentez de faire ? approcher
de l’invisible… Réponse : Ce qu’on fait naturellement, ce que font
beaucoup d’écrivains à leur manière. Quand j’étais adolescent, l’un
des premiers livres qui m’avaient touché, c’est un livre de Maurice
Maurice Blanchot
Blanchot… je ne connaissais rien à la philosophie et à toute cette
école… c’était un livre qui s’appelait Thomas l’Obscur… voilà
c’est Thomas l’Obscur… »
entre roman et récit
Le 28 janvier 1942, à la sortie de Thomas l’Obscur, Thierry
Maulnier faisait le commentaire suivant dans sa chronique
littéraire : « Le premier roman de M. Maurice Blanchot constitue
à n’en pas douter une des expériences les plus subtiles et les plus
audacieuses qui aient été faites depuis longtemps pour faire dire
entre roman et récit
aux mots plus ou autre chose que ce qu’ils ont coutume de dire
dans leur emploi habituel. »
Maurice Blanchot
Deux témoignages différents mais la même intuition sur un
auteur à part qui a marqué toute une génération d’écrivains.
L’intention de cet ouvrage collectif sur les romans et récits de
Maurice Blanchot est justement de creuser cet informulé dans
Photo de couverture © Anne-Lise Large
le connu du mot, autrement dit la manière dont l’écriture de
Blanchot pose la question de l’invention du langage à travers l’acte
de nomination : comprendre le combat que livre Thomas avec,
pour ou contre le mot.
23 €
www.pressesparisouest.fr isbn : 978-2-84016-173-8
presses universitaires de paris ouest presses universitaires de paris ouest
CouvBlanchotRoman.indd 1 29/11/13 11:46
Collection
Résonances de Maurice Blanchot
dirigée par Éric Hoppenot et Alain Milon
www.pressesparisouest.fr
Blanchot.indb 1 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 2 29/11/13 11:56
Maurice Blanchot, entre roman et récit
Blanchot.indb 3 29/11/13 11:56
Dans la même collection :
Emmanuel Lévinas-Maurice Blanchot, penser la différence
Maurice Blanchot et la philosophie
Blanchot.indb 4 29/11/13 11:56
Maurice Blanchot, entre roman et récit
Sous la direction d’Alain Milon
presses universitaires de paris ouest
Blanchot.indb 5 29/11/13 11:56
www.pressesparisouest.fr
2013
© Presses universitaires de Paris Ouest
isbn : 978-2-84016-173-8
Blanchot.indb 6 29/11/13 11:56
Sommaire
Ouverture
Au seuil de l’écriture : Thomas, sans récit, sans roman ......................................................13
Alain Milon
L’avènement du récit
L’événement du récit ou quand « l’au-delà »
est appelé dans la scène ......................................................................................................33
Pierre Madaule
Le roman est le récit ...........................................................................................................43
Antoine Philippe
Blanchot.indb 7 29/11/13 11:56
La considération de la dynamique dans les récits de Blanchot,
approche de la genèse de l’écriture et de la pensée..............................................................59
Geoffrey Martinache
La question de la nomination
Le pouvoir des mots : autour de Thomas l’Obscur ............................................................75
Anca Calin
Maurice Blanchot, Opus communis. Lecture dans le pacte communicationnel :
« Faites en sorte que je puisse vous parler. » .......................................................................93
Slimane Lamnaoui
Maurice Blanchot : « Je » ou comment s’en débarrasser.
De l’objet voix à l’« ob-je » ............................................................................................... 111
Maxime Decout
Espace narratif, espace fragmentaire
L’imaginaire au singulier : l’image de l’escalier
dans l’œuvre fictionnelle de Blanchot ............................................................................... 127
Arthur Cools
L’œil obscurci .................................................................................................................... 145
Tomasz Swoboda
La parole aveugle. L’Apocalypse ou le moment spectral
dans l’écriture fictionnelle de Blanchot ............................................................................ 159
Renato Boccali
Le Dernier entretien :
la pensée épuisée et l’épuisement du sujet ........................................................................ 173
Gary D. Mole
Blanchot.indb 8 29/11/13 11:56
Le problème des espaces dans Le Dernier homme.
Du récit à l’écriture fragmentaire..................................................................................... 189
Huges Choplin
L’univers littéraire du récit :
L’Instant de ma mort, Le Très-Haut, Au moment voulu
L’Instant de ma mort de Maurice Blanchot
ou une question inventée face à l’impensable… .............................................................. 207
Claudine Hunault
« Comme un souvenir indestructible » :
L’Instant de ma mort de Maurice Blanchot… ................................................................ 217
Caroline Sheaffer-Jones
Le Très-Haut est-il un roman religieux ?… ..................................................................... 235
François Brémondy
Aller plus loin, c’est déjà me lier au retour… ................................................................... 259
Shuling Stéphanie Tsai
Conclusion
Le fragment ou la strangulation de l’écriture… ............................................................... 275
Alain Milon
Annexes
Critiques de Thierry Maulnier à propos des deux premiers romans
de Maurice Blanchot, Thomas l’Obscur et Aminadab… ............................................... 291
Biographie des auteurs… ...............................................................................................301
Pg_debut170x200orbisLittCSS5.indd 9 29/11/13 12:02
Blanchot.indb 10 29/11/13 11:56
Ouverture
Blanchot.indb 11 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 12 29/11/13 11:56
Au seuil de l’écriture :
Thomas, sans récit, sans roman
Alain Milon
D
ans Le Livre à venir, Blanchot s’interroge sur le secret de l’écriture comme
expression d’un récit pur : « Peut-il y avoir un récit pur ? Tout récit, ne fût-ce que
par discrétion, cherche à se dissimuler dans l’épaisseur romanesque1. » Parler de
récit pur comme d’un texte libéré des contraintes romanesques, ce n’est pas pour
réfléchir sur la spécificité de deux genres littéraires différents ; c’est plutôt se demander
quelle peut être la valeur de « la confusion fascinante2 » qui peut exister autant entre ces
genres qu’entre la réalité et la fiction. Confusion fascinante car derrière le classement
par genre, qu’il soit « récit », « roman », « critique » ou « nouvelles », ce ne sont pas les
catégories littéraires que Blanchot analyse, mais le redéploiement de la langue sur elle-
même3, et à travers ce redéploiement la manière dont des éléments fictionnels passent
dans la réalité, non pas la réalité vécue mais celle qui façonne le processus de nomination.
1. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, « Folio/Essais », Paris, 1986, p. 19.
2. Ibid., p. 19.
3. Foucault Michel, « La pensée du dehors », in Critique, no 229, « Maurice Blanchot »,
juin 1966, p. 530.
13
Blanchot.indb 13 29/11/13 11:56
Finalement, la différence entre les textes « critiques » et les œuvres fictionnelles de
Blanchot est purement factuelle puisque le penser de la nomination dans La Part du feu
et le vécu de cette même nomination dans Thomas l’Obscur ne sont que des mises en
perspective de la même impossibilité à nommer.
En réalité, la question du classement des textes de Blanchot n’apporte rien, à supposer
même que l’indication d’un genre sur la couverture d’un ouvrage puisse en déterminer
la lecture. Ce n’est pas le fait de répertorier une œuvre comme récit ou comme roman
qui importe mais de comprendre le cercle vicieux que Pérec décline dans « Penser/clas-
ser » : classe-t-on avant de penser, ou pense-t-on avant de classer ? En fait, Pérec s’amuse
à montrer que classer et penser sont deux modalités d’un même mouvement : on pense
pour classer et on classe en pensant.
Si l’on prend le cas de Thomas l’Obscur, pierre angulaire de l’œuvre de Maurice
Blanchot, on observe que l’ouvrage a d’abord été présenté par l’éditeur comme un roman
puis, dans sa deuxième édition, comme un récit. Ce changement de catégorie est-il dû à
la simple réduction de deux tiers de l’ouvrage, ou est-il la trace d’un véritable changement
d’écriture ? En réduisant quantitativement son texte, Blanchot en change-t-il finalement
la nature qualitative ? Si la première version de Thomas l’Obscur contient plus de narra-
tion, d’épanchements psychologiques, de personnages, de descriptions, les interrogations
de Blanchot sur la véritable nature de l’acte de nomination en sont-elles transformées ?
Pour beaucoup, Blanchot a appauvri et presque tué son livre en rédigeant une deuxième
version plus courte4. Pour d’autres, il l’a sauvé en le rendant plus dense. Les éventuelles
4. Je pense précisément à l’introduction, « Retour d’épave », de Pierre Madaule publiée lors de la
réédition de la première version de Thomas l’Obscur en 2005 chez Gallimard. Dans cette
introduction, il insiste sur la perte que représentent ces coupes dans le roman. Pourtant, dans son
ouvrage, Une tache sérieuse ?, il écrit à propos du travail de Blanchot : « […] il n’y aurait eu rien à
chercher, aucune énigme à oublier, parce qu’il n’y avait rien à découvrir. » (Paris, Gallimard, 1973,
p. 21). Ce « rien à découvrir » peut se comprendre aussi comme s’il s’agissait d’une réponse connue
d’avance : il n’y a rien à découvrir mais on le savait depuis longtemps. Qu’importe alors que le texte
soit coupé ou non ! D’ailleurs, tout au long de son livre, Madaule fait état de sa grande déception
lorsqu’il a constaté la disparition de l’épilogue de L’Arrêt de mort (1948), surtout la dernière phrase :
« Que cela soit donc rappelé à qui lirait ces pages en les croyant traversées par la pensée du malheur.
Et plus encore, qu’il essaie d’imaginer la main qui les écrit : s’il la voyait, peut-être lire lui
deviendrait-il une tâche sérieuse. » Cette dernière phrase pose en fait la question de l’antériorité
ontologique de la lecture sur l’antériorité chronologique de l’écriture (pour lire il faut que le texte
soit écrit, mais un texte écrit a d’abord été un texte lu). La lecture est une tâche sérieuse, plus
sérieuse finalement que l’écriture. Alors que l’auteur est pris dans un faisceau collectif d’écriture,
14
Blanchot.indb 14 29/11/13 11:56
sept ou huit versions différentes de Thomas l’Obscur non publiées n’offrent un intérêt que
pour les généticiens du texte. Pour peu que la notion d’auteur ait un sens, Blanchot reste
le seul responsable, au moins à l’état final, de son écriture.
Cette cure d’amaigrissement ressemble surtout à une série de clins d’œil sur son
propre travail : le fragment inscrit à l’intérieur de son écriture, l’impossibilité de nom-
mer, le neutre, les nuits, le « il », la folie d’un jour, une écriture qui ne l’a jamais accom-
pagné, un moment voulu qui ne vient pas au moment voulu, un dernier moment, celui
de la mort annoncée de l’écriture5… Face à cette réduction drastique, la question n’est
plus de savoir dans quel genre classer ce nouveau texte de Blanchot, ni pourquoi il
semble avoir changé d’étiquette. La question porte plutôt sur son travail sur la langue.
Blanchot, dans une moindre mesure qu’Artaud6 certes, fait de la langue une matière
brute, une matière à œuvrer.
Le passage de la première à la seconde édition de Thomas l’Obscur fournit une occa-
sion de comprendre le projet général de Blanchot. Il est étonnant d’ailleurs de voir com-
ment certains commentateurs vont chercher dans la différence matérielle des deux
versions une différence catégorielle : le roman devenant récit. Lorsque Blanchot écrit en
ouverture de sa deuxième version de Thomas l’Obscur qu’elle n’ajoute rien par rapport à
la première, ce n’est pas au sens d’augmentation qu’il faut comprendre « ajouter ». De la
même manière, quand il écrit dans le même texte qu’« elle leur ôte beaucoup », cela ne
veut pas dire qu’il y a soustraction ou disparition. S’il y a perte, c’est au sens où elle est
un gain non quantifiable, c’est-à-dire sans plus-value ou moins value. Il n’y a aucune
le lecteur serait, lui, solitaire. La question est de savoir si, en supprimant une partie de son texte,
Blanchot met son lecteur devant une disparition ou un vide. Le vide laissé par Blanchot est-il une
absence ou une présence, à l’image de l’apôtre Jean, qui, devant le tombeau vide du Christ, confirme
sa croyance ?
5. La Folie du jour, L’Arrêt de mort, Au Moment voulu, Celui qui ne m’accompagnait pas, Le Der-
nier homme, sont des ouvrages de Blanchot.
6. Parler de la langue d’Artaud reviendrait à réduire son travail à une stylistique. Par contre, dire
Artaud et la langue, c’est le moyen de montrer comment la langue devient un corps à part, un être
vivant et autonome que l’écrivain combat pour la faire rompre. Artaud parlerait à côté de la
langue en quelque sorte dans une écriture sans langue. Sur cette question du rapport entre Artaud
et la langue, voir Milon Alain, La Fêlure du cri : violence et écriture, Paris, Encre marine, 2010 et
L’Écriture de soi : ce lointain intérieur. Moments d’hospitalité littéraire autour d’Antonin Artaud,
La Versanne : Encre marine, 2005. Voir aussi Antonin Artaud : autour de Suppôts et Suppliciations,
Milon Alain et Rippol Ricard (dir.), Paris, Presses universitaires de Paris Ouest, 2013.
15
Blanchot.indb 15 29/11/13 11:56
valeur marchande dans ce genre de gain non quantifiable, ni ajout, ni perte en fait mais
l’expression d’une distinction. Au lecteur d’accepter qu’en ôtant quelque chose à un texte,
on peut donner encore plus en l’obligeant à se concentrer sur l’essentiel. Finalement, cette
perte ne retire rien au roman pour l’offrir au récit. Elle permet juste de viser l’essentiel et
l’immédiat : « […] la présente version n’ajoute rien, mais comme elle leur ôte beaucoup,
on peut la dire autre et même toute nouvelle, mais aussi toute pareille, si, entre la figure
et ce qui en est ou s’en croit le centre, l’on a raison de ne pas distinguer, chaque fois que
la figure complète n’exprime elle-même que la recherche d’un centre imaginaire7. »
Ce centre imaginaire est le cœur du travail de Blanchot. Il montre comment l’écrivain
s’y prend pour redéployer la langue sur elle-même afin d’en mesurer les limites et les
faiblesses. Ce redéploiement de la langue prend quelquefois un aspect physique – les
artifices typographiques, par exemple, pour signaler ici et là la présence d’un fragment
clairement revendiqué comme dans Le Pas au-delà, L’Attente l’oubli ou L’Écriture du
désastre. Mais il peut aussi prendre un autre aspect, le plus fréquent en fait, quand il est
inscrit dans le corps même de l’écriture et qu’il constitue la matière même de la langue.
Il est là en fait pour rappeler l’agencement général du projet blanchotien : la fabrication
d’une langue littéraire pour reléguer la langue ordinaire et tenter de toucher « l’infor-
mulé dans le connu du mot ». Que le traitement de cet informulé soit pensé dans ses
textes critiques ou qu’il soit vécu dans ses romans et récits, cela ne change rien au pro-
blème. Dans cette entreprise de relégation en fait, la question du genre littéraire devient
complètement anecdotique. Seule l’ulcération du mot importe pour saisir la folie du
langage : « Que la folie soit présente dans tout langage ne suffit pas à établir qu’elle n’y est
pas omise. Le nom pourrait l’éluder en ceci que le nom comme nom donne au langage
qui l’utilise pour une communication tranquille le droit d’oublier qu’avec ce mot hors
mot s’introduit la rupture du langage avec lui-même : rupture que seul un « autre » lan-
gage permettrait de dire (sans du reste la communiquer)8. » La nomination ne stabilise
qu’une langue morte, une langue qui sert d’outil de communication même si cela peut
paraître paradoxal d’envisager l’acte de communication comme un « arrêt de mort ».
Par contre, dès l’instant où cette nomination se réalise par la folie du langage, la langue
reprend vie, alors que cette vitalité s’inscrit dans l’impossibilité de nommer. La folie du
7. Blanchot Maurice, « Avertissement », in Thomas l’Obscur (2e version), Paris, Gallimard,
« L’Imaginaire », 1992, p. 8.
8. Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, Paris, Gallimard, 1973, p. 67.
16
Blanchot.indb 16 29/11/13 11:56
langage devient le point d’attaque qui permet à Blanchot de construire tout son système
d’écriture à partir de l’opposition entre langage ordinaire (langue de communication) et
langage littéraire (La Folie du jour).
Le mot, apparemment, porte un énoncé identifié, mais plus il s’énonce, plus il annonce
un « improbable » qui révèle l’étendue de ses multiples incapacités. Cette possibilité
d’écriture reformule sans cesse son impossibilité à dire : « Si, pour nier, il faut dire et,
disant, affirmer ; si, en conséquence, le langage semble ne pouvoir se libérer d’une pre-
mière affirmation, de sorte que, lorsque tu parles, tu es déjà prisonnier, luttant toujours
en retard contre elle, d’une énonciation qui s’affirme d’abord comme parole et affirme
dans la parole, il faudrait encore savoir ce que veut dire cette affirmation, énonciation9. »
La puissance de la phrase n’est pas dans le mot proféré mais dans sa gestation, une gesta-
tion bien singulière qui tente de nier ce qu’elle cherche à mettre au monde. Blanchot
retrouve Michaux : « Les tables elles-mêmes parlent, à ce qu’on dit, de se libérer de leurs
fibres10. » Tout dans la table la pousse à se libérer de sa nature de table. Tout dans la
phrase la pousse à s’affranchir de sa nature de mot et du sens qu’il porte. Ce n’est pas
l’accouchement qui est heureux – la création littéraire enfantant un texte –, mais la ges-
tation qui s’interroge sur les raisons d’être de ce qu’elle porte en elle et qui se dit, à chaque
occasion, qu’il est encore temps de tout arrêter ; tout arrêter car la seule certitude est celle
de l’incertitude qui accompagne l’acte d’écriture : « La certitude qu’en écrivant il mettait
précisément entre parenthèses cette certitude, y compris la certitude de lui-même comme
sujet d’écrire, le conduisit lentement, cependant aussitôt, dans un espace vide dont le
vide […] n’empêchait nullement les tours et détours d’un chemin très long11. »
La nomination s’inscrit ainsi dans un processus d’exclusion du mot dont l’effet est
double puisqu’elle énonce autant son impossibilité de nommer que sa possibilité. Il ne
s’agit pas de jouer avec les situations paradoxales – toujours écrire cette impossibilité
d’écrire ou parler de l’impossibilité de dire12 –, ni de dire qu’il est impossible au mot de
nommer, mais de montrer simplement que cette impossibilité est à l’origine du mouvement
9. Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, op. cit., p. 70.
10. Michaux Henri, « La Vie dans les plis », in Œuvres complètes. Tome II, Paris, Gallimard,
« Bibliothèque de La Pléiade », 2001, p. 213.
11. Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, op. cit., p. 9. Il ne faut pas oublier que Blanchot a fait
son mémoire de fin d’études en philosophie sur le dogmatisme chez les sceptiques.
12. C’est le sens de l’article de Laporte Roger, « Le oui, le non, le neutre », in Critique, op. cit., p. 579.
17
Blanchot.indb 17 29/11/13 11:56
même de la langue : « Le mot n’a de sens que s’il nous débarrasse de l’objet qu’il nomme13. »
Cette impossibilité de la langue se traduit dans la langue littéraire par l’effet palimpseste de
l’acte d’écriture : « Écrire, c’est peut-être non-écrire en réécrivant – effacer (en écrivant par-
dessus) ce qui n’est pas encore écrit et que la réécriture non seulement recouvre, mais
restaure obliquement en la recouvrant, en obligeant à penser qu’il y avait quelque chose
d’antérieur14… » L’acte d’écriture est avant tout une opération de déchiffrement d’un
manuscrit déjà écrit que chaque écrivain se contente de reformuler selon son style. Mais le
style n’est pas une mise en forme spécifique à chaque auteur ; plutôt la mise en branle d’une
puissance d’écriture propre à sa folie. L’écriture de Céline condamne le style pour lui
permettre de réveiller, par son style, sa propre mise à mort.
Quant à cette impuissance de la langue sur laquelle Blanchot construit toute son œuvre,
nous retrouvons là les vieilles querelles de la philosophie antique entre Aristote, Platon et
Antisthène15, querelles relayées par Mallarmé dont Foucault dira, à propos de son
interrogation poétique, que « le mot est l’inexistence manifeste de ce qu’il désigne16 ».
Blanchot soumet la nomination à la perte et l’effacement de la désignation dont le sujet
n’est qu’un effet collatéral bien peu important. Aller vers une certaine sécheresse, c’est la
quête du dialogue sans personnage de L’Attente l’oubli : « Ils cherchaient l’un et l’autre la
pauvreté dans le langage. Sur ce point ils s’accordaient. Toujours, pour elle, il y avait trop
de mots et un mot de trop, de plus des mots trop riches et qui parlaient avec excès. Bien
qu’elle fût apparemment peu savante, elle semblait toujours préférer les mots abstraits, qui
n’évoquaient rien17. » Viser la pauvreté du langage, c’est faire l’économie du mot de trop
qui transforme la langue en moyen de communication. Dans Le Pas au-delà, Blanchot
13. Blanchot Maurice, La Part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 37.
14. Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, op. cit., p. 67.
15. Pour Antisthène, contrairement à ce que pense Aristote, toute définition est impossible puisqu’elle
substitue à l’essence de la chose des péri ou paraphrases. En critiquant vertement les partisans
d’Antisthène, Aristote écrira dans le livre H, 3, 25, de la Métaphysique : « Ils prétendent qu’il n’est pas
possible de définir l’essence, parce que la définition n’est que du verbiage, et qu’on peut seulement faire
connaître quelle sorte de chose c’est : on dira de l’argent, par exemple, non pas ce qu’il est en lui-même,
mais qu’il est comme de l’étain. » (Paris, Vrin, 1974, p. 466, trad. J. Tricot). Pour Antisthène, une chose
peut être nommée sans être définie. Pour Platon au contraire, il faut viser l’exigence définitionnelle
pour arriver au constat énoncé dans Cratyle selon lequel connaître le mot c’est connaître la chose ; le
Théétète donnant la réponse finale et montrant que la question n’est pas de savoir si le mot dit ou non
la chose, si le mot est ou non un instrument, mais de rechercher le sens et la signification de la réalité.
16. Foucault Michel, « La pensée du dehors », in Critique, op. cit., p. 543.
17. Blanchot Maurice, L’Attente l’oubli, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 2000, p. 16.
18
Blanchot.indb 18 29/11/13 11:56
insistera sur les raisons pour lesquelles le langage, celui de la langue littéraire, n’est pas un
instrument de communication, comme nous l’évoquions précédemment, mais une mise à
nu, mise à nu qui rappelle la nudité première de René Char18.
Finalement, Blanchot bégaie et réécrit sans cesse la même formule en la ponctuant
d’interrogations puissantes, matière même de tous ses textes. Chaque ligne écrite résonne
de son propre écho. Elle se demande comment saisir le sens qu’il y a dans le mot sans le
formuler par le mot. « Exprimer sans mots le sens des mots19 » revient comme une sorte
de ritournelle qui nous indique le territoire de la langue. Sorte de ritournelle sans refrain
parce que le territoire de la langue reste à trouver20, l’écriture laisse inexprimé l’expri-
mer21. Thomas ne peut rien devant cette économie verbale à la mesure de la prolixité de
son auteur. Plus le texte s’écrit, plus il enlise le lecteur dans le gouffre d’une écriture qui
ne cesse d’interroger, autant Blanchot sur les raisons mêmes d’écrire, que Thomas sur ce
qui le pousse à exister comme protagoniste.
Des personnages disparaissent dans la deuxième version de Thomas l’Obscur, soit !
Irène n’est plus, mais sa disparition n’est-elle pas le moyen que Blanchot a trouvé pour
se demander si les personnages sont d’une quelconque utilité dans le déroulement de la
trame romanesque ? D’ailleurs Thomas et Anne sont-ils des personnages, des doubles
d’eux-mêmes ou des miroirs renvoyant une absence de sujet22 ?
18. Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, op. cit., p. 57.
19. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, 2e version, 1950. Paris, Gallimard, « L’Imaginaire »,
1992, p. 61.
20. L’écriture est ritournelle au sens où la ritournelle se définit comme un « ensemble de
matières d’expression qui trace un territoire, et qui se développe en motifs territoriaux, en pay-
sages territoriaux », voir Deleuze Gilles, Guattari Félix, Mille plateaux, Paris, Les Éditions de
Minuit, 1980, p. 397. Les ritournelles se différencient selon les marquages territoriaux qu’elles
mettent en scène. Il existe ainsi des ritournelles territoriales qui agencent un territoire, des ritour-
nelles de fonctions territorialisées comme la berceuse qui territorialise le sommeil, des ritour-
nelles de fonctions territorialisées comme les comptines qui proposent de nouveaux agencements
dont la forme est spécifique au sens où elles ne sont pas chantées de la même manière selon les
endroits, et des ritournelles qui permettent de rassembler des forces pour partir comme les ritour-
nelles de départ, voir Deleuze Gilles, Guattari Félix, Mille plateaux, op. cit., p. 402-403.
21. « Exprimer cela seulement qui ne peut l’être. Le laisser inexprimé », Blanchot Maurice,
L’Attente l’oubli, op. cit., p. 27.
22. J. Starobinsky note que la première version de Thomas l’Obscur « fait intervenir des
“apparitions-disparitions” de personnages ou d’objets : après un instant de proximité ». Voir
Starobinsky Jean, « Thomas l’Obscur. Chapitre Ier », in Critique, op. cit., p. 501.
19
Blanchot.indb 19 29/11/13 11:56
Thomas signifie jumeau en araméen. Mais le double n’est pas seulement la duplication
d’une chose ; il peut être duplicité, autrement dit il peut avoir le caractère des choses qui
ne se montrent pas telles qu’elles sont réellement. Et c’est là tout l’enjeu de cet informulé
dans le connu du mot que Blanchot explore. Le double ne double pas, tout comme deux
n’est pas deux fois un. Le double de Thomas affirme plutôt l’impossibilité de l’unité,
l’impossible fixation du sens : « Cet être [Thomas] qui était lui-même et qui se séparait
de lui23. » Si Thomas le double ne double pas les choses, c’est parce que Blanchot
condamne l’idée même d’unité et les modalités qui l’accompagnent. Pas d’état, pas de
stabilité, pas d’assise, pas de modalité constituée de l’un. En fait, par le mot, Blanchot
active une fissure à l’origine du mouvement singulier qui anime la langue.
La fissure n’est pas une fracture dont l’effet serait de séparer les choses en plusieurs
morceaux. L’essentiel n’est pas que les choses se brisent, mais qu’elles vivent de brisures.
La force du mot n’est pas qu’il se scinde et se fracture, mais qu’il vive de scissions et de
fissures. Vivre de brisures pour capter le mouvement intérieur de la langue, sa modula-
tion à la manière de tous ceux qui « marchaient ainsi, immobiles à l’intérieur du mou-
vement24 ». Marcher immobile à l’intérieur du mouvement, c’est aussi la manière dont
Thomas se déplace quand il est pris par l’angoisse de la nuit : « C’était une modulation
dans ce qui n’existait pas, une manière différente d’être absent, un autre vide dans lequel
il s’animait25. » Mais c’est surtout la manière dont Blanchot compose plus qu’il n’écrit,
immobile dans l’écriture à l’intérieur du mouvement de la phrase. C’est là la singularité
de sa composition musicale. La phrase bouge en vivant de brisures pour rendre compte
de son informulé. Dans l’usage que Blanchot fait de la langue littéraire, le mot dans la
phrase n’est jamais envisagé comme le moyen de segmenter la réalité pour arriver à tra-
duire un sens. Il provoque plutôt un mouvement d’ondulation que la phrase retrace.
En écrivant Thomas l’Obscur, Aminadab, Le Très Haut, il enchâsse des lignes sans fin
qui se renvoient l’une l’autre leur propre écho en trouvant l’occasion de refuser les lois
de l’arithmétique. Blanchot n’additionne rien ; il ne redouble pas son écriture en la
dupliquant. Il écrit plutôt par-dessous pour soustraire le factuel jusqu’à mettre au jour
son intention première : le processus d’énonciation d’une impossible nomination pour
toucher l’informulé dans le connu du mot : « Le mot me donne ce qu’il signifie, mais
23. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur. 1re version, 1941. Paris, Gallimard, 2005, p. 47.
24. Blanchot Maurice, L’Attente l’oubli, op. cit., p. 40.
25. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, 2e version, op. cit., p. 30.
20
Blanchot.indb 20 29/11/13 11:56
d’abord il le supprime26. » Pris par une sorte d’économie verbale d’un autre genre
puisque Blanchot reste tout de même un écrivain insatiable, son écriture efface la dupli-
cation – la répétition du même dans l’identique – pour révéler la duplicité – la répéti-
tion du même dans la différence27. Il donne l’impression de dupliquer la même formule
tout au long de ses écrits : « Dans chaque mot, tous les mots28 », alors qu’en même temps
il cherche à atteindre une « duplicité » pour alléger son écriture : « Exprimer sans mots
le sens des mots29. »
Cette duplicité dans la duplication rend compte du mouvement intérieur de l’écriture,
mouvement immobile que Blanchot traduit de la manière suivante : « Dans chaque mot,
non pas les mots, mais l’espace qu’apparaissant, disparaissant, ils désignent comme l’es-
pace mouvant de leur apparition et de leur disparition30. » Cet espace mouvant n’est pas
circonscrit par une géométrie spatiale mais par une géométrie poétique refusant toute
sorte de repères, d’axes ou de plans. C’est la géométrie poétique qui fait du mot, non pas
un lieu de signification, mais un processus, un mouvement faisant apparaître et dispa-
raître le mot lui-même. Et ceci d’autant plus qu’il est souvent question du vide pour
qualifier cette géométrie. Les couloirs, chambres, étendues sont souvent vacantes chez
Blanchot, et dans ces espaces nus des bruits retentissent : « La caractéristique de la
chambre est son vide… Les voix résonnent dans l’immense vide, le vide des voix et le
vide de ce lieu vide31. »
26. Blanchot Maurice, La Part du feu, op. cit., p. 312.
27. Cette lecture de l’éternel retour comme répétition du même dans l’identique, puis retour du
même dans la différence, nous la retrouvons chez Blanchot dans Le Pas au-delà, op. cit., p. 21 :
« L’Éternel Retour du Même : le même, c’est-à-dire le moi-même en tant qu’il résume la règle
d’identité, c’est-à-dire le moi présent. Mais l’exigence du retour, excluant du temps tout mode
présent, ne libérait jamais un maintenant où le même reviendrait au même, au moi-même. » Le
même se révèle d’abord dans l’identique, puis dans la différence.
28. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 528. Cela renvoie à une
formule identique de Thomas l’Obscur. 1re version, op. cit., p. 44 : « […] observé par un mot
comme par un être vivant, et non seulement par un mot, mais par tous les mots qui se trouvaient
dans ce mot, par tous ceux qui l’accompagnaient et qui à leur tour contenaient en eux-mêmes
d’autres mots. »
29. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, 2e version, op. cit., p. 61.
30. Blanchot Maurice, L’Attente l’oubli, op. cit., p. 101-102.
31. Ibid., p. 14-15.
21
Blanchot.indb 21 29/11/13 11:56
Lévinas s’attarde sur la singularité d’une telle géométrie dans l’écriture de Blanchot.
En prenant appui sur L’Attente l’oubli, il écrit : « Le langage est fermé comme cette
chambre32. » Le langage semble se prendre lui-même dans cette fermeture au sens où les
mots qu’il utilise agissent comme des serrures emprisonnant le sens une fois pour toute.
La phrase s’organise alors comme une succession de chambres closes qui se succèdent
pour s’ouvrir sur les suivantes qui ferment les précédentes et cela sans fin… Les mots ne
sont pas pour autant des espaces indépendants les uns des autres. Ce sont simplement
des occasions pour passer d’une pièce à l’autre afin de traduire une seule impression :
« Ne pas s’en sortir d’en sortir33. » Finalement, la question que pose Blanchot lorsqu’il
parle de la chambre, c’est de savoir si la langue est à l’intérieur ou l’extérieur de la pièce,
et surtout comment effacer les traces de son passage, obsession récurrente dans L’Attente
l’oubli. Tout le problème avec cet auteur est de savoir si l’écriture peut être le moyen de
briser la clôture de la chambre qui enferme la langue. La pièce étant le mot, elle enserre-
rait la langue que seule l’écriture permettrait de libérer. Mais l’écriture ne dit pas les
choses par ce qu’elle écrit. Elle n’énonce rien ; elle semble plutôt s’emmurer elle-même.
Lévinas fait remarquer que l’acte ontologique que le discours accompli au moment où il
s’énonce, l’emmure à l’instant même de son énonciation34. Mais l’essentiel n’est pas que
la chose se brise mais qu’elle vive de brisure. Il en est de même avec le mot : l’essentiel est
qu’il fasse vivre la langue de ses brisures ; l’écriture devenant alors l’occasion de faire
vibrer le mot dans sa modulation35.
Effacer par le mot la trace du mot, c’est l’autre piège que nous tend la langue. Nous
sommes pris par la malice de la langue pour Blanchot, mais plus que la question de
savoir où est la langue, c’est son mouvement qu’il faut saisir, un mouvement ondulant
sur lui-même, en prise avec l’incertitude qu’elle provoque. Plus de garantie quant au
sens que le mot porte, plus de certitude quant à l’emplacement où se trouve la langue.
On retrouve bien ici la nature de la modulation : mettre les choses dans un mouvement
32. Lévinas Emmanuel, Sur Maurice Blanchot, Montpellier, Fata Morgana, 1975, p. 35.
33. Ibid., p. 35.
34. Ibid., p. 32.
35. Dans Une Chambre à soi, Virginia Woolf pose la même question que Blanchot dans L’Attente
l’oubli. Une chambre à soi ce n’est pas trouver un endroit tranquille pour écrire comme si l’écri-
ture était liée à la tranquillité. Une chambre à soi, c’est la chambre à soi de l’écriture, l’occasion
pour l’écrivain de commencer à comprendre véritablement le mouvement de la langue, le mou-
vement des choses qui se font en se faisant, saisir Les Vagues dirait V. Woolf.
22
Blanchot.indb 22 29/11/13 11:56
et non dans un état. La modulation chante la mélodie des choses qui se font en se faisant
sans s’arrêter à un centre ou à un commencement. C’est ce même mouvement que l’on
retrouve dans le redéploiement de la duplicité – la fiction – dans la duplication – la réa-
lité –, mouvement que Thomas l’Obscur exprime parfaitement.
Thomas l’Obscur, aussi peu roman que récit, illustre bien les nuances qui existent entre
duplication et duplicité, variation et variante. Thomas l’Obscur, roman, première version,
n’est pas la duplication du Thomas l’Obscur, récit, deuxième version, non pas parce
qu’entre les deux plusieurs versions sont envisagées, mais parce qu’entre les dix ans qui
séparent les deux publications, la question de la nomination reste identique. Le problème
n’est pas celui de la croissance d’un texte, ou de la superposition de couches. Et que
peuvent apporter les sept ou huit autres versions de Thomas l’Obscur dès l’instant où l’on
ne s’intéresse pas à la genèse d’un texte, mais aux raisons de son impossible énonciation ?
Blanchot n’empile pas des versions les unes sur les autres ; il cherche plutôt à mettre au
jour la duplicité de Thomas l’Obscur. Ce texte devient alors la formulation explicite de
toutes ces différences que le corps de la phrase révèle. Ce roman et ce récit sont tout autant
le même texte que deux clichés d’une même écriture en train de se faire. Ce n’est pas une
modalité littéraire qui rendrait Thomas l’Obscur définitivement roman ou définitivement
récit que l’auteur cherche, mais le conatus de l’écriture, l’effort, le mouvement du texte qui
met en scène le processus de différenciation, sa modulation finalement, expression de la
multiplicité de la phrase, l’impulsion de ce qui advient de la nomination.
Blanchot, par la voix d’un double, Thomas, fait le choix du processus de différencia-
tion qu’instaure la soustraction, le n-1, plutôt que celui de l’homogénéité de l’addition,
le n+1. Thomas l’Obscur reformule sans cesse son refus de l’unité, que ce soit celle cir-
conscrite par l’énoncé contenu dans le mot, ou celle du refus d’un centre, point d’an-
crage et surtout point de repère. Dans son avant-propos à la deuxième édition, Blanchot
formule cette idée : « […] l’on a raison de ne pas distinguer, chaque fois que la figure
complète n’exprime elle-même que la recherche d’un centre imaginaire36. » Il n’y a pas
de centre parce qu’accepter un point focal c’est admettre implicitement l’existence d’une
36. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, 2e version, op. cit., p. 7. Dans l’avertissement de
L’Espace littéraire, Blanchot parle d’un centre non fixe qui attire le « livre même fragmentaire ».
Cette question du centre caché est récurrente chez Blanchot : « Ce livre est mystérieux parce qu’il
tourne autour d’un centre caché dont l’auteur n’a pu s’approcher. », in L’Espace littéraire, Paris,
Gallimard, 1955, p. 166.
23
Blanchot.indb 23 29/11/13 11:56
stabilité sémantique dans la langue littéraire, mais c’est surtout s’enfermer dans la
chambre, celle évoquée plus haut de L’Attente l’oubli, espace mort de l’écriture. Il n’y a
pas de centre, hormis un centre imaginaire, pour Blanchot. Pas de centre pour éviter de
tomber dans le piège du point d’attache, celui qui ordonne au récit de suivre un itiné-
raire avec un commencement et une fin, mais surtout avec un auteur revendiquant une
appropriation littéraire. Et ceci d’autant plus que toute écriture semble obéir à « la
modalité du “peut-être”37 ». Ni oui, ni non, un peut-être, autre reformulation d’un « on »
pris dans l’espace du neutre38.
En réalité, Blanchot n’écrit pas ; il passe son temps à annoncer une tentative d’écriture.
Le lecteur n’est pas fasciné par un texte qui lui apporte quelque chose. Il est plutôt pris
dans un mouvement de révolte quand il a lu un texte qui lui retire ce qu’il aurait voulu
écrire. Ce rapport entre le lecteur et l’auteur se construit sur une distance intérieure,
celle qui fissure le rapport moi-autrui, une distance qui permet à la présence de s’affir-
mer : « […] nous n’avons de relations avec autrui que si nous ne sommes pas confondus
avec autrui, nous ne communiquons pleinement avec quelqu’un qu’en possédant, non
pas ce qu’il est, mais ce qui nous sépare de lui, son absence plutôt que sa présence et,
mieux encore, le mouvement infini pour dépasser et faire renaître cette absence39. » La
voie araméenne de Thomas annonce celle des pré-socratiques, Héraclite, notamment,
qui, dans son Fragment XXXI, questionne la nature du double comme moitié.
Le double comme moitié est le principe qui fonde l’écriture de Blanchot. Ce double
comme moitié s’inscrit dans l’idée que le même n’est pas l’identique, proposition que
Parménide faisait déjà dans son Fragment III : « Car même chose sont le penser et
37. Lévinas Emmanuel, Sur Maurice Blanchot, op. cit., note 1, p. 78.
38. Blanchot a été fortement marqué par la lecture de Hegel. On retrouve ici et là des traces de
la pensée du philosophe allemand, notamment en ce qui concerne la question de l’impossibilité
de dire « Je ». L’écrivain trouve chez Hegel la justification ontologique du « on ». Dans Une Voix
venue d’ailleurs, il cite Hegel pour asseoir la question du neutre : « D’où il résulte et, c’est très
important : “L’entité que je fus ne peut plus dire ‘je’. ‘Je’ ne peut plus se parler alors qu’à la troi-
sième personne”. C’est ainsi que Hegel en vient à “nous” (nous, c’est-à-dire moi alors et mainte-
nant). », Paris, Éditions Virgile, p. 29. Mais il ne faut jamais oublier que derrière ce « Je », ce « Il »,
ce « On », c’est le « Il y a », le Neutre, autrement dit l’effacement, par le langage, de tout sujet : « Le
moi est alors une abréviation que l’on peut dire canonique… », in Blanchot Maurice, Le Pas
au-delà, op. cit., p. 12.
39. Blanchot Maurice, La Part du feu, op. cit., p. 229.
24
Blanchot.indb 24 29/11/13 11:56
l’être40. » Penser et Être sont le même, cela ne veut pas dire qu’ils sont identiques. Ce n’est
pas une tautologie, c’est plutôt reconnaître que le « et » n’a pas de valeur additive mais
qu’il interroge le lieu de la pensée. Le « et » devient l’occasion de réfléchir sur l’empiéte-
ment de l’un sur l’autre, empiétement qui prend la forme d’une brisure, brisure ontolo-
gique, celle de la philosophie qu’évoque K. Axelos quand il analyse ce fragment41.
Pour comprendre la nature du double comme moitié de l’écriture de Blanchot, il faut
revenir au Fragment XXXI de « De la Nature » lorsqu’Héraclite écrit : « Métamorphose
du Feu : en premier lieu la Mer : et de la Mer, la moitié Terre et la moitié prestèr
(prhsthr)… (Terre) coule en Mer, et est mesurée selon le même logos, tel qu’il fut en
premier lieu42. » Ce prester, qui est un « presque » la terre, permet de comprendre
comment s’agence l’écriture de Blanchot. Et si nous citons la traduction de Clémence
Ramnoux, c’est aussi parce que Blanchot a écrit la préface de cet ouvrage republiée dans
L’Entretien infini dans laquelle il rappelle l’importance de la pensée pré-socratique dans
sa conception du langage.
Le double pour Héraclite n’est pas la multiplication par deux d’une unité, mais la pré-
sence potentielle d’une scission que l’idée de moitié actualise. La moitié n’est pas un état
mais un mouvement. Plus que la moitié comme résultat d’une division, c’est la moitié
comme mise en mouvement des choses qu’Héraclite expose dans son Fragment XXXI.
Le feu est une moitié de l’eau, et la terre une moitié de la mer. Mais le feu comme moitié
de l’eau, et l’eau comme moitié du feu ce n’est pas pour justifier l’existence du feu comme
élément à part entière pris dans un état précis. Non, le double comme moitié est là pour
rendre compte du prolongement des choses, de leur mouvement, mais surtout du pro-
cessus qui les fait agir. Quand le feu se prolonge dans la terre et la terre se prolonge dans
le feu, pour Héraclite, c’est pour signaler que le prolongement importe plus que l’état
dans lequel se trouve l’élément lui-même. Le prolongement permet de rendre compte
40. Parménide, « De la Nature », in Les Présocratiques, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », 1988, p. 258.
41. Axelos Kostas, Ce qui advient, Paris, Les Belles Lettres, « Encre marine », 2009, p. 40. Par-
ménide rappelle en écho le Fragment LXXXVIII d’Héraclite : « Même chose en nous/ être vivant
ou être mort/ être éveillé ou être endormi/ être jeune ou être vieux/ Car ceux-ci se changent en
ceux-là/ et ceux-là de nouveau se changent en ceux-ci. », dans « Fragments », in Les Présocratiques,
op. cit., p. 166.
42. Héraclite, « Fragment XXXI » traduit par Clémence Ramnoux, in Ramnoux Clémence,
Héraclite ou l’Homme entre les choses et les mots, Paris, Les Belles Lettres, 1968, p. 77.
25
Blanchot.indb 25 29/11/13 11:56
du mouvement qui anime le flux du feu et de la terre pris dans un processus commun,
celui du devenir, celui de ce qui advient des choses.
Tout est double dans sa moitié pour montrer que l’unité est impossible. Ce double si
singulier, quand il est pensé comme principe ontologique montre que l’unité arithmé-
tique est aussi un leurre. La terre n’est pas une unité, elle est simplement la possibilité pour
la mer d’exister comme double de la terre, et il en est de même pour la mer. La mer est la
possibilité d’être le double de la terre. Le double s’affirme alors, non comme une addition,
mais une continuité prise dans un devenir qui s’inscrit lui-même dans un processus de
différenciation. Le double comme moitié est ainsi le moyen de rendre l’unité impossible.
Le fragment XXXI d’Héraclite nous permet de mieux comprendre que la moitié d’une
chose n’est pas sa séparation en deux, mais la possibilité pour cette chose d’être double.
C’est par ce biais que l’on commence à saisir la nature profonde de la séparation.
Il y a ainsi une vision pauvre du double, deux fois un, et une vision plus interrogative
du double quand il s’affirme comme l’impossibilité pour une chose d’être une. Le double
comme moitié, ce n’est pas la moitié du double, une moitié constituée par deux unités,
mais la scission dans le double. Finalement, on retrouve le double, non comme duplica-
tion mais comme duplicité, et derrière la duplicité, la fracture et la fissure. En réalité, le
double ne double pas. Ce refus de l’unité va du devenir d’Héraclite à la condamnation
du positivisme et de l’accumulation des connaissances chez Péguy dans Clio43 en passant
par la logique de la différence contre logique de la préférence de Lavelle44, l’économie
générale de Bataille45 avec la perte comme gain non quantifiable, ou Blanchot et son
innommable dans le connu du mot.
Blanchot fera souvent référence à la duplicité de l’unité pour évoquer l’impossible
stabilité de l’homme : « S’il est vrai qu’il y a (dans la langue chinoise) un caractère d’écri-
ture indiquant à la fois “homme” et “deux”, il est facile de reconnaître dans l’homme
celui qui est toujours soi et l’autre, la dualité heureuse du dialogue et la possibilité de la
communication. Mais il est moins facile, plus important peut-être de penser “homme”,
c’est-à-dire aussi “deux” comme l’écart auquel manque l’unité, le saut du 0 à la dualité,
43. Péguy Charles, « Clio », in Œuvres en prose, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade »,
1961.
44. Lavelle Louis, Traité des valeurs, Paris, PUF, 1951.
45. Bataille Georges, « La notion de dépense », in La Part maudite, Paris, Les Éditions de
Minuit, 1967.
26
Blanchot.indb 26 29/11/13 11:56
le 1 se donnant alors comme l’interdit, l’entre-deux46. » La dualité n’est pas dans la scis-
sion mais dans l’impossibilité d’envisager une unité. Le double comme moitié serait ici
la capacité de l’homme à creuser l’écart : le deux devient ce qui creuse l’écart entre le 0 et
la dualité, alors que le 1 n’est plus une unité mais ce qui permet de penser le refus de
l’unité. Le un n’est pas un élément à part entière mais la possibilité laissée à une chose de
se laisser porter par le processus. Il y a là une autre arithmétique qui fait de la soustrac-
tion la puissance du mouvement de la langue – la langue littéraire pour laquelle les mots
sont à saisir par le retrait qu’ils provoquent –, et de l’addition la répétition de l’identité
– la langue ordinaire pour laquelle les mots reproduisent leur vacuité.
La variation se définit comme un changement d’aspect, de degré ou de valeur. Elle
peut dans certains cas se mesurer selon un écart type qui détermine son coefficient de
variation. On parle alors de variance. La variante, elle, est le mouvement intérieur de ce
changement. Plus nuancée et plus subtile, la variante permet de saisir la douce modula-
tion d’un ensemble apparemment homogène. En musique, on parlerait de différence de
motif pour qualifier la variante. C’est d’ailleurs de cette manière qu’Adorno analyse,
dans son ouvrage Mahler, la différence entre variante et forme ; la variante n’étant pas
une autre forme mais l’expression d’un motif différent. L’ensemble paraît, de l’extérieur,
similaire sauf pour ceux qui saisissent, de l’intérieur, la nuance. La variante dans la
musique de Mahler, mais cela vaut aussi pour celle de Bartók, est le moyen de faire appa-
raître une distance dans ce qui semble identique. Il ne s’agit pas de répéter à l’identique
des thèmes folkloriques du passé, mais de dégager, à partir de ces thèmes, des motifs
autres. Par ce biais, le musicien met au jour, dans chaque ligne mélodique, les nuances
du thème musical qui semble invariant. Bartók dira que la musique retrouve ainsi « sa
langue maternelle47 » pour inventer une imitation48 sans qu’il soit question de faire
preuve d’originalité à tout prix, ou s’il y a recherche d’originalité c’est uniquement au
sens du silence de la subjectivité.
46. Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, op. cit., p. 57. En réalité, on ne sait pas de quel idéo-
gramme Blanchot parle. En chinois, le caractère人signifie « homme ». Pour dire « homme » et
« deux », il fait peut-être allusion à un idéogramme (combinaison de caractères) 仁 qui signifie
charité entre deux hommes, au sens éthique : 人 (homme), 子 (personne/fils/homme), 大 (grand).
47. Bartók Béla, Bartók, sa vie et son œuvre, Paris, Boosey & Hawkes, 1956, p. 155.
48. Ibid., p. 158.
27
Blanchot.indb 27 29/11/13 11:56
Dans le cas des deux versions de Thomas l’Obscur, la question n’est même pas de savoir
si l’une remplace l’autre ou si la deuxième version est une variation de la première. Cela
ne veut pas dire que Blanchot radote, mais simplement qu’il est dans la reformulation
incessante, « le ressassement d’une vieille histoire, sans commencement ni fin, un
remous impersonnel et profond49… » et c’est comme cela que se traduit le retour du
même dans la différence, de la question de la nomination. La mort, l’Au-Delà, le Très-
Haut, sont, plus que des thèmes, des occasions d’interroger les limites de la nomination.
Blanchot se satisfait d’être ainsi pris dans le croisement de la pensée d’Héraclite et de
celle de Parménide, mais qui oserait s’en plaindre ?
Mais son écriture est aussi prise dans un autre paradoxe, tout aussi intérieur que celui
de l’informulé ; c’est celui du balancement des contraires : « Tout ce qu’Anne aimait
encore, le silence et la solitude, s’appelait la nuit. Tout ce qu’Anne détestait, le silence et
la solitude, s’appelait aussi la nuit50. » À l’origine de chaque mise en branle de la phrase
blanchotienne, se cache une affirmation qui énonce son contraire, seul moyen pour lui
de permettre à la phrase de vivre par ses brisures. Le contraire ne brise pas l’affirmation
puisqu’il est déjà présent avant que la phrase ne soit énoncée. Un contraire brisant une
phrase, ce serait une formule contradictoire : formuler A pour ensuite énoncer non-A.
Avec Blanchot, le contraire n’est pas formel ; il est inscrit au plus profond de son expres-
sion et explique le mouvement intérieur de l’écriture : « […] attendre est l’impossibilité
d’attendre51 » ou « L’attente est l’usure qui ne s’use pas52. » Devant ce mouvement inté-
rieur, le lecteur comme l’écrivain ne sont pas pris au piège de la phrase au sens où le sens
serait impossible à atteindre ; ils sont plutôt pris à leur propre piège, eux qui croyaient
être en mesure de cerner quelque chose. Avant même d’énoncer un sens, les phrases ont
disparu en faisant disparaître toute trace de sujet. Le langage ne permet pas à un « Je » de
s’exprimer ; il s’envisage d’abord comme l’effacement de ce qu’il énonce. Il est « la forme
toujours défaite du dehors53 ». Le langage n’est ni dehors, ni dedans pour Blanchot. S’il
défait le dehors, c’est au sens où il vide toute nomination de son sens.
49. Lévinas Emmanuel, Sur Maurice Blanchot, op. cit., p. 30.
50. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, 2e version, op. cit., p. 82.
51. Blanchot Maurice, L’Attente l’oubli, op. cit., p. 76.
52. Ibid., p. 86.
53. Foucault Michel, « La pensée du dehors », in Critique, op. cit., p. 545.
28
Blanchot.indb 28 29/11/13 11:56
Cette impression de vide liée à l’impossible nomination se retrouve dans la syntaxe
même de l’écriture de Blanchot. Jean Starobinski montre comment l’usage que l’écrivain
fait des propositions relatives renforce cet effet de mouvement intérieur de la phrase. La
proposition relative permet l’enchâssement d’une phrase dans une seconde et cela
jusqu’au point final. Cet enchâssement enfonce le lecteur dans les profondeurs du mot
et lui donne l’impression de suffoquer, non seulement en raison de la longueur de la
phrase, mais aussi parce qu’il perd pied et oublie le centre qu’occupe de manière éphé-
mère la proposition principale : « On en trouve encore l’équivalent dans le style même
de Blanchot, dans ses relatives développantes qui prennent appui sur un mot déjà pré-
sent dans la phrase précédente, répété et pris comme nouveau point de départ, indice de
la pensée en progrès sur ce qu’elle a découvert et qui ne peut s’en tenir à ce qu’elle vient
d’affirmer54… ». C’est ce que Blanchot appelle « le serpent de la phrase55 » ou l’entrela-
cement de phrases qui se lovent en elles-mêmes.
Le vide et l’absence planent sur les textes de Blanchot. Rien n’a la capacité de signifier
pour lui. Cela ne veut pas dire que le sens est impossible à atteindre ; simplement qu’il
est le témoignage d’une impossibilité pour la langue de se construire sur autre chose
que sur son incapacité.
54. Starobinski Jean, « Thomas l’Obscur, chapitre premier », in Critique, op. cit., p. 506.
55. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, 1re version, p. 45.
Blanchot.indb 29 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 30 29/11/13 11:56
L’avènement du
récit
Blanchot.indb 31 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 32 29/11/13 11:56
L’événement du récit ou quand « l’au-delà »
est appelé dans la scène
Pierre Madaule
C
ette question de l’événement du récit a été traitée par Blanchot le 1er juillet
1954 dans un texte intitulé « Le chant des Sirènes » qui, significativement, a été
repris en tête d’un volume intitulé Le Livre à venir, publié en 1959. Dans ce texte,
le récit tel que l’entendait Blanchot – et cela s’applique particulièrement à ses propres
récits à partir de L’Arrêt de mort en 1948 – est défini de la façon suivante : « Le récit n’est
pas la relation de l’événement, mais cet événement même, l’approche de cet événement,
le lieu où celui-ci est appelé à se produire, événement encore à venir, et par la puissance
attirante duquel le récit peut espérer, lui aussi, se réaliser1. »
Ce paradoxe du récit qui, répétons-le avec Blanchot, consisterait dans ce fait que l’évé-
nement du récit serait le récit même en tant que récit, est en quelque sorte illustré et
complété par cette affirmation de L’Écriture du désastre à propos d’« une scène primi-
tive » : « Mais “l’au-delà” […] est […] appelé dans la scène […]2 ». L’événement du récit
1. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, « Folio/Essais », 2003, p. 14.
2. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 178.
33
Blanchot.indb 33 29/11/13 11:56
se produirait, selon moi, lorsque à un moment donné dans le récit et par le récit l’au-delà
entrerait dans la scène, la scène devenant alors une scène du récit.
C’est autour de cette proposition : « l’au-delà entre dans la scène », que je vais articuler
mes arguments. Et l’événement du récit sera examiné à partir des récits de Blanchot,
essentiellement ici L’Arrêt de mort et Au Moment voulu mais sans négliger L’Instant de ma
mort. Il le sera à trois niveaux : celui du récit fictionnel, soit quand le narrateur n’est pas
donné comme moins fictif que l’histoire qu’il raconte ; celui du récit qui, par la fiction,
prétendrait exprimer des vérités qui, elles, ne seraient pas fictives ; et celui du lecteur
enfin, un lecteur qui serait appelé à donner son adhésion au récit. Mais quel genre d’ad-
hésion ? Et à quoi ? Et surtout comment ?
En fin de parcours et après un examen plus détaillé d’une grande scène d’Au Moment
voulu3, je voudrais ouvrir un débat sur les raisons pour lesquelles ces récits de Blanchot
font, en général, l’objet de lectures insuffisantes, lectures insuffisantes surtout et d’abord
quand ce sont des lectures dites savantes.
Mais revenons à la formule initiale en la brièveté de son commencement : « Le récit
n’est pas la relation de l’événement, mais cet événement même. » Au début de L’Arrêt de
mort, nous pouvons lire dès la deuxième page du texte : « Il y a dix mots que je puis dire.
À ces mots j’ai tenu tête pendant neuf années4. »
Et le narrateur ajoute, mais sans prononcer ces « mots » qui pourtant éclaireraient le
récit : « Mais, ce matin qui est le 8 octobre […], je suis presque sûr que les paroles qui ne
devraient pas être écrites, seront écrites. Depuis quelques mois, il me semble que j’y suis
résolu5. » Neuf années, lisions-nous plus haut à propos de la durée de la résistance du
narrateur à l’écriture de ces « dix mots », soit depuis 1938 si nous comptons bien, le
8 octobre étant celui de 1947. Ainsi et par ces précisions, le narrateur nous introduit-il
aussi dans la scène d’écriture avec son effet supplémentaire de réalité.
L’absence des « dix mots » dans le texte, je le répète, n’en devient que plus frappante et
même quelque peu scandaleuse aux yeux d’un lecteur qui, après avoir lu une première
fois le récit en entier, voudrait reprendre dès le début la lecture de ce récit, et ceci afin de
3. Blanchot Maurice, Au Moment voulu, Paris, Gallimard, 1951, p. 131-137.
4. Blanchot Maurice, L’Arrêt de mort, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 1948, p. 8.
5. Ibid., p. 8.
34
Blanchot.indb 34 29/11/13 11:56
ne pas en rester définitivement à l’énigme du récit et aux deux épilogues successifs qui
concluent sans conclure vraiment l’histoire racontée.
Or une lecture raisonnée de L’Arrêt de mort, après une première lecture spontanée,
mais avant la déception d’une fin de récit ne parvenant pas à se donner pour une fin
véritable, se devrait, me semble-t-il, de se proposer à elle-même une version plausible de
ces dix mots. Cette version exprimerait ainsi déjà quelque chose de la participation du
lecteur à la lecture qu’il viendrait de faire. Et, à ce titre, elle serait, je le pense, exigible de
tout lecteur prétendant à une lecture raisonnée. Mais personne n’est obligé, je le précise
tout de suite, de risquer de polluer la magie d’une première lecture et le souvenir de cette
lecture par les inévitables dilacérations d’une lecture raisonnée.
Voici ma formule en première approximation : « Par le récit [je voudrais] révéler au
monde la vérité de ma condition. »
Mais, pourquoi « au monde ? » Parce que, cette fois pour le narrateur qui, nous dit-il,
a déjà écrit des livres et même des romans dans la même intention, il s’agirait, dans sa
volonté de communiquer ce qui est resté secret, d’aller plus loin que le cercle trop étroit
des lecteurs férus de haute littérature. Il s’agirait en effet, et par le moyen détourné du
récit littéraire, d’avouer l’inavouable. Et ainsi s’expliquerait la « gêne » que l’auteur-nar-
rateur exprime dès la deuxième phrase de L’Arrêt de mort, soit : « J’éprouve, à en parler
[de ces événements qui “me sont arrivés”], la plus grande gêne. » Cette « gêne », on ne la
trouve exprimée dans aucun des débuts des trois romans de Blanchot qui précèdent
L’Arrêt de mort.
Mais plus précisément, pourquoi une telle gêne ? Ce ne peut être, hypothèse de lecture
et donc de ce lecteur de L’Arrêt de mort que je suis peu à peu devenu, que parce qu’il
faudrait, par ces dix mots, révéler une incongruité ou, si l’on veut, une « inconvenance
majeure », pour reprendre un titre de Blanchot. La formule proposée à l’instant pour les
« dix mots » ne suffirait donc pas. Trop abstraite, elle ne susciterait en elle-même aucune
gêne. Alors le récit dans son ampleur ? Mais le récit aurait-il la capacité de remplir la
fonction de ces dix mots ? Sans doute pas puisque condamné par sa définition même à
rester tout entier prisonnier de sa forme littéraire. L’objectif de ce résumé en « dix mots »
ne serait-il pas – et tout à l’opposé de ce que promet le récit – de faire entrer un morceau
d’extra-littéraire dans la littérature même ? Un morceau fibreux, non digérable, même
réduit à ces quelques « dix mots ».
35
Blanchot.indb 35 29/11/13 11:56
Pourtant le tour pris par mon exposé m’oblige à risquer une seconde formule pour ces
« dix mots ». Et d’ailleurs un tel redoublement ne devrait pas surprendre dans l’espace
du récit, L’Arrêt de mort que je ne quitte pas. Un jour, Blanchot lui-même ne m’a-t-il pas
écrit au sujet d’une particularité touchant la photographie du suaire de Turin dans L’Ar-
rêt de mort : « Si derrière le suaire, surgit l’image insolite de Véronique, c’est que par là
était indiqué que tout serait double, inséparable et irréductible à l’unité6. » Cette
remarque de Blanchot est-elle pour moi une excuse suffisante ? Je ne sais, mais j’ai cru
pouvoir m’autoriser d’elle pour avancer une seconde formule. La voici : « L’essentiel de
ce que Thomas disait de son état et de sa condition s’applique à moi, l’homme qui est
l’auteur de ce récit. » Précisons qu’il s’agit ici de ce que disait Thomas dans son grand
monologue de Thomas l’Obscur, chapitre XIV (ou XI dans la nouvelle version de Tho-
mas l’Obscur, une version plus courte et en principe, plus resserrée, qui est de 1950, la
première, l’intégrale, si j’ose dire, étant de 1941).
De ce grand monologue de Thomas l’Obscur, vingt-sept pages compactes dans la réé-
dition de 2005, je vais tirer deux courtes citations, et seulement deux pour le moment7.
Elles suffiront à montrer l’état de Thomas et, par conséquent, sa condition. Ces deux
indications touchant Thomas concerneront, je le répète, le narrateur de L’Arrêt de mort.
En ce qui concerne la première qui prend place dans une phrase beaucoup plus longue
et touffue – mais il faut négliger les incidentes si l’on veut « comprendre » (je place le
mot comprendre entre guillemets) – on peut lire, si l’on en a la volonté, que :
« La mort n’a rien de commun avec l’arrêt de vie », et que moi, Thomas, j’en fis la
preuve par mon existence même8.
Répétons : « La mort n’a rien de commun avec l’arrêt de vie ».
La deuxième phrase, elle aussi très longue, et dont je tire la deuxième citation, indique
en substance que :
Ce qui […] dans la vie commune [de chaque homme] dure [en tout] quelques
secondes [soit, par exemple, la confrontation avec le « cadavre » qu’il deviendra] [ces
« quelques secondes » donc, firent] toute ma vie9.
6. Correspondance personnelle entre Maurice Blanchot et Pierre Madaule.
7. Il aurait dû y en avoir une troisième. Voir le post-scriptum.
8. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, Paris, Gallimard, éd. 1941, p. 211 ; éd. 2005, p. 296.
9. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, op. cit., éd. 2005, p. 296.
36
Blanchot.indb 36 29/11/13 11:56
Soulignons : « Ces quelques secondes firent toute ma vie. »
Autrement dit, la situation du narrateur-auteur de L’Arrêt de mort serait comparable à
celle de certaines personnes qui, ayant été placées par les circonstances de leur vie dans
un état physique et mental de mort imminente, en sont revenues et ont prétendu ensuite
avoir vécu en ces quelques secondes où leur cœur ne battait plus, une expérience non
seulement impossible en temps normal mais difficilement croyable, soit, par exemple :
– la sortie du corps et donc une manière de dédoublement, la conscience étant alors
séparée du corps apparemment mort sur la table d’opération du chirurgien ;
– soit encore un sentiment de vision à 360 degrés disent les spécialistes ;
– soit enfin, dans quelques cas, un sentiment de savoir global, comme le « Je savais
tout » tel qu’exprimé à la page 94 d’Au Moment voulu, ou le « Elle était sous mon regard
qui voit tout » à la page 82 de L’Arrêt de mort, ou enfin – et pour montrer que cela revient
de récit en récit – les mots « il était capable de penser tout, de savoir tout » à la page 32
du Dernier homme.
Dans les récits de Blanchot, ces potentialités interviennent notamment lors des sensa-
tions d’éveil qui ponctuent la narration de l’histoire. Il en va ainsi tout particulièrement
dans un récit tel qu’Au Moment voulu. On y rencontre aussi ces faits de fusion tels qu’in-
diqués par exemple dans le même Au Moment voulu, faits curieusement non réciproques :
« Elle était toi pour moi, et j’étais moi pour elle10 », ou : « Elle fut moi pour lui [celui qui,
dans ce récit, figure le dernier homme]11. »
Ces phénomènes – on ne le dira jamais assez – ne sont pas d’ordre psychologique même
s’ils ont nécessairement des conséquences sur la psychologie des personnages de ces récits.
Ce sont des phénomènes d’un tout autre ordre. Et c’est ce type de réalités que, selon moi,
les récits de Blanchot veulent proposer aux lecteurs – mais dans le cadre connu et com-
mun du Paris de 1938-1940 – et dans des circonstances appartenant, elles aussi, et même
quand il s’agit de mort, au monde commun où nous vivons. Le but serait d’obtenir que
ces circonstances rendent vraisemblable ce qui, par ailleurs, appartient à l’extraordinaire.
Mais pourquoi en parler ? Parce que le narrateur-auteur en écrivant et par l’écriture
cherche le moyen de ne pas rester définitivement séparé du reste de l’humanité. Ainsi,
commencerions-nous d’apercevoir les raisons du caractère tragique de ces récits
10. Blanchot Maurice, Au Moment voulu, op. cit., p. 134.
11. Blanchot Maurice, Le Dernier homme, Paris, Gallimard, 1957, p. 29.
37
Blanchot.indb 37 29/11/13 11:56
pourtant réputés traversés par des mouvements de gaieté (Georges Bataille dans un
article célèbre sur Au Moment voulu : « Ce monde où nous mourons »).
Si l’enjeu vital du récit est bien de sortir enfin par la parole publique de « l’intimité
orgueilleuse de la terreur » où le narrateur-auteur paraissait devoir rester enfermé12, il
faut que quelqu’un, un lecteur anonyme de préférence, puisse entendre l’appel implicite
et se décide à en témoigner. La page 56 de L’Arrêt de mort exprime-t-elle cet appel indirect
selon sa nature ? Il intervient en cette page qui est située au début de la deuxième partie
du récit, soit au moment où le récit, après l’effort puissant de la première partie et la mort
espérée définitive, tente de rebondir car, dit le récit, « tout ne s’est pas encore passé ».
L’enjeu serait donc, après cette mort de J., une mort voulue définitive, répétons-le et
coïncidant donc, cette fois, avec un véritable « arrêt de la vie », de sortir réellement du
silence. Mais pour cela, il faudrait d’abord que le narrateur se fasse entendre lui-même
par lui-même, condition pour se faire entendre des autres. Il écrit alors en cette même
page : « que jamais le silence ne se soit dit à lui-même : prends garde, il y a là quelque
chose dont tu me dois compte13 ». Car parler, parler vraiment, désormais il le faut.
« J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé », écrivait l’apôtre Paul dans la deuxième épître aux
Corinthiens. Ce sens fort du mot parler était pour lui inévitable parce qu’il venait d’écrire :
« La mort en moi fait son œuvre pour que la vie en vous apparaisse. » (2 Co 4, 12-13)
« Et moi, la fin, j’écris en vue de la fin », de « cette fin que je cherche vainement »,
écrira plus tard le narrateur de L’Arrêt de mort dans l’épilogue final, celui qui fut effacé
dans l’édition de 1971. Cette fin n’est pas, en tant que telle, littéraire, pourrait-on,
devrait-on ajouter. Ce que le roman n’a pu faire – il y a eu trois romans depuis 1941 – il
faut que le récit y parvienne, ou à tout le moins, qu’il s’efforce d’y parvenir et en utilisant
de nouveaux moyens. Le récit doit persuader son lecteur que ce n’est pas fictivement que
lui, le récit, s’est engagé dans cette voie.
Et pourtant, il faudra attendre l’année 1980 et la parution dans L’Écriture du désastre
du commentaire de ce court texte qu’est Une scène primitive ? avec son point d’interro-
gation et sa mise entre parenthèses – je parle du titre de ce morceau – pour lire soixante
pages plus loin cette affirmation étonnante par laquelle j’ai commencé cet exposé :
12. Blanchot Maurice, L’Arrêt de mort, op. cit., p. 56.
13. Ibid.
38
Blanchot.indb 38 29/11/13 11:56
« Mais “l’au-delà” […] est […] appelé dans la scène14 ». J’ai supprimé toutes les inci-
dentes de la longue phrase où figure cette affirmation afin de la restituer ici en toute sa
force, les mots « l’au-delà », il faut le dire, ayant été placés entre guillemets par l’auteur.
Et donc le récit aura pour fonction et pour tâche d’agencer les séquences de faits par
lesquelles l’événement de l’entrée dans l’au-delà dans la scène deviendrait non seule-
ment plausible mais comme inévitable.
Il faut, il faudrait, que sur ce point qui est le centre, le récit soit convaincant. C’est son
défi premier, un défi d’autant plus difficile à soutenir que le narrateur, dans son récit, se
serait rendu proche d’un homme quelconque vivant à Paris en ces années 38-40 de l’autre
siècle. Le narrateur n’est pas Maldoror, il n’est pas non plus Thomas de Thomas l’Obscur,
celui « dont la mission paraissait être de condamner le soleil » et qui transformé en un
« bloc de passions » et « dévoré à l’intérieur par une foison de flammes obscures ne reje-
tait que scories et laves froides15 », ou enfin celui qui, marchant « comme un berger » « au
milieu de la solitude du quaternaire16 », « conduisait le troupeau des constellations17 ».
Il faut donc, il faudrait, que la scène elle-même soit appelée dans le récit par une « his-
toire », qui, elle-même devrait être racontée et alors mise en récit. Il est très éclairant à ce
propos que Blanchot ait choisi, probablement avant L’Arrêt de mort malgré les dates de
publication, de montrer au lecteur, par un texte intitulé La Folie du jour, ce que serait la
scène de l’au-delà sans les approches progressives et circonstancielles de la mise en récit.
Ce texte, publié pour la première fois en 1949 sous le titre Un récit ? Avec un point
d’interrogation après le mot « récit », a été repris en 1973 sous son nouveau titre par les
éditions Fatal Morgan, puis en 2002 par les éditions Gallimard. C’est cette dernière édi-
tion que j’utilise ici. Je vais présenter les trois alinéas des pages 16 et 17 qui commencent
par ces mots : « Dehors, j’eus une courte vision », et où l’on va assister au mouvement
d’aller et retour d’une voiture d’enfant passant par une porte cochère. Commençons la
lecture des trois alinéas :
Dehors, j’eus une courte vision : il y avait à deux pas, juste à l’angle de la rue que
je devais quitter, une femme arrêtée avec une voiture d’enfant, je ne l’apercevais
qu’assez mal, elle manœuvrait la voiture pour la faire entrer par la porte cochère.
14. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, op., cit., p. 178.
15. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, op. cit., éd. 1941, p. 49 ; éd. 2005, p. 79.
16. Ibid.
17. Ibid., éd. 1941, p. 230 ; éd. 2005, p. 321.
39
Blanchot.indb 39 29/11/13 11:56
À cet instant entra par cette porte un homme que je n’avais pas vu s’approcher. Il
avait déjà enjambé le seuil quand il fit un mouvement en arrière et ressortit. Tandis
qu’il se tenait à côté de la porte, la voiture d’enfant, passant devant lui, se souleva
légèrement pour franchir le seuil et la jeune femme, après avoir levé la tête pour le
regarder, disparut à son tour.
Cette courte scène me souleva jusqu’au délire. Je ne pouvais sans doute pas complè-
tement me l’expliquer et cependant j’en étais sûr, j’avais saisi l’instant à partir duquel
le jour, ayant buté sur un événement vrai, allait se hâter vers sa fin. Voici qu’elle arrive,
me disais-je, la fin vient, quelque chose arrive, la fin commence. J’étais saisi par la joie.
J’allai à cette maison, mais sans y entrer. Par l’orifice, je voyais le commencement
noir d’une cour. Je m’appuyai au mur du dehors, j’avais certes très froid ; le froid m’en-
veloppant des pieds à la tête, je sentais lentement mon énorme stature prendre les
dimensions de ce froid immense, elle s’élevait tranquillement selon des droits de sa
nature véritable et je demeurais dans la joie et la perfection de ce bonheur, un instant
la tête aussi haut que la pierre du ciel et les pieds sur le macadam.18
Puis, comme pour souligner l’importance des dernières lignes, celles de l’« énorme
stature », le narrateur va à la ligne et écrit : « Tout cela était réel, notez-le. » Nous sommes
placés alors, nous lecteurs, devant une double réalité, la réalité triviale ou d’apparence
triviale de la scène de rue, y compris le mouvement du narrateur allant à « cette maison »
puis s’appuyant « au mur du dehors », et cette autre réalité, elle extraordinaire, d’un
froid cosmique et de la sensation d’immensité éprouvée jusque dans le corps du narra-
teur et par ce corps qui est aussi son corps. L’appui du mur n’est pas de trop ici, même si
ce mur évoque, dans le trouble et l’ébranlement du narrateur, un autre mur, celui de la
page 11 : « Comme beaucoup d’autres » écrit-il, « Je fus mis au mur » et, ajoutera-t-il
plus tard, cette fois à l’adresse de Jacques DERRIDA, « presque fusillé ».
Derrida, c’est lui qui en 1986, dans l’introduction à Parages, un ouvrage tout entier
consacré à Blanchot et particulièrement à ses récits, écrivait :
Ces fictions, gardons le nom, je croyais les avoir déjà lues. Aujourd’hui, au moment où,
les ayant étudiées, puis longuement citées, j’ose publier ces essais, j’en suis moins sûr que
jamais. D’autres œuvres de Blanchot m’accompagnent depuis longtemps, celles que l’on
situe, aussi improprement, dans les domaines de la critique littéraire ou de la philosophie.
18. Blanchot Maurice, La Folie du jour, Paris, Gallimard, 2002, p. 16-17.
40
Blanchot.indb 40 29/11/13 11:56
Non qu’elles me soient, elles, devenues familières. Du moins avais-je pu croire, au cours
des années dont je parle, y avoir déjà reconnu un mouvement essentiel de la pensée. Mais
les fictions me restaient inaccessibles, comme plongées dans une brume d’où ne me
parvenaient que de fascinantes lueurs, et parfois, mais à intervalles irréguliers, la lumière
d’un phare invisible sur la côte19.
Ces paroles, on pourrait longuement les commenter, notamment cette lumière d’un
phare insituable dont le balayage périodique éclaire tour à tour le lecteur, puis le plonge
dans la nuit. On ne saurait mieux exprimer le va-et-vient de la compréhension, cette
houle qui balance le lecteur et l’empêche de s’arrêter à un sens défini. Et il n’est pas sûr
que Derrida en ait su plus sur les récits de Blanchot après son grand commentaire de
L’Instant de ma mort20.
Mais pour terminer je préfère citer une phrase étonnante de Blanchot sur la lecture.
Nous parlions d’appel de l’œuvre. Voici ce qu’écrivait Blanchot dans « Lire », un texte
publié le 1er mai 1953 dans la NRF et repris en bonne place dans L’Espace littéraire :
Mais à l’appel de la lecture littéraire, ce qui répond, ce n’est pas une porte qui tombe
[…], c’est plutôt une pierre plus rude [sous-entendu « que celle du tombeau »],
écrasante, déluge démesuré de pierres qui ébranle la terre et le ciel21.
Le tsunami, le tremblement de terre, la secousse apocalyptique, ces événements ils
seraient aussi pour le lecteur s’il savait lire, s’il pouvait lire. C’est le lecteur en effet qui,
lui et lui seul, serait appelé à « réaliser » le récit, à le rendre « réel », fût-ce au prix d’un
tel ébranlement.
Étrange destin de la littérature de récit ! Qui, avant Blanchot, avait à ce point exhaussé
la lecture ? Mais qui, aussi, l’avait autant humiliée ? Au début du même texte, « Lire »,
Blanchot avait rappelé cette parole d’une malade de Pierre Janet « qui ne lisait pas volon-
tiers parce que, remarquait-elle, “un livre qu’on lit devient sale”22 ».
19. Derrida Jacques, Parages, Paris, Galilée, 2003, p. 11.
20. Voir Derrida Jacques, Demeure, Paris, Galilée, 1998.
21. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, « Folio/Essais », 2003, p. 257-258.
22. Ibid., p. 251.
41
Blanchot.indb 41 29/11/13 11:56
Post-scriptum
Je ne sais pourquoi j’ai supprimé de mon exposé ce programme suggéré par Thomas
l’Obscur : « Donner à rien, sous sa forme de rien, la forme de quelque chose23 », car, au
principe du récit blanchotien en acte, il y aurait la même formule mais en la modifiant
légèrement et en y ajoutant le mot « chance », soit donc « donner sa chance au rien, en
tant que rien, mais sous la forme de quelque chose ».
De là, la nécessité du vide de la chambre24 pour qu’y intervienne peut-être « la
chance25 ».
23. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, op. cit., éd. 1941, p. 208 ; éd. 2005, p. 291.
24. Voir Blanchot Maurice, L’Arrêt de mort, op. cit., p. 64 et 65.
25. Blanchot Maurice, Au Moment voulu, op. cit., p. 21.
Blanchot.indb 42 29/11/13 11:56
Le roman est le récit
Antoine Philippe
A
près des années de polémique1, il est maintenant avéré que la fiction de Mau-
rice Blanchot, cette écriture de la Nuit, s’est faite en rupture avec ce que Blanchot
vivait et écrivait dans des publications politiques le Jour2. De plus, il est commu-
nément admis que cette écriture de la Nuit aurait ensuite rompu avec elle-même lorsque
Blanchot aurait cessé d’écrire des romans pour commencer à écrire des récits. Cette idée
s’appuie d’abord sur la mention de « roman » qui suit le titre de ses premières fictions
– les plus longues – puis sur celle de « récit » pour la plupart des suivantes – du moins
pendant un certain temps ; elle se confirme aussi par l’usage qui se fait de ces termes à
l’intérieur de certaines fictions, en particulier L’Arrêt de mort3 ; elle se stabilise enfin grâce
1. Voir en particulier Mehlman Jeffrey, Legacies of Antisemitism in France, Minneapolis, Uni-
versity of Minnesota Press, 1983 et Mesnard Philippe, Maurice Blanchot. Le sujet de l’engagement,
Paris, L’Harmattan, 1996.
2. Fait solidement établi au moins depuis Hill Leslie, Blanchot Extreme Contemporary, London,
Routledge, 1997 et Bident Christophe, Maurice Blanchot. Partenaire invisible, Seyssel, Champ
Vallon, 1998.
3. Blanchot Maurice, L’Arrêt de mort, Paris, Gallimard, 1948.
43
Blanchot.indb 43 29/11/13 11:56
au célèbre essai « La rencontre de l’imaginaire », qui constitue la première partie du
« chant des Sirènes4 », et qui oppose le « roman » au « récit ». Toutefois, nous pensons que
la mise en parallèle de cet article, de cette pratique éditoriale et de ces instances narratives
a suscité un immense malentendu, car il donne l’impression – très largement partagée,
mais selon nous erronée – que le contraste que Blanchot établit entre « roman » et « récit »
dans Le Livre à venir correspondrait à une opposition entre « ses » romans et « ses » récits.
Certes, la conception commune ne fait pas l’unanimité. En fait, il semble que l’on
pourrait classer en trois grandes catégories les différentes positions des critiques face à la
question du contraste entre roman et récit dans l’œuvre fictionnelle de Blanchot. La
première position, et la plus radicale, est celle qu’exprime Pierre Madaule qui constate
une coupure nette entre les structures narratives du dernier roman et du premier récit,
coupure réalisée en l’an 1947 qui vit leur aboutissement commun : « Un abîme sépare le
je narratif du roman Le Très-Haut, qui paraît en même temps que L’Arrêt de mort, et le je
narratif de L’Arrêt de mort5. » Mais à cette différence formelle s’ajoute la tension très
différente qu’ils entretiennent avec le biographique selon lui. D’une part, le roman se
cantonne dans la fiction : « Ce personnage d’Henri Sorge nous est donné comme imagi-
naire, et sont donnés par suite comme imaginaires aussi tous les épisodes de l’histoire6. » ;
alors que le récit est un langage de vérité, même si son chemin est complexe et tortueux ;
ainsi Madaule propose-t-il de traduire le sens profond de l’incipit de L’Arrêt de mort par
ces mots : « Mon texte n’aurait pas de sens si je ne pensais pas qu’il puisse avoir valeur de
témoignage7. » Le sens ultime de ce témoignage n’a jamais été clairement élucidé par
Pierre Madaule, mais il semble constituer l’horizon de sa recherche.
La deuxième position, opposée, est parfaitement résumée par Daiana Dula-Manoury
qui pense que « la différence présupposée entre récit et roman n’apparaît pas comme révé-
latrice8 ». Elle ajoute : « Si Aminadab est annoncé comme un roman, Thomas l’Obscur ne
comporte pas telle inscription9. » – ce qui est d’ailleurs erroné (erreur peut-être due à une
4. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, 1959, p. 9-37.
5. Madaule Pierre, « L’événement du récit », in Revue des Sciences Humaines, n° 253 (« Maurice
Blanchot »), janvier-mars 1999, p. 76.
6. Ibid., p. 76.
7. Ibid., p. 77.
8. Dula-Manoury Daiana, Queneau, Perec, Butor, Blanchot. Éminences du rêve en fiction, Paris,
L’Harmattan, 2004, p. 318.
9. Ibid., p. 318.
44
Blanchot.indb 44 29/11/13 11:56
confusion entre la première et la deuxième version du roman). Elle évoque ensuite divers
critiques tels que Françoise Collin, Jean-Philippe Miraux ou Marie-Laure Hurault pour
qui cette distinction ne semble pas particulièrement pertinente. Même si nous pensons
que ce doute quant à la nature du contraste entre roman et récit repose sur une intuition
juste, le poser de cette manière sans l’analyser ni rien prouver nous paraît insuffisant du
point de vue théorique. Dula-Manoury dit au fond que cette distinction n’est pas impor-
tante à ceux qui ne l’ont pas posée, mais elle oublie de préciser que Blanchot, lui, l’a posée
et qu’il conviendrait donc de se demander pourquoi il l’a fait et ce que cela implique.
La troisième position, qui est de loin la plus consensuelle, consiste à plaquer la notion
de roman exposée dans « Le chant des Sirènes » sur les trois œuvres les plus longues
Thomas l’Obscur10 (première version), Aminadab11 et Le Très-Haut12 et à qualifier de récit
toutes les autres fictions, qu’elles leur soient antérieures ou postérieures. C’est ce que fait
la majorité des critiques, avec parfois quelques entorses dans le détail de cette règle. Par-
ticulièrement révélateur est le cas de Christophe Bident qui oppose d’abord roman et
récit en termes de longueur et de style, le récit étant pour lui une fiction plus courte et
plus dense que le roman. Ainsi, il considère que la deuxième version de Thomas l’Obs-
cur13 est un récit, parce qu’elle est une version abrégée du roman (que Gallimard a cepen-
dant sous-titré « nouvelle version » et non pas « récit »). Il qualifie même de « passage au
récit » l’année 1947 qui vit l’écriture de cette nouvelle version ainsi que de L’Arrêt de
mort : « C’est surtout l’année où les deux nouveaux récits s’achèvent. L’Arrêt de mort et la
nouvelle version de Thomas l’Obscur, de rédaction extrêmement contemporaine, d’es-
thétique comparable, donnent comme un double tour d’écrou, décisif, irréversible, à
l’écriture blanchotienne14. » Ce « tour d’écrou » effectué « dans la nuit d’Èze » est donc
un changement stylistique, un tournant minimaliste qui correspondrait à une matura-
tion de l’écrivain revenu des excès baroques de ses romans.
De manière apparemment paradoxale, mais sans doute pourtant dans l’espoir de
conserver une certaine cohérence à sa conception de la forme du récit, Bident considère que,
10. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, Paris, Gallimard, 1941.
11. Blanchot Maurice, Aminadab, Paris, Gallimard, 1942.
12. Blanchot Maurice, Le Très-Haut, Paris, Gallimard, 1948.
13. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, 2e version, 1950, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 1992.
14. Bident Christophe, Maurice Blanchot. Partenaire invisible, op. cit., p. 281.
45
Blanchot.indb 45 29/11/13 11:56
malgré sa longueur, « Aminadab est le premier “récit” publié par Blanchot15. » Il justifie cette
classification tout à fait à rebours de la tradition (et contraire au sous-titre de la couverture)
par le fait que, dans un dépouillement qui l’apparente aux fictions de Kafka, Aminadab
« trace un parcours linéaire, procédant par des tableaux qui mettent à nu les personnages,
entretiennent leur espoir, abondent leur stupeur. Il possède le langage, le cadre et les formes
esthétiques du récit, un monde insituable et comme fantastique, des personnages qui
s’affrontent au non-sens, qui accomplissent eux-mêmes des gestes inexpliqués16 ». Ce genre
linéaire, dense et à l’atmosphère fantastique – qu’il qualifie de récit malgré sa longueur –,
Bident l’assimile complètement à l’idée générique de récit que Blanchot théorise dans « Le
chant des Sirènes » : « Chant des Sirènes ? Aminadab est déjà ce récit de la navigation, ce pur
récit que dans Le Livre à venir Blanchot opposera au roman17 […] ».
De plus, à la valeur formelle du genre récit s’ajouterait une plus grande propension à
l’autobiographie. Ainsi dit-il du triptyque L’Arrêt de mort, Au Moment voulu18, Celui qui
ne m’accompagnait pas19 : « Cette expérience commune confère à la nouvelle parole nar-
rative le statut autobiographique tenace déjà éprouvé dans L’Arrêt de mort ou La Folie du
jour20. » D’ailleurs, le biographe Bident n’hésite pas à identifier parfois le narrateur blan-
chotien à l’auteur Blanchot lui-même :
Si l’on en croit le récit lui-même, c’est le 8 octobre précisément que Blanchot commence
ou plutôt recommence L’Arrêt de mort (cette date n’est pas improbable). […] « Je ne crains
pas de livrer un secret », ajoute-t-il, accentuant l’impact autobiographique du récit21.
Cependant, si on note les différentes occurrences des mots « roman » et « récit » dans
Maurice Blanchot. Partenaire invisible, on remarque une grande souplesse de l’usage de
ces deux termes, souplesse qui semble se justifier par l’idée que les récits sont le meilleur
de Blanchot esthétiquement et le plus vrai autobiographiquement ; et que les romans
préfigurent les récits à venir, en sont l’ébauche imparfaite.
15. Ibid., p. 204.
16. Ibid., p. 204-205.
17. Ibid., p. 207.
18. Blanchot Maurice, Au Moment voulu, Paris, Gallimard, 1951.
19. Blanchot Maurice, Celui qui ne m’accompagnait pas, Paris, Gallimard, 1953.
20. Bident Christophe, Maurice Blanchot. Partenaire invisible, op. cit., p. 305-306.
21. Ibid., p. 281.
46
Blanchot.indb 46 29/11/13 11:56
Nous nous trouvons donc devant un panorama critique qui fait généralement de l’es-
sai « La rencontre de l’imaginaire » un texte fondamental pour la compréhension des
fictions, mais qui à l’occasion y voit un texte peu signifiant. Dans les deux cas, on perçoit
un certain malaise, soit à appliquer des notions si bien contrastées en théorie à un cor-
pus blanchotien qui ne l’est pas tant que ça, soit à expliquer pourquoi cette notion mise
en avant par Blanchot n’aurait pas de valeur explicative. Or, une lecture plus précise de
cet essai peut nous permettre d’y voir plus clair et de restituer la place, significative mais
non pas novatrice, de cet essai dans la théorie littéraire blanchotienne.
Une difficulté importante vient du fait que pour Blanchot un roman peut receler un
« récit » et un récit peut n’être qu’un « roman », comme il le montre dans « L’expérience
de Proust », la seconde partie – trop souvent négligée – du « chant des Sirènes ». Blan-
chot y rappelle que Proust, avant de concevoir La Recherche, avait écrit un roman Jean
Santeuil qu’il jugeait être un récit « pur », parce qu’il narrait de manière fragmentaire ses
expériences d’instants extatiques. Le critique Feuillerat a pensé trouver en Jean Santeuil
le principe fondamental de La Recherche, un principe que Proust aurait « trahi », une
audace à laquelle il aurait renoncé en enrobant son récit de phrases romanesques. Blan-
chot estime au contraire que Jean Santeuil est un « roman » traditionnel, parce que
Proust a figé ces extases temporelles en moments complètement révolus ; alors que dans
La Recherche, il « […] est resté docile à la vérité de son expérience qui ne le dégage pas
seulement du temps ordinaire, mais l’engage dans un temps autre, ce temps “pur” où la
durée ne peut jamais être linéaire et ne se réduit pas aux événements22. » Ainsi, même si
Jean Santeuil a paru réaliser l’idéal proustien d’un « récit pur », c’est La Recherche, ce
roman-fleuve, qui a accompli l’idéal du « récit » d’ouvrir un temps « autre » en parcou-
rant un espace imaginaire « sphérique » où temps passé et temps présent se confondent.
Nous nous proposons de démontrer que la dichotomie roman/récit divise, d’une part,
la grande majorité des romans contemporains qui se trouvaient selon Blanchot empêtrés
dans l’esthétique réaliste et, d’autre part, une « autre » forme de littérature visant la « pro-
duction de l’irréel » et non pas la « reproduction du réel », et qui recense toutes les œuvres
vraiment créatrices dont bien sûr « toutes les fictions » de Blanchot. En opposant le récit
au roman, Blanchot a réaffirmé son geste nocturne de rejet du Jour, car ce qu’il baptise à
ce moment-là « roman » est la fiction qui reste arrimée au réel, une sorte de « littérature
du Jour » ; et ce qu’il entend par « récit », c’est toute son écriture de la Nuit, toute sa fiction
22. Blanchot Maurice Le Livre à venir, op. cit., p. 35.
47
Blanchot.indb 47 29/11/13 11:56
depuis Le Dernier mot23 jusqu’à L’Instant de ma mort24. En fait, nous allons voir que « La
rencontre de l’imaginaire » est venue préciser le contraste entre le « roman réaliste du
passé » et un « roman mallarméen à venir » que Blanchot avait proposé dans « Le jeune
roman25 » dès 1941.
Que dit Blanchot dans « Le jeune roman » ? Il y déplore la timidité créative d’un roman
français contemporain englué dans le réalisme le plus éculé, alors que d’autres pays (et il
pense aux écrivains anglophones : James Joyce, William Faulkner, Virginia Woolf, etc.) se
risquent à renouveler le roman en profondeur. Le problème du réalisme est qu’il n’offre
qu’une unité superficielle au roman, alors qu’un roman devrait tenir par sa cohérence
formelle, et non par ce qui est extérieur à lui, à savoir son sujet. Blanchot rejette l’argu-
ment qui voudrait que, sous prétexte que la vie serait faite de hasards, le roman puisse se
contenter d’imiter la vie en avançant au hasard. Il y a bien, concède-t-il, des romanciers
français contemporains de talent qui seraient capables de dépasser ce réalisme, mais il
leur reproche de ne pas aller aussi loin qu’ils le pourraient et de se réfugier dans les
conventions, de peur – semble-t-il – d’enfanter des monstres. Blanchot souhaite la venue
d’un nouveau type de romancier, infiniment plus exigeant, qui irait au bout de son idéal
et dont l’œuvre serait entièrement nécessaire. En bref, ce romancier « serait pour le
roman ce que Mallarmé a été pour la poésie26 ».
Treize ans plus tard, dans « La rencontre de l’imaginaire », Blanchot se moque de celui
qui passe trop facilement pour le plus grand des aventuriers, Ulysse, le dépeignant
comme un homme trop calculateur qui ne pense qu’à rester lui-même, et loue au
contraire Achab parce qu’il a le courage d’aller au bout de sa fascination. Ulysse, par ses
dérives involontaires et chaotiques, symbolise le « roman », dont le principe de progres-
sion narrative est le hasard. Cela fait certes du roman un genre superficiel, mais le roman
vit de cette superficialité, car il trouve sa justification dans le divertissement. Achab, au
contraire, symbolise le « récit » en ce qu’il ne poursuit qu’un but bien précis, celui de
rencontrer les Sirènes, c’est-à-dire Moby Dick, et il y fonce sans réserve : il s’y engloutit,
mais accomplit en même temps le destin de l’art qui n’est pas de se réfugier dans le réel,
23. Écrit en 1936, mais aujourd’hui disponible dans Blanchot Maurice, Après coup, Paris,
Les Éditions de Minuit, 1983.
24. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, Paris, Gallimard, 1994.
25. Blanchot Maurice, Faux pas, Paris, Gallimard, 1943, p. 209-218.
26. Ibid., p. 212.
48
Blanchot.indb 48 29/11/13 11:56
mais de s’engouffrer dans l’imaginaire. Certes, Ulysse est hardi et se risque à entendre le
chant des Sirènes, mais il s’empêche d’en suivre l’appel, assurant son retour à la vie nor-
male et la fin heureuse de ses aventures. Blanchot imagine un « autre » Ulysse qui serait
Homère, c’est-à-dire que son aventure ne serait pas faite d’événements empruntés aux
représentations les plus conventionnelles de la vie réelle, mais correspondrait au travail
même de l’écrivain. Cet Ulysse-Homère-là irait au bout de son projet de créer une œuvre
entièrement imaginaire et même seulement à venir, car il n’en n’aurait jamais fini de
rejeter la diversité du réel pour lui substituer l’unicité du passage du réel à l’imaginaire.
Comment peut-on penser que dans cet essai Blanchot parle de « ses » romans en évo-
quant Ulysse alors qu’Ulysse ressemble de très près à ce romancier contemporain hardi
mais inhibé et finalement décevant que Blanchot dénonçait ? Comparons :
[…] les romans d’hier ont été remarquables par leur fidélité à une tradition tran-
quille et médiocre […]. Les causes de cette décadence sont nombreuses27.
avec
[…] l’entêtement et la prudence d’Ulysse, sa perfidie qui l’a conduit à jouir du spec-
tacle des Sirènes, sans risques et sans en accepter les conséquences, cette lâche, médiocre
et tranquille jouissance, mesurée, comme il convient à un Grec de la décadence28 […].
Termes surprenants pour parler d’Ulysse, si l’on ne se souvient qu’ils sont ceux-là mêmes
que Horkheimer et Adorno usèrent dans La Dialectique de la raison29 publiée dès 1947.
27. Ibid., p. 209. Nous soulignons.
28. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, op. cit., p. 11. Nous soulignons.
29. Horkheimer Max et Adorno Theodor, La Dialectique de la Raison, Paris, Gallimard,
1974. Les sociologues allemands ont, on le sait, développé l’idée que la Raison (l’Aufklärung,
l’esprit des Lumières), loin d’arracher les hommes à la pensée mythique, n’a fait qu’en
poursuivre impitoyablement les visées. En effet, alors que la Raison se conçoit elle-même
comme une entreprise d’éclaircissement chassant toute magie de la pensée, Horkheimer et
Adorno voient dans les mythes une Raison encore sous-équipée qui cherchait à « informer,
dénommer, narrer les origines [et], par là-même, représenter, confirmer, expliquer » (p. 26).
Par la puissance de la technique, les conditions de vie matérielles des hommes ont progressé,
mais seulement aux dépens d’une régression civilisationnelle, car, en réduisant la nature à une
chose qu’il contrôle, l’homme s’est lui-même chosifié. La raison est devenue un moyen
tellement puissant que ce moyen s’est substitué à toute notion de fin (ce qui nous a conduits à
la folie destructrice de la seconde guerre mondiale par exemple). Pour Hokheimer et Adorno,
la séduction du chant des Sirènes « représente la tentation de se perdre dans le passé. » (p. 48).
49
Blanchot.indb 49 29/11/13 11:56
Mais imagine-t-on une seule seconde que Blanchot utiliserait ces termes pour décrire
ses propres romans ? Deux raisons font que ce n’est pas possible.
D’une part, cette médiocrité du roman est intimement liée à son parti pris de réalisme.
Lorsque, en 1954, il dit du roman : « Changer sans cesse de direction, aller comme au
hasard et pour fuir tout but, […], telle a été sa première et sa plus sûre justification30 », il
ne fait que reprendre de manière adoucie sa condamnation de 1941 : « Chose bizarre, on
invoque pour rendre le roman “nécessaire” le fait qu’il reproduit des événements, eux-
mêmes sans nécessité, système confus et impénétrable de chances et de “hasards”31. » Le
récit, lui, ne reproduit pas le monde, il en produit un nouveau totalement dégagé du
monde : « […] pour Melville lui-même, le monde menace sans cesse de “s’enfoncer dans
cet espace sans monde” vers lequel l’attire la fascination d’une seule image32. » – ce que
Blanchot annonçait en 1941 : « […] le propre de « l’œuvre véritable » est de « créer un
monde » où les êtres que nous sommes et les faits qui nous composent atteignent une
nécessité et même une « fatalité » que la vie ne leur donne généralement pas […]33 ».
Ainsi, Thomas l’Obscur, Aminadab et Le Très-Haut ne sont pas des « romans » qui
pècheraient par réalisme, mais sont des « œuvres véritables » qui créent leur propre monde
impossible à réduire à une réalité connue. Thomas l’Obscur aussi bien que L’Arrêt de mort
sont des « récits », car ils sont tous deux aux « antipodes » du réalisme.
Or, tout l’effort d’Ulysse consiste à se constituer comme être « individué » en s’ancrant solidement
dans le présent et en s’arrachant au poids des déterminations du passé tout comme aux fatalités
d’un futur conçu comme un destin. Succomber à la séduction du passé va devenir l’apanage de cet
îlot de non-raison que constitue dans la société bourgeoise le domaine de l’art. Bien sûr, cette
plongée dans le passé forme l’épine dorsale de l’œuvre de Proust, œuvre qui sert à Blanchot à
illustrer ce que serait un « autre » temps, le temps d’écrire, le temps d’une véritable rencontre avec
les Sirènes. Blanchot puise donc chez les critiques allemands l’idée que, L’Odyssée étant « le texte
fondamental de la civilisation européenne » (p. 60), il marquerait en particulier le moment-clé de
l’autonomisation du domaine de l’art. Mais si le paradigme de l’art est, depuis ce temps reculé
– qui marque pour Horkheimer et Adorno la naissance de la pensée bourgeoise –, une rencontre
« ratée » avec les Sirènes, alors Blanchot décrira ce qu’il comprend comme une autre forme de
littérature, existant depuis toujours, mais prenant son essor à l’époque contemporaine, et qui
serait une rencontre « réussie », celle d’Achab avec Moby Dick, une rencontre fascinante où l’on
s’engouffre et disparaît.
30. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, op. cit., p. 13.
31. Blanchot Maurice, Faux pas, op. cit., p. 210. Nous soulignons.
32. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, op. cit., p. 16. Nous soulignons.
33. Blanchot Maurice, Faux pas, op. cit., p. 210. Nous soulignons.
50
Blanchot.indb 50 29/11/13 11:56
D’autre part, la médiocrité du « roman » renvoie à la médiocrité de l’ambition de
l’écrivain qui, par pusillanimité, prend refuge sur le terrain bien balisé de la tradition la
plus banale. Or, Blanchot se fait une très haute idée du véritable écrivain : « L’histoire qui
importe chez un artiste n’est pas l’histoire de sa vie, mais celle de son orgueil34. » ; et,
logiquement, il nourrit la même estime de soi en tant qu’écrivain et c’est à lui-même
qu’il pense lorsque, en 1941, à la veille de la publication de Thomas l’Obscur, il souhaite
l’apparition de « […] quelque écrivain, symbole de “pureté” et d’“orgueil”, qui serait
pour le roman ce que Mallarmé a été pour la poésie35 […] ». Cet orgueil, Blanchot ne le
dément pas treize ans plus tard, même si le recul lui donne la pudeur de le baptiser « pré-
tention » : « Le récit est “héroïquement” et “prétentieusement” le récit d’un seul épisode,
celui de la rencontre d’Ulysse et du chant insuffisant et attirant des Sirènes36. » Alors que
« superficiel » implique « sans ambition », comment pourrait-il traiter ces romans nés
de son orgueil – ou de sa prétention – de superficiels ?
Ce qui montre peut-être le mieux que le « récit » n’est pas ce que l’on croit, c’est
l’article « L’art du roman chez Balzac37 » paru deux mois après « Le jeune roman » et
qui en reprend l’argumentation à propos des romans de Balzac. Ceux-ci seraient,
d’après cette terminologie, des « récits ». Comparons le roman de Balzac : « Son ambi-
tion est d’attirer le lecteur, de le retenir en lui rendant inhabitable l’univers réel et de
lui fermer toute issue pour qu’il ne puisse plus imaginer d’autre manière de vivre que
celle de “La Comédie humaine38”. » avec le récit : « Réunir dans un même espace Achab
et la baleine, les Sirènes et Ulysse, voilà le vœu secret qui fait d’Ulysse Homère, d’Achab
Melville et du monde qui résulte de cette réunion le plus grand, le plus terrible, et le
plus beau des mondes possibles, hélas un livre, rien qu’un livre39. » De même, chez
Balzac : « Il n’y a donc pas à revenir sur l’étendue de la création balzacienne où l’ima-
gination se substitue à la réalité40. » ; et « […] le récit a pour progresser cet autre temps,
34. Blanchot Maurice, Chroniques littéraires du Journal des débats. Avril 1941-Août 1944, Paris,
Gallimard, 2007, p. 95.
35. Blanchot Maurice, Faux pas, op. cit., p. 212. Nous soulignons.
36. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, op. cit., p. 13. Nous soulignons.
37. Blanchot Maurice, Faux pas, op. cit., p. 203-208.
38. Ibid., p. 205.
39. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, op. cit., p. 15-16.
40. Blanchot Maurice, Faux pas, op. cit., p. 205.
51
Blanchot.indb 51 29/11/13 11:56
cette autre navigation qui est le passage du chant réel au chant imaginaire […]41 » ; ou
encore, pour Balzac : « Il y a […] dans l’ensemble de “La Comédie humaine” […] une
liaison de mouvements intellectuels dont la complexité et la vigueur logique sont pous-
sées si loin qu’elles atteignent une force et une violence presque inhumaines42. » et pour
le récit : « De quelle nature était le chant des Sirènes ? […] c’était un chant inhumain
[…]43 » ; et encore pour Balzac : « La description est emportée par une loi mécanique
[…]. Elle ne se règle que sur elle-même, souverainement indifférente à la réalité qu’elle
décrit et atteignant sans risque les métamorphoses les plus bouleversantes44. » et pour le
récit : « Le récit est lié à cette métamorphose à laquelle Ulysse et Achab font allusion45 ».
Or, si le roman balzacien, cet apogée du roman au narrateur omniscient à la troisième
personne, est déjà un « récit », comment le roman blanchotien ne le serait-il pas ?
L’aspect le plus regrettable de ce quiproquo est qu’il présente au lecteur une conception
insoutenable de la nature « et » des « romans » « et » des « récits » de Blanchot. Bien que
Blanchot précise que « […] le caractère du récit n’est nullement pressenti, quand on voit
en lui la relation vraie d’un événement exceptionnel, qui a eu lieu et qu’on essaierait de
rapporter46 » ; on a vu que la critique partageait largement l’idée que le récit aurait une
valeur de « témoignage », de « vérité », et même d’« autobiographie », qui s’opposerait à
l’« invention », la « fiction » voire la « fausseté » du roman. Cette notion s’autorise sans
doute de cette autre phrase de « La rencontre des Sirènes » : « Qu’arriverait-il si Ulysse et
Homère, au lieu d’être des personnes distinctes se partageant commodément les rôles
étaient une seule et même personne47 ? », que certains interprètent comme une variété
« postmoderne » de pacte autobiographique. Il est vrai qu’on semble retrouver ce pacte
dans les premiers récits à être considérés comme tels, à savoir L’Arrêt de mort et La Folie
du jour ; en effet, les deux narrateurs sont dotés d’une certaine ressemblance avec Blanchot
lui-même : ils sont écrivains et font référence à leur histoire comme étant l’histoire même
que Blanchot est en train de nous raconter. De plus, certains détails, soit structurels,
41. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, op. cit., p. 16.
42. Blanchot Maurice, Faux pas, op. cit., p. 206.
43. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, op. cit., p. 9.
44. Blanchot Maurice, Faux pas, op. cit., p. 208.
45. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, op. cit., p. 16.
46. Ibid., p. 14.
47. Ibid., p. 14.
52
Blanchot.indb 52 29/11/13 11:56
comme les dates dans L’Arrêt de mort, soit anecdotiques comme l’épisode de la mise en
joue par un peloton d’exécution dans La Folie du jour peuvent renforcer l’idée d’un pacte
autobiographique. Enfin, le narrateur de L’Arrêt de mort affirme dans l’incipit à la fois
qu’il souhaite faire un récit fidèle à certains événements vrais et aussi qu’il a échoué dans
le passé, parce que son récit se serait à plusieurs reprises transformé en romans.
Cependant, ce pacte autobiographique est vite démenti par le contenu des événements
relatés. Qui croira que Blanchot – tel le narrateur de L’Arrêt de mort – a « ressuscité » une
femme, puis qu’il l’a « euthanasiée » sans qu’elle le lui ait demandé ? et aussi que pour
leur première rencontre, elle avait « vraiment » ouvert la porte « fermée à clé » de sa
chambre d’hôtel ? Quant à La Folie du jour, le narrateur admet que les médecins le consi-
dèrent comme un « fou » et il accepte de bon gré de se laisser enfermer dans l’asile psy-
chiatrique où, étrangement, il se trouvait déjà. Or, nous savons que Blanchot n’était pas
fou, et que s’il connaissait la folie, c’était « du point de vue des médecins » – ayant étudié
la psychiatrie. La ressemblance entre le narrateur et l’auteur était donc une « illusion » à
laquelle nous nous sommes laissé prendre et le récit nous met en évidence ces deux
choses-là : il a menti (ce n’était pas essentiellement autobiographique) et nous y avons
cru (il nous a « fait croire » à cette valeur autobiographique).
La fusion entre Ulysse et Homère à laquelle nous convie Blanchot ne peut donc pas se
comprendre selon le principe du souvenir de faits passés. Il est clair qu’Homère ne fut
pas Ulysse et qu’il n’a rien vécu de ce qu’Ulysse vit dans L’Odyssée. Que dit précisément
Blanchot ? « Entendre le Chant des Sirènes, c’est d’Ulysse qu’“on” était, devenir Homère48
[…] », c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas pour Homère de devenir Ulysse, comme dans une
fiction d’inspiration autobiographique, mais pour le personnage Ulysse de devenir le
narrateur Homère. Le renversement qu’accomplit ce « on » est étonnant. Traditionnelle-
ment, « on » se projette dans un personnage ; mais ce « on »-personnage incapable de
retrouver son chemin devient un narrateur tout aussi perdu que l’était Ulysse, un narra-
teur qui « n’en sait pas plus » que le personnage, puisqu’il est lui-même ce personnage
principal ; mieux : il est le sujet unique de l’histoire, car c’est du narrateur et de son
ignorance qu’il s’agit.
En effet, les narrateurs blanchotiens, malgré leur souci apparent de rigueur et de
sincérité, ne peuvent jamais décrire avec précision ce qui leur arrive. En fait, c’est pire que
48. Ibid., p. 15. Nous soulignons.
53
Blanchot.indb 53 29/11/13 11:56
cela, puisque, après avoir proféré leur amour de la vérité, ils finissent par afficher une
extrême négligence dans leur restitution des faits. Celui de La Folie du jour joue sur le mot
« récit », qui peut s’employer en français pour une narration vraie aussi bien que pour
une fiction. Cette ambiguïté justifie le fameux point d’interrogation à l’appellation de
« récit » qui constituait le titre initial du texte ; l’ambivalence provoque aussi le
malentendu que l’on sait entre le narrateur et ses médecins : alors qu’ils attendent de lui
des « faits », il s’obstine à leur donner ses faits ; il peut certes « leur racont[er] l’histoire
tout entière » mais il n’est plus « […] capable de raconter des faits dont il se souvient49 ».
L’histoire qu’il raconte n’est donc pas le récit de ses souvenirs. D’ailleurs, ne devrait-il
pas dire : « Je leur racontai mon histoire tout entière » plutôt que « l’histoire » ? L’usage
de l’article défini suggère que cette histoire est détachée de sa personne ; de plus, sa
répétition à l’identique est suspecte, comme le seraient des aveux qui répéteraient
« exactement » les mêmes mots ad libitum ; enfin, peut-on jamais raconter son histoire
« tout entière » ? Et comment l’histoire d’un homme d’âge moyen pourrait-elle être
aussi courte ? Même si cet homme-là n’était pas fou, il serait pour le moins essentiellement
amnésique « et ne le saurait pas ». Or, qu’est-ce que cela signifie qu’il ait « perdu le sens
de l’histoire » ? Pour Hegel, le sens de l’histoire est la réalisation de l’Esprit absolu, c’est-
à-dire d’un esprit du monde devenu conscient de lui-même. Le narrateur n’a plus le
sens de l’histoire, parce qu’il a perdu toute conscience de lui-même.
Le narrateur de L’Arrêt de mort finit pareillement par affirmer que les faits qu’il souhai-
tait tant raconter sans en faire des romans : « Je n’ai pas peur de la vérité. Je ne crains pas
de livrer un secret50. », ne sont peut-être pas avérés « et que cela n’a pas d’importance à
ses yeux » : « […] il était insignifiant de savoir si les choses s’étaient réellement passées
ainsi51 ». D’ailleurs, ajoute-t-il, « […] la vérité n’est pas dans ces faits. Les faits eux-mêmes,
je puis rêver de les supprimer. Mais, s’ils n’ont pas eu lieu, d’autres, à leur place, arrivent
et, à l’appel de l’affirmation toute-puissante qui est unie à moi, ils prennent le même sens
et l’histoire est la même52 ». Si ce qu’il voulait raconter avait pu être autre, c’est que ces
événements n’en sont pas, qu’ils ne commencent à exister qu’au moment où il les raconte,
c’est-à-dire au moment où il les invente, et qu’il aurait pu en inventer d’autres.
49. Blanchot Maurice, La Folie du jour, Paris, Gallimard, 2002, p. 30.
50. Blanchot, L’Arrêt de mort, op. cit., p. 7.
51. Ibid., p. 126.
52. Ibid., p. 126.
54
Blanchot.indb 54 29/11/13 11:56
Ainsi, les narrateurs n’ont rien vécu de ce qu’ils disent avoir vécu. Celui de L’Arrêt de
mort dit : « Ces événements me sont arrivés en 193853 » ; ces « événements » ne sont donc
pas simplement « arrivés », comme arrive tout événement, c’est-à-dire indépendam-
ment des témoins qui les racontent. D’ailleurs, ne nous prévient-il pas dès le début :
« J’écrirai librement, sûr que ce récit ne concerne que moi54 » ? Et ne conclut-il pas de
même : « […] tout ce qui est arrivé, je l’ai voulu55 […] » ? Le narrateur ne peut pas ne pas
parler de lui-même et uniquement de lui-même. Ne nous affirme-t-il pas qu’il est « un
homme qui veut finir seul56 » ? Cette solitude finale du narrateur alors qu’il vient de cla-
mer sa passion pour Nathalie, comment faut-il la comprendre, sinon que Nathalie n’est
que sa « pensée », et que c’est à « elle » qu’il dit « […] éternellement : “Viens”, et éternel-
lement, elle est là57. » Nathalie est la Sirène, c’est-à-dire l’illusion faite femme, la fausseté,
le piège qui le fait sombrer dans les profondeurs de l’oubli du monde. Le narrateur vit
une aventure en pensée, une liaison avec les mots, une rencontre imaginaire à laquelle
lui-même ne croit pas complètement, une aventure dont on ne peut suivre les péripéties
qu’en observant « la main qui les écrit58 ».
Mais les personnages-narrateurs de ces deux récits sont-ils si différents des personnages
des romans de Blanchot et de la manière dont le narrateur épouse leur point de vue ? De
fait, dans le « prière d’insérer » à la première édition de L’Arrêt de mort, Blanchot affirme
que ce récit et le roman Le Très-Haut sont « les deux versions inconciliables et cependant
concordantes d’une même réalité, également absente de toutes deux ». À rebours du
contraste marqué entre roman et récit que Blanchot établit dans « La rencontre des
Sirènes », il est soucieux de préciser que ce roman-ci et ce récit-là sont beaucoup plus
proches qu’il ne semble. Par ailleurs, il suffit de les avoir lus pour se convaincre que ce n’est
pas au niveau du monde des événements eux-mêmes qu’ils « concordent ». Mais le premier
exergue au roman semble paraphraser la fin de la première édition de L’Arrêt de mort : « Je
suis un piège pour vous. J’aurai beau tout vous dire ; plus je serai loyal, plus je vous
53. Ibid., p. 7.
54. Ibid., p. 8.
55. Ibid., p. 127.
56. Ibid., p. 128.
57. Ibid., p. 127.
58. Ibid., p. 128.
55
Blanchot.indb 55 29/11/13 11:56
tromperai : c’est ma franchise qui vous attrapera59 ». Pourquoi Blanchot éprouve-t-il le
besoin de détacher cette phrase d’Henri Sorge à son médecin pour en faire son épigraphe,
c’est-à-dire l’envoi de l’écrivain à son lecteur ? Sinon que, là encore, c’est Ulysse qui devient
Homère, et le personnage qui engouffre le narrateur. Derrière son masque, le héros peut
bien dire la vérité, puisqu’il se trompe lui-même ; en disant la vérité, qui n’est que « sa »
vérité, il trompe. Henri Sorge sait que son esprit est dérangé : « – Oui, je suis malade. Mes
idées sentent la maladie60. » Mais ce moment de clairvoyance ne change rien, puisqu’il ne
sait pas « en quoi » ses idées sont erronées et qu’il n’accepte le principe de son erreur que
pour en dénier le détail. Alors qu’il parle à son médecin traitant comme si celui-ci était
Bouxx, sa conscience de commettre une erreur ne change rien à sa volonté de la prolonger :
[…] je tenais à vous avertir que, même si je ferme les yeux, même si j’ai l’air de
me tromper sur les choses, de vous prendre par exemple pour un autre, ce serait une
erreur de regarder ce malentendu comme sérieux. Quoi que je fasse, je sais tout de
même qui vous êtes61.
Finalement, ce qui caractérise Henri Sorge, c’est son déni permanent de la réalité. Il
s’enfonce dans la folie pour ne pas vouloir admettre vraiment qu’il est à part. La formule
initiale : « Je n’étais pas seul, j’étais un homme quelconque. Cette formule, comment
l’oublier62 ? » constitue le programme narratif de tout le roman ; il va réussir à oublier
cette « formule » et rencontrer sa Sirène Jeanne Galgat qui verra en lui – lui qui n’arrivait
même pas à intéresser son voisin de table au restaurant – le Très-Haut, le Dieu caché,
caché dans ce pavillon pour isolés où il finira seul avec son illusion, mais sa solitude se
mettra, comme le dit le narrateur de L’Arrêt de mort, « à parler ».
Certes, il y a une grande hétérogénéité entre les romans et les récits et nous n’avons pas
la place, dans le cadre de cet article, de montrer l’appartenance de chaque fiction de
Blanchot au genre « récit » qu’il a défini. Nous nous contenterons de remarquer que
cette hétérogénéité se retrouve entre romans d’une part et entre récits d’autre part. En
effet, le saut qualitatif n’est pas plus grand du Très-Haut à L’Arrêt de mort – deux fictions
à la première personne, qui paraissent en partie réalistes et qui s’inscrivent sur un fond
59. Blanchot Maurice, Le Très-Haut, op. cit., p. 7.
60. Ibid., p. 86.
61. Ibid., p. 83.
62. Ibid., p. 9.
56
Blanchot.indb 56 29/11/13 11:56
de désastre collectif – que de L’Arrêt de mort au Moment voulu – qui est une histoire
difficile à suivre, presque sans événements et sans arrière-plan et contenant à peine des
figures. D’ailleurs, l’évolution des récits est constante : alors que Au Moment voulu pré-
sente encore des personnages, Celui qui ne m’accompagnait pas n’en a plus. De même, le
fragmentaire qui s’annonce dans les derniers récits se réalise dans L’Attente l’oubli63 puis
se prolonge dans L’Entretien infini64 et les autres recueils « mixtes », alternant le narratif
et l’argumentatif. En résumé, la fiction blanchotienne ne se divise pas en « deux »
périodes, car dès Le Dernier mot, Blanchot a écrit des récits et non pas des romans et
chacun de ces récits marque une évolution formelle notable sur la précédente, s’appro-
chant toujours plus près du chant des Sirènes, espérant réaliser enfin un « récit », même
si celui-ci reste toujours à venir.
63. Blanchot Maurice, L’Attente, l’oubli, Paris, Gallimard, 1962.
64. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969.
Blanchot.indb 57 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 58 29/11/13 11:56
La considération de la dynamique dans les récits de Blanchot,
approche de la genèse de l’écriture et de la pensée
Geoffrey Martinache
L
a lecture singulière que propose Maurice Blanchot des auteurs tels que
Michaux, Artaud, Sade, Bataille ou Char se nourrit des débats engagés dans les
sciences humaines de l’époque. Blanchot développe dans ses essais critiques une
réflexion profonde et persévérante de ce qu’il appelle « l’expérience littéraire ». Il
convient alors de replacer les romans et les récits de Blanchot dans la perspective des
essais critiques puisque les uns se nourrissent des autres et qu’ils forment ensemble
l’unité de son œuvre. Blanchot ne conçoit pas la littérature comme un objet extérieur
exposé à la critique et à la théorie littéraire. La lecture comme l’écriture forment ensemble
une dynamique, l’une s’inscrivant dans la perspective de l’autre, en affirmant la spécifi-
cité de chacun en miroir. Ainsi, la critique devient le prolongement de la lecture et inver-
sement, pour engager une expérience commune, une aventure pour laquelle la
destination n’a que peu d’importance par rapport à l’errance qui interroge à la fois les
certitudes établies comme le sujet qui les porte. Cette expérience littéraire porte sur les
conditions de possibilité de la littérature, son rapport au réel, à la mimésis, au possible.
Dans la dynamique de ce mouvement, la critique ne cherche plus à étudier la littérature
59
Blanchot.indb 59 29/11/13 11:56
en fonction d’un certain nombre de codes externes et préalablement définis mais elle
propose d’en faire l’expérience.
C’est dans ce perpetuum mobile1 que la dynamique de l’œuvre se fait sentir. Le rôle du
lecteur comme de l’écrivain n’est pas de faire de l’œuvre un objet fini mais d’assurer ses
conditions de possibilité. Dans « La rencontre de l’imaginaire », Blanchot précise que le
récit n’est pas seulement « le récit d’un seul épisode » mais celui d’une rencontre, celle
« d’Ulysse et du chant insuffisant et attirant des sirènes ». Ainsi, « […] le caractère du
récit n’est nullement pressenti, quand on voit en lui la relation vraie d’un événement
exceptionnel, qui a lieu et qu’on essaierait de rapporter. Le récit n’est pas la relation de
l’événement encore à venir et par la puissance attirante duquel le récit peut espérer, lui
aussi, se réaliser2 ». Le récit n’apparaît plus comme une succession d’événements mais
comme le flux continu du mouvement de l’écriture. L’écrivain ne propose plus de resti-
tution réglée et calculée de ses actes mais au contraire il s’expose au flux permanent, si
continu que les événements qui la composent ne sont plus conçus comme des étapes de
son mouvement, mais dissous dans sa dynamique. Écrire devient un mouvement sans
origine ni fin : « Ce qui s’écrit livre celui qui doit écrire à une affirmation sur laquelle il
est sans autorité, qui est elle-même sans consistance, qui n’affirme rien, qui n’est pas le
repos, la dignité au silence, car elle est ce qui parle encore quand tout a été dit, ce qui ne
précède pas la parole, car elle l’empêche plutôt d’être la parole commençante, comme
elle lui retire le droit et le pouvoir de s’interrompre3. » Alors, si « le récit d’Homère […]
n’est rien d’autre que le mouvement accompli par Ulysse au sein de l’espace que lui
ouvre le chant des sirènes », cela veut dire que « le récit ne relate que lui-même […] » et
que « cette relation, en même temps qu’elle se fait, produit ce qu’elle raconte ». Pour
Blanchot, le récit tout entier est mouvement, mobilité, que seule l’étude globale du pro-
cessus permettra d’envisager la finalité par la mise sous tension des forces en jeux pour
en faire jaillir le sens : « Le récit est mouvement vers un point, non seulement inconnu,
ignoré, étranger, mais tel qu’il ne semble avoir, par avance et en dehors de ce mouvement,
aucune sorte de réalité, si impérieux cependant que c’est de lui seul que le récit tire son
1. Nous nous permettons de renvoyer à l’ouvrage de Jeanneret Michel, Perpetuum mobile,
métamorphose des corps et des œuvres de Vinci à Montaigne, Paris, Macula, 2000 qui étudie l’idée
du mouvement perpétuel dans la science, les arts et la littérature.
2. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, « Folio/Essais », 2005, p. 14.
3. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, op. cit., p. 20.
60
Blanchot.indb 60 29/11/13 11:56
attrait, de telle manière qu’il ne peut même “commencer” avant de l’avoir atteint, mais
cependant c’est seulement le récit et le mouvement imprévisible du récit qui fournissent
l’espace où le point devient réel, puissant et attirant4. » Blanchot fait donc reposer son
rapport à l’écriture sur l’intentionnalité lévinassienne : « L’œuvre de Maurice Blanchot
où la littérature n’est ni l’approche du beau idéal, ni l’un des ornements de notre vie, ni
le témoignage de l’époque […], mais la relation ultime avec l’être dans une anticipation,
quasiment impossible, de ce qui n’est plus l’être – cette œuvre ne se conçoit pas en dehors
de l’idée radicale d’intentionnalité5 ». Dans cette considération, l’expérience de l’écriture
selon Maurice Blanchot n’est pas un objet du monde. Elle ne s’ajoute pas à un monde
pré-existant. C’est une expérience jamais finalisée, toujours à l’œuvre, constamment en
train de se faire. Elle ne se présente pas comme une chose faite, mais comme une chose
se faisant. La relation entre la phénoménologie lévinassienne et la conception de la litté-
rature par Blanchot se fait au moyen d’une corrélation entre une perspective permettant
de donner du sens à ce qui apparaît mais aussi grâce à la finalité de ce mouvement, ce
vers quoi il est attiré. L’expérience de l’écriture ne peut pas être considérée comme une
écriture automatique dénuée de toute finalité ou de toute intention précise. Néanmoins,
l’acte d’écrire ne se résume pas à trouver la formulation la plus précise possible d’une
idée mais à saisir le mouvement d’ensemble du langage pour se constituer en œuvre lit-
téraire singulière et autonome6. Blanchot cherche sa langue au travers de sa formation et
l’œuvre doit préserver cette dynamique originelle. Alors l’œuvre finale de Blanchot est
comme engagée dans la palpitation du langage. À travers ce mouvement de/dans l’écri-
ture, elle présente la dimension intempestive de son processus. Les récits de Blanchot
apparaissent donc à la lumière de ces remarques comme processus à l’œuvre et non
comme simple déposition d’une réalité basée sur un monde prédéfini.
4. Ibid., p. 14.
5. Lévinas Emmanuel, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris, Vrin, 1994,
p. 144, cité par Cools Arthur, « Intentionnalité et singularité. Maurice Blanchot et la phénomé-
nologie » in Maurice Blanchot et la philosophie, Hoppenot Éric, Milon Alain (dir.), Paris, Presses
Universitaires de Paris Ouest, 2010, p. 145.
6. À ce sujet, voir Cools Arthur, « Intentionnalité et singularité. Maurice Blanchot et la phéno-
ménologie », op. cit., p. 142-146 ; voir aussi Malabou Catherine, Le Change Heidegger, Paris, Léo
Scheer, 2004. Catherine Malabou propose une lecture de la pensée d’Heidegger insistant sur la
question de la transformation, du changement, de la métamorphose, de la convertibilité.
61
Blanchot.indb 61 29/11/13 11:56
Fouiller le rythme
La visibilité de la terre est un fait fondamental pour la pensée et l’imagination
modernes. Blanchot remarque qu’un certain nombre de penseurs ont fait de la terre le
lieu permettant de s’interroger sur le fondement ontologique pour représenter la repré-
sentation, penser la pensée, peindre la peinture ou encore écrire sur l’écriture. Qu’il
s’agisse de Hölderlin, Baudelaire, Hugo, Flaubert, en ce moment de modernité, les
artistes se doivent de porter une réflexion sur leur œuvre et d’incorporer cette réflexion
dans le contenu de leur œuvre. C’est ainsi que la terre désigne la problématique fonda-
mentale de la modernité pour deux raisons. D’une part, elle questionne la structure de
l’acte créatif (penser, écrire, peindre). D’autre part, elle structure la pensée, l’écriture et
la peinture modernes. L’œuvre est alors tournée vers « la profondeur élémentaire, vers
cet élément qui serait la profondeur et l’ombre de l’élément et dont nous savons que les
objets n’y font pas allusion, dans l’apparence d’être qu’ils donnent à la matière7. » Il
serait trop facile de penser que le fond élémentaire de l’œuvre est fait de sa matière. Pour
une œuvre littéraire il s’agirait du langage. La matière de l’œuvre n’est donc pas simple-
ment son fond élémentaire : « […] L’erreur est de croire que le langage soit un instru-
ment dont l’homme dispose pour agir ou pour se manifester dans le monde ; le langage
en réalité dispose de l’homme en ce qu’il lui garantit l’existence du monde et son exis-
tence dans le monde8. » La langue se singularise par sa promptitude à s’affranchir de la
réalité, à s’abstraire du monde sensible pour se reconstituer comme monde à part dispo-
sant d’une « cadence propre9 ». L’impossibilité de dire doit également être prise en
compte par l’auteur. Le langage ne se réduit pas à un réseau de possibilités en attente
d’être actualisées dans l’œuvre. C’est en même temps une impossibilité manifeste de dire
en dépit de ces possibilités. Ainsi, la matière de la profondeur élémentaire n’est pas le
langage comme matière de l’œuvre littéraire mais d’une entité à travers laquelle il sera
possible de ressentir le processus d’absolutisation et d’essentialisation10 du langage litté-
raire tel que Blanchot l’étudiera de plus en plus clairement au fil de ses œuvres, notam-
ment à partir de Faux Pas.
7. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, « Folio/Essais », 2007, p. 298.
8. Blanchot Maurice, Faux Pas, Paris, Gallimard, 1999, p. 191.
9. Ibid., p. 129.
10. Voir Hart Kevin, The dark Gaze : Maurice Blanchot and the sacred, Chicago, University of
Chicago Press, 2010, p. 12. Je traduis.
62
Blanchot.indb 62 29/11/13 11:56
Détachée de toute préoccupation de désignation, la profondeur élémentaire de l’œuvre
littéraire donne une matière susceptible de rendre compte de la puissance d’événement
de l’œuvre, qui fait « […] le jour […] plus jour à nos yeux, et la mer qu’il domine est
plus proche d’elle-même, la nuit plus proche de la nuit11. » À plusieurs occasions,
Blanchot évoque le concept de rythme pour restituer cette dimension de l’œuvre. Il le
précise en citant dans un premier temps Hölderlin et en précisant que le rythme est « le
fond élémentaire » à partir de quoi l’œuvre peut advenir. En effet, puisque l’œuvre fait
apparaître ce qui disparaît dans l’objet. Hölderlin cité par Blanchot : « Quand le rythme
est devenu le seul et unique mode d’expression de la pensée, c’est alors seulement qu’il y
a poésie. Pour que l’esprit devienne poésie, il faut qu’il porte en lui le mystère d’un
rythme inné. C’est dans ce rythme seul qu’il peut vivre et devenir visible. Et toute œuvre
d’art n’est qu’un seul et même rythme. Tout n’est que rythme. La destinée de l’homme
est un seul rythme céleste, comme toute œuvre d’art est un rythme unique12. »
La communauté de pensée souvent évoquée entre Blanchot et Lévinas, qui construit,
dans De l’existence à l’existant, une entreprise inspirée « dans une large mesure […] de
la philosophie de Martin Heidegger », mais motivée par « un besoin profond de quitter
le climat de cette philosophie », peut nous aider à comprendre comment Blanchot
accomplit le geste philosophique de substituer la réalisation au concept et considère « la
notion d’un exister qui se fait sans nous, sans sujet, d’un exister sans existant » c’est-à-
dire non plus comme une unité indivisible mais comme le déploiement et la pensée de
son apparition. Cette relation entre l’événement et le processus a été explicitée par
Lévinas sous le concept d’« il y a ». À plusieurs reprises, Lévinas a évoqué l’œuvre de
Blanchot comme utilisation pertinente de l’« il y a » que ce soit dans ses récits comme
Thomas l’Obscur13 ou Aminadab14 : « C’est là un thème que j’ai retrouvé chez Maurice
Blanchot, bien que lui ne parle pas de l’il y a mais du neutre ou du dehors15. » La question
philosophique de la relation entre Lévinas et Blanchot ayant été maintes fois débattue,
nous éviterons de nous y attarder. Il ne s’agit pas pour nous de pointer les lignes de
convergence entre les deux termes, mais de pointer une considération de la différence
11. Blanchot Maurice, Faux Pas, op. cit., p. 129
12. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 299.
13. Lévinas Emmanuel, De l’Existence à l’existant, Paris, Vrin, 1963, p. 103.
14. Lévinas Emmanuel, Le Temps et l’autre, Paris, PUF, « Quadrige », 1994, p. 37.
15. Lévinas Emmanuel, De l’Existence à l’existant, op. cit., p. 48.
63
Blanchot.indb 63 29/11/13 11:56
entre l’événement et le processus permettant dans ces conditions de penser que Blanchot
met l’accent sur le déploiement de l’œuvre et sur les conditions de son apparition. Le
rythme comme déploiement et l’apparition de son élan sont autant de problématiques
qui nous poussent à penser l’œuvre au-delà du simple fait qu’il y a du rythme dans les
textes écrits par Blanchot. Il convient de nous pencher sur cette intimité du mouvement
d’écriture que le rythme parvient à ouvrir. Blanchot nous invite à nous intéresser à
l’œuvre en tant qu’intimité mais aussi à l’œuvre en tant qu’elle excède l’unité. Écrire
n’est jamais pour lui être écrit. Il revient à nous interroger sur la teneur de ce mouvement
capable d’opérer une transformation de l’œuvre.
Les forces de l’œuvre
L’œuvre littéraire est donc aux yeux de Blanchot d’emblée et constitutivement puis-
sance de transformation. Elle est toujours et jamais la même. Transformation se faisant
de manière autonome en elle-même comme manifestation de l’altérité : « Le rythme
encore privé de mots, la voix qui ne dit rien, qui ne cesse de dire, doit devenir puissance
de nommer16. » Le rythme d’une œuvre est sa structure la plus intime. Elle cadre son
devenir et son apparence. Le rythme ne peut être, il est puissance de devenir, ensemble de
possibilités. Le rythme est pour Blanchot une force active, non encore articulée permet-
tant « […] par puissance de l’ébranlement [au] jour [d’être] plus jour à nos yeux, et la
mer qu’il domine […] plus proche d’elle-même, la nuit plus proche de la nuit17. », c’est-
à-dire d’être saisi dans son déploiement et non comme une simple répétition mécanique.
L’œuvre, comme le rythme, n’est pas une agrégation d’unités dont seule la dernière aurait
une importance rendant les précédentes obsolètes. Pour Blanchot, faire exister une œuvre
littéraire revient à exprimer son devenir en amplifiant les forces ontologiques contenues
en elle. En ce sens, l’œuvre est comme en emphase d’elle-même. Et ce rayonnement n’est
autre que ce que nous appelons le rythme et qui constitue l’œuvre comme telle.
Blanchot précise que l’œuvre « n’est pas l’unité amortie d’un repos18. » Le fond élé-
mentaire est donc un chaos informe constitué de forces, de « gisements » aussi impré-
visibles qu’étonnants qui, grâce au rythme, s’actualisent dans l’œuvre qui apparaît
16. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 301.
17. Ibid., p. 298.
18. Ibid., p. 300.
64
Blanchot.indb 64 29/11/13 11:56
donc comme la mise en œuvre de sa propre formation, la mise en acte de sa propre
genèse. Il est donc évident que le rythme comme fond élémentaire de l’œuvre ne peut
pas se constituer comme un thème parce qu’il ne peut devenir concret qu’en s’activant.
Il ne prend consistance que dans la dynamique de son processus. Blanchot ne confère
pas à la littérature une fonction représentative qui aurait pour vocation de rendre pré-
sentable une idée mais la littérature n’existe qu’en rendant visible la modulation spéci-
fique de son activité, dans l’amplitude disponible de son geste artistique. Blanchot fait de
l’œuvre la forme ultime de la mobilité puisqu’elle devient dans cette considération le
milieu où s’opposent toutes les forces indispensables à toute œuvre possible. Ce champ
de forces constitutif du rythme n’a aucune forme préétablie. Il n’est enfermé par aucune
délimitation. Seul le rythme peut le rendre visible et saisissable. L’œuvre ne se constitue
œuvre que par l’animation de ces forces contraires qui ne sont autres que les effets du
geste artistique, constitué comme acte de surgissement. Une fois la forme de l’œuvre
trouvée, ces forces ne disparaissent pas, elles lui survivent et se constituent comme éven-
tualité de sa continuation, comme réserve de devenir de l’œuvre. Les potentialités se
poursuivent alors. Une résonance interne se forme pour amplifier le rythme déjà sen-
sible et perpétuer son activité. Le rythme qui anime alors les forces contraires, les agite,
pour permettre à l’œuvre de devenir « l’épanouissement de ce qui, pourtant se cache et
demeure fermé […]19 » n’est pas déjà constitué et les forces n’auraient comme charge
que de l’animer. Le rythme est bien le devenir comme possibilité du virtuel. On observe,
dans ce fond élémentaire de l’œuvre, la mise en œuvre permanente de l’être artistique
comme extase d’une dynamique dont il est l’émanation. En effet, apparaître pour le
rythme, c’est se manifester soi-même, par le geste, dans l’œuvre.
C’est en suivant ces forces que nous pouvons envisager toutes les possibilités de
l’œuvre. Le rythme s’inscrit dans le prolongement de l’œuvre, sa dynamique continue.
Il se présente comme son champ des possibilités qui réclament encore une actualisa-
tion. Même si le possible paraît entrer en contradiction avec le concept de la réalité de
l’œuvre (tant que la possibilité n’est pas actualisée, elle n’est pas encore réelle) ces forces
peuvent être appréhendées comme appartenant à un seul et même mouvement car
dans leur exercice, ils ne s’ignorent pas l’un l’autre. Il y a le réel tel qu’il est et il y a les
effets possibles du réel. Cependant, le réel déchargé de la réalité du possible doit aussi
être considéré comme un réel possible, non pas parce qu’il ne sera jamais considéré
19. Ibid.
65
Blanchot.indb 65 29/11/13 11:56
comme réalité mais parce qu’il peut éventuellement se charger de réalité et devenir de
manière effective une partie prenante de la réalité. Il y a en effet un devenir-réel du
possible20. Ainsi le rythme de l’œuvre rend compte de cette opérationnalité des élé-
ments et de ce basculement du domaine de la possibilité vers celui de la réalité.
Christophe Bident précise dans sa biographie très fouillée de Blanchot que lors de sa
formation philosophique l’importance de Bergson, prix Nobel en 1927, passe par une
appréhension particulière du temps faisant de la durée une force créatrice « où l’intui-
tion accomplit le mouvement de l’esprit21 ». Il est donc possible de supposer que cette
conception du rythme comme lieu de possibilités et de prolongement de la réalité est due
à l’influence de Bergson qui reprend le même principe. Alors, le possible prend la forme
de ce qui est susceptible de se réaliser sans aucune confirmation. Puisque le possible est
fait d’un éventail très large d’éventualités qui ne se réalisent pas forcément, la réalisation
impose un choix, l’élimination de certains possibles alors que d’autres se matérialisent
dans l’œuvre. L’artiste fait le choix de développer tel ou tel élément du rythme.
Le rythme comme genèse de l’œuvre
Une fois ces forces identifiées, le rythme nous permettrait d’accomplir la genèse de la
pensée en même temps que la genèse de l’objet. Il ne s’agit pas ici d’identifier les
conditions de possibilités du phénomène de l’œuvre mais d’accompagner la mouvance
même de l’œuvre, elle-même sans origine, en réduisant l’écart entre une méthode
descriptive et une méthode active. Il n’est donc pas question de reconstituer grâce au
rythme le processus dont l’œuvre est l’aboutissement mais de réactiver ce processus dans
l’œuvre finie. Le temps originel est réinventé comme temps de déploiement de l’œuvre.
Le Livre à venir est dans cette perspective un titre programmatique. Ce livre qui présente
une projection dans l’avenir est également son esquisse, sa perspective, sa préparation.
20. Voir, à ce sujet, Mechoulan Éric, « Bergson anachronique, ou la métaphysique est-elle
soluble dans l’intermédialité ? », in Devenir-Bergson – Intermédiallté, n° 3, 2004, p. 119. En
développant ce qu’il appelle le rythme (du) réel, Éric Méchoulan complète cette idée en s’ap-
puyant sur le texte de Bergson, « Le possible et le réel », de 1930.
21. Bident Christophe, Maurice Blanchot, partenaire invisible, Paris, Champ Vallon, 1998, p. 45.
Christophe Bident renvoie également à un article de Blanchot sur Bergson attestant de sa connais-
sance précise des concepts bergsoniens : Blanchot Maurice, « Bergson et le symbolisme », in
Journal des débats, 10 février 1942, p. 3.
66
Blanchot.indb 66 29/11/13 11:56
Blanchot se focalise durant toute sa carrière sur ce qui rend une œuvre possible, ses
conditions de visibilité ou d’extase. Alors, il ne cesse de se référer aux « marges du
texte » en étudiant les auteurs. Il va puiser dans les correspondances, les manuscrits, les
journaux des écrivains dont il cherche à percer la pensée pour saisir enfin et de manière
globale la possibilité de l’œuvre qu’il situe entre l’auteur et son texte. La considération
du rythme peut être une autre manière de considérer l’œuvre en train de se faire. Le
rythme comme genèse de l’œuvre est fondamental pour la pensée de Maurice Blanchot
car elle définit l’ontologie comme une opération d’apparition perpétuée22, elle met en
évidence sa réalité de processus, elle précise que le devenir est une dimension de
l’œuvre, non ce qui lui advient selon une succession qui serait donnée par une unité
originelle mais aussi parce que seul le mouvement de l’écriture est susceptible de frayer
la voie du rythme blanchotien s’édifiant en lui, dans les apparitions fraîches23.
Si une œuvre littéraire, pour exister, doit effectuer sa formation, comment l’œuvre
peut-elle s’amalgamer avec sa propre opération de constitution ? Comment le rythme
blanchotien peut-il constituer l’œuvre en activité et en prendre la mesure ?
En 1942, Blanchot publie son second roman, Aminadab, qui reprend le thème de l’er-
rance du héros déjà initié ailleurs dans un hôtel labyrinthique. La description y tient une
place particulière. Le visage de chacun des portraits décrits dans le récit est brouillé ou
effacé. Ce dispositif descriptif place Thomas dans un espace neutre qui l’oblige à enta-
mer une quête interprétative à la fois décevante et libératrice. Alors que deux visiteurs de
la maison fascinés par une fresque peinte au plafond de la salle demandent de manière
désinvolte pourquoi il n’y avait pas, ce jour-là, de spectacle de danse, deux individus
choqués de cette remarque, sont incapables de répondre clairement à cette question et
bredouillent quelques mots « mais qui devaient signifier : nous ne sommes pas compé-
tents, nous n’y sommes pour rien ».
Dans Aminadab, Blanchot n’est pas le seul bien sûr à rapprocher les deux arts. L’associa-
tion de la musique et de la littérature n’est pas neuve et suscite d’emblée de nombreux
rapports très différents les uns des autres : la poésie, le chant, la voix, la musicalité, le timbre,
l’harmonie. Les notions, les genres et les formes se croisent et se rencontrent sous le signe
de l’analogie le plus souvent ou de la correspondance au sens baudelairien du terme.
22. Voir, à ce sujet, Wiskus Jessica, The rythm of thought, Chicago, The University of Chicago
press, 2013, p. 18.
23. Ibid.
67
Blanchot.indb 67 29/11/13 11:56
Cependant, à l’instar de la proposition de Francis Marmande, lire la littérature à travers ce
qu’elle dit de la musique en dehors de tout rapport analogique est l’enjeu principal de cette
partie du texte d’Aminadab dans lequel Blanchot évoque le rythme musical. L’insistance
sur le sonore et le rythme est la mise en jeu comme ressort syntaxique de cet extrait d’Ami-
nadab24. En étudiant le rythme dans cette œuvre, nous serons en mesure d’accomplir la
genèse de la pensée en même temps que la genèse de l’objet. Il ne s’agit pas ici d’identifier
les conditions de possibilités du phénomène de l’œuvre mais d’accompagner la mouvance
même de l’œuvre en son autogenèse.
Dans cet extrait d’Aminadab25, Blanchot nous propose une description attentive, sen-
sible et méticuleuse d’une musique que Thomas ressent comme une véritable expé-
rience. Lorsque la voix se fait entendre, elle brise le bruit ambiant devenu assourdissant
et dépourvu de signification pour s’élever dans les airs et tenter de retrouver la sponta-
néité inventive des chants d’oiseaux. Ce qui maintient le rythme blanchotien dans cet
extrait c’est d’abord les mouvements contraires « qui ne se concilient jamais et qui ne
s’apaisent pas26 ». Leur coprésence est essentielle pour le rythme. L’espacement, consti-
tutif du rythme entre ces deux forces antagonistes, devient orientation qui ne peut se
concrétiser qu’à travers cet intervalle. L’intervalle est la seule entité au sein de l’activité
de l’œuvre à réussir à mettre en mouvement les forces antagonistes qui libèrent une
charge d’énergie créatrice.
Le chanteur oppose dans ces conditions, sans s’en rendre compte, la stabilité des
éléments individuels au flux d’énergie qui les crée et c’est dans l’intervalle qui mène à la
conception que se mesure l’œuvre se faisant. Sous les apparences, se cachent alors les
forces vitales dont le dynamisme est le plus connu. Sans consistance propre, imprévisible,
cette force, capable de construire « des colonnes de sons » constitue le devenir même.
C’est en lui que peut se trouver la réalité en soi, et non pas dans une temporalité fictive
ou dans un temps abruti par sa répétition mécanique. La teneur de ce chant est
particulière puisque les sons ne sont pas successifs mais se confondent. Ainsi, le rythme
dans cet extrait, conformément à la définition blanchotienne, ne s’inscrit pas dans une
succession, il ne passe pas d’une unité à une autre en niant la précédente mais il entretient
24. Voir Marmande Francis, « La Perfection de ce bonheur », in Maurice Blanchot. Récits cri-
tiques, Bident Christophe et Vilar Pierre (dir.), Paris, éditions Farrago/Léo Scheer, p. 421.
25. Blanchot Maurice, Aminadab, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 2004, p. 168-169.
26. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 300.
68
Blanchot.indb 68 29/11/13 11:56
un potentiel d’être qui n’est autre que l’énergétique de sa présence. Le rythme de cette
musique amplifie les énergies contenues en lui et permet alors de considérer que le
devenir est une dimension du récit, non ce qui lui advient selon une succession qui serait
subie par une entité présupposée. Cette conception du récit fait mais toujours en train
de se faire ouvre une compréhension de l’œuvre où sa libre formation est possible.
La force questionnante comme débord du mouvement de la pensée
Blanchot semble alors proposer une phénoménologie du devenir qui impose de fait à
l’œuvre de retrouver son « fond élémentaire » d’où « les paroles jaillirent […] de la
confusion où elles avaient été perdues » et les énergies fluctuantes capables de métamor-
phoses qui y gisent et transformer le son en beauté « inattendue ». Alors si l’être accepte
de s’engouffrer dans les méandres d’une exploration profonde et inattendue, il accède au
« bonheur » comme « récompense d’un pénible travail ».
Cependant, cette exploration réclame une adaptation de la conscience qui ne peut
plus se situer dans un face à face avec l’œuvre pour se la représenter, mais doit réinventer
sa place à chaque fois pour redéfinir le rapport qu’elle entretient avec l’œuvre et se placer
au cœur même du devenir. Il faut pour cela prêter attention aux rythmes en constante
modulation, et donc impossibles à fixer ni à mesurer parce qu’il n’y a aucun repère stable
ni aucune finalité. Bien sûr un tel rythme, qui dépasse le partage entre les éléments de la
métrique envisageant une ouverture de la parole comme un réseau à plusieurs
dimensions, un ensemble de modifications et de modulations impossibles à saisir ou à
fixer ne peut qu’être source de désorientation et de perturbations. Le rythme ne résulte
pas là d’une juxtaposition arbitraire d’éléments constituants une composition mais
d’une relation d’opérations se transformant en énergie pour devenir une composition se
modifiant constamment. Alors au sein de ces opérations même, le rythme est cette
existence de rapport mettant en œuvre l’exercice d’une rupture porteuse de l’énergie du
rythme, pur processus sans finalité. Dans L’Entretien infini, Blanchot précise que ce
mouvement est inhérent à la littérature : « La désorientation est à l’œuvre dans la parole,
par une passion d’errer qui n’a pas de mesure. […] Parler comme écrire nous engage
dans un mouvement séparateur, une sortie oscillante et vacillante27. » La rupture du
discontinu dans le rythme comme le désastre ou la catastrophe est ce qui constitue
27. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 2004, p. 38-39.
69
Blanchot.indb 69 29/11/13 11:56
l’expérience de l’écriture pour Blanchot à tel point qu’il place le danger comme
constituant de la pensée artistique. En citant Rilke dans L’Espace littéraire, Blanchot
souligne que « Les œuvres d’art sont toujours les produits d’un danger couru, d’une
expérience menée jusqu’au bout, jusqu’au point où l’homme ne peut plus continuer. »
La pensée est alors associée à une rupture, elle est « l’affirmation d’une expérience
extrême28. » La pensée, prise dans un tel rythme, ne peut se fixer définitivement sur
aucun objet et ne peut pas non plus cesser la dynamique incessante de son errance.
Dépourvue de toute attache, elle ne peut se fixer en aucun lieu, elle ne peut que se
mouvoir dans les méandres d’un dire affranchi de l’obligation de signification qui
prendrait corps en suivant l’idée.
Comme le rythme, la pensée aurait donc pour caractéristique principale de pouvoir
sans cesse se réinventer en prenant en compte l’enchaînement des éléments de son anté-
riorité : « Le calme détour de la pensée, retour d’elle-même en l’attente. Par l’attente, ce
qui se détourne de la pensée retourne à la pensée devenue son détour. L’attente, l’espace
du détour sans digression, de l’errement sans erreur29. » La pensée est en perpétuelle
évolution, formellement comme logiquement, comprise dans la palpitation vivante du
rythme pour prendre une forme assumée par ce qui est mouvant. Ce changement
constant relève de la modulation. Il s’agit, chaque fois que cela nous est proposé de
suivre son flux qui, lorsqu’il se présente à nous, a été soumis à un refaçonnage plus ou
moins sophistiqué. La pensée nous incite à une irréductible dialectique de l’immobilité
et du mouvement, de l’équilibre et de la rupture d’équilibre. Elle est dépassée parfois, elle
se métamorphose sans fin. Loin d’être une condamnation à l’image de la légende du juif
errant30, l’errance de la pensée est un mouvement qui empêche tout enracinement, toute
28. Voir, à ce sujet, Lannoy Jean-Luc, Langage, perception, mouvement, Merleau-Ponty et Blan-
chot, Paris, Jérôme Millon Éditeur, 2008, p. 226.
29. Blanchot Maurice, L’Attente l’oubli, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 2000, p. 61.
30. Le mythe d’Ahasvérus ou le Juif errant prend son origine dans le chemin de croix qui conduit
le Christ à la crucifixion. Alors que ce dernier peinait à porter sa croix jusqu’au mont des Oliviers,
il demande de l’aide à un cordonnier qui lui refuse, préférant être spectateur de la scène. Jésus lui
répond alors « Je m’arrêterai et reposerai et tu chemineras ». Le cordonnier méprisant reçoit alors
la sentence d’errer interminablement, sans repos. Cette impossibilité de se fixer le placera au ban
de la société. Il parcourt alors le monde à la recherche d’un salut. À partir du xive siècle, un petit
opuscule allemand décide de représenter le Juif errant sous les traits du petit personnage courbé
par la fatigue avec une longue barbe et un bâton. Cette imagerie contribue à la popularisation du
mythe et incite un grand nombre d’intellectuels à se pencher sur de nouvelles interprétations.
70
Blanchot.indb 70 29/11/13 11:56
fixation31. La pensée, comme le rythme, se définissent à travers une genèse qu’ils font et
non pas à partir d’un principe pour lequel ils ne seraient que l’effet. Leur nature com-
mune est le processus. Le rythme est le moyen pour Blanchot de maintenir l’équilibre
précaire du mouvement de la pensée conditionné par l’impossibilité de se poser. Tou-
jours en mouvement, jetée vers une excitation constante, la pensée est poussée à se
mettre en danger plutôt que de choisir le repos comme condition. La recherche du dan-
ger pour Blanchot coïnciderait avec une recherche de la pensée authentique qui n’a pas
pour but de trouver un chemin pour établir du sens mais qui trouve dans son errance
sans fin une dynamique propice au questionnement.
Ainsi, la pensée ne se contente pas de rebondir sans cesse pour exister ni de se cantonner
à son sens classique qui veut qu’elle s’interroge sans répit. Pour Blanchot, penser ne peut
pas se résumer à construire un ensemble d’hypothèses théoriques qu’il convient par la
suite d’interroger, de préciser et de formuler pour proposer une structure intellectuelle
Ainsi au xixe siècle, on enregistre beaucoup d’occurrences à ce mythe dans divers domaines artis-
tiques : la littérature évidemment avec Eugène Sue ou H. G. Wells, dans les arts graphiques avec les
douze gravures de Gustave Doré en 1859 qui connurent un succès populaire. L’artiste montre dans
cette série sa parfaite connaissance à la fois, de la tradition iconographique et des différentes ver-
sions du mythe. Il choisit de le représenter en mettant l’accent sur sa culpabilité envers le Christ
qui est toujours présent dans les gravures et sur sa capacité à braver les dangers pour continuer son
chemin jusqu’au jugement dernier. Courbet lui, choisit de moderniser le mythe en s’écartant des
textes pour offrir une métaphore de l’artiste dans La rencontre peint en 1854.
31. L’insomnie est présentée par Blanchot comme l’expérience paradigmatique de cet état de
sans repos. Dans cette agitation aussi bien mentale que corporelle, l’homme est incapable d’adap-
ter son mode d’être aux circonstances de la nuit. Alors que les sens devraient commencer à
défaillir pour plonger l’homme dans un sommeil profond, ils sont toujours en alerte. Il n’y a plus
de cloisonnement entre sommeil et éveil mais un état d’alerte permanent que Blanchot souligne
par le caractère diurne du sommeil car il se décentre de la vie qui impose le repos : « Le sommeil
signifie qu’à un certain moment, pour agir, il faut cesser d’agir – qu’à un certain moment, sous
peine de me perdre dans le vagabondage, je dois m’arrêter, transformer virilement l’instabilité des
possibles en un seul point d’arrêt contre lequel je m’établis et me rétablis ». Blanchot Maurice,
L’Espace littéraire, op. cit., p. 360. L’insomnie concerne ainsi un rapport particulier au jour. Le
sommeil devient diurne car il extrait l’individu du rythme quotidien de sa vie qui lui impose le
sommeil pour trouver son repos. Mais dans l’insomnie, le sommeil ne se conçoit pas comme un
repos. Le corps de l’insomniaque se transforme en cadavre parce qu’il ne trouve pas sa position
propre. Sa position contrainte, muscles tendus, immobilité du corps qui se lève, se retourne, et
essaye de trouver sa place dans le sommeil suggère l’errance de l’homme jusque dans son lit trans-
formé en labyrinthe cloisonné par des pensées évanescentes. C’est l’être tout entier qui pendant le
sommeil cherche une nouvelle identité par le rêve qui paradoxalement n’est plus le propre du
sommeil mais de l’insomnie car il ne peut être atteint que lorsque le sommeil profond est dérangé.
71
Blanchot.indb 71 29/11/13 11:56
d’ensemble et porter une signification précise sur le sujet. Penser revient à prendre le
risque de l’inconnu, c’est-à-dire du côté de ce qui n’est pas maîtrisé mais qui pourrait
éventuellement mener jusqu’au dehors32. Alors, « Les vraies pensées sont des pensées du
refus, refus de la pensée naturelle, de l’ordre légal et économique, lequel s’impose comme
une seconde nature, de la spontanéité qui n’est qu’un mouvement d’habitude, sans
recherche, sans précaution, et qui prétend être un mouvement de liberté. Les vraies
pensées questionnent, et questionner, c’est penser en s’interrompant33. » Le mouvement
qui favorise la pensée authentique n’est pas linéaire mais un mouvement constitué de
ruptures et de valeurs différentes lorsque la parole cherche à s’accorder avec la force
interrogeante qui déborde la pensée et qui lui permet de se ressourcer. Au lieu d’attirer
l’unité que lui proposerait le leurre de la réponse, la pensée se doit d’aller au-delà et de
maintenir par le rythme un perpétuel mouvement. Ce mouvement naît précisément de
la répétition du questionnement, rebondissant sans cesse, dans une constante mobilité
pour ne pas tomber dans le faux repos de la réponse. Le rythme de la pensée chez
Blanchot est la condition pour que l’expérience de l’écriture soit une expérience totale34.
Il est le paradigme de l’incomplet qui, malgré tout, accomplit : « La question, si elle est
parole inachevée, prend appui sur l’inachèvement. Elle n’est pas incomplète en tant que
question ; elle est, au contraire, la parole que le fait de se déclarer incomplète accomplit.
La question replace dans le vide l’affirmation pleine, elle l’enrichit de ce vide préalable.
Par la question, nous nous donnons la chose qui nous permet de ne pas l’avoir encore ou
de l’avoir comme désir. La question est le désir de la pensée35. »
32. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 326. « Cette expérience est celle de l’art.
L’art, comme image, comme mot et comme rythme, indique la proximité menaçante d’un dehors
vague et vide, existence neutre, nulle, sans limite, sordide absence, étouffante condensation où
sans cesse être se perpétue sous l’espèce du néant. »
33. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 499.
34. Blanchot Maurice, La Part du feu, Paris, Gallimard, « Blanche », 2000, p. 58 : « Le langage
le plus élémentaire porte en lui un léger mouvement vers sa réalisation totale, un infime besoin de
faire apparaître en même temps les deux aspects qui le constituent. [...] Si ce mystère est la méta-
morphose du sens en mot et du mot en sens, le poème, en fixant le mot dans une matière plus
stricte et le sens dans une conscience plus forte, semble en effet une tentative pour empêcher le jeu
de la métamorphose, semble un défi jeté au mystère, mais celui-ci, se produisant malgré tant de
précautions et contre la puissante machine préparée pour l’anéantir, n’en est que plus frappant et
deux fois mystère. Peut-être, à la vérité, le mot métamorphose nous rend-il trop proche l’étrange
anomalie que représente la prétention du langage à s’accomplir totalement. »
35. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 14.
Blanchot.indb 72 29/11/13 11:56
La question de la
nomination
Blanchot.indb 73 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 74 29/11/13 11:56
Le pouvoir des mots :
autour de Thomas l’Obscur
Anca Calin
L
a réalité est difficile à exprimer quelle que soit la langue. La traduction
semble inscrite dans l’acte même d’écriture ou de lecture. Une altérité se construit
ainsi dès que la formulation se met en scène. Pourtant la langue dans laquelle le
lecteur-écrivain1 s’exprime appartient au monde réel même s’il s’agit d’une convention.
1. Selon Blanchot, l’entrée dans la littérature se fait exclusivement par la lecture et la sortie obliga-
toirement par l’écriture. Les variantes « lecture sans écriture » ou « écriture inspirée par un talent
inné » sont inconcevables pour le penseur français. Le processus intellectuel qui a lieu entre ces deux
limites (un texte avant d’être lu est une limite, ainsi qu’un texte après avoir été écrit devient toujours
une limite) représente l’essence même de la création littéraire. Il s’agit d’un processus de lecture-
réflexion-écriture, trois pôles d’une même démarche, que Blanchot illustre dans son chef-d’œuvre,
Thomas l’Obscur. Comment s’appelle le sujet de cette démarche de lecture-réflexion-écriture ? Com-
ment nommer l’individu qui accomplit en même temps le travail de lecture, de réflexion et d’écri-
ture ? Nous pensons que le terme le plus adéquat pour exprimer la qualité de l’individu dont parle
Blanchot est celui de lecteur-chercheur-écrivain. Mais pour la facilité de la communication nous
retiendrons le terme de lecteur-écrivain ou tout simplement lecteur, non pas au sens utilisé dans
l’acception contemporaine où l’acte de lecture est un acte passif qui n’implique pas nécessairement
un acte d’écriture, mais au sens du lecteur blanchotien vu en tant qu’instance supérieure dont la
fonction implique simultanément un travail de lecteur, de chercheur et d’écrivain.
75
Blanchot.indb 75 29/11/13 11:56
Elle a sa propre logique, ses règles esthétiques qu’elle impose à l’écriture, logique qui
semble accorder plus d’importance à la formulation qu’à la pensée. Le mouvement per-
manent qui définit l’objet de la pensée fait que celui-ci est toujours « plus important,
plus intéressant, plus capable (plein de droits)2 » par rapport au mot qui aspire à l’expri-
mer et qui est très fixe et limité. Sommes-nous devant une « impossible nomination » ?
Et que peut l’écrivain-lecteur devant cette situation ?
C’est la question que pose Blanchot dans son ouvrage, Thomas l’Obscur. Il y présente le
mouvement même de la création en train de s’accomplir ; ce mouvement de « nomination »
et d’« écriture », non pas au sens de former des lettres sur une page blanche, mais au sens du
mouvement de la pensée qui tente d’exprimer quelque chose. Ce désir de nomination
détermine la volonté de soumettre l’être à une violence indescriptible : chercher à exprimer
ce chaos par un ordre préétabli et désirer dire infiniment avec une langue limitée : « Quelle
violence doit s’exercer sur la pensée pour que nous devenions capables de penser, violence
d’un mouvement infini qui nous dessaisit en même temps du pouvoir de dire Je3. »
Le « lecteur-écrivain » perçoit cette violence comme un mouvement qui vient de l’ex-
térieur comme une pensée ou une voix hors lui. Il se retrouve dans un milieu qui pro-
voque une agitation intérieure, une fuite de la pensée qui n’est pas facile à supporter. Le
lecteur-écrivain ressent, comme Blanchot, « sa haine pour Thomas, son amour pour
Thomas4 » quand il lit-écrit un texte comme Thomas l’Obscur qui est en fait sa propre
œuvre, œuvre qui appartenant entièrement au lecteur. C’est pourquoi l’écriture devient
dans ces conditions une manière de calmer, de soulager, de libérer l’écrivain de cette
force intérieure. Les règles imposées par la langue rendent le travail supportable, quoique
de manière insatisfaisante et décevante. Pour l’écrivain, toute structure langagière paraît
construite de manière artificielle, insuffisante. Elle ne traduit pas la procédure intime de
la pensée pure dont l’intermittence et le mouvement incessant sont la condition même
de son existence. Chez Blanchot, la pensée se présente comme quelque chose qui obsède
et torture l’écrivain, alors que l’écriture, elle, l’aide à comprendre. Elle devient une sorte
2. Ponge Francis, La Rage de l’expression, Paris, Gallimard, Paris, 1976, p. 10.
3. Deleuze Gilles et Guattari Félix, Qu’est-ce que la philosophie ? Paris, Les Éditions de Minuit,
1991, p. 55.
4. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, [deuxième version, 1950], Paris, Gallimard,
« L’Imaginaire », 1992, p. 70.
76
Blanchot.indb 76 29/11/13 11:56
de soulagement ou plutôt de thérapie contre ses obsessions puisque tout ce qui est for-
mulé possède une intensité dégradée :
Les domaines intérieurs ne se superposent pas avec la langue, elles traînent l’écrivain
là où les mots ne trouvent pas d’abri. Et souvent, c’est exactement sur les choses essen-
tielles qu’on ne peut plus rien dire. Et l’impulsion d’en parler marche bien justement
parce qu’elle rate son but5.
Finalement, grâce à l’échec de communication, l’écriture existe et se construit. Langue et
pensée, quoique incompatibles, forment un cercle vicieux ou une sorte de compensation
qui aide l’écrivain à se détacher du monde social, réel, pour pouvoir explorer la langue
tout en sachant que pour Blanchot cela conduit à une impossibilité.
Deux versions de Thomas l’Obscur :
le trajet vers le silence du livre
Il arrive très rarement dans l’histoire de la littérature qu’un écrivain récrive un texte en
le raccourcissant comme Blanchot l’a fait avec Thomas l’Obscur. La première version a
plus de trois cents pages alors que la deuxième6 environ cent vingt, une diminution de
deux tiers donc. Est-ce que cela veut dire que l’une est meilleure que l’autre : la première
plus complète ou la deuxième plus affaiblie ?
Dans la deuxième version de Thomas l’Obscur, Blanchot a condensé l’essence même de
toute son œuvre. Comme il dit dans une lettre à Bataille, cette deuxième version
représente « le noyau » même de sa pensée :
J’ai mis au point ces jours-ci une version autre de Thomas l’Obscur. Autre : en
ce sens qu’elle réduit des deux tiers la première édition. C’est cependant un livre
véritable et non des morceaux de livre ; je puis même dire que ce projet n’est pas un
projet de circonstance ou inspiré par de complaisances d’édition, mais j’y ai souvent
pensé, ayant toujours eu le désir de voir à travers l’épaisseur des premiers livres,
5. Müller Herta, Regele se-nclina si ucide, Iasi, Polirom, 2005, p. 13-14, (n.t.).
6. Nous parlons en termes de première ou deuxième version par rapport aux versions publiées
(1941 et 1950, chez Gallimard), bien qu’il soit connu parmi les archivistes de l’œuvre de Blanchot
que ce texte connaît en réalité 7 ou 8 versions non publiées.
77
Blanchot.indb 77 29/11/13 11:56
comme on voit dans une lorgnette l’image très petite et très lointaine de dehors, le
livre très petit et très lointain qui m’en paraissait le noyau7.
Thomas l’Obscur, deuxième version, n’est pas donc le résumé de la première : il est une
mise en perspective « à travers » l’œuvre de Blanchot, de sa pensée. C’est la concentra-
tion de toutes ses idées qui concernent la création littéraire, l’essence de tout ce dont il
avait parlé jusque-là dans des textes de fiction ainsi que dans des études théoriques.
La publication du nouveau Thomas l’Obscur prouve la conviction même de Blanchot
et de tout bon écrivain selon laquelle la littérature n’est que l’essai de mise en ordre de sa
pensée, c’est-à-dire, tout ce qui est écrit représente une sorte d’exercice préparatoire, une
expérimentation, des étapes intermédiaires en vue de construire une œuvre finale qui
contient tout et après laquelle on ne peut plus rien dire.
Le deuxième Thomas l’Obscur est loin d’être un texte « abrégé », « mutilé », « tron-
qué », « affaiblit », « appauvrit », « dégradé par effacement8 » et ni un assemblage de
fragments tirés de la première version. Il n’est pas non plus un amas d’idées principales,
exprimées clairement pour que tout le monde comprenne. C’est bien une œuvre auto-
nome, indépendante et unique. Autant le style même de Blanchot que sa volonté d’en-
fermer l’écriture dans un rapport lecteur-écrivain y contribue beaucoup. Ainsi, au
contact de Thomas l’Obscur, le lecteur vit une « expérience de lecture » qui se traduit
comme un acte de résistance. Le lecteur est obligé de faire un grand effort de lecture qui
se transforme vite en une « expérience d’écriture ». Il a vraiment l’impression que c’est
lui qui écrit le livre, que sa lecture très difficile l’oblige à méditer sur chaque ligne comme
s’il s’agissait d’un acte de réécriture. Aucune phrase ne peut être prise en tant que telle.
Elle est interprétable et chaque mot est un programme. C’est un livre qui peut être lu à
partir de n’importe quel point. Ou plutôt, c’est un livre qui ne peut pas être véritable-
ment « lu », seulement réfléchi. C’est dans ce sens qu’il est « illisible », non pas par inco-
hérence grammaticale, mais parce qu’il suppose par défaut une compréhension inscrite
dans un rapport lecteur-écrivain : « Le roman de Blanchot est une action sans cesse
7. Citation reprise de Bident Christophe, Maurice Blanchot. Partenaire invisible, Seyssel,
Champ Vallon, 1998, p. 287.
8. Madaule Pierre, « Retour d’épave », préface à Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur [première
version, 1941], Paris, Gallimard, 2005.
78
Blanchot.indb 78 29/11/13 11:56
recommencée et recommençable9. » D’où la nécessité pour le lecteur de « Lutter pour la
clarté et, à cette fin, de travailler […] en direction d’un retour à la fixité et à l’immobilité
d’un texte écrit et inchangeable10. » Dans la tentative de compréhension de ce texte, le
lecteur, en le réécrivant, crée sa propre œuvre, elle-même sujette à une réécriture.
Contrairement aux propos de Blanchot qui soutient que le lecteur ne sent pas la vie
intérieure consacrée au livre qui reste « sans auteur, sans le sérieux, le travail, les lourdes
angoisses, la pesanteur de toute une vie qui s’y est déversée, expérience parfois terrible,
toujours redoutable, que le lecteur efface et, dans sa légèreté providentielle, considère
comme rien11 », Thomas l’Obscur semble dire le contraire. Dès les premières lignes, le
lecteur commence à vivre les frémissements de l’acte de création. Il ne s’agit pas de la
vie intérieure de l’écrivain Blanchot, mais de la vie intérieure du lecteur en train de
fabriquer quelque chose.
La force de Thomas l’Obscur, nouvelle version, repose sur le fait qu’il donne l’illusion
qu’il peut être lu par n’importe qui, et de n’importe quelle manière. Il y a des commenta-
teurs qui prennent ce texte pour un roman d’amour, d’autres qui affirment qu’il traite de
l’espace littéraire, voire qu’il n’aborde que la question de l’impossible nomination. En fait,
Thomas l’Obscur représente tout cela. La clé de l’interprétation vient de son angle de lec-
ture, mais aussi de la liberté, de la disponibilité et de l’ouverture intellectuelle du lecteur.
C’est une façon d’écrire sans écriture, une écriture qui ne nomme pas directement les
choses, mais qui les suggère pour les montrer comme des possibilités. L’essentiel de l’œuvre
résiderait dans la question qu’elle soulève plus que dans les explications qu’elle propose.
Le langage ne fait que nommer ; il est la matière brute d’où la langue tire quelques traits
pour exprimer un sens, un seul sens, en se trouvant ainsi dans l’impossibilité de décrire
l’objet dans son ensemble. La seule chose donc qu’une œuvre peut faire est de donner un
sens. Mais une œuvre est forte, non pas quand elle impose son sens au lecteur, mais quand
elle fait naître dans celui-ci un ensemble de sens qui, à leur tour, sont sujet à interprétation.
L’« allègement » de Thomas l’Obscur explique ce désir de Blanchot : faire de telle sorte
que l’œuvre finisse par dire plus avec le moins de mots possibles. Pour lui, penser signifie
9. Poulet Georges, « Maurice Blanchot critique et romancier », in Critique, no 229, « Maurice
Blanchot », juin 1966, p. 495-496.
10. Madaule Pierre, « Retour d’épave », préface à Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur [pre-
mière version, 1941], op. cit., p. 17.
11. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1973, p. 256.
79
Blanchot.indb 79 29/11/13 11:56
refuser, éliminer, sélectionner, pour ne pas laisser piéger par le verbiage : « Tout sujet est
un ; et, quelque vaste qu’il soit, il peut être renfermé dans un seul discours12. » Ainsi, le
discours, le message d’un écrivain doit être essentiel. L’écriture vise cet effacement continu.
Le deuxième Thomas l’Obscur montre la possibilité d’une réalité sans la nommer direc-
tement, ou seulement par la suggestion qui cherche à atteindre le silence : un texte est plus
court, plus affiné, pour « dire » plus. Blanchot préfère concentrer son écriture pour que
l’attention du lecteur se focalise sur l’essentiel qui ne se trouve pas dans le texte, mais en
lui-même : « Peut-être y avait-il aussi, dans l’acte trop impérieux de terminer par un
blanc, ce désir ironique : si à chaque réédition quelque chose – le plus important, le moins
important – disparaissait, il y aurait une fois où tout rentrait (métaphoriquement) dans
le silence, et l’auteur-lecteur dans le calme13. »
Ce récit traduit l’effacement que Blanchot a recherché pendant plus de dix années tant
il a remanié ce texte, remaniement dont on voit les traces dans les nombreuses versions
non publiées. Cela marque le trajet de la littérature même, le trajet vers le silence que
toute œuvre aspire à toucher. Le silence dans la littérature n’est donc pas une pause dans
la parole, mais un travail sur soi-même. Plus l’œuvre se tait, plus sa présence est ressentie
à l’intérieur du lecteur : « Quand on se tait, on devient désagréables, quand on parle, on
devient ridicules14. » En parlant, nous sommes « ridicules » car les mots ne disent rien et
nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer réellement nos pensées. Les mots sont
incapables, en raison de leur dimension inscrite, stable et donc limitée de nommer exac-
tement les choses qu’elles tentent de décrire. La parole formule sa propre précarité et
relate sa marginalité. En se taisant, nous devenons « désagréables » car le silence signale
une fièvre intérieure, des pensées cachées ou retenues, voire même une indifférence :
« Elle ne disait rien, mais ne rien dire était pour elle un mode d’expression trop signifi-
catif, au-dessous duquel elle réussissait à moins dire encore15. »
12. Buffon George-Louis, « Discours sur le style », in Histoire naturelle, t. X, Paris, Union fran-
çaise d’édition, 1978, p. 148.
13. Fragment de lettre de Blanchot à Pierre Madaule, cité par celui-ci dans Madaule Pierre,
« Retour d’épave », préface à Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur [première version, 1941],
op. cit., p. 15.
14. Müller Herta, Regele se-nclina si ucide, op. cit., p. 83, (n.t.).
15. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur [première version, 1941], op. cit., p. 11.
80
Blanchot.indb 80 29/11/13 11:56
Mais est-ce que le lecteur-écrivain entre véritablement dans le silence lorsqu’il est
devant une feuille blanche ? Blanchot semble nous dire le contraire. C’est à partir du
blanc que les frémissements intérieurs commencent, que l’envie de rechercher se
déclenche pour pousser à la surface une œuvre jusqu’à ce moment-là en attente : « Tout
doit s’effacer, tout s’effacera. C’est en accord avec l’exigence infinie de l’effacement
qu’écrire a lieu et a son lieu16. » Écrire, nommer les choses, c’est effacer la folie qui passe
par l’esprit. Plus l’écrivain efface, en disant seulement l’essentiel par quelques mots, plus
il fait naître chez le lecteur l’envie d’interprétation.
Nous considérons Thomas l’Obscur, deuxième version, de ce point de vue-là comme son
chef-d’œuvre. Il montre au lecteur comment se fait la littérature sans avoir besoin de lui
expliquer. Cette approche est beaucoup plus subtile car elle oblige le lecteur à écrire « à vif »
pour entrer dans la chaîne ininterrompue qui constitue la littérature. Blanchot lui-même a
eu cette envie car il ne s’est jamais arrêté d’écrire après Thomas l’Obscur. Ce texte peut être
compris comme la fondation de toute son œuvre, une sorte d’œuvre programmatique.
L’échec de l’écriture
En partant de l’incapacité des mots à exprimer la connaissance dans sa totalité et son
intensité, Emmanuel Lévinas, dans une analyse de L’Attente, l’oubli17, parle d’« auto-tra-
hison » de la parole dans son ambition de passer du monde de l’esprit au monde réel
pour devenir un produit culturel : « Que le verbe poétique lui-même puisse cependant
se trahir et s’engloutir dans l’ordre pour se montrer produit culturel, document ou
témoignage, encouragé, applaudi et primé, vendu, acheté, consommé et consolant, par-
lant tout seul dans la langue d’un peuple – s’explique par le lieu même où il surgit – et il
n’y en a pas d’autre – entre la connaissance qui embrasse le Tout et la culture à laquelle
il s’intègre, deux mâchoires qui menacent de se reformer sur lui. Blanchot guette préci-
sément le moment entre le voir et le dire où les mâchoires restent entr’ouvertes18. »
C’est donc ce monde où le mot prend naissance qui oblige l’objet à n’avoir qu’une
forme tronquée. Le mot vient d’un monde en désordre qui nécessite un ordonnancement,
16. Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, Paris, Gallimard, Paris, 1973, p. 76.
17. Texte publié chez Gallimard en 1962.
18. Lévinas Emmanuel, « La servante et son maître. À propos de L’Attente, l’oubli », in Critique,
no 229, op. cit., p. 521.
81
Blanchot.indb 81 29/11/13 11:56
une mise en forme qui ne peut avoir lieu qu’à la lumière du monde réel. Par l’intermédiaire
de la langue, l’écrivain affirme, dit, nomme des choses dans leur nature incertaine. Il les
simplifie, ou plutôt il les détruit.
L’acte de lecture deviendrait alors impossible si le chaos des pensées du lecteur pouvait
être transféré dans l’écriture. C’est pourquoi dans la littérature, les mots ne suffisent pas.
Ils disent des choses précises et ne peuvent pas exprimer les choses essentielles, entortillées.
Les idées à nommer sont prises dans une formation continue, toujours en mouvement,
elles représentent la lutte permanente de l’écrivain avec lui-même. Le contenu de l’objet à
décrire est quelque chose dont le sens global est impossible à toucher, alors que l’écriture
n’est qu’« une seule » facette de l’objet, une seule possibilité de l’impossible : « L’entrechoc
des mots, les analogies verbales sont un des moyens de scruter l’objet19. » Peu importe le
nombre d’angles et de moments d’où l’on regarde, l’objet reste toujours inépuisable par
son intériorité cachée qui se forme paradoxalement à l’extérieur, chez le lecteur.
La tâche du lecteur-écrivain est donc d’essayer d’exprimer la pensée, cette « fuite muette
et ahurie20 » qui se trouve à l’esprit de tout lecteur préoccupé véritablement par son tra-
vail. Mais comment le faire puisque cette fuite s’éloigne immédiatement des mots trouvés
exactement pour elle ? « Quels sont ces mots et combien de rapidement devraient-ils
venir à la portée de la main et alterner avec d’autres, pour rejoindre les pensées21 ? »
Malgré ses incapacités, la littérature a toutefois besoin de mots pour que la lecture soit
possible. Toutefois, les mots sont morts par défaut. Ils naissent morts pour qu’on puisse
les lire car on ne peut pas lire une image en mouvement, il faut l’arrêter pour pouvoir la
saisir. À partir de ce point commence le travail de l’écrivain. Il se lance dans l’écriture au
moment où tous les mots paraissent perdre leur pouvoir. Quand l’écrivain voit que les
mots qu’il écrit ne couvrent pas entièrement l’idée qu’il veut exprimer, il sent le besoin
d’expliquer encore et encore ce qu’il veut dire. Il cherche ainsi en permanence le mot juste
pour comprendre et décrire toutes ses pensées et ainsi la littérature se développe et avance.
19. Ponge Francis, La Rage de l’expression, op. cit., p. 10. Pour une lecture de l’impossible nomi-
nation et la question de la modulation entre Ponge et Blanchot, voir Milon Alain, La Fêlure du
cri : violence et écriture, Paris, Encre marine, 2010.
20. Müller Herta, Regele se-nclina si ucide, op. cit., (n.t.).
21. Ibid., p. 14, (n.t.).
82
Blanchot.indb 82 29/11/13 11:56
Lire-écrire au-delà des mots
Confronté à l’impossible nomination, l’écrivain tente de trouver une solution salva-
trice : il tente d’« obliger » les mots à dire ce que lui veut dire. Il cherche le mot ou l’ex-
pression appropriés, quoiqu’en « faussant un peu [leur] jonction22 », comme dit
Blanchot. L’écrivain réalise alors des rapprochements inhabituels, forcés. Il va jusqu’au
moment où il croit être arrivé à un « état du possible23 », le moment où il croit avoir
trouvé une variante acceptable pour ce qu’il veut dire. Mais lorsque les mots com-
mencent à « reculer devant la vérité », l’écrivain trouve comme dernière solution à
« exprimer sans mot le sens des mots24 » par une « impropriété maîtrisée et sublime25 »
de l’expression. Car comment pourrait-il exprimer autrement l’« inarticulation de la
pensée », sa perte ? Cette issue est réalisable car la véritable littérature n’est pas faite de
mots. Ceux-ci ne sont que des outils à l’aide desquels l’écrivain forme des sensations et
des images. Le mot est mort, limité, il n’a pas de sens, mais il « vise » un sens.
Le « sens en vain cherché du mot vivifiant26 », comme l’appelle Blanchot, ne fait pas
partie d’un processus artificiel. Personne ne se propose expressément de regarder les sou-
terrains des mots. La distance que le lecteur prend par rapport au texte l’oblige à transfé-
rer ses pensées naturellement vers les couches intérieures du texte. Quand un lecteur
prononce un mot, celui-ci finit par disparaître. Cette répétition n’est pas faite machina-
lement, le lecteur ne lit pas le texte plusieurs fois comme un robot, c’est la répétition
même qui le détermine à prendre une distance par rapport à la dimension même du mot.
Le lecteur entre dans les couches intérieures, il commence à regarder comment le mot est
construit. Il apprend ainsi du mot car il le « réfléchit », il le recrée et le module à partir de
sa propre manière tout en posant ses limites. C’est ce qui se passe avec la nouvelle de
Borges, Pierre Ménard, auteur du Quichotte27. Autrement, il est impossible de viser l’aune
œuvre achevée. Borges questionne ainsi l’idéalité vers laquelle aspire tout écrivain, le
désir qui donne à toute œuvre une potentialité. La manière de lire le texte de Cervantès
– l’importance donnée à l’œuvre par le lecteur et/ou la force de l’œuvre de l’attirer –
22. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur [deuxième version, 1950], op. cit., p. 113.
23. Ibid., p. 112.
24. Ibid., p. 61.
25. Vianu Ion, Cartile care ne-au facut oameni, Bucuresti, Humanitas, 2010, p. 132.
26. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur [première version, 1941], op. cit., p. 285.
27. Borges Jorge Luis, Fictions, Paris, Gallimard, 1983.
83
Blanchot.indb 83 29/11/13 11:56
mène à la sortie de celle-ci de la réalité sociale. Ménard, en lisant ce texte, le récrit en fait
en le raisonnant. Sa lecture-écriture est plus subtile car il saisit uniquement l’essence. Le
lecteur Ménard, lecteur idéal, passe outre les notations d’ordre historique. Il ignore tout
détail qui peut situer le texte dans le temps ou l’espace. Il réussit ainsi à écrire un texte
identique à celui de Cervantès, mais beaucoup plus raffiné. Les deux textes sont « verba-
lement identiques, mais le second est presque infiniment plus riche28 » en raison de son
ambiguïté qui résulte de l’impossibilité même de le fixer sur un point de la réalité.
L’autonomie de la pensée
L’idéalité de la pensée vers laquelle l’écriture tend implique obligatoirement une repré-
sentation. La pensée n’existe pas en tant que telle, sans aucun lien avec l’extérieur. Et,
dans la littérature, c’est l’écriture qui représente la pensée dans le monde de dehors. Mais
l’aspect qui nous intéresse, c’est que l’écriture n’est jamais complète, elle n’est que la
trace, l’ombre de la raison sur la page, les débris produits par le mouvement de la pensée
et non pas sa copie conforme. L’incapacité de la pensée de trouver les mots justes pour
s’exprimer prouve combien elle est « autonome », combien l’être est incapable de la
contrôler. Les écritures ne sont que des sorties instantanées des idées de leur plénitude.
Dans ces conditions, l’écrivain est seulement un accident, une courte station durant
laquelle l’idée descend pour prendre le trajet de la pensée. Rien d’essentiel donc dans
cette activité d’écriture, des accidents seulement et l’écrivain, étant obligé d’accepter
cette posture marginale, se rend compte que son écriture va vers le « désastre29 » : « Écrire,
c’est finalement se refuser à passer le seuil, se refuser à “écrire”30. »
L’écriture est le refus plus ou moins conscient d’aller plus loin, d’avancer. Au lieu de
continuer à creuser des galeries souterraines, ou à construire d’autres ponts, l’écrivain
arrête sa pensée pour la nommer. Mais une chose arrêtée est morte, elle ne vit plus et ne
bouge plus. Elle est extraite de son environnement. Dans ces conditions, l’expression qui
dénomme la chose ne peut pas être complète car la chose même, extraite de son milieu,
n’est plus complète.
28. Ibid., p. 49.
29. Référence au livre de Blanchot, L’Écriture du désastre, paru chez Gallimard en 1980.
30. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, 1959, p. 281.
84
Blanchot.indb 84 29/11/13 11:56
La littérature n’est pas constituée par de mots, elle se définit par « la recherche des
mots ». La littérature est un immense verbe en mouvement, un verbe d’action. Ce n’est
pas quelque chose de stable et de permanent. C’est une recherche qui implique le lecteur
en l’obligeant à participer à l’acte d’écriture. Le lecteur intervient quand il se rend
compte que le mot qu’il lit, par la limite qu’il présuppose, ne délimite pas entièrement le
réel vécu. C’est le moment où le lecteur cherche à compléter le mot pour construire un
réel incréé. C’est cette partie cachée des mots donc qui influence le lecteur et le pousse
vers l’écriture et non pas les paroles qui constituent le texte. Selon Blanchot, l’œuvre :
« Elle et elle seule et justement elle qui était à la source des mots, elle subissait comme
une épreuve au-dessus de ses forces l’expression de ses propres paroles31. »
La recherche met en lumière « la fuite muette, ahurie » qui se trouve dans la tête de
tout lecteur véritable et que finalement le simple lecteur passif ne ressent jamais. Le lec-
teur passif ne connaît que le produit final, il ne sent pas la vie intérieure de l’œuvre. Il ne
cherche que l’information et ne se demande jamais comment cette « information » a été
créée. La littérature grandit par cette recherche de mots adéquats, par cette lutte qui
paraît perdue par avance entre pensées et mots :
Quand on dit « chercher ses mots », cela ne veut pas dire que l’on ne trouve pas les
mots pour dire ce que l’on a à dire, mais qu’en cherchant ses mots on laisse ouvert un
espace pour une présence autre que soi, non pas pour que l’autre parle à notre place, ni
pour parler avec l’autre, mais pour montrer tout simplement la réalité de la bifurcation
accompagnée du lent processus de dissolution que la voix provoque32.
« La recherche des mots » dans la littérature a lieu dans l’espace qui s’ouvre entre « le
voir » immanent et « le dire » ordonné. Les mots viennent à l’aide de la lecture, se
transforment dans la tête et ressortent déjà détruits. Une fois prononcés, leur sens n’est
plus valable. Dans le même instant, ils sont et ne sont plus. Blanchot parle ainsi d’un
« instant maudit, car cette combinaison unique, entrevue dans un éclair, se dissipa dans
un éclair33 ». Dans un instant, les mots sont considérés justes par le lecteur en train de
devenir écrivain et, dans le même instant, ils meurent au moment où celui-ci part à la
recherche d’autres mots. Cet instant ne fait qu’inviter ou plutôt entraîner quelqu’un d’autre,
31. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur [première version, 1941], op. cit., p. 106.
32. Milon Alain, La Fêlure du cri : violence et écriture, op. cit., p. 79-80.
33. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, [première version, 1941], op. cit., p. 95.
85
Blanchot.indb 85 29/11/13 11:56
une autre pensée : « Peut-être un homme se glissa-t-il par la même ouverture34 » espère
Thomas pour que son travail d’écriture devienne un travail commun, croisé et partagé.
Deux pensées s’influencent l’une l’autre, se construisent l’une l’autre dans une écriture
métissée qui garde le poids de chaque partie, dans des mots qui contiennent en eux le
passé intérieur de chaque élément qui le compose.
Nous parlons d’un passé « intérieur » et non pas « antérieur » car cette intériorité est
lointaine et proche à la fois et dépasse la dimension chronologique dans une atempora-
lité qui caractérise la vraie littérature. Cette « conversation conceptuelle » se passe en
profondeur et ne veut pas révéler une relation directe entre deux personnes. Elle sou-
ligne le fait que la pensée de l’écrivain, et donc son écriture, est toujours une réaction ou
une réponse à une invitation. La littérature devient une chaîne ininterrompue d’idées
qui s’entrelacent sans appartenir à personne. Chaque écrivain est par définition mul-
tiple, il forme un ensemble tout en marquant ainsi la neutralité littéraire. On se demande
très souvent « qui a eu cette idée » ? Ni l’un ni l’autre, personne n’ose revendiquer une
idée, mais tous, dans une « communauté inavouable35 » pour utiliser l’expression de
Blanchot, l’ont. Le mélange est inscrit dans tout texte, toute phrase, tout mot. Cet
échange d’idées qui se complètent, s’ajustent et se modifient, représente la condition
même d’existence de la littérature.
Autour d’un point central
La vraie littérature se trouve au-delà des mots car la pensée du lecteur-écrivain tourne
autour d’un point qu’elle ne réussit jamais à toucher. Plus le lecteur avance dans son
introspection, plus le point qu’il cherche s’éloigne car la seule chose certaine dans la
connaissance humaine est l’incertitude. Un texte littéraire n’exprime que ce mouvement
infini de la recherche du point final ou « central », comme l’appelle Blanchot, point qu’il
n’arrive jamais à nommer. L’expression littéraire représente donc le trajet de la pensée,
son devenir même :
Un livre, même fragmentaire, a un centre qui l’attire : centre non pas fixe, mais qui se
déplace par la pression du livre et les circonstances de sa composition. Centre fixe aussi,
34. Ibid., p. 18.
35. Référence à l’ouvrage de Blanchot qui porte le même titre, La Communauté inavouable,
Paris, Les Éditions de Minuit, 1983.
86
Blanchot.indb 86 29/11/13 11:56
qui se déplace, s’il est véritable, en restant le même et en devenant toujours plus central,
plus dérobé, plus incertain et plus impérieux. Celui qui écrit le livre, l’écrit par désir, par
ignorance de ce centre. Le sentiment de l’avoir touché peut bien n’être que l’illusion de
l’avoir atteint ; quand il s’agit d’un livre d’éclaircissements, il y a une sorte de loyauté
méthodique à dire vers quel point il semble que le livre se dirige36.
Le centre du livre, son noyau, est insaisissable car il se trouve en dehors du texte. Techni-
quement, il n’est pas dans les mots et les phrases qui forment le texte. Les mots ne repré-
sentent que la partie extérieure du texte. Le vrai contenu est au-delà, dans l’intime des
mots, comme s’ils formaient une partie secrète et profonde, visible uniquement par le
lecteur subtil. En réalité, ce point central vit à l’intérieur du lecteur, dans ses pensées. Et
c’est la recherche même de ce centre qui constitue la matière du livre. La vérité d’une
œuvre ne réside pas dans le texte écrit car il ne donne qu’une forme, une seule, qui
s’approprie au monde où elle apparaît. Les choses à exprimer sont pensées globalement,
dans l’ensemble de leur champ d’immanence, alors que les choses exprimées ne repré-
sentent qu’une seule forme qui se moule dans le lieu dans lequel elle apparaît. Ces choses
ne constituent pas la copie conforme du monde d’où elles viennent.
Le lecteur-écrivain cherche à comprendre la nature de cette tentative de nomination
en lisant en écrivant37. C’est ainsi qu’il crée son œuvre en partant de l’échec de l’écriture.
Mais alors « pourquoi écrire » ? D’habitude, à cette question, les écrivains répondent que
l’obstination et la persévérance devant la page blanche tiennent à deux choses. La pre-
mière est que la fixation par des mots est la seule forme de perpétuation et de conserva-
tion de vécus intérieurs ; la deuxième est que la lecture est une forme d’échappatoire
pour éviter de sombrer dans la quête folle de l’écriture.
Pourquoi Blanchot écrit-il ?
Les conditions de l’acte de création littéraire sont une véritable obsession chez Blanchot.
C’est ainsi qu’il définit la construction de l’« espace littéraire ». Cette nécessité de continuer
36. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 5.
37. Référence au livre de Gracq Julien, en lisant en écrivant, Paris, José Corti, 1982. La lettre
initiale est écrite en minuscule avec intention, ainsi que l’absence de la virgule entre les deux
verbes, dans le but de suggérer exactement cette incertitude dans l’ordre des deux actes : est-ce que
la lecture est réellement antérieure à l’écriture ? Est-ce qu’il s’agit vraiment de deux actions ou
est-ce un même acte ?
87
Blanchot.indb 87 29/11/13 11:56
à interpréter la littérature détermine Blanchot à écrire toujours le même livre : « Il y a,
pour tout ouvrage, une infinité de variantes possibles38. » Cette affirmation est applicable
à la littérature en général, y compris à sa propre œuvre au sens où chaque volume traite
cette question de l’« impossible nomination » qui fait croître la littérature sous des formes
diverses. Dans l’introduction du deuxième Thomas l’Obscur, Blanchot explique : « La
présente version n’ajoute rien, mais comme elle leur ôte beaucoup, on peut la dire autre et
même toute nouvelle, mais aussi toute pareille39. »
Les deux versions de Thomas l’Obscur sont donc « identiques » en contenu, mais « dif-
férentes » du point de vue de la forme. Cette affirmation peut ère élargie aux autres
ouvrages de Blanchot, quels qu’ils soient. Thomas l’Obscur traite de la même probléma-
tique que L’Espace littéraire, Aminadab, Le Livre à venir, La Part du feu… C’est la même
question de l’origine de la littérature. Mais pourquoi Blanchot multiplie-t-il ses livres
alors ? Pourquoi plus de trente volumes pour raconter la même histoire ? Ce n’est pas
pour rien que le thème de l’ombre et du double revient de manière récurrente. Pour
Blanchot, l’œuvre n’est qu’un exercice de l’esprit, mais c’est surtout « une occasion de se
reconnaître et de s’exercer infiniment40 ». L’acte de création se présente finalement
comme une expérience « ininterrompue » et « impossible » ; « ininterrompue » car elle
est permanente et « impossible » car elle ne sera jamais achevée. L’œuvre est un stade
dans une suite de transformations intérieures. Celui qui fait l’œuvre n’est jamais lui-
même accompli, achevé. Concernant l’œuvre de Blanchot, nous sommes face à une
« recherche dont on ne peut jamais dire qu’elle est entièrement vaine, puisque chaque
nouvelle parole est susceptible de restituer à ce qui est perdu l’un de ses aspects ; mais
recherche qui n’est jamais complétée, qui ne peut jamais s’achever, puisque tout ce que
la parole peut faire, c’est d’évoquer l’ombre du réel, de le faire voir, comme à Faust le
visage d’Hélène, dans un miroir. La littérature n’a donc jamais terminé sa tache. Elle ne
la terminera jamais. Chaque œuvre est une parole qu’un même auteur reprend intermi-
nablement dans une série d’œuvres. C’est une besogne de Sisyphe41 ».
38. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, [deuxième version, 1950], op. cit., p. 7.
39. Ibid.
40. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 103.
41. Poulet Georges, « Maurice Blanchot critique et romancier », in Critique, no 229, op. cit., p. 488.
88
Blanchot.indb 88 29/11/13 11:56
La littérature est une forme d’expression qui n’illustre que l’impossibilité de traduire
en mots l’expérience de l’existence, la certitude que les mots vont vers l’échec et l’espoir
que, à la fin, quand le trajet du langage est terminé, il reste le silence qui suggère.
Cette écriture qui est son propre écho ne doit pas être comprise comme un dédain
envers le lecteur. Elle représente une « recherche du temps perdu », temps non histo-
rique mais instant d’expériences vécues que l’écrivain essaie de comprendre. Dans
L’Arrêt de mort, il propose une explication : « Si j’ai écrit des livres, c’est que j’ai espéré
par des livres mettre fin à tout cela. Si j’ai écrit des romans, les romans sont nés au
moment où les mots ont commencé de reculer devant la vérité. Je n’ai pas peur de la
vérité. Je ne crains pas de livrer un secret. Mais les mots, jusqu’à maintenant, ont été
plus faibles et plus rusés que je n’aurais voulu42. » « Mettre fin à tout cela », c’est mettre
fin au harcèlement de la pensée, au délire intérieur qui l’oblige, pour se sauver lui-
même, à écrire. Pourquoi Blanchot écrit-il des romans au moment où il se rend compte
que les mots ne satisfont pas la réalité, et qu’ils ont commencé à « reculer devant la
vérité » ? Il met en discussion, par une sorte d’opposition, les mots « livre » et « roman ».
Les romans sont-ils toujours des livres ?
Il pose la question de la supériorité du texte de fiction – roman et récit – sur d’autres
types de textes comme la critique ou la théorie littéraire, voir les essais philosophiques.
La forme narrative et le style de ses fictions brisent ainsi les conventions car, quoique ses
romans et récits parlent d’aventures banales en apparence, le lecteur se rend compte par
la suite que la démarche narrative est atypique. Ses textes contiennent en eux-mêmes un
rapport à l’expérience et le mouvement de la pensée qui les a fait naître. Ils posent la
question de la possibilité même de l’acte d’écriture. Le roman « toujours incomplet »
provoque le lecteur, et lui donne à penser, à agir, à « écrire » finalement. En réalité, Blan-
chot nous suggère un certain ordre de lecture de ses œuvres. On sait qu’il a commencé
son activité littéraire par des romans considérés comme illisibles et impénétrables pour
ses contemporains. Il a ensuite expliqué ses idées par des essais théoriques dans lesquels
il exprime les choses plus directement, en espérant « mettre fin à tout cela », à toutes les
obsessions littéraires qui le harcèlent. Mais l’idée essentielle qui se dégage, c’est l’indiffé-
rence que le lecteur doit montrer par rapport à l’aspect que le texte prend. Livre, roman,
essai, poésie, etc., peu importe la forme tant que le contenu qu’elle porte met le lecteur
dans le mouvement de sa propre création.
42. Blanchot Maurice, L’Arrêt de mort, Paris, Gallimard, Paris, 1948, p. 7.
89
Blanchot.indb 89 29/11/13 11:56
Il définit ainsi la poésie comme « pure affirmation », la philosophie comme une
« manière d’interroger » et plus généralement la littérature comme « l’espace de ce qui
n’affirme pas, n’interroge pas43 ». Ainsi, la philosophie, la poésie, la littérature sont,
pour lui, trois moyens d’expression qui ne se prêtent à aucune échelle de valeurs. Ces
expressions existent en tant que telles et expriment, par leur nature, une incertitude et
une instabilité dans l’interprétation. Ces trois modes d’expression « s’opposent à toute
parole certaine qui décide, à toute réalité triomphante qui se proclame, à toute décla-
ration unilatérale, à toute vérité substantielle, à tout savoir traditionnel, – d’une
manière générale à toute parole fondée sur un rapport de puissance, lequel se dérobe
nécessairement sous un système de valeurs44 ». Aucune instance critique ne doit se
permettre d’exprimer ou d’imposer une solution unique à ces types d’écrits littéraires
ou philosophiques instables par nature.
Cette instabilité dans l’interprétation détermine Blanchot à continuer à écrire en espé-
rant dire une fois pour toujours ce qu’il « faut » dire. C’est ce besoin d’expliquer les
choses à l’infini qui l’a poussé à adopter diverses formes d’écriture. Il a commencé par
des romans qui, par leur style inhabituel, ont un réel pouvoir de suggestion. Mais tente-
t-il de clarifier ses idées par des essais théoriques ? Est-ce la raison du succès de L’Espace
littéraire au détriment de son chef-d’œuvre Thomas l’Obscur. Est-ce cette illisibilité qui
fait que très peu d’études ont été faites sur son œuvre romanesque, « scandaleusement
peu, eu égard à la très haute qualité de son œuvre45 ».
Jean Paulhan, comme membre du comité de lecture de Gallimard, écrivait dans la fiche
réalisée en vue de la publication de Thomas l’Obscur en 1941 que cet ouvrage « ne peut
guère s’analyser » à cause des métamorphoses de Thomas qui, d’un personnage banal,
devient étrangement « une pensée ». Il reconnaît ainsi que ce n’est pas seulement le per-
sonnage qui bouge mais le texte même, et c’est cela qui lui donne sa force. Paulhan ajoute
toutefois : « Il mérite certainement d’être publié. Il se lit, une fois accepté, avec passion46. »
43. Blanchot Maurice, « L’étrange et l’étranger », in Nouvelle revue française, no 70,
octobre 1958, p. 673.
44. Ibid.
45. Starobinski Jean, « Thomas l’Obscur, chapitre premier », in Critique, no 229, op. cit., Paris,
Les Éditions de Minuit, juin 1966, p. 506.
46. Cette fiche de lecture fait partie de l’archive de la maison d’édition Gallimard, voir l’exposi-
tion Gallimard, 1911-2011 : un siècle d’édition, Paris, Bibliothèque Nationale de France,
22 mars-3 juillet 2011.
90
Blanchot.indb 90 29/11/13 11:56
Sur la différence entre les textes critiques ou philosophiques et les textes romanesques et
leur degré d’accessibilité, Jacques Derrida déclare : « Ces fictions, gardons le nom, je croyais
les avoir déjà lues. Aujourd’hui, au moment où, les ayant étudiées, puis longuement citées,
j’ose publier ces essais, j’en suis moins sûr que jamais. D’autres œuvres de Blanchot m’ac-
compagnent depuis longtemps, celles que l’on situe, aussi improprement, dans les
domaines de la critique littéraire ou de la philosophie. Non qu’elles me soient, elles, deve-
nues familières. Du moins avais-je pu croire, au cours des années dont je parle, y avoir déjà
reconnu un mouvement essentiel de la pensée. Mais les fictions me restaient inaccessibles,
comme plongées dans une brume d’où ne me parvenaient que de fascinantes lueurs, et
parfois, mais à intervalles irréguliers, la lumière d’un phare invisible sur la côte47. »
Quoique identiques sur le contenu, la différence entre les essais et les romans consiste
dans l’effet qu’ils ont sur le lecteur. Les essais sont plus didactiques, plus théoriques. Ils
disent les choses à peu près franchement. Ils ont un taux de compréhensibilité plus élevé,
mais en même temps le lecteur ne sent pas l’émotion liée à la nature même de l’écriture
littéraire. Les textes de Blanchot prennent la forme de romans, récits ou études théo-
riques et peu importe d’ailleurs cette forme puisque c’est la nature même de l’écriture,
son incapacité à exprimer l’essentiel tout en donnant à la littérature un pouvoir de com-
mencement, qui détermine la posture de Blanchot. Thomas l’a obsédé toute sa vie ; il
représente la création littéraire même, le double de tout lecteur48.
En guise de conclusion : Maurice Blanchot, romancier ?
Presque tous les livres de Blanchot publiés dans les éditions de poche s’ouvrent avec la
notice suivante : « Maurice Blanchot fut romancier et critique. » Les ouvrages censés être
considérés comme des « romans » sont : Thomas l’Obscur, Aminadab et Le Très-Haut. Bien
que tous parus à la même maison d’édition, chez Gallimard, nous observons toutefois une
inconstance ou une hésitation d’une édition à l’autre, ou plutôt d’une collection à l’autre
car ces textes, publiés au début dans la collection « Blanche », portent sur la couverture la
mention « roman ». Republiés dans la collection « L’Imaginaire », ils ne sont ni romans, ni
récits. D’où vient ce changement ? Est-ce le fait de l’auteur, de l’éditeur ?
47. Derrida Jacques, Parages, Paris, Galilée, 2003, p. 10-11.
48. Suggestion donnée par Blanchot lui-même, par le choix de ce nom, Thomas, qui en araméen
signifie « jumeau ».
91
Blanchot.indb 91 29/11/13 11:56
La question qui nous intéresse en réalité concerne l’intégration d’une œuvre dans une
catégorie, ou plus précisément la non-intégration d’une vraie œuvre dans un genre lit-
téraire. Qualifier ces livres de « romans », cela va à l’encontre des propos de Blanchot.
Pour lui, la littérature, la culture en général, est une fascination du singulier, une atten-
tion portée à l’individu, ou même à l’œuvre. Une œuvre véritable ne peut pas être caté-
gorisée. Elle est, par nature, unique.
Thomas, Anne, Irène qui apparaissent dans Thomas l’Obscur sont-ils vraiment des
personnages au sens de personnages avec une typologie psycho-sociale ? Y a-t-il là effec-
tivement une narration fictionnelle ou une intrigue ? Pour un lecteur superficiel, la
réponse à toutes ces questions est positive. Même pour un lecteur plus avisé la réponse
n’est pas évidente. Apparemment, Thomas et les autres sont en effet des personnages de
roman. Mais le lecteur qui entre véritablement dans l’œuvre de Blanchot se rend compte
dès les premières pages que Thomas l’Obscur nous fait vivre l’expérience qui questionne
la possibilité même de l’acte d’écriture. Ce récit est en réalité une ample métaphore qui
illustre les frémissements, les vacillations intimes d’un individu en train de construire
un acte de création. Au centre de ce texte se trouve l’effort de la pensée. Dans Thomas
l’Obscur, il n’y a pas d’intrigue. Le texte est formé par des fragments de vécus intérieurs
d’où se détache une réflexion sur la fonction même de la littérature que l’on peut tra-
duire de la manière suivante : la métamorphose dans le langage de la vie dans son écou-
lement impétueux. La condensation de ce sujet dans Thomas l’Obscur et la manière dont
il est écrit, ou plutôt « suggéré », font de ce texte le chef-d’œuvre de Blanchot.
La situation est semblable pour les deux autres textes, Aminadab et Le Très-Haut et aussi
pour des œuvres en prose plus courtes comme L’Arrêt de mort, Celui qui ne m’accompa-
gnait pas, L’Attente, l’oubli, L’Instant de ma mort… En apparence, ce sont des romans ou
des récits, mais très vite le lecteur se rend compte que ce sont des textes plutôt philoso-
phiques car Blanchot y analyse la manière dont se construit le concept d’« espace litté-
raire ». C’est peut-être ici l’explication du fait que l’œuvre de Blanchot, et surtout ses
romans, ont été qualifiés d’« illisibles ». L’écriture de Blanchot traduit sa volonté d’obliger
le lecteur à entrer sans préjugés dans le texte, à être un lecteur neutre qui ne se laisse
influencer par aucune opinion extérieure. Le lecteur doit être lui-même en contact direct
avec le texte. Bien que l’expression reste littéraire, ses textes sont des occasions d’entrer
dans la pensée d’un « espace littéraire » qui se fabrique à partir de son « impossible
nomination ».
Blanchot.indb 92 29/11/13 11:56
Maurice Blanchot, Opus communis
Lecture dans le pacte communicationnel :
« Faites en sorte que je puisse vous parler. »
Slimane Lamnaoui
L
a parole, caractère familier de la vie quotidienne, semble aussi naturelle à
l’homme que la marche. Elle est le plus grand dénominateur, l’invariant anthro-
pologique par excellence ; ce qui définit l’essence humaine selon Heidegger :
« L’homme est homme en tant qu’il est celui qui parle1. »
Pour éprouver ce qui dans le déploiement de la parole lie, relie et délie en même temps,
choisissons un texte de Maurice Blanchot : L’Attente, l’oubli. Et à l’intérieur de ce texte,
une phrase tantôt au singulier : « Fais en sorte que je puisse te parler », tantôt au pluriel :
« Faites en sorte que je puisse vous parler. » Parole sans cesse répétée et recadrée, dont
dépend la créativité intellectuelle. Ce leitmotiv majeur2 dit tout le nouage, le lien de la
relation de la parole littéraire adressée par-delà les limites physiques du livre qui la contient ;
1. Heidegger Martin, Acheminement vers la parole, Neske, Tübingen, 1959 pour l’édition alle-
mande, traduit de l’allemand par J. Beaufret, W. Brokmeir et F. Fédier, Paris, Gallimard, « NRF »,
1976, p. 13.
2. Dans L’Attente, l’oubli, la phrase : « Fais en sorte que je puisse te parler », « Faites en sorte que
je puisse vous parler » est répétée huit fois. Blanchot Maurice, L’Attente, l’oubli, Paris, Gallimard,
1962, p. 14-24-25-26-57-86-110 et 135.
93
Blanchot.indb 93 29/11/13 11:56
poursuivant ceci que nous pouvons définir en termes heideggériens : « Porter à la parole
la parole en tant que parole3. » Toujours est-il qu’il y a ce fait étrange : la parole n’est pas
toujours audible, elle nous hurle mais on ne l’entend pas. Ici, il est question du dialogue
avec l’autre comme expérience intermittente de l’invite et de l’interruption, de la possibi-
lité-impossibilité de l’échange.
Cette mise en scène du procès4 de la parole pose d’abord le problème de la communica-
tion : la marge entre ce que nous disons, et ce que l’autre perçoit, comprend, restitue. Bref,
l’approche de tous ces aspects de relation et de contenu du message, de l’énoncé et de
l’énonciation, du « dire » et du « montrer », du texte verbal et du comportement. Toutefois,
au lieu d’interroger la parole comme information, le texte selon un angle d’incidence par-
ticulier pense l’information comme parole. Le problème n’est pas prioritairement d’ordre
linguistique ou narratologique, le livre de Blanchot s’intéresse plus particulièrement à
l’homme qui « transmet5 » : l’intellectuel pris dans la spirale de la « médiasphère ».
En effet, plus qu’une méditation sur l’acte nu de l’interlocution et de la circulation du
message, l’œuvre de Blanchot place le débat dans l’horizon historique de la transmission
de la pensée dans son lien avec la performance technique et le support ; plus que le pro-
cessus, la procession, le fait de la continuité et donc de la culture. Elle pose la question du
3. Ibid., p. 229.
4. Le terme « procès » au sens grammatical du terme : l’expression du temps dans la catégorie du
verbe. Au même titre que la notion de l’« aspect », l’ordre du procès désigne le temps au cours
duquel l’action d’un verbe imprime sa durée. Ainsi dans la proposition qui nous intéresse : « Que
je puisse vous parler », le procès est vu en fonction du signifié lexical du verbe « parler » ainsi que
de sa fréquence. Il peut ainsi être envisagé sous l’aspect « continuatif » ou « non-conclusif » (durer
sans interruption) ou encore « itératif » : le nombre indéfini de fois où il se répète.
5. « Nous connaissons déjà assez bien l’homme qui parle (linguistique), désire (psychanaly-
tique), produit (économie), s’agroupe (sociologie), calcule (sciences cognitives), qui ou que l’on
gouverne (politique), qui apprend ou enseigne (sciences de l’éducation) […]. À quel sujet la
médiologie a-t-elle affaire ? Sans exclure ce qu’on nomme communication, elle s’intéresse plus
particulièrement à l’homme qui transmet. » Debray Régis, Introduction à la médiologie, Paris,
PUF, « Premier cycle », 2000, p. 2. C’est là un principe de la médiologie : non le domaine de la
communication verbale, mais celui de la transmission où la communication n’est pas d’ordre
personnelle, mais institutionnelle, c’est-à-dire un type de communication qui se distingue de
l’acte idéal de la communication interindividuelle (échange de face-à-face de la raison partagée
sans médiation) : le cas de la communication médiatique pour l’intellectuel, être des médias par
excellence (du latin medius, qui est au milieu, renvoyant pour sa part à la mise en relation à dis-
tance, sans possibilité majeure d’interaction entre le récepteur et l’émetteur.). Voir Magret Éric,
Sociologie de la communication et des médias, Paris, Armand Colin, 2004.
94
Blanchot.indb 94 29/11/13 11:56
rapport entre la sphère des idées et la sphère des médias, le médium et la médiation, le
code et le milieu. Ceci nous place dans une préoccupation d’ordre plutôt médiologique,
où l’accent est davantage mis, au-delà d’une sociologie de la communication, sur l’an-
thropologie de la transmission. La thèse de la possibilité, chez Blanchot, d’une
parole impérieusement « orale » rendue possible par son contraire : la parole écrite,
appelée à détourner sa précarité « parlante » par le recours à l’écriture. Car, selon
R. Debray : « La mémoire la plus forte est plus faible que l’encre la plus pâle6. » Mais
l’écriture-même que devient-elle au sein du milieu techno-social avec ses médiums, ses
canaux, et ses supports ?
La parole comme un des modes de l’existence est inséparable de son environnement
d’objets, et de son « technosystème7 ». Aujourd’hui, à l’époque de l’explosion informa-
tive et de l’inflation de nouveaux outils à communiquer (nouvelles machines à images,
nouvel imaginaire), l’avènement des réseaux virtuels a produit un vaste horizon de nou-
velles pratiques. Les esthétiques classiques – l’unité de l’œuvre avec son autorité, son être
lié à un auteur – en sont notablement minées. L’objet livre, la parole intellectuelle sont
en train de devenir l’impensé de la modernité. C’est pourquoi, s’élève de plus en plus la
voix qui dénonce le règne contemporain de l’usurpation de la parole, où résonne ce
drame de l’alliance de l’homme avec son dire :
On a remis en cause et définitivement la vertu de la parole. On a dévalorisé les forces
symboliques, […] on a noyé la puissance de la métaphore dans une sémiologie vaine,
on a créé une nouvelle forme d’effraction culturelle ne renvoyant qu’à elle-même. On
a inventé […] le symbole qui ne symbolise rien. Pas même le symbole qui symbolise le
rien. Le symbole qui symbolise le symbole qui symbolise rien8.
L’alarme de Blanchot pose enfin le problème de la communauté, engage les ques-
tions fondamentales de « l’être-en-commun », de la communication et de l’incommu-
nicabilité. Seul le mythe du logos, dépositaire et vecteur d’une communication
virtuellement universelle, donne consistance à la communauté. La parole au sens de
6. Debray Régis, Introduction à la médiologie, op. cit., p. 19.
7. Tisseron Serge, Comment l’esprit vient aux objets, Paris, Aubier, 1999.
8. Py Olivier, Épître aux jeunes acteurs, pour que soit rendue la parole à la parole, Paris, Actes Sud,
« Actes Sud-Papiers », 2000, p. 23.
95
Blanchot.indb 95 29/11/13 11:56
partage d’un « bien social » (Communicarius9) est ce qui ménage un espace commun
de la rencontre. Parole articulée, elle-même articulante de l’autre et de sa culture. La
percevoir appelle à interpréter et à adapter sa culture (sa clôture) au monde de l’autre.
L’écriture chez Blanchot est ainsi le contraire d’un objet fermé. Ce souci de donner de
la voix s’inscrit contre l’autisme endogène qui habite le fond inconscient de chacun.
Face à une tradition basée sur une sémiotique de l’être se confondant avec son dire,
comment aujourd’hui la variable communicationnelle et ses variations techniques
affectent-elles cet invariant culturel et anthropologique : la parole littéraire ?
Du dialogue
Dans L’Attente, l’oubli, la pression du dialogue est grande. Une telle parole jusqu’où
intime-t-elle, invite-t-elle vraiment ? Quel est le ton qui permet de la prononcer ? « Faites
en sorte que… », L’injonction ne semble demander, en guise de réponse, ni acquiescement
ni réfutation. Elle suscite l’énigme : « Faites en sorte que je puisse vous parler. – Oui,
mais avez-vous une idée de ce que je devrais faire pour cela10 ? » Dans cette « plus-value »
de la parole, la verbalisation devient un acte de foi (« J’ai cru et j’ai parlé », Saint-Paul,
Seconde lettre aux Corinthiens) ; l’exhortation de Blanchot tiendrait du requiem, aurait
quelque chose de liturgique. L’autre est une prière, un lieu de pèlerinage vers où l’on
porte sa question : « Fais en sorte que je puisse te parler. Il ne pourrait plus jamais
oublier cette prière11. »
La phrase revient sans cesse dans le livre de Blanchot : « Fais en sorte que je puisse te
parler », « Faites en sorte que je puisse vous parler », comme si parler ne parlait pas encore.
Celui qui la profère parle pourtant. L’action de « parler » si elle semble s’adresser, demeure
néanmoins une articulation intransitive : vous parler de quoi ? Elle déclenche un embrayage
sur l’objet qui ici s’annule. Impossibilité donc de donner à la phrase quelque contenu :
9. Issu du latin communicarius/communicare, le terme est associé à l’idée de « participer à », de
« communier (y compris physiquement) », la mise en commun des richesses auxquelles tous ont
part, sacrifice offert au nom de tous à tous les dieux. Communicator : celui qui communique, qui
fait part de, qui prend part à quelque chose. Le premier sens de communication qui apparaît dans
la seconde moitié du xive siècle est celui de partage, de mise en commun, de « communion ».
10. Blanchot Maurice, L’Attente, l’oubli, op. cit., p. 14.
11. Ibid., p. 57.
96
Blanchot.indb 96 29/11/13 11:56
« Parler de quoi ? » Ont du sens des mots qui débouchent sur une action, les autres
retombent tôt ou tard au niveau de « Paroles, paroles… » dénoncées par la chanson.
Mais d’un autre côté, il s’agit d’une situation où le cadre prime sur le contenu de la
communication. Celui-ci approche de zéro, tandis que la relation tend vers l’infini. Elle
vaut par le primat de l’interlocution. Ces énoncés dont le contenu n’apprend rien à per-
sonne peuvent avoir comme ceux de la politesse ou du rituel, d’autres fonctions rela-
tionnelles ou sécurisantes12. L’invocation de Blanchot gagne aussi par la répétition qui
est l’occasion de certains recadrages dont dépend la créativité intellectuelle, de part et
d’autre la barre de fraction où s’instaure la relation entre « je » et « tu ».
« Fais en sorte que je puisse te parler » : cette phrase vaut-elle la peine d’être traduite
dans une autre : « Faites en sorte que je puisse vous parler » ? Postuler à la parole dans la
parole, désirer parler quand on parle déjà, l’énigme de cet acte s’annonce dans les para-
doxes qu’il renferme. L’un des écueils de cette proposition c’est qu’elle n’est que « paroles
verbales » c’est-à-dire que les mots utilisés ne recouvrent aucune réalité : « Fais en sorte
que je puisse te parler. “Que dois-je dire ?” – “Que voulez-vous dire ?” » – « Cela qui, si je
le disais, détruirait cette volonté de dire13. »
Déchéance d’une communication qui n’accède pas au stade proprement information-
nel. Ce n’est pas une parole de type référentiel. Une telle phrase est dite « limitante » dès
lors qu’elle génère des prédictions d’échec et freine les possibilités d’avoir quelque chose
à communiquer, en empêchant d’utiliser de façon constructive les données d’un contenu.
12. Au-delà de la « linguistique de la parole » postsaussurienne : les études, entre autres, consa-
crées à l’énonciation (avec Benveniste notamment) qui intègrent la situation de locution, d’inter-
locution dans l’acte individuel d’utilisation de la langue, et Roman Jakobson dans son livre Essai
de linguistique générale (1963) qui propose de distinguer six fonctions du langage : référentielle
(donner une information), émotive (traduire une émotion), conative (donner un ordre), pha-
tique poétique (rechercher l’esthétique), métalinguistique (réguler son propre discours). La fonc-
tion phatique (maintenir le contact), en particulier, selon laquelle l’énoncé révèle les liens ou
maintient les contacts entre le locuteur et l’interlocuteur. L’approche « médiologique » nous inté-
resse ici plus particulièrement. Celle-ci accorde la priorité à la transmission qui ne suppose pas un
rapport d’émetteur/récepteur ; s’occupe, au-delà de la parole communicante, au problème de sa
médiatisation et de sa transmission. Nous ne sommes pas uniquement dans la linguistique mais
dans la médiologie. R. Debray dit : « Un sémiologue s’attachera en priorité au signifié graphique,
ou au jeu des signifiants, un médiologue à la procédure d’inscription ainsi qu’à l’outil et au maté-
riau utilisé », Debray Régis, op. cit., p. 25. Or, il s’agit du mode d’inscription de la parole littéraire
et intellectuelle et de son accomplissement à travers l’écriture.
13. Blanchot Maurice, L’Attente, l’oubli, op. cit., p. 24.
97
Blanchot.indb 97 29/11/13 11:56
Si elle s’apparente au métalangage – coder du sein de la parole la valeur qu’on accorde à
celle-ci – tout se passe comme si une contradiction intenable opposait le niveau et le
métaniveau du message, ses aspects de contenu et ses aspects de relation. Le contenu
verbal se trouve donc démenti au direct de son énonciation : affirmer que l’on veut par-
ler tout en ne disant que cette affirmation, comme lorsqu’on affirme à table : « C’était
délicieux vraiment… », en rendant l’assiette pleine.
Parler ne va pas de soi : « Que je puisse… ». L’action est sujette à caution, elle relève de
l’éventuel (le subjonctif et l’auxiliaire modal : pouvoir). Deux problèmes se posent à ce
niveau, selon les termes de Derrida14 : la parole ne sait pas si elle va pouvoir avoir lieu. La
parole ne sait pas si elle va pouvoir s’adresser. La tâche de parler demeure ainsi sans pou-
voir ; elle ne se donne pas tous les moyens de l’expression : « Pourquoi attirez-vous en
moi cette parole qu’ensuite il me faut dire ? Et jamais vous ne répondez ; jamais vous ne
faites entendre quelque chose de vous15. » De là l’éclatement de la structure sur de nou-
veaux problèmes : où trouver le viatique d’un « quelque chose à dire » ? Où trouver une
place pour la parole dans cette défaillance ?
Le dialogue dysfonctionne. En tant que partage et croisement, il est souvent probléma-
tique. Vouloir dialoguer n’aboutit qu’au brouillage de la communication. D’où la situa-
tion dramatique des personnages dans le récit blanchotien. L’expression des interlocuteurs
n’est souvent qu’une aliénation, c’est une répétition où la parole fait écho à la parole,
absurdement : « Le toi et le moi se défont dans un dialogue perpétuellement illusoire16. »
Pour celui qui parle comme pour celui qui écoute, il s’agit d’un échange et en même
temps d’une interruption : « Ils se tiennent toujours l’un en face de l’autre, cependant
détournés l’un de l’autre, ne se regardant que de très loin17. » Dans L’Attente, l’oubli, la
parole ne se donne pas à entendre d’autrui : « Il aurait voulu avoir le droit de lui dire :
“Cesse de parler, si tu veux que je t’entende.” Mais elle ne pouvait plus se taire à présent,
même ne disant rien18. » La parole ne se donne pas à entendre elle-même. « Fais en sorte
14. Santiago Hugo, Maurice Blanchot, Film de 57’ en couleur, conception Ch. Bident et
H. Santiago, réalisation H. Santiago, production : Ina FR3, « Série : un siècle d’écrivains », 1998.
15. Blanchot Maurice, L’Attente, l’oubli, op. cit., p. 12-13.
16. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, 2e version, 1950, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire »,
1992, p. 216.
17. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. XVI.
18. Blanchot Maurice, L’Attente, l’oubli, op. cit., p. 12.
98
Blanchot.indb 98 29/11/13 11:56
que je puisse te parler. », cette requête semble articuler la parole sur autre chose qu’elle-
même : « C’est la voix qui t’est confiée, et non ce qu’elle dit19. » Toujours en décalage, son
énonciation est appréhendée comme si la parole, le langage n’étaient pas placés dans le
sujet mais en dehors de lui, à un niveau désynchronisé, jamais contemporain, tantôt
antérieur et tantôt à venir : « C’est toujours la vieille parole qui veut être là à nouveau
sans parler20. » D’où vient-elle ? De quel lieu de la parole et de l’antériorité de la parole ?
D’un point de vue médiologique, « Fais en sorte que je puisse te parler » revient à se
demander en dernier recours de quelle sorte l’écrivain va-t-il pouvoir rendre compte de
cette problématique communicationnelle moderne : la légitimité de la parole littéraire et
l’impératif de son écoute. Voici quelques hypothèses.
Le primat de la communication sur l’information
Communiquer c’est mettre et être en commun, avant et indépendamment de tout
envoi de messages particuliers. C’est un truisme dans les théories communicationnelles.
L’information suppose en général la communication. Cette condition n’est pas symé-
trique : la communication n’est pas toujours une signification linguistique, ne conduit
pas invariablement à l’information, et s’en passe même aisément.
À défaut de dire, le mouvement de la parole vise à sauver au moins le contact en le
maintenant : « La principale sauvegarde de cette voix qui dit, avec un peu de froideur : “Je
voudrais vous parler21”. » Les théories du langage parlent par extension de communica-
tion phatique chaque fois que le sujet veut s’assurer de la relation indépendamment du
contenu du message22. L’information : « Fais en sorte que… » s’épuise dans la redondance
19. Ibid., p. 11.
20. Ibid., p. 13.
21. Ibid., p. 132.
22. S’agissant de connaissances de base supposées bien connues chez le lecteur, il ne saurait être
question ici de retracer l’histoire du saussurisme et de la linguistique après Saussure. C’est là un
des postulats les plus incontestés dans l’approche postsaussurienne de la « linguistique de la
parole » ou énonciation et de la communication (les fonctions du langage de R. Jakobson) qui
vont au-delà de la bifurcation fondamentale de Saussure : langue/parole (langage), distinction
d’où ont découlé les autres principes de sa linguistique : synchronie/diachronie (langue), signi-
fiant/signifié (signe) et de manière embryonnaire : phonétique/phonologie. Au stade du Cours de
linguistique générale, la théorie linguistique ne pouvait pas encore être le langage pris dans son
tout (avec ses parties physique, psychologique, psychique).
99
Blanchot.indb 99 29/11/13 11:56
et la prévisibilité pure : une répétition comme telle n’apporte nulle information. Mais
elle peut avoir d’autres valeurs, expressives, conatives, poétiques ou communication-
nelles en général. Le but ultime de la parole n’est pas le message, mais la disponibilité du
contact. Le réseau est d’abord phatique : « Fais en sorte que je puisse te parler. », celui où
communiquer n’est pas informer prioritairement. Ici l’acte de parler prévaut par le don
de l’échange interpersonnel, au-delà de la valeur pratique du logos. Blanchot semble
désintellectualiser pour ainsi dire ce phénomène communicationnel au profit d’un
commandement davantage plus liant, celui de la communion :
Depuis quelque temps, je lui parlais dans sa langue maternelle, que je lui trouvais
d’autant plus émouvante que j’en connaissais moins les mots. […] et à son tour elle me
répondait en français, mais un français différent du sien, plus enfantin et plus bavard,
comme si sa parole fût devenue irresponsable, à la suite de la mienne, employant une
langue inconnue23.
Blanchot pose ici le problème de l’écriture et du langage en tant que séparation, dis-
tance et interruption. La parole diffère de parler : « Parlant, différant de parler. Pourquoi
quand elle parlait, différait-elle de parler24 ? » Dans son pivotement autour d’elle-même,
la parole tendue du côté de son antériorité rétablit paradoxalement le rapport dans les
termes de ce qui est à venir, devenant ce qu’elle a encore à dire, toujours de nouveau, plus
proche, jamais accomplie. C’est pourquoi parler est un procès qui se conjugue dans un
futur toujours inaccompli :
Différence : elle ne peut être que différence de parole, différence parlante, qui permet
de parler, mais sans venir elle-même, directement, au langage – ou y venant, et alors
nous renvoyant à l’étrangeté du neutre en son détour, cela qui ne se laisse pas neutra-
liser. Parole qui toujours par avance, en sa différence, se destine à l’exigence écrite25.
C’est un passage limite entre une impossibilité de parler et en même temps sa pressante
nécessité. Face à la parole assoupie dans ce qui n’est pas encore dit, reste l’urgence
– comme ultime recours – de l’animer et de la déployer dans la souveraineté du je-ne-
parle-pas-encore : « Parole qu’il faut répéter avant de l’avoir entendue […] nécessité de
23. Blanchot Maurice, Au Moment voulu, Paris, Gallimard, 1951, renouvelé en 1979, p. 99-100.
24. Blanchot Maurice, L’Attente, l’oubli, op. cit., p. 111.
25. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 254.
100
Blanchot.indb 100 29/11/13 11:56
la laisser aller26. » Cela pourtant n’arrive pas. Mais cela appelle la veille incessante :
l’avènement est en fait « in-avènement ». Inscrite à même le titre de L’Attente, l’oubli,
l’attente de la parole appelle l’attention, provoque l’« ouverture sur l’inattendu » :
« L’attention, accueil de ce qui échappe à l’attention, ouverture sur l’inattendu, attente
qui est l’inattendu de toute attente27. »
Dès lors, la pensée chez Blanchot connaît un bouleversement où les concepts se
trouvent marqués par leur contraire : la communication est l’incommunicable, la com-
munauté une absence de communauté et la parole sa propre négativité. Autrement dit,
comme le souligne J.-L. Nancy28, tout ce que la philosophie a mis sous le concept de la
communication, à savoir l’amitié, la proximité, la familiarité, la connaissance de l’autre,
se trouve ici radicalement remis en question :
La parole lorsque celle-ci n’est pas repliée en façons parlantes […] une parole sans
partage et pourtant nécessairement multiple, de telle sorte qu’elle ne puisse se déve-
lopper en paroles : toujours déjà perdue, sans usages et sans œuvre et ne se magnifiant
pas dans cette perte même29.
Cependant, cette impossibilité n’a rien d’annihilant. Ce qui est en apparence refus de
la relation, est le sens même du rapport à l’autre : « Le rapport avec l’autre qui est la
communauté même, laquelle ne serait rien si elle n’ouvrait celui qui s’y expose à l’infi-
nité de l’altérité, en même temps qu’elle en décide l’inexorable finitude30. » Le « parler »
qui s’arrête au seuil sans cesse reculant de la parole, laisse pressentir au moins que
« quelque chose se dit ne se disant pas ». C’est là son mérite : « Pour que le parler ne
s’arrête pas à la parole, dite ou à dire ou à dédire : laissant pressentir que quelque chose
se dit, ne se disant pas31. » C’est qu’il s’agit de mener à son terme un certain épuisement
de la parole littéraire pour atteindre à une sorte de virginité de la rencontre :
26. Blanchot Maurice, L’Attente, l’oubli, op. cit., p. 13.
27. Ibid., p. 45.
28. Santiago Hugo, Maurice Blanchot, op. cit.
29. Blanchot Maurice, La Communauté inavouable, Paris, Les Éditions de Minuit, 1983, p. 25.
30. Ibid., p. 33.
31. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 39.
101
Blanchot.indb 101 29/11/13 11:56
Ils cherchaient l’un et l’autre la pauvreté dans le langage. Sur ce point, ils s’accor-
daient. Toujours, pour elle, il y avait trop de mots et un mot de trop, de plus des mots
trop riches et qui parlaient avec excès32.
Blanchot évoque souvent le problème de l’échange en ces termes : « Le fond sans fond
de la communication33 » Le paradoxe du « fond sans fond » n’aboutit guère à l’impasse,
mais à l’ouverture sur l’Autre. L’auteur dit : « Seule en vaut la peine la transmission de
l’intransmissible34. » Autrement dit, l’intransmissibilité de la pensée ne doit pas décou-
rager l’impératif de la dire. Cela seul donc « en vaut la peine ». Mais, pour rappeler
J.-L. Nancy, la « peine » aussi que cela vaut, c’est la peine infinie à se faire comprendre de
l’Autre : non pas m’entendre moi-même, mais me donner à entendre. En d’autres termes,
tout le mouvement par lequel le moi sort de son moi, s’ouvre sur l’autre, c’est-à-dire
existe véritablement : « Partout où je me trouvais, un intervalle qui était sa demeure, à
dresser la tente de l’exil où je pouvais communiquer avec lui35. »
Le problème de l’échange est également traduisible par la prévalence du cadre sur le
contenu de la communication. En effet, la sémantique de toute relation entre locuteurs
se définit par deux niveaux d’émission et de réception des messages. Premièrement, des
messages-cadres et sur la base de ceux-ci des messages de contenus ou d’information
proprement dite. Les théories des sciences de l’information et de la communication
accréditent la thèse que la reconnaissance du code et du cadre est la condition élémen-
taire de la perception du message. La formule de Blanchot exprime fortement cette idée
que toute connaissance évolue sur un fond de reconnaissance « Connaître, c’est recon-
naître36 », ce préalable minimal de toute discussion : s’identifier mutuellement comme
des interlocuteurs à part entière.
Que dit Blanchot ? « Fais en sorte que je puisse te parler. » Invitation à la prise de la
parole, mais aussi désir de l’autre sous la forme d’une écoute condensée. La proposition
est donc traduisible en ceci : « Fais en sorte que tu puisses m’écouter ». La parole découvre
son objet dans l’attention infinie que demande l’écoute. Or, dans toute communication,
32. Blanchot Maurice, L’Attente, l’oubli, op. cit., p. 19.
33. Blanchot Maurice, La Communauté inavouable, op. cit., p. 35.
34. Ibid.
35. Blanchot Maurice, Celui qui ne m’accompagnait pas, Gallimard, 1953, p. 86.
36. Le mot de Pascal traduit cette idée de re-connaissance : « Tu ne me chercherais pas si tu ne
m’avais déjà trouvé ».
102
Blanchot.indb 102 29/11/13 11:56
la difficulté consiste dans le fait que le contexte et le monde propre du récepteur l’em-
portent désormais sur la sémantique interne du message ou l’intention de l’émetteur. La
pertinence supplante la vérité, le tranchant de l’information se trouve émoussé dans le
circuit « je – ici – maintenant » de celui qui la réceptionne. Dans cette optique, l’incipit
du Très-Haut peut se lire comme la représentation de cette part maudite, mal dite de nos
échanges et qui ne se laisse pas quantifier facilement à la seule performance logico-lan-
gagière. La parole en tant qu’espace commun de la rencontre et de la communication,
devient un terrain de conflit37.
Le primat de l’oralité
La supplique de Blanchot est une mise en scène de l’oralité : « Que je puisse te par-
ler ». L’écriture travaille sur sa matérialité en tant que « système auditif » et « enchaî-
nement des sons articulés38. » Tel l’art contemporain qui met les tripes à l’air (la toile,
le volume, le châssis), l’écriture s’auto-bouclant se fait gloire de ces accessoires et de
ces organes rendus visibles : parole de la voix, voix de la parole. Selon ce point de vue,
le « désœuvrement » blanchotien se donnerait à entendre comme l’acte de défaire
encore l’œuvre de sa conception substantielle pour lui restituer son sens verbal en tant
que circulation de la parole et de sa transmission. Le livre de L’Attente, l’oubli a porté
cette dédicace : « Dans la pensée du but qui nous est commun. », par laquelle Blanchot
s’adresse à ses amis intellectuels39, tous acteurs de la parole. Cet espace fait d’écho par-
lant est l’espace même de l’écriture : « “La communauté” s’inscrit dans l’écriture […]
37. Le roman s’ouvre sur une phrase confiante, d’une simplicité inouïe : « Je n’étais pas seul,
j’étais un homme quelconque. » Se produit ensuite, un incident d’une grande banalité : le héros
heurte quelqu’un dans le métro, celui-ci le bouscule. Le héros lui dit : « Vous ne me faites pas peur. »
Et l’autre de lui donner un coup de poing sur la figure. Il s’écroule par terre. La scène traduit une
réalité sociologique de plus en plus inquiétante : la tendance à voir se transformer la parole comme
support des rapports sociaux, en force de rupture qui dissout les liens de solidarité. Selon Daniel
Dobbels, la violence que subit le héros est cette même violence qu’éprouvent les gens de ne pas
supporter le fait de se parler les uns aux autres.
38. « Par parler nous entendrons désormais le système auditif des symboles linguistiques, l’en-
chaînement des sons articulés. » Sapir Edward, Le Langage : introduction à l’étude de la parole,
traduit de l’anglais par S. M. Guillemin, Paris, Payot, 1970 pour la traduction française, 2001 pour
la présente édition, p. 33.
39. Dédicace à Georges Bataille.
103
Blanchot.indb 103 29/11/13 11:56
indiquant seulement l’espace où retentit, pour tous et pour chacun, et donc pour per-
sonne, la parole toujours à venir du désœuvrement40. »
La question concerne la situation problématique de la parole intellectuelle dans le pay-
sage médiatique contemporain. Depuis la seconde moitié du xxe siècle, l’épaississement
médiatique et la prodigieuse variété des vecteurs, avec la désorientation et la déstabilisa-
tion qu’ils provoquent, font lever une problématique en lieu et place d’une évidence.
L’Attente, l’oubli annoncerait de loin cette situation de l’intellectuel plus que jamais
« médiodépendant », dans la mesure où les médias constituent de plus en plus le milieu
de son activité. Il semble que l’écrivain vit un ultime paradoxe : revendiquer la parole
pour un intellectuel qui, par définition, est un homme de la parole et du discours : « “Faites
en sorte que je puisse vous parler” – “Eh bien, rassurez-vous, vous avez parlé plus que je
ne vous ai entendue.” – “entendue” – “J’ai donc parlé, et parlé en vain. C’est le pire”41. »
Au cours de l’histoire la plupart des maîtres à penser de l’humanité n’eurent pas
recours à l’écrit, mais à la parole. Pensons à Pythagore, au Christ, à Socrate, à Bouddha.
Plus que l’encre, la salive et la manducation du texte : « C’est juste, parler est la dernière
chance qui nous reste, parler est notre chance42. » L’homélie du personnage de L’Attente,
l’oubli (« Elle ») défendrait ici la possibilité d’une parole impérieusement « orale »,
mais qui paradoxalement ne peut être rendue possible que par sa rédaction même.
Autrement dit : la parole est appelée à détourner sa précarité « parlante » par son
encodage dans l’écriture.
L’énigme d’une telle requête « Fais en sorte que… » se débrouille proportionnelle-
ment à sa nature même : par sa répétitive scansion, la prière ne manque pas de retentir
aussi comme un appel catégorique, voire une mise en demeure de l’Autre, au nom d’un
« devoir d’écoute », et que réclame souverainement le préalable « droit à parler ». De
cette hantise de rompre l’indifférence de l’Autre dépend « l’être ou ne pas être » au sens
shakespearien du mot, de la parole.
C’est ainsi que Blanchot se pose en dialecticien non seulement de la nécessité de « par-
ler » mais de l’utilité d’un tel acte, lequel ne peut se concevoir que dans la perspective
d’un « se faire entendre ». Comment le fait de disposer de la « parole » pourrait-il avoir
40. Blanchot Maurice, La Communauté inavouable, op. cit., p. 77.
41. Blanchot Maurice, L’Attente, l’oubli, op. cit., p. 155.
42. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. XVI.
104
Blanchot.indb 104 29/11/13 11:56
un sens s’il n’était sanctionné par une disponibilité d’écoute ? Comment au-delà de la
possibilité-impossibilité du droit d’expression, la liberté d’une telle performance trouve-
t-elle à s’exercer dans la défense des droits de la pensée et de la libre délibération intel-
lectuelle43 ? Pourquoi une telle exigence ?… Réclamer à tout prix la parole, vouloir
continuer à « être à la conversation » annoncerait-il la fin d’une grande tradition ?
« Peut-être mon effort consistait-il à ouvrir, partout où je me trouvais, un intervalle qui
était sa demeure, à dresser la tente de l’exil où je pouvais communiquer avec lui44. »
Le problème n’est pas de l’ordre de « la liberté d’expression » ou du droit de présence
de la parole – en Occident ce sont des questions tranchées depuis longtemps. Il serait
précisément tout autre : celui de la démesure de l’activité parlante, de la fureur de la
parole en trop étalée partout. En effet, aujourd’hui à l’ère de la communication univer-
selle vivant au rythme des multinationales médiatiques, et des « professionnels » des
débats publics, ménager une aire saine pour la parole littéraire authentique devient de
plus en plus difficile. Un nouveau débat esthétique et une nouvelle psychologie se créent
sans doute : « Nous avons remplacé la culture par du culturel au nom de la culture. Nous
avons remplacé le culturel par de la communication au nom du culturel45. »
Comment pouvoir alors efficacement parvenir à communiquer ? Comment commu-
niquer cette impossibilité même ? L’écrivain qui tente de faire parvenir sa pensée est
acculé à user de détours : lancer en boucle ce message « Fais en sorte que je puisse te
parler. » La postérité, quel que soit le paysage, portera cette hantise, à l’image de cette
homélie d’Olivier Py : « Ne rien jouer d’autre, rien d’autre que “je parle”. Je parle au non
du Verbe qui ne dit rien que lui-même dans la réflexivité Suprême de Son délire46. »
43. Sans vouloir mondialiser le problème du « droit à la parole » – l’Occident démocratique a
rompu définitivement avec ce crime de droit commun – il faut signaler toutefois l’importance de
la leçon de Blanchot pour les intellectuels dans le contexte tiers-mondiste (le monde arabe notam-
ment) où la doxa continue de façonner encore toutes les démarches conceptuelles ; où les esprits
réformistes (hommes de lettres et journalistes) sont victimes d’une véritable non-lecture, tou-
jours rappelés à l’ordre pour réinsérer les modèles de pensée et d’action « réglementaires ». Autant
de vues pré-modernes absolument intenables dans l’ambiance intellectuelle d’aujourd’hui.
44. Blanchot Maurice, Celui qui ne m’accompagnait pas, op. cit., p. 86.
45. Py Olivier, Épître aux jeunes acteurs, pour que soit rendue la parole à la parole, op. cit., p. 21.
46. Ibid., p. 33. Ou encore cette parole maghrébine également insoumise à sa condition tiers-
mondiste : « Ma voix est la seule chose matérielle en laquelle je peux encore me révéler. Allez donc
couper la main ou les testicules à une voix. Essayez de trouver la tête d’une voix, le trou d’où elle
105
Blanchot.indb 105 29/11/13 11:56
Dire en redisant ce dire, telle serait la condition de l’intellectuel, son ultime recours. À
cet égard, la titrologie blanchotienne est éminemment significative : L’Entretien infini, Le
Ressassement éternel, Le Pas (la parole ?) au-delà. Dans l’excès de bruit, il faut répéter
jusqu’à trouver une oreille attentive dans le brouhaha ambiant : « Il aurait voulu avoir le
droit de lui dire : “Cesse de parler, si tu veux que je t’entende”. Mais elle ne pouvait plus
se taire à présent, même ne disant rien47. » Phrase après phrase et œuvre après œuvre :
répéter, répéter ; il en restera toujours quelque chose. D’où le mot d’ordre de Blanchot :
« De là cette injonction : ne change pas de pensée, répète-la si tu le peux48. » Le récit
blanchotien se clôt souvent sur cette exigence du « parler maintenant » quand toute
semble fini. Plusieurs excipit portent ainsi cette hantise :
Maintenant, c’est maintenant que je parle49.
Oui, il faut parler sans cesse, sans arrêt. – Le désirez-vous ? – Il le faut ! Maintenant,
maintenant50.
“Qui êtes-vous ?” C’était comme si cette question allait lui permettre de tout tirer
au clair51.
Mais qu’est-ce donc que de persévérer dans la parole ? Cette interrogation peut alors se
décliner ainsi : qu’est-ce qui rend la parole possible ? Qu’est-ce qui fonde le lien social
aujourd’hui ? Est-ce la communauté, la communication, l’État ? Comment faire durer le
vivre-ensemble ? Repenser ces questions classiques de la philosophie, revient à penser les
problèmes concrets de la cité52.
pisse, ou alors les seins sur lesquels vous pourriez accrocher les pinces de vos gégènes. Rien. »
Abdellatif Laâbi, Discours sur la colline arabe, Paris, L’Harmattan, 1985, p. 11.
47. Blanchot Maurice, L’Attente, l’oubli, op. cit., p. 12.
48. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, op. cit., p. 13.
49. Blanchot Maurice, Le Très-Haut, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 1948, renouvelé en
1975, p. 243.
50. Blanchot Maurice, Celui qui ne m’accompagnait pas, op. cit., p. 154.
51. Blanchot Maurice, Aminadab, Paris, Gallimard, 1942, p. 227
52. D’où l’importance de la question politique. La parole de l’intellectuel pourrait-elle ne pas être
politique ? Celle-ci – c’est ici le lieu de répéter ce truisme – relève simultanément de l’évolution
historique et du social comme de la métaphysique qui la soutient. Le cas encore une fois des pays
non démocratiques où la pensée perd son indépendance à cause du politique, où la position des
intellectuels est souvent déterminée par des dispositifs idéologiques où généralement, ce sont les
mécanismes politiques qui l’emportent. Toutefois, l’idée de la pensée intellectuelle (littéraire ou
philosophique) à n’être plus ou moins, qu’une mise en forme d’« idées politiques » a ses limites.
106
Blanchot.indb 106 29/11/13 11:56
Les premières fictions de Blanchot subissent cette épreuve d’un monde de luttes
armées, où est perdu le sens du lien, le lien du sens ? Comment communiquer cette
impossibilité même ? Les notions que Blanchot développera par la suite de « désastre »,
« désœuvrement », « attente » de la parole et son « oubli » sont la meilleure expression
pour dire les ruptures du dialogue et les impasses historiques : « Ô ville, dis-je, puisque
bientôt je ne pourrai plus par mon langage communiquer avec vous, laissez-moi jusqu’à
la fin jouir de ces choses auxquelles les mots répondent s’ils se brisent53. » Comment
communiquer dans un monde de slogans et de « mots d’ordre » ? :
À certains carrefours, la terre tremblait et il semblait que la populace marchât sur le
vide, qu’elle franchissait sur une passerelle de vociférations. La grande consécration du
« jusqu’à ce » que eut lieu vers midi. Avec des débris de paroles, comme si du langage
n’eussent subsisté que les formes d’une longue phrase écrasée par le piétinement de
la foule54.
Comment échapper à la parole péremptoire et omnipotente qui dispense l’homme de
penser, au sommeil de la masse, aux phénomènes primaires d’influence, d’identifica-
tion ? La même parole pour tous n’est plus parole, mais expression du totalitarisme. Le
langage s’efface dans une forme de scansion qui rassemble certes, mais qui n’aboutit à
aucun échange : « Je me suis laissée entraînée par la foule qui m’enveloppait, me pressait.
Ses cris, venus de très bas, me traversaient le corps, remontaient jusqu’à ma bouche. Je
parlais sans avoir à dire un mot55. »
Blanchot met en garde contre l’articulation de la thématique politique sur la réflexion littéraire :
« Il y a l’action politique, il y a une tâche qu’on peut dire philosophique, il y a une recherche
éthique. » Blanchot Maurice, La Communauté inavouable, op. cit., p. 35-36. Michel Foucault
dénonce le rapprochement inconsidéré entre la pensée souveraine et le pragmatisme opportuniste
de la politique : « L’ignorent en leur profonde niaiserie, ceux qui affirment qu’il n’y a point de phi-
losophie sans choix politique, que toute pensée est “progressiste” ou “réactionnaire” ? Leur sottise
est de croire que toute pensée “exprime” l’idéologie d’une classe. » Foucault Michel, Les Mots et les
choses, Paris, Gallimard, « Tel », 1966, p. 339.
53. Blanchot Maurice, « Le dernier mot » in Après Coup précédé par Le Ressassement éternel,
Paris, Les Éditions de Minuit, 1983, p. 65.
54. Ibid., p. 63. C’est Blanchot qui souligne.
55. Ibid., p. 64.
107
Blanchot.indb 107 29/11/13 11:56
Contre la puissance manipulatrice de la parole, cette boîte de Pandore – « boîte noire
encore fermée », dirait Régis Debray56 – l’écriture propose, à juste titre, le ciment de la
parole. Accéder à la formulation est ce qui assure au moins le lien. Narrateur et person-
nage, écrivain et lecteur, les instances se font l’une l’autre dans un déplacement-détour-
nement permanents par rapport à elles-mêmes et par rapport à la parole. Au début de
L’Entretien infini, Blanchot dit : « C’est juste, parler est la dernière chance qui nous reste,
parler est notre chance57. » L’idylle, dès 1935, propose le ciment de la parole comme la
seule ressource contre la menace de l’incommunicabilité. Faute d’intellection, le dialogue
est donc ce qui assure au moins le lien. Contre la peur de l’« étouffement », le personnage
cherche à « échanger des paroles », « parler à quelqu’un », « sortir de ses pensées » :
Akim sentit combien lui pesait l’absence du vieillard qui était la seule personne avec
laquelle il pût échanger des paroles. Ce soir, il fallait qu’il parlât à quelqu’un ; il mour-
rait d’étouffement s’il ne sortait pas de ses pensées58.
La parole ricoche dans l’équivoque du silence et de la solitude. Pour se justifier, elle se
tourne vers elle-même. Et de cette impossibilité de parler, elle déploie un espace phy-
sique à la parole :
Je me suis enfermé, seul […] mais cette solitude elle-même s’est mise à parler, et
à mon tour, de cette solitude qui parle, il faut que je parle, non par dérision, mais
parce qu’au-dessus d’elle veille une plus grande qu’elle et au-dessus de celle-ci une plus
grande encore, et chacune recevant la parole afin de l’étouffer et de la taire, au lieu de
cela la répercute à l’infini, et l’infini devient son écho59.
Ce drame de la parole in-communicante ne se démentira pas au fil des récits de
Blanchot. Le parler est ainsi souvent l’expression pathétique de l’absence de l’interlocuteur.
La voix se scinde dans une sorte de dédoublement schizophrénique : « Quelqu’un en moi
converse avec lui-même. Quelqu’un en moi converse avec moi-même60. » Ainsi, la
communauté que l’auteur défend n’est pas une abstraction, c’est un mouvement lui aussi
56. Debray Régis, « À l’entrée de cette boîte : des discours, des brochures, des mots ; à la sortie
des églises, des armées, des États. », in Introduction à la médiologie, op. cit., p. 114.
57. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. XVI.
58. Blanchot Maurice, Après Coup précédé par Le Ressassement éternel, op. cit., p. 34.
59. Blanchot Maurice, Au moment voulu, op. cit., p. 57.
60. Blanchot Maurice, L’Attente, l’oubli, op. cit., p. 46.
108
Blanchot.indb 108 29/11/13 11:56
sans cesse en déplacement entre « je » et « tu », entre le sujet et l’écriture, le moi et la
culture ; dynamique qui expose à l’ouvert et à l’infini : « Me maintenir présent dans la
proximité d’autrui qui s’éloigne […] voilà ce qui me met hors de moi et est la seule
séparation qui puisse m’ouvrir, dans son impossibilité, à l’Ouvert d’une communauté61. »
L’écriture n’expose pas, ne consacre pas : elle fait d’abord exister, son activité est irréductible
à une opération mécanique, aux techniques industrielles destructrices d’aura.
Rappelons pour finir comme pour commencer le mot de Blanchot : « Fais [Faites] en
sorte que je puisse te [vous] parler. » Dans cette forme dialoguée en apparence, ce qui est
en substance mis en scène, c’est le drame du soliloque, le mystère d’une parole à double
entente qui se donne la réplique à elle-même, commémore sans cesse le retour de ce qui
disparaît, qui fait retour de sa disparition même.
S’agissant de Blanchot, l’appel de l’écriture, ce que dit la bouche de l’œuvre ne peut
être saisi qu’à partir de l’espace essentiel de l’œuvre elle-même, son « espace littéraire ».
Certes62. Mais cet appel est aussi fermement lié au monde et au destin de la parole intel-
lectuelle au sein des divers modes de communication. Il est devenu le problème de notre
temps : par quel moyen l’écrivain pourra-t-il faire entendre sa voix au milieu de l’affai-
rement verbal mondial, des éclats des voix de tous ordres ? Dès 1950, Blanchot exprime
ce souci du modi essendi de l’écrivain dans la société :
Comment l’artiste est-il encore possible au sein d’une société bourgeoise qui n’ac-
cueille l’art que comme le divertissement d’un instant, petite chose frivole et vaine,
d’ailleurs légèrement inquiétante, mais agréable, mais facile à maintenir dans le bon
usage de l’ordre ? Ces questions se sont posées sans cesse pour tous les écrivains qui
voient dans l’art le sérieux, qui sont liés puissamment à l’art et puissamment au
monde63.
L’invocation « Fais en sorte que… » engage le problème du rapport du médium et de
la médiation et, au-delà, celui de l’émotion spirituelle dans son rapport aux bricoles
61. Blanchot Maurice, La Communauté inavouable, op. cit., p. 21.
62. Il y a peut-être lieu de parler ici d’une forme de conventionnalisme critique entretenu à
l’égard de l’œuvre de Blanchot. L’approche essentiellement littéraire et philosophique équivaut
souvent à un pacte de lecture prescrit à celui qui aborde cette œuvre qui, faut-il le dire, représente
l’extrémité la plus aiguë de la pensée littéraire. Sans désemparer, cette loi a fini par acquérir la
force d’un dogme.
63. Blanchot Maurice, « Le Docteur Faustus » in Maurice Blanchot. La condition critique,
articles 1945-1998, Paris, Gallimard, 2010, p. 168.
109
Blanchot.indb 109 29/11/13 11:56
matérialistes et aux récupérations politiques. Plus qu’une question esthétique, la pro-
blématique relève d’une économie de la communication et d’une anthropologie de la
transmission. Il pose la question de la libération du dedans par le dehors, cette pro-
priété unique que l’homme possède de placer sa mémoire en dehors de lui-même,
dans l’organisme social.
Le discours blanchotien tente d’éprouver ce paradoxe bouleversant de la parole intel-
lectuelle appelée à se détourner de sa précarité essentielle par sa survie dans et par la
médiation de l’écriture ; de la parole inaudible à l’ère nouvelle d’autres moyens d’expres-
sion qui exproprient celle-ci à son sujet et la réduisent à une forme d’aphasie ; où le
« dernier mot » reste au Média qui, comme le pensait Macluhan, modèle directement le
sensorium individuel à son image, et au Médium « qui fait de toute anti-culture, culture,
et du crachat, une eau bénite64. » Face à cette déchéance Blanchot propose l’appel
constant du discours, le besoin du liant que confère le mythe du logos. L’homme ne vit
pas seulement de contenus d’informations ni même de vérités, mais d’abord de rela-
tions, dans une communauté de parole ouvrant constamment sur l’autre. C’est parce
que nous pouvons parler que nous sommes des hommes.
64. Debray Régis, Introduction à la médiologie, op. cit., p. 68.
Blanchot.indb 110 29/11/13 11:56
Maurice Blanchot : « Je » ou comment s’en débarrasser.
De l’objet voix à l’« ob-je »
Maxime Decout
L
’entrée en littérature, pour le théoricien Maurice Blanchot, est l’expérience
d’une dépossession, le franchissement d’un seuil au-delà duquel l’écrivain affronte
l’innommable et le silence. La littérature serait ainsi le lieu d’une suppression de soi
et du sens, plaçant celui à qui elle s’impose devant une nécessité absolue : Je ou comment
s’en débarrasser. Car l’égographie n’appartient pas au territoire de la littérature tel que
l’envisage Blanchot. En effet, l’écrivain serait celui qui « perd le pouvoir de dire “Je”1 ».
Thomas l’Obscur et Aminadab valideraient une telle assertion. Et pourtant la poétique du
récit chez Blanchot, du Très-Haut à La Folie du jour, ne cesse de contredire, du moins en
surface, les propos du critique : elle laisse le récit soumis à une voix où triomphe le « je ».
Contradiction ? Scission entre le penseur et l’écrivain ? Ou plus sûrement renouveau
radical de la pensée du sujet et de l’écriture du « je » ? Tendu entre Thomas l’Obscur et
L’Attente l’oubli, deux extrêmes dans le temps mais aussi dans la conception de la voix
narrative, le récit chez Blanchot affronte le « je » pour en repenser la logique. Recourant à
un « neutre » auquel elle ne semble pouvoir s’assigner strictement, l’écriture de Blanchot
1. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, « Folio/Essais », 1988, p. 21.
111
Blanchot.indb 111 29/11/13 11:56
se lie à deux organes d’émission et de réception spécifiques et problématiques : l’œil et la
bouche. Annexant les propriétés du viscéral à l’optique et au vocal qui guident la narration,
les instances textuelles voisinent des organes devenus menaçants, incarnant des mots
monstrueux et autophagiques qui imposent de redéfinir le récit. Car l’injonction est
absolue chez Blanchot : « se perdre, il le faut2 ». Et elle s’adresse autant au personnage, au
narrateur, au récit lui-même, qu’au lecteur. Aussi, avec l’attaque portée contre le « je », se
joue une tentative de liquidation du récit, du moins d’une certaine conception du récit.
Comme le rappelle le narrateur de Celui qui ne m’accompagnait pas, « j’ai tout, sauf…
[…] sauf que je voudrais en être débarrassé3 » : la consistance du « je » se doit d’être mise
à mal, évacuée, au prix d’une refonte radicale des cadres du récit.
Ingérence de la voix narrative en objet regard et en objet voix
Les personnages de Blanchot, pour mieux préserver leur opacité, sont d’abord comme
réduits à deux données principales : le regard et la voix. Là réside presque uniquement
leur faire. Rien n’a plus cours dans l’univers du texte, si ce n’est les instruments censés le
guider lui-même, c’est-à-dire saisir et dire le monde. C’est presque toujours une parole
ou un regard, ou leur absence, qui déclenchent les sentiments ou pensées du personnage.
Dans chaque récit, les vrais actes sont des actes de langage. « Cette question parut la
bouleverser4 », affirme le narrateur de L’Arrêt de mort. C’est ainsi le locutoire en lui-
même qui porte une sorte de violence d’agir sur les êtres. Dès lors, les mots sont doués
d’une vie propre, marqués par une visible tendance à s’autonomiser, jusqu’à pouvoir être
vu : « ces paroles, je ne faisais plus effort pour les prendre : je les regardais5 ». Le dicible
se constitue en visible. Ainsi deux mouvements parallèles se jouent : le personnage
semble parfois être annexé au domaine du verbal, alors que le mot peut acquérir le statut
d’objet, voire de personnage à part entière : « Je me portai vers sa réponse […], ma
question resta suspendue entre nous et […] j’aurais aimé la soutenir, l’élever jusqu’à son
visage […]. Il eût fallu que je sorte vraiment de ma personne et, par ma vie, que je donne
2. Blanchot Maurice, L’Arrêt de mort, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 1977, p. 108.
3. Blanchot Maurice, Celui qui ne m’accompagnait pas, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire »,
1993, p. 8.
4. Blanchot Maurice, L’Arrêt de mort, op. cit., p. 122.
5. Ibid., p. 123.
112
Blanchot.indb 112 29/11/13 11:56
vie aux mots6. » Le personnage est dépris de soi au profit du mot. Un mot qui a une chair,
qui est une chair, qui est la chair de l’être.
Apparaît ainsi, dans l’écriture, une attraction presque cannibale pour son objet. Le
texte semble représenter une menace de dévoration du lecteur comme le souligne la
lecture pratiquée par Thomas qui « était, auprès de chaque signe, dans la situation où
se trouve le mâle quand la mante religieuse va le dévorer7 ». Plus exactement, chaque
mot devient « comme un œil demi-fermé », modifiant la position du voyeur qu’est le
lecteur, dont l’attention n’est dirigée vers l’objet-mot que pour lutter contre l’avale-
ment qui l’attend. Ainsi « les mots s’emparaient de lui et commençaient de le lire8 ». Le
personnage devient un texte alors que les mots deviennent des personnages. Dès lors,
l’acte de lire s’apparente à une cérémonie sacrificielle où le lecteur, qui accorde au lu
sa force sans commune mesure, ne peut le faire que dans un holocauste consenti : « il
entra avec son corps vivant dans les formes anonymes des mots, leur donnant sa subs-
tance, formant leurs rapports, offrant au mot être son être9 ». L’ingestion indique que
toute lecture est un arrachement à soi, que tout lecteur est une sorte d’auteur qui
réécrit le texte avec sa propre chair jusqu’à se dessaisir de lui-même et jusqu’à s’abo-
lir10. En effet, Thomas « se reconnut avec dégoût sous la forme du texte qu’il lisait ».
Processus spéculaire, entre texte et lecteur, qui, simulant une mise à mort, met à nu,
par l’écrit, celui qui lit.
Cette dévoration réciproque, entre le personnage et le texte, entre le lecteur et le texte,
ne tend pourtant pas vers un anéantissement absolu puisque, à travers elle, émerge deux
lambeaux métonymiques et pluriels du texte, du personnage et du narrateur : l’œil et la
voix. Objets du récit, ces morceaux en sont aussi les viatiques et les structures. C’est bien
pourquoi le processus du voir tend souvent à s’autonomiser :
Il ne voyait rien et, loin d’en être accablé, il faisait de cette absence de vision le point
culminant de son regard. Son œil, inutile pour voir, prenait des proportions extraordinaires
[…]. Par ce vide, c’était donc le regard et l’objet du regard qui se mêlaient. Non seulement
6. Ibid., p. 120.
7. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, Paris, Gallimard, 1950, p. 27.
8. Ibid., p. 28.
9. Ibid., p. 29.
10. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 254-261.
113
Blanchot.indb 113 29/11/13 11:56
cet œil qui ne voyait rien appréhendait quelque chose, mais il appréhendait la cause de sa
vision. Il voyait comme objet ce qui faisait qu’il ne voyait pas11.
De ce mélange, qui est aussi scission, entre ce qui est vu et l’instance qui voit, émerge
un regard potentiellement coupé de la vision, un « objet regard » à la manière dont
Lacan l’envisage. Le personnage, livré à un regard schizoïde, désigne en creux le processus
textuel, en faisant écho à un mode de narration qui s’affiche comme singulier, autant
que le processus de la lecture. Toujours à la recherche de lui-même, le récit effectue
d’incessantes plongées dans les entrailles de sa propre « parole » pour essayer de « voir »
ce qui s’y joue. La fascination du personnage pour l’œil indique alors clairement un
mécanisme qui lui est propre : le rêve de faire corps avec le texte. Thomas, devenu un
mot qui se dévore lui-même, redouble ainsi le désir toujours présent de donner chair à
un narrateur objectivé et viscéral, et donc à la voix narrative, dans une sorte d’anastomose
géante de l’œil et de la bouche. C’est le fantasme que relaye l’épisode du chat aveugle qui
voit Thomas. Le chat n’est caractérisé que par une voix limite, hors de toute appréhension
humaine, une « voix incompréhensible qui s’adressait à la nuit et parlait12 » : il singularise
dans le texte l’« objet voix » qui répond à l’« objet regard ». L’animal condense d’ailleurs
progressivement les deux supports textuels et les deux pulsions qui organisent le texte :
le regard et la voix. Pure voix qui le parle, le chat est aussi livré à une sorte d’indépendance
de sa tête qui « grandit sans cesse » et qui, « au lieu d’une tête, semble n’être qu’un
regard13 ». Le chat, qui est aussi un chat-voix et un chat-œil, est l’emblème même d’une
textualité monstrueuse et organique, guidée par une puissance incarnée des mots et de
la voix narrative qui se signale comme telle en faisant irruption dans le texte. Ce que
Blanchot refuse : le recel des instances du voir et du dire comme structures narratives
qu’opère traditionnellement le récit hétérodiégétique14. Par ce recours aux objets voix et
regard, qui place en abyme les instances focale et vocale, Blanchot s’oriente vers une
tentative de renouveler le narrateur classique.
11. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, op. cit., p. 17-18.
12. Ibid., p. 34.
13. Ibid., p. 37.
14. Voir à cet égard l’analyse qu’en fait Maurice Blanchot dans L’Entretien infini, Paris, Gallimard,
1969, p. 558-565.
114
Blanchot.indb 114 29/11/13 11:56
L’impossible « disparition élocutoire » de la voix narrative
La prose de Blanchot est ainsi une prose de l’arrachement, qui lutte contre les mots et
qui exhibe ses propres instruments, l’œil et la voix. Le rêve de supprimer tout organe
d’émission renvoie à la chimère que cultive la critique littéraire de Blanchot : celle de la
nudité du verbe, de son autonomie folle, à la manière dont l’œil et la bouche peuvent
être autonomes.
Blanchot semble dès lors avoir tenté d’épuiser toutes les possibilités de la voix narrative,
à partir de sa monstration initiale en objet. Alors que les premiers textes (Thomas
l’Obscur, Aminadab) se fondent sur une narration à la troisième personne, et la majorité
des autres sur un récit homodiégétique, c’est peut-être L’Attente l’oubli qui semble
représenter le point d’aboutissement de ces positions. L’écrivain semble revenir au « il »
du premier récit, dans un récit hétérodiégétique qui reste pourtant problématique. La
diégèse est presque entièrement absente. Le fragment et le dialogue l’emportent dans un
récit qui est comme parlé par des voix désincarnées.
L’entrée en lecture à l’incipit de L’Attente l’oubli indique avec force la nature para-
doxale de l’expérience de l’énonciation littéraire en posant une question : « “Qui parle ?”
disait-elle. “Qui parle donc ?” Elle avait le sentiment d’une erreur15 ». Cette interrogation
s’applique aussi à la voix narrative. Car la voix dont il est ici question est exhibée comme
le lieu d’une imposture, elle fait croire à un être qui n’est pas le bon. Cette erreur pre-
mière est une invitation pour le lecteur à ne pas accepter les apparences du texte et de sa
voix narrative. Le texte, en effet, se révélera double. Alors même qu’il ressemble à une
narration à la troisième personne, son énonciation se fissure à plusieurs endroits, lais-
sant sans cesse apercevoir des « je » problématiques : « Sans doute voulait-elle qu’il répé-
tât ce qu’elle avait dit, seulement le répéter. Mais jamais elle ne reconnaissait en mes
paroles les siennes. Est-ce que j’y changeais à mon insu quelque chose16 ? »
Au premier chef, tout porte à croire que la voix narrative impersonnelle laisse filtrer
celle de son personnage. Pourtant, semble ici s’esquisser une sorte de dédoublement entre
le personnage et le narrateur, ouvrant un espace incertain où leur conjonction pourrait
s’opérer. La « disparition élocutoire », ce rêve mallarméen, s’apparente donc à un leurre,
impossible à réaliser si, derrière chaque parole des personnages, se cache en effet le spectre
15. Blanchot Maurice, L’Attente l’oubli, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 2000, p. 7.
16. Ibid., p. 11.
115
Blanchot.indb 115 29/11/13 11:56
du narrateur, donnant l’« impression que quelqu’un parle “par-derrière”17 ». Cette pré-
sence oblique d’un narrateur autorise dès lors la suspension d’une instance exclusive à
même de se charger d’un dire flottant et autonome. En ce sens, les mots introducteurs du
récit, « Ici, et sur cette phrase qui lui était peut-être aussi destinée, il fut contraint de
s’arrêter18 », révèlent leur duplicité en ce que les déictiques renvoient autant à la phrase
écrite par le personnage qu’à celle lue par le lecteur et donc prononcée par un narrateur
encore absent dont on devine en creux la présence. De la sorte, l’attribution des paroles
au personnage ou au narrateur est souvent incertaine :
Quelqu’un en moi converse avec lui-même. Quelqu’un en moi converse avec
quelqu’un. Je ne les entends pas. Pourtant, sans moi qui les sépare et sans cette
séparation que je maintiens entre eux, ils ne s’entendraient pas19.
Au-delà d’une réflexion du protagoniste, ce fragment pourrait être attribué au narra-
teur, annonçant la figure d’un narrateur imprévisible qui, usurpant les attributs des per-
sonnages, avoue leur facticité. Les voix auxquelles le texte donne la parole se nouent en
une source commune qui déclare illusoire leur différenciation opérée dans le récit tradi-
tionnel. La « séparation » entre les énonciateurs, grâce au narrateur, déjà fortement
estompée dans le texte et pourtant maintenue peu ou prou, se dénonce comme une
nécessité narrative, peut-être plus pour que le lecteur les « entende » que pour que les
voix s’entendent entre elles. La voix narrative serait donc bien une voix vorace, rappelant,
d’une autre manière, celle de Thomas l’Obscur, et dont on ne se débarrasse pas si facile-
ment que cela. Alors même que les paroles des personnages se donnent pour autonomes,
elles ne peuvent finalement faire disparaître la substance propre qui compose chacun de
leur dire comme autant de morceaux reconnaissables issus de la voix narrative.
L’incertitude sur la voix vient alors renouveler la position du narrateur par rapport au
récit et au personnage. C’est pourquoi, au cours du premier dialogue où le narrateur
s’incarne dans son texte, rien ne vient lever l’ambiguïté des énonciateurs. Quelle voix
peut-on attribuer au narrateur et quelle voix au personnage ? Impossible de le décider,
d’autant que tous deux se posent des questions. Ces questions disent bien que, contre
toute attente, le narrateur adopterait ici la position d’un enquêteur qui interroge son
17. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 557.
18. Blanchot Maurice, L’Attente l’oubli, op. cit., p. 7.
19. Ibid., p. 35.
116
Blanchot.indb 116 29/11/13 11:56
propre personnage. Le narrateur est de la sorte autant aspiré au centre du texte que relégué
à l’extérieur du personnage. De ce fait, comme l’explique L’Entretien infini, la présence du
narrateur n’est « nullement un espace de domination » mais la « distance infinie qui fait
que se tenir dans le langage, c’est toujours déjà être au dehors20 ». Mettant fin aux rêves
balzaciens de totalité de savoir du narrateur omniscient, qui parle tous ses personnages, le
narrateur blanchotien les parle mais sans avoir de prise sur eux, il est l’organe de phonation
involontaire où l’on parle, l’instance relais de l’objet voix de Thomas l’Obscur.
Du « je » des personnages au « il »
Mais ce trouble énonciatif qui saisit la voix narrative ne se limite pas là puisqu’il s’étend
finalement aussi aux personnages. De la sorte, au cours de la dernière partie du vaste
dialogue entre le narrateur et l’homme, c’est l’homme lui-même qui finit par s’absenter
du discours puisque le narrateur se met à le désigner à la troisième personne alors qu’il lui
parle directement21. Cet infléchissement de l’énonciation, qui échange, sans l’abolir, le
« je » du personnage avec un « il », indique une fusion progressive du personnage dans la
voix du narrateur et révèle bien que la « séparation » entre les voix n’est qu’un artifice.
Bien plus, le discours des personnages lui aussi se désolidarise d’eux-mêmes, lorsque
leur « je » se désincarne, dans leurs propres paroles, en un « il » distancié et quasi
objectal : « Comment en sont-ils venus à se parler22 ? », demande l’un des deux per-
sonnages à l’autre, apparemment à propos d’eux-mêmes. Respectant pourtant les
conventions typographiques du discours direct, cet échange indique à la fois une dis-
tance à soi des personnages et la fragilité des codes du discours qui masquent mal leur
caractère contrefait. Les personnages ne parlent-ils pas alors d’autres personnages, de
tous les personnages des récits de Blanchot, n’ont-ils pas enfin rejoint ce qu’ils n’ont
cessé d’être qu’en apparence en respectant a minima les codes du récit, des projections
de la voix narrative ? Les personnages ne vivent plus leurs événements mais les
racontent, affichant ainsi qu’ils ont toujours été séparés d’eux-mêmes. L’un d’eux pré-
cise d’ailleurs : « C’est notre supériorité sur eux : comme si nous étions leur secret23 ».
20. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 557.
21. Blanchot Maurice, L’Attente l’oubli, op. cit., p. 97.
22. Ibid.
23. Ibid., p. 104.
117
Blanchot.indb 117 29/11/13 11:56
Hâlant le lecteur dans les coulisses obscures de la narration, les personnages ont ren-
contré leur essence au-delà d’eux-mêmes, ils sont devenus des sortes de narrateurs
supérieurs aux protagonistes englués dans le monde du récit car sans conscience de
leur origine. Et ce processus de mue débute symptomatiquement juste après la pre-
mière intrusion de la parole du narrateur, de son « je », dans le dialogue, c’est-à-dire
après le contact contaminant de sa voix avec celle de l’homme.
Dès lors, le texte s’oriente vers une fusion de toutes les voix, ne tranchant jamais pour
un mode d’énonciation ou pour un autre, toutes les voix parlant comme une seule :
« Qu’est-ce qui vous surprend dans ces mots ? Ils sont simples. » _ « Je crois que je
m’étais fait à l’idée que vous ne parleriez pas. Vous n’aviez encore rien dit jusqu’ici, et il
n’y avait rien à dire non plus. » _ « […] Qu’y a-t-il, dans cette voix, de plus inattendu
que dans tout ce qui est arrivé et dont vous avez si aisément tiré parti ? […] Et c’est à
cause de la voix ? Que lui reprochez-vous24 ? »
Le personnage, dans la dernière réplique, évoque l’étrangeté qu’il perçoit dans « cette
voix » et non dans « sa voix » : Blanchot refuse le possessif, car les voix n’appartiennent
jamais mais flottent, se déplacent, passent de l’une à l’autre des instances énonciatives.
C’est pourquoi il est possible de lire cette dernière phrase à plusieurs niveaux : comme
une interrogation du personnage, du narrateur ou encore comme une mise en abyme de
la position du lecteur, surpris de l’émergence problématique d’une voix indéfinissable et
confronté à la Méduse de l’objet voix. Ce vertige énonciatif fait de cette voix le support
d’une interrogation essentielle : quelle est cette voix autonome, ce monstre textuel qui
semble peu à peu se dégager de toutes les gangues ? Car il s’agit d’une voix « qui dit, avec
un peu de froideur : “Je voudrais vous parler25.” ». Mobilisant son propre « je », mais dans
une certaine distance évoquée par sa « froideur », la voix s’affranchit de toute tutelle et
clame son droit à l’indépendance.
C’est là que s’origine une tentative de niveler les voix : « Quand vos paroles seront au
même niveau que les miennes, quand les unes et les autres seront ainsi égales, elles ne
parleront plus26 », assure un personnage. Une égalisation déjà mise en œuvre dans le dia-
logue et le récit, où l’identification de l’homme, de la femme ou du narrateur est souvent
24. Ibid., p. 98.
25. Ibid., p. 99.
26. Ibid., p. 117.
118
Blanchot.indb 118 29/11/13 11:56
incertaine. Ainsi, Blanchot semble partir en quête d’une « parole égale, espacée sans
espace, […] ne disant pas quelque chose, parlant seulement, parlant sans vie, sans voix,
à voix plus basse que toute voix27 ». Une voix, présente dans sa propre absence, aurait
une certaine parenté avec cette « voix phénoménologique28 » qu’analyse Derrida. Le récit
chez Blanchot est parlé mais sans voix identifiable, il est un récit où la voix narrative
rassemble toutes les autres voix en un objet composite et tentaculaire.
Déviance vers l’« ob-je » : l’oubli du « je » et du « il », l’attente du « je-il »
À diverses échelles, il semble bien que la folie vocale dont fait montre L’Attente l’oubli
soit en partie la cristallisation d’une tendance marquée dans l’ensemble des textes
blanchotiens, même dans ceux écrits à la première personne.
Dans La Folie du jour, le personnage semble finalement incapable de répondre à la
« demande de récit29 » dont parle Derrida et que formulent les docteurs de la loi. Il avoue
son impuissance à s’attacher à une intrigue, à fournir des événements pris en charge par les
codes de la diégèse : « Je dus reconnaître que je n’étais pas capable de former un récit avec ses
événements. J’avais perdu le sens de l’histoire […]. Un récit ? Non, pas de récit, plus jamais30. »
De même, chacune des deux parties de L’Arrêt de mort se conclut sur une sorte de
constat d’impuissance par rapport au récit :
Il faut que ceci soit entendu : je n’ai rien raconté d’extraordinaire ni même de sur-
prenant. L’extraordinaire commence au moment où je m’arrête. Mais je ne suis plus
maître d’en parler31.
Qui peut dire : ceci est arrivé, parce que les événements l’ont permis ? Ceci s’est passé,
parce que, à un certain moment, les faits sont devenus trompeurs et, par leur agencement
étrange, ont autorisé la vérité à s’emparer d’eux ? Moi-même, je n’ai pas été le messager
malheureux d’une pensée plus forte que moi, ni son jouet, ni sa victime, car cette pensée,
si elle m’a vaincu, n’a vaincu que moi […]32.
27. Ibid., p. 116-117.
28. Derrida Jacques, La Voix et le phénomène, Paris, PUF, Quadrige, 1998, p. 15.
29. Derrida Jacques, Parages, Paris, Galilée, 1986-2003, p. 121.
30. Blanchot Maurice, La Folie du jour, Paris, Gallimard, 2002, p. 29-30.
31. Blanchot Maurice, L’Arrêt de mort, op. cit., p. 53.
32. Ibid., p. 127.
119
Blanchot.indb 119 29/11/13 11:56
Dans les deux cas, le récit échappe au « je » et à son contrôle, comme ne débutant
que lorsque le « je » se tait. Le récit conduit par le « je » avoue donc ses failles et ses
limites. Pas plus qu’un autre, il n’est apte à produire un récit traditionnel et à se couler
dans ses codes. Le « je » n’est pas en mesure d’être le garant du récit. Car il est toujours
un simulacre à refuser. Même dans La Folie du jour, avec un « je » pourtant central
comme dans tout monologue, le narrateur constate à propos de ces interrogateurs :
« Nous étions tous comme des chasseurs masqués. Qui était interrogé ? Qui répon-
dait ? L’un devenait l’autre. Les mots parlaient seuls33. » Le « je » chez Blanchot ne
cache pas son impersonnalité, sa proximité avec ceux qui ne parlent pas, dessaisi de ses
pouvoirs par une parole affranchie.
À rebours, dans les deux récits hétérodiégétiques que sont Thomas l’Obscur et Amina-
dab, le narrateur est apparemment le grand absent. Pourtant, la focalisation externe éta-
blit sa subjectivité. La voix narrative surjoue son rôle de régie, en exhibant les marques
de sa présence. Elle encombre la page de la moindre nuance, à travers de nombreuses
modalisations (sans doute, peut-être…), alors même que ce narrateur-personnage, dans
les récits homodiégétiques, reste presque insituable, ou tout au moins étrangement éloi-
gné, comme les autres personnages. Ces narrateurs très dissemblables, ce « je » et ce
« il », semblent ainsi avoir des similitudes dans leur présence-absence. Le « je » ne serait
pas si différent que cela du « il ». Et ce à cause du lien qui s’effectue entre le signifiant
pronominal « je » et le domaine référentiel du « il ». Les catégories de Benveniste se
pénètrent : le discours chez Blanchot, avec son « je », tend à déplier une subjectivité
devenue distante qui s’annexe les propriétés d’une « non-personne34 ». C’est là toute la
difficile quête de Celui qui ne m’accompagnait pas qui s’énonce dans la première
phrase du texte : « Je cherchais, cette fois, à l’aborder35 ». Comment le « je » peut-il
« aborder » le « il » ? Comment se débarrasser du « je » dans le « il » ? Car ce « je » qui
parle devant un autre cultive le fantasme irréalisé d’« être à bout », c’est-à-dire au bout
de lui, du « je », comme au bord de l’autre, du « il » :
Mais un jour je m’aperçus que ce que j’écrivais le concernait toujours davantage et,
quoique de manière indirecte, semblait n’avoir d’autre but que de le refléter. […] J’y
voyais ce qui pouvait me paralyser le plus […] parce que j’allais peut-être au contraire
33. Blanchot Maurice, La Folie du jour, op. cit., p. 28.
34. Benveniste Émile, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, p. 254.
35. Blanchot Maurice, Celui qui ne m’accompagnait pas, op. cit., p. 7. Nous soulignons.
120
Blanchot.indb 120 29/11/13 11:56
faire de plus grands efforts pour le rendre manifeste. C’est alors que je me raccrochais
à moi-même. […] J’espérais que la nécessité de dire « Je » me permettrait de mieux
maîtriser mes rapports avec ce reflet36.
Le « je » est bien conçu comme un reflet du « il ». L’écriture du « je » est hantée par le
« il », elle devient autant une zone d’abord qu’une propédeutique pour lui résister, l’éva-
cuer et maintenir un « je » définitivement contesté par la présence fascinante du « il »
qui l’attire et risque sans cesse de l’annuler. L’ensemble du récit joue sur ce bord, cherche
à franchir ce « pas au-delà » du « je » comme du « il », qui est aussi un « pas-je » et un
« pas-il », articulant le nom et son mouvement, à l’adverbe et sa négation comme le
suggérait Derrida dans un autre contexte37. Chaque pronom accompagne l’autre dans
son propre retrait.
Cette absence-présence du « je » a ainsi toujours d’étranges similitudes avec le statut
du personnage. Inconsistant, presque immatériel, ce dernier est pourtant hautement
présent et, puisque son action tend à se raréfier, c’est bien sa pensée qui forme
l’épicentre du texte. De même, le narrateur, désincarné, est en même temps une
instance encombrante dont le vocal a trait à l’organique et qui est une autre facette de
l’objet voix. La déviance qui s’organise se veut révélation d’un « je-il » toujours masqué
dans le récit traditionnel, et dont L’Attente l’oubli, témoigne. L’écrivain, dépossédé du
« je », comme le suggère L’Espace littéraire, ne perd donc pas grammaticalement « le
pouvoir de dire “Je38” ». Il perd le référent singulier du pronom, l’encombrant ego.
Écrire pour Blanchot consisterait à passer d’un « il » conçu comme l’oripeau grossier
d’un « je », d’un « il » non antinomique de l’égographie, de cet « “ego” manifeste sous
le voile d’un “il” d’apparence39 », au « je-il », forme nouvelle d’un « je » grammatical
ayant pour référent un « ob-je ». C’est-à-dire un « je » comme non-personne, un « je »
absenté par les forces du « il » mais qui conserve sa singularité. Le « je-il », dont la
présence se réalise par l’absence conjointe du « je » et du « il », serait ainsi l’inscription
énonciative et littéraire singulière du neutre que la pensée de Blanchot théorise. La
trajectoire de l’auteur Blanchot, du « il » au « je », en apparence contradictoire avec le
trajet souligné par le critique, est de ce fait le parfait inverse du parcours de Proust par
36. Ibid., p. 10. Nous soulignons.
37. Derrida Jacques, Parages, op. cit., p. 46-47.
38. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 21.
39. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 559.
121
Blanchot.indb 121 29/11/13 11:56
exemple, abandonnant le « il » de Jean Santeuil pour laisser triompher le « je » de La
Recherche40, dans un « il » premier qui n’était que le voile d’un ego. C’est pourquoi,
après la dévoration dont la lecture est l’opérateur auprès de Thomas, celui-ci parvient
à une sorte de révélation : « en sa personne déjà privée de sens, tandis que, juchés sur
ses épaules, le mot Il et le mot Je commençaient leur carnage, demeuraient des paroles
obscures, âmes désincarnées et anges des mots, qui profondément l’exploraient41 ».
Les pronoms se heurtent avec violence, ils sont le lieu d’une dilacération de la chair du
personnage et non pas d’un affermissement du sujet et de l’ego. Dans ce combat à
mort des pronoms, dans cette sorte de théomachie et de théogonie pronominales, qui
est une lutte contre l’ego, ce sont les « âmes désincarnées » des mots qui émergent,
c’est-à-dire une parole épurée du « moi » et affranchie.
De la sorte, lorsque le récit de L’Attente l’oubli s’achève, il rebondit étrangement en une
section finale42, sous la forme d’une brève relance en italiques qui est le lieu d’un dia-
logue extrêmement singulier, faisant alterner la parole d’un personnage, mais sans guil-
lemets, et, des fragments de narration à la troisième personne qui eux sont entre
guillemets. Le discours et le récit ont échangé leur place. On ne sait plus ce qui est récit
et ce qui est discours. Pourtant, Genette soulignait bien que tout discours pouvait, sans
se modifier, intégrer des fragments de récit alors que le récit, dès le discours pointe en lui,
s’annule et s’annexe au discours43. C’est pourquoi la clausule de L’Attente l’oubli souligne
un élément essentiel : le récit, conçu selon les catégories de Benveniste, a finalement été
ingéré par le discours. Là réside la véritable tendance cannibale du texte sur lui-même.
Le récit chez Blanchot n’existe pas en lui-même, parce qu’il est toujours parlé par une
voix, même masquée. Il est donc toujours discours. Le récit, en tant que narration, est
finalement dit plus qu’écrit, il ne résulte pas d’un « il » factice, mais, comme le reste, est
tout entier issu de la voix narrative. Le texte serait donc toujours parlé, soumis à l’ingé-
rence d’une voix, apparenté peu ou prou à une forme de monologue dissimulé, mais
non pas lié à un ego, mais à un « je » dépris de lui-même et empreint des scories du « il »,
comme La Folie du jour l’annonce clairement avec ce « je » singulier et partiellement
dépersonnalisé. Blanchot déleste ainsi le récit traditionnel de ses alibis et mensonges de
40. Voir à ce sujet Genette Gérard, Figures III, Paris, Seuil, « Poétique », 1972, p. 256-257.
41. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, op. cit., p. 29.
42. Blanchot Maurice, L’Attente l’oubli, op. cit., p. 121-122.
43. Genette Gérard, Figures II, Paris, Édition du Seuil, « Points/Essais », 1969, p. 61-69.
122
Blanchot.indb 122 29/11/13 11:56
surface, de ses dérivations lyriques ou illusionnistes, il corrode la pellicule qui sépare les
voix pour un récit hypostase du « je-il ».
Je ou comment s’en débarrasser. Voilà donc bien l’inesquivable même chez Blanchot.
Et, dans cette quête somme toute inachevable44, il ne s’agit pas d’évincer le « je » comme
pronom mais bien comme ego. Car le renouveau du narrateur n’est pas mis à mort de sa
présence mais de sa référence à un sujet, de son « cogito » pourrait-on dire. Son cadavre,
comme celui d’Amédée, ne cesse de grossir et d’encombrer les textes. Partout s’inscrit en
effet, non la conscience d’un narrateur, mais une instance focale et vocale, réalisée par
exemple en objet voix inquiétant dans Thomas l’Obscur ou en spectre d’un « je », devenu
« je-il » dans L’Attente l’oubli. La poétique du récit propre à Blanchot se veut donc une
poétique de la voix, une écriture récitée plus qu’oralisée, où la quête des mots passe par
une remise en cause du statut du narrateur qui, toujours présent à l’état latent, s’affiche
comme l’origine dépersonnalisée, l’organe phonatoire désincarné, d’une voix à l’état nu.
Thomas l’Obscur, en prolongeant visiblement la poétique du récit de Kafka comme
l’analyse L’Entretien infini45. La Folie du jour explore de son côté un « je » moins hysté-
rique et moins personnel que ne le sont ceux de Beckett et de Des Forêts, se chevillant
autour d’une faillite et d’un aveu d’impuissance du « je » devant le récit diégétique et
devant une consistance individuelle. Refusant ainsi autant le « roman parlant46 » à la
Queneau, Céline ou Ramuz que la logorrhée monologale de Dostoïevski, Beckett ou Des
Forêts, le texte blanchotien part en quête d’une nouvelle conception du récit et de la voix
narrative. L’inscription du narrateur au creux des récits à la troisième personne, et sa
désincarnation dans les récits à la première personne, semblent se conjoindre dans une
visée unique : l’évacuation d’une instance personnelle prenant en charge la voix, ins-
tance qui s’apparenterait à une amarre opérant une compromission de l’évanescent et de
l’insaisissable avec le monde de la psychologie, des individus, du sens et du concret.
44. Le « je », après L’Attente l’oubli, ne disparaît pas définitivement puisqu’il revient dans la voix
narrative du récit de L’Instant de ma mort.
45. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 563-565.
46. Meizoz Jérôme, L’Âge du roman parlant, Genève, Droz, 2001.
Blanchot.indb 123 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 124 29/11/13 11:56
Espace narratif,
espace
fragmentaire
Blanchot.indb 125 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 126 29/11/13 11:56
L’imaginaire au singulier : l’image de l’escalier
dans l’œuvre fictionnelle de Blanchot
Arthur Cools
L
e crime, ou la faute, est partout. Le lecteur se rappelle sans doute le film de
Hitchkock, Vertigo. La tension psychologique et le nœud du récit se construisent
à partir d’une scène au cœur de laquelle se trouve un escalier – l’escalier d’un
clocher où va se produire l’événement d’une chute mortelle. L’importance de cette
structure spatiale se signale dès l’ouverture du film par un générique où un escalier, en
forme de spirale, s’ouvre dans l’œil d’une femme, attirant le regard de la caméra dans un
vertige abyssal. L’escalier et le mouvement qu’il produit se présentent comme un leitmo-
tiv de tout le film. Sans celui-ci et le vertige qu’il suscite chez le personnage principal, le
drame ne se déroulerait pas. L’escalier n’y fonctionne pas seulement comme un élément
du décor devant lequel se produit l’événement, il est bien davantage la figure concrète de
l’espace qui produit l’événement et même en détermine le sens.
C’est dans une perspective similaire que je voudrais examiner l’image de l’escalier dans
les romans et les récits de Blanchot. Quoi de plus banal dans un récit qu’un escalier ? Quoi
de plus indifférent pour la construction d’un espace imaginaire qu’une telle coupure
spatiale ? Il n’y a certes guère de récit dans les temps modernes qui ne fait pas mention
127
Blanchot.indb 127 29/11/13 11:56
d’un escalier pour décrire le lieu d’une action quelconque ou de l’intrigue qui se
déroulerait par la suite indépendamment de cette description, tel le souvenir involontaire
de Swann qui lui vient sur les marches du baptistère de Saint-Marc. Dans le cas de
Blanchot, il me semble que ce rapport est un peu différent. La notion d’espace est au
cœur de son approche de la littérature. On dit communément qu’il a transformé le récit
au point de faire apparaître l’espace imaginaire qui le conditionne. Pourtant, dès qu’il
s’agit de savoir comment cette transformation s’est réalisée, ou bien, comment cet espace
se concrétise dans le monde fictionnel de ses romans et récits, la notion d’espace reste en
suspens. Au lieu de donner une analyse descriptive de la construction spatiale, on qualifie
d’emblée cet espace en termes mallarméens de désorienté, dispersé ou neutre. Et
pourtant, la figuration de l’espace joue un rôle fondamental dans les romans et les récits
de Blanchot. Il ne s’agit jamais seulement d’un emplacement de l’action, mais aussi de
l’expression de l’imaginaire. L’escalier comme la vitre, le couloir ou la rue ne sont pas
seulement des instruments descriptifs d’un espace donné où a lieu l’action, mais ils sont
liés à l’avènement du récit de telle sorte qu’ils contribuent aussi à éveiller le sens même
de l’événement raconté.
Le but de cet article est de montrer à partir des scènes dans les romans et les récits
comment l’escalier, comme figuration de l’espace, reflète et conditionne aussi l’imagi-
naire tel que Blanchot nous invite à l’entendre1. Dans une telle optique, l’escalier ne
désigne pas seulement un lieu – lieu commun sans doute – qui localise l’événement
raconté, mais il fonctionne aussi comme une image-clé, pour ainsi dire « dernière »,
jetant une certaine lumière sur la singularité de cet événement. L’enjeu est donc double.
D’une part, il s’agit de rapporter l’événement du récit à une condition, une figuration de
l’espace qui le singularise. D’autre part, il s’agit d’éveiller dans cette condition une valeur
transcendantale dans le sens philosophique du terme, condition qui détermine les traits
distinctifs de l’événement du récit.
À cet effet, je voudrais tout d’abord entendre l’espace ouvert par l’escalier en termes
d’événement – approche phénoménologique pour laquelle je me laisse inspirer par une
analyse de l’espace comme événement par Jean-Luc Marion. Pour pouvoir transposer
cette analyse à l’enjeu qui nous concerne, il faut toutefois saisir d’abord les caractéristiques
1. Pour une approche de cette notion de l’imaginaire, nous renvoyons à titre d’exemple à Blan-
chot Maurice, « La rencontre de l’imaginaire », dans Le Livre à venir, Paris, Gallimard, « Folio/
Essais », 1959, p. 9-37.
128
Blanchot.indb 128 29/11/13 11:56
essentielles de la construction de l’espace telle qu’elles sont données par la coupure
spatiale de l’escalier, avant d’expliciter l’événement qui s’organise autour de lui dans les
romans et les récits de Blanchot. Enfin, dans une dernière partie, j’essaierai de préciser
comment l’image de l’escalier touche au cœur même de l’approche blanchotienne de
l’imaginaire, de son entente et de sa transformation.
L’escalier comme construction de l’espace
Dans le deuxième chapitre de De Surcroît, « L’événement ou le phénomène advenant »,
Jean-Luc Marion donne un exemple de l’analyse qui nous concerne2. Il s’agit de la salle
de conférence, « la Salle des Actes », où il présente sa communication et qu’il décrit non
pas comme un objet, mais telle qu’elle apparaît sur le mode de l’événement. Par là, il
donne à savoir qu’il ne suffit pas de considérer l’espace comme un objet pour en décrire
sa phénoménalité. Celle-ci présuppose toujours l’événement de la donation par laquelle
un phénomène se montre, et selon Marion, ce sont les phénomènes du type de l’événe-
ment qui gardent la trace de leur donation. Or, fait-il sens de décrire l’espace en termes
d’événement ? Et comment le fait-il ?
Ce n’est pas une description de la disponibilité objective de la salle (ou de ses traits
empiriques) qu’il donne, mais de sa permanence qu’il appelle « en attente », signalant par
là que le sens de la phénoménalité de la salle se définit en rapport avec l’expérience, le
vécu de celui qui s’y installe. Dès lors, de la « Salle des Actes », Marion donne une descrip-
tion selon les trois axes du temps : le passé (c’est-à-dire le déjà là de sa facticité), le présent
(le moment actuel de l’événement tel qu’il est en train de s’accomplir : unique et non
répétable) et le futur (le « sans fin » de l’herméneutique de ce qui se passe à partir de cette
salle). Ce qui permet alors de parler de l’espace en termes d’événement, c’est que le sens
de sa phénoménalité déborde sans cesse son apparition strictement objective. La tentative
de retrouver ce sens et de l’articuler implique donc de réinscrire l’objectivité empirique
de l’espace de la « Salle des Actes » dans l’événement par lequel celui-ci advient.
Cette approche de Marion peut sans doute être considérée comme exemplaire pour
le but que nous nous sommes posé. Néanmoins, deux remarquent sont à faire ici qui
décideront des choix à prendre pour l’analyse ultérieure. D’abord, dans la description
2. Marion Jean-Luc, De Surcroît. Étude sur les phénomènes saturés, Paris, PUF, « Perspectives
critiques », 2001, p. 35-62.
129
Blanchot.indb 129 29/11/13 11:56
donnée de la « Salles des Actes », le présent de l’événement qui se produit dans cet
espace (la conférence où il prend la parole) prime sur le phénomène de la salle en tant
qu’événement de l’espace. Sans doute y a-t-il un rapport entre l’un et l’autre, mais ce
rapport n’est pas thématisé par Marion. En plus, dans son approche de la salle comme
phénomène advenant, Marion réduit la phénoménalité de l’espace à la triple temporalité
de l’événement. Cette réduction me paraît toutefois éliminer deux autres dimensions
impliquées dans la phénoménalité de l’espace, mais irréductibles à l’un des trois axes
temporels : l’imaginaire d’une part et la spatialisation de l’autre.
Par la première dimension, j’entends ceci. Le sens d’un espace se compose aussi par
tout ce qu’il évoque, par toutes les projections imaginaires qu’il suscite. Tout d’abord, les
événements du passé contribuent à cet imaginaire : on n’entre pas de la même façon
dans la chambre où un parent vient de mourir. Mais les événements évoqués par la fonc-
tion de la salle ont un même effet : ainsi dit-on par exemple que la salle des thèses suscite
à chaque fois un sentiment de terreur chez les nouveaux doctorants. En outre, l’imagi-
naire se construit aussi à partir des coordonnées spatiales, par la localisation (par
exemple : la « Salle des Actes » se trouve au centre de la ville de Paris, elle fait partie du
bâtiment qui a une fonction académique, etc.), mais aussi par une ambiance spatiale :
une salle en haut du bâtiment avec une vue panoramique sur la ville a une tout autre
ambiance qu’une salle en bas, fermée par quatre murs sans ouverture vers le dehors.
Ce dernier aspect renvoie déjà à ce que j’entends par l’autre dimension irréductible
aux axes temporels, la spatialisation. Chaque expérience concrète de l’espace présuppose
des déterminations spatiales implicites que l’analyse peut progressivement expliciter. Je
pense concrètement à des oppositions telles que : en deçà/au-delà, horizontal/vertical,
haut/bas, plein/vide, ouverture/fermeture, orienté/désorientant, droit/courbe, etc. Il me
paraît que ces éléments sont constitutifs de la phénoménalité de l’espace, dans le sens
justement où Marion parle de la donation : ils sont ce à partir de quoi l’espace se montre
tel qu’il est, et de cette façon, ils débordent dans une large mesure la visibilité de l’espace.
L’analyse qui les rend explicite, cherche en fait à définir les caractéristiques essentielles
d’un espace donné par des moyens strictement spatiaux et contribue de la sorte à une
approche de l’espace en termes d’événement sans pour autant se limiter à un des trois
axes de la temporalité. Je vais ébaucher une telle analyse de la construction spatiale de
l’escalier avant d’examiner comment il apparaît dans le monde imaginaire des romans
et des récits de Blanchot.
130
Blanchot.indb 130 29/11/13 11:56
Comment décrire la construction spatiale réalisée par l’escalier ? L’escalier n’est pas
l’emplacement de l’espace : il présuppose déjà une certaine dimension spatiale sans
laquelle il ne pourrait s’installer. Quel est cet espace qu’il présuppose ? On peut le décrire,
il me semble, en quelques-uns de ces couples d’opposition que nous venons de mention-
ner. Un escalier, même s’il ne mène nulle part, n’existe pas dans le vide. Il repose sur un
sol et il se démarque justement par rapport à ce sol sur lequel il s’élève. Ce sol est une
première dimension spatiale qui se définit par la surface : une étendue délimitée par la
ligne horizontale. Le principe le plus élémentaire pour créer une distinction spatiale,
– les peintres le savent très bien – c’est une horizontale. Celle-ci marque une frontière,
coupant par là l’indistinct en un espace divisé : un en deçà et un au-delà. Il n’est pas
nécessaire de supposer déjà une hauteur dans cette distinction : l’en deçà tel qu’il se
donne par la ligne élémentaire suscite la dimension d’un jusque-là (d’une limitation),
l’au-delà en revanche une dimension d’un lointain inaccessible (d’un illimité). La déli-
mitation de la surface par un en deçà se caractérise en outre par une fixité, une perma-
nence des rapports entre l’avant et l’arrière et elle donne ainsi à la surface une impression
de stabilité sur laquelle la construction de l’escalier peut se reposer, s’ériger.
L’escalier accuse aussi une ligne verticale. La dimension de hauteur fait partie de son
essence spatiale. Cette dimension n’est pourtant pas un trait spécifique de l’escalier : elle
est réalisée dès qu’il y a un mur, un rempart, un amoncellement du matériau suffisam-
ment résistant pour se laisser ériger sur la ligne horizontale. Un mur divise l’espace en
un dedans et un dehors et en un haut et un bas. Il permet la construction d’un toit, d’un
étage supérieur, donnant appui à ce qui réalise une couverture. Il transforme ainsi la
surface en un enclos et ajoute à la délimitation de l’espace réalisée par la ligne horizon-
tale une dimension de fermeture et des qualités impliquées par celle-ci : défense contre
l’extérieur, protection de l’intérieur, intériorité, etc. Ce qui se trouve en deçà devient par
l’érection d’un rempart protégé, mis à l’abri ; ce qui se trouve au-delà doit du coup rester
dehors, exposé à l’illimité.
L’escalier présuppose cet espace qui se laisse articuler par l’horizontale et la verti-
cale, l’en deçà et l’au-delà, le limité et l’illimité, le haut et le bas, l’intérieur et l’exté-
rieur, la surface et l’enclos. Cependant, la construction de l’espace qu’il réalise ne se
réduit pas à la somme de ces coordonnées ou à la fonction de réaliser leur cohésion.
Bien au contraire, il ouvre à une nouvelle dimension de l’espace. Son trait spécifique
peut être défini comme un principe de changement, de transformation de l’espace.
131
Blanchot.indb 131 29/11/13 11:56
Ce qu’il ajoute aux déterminations déjà données, c’est qu’il implique un mouvement,
mouvement tout corporel qui met en cause la stabilité et la fixité des coordonnées
spatiales : monter, descendre – se mouvoir non pas dans une ligne droite, mais en
direction de ce qui est plus haut ou plus bas, et non pas par un mouvement continu,
mais en grimpant les marches – voilà le mouvement corporel à travers l’espace déjà
donné que seul l’escalier rend possible. Une telle transformation peut être entendue de
différentes façons. Tout d’abord, et de façon la plus simple, l’escalier donne accès à un
autre endroit. Changement de l’espace signifie alors passer d’un endroit à l’autre. Mais
un tel changement est déjà opérant par le mouvement d’escalader les marches. Avec
chaque pas change également la perspective de l’espace et il faut sans cesse ajuster les
distances mouvantes entre haut et bas, en deçà et au-delà, intérieur et extérieur. Enfin,
arrivé à son terme, ces rapports sont renversés : ce qui était constitué comme là-haut,
devient à présent l’endroit qui fixe ce qui est en bas, ce qui était considéré comme au-
delà devient l’endroit où se donne l’en deçà. La construction de l’espace par l’escalier
peut donc être décrite en termes de transformation d’espace à partir d’une ligne hori-
zontale (la stabilité) et une ligne verticale (la hauteur) déjà données.
L’escalier et l’imaginaire dans les romans et les récits de Blanchot
Étant donnée cette analyse concise de la construction spatiale de l’escalier, demandons-
nous à présent comment l’imaginaire est évoqué à partir de ces déterminations explicitées
dans les romans et les récits de Blanchot. C’est-à-dire, quels événements sont relatés à
l’expérience spatiale de l’escalier ? Je signale quatre traits récurrents qui sont décisifs pour
déterminer le sens de l’apparition de l’escalier dans l’œuvre fictionnelle de Blanchot.
Il y a d’abord – on s’en doute – l’événement le plus ordinaire qui se produit dans
l’espace ouvert par l’escalier : le mouvement corporel de monter et de descendre. Les
personnages montent et descendent des escaliers comme s’il s’agissait de l’événement le
plus anodin, inutile presque de raconter. Que dire davantage ? À première vue, ni ce
mouvement ni la présence matérielle de l’escalier ne semblent recevoir une attention
particulière, sauf peut-être ceci que l’espace où est en train de se réaliser le mouvement
apparaît tantôt en rapport avec un autre escalier, tantôt en rapport avec une partie
minimale de l’escalier : une marche. Dans ces deux sens-ci, l’expérience de l’escalier ne
se limite pas seulement à créer un passage d’un lieu à un autre (de la chambre à la rue
dans l’immeuble où habite Henri Sorge dans Le Très-Haut, d’un étage à un autre dans
132
Blanchot.indb 132 29/11/13 11:56
l’immeuble dont parle Aminadab), mais elle se rapporte aussi à l’expérience d’une
répétition dans le premier cas (la découverte d’un autre escalier dans Aminadab et dans
la maison familiale du Très-Haut), et dans le deuxième cas à l’expérience d’un seuil (le
gardien avec son pied sur la marche au début d’Aminadab). Comme si la transformation
de l’espace réalisée par l’escalier ne se prolongeait pas dans un changement de perspective
du mouvement corporel, clouant celui-ci au même endroit (un autre escalier, un
trébuchement). Laissons ici cette première description de la spatialisation de l’escalier :
il faut y revenir à la fin de cet examen.
Plus surprenante, toutefois, c’est l’apparition du féminin dans l’espace ouvert par
l’escalier. Sans doute cet espace, créant une communication entre divers endroits,
favorise-t-il les rencontres et a-t-il pour cette raison une dimension sociale autre que
celle de la salle d’accueil ou de la chambre privée. La dimension sociale telle qu’elle est
liée à cet espace reste en rapport avec le mouvement de monter et de descendre et donne
lieu à des rencontres furtives, passagères. Dans les descriptions que l’on trouve de cet
espace dans les romans et les récits de Blanchot domine clairement la présence des
personnages féminins. La présence masculine n’est certes pas absente, mais elle est
plutôt liée à la fonction de gardien, de propriétaire ou de l’habitant de l’immeuble en
tant que tel et moins à l’événement qui se produit à partir de l’escalier. L’homme plutôt
cache ou obstrue l’ouverture de l’escalier3, tandis que le personnage féminin entraîne
vers cet espace. Ce rapport entre l’escalier et l’apparition du féminin, on le constate déjà
dès le premier récit de Blanchot, « Le dernier mot », où le personnage principal entraîne
une jeune femme dans le tour du Tout-Puissant où ils montent tous deux « l’escalier qui
semblait occuper toute la largeur de l’édifice4. » Ce rapport revient à plusieurs reprises,
mais sera développé de différentes façons dans d’autres récits. Dans Thomas l’Obscur,
« une jeune fille », qui est dans un rapport de servante à l’égard de l’hôtelier, « monta
l’escalier » montrant à l’étranger qui vient d’arriver à l’auberge sa chambre. Un peu
après, une autre jeune fille, « habitant l’auberge, du nom d’Anne », va également
« avancer vers les premières marches de l’escalier » et monter pour rejoindre l’étranger5.
3. Voir Blanchot Maurice, Aminadab, Paris, Gallimard, 1942, p. 55 : « L’escalier était à demi
caché par l’homme qui se tenait juste devant la porte et qui ne semblait pas avoir l’intention de
s’écarter. »
4. Blanchot Maurice, Après coup, précédé par Le Ressassement éternel, Paris, Les Éditions de
Minuit, 1983, p. 74.
5. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, Paris, Gallimard, 1941, p. 27-29.
133
Blanchot.indb 133 29/11/13 11:56
Dans Aminadab, c’est le « petit signe » donné par « la jeune fille » à la fenêtre qui fait
entrer Thomas dans la maison pour monter l’escalier6. Ce rapport entre la présence
d’une jeune fille, une apparente invitation, l’escalier et le mouvement de monter se
répète et se concrétise dans la figure de la sœur du personnage principal au cœur du
récit dans Le Très-Haut :
Un matin, avant que personne ne fût levé, Louise descendit dans ma chambre. Elle
portait une robe rouge, étrange rouge, sombre et violent. Marchant à deux pas devant
moi, elle me fit traverser la salle, puis une autre, plus grande, et entrer dans le vesti-
bule. Je la suivais, regardant ce rouge si étrange. Dans le vestibule, elle me poussa vers
l’escalier et nous montâmes silencieusement. […] Je l’entendis chuchoter : « Viens. »
Elle ouvrit la porte. Je la voyais déjà sur l’escalier, tournant vers moi sa robe rouge et
m’attendant. « Viens, dit-elle, viens vite. »7
Ces exemples ne sont certes pas exhaustifs, mais ils suffisent pour resituer toute l’adresse
de l’invitation (« viens »), dont le lecteur se rappelle sans doute la portée événementielle
dans les commentaires de Jacques Derrida8, dans l’espace de l’escalier. Il en résulte une
troisième caractéristique de l’événement qui se produit en rapport avec l’escalier dans le
monde fictionnel de Blanchot, mais qui n’est pas toujours liée à la présence du person-
nage féminin. L’escalier et le mouvement qu’il implique se présentent aussi dans un rap-
port de recherche et de désir. Dans « L’Idylle », dans sa tentative de fuir, c’est « pour
découvrir une nouvelle issue » qu’il faut à Akim « monter les escaliers et s’enfoncer à
travers des constructions dont on ne savait si elles conduiraient jamais au-dehors9. » Dans
« Le dernier mot », le personnage principal entre dans la tour et se dirige vers le sommet
afin de rejoindre la hauteur et de rechercher l’autorité du propriétaire de la tour, celui qui
est appelé « le Tout-Puissant10. » De même, dans Aminadab, Thomas entre dans la maison
et se lance sur les marches de l’escalier vers le troisième étage pour retrouver la jeune fille
qui lui avait fait signe et dans sa recherche consécutive de sonder le secret de la maison il
lui faudra monter plusieurs autres. L’invitation de la sœur à monter l’escalier dans la
scène du Très-Haut que nous venons de citer dans l’alinéa précédent établit un rapport
6. Blanchot Maurice, Aminadab, op. cit., p. 9.
7. Blanchot Maurice, Le Très-Haut, Paris, Gallimard, 1948, p. 55-58.
8. Derrida Jacques, Parages, Paris, Galilée, 1986, p. 21-116.
9. Blanchot Maurice, Après coup, op. cit., p. 51.
10. Ibid., p. 79.
134
Blanchot.indb 134 29/11/13 11:56
de désir auprès du narrateur auquel il ne peut pas se dérober, mais qui est à la fois sans
issue11. Dans Le Moment voulu, l’instant appelé « pour l’un et pour l’autre […] le
moment voulu », se rapporte à la scène qui se déroule dans l’espace de l’escalier :
[…] j’ouvrais alors la porte et regardais vers le bas de l’escalier […]. En cet instant, à
travers l’immense étendue, elle me donnait l’impression d’être assise, elle aussi, en bas
de l’escalier, sur la large marche du tournant12 […].
Enfin, dernière caractéristique, l’espace de l’escalier apparaît lié à l’événement d’un
effondrement. À la fin du premier récit, « Le dernier mot », « c’est l’escalier qui s’ef-
fondre, […] le sol nous manque13 » : la tour s’écroule faisant précipiter au dehors la fille,
le propriétaire et le narrateur. Dans Aminadab, ceux qui cherchent à fuir l’immeuble par
le sous-sol doivent passer par un escalier « vermoulu14 ». L’écroulement de l’escalier y
devient une appréhension imaginaire : « Parfois, à force de crainte, nous nous imagi-
nions avoir entendu le vacarme d’un écroulement15 […]. » Dans Le Très-Haut, l’image
d’un « escalier en ruine » est appelée par le narrateur qui vient de monter vers la chambre
de sa sœur « quelque chose d’ancien, de criminellement ancien16 ».
Ces caractéristiques, qui relèvent de l’imaginaire, ont des conséquences directes sur la
construction spatiale de l’escalier, en particulier sur les lignes horizontale et verticale
telles que nous les avons décrites dans la première partie. En ce qui concerne la ligne
verticale, la hauteur – le mouvement de monter – apparaît en vertu même de la présence
dominante du féminin comme une dimension de l’attrait, mais aussi comme une
présence qui surplombe et à laquelle il faut se soumettre. L’en bas – le mouvement de
descendre –, en revanche, est plutôt liée à l’(im)possibilité de sortir, d’échapper au
dehors, mais suscite aussi, à cause de l’incertitude inhérente à ce projet et de sa dimension
11. Voir à titre d’exemple Blanchot Maurice, Le Très-Haut, op. cit., p. 73 : « Elle prit une clé,
ouvrit la porte. Il y avait trois marches qu’elle descendit, moi à sa suite. […] je frissonnai, mais
non pas seulement l’effroi ni d’horreur, le désir aussi me fit frissonner. »
12. Blanchot Maurice, Au Moment voulu, Paris, Gallimard, 1979, p. 138-139.
13. Blanchot Maurice, Après coup, op. cit., p. 81.
14. Blanchot Maurice, Aminadab, op. cit., p. 106. Voir p. 98 : « Le sous-sol était très mal des-
servi. Seul un escalier à demi rongé par l’humidité y conduisait et comme la descente se faisait à
pic dans le vide, nous n’avions aucune envie de nous exposer à une chute pour séjourner dans un
lieu qui nous repoussait plus qu’il ne nous attirait. »
15. Ibid., p. 103.
16. Blanchot Maurice, Le Très-Haut, op. cit., p. 58.
135
Blanchot.indb 135 29/11/13 11:56
souterraine, la répulsion et la terreur. Cette duplicité à l’intérieur de la verticale est en
rapport avec l’événement d’une attente et/ou d’une recherche (rencontre, sortie) où la
transformation de l’espace par le mouvement qu’il suscite se décrit en premier lieu en
termes de l’intérieur entendu comme clôture (à titre d’exemple : s’enfermer, pétrifier,
suffoquer) et de l’extérieur entendu comme sortie (à titre d’exemple : quitter, se
précipiter, respirer). Sur la ligne horizontale, la stabilité se révèle incertaine et risque sans
cesse de faire obstacle aux mouvements corporels sur la ligne verticale, soit parce qu’elle
donne lieu à un bouleversement – ou bien par le fait de bousculer un autre homme
comme dans Le Très-Haut17, ou bien par le fait d’être immobilisé comme dans
Aminadab18, ou bien encore bouleversement des rapports sociaux comme dans Thomas
l’Obscur19 –, soit parce que l’espace de l’escalier en tant que tel se révèle sur le point de
manquer tout sol et de s’effondrer. Cette incertitude inhérente à la ligne horizontale est
en rapport avec l’événement d’un manque indéfinissable, une absence impossible à tirer
au clair, qui entraîne et paralyse les personnages sur les marches de l’escalier.
L’escalier comme expression de la loi
Les différents événements relatés à l’escalier que nous venons de résumer jouent un
rôle décisif pour saisir le sens de la construction spatiale de l’escalier tel qu’il apparaît à
partir des romans et récits de Blanchot. Mais est-il possible de dire davantage que ce sens
a aussi une valeur transcendantale et qu’il jette une lumière sur la condition de l’imagi-
naire tel que Blanchot l’entend ?
Dans l’histoire de la philosophie, on a à plusieurs reprises utilisé l’image de l’escalier
pour exprimer l’essentiel, comme métaphore de l’esprit et/ou de la conscience humaine.
Je donne deux exemples. Dans ses Leçons sur la Philosophie de l’Histoire, Hegel parle de
la vie de l’esprit en termes d’un « mouvement en cercle des escaliers » (ein Kreislauf von
Stufen20) dont il dit qu’ils existent l’un à côté de l’autre et qu’ils apparaissent néanmoins
17. Blanchot Maurice, Le Très-Haut, op. cit., p. 113 : « Je bousculai quelqu’un dans l’escalier et
me précipitai au dehors. »
18. Blanchot Maurice, Aminadab, op. cit., p. 14.
19. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, op. cit., p. 29-30.
20. Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, sous la
rédaction d’Eva Moldenhauer et Karl Markus Michel, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, « Werke/
Georg Wilhelm Friedrich Hegel », 1970, p. 105.
136
Blanchot.indb 136 29/11/13 11:56
comme appartenant déjà au passé. Par le paradoxe de cette image, qui combine l’identité
et l’horizontalité du cercle avec la multiplicité et la verticalité des escaliers, Hegel veut
saisir à la fois l’unité de la présence de l’esprit et son devenir. Mais elle signale aussi que
l’esprit doit parcourir tous ces moments, monter à chaque fois de nouveau les escaliers,
pour être chez soi tout en ayant le pouvoir de se saisir dans toute sa profondeur. De ce
mouvement en cercle des escaliers, M.C. Escher a donné une visualisation dans un gra-
phique qui s’appelle « monter et descendre ». Elle rappelle la description de l’expérience
d’Alexandre Akim dans L’idylle à la fin de sa tentative de fuir qui ne mène à aucune issue :
Il semblait qu’en entrant dans ces crues on entrait dans les maisons ; les cours se
confondaient avec les places publiques ; les ponts passaient d’un édifice à l’autre et
couraient au-dessus des immeubles comme des balcons interminables ; retrouvait-on
un peu de liberté, c’est qu’on était enfermé dans un jardin et il fallait, pour découvrir
une nouvelle issue, monter les escaliers et s’enfoncer à travers des constructions dont
on ne savait si elles conduiraient jamais au-dehors21.
Un tout autre exemple se trouve dans un texte d’Emmanuel Lévinas sur Husserl, « La
ruine de la représentation ». Il se sert de l’expression « esprit de l’escalier » pour qualifier
l’explicitation progressive des horizons cachés de la conscience, ce qu’il considère comme
la découverte principale de l’approche phénoménologique :
Il faut un acte second et un esprit de l’escalier pour découvrir les horions cachés qui
ne sont plus le contexte de cet objet, mais les donneurs transcendantaux de son sens.
[…] Que Husserl lui-même ait vu cet esprit de l’escalier sous formes d’actes objecti-
vants et pleinement actuels de la réflexion (en vertu de quel privilège ?), n’a peut-être
pas été déterminant pour l’influence de son œuvre22.
Dans cette image, la figure du cercle a tout à fait disparu. La possibilité de rassembler
le savoir afin de se rejoindre et d’être chez soi n’est plus donnée. La verticalité impliquée
dans la figure de l’escalier annonce la découverte de nouveaux horizons de savoir qui ne
se produit que par la dimension d’un retardement, d’un après coup.
Il est clair qu’il n’est pas difficile de retrouver cette dimension de l’après coup dans
l’approche blanchotienne de l’imaginaire. Elle fait partie de sa définition de la loi du récit
21. Blanchot Maurice, Après coup, op. cit., p. 51.
22. Lévinas Emmanuel, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris, Vrin, 1994, p. 135.
137
Blanchot.indb 137 29/11/13 11:56
entendu comme événement et approche de cet événement23. Pourtant, je ne pense pas
que la métaphorique de l’escalier dans les textes de Blanchot se définisse par ce sens phé-
noménologique de l’après coup, ni d’ailleurs par le sens hégélien mentionné plus haut.
L’image de l’escalier, telle qu’elle se concrétise dans le monde imaginaire de Blanchot, est
tout autant révélatrice je ne dirais pas de l’esprit humain, mais d’une condition qui est en
cause dès qu’il est question de l’homme et de la pensée, condition qui est en rapport avec
la loi. C’est ce que je voudrais exposer dans ce qui suit.
Commençons d’abord par signaler que l’image de l’escalier revient dans L’Écriture du
désastre pour qualifier la veille, la pensée qui veille. Blanchot écrit : « Comme si la veille
doucement passivement nous laissait descendre l’escalier perpétuel24. » L’image est
importante parce qu’elle est mentionnée en rapport avec la notion du désastre : « Le
désastre ne fait pas disparaître la pensée, mais de la pensée, questions et problèmes,
affirmation et négation, silence et parole, signe et insigne. Alors […] la pensée veille25. »
Le retour de l’image de l’escalier dans ce rapport au désastre est révélateur de l’apport de
la figuration de l’espace dans l’œuvre fictionnelle de Blanchot à son approche de la
notion du désastre dans ses écrits fragmentaires. L’image est, en outre, énigmatique, car
comment entendre la primauté de descendre et l’escalier dit « perpétuel » ? L’adjectif
« perpétuel » suggère que l’escalier est toujours là, même s’il n’est pas mentionné, même
si son effondrement est évoqué, même si ce qu’il y a, ce n’est que le vide. Si l’escalier est
« perpétuel », le vide, la chute, l’absence ne peuvent être approchés qu’à partir de la
construction spatiale de l’escalier. Autrement dit, il faut entendre celui-ci comme une
condition : même dans le vide, même en trébuchant, l’on ne finit pas de monter/
descendre sur les marches de l’escalier. La primauté de « descendre » invite en revanche
à reconsidérer l’équivalence entre monter et descendre comme mouvements corporels
caractéristiques de l’espace de l’escalier. Cette primauté signifie qu’il faut redécrire le
changement/la transformation de l’espace auxquels donne lieu l’escalier.
23. Blanchot Maurice, « La rencontre de l’imaginaire », dans Le Livre à venir, op. cit., p. 14 :
« Le récit n’est pas la relation de l’événement, mais cet événement même, l’approche de cet événe-
ment, le lieu où celui-ci est appelé à se produire, événement encore à venir et par la puissance
attirante duquel le récit peut espérer, lui aussi, se réaliser. »
24. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1984, p. 87.
25. Ibid.
138
Blanchot.indb 138 29/11/13 11:56
La primauté de descendre s’éclaire dès que l’on présente l’escalier comme une figura-
tion de la loi. Le propre de la loi, c’est que : 1. la loi relève de la hauteur : elle oblige et
ordonne, c’est-à-dire elle est descendante ; 2. la hauteur même doit être inaccessible
pour que la loi oblige et ordonne ; 3. la loi est enfreinte sans que l’infraction ruine la
puissance de la loi ; 4. ce qui est extérieur à la loi, c’est-à-dire ce qui ne tombe pas sous la
loi, échappe à la distinction entre haut et bas. L’image de l’escalier et du mouvement qu’il
implique résume ces différents traits de la loi que Blanchot a évoqués à plusieurs
reprises et de façon de plus en plus révélatrice d’une condition fondamentale de l’homme
et de la pensée : d’abord dans la figuration de l’espace dans le récit Aminadab, puis
comme expression générale de la recherche du récit dans L’Espace littéraire, et enfin par
rapport à l’extériorité de l’écriture dans « L’absence de livre » à la fin de L’Entretien infini.
Dans Aminadab, l’escalier et le mouvement corporel qu’il implique déterminent à
tel point l’espace du récit qu’ils deviennent l’enjeu même de l’événement raconté.
Monter/descendre – voilà ce qui est l’action envisagée (et à la fois différée), le mouve-
ment à accomplir (et à la fois irréalisable) au cœur même du récit. Mais, en tant que
tel, l’escalier commence par fonctionner comme une figuration qui rend possible de
parcourir et d’explorer l’espace propre de la loi. D’abord, l’espace ouvert par l’escalier
tombe sous la loi. Dès son entrée dans l’immeuble, Thomas bute contre le gardien qui
lui barre l’accès à l’étage supérieur. L’interdiction est mentionnée de façon explicite
dans le récit sur les règles pour les locataires de l’immeuble : « Monter ou descendre
nous était défendu26. » Et pourtant, l’interdiction s’avère inégale par rapport aux
étages supérieurs. « L’interdiction les visait tout spécialement et au fond ne visait
qu’eux27. » Par rapport au sous-sol, il reste « la liberté de nous y rendre », mais c’est
plutôt l’état peu agréable du sous-sol qui repousse le désir de descendre et l’escalier à
demi rongé par l’humidité rend la descente périlleuse (« à pic dans le vide »). Le désir
se porte donc envers les étages supérieurs et la possibilité de s’y rendre semble donnée
par l’existence d’« un escalier commun28 ». Ainsi, l’escalier non seulement tombe sous
la loi, mais installe aussi la loi et invite à la transgresser. « La troupe des rebelles, en
quittant notre salle, […], peut-être prisonnière de la loi qui lui inspirait sa démence,
26. Blanchot Maurice, Aminadab, op. cit., p. 98.
27. Ibid., p. 99.
28. Ibid.
139
Blanchot.indb 139 29/11/13 11:56
se jeta sur l’escalier qui conduit au premier étage, comme si elle avait franchi à cet
instant la ligne de démarcation au-delà de laquelle elle ne devait pas aller29. »
L’escalier se présente dans Aminadab comme la condition sans laquelle il ne serait pas
possible de donner une figuration de l’espace de l’immeuble où Thomas est entré, ni de
raconter le récit de l’événement de sa recherche – condition « perpétuelle », car quelle
que soit la direction de la recherche de Thomas pour rejoindre la jeune fille qui lui avait
fait signe ou bien pour retrouver une sortie à sa recherche, il lui faut se décider entre
monter ou descendre. En outre, l’exploration de l’espace ouvert par l’escalier dans ce
roman permet déjà d’expliquer pourquoi, dans cette recherche, le mouvement de des-
cendre l’emporte sur celui de monter. Cette primauté n’est pas logique ni chronolo-
gique, le désir portant vers les étages supérieurs que Thomas va rejoindre. Mais elle
relève d’un après-coup non envisagé : seulement dans la mesure où les étages supérieurs
s’avèrent inaccessibles ou bien que leur accès se révèle inapproprié à la recherche enga-
gée, les sous-sols et la voie de la descente s’imposeront afin de pouvoir circonscrire fina-
lement l’espace de l’immeuble et rejoindre son extériorité. « La grande porte » où se fait
le seuil de l’entrée et où l’on aura échappé à la puissance de la loi est entrevue à la fin du
récit et située dans les souterrains :
Là-bas, les locataires cessent de dépendre du règlement dont la puissance, déjà
affaiblie dès qu’on approche de la grande porte, est tout à fait suspendue lorsqu’on a
franchi le seuil30.
Ce mouvement n’est pas accompli par le personnage principal d’Aminadab, mais la
descente est l’enjeu de la recherche d’Orphée dès son premier pas aux enfers, itinéraire
exemplaire de ce que Blanchot entend par la loi du récit (voir note 23). L’escalier, il faut
le dire, n’est pas mentionné dans cette descente, mais celle-ci ouvre et délimite l’espace
où la rencontre avec Eurydice, « [ce] point profondément obscur31 » vers lequel tend le
récit, devient possible. C’est encore le féminin qui constitue ici le point d’attrait de ce
mouvement, et le désir qu’il suscite entraîne de nouveau la recherche dans un espace qui
se caractérise par la distinction entre haut et bas. Mais cette fois-ci ce qui est recherché,
c’est de pouvoir rejoindre ce qui est extérieur à la loi, ce qui échappe à la distinction
29. Ibid., p. 105.
30. Ibid., p. 212.
31. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955 p. 227.
140
Blanchot.indb 140 29/11/13 11:56
entre haut et bas. C’est pourquoi le mouvement en bas s’impose : en descendant, c’est la
loi du jour, la loi du monde et des vivants, la loi de l’œuvre et de la forme qu’Orphée
cherche à abandonner, pour rejoindre Eurydice dans la nuit (non pas la nuit qui succède
au jour), mais « l’autre nuit », précise Blanchot32, dans l’autre du monde (qui n’est pas
un autre monde, mais plutôt un arrière-monde), non pas pour la ramener vers soi, à la
clarté du jour et du monde, et la faire chanter dans l’œuvre, mais pour la regarder en face
dans l’indistinction nocturne, avant toute distinction entre haut et bas. Or, par la
radicalité même de ce mouvement, celle-ci s’avère précisément indépassable : il n’y a que
le choix entre « descendre “ou” monter » et il ne reste à Orphée, qui est déjà sur le point
de remonter, que de se tourner pour jeter son regard sur ce qui échappe à la distinction
entre haut et bas.
La descente d’Orphée aux enfers est pour Blanchot une image qui lui permet de cerner
davantage ce dont il s’est approché par l’image de l’escalier dans Aminadab, à savoir
l’espace propre à la loi. Elle révèle à quel point cet espace est pour lui un absolu. Cela
devient particulièrement visible dans son interprétation de l’interdiction qui frappe
selon le mythe le regard d’Orphée. Pour Blanchot, l’interdit ne se rapporte pas plus à ce
regard qu’aux premiers pas de la descente. « Il est inévitable qu’Orphée passe outre à la
loi qui lui interdit de « se retourner », car il l’a violée dès ses premiers pas vers les ombres.
Cette remarque nous fait pressentir qu’en réalité Orphée n’a pas cessé d’être tourné vers
Eurydice : il l’a vue invisible33 […]. » L’interdit frappe le mouvement de la descente dès
le premier pas et dans sa totalité, justement parce que cette descente est la recherche de
rompre avec la loi et de rejoindre ce qui lui échappe. Cela signifie en fait deux choses.
D’abord, il n’y a pas un hors-la-loi : l’extériorité de la loi ne peut être recherchée qu’à
partir de la descendance de la loi (à partir de sa hauteur). C’est-à-dire : la rupture est
impossible. Et deuxièmement, l’infraction de la loi est la façon même par laquelle la loi
affirme son autorité. C’est-à-dire : la faute est partout. Il nous faut « perpétuellement »
monter ou descendre et dans la recherche qui résulte de ce mouvement inlassable par
l’attrait même de cette hauteur que nous n’avons pas installée nous-mêmes, il est inévi-
table de franchir la limite imposée par la loi – infraction par laquelle la loi manifeste
justement son autorité.
32. Ibid.
33. Ibid., p. 227.
141
Blanchot.indb 141 29/11/13 11:56
L’espace propre à la loi – ouvert par sa hauteur inaccessible et qui ouvre à une recherche
(imaginaire) – est absolu et infranchissable : c’est cela que recèlent l’image de l’escalier
(avec le changement entre haut et bas qu’il implique) et la primauté de descendre (avec
sa recherche de l’extérieur). C’est à ces mêmes caractéristiques que Blanchot a recours
pour différencier enfin l’extériorité de la loi et l’extériorité de l’écriture, comme s’il fal-
lait d’abord traverser l’espace propre de la loi et exécuter la recherche qu’il impose avant
de pouvoir considérer l’écriture comme extériorité, comme si la découverte de celle-ci
ne devenait possible qu’à partir de l’examen de celui-là :
On ne peut remonter de l’extériorité comme loi à l’extériorité comme écriture ;
remonter, ici, serait descendre. C’est-à-dire, on ne peut « remonter » qu’en acceptant,
incapable d’y consentir, la chute, chute essentiellement aléatoire dans le hasard ines-
sentiel (cela que la loi appelle dédaigneusement jeu – le jeu où chaque fois tout est
risqué, tout est perdu : la nécessité de la loi, le hasard de l’écriture). La loi est le sommet,
il n’en est pas d’autre. L’écriture reste hors de l’arbitrage entre haut et bas34.
En guise de conclusion
L’image de l’escalier et le mouvement qu’il implique semblent bel et bien avoir un sens
fondamental dans l’approche blanchotienne de l’imaginaire, sens qui est encore autre
que celui de Vertigo de Hitchkock, qui l’a peut-être trop réduit au psychologique de son
personnage principal. Car cette image est pour Blanchot liée à une recherche qui exprime
une condition en produisant l’événement où se manifeste l’absolu de la loi : la hauteur
inaccessible et l’extérieur infranchissable de la loi, incitant inlassablement la pensée à
s’impatienter, trébucher, se reprendre et se déplacer.
Pourtant, à la fin de cet exposé, on pourrait se demander de quoi l’escalier est en fait
l’image et quel est cet espace dont il est dit qu’il est « propre » à la loi. La question semble
risquée. On se rappelle sans doute la description que Blanchot a donnée de la dépouille
dans son texte « Les deux versions de l’imaginaire » : si l’on se demande de quoi la
dépouille est image, il faut répondre qu’elle n’est image que de soi, si l’on veut bien saisir
l’enjeu de cette description. Car dans cette autoréférence consiste la pertinence de la
distinction entre deux versions de l’imaginaire : la première – conception traditionnelle –
34. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 636.
142
Blanchot.indb 142 29/11/13 11:56
renvoie la duplicité caractéristique de l’image à la présence d’un objet déjà donné, la
deuxième à une absence inhérente à l’image.
Il va sans dire que l’image de l’escalier dans l’œuvre de Blanchot a tout autant une
portée originelle et qu’elle recèle une absence qui ne permet pas de la déterminer par
une présence réelle (par exemple : ce même escalier d’un clocher où se produit deux fois
une chute mortelle dans la version de Hitchkock). Pourtant, il ne me semble pas qu’il
soit nécessaire de répondre la question posée par la tautologie : l’image de l’escalier ne
renvoie qu’à soi, à la duplicité de son espace vide. La caractéristique de la dépouille est
que la place est en défaut – on se le rappelle : « [La] base manque, le lieu est en défaut, le
cadavre n’est pas à sa place. Où est-il ? Il n’est pas ici et pourtant il n’est pas ailleurs ; nulle
part ? mais c’est qu’alors nulle part est ici35. » L’escalier, en revanche, nous l’avons exposé
dans la première partie, présuppose un emplacement et, par conséquent, une délimita-
tion de l’espace. L’escalier est donc l’image d’une construction spatiale qu’il est possible
de différencier par rapport à d’autres.
Dans la première partie, nous avons distingué cet espace de l’escalier par rapport aux
lignes horizontale et verticale. La première est constitutive de la distinction entre ici et là,
un en deçà et un au-delà : par elle se produit « la substitution d’une extériorité limitée à
une extériorité sans limitation36 ». C’est par la figure de la trace ou de l’inscription que
cet espace peut être visualisé. La verticale, en revanche, on se le rappelle, ajoute la dis-
tinction entre haut et bas, entre un dedans et un dehors. Elle permet la construction
d’un bâtiment, avec des compartiments établis, une division bien ordonnée des espaces,
soumettant à soi toute extériorité, et une clôture maîtrisable. Cette fois-ci, c’est le dis-
cours avec ses parties, sa structure et sa clôture qui en donne l’image. L’escalier ajoute à
ces deux dimensions le mouvement, le changement de l’espace : il s’érige sur la première
et il rend possible de renverser la fixité de la deuxième. Il permet que l’ici-bas commu-
nique avec là-haut et que là-haut devient le lieu où apparaît l’ici-bas, sans que l’un et
l’autre s’effondrent dans un nulle part. C’est-à-dire : l’escalier non seulement présup-
pose une extériorité limitée et une division entre haut et bas, mais il présuppose aussi le
corps comme base, qui est bien à sa place pour pouvoir monter et descendre.
35. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 344.
36. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 633.
143
Blanchot.indb 143 29/11/13 11:56
Il est donc bel et bien possible de préciser l’espace auquel renvoie l’escalier : c’est l’es-
pace ouvert, orienté et traversé par le corps humain. C’est pourquoi apparaît la distinc-
tion entre masculin et féminin : celle-ci qualifie la disposition de cet espace. L’écart à
l’intérieur de cette distinction et l’attrait entre les deux qu’elle suscite sont évoqués pour
déclencher la transformation, voire le bouleversement de l’espace traversé et pour déter-
miner le lieu où l’événement de leur rencontre se produit. Or, de cet espace, c’est le récit
qui en explore les limites : c’est dans le récit qu’il est parcouru, c’est dans le récit que
s’accomplit le mouvement vers ce « lieu » où l’événement est appelé à se produire. C’est
ainsi, par ce double renvoi à l’espace du corps et à celui du récit, que l’image de l’escalier
reflète une condition de l’approche blanchotienne de l’imaginaire.
Blanchot.indb 144 29/11/13 11:56
L’œil obscurci
Tomasz Swoboda
L
’amitié de Maurice Blanchot avec Georges Bataille remonte aux années
1940. Elle revêt la forme étrange d’une relation marquée au début par un rythme
de rencontres quotidiennes, remplacée ensuite par celle qui se passe sans tête-à-
tête, une amitié, pour ainsi dire, textuelle où au livre de l’un répond la publication sui-
vante de l’autre. Comme le dit le biographe de Bataille, « entre leurs deux pensées, il y a
plus d’une analogie ; […] elles se font écho quand elles ne se complètent pas1. »
Quel est l’impact des relations complexes entre Georges Bataille et Maurice Blanchot
sur les conceptions visuelles de ce dernier ? Quels rôles peuvent jouer l’œil et le regard
dans l’œuvre de celui qui, pendant des dizaines d’années, refusait à la littérature le droit
à la représentation, qui a laborieusement témoigné de l’impossibilité de donner une
image du réel, qui a déployé son écriture autour des sujets à l’adverbe commun : non-
être, non-savoir, non-dit ? Or, il semble qu’à ces négations multiples il est possible d’en
ajouter une autre, liée justement au regard : l’invisibilité. Une négation qui dit du voir
ce que le silence dit du langage : qui le met en question, qui crée une boucle à la fois
1. Surya Michel, Georges Bataille, la mort à l’œuvre, Paris, Gallimard, 1992, p. 380.
145
Blanchot.indb 145 29/11/13 11:56
logique et pragmatique, en posant la question sur une instance visuelle qui permette de
constater une « invisibilité » ou bien un « non-voir ». Ce serait également la question
de la place du (non-)voir dans les fictions blanchotiennes où, comme le constate à juste
titre Jean-Philippe Miraux, le regard est « […] un point nodal d’étrangeté dans le récit,
lieu de bouleversement, lieu cataclysmique pour le sujet2. » Un lieu donc – comme chez
Bataille, le « jeune » Bataille, en tout cas – central mais – exactement comme chez
Bataille – installé dans un espace de négation, voire exposé à des attaques farouches de
tous côtés : philosophique, poétique, existentiel, anthropologique. En effet, Miraux
ouvre sa réflexion sur le regard chez Blanchot en remarquant que « […] la quasi-totalité
de l’œuvre de Blanchot s’insurge contre le primat de la vision, du visible et de l’invisible,
de cette dichotomie qui rend possible notre connaissance du monde3. » On a donc
affaire au même mouvement que celui qui apparaît dans les « points nodaux » des
textes de Bataille mais aussi ceux de Leiris ou Artaud, de Caillois ou Klossowski, de
même que dans ceux d’autres auteurs qui se sont approprié la nature binaire du sacré,
l’inextricabilité de la fascination et de l’angoisse, du désir et de la haine, du sublime et
de la bassesse, du maître et de l’esclave. De même que pour tuer son père, il faut d’abord
l’introniser, de même pour détruire l’œil, il faut d’abord le fixer, y voir le reflet de son
propre œil, et l’énucléer, l’un ou l’autre, ou bien les deux à la fois. Le triomphe sur le
regard ne peut avoir de l’importance que si l’on admet d’abord sa force et son pouvoir.
Bien évidemment, à la base de toute la problématique du voir chez Blanchot, se trouve
le mythe d’Orphée dont l’interprétation, déjà largement commentée, a trouvé sa meil-
leure expression dans L’Espace littéraire. On ne se lassera jamais de citer ces mots :
Il est inévitable qu’Orphée passe outre à la loi qui lui interdit de « se retourner », car
il l’a violée dès ses premiers pas vers les ombres. Cette remarque nous fait pressentir
que, en réalité, Orphée n’a pas cessé d’être tourné vers Eurydice : il l’a vue invisible,
il l’a touchée intacte, dans son absence d’ombre, dans cette présence voilée qui ne
dissimulait pas son absence, qui était présence de son absence infinie. S’il ne l’avait
pas regardée, il ne l’eût pas attirée, et sans doute elle n’est pas là, mais lui-même, en
ce regard, est absent, il n’est pas moins mort qu’elle, non pas mort de cette tranquille
2. Miraux Jean-Philippe, Maurice Blanchot : quiétude et inquiétude de la littérature, Paris,
Nathan, « 128 : Écrivains », 1998, p. 37.
3. Ibid., p. 36.
146
Blanchot.indb 146 29/11/13 11:56
mort du monde qui est repos, silence et fin, mais de cette autre mort qui est mort sans
fin, épreuve de l’absence de fin4.
Dans l’interprétation blanchotienne, le regard d’Orphée est donc le signe d’une double
disparition, celle du sujet et celle de l’objet, une tentative, vouée à l’échec, de voir l’invi-
sible, un effort, intérieurement contradictoire, de franchir une frontière infranchissable,
dont le caractère infranchissable n’est pas le résultat d’un interdit mais du fait que – de
même que le sujet et l’objet – elle disparaît au moment même où la transgression la
menace. C’est une conception extrêmement importante pour l’histoire de la lutte contre
la dichotomie du visible et de l’invisible au xxe siècle mais – de même que l’idée du
caractère sacré du regard, partagée par Bataille et consorts – un peu oubliée ou délaissée
par les écrivains, artistes et philosophes contemporains.
Certes, contrairement à Bataille, Blanchot néglige le caractère matériel de l’œil, voire
le regard lui-même : il les traite, pour ainsi dire, d’une façon instrumentale dans la
mesure où ils deviennent des figures de la création littéraire et se trouvent soumis à la
réflexion métatextuelle : « Écrire commence avec le regard d’Orphée5. » Mais le passage
de L’Espace littéraire cité ci-dessus apparaîtra comme important pour « l’histoire de
l’œil » en Occident, si on le juxtapose aux phrases qui lui ressemblent du point de vue
rhétorique. Cette ressemblance révèle, en effet, un des procédés auxquels l’œil et le
regard sont soumis dans l’écriture blanchotienne, à savoir à une sorte de déséquilibra-
tion qu’introduit dans l’ordre du visible (de l’invisible) l’emploi des figures telles que
l’antithèse, la paronomase ou une simple répétition qui, à cause de l’usage excessif,
bouleversent les relations logiques et font éclater le système de la représentation, bien
que tout (?) soit joué dans les limites du langage. Dans le passage cité, ces jeux rhéto-
riques concernent les mots tels que « présence », « absence », « regard » et « fin ». Et en
voici d’autres exemples, trouvés dans la seconde version de Thomas l’Obscur : « […] il
lui fallait un moi sans sa solitude de verre, sans cet œil atteint depuis si longtemps de
strabisme, l’œil dont la suprême beauté est de loucher le plus possible, l’œil de l’œil, la
pensée de la pensée6. » ; « Ayant deux yeux dont l’un d’une extrême acuité de vision,
4. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, « Idées », 1968, p. 229.
5. Ibid., p. 234. À ce sujet, voir Carrera Alessandro, « Blanchot’s gaze and Orpheus’s singing.
Seeing and listening in poetic inspiration », in Panorama: philosophies of the visible, Wurzer Wil-
helm S. (dir.), New York/Londres, Continuum, « Textures », 2002, p. 45-54.
6. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, Paris, Gallimard, 1950, p. 67-68.
147
Blanchot.indb 147 29/11/13 11:56
c’est avec celui qui n’était œil que par son refus de voir que je voyais tout ce qui était
visible7. » ; « Elle me voyait par ses yeux qu’elle échangeait contre les siens8 […]. » Ces
procédés langagiers débouchent sur la déstabilisation de l’ordre du voir, et plus préci-
sément sur la difficulté de distinguer le sujet de l’objet, sur leur unification, ou bien
sur l’alternance des fonctions du regardant et du regardé, ou bien du non-regardant et
du non-regardé. De même que dans la scène fameuse d’Aminadab où Thomas entre
dans l’atelier d’un peintre. Il y trouve un tableau inachevé qui représente, avec une
précision incroyable, l’atelier même où il se trouve. Il ne peut être achevé qu’avec l’ap-
parition de Thomas qui a l’impression « […] de faire déjà partie du tableau, de sorte
que la reproduction de ses traits n’avait plus grande importance9. » Qui plus est, une
fois l’œuvre achevée, Thomas ne s’y reconnaît plus ; en revanche, il y distingue les yeux
de l’artiste : la toile s’avère un autoportrait voilé. Comme l’écrit Manola Antonioli :
« Si tout autoportrait implique un certain aveuglement, l’impossibilité de rendre
visibles les conditions de la vision et de la vision de soi-même, les yeux réels du peintre
sont les yeux de son autoportrait fictif. Mais les yeux représentés sur la toile pour-
raient également être les yeux de Thomas, vus par le peintre de la même façon dont
Thomas croit voir les yeux de l’artiste10. »
Pas de récit
À cette mise en question de l’identité du regard Blanchot ajoute un embrouillement
lexical. Écoutons ces phrases de L’Arrêt de mort : « Je l’ai regardée, cela est sûr, je l’ai fixée,
mais je ne l’ai pas vue11. » ; « Je la voyais d’extrêmement loin : elle était sous mon regard
qui voit tout, mais je me posais toujours cette question : est-ce que je la remarque12 ? »
Dans ces passages – et l’on pourrait facilement multiplier des exemples – on a affaire à la
différentiation du sens des verbes tels que « voir », « regarder », « fixer » ou « remarquer »,
dont les connotations différentes sont exploitées par Blanchot en vue d’une déstabilisation
7. Ibid., p. 111.
8. Ibid., p. 116.
9. Blanchot Maurice, Aminadab, Paris, Gallimard, 1942, p. 22.
10. Antonioli Manola, L’Écriture de Maurice Blanchot : fiction et théorie, Paris, Kimé,
« Philosophie, épistémologie », 1999, p. 92.
11. Blanchot Maurice, L’Arrêt de mort, Paris, Gallimard, 1977, p. 34.
12. Ibid., p. 82.
148
Blanchot.indb 148 29/11/13 11:56
sémantique du « champ visuel ». Cette déstabilisation a lieu indépendamment du choix
rhétorique de l’écrivain, qu’il ait recours à la répétition, à la différentiation sémantique,
ou bien – comme dans ce dialogue socratique – à la définition :
– Voir, c’est donc saisir immédiatement à distance. – …immédiatement à distance et
par la distance. Voir, c’est se servir de la séparation, non pas comme médiatrice, mais
comme un moyen d’immédiation, comme im-médiatrice13.
Tous ces procédés, apparemment purement rhétoriques, dynamisent le système com-
plexe du voir qui, pendant des siècles, fondait la construction du sujet « oculocentrique »
en Occident. Mais le vrai démontage, la vraie déconstruction nécessitait des actions
encore plus fermes.
« Fermes » ne veut point dire « radicales ». Si naturel pour Bataille, le viol sur l’œil
n’est pas le propre de Blanchot. S’il apparaît, ce n’est qu’en tant qu’une exception à la
règle, et il joue un rôle différent dans le récit que chez l’auteur de l’Histoire de l’œil. Une
telle exception se retrouve dans La Folie du jour, intitulé primitivement Un récit ?, qui
termine par cette phrase fameuse qui résume la philosophie blanchotienne de la littéra-
ture : « Un récit ? Non, pas de récit, plus jamais14. »
Le narrateur homodiégétique de ce, comme l’appelle Christophe Bident, « autopor-
trait fictif » qu’est La Folie du jour, résume sur quelques pages sa vie et, avant tout, fait
passer, dans ce récit paradoxal et impossible, les idées de Blanchot lui-même sur la fonc-
tion de la littérature. Fonction qui consiste à ne se soumettre à aucune loi et en même
temps à refuser le récit, visiblement identifié au pouvoir, par quoi Blanchot anticipe non
seulement la réflexion foucaldienne15 mais aussi un tournant ultérieur, celui du post-
structuralisme, contre la narration. Parmi les quelques scènes et épisodes de La Folie du
jour, se retrouve ce petit passage sur les yeux :
Je faillis perdre la vue, quelqu’un ayant écrasé du verre sur mes yeux. Ce coup m’ébranla,
je le reconnais. J’eus l’impression de rentrer dans le mur, de divaguer dans un buisson de
silex. Le pire, c’était la brusque, l’affreuse cruauté du jour ; je ne pouvais ni regarder ni ne
pas regarder ; voir c’était l’épouvante, et cesser de voir me déchirait du front à la gorge16.
13. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 39.
14. Blanchot Maurice, La Folie du jour, Paris, Gallimard, 2002.
15. Ce texte a paru pour la première fois sous le titre Un récit ? dans la revue Empédocle, en 1949.
16. Blanchot Maurice, La Folie du jour, op. cit., p. 18.
149
Blanchot.indb 149 29/11/13 11:56
Cet événement a de graves conséquences pour le narrateur : « Le verre ôté, dit-il, on
glissa sous mes paupières une pellicule et sur les paupières des murailles d’ouate17. » Tou-
tefois, cette thérapie – qui semble empruntée à l’imagination de Michel Leiris18 – n’est
que partiellement efficace. Le narrateur guérit mais ne peut toujours pas lire ni écrire, il
cache son regard dans l’ombre des lunettes foncées, il marche dans la rue « […] comme
un crabe, [s]e tenant fermement aux murs19. » Et lui à avouer : « Si voir c’était le feu, j’exi-
geais la plénitude du feu, et si voir c’était la contagion de la folie, je désirais follement cette
folie20. » C’est donc à partir de cet épisode – apparemment assez anodin par rapport aux
questions philosophiques sérieuses que ce texte aborde – que le récit prend son titre. Que
peut signifier cette mise en relief dans une histoire si énigmatique et si elliptique ?
Selon Jacques Derrida, c’est le voir qui constitue le sujet principal de La Folie du jour : en
effet, la folie consiste justement à voir, non d’une façon ordinaire, mais à voir en voyant la
vue même, en voyant la visibilité et les conditions du voir, c’est-à-dire ce qui devrait rester
invisible21. La tache aveugle, le blind spot, l’un des paradoxes privilégiés de la philosophie
occidentale, se trouve ainsi en quelque sorte anéantie dans ce non-récit blanchotien : néan-
moins, c’est la folie qui est la conséquence de ce bouleversement, de ce regard trop perspi-
cace. L’attentat aux principes du voir – qui sont en même temps les principes du penser – ne
peut pas rester impuni. Dans ce sens, Andrzej Leśniak a raison en disant à propos de La
Folie du jour qu’« Écrire sur le regard mène Blanchot inévitablement à écrire sur la cécité,
sur l’affaiblissement de la vue. », et que « La vue et le regard ne sont possibles que dans la
mesure où ils sont menacés, peut-être même grâce à la menace22. » Mais La Folie du jour
dit quelque chose de plus : à savoir que, comme dans Histoire de l’œil, le récit du viol sur le
regard se situe à la limite de ce qui peut être raconté. D’un côté, il est le seul récit possible,
le seul digne d’être raconté « à la folie » ; de l’autre, il est justement ce qui rend tout récit
impossible, ou plutôt ce qui condamne le narrateur au silence, à un silence dans la folie,
qui fait pendant aux « yeux révulsés » batailliens, ceux qui ont vu ce qui était interdit.
17. Ibid.
18. Je pense à la phénoménologie des paupières au moment du réveil dans Leiris Michel,
La Règle du jeu, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2003, p. 289-290.
19. Blanchot Maurice, La Folie du jour, op. cit., p. 20.
20. Ibid., p. 19-20,
21. Derrida Jacques, Parages, Paris, Galilée, 1986, p. 137.
22. Leśniak Andrzej, « Spojrzenie : Blanchot i Balzak », in Maurice Blanchot : literatura ekstre-
malna, Mościcki Paweł (dir.), Varsovie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2007, p. 89.
150
Blanchot.indb 150 29/11/13 11:56
À la place des yeux mot yeux
Ce qui est le plus important à dire sur la fonction des yeux dans les écrits blanchotiens
ne se trouve pas non plus dans cette scène souvent commentée qu’est l’épisode de la
lecture de Thomas l’Obscur. Le héros éponyme est assis dans sa chambre et il lit : il lit
même si on peut penser qu’il feint la lecture puisque le livre est toujours ouvert à la
même page. En effet, il s’agit d’une lecture particulière :
Il était, auprès de chaque signe, dans la situation où se trouve le mâle quand la mante
religieuse va le dévorer. L’un et l’autre se regardaient. Les mots, issus d’un livre qui pre-
nait une puissance mortelle, exerçaient sur le regard qui les touchait un attrait doux et
paisible. Chacun d’eux, comme un œil à demi fermé, laissait entrer le regard trop vif
qu’en d’autres circonstances il n’eût pas souffert23.
La relation entre le lisant et le lu s’en trouve donc bouleversée : Thomas ne se trouve
pas dans la situation d’un sujet dominant sur un objet mais plutôt dans celle d’un sujet
par rapport à un autre sujet, ce dernier ayant, de surcroît, le même avantage qu’a la
mante religieuse sur son mâle. À ce moment du texte blanchotien ce regard du texte-
Méduse ne fonctionne qu’au niveau métaphorique : la mante religieuse et le mot-œil ne
sont, pour le moment, que les termes d’une comparaison. Le récit n’a pas encore dépassé
cette limite au-delà de laquelle – comme dans Histoire de l’œil où l’urine devient vrai-
ment larmes, et l’œil du prêtre est l’œil de Marcelle – la métaphore envahit l’ordre réa-
liste du monde représenté pour le faire voler en éclats avec tout le système de la mimésis
oculocentrique. Cela ne tarde pourtant pas à arriver, déjà quelques phrases après, où le
narrateur observe : « Il se voyait avec plaisir dans cet œil qui le voyait24. » Et un peu plus
bas : il était « […] observé par un mot comme par un être vivant, et non seulement par
un mot, mais par tous les mots qui se trouvaient dans ce mot, par tous ceux qui l’accom-
pagnaient et qui à leur tour contenaient eux-mêmes d’autres mots, comme une suite
d’anges s’ouvrant à l’infini jusqu’à l’œil de l’absolu25. » Plus d’un mot sur la subjectivité
de Thomas, aucun « comme si ». C’est le texte qui regarde le lecteur qui du lisant se
transforme en lu, et l’œil regardant devient l’œil regardé par un nombre infini de mots-
yeux. La suite semble issue des récits de Julio Cortàzar : « les mots s’emparaient de lui et
23. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, op. cit., p. 27.
24. Ibid., p. 28.
25. Ibid.
151
Blanchot.indb 151 29/11/13 11:56
commençaient à le lire26. » Comment cela finit-il ? « Pendant des heures, il se tint immo-
bile, avec, à la place des yeux, de temps en temps le mot yeux : il était inerte, fasciné et
dévoilé27. »
Non seulement donc s’y trouve dépassée la frontière entre le métaphorique et le littéral
mais aussi le statut de Thomas lui-même semble évoluer : d’un sujet en contact avec un
objet il passe à la relation sujet/sujet pour se trouver enfin dans une situation où il
communique avec un sujet en tant qu’objet, c’est donc plutôt ce sujet (qui était avant un
objet) communique avec lui, en l’aliénant en tant qu’un sujet objectivisé. Ce bref épisode
raconte donc presque toute l’histoire de l’œil en Occident28. Peut-être est-ce pour cela
que Jacques Lacan l’évoqua, à la fin d’un de ses séminaires, presque sans commentaire,
en incitant le public à lire le texte entier29. Si, dans L’Arrêt de mort, le psychanalyste a
trouvé une excellente illustration de ce qu’il appelle « la seconde mort », la scène de
26. Ibid.
27. Ibid., p. 29.
28. Grzegorz Jankowicz observe, à juste titre, que dans une telle interprétation – juste à mon
avis –, cette scène représente « l’expérience de la lecture dans sa forme pure », et « si Thomas
l’Obscur était le seul texte de Blanchot sur la lecture, on pourrait penser qu’il n’y avait pas d’élève
plus assidu de Heidegger ». « Le problème est que, ajoute le critique polonais, Blanchot met en
relief qu’on a ici affaire à un désir, à un fantasme qu’on a créé à l’usage d’une culture désespérée
après la perte du monde » (Jankowicz Grzegorz, « Doświadczenie lektury : lektura eksperymen-
talna (Heidegger, Blanchot) », in Maurice Blanchot : literatura ekstremalna, op. cit., p. 98). Si je suis
d’accord avec la première partie de la réflexion de Jankowicz, je n’arrive pas à trouver cette « mise
en relief », à moins que ce soit le texte sur Lautréamont qui suggère la conception d’une « lecture
expérimentale » où l’expérience est la conséquence de l’impossibilité de se soumettre complète-
ment au texte lu. Ce texte conduit pourtant Jankowicz à une conclusion qui confirme sa lecture,
et en même temps la mienne, de Thomas l’Obscur : « Pour Blanchot, la lecture est toujours liée à
l’objectivisation du lecteur, à un sacrifice quasiment masochiste de celui qui lit. Le pouvoir de la
littérature est illimité, et l’expérience de la lecture recèle toujours la possibilité d’une destruction
complète du sujet » (ibid., p. 96). Voir aussi Lesniak Andrzej, Topografie doświadczenia : Maurice
Blanchot i Jacques Derrida, Cracovie, Aureus, 2003, p. 34-44. Wacław Rapak inscrit allusivement
cette scène dans un contexte plus large de l’œuvre de Blanchot dans son analyse de ses récits des
années 1930 : Rapak Wacław, « Après coup » précédé par « Le ressassement éternel » de Maurice
Blanchot : une lecture, Cracovie, Universitas, 2005, notamment p. 210-219.
29. Lacan Jacques, Séminaire IX : l’identification (1961–1962), texte inédit. J’utilise la
version électronique des notes du cours, accessibles sous l’adresse http://staferla.free.fr/S9.
Dans cette version, qui compte 611 pages, la mention sur Blanchot apparaît aux pages 604-
606. C’est Christophe Halsberghe qui fait remarquer cette présence de Blanchot chez Lacan
(Halsberghe Christophe, La Fascination du commandeur. Le sacré et l’écriture en France à partir
du débat-Bataille, Amsterdam/New York, Rodopi, « Faux Titre », 2006, p. 382).
152
Blanchot.indb 152 29/11/13 11:56
lecture, ou plutôt ce qui la suit, est pour lui « une incarnation de l’objet petit a », lié à la
répulsion dont parle Freud en analysant le cas de « l’homme aux rats30 ». Dans le texte de
Blanchot, en effet, Thomas – métamorphosé déjà, comme Gregor Samsa, en quelque
chose qui rampe – est persécuté par des mots sous la forme d’« un rat gigantesque, aux
yeux perçants, aux dents pures, et qui était une bête tout-puissante31 ». Cette image
repoussante et paradoxale de l’objet insaisissable du désir est la vraie fin de la scène de
lecture : lecture considérée non pas comme expérience mais comme angoisse et horreur,
comme peur d’avoir un œil touché par un autre œil.
La nuit
Cependant, dans le même récit, se trouve aussi un autre aspect de ce sentiment singu-
lier d’être regardé (touché) par un autre œil. Dans le plus long chapitre du livre, chapitre
composé presque exclusivement d’un monologue du personnage éponyme, Thomas,
réfléchissant sur son rapport au monde, constate entre autres :
Je suis vu. Je me destine sous ce regard à une passivité qui, au lieu de me réduire,
me rend réel. […] Je suis vu. Poreux, identique à la nuit qui ne se voit, je suis vu. Aussi
imperceptible que lui [le regard du monde], je le sais qui me voit. Il est même l’ultime
possibilité que j’aie d’être vu alors que je n’existe plus. Il est ce regard qui continue à
me voir dans mon absence. Il est l’œil que ma disparition, à mesure qu’elle devient plus
complète, exige de plus en plus pour me perpétuer comme objet de vision. Dans la nuit
nous sommes inséparables. Notre intimité est cette nuit même32.
Le statut étrange du personnage, qui n’arrive pas à mourir définitivement, trouve ici
une explication, si partielle soit-elle, grâce à la présentation de la situation de l’œil et du
regard : paradoxalement, être vu, être objet, objet du regard, apparaît comme une chance
pour exister, les ressources de l’existence subjective étant déjà épuisées. Et c’est la nuit
qui le rend possible, cette nuit poreuse comme Thomas – certes, c’est Thomas qui est
poreux comme la nuit mais la réciprocité et l’interchangeabilité des fonctions est ici
30. Lacan Jacques, Séminaire IX : l’identification (1961–1962), op. cit. Voir Freud Sigmund,
L’Homme aux rats : un cas de névrose obsessionnelle, suivi de Nouvelles remarques sur les
psychonévroses de défense, Paris, Payot, 2010.
31. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, op. cit., p. 32.
32. Ibid., p. 124-125.
153
Blanchot.indb 153 29/11/13 11:56
presque totale – et comme lui à la fois visible et invisible. En commentant ce passage,
Eugène Chang observe à juste titre que « Là où il n’y a plus de sujet ni objet, intérieur ni
extérieur, l’expérience intérieure devient une expérience-limite, ouverte au seul extérieur,
et rien de plus33. » Cette ouverture est une chance pour renverser les relations, un signe
envoyé à la nuit et à l’œil qui m’observe, après quoi ils peuvent s’insinuer en moi, et moi,
je peux devenir ce qu’ils veulent. C’est une camera obscura paradoxale où l’obscurité
devient la condition du voir : « Sur la rétine de l’œil absolu, je suis la petite image
renversée de toutes choses34. »
On le sait, la nuit dont parle Blanchot n’est pas une nuit ordinaire, considérée comme le
contraire du jour. Souvent, surtout dans L’Espace littéraire, dans des essais comme
« Le dehors, la nuit » ou « Le regard d’Orphée », il utilise l’expression « l’autre nuit », qui
renvoie à l’expérience qu’ont de la nuit ses propres personnages mais qu’il retrouve égale-
ment dans d’autres textes : il s’agit de l’expérience de l’inaccessible, de l’irrévocable mais
aussi de l’invisible qui, en quelque sorte, s’impose à notre regard. En se référant à ces par-
ties de L’Espace littéraire, Michal Pawel Markowski ainsi définit cette expérience particu-
lière : « Ce n’est pas une nuit où on ne voit rien mais une nuit qu’on ne voit pas, ou plutôt :
une nuit dont l’invisibilité est visible quand on essaie en vain de voir quoi que ce soit35. »
Toutefois, de nouveau, ce n’est qu’un aspect du phénomène. Blanchot, comme la plu-
part des grands auteurs, est rarement univoque, notamment dans ses leitmotivs : on ne
peut pas s’attendre à ce qu’un artiste intelligent répète inlassablement une même pensée,
convaincu de son caractère évident et indiscutable. Ce qu’on estime tant, et qu’on appelle
quelquefois une obsession, n’est souvent qu’une forme dont l’auteur n’arrive pas à se
séparer et dont il examine la dimension philosophique et la résistance à la matière de la
pensée. Dans le cas de Blanchot, cette analyse comporte la question sans cesse posée aux
conditions du voir, aux limites du visible et de l’invisible. Si donc L’Espace littéraire mais
aussi Thomas l’Obscur parlent de l’invisibilité visible de la nuit, force est de rappeler cette
remarque de Michel Foucault sur le statut de la fiction chez Blanchot :
33. Chang Eugène, Disaster and hope : a study of Walter Benjamin and Maurice Blanchot, thèse,
philosophie, Yale University, Faculty of the Graduate School, mai 2006, 157 p. (dactyl.), p. 130.
34. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, op. cit., p. 126.
35. Markowski Michał Paweł, « Maurice Blanchot : fascynacja zewnętrznością », in Maurice
Blanchot : literatura ekstremalna, op. cit., p. 42-43.
154
Blanchot.indb 154 29/11/13 11:56
Le fictif n’est jamais dans les choses ni dans les hommes, mais dans l’impossible
vraisemblance de ce qui est entre eux : rencontres, proximité du plus lointain, absolue
dissimulation là où nous sommes. La fiction consiste donc non pas à faire voir l’invi-
sible, mais à faire voir combien est invisible l’invisibilité du visible36.
Foucault, imitant à sa façon les paralogismes blanchotiens, parle donc d’une situation
inverse par rapport à celle qu’on a évoquée plus haut, en citant Markowski : il ne s’agit
pas de la visibilité de l’invisible mais de l’invisibilité invisible du visible, c’est-à-dire
d’une déréalisation du réel, du refus d’admettre son existence dans ce que Blanchot
appelle littérature, et que Foucault, pour des raisons de clarté (quand même !), appelle
fiction. Il est toutefois significatif que l’auteur de Surveiller et punir parle de cette situation
en termes de visibilité et d’invisibilité : c’est sans doute une allusion à ce grand thème
blanchotien qu’est le mythe orphique qui – contrairement à ce que j’affirmais dans
l’introduction – constitue, dans cette œuvre, non seulement la figure de toute création
mais aussi dit quelque chose d’important sur le regard même. En effet, ce mythe y
apparaît si riche – comme la forme obsessive d’un grand artiste – qu’il comprend à la
fois la visibilité de l’invisible et l’invisibilité du visible. Et si on réfléchit sur le statut
particulier d’Orphée et d’Eurydice – d’un vivant (visible) descendu dans le monde des
morts (invisibles), et d’une morte (invisible) qui revient dans le monde des vivants
(visibles) – il faut constater que le mythème culminant, comme appelleraient cette scène
les structuralistes, c’est-à-dire le regard d’Orphée qui précipite Eurydice dans l’abîme
des ténèbres, s’appuie en réalité sur une impossible tautologie, exprimée on ne peut
mieux par Simon Critchley : « Orphée ne veut pas rendre l’invisible visible mais plutôt
(chose impossible) voir l’invisible en tant qu’invisible37. » Ainsi il devient clair (si quelque
chose peut être clair ici) que le sentiment étrange qui accompagne la lecture du
monologue de Thomas, le sentiment que cette situation est à la fois connue et différente
de ce qu’on connaît, peut en partie résulter d’une sorte d’inversion sexuelle par rapport
à ce « connu », c’est-à-dire à l’hypotexte qu’est le mythe orphique : en effet, Thomas n’est
pas ici Orphée mais Eurydice, quelqu’un qui désire un œil dont le regard signifie la
confirmation de l’existence et le retour à la vie. À ce détail près que – comme dans le
mythe, comme chez Blanchot – ce regard signifiera aussi la privation décisive de cette
36. Foucault Michel, Dits et écrits, 1954-1988. I, 1954-1969, Paris, Gallimard, 1994, p. 524.
37. Critchley Simon, Very little—almost nothing : death, philosophy, literature, Londres/New
York, Routledge, « Warwick Studies in European Philosophy », 1997, p. 43.
155
Blanchot.indb 155 29/11/13 11:56
vie même. « Dans la nuit nous sommes inséparables », dit Thomas. C’est la condition
sine qua non de cette belle illusion qui demande, en réalité, de fermer les yeux ou bien de
se perdre dans l’épaisseur de « l’autre nuit », sans distinguer le visible et l’invisible, le
proche et le lointain.
Pourtant, ce n’est qu’une solution provisoire, pour ne pas dire frivole. Une sortie
théorique – mais pas existentielle – de cette impasse est offerte par la notion du regard
fasciné que Blanchot oppose au regard voyant :
La fascination est le regard de la solitude, le regard de l’incessant et de l’intermi-
nable, en qui l’aveuglement est vision encore, vision qui n’est plus possibilité de voir,
mais l’impossibilité de ne pas voir, l’impossibilité qui se fait voir, qui persévère – tou-
jours et toujours – dans une vision qui n’en finit pas : regard mort, regard devenu le
fantôme d’une vision éternelle38.
Et ce que voit la personne fascinée
N’appartient pas au monde de la réalité, mais au milieu indéterminé de la fascination
[…] où ce que l’on voit saisit la vue et la rend interminable, où le regard se fige en lumière,
où la lumière est le luisant absolu d’un œil qu’on ne voit pas, qu’on ne cesse portant de
voir, car c’est notre propre regard en miroir, ce milieu est, par excellence, attirant, fasci-
nant : lumière qui est aussi l’abîme, une lumière où l’on s’abîme, effrayante et attrayante39.
Contrairement donc au regard voyant, « ce regard de la possession et de la violence
appropriatrice40 », le regard fasciné est celui qui se laisse posséder, s’approprier et violer.
Le premier suppose la distance et le manque du contact physique (il est donc identique
à l’œil philosophique de la pensée occidentale), alors que le second est une expression
de la passivité et de la proximité41. C’est – pour parler en termes bachelardiens – un lit
doux du rêve où, dans une tendre solitude, on laisse les songes se développer à l’infini :
« Voir dans le rêve, c’est être fasciné, et la fascination se produit, lorsque, loin de saisir
38. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 26.
39. Ibid.
40. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 274.
41. Sur l’opposition du regard voyant et du regard fasciné, voir Schulte Nordholt Anne-Lise,
Maurice Blanchot. L’écriture comme expérience du dehors, Genève, Droz, 1995, chap. 5, § 2.2.2 ; et
aussi Antonioli Manola, L’Écriture de Maurice Blanchot : fiction et théorie, op. cit., p. 70 et suiv.
156
Blanchot.indb 156 29/11/13 11:56
à distance, nous sommes saisis par la distance, investis par elle42. » Être fasciné c’est être
confronté aux ténèbres aveuglantes de la nuit. L’œil ne voit alors plus rien si ce n’est son
propre reflet dans un miroir noir. Il se perd dans l’abîme de l’invisible. Il s’obscurcit des
ténèbres de « l’autre nuit », de cette « invisibilité visible » dont parle Markowski, de
cette « invisibilité du visible » dont parle Foucault, de cette « invisibilité de l’invisible »
enfin dont parle Simon Critchley.
42. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 41.
Blanchot.indb 157 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 158 29/11/13 11:56
La parole aveugle.
L’Apocalypse ou le moment spectral
dans l’écriture fictionnelle de Blanchot
Renato Boccali
L
’œuvre romanesque de Blanchot puise avec profusion dans le réservoir séman-
tique et métaphorique de l’Apocalypse de Jean. Le dispositif d’images, qui rend pos-
sible la révélation, est toujours accompagné d’une voix « hors champ » anonymement
productrice de messages1. Si, à l’origine, ces messages avaient un centre et un but – le
dévoilement d’une vérité révélée –, au fil du temps ils se perdent dans une immense pro-
lifération communicative qui transforme le modèle apocalyptique. La fin imminente
devient immanente et l’attention est alors portée sur les avant-derniers temps où les per-
manents produisent une usure de la fin qui devient transition sans fin. L’impossibilité de
conclure devient, donc, le paradigme qui fait éclater le récit fictionnel de la fin.
Il semble possible de montrer, au fil de certains récits de Blanchot tels que, La Folie du
jour, Le Ressassement éternel, L’Attente, l’oubli, non seulement que l’Apocalypse repose en
hypotexte dans ces récits, générant un nouveau type d’écriture, mais qu’elle fournit tout
un dispositif d’images. Ces images sont toutefois complètement chavirées par Blanchot.
1. Voir Derrida Jacques, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, Paris, Galilée,
« Débats », 1 983.
159
Blanchot.indb 159 29/11/13 11:56
Elles circulent dans les textes sous forme désémantisée, elles sont presque des images
vidées, des phantasmata. Ces images spectrales qui hantent les textes jouent alors un rôle
capital dans l’économie de l’écriture littéraire qui oscille entre cécité et parole, impossi-
bilité de vision et possibilité (bien que toujours fragile) d’écriture.
« Voici qu’elle arrive, me disais-je, la fin vient, quelque chose arrive, la fin commence.
J’étais saisi par la joie2. » Par ces mots, l’anonyme narrateur, protagoniste de La Folie du
jour, manifeste la joie soudaine qui le saisit après la révélation provoquée par la « courte
vision3 » dont il est témoin. Mais de quelle joie s’agit-il ? Quelle est la vision qui se
montre à l’écrivain ?
Il s’agit d’une joie bizarre, d’un bonheur fou, qui arrive après un séjour dans le ventre
d’une bibliothèque, dans les « bas-fonds surchauffés4 » où le narrateur se meut à travers
des passerelles, apportant des volumes à un employé qui les transmet, dit Blanchot, « au
sombre esprit de la lecture. Mais cet esprit lança contre moi des paroles peu aimables ;
sous ses yeux, je rapetissais ; il me vit tel que j’étais, un insecte, une bête à mandibules
venue des régions obscures de la misère5. » Et pourtant le narrateur venait de nous avouer
sa propension à la lecture, confessant avoir beaucoup lu. Ce cumul de livres lus, soumis
au changement en fonction de la disparition du narrateur et de son activité herméneu-
tique, constitue une archive infinie à laquelle chacun trouve son accès selon un mouve-
ment d’exégèse personnelle allant d’une galerie à une autre du souterrain de la
bibliothèque. Il n’y a pas de sortie pour l’homme du sous-sol, qui demeure seul dans une
chambre après avoir assisté à la folie du monde : « Je fus mis au mur comme beaucoup
d’autres. Pourquoi ? Pour rien. Les fusils ne partirent pas. Je me dis : Dieu, que fais-tu ? Je
cessais alors d’être insensé. Le monde hésita, puis reprit son équilibre6. » À partir de ce
moment la mort attendue mais jamais arrivée produit une condition d’après-mort et, de
cette manière, elle devient un événement de la vie. Le narrateur peut alors décrire la mise
en terre de son corps, sa consumation, sa transformation en squelette. Ce n’est qu’à l’âge
2. Blanchot Maurice, La Folie du jour, Montpellier, Fata Morgana, 1 973 ; Paris, Gallimard,
2002, p. 17.
3. Ibid., p. 16.
4. Ibid., p. 15.
5. Ibid., p. 16.
6. Ibid., p. 11.
160
Blanchot.indb 160 29/11/13 11:56
de la maturité qu’il sort « de la fosse de boue7 » et, comme un spectre, il hante le monde
jusqu’au moment où arrive la vision et, avec elle, l’espérance : la venue de la fin, son com-
mencement. Il s’agit de quelque chose d’attendu, de profondément voulu, quelque chose
qui doit arriver selon l’ordre des événements inscrit dans l’histoire. Il nous semble, alors,
pouvoir discerner dans la narration un paradigme apocalyptique à téléologie éclatée qui
structure le récit sur une attente prophétique déçue. La théologie biblique de l’histoire, en
particulier dans sa déclination chrétienne, nous offre l’opportunité de lire le texte blan-
chotien à la lumière de la tension temporelle entre mémoire et prophétie, sur la base d’un
modèle messianique dont la prédominance n’est pas exclusive dans l’œuvre de Blanchot.
Commencement, déploiement, fin. Voilà la téléologie du temps historique qui à partir
de la Genèse, et selon l’ordre eschatologique chrétien, se dispose à la fin, à cette fin qui est
aussi la fin, la promesse de la parousie, de la nouvelle venue du Christ. La fin, selon la pers-
pective théologique commune aux différentes confessions du christianisme, constitue le
moment conclusif du développement de la série d’événements narrés par l’histoire sacrée,
selon une direction orientée vers l’accomplissement de la fin ultime qui ordonne le cours
des événements. Fin, donc, comme conclusion, achèvement et nouveau commencement.
C’est précisément la venue de la fin que le narrateur attend et que la vision annonce,
en conformité avec le dispositif narratif centré sur la vision employée dans le récit apo-
calyptique de Jean. Mais il s’agit d’une étrange et courte vision, celle d’une femme avec
une voiture d’enfant qui essaie d’entrer dans une porte cochère. Au même moment, un
homme, jusque-là inaperçu par le narrateur, franchit la porte, mais il fait marche arrière
et cède le pas à la femme en voiture qui, aussitôt, disparaît dans la cour.
De quel type de vision s’agit-il ? Remarquons que la scène est bien concrète, réelle, il
n’y a pas de symboles à interpréter, pas de vérités allégoriques à discerner. C’est du côté
du monde qu’elle se produit et c’est proprement son caractère concret qui la rend pos-
sible. Cette vision est alors la révélation (apokaluptô) de la présence du monde grâce à
laquelle le narrateur saisit « l’instant à partir duquel le jour, ayant buté sur un événe-
ment vrai, allait se hâter vers sa fin8 ». Le jour se manifeste dans sa plénitude, dans la
brutalité de sa présence qui semble annoncer la possibilité d’un anéantissement long-
temps attendu, du commencement de la fin, celle révélée par le mystère de la banalité
7. Ibid., p. 13.
8. Ibid., p. 17.
161
Blanchot.indb 161 29/11/13 11:56
qui fait paraître ce qui était passé jusqu’alors inaperçu. Mais la perfection de ce bonheur
ne dure pas longtemps. Ce qui semblait réel montre son véritable visage. L’événement
auquel le narrateur assiste comme un tacite témoin est fallacieux, il n’annonce pas l’ou-
verture à autrui qui mettrait fin à son existence d’après-mort en faisant disparaître le
monde tel qu’il le connaît. Le fait que l’homme se retire pour laisser passer la femme en
voiture ne manifeste pas la condition ontologique d’être-pour-autrui, car la femme dis-
paraît soudain et le narrateur qui se dirige vers cette maison ne voit rien d’autre que « le
commencement noir d’une cour », l’anonyme fond obscur d’un endroit sans lumière.
Le monde reste là, intact. Mais, nous dit le narrateur, « je faillis perdre la vue, quelqu’un
ayant écrasé du verre sur mes yeux. Ce coup m’ébranla, je le reconnais9. »
Un autre événement inattendu lui arrive, quelqu’un lui écrase un verre sur les yeux,
sans que nous en sachions la raison. Nous connaissons seulement ce qui se produit après
cette action physiquement indolore pour le narrateur, au moins apparemment. « Le pire,
– il confesse – c’était la brusque, l’affreuse cruauté du jour ; je ne pouvais ni regarder ni
ne pas regarder ; voir c’était l’épouvante, et cesser de voir me déchirait du front à la
gorge. En outre, j’entendais des cris d’hyène qui me mettaient sous la menace d’une bête
sauvage (ces cris, je crois, étaient les miens)10. » Il se produit alors une étrange situation
dans laquelle le narrateur se trouve dans une condition paradoxale, il ne peut plus regar-
der mais, en même temps, il est dans l’impossibilité de ne pas voir. Quelque chose le
pousse à voir, une douleur déchirante lui impose la vision, mais cette vision ne produit
chez lui que de l’épouvante. En fond, les cris de la bête sauvage sont des cris qui se
confondent avec les siens. Cette atmosphère d’apocalypse annonce peut-être une nou-
velle révélation. Sous la menace de la bête, des cris se répandent dans l’air et le sang de la
blessure, holocauste de purification, est bloqué par « des murailles d’ouate11 » qui répa-
rent les paupières sur lesquelles une pellicule s’est déposée. Maintenant la vision est
possible, selon une séquence narrative déréglée qui rappelle la scène fameuse de l’aveu-
glement de l’œil montrée par Luis Buñuel dans Le Chien andalou.
Le film, produit avec Dalí, nous transporte, dès son début, dans un temps hors du
temps, celui de la fable, du « il était une fois ». Il s’ouvre sur le metteur en scène en train
d’aiguiser un couteau à côté d’une fenêtre, il sort sur une terrasse et, après avoir regardé
9. Ibid., p. 18.
10. Ibid.
11. Ibid.
162
Blanchot.indb 162 29/11/13 11:56
la lune, s’approche d’une femme assise sur une chaise, lui écarquille l’œil gauche puis le
coupe en deux. La séquence d’images se base sur un découpage onirique et sur un pro-
cessus d’association qui juxtapose un mince nuage qui passe en découpant la lune en
deux à l’entaille de l’œil provoquée par le couteau. Tout s’interrompt et une inscription
à l’écran nous emmène, par saut dans le temps, « huit ans après ». Selon la poétique
surréaliste des auteurs, à la scène est confiée la tâche de déchirer le regard du spectateur
pour lui montrer, bien qu’avec des souffrances, ce qu’il n’a jamais vu ou ce qu’il n’a pas
eu le courage de regarder. La surréalité est alors un fond sur lequel la réalité se projette,
un espace qui précède chaque rationalisation et schématisation du réel. Un espace fon-
damentalement onirique qui permet l’affleurement progressif de la conscience à ce qui
se trouve au-dessous du monde de la veille.
Dans le récit de Blanchot, le médecin dit au narrateur aux yeux blessés : « vous dor-
miez » ; et celui-ci affirme : « je dormais12 ! » Mais il n’y a pas d’onirisme ici, car il se hâte
d’avertir : « J’avais à tenir tête à la lumière de sept jours : un bel embrasement ! Oui, sept
jours ensemble, les sept clartés capitales devenues la vivacité d’un seul instant me deman-
daient des comptes13. » Il s’agit alors d’une véritable vision, la cécité de ses yeux ouvre
une autre possibilité de vision, celle d’une lumière excessive produite par sept jours mais
qui se condense dans un seul instant, l’instant kairotique où se montre la vérité. Tout
comme dans l’apocalypse, le voile est déchiré, le temps est venu, l’attente s’avère termi-
née. Le narrateur semble demeurer dans l’instant ineffable où le temps s’est effondré et
l’histoire s’arrête. Mais cet instant se dilate, devient presque durable, l’instant d’un res-
sassement éternel, celui de la mort, au point que notre narrateur nous dit : « souvent je
mourais sans rien dire. À la longue, je fus convaincu que je voyais face à face la folie du
jour ; telle était la vérité : la lumière devenait folle, la clarté avait perdu tout bon sens ; elle
m’assaillait déraisonnablement, sans règle, sans but14. » La folle lumière est alors la révé-
lation finale, l’apocalypse comme mise à nu de la vérité. La lumière se montre en se
rendant visible à travers son dévoilement, mais aussi en produisant une catastrophe. La
condition de possibilité de sa venue est liée au double aveuglement du narrateur : aveu-
glement initial produit par le verre écrasé sur les yeux et second aveuglement produit par
la vision-révélation de la lumière qui voile la vue en dévoilant sa présence obsédante.
12. Ibid.
13. Ibid.
14. Ibid., p. 19.
163
Blanchot.indb 163 29/11/13 11:56
L’aveuglement apocalyptique ne montre rien d’autre que la vérité des yeux, c’est-à-
dire l’impossibilité de toute vision et de toute vérité, le dérèglement de toute logique et
la fin de toute téléologie. Mais, nous rappelle Derrida dans son texte Mémoires d’aveugle,
Devenant ainsi martyre, donc témoignage, l’aveuglement est souvent le prix à payer
pour qui doit ouvrir enfin les yeux, les siens ou ceux d’un autre, afin de recouvrer
une vue naturelle ou l’accès à une lumière spirituelle […] Le témoignage substitue le
récit à la perception. Il ne peut voir, montrer et parler en même temps, et l’intérêt de
l’attestation comme du testament, tient à cette dissociation15.
La folie du jour ne peut pas être racontée mais seulement témoignée, elle est de l’ordre
de la perception et non pas de la narration. Le narrateur, après cette fulgurante révélation,
ne pourra donc qu’attester cette vérité par sa seule présence, se cachant dans une clinique
et, parfois, sortant au dehors avec le brûlant désir de « voir quelque chose en plein jour16 ».
Des gens arrivent à la clinique et le narrateur s’expose à leur vue, il ne peut pas se
cacher et il leur distribue son sang. Dans cette interdiction et cette prescription presque
christologique reposent la faute et la Loi. C’est lui qui donne à voir aux individus qui se
rendent à la clinique, avec son sang il leur donne la vision du jour, il rend justice avec sa
présence sans rien comprendre de la justice et du discours anonyme de la Loi. Les
cicatrices de son regard brûlent, la vue devient une plaie et quand on lui demande de
raconter comment « au juste » les choses se sont passées, il recommence son récit, mais
l’attente de ses interlocuteurs est frustrée, il s’arrête avant d’en venir aux faits. Il est
contraint de reconnaître qu’il n’est pas capable de former un récit avec les événements
qui se sont passés car il a « perdu le sens de l’histoire, cela arrive dans bien des maladies17 ».
Mais sa réponse ne satisfait pas ses deux interlocuteurs, un ophtalmologue et un
psychiatre, qui lui imposent presque un interrogatoire, « autoritaire, surveillé et contrôlé
par une règle stricte18 ». Il n’y a pas de véritable liberté, le biopouvoir médical contrôle le
regard et la pensée en imposant un ordre préétabli. La petite communauté de deux
personnes assujettit à son autorité le discours en réclamant un récit qui ne serait rien
d’autre que l’enchaînement réglé et rationnel des événements selon un ordre des raisons
15. Derrida Jacques, Mémoires d’aveugle, Paris, Réunion des musées nationaux, « Parti pris »,
1990, p. 106.
16. Blanchot Maurice, La Folie du jour, op. cit., p. 19.
17. Ibid., p. 29.
18. Ibid.
164
Blanchot.indb 164 29/11/13 11:56
typiquement cartésien. Mais, de cette manière, la parole de l’autre ne peut pas advenir et,
au fond, elle n’est même pas requise. Ce qui est exigé est un rapport policier, car « un
écrivain, un homme qui parle et qui raisonne avec distinction, est toujours capable de
raconter des faits dont il se souvient19 ».
La perte du sens de l’histoire est la perte du récit, de la possibilité de faire entrer dans un
ordre langagier ce qui n’est pas racontable, à savoir la folie du jour qui, selon les mots de
Lévinas, est « folie d’aujourd’hui, mais folie du jour aussi en tant que le jour y est désiré à
la folie et en tant que le jour – clarté et mesure – y entre en folie et, dès lors, – notam-
ment – en tant que la folie du jour s’oppose à la folie ou à l’affolement de la nuit20 ».
Peut-être, toutefois, y a-t-il encore un dernier mot à dire car, affirme Blanchot, « quand
tout est dit, ce qui reste à dire est le désastre, ruine de la parole, défaillance par l’écriture,
rumeur qui murmure : ce qui reste sans reste (le fragmentaire)21 ». Dire le désastre signi-
fie alors dévoiler le naufrage total qui emporte même le récit, d’après une économie
sacrificielle qui impose la répétition, l’effondrement général, l’évanouissement du pré-
sent. Le désastre n’est pas l’ultime, mais ce qui entraîne l’ultime dans la catastrophe du
désastre, à savoir, l’Apocalypse. Il s’agit de quelque chose qui se passe ici, en excès sur
toute présence, dans un temps qui est déjà hors de l’histoire mais pas tout à fait hors du
temps. Nous sommes entraînés au bord extrême de l’attente, où l’inexorabilité du temps
qui arrive à son dernier but s’arrête au seuil de l’avant-dernier temps, le « “déjà” ou “tou-
jours déjà” [qui] est la marque du désastre, le hors de l’histoire historique22 […] ». La fin
commence mais n’en finit pas d’en finir ou, pour reprendre les mots que Beckett fait
prononcer à Clov dans Fin de partie, « Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir23. »
Fini, c’est une constatation, nous sommes à la fin, on ne peut éviter d’en prendre acte.
C’est fini, pourtant ça va finir, nous sommes dans l’avant-dernier instant qui transite vers
sa fin, c’est le finir en acte, l’épuisement de la fin qui finit. Ou ça va peut-être finir, à peu
près, plus ou moins, ça va presque finir car cet avant-dernier instant ne semble pas vou-
loir finir bien que la fin soit inscrite dans sa nature. C’est déjà fini, c’est toujours déjà fini,
19. Ibid., p. 30.
20. Lévinas Emmanuel, « Exercices sur La Folie du jour », in Sur Maurice Blanchot, Montpellier,
Fata Morgana, « Essais », 1975, p. 58.
21. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 2002, p. 58.
22. Ibid., p. 68.
23. Beckett Samuel, Fin de partie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1957, p. 15.
165
Blanchot.indb 165 29/11/13 11:56
apocalypse sans Apocalypse, apocalypse sans vision, sans images, réduite à la seule
catastrophe, au désastre. Voilà la catastrophe inhérente à l’apocalypse : la fin sans fin, le
renvoi du temps voulu qui diffère la clôture du temps vers une impossible fin. C’est la
chute du temps dans un présent sans futur, qui a comme unique futur le présent. Cela
est donc la fin, l’annonce catastrophique : « l’il y a qui porte le rien et empêche l’anni-
hilation pour que celle-ci n’échappe pas à son processus interminable dont le terme est
ressassement et éternité24 ».
En ce sens, l’apocalypse comme désastre immanent inaugure un « contre-temps » par
rapport à la temporalité que la théologie de l’histoire chrétienne a élaborée pendant des
siècles en indiquant les étapes du commencement et de la fin des temps. Au fond, ce
contre-temps n’est rien d’autre qu’un contretemps, un imprévu, lié à l’imminence diffé-
rée, au salut et à la rédemption qui ne se réalisent pas. C’est la fin qui tarde à se dissoudre
et la révélation, si révélation il y a, n’est que l’annonce de la rédemption envisagée du
point de vue de son absence radicale, du point de vue d’un impossible salut. Voilà le
désastre, quelque chose qui ne s’accomplit pas mais qui, cependant, arrive, comme s’il
était depuis toujours déjà arrivé. Le contre-temps est alors un temps de passage, non pas
une durée, mais ce qui est passé, ce qui va passer ou qui peut-être passera. Il s’agit d’un
transit jamais révolu, en pérenne phase de transition vers l’achèvement du passage qui
ne s’accomplit jamais réellement et totalement, se tenant dans une perpétuelle suspen-
sion. Le contre-temps ne répond pas à l’attente, il est hors de toute orientation, il est
désorienté, sans possibilité de trouver un point final d’orientation. Blanchot parle
d’« imminence ajournée25 », c’est-à-dire d’une imminence qui n’arrive jamais mais qui
s’ajourne chaque fois qu’elle annonce son arrivée, sa venue dans un temps qui n’est pas
tout à fait certain parce qu’il n’arrive pas une fois pour toutes. Il s’agit d’un temps qui
détruit le temps, qui l’annule en le poussant vers sa fin, anéantissant sa durée pour le
réduire au simple passage vers l’extrémité ultime, suspendu au bord du gouffre, sans
véritable possibilité de transiter.
Que faire alors ? Blanchot nous suggère, faisant parler un personnage anonyme « chargé
du discours » : « Il faut que vous soyez comme un bateau à qui toujours doit manquer le
port, mais qui dispose d’un gouvernail. Par l’intermédiaire de “jusqu’à ce que”, le temps
24. Blanchot Maurice, « Après coup », in Après coup précédé par Le Ressassement éternel, Paris,
Les Éditions de Minuit, 2003, p. 94.
25. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, op. cit., p. 92.
166
Blanchot.indb 166 29/11/13 11:56
rejette les écueils et devient sa propre épave26 ». Il ne reste que l’épave du temps qui ne se
brise pas encore contre les écueils du néant. Dans le temps de la fin, le temps de « jusqu’à
ce que », l’homme navigue avec un gouvernail qui le conduit vers la mer ouverte, au-delà
de tous les ports, sans port, dans la douleur vivante du manque : « Solitude qui rayonne,
vide du ciel, mort différée : désastre27. »
Dans cette situation de vide et de ressassement éternel, au milieu du vacarme des cris
et hurlements qui accompagnent les scènes phantasmatiques du Dernier mot, une nou-
velle vision s’ouvre pour l’anonyme narrateur du récit, il monte sur le sommet d’une
tour et regarde au dehors à travers « une vitre, longue et étroite, qui, encastrée dans la
muraille, laissait passer les regards au-dehors et cependant reflétait aussi les choses de
l’intérieur28 ». Ce qui s’offre à la vue n’est que désolation, un désert, un effondrement
général des édifices et le soleil, un soleil qui brûle et n’éclaire pas. Soudain, il casse la vitre
et le sang coule par cette fente. Encore une fois, comme dans La Folie du jour, un sacrifice
qui voit l’écoulement du sang comme moment paradigmatique pour l’accès à une vision
après un aveuglement nécessaire. Mais le bonheur d’être aveugle, de ne plus voir, comme
préfiguration de la fin, ne dure pas car « le pire arriva. Au fond de mes yeux sans vue se
rouvrit le ciel qui voyait tout, et le vertige de fumée et de larmes qui les obscurcissait
s’éleva jusqu’à l’infini, où il se dissipa en lumière et en gloire. Je me mis à balbutier29. »
Ainsi Blanchot décrit-il l’expérience ultime, celle de l’obscurcissement de la vue, de la
cécité qui présage la venue du désastre comme réouverture de la vision, d’une vision
aveugle qui fait disparaître l’obscurcissement dans une lumière accablante qui brûle le
regard et fait éclater les images en découvrant un nouvel horizon qui ouvre sur le vide. Il
ne reste alors plus qu’à parler avec le propriétaire de la tour qui se révèle, après le chant
du coq, être le Tout-Puissant. Dans son bégaiement le dernier homme essaye d’avertir le
propriétaire de l’écroulement général auquel même la tour ne pourra résister. Il le ras-
sure toutefois bien contre la pressante inquiétude de la femme qui est avec eux et s’agite
en essayant de les avertir de ce qui se passe au-dehors. L’incendie ravage le bois, les eaux
envahissent la campagne, une tempête souffle dans le désert, la terre tremble et les cris
d’une immense foule montent jusqu’au sommet de la tour. Les indices de l’apocalypse
26. Blanchot Maurice, « Le dernier mot », in Après coup, op. cit., p. 63-64.
27. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, op. cit., p. 220.
28. Blanchot Maurice, « Le dernier mot », in Après coup, op. cit., p. 75.
29. Ibid., p. 77.
167
Blanchot.indb 167 29/11/13 11:56
laissent le propriétaire impassible, dans son illusion d’éternité. La tour ne cédera pas, elle
ne s’écroulera pas et, bien que l’escalier soit en train de s’effondrer, il rassure la femme
« par sa tranquillité, et, quand la chute de la tour les précipita au-dehors, ils tombèrent
tous trois sans dire un mot30 ».
Il ne reste que le silence après la chute et après l’élimination du « mot d’ordre » sur lequel
s’ouvrait le récit. Il y a donc circularité entre l’anéantissement final, la ruine de la tour, la
chute du propriétaire, du narrateur et de la femme et l’effacement du mot d’ordre dont
l’auteur nous informe au début. Il n’y a plus de langage et le récit dans sa linéarité s’efface
progressivement, entraîné dans le naufrage total. En somme, nous explique Blanchot :
[…] l’Apocalypse enfin, découverte de rien d’autre que la ruine universelle, laquelle
s’achève par la chute de la dernière Tour, Tour sans doute de Babel, en même temps
que silencieusement sont précipités au-dehors le propriétaire (l’être qui s’est toujours
assuré la définition du « propre » – Dieu évidemment, fût-il une bête), le narrateur qui
a gardé le privilège de l’ego, et la fille simple et merveilleuse, celle qui probablement
sait tout, du plus humble savoir31.
La chute de la dernière tour est donc la chute du langage, qui n’amène pas la confusion
des idiomes mais plutôt l’effacement de toute parole et de toute possibilité de parler. Il
s’agit d’une condition où le silence éternellement se parle au travers d’une déchirure qui
fend le silence et permet un nouveau bruit, celui qui annonce l’ère sans parole, l’ère de
l’absence de toute parole qui parle. « Un écrivain, dit Blanchot, est celui qui impose
silence à cette parole […] et c’est ce défaut de silence qui révélerait peut-être la dispari-
tion de la parole littéraire32. » Il s’agit, au fond, d’une parole spectrale, d’une parole que
ne parle pas, qui annule le « dit » à la faveur du « dire », en laissant parler en elle l’ab-
sence et un autre temps qui n’a rien à voir avec la durée ou la permanence éternelle. Le
temps du récit, d’un récit impersonnel et réduit à l’essentiel, est un temps sans présent.
Ou, à vrai dire, un temps irréellement présent, un temps spectral qui hante l’œuvre, bien
présent en elle mais absent dans sa substance, toujours à venir sans cependant possibilité
30. Ibid., p. 81.
31. Blanchot Maurice, « Après coup », in Après coup, op. cit., p. 93.
32. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, « Folio/Essais », 2003, p. 298.
168
Blanchot.indb 168 29/11/13 11:56
de venir. L’œuvre est alors l’attente de l’œuvre, l’attente de sa présence à venir, l’inat-
tendu de toute attente qui reste imprévisible33.
L’écriture conserve la tâche de dire ce qu’elle ne peut pas décrire, l’attente infinie de ce
qui ne semble pas venir et, ce faisant, elle convoque un temps spectral, un hors du temps
qui reste, néanmoins, à l’intérieur du temps, se maintenant inexorablement ouvert à la
clôture de la fin. Derrida parle explicitement d’un moment spectral :
Un moment qui n’appartient plus au temps, si l’on entend sous ce nom l’enchaî-
nement des présents modalisés (présent passé, présent actuel « maintenant », présent
futur). Nous questionnons cet instant, nous nous interrogeons sur cet instant qui n’est
pas docile au temps, du moins à ce que nous appelons ainsi. Furtive et intempestive,
l’apparition du spectre n’appartient pas à ce temps-là, elle ne donne pas le temps, pas
celui-là : « Enter the Ghost, exit the Ghost, re-enter the Ghost » (Hamlet)34.
Le moment spectral est alors l’apparition phantasmatique du temps de la fin, hors du
temps, déjà-là et pas-encore. Un instant indocile où le temps ne se précipite plus vers sa
consommation mais reste suspendu dans une consumation sans fin. Les extases du
temps se fracturent, ses trois directions vectorielles s’annulent : plus de telos, plus de
skopos, plus d’eschaton. Leur hypostatisation comporte la perte de l’unité qui les faisait
converger vers la plenitudo temporum et, de cette manière, l’instant, le Jetzt-zeit, manque
sa dimension kairotique qui le qualifierait de « temps juste », temps de l’ouverture du
sens ultime. Pour Blanchot, toutefois :
Le Temps dérangé, sorti de ses gonds, se laisse encore attirer, fût-ce à travers l’expé-
rience de la fêlure, en une cohérence qui s’unifie et s’universalise. Mais l’expérience
inexpérimentée du désastre, retrait du cosmique qu’il est trop facile de démasquer
comme l’effondrement […], nous oblige à nous dégager du temps comme irréversible,
sans que le Retour en assure la réversibilité35.
33. Cette attente est produite par la loi secrète du récit. « Le récit est mouvement vers un point,
non seulement inconnu, ignoré, étranger, mais tel qu’il ne semble avoir, par avance et en dehors
de ce mouvement, aucune sorte de réalité […], mais cependant c’est seulement le récit et le
mouvement imprévisible du récit qui fournissent l’espace où le point devient réel, puissant et
attirant », ibid., p. 14.
34. Derrida Jacques, Spectres de Marx, Paris, Galilée, « La philosophie en effet », 1993, p. 17.
35. Ibid., p. 125.
169
Blanchot.indb 169 29/11/13 11:56
Le ressassement éternel n’est pas l’éternel retour nietzschéen sur lequel le surhomme
affirme sa volonté de vouloir, sa volonté de puissance. La répétition du désastre est la fin
qui n’en finit pas d’en finir sans jamais réellement finir. Et ce temps « dérangé », ce temps
d’apocalypse, est un temps au risque de la perte de cohérence par le maintenant spectral,
« un maintenant disjoint ou désajusté, “out of joint”, un maintenant désajointé qui
risque toujours de ne rien maintenir ensemble dans la conjonction assurée de quelque
contexte dont les bords seraient encore déterminables36. » Ce maintenant out of joint,
sorti de ses gonds, hante spectralement le temps comme un revenant qui revient encore
et encore, rendant difficile l’unité de ce qui ne semble plus rester ensemble, d’un temps
radicalement disjoint, sans jointure assurée.
Ce temps se réunit seulement anachroniquement, au-delà de l’événementialité de
l’histoire, dans l’absence d’événements ou plutôt dans leur virtualisation anhistorique.
Le centre de rayonnement des événements est perdu, il ne reste que le murmure des
mots d’un récit sans direction, qui ouvre un espace d’attente ou d’hospitalité à ce qui ne
peut pas arriver. La narration se fragmente, se fissure, perd aussi sa linéarité en se tenant,
comme dit Blanchot dans L’Attente l’oubli, « en ce point extrême de l’attente où depuis
longtemps ce qu’il y a à attendre ne sert qu’à maintenir l’attente, dans le moment peut-
être dernier, peut-être infini37 ». Nous assistons, et ce texte nous le montre parfaitement,
au désœuvrement du récit, contraint de ne plus rien raconter sinon l’absence et l’attente
perpétuelle de ce qui n’arrive pas. Attente désespérée qui l’épuise en provoquant une
distraction qui fait oublier le motif de l’attente. Ce qui reste est seulement l’attente dans
le temps vide de la kénose du récit où le langage se retire, même la dernière trace d’espé-
rance que l’inattendu arrive disparaît.
L’intrigue pyramidale, orientée vers une conclusion téléologique d’un ensemble
d’événements connexes, éclate en produisant une dispersion et une discontinuité radicales
dans le tissu narratif. L’explicite du récit explose en fragmentant l’intrigue, incapable
désormais d’être reconstituée en unité. Nous sommes alors bien au-delà de ce que
Frank Kermode appelait The Sense of an Ending, c’est-à-dire l’immanence du temps
apocalyptique dans le roman contemporain qui transforme la fin en crise perpétuelle,
moment sans fin de la transition qui se sécularise en produisant un nouveau paradigme
36. Ibid., p. 21.
37. Blanchot Maurice, L’Attente l’oubli, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 2000, p. 13.
170
Blanchot.indb 170 29/11/13 11:56
apocalyptique où la crise prend la place de la fin38. Chez Blanchot, en effet, la crise est
entraînée dans le désastre et l’impossible transition devient attente ou « attente de
l’attente, reprenant en elle le commencement, suspendant la fin et, dans cet intervalle,
ouvrant l’intervalle d’une autre attente39 ». L’impossibilité d’attendre rouvre le temps sans
qu’on puisse lui donner cohérence et unité ; l’intervalle d’attente est alors le véritable
temps du récit dans lequel quelque chose se dit, même si ce n’est rien d’autre que la
stagnation de l’attente, son pourrissement. Cela fait venir à la présence l’absence du temps
qui néanmoins ne fait pas finir l’attente. Laisser venir cette présence signifie effacer tout
présent en retombant dans l’espace de l’absence et dans la dispersion de la parole.
La voix narrative devient alors sans sujet identifiable, une voix presque hors champ,
sans possibilité de savoir qui parle et qui écrit. Le langage dévoile sa structure trans-
cendentalement apocalyptique vouée à l’annihilation de la parole qui annonce la fin.
Mais, nous avertit Blanchot, « la littérature, en se faisant impuissance à révéler, voudrait
devenir révélation de ce que la révélation détruit. Effort tragique40. » Il ne reste qu’un
résidu d’écriture contre l’oubli, une survivance langagière qui résiste à la destruction en
se vouant à la dispersion, emportée par les quatre vents de l’absence qui soufflent de
nulle part : le Dehors, le Neutre, le Désastre, le Retour41. « Reste [cependant] l’innommé
au “nom” de quoi nous nous taisons42. »
38. Voir Kermode Franck, The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction, New York,
Oxford University Press, 1967. En reprenant le paradigme apocalyptique proposé par Kermode,
Paul Ricœur nous offre un commentaire visant à expliquer l’analogie entre la Fin évoquée par
l’Apocalypse et la clôture de l’œuvre littéraire. Le Jugement dernier devient fin immanente, tran-
sition interminable qui a son équivalent dans les œuvres littéraires contemporaines. « L’idée de fin
du monde nous vient par le moyen de l’écrit qui, dans le canon biblique reçu dans l’Occident
chrétien, conclut la Bible. L’Apocalypse a pu signifier ainsi à la fois la fin du monde et la fin du
livre. […] L’Apocalypse […] offre le modèle d’une prédiction sans cesse infirmée et pourtant
jamais discréditée, et donc d’une fin elle-même sans cesse ajournée. […] L’Apocalypse, dès lors,
déplace les ressources de son imagerie sur les Derniers Temps – temps de Terreur, de Décadence
et de Rénovation – pour devenir un mythe de la Crise. » Ricœur Paul, Temps et récit. T. 2. La
configuration dans le récit de fiction, Paris, Éditions du Seuil, « Points/Essais », 1984, p. 47.
39. Blanchot Maurice, L’Attente l’oubli, op. cit., p. 38.
40. Blanchot Maurice, La Part du feu, Paris, Gallimard, « NRF », 1949, p. 317.
41. Voir Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, op. cit., p. 95.
42. Ibid., p. 139.
Blanchot.indb 171 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 172 29/11/13 11:56
Le Dernier entretien :
la pensée épuisée et l’épuisement du sujet
Gary D. Mole
Jusqu’au dernier moment, je vais être tenté d’ajouter un mot à ce qui a été dit. Mais
pourquoi un mot serait-il le dernier ? La dernière parole, ce n’est déjà plus une parole
et, cependant, ce n’est pas le commencement d’autre chose. Je vous demande donc de
vous rappeler ceci, pour bien conduire vos observations : le dernier mot ne peut être
un mot, ni l’absence de mot, ni autre chose qu’un mot1.
Blanchot n’était sans doute ni le premier ni le dernier écrivain à puiser dans les ressources
de la fiction pour épuiser la fiction même. Mais il était certainement parmi les plus habiles,
les plus lumineusement obscurs, les plus obscurément lumineux, à se perdre dans les
détournements de sa voix narrative. Les détours ou les divagations de la fiction de Blanchot
n’ont de cesse fait appel aux lecteurs – à l’image de Thomas dans Aminadab, invité à
pénétrer dans la maison, errant dans l’obscurité de l’immeuble dans le désir inassouvi de
« tout tirer au clair2 » – tout en battant en brèche toutes les orientations critiques,
1. Blanchot Maurice, « Le Dernier mot » (1935-1936), in Après Coup, précédé par Le Ressassement
éternel, Paris, Les Éditions de Minuit, 1983, p. 77.
2. Blanchot Maurice, Aminadab, Paris, Gallimard, 1942, p. 227.
173
Blanchot.indb 173 29/11/13 11:56
théoriques, méthodologiques, voire épistémologiques qui se sont disputé l’ascendance sur
le corpus depuis les premiers ouvrages de Pierre Madaule, Daniel Wilhem, Evelyne Londyn
et Georges Préli dans les années soixante-dix3, Parages de Derrida en 1986, rédigés dans les
« rivages inaccessibles ou […] inhabitables » de L’Arrêt de mort et de La Folie du jour4, la
tentative soutenue de Manola Antonioli en 1999 de penser tout le rapport entre fiction et
théorie chez Blanchot5, et jusqu’aux « rencontres clandestines » entre la philosophie et
l’œuvre narrative de Blanchot dans le volume récemment publié sous la direction de
Kevin Hart6, pour ne citer que quelques jalons dans l’histoire de la réception critique de la
fiction de Blanchot. L’analyse de l’« état présent7 » des études de cet abondant corpus de
trois romans et de dix récits éclairerait utilement le processus de consécration de Blanchot
dont la fiction joue un rôle de plus en plus prépondérant dans l’histoire du paysage
littéraire français du xxe siècle.
Il n’est cependant pas dans nos intentions d’offrir une telle synthèse. L’horizon de notre
étude est plus restreint : nous nous proposons de naviguer dans les marges du corpus
narratif, non pas dans le vain espoir d’élucider de manière définitive un texte périphéral
pour le ramener au centre des préoccupations narratives de Blanchot, mais dans la tenta-
tive de restituer au texte en question un statut qui, à quelques exceptions près, lui a été
occulté, celui tout simplement d’un récit au sens blanchotien du terme, au sens que
donne Blanchot en fin de compte à toute littérature, comme à toute pensée : expérience
que d’elle-même et pour elle-même, « expérience de l’étrangeté, elle ne saisit cependant,
3. Voir Madaule Pierre, Une Tâche sérieuse ?, Paris, Gallimard, 1973 ; Wilhem Daniel,
Maurice Blanchot. La Voix narrative, Paris, Union Générale d’Éditions, « 10/18 », 1974 ; Londyn
Évelyne, Maurice Blanchot romancier, Paris, Nizet, 1976 ; Préli Georges, La Force du dehors,
Fontenay-sous-Bois, Recherches, 1977.
4. Derrida Jacques, Parages, Paris, Galilée, 1986, p. 15.
5. Voir Antonioli Manola, Maurice Blanchot. Fiction et théorie, Paris, Kimé, 1999.
6. Voir Clandestine Encounters. Philosophy in the Narratives of Maurice Blanchot, Hart
Kevin (dir.), Notre Dame (In), University of Notre Dame Press, 2010.
7. Michael Holland a entrepris une telle démarche pour l’ensemble de la critique blanchotienne
(jusqu’en 2004), ouvrant la voie à une étude d’une plus grande ampleur des divers aspects de
l’œuvre de Blanchot, y compris sa fiction ; voir Holland Michael, « État présent : Maurice
Blanchot », in French Studies, vol. 58, no 4, octobre 2004. p. 533-538.
174
Blanchot.indb 174 29/11/13 11:56
elle n’institue rien que le mouvement de refus par lequel elle se constitue sans relâche et
sans relâche échoue à se constituer8. »
Un récit ?
Pour ajouter un récit à l’œuvre narrative de Blanchot, il s’agit paradoxalement de ren-
contrer son auteur au moment – mais un moment qui s’étend sur plusieurs années – où
les frontières génériques de son œuvre n’ont plus cours : discours critique, théorique,
philosophique, narratif, tout s’effondre au fur et à mesure des années soixante dans la
recherche de ce que Michael Holland a appelé un « nouvel idiome9 », radicalement
interrogateur de la pensée, du langage, et de l’écriture. Pour la fiction même, on sait que
la critique blanchotienne a été très sensible, pendant de nombreuses années, au point de
transition que représentait l’an 1948 avec la publication à la fois du « dernier » roman de
Blanchot, Le Très-Haut, et du « premier » récit, L’Arrêt de mort, suivie en 1949 par
Un Récit (?) (avec et sans le point d’interrogation ; le texte deviendra La Folie du jour10),
la « nouvelle version » de Thomas l’Obscur en 1950, et les trois autres récits des années
cinquante11. Les Éditions de Minuit n’ont pas manqué de troubler les eaux en ressusci-
tant en 1951 les deux récits Le Dernier mot et L’Idylle, tous deux déjà publiés en revue en
194712 mais en réalité rédigés entre 1935 et 1936, datant donc « d’avant » le premier
roman, Thomas l’Obscur, celui-ci pourtant en cours, selon l’aveu de Blanchot même,
8. Blanchot Maurice, « L’étrange et l’étranger », in La Nouvelle revue française, no 70,
octobre 1958, p. 673-683, repris dans La Condition critique : articles 1945-1998, Bident Christophe
(dir.), Paris, Gallimard, 2010, p. 288.
9. Voir Holland Michael, Towards a New Idiom : The Fiction and Criticism of Maurice Blanchot
from 1941-1955, Thèse, Philosophie, University of Oxford, 1982.
10. Voir Mole Gary D., « “Folie d’Auschwitz qui n’arrive pas à passer” : texture Lévinassienne
ou récit blanchotien ? », in Emmanuel Lévinas, Maurice Blanchot. Penser la différence, Hoppenot
Éric, Milon Alain (dir.), Paris, Presses universitaires de Paris Ouest, 2007, p. 461.
11. Il s’agit du Moment voulu (1951), de Celui qui ne m’accompagnait pas (1953), et du
Dernier homme (1957).
12. Voir Blanchot Maurice, « L’Idylle » (juillet 1936), in La Licorne, no 1, printemps 1947,
p. 33-58, et « Le Dernier mot » (1935), in Fontaine, no 60, mai 1947, p. 177-194 ; tous deux repris
dans Blanchot Maurice, Le Ressassement éternel, Paris, Les Éditions de Minuit, 1951, et encore
dans Blanchot, Après Coup, précédé par Le Ressassement éternel, op. cit.
175
Blanchot.indb 175 29/11/13 11:56
depuis 193213, ainsi gardant tout de même son statut privilégié de « socle de toute l’œuvre
narrative ultérieure de Blanchot14. » Quoi qu’il en soit, la désignation du récit qui aurait
déplacé et supprimé celle du roman dans la fiction de Blanchot devait elle aussi dispa-
raître avec L’Attente, l’oubli en 1962, le « dernier » récit de Blanchot, même si ni ce texte
ni celui qui l’a précédé, Le Dernier homme, n’ont affiché de terme générique. Dans cette
optique évolutionniste – du roman au récit et à la disparition de celui-ci – on devait
rester quelque peu dérouté par la présence de certains fragments dans Le Pas au-delà de
1973 et L’Écriture du désastre en 1980, qui semblaient porter encore les traces d’une écri-
ture de fiction qu’on pensait définitivement révolue. La publication inattendue de L’Ins-
tant de ma mort en 1994 n’a fait que basculer davantage la certitude catégorique,
catégorisante, déjà douteuse, que L’Attente, l’oubli avait été le dernier récit, car, quoique
sans mention générique, L’Instant de ma mort a été largement reçu comme un récit ou
tout au moins, à l’instar de Derrida dans Demeure, comme un texte hybride probléma-
tisant les rapports entre fiction et témoignage15. Si l’adieu au récit dans L’Attente, l’oubli
fut donc congédié pour accueillir trente ans plus tard L’Instant de ma mort, qu’en est-il
justement de ces fragments en italique publiés entre les deux, principalement dans Le
Pas au-delà mais aussi dans L’Écriture du désastre, et qui semblent en effet s’attacher
encore au discours narratif ? Si on mettait ces passages ensemble, de bout à bout, en
obtiendrait-on un récit, « le » récit d’entre 1962 et 1994, une sorte d’« entre-récit » ? La
fabrication d’une nouvelle fiction à part, mais dans le même enchaînement d’idées, dans
ces rebondissements, cette « indécidabilité radicale » récemment étudiée par Leslie Hill16,
qu’en est-il de ce texte liminaire dont les premiers mots sont « Le sentiment qu’il a… »,
dans L’Entretien infini ? C’est ce texte-là qui retient notre attention et que nous vou-
drions interroger dans cette étude.
13. C’est ce que Blanchot prétend dans les onze lignes introductives à la nouvelle version ; voir
Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, 2e version, Paris, Gallimard, 1950, p. 7. Notons en passant
que jusqu’à la quatrième édition de cette nouvelle version publiée en 1950, le texte longtemps
considéré par la critique comme un récit porte encore sur la couverture le terme de « roman ».
14. Madaule Pierre, « Retour d’épave », in Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur, 1re version
1941, Paris, Gallimard, 2005, p. 9.
15. Voir Derrida Jacques, Demeure, Paris, Galilée, 1998.
16. Voir Hill Leslie, Radical Indecision : Barthes, Blanchot, Derrida, and the Future of Criticism,
Notre Dame (In), University of Notre Dame Press, 2010.
176
Blanchot.indb 176 29/11/13 11:56
Le texte fut publié d’abord sous le titre « L’Entretien infini » dans le numéro 159 de La
Nouvelle Revue Française en mars 196617, le premier de deux textes seulement que publia
Blanchot au courant de l’année et précédé d’un côté par un article important sur Sade
en octobre 196518 et suivi de l’autre par un essai sur Nietzsche et l’écriture fragmentaire
en décembre 196619. De nombreux commentateurs ont fait mention, par divers biais, de
ce texte, mais rares sont ceux qui s’y sont penchés tout particulièrement et encore plus
rares ceux qui se sont aventurés à l’intégrer explicitement dans le corpus narratif de
Blanchot. C’est donc à juste titre que Christophe Bident dans son essai biographique sur
Blanchot n’hésite pas à qualifier ce texte de récit20, terme générique repris par deux autres
lecteurs qu’il convient de signaler, Christopher Fynsk et Éric Hoppenot.
Pour Bident, le récit qui ouvre le livre le plus volumineux de Blanchot, met en scène
deux hommes dont les « deux paroles » sont « épuisées par l’exigence de partage de
leurs rumeurs21 » ; il est « déjà comme surgi de la faiblesse », « surgi de cette époque où
la maladie à nouveau frappe son auteur et l’oblige au retrait22. » Esquisse de l’impuis-
sance, amenuisement des forces, extension de la fatigue, faiblesse de la voix narrative,
le récit, « régi par une crispation absolue qui tue l’être23 », traduit, pour Bident, le
« mouvement de vérité qui légitime, en ce seuil narratif, le pas vers l’autre que répétera
chaque article critique24. » C’est ainsi que Bident donne sens au texte dans une optique
non seulement rétrospective (« c’est toute la recherche narrative des années cinquante
17. Voir Blanchot Maurice, « L’Entretien infini », in La Nouvelle revue française, no 159,
mars 1966, p. 385-401 ; repris, sans titre, dans Blanchot Maurice, L’Entretien infini, Paris,
Gallimard, 1969, p. IX-XXVI, désormais cité entre parenthèses directement dans le corps de notre
texte sous la forme (E, pagination).
18. Voir Blanchot Maurice, « Français, encore un effort… », in La Nouvelle revue française,
no 154, octobre 1965, p. 600-618 ; repris sous le titre « L’insurrection, la folie d’écrire » in Blan-
chot, L’Entretien infini, op. cit., p. 323-342.
19. Voir Blanchot Maurice, « Nietzsche et l’écriture fragmentaire », in La Nouvelle revue
française, no 168, décembre 1966, p. 967-983 ; repris avec le même titre dans Blanchot, L’Entretien
infini, op. cit., p. 227-255.
20. Bident Christophe, Maurice Blanchot, partenaire invisible. Essai biographique, Seyssel,
Champ Vallon, 1998, p. 435.
21. Ibid., p. 449.
22. Ibid.
23. Ibid., p. 450.
24. Ibid.
177
Blanchot.indb 177 29/11/13 11:56
[…] qui se répercute sur la forme critique de l’entretien et du fragment25 »), mais éga-
lement prospective (le récit anticipe la thématique et la forme de l’entretien infini à
venir, « l’interruption comme sens et la rupture comme forme26. ») Bident accomplit
donc implicitement ce geste répandu dans la critique blanchotienne qui consiste à lire
la création narrative de Blanchot à la lumière de ses écrits théoriques et critiques. En
effet, il devient relativement aisé d’associer très concrètement le récit à de nombreux
chapitres du recueil L’Entretien infini qui aident par un mouvement précisément
rétrospectif à « éclairer » le texte qui inaugure le recueil. L’expérience de l’interruption,
l’exigence de la discontinuité, l’expérience non-dialectique de la parole, la parole
comme détour, la parole où les choses ne se cachent pas, ne se montrant pas, la parole
de l’attente où les choses sont retournées vers l’état latent, l’interruption qui introduit
l’attente qui mesure la distance entre deux interlocuteurs, parler par fatigue, malheur,
douleur27, et surtout les nombreuses pages consacrées au neutre, au rapport du troi-
sième genre, à l’écriture fragmentaire : ce sont là autant de mots, de phrases, d’études
qu’une lecture attentive saurait mobiliser pour faire signifier ce « dernier » entretien
(E, IX) qui ne peut que dérouter de premier abord.
Christopher Fynsk ne résiste pas, lui non plus, à la tentation pour « expliquer » le récit
de renvoyer le lecteur à des études ultérieures dans L’Entretien infini, notamment par
rapport aux notions de la fatigue, du dialogue, de l’altérité, de l’insuffisance, et de la rup-
ture, même s’il fait également mention en passant de L’Amitié, de L’Arrêt de mort, et de La
Folie du jour – mais aussi de Heidegger qui ferait « parler le langage dans son essence » et
de la curieuse expression « une existence sabbatique » chez Lévinas28. Ces divers renvois
ne viennent pas pourtant obscurcir la lecture judicieuse de Fynsk de ce qu’il refuse, lui, de
reconnaître comme « un simple récit », y voyant plutôt « le parcours de cet espace neutre
que Blanchot dessine à plusieurs reprises dans L’Entretien infini lorsqu’il examine les rap-
ports multiples qui s’établissent dans une conversation entre deux hommes où l’impossi-
bilité est en jeu29. » Pour Fynsk, il s’agit d’un texte en deux parties : celle qui consiste en la
25. Ibid., p. 436.
26. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 9.
27. Ibid., p. 5, 9, 90, 28, 41, 43, 108, 111.
28. Voir Fynsk Christopher, « Un simple changement », in Blanchot dans son siècle, colloque
[Cerisy-la-Salle, 2-9 juillet 2007], textes rassemblés par Monique Antelme, Gisèle Berkman,
Christophe Bident et al., Lyon, Parangon-Vs, « Sens public », 2009, p. 228-236.
29. Ibid., p. 229.
178
Blanchot.indb 178 29/11/13 11:56
visite « sans cause précise » du « visiteur » à l’« hôte » dont la fatigue « dépasse la
défaillance physique » et où l’interruption ou l’effacement de l’amitié semble être le rap-
port principal entre les deux ; et une deuxième partie qui témoigne de l’entrée dans la
fatigue du cercle où se produit un dédoublement du dialogue par lequel le narrateur qui
occupait la place du visiteur se déplace pour occuper celle de l’hôte. Un autre rapport
entre les sujets s’installe, un déplacement fondamental où le visiteur, devenu autre, « entre
dans l’espace de la solitude qui n’est pas une solitude, mais plutôt un espace neutre où son
dessaisissement ou désœuvrement se réfléchit infiniment30. » Se dessine alors, à la fin du
texte, un espace de l’écriture où « le sujet de cette “expérience”, le lieu-tenant d’un sujet,
apprend à vivre […] à cette limite – ou cette rupture – du pouvoir parler que Blanchot
nomme [plus loin dans L’Entretien infini] “le désœuvrement (peut-être de la pensée)”31. »
Sans forcément remettre en cause cette lecture, notons en passant qu’en identifiant, ne
serait-ce que pour faciliter le discours critique, les deux voix anonymes comme « visi-
teur » et « hôte », Fynsk cède à la tentation de la « référentialité » dont Brian Fitch nous
aurait appris à nous méfier depuis son étude des récits de Blanchot de 199232.
Pour sa part, Éric Hoppenot, dans un article en partie consacré aux emprunts de Barthes
à Blanchot pour les figures de la Fatigue et du Neutre, place le récit, comme toute l’œuvre
de Blanchot, entièrement sous le signe ontologique de la Fatigue, une Fatigue pourtant qui
n’est ni conceptualisée, ni théorisée, ni l’objet d’une approche phénoménologique33. Pour
Hoppenot, le récit qui ouvre L’Entretien infini est à rattacher à toute une « littérature de
l’épuisement » qui caractérise une certaine littérature moderne – et autant qu’on puisse en
juger par l’essai de Dominique Rabaté, Vers une littérature de l’épuisement, dont la formule
est elle-même empruntée à un article de 1967 de l’écrivain américain John Barth34,
Hoppenot aurait tout à fait raison – mais en même temps la fatigue blanchotienne telle
qu’elle se manifeste dans le récit est profondément singulière. Aussi, selon Hoppenot, dans
une série d’énoncés qui semblent décrire le non-conceptualisable, « le temps de l’écriture
fragmentaire marque celui de la Fatigue, de l’exténuation, de l’épuisement du corps
30. Ibid., p. 235.
31. Ibid.
32. Voir Fitch Brian T., Lire les récits de Maurice Blanchot, Amsterdam, Rodopi, 1992.
33. Voir Hoppenot Éric, « Écriture et Fatigue dans les œuvres de Roland Barthes et Maurice
Blanchot », in Maurice Blanchot, de proche en proche, Hoppenot Éric, Manoury Daiana (dir.),
Paris, Éditions Complicités, 2008, p. 175-192.
34. Voir Rabaté Dominique, Vers une littérature de l’épuisement, Paris, José Corti, 1991, p. 175.
179
Blanchot.indb 179 29/11/13 11:56
et de la raréfaction de la parole » ; « le temps de “l’absence de temps” s’éprouve comme un
excès de Fatigue » ; « Si la Fatigue est une perte de pouvoir sur soi, sur le monde, la Fatigue
est aussi le temps de l’écriture, le temps circulaire du repliement sur soi35. » Comme Fynsk,
Hoppenot identifie deux parties au récit, celle qui « théâtralise une structure à deux voix
qui s’usent peu à peu à circonscrire la fatigue », et celle où « ce ne sont plus les deux voix
des “personnages” qui parlent, mais le narrateur qui s’entretient avec lui-même36 », mais il
souligne également toute la structure paradoxale de la Fatigue qui bloque l’accès à la vérité
qu’elle promet de révéler, constitue elle-même l’obstacle à l’entretien qu’elle rend possible
et où, finalement, « le sujet est épuisé, à bout, il ne peut aller plus loin, faire un “pas au-delà”,
et en même temps la Fatigue se trouve être une formidable matrice générative37. » D’où,
toujours selon Hoppenot, la métaphore du cercle qui exprime la claustration : la Fatigue
enferme les personnages et leur parole dans un entretien infiniment différé38.
Si nous avons longuement insisté sur ces lectures, ce n’est pas pour nous inscrire en faux
contre elles. Chacune à sa façon est percutante et légitime, soutenue par le texte même de
Blanchot, lequel ainsi, peut-on dire, l’absorbe à son tour. Notre effort dans ce qui suit est
plutôt de prolonger, de soutenir, et de renforcer ces lectures, à cette différence près que
nous entendons « décontextualiser » le récit, le lire en faisant abstraction autant que pos-
sible de son contexte de texte liminaire, de son statut de texte anticipatoire, afin de le
retrouver dans la solitude et l’isolement de sa première publication de mars 1966, sans
passé, sans avenir, sans « hors texte », dans le présent infini, ou l’infini présent où deux
« amis » se retrouvent pour parler, se parler. Tout texte littéraire est certainement le produit
complexe d’un contexte historique, politique, culturel – et biographique, ne soyons pas
trop faussement naïfs – mais l’avantage d’isoler ainsi le récit (car Bident, Fynsk, et Hoppe-
not ne se sont pas trompés, il en est assurément un), est de nous permettre de mieux cerner
quelques-uns de ses mécanismes internes, sans nous perdre dans « une parole qui lui est
extérieure », pour emprunter une formule au récit même (E, XIX). Notre commentaire
s’articule en cinq parties ; si nous affirmons qu’il s’agit bel et bien d’un récit, nous ne pré-
tendons aucunement épuiser toutes ses résonances textuelles.
35. Hoppenot Éric, « Écriture et Fatigue dans les œuvres de Roland Barthes et Maurice
Blanchot », in Maurice Blanchot, de proche en proche, op. cit., p. 186.
36. Ibid., p. 188.
37. Ibid., p. 187.
38. Ibid., p. 189.
180
Blanchot.indb 180 29/11/13 11:56
La forme, plus ou moins
Ce qui frappe le lecteur de premier abord, c’est la double forme du récit, celle de
l’entretien qui n’est pas la simple transcription d’une conversation ou d’une discussion,
et celle du fragment, dont il y a vingt-huit au total, tous en italique et d’une longueur
inégale, chacun séparé par le binôme de deux plus sur deux moins (±±), « comme si »,
comme le dit à juste titre Christophe Bident, « chaque signe algébrique indiquait la sus-
pension et la neutralité de ce qui s’avance, séparé, dans la juxtaposition des deux voix
anonymes39. » Plus « ou » moins, plus « et » moins, « ni » plus « ni » moins, ni l’un ni
l’autre (et doublement le cas), les deux formes sont déroutées conjointement l’une par
l’autre dans un texte qui se divise pourtant, de manière asymétrique, en deux parties : les
commentateurs, on l’a vu, n’ont pas manqué de remarquer cette division, sans cepen-
dant s’accorder sur le moment où elle s’opère. Pour notre part, la division intervient
après le dix-septième fragment (E, XXI) qui contient le dernier échange de paroles entre
les deux voix, laissant onze fragments à la fin où le « je » du narrateur se dédouble pour
s’entretenir avec un « tu », lui-même ou un autre, lui-même « comme » autre, encore
que tout le récit, vu de manière pragmatique, n’est qu’une mise en scène où Blanchot
(s’extériorisant) s’entretient avec lui-même.
Une simple rencontre
Dès les premiers mots de la première partie, Blanchot semble offrir un scénario à
déchiffrer. En effet, comme en témoigne la lecture de Fynsk, on peut s’accrocher à des
bribes de récit qu’on s’efforce par la suite de traduire en images concrètes. À parcourir
donc les sept premiers fragments, sous la tutelle par exemple de l’effet de réel barthé-
sien, l’approche qui consiste à vouloir lire le récit de manière référentielle, autrement
dit à visualiser une histoire ou une intrigue, nous donne la scène suivante : un homme
rend visite, suite à des lettres ou des coups de fil reçus, à un ami qui habite un appar-
tement, peut-être une maison, ou à peine une chambre. L’ami en question se lève
pour lui ouvrir la porte au seuil de laquelle ils se tiennent un temps, immobiles. Le
seuil enfin franchi, ils s’assoient autour d’une table, de sorte qu’ils semblent adresser
la parole à une tierce personne plutôt qu’à eux-mêmes. L’un d’eux se lève à un certain
39. Bident Christophe, Maurice Blanchot, partenaire invisible, op. cit., p. 447.
181
Blanchot.indb 181 29/11/13 11:56
moment et se dirige vers des rayonnages où se trouvent une quantité de livres. Mais
surtout, ces hommes, réunis par l’amitié, sont fatigués, aux prises avec une lassitude
écrasante, au bord de l’épuisement. Cette fatigue est-elle physique ? On hésite, on
pense sentir que oui, mais on sent aussi qu’elle est autre chose. Et l’action s’arrête là.
L’histoire prend fin. Il ne se passe plus rien. La concrétisation des référents ne peut
aller plus loin. Non-linéaire, la narration nous confond. La phrase « un peu plus
tard » qui y figure à plusieurs reprises, ne permet pas d’établir une chronologie d’évé-
nements ; la nuit s’établit au grand jour autour des interlocuteurs. Force est de consta-
ter alors que la farouche résistance du récit à toute construction visuelle, à toute
matérialisation de sa mise en scène, fait échouer des codes herméneutiques qui
régissent la description réaliste. Blanchot semble afficher dans le texte même cet échec
inévitable lorsqu’il fait dire à son narrateur dans la deuxième partie du récit, que
« parler, ce n’est pas voir » (E, XXII). Sans vouloir réduire parler et écrire à des actes
identiques, à des reflets l’un de l’autre, tout porte à croire que le récit de Blanchot
n’est pas à « voir », n’est pas à visualiser au-delà des images les plus rudimentaires. Le
récit, en revanche, « dit ». Il est « à dire ». Il est l’« entretien » même. Ce qui pousse
l’effort interprétatif à un tout autre niveau de lecture, s’intéressant non pas à ce que
« raconte » le texte (qu’on peut réduire à la limite à une simple rencontre de deux
hommes anonymes dans un appartement quelconque), mais à ce que « dit » le texte :
de quoi s’entretiennent ces deux voix ?
L’entre-dire de l’entretien
Se penchant précisément sur cette question, Éric Hoppenot arrive à la conclusion que
les deux hommes ne s’entretiennent de rien. « L’entretien », écrit-il, « n’a pas comme
finalité l’échange de pensées, de sentiments, de thèses, il faudrait davantage lire cet entre-
tien comme une genèse qui avorte40. » Hoppenot n’a pas tort, mais ce qu’il dit est vrai en
partie seulement, car manifestement un échange de pensées a bien lieu dans ce récit qui,
comme on vient de le constater, résiste à la visualisation, refuse de s’ériger en histoire,
mais qui se donne au dire. Les interlocuteurs le reconnaissent dès le début : ils sont là,
l’un appelé par l’autre (mais celui-là serait venu sans l’appel de celui-ci), pour parler de
40. Hoppenot Éric, « Écriture et Fatigue dans les œuvres de Roland Barthes et Maurice
Blanchot », in Maurice Blanchot, de proche en proche, op. cit., p. 187.
182
Blanchot.indb 182 29/11/13 11:56
l’« événement » à l’égard duquel il ne convient pas d’être bienveillant, dit l’un, mais
qu’ils se sont promis d’évoquer aujourd’hui, dit l’autre (E, IX). Pour en parler enfin :
« enfin » car cet entretien « est commencé depuis longtemps » (E, IX) ; enfin car « cet
entretien sera le dernier » (E, IX). Un événement donc difficile à accueillir dans la bien-
veillance de la parole, un événement ou un fait auquel vient aboutir une situation. Doit-
on en conclure que quelque chose s’est passé ? Mais rien ne s’est passé. L’événement est
récalcitrant. Il vient, s’il vient, sans passer, sans se passer. Tout comme l’histoire, l’événe-
ment lui aussi résiste. Cet événement qu’ils cherchent depuis longtemps à évoquer n’est
pas advenu. Il est sa propre impossibilité : « Un événement », écrit le narrateur dans le
douzième fragment, « cela qui pourtant n’arrive pas, le champ de l’inarrivée et, en même
temps, ce qui, arrivant, arrive sans se rassembler en quelque point défini ou détermi-
nable – la survenue de ce qui n’a pas lieu comme possibilité une ou d’ensemble » (E,
XIX). Tel quel, dans le champ de l’inarrivée, l’événement ne peut concerner un sujet. Il
est ce que le narrateur appelle « le non-concernant » (E, XXIII), le désintéressé, ce qui ne
concerne personne, ce qui ne se concerne pas (E, XXIII). Il ne peut alors être l’objet
d’une réflexion, être l’objet phénoménologique se livrant à la conscience et à la descrip-
tion. C’est pourquoi cet événement ne fait pas évoluer un dialogue entre les interlocu-
teurs : la « genèse qui avorte », dans la formule de Hoppenot. L’entretien ne saurait
avancer à partir ou autour de l’événement sans que la parole soit contrainte à tourner en
rond. Mais justement, « engagés dans le même discours » (E, XIV), précise le texte, les
interlocuteurs tournent en rond. L’entretien avance comme en reculant, un pas en avant,
trois pas en arrière, repoussant la dialectique dialogique d’affirmation et de contradic-
tion. Comme on l’a vu, le paradoxe est déjà signalé dans les signes algébriques des
binômes qui président sur chaque fragment, les plus et les moins, ni plus ni moins,
situant l’entretien dans un « entre-dire » (E, XXVI) qui défait le discours de la raison, de
l’unité, de la loi, de la parole générale et quotidienne. Ainsi l’entretien est inter-dit,
imposant sur lui-même l’interdiction de se construire en dialogue. Dans cette parole qui
tient incessamment et infiniment « entre », les interlocuteurs ne sont pas davantage
capables de disparaître, de se taire, que les livres sont capables d’être achevés. On écrit
toujours et pour toujours le dernier mot, sans le prononcer. « La tâche reste inachevée »,
écrit le narrateur (E, XII).
183
Blanchot.indb 183 29/11/13 11:56
La fatigue fatigante
De cette situation Blanchot tire tout le paradoxe du récit : la condition de l’entretien
est la fatigue, non pas la fatigue physique finalement ou la fatigue de la « défaillance
physique41 », comme le remarque Fynsk, et non plus la fatigue qui s’énoncerait « dans
une parole mélancolique, dépressive, voire suicidaire42 », selon les dires de Hoppenot,
mais la fatigue qui épuise la parole même qui tente de l’exprimer. Rejetant toute
caractérisation psychologique, Blanchot nous donne des interlocuteurs diaphanes à
l’extrême-limite de l’épuisement en train d’épuiser la parole qui loin de les rapprocher
les éloigne dans une séparation infinie, leur rapprochement étant la séparation même,
la distance qui les éloigne l’un de l’autre. L’événement qui ne se laisse pas cerner, ne
concernant pas, ne se concernant pas, devient dès lors la mise en abîme de la
représentation du récit qui ne s’actualise pas autrement que par l’entretien impossible.
L’événement est la fatigue qui est l’interruption qui est l’événement qui est la fatigue,
et ainsi de suite, comme une rose est une rose est une rose chez Gertrude Stein… De
cette perspective infiniment circulaire, les deux phrases des douzième et dix-huitième
fragments sont à rapprocher l’une de l’autre : « Qu’est-ce donc que cet événement sous
lequel, fatigué, il se tiendrait fatigué ? » (E, XIX) ; « Quand il parle de fatigue, il est
difficile de savoir de quoi il parle » (E, XXI).
Éric Hoppenot a déjà étudié la fatigue dans le récit, il n’est pas dans nos propos de
revenir sur ses excellentes analyses. Nous nous contentons de signaler que la fatigue est
ce qui rend à la fois possible et difficile l’entretien (E, X). Ce n’est ni avec ni par la
fatigue que les interlocuteurs n’arriveront à dire l’événement qui, en fin de compte,
n’est que cette impossibilité de dire, de se dire, et peut-être, comme nous venons de le
suggérer, n’est que la fatigue elle-même – « peut-être » car tout dans les récits de
Blanchot est à placer sous le signe de l’hypothèse interprétative. Tout comme
l’événement, la fatigue ne saurait figurer comme l’objet d’une pensée : « de quoi parle-
t-on quand on parle de fatigue » est une question « insensée », vouée à rester sans
réponse, car toute réponse s’épuise déjà dans la question. C’est le propre de la fatigue
de ruiner toute tentative de la dire, c’est la raison pour laquelle finalement il y a transfert
41. Fynsk Christopher, « Un simple changement », in Maurice Blanchot, de proche en proche,
op. cit., p. 230.
42. Hoppenot Éric, « Écriture et Fatigue dans les œuvres de Roland Barthes et Maurice
Blanchot », in Maurice Blanchot, de proche en proche, op. cit., p. 185.
184
Blanchot.indb 184 29/11/13 11:56
entre ce qu’en disent les interlocuteurs et le narrateur du récit et ce que nous pouvons
en dire : ainsi, comme on l’a vu, lorsque Éric Hoppenot affirme dans une série de phrases
que la fatigue est le temps de l’écriture, que la fatigue est l’épuisement de la parole, ou
que dans la fatigue le sujet se vide, épuisé, il tend vers la description du non-descriptible.
Nous n’avons pas échappé à cette tentation. Ne serait-ce pas inévitable dès que le discours
critique – celui qui tire vers la clarté et la lumière, celui que Blanchot aurait tenté de
remettre radicalement en cause à partir de la fin des années cinquante, à commencer par
le sien propre – dès que le discours critique cherche à se séparer du texte de Blanchot, à
s’en éloigner pour ne pas le reproduire, pour ne pas faire « du » Blanchot ? Peut-être. La
fatigue fatigue, il est vrai, de par ce qu’elle promet comme vérité et révélation et de par
ce qu’elle interdit l’accès à ce qui pourrait être vrai et révélé.
Cet accent sur la vérité de la fatigue n’a pas été suffisamment souligné. Hoppenot la
note en passant, mais les mots « vrai », « vraiment », « vérité » figurent jusqu’à dix-huit
fois dans le récit, témoignant d’un discours de ou sur la vérité, une vérité qui n’est pas à
voir et qui s’affiche tout en s’annulant. On suit les méandres et les détours du texte à la
recherche de cette vérité, convaincu de pouvoir la dévoiler mais devant se résigner fina-
lement au fait que cette vérité, quelle qu’elle soit, ne s’articule pas. C’est un peu à la
manière dont on peut affirmer que Blanchot écrit non sans humour – comme en
témoignent la « gaieté » de l’un des interlocuteurs et les rires qu’ils partagent à plusieurs
reprises – pour se résigner enfin à notre incapacité de définir cet humour qui ne fait ni
rire ni sourire. « Humour funeste », dit Bident, sans grande conviction43. En fin de
compte, si l’événement à évoquer est la fatigue et la fatigue est l’événement, les interlo-
cuteurs sont entraînés, tout comme le narrateur, dans un cercle qui dès qu’il se prononce
est déjà une « absence de cercle », un « autre cercle » et qui, contrairement à ce qu’on
pourrait penser, n’enferme pas celui qui y entre : « De cet autre cercle », écrit le narrateur,
« il sait seulement qu’il n’y est pas enfermé et, en tout cas, qu’il n’y est pas enfermé avec
lui-même. Au contraire, le cercle qui se trace – il oublie de le dire : le trait commence
seulement – ne lui permet pas de s’y comprendre. C’est une ligne ininterrompue et qui
s’inscrit en s’interrompant » (E, XVII).
43. Bident Christophe, Maurice Blanchot, partenaire invisible, op. cit., p. 450.
185
Blanchot.indb 185 29/11/13 11:56
Le cercle qui n’en est pas un
Ainsi Blanchot fait intervenir dans le récit un nouveau paradoxe : le cercle ou l’absence
de cercle ou encore l’autre cercle se trace comme une ligne ininterrompue qui s’inter-
rompt. Ayant perdu le pouvoir de s’exprimer d’une manière continue, le narrateur, à la
fois « je », « tu », « il » et dont il s’agit de façon plus explicite dans la deuxième partie du
récit, entre dans le cercle (disparaissant) par le biais de l’écriture, accentuant d’un côté le
discours logique où la raison est à l’œuvre, « cherchant l’identité et l’unité » (E, XXII), et
de l’autre le « mouvement ininterrompu de l’écriture » (E, XXII). C’est dans ce mouve-
ment que s’affirme ce que le narrateur appelle « la force froide de l’interruption » où le
dialogue ne s’arrête pas – ce dialogue qui n’en est pas un, ne demandant ni acquiesce-
ment ni réfutation, « n’affirmant ni ne retirant rien » (E, XXIV) – mais fait disparaître à
jamais l’espace commun auquel appartiennent les interlocuteurs. « Interruption : une
douleur, une fatigue », écrit le narrateur, une interruption qui se présente surtout comme
« la brèche ouverte dans le cercle » (E, XXVI), brèche par laquelle le sujet écrivant est
expulsé du cercle dans lequel il est entré. Ni dedans ni dehors, cet espace serait en fait
temporel, celui d’un présent infini, la « parole de l’éternité temporelle, disant : mainte-
nant, maintenant, maintenant ! », autrement dit « le temps de l’entre-dire » (E, XXVI).
C’est dans le tout dernier fragment que Blanchot, obscur peut-être mais qui n’a jamais
cherché l’obscurantisme, semble se relaxer, livrant quelques expressions qui se présen-
tent comme les clés d’un texte énigmatique : « Comment en était-il venu à vouloir l’in-
terruption du discours ? » (E, XXVI) demande le narrateur. Cette interruption ne serait
ni la pause légitime qui permet l’échange de paroles entre deux interlocuteurs, telle
qu’on la trouve dans la première partie du récit où les deux voix anonymes tentent avec
un calme désespoir d’évoquer l’événement qui leur échappe ; et elle n’est pas non plus le
silence austère de la parole tacite, ce silence qui précède et prépare la formulation de la
parole et qui correspond peut-être à ce que Nathalie Sarraute a appelé les « tropismes ».
L’interruption voulue, celle vers laquelle tend tout le récit, est l’interrruption froide,
« la rupture du cercle » (E, XXVI). Ainsi, simultanément entraîné dans le cercle par le
mouvement ininterrompu de l’écriture – où même quand, enfin, on n’écrit pas, on
écrit qu’on n’écrit pas – et expulsé du cercle tracé par l’interruption froide, le sujet
écrivant se trouve – se perd, devrais-je dire, car le sujet serait expulsé lui-même, de lui-
même – se trouve donc, pour ainsi dire, radicalement hors-la-loi – hors la « seule loi »
qui « consiste dans ce discours unique continu universel » (E, XXIV) –, ex-centrique,
186
Blanchot.indb 186 29/11/13 11:56
ex-ilé, étranger comme seule peut l’être, selon le narrateur, une personne à ce point
fatiguée (E, XIII), errant dans un entre-dire tendu vers son effacement, vers sa pulvéri-
sation, vers sa disparition, œuvrant pour son désœuvrement, puisant dans l’épuise-
ment de sa propre parole incessante et interminable.
Toujours et jamais le dernier mot
Dans le récit « L’Entretien infini » devenu récit liminaire sans titre, « Le sentiment qu’il
a… », se tenant au seuil du volume auquel il fait don de son nom, Blanchot poursuit sous
la double forme de l’entretien et du fragment, une série de « sorties » : une sortie d’abord
de « l’histoire flamboyante, riche de sens, cependant immobile, à laquelle tous
paticip[ent] » (E, XVIII), comme le dit le narrateur, l’histoire qu’il convient d’entendre
dans les deux acceptions du terme : « histoire-fiction » (impossible dès lors de remonter
le fil de la représentation), et « histoire-événement » (impossible dès lors de retracer le fil
événementiel) ; une sortie ensuite de l’ontologie de l’être dans sa coïncidence avec soi, afin
d’opérer cette altération qui serait la brèche ouverte vers l’autre (impossible dès lors de
fixer dans un sujet quelconque la voix narrative) ; une sortie enfin de la pensée, du dis-
cours unique, de toute autorité s’érigeant en loi (et impossible dès lors de penser l’espace
temporel de l’entre-dire). Ces sorties ou « évasions », liées l’une à l’autre comme par un
cordon ombilical, ne sont ni l’objet d’une intentionnalité ni le sujet d’une dialectique où
la pensée ne ferait que s’affirmer dans sa propre négation. Il s’agit plutôt d’une expérience
non-dialectique de la parole que Blanchot nomme dans le récit le « neutre », le neutre qui
« sonne étrangement pour “moi” » (E, XXII) et qui est la « fatigue » même dont la pro-
priété essentielle est de défaire le discours que paradoxalement elle permet et d’épuiser
jusqu’au dénuement ses propres ressources, y compris le sujet qui l’exprime. Le neutre, la
fatigue, ou l’interruption froide qui ne laisseraient plus de possibilité au récit, hormis une
seule : la possibilité de se relancer infiniment, ainsi traçant « le mouvement ininterrompu
de l’écriture » que Blanchot aurait inauguré avec Thomas l’Obscur et/ou Le Dernier mot
dans les années trente, et bouclé avec L’Instant de ma mort soixante ans plus tard. Mais ces
origines et cette apparente finalité, si elles tracent un cercle, n’ont de cesse d’être inter-
rompues : interruption de l’être, du mot d’ordre, de la mort. Le récit « L’Entretien infini »
participe à ce mouvement à un moment convulsif : la rupture du cercle est-ce à quoi se
donne l’entretien. Les derniers mots du récit, « le cœur cessant de battre, l’éternelle pul-
sion parlante s’arrêtant » (E, XXVI), sont eux-mêmes soumis à l’interruption : la voix
187
Blanchot.indb 187 29/11/13 11:56
narrative de Blanchot, la rumeur de sa parole, le murmure de ses mots, sont un long appel
non à la mort et non à mourir, mais « au » mourir : « le » mourir, infinitif substantivé qui
échappe à tout pouvoir et à tout vouloir, la mort résonnant dans sa verbalité. Ce sont ces
résonances que nous entendons dans le texte « L’Entretien infini » ou « Le sentiment qu’il
a… » et pour lequel nous soutenons la revendication du statut de récit blanchotien.
Il se peut que nous ayons « mal » entendu, mais ce malentendu – être induit en erreur –
est la possibilité vers laquelle tend toute lecture de l’œuvre narrative de Blanchot. Et c’est
pourquoi le dernier mot sur le dernier entretien de Blanchot restera toujours à dire ; il ne
peut appartenir ni au texte ni à son commentaire, mais à l’entre-deux, comme si le texte,
déjouant d’avance toute ressource interprétative, appelait et congédiait au même
moment son lecteur, s’affirmant et se disparaissant dans le mouvement de l’écriture. Du
moins, pour le lecteur, c’est « le sentiment qu’il a » chaque fois qu’il entre dans ce récit.
Lecture épuisante, inépuisable, de ce dernier entretien commencé depuis longtemps et
qui ne cesse de prendre fin.
Blanchot.indb 188 29/11/13 11:56
Le problème des espaces dans Le Dernier homme.
Du récit à l’écriture fragmentaire
Huges Choplin
U
ne hypothèse est à l’origine de ce texte : le problème des espaces, tel qu’il se
pose dans Le Dernier homme, conduit Blanchot à rompre avec la logique même
des récits et à faire valoir une nouvelle écriture, essentiellement non narrative :
« l’écriture fragmentaire ». De façon à construire cette hypothèse (voir § 3), il convient,
d’abord, de s’attacher à prendre la mesure du problème blanchotien des espaces. Dans
cette perspective, nous identifierons « quatre types d’espace » qui caractérisent l’univers
du Dernier homme (voir § 1). Puis, nous soutiendrons que le problème posé par l’articu-
lation de ces espaces se résout chez Blanchot par l’« ouverture » – « non événemen-
tielle » – de ce que nous proposons d’appeler un « milieu atopique » (voir § 2).
Ce travail prolonge une recherche sur Blanchot qui s’emploie à montrer dans quelle
mesure celui-ci se soustrait à une logique qui nous paraît structurer en profondeur un
espace important de la philosophie française contemporaine – de Lévinas à Alain Badiou
en passant par Foucault, Deleuze et Jean-Luc Marion – : la « logique de l’événement ».
Sans nier l’hétérogénéité, à certains égards, de ces différentes problématiques, nous
soutenons en effet que, chez tous ces auteurs, s’atteste le primat d’« une épreuve de
189
Blanchot.indb 189 29/11/13 11:56
l’événement1 ». Épreuve de l’événement : nous désignons ici le « renversement du
pouvoir du sujet » par « une force » – une « autorité » ou bien une « puissance » –
événementielle, cette épreuve conduisant, dans le premier cas (celui de l’autorité), à
instituer une subjectivité inédite (Lévinas, Marion ou Badiou) ou bien plutôt, dans le
second (celui de la puissance), à faire valoir une impersonnalité irréductible (Deleuze).
Il est indiscutable que la recherche de Blanchot obéit à cette logique contemporaine de
l’événement, du moins dans la mesure où elle mobilise une puissance impersonnelle, proba-
blement proche de celle de Deleuze2. Mais l’« enveloppement » du milieu atopique qu’engage
– aussi – Le Dernier homme, n’affranchit-il pas Blanchot de cette logique contemporaine ?
Les espaces dans Le Dernier homme
Éléments introductifs
Nous privilégions ici l’analyse des espaces « objets » du Dernier homme, nous pour-
rions dire : des espaces de l’« histoire » – plutôt que de la « narration » (selon la distinc-
tion proposée par Genette) – si ce texte blanchotien ne venait, justement, remettre en
cause la logique même des récits. De toute façon, il faut d’emblée préciser que, du point
de vue de Blanchot, ces espaces de « l’histoire » décrivent d’abord, très probablement,
dans Le Dernier homme – comme dans les autres textes blanchotiens contemporains de
cet ouvrage théorique qu’est L’Espace littéraire –, l’espace même – non mondain, imper-
sonnel, neutre – qu’ouvre l’« écriture » comme telle.
La première partie du Dernier homme se déroule dans un lieu près de la montagne, d’où
l’on peut voir la mer – un lieu réunissant, semble-t-il, des personnes malades. Elle est consa-
crée à la description des « rapports entre trois personnes » : le narrateur, probablement un
écrivain ; une jeune femme, présente depuis longtemps dans ce lieu, et le dernier homme,
« peut-être » « bien plus âgé3 » que le narrateur et cette jeune femme. La seconde partie du
1. Voir Zarader Marlène, L’Être et le neutre. À partir de Maurice Blanchot, Lagrasse, Verdier,
« Philia », 2001, p. 82-83 ; Choplin Hugues, L’Espace de la pensée française contemporaine. À partir
de Lévinas et Laruelle, Paris, L’Harmattan, « Nous, les sans-philosophie », 2007, p. 260.
2. Sur l’épreuve blanchotienne de l’événement, voir Blanchot Maurice, L’Espace littéraire,
Paris, Gallimard, « Folio/Essais », 1999, p. 323.
3. Blanchot Maurice, Le Dernier homme, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 2007, p. 25.
190
Blanchot.indb 190 29/11/13 11:56
texte, plus abstraite, ne mentionne plus explicitement ces trois personnes (de ce point de
vue, le dernier homme semble bien disparaître) ; elle engage bien plutôt les rapports entre
un « je » et un « toi » principalement, mais aussi entre ce « je », un « il » et un « nous », pro-
noms dont rien ne nous dit qu’ils indiquent des personnes concrètes.
Que, dans l’ensemble du texte, l’espace prime dans l’examen de ces rapports, on peut le
montrer en soulignant combien « toutes » les composantes importantes mobilisées par ce
texte semblent comprises « spatialement ». Mentionnons ici trois exemples significatifs :
– le dernier homme lui-même est décrit, par exemple, comme un « grand vide » que
l’on peut « pénétrer » ou « remplir4 » ;
– l’« attente » – composante pourtant « temporelle » – est décrite comme portée
étrangement par l’espace5 ;
– enfin, la « souffrance », elle aussi, relève d’un espace6.
L’espace semble ainsi structurer toutes les composantes du texte, comme si ces com-
posantes, certes irréductibles à l’espace, venaient néanmoins colorer un espace les
structurant au préalable. Mais de quel espace – ou de quels espaces – s’agit-il ?
Dans cette étude du Dernier homme, nous nous en tiendrons à l’analyse des espaces
« concrets », c’est-à-dire susceptibles a priori de s’inscrire dans nos vies ordinaires : des
corps, des tables, des couloirs, de la lumière, etc. Nous estimons que cette analyse – qui
nous conduit à distinguer quatre types d’espace concret – rend possible une première
approche de la complexité des dimensions de l’espace blanchotien7.
Quatre types d’espace
Cette identification, au sein du Dernier homme, de quatre types d’espace a été rendue
possible par la confrontation de ce texte et de problématiques théoriques contempo-
4. Ibid., p. 60.
5. Ibid., p. 143-144.
6. « […] cet espace de souffrance », ibid., p. 89.
7. Cette analyse devrait être complétée par une prise en compte des espaces « abstraits », presque
mathématiques ou géométriques, également requis par Le Dernier homme : « point », « ligne »,
« sphère », « vide », etc. C’est probablement une spécificité de l’écriture de Blanchot – du moins
de celle qui se déploie dans Le Dernier homme – que de conjuguer étroitement, parfois dans la
même phrase, ces deux genres d’espace, concret et abstrait.
191
Blanchot.indb 191 29/11/13 11:56
raines : celles de Merleau-Ponty, Lévinas et Deleuze et, sur un plan sociologique, de
Bruno Latour et Dominique Vinck. Aussi différentes soient-elles, toutes ces probléma-
tiques partagent avec Blanchot l’exigence de faire valoir un « espace impersonnel » ou,
du moins, un espace non subordonné à une « substance subjective ».
Le premier type d’espace requis dans Le Dernier homme désigne des « lieux-corps » :
un « visage » – lieu-corps très présent dans la seconde partie du texte8 –, mais aussi : une
paupière, une bouche, un bras, des dents, un pied, une jambe, une cuisse, un front, une
épaule, une tête, des genoux.
L’espace est donc ici défini par un lieu particulier : le « corps » ou une partie du corps. Plus
précisément, à une exception près (celle du cœur9), les lieux-corps requis par Blanchot ne
sont pas des parties « intérieures » au corps (comme des organes) qui conduiraient à penser
les personnes de « l’histoire » comme des « substances », devant être qualifiées en elles-
mêmes. Au contraire, on peut considérer que, dans la lignée peut-être de la phénoménologie
de Merleau-Ponty10, tous ces lieux-corps (visage, bras, etc.) marquent l’« ouverture » des
personnes aux rapports qu’ils entretiennent avec un dehors, extérieur à eux-mêmes.
Le deuxième type d’espace désigne des « lieux-objets », tels : un « lit », une « table », un
« fauteuil », un « piano », une « borne », un « pieu ». Sans doute peut-on distinguer, parmi
ces lieux-objets, des lieux qui, tel un « lit », sont très proches des « lieux-corps » (en tant
qu’ils semblent prêts à les accueillir) et des lieux-objets qui, telle une « table », touchent sans
doute davantage à ce qui se passe « entre » les trois personnes du Dernier homme11.
8. Si l’on songe à la phénoménologie d’autrui de Lévinas, ce primat du visage s’avère particuliè-
rement surprenant dans la mesure où cette seconde partie ne traite pas de rapport inter-person-
nel. Mais ici, le visage, loin de désigner un appel d’autrui instituant une subjectivité (comme il
l’est chez Lévinas), ouvre, comme nous le verrons, sur l’« élément » du « calme ».
9. Voir Blanchot Maurice, Le Dernier homme, op. cit., p. 143.
10. Bien entendu, les liens, touchant la question du corps, entre Blanchot et Merleau-Ponty
mériteraient une analyse approfondie, qui soulignerait – également – les points de divergence entre
leurs deux recherches. Voir Collin François, Maurice Blanchot et la question de l’écriture, Paris,
Gallimard, « Tel », p. 120-159. Pour notre part, nous proposerions de conduire cette analyse en
nous appuyant prioritairement sur Le Visible et l’invisible : Merleau-Ponty n’y déploie-t-il pas une
pensée d’un « milieu sauvage », comparable au milieu – atopique – qui s’atteste chez Blanchot ?
11. Il est possible ainsi de rattacher aux « trois rapports », 1) entre le dernier homme et la jeune
femme, 2) le dernier homme et le narrateur, 3) celui-ci et la jeune femme, respectivement (et par
exemple) : un « piano » (voir Blanchot Maurice, Le Dernier homme, op. cit., p. 70), un « fauteuil »
(ibid., p. 84) et une « table » (ibid., p. 34).
192
Blanchot.indb 192 29/11/13 11:56
Cette seconde forme de lieu-objet n’est pas sans rappeler les « objets inter-médiaires »
thématisés par la sociologie des réseaux et des inter-actions développée par Latour ou Vinck,
même si – et la précision est d’importance –, dans Le Dernier homme, toute logique
d’« action » – ou d’inter-« action » – est justement significativement mise au second plan. Il
est logique que cette forme de lieu-objet disparaisse de la seconde partie de l’ouvrage, dans
la mesure où disparaissent aussi, dans cette partie, les relations « inter »personnelles12.
Le troisième type d’espace désigne des lieux d’« interface ». Par ce terme, nous enten-
dons caractériser des lieux significativement rattachés, dans Le Dernier homme, à un
enjeu d’« entrée » ou de « sortie », d’« ouverture » ou de « fermeture ». Parmi ces lieux
d’interface, on peut distinguer les lieux mêmes dans lesquels l’enjeu est a priori plutôt
d’entrer ou de s’enfermer : une « chambre », une « chapelle », et les lieux qui sont davan-
tage des lieux d’« interface » en tant que tels : des lieux de transition où se jouent préci-
sément l’entrée ou la sortie, l’ouverture ou la fermeture. Ils sont très variés dans
Le Dernier homme : un « couloir », une « fenêtre », mais aussi : un « escalier », une
« porte », un « mur », une « vitre », un « balcon », une « façade », une « fissure », une
« écluse », une « rive », un « chemin », une « pente », un « barrage ».
Mettre au premier plan ce type d’espace est, pensons-nous, un geste spécifique à la
recherche blanchotienne13.
Le quatrième type d’espace, enfin, n’est plus un lieu : il désigne les « éléments » ou des
dimensions spatiales « non localisables » en prise avec les quatre éléments : la lumière, le
jour et la nuit, le ciel, la neige, la mer et les vagues, le désert et le sable, le feu.
Cet espace « élémental » est également mis en jeu par les concepts d’« il y a » ou de
« chaos » que font respectivement valoir Lévinas et Deleuze, même si, comme nous allons
le soutenir, il ne saurait obéir à une « puissance événementielle » (puissance que ces deux
auteurs rattachent à ces concepts).
12. Cette seconde partie ne requiert même aucune des deux formes de lieu-objet ici identifiées.
13. En tous les cas, nous ne connaissons pas de concepts philosophiques – ou issus des sciences
de l’homme – susceptibles de faire signe vers ces lieux d’interface.
193
Blanchot.indb 193 29/11/13 11:56
De l’événement au milieu du calme
Le problème de l’entrée
Comment donc Blanchot articule-t-il ces quatre types d’espace ? Il paraît nécessaire de
traiter cette question – complexe – en fonction d’un motif déterminant dans l’œuvre
blanchotienne en général et dans Le Dernier homme en particulier : celui de l’« entrée
comme telle » ou de l’« attrait comme tel14 » – entrée dans, ou attrait par, l’espace singu-
lier qu’ouvre l’écriture selon Blanchot. Touchant l’importance de ce motif dans ce texte,
qu’il nous suffise, ici, de mentionner que le dernier homme lui-même engage une telle
entrée : « Quand il s’approchait, on “entrait dans un espace” […]15. »
Dès lors, le problème est d’articuler, selon ce motif de l’entrée/attrait, les quatre
types d’espace identifiés. Deux points semblent devoir être soulignés. Tout d’abord, on
peut considérer, en s’appuyant sur L’espace littéraire – dans lequel l’espace de l’écriture
relève d’une « autre nuit » –, que Le Dernier homme requiert les « éléments16 » pour
qualifier la teneur ou la « profondeur » de l’espace – ou du « dehors » – blanchotien.
Entrer dans ce dehors signifie alors entrer dans une profondeur « élémentale », décrite
par exemple comme « nappe de “lumière” étonnamment ténue17 ». Que les éléments
soient aussi importants dans Le Dernier homme, cela tient donc non pas seulement à ce
qu’ils y désignent des dimensions réelles de « l’histoire » mais à ce que Blanchot
les travaille (les éléments perdant dès lors leur nature sensible ou mondaine) pour
caractériser la teneur ou la profondeur de l’espace – de l’« autre espace18 » – qu’il s’attache
à penser : « “Espace de froide lumière” où tu m’as “attiré”19. »
14. Ce motif est déterminant aussi bien dans l’œuvre théorique – il engage de nombreuses
dimensions conceptuelles (fascination, glissement, pas au-delà, dehors…) – que dans l’œuvre
narrative (et ce depuis l’entrée de Thomas dans la « mer » au début du premier roman blanchotien :
Thomas l’Obscur). Voir Starobinski Jean, « Thomas l’Obscur, chapitre premier », in Critique,
n° 229 (« Maurice Blanchot »), juin 1966, p. 500.
15. Blanchot Maurice, Le Dernier homme, op. cit., p. 27. Nous soulignons. Touchant cette
entrée ou cet attrait tel qu’il est porté par Le Dernier homme, voir ibid., p. 13, 32, 42, 56-57, 59, 63.
On pourrait sans doute montrer combien Le Dernier homme mobilise également – pour marquer
cette entrée – des « objets » spécifiques : « pointe », « aiguille », « flèche ».
16. Ibid., p. 9. Nous soulignons.
17. Ibid., p. 55. Nous soulignons.
18. Ibid., p. 38.
19. Ibid., p. 143. Nous soulignons.
194
Blanchot.indb 194 29/11/13 11:56
Second point : dans ce texte, cette entrée dans l’« autre espace » blanchotien comme
profondeur élémentale – cette entrée dans « un autre ciel20 » – s’effectue de façon privilé-
giée par deux types de lieu – et par leur conjugaison – : les lieux d’« interface » – que nous
avons, précisément, définis selon des enjeux d’entrée (ou de sortie) – et les lieux-« corps ».
Touchant les premiers, citons ce passage (mentionnant une fenêtre et une chambre) :
Par la petite « fenêtre » entre un souvenir de « lumière », et c’est une « clarté » froide
qui pénètre partout, qui fait le vide et est la clarté du vide. Je me rappelle bien cette
« chambre » que tu délimites strictement avec la rigueur qui t’est propre, et d’où je ne
puis « sortir » car « ici » déjà règne le « dehors »21.
Touchant les seconds (ici représentés par le visage) : « Il faut que je te tourmente
jusqu’à ce que le “grand espace nocturne” s’apaise un instant en ce “visage” qui doit lui
faire face22. » Citons, enfin, un texte ouvrant l’espace élémental par une conjugaison du
visage (yeux, bouche) et de ce lieu d’interface qu’est la chambre :
Que je sois couché dans cette fosse de « lumière » qui est strictement délimitée, sauf
sur un point, je le reconnais. Rappelle-toi : les « yeux » sont fermés, et la « bouche » aussi
est fermée. Cela se passait probablement dans la « chambre ». J’avais sous les « pau-
pières » le « noir profond » […]. Je demeurais auprès du « noir », peut-être en lui23.
L’hypothèse que nous soumettons est donc la suivante : dans Le Dernier homme, Blanchot
articule les quatre types d’espace identifiés en considérant les lieux-corps et les lieux
d’interface – le cas échéant conjugués – comme des « lieux d’entrée » dans la dimension
élémentale, non localisable, qui constitue l’espace blanchotien (les lieux-objets, ici non
mentionnés, ne désignant pas, quant à eux – du moins dans ce texte –, une telle entrée).
Cette hypothèse ne résout pas toutes les difficultés. Comment concilier en effet ces
lieux (une chambre, un visage) « et » cette profondeur élémentale – sur laquelle ils
ouvrent ? Comment donc penser cette entrée, par des « lieux », dans un espace élémental,
« non localisable » ?
20. Ibid., p. 46.
21. Ibid., p. 126. Nous soulignons.
22. Ibid., p. 145. Nous soulignons.
23. Ibid., p. 135. Nous soulignons.
195
Blanchot.indb 195 29/11/13 11:56
Une entrée événementielle ? À partir de Foucault
De façon à concilier ces lieux et cette profondeur non localisable, une première piste
consiste à faire valoir un registre omniprésent dans Le Dernier homme – à travers la
« rumeur », les « bruits », les « cris », les « plaintes » – : le registre « sonore24 ». Ce registre
semble en effet pouvoir marquer « à la fois » une localisation – dans des lieux-corps, des
lieux d’interface ou des lieux-objets (« entre » des interlocuteurs) – « et » ce qui rompt
avec toute localisation25. Un ingrédient sonore particulier pourrait sans doute ici être
privilégié : celui du « cri26 » (cri qui, dans le texte, est parfois celui du dernier homme,
parfois non). Il paraît en effet pouvoir désigner une entrée ou une « percée profonde »,
depuis ces « lieux-corps » que sont le visage ou la bouche. Il comporte, de surcroît, une
dimension « affective » qui paraît adéquate à l’espace – de souffrance – blanchotien.
Dès lors, on peut considérer que, si cet espace comme tel structure le sonore, inverse-
ment, le cri donne à cet espace – « à la fois » localisé « et » profond, proche « et » loin-
tain – toute sa couleur ou sa consistance. Mais si cet ingrédient du cri indique certes,
ainsi, ce qui remplit l’espace blanchotien, il ne permet pas de qualifier la structure
– paradoxale – de cet espace lui-même. C’est pourquoi il est nécessaire de faire-valoir ici
une seconde piste, que nous proposons de rattacher à deux concepts foucaldiens : le
« corps utopique » et l’« hétérotopie27 ».
Les hétérotopies, tout d’abord, désignent pour Foucault des « lieux autres » – ou
encore des « contre-espaces28 » – qui, essentiellement, viennent « contester », d’une façon
ou d’une autre, les espaces normaux d’une société. Foucault mentionne comme exemples
24. À propos de ce lieu d’interface qu’est un « couloir » : « Tout y semblait, comme dans un tunnel,
également “sonore”, également silencieux, les “pas”, les “voix”, les “murmures” derrière les “portes”, les
“soupirs”, les sommeils heureux, malheureux, les “crises” de toux, les “sifflements” de ceux qui respiraient
mal et parfois le “silence” de ceux qui ne semblaient plus respirer. » Ibid., p. 104. Nous soulignons.
25. De ce point de vue, la dimension de la « rumeur » – ou de la « rumeur “profonde” » (ibid.,
p. 63. Nous soulignons) – semble particulièrement précieuse : « Est-ce la rumeur qui sans cesse
passe entre nous et dont les échos différents nous parviennent de rive à rive ? » Ibid., p. 138-139.
Voir aussi ibid., p. 111.
26. Voir Collin Françoise, Maurice Blanchot et la question de l’écriture, op. cit., p. 101.
27. Voir Antonioli Manola, « Maurice Blanchot et Michel Foucault : hétérotopies ». http://
www.mauriceblanchot.net/blog/index.php?post/2005/10/22/119-manola-antonioli-maurice-
blanchot-et-michel-foucault-heterotopies (dernière consultation : 23 septembre 2011).
28. Foucault Michel, Le Corps utopique suivi de Les Hétérotopies, Paris, Lignes, 2009, p. 24,
souligné par Foucault.
196
Blanchot.indb 196 29/11/13 11:56
d’hétérotopies : les « cimetières », les « navires », les « maisons closes ». Mais doit-on
considérer que les lieux décrits par Blanchot (les chambres par exemple) sont des
hétérotopies ou des contre-espaces ? Contestent-ils en effet réellement les autres espaces
sociaux, ou du moins jusqu’à quel point cette contestation – de lieux par d’autres lieux –
est-elle au centre du propos de Blanchot ?
En tous les cas, si cette approche foucaldienne nous paraît ici pertinente, c’est dans la
mesure où elle se centre – aussi – sur « l’ouverture » ou l’entrée « comme telle » que ces
hétérotopies rendent possible29. Bien plus, dans une perspective très blanchotienne,
Foucault les détermine parfois comme des « ouvertures d’éléments » (ou de dimensions
élémentales). Mentionnons deux exemples. En premier lieu, Foucault décrit cette
hétérotopie que désigne, pour les enfants, « le grand lit des parents » :
C’est sur ce grand lit, qu’on découvre l’« océan », puisqu’on peut y nager entre les
couvertures ; et puis ce grand lit, c’est aussi le « ciel », puisqu’on peut bondir sur les
ressorts ; […] c’est la « nuit », puisqu’on y devient fantôme entre les draps30.
« Océan », « ciel », « nuit » : voilà donc les dimensions élémentales qu’ouvre cette
hétérotopie ou ce lieu-« objet » (lieu ici d’ouverture ou d’entrée) qu’est, pour les enfants,
le « lit » des parents.
Le second exemple doit être rattaché au concept de « corps utopique ». Soutenant la
thèse selon laquelle, loin d’être seulement « un ici irrémédiable31 », le corps, « utopique »,
ouvre « un autre espace32 » non mondain33, s’intéressant ainsi, précisément, aux « utopies
29. Il est ainsi question du « système d’ouverture et de fermeture » (ibid., p. 32) des hétérotopies.
Ce système concerne d’abord l’entrée – ou non – « dans » les hétérotopies « en elles-mêmes ».
Mais, comme nous allons le voir, la question foucaldienne de l’ouverture des hétérotopies engage
également l’ouverture – « depuis » ces hétérotopies – d’une dimension élémentale. Il est
remarquable que cette double perspective sur les hétérotopies – entrée « dans », entrée « depuis » –
soit également à l’œuvre, dans Le Dernier homme, à propos de ce lieu d’« interface » que désigne
la « chambre ». Voir Blanchot Maurice, Le Dernier homme, op. cit., p. 74, 75, 135.
30. Foucault Michel, Le Corps utopique suivi de Les Hétérotopies, op. cit., p. 24. Nous soulignons.
Concernant le « lit » et les « éléments » chez Blanchot, voir Blanchot Maurice, La Communauté
inavouable, Paris, Les Éditions de Minuit, 1983.
31. Foucault Michel, Le Corps utopique suivi de Les hétérotopies, op. cit., p. 17.
32. Ibid., p. 15.
33. Voir ibid., p. 17.
197
Blanchot.indb 197 29/11/13 11:56
scellées “dans” le corps34 », Foucault en vient à penser l’ouverture de dimensions
élémentales (comme la lumière du soleil) « à même la tête », d’une manière à nouveau
très blanchotienne :
Ma tête : quelle étrange « caverne ouverte » sur le monde extérieur […] et çà, je suis
bien sûr que les choses entrent dans ma tête quand je regarde, puisque le « soleil »,
quand il est trop fort et m’éblouit, va déchirer jusqu’au fond de mon cerveau35.
Ces analyses foucaldiennes nous semblent devoir être rattachées à la catégorie de
l’« événement ». L’événement, n’est-ce pas en effet, précisément, cette entrée du
« dehors » dans l’ici, le « renversement » du lieu par une dimension non localisable : un
« ailleurs » – éventuellement élémental36 ? N’est-ce pas, en tous les cas, ce geste de ren-
versement « événementiel » que porte la problématique foucaldienne de l’espace, en
tant qu’elle fait valoir, « contre » l’espace du monde, une hétérotopie ou une utopie
– parfois élémentale ? Plus encore : ce geste foucaldien n’est-il pas typique d’une cer-
taine philosophie française contemporaine ? Il est en tous les cas remarquable que des
auteurs aussi différents que Deleuze ou Lévinas fassent valoir une telle pensée de l’évé-
nement. Qu’il relève des lignes de « fuite » deleuziennes – faisant « fuir » l’ici vers un
ailleurs (déterminable selon un chaos ou une « mer » agitée37) – ou de la « percée »
lévinassienne du « visage » dans la profondeur d’un « autre temps » (passé immémo-
rial ou futur inanticipable38) : dans les deux cas, l’événement engage bien, en effet,
l’ouverture même du lieu par ou vers un « ailleurs non localisable » (ailleurs qui est
donc de type élémental chez Deleuze). Plus encore, tout comme Foucault, Deleuze et
34. Ibid., p. 17. Nous soulignons.
35. Ibid., p. 12-13. Nous soulignons. On remarquera que Foucault qualifie la tête et le corps
utopique selon une formule – « lieux sans lieu » (ibid., p. 12) – qu’il utilise également dans son
analyse des espaces – « maisons », « couloirs », « portes », « chambres » – des « récits de Blanchot »,
voir Foucault Michel, La Pensée du dehors, Montpellier, Fata Morgana, 2003, p. 24.
36. Il faudrait pouvoir distinguer des « types d’événement » selon le type de dimension spatiale
ou/et temporelle qu’ils peuvent faire surgir.
37. Voir Deleuze Gilles, Guattari Félix, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Les Éditions de
Minuit, p. 189-206.
38. L’événement lévinassien du visage n’engage donc pas réellement un autre espace. C’est l’« il
y a » – contre lequel, précisément, Lévinas s’attache à établir le visage – qui requiert une dimen-
sion élémentale. Mais Lévinas questionne moins l’« entrée » dans cette dimension (et l’événement
que cette entrée pourrait désigner) que la possibilité d’en « sortir » – par le visage. Voir Lévinas
Emmanuel, Totalité et infini, Paris, Le livre de poche, « Biblio/Essais », 1992.
198
Blanchot.indb 198 29/11/13 11:56
Lévinas rattachent probablement cet événement – vital (Deleuze) ou éthique (Lévi-
nas) – au « corps », corps déformé par la puissance délocalisante du « mouvement »
chez Deleuze39 ou visage perçant le monde comme tel chez Lévinas – comme si tous
trois s’attachaient bien à questionner « l’événement d’un corps utopique ».
Jusqu’à quel point cette logique événementielle correspond-elle à ce qui se joue, chez
Blanchot, en particulier dans Le Dernier homme ? Faut-il donc considérer, notamment,
que les lieux-corps identifiés dans ce texte désignent des corps utopiques, constitués
événementiellement – ou ouvrant événementiellement une profondeur élémentale ?
Incontestablement, Blanchot obéit – du moins dans une certaine mesure – à cette
logique contemporaine de l’événement. On peut le suggérer de diverses manières. Tout
d’abord, il serait étonnant que Blanchot se soustrait complètement à cette logique alors
même qu’il est fort probable que l’analyse de l’événement proposée dans L’Espace
littéraire ait eu une influence significative sur certains contemporains, et tout
particulièrement sur Deleuze40. Plus encore, l’« attrait » – ce motif central de la recherche
blanchotienne, du reste souligné par Foucault41 – ne relève-t-il pas d’une force ou d’une
puissance42, délocalisante et de type événementiel ? Dernier point, concernant peut-être
plus particulièrement Le Dernier homme : il est légitime de considérer que l’ingrédient
du « cri », si présent dans ce texte, constitue précisément un ingrédient « événementiel ».
N’est-il pas particulièrement significatif que cette rupture – événementielle – du « cri »
s’atteste également aussi bien chez Lévinas que chez Deleuze43 ?
Et pourtant la recherche de Blanchot nous semble globalement « ambiguë » relati-
vement à l’événement : si, d’un certain côté, elle semble donc bien y souscrire, de
39. Voir Deleuze Gilles, Francis Bacon : logique de la sensation, Paris, Éditions de la différence, 1996.
40. Voir Deleuze Gilles, Logique du sens, Paris, Les Éditions de Minuit, 2005, p. 178-179.
41. Voir Foucault Michel, La Pensée du dehors, op. cit., p. 41-46.
42. « Tentation de nous laisser, sous son regard, disparaître et renaître en une “puissance” sans nom
et sans visage. Je pressentais cette puissance, je suivais cette “force d’attrait”. » Blanchot Maurice, Le
Dernier homme, op. cit., p. 56-57 (nous soulignons). Pourrait-on considérer que l’ambiguïté de Blan-
chot relativement à la logique contemporaine de l’événement se lit au niveau du motif d’« entrée/
attrait », l’« attrait » obéissant à cette logique alors que l’« entrée » s’y soustrait (dans le calme) ?
43. Voir Lévinas Emmanuel, Totalité et infini, op. cit., p. 273 ; Deleuze Gilles, Francis Bacon :
logique de la sensation, op. cit., p. 29.
199
Blanchot.indb 199 29/11/13 11:56
l’autre, elle paraît incontestablement s’en affranchir. C’est bien ce que semble attester
significativement Le Dernier homme44.
Une entrée dans le milieu atopique du calme ?
Un thème dominant du Dernier homme, et surtout de sa seconde partie, marque, à
nos yeux, cette irréductibilité à l’événement : le thème du « calme ». L’ouverture de l’es-
pace blanchotien engage d’abord, en effet, dans cette seconde partie, une « entrée dans
le calme » : « Plus tard, il se demanda comment il était entré dans le calme45. » Que cette
entrée dans le calme désigne l’ouverture de l’espace blanchotien, c’est ce que confirme
la manière dont cette entrée s’effectue – tout comme celle dans l’espace élémental46
(analysée plus haut) – selon une conjugaison de lieux-corps et de lieux d’interface.
Blanchot écrit ainsi à propos des « visages » :
Certains sont très beaux, tous ont même une certaine beauté et quelques uns, autant que
j’ai pu m’en rendre compte dans le « couloir », sont merveilleusement attirants, dans la
mesure peut-être où eux-mêmes subissent, dans le « calme » et le silence, l’attrait essentiel47.
Comment donc cette entrée dans le « calme » pourrait-elle encore procéder d’un évé-
nement – d’une « rupture » ou d’une « transgression » événementielle ? Ne tenons-nous
pas en effet, avec le calme, ce qui, précisément, se refuse à une telle logique événementielle
– et à l’autorité ou la « puissance48 » que cette logique requiert ? Mais, alors, comment le
calme se constitue-t-il donc, comment s’ouvre-t-il – s’il ne relève pas d’un événement ?
Cette question paraît d’autant plus problématique que, dans Le Dernier homme, le calme
44. Relevons d’emblée cette interrogation qui semble être celle du dernier homme : « Qu’en-
tendent-ils donc par événement ? » Blanchot Maurice, Le Dernier homme, op. cit., p. 15.
45. Ibid., p. 147.
46. Touchant la dimension élémentale du calme – telle qu’elle s’ouvre depuis un « couloir » –
voir ibid., p. 104.
47. Ibid., p. 144.
48. Dans Celui qui ne m’accompagnait pas, Blanchot écrit : « Ce n’était pas cette “puissante” rumeur
du “dehors” qui me tenait éveillé, c’était “au contraire”, le “calme prodigieux” qu’un tel “bruit” laissait
intact. » Blanchot Maurice, Celui qui ne m’accompagnait pas, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire »,
2004, p. 49. Nous soulignons.
200
Blanchot.indb 200 29/11/13 11:56
et l’événement semblent parfois très proches49. Pour notre part, nous proposons ici de
faire valoir le concept de « milieu atopique ».
L’idée de milieu, tout d’abord, est présente dans ces textes théoriques globalement
contemporains du Dernier homme que sont L’Espace littéraire et Le Livre à venir50. De notre
point de vue, cette idée permet de rendre compte, premièrement, de l’ancrage « localisé »
de l’espace du calme qui s’ouvre « entre » les, ou au « milieu » des, personnes51. Selon notre
analyse du Dernier homme, le milieu ainsi entendu (selon sa composante localisée) relève
de la conjugaison de lieux-corps et de lieux d’interface. Plus encore, en tant qu’il désigne
non seulement ce qui configure « entre », mais aussi ce qui entoure ou « enveloppe » les
personnes (et les lieux), le milieu semble à la hauteur du problème ici formulé, à savoir :
concilier cette localisation « entre » et la profondeur « élémentale » (non localisée) que
cette localisation peut ouvrir. En ce sens, « entrer dans le calme » par la conjugaison de
lieux-corps et de lieux d’interface reviendrait à « entrer dans » ou « selon un milieu52 ».
Mais si cette entrée n’est pas événementielle, comment donc la qualifier ?
Ce milieu est « a-topique » : si nous proposons ainsi de substituer l’adjectif
« a-topique » à l’adjectif foucaldien « u-topique », c’est parce que celui-ci semble encore
trop lié à une exigence de « renversement » (événementiel), exigence qui ne semble pas
centrale dans ce texte sur le calme qu’est Le Dernier homme ou, du moins, sa seconde partie.
49. « Si je réfléchis sur “l’événement” qui se produisit, je devrais dire qu’il “se confond presque
pour moi avec le calme” qui me permit d’y faire face. » Blanchot Maurice, Le Dernier homme,
op. cit., p. 106. Nous soulignons. Cette proximité est aussi, probablement, celle du calme et du « cri ».
Voir ibid., p. 36-37. De façon générale, il faudrait questionner plus avant le rapport complexe,
ambigu, que l’œuvre de Blanchot établit entre l’espace de l’écriture – ou le neutre – et l’événement.
Voir par exemple Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, Paris, Gallimard, 2008, p. 20, 23-24, 25.
50. Voir Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 29-30 ; Le Livre à venir, Paris,
Gallimard, « Folio/Essais », 2005, p. 23.
51. « Espace de ce visage toujours plus invisible et, entre nous, le calme. » Blanchot Maurice,
Le Dernier homme, op. cit., p. 141.
52. On soulignera que l’idée de « milieu » est explicitement présente dans la philosophie
contemporaine du « mouvement », celle qui se déploie chez Deleuze, Simondon et même Lévinas
(au niveau de sa thématisation de l’« il y a »). Ne peut-on penser que cette philosophie fait ainsi
signe vers le milieu – atopique – qui, précisément, est « à même » le mouvement sans cependant
être en soi mouvementé : qui « enveloppe » le mouvement (voir Lévinas Emmanuel, Totalité et
infini, op. cit., p. 138) ou que celui-ci « traverse » – ce milieu étant trop « impuissant » ou
« immobile » pour pouvoir opérer lui-même une traversée ?
201
Blanchot.indb 201 29/11/13 11:56
De ce point de vue, a-topique semble plus indifférent ou plus « neutre53 ». Faut-il dès
lors proposer le concept de « corps atopique », en particulier pour qualifier le statut des
« lieux-corps » identifiés dans Le Dernier homme ? Peut-être. Mais il importe également,
pensons-nous, de compléter cette analyse de la complexité de l’espace – ou du milieu –
blanchotien, en considérant – de façon exploratoire – la dimension de l’« enveloppement »,
singulièrement présente dans Le Dernier homme54. Si l’entrée dans le milieu atopique du
calme ne se comprend pas comme un événement, ne serait-ce pas parce que ce milieu,
loin de rompre événementiellement avec le monde – loin de le transgresser –,
l’« enveloppe » ? Cet enveloppement ne pourrait-il marquer la manière dont, dépourvu
de puissance et d’autorité, le calme non seulement s’ouvre « à même » le monde mais
aussi est « traversé » par l’événement ?
Du récit à l’écriture fragmentaire
Au terme de cette analyse, nous proposons l’hypothèse suivante touchant l’évolution
du mode d’écriture de Blanchot : dans l’œuvre de celui-ci, la fin des récits et l’émergence
de l’écriture fragmentaire sont à rattacher, au moins dans une certaine mesure, au pro-
blème des espaces ici soulevé ainsi qu’à sa résolution selon une dimension
non événementielle.
Que ce problème, ou du moins son primat dans l’écriture blanchotienne, induise une
contestation de la « logique narrative » comme telle, on peut le suggérer en s’appuyant
sur l’analyse ricœurienne du récit. Du point de vue de Ricœur, le récit a essentiellement
vocation à « concilier des temps hétérogènes », en particulier le temps du sujet et le
temps du monde55. Or, nous l’avons vu : le problème blanchotien de conciliation priori-
tairement posé dans Le Dernier homme est un problème de conciliation non pas de
temps hétérogènes mais bien d’« espaces hétérogènes ».
53. Bien entendu, nous faisons ici allusion au concept blanchotien de « neutre », déployé en par-
ticulier dans L’Entretien infini (ouvrage dont plusieurs textes font signe vers ce milieu atopique).
54. Elle est y rattachée à une pensée « immobile » qui enveloppe (donc) et peut-être protège.
Voir ibid., p. 111, 119, 122.
55. Voir Ricoeur Paul, Temps et récit. 3. Le temps raconté, Paris, Éditions du Seuil, « Points/
Essais », 1985.
202
Blanchot.indb 202 29/11/13 11:56
Que ce problème – et sa résolution non événementielle – impliquent une rupture
avec la logique narrative, on peut également le marquer en soulignant les liens
déterminants qui, selon Genette et Blanchot lui-même, s’établissent entre récit et
« événement ». En particulier, dans sa propre analyse du « récit56 » – et de son lien
constitutif avec l’événement –, Blanchot semble conjuguer les deux sens d’événement que
font valoir les philosophes contemporains ici sollicités (premier sens) et Genette (second
sens)57 : l’événement qui, selon Blanchot, « constitue » le récit lui-même (ou la narration
elle-même) – ou dont le récit est « l’approche58 » – n’engage-t-il pas en effet « à la fois »
l’identité du contenu narratif et de la narration (pour reprendre les termes de Genette)
– l’identité de Ulysse et d’Homère59 – « et » la transgression, typique d’une certaine
philosophie française contemporaine, du monde comme tel (dans les termes de
Blanchot : l’ouverture de l’espace imaginaire au sein du réel) ? Dès lors, le recul, chez
Blanchot, de l’écriture narrative semble difficilement séparable de la mise au second
plan de la logique de l’événement (qu’il soit entendu selon Foucault, Deleuze ou Lévinas
ou bien selon Genette) – cette mise au second plan que, précisément, rend possible, de
notre point de vue, le milieu du calme.
Nous soutenons ici non pas, bien entendu, qu’un texte comme Le Dernier homme
abolit le temps ou l’événement mais bien plutôt que l’écriture non narrative de Blanchot
est « prioritairement » régie par un problème qui est lié non pas au temps ou à
l’événement comme l’est le récit – mais aux espaces60, en tant qu’ils se soustraient, au
moins dans une certaine mesure, à l’événement. Par exemple, La Folie du jour – qui
interroge explicitement la possibilité, ou l’impossibilité, du récit – repose aussi sur ce
problème des espaces et fait valoir en particulier les quatre types d’espace ici identifiés61.
56. Nous faisons ici référence au premier texte du Livre à venir : « La rencontre de l’imaginaire ».
57. Il faudrait distinguer soigneusement – mais aussi articuler (avec l’aide de Blanchot) –
l’événement au sens de Foucault, Deleuze ou Lévinas et l’événement au sens de Genette – du
point de vue duquel, l’événement détermine aussi bien le récit comme « histoire » (ou contenu
narratif) que le récit comme acte même de « narration ». Voir Genette Gérard, Figures III, Paris,
Seuil, « Poétique », 1972, p. 71.
58. Voir Blanchot Maurice, Le Livre à venir, op. cit., p. 14.
59. Voir ibid., p. 14-15.
60. Touchant ce primat blanchotien de l’espace (ou des espaces), voir Durand Thierry, « Les
dimensions de l’espace chez Maurice Blanchot », http://www.mauriceblanchot.net/blog/public/
DURAND._BL.ESPACE.pdf (dernière consultation : 23 septembre 2011).
61. Voir Blanchot Maurice, La Folie du jour, Montpellier, Fata Morgana, 1986, p. 11, 12, 15, 20, 22.
203
Blanchot.indb 203 29/11/13 11:56
Mais il est probable que ces espaces demeurent, dans ce « récit », subordonnés à une
logique encore événementielle, La Folie du jour étant, semble-t-il, organisé autour de cet
événement qu’est l’« entrée » de verre dans les yeux du narrateur (événement remarquable
car il semble bien proche – aussi – de cette entrée, précisément non événementielle,
qu’est l’entrée dans l’élément du calme). En revanche, Le Dernier homme – ou en tous les
cas sa seconde partie – met « au premier plan », de notre point de vue, le problème des
espaces – et le milieu du calme – et disqualifie ainsi le primat de la logique temporelle ou
événementielle de la narration62.
Cette contestation blanchotienne du récit donne lieu, selon nous, à l’émergence
de l’écriture fragmentaire63. Sur ce point, nous nous en tiendrons ici à une indication. La
pratique d’« effacement » de l’écriture qui caractérise essentiellement l’écriture
fragmentaire64 ne désigne-t-elle pas précisément l’ouverture non événementielle
du milieu atopique, la manière dont ce milieu peut « envelopper » l’écriture ? Effacer, ne
cesser d’effacer, n’est-ce pas, en effet, s’attacher à ouvrir ce milieu du calme, « à même »
l’écriture65 ? Questionnement sur l’effacement qui nous conduit, finalement, à
repositionner explicitement le problème blanchotien des espaces du côté de
l’écriture elle-même.
62. Il est bien sûr significatif, de ce point de vue, que Blanchot ait supprimé, dans la nouvelle
version de l’ouvrage, la mention « récit », présente dans la 1re version. Voir aussi Bident
Christophe, Maurice Blanchot, partenaire invisible, Seyssel, Champ Vallon, 1998, p. 366-367.
63. Éric Hoppenot a déjà questionné l’émergence de cette écriture et, en particulier, suggéré en
quoi Le Dernier homme relevait déjà d’une première forme d’écriture fragmentaire : par la forme
initiale de sa parution – en trois textes séparés –, par sa mobilisation de passages en italiques au
sein même du texte, également par la toute fin de l’ouvrage, composée de deux fragments. Voir
Hoppenot Éric, « Maurice Blanchot et l’écriture fragmentaire : “le temps de l’absence de temps” »,
in L’Écriture fragmentaire : théories et pratiques, actes du 1er colloque international du Groupe de
recherche sur les écritures subversives [Barcelone, 21 au 21 juin 2001], Ripoll Ricard (dir.),
Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2002.
64. Que l’on songe aux blancs entre les fragments mais aussi à ces fragments commençant sans
majuscule et/ou s’achevant sans ponctuation ou encore au style « lapidaire » (dépourvu de
verbes) qui détermine parfois cette écriture.
65. L’écriture fragmentaire – telle qu’elle se déploie après Le Dernier homme, en particulier dans
Le Pas au-delà ou dans L’Écriture du désastre – semble conjuguer quatre écritures : 1) narrations,
2) argumentations philosophiques, 3) dialogues et 4) citations. Sans doute cette conjugaison même
peut-elle être pensée comme un « agencement » – d’écritures « hétérogènes » – au sens de Deleuze.
Mais il importe alors de préciser que l’ouverture (ou l’entrée) qu’elle rend possible ne se résout pas
dans la « fuite » – encore événementielle – rendue possible par les agencements deleuziens.
Blanchot.indb 204 29/11/13 11:56
L’univers
littéraire du récit :
L’Instant
de ma mort,
Le Très-Haut,
Au moment voulu
Blanchot.indb 205 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 206 29/11/13 11:56
L’Instant de ma mort de Maurice Blanchot
ou une question inventée face à l’impensable
Claudine Hunault
Revenir, ce serait en venir de nouveau à s’ex-centrer, à errer.
Seule demeure l’affirmation nomade1.
Maurice Blanchot
J
’ai choisi d’évoquer L’Instant de ma mort pour l’ambiguïté dont ce texte est tissé.
C’est à partir d’elle que je m’autoriserai une hypothèse sur l’expérience dans laquelle
la figure du neutre aurait pris sa source : l’expérience de l’effraction du réel. Dans ce
très court texte, qui fait partie des tout derniers écrits publiés, Maurice Blanchot ne
raconte pas l’instant où il aurait failli mourir. L’Instant de ma mort est une expérience de
la parole qui se découpe au cœur du langage. Expérience de la parole qui est aussi une
expérience de la division du sujet. Dans quelle mesure est-ce au prix de l’éviction sans
recours d’un sujet unifié que s’opèrent la percée et le travail de l’écriture ?
1. Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, Paris, Gallimard, 1973, p. 49.
207
Blanchot.indb 207 29/11/13 11:56
Cinquante années plus tard Maurice Blanchot « revient » sur un événement vécu par
lui en 1944. Christophe Bident dans l’essai biographique intitulé Maurice Blanchot, par-
tenaire invisible2, indique avec précision la correspondance et les témoignages permet-
tant de situer l’événement dans une réalité.
C’est l’été 1944, un lieutenant nazi frappe à la porte du Château, la grande maison
familiale de Quain, hurle à tous de sortir. Le lieutenant montre à Maurice Blanchot/le
narrateur les douilles sur le sol qui témoignent d’un combat, criant : « Voilà à quoi vous
êtes parvenu. » Le nazi aligne ses hommes et fait mettre le jeune homme en joue, laissant
rentrer les femmes : « Je sais – le sais-je – que celui que visaient déjà les Allemands, n’at-
tendant plus que l’ordre final, éprouva alors un sentiment de légèreté extraordinaire,
une sorte de béatitude (rien d’heureux cependant), – allégresse souveraine ? La ren-
contre de la mort et de la mort ? […] Désormais, il fut lié à la mort, par une amitié
subreptice3. » À ce moment éclate « le bruit considérable d’une proche bataille » menée,
pour faire diversion, par les camarades du maquis. Le lieutenant s’éloigne, va voir. Un
des hommes du peloton d’exécution s’approche du narrateur, lâche son identité : « Nous,
pas allemands, russes… armée Vlassov », et lui fait signe de disparaître dans les bois
proches. « C’est dans le bois épais que tout à coup, et après combien de temps, il retrouva
le sens du réel. » Le Château est épargné ; il a suscité le respect du lieutenant nazi, les
fermes non ; elles ont brûlé ; trois jeunes fermiers ont été abattus :
Alors commença sans doute pour le jeune homme le tourment de l’injustice […].
Demeurait cependant, au moment où la fusillade n’était plus qu’en attente, le senti-
ment de légèreté que je ne saurais traduire : libéré de la vie ? L’infini qui s’ouvre ? Ni
bonheur, ni malheur. Ni l’absence de crainte et peut-être déjà le pas au-delà. Je sais,
j’imagine que ce sentiment inanalysable changea ce qui lui restait d’existence. Comme
si la mort hors de lui ne pouvait désormais que se heurter à la mort en lui. « Je suis
vivant. Non, tu es mort. »
Que disent ces huit pages ? Viennent-elles marquer une vérité de ce qui eut lieu ? Il y a
une réelle séduction biographique et peut-être d’autant plus agissante qu’elle concerne
un écrivain qui n’a cessé de la déjouer. Est-il nécessaire de décider que ces pages aient à
relever d’un témoignage ou d’une fiction ? Pourrions-nous accepter de nous en tenir à
2. Bident Christophe, Maurice Blanchot, partenaire invisible, Seyssel, Champ Vallon, 1998,
p. 228, 229, 230.
3. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, Montpellier, Fata Morgana, 1994, p. 10.
208
Blanchot.indb 208 29/11/13 11:56
une voie autre, celle de l’indécidable ? Avons-nous besoin d’une réalité prouvée ?
Donnerait-elle une solidité plus grande à ce que l’écrit de 1994 nous offre de comprendre ?
Posons que nous nous intéressions au processus de parole plutôt qu’à la vérité. Posons
que nous questionnions une expérience d’écriture et non l’exactitude des faits.
L’expérience d’écriture dont il s’agit n’est pas orpheline de l’expérience du réel. Mais cela
se résume-t-il à des faits ? Il est possible de renverser le regard : l’expérience – les
expériences – du réel se manifestent en dessous des faits. La vérité, ou ce qui en tiendrait
lieu, se situe en dehors de l’exactitude des événements. L’écriture de Blanchot au long de
ces huit pages nous abandonne à de l’improbable, au sens propre de ce que ni lui ni
aucun exégète ne saurait prouver. Nous n’entrons pas, nous ne sommes pas invités à
entrer, dans le corps d’une narration. Des mots nous retiennent à la porte : « “Je me
souviens4” d’un jeune homme », « Je sais – “le sais-je” – », « “À sa place”, je ne chercherais
pas à analyser ce sentiment de légèreté », « “Je crois” qu’il s’éloigna », « Je sais, “j’imagine”
que ce sentiment inanalysable changea ce qui lui restait d’existence ». Nous sommes
écartés de la narration par des mots qui doublent ce qui vient à peine de se dire et en
retirent ce qu’ils pourraient porter de certitude et d’attestation de l’action. Le glissement
léger d’un « je » à un « il », « je » regardant agir le jeune homme dans une distance voilée
et assourdie, au point que nous n’entendons pas « le bruit considérable d’une proche
bataille », nous laisse dans une mouvance étrange, sans prise aucune sur un bord ou
l’autre de ce qui se passe ; nous n’avons, lecteurs, aucune part à un éventuel dialogue,
nous sommes tenus silencieux et entourés de silence. Le texte agit par ce qu’il passe sous
silence et ce que la mémoire de Blanchot a cédé au silence vide du passé. Cela fait trou
non seulement dans le texte mais aussi dans la perception. Les ellipses de l’écriture ont
une intuition fine des ellipses de la perception. Nous sommes conviés au souvenir de la
mort empêchée d’un jeune homme et nous quittons le texte sur la mort réappropriée
par le narrateur. De « Je me souviens d’un jeune homme » à « l’instant de ma mort
désormais toujours en instance », l’empathie est dissuadée. La narration se décale
imperceptiblement, par de fragiles écarts, passant d’un ordre crié au présent par le
lieutenant nazi au consentement calme et distant du jeune homme que le narrateur
regarde comme s’il était encore là, dans l’instant de le dire, comme si ce passé venait
doucement se presser contre le flanc du présent. Le livre descend une première pente
jusqu’à l’instant inqualifiable, « La rencontre de la mort et de la mort ? ». Nous y sommes
4. Nous soulignons.
209
Blanchot.indb 209 29/11/13 11:56
très vite à cet instant, il est déjà là à la troisième page. La fascination que son annonce
exerçait laissait imaginer un emplacement choisi, pressenti. Au fond nous nous
attendions à quelque chose, et qui a toujours à voir avec du récit. Or la chose arrive de
façon furtive, légèrement écartée d’un argument de sagesse : « À sa place, je ne chercherai
pas à analyser. » Et brusquement nous sommes sur l’autre versant plus long, plus haut à
remonter que le premier, détails d’une activité de vivants, bruits, voix, choses de guerre,
fragments d’Histoire, et nous nous posons à nouveau sur ce qui insiste du souvenir,
l’instant où la chose a lieu dans ce temps d’immobilité absolue, où la mort vivante entre
par effraction dans un corps dépris de passion.
L’Instant de ma mort rapporte les traces d’une situation qui met en scène un événe-
ment traumatique. Un jeune homme est brutalement exposé à un événement auquel
aucun « Nom-du-père » n’a le pouvoir de faire face ; aucun Nom-du-père n’a pouvoir
de lui garantir un sens face à ce qui est en train d’arriver et qui peut le détruire physi-
quement et psychiquement. Ça pourrait ne plus tenir au sortir de l’événement, ça pour-
rait se désarticuler ou se paralyser comme certaines incapacités physiques brutales,
consécutives à un choc.
Qu’est-ce qui fait qu’on peut en revenir, que le jeune homme revient de ce choc ? Ce
qui se passe : le jeune homme est tenu en joue par les fusils allemands, suspens avant
l’ordre final de tirer. Une question se lève en lui, ou plutôt l’écrivain Blanchot fait se lever
une question : « La rencontre de la mort et de la mort ? ». Devant l’impensable qui aurait
pu le faire sombrer à tout jamais, sombrer y compris sans mourir, Blanchot produit
quelque chose d’aberrant : une question qui s’écarte de toute raison. Il produit des mots
ainsi articulés qu’ils sont une pure création de la pensée. La question s’invente en lui
comme réponse à l’expérience limite. Dans cette situation inouïe, lorsque le jeune
homme n’est plus qu’en attente – et est-ce encore de l’attente ou la calme endurance
d’une exposition au réel ? – alors qu’aucun discours ne saurait rendre compte de ce qui
est en route, Blanchot produit une question où du signifiant se crée, dans une radicalité
que rien ne vient soutenir et qui fait en soi autorité. La question qui se dresse en lui,
attrape quelque chose de l’impensable auquel le narrateur est exposé.
« La rencontre de la mort et de la mort ? » est l’expérience qui convie autrui en lui,
une expérience qui à la fois fonde la conscience de l’humain, conscience de sa mort, et
fonde le réel en tant que l’impensable de la mort. Là réside la coupure. Blanchot
introduit l’impensable de la mort et non pas un face à face avec la mort, ou un face à
210
Blanchot.indb 210 29/11/13 11:56
face avorté avec la mort, ce qui revient au même en termes de spectaculaire et de
fascination. C’est cela, cette capacité surprenante de Blanchot à écrire l’expérience de
l’effraction du réel, qui nous écarte d’un retour à la preuve et de la tentation de rabattre
le texte sur une vérité. Cette effraction du réel nous met devant une rupture soudaine.
Une déliaison s’est faite, nous demeurons avec le sentiment d’une perte qui opère dans
l’expérience et dans le langage : perte d’une dette, de l’espoir et de la peur. La violence
de l’événement a rompu un rapport de dette envers le père, envers ceux auxquels nous
serions redevables de notre vie. « S’il devient possible, en suivant le principe hégélien,
de ne plus être redevable de sa vie aux parents, on en devient le maître et le propriétaire. »
Je m’appuie là sur une proposition de Lucien Israël dans Pulsions de mort5. « Si nous en
sommes seuls responsables, nous avons le droit d’en disposer et à partir du moment où
ce droit est acquis, la peur de la mort disparaît. » Israël et Blanchot à leur insu se
répondent : « Qui dispose [de sa mort], dispose extrêmement de soi6 », écrit Blanchot
à propos de Kafka. « Seulement l’acquisition de ce droit à disposer de sa vie passe par
l’inconscient. » rappelle Israël. L’allusion à Hegel aux dernières pages de L’Instant de
ma mort aurait-elle valeur d’assentiment ? C’est un clin d’œil, bien sûr. À partir de là
nous pouvons comprendre que Blanchot, « désormais, [...] fut lié à la mort par une
amitié subreptice ». Le pouvoir mourir signe la rupture d’une dette. Il est le lieu d’une
perte sans manque. Nous percevons dès à présent que le rapport à la mort est condition
absolue de l’écriture : « L’on ne peut écrire que si l’on reste maître de soi devant la
mort, si l’on a établi avec elle des rapports de souveraineté7. » Blanchot ira jusqu’à
parler d’un don de la mort qui aurait été donné à Kafka et ce don est lié à celui de
l’écriture8. Si le don de la mort est acquis, l’espoir est sans emploi. Débarrassé de
l’espoir (« enfin débarrassé de ça » comme le dit Marguerite Duras dans La Pluie d’été),
c’est-à-dire débarrassé de l’espoir de soi, de l’espoir de sa propre vie, une place très
vaste se dégage pour autrui en soi, « le sentiment de compassion pour l’humanité
souffrante ». La peur, quant à elle, est tombée hors langage, devenue un morceau de
langage, devenue sa part morte, ainsi que Blanchot le précise dans Le Pas au-delà9.
5. Israël Lucien, Pulsions de mort, Strasbourg/Ramonville Saint-Agne, Arcanes/Éditions Érès,
« Hypothèses », 2007, p. 107.
6. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, « Folio/Essais », 1988, p. 110.
7. Ibid., p. 113.
8. Ibid., p. 113.
9. Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, op. cit., p. 84.
211
Blanchot.indb 211 29/11/13 11:56
C’est peut-être dans cette chute que naît « un sentiment de légèreté extraordinaire ».
La peur devenue la part morte du langage – « lapsus absolu10 », un mot qui tombe hors
langage sans qu’un autre le remplace – appelle la mort de Dieu. Le passage du seuil se fait
sans Dieu. « Peut-être déjà le pas au-delà. »
Blanchot, devant l’impensable de la mort, vit le pas au-delà, il est dedans, dans un
espace dont participent la vie et la mort et qui n’est ni l’un ni l’autre, neuter : c’est le
neutre, l’inconnu au neutre. La réponse à l’impensable, c’est quelque chose qui s’écrit
dans la rencontre de la mort et de la mort. Écrire a lieu dans cette faille : Blanchot se rend
au bord extrême d’écrire et c’est à partir de ce bord qu’il écrit.
À l’attente d’un récit que pourrait susciter le titre L’Instant de ma mort, Blanchot
répond par une parole oblique. Si nous avons en mémoire La Folie du Jour où l’événe-
ment de Quain est déjà présent, nous nous rappelons que la demande de récit jusque
dans les formes les plus bienveillantes de la demande, garde la marque d’une mise à la
question. Celui qui cède à l’injonction du récit pactise avec l’inquisiteur. Quelle est la
demande ? De fournir des faits, de fournir du vrai pour nous prouver que quelque chose
a eu lieu et que le passé n’est pas vide.
Si des faits peuvent être racontés, des couches de passé alors se sédimentent sur
lesquelles on peut prendre appui pour vivre innocemment le présent. Le récit aurait ainsi
pour fonction de garantir l’acte ou l’événement et de le préserver de la chute dans ce que
Blanchot nomme « l’effroyablement ancien, là où rien ne fut jamais présent ». Le récit
fait oublier la chute de l’événement dans le vide où le temps est aboli. Le récit colmate les
fissures par où une perte serait avérée. Le récit pactise-t-il avec quelque chose ? Le récit
pactise avec la folie. Le récit cherche un accommodement avec la folie, il négocie un lieu
viable. Avec la folie en tant que la perception soudaine du réel et la perte de ce qui
permettait de penser une unité. Avec la folie comme parole mangée de perte. La demande
de récit est portée par l’envie secrète que, s’en tenant aux faits et à la mort comme un fait,
la perte soit annulée. Blanchot ne se protège pas de la folie par le recours au récit.
Dans ce qui le désigne comme passé, le temps en tant que mesure d’une présence se
dérobe. L’événement est désormais insituable dans un présent. Si le récit vise à faire
oublier la chute dans le vide du temps, le récit par un renversement qui n’est pas si sur-
prenant, garantit l’oubli de l’événement même. Le fait sombre dans l’abîme de ce qu’on
10. Ibid., p. 85.
212
Blanchot.indb 212 29/11/13 11:56
appelle le passé, le récit signant l’oubli de la chute, est de facto l’oubli du fait. Il n’en
maintient la marque d’existence qu’au prix de l’illusion, et suggère Blanchot en conni-
vence avec la Loi peut-être : « Il le savait (en accord peut-être avec la loi) : le passé est
vide11. » La connivence est cet accord par lequel nous acceptons ensemble de serrer les
paupières et de fermer les yeux sur… le vide du passé. Ce qu’en d’autres termes, Lacan
affirme : « Qu’est-ce qu’un fait ? Il n’y a de fait que du fait que le parlêtre le dise. Il n’y a
pas d’autres faits que ceux que le parlêtre reconnaît comme tels en les disant. Il n’y a de
fait que d’artifice12. » Fournir des faits pour qu’il soit possible de jouir de leur illusoire
vérité. Que narrateur et inquisiteur soient ficelés au lieu d’une indistincte jouissance :
« Nous étions tous comme des chasseurs masqués. Qui était interrogé ? Qui répondait ?
L’un devenait l’autre13. » La parole ne remplit plus sa fonction qui consiste à inscrire la
différence des places ; sa fonction de séparation et de singularisation du sujet est abolie.
On ne sait plus qui est qui, caractéristique de la jouissance incestueuse.
Si L’Instant de ma mort se dérobe à ce qu’on peut appeler un récit, c’est qu’il déjoue la
tentation de faire passer le dire au dit. On ne pourra jamais – ou il faudrait une sacrée
prétention – indiquer : voilà ce qu’il y a dans cet événement, voilà exactement ce que
Blanchot a voulu dire, voilà ce qui se joue dans ces mots-là. C’est-à-dire qu’on ne rendra
pas le dire par un dit. Si nous faisons cette opération qui consiste à faire passer du dire
au dit, nous produisons à notre tour du récit à partir de la parole de Blanchot. Au fond
toute tentative ou tentation, de traduire un dire en termes de vérité, relève d’un mouve-
ment incestueux qui vise à jouir d’une vérité au lieu de l’autre et avec lui. « La rencontre
de la mort et de la mort ? », c’est, depuis notre savoir de vivant, une proposition impos-
sible et indémontrable. Le titre déjà l’annonce, L’Instant de ma mort, le titre peut-il ren-
voyer au nom de l’auteur, Maurice Blanchot ? L’ambigu est là, dès les premiers mots.
C’est un savoir déjà là et qui, comme pure poésie, ne se soumet à aucune preuve : « Je suis
vivant. Non, tu es mort. »
L’écriture ou la désécriture de l’événement interdit que soit établi un rapport du réel
auquel Blanchot est exposé, avec la vérité. L’inceste est à entendre ici comme métaphore
du rapport que la vérité entretiendrait avec le réel.
11. Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, op. cit., p. 23.
12. Lacan Jacques, Livre XXIII, Le Sinthome, Paris, Éditions du Seuil, « Champ Freudien »,
2005, p. 66.
13. Blanchot Maurice, La Folie du jour, Montpellier, Fata Morgana, 1973, p. 36.
213
Blanchot.indb 213 29/11/13 11:56
L’écriture de L’Instant de ma mort a lieu longtemps après l’événement qui l’inspire.
Blanchot revient sur l’événement non pour sa valeur informative mais parce qu’il a
quelque chose à y lire ; le désir y prend une part importante, il fonde la lecture que fait
l’écrivain de ce que le jeune Blanchot a – l’écrivain le croit – vécu : « Revenir, ce serait en
venir de nouveau à s’ex-centrer, à errer. Seule demeure l’affirmation nomade14. » Il erre
autour de l’événement et n’en saisit que de l’estompé. La béance du désir comme constat
d’absence en devient ici presque intime, tant elle parle.
L’écriture dans l’après vient au plus près de l’expérience d’une « sensibilité primor-
diale », je reprends la proposition de Christian Fierens lors d’un récent colloque à
Bruxelles sur « Parole et Topologie15 ». Sensibilité au plus ancien, qui serait en amont de
tout développement, et sensibilité servant d’origine à l’écriture de l’œuvre. Ces deux
mots, sensibilité primordiale, me paraissent essentiels pour approcher ce qui chez
l’homme Maurice Blanchot le met au contact du réel. Une « sensibilité primordiale » est
celle qui fait se rejoindre dans un même corps, le désir et le désastre. C’est celle qui très
tôt, dans l’enfance sans doute, a pris acte de la défaillance interminable de l’astre et de
l’absence définitive d’abri. C’est celle qu’évoque [Une scène primitive16 ?] où, sous les yeux
de l’enfant, le ciel s’ouvre sur son vide. À la vue du ciel soudain « noir absolument et vide
absolument », une joie « ravageante » submerge l’enfant, et pour nous lecteurs, cette joie
fait signe à l’allégresse souveraine du jeune homme face aux fusils nazis. La sensibilité
dont je parle n’éprouve pas le besoin de pousser les questions jusqu’au point qui confir-
merait l’interrogation : « Je sais – le sais-je – », « C’est dans le bois épais que tout à coup,
et après combien de temps, il retrouva le sens du réel. » Les questions laissent glisser le
mot, les mots, dans un sans fond, dont il serait tout à fait désuet d’attendre une réponse.
Ces questions érodées, privées de leur pouvoir d’interrogation, ont la douceur lente
d’une désaccoutumance et le goût de l’abandon pour celui que la réponse ne concerne
plus. Les questions reprendront leur fonction d’interrogation lorsqu’il sortira du bois, le
bois où le temps s’abolit - je ne peux m’empêcher de penser au bois sacré des tragédies
et des légendes que le héros traverse dans une absence de mémoire. Le jeune homme
verra les cadavres gonflés des chevaux dans les champs et les marques crues de la guerre,
14. Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, op. cit., p. 49.
15. Parole et topologie, colloque organisé à l’Université Libre de Bruxelles par Christian Fierens,
psychanalyste, et par Le Questionnement Psychanalytique, janvier 2011.
16. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, [Une scène primitive ?], Paris, Gallimard, 1980, p. 117.
214
Blanchot.indb 214 29/11/13 11:56
alors la question du temps écoulé se posera avec un point d’interrogation : « En réalité,
combien de temps s’était-il écoulé ? » pendant qu’il était dans le bois du temps arrêté.
L’Instant de ma mort n’offre aucune révélation dont nous pourrions nous saisir pour
assurer nos pas face à la peur et à la folie. Il y a pour nous lecteurs, une séparation à
accepter, et une solitude d’un dire qu’on ne peut cerner qu’à partir du réel, du réel comme
une impossibilité. Il faut s’en tenir à la dynamique du dire à partir de sa source, ici le réel.
On ne peut pas attraper ce dire ni le manipuler pour lui faire soutenir une vérité.
L’invention fulgurante « La rencontre de la mort et de la mort ? » est à lire et à entendre
comme un dire qui file de tous côtés, qui ne peut se compléter d’aucune affirmation ou
négation. Il est sans recours à la réalité extérieure. Blanchot écrit dans le pas au-delà, sans
les ressources de l’énoncé. Un « Dire hors dit » – parole de Blanchot dans L’Écriture du
désastre17 – parole d’écriture par où la rencontre se perpétue, de la mort et de la mort.
Lisant L’Instant de ma mort ou La Folie du jour, je ne peux atteindre un centre où je
viendrais récupérer quelque consistance, quelque unité du texte et à travers lui une
confirmation de ma propre consistance. La désécriture de Blanchot possède une vertu
active : elle rappelle d’une façon concrète, le lecteur à sa condition de sujet supposé. La
division du sujet se re-marque de la perte à laquelle le texte le renvoie.
Il y a là une parole qui ne s’accroche ni à un événement – des soldats vont tirer sur un
jeune homme, un officier nazi veut le tuer, objet visible de la scène – ni à l’affect de celui
qui est concerné, à savoir Blanchot. C’est une parole neutre. La perception qui se mani-
feste sous la forme de ces mots – la mort rencontrant la mort ? – est une perception du
neutre, une perception de ce qui ne relève ni du subjectif ni de l’objectif et qui peut se
produire parce que les deux sont présents – l’objectif de l’événement et le sujet concerné –
une perception qui se produit dans le neuter, dans le ni l’un ni l’autre. Le concept de
neutre s’inaugurerait ici, dans une aptitude de la perception, le neutre prendrait sa source
dans une porosité singulière qui a permis à Blanchot de frayer avec le réel, entendu dans
le sens où Lacan l’introduit dans le Séminaire sur le sinthome : « [...] cet impensable, c’est
la mort dont c’est le fondement du Réel qu’elle ne puisse être pensée ». Le neutre prend
place à cet endroit de l’écart entre la mort et la mort, à l’endroit du réel et la parole au
neutre s’écrira, dans l’œuvre, en direction du réel. Le neutre sourd de l’événement d’être,
17. Ibid., p. 116.
215
Blanchot.indb 215 29/11/13 11:56
remarquable dans ces scènes18 où la réalité descriptible et situable dans le temps, laisse voir
ses déchirures ; par elles file le réel, l’impensable du « rien au-delà ». Là se serait dessinée
pour un temps encore à venir la nécessaire fonction du neutre. Dans l’après, vient la
parole, parabole dont deux lettres sont tombées, qui contourne son objet pour le saisir et
qui le rate. Dire le réel, ça se rate, encore, ça se rate mieux, Beckett nous l’a dit.
Dans « La Mort du jeune aviateur anglais », Duras écrit : « Il y a souvent des récits, et
très peu souvent de l’écriture19. » Est-ce que l’écriture aurait lieu s’il n’y avait pas des
choses comme ça, la mort rencontrant la mort dans un corps de vivant ?
Le neutre, concept et figure littéraire, me semble remplir pour Blanchot une fonction
parallèle à celle du sinthome lacanien, à savoir la possibilité d’assurer un passage
d’existence là où la structure du sujet est en passe de faillir dans son nouage, le sinthome
venant reprendre le nouage du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire. Sans doute
Blanchot fait-il en juin 1944, l’expérience dont Antelme témoigne dans L’Espèce humaine :
« L’homme est l’indestructible qui peut être détruit20. » Le neutre viendra désormais
marquer et rappeler l’étroite ligne de l’indestructibilité toujours menacée. Surprenante
au regard de la ténuité apparente du concept, la puissance du neutre portera l’écriture de
Blanchot dans les régions les plus reculées de l’expérience humaine, là où il n’est de
parole que de « mi-dire » ou d’« entre-dire ». L’impensable de la mort se rappellera
comme le lieu à partir duquel il voit. La mort si présente dans son œuvre ne relève pas
d’un intérêt morbide, elle est le lieu inoubliable où se forma son regard.
18. À propos du titre [Une scène primitive ?] Blanchot indique que le mot scène a été donné
« simplement pour ne pas en parler ainsi que d’un événement ayant eu lieu à un moment du
temps », in L’Écriture du désastre, op. cit., p. 176.
19. Duras Marguerite, « La Mort du jeune aviateur anglais », in Écrire, Paris, Gallimard,
« Folio », 1993, p. 79.
20. Antelme Robert, Textes inédits sur L’Espèce humaine, Paris, Gallimard, « Blanche », 1996, p. 77.
Blanchot.indb 216 29/11/13 11:56
« Comme un souvenir indestructible » :
L’Instant de ma mort de Maurice Blanchot
Caroline Sheaffer-Jones
La révélation de Surlej, révélant que tout revient, fait du présent l’abîme où nulle présence n’a
jamais eu lieu et où s’est toujours déjà abîmé le « tout revient ».
Maurice Blanchot, Le Pas au-delà1
La mort impossible nécessaire : pourquoi ces mots – et l’expérience inéprouvée à laquelle ils se
réfèrent – échappent-ils à la compréhension ? Pourquoi ce heurt, ce refus ? Pourquoi les effacer en en
faisant une fiction propre à un auteur ?
Maurice Blanchot, L’Écriture du désastre2
Rien n’est moins animal en effet que la fiction, plus ou moins éloignée du réel, de la mort.
Georges Bataille, « Hegel, la mort et le sacrifice », Œuvres complètes, XII3
1. Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, Paris, Gallimard, 1973, p. 26. Voir aussi Bataille Georges,
« L’Obélisque », in Œuvres complètes. 11. Articles. Vol. 1, 1944-1949, Paris, Gallimard, 1970, p. 510-511.
2. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 110 ; voir aussi Derrida
Jacques, Demeure. Maurice Blanchot, Galilée, 1998, p. 56-59.
3. Bataille Georges, « Hegel, la mort et le sacrifice », in Œuvres complètes, XII, Paris, Gallimard,
1988, p. 337.
217
Blanchot.indb 217 29/11/13 11:56
La Dispersion
Dans L’Instant de ma mort, paru en 1994, Maurice Blanchot raconte l’histoire émouvante
d’un jeune homme qui, comme par miracle, échappa au peloton d’exécution en 1944,
tandis que trois jeunes gens furent fusillés. Si, encore une fois chez Blanchot, l’écriture et
la mort sont indissolublement liées, il est évident que dans ce texte d’ailleurs très court le
questionnement se déplace. Il n’y va pas de l’approche de la mort dans la poursuite d’une
parole originelle, comme dans L’Espace littéraire ou encore Le Livre à venir, mais du
témoignage d’un secret nécessairement indicible à jamais, d’une parole « témoignant
pour l’absence d’attestation4 ». Maurice Blanchot a écrit non seulement de nombreux
textes politiques, des articles de critique littéraire, recueillis dans plusieurs ouvrages, des
essais et des fragments d’ordre philosophique, mais aussi des romans et des récits. Or,
qu’en est-il de L’Instant de ma mort ? Ce témoignage porte sur ce qui est aux limites du
réel et de l’irréel ; les frontières entre l’histoire autobiographique et l’œuvre de fiction
sont problématiques. En effet, n’y aurait-il pas lieu de parler parfois sous forme de fiction,
surtout lorsqu’il s’agit de la mort ? Une telle « expérience-limite » ou plus exactement
« l’expérience inéprouvée », comme la décrit Maurice Blanchot dans L’Écriture du
désastre5, met forcément en jeu la « connaissance de l’inconnu6 », si l’on peut dire, et rend
incertaine la démarcation entre « la vérité » et « la fiction », l’autobiographie et la
narration. C’est sur cette question que je m’interroge ici, tout en me référant notamment
au texte intitulé « Autobiography As De-facement », publié par Paul de Man dans The
Rhetoric of Romanticism7, ainsi qu’à plusieurs écrits de Jacques Derrida.
L’Instant de ma mort a suscité de nombreuses réflexions importantes dont celles de
Jacques Derrida, Philippe Lacoue-Labarthe, René Major ou encore Ginette Michaud8.
4. Blanchot Maurice, Le Pas au-delà, op. cit., p. 107.
5. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, op. cit., p. 110. Voir aussi p. 181-182.
6. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 70-83.
7. Man Paul de, « Autobiography as De-facement », in The Rhetoric of Romanticism, New York,
Columbia University Press, 1984, p. 67-81.
8. Voir notamment Derrida Jacques, Demeure. Maurice Blanchot, op. cit. ; De Vries Hent, « “Lap-
sus Absolu” : Notes on Maurice Blanchot’s The Instant of My Death », in Yale French Studies, no 93,
1998, « The Place of Maurice Blanchot », p. 30-59 ; Major René, « Le jeune homme et la mort », in
Au commencement. La vie la mort, Paris, Galilée, 1999, p. 13-25 ; Lacoue-Labarthe Philippe, « La
Contestation de la mort », in Le Magazine littéraire, no 424, 2003, p. 58-60 (voir aussi Agonie termi-
née, agonie interminable. Sur Maurice Blanchot, suivi de L’émoi, Paris, Galilée, 2011, p. 91-117) ;
218
Blanchot.indb 218 29/11/13 11:56
Plusieurs questions philosophiques s’y lisent en filigrane, mais avant tout le problème de
la mort se pose, c’est-à-dire celui de « ma mort », de la mort propre ou encore de la mort
de « l’irremplaçable », comme l’évoque Derrida, entre autres, dans Chaque fois unique, la
fin du monde9. Dans L’Instant de ma mort, Blanchot reprend la problématique complexe
qu’il a explorée en détail de façons différentes, notamment à partir de Hegel, Heidegger,
Lévinas et Nietzsche. Comme dans « L’Indestructible. L’Espèce humaine10 », il décrit l’hor-
reur de l’inhumanité de l’homme envers l’autre, tout en mettant en avant la Résistance.
Dans L’Instant de ma mort, d’autres écrits sont reformulés, leurs contextes relancés et
déplacés. Par exemple, au début de l’histoire, l’évocation du souvenir fait écho non seule-
ment au poème intitulé « Souvenir » de Hölderlin, dont les derniers mots sont « les poètes/
Fondent ce qui demeure », mais aussi à l’interprétation du poème par Heidegger dans
Approche de Hölderlin11. Le titre Demeure. Maurice Blanchot de Jacques Derrida fait allu-
sion à un certain déplacement qui se lit dans L’Instant de ma mort à l’égard de ces textes,
Lecarme Jacques, « Demeure, la question de l’autobiographie (sur L’Instant de ma mort) », in Mau-
rice Blanchot. Récits critiques, Bident Christophe et Vilar Pierre (dir.), Tours, Farrago, 2003, p. 451-
462 ; Hoppenot, Éric (dir.), L’Épreuve du temps chez Maurice Blanchot, Paris, Éd. Complicités, 2006 ;
Michaud Ginette, Tenir au secret (Derrida, Blanchot), Paris, Galilée, 2006 ; Toudoire-Surlapierre,
Frédérique, « Derrida, Blanchot, “Peut-être l’extase” », in Fabula-LHT (Littérature, histoire, théorie),
no 1, 2006, « Les philosophes lecteurs », URL : http://www.fabula.org/lht/1/Toudoire-Surlapierre.
html ; Jeannelle Jean-Louis, « André Malraux et Maurice Blanchot à l’instant de la mort », in
Europe, no 940-941, 2007, p. 127-142 ; Davis Thomas S., “Neutral War. L’Instant de ma mort”, in
Clandestine Encounters : Philosophy in the Narratives of Maurice Blanchot, Hart Kevin (dir.), Notre
Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 2010, p. 304-326 ; Majorel Jérémie, « Blanchot,
mort-vivant », in Le Magazine littéraire, no 516, 2012, p. 85.
9. Derrida Jacques, Chaque fois unique, la fin du monde. Textes présentés par Pascale Anne
Brault et Michael Naas, Paris, Galilée, 2003, p. 9 ; Apories. Mourir, s’attendre aux « limites de la
vérité », Paris, Galilée, 1996. Voir aussi Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard,
1955, p. 101-131 ; « Écrire pour pouvoir mourir – Mourir pour pouvoir écrire », in ibid., p. 111.
10. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 191-200. Voir aussi « Tu peux tuer cet
homme », in ibid., p. 271-280 ; LÉvinas Emmanuel, « Tu ne tueras point », in Difficile Liberté.
Essais sur le judaïsme, Paris, Albin Michel, 1976, p. 21-23.
11. Voir, entre autres textes, Heidegger Martin, « Souvenir » (Andenken), in Approche de
Hölderlin, traduit par Henri Corbin, Michel Deguy, Françoise Fédier et Jean Launay, Paris,
Gallimard, 1973, p. 99-194. Heidegger écrit : « L’inhabituel ne se laisse pas immédiatement
rencontrer ni saisir dans l’habituel. L’inhabituel ne s’ouvre et n’ouvre l’Ouvert que dans la poésie
(ou, séparée d’elle par un abîme, et à son heure, dans la “pensée”) », in ibid., p. 131. Voir aussi
Heidegger Martin, « Que veut dire “penser” ? », in Essais et Conférences, traduit de l’allemand par
Préau André et préfacé par Beaufret Jean, Paris, Gallimard, 1958, p. 151-169 ; « Bâtir habiter
penser », in ibid., p. 170-193 ; Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 367-379.
219
Blanchot.indb 219 29/11/13 11:56
mais qui n’est pas non plus celui de « l’authenticité de l’exil » que met en relief Emmanuel
Lévinas dans sa lecture de Blanchot12. En somme, s’il est nécessaire de lire le récit de Blan-
chot dans sa singularité, il faut être attentif également à une certaine trace de l’écriture, à
un désœuvrement qui s’y opère.
Blanchot réfléchit à la mort de trois jeunes gens en 1944, événements dont il existe
d’autres témoignages13, et à sa mort. Par un biais, l’histoire a un air d’irréalité. Se référant
non seulement à ce récit mais aussi à une lettre qu’il avait reçue de Blanchot au moment
du cinquantième anniversaire des faits évoqués dans L’Instant de ma mort14, Derrida
pose le problème du rapport entre la fiction et le témoignage. Il écrit :
La possibilité de la fiction littéraire hante, comme sa propre possibilité, le témoi-
gnage dit vérace, responsable, sérieux, réel. Cette hantise est peut-être la passion même,
le lieu passionnel de l’écriture littéraire, comme projet de tout dire – et partout où elle
est auto-biographique, c’est-à-dire partout, et partout autobio-thanatographique15.
Au fond des témoignages différents de Blanchot, Derrida met donc en évidence la
hantise de la fiction littéraire, qui serait peut-être « la passion même ».
Dans « Autobiography as De-facement », Paul de Man souligne aussi l’impossibilité
d’écarter tout simplement la fiction du témoignage ou, plus précisément, de l’autobio-
graphie. J’insiste seulement sur quelques aspects de ce texte. Pour de Man, l’autobiogra-
phie ne dépend pas tout simplement de la référence ou de la réalité, contrairement à ce
que l’on croit. Au lieu de penser que la vie produirait l’autobiographie, censée être la
mise en scène de vies et d’événements réels, on pourrait dire, au contraire, que le projet
autobiographique lui-même pourrait produire et déterminer la vie – les actions de l’au-
teur seraient gouvernées ainsi par les nécessités de l’auto-portrait16. En effet, l’autobio-
graphie serait plutôt une « figure de lecture ou de compréhension », qui a lieu dans une
12. Lévinas Emmanuel, Sur Maurice Blanchot, Montpellier, Fata Morgana, 1975, p. 7-26.
13. Voir Bident Christophe, Maurice Blanchot partenaire invisible. Essai biographique, Paris,
Seyssel, Champ Vallon, 1998, p. 581-583 ; « La part de l’autobiographie », in Le Magazine littéraire,
no 424, 2003, p. 24-28.
14. Derrida Jacques, Demeure. Maurice Blanchot, op. cit., p. 64-65.
15. Ibid., p. 94. Voir aussi Passions de la littérature. Avec Jacques Derrida, Lisse Michel (dir.),
Paris, Galilée, 1996 ; Nancy, Jean-Luc, Maurice Blanchot. Passion politique, lettre-récit de 1984,
suivie d’une lettre de Dionys Mascolo, Paris, Galilée, 2011.
16. Man Paul de, « Autobiography as De-facement », in The Rhetoric of Romanticism, op. cit., p. 69.
220
Blanchot.indb 220 29/11/13 11:56
certaine mesure dans tous les textes. De cette façon, de Man met en avant une structure
spéculaire dans le « moment autobiographique », lorsque deux sujets s’alignent et se
déterminent, se substituant, l’un à la place de l’autre17. En fin de compte, puisque le
moment spéculaire ne caractérise pas seulement « l’autobiographie » mais fait partie
aussi de toute compréhension, on pourrait prétendre également qu’aucun texte n’est
« autobiographique ». Ce moment expose précisément « la structure tropologique de la
pensée ». De Man écrit :
Le moment spéculaire qui appartient à tout acte de compréhension révèle la struc-
ture tropologique qui sous-tend toutes les connaissances, y compris la connaissance
de soi. L’intérêt de l’autobiographie, dès lors, ce n’est pas de révéler une connaissance
de soi digne de foi – elle ne le fait pas – mais de démontrer de manière saisissante
l’impossibilité de la clôture et de la totalisation (c’est-à-dire l’impossibilité d’accéder
à l’être) de tous les systèmes textuels constitués par des substitutions tropologiques18.
D’après de Man, il y a donc un système de compréhension qui ne se ferme pas entre
l’auteur représenté dans le texte et celui qui l’écrit, ou encore entre l’auteur et le lecteur19.
Par l’évocation de cette structure spéculaire inéluctable, de Man met fondamentalement
en cause la connaissance de soi comme révélation pour souligner la dispersion des
« substitutions tropologiques ». De même, c’est sur l’impossibilité de la totalisation
qu’insiste Derrida dans sa lecture intitulée Mémoires, pour Paul de Man : « Loin d’assurer
l’identification à soi, le rassemblement auprès de soi, cette structure spéculaire met en
évidence une dislocation tropologique qui interdit la totalisation anamnésique de soi20 ».
Pour de Man, le manque de clôture de tous les systèmes textuels nous empêche de tran-
cher une fois pour toutes entre l’autobiographie et la fiction, entre la « vérité » et la
« fiction » qui, dans une certaine mesure, se recoupent.
Avant d’aborder L’Instant de ma Mort, je ferai quelques remarques sur l’histoire
d’Orphée de L’Espace littéraire, qui nous fait réfléchir à l’impossibilité de la totalisation
17. Ibid., p. 70.
18. Ibid., p. 71, passage cité in Derrida Jacques, Mémoires, pour Paul de Man, Paris, Galilée,
1988, p. 45. Voir aussi Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, op. cit., p. 105 ; Derrida Jacques,
Demeure, op. cit., p. 52-53.
19. Man Paul de, « Autobiography as De-facement », in The Rhetoric of Romanticism, op. cit., p. 72.
20. Derrida Jacques, Mémoires, pour Paul de Man, op. cit., p. 45.
221
Blanchot.indb 221 29/11/13 11:56
et à l’« éparpillement infini21 » des figures textuelles. La mise en rapport de ce texte et
de L’Instant de ma Mort fera ressortir ce qui est en jeu entre l’écrivain et les personnages
d’un récit, c’est-à-dire la relation problématique entre celui qui raconte une histoire et
ceux qui y figurent : il y va des limites entre la « vérité » et la « fiction ». Dans L’Espace
littéraire, où les confins du réel et de l’irréel sont indéfinis, Blanchot écrit sur plusieurs
auteurs dont Mallarmé, Kafka, Rilke et Hölderlin. Dans la déclaration liminaire du
texte, il constate ceci : « Un livre, même fragmentaire, a un centre qui l’attire », centre
« non pas fixe » et cependant « fixe aussi ». Le « point » vers lequel ce livre se dirigerait
serait « ici, vers les pages intitulées Le regard d’Orphée ». Blanchot réfléchit ici à dis-
tance à son œuvre presque achevée et pourtant à venir. Il jette un regard sur le livre, qui
est en train de se réaliser, pour essayer de voir son parcours. Pourtant, se retournant
vers les figures du texte dans la répétition du mouvement d’Orphée, il s’expose à la
dispersion sans fin. C’est comme si le regard de l’écrivain était celui de son personnage
Orphée, comme s’il se perdait dans la fascination de l’image22. Se reconnaissant de près
ou de loin dans le personnage mythique d’Orphée, voire Eurydice, l’écrivain serait déjà
mort et vivant, au regard à la fois fixe et non fixe. Il serait pris inévitablement dans le
non-savoir. Blanchot écrit dans ses propos liminaires : « Celui qui écrit le livre l’écrit
par désir, par ignorance de ce centre. Le sentiment de l’avoir touché peut bien n’être
que l’illusion de l’avoir atteint ». Au lieu de poursuivre le chemin de la connaissance de
soi, l’écrivain risque toujours de se perdre dans l’insaisissable. Écrire, c’est « passer du
Je au Il, de sorte que ce qui m’arrive n’arrive à personne » et enfin, c’est entrer dans
« l’interminable, l’incessant », dans le « recommencement éternel23 ».
Si de Man décrit l’impossibilité de la totalisation des systèmes textuels, Blanchot sou-
ligne par un biais différent l’impossibilité de comprendre l’espace littéraire comme
totalité. Au lieu d’accomplir la tâche de tout dire dans le mouvement par lequel il se
retourne, l’écrivain risque de disparaître dans le désœuvrement infini. Blanchot écrit
d’Orphée et d’Eurydice :
21. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 27.
22. Ibid., p. 25-27.
23. Ibid., p. 16-20, 27-28. « Écrire, c’est disposer le langage sous la fascination et, par lui, en lui,
demeurer en contact avec le milieu absolu, là où la chose redevient image, où l’image, d’allusion
à une figure, devient allusion à ce qui est sans figure et, de forme dessinée sur l’absence, devient
l’informe présence de cette absence, l’ouverture opaque et vide sur ce qui est quand il n’y a plus
de monde, quand il n’y a pas encore de monde », in ibid., p. 27-28.
222
Blanchot.indb 222 29/11/13 11:56
Euyridice est, pour lui, l’extrême que l’art puisse atteindre, elle est, sous un nom qui
la dissimule et sous un voile qui la couvre, le point profondément obscur vers lequel
l’art, le désir, la mort, la nuit semblent tendres. Elle est l’instant où l’essence de la nuit
s’approche comme l’« autre » nuit24.
Ce qu’Orphée voudrait saisir dans son œuvre, c’est justement cet « instant » de l’autre
nuit, « la dissimulation qui apparaît », au fond la présence de l’absence de tout. Dans
L’Espace littéraire, l’écrivain ferait face à l’impossibilité de sa tâche, telle serait la nostalgie
du « lointain souvenir du regard d’Orphée25 ». Si, dans L’Espace littéraire, Blanchot
approfondit ses réflexions au point où les limites entre l’écrivain et ses personnages
mythiques ne se dessinent pas clairement, dans « La Rencontre de l’imaginaire » du Livre
à venir, il ne s’interroge pas moins sur les frontières indéfinies de l’écriture. À la recherche
du moment où le récit se réaliserait vraiment, Blanchot considère la transformation
d’Ulysse en Homère26. Comme Homère et Ulysse, Melville et Achab ou alors Orphée et
Eurydice, Blanchot et les figures de ses écrits seraient tous inextricablement liés. De
même que Paul de Man insiste sur la difficulté de séparer de façon nette l’autobiographie
et la fiction, de même Blanchot ne cesse d’attirer l’attention sur les limites probléma-
tiques du réel et du fictif, surtout par rapport à l’« expérience » de la mort.
L’adresse
Comme le souligne de Man, le manque de clôture des systèmes tropologiques rend
impossible la distinction péremptoire entre l’autobiographie et la fiction. L’Instant de
ma mort porte également sur les limites où une telle distinction n’a plus de sens.
Pourtant, en un sens, il y a bien témoignage de l’« expérience » de la mort dans l’histoire
qui se présente. À la fin du texte, le narrateur parle du « sentiment de légèreté qui est la
mort même » et de « l’instant de ma mort désormais toujours en instance27 ». Ces mots
nous renvoient en quelque sorte au début du texte, où l’« instant » serait de nouveau
24. Ibid., p. 227, Blanchot souligne.
25. Ibid., p. 229-232.
26. « Entendre le Chant des Sirènes, c’est d’Ulysse qu’on était devenir Homère, mais c’est pour-
tant seulement dans le récit d’Homère que s’accomplit la rencontre réelle où Ulysse devient celui
qui entre en rapport avec la force des éléments et la voix du gouffre », in Blanchot Maurice, Le
Livre à venir, Paris, Gallimard, 1959, p. 15.
27. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, Montpellier, Fata Morgana, 1994, p. 20.
223
Blanchot.indb 223 29/11/13 11:56
« en instance » et où il y va encore une fois de la « mort même » : « Je me souviens d’un
jeune homme – un homme encore jeune – empêché de mourir par la mort même – et
peut-être l’erreur de l’injustice28. » Il y aurait, pour ainsi dire, un parcours où le récit
constituerait un « tout » et représenterait le témoignage d’un certain dépassement de la
mort. Quoique cette survie ne dépende pas de manœuvres, telles que les décrit Blanchot
chez Ulysse lors de la rencontre avec les Sirènes dans Le Livre à venir, c’est pourtant un
peu comme si l’on pouvait surmonter, au moyen d’artifices ou par un saut29, l’« expérience »
de la mort pour se retrouver dans son identité.
Dans L’Instant de ma mort, « l’erreur de l’injustice30 » et l’« expérience » de la mort
seraient donc à la limite compréhensibles, un peu comme dans « La littérature et le
droit à la mort ». Rappelons que dans cette conception, Blanchot écrit sur la littérature
à partir de la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel, tout en s’appuyant en particulier sur
Introduction à la lecture de Hegel par Kojève. Blanchot décrit l’écrivain, qui serait « le
maître de l’imaginaire » :
La vérité, c’est qu’il ruine l’action, non parce qu’il dispose de l’irréel, mais parce qu’il
met à notre disposition « toute la réalité ». L’irréalité commence avec le tout. L’imagi-
naire n’est pas une étrange région située par-delà le monde, il est le monde même, mais
le monde comme ensemble, comme tout31.
L’Instant de ma mort ferait écho à ces « moments fabuleux » révélés dans « La littérature
et le droit à la mort ». Dans ce texte, l’œuvre ne représenterait pas l’écriture d’un seul
écrivain, mais parlerait en tant qu’absolu à partir de rien. En somme, Sade serait l’écrivain
qui saurait tout dire à la fin de l’histoire et qui apprécierait la « souveraineté » dans la
mort : « Il écrit une œuvre immense, et cette œuvre n’existe pour personne. Inconnu,
mais ce qu’il représente a pour tous une signification immédiate. Rien de plus qu’un
écrivain, et il figure la vie élevée jusqu’à la passion, la passion devenue cruauté et folie32. »
La vérité de la littérature serait « cette vie qui porte la mort et se maintient en elle » ; par
la mort, par « le pouvoir prodigieux du négatif », « l’existence est détachée d’elle-même
28. Ibid., p. 7.
29. Voir Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 234.
30. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 7.
31. Blanchot Maurice, La Part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 307, Blanchot souligne.
32. Ibid., p. 309-311.
224
Blanchot.indb 224 29/11/13 11:56
et rendue significative33 ». Se métamorphosant sur ses deux versants, la littérature aurait
son origine dans « ce double sens initial » et elle serait comme le savoir absolu ou le Livre
de la fin de l’histoire34.
Si l’histoire de L’Instant de ma mort est bien différente de celle de « La littérature et le
droit à la mort », en un sens il s’agit aussi d’une histoire apocalyptique où tout serait en
jeu. La mention de Napoléon et de Hegel n’est pas fortuite. Rappelons que Hegel est le
Sage dans Introduction à la lecture de Hegel par Kojève. La vérité, « c’est Napoléon révélé
par Hegel, c’est Hegel révélant Napoléon ». Kojève écrit :
Ce Sage, qui révèle (par le « Savoir ») la réalité (incarnée en Napoléon), est l’incar-
nation de l’Esprit absolu : il est donc, si l’on veut, ce Dieu incarné dont rêvaient les
Chrétiens. (Le Christ véritable, réel = Napoléon-Jésus + Hegel-Logos ; l’incarnation a
donc lieu non au milieu, mais à la fin des temps35.)
Par ailleurs, Kojève souligne que dans cette réalisation de l’histoire, il y aurait satisfac-
tion définitive, ce qui rendrait « inutile et impossible toute fuite (Flucht) dans un « au-
delà » (Jenseits), fuite qui s’effectue dans la Foi ou par l’imagination artistique36 ». Dans
L’Instant de ma mort, il ne faut pas oublier que le narrateur se demande si le lieutenant
était « assez cultivé » pour associer la date sur la façade du Château avec la bataille de
Iéna et la reconnaissance par Hegel en Napoléon comme « l’âme du monde ». Pourtant
le narrateur ajoute qu’il s’agit de « Mensonge et vérité », puisque « les Français pillèrent
et saccagèrent sa demeure37 ». Il est évident donc que L’Instant de ma mort s’inscrit au-
delà de toute révélation de la vérité et que Blanchot met en cause la conception d’une
prise de conscience de l’absolu, telle que la décrit Kojève à partir de Hegel.
L’Instant de ma mort expose un parcours, qui n’est pas de l’ordre de la vérité et qui ne
se laisse pas concevoir simplement comme survie ou comme dépassement de
33. Ibid., p. 330-331.
34. Voir Kojève Alexandre, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménologie de
l’Esprit professées de 1933 à 1939 à l’École des Hautes Études, réunies et publiées par Raymond
Queneau, Paris, Gallimard, 1947, p. 384-395.
35. Ibid., p. 147-148. Dans un autre contexte, voir aussi Derrida Jacques, L’Écriture et la
différence, Paris, Seuil, 1967, p. 38-39.
36. Kojève Alexandre, Introduction à la lecture de Hegel, op. cit., p. 155. Kojève souligne. Voir
aussi Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 284-286.
37. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 14-15.
225
Blanchot.indb 225 29/11/13 11:56
l’« expérience » de la mort. Dans cette lecture, le récit très court de Blanchot ne se boucle
pas mais fait signe vers l’ouverture, vers le secret de la « mort même » et le « mot-
absence38 ». Derrida met en relief une parodie dans le texte : « la Passion, la Résurrection,
le Savoir absolu sont mimés, répétés et déplacés. Et c’est déjà dans la vie sans vie de cette
survivance désormais comme fictive que tout savoir va trembler39 ». La négativité
hégélienne est simulée et déplacée dans la répétition. Mise en cause est la conscience de
soi, où le maître accepterait le risque de la mort, tandis que l’esclave serait attaché à la vie.
Le jeune homme du récit fait face à la mort et « ne cherchait pourtant pas à fuir40 ». On
croyait qu’il appartenait à « une classe noble », celle des « Seigneurs41 ». Cependant il
s’agit plutôt d’une confrontation avec la mort, qui ne dit rien, qui ne témoigne que de
l’absence, dépassant toute « économie restreinte42 ». L’Instant de ma mort nous ramène
sans arrêt au bord de l’abîme. Pour décrire l’« expérience » de l’inconnu et le « face-à-
face43 », Blanchot a recours au « comme si ». Au moment où le nazi met en rang les
hommes, le jeune homme pense qu’il faut faire rentrer sa famille dans la maison. Il y
avait alors « un long et lent cortège, silencieux, comme si tout était accompli44 ». Ce serait
l’instant de la mort du jeune homme, des jeunes gens, la fin de « tout ». C’est comme si
l’on regardait le cortège funèbre lors de son enterrement ; comme si la voix d’outre-
tombe annonçait la fin. C’est l’histoire d’une passion, qui fait écho aux paroles du Christ
38. Blanchot se réfère aussi au « mot-trou » dans Le Ravissement de Lol. V. Stein de Marguerite
Duras pour décrire la « voix narrative », « une voix neutre qui dit l’œuvre à partir de ce lieu sans
lieu où l’œuvre se tait », in Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 565.
39. Derrida Jacques, Demeure, op. cit., p. 80.
40. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 8.
41. Ibid., p. 15-16.
42. Derrida Jacques, « De l’économie restreinte à l’économie générale. Un hégélianisme sans
réserve », in L’Écriture et la différence, op. cit., p. 369-407 ; Bataille Georges, « La Part maudite.
Essai d’économie générale », in Œuvres complètes, VII, Paris, Gallimard, 1976, p. 17-179.
43. Dans « Tout autre est tout autre », Derrida écrit : « Il n’y a pas de face-à-face et de regard
échangé entre Dieu et moi, entre l’autre et moi. Dieu me regarde et je ne le vois pas, et c’est depuis ce
regard qui me regarde que ma responsabilité s’initie », in Donner la mort, Paris, Galilée, 1999, p. 126.
44. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 10.
226
Blanchot.indb 226 29/11/13 11:56
au moment de la mort : « Tout est achevé45 », mais le sacrifice serait conçu dans une
perspective bien différente46.
Tout se joue dans le récit entre le narrateur et le jeune homme, entre le « réel » et
l’« irréel », le temps et l’éternité. Par la séparation du « je » et du « il », le narrateur et le
personnage n’occuperaient pas en effet le même espace. Plutôt que le rêve nostalgique de
la « simultanéité imaginaire » ou des « extases temporelles » du Livre à venir47, L’Instant
de ma mort évoquerait la non-contemporanéité de l’« absence de communauté48 ». Dans
ce récit, il y aurait d’une part, l’immobilité de l’éternité ou l’« extase » dont s’approche-
rait peut-être le jeune homme et d’autre part, du côté du narrateur qui se souvien-
drait des événements, un mouvement dans l’espace et le temps. Après avoir signalé le
départ du lieutenant, qui s’est renseigné sur la bataille des « camarades du maquis », le
narrateur ajoute : « Les Allemands restaient en ordre, prêts à demeurer ainsi dans une
immobilité qui arrêtait le temps49 ». Derrida décrit « l’instant éternel » des tableaux de
Goya et de Manet, Le Trois Mai (1814), ainsi que l’Exécution de Maximilien (1868)50. Le
Château avec l’inscription de la date marquerait la fin de l’histoire ; « Sur la façade était
inscrite, comme un souvenir indestructible, la date de 180751. » Pourtant, dans L’Instant
de ma mort, c’est aussi comme si, invraisemblablement, un pas au-delà s’effectuait entre
45. « Puis, sachant que tout était achevé désormais, Jésus dit, pour que toute l’Écriture s’accom-
plit : “J’ai soif […] Tout est achevé” », L’Évangile selon Saint Jean, 19 : 28, 29. Notons que le jeune
homme « avançait lentement d’une manière presque sacerdotale ». Blanchot écrit : « Je crois qu’il
s’éloigna, toujours dans le sentiment de légèreté, au point qu’il se retrouva dans un bois éloigné,
nommé “Bois des bruyères”, où il demeura abrité par les arbres qu’il connaissait bien. C’est dans
le bois épais […] », in L’Instant de ma mort, op. cit., p. 9 ; p. 12-13.
46. Voir notamment Nietzsche Friedrich, L’Antéchrist. Imprécation contre le Christianisme, in
Œuvres, II, Lacoste Jean et Le Rider Jacques, traduction par Albert Henri, traduction révisée par
Lacoste Jean, Paris, Éditions Robert Laffont, 1993, p. 1031-1103. Ecce homo se termine par les mots
« M’a-t-on compris ? – Dionysos face au Crucifié… », in Nietzsche Friedrich, Ecce homo. Comment
on devient ce qu’on est, dans Œuvres, II, Lacoste Jean et Le Rider Jacques (dir.), traduction par
Albert Henri, traduction révisée par Lacoste Jean, Paris, Éditions Robert Laffont, 1993, p. 1198.
47. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, op. cit., p. 19.
48. Voir Blanchot Maurice, La Communauté inavouable, Paris, Les Éditions de Minuit, 1983,
p. 12-13.
49. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 12.
50. Derrida Jacques, Demeure, op. cit., p. 96.
51. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 14. Derrida note : « C’est le lundi
13 octobre 1806 que Iéna fut occupé par les Français. » Voir Derrida Jacques, Demeure, op. cit.,
p. 109-111, note 1 ; p. 112, note 1 ; Michaud Ginette, Tenir au secret, op. cit., p. 75-79.
227
Blanchot.indb 227 29/11/13 11:56
le « réel » et l’« irréel », entre le narrateur et le jeune homme, entre la « vie » et la « mort ».
Si le narrateur dit du jeune homme : « À sa place, je ne chercherai pas à analyser ce sen-
timent de légèreté », c’est aussi comme si, à la limite, le narrateur se trouvait à cette place.
Il offre une analyse à la place du jeune homme, à « sa » place, tout en gardant une cer-
taine distance envers l’autre : « Il était peut-être tout à coup invincible. Mort-immortel.
Peut-être l’extase52. » Comme le jeune homme, le narrateur serait emporté par la mort ;
l’un et l’autre, ne tenant pas pour autant « ensemble53 », seraient entraînés dans un face-
à-face qui ne se situerait ni dans le réel ni dans l’irréel.
Dans L’Instant de ma mort, il y a un va-et-vient de l’écriture, en quelque sorte une
« marche de l’écrevisse54 », car le texte se reprend sans cesse, souvent par l’inversion des
mots ou l’emploi du chiasme. Blanchot écrit : « Je me souviens d’un jeune homme » et
ensuite les mots « jeune » et « homme » se trouvent dans l’ordre inverse : « – un homme
encore jeune ». De même, nous lisons : « Cette fois, hurlement : “Tous dehors” » et puis
« “Dehors, dehors.” Cette fois, il hurlait » ou encore « Je sais – le sais-je55 ». Ces tournures
ont pour effet de marquer le pas et de montrer l’indifférence entre les progressions et les
régressions de l’histoire dans ce témoignage, qui aurait lieu après le Livre de la fin de
l’histoire56. Pourtant, par la répétition des mots, par le déplacement des figures, il est
évident aussi que le texte s’affirme. Si le Russe parle « d’une voix ferme », le mot « ferme »
est repris dans l’expression « toutes les fermes brûlaient57 ». Si Blanchot écrit : « Napo-
léon, sur son petit cheval gris, passait sous les fenêtres de Hegel », il note également ceci
dans cette histoire : « Même les chevaux gonflés, sur la route, dans les champs, attestaient
une guerre qui avait duré58 ». Au fond, il ne s’agit ni de la vérité selon Kojève, à savoir
« Napoléon révélé par Hegel », « Hegel révélant Napoléon59 », ni du Livre de la fin de
l’histoire. Les figures de Napoléon et de Hegel feraient partie plutôt de l’absence d’œuvre,
52. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 11.
53. Voir Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, op. cit., p. 42.
54. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 45.
55. Voir Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 7-10.
56. Voir aussi Derrida Jacques, « De l’économie restreinte à l’économie générale », in L’Écriture
et la différence, op. cit., p. 406-407 ; De la grammatologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1967,
p. 15-41 ; Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, op. cit., p. 118-120.
57. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 12-13.
58. Ibid., p. 13-14.
59. Kojève Alexandre, Introduction à la lecture de Hegel, op. cit., p. 148.
228
Blanchot.indb 228 29/11/13 11:56
de l’attestation impossible. Dans « La Voix narrative (“le il, le neutre”) », Blanchot décrit
« le tourment de l’impossible narration », « l’attrait d’une parole tout à fait extérieure :
la pure extravagance60 ».
Si L’Instant de ma mort commence par « Je me souviens », c’est-à-dire en un sens par
le regard d’Orphée, il arrive un moment où l’on ne sait si c’est le narrateur ou si c’est le
jeune homme qui parle. À la fin de la première partie du texte, Blanchot écrit :
C’était cela, la guerre : la vie pour les uns, pour les autres, la cruauté de l’assassinat.
Demeurait cependant, au moment où la fusillade n’était plus qu’en attente, le senti-
ment de légèreté que je ne saurais traduire : libéré de la vie ? L’infini qui s’ouvre ? Ni
bonheur, ni malheur. Ni l’absence de crainte et peut-être déjà le pas au-delà. Je sais,
j’imagine que ce sentiment inanalysable changea ce qui lui restait d’existence. Comme si
la mort hors de lui ne pouvait désormais que se heurter à la mort en lui. « Je suis vivant.
Non, tu es mort61. »
Le « je » et le « il » seraient aux limites du « face-à-face » ou du moment spéculaire, où
il n’y a pas de certitude mais plutôt l’impression « Je sais, j’imagine ». On ne sait qui
parle à la fin du paragraphe. Est-ce le jeune homme qui se parle ou est-ce le narrateur
qui commence à réfléchir à sa situation ? S’agit-il d’un monologue ou d’un dialogue ?
Qui serait vivant et qui serait mort ? À cet instant, le passé et l’avenir seraient en jeu. Ni
vivants ni morts, le narrateur et le jeune homme ne seraient en face de personne, l’un et
l’autre entraînés sans cesse dans la rencontre avec la mort, « l’infini qui s’ouvre ? ».
« L’instant de la mort » envahirait tous les moments, un peu comme le « point fixe » et
« cependant non fixe » de L’Espace littéraire. Ouverture sans fin, le texte affirmerait le
non-savoir, l’absence, « La rencontre de la mort et de la mort62 ? ». L’Instant de ma mort
est en un sens le témoignage impossible d’un jeune homme, de trois jeunes gens, ainsi
que d’autres. Pourtant, au fond, il n’y aurait pas de compréhension de l’« expérience » de
la mort, aucun « vrai deuil »63 du désastre.
60. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 567, note 1. Voir aussi Lévinas Emmanuel,
Totalité et infini, essai sur l’extériorité, La Haye, Martinus Nijhoff, 1961, 161-195.
61. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 16-17. Voir aussi Derrida Jacques,
Demeure, op. cit., p. 129-130.
62. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 10.
63. Voir Derrida Jacques, Mémoires, pour Paul de Man, op. cit., p. 50-54.
229
Blanchot.indb 229 29/11/13 11:56
L’Instant de ma mort dépasse la conception de la fin de l’histoire décrite par Kojève. Les
mots « amitié », « extase », « bataille » font écho à un dialogue soutenu entre Blanchot et
Bataille ; il y a le rire, la poésie et l’extase de L’Expérience intérieure64. Bataille expose la
tache aveugle dans l’entendement, à la place du savoir absolu, c’est-à-dire l’ouverture
sans fond où l’entendement se perd. Par le « sentiment de légèreté » nietzschéenne, par
l’« allégresse souveraine » et les remarques de l’un des Russes dans « une sorte de rire65 »,
il est évident qu’il ne s’agirait donc pas de « maîtrise » dans L’Instant de ma mort mais de
« souveraineté » ; il y va de ce qui excède la vérité de la conscience de soi. La « perte abso-
lue du sens » n’apparaîtrait pas dans l’économie de vie qu’est la phénoménologie de
l’esprit. Derrida insiste sur l’éclat de rire de Bataille, qui, bien sûr, ne révèle pas la souve-
raineté mais accuse la différence entre la maîtrise et la souveraineté66. Dans cette lecture
de Bataille, Derrida écrit :
Être impassible, comme le fut Hegel, à la comédie de l’Aufhebung, c’est s’aveugler à
l’expérience du sacré, au sacrifice éperdu de la présence et du sens. Ainsi se dessine une
figure d’expérience – mais peut-on encore se servir de ces deux mots ? – irréductible à
toute phénoménologie de l’esprit, s’y trouvant, comme le rire en philosophie, « dépla-
cée », mimant, dans le sacrifice, le risque absolu de la mort, produisant à la fois le risque
de la mort absolue, la feinte par laquelle ce risque peut être vécu, l’impossibilité d’y lire un
sens ou une vérité, et ce rire qui se confond, dans le simulacre, avec l’ouverture du sacré67.
64. Bataille écrit : « Dans le “système”, poésie, rire, extase ne sont rien, Hegel s’en débarrasse à la
hâte : il ne connaît de fin que le savoir. Son immense fatigue se lie à mes yeux à l’horreur de la
tache aveugle. », in Bataille Georges, L’Expérience intérieure, dans Œuvres complètes, V, Paris,
Gallimard, 1973, p. 130. Voir aussi Bataille, Georges, « Ce monde où nous mourons », in
Critique, no 123-124, 1957, p. 675-684 ; Halsberghe Christophe, « Georges Bataille ou les limites
d’une entente », in Maurice Blanchot, de proche en proche, Hoppenot Éric, Manoury Daiana,
(dir.), Paris, Éditions Complicités, 2008, p. 245-263.
65. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 10-12.
66. Derrida Jacques, L’Écriture et la différence, op. cit., p. 375-376. Voir aussi Séminaire, La bête et
le souverain. Volume 2 (2002-2003), Lisse Michel, Mallet Marie-Louise, Michaud Ginette (dir.),
Paris, Galilée, 2010, p. 247-271 ; Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, op. cit., p. 200.
67. Derrida Jacques, L’Écriture et la différence, op. cit., p. 378, Derrida souligne. Bataille écrit :
« L’émoi dont je parle est connu, il est définissable, et c’est l’horreur sacrée : l’expérience à la fois
la plus angoisssante et la plus riche, qui ne se limite pas d’elle-même au déchirement, qui s’ouvre
au contraire, ainsi qu’un rideau de théâtre, sur un au-delà de ce monde-ci, où le jour qui s’élève
transfigure toutes choses et en détruit le sens borné. » Bataille, Georges, « Hegel, la mort et le
sacrifice », in Œuvres complètes, op. cit., XII, p. 338, Bataille souligne.
230
Blanchot.indb 230 29/11/13 11:56
C’est une voix « spectrale, fantomatique68 » qui parle dès le début de L’Instant de ma mort.
Dans le mouvement par lequel le « je » se souvient du jeune homme, c’est comme s’« il »
parlait déjà à partir de la mort. Le « je me souviens » n’indiquerait pas l’identité à soi d’un
sujet, même si les mots « je » et « me » sont on ne peut plus proches l’un de l’autre, mais
plutôt un « je » déjà traversé par la mort. Dans Mémoires. Pour Paul de Man, Derrida écrit :
[…] « nous » ne sommes jamais « nous-mêmes », et entre nous, identiques à nous,
un « moi » n’est jamais en lui-même, identique à lui-même, cette réflexion spéculaire ne
se ferme jamais sur elle-même, elle n’apparaît pas « avant » cette « possibilité » du deuil,
avant et hors de cette structure d’allégorie et de prosopopée qui constitue d’avance tout
« être-en-nous », « en-moi », entre nous ou entre soi. Le Selbst, le self, le soi-même ne s’ap-
paraît que dans cette allégorie endeuillée, dans cette prosopopée hallucinatoire – et avant
même que la mort de l’autre n’arrive « effectivement », comme on dit, dans la « réalité »69.
L’Instant de ma mort serait comme des mémoires d’outre-tombe, destinés à tous et à
personne, car le récit se situerait en effet dans cette temporalité indéfinissable du « tout à
coup, et après combien de temps70 ». Celui qui parle s’adresserait, au-delà de la mort, aux
autres, à lui-même comme autre, aux jeunes gens qui furent tués cruellement en 1944 et
aux survivants. Le texte serait comme une « archive » que Derrida associe, dans Mal
d’Archive, avec l’« expérience irréductible de l’avenir71 ». Si, dans L’Instant de ma mort,
dans ce « livre testamentaire72 », Blanchot se retourne vers certains événements du passé,
vers la mort toujours déjà survenue, voire le passé immémorial, il affirme avant tout
l’ouverture à ce qui vient73. Hantise de l’avenir toujours déjà passé, ce témoignage ne
serait ni de l’ordre du réel ni de l’ordre du fictif.
68. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 566.
69. Derrida Jacques, Mémoires, pour Paul de Man, op. cit., p. 49, Derrida souligne. Voir aussi Man
Paul de, “Allegory of Reading (Profession de foi)”, in Allegories of Reading. Figural Language in Rousseau,
Nietzsche, Rilke, and Proust, New Haven et Londres, Yale University Press, 1979, p. 221-245.
70. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 13. Blanchot écrit dans Le Livre à venir :
« aussitôt quoique peu à peu », op. cit., p. 28.
71. Derrida Jacques, Mal d’Archive, Paris, Galilée, 1995, p. 109. Voir aussi Lisse Michel, L’Expé-
rience de la lecture. 2. Le glissement, Paris, Galilée, 2001, p. 116-118 ; « Le concept de “scène de
lecture” chez Paul de Man », ibid., p. 153-159.
72. Lacoue-Labarthe Philippe, « La Contestation de la mort », op. cit., p. 58.
73. Derrida décrit l’« ouverture messianique à ce qui vient » et le « messianique sans messia-
nisme », in Derrida Jacques, Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle
Internationale, Paris, Galilée, 1993, p. 111-112
231
Blanchot.indb 231 29/11/13 11:56
Rappelons que dans l’article intitulé « Autobiography as De-facement », Paul de Man
souligne l’impossibilité de la totalisation des systèmes tropologiques. Les frontières entre
l’autobiographie et l’œuvre de fiction seraient indécidables. Dans L’Instant de ma mort,
le narrateur et le personnage du jeune homme se disent l’un et l’autre, l’un à l’autre : « Je
suis vivant. Non, tu es mort ». On ne sait plus qui parle dans cette rencontre étrange :
tous les deux seraient comme des spectres. C’est comme si, à l’instant, l’un et l’autre
étaient morts et ne pouvaient pas témoigner. Comme Orphée et Eurydice, Melville et
Achab, Homère et Ulysse, le narrateur et les personnages de L’Instant de ma mort seraient
toujours déjà pris dans une sorte de face-à-face avec la mort, qui traverse la vie. Il y va de
ce qui dépasse la connaissance, du secret de l’inconnu, de la cendre qu’évoque Derrida
dans Feu la cendre74.
À la fin de l’histoire, Blanchot décrit une rencontre avec Malraux. « Plus tard, revenu à
Paris, il rencontra Malraux. Celui-ci lui raconta qu’il avait été fait prisonnier (sans être
reconnu), qu’il avait réussi à s’échapper, tout en perdant un manuscrit. “Ce n’étaient que
des réflexions sur l’art, faciles à reconstituer, tandis qu’un manuscrit ne saurait l’être”75. »
Avec Paulhan, « il » chercha en vain le manuscrit. Lors du pillage de « la chambre haute »
du Château par les Allemands, le jeune homme aussi avait perdu un manuscrit. Ce vide
s’inscrit en abîme dans le récit ; c’est en effet comme si tout le texte de L’Instant de ma mort
ne témoignait que de l’ouverture de l’infini76. L’Instant de ma mort ne signalerait que le vide
des manuscrits emportés. Cependant, si le néant se montrait, en un sens comme s’il s’agis-
sait du vide du tombeau du Christ ressuscité – évoqué dans Les Intellectuels en question77 –,
Blanchot témoignerait aussi des trois jeunes gens abattus, d’un jeune homme et de la résis-
tance courageuse devant l’injustice. Contrairement aux trois figures, Malraux, Paulhan et
Blanchot de la deuxième partie du récit, les trois jeunes gens ne laissent pas de témoignage.
Ce sont ces âmes, plutôt que « l’âme du monde » symbolisée par Napoléon, que le texte de
74. Derrida Jacques, Feu la cendre, Paris, Des femmes, 1987.
75. Blanchot Maurice, L’Instant de ma mort, op. cit., p. 19.
76. On sait que dans ses analyses de La Folie du jour dans Parages, Derrida met en relief l’inva-
gination du bord initial et du bord intérieur du récit de Blanchot, notamment par rapport à la
répétition des mots « Je ne suis ni savant ni ignorant », in « Un récit ? », Derrida Jacques, Parages,
Paris, Galilée, 2003, p. 250-257. Blanchot Maurice, La Folie du jour, Montpellier, Fata Morgana,
1973, p. 9, 36, 38.
77. Blanchot Maurice, Les Intellectuels en question. Ébauche d’une réflexion, Paris, Fourbis,
1996, p. 7-8.
232
Blanchot.indb 232 29/11/13 11:56
Blanchot fait vivre. Blanchot s’adresse à elles dans L’Instant de ma mort, ainsi qu’à tous ceux
qui font l’« expérience » de la mort.
Rappelons que pour de Man, qui se réfère notamment à Shakespeare, Milton et
Wordsworth dans « Autobiography as De-facement », il n’y a pas de totalisation des sys-
tèmes tropologiques, d’où l’impossibilité de distinguer de façon nette entre l’autobiogra-
phie et la fiction. La figure de l’autobiographie ou du discours épitaphique serait d’ailleurs
la prosopopée, la « fiction de la voix-d’outre-tombe ». Le soleil, en tant qu’esprit souverain,
lirait l’épitaphe ou le « nom nu ». L’épitaphe se transformerait en « voix » à partir du soleil,
qui la « regarde » ; « une pierre sans inscription laisserait le soleil suspendu dans le néant78 ».
Dans Mémoires, pour Paul de Man, Derrida souligne que cette « fiction de la voix d’outre-
tombe » « hante toute voix dite réelle et présente79 ». Il est évident aussi que L’Instant de ma
mort ne porte ni sur le « réel » ni sur le « fictif ». Dans « La Nuit surveillée », des Écrits
politiques 1953-1993, Blanchot réfléchit de nouveau à l’espèce humaine et s’adresse à
Robert Antelme : « Je me persuadais que vous étiez là : non pas vous, mais cette parole
répétée : “Je m’éloigne, je m’éloigne”. » Enfin, Blanchot écrit : « Nous maintiendrons la plé-
nitude jusque dans le néant80. » Dans L’Instant de ma mort, récit d’un certain face-à-face
avec la mort, la voix d’outre-tombe parlerait un instant, éternellement, pour faire vivre
trois jeunes gens, un jeune homme, ainsi que ceux qui ont perdu la vie et ceux qui feront
face à la mort. Si, dans L’Instant de ma mort, le nom devient aussi « mémorable qu’un
visage », pour reprendre la description de la prosopopée par de Man, il faut rappeler que
cette adresse affirme déjà non seulement le « don des visages », mais aussi leur « retrait »,
la figuration et l’effacement81.
78. Man Paul de, « Autobiography as De-facement », in The Rhetoric of Romanticism, op. cit.,
p. 75-77. Voir aussi Derrida Jacques, Mémoires, pour Paul de Man, op. cit., p. 47.
79. Ibid., p 47-48.
80. Blanchot Maurice, Écrits politiques, 1953-1993. Textes choisis, établis et annotés par Éric
Hoppenot, Paris, Gallimard, 2008, p. 251-252.
81. Voir Man Paul de, « Autobiography as De-facement », in The Rhetoric of Romanticism,
op. cit., p. 76-81 ; Derrida Jacques, Mémoires, pour Paul de Man, op. cit., p. 48-49.
233
Blanchot.indb 233 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 234 29/11/13 11:56
Le Très-Haut est-il un roman religieux ?
François Brémondy
À Georges Kliebenstein
Peut-être a-t-il changé la condition de tous, peut-être seulement la mienne.
Maurice Blanchot, Le Dernier homme
À
quel genre de roman appartient Le Très-Haut ? Une telle question apparaî-
tra sans doute datée, et dépassée à un moment où, si l’on en croit Blanchot,
« chaque livre semble […] indifférent à la réalité des genres » : « seul importe le
livre, tel qu’il est, loin des genres, en dehors des rubriques, prose, poésie, roman, témoi-
gnage, sous lesquelles il refuse de se ranger et auxquelles il dénie le pouvoir de lui fixer sa
place et de déterminer sa forme. Un livre n’appartient plus à un genre, il appartient à la
seule littérature1… » Avant Blanchot Benedetto Croce et après lui Theodor Adorno2
1. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, Paris, 1959, p. 292-293. Voir Blanchot
Maurice, L’Espace Littéraire, Paris, Gallimard, 1955, p. 294, note 1.
2. Adorno Theodor Wiesengrund, Théorie esthétique, Paris, Klincksieck, 1970, p. 255.
235
Blanchot.indb 235 29/11/13 11:56
professèrent ce nominalisme esthétique. Certes, « le concept de genre est emprunté aux
sciences naturelles3 ». Or la découverte de l’évolution biologique a conduit à rejeter l’es-
sentialisme4 et à reconnaître avec Darwin que la variation individuelle est la réalité natu-
relle fondamentale. Mais, contrairement à ce que semble penser Blanchot, le refus
d’admettre « un ordre des essences » n’implique pas la négation de « la réalité des genres »
– on doit seulement les concevoir autrement, tout comme les espèces : non plus
immuables, mais engendrés. On devrait dire qu’il y a bien une réalité des genres litté-
raires, mais dérivée, et que, de même que les espèces vivantes dérivent d’individus
mutants, les genres procèdent de certaines œuvres exceptionnelles5. Je crois donc pouvoir
légitimement rechercher le genre du Très-Haut (relève-t-il, comme on l’a dit, du fantas-
tique, ou, comme je le crois, de l’étrange) et surtout, la lignée dans laquelle il s’inscrit.
Le Très-Haut et la Peste
L’argument n’a rien d’extraordinaire. Un jeune fonctionnaire (Henri Sorge) est cir-
convenu par un voisin (Pierre Bouxx), apparemment un médecin, en réalité le chef
d’une organisation subversive, qui a reconnu en lui le beau-fils d’un membre de l’appa-
reil d’État – un État plus ou moins totalitaire. Une épidémie se déclare. Le chef révolu-
tionnaire met à profit l’incapacité de l’administration pour prendre le contrôle de la
région infestée. Le jeune homme, l’un des premiers malades, choisit, contre le souhait de
son beau-père et sur l’invitation du chef révolutionnaire, de rester dans l’immeuble
transformé en hôpital. À la fin, le chef révolutionnaire déclenche une insurrection géné-
rale. Une infirmière (Jeanne Galgat) qui s’est liée au jeune homme le tue, après avoir
salué en lui « le Très-Haut ».
On retrouve le thème de l’épidémie dans un autre roman de l’époque, La Peste, d’Albert
Camus. Parce qu’il parut en 1947, un an avant Le Très-Haut, Évelyne Londyn estime même
3. Voir Todorov Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Éditions du Seuil, 1970, p. 10.
4. Adorno réfère le « déclin des genres » et le nominalisme esthétique à « l’éclatement de l’ordre
moyenâgeux », Adorno Theodor Wiesengrund, Théorie esthétique, op. cit., p. 255. Cet ordre « moye-
nâgeux » semble perdurer au moins jusqu’au xviiie siècle, voir Linné Carl von, Systema Naturae, 1758.
5. Voir « De toutes les influences qui s’exercent dans l’histoire d’une littérature, la principale est
celle des œuvres sur les œuvres », Brunetière Ferdinand, Manuel de l’Histoire de la Littérature
française, Paris, Delagrave, 1893, p. II-III.
236
Blanchot.indb 236 29/11/13 11:56
qu’il est possible que Blanchot s’en soit inspiré, paru en 1947, un an avant Le Très-Haut6.
En réalité le roman de Blanchot fut commencé plusieurs années avant sa parution, puisque
Les Cahiers de la Table ronde et Les Cahiers de la Pléiade en publièrent des extraits : « Le
Tout-Puissant » et « En bonne voie » en juillet 1945 et en avril 1946.
L’épidémie est aussi le sujet du roman de Jean Giono Le Hussard sur le Toit. Or, dans ces
deux romans l’épidémie figure la même réalité. D’après Gaétan Picon : « [La peste du
roman de Camus] est de toute évidence le symbole d’une réalité historique que [ses lec-
teurs ont] bien connue. Cette ville surprise par le surgissement abrupt de la tragédie, com-
ment ne pas la reconnaître ? La cité en proie à la peste évoque la France en proie à
l’occupation et à la guerre7. » Et Marcel Neveux a donné la même interprétation du choléra
de 1 832 qui sévit dans la Provence du Hussard8. Si des contemporains ont pu faire cette
interprétation de la peste et du choléra des romans de Camus et de Giono, on doit admettre
que l’épidémie indéterminée du Très-Haut figure elle aussi la guerre et l’Occupation.
Dans ce cas, l’action du chef révolutionnaire figurerait l’ambition révolutionnaire de
la Résistance, et le choix que fait le jeune fonctionnaire de rester dans l’immeuble figu-
rerait la conversion politique de Blanchot, qui, après avoir milité dans les rangs de la
Jeune Droite dans les années trente, choisit à partir de la Libération de se rapprocher du
communisme. De fait celui-ci publia le premier extrait de son roman en juillet 1945
dans Les Cahiers de la Pléiade et, la même année, il consacra un article à L’Espoir d’André
Malraux dans lequel il manifesta, pour la première fois, sa sympathie à l’égard du com-
munisme. Or il confia plus tard, dans L’Instant de ma Mort, que c’est à partir de juil-
let 1944, après avoir failli être fusillé par les occupants, qu’il aurait éprouvé un sentiment
de culpabilité « en raison de […] l’injustice » dont il crut bénéficier dès lors que, le jour
où il fut épargné, d’autres ne le furent pas, et qu’il ne le fut que parce qu’aux yeux des
soldats il appartenait à la classe supérieure9.
6. Londyn Evelyne, Maurice Blanchot romancier, Paris, A.G. Nizet, 1976, p. 188.
7. Picon Gaëtan, « La Peste, d’Albert Camus », in L’Usage de la lecture, Paris, Mercure de France,
1960, p. 81.
8. Neveux Marcel, « Une théorie du choléra », in Cahiers Jean Giono, Paris, Gallimard, 1954.
9. Voir Blanchot Maurice, L’Instant de ma Mort, Montpellier, Fata Morgana, 1995, p. 7.
237
Blanchot.indb 237 29/11/13 11:56
Le Très-Haut et Madame Edwarda
Cependant, il y a l’épisode final. À la fin de l’avant-dernier chapitre l’infirmière recon-
naît dans son malade « le Seigneur » : « Maintenant, je sais qui vous êtes, je l’ai décou-
vert, je dois le proclamer […] Oui, je vous vois, je vous entends, et je sais que le Plus-Haut
existe. Je puis le célébrer, l’aimer. Je me tourne vers lui en lui disant : Écoute, Seigneur.
[…] Je sais que tu es l’Unique, le Suprême. Qui pourrait rester debout devant toi10 ? » C’est
cet épisode qui justifie le titre du roman.
Rappelons au sujet de ce titre que « le Très-Haut » est un nom de Dieu qui apparaît
dans l’Évangile : l’Ange annonce à Marie que son fils sera appelé « fils du Très-Haut11 ». Ce
nom apparaît d’abord dans la Genèse : « Melchisedec […] était prêtre du Dieu Très-Haut
(Elyon)12… » – Melchisedech apportant « du pain et du vin » à Abram, et paraissant
« sans père ni mère » dès lors que dans la Genèse on ne mentionne pas ses ancêtres, fut
considéré par l’auteur de l’« Épître aux Hébreux » comme une préfiguration du Christ13.
Le même nom apparaît dans le Cantique de Moïse, dont il ressort qu’à une époque très
ancienne ce fut le nom du Dieu suprême, supérieur à Iahvé et aux autres dieux : « Quand
le Très-Haut donna aux nations leur héritage […] le lot de Iahvé, ce fut son peuple14 ».
D’autre part, comme l’a signalé Pierre Madaule, l’une des deux épigraphes, qui est
tirée d’une lettre de Sorge à Bouxx (« tout ce qui vous vient de moi n’est pour vous que
mensonge, parce que je suis la vérité15 ») rappelle deux paroles que l’Évangile de Jean
attribue au Christ : « Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas » et « Je suis
[…] la Vérité16 ». Le titre du roman et cette épigraphe semblent faire de cette fin non pas
seulement un dernier « épisode », mais l’aboutissement de tout le livre.
Il s’agirait d’une sorte d’évangile moderne. On s’étonnera sans doute d’une telle
réponse à la question de savoir à quel genre littéraire appartient ce roman. Mais, après
tout, comme l’a récemment soutenu un exégète, Bruno Delorme, les trois premiers
10. Blanchot Maurice, Le Très-Haut, Paris, Gallimard, 1948, p. 221.
11. Luc, I 32.
12. La Genèse, XIV, 18-19.
13. Voir ibid., VII, 3.
14. Le Deutéronome, XXXII, 8-9. Mais c’est un nom de Iahvé dans les Psaumes.
15. Blanchot Maurice, Le Très-Haut, op. cit., p. 7 et 171.
16. Jean, VIII, 45 et XIV, 7.
238
Blanchot.indb 238 29/11/13 11:56
évangiles sont pour une part des romans, et le Christ est, pour une part, un personnage
romanesque17. Et Blanchot ne serait pas le premier romancier moderne à récrire un
évangile ; on sait en effet que d’après Dostoïevski, « le prince [Myshkine, c’est] le
Christ18 ». Comme l’a remarqué Georges Philippenko, « L’Idiot de Dostoïevski peut être
considéré comme une vaste méditation sur l’épisode de la femme adultère de l’Évangile
de Jean et celui, voisin, de la pécheresse19 ». Au xxe siècle enfin, deux romanciers, François
Mauriac et Anthony Burgess, ont proposé des romans modernes reprenant l’histoire
racontée dans les Évangiles20.
Mais on sait le sens des romans des évangélistes, l’un de ces derniers, Jean, l’a dit :
« [Ces signes] ont été mis par écrit, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu21… » D’après Dostoïevski au contraire, « [l’Évangile de Jean] trouve le miracle
dans [la] seule incarnation, la seule apparition du beau », et tel est le sens de L’Idiot :
« Ma pensée principale [fut] de représenter une nature humaine absolument belle. »
– or « il n’existe au monde qu’un être absolument beau, [et c’est] le Christ22. » Mauriac
et Burgess sont des catholiques et ils ont des intentions apologétiques. Mauriac, en par-
ticulier, souhaita persuader le lecteur que le personnage du Christ n’était pas une fiction,
que « le Jésus des Évangiles est le contraire d’un être artificiel et composé23. » Quel a pu
être le but de Blanchot ? Fidèle à ses principes il ne l’a évidemment pas dit.
La différence entre Le Très-Haut et les évangiles modernes est cependant manifeste et
permet peut-être de répondre à cette question. Dostoïevski, Mauriac et Burgess pensent
au Christ et ils ont pour modèle l’Évangile ou une scène de l’Évangile. Ce que Blanchot
a dans l’esprit, c’est seulement l’idée d’incarnation. Et son modèle n’est pas l’Évangile
mais, sans doute, Madame Edwarda que Georges Bataille avait publié deux ans avant que
Blanchot ait commencé de rédiger son roman.
17. Voir Delorme Bruno, Le Christ grec, Paris, Bayard, 2009, p. 15, 30, 39, 51, 86, 114-115 et 42-45.
18. « Le pr. – le Christ », in Les Carnets de L’Idiot, dans Dostoïevski Fedor, L’Idiot, Paris,
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 893.
19. Philippenko Georges, « La sainteté impossible », in Nouveau Recueil, n° 37.
20. Mauriac François, La Vie de Jésus, Paris, Flammarion, 1936 ; Burgess Anthony, Jesus Christ
and the Love Game [1976], trad. fr. Jésus de Nazareth, Paris, Robert Laffont, 1977.
21. Jean, XX, 31.
22. Dostoïevski Fedor, Correspondance, t. 3, Paris, Calmann-Levy, 1960, p. 171.
23. Mauriac François, « Préface », in La Vie de Jésus, op. cit., p. III.
239
Blanchot.indb 239 29/11/13 11:56
Le récit de Bataille est certes, lui aussi, à sa manière, un évangile. Une prostituée y dit
au narrateur : « Tu vois […] je suis DIEU… » et peu après il « sait » « qu’Elle n’avait pas
menti, qu’Elle était DIEU ». Il affirme qu’il le dit sérieusement, tout en reconnaissant
que c’est absurde : « Il est vain de faire une part à l’ironie quand je dis de Madame
Edwarda qu’elle est DIEU. Mais que Dieu soit une prostituée de maison close et une
folle, ceci n’a pas de sens en raison24. »
Mais Madame Edwarda est manifestement une transgression, Bataille a l’intention de
blasphémer25. En effet, Edwarda, d’abord, est une femme, alors que Dieu, dans la
tradition juive et chrétienne, est un être masculin. Ensuite, et surtout, c’est une prostituée,
et elle dit qu’elle est Dieu en montrant son sexe, alors que la Bible présente un Dieu
chaste et définit le sexuel comme l’impur : préparant la rencontre de son peuple avec
Iahvé, Moïse leur dit en effet : « Soyez prêts dans trois jours [et] n’approchez pas de la
femme26 ». Le Nouveau Testament à son tour présente un Dieu Père qui n’engendre pas
sexuellement et le fondateur du christianisme, à la différence d’Abraham, de Moïse et de
Mahomet, n’est pas marié27, et non seulement Jésus est chaste, mais aussi sa mère Marie
et Joseph son père selon la loi. Et c’est conforme à l’enseignement de Jésus qui a ceci
d’unique que d’après lui la vie éternelle exclut la sexualité (« à la résurrection […] on ne
prend ni femme ni mari mais on est comme des anges dans le ciel28 ») et c’est pourquoi
la chasteté en serait l’anticipation (« Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus
tels à cause du Royaume des Cieux. Qui peut comprendre, qu’il comprenne !29 »). Paul,
de même, enseigne qu’« il est bon pour l’homme de s’abstenir de la femme30 ».
24. Bataille Georges, Madame Edwarda, Paris, Pauvert, 1956, p. 41, 50 et 57.
25. Voir Surya Michel, Georges Bataille, la mort à l’œuvre, Paris, Seguier, 1987, p. 308-309.
26. L’Exode, XIX, 5. Voir Samuel, I, XX, 5.
27. Burgess fait de Jésus « un homme marié, puis un veuf sans enfant », in Jésus de Nazareth,
op. cit., p. 5. Certaines légendes évoquent un mariage du Bouddha et une vie de plaisirs antérieure
à sa conversion.
28. Voir ibid., XIX, 12. Voir Pohier Jacques, « Au Nom du Père », Recherches théologiques et
psychanalytiques, Paris, Le Cerf, 1972, p. 178-179.
29. Matthieu, XXII 30.
30. Corinthiens, I VII 1. Signalons toutefois que longtemps avant le bouddhisme prescrivit la
continence.
240
Blanchot.indb 240 29/11/13 11:56
La signification du Très-Haut
Certes il n’y a rien de la transgression bataillienne dans Le Très-Haut. Cependant, le
récit de Bataille s’achève sur une autre idée : s’interrogeant sur le sens de l’univers (« tout
serait-il absurde ou y aurait-il un sens ? »), le narrateur se demande : « Dieu, du moins,
saurait-il ? » et il répond : « DIEU, s’il « savait », serait un porc31. » Cela reste énigma-
tique32. Mais, dans un ouvrage publié la même année – L’Expérience intérieure – Bataille
avait formé plus explicitement l’idée d’un « [Dieu qui] s’ignore lui-même » et ne peut
que s’ignorer : « S’il se révélait à lui-même, […] il cesserait aussitôt d’être Dieu, il n’y
aurait plus […] qu’une présence hébétée, imbécile33. » N’est-ce pas le thème du roman
de Blanchot ? Dans L’Expérience intérieure, Bataille a témoigné sa proximité avec « la
nouvelle théologie (qui a l’inconnu pour objet) », théologie qui d’après lui était implici-
tement contenue dans le premier roman de Blanchot, Thomas l’Obscur. On peut donc
raisonnablement supposer que l’auteur du Très-Haut a incarné dans Sorge ce Dieu
inconnu à lui-même34.
Critique des lectures surnaturalistes
Le lecteur de Bataille ne doute pas cependant qu’Edwarda ne soit « une folle » – comme
le dit, d’ailleurs, le narrateur lui-même. Mais la majorité des critiques du Très-Haut croient
que Sorge, le jeune fonctionnaire, est réellement le Très-Haut. Georges Préli et Ann Smock
restent circonspects35. Mais les autres estiment que c’est à juste titre que Sorge est salué
31. Bataille Georges, Madame Edwarda, op. cit., p. 71.
32. Voir l’interprétation de Michel Surya dans Georges Bataille, la mort à l’œuvre, op. cit., p. 310.
33. Bataille Georges, L’Expérience intérieure, Paris, Gallimard, 1943, p. 131. On peut aussi se
reporter à l’interprétation que Bataille donna treize ans plus tard dans la préface à Madame
Edwarda, op. cit., p. 18-19.
34. Voir Brémondy François, « Le Très-Haut et l’incognito de Dieu », n° spécial « Maurice
Blanchot », Lille, Revue des Sciences Humaines, 1999.
35. Voir Préli Georges : « À la fin, Jeanne, l’infirmière, lui réplique : « Je sais que tu es l’Unique
[…]. » Ces paroles ne sont-elles pas extravagantes et folles ? […] En quoi Sorge, homme quel-
conque […] peut-il apparaître comme le Plus-Haut, l’Unique […] ? », in La Force du Dehors,
Paris, Recherches, « Encres », 1977. Préli propose une réponse à cette question, mais il se borne
ainsi à exposer la « signification » des paroles de Jeanne. C’est aussi le cas, semble-t-il, d’Ann
Smock : « Là [dans Le Très-Haut] le Plus-Haut descend dans le plus bas… », in « Où est la loi ? Law
and Sovereignety in Aminadab and Le Très-Haut », Sub-Stance n° 14, 1976, p. 104.
241
Blanchot.indb 241 29/11/13 11:56
comme l’Unique. Ainsi Pierre Klossowski : « [Henri Sorge] n’est autre que celui dont on
avait dit qu’il n’a pas d’essence parce que son essence c’est son existence36 » (c’est-à-dire
Dieu, d’après saint Thomas d’Aquin et quelques autres théologiens37). Évelyne Londyn :
« Sorge […] devient subitement la divinité à la fin du roman38 ». Allan Stoekl : « A plu-
sieurs moments, des personnages le « reconnaissent » pour ce qu’il est : le Très-Haut39. »
Gary Mole : « À la fin du roman, Sorge […] est révélé comme le Très-Haut du titre […].
Sorge est aussi “l’Unique, le Suprême” […]. Sorge […] est simultanément “un homme
quelconque” et “l’Unique”. Il n’est pas transformé dans le Très-Haut mais révélé comme tel
par Jeanne Galgat. […] Blanchot tient en réserve jusqu’à la fin du roman la révélation de
cette vérité suprême40. »
S’il en était ainsi, le roman de Blanchot pourrait être rapproché de certaines fictions
du xxe siècle qui rapportent des événements surnaturels, plus exactement des événe-
ments qui répètent certains événements surnaturels de la vie du Christ : par exemple le
drame de Kaj Munk Ordet41 (1925) dont le cinéaste Carl Dreyer a tiré un chef-d’œuvre,
et le premier roman de Georges Bernanos Sous le Soleil de Satan (1926), répètent, l’un la
résurrection de Lazare, l’autre la tentation au désert42.
Le drame de Munk présente un jeune homme, Johannes Borgen, qui semble devenu
fou au cours de ses études de théologie – sa folie consiste à se prendre pour le Christ (il
a trop lu Kierkegaard). Sa belle-sœur Inger meurt en couches, il tente de la ressusciter, il
échoue et s’enfuit de chez lui. Il revient le lendemain, guéri – et il ressuscite la jeune
femme. Est-ce à dire qu’il est réellement le Christ ? C’est ce qui croit Patrick Zeyen : « Le
drame met en cène le Christ même, dans ce qu’on pourrait appeler une parousie c’est-à-
dire une seconde incarnation du Christ parmi les hommes43. »
36. Klossowski Pierre, Un si funeste désir, Paris, Gallimard, 1963, p. 171.
37. Ibid.
38. Londyn Evelyn, Maurice Blanchot romancier, op. cit., p. 181.
39. Stoekl Allan, « Death at the end of history », in Blanchot Maurice, The Most High,
Lincoln and London, University of Nebraska Press, 1996, p. XX.
40. Mole Gary, Lévinas, Blanchot, Jabès, op. cit., p. 89 et 93.
41. Munk Kaj, Ordet, pièce en quatre actes, trad. fr. Vincent Dulac, Paris, Esprit Ouvert, 1996.
42. Voir Matthieu, IV, Jean, XI.
43. Zeyen Patrick, « Une œuvre mystique », in Dreyer Carl Theodor, Ordet, Paris, MK2, 2006.
242
Blanchot.indb 242 29/11/13 11:56
Le héros du roman de Bernanos, l’abbé Donissan, tente lui aussi une résurrection,
cédant à la supplication d’une mère, et lui aussi il échoue. Mais l’événement surnaturel
est la rencontre que le héros fait de Satan en personne. Celui-ci a pris l’apparence d’« un
petit homme, fort vif44 », un maquignon qui « trotte » à côté de lui, une nuit, à la cam-
pagne – « l’apparence »… mais Bernanos ne présente pas Satan comme une « appari-
tion », une « vision » de l’abbé : il est physiquement réel. C’est ainsi que le romancier
écrit qu’après que l’abbé l’a regardé et lui a dit ce qu’il a vu en lui, « le monstre roula du
haut en bas sur la route, et se tordit dans la boue, tiré par d’horribles spasmes45… » Le
théologien Hans Urs von Balthasar estima que « la scène présente un caractère mythique
qui n’est guère tolérable, même dans un roman. […] L’élément mythique, dans la scène
du Soleil, c’est que Donissan s’entretient avec le démon qui rit, qui pleure, qui se tord,
qu’il se comporte avec lui comme s’il était son semblable. […] Ce que Bernanos veut
traduire ici, c’est une inexprimable familiarité avec l’abîme, mais il l’a fait en des termes
qui font trop de place encore à la mythologie romantique, et cette mythologie menace de
tout gâter46. » Au contraire Michel Estève vanta « le réalisme47 » du romancier.
Dans quel genre littéraire classer ces fictions ? On sera tenté de répondre : dans celui de
la littérature fantastique. Et certes le sentiment du fantastique naît devant l’apparition de
ce qu’on juge impossible. Mais un tel sentiment ne dure pas : après un instant d’hésita-
tion, ou bien on admet la réalité du surnaturel, ou bien l’on s’attend à une explication
rationnelle, on peut aussi rechercher dans sa mémoire les indices qui permettraient de la
trouver48. Or Bernanos, qui fut un croyant fervent et dont la plupart des héros sont des
prêtres, affirme que l’être que rencontre l’abbé est surnaturel : « Quel homme n’eût
entendu avec une plainte proférée avec des mots – et cependant “hors du monde”49. » Kaj
Munk était lui aussi un croyant, il était même pasteur, et ni son drame ni le film de
Dreyer, qui montrent la résurrection d’Inger, ne permettent au spectateur de douter de
la réalité de cette résurrection.
44. Bernanos Georges, Sous le Soleil de Satan, t. III, Paris, Gallimard, 1961, p. 167.
45. Ibid., p. 173.
46. Balthazar Hans Urs von, Le Chrétien Bernanos, 1954, trad. fr. Paris, Éditions du Seuil,
1956, p. 331-332.
47. Voir Estève Michel, Notes à Sous le Soleil de Satan, op. cit., p. 1761.
48. Voir Todorov Tzvetan, Introduction à la Littérature fantastique, op. cit., p. 29 et 46.
49. Bernanos Georges, Sous le Soleil de Satan, op. cit., p. 179. Je souligne.
243
Blanchot.indb 243 29/11/13 11:56
Dans d’autres œuvres au contraire le surnaturel n’est qu’une apparence : ainsi dans le
Dies Irae du même Dreyer le cinéaste suggère qu’Anne, la jeune épouse du pasteur, est
une sorcière aux pouvoirs surnaturels, mais le spectateur est libre de penser qu’il n’y a en
réalité qu’une série de coïncidences. Ainsi encore dans La Chute de la Maison Usher
d’Edgar Poe, le retour à la vie de Madeline peut s’expliquer comme la sortie d’un état
cataleptique et l’écroulement de la maison par une lézarde à peine visible. Jules Verne le
remarqua : « Poe ne semble pas admettre [l’intervention de la Providence], il prétend
tout expliquer par les lois physiques […] On ne sent pas en lui cette foi que devrait lui
donner l’incessante contemplation du surnaturel50. » On peut aussi avoir affaire, non à
des coïncidences, mais au « rêve, [à] l’influence des drogues, [aux] illusions des sens,
enfin [à] la folie. » Et c’est pourquoi « les romans de Dostoïevski pourraient être rangés
dans la catégorie de l’étrange51. »
Considérons par exemple la rencontre d’Ivan Karamazov et du démon. Comme l’a
noté Balthasar52, la présentation de Dostoïevski n’est pas du tout celle de Bernanos. Le
lecteur est averti que le démon n’est pas réel, car le chapitre s’intitule « Une hallucination
d’Ivan Fiodorovitch », et que le narrateur (qui n’est pas un personnage) prévient qu’Ivan
est « à la veille d’un accès de fièvre chaude » et délire, et le personnage lui-même en a
conscience, puisqu’il dit à son « visiteur » :
Écoute, je crois que j’ai le délire […] Je ne t’ai jamais pris un seul instant pour une
réalité, s’écria Ivan avec rage. Tu es un mensonge, un fantôme de mon esprit malade
[…] Tu es une hallucination, l’incarnation de moi-même, d’une partie seulement de
moi… de mes pensées et de mes sentiments53.
Où classer le roman de Blanchot ? Avec celui de Bernanos, ou avec celui de Dostoïevski ?
D’après Evelyne Londyn, Le Très-Haut relève du fantastique, parce qu’il « vacille tout au
long entre le surnaturel et le quotidien », et que, à la fin du roman, la réalité du
surnaturel s’imposerait54. Je ne le crois pas, et je voudrais soutenir qu’aucun des
50. Verne Jules, Œuvres complètes, Lausanne, Éditions Rencontre, t. XXXIII, 1967-1971, p. 489.
51. Todorov Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique, op. cit., p. 52.
52. Balthazar Hans Urs von, Le Chrétien Bernanos, op. cit., p. 319.
53. Dostoïevski Fedor, Les Frères Karamazov, trad. fr. Paris, Gallimard, 1952, p. 663-666.
54. « Nous n’hésitons pas entre le naturel et le surnaturel ». « Nous hésitons [seulement] quant
à la signification des paroles de Sorge qui terminent le roman », Maurice Blanchot romancier,
op. cit., p. 181.
244
Blanchot.indb 244 29/11/13 11:56
événements que rapporte ce roman n’est « surnaturel », même si certains sont
« étranges55 », et en dépit du fait que Blanchot n’aurait vu dans un tel classement qu’un
« moyen superficiel de reconnaissance56 ».
Quelles sont en effet les raisons qui font croire à certains critiques que Sorge est effec-
tivement le Très-Haut ? Stoekl et Mole croient ce qu’un ou plusieurs personnages disent
ou semblent dire de lui. Pour Stoekl, Jeanne « reconnaît » Sorge pour « ce qu’il est ». Si
Stoekl place à juste titre « reconnaît » entre guillemets, il a tort de penser qu’elle le recon-
naît pour « ce qu’il est », car il n’y a pas de raison de croire ce que dit un personnage, et
le doute est plus que légitime lorsqu’il témoigne d’un événement surnaturel. Mole rap-
pelle une parole de Bouxx, qui remarque en Sorge « quelque chose de tout à fait particu-
lier, […] peut-être est-ce encore à naître », et une autre de Louise, la sœur de Sorge, qui
« ne voit rien au-dessus de [lui57] », et il suggère que ces expressions devraient nous faire
pressentir la révélation finale. Mais c’est là surinterpréter des propos dont la significa-
tion est bien plus banale. Si on n’en rejette pas a priori leur sens littéral ni leur contexte,
on lit seulement que Bouxx, qui est médecin, pronostique l’état futur d’un malade, et
que Sorge ne fait que lui confier l’amour exalté que lui porte sa sœur cadette.
Klossowski, lui, se fonde sur le nom de Sorge, qui d’après lui renvoie au souci
heideggérien. En fait ce nom est aussi bien celui de l’espion Richard Sorge58, célèbre à
l’époque de la rédaction du Très-Haut. Mais quand bien même Blanchot aurait pensé à
la « Sorge », on ne saurait passer de celle-ci à l’Étant suprême. Klossowski se fonde aussi
sur cet argument que « si Henri n’était qu’une essence ayant reçu l’existence [c’est-à-dire
une créature] […] le roman perdrait de son intérêt et le titre du livre ne se justifierait
plus59. » Certes, le titre des Frères Karamazov ne serait pas justifié si aucun des personnages
ne portait le nom de Karamazov, mais le titre des Démons cesse-t-il d’être justifié parce
que certains personnages de ce roman ne sont pas réellement des démons mais seulement
des hommes « démoniaques » ?
55. Voir Todorov Tzvetan, Introduction à la Littérature fantastique, op. cit, p. 46.
56. Blanchot Maurice, « Le Merveilleux », in La Condition critique, articles 1945-1998, Paris,
Gallimard, 2010, p. 116.
57. Mole Gary D., Lévinas, Blanchot, Jabès, op. cit., p. 93. Voir Le Très-Haut, op. cit., p. 20 et 87.
58. Voir Stoekl Allan, « Death and the End of History », op. cit., p. XXII.
59. Klossowski Pierre, Un si funeste Désir, op. cit., p. 171.
245
Blanchot.indb 245 29/11/13 11:56
Quant à Évelyne Londyn, elle assure que « des événements [du Très Haut] relèvent
du fantastique et sont une fissure du surnaturel dans le cours naturel des choses60 », et
elle cite un épisode dans lequel « [sa sœur] coupe ses cheveux, qui apparaîtront ensuite
intacts, à l’étonnement de Sorge qui bénéficie de ses démonstrations magiques61. »
Mais voici le texte de Blanchot :
Au moment où sa tête s’inclinait, dénouant son écharpe, elle répandit ses cheveux
qui coulèrent, se déversèrent, me frôlant, me touchant, m’ensevelissant dans une masse
plus noire et plus morte que la terre du jardin. J’éprouvais un sentiment sans nom. Je
sentais cette chevelure. Je voyais ses mains en approcher, y glisser la pointe d’une lame
blanche, j’entendis ses ciseaux s’ouvrir et mordre. – Je l’aperçus qui elle aussi courait.
[…] En une seconde elle fut sur moi. […] Quand je levais les yeux je vis ses cheveux
dénoués sur ses épaules, en belles nappes intactes62.
Comme on voit, il n’y a rien là de magique. Sorge a seulement dit qu’il a entendu les
ciseaux « s’ouvrir et mordre [ses cheveux] », mais sa sœur a pu n’en couper qu’une
mèche. Surtout, Sorge tait ce qui suivit l’instant où il entend les ciseaux : « J’entendis ses
ciseaux s’ouvrir et mordre. Et qu’arriva-t-il ? – Je l’aperçus qui elle aussi courait. »
Autrement dit, il y a comme un blanc, on passe sans transition des cheveux coupés dans
le caveau à la course dans le cimetière. Bien plus, Sorge dit que sa sœur lut quelque
chose dans son regard, alors « ses yeux devinrent de cendre, quelque chose se déclen-
cha, elle me gifla… » Que lit-elle dans son regard ? Il ne le sait pas. L’événement est
moins « surnaturel » que mystérieux.
Une attaque hystérique
Les lecteurs surnaturalistes résument la fin du roman en rapportant que Jeanne salue
Sorge comme le Très Haut, ce qui ferait « basculer le roman dans le surnaturel63 ». Mais
avant de tirer cette conclusion, il faut examiner plus concrètement le personnage de
Jeanne et les circonstances de sa proclamation. Il ne suffit pas de dire discrètement,
60. Londyn Evelyne, Maurice Blanchot romancier, op. cit., p. 181.
61. Ibid., p. 192.
62. Blanchot Maurice, Le Très-Haut, op. cit., p. 75.
63. Londyn Évelyne, Maurice Blanchot romancier, op. cit., p. 181.
246
Blanchot.indb 246 29/11/13 11:56
comme Klossowski, qu’elle est « étrange ». Il faut préciser que cette proclamation est
faite dans une sorte d’« attaque hystérique ».
Sorge rapporte une « scène folle » qui a lieu quelques jours auparavant : « Elle déclara
qu’elle ne quitterait plus ma chambre et m’interdit d’en sortir. Elle me fit répéter des
mots que j’entendis à peine et qui ressemblaient à ceux-ci : « Je te chérirai et te protége-
rai, je ne regarderais que toi. » Je dus la fuir car elle me griffait le visage. Je m’accroupis
dans un coin, elle se déchirait, pleurait et criait. [Je la vis] tout à coup à nouveau raide, à
demi nue, mais […] rigide et […] impassible64. » Quelques jours plus tard, elle lui répète
que s’il a besoin de quelque chose, il ne doit le demander qu’à elle, et elle lui fait une
scène de jalousie : alors qu’il lui demande la permission de faire « quelques pas… jusqu’à
la cuisine », elle lui répond : « Non, ces femmes sont sottes et méchantes, elles ne com-
prennent pas ce qu’il vous faut. Qui vous a donné du vin ? […] C’est cette gamine. Elle
vous épie […] Je ne le supporterai pas. Je la battrai, je l’écraserai65. »
C’est après cette scène de jalousie qu’elle le salue comme le Très-Haut : « Elle me saisit
par le bras, me fit lever, me regarda des pieds à la tête, puis se mit à rire. J’eus l’impression
que la scène de l’autre jour allait se renouveler, elle tremblait, la bouche entrouverte, et
plus cette bouche s’ouvrait, plus les dents se serraient. Je fus pris de vertige. Je voulus
m’écarter, mais elle me retint avec passion. À deux ou trois reprises, elle chuchota :
“Maintenant ! Maintenant ! Maintenant”66 ! » Manifestement, on peut s’inquiéter de la
santé mentale de cette femme. Les circonstances de sa proclamation suggèrent que celle-
ci est le symptôme de ce qu’on appelait naguère « folie hystérique67 ».
Celle-ci n’a rien d’exceptionnel, l’Étude sur le délire religieux du Dr Dupain contient
un grand nombre d’observations de délires religieux d’hystériques, telle cette Mathilde,
ayant des relations sexuelles avec un homme qu’elle croit le Christ, un autre qu’elle
croit le Père éternel et un troisième qu’elle croit le Saint-Esprit68. Certes, l’infirmière du
roman de Blanchot est moins naïve que les femmes observées par le Dr Paul Richer ou
64. Ibid., p. 216.
65. Ibid., p. 221.
66. Ibid.
67. Voir Dupain Jean-Marie (Dr), Étude clinique sur le délire religieux, Paris, A. Delahaye et E.
Lecrosnier, 1888 : « [Des] idées délirantes religieuses […] se manifestent chez les hystériques, qu’elles
aient ou non des accès convulsifs » (2e partie, chap. I, § III « Du délire religieux dans l’hystérie »).
68. Voir Observation XLVI, in ibid..
247
Blanchot.indb 247 29/11/13 11:56
le Pr Krafft-Ebing69, son érotomanie est moins évidente. Mais c’est que les cas rapportés
par les psychiatres concernent des malades d’origine populaire – les hystériques des
classes supérieures étaient sans doute admises dans des cliniques plus discrètes. D’autre
part, Jeanne ne se réfère pas au Christ. Mais c’est que l’univers du roman n’est pas
religieux, de sorte que toute précision mentionnant par exemple le nom de « Jésus » ou
le titre du « Christ » paraîtrait arbitraire.
On objectera que Jeanne n’est pas la seule à reconnaître en Sorge « le Très-Haut ». « En
sortant, dit-il juste après, j’avais rencontré une femme à qui j’avais ouvert la porte et
adressé un petit salut. Cette femme m’avait fixé un instant, avait tressailli, et, devenue
livide, s’était lentement jetée à mes pieds, d’un mouvement réfléchi, le front contre le
sol70 ». On objectera surtout que Sorge ne s’étonne pas de ce mouvement d’adoration :
« Après son départ, j’avais été soulevé d’enthousiasme. J’aurai voulu faire quelque chose
d’extraordinaire, me tuer, par exemple. Pourquoi ? À cause de la joie, sans doute. À pré-
sent, ce mouvement de joie me semblait incroyable. Je ne ressentais que de l’amertume.
J’étais accablé et frustré71. » Sorge ne s’étonne pas plus de la confession de Jeanne, il lui
répond : « N’auriez-vous pu garder cela pour vous ? […] Pourquoi avez-vous parlé ?
Retenez cela : je ne prends pas vos confidences à mon compte. Je n’en suis pas respon-
sable. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Je l’ai oublié tout de suite. […] Vos paroles ne
signifient rien, dis-je amèrement. Même si elles se rapportaient à quelque chose de vrai,
elles n’auraient aucune valeur72. »
Un épileptique
Ces paroles ne constituent certes pas un démenti de ce que Jeanne a proclamé. Mais on
a plusieurs raisons de douter de la santé mentale de Sorge lui-même, qui semble bien
plus gravement atteint qu’Ivan Karamazov. Or c’est lui le narrateur du récit. Dès lors on
a une excellente raison de penser que ce qu’il raconte n’est que ce qu’il imagine.
69. Voir Observation XLIV de Krafft-Ebing : Hystérie avec délire religieux chez une héréditaire
dégénérée, citée par J.M. Dupain, in ibid.
70. Blanchot Maurice, Le Très-Haut, op. cit., p. 222.
71. Ibid.
72. Ibid.
248
Blanchot.indb 248 29/11/13 11:56
Dès la troisième ligne du roman, on sait qu’il sort d’un « congé de maladie73 », à la
deuxième page, on apprend qu’il a passé ce congé dans une clinique, on saura plus tard
qu’il y a séjourné « plusieurs semaines74 ». Cette maladie n’a pas été identifiée. « J’ai eu
une fièvre extraordinaire, rien que la fièvre. On attendait d’autres symptômes, mais il
n’y en avait pas75. » Or comme chacun sait, une forte fièvre peut provoquer le délire.
C’est ce que semble confirmer la description qu’il fait plus tard de son état, au chapitre
suivant, dans une conversation avec la jeune voisine qu’il a abordée, Marie Scadran.
« Vous n’avez jamais été malade ? Ce qui arrive alors est fantastique : c’est une tentation
permanente, on ne sait plus de quoi il s’agit, l’on ne reconnaît plus les gens, et cepen-
dant l’on comprend tout infiniment mieux. Il n’y a plus de commencement, tout est
étalé dans une lumière tranquille et complète et les points de vue de chacun coïnci-
dent76… » « C’est le délire, dit-elle. » Sorge le lui confirme : « Oui, le délire, dis-je en
m’arrêtant. […] Vous sortiez de votre lit, me disait l’infirmière, et tourniez sans arrêt
autour d’une table. Quelle sottise, n’est-ce pas ? Pourtant, cela avait un sens, je vous le
jure, c’était même un extraordinaire symbole77. » Plus tard, dans une conversation avec
son voisin, Sorge admet que peut-être il délire : « Croyez-moi, j’ai peut-être le délire,
mais votre intervention est superflue […] ».
D’autre part, deux personnages du roman demandent à Sorge s’il n’est pas épileptique.
« Vous n’êtes jamais tombé du haut mal78 ? », lui demande son voisin, le médecin révolu-
tionnaire. Sa voisine lui pose la même question : « Vous m’avez fait peur, dit-elle. Cela a
été si brusque. J’ai cru à une crise. Ne tombez-vous pas du haut mal79. » Il s’est en effet
évanoui en regardant leurs visages dans le miroir : « Une seconde nous nous regardâmes
ainsi. « Ah ! » cria-t-elle. Je gardai ce cri dans les oreilles, pendant qu’elle m’entraînait, me
tirait ; je l’entendais encore en rouvrant les yeux, de sorte que c’est lui qui me fit reprendre
mes sens. » Autrement dit il a perdu conscience. Or « il est assez fréquent de rencontrer
73. Sa mère lui dit : « Tu es si souvent malade », in ibid., p. 55.
74. Ibid., p. 61.
75. Ibid., p. 10.
76. Ibid., p. 36.
77. Ibid., p. 36-37.
78. Ibid., p. 135.
79. Ibid., p. 96.
249
Blanchot.indb 249 29/11/13 11:56
dans la folie épileptique des préoccupations mystiques80. » Et dans sa thèse sur le délire
religieux, le Dr Dupain cite un grand nombre de cas de ce genre, tel cet homme, Georges,
qui tous les mois, croyait qu’il était le fils de Dieu, déclamait, parlait de ressusciter son
père, d’immoler sa femme, et puis ensuite ne se souvenait plus de rien81.
On objectera à la première explication du délire de Sorge que le même mot « délire »,
désigne deux choses différentes : un désordre temporaire des facultés mentales consécu-
tif à la fièvre, et une construction intellectuelle fausse et invraisemblable qui relève de la
psychiatrie. Et on objectera à la deuxième explication qu’aujourd’hui l’épilepsie n’est
plus considérée comme une maladie mentale. Par conséquent un homme peut bien
avoir souvent beaucoup de fièvre, il peut bien être épileptique, ce n’est pas une raison de
supposer qu’il délire. C’est vrai. Mais Sorge n’est pas un homme réel, c’est un person-
nage et il a donc été créé à partir des connaissances médicales de son auteur et donc,
inévitablement, de son époque. Blanchot, rédigeant Le Très-Haut, a sans doute cru ce
qu’on croyait encore il y a soixante ans, à savoir que l’épilepsie était une maladie men-
tale, comme Dostoïevski a cru qu’un accès de fièvre chaude pouvait déclencher la folie.
Un psychotique
C’est d’autre part le comportement de Sorge qui dès le premier chapitre suggère au
lecteur que ce personnage est atteint d’une maladie mentale82. Et le romancier prend
soin de le lui faire dire par plusieurs personnages.
80. Dupain J. M., Étude clinique sur le délire religieux, op. cit., § IV, « Du délire religieux dans
l’épilepsie ».
81. Voir ibid., « Observation XLIV ».
82. D’autres commentateurs le pensent. Voir Janssen Sandra : « D’autres personnages per-
çoivent ce narrateur comme un individu assez singulier du point de vue psychique », dans « Le
complot de la loi, psychose et politique dans Le Très-Haut de Maurice Blanchot », in actes
(à paraître) du colloque « Blanchot et le politique » (Université Paris Ouest Nanterre La Défense,
4-6 mai 2009), et Philipe Antoine : « L’histoire ne prend son sens qu’à partir du moment où on
se rend compte qu’elle nous est contée par un fou », in Le Prix de la Solitude, une lecture du Très-
Haut de Maurice Blanchot (à paraître). Philipe a remarqué un détail qui suggère que la clinique
dont Sorge vient de sortir est une clinique psychiatrique : « Le salon est dans un perpétuel demi-
jour. », « […] il y avait une question d’ambiance, de silence : le médecin m’avait expliqué cela… »,
in Le Très-Haut, op. cit., p. 10. D’après Philipe, le narrateur de La Folie du Jour, lui aussi, est fou.
Voir Philipe Antoine, « Le médecin de nuit » (Le Prix de la Solitude…, à paraître).
250
Blanchot.indb 250 29/11/13 11:56
– Ainsi, à la première page, Sorge se rappelle qu’on lui avait dit : « pas de secousse83 ».
Après l’altercation que rapporte le tout premier épisode du roman, il s’adresse à l’homme
qui l’a frappé : « Je voudrais savoir qui vous êtes. […] Êtes-vous marié ? Avez-vous des
enfants ? », de sorte que le commissaire de police s’étonne : « Mais c’est un énergu-
mène84 ! » Ayant entrepris au restaurant de causer avec un autre client, il le soupçonne
sans raison de juger que ses propos sont répréhensibles, lui en ayant demandé la confir-
mation : il prend brusquement conscience que ces questions sont « déplacées » ; le client
le lui confirme sèchement : « Moi aussi, j’ai mon franc-parler. Mais je ne me plains pas
devant n’importe qui […] Les têtes faibles ne manquent pas85. »
– Lors de leur première rencontre, Bouxx, son voisin médecin, lui dit qu’il lui paraît
« différent des autres » : « Je suis frappé par… est-ce votre façon de parler, ou vos idées,
certains de vos gestes. » ; et il lui signale certaines bizarreries : « Savez-vous, dit-il avec
une impudence naïve, que vous parlez en marchant ? Vous remuez les lèvres, vous faites
même quelques gestes86. »
– Lorsqu’il revoit la jeune voisine qu’il a dérangée la veille, il la remercie de l’accueil
qu’elle lui a fait dans des termes surprenants : « […] la conversation a lieu, comme si rien
ne nous séparait, comme si nous avions en commun l’essentiel. Je suis sûr que vous
voyez clair en moi ? » ; elle lui répond, gênée : « Vous êtes… vous êtes un enthousiaste » :
manifestement elle voulait d’abord formuler un diagnostic plus sévère. Lorsqu’il lui
décrit ce qu’il a éprouvé pendant sa maladie, elle lui dit : « Qu’avez-vous ? […] Faites
attention, vous vous exaltez87. » Lors de leur seconde rencontre, après une scène qui reste
assez mystérieuse, elle lui dit : « Vous rendez-vous compte que vous êtes tout à fait fou ?
[…] Ne me regardez pas de cet air… cet air maniaque88. »
– À son supérieur, Iche, Sorge confie la révélation qu’il a eue lors de sa maladie, « le
sentiment que le travail est le fond de l’existence, qu’on n’existe pas tant qu’on vit dans
un monde où en travaillant l’on s’humilie et l’on se ruine. – Qu’avez-vous ? dit Iche.
83. Blanchot Maurice, Le Très-Haut, op. cit., p. 9.
84. Ibid., p. 10.
85. Ibid., p. 14.
86. Ibid., p. 18.
87. Ibid., p. 28.
88. Ibid., p. 99. « Maniaque » est le terme utilisé par le Dr Dupain pour désigner l’accès délirant
de l’épileptique.
251
Blanchot.indb 251 29/11/13 11:56
Mais c’est de la philosophie89 ! » : autrement dit il diagnostique, lui aussi, une inquié-
tante exaltation. Sorge continue et finit par lui confier ce qui semble l’expression d’un
délire des grandeurs et Iche, ne pouvant lui dire qu’il déraisonne, lui répond après un
instant de silence : « Vous raisonnez trop. »
– Lui-même semble parfois conscient de son état :
Je suis un malade, je le sais. Ce sont mes idées qui me surmènent : c’est-à-dire que je
ne pense à rien, et pourtant je ne puis me débarrasser de ce que je pense. […] Oui, je
suis un malade. Mes idées sentent la maladie90.
Le lecteur ne peut douter que Sorge est psychotique lorsqu’il manifeste qu’il ne se
distingue pas clairement d’autrui91. Au début de ses relations avec Bouxx, il lui confie
d’abord qu’il doute de sa réalité : « Bonne nuit ; je finirai par croire que vous m’avez
réellement rendu visite. » « Je doute parfois que vous existiez92 ». Cela peut paraître un
trait d’humour. Cela ne peut pas être le cas plus tard, lorsqu’il dit à son interlocuteur
que par la bouche de celui-ci c’est en réalité lui, Sorge, qui parle : « Vous ne m’apprenez
rien, vous ne faites qu’exprimer ce que je pense, et quand vous parlez, ce n’est pas vous,
c’est moi qui parle93. » Une autre fois, il dit de Bouxx que celui-ci lui parle « comme si
sa parole avait voulu précéder la [sienne], afin de mieux se faire passer pour distincte
de [sa] pensée94… » Lisant plus tard une lettre de Bouxx, Sorge se dit : « Ces mots, je
savais qu’ils étaient en quelque sorte écrits par moi, je les lisais, je les jugeais honteux,
mais je les comprenais, je les approuvais95… » Recevant, plus tard encore, une autre
lettre de Bouxx, « pour la rendre vraie, [il l’écrit lui-]même96 » Il éprouve le même
trouble dans une conversation avec un autre malade, Dorte : « Qui vous a soufflé ces
idées ? Vous me les volez […] Voyons, dis-je, laissez-moi me reprendre. J’ai l’impression
89. Ibid., p. 30.
90. Ibid., p. 86.
91. Sur les symptômes paranoïaques de Sorge, voir Janssen Sandra, « Le complot de la loi… »,
op. cit.
92. Blanchot Maurice, Le Très-Haut, op. cit., p. 48 et 43.
93. Ibid., p. 47.
94. Ibid., p. 136.
95. Ibid., p. 146-147.
96. Ibid., p. 194.
252
Blanchot.indb 252 29/11/13 11:56
d’avoir dit à Bouxx quelque chose d’analogue97… » et dans une conversation avec son
beau-père :
C’est en moi qu’il lisait, c’est de moi qu’il tirait cette pensée sans défaut de sorte que
ce qu’il exprimait mécaniquement, […] je devais le faire surgir du fond de ma sincé-
rité, par un effort de plus en plus lassant, dans la fièvre de celui à qui la parole peut à
chaque instant manquer98 […]
Que penser d’ailleurs de ce que Sorge confie à son chef de bureau : « Je sens parfaite-
ment que si je changeais ou si je perdais la tête, l’histoire s’écroulerait » ? Cette dernière
confidence conduit le lecteur à se demander si l’écroulement de l’histoire99 dont il lit
ensuite le récit n’est pas l’invention d’un homme qui a perdu la tête.
À un moment, enfin, le lecteur à l’impression que Bouxx est le psychiatre qui soigne
Sorge, lorsqu’il lui dit : « Finissons-en. Vous savez parfaitement que je ne suis ni celui-ci
ni celui-là, mais votre médecin. Je vous soigne. Vous devez avoir confiance en moi », et la
réponse de Sorge n’est pas exactement un démenti :
Que voulez-vous que cela me fasse que vous soyez médecin ? Vous l’êtes, vous ne
l’êtes pas. Je sais tout cela. Et peut-être cet immeuble peut bien être une clinique.
Qu’est-ce que cela change100 ?
La signification de la folie de Sorge
Pourquoi raconter l’histoire d’un fou qu’une folle finit par prendre pour Dieu ? S’agi-
rait-il d’une provocation positiviste ? « On a vu plus d’une fois un schizophrène fonder
une secte101. » « Souvent les récits mythologiques […] donnent l’impression que leur
origine ne peut être expliquée sans la connaissance de ces états psychiques particuliers
de la démence précoce » et aujourd’hui « les malades appartenant au groupe de la
démence précoce peuvent jouer un rôle comme fondateurs de sectes religieuses102. »
97. Ibid., p. 112.
98. Ibid., p. 126-127.
99. À la fin du roman Sorge parle de « l’énorme trou où trébuchait l’histoire », ibid., p. 220.
100. Ibid., p. 84.
101. Jaspers Karl, Strindberg et Van Gogh, Paris, Les Éditions de Minuit, 1953, II, I, p. 152.
102. Jaspers Karl, Psychopathologie générale, Paris, Alcan, 1933, p. 584-585.
253
Blanchot.indb 253 29/11/13 11:56
Pourquoi n’aurait-ce pas été le cas de Jésus de Nazareth ? C’était d’ailleurs, d’après
l’évangéliste Jean, l’opinion de beaucoup de « Juifs » : « Il a un démon, il délire103 » et
d’après l’évangéliste Marc, c’était celle des « siens » : « Ils disaient : Il a perdu le sens104. »
Mais une telle perte, pour des croyants modernes, peut être au contraire l’indice d’une
divinité inconcevable. C’est ainsi que Dostoïevski, pensant au Christ, trace la figure de
L’Idiot. C’est ainsi que, plus récemment, Michel Henry a raconté la passion de José, un
fou qui déclare à ses psychiatres qu’il est « le fils du roi » dans les termes mêmes de la
réponse du Christ au Sanhédrin : « Répondez : êtes-vous le fils du roi, oui ou non ? – Vous
l’avez dit, je le suis105 » Ce n’est évidemment pas l’intention de l’auteur de C’est moi la
Vérité de tourner en dérision « le contenu essentiel du christianisme ». Au contraire, par
la folie de José, Henry veut sans doute figurer que « le discours du Christ sur lui-même
[…] leur demeure incompréhensible parce que les hommes ne comprennent leur propre
condition qu’à la lumière de la vérité du monde106. »
Ce ne peut être cependant ce que voulut dire Blanchot, dont la pensée est on ne peut
plus éloignée de la philosophie de Henry. Pourquoi donc a-t-il choisi de faire de Sorge
un fou ? Peut-être l’indique-t-il dans une page de « La folie par excellence » qu’il publia
en tête de l’« étude psychiatrique comparative » de Karl Jaspers intitulée Strindberg et
Van Gogh, page dans laquelle il démarque le chapitre « Expériences psychiatriques sur la
spiritualité des schizophrènes ».
Celui-ci déclare que chez certains schizophrènes il semble que se révèle « une profon-
deur métaphysique ». Quelque chose les livre « au frisson, à l’effroi et au ravissement ».
La conduite de la vie devient plus naturelle, plus passionnée, mais en même temps irra-
tionnelle et « démonique ». « Tout se passe comme si le démonique qui, chez l’homme
sain, est assourdi, réprimé par le souci d’un but, au commencement de ces maladies
réussissait à se faire jour, à accomplir une percée » Ou encore c’est comme si dans le
monde de l’étroit horizon humain apparaissait un météore. Mais, souvent avant que
l’entourage ait pris conscience de l’étrangeté de cette apparition, tout finit dans la psy-
chose ou dans la mort. Jaspers maintient que l’existence démonique, « cette tendance à
103. Jean, X 20.
104. Marc, III 20.
105. Henry Michel, Le Fils du Roi, Paris, Gallimard, 1981, p. 231 ; voir Matthieu, XXVI 63-64.
106. Henry Michel, C’est Moi la Vérité, pour une philosophie du christianisme, Paris, Éditions du
Seuil, 1996, p. 92.
254
Blanchot.indb 254 29/11/13 11:56
se dépasser éternellement, à s’affirmer sans repos au regard de l’absolu, dans l’effroi et le
ravissement », doit être considérée en dehors de la psychose. Mais la maladie ne serait
que l’occasion de « la percée », fût-ce pour peu de temps.
On dirait que l’âme, remuée de fond en comble, dans ce bouleversement montre
sa profondeur, puis, quand s’achève l’ébranlement, tombe en ruine, devient le chaos,
devient de pierre107.
Il y a une telle « percée » au début du Très-Haut : dans le deuxième chapitre, Sorge sort
de son bureau de l’Hôtel de Ville, et c’est la seule page heureuse du roman, ce qui, je
crois, justifiera une citation un peu longue :
La rue était extraordinairement claire, le vent était tombé. Une sorte de courant
lumineux allait d’un passant à l’autre, d’une voiture à une autre. Les pavés, les maisons
brillaient. […] Je n’avais aucune envie de voir surgir quelqu’un en particulier, et même
je pensais que ce n’était pas possible. Je suivis une rue, une autre. J’allais de l’avant,
personne ne m’arrêtait, le jour était radieux, un de ces jours qui expriment complè-
tement pourquoi, par-delà les vicissitudes du jour et de la nuit, demeure un hori-
zon ineffaçable de lumière Avec chaque passant me venait le sentiment que tous mes
secrets lui étaient révélés, que tous les siens m’étaient connus ; ses secrets, c’est-à-dire
qu’il marchait, qu’en marchant il avait une idée et que rien d’étranger ne pouvait de
lui me surprendre. Je me mis à courir. Pourquoi ? Dans une ville on ne court pas. Mais
justement je pouvais agir en excentrique. En vérité, je le pouvais : J’étais là, partout,
au-dehors, chacun pouvait me voir, sur les immeubles, sur la main blanche de l’agent,
sur la rive lointaine du fleuve, et pourtant je courais, d’ailleurs je ne courais pas, j’étais
emporté par un sentiment de triomphe, la certitude à jamais aperçue que le ciel nous
appartenait, que nous avions la charge de l’administrer comme le reste, qu’à chaque
instant je le touchais et le survolais108.
Ensuite, l’âme de Sorge « tombe en ruine ».
Concluons. Klossowski a prétendu que si Sorge n’était qu’une créature comme les
autres hommes, « le “roman” perdrait de son intérêt109. » C’est une objection qu’on pour-
rait faire à l’idée que Sorge est fou. Mais autant dire que Dies Irae perd de son intérêt si
l’on ne croit pas qu’Anne est une sorcière, ou que La Chute de la Maison Usher perd le sien
107. Jaspers Karl, « La folie par excellence », in Strindberg et Van Gogh, op. cit., p. 165.
108. Blanchot Maurice, Le Très-Haut, op. cit., p. 39-40
109. Klossowski Pierre, Un si funeste Désir, op. cit., p. 171.
255
Blanchot.indb 255 29/11/13 11:56
dès lors qu’on croit pouvoir juger que le retour à la vie de Madeline n’est pas une résur-
rection et que la chute de la maison n’a rien de surnaturel.
Peut-être doit-on élargir la définition du fantastique et considérer, avec Louis Vax,
qu’il ne se réduit pas à la violation des lois de la nature physique. Au contraire, « le fan-
tastique se fonde sur le négatif dans tous les domaines » ; s’« il affirme la réalité de l’im-
possible dans l’ordre physique », il affirme aussi la réalité « du monstrueux dans l’ordre
esthétique et moral ».
La rupture intéresse le monde des valeurs autant que celui des choses. Le fantas-
tique, en effet, se fonde sur le négatif dans tous les domaines, il affirme la réalité de
l’impossible dans l’ordre physique, la réalité du monstrueux dans l’ordre esthétique
ou moral110…
À vrai dire, Todorov lui-même, tentant de définir « l’étrange pur », reconnut que
« l’impression d’étrangeté n’est pas [toujours] liée au fantastique mais [qu’elle l’est par-
fois] à ce que l’on pourrait appeler “l’expérience des limites”111 », et il a illustré son idée
par l’exemple de l’œuvre d’Edgar Poe : ainsi, dans La Maison Usher, « c’est » d’après lui
« l’état extrêmement maladif du frère et de la sœur qui trouble le lecteur112. »
Dans le même sens, Blanchot avait écrit de Poe que « [certains de ses contes] sont
l’œuvre aveugle d’une obsession qui, par tous les moyens, cherche une issue » et que c’est
à cause de cela que « ces fictions “bizarres” sont les plus réelles113. » Ce que Blanchot dit
de « certains contes de Poe », on ne peut le dire de son roman : ce n’est certes pas « l’œuvre
aveugle d’une obsession », cette dernière, nous l’avons vu, est parfaitement consciente.
Mais ce que Todorov dit de La Maison Usher, je crois qu’on doit le dire du Très-Haut.
110. Vax Louis, La Séduction de l’étrange, op. cit., p. 176.
111. Voir Todorov Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique, op. cit., p. 51-52.
112. Ibid., p. 54. Dans une recension des Histoires extraordinaires, Barbey d’Aurevilly vit en Poe
« le paraboliste acharné de l’enfer qu’il avait dans le cœur. », Le Réveil, 15 mai 1858.
113. Voir Blanchot Maurice « Le merveilleux », in La Condition critique, op. cit., p. 123. Evelyne
Londyn et Pierre Madaule ont noté le souvenir d’un conte de Poe dans Le Très-Haut : « [Une hallu-
cination] rappelle la littérature fantastique et en particulier le conte d’Edgar Poe, Le Cheval de Feu.
Sorge, mené par sa sœur dans sa chambre […] voit s’animer la tapisserie… », Londyn Evelyne,
Maurice Blanchot romancier, op. cit., p. 191 ; « [L’image folle de] ce cheval gigantesque, […] on [la]
trouve déjà dans Metzengerstein, l’une des Histoires extraordinaires d’Edgar Poe. […] Il est presque
superflu de souligner les analogies entre le texte de Blanchot et celui de Poe », Madaule Pierre,
« Fonction du regard et réveil de l’image dans L’Arrêt de Mort », Lignes, n° 11, 2003, p. 44-46.
256
Blanchot.indb 256 29/11/13 11:56
Ce n’est pas seulement l’obsession christologique de Blanchot, c’est l’état « extrême-
ment maladif » de Sorge qui trouble et retient le lecteur, que cette maladie soit celle qui
décime la population, ou qu’elle ne dévaste que l’âme de ce personnage.
Bien plus, l’histoire étant racontée par Sorge lui-même, l’originalité et l’intérêt de ce
roman sont de nous faire éprouver ce qu’éprouve un fou. De ce point de vue, c’est du
Benjy de Le Bruit et la Fureur que Sorge devrait être rapproché, c’est à « l’histoire racon-
tée par un idiot114 » que Le Très-Haut devrait être comparé. Ainsi aura été remplie, une
nouvelle fois, la vocation du roman, car celui-ci, « du moins sous sa forme littéraire, a
pour but de nous faire sortir de nous-mêmes, de nous faire « sentir », et non seulement
« connaître », ce que sent un autre, de nous faire en quelque sorte pénétrer en lui, de
nous faire « vivre » psychologiquement et non seulement « savoir », ce qu’il vit, de deve-
nir l’espace d’une lecture cet autre115. » Quel autre roman nous aura fait mieux sentir ce
que vit un fou ? Le Très-Haut, c’est en effet La Chute de la Maison Usher racontée par un
Roderick Usher sans visiteur, c’est L’Idiot raconté par le prince Myshkine après qu’il a
réintégré l’établissement de Schneider, c’est Nadja racontée non par Breton mais par
Nadja elle-même.
Proust a parlé d’« un côté Dostoïevski de Madame de Sévigné116 » – je crois qu’on
pourrait parler d’un côté Faulkner et même d’un côté Poe de Blanchot.
114. Voir Faulkner William, Le Bruit et la Fureur, Paris, Gallimard, « 7 avril 1925 ». – Blanchot n’a
cité qu’incidemment le nom de Faulkner, notant dans un article sur « Le merveilleux » qu’on prétend
à tort « notre époque prisonnière d’un néo-naturalisme généralement qualifié d’abject, et soumise
à l’influence de la littérature américaine d’où sont exclus, on le sait, Melville, Poe, Hawthorne (et
bientôt Faulkner) », Blanchot Maurice, La Condition critique, op. cit., p. 115-116.
115. Kaplan Francis, « Un roman vrai », in Duc de Saint-Simon, Mémoires du Règne de Louis
XIV, Paris, Flammarion, 2002, p. 6.
116. Proust Marcel, À la Recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, 1954, t. III, p. 378.
Blanchot.indb 257 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 258 29/11/13 11:56
Aller plus loin,
c’est déjà me lier au retour
Shuling Stéphanie Tsai
Toujours encore à venir, toujours déjà passé, toujours présent dans un commence-
ment si abrupt qu’il vous coupe le souffle, et toutefois se déployant comme le retour et
le recommencement éternel – « Ah, dit Goethe, en des temps autrefois vécus, tu fus ma
sœur ou mon épouse » – tel est l’événement dont le récit est l’approche1.
De Judith à Claudia
Au début du Moment voulu, le narrateur, « Je », après une longue séparation, retourne
à l’appartement qu’il habitait jadis avec Judith. Celle-ci lui ouvre la porte. À première
vue, le visage de Judith a peu changé, ce qui a pour conséquence de réveiller chez lui un
passé enfoui : « Sa figure ou plutôt son expression qui ne variait presque pas, à mi-che-
min entre le sourire le plus gai et la réserve la plus froide, ressuscitait en moi un souvenir
terriblement lointain2… » Elle est restée aussi jeune qu’auparavant. De manière presque
1. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, « Folio/Essais », 1959, p. 18.
2. Blanchot Maurice, Au Moment voulu, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 1979, p. 9.
259
Blanchot.indb 259 29/11/13 11:56
anecdotique, « Je » observe que l’appartement est, lui, méconnaissable : « Les petites
chambres avaient été transformées, comme je le vis aussitôt, mais même dans ce nou-
veau cadre que je n’arrivais pas encore à saisir et qui me plaisait peu, elle [Judith] était
parfaitement la même3… ».
Dans l’esprit de « Je », Judith est restée la même tout en étant différente. Son visage
apparaît comme une image du passé, mais le passé n’étant plus, l’image que « Je » voit ne
se réfère ni à Judith « maintenant, » ni à « l’ancienne Judith » qui n’est plus. Ce visage est
comme perdu ; c’est une sorte de figure privée d’identité, à la fois familière et étrangère.
Il évoque une fêlure, un instant entre-deux choses dans lequel les variations se ras-
semblent et se ressemblent. Le temps s’éprouve désormais comme une inflexion de
formes figurées dans un espace rénové : « Elle était parfaitement la même, non seule-
ment fidèle à ses traits, à son air, mais à son âge : d’une jeunesse qui la rendait étrange-
ment ressemblante4. » L’ancienne Judith ressemble à Judith rajeunie dans le même
appartement qui lui a changé. L’espace change mais les personnages qui évoluent dans
cet espace ne bougent pas : « C’est ce souvenir, profondément enterré, plus que vieux,
qu’elle [Judith] semblait copier pour paraître si jeune5. »
L’inflexion des visages de Judith a pour effet de rendre visible une sorte de vie repliée
dans des formes tout autant identiques qu’elles sont différentes. Le déploiement de ces
variantes du même pris dans des mouvements différents est lui-même prisonnier d’un
rapport espace-temps dont l’effet premier est de provoquer l’étonnement de « Je » :
Oui, un mouvement étrange venait à moi, une possibilité inoubliée, qui se moquait
des jours, qui rayonnait à travers la nuit la plus sombre, une puissance sans regard,
contre laquelle l’étonnement, la détresse ne pouvaient rien6.
Cette situation a des conséquences sur « Je ». Il est pris par une expérience « horrible »,
« abominable », voire « intolérable7 ». Tel un « bœuf assommé8 », il éprouve une
expérience-limite qui a des conséquences sur son rapport aux autres personnages.
3. Blanchot Maurice, Au Moment voulu, op. cit., p. 8.
4. Ibid., p. 8-9.
5. Ibid., p. 9.
6. Ibid., p. 10-11.
7. Ibid., p. 14.
8. Ibid., p. 6.
260
Blanchot.indb 260 29/11/13 11:56
Cette expérience de la limite met au jour un mouvement du temps qui détermine la
perception que « Je » a eu de ces deux visages de Judith. Il y a bien deux visages de la
même personne, deux visages qui se ressemblent mais deux visages qui sont en même
temps pris dans des temps différents. Cette expérience-limite conduit le narrateur à un
seuil, un passage entre deux mondes différents dont chacun a ses lois propres : « Je
demeurai probablement sur le seuil. Malgré tout, il y avait là un passage, une épaisseur
qui avait ses lois ou ses exigences propres9. » Et c’est justement dans la présence de ce
seuil qui permet d’appréhender l’épaisseur du récit de Blanchot. Deux visages presque
identiques pour un même personnage, un appartement identique mais des lieux diffé-
rents, tout cela pour un même rapport au récit : l’occasion de saisir l’épaisseur du mou-
vement même des choses que le texte, Au Moment voulu, met en place. Au moment voulu
pour se demander s’il y a un seul moment et si le moment peut être voulu ? Quel est donc
ce moment « voulu » du moment voulu ? Est-ce celui du narrateur ? Celui des person-
nages – Judith ou Claudia ? Ou n’est-ce pas plutôt le moment voulu d’un personnage à
l’autre, ou d’un lieu à l’autre ? Le moment voulu n’est-il pas au contraire celui d’un
espace voulu : celui que le narrateur chercherait désespérément, et qui faute de le trouver
partirait à la recherche de personnages dont il imagine qu’ils sont plus aisés à saisir ?
Le moment voulu reste celui d’un récit qui se fait, le moment d’une histoire que l’on
raconte, le moment qui permet aux personnages de se mettre en scène, le moment qui
donne à « Je » une consistance. Le récit d’un récit qui ne trouvera jamais son moment
voulu. Derrière toutes ces questions transparaissent les variations du visage de Judith
qui, comme un spectre, viendrait nous dire quels sont les états possibles que le récit peut
prendre dans l’espace d’un moment choisi. Le visage de Judith devient alors une figure
du temps, le temps du récit, le temps de l’autre, le temps des personnages, mais surtout
le temps de la langue. Tous ces temps se fabriquent en posant à chaque fois la même
question : ces temps sont-ils bien dans le moment voulu ? Mais ce moment voulu, quel
est-il en fin de compte ? Y a-t-il seulement un temps du moment voulu ? Toutes ces ques-
tions prennent la forme des variations invariantes du visage de Judith. Variations car le
visage de Judith change sous l’effet du temps qui s’écoule ; invariant car le temps qui
s’écoule n’est pas celui du temps voulu. Le temps voulu est justement la traduction d’un
temps autre que le temps qui s’écoule :
9. Ibid.
261
Blanchot.indb 261 29/11/13 11:56
De toute manière, il y avait manifestement entre nous une telle accumulation
d’événements, de réalités démesurées, de tourments, de pensées incroyables et aussi
une telle profondeur d’oubli heureux qu’elle n’avait aucune peine à ne pas s’étonner
de moi. Je la trouvai étonnamment peu changée10.
Le moment voulu reste celui d’un temps, d’un temps voulu, mais d’un temps « perdu »,
le temps perdu de la recherche de Proust, ce temps qui prend la forme de l’espace, le
temps d’un moment voulu qui se traduit par le changement des espaces propres à cet
appartement dans lequel, jadis, le narrateur régnait. C’est tout ce dispositif de la tempo-
ralité à la fois pris dans l’écoulement de la durée, mais aussi inscrit dans un espace fabri-
quant un temps, celui du temps voulu, que le narrateur ressent en découvrant le visage de
Judith et l’appartement dans lequel il a vécu. Les deux sont liés, visage et lieu, deux choses
entremêlées pour rendre compte du temps qui prend la forme d’un espace : « D’un côté,
il y avait la salle de bain communiquant avec la chambre que je venais de quitter, plus loin
devaient se trouver la cuisine et la seconde chambre : tout était clair dans mon esprit, mais
pas du dehors11. » Un sentiment de dépaysement naît de cet espace et la carte intérieure
du lieu pousse le narrateur au bout de son existence. C’est à travers cette expérience-
limite que « Je » ressent la violence horrible née de ce « sentiment d’épouvante12 » :
Tout indique que j’avais un air atrocement égaré, j’entrais à peu près sans le savoir,
sans le sentiment de me déplacer, occupé par une chute stationnaire, incapable de voir,
à mille lieux de m’en rendre compte. Je demeurai probablement sur le seuil13.
Les visages de Judith évoquent le temps perdu dans l’épaisseur des formes de la réalité
historique des propres morceaux de vie de l’ensemble des personnages. Mais ce que
Judith provoque chez le narrateur n’a rien à voir avec ce qu’évoque, pour « Je », Claudia,
l’amie d’enfance de Judith. Claudia est au contraire la « mesure » de tous les temps, une
présence presque objective, celle qui mesure et l’espace et le temps. Cette mesure que
Claudia orchestre est celle de l’instant présent dans lequel la réalité des choses s’affirme14.
Devant Claudia et la temporalité qu’elle met en scène, « Je » est comme touché par la Vie,
10. Ibid., p. 8.
11. Ibid., p. 13.
12. Ibid., p. 14.
13. Ibid., p. 15.
14. Ibid., p. 26.
262
Blanchot.indb 262 29/11/13 11:56
touché « par la promptitude de ce que Claudia jugerait bon de décider15. » « Je » (Claudia)
est comme « guidée par l’idée étrange – mais peut-être pure passion, pur désir de rester
jalousement seule maîtresse dans ce domaine –, par le besoin d’arracher [Je] au plus vite
à la chambre16. » La présence de Claudia, par sa seule réalité dessine un nouveau plan, ou
pour être plus précis, le seul plan de communication véritable de l’appartement, celui
qui s’ouvre au milieu du couloir. Le couloir devient ce lien naturel qui met tous les
personnages sous un même toit. Et dans ce rapport au temps, « Je » réalise que Claudia
est la seule qui assure à l’ensemble toute la discrétion nécessaire. Sans cette réserve
« c’était cela qui risquait de nous jeter les uns contre les autres, et non une franche
reconnaissance de la réalité17 ».
Par rapport à Judith, Claudia reste naturelle : « Le naturel lui donnait sa caution, et
aurait-elle fait des choses insensées – elle devait bien en faire –, cela se passait derrière
des apparences trop justes pour prêter à remarquer18. » Une sensation de violence s’ins-
talle néanmoins dans l’esprit de « Je », sensation qui détermine le rapport d’intimité
entre « Je » et Claudia dès les premiers contacts :
Je marchai lourdement sur elle, et elle put croire que nous allions carrément nous
battre : j’en suis sûre, elle était prête à s’attaquer à moi, à me briser les os si elle le pou-
vait et, en tout cas, à me rendre coup pour coup sans céder19.
Ce contact singulier entre les personnages épouse naturellement les mouvements de la
vie qui sont aussi des moments du récit. Ce contact met en perspective le plan immédiat et
le plan poétique du quotidien, cet ensemble de petits riens des choses qui aboutit néan-
moins à quelque chose20. Ce plan de perspectives complémentaire est pris dans l’instant
présent. Il n’a rien à voir avec l’utilité de la vie en communauté telle qu’elle est entendue
par la société. Il ne s’agit pas de se contenter d’une forme figée de relation, mais au contraire
de rendre visible l’état profond des choses, celui que les personnages rendent visibles. On
retrouve ici toute l’ampleur de la vie que les personnages de Blanchot mettent en scène :
15. Ibid., p. 28.
16. Ibid., p. 29.
17. Ibid., p. 66.
18. Ibid., p. 36.
19. Ibid., p. 33-34.
20. Ibid., p. 57.
263
Blanchot.indb 263 29/11/13 11:56
Naturellement, cela n’était pas tenable, et nous n’étions nullement là pour faire tenir
debout notre petite communauté : tout au contraire, chacun s’appuyait sur l’immi-
nence du dénouement – imminence qui n’avait rien à voir avec la durée –, mais s’y
appuyait si fortement que la construction d’un instant, fondée sur rien pouvait aussi
apparaître des plus solides21.
Toutefois, dans un tel moment, personne n’est à la hauteur d’un tel instant. Si les per-
sonnages, et plus particulièrement le narrateur, sont capables de comprendre et d’inter-
préter que ce qui est de l’ordre du « dit » ; aucun n’est dans la capacité de maîtriser ce qui
est de l’ordre du « vu » : « Et même maintenant où je l’ai lié, je suis maître de ce que je dis,
non de ce que j’ai vu22. » On retrouve en fait la question du « Parler ce n’est pas voir » de
Blanchot, une pensée libérée de la figure de la représentation. Parler ce n’est pas voir parce
que la vérité n’est pas de sens, elle n’a pas « un » sens. C’est à cet instant précis du présent,
celui que Blanchot définit comme l’instant de l’« inspiration » que nous touchons le noyau
de ce qu’il appelle l’expérience littéraire en tant que jugement esthétique et morale :
Je devais me condamner à un effort terrible de passivité, dès ce moment, – ce qui
était sans doute le résultat d’une longue histoire, mais plus encore de quelque chose
qui n’était pas mon œuvre et qu’il me semble que je ne pénétrerai parfaitement que
le moment venu – j’avais gagné, moi aussi, le droit de me tenir fermement à la seule
passion de mon regard, fut-il stérile et peu heureux23.
Blanchot nous montre comment, dans les différentes manières de mettre les choses à
distance en vue de tisser un lien entre les gens ou entre les choses, le récit s’organise.
C’est presque un travail de tapisserie dont la trame représente les liens de la vie, les liens
entre les personnages, voire les liens que les mots réussissent à tisser :
Mais, dans le travail de tapisserie que nous étions en train de composer fil à fil avec
nos gestes – tapisserie bien faite pour le décor d’un musée –, la raideur et l’allure
guindée qui étaient les nôtres, disparaissaient grâce à la vie parfaitement naturelle qui
circulait entre nous24.
21. Ibid., p. 57.
22. Ibid., p. 58.
23. Ibid.
24. Ibid., p. 62.
264
Blanchot.indb 264 29/11/13 11:56
Et Blanchot, en répétant à maintes reprises le mot « naturel » ou « naturellement » cherche
à montrer que le parler n’est pas un voir au sens où le parler s’affranchit de la vérité comme
mesure du vrai et du faux25. Il convient finalement de jeter l’éponge sur cet impératif de
répéter les questions vaines sur ce qui se passait « au juste26 ». Seul compte le fait d’être
« occupé à regarder un visage, à toucher un corps27 » sans souci de ce qu’il y a à retenir, ou
de poser des questions pour savoir « ce que ce visage voyait de moi28 ». On ne se soucie plus
de rien, on cherche à toucher un instant pour atteindre une figure de l’existence : « Tout
l’espace, du plus loin au plus proche, entièrement occupé par la réalité vivante d’une
figure29. » Cet instant de contact sublime avec le présent illumine le tout du Plein comme
celui du Vide, un Tout qui devient un Rien, celui d’un simple moment voulu : « La mort !
mais, pour mourir, il fallait écrire, – La fin ! Et pour cela, écrire jusqu’à la fin30. » C’est à ce
moment où « Je » se trouve saisi par le mouvement brusque, le bond presque sauvage que
« Je » voit jour, vision liée à un commencement d’une période nouvelle, « tragique a bien
des points de vue31, » terrible par la puissance de son ébranlement, mais qui ouvre un puits
dans lequel je « tombais cependant au cœur vertigineux du temps32. »
Parole brute, parole essentielle – le sursaut d’inspiration
À partir d’une scène de vie quotidienne au cours de laquelle les trois personnages,
Judith, Claudia et « Je », sont dans une pièce de l’appartement en train de regarder un
feu de cheminée, Blanchot construit toute une partie de son récit à partir de la figure du
25. Ibid.
26. Ibid., p. 89.
27. Ibid., p. 62.
28. Ibid.
29. Ibid., p. 63. Kai Gohara inscrit Claudia dans l’ordre de la médiation, et cela par l’utilisation
du prosôpon ; le masque ou le comédien. Dans un théâtre antique, une sorte de théâtralité se
trouve dans cette figure qui met en scène l’art de la prosopopée qui consiste à appeler « un absent »
sur la scène « en tant que masque » et à le présenter (« “Figures” féminines comme prosôpon dans
Au Moment voulu », in L’Œuvre du féminin dans l’écriture de Maurice Blanchot, E. Hoppenot,
D. Manouri [dir.], Paris, Complicités, 2004). Ce que nous voudrions souligner ici, c’est le passage
entre les figures possibles et le prosôpon [visage] qui met en scène l’invisibilité.
30. Blanchot Maurice, Au Moment voulu, op. cit. p. 87.
31. Ibid., p. 86.
32. Ibid., p. 87.
265
Blanchot.indb 265 29/11/13 11:56
chaud et du froid. D’un côté, Judith se contente de regarder dehors par la fenêtre, et de
l’autre, Claudia, « agenouillée, attendait le bon plaisir des bûches33 ». Le silence règne, et
pourtant les interrogations s’engagent sans qu’aucune parole ne soit proférée. La
différence entre les deux figures féminines se distingue surtout par rapport à leur
manière de s’exposer chacune l’une devant l’autre. Concernant Judith, « Je » se demande
« si elle n’essayait pas d’enfermer la vérité, de la traduire dans cette situation d’une
remarquable ironie : j’étais là en chair et en os, mais Judith continuait à me regarder
stérilement par la fenêtre34 ». À la froideur de Judith s’oppose l’instant de bonheur
inspiré par Claudia, instants de bonheur qui ne cherchent aucune éternité, mais qui sont
plutôt bondissants à l’image du crépitement du feu de cheminée :
À peine eut-elle touché mon regard qu’elle poussa un cri prodigieux, presque un
hurlement ; et sans doute fit-elle un mouvement en arrière, mais avec une brutalité qui
ne tenait compte de rien, je bondis férocement sur elle et la ressaisis35.
Derrière cette image du froid de la neige, celui du regard de Judith, et du chaud du feu
de cheminée, celui de la douceur d’expression de Claudia, c’est la figure du récit du
Moment voulu qui se dessine. Le froid, le chaud, la neige, le feu, Judith, Claudia : quel est
donc ce moment voulu ? Blanchot a déjà sa réponse : « Personne ici ne désire se lier à une
histoire36 », autrement dit, le moment voulu est celui de l’attente d’un choix. Et derrière
cette attente, c’est toute la question de la langue pour Blanchot que l’on retrouve.
Lorsque Blanchot parle du langage, il fait souvent allusion à la distinction faite par
Mallarmé entre « la parole brute » ou « immédiate » et « la parole essentielle. » Selon
Mallarmé, cité par Blanchot : « La parole brute “a trait à la réalité des choses”, “Narrer,
enseigner même décrire” nous donne les choses dans leur présence, les “représentés”37. »
Tandis que « la parole essentielle les éloigne, les fait disparaître, elle est toujours allusive,
elle suggère, elle évoque38. » Et Blanchot, qui rejette cette distinction « brutale » de
Mallarmé, de protester : « Cependant, la parole brute n’est nullement brute. Ce qu’elle
représente n’est pas présent39. »
33. Ibid., p. 95.
34. Ibid., p. 96.
35. Ibid., p. 106.
36. Ibid., p. 108.
37. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, « Idées », 1968, p. 38.
38. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 38.
39. Ibid., p. 39.
266
Blanchot.indb 266 29/11/13 11:56
Selon Blanchot, dans le monde de tous les jours, le langage sert d’outil. Il nous met en
rapport avec les objets, avec « ce qui nous est immédiatement proche et notre voisi-
nage40 », mais ce langage de communication que Mallarmé appelle « brut » ou « immé-
diat », n’est pourtant ni l’un ni l’autre. Au contraire, il « est extrêmement réfléchi » et
« lourd d’histoire41 ». Nous sommes trop habitués à l’utilité du langage dans notre vie
quotidienne pour réfléchir à « la nature » du langage caché sous le voile de son usage
utilitaire. En réalité, « un mot ne nomme rien, ne représente rien42. »
Sur le plan utilitaire, le langage immédiat fonctionne au niveau de notre imaginaire. Il
représente mais ne s’identifie jamais à l’objet dans « la réalité » à laquelle il prétend se
référer. Au-delà de la distinction opérée par Mallarmé, « la nature » du langage reste la
même. Quand le langage nomme les choses, il ne « présente » que leur « absence. » D’après
Blanchot, l’usage seul distingue « la parole immédiate » de « la parole essentielle. » Ainsi,
dans la parole brute ou immédiate, le langage se tait comme langage, mais en lui les
êtres parlent, et, par suite de l’usage qui est sa destination, parce qu’il sert d’abord à
nous mettre en rapport avec les objets, parce qu’il est un outil dans un monde d’outils
où ce qui parle, c’est l’utilité, la valeur, en lui les êtres parlent comme valeurs, prenne
l’apparence stable d’objets existant un par un et se donnent la certitude de l’immuable43.
En effet, le langage pour Blanchot est le même dans la parole immédiate comme dans la
parole essentielle. Ce qui fait la différence entre les deux, c’est l’usage que l’on en fait.
Dans le premier cas, le langage est utilisé comme outil de communication ; il donne
l’illusion de représenter les objets et nous met ainsi en rapport avec le monde de tous les
jours. Lorsque le langage lui-même parle en tant que parole « essentielle, » ce qui se met
en évidence, c’est la conversion du quotidien en poétique du langage :
La parole poétique n’est plus parole d’une personne : en elle, personne ne parle et ce
qui parle n’est personne, mais il semble que la parole seule se parle. Le langage prend
alors toute son importance ; il devient l’essentiel ; le langage parle comme essentiel, et
c’est pourquoi la parole confiée au poète peut être dite parole essentielle44.
40. Ibid., p. 40.
41. Ibid.
42. Ibid., p. 39.
43. Ibid., p. 40.
44. Ibid., p. 42.
267
Blanchot.indb 267 29/11/13 11:56
Il est important de noter ici que le mot « essentiel » ne fait aucunement référence à la
notion de substantialité. Il signifie plutôt que les mots « ne doivent pas servir à designer
quelque chose ni donner voix à personne, mais qu’ils ont leurs fins en eux-mêmes45. »
Selon Blanchot, écrire ne pourrait donc consister à perfectionner le langage « immé-
diat » ou « brut, » à le rendre plus pur comme Mallarmé le prétend. Le langage littéraire
d’après Blanchot n’est pas un rituel avec ses usages, ses images, ses emblèmes, ses for-
mules éprouvées. Et l’œuvre dans la pensée de Blanchot ne se donne pas non plus comme
un ensemble calculé ou un objet formé par « l’entente d’un métier et l’habileté d’un
savoir-faire46 ». Écrire, en fait, commence seulement quand nous nous laissons emporter
par le langage jusqu’au point « où rien ne se révèle ». Plus précisément, il ne s’agit pas,
dans l’acte d’écriture, d’une hiérarchie des niveaux du langage, mais d’une recherche du
point d’émergence du sens poussé à la limite, à la fêlure comme à l’ouverture vers un
« autrement » silencieux. Et ce que nous admirons dans une œuvre, ce n’est, « non pas le
style, ni l’intérêt de la qualité du langage, mais précisément ce silence47 ».
C’est ainsi qu’un après-midi, « Je » entend s’élever la voix de Claudia qui chante en
plusieurs langues incompréhensibles de très belle manière : « Depuis longtemps le chant
était pour moi, lieu de déception… surtout la cérémonie du chant, la voix dite “glorieuse,
sépulture et royale” me fatigue48. » Mais cette voix de Claudia est différente, elle est
« neutre », « repliée en une région vocale où elle se dépouillait si complètement de toutes
perfections superflues qu’elle semblait privée d’elle-même49. » Cette voix « de pauvre »,
« sans souci de la qualité des œuvres » change sans intention d’être entendue. Elle est
comme elle est étrangère, comme si elle était seule dans le désert. Claudia chante d’une
voix tellement « pauvre » qu’elle fait entendre le silence, et c’est de cette même manière
45. Ibid.
46. Ibid., p. 43.
47. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 22. Comme Alain Milon le fait remarquer :
« Blanchot préfère s’interroger sur la manière dont l’écriture devient un lieu d’accueil dont le
temps et l’espace sont des modulations de ses propres variations » ; « le temps [devenant] un
espace de potentialité qui permet à l’écriture de prendre des formes multiples ». Voir « La
fabrication de l’écriture à l’épreuve du temps », in L’Épreuve du temps chez Maurice Blanchot,
E. Hoppenot, Paris, Complicités, 2005. L’appartement dans le récit est bien une figure de ce lieu
d’accueil où se déploient différentes mémoires en tant que visages et emplacement des meubles
aussi bien que comme passage entre les formes multiples du vide.
48. Blanchot Maurice, Au Moment voulu, op. cit., p. 69.
49. Ibid., p. 68.
268
Blanchot.indb 268 29/11/13 11:56
qu’écrit « Je » dans Au Moment voulu. « Je » écrit jusqu’au point où le langage montre,
non seulement l’absence des choses, mais aussi l’anéantissement du langage même,
jusqu’au moment où, telle la voix de Claudia, le langage chante l’absence de langage.
Mais affirmer que le langage/la voix « chante » l’absence de langage, cela ne veut pas dire
qu’il/elle nomme cette absence ou ce silence, mais plutôt que le langage s’abandonne
dans le contact avec le silence. D’un côté, le langage « chante » de sorte que ce silence ou
cette absence sont entendus ; de l’autre « Je » écrit pour se taire dans le Silence ; de l’autre,
« Je » écrit pour imposer le silence au Silence afin d’entendre. C’est ainsi que :
parler n’est encore que l’ombre de la parole [incessante], langage qui n’est encore
que son image, langage imaginaire et langage de l’imaginaire, celui que personne ne
parle, murmure de l’incessant et de l’interminable auquel il faut imposer silence, si l’on
veut, enfin, se faire entendre50.
« Je » écrit donc pour s’entendre, et paradoxalement pour se taire. D’un côté, il lui faut
écrire pour s’entendre parler, pour imposer une forme de silence au Silence qui ne cesse
de parler ; de l’autre, en écrivant, il apporte son propre silence destituant toute parole par
le grand Silence. Un mouvement de retour naît ainsi, mouvement qui s’engage vers la
solitude essentielle, vers le point non-style, vers la fêlure où le sujet écrivant devient
personne et que « là où je suis, je ne [peux] plus m’adresser à moi et que celui qui
s’adresse à moi, ne [dit] pas “Je” ne soit pas lui-même51. » Pour Blanchot, écrire nous
engage alors vers cette « fêlure d’inspiration » où le « Je » rencontre la limite de sa propre
voix et accepte de s’abandonner au Silence infini tout en gardant le droit de parler.
Il s’agit d’un seuil, d’une limite comme point d’émergence où les formules toutes faites
du langage virent de sens, où le plein touche le vide, où le vide fait germiner le plein. La fin
commence et recommence. Écrire est alors un mouvement dans lequel le sujet s’engage
dans une production de sens qui le renvoie constamment à la limite de son pouvoir,
au pied d’une « grande muraille ferme » où une « altérité » advient et revient. Le poète
s’acharne à écrire jusqu’à éprouver sa maîtrise pour s’abandonner dans une altérité
inexprimable. À la fin du Moment voulu, « Je » a cette formule : « Cependant, bien que
le cercle déjà m’entraîne, et même s’il me fallait l’écrire éternellement, je l’écrirais
50. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit. p. 51.
51. Ibid., p. 23.
269
Blanchot.indb 269 29/11/13 11:56
pour effacer l’éternel : maintenant, la fin52. » C’est en s’imposant le silence que le sujet
écrivant façonne son style d’écriture. Le rapport de l’écrivain à sa propre écriture
détermine le ton de l’œuvre : « Le ton n’est pas la voix de l’écrivain, mais l’intimité du
silence qu’il impose à la parole53. »
Pour Blanchot, le « sens » de l’écriture n’est donc pas déterminé par le sujet (soit
auteur, soit lecteur) qui prend l’œuvre comme son objet à signifier ou à juger. Le sens
signale plutôt la direction de l’acte d’écriture, l’orientation vers l’essence même de
l’œuvre, ce que Blanchot appelle en fait l’origine de la littérature. Il ne faudrait pas
néanmoins confondre l’essence de l’œuvre avec la forme, le contenu, la structure ou le
genre de l’œuvre. L’essence ici suggère plutôt une fêlure, une fente qui marque le point
de sursaut que Blanchot signale comme l’instant d’inspiration où le sujet-auteur se
trouve désœuvré. On retrouve cette idée dans L’Arrêt de mort. « Je » essaie d’écrire à
plusieurs reprises des événements arrivés en 1938, mais il n’y parvient qu’en 1940 alors
qu’il est pris dans un état de désœuvrement qui permet que l’œuvre se fasse : « Il m’a
fallu tout à coup ouvrir les yeux et me laisser tenter par une pensée superbe que j’essaie
en vain de mettre à genoux54. » L’attirance vers cette « pensée superbe » est justement ce
que Blanchot désigne par l’inspiration, là où commence la véritable écriture comme fin
du langage qui ferait « de l’œuvre une voie vers l’inspiration, ce qui protège et préserve
la pureté de l’inspiration, et non pas de l’inspiration une voie vers l’œuvre55 ».
Le langage immédiat est ainsi rendu constamment « impuissant » par le saut où la
modulation de l’utilité qui met en visibilité le langage essentiel dans sa propre invisibilité.
Plus question de dichotomie sujet-objet. Cet instant d’impuissance donne lieu à une
nature radicalement ou essentiellement différente du langage. Il ne s’agit plus de la
prolifération des formes signifiantes, mais d’une immersion du sujet dans le langage
comme s’il était immergé dans l’eau. Le langage n’est plus utilisé mais vécu. Le langage-
vie ne cesse de se dépasser lui-même. Il a une valeur d’utilité, mais il se nie aussi dans un
« au-delà » qui est « autre que soi-même ». Ce qui nous intéresse dans le langage, c’est la
fêlure ou la limite souple et élastique entre des formes qui se mesurent et se comparent à
l’échelle de cet « Autrement ». Sous la pression de sa mutation, le langage-vie « s’agrandit »
52. Blanchot Maurice, Au Moment voulu, op. cit., p. 166.
53. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit. p. 22.
54. Blanchot Maurice, L’Arrêt de mort, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 1948, p. 55.
55. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 246.
270
Blanchot.indb 270 29/11/13 11:56
toujours jusqu’au point où il s’épuise pour remettre en scène la reconstitution d’un cadre
différent pour la re-production du sens. Blanchot affirme ainsi toutes les formes littéraires
tout en les niant. Il nous faut des formes pour prendre conscience des limites, et la prise
de conscience de la limite permet de relancer la création des formes.
À partir des critiques blanchotiennes du langage mallarméen, nous postulons que le
langage-vie de Blanchot ne tend pas vers une purification du contenu par des formes, mais
cherche à atteindre la lisière d’un pouvoir subjectif qui s’efforce de faire le pas « au-delà, »
en niant les formes existantes. Le langage-vie met en épreuve sa propre mort afin de renaître
« autrement ». L’essentiel réside dans la tentative de contact entre la forme et le contenu
sans écart. On pourrait parler ainsi d’une « religiosité » dans l’expérience littéraire chez
Blanchot en tant que « production subjective des formes remises en épreuve ». Dans cette
mise à l’épreuve des formes comme du temps, le langage-vie, tout comme le « moi » de
l’écrivain, cherche à « sauter ». Le Pas au-delà est donc le « pas » qui nie le langage-forme
dans son plan immédiat pour épouser le langage-vie dans l’au-delà d’un plan essentiel.
Le couloir du Pas au-delà
Lorsque « Je » arrive à saisir le « moment voulu », il met fin à son désir de rattraper le
temps perdu. Au moment voulu qui n’est pas voulu, nous nous trouvons dans un temps
sans temps, un non-temps qui ne veut plus se perdre dans une répétition sans fin. Le
« maintenant » advient pour interrompre le temps linéaire du récit. Il s’inscrit à
l’imparfait, au présent et même au futur. Ce maintenant intervient à chaque moment
sans le moindre souci de la concordance des temps, que ce soit par rapport au temps de
l’histoire qui fut, ou par rapport au temps de la narration qui est. Ces « maintenant »
sont comme une prise de conscience de la limite. Ils ouvrent le plan de la parole essentielle
qui ne cesse de s’affirmer dans l’éternel retour : « Je puis me rappeler tout cela, et me le
rappeler, ce n’est sans doute qu’un pas de plus dans le même espace, là où aller plus loin,
c’est déjà me lier au retour56. » Le présent du maintenant marque à la fois le « faux pas »
de la répétition, et le « pas » au-delà du non-temps. Comme Ulysse, il s’agit d’aller à la
rencontre d’un espace où le mouvement de l’existence « non seulement peut être compris,
mais restitué, réellement éprouvé et réellement accompli57 ». Le héros de l’Odyssée, lorsqu’il
56. Ibid., p. 166.
57. Blanchot Maurice, Le Livre à venir, op. cit. p. 19.
271
Blanchot.indb 271 29/11/13 11:56
entend le chant énigmatique des Sirènes, comprend que « se réalise selon les moments vrais
qui le rendent, quoique passé, présent58. » C’est exactement ce qui arrive dans l’acte d’écriture
lorsque Blanchot affirme qu’« Écrire, c’est entrer dans la fascination de l’absence de
temps59 » ; cette absence là n’est pas destinée à être retrouvé, mais à être vécu.
La rencontre du maintenant, loin de s’exposer au vide d’un gouffre, prend la forme de ce
couloir d’appartement qui rend possible la mise en communication des pièces, et par voie
de conséquence, des personnages. Le couloir est comme un « mi-lieu » qui sépare tout en
reliant les deux chambres. Il permet aussi au narrateur de s’engager autrement. Au mi-lieu
du couloir, « Je » passe de l’ordre du jour « lumineux » avec Judith à l’obscurité où
j’ai eu à supporter la plus grande douleur et cependant rencontré le moment le plus
vrai et le plus joyeux, comme si je m’étais heurté là non pas à la vérité froide, mais à la
vérité devenue la violence et la passion de la fin60.
Maintenant met fin à un temps qui s’établit sur la passion d’une répétition sans fin – la
façon d’aimer de Judith : « Il était bien vrai que nous nous entendions, mais dans la
profondeur de maintenant, là où la passion signifie aimer et non pas être aimé61. » Le
narrateur et Judith sont pris dans un rapport à sens unique dans lequel elle regarde le
narrateur sans qu’il ne la voie. Ce rapport à sens unique est une façon de traduire la
nature singulière de la temporalité du Moment voulu. On assiste à un retour au
commencement du récit lorsque « Je » rencontre Claudia pour la première fois : « Je
n’avais guère le temps de me le demander, tout juste le temps de saisir, de surprendre,
moi aussi, la vérité de ce frôlement et de lui dire : “Comment, vous étiez là ! Maintenant !”62 »
Vers la fin du récit, même si Claudia refuse d’aller dans le Sud avec le narrateur « Je », il
reste persuadé qu’elle sera de retour. On assiste à la coïncidence du moment voulu avec
la fin du récit. Le moment voulu est bien celui de la fin choisie du récit.
58. Ibid., p. 19.
59. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit. p. 25.
60. Blanchot Maurice, Au Moment voulu, op. cit., p. 166.
61. Ibid., p. 149.
62. Ibid., p. 25.
Blanchot.indb 272 29/11/13 11:56
Conclusion
Blanchot.indb 273 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 274 29/11/13 11:56
Le fragment ou la strangulation de l’écriture
Alain Milon
«
“Fragment”, un nom, mais ayant la force d’un verbe, cependant absent1… » :
un nom qui a la force d’un verbe pour fabriquer une phrase, une phrase qui, par le
nom, tente de toucher la nomination. Pourtant, tout en étant présent par ce qu’il
essaie de nommer, le verbe reste absent, et c’est au fragment de rendre compte de cette
absence puisque, tout en tentant de dire, il justifie l’inachèvement de ce qu’il signifie. Reste
à savoir si le fragment ouvre par sa possibilité plus qu’il n’enferme dans son impossibilité.
Inscrite dans le corps même de l’écriture, la mission de l’écriture fragmentaire consiste
alors à pousser la nomination dans ses retranchements :
[…] une littérature de fragment qui se situe hors du tout, soit parce qu’elle suppose
que le tout est déjà réalisé (toute littérature est une littérature de fin des temps), soit
parce qu’à côté des formes de langage où se construit et se parle le tout, parole du
savoir, du travail et du salut, elle pressent une toute autre parole libérant la pensée
d’être seulement pensée en vue de l’unité, autrement dit exigeant une discontinuité
essentielle. En ce sens, toute littérature est le fragment, qu’elle soit brève ou infinie,
1. Blanchot Maurice, « Parole de fragment », in L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 451.
275
Blanchot.indb 275 29/11/13 11:56
à condition qu’elle dégage un espace de langage où chaque moment aurait pour sens
et pour fonction de rendre indéterminés tous les autres ou bien (c’est l’autre face)
où est en jeu quelque affirmation irréductible à tout processus unificateur2.
En fait, ce commentaire de Blanchot sur son propre travail n’apporte pas grand-chose.
L’écrivain ne fait que commenter une écriture qui est déjà un commentaire de l’écriture
elle-même. Le seul intérêt de cette citation est de résumer son approche de la qualité
fragmentaire de l’écriture, autrement dit l’acceptation que l’écrivain, « libérant le dis-
cours du discours », atteigne, par le fragment, une parole pleine et entière, une parole de
l’économie verbale, « une parole de fragment » et de la dislocation, une parole qui touche
le réel inextinguible de Char. Et ce n’est pas par hasard que le texte de Blanchot, « Parole
de fragment », soit entièrement consacré à la poésie de Char, poésie de la pulvérisation
de la langue, quand celle-là permet à la langue d’exister.
L’écriture fragmentaire ne strangule pas l’écriture par son étroitesse, ni par son
inachèvement. Elle n’est pas fragmentaire par « accident » – les aléas des indices
typographiques ou les marques temporelles3 – mais par « nécessité » – l’impossible
nomination –, autre moyen de reconnaître que le fragmentaire sauve l’écriture (il reste
un acte d’écriture) tout en la remettant en cause (il mesure ses incapacités). En fait, le
fragment nous dit, plus implicitement qu’explicitement, que la nomination ne peut rien
pour le discours. Tous ceux qui « fragmentent » le fragment en le limitant à des artifices
typographiques comme le losange4 ou le signe ± ne perçoivent de l’espace littéraire que
sa forme géométrique en oubliant sa composante essentielle : l’indétermination de son
espace poétique. Et quand il arrive à Blanchot de fragmenter le fragment, c’est
uniquement pour indiquer la puissance d’indétermination de l’écriture. En réalité, le
fragment ne s’arrête pas aux limites géographiques du fragment ; il est inscrit dans le
2. Blanchot Maurice, Écrits politiques, 1958-1993, Paris, Gallimard, 2008, p. 112. Dans ce texte,
Blanchot fait état de quatre types de fragment : le fragment dialectique, le fragment aphoristique,
le fragment de la pensée voyageuse, et l’écriture fragmentaire. De ces quatre types de fragment,
c’est le dernier qui rend le mieux compte de son écriture.
3. Le fragment n’est pas inscrit dans une « antériorité » (une esquisse) ou une « postériorité »
(un addendum) comme Blanchot le précise dans L’Entretien infini (op. cit., p. 451), mais dans la
dislocation et la pulvérisation. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui pousse Blanchot à penser le
fragment dans une mise en correspondance avec la poésie de René Char.
4. Le losange a une valeur en logique ; il signifie la possibilité. Le signe ± a la valeur d’une
approximation en algèbre. Possibilité et approximation sont des caractéristiques formelles de
l’écriture fragmentaire.
276
Blanchot.indb 276 29/11/13 11:56
corps même de l’écriture de Blanchot. Fragmenter le fragment, cela revient à montrer
comment la faille et la fêlure sont inscrites dans le corps même de la nomination. C’est
par exemple la fêlure d’un mot quotidien qui, prononcé plusieurs fois de suite, finit par
devenir inconnu comme par une sorte d’hypnose sonore.
Mais la tentative que représente le fragment aboutit-elle à autre chose qu’à la mise en
demeure de l’écriture elle-même ? Finalement, le nom est présent tout en étant absent, et
c’est bien le drame de la nomination. Les phrases de Blanchot auront beau faire ; elles
resteront prisonnières de leur incapacité à sortir la nomination de son impossibilité à
dire les choses. L’écriture blanchotienne, et qu’elle soit fragmentaire ou non ne change
rien, chante le même mot d’ordre : « l’informulé dans le connu du mot ». Mais répétons-
le encore, l’impossible nomination chez Blanchot n’est pas liée à une situation histo-
rique (le drame de l’holocauste rendant toute poésie impossible) ; elle est d’abord et
avant tout l’expression ontologique de l’écriture (la nomination est inscrite dans l’évé-
nement qui pour Blanchot se traduit par un informulé). Le fragment n’est pas l’incom-
plétude, l’inachèvement ou l’ébauche ; il est d’abord puissance de fragmentation,
autrement dit la capacité de l’être à se mettre en mouvement.
Le fragment chez Blanchot n’a rien à voir avec la remarque wittgensteinienne, l’apho-
risme de Marc-Aurèle ou la maxime épicurienne ; peut-être, mais avec légèreté, avec
l’avertissement nietzschéen à condition de comprendre que si l’avertissement a une valeur
aphoristique c’est au sens d’une ouverture et non d’une circonscription. Mais pourquoi
parler autant du fragment ? Peut-être parce qu’il constitue une caractéristique essentielle
de son écriture qui relève plus de l’ordre ontologique que de la construction stylistique
comme il le fait remarquer dans L’Entretien infini en faisant référence au Discours sur le
style de Buffon : « Bien écrire, c’est à la fois bien sentir, bien penser et bien dire5. »
Le fragment dont parle Blanchot, celui de l’écriture fragmentaire, possède toutes les qua-
lités de ce que Buffon appelle le « moule intérieur » lorsque le savant s’interroge sur cette
puissance qui donne à cette matière l’activité et le mouvement nécessaires pour
pénétrer le moule intérieur ? et s’il existe une telle puissance, ne serait-ce pas par une
puissance semblable que le moule intérieur lui-même pourrait être reproduit6 ?
5. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 488. Blanchot modifie en fait la formule de
Buffon qui écrit : « Bien écrire, c’est tout à la fois bien penser, bien sentir et bien rendre […] »
6. Buffon Georges-Louis, Œuvres complètes, t. 12, Paris, Verdières et Ladrange, Libraires, 1828, p. 47.
Dans L’Entretien infini (op. cit., p. 488), Blanchot fait référence au Discours sur le style de Buffon.
277
Blanchot.indb 277 29/11/13 11:56
Si l’on parle de moule intérieur pour évoquer le fragment, c’est pour rendre compte de
l’apparente contradiction des termes. Comme le moule intérieur n’est pas une enveloppe
extérieure, le fragment de l’écriture fragmentaire n’est pas une esquisse. De là l’appa-
rente contradiction : comment un moule peut être intérieur tout en étant extérieur ? Et
comment un fragment peut être fragment tout en étant puissance d’existence ?
Ces penseurs extrêmes sont dans la même correspondance : Blanchot, extrême dans sa
lecture de l’espace d’écriture, et Buffon extrême dans la lecture de l’échelle du vivant :
« On peut nous dire que cette expression, moule intérieur, paraît d’abord renfermer
deux idées contradictoires, que celle du moule ne peut se rapporter qu’à la surface, et
que celle de l’intérieur doit ici avoir rapport à la masse ; c’est comme si l’on voulait
joindre ensemble l’idée de la surface et l’idée de la masse, et on dirait tout aussi bien une
surface massive qu’un moule intérieur. J’avoue que, quand il faut représenter des idées
qui n’ont pas encore été exprimées, on est obligé de se servir quelquefois de termes qui
paraissent contradictoires […]7 » Le moule intérieur est le moyen pour Buffon de rendre
compte de la puissance d’existence de l’organisation de la vie. Le fragment quant à lui
explique la puissance d’existence de l’écriture. Et la question ne se résume pas à un rap-
port forme/contenu. Il s’agit plutôt de la persistance et de l’imposition que le moule
intérieur véhicule, ce qui vaut d’ailleurs autant pour l’organisation du vivant (la vie) que
pour l’organisation de la langue (le style). C’est ce que Buffon note dans son Discours sur
le style quand il parle de la « prise de forme » qui permet au principe d’individuation de
se réaliser hors d’un rapport hylémorphique déterminé par l’imposition de la forme sur
la matière. La « prise de forme » n’est pas la forme extérieure que revêt une matière mais
l’intussusception de la forme et de la matière8.
Dans le cas de l’écriture fragmentaire, le fragment ne relève pas de la topographie mais
du « rythme » que les échanges entre le style (le moule) et le mot (la matière) expriment.
Dans ces échanges, les jeux de puissance de l’un et de l’autre sont imprévisibles. Le moule
intérieur est moule par sa matière, et matière par son moule. Buffon fait d’ailleurs
remarquer que « cette extension se fait par l’intussusception d’une matière accessoire et
étrangère qui pénètre dans l’intérieur et qui devient semblable à la forme identique avec
7. Buffon Georges-Louis, « Histoire des animaux », in Œuvres complètes. L’histoire naturelle,
t. 3, chap. II, Paris, Duménil Éditeur, 1834, p. 388.
8. L’intussusception se définit en biologie comme le mode d’accroissement des êtres vivants
consistant en la pénétration par endosmose d’éléments nutritifs à l’intérieur de l’organisme.
278
Blanchot.indb 278 29/11/13 11:56
la matière du moule9 ». Le fragment, quant à lui, s’affirme comme l’expression du prin-
cipe différentiel des choses, autrement dit comme variation rendant compte de la conti-
nuité et de la discontinuité du processus d’écriture quand il énonce et annonce son
impossibilité : « Remarquons qu’écrire est conçu comme une totalité dont le dire ne
serait qu’un moment ou un composant, peut-être une détermination seconde10. » L’écri-
ture dépasse le dire puisque sa détermination est ailleurs. C’est cet ailleurs que Blanchot
questionne ; le fragment devenant espace d’interrogation de ce que la nomination tente
de circonscrire.
Le fragment, comme le moule intérieur, n’est ni une préformation, ni une préfigura-
tion, encore moins une prédétermination. Il est simplement la préparation de l’écriture
au sens où celle-ci s’affirme comme lieu de conflit entre le possible et l’impossible. En
fait, le fragment a un intérêt quand il permet de montrer les limites de l’écriture jusqu’à
épuiser le sens qu’elle porte au risque de l’étrangler. C’est aussi le moyen qu’a l’impos-
sible de s’exprimer. La puissance du fragment est là, dans sa capacité, tout en interro-
geant le sens, de tuer l’écriture. N’étant plus esquisse par accident, mais possibilité par
essence, le fragment prépare l’écriture à l’annonce de sa disparition.
Mais quelle est donc cette écriture qui s’installe « dans sa signifiance sans signifié,
c’est-à-dire dans sa musicalité11 » ? Rien d’autre que « la “fable” de la fermeture de
l’être12 », mais c’est déjà essentiel parce que cette fable de la fermeture nous mène tout
droit à la strangulation. Cette fable, c’est aussi celle de la pensée qui en visant l’être pense
le toucher. Certains y verront une ouverture, d’autres une fermeture. La question est de
savoir vers quel règlement ontologique penche Blanchot : celui d’une ontologie directe
(l’être est), indirecte (l’être est par ce qu’il nomme) ou négative (ce que n’est pas l’être) ?
Lévinas, comme tous les grands musiciens de la pensée, est l’un des rares à entendre
l’air chanté par Blanchot. Il faut une oreille aiguisée pour saisir la musicalité de ces
moments de signifiance qui peuvent se passer de la pesanteur du sens. L’écriture de
Blanchot est là comme un bloc qui ne pardonne rien. Elle est cette musique qui surgit
dont on ne sait où, cette réflexion dense qui décourage les touristes de la pensée, et cette
9. Buffon Georges-Louis, « Histoire des animaux », in Œuvres complètes. L’histoire naturelle,
t. 3, chap. III, op. cit., p. 390.
10. Blanchot Maurice, L’Entretien infini, op. cit., p. 488.
11. Lévinas Emmanuel, Sur Maurice Blanchot, Saint-Clément-la-Rivière, Fata Morgana, p. 57.
12. Ibid., p. 57.
279
Blanchot.indb 279 29/11/13 11:56
fulgurance dans les enchaînements. Étonnante construction d’une signifiance sans
signifié, d’une musicalité sans note ou d’une phrase sans mot. Déjà Verlaine nous
murmurait à l’oreille : « De la musique avant toute chose,/ Et pour cela préfère l’Impair/
Plus vague et plus soluble dans l’air,/ Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. » Blanchot,
lui, continue à chanter tout en débarrassant sa musique de la pesanteur de ces mélodies
trop musicales ou de ces significations qui s’obstinent à vouloir nommer.
L’écriture de Blanchot, qu’elle soit dans le roman, le récit ou l’essai, s’organise alors
autour de sa propre strangulation, celle qui va jusqu’au bout de son acte : s’étouffer soi-
même pour empêcher le mot de respirer. L’écrivain s’étouffe pour ne pas laisser vivre ce
pourquoi il existe : l’écriture. S’il s’asphyxie, ce n’est pas par manque d’oxygène, mais par
trop d’air. Blanchot est comme le Zarathoustra de Nietzsche. Il perd son souffle, non
parce qu’il est à bout de souffle quand il écrit, non parce que le fragment est une raréfac-
tion de l’écriture mais parce qu’il est ce qui lézarde la matière même de la nomination.
L’écrivain condense à lui seul « […] la genèse d’un être qui projette et d’un être qui
retient13 ». Blanchot nous plonge ainsi dans une économie verbale, mais cette économie
n’a rien à voir avec ces économies de lecture qui coûtent cher. Il s’agit plutôt d’une éco-
nomie générale de la pensée qui met à nu la « nudité première » de René Char pour
atteindre ce « réel inextinguible ». Le fragment est comme une ritournelle qui chante
continuellement le même air : « exprimer sans mot le sens des mots14 », afin de nous
indiquer où se trouve le territoire de l’écriture. C’est pourquoi l’écriture fragmentaire,
quand elle oublie le fragment, participe de cette strangulation de l’écriture, et cela n’a
aucun lien avec sa nature de fragment. Le fragment ne strangule pas l’écriture parce qu’il
serait la simple esquisse d’une pensée. S’il strangule l’écriture, c’est au contraire parce
qu’il épuise tous les possibles. Le fragment s’inscrit en réalité dans un espace littéraire
qui organise la fermeture de l’être.
Toutefois, cette fermeture est aussi le signe d’un retour, mais un retour qui refuse tout
point d’ancrage. Blanchot n’est pas en partance ; il est dans l’attente et son attente, parce
qu’elle est celle de l’oubli, n’attend aucun complément d’objet direct ou indirect. Elle est
cette attente qui « donne l’attention en retirant tout ce qui est attendu15 ». Le retour pour
lui prend plusieurs formes. Il est autant le retour du juif dans le grec, que le retour de la
13. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, p. 268.
14. Blanchot Maurice, Thomas l’Obscur. 2e version. Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 1992, p. 61.
15. Blanchot Maurice, L’Attente l’oubli, Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 2000, p. 36.
280
Blanchot.indb 280 29/11/13 11:56
Bible dans l’Odyssée, le retour d’Ève dans Pandore, le retour d’Isaac dans Iphigénie, le
retour de Moïse dans Ulysse, le retour de Narcisse dans Écho, le retour de la Thora dans
la Thémis, mais surtout le retour du possible dans l’impossible. Ces retours sont l’ex-
pression d’un voyage qui traduit le mouvement de la langue, un retour qui refuse le
point de départ ou le parcours d’un point à un autre pour préférer le mouvement inces-
sant. À chaque juif son grec parce que le grec est la possibilité offerte au juif de rester juif.
Ils sont tous les deux dans le même mouvement, chacun avec des perspectives propres.
À chaque fragment sa strangulation parce que la strangulation est la possibilité offerte
au fragment d’être fragmentaire. Mais surtout à chaque possible son impossible parce
que l’impossibilité est encore une possibilité, et il en va de même pour chaque phrase
dans sa modulation, et pour chaque signifiance dans sa musicalité.
D’ailleurs, la question n’est même plus de savoir si l’univers littéraire de Blanchot est
un espace de fermeture qui se replie en raison d’un échec, ou s’il s’agit d’un espace qui
se déplie dans l’épuisement des possibles de l’écriture. Acceptons pour l’instant qu’il
s’ouvre sur une possibilité pour finir par se refermer sur l’espoir qu’offre l’impossibilité
d’écrire, au risque de mourir de strangulation.
Qu’advient-il alors de l’écriture de Blanchot ? Ouverture sans possibilité de fermeture,
ou fermeture dans l’attente d’une clôture irréversible ? Ce qui advient finalement, ce
n’est rien d’autre que ce que peut mettre en place l’indétermination de la nomination.
L’essentiel de son espace d’écriture ne s’inscrit dans aucune géométrie spatiale. Pourquoi
alors parler d’espace littéraire sachant qu’il est sans espace, ou pour être plus précis sans
géométrie ? N’est-ce pas d’ailleurs ce qui sauve l’espace : la présence d’une géométrie
poétique ? Cette indétermination de la nomination a en réalité d’autres qualités ; elle
explique l’origine de l’improféré que Blanchot ira chercher dans une relecture bien
singulière de la scène primitive freudienne.
Dans L’Écriture du désastre Blanchot consacre ainsi deux textes à la scène primitive dans
lesquels il décrit l’expérience intime de l’acte d’écriture16. En reprenant ce concept
freudien sur le champ littéraire, Blanchot interroge « la scène primitive » de la nomination.
S’agit-il d’une nomination que l’écrivain refuserait, sinon d’énoncer, au moins de réaliser
jusqu’au bout, une sorte de coït sans orgasme, ou s’agit-il du seul fait de mettre les choses
16. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 117 et 176. Dans ces
deux textes, l’expression « scène primitive » est entre parenthèses et avec un point d’interrogation
comme pour signaler l’incertitude d’un tel événement.
281
Blanchot.indb 281 29/11/13 11:56
en rapport que l’écrivain refoulerait, mise en rapport sexuel dans l’univers freudien, ou
mise en rapport du mot et du sens dans l’univers de l’écrivain ? C’est ainsi ce que Blanchot
met en place dans L’Écriture du désastre quand, s’interrogeant sur la scène de l’improféré
de la nomination, il renvoie le lecteur au vers d’Igitur de Mallarmé : « Je profère la parole
pour la replonger dans son inanité » ? L’improféré est une nomination inachevée comme
la scène primitive est la mise en scène imaginaire d’un rapport sexuel. Cela ne veut pas
dire que l’inachevé du mot est l’imaginaire sexuel, mais seulement que dans les deux cas,
le mouvement, la différence, l’incertain l’emportent sur la certitude et la stabilité de l’acte.
La notion freudienne de « scène primitive » renvoie à l’angoisse du jeune enfant voyant
pour la première fois un rapport sexuel entre ses parents. Cette « scène primitive »
représente chez Freud une sorte d’événement primordial qui intervient dans la genèse et
le développement de la sexualité de l’enfant, et peu importe que cette scène soit réelle ou
qu’elle relève des fantasmes primordiaux de la sexualité enfantine.
Ce qui est intéressant dans la scène primitive c’est qu’elle est tout autant un événement
historique (elle existe comme morceau de la réalité) qu’un événement fantasmatique
interprété après coup par l’enfant (le délire sexuel). Réalité et fantasme s’enchevêtrent
pour constituer l’imaginaire sexuel de l’enfant. C’est ainsi que la littérature psychanaly-
tique montre comment le complexe d’Œdipe réactive cette scène primitive par la prohi-
bition de l’inceste et par la transgression de cette prohibition à travers la personnification
des acteurs de cette scène (le père-la mère-le fils). La scène primitive pose en fait la
question du rapport réel-imaginaire, détermination-indétermination, sexualité accep-
tée-sexualité fantasmée. Mais elle pose aussi la question du sens à donner à l’idée de
« premier ». Si, en psychanalyse, le premier est chronologique au sens où, ensuite, la
scène est inscrite dans l’inconscient de l’enfant, pour Blanchot au contraire, le premier
reste ontologique dans la mesure où l’improféré reste quoi qu’il arrive improféré.
Nomination réalisée ou indéterminée ? Passage à l’acte ou impossibilité d’écriture ?
Finalement, la scène primitive est-elle une « nomination primitive », celle du Verbe de la
tradition biblique du « Au commencement était le Verbe » de l’évangile selon saint Jean,
ou une « écriture indéterminée », celle de l’informulé dans le connu du mot ?
Si dans la scène primitive freudienne l’enfant ne sait dire et faire ce qu’il voit même s’il
pressent ce qui se cache derrière ce qu’il voit ; dans la scène primitive de la nomination
au contraire, l’écrivain entrevoit par l’acte d’écriture ce qu’il ne peut nommer. Les
interdits de l’espace psychanalytique ne sont pas ceux de l’espace littéraire même s’il est
282
Blanchot.indb 282 29/11/13 11:56
toujours question de rapport. Devant cette mise en rapport transparaît pourtant la
même impuissance ; impuissance sexuelle de l’enfant à passer à l’acte, impuissance de
l’écrivain à pouvoir nommer ce qu’il pense. Mais si l’une est passagère, l’autre est
irréversible et irrémédiable. L’impossible passage à l’acte de nomination semble
dramatique et meurtrier pour l’écrivain parce que cela ravive la littérature comme droit
à la mort pour reprendre le titre d’un texte important de Blanchot.
On retrouve d’ailleurs dans le « Parler, ce n’est pas voir » de L’Entretien infini, le même
questionnement sur la mise en rapport des choses, mais également la même interroga-
tion sur l’impossible correspondance du « parler » et du « voir ». Alors que dans la scène
primitive freudienne, l’enfant voit ce dont il ne peut parler ; dans la scène primitive de
Blanchot, le « Parler » ne peut être un « Voir », autrement dit, la pensée que l’expérience-
limite annonce se libère du poids d’un savoir déterminé par les exigences optiques que
la philosophie antique et classique impose. Mais dans le cas de la scène primitive freu-
dienne, celle de l’interdit qui règne autour de la sexualité adulte, celle-ci s’actualise dans
l’inconscient du sujet alors que l’autre se réalise dans la prise de conscience de l’impos-
sibilité de la nomination. En fait, on ne peut réellement parler de la scène primitive ; il
s’agit plutôt de la mise en place d’un dispositif ; dispositif d’une sexualité en passe d’être
accomplie, dispositif d’une nomination qui s’interroge encore sur sa capacité à nommer
quoi que ce soit. Tout est interdit dans la scène primitive, mais l’interdit ne s’inscrit pas
dans le même rapport. Face à la détermination sexuelle chez Freud (la scène primitive
annonce une sexualité en cours de réalisation), il y a une indétermination nominale chez
Blanchot (la scène de la nomination annonce une impossibilité de nommer).
Cet interdit est l’interdit de la transgression dans la scène primitive psychanalytique
alors qu’il est l’« entre-dit » de l’écriture dans la scène de la nomination. L’interdire de la
nomination est un entre-dire ou un inter-dit qui s’évertue à mettre en relation la tenta-
tive du mot à désigner ce qu’il voit même si l’on sait que cela conduira nécessairement à
un « Parler, ce n’est pas voir ». Pourtant, qu’il s’agisse de la scène primitive du rapport
sexuel, ou de la scène primitive du rapport nominal, la scène primitive reste un récit
inénarrable, et c’est le drame du passage à l’acte, qu’il soit acte sexuel ou acte d’écriture.
Quand Blanchot fait référence à la scène primitive dans L’Écriture du désastre, il évoque
précisément l’instant immédiatement antérieur au « voir », le moment précis où l’écri-
vain, lecteur du monde finalement, provoque une brèche dans le mot, brèche qui laisse
entrevoir l’impossible nomination inscrite dans l’épaisseur du sens. Mais le « voir » de la
283
Blanchot.indb 283 29/11/13 11:56
scène primitive de la nomination est d’une tout autre nature que le « voir » de la scène
primitive freudienne. Lorsqu’il annonce qu’« écrire, ce n’est pas donner la parole à
voir17 » afin de questionner le « Parler, ce n’est pas voir », il montre les limites de la scène
primitive freudienne. Voir l’acte sexuel, ce n’est pas connaître l’acte sexuel, alors que
Freud induit dans la vision d’une chose, la connaissance de la chose. Il est clair que pour
Blanchot la connaissance d’une chose ne se réduit pas à l’image de cette chose, de la
même manière que voir une chose ce n’est pas la connaître.
On retrouve ici la critique de l’image faite par Blanchot. L’image est le témoignage de
la défaillance interne de la visibilité. Elle ne peut être « la suivante de l’objet » :
L’image n’a rien à voir avec la signification, le sens, tel que l’impliquent l’existence du
monde, l’effort de la vérité, la loi et la clarté du jour. L’image d’un objet non seulement
n’est pas le sens de cet objet et n’aide pas à sa compréhension, mais tend à l’y soustraire
en le maintenant dans l’immobilité d’une ressemblance qui n’a rien à quoi ressembler18.
Dans ces lignes, Blanchot insiste sur le fait que l’image n’est pas la représentation d’un
objet. Elle n’a même aucune ressemblance avec l’objet ; elle est plutôt sa dissimulation,
ce qui engendre son éloignement finalement.
L’image n’a même pas de signification pour Blanchot dans la mesure où elle ne traduit
aucunement l’existence de l’objet. En réalité, elle tend à nous soustraire de la compré-
hension que l’on peut en avoir. Il n’y a alors rien à quoi ressembler, et c’est justement ce
que montre Blanchot : refuser que l’image ressemble à quelque chose au risque de sou-
mettre l’image à l’immobilité de la ressemblance. Si l’image est la ressemblance d’une
chose, elle limite cette chose à ce que la ressemblance impose. L’image n’est plus dans la
reproduction d’une chose mais dans l’éloignement de cette chose. Sa puissance se
mesure à sa capacité à s’éloigner de ce dont elle est l’image. En fait, le « Parler, ce n’est pas
voir » traduit explicitement cette distance qui sépare l’image de son objet. Comme le
« parler » traduit une libération à l’égard des exigences optiques qu’impose le savoir,
l’image traduit une mise à distance de ce qu’elle réfléchit à la manière du miroir qui
réfléchit sur ce qu’il réfléchit pour reprendre la formule de Cocteau : « Les miroirs
17. Blanchot Maurice, « Parler, ce n’est pas voir », in L’Entretien infini, op. cit., p. 38.
18. Blanchot Maurice, L’Espace littéraire, op. cit., p. 354. On retrouve cette idée dans « L’Absence de
livre », in L’Entretien infini, op. cit., p. 435 : « Que l’art ne dit pas la réalité, mais son ombre, qu’il est
l’obscurcissement et l’épaississement par quoi quelque chose d’autre s’annonce à nous sans se révéler. »
284
Blanchot.indb 284 29/11/13 11:56
feraient bien de réfléchir un peu avant de renvoyer les images. » Toute la connaissance
réside dans cette mise à distance des choses que l’on cherche à connaître.
Mais Blanchot n’est pas le seul à montrer les limites de la scène primitive. Maurice
Merleau-Ponty insistait déjà sur les lacunes de la conception freudienne. Et même si la
perspective de Merleau-Ponty n’est pas celle de Blanchot, ils restent d’accord sur le fait
que la vision d’une chose n’est pas la connaissance de cette chose : « S’il arrive par hasard
qu’un enfant soit témoin d’une scène sexuelle, il peut la comprendre sans avoir
l’expérience du désir et des attitudes corporelles qui le traduisent, mais la scène sexuelle
ne sera qu’un spectacle insolite et inquiétant, elle n’aura pas de sens, si l’enfant n’a pas
encore atteint le degré de maturité sexuelle où ce comportement devient possible pour
lui. Il est vrai que souvent la connaissance d’autrui éclaire la connaissance de soi : le
spectacle extérieur révèle à l’enfant le sens de ses propres pulsions en leur proposant un
but. Mais l’exemple passerait inaperçu s’il ne se rencontrait avec les possibilités internes
de l’enfant. Le sens des gestes n’est pas donné mais compris, c’est-à-dire ressaisi par un
acte du spectateur. Toute la difficulté est de bien concevoir cet acte et de ne pas le
confondre avec une opération de connaissance19 ». « Bien concevoir cet acte », cela
signifie entrer en contact direct et « immédiat » avec l’acte, mais ce n’est pas pour autant
l’assumer, l’utiliser ou réfléchir sur la distance qui sépare l’acte de celui qui commet
l’acte pour le transformer en une « opération de connaissance ». La ressemblance d’une
chose n’est pas la représentation de cette chose20.
Sur le terrain de la nomination, cela revient à comprendre la distance qui sépare le mot
du sens, ou le « parler » du « voir ». C’est aussi l’occasion de réaffirmer que le « parler »
n’est plus un « voir » et que « Voir, c’est donc saisir “immédiatement” à distance21 ». Le
« voir » n’est pas la garantie de la représentation encore moins de la vérité ; la vérité, au
sens de quête de la vérité absolue est un leurre. Pour Blanchot, se libérer des exigences
optiques, c’est la possibilité offerte aux choses d’exister dans leur propre espace avec
leurs propres distances. Par son « Parler, ce n’est pas voir », l’écrivain montre les limites
de la représentation quand elle s’affirme comme marque de la ressemblance des choses.
19. Merleau-Ponty Maurice, « L’interrogation philosophique. Phénoménologie de la percep-
tion I. Le corps VI », in Œuvres, Paris, Gallimard, « Quarto », 2010, p. 872.
20. On retrouve cette idée tout au long de l’ouvrage de Foucault Michel, Les Mots et les choses,
Paris, Gallimard, 1969.
21. Blanchot Maurice, « Parler, ce n’est pas voir », in L’Entretien infini, op. cit., p. 39.
285
Blanchot.indb 285 29/11/13 11:56
Dans les deux paragraphes de L’Écriture du désastre concernant la scène primitive,
Blanchot analyse le regard de l’enfant qui est aussi celui de l’écrivain ; un regard qui part
de l’objet regardé et se déplace vers le haut du ciel, un regard qui touche « le ciel, le
même ciel, soudain ouvert22 », à condition que ce soit « le même ciel… – Précisément, il
faut que ce soit le “même”23 ». C’est là l’instant immédiatement antérieur au « voir » où
celui qui regarde commence à « percevoir » et à « entrevoir », comme par une brèche, la
profondeur du mot. C’est aussi le seul moyen d’entrer directement et d’une manière
« immédiate » dans le mot pour l’interroger dans sa capacité de nommer. Qu’est-ce qui
fait que le mot regardé ou saisi touche l’écrivain ? Que se passe-t-il pour que l’évène-
ment qui a lieu, autrement dit « la “circonstance fulgurante” par laquelle l’enfant fou-
droyé voit24 », prenne le poids d’une « scène primitive » qui déclenche le processus de
nomination avec ses impossibilités ?
En fait, penser le même mot, c’est penser au-delà du mot, et réfléchir sur le sens sup-
pose un « retard » qui se traduit par ce que Blanchot appelle une « rupture de l’entente »,
une sorte d’incompréhension inscrite dans la nomination. L’écrivain regarde le mot
comme l’enfant, même si le registre est différent, regarde l’acte sexuel de ses parents. Il
lit une expression qu’il ne comprend pas ou qu’il croit avoir comprise. Et c’est là toute la
complexité de la nomination qui rend la scène incompréhensible. Pourtant, même si
cela ne lui « parle » pas, sa pensée travaille sur l’acte de nomination. Et c’est justement
cet « attrait d’attention » qui permet à la nomination, même si elle existe dans son
impossibilité, de prendre forme.
Cette forme est celle d’un « court-circuit25 » à l’intérieur du mot : une séparation, une
distance entre le mot et le sens. Le mot existe mais le sens n’existe pas encore parce qu’il
n’est pas encore formé par l’écrivain, comme l’acte sexuel existe même s’il n’a aucun
sens pour l’enfant. Cette rupture entre mot et sens prend forme dans la géométrie poé-
tique que nous évoquions précédemment. D’une certaine manière, en travaillant sur le
processus de nomination, l’écrivain s’éloigne et se rapproche du sens porté par le mot.
22. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, op. cit., p. 117.
23. Ibid., p. 177-178.
24. Ibid., p. 177.
25. Blanchot Maurice, « Le mystère dans les Lettres », in La Part du feu, Paris, Gallimard,
1949, p. 55.
286
Blanchot.indb 286 29/11/13 11:56
Ce « merveilleux phénomène, prodigieux court-circuit26 », comme dit Blanchot, se pro-
duit entre le sens et le mot. À la fois à distance et en contact, le mot et le sens restent deux
entités autant inconciliables qu’inséparables.
Le court-circuit rend compte simultanément d’une rupture et d’une mise en contact
plus intense. C’est là tout le paradoxe de ce court-circuit qui, en rompant l’unité de la
parole, fait de telle sorte que le mot ne soit plus lié conventionnellement à un sens
puisque le sens se forme au-delà du mot.
Le plus important n’est pas le mot ni le sens mais leur « rapport », un rapport en fait
qui met en place un mouvement. La scène primitive de l’acte d’écriture est dans la
modulation qu’elle provoque. La nomination, même impossible, est prise dans le conti-
nuum de la parole. Pour Blanchot, c’est ce « rapport » indéterminable, ce contact immé-
diat du mot et du sens dans l’acte de nomination qui fait que la parole s’accomplit et que
la littérature, comme acte d’écriture, prend forme. Nous sommes loin de la lecture freu-
dienne qui réduit la scène à une opération de fabrication de la connaissance. Sur ce
point, Blanchot et Merleau-Ponty s’accordent.
Le « rapport », ainsi évoqué, devient l’« unité fondamentale », non pas sous la forme
de l’unité sens-mot du langage conventionnel, mais sur le plan d’une conscience supé-
rieure qui gère l’acte de nomination :
Il y a un autre sens que le sens intelligible, il y a une signification qui n’est encore
ni claire ni distincte, qui n’est pas pensée expressément, mais qui est comme jouée ou
mimée ou vécue par tout être capable de saisir et de communiquer un sens27.
La parole se crée alors et la littérature se fabrique dans et par l’acte de nomination qui
est un « nom qu’il faut entendre comme un verbe, le mouvement de tourner, vertige où se
reposent le tourbillon et le saut et la chute28 ». Tout bouge car, dans ce rapport mot-sens-
acte de nomination, « voir le mot » et « dire le sens » ne sont pas des actions distinctes,
mais des présences simultanées. Comme le fait remarquer Lévinas, « Blanchot guette
précisément le moment entre le voir et le dire où les mâchoires restent entr’ouvertes29 ».
26. Ibid., p. 56.
27. Ibid., p. 60.
28. Blanchot Maurice, « Parler, ce n’est pas voir », in L’Entretien infini, op. cit., p. 42.
29. Lévinas Emmanuel, Sur Maurice Blanchot, op. cit., p. 40.
287
Blanchot.indb 287 29/11/13 11:56
Dans la littérature, le « dire » traduit exactement le « voir », le « penser » et le « parler »
formant un seul mouvement :
Le dit qui, sans renvoyer à un non-dit (comme c’est devenu la coutume de le pré-
tendre) ou à une richesse de paroles inépuisable, réserve le Dire qui semble le dénon-
cer, l’autoriser, le provoquer à un dédit. – Dire : pouvoir de dire30 ?
C’est pourquoi « penser » n’est pas encore une « pensée », comme « parler » n’est pas
encore une « parole ». La tâche de la nomination est donc d’essayer d’exprimer le
« penser » et non « les pensées » même si celui-là est impossible. L’acte de nomination
s’inscrit ainsi dans la découverte d’un « mouvement » pris dans le piège d’une distance
étrangère qui s’éloigne au fur et à mesure que l’on s’approche de ce que l’on cherche à
découvrir. Ce « rapport dans le non-rapport » pose une question primordiale : cette
découverte a-t-elle le poids d’une « scène primitive » ?
30. Blanchot Maurice, L’Écriture du désastre, op. cit., p. 177.
Blanchot.indb 288 29/11/13 11:56
Annexes
Blanchot.indb 289 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 290 29/11/13 11:56
Critiques de Thierry Maulnier à propos des deux premiers
romans de Maurice Blanchot, Thomas l’Obscur et Aminadab
S
i nous présentons les deux comptes rendus de Thierry Maulnier, l’un de
janvier 1942 et l’autre de novembre 1942, c’est parce qu’ils sont le témoignage d’un
écrivain découvrant une œuvre encore inconnue. Hors de tout contexte universi-
taire, ces lectures de Maulnier traduisent un sentiment fort sur la singularité de l’écriture
de Blanchot. Il exprime, à travers sa sensibilité d’écrivain, la densité d’une écriture à
travers son questionnement sur la manière dont ces deux romans posent explicitement
la question de l’invention du langage : comment se réalise littérairement l’acte de nomi-
nation alors qu’il s’enferme dans sa propre impossibilité.
Maulnier, comme Lévinas, fait partie de ces écrivains qui refusent toute opération de
déplacement dans leur lecture de Blanchot. Il nous montre que la pensée de l’écrivain est
loin de toute vision mystique de la littérature.
Maurice Blanchot – Thomas l’Obscur (Gallimard)
Pour tout écrivain, il existe un problème du langage. J’entends que tout écrivain,
disposant d’un langage qu’il ne peut inventer que dans une certaine mesure, puisque les
291
Blanchot.indb 291 29/11/13 11:56
mots et les règles de leur assemblage lui sont donnés par la langue et la grammaire, et
que pourtant il doit inventer dans une certaine mesure, puisqu’il n’aurait pas de raison
d’écrire s’il ne voulait signifier par la forme qu’il donne à son langage quelque chose qui
soit différent de ce qui a été dit avant lui, se trouve en quelque sorte partagé entre la
nécessité de communiquer avec autrui et la nécessité d’introduire dans un système de
signes commun à tous une signification extraordinairement personnelle et intime. De là
mille recherches et mille artifices pour faire dire à un langage qui appartient à tous ce
dont l’auteur, et l’auteur seul, s’est jusqu’à présent avisé. De là, la nécessité d’utiliser le
langage non comme il est utilisé dans la vie habituelle, c’est-à-dire comme un système
de signes concernant des idées et des objets également présents à la conscience de celui
qui parle et de celui qui écoute, mais comme une clé destinée à ouvrir devant les yeux du
lecteur des parties du monde ou de l’esprit dont, faute d’attention ou de conscience, il ne
s’est pas encore avisé. Ce rôle de l’écrivain, qui est de rendre les yeux du lecteur sensibles
à des couleurs pour lesquelles il était jusque-là aveugle, de lui faire saisir des rapports
entre les choses jusque-là imperceptibles, et d’une façon générale de le faire accéder non
à ce qui lui est étranger – aucun signe ne pourrait évoquer en nous une réalité qui nous
serait parfaitement étrangère –, mais à ce qui se trouve en lui de richesses latentes, à ce
qui se trouve scellé et inapprochable dans ces chambres de notre esprit où ne nous
mènent pas nos préoccupations habituelles, – ce rôle de l’écrivain conduit infailliblement
le poète et le romancier à se forger un langage qui leur soit propre avec le langage de tout
le monde. De là la nécessité d’un style qui soit celui de l’écrivain. De là l’impossibilité de
distinguer le fond et la forme. Il est impossible d’exposer quoi que ce soit qui soit le fruit
d’une recherche personnelle et incomparable dans un langage qui soit, dans toute sa
banalité, le langage de tout le monde : car on ne peut dire avec le langage de tout le
monde que ce que dit le langage de tout le monde.
Le premier roman de M. Maurice Blanchot constitue à n’en pas douter une des
expériences les plus subtiles et les plus audacieuses qui aient été faites depuis longtemps
pour faire dire aux mots plus ou autre chose que ce qu’ils ont coutume de dire dans leur
emploi habituel. Non pas en nous les livrant en quelque sorte à l’état brut, tels que
certains poètes prétendent les jeter devant nous, comme les produits, soi-disant
respectables et révélateurs en eux-mêmes, du délire et du désordre mental, non pas
alignés dans la grise monotonie de ce monologue intérieur, expression extrême d’un
absurde réalisme, qui prétend reconstituer pour nous la vie intérieure dans toute la
complexité du flot de ses phénomènes (comme si chacun de ces phénomènes était
292
Blanchot.indb 292 29/11/13 11:56
nécessairement significatif). M. Maurice Blanchot emploie un langage parfaitement
organisé et intelligible, pesé et calculé dans tous ses termes d’une façon très précise pour
remplir sa fonction littéraire, et sa phrase, bien qu’alourdie parfois par l’abondance des
termes abstraits, atteint souvent à une extrême pureté, à une harmonie classique. Mais
l’effort même et l’extrême tension auxquels il soumet un langage pour atteindre par le
moyen du mot le plus loin possible dans le domaine des mystères qui se refusent
habituellement à la parole, imposent une attention extrême et rebuteront sans doute
beaucoup de lecteurs. Je doute que M. Maurice Blanchot s’en afflige. Je ne pense pas que
cet écrivain, à qui ses chroniques littéraires du Journal des Débats, remarquables non
seulement par une extrême rigueur dans la pensée, mais par ce don de pénétration
poétique sans lequel il n’est pas de critique véritable, ont donné une place toute
particulière parmi les critiques d’aujourd’hui, ait voulu en publiant Thomas l’Obscur se
ranger parmi ceux qui écrivent pour tout le monde.
Le monde dans lequel M. Maurice Blanchot nous entraîne sur les pas de ces étranges
créatures que sont Anne et Thomas n’est pas celui où nous conduisent nos promenades
habituelles. Il serait inexact pourtant de dire qu’il n’est pas réel. Il s’agit seulement d’une
réalité autre que celle dont la vie quotidienne est remplie, de cette réalité plus obscure,
plus redoutable, plus insondable, dont l’esprit entr’aperçoit parfois les profondeurs dans
les interstices du monde connu, et qui jette parfois son ombre ou son éclair furtif sur les
gestes les plus banals, et sur les visages les plus ordinaires le halo fugitif d’une impénétrable
énigme. Il semble que les parois du monde connu soient perméables aux corps de chair
des héros de M. Maurice Blanchot comme les murs le sont aux fantômes ; le chemin
dans lequel ils s’engagent au sortir de leur maison, la rue où ils marchent les mènent en
quelques instants au cœur de l’inconnaissable, dans la nuit où germe la semence des
mondes, dans les abîmes du néant et de la mort. Un mystérieux privilège leur donne un
accès pour ainsi dire habituel à ce qu’on pourrait appeler l’envers du monde, aux lieux
où leur forme même et leur substance se dissolvent dans des songes terribles, se modifient
dans des formes monstrueuses, se fondent dans les poussiers de l’univers, s’abolissent
dans des contemplations qui font songer à l’expérience mystique de la nuit ou à ces
exercices de la méditation orientale qui tendent à la contemplation de l’invisible, à la
coïncidence des contradictions, à la dissolution de l’être dans le non-être, à la négation
universelle où le néant même est nié. La marche et la méditation de l’étrange Thomas
transforment si aisément le monde habituel en un monde plus familier encore pour lui,
familier et épouvantable, de décomposition et de recomposition des substances
293
Blanchot.indb 293 29/11/13 11:56
ordinaires en formes qui n’ont pas de forme, en visages intermédiaires entre l’être et le
non-être, en monstres et en animaux fabuleux, qu’il est à peine possible au lecteur de
savoir si le personnage dont il suit ainsi les explorations saisissantes abandonne alors le
monde de la réalité pour celui du rêve, ou, au contraire, celui des apparences qui
constituent la réalité qui nous suffit habituellement pour la véritable réalité.
Il va sans dire que l’auteur se borne à suivre ses personnages dans leurs explorations et
dans leurs métamorphoses au-delà du monde, et qu’il dédaigne absolument de nous
conter une histoire. Ou du moins l’histoire qu’il nous raconte, la rencontre d’un homme
et d’une femme et leur amour, auquel la mort de la femme met fin, est la plus simple, la
plus schématique, la plus « insignifiante » possible, elle n’est que la trame, la plus lâche
qui soit, qui permet aux actes des personnages de trouver au-delà des ordinaires appa-
rences et des ordinaires existences leurs extraordinaires prolongements entre la réalité et
le rêve, entre la pensée et le néant. Des noms seront prononcés à propos de ce livre sin-
gulier, difficile et saisissant. Celui de Lautréamont, sans doute, à qui M. Maurice Blan-
chot semble avoir emprunté sa technique de l’emploi du langage, pour une
désorganisation, conduite avec une féroce rigueur, de l’ordinaire réalité et la création
d’un monde aux multiples, monstrueuses et somptueuses métamorphoses. Celui de
Giraudoux aussi : beaucoup de pages de M. Maurice Blanchot ressemblent d’une res-
semblance parfois trop grande, à des pages de Jean Giraudoux, par la décomposition de
la réalité à travers le prisme exacte et scintillant de métamorphoses significatives et l’ap-
titude à faire sortir du plus humble des objets et des gestes une sorte de halo divin, la
puissance et le rayonnement même du mythe. Mais bien d’autres noms encore pour-
raient venir à l’esprit du lecteur de Thomas l’Obscur, ceux des romantiques allemands et
de Nerval, ceux de certains surréalistes parfois, ceux aussi des précieux, selon que l’atten-
tion de ce lecteur se porterait sur ces glissements si particuliers de l’œuvre dans l’irréalité
fantastique, sur des floraisons d’images saisissantes, sur la recherche de la rigueur par le
raffinement de l’expression et l’emploi souvent audacieux et heureux, parfois systéma-
tique jusqu’au procédé, du contraste et de l’antithèse. Il suffira toutefois de quelques
citations pour montrer à quel degré de maîtrise l’écrivain est parvenu dans la maîtrise de
ses moyens d’expression : « Avec la nuit un printemps nouveau rajeunissait l’été. Sans
automne, sans hiver la nature remontait à ses sources. Les fleurs, décolorées et flétries,
ayant tout le jour illustré un monde sans odorat, l’inondaient de parfums. La prairie
était verte, prête pour une dernière moisson sous la lune. Le ciel, rongé pendant des
heures par des nuances équivoques, était bleu. Le jardin était rouge. On eût dit qu’avant
294
Blanchot.indb 294 29/11/13 11:56
de mourir le soleil rejetait les combinaisons trop raffinées de teintes et semait toutes les
couleurs principales de son prisme. Son dernier présent à la terre, après la chaleur et la
lumière, c’étaient les couleurs enfantines. Bientôt le monde ne fut plus éclairé que par du
violet, de l’indigo, de l’orangé : la lumière, cadavre étincelant, se décomposait. Puis l’au-
bergiste vit le soleil disparaître ; un peu d’écume jaune marqua au coin de l’horizon la fin
de son apoplexie. Et la terre enfin seule commença à vivre pour elle-même. Une lueur
merveilleuse sortait des buissons, des fourrés, de tout ce qui pendant le jour recélait
l’ombre ; chaque feuille devenait luciole, chaque brin d’herbe ver luisant… Pendant
quelques secondes, la terre défia les catastrophes : elle roula, solitaire et heureuse, dans
un firmament éteint. » Voici une autre page où le monde lui-même paraît se décompo-
ser dans une inexplicable métamorphose : « Des milliers d’hommes, nomades dans leurs
maisons, n’habitant plus nulle part, se répandirent sans quitter leur chambre jusqu’aux
confins du monde. Quelques-uns dont les corps semblaient glacés s’enfoncèrent dans de
profondes crevasses, et, bien qu’ils n’eussent pas quitté la plaine, on eût dit qu’ils se
jetaient dans le sol, murmurant d’une voix monotone des plaintes qu’ils ne percevaient
pas… Ils s’avancèrent dans la terre, entraînant sous leurs pas l’immensité de la matière.
Cependant, alors que l’énorme masse des choses se brisait sous un nuage de cendres, ces
êtres ne pouvaient plus être considérés comme morts. Plusieurs parurent mêlés à des
ébauches de création et on les vit pendant un infime instant devenir des rochers, des
arbres, de la boue. Il semblait que l’univers cherchât à se reformer sur leurs corps dont la
dislocation emplissait l’horizon de perspectives monstrueuses. Ils s’agrégeaient des
montagnes. Ils sortaient du fond des choses et ils s’élevaient comme des planètes rava-
geant par leurs orbes fortuits l’arrangement universel. Corps étincelants ils apparais-
saient sur une immense étendue. Avec leurs mains aveugles ils touchaient les mondes
invisibles qu’ils détruisaient. Des soleils qui ne brillaient plus s’épanouissaient dans leurs
orbites – les restes d’une réalité prodigieuse s’accumulaient dans leur nature anéantie –
la grande journée les embrassait en vain. Thomas avançait toujours. Comme un berger
il conduisait le troupeau des constellations, la marée des hommes étoiles vers la première
nuit. » De telles lignes ne trompent pas. Quelques réserves qu’il soit permis de faire sur
une œuvre d’un accès aussi abrupt que Thomas l’Obscur, elles signifient qu’un véritable
écrivain est apparu.
Thierry Maulnier,
L’Action française, « Causerie littéraire », 28 janvier 1942, p. 1.
295
Blanchot.indb 295 29/11/13 11:56
Maurice Blanchot – Aminadab (Gallimard)
En parlant au lecteur, il y a quelques mois, du premier livre de M. Maurice Blanchot,
ce Thomas l’Obscur, qui était une immobile descente de l’esprit au cœur de la nuit ou se
composent et se décomposent les formes, dans le monde interdit où se dérobent la cau-
salité et l’identité, une sorte d’épreuve de la dissolution de l’être, quelque chose comme
l’expérience qu’un vivant pourrait avoir de la mort, on avait dit ici avec quel intérêt il
fallait attendre le prochain ouvrage d’un auteur si remarquable et si singulier. Cet
ouvrage vient de paraître, et l’on ne s’étonnera pas qu’il nous conduise, tout comme le
premier, en dehors des voies habituellement fréquentées par la littérature.
Thomas l’Obscur se faisait remarquer d’abord par la hautaine indifférence avec laquelle
l’auteur y avait dédaigné tous les moyens par lesquels les romanciers – et ceux-là même
qui nous entraînent au cœur des plus indicibles mystères – éclairent et jalonnent en
général la route qu’ils nous font suivre, et s’était refusé à voiler les présences ou les
absences essentielles avec lesquelles il entreprenait de mettre le lecteur en contact, de
l’habit des apparences familières. Nous étions à l’envers du monde, et à peu près rien de
ce décor somme toute rassurant que le monde offre aux mouvements de notre vie quo-
tidienne n’était plus perceptible. Dans un labyrinthe d’autant plus redoutable que la
complexité même n’y était point immobile, que les nœuds s’y faisaient et s’y défaisaient
sans cesse, et que les monstres n’y étaient que des dénominations et des contours abso-
lument provisoires imposés en quelque sorte contre nature à ce qui n’a par nature ni
nom ni forme, M. Maurice Blanchot nous entraînait en avant non par le fil d’Ariane
d’une chaîne d’événements incorporables à notre expérience habituelle, mais en quelque
sorte par le seul vertige. Aminadab nous est offert sous une apparence extrêmement
différente, et, dans la mesure tout à fait partielle où l’on peut caractériser un art aussi
peu comparable que celui de M. Maurice Blanchot par des affinités ou des ressem-
blances, il semble que dans Aminadab cet art abandonne son lien à Lautréamont pour
un lien à Kafka.
L’écriture même du nouveau livre de M. Maurice Blanchot manifeste fortement ce
changement d’orientation. Elle a perdu cette étonnante richesse poétique, cette somp-
tuosité scintillante, cet éclat d’or et de nuit qui faisait si saisissants certains passages de
Thomas l’Obscur. Il semble que M. Maurice Blanchot ait voulu faire traverser à son style
l’épreuve d’un dépouillement volontaire, le dénuder de son vêtement de métaphores,
l’amener par la voie d’un ascétisme volontaire à un état de fluidité tantôt extrêmement
296
Blanchot.indb 296 29/11/13 11:56
proche et toutefois infiniment différent de la banalité, tantôt découvrant la structure
toute classique d’une phrase presque oratoire avec une majesté imposante, comme si
c’était non plus par des recherches précieuses et d’extrêmes raffinements de l’expression,
mais dans une pauvreté calculée, et dans le langage de tous les jours, que M. Maurice
Blanchot avait voulu cette fois faire apparaître l’inaccessible grandeur des énigmes qu’il
nous invite à affronter, comme si ce que l’univers offre de plus impénétrable à nos
regards et à nos songes ne pouvait nous être livré et dérobé en même temps que par un
langage poussé à la transparence absolue.
Le problème posé à l’attention du lecteur par Aminadab ne consiste donc à aucun
degré dans l’obscurité de ce qu’il est convenu, de façon d’ailleurs inexacte et comme
scolaire, d’appeler la forme, et l’on chercherait en vain dans Aminadab ces assemblages
par eux-mêmes énigmatiques de mots que la littérature hermétique propose à notre
examen comme des messages chiffrés. Avec les mots les plus ordinaires, avec des
événements dans lesquels la part de l’étrangeté est pour ainsi dire réduite au minimum,
M. Maurice Blanchot ne nous entraîne pas seulement dans un univers plus insolite et
plus irrespirable que celui de toutes les histoires extraordinaires ; il nous met encore aux
prises avec cela même qui est le plus rebelle à la connaissance humaine, au point qu’il est
permis de ne voir dans Aminadab que la tragédie transcrite et figurée de cette connaissance
elle-même, de cette course errante éternellement à la suite de l’ombre d’une Toison ou
d’un Graal incessamment dérobés, de cette interrogation obstinée et angoissée à l’adresse
d’un destin qui donne toujours sa réponse à côté de la question.
À cet égard, on peut dire et on dira sans doute que le récit de M. Maurice Blanchot
– puisqu’il s’agit cette fois, à la différence de Thomas l’Obscur, d’un récit véritable, où le
lecteur accompagne le personnage dans une série d’événements enchaînés par une
logique dont l’étrangeté est précisément d’être analogue à la logique ordinaire – est un
récit symbolique. Encore faudrait-il s’entendre sur le mot même de symbole et bien
comprendre que le symbolisme d’Aminadab ne consiste pas dans l’emploi ingénieux ou
brillant de figures destinées à traduire à l’esprit quelque vérité plus ou moins rebelle à
l’expression littérale, mais au contraire dans la tentative d’évoquer, par les actes, les
objets et les mots les plus sévèrement dépouillés de tout appareil poétique et en quelque
sorte les plus pauvres, la richesse et le caractère redoutable de ces énigmes que tout l’ef-
fort humain de l’art et de la connaissance, au cours de nombreux siècles, n’est point
parvenu et ne saurait parvenir à épuiser.
297
Blanchot.indb 297 29/11/13 11:56
Thomas – car c’est Thomas que nous retrouvons dans Aminadab – pénètre dans une
maison singulière, dont la porte, fait remarquable, est munie d’une sorte de judas dont
la manœuvre bloque automatiquement la porte elle-même, de sorte que celui qui
cherche à contempler ce qui se passe à l’intérieur de la maison se condamne en quelque
sorte, pendant le temps au moins de sa contemplation, à ne point y avoir accès. Une fois
dans la maison, Thomas n’a plus d’autre souci que l’exploration de cette maison
singulière où un certain nombre de locataires, attachés à la maison par l’espoir d’y
atteindre une vérité essentielle et indiscernable, vivent dans une réclusion qui, bien que
volontairement acceptée et en quelque sorte chérie, n’en a pas moins tous les caractères
extérieurs de la misère et de la captivité. Mais un mystère de cette existence elle-même,
mystère accru encore par la présence de serviteurs en qui se confondent les signes de la
servilité et d’une autorité considérable, du zèle, et d’une négligence ou d’une maladresse
incurables, se trouve compliqué par un autre mystère. L’existence des habitants de la
maison n’est pas seulement bornée par les murs entre lesquels ils sont désormais voués
à oublier leur vie intérieure, mais encore par la double énigme des sous-sols et surtout
des étages supérieurs, étages non point murés, mais cependant impénétrables, défendus
contre tout accès des « locataires » par une loi si mystérieuse et si forte que nul ne songe
à la transgresser, et que les seuls téméraires qui s’y soient risqués une fois en ont reçu la
punition sous la forme d’un châtiment d’autant plus horrible qu’ils en étaient pour ainsi
dire les seuls auteurs d’un acte de démence collective qui les a menés droit à leur perte.
La maison elle-même est d’ailleurs régie par une autorité toute puissante, mais d’autant
plus inaccessible qu’elle ne réside en aucune personne, par un livre de règlements
d’autant plus respectés que dans leur forme exacte ils paraissent n’avoir jamais été
connus, puisque le livre dans lequel ils sont enfermés n’a jamais été consulté par
personne. Une fois entré dans cette maison semée de toutes parts de pièges d’autant plus
terrifiants qu’ils ne comportent aucun des caractères capables de susciter l’effroi, de
défenses d’autant plus impérieuses que nulle sanction visible ne frappe celui qui les
brave, de portes d’autant mieux interdites qu’elles sont ouvertes sans résistance à celui
qui les heurte, et de gardiens d’autant plus muets qu’ils répondent avec une bonne
volonté évidente à toutes les questions qu’on leur pose, Thomas y entreprend une
exploration lente et pénible, dont le but est d’atteindre les étages supérieurs et d’en
pénétrer le mystère. La maison où il circule librement – encore qu’il soit lié par une
chaîne à un prisonnier dont il a partagé la chambre et qui le suit comme un double muet
et maladroit –, déroule autour de lui ses puissantes fantasmagories. Les habitants
298
Blanchot.indb 298 29/11/13 11:56
répondent à ses questions, mais l’univers où nous conduit M. Maurice Blanchot est
comparable à cet univers du rêve, où il n’est répondu aux questions que par d’autres
questions ou par le silence, où des gestes restent suspendus et inachevés, où des visages
vieillissent et se décomposent en un instant, où l’explication fournie sur un détail
mystérieux, encore qu’en elle-même parfaitement claire et pour ainsi dire impeccable,
ne fait que jeter sur le problème principal une obscurité plus profonde. Thomas avance
donc peu à peu dans cette maison à plus d’un égard comparable au Château de Kafka ; il
atteint les étages supérieurs au-delà de l’interdiction invisible ; il y trouve une jeune fille
qu’il cherchait, et cette jeune fille l’attendait. Mais cette jeune fille est-elle celle qu’il
cherchait ? Est-il celui qu’elle attendait ? Les étages supérieurs de la maison sont
maintenant connus, mais ils n’ont livré ni la clé du mystère, ni même la nature du
mystère, et le succès de Thomas est un échec ; peut-être est-ce du côté des sous-sols qu’il
eût fallu chercher. Mais chercher quoi ? Ce n’est pas seulement la solution de l’énigme
qui le dérobe éternellement : c’est l’énigme elle-même, et la maison d’Aminadab est
insondable comme le mal et le monde.
Thierry Maulnier,
L’Action française, « Causerie littéraire », 26 novembre 1942, p. 1.
Blanchot.indb 299 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 300 29/11/13 11:56
Biographie des auteurs
Renato Boccali
Maître de conférence à l’université IULM de Milan où il enseigne l’Esthétique. Il est le coordina-
teur de la Chaire UNESCO-IULM « Cultural and Comparative Studies on Imaginary ». Ses
recherches portent essentiellement sur la phénoménologie et l’herméneutique, les théories et les
pratiques de l’image, le rapport entre littérature et philosophie. Il est l’auteur de plusieurs études
sur Merleau-Ponty, Lévinas, Ricœur, Blanchot, Derrida. Parmi ses publications : L'Eco-logia del
visibile: Merleau-Ponty teorico dell'immanenza trascendentale [L’Éco-logie du visible. Merleau-
Ponty théoricien de l’immanence transcendantale], Milan, Mimesis, 2011 ; Le Frontiere dell'alterità
[Les frontières de l’altérité. Imaginaires du proche, de l’étranger et de l’exotique], avec P. Proietti,
Palerme, Sellerio, 2009 ; La Narrazione come traccia: percorsi e forme del raccontare attraverso lo
sguardo del Novecento [La Narration comme trace. Parcours et formes du récit au xxe siècle], avec
A. Fioravanti, G. Saccoccio, Rome, EDUP, 2002.
François Brémondy
Professeur de philosophie, François Brémondy a publié quelques articles sur Maurice Blanchot :
« Lévinas, Blanchot et la Bible », in Emmanuel Lévinas, Maurice Blanchot, penser la différence,
Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2007 ; « Pascal fut-il un penseur dialectique ? » in
Maurice Blanchot et la philosophie, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2010 ; « Naïf
301
Blanchot.indb 301 29/11/13 11:56
examen de quelques paradoxes de Maurice Blanchot sur la littérature et la pensée », Lignes, 2012.
Il a d’autre part publié plusieurs études sur Pascal : « Le Plan retrouvé », Concepts n° 1, 1999,
« Apologie de l’édition Kaplan des Pensées », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 2009,
« L’Effroi de Pascal », Contre Attaques n° 2, 2010 ; sur la philosophie de Raymond Ruyer : « Ruyer
critique de Bergson », in Bergson et les neurosciences, 1997, « Ruyer et la physique quantique », Les
Études philosophiques, 2007, etc. et un Bestiaire de Friedrich Nietzsche (Sils Maria, 2011).
Anca Calin
Enseignant-chercheur à l’Université Dunarea de Jos de Galati, Roumanie, Anca Calin s’intéresse
aux questions liées à l’acte de nomination à partir de l’œuvre de Maurice Blanchot. Elle a soutenu
sa thèse de philosophie et de littérature, intitulée La question de la nomination dans l'œuvre de
Maurice Blanchot, université Paris Ouest Nanterre La Défense et l’université Dunarea de Jos de
Galati. Elle a publié plusieurs articles portant sur la question l’acte de nomination à partir du
dispositif lecteur/texte/auteur. « L’acte de création comme mouvement de déformation », Défor-
mer le réel, Cahiers ERTA n° 3, Institut de Philologie Romane, université de Gdansk, Pologne,
2013 ; « La chorégraphie du langage littéraire », revue Mélanges francophones no 7 (Une écri-
ture… l’absente de toute lecture ?), Presses Universitaires de Galati, 2012 ; « Éléments pour une
analyse critique de certaines notions-clés des théories littéraires », Lexique commun/Lexique
spécialisé, Galati, Europlus, 2010 ; « Une lecture critique de la figure du lecteur », Communica-
tion interculturelle et littérature, n° 2, Galati, Europlus, 2010.
Arthur Cools
Arthur Cools enseigne la philosophie contemporaine, la philosophie de l'art et la philosophie de la
littérature au Département de Philosophie à l'Université d'Anvers. Il est membre du comité de
rédaction de la collection « Résonances de Maurice Blanchot ». Il est l'auteur de Langage et
subjectivité. Vers une approche du différend entre Maurice Blanchot et Emmanuel Lévinas, Louvain,
Peeters, 2007. Récemment, il a (co-)édité The Locus of Tragedy, Boston, Brill, 2008 ; Maurice Blanchot.
De stem en het schrift. Drie opstellen over de esthetische distantie in de vertelling, het humanisme en de
toekomst van de boekcultuur, Zoetermeer, Klement ; Kalmthout, Pelckmans, 2012 et Metaphors in
Modern and Contemporary Philosophy, Bruxelles, University Press Antwerp, 2013.
Maxime Decout
Maître de conférences à l’université Lille 3 Charles de Gaulle. Il est l’auteur d’Albert Cohen : les
fictions de la judéité, Paris, Classiques-Garnier, 2011 et a dirigé le numéro d’Europe consacré en
janvier 2012 à Georges Perec. Son travail porte sur les rapports entre littérature et judéité. Il a
publié plusieurs articles sur Albert Cohen (Poétique, Les Temps modernes, Études littéraires, Gene-
sis…), Georges Perec (Europe, Poétique, Roman 20-50, Littérature, Études littéraires, Genesis…),
Hélène Cixous (Critique) et Patrick Modiano (Littérature).
302
Blanchot.indb 302 29/11/13 11:56
Hugues Choplin
Docteur en philosophie (Paris Ouest), ingénieur de Télécom ParisTech, Hugues Choplin est
enseignant-chercheur à l'université de technologie de Compiègne. Il a consacré plusieurs
ouvrages à la problématisation de la pensée française contemporaine (Levinas, Laruelle, Blanchot,
Deleuze, Badiou) dont L'Espace de la pensée française contemporaine. À partir de Levinas et de
Laruelle, Paris, L'Harmattan, 2007, L'Ingénieur contemporain, le Philosophe et le Scientifique, Paris,
Encre marine, « À présent », 2013, et Chercher en silence avec Maurice Blanchot. À partir de la
pensée française contemporaine, Paris, L'Harmattan, 2013, à paraître.
Claudine Hunault
Metteur en scène de théâtre et d’opéra, actrice et écrivain. Elle donne de nombreuses formations
sur la présence scénique et le rapport du chant à la parole à des chanteurs et des acteurs. Dernière
publication : Des choses absolument folles, Bruxelles, EME, 2012.
Slimane Lamnaoui
Professeur habilité de littérature française à l’université de Fès au Maroc. Il est l'auteur de nom-
breux articles sur la littérature française et la littérature arabe classique. Derniers ouvrages
publiés : « La traduction de l’éros arabe entre thème et version, corps culturel et corps textuel » in
Traduire le texte érotique, Presses de l’université de Québec, Figura, « Figura », 2013, et La Céré-
monie du papier (recueil de poésie), Paris, Les Éditions du Panthéon, 2011.
Pierre Madaule
Écrivain, auteur de Maurice Blanchot-Pierre Madaule, correspondance (1953-2002), Paris,
Gallimard, 2012, Une tâche sérieuse, Paris, Gallimard, 1973.
Geoffroy Martinache
Maître de Conférences à l’université catholique de Lille. Il a publié plusieurs articles en esthétique
sur Rodin, Blanchot ou Derrida. Ses recherches portent actuellement sur l'ontologie plastique et
sur le devenir en peinture ou en littérature.
Alain Milon
Professeur de philosophie des universités, Université de Paris Ouest Nanterre. Derniers ouvrages
publiés : Philosophie de l’écologie : le plan de nature, Belval, Circé, 2014 ; Cartes incertaines. Regard
critique sur l'espace, Paris, Encre marine, 2013 ; La Fêlure du cri : violence et écriture, Paris, Encre
marine, 2010 ; Bacon, l’effroyable viande, Paris, Encre marine, 2008 ; L’Écriture de soi : ce lointain
intérieur, Paris, Encre marine, 2005 ; La Réalité virtuelle. Avec ou sans le corps, Paris, Autrement,
2005 ; Contours de lumière : les territoires éclatés de Rozelaar Green, Draeger, 2002 ; L'Art de la
303
Blanchot.indb 303 29/11/13 11:56
Conversation, Paris, PUF, « Perspectives critiques », 1999 ; L'Étranger dans la Ville. Du rap au graff
mural, Paris, PUF, « Sociologie d'aujourd'hui », 1999 ; La Valeur de l'information : entre dette et
don, Paris, PUF, « Sociologie d'aujourd'hui », 1999. Direction d’ouvrages collectifs : Artaud autour
de Suppôts et Suppliciations, (dir. Alain Milon et Ricard Ripoll), Nanterre, Presses universitaires
de Paris Ouest, 2013 ; Le Livre au corps, (dir. A. Milon et M. Perelman), Nanterre, Presses univer-
sitaires de Paris Ouest, 2012 ; Maurice Blanchot et la philosophie, (dir. E. Hoppenot et A. Milon),
Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2010 ; Levinas-Blanchot : penser la différence, Paris,
coédition Unesco – Presses universitaires de Paris Ouest, (dir. E. Hoppenot et A. Milon), 2e édi-
tion 2009 ; L’Esthétique du livre (dir. A. Milon et M. Perelman), Nanterre, Presses universitaires de
Paris Ouest, 2010 ; Dictionnaire du corps, Paris, PUF, 2007 ; Le Livre et ses espaces (dir. A. Milon et
M. Perelman), Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2007.
Gary D. Mole
Professeur et ancien directeur du département de français à l'université Bar-Ilan en Israël. Il est
l'auteur notamment d’ouvrages sur Levinas, Blanchot et Jabès, sur la poésie française de la dépor-
tation, et de nombreuses études sur divers aspects de la littérature française et francophone. Il
s'intéresse particulièrement aux rapports entre la littérature et la guerre : la Shoah, la déportation,
la poésie de la Grande Guerre, la violence et le génocide dans la fiction francophone postcoloniale
de l'Afrique subsaharienne. Il est membre du comité éditorial de la collection « Résonances de
Maurice Blanchot », du comité consultatif de Yod : Revue des études hébraïques et juives, et lecteur
pour Dalhousie French Studies (Canada).
Antoine Philippe
Docteur en littérature française de l’université de Californie à Irvine. Il est actuellement Profes-
seur associé à l’université de Porto Rico, où il enseigne la littérature française et comparée, le
cinéma et la théorie littéraire. Il a publié plusieurs articles sur le cinéma et sur Maurice Blanchot,
en particulier : « Le Complexe d’Orphée, une lecture de Thomas l’obscur de Maurice Blanchot »,
Contre-attaques 1 (Janvier-Juin 2009). Il est en train de terminer une monographie qui porte sur
La Folie du jour, L’Arrêt de mort et Le Très-Haut.
Caroline Sheaffer-Jones
Caroline Sheaffer-Jones enseigne la littérature française à l’université de Nouvelle-Galles du Sud
à Sydney, en Australie. Elle a publié des textes sur divers aspects des écrits de Blanchot, ainsi que
sur Camus, Derrida et Sarah Kofman, notamment « As Though with a New Beginning: Le dernier
homme », in Clandestine Encounters: Philosophy in the Narratives of Maurice Blanchot, Hart Kevin
(dir.), University of Notre Dame Press, Notre Dame, IND. 2010, p. 241-262 ; in « Tableau Before
the Law: Albert Camus’ The Fall After Deconstruction », in Derrida Today, vol. 6, n° 1, mai 2013,
p. 115-134.
304
Blanchot.indb 304 29/11/13 11:56
Stéphanie Tsai
Professeur de littérature française à l'Université nationale centrale de Taiwan. Elle est spécialiste
de la théorie française et travaille autour des questions de la modernité et de la subjectivation :
L'épreuve de la modernité, Taipei, Kuang Tang 2009. Elle travaille la notion d’écriture et de nature
à partir des textes de Blanchot et de Zola. Elle a été nommée Fellow chercheuse à la Société des
Sciences Humaines à l'université de Cornell, États-Unis en 2009-2010, et a été professeure invitée
à l'université Lyon III en 2010-2011.
Tomasz Swoboda
Tomasz Swoboda enseigne la littérature, la traduction et l’anthropologie du spectacle à l’univer-
sité de Gdańsk et à l’université de Szczecin. Auteur d’une thèse de doctorat consacrée au roman
décadent et d’une thèse d’habilitation sur Bataille, Leiris, Artaud et Blanchot. Traducteur en
polonais de Nerval, Barthes, Bataille, Caillois, Ricœur, Poulet, Richard, Vovelle et Le Corbusier.
Blanchot.indb 305 29/11/13 11:56
Blanchot.indb 306 29/11/13 11:56
sous la direction
L e 14 septembre 2011, dans l’émission de Laure Adler Hors d’Alain Milon dans la même collection :
champ sur France Culture, Jean-Luc Godard tenait les propos
suivants : « Question : Expliquez-nous la différence entre du Emmanuel Lévinas-Maurice Blanchot :
cinéma vrai et des films, faire des films. Réponse : Les films on penser la différence
sous la direction
d’Alain Milon
peut les voir, le cinéma on ne peut pas le voir. On peut juste voir Maurice Blanchot et la philosophie
ce qu’on ne peut pas voir… de l’inconnu ou des choses comme
cela… Question : C’est cela que vous tentez de faire ? approcher
de l’invisible… Réponse : Ce qu’on fait naturellement, ce que font
beaucoup d’écrivains à leur manière. Quand j’étais adolescent, l’un
des premiers livres qui m’avaient touché, c’est un livre de Maurice
Maurice Blanchot
Blanchot… je ne connaissais rien à la philosophie et à toute cette
école… c’était un livre qui s’appelait Thomas l’Obscur… voilà
c’est Thomas l’Obscur… »
entre roman et récit
Le 28 janvier 1942, à la sortie de Thomas l’Obscur, Thierry
Maulnier faisait le commentaire suivant dans sa chronique
littéraire : « Le premier roman de M. Maurice Blanchot constitue
à n’en pas douter une des expériences les plus subtiles et les plus
audacieuses qui aient été faites depuis longtemps pour faire dire
entre roman et récit
aux mots plus ou autre chose que ce qu’ils ont coutume de dire
dans leur emploi habituel. »
Maurice Blanchot
Deux témoignages différents mais la même intuition sur un
auteur à part qui a marqué toute une génération d’écrivains.
L’intention de cet ouvrage collectif sur les romans et récits de
Maurice Blanchot est justement de creuser cet informulé dans
Photo de couverture © Anne-Lise Large
le connu du mot, autrement dit la manière dont l’écriture de
Blanchot pose la question de l’invention du langage à travers l’acte
de nomination : comprendre le combat que livre Thomas avec,
pour ou contre le mot.
23 €
www.pressesparisouest.fr isbn : 978-2-84016-173-8
presses universitaires de paris ouest presses universitaires de paris ouest
CouvBlanchotRoman.indd 1 29/11/13 11:46
sous la direction
L e 14 septembre 2011, dans l’émission de Laure Adler Hors d’Alain Milon dans la même collection :
champ sur France Culture, Jean-Luc Godard tenait les propos
suivants : « Question : Expliquez-nous la différence entre du Emmanuel Lévinas-Maurice Blanchot :
cinéma vrai et des films, faire des films. Réponse : Les films on penser la différence
sous la direction
d’Alain Milon
peut les voir, le cinéma on ne peut pas le voir. On peut juste voir Maurice Blanchot et la philosophie
ce qu’on ne peut pas voir… de l’inconnu ou des choses comme
cela… Question : C’est cela que vous tentez de faire ? approcher
de l’invisible… Réponse : Ce qu’on fait naturellement, ce que font
beaucoup d’écrivains à leur manière. Quand j’étais adolescent, l’un
des premiers livres qui m’avaient touché, c’est un livre de Maurice
Maurice Blanchot
Blanchot… je ne connaissais rien à la philosophie et à toute cette
école… c’était un livre qui s’appelait Thomas l’Obscur… voilà
c’est Thomas l’Obscur… »
entre roman et récit
Le 28 janvier 1942, à la sortie de Thomas l’Obscur, Thierry
Maulnier faisait le commentaire suivant dans sa chronique
littéraire : « Le premier roman de M. Maurice Blanchot constitue
à n’en pas douter une des expériences les plus subtiles et les plus
audacieuses qui aient été faites depuis longtemps pour faire dire
entre roman et récit
aux mots plus ou autre chose que ce qu’ils ont coutume de dire
dans leur emploi habituel. »
Maurice Blanchot
Deux témoignages différents mais la même intuition sur un
auteur à part qui a marqué toute une génération d’écrivains.
L’intention de cet ouvrage collectif sur les romans et récits de
Maurice Blanchot est justement de creuser cet informulé dans
Photo de couverture © Anne-Lise Large
le connu du mot, autrement dit la manière dont l’écriture de
Blanchot pose la question de l’invention du langage à travers l’acte
de nomination : comprendre le combat que livre Thomas avec,
pour ou contre le mot.
23 €
www.pressesparisouest.fr isbn : 978-2-84016-173-8
presses universitaires de paris ouest presses universitaires de paris ouest
CouvBlanchotRoman.indd 1 29/11/13 11:46
Vous aimerez peut-être aussi
- Mes années Malraux: Biographie et galerie de portraitsD'EverandMes années Malraux: Biographie et galerie de portraitsPas encore d'évaluation
- Les Enquêtes de Maigret, de Georges Simenon: Lecture des textesD'EverandLes Enquêtes de Maigret, de Georges Simenon: Lecture des textesPas encore d'évaluation
- Michel "Houellebecq", Exemple Parfait de La Soumission Au "Politiquement Correct"?Document9 pagesMichel "Houellebecq", Exemple Parfait de La Soumission Au "Politiquement Correct"?Yvette DiazPas encore d'évaluation
- La Phrase de ProustDocument3 pagesLa Phrase de ProustBabette HersantPas encore d'évaluation
- NANCY, Jean-Luc_La Communauté DésavouéeDocument82 pagesNANCY, Jean-Luc_La Communauté DésavouéeLuis Felipe AbreuPas encore d'évaluation
- Pages de Int 4entretienDocument19 pagesPages de Int 4entretiennathalie.kaersoel1979Pas encore d'évaluation
- Merleau Ponty SignesDocument343 pagesMerleau Ponty SignesPawel Gajdek100% (6)
- TFETFETFEDocument50 pagesTFETFETFEFrançois HeusePas encore d'évaluation
- Nancy La Communauté Desavouée PDFDocument173 pagesNancy La Communauté Desavouée PDFJuan José Martínez OlguínPas encore d'évaluation
- Carnet de LectureDocument3 pagesCarnet de LectureJujuPas encore d'évaluation
- Thèse Boukelou PDFDocument207 pagesThèse Boukelou PDFCélia MaloumPas encore d'évaluation
- Malraux Camus SartreDocument154 pagesMalraux Camus SartreHandala Mohamed100% (2)
- Corpus ConformismeDocument5 pagesCorpus Conformismestanic jeremyPas encore d'évaluation
- Citations Roman M. DIONG LMCMBDocument6 pagesCitations Roman M. DIONG LMCMBamethk554Pas encore d'évaluation
- Ens 20 0497Document83 pagesEns 20 0497philomenederassem1Pas encore d'évaluation
- Le Fils DU PauvreDocument65 pagesLe Fils DU PauvreHope WilliamPas encore d'évaluation
- Jean-Claude Michéa - ConversationDocument13 pagesJean-Claude Michéa - ConversationSherlock DestinyPas encore d'évaluation
- BlanchotDocument34 pagesBlanchotchantal tcheterianPas encore d'évaluation
- Valentine Barbero - L'ethopée Satirique Dans Le Misanthrope de MolièreDocument52 pagesValentine Barbero - L'ethopée Satirique Dans Le Misanthrope de MolièrelionelPas encore d'évaluation
- Corrigé Parcours 2ndeDocument15 pagesCorrigé Parcours 2ndeMonsieur JesaistoutPas encore d'évaluation
- Genie Me ConnuDocument340 pagesGenie Me ConnuJean-Charles SavardPas encore d'évaluation
- Bataille-dette-1Document9 pagesBataille-dette-1poseduPas encore d'évaluation
- D'Adorno À Rosa - Les Six de FrancfortDocument4 pagesD'Adorno À Rosa - Les Six de FrancfortAhmed KabilPas encore d'évaluation
- Ionesco Notes Et Contre-NotesDocument2 pagesIonesco Notes Et Contre-NotesTommaso SabatiniPas encore d'évaluation
- Roman 0048-8593 1999 Num 29 104 3421Document3 pagesRoman 0048-8593 1999 Num 29 104 3421BlagojePas encore d'évaluation
- L'Archive D'un Coup de DésDocument941 pagesL'Archive D'un Coup de DésAlexander CaroPas encore d'évaluation
- 9782259290081Document24 pages9782259290081Michel-françois Le HellocoPas encore d'évaluation
- Joachim Du Bellay, Je Me Ferai Savant en La PhiDocument7 pagesJoachim Du Bellay, Je Me Ferai Savant en La PhiTutoriels of PicturesPas encore d'évaluation
- La Nausée — WikipédiaDocument1 pageLa Nausée — Wikipédiargzgxfgnp5Pas encore d'évaluation
- LEFEBVRE, Henri. Justice Et VéritéDocument29 pagesLEFEBVRE, Henri. Justice Et VéritéCláudio SmalleyPas encore d'évaluation
- Prose Du MondeDocument159 pagesProse Du Mondekantikors100% (1)
- Utcl Broch Manifeste Communisme Libertaire 1985Document63 pagesUtcl Broch Manifeste Communisme Libertaire 1985Διάδοση ΑγώνωνPas encore d'évaluation
- BlaDocument555 pagesBlaMelissa Faria Santos100% (1)
- DjanfarMourdi FR M1 10Document93 pagesDjanfarMourdi FR M1 10Hamza٨٣٩٣Pas encore d'évaluation
- Texte Jean-Francois Lyotard - Copie v2Document15 pagesTexte Jean-Francois Lyotard - Copie v2yaminaboussahela5Pas encore d'évaluation
- BONNEFOY, Yves. Lever Les Yeux de Son LivreDocument22 pagesBONNEFOY, Yves. Lever Les Yeux de Son LivreCandice CarvalhoPas encore d'évaluation
- BLUM Bergounioux PDFDocument79 pagesBLUM Bergounioux PDFoliv2gPas encore d'évaluation
- Jacques Bouveresse, L'abîme Des Lieux CommunsDocument14 pagesJacques Bouveresse, L'abîme Des Lieux CommunsE2284337253Pas encore d'évaluation
- AL06P87Document6 pagesAL06P87Sarah TshibandaPas encore d'évaluation
- 029 Dany Robert Dufour Les Soubassements Philosophiques Du Liberalisme 3 Sur 3Document6 pages029 Dany Robert Dufour Les Soubassements Philosophiques Du Liberalisme 3 Sur 3picondidierPas encore d'évaluation
- Mon Mémoire Fin. - 2Document73 pagesMon Mémoire Fin. - 2Fares ManiaPas encore d'évaluation
- Formulations Pour Le Commentaire Et Autres Travaux D'Analyse XXX Aménager Publication XXXDocument15 pagesFormulations Pour Le Commentaire Et Autres Travaux D'Analyse XXX Aménager Publication XXXBouchahda AmalPas encore d'évaluation
- These Gisele Leyicka BissangaDocument512 pagesThese Gisele Leyicka BissangaMoussa Abou DansokhoPas encore d'évaluation
- Patrick Modiano Écrivain de L'angoisseDocument106 pagesPatrick Modiano Écrivain de L'angoisseSondes BenAliPas encore d'évaluation
- Cours N° 3 L'après NaturalismeDocument4 pagesCours N° 3 L'après Naturalismemercibeaucoup7044Pas encore d'évaluation
- Séance DécouverteDocument28 pagesSéance DécouverteErza ScarlettPas encore d'évaluation
- Emmanuel Mounier: BiographieDocument1 pageEmmanuel Mounier: BiographieMarcus HKPas encore d'évaluation
- Entretien Avec Lewis MumfordDocument11 pagesEntretien Avec Lewis MumforduPas encore d'évaluation
- Livret 2017Document37 pagesLivret 2017Christophe MeunierPas encore d'évaluation
- Let RangerDocument39 pagesLet RangerАня ТыжневаяPas encore d'évaluation
- Socialisme Fasciste (1934)Document5 pagesSocialisme Fasciste (1934)Саша ПаповићPas encore d'évaluation
- Tragique Et Personnages Dans Partir de Tahar Ben JellounDocument90 pagesTragique Et Personnages Dans Partir de Tahar Ben JellounPerle BleuePas encore d'évaluation
- SartreDocument88 pagesSartreDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Lecture Cursive 2Document6 pagesLecture Cursive 2CléoPas encore d'évaluation
- Vendredi ou la Vie sauvage de Michel Tournier (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)D'EverandVendredi ou la Vie sauvage de Michel Tournier (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)Pas encore d'évaluation
- Écritures er réécritures dans l'oeuvre de François TruffautD'EverandÉcritures er réécritures dans l'oeuvre de François TruffautPas encore d'évaluation
- Qu'est-ce que la littérature ? de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandQu'est-ce que la littérature ? de Jean-Paul Sartre: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Prétextes: Réflexions sur quelques points de littérature et de moraleD'EverandPrétextes: Réflexions sur quelques points de littérature et de moralePas encore d'évaluation
- La Nausée de Jean-Paul Sartre (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandLa Nausée de Jean-Paul Sartre (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- La Nouvelle Vague: Les Dossiers d'UniversalisD'EverandLa Nouvelle Vague: Les Dossiers d'UniversalisPas encore d'évaluation
- LIVRE-REVUE-ROMAN 20-50-Jules RomainsDocument157 pagesLIVRE-REVUE-ROMAN 20-50-Jules Romainssdoreau001Pas encore d'évaluation
- LIVRE-REVUE-CRITIQUE N. 901-Porter La ModeDocument171 pagesLIVRE-REVUE-CRITIQUE N. 901-Porter La Modesdoreau001Pas encore d'évaluation
- LIVRE-REVUE-CRITIQUE 2004:10 (N. 689) - de Leiris À Derrida: Règles Du "Je"Document94 pagesLIVRE-REVUE-CRITIQUE 2004:10 (N. 689) - de Leiris À Derrida: Règles Du "Je"sdoreau001Pas encore d'évaluation
- LIVRE-REVUE-LITTÉRATURE-nº 52-Georges BatailleDocument137 pagesLIVRE-REVUE-LITTÉRATURE-nº 52-Georges Bataillesdoreau001Pas encore d'évaluation
- LIVRE-AMADEO LÓPEZ Ed-Figures de La Violence Dans La Littérature de Langue EspagnoleDocument228 pagesLIVRE-AMADEO LÓPEZ Ed-Figures de La Violence Dans La Littérature de Langue Espagnolesdoreau001Pas encore d'évaluation
- La MusiqueDocument8 pagesLa Musiquevodes aristidePas encore d'évaluation
- Henri PousseurDocument5 pagesHenri PousseurasimPas encore d'évaluation
- 1creation de Diagrammes GeochimiquesDocument2 pages1creation de Diagrammes GeochimiquesSoltani AkRêmPas encore d'évaluation
- Le Sentiment de Vide Intérieur Être Présent À Soi-MêmeDocument138 pagesLe Sentiment de Vide Intérieur Être Présent À Soi-Mêmeقناتك الجزائرية100% (1)
- Ueo 3 Theme VersionDocument8 pagesUeo 3 Theme Versionsarah971100% (2)
- Crack WEPDocument5 pagesCrack WEPBadr GrayMan HakkariPas encore d'évaluation
- PAT ChefchaouenDocument46 pagesPAT Chefchaouensami87100% (1)
- 1 - Index de BarthelDocument1 page1 - Index de Barthelmoa SanPas encore d'évaluation
- Raccourcisclavierwindows PDFDocument2 pagesRaccourcisclavierwindows PDFhassnae100% (6)
- Fiche D'exercices #1Document1 pageFiche D'exercices #1Emilia Lages0% (1)
- Moulin de LaunoyDocument5 pagesMoulin de LaunoyJohan Calaii RagotPas encore d'évaluation
- Madame Bovary Oral FRDocument2 pagesMadame Bovary Oral FRJulien KrcPas encore d'évaluation
- MagieDocument41 pagesMagieleefalkPas encore d'évaluation
- Oncf-Voyages-Mouhssine MokhfiDocument1 pageOncf-Voyages-Mouhssine MokhfimmokhfiPas encore d'évaluation
- Memento EclipseDocument2 pagesMemento EclipseNicolas MacéPas encore d'évaluation
- PointsDocument34 pagesPointsLaurent SuissePas encore d'évaluation
- Brochure Visiteur Chateau de ChantillyDocument9 pagesBrochure Visiteur Chateau de ChantillyPLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- Aklunon Gbènon-1Document1 pageAklunon Gbènon-1Djigbenou OswaldPas encore d'évaluation
- Surnombre - Jeu CombinéDocument1 pageSurnombre - Jeu CombinéJulien Munoz100% (1)
- Thème Formation Des Enseignants Et Organisation Du Travail Des ÉlèvesDocument4 pagesThème Formation Des Enseignants Et Organisation Du Travail Des ÉlèvesAmaury GagelinPas encore d'évaluation
- Noel Cest LamourDocument5 pagesNoel Cest LamourEMILIOPas encore d'évaluation
- CCTP Panneaux Signalisation Routière Verticale - 1Document9 pagesCCTP Panneaux Signalisation Routière Verticale - 1bel lanaPas encore d'évaluation
- Pase Pronominal EsDocument1 pagePase Pronominal EsacademiasunPas encore d'évaluation
- VMWARE WORKSTATION PRO - Initiation À La VirtualisationDocument71 pagesVMWARE WORKSTATION PRO - Initiation À La VirtualisationPolovsky MG GodenPas encore d'évaluation
- Aikido Mag 0706Document24 pagesAikido Mag 0706Mahieddine MokhtariPas encore d'évaluation
- Presentation Hiyel AfricaDocument17 pagesPresentation Hiyel AfricaHenri-Mill FETCHOUANGPas encore d'évaluation
- Hac HDBW1400R Z PDFDocument3 pagesHac HDBW1400R Z PDFحامل المسكPas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document76 pagesChapitre 3Goran Person DongmoPas encore d'évaluation
- Encvip LotoDocument32 pagesEncvip LotoJean-Michel GaudionPas encore d'évaluation
- French 4ap19 3trim1Document2 pagesFrench 4ap19 3trim1Mansour ContentPas encore d'évaluation