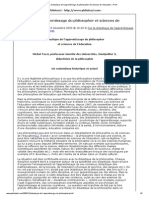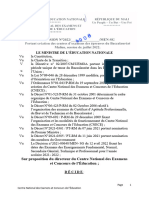Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Difficultés Et Curiosité Sans Notes Ni Italiques
Transféré par
Vincent CitotCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Difficultés Et Curiosité Sans Notes Ni Italiques
Transféré par
Vincent CitotDroits d'auteur :
Formats disponibles
DIFFICULTÉS ET CURIOSITÉS DE L’ENSEIGNEMENT
DE LA PHILOSOPHIE EN FRANCE
Vincent CITOT
ÉSPÉ de Paris
AMBIGUÏTÉS ET PARADOXES DE L’ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE EN GÉNÉRAL
Puisqu’il s’agit ici de s’interroger sur l’enseignement de la philosophie, autant se
mettre d’accord préalablement sur ce qu’est la philosophie. En effet, comment enseigner
quelque chose dont on ignorerait la nature ? Mais une difficulté surgit immédiatement :
il y a presque autant de définitions de la philosophie que de philosophes. On peut la
contourner en s’entendant sur le fait que la philosophie est une certaine façon de penser
plutôt qu’une science particulière experte de tel ou tel secteur du réel. La philosophie
n’est pas « quelque chose » que l’on pourrait enseigner au sens où l’on transmet un
contenu cognitif. Les philosophes ne s’entendent guère sur la nature et la spécificité de
la pensée philosophique, mais ils conviennent généralement que la philosophie est avant
tout un mode de réflexion, que l’enseignant cherche à susciter chez l’enseigné (élèves
ou étudiants). Certes, un professeur de mathématique, de physique ou d’histoire
pourrait dire aussi bien qu’il enseigne une certaine façon de penser. Mais ces diverses
méthodes doivent mener à un résultat qui s’appelle le savoir. Et même si ce dernier est
perfectible, approximatif, relatif et historique, il n’y a pas autant de théories scientifiques
qu’il y a de scientifiques – la science en serait ruinée. La philosophie s’accommode mieux
du pluralisme doctrinal – ce qui a des conséquences sur les modalités de son ensei-
gnement. Le professeur de philosophie transmet moins un savoir ou une méthode par-
ticulière d’acquisition du savoir, qu’une disposition à penser les savoirs et les valeurs. Ce
qui compte est l’acte même de philosopher. L’objectif n’est pas de produire une agilité à
reproduire les raisonnements du professeur, mais d’apprendre à penser par soi-même
(ce qui requiert d’abord de se déprendre de soi-même). Former des petits philosophes,
en somme, et non pas des petits érudits au sujet de la philosophie des autres. Qu’est-ce
à dire, sinon que l’enjeu de l’enseignement philosophique est de donner la possibilité
aux enseignés de formuler eux-mêmes des problèmes philosophiques, et de les résoudre
également par eux-mêmes ?
D’où la perplexité que suscite cet enseignement chez les élèves, parents d’élèves,
ministres et même dans l’ensemble de la communauté citoyenne : on ne voit pas bien
« concrètement » ce qu’il transmet ni comment il est évalué ou évaluable. D’un côté, l’en-
seignement philosophique ne serait plus philosophique s’il consistait simplement dans
L'enseignement philosophique – 6 8 e année – Numéro 3
58 VINCENT CITOT
l’apprentissage de doctrines, de savoirs ou même de problèmes préconçus ; de l’autre il
ne serait plus enseignement s’il consistait pour l’enseigné à assister aux performances
intellectuelles que son professeur réaliserait pour son propre compte. L’enseignement
philosophique ne peut être ni une invitation à la mémorisation, ni le spectacle d’un phi-
losophe se produisant sur une estrade. Dans les deux cas, il rendrait les élèves passifs,
ce qui contredirait les réquisits de la discipline. Le problème pédagogique peut donc se
formuler ainsi : comment apprendre à philosopher, sachant qu’il faut bien montrer
l’exemple, tout en faisant comprendre aux enseignés que l’exemple du professeur n’est
pas à reproduire tel quel ? C’est sa démarche intellectuelle qu’il faut reproduire, l’ap-
titude à problématiser, et non pas le contenu particulier d’une pensée – fût-elle celle du
professeur. Mais en même temps, il est clair que toutes les pensées ne se valent pas. Or
le juge qui hiérarchise ces dernières doit être à la fois neutre et philosophe, au-dessus
des philosophies d’élèves et dans la philosophie néanmoins – position ambivalente
souvent mal comprise. Ces ambiguïtés peuvent se résumer par le double paradoxe
suivant : l’enseigné doit apprendre à penser par soi-même en épousant provisoirement
la pensée d’un autre ; l’enseignant doit réaliser un acte philosophique qui se veut per-
tinent, et même qui dégage des vérités universelles, tout en admettant qu’on puisse
penser autrement, et même en réclamant des élèves qu’ils pensent singulièrement. L’en-
seignement de la philosophie, on le voit, pose des problèmes pédagogiques redoutables.
Notre propos n’est pas de dire que ces paradoxes doivent être surmontés : nous les
jugeons irréductibles. Soit on renonce à l’enseignement philosophique, soit on est
contraint de composer avec eux. En effet, la philosophie elle-même est une discipline
paradoxale : elle a rapport aux savoirs sans être une science, elle convoque des valeurs
sans être une morale, elle promeut la sagesse sans être un simple art de vivre. Une phi-
losophie complète coordonne toutes ces dimensions (connaissances, valeurs, sagesse).
Mais coordonner des paradoxes ne les dissipe pas, et notre questionnement pédagogique
reste entier : comment enseigner un savoir qui n’en est pas vraiment un, une morale qui
refuserait le prêchi-prêcha précritique, ou encore une sagesse individuelle qui vaille
pour tout le monde ? Dans la mesure où philosopher requiert de penser par soi-même,
de s’engager dans une démarche normative et d’harmoniser ses idées avec sa vie, on
peut dire que l’universel philosophique est toujours un « universel singulier ». Or tout ce
qui est singulier fait difficilement l’objet d’un enseignement général, a fortiori d’un pro-
gramme éducatif national pour une instruction de masse. L’enseignement philosophique
était-il plus aisé quand il prenait la forme d’une relation interindividuelle maître-dis-
ciple ? Sans doute pas. À notre sens, c’est l’idée d’enseigner la philosophie qui est para-
doxale, quelles que soient les modalités pratiques. L’élève face à son maître est toujours
confronté à la double injonction contradictoire de penser et de faire comme il dit tout
en s’affranchissant de sa tutelle – comme le bon maître y invite justement contre lui-
même. Faudrait-il alors renoncer à enseigner la philosophie ? Certainement pas : la dif-
ficulté ne nous semble pas un motif suffisant de renoncement.
CURIOSITÉ PÉDAGOGIQUE : PLUS DE PHILOSOPHIE DANS LE SECONDAIRE QUE DANS
LE SUPÉRIEUR
Ne pas renoncer, mais adapter. La philosophie ne s’enseigne pas de la même façon
dans un rapport personnel maître-disciple et dans une salle de classe, avec des élèves
performants et des étudiants poussifs, dans le Secondaire et dans le Supérieur, en
licence, en doctorat et dans les ÉSPÉ (Écoles supérieures du professorat et de l’édu-
cation). L’objet principal de notre réflexion portant sur le Secondaire, nous mettons de
L’enseignement philosophique – 68e année – Numéro 3
DIFFICULTÉS ET CURIOSITÉS DE L’ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE EN FRANCE 59
côté les autres modalités d’enseignement. Un mot tout de même sur la comparaison du
Secondaire et du Supérieur, qui nous semble édifiante. Il est en effet remarquable que
l’art de la problématisation philosophique soit au cœur des programmes et des exigences
du Secondaire, tandis qu’il est presque absent du Supérieur – où l’histoire de la philo-
sophie tient globalement lieu de philosophie. On caricaturerait à peine la situation en la
résumant ainsi : on demande aux élèves des filières générales et technologiques de faire
de la philosophie authentique (alors que, pour beaucoup d’entre eux, ils s’en passeraient
volontiers) ; mais dès lors que certains choisissent de faire de la philosophie leur spé-
cialité universitaire, on ne leur propose plus qu’une discipline de substitution (l’histoire
de la philosophie). Pour un nombre croissant de lycéens, l’enseignement de la philo-
sophie est une sorte d’objet éducatif non identifié – qu’il soit craint, fantasmé ou moqué.
Beaucoup seraient très heureux si on leur dictait « du contenu », c’est-à-dire si on leur
faisait apprendre les pensées positives de tel ou tel auteur. D’autres sont sensibilisés au
mode de raisonnement philosophique, à l’exigence critique et à la liberté intellectuelle
dont l’enseignement philosophique de Terminale fait la promotion. Parmi eux, quelques-
uns sont tellement motivés qu’ils choisissent de s’engager dans des études de philo-
sophie – ce qui revient souvent à faire de cette dernière un métier et une vie. Ceux-là
sont certainement déçus, une fois arrivés dans le Supérieur, de constater qu’on leur
donne comme nourriture spirituelle quelque chose de très différent de ce qui les avait
passionnés en Terminale.
Certes, un enseignement public national n’a pas pour vocation fondamentale de faire
plaisir aux élèves et étudiants, ni de répondre à leurs attentes idiosyncrasiques. Mais en
vertu d’un principe d’honnêteté et de transparence, il serait tout de même souhaitable
que ce que l’on enseigne correspondît aux dénominations des disciplines et des cours.
Le contenu doit être conforme à l’intitulé. Par exemple, si un cours porte sur telle œuvre
de tel auteur, et que son objet est de la comprendre, il faut qu’il apparaisse dans « la
maquette » comme un cours d’exégèse – ou d’explication de texte, à tout le moins. Si
l’objet du cours est d’acquérir une intelligence historique en histoire de la philosophie,
qu’il soit indiqué comme un cours d’histoire (ce qui mettrait en rivalité les historiens de
la philosophie de formation philosophique et les historiens de la philosophie de for-
mation savante). S’il s’agit de philosopher (à partir d’une œuvre, d’un auteur, ou direc-
tement à propos d’un problème général) qu’il apparaisse comme un cours de philo-
sophie. L’enseignement universitaire devrait clarifier les finalités des divers cours, donc
les compétences attendues pour les évaluations. Cela éviterait de confondre des spécia-
lités aussi diverses que l’explication, le commentaire, l’histoire et la philosophie. Il nous
semble que tout le monde y gagnerait, et que les spécialités en question seraient mieux
honorées. Mais nous ne pouvons développer ici ce point.
LES CONDITIONS D’UN ENSEIGNEMENT EFFICIENT ET LA QUESTION DE LA FOR-
MATION DES ENSEIGNANTS
S’agissant de l’enseignement secondaire, il nous semble que le programme tel qu’il est
conçu aujourd’hui (les notions, les distinctions conceptuelles – les repères –, les auteurs,
les principes pédagogiques et les exercices – dissertation et explication de texte), est glo-
balement satisfaisant. On peut, sur sa base, faire de véritables cours de philosophie, et
former comme il convient de jeunes apprentis à la philosophie. Mais pas dans n’importe
quelle condition. Il existe des programmes parfaits « sur le papier » qui sont imprati-
cables dans la réalité. De même que Solon reconnaissait qu’il n’avait pas donné aux
Athéniens les meilleures lois qu’on puisse concevoir, mais seulement celles qui leur
L'enseignement philosophique – 6 8 e année – Numéro 3
60 VINCENT CITOT
convenaient et qu’ils pouvaient supporter, il faut chercher moins un programme idéal
qu’un programme opératoire. Celui qui permette aux élèves de hisser au maximum leur
niveau de réflexion philosophique. Deux conditions sont requises pour que le pro-
gramme actuel soit efficient : que les enseignants soient aptes à l’enseigner, et que les
enseignés soient aptes à en recevoir l’enseignement. Commençons par la première
condition.
Un bon enseignant en philosophie doit pouvoir développer une pensée précise et éclai-
rante à propos de thèmes aussi divers que « L’inconscient », « Le vivant », « La société »,
« L’art », « L’histoire », « Le langage », ou encore « Le droit ». Il va de soi que certaines
connaissances en psychologie ou en psychanalyse sont utiles pour disserter sur l’incons-
cient, en biologie sur le vivant, en sociologie sur la société, etc. Imagine-t-on un cours
de philosophie sur « l’histoire » dispensé par un professeur sans culture historique, ou
un cours sur « l’art » sans culture artistique ? Le philosophe ne peut être simplement un
habile rhéteur, capable de « dialectiser » des couples de contraires, de monter en épingle
un paradoxe ou de faire des « mises en abîme » par des jeux réflexifs. Philosopher
authentiquement n’est pas jouer avec des concepts ni faire des raisonnements in abs-
tracto : c’est penser le réel, dans toutes ses dimensions. L’enseignant (certifié, agrégé,
contractuel) devrait, à notre sens, être un peu moins dialecticien et un peu plus savant
– ce qui ne l’empêcherait nullement de construire des problématiques philosophiques.
À cette condition, il pourrait se montrer digne du programme actuellement en vigueur.
Or depuis le début du XIXe siècle, la philosophie s’est tendanciellement éloignée du pôle
scientifique pour se rapprocher du pôle littéraire. À tel point qu’on la considère
aujourd’hui spontanément comme une discipline « littéraire ». Il nous semble que la
prise de distance avec la culture scientifique est dommageable pour la qualité de la pro-
duction contemporaine. Cette déconnexion a aussi des effets sur la nature de l’ensei-
gnement universitaire, la formation et le recrutement des professeurs du Secondaire,
donc les cours qu’ils dispensent. Les enseignants de philosophie ont une culture scienti-
fique trop faible ou datée. Du coup, les élèves se retrouvent souvent dans la situation
délicate d’avoir à choisir entre ce que leur dit le « prof de philo » sur l’animalité, le
vivant, la société, l’économie, le droit, la laïcité, etc., et ce qui leur vient aux oreilles par
les collègues biologistes, physiciens, économistes, sociologues ou historiens. Autant un
économiste n’a pas besoin de philosophie pour étudier correctement les échanges éco-
nomiques, autant un philosophe a besoin de connaître un peu d’économie pour parler
sans trop de naïveté du même sujet (rappelons que « les échanges » sont au programme
de philosophie en section ES).
Ces remarques sur la façon dont on peut aborder le cours sur « La société et les
échanges » nous amènent à évoquer un autre point délicat : celui de la neutralité poli-
tique des enseignants de philosophie quand ils traitent de questions économiques,
sociales et « sociétales ». Faire cours sous une forme dissertative en s’engageant dans une
thèse est une chose ; infuser dans l’esprit des élèves ses propres convictions politiques
en est une autre. Sous couvert de promouvoir la pensée critique et le jugement per-
sonnel, certains ne se privent guère de faire passer quantité de messages politiques.
Puisqu’être philosophe c’est rejeter les allégeances et les arguments d’autorité, ne peut-
on pas en profiter pour faire de la subversion une valeur et, de là, défendre des idées
politiquement subversives ? Avec la bienveillance propre à l’éducateur, l’enseignant se
transforme ainsi souvent en évangélisateur soft. C’est trahir le devoir de neutralité qui
correspond au statut, mais aussi manquer à une exigence pédagogique essentielle de
l’enseignement philosophique. En outre, ça revient à exclure ceux qui, dans la classe,
penseraient différemment, et seraient trop timides pour le faire savoir. Bref, nous
L’enseignement philosophique – 68e année – Numéro 3
DIFFICULTÉS ET CURIOSITÉS DE L’ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE EN FRANCE 61
pouvons résumer ainsi notre propos : le programme actuel de philosophie est excellent
s’il est traité par des professeurs excellents.
LES CONDITIONS D’UN ENSEIGNEMENT EFFICIENT ET LE NIVEAU DES ÉLÈVES
On retrouve du côté des élèves, au niveau qui est le leur, ces deux problèmes de l’in-
culture et du poids de l’idéologie. Enseigner la philosophie fait sens pour l’élève quand
il dispose d’une certaine culture générale susceptible de nourrir sa réflexion. Sinon,
celle-ci tourne à vide, à la manière d’un cycliste sur son vélo d’appartement, s’imaginant
traverser de fabuleux paysages. La réflexion et le raisonnement sont des outils pour tra-
vailler quelque matière première intellectuelle. Ils doivent s’exercer sur quelque chose.
Dans le même ordre d’idée, vouloir enseigner « l’esprit critique » à des jeunes gens qui
en sont totalement dépourvus revient généralement à armer leurs préjugés – qui en
deviennent d’autant plus dangereux. Beaucoup conçoivent cet enseignement comme
une invitation au bazar, à l’anarchie et à la critique tous azimuts des autorités. Rien n’est
plus pathétique que de voir des adolescents détourner les instruments intellectuels du
professeur de philosophie pour en faire usage contre son autorité, et donc contre son
enseignement. Vanter les vertus de l’indépendance d’esprit à des élèves persuadés d’être
déjà tout à fait autonomes intellectuellement, renforce leur autosuffisance. Peu s’en faut
pour qu’ils entreprennent à leur tour d’édifier leur professeur en lui enseignant la vérité
sur « le 11 septembre », sur « les Illuminati », et finalement sur la société contemporaine
tout entière – dont le pauvre petit fonctionnaire qui leur fait face, victime de l’idéologie
médiatique, n’aurait aucune idée. L’enseignant passe souvent pour un benêt parce qu’il
a la naïveté de croire qu’il y a des causes, et pas simplement des complots ; des néces-
sités, et pas seulement des manipulateurs.
C’est triste à dire, mais il se pourrait que la philosophie soit nuisible si elle est
enseignée dans des conditions si mauvaises. Certains jeunes ont besoin de preuves et de
faits davantage que de raisonnements philosophiques. Il est surtout urgent de les ins-
truire au sujet de l’évolution des espèces, de l’origine de l’homme, de l’histoire des reli-
gions et du fait colonial (quand ce n’est pas de l’existence des chambres à gaz). Nous
exagérerions à peine en disant qu’ils ont besoin de dogmes – en tout cas de choses à
apprendre, de « vérités » à assimiler. En espérant que, plus tard, ils aient la maturité
pour examiner avec un recul philosophique ces premiers acquis. On ne peut sauter les
étapes, passer de l’enfance à l’âge adulte sans avoir été adolescent, ou de l’ignorance à
la pensée critique sans être passé par l’apprentissage d’un certain savoir – qu’il s’agira
ensuite de questionner.
Parmi les autres conditions pour que le programme actuel soit enseignable figure
aussi le niveau de langage. Faire des distinctions conceptuelles subtiles ne sert à rien si
les élèves maîtrisent mal le français. Voici par exemple quelques « repères » du pro-
gramme qui ne sont pas toujours compréhensibles par certains élèves, en dépit des
efforts de leur professeur : « En acte / en puissance », « intuitif / discursif », « origine /
fondement », « ressemblance / analogie », ou encore « transcendant / immanent ». Bien
entendu, la lecture des auteurs au programme est également très difficile pour ces
mêmes élèves : Plotin, Montaigne, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger,
Sartre, Merleau-Ponty et Levinas leur sont à peu près inaccessibles. Mais Descartes,
Pascal, Rousseau et même tous les autres sont aussi très peu compréhensibles – sinon
par de lourds efforts, auxquels les élèves ne veulent généralement pas consentir. En
effet, une des conditions de possibilité de l’enseignement de la philosophie est l’assimi-
lation de la posture scolaire en tant que telle, c’est-à-dire la capacité de rester assis sur
L'enseignement philosophique – 6 8 e année – Numéro 3
62 VINCENT CITOT
une chaise pendant cinquante-cinq minutes sans bavarder avec ses voisins (mais éven-
tuellement en intervenant à l’oral après que le professeur a donné la parole). Or ce sont
la plupart du temps ceux qui auraient le plus besoin d’écouter sagement le cours qui
sont le moins disposés à le faire.
Dans ces conditions, on comprend que ces élèves ne soient pas en mesure de trans-
former les sujets de dissertation qui leur sont soumis en des problèmes philosophiques,
puis de les traiter sous une forme dissertative. En guise de dissertation, l’enseignant se
retrouve avec un déballage de préjugés vaguement mis en ordre. Dans bien des lycées,
les « bac blancs » de quatre heures sont devenus inutiles ; les élèves n’ayant plus rien à
écrire au bout de deux heures. En outre, le correcteur doit souvent constater avec dépit
que son cours n’a presque servi à rien. Ou bien il le retrouve par morceaux et trans-
figuré, comme une imprimante qui aurait restitué un fichier corrompu. Il se remonte le
moral en évoquant le souvenir de tel ou tel élève qu’il est parvenu à « tirer de là » ; à
ceux qui « s’en sont sortis », à telle ou telle remarque, en cours, qui l’a bouleversé par la
justesse de l’intuition qu’elle manifestait (et surtout du fait qu’elle était inattendue, étant
donné le niveau de la classe). Mais sur combien d’années, et par rapport à combien
d’élèves ? Quel rendement, si nous osions le terme ? Que répondre à ceux qui voudraient
tirer de tout cela argument pour supprimer purement et simplement l’enseignement de
la philosophie en classes technologiques ? Pourquoi ne pas rendre cette discipline option-
nelle, de sorte que seuls les bons lycées puissent la proposer et la dispenser, là où les
conditions de son enseignement sont présentes ? Nous ne militons pas du tout ici pour
supprimer la philosophie ou la rendre optionnelle ; et pourtant nous constatons qu’elle
n’est déjà plus enseignée comme elle le devrait dans bien des lycées (faute des condi-
tions susmentionnées).
TROIS OPTIONS À CONSIDÉRER
Trois options s’offrent à nous. La première consiste à ne rien faire et accepter que
l’enseignement philosophique soit, ici ou là, dévoyé. Au lieu de philosopher, l’enseignant
organise des débats, structure les préjugés des uns et des autres, donne une forme
rationnelle aux opinions, tente de bousculer quelques idées reçues, se transforme en
professeur de culture générale ou en doxographe vulgarisateur. Ici ou là seulement. Va-
t-on bouleverser un programme national pour s’adapter à certains lycées ? Ce serait du
nivellement par le bas. Donc, première option (appelons-la conservatrice) : en rester là.
De la philosophie si possible ; de la sous-philosophie dans le cas contraire ; le tout avec
des programmes inchangés.
Deuxième option : on s’arrange pour que les élèves qui n’ont aucunement le niveau
de Terminale ne se retrouvent pas en Terminale. Cela paraît du bon sens, mais une telle
réforme serait en fait presque impossible, étant donné les forces et les idéologies en pré-
sence. Il faudrait faire redoubler les élèves. Mais comme le redoublement ne sert à rien
pour ceux qui sont vraiment de niveau faible (les études le montrent), il faudrait les
orienter précocement et renoncer au « Collège unique ». Ce serait un aveu d’échec
général des politiques éducatives depuis quarante ans. De surcroît, il faudrait prévoir un
ensemble de mesures économiques destinées à rendre possible l’insertion sur le marché
du travail de ces jeunes sous-diplômés, que les employeurs rechignent à payer au niveau
du salaire minimum en vigueur. C’est l’option réformatrice.
Troisième option : la pragmatique. Elle consiste à revoir les programmes et les
épreuves de philosophie dans les filières qui concentrent le plus d’élèves dits « en diffi-
culté » (qu’ils soient effectivement en difficulté ou qu’ils mettent leurs professeurs et leur
L’enseignement philosophique – 68e année – Numéro 3
DIFFICULTÉS ET CURIOSITÉS DE L’ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE EN FRANCE 63
établissement « en difficulté »). On supprimerait quelques « repères » et quelques
« auteurs », et on reconsidérerait les modalités d’évaluation. De même que l’explication
de texte est adaptée dans les filières technologiques (les élèves sont guidés par des ques-
tions), on pourrait envisager de les guider également dans l’exercice de la dissertation.
Au lieu de leur demander de construire eux-mêmes une problématique, on pourrait les
inviter à argumenter à charge et à décharge sur un problème préalablement formulé –
et leur laisser la possibilité de conclure. Le risque serait alors de proposer un ensei-
gnement de la philosophie au rabais. Mais n’est-ce pas déjà ce que font tous les collègues
en poste dans ces établissements ? Certes, mais l’officiel n’étant pas l’officieux, on
conçoit qu’il y ait là matière à hésitations. La vraie question serait peut-être celle-ci :
veut-on continuer à voiler la vérité et « sauver les apparences », ou bien se décide-t-on
à prendre acte du réel (et par là même le taureau par les cornes) ? Quand on fait pro-
fession de philosopher, on est plutôt porté à aimer la vérité ; mais on peut aussi consi-
dérer que, tout en regardant celle-ci en face, l’adaptation au réel et le renoncement à
l’idéal n’est pas nécessaire – voire que l’hypocrisie et le louvoiement (entre l’officiel et
l’officieux) ont bien des vertus.
Chacune des trois options présente des avantages et des inconvénients. La conser-
vatrice évite les conflits, mais au prix d’une certaine hypocrisie ; la pragmatique n’est pas
hypocrite, mais elle est peu ambitieuse ; la réformatrice est ambitieuse, mais susciterait
des oppositions de toutes parts. Notre préférence va tout de même à cette dernière, qui
semble avoir avec elle le bon sens, comme nous l’avons évoqué rapidement (les élèves
de Terminale doivent avoir le niveau correspondant au programme de Terminale). Il
s’agirait d’une réforme générale de l’enseignement Secondaire qui tirerait toutes les
conséquences des études sur l’inefficacité du redoublement (et du non-redoublement).
Elle aurait des effets immédiats sur l’enseignement Supérieur, et notamment sur la
licence, qui est en train de devenir une usine à mauvais élèves. Si l’on veut conserver le
principe du bac comme « porte d’entrée » à l’Université, il faut revoir le système de
sélection dans le Secondaire. Si rien n’est fait rapidement, les tendances actuelles vont
se renforcer : enseignement public pour les élèves « en difficulté » (dans le Secondaire
et dans le Supérieur, au moins jusqu’à l’entrée en Master) ; enseignement privé (et
quelques pôles d’excellence publics) pour les élèves plus performants et pour ceux qui
en ont les moyens.
L'enseignement philosophique – 6 8 e année – Numéro 3
Vous aimerez peut-être aussi
- Vincent Citot: "Difficultés Et Curiosités de L'enseignement de La Philosophie en France"Document6 pagesVincent Citot: "Difficultés Et Curiosités de L'enseignement de La Philosophie en France"Vincent CitotPas encore d'évaluation
- Frances Ensino FilDocument5 pagesFrances Ensino FilLeonardo PortoPas encore d'évaluation
- Une Didactique de La Philosophie Est-Elle PossibleDocument18 pagesUne Didactique de La Philosophie Est-Elle PossiblePhilippa Simões100% (1)
- Perrin Histoire Des Idees Et Didactique PDFDocument9 pagesPerrin Histoire Des Idees Et Didactique PDFWahiba YahiaouiPas encore d'évaluation
- Philotozzi Didactique de L'apprentissage Du Philosopher Et Sciences de L'éducation PrintDocument5 pagesPhilotozzi Didactique de L'apprentissage Du Philosopher Et Sciences de L'éducation PrintPhilippa SimõesPas encore d'évaluation
- Tozzi - Dictionnaire de L'apprentissage Du Philosopher en Classe de TerminaDocument38 pagesTozzi - Dictionnaire de L'apprentissage Du Philosopher en Classe de TerminaAnonymous 6N5Ew3Pas encore d'évaluation
- Former Aux Processus de Pensee v3 Conceptualisation Et Carte Mentale ConceptualiserDocument20 pagesFormer Aux Processus de Pensee v3 Conceptualisation Et Carte Mentale ConceptualiserWahiba YahiaouiPas encore d'évaluation
- De L Approche de Quelques Notions Du ProgrammeDocument11 pagesDe L Approche de Quelques Notions Du ProgrammeThierno LYPas encore d'évaluation
- KOHAN Un Ejercicio de Filosofia de La EducaciónDocument8 pagesKOHAN Un Ejercicio de Filosofia de La EducaciónLulú Aimé GaiadaPas encore d'évaluation
- Leandri Dissertation Philologos2017 V3Document8 pagesLeandri Dissertation Philologos2017 V3aleandriSPas encore d'évaluation
- Enseigner La Philosophie v2Document406 pagesEnseigner La Philosophie v2mlpla25562Pas encore d'évaluation
- Transposition Didactique PerrenoudDocument9 pagesTransposition Didactique PerrenoudMeriem Adem100% (1)
- Paul Mathias - Philo, Marqueur de L'enseignement en FranceDocument3 pagesPaul Mathias - Philo, Marqueur de L'enseignement en FranceFrancesco KaramazovPas encore d'évaluation
- Tozzi - La Didactique en FranceDocument42 pagesTozzi - La Didactique en FrancewholybreakerPas encore d'évaluation
- Syllabus - Philosophie 2019-20Document170 pagesSyllabus - Philosophie 2019-20Amandine ClementPas encore d'évaluation
- 43661711Document6 pages43661711Salif SawadogoPas encore d'évaluation
- Introduction A La PhilosophieDocument186 pagesIntroduction A La PhilosophieKhouloud AdouliPas encore d'évaluation
- Durkheim. 1963. La Morale LaïqueDocument9 pagesDurkheim. 1963. La Morale Laïquemar-23423Pas encore d'évaluation
- Les Origines Et La Specificité de La Reflexion PDFDocument28 pagesLes Origines Et La Specificité de La Reflexion PDFwaly100% (11)
- Forquin 1Document4 pagesForquin 1Samir JebliPas encore d'évaluation
- Chapitre Ii Ancrages Theoriques de LeducationDocument16 pagesChapitre Ii Ancrages Theoriques de LeducationTejiPas encore d'évaluation
- Debat Philo PrimaireDocument20 pagesDebat Philo PrimairebiorellePas encore d'évaluation
- Plan Du DevoirDocument7 pagesPlan Du Devoirlouiswiselet98Pas encore d'évaluation
- Éléments de Cours PhilosophieDocument39 pagesÉléments de Cours PhilosophieAbba100% (2)
- PhilosopherDocument6 pagesPhilosopherMamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- Philo Et Science PDFDocument2 pagesPhilo Et Science PDFndiaye100% (1)
- 9782092608791Document20 pages9782092608791angekellyyoboue5Pas encore d'évaluation
- ENS-SP DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE-Axe 1Document3 pagesENS-SP DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE-Axe 1houdahoudahh262Pas encore d'évaluation
- Illich FreireDocument48 pagesIllich FreireJohnny DESIRPas encore d'évaluation
- Coursdephilosophie Albert MENDIRIDocument428 pagesCoursdephilosophie Albert MENDIRIStanislasPas encore d'évaluation
- L'inutilité Du Cours de PhilosophieDocument15 pagesL'inutilité Du Cours de PhilosophieAnonymous 6N5Ew3Pas encore d'évaluation
- Mouna PHDocument2 pagesMouna PHmsambihafilsPas encore d'évaluation
- UntitledDocument526 pagesUntitledharaya kobPas encore d'évaluation
- 9782749509365Document8 pages9782749509365Sénégal mon paysPas encore d'évaluation
- Islandora 63029Document57 pagesIslandora 63029livelydreamPas encore d'évaluation
- Colloque de Philosophie: Le Sens de L'activité Philosophique en QuestionDocument4 pagesColloque de Philosophie: Le Sens de L'activité Philosophique en Questionamine1331Pas encore d'évaluation
- Halte (J.-F.) - La Didactique Du Français 3 PAGESDocument3 pagesHalte (J.-F.) - La Didactique Du Français 3 PAGESdounia.azza20Pas encore d'évaluation
- Questce Quune Discipline ScolaireDocument3 pagesQuestce Quune Discipline ScolaireLucas TrindadePas encore d'évaluation
- Cours de Philosophie Et Logique UAK Juillet 2022Document67 pagesCours de Philosophie Et Logique UAK Juillet 2022Axel-ronnie ThamerPas encore d'évaluation
- La Philosophie A L Ecole Primaire-1Document2 pagesLa Philosophie A L Ecole Primaire-1RAMZI AzeddinePas encore d'évaluation
- Didactique PDFDocument15 pagesDidactique PDFRIDA ELBACHIR100% (1)
- Michel Onfray PDFDocument2 pagesMichel Onfray PDFikoukPas encore d'évaluation
- Didactique Du FrancaisDocument104 pagesDidactique Du FrancaisAthenaDonaPas encore d'évaluation
- Samuel Johsua, Jean-Jacques Dupin, Initiation À La Didactique Des Sciences Et Des MathématiquesDocument3 pagesSamuel Johsua, Jean-Jacques Dupin, Initiation À La Didactique Des Sciences Et Des MathématiquesMaria BauleoPas encore d'évaluation
- Merieu Des Lieux Communs A Concepts ClesDocument19 pagesMerieu Des Lieux Communs A Concepts ClesBOUGUIDANG DAVIDPas encore d'évaluation
- 00 - Qu'est-Ce Que La PhilosophieDocument2 pages00 - Qu'est-Ce Que La PhilosophiegillesPas encore d'évaluation
- Didactique Selon MatDocument4 pagesDidactique Selon MatAlexis SeruvugoPas encore d'évaluation
- Introduction Didactique PDFDocument34 pagesIntroduction Didactique PDFIst Mir Egal100% (1)
- Comment Les Debats Philosophiques en Classe Peuvent-Ils Contribuer A Des Apprentissages de Meilleure Qualite Chez Les Eleves ?Document36 pagesComment Les Debats Philosophiques en Classe Peuvent-Ils Contribuer A Des Apprentissages de Meilleure Qualite Chez Les Eleves ?mona lisaPas encore d'évaluation
- Le Statut de La Pedagogie MierieuDocument28 pagesLe Statut de La Pedagogie MierieuMarina MorariPas encore d'évaluation
- 1997 HoussayeDocument8 pages1997 HoussayeMayssa RjaibiaPas encore d'évaluation
- Russell - Valeur de La PhilosophieDocument6 pagesRussell - Valeur de La PhilosophieFrancis ProulxPas encore d'évaluation
- Qu'est-Ce Que La Philosophie - Assistance Scolaire Personnalisée Et Gratuite - ASPDocument7 pagesQu'est-Ce Que La Philosophie - Assistance Scolaire Personnalisée Et Gratuite - ASPIbrahimaPas encore d'évaluation
- Programme de Philosophie Terminale Générale 2020-2021 Spe238 - Annexe1 - 1159159Document6 pagesProgramme de Philosophie Terminale Générale 2020-2021 Spe238 - Annexe1 - 1159159Mathieu BompointPas encore d'évaluation
- HJHDocument22 pagesHJHMourad Bennay HarrakPas encore d'évaluation
- Apprendre A Philosopher Kant HegelDocument5 pagesApprendre A Philosopher Kant HegelWahiba YahiaouiPas encore d'évaluation
- La Pédagogie positive - Pourquoi et commentD'EverandLa Pédagogie positive - Pourquoi et commentÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Savoir enseigner dans le secondaire: Didactique généraleD'EverandSavoir enseigner dans le secondaire: Didactique généralePas encore d'évaluation
- 2 Enseignement SYSTEME EDUCATIF en France LexiqueDocument5 pages2 Enseignement SYSTEME EDUCATIF en France LexiqueДиана РезниковаPas encore d'évaluation
- Enstmo 2023yampi KameniDocument1 pageEnstmo 2023yampi KameniBoris le ZockyPas encore d'évaluation
- ECE.002.DOC.001 Bulletin D Inscription 4Document9 pagesECE.002.DOC.001 Bulletin D Inscription 4tamowaPas encore d'évaluation
- EducationDocument59 pagesEducationFatima RahmounPas encore d'évaluation
- L'éducationDocument5 pagesL'éducationENDLESS100% (1)
- Centre D'examen 2022Document15 pagesCentre D'examen 2022ncoulibaly409Pas encore d'évaluation
- Solution To Entre Jeunes-XDocument65 pagesSolution To Entre Jeunes-XN.r. SaravananPas encore d'évaluation
- Enseigner en Unité Denseignement - Cycles 2, 3 Et 4 (French Edition) (Bruno Egron) (Z-Library)Document487 pagesEnseigner en Unité Denseignement - Cycles 2, 3 Et 4 (French Edition) (Bruno Egron) (Z-Library)Hizenheim100% (1)
- Obseques TEKAMDocument4 pagesObseques TEKAMjosephinebapounguePas encore d'évaluation
- Maths 3e RépubliqueDocument15 pagesMaths 3e République31071978Pas encore d'évaluation
- WP2018 11Document45 pagesWP2018 11Karim KhelifiPas encore d'évaluation
- 243 - Prov ESG 13 Septembre 2018 - OkDocument46 pages243 - Prov ESG 13 Septembre 2018 - OkCamerounWeb100% (2)
- Gpi 3 1 TunisieDocument3 pagesGpi 3 1 Tunisiecherif yahyaouiPas encore d'évaluation
- Atlas Territorial de Labandon Scolaire 18 12 WebDocument169 pagesAtlas Territorial de Labandon Scolaire 18 12 Webothmane SupPas encore d'évaluation
- Résultats Du Concours FUE SMPCDocument11 pagesRésultats Du Concours FUE SMPCRedouane SouadiPas encore d'évaluation
- Guide Des Niveaux de Formation - Janvier 2020Document417 pagesGuide Des Niveaux de Formation - Janvier 2020manohisoaPas encore d'évaluation
- Fondements de La Politique Éducative en Algérie: N°43, Juin 2015-Tome B - PP 109-125Document17 pagesFondements de La Politique Éducative en Algérie: N°43, Juin 2015-Tome B - PP 109-125Alice CeliaPas encore d'évaluation