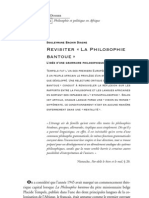Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Critique de La Raison Orale M - D
Transféré par
fallou gueye0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
14 vues3 pagesTitre original
CRITIQUE_DE_LA_RAISON_ORALE_M-_D
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
14 vues3 pagesCritique de La Raison Orale M - D
Transféré par
fallou gueyeDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 3
CRITIQUE DE LA RAISON ORALE OU COMMENT DIRE LE LOGOS
PAR MAMOUSSE DIAGNE, PHILOSOPHE
Dans l’annexe de ma Thèse d’État soutenue en 2003, je tente d’examiner à
nouveaux frais une question qui a polarisé les débats des philosophes africains
dans les années 1960-1970, et qui, au-delà de ses variations successives, pourrait
s’énoncer ainsi : « Dans l’Afrique noire traditionnelle a-t-il existé ou non une
philosophie dont il serait possible d’attester les traces dans l’héritage qui nous est transmis ? »
Lorsque j’en vins à publier la Thèse principale sous le titre Critique de la raison orale : les
pratiques discursives en Afrique noire, en accord avec l’éditeur, j’ai accepté d’en détacher cette
partie, en l’intitulant De la philosophie et des philosophes en Afrique noire.
C’est dire que le thème de cette Table ronde rencontre parfaitement les préoccupations qui
ont été les miennes au cours de la vingtaine d’années que j’ai consacrée à cette recherche. Il
convient cependant de dire tout de suite que la question de la philosophie n’était pas mon objet à
proprement parler, mais le mode d’articulation des énoncés et les caractéristiques de leur
transmission et de leur archivage dans les cultures traditionnelles africaines qualifiées comme des
cultures orales. D’où le changement du titre au moment de la publication, auquel on a voulu donner
une allure volontairement kantienne, pour lui faire dire : « A quelles conditions et selon quelles
modalités une civilisation qui ne dispose pas d’un support indépendant du locuteur comme
l’écriture confectionne, transmet et archive son patrimoine ? » Ce sont les résultats de la recherche
mêmes qui nous ont amené à reprendre pour notre propre compte la question de l’existence ou de la
non-existence de la philosophie dans l’Afrique traditionnelle, subodorant, dans les débats de toute
une génération de philosophes (la mienne et celle qui la précède de peu), quelque chose comme un
malentendu. Si donc le thème de cette Table ronde me donne l’impression de confronter, dans un
même champ conceptuel oralité et philosophie, je ne peux qu’être ravi, car ce que je considérais
comme le point aveugle du débat d’alors peut être mis en pleine lumière.
Poser la question de l’existence ou non de la philosophie en Afrique c’est, en effet, produire
un énonce qui n’est simple qu’en apparence. Veut-on dire par là que l’Afrique noire, dans sa
tradition de pensée réfléchie, a produit un discours philosophique à l’instar de ce qui, à un moment
donné, a émergé dans le champ occidental ? Ou que la philosophie, quelle que soit la définition
qu’on lui donne, est celle qui, au terme d’une histoire plus ou moins mouvementée, fait partie du
legs occidental, même si les penseurs du continent peuvent, selon des préoccupations et des
modalités diverses cibler, par son entremise, des objets inédits, pouvant aller jusqu’à en subvertir le
contenu ? En répondant positivement à la première question, on se trouve dans l’obligation de
produire les fondements factuels et théoriques à partir desquels un concept classificatoire (celui de
philosophie) sert à qualifier, dans deux traditions culturelles des traits assez pertinents pour asseoir
une critériologie. En répondant par la négative, on devra invoquer plus que la simple réponse
positive à la deuxième question, en allant au-delà du fait pour montrer pourquoi les traditions
africaines telles que nous les connaissons, n’ont pas pu engendrer ce qui est connu et accepté sous le
nom de philosophie. Que ce soit à titre provisoire ou non, cela n’’importe qu’en second lieu,
puisque, par là même on aura réglé la question de fait. Dans tous les cas, l’horizon du philosophe
africain comportera une délimitation du concept de philosophie, soit suffisante pour y faire entrer
les pensées africaines traditionnelles, soit exigeant un espace plus large dans lequel la philosophie
coexisterait avec d’autres modalités du penser autres que philosophiques. Le statut et le nom qu’on
lui donne alors ne vient qu’ensuite, sans aucun jugement de valeur ni aucune tentative de
hiérarchisation.
La question de l’existence ou non d’une philosophie africaine traditionnelle peut être piégée
par la non-exhibition des positions philosophiques de celui-là même qui la pose. Il occupe un lieu
d’où il convoque l’interlocuteur qu’il somme de venir l’y trouver, délimitant par avance les
positions d’interlocution. C’est pour cette raison, me semble-t-il, que cette question telle qu’on la
pose souvent, n’est pas initiale. Elle suppose la réponse à une autre. Avant de se demander si
l’Afrique noire traditionnelle a ou non pensé philosophiquement, il faut demander comment
l’Afrique noire a pensé, quelles procédures elle a mis en œuvre pour ce faire, et par quels
mécanismes (dont l’inventaire est à faire) elle est arrivée à dire ce qu’elle dit pour transmettre son
patrimoine culturel. C’est précisément à ce programme que nous nous sommes attaché dans la
Critique de la raison orale.
La première thèse que nous avons tenté d’y mettre en place, en essayant de lui donner la
dignité d’un énoncé théorique est celle-ci : les civilisations africaines traditionnelles sont des
civilisations de l’oralité. Et, consignant le poids de sa dette en cette circonstance, je dois dire que
c’est une réflexion du sociologue béninois Honorat Aguessy qui m’a mis sur la voie. Étudiant les
religions africaines, il a signalé dans la cosmogonie fon l’importance d’une divinité de la parole,
Lêgba, qui remplit des fonctions similaires à celles d’Hermès, avec cette particularité qu’il est un
interprète et un intermédiaire entre les dieux dont il transmet les messages exclusivement oraux. De
façon générale, la conception pneumatique de la création et le statut de la parole proférée constitue
une donnée permanente dans les mises en scène des cosmogonies africaines. Comme cet auteur, en
affirmant que les civilisations africaines traditionnelles sont des civilisations de l’oralité, on n’a pas
voulu occulter le fait que l’écriture a été présente sur le continent, comme les hiéroglyphes en
Egypte ou l’écriture Bamoun ou Vaï au Cameroun. Mais il s’agit là de faits marginaux, ou de
moyens servant à préserver certains secrets, comme le savoir sacré ou la chronique de la dynastie
royale. Dans tous les cas, l’écriture étant un phénomène insuffisamment pertinent pour caractériser
ces cultures, on est fondé à parler au moins de civilisations à dominante massivement orale, avec les
conséquences qu’il conviendra de tirer rigoureusement le moment venu.
Si toute civilisation est confrontée à trois soucis, à savoir l’élaboration, la gestion et la
transmission de son patrimoine, en posant la question d’allure kantienne (A quelles conditions et
selon quelles procédures), nous avons été mis en présence d’un fait décisif. Ces procédures ne sont
pas du même type selon qu’on a affaire à une culture orale ou à une culture scripturaire. Si, dans le
second cas, l’existence d’un support indépendant du sujet énonciateur des messages garantit la
pérennité de ceux-ci et a des effets indéniables sur les trois opérations signalées, il n’en va pas de
même dans une culture dont la fragilité demeure une caractéristique fondamentale. Ces opérations
dépendent ici d’un locuteur dont le message est déjà surdéterminé par la densité de sa présence
physique, par le pathos de sa voix en situation de performance, mais encore par toute la mimique et
la gestuelle dont les Dogon disent qu’elles sont les « tambours d’eau de la parole ». De cette parole
incarnée, il faut dire que le support est surtout soumis à la maladie, à la décrépitude et à la mort.
Pour le dire en un mot, si toutes les civilisations savent qu’elles sont mortelles, en un sens
légèrement différent de celui que Valéry donnait à cette expression, toutes n’y sont pas exposées de
la même manière et toutes n’y répondent pas avec les mêmes moyens et selon les mêmes modalités.
En particulier, dans une civilisation de l’oralité, il faut le dire avec force, l’Oubli n’est que
l’autre façon de désigner la Mort. On connaît le fameux mot du sage Amadou Hampâté Bâ, qui
souligne ce fait en même temps qu’il indique l’urgence d’une tâche : « En Afrique, quand un
vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle ».
Voilà, métaphoriquement exprimé, le grand défi auquel, plus que toutes les autres, les
cultures orales sont confrontées : faire en sorte que les bibliothèques ne brûlent pas. Et, du fait
qu’elles ne disposent pas de l’alternative qu’ouvre la constatation de Hampâté Bâ, à savoir le
transfert dans un autre système d’archivage, il faut bien qu’elles forgent des dispositifs originaux ne
figurant pas dans l’arsenal des civilisations scripturaires, ou n’y ayant pas la même place et la même
fonction. Au terme de longues investigations, nous avons pu mettre en évidence qu’il en était bien
ainsi : il existe dans les civilisations africaines des facteurs et de procédés irréductibles à ceux qui
sont présents dans une culture écrite.
Parmi ces procédés, il y en a un qui nous a paru si fondamental qu’il nous a paru satelliser
les autres et structurer tout le champ de ce qu’il est convenu, à la suite de certains auteurs de
désigner par le terme d’ « orature ». Nous l’avons appelé le « procédé de dramatisation », en signe
de reconnaissance à Michel Serres qui, dans un texte écrit en hommage à Jean Hippolyte a produit
cette phrase heuristique : « Dans une civilisation de tradition orale, la dramatisation est la forme
véhiculaire du savoir ». Débordant le champ d’application de cet énoncé qui se limitait à la
remémoration du théorème de Pythagore, nous avons traqué le procédé de dramatisation depuis les
récits fragmentaires comme le proverbe et la devinette, jusqu’au savoir profond véhiculé par le récit
initiatique, en passant par le conte et le récit d’argument historique. Dans chacun de ces genres
oraux, nous avons mis en place et tenté de vérifier la pertinence d’une unique hypothèse : une idée
étant donnée, au moyen de l’image et de la mise en scène (soit une histoire de longueur variable,
avec des personnages plus ou moins typés) elle est « habillée », illustrée, validée et estampillée par
une tradition narrative pour, au terme de tests probants, être reçue dans le patrimoine culturel.
Mettre en scène l’idée, ce qui revient à la « Jouer » ou la faire jouer par les personnages d’un
récit confectionné à cet effet, telle est la riposte que les cultures orales (et pas seulement celles de
l’Afrique) ont trouvé pour déjouer leur ennemi mortel, l’oubli. Ce n’est pas un choix, mais le
résultat des contraintes du fait oral lui-même. Potentielle dans les récits fragmentaires où la brièveté
suffit pour garantir la rétention du message, la dramatisation se donne libre cours et se complexifie
dans les récits plus amples, mettant constamment à l’ordre du jour la différence que Socrate
instaurait entre « brachylogie » et « macrologie » dans . Mais le problème le plus important pour
notre propos concerne la nature même de ce qui doit être préservé et que nous désignons par le
terme générique du « mémorable », cette notion débordant chez nous le champ de l’historique. Dans
ce dernier, le récit se moule préférentiellement dans la forme de l’épopée qui, à son point culminant,
est le point de rencontre avec la parole mythique dans le récit de fondation.
C’est l’étude de l’initiation, comme lieu du savoir profond, celui qui concerne les dieux,
l’origine des hommes et des cités, bref le hors-temps où s’est joué la scène primordiale, qui nous a
permis de tirer les conclusions décisives pour notre propos. Le savoir initiatique s’inscrit d’emblée
dans une matrice asymétrique de deux interlocuteurs que sont le Maître de l’initiation et le candidat
à l’initiation. L’analyse systématique de deux récits, Kaïdara et Koumen nous a permis d’isoler des
lois fondamentales, comme la non interchangeabilité des positions d’interlocution, et le caractère a-
critique de l’enseignement. Mais c’est surtout la règle d’or qui cadenasse l’institution initiatique,
celle du secret, qui a fait l’objet d’un examen attentif. Notre conclusion : un savoir qui jouxte le
sacré, n’use que de l’image pour des raisons essentielles, et se soustrait à toute possibilité de
critique et d’autocritique ne saurait revendiquer la définition classique de la philosophie. Cheikh
Anta Diop a vu dans l’institution initiatique l’un des obstacles majeurs au développement de la
science, qui a fait perdre à Afrique l’avance acquise par l’Egypte. Dès sa naissance, la philosophie
pose comme exigence la pratique de la définition univoque et donc la lutte contre l’image, source
inévitable de surdétermination sémantique. Son émergence s’est accompagnée d’une désacralisation
de l’ancien logos et de la possibilité de principe donnée à chacun de soumettre toute opinion au
libre et public examen sur l’Agora. Le passage de l’Apologie de Socrate brise la clôture même de
l’initiation, en liquidant tout mystère et tout secret. En posant la permutabilité en droit des positions
d’interlocution, il fait du lieu d’où se profère le logos philosophique un lieu vide pouvant être
occupé par un sujet quelconque.
Les circonstances historiques très particulières qui ont rendu possible un tel état de fait sont
difficilement reproductibles telles quelles ailleurs. C’est l’écroulement des anciens systèmes de
représentations, avec l’émergence d’une entité inédite qu’est la cité. Il faut insister sur la
contemporanéité extraordinaire du philosophe et du citoyen, et l’écriture utilisée pour la diffusion
du savoir, conditions non réunies même pour l’Egypte. Et parce que les Grecs eux-mêmes n’ont pas
philosophé de tout temps, on ne devrait éprouver aucune gêne à admettre que la philosophie, telle
qu’elle est apparue dans les cités grecques des VIe et Ve siècles, constitue un tel accident de
l’histoire qu’on est bien fondé à parler de « miracle ». Que cette particularité, par ce que je qualifie
de chance inouïe de l’Occident, en soit venu à conquérir la planète n’autorise pas à parler de
métaphysique bantoue ou de philosophie yoruba comme si cela allait de soi ou comme s’il y avait là
un brevet d’humanité. Dans sa riche diversité, l’humanité ne résout pas les tâches qu’elle ne se pose
pas, et n’a pas besoin de se poser selon le contexte. Partout et toujours, elle a bien pensé, mais en
fonction des défis à relever et des moyens dont elle disposait. Entre autres, le système d’archivage
du savoir qu’elle était en mesure de mobiliser conformément à ses objectifs.
Contextualiser la philosophie, c’est ce qui me paraît essentiel, pour penser la singularité de
sa naissance, ainsi que les accidents de l’histoire qui en ont permis la diffusion et les
enrichissements successifs. C’est, me semble-t-il, une perspective féconde pour comprendre que des
hommes historiquement, géographiquement et pourquoi pas politiquement situés puissent penser
philosophiquement hic et nunc ce qui constitue en propre leurs sociétés dans leur passé, leur présent
et leurs projets. Nous avons-nous-mêmes tenté de le faire pour ce qui concerne les sociétés
traditionnelles africaines, en tentant de mettre à leur juste place le statut et le fonctionnement de
leurs savoirs et de leurs savoir faire, sans nous priver de signaler ce qui y constituaient de véritables
impasses. A vrai dire la chance inouïe des penseurs africains actuels, placés au confluent de
plusieurs héritages, est de bénéficier de ce que, dans un texte produit à l’occasion d’un autre
cilloque, je qualifie de «double mémoire ».
A côté de la Critique de la raison pure de Kant ou de l’Ethique de Spinoza, ils ont dans leur
champ de réflexion les maximes du sage Kothie Barma Fall le sénégalais, contemporain de
Descartes, et l’étonnante cosmogonie venue du fond des âges rapportée à Marcel Griaule par le
dogon Ogotemmêli sur les falaises de Bandiagara. C’est tout ce legs qu’ils ont à penser et à
repenser, à problématiser et à dépasser peut-être dans des synthèses inédites pour, à l’échelle de la
mondialisation articuler en direction de leurs autres collègues un message qui n’aura de limites que
celles de leur audace théorique.
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Recettes Du Blog de La Geomancie AfricaineDocument194 pagesLes Recettes Du Blog de La Geomancie AfricaineBapsbabcar Sow88% (16)
- Les Recettes Du Blog de La Geomancie AfricaineDocument194 pagesLes Recettes Du Blog de La Geomancie AfricaineBapsbabcar Sow88% (16)
- Les Recettes Du Blog de La Geomancie AfricaineDocument194 pagesLes Recettes Du Blog de La Geomancie AfricaineBapsbabcar Sow88% (16)
- Akayovu On N'en Parlera Plus. de L'histoire, Ce Mal EntenduDocument7 pagesAkayovu On N'en Parlera Plus. de L'histoire, Ce Mal EntenduAkayovu Arts To UbwengePas encore d'évaluation
- (Situations Et Perspectives) Fabien Eboussi Boulaga - La Crise Du Muntu - Authenticité Africaine Et Philosophie-Presénce Africaine (2013 (1977) )Document121 pages(Situations Et Perspectives) Fabien Eboussi Boulaga - La Crise Du Muntu - Authenticité Africaine Et Philosophie-Presénce Africaine (2013 (1977) )Teresa AlcántaraPas encore d'évaluation
- Traité de Santé Et de Longevité ActiveDocument32 pagesTraité de Santé Et de Longevité ActiveThomas Desrosiers100% (1)
- TD SVT3-Dhouha 2018-2019 - Géologie de La TunisieDocument44 pagesTD SVT3-Dhouha 2018-2019 - Géologie de La Tunisieسالم شعبان100% (3)
- Analyse Comparative de La Met Et de La MebDocument23 pagesAnalyse Comparative de La Met Et de La MebSoumaïla OuédraogoPas encore d'évaluation
- Problematique de La Philosophie AfricaineDocument3 pagesProblematique de La Philosophie AfricaineYawilhit Calixte100% (2)
- Dossou Y. Davy: Philosophie Africaine: Principaux Courants Et PerspectivesDocument20 pagesDossou Y. Davy: Philosophie Africaine: Principaux Courants Et PerspectivesUlrich LontsiPas encore d'évaluation
- Ethnophilosophie Le Mot Et La Chose - P.J. - HountondjiDocument9 pagesEthnophilosophie Le Mot Et La Chose - P.J. - HountondjiChristian Cuniah50% (2)
- Séverine Kodjo-Grandvaux - Philosophies Africaines-Présence Africaine (2013)Document303 pagesSéverine Kodjo-Grandvaux - Philosophies Africaines-Présence Africaine (2013)Mateus Raynner André100% (2)
- La Philosophie Bantoue PDFDocument10 pagesLa Philosophie Bantoue PDFPaulo MarquesPas encore d'évaluation
- PhiloDocument10 pagesPhiloBoom Shine100% (1)
- Lecture Des CaurisDocument33 pagesLecture Des CaurisRaymond Edimo50% (2)
- Litterature Orale Et Civilisation de 1'oralite en AfriqueDocument25 pagesLitterature Orale Et Civilisation de 1'oralite en AfriqueffitouirPas encore d'évaluation
- Cours L1 Philo Afric Abad Kout-1Document25 pagesCours L1 Philo Afric Abad Kout-1john AkaPas encore d'évaluation
- Ernest-Marie Mbonda - Les Paradoxes de La Philosophie AfricaineDocument15 pagesErnest-Marie Mbonda - Les Paradoxes de La Philosophie AfricainewandersonnPas encore d'évaluation
- Louis-Roi-Boniface Attolodé - L'idée de Philosophie AfricaineDocument19 pagesLouis-Roi-Boniface Attolodé - L'idée de Philosophie Africainewandersonn100% (2)
- Ustrés Et Déçus Des Tracasseries de La ColonisationDocument12 pagesUstrés Et Déçus Des Tracasseries de La Colonisationhamtid2010Pas encore d'évaluation
- Souleymane Bachir Diagne - Revisiter 'La Philosophie Bantoue'. L'idée D'une Grammaire PhilosophiqueDocument10 pagesSouleymane Bachir Diagne - Revisiter 'La Philosophie Bantoue'. L'idée D'une Grammaire PhilosophiquewandersonnPas encore d'évaluation
- Theme de MemoireDocument46 pagesTheme de Memoireemana44100% (1)
- Sujets Traités Philo TerminaleDocument33 pagesSujets Traités Philo TerminaleRostevi Bibis100% (1)
- Cours Optionnel de Cosmologie L2 Ufhb 2013Document23 pagesCours Optionnel de Cosmologie L2 Ufhb 2013Emmanuel DavisPas encore d'évaluation
- Reflexions Icono Préco 2Document2 pagesReflexions Icono Préco 2Marina PapayaPas encore d'évaluation
- Expose La Philosophie AfricaineDocument10 pagesExpose La Philosophie Africaineouedraogoabdourachide9100% (1)
- La Philosophie en AfriqueDocument5 pagesLa Philosophie en AfriqueDavePas encore d'évaluation
- INTRODUCTIO1Document7 pagesINTRODUCTIO1Alpha MARAPas encore d'évaluation
- 11 Philosophie Africaine-1Document2 pages11 Philosophie Africaine-1Elimane ThiamPas encore d'évaluation
- Ali BenaliDocument346 pagesAli Benalimidou89Pas encore d'évaluation
- Introduction A La PhilosophieDocument6 pagesIntroduction A La PhilosophieRuan ShadowPas encore d'évaluation
- .EpubDocument392 pages.EpubRamiara RamiaraPas encore d'évaluation
- 7 - La Littérature Orale AfricaineDocument8 pages7 - La Littérature Orale Africainegorguy60% (5)
- LLL - Les Littératures en Langues Africaines Ou L'inconscient Des Théories Postcoloniales PDFDocument12 pagesLLL - Les Littératures en Langues Africaines Ou L'inconscient Des Théories Postcoloniales PDFdrago_rossoPas encore d'évaluation
- THL 2183Document134 pagesTHL 2183Zoubaida HammamiPas encore d'évaluation
- Cours D'histoire de Philosophie Africaine Plan 2021-2022Document172 pagesCours D'histoire de Philosophie Africaine Plan 2021-2022Emmanuel BakunguPas encore d'évaluation
- L'exposé Sur L'idée D'une Philosophie AfricaineDocument3 pagesL'exposé Sur L'idée D'une Philosophie AfricaineGackou Albert100% (3)
- Querelle Enfant NoirDocument14 pagesQuerelle Enfant NoirdarlinebalePas encore d'évaluation
- Cea 198 0419Document35 pagesCea 198 0419Diego MarquesPas encore d'évaluation
- 2014PA030178Document310 pages2014PA030178Ouazzani KhalidPas encore d'évaluation
- Théorie Critique Et Modernité Négro-Africaine - Chapitre II. La Philosophie Africaine - Discours de Maitrise - Éditions de La SorbonneDocument85 pagesThéorie Critique Et Modernité Négro-Africaine - Chapitre II. La Philosophie Africaine - Discours de Maitrise - Éditions de La SorbonneGhislaine LalaPas encore d'évaluation
- Thme I - La Problematique de La Philosophie en AfriqueDocument4 pagesThme I - La Problematique de La Philosophie en AfriquePatrick NgondamaPas encore d'évaluation
- Etudesafricaines 16181Document31 pagesEtudesafricaines 16181Aboubacar DoucouréPas encore d'évaluation
- 2020 Litterature Orale AfricaineDocument20 pages2020 Litterature Orale AfricaineMaurice KamdoumPas encore d'évaluation
- Proc 12 Kha TibiDocument33 pagesProc 12 Kha TibiAdil KorchiPas encore d'évaluation
- L'invention de L'afrique Gnose, Philosophie Et Ordre de La ConnaissanceDocument512 pagesL'invention de L'afrique Gnose, Philosophie Et Ordre de La ConnaissanceLendou Djibril Koffi100% (5)
- Cours de PhiloDocument46 pagesCours de PhiloNdoupendjiPas encore d'évaluation
- Une Culture Sans Qualités Autour D' Europe, La Voie RomaineDocument15 pagesUne Culture Sans Qualités Autour D' Europe, La Voie RomainePaulo AlvesPas encore d'évaluation
- 5003 Article Version PublieeTRANSHUMANCE OU STRUGGLEFORLIFISME CULTUREL AFRICAIN ? CAS DE LA CULTURE SONGYE1 PAR KASENDWE MALALA ConstantinDocument8 pages5003 Article Version PublieeTRANSHUMANCE OU STRUGGLEFORLIFISME CULTUREL AFRICAIN ? CAS DE LA CULTURE SONGYE1 PAR KASENDWE MALALA ConstantinConstantin KasenduePas encore d'évaluation
- Provenzano FrancophonieDocument17 pagesProvenzano Francophoniechilis32889Pas encore d'évaluation
- Mémoire Collective Et Sociologie Du BricolageDocument17 pagesMémoire Collective Et Sociologie Du BricolagearvPas encore d'évaluation
- Banza Mwepu Mulundwe Et Mohota Tashahwa - Mythe, Mythologie Et Philosophie AfricaineDocument220 pagesBanza Mwepu Mulundwe Et Mohota Tashahwa - Mythe, Mythologie Et Philosophie AfricainewandersonnPas encore d'évaluation
- Extrait Mongo Beti PDFDocument15 pagesExtrait Mongo Beti PDFIBRAHIMA GUEYEPas encore d'évaluation
- Provided by Réseaux de Chercheurs - CRITAOIDocument14 pagesProvided by Réseaux de Chercheurs - CRITAOImst048355Pas encore d'évaluation
- Philosophie AfricaineDocument4 pagesPhilosophie AfricaineAlphonse Dominique Marie MbengPas encore d'évaluation
- Les Prédiscours - Discours Et Cognition - Une Nouvelle Perspective en Analyse Du Discours - Presses Sorbonne NouvelleDocument8 pagesLes Prédiscours - Discours Et Cognition - Une Nouvelle Perspective en Analyse Du Discours - Presses Sorbonne Nouvelleyousra.aissaoui.flshPas encore d'évaluation
- Variations DécolonialesDocument16 pagesVariations DécolonialesBárbara BragatoPas encore d'évaluation
- L'afrique - Hommes Et Culture À L'épreuve Du StéréotypeDocument7 pagesL'afrique - Hommes Et Culture À L'épreuve Du Stéréotypeabbes18Pas encore d'évaluation
- Comment Philosopher en Afrique Aujourd'Hui (PDFDrive)Document126 pagesComment Philosopher en Afrique Aujourd'Hui (PDFDrive)Raïs MahoungouPas encore d'évaluation
- Je Partage Philosophie Dissertation TD Avec VousDocument32 pagesJe Partage Philosophie Dissertation TD Avec VousPatrick NgondamaPas encore d'évaluation
- Sur la philosophie africaine: Critique de l�ethnophilosophieD'EverandSur la philosophie africaine: Critique de l�ethnophilosophiePas encore d'évaluation
- Criture Et Oralit Dans Loeuvre de Calixthe BeyalaDocument24 pagesCriture Et Oralit Dans Loeuvre de Calixthe BeyalamkoffietranhanssaviolaPas encore d'évaluation
- De Quelle Philosophie L'afrique D'aujourd'hui A-T-Elle Besoin Pour Se DevelopperDocument23 pagesDe Quelle Philosophie L'afrique D'aujourd'hui A-T-Elle Besoin Pour Se DevelopperChrist carel NGUENGA NDZEDIPas encore d'évaluation
- Bell Hooks, 'Choisir La Marge Comme Espace D'ouverture Radicale'Document10 pagesBell Hooks, 'Choisir La Marge Comme Espace D'ouverture Radicale'Camille BardinPas encore d'évaluation
- Le Disciple de La Colombe: Une OEuvre Poétique En Hommage à Malcolm XD'EverandLe Disciple de La Colombe: Une OEuvre Poétique En Hommage à Malcolm XPas encore d'évaluation
- Les Secrets de La Sourate Al QadrDocument36 pagesLes Secrets de La Sourate Al QadrZakaria Samake88% (8)
- IMMFORM202306Document2 pagesIMMFORM202306fallou gueyePas encore d'évaluation
- IMMFORM202306Document2 pagesIMMFORM202306fallou gueyePas encore d'évaluation
- Cours Automatisme Première PartieDocument32 pagesCours Automatisme Première PartieRabbiPas encore d'évaluation
- Activites Masse Et PoidsDocument2 pagesActivites Masse Et PoidsMatt gamePas encore d'évaluation
- 2017 Nassori DouniaDocument158 pages2017 Nassori DouniaMohamedElKatarPas encore d'évaluation
- CC 2 CommandeDocument2 pagesCC 2 CommandeChampion NgangoumPas encore d'évaluation
- 1C Theme 4 PDFDocument20 pages1C Theme 4 PDFphilippe dmtPas encore d'évaluation
- 3 Cra Developper Les Perf de L'espace Co & Eval Action Co E42Document5 pages3 Cra Developper Les Perf de L'espace Co & Eval Action Co E42claude.cadassePas encore d'évaluation
- Francés 1 Guía de Estudio para Semana 13 Al 17Document13 pagesFrancés 1 Guía de Estudio para Semana 13 Al 17roseannefigueroaPas encore d'évaluation
- Révision Grammaticale Niveau A2Document6 pagesRévision Grammaticale Niveau A2Kathia RiosPas encore d'évaluation
- Support Cours Itil4Document158 pagesSupport Cours Itil4Kamel KhelifiPas encore d'évaluation
- Nperrin 2005 - La Méthode Inductive, Un Outil Pertinent Pour La Formation Par La RechercheDocument16 pagesNperrin 2005 - La Méthode Inductive, Un Outil Pertinent Pour La Formation Par La RechercheNPPas encore d'évaluation
- Hicham 12Document2 pagesHicham 12Hicham KhalPas encore d'évaluation
- 1MRK505366-BFR B FR Guide de L Acheteur Protection Differentielle de Ligne RED650 2.1Document82 pages1MRK505366-BFR B FR Guide de L Acheteur Protection Differentielle de Ligne RED650 2.1Top TopPas encore d'évaluation
- Exercice Sur Les MomentsDocument3 pagesExercice Sur Les MomentsDiagne100% (3)
- Cahier Technique BD 21-12-11Document16 pagesCahier Technique BD 21-12-11ThareaultPas encore d'évaluation
- Maintenance 2007 UltrasonsDocument79 pagesMaintenance 2007 Ultrasonsmarmara161616Pas encore d'évaluation
- Équipement: Une Aventure ExtraordinaireDocument119 pagesÉquipement: Une Aventure ExtraordinaireLa PerformancePas encore d'évaluation
- Leçon 1 Communication MédiasDocument8 pagesLeçon 1 Communication MédiashaidaraPas encore d'évaluation
- 11 UnesequencedequatriemeDocument12 pages11 UnesequencedequatriemeMax FournierPas encore d'évaluation
- Relation Caraman Siege-ConstantineDocument88 pagesRelation Caraman Siege-ConstantineAbdelaziz ArdjPas encore d'évaluation
- Les Grands Penseurs Du Langage-2019Document129 pagesLes Grands Penseurs Du Langage-2019Jaâfar NASRANEPas encore d'évaluation
- Traitement D'une Eau Naturelle Polluée Par Adsorption Sur Du Charbon Actif (CAK) Préparé À Partir de Tourteaux de Karité - Archive Ouverte HALDocument4 pagesTraitement D'une Eau Naturelle Polluée Par Adsorption Sur Du Charbon Actif (CAK) Préparé À Partir de Tourteaux de Karité - Archive Ouverte HALKOLANIPas encore d'évaluation
- Evalu Perfor Analy Du Biuret.Document3 pagesEvalu Perfor Analy Du Biuret.NouriPas encore d'évaluation
- Mon Premier Sujet de ReflexionDocument2 pagesMon Premier Sujet de ReflexionBekaraPas encore d'évaluation
- Fiches de Maths Pour Le BrevetDocument5 pagesFiches de Maths Pour Le BrevetMaelys BressonPas encore d'évaluation
- Ecluses Csne Groupement OneDocument3 pagesEcluses Csne Groupement OnebediangPas encore d'évaluation
- Quiz Tissu Conjonctif OrdinaireDocument53 pagesQuiz Tissu Conjonctif OrdinaireRania MaddahPas encore d'évaluation
- Bal - 21000-05-03 LTM 1200-5.1Document1 702 pagesBal - 21000-05-03 LTM 1200-5.1Mamadou djibril Ba100% (2)