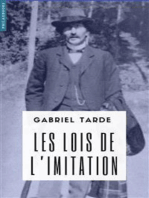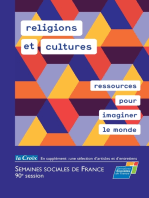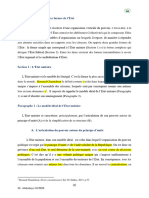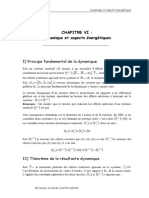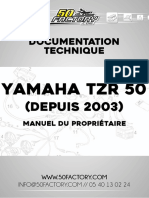Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Urfalino Consensus
Urfalino Consensus
Transféré par
Tomas BredestonCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Urfalino Consensus
Urfalino Consensus
Transféré par
Tomas BredestonDroits d'auteur :
Formats disponibles
La décision par consensus apparent: Nature et propriétés
Author(s): Philippe Urfalino
Source: Revue européenne des sciences sociales , 2007, T. 45, No. 136, Démocratie
délibérative, démocratie débattante, démocratie participative (2007), pp. 47-70
Published by: Librairie Droz
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/40370631
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
Librairie Droz is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Revue
européenne des sciences sociales
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Revue europeenne des sciences sociales, Tome XLV, 2007, N° 136, pp. 47-70
Philippe URFALINO
LA DECISION
PAR CONSENSUS APPARENT
Nature et proprietes1
Les philosophes et les politologues dont les reflexions visent a promouvo
une democratic deliberative privilegient un mode de decision collective le p
souvent denomme « decision par consensus ». Us rejoignent sur ce point pr
certains mouvements politiques alternatifs et protestataires (ecologistes, fe
nistes, mouvements de patients). Les uns et les autres estiment preferable que
decisions soient prises a Tissue d'une longue discussion permettant de degage
consensus plutot que par un vote, notamment a la majorite. Le consensus est
ferable a la regie de majorite pour au moins deux raisons : le souci de parvenir a
consensus exige une ecoute de tous les points de vue et permet plus facilemen
participation de chacun a la discussion ; la participation de tous a la deliberatio
1' exigence de consensus accroissent la qualite et la legitimite de la deci
(Cohen [1989]). II n'est pas rare que 1' argumentation en faveur d'une democr
deliberative fasse reference a des precedents historiques, et notamment a la
valence dans presque toutes les societes «traditionnelles» de ce qu'on appelle
Afrique la palabre. Ainsi James Fishkin (1991) mentionne-t-il l'exemple
assemblies Quaker ou la discussion continuait jusqu'a l'obtention d'un consen
sus, de telle maniere qu'aucune decision ne pouvait etre prise contre la volon
Tun d' entre eux. De la meme fa^on, Amartya Sen (2005), dans une reflexion
les racines non occidentales de la democratic, qui l'amene a en privilegi
dimension deliberative, illustre par la tradition de la palabre l'existence d'u
culture politique du debat public et ouvert a tous, hors de 1' Occident. Le lien en
democratic et palabre, theme ancien, est reactive via un extrait remarquab
1' autobiographic de Nelson Mandela. L' ancien leader de 1' Afrique du S
explique que sa conception du commandement fut profondement influencee p
deroulement des reunions tribales de la societe Thembu qu'il avait pu obser
dans sa jeunesse :
«Tous ceux qui voulaient parler le faisaient. C'etait la democratic sou
forme la plus pure. II pouvait y avoir des differences hierarchiques entre ceu
parlaient, mais chacun etait ecoute, chef et sujet, guerrier et sorcier, boutiqui
agriculteur, proprietaire et ouvrier. Les gens parlaient sans etre interrompus e
reunions duraient des heures. Le gouvernement avait pour fondement la libe
d' expression. . . . Les reunions duraient jusqu'a ce qu'on soit arrive a une sor
1 La redaction de ce texte a grandement benefici6 des discussions que j'ai pu avoir avec Bern
Manin et Pasquale Pasquino. Par ailleurs, les commentaires de Catherine Ales, Alban Bouvier, Seb
tien Dalgalarrondo, Boris Hauray, Philippe de Lara, Gabriel Nardacchione et Gudrun Urfalino m
permis d'ameliorer une premiere version de ce texte. Je les en remercie tous tres chaleureusem
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
48 PHILIPPE URFALINO
consensus. Elles ne pouvai
Cependant, l'unanimite po
moment plus propice pou
devait ecouter tous les hom
tant que peuple. La regie d
devait pas etre ecrasee pa
Le propos de cet article n
sion par consensus ou d'ex
modernes. Mon propos es
cite de ce mode de decision
vote a la majorite et a l'u
seulement la reflexion sur
theorie des decisions colle
conceptuelle me parait uti
vail n'a pas ete integralem
En effet, les reflexions s
criptions des ethnologues,
La sequence finale de ce qu
sion a l'unanimite » n'est
comprendre que, a la fin,
auteurs ne decrivent pas l
donne les moyens de repon
rendent-ils compte que, d
collective est prise?
Dans une premiere parti
nibles dans la litterature p
rai la decision par conse
caracteristiques et les pro
a l'inverse du vote, n'a pas
1. UN PROBLEME DE DESCRIPTION
«Les Navahos n'ont pas la notion de gouvernement representatif. Ils ont l
bitude de decider de toute question dans des rencontres de tous les individ
concernes... Traditionnellement, ils ne prennent une decision qu'apres en a
discute jusqu'a ce que l'unanimite soit reunie, ou jusqu'a ce que l'oppos
trouve inutile de continuer a soutenir son point de vue ». Cette maniere de pren
collectivement des decisions, decrite en 1946 par Clyde Kluckhon et Dorot
Leughton pour les Indiens Navahos2, semble bien avoir ete le mode de decisi
plus repandu dans l'histoire des societes humaines. L'anciennete et la presenc
tous les continents de ce mode de decision dit tantot «par consensus », tanto
l'unanimite », sont attestees par les travaux des ethnologues et des histori
C'est le seul mode de decision mentionne pour les societes de chasseurs cueil
2 The Navaho, Cambridge, Massachusetts, 1946, cite par Bertrand de Jouvenel (1977, p.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA DECISION PAR CONSENSUS APPARENT 49
(Baechler [1994], Silberbauer [1982]); il etait egale
sion collective legitime dans les communautes
[2000]), en Afrique noire (Abeles [2003], Terra
[1979], Smith [1959]). Les communautes villag
Age avaient egalement 1' usage des assemblies del
sions sans vote, notamment dans le centre et le N
(cite par Dumont [1983], p. 99) a note la prevalen
germanique; l'assemblee des chefs de clans islanda
doute de la meme maniere (Byock [2001]). Le souc
encore dans les decisions au sein de certains villag
cinquante ans (Yngvesson [1978] pour la Suede, Ba
Par ailleurs, les techniques de vote n'ont ete pra
la plupart des societes, et notamment via la mod
l'initiateur puis le diffuseur. L'Europe occidentale
t-il, la memoire des techniques electorates de l'an
c'est principalement au sein des ordres monastiqu
niques furent redecouvertes (Moulin [1958], Gaud
aux assemblies politiques provinciates. La colonisa
ete les principaux vecteurs de la diffusion de la p
niveau des villages, en Afrique et en Asie.
Bref, le consensus ou l'unanimite semblent avoir
lective predominant dans la quasi-totalite des socie
ne tende a le remplacer. Pourtant, les descriptions
decision par consensus ou decision a l'unanimite s
(1.1). Rares sont celles qui rendent compte pre
consensus ou cette unanimite sont constates par le
cription de la maniere par laquelle la decision col
prendre conscience de 1' usage frequent, y compris
ce mode de decision (1.3).
Une precision s'impose ici, avant d'examiner le
des decisions collectives. Certaines descriptions peu
santes, parce que le lecteur y cherche ce qu'il ne p
cription precise des decisions collectives, par exem
nologiques, ne tient pas toujours au faible intere
Cette absence est parfois le reflet de ce que la not
n'est pas pertinente pour la societe qu'il etudie. E
notion suppose que la decision prise collectivemen
membres en faveur du respect de sa mise en oeuvr
ment amerindiennes, ne connaissent pas un tel p
Catherine Ales sur les premisses des raids collectif
Yanomami, montrent que la succession de prises de
precede l'expedition ressemble mais ne s'apparent
decision collective. Malgre l'interdependance des
sonnees voisines - et le fait que tout le monde, par
3 Le vote a la majorite etait egalement present dans les m
[2003]) et plus generalement dans les monasteres bouddhique
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
50 PHILIPPE URFALINO
de patir de ses consequen
prises de parole (Ales [200
a chacun d'evaluer ce qu'il
coordination et l'interdep
lective. Cette observation
la regie d'unanimite ment
pond sans doute pas a de
permettant de constater
maniere dans son excursu
II va de soi que s'il n'y a p
bleme de sa description. L
tes et des situations ou la
quences concernent la colle
elle fait l'objet d'une trava
tion a un «dictateur» au
membres du groupe consi
1.1. La decision a l'unan
II est possible de generali
litterature ethnologique,
une caracteristique frustr
l'Est: meme quand elles s'
dership et le controle socia
une activite qui apparait,
vie publique de ces societe
decisions qui concernent t
compte des progres realis
qui m'interesse ici, je dira
mais forts riches (Detienn
sion, l'essentiel de la descr
tion des participants, le d
Aussi, alors meme que l'u
jours mentionne, la manie
ment et surtout permetten
Ce probleme de descriptio
donnees suffisamment pr
decision qui n'occupe qu'u
valence intellectuelle du modele du vote. Je mentionnerai deux etudes remar-
quables pour illustrer ce point.
Le livre de Samuel Popkin (1979) est une reference majeure pour Implication
du paradigme de l'individualisme methodologique a l'etude des societes pay-
sannes. II y precise que jusque dans les annees 30 et 40, dans les villages du Sud
Vietnam, les decisions collectives etaient prises a T unanimite; et il explique la
prevalence de cette regie de decision par le systeme d'interdependance dans les-
quels sont pris les villageois : une decision collective peut avoir des consequences
dramatiques pour une famille, d'ou le caractere adapte d'une regie qui accorde a
chacun un droit de veto, tandis que la division sexuelle du travail permet d' absorber
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA DECISION PAR CONSENSUS APPARENT 5 1
le temps depense pour se mettre d' accord (les ho
femmes et enfants travaillent). Quel que soit l'intere
noter que l'ouvrage, qui utilise des donnees de sec
description du fonctionnement des conseils de vi
savoir si 1' unanimite requise est attestee par un vo
L' etude de Marc Abeles sur les assemblies dans
pie meridionale, offre au lecteur une description b
de decision collective. Ici l'auteur precise que le vo
s'appuie sur le contraste entre le vote majoritaire qu
sion qui exige un consensus ou une unanimite (les d
sans vote. Mais le lecteur ne sait pas comment l'un
aux participants. La citation d'un extrait est necess
probleme de la description :
« Quand il juge que la reunion a suffisamment avance, le
thetiser les debats et d'emettre une proposition qui facilit
qu'une unanimite se degage au terme des deliberations. A
corps une veritable opinion dominante qui s'affirme au
frages. II n'y a pas de vote, il n'est pas question de compt
sus se produise, faute de quoi il apparait preferable de c
le debat par la suite. ... L'assemblee n'equivaut pas a
citoyens. C'est ce qu'exprime clairement le mode de dete
n'est pas question d'additionner des voix. Ce qui importe
veritable unanimite.» (Abeles [2003], p. 400 et 404).
La description fine de Marc Abeles butte ici sur
D'un cote, il souligne que la pensee politique des Oc
vidualisme politique, l'assemblee n'est pas con£ue
citoyens et la legitimite de la decision collective n'
tion des parcelles individuelles de souverainete. D
comment pourrait etre constate 1' achievement de la
ment que de maniere additive, puisque ce consensus
unanimite ». L' expression semble indiquer qu'il y a
approuve la meme option. Comment les Ocholos co
l'unanimite? II est remarquable qu' Abeles util
(« emporter tous les suffrages ») au moment meme
se realise sans vote. Mais comment constater l'unan
des participants a exprime de quelque maniere (mai
approbation a l'egard de la meme option, soit bien
constat de l'unanimite impose une sorte de vote. Au
a l'unanimite parait-elle contradictoire avec 1' obse
Ainsi Popkin oppose-t-il 1' usage de la regie de m
sans pouvoir preciser si cette unanimite est attest
miens par un vote. Tandis qu' Abeles insiste sur le
sus, mais 1' assimilation de ce consensus a une unan
prehensible 1' absence d'un vote, aussi informelle q
opinions. Dans les deux cas, meme si c'est a des deg
tion est insuffisante. II manque une partie du pro
pourtant essentielle : sa terminaison, la maniere par
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
52 PHILIPPE URFALINO
1.2. Un mode d'arret de la decision collective
Le probleme de description des travaux mentionnes precedemment tient a ce
qu'ils ne permettent pas de repondre a la question suivante. La decision par
consensus correspond-elle a un mode d'arret de la decision different de celui
observe dans les procedures de vote? Deux etudes nous permettent de repondre
tres exactement a cette question.
La decision par consensus dans un village du Soudan
L' etude de Sherif El-Hakim sur les processus de decision dans un village du
Soudan, observes en 1970 et 1971, fait exception dans la litterature ethnogra-
phique par son attention pour la procedure d'arret collectif de la decision4. Les
deux mille habitants de Khuriet, generalement issus de la meme ancienne tribu
nomade arabe, vivent pour la plupart de petites cultures et de l'elevage de cha-
meaux, de moutons et de chevres. Le village est compose de dix hameaux entou-
rant une aire centrale comprenant le court du Sheikh, la place du marche, le centre
de distribution d'eau, un dispensaire et deux mosquees. La participation aux deci-
sions touchant la collectivite est regie par deux principes. II y a d'abord des
« notables » ou des personnages disposant d'une certaine autorite, celle-ci etant
souvent associee a des responsabilites. Ces notables ont un role et un poids speci-
fique dans les decisions collectives. Le deuxieme principe est que tout villageois
a le droit de participer des lors que la decision touche ses interets. La ou leurs inte-
rets sont engages, les villageois estiment, et se voient reconnaitre, le droit de par-
ticiper. Seuls les hommes, constamment impliques dans divers conciliabules pen-
dant que femmes et enfants assurent l'essentiel de l'activite productive du village,
participent aux frequentes et longues reunions du village. L' initiative d'une
reunion en vue d'une decision collective ne peut etre le fait de n'importe quel vil-
lageois, mais seulement des plus influents d'entre eux. L'annonce d'une telle
reunion se fait par bouche a oreille. On prend soin de faire en sorte que les gens
concernes par les decisions a prendre soient informes et puissent etre presents a la
reunion. Les gens s'acheminent alors vers la place principale, par petits groupes
de deux ou trois, et discutent les uns avec les autres en attendant que le nombre des
presents s'accroisse. Cette periode d'attente peut durer une heure et cesse quand
un notable prend la parole et presente longuement le but de la reunion, les donnees
du probleme qu'elle doit traiter, les opinions emises lors des reunions informelles
anterieures. Cela se fait dans le plus grand silence, sauf si quelqu'un souligne l'ab-
sence d'un villageois concerne, ce qui exige une discussion pour savoir si cette
absence est dommageable ou pas. Enfin, celui qui a pris la parole conclut son dis-
cours en exposant ce qui lui semble etre la solution. De nombreuses voix s'elevent
en meme temps, certains donnent leur opinion au groupe qui discute a proximite,
d'autres client et gesticulent pour attirer l'attention de tous. Au bout d'un certain
temps, pendant lequel l'agitation et le brouhaha s'apaisent puis s'elevent plusieurs
fois, le silence se fait pour ecouter un homme, toujours different de celui qui avait
ouvert la reunion, qui presente ce qui lui semble etre le consensus degage par la
discussion. Trois cas de figure sont alors envisageables.
4 Cette exception est sans doute a mettre en relation avec 1' usage de la theorie de la decision col-
lective de Coleman (1966), reference rarement mobilisee en ethnologic
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA DECISION PAR CONSENSUS APPARENT 53
- Si a la suite de cette proposition de consensus,
quiescement sont entendues, sans autres complic
vient que d'un ou deux participants pendant que
cieux, la reunion prend fin et la proposition eno
lective.
- Dans les rares cas ou la proposition est explicite
brouhaha rompent la reunion.
- Le plus souvent, si des disaccords sont exprime
Us sont manifestos indirectement par 1' introduct
ont peu de relation avec le probleme en discussio
former l'enjeu de la reunion. Alors l'assemblee r
desordonnee jusqu'a ce qu'une autre proposition,
consensus, soit avancee de la meme maniere que
velles propositions ne peuvent emerger ou si el
tees, le temps passant, la reunion s'acheve sans d
Les decisions sur les bateaux de peche suedois
Dans les assemblies que nous venons de decrire, a
des opinions n'est perceptible, aucune regie formelle
lisee. Barbara Yngvesson (1978) a note la meme ab
a observees en 1967 et en 1968 dans une communaute
de la cote ouest de la Suede. Au sein des bateaux de
semblee qui tient lieu de corps politique de Tile, reg
decisions collectives y suivent le meme protocole. Q
etre prise lors d'une sortie en mer, par exemple c
membre de l'equipage ne saurait, fut-il l'un des prop
choix. La decision doit etre collective. Celle-ci res
pecheurs propose un changement de localisation, sou
suit une periode de temps d'au moins une demi-heu
dues ; 3) en 1' absence de contre-propositions, le mem
et le bateau rejoint la zone annoncee. Le conseil de
partir des propositions de son president de seance.
Les deux monographies de El-Hakim et d' Yngv
tion precise de la maniere dont est arretee la dec
n'est pas suivie par un vote, mais par remission d'
de propositions censees correspondre a un consens
un denombrement des opinions, mais par le const
la derniere proposition emise.
1.3. Inventaire d'un usage
Pour des raisons explicitees plus loin, je prop
consensus apparent» ce mode de decision collectiv
ses caracteristiques, il apparait que son usage est pl
Pour ma part, les lectures et les enquetes que
assemblies deliberantes, m'invitent a distinguer t
occurrence: 1) dans les societes etudiees par les et
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
54 PHILIPPE URFALINO
rassemblerai ces emplois
pages, le terme etant pri
nentes, sages, savants, ma
assemblies ou commission
parmi lesquels la decisio
comme un expedient.
La palabre. Sherif El-Hak
sequence negligee par les
de l'arret de la decision. O
que des decisions a l'unani
que j'appelle desormais la
ture que je ne peux ici tra
d'autant plus plausible qu
sont precises, plus elles se
decision par consensus app
la liste des caracteristiques
suivant, par degre de prec
sus; 2) affirmation de 1'
nimite reelle mais au cons
de consensus facilitent la
consensus n'est plus cont
j'ai pu rassembler me sem
laquelle la description la p
Quoiqu'il en soit, on com
societes marquees par une a
pendance des interets indi
1' occurrence les hommes
necessaires a ce mode de
decision n'est pas observa
usages que je vais menti
modernes.
Les areopages. Le vote est le modele dominant des decisions collectives dans
les societes occidentales, et ce bien au-dela des seules elections politiques. Pour-
tant, on y rencontre des organes deliberatifs qui rejettent la possibility d'arreter
leur decision par un denombrement des opinions. Le vote est utilise exceptionnel-
lement, comme dernier recours, si les participants ne parviennent pas a un consen-
sus. C'est le cas de certaines cours constitutionnelles (Ferejohn, Pasquino [2002];
Pasquino [2006]) et de certaines commissions d' experts comme celles qui ont la
charge d'autoriser la mise sur le marche des medicaments en Europe et en France
(Hauray [2005], Urfalino [2006]). Les membres de ces areopages, non elus et
depourvus de fonction representative, sont nommes pour leur competence. II
importe de noter que, comme le souligne Pasquino (2006), les decisions en cause
ne sont pas reductibles a 1' alternative oui/non. Face a la question de la constitu-
5 Yngvesson, precise sur l'arret, est beaucoup plus discrete que El-Hakim sur la discussion.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA DECISION PAR CONSENSUS APPARENT 55
tionnalite d'une loi, les arguments qui justifient la
voire plus, importants que son contenu positif ou
demande d'autorisation de mise sur le marche d'un
pas simplement « oui » ou « non », mais « non » tant
pas remplies ou «oui» dans telles conditions tres
decision est arretee quand une proposition finale
paquet de choix et d'attendus, ne suscite plus d' ob
Dans le cas de la palabre, aucun autre mode de d
societaires ne connaissent pas les pratiques du vo
les estiment inadaptees a leur societe (Terray [19
maniere, dans les areopages, le recours au vote est
des cas ou la decision par consensus est utilisee da
missions deliberantes qui par ailleurs pratiquent re
exemples correspondant a ce type d' usage.
Le consensus comme expedient. Le premier e
etude sur les Fonds Regionaux d' Art contemporai
conseil d' administration de ces fonds avait la char
propositions d'achats d'ceuvres d'art contemporain
Dans une partie des regions francaises, la majorite
posaient etait hostile aux choix des experts en fav
des neophytes; en revanche, le president du co
FRAC, souvent un important notable politique reg
l'avis des experts, moins par gout que parce qu'il
niveau international que les experts souhaitaient
renommee de la region. Dans l'une des trois regio
FRAC avait 1' habitude, apres que les ceuvres avaien
ou Ton pouvait s'attendre a un vote, de dire ceci a
nistrateurs : « Chers amis, vous avez ecoute les exp
de grande qualite. Nous n'allons quand meme p
prenne toutes, vous etes d'accord?». Les elus retic
l'homme politique montant de la region, le preside
sans l'expression de disaccords, l'achat des ceuvre
susciter un rejet brutal de son stratageme et
conseillers avait senti - une opposition trop forte
sortir du lot a acheter (Urfalino, Vilkas [1995]).
J'ai pu observer de pres pendant quatre annees l
tion du Comite national de la recherche scientifiqu
tion scientifique en France. Chaque section, c
membres elus ou nommes, assure 1' evaluation des
du Centre National de la Recherche scientifique.
dont la section a la charge (classement des laborato
a une promotion ou a un recrutement) sont prise
6 II importe de preciser que d' autres areopages ayant les me
va ainsi des cours supremes des Etats-Unis et, pour les medicam
Administration. On ne peut aborder ici la reflexion sur ces diff
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
56 PHILIPPE URFALINO
selon la regie de majorite.
et semblant susciter aisem
consensus apparent. C'etai
de deuxieme rang dont l'ob
premier rang : le meilleur
clore le debat sur une quest
cussion, le president de
semble que nous avons suf
Si personne ne contestait 1
sions au vote. II arrivait p
gation du debat. Celui-ci r
sition de passer au vote. D
d'un disaccord prolonge, a
pour departager ceux qui s
passer au vote. On vota do
dant que pour ce vote au c
fut prise selon la regie du
logique du formalisme elec
mode de decision que le vo
au vote.
Le troisieme exemple, le plus documente, est issu d'une etude minutieuse et
systematique des decisions prises au sein d'un parti politique suisse dans le canto
de Berne (Steiner, Dorff [1980]). Utilisant l'interview, l'observation et Tanalys
des documents, Steiner et Dorff ont suivi 111 reunions de ce parti, de Janvier 1969
a septembre 1970. Us y ont observe 466 situations ou une decision devait etre prise,
suite a un disaccord sur une action a entreprendre. Us avaient prevu trois modes d
reglement de ces situations : par un vote a la majorite ; par la formation d'un accord
explicite et oral apres que les partisans d'une option se sont clairement rallies
1' autre option; par la non decision. 37% des 466 cas n'entraient dans aucune de
trois categories envisagees. Les auteurs ont d'abord songe a une categorie resi-
duelle. Puis, ils ont du admettre que ces cas renvoyaient a un quatrieme type cor
respondant a la sequence suivante : apres un temps de discussion, un membre du
groupe donne une interpretation des conclusions qui, selon lui, ressortent du debat.
Si personne ne s'oppose a cette interpretation, celle-ci vaut decision. Grace a l'ob
servation fine des reunions et des conciliabules qui s'ensuivent, les auteurs ont p
estimer que, sur les 170 cas de decision par consensus apparent, 85 avaient une
issue conforme a la majorite des opinions, 19 a une minorite, tandis que 6
denouaient une situation sans majorite detectable. Deux des interrogations de Stei
ner et Dorff face a ces resultats nous interessent plus particulierement. Pourqu
ceux qui continuent a desapprouver la position qui beneficie de l'« interpretation
ne manifestent-ils pas leur disaccord? Pourquoi ne reclament-ils pas un vote,
notamment pour s' assurer qu'ils sont bien minoritaires? La reponse issue de leur
7 Le redoublement de la procedure, voter pour decider de voter ou non, peut paraitre ridicule,
Uderzo en fit l'objet d'un gag dans l'un de ses albums d' Asterix (Goscinny, Uderzo, 1991, p. 22). Pou
autant, la fixation de la duree de la deliberation precedant le vote peut etre un enjeu important, vo
notamment dans le cas du CNRS (Vilkas [1996]).
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA DECISION PAR CONSENSUS APPARENT 57
interviews et observations est la suivante: Ceux q
tion » qui vaut decision - et qui pourtant ne la con
precise de la reelle distribution des preferences, m
d'obtenir la majorite au cas ou ils reclameraient un
rendre patent leur echec et/ou souhaitent ne pas re
legitimite de la position qui remporte par « interpr
Dans ce dernier cas, 1' usage de la decision par
legitimite que son utilisation comme un coup de
FRAC, et n'est pas reserve a des aspects technique
sion, comme dans le cas du CNRS. Utilisee concu
la decision par consensus apparent est cependant
elle est susceptible d'etre rejetee au benefice de ce
importants et que l'assemblee est fortement divise
cipant est en droit de reclamer un vote, la decision
nue dans deux situations : 1) elle semble accelerer
estime conforme au vceu de la majorite ; 2) elle co
cipations de celui qui propose une interpretation
contestee et de ceux qui, tout en la rejetant, prefe
etre minoritaires et ne souhaitent pas que cette m
A l'aide des etudes et des observations inventor
d' examiner les proprietes de ce mode de decision
2. LES PROPRIETES CONSTITUTIVES DE LA DECISION
PAR CONSENSUS APPARENT
L' ensemble des cas et des descriptions que j'ai evoques et parfois resum
dans la partie precedente permet de degager une regie de decision specifique
la difference avec les differentes formes de vote ne me semble pas avoir ete
samment bien estimee. Je propose de nommer decision par consensus app
cette regie de decision specifique, en reference a ses six caracteristiques con
tives :
- C'est une regie d'arret de la decision, au meme titre que les procedures de
vote;
- C'est la constatation collective d'un consensus apparent qui tient lieu de regie
d'arret;
- Elle menage une impression de continuity entre processus et arret de la deci-
sion;
- Cette regie prevaut dans un contexte ou, pour quelque raison, la recherche du
consensus est indexee sur le souci de la qualite de la decision ;
- Le consensus apparent exige non pas l'unanimite mais, a cote de ceux qui
approuvent, le consentement des reticents ;
- La contribution des participants a la decision est marquee par le contraste entre
un droit egal a la participation et une inegalite legitime des influences.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
58 PHILIPPE URFALINO
2.1. Une procedure d'arr
La notion de regie de dec
breuses regies de natures
decisions collectives : celle
participants, l'ouverture e
Le probleme de description
tie de T ensemble du proc
d'une intention d'agir. C'e
Sherif El-Hakim et de Ba
autres descriptions. Aussi
employee dans le sens rest
On peut conjecturer que l
rature ethnologique tiennen
conception de la decision c
techniques electorates. Cel
sion par consensus appare
de maniere informelle. P
l'usage du terme « decisio
quand, faute d'un vote, ri
dans son usage courant, de
de decision n'a pas ete bea
logie des organisations, le
concentre leurs reflexions
des sequences et mecani
resoudre, a la production
Soucieuses de demythifie
elles ont a juste titre mis
1' absorption de la determ
D'ou leur faible interet po
ont considerablement ame
mais ont laisse dans une c
elles ont ignore le concept
decision (Urfalino [2005])
constater que le concept de
decision n'est jamais un e
est vrai ou faux au regard
entreprendre. Ensuite, to
sion. Mais, pour qu'il puiss
un laps de temps entre ce
temps pointe une distinctio
l'arret d'une intention d'ag
processus, ce qui concour
decidee : il y a decision qu
cote, s'interpose l'arret d'
amene ainsi a mettre en av
Or dans le cas d'une deci
pas distinguable de la fin
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA DECISION PAR CONSENSUS APPARENT 59
va tout autrement dans le cas d'une decision collect
ploie ce terme : c'est-a-dire une decision en assemb
collectif et sur laquelle chacun des participants co-
tervenir et de peser directement. Ainsi entendue,
une procedure d'arret collectif.
Or une telle procedure doit satisfaire deux exigenc
que puisse etre determine un arret de la decision (e
faut egalement que cet arret soit produit, per9u et ac
et par chacun (exigence de reconnaissance mu
deuxieme exigence induit une contrainte de descr
souhaite rendre compte de ce mode de decision co
avoir une dimension phenomenologique (au sens pr
doit montrer de quelle maniere, par quel procede, il
qu'un arret a emerge de leurs contributions au proc
ou les etres humains ne sont pas mutuellement tran
tion reciproque de leurs pensees suppose l'usage de
faut que les membres aient les moyens de savoir
decision est prise8. Or, de deux choses Tune : ou bi
et il doit etre rendu perceptible par une technique
mettant de constater qu'il y a bel et bien unanim
d'une technique electorate qui peut-etre tres somm
exemple) ; ou bien il n'y a pas une telle technique d
opinions est impossible. Dans ce dernier cas, c'est
tion a une proposition qui transforme celle-ci en d
constat d'une absence.
La decision par consensus apparent et le vote sont done deux procedures dis-
tinctes d'arret de la decision collective. L'une ne comprend pas plus que l'autre
l'ensemble du processus de decision, mais l'une et l'autre regissent sa terminai-
son. Elles le font d'une maniere radicalement differente, comme en atteste l'exa-
men de la notion de consensus apparent.
8 II peut arriver qu'un ou plusieurs participants n'aient pu observer l'arret et que celui-ci fasse
pour eux l'objet de conjectures ou de croyances individuelles. Pour autant, qu'une decision ait ete
prise, ou que Ton soit en train de la prendre, ou que finalement on ait renonce momentanement a arre-
ter une option, ce sont la, la plupart du temps, autant de faits, c'est-a-dire d'etats ne pretant pas a dis-
cussion. La regie de decision institute permet de reconnaitre ces etats. Ainsi consue, la decision cor-
rectement prise ne me semble pas pouvoir etre assimilee a une croyance collective, comme le suggere
Margaret Gilbert dans l'un de ses textes. Elle illustre sa conception de la croyance collective en decri-
vant un cas imaginaire et plausible de discussion des membres d'un college d' Oxford sur la qualite des
repas servis a leur « Table Haute ». Sa description correspond exactement a ce que j'appelle decision
par consensus apparent, a une difference importante pres : elle n' envisage pas, ou du moins ne precise
pas, que la terminaison de la discussion qu'elle imagine puisse avoir le statut d'une decision, soit l'ar-
ret d'une intention d'agir. II est pourtant difficile de ne pas y penser a la lecture de cet extrait: « le plus
ancien des membres eleve la voix et declare sur un ton categorique et definitif : "II est clair que ce n'est
pas assez varie ! II faut que quelqu'un aille parler au chef !" II regarde autour de lui brievement. S'en-
suit une pause. Puis: "Si nous passions a un autre sujet?" Personne ne fait d'objections.» (Gilbert,
2003, p. 96). Discuter la these de Gilbert exigerait une clarification du statut des concepts de decision,
de regie de decision et de croyance collective que je ne peux entreprendre ici.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
60 PHILIPPE URFALINO
2.2. Apparence de consen
L'adjectif « apparent » doi
II peut etre entendu comm
ceptible d'etre faux ou tro
presente a nous et devient
grec, de « phenomenon
Le consensus est d'abord
Cela resulte de ce qu'il n'e
l'absence de contestation
la distribution exacte des
rement la decision par con
mite proprement dite. Ce
tout le moins la possibilit
option : selon une telle reg
lement convergents ou ide
exige non pas l'unanimite
consensus incline a le pe
absence laisse pendante
desapprouvent. La double
proposition P », n'equivaut
bation deP»9.
Le consensus est ensuit
consensus apparent suppos
tation qu'elle n'est pas rej
disaccord est essentiel : il
arretee. Un temps d'arret s
tation ou son absence acco
nouveau 1' importance de
consensus, mais l'absence
absence, valant attestation
chacun des participants a
tion d'action a entreprend
contestation explicite ; ce
la decision arretee.
2.3. La continuity entre deliberation et decision
Lorsqu'une proposition est emise, elle est susceptible soit de valoir decision, si
personne ne la conteste, soit de n'etre que l'une des etapes de formation de la pro-
position finale, si elle est contestee. La phase finale du processus de decision n'est
pas etablie a l'avance. Le fait qu'une proposition soit la derniere et vaille decision
n'est su que retrospectivement, quand on a constate l'absence d'opposition.
Cet aspect est, apres l'absence de denombrement des avis, une deuxieme
grande difference avec l'arret de la decision par vote. Dans ce dernier cas, il y a
discontinuite entre la deliberation, entendue comme la discussion collective en
9 La sincerite de 1' expression de 1' accord ou du disaccord importe peu ici.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA DECISION PAR CONSENSUS APPARENT 6 1
vue de la decision, et 1' usage de la technique electo
moments bien separes, au point meme, comme on
decider ou de se referer a une regie pour savoir q
place au vote. U arret par consensus apparent assur
entre la deliberation et la decision. La succession d
entre plusieurs phases de discussion, d'une part, et l
tut de derniere proposition ne puissent etre definis
chent de discriminer une phase de deliberation et u
En consequence, la decision - toujours entendue co
d'entreprendre une action - semble emerger directe
est particulierement pertinent pour caracteriser de m
lation de l'ideal de la discussion rationnelle. Je pens
sur la democratic deliberative, celles qui promeuven
lective selon lequel la discussion, limitee a un echan
naires egaux, doit aboutir a une decision par le m
[1989]). Ce dernier est assure par l'hypothese et le
soit guide dans la determination de sa volonte par
(Chambers [1996]). La maniere de constater ce conse
vote avec requete d'unanimite n'est pas evoque. Ha
recours au vote a la majorite dans le cas ou une de
qu'un consensus ait ete atteint; il admet done la po
la deliberation et 1' arret de la decision, quand le con
cela laisse pendante la question de savoir comment
realisable, est constate. La formulation de cet ideal
de ce que doit etre la deliberation, s' attache a lister l
satisfaites. Mais ces auteurs, comme il est courant dan
position normative, ne se plient pas a l'exigence d
qu'un observateur devrait satisfaire pour rendre co
nelle ou d'une deliberation, au cas ou les modeles i
democratic deliberative pourraient etre realises. Or
descriptive, a savoir montrer comment les participa
arret, force est d'admettre que, faute d'un vote a l'un
de tete), le modele descriptif de l'aboutissement de
la deliberation (telle qu'elle est imaginee par une p
deliberative ») est la decision par consensus apparen
2.4. La preference pour un consensus de qualite
La decision par consensus apparent est utilisee da
collective ou Ton attache de l'importance a une cer
Cette conception associe etroitement approbation
souci d'un « consensus de qualite » est observable
dans les areopages.
10 Cette continuite entre discussion et decision explique en pa
loppees dans cette deuxieme partie rencontrent celles, tres ec
d'une distinction heuristique, voter et deliberer, legerement di
mode d' arret de la decision.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
62 PHILIPPE URFALINO
Emmanuel Terray soulig
certaine conception de la d
solution juste et une seule ;
de Tin venter, mais de la
de vue partiel: c'est done l
ment au devoilement de la
commission fran9aise d'A
ne possede la verite, il faut
de leur mise en commun et de la discussion ».
De tels propos manifestent clairement les merites attribues a la confrontation
des points de vue. Mais il est remarquable que, dans le cas de la palabre comme
dans celui de la commission d'AMM, la valorisation de la deliberation aille de
pair avec le rejet du vote. Ce rejet ne va pas de soi, car, apres tout, on peut voter
apres que les opinions ont ete enrichies par la discussion11. Le consensus apparent
s' oppose ici une nouvelle fois au vote par deux aspects etroitement articules :
A. la recherche conjointe de la qualite de la decision et du nombre de ceux qui
l'approuvent;
B. le consensus n'est pas une sommation d' opinions individuelles.
A. La ou la decision par consensus apparent est la maniere legitime de prendre
des decisions, les participants ne renoncent pas a joindre le nombre et la
sagesse, a rebours de ce que nous montre 1' emergence historique des tech-
niques du vote et l'histoire de la reflexion sur celles-ci. Les Grecs soulignaient
deja la possibility d'un ecart entre les choix du peuple, numeriquement supe-
rieur, et les voies de la sagesse politique (Thucydide, VI, 24). Les ordres
monastiques d' Occident qui ont reinvente les techniques electorates ont mis
plusieurs siecles a admettre que le nombre (la majorite) puisse peser davantage
qu'une minorite supposee eclairee dans la designation du responsable des
monasteres : il leur fallut six cents ans pour laisser la major pars dominer sans
ponderation la saniorpars (Moulin [1958]). L'histoire de la reflexion sur les
choix collectifs presente un mouvement similaire : 1'evolution est allee de l'es-
perance de la decouverte d'une bonne regie d'agregation pour prendre une
bonne decision (e'etait l'espoir de Condorcet qui parlait de « decision vraie»)
a la recherche moins ambitieuse des regies dont le resultat « represente » la dis-
tribution des preferences individuelles de la moins mauvaise maniere possible
(Black [1958]; Arrow [1951]; Guilbaud [1952]). La recherche de la represen-
tativite a remplace le souci de la qualite. La disjonction generee par le vote
entre la recherche de la qualite de la decision supposee diriger la discussion et
le constat de 1' addition des voix est irreductible. Elle reste presente et est
meme encore plus saillante quand on cherche a en diminuer l'ampleur. C'est
le cas du vote motive: pour limiter 1' influence d'interets illegitimes, il arrive
qu'on exige des membres d'un groupe deliberant que leur vote soit public et
11 Les assemblies devant arreter une decision collective peuvent presenter les trois cas de figures
suivants : 1) passage direct au vote, une autre assemblee ayant la charge de la deliberation et de la fixa-
tion des options en concurrence (Pasquino [2006]); 2) deliberation puis vote; 3) deliberation et
absence de vote, la decision etant arretee par consensus apparent.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA DECISION PAR CONSENSUS APPARENT 63
motive. Chacun doit justifier son vote par une
procede a une limite bien connue : 1' argumentat
puisqu'un bon orateur trouve aisement des rais
un vote qui a des motifs moins avouables12. Da
apparent, la recherche du consensus n'est pas d
de la decision13. Dans les contextes ou elle prevau
parce qu'il risque de sacrifier la qualite de la de
des experts de la commission d'AMM : « Dans la
de vote. £a peut etonner. C'est fondamentaleme
decision scientifique. Done, 9a doit etre un con
des choses mysterieuses.» Via le consensus appa
doivent se confondre et non s'opposer. Le voca
tique moderne congruent avec l'esprit de cet
Contrat social de Rousseau: on attend de la v
qu'elle « declare » la volonte generate (la qualite
B. Si le consensus suppose bien 1' approbation du p
de contestation, il ne se confond pas avec la som
nologues soulignent ce point quand ils expliquen
un contexte normatif d'ou l'individualisme polit
89]; Abeles [2003]). On comprend que 1' absence
des opinions va de pair avec une conception de l
rapport avec l'idee d'une sommation des citoyen
criptions ne permettent pas de saisir a quoi cela
processus meme de la discussion. Les descriptio
rains sont sur ce point plus precises. Pasquino, so
nelle italienne, explique qu'un juge ne saurai
aupres de ses partenaires, comme une volonte m
peser a titre de « fragment egal » de la souveraine
nom de sa preference pour l'option x; seule vaut
raison de choisir x». L' argument remplace la vo
ment l'integration des arguments remplacent l
(Pasquino, 2006). De la meme maniere, un exper
ne doit pas esperer peser sur la decision du seul
nion pour ou contre l'autorisation d'un medicam
recommandation associee a son autorisation. So
que son argument a convaincu, est repris par les
12 Les disputes au sein de l'assemblee des ingenieurs des Pon
lat, substitua le vote au consensus, en fournissent une tres
13 Quand il y a vote, le souhait de parvenir a une bonne decis
integre d'une maniere ou d'une autre au mecanisme de l'arret.
ait ete feconde, mais une fois que la procedure electorale est lan
tat agrege.
14 Je dois cependant admettre, comme me le fait remarque
areopages tend a associer trop etroitement 1' absence de conte
rent, a l'exigence argumentative. Or il est possible de concevo
consensus apparent comme un mecanisme d' expression et d
mentation.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
64 PHILIPPE URFALINO
Ainsi la decision par con
doxal avec le vote et nota
quant a la manifestation
consensus suffit; mais l'a
doit attester la qualite de
2.5. Qui ne dit mot conse
La decision par consensus
a ne pas s'opposer a la pro
que la palabre n'exige pas
vent, une minorite se rall
finissant par renoncer a
[1982], pp. 32-34). Dans le
pletement les decisions qu
De la meme maniere, no
d'« expedients », des oppo
contester et ne demandai
faire.
Dans le cas d'un vote a la majorite, simple, absolue ou qualifiee, une forme de
consentement est egalement presente. Mais elle est inscrite dans 1' adhesion au
principe de la regie de majorite et dans son bon f onctionnement : la minorite
accepte que la decision suive 1' opinion de la majorite. Suivre la regie de majorite
expose automatiquement a un tel consentement. Dans le cas de la decision par
consensus apparent, le consentement est plus actif et plus personnalise parce qu'il
concerne directement l'expression des participants: des lors qu'apparait, par
tatonnement et par une succession de propositions, une tendance rassemblant de
moins en moins d' opposants explicites, les derniers d'entre eux doivent se deman-
der s'il vont ou non renoncer a exprimer leur disaccord. Pourquoi renoncent-ils?
Puisque la decision par consensus apparent semble accorder un droit de veto a
chaque participant, a l'instar du vote a l'unanimite, la question des motifs et des
raisons de ce renoncement merite en effet d'etre posee. Cette question rencontre
dans la litterature deux types de reponses.
La premiere a trait aux interets des acteurs et aux rapports de force qui les lient.
Les opposants se taisent parce que tel est leur interet au regard de la capacite de
retorsion que detiennent a leur encontre les principaux partisans de la proposition
avancee. El-Hakim souligne que les notables savent exprimer, par des gestes ou
des intonations de la voix, 1' importance qu'ils attachent ou non a une decision et
que, parallelement, celui qui s' oppose a un consensus propose ou soutenu par tel
notable ayant la main sur la repartition individuelle de biens collectifs (par ex. le
responsable de la distribution d'eau ou celui du dispensaire) peut craindre d'en
subir la mauvaise volonte quand il aura besoin de ces biens. De la meme maniere,
nous avons mentionne que les membres du conseil d' administration du FRAC
n'osaient pas s'opposer au coup de force de leur president, deguise en proposition
de consensus, parce que ce dernier etait une figure montante de la region et de leur
parti politique.
La seconde reponse insiste sur la dimension normative : a un moment donne,
la contestation est illegitime et suscitera la reprobation. Ainsi, explique Terray,
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA DECISION PAR CONSENSUS APPARENT 65
dans la mesure ou la palabre est concue comme un
bonne solution a un probleme, « a partir du mom
s'arrete; tout propos supplementaire serait superf
qui est la plus favorable au bonheur de la comm
Tunanimite des suffrages; des qu'elle a ete enonc
opposer revelerait par la meme qu'il prefere son inte
ral » (Terray [1987-89], p. 21). Encore une fois, la
permet pas de satisfaire notre curiosite. On aimer
pants peuvent avoir le sentiment que la « solution
la persistance de disaccords. A partir de quels indi
objections jusque-la legitimes sont desormais mal
vations plus aisees des areopages contemporains m
un expert de la commission d' AMM qui a eu l'occ
une proposition ou a un aspect de la proposition du
a reserver a un medicament. Ses objections ont dej
lective et ont ete, par exemple, en partie integrees d
tees, ce avec des arguments qui semblent avoir con
Si ce meme expert continue a s'opposer a la propos
de seance, avec des arguments semblables a ceux d
ment et la reprobation. Son engagement dans cet
eventuellement soupconnable. Son entetement est
comme si son opinion avait une valeur en tant qu
indexee sur le succes de ses arguments. II en irait
constitutionnelle italienne, evoquee par Pasquino
blable. Ici, le consentement a pour levier l'epuisem
II se peut que, apres un long debat et plusieurs ob
de consensus ne m' agree toujours pas, pour quelq
n'ai plus la capacite de m'y opposer par des argum
du contexte normatif et de la rhetorique a l'oeuvr
Comment Implication du consentement doit-ell
rets et l'autorite des arguments? El-Hakim (1978)
interets, faisant de la decision par consensus u
social, entendue au sens de Coleman (1966), dont
les variations de la distribution des ressources et
differents participants sur les autres. Cette option
que, faute de description detaillee, on ne puisse tr
autre. Toutefois, dans la palabre, les decisions en c
rets directs et personnels des participants, aussi l'
elle que s'exercent en faveur du consentement
normes collectives, sans que Ton puisse se repr
revanche, dans les areopages contemporains, les s
ralement pas d'interets directs en jeu. Aussi peut
s'ils peuvent avoir des convictions fortes et s' enga
normes de 1' argumentation regissent quasi ex
consentement.
Conformement a T adage «Qui ne dit mot consent », l'arret de la decision p
consensus apparent suppose que ceux qui n'approuvent pas la proposition ou
n'y adherent pas completement consentent a ne plus s'exprimer.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
66 PHILIPPE URFALINO
2.6. Egalite de participatio
Les partisans comme les o
qu'elle s'appuie sur un pri
ailleurs 1' exigence et le te
tent cette participation. C
souvent mis en avant par
(Bidima [1997]; Mandela
Mais l'egalite quant a la p
de droit, du poids des diff
rent. Alors que le vote, no
teur pese exactement le m
la deliberation et la decisio
tendent pas assurer l'egali
Pasquale Pasquino note a
d'une assemblee deliberant
egalites d'influence15. J'a
non seulement il y a des d
poids dans la decision, ma
Elles motivent d' ailleurs le
discuter des merites resp
societe Abron qu'il a etud
leur semble injustifiee: «l
parait tout a fait saugrenu
il y a des vieillards experim
89]). II en va de meme dan
marche des medicaments.
de competences entre les m
differentes questions tra
fluence de chacun sur la decision finale. Les deux extraits d' interviews suivants le
manifestent clairement:
« II ne faut pas voter, car cela donne le meme poids a chacun. Si on examine le dossier
d'un medicament pour le coeur, mon collegue cardiologue doit avoir plus de poids que
moi.»
«On arrive toujours a un consensus, c'est bien mieux. II n'y a jamais eu de vote. Vaut
mieux que les gens s'expliquent. Que ceux qui sont competents s'expliquent. II y a des
membres de droit qui representent les academies de medecine, de pharmacie, FInserm.
Us sont representatifs mais ils n'ont pas une competence. Les experts sont competents.
Done le probleme du vote c'est qu'il donne un meme poids a tous.»
Ainsi 1' usage de la decision par consensus apparent est-il congruent avec la
legitimite des inegalites des contributions individuelles a la decision collective.
Le souci de l'egalite en matiere de participation y cotoie la reconnaissance des
inegalites d'influence.
15 II en note cinq: l'autorite personnelle, la competence technique, la puissance argumentative,
l'ordre des prises de parole, le role de president de seance.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA DECISION PAR CONSENSUS APPARENT 67
CONCLUSION
Mon objectif etait de cerner la specificite d'un mode de decision collect
habituellement denomme « decision par consensus » ou « decision a l'unanim
Dans la premiere partie, il est apparu que c'etait la description precise de la
nique d'arret de la decision qui permettait de distinguer clairement ce que
finalement appele la « decision par consensus apparent » du vote a la majori
a l'unanimite. Cette distinction a autorise un premier inventaire sommair
usages de cette regie de decision. Dans la deuxieme partie, j'ai examine six
prietes de la decision par consensus apparent qui, par contraste avec le vote
notamment mis en evidence certains aspects normatifs qui accompagnent, da
palabre et les areopages, la pratique de cette maniere d'arreter la decision.
conclure, j'aimerais mentionner trois lemons.
1) Le contexte normatif de la decision par consensus apparent. Les aspe
normatifs mis en evidence dans la deuxieme partie invitent a distinguer nett
l'usage du consensus comme expedient, liste dans la premiere partie, de son
dans les areopages et la palabre. Quand il est utilise comme un expedient, l'a
par consensus apparent est moins legitime que le vote avec lequel il coexis
n'est done jamais tres loin d'une forme degradee de vote informel. Ce type m
et instable tend a montrer qu'une forme d'arret de la decision est congruent
des idees et des normes attachees a la decision et a son contexte.
2) Decision par consensus apparent et democratie deliberative. Les promo-
teurs d'une democratie plus deliberative ont raison d'evoquer les exemples de
pratiques telles que la palabre. Toutefois, ils n'en retiennent qu'un aspect, l'ega-
lite de la participation aux debats, en negligeant un autre pourtant indissociable :
l'inegalite des participants quant au poids de leur contribution au resultat final.
Seul le vote assure que chaque electeur a la meme influence que tous les autres. Si
l'autorite du meilleur argument doit l'emporter dans la decision et si la delibera-
tion ne debouche pas sur un vote, la decision par consensus apparent, qui est le
modele descriptif de la decision par discussion rationnelle, suppose legitime et
genere de fait l'inegalite des participants face a la decision collective. II apparait
ainsi que le souci d'une participation plus egalitaire a la deliberation heurte fronta-
lement la conception de l'egalite politique qui a jusqu'ici prevalu dans les demo-
craties occidentals et qui a preside a l'emergence du suffrage universel16. II est
d'ailleurs remarquable que la « democratie des autres » que Sen (2005) detecte dans
les traditions non occidentals, qualifiee de « vision beaucoup plus large de la
democratie en terme de debat public » (p. 15), soit depourvue de passion egalitaire.
3) Deux distinctions utiles pour la comparaison. II me semble que la prise en
compte de la specificite de la decision par consensus apparent enrichit les bases
16 « L'egalite politique rapproche et annule ce qu'il y a de plus naturellement different entre les
hommes : le savoir et le pouvoir. C'est la forme d'egalite qui est la plus artificielle et la plus exemplaire
a la fois... Le suffrage universel... est indissociablement signe et realite, chemin montre du doigt et
egalitedejala»,Rosanvallon, 1992, pp. 15-16.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
68 PHILIPPE URFALINO
conceptuelles de 1' analys
rentes societes humaines
sont correctement disting
congruents a des contextes
respecte pas exactement u
Bien qu'en l'etat de la litte
techniques electorates a l'h
aux societes modernes et
modernes. En effet, d'un
decision dans certains are
les societes modernes. Et,
est averee dans nombre de
currence dans ces societes
torate. La distinction entr
autre cote, un arret de la
done centrale pour la refl
Elle doit etre associee a u
tionnee rapidement (intro
son absence. Elle n'est qu'
la notion de decision colle
semblee ou Fidee d'obligat
certaines references a la
l'idee d'une decision collec
censes l'entreprendre (Sim
Mais l'objet de cet article
tre que la decision par co
informelle du vote a Funan
tient pas a l'usage ou non
que les recours a la major
meme genre : le vote. La d
apparent, et de l'opposer c
la decision collective: la m
d'un cote, le denombreme
et, de F autre cote, une pr
gnance du modele du vote
nature specifique d'une au
positive, faire une proposi
Centre de Sociologie du T
BIBLIOGRAPHIE
Abeles, Marc, Les lieux du politique, Societe d'ethnographie, 1983.
Abeles, Marc, «Revenir chez les Ocholos», in Detienne, Marcel (ed.), 2003, pp. 393-413.
Ales, Catherine, Entre cris et chuchotements. Organisation sociale et symbolique des Y
Paris, Editions Karthala, 2006.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA DECISION PAR CONSENSUS APPARENT 69
Arrow, Kenneth, Choix collectif et preferences individuelles, C
Baechler, Jean, Democraties, Calmann-Levy, 1994.
Bailey, Fredrick George, 1965, « Decisions by consensus in c
M.(ed.), Political systems and distribution of power, Tavistos
Barnes, John., « Class and Committees in a Norwegian Island Pa
pp. 39-58.
Bidima, Jean-Godefroy, La palabre. Une juridiction de la parole, Michalon, 1997.
Black, Duncan, The Theory of Committees and Elections, Cambridge University Press, 1958.
Byock, Jesse, Viking Age Iceland, Penguin Books, 2001.
Chambers, Simone, Reasonable Democracy. Jiirgen Habermas and the Politics of Discourse, Cornell
University Press, 1996.
Cohen, Joshua, « Deliberation and Democratic Legitimacy », in Hamlin, Alan and Petit Phillip, eds,
The Good Polity, Blackwell, 1989.
Coleman, James, « Foundations for a theory of collective decisions », American Journal of Sociology,
1966, n° 71, pp. 615-627.
Detienne, Marcel (ed.), Qui veutprendre la parole?, Le genre Humain, n° 40-41, Seuil, 2003.
Dumont, Louis, Homo Hierachicus, Gallimard, Tel, 1966.
Dumont, Louis, Essais sur Vindividualisme, Seuil, 1983.
El-Hakim, Sherif, «The Structure and Dynamics of Consensus Decision-Making », Man, vol. XIII,
1978.
Ferme, Mariane, « The Violence of Numbers : Consensus, Competition and the Negociation of Diputes
in Sierra Leone », Cahiers d'Etudes Africaines, 150-152, vol. XXXVIII, 1998, pp. 555-580.
Ferejohn, John, Pasquino, Pasquale, « Consititutional Courts as Deliberative Institutions », in Alava-
rez, Sadurski (ed.), Consitutional Justice, East and West, Kluwer Law International, 2002.
Fishkin, James, Democracy and Deliberation, Yale University Press, New Haven, 1991.
Gaudemet, Jean, Les elections dans I'Eglise latine, Fernand Lanore, 1979.
Gilbert, Margaret, Marcher ensemble. Essais sur les fondements des phenomenes collectifs, PUF, col-
lection Philosopher en sciences sociales, 2003.
Goscinny, Rene, Uderzo, Albert, Asterix. Le glaive et la rose, Les editions Albert Rene, 1991.
Graber, Frederic, La deliberation technique. Disputes d'ingenieurs des Ponts et Chaussees sous la
Consulat, These de doctorat EHESS, 2004.
Graber, Frederic, « Obvious decisions. Decision-making among French Ponts-et-Chausse'es engineers
around 1800», Working oaoer, 2005.
Guilbaud Georges-Theodule, «Les theories de l'interet general et le probleme de la logique de l'agre-
gation», Economie appliquee, 15, 1952, pp. 509-51 1.
Habermas, Jiirgen, Droit et democratie. Entrefaits et normes, Gallimard, 1997.
Hauray, Boris, Controler les medicaments dans un espace europeen. Politique, expertise et influence
desfirmes, Presse de Sciences-Po, 2005.
De Jouvenel, Bertrand, De la politique pure, Calmann-Levy, 1977.
Moulin, Leo, «Sanior et major pars. Note sur 1'evolution des techniques electorates dans les ordres
religieux du Vie au XHIe siecle», Revue Historique de Droit Frangais et Etranger, 1958, vol.
XXXV.
Mane, Alain, «Les assemblies villageoise dans la Kabylie contemporaine », Etudes Rurales, n° 155-
156, juillet-decembre 2000, pp. 179-212.
Mandela, Neslon, Un long chemin vers la liberte, Fayard, 1995.
Martin, Pierre, « Reconcilier deliberation et egalite politique : Fishkin et le sondage deliberatif », Revue
Francaise de Science Politique, n°l, vol. 48, fevrier 1998, pp. 150-154.
Pasquino, Pasquale (2007), « Voter et deliberer», Revue Europeenne des Sciences Sociales, a paraitre.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
70 PHILIPPE URFALINO
Popkin, Samuel, The Rational Pe
sity of California Press, Londo
Richards, Audrey and Kuper, Ad
logy, Cambridge University Pr
Raz, Joseph, « Reasons for Actio
499.
Rosanvallon, Pierre, Le sacre du
Sen, Amartva, La democratic de
Silberbauer, George, « Political P
and history in band Societies
l'homme, New York/Paris, 198
Simmel, Georg, Sociologie, PUF
Smith, Thomas, The agrarian Or
Souyri, Pierre Francois, « Des co
cel, 2003, pp. 85-94.
Steiner, Jtirg, and Dorff, Robe
looked Decision Mode», British
Terray, Emmanuel, «Un anthrop
nale per la storia economica e
Terray, Emmanuel, « Le debat po
Revue Francaise de Sciences Po
Thucydide, La guerre du Pelopo
Turton, David, «The Relationship
Bloch Maurice, Political Langua
1975, pp. 163-184.
Urfalino, Philippe, La decision f
ponible sur le site CESTA-EHE
Urfalino, Philippe (2006), «La c
Urfalino, Philippe, Vilkas Cath
d'Art contemporain, L'Harmatt
Vilkas, Catherine., Evaluation
recherche scientique», Sociolog
Yngvesson, Barbara, « Leadershi
Ethnos, n° 1-2, 1978.
This content downloaded from
109.190.14.195 on Thu, 11 Mar 2021 18:25:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Vous aimerez peut-être aussi
- LEFEBVRE, Henri. Justice Et VéritéDocument29 pagesLEFEBVRE, Henri. Justice Et VéritéCláudio SmalleyPas encore d'évaluation
- L'Organigramme Complet Des RépublicainsDocument1 pageL'Organigramme Complet Des RépublicainsRTLfrPas encore d'évaluation
- Livre1 2004Document160 pagesLivre1 2004Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Les Civilisations Dans Le Regard de L Autre Actes 2001Document285 pagesLes Civilisations Dans Le Regard de L Autre Actes 2001ze_n6574100% (2)
- Problemes Archeologiques, Problemes Humains: Moi, Nous Et Les AutresDocument11 pagesProblemes Archeologiques, Problemes Humains: Moi, Nous Et Les AutresAlain SergePas encore d'évaluation
- Ruyssen, Thomas (1951) La Querelle de L'HumanismeDocument16 pagesRuyssen, Thomas (1951) La Querelle de L'HumanismeEbert ValentinPas encore d'évaluation
- Dupont - La Postmodernité - Une Réalité Entre Pensée Et Discours - 1999Document15 pagesDupont - La Postmodernité - Une Réalité Entre Pensée Et Discours - 1999kspcautePas encore d'évaluation
- d492df3e-98c7-4f39-a164-34d7b813a04aDocument15 pagesd492df3e-98c7-4f39-a164-34d7b813a04aJUNIOR MUDIATPas encore d'évaluation
- CIVILISATION - Le Mot Et L'idéeDocument142 pagesCIVILISATION - Le Mot Et L'idéeMarco Paolo100% (3)
- Hasan Identite Et Singularite1Document21 pagesHasan Identite Et Singularite1Ousmane NiangPas encore d'évaluation
- Le Rythme de La Vie by Maffesoli Michel ZDocument159 pagesLe Rythme de La Vie by Maffesoli Michel ZAbdelali Affane100% (4)
- Derrida Violence Et MétaphysiqueDocument34 pagesDerrida Violence Et MétaphysiqueMerotPas encore d'évaluation
- Textes Atelier Philo 14 Décembre 2023 (Version Revue)Document2 pagesTextes Atelier Philo 14 Décembre 2023 (Version Revue)OrdreEtProgres U235Pas encore d'évaluation
- Dialogue Des CivilisationsDocument0 pageDialogue Des CivilisationsslamaPas encore d'évaluation
- Crozatier Nicolas - Transhumanisme Et Heritage PrometheenDocument234 pagesCrozatier Nicolas - Transhumanisme Et Heritage PrometheenLouis Yannick EssombaPas encore d'évaluation
- Les Limites de L'acceptable Jean-Pierre CavailléDocument348 pagesLes Limites de L'acceptable Jean-Pierre CavailléIntinionPas encore d'évaluation
- Pour Resister A La RegressionDocument29 pagesPour Resister A La RegressionChristophe Solioz100% (3)
- Chocs de Langues Et de CulturesDocument466 pagesChocs de Langues Et de CulturesJulien ParlantPas encore d'évaluation
- Actes Colloque Bernard CHARBONNEAU Habiter La Terre SETDocument180 pagesActes Colloque Bernard CHARBONNEAU Habiter La Terre SETruivalensePas encore d'évaluation
- Une Histoire Critique de La Sociologie Allemande Alienation Et Reification Vol 1 Marx Simmel Weber Et Lukacs - CompressDocument296 pagesUne Histoire Critique de La Sociologie Allemande Alienation Et Reification Vol 1 Marx Simmel Weber Et Lukacs - CompressbenazsalouaPas encore d'évaluation
- La Sociologie Face Au Changement SocialDocument15 pagesLa Sociologie Face Au Changement SocialSerigne SyllaPas encore d'évaluation
- Cahier Du PASCRENA N°5 CopieDocument258 pagesCahier Du PASCRENA N°5 CopiecourtinPas encore d'évaluation
- Philo Vaovao 1Document3 pagesPhilo Vaovao 1mandarajaohariveloPas encore d'évaluation
- Politique de L'immortalité. Quatre Entretiens Avec Thomas Knoefel de Boris Groys, Paris, Maren Sell Éditeur, 2005, 219 PDocument5 pagesPolitique de L'immortalité. Quatre Entretiens Avec Thomas Knoefel de Boris Groys, Paris, Maren Sell Éditeur, 2005, 219 P張浩淼Pas encore d'évaluation
- Colle Sur La CoutumeDocument3 pagesColle Sur La CoutumeInes CouliouPas encore d'évaluation
- Rousseau Bergson Simondon - Odt.odtDocument174 pagesRousseau Bergson Simondon - Odt.odtDaniel BorgesPas encore d'évaluation
- Initiation À L'interculturelDocument30 pagesInitiation À L'interculturelmeryam sadkiPas encore d'évaluation
- Le CyberespaceDocument12 pagesLe CyberespaceAirton Luiz JungblutPas encore d'évaluation
- Le Monde Comme Dissonance Et Comme PolytDocument20 pagesLe Monde Comme Dissonance Et Comme PolytatienzarthomasPas encore d'évaluation
- 9782021473049 (2)Document19 pages9782021473049 (2)Miguel EscobarPas encore d'évaluation
- 376 Transition Ecologique CitoyenneDocument140 pages376 Transition Ecologique Citoyennesth39000Pas encore d'évaluation
- Cheyronnaud, Lenclud, Blasphèmes. D'un MotDocument11 pagesCheyronnaud, Lenclud, Blasphèmes. D'un MotKamelPas encore d'évaluation
- Piratons La DémocratieDocument74 pagesPiratons La DémocratieKorben100% (1)
- Forme Pratique Musicale de Henri PousseurDocument20 pagesForme Pratique Musicale de Henri PousseurHoratio decarliPas encore d'évaluation
- This Content Downloaded From 128.196.18.172 On Mon, 13 Feb 2023 05:55:15 UTCDocument11 pagesThis Content Downloaded From 128.196.18.172 On Mon, 13 Feb 2023 05:55:15 UTCNicolas TreiberPas encore d'évaluation
- Miserias y Virtudes Del Proceso ElectoralDocument5 pagesMiserias y Virtudes Del Proceso ElectoralMaria Mercedes Prado EspinosaPas encore d'évaluation
- Naissance D'une Civilisation: Yves Brunsvick Et André DanzinDocument105 pagesNaissance D'une Civilisation: Yves Brunsvick Et André DanzinBernard HounnouvePas encore d'évaluation
- La Responsabilite de ProtegerDocument244 pagesLa Responsabilite de Protegeramaria_456Pas encore d'évaluation
- Rajaoson Julien 2008Document139 pagesRajaoson Julien 2008JOVIALPas encore d'évaluation
- Ricoeur Le Savant...Document418 pagesRicoeur Le Savant...Silvia GabrielPas encore d'évaluation
- PUREN - 2015f - Réflexion Méthodologique Manque Saines PolémiquesDocument18 pagesPUREN - 2015f - Réflexion Méthodologique Manque Saines PolémiquesAnass El JanatiPas encore d'évaluation
- Introduction Du Dossier Affecter, Être Affecté. Autour Des Travaux de Jeanne Favret-SaadaDocument13 pagesIntroduction Du Dossier Affecter, Être Affecté. Autour Des Travaux de Jeanne Favret-SaadaDomenico ScandellaPas encore d'évaluation
- Cahier Du CELHTO N°1 (1986)Document91 pagesCahier Du CELHTO N°1 (1986)Centre d'Etudes Linguistiques et Historiques par Tradition Orale (CELHTO)Pas encore d'évaluation
- Bords A Bords Vers Une Pensee MusiqueDocument12 pagesBords A Bords Vers Une Pensee MusiqueAntoninBourgaultPas encore d'évaluation
- Thermodynamique de l'évolution: Un essai de thermo-bio-sociologieD'EverandThermodynamique de l'évolution: Un essai de thermo-bio-sociologiePas encore d'évaluation
- These MarclengletDocument457 pagesThese MarclengletFelipe PinhoPas encore d'évaluation
- Christophe de Voogd - Réformer: Quel Discours Pour Convaincre ?Document56 pagesChristophe de Voogd - Réformer: Quel Discours Pour Convaincre ?FondapolPas encore d'évaluation
- Bazan A PDFDocument255 pagesBazan A PDFCharles PurplePas encore d'évaluation
- AUDOUZE, F. Le Geste Et La Parole Revisité.Document16 pagesAUDOUZE, F. Le Geste Et La Parole Revisité.Gabriela PradoPas encore d'évaluation
- Textes Atelier Philo 6 Février 2024Document2 pagesTextes Atelier Philo 6 Février 2024OrdreEtProgres U235Pas encore d'évaluation
- L'Ordre Du Discours Michel Foucault (1971)Document47 pagesL'Ordre Du Discours Michel Foucault (1971)acdomainPas encore d'évaluation
- Philosophie CultureDocument113 pagesPhilosophie Cultureroberto estradaPas encore d'évaluation
- DE L'UNITÉ DU SAVOIR. GonsethDocument11 pagesDE L'UNITÉ DU SAVOIR. GonsethPedro ArriagaPas encore d'évaluation
- Balibar, Étienne, Quel Universalisme Aujourd'Hui, e Cercle Gramsci, 3 December 1993, LimogesDocument28 pagesBalibar, Étienne, Quel Universalisme Aujourd'Hui, e Cercle Gramsci, 3 December 1993, LimogesbalibarPas encore d'évaluation
- La démonarchie ou l'illusion de la démocratie: ThéâtreD'EverandLa démonarchie ou l'illusion de la démocratie: ThéâtrePas encore d'évaluation
- Sergio Vieira de Mello La Conscience Du MondeDocument17 pagesSergio Vieira de Mello La Conscience Du MondeSybile VlianaPas encore d'évaluation
- La Formation Du Citoyen Aux Prises Avec Les Echelles de Temps Et D'EspaceDocument17 pagesLa Formation Du Citoyen Aux Prises Avec Les Echelles de Temps Et D'EspaceMohamed MhdPas encore d'évaluation
- religions et cultures, ressources pour imaginer le mondeD'Everandreligions et cultures, ressources pour imaginer le mondePas encore d'évaluation
- Iso 19011 2018Document13 pagesIso 19011 2018antsiva 201Pas encore d'évaluation
- Examen Comptabilite Des Societes L3 FasegDocument3 pagesExamen Comptabilite Des Societes L3 Fasegawathimbo05Pas encore d'évaluation
- OuldEbaMoussa 2013Document399 pagesOuldEbaMoussa 2013cherrou7Pas encore d'évaluation
- RCI - Le Code de La Nationalite-1962Document21 pagesRCI - Le Code de La Nationalite-1962Pierre DrevonPas encore d'évaluation
- STB Etats Financiers Annuels Individuels 31 12 2018 - 0 PDFDocument52 pagesSTB Etats Financiers Annuels Individuels 31 12 2018 - 0 PDFBen amor WaelPas encore d'évaluation
- 18 Avis de Concours ItsDocument1 page18 Avis de Concours ItsAttio Safi ChantalPas encore d'évaluation
- Reglement de Consultation A.O.O #17/DBM/2020Document10 pagesReglement de Consultation A.O.O #17/DBM/2020ocgcdrcePas encore d'évaluation
- RakotosalamaAndriamparanyFJ GES M1 11Document118 pagesRakotosalamaAndriamparanyFJ GES M1 11DahMalikiHabibouPas encore d'évaluation
- Dahir 1-09-02 Loi 45-08 Organistion Des Finances Des CLDocument19 pagesDahir 1-09-02 Loi 45-08 Organistion Des Finances Des CLAyoub FoulalPas encore d'évaluation
- N°007-Supports FinanciersDocument21 pagesN°007-Supports FinanciersRahim DoudouuPas encore d'évaluation
- COURS 5. Propriété IntellectuelleDocument9 pagesCOURS 5. Propriété IntellectuelleRahimoRhmPas encore d'évaluation
- Darty Facture-2Document1 pageDarty Facture-2Raymond ReddingtonPas encore d'évaluation
- Texte Exposé Sitting Bull 1ère EMCDocument2 pagesTexte Exposé Sitting Bull 1ère EMCYohan RigalPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Les Différentes Formes de L'etatDocument11 pagesChapitre 2 - Les Différentes Formes de L'etatOumoul khairy SambePas encore d'évaluation
- Avis Consultatif: Repoblikan'I MadagasikaraDocument4 pagesAvis Consultatif: Repoblikan'I MadagasikaraLivaRaharyPas encore d'évaluation
- Diode SchottkyDocument6 pagesDiode SchottkyVino DongaPas encore d'évaluation
- SERIE 1 Exercices Sur L'affectation Du Résultat Exercice 1Document3 pagesSERIE 1 Exercices Sur L'affectation Du Résultat Exercice 1anass FFPas encore d'évaluation
- s3711 - Demande de Complementaire Sante Solidaire 0Document6 pagess3711 - Demande de Complementaire Sante Solidaire 0Betty ChateauneufPas encore d'évaluation
- الإمتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2011 مادة الاقتصاد والتنظيم الاداري للمقاولات مسلك العلوم الإقتصاديةDocument6 pagesالإمتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2011 مادة الاقتصاد والتنظيم الاداري للمقاولات مسلك العلوم الإقتصاديةFadoua Moatassim BüyüküstünPas encore d'évaluation
- Construction D'un Portefeuille Obligataire OptimalDocument71 pagesConstruction D'un Portefeuille Obligataire OptimalHajar Allam100% (1)
- Fiscalité InternationaleDocument3 pagesFiscalité InternationaleCyrano DemontcuqPas encore d'évaluation
- 10 Chapitre 6 Dynamique Et Aspects ÉnergétiquesDocument8 pages10 Chapitre 6 Dynamique Et Aspects ÉnergétiquesmidoPas encore d'évaluation
- 1302 PDFDocument30 pages1302 PDFZahra ghedadbiaPas encore d'évaluation
- Bourses Etudiants Internationaux 0222Document5 pagesBourses Etudiants Internationaux 0222Prince Wilondja DoudouPas encore d'évaluation
- COURS EOE Première Fiche N°1Document50 pagesCOURS EOE Première Fiche N°1bonabe gaelPas encore d'évaluation
- Yamaha TZR 50 - Manuel Du PropriétaireDocument87 pagesYamaha TZR 50 - Manuel Du PropriétaireHerve vellaPas encore d'évaluation
- Les Séries À CompiègneDocument13 pagesLes Séries À CompiègnepoutourrouPas encore d'évaluation
- Le Compte de ResultatDocument5 pagesLe Compte de ResultatMhand AtlaghPas encore d'évaluation
- (Henri Guillemin) Benjamin Constant Muscadin PDFDocument304 pages(Henri Guillemin) Benjamin Constant Muscadin PDFMario CplazaPas encore d'évaluation