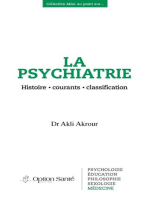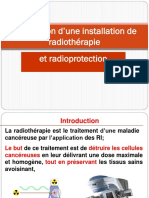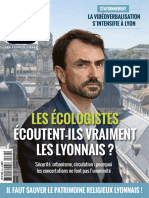Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Art T Di Information Psych I at Rique
Art T Di Information Psych I at Rique
Transféré par
heesham momadTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Art T Di Information Psych I at Rique
Art T Di Information Psych I at Rique
Transféré par
heesham momadDroits d'auteur :
Formats disponibles
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.
net/publication/360076128
Trouble dissociatif de l'identité en 2021 : stigmates d'un trouble dissociatif et
d'une suspicion centenaire Dissociative identity disorder in 2021: A century of
stigma and suspici...
Article in L information psychiatrique · November 2021
DOI: 10.1684/ipe.2021.2340
CITATIONS READS
0 551
1 author:
Eric Binet
École de Psychologues Praticiens - Institut Catholique de Paris
45 PUBLICATIONS 65 CITATIONS
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Eric Binet on 20 April 2022.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
Troubles dissociatifs
L’Information psychiatrique 2021 ; 97 (9) : 785-8
Trouble dissociatif de l’identité en 2021 :
stigmates d’un trouble dissociatif
et d’une suspicion centenaire
Résumé. Pour la première fois en France, il a fallu attendre 2020 pour qu’un col-
Éric Binet loque soit entièrement consacré au trouble dissociatif de l’identité (TDI) sous l’égide
de l’AFTD. S’agissait-il d’un « retour du refoulé » de la psychiatrie française ou d’un
Président de l’AFTD, changement de paradigme nous permettant de tourner la page des « épidémies
psychologue clinicien, d’extase » ? S’il s’avère que les controverses entourant le TDI sont innombrables,
maître de conférences tant sont nombreux ceux qui y voient encore une fiction, la file active de publi-
École des psychologues praticiens, Paris cations qui s’y réfèrent s’amenuise de plus en plus. À l’inverse, les recherches
en imagerie médicale confirment chaque année un peu plus l’importance de la
classification nosographique de cette pathologie, ses stigmates. Mais comment dif-
férencier la connaissance d’une psychopathologie héritée de violences extrêmes
pendant l’enfance, d’autres représentations héritées d’une suspicion quant à la
reconnaissance de leur existence ?
Mots clés : dissociation, trouble dissociatif de l’identité, psychopathologie, noso-
logie, nosographie psychiatrique
Abstract. Dissociative identity disorder in 2021: A century of stigma and
suspicion. It was not until 2020 that the first symposium in France entirely devoted
to dissociative identity disorder (DID), under the aegis of the AFTD, was orga-
nized. Was this a “return of the repressed” in French psychiatry or a paradigm
shift allowing us to turn the page on “epidemic religious monomania”? While the
controversies surrounding DID are innumerable, so many still see it as a fiction,
and the number of publications that reference it is becoming increasingly thin. On
the other hand, every year, medical imaging research confirms the importance of
this pathology’s nosographic classification and stigmata a little more. But how can
we differentiate knowledge of a psychopathology inherited from extreme violence
during childhood from other representations inherited from a suspicion regarding
the recognition of their existence?
Key words: dissociation, dissociative identity disorder, psychopathology, noso-
logy, psychiatric nosography
Resumen. Trastorno disociativo de la identidad en 2021: el estigma de un
trastorno disociativo y una sospecha centenaria. Por primera vez en Francia,
hubo que esperar hasta el 2020 para que un simposio se dedicara íntegramente
al TDI bajo los auspicios de la AFTD. ¿Se trataba de un “retorno de lo reprimido”
en la psiquiatría francesa o de un cambio de paradigma que permitiría pasar la
página de las “epidemias de éxtasis”? Si bien es verdad que las controversias en
torno a el TDI son innumerables, por lo muchos que son los que siguen considerán-
dolo una ficción, el hilo activo de publicaciones que se refieren a él es cada vez más
escaso. Al contrario, la investigación médica por imagen confirma cada año un poco
más la importancia de la clasificación nosográfica de esta patología, sus estigmas.
Pero, ¿cómo diferenciar el conocimiento de una psicopatología heredada de extre-
madas violencias durante la infancia, de otras representaciones heredadas de una
sospecha en cuanto al reconocimiento de su existencia?
Palabras claves: disociación, trastorno disociativo de la identidad, psicopatología,
nosología, nosografía psiquiátrica
La validité des recherches les plus récentes en L’acceptation de cette entité nosographique dans la lit-
imagerie médicale [1], confirmant l’objectivation de térature scientifique comme un fait établi est pourtant
sa symptomatologie clinique, n’empêche pas que le d’une actualité qui dépasse nos frontières, des désac-
doi:10.1684/ipe.2021.2340
trouble dissociatif de l’identité (TDI) soit encore ignoré cords persistant il est vrai sur son étiologie, la façon dont
par une majorité de professionnels en santé mentale. il se produit. Ces divergences dépassent largement le
TDI pour concerner la genèse des troubles dissociatifs,
Correspondance : É. Binet même si le TDI peut se targuer d’être l’état patholo-
<ebinet@wanadoo.fr>
gique qui soulève le plus de passions. Car rarement une
Pour citer cet article : Binet É. Trouble dissociatif de l’identité en 2021 : stigmates d’un trouble dissociatif et d’une suspicion centenaire. L’Information
psychiatrique 2021 ; 97 (9) : 785-8 doi:10.1684/ipe.2021.2340 785
© John Libbey Eurotext, 2021
É. Binet
construction symptomatique a autant fait parler d’elle au sémantique, qui s’est opéré à la fin du XXe siècle, pour ne
cours de l’histoire moderne de la psychologie et jamais plus parler que d’identité nous pose maintenant la ques-
une conception comme le TDI n’avait mis autant la dis- tion de la perte de soi et, surtout, nous amène à nous
sociation sur le devant de la scène dans la psychologie interroger sur ce qu’on entend au juste par identité en
contemporaine. Sur ce plan, de plus en plus rares sont tant qu’unité/multiplicité et libre-arbitre. C’est justement
ceux à ne pas voir dans le TDI ce que Spiegel [2] décrit le questionnement dont traite le dernier ouvrage d’Edgar
comme une dissociation pathologique qui « est vécue Morin [7] allant de pair avec une pensée complexe sur
comme une perturbation involontaire de l’intégration l’identité humaine posant le principe de diversité unitas-
normale de la conscience consciente et du contrôle des multiplex : « Le refus d’une identité monolithique ou
processus mentaux ». Cette description dépeint assez réductrice, la conscience de l’unité/multiplicité (unitas
justement cette discontinuité aboutissant à l’émergence multiplex) de l’unité sont des nécessités d’hygiène men-
de plusieurs états de personnalités distincts, d’identités tale pour améliorer les relations humaines ».
dissociatives. Ainsi, on peut se demander si ces polémiques autour
En ne cessant d’être l’objet de polémiques depuis de cette psychopathologie, et le fait que celle-ci se carac-
le milieu du XIXe siècle, les débats actuels sur le TDI térise par le fait qu’un corps puisse être habité par
sont peut-être sur le point de nous faire sortir d’un plusieurs personnalités, ne portent pas en elles-mêmes
climat de controverse idéologique où se conjuguent les stigmates d’une désunion, d’une discontinuité de
l’inexpérience et les convictions des uns et des autres. notre intériorité. Les changements de personnalités qui
En effet, dans la 4e édition révisée du DSM IV en 1994 caractérisent le TDI, les différentes formes de sub-
[3], Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor- jectivités diraient d’autres, entraînent un haut risque
der (APA), le trouble dissociatif de l’identité – auparavant de confusion mais pas seulement chez ceux qui en
appelé trouble de personnalité multiple dans le DSM III sont atteints. Cette réalité clinique nous interpelle plus
[4] et III-R – a enfin été reconnu dans le champ de la généralement quant à notre propre sens de soi, notre
psychiatrie au niveau international. Intégration que l’on agentivité pour reprendre le terme d’Albert Bandura [8].
a également retrouvée la même année dans la CIM Elle rompt avec la conception d’un sujet traditionnel,
[5], avec moultes précautions oratoires, lesquelles se comme être pensant, telle qu’elle est pensée par la tra-
sont trouvées allégées dans la dernière CIM-11 [6] dans dition philosophique occidentale ; de la même manière
sa section spécifique sur les troubles dissociatifs. Ce que l’homme se donne à lui-même une image unitaire
changement de dénomination il y a plus de vingt ans du monde, de lui-même. Elle vient donc heurter les
entraînait une évolution de la nosographie psychiatrique schémas qui structurent traditionnellement notre pen-
qui doit être replacée à chaque fois dans un contexte sée. Quelle que soit la modélisation théorique qui se
historique, social. Mais si une forme d’unanimité dans prête à une réflexion sur le TDI, nous sommes amenés
les manuels diagnostiques internationaux est mainte- à nous interroger sur ce qui, selon nous, notre culture
nant posée, peut-on pour autant considérer que le TDI et nos codes sociaux, constitue une individualité, ce qui
est de nos jours mieux connu des professionnels de ter- nous permet de la contrôler et d’en garder une mémoire.
rain ? Pour ceux et celles qui le considèrent comme une Comment, par exemple suivant notre histoire, le récit
authentique psychopathologie, arrivent-ils à reconnaître que nous pouvons en faire, pouvons-nous nous consi-
des personnes simulant un TDI, ou de faux positifs, dérer comme un moi ou un soi unique ? Entraînant de
comme on peut les suspecter en épidémiologie ? Par facto une multiplicité de questionnements dès lors que
exemple, comme on les découvre régulièrement sur l’on en vient à parler du TDI, nous nous retrouvons plus
les réseaux sociaux et Youtube sous la forme d’avatars que pour toute autre psychopathologie face à une multi-
numériques suscitant autant fascination que rejet. tude d’opinions, clivées, ou simplement d’effets miroir.
Somme toute, pas si l’on écoute le nombre de clini- Une pluralité de voix dont il est parfois difficile de savoir
ciens qui continuent globalement de ne pas croire à son laquelle a raison... Il convient alors de ne pas chercher
existence, ou si l’on observe les programmes de cours à escamoter ces éléments contradictoires, sans aucun
universitaires en médecine ou psychologie qui n’en font doute de nature contre-transférentielle, mais plutôt de
pas mention. Ainsi, en surgissant comme un « retour les prendre en compte comme une composante associée
du refoulé » de la psychiatrie classique française, son à ce diagnostic, au défi actuel qu’exige sa compréhen-
étude s’impose à nous et vient réinterroger une vision sion.
franco-française de la dissociation héritée du XXe siècle Pour rappel, les controverses ont toujours existé
qui la considère comme pathognomonique de la schizo- dès lors qu’une personne a présenté plusieurs iden-
phrénie et. . . de l’hystérie. Nul doute qu’il ait fallu alors tités distinctes, des « alters », ce qui fut appelé plus
tout ce temps pour sortir d’une forme de suspicion cen- anciennement encore « double conscience », « per-
tenaire ne parvenant pas à reconnaître ce trouble de la sonnalités alternantes » ou un « dédoublement de la
conscience et de la compréhension de soi aboutissant à personnalité », ou encore « personnalités dédoublées »
une compartimentation intrapsychique extrême. En quit- [9]. On pense notamment au milieu XIXe siècle, berceau
tant la notion de personnalité multiple, le glissement de l’émergence du moi pluriel auquel le philosophe
786 L’Information psychiatrique • vol. 97, n ◦ 9, novembre 2021
© John Libbey Eurotext, 2021
Trouble dissociatif de l’identité en 2021 : stigmates d’un trouble dissociatif et d’une suspicion centenaire
analytique Hacking [10] fait remonter leur première aménagements défensifs conscients et inconscients,
apparition à 1885 avec l’observation du Dr Voisin, méde- comme la dénégation et le déni, individuels et col-
cin à Bicêtre, qui décrivit un patient, un certain Vivet, lectifs, pour garantir une mise à distance de réalités
présentant pas moins de huit personnalités distinctes. impensables, insupportables, et pour beaucoup inima-
À cette même époque, Ambroise Tardieu (1860) lança ginables. Cultures et époques sont des caractéristiques
une première étude de médecine légale sur « les sévices qui influencent l’acceptabilité ou l’accessibilité à cer-
et mauvais traitements exercés sur les enfants » [11]. taines notions psychologiques au point de s’interroger
Il y décrivait 632 cas de violences sexuelles, pour la parfois si ces notions ne sont pas de pures constructions
plupart sur des mineures ; notant que ces viols pou- sociales. Ainsi, que l’on engage le débat pour savoir si
vaient conduire à l’hystérie, voire au suicide. Dans une le TDI est une réalité ou une pure fantaisie de l’esprit,
autre étude parue en 1868, il relevait 726 meurtres de les échanges qui en découlent ne sont donc pas qu’une
nouveau-nés à Paris identifiés entre 1837 et 1866 [12]. Ce simple controverse, ils illustrent des courants de pen-
changement du discours médicolégal ouvrait à une pre- sée, des formes de constructions sociales ou des replis
mière reconnaissance scientifique, épidémiologique, de défensifs avec toutes les questions inhérentes qu’elles
ces violences, en particulier sur les enfants, mais il faudra peuvent générer.
finalement attendre encore près d’un siècle pour arriver Certes, comme en France avec les « épidémies
à une reconnaissance de leurs conséquences psycholo- d’extases » au XVIIIe et jusqu’au début du XIXe dans
giques. De ce point de vue, notre société a encore du le cimetière jouxtant l’église Saint-Médard à Paris, on
mal à reconnaître la gravité de ces conséquences sur le ne peut ignorer la période outre-Atlantique du « syn-
plan neurodéveloppemental, surtout pendant la petite drome de la fausse mémoire » au cours de laquelle sont
enfance, le TDI étant l’exemple d’altération sans doute apparues d’innombrables personnalités multiples acti-
le plus inquiétant et, de fait, celui qui soulève le plus de vées par des psychothérapeutes peu scrupuleux et avec
déni ou de dénégation. des pratiques anti-déontologiques ayant voulu à tout
Pourtant, ces descriptions de multiplication de cons- prix voir dans les malaises existentiels de leurs patients
ciences dans les articles de Henri Piéron, Alfred Binet, en des agressions sexuelles vécues dans leur enfance.
passant par la présentation que Pierre Janet [13] avait fait L’épidémie de pseudo « personnalités multiples »,
du cas d’Estelle de Despine, ne datent pas d’hier. Elles associée au « mouvement des souvenirs retrouvés »,
remontent à la fin du XIXe siècle, début du XXe , époque où accompagnée de procès retentissants jusqu’au début
cette multiplicité pouvait être associée à l’hystérie, à la des années 1990 accrut encore plus cette méfiance
transe religieuse ou une psychose hallucinatoire, jusqu’à ancestrale. Elle a en réalité mis en évidence, comme
la considérer comme de la schizophrénie. Autant de ver- l’a décrit Spanos [17], que la dissociation peut être
sions d’une théâtralisation de la psychiatrie qui doit sans induite expérimentalement. Ce faisant, cette mésaven-
doute beaucoup à l’œuvre de Charcot. Au fil du temps, ture nous a appris qu’il y a un réel risque à attribuer
plusieurs modèles théoriques ont tenté d’élaborer des exclusivement un rôle étiologique aux mémoires trau-
modèles explicatifs souvent hélas avec des caractéri- matiques. Comme E.F. Loftus l’a expliqué depuis 1994
sations trop restrictives. Actuellement, l’hypothèse les [18], et plus récemment encore [19], il ne fait aucun
considérant comme de simples altérations de la person- doute que de meilleurs appuis empiriques soient néces-
nalité, des personnalités métaphoriques, est contredite saires, sans doute multifactoriels, pour comprendre la
par plusieurs recherches en imagerie médicale [14, 15]. genèse des troubles dissociatifs notamment en émettant
Effectivement, des personnes simulant un TDI ne pré- l’hypothèse de leur origine pendant la petite enfance,
sentent pas les mêmes profils neurophysiologiques que par le retrait attentionnel décrit par A. Deprez [20] ou en
les personnes souffrant réellement d’un TDI. Est-ce à tant que répétition d’une expérience d’exposition à des
dire que les personnes se dissocient d’une manière troubles dissociatifs des figures d’attachement se réver-
différente au XXe siècle qu’au XIXe siècle ? Où les obser- bérant chez le tout-petit [21]. Pour le dire autrement, nous
vations – et les filtres des observateurs – des tableaux savons maintenant que la dissociation ne protège pas
cliniques ont-ils évolué au cours du temps ? Le fait d’influences suggestives, d’échecs cognitifs. Elle peut
est, si on associe l’apparition d’un TDI à des maltrai- même augmenter la vulnérabilité aux influences sugges-
tances précoces, en particulier à des violences sexuelles, tives liées au stress [22]. En somme, nous voilà de plus
nous n’avions effectivement pas les mêmes représen- en plus amenés à considérer qu’il n’y a pas forcément
tations de cette réalité avant les années 1980. Cette de lien direct entre un traumatisme et la dissociation
reconnaissance est récente et clairement nous ne retrou- mais une complexité causale aggravée par le trauma-
vons pas d’identification rétrospective de cette forme tisme impliquant de nombreuses variables autres que
de iatrogénie dans le passé. Ainsi, la souffrance des le traumatisme lui-même. Et ce sont leurs variations,
enfants liée aux maltraitances, pas seulement sexuelles, tant quantitatives que qualitatives, qui déterminent le
a longtemps été méconnue, sous-estimée comme elle niveau de complexité des phénomènes dissociatifs dont
l’est encore aujourd’hui dans le champ de la petite ils découlent et qui en découlent. Faute de ne pas en
enfance [16]. Cette sous-estimation est associée à des tenir compte, le risque est grand de frôler la pétition de
L’Information psychiatrique • vol. 97, n ◦ 9, novembre 2021 787
© John Libbey Eurotext, 2021
É. Binet
principe et finalement de n’asseoir notre capacité à Liens d’intérêt l’auteur déclare ne pas avoir de lien
rendre compte des phénomènes dissociatifs en ne d’intérêt en rapport avec cet article.
se référant qu’à une croyance. Ce chevauchement
complexe de plusieurs variables donnerait une piste
Références
explicative pour comprendre pourquoi certaines per-
sonnes victimes de violences sexuelles dans leur petite 1. Reinders AATS, Marquand AF, Schlumpf YR, et al. Aiding the diagno-
enfance développent un TDI et d’autres pas. sis of dissociative identity disorder: pattern recognition study of brain
biomarkers. Br J Psychiatry 2019 ; 215(3) : 536-44.
C’est dire aussi que la dimension herméneu-
2. Spiegel MD, Loewenstein RJ, Lewis-Fernández R, et al. Dissociative
tique entourant cette notion imagée, le TDI, dépeint disorders in DSM-5. Depress Anxiety 2011 ; 28 : 824-52.
dans la littérature psychiatrique depuis près de deux 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual
siècles, ne peut être séparée de sa prise en compte. of mental disorders. 4th edition. DSM-4. Washington DC, 1994.
L’herméneutique étant depuis Heidegger une manière 4. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual
of mental disorders. 3rd edition. DSM-3. Washington DC, 1980.
de comprendre l’existence humaine dans son rapport
5. Organisation mondiale de la santé. Classification Internationale des
au monde comme interprétation, notre vision de la troubles mentaux – CIM-10. Paris : Masson, 1994.
souffrance humaine est nécessairement associée à une 6. Organisation mondiale de la santé. ICD-11 [CIM-11] International
signification à partir d’une histoire, d’une culture au sein Classification of Diseases. 11th version. 2019. https://icd.who.int/browse
11/l-m/en#http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f585833559
desquelles nous sommes attachés en tant qu’humain,
(consulté le 1/11/21).
dans notre rapport à nous-mêmes, à l’autre et à l’altérité.
7. Morin E. Leçons d’un siècle de vie. Paris : Denoël, 2021.
Le développement de la recherche sur le TDI, tout 8. Bandura A. Social cognitive theory: an agentic perspective. Annu Rev
d’abord en Europe puis en Amérique, a entraîné un Psychol 2001 ; 52 : 1-26.
entrecroisement de systèmes théoriques ou spéculatifs. 9. Bless H. Psychiatrie pastorale. Paris : Lethielleux, 1936.
Ces différents niveaux constituent notre compréhen- 10. Hacking I. L’âme réécrite. Étude sur la personnalité multiple et les
sciences de la mémoire. Paris : Les Empêcheurs de penser en rond, 1998.
sion du TDI mais ils ont aussi entraîné une forme
11. Tardieu A. Étude médico-légale sur les sévices et mauvais traitements
d’élaboration doctrinale suspicieuse, radicale et repliée exercés sur les enfants. Ann hyg publique méd lég 1860 ; 13 : 361-98.
sur elle-même, parfois dans une critique totale empê- 12. Tardieu A. Étude médico-légale sur l’infanticide. Paris : J-B Ballière et
chant une expérience de dialogue, d’ouverture et de fils, 1868.
transformation. Mais les limites que nous impose notre 13. Janet P. L’automatisme psychologique : essai de psychologie expé-
rimentale sur les formes inférieures de l’activité humaine. Paris : Félix
héritage historique, ses errements, ne peuvent empê- Alcan, 1889.
cher des lignes d’évolutions internes. En soi, la prise 14. Reinders AATS, Willemsen ATM, Vos HPJ, Boer JAD. Fact or fac-
en compte actuelle du TDI procède dans le champ de titious? A psychological study of authentic and simulated dissociative
identity states. Plos One 2012 ; 7(6) : e39279.
la santé mentale par un effondrement de la relative per-
15. Schlumpf YR, Reinders AATS, Nijenhuis ERS, Luechinger R, Van Osch
manence de certaines normes, certains savoirs, même MJP, Jancke L. Dissociative part-dependent resting state activity in dis-
si elle permet toujours l’exercice du jugement critique sociative identity disorder: a controlled fMRI perfusion study. Plos One
2014 ; 9(6) : e98795.
en tenant compte également du fait que nous nous heur-
16. Binet E, Weigel B, Le Nestour A. Aménagement des processus défen-
tons à des données encore parfaitement inconnues pour sifs et mobilisation des affects en crèche. Étude clinique et analyse
comprendre la complexité de sa psychogenèse. psychodynamique. Psychiatr Enfant 2007 ; 50 : 205-57.
On peut espérer que le premier ouvrage en langue 17. Spanos N. Multiple identity enactments and multiple personality
disorder: a sociocognitive perspective. Psychol Bull 1994 ; 116(1) : 143-65.
française sur le TDI, sous l’égide de l’AFTD, qui paraî-
18. Loftus EF, Polonsky S, Fullilove MT. Memories of childhood sexual
tra aux éditions Dunod début 2022 soutiendra une abuse: remembering and repressing. Psych Wom Quart 1994 ; 18 :
réflexion approfondie sur le sujet. Regroupant une sélec- 67-84.
19. Loftus EF, Ketcham K. Le syndrome des faux souvenirs.
tion de contributions, pour certaines présentées lors de
Paris : éditions Exergue, 2012.
la 4e journée de conférences organisée par L’Association 20. Deprez A. Comprendre l’émergence d’un TDI au regard du dévelop-
francophone du trauma et de la dissociation, le 28 mars pement précoce confronté à l’adversité et au nouveau modèle théorique
2020 à Paris « Quand le trauma divise : le trouble dis- de l’attachement. In : Binet E, éd. Évaluer et prendre en charge le trouble
dissociatif de l’identité. Paris : Dunod, 2022.
sociatif de l’identité en 2020 », cet ouvrage constitue 21. Binet E. Répression des pleurs comme traumatismes rela-
le point d’orgue d’une réflexion permettant de mieux tionnels précoces. J Trauma Dissociation 2020 ; 4(2) : 100139.
connaître les multiples facettes du TDI. doi: 10.1016/j.ejtd.2020.100139.
788 L’Information psychiatrique • vol. 97, n ◦ 9, novembre 2021
View publication stats © John Libbey Eurotext, 2021
Vous aimerez peut-être aussi
- La Peur Des Autres Trac - Timidité - Phobie Sociale by André Christophe - Légeron Patrick - Z Lib - OrgDocument620 pagesLa Peur Des Autres Trac - Timidité - Phobie Sociale by André Christophe - Légeron Patrick - Z Lib - OrgHassene Menoueri100% (1)
- Evaluation Clinique de L'enfantDocument546 pagesEvaluation Clinique de L'enfantKyiubi el mundo100% (2)
- La Personnalité Fractionnée Et Amnésique Comprendre Le Trouble Dissociatif de L'identité PDFDocument97 pagesLa Personnalité Fractionnée Et Amnésique Comprendre Le Trouble Dissociatif de L'identité PDFAlexandre LebretonPas encore d'évaluation
- Les Grandes Problématiques de La Psychologie Clinique PDFDocument256 pagesLes Grandes Problématiques de La Psychologie Clinique PDFrogers4u2100% (8)
- Christophe André & Antoine Pélissolo & Patrick LégeronDocument359 pagesChristophe André & Antoine Pélissolo & Patrick LégeronBen Abdeljalill Mouna100% (1)
- La Peur Des Autres Trac, Timidite, Phobie Christophe AndreDocument684 pagesLa Peur Des Autres Trac, Timidite, Phobie Christophe AndreMagloire KajidPas encore d'évaluation
- Heuristiques Et Biais Cognitifs VFDocument21 pagesHeuristiques Et Biais Cognitifs VFetiemblePas encore d'évaluation
- Body language: Reconnaître et interpréter les gestes de la confianceD'EverandBody language: Reconnaître et interpréter les gestes de la confiancePas encore d'évaluation
- Troubles Schizophreniques 2021Document20 pagesTroubles Schizophreniques 2021Sokhna kiné Ndiaye GUEYE100% (1)
- TE - Theo BURY - Analyse Differentielle Perversions Et PsychoseDocument40 pagesTE - Theo BURY - Analyse Differentielle Perversions Et PsychoseBury ThéoPas encore d'évaluation
- La Cause Freudienne 78 - Des Autistes Et Des PsychanalystesDocument270 pagesLa Cause Freudienne 78 - Des Autistes Et Des PsychanalystesLeandraPas encore d'évaluation
- Clinique Des PsychosesDocument11 pagesClinique Des PsychosesBRAKNESSPas encore d'évaluation
- Exploration Du Milieu de TravailDocument32 pagesExploration Du Milieu de TravailMohammed FaycalPas encore d'évaluation
- Conception D'une Installation de RadiothérapieDocument56 pagesConception D'une Installation de RadiothérapieAbdelah El ArabiPas encore d'évaluation
- Troble Disociatif de L'identiteDocument8 pagesTroble Disociatif de L'identiteSimona FrunzaPas encore d'évaluation
- Projet Management InterculturelDocument15 pagesProjet Management InterculturelMaria MagdalenaPas encore d'évaluation
- Antonio Di Ciaccia-Qu Est-Ce Que La PsychoseDocument21 pagesAntonio Di Ciaccia-Qu Est-Ce Que La PsychoseFengPas encore d'évaluation
- RAPPORTDocument7 pagesRAPPORTIvan TchognaPas encore d'évaluation
- Troble Disociatif de L IdentiteDocument12 pagesTroble Disociatif de L IdentitesimonescuPas encore d'évaluation
- Neuropsychologie Sociale Quesque Bertoux AcceptedDocument17 pagesNeuropsychologie Sociale Quesque Bertoux Acceptedeya04930Pas encore d'évaluation
- Cahier de DPC: Version of RecordDocument36 pagesCahier de DPC: Version of RecordEllya SohyPas encore d'évaluation
- Collège Saint Louis: (Date)Document10 pagesCollège Saint Louis: (Date)elallalihajar14Pas encore d'évaluation
- Antonio Di Ciaccia - Qu Est-Ce Que La Psychose - Le Pont FreudienDocument21 pagesAntonio Di Ciaccia - Qu Est-Ce Que La Psychose - Le Pont FreudienJonathan LerPas encore d'évaluation
- Szondiana - Journal of Fate Analysis and Contributions To Depth PsychologyDocument88 pagesSzondiana - Journal of Fate Analysis and Contributions To Depth Psychologylovaseszter97Pas encore d'évaluation
- Beatriz Udenio - L Adolescence Et Ses Vacillements - Le Pont FreudienDocument21 pagesBeatriz Udenio - L Adolescence Et Ses Vacillements - Le Pont FreudienJonathan LerPas encore d'évaluation
- LQ 766Document27 pagesLQ 766Sebastian GodlewskiPas encore d'évaluation
- Les Troubles BipolairesDocument113 pagesLes Troubles Bipolairessandrine Bonnefont-DesiagePas encore d'évaluation
- Anthropologie Et FolieDocument36 pagesAnthropologie Et Foliemoukinechriphe02Pas encore d'évaluation
- These A Breuillot Claude 2021Document322 pagesThese A Breuillot Claude 2021dq2y945tmdPas encore d'évaluation
- 2021 Poenaru Psychopathologie Capitalisme Cognitivo ComportementalDocument12 pages2021 Poenaru Psychopathologie Capitalisme Cognitivo ComportementalChloé PlaziatPas encore d'évaluation
- Classifications en Psychiatrie de L'enfantDocument10 pagesClassifications en Psychiatrie de L'enfantAsma Ben OthmanPas encore d'évaluation
- La Dépression - Institut DiderotDocument67 pagesLa Dépression - Institut DiderotAnna MPas encore d'évaluation
- Biblio 4 SISM 2020 Qs Conséq Des Discrim PR Pers Vivant Avec Tbles Psychiq GD Publ AscodocpsyDocument6 pagesBiblio 4 SISM 2020 Qs Conséq Des Discrim PR Pers Vivant Avec Tbles Psychiq GD Publ AscodocpsySirimah Devi PlaichePas encore d'évaluation
- PSYCHOPATHOLOGIE Questions de PsychopathologieDocument117 pagesPSYCHOPATHOLOGIE Questions de Psychopathologiearchange gabPas encore d'évaluation
- Travaux D'étude Et de Recherche, LALLEMAN Constance Groupe 6Document15 pagesTravaux D'étude Et de Recherche, LALLEMAN Constance Groupe 6Constance LallemanPas encore d'évaluation
- Le Point Du Vue Du Psychanalyste Au Dossier de TonusDocument3 pagesLe Point Du Vue Du Psychanalyste Au Dossier de TonusAndré LopesPas encore d'évaluation
- Important Chapitre 7. Pathologies Narcissiques-Limites Et Enveloppes Institutionnelles - Cairn - InfoDocument24 pagesImportant Chapitre 7. Pathologies Narcissiques-Limites Et Enveloppes Institutionnelles - Cairn - InfoJMPas encore d'évaluation
- Borderline 2014Document52 pagesBorderline 2014faillertuePas encore d'évaluation
- Introduction. L'enveloppe Psychique, Une Perspective Critique - Cairn - InfoDocument19 pagesIntroduction. L'enveloppe Psychique, Une Perspective Critique - Cairn - InfoJMPas encore d'évaluation
- Extrato - Revue Recherches N. 08Document14 pagesExtrato - Revue Recherches N. 08correia.acrPas encore d'évaluation
- Psychologie Des JeunesDocument6 pagesPsychologie Des JeunesFabiana Perez GarciaPas encore d'évaluation
- Decouverte de La Psychanalyse FreudienneDocument9 pagesDecouverte de La Psychanalyse Freudiennekhadiro mahboulPas encore d'évaluation
- 1 s2.0 S000344871830218X AmDocument22 pages1 s2.0 S000344871830218X Amkoffi aya michèlePas encore d'évaluation
- Identite NarrativeDocument7 pagesIdentite NarrativeDEPas encore d'évaluation
- Trouble de La Personnalité SchizotypiqueDocument8 pagesTrouble de La Personnalité Schizotypiqueantoine2567Pas encore d'évaluation
- TA Adolescence WEBDocument34 pagesTA Adolescence WEBvanessa saPas encore d'évaluation
- Extrait Évaluer Et Prendre en Charge L'enfant Et L'adolescent en PsychologieDocument19 pagesExtrait Évaluer Et Prendre en Charge L'enfant Et L'adolescent en Psychologiebenloucifhadjer286Pas encore d'évaluation
- La Maladie Mentale Comme Problème Social: Henri DorvilDocument16 pagesLa Maladie Mentale Comme Problème Social: Henri Dorvildoryyyy2004Pas encore d'évaluation
- MD Maes p21837 2019Document63 pagesMD Maes p21837 2019matthieu kayembePas encore d'évaluation
- Extrait-Symptomes-contemporains 24pDocument24 pagesExtrait-Symptomes-contemporains 24pannalyrivierePas encore d'évaluation
- Veille 2022-12-15Document3 pagesVeille 2022-12-15LoreaudPas encore d'évaluation
- 2023 - La Psychologie A Une Fonction SocialeDocument5 pages2023 - La Psychologie A Une Fonction Socialenicola.thiryPas encore d'évaluation
- MalevalDocument17 pagesMalevalmojepatikePas encore d'évaluation
- Lagrange Et Les SondagesDocument4 pagesLagrange Et Les SondagesstarwalkersPas encore d'évaluation
- ExtraitDocument27 pagesExtraitSaïd Ben MoussaPas encore d'évaluation
- 1 s2.0 S0222961712018119 MainDocument5 pages1 s2.0 S0222961712018119 MainAbdoulhamid NaouirouPas encore d'évaluation
- Psychanalyse Et Science CognitiveDocument4 pagesPsychanalyse Et Science CognitiveAumercierPas encore d'évaluation
- Full Download Clinique Des Etats Psychotiques Chez L Adulte 2E Ed 2Nd Edition Vincent Di Rocco Online Full Chapter PDFDocument69 pagesFull Download Clinique Des Etats Psychotiques Chez L Adulte 2E Ed 2Nd Edition Vincent Di Rocco Online Full Chapter PDFgayeacaarabeaae209Pas encore d'évaluation
- Psychotique Définition - Recherche Google PDFDocument1 pagePsychotique Définition - Recherche Google PDFKelly Mccollough-LessardPas encore d'évaluation
- Expo ClichésDocument51 pagesExpo ClichéslamottePas encore d'évaluation
- Les Deficiences IntellectuellesDocument5 pagesLes Deficiences Intellectuelleshadjar.djebbour.psyPas encore d'évaluation
- Soigner Les Maladies MentalesDocument44 pagesSoigner Les Maladies Mentaleseqram rePas encore d'évaluation
- La Maladie de Gilbert Chez Le Noir Africain A Propos de 4 Observations Au Centre Hospitalier National de OuagadougouDocument5 pagesLa Maladie de Gilbert Chez Le Noir Africain A Propos de 4 Observations Au Centre Hospitalier National de Ouagadougoumouanmartin6Pas encore d'évaluation
- Muscu Bas Du CorpsDocument2 pagesMuscu Bas Du CorpsSehi LaurentPas encore d'évaluation
- 2003 Personnel CCLINDocument147 pages2003 Personnel CCLINOumaima TrabelsiPas encore d'évaluation
- REC MagasinierDocument27 pagesREC MagasinierHorch NadjetPas encore d'évaluation
- QCM Pathologie Des BoursesDocument5 pagesQCM Pathologie Des Boursesmohammed blilPas encore d'évaluation
- MCC Pharma20 21 VF PDFDocument48 pagesMCC Pharma20 21 VF PDFimaneabdelli1997Pas encore d'évaluation
- Questionnaire Santé Pour Certificat de Sport Français - AnglaisDocument1 pageQuestionnaire Santé Pour Certificat de Sport Français - AnglaisMohamed SangarePas encore d'évaluation
- Recette HaccpDocument3 pagesRecette HaccpMouldi MakhloufPas encore d'évaluation
- LSD Handicap Épisode 3 - Lutter Ensemble Contre Le ValidismeDocument15 pagesLSD Handicap Épisode 3 - Lutter Ensemble Contre Le ValidismeMoralesPas encore d'évaluation
- La Femme Du Pervers Narcissique - Cairn - InfoDocument22 pagesLa Femme Du Pervers Narcissique - Cairn - Infohalimiakila06Pas encore d'évaluation
- Planning Des Examens - session2-MPI+DL-15juinDocument1 pagePlanning Des Examens - session2-MPI+DL-15juinarfPas encore d'évaluation
- TP de Parasitologie 1 1 1Document32 pagesTP de Parasitologie 1 1 1junior yotedjePas encore d'évaluation
- Controle 2 - Semestre 1 - 3APIC - 2021-2022Document2 pagesControle 2 - Semestre 1 - 3APIC - 2021-2022Youssef ETTAJYPas encore d'évaluation
- Revue de La Litterature Sur La Prise enDocument12 pagesRevue de La Litterature Sur La Prise enLubin MiyabaPas encore d'évaluation
- Triade Cognitive de BeckDocument9 pagesTriade Cognitive de BeckMANAL ALILOUPas encore d'évaluation
- Fiche Demande de Test Covid - Pharmacie OpéraDocument1 pageFiche Demande de Test Covid - Pharmacie OpéraMathieu 777Pas encore d'évaluation
- Guide D Installation Pur Medecins Et Medecins Dentistes Version 2017Document3 pagesGuide D Installation Pur Medecins Et Medecins Dentistes Version 2017mpakoucelestePas encore d'évaluation
- Edentement Canine IncluseDocument24 pagesEdentement Canine IncluseoumPas encore d'évaluation
- Cours 11 Suite Version 30 Novembre 2023Document46 pagesCours 11 Suite Version 30 Novembre 2023duboisaudrey2002Pas encore d'évaluation
- Reglement Interieur Rhadamante 2023Document19 pagesReglement Interieur Rhadamante 2023alicebechu2fPas encore d'évaluation
- Exercice 2-23Document2 pagesExercice 2-23Thùy Linh HoàngPas encore d'évaluation
- 0320 Sexologie - Diu 2Document2 pages0320 Sexologie - Diu 2Clem CarnPas encore d'évaluation
- Production de MédicamentsDocument55 pagesProduction de Médicamentsbokafrica1Pas encore d'évaluation
- Tubes Des Prélèvements Pour MédecinsDocument2 pagesTubes Des Prélèvements Pour MédecinsKhadhraoui JamelPas encore d'évaluation
- Dgaumip-007 ProtocoleDocument63 pagesDgaumip-007 ProtocoleCtv MontrealPas encore d'évaluation
- La Prématurité.Document7 pagesLa Prématurité.anis anis100% (1)
- Strategie Iccm - Grille Supervision Asc Kobotoolbox 2Document8 pagesStrategie Iccm - Grille Supervision Asc Kobotoolbox 2zak nanPas encore d'évaluation