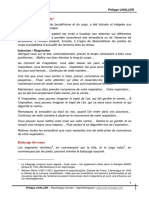Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Module 7 de Osphrologie
Module 7 de Osphrologie
Transféré par
gtb.ftbTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Module 7 de Osphrologie
Module 7 de Osphrologie
Transféré par
gtb.ftbDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
115 avenue de Grammont 37000 TOURS
112 rue de Turenne 75003 PARIS
MODULE 7
Madame, Monsieur,
Pour le module n° 7 vous devez répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi la « projection » est-elle révélatrice de
l’émergence de l’inconscient ?
2. Quelles sont les caractéristiques psychologiques et
philosophiques de la Relaxation 1er Degré ?
Dans la mesure du possible, il serait judicieux que vous puissiez animer une séance
de Relaxation dynamique 1er Degré, 2ème Cycle avec quelques amis volontaires.
Restant à votre disposition, veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes
sincères salutations.
William BONNET & Collaborateurs
MODULE N° 7 1 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
MODULE N° 7
SOPHROLOGIE ET DEVELOPPEMENT AFFECTIF
LE CONCEPT DE PROJECTION EN PSYCHOLOGIE
1 - HISTORIQUE
FRANK en 1939 est le premier à employer l’expression de « méthode projective »
pour rendre compte de la parenté entre trois épreuves psychologiques :
- le test d’association de mots de JUNG 1904,
- le test des taches d’encre de RORSCHACH 1920,
- le T.A.T. de MURRAY 1935.
FRANK montrait que ces techniques constituent le prototype d’une investigation
dynamique et holistique de la personnalité. En effet en utilisant ce type de tests, la
personnalité est envisagée comme une totalité en évolution dont les éléments
constitutifs sont en interaction.
En effet les tests projectifs sont devenus un des instruments les plus précieux de la
méthode clinique en psychologie, ils sont également une application pratique des
conceptions théoriques de la psychologie dynamique et notamment de la
psychanalyse.
Cependant, il est important de souligner que ces méthodes projectives révèlent un
caractère différent des tests psychométriques. Ils apportent au psychologue des
connaissances importantes sur autrui; de même, ce type de tests permet de
renforcer la finesse de l’entretien clinique, ce qui compense en partie leur moindre
rigueur statistique.
Les techniques projectives se distinguent des tests d’aptitude essentiellement par
l’ambiguïté du matériel présenté au sujet et la liberté des réponses qui lui est laissée.
Les tests projectifs se réfèrent essentiellement aux théories de la psychanalyse,
l’exemple de JUNG est significatif; en effet pour la psychologie expérimentale,
l’association des idées est une fonction mentale générale dont on cherche les lois du
fonctionnement. Pour la psychanalyse, ces associations sont dites libres, elles sont
rigoureusement déterminées par l’histoire du patient et de ses conflits inconscients.
En 1915 un suisse nommé RORSCHACH eut l’idée décisive que l’interprétation des
taches d’encre constituait une épreuve non pas d’imagination mais de personnalité;
c’est en effet l’organisation individuelle de la personnalité qui structure la perception
de telles taches.
L’expérience du dessin représente également une source historique des tests
projectifs. En effet en 1920 et 1930, les psychanalystes étendent leurs traitements
aux enfants et à la place de l’expression verbale, trop peu mûre chez ces derniers,
recourent aux dessins et aux jeux libres comme substituts des associations libres.
MODULE N° 7 2 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
A la même époque, les méthodes actives s’emparent de la pédagogie, elles prônent
le dessin et le récit libre pour épanouir la personnalité de l’enfant.
Dessin et récit libre se révèlent rapidement posséder une signification symbolique
analogue à celle des rêves et des symptômes névrotiques.
MURRAY en 1935 aux Etats Unis créé le premier test qui s’inspire de la technique
du récit libre : le test d’aperception des thèmes ou T.A.T.
Les tests projectifs utilisant le dessin sont plus tardifs.
En 1949, KOCH publie en Suisse le test de l’arbre et MACHOVER aux Etats Unis le
test du dessin d’une personne.
2 - ETYMOLOGIE
Le mot projection peut revêtir trois sens :
- le sens premier dénote une action physique, le jet, par exemple un lancement
de projectile. Par une analogie métaphorique, FREUD a désigné là par projection
une action psychique, caractéristique de la paranoïa qui consiste à expulser de la
conscience les sentiments répréhensibles pour les attribuer à autrui. En ce sens les
tests projectifs favorisent la décharge dans le matériel présenté au sujet de tout ce
que celui-ci refuse d’être, de ce qu’il ressent en lui comme mauvais ou comme étant
ses points vulnérables,
- les tests projectifs amènent le sujet à produire un protocole de réponse telle
que la structure de ce protocole corresponde à la structure de sa personnalité,
- le troisième sens du mot projection tire son origine de l’optique. La projection
lumineuse envoie sur une surface à partir d’un foyer des rayons ou des radiations, ce
mécanisme de projection a trouvé une transposition en psychophysiologie et en
psychologie (l’animisme, le mythe, la superstition consistent à percevoir dans le
monde extérieur des états affectifs qui sont en fait intérieurs).
Un test projectif est comme un rayon X qui traverse l’intérieur de la personnalité, fixe
l’image du noyau secret de celle-ci sur un révélateur (passation du test) et en permet
ensuite une lecture facile par agrandissement ou projection grossissante sur un
écran (interprétation du protocole).
Ce qui est caché est ainsi mis en lumière, le latent devient manifeste, l’intérieur est
amené à la surface.
Le premier sens du mot, celui de décharge pulsionnelle et émotionnelle précise le
niveau auquel opère le test projectif : il s’agit en quelque sorte d’un processus
psychanalytique bref; la passation d’un tel test est, au sens plein de l’expression, une
mise à l’épreuve pour le sujet, c’est-à-dire une épreuve de vérité.
Le second sens établit une correspondance structurale entre la personnalité conçue
comme le système des conduites propres à un individu, et les productions de celui-ci
dans une situation définie par deux variables : le matériel du test, les consignes de
liberté orientées du test.
MODULE N° 7 3 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
Le troisième sens véhicule des représentations archaïques de l’image du corps ou le
dedans est opposé au dehors, le caché à la surface.
3 - LA PROJECTION SELON FREUD
FREUD a parlé de projection à deux moments distincts de son oeuvre.
La première se situe en 1896 lorsqu’il découvre la psychanalyse, il sait que le
mécanisme purement psychologique du refoulement explique les symptômes
hystériques, que le maniement de la résistance et du transfert en permet le
traitement, il étend ce type d’explication qui concerne uniquement la forme des
symptômes à chaque psychonévrose; ainsi le refoulement du conflit s’exprime en
conversion dans l’hystérie, en déplacement de la culpabilité dans l’obsession, en
négation de la réalité par suite d’un chagrin profond dans l’hallucination, en
projection sur autrui de la haine chez un sujet perturbé.
- Exemple : dans la paranoïa, le reproche envers soi-même est refoulé d’une
manière qu’on peut décrire comme étant une projection, en suscitant un symptôme
consistant en méfiance envers autrui 1896.
- Exemple d’une homosexualité vécue sur le mode paranoïde : la genèse du
désir de persécution s’effectue en trois temps selon FREUD :
a) moi (un homme), je l’aime (lui, un homme) mais son caractère homosexuel
rend cet amour intolérable à la conscience.
b) le sentiment d’amour est alors retourné en son contraire : je ne l’aime, je le
hais, mais la conscience du sujet ne tolère pas davantage d’éprouver un sentiment
hostile.
c) je le hais devient il me hait ou me persécute, ce qui signifie la haine que je lui
porte, c’est là une projection, la haine n’est pas mon fait, or, elle existe, donc elle est
le fait de mes ennemis. Un sentiment d’origine interne est ainsi vécu par le sujet
comme s’il était la conséquence d’une perception externe: je ne l’aime pas, je le hais
parce qu’il me persécute.
La projection est ici l’expulsion d’un désir intolérable et son rejet au dehors de la
personne. Il y a projection de ce que l’on ne veut pas être ( FREUD).
A un second stade, FREUD pense que la projection est la simple méconnaissance
par le sujet de désir et d’émotion qu’il n’accepte pas comme siens, dont il est
partiellement inconscient et dont il attribue l’existence à des réalités extérieures.
Pour FREUD, la projection est un mécanisme de déplacement car il conserve le
continu du sentiment inconscient en déplaçant l’objet de ce sentiment.
La projection est un processus psychique primaire au même titre que
l’accomplissement hallucinatoire du désir dans le rêve ou que le transfert
psychanalytique.
MODULE N° 7 4 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
Les processus psychiques primaires obéissent au principe du plaisir, ils visent à
instaurer l’identité des perceptions.
Dans « Totem et Tabou » 1912, FREUD donne un développement plus étendu des
mécanismes de projection : l’animisme, la pensée magique et la tout puissance des
idées qu’on observe chez le primitif, l’enfant et le névrosé résultent de la projection
des processus psychiques primaires dans le monde extérieur. De là, découle
également l’intuition de FREUD selon laquelle la création artistique est une projection
de l’artiste dans son oeuvre.
4 - LA SITUATION DE TESTS PROJECTIFS
1 - Caractéristique
La situation de tests projectifs peut être définie d’après ses ressemblances et ses
différences avec la situation psychanalytique; en effet le patient qui entreprend une
cure psychanalytique est invité à parler librement, aucun thème de départ, aucune
directive ne lui sont fournis, il fait part des idées, des sensations, des images
mentales, des affects au fur et à mesure que ceux-ci se présentent à sa conscience,
par ailleurs il a un temps indéfini devant lui.
Le sujet soumis à un test projectif se trouve dans une situation analogue de liberté
mais non de durée, ce qui entraîne deux différences supplémentaires : l’introduction
d’un matériel préalable et celle d’une enquête ultérieure.
Le sujet testé est en effet libre de ses réponses, il est libre de dire ou de faire ce qu’il
veut à partir du matériel qui lui est présenté et du type d’activité qui lui est proposé.
Il n’y a pas de bonne et de mauvaise réponse fixée à l’avance, la première idée qui
lui vient à l’esprit est la bonne.
Comme en psychanalyse, ce qui compte c’est ce qui se présente spontanément à la
conscience.
Les recherches ont montré que sous une apparence non structurée, les tests
projectifs font recours à des structures très précises qui sont essentiellement de
nature affective et fantasmatique. Les tests projectifs favorisent l’émergence
d’associations libres, c’est la raison pour laquelle le matériel est souvent ambigu
(taches d’encre, gravures vagues, dessins ébauchés, mots multivoques) car celui-ci
est un déclencheur d’associations.
Les consignes renvoient le sujet à son propre désir; à l’issue du test, il est nécessaire
de procéder à une enquête afin de cerner la dynamique psychique et personnelle qui
a conduit le sujet à fournir les réponses qu’il vient de donner.
Comme dans la situation psychanalytique, la consigne qui laisse au sujet la plus
grande liberté est en même temps pour lui une contrainte car par cette méthode, il
est condamné à être libre, c'est-à-dire à se révéler lui-même. Pour FREUD, être libre,
c’est un moyen de réaliser ses désires. Mais chez le sujet cette perspective de liberté
mobilise en même temps de l’angoisse, car certains désirs sont intérieurement
interdits.
MODULE N° 7 5 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
Le testeur adopte l’attitude de neutralité bienveillante caractéristique du
psychanalyste; en effet, il s’ébauche entre le testé et le testeur une relation
transférentielle plus ou moins manifeste et plus ou moins brève qui, selon qu’elle est
positive ou négative, stimule les productions du sujet ou ses blocages. La différence
avec la cure psychanalytique consiste en ce que le matériel proposé au sujet
constitue une médiation entre le testeur et le testé. Le sujet ne dévoile son désir
qu’indirectement au psychologue, il lui parle à travers l’élaboration qu’il fait du
matériel présenté.
On peut noter une autre différence entre la méthode psychanalytique et la méthode
projective, le patient est généralement allongé en situation psychanalytique alors que
le testé est généralement assis, la régression psychique liée à la position du corps
dans l’espace est ainsi plus profonde avec la psychanalyse, cette différence relative
à l’espace va dans le même sens que la différence relative à la durée : le testé est
invité à une brève plongée dans l’inconscient, on lui laisse les moyens de se
reprendre rapidement.
Les points communs à toutes les épreuves projectives consistent dans la qualité
particulière du matériel proposé à la fois concret et volontairement ambigu. Les
consignes, en général, reprennent cette injonction essentielle de « l’imaginé à partir
du voir », susceptible de déclencher la mobilisation de conduite perceptive et de
conduite projective.
Les épreuves projectives proposent des situations dont les variables sont définies,
l’objectif étant d’engendrer des réactions au niveau du sujet et d’observer les moyens
qu’il va trouver pour répondre aux consignes, ceci témoigne des modalités
particulières de son fonctionnement psychique.
2 - Les effets
La structuration inconsciente du matériel des tests projectifs se caractérisant
essentiellement par un flou relatif des consignes va permettre l’émergence de la
structure profonde de la personnalité, le matériel va réactiver les conflits
psychologiques et déclencher une angoisse et une régression.
L’angoisse est associée à des représentations fantasmatiques inconscientes qui
transparaissent dans le contenu des réponses du sujet.
Les mécanismes de défense du moi contre l’angoisse et contre les fantasmes se
manifestent plutôt dans les caractéristiques formelles des réponses. La psychanalyse
distingue trois aspects de la régression psychique :
- un aspect formel où il y a régression de la pensée rationnelle et conceptuelle,
- un aspect chronologique, il y a régression de l’état adulte à la petite enfance
ou si le sujet est un enfant il y a régression à des stades antérieurs du
développement pulsionnel,
- un aspect topique où l’on peut observer une régression du moi au ça.
MODULE N° 7 6 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
D’une façon générale, la situation projective comme la situation psychanalytique
provoque la régression dans l’appareil psychique; ainsi l’inconscient est confronté au
principe de réalité ainsi qu’au principe de plaisir.
- selon les tests utilisés, il semble que la régression soit plus ou moins
marquée, exemple, le T.A.T.
Dans le T.A.T. , les mécanismes de régression sont moins profonds que dans le test
du RORSCHARCH car le matériel utilisé est plus figuratif.
5 - LES DIVERS TYPES DE PROJECTION
La confusion faite entre expression et projection demande à être dissipée, le dessin
libre, le récit libre, le jeu dramatique improvisé expriment la personnalité de celui qui
les pratique.
L’extériorisation qu’ils déclenchent peut avoir une vertu thérapeutique ou
pédagogique ou esthétique mais pour ces derniers on ne peut pas parler à
proprement dit de test car le test suppose une situation standardisée et une intention
d’évaluation de la part du psychologue. BELLAK et SYMONDS proposent de
distinguer
- les techniques d’expression où le sujet est entièrement libre tant au point de
vue des consignes que du matériel proposé,
- les techniques projectives où les réponses sont libres mais le matériel est
défini et standardisé,
- les techniques d’adaptation constituées par des tests psychométriques où une
seule réponse est correcte et où le matériel requiert une précision rigoureuse,
- dans leur pratique quotidienne, les psychologues distinguent deux catégories
de tests projectifs :
a) Les tests projectifs thématiques, dont le T.A.T. reste le modèle, révèlent les
contenus significatifs d’une personnalité :
- nature des conflits
- désirs fondamentaux
- réaction à l’entourage
- moments clés de l’histoire vécue, tels sont les jeux dramatiques, les dessins
ou récits libres, les interprétations de tableaux, de photographies ou de documents.
Le testé peut projeter ce qu’il croit être, ce qu’il voudrait être, ce qu’il refuse d’être, ce
que les autres sont ou devraient être envers lui.
Par l’utilisation des tests projectifs, nous sommes renseignés sur les réseaux de
motivations dominantes du sujet, sur ses mécanismes de défense, sur ce que
CATTELL appelle « la dynamique du moi ».
b) Les tests projectifs structuraux ont pour prototype le RORSCHACH, il ne
recueille plus comme les tests thématiques la manifestation des forces vives du
sujet, ils aboutissent plutôt à une coupe représentative du système de sa
personnalité, de son équilibre, de sa façon d’appréhender le monde; il s’agit plutôt
d’observer les interrelations entre les instances du ça, du moi et du surmoi.
MODULE N° 7 7 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
T.A.T.
1 - HISTORIQUE
C’est en 1935 que MORGAN et MURRAY publièrent la première forme du
THEMATIC APPERCEPTION TEST (test d’aperception des thèmes).
En 1938, MURRAY expose les résultats de ses recherches dans son livre intitulé
« explorations de la personnalité ».
En 1943, il publie la forme définitive du texte avec le manuel d’application
actuellement utilisé.
Henry MURRAY, médecin et biochimiste, avait découvert la perspective
psychanalytique grâce à JUNG avec qui il commença une psychanalyse personnelle
qu’il acheva avec ALEXANDER à Chicago.
Son test porte la marque de cette double formation : il cherche à réaliser une
expérimentation provoquée sur l’inconscient. Nommé directeur de la clinique
psychologique d’Harvard, il met sur pied une énorme expérience destinée à valider
un inventaire exhaustif des variables de la personnalité et à fournir ainsi une base
scientifique à l’interprétation de son texte.
Des étudiants volontaires se soumettent pendant plusieurs mois à une vingtaine de
techniques d’investigations psychologiques administrées et dépouillées par des
expérimentateurs distincts : entretiens guidés, autobiographies, séances
d’associations libres sur les souvenirs d’enfance et la vie sexuelle, conversations
impromptues, questionnaires, test de Rorschach, test de Rosenzweing, test de
niveau d’inspiration, test d’interaction sociale, test de jugement esthétique, test
d’intérêt etc...
Des réunions fréquentes de synthèse sur chaque sujet puis de généralisation des
résultats individuels permirent d’élaborer les trois listes suivantes de variables
fondamentales de la personnalité.
2 - LISTE DES VARIABLES
I° Liste des motivations
Il y a 20 besoins regroupés sous neuf rubriques :
Rubrique a) : 1. Besoin de domination,
2. Besoin de soumission,
3. Besoin d’autonomie,
4. Besoin d’agression,
5. Besoin d’humiliation;
Rubrique b) : 6. Besoin d’accomplissement2;
MODULE N° 7 8 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
Rubrique c) : 7. Besoin sexuel,
8. Besoin de sensations,
9. Besoin d’exhibition (de soi),
I0. Besoin de jeu;
Rubrique d) : II. Besoin d’affiliation (affinité envers autrui),
I2. Besoin de réjection (rejeter les autres);
Rubrique e) : I3. Besoin d’être secouru,
I4. Besoin de protéger;
Rubrique f) : Besoin d’éviter le blâme (cette rubrique, d’abord
retenue, n’a pas été validée);
Rubrique g) : I5. Besoin d’éviter l’infériorité,
I6. Besoin de se défendre,
I7. Besoin de réaction;
Rubrique h) : I8. Besoin d’éviter la souffrance;
Rubrique i) : I9. Besoin d’ordre;
Rubrique j) : 20. Besoin d’intellection (compréhension intellectuelle).
2° Liste des facteurs internes
Il s’agit des instances psychiques décrites par la psychanalyse et qui
interviennent, à coté des besoins, dans le déclenchement des conduites
:
- idéal du moi (idéal d’accomplissement de soi),
- narcissisme (amour du moi pour lui-même),
- surmoi intégré (le moi peut s’y conformer),
- surmoi en conflit (crise de conscience, sentiments de culpabilité,
dépression).
3° Liste des traits généraux
Ce sont les états intérieurs et les émotions vécus par le sujet :
I. Angoisse,
MODULE N° 7 9 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
2. Créativité,
3. Conjonctivité-disjonctivité (coordination ou non de l’action et de la
pensée),
4. Emotivité,
5. Persistance de l’effort,
6 Exocathexio-endocathexion (investissement de l’énergie soit dans la
vie pratique, soit dans la vie intérieure),
7. Intraception-extroception (dominance soit des sentiments et de
l’imagination, soit des faits),
8. Impulsion-délibération (avant l’action),
9. Intensité de l’effort,
I0. Projectivité-objectivité (dans les jugements sur autrui),
II. Radicalisme-conservatisme (en politique),
I2.Uniformité-changement.
3 - ADMINISTRATION
Le test se compose de 31 images constituées sous forme de dessins, de
photographies, de reproductions de tableaux ou de gravures. La signification
des images est volontairement ambiguë. Une planche (la planche 16 est
complètement blanche : elle favorise la projection de l’image idéale que le sujet se
fait de lui-même).
Selon MURRAY, le sujet est invité à raconter une histoire pour chaque planche, les
consignes imposent à l’examinateur de veiller, en posant des questions appropriées ,
à ce que l’histoire ait un commencement, un déroulement et une fin. On demande au
sujet que soit précisé ce qui se passe sur l’image, les sentiments éprouvés par les
personnages, ce qui s’est passé auparavant, quel sera le dénouement, on informe le
sujet qu’il dispose en moyenne de 5 minutes par planche. Les consignes sont
susceptibles de variations selon l’âge, l’intelligence, les troubles du sujet,
l’examinateur encourage le sujet à la brièveté ou au détail selon le cas, il peut par
exemple, attirer l’attention du sujet sur un détail l’image négligé par lui mais il
s’abstient de toute suggestion ou information sur ce que représente l’image ou le
détail.
Pour la planche 16, planche blanche, on demande au sujet d’imaginer une gravure
au besoin en fermant les yeux puis d’inventer une histoire à partir d’elle. Après la
passation, on procède à une enquête pour savoir d’où le sujet a tiré l’idée de son
histoire : lecture, film sont le plus souvent évoqués, les souvenirs personnels, les
fragments d’histoires vécues, les fantaisies plus ou moins inconscientes du sujet sont
par contre les plus significatives.
MODULE N° 7 10 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
Lors de l’enquête, on peut provoquer systématiquement les associations libres du
sujet à partir de chaque phase de l’histoire, cette méthode sort du cadre du test et
constitue un début de psychothérapie.
4 - L’INTERPRETATION
L’interprétation du T.A.T. présente de plus grandes difficultés que celle du
RORSCHACH : il n’existe pas de cotation chiffrée permettant d’aboutir à un
psychogramme.
Selon MURRAY, dans sa première étude de 1935, les histoires inventées par le sujet
constituent des descriptions légèrement déguisées de la conduite de celui-ci dans la
vie réelle. La façon dont le sujet réagit au matériel du test est souvent analogue à la
manière de réagir à son entourage familial et social habituel.
Dans son manuel de 1943, MURRAY propose un principe de transcriptions capitales:
les histoires forgées par le sujet contiennent d’une part un héros auquel le sujet
s’identifie et auquel il attribue ses propres motivations, d’autre part, des personnages
en interaction avec le héros qui représentent les forces du milieu familial et social
réelles dont le sujet ressent la pression.
Ce principe d’inspiration béhavioriste a été conservé par la plupart des auteurs.
MURRAY distingue l’analyse formelle du protocole et l’analyse du contenu.
L’analyse formelle étudie la compréhension de la consigne par le sujet, son degré de
coopération à l’épreuve, l’exactitude de sa perception de chaque image, la
construction des histoires, leur cohérence, leur concision, leur richesse en détails,
leur degré de réalité, leur style, l’absence d’une phase de l’histoire, la tendance aux
descriptions ou aux allégories plutôt qu’aux interprétations, le langage employé :
pauvreté ou richesse, présence ou absence de certaines catégories verbales,
longueur des histoires, syntaxe etc...
Tout cela donne des renseignements sur l’intelligence du sujet, l’exactitude de sa
pensée, ses capacités artistiques ou littéraires, ses aptitudes verbales et aussi sur
son intuition psychologique et son sens de la réalité. Les tendances pathologiques
peuvent s’y déceler facilement.
L’analyse de contenu comporte cinq points :
a) Les motivations du sujet s’expriment au travers du héros de la planche
La première tache de l’examinateur est de déceler parmi les personnages
de chaque histoire le héros auquel le sujet s’est identifié, les critères sont les
suivants :
- le héros tend à être le personnage auquel le sujet testé s’est le plus
intéressé adoptant son point de vue, décrivant avec le plus de détails ses actions et
ses sentiments.
MODULE N° 7 11 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
Le héros, c’est celui qui ressemble le plus au sujet par l’âge, le sexe, le caractère,
l’histoire.
Le héros est celui qui joue le rôle central dans le déroulement de l’action dramatique.
Le héros est généralement un des personnages représenté sur une image, il est
facile à désigner pour la majorité de l’histoire.
Parfois, il est nécessaire de distinguer plusieurs héros partiels ou encore un héros
primaire et un héros secondaire. Chacun d’eux représentant alors les tendances
inacceptées, mal intégrées ou conflictuelles chez le sujet.
Les actions accomplies par le héros de chaque histoire ou les émotions qu’ils
expriment représentent les motivations du sujet (les variables de la personnalité).
MURRAY suppose qu’il s’agit là de besoins profonds, latents et qui sont, à l’occasion
, source du comportement manifeste du sujet (se référer à la liste des motivations).
Chaque fois qu’une variable se présente chez le héros d’une histoire, MURRAY la
cote de 1 à 5 selon son intensité, sa durée, sa répétition et son importance dans le
cours de l’histoire.
b) Les forces de l’entourage exercent leur influence sur le héros :
MURRAY considère que les forces de l’entourage sur le héros sont en fait
des pressions. Elles sont insérées à partir des actions et des émotions des autres
personnages des histoires. La liste de MURRAY est la suivante : affiliation,
agression, danger physique, domination, manque ou perte de quelque chose dont le
héros a besoin, protection, rejet. MURRAY cote également de 1 à 5 chaque
présence d’une de ces variables.
c) Déroulement et dénouement de l’histoire :
Pour chaque histoire, il y a lieu de noter :
- comment le héros réagit à l’entourage, c’est-à-dire comment il se conduit
dans la situation qui constitue le thème de l’histoire inventé par le sujet (analyse des
vernes exprimant les conduites, par exemple agitation, abandon, dissimulation,
triomphe etc...),
- comment il fait progresser la situation vers le dénouement (style de sa
conduite impulsive ou contrôlée, énergique ou faible, tenace ou labile, coordonnée
ou non, souple ou rigide, avec initiative ou inerte),
- comment se produit le dénouement (par l’action volontaire du sujet, par
celle de l’entourage, les choses s’arrangent-elles d’elles-mêmes?, etc...),
- de quelle nature est le dénouement : pleinement conforme à la
motivation du sujet, conforme après effort ou compromis, échec partiel pour le sujet,
échec total, absence de dénouement).
d) Analyse des thèmes :
Après avoir analysé séparément les motivations du héros et les forces de l’entourage
qui exercent leur influence sur lui, il est nécessaire de saisir globalement leur
interaction. Un thème est constitué par une telle interaction : c’est une unité
dramatique. Chaque histoire narrée par le sujet comprend un ou plusieurs thèmes.
MODULE N° 7 12 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
Il faut relever les thèmes les plus fréquents et aussi les thèmes exceptionnels par
leur intensité dramatique, par leur richesse psychologique ou par leur carctère unique
dans le thème. Les thèmes nous renseignent sur les problèmes majeurs ou mineurs
du sujet.
e) Intérêt et sentiment :
Il s’agit d’isoler les habitudes positives ou négatives du héros envers les figures
paternelles (homme âgé), maternelles (femme âgée) et envers les personnages de
l’un et l’autre sexe, du même âge que lui.
Une fois effectuées l’analyse formelle et l’analyse du contenu, on procède à la
synthèse des résultats, MURRAY donne à ce propos les indications suivantes :
a) les récits élaborés par le sujet peuvent représenter un aspect de sa
situation actuelle dans la vie et quelques fois dans le test une situation passée, une
situation espérée ou redoutée, ou une situation dans laquelle il se trouvera
normalement à l’avenir.
b) du point de vue de la personnalité du sujet, ses récits peuvent être
rapportés à des souvenirs personnels, à des sentiments et des désirs actuels, à des
choses qu’il aurait voulu faire, à ce qu’il imagine pouvoir être ou faire un jour, à des
tendances élémentaires inconscientes et sources de rêverie infantile.
c) il faut départager les histoires impersonnelles uniquement déterminées
par les gravures et les histoires où le sujet s’est véritablement projeté. Selon
MURRAY, 30% des histoires sont impersonnelles.
d) l’interprétation d’un T.A.T. doit tenir compte des trois niveaux de la
personnalité : les tendances refoulées, la pensée intérieure, le comportement. Ces
trois niveaux sont à rapprocher de l’inconscient, du pré-conscient et du conscient,
selon FREUD. Le T.A.T. remonte du comportement à sa source mais il découvre des
motivations qui peuvent ne pas se réaliser dans le comportement.
CONTENUS MANIFESTES ET CONTENUS LATENTS AUX PLANCHES DU
T.A.T.
Contenus manifestes et contenus latents
Aux planches du T.A.T.
Pour une analyse plus fine des contenus manifestes et latents, voir V. Shentoub et
coll. Manuel d’utilisation du T.A.T.; approche psychanalytique, Paris, Dunod, 1990.
PLANCHE 1
Manifeste : un garçon, la tête entre les mains, regarde un violon posé devant
lui.
Latent : renvoie à l’image d’un enfant; l’accent porte donc sur l’immaturité
fonctionnelle face à un objet d’adulte.
Le conflit peut porter sur la difficulté, voire l’impossibilité à utiliser cet objet
dans l’immédiat, avec aux deux extrêmes la position dépressive (incapacité,
impuissance) et la position mégalomaniaque (toute-puissance).
MODULE N° 7 13 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
PLANCHE 2
Manifeste : « Scène champêtre ». Un homme avec un cheval, une femme
adossée à un arbre, une jeune fille au premier plan tient des livres.
Latent : renvoie au triangle oedipien : père-mère-fille, mais sans notion
d’immaturité fonctionnelle.
Le conflit peut porter sur la position du jeune adulte face au couple, ce qui
est objectivé au niveau du contenu manifeste par la différence entre les deux plans.
Chaque personnage pouvant être perçu comme nanti à sa façon.
PLANCHE 3BM
Manifeste : un individu affalé au pied d’une banquette (sexe et âge
indéterminés, objet également flou).
Latent : renvoie à la position dépressive avec traduction corporelle.
PLANCHE 4
Manifeste : une femme près d’un homme qui se détourne (différence de sexe,
mais non de génération).
Latent : renvoie à une relation de couple manifestement conflictuelle avec
deux pôles : agressivité-tendresse.
PLANCHE 5
Manifeste : une femme d’âge moyen, la main sur la poignée d’une porte,
regarde à l’intérieur d’une pièce.
Latent : renvoie à une image féminine (maternelle) qui pénètre et regarde.
PLANCHE 6BM
Manifeste : un homme, de face, l’air soucieux, et une femme âgée qui
regarde ailleurs (différence de sexe et différence de génération).
Latent : renvoie à une relation mère-fille dans un contexte de malaise. Le
conflit peut se nouer autour de l’interdit du rapprochement oedipien objectivé au
niveau de l’image par l’espace qui sépare les deux protagonistes de même que par
leur position rspective.
PLANCHE 7BM
Manifeste : deux têtes d’hommes côte à côte; l’un « vieux » tourné vers
l’autre « jeune » qui fait la moue (différence de génération, pas de différence de
sexe, pas d’immaturité fonctionnelle).
Latent : rapproché de type père-fils, dans un contexte de réticence du fils
au niveau des idées (corps exclus).
Le conflit peut se nouer autour du rapprochement entre ces deux
personnages avec deux pôles : tendresse-opposition.
PLANCHE 8BM
Manifeste : un homme couché, deux hommes penchés sur lui avec un
instrument. Au premier plan, un garçon seul qui tourne le dos à la scène, et un fusil
(pas de différence de sexe, différence de génération, pas d’immaturité fonctionnelle).
MODULE N° 7 14 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
Latent : renvoie à une scène d’agressivité ouverte mettant en présence
des hommes adultes et un adolescent dans un contexte de positions contrastées
active/passive.
Le conflit peut se nouer autour de la scène d’agressivité ouverte du
deuxième plan en la reliant au garçon et au fusil du premier plan.Il renvoie au
problème de l’agression corporelle qui peut être vécue au niveau de la castration ou
au niveau de la destruction.
PLANCHE 6GF
Manifeste : une jeune femme assise au premier plan se retournant vers
un homme qui se penche sur elle (pas de différence de génération marquée,
différence de sexe).
Latent : renvoie à une relation hétérosexuelle dans un contexte de désir
libidinal et de défense contre le désir (y compris la culpabilité). Le désir est objectivé
par le mouvement de l’un vers l’autre, et la défense par la séparation des plans.
Le rapproché oedipien est offert et interdit à la fois.
PLANCHE 7GF
Manifeste : une femme, livre à la main, penchée vers une petite fille à
l’expressin rêveuse qui tient un poupon dans les bras (différence de génération,
immaturité fonctionnelle pour la fille).
Latent : renvoie à une relation de type mère-fille dans un contexte de
réticence de la part de la fillette (rivalité, identification).
Le conflit se noue autour de l’identification à la mère, favorisée par celle-ci.
PLANCHE 9GF
Manifeste : une jeune femme, derrière un arbre, portant des objets,
regarde une deuxième jeune femme qui court en contrebas (pas de différence de
génération, ni de sexe, pas d’immaturité fonctionnelle).
Latent : renvoie à une situation de rivalité féminine dans un contexte
dramatisé.
Le conflit peut se nouer autour de la rivalité féminine accentuée au niveau
du matériel par la ressemblance entre les deux femmes et le fait que l’une semble
surveiller la fuite de l’autre.
PLANCHE 10
Manifeste : un couple qui se tient embrassé (seuls les visages sont
représentés; le contraste blanc et noir est accentué).
Latent : renvoie à l’expression libidinale au niveau du couple. L’image est
suffisamment peu nette pour qu’il puisse y avoir différentes interprétations quant au
sexe et à l’âge des deux personnages. La fantaisie peut également tenir compte du
halo dramatique objectivé par le contraste blanc-noir.
PLANCHE 11
Manifeste : paysage chaotique avec de vifs contrastes d’ombres et de
clarté, en à pic (détail à gauche : style dragon ou serpent).
Latent : réactivation d’une problématique prégénitale. Quelques éléments
plus structurés (pont, route...) peuvent permettre la remontée vers un niveau moins
archaïque (régression possible ou pas).
MODULE N° 7 15 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
PLANCHE 13MF
Manifeste : une femme couchée, la poitrine dénudée et un homme au
premier plan le bras devant le visage.
Latent : renvoie à l’expression de la sexualité et de l’agressivité dans le
couple.
PLANCHE 13B
Manifeste : un petit garçon assis sur le seuil d’une cabane aux planches
disjointes (contraste : lumière à l’extérieur et intérieur très noir).
Latent : renvoie à la capacité à être seul, l’accent portant ici sur
l’immaturité fonctionnelle (image d’un enfant) et sur la précarité du refuge maternel
symbolisé par la cabane (capacité de fantasmer l’objet absent).
PLANCHE 19
Manifeste : image « surréaliste »de maison sous la neige ou de bateau
dans la tempête avec fantômes, vagues...
Latent : réactivation d’une problématique prégénitale. Le stimulus peut
évoquer un contenant et un environnement permettant la projection du bon et du
mauvais objet.
La planche pousse à la régression et à l’évocation de fantasmes
phobogènes.
PLANCHE 16
Manifeste : « Carte blanche » pour le sujet.
Latent : renvoie à la manière dont le sujet structure ses objets privilégiés
et aux relations qu’il établit avec eux (niveau aauquel il se place. Poids et impact des
procédés défensifs).
En l’absence d’un support imagé, les éléments transférentiels peuvent y
devenir prégnants.
Chaque fois qu’on se livre à l’analyse des récits fournis par le sujet , on
confronte la problématique abordée aux contenus latents sollicités préférentiellement
par les planches.
Dans les meilleurs des cas, on observe une correspondance entre le contenu latent
du discours du sujet et le contenu latent du matériel.
Ainsi à la planche n°1, la reconnaissance et l’élaboration de la problématique
(angoisse de castration) suppose que la différenciation entre sujet et objet soit
solidement établie. Quand les processus d’individualisation sont perturbés, l’accent
porte sur les difficultés voire l’incapacité à poser une représentation de sujet unifié
face à un objet dont l’intégrité ne serait pas menacée : en témoignent les thèmes
d’instrument cassé, les bizarreries dans l’appréhension du personnage ou encore les
fausses perceptions.
A la planche 2, la situation oedipienne n’est pas toujours mise en scène ou ne
montre pas sa dimension organisatrice : apparaît alors une pseudo triangulation soit
par télescopage des orles, soit par un clivage entre un bon et un mauvais objet qui
se substitue à la différence des sexes.
MODULE N° 7 16 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
La planche 5 renvoie à la relation à l’image maternelle, mais celle-ci peut être traitée
dans des contextes très différents : dans un registre oedipien, la planche réactive la
curiosité sexuelle et la culpabilité qu’elle engendre, les deux étant condensés dans le
regard du personnage féminin qui pénètre dans une pièce sur l’image. Dans d’autres
contextes, en l’absence, par exemple, d’une intériorisation suffisante du surmoi,
l’image maternelle intrusive est persécutive voire mortifère qui envahit le champ
associatif.
La planche 7GF, tout en mettant l’accent sur les processus identificatoires au sein
de la relation mère/fille éveille des représentations et des affects liés aux interactions
précoces mère/enfant. Le sujet se focalise, par exemple, sur la manière dont la
fillette porte le bébé livrant des associations importantes sur son vécu de ce que
WINNICOTT appelle le HOLDING.
La planche 8BM peut être traitée en termes oedipiens : agressivité, culpabilité
envers l’image paternelle, angoisse de castration mais dans des contextes moins
évolués, les charges d’agressivité beaucoup plus intenses nourrissent des fantasmes
de relation sadomasochiste ou font basculer la problématique du coté de la
destruction et de l’angoisse d’anéantissement.
La planche 9GS sollicite au niveau le plus évolué l’évocation d’un conflit de rivalités
entre deux femmes de la même génération, mais quand les pulsions agressives sont
trop fortes, elles donnent naissance à des représentations d’image maternelle
persécutant ou mortifère, exemple, thème de surveillance ou de noyade. C’est
l’environnement (la mer déchaînée, la tempête, le ciel d’orage) qui devient le support
de la projection d’un mauvais objet. Si les repères d’identification sont peu solides, la
ressemblance manifeste des deux jeunes filles rend difficile leur distinction, la
confusion de l’identité devient patente.
La planche n°10 est exemplaire pour montrer la diversité des registres conflictuels
qu’elle est susceptible de réactiver : au niveau le plus évolué, elle permet d’évoquer
la liaison entre tendresse et libido soulignant par là même l’élaboration et le déclin du
conflit oedipien.
Les planches 4, 6BM, 6GM, 7BM structurées avec évidence par la différence de
sexe et des générations se prêtent moins aisément à des associations régressives.
Cependant leurs caractéristiques relationnelles qui privilégient un approché duel
donnent lieu à des manifestations d’angoisse parfois intense quand le sujet a du mal
à se situer par rapport à l’image parentale ressentie comme dangereuse par sa
puissance ou sa proximité : on observe des débordements pulsionnels, des
émergences processus primaire (fantasmes incestueux, fantasmes de destruction)
ou encore une inhibition invalidante qui rend compte de l’impossibilité à métaboliser
les conflits.
Les planches 3BM et 13B renvoient d’emblée à une problématique de perte d’objet;
quand l’accès à l’ambivalence n’a pas été possible, les sujets régressent vers une
position schizo-paranoide ou bien se défendent contre l’angoisse sur un mode
maniaque. Les deux planches testent les possibilités du sujet à se maintenir dans sa
continuité d’être alors que l’objet est perdu ou absent, ce qui suppose l’intériorisation
MODULE N° 7 17 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
de cet objet et la liaison entre pulsion agressive et pulsion libidinale. Quand ces
conditions ne sont pas remplies, ces planches donnent lieu à des pertes de
destruction, à des représentations ou à des défenses massives. Dans le meilleur des
cas, le sujet est capable d’évoquer un thème destructif mettant en évidence
l’association entre la représentation de perte d’objet et les objets qui lui sont liés.
LE C.A.T.
1 - HISTORIQUE
C’est Ernest KRIS qui le premier suggéra l’idée du C.A.T. au cours d’une discussion
avec l’auteur principal sur les problèmes théoriques de la projection et sur le T.A.T.
Le Dr KRIS fit remarquer que les enfants s’identifieraient probablement plus
facilement à des animaux qu’à des personnes; c’est bien connu depuis que FREUD
a écrit l’histoire du petit Hans dans « la folie d’un enfant de cinq ans ». Les auteurs
pensèrent à ce problème pendant et choisirent un certain nombre de situations
fondamentales pour les enfants et susceptibles de révéler les aspects dynamiques
de leurs problèmes.
Il est théoriquement juste de supposer que les animaux sont probablement entre trois
et dix ans environ les meilleurs sujets d’identification.
2 - NATURE ET BUT DU TEST
Le C.A.T. comprend dix images qui représentent des animaux dans des situations
diverses, il est destiné aux enfants des deux sexes et c’est entre trois et dix ans qu’il
trouve son meilleur emploi.
Après avoir établi un bon contact avec l’enfant, on lui présente les planches. On note
les réponses mot pour mot et on les analyse par la suite pour en obtenir une
interprétation. Le C.A.T. est une méthode projective, c’est-à-dire une méthode
d’investigation de la personnalité pour l’étude de la signification dynamique des
différences individuelles dans la perspective de stimuli standardisés.
Ce test est un descendant direct du « Thematic Apperception Test » de Henry
MURRAY.
Le but du C.A.T. est d’aider à comprendre les rapports existants entre l’enfant et
le personnage et les tendances les plus importantes de sa vie. Les images
visent à obtenir des réponses aux problèmes de nutrition en particulier, et aux
problèmes oraux en général, à explorer les problèmes de rivalités entre frère et
soeur, à expliquer l’attitude de l’enfant face aux personnages parentaux et la façon
dont il les perçoit, à connaître les rapports de l’enfant avec ses parents en tant que
couple désigné techniquement par le thème « complexe d’Oedipe » avec culmination
dans l’impression résultant des premières relations sexuelles observées, c’est-à-dire
MODULE N° 7 18 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
les fantasmes de l’enfant qui voit ses parents couchés ensemble. Dans le même
ordre d’idées, le C.A.T. cherche à découvrir les fantasmes de l’enfant concernant
l’agression, la façon dont le monde adulte l’accepte, ses craintes d’être seul la nuit
avec un rapport possible à la masturbation, le comportement lors de la toilette et la
manière dont les parents y réagissent.
3 - ADMINISTRATION
Quand on administre le C.A.T., on doit tenir compte des problèmes particuliers de
l’application des tests aux enfants, il faut établir un bon contact avec l’enfant, chose
qui sera en général considérablement plus difficile avec les enfants jeunes ou les
plus perturbés; il est préférable de faire connaissance préalablement avec l’enfant,
de lui faire faire d’abord des jeux de façon à l’habituer à l’examinateur, à la situation
et à réduire l’anxiété au minimum. Toutes les fois que cela sera possible, et en
particulier avec les enfants les plus jeunes, on devra présenter le C.A.T. comme un
jeu et non comme un test.
Dans le cas d’enfants qui savent qu’il s’agit évidemment d’un test, il est préférable de
reconnaître le fait franchement mais alors en expliquant le plus soigneusement
possible qu’il ne s’agit pas d’un test de compétition, que l’enfant ne doit en attendre
ni approbation, ni désapprobation, qu’il ne risque de rencontrer ni émulation ni
sanction.
La meilleure technique a été celle qui consiste à englober aussi souvent que possible
l’administration du test dans une situation de groupe, dans une crèche par exemple,
on peut choisir d’abord l’enfant le moins craintif et le plus sociable en laissant
comprendre que c’est là une sorte de distinction et quelque chose d’agréable et
d’attrayant. Si l’on réussit ainsi avec me premier, les autres enfants se disputeront le
tour suivant et collaboreront avec intérêt.
Comme indication positive, il est préférable de dire à l’enfant que l’on va jouer à un
jeu dans lequel il doit raconter une histoire d’après des images, il devra dire ce qui se
passe, ce que les animaux font, à certains moments bien choisis, on peut demander
à l’enfant ce qui s’est passé avant dans l’histoire et ce qui arrivera ensuite.
On s’apercevra probablement qu’il est souvent nécessaire d’encourager et de
pousser l’enfant, les interruptions sont permises, mais en encourageant, il faut bien
prendre garde ne rien suggérer.
On devra noter mot pour mot les réponses de l’enfant ainsi que ses réactions, ses
remarques et son comportement.
Habituellement, l’enregistrement par écrit ou avec un magnétophone de ce qu’ils
racontent ne troublent pas les enfants. Si néanmoins, ils demandent pourquoi on
enregistre, on ne peut que flatter leur narcissisme en leur disant que c’est pour
pouvoir relire ou leur faire réentendre ce qu’ils ont dit.
Un problème difficile peut se poser si l’enfant veut que l’examinateur raconte une
histoire, c’est là essentiellement une demande qui vise à obtenir quelque chose
plutôt qu’à donner soi-même et c’est surtout sous cet aspect qu’il faut le considérer.
MODULE N° 7 19 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
Il est bon de garder toutes les images hors de la vue de l’enfant excepté celles dont
on est en train de se servir car les enfants les plus jeunes ont tendance à jouer avec
toutes les images à la fois en les choisissant au hasard pour raconter leur histoire.
Ces images ont été numérotées et mises dans un ordre déterminé pour des raisons
spéciales, elles doivent donc être administrées dans l’ordre indiqué. Cependant si un
enfant est particulièrement agité et que l’on ait déjà des indications sur les problèmes
concernant ses troubles habituels, on peut restreindre le test aux quelques planches
qui, vraisemblablement, éclaireront ses problèmes particuliers.
Par exemple, un enfant pour lequel se posent des questions de rivalités entre frère et
soeur, on présentera spécialement les planches 1 et 4.
Lorsque l’enfant a raconté toutes les histoires, on peut revenir sur chacune d’elles,
demander des détails sur des points précis, tels que : pourquoi avoir donner tel nom
de personne, tel nom de lieu, tel âge, etc... et même questionner sur le genre de
dénouement donné à une histoire. Si la durée de l’attention d’un enfant ne permet
pas cette procédure, il sera bon de la remettre à une date aussi proche que possible
de l’administration.
Il convient d’attirer particulièrement l’attention sur l’important qu’il y a à connaître la
situation du sujet dans la vie réelle et les conditions de son comportement. Il est tout
à fait exact que les interprétations aveugles des histoires, c’est-à-dire celles que l’on
fait en l’absence de toute autre donnée peuvent amener à une connaissance intuitive
remarquable et singulièrement précise, néanmoins pour l’utilisation clinique, il est
important de confronter les données projectives au plus grand nombre possible de
renseignements concernant la situation réelle.
Il est aussi spécialement important pour l’enquête d’élucider si une histoire donnée,
ou certains de ses détails, reflètent un état de chose réel ou un souhait, par exemple,
si le personnage du père est vu comme particulièrement patient, attentionné et
protecteur, il sera facile d’établir si c’est là un reflet de la véritable idée que l’enfant
se fait de son père ou si la réalité étant à l’opposé les histoires traduisent
essentiellement un souhait.
4 - DESCRIPTION DES IMAGES DU C.A.T.
Nous présentons ci-dessous, les thèmes-types de réponses données aux différentes
images du C.A.T.
IMAGE 1 : poussins assis à une table sur laquelle est posé un grand bol de
nourriture. A l’écart se trouve un poulet de grande taille, aux contours estompés.
Les réponses tournent autour des repas et de la nourriture, suffisante ou non,
donnée par l’un ou l’autre des parents. Les thèmes de rivalité entre frères se font jour
à propos de celui qui reçoit le plus, de celui qui est bien élevé ou non, etc. La
nourriture peut être considérée comme une récompense ou, inversement, la privation
comme une punition. Des problèmes oraux apparaissent : satisfaction ou frustration,
problèmes de nutrition proprement dite.
MODULE N° 7 20 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
IMAGE 2 : un ours tire à un bout d’une corde, tandis qu’un autre ours et un ourson
tirent à l’autre bout .
Il est intéressant ici de noter si l’enfant identifie le personnage avec lequel il collabore
(s’il en est un) comme le père ou la mère. Il peut voir la scène comme un véritable
combat accompagné de la peur de l’agression : on y trouve la réalisation de son
propre désir d’agression ou d’autonomie, etc.
De façon plus bénigne, il y voit un jeu (lutte à la corde, par exemple). Parfois la corde
elle-même peut être un sujet d’inquiétude : rupture de la corde considérée comme un
jouet, et crainte de la punition qui s’ensuit; ou encore la corde est uniquement un
symbole concernant la masturbation, et sa rupture représente les craintes de
castration.
IMAGE 3 : un lion, avec une pipe et une canne, assis dans un fauteuil; dans le coin
inférieur droit, une petite souris apparaît à un trou.
Cette image est généralement perçue comme représentation du père, équipée de
ces symboles que sont la pipe et la canne. Cette dernière peut, soit être vue comme
instrument d’agression, soit permettre à l’enfant de transformer ce personnage
paternel en un être vieux et impuissant qui n’est pas à craindre. C’est là
généralement un processus de défense. Si le lion est perçu comme une figure
paternelle puissante, il sera important de noter si cette puissance est bienveillante ou
dangereuse. La souris est vue par la grande majorité des enfants, et souvent prise
comme personnage d’identification. Dans ce cas, grâce à des subterfuges et aux
circonstances, elle peut devenir le personnage le plus puissant. Au contraire, il arrive
qu’elle soit entièrement à la merci du lion. Certains enfants s’identifient au lion, et l’on
rencontre des sujets qui changent de personnage d’identification une ou plusieurs
fois, donnant la preuve d’une confusion de leur rôle, d’un conflit soumission-
autonomie, etc.
IMAGE 4 : une mère kangourou, un chapeau sur la tête, porte un panier contenant
une bouteille de lait; dans sa poche ventrale, elle porte un bébé kangourou qui tient
un ballon; sur une bicyclette, un jeune kangourou plus grand.
Cette image évoque des thèmes de rivalité fraternelle ou des préoccupations
touchant la naissance des enfants. Dans les deux cas, les rapports avec la mère
apparaissent souvent comme un trait important. Parfois, un enfant aîné s’identifiera
au bébé qui est dans la poche, ce qui indique un désir de régression pour se
rapprocher de la mère. Au contraire, il arrivera à un enfant qui est le plus jeune dans
la réalité, de s’identifier au plus âgé, ce qui indique un désir d’indépendance et
d’autorité. Le panier peut suggérer des thèmes de nutrition. Il peut aussi amener un
thème de fuite devant le danger. Notre expérience suggère que cette image peut
aussi donner lieu à des interprétations liées à des craintes inconscientes touchant les
rapports père-mère, la sexualité, la grossesse, etc.
IMAGE 5 : une pièce obscure avec un grand lit dans le fond; au premier plan, deux
oursons dans un lit d’enfant.
Ici, on rencontre couramment des récits concernant les rapports parentaux dans
toutes leurs variantes; l’enfant est préoccupé par ce qui se passe entre ses parents
MODULE N° 7 21 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
lorsqu’ils sont couchés. Ces histoires sont le reflet de maintes suppositions,
observations, confusions de l’enfant, et de retentissements émotionnels. Les deux
enfants dans le petit lit conduisent à des thèmes de manipulation et d’exploration
réciproques.
IMAGE 6 : une caverne sombre, avec les silhouettes vaguement esquissées de deux
ours dans le fond; un ourson est étendu au premier plan.
Voici encore une image évoquant des histoires concernant les rapports parentaux.
Elle est utilisée en complément de la planche 5, car l’expérience pratique a montré
que souvent l’image 6 met nettement en lumière ce qui avait été refoulé dans les
réponses à la planche précédente.
Dans cette situation triangulaire, la simple jalousie se reflète parfois. Les problèmes
de la masturbation au lit peuvent apparaître dans les réponses aux planches 5 et 6.
IMAGE 7 : un tigre montrant les crocs et sortant les griffes, bondit vers un singe qui,
lui aussi, saute en l’air.
Ici se révèlent les craintes d’agression et le comportement qui è répond. Le degré
d’anxiété de l’enfant devient souvent apparent. Il arrive qu’il soit assez grand pour
que l’enfant repousse l’image, ou encore que les mécanismes de défense soient
assez bons (ou assez peu réalistes) pour qu’il tire de la scène une histoire
inoffensive. Il arrive même que le singe l’emporte sur le tigre. Les queues des
animaux conduisent facilement à la projection des craintes ou des désirs de
castration.
IMAGE 8 : deux songes adultes sont assis sur un canapé et prennent le thé. Au
premier plan, un singe adulte est assis sur un pouf et parle à un jeune singe.
Ici, l’on découvre souvent le rôle que l’enfant s’attribue dans la constellation familiale.
Son interprétation du singe principal (au premier plan) comme représentant son père
ou sa mère est significatif, selon qu’il le perçoit comme un singe bienveillant ou au
contraire sermonneur et inhibiteur. Les tasses de thé donneront naissance, parfois,
de nouveau à des thèmes oraux.
IMAGE 9 : par la porte ouverte d’une pièce éclairée, on voit une pièce obscure; dans
cette pièce obscure se trouve un lit d’enfant où est assis un lapin qui regarde vers la
porte.
Les thèmes de craintes de l’obscurité, d’être laissé seul, d’abandon par les parents,
la curiosité significative de ce qui se passe dans la pièce voisine, sont autant de
réponses courantes à cette image.
IMAGE 10 : un petit chien est couché en travers des genoux d’un chien adulte; les
deux personnages, avec un minimum de traits expressifs, se trouvent au premier
plan d’une salle de bains.
Cette planche provoque des histoires de « crime et châtiment », qui révèlent quelque
chose des conceptions morales de l’enfant. Il y a fréquemment des récits sur
l’apprentissage de la propreté, aussi bien que sur la masturbation. Plus encore que
MODULE N° 7 22 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
certaines autres planches, celle-ci est nettement révélatrice des tendances
régressives.
5 - INTERPRETATION DU C.A.T.
Pour faciliter l’analyse interprétative du C.A.T. , il est important de tenir compte des
dix points ci-dessous :
- 1 - LE THEME PRINCIPAL
Récapitulons : nous nous intéressons à ce qu’un enfant tire de nos images et nous
voulons savoir pourquoi il donne telle histoire particulière (ou interprétation). Plutôt
que de juger d’après une seule histoire, il sera plus sûr de pouvoir trouver un
dénominateur commun, une tendance commune à plusieurs histoires, par exemple,
si dans différents récits, le héros principal est affamé et a recours au vol pour
satisfaire sa faim, il n’est pas déraisonnable de conclure que cet enfant est
préoccupé par des idées d’insatisfaction (manque de nourriture et plus généralement
d’attention et que dans ses fantasmes, il prend aux autres ce qui lui manque),
l’interprétation consiste alors à découvrir les dénominateurs communs au schéma du
comportement. Nous pouvons dans ce sens parler de thème d’une ou plusieurs
histoires, un thème peut évidemment être plus ou moins compliqué.
- 2 - LE HEROS PRINCIPAL
En effet, comme il peut y avoir plusieurs personnages dans une histoire, il est
nécessaire de préciser le personnage auquel le sujet s’identifie en tant que héros;
pour cela, il faut spécifier quelques critères objectifs permettant de distinguer le héros
des autres personnages : le héros est les personnage autour duquel l’histoire est
essentiellement construite, il est celui qui ressemble le plus au sujet par l’âge et le
sexe, c’est de son point de vue que l’histoire est racontée, ces critères d’identification
sont le plus souvent corrects. Dans certaines histoires, il arrive qu’il y ait plus d’un
héros et que le sujet s’identifie aux deux à la fois ou à chacun d’eux successivement.
Parfois, un personnage d’identification d’importance secondaire dans l’histoire peut
représenter des attitudes inconscientes que le sujet refoule plus profondément. Il est
probable que les intérêt, les désirs, les déficiences, les dons, les aptitudes attribués
au héros sont ceux que le sujet possède, souhaite posséder ou craint d’avoir. Il est
important de noter le degré d’adaptation du héros, c’est-à-dire à faire face à toutes
les circonstances selon les critères d’adaptation du milieu auquel il appartient.
L’adaptation du héros est le meilleur moyen de mesurer la force du moi, c’est-à-dire
à bien des points de vue, du degré d’adaptation du sujet lui-même.
- 3 - COMMENT SONT VUS LES PERSONNAGES
Nous nous intéressons là à l’aspect sous lequel l’enfant voit les personnages qui
l’entourent et à la façon dont il réagit en face d’eux.
- 4 - IDENTIFICATION
Il est très important de noter à quel memebte de sa famille, l’enfant s’identifie, à un
frère ou à une soeur, à un parent etc... il est aussi très important d’examiner le
caractère adapté de l’identification, par exemple, si un petit garçon après 5 ans,
s’identifie au père, au frère aîné, à l’oncle plutôt qu’à la mère ou la soeur plus jeune,
bien que évidemment le processus des identifications ne soit achevé qu’à la fin de la
puberté, l’histoire des premières années de l’enfance peut avoir une grande
importance.
MODULE N° 7 23 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
- 5 - INTRODUCTON DE PERSONNAGES, D’OBJETS, DE
CIRCONSTANCES EXTERIEURES
L’introduction d’un personnage qui n’est pas dessiné sur la planche peut revêtir une
certaine importance. En effet, il peut évoquer des circonstances extérieures telles
que l’injustice, la sévérité, l’indifférence, la privation, et la tromperie, il donne des
indications sur la nature du monde où l’enfant croit vivre.
- 6 - OBJETS OU PERSONNAGES OMIS
Si dans un récit, l’enfant omet un ou plusieurs personnages de l’image, on doit
envisager la possibilité d’une interprétation dynamique, l’explication la plus simple est
habituellement que cette omission exprime le désir que ce personnage ou objet ne
se trouve pas là, soit en raison d’une simple hostilité, ou parce que le personnage ou
l’objet en question es cause de conflit grave, peut-être en raison de sa valeur
positive.
- 7 - NATURE DE L’ANXIETE
Il n’est pas nécessaire d’insister sur l’importance qu’il y a à déterminer les principaux
types d’angoisse d’un enfant, celle qui touche à la douleur physique, aux punitions, à
la crainte de manquer d’affection ou de la perdre, à la peur d’être abandonné sont
sans doute les plus importants.
Il est précieux de noter dans le contexte les défenses opposées par l’enfant aux
craintes qui l’assiègent, il est intéressant de savoir quelle forme prend cette défense :
fuite, passivité, agression, manifestations orales, accaparement, renoncement,
régression etc...
- 8 - CONFLITS IMPORTANTS
Lorsque nous étudions le conflits importants, nous voulons connaître non sulement la
nature des conflits, mais encore la défense que l’enfant oppose à l’anxiété
provoquée par ces conflits, c’est là une excellente occasion d’étudier la première
formation du caractère et il se peut que nous en tirions des indications pour le
pronostic.
- 9 - PUNITION DE LA FAUTE
Dans une histoire, le rapport entre la faute commise et la gravité de la punition qui lui
correspond nous donne une excellente mesure du développement du surmoi de
l’enfant. Il est intéressant d’étudier les circonstances dans lesquelles la punition est
donnée et par qui elle est infligée; une punition immédiate dénote actuellement un
sentiment de culpabilité plus forte que dans le cas où le héros est laissé impuni.
- 10 - DENOUEMENT DES HISTOIRES
Ce qui nous intéresse, c’est de voir une histoire qui finit bien de façon réaliste et
optimiste ou le contraire. Cette variable nous indique la tonalité émotionnelle
générale de l’enfant : déprimé et désespéré ou gai et optimiste. Le dénouement est
également une mesure de la force du moi, il est généralement en accord avec le
degré d’adaptation du héros.
MODULE N° 7 24 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
- 11 - NIVEAU DE MATURATION
On peut tirer du C.A.T. une indication importante sur le niveau de développement de
l’enfant tel qu’il apparaît à travers une histoire, de même on peut évaluer le niveau de
performance intellectuelle du point de vue de l’usage du langage, de la
conceptualisation, de la structuration (en suivant, par exemple, les conceptions de
PIAGET).
6 - EXEMPLES DE CAS
Nous présentons ci-dessous un certain nombre de fragments de protocoles pour
illustrer les types de réponses au C.A.T. On ne les a pas choisis parce que
particulièrement réussis, mais plutôt pour exposer les difficultés et les subtilités de
l’interprétation.
Cas 1. - S.Q. : enfant noir de 3 ans 11 mois - milieu socio-économique médiocre
On a facilement pris contact avec le sujet à la nursery en l’aidant à s’habiller
pour sortir. Amené peu après pour se faire soigner une coupure à la joue, il a
accepté l’offre de jouer à un jeu (C.A.T.). Semblait hésiter entre s’en aller et suivre
l’examinateur. Quelques instants passés dans la cour de récréation où il s’est montré
mal à l’aise, mais pas timide. Voici trois histoires extraites du protocole.
- Image 2 : « un ours ou petit minet et un homme avec une corde... Un gros,
gros ours... et il devient tellement gros.
(Que fait-il?)
« Il est venu voir les gens. »
- Image 3 : « un homme avec une pipe; il habite dans la maison. Il enlève ses
habits. »
(Pourquoi?)
« Parce qu’il n’a pas d’habits. Il a jeté tous ses habits. Il veut pas d’habits. » (Il
chantonne).
« Pas de culotte, pas de bas, pas de chaussures. »
(Qu’est-ce-qu’il veut?)
« Il veut avoir plein de cheveux autour de lui. »
(Qu’est-ce-qu’il fait?)
« Il est assis sur une chaise sale, et il n’a pas d’habits. »
- Image 9 : Jeannot Lapin. Vous voyez ce lapin? Il est au lit. Et l’autre Jeannot
Lapin est en train de monter l’escalier. Il a pris les affaires et il est rentré à la maison
et il a dit qu’il se pourrait bien qu’il installe un autre Jeannot Lapin dans la maison. Il
a vite monté les escaliers, et il est redescendu aussitôt (il chantonne) et le père ours
sort de la cour (le coin sombre à gauche) et il a vu un lapin -monte là-haut, monte là-
haut au lit! »
Il est évident que l’histoire 2 est très pauvre. Tout ce qui retient l’attention,
c’est
« Le gros ours qui est devenu si gros », ce qui, en soi, ne suggère guère
d’hypothèse. Cependant, l’histoire 3 montre à plusieurs reprises que le sujet refuse
les vêtements, veut « s’asseoir sur une chaise sale et sans aucun habit ». Ceci
indiquerait un désir de régression à un stade antérieur. Nous ne savons pas encore
MODULE N° 7 25 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
pourquoi. Puis, dans l’image 9, l’indice le plus évident réside dans le fait que le lapin
« pourrait bien installer un autre lapin dans la maison », ce qui semble indiquer que
le sujet est préoccupé par la venue d’un autre bébé à la maison. Ceux qui ont une
formation psychanalytique verront une nouvelle expression de cette idée dans la
montée par l’escalier et dans l’apparition du père venant de la cave, symboles
associés au souvenir évident d’avoir reçu l’ordre d’aller se coucher, lié peut-être avec
quelque activité sexuelle. Notre supposition peut maintenant être confirmée par une
courte référence de l’histoire 2 « le gros ours qui est devenu tellement gros », qui
peut se rapporter à la grossesse de la mère. Nous pouvons alors comprendre dans
l’histoire 3, son attitude régressive, qui se rapporte à l’arrivée d’un rival. Ce sont là
les conclusions auxquelles nous avons abouti par l’analyse aveugle de ces histoires.
Un contrôle d’après les renseignements donnés par l’assistante sociale révéla que ce
n’était pas exactement un frère, mais un petit cousin, qui était arrivé à la maison.
Comme la tante et le rival (son fils) habitaient le même logement que le sujet, la
signification psychologique était la même. La maîtresse du jardin d’enfants ne fît que
confirmer les problèmes de comportements du sujet. Nous avions ensuite à tenir
compte de la déclaration du sujet disant que le héros « voulait avoir plein de cheveux
autour de lui ». On pouvait en conclure qu’il s’était comparé au père et voulait avoir
des poils sur la poitrine et aussi sur le pubis. Parmi les problèmes de comportement
indiqués par la maîtresse, il y avait surtout le fait que le sujet s’intéressait beaucoup à
la façon dont étaient faites ses petites camarades de jeu.
Ce compte-rendu peut servir d’exemple du cas d’un enfant dont les réponses
sont relativement pauvres et dont chaque histoire, considérée seule, est très
décevante tant qu’on ne l’a pas rapprochée des autres.
Quoiqu’il en soit, l’utilité du C.A.T. dans ce cas apparaît clairement. La
maîtresse et l’assistante sociale savaient que l’enfant présentait un problème de
comportement et s’intéressait sexuellement beaucoup aux petites filles. Notre test
relie ces difficultés de comportement à la rivalité avec un pseudo-frère et des
préoccupations concernant la procréation. Après avoir établi ces rapports, il serait
relativement simple d’en parler à l’enfant à propos de ses récits : il ne doit pas être
content de l’arrivée du bébé, il doit se demander d’où viennent les petits enfants, etc.
En même temps, l’assistante sociale pourrait essayer d’atténuer sa curiosité sexuelle
par un moyen quelconque offert par les circonstances, et indiquer à la mère
comment agir avec lui.
Cas 2. - K.S. , 6 ans 4 mois, fillette de race blanche, situation socio-économique
petite bourgeoisie
Nous donnons seulement la réponse à l’image 3, dans laquelle le lion, pour
cette enfant très intelligente, devient le personnage du père; la situation oedipienne
apparaît ici clairement .
- Image 3 : « Celui-là est gentil. Le Roi Lion, c’est comme ça que je l’appelle. Et
je pense qu’il faut inventer un nom pour eux, n’est-ce-pas? Il y avait un lion et il dit au
roi : « J’ai entendu raconter vos histoires et j’ai entendu dire que vous êtes très
fatigué et que vous cherchez un autre lion pour vous remplacer. (à l’examinateur) Ça,
je ne veux pas que vous l’écriviez, je vais juste vous le dire.
MODULE N° 7 26 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
« Vous comprenez, l’autre lion était le roi de tous les lions et il devenait très
fatigué, aussi elle dit à l’autre lion : « si vous faites tout ce travail difficile, si vous
pouvez le faire complètement, vous deviendrez roi. La première tâche, c’est que
vous devez aller découvrir une princesse - une reine - non, une princesse pour
l’épouser. Si vous n’en trouvez pas une qui vous convienne, on vous coupe la tête!
Ah! pensait le lion, si je pouvais retrouver ma petite fille chérie. Parce qu’il était aussi
un roi des lions, mais il ne l’avait jamais dit, vous comprenez? Maintenant, je peux
aller chercher ma fille. (à l’examinateur) Mais ça, je veux juste vous le dire, ne
l’écrivez pas.
(L’histoire, alors considérée comme terminée, fut cependant reprise plus tard par
l’examinateur.)
« Maintenant, celle-là, je ne veux pas que vous l’écriviez, je vais juste vous en
parler. Le roi voulait retrouver sa fille. Il l’avait envoyée se promener à travers le
monde et alors il lui a téléphoné au premier endroit où elle devait être et on lui a dit
qu’elle était partie. Puis il a téléphoné au deuxième endroit et elle n’y était pas non
plus. Alors il a téléphoné au troisième hôtel, on l’a appelée au téléphone et elle a
répondu qu’elle serait là aussitôt, en quatre minutes, et ils se sont mariés et alors ils
ont joué un tour à l’autre roi. Vous comprenez, celui-ci était vraiment le roi des lions ,
mais il a dit : « Qu’est-ce-que vous faites ici? Allez vous-en! » Mais ils dirent qu’ils
étaient mariés et que le roi était le vrai roi; alors il a fallu que l’autre roi s’en aille.
Irrespectueux à ce point des tabous sociaux, le roi (père) épouse sa fille -
quoiqu’une partie de l’histoire reste très confuse. L’identification est très claire. Il y a
comme une conscience subliminale que tout cela est interdit, car la petite fille
demande à l’examinateur de ne pas prendre l’histoire en notes1. A côté de l’aspect
dynamique, il convient de noter le processus infantile de pensée concret et
spécifique : « en quatre minutes, ils se marièrent. »
Cas 3. - M.I. ,10 ans 4 mois, garçon de race blanche, situation socio-économique
médiocre
Nous présentons l’histoire suivante donnée pour l’image 3 afin de montrer à
quel point une réponse peut être riche d’éléments et étendue.
- Image 3 : « Il était une fois un lion qui habitait dans une forêt. Il était très fou et
il n’aimait que lui, et il était très fier de lui, et il n’aimait personne d’autre que lui et
tout le monde avait peur de lui parce qu’il était très fort et qu’il pouvait casser
n’importe quoi, comme des arbres de 20 ou 30 mètres de haut et d’un mètre
d’épaisseur, il n’avait qu’à les pousser comme une corde et ils tombaient. Un jour, il
se dit qu’il allait hypnotiser tous les gens et tous les animaux pour pouvoir les
commander tous. D’abord, il alla à une des maisons du renard, il les regarda et les
regarda encore, jusqu’à ce qu’ils soient hypnotisés, et toute la famille vînt en courant
vers lui. Puis il alla chez les écureuils; il hypnotisa toute la famille et tous les
écureuils qui étaient là. Il habitait une grande maison énorme et il avait tout ce qu’il
voulait. Quand il a eu hypnotisé tout le monde, il a pris une grande chaise énorme et
une bonne pipe et il avait une réserve pleine de tabac, et il avait une tour, et il en
avait une autre pleine de cannes; mais il y avait une chose qu’il n’avait pas - il n’avait
MODULE N° 7 27 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
pas un beau corps. Il voulait avoir de beaux cheveux blonds - blonds et bruns en
même temps, des yeux bleus, et les cheveux jolis et bien peignés.
Il voulait que toutes ses affaires brillent et il n’avait pas assez de monde pour faire
briller ses cannes et ses affaires. Le lendemain, il est retourné à la forêt et n’a vu
personne alors il a continué à marcher jusqu’à une grande ville, et il n’y a vu
personne parce qu’il faisait nuit, il n’y avait même pas une lumière qui brillait, alors il
a continué à marcher jusqu’à ce qu’il arrive à un grand château.
1 Des renseignements complémentaires révèlent que cette fillette était en conflit de
rivalité avec sa mère.
« Il en était très jaloux parce qu’il avait un grand clocher énorme et en haut, il y
avait aussi une grande cour; à l’autre bout, il y avait une autre partie du château qui
avait 3 clochers; un très grand au milieu et un plus petit de chaque côté et ils avaient
tous des diamants; et sur la pointe, il y avait un gros rubis et l’autre porte de l’autre
côté en avait un aussi - un rubis bleu et il était si jaloux qu’il tournait en rond autour
en courant. Et il rugissait très fort et ça faisait résonner tous les bâtiments autour, ça
grognait dans ses oreilles, il s’arrêta et se tint tranquille parce que ça lui faisait mal. Il
ne s’était jamais aperçu qu’il avait une voix aussi forte. Puis il s’est glissé dans le
château, il s’est approché de la porte et il a vu une sonnette et il ne savait pas ce que
c’était alors il a appuyé dessus et ça a fait tellement de bruit qu’il a eu peur; au bout
d’un petit moment, personne ne répondait, alors il a vu le bouton de la porte, il l’a
ouverte et il a vu qu’il faisait noir comme dans un four aussi il marchait en tournant et
finalement, il se cogna contre quelque chose - il tomba et il s’aperçut que c’était une
porte, il l’ouvrit et il trouva un lit avec une belle princesse dessus et il n’était pas
content qu’elle soit à son aise pendant que lui ne l’était pas; aussi, il sauta sur elle et
l’avala en une bouchée et après il est parti et quand il est revenu à son château, il se
sentait tout drôle. Il s’assit et se mit à réfléchir et devint furieux contre lui-même à
cause de la jeune fille - c’était une très gentille jeune fille, elle aimait tout le monde,
alors il alla à l’endroit où il avait des tas et des tas de nourriture; il prit des poulets,
des cochons (c’étaient des animaux qu’on avait déjà tués), toute la nourriture que les
animaux aiment et puis il alla dans une autre pièce et prit du bois. Et il prenait tout le
bois et toute la nourriture et tout le monde le regardait même la souris, dans la
maison. Puis, il est allé dans une autre réserve et il a pris des tonnes et des tonnes
de fromage et il a fait un grand trou et la souris s’est fait une maison dans le fromage.
Elle avait très faim parce qu’elle était toute maigre et quand elle a eu fini, elle ne
pouvait plus rentre dans son trou. Alors le lion alla dehors et donna tout à tout le
monde, et il fut très heureux. Le lendemain, tout le monde l’aimait bien, mais il n’était
pas encore content de lui parce qu’il avait oublié de déshypnotiser les castors alors il
est allé déshypnotiser les castors et tout le monde l’aime. »
M.I. s’identifie au lion dans un récit qui vraisemblablement est, dans une large
mesure, un fantasme de réalisation d’un désir. Souvent cependant, l’autocritique, la
conscience de ses défauts, côtoient une surcompensation. « Il n’aimait que lui-
même et il était très fier de lui, et tout le monde avait peur de lui et il pouvait casser
n’importe quoi...? Puis, après s’être installé dans une belle habitation avec une
bonne pipe, il nous révèle soudain qu’il est mécontent de son corps. Suit une histoire
symbolique de jalousie à propos d’un « grand et gros clocher »... « avec deux plus
petits de chaque côté » : probablement représentation symbolique d’un grand organe
sexuel. Par la suite, il découvre une belle princesse dans un lit. Il nous fournit alors
MODULE N° 7 28 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
un fantasme e prise de possession orale (sans doute de la mère) absolument primitif
: « il avale la princesse en une bouchée. » Après avoir commis cette faute, sa
conscience (sur-moi) se manifeste sous forme d’une réaction-sublimation de ses
tendances.
Il fournit des tonnes de nourriture à tous les animaux y compris la souris et
« donna tout à tout le monde... et fut alors très heureux ». Dans le courant de
l’histoire, il précise par une remarque entre parenthèses, que tous les poulets et les
porcs qu’il donne à manger aux autres animaux étaient déjà morts. C’est-à-dire qu’il
nous fait connaître qu’il n’a plus commis aucun meurtre. Par la suite, il est
récompensé d’avoir renoncé à ses tendances accapareuses et agressives par
l’affection de chacun : c’est-à-dire que nous trouvons un net indice de socialisation. Il
reste encore mécontent de lui-même, jusqu’à ce qu’il se souvienne des castors
hypnotisés et aille les réveiller.
C’est là l’histoire d’un enfant, semble-t-il assez perturbé, qui croit ne pas avoir
un corps normal, et qui a de fortes tendances d’accaparement et d’agression; il les
considère comme mauvaises, et il développe un sur-moi excessif pour y faire face.
La gravité de ces désordre et leur étendue se sont manifestées plus clairement dans
un certain nombre d’histoires qu’il n’est pas nécessaire de reproduire ici. L’examen
de la situation véritable révéla que cet enfant vivait dans un foyer très troublé, le père
l’ayant abandonné, et la mère étant suspectée d’une promiscuité indécente. L’enfant
était réellement petit pour son âge et souvent n’avait pas assez à manger. Ce dernier
renseignement explique qu’il soit mécontent de son corps (comme l’était le lion) et
qu’il ait un grand besoin d’accaparement et d’ « absorption » orale.
Cette histoire, et plusieurs autres racontées par le même sujet, révèlent un
excellent vocabulaire et une aptitude à l’organisation dénotant une intelligence
considérablement supérieure à la moyenne. Le C.A.T. se révèle être, à ce point de
vue, très utile, puisque les tests d’intelligence ne lui ont donné un Q.I. de 103.
Le C.A.T. nous indique que son véritable niveau intellectuel doit être
considérablement plus élevé et que probablement les troubles émotionnels de cet
enfant sont responsables de la médiocrité de son rendement.
Cas 4. - C.C., 10 ans 6 mois, fille de race blanche, bonne situation socio-économique
Le cas suivant est présenté pour donner aux utilisateurs du C.A.T. un exemple
d’un compte-rendu dit normal. Il se limitera à trois histoires tirées d’une série
relativement anodine1. Nous présentons encore la réponse à l’image 3 en raison de
sa valeur de contraste, avec celle donnée par l’enfant du cas 3.
- Image 3 : « Oh, cela me rappelle la fable du lion et de la souris; est-ce-que ça
peut être une histoire de ce genre? Il était une fois lion qui était le roi de tous les
animaux. Il travaillait très dur tout le jour et toute la nuit et il avait peu de repos. Il se
promenait de long en large dans tout le royaume pour voir ce que tout le royaume
faisait. Il n’avait jamais le temps de se distraire parce qu’il pensait qu’il devait
surveiller tout le monde pour être sûr que tout allait bien. Un jour, il s’assit pour se
reposer quelques minutes avec sa pipe, et il pensait : sapristi, je n’ai pas le temps de
MODULE N° 7 29 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
m’amuser; voilà que je deviens vieux et ridé et bientôt je serai à l’âge de mourir sans
rien avoir fait de ce que je voulais faire. Le roi ne s’apercevait pas qu’il parlait tout
haut et fût tout surpris d’entendre une voix disant : « Oh roi! Vous avez raison, et si
vous ne commencez pas à faire maintenant les choses dont vous avez envie, vous
ne les ferez jamais. Le roi sauta en l’air d’étonnement et regarda autour de lui, et là, -
dans un petit trou du mur - il y avait une souris. Le roi fût d’abord très en colère; puis,
il se mit à rire à l’idée qu’une petite souris lui disait ce qu’il fallait faire. Puis le roi dit :
« Qu’est-ce-que tu conseillerais, toi, petite souris audacieuse? » La souris dit :
« Qu’est-ce-que vous voulez faire d’abord? » Le roi réfléchit une minute, puis il dit : «
Je voudrais faire une promenade en avion à l’étranger. » La souris dit : « Quel animal
après vous est le plus capable du royaume? » Le roi dit : « Voyons, réfléchissons. Je
sais lequel est le plus audacieux, c’est toi. Ah, oui, mon cousin Léo le lion, il avait
presque d’aussi bonnes notes que moi en classe. »
Certaines histoires révélèrent d’importants besoins oraux. Nous sommes quelque
peu coupables d’avoir beaucoup simplifié la présentation de ce cas.
« Très bien, dit la souris, vous le nommez vice-président, et vous partez faire
votre voyage. » C’est ce que fit le lion et il s’amusa merveilleusement, et quand il
revint, il était tout reposé et il décida de récompenser la petite souris pour son
merveilleux conseil. »
Cette enfant s’identifie à la souris, mais avec une souris très audacieuse,
intelligente et ingénieuse. Elle voit le lion - semble-t-il - comme un père qui travaille
beaucoup et s’occupe de tout le monde avec bienveillance. Le père-lion accepte
volontiers un conseil de la souris-enfant qui s’intéresse si amicalement à lui. Le récit
tout entier est traité par le sujet avec un sens humoristique délicat et une conscience
très fine du rôle de l’enfant. Elle s’identifie volontiers au bien-être du père pour en
tirer individuellement un profit personnel.
- Image 1 : « Ça c’est la famille d’un coq et d’une poule, avec trois petits
poussins. Ils sont tous à table pour le petit déjeuner et la mère poule est en train de
servir le grain. Papa coq dit : « De la bouillie d’avoine, je déteste la bouillie
d’avoine! » Le poussin du milieu dit : « De la bouillie d’avoine, je déteste la bouillie
d’avoine! » L’aîné des poussins dit : « De la bouillie d’avoine, je déteste la bouillie
d’avoine! » Maman poule dit : « C’est très mal, devinez ce que vous allez manger ce
matin pour le petit déjeuner : de la bouillie d’avoine! »
Cette histoire n’illustre pas grand-chose, excepté que nous avons ici une scène
domestique dans laquelle les poussins s’identifient au père, tandis que la mère
représente, de façon simple, un personnage qui détient fermement l’autorité à
l’intérieur de son domaine. Comme l’histoire ne va pas plus loin et qu’elle se termine
sur la phrase de la mère, nous pouvons penser qu’elle est essentiellement le reflet
d’une bonne adaptation. A la vérité, cette impression est confirmée par le contenu
des autres histoires, et aussi par le tour humoristique employé.
- Image 4 : « Un jour, la mère Kangourou dit à la grande soeur : « Tu ne sautes
pas assez vite ni assez haut. Cet après-midi, après le déjeuner, je t’emmènerai
dehors et je te donnerai des leçons. » Aussi, l’après-midi, la mère Kangourou et la
grande sœur Kangourou quittèrent la maison pour une colline voisine. C’était une
belle journée claire et fraîche, juste comme il faut pour des leçons de saut. Aussi,
MODULE N° 7 30 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
elles commencèrent, la mère montrait à la grande sœur exactement comme il fallait
faire. Au bout d’une demi-heure environ, la sœur avait compris et elle sautait aussi
vite et aussi haut que la maman, aussi la mère dit : « Rentrons et allons chercher le
bébé, et nous descendrons jusqu’au bureau pour montrer à Papa comme tu sais
bien sauter. »
On voit, dans cette histoire, une enfant capable, une mère attentive et
soucieuse de montrer les progrès de son enfant à un père qui, de son côté, admet
qu’on aille le voir à son bureau. C’est volontiers que le plus jeune enfant est compris
dans ce bonheur familial que révèle tout le récit de cette très brillante enfant.
Les renseignements obtenus sur la situation réelle confirmaient que l’on avait
affaire à une enfant émotionnellement bien développée dans un foyer initié à la
psychologie et non traumatisant. Cependant, certains problèmes de comportement
se posaient pour elle, car elle avait un grand besoin d’affection.
7 - L’INTERET DES TESTS THEMATIQUES POUR L’ENFANT
L’utilisation des épreuves projectives dans l’examen psychologique des enfants est à
la fois plus répandue et davantage qu’en clinique adulte.
L’intérêt des méthodes projectives en clinique infantile réside en ce qu’elles
constituent un moyen d’approche et d’investigations riche en informations sur le
fonctionnement psychique de l’enfant, qui de surcroît facilite la rencontre avec lui en
lui offrant matière et prétexte à s’exprimer.
En effet, l’enfant apparaît au cours de la consultation qui le concerne surtout à
travers ses symptômes et à travers le discours tenu sur lui par son entourage. Les
entretiens avec l’enfant ne constituent pas d’emblée le moyen d’approche le plus
facile si le clinicien ne propose pas de matériels divers, jouets, papiers, crayons, pâte
à modeler, etc... Qui serviront de prétexte ou de support à l’expression.
On peut considérer que les tests projectifs jouent un rôle similaire dans la mesure où
la communication s’établit à travers leur médiation comme objet tiers.
La spécificité des épreuves projectives chez l’enfant fait qu’elles impliquent une
double sollicitation du sujet à la fois perceptives et projectives.
Le dépouillement est plus complexe pour les adultes, il faut en effet étudier les
caractéristiques individuelles de l’enfant en les confrontant à des repères changeants
puisque sans cesse modifiés par le développement psychologique de l’individu.
Nous pouvons résumer ce que l’on peut attendre des tests thématiques :
- apprécier le rapport de l’enfant au réel et ses capacités d’utiliser ses
potentialités cognitives,
- dégager ses possibilités de jouer entre l’imaginaire et le réel sans
confusion ni débordement, ce qui signe l’existence d’un espace psychique propre à
des aptitudes probables à la mentalisation,
- situer l’enfant en ce qui concerne les processus d’individuation de
différenciation et d’identification,
MODULE N° 7 31 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
- cerner les grandes lignes de son organisation défensive,
- évaluer le registre des conflits et ses capacités à les élaborer,
- analyser les caractéristiques essentielles des images parentales (leur
distinction effective ou la confusion qui les englobe, leur différenciation sexuelle nette
ou leur identification floue, les modulations des relations établies avec l’un ou l’autre
parent en fonction de leurs similitudes et de leurs différences).
CONCLUSION
La présentation ordonnée des planches est indispensable car la construction du test
obéit à une logique temporelle intéressante à respecter.
La planche 1 met l’accent sur la relation primitive à une image maternelle à peine
figurée mais dont la connotation orale essentielle sous-tend des sollicitations
fantasmatiques fondamentales.
La planche 2 met en scène une relation à trois, l’accent portant sur la différence de
génération sans que soit repérable la différence des sexes, par contre, c’est aux
planches 3 et 4 que les images parentales (paternelles 3 et maternelles 4) sont
définies par la surenchère d’indices signifiant qui en permet la différenciation et
l’identification.
Les quatre premières planches constituent une sorte de présentation des images
parentales qui va servir de cadre à la dramatisation des conflits proposés aux
planches suivantes.
Il faut en effet que les processus de reconnaissance et d’identification soient
relativement élaborés pour que puisse véritablement s’organiser la fantasmatique
oedipienne sollicitée aux planches 5 et 6.
La planche 7 devient alors inductrice d’angoisse de castration ouvrant la voie à la
sublimation et à l’intériorisation des interdits oedipiens (planche 8).
La planche 9 éprouve durement la capacité à supporter la solitude mais pourrait
bien constituer l’articulation essentielle entre la position dépressive et ses incidences
dans le renoncement de l’objet d’amour oedipien.
Le test se termine par un rapproché corporel (planche 10) dont la connotation anale
étayerait la distinction entre dedans et dehors, la possibilité d’évoquer un conflit en
acceptant l’ambivalence et la capacité de se séparer de l’objet.
MODULE N° 7 32 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
Fiche récapitulative
1 Thème principal : (niveau diagnostique : si les niveaux descriptifs et interprétatifs
sont désirés, utiliser une feuille volante ou la page 5).
2. Héros principal : âge sexe métier aptitudes
intérêts traits image du corps
adaptation et/ou image de soi
3. Besoins principaux du héros :
a) besoins comportementaux du héros (tels que dans l’histoire)
b) personnages, objets ou circonstances introduits
impliquant un besoin de
c) personnages, objets ou circonstances omis
impliquant un besoin de
4. Conception de l’environnement (monde) comme :
5. a) personnages parentaux (m ------- , f ---------------- ) vus comme
les réactions du sujet à leur égard sont
b) personnages du même âge (m--- ,f ---------------- ) vus comme
les réactions du sujet à leur égard sont
c) personnages plus jeunes (m ----- , f ---------------- ) vus comme
les réactions du sujet à leur égard sont
6. Conflits significatifs :
7. Nature des anxiétés : (v)
de douleur physique et/ou de punition
de désapprobation
de manque ou de perte d’affection de maladie ou de blessure
d’être abandonné d’être privé
d’être surclassé et sans aide
d’être dévoré autres
8. Principales défenses contre les conflits et les craintes : (v)
répression formation de réaction
régression dénégation introjection
isolement destruction
rationalisation autres
9. Sévérité du sur-moi manifeste par : (v)
châtiment du « crime »
immédiat juste trop sévère
retardé injuste trop indulgent
réponse initiale retardée ou pauses bégaiement
10. Intégration du moi, se manifestant par : (v,v,v,v,v,v,)
adaptation du héros solution adéquate
dénouement : heureux malheureux inadéquat
réaliste irréaliste
processus de pensée révélés par pointage comme :
stéréotypés originaux appropriés
complets incomplets inappropriés
Intelligence : (v) supérieure au-dessus de la moyenne
moyenne inférieure à la moyenne déficiente
MODULE N° 7 33 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
LE TEST DE RORSCHACH
Le Test de RORSCHACH est un test projectif intéressant pour sonder l’inconscient. Il
se compose de 10 planches représentant des taches, qui figurativement ne
présentent rien de précis.
1. OBJECTIF DU TEST:
RORSCHACH est un psychiatre suisse qui, travaillant auprès de malades mentaux,
avait présenté à ces derniers des taches d’encre en leur demandant ce qu’elles
représentaient. En étudiant les réponses, il avait constaté que les malades donnaient
souvent des réponses semblables. Par exemple, certaines formes ou couleurs
provoquaient chez les schizophrènes des réponses différentes des paranoïaques. A
partir de cette constatation, RORSCHACH sélectionna soigneusement des taches et
développa son expérience auprès de sujets normaux.
Ayant établi une relation entre certains troubles mentaux et les interprétations des
taches, il réalisa ce test qui permet de déceler les traits essentiels de la personnalité
humaine.
2. PASSATION
L’examinateur présente au sujet les planches une par une, toujours dans le même
ordre, en lui demandant d’indiquer ce qu’il voit. Le temps de passation n’est pas
limité.
3. INTERPRETATION DES REPONSES
Elle est faite en fonction de quatre critères:
• La localisation
• Le déterminant
• Le contenu
• La banalité
A. La localisation:
Elle détermine si le sujet a répondu en fonction d’une partie de la tache ou de sa
totalité. Dans le second cas, on dit que la réponse est « globale ». Elle est codifiée
par la lettre « G ». Ainsi, si le sujet voit une chauve-souris dans la planche V, la
réponse est codifiée « G » car la tache a été interprétée entièrement.
Si elle l’a été partiellement (le sujet voit par exemple une corne de vache), la réponse
est codifiée par la lettre « D ».
Si la réponse du sujet est déterminée par des interprétations partielles qui son
inhabituelles, elle est codifiée « Dd ».
Enfin, la codification « Dbl » s’applique aux réponses intermaculaires, c’est à dire
lorsque le sujet interprète non pas la tache mais les espaces blancs qui séparent les
différentes parties.
MODULE N° 7 34 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
Il n’est pas possible d’interpréter chacun de ces facteurs indépendamment des
autres car il existe une étroite interaction entre les trois critères.
Prenons le cas du code « G » qui est considéré comme le signe d’une intelligence
globale liée à une capacité de synthèse. Mais une réponse « G » peut venir aussi
d’une personne incapable d’entrer dans les détails et de considérer les différentes
données d’un problème. Pour une interprétation exacte de ce facteur, il faut le relier
aux critères que nous allons étudier.
B. Le déterminant:
L’examinateur détermine maintenant ce qui a permis au sujet d’interpréter la tache:
• Les réponses forme: Ce sont les plus nombreuses. Le sujet considère une
forme et établit sa réponse en fonction de l’image qu’elle lui inspire. Si nous
prenons l’exemple de la planche I, ou le sujet voit un papillon, cette réponse
est codifiée: « GF+ ». Le signe « F+ » signifie bonne forme, le signe « F- »
signifie mauvaise forme.
• RORSCHACH a utilisé une méthode statistique pour déterminer les bonnes et
les mauvaises formes. Les premières sont celles qui apparaissent le plus
souvent dans les réponses. Les secondes sont données beaucoup plus
rarement. ou sont trop éloignées de la tache.
• Les réponses mouvement: Les représentations données par le sujet sont en
mouvement. Ainsi, la planche II peut représenter deux femmes en train de
danser. Les réponses mouvement sont codifiées avec la lettre « K ».
• Les réponses couleur: Certaines planches sont colorées. Ces couleurs
peuvent être à l’origine d’une interprétation (un lac, un feu d’artifice, et...). Si la
réponse est basée exclusivement sur la couleur, elle est codifiée par la lettre
« C ». Par contre si la forme est primordiale et la couleur secondaire, comme
un papillon rouge, elle sera codifiée « FC ».
• Si la réponse est fondée sur la couleur et, secondairement sur la forme, son
code sera « CF ».
• Les réponses estompage: sont déterminées par la prise en compte des
ombres et des nuances existant entre le noir, le blanc, le gris et le noir
(fourrure, mousse...). Elles sont codifiées par la lettre « E ».
• Les réponses clair-obscur: sont engendrées par les zones obscures des
taches (nuages noirs, ténèbres...). Le sujet a cherché à percer l’obscurité et le
mystère que celle-ci est sensée recouvrir. Leur codification est « Clob ».
C. Le contenu:
L’examinateur détermine maintenant le contenu des réponses qui est classé en
plusieurs groupes:
• Les animaux « A » et les parties de ceux-ci « Ad »
MODULE N° 7 35 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
• Les êtres humains « H » et les parties de ceux-ci « Hd »
• Les réponses anatomiques « Anat »
• Les objets « Obj »
• Les organes sexuels « sex »
• Les plantes « Pl »
• La nature « Nat »
D. La banalité:
Les réponses banales sont celles que l’on retrouve le plus souvent. Elles sont
codifiées « Ban ».
Prenons l’exemple d’une réponse et codifions la. Si le sujet voit deux ours en train de
danser à la planche II, elle sera codifiée:
GF+KABan
• G: la réponse est globale
• F+K : le déterminant est une bonne forme en mouvement
• A: le contenu est animal
• Ban: la réponse est banale.
Une fois le test terminé, l’examinateur codifie chaque réponse en fonction des règles
que nous venons de voir. Il effectue alors divers calculs: pourcentage de bonnes ou
de mauvaises formes, de réponses animales, végétales, humaines, type de
résonance intime, etc...
Ce dernier indice Type de Résonance Intime «T.R.I. » est important car il détermine
l’affectivité du sujet. Il est obtenu en calculant le rapport des réponses « K » sur les
réponses « C ». Cet indice révèle la tendance à l’introversion ou l’extraversion.
RORSCHACH considère que les réponses « K » prédominent chez les sujets
introvertis. Les réponses des sujets extravertis sont de type « C ».
LES QUATRE TYPES DE PERSONNALITE D’APRES L’INDICE « T.R.I. »:
1. Le type extratensif:
Il est caractérisé par une forte prédominance de réponse « C » par rapport aux
réponses « K ». Le sujet est extraverti, orienté vers l’autre, mais parfois incapable de
prendre du recul lorsqu’il s’agit d’aborder un problème.
2. Le type introversif:
Il est caractérisé par la prédominance des réponses « K » par rapport aux réponses
« C ». Le sujet a tendance à s’isoler, à vivre intérieurement. Ses rapports avec les
autres sont plus difficiles. Ce sujet est capable d’une plus grande productivité.
MODULE N° 7 36 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
3. Le type coarté:
Le type coarté est déterminé par un nombre de réponse « C » et « K » faible. Le
sujet peut manquer d’imagination, être morose, fade, sans volonté ni ambition.
4. Le type ambiéqual:
Il caractérise les sujets équilibrés, appréciant le contact humain mais sachant se
replier sur eux-même pour développer leur énergie créatrice. Les réponses sont
nombreuses, les réponses « K » étant légèrement prépondérantes.
TABLEAU SYNOPTIQUE
LOCALISATION
REPONSE CODE INTERPRETATION
Réponse globale G Capacité de synthèse, d’organisation. Généralisation, abstraction
Détail courant D Intelligence pratique et rationnelle
Détail inhabituel Dd Difficulté de vision globale, inhibition, incertitude
Détail intermaculaire Dbl En conflit, opposant, agressivité, excentricité
DETERMINANT
REPONSE CODE INTERPRETATION
Bonne forme F+ Justesse d’appréciation, rigueur, capacité d’objectivité
Mauvaise forme F- Si plus de 30 à 40% de F- : Capacité intellectuelles réduites
Forme couleur FC Appréciation réaliste des événements, régulation de l’émotivité
Couleur forme CF Caractère versatile, spontanéité, absence de rigueur.
Excentrisme
Couleur pure C Irritabilité, conflit intra psychique, difficulté de contrôle
Mouvement K Confiance en soi, créativité et dynamisme
Estompage E Fuite devant les responsabilités, difficulté de les apprécier.
Clair-obscur Clob Anxiété, manque d’assurance, timidité
CONTENU
REPONSE CODE INTERPRETATION
Animaux A L’interprétation se fait en fonction des différentes réponses
Etre Humains H L’interprétation se fait en fonction des différentes réponses
Anatomique Anat L’interprétation se fait en fonction des différentes réponses
Objets Obj L’interprétation se fait en fonction des différentes réponses
Sexuel Sex L’interprétation se fait en fonction des différentes réponses
Plantes Pl L’interprétation se fait en fonction des différentes réponses
MODULE N° 7 37 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
LE TEST DE L’ARBRE
1. HISTORIQUE
Ce test a été développé par Charles KOCH, psychologue suisse. Une étude
statistique portant sur de nombreux dessins d’arbre lui permit de constater un rapport
entre certain traits de caractère et les graphismes.
L’arbre a été choisi comme support de la personnalité car il a une grande valeur
symbolique. De même, son image se rapproche de celle de l’être humain.
La consigne consiste à demander au sujet de dessiner un arbre.
2. INTERPRETATION
Dans un premier temps, l’examinateur étudie la zone de champ graphique:
A SPIRITUALITE B
INHIBITION REBELLION
RECUL - INTROVERSION PROGRES - EXTRAVERSION
D ACCAPAREMENT OBSTINATION C
MATERIALITE
Si l’on considère A la zone supérieure gauche, B la zone supérieure droite, C la zone
inférieure droite et D la zone inférieure gauche, on peut dire que:
• A représente la passivité
• B représente le dynamisme
• C représente les pulsions
• D représente la régression
3. ELEMENTS D’ANALYSE
La taille de l’arbre:
Elle exprime la tendance à l’affirmation. Un petit arbre est le reflet d’une certaine
timidité
MODULE N° 7 38 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
La force du trait:
Un trait léger et tremblotant traduit une absence de confiance en soi alors qu’un trait
marqué évoque l’affirmation de soi.
Les racines:
Elles ne sont représentées essentiellement par les enfants, les adultes équilibrés les
oubliant totalement.
Le tronc:
C’est un élément important considéré comme étant la zone concrète par opposition à
la couronne jugée abstraite et intellectuelle. Un tronc élargi à la base traduit un fort
côté primaire, ainsi que des difficultés d’apprentissage. Un élargissement vers la
gauche signifie un attachement au passé, le sujet est méfiant et craint l’autorité. Les
entailles dans le tronc symbolisent un sentiment de culpabilité. Les bosses évoquent
un traumatisme. Un tronc dessiné avec un seul trait peut péciser des tendances
schizophréniques et une intelligence médiocre. Lorsque le tronc est noirci cela traduit
l’humeur dépressive. Un tronc tordu résulte d’un choc affectif.
La couronne de feuillage:
Une couronne en boule traduit le manque de confiance en soi, la banalité et
l’absence de créativité. L’agressivité se traduit par des branches acérées. Les
branches tombantes sont le signe d’un caractère dépressif.
TESTEZ-VOUS : VRAI OU FAUX
Répondez aux questions suivantes pour mesurer vos sentiments et
complexes:
V F ?
1. les petits ruisseaux font les grandes rivières
2. une hirondelle ne fait pas le printemps
3. quand les chats ne sont pas là, les souris dansent
4. plus on grandit, plus on comprend les choses
5. on a toujours besoin, dans la vie, de ses frères et de ses sœurs
7. le père qui protège et la mère qui berce, voilà l’image du bonheur
9. plus on est de monde, plus on s’amuse
11. grandir, c’est être plus fort et plus sage
13. un pêché n’est jamais si grave qu’on le croit
15. quand on est fort, on peut se servir de n’importe quelle arme, on gagne
toujours
17. la vraie camaraderie est celle des frères et des soeurs entre eux
19. l’amour des parents ne fait jamais de préférence entre les enfants
21. partir de la maison, c’est mûrir un peu
23. plus un enfant grandit, moins il a besoin de caresses
25. il est toujours facile de montrer que l’on a rien à se reprocher
27. on ne peut compter que sur soi
29. les frères naissent ennemis mais la fraternité efface les discordes
MODULE N° 7 39 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
31. il faut savoir céder sa place à quelqu’un même si on ne l’aime pas
33. revenir à la maison, c’est trouver la paix
35. le bonheur est devant nous et non pas dans le passé
37. on n’a jamais besoin de cacher quoi que ce soit aux autres
39. la faiblesse est le pire des défauts
6. il est stupide, quand on a déjà un enfant , d’en demander encore un autre
8. il y a toujours une troisième personne qui vient troubler la paix des deux
autres
10. les autres ne savent jamais tout ce que chacun pense
12. il n’y a que les tout-petits qui soient vraiment heureux
14. on n’est jamais tout à fait innocent
16. la raison du plus fort est toujours la meilleure
18. souvent, l’innocent est puni à la place du coupable
20. on a souvent envie de défendre un des parents contre l’autre
22. il y a toujours un moment où l’on se sent de trop
24. l’âge le plus mignon est celui du biberon
26. tôt ou tard, on sera puni
28. on ne rréussit jamais autant qu’on l’espérait
30. il y a souvent des choses dont on voudrait se débarrasser mais qu’on est obligé
de garder
32. quand on aime quelqu’un, il est dur de le partager avec quelqu’un d’autre
34. celui qui n’aime pas un enfant dit que cet enfant ne l’aime pas
36. on a toujours raison d’avoir peur de l’avenir
38. personne ne sait à quel point chacun est coupable
40. les autres nous croient toujours plus bêtes que nous sommes
Caïn Oedi Exclu Aban Culpa Inf
30 32 34 36 38 40
N
18 20 22 24 26 28
6 8 10 12 14 16
5 7 9 11 13 15
H
17 19 21 23 25 27
29 31 33 35 37 39
Pour analyser les résultats, encercler sur le tableau le chiffre de la question lorsque
votre réponse est située immédiatement à droite de la ligne verticale noire de la
feuille réponse.
Puis noircissez le nombre de briques au-dessus du trait noir du tableau
correspondant au nombre de chiffres encerclés dans chaque colonne. (Maximum 6)
MODULE N° 7 40 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
Le nombres de briques correspond à l’intensité des sentiments ou complexes de
chaque colonne :
Exemple : si vous avez encerclé les chiffres 30 et 17 à la colonne de rang 1, vous
totalisez 2 briques pour le complexe de Caïn. Vous placez ces deux briques au-
dessus de la ligne noire de la colonne n° 1.
• Complexe de Caïn
• Complexe d’Œdipe
• Sentiment d’exclusion
• Sentiment d’abandon
• Sentiment de culpabilité
• Sentiment d’infériorité.
RELAXATION DYNAMIQUE PREMIER DEGRE
2EME CYCLE
MEDITATION SOPHRONIQUE
(RD1B)
1. Sophronisation de base debout:
En position de grounding on se relaxe en atteignant la zone sophroliminale. puis on
se concentre sur son « image positive »
2. Exercice des poignets
• Geste des doigts en griffes: on lève les bras à l’horizontal cependant qu’on
inspire profondément. On retient l’air en gardant les doigts crispés. Puis on expire
en redescendant les mains le long de l’axe corporel. On prend conscience des
doigts que l’on intègre dans le vécu du schéma corporel.
• Geste des mains en éventail: on lève les bras à l’horizontal cependant qu’on
inspire profondément. On retient l’air en orientant les poignets de gauche à droite.
Puis on expire en redescendant les mains le long de l’axe corporel. On prend
conscience des poignets que l’on intègre dans le vécu du schéma corporel.
• Geste des poings fermés: on lève les bras à l’horizontal cependant qu’on inspire
profondément. On retient l’air en gardant les poings serrés. Puis on expire en
redescendant les mains le long de l’axe corporel. On prend conscience des bras
et du thorax que l’on intègre dans le vécu du schéma corporel.
Chaque exercice est fait trois fois
MODULE N° 7 41 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
3. Méditation sur l’objet neutre, l’image positive
4. Exercices abdominaux:
Cela consiste à faire un barattage abdominal d’abord lentement, puis plus
rapidement.
A l’issus de l’exercice on retrouve l’image de concentration.
5 Geste du Nauli:
On prend appui sur les cuisses avec les mains, tout en fléchissant les genoux (cf
figure). Dans cette position on fait l’exercice respiratoire du barattage abdominal en
effectuant en même temps un brassage abdominal. Ce dernier s’effectue en
favorisant une rotation des abdominaux qui massent l’intérieur du ventre
L’exercice est fait trois fois
6. Geste de torsion
En respiration libre, on croise les mains au-dessus de la tête puis on balance le buste
de droite à gauche comme si l’on faisant un étirement. Puis on ramène les bras dans
leur position initiale
7. Rotation axiale
Cet exercice consiste à réaliser une rotation autour de son axe corporel; de droite à
gauche et de gauche à droite, les bras ballants. L’exercice se fait en respiration libre.
8. Saut du polichinelle:
En respiration libre, on sautille sur place, sur les pointes de pieds, le corps restant
décontracté au maximum. Puis l’on prend conscience des jambes que l’on intègre
dans le vécu de son schéma corporel.
9. Relaxation et récupération en position allongée:
D’abord en position « décubitus dorsal », puis en « décubitus latéral gauche »,
enfin en « décubitus latéral droit ». Dans ces positions, on cultive le « lâcher-
prise » et l’on médite sur son image de concentration.
On termine par une S.A.P.
10. Reprise
(Les exercices filmés sont disponibles sur DVD)
BIBLIOGRAPHIE :
• Catherine CHABERT « Le Rorschach en clinique adulte »
aux Editions Dunod
• Vesca SHENTOUB « Le manuel d’utilisation du T.A.T »
aux Editions Dunod.
• Didier ANZIEU et Catherine CHABERT « Les méthodes
projectives » aux Editions PUF (Coll. Le Psychologue)
MODULE N° 7 42 © Ecole de Somatothérapies et de Sophrologie Appliquées
Vous aimerez peut-être aussi
- Exemple de Rapport de StageDocument16 pagesExemple de Rapport de StagelucilegaubePas encore d'évaluation
- Fiche LE VOYAGE DANS LE COSMOS (Prise de Recul)Document2 pagesFiche LE VOYAGE DANS LE COSMOS (Prise de Recul)gtb.ftb100% (1)
- Fiche LE VOYAGE DANS LE COSMOS (Prise de Recul)Document2 pagesFiche LE VOYAGE DANS LE COSMOS (Prise de Recul)gtb.ftb100% (1)
- Sophronisation de BASE VIVANTIELLEDocument2 pagesSophronisation de BASE VIVANTIELLEgtb.ftbPas encore d'évaluation
- Sophronisation de BASE VIVANTIELLEDocument2 pagesSophronisation de BASE VIVANTIELLEgtb.ftbPas encore d'évaluation
- انتشارDocument8 pagesانتشارkimangel991Pas encore d'évaluation
- Audiocament Méta RelaxationDocument3 pagesAudiocament Méta RelaxationP VincentPas encore d'évaluation
- Carte Mentale ProtocoleDocument1 pageCarte Mentale ProtocoleHeclyusPas encore d'évaluation
- Série 2 Automatisme Avec CorrigéDocument11 pagesSérie 2 Automatisme Avec Corrigéamine milano100% (2)
- 1Document38 pages1رونقالحياةPas encore d'évaluation
- PNL - Phobie - Principe Et ChangementDocument4 pagesPNL - Phobie - Principe Et ChangementsoriboPas encore d'évaluation
- Grille D'évaluation de Son Stress: Echelle FrederickDocument12 pagesGrille D'évaluation de Son Stress: Echelle FrederickREALIZasbl50% (2)
- Exercices Corrigs Chimie Quantique PDFDocument2 pagesExercices Corrigs Chimie Quantique PDFJennifer20% (5)
- Guidage en TranslationDocument6 pagesGuidage en TranslationKamel Bousnina0% (1)
- Module 3 de SophrologieDocument38 pagesModule 3 de Sophrologiegtb.ftbPas encore d'évaluation
- Introduction A La SophrologieDocument24 pagesIntroduction A La SophrologieROGER DominiquePas encore d'évaluation
- MODULE 6 de SophrologieDocument21 pagesMODULE 6 de Sophrologiegtb.ftbPas encore d'évaluation
- Module 9 SophrologieDocument52 pagesModule 9 Sophrologiegtb.ftb0% (1)
- La Sophrologie Expliqué Aux EnfantsDocument2 pagesLa Sophrologie Expliqué Aux EnfantsgtbaPas encore d'évaluation
- Extrait Sophrologue Vivance Systeme EdDocument5 pagesExtrait Sophrologue Vivance Systeme EdClarance Desirée NjohPas encore d'évaluation
- Carte Mentale SophronisationDocument1 pageCarte Mentale SophronisationHeclyusPas encore d'évaluation
- Protection Sophronique Des CapacitesDocument3 pagesProtection Sophronique Des Capacitesgtb.ftbPas encore d'évaluation
- Trame Dossier de Sophrologue Suivi de Clients - Version 2024Document19 pagesTrame Dossier de Sophrologue Suivi de Clients - Version 2024Charlene.sagnesPas encore d'évaluation
- Anamnèse 3Document4 pagesAnamnèse 3DodiePas encore d'évaluation
- La Sophrologie Et La Gestion Du StressDocument33 pagesLa Sophrologie Et La Gestion Du StressROGER DominiquePas encore d'évaluation
- Flyer Sophrologie Bien-ÊtreDocument2 pagesFlyer Sophrologie Bien-ÊtreColombe BlanchePas encore d'évaluation
- Guide AcouphenesDocument2 pagesGuide AcouphenesBA SouPas encore d'évaluation
- Améliorer Le Contrôle Par Le Travail A PiedDocument32 pagesAméliorer Le Contrôle Par Le Travail A PiedNadia BernardPas encore d'évaluation
- Vaincre La Panic Les PhobiesDocument99 pagesVaincre La Panic Les Phobiesعبد الغفور الحجريPas encore d'évaluation
- Fiche (SPR) SOPHRO PERCEPTION RELAXATIVEDocument2 pagesFiche (SPR) SOPHRO PERCEPTION RELAXATIVEgtb.ftbPas encore d'évaluation
- Integration de l'EMDR Et Des Etats Du MOiDocument20 pagesIntegration de l'EMDR Et Des Etats Du MOiHypnotica FrancePas encore d'évaluation
- Explorer Comment Les Neurosciences Peuvent Aider à Identifier Et Changer Les Croyances LimitantesDocument5 pagesExplorer Comment Les Neurosciences Peuvent Aider à Identifier Et Changer Les Croyances LimitantesMohamed Amine EL MHASSANIPas encore d'évaluation
- Les Troubles Bipolaires PDFDocument17 pagesLes Troubles Bipolaires PDFwish064100% (1)
- Maigrir Et Confiance en SoiDocument2 pagesMaigrir Et Confiance en Soiloutrage0% (1)
- BoulimieDocument2 pagesBoulimiePatrick DescoubèsPas encore d'évaluation
- Bouli MieDocument12 pagesBouli MieKẳw Thēr100% (1)
- Formation SophrologieDocument7 pagesFormation SophrologieCadet RaparivoPas encore d'évaluation
- Techniques de Détente Su Anorexie MentaleDocument14 pagesTechniques de Détente Su Anorexie MentaleIsabelle GazagnePas encore d'évaluation
- Théorie Polyvagale Et Sentiment de Sécurité - EDocument256 pagesThéorie Polyvagale Et Sentiment de Sécurité - EredjdalPas encore d'évaluation
- Je D 233 Couvre Le Yoga by Gilles Diederichs Veronique Salomon-RieuDocument51 pagesJe D 233 Couvre Le Yoga by Gilles Diederichs Veronique Salomon-RieuivanPas encore d'évaluation
- Plan de Traitement Traumas Simples Et Complexes Mai2014Document20 pagesPlan de Traitement Traumas Simples Et Complexes Mai2014sandrine Bonnefont-DesiagePas encore d'évaluation
- Fiche (SRS) SOPHRO RESPIRATION SYNCHRONIQUEDocument3 pagesFiche (SRS) SOPHRO RESPIRATION SYNCHRONIQUEgtb.ftbPas encore d'évaluation
- PNL - La Stratégie PNL Pour L'orthographeDocument3 pagesPNL - La Stratégie PNL Pour L'orthographesoriboPas encore d'évaluation
- La SonothérapieDocument3 pagesLa SonothérapierivelloPas encore d'évaluation
- Psychologie-Du-Dev Résumé 2014-2015Document80 pagesPsychologie-Du-Dev Résumé 2014-2015Wang Tae95100% (1)
- Fiche (SSV) Sophro Stimulation VitaleDocument2 pagesFiche (SSV) Sophro Stimulation Vitalegtb.ftbPas encore d'évaluation
- INT - Thérapie de CoupleDocument20 pagesINT - Thérapie de CoupleAyelo CkerimPas encore d'évaluation
- Thérapies - Troisième - Vague - Dionne&Blais Cas de Pierre 2Document44 pagesThérapies - Troisième - Vague - Dionne&Blais Cas de Pierre 2caramel47Pas encore d'évaluation
- Jeux-Video Ecrans Laddiction Qui Inquiete Les Parents PDFDocument8 pagesJeux-Video Ecrans Laddiction Qui Inquiete Les Parents PDFdino100% (1)
- Attaque de Panique1254093882Document32 pagesAttaque de Panique1254093882Khaoula100% (1)
- Hypnose Périnatale À GrenobleDocument2 pagesHypnose Périnatale À GrenobleWilliamsKendall43Pas encore d'évaluation
- Mélange Des ÉmotionsDocument7 pagesMélange Des ÉmotionsMed ALI GHARBIPas encore d'évaluation
- Pour Vous Remercier de Votre ConfianceDocument7 pagesPour Vous Remercier de Votre ConfianceJuba64.Pas encore d'évaluation
- Echelle de Bech Et RafaelsenDocument4 pagesEchelle de Bech Et RafaelsenAntoine GrimaldiPas encore d'évaluation
- DeuilDocument10 pagesDeuilJoargens Jerry Jean PierrePas encore d'évaluation
- 7-Piliers Gym Oculaire IntegraleDocument17 pages7-Piliers Gym Oculaire Integralelouis.levy17100% (1)
- Mémoire Hypnose Guislaine GARINET V4 1Document33 pagesMémoire Hypnose Guislaine GARINET V4 1bagheera01Pas encore d'évaluation
- 7 Profils D'apprentissageDocument8 pages7 Profils D'apprentissagegarancehappi7Pas encore d'évaluation
- Deuil Perinatal Journal DaccompagnementDocument23 pagesDeuil Perinatal Journal Daccompagnementapi-325570168Pas encore d'évaluation
- Sophro Programmation Future (SPF)Document2 pagesSophro Programmation Future (SPF)gtb.ftbPas encore d'évaluation
- Hypnose À Toulouse Muret (31 Haute Garonne) Arrêt Du Tabac Perte PoidsDocument1 pageHypnose À Toulouse Muret (31 Haute Garonne) Arrêt Du Tabac Perte PoidsLindholmKennedy58Pas encore d'évaluation
- HypersensibleDocument1 pageHypersensibleDjouma Kossi AhmatPas encore d'évaluation
- 05 Le Balayage CorporelDocument4 pages05 Le Balayage CorporelLuc BrohierPas encore d'évaluation
- Sophro Presence Des Valeurs (SPV)Document3 pagesSophro Presence Des Valeurs (SPV)gtb.ftb0% (1)
- SOPHRO MNESIE SENSO PERCEPTIVE (S.MN.S.P)Document3 pagesSOPHRO MNESIE SENSO PERCEPTIVE (S.MN.S.P)gtb.ftb100% (1)
- Protection Sophronique Des CapacitesDocument3 pagesProtection Sophronique Des Capacitesgtb.ftbPas encore d'évaluation
- Fiche (SRS) SOPHRO RESPIRATION SYNCHRONIQUEDocument3 pagesFiche (SRS) SOPHRO RESPIRATION SYNCHRONIQUEgtb.ftbPas encore d'évaluation
- Fiche (SSV) Sophro Stimulation VitaleDocument2 pagesFiche (SSV) Sophro Stimulation Vitalegtb.ftbPas encore d'évaluation
- Bible de Médecine InterneDocument110 pagesBible de Médecine InterneAnou Kalenga100% (1)
- TD4 AaDocument4 pagesTD4 AaRadia Kadi100% (1)
- Chapitre 2 Traction-CompressionDocument12 pagesChapitre 2 Traction-CompressionJalal Raougui100% (1)
- CuisineDocument45 pagesCuisineBio ecoPas encore d'évaluation
- La Voiture Hybride Est La Solution D'avenirDocument7 pagesLa Voiture Hybride Est La Solution D'avenirNguyễn Linh ChiPas encore d'évaluation
- LifeFitness 95xi 93X 90X Assembly Instructions 62a07300Document8 pagesLifeFitness 95xi 93X 90X Assembly Instructions 62a07300powerliftermiloPas encore d'évaluation
- Mauritanie Les Peuls Sont-Ils Mauritaniens PR ELY MustaphaDocument2 pagesMauritanie Les Peuls Sont-Ils Mauritaniens PR ELY MustaphaAmadou MbayePas encore d'évaluation
- Le Courant Electrique Alternatif Sinusoidal Resume de Cours 1Document2 pagesLe Courant Electrique Alternatif Sinusoidal Resume de Cours 1JOBNA CHATIRAPas encore d'évaluation
- Reduction Et MajorationDocument7 pagesReduction Et MajorationFadila CheradiPas encore d'évaluation
- ACCROCHE ET LEVAGE DocumentDocument71 pagesACCROCHE ET LEVAGE Documentvsdfsd258Pas encore d'évaluation
- Fiche de Séance Sophro-Animation 3-5Document5 pagesFiche de Séance Sophro-Animation 3-5esprit.irisePas encore d'évaluation
- Cours Beton Armé 1Document34 pagesCours Beton Armé 1asribadrPas encore d'évaluation
- Les Difficultés de Compréhension de L'Aspect Culturel Des Expressions Idiomatiques Chez Les Apprenants de FleDocument13 pagesLes Difficultés de Compréhension de L'Aspect Culturel Des Expressions Idiomatiques Chez Les Apprenants de FleGABRIELA SBURLANPas encore d'évaluation
- 53db7ccc739ce PDFDocument5 pages53db7ccc739ce PDFRaoudha MzoughiPas encore d'évaluation
- Wiki Du BTS Electrotechnique - SA - Déphasage Entre Deux Fonctions Sinusoïdales 2Document1 pageWiki Du BTS Electrotechnique - SA - Déphasage Entre Deux Fonctions Sinusoïdales 2Mohamed ElmardiPas encore d'évaluation
- 6 GastrulationDocument27 pages6 GastrulationCó TênPas encore d'évaluation
- Exercices Electrotechnique TD CorrigesDocument16 pagesExercices Electrotechnique TD CorrigesSouleyman Amadou DialloPas encore d'évaluation
- Evaluation Diagnostique Mouvement InteractionsDocument7 pagesEvaluation Diagnostique Mouvement Interactions4eme8 AZUELOS ElyottPas encore d'évaluation
- Home DDDDocument196 pagesHome DDDameg15Pas encore d'évaluation
- Cineamtique LoisDocument9 pagesCineamtique LoiskajtiPas encore d'évaluation
- Burkina Faso - Assessment of Agricultural Information NeedsDocument277 pagesBurkina Faso - Assessment of Agricultural Information NeedsJan Goossenaerts100% (1)
- L'homme AntenneDocument2 pagesL'homme AntenneJérémiPerreaultPas encore d'évaluation
- Embiellage IndenorDocument6 pagesEmbiellage IndenorJean Pierre GaudillierPas encore d'évaluation
- Les Différentes Opérations Subissent Par Le Gaz Naturel Au Niveau Des PuitsDocument37 pagesLes Différentes Opérations Subissent Par Le Gaz Naturel Au Niveau Des Puitsilyes9093% (14)
- ch1 Béton GENERALITESDocument4 pagesch1 Béton GENERALITESSAIDI BachirPas encore d'évaluation
- Chaussure Securtite JAL GROUP PDFDocument84 pagesChaussure Securtite JAL GROUP PDFBESSEMYPas encore d'évaluation
- These Evaluation BiomedDocument97 pagesThese Evaluation BiomedToure ahmed100% (1)