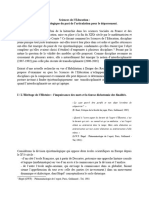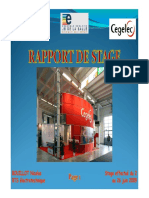Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Resume Chapitre 2
Transféré par
sakina lahssiniTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Resume Chapitre 2
Transféré par
sakina lahssiniDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le deuxième chapitre évoque la notion de système ouvert.
En effet, « le simple n’est plus le fondement de toute
chose, mais un passage, un moment entre des complexités » (27). Il mentionne à ce propos la théorie des systèmes
de Bertalanffy, rappelant que la théorie systémique « a mis au centre de la théorie non une unité élémentaire discrète,
mais un tout qui ne se réduit pas à la somme de ses parties constitutives ». (29). Or, Morin constate deux choses :
d’un part, la permanence des structures malgré la modification des parties constitutives (observation évidente dans
les cas des êtes vivants) « les structures restent les mêmes bien que les constituants soient changeants » (31) ; et le
lien permanent entre un système et son environnement : un système ne peut s’en abstraire, il a une relation
constitutive avec son entour, même si « dans un sens, le système doit se fermer au monde extérieur afin de maintenir
ses structures et son milieu intérieur qui, sinon, se désintégreraient. Mais c’est son ouverture qui permet cette
fermeture » (31). Cela va à l’encontre de la « métaphysique occidentale/cartésienne, pour qui toutes choses vivantes
sont considérées comme closes, et non comme des systèmes organisant leur clôture (c’est-à-dire leur autonomie)
dans et par leur ouverture ». En effet, « les lois d’organisation du vivant ne sont pas d’équilibre, mais de déséquilibre,
rattrapé ou compensé, de dynamisme stabilisé » (31).
E. Morin en déduit alors cette relation : « la réalité est dès lors autant dans le lien que dans la distinction entre le
système ouvert et son environnement » (32). Il s’interroge ensuite sur l’information, qui n’est pas un ingrédient
mais une théorie, et qui est constitutive de l’organisation. Le développement de l’information entraîne le
développement de l’organisation et donc le développement de la complexité. « L’information est un concept
problématique, non un concept solution » (37). S’ensuivent des considérations sur Gödel, sur l’entropie, sur l’auto-
organisation. Il se moque au passage des « prétentieuses études quantitatives sur bulldozers statistiques, guidées par
des pilotes à petite cervelle : relier, relier toujours était une méthode plus riche, au niveau théorique même, que les
théories blindées, bardées épistémologiquement et logiquement, méthodologiquement aptes à tout affronter, sauf
évidemment le réel » (48). Il s’ensuit cette conclusion lumineuse : « la complexité dans un sens a toujours affaire
avec le hasard » (49) qui renvoie à nos considérations sur le risque.
Car au fond, la théorie de la complexité « permet l’émergence, dans son propre champ, de ce qui avait été jusqu’alors
rejeté hors de la science : le monde et le sujet » (52). « La science occidentale s’est fondée sur l’élimination positiviste
du sujet à partir de l’idée que les objets pouvaient être observés et expliqués en tant que tel » (54). « Le sujet est
renvoyé, comme perturbation ou bruit, précisément parce qu’il est indescriptible selon les critères de l’objectivisme
» (55). Mais le sujet « prend sa revanche dans la morale, la métaphysique, l’idéologie ». Et plus loin, « l’objet, à la
limite le monde, devient bruit » (56). « Ainsi apparaît le grand paradoxe : sujet et objet sont indissociables, mais
notre mode de pensée exclut l’un par l’autre » (57). Ce rapport du sujet et de l’objet peut être réconcilié : « ainsi le
monde est à l’intérieur de notre esprit, lequel est à l’intérieur du monde » (60). Cela permet le dépassement si l’effort
porte sur la « relation entre le chercheur et l’objet de sa connaissance, en portant consubstantiellement un principe
d’incertitude et d’autoréférence » (61) ; cela nous permet « de nous distancier à nous même, de nous regarder de
l’extérieur, de nos objectiver » (62), ce qui, d’une certaine façon, renvoie à l’indécidabilité de Gödel.
Vous aimerez peut-être aussi
- Médecine Anatomie À Sa Plus Simple expression-Anamnese-Termes Médicaux-Cours 6Document127 pagesMédecine Anatomie À Sa Plus Simple expression-Anamnese-Termes Médicaux-Cours 6jeromesbazoges100% (9)
- Bouddhisme Et Physique QuantiqueDocument15 pagesBouddhisme Et Physique QuantiquericojimiPas encore d'évaluation
- AbracadabraDocument5 pagesAbracadabraEzoOccultPas encore d'évaluation
- LIASSE FISCALE SYSCOHADA REVISE SYSTEME NORMAL-Ref - 07-02-19Document118 pagesLIASSE FISCALE SYSCOHADA REVISE SYSTEME NORMAL-Ref - 07-02-19issoufou Amadou100% (1)
- L'approche Cybernétique PDFDocument16 pagesL'approche Cybernétique PDFMaryem ZouitenPas encore d'évaluation
- Le FlambeauDocument9 pagesLe Flambeaucris.philip2938Pas encore d'évaluation
- Morin Introduction A La Pensee Complexe 1990Document5 pagesMorin Introduction A La Pensee Complexe 1990Chtioui AbdelouahedPas encore d'évaluation
- NF en Iso 9712 2012 CofrendDocument44 pagesNF en Iso 9712 2012 CofrendFRANDON Mathieu100% (1)
- Approche SystémiqueDocument10 pagesApproche SystémiquellabnipPas encore d'évaluation
- Pyramide de MaslowDocument23 pagesPyramide de MaslowManser Khalid100% (1)
- La Sociologie CognitiveDocument40 pagesLa Sociologie Cognitivecorpanzil100% (2)
- DURKHEIM, Émile - Soiologie Et Sciences SocialesDocument29 pagesDURKHEIM, Émile - Soiologie Et Sciences SocialesjeansegataPas encore d'évaluation
- Quantique Dogen 3Document17 pagesQuantique Dogen 3luqmanPas encore d'évaluation
- Methodes Des Sciences SocialesDocument37 pagesMethodes Des Sciences SocialesOURIQUA100% (2)
- Holisme PDFDocument10 pagesHolisme PDFDeroy GarryPas encore d'évaluation
- Le Guide Piscine 2017Document36 pagesLe Guide Piscine 2017Soukaina Toumzine100% (1)
- Le Métier de SociologueDocument9 pagesLe Métier de SociologueZou DialloPas encore d'évaluation
- Bertrand Russell - Le Réalisme Analytique (1911)Document9 pagesBertrand Russell - Le Réalisme Analytique (1911)lepton100100% (1)
- Theorie Des Categories (1993-1994) (Tran - Alain BadiouDocument49 pagesTheorie Des Categories (1993-1994) (Tran - Alain Badiouantirenegat0% (1)
- Etude Et Conception D'une Centrale A BetonDocument60 pagesEtude Et Conception D'une Centrale A Betonjihenk100% (14)
- Resumã© Ouvrage Alain Thietart Methodologie de RechercheDocument55 pagesResumã© Ouvrage Alain Thietart Methodologie de RechercheMariam Nassiri.100% (1)
- Approche SystemiqueDocument19 pagesApproche SystemiquediorthianePas encore d'évaluation
- Embryologie Spéciale Premiers Stades PACES Version À Imprimer 2015-2016 PDFDocument105 pagesEmbryologie Spéciale Premiers Stades PACES Version À Imprimer 2015-2016 PDFIbnattya AbdellatifPas encore d'évaluation
- Daid ZakiaDocument252 pagesDaid ZakiaIsmail TalbiPas encore d'évaluation
- Approche SystémiqueDocument11 pagesApproche Systémiquewebsearch_ss100% (2)
- Les Positionnements ÉpistmologiquesDocument15 pagesLes Positionnements ÉpistmologiquesAli TarkiPas encore d'évaluation
- Le SystèmeDocument11 pagesLe Systèmerachid45Pas encore d'évaluation
- workingpaperCEPN2015 20Document22 pagesworkingpaperCEPN2015 20H Mour KhalPas encore d'évaluation
- Sciences SocialesDocument9 pagesSciences SocialesIssam GhannamePas encore d'évaluation
- Introduction A La Pensee ComplexeDocument6 pagesIntroduction A La Pensee ComplexepaulinelouettePas encore d'évaluation
- Introduction À La Systémique - WikiDocument10 pagesIntroduction À La Systémique - WikisusCities100% (1)
- Jean-Hugues Barthélémy Et Vincent Bontems Philosophie - de - La - Nature - Et - ArtefactDocument11 pagesJean-Hugues Barthélémy Et Vincent Bontems Philosophie - de - La - Nature - Et - Artefactjosé macedoPas encore d'évaluation
- Fm-0020-Approche SystémiqueDocument5 pagesFm-0020-Approche Systémiquelamoma389Pas encore d'évaluation
- Cours de Psycho l1Document27 pagesCours de Psycho l1Matt DelakaoiPas encore d'évaluation
- Remarques Historiques Sur La Notion de SystèmeDocument9 pagesRemarques Historiques Sur La Notion de SystèmeRomain BernardPas encore d'évaluation
- PetitotDocument50 pagesPetitotJana AssaPas encore d'évaluation
- Approche SystemiqueDocument10 pagesApproche SystemiqueAYOUBKAPas encore d'évaluation
- La Liberté Du Physicien - Lectures de Comprendre La Physique Quantique de Jean Bricmont 230221Document82 pagesLa Liberté Du Physicien - Lectures de Comprendre La Physique Quantique de Jean Bricmont 230221Albert DechambrePas encore d'évaluation
- Introduction A La SystemiqueDocument16 pagesIntroduction A La SystemiqueFatimazahraPas encore d'évaluation
- SystémiqueDocument36 pagesSystémiquecharfeddine bmsPas encore d'évaluation
- Jardiner L'évident (Philosophie)Document12 pagesJardiner L'évident (Philosophie)Maurizio BadanaiPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument11 pages1 PBNOUANI ChristPas encore d'évaluation
- L'Epistemologie Des Relations InterdisciplinairesDocument9 pagesL'Epistemologie Des Relations InterdisciplinairesJulisse Savi da Silva100% (1)
- L'épistémologie Des Sciences SocialesDocument21 pagesL'épistémologie Des Sciences SocialesPapa Birane TourePas encore d'évaluation
- Associationnisme 4Document4 pagesAssociationnisme 4Juba64.Pas encore d'évaluation
- Spinoza Et La Methode Generale de M Gueroult DeleuzeDocument13 pagesSpinoza Et La Methode Generale de M Gueroult DeleuzedidilpipaffPas encore d'évaluation
- Lefebvre H La Notion de Totalite Dans Les Sciences SocialesDocument24 pagesLefebvre H La Notion de Totalite Dans Les Sciences SocialesEl RevésPas encore d'évaluation
- Hadot Parties de La PhilosophieDocument24 pagesHadot Parties de La PhilosophieRino BocPas encore d'évaluation
- La Question de La Méthode en Science PolitiqueDocument29 pagesLa Question de La Méthode en Science PolitiqueMourad BenslimaniPas encore d'évaluation
- Première Partie: Conceptions Du Monde Et ConnaissanceDocument41 pagesPremière Partie: Conceptions Du Monde Et ConnaissanceMarcel RobertPas encore d'évaluation
- L - École Systémiiiique PPT - 2Document55 pagesL - École Systémiiiique PPT - 2La Krizi Mohamed100% (1)
- Approche SystèmiqueDocument7 pagesApproche SystèmiqueMaria RechidPas encore d'évaluation
- Spinoza Et La Méthode Générale de M. Gueroult - DeleuzeDocument13 pagesSpinoza Et La Méthode Générale de M. Gueroult - DeleuzedekknPas encore d'évaluation
- Léon Noël - La Philosophie de La ContingenceDocument17 pagesLéon Noël - La Philosophie de La ContingenceZEMMELPas encore d'évaluation
- Résumé Du Texte Anatomie Des Théories Extrait Du Livre Les Théories de La ConnaissanceDocument2 pagesRésumé Du Texte Anatomie Des Théories Extrait Du Livre Les Théories de La ConnaissanceAya HamanePas encore d'évaluation
- Sciences SocialesDocument56 pagesSciences SocialesAngelique VannelPas encore d'évaluation
- Les Idéologies Fernand DumontDocument172 pagesLes Idéologies Fernand DumontGuettabyPas encore d'évaluation
- Science Et Idéologie. 4.Document3 pagesScience Et Idéologie. 4.ClaudeTartobusPas encore d'évaluation
- Morin Avenues de La ComplexiteDocument6 pagesMorin Avenues de La ComplexitedislapufePas encore d'évaluation
- Epistémologie Et Science: Principes Et Tendances: Cours Master S1 2013-2014Document28 pagesEpistémologie Et Science: Principes Et Tendances: Cours Master S1 2013-2014Abdelkrim OukerroumPas encore d'évaluation
- Methodes Des Sciences SocialesDocument37 pagesMethodes Des Sciences SocialesMambolinirainy ClaraPas encore d'évaluation
- La Question Philosophique de La SCIENCE Bac Blanc 2023 EnvoiDocument13 pagesLa Question Philosophique de La SCIENCE Bac Blanc 2023 EnvoiSarah AmmarPas encore d'évaluation
- Cours de Sociologie Formation ContinueDocument82 pagesCours de Sociologie Formation ContinueStefaniePas encore d'évaluation
- Epistémologie Ou Philosophie de La Nature?: Xavier VerleyDocument18 pagesEpistémologie Ou Philosophie de La Nature?: Xavier VerleyAdama NdiayePas encore d'évaluation
- Max Kistler, Causalité Et Lois de La Nature, Paris, Vrin, 1999, 311 PDocument5 pagesMax Kistler, Causalité Et Lois de La Nature, Paris, Vrin, 1999, 311 PJuan Jose Muñoz VillacianPas encore d'évaluation
- Enjeu Épistémologique - Chemin de Formation 9Document7 pagesEnjeu Épistémologique - Chemin de Formation 9Chatellier MarcPas encore d'évaluation
- Le Probleme Des Mecanismes Communs Dans Les Sciences de L'hommeDocument22 pagesLe Probleme Des Mecanismes Communs Dans Les Sciences de L'hommeBocar Diao100% (1)
- Individualisme Et Holisme (Rémi Lenoir)Document4 pagesIndividualisme Et Holisme (Rémi Lenoir)Jan LPas encore d'évaluation
- Matériaux philosophiques et scientifiques pour un matérialisme contemporain: Volume 2D'EverandMatériaux philosophiques et scientifiques pour un matérialisme contemporain: Volume 2Pas encore d'évaluation
- Cours de philosophie positive d'Auguste Comte: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandCours de philosophie positive d'Auguste Comte: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- WL WP LimitDocument2 pagesWL WP LimitAHMED BelPas encore d'évaluation
- Avant Métré Et MétréDocument11 pagesAvant Métré Et MétréNZOKOU ABAGHA VIVIENPas encore d'évaluation
- Armure SatinDocument4 pagesArmure SatinWDSOPas encore d'évaluation
- La Marche Qui SoigneDocument3 pagesLa Marche Qui SoigneGilles MalatrayPas encore d'évaluation
- Manuel QualitéDocument8 pagesManuel QualitéAlma BelakoudPas encore d'évaluation
- L'appareil À Ultrasons en Résumé: Toute Peau - Personnes Présentant Des Broches Ou Plaques Métalliques Sous-CutanésDocument2 pagesL'appareil À Ultrasons en Résumé: Toute Peau - Personnes Présentant Des Broches Ou Plaques Métalliques Sous-CutanésNaomiPas encore d'évaluation
- Guide - CATIA V5 - Debutant P6Document10 pagesGuide - CATIA V5 - Debutant P6Cad QuestPas encore d'évaluation
- Tableau RomanDocument11 pagesTableau RomanYasmine El AlamiPas encore d'évaluation
- Le Diagnostic en Parodontie (LE DIAGNOSTIC Clinique)Document17 pagesLe Diagnostic en Parodontie (LE DIAGNOSTIC Clinique)BendenPas encore d'évaluation
- Powerpoint CegelecDocument25 pagesPowerpoint CegelecnbPas encore d'évaluation
- Velux Einbauprodukte FRDocument3 pagesVelux Einbauprodukte FRBaptiste DespresPas encore d'évaluation
- Etude Du Comportement en Fatigue de La Bielle - Application Sous ANSYSDocument10 pagesEtude Du Comportement en Fatigue de La Bielle - Application Sous ANSYSHocine DzPas encore d'évaluation
- Ewd50 Manuel D InstructionDocument64 pagesEwd50 Manuel D Instructionhassan issamPas encore d'évaluation
- Impact Internat - Hepato-Gastro-Enterologie PDFDocument916 pagesImpact Internat - Hepato-Gastro-Enterologie PDFChakib BelkhodjaPas encore d'évaluation
- ! Livret TCI S4 2024Document36 pages! Livret TCI S4 2024jujubaud.85Pas encore d'évaluation
- Cours SuitesDocument6 pagesCours SuitesHermanPas encore d'évaluation
- ETAT ET LIBERTE Abdoulaye Bah OKDocument12 pagesETAT ET LIBERTE Abdoulaye Bah OKThierno LYPas encore d'évaluation
- Programme Stand Congrès Des Sapeurs-PompiersDocument2 pagesProgramme Stand Congrès Des Sapeurs-PompiersLoïc ChPas encore d'évaluation
- Ber36 8 9 PDFDocument2 pagesBer36 8 9 PDFPedro Duarte PegoPas encore d'évaluation
- Peintures Murales de Mesnard-La-BarotiereDocument21 pagesPeintures Murales de Mesnard-La-BarotiereJmcauneauPas encore d'évaluation